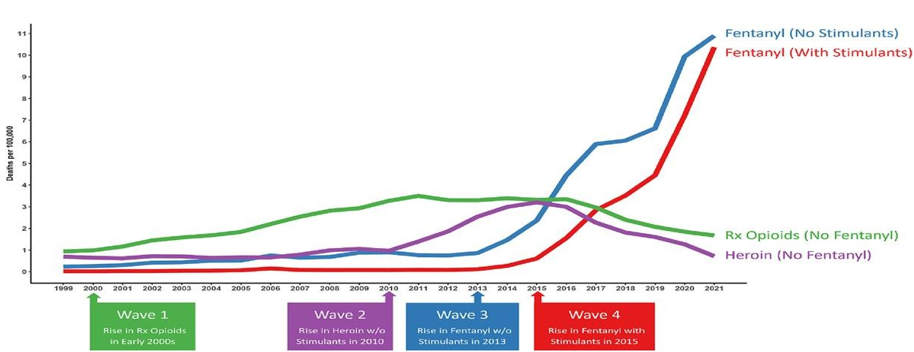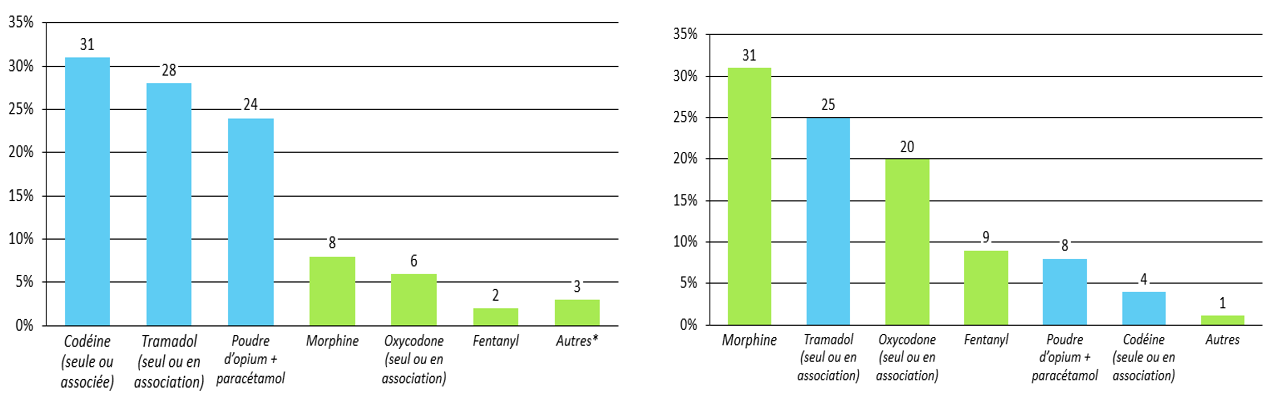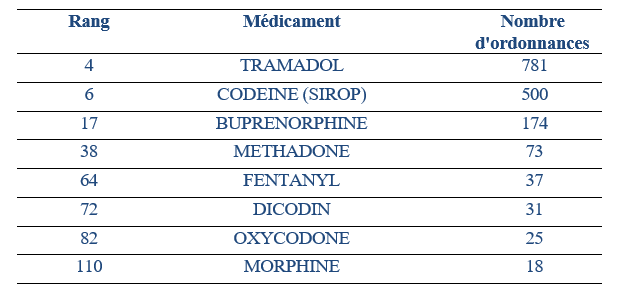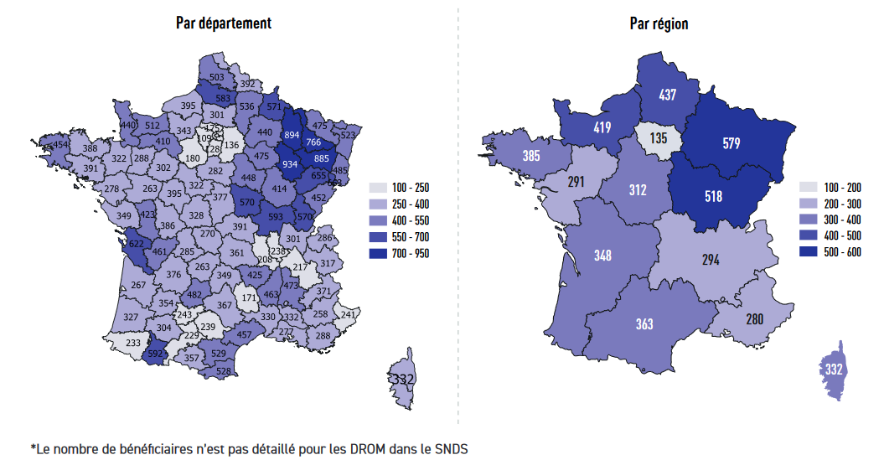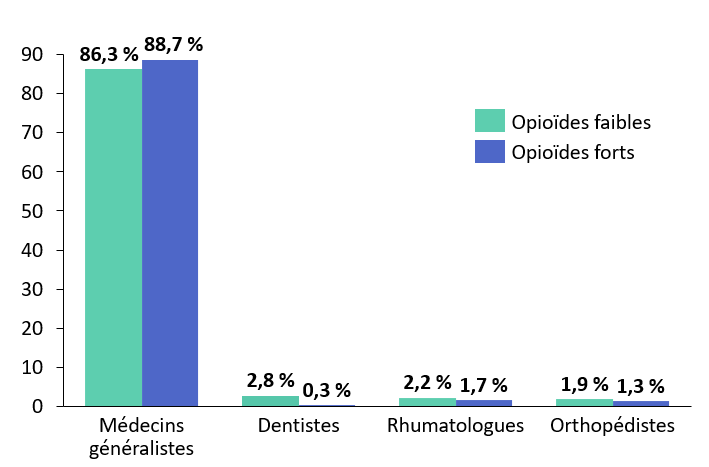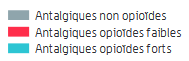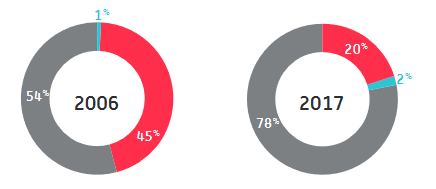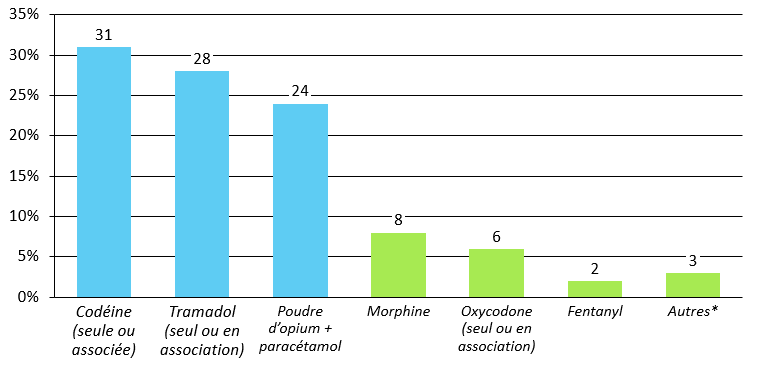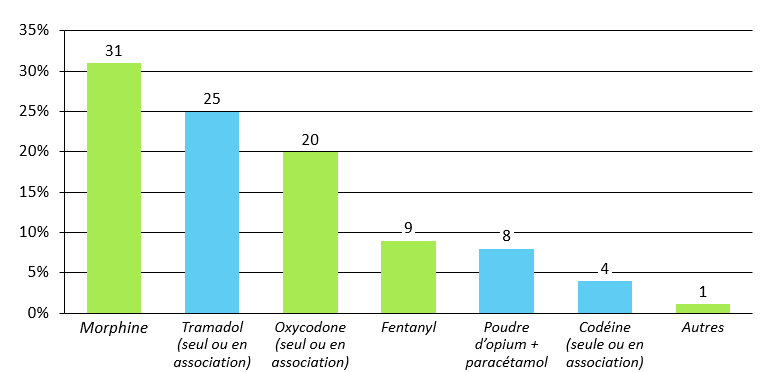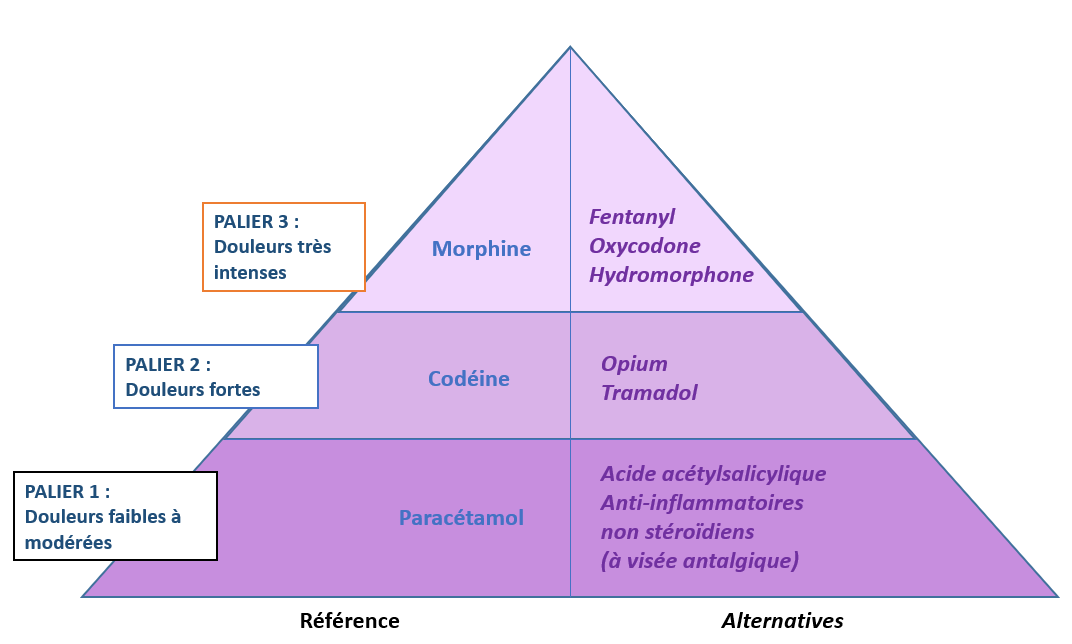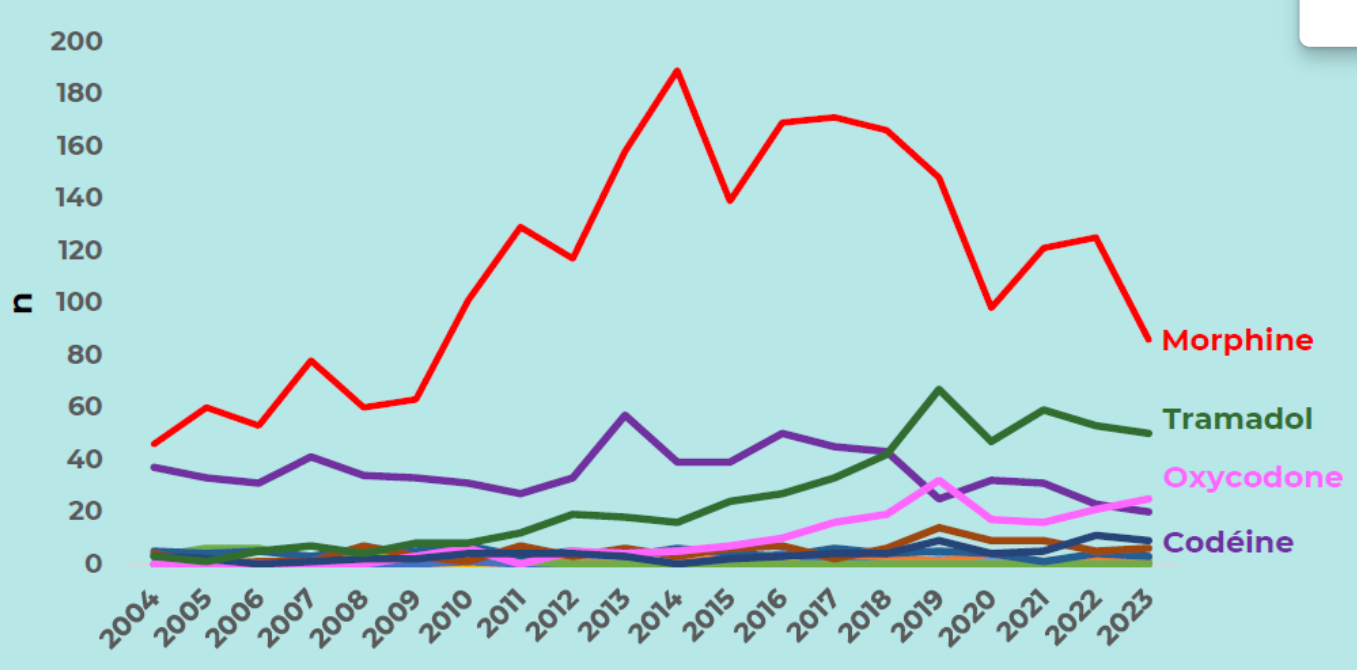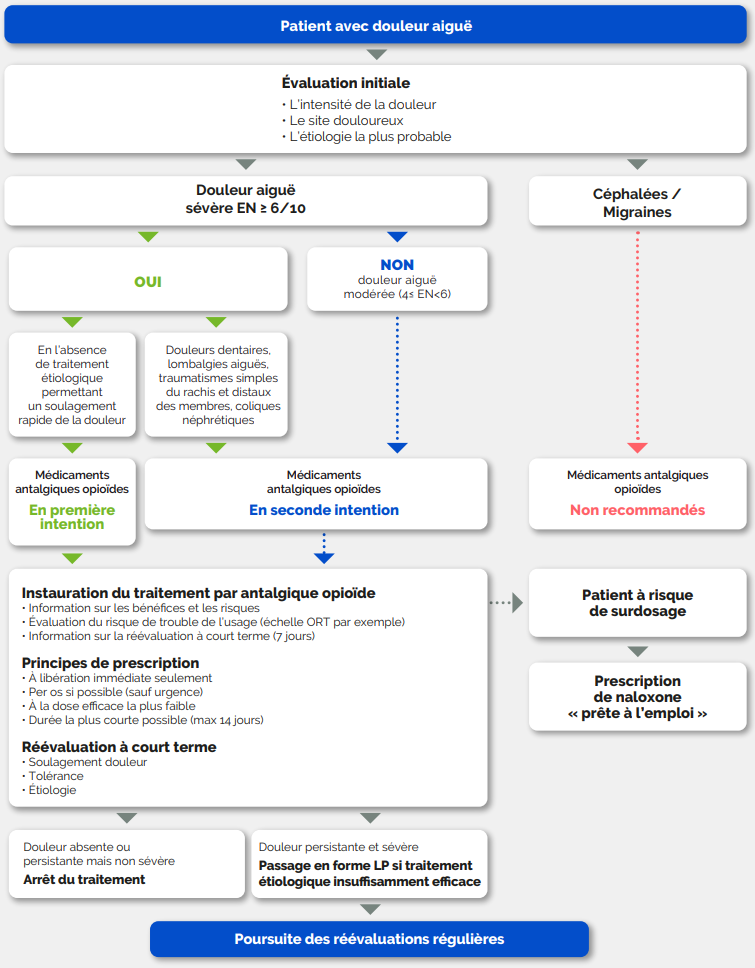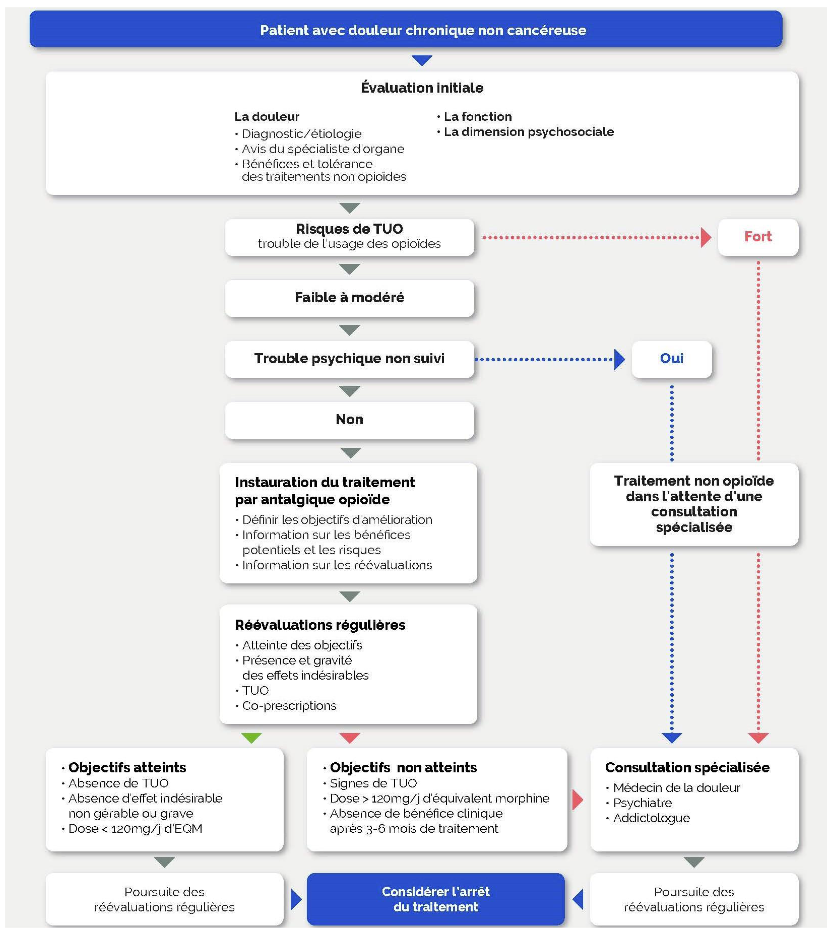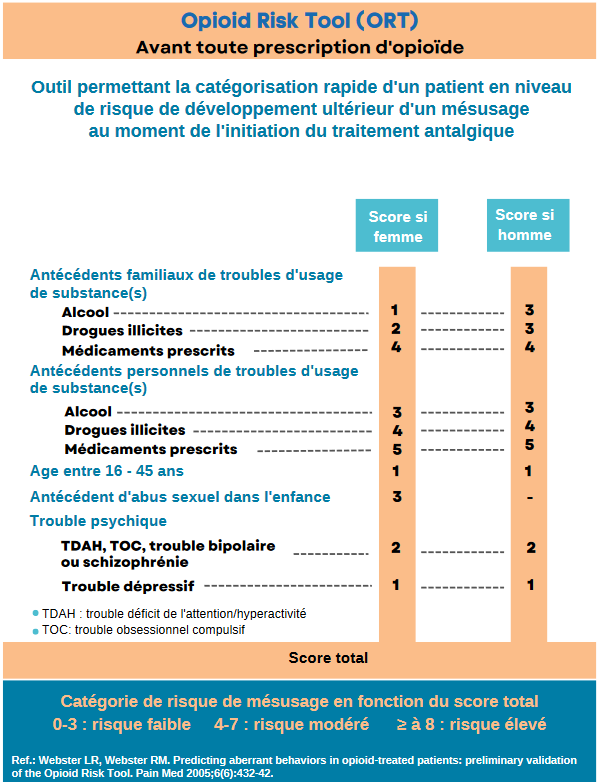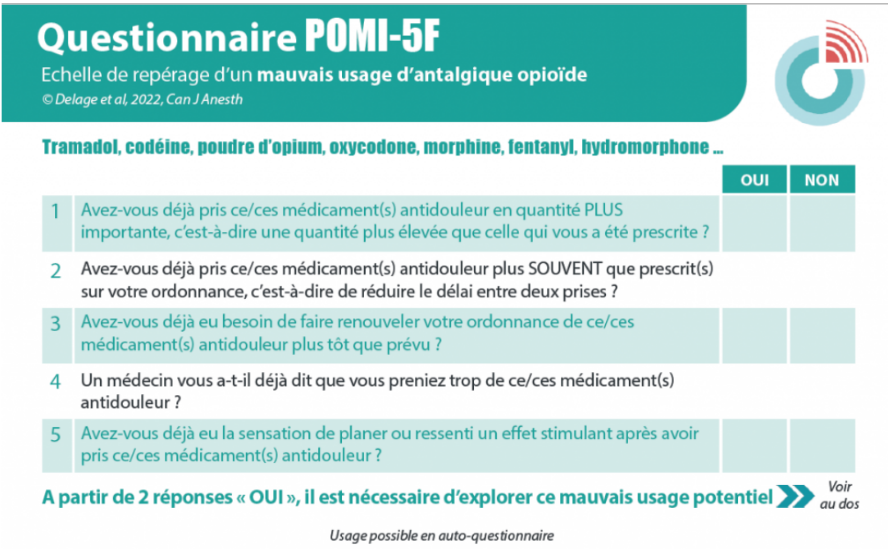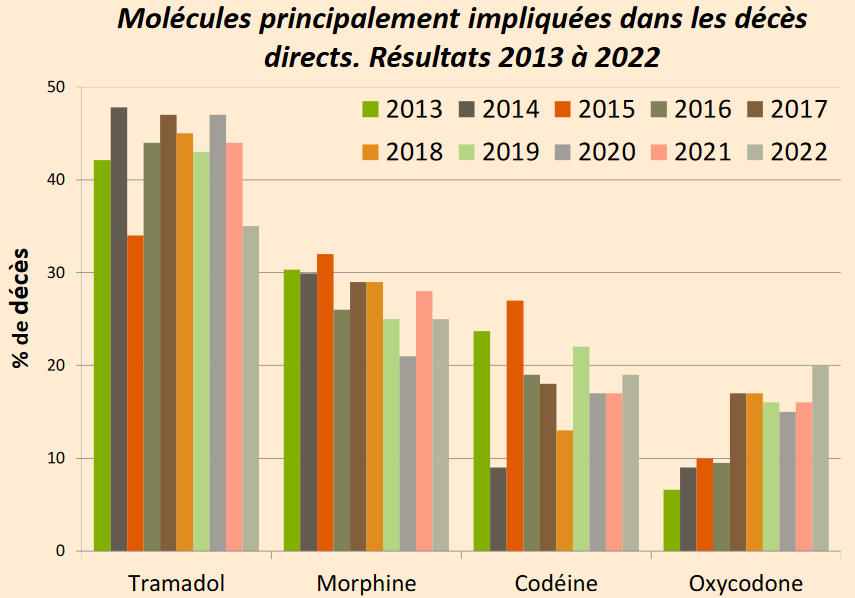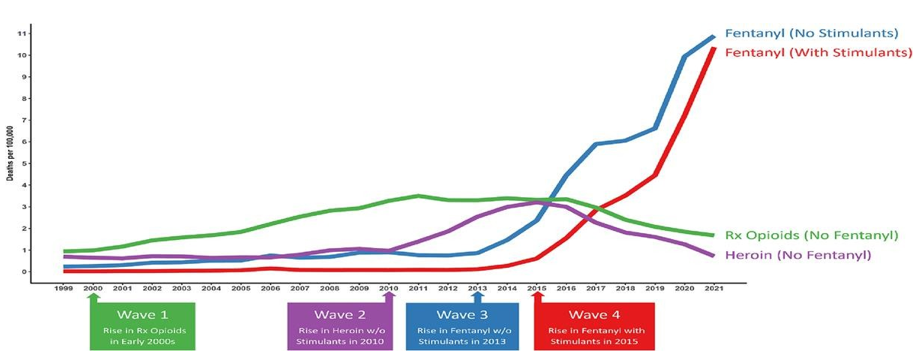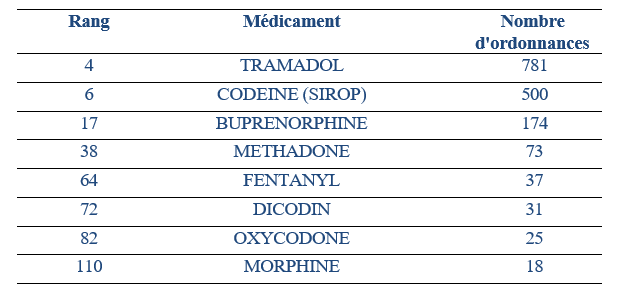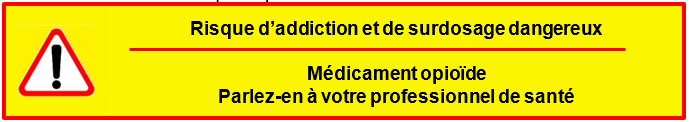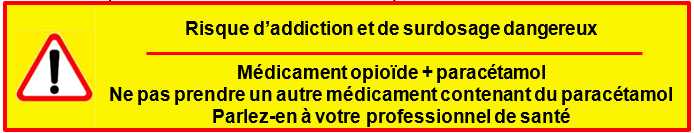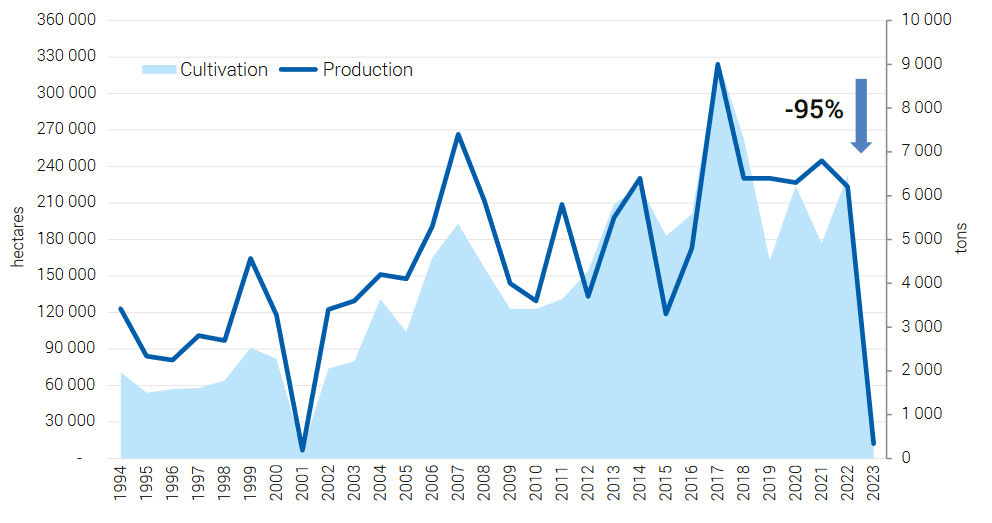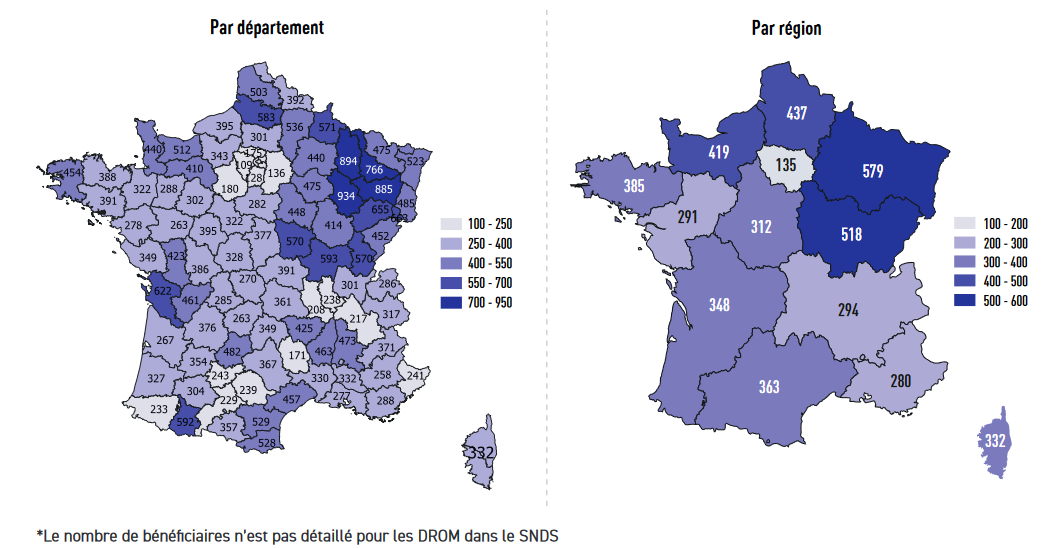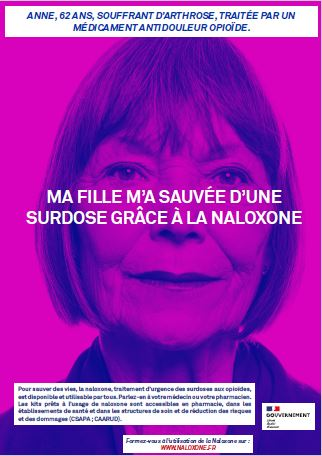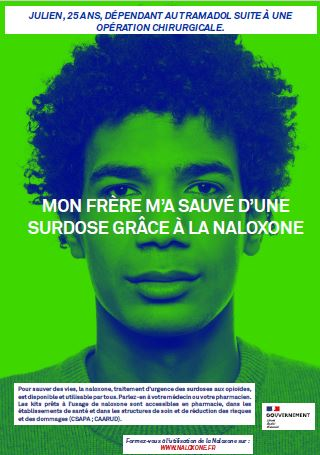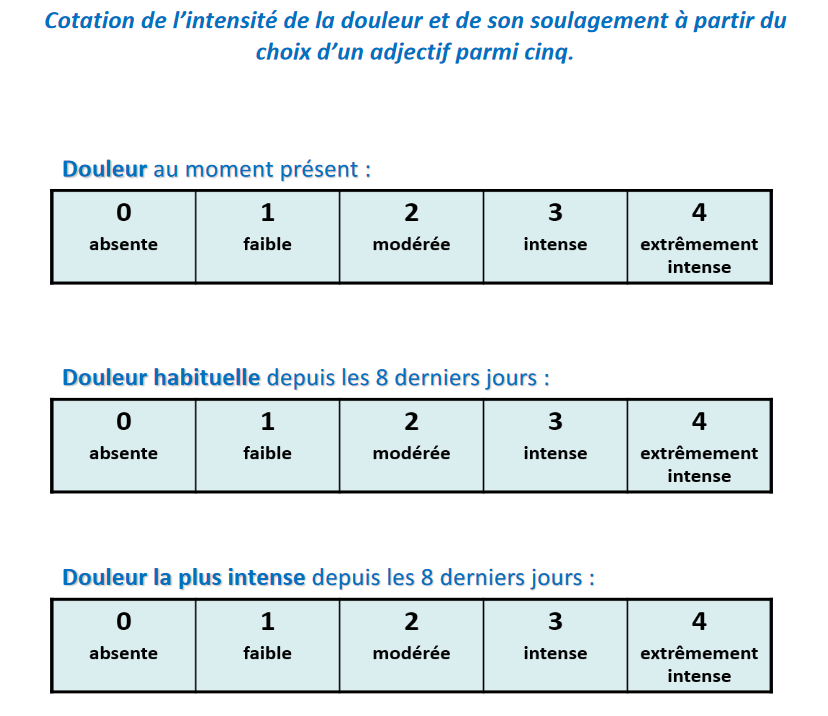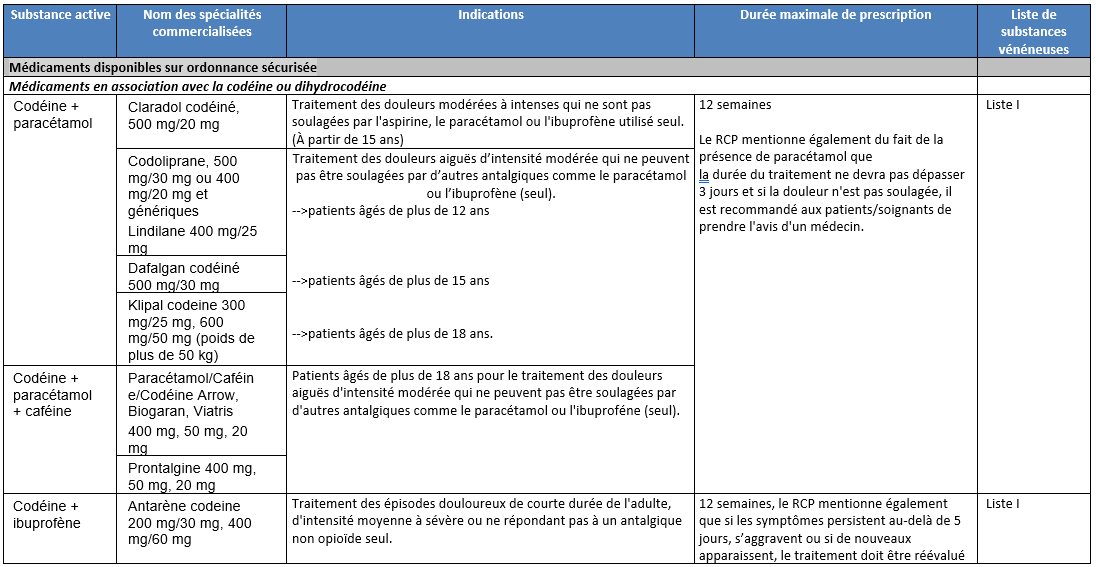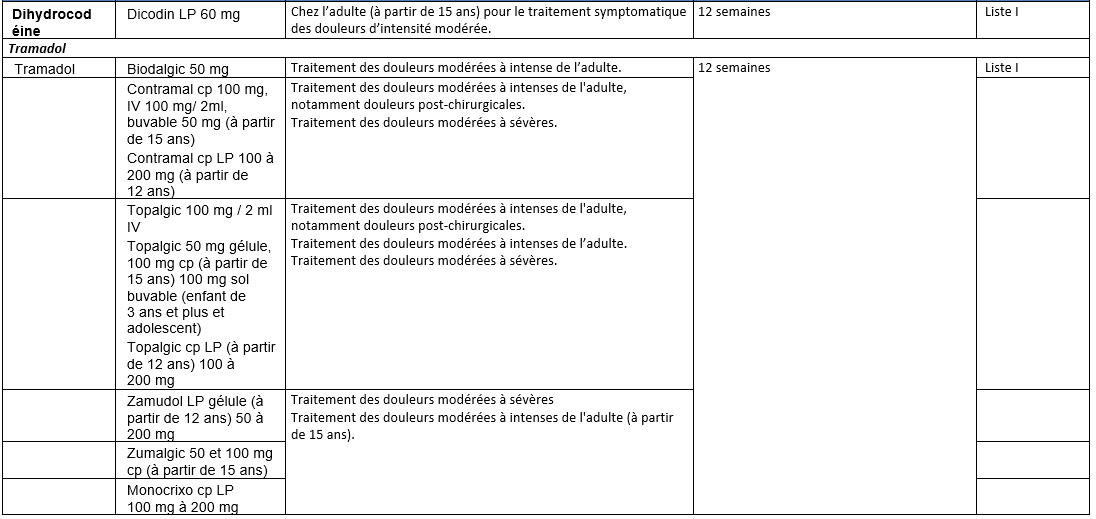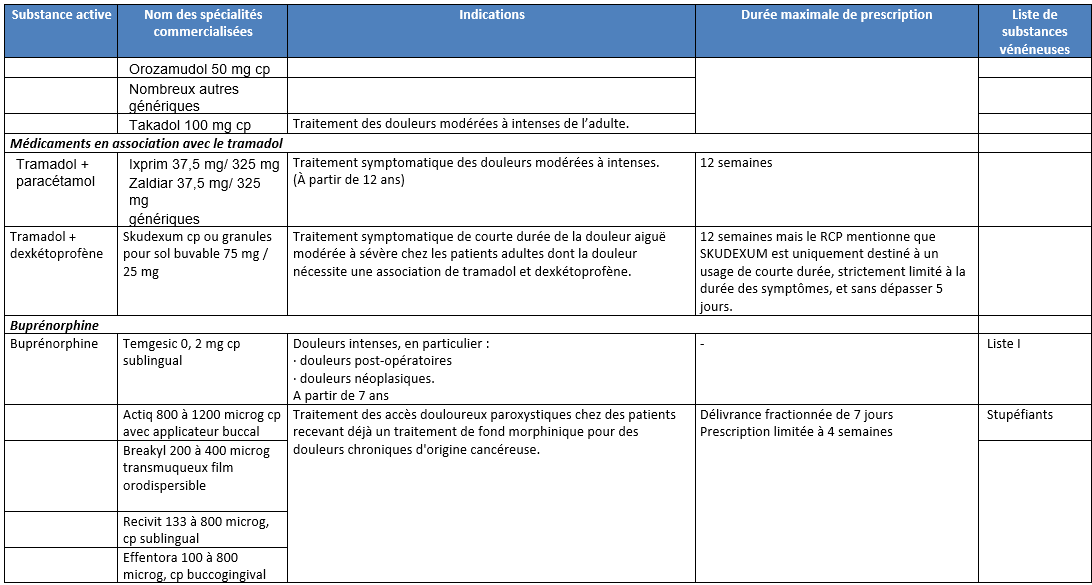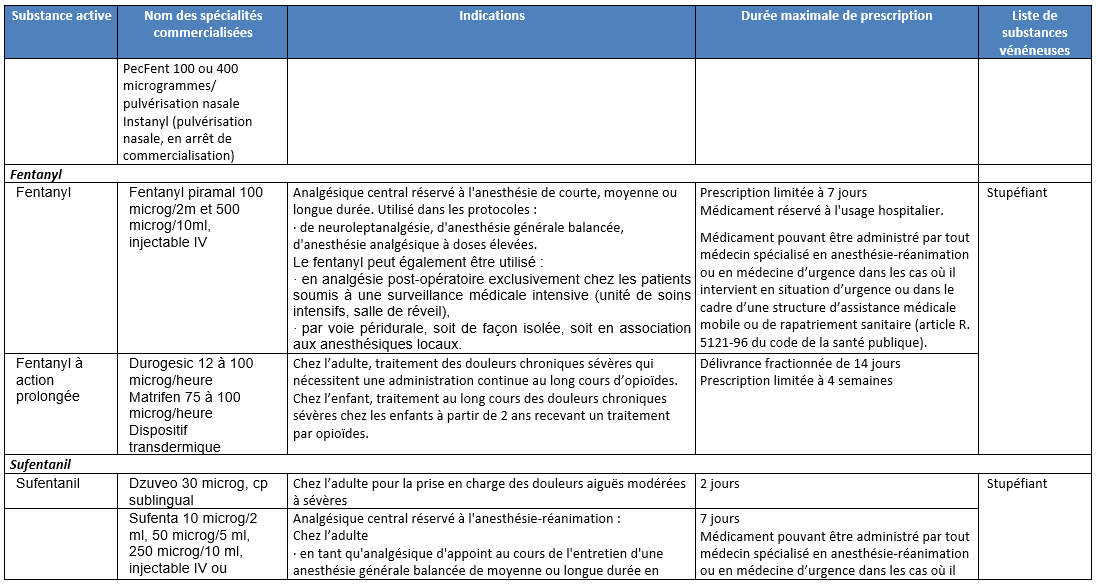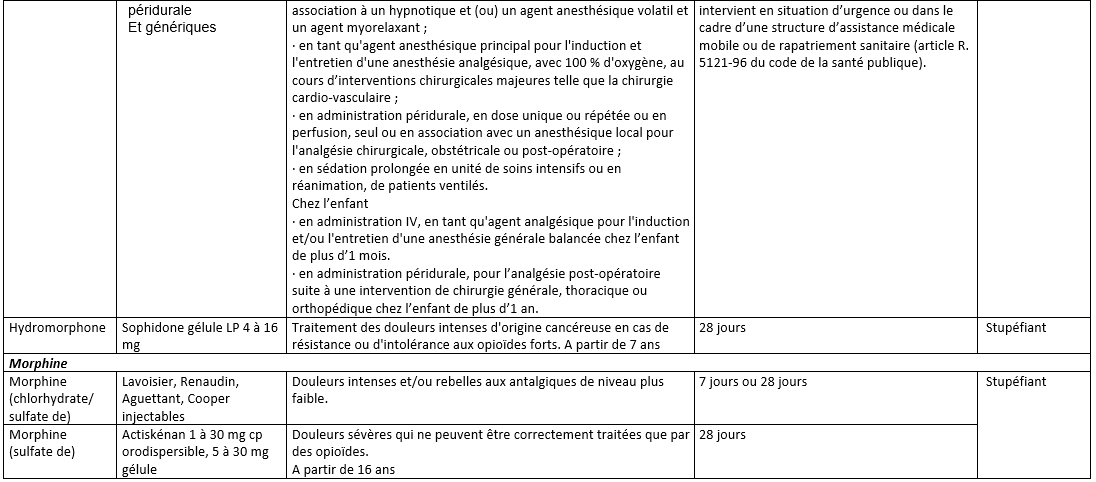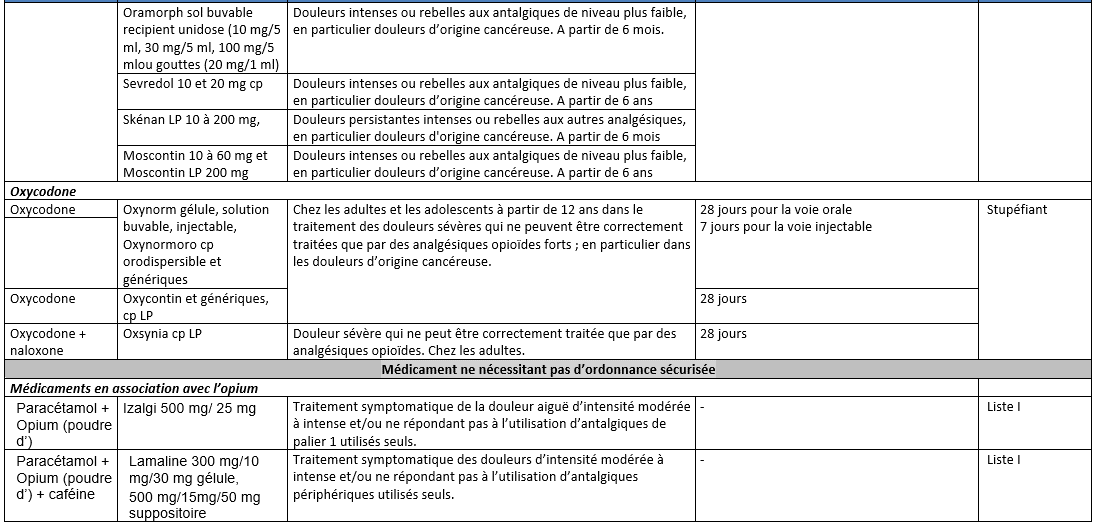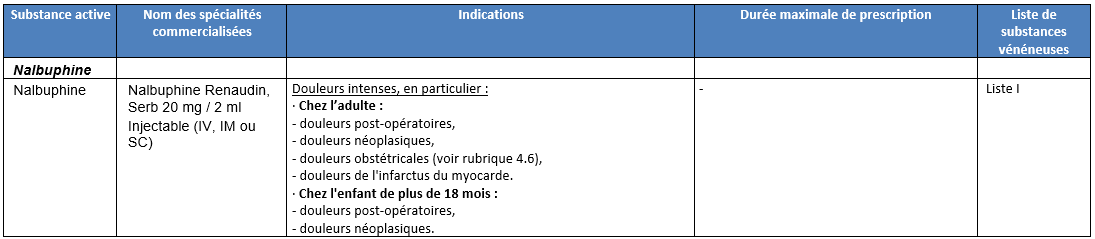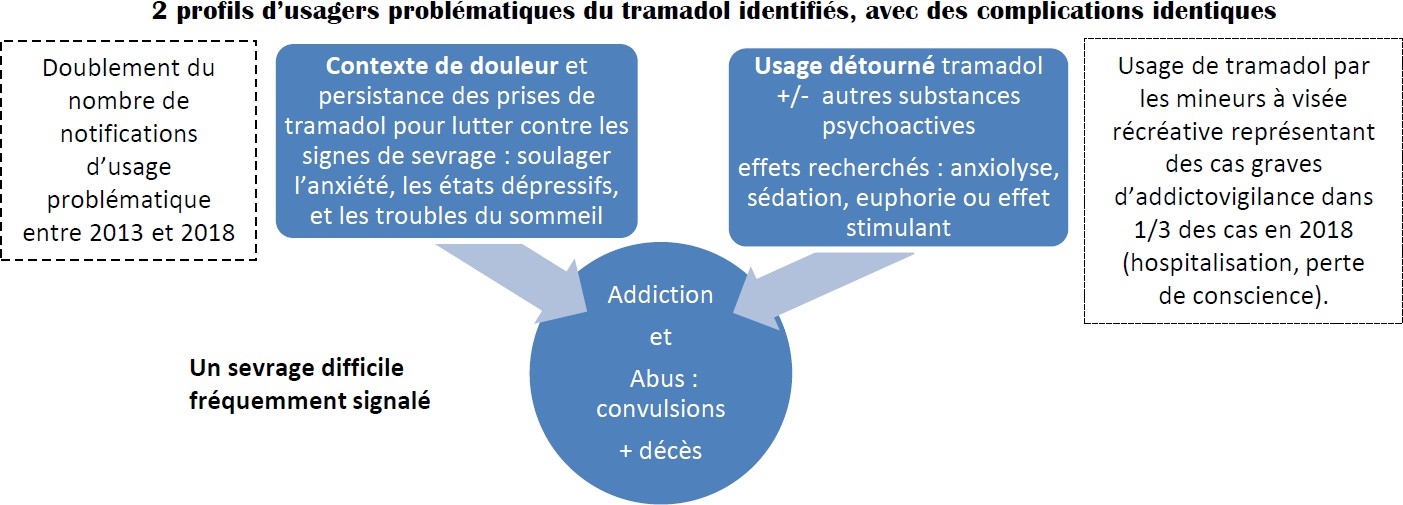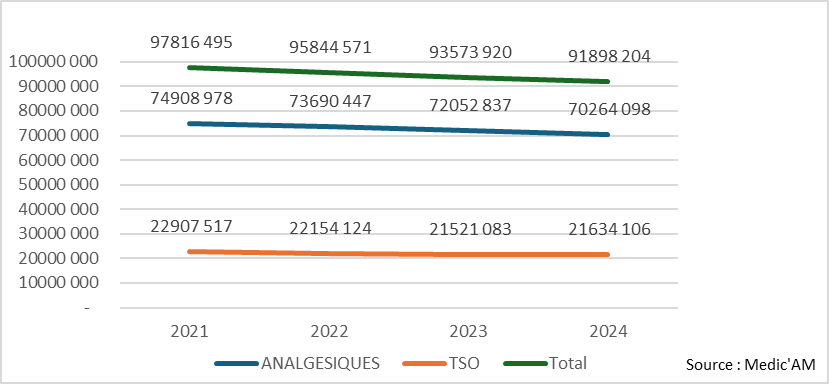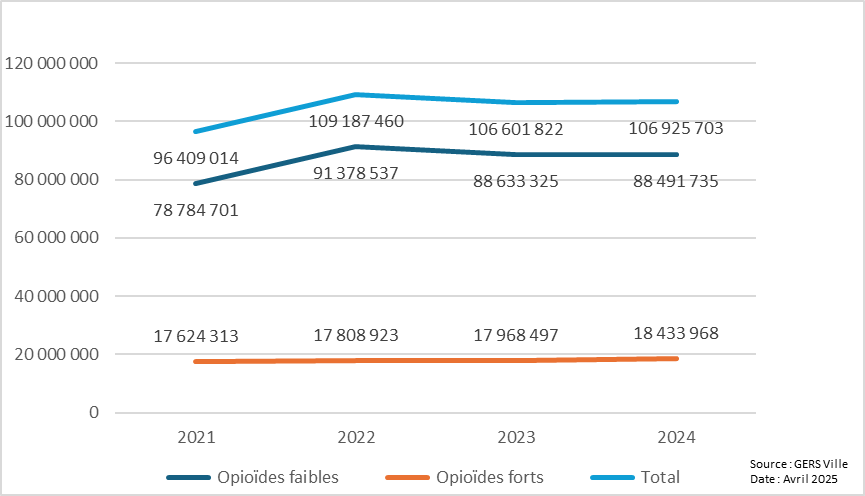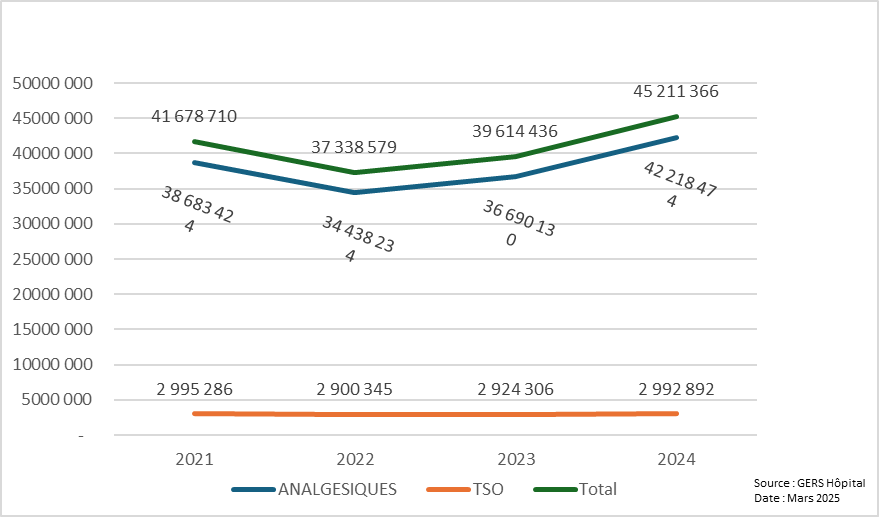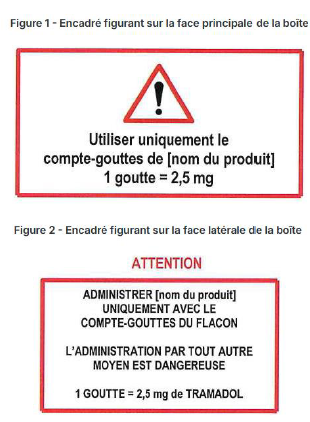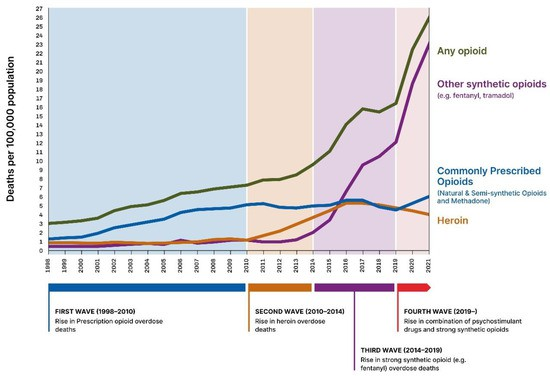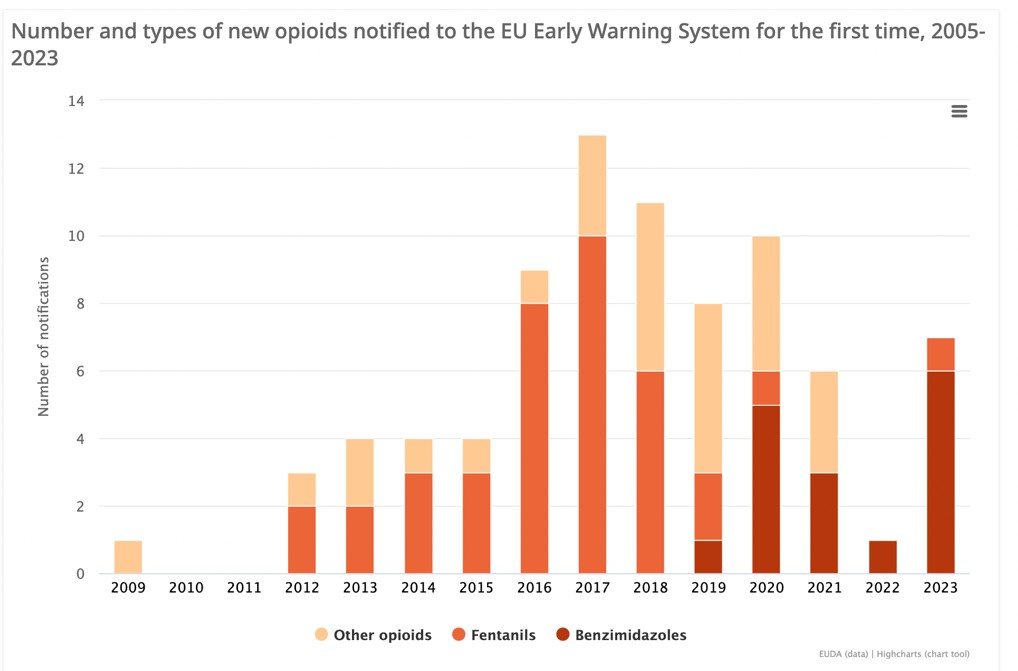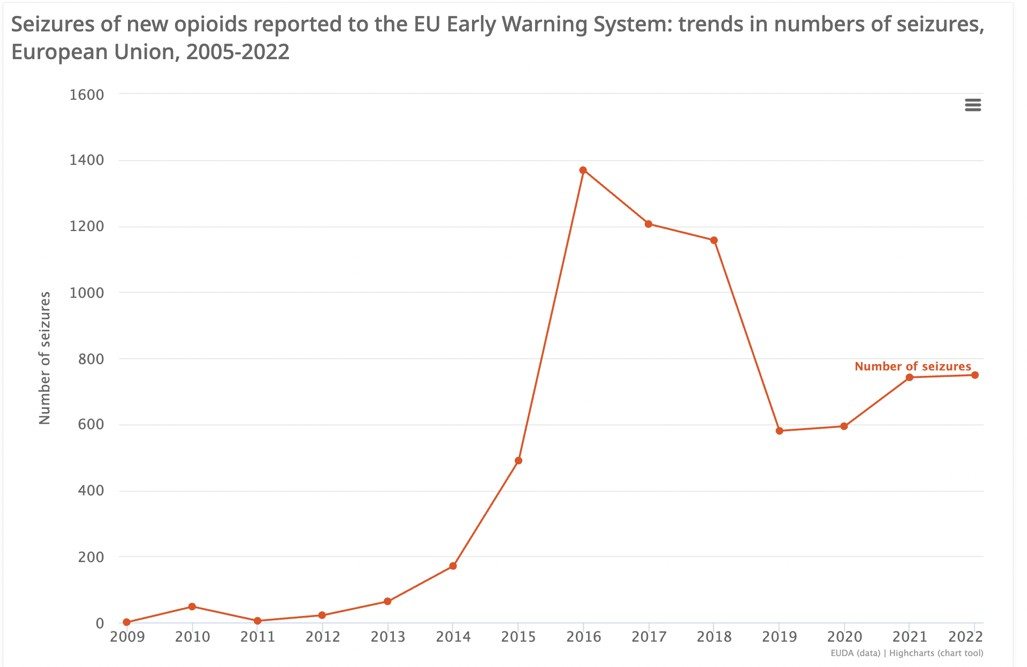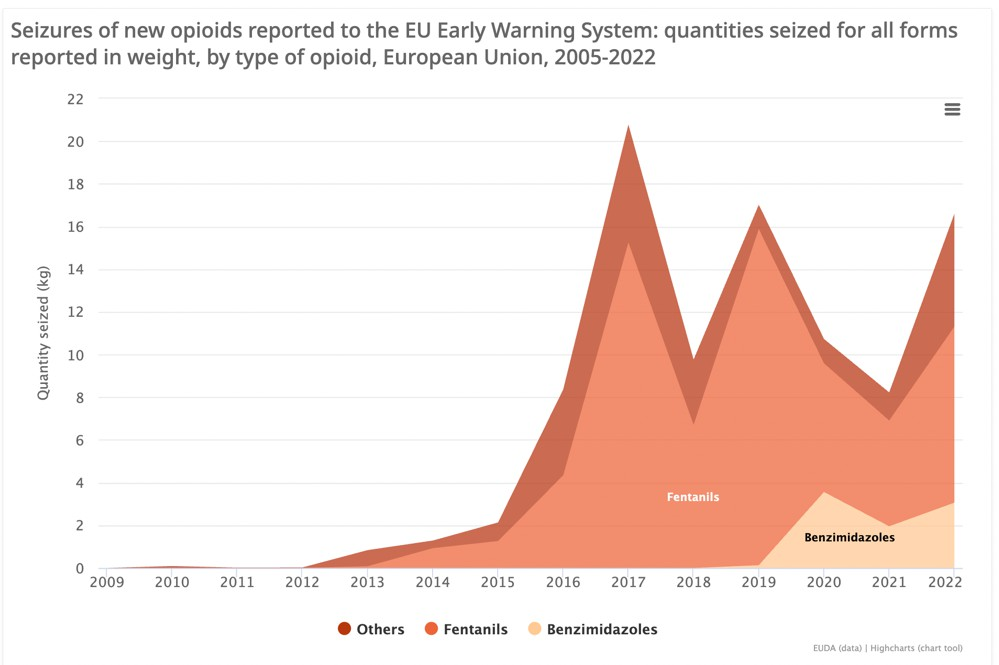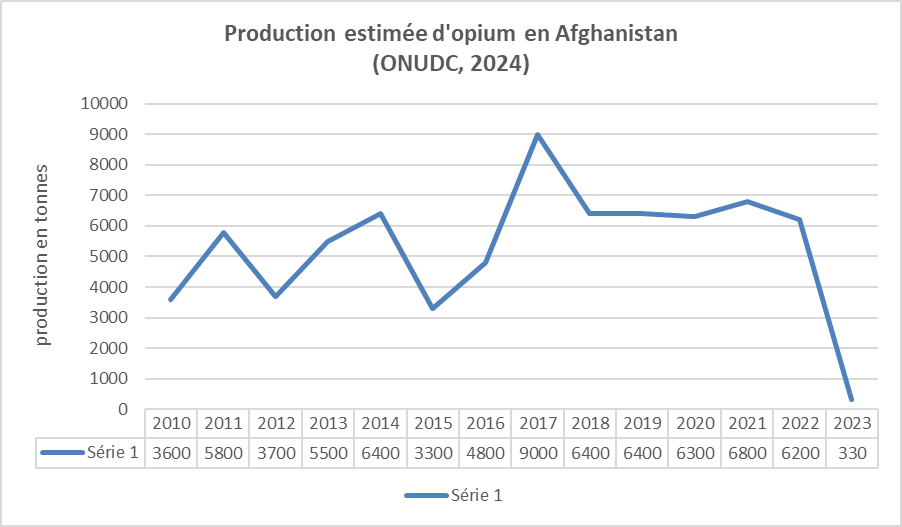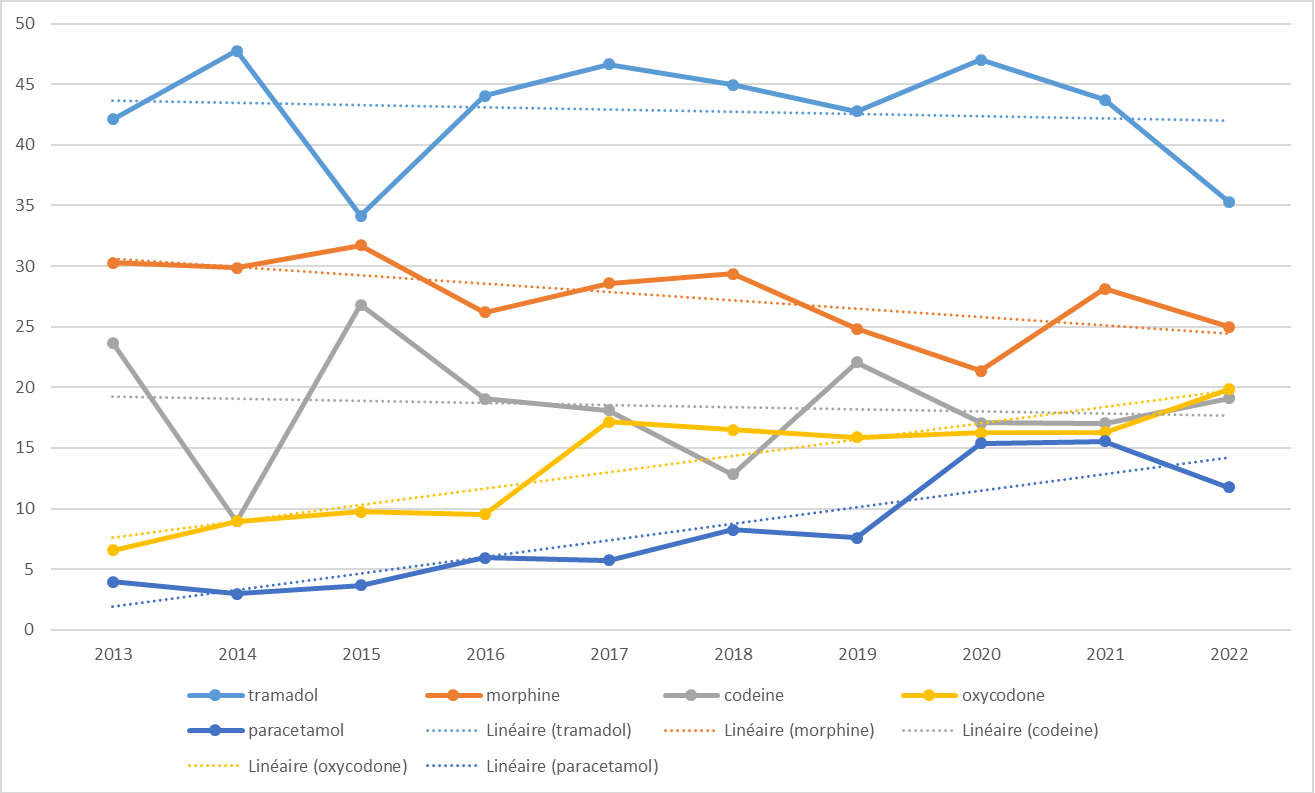- L'ESSENTIEL
- I. MALGRÉ UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE,
L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE
- A. LA CRISE AMÉRICAINE DES
OPIOÏDES : D'UNE SURPRESCRIPTION GÉNÉRALISÉE
À UNE HÉCATOMBE
- 1. D'une libéralisation de la prescription
d'opioïdes encouragée par des politiques commerciales agressives
à une vague de pharmacodépendance
- 2. Un resserrement brutal des conditions de
prescription et le déport vers le marché noir
- 3. La multiplication des surdoses mortelles,
liée à l'arrivée de substances plus puissantes
et plus difficiles à doser, les fentanyloïdes,
désormais associés à des psychostimulants
- 1. D'une libéralisation de la prescription
d'opioïdes encouragée par des politiques commerciales agressives
à une vague de pharmacodépendance
- B. EN FRANCE, UNE PROGRESSION PRÉOCCUPANTE
DES MÉSUSAGES ET DES SURDOSES PROVOQUÉE PAR UNE SOUS-ESTIMATION
DES RISQUES PAR LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS
- C. L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE
À L'AMÉRICAINE EN FRANCE
- A. LA CRISE AMÉRICAINE DES
OPIOÏDES : D'UNE SURPRESCRIPTION GÉNÉRALISÉE
À UNE HÉCATOMBE
- II. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE DOIT
DÉFINIR UN PLAN D'ACTION POUR LUTTER CONTRE LA DOULEUR ET LES CONDUITES
ADDICTIVES
- I. MALGRÉ UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE,
L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- I. RENFORCER L'INFORMATION ET FACILITER
L'ORIENTATION DES PATIENTS POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE DÉPENDANCE ET
LES MÉSUSAGES
- II. MIEUX SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ AUX RISQUES LIES AUX OPIOÏDES ET POURSUIVRE L'ENCADREMENT DES
PRESCRIPTIONS
- III. APPROFONDIR ET COMPLÉTER LA POLITIQUE
DE RÉDUCTION DES RISQUES
- I. RENFORCER L'INFORMATION ET FACILITER
L'ORIENTATION DES PATIENTS POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE DÉPENDANCE ET
LES MÉSUSAGES
- LISTE DES SIGLES
- AVANT PROPOS
- I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,
MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS
- A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,
SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR,
MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES
- B. UNE AUGMENTATION PRÉOCCUPANTE DES
MÉSUSAGES ET DES TROUBLES LIÉS À L'USAGE
- 1. La progression des mésusages et des
usages détournés
- 2. Des prescriptions parfois inadaptées au
niveau de risque associé à la consommation de médicaments
opioïdes
- 3. Les risques liés aux opioïdes,
notamment la dépendance, sont insuffisamment évalués
par les médecins
- a) Une sous-estimation du risque et des
symptômes de la dépendance, liée au déficit de
formation initiale et continue des professionnels de santé
- b) Un défaut d'utilisation des outils
existants afin d'évaluer les risques
- c) Le manque de coordination entre les
professionnels de santé accroît les risques de
mésusage
- a) Une sous-estimation du risque et des
symptômes de la dépendance, liée au déficit de
formation initiale et continue des professionnels de santé
- 4. Des mésusages favorisés par la
méconnaissance des consommateurs des risques associés aux
substances opioïdes
- 1. La progression des mésusages et des
usages détournés
- A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,
SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR,
MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES
- II. SI LA FRANCE N'APPARAÎT PAS
EXPOSÉE À UNE CRISE DES OPIOÏDES À
L'AMÉRICAINE, LA MAÎTRISE DE CE RISQUE NÉCESSITE DE
RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
- A. UN CADRE DE PRESCRIPTION ET DE
DÉLIVRANCE DES OPIOÏDES GLOBALEMENT SÉCURISÉ
- 1. Une régulation stricte de l'information
promotionnelle relative aux médicaments opioïdes, doublée
d'une politique active de pharmaco- et d'addictovigilances
- 2. Un encadrement rigoureux des conditions de
prescription et de délivrance des médicaments opioïdes,
récemment resserré
- a) Le resserrement des conditions de prescription
et l'encadrement de la durée de prescription
- b) Le déploiement progressif des
ordonnances sécurisées et numériques
- c) Une politique de sensibilisation et de
contrôle accrus des prescripteurs
- d) Le renforcement de l'encadrement des conditions
de dispensation des antalgiques opioïdes
- a) Le resserrement des conditions de prescription
et l'encadrement de la durée de prescription
- 3. Des normes perfectibles relatives au
conditionnement et à l'étiquetage des médicaments
opioïdes
- 1. Une régulation stricte de l'information
promotionnelle relative aux médicaments opioïdes, doublée
d'une politique active de pharmaco- et d'addictovigilances
- B. UNE MAÎTRISE DES RISQUES
CONDITIONNÉE À UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
- 1. Une restriction de l'accès aux
opioïdes non accompagnée comporterait un risque accru de
détournements et de mésusages
- 2. Renforcer la politique de réduction des
risques vis-à-vis des usagers
- 3. Agir en faveur de la prévention et de la
dépendance
- 4. Faire évoluer la formation des
médecins et consolider la structuration d'une offre de soins
spécialisée
- 1. Une restriction de l'accès aux
opioïdes non accompagnée comporterait un risque accru de
détournements et de mésusages
- A. UN CADRE DE PRESCRIPTION ET DE
DÉLIVRANCE DES OPIOÏDES GLOBALEMENT SÉCURISÉ
- I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,
MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
- ANNEXES
- TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES CONDITIONS DE PRESCRIPTION DES OPIOÏDES
- CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS
(CNOP)
- ASSOCIATION DES CENTRES D'ÉVALUATION
ET D'INFORMATION SUR LA PHARMACODÉPENDANCE-ADDICTOVIGILANCE (CEIP-A)
- HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
- LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT (LEEM)
- FÉDÉRATION ADDICTION
- HALTE SOINS ADDICTIONS DE STRASBOURG
- AUTO SUPPORT ET RÉDUCTION DES
RISQUES
PARMI LES USAGERS DE DROGUES (ASUD)
- ASSOCIATION DE RÉDUCTION DES RISQUES
SAFE
- PR BENJAMIN ROLLAND, PSYCHIATRE ET
ADDICTOLOGUE
- MICHEL GANDILHON,
EXPERT ASSOCIÉ AU PÔLE SÉCURITÉ-DÉFENSE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET ME'TIERS (CNAM)
- SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'ÉVALUATION
ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (SFETD)
- OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES
ET DES CONDUITES ADDICTIVES (OFDT)
- AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
- DR SIBYLLE MAURIES, PRATICIEN HOSPITALIER
- AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LES
DROGUES (EUDA)
- CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS
(CNOP)
- TABLEAU RÉCAPITULATIF
N° 848
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur les dangers des opioïdes,
Par Mmes Patricia DEMAS, Anne-Sophie ROMAGNY
et Anne
SOUYRIS,
Sénatrices
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
L'ESSENTIEL
___________
L'usage des antalgiques opioïdes pour le soulagement de la douleur s'accompagne de risques de mésusages importants, en nette augmentation ces dernières années.
Dans un contexte marqué par la crise américaine des opioïdes, les rapporteures ont formulé vingt recommandations visant à renforcer la politique de prise en charge de la douleur et de gestion des conduites addictives. La commission les a adoptées.
I. MALGRÉ UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE, L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE
A. LA CRISE AMÉRICAINE DES OPIOÏDES : D'UNE SURPRESCRIPTION GÉNÉRALISÉE À UNE HÉCATOMBE
Depuis 25 ans, les États-Unis ont été touchés par plus de 800 000 décès liés à des surdoses d'opioïdes1(*). Cette crise, qui frappe toute l'Amérique du Nord, a connu son apogée en 2022, avec près de 120 000 morts sur le sous-continent.
1. D'une libéralisation de la prescription d'opioïdes encouragée par des politiques commerciales agressives à une vague de pharmacodépendance
Dans un contexte marqué par une demande sociale accrue de prise en charge de la douleur, les prescriptions d'opioïdes se sont libéralisées aux États-Unis dans les années 1990. En cause, des stratégies commerciales agressives des laboratoires pharmaceutiques, qui ont stimulé l'offre par une politique de lobbying auprès des médecins, et encouragé la demande par la promotion de certains médicaments comme l'OxyContin auprès du grand public, en occultant bien souvent les risques de dépendance consubstantiels à cette classe thérapeutique.
Malgré les risques, la prescription d'opioïdes s'est alors généralisée, voire banalisée. Ainsi, en 2014, 99 % des médecins américains prescrivaient des opioïdes au-delà des durées recommandées. Des centaines de milliers d'Américains ont donc développé une dépendance aux opioïdes.
2. Un resserrement brutal des conditions de prescription et le déport vers le marché noir
Prenant conscience de la crise sanitaire émergente, les pouvoirs publics ont brutalement resserré les conditions de prescription de ces médicaments, causant un effondrement de 45 % de la délivrance d'opioïdes prescrits entre 2011 et 2019. Privés de médicaments sur ordonnance, de nombreux patients dépendants se sont déportés vers le marché de rue, alors dominé par l'héroïne. La consommation d'opioïdes et la qualité des substances consommées sont alors devenues incontrôlables pour les pouvoirs publics : le nombre de surdoses mortelles liées à l'héroïne s'est envolé.
3. La multiplication des surdoses mortelles, liée à l'arrivée de substances plus puissantes et plus difficiles à doser, les fentanyloïdes, désormais associés à des psychostimulants
À partir de 2015, l'héroïne a progressivement été supplantée par l'arrivée sur le marché noir des fentanyloïdes, des opioïdes de synthèse peu coûteux, mais 50 fois plus puissants.
La puissance des fentanyloïdes et l'hétérogénéité de leur composition en fonction des fournisseurs les rendent très difficiles à doser, ce qui cause une augmentation exponentielle des surdoses liées à ces produits. L'association des fentanyloïdes avec des psychostimulants, observée depuis le début des années 2020, accroît encore le risque de surdose. En quelques années, le fentanyl est ainsi devenu la première cause de mortalité des 18/49 ans aux États-Unis. En 2023, quelque 75 000 surdoses mortelles ont été attribuées aux fentanyloïdes aux États-Unis, soit près des trois quarts du nombre total d'overdoses.
Une baisse de 20 % des surdoses est attendue en 2024, grâce à un meilleur accès aux traitements de substitution, à la généralisation de l'emploi de la naloxone, et au renforcement de l'encadrement des prescriptions.
Les quatre vagues de la crise américaine des opioïdes
Source : Friedman et al., Addiction, 2023
B. EN FRANCE, UNE PROGRESSION PRÉOCCUPANTE DES MÉSUSAGES ET DES SURDOSES PROVOQUÉE PAR UNE SOUS-ESTIMATION DES RISQUES PAR LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS
1. Une évolution préoccupante de la consommation, des mésusages et des surdoses
La France connaît, depuis plusieurs années, une évolution notable de la consommation d'opioïdes, et des mésusages et surdoses associés. Si l'ampleur de ce phénomène demeure incomparable avec la surconsommation incontrôlée observée aux États-Unis dans les années 2000, un certain nombre de signaux préoccupants doit inciter les pouvoirs publics à prendre toute la mesure d'un risque de banalisation des usages des médicaments opioïdes.
· En 2024, près de 12 millions de Français se sont vu prescrire des antalgiques opioïdes. Si les antalgiques non opioïdes restent majoritaires, les opioïdes représentent aujourd'hui 22 % de la consommation d'antalgiques en France, concentrés sur les opioïdes de palier 2 comme le tramadol ou la codéine (20 %). La part des opioïdes forts (oxycodone, morphine) reste modeste (2 %), mais progresse rapidement au détriment des opioïdes faibles, démontrant une tendance à l'escalade thérapeutique, mais aussi une incidence accrue des douleurs chroniques. Les ventes d'opioïdes forts, présentant des risques accrus, ont ainsi progressé de 59 % depuis 2010.
· Les mésusages, des consommations à visée thérapeutique non ou mal encadrées médicalement, s'accentuent également. Depuis 2017, les signalements relatifs au mésusage du tramadol ont doublé. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), ce sont désormais 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol qui présentent des pratiques de mésusage.
· Les cas les plus graves suivent également une dynamique préoccupante. Entre 2006 et 2015, les cas de troubles liés à l'usage d'opioïdes ont plus que doublé, l'oxycodone présentant une trajectoire particulièrement inquiétante. Le nombre de patients dépendants a également de quoi alerter : 47 % des usagers de tramadol éprouveraient des difficultés à arrêter leur traitement. Enfin, le nombre de décès liés à l'usage d'opioïdes prescrits, hors usagers à risques, s'est accru de 20 % entre 2018 et 2022.
Antalgiques opioïdes les plus vendus en
officine (à gauche)
et en établissements (à droite) en
2023
Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM
2. Une progression des mésusages portée par une sous-estimation des risques par les patients comme par les professionnels de santé
Face à la volonté légitime de soulager la douleur, l'usage d'opioïdes est en quelque sorte devenu un réflexe, tant pour les patients qui les réclament que pour les professionnels qui les prescrivent.
· Les recommandations de bon usage des opioïdes, qui n'ont certes été publiées par la HAS qu'en 2022, sont insuffisamment observées dans les prescriptions des professionnels, peu formés et sensibilisés à la question. Selon une étude, plus de 80 % des prescriptions de codéine concernent des indications pour lesquelles le recours aux opioïdes n'est pas recommandé en première intention, telles que la lombalgie ou les douleurs dentaires, voire formellement déconseillé, par exemple pour les céphalées.
De plus, le manque de coordination entre prescripteurs de ville, hospitaliers et pharmaciens, conduit à une prise en charge en silo, contraire à l'approche holistique qui devrait prévaloir. Cela conduit à des prescriptions inadaptées ou à une prolongation non justifiée des traitements.
· Du côté des patients, l'automédication et le partage de traitements, pratiques largement banalisées associées à des surdosages et au développement incontrôlé d'une pharmacodépendance, sont en cause.
Les patients, ignorant trop souvent les risques voire la nature de leur traitement opioïde, sont, de ce fait, placés dans un rôle de consommateur passif et ne peuvent être acteurs du bon usage. L'information des patients, érigée en droit par la loi Kouchner et constitutive d'une obligation déontologique pour les professionnels, demeure insuffisante : un praticien sur cinq admet ne pas fournir d'information systématique sur les risques liés aux opioïdes.
C. L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE EN FRANCE
1. Un encadrement globalement sécurisé de la promotion et de la prescription d'opioïdes, et un suivi rigoureux de l'addictovigilance
Afin d'éviter l'importation de la crise américaine, la France dispose d'atouts sur lesquels compter.
· Contrairement aux États-Unis, la promotion des médicaments y est strictement encadrée : les publicités auprès du grand public sont interdites pour les opioïdes, et celles visant les professionnels de santé sont soumises à un visa de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cet encadrement pourrait utilement être complété par l'élaboration de recommandations spécifiques pour les supports promotionnels.
· En réaction à la trajectoire préoccupante des mésusages, les autorités sanitaires ont également resserré les conditions de prescription. Tous les opioïdes sont soumis à prescription médicale obligatoire depuis 2017. De plus, à quelques exceptions près, les opioïdes font désormais l'objet d'un plafonnement de leur durée de prescription, fixée au plus à quatre semaines pour les médicaments stupéfiants, et à douze semaines pour le tramadol depuis 2020 et pour la codéine depuis le 1er mars dernier.
· Afin de lutter contre les falsifications d'ordonnances, qui touchent tout particulièrement les opioïdes, les opioïdes classés comme stupéfiants et, depuis le 1er mars dernier, le tramadol et la codéine doivent être prescrits par une ordonnance numérique ou, à défaut, une ordonnance sécurisée.
Fausses prescriptions d'opioïdes confirmées signalées à la Cnam
Source : Cnam
· Les partenaires conventionnels se sont également saisis de la question : la dernière convention médicale fixe un objectif de diminution de 10 % du volume d'opioïdes de palier 2 prescrits en ville, et la Cnam mène des contrôles renforcés sur les médecins réalisant des prescriptions atypiques.
· Enfin, la France peut compter sur des réseaux d'addictovigilance et de pharmacovigilance performants, qui recensent et quantifient les usages non conformes afin d'alerter précocement les autorités sanitaires de toute évolution préoccupante. Les rapporteures préconisent de consolider ces acquis en réévaluant les moyens accordés aux centres d'addictovigilance, particulièrement peu pourvus au regard de leurs missions, et en accentuant les efforts de testing afin de mieux connaître les substances sur le marché, et leurs risques pour la santé.
2. Des fragilités et des signaux préoccupants à ne pas négliger
Il convient toutefois de ne pas négliger certains champs qui apparaissent aujourd'hui comme des angles morts de la régulation de la consommation d'opioïdes.
· Le conditionnement des médicaments opioïdes est parfois inadapté aux posologies recommandées, ce qui conduit les patients à accumuler des boîtes d'antalgiques non terminées dans leur armoire à pharmacie. Cela renforce naturellement les risques d'automédication. Sur le modèle du travail conduit pour la réduction de la taille des boîtes de tramadol, il doit être envisagé de revoir le conditionnement de certaines spécialités comme le Dafalgan codéiné.
· Par ailleurs, bien que l'étiquetage des opioïdes constitue un vecteur d'information essentiel pour le patient, celui-ci ne fait aujourd'hui pas figurer de mentions d'alerte relatives au risque de pharmacodépendance encouru. Sur le modèle des États-Unis ou de l'Australie, une telle évolution est en bonne voie pour le tramadol ou la codéine, mais elle doit être étendue à l'ensemble des opioïdes de palier 2 comme de palier 3.
· Enfin, face à la diminution brutale de la production d'héroïne par l'Afghanistan, de nouveaux opioïdes de synthèse comme les nitazènes ou les fentanyloïdes, plus puissants et plus dangereux, arrivent en France sur le marché noir. Il convient d'accorder une attention toute particulière à la pénétration de ces produits en France, encore embryonnaire mais déjà bien présente chez certains de nos voisins européens.
II. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE DOIT DÉFINIR UN PLAN D'ACTION POUR LUTTER CONTRE LA DOULEUR ET LES CONDUITES ADDICTIVES
A. RÉINVESTIR DANS UNE POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
1. Un objectif relégué au second plan conduisant à des carences persistantes
· Trois plans nationaux de lutte contre la douleur ont été successivement portés par le Gouvernement entre 1998 et 2010 (1998-2000, 2002-2005, 2006-2010). Ces plans ont permis de simplifier les conditions de prescription des principaux antalgiques, et favorisé la structuration de la prise en charge de la douleur au sein des établissements de santé et en ville.
Ainsi, les structures spécialisées douleur chronique (SDC), au nombre de 274 en 2023, constituent selon la HAS « un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques ».
· Néanmoins, malgré les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, le 4e plan national de lutte contre la douleur n'a pas vu le jour. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a certes inscrit la douleur parmi les objectifs auxquels concourt la politique de santé publique, mais celle-ci n'apparaît plus comme une priorité.
On estime entre 20 % et 30 % la part des Français souffrant de douleurs chroniques. Parmi eux, seuls 37 % se déclarent satisfaits de leur prise en charge.
Or, la douleur constitue la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'urgences. Lorsqu'elle se chronicise, elle induit des répercussions psycho-sociales pour 70 % des patients et altère la qualité de vie de 50 % d'entre eux.
· Il en résulte des carences persistantes, notamment en matière d'offre de soins. D'une part, les SDC pâtissent d'une faible accessibilité liée aux délais de prise en charge et d'une inégale répartition sur le territoire : seuls 3% des patients douloureux chroniques y ont donc accès. D'autre part, l'insuffisante coordination des parcours de soins engendre des ruptures de parcours ou des chevauchements de prescriptions, qui favorisent les mésusages.
2. Une nécessité : dessiner les contours d'un nouveau plan national de lutte contre la douleur
Ces constats plaident en faveur d'une nouvelle feuille de route dédiée au traitement de la douleur.
· En premier lieu, la situation des SDC doit être consolidée. La saturation de ces structures ne permet ni que les files actives soient prises en charge dans des délais conformes aux recommandations internationales, ni que les patients bénéficient d'un traitement adapté. La situation financière des SDC doit également être sécurisée, le manque de moyens financiers et humains menaçant la pérennité de certaines structures.
· En deuxième lieu, une meilleure coordination de tous les acteurs de l'offre de soins est indispensable. À cet égard, les dispositifs incitatifs à l'utilisation du dossier médical partagé doivent être soutenus, pour éviter les prescriptions redondantes et limiter les prolongations injustifiées de traitements.
· Ces priorités justifient que soit formalisé un nouveau plan national de lutte contre la douleur, pour apporter à la problématique des mésusages d'opioïdes des réponses globales en matière d'offre de soins, de la prévention à la prise en charge.
B. RENFORCER LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES EN MATIÈRE D'ADDICTIONS
1. Poursuivre les efforts pour améliorer l'accès aux traitements par agonistes opioïdes
· La France est l'un des pays européens dans lesquels l'accès des usagers aux traitements par agonistes opioïdes (TAO) est le plus élevé.
L'organisation de l'offre souffre néanmoins de disparités territoriales importantes. L'accès aux TAO est ainsi plus limité en Île-de-France et dans les territoires ultra-marins.
Nombre de bénéficiaires de TAO en ville pour 100 000 habitants de 15 à 74 ans (2023)
Source : OFDT
Ces inégalités s'expliquent en partie par l'engorgement des structures d'addictologie, ainsi que par un défaut d'accompagnement des médecins généralistes, lesquels peuvent refuser d'initier ou de renouveler des prescriptions de TAO.
Face à ce constat, et compte tenu des limites de durée de prescription des TAO (14 à 28 jours), la situation des patients dépendants devrait être sécurisée pour éviter les ruptures de traitements. La dispensation en ville de la buprénorphine à libération prolongée et une réflexion sur l'opportunité d'élargir l'offre de TAO au sulfate de morphine, pourraient constituer des réponses utiles.
· En revanche, malgré les recommandations de la HAS, l'accès à la naloxone demeure très insuffisant. Son administration permettrait pourtant d'empêcher 4 décès sur 5 par overdose.
Antidote aux surdoses d'opioïdes, la naloxone permet de prévenir l'effet de dépression respiratoire pouvant causer le décès. Actuellement, l'hétérogénéité des conditions de son remboursement et des modalités de sa délivrance nuit à sa disponibilité.
Dès 2022, la HAS a recommandé aux pouvoirs publics d'améliorer la diffusion de la naloxone grâce à « un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone ».
Seuls les médicaments à base de naloxone délivrés sur prescription médicale sont, en tout ou partie, remboursés par l'assurance maladie, et l'exigence de prescription médicale pour la délivrance de certaines spécialités constitue un obstacle de plus à son accessibilité. Selon les rapporteures, il est grand temps de donner une portée concrète à la recommandation de la HAS (cf. supra).
2. Élargir la politique de réduction des risques et favoriser la responsabilisation des usagers
· Plusieurs experts mettent en avant le risque que comporterait une restriction non accompagnée des prescriptions d'opioïdes pour les usagers, incités à se reporter vers des modes d'approvisionnement illégaux.
De ce point de vue, les conséquences du passage à l'ordonnance sécurisée pour le tramadol et la codéine devront être évaluées. Toute régulation de l'accès aux médicaments opioïdes doit être pensée dans le cadre d'une politique globale de réduction des risques, incluant un accès aux TAO.
· Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer la politique de réduction des risques (RdR) et de l'élargir au-delà des publics ciblés par les politiques « d'aller vers » pour viser l'ensemble des usagers d'opioïdes.
Alors que la RdR demeure une politique globalement confidentielle, une promotion en population générale permettrait de déstigmatiser les usagers d'opioïdes et de saisir la diversité des profils concernés par les mésusages.
L'éducation thérapeutique constitue également un levier opportun pour rendre les patients acteurs de leur prise en charge. Les professionnels de la douleur appellent à ce qu'elle soit renforcée.
Enfin, le déploiement de programmes ciblant les usagers les plus à risque, à l'image du programme POP « Prévention et réduction des risques des surdoses liées aux opioïdes en région PACA » doit demeurer une priorité. L'expérimentation des haltes soins addictions (HSA) s'inscrit dans ce cadre.
C. FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES
1. Améliorer la formation des professionnels de la santé en matière de prise en charge de la douleur et des conduites addictives
La formation des professionnels de santé en matière de prise en charge de la douleur et des conduites addictives est indiscutablement lacunaire.
· S'agissant de la formation initiale, ni l'algologie ni l'addictologie ne sont reconnues comme des spécialités médicales constituées en diplômes d'études spécialisées (DES).
S'il existe des formations spécialisées transversales (FST) optionnelles sur la douleur et l'addictologie, la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) indique que la réforme du troisième cycle des études médicales aurait conduit à une diminution de moitié du temps de formation consacré à la douleur.
Ces carences dans la formation étant partagées notamment par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, les rapporteures préconisent d'inscrire un module renforcé sur la prise en charge de la douleur et des addictions dans les études des professionnels de santé concernés.
· Le développement de programmes de formation continue, aisément accessibles aux professionnels en exercice, apparaît également nécessaire, a fortiori dans l'optique de la préconisation de la SFETD d'intégrer le dépistage de la douleur aux consultations de prévention aux âges clés de la vie (« Mon bilan prévention »).
2. Soutenir et accompagner l'évolution des pratiques professionnelles
· Le médecin généraliste est l'acteur central de la prise en charge de la douleur chronique, prescripteur de 86,3 % des opioïdes faibles et de 88,7% des opioïdes forts.
Or la recherche du « zéro douleur », qui favorise les prescriptions inadaptées et les dérives vers les situations d'accoutumance, ne doit pas constituer un objectif thérapeutique en soi.
Les médecins généralistes, peu sensibilisés aux conditions de prescription des opioïdes et au repérage des conduites addictives, sont confrontés à une escalade thérapeutique qu'ils ne savent plus gérer. Or, la HAS comme la SFETD soulignent la nécessité d'accompagner toute prescription d'opioïde d'un projet de déprescription.
· L'évolution des pratiques professionnelles doit donc être soutenue :
- en renforçant l'implication des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et de la HAS dans la diffusion des référentiels de bonnes pratiques sur la prescription des opioïdes ;
- en repositionnant les médicaments opioïdes dans une prise en charge multimodale associant des antalgiques non opioïdes et/ou des approches non médicamenteuses.
Liste des principales recommandations
I. Renforcer l'information et faciliter
l'orientation des patients pour lutter
contre le risque de
dépendance et les mésusages
Recommandation n° 1 : Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes.
Recommandation n° 3 : Faire apparaître une mention du risque de dépendance sur les boîtes de médicaments opioïdes, y compris de palier 2.
Recommandation n° 5 : Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur.
II. Mieux sensibiliser les professionnels de
santé aux risques liés aux opioïdes
et poursuivre
l'encadrement des prescriptions
Recommandation n° 8 : Évaluer l'impact de l'obligation de recourir à des ordonnances sécurisées pour le tramadol et la codéine et, le cas échéant, envisager de soumettre l'ensemble des opioïdes à une obligation d'ordonnance sécurisée.
Recommandation n° 11 : Intégrer un module obligatoire renforcé sur la lutte contre la douleur et les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés.
Recommandation n° 14 : Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur.
III. Approfondir et compléter la politique de réduction des risques
Recommandation n° 16 : Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitement par agonistes opioïdes et en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde.
Recommandation n° 18 : Améliorer la disponibilité des traitements par agonistes opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée.
Recommandation n° 20 : Consolider le réseau national d'addictovigilance en renforçant les moyens humains à la disposition des CEIP-A et développer des dispositifs d'analyse des drogues permettant d'évaluer précocement les évolutions des produits et leurs conséquences sur la santé humaine.
Réunie le mercredi 9 juillet 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les 20 recommandations des rapporteures, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
___________
I. RENFORCER L'INFORMATION ET FACILITER L'ORIENTATION DES PATIENTS POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE DÉPENDANCE ET LES MÉSUSAGES
Recommandation n° 1 : Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes.
Recommandation n° 2 : Renforcer l'éducation thérapeutique des patients par la mise à disposition dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les services de médecine d'urgence, d'outils d'auto-évaluation de la douleur et du risque de dépendance.
Recommandation n° 3 : Faire apparaître une mention du risque de dépendance sur les boîtes de médicaments opioïdes, y compris de palier 2.
Recommandation n° 4 : Mener une campagne nationale non stigmatisante sur le bon usage et les risques associés à la consommation de médicaments opioïdes à destination du grand public.
Recommandation n° 5 : Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur.
Recommandation n° 6 : Systématiser l'évaluation par un médecin spécialiste ou formé à la prise en charge de la douleur ou à l'addictologie au-delà de 3 mois de traitement ou en cas de prise d'une dose journalière supérieure à l'équivalent de 120 mg de morphine.
II. MIEUX SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUX RISQUES LIES AUX OPIOÏDES ET POURSUIVRE L'ENCADREMENT DES PRESCRIPTIONS
Recommandation n° 7 : Sensibiliser et informer les professionnels soignants par une campagne permettant le dialogue, l'information et l'orientation des patients sur l'usage et les risques des opioïdes.
Recommandation n° 8 : Évaluer l'impact de l'obligation de recourir à des ordonnances sécurisées pour le tramadol et la codéine et, le cas échéant, envisager de soumettre l'ensemble des opioïdes à une obligation d'ordonnance sécurisée.
Recommandation n° 9 : Accélérer le calendrier de déploiement d'un dispositif de prescription entièrement numérique partout où cela est possible.
Recommandation n° 10 : Travailler sur le conditionnement des médicaments opioïdes pour réduire le nombre de comprimés par boîte lorsque le conditionnement ne correspond pas aux posologies recommandées.
Recommandation n° 11 : Intégrer un module obligatoire renforcé sur le traitement de la douleur et la lutte contre les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés.
Recommandation n° 12 : Développer la coopération entre les conseils des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et la Haute Autorité de santé pour favoriser la diffusion des référentiels de bonnes pratiques et des outils d'aide à la prescription et à la dispensation des opioïdes.
Recommandation n° 13 : Faire apparaître, dans les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation certifiés par la HAS, des messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes, le risque de dépendance et le risque de surdoses.
Recommandation n° 14 : Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur.
Recommandation n° 15 : Élaborer des recommandations spécifiques sur la rédaction des supports promotionnels des opioïdes par les laboratoires (constitution d'un cahier des charges, mention explicite des risques de dépendance et de comorbidité, et des indications de prescription en première et deuxième intention établies par les autorités sanitaires).
III. APPROFONDIR ET COMPLÉTER LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES
Recommandation n° 16 : Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitement par agonistes opioïdes et en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde.
Recommandation n° 17 : Former les services de police et de secours à l'utilisation de la naloxone et les équiper de kits de naloxone prêts à l'emploi.
Recommandation n° 18 : Améliorer la disponibilité des traitements par agonistes opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée.
Recommandation n° 19 : Engager une réflexion avec les autorités sanitaires sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme traitement par agonistes opioïdes.
Recommandation n° 20 : Consolider le réseau national d'addictovigilance en renforçant les moyens humains à la disposition des CEIP-A et développer des dispositifs d'analyse des drogues permettant d'évaluer précocement les évolutions des produits et leurs conséquences sur la santé humaine.
LISTE DES SIGLES
___________
|
A |
|
|
AINS |
Anti-inflammatoire non stéroïdien |
|
ALD |
Affection de longue durée |
|
AMM |
Autorisation de mise sur le marché |
|
ANSM |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
|
ARS |
Agence régionale de santé |
|
ASAFO |
Alerte sécurisée aux fausses ordonnances |
|
C |
|
|
Caarud |
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues |
|
CEIP-A |
Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance |
|
CESAN |
Commandement pour l'environnement et la santé |
|
CETD |
Centre d'évaluation et de traitement de la douleur |
|
Clud |
Comité de lutte contre la douleur |
|
Cnam |
Caisse nationale de l'assurance maladie |
|
Cnop |
Conseil national de l'ordre des pharmaciens |
|
CNRD |
Centre national ressources douleur |
|
CSAPA |
Centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie |
|
D |
|
|
DANTES |
Décennie D'ANTalgiques En France |
|
DDJ |
Dose définie journalière |
|
DES |
Diplôme d'études spécialisées |
|
DGS |
Direction générale de la santé |
|
DGOS |
Direction générale de l'offre de soins |
|
DHPC |
Direct healthcare professional communications |
|
DMP |
Dossier médical partagé |
|
DRAMES |
Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances |
|
Drees |
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques |
|
DSM |
Diagnostique et statistique des troubles mentaux |
|
DTA |
Décès toxiques par antalgiques |
|
E |
|
|
EMOA |
Étude sur les usages de médicaments opioïdes antalgiques |
|
ETP |
Équivalent temps plein |
|
EUDA |
European union drugs agency |
|
EVA |
Échelles visuelles analogiques |
|
EVS |
Échelles verbales simples |
|
F |
|
|
FDA |
Food and drug administration |
|
FFA |
Fédération française d'addictologie |
|
FST |
Formation spécialisée transversale |
|
H |
|
|
HAS |
Haute Autorité de santé |
|
HCSP |
Haut Conseil de la santé publique |
|
I |
|
|
IGAS |
Inspection générale des affaires sociales |
|
Inserm |
Institut national de la santé et de la recherche médicale |
|
ISRS |
Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine |
|
ISRSNa |
Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine-noradrénaline |
|
L |
|
|
LAD |
Logiciels d'aide à la dispensation |
|
LAP |
Logiciels d'aide à la prescription |
|
Leem |
Les entreprises du médicament |
|
M |
|
|
MIG |
Mission d'intérêt général |
|
Mildeca |
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |
|
MOOC |
Massive open online course |
|
N |
|
|
NOS |
Nouveaux opioïdes de synthèse |
|
NPS |
Nouveaux produits de synthèse |
|
O |
|
|
OFDT |
Observatoire français des drogues et des tendances addictives |
|
OFMA |
Observatoire français des médicaments antalgiques |
|
OMS |
Organisation mondiale de la santé |
|
ONDCP |
Office of national Drug Control Policy |
|
OPPIDUM |
Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse |
|
ORT |
Opioid Risk Tool |
|
OSIAP |
Ordonnances suspectes, Indicateur d'abus possible |
|
P |
|
|
POMI |
Prescription Opioid Misuse Index |
|
S |
|
|
SDC |
Structures spécialisées douleur chronique |
|
SFETD |
Société française d'évaluation et de traitement de la douleur |
|
Sintes |
Système d'identification national des toxiques et des substances |
|
T |
|
|
TAO |
Traitement par agonistes opioïdes |
|
TREND |
Tendances récentes et nouvelles drogues |
|
U |
|
|
UNODC |
United nations office on drugs and crime |
AVANT PROPOS
___________
La crise américaine du fentanyl a de façon spectaculaire mis en lumière les ravages que peut causer la consommation non maîtrisée de substances opioïdes. En 2022, plus de 110 000 décès imputables à ces substances ont été enregistrés aux États-Unis. Les autorités américaines ont réagi tardivement, en développant notamment des dispositifs de réduction des risques et d'accompagnement des usagers qui semblent porter leurs fruits, un reflux du nombre de morts étant constaté depuis 2023.
Les caractéristiques du système de santé américain, très libéral, ont indubitablement constitué un cadre propice au développement de cette crise dramatique, qu'il s'agisse de la faible régulation des conditions de prescription des médicaments, du soutien commercial et publicitaire dont bénéficie l'industrie des produits de santé, ou de l'inégalité d'accès des patients aux services de santé.
Si le système de santé français se distingue nettement du modèle qui prévaut aux États-Unis, la situation américaine constitue un avertissement auquel les pouvoirs publics devraient prêter une attention toute particulière. Depuis plusieurs années en effet, des signaux émanant du réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance français soulèvent des inquiétudes légitimes et justifient une vigilance accrue des autorités sanitaires. La consommation d'opioïdes forts, c'est-à-dire de médicaments classés comme stupéfiants, connaît ainsi une croissance significative depuis une vingtaine d'années. En parallèle, le nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation d'antalgiques opioïdes est en nette augmentation, de même que le nombre d'hospitalisations liées à la consommation de ces substances obtenues sur prescription médicale (+ 167 % entre 2000 et 2017). L'enjeu de formation des médecins à la prescription des médicaments opioïdes, central dans l'émergence de la crise aux États-Unis, se pose dans des termes similaires en France.
Prenant la mesure de cette situation, le Gouvernement a, en 2018, défini une feuille de route visant à « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes » pour la période 2019-2022. La survenue de la crise sanitaire de la covid-19 n'a toutefois pas permis le déploiement des actions qu'elle prévoyait dans des conditions adéquates. Sa mise en oeuvre s'en est trouvée interrompue, alors que les signaux d'alerte relatifs aux mésusages des opioïdes se sont plutôt confirmés au cours des dernières années.
Afin de préciser le cadre d'analyse de la présente mission d'information, il apparaît utile de préciser que le terme « opioïdes » désigne une grande diversité de substances dérivant du pavot somnifère, ou pavot à opium, réunies en une classe pharmacologique unique. La classe des opioïdes regroupe les dérivés naturels du pavot (opium, morphine, codéine)2(*), des composés semi-synthétiques (héroïne, hydromorphone, oxycodone, buprénorphine) et des composés purement synthétiques (fentanyl, méthadone, tramadol) fabriqués en laboratoire.
Les médicaments opioïdes sont principalement utilisés en tant qu'antalgiques, en anesthésie et, pour certains d'entre eux, en tant que traitement agoniste aux opioïdes dans une perspective de sevrage des usagers dépendants. En fonction de leurs caractéristiques pharmacologiques et des risques de mésusages, de troubles de l'usage et de dépendance auxquels ils sont associés, les médicaments opioïdes répondent à des indications thérapeutiques différentes et à des conditions de prescription plus ou moins restrictives. Ainsi, certains sont inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses3(*) ; d'autres sont classés parmi les stupéfiants (morphine, fentanyl, oxycodone...).
La Haute Autorité de santé (HAS) rappelle que les opioïdes ont « grandement contribué à l'amélioration de la prise en charge de la douleur »4(*). Dans un contexte de vieillissement de la population et de chronicisation de certaines pathologies, notamment des cancers, l'utilisation d'antalgiques opioïdes constitue une réponse à la demande de soulagement de la douleur des patients. Toutefois, en raison de leurs propriétés psychotropes, les opioïdes peuvent engendrer des troubles de l'usage plus ou moins importants, et placer les patients dans une situation de pharmacodépendance.
Face à ces risques, la sécurisation de l'usage des médicaments opioïdes est cruciale. Il faut pourtant prendre garde à ne pas restreindre excessivement l'accès des patients à ces médicaments, qui présentent un intérêt thérapeutique avéré pour traiter la douleur, notamment les douleurs d'intensité sévère ou réfractaires, par exemple d'origine cancéreuse. Aux États-Unis, la restriction des conditions de prescription par la Food and Drug Agency à partir de 2010, non anticipée et non accompagnée, avait contribué à l'aggravation de la crise.
La plupart des experts estiment qu'un scénario à l'américaine est improbable en France, en raison des règles en vigueur relatives à l'encadrement des pratiques de commercialisation et de prescription des médicaments. Pourtant, les évolutions constatées depuis le début des années 2000 en France et en Europe incitent à une grande vigilance. Elles s'inscrivent en effet dans un contexte globalisé qui ne permet pas d'isoler la situation française de celle de ses voisins européens ni de la dynamique plus globale de recomposition du marché des drogues opioïdes illégales (héroïne, nouveaux opioïdes de synthèse).
Si les travaux de la mission se sont concentrés sur le champ des médicaments opioïdes, les évolutions qui caractérisent le marché des opioïdes illégaux ont été analysées comme un élément de contexte pour comprendre et anticiper le développement de nouveaux usages des médicaments opioïdes. Ces évolutions doivent également être prises en compte pour définir une politique de réduction des risques adaptée, qui réponde aux enjeux de santé publique que soulèvent les mésusages des opioïdes en France.
Dans un premier temps, la mission s'est attachée à décrire le contexte dans lequel s'inscrit la hausse de la consommation de médicaments opioïdes en France, à comprendre les sous-jacents de cette évolution et à caractériser les risques de santé publique associés à une augmentation avérée des mésusages et des surdoses (I). Dans un second temps, la mission s'est appliquée à interroger les pratiques et le cadre de prescription des médicaments opioïdes en France, afin de prévenir les dérives associées à leur délivrance et à leur consommation. Cette analyse a conduit les rapporteures à formuler vingt recommandations pour prévenir un accroissement non maîtrisé de la consommation et des mésusages d'opioïdes en France (II).
I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES, MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS
A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES, SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR, MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES
1. Malgré des insuffisances persistantes, des progrès importants ont été accomplis dans la prise en charge de la douleur
a) Des progrès notables accomplis
En prévoyant que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur »5(*), la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades érige la prise en charge de la douleur en objectif thérapeutique à part entière. Dès la fin des années 1990, elle est affichée comme une priorité de santé publique, avec le premier plan national de lutte contre la douleur.
• Un plan de lutte contre la douleur est porté en 1998 par le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner. Cette feuille de route triennale (1998-2000) a permis d'identifier des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle6(*), et prévu de simplifier les modalités de prescription des antalgiques majeurs, dont les stupéfiants, en instaurant une prescription médicale sécurisée sur ordonnance. Il a également conduit à renforcer la formation des médecins par l'introduction d'un module obligatoire sur la lutte contre la douleur et les soins palliatifs dans le programme initial du deuxième cycle des études médicales.
• Deux autres plans de lutte contre la douleur lui ont succédé, couvrant les périodes 2002-2005 et 2006-2010, qui ont favorisé la structuration progressive de la prise en charge de la douleur en France, notamment de la douleur chronique dans le cadre de structures spécialisées.
Depuis 2023, 274 structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique (SDC) sont labellisées par les agences régionales de santé (ARS)7(*) - contre 245 en 20178(*) -, réparties en deux niveaux de recours et d'expertise :
- les consultations douleur, structures pluriprofessionnelles de proximité dans lesquelles exercent des médecins, des infirmiers et des psychologues ;
- les centres d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD), qui regroupent des médecins de plusieurs spécialités et peuvent comporter des lits d'hospitalisation.
Ces structures, accessibles sur avis préalable d'un médecin généraliste ou spécialiste, constituent « un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques »9(*).
Au sein des établissements de santé, la prise en charge de la douleur s'est également améliorée avec la création des comités de lutte contre la douleur (Clud), sous l'impulsion du deuxième plan national de lutte contre la douleur. Ces instances, souvent rattachées aux directions qualité des établissements, ont permis de construire et de promouvoir une véritable culture de prise en charge de la douleur, en rassemblant en leur sein des personnels médicaux et paramédicaux10(*). L'évaluation de la douleur du patient et la mise en place d'une stratégie de soulagement de celle-ci constituent aujourd'hui un indicateur de la qualité et de la sécurité des soins, mesuré par la HAS pour la certification des établissements de santé.
• Les plans successifs de lutte contre la douleur ont également contribué à améliorer l'accès aux médicaments antalgiques, notamment aux opioïdes.
L'élaboration de recommandations sur le bon usage des médicaments antalgiques, notamment pour la prise en charge de publics spécifiques comme les enfants ou les personnes âgées, et la diffusion de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ont permis d'accompagner les professionnels de santé dans leurs pratiques de prescription.
En 2015, près de 12 millions de Français (17,1 %) ont reçu un traitement antalgique opioïde sur prescription11(*), proportion globalement stable jusqu'à aujourd'hui.
• À noter enfin qu'un Centre national ressources douleur (CNRD) a été créé en 200212(*). Adossé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le CNRD réalise et met à la disposition du public et des professionnels de santé une veille documentaire sur toutes les questions relatives à la douleur. Il promeut également les droits des patients en matière de prise en charge de la douleur.
• Néanmoins, malgré les recommandations formulées par le haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport d'évaluation du troisième plan national de lutte contre la douleur13(*), le 4e plan national de lutte contre la douleur qui devait voir le jour n'a jamais été formalisé.
Le HCSP préconisait d'approfondir les avancées permises par les trois plans précédents et de sortir d'une prise en charge et d'une expertise trop hospitalo-centrées pour développer la structuration de la prise en charge de la douleur en ville. Il soulignait également la nécessité d'un pilotage dédié et volontariste, grâce à une volonté politique affirmée. La politique de santé publique est, de ce point de vue, demeurée au milieu du gué.
b) Des insuffisances persistantes
Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la douleur n'apparaît plus, aujourd'hui, comme une priorité de santé publique. Depuis 2016, la prévention de la douleur est pourtant inscrite parmi les objectifs permanents auxquels doit concourir la politique de santé publique14(*).
La part des Français souffrant de douleurs chroniques est estimée entre 20 %15(*) et 30 %16(*). Parmi eux, seuls 37 % se déclarent satisfaits de leur prise en charge17(*).
• En premier lieu, plusieurs difficultés relèvent de l'organisation et de l'accessibilité des structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique, en particulier :
- la longueur des délais de prise en charge - de 5 à 730 jours entre la demande de rendez-vous d'un patient et la première consultation, avec un délai médian de 90 jours -, qui excède les recommandations internationales18(*) ;
- l'inégale répartition des structures sur le territoire, renforçant les difficultés d'accès à une prise en charge adéquate pour certains patients ;
- l'insuffisance des ressources humaines disponibles, principalement médicales, au regard des besoins à couvrir.
Il en résulte une saturation des SDC, auxquelles n'accèdent que 3 % des patients souffrant de douleurs chroniques d'intensité modérée à sévère, et une situation dans laquelle 70 % de ces mêmes patients ne reçoivent pas de traitement approprié19(*).
Les SDC se trouvent aujourd'hui en situation de fragilité et la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD) indique qu'un tiers des structures seraient menacées de disparition dans les prochaines années, en raison d'un manque de moyens financiers et humains20(*).
Le modèle de financement des SDC a été révisé en 2023, dans l'objectif de mieux s'adapter aux besoins des territoires21(*). Le caractère récent de cette réforme ne permet pas d'en dresser un bilan consolidé. En tout état de cause, il apparaît que le montant de la dotation « mission d'intérêt général » (MIG) déléguée aux SDC a été augmentée ces dernières années, en lien avec l'augmentation du nombre de structures nouvellement labellisées en 2023. En 2024, 78,4 millions d'euros ont ainsi été alloués aux 274 SDC en première circulaire budgétaire, contre 60,8 millions d'euros en 2020 pour 212 SDC22(*).
• En deuxième lieu, le défaut de coordination des parcours des soins est un constat que partagent les professionnels de santé et les patients eux-mêmes.
Le Gouvernement reconnaît ainsi que « les acteurs de premier recours (médecins généralistes, pharmaciens...) sont parfois isolés et démunis face aux problématiques d'addiction d'autant que celles-ci peuvent être fréquemment associées à des vulnérabilités et comorbidités qui viennent complexifier la prise en charge »23(*).
Alors qu'une prise en charge adaptée de la douleur et, le cas échéant, des mésusages ou des situations de dépendance nécessiterait une coordination pluriprofessionnelle et une communication des acteurs généralistes de proximité - médecins traitants, infirmiers libéraux, pharmaciens d'officine - avec des structures de prise en charge spécialisées - CSAPA24(*) et Caarud25(*) (cf. infra) en ambulatoire, médecins addictologues, algologues et SDC en milieu hospitalier -, les parcours des patients demeurent largement chaotiques. Il en découle des ruptures de parcours ou des chevauchements de prescriptions qui favorisent les mésusages et l'addiction.
Les CSAPA et les Caarud, acteurs de la politique
de réduction
des risques liés à l'usage de substances
psychoactives
Les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) sont des établissements médico-sociaux dont l'action s'inscrit dans le cadre de la politique de réduction des risques et des dommages liés à l'usage de substances psychoactives.
Les CSAPA s'adressent aux personnes ayant développé une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction, avec ou sans substance (par exemple, le jeu excessif et pathologique). Ils assurent des missions d'accueil et d'information, d'évaluation, d'orientation ainsi que d'accompagnement à la réduction des risques et de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Les usagers peuvent y être suivis pour leur sevrage et y bénéficier de traitements médicamenteux adaptés26(*).
Les Caarud ont une mission plus spécifiquement orientée sur l'accompagnement des usagers à la réduction des risques et accueillent des publics plus précaires ou marginalisés. Il revient ainsi aux Caarud d'oeuvrer au soutien de ces usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et l'insertion ou la réinsertion professionnelle27(*).
Ces structures, gérées par des établissements de santé ou par des associations, constituent un maillon important de la chaîne de repérage, d'orientation et de prise en charge des usagers de substances opioïdes.
Selon les données de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), la France compte 385 CSAPA et 146 Caarud.
• En troisième lieu, la formation des professionnels de santé en matière de prise en charge de la douleur reste lacunaire. La réforme du troisième cycle des études médicales aurait conduit, selon la SFETD, à une diminution de moitié du temps de formation consacré à la douleur28(*).
À ce jour, la médecine de la douleur n'est pas reconnue comme une spécialité, aucun diplôme d'études spécialisées (DES) ne lui étant associé. Depuis 2017, elle peut être enseignée en tant que formation spécialisée transversale (FST) au cours du troisième cycle des études médicales29(*), mais les FST sont en principe optionnelles ; elles ont une durée d'une année. La médecine de la douleur a par ailleurs connu un processus d'universitarisation et dispose d'une sous-section du conseil national des universités30(*).
L'intégration des enseignements relatifs au repérage et à la prise en charge de la douleur demeure toutefois fragile dans le cursus de formation initiale des jeunes médecins et mériterait d'être renforcée.
Le même constat peut être dressé s'agissant de l'addictologie, qui n'est pas constituée en DES. L'addictologie peut être enseignée sous forme de FST, au cours du troisième cycle, notamment dans le cadre du DES d'hépato-gastro-entérologie, de médecine générale, de médecine interne et immunologie, de psychiatrie ou de santé publique.
2. Le médecin généraliste est le principal acteur de la prise en charge de la douleur
a) Une prévalence importante des douleurs chroniques parmi les Français
À titre liminaire, il convient de distinguer la douleur aiguë de la douleur chronique : ainsi, une douleur qui persiste au-delà de trois mois est reconnue comme une douleur chronique, alors que la douleur aiguë ne persiste pas et cède au traitement, le plus souvent dans les six semaines. Or, dans un cas et dans l'autre, les objectifs thérapeutiques poursuivis sont bien différents. Face à des douleurs chroniques, l'objectif sera d'éviter l'escalade thérapeutique, la difficulté étant que celles-ci peuvent générer des incapacités au quotidien.
• La douleur est la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'accueil des urgences.
Les douleurs chroniques, quelle que soit leur intensité, concerneraient 20 % à 30 % de la population adulte (cf. supra). Quant à la proportion de Français ayant bénéficié du remboursement d'un antalgique opioïde, elle apparaît relativement stable ces dernières années, aux alentours de 17 % de la population. Précisément, elle s'établissait à 16,9 % en 202431(*), soit 11 535 016 personnes, et à 17,1 % en 201532(*).
La Société française d'évaluation et de traitement de la douleur rappelle en outre que33(*) :
- la moitié des patients douloureux chroniques subissent une altération de leur qualité de vie ;
- 45 % de ces patients sont concernés par des arrêts de travail d'une durée cumulée d'au moins 4 mois par an ;
- enfin, environ 70 % souffrent de répercussions psycho-sociales telles que des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression ou des troubles cognitifs.
• La prescription d'antalgiques opioïdes s'inscrit en principe dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS), de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et des sociétés savantes, notamment de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD).
Les données disponibles montrent qu'aujourd'hui, la majorité des opioïdes faibles sont prescrits pour traiter une douleur aiguë, et, inversement, que la majorité des opioïdes forts le sont pour des douleurs chroniques, notamment dorsales et liées à de l'arthrose34(*).
b) Un rôle de primo-prescripteur largement dévolu au médecin généraliste
• Le médecin généraliste est aujourd'hui l'acteur central de la prise en charge de la douleur chronique en France.
En 2017, les médecins généralistes prescrivaient 86,3 % des opioïdes faibles et 88,7 % des opioïdes forts. Les dentistes, les rhumatologues et les orthopédistes ne représentent ainsi qu'une part marginale des prescriptions35(*).
Du fait de son rôle de médecin de proximité et de son accessibilité en premier recours, le médecin généraliste est amené à prendre en charge toutes les douleurs du quotidien, des céphalées aux lombalgies en passant par l'arthrose.
• Son rôle a d'ailleurs été renforcé par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui inscrit parmi les missions du médecin généraliste de premier recours l'administration et la coordination des soins visant à soulager la douleur. Cette loi prévoit également que le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur36(*).
Au-delà du rôle de primo-prescripteur qu'il assume, notamment en matière de douleur chronique, une réévaluation périodique de la douleur par les médecins généralistes apparaît essentielle pour anticiper les situations de mésusage et de dépendance que la consommation d'opioïdes peut occasionner. Elle permet d'organiser une stratégie de désescalade thérapeutique ainsi que l'arrêt progressif du traitement. Elle demeure toutefois insuffisamment pratiquée.
D'une part, cette nécessaire réévaluation médicale de la douleur à intervalles réguliers se heurte aux difficultés d'accès aux médecins, alors que 11 % des Français ne disposaient pas de médecin traitant en 202137(*) et qu'en 2022, 714 000 patients en affection de longue durée (ALD) n'en avaient toujours pas.
D'autre part, les médecins généralistes n'ont que peu le réflexe de la mettre en pratique, en raison des lacunes de leur formation en matière de prise en charge de la douleur et des addictions (cf. supra).
Principaux prescripteurs de médicaments opioïdes, par classe d'opioïdes
Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM
• Les douleurs chroniques peuvent se révéler extrêmement invalidantes au quotidien. Non seulement elles détériorent la qualité de vie, mais elles engendrent aussi des incapacités et des handicaps de diverses natures, relationnels, psychosociaux, professionnels ou scolaires. La SFETD rappelle qu'« un patient douloureux sur deux se sent fatigué en permanence et ne peut vivre normalement, éprouvant des difficultés à développer ou à maintenir une vie sociale normale »38(*). Dans ces conditions, le soulagement maximal de la douleur est bien souvent recherché par les médecins, sans qu'il ne soit toujours prêté attention aux troubles de l'usage et au risque de dépendance susceptibles de découler de la consommation de médicaments opioïdes.
L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) relève que « les médecins sont confrontés à la difficulté d'arrêter ces médicaments conjointement avec le patient, face au manque d'alternative pharmacologique pour soulager certaines douleurs, notamment chroniques »39(*). L'absence de repérage précoce des situations de mésusage voire de dépendance favorise évidemment l'impasse thérapeutique, dans laquelle la prolongation des prescriptions d'opioïdes, voire l'augmentation des doses, semble être le seul recours à la disposition des médecins généralistes.
• Par ailleurs, pour les usagers ayant développé une dépendance, les médecins généralistes sont amenés à prescrire une forme particulière d'opioïdes40(*), que sont les traitements par agonistes opioïdes (TAO)41(*). Ils en sont les principaux prescripteurs, étant à l'origine de 90,4 % des prescriptions en ville en 202342(*).
3. Le risque de banalisation de la consommation d'opioïdes ne doit pas être négligé
a) Une consommation d'opioïdes forts en hausse, parallèle à une diminution de celle des opioïdes faibles
Des évolutions significatives sont constatées concernant les ventes et les consommations de médicaments opioïdes. Il faut toutefois replacer ces évolutions dans le panorama plus large de la consommation des médicaments antalgiques, incluant des non-opioïdes.
• Ainsi, les médicaments antalgiques consommés en France sont très majoritairement non opioïdes43(*) : ceux-ci représentent 78 % des antalgiques consommés contre 22 % pour les antalgiques opioïdes, dont 20 % d'opioïdes faibles et 2 % d'opioïdes forts44(*).
• Entre 2010 et 2023, on observe une baisse marquée des ventes de médicaments opioïdes de palier 2 (- 35 %) et une forte augmentation parallèle des ventes d'opioïdes de palier 3 (+ 59 %), en ville et à l'hôpital. Cette augmentation est principalement portée par la progression de l'usage de la morphine (+ 38 % de vente en ville et + 15 % à l'hôpital) et, de façon spectaculaire, par celle de l'oxycodone (+ 242 % de vente en ville et + 70 % à l'hôpital)45(*).
Néanmoins, la consommation d'opioïdes forts reste très inférieure à celle des opioïdes faibles : elle s'élevait ainsi à 2,9 doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants par jour46(*) contre 24,3 DDJ pour les antalgiques opioïdes faibles, soit environ 8,5 fois moins.
Au global, la consommation d'antalgiques non opioïdes a progressé au détriment des antalgiques opioïdes faibles, tandis que celle des opioïdes forts est en hausse en valeur absolue et en valeur relative.
Évolution de la consommation des antalgiques opioïdes et non opioïdes en France entre 2006 et 2017
Source : ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019
Antalgiques opioïdes de paliers 2 et 3 les plus vendus en officines en 2023
*La catégorie « Autres » inclut les substances suivantes : dihydrocodéine, hydromorphone, buprénorphine, nalbuphine, péthidine.
Les opioïdes faibles sont présentés en bleu ; les opioïdes forts sont présentés en vert.
Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM
Antalgiques opioïdes de paliers 2 et 3 les plus vendus aux hôpitaux en 2023
Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM
En agrégeant les données de consommation en ville et à l'hôpital, le tramadol est la première substance opioïde consommée, suivie de la codéine. On observe néanmoins une diminution du nombre de Français traités par tramadol et codéine (opioïdes de palier 2), tandis que le nombre de patients traités par des opioïdes de palier 3, en particulier la morphine et l'oxycodone, classés comme stupéfiants, augmente.
Principes de classification des substances opioïdes
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé en 1986 une classification des opioïdes, utilisée encore aujourd'hui, qui identifie trois niveaux de substances en fonction de leur puissance pharmacologique et de l'intensité de la douleur à traiter : ainsi, le premier niveau, ou palier 1, correspond aux antalgiques non opioïdes, tandis que les paliers 2 et 3 correspondent aux antalgiques opioïdes respectivement faibles et forts.
Selon cette classification, les opioïdes de palier 2 « sont indiqués pour les douleurs d'intensité modérée à sévère, que ce soit pour la prise en charge de la douleur liée au cancer, mais aussi, lorsqu'ils sont recommandés, pour le traitement de certaines douleurs aiguës ou chroniques non soulagées par la prise de paracétamol ou d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) tel que l'ibuprofène, auquel ils sont fréquemment associés » ; les opioïdes de palier 3 sont quant à eux « indiqués pour la prise en charge de douleurs sévères ou résistantes aux antalgiques de palier inférieur, et en particulier celles liées au cancer »47(*).
Utilisée à l'origine pour fixer un cadre de prescription pour le traitement des douleurs cancéreuses, cette classification est largement employée pour caractériser les substances opioïdes prescrites pour tous types de douleurs.
Présentation des médicaments opioïdes selon la classification de l'OMS
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
Si cette classification demeure une référence - la HAS la mentionne dans son guide sur le bon usage des médicaments opioïdes de 2022 - elle est néanmoins remise en cause depuis plusieurs années en ce qu'elle ne reflète ni l'efficacité d'un traitement ni les effets indésirables associés à la consommation des substances opioïdes, qui dépendent de la combinaison de facteurs multiples, notamment de la dose prescrite et de la durée de prescription, mais aussi de caractéristiques propres aux patients.
La classification de Lussier-Beaulieu48(*) définie en 2010, se fonde sur le mécanisme d'action antalgique des substances opioïdes, plutôt que sur l'intensité des douleurs ressenties par le patient. Cette approche limite le risque de banalisation de l'usage des opioïdes dits faibles et s'écarte du principe de prescription graduée en fonction de l'intensité de la douleur.
b) Des indicateurs alarmants relatifs au nombre de décès et d'hospitalisations liés aux surdoses d'opioïdes
La consommation de substances opioïdes peut s'accompagner de troubles de l'usage, d'abus, d'un risque de dépendance et de surdose engendrant des complications graves jusqu'au décès. Les différentes enquêtes du réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance permettent de suivre l'évolution de ces indicateurs. Les données préoccupantes dont elles font état nécessitent de prendre toute la mesure d'un risque tenant à la banalisation des prescriptions et des usages des médicaments opioïdes.
• La consommation d'opioïdes forts est davantage corrélée à un usage chronique des antalgiques opioïdes (14,3 % en 2015) que celle des opioïdes faibles (6,6 % en 2015)49(*).
Ce constat peut s'expliquer par la nature des douleurs du patient en relation avec la pathologie dont il souffre, mais il est aussi le marqueur d'un risque accru de trouble de l'usage et de dépendance.
• Au-delà de ce constat général, l'évolution du nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation d'antalgiques opioïdes, en nette augmentation, justifie une vigilance accrue des autorités sanitaires. Il a plus que doublé entre 2006 et 201550(*).
Parmi les usagers déclarant un usage problématique d'analgésiques opioïdes pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie, la morphine est la substance la plus représentée, suivie du tramadol et de l'oxycodone, ces deux derniers produits connaissant une nette augmentation de leurs usages problématiques depuis 201851(*).
En 2023, plus de la moitié des consommateurs d'oxycodone se déclarent dépendants, et le nombre d'usagers déclarant l'oxycodone comme produit ayant entraîné une dépendance a doublé - passant de 13 à 24 - entre 2022 et 202352(*).
• En outre, entre 2000 et 2017, le nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale a augmenté de 167 %, passant de 15 à 40 hospitalisations pour un million d'habitants53(*). En 2018, on dénombrait environ 16 000 hospitalisations à la suite d'un passage aux urgences en lien avec la consommation d'opioïdes, soit une hausse de 10 % depuis 201054(*).
Outils de surveillance des consommations et des
usages
de médicaments opioïdes en France
En France, les autorités sanitaires mobilisent plusieurs dispositifs de surveillance pharmaco-épidémiologique, pilotés par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) sous l'autorité de l'ANSM.
Les principaux outils de surveillance mobilisés sont les suivants :
• OPPIDUM (Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse) : cette enquête conduite chaque année par le CEIP-A de Marseille vise à recueillir des informations sur les substances consommées par les usagers pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques - CSAPA et Caarud - ainsi que sur leurs modes de consommation.
• OSIAP (Ordonnances suspectes, Indicateur d'abus possible) : deux fois par an, sur une période de quatre semaines, le CEIP-A de Toulouse interroge un réseau de pharmacies d'officine dites sentinelles qui signalent des ordonnances suspectées d'avoir été falsifiées ou volées. Les pharmacies peuvent par ailleurs, tout au long de l'année, signaler des ordonnances jugées suspectes.
• DRAMES (Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances) : cette enquête conduite par le CEIP-A de Grenoble permet de recenser les cas de décès liés à l'usage abusif de substances psychoactives, d'identifier les substances concernées et d'estimer le nombre de décès survenus dans de telles situations chaque année en France. Les décès liés aux TAO y sont comptabilisés.
• DTA (Décès Toxiques par Antalgiques) : cette enquête prospective annuelle vise à recenser les cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques ainsi que les médicaments impliqués, à évaluer leur dangerosité et à estimer l'évolution du nombre de décès. Elle est également conduite par le CEIP-A de Grenoble.
• DANTE (« Décennie D'ANTalgiques En France ») : il s'agit d'une étude observationnelle ponctuelle, coordonnée par le CEIP-A de Bordeaux, qui établit un état des lieux de la consommation des antalgiques en France entre 2006 et 2015, dont les pratiques d'automédication, et qui analyse les mésusages d'antalgiques. L'étude se fonde notamment sur les données de vente et de délivrance des médicaments.
Par ailleurs, le réseau Sintes (Système d'identification national des toxiques et des substances) participe également de l'efficacité du dispositif de surveillance et d'alerte sanitaire national. Créé en 1999 par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) au sein d'un dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) plus large, Sintes repose sur un partenariat avec 17 structures locales, implantées en métropole et en outre-mer, un réseau de 715 collecteurs travaillant au plus proches des usagers, dans des structures d'accueil, de prévention et de soins, et une collaboration avec 11 laboratoires accrédités pour analyser les compositions de produits psychoactifs sur le marché.
• Enfin, les décès sont également en augmentation. Selon l'enquête DTA (cf. supra) qui recense les décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, leur nombre a crû de 20 % entre 2018 et 2022, passant de 118 à 142 décès.
De façon constante depuis sa création en 2013, l'enquête identifie le tramadol comme premier médicament antalgique impliqué dans les décès, hors usages abusifs connus chez des sujets ayant des antécédents de dépendance ; en 2022, il est à l'origine de 35 % des décès liés à des mésusages. Par ordre d'importance, les autres antalgiques opioïdes impliqués dans le plus grand nombre de décès sont la morphine (25 % des décès en 2022), l'oxycodone (20 % des décès en 2022) et la codéine (18 % des décès en 2022)55(*).
• Quant aux décès survenant chez des sujets avec des antécédents de dépendance ou d'abus56(*), les traitements par agonistes opioïdes sont les principaux produits impliqués. Ils sont la cause de 300 décès, contre 50 décès pour les médicaments opioïdes non TAO.
Au total, les médicaments opioïdes et les TAO représentent 47 % des décès recensés chez les sujets à risques, plus de la moitié restant causée par des substances illicites (385 décès en 2022)57(*).
Hors substances illicites, l'augmentation totale des décès constatés chez les sujets caractérisés par une situation de dépendance ou une consommation abusive est exclusivement imputable aux TAO (+ 51,5 % entre 2018 et 2022) et notamment à la méthadone - à l'origine de 163 décès en 2018 et de 255 décès en 2022 (+ 56,4 %) -, qui fait l'objet d'importants mésusages.
Selon l'OFDT, le nombre de décès par surdose serait même sous-estimé d'environ 30 %, en raison de la non-exhaustivité des recensements effectués, qui reposent sur les signalements aux CEIP-A58(*).
• Ces indicateurs justifient une préoccupation forte et une vigilance accrue concernant les usages de divers opioïdes, notamment :
- du tramadol, opioïde faible fortement représenté dans les notifications d'usage problématique du réseau d'addictovigilance, premier impliqué dans les décès de l'enquête Décès Toxiques par Antalgiques (DTA) et parmi les cinq produits en tête de classement dans l'enquête OSIAP ;
- de l'oxycodone, opioïde fort particulièrement addictogène qui connaît une importante augmentation de sa consommation, certainement liée à l'extension de ses indications aux douleurs non cancéreuses.
« Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes : feuille de route 2019-2022 » : le plan d'action ministériel au point mort
Face aux signaux inquiétants relevés par les dispositifs nationaux d'addictovigilance et de pharmacovigilance - hausse de la consommation de médicaments opioïdes, augmentation des surdoses et des hospitalisations, apparition de nouveaux produits de synthèse -, le ministère de la santé a formalisé un plan d'action pour lutter contre les mésusages et les surdoses d'opioïdes, décliné en cinq axes :
- améliorer les pratiques professionnelles ;
- assurer une diffusion large de la naloxone prête à l'emploi ;
- impliquer les usagers et leur entourage en les informant sur les surdoses d'opioïdes et l'utilisation de naloxone ;
- mettre en réseau l'ensemble des acteurs au niveau territorial afin notamment de diffuser la naloxone ;
- renforcer le système de vigilance, d'alerte et de réponse.
La mise en oeuvre de cette feuille de route s'est heurtée à la survenue de la crise de la covid-19. La direction générale de la santé (DGS) établit actuellement un bilan des actions ayant pu être menées jusqu'à aujourd'hui : 46 % seraient considérées comme achevées, 24 % en cours de réalisation et 30 % n'auraient pas été enclenchées.
Parmi les actions effectivement mises en oeuvre, peut être citée la formalisation de recommandations de bonnes pratiques par la HAS sur le bon usage des médicaments opioïdes, en 2022.
En 2025, plus de la moitié des actions demeure pourtant inachevée ou non engagée, tandis que les indicateurs de consommation et de mésusages des médicaments opioïdes justifieraient une mise en application urgente.
Au-delà de cette feuille de route centrée sur la prévention des surdoses d'opioïdes, un nouveau plan national « douleur » permettrait de resituer la problématique des mésusages d'opioïdes dans une perspective plus large et d'apporter des réponses globales en matière d'offre de soins, de la prévention à la prise en charge.
B. UNE AUGMENTATION PRÉOCCUPANTE DES MÉSUSAGES ET DES TROUBLES LIÉS À L'USAGE
1. La progression des mésusages et des usages détournés
La trajectoire de consommation des opioïdes - médicamenteux ou non - s'accompagne dans notre pays d'une progression des mésusages et usages détournés, qui a fait consensus lors des auditions menées par la mission.
Distinctions conceptuelles : le mésusage, l'usage détourné, le trouble lié à l'usage
Le mésusage désigne l'usage non conforme aux termes de l'autorisation (AMM59(*) notamment), de l'enregistrement ou du cadre de prescription compassionnelle ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques [...]60(*) dans un but médical et inapproprié. Le mésusage fait donc référence à l'utilisation d'un médicament hors des cadres de prescription et d'administration prévus, pour une visée thérapeutique.
L'usage détourné désigne la prescription, la consommation ou le commerce d'un médicament pour obtenir des effets psychoactifs, ainsi que toute autre utilisation à des fins frauduleuses ou lucratives.
Le trouble lié à l'usage est un terme apparu dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 5 (DSM-5) afin de désigner médicalement un mode pathologique de comportements liés à la consommation d'une substance. Ce terme tient compte de la continuité des situations vécues pour un processus pathologique identique, regroupant ainsi d'anciennes catégories d'abus et de dépendance.
Source : Direction générale de la santé
a) Les enquêtes d'addictovigilance démontrent une augmentation des mésusages
Depuis plus de dix ans, le mésusage des opioïdes tend à se répandre sur le territoire national, une tendance jugée « préoccupante » par le Groupe Santé Addictions61(*).
Les mésusages peuvent être volontaires, mais aussi subis lorsqu'ils sont liés à une méconnaissance du patient ou des professionnels de santé des conditions permettant un bon usage des thérapeutiques concernées. Ils peuvent découler d'un mauvais suivi des préconisations médicales par les patients, mais aussi de prescriptions ou dispensations inappropriées par les professionnels de santé.
Il peut prendre différentes formes : les plus fréquentes concernent une consommation non encadrée médicalement ou une automédication, le chevauchement de traitements avec d'autres opioïdes ou d'autres médicaments dépresseurs du système nerveux central comme les benzodiazépines, ou encore le non-respect de la posologie ou des précautions d'emploi.
Certains publics sont particulièrement vulnérables face aux mésusages : le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop) cite notamment les patients ayant des « antécédents d'addiction » ou de « troubles psychiatriques », tandis que le Conseil national de l'ordre des médecins y adjoint « les personnes âgées, [...] en situation de précarité ou dans le cadre d'une polymédication ».
S'il est difficile de quantifier précisément l'ampleur de la prévalence des mésusages sur l'ensemble des opioïdes à l'échelle nationale, les pouvoirs publics ont mené des études ciblées sur les principaux opioïdes. La Haute Autorité de santé indique ainsi que « 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol présentaient un comportement de mésusage de leur traitement, dont respectivement 14 % et 24 % pour une finalité autre qu'un effet antalgique (anxiété, sommeil, stimulant...) ».
Pour caractériser l'évolution des mésusages, il est utile d'observer les tendances des résultats de l'enquête Oppidum62(*). Menée par les CEIP-A sur la base d'une collecte, chaque mois d'octobre, des remontées de près de 30063(*) structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques, cette étude recense les mésusages et usages détournés constatés. Sans avoir de portée exhaustive, cette enquête donne une idée des tendances à l'oeuvre, notamment pour les comportements associés à une pharmacodépendance sévère.
Comme chaque année, l'édition 2023 de cette enquête fait apparaître un mésusage particulièrement prégnant de la morphine, principalement lié aux détournements de la voie d'administration des sulfates de morphine vers une injection intraveineuse : il s'agit là, bien souvent, d'usages détournés plutôt que de mésusages.
Sur une plus longue période, certains médicaments connaissent une hausse préoccupante du nombre de mésusages signalés : tel est, notamment, le cas du tramadol dont le nombre de signalements a doublé depuis 2017, ou de l'oxycodone. La codéine connaît, au contraire, une tendance baissière depuis 2017, date de l'instauration d'une prescription médicale obligatoire64(*).
Évolution des signalements de
médicaments opioïdes
dans Oppidum depuis 2004
Source : CEIP-A
L'évolution globalement défavorable des mésusages peut notamment être mise en lien avec la raréfaction de l'offre de soins sur les territoires, qui laisse moins de temps aux professionnels de santé pour dispenser les informations nécessaires à l'éclairage du patient et pour évaluer précisément chaque situation.
b) Des usages détournés de plus en plus diversifiés
Au-delà des mésusages observés, les médicaments opioïdes font l'objet de nombreux usages détournés afin d'obtenir des effets psychoactifs. Il s'agit bien, dans tous les cas, d'utilisations détournées de médicaments autorisés à être commercialisés, pour en obtenir des effets récréatifs.
À la demande des rapporteures, la direction générale de la santé (DGS) a énuméré certains des principaux usages détournés recensés :
« - recherche d'effets euphoriques ;
- augmentation des doses pour renforcer ou prolonger les effets ;
- modification des voies d'administration (ex : injection de médicaments destinés à une prise orale) ;
- dépendance et évitement du sevrage, en raison du développement d'une tolérance. »
Les usages détournés suivis dans le cadre de la politique française d'addictovigilance et par les acteurs de terrain se sont récemment diversifiés.
• Apparu dans les années 1960 au Texas, le purple drank (boisson violette), aussi appelé « lean », est une boisson à base de sirop codéiné mélangé à un soda. Afin de renforcer les effets psychotropes de la mixture et de compenser certains effets secondaires de la codéine, des antihistaminiques comme la prométhazine y sont souvent utilisés comme adjuvants.
La consommation de purple drank induit un état d'euphorie et de somnolence liée aux effets sédatifs de ses composantes. Elle expose ses consommateurs à des risques d'intoxication et, lorsque la dose de codéine ingérée est excessive, à une détresse respiratoire pouvant conduire à la mort.
Popularisée dans les textes de certains chanteurs américains65(*) puis français66(*), la lean a connu un certain essor en France, notamment chez les jeunes. Elle est parfois associée à de l'alcool, du cannabis ou à d'autres psychoactifs, ce qui ne fait que renforcer les risques associés à la substance.
Selon l'association de réductions des risques Safe, l'usage à des fins récréatives a toutefois « très fortement décliné après la restriction des modalités de délivrance en juillet 2017 »67(*).
• Le tramadol fait également l'objet d'usages détournés, soit pour ses propriétés propres (sédatif, recherche d'euphorie), soit « pour réguler les effets jugés trop intenses de psychostimulants comme la cocaïne »68(*).
• Particulièrement à Paris et en Île-de-France, on constate une progression des injections de sulfates de morphine (Skénan) « majoritairement auprès d'usagers en situation de précarité »69(*). Il s'agit là d'un dévoiement du mode d'administration du médicament afin d'en favoriser les effets psychoactifs, celui-ci étant, en principe, commercialisé sous la forme de gélules. Ce phénomène touche notamment des patients utilisant également les sulfates de morphine pour des raisons thérapeutiques.
• Enfin, l'association Safe mentionne « les pratiques d'injection de fentanyl, à partir des patchs ». Celles-ci « restent toujours très marginales et circonscrites à des personnes, principalement d'origine géorgienne en situation de grande précarité ».
2. Des prescriptions parfois inadaptées au niveau de risque associé à la consommation de médicaments opioïdes
La prescription d'opioïdes s'est banalisée comme moyen de répondre à la douleur - rappelons que, selon le rapport Charges et Produits 2025 de la Cnam, environ 12,5 millions d'assurés se sont vu rembourser des médicaments opioïdes en 2024.
Si la consommation de médicaments opioïdes, associée à des risques substantiels de dépendance et d'autres effets secondaires, est si fréquente, c'est notamment faute d'application suffisante des recommandations de bonnes pratiques émises par la Haute Autorité de santé. Certaines prescriptions d'opioïdes apparaissent donc inadaptées.
a) Des effets secondaires importants, incluant la dépendance mais ne s'y limitant pas
L'usage des opioïdes, bien qu'essentiel dans la prise en charge de certaines douleurs aiguës ou chroniques sévères, s'accompagne d'une série d'effets secondaires qui peuvent compromettre la qualité de vie des patients, limiter l'efficacité thérapeutique, voire mettre en jeu leur pronostic vital en cas de surdose. Cette pluralité d'effets souligne la complexité de la gestion des opioïdes, tant pour les prescripteurs que pour les patients, et appelle à une vigilance accrue dans leur usage.
• La consommation d'opioïdes est associée à un risque de pharmacodépendance élevé lié à l'activation des récepteurs mu, lié tant au médicament et à sa posologie qu'à des facteurs individuels.
La définition de la pharmacodépendance
Le code de la santé publique définit la pharmacodépendance comme « l'ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique »70(*).
La consommation au long cours de médicaments opioïdes s'accompagne en effet du développement d'une tolérance, c'est-à-dire une diminution de la réponse analgésique pour une posologie donnée. Cela rend nécessaire d'accroître les posologies pour retrouver l'effet escompté, et expose les patients à un risque de dépendance physique.
La HAS indique que « la dépendance physique se traduit cliniquement par la nécessité de maintenir les prises d'opioïdes pour éviter l'apparition d'un syndrome de sevrage désagréable. Ce dernier est caractérisé par l'association de symptômes dits « de manque » (bâillements avec rhinorrhées et larmoiements, arthralgies et myalgies diffuses accompagnées de crampes musculaires, désordres digestifs, frissons et tremblement des extrémités, hyperhidrose, irritabilité accompagnée d'agitation, de troubles anxieux et d'insomnie). ».
Cette dépendance physique s'accompagne fréquemment d'une dépendance psychologique, liée à l'envie d'éviter les symptômes de sevrage : le patient peut alors rencontrer « des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance » parfois liées à un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance psychoactive (« craving »), voire se renfermer sur lui-même et délaisser peu à peu toute autre source de plaisir et d'intérêt.
Comme l'a montré l'exemple américain71(*), la sous-estimation ou la méconnaissance des risques de pharmacodépendance associés à la consommation à grande échelle de médicament opioïdes peut engendrer un déport de la consommation vers le marché illicite, lorsque la quantité d'opioïdes prescrits ne suffit plus à répondre aux cravings du patient.
Selon une étude menée par l'OFMA et l'institut Analgesia72(*), respectivement 36 % et 47 % des usagers de codéine et de tramadol indiquaient avoir des difficultés à arrêter ou diminuer leur traitement.
Plusieurs facteurs influencent la survenue de la dépendance : la dose prescrite, la durée du traitement, les antécédents personnels ou familiaux de troubles addictifs, ainsi que les comorbidités psychiatriques comme la dépression ou l'anxiété. Le risque de dépendance n'est pas uniquement une question de dosage, mais aussi de vulnérabilité individuelle, ce qui complique la mise en place de règles strictes applicables à tous.
La prégnance des critères associés à la dépendance détermine l'existence d'un trouble de l'usage chez le patient.
• Au-delà du risque de dépendance, la consommation de médicaments opioïdes peut entraîner de nombreux effets secondaires propres à cette classe thérapeutique en ce qu'ils résultent tous « d'une activation des récepteurs opioïdes »73(*), selon l'ANSM. Ces effets indésirables, listés par l'ANSM, sont de nature digestive, neurologique, cardiovasculaire et respiratoire :
- des troubles digestifs : la constipation, découlant de l'activation des récepteurs mu impliqués dans le transit, est le principal effet secondaire, mais des nausées ou des vomissements peuvent également survenir ;
- des troubles neurologiques : somnolence, sédation, confusion, tremblements, clonies, risque de convulsions ;
- des troubles cardiovasculaires : hypotension orthostatique, bradycardie ;
- un risque de dépression respiratoire pouvant mettre en jeu le pronostic vital. En effet, comme l'indique la HAS, « la désensibilisation des centres respiratoires à l'hypercapnie et l'abolition du réflexe de toux liée aux opioïdes peuvent conduire à une réduction de la fréquence ventilatoire, favorisant le risque de dépression respiratoire »74(*).
S'ajoutent à cette liste des effets secondaires spécifiques pour les traitements chroniques : l'ANSM évoque « des effets endocriniens (hypogonadisme), des troubles cognitifs et thymiques, des troubles de la libido, ainsi qu'une hyper algésie induite par les opioïdes »75(*). Ces effets secondaires sont particulièrement peu connus des patients et des prescripteurs, malgré leurs retentissements sur la qualité de vie.
Bien que répandue, la consommation de médicaments opioïdes s'accompagne donc de risques certains pour la santé des patients, d'autant que leurs effets secondaires s'avèrent particulièrement fréquents. L'étude DANTE76(*), conduite en 2019 par l'ANSM, fait ainsi apparaître que plus du tiers des patients interrogés subissaient des effets indésirables liés à leur consommation de codéine.
Compte tenu de cette multiplicité d'effets secondaires et de leurs conséquences, la prescription des opioïdes doit être réalisée avec rigueur et dans un cadre strictement défini. Il est essentiel d'évaluer régulièrement les bénéfices et les risques, en adoptant une démarche proactive de prévention des effets indésirables.
b) Des risques liés aux interactions médicamenteuses peu pris en compte
Aux risques intrinsèques aux médicaments opioïdes s'ajoutent des risques d'interactions avec d'autres médicaments.
Interrogée par les rapporteures, l'ANSM fait ainsi valoir que des interactions médicamenteuses existent entre les opioïdes et :
« - les médicaments dépresseurs du système nerveux central (dont les benzodiazépines et apparentés) et les gabapentinoïdes (prégabaline et gabapentine), qui augmentent le risque de dépression respiratoire ;
- des neuroleptiques, hydroxyzine, amiodarone, escitalopram pour le tramadol et l'oxycodone, associations médicamenteuses qui peuvent majorer les troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointe, souvent lié à un allongement de l'intervalle QT.
- avec les triptans et les antidépresseurs de type ISRS et ISRSNa, concernant le tramadol, médicaments qui majorent son effet sérotoninergique.
- les opioïdes eux-mêmes. On peut noter que dans la majorité des cas, l'association de médicaments antalgiques opioïdes n'est pas recommandée, sauf particularités »77(*).
La prescription concomitante de ces traitements et d'antalgiques opioïdes doit donc faire l'objet d'une attention particulière et d'un suivi renforcé.
c) Des prescriptions hors indications fréquentes, malgré les recommandations de la HAS
Malgré l'ensemble des risques associés à la consommation d'opioïdes, la fréquence des prescriptions hors indications est préoccupante. De telles prescriptions, contraires au bon usage, soulèvent des questions d'efficacité clinique et de sécurité sanitaire.
Prenant acte des alternatives thérapeutiques et des risques induits, la HAS a fait paraître, en 2022, des recommandations sur le bon usage des opioïdes, pour la douleur aiguë et pour la douleur chronique.
• Pour la douleur aiguë, la HAS ne recommande la prescription d'opioïdes en première intention que pour certaines douleurs sévères78(*), en l'absence de traitement étiologique permettant un soulagement rapide de la douleur.
Lorsqu'un antalgique opioïde est indiqué, la HAS recommande « d'utiliser la dose efficace la plus faible possible pendant la durée la plus courte possible et d'utiliser des formulations d'opioïdes à libération immédiate en évitant de commencer à utiliser des formulations à longue durée d'action ou à libération prolongée (y compris le fentanyl transdermique) pour le traitement de la douleur aiguë »79(*). La voie d'administration orale doit être privilégiée, lorsqu'elle existe.
Les opioïdes ne doivent, en principe, pas être prescrits en première intention pour certaines douleurs, « en raison de leur balance bénéfices/risques défavorable »80(*) :
- les douleurs dentaires ;
- les lombalgies aiguës ;
- les traumatismes simples du rachis et distaux des membres ;
- les coliques néphrétiques.
Les antalgiques opioïdes ne sont par ailleurs en aucun cas recommandés pour le traitement des céphalées et des migraines, même en deuxième intention, « quelle que soit l'intensité de la douleur »81(*).
Recommandations de
la HAS sur la prise en charge d'une douleur aiguë
par traitement
antalgique opioïde
Source : HAS
• Pour la douleur chronique, la Haute Autorité de santé préconise, avant toute prescription d'opioïdes, une évaluation préalable des risques de troubles de l'usage. Si ceux-ci sont forts, ou si le patient présente un trouble psychique non suivi, une alternative thérapeutique, médicamenteuse ou non, doit être privilégiée dans l'attente d'une consultation spécialisée auprès d'un médecin de la douleur, d'un psychiatre ou d'un addictologue.
Afin de limiter les risques de dépendance induits en détectant précocement les signes de troubles de l'usage, la HAS recommande, dès la prescription, la fixation d'objectifs thérapeutiques, puis des réévaluations régulières.
La HAS indique, en revanche, que « les médicaments antalgiques opioïdes sont indiqués dans la douleur liée au cancer ».
Recommandations de la HAS sur la prise en charge
d'une douleur chronique
non cancéreuse par traitement antalgique
opioïde
Source : HAS
• Toutefois, il ressort des auditions conduites par les rapporteures que ces recommandations sont, en pratique, peu suivies par les prescripteurs.
Ainsi, une enquête des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A), citée par l'ANSM, indique que les motifs d'achats de codéine déclarés par les patients sont les céphalées (46,5 %), les dorsalgies (21,2 %) et les douleurs dentaires (11,7 %).
Dans près de 80 % des cas suivis par l'enquête, la codéine a donc été prescrite pour des types de douleurs ne faisant pas l'objet d'une recommandation d'usage en première intention. Pour le cas des céphalées qui constitue quasiment la moitié des usages déclarés lors de l'enquête, la prescription d'opioïdes n'est même jamais recommandée.
L'ANSM constate ainsi que « le non-respect de la seconde intention fait partie des types de mésusage les plus souvent remontés par les enquêtes d'addictovigilance »82(*).
Pour la douleur chronique, le constat n'est guère plus reluisant. Certains médicaments, comme le fentanyl, font l'objet d'un mésusage presque généralisé : selon les chiffres de la DGS, « 51 % des prescriptions de fentanyl à action rapide sont hors autorisation de mise sur le marché (AMM) »83(*).
Le suivi des prescriptions en cas de douleur chronique, préconisé par la HAS, n'est pas systématiquement assuré : la docteure Evelyne Renault-Tessier dénonce ainsi des « prescriptions médicales renouvelées sans réévaluation et sans stratégie de déprescription », certainement renforcées par le nomadisme médical qu'elle juge être un « grand pourvoyeur de mésusages »84(*).
Une fois posé le constat de la prégnance des prescriptions d'opioïdes inadaptées, il convient d'en rechercher les causes.
• D'une part, les auditions ont fait apparaître une forme d'« opioïdo-centrisme » dans le traitement de la douleur par les professionnels de santé.
La prescription d'opioïdes pour soulager la douleur semble encore être un réflexe chez certains professionnels. Cette logique, souvent motivée par le souci légitime de soulager rapidement la souffrance, tend toutefois à réduire la complexité de la douleur à une simple cible pharmacologique, occultant ses dimensions psychologiques, sociales et fonctionnelles.
L'étude précitée des CEIP-A fait ainsi apparaître que 39,2 % des patients interrogés ne s'étaient vu prescrire aucun autre antalgique avant la codéine.
Cette tendance à la prescription systématique d'opioïdes est renforcée par une méconnaissance, chez certains professionnels, des risques engendrés par ces médicaments85(*). Une étude qualitative menée par l'OFDT86(*) démontre ainsi qu'« une partie non négligeable des médecins peut minimiser la gravité des problèmes avec les opioïdes (notamment la dépendance) et traiter de manière exclusive le problème de la douleur ».
Le recours quasi-systématique à ces substances se fait parfois au détriment d'une approche multimodale et individualisée de la douleur. Si les opioïdes constituent bien sûr une part déterminante de la réponse médicale à apporter aux souffrances des patients, ils ne doivent pas moins s'inscrire dans un arsenal thérapeutique plus varié, incluant d'autres antalgiques, des thérapies cognitivo-comportementales, une rééducation fonctionnelle ou un accompagnement psychologique87(*).
Cet « opioïdo-centrisme » est, par ailleurs, renforcé par les conditions de prise en charge en vigueur en France selon la société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD), qui met en avant la « non-prise en charge financière de nombre de [...] thérapies non-médicamenteuses »88(*) comme un facteur expliquant leur défaut d'intégration à la stratégie thérapeutique.
• D'autre part, le professeur Benjamin Rolland, chef du service universitaire d'addictologie de Lyon, explique un tel écart entre les pratiques de prescription et les recommandations par le fait que ces dernières « sont souvent peu lues et peu connues chez les médecins ou soignants non spécialistes »89(*). La parution de ces recommandations de bonnes pratiques a, il est vrai, été tardive, comme le déplore le Cnop90(*).
Ces éléments mettent en lumière des carences dans l'appréhension de la douleur par les professionnels de santé, explicables notamment par un défaut de formation et d'appropriation des outils existants.
3. Les risques liés aux opioïdes, notamment la dépendance, sont insuffisamment évalués par les médecins
Les risques de mésusage liés aux opioïdes sont donc pour partie attribuables aux professionnels de santé, dont le niveau de connaissances sur la prise en charge de la douleur et l'addictologie apparaît hétérogène, et certainement perfectible.
Ce constat semble faire consensus auprès des organismes auditionnés par la mission : à titre d'exemple, la SFETD déplore une « carence générale sur l'évaluation, le traitement et le retentissement des douleurs chroniques »91(*) tandis que le Cnop note une « méconnaissance par les professionnels de santé des propriétés des opioïdes sur le psychisme (anxiolyse, euphorie, diminution de l'insomnie) »92(*).
Il est appuyé par diverses études : dans ses réponses au questionnaire des rapporteures, la Fédération Addictions note que « les données issues de l'enquête réalisée dans le cadre du livre blanc sur la naloxone93(*) montrent que seuls 8 % des médecins interrogés se disent conscients du risque de surdosage lié aux opioïdes ».
a) Une sous-estimation du risque et des symptômes de la dépendance, liée au déficit de formation initiale et continue des professionnels de santé
Source d'erreurs de prescription, la sous-évaluation des risques liés aux opioïdes est tout d'abord à rapprocher d'un déficit de formation initiale et continue de certains professionnels de santé sur le sujet de la prise en charge de la douleur et de l'addictologie. Ces lacunes seraient « identifiées de longue date »94(*), selon le Groupe Santé Addictions, qui a conduit différentes enquêtes sur le sujet entre 2018 et 2023.
Ainsi, les travaux précités de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique (Drees), font apparaître que près de la moitié (48 %) du panel de médecins généralistes interrogés se considèrent insuffisamment formés pour repérer les risques de mésusage liés aux opioïdes.
Plus préoccupant encore, l'association SAFE indique que les études préalables à la parution du livre blanc sur la naloxone ont fait apparaître que 30 % des médecins interrogés n'avaient jamais été formés à la prise en charge de la douleur, et 37 % n'avaient plus reçu de formation à ce sujet depuis leur formation initiale.
L'hétérogénéité des connaissances des professionnels de santé sur ces problématiques n'est pas sans poser problème pour l'accès aux soins : les patients concernés par des mésusages se concentrant sur une faible proportion de médecins. Des données fournies par le Groupe Santé Addictions sont éloquentes à cet égard : « aujourd'hui, 80 % des patients sous buprénorphine sont suivis par seulement 5 % des médecins généralistes »95(*).
Cela peut expliquer, selon une étude qualitative menée par l'OFDT96(*), une pratique extensive du renouvellement en ville d'antalgiques opioïdes primo-prescrits à l'hôpital. Les praticiens hospitaliers étant « jugés plus spécialisés ou parfois plus compétents » sur la question de la prise en charge de la douleur, les médecins de ville renoncent parfois à remettre en question leurs prescriptions, ou à s'engager dans une stratégie de déprescription.
Il convient donc de sensibiliser davantage les professionnels de santé aux risques liés à la prescription d'opioïdes. Les rapporteures préconisent le déploiement d'une campagne de communication de grande ampleur dédiée aux opioïdes, qui puisse permettre d'améliorer l'information des patients et d'adapter au mieux les stratégies thérapeutiques mises en oeuvre.
Recommandation : Sensibiliser et informer les professionnels soignants par une campagne permettant le dialogue, l'information et l'orientation des patients sur l'usage et les risques des opioïdes.
La question de la formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur et à l'addictologie doit être appréhendée sous deux prismes : celui de la formation initiale et celui de la formation continue.
• La formation initiale en addictologie des professionnels de santé est très hétérogène, et reste largement à la discrétion de chaque université. Des lacunes existent, tant au niveau du volume d'heures de cours dispensé sur le sujet qu'au niveau de la qualité des contenus.
Il n'existe, d'une part, aucun enseignement de tronc commun harmonisé consacré à l'addictologie dans les cursus des différents professionnels de santé impliqués : médecins généralistes, pharmaciens ou infirmiers, par exemple. Selon une enquête menée en 2021 par le Groupe Santé Addictions auprès des facultés de médecine, « dans certaines universités, l'enseignement de l'addictologie se limite à un seul cours de deux heures ; dans d'autres, il est intégré de manière dispersée dans différents modules, sans logique structurante »97(*). Ce volume horaire ne saurait, bien sûr, donner à tous les professionnels les armes nécessaires pour appréhender dûment les enjeux liés aux antalgiques opioïdes.
La formation à la douleur demeure, elle aussi, souvent marginale dans les cursus de médecine, de pharmacie et de soins infirmiers, alors même qu'elle représente une réalité quotidienne de la pratique clinique.
La qualité des contenus proposés est également perfectible, selon le Groupe Santé Addictions. Celui-ci indique en effet que « dans de nombreuses facultés, l'addiction n'est pas abordée comme une pathologie en soi, mais uniquement à travers ses conséquences somatiques : par exemple, l'alcoolisme dans les modules de gastro-entérologie, le tabac en pneumologie, ou les opioïdes comme effet secondaire des traitements contre la douleur. Le produit, plus que le patient, structure encore trop largement les contenus. »98(*)
Au-delà du contenu académique, une étude qualitative de l'OFDT99(*) montre les limites de l'apprentissage pratique de la prescription de médicaments opioïdes, qui ne permet pas pleinement la responsabilisation ou la prise de recul des professionnels formés. Selon celle-ci, lors de « l'internat, les médecins ne considèrent pas être formés à « bien prescrire », du fait de l'influence des visiteurs médicaux ou parce que les chefs de clinique ou les maîtres de stage choisissent la molécule à leur place ».
La DGS fait toutefois savoir que, dans le cadre de la feuille de route « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes » 2019-2022, un « renforcement de la formation initiale [...] des médecins sur le sujet du bon usage et du risque de surdoses »100(*) a été mis en oeuvre.
• Des initiatives fleurissent cependant pour renforcer la formation continue des professionnels de santé.
La prise en charge de la douleur et l'addictologie sont bien représentées dans les orientations prioritaires de développement professionnel continu101(*) pour 2023 à 2025 : l'orientation prioritaire n° 3 concerne l'« amélioration de l'évaluation, du traitement et de la prise en charge de la douleur », tandis que l'orientation n° 19 est intitulée « repérage, accompagnement et prise en charge des pratiques addictives ».
De plus, différentes universités102(*) ont développé des diplômes universitaires relatifs à l'addictologie ou à la prise en charge de la douleur, principalement à l'attention des médecins et des infirmiers.
Toutefois, la formation continue repose aujourd'hui principalement sur des formats en présentiel, peu accessibles aux médecins de ville, en particulier ceux exerçant dans des zones rurales pourtant touchées au premier titre par la dépendance aux opioïdes.
Pour répondre à cette problématique, la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) travaille actuellement sur le déploiement d'un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) sur ces sujets.
La Cnam a également ciblé 14 000 généralistes dont la patientèle est fortement consommatrice de tramadol, afin de les inviter à participer à une campagne d'accompagnement sur le bon usage de ce médicament.
b) Un défaut d'utilisation des outils existants afin d'évaluer les risques
Les carences dans la formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur et à l'addictologie pourraient toutefois être compensées par l'usage de différents outils prévus pour accompagner les prescripteurs et les dispensateurs dans leur activité.
• On peut par exemple penser aux logiciels d'aide à la prescription (LAP)103(*) et à la dispensation (LAD) certifiés par la HAS, visant respectivement à accompagner le médecin pour qu'il réalise les meilleurs choix thérapeutiques en limitant les interactions médicamenteuses, et le pharmacien afin d'éviter les erreurs à la délivrance et de garantir une meilleure adaptation du conseil pharmaceutique.
Le déploiement de ces logiciels, qui constituent un appui décisif à la sécurité et à l'efficacité thérapeutique en diffusant les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la HAS, est encouragé par les pouvoirs publics. Disposer d'un LAP certifié par la HAS est, par exemple, devenu nécessaire pour les médecins afin de toucher le forfait structure et la future dotation numérique.
Ces outils pourraient donc renforcer l'information des professionnels de santé sur les risques liés à la prescription des antalgiques opioïdes, et encourager le développement d'approches plus multimodales et individualisées de prise en charge de la douleur.
Toutefois, à ce jour, les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ne comportent pas de messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes ni sur le risque de surdoses.
Recommandation : Faire apparaître, dans les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation certifiés par la HAS, des messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes, le risque de dépendance et le risque de surdoses.
• Certains instruments spécifiques existent aujourd'hui afin d'accompagner les professionnels de santé dans la prescription et la dispensation d'antalgiques opioïdes, mais ceux-ci sont insuffisamment mobilisés, ce qui entraîne une hausse du risque de mésusage.
Depuis mars 2022, deux outils sont recommandés par la HAS en vue de la prescription ou du renouvellement d'une prescription d'antalgiques opioïdes : il s'agit des questionnaires Opioid Risk Tool (ORT) et du questionnaire Prescription Opioid Misuse Index (POMI).
Le premier vise à accompagner les prescripteurs dans l'analyse des risques associés à la primo-prescription d'antalgiques opioïdes. Il doit donc être réalisé ex ante, avant toute prescription. Il consiste en une série de cinq questions concernant les antécédents familiaux et personnels de troubles d'usage de substances, les antécédents personnels traumatiques, l'âge du patient, et la présence de certains troubles psychiques.
À chaque réponse est associé un nombre de points, qui, cumulé, donne une estimation du risque de développement ultérieur d'un mésusage chez le patient, laquelle doit être prise en compte dans la stratégie thérapeutique déployée.
Questionnaire ORT
Source : Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Le questionnaire POMI vise quant à lui à détecter des mésusages chez des patients déjà traités par des antalgiques opioïdes, et trouve donc sa place au moment d'un renouvellement de prescription. Cela rend cet outil particulièrement pertinent pour le suivi des douleurs chroniques non cancéreuses.
Un travail mené en 2021 par des chercheurs104(*) notamment issus de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) a permis la traduction et l'adaptation culturelle de cet outil au contexte français et européen, dans une version appelée POMI-5F.
Le questionnaire, qui peut être auto-administré, consiste en cinq questions recoupant les principaux mésusages constatés : augmentation des doses ou des fréquences, consommation excessive, recherche d'effets détournés. Lorsque le patient répond favorablement à deux questions ou plus, il convient d'explorer plus avant le risque de mésusage, et d'adapter le cas échéant la stratégie thérapeutique. Les professionnels sont particulièrement invités à rechercher les signes de dépendance physique et de tolérance, d'inefficacité du médicament, d'usage non thérapeutique et de craving.
Questionnaire POMI-5F
Source : OFMA
Selon l'association SAFE, citant une étude réalisée dans le cadre de l'élaboration du livre blanc sur la naloxone, seul « 1/3 des médecins interrogés utilisent un questionnaire permettant d'évaluer le risque de mésusage chez les patients traités par antalgiques opioïdes, 20 % utilisant le questionnaire ORT et 14 % le questionnaire POMI ».
Peu mobilisés par les prescripteurs malgré leur simplicité d'usage et leur caractère didactique, ces outils ne sont guère plus utilisés par dispensateurs : dans la même enquête, 77 % des pharmaciens répondants disaient ne pas connaître les échelles d'évaluation de risque de mésusage.
Dans ces conditions, le Cnop recommande une « diffusion plus large »105(*) de ces outils.
c) Le manque de coordination entre les professionnels de santé accroît les risques de mésusage
Comme l'indique la Haute Autorité de santé dans ses réponses au questionnaire des rapporteures, « le défaut de coordination des professionnels de santé en ville et ville-hôpital est source de prises en charge non optimales voire inadaptées des douleurs chroniques et potentiellement d'une utilisation inadaptée des morphiniques voire de leur mésusage en ville »106(*). La Fédération française d'addictologie s'inquiète quant à elle plus spécifiquement du « manque de coordination entre prescripteurs et pharmaciens »107(*).
Le manque de communication entre professionnels de santé - prescripteur et médecin traitant ou prescripteur et pharmacien notamment - peut en effet conduire à une prise en charge en silo, contraire à l'approche holistique qui devrait prévaloir et menant à « des prescriptions inadaptées ou à une prolongation non justifiée des traitements »108(*).
Une étude qualitative sur l'usage des médicaments opioïdes antalgiques (EMOA)109(*) menée par l'OFDT démontre ainsi que « les difficultés à modifier ou arrêter la prescription d'un médicament qui a été initiée par un autre professionnel, ou dans d'autres secteurs de la chaîne de soins, tiennent surtout aux difficultés de coopération entre acteurs du système des soins et aux engagements assumés dans la prise en charge », ces difficultés étant renforcées par le sentiment de manque de légitimité de certains prescripteurs à remettre en question des prescriptions de leurs confrères, parfois jugés plus expérimentés.
Le défaut de coordination entre les professionnels de santé impliqués dépend, notamment, du mode d'exercice retenu : l'étude de l'OFDT précitée tend notamment à prouver que l'exercice auprès d'autres professionnels permettant un regard scientifique extérieur - en maison de santé ou en centre de santé notamment - est plus propice à l'internalisation et à la gestion des problèmes de mésusage liés aux opioïdes.
4. Des mésusages favorisés par la méconnaissance des consommateurs des risques associés aux substances opioïdes
Si les imperfections du système de santé expliquent une partie des mésusages et des troubles de l'usage constatés sur les médicaments opioïdes, les patients peuvent également en être à l'origine, en n'appliquant pas les consignes des professionnels de santé ou en n'identifiant pas le développement d'une pharmacodépendance, parfois du fait d'une méconnaissance de ses signes.
Alors que la prise de médicaments antalgiques opioïdes présente des risques significatifs pour le patient, on ne peut se contenter que celui-ci adopte un rôle de « consommateur » passif. Il convient, au contraire, de véritablement faire du patient un « acteur du bon usage des traitements »110(*), ce qui suppose des efforts d'éducation thérapeutique et de responsabilisation.
a) Une méconnaissance des risques associés aux substances consommées
La méconnaissance des risques associés à la prise d'antalgiques opioïdes par leurs consommateurs constitue la principale source de mésusage provenant du patient.
Ce phénomène a fait consensus lors des auditions conduites par la mission. Certains patients ignorent les dangers liés aux opioïdes, d'autres ignorent même qu'ils sont traités par un tel antalgique.
Les malades traités avec des opioïdes ne sont, d'une part, pas toujours au fait de la classe thérapeutique dans laquelle s'inscrit leur traitement. Ce constat est particulièrement préoccupant pour les opioïdes de palier 2, dits « faibles », pour lesquels les professionnels de santé impliqués ne précisent pas systématiquement qu'il s'agit d'opioïdes. L'ANSM déplore ainsi chez les patients consommateurs de « tramadol et [de} codéine, la méconnaissance de l'appartenance de ces médicaments [à la classe] pharmacothérapeutique des antalgiques opioïdes »111(*).
Chez les patients qui savent être traités par des opioïdes, la connaissance des risques associés à ce traitement demeure toutefois perfectible. Selon l'ANSM, « une majorité de patients » ignorerait que les antalgiques opioïdes sont « susceptibles d'entraîner une accoutumance, une dépendance physique et psychologique, et un trouble de l'usage d'opioïdes », ce qui « participe au risque de survenue de ces effets indésirables et de l'absence ou du retard de leur prise en charge »112(*).
La HAS fait le même constat lorsqu'elle observe, citant une étude de l'OFMA et de l'Institut Analgesia113(*), que « 9 usagers de tramadol ou codéine sur 10 ignorent le risque d'arrêt respiratoire en cas de surdosage de ces médicaments », alors que les CEIP-A ont recensé, en 2022, 74 décès liés à une surdose de ces molécules114(*) dans le cadre de l'enquête Décès toxiques par antalgiques (DTA). Cela fait du tramadol et de la codéine respectivement le premier et le troisième antalgique les plus létaux.
Source : Addictovigilance.fr
L'ignorance de la catégorisation comme opioïde de son traitement ou la méconnaissance des effets indésirables associés à la consommation de ces médicaments expose les patients à des risques accrus de mésusage : comme le rappelle la Fédération française d'addictologie, « une dépendance peut s'installer très vite, sans que l'on s'en rende compte »115(*).
Pour expliquer la méconnaissance des risques liés aux traitements opioïdes par les patients, les auditions ont permis aux rapporteures d'avancer trois pistes principales : le manquement, par les professionnels de santé, à leur devoir d'information des patients, l'insuffisance et le défaut de ciblage des campagnes de communication grand public, et les limites de l'étiquetage des médicaments opioïdes.
• Le manquement à l'obligation d'information du patient applicable aux professionnels de santé est, sans nul doute, l'une des principales raisons de la mauvaise appréhension par les patients des risques de leur traitement antalgique opioïde.
Dans un mouvement d'affirmation des droits individuels et d'évolution de la relations soignant-soigné encouragé par la jurisprudence, l'article 11 de la loi dite « Kouchner »116(*) de 2002 a consacré le droit, pour le patient, d'être informé de son état de santé. Cette obligation d'information, applicable « à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables »117(*), touche un champ assez large : il recouvre notamment l'utilité, l'urgence, les conséquences ou les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des traitements engagés.
Cette obligation figure également, sous une autre forme et depuis parfois plus longtemps118(*), dans les codes de déontologie de différentes professions de santé.
Pour les médecins, l'article 35 du code de déontologie119(*) dispose que le praticien « doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose », étant entendu que le médecin doit tenir compte de la personnalité du patient dans les explications apportées et veiller à sa compréhension.
L'article R. 4312-13 du code de la santé publique prévoit, pour les infirmiers, l'obligation déontologique de mettre « en oeuvre le droit de toute personne d'être informée de son état de santé », de façon « loyale, adaptée et intelligible ». Lorsqu'il est saisi d'une demande d'information ultra vires, l'infirmier doit rediriger le patient vers le professionnel de santé compétent.
Seuls peuvent faire obstacle au droit d'information du patient sa propre volonté de renoncer à être informé, l'urgence ou l'impossibilité pour le professionnel de santé de respecter cette obligation120(*).
Par conséquent, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et les dispositions des différents codes de déontologie devraient, en principe, faire obligation aux médecins, infirmiers et pharmaciens impliqués dans les traitements par antalgiques opioïdes d'informer les patients des « conséquences » et des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » associés à cette classe thérapeutique.
Une enquête du panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale menée par la Drees conduite entre décembre 2019 et mars 2020 sur 2 412 médecins fait toutefois apparaître d'importantes lacunes dans l'information prodiguée aux patients. Ainsi, près d'un praticien sur cinq (19 %) n'informe pas systématiquement ses patients sur les risques de mésusages ou de dépendance liés à la consommation d'opioïdes prescrits.
L'obligation légale et déontologique d'information du patient se doit d'être scrupuleusement respectée, encore plus particulièrement lorsque le traitement suivi est porteur de risques lourds sur la santé. Les rapporteures estiment donc qu'il est crucial que ces obligations soient rappelées aux prescripteurs, et que ceux-ci s'engagent effectivement dans une information systématique au patient, adaptée au produit prescrit et à sa posologie. Une sensibilisation des professionnels de santé par les ordres, chargés de veiller à la déontologie, pourrait être envisagée, de même que la mise en oeuvre de sanctions ordinales pour les professionnels réfractaires.
Recommandation : Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes.
• Des programmes de communication grand public pour faire connaître les risques associés aux antalgiques opioïdes existent, mais ils demeurent insuffisamment visibles du grand public. En tout état de cause, comme l'indique la Mildeca, « la communication sur les risques liés au mésusage des opioïdes mérite d'être renforcée »121(*).
Le constat d'une carence d'information du grand public sur les risques liés aux opioïdes est largement partagé, y compris auprès des professionnels. L'association SAFE défend que « cet avis est étayé par les études que [l'association a] pu mener auprès des professionnels pharmaciens, médecins, et acteurs de l'addictologie et de la réduction des risques, qui considèrent tous que l'information est insuffisante tant au niveau collectif qu'individuel »122(*).
Certaines initiatives existent bien, à l'image du programme « Prévention et réduction des risques de surdoses liées aux opioïdes en région PACA » (POP), lancé par le CEIP-A de Marseille et présenté plus en détail infra.
Toutefois, de tels programmes disposent rarement d'une ampleur nationale : le Groupe Santé Addictions déplore ainsi que « la communication sur les risques de mésusage et de dépendance liés aux opioïdes [...] [soit] morcelée, peu visible pour le grand public, et le plus souvent cantonnée à des cercles professionnels ou institutionnels »123(*). Les actions de communication menées trouvent donc, bien souvent, peu de relais et guère plus d'écho dans la population générale.
En conséquence, le niveau d'information global de la population sur les risques liés aux antalgiques opioïdes est très insuffisant, ce qui présente des risques de santé publique accrus à l'échelle individuelle, pour son entourage, et à l'échelle collective :
- à l'échelle individuelle, les patients dûment informés des risques par leur médecin ont tendance à moins y prêter d'attention s'ils n'ont pas été sensibilisés de leur existence au préalable ;
- à l'échelle de l'entourage, les proches des patients ne peuvent se montrer suffisamment vigilants à l'apparition des premiers signes de mésusage ou de pharmacodépendance, puisqu'ils en ignorent les manifestations, ce qui retarde et complexifie d'autant la prise en charge du mésusage ;
- à l'échelle collective, la méconnaissance des risques associés aux opioïdes et des réponses à y apporter a des impacts de santé publique, notamment en cas de surdose d'opioïdes dans un lieu public.
• Enfin, l'étiquetage des produits sur le marché ne permet pas d'offrir une vision claire des dangers liés aux médicaments antalgiques opioïdes. Des réflexions sont actuellement en cours pour faire évoluer l'étiquetage de certains médicaments opioïdes afin de faire apparaître des mentions d'alerte permettant la sensibilisation des patients au risque de dépendance124(*).
b) L'automédication : une pratique répandue et problématique
Si elle est parfois perçue comme une pratique anodine, voire de bon sens, l'automédication n'est pas dénuée de risques, en particulier lorsqu'elle concerne des médicaments comme les antalgiques opioïdes, dont les effets secondaires sont puissants et dont les dangers sont méconnus et sous-évalués125(*).
L'ensemble des médicaments opioïdes sont, pour cette raison, soumis à prescription médicale obligatoire126(*). Malgré cela, l'inadaptation de certains conditionnements trop volumineux127(*) conduit les patients à accumuler des boîtes entamées mais non finies dans les « pharmacies familiales ». Les patients peuvent donc être tentés de traiter par eux-mêmes la survenue de douleurs modérées à intenses ultérieures, avec des médicaments qui leur avaient été prescrits pour d'autres pathologies.
Malgré les risques associés, l'automédication est, de fait, particulièrement répandue chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Citée par la SFETD, l'enquête PREVA-DOL menée par l'observatoire français de la douleur et des antalgiques (OFDA) démontre que 16 % des Français souffrant de douleurs chroniques pratiquent l'automédication.
Les causes de ce phénomène sont plurielles et résultent d'une conjonction de facteurs environnementaux et sociaux.
Au-delà de la méconnaissance des effets secondaires et des risques encourus, il est certain que l'automédication et la mobilisation de la « pharmacie familiale » deviennent d'autant plus attractives pour les patients que l'accès aux médecins se complexifie et demande du temps et des efforts.
L'ANSM indique également que différents facteurs sociaux, parmi lesquels l'« isolement social », la « précarité » ou le « chômage », peuvent « favoriser l'automédication »128(*). Interrogé sur la question, le Cnop y ajoute d'autres facteurs, comme la « croyance qu'il existe toujours un produit disponible pour modifier l'humeur, le malaise » et la « dégradation de la santé mentale »129(*) de la population.
En l'absence de contrôle médical, les patients en automédication s'exposent davantage à des erreurs de posologie : l'étude DANTE menée par le réseau des CEIP fait par exemple apparaître que « 13,3 % des patients en automédication avec de la codéine sont en surdosage »130(*).
L'automédication favorise donc la survenue des risques les plus graves liés à la consommation d'opioïdes : surdosages involontaires, syndromes de sevrage, développement d'une pharmacodépendance, etc.
En outre, l'automédication retarde le recours à une évaluation médicale approfondie, en masquant les symptômes d'une pathologie sous-jacente ou en complexifiant le diagnostic.
Au-delà de l'automédication stricto sensu, la disponibilité d'antalgiques opioïdes dans les armoires à pharmacie familiales conduit certains patients à s'improviser médecins et à partager leur traitement à leur entourage. Ce phénomène est plus inquiétant encore que l'automédication dans la mesure où il s'applique à des patients n'ayant potentiellement jamais subi une analyse médicale sur le bien-fondé d'une prescription d'opioïdes. L'accès via l'entourage, qui constitue selon l'ANSM un facteur explicatif de la vulnérabilité au risque de dépendance, est particulièrement répandu. Selon la HAS, citant une enquête menée par l'OFMA et l'institut Analgesia131(*), « respectivement 41 et 42 % des patients traités par codéine ou tramadol déclarent avoir déjà partagé leur traitement avec une personne de leur entourage »132(*).
Afin de répondre aux problématiques engendrées par la consommation de médicaments opioïdes non encadrée médicalement, un effort d'éducation thérapeutique des patients apparaît indispensable133(*).
II. SI LA FRANCE N'APPARAÎT PAS EXPOSÉE À UNE CRISE DES OPIOÏDES À L'AMÉRICAINE, LA MAÎTRISE DE CE RISQUE NÉCESSITE DE RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Alors que les États-Unis et le Canada connaissent une crise de santé publique sans précédent liée à la consommation d'opioïdes, les rapporteures se sont naturellement interrogées sur la vulnérabilité de la France à l'importation d'une telle crise.
Elles ont donc souhaité analyser les causes de la crise américaine, et évaluer les risques résultant de la situation actuelle en France.
Si la méconnaissance des risques liés aux opioïdes par les patients et le non-respect des recommandations sanitaires par les prescripteurs sont deux éléments inquiétants, il ressort du travail des rapporteures, fondé sur l'ensemble des auditions qu'elles ont conduites134(*), que la France s'est dotée d'un cadre de surveillance et de maîtrise des risques beaucoup plus ambitieux que les États-Unis, lequel semble aujourd'hui faire obstacle à une crise d'une ampleur similaire à celle que traverse l'Amérique du Nord, causée par des médicaments prescrits.
Les axes de vulnérabilité doivent toutefois faire l'objet d'une analyse renforcée et d'une réponse résolue, notamment en ce qui concerne l'arrivée potentielle de nouveaux opioïdes de synthèse illicites sur le territoire.
La crise des opioïdes en Amérique du Nord : quelques points d'analyse
Selon l'OFDT, sur les 25 dernières années, « plus de 800 000 décès » aux États-Unis seraient « directement attribuables » aux surdoses d'opioïdes.
Au coeur de la crise, en 2022, selon le Center for Disease Control (CDC) cité par l'Ambassade de France aux États-Unis, ont été recensés près de 110 000 morts par surdose. Les données fédérales ont révélé un léger infléchissement des décès par surdose aux États-Unis en 2023, avec un nombre de décès estimé à 107 500. Cette même année, 8 600 décès étaient à déplorer au Canada.
Si « les premiers signes d'une consommation abusive d'opioïdes sont apparus au début des années 2000, notamment dans des communautés défavorisées de la ceinture appalachienne »135(*), il a fallu attendre 2011 pour que l'Office of national Drug Control Policy (ONDCP) évoque enfin une « crise de santé publique », une expression aujourd'hui consacrée.
Les différents commentateurs considèrent le plus souvent que la crise des opioïdes en Amérique du Nord a connu, à ce jour, quatre phases.
• D'abord, la première phase a été marquée par la large diffusion d'une pharmacodépendance au sein de la population et une hausse des décès liée aux surdoses d'opioïdes prescrits, lors des années 1990 et 2000.
Cette diffusion à grande échelle a été rendue possible par des « prescriptions médicales excessives et inadéquates »136(*), visant à répondre à la « demande croissante des patients pour soulager la douleur, aiguë ou chronique » dans un contexte général de « libéralisation de la prescription des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non liée au cancer »137(*).
Ces pratiques médicales ont été motivées par « des stratégies de marketing agressif déployées par certains laboratoires pharmaceutiques »138(*), agissant à la fois sur la demande d'opioïdes par les patients via les publicités grand public et sur la banalisation de la prescription de tels produits par une politique de lobbying auprès des médecins (visiteurs médicaux) et des pouvoirs publics, occultant souvent les risques de dépendance associés.
Dans les années 1970, les médecins américains étaient pourtant initialement réticents à prescrire des antalgiques opioïdes, par crainte de leur nature addictive. Mais la communication des industriels et la dissimulation des chiffres d'addiction ont fini par convaincre les professionnels, qui ont été amenés à prescrire des opioïdes avec une grande légèreté : en 2014, alors que la crise des opioïdes était déjà virulente, « 99 % [des médecins américains] prescrivaient des médicaments opioïdes hautement addictifs pour une durée supérieure aux trois jours recommandés par les CDC ».139(*)
Symbole de cette légèreté, « 780 millions d'antidouleurs ont été vendus en Virginie occidentale entre 2007 et 2012, soit 433 pilules par habitant »140(*).
Un produit, l'OxyContin, de l'oxycodone commercialisée par le laboratoire Purdue Pharma, est représentatif de l'ensemble de ces dérives. Le laboratoire exploitant défendait, dans sa communication, que le risque de dépendance à l'OxyContin était inférieur à 1 %, sans attirer la vigilance des pouvoirs publics. Pourtant, des centaines de milliers d'américains en sont devenus dépendants, et l'OxyContin a été le médicament prescrit à l'origine de plus grand nombre de surdoses jusque dans les années 2010. Ses pilules, réduites en poudre et inhalées pour multiplier l'effet euphorisant, ont en effet fait l'objet d'usages détournés dès les années 2000. Le laboratoire a, plus tard, accepté un accord judiciaire à hauteur de 8 milliards de dollars après avoir été « accusé d'avoir causé l'épidémie par marketing trompeur »141(*).
Selon les universitaires Anne Case et Angus Deaton, auteurs de l'ouvrage Deaths of Despair en 2021, la crise des opioïdes aux États-Unis est née non seulement de facteurs politiques et socio-médicaux évoqués précédemment, mais également de facteurs purement sociologiques. La crise, qui a d'abord touché au premier chef les communautés blanches paupérisées, serait, selon eux, également liée aux inégalités structurelles de la société américaine, engendrant une forme d'insatisfaction et de désespoir qui forme un terreau propice à la pharmacodépendance.
• La deuxième phase de l'épidémie se caractérise par la hausse des décès liés à la consommation d'héroïne, à compter de l'année 2010, liée au déport de la consommation du marché légal prescrit vers le marché illégal.
Prenant conscience de la crise de santé publique engendrée par la diffusion de la pharmacodépendance aux opioïdes dans sa population, la Food and Drug Administration (FDA), le Gouvernement fédéral et les États ont décidé de resserrer brutalement les conditions de prescription et de dispensation des opioïdes : en 2010, l'OxyContin est retiré du marché sous sa forme initiale, et, progressivement, « 39 États ont adopté des lois et règlements limitant la prescription ou la délivrance d'opioïdes »142(*).
Il s'ensuit un effondrement de la délivrance d'opioïdes prescrits : « le nombre d'analgésiques opioïdes délivrés sur ordonnance aux États-Unis a chuté d'environ 45 % entre 2011 et 2019 (7,1 milliards de pilules) » selon l'Ambassade. Si cette mesure a permis de contenir le nombre de décès par surdose de médicaments opioïdes, son caractère soudain et l'absence d'accompagnement apporté aux patients pharmacodépendants n'ont finalement fait que déporter et empirer la crise.
Certains patients pharmacodépendants n'ayant désormais plus accès à la prescription, ils sont donc confrontés à l'impossibilité de se fournir sur le marché légal. Certains font face à un syndrome de sevrage forcé, d'autres se déportent vers le marché des opioïdes de rue, alors principalement tourné sur l'héroïne. La consommation d'opioïdes et la qualité des opioïdes consommés devient alors nettement moins contrôlable par les pouvoirs publics.
- La troisième phase de la crise est caractérisée par la hausse des décès liés aux surdoses d'opioïdes de synthèse comme le fentanyl, consommés sans stimulant, des années 2015 à 2020. Autour des années 2015, le fentanyl, un opioïde considéré entre 25 et 50 fois plus puissant que l'héroïne, arrive sur le marché de rue américain, avec ses dérivés appelés fentanyloïdes. Si le fentanyl est d'abord un médicament, les fentanyloïdes de rue sont produits illicitement « dans des laboratoires de synthèse principalement au Mexique, à partir de matières premières importées de Chine ou d'Inde »143(*). Moins cher et plus fort que l'héroïne, il a tôt fait de se substituer à cette dernière. Le nombre de surdoses mortelles d'héroïne est alors divisé par deux en dix ans. Toutefois, la puissance des fentanyloïdes et l'hétérogénéité de leur composition en fonction des fournisseurs les rendent très difficiles à doser, ce qui cause une augmentation extrêmement dynamique des surdoses liées à ces produits, et particulièrement des surdoses mortelles.
• Depuis les années 2020, le fentanyl est également consommé avec des psychostimulants, ce qui renforce encore le risque de surdose. Les consommateurs sont plus jeunes, plus précaires, et plus fréquemment issus des minorités hispaniques et afro-américaines. Le fentanyl, associé ou non à des psychostimulants, est désormais responsable des trois quarts des surdoses mortelles aux États-Unis. Selon l'Ambassade de France aux États-Unis, « les surdoses mortelles dues au fentanyl illicite ont augmenté de 94 % entre 2019 et 2021 et sont alors devenues la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 49 ans ». En 2023, 75 000 personnes sont mortes d'une surdose de fentanyl. Pour 2024, une baisse significative des surdoses est attendue, autour de 20 %. Celle-ci est explicable par différents facteurs : accès renforcé aux agonistes opioïdes (buprénorphine, méthadone), équipement des services de secours et de sécurité en naloxone, lutte contre les trafics, encadrement des prescriptions permettant de limiter le « flux » de nouveaux patients pharmacodépendants.
Les quatre vagues de la crise américaine des opioïdes
Source : Friedman et al., Addiction, 2023, cité par Marie Jauffret-Roustide lors de son audition plénière par la commission des affaires sociales
A. UN CADRE DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE DES OPIOÏDES GLOBALEMENT SÉCURISÉ
1. Une régulation stricte de l'information promotionnelle relative aux médicaments opioïdes, doublée d'une politique active de pharmaco- et d'addictovigilances
La France se distingue des États-Unis des années 1990 par deux aspects principaux, qui la rendent moins susceptible de connaître un scénario similaire à celui vécu outre-Atlantique avec les opioïdes.
D'une part, contrairement aux États-Unis, qui avaient laissé une grande liberté aux industriels pour faire la promotion de leurs médicaments vis-à-vis du grand public, la France a fait le choix d'un encadrement particulièrement strict des stratégies promotionnelles des médicaments soumis à prescription.
D'autre part, la France s'est dotée très tôt d'un réseau d'addicto- et pharmacovigilance actif et réactif, capable de faire remonter rapidement des tendances préoccupantes observées sur le terrain pour permettre l'adaptation des politiques conduites.
a) Une régulation stricte de la publicité des médicaments soumis à prescription
La question de la publicité et de la promotion des antalgiques opioïdes se trouve au coeur de l'émergence de la crise américaine. Les stratégies commerciales très agressives de certains laboratoires, auprès des médecins mais aussi du grand public, ont en effet contribué à la surprescription massive et non contrôlée d'opioïdes144(*).
En France, le législateur a, dès le XXe siècle, fait le choix d'un encadrement strict de la faculté laissée aux industriels de faire la promotion de leurs produits et des modalités à leur disposition pour ce faire. Son objectif était de garantir un usage rationnel du médicament et de prévenir les comportements à risques liés à l'automédication ou à l'influence commerciale. La loi prévoit des cadres promotionnels différents selon le public visé, les critères pour engager des actions commerciales étant plus stricts pour le grand public que pour les professionnels.
• Comme l'indique les entreprises du médicaments (Leem), « la publicité à destination du grand public est interdite en France pour [les opioïdes] à prescription médicale obligatoire », une philosophie très différente de celle des États-Unis. Cette interdiction ressort de la lecture de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, qui conditionne la légalité d'une publicité pour un médicament au fait :
- que ce médicament soit accessible sans prescription médicale145(*) ;
- qu'il ne soit remboursable par la sécurité sociale sous aucune de ses formes ;
- que son autorisation de mise sur le marché ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité en raison d'un risque de santé publique.
Seules deux exceptions sont prévues par la loi : la publicité est autorisée pour les substituts nicotiniques et pour les vaccins remboursables si ceux-ci figurent sur une liste et après contrôle de la HAS146(*).
La publicité est soumise à une autorisation préalable de l'ANSM147(*) et doit, en tout état de cause, être accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes148(*).
• La publicité à destination des professionnels de santé est autorisée149(*), mais soumise à un encadrement strict. En effet, la publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage »150(*). Elle doit respecter les dispositions de l'AMM et des stratégies thérapeutiques recommandées par la HAS.
L'ANSM est chargée du contrôle de ces dispositions : la diffusion des publicités est ainsi soumise à son autorisation préalable et l'octroi d'un « visa de publicité »151(*), dont la durée de validité est de deux ans.
L'ANSM veille également « à la conformité et la cohérence des supports promotionnels avec :
- les évaluations et recommandations des autorités de santé ;
- les campagnes de bon usage ou programmes de santé publiques »152(*).
Dans les faits, selon le Leem, « les supports promotionnels doivent contenir les informations essentielles du bon usage des médicaments, telles que décrites dans la recommandation « Présentation des données de sécurité » de l'ANSM. En particulier dans le cas des opioïdes l'indication, la durée de prescription, les contre-indications, les évènements indésirables, les données de sécurité obligatoires (les risques d'abus, mésusages et d'overdose) et règles de prescription et délivrance : ordonnance sécurisée pour tramadol/codéine/ dihydrocodéine »153(*).
L'ANSM fait paraître des recommandations pour la publicité, afin d'accompagner les industriels vers la production de supports promotionnels susceptibles d'être autorisés.
La DGS indique toutefois qu'« à ce jour, il n'existe pas de recommandations spécifiques pour l'élaboration des supports promotionnels de ces produits [des opioïdes] par les laboratoires ». Compte tenu des dérives observées dans la stratégie promotionnelle des opioïdes aux États-Unis, et afin de mieux cadrer les publicités en faveur de ces produits auprès des professionnels de santé, les rapporteures estiment qu'il serait opportun que l'ANSM travaille à l'élaboration de recommandations spécifiques sur le sujet.
Recommandation : Élaborer des recommandations spécifiques sur la rédaction des supports promotionnels des opioïdes par les laboratoires (constitution d'un cahier des charges, mention explicite des risques de dépendance et de comorbidité, et des indications de prescription en première et deuxième intention établies par les autorités sanitaires).
b) Une politique active de pharmaco- et d'addictovigilances
La France peut également s'appuyer sur une politique active de pharmacovigilance et d'addictovigilance, coordonnée par l'ANSM154(*).
• Comme l'indiquent les CEIP-A dans leur réponse au questionnaire des rapporteures, l'addictovigilance a « pour objectif la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'abus, d'usage détourné et de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives à l'exception de l'alcool éthylique seul et du tabac »155(*). Elle repose sur un réseau de 13 centres156(*), qui consolident les signalements émanant principalement de médecins, de pharmaciens, de structures spécialisées et des établissements de santé, auxquels il est fait obligation de reporter tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné157(*). Les auxiliaires médicaux peuvent également être amenés à réaliser de tels signalements. Au surplus, les exploitants sont tenus de déclarer à l'ANSM tout cas grave de pharmacodépendance ou d'usage détourné d'un de leurs produits158(*). Ceux-ci mènent aujourd'hui, en lien avec les CEIP-A, des « suivis spécifiques et renforcés de pharmacodépendance et d'addictovigilance de certains opioïdes (analyses régulières des données françaises : revue de la littérature, surveillance des cas d'abus et de dépendance, usage détourné, mésusage, analyse de cas graves...) »159(*).
L'addictovigilance vise à recenser et quantifier les situations problématiques le plus tôt possible, avant qu'elles ne puissent poser un problème de santé publique majeur. En ce sens, les CEIP-A sont fondés « à alerter les autorités sanitaires et à informer les professionnels de santé, et dans certains cas, les populations ciblées pour minimiser les risques pour la santé publique »160(*).
Le réseau des CEIP-A a développé de nombreux outils pharmacoépidémiologiques, reposant sur diverses enquêtes161(*). Complétées par le dispositif TREND/SINTES de l'OFDT, celles-ci donnent aux autorités sanitaires une vision dynamique et complète de l'évolution de la pharmacodépendance, qui constitue un atout remarquable afin d'adapter les politiques de santé publique en temps réel.
Selon la SFETD, « la France a observé le phénomène aux USA et a adapté sa stratégie de pharmaco-surveillance de ces médicaments via son réseau d'addictovigilance » en renforçant ses prérogatives. L'élargissement des prérogatives des CEIP-A ne s'est toutefois pas véritablement accompagné d'un redimensionnement de leurs moyens : le réseau dispose aujourd'hui de moins de 30 équivalents temps plein (ETP) sur 13 centres pour mener à bien ses missions. Le réseau estime ainsi être aujourd'hui « sous-dimensionné pour mener à bien l'ensemble de ses missions », qui plus est alors que « le panorama des substances psychoactives s'est diversifié et amplifié »162(*).
La politique active en matière d'addictovigilance est, de l'avis des rapporteures, un enjeu décisif afin de garantir une gestion dynamique et en amont des problématiques de santé publique pouvant découler des abus de médicaments opioïdes. Ce dispositif national, unique en Europe par sa structuration et sa capacité d'alerte, a permis la détection précoce de signaux préoccupants, tels que l'augmentation des cas de mésusage de tramadol ou les détournements de certaines formes transdermiques de fentanyl. Le Cnop estime qu'il convient de « maintenir et promouvoir les programmes observationnels d'addictovigilance »163(*) conduits par les CEIP-A.
En ce sens, les rapporteures estiment qu'il est prioritaire que le réseau des CEIP-A, dont le travail de qualité est la clé de voûte du système, puisse disposer des moyens humains nécessaires pour mener à bien l'ensemble de ses missions. Les CEIP-A doivent, en outre, faire preuve d'une vigilance particulière afin d'analyser les substances nouvellement introduites sur le territoire national et de suivre l'évolution des consommations qui en découlent. Une politique plus active en matière de testing des substances en circulation pourrait notamment susciter des notifications accrues aux CEIP-A pour leur permettre d'analyser de manière plus dynamique les évolutions des produits consommés, d'étudier leurs impacts sur la santé et d'alerter les pouvoirs publics aussi précocement que possible.
Une telle politique de testing a déjà été mise en oeuvre, par exemple dans la Halte soins addictions de Paris : elle pourrait être étendue à l'avenir à d'autres structures de soins et de réduction des risques comme les Caarud.
Recommandation : Consolider le réseau national d'addictovigilance en renforçant les moyens humains à la disposition des CEIP-A et développer des dispositifs d'analyse des substances permettant d'évaluer précocement les évolutions des produits et leurs conséquences sur la santé humaine.
• La pharmacovigilance a, quant à elle, pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et préparations164(*). Elle est pilotée par l'ANSM, assistée par un réseau de 31 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), qui collectent les cas d'effets indésirables que doivent déclarer les professionnels médicaux et pharmaciens ainsi que les exploitants, et que peuvent déclarer les autres professionnels de santé, les patients et leurs associations agréées165(*). En particulier, les exploitants, considérés comme responsables du bon usage de leurs spécialités166(*), sont tenus de mettre en oeuvre différents dispositifs, listés par le Leem dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteures :
« - la surveillance des effets indésirables et des situations spéciales (collecte, enregistrement et déclaration aux autorités de santé) ;
- la détection de signal (qualitative et quantitative et dont l'augmentation anormale des ventes fait partie) ;
- le plan de gestion de risques ou PGR (caractériser, quantifier, prévenir ou minimiser les risques d'un médicament, obtenir des informations manquantes) ».
Les CRPV signalent à l'ANSM les effets indésirables marquants recensés, soit parce qu'ils sont inattendus, soit parce qu'ils surviennent chez des personnes à risque. Ils signalent également les erreurs médicamenteuses marquantes, et les usages médicamenteux non conformes. Cela permet de quantifier et de qualifier le mésusage et de « recueillir les informations nécessaires à l'évaluation de leur impact en termes de santé publique, afin de mettre en place les mesures adaptées pour prévenir ou réduire cet usage »167(*).
Enfin, comme le rappelle l'ANSM, « les médicaments opioïdes font par ailleurs tous l'objet d'une surveillance européenne au travers des PSURs »168(*).
2. Un encadrement rigoureux des conditions de prescription et de délivrance des médicaments opioïdes, récemment resserré
Les autorités sanitaires doivent maintenir un juste équilibre entre la garantie de l'accès aux antalgiques pour les patients dont la douleur le justifie, et un encadrement suffisant de la prescription et de la dispensation de ces derniers afin de limiter les mésusages et les troubles de l'usage.
L'exemple américain a bien montré les conséquences d'une politique qui penche excessivement d'un côté ou de l'autre de cette ligne de crête sur laquelle il faut cheminer. D'abord, un encadrement et un suivi insuffisant de la consommation d'opioïdes ont engendré une politique massive de surprescription auprès des patients, laquelle a suscité une épidémie de pharmacodépendance au sein de la population. Ensuite, le resserrement soudain des conditions de prescription, sans accompagnement suffisant des patients, a précipité les patients pharmacodépendants vers le sevrage ou le marché de rue, tout en limitant excessivement l'accès à la prise en charge de la douleur pour le flux de nouveaux patients nécessitant des antalgiques.
En France, l'encadrement de la prescription et de la délivrance des médicaments opioïdes s'est renforcé lors des dernières années. Il repose sur quatre piliers : la limitation de la durée maximale de prescription, le développement des ordonnances sécurisées ou numériques, le contrôle et l'accompagnement des prescripteurs, et l'encadrement de la dispensation.
Les mesures mises en oeuvre à ce jour semblent garantir un équilibre adéquat entre accès aux opioïdes et limitation des risques, même si les récentes mesures d'encadrement devront faire l'objet d'une évaluation d'impact rigoureuse.
a) Le resserrement des conditions de prescription et l'encadrement de la durée de prescription
Les autorités sanitaires ont récemment souhaité soumettre l'ensemble des spécialités contenant des opioïdes à prescription préalable et encadrer quasi systématiquement la durée de prescription de ces médicaments, afin de lutter contre les risques de pharmacodépendance et d'usages détournés.
D'abord, depuis 2017, aucune spécialité opioïde ne peut être délivrée sans prescription médicale préalable. Un arrêté169(*) a notamment soumis la codéine à une prescription obligatoire, y compris les médicaments vendus sous forme de sirop. Cette mesure faisait suite « à l'identification de nombreux cas d'abus et d'usage détournés de ces médicaments en particulier chez des adolescents et de jeunes adultes »170(*), dans un contexte marqué par l'essor de la lean.
De plus, les autorités sanitaires ont entendu encadrer la durée de prescription maximale des médicaments opioïdes. En effet, selon le professeur Benjamin Rolland, « de nombreuses études suggèrent que plus les prescriptions d'opioïdes durent dans le temps, plus elles sont inefficaces, et plus elles exposent à des risques d'addiction »171(*).
• D'une part, les antalgiques opioïdes de palier 3 relèvent172(*) du régime des substances stupéfiantes173(*). Il s'agit, notamment, du fentanyl, de la morphine, de la méthadone ou de l'oxycodone174(*).
Ce régime induit une limitation de la durée de prescription : en effet, il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants « pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours »175(*). Sur décision du directeur général de l'ANSM, la durée maximale de prescription de certains médicaments classés comme stupéfiants peut être abaissée en dessous de ce seuil176(*) : le fentanyl voit sa prescription limitée à sept jours177(*), tout comme certaines spécialités morphiniques ou les spécialités d'oxycodone par voie injectable. Une spécialité de surfentanil voit même sa durée de prescription limitée à deux jours178(*).
• D'autre part, les médicaments opioïdes ne relevant pas du régime des stupéfiants sont toutefois inscrits sur les listes I et II179(*) des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique : il s'agit en effet de médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé, ou contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale.
Or, comme le rappelle le Cnop, il ressort de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique que « certains médicaments antalgiques relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumis en totalité ou en partie au régime particulier des stupéfiants par décision du directeur général de l'ANSM ».
Aussi, face aux risques de mésusage et de pharmacodépendance constatés, l'ANSM a souhaité limiter, à compter du 15 avril 2020, à douze semaines la durée maximale de prescription des médicaments contenant du tramadol180(*), seul ou en association181(*).
Plus récemment, depuis le 1er mars 2025182(*), l'ANSM a souhaité appliquer cette même limitation aux spécialités à base de codéine ou de dihydrocodéine183(*). L'agence indique avoir été motivée par « la persistance des cas de mésusage (abus, surdosage) [et] de dépendance », malgré les mesures déjà mises en oeuvre comme la prescription obligatoire.
Afin d'accompagner les médecins face aux nouvelles modalités de prescription184(*), « une lettre aux professionnels de santé (DHPC) a été envoyée le 2/12/2024 à tous [les] médecins (toutes spécialités médicales), libéraux et hospitaliers (exerçant en établissements de santé publics ou privés), chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage- femmes et pharmaciens d'officine et hospitaliers (PUI). Elle rappelle les nouvelles modalités de prescription, les conduites à tenir par les prescripteurs et les pharmaciens, les mises en garde et mesures de prudence. »185(*)
Ainsi, selon l'ANSM, à ce jour « peu de médicaments opioïdes ne disposent pas de durée maximale de prescription : il s'agit des spécialités à base d'opium, de la nalbuphine et d'une spécialité à base de buprénorphine (TEMGESIC) ».
Toutefois, de nouvelles réductions des durées maximales de prescription ne semblent, à ce stade, pas opportunes selon le Cnop.
Certains acteurs auditionnés comme la Cnam souhaiteraient toutefois aller plus loin sur la question et « n'autoriser que la prescription d'une durée minimale (sic) pour un médecin non désigné et de n'autoriser qu'un nombre limité de recours à un médecin ou pharmacien non désigné ». Les rapporteures estiment toutefois qu'une telle solution présenterait un risque excessif pour l'accès aux soins, dans un contexte où le nomadisme médical est parfois contraint pour des assurés sans médecin traitant ou habitant dans des zones sous-denses, et ne la retiennent donc pas, à ce stade, comme recommandation.
• Compte tenu du resserrement des conditions de prescription des opioïdes, il semble nécessaire de renforcer le suivi spécialisé pour les patients les plus exposés aux risques de pharmacodépendance afin d'évaluer les risques encourus au-delà de la durée maximale de primo-prescription. Ce suivi apparaît d'autant plus nécessaire dans un contexte marqué par l'insuffisance de la formation des professionnels de santé à l'addictologie et à la prise en charge de la douleur186(*) et par la méconnaissance des risques associés aux opioïdes par les patients. Cela concerne également les patients dont le traitement prévoit une posologie particulièrement lourde.
Les rapporteures estiment donc opportun de prévoir une évaluation systématique, par un professionnel spécialiste de la douleur ou de l'addictologie ou dûment formé à ces sujets, de chaque patient au-delà de trois mois de traitement ou en cas de prise journalière supérieure à l'équivalent de 120 mg de morphine. Cette évaluation est également soutenue par divers acteurs auditionnés, sous des modalités parfois légèrement différentes : le Cnop, la SFETD187(*) et Evelyne Renault-Tessier188(*) préconisent par exemple des solutions similaires.
Une telle consultation permettrait, pour les patients, de recevoir une information fiable et systématique à un moment charnière des traitements antalgiques opioïdes, au cours duquel se manifestent fréquemment les premiers signes de pharmacodépendance. Elle ferait bénéficier les patients d'un regard spécialisé sur la question de la prise en charge de la douleur ou de l'addiction, qui permettrait d'amender la stratégie thérapeutique si besoin, et favoriserait la détection des premiers signes de pharmacodépendance ou de mésusage afin de pouvoir agir précocement.
Selon les données de la SFETD, 24 % des patients traités par tramadol ou codéine le sont depuis plus de 3 mois et bénéficieraient, demain, d'une consultation spécialisée.
Recommandation : Systématiser l'évaluation par un médecin spécialiste ou formé à la prise en charge de la douleur ou à l'addictologie au-delà de 3 mois de traitement ou en cas de prise d'une dose journalière supérieure à l'équivalent de 120 mg de morphine.
b) Le déploiement progressif des ordonnances sécurisées et numériques
Face au phénomène de fausses ordonnances, renforcé par les mésusages associés aux opioïdes et les trafics de rue qui les impliquent, l'ANSM a récemment souhaité renforcer la sécurité des ordonnances pour des opioïdes.
L'utilisation d'ordonnances falsifiées constitue un phénomène particulièrement préoccupant, notamment pour les opioïdes de palier 2. De telles ordonnances mettent à mal la sécurité sanitaire des patients en modifiant les produits ou posologie prescrits ou en altérant les assurés bénéficiaires. Elles dégradent également la sécurité publique en nourrissant des trafics violents lorsque leur objectif est d'approvisionner le marché de rue.
Selon l'enquête OSIAP, menée par les CEIP-A, les médicaments opioïdes, surtout ceux de palier 2, sont particulièrement impliqués dans les fausses ordonnances :
- le tramadol, seul ou en association, est impliqué dans 15,6 % des signalements en 2023 ;
- les spécialités antitussives à base de codéine représentent 11,9 % des signalements la même année ;
- les spécialités antalgiques codéinées constituent quant à elle 9,2 % des cas observés.
Tramadol et codéine représentent donc, à eux seuls, plus du tiers des cas suspects recensés par l'enquête OSIAP.
Le phénomène de falsification des ordonnances d'opioïdes alarme d'autant plus les pouvoirs publics qu'il se développe progressivement. En effet, « les données de l'OSIAP montrent qu'entre 2019 et 2023, il y a une tendance à la hausse des ordonnances suspectes pour le tramadol et la codéine, seuls ou en association. De plus, le taux de détournement du fentanyl transdermique, du tramadol et de l'oxycodone est en augmentation depuis 2021 »189(*).
En août 2024, la Cnam a complété les efforts mis en oeuvre par le réseau des CEIP-A avec la mise en oeuvre du téléservice Alerte sécurisée aux fausses ordonnances (Asafo), visant à recueillir au niveau national les ordonnances falsifiées auprès de toutes les officines. Selon la Cnam, 5 000 ordonnances transmises à ce jour ont été confirmées comme frauduleuses par les prescripteurs.
Les opioïdes figurent, là encore, en bonne position dans les signalements Asafo : tramadol, sirops codéinés et buprénorphine se placent tous trois dans les vingt médicaments les plus touchés.
Fausses prescriptions d'opioïdes confirmées signalées à Asafo
Source : Cnam
Face à ce phénomène, les autorités sanitaires ont souhaité étendre le déploiement des ordonnances sécurisées et numériques.
• Depuis le 22 décembre 2023, les ordonnances dématérialisées sont, en principe, le mode privilégié pour effectuer une prescription médicamenteuse190(*). Ces ordonnances, établies via les LAP référencés au moyen d'un téléservice fourni par la Cnam191(*), sont imprimées et remises au patient. Il n'existe en effet aujourd'hui pas de procédure entièrement numérique, permettant une transmission directe du prescripteur au pharmacien sans besoin du concours du patient. Les ordonnances dématérialisées font figurer un QR Code comportant un numéro unique de prescription, qui peut être lu par le pharmacien à l'aide de son LAD référencé.
L'ordonnance numérique répond à l'enjeu de sécurisation des ordonnances d'opioïdes puisque le QR Code à scanner est particulièrement difficile à imiter pour les faussaires, celui-ci n'étant généré que sur prescription médicale.
• Toutefois, les professionnels ne sont, dans certains cas, pas tenus de procéder par voie dématérialisée192(*), notamment lorsque le téléservice est indisponible ou la connexion internet insuffisante. L'obligation de recourir à la prescription dématérialisée ne s'applique pas non plus aux prescriptions établies et exécutées au sein des établissements de santé193(*) et des hôpitaux des armées194(*).
Dans les faits, la pénétration des ordonnances dématérialisées en ville reste aujourd'hui perfectible.
Pour limiter les risques de falsification d'ordonnance lorsqu'ils ne recourent pas à une ordonnance dématérialisée, les prescripteurs sont invités à réaliser des ordonnances dites sécurisées.
Les ordonnances sécurisées sont des ordonnances « répondant à des spécifications techniques »195(*) particulières, visant à faire obstacle à leur falsification. Elles mentionnent « en toutes lettres le dosage, la posologie et la durée de traitement »196(*) et sont imprimées par un éditeur agréé197(*) sur un papier filigrané sans azurant optique, avec des mentions pré-imprimées en bleu faisant notamment figurer le nom et le contact du prescripteur, et un carré en micro-lettres dans lequel doit être inscrit le nombre de spécialités prescrites.
Ces ordonnances sont donc considérablement plus difficiles à falsifier que les ordonnances standard. C'est pourquoi leur recours est obligatoire, de longue date, pour les stupéfiants.
La Cnam indique toutefois que « le dispositif d'ordonnance sécurisée papier rend plus difficile la fraude, sans réduire le risque à zéro. Il est possible pour des fraudeurs de contourner le dispositif en volant un carnet d'ordonnances sécurisées au cabinet d'un médecin ou en volant des blocs d'ordonnances sécurisées dans une imprimerie ou lors de leur transport »198(*).
Faisant usage de la possibilité199(*) de soumettre ces produits à tout ou partie du régime des stupéfiants, l'ANSM a étendu, au 1er mars 2025, aux spécialités contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine l'obligation de recourir à une ordonnance sécurisée en cas d'impossibilité de fournir une ordonnance dématérialisée200(*).
Par conséquent, la délivrance de tous les opioïdes sur le marché est aujourd'hui soumise à la présentation d'une ordonnance sécurisée201(*), à l'exception de la nalbuphine et de la poudre d'opium associée au paracétamol, le cas échéant avec de la caféine.
Cette décision a reçu un accueil mitigé : s'il s'agit selon la SFETD d'une « bonne idée en théorie »202(*), des craintes existent que l'obligation de recourir à une ordonnance sécurisée ne conduise à « une diminution des prescriptions, devenues trop contraignantes », provoquant un déport vers les derniers opioïdes non concernés ou « une prise en charge insuffisante de certaines douleurs ».
En outre, un observatoire de suivi a été mis en place par l'ANSM et la Cnam afin de suivre l'évolution des consommations des spécialités à base de tramadol et codéine, seuls ou en association et d'évaluer le report vers d'autres spécialités.
Les rapporteures saluent cette initiative, qui devrait permettre d'identifier précocement tout risque généré par l'extension aux opioïdes de palier 2 de l'obligation de recours à une ordonnance sécurisée.
Les rapporteures estiment que le risque lié aux falsifications d'ordonnances ne saurait être sous-estimé. Par conséquent, elles préconisent, sous réserve que l'instauration de l'obligation d'ordonnance sécurisée pour les opioïdes de palier 2 ne se traduise pas par un déport excessif vers la poudre d'opium ou par une moindre prise en charge de la douleur, d'envisager de soumettre dans un second temps l'ensemble des opioïdes à une telle obligation.
Recommandation : Évaluer l'impact de l'obligation de recourir à des ordonnances sécurisées pour le tramadol et la codéine et, le cas échéant, envisager de soumettre l'ensemble des opioïdes à une obligation d'ordonnance sécurisée.
Les rapporteures partagent toutefois l'analyse du professeur Benjamin Rolland, qui rappelle que « dans le passé, la sécurisation des prescriptions de certains médicaments à risque addictif a entrainé une diminution des prescriptions, et notamment des prescriptions à haut dosage, même si cela n'a pas non plus constitué une solution miraculeuse aux problèmes de mésusage et de détournement. Cela a été notamment le cas pour le zolpidem (Aquizerate et al. 2023) ou plus récemment pour la prégabaline (de Ternay et al., 2025) »203(*).
Les rapporteures estiment également, comme la SFETD ou le Cnop, que le déploiement plus large des ordonnances dématérialisées constitue une solution plus efficace et entraînant moins d'effets de bord que l'extension de l'ordonnance sécurisée.
Elles ne soutiennent donc l'extension du champ des ordonnances sécurisées que de façon subsidiaire et estiment que le développement du recours aux ordonnances dématérialisées doit être la priorité des pouvoirs publics partout où cela est possible.
En particulier, les rapporteures recommandent d'accélérer le calendrier de déploiement d'un dispositif de prescription entièrement numérique, qui ne requière plus l'impression des ordonnances par le médecin. Une telle mesure évitera de faire transiter les prescriptions par le patient, avec des risques de vols ou de pertes associés.
Il est précisé que cette évolution ne viendrait nullement aggraver la fracture numérique : l'ordonnance papier restera disponible pour tous les cas dans lesquels le recours à l'ordonnance numérique ne serait pas possible ou pas souhaitable.
Un travail de pédagogie auprès des professionnels de santé apparaît aussi indispensable afin que chacun puisse s'approprier ces nouveaux outils.
Recommandation : Accélérer le calendrier de déploiement d'un dispositif de prescription entièrement numérique partout où cela est possible.
c) Une politique de sensibilisation et de contrôle accrus des prescripteurs
Afin de lutter contre la sur-prescription d'opioïdes et de renforcer l'information des professionnels sur les risques associés à ces médicaments, la Cnam a récemment mis en oeuvre certaines mesures de contrôle et de sensibilisation.
Afin de pallier toute forme d'« opioïdo-centrisme » dans la gestion de la douleur, la nouvelle convention médicale 2024-2029 conclue le 4 juin 2024204(*) fait figurer l'engagement de « limiter le recours aux analgésiques de niveau 2 à risque de dépendance »205(*), notamment le tramadol et la codéine. Un objectif chiffré a été fixé dès 2025, avec une réduction de 10 % du volume de boîtes par rapport à 2023.
Cet objectif conventionnel se double d'un renforcement des politiques de contrôle de la Cnam. Celle-ci utilise les bases de données de remboursement pour identifier les patients excessivement consommateurs de médicaments « considérés comme à risque de mésusage et de trafics »206(*). La liste, actualisée chaque année, fait notamment figurer de nombreux opioïdes : « buprénorphine, méthadone, morphine, codéine, dihydrocodéine, fentanyl, oxycodone, tramadol »207(*).
Lorsqu'un médecin prescrit des doses excessives pour un même assuré, « un contrôle médicalisé est réalisé par le service du contrôle médical de l'assurance maladie pour normaliser le traitement »208(*), en s'appuyant sur un protocole de soins.
Lorsque plusieurs assurés sont concernés par des surprescriptions émanant d'un même médecin, « une analyse de son activité [est] déclenchée par le service du contrôle médical. En cas de confirmation de pratiques inappropriées, des actions contentieuses seront engagées (action ordinale, voire pénale si suspicion de contribution à un trafic de médicaments). »209(*)
d) Le renforcement de l'encadrement des conditions de dispensation des antalgiques opioïdes
La dispensation des médicaments opioïdes fait également l'objet d'un encadrement strict, qui découle à la fois de mesures de droit commun et de mesures spécifiques aux médicaments stupéfiants ou assimilés.
Avant toute chose, comme le rappelle le Cnop, « conformément à l'article R. 4235-61 du code de la santé publique, lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance ».
Au-delà de ce cadre global, différentes obligations s'appliquent sur la délivrance de médicaments stupéfiants.
Il y a, d'une part, un encadrement de la temporalité de la délivrance. Pour les médicaments stupéfiants ou soumis à cette réglementation, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou dans la totalité de la fraction de traitement que dans les trois jours210(*) suivant son établissement, on parle de « délai de carence »211(*). Par dérogation, lorsqu'un médicament stupéfiant est prescrit en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance doit être présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et le troisième jour suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.
La délivrance peut également être fractionnée212(*) pour certains médicaments stupéfiants ou assimilés. Tel est par exemple le cas de certaines spécialités de buprénorphine ou du fentanyl transdermique.
3. Des normes perfectibles relatives au conditionnement et à l'étiquetage des médicaments opioïdes
Si les conditions de prescription et de délivrance, récemment resserrées, apparaissent perfectibles mais globalement de nature à ménager un équilibre entre encadrement et accès aux soins, des marges d'amélioration considérables subsistent concernant le conditionnement et l'étiquetage des antalgiques opioïdes.
a) Des évolutions à envisager concernant le conditionnement
• Le conditionnement des antalgiques opioïdes constitue un enjeu décisif afin de lutter contre les mésusages. Des conditionnements inadaptés aux posologies recommandées entraînent en effet la constitution de stocks de boîtes entamées mais non finies de médicaments opioïdes dans les armoires à pharmacie familiales, de nature à accroître les risques d'automédication et de partages de traitement213(*). De trop gros conditionnements renforcent également les risques d'utilisation prolongée, et donc d'abus et de pharmacodépendance.
Prévoir des petits conditionnements pourrait également être pertinent « dès l'initiation du traitement »214(*) selon le Cnom, non seulement afin d'éviter la constitution de stocks, mais également afin de prévenir les cas où le traitement, inadapté, doit rapidement être réévalué. À ce sujet, la docteure Evelyne Renault-Tessier propose également de « permettre la délivrance sur des courtes durées, sans délivrer toute la boite »215(*).
Or les auditions ont mis en évidence qu'un certain nombre de médicaments antalgiques opioïdes disposaient de conditionnements trop volumineux par rapport aux posologies recommandées, ce qui doit entraîner une réflexion des autorités sanitaires afin d'agir conjointement avec les industriels pour revoir à la baisse les conditionnements des médicaments concernés.
Ce travail a déjà débuté : sur demande de l'ANSM, des conditionnements de tramadol de petite contenance ont été mis en vente en janvier 2023. Ces derniers, contenant 10 ou 15 comprimés ou gélules, apparaissent en effet mieux adaptés à des traitements de courte durée. En parallèle, les plus gros conditionnements restent disponibles pour les traitements sur le long cours. Comme l'indique l'ANSM, « les pharmaciens sont tenus de délivrer les conditionnements des médicaments adaptés à la prescription, et donc les petits conditionnements de tramadol lorsque les prescriptions de ces médicaments sont établies pour de courtes durées »216(*).
Les efforts conjoints de l'ANSM et des industriels afin d'adapter les conditionnements en fonction des posologies recommandées doivent maintenant être étendus à d'autres spécialités. Cela permettrait, selon le Cnop, d'« ajuster au mieux la dispensation aux besoins du patient »217(*).
Selon le Cnop, le conditionnement de l'Ixprim, une spécialité associant tramadol et paracétamol vendue par boîtes de vingt comprimés, « est inadapté aux posologies recommandées »218(*). La même remarque prévaut pour le Dafalgan codéiné, une spécialité associant codéine et paracétamol vendue par seize gélules.
Les rapporteures, convaincues que l'enjeu du conditionnement ne doit pas être sous-estimé afin de combattre les risques de mésusage, recommandent donc de poursuivre le travail engagé pour diminuer les conditionnements lorsque ceux-ci sont trop volumineux par rapport aux posologies recommandées.
Recommandation : Travailler sur le conditionnement des médicaments opioïdes pour réduire le nombre de comprimés par boîte lorsque le conditionnement ne correspond pas aux posologies recommandées.
Enfin, comme l'indique la docteure Evelyne Renault-Tessier, il pourrait être opportun de développer un système afin de « rapporter les médicaments en surnombre avec un circuit de récupération »219(*) afin de limiter la constitution de stocks de médicaments vénéneux au domicile des patients pour limiter les risques d'automédication et de prise accidentelle de médicaments opioïdes.
• Au-delà de la question de la taille des boîtes, il existe un enjeu de différenciation des conditionnements en fonction de la concentration en opioïdes pour certains médicaments. Les patients pourraient en effet être amenés à confondre des médicaments dont le conditionnement serait trop similaire malgré des différences de dosage parfois significatives, pouvant impacter la sécurité du traitement. La docteure Evelyne Renault-Tessier note par exemple que les dosettes d'Oramorph, une spécialité à base de sulfate de morphine, contiennent 5 millilitres de liquide quelle que soit la quantité de substance active, ce qui peut mener à des confusions. Celles-ci peuvent être d'autant plus sérieuses que la concentration varie de 10 à 100 milligrammes, soit un facteur dix.
b) Des marges de progression en matière d'étiquetage
Face aux carences observées dans la connaissance des risques associés aux antalgiques opioïdes, l'étiquetage des médicaments est susceptible de favoriser la diffusion de l'information auprès des patients. L'ANSM fait à ce titre remarquer que « comme le rappelle la jurisprudence récente des juridictions administratives et judiciaires, l'étiquetage d'un médicament joue un rôle majeur en tant que vecteur d'information pour les patients et les utilisateurs »220(*).
Confrontée à la crise des opioïdes, la food and drug administration (FDA) américaine a ainsi « imposé dès 2016 un encadré de type "black box warning" sur les notices et conditionnements des opioïdes, mettant en garde contre les risques de dépendance, de surdose et de décès, notamment en cas d'association avec d'autres dépresseurs du système nerveux central »221(*).
En Australie, un étiquetage similaire222(*) est désormais obligatoire sur tous les opioïdes délivrés en pharmacie.
En France, les travaux sur le sujet ne font que débuter.
Tenant compte des risques particuliers associés à cette substance, et dans le contexte de la crise américaine du fentanyl, une mention d'alerte indiquant : « La prise accidentelle de ce médicament peut être dangereuse voire même mortelle » est désormais apposée sur les boîtes de fentanyl transmuqueux, depuis octobre 2021, et transdermique, depuis décembre 2022.
En coopération avec le Leem, l'ANSM entend désormais procéder à l'ajout d'une mention d'alerte sur les spécialités contenant du tramadol, de la codéine. Cette évolution « devrait entrer en vigueur en 2026 »223(*), selon le Leem.
L'encadré d'alerte fera figurer, dans tous les cas, la mention « Risque d'addiction et de surdosage dangereux ». Sa forme diffèrera selon que la spécialité contient l'opioïde seul, ou en association avec du paracétamol. Cela s'explique par l'enjeu de pédagogie spécifique à conduire pour les spécialités associées à du paracétamol : les patients concernés sont particulièrement peu nombreux à savoir qu'ils consomment des opioïdes, et le paracétamol est une molécule dont la prise est banalisée dans la population, malgré les risques associés en cas de surdose. Cela explique que l'étiquetage des spécialités contenant du paracétamol fasse déjà figurer une mention d'alerte sur le risque de surdosage.
Mention d'alerte affichée pour les
spécialités à base de tramadol
ou de codéine
seule ou en association à une autre substance
que le
paracétamol à compter de 2026
Source : ANSM
Mention d'alerte affichée pour les spécialités à base de tramadol ou de codéine en association avec du paracétamol à compter de 2026
Source : ANSM
Si aucun projet n'est finalisé à ce stade, l'ANSM fait noter qu'elle a « d'ores et déjà engagé des travaux relatifs à l'apposition de messages d'alertes sur l'ensemble des opioïdes « forts » (du palier III) »224(*).
Il semble que l'ensemble des parties prenantes se soient montrées plutôt favorables à une telle mesure : il revient donc désormais à l'ANSM « d'engager une procédure contradictoire en vue de pouvoir procéder à la modification des AMM des spécialités concernées avec les laboratoires titulaires de ces AMM »225(*), et de définir plus précisément la mention d'alerte à afficher.
Les rapporteures estiment qu'il serait bienvenu, et même indispensable, de renforcer l'information des patients sur le risque de dépendance en affichant clairement une mention de ce risque pour l'ensemble des spécialités contenant des opioïdes. Elles soutiennent donc le travail engagé par l'ANSM en concert avec les industriels, et souhaitent que celui-ci aboutisse le plus rapidement possible.
Recommandation : Faire apparaître une mention du risque de dépendance sur les boîtes de médicaments opioïdes, y compris de palier 2.
B. UNE MAÎTRISE DES RISQUES CONDITIONNÉE À UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
1. Une restriction de l'accès aux opioïdes non accompagnée comporterait un risque accru de détournements et de mésusages
a) Un risque de transmission de la demande du marché légal au marché illégal
• Aux États-Unis, la deuxième vague de la crise des opioïdes, au début des années 2010, trouve son origine dans le déclenchement d'une régulation plus stricte par la FDA des pratiques de prescription de certains médicaments opioïdes, en particulier l'oxycodone. Les nombreux patients devenus dépendants à ces substances se sont, dans un délai très court, retrouvés dépourvus de traitement et sans solution de substitution, n'ayant pas accès aux TAO.
Les patients se sont alors tournés vers l'héroïne de rue et, rapidement, vers des opioïdes synthétiques beaucoup plus puissants, en particulier le fentanyl et le carfentanyl226(*). La consommation de ces substances achetées sur le marché noir a conduit à une augmentation sensible du nombre d'overdoses mortelles, qui a quasiment doublé entre 2005 et 2016 pour atteindre environ 63 000 décès, dont les deux tiers sont dus aux opioïdes227(*). Cette phase est identifiée comme la troisième vague de la crise des opioïdes.
Le Canada a connu une situation comparable. En 2016, le pays est devenu le deuxième consommateur d'opioïdes au monde, après les États-Unis. Pourtant, à partir de 2011, les autorités politiques canadiennes ont pris des mesures pour encadrer la disponibilité des médicaments opioïdes, qui se sont traduites par une forte diminution des prescriptions. Il s'est ensuivi un développement de la circulation illégale des opioïdes, détournés ou produits clandestinement, directement corrélée à la régulation du marché légal. C'est dans ce contexte que le gouvernement canadien a modifié son approche, en adoptant en 2016 la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, notamment axée sur la réduction des risques. Diverses mesures ont permis, dans ce cadre, de faciliter l'accès aux TAO et à la naloxone (cf. infra).
• En France, le risque de report des consommateurs d'opioïdes vers le marché illégal, en cas de restriction excessive des conditions d'accès aux opioïdes légaux, est mis en avant par plusieurs experts.
La sociologue Marie Jauffret-Roustide met ainsi en garde contre les éventuelles conséquences non anticipées du passage à une prescription sur ordonnance sécurisée pour le tramadol et la codéine228(*). Selon la Fédération Addiction, premier réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie, une telle obligation est susceptible d'« engendrer des réactions défensives ou d'évitement de la part des prescripteurs » conduisant à « un moindre accès aux antalgiques opioïdes pour les personnes qui en ont légitimement besoin »229(*). Sur la même ligne, l'association de réduction des risques ASUD signale que les conséquences du passage des médicaments contenant de la codéine en prescription obligatoire depuis 2017 n'ont jamais été évaluées, en particulier l'effet report vers le marché illégal.
En effet, ces dernières années, la France a plutôt fait le choix d'un encadrement renforcé des conditions de prescription et de délivrance des médicaments opioïdes : réduction des durées maximales de prescription du tramadol et de la codéine, obligation d'ordonnance sécurisée pour prescrire et délivrer ces mêmes produits, diminution du conditionnement des boîtes de certains antalgiques opioïdes, etc.
Si ces évolutions constituent des garde-fous utiles, il convient néanmoins de demeurer vigilant à ce que l'exigence d'un encadrement plus strict ne dérive pas en un durcissement contre-productif et inopportun des conditions d'accès aux antalgiques opioïdes. En effet, des traitements insuffisants ou inappropriés de la douleur tendent à augmenter les pratiques d'automédication des patients, de mésusages voire de substitution de médicaments obtenus dans un cadre légal par des opioïdes illicites ou vendus sur le marché noir.
À cet égard, le Groupe Santé Addictions alerte sur la situation des usagers ayant développé des troubles de l'usage ou une dépendance à un opioïde « qui, en l'absence de traitement adapté, risqueraient de se tourner vers des produits illicites, potentiellement contaminés par des opioïdes de synthèse. »230(*) Pour ces personnes particulièrement exposées au risque de l'approvisionnement illégal, le collectif préconise d'autoriser la prescription de buprénorphine à libération prolongée en ville.
• Si la France demeure relativement épargnée par ce phénomène de transmission de la demande d'opioïdes au marché illégal, c'est principalement parce qu'elle n'a pas connu les mêmes dérives de prescriptions dérégulées qu'aux États-Unis et en raison de la disponibilité relativement bonne de l'offre de TAO.
Toute régulation de l'accès aux médicaments opioïdes doit donc être pensée dans le cadre d'une politique plus globale de réduction des risques, incluant un accès aux TAO (cf. infra).
b) Un contexte préoccupant marqué par la baisse de la production mondiale d'héroïne et l'émergence des nouveaux opioïdes de synthèse
Les craintes relatives au détournement de certains usagers d'opioïdes par le marché illégal sont alimentées par une modification de la géographie mondiale de la production et de l'approvisionnement des drogues de synthèse, caractérisée par la baisse de la production d'héroïne et l'émergence concomitante de nouveaux opioïdes de synthèse.
• En avril 2022, la décision du régime des talibans en Afghanistan d'interdire la culture du pavot a conduit à un effondrement de la production mondiale d'héroïne. Avant cette décision, le pays, premier producteur mondial d'héroïne, concentrait environ 80 % de la production d'opium destinée principalement au marché européen.
Les espaces agricoles consacrés à la culture du pavot sont ainsi passés de 233 000 hectares à 10 800 hectares entre 2022 et 2023, tandis que sur la même période, la production chutait de 6200 tonnes à 333 tonnes, soit un effondrement de 95 % du niveau de production231(*).
Cultures et production d'opium en Afghanistan (1994-2023)232(*)
Source : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2023
Or la France constitue un débouché important pour le marché de l'héroïne en Europe de l'Ouest. Entre 2017 et 2023, l'expérimentation de l'héroïne a connu une forte progression, passant de 1,3 % de la population à 2 % chez les 18-64 ans233(*). On estime actuellement à 150 000 le nombre d'usagers d'héroïne en France.
Les routes de l'héroïne et des nouveaux opioïdes de synthèse
Les routes de l'héroïne
L'héroïne consommée en France est principalement acheminée depuis l'Afghanistan par la route des Balkans. Celle-ci traverse l'Iran et la Turquie avant d'entrer en Europe par la branche sud (Grèce, Albanie), la branche nord (Bulgarie, Roumanie) ou la branche centrale (Bulgarie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, jusqu'en Italie ou en Autriche).
D'autres itinéraires peuvent être empruntés entre l'Afghanistan et l'Europe, de façon secondaire : soit la route du Caucase qui traverse l'Iran, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, puis la Géorgie et enfin, la mer Noire pour atteindre la Bulgarie ou la Roumanie ; soit la route du Sud qui traverse également l'Iran, ou le Pakistan, poursuit jusqu'à la péninsule arabique en passant par le golfe d'Oman, ou jusqu'à l'Afrique de l'Est, d'où la drogue est acheminée par ferry vers les ports européens.
En Europe de l'ouest, les Pays-Bas et la Belgique constituent les principaux territoires de stockage et de redistribution de l'héroïne où viennent s'approvisionner les trafiquants et divers réseaux d'usagers-revendeurs.
Les routes des nouveaux opioïdes de synthèse
Les molécules des nouveaux opioïdes de synthèse sont majoritairement fabriquées en Chine et en Inde, secondairement en Russie. Si les routes de circulation et les chaines d'approvisionnement de ces produits demeurent encore méconnues, le darkweb semble tenir une place centrale dans leur diffusion. En raison de leur puissance pharmacologique, de petites quantités suffisent à fabriquer des centaines de pilules. Cette caractéristique autorise des envois par simple fret postal ou express, depuis la Chine et les États-Unis, contenant de quelques dizaines à plusieurs centaines de grammes par colis234(*).
Bertrand Monnet, professeur à l'Edhec et responsable de la chaire management des risques criminels, a mis en lumière le rôle des cartels mexicains dans le développement du marché des fentanyloïdes aux États-Unis235(*). Or ces cartels entretiennent aussi des liens avec les réseaux criminels implantés en Europe, avec l'objectif affiché de faire entrer les fentanyloïdes sur le marché européen236(*).
• Face aux tensions que cette situation suscite sur l'approvisionnement mondial en héroïne, les experts mettent en avant un risque de report des consommations vers les nouveaux opioïdes de synthèse (NOS) produits dans des laboratoires clandestins et aux effets beaucoup plus puissants que ceux des principes actifs qu'ils reproduisent.
Michel Gandilhon, chercheur à l'OFDT et membre du conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales rappelle qu'« une telle configuration s'est retrouvée dans les pays baltes confrontés à une pénurie [d'héroïne] en 2010, laquelle a été comblée par des opioïdes de synthèse »237(*). L'OFDT relève également que « le choc d'offre sur la production d'héroïne [...] est allé de pair avec l'essor des opioïdes de synthèse »238(*). Plus globalement, l'agence européenne des drogues (EUDA) considère qu'« une évaluation de la situation européenne actuelle suggère que les changements dans la disponibilité et l'utilisation des opioïdes synthétiques constituent une menace crédible pour la santé publique »239(*).
Les NOS présentent des caractéristiques intéressantes pour les laboratoires clandestins et les réseaux criminels, liées aux conditions de leur production et de leur transport : « Contrairement aux drogues à base de plantes, ces substances peuvent être fabriquées n'importe où, sans qu'il soit nécessaire de les cultiver à grande échelle, ce qui les rend plus faciles et moins chères à produire et à distribuer pour les trafiquants. »240(*) Ces caractéristiques s'appliquent notamment aux dérivés du fentanyl, « facile à fabriquer, peu cher et facile à transporter, ce qui favorise sa diffusion » par rapport à l'héroïne241(*).
Depuis 2008, l'OFDT a recensé quelques 368 nouveaux produits de synthèse, dont 35 depuis 2021, sur 897 répertoriés en Europe242(*).
• Les Pays-Bas et la Belgique sont identifiés comme des zones sensibles pour le trafic émergent de NOS en Europe243(*).
Si les routes de l'héroïne sont distinctes de celles des NOS, elles présentent néanmoins des points de convergence. En Europe, le territoire des Pays-Bas constitue un centre névralgique du trafic d'héroïne ; il concentre également des infrastructures techniques permettant de développer une production de NOS. De façon générale, les installations de découpe et de conditionnement des substances opioïdes sont, en Europe, plus fréquentes que les laboratoires de production, implantés de façon encore marginale.
• En conclusion, l'EUDA souligne dans son dernier rapport que « si elle se poursuit, la baisse de la production d'opium et d'héroïne en Afghanistan aura probablement une incidence sur la disponibilité de l'héroïne en Europe, bien qu'il soit difficile de prévoir quand cela se produira et quelles seront les conséquences dans les différents États membres de l'Union européenne »244(*).
Compte tenu, d'une part, de l'importance de la production d'héroïne et des stocks de pavot constitués ces dernières années, d'autre part, de l'explosion de la production de pavot en Birmanie, le risque d'une pénurie imminente d'héroïne n'apparaît que peu vraisemblable.
En effet, la Birmanie a depuis pris le relai, multipliant sa production par 2,5 en deux ans - de 423 tonnes en 2021, celle-ci est passée à 1080 tonnes en 2023 - et devenant ainsi le premier producteur mondial de pavot à opium245(*). Plus globalement, la région dite du triangle d'or (Laos, Birmanie, Thaïlande) constitue une importante zone géographique pour la production d'opium dans le monde.
À court terme, la principale conséquence de l'arrêt de la production en Afghanistan réside principalement dans l'augmentation du prix de l'héroïne, rendant de facto cette drogue moins accessible aux usagers.
c) Une progression toutefois encore limitée du marché illégal
Dans ce contexte mondial et européen préoccupant, le marché illégal des opioïdes, alimenté par la production illégale de substances synthétiques et semi-synthétiques et par le détournement de médicaments issus du circuit légal, semble relativement maîtrisé en France.
• En premier lieu, si la France ne semble pas exposée à des situations d'abus massifs de prescription, les détournements de médicaments et les falsifications d'ordonnances constituent l'un des modes d'approvisionnement qui favorisent l'accroissement des mésusages.
En France, les principaux médicaments faisant l'objet de détournements sont la buprénorphine (Subutex), les sulfates de morphine (Skénan) et la méthadone. La Mildeca, se basant sur les observations du Commandement pour l'environnement et la santé (CESAN), relève que « l'approvisionnement de ce trafic repose sur le nomadisme médical et pharmaceutique, facilité par l'usage de fausses ordonnances obtenues sur les réseaux sociaux ou Internet, ainsi que sur des vols commis chez les grossistes »246(*).
Le dispositif TREND de l'OFDT met en évidence l'importance du trafic de rue et des réseaux régionaux ou locaux de revendeurs dans la circulation illégale de certains médicaments opioïdes, en particulier le Subutex, le Skénan et la méthadone. Des réseaux internationaux existent également, comme en atteste le démantèlement en juin 2024 d'un trafic de fentanyl impliquant une filière géorgienne, qui avait mis à jour le recours à plus de 700 ordonnances dérobées ou falsifiées. La vente de médicaments en ligne prend également de l'ampleur. S'agissant du fentanyl pour lequel il ne semble pas exister de marché de rue bien établi, la circulation s'organiserait principalement via internet, sur le darkweb ou des groupes de messagerie cryptées.
Les opioïdes figurent dans le classement de tête des médicaments les plus concernés par les ordonnances frauduleuses. L'enquête Osiap et la base Asafo ont en effet démontré la place prépondérante qu'occupent les médicaments opioïdes dans les falsifications d'ordonnances (cf. supra). Rappelons en effet que le tramadol et la codéine analgésique représentent à eux seuls plus du tiers des médicaments concernés.
Si le fentanyl apparaît moins fréquemment impliqué (3,9 % des cas pour Osiap et 64e position dans la base Asafo), des professionnels de santé observent pourtant que sa consommation hors cadre thérapeutique est en augmentation. La HSA de Strasbourg fait ainsi remonter une utilisation croissante du fentanyl depuis quatre ans, en nombre d'usagers injecteurs, corrélativement à une baisse significative des autres produits opiacés (sulfates de morphine, héroïne, buprénorphine...)247(*).
L'augmentation du trafic de fausses ordonnances a conduit la Cnam à créer, en 2024, une unité de contrôle et d'investigation des fraudes émergentes qui lui est directement rattachée, et six pôles interrégionaux d'enquêteurs judiciaires. En collaboration étroite avec les services de police et de justice, les quelque 60 agents affectés dans ces pôles sont habilités à mener des enquêtes pour repérer, infiltrer et contribuer au démantèlement des fraudes en bandes organisées, notamment lorsqu'elles concernent des trafics de médicaments.
Dans la lutte contre le trafic illégal et les détournements de médicaments, ce nouveau dispositif vient compléter diverses mesures qui ont contribué, ces dernières années, à sécuriser le circuit du médicament (sérialisation, déploiement de la e-prescription, ordonnance obligatoire sécurisée pour le tramadol et la codéine, application ASAFO...).
• En deuxième lieu, la France apparaît aujourd'hui globalement préservée du développement du marché noir des nouveaux opioïdes de synthèse (NOS), comparativement aux États-Unis et à d'autres pays européens.
Parmi les NOS, les fentanyloïdes ou dérivés du fentanyl font l'objet d'une surveillance particulière des pouvoirs publics, au regard de leur implication dans la crise américaine des opioïdes et du nombre de décès qu'ils ont engendrés. Le cas récent d'importation de carfentanil par go-fast depuis les Pays-Bas en France (mars 2024) a remis en lumière l'existence d'un risque direct de pénétration du marché français.
Tous les experts s'accordent pourtant à dire que la prévalence du fentanyl illégal dans les usages de drogues demeure marginale en Europe, à l'exception des pays baltes : 34 fentanyloïdes avaient été identifiés en Europe en 2019, dont 10 en France248(*), la circulation de ces molécules transitant essentiellement sur le darkweb pour un marché encore confidentiel. Les dérivés du fentanyl ne suscitent à l'heure actuelle pas d'inquiétude forte chez les autorités sanitaires françaises, qui demeurent néanmoins vigilantes aux signaux recensés par les dispositifs d'addictovigilance et de pharmacovigilance.
Sur ce point, il convient de bien distinguer les fentanyloïdes produits dans des laboratoires clandestins, du fentanyl de rue dont la diffusion repose majoritairement sur des détournements de prescriptions ou des reventes illégales de médicaments et qui reposent sur des réseaux d'usagers-revendeurs (cf. supra).
En revanche, les nitazènes, qui constituent une autre catégorie de NOS, sont l'objet d'une préoccupation prioritaire des autorités sanitaires françaises. Identifiés pour la première fois sur le territoire national en 2021, les nitazènes sont des produits particulièrement puissants et dangereux. À titre d'exemple, alors que le fentanyl est déjà jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine (en intraveineuse), l'étonitazène l'est dix fois plus que le fentanyl et l'isotonitazène cinq fois plus.
L'ANSM a décidé, en juillet 2023, de classer ces substances comme produits stupéfiants après que plusieurs dizaines de décès leur ont été imputés en Europe, notamment en Angleterre et dans les pays de l'Est, et qu'un cluster de cas d'overdoses à l'isotonitazène a été identifié en Occitanie. Au préalable, une enquête d'addictovigilance avait permis de mettre en évidence des risques d'abus, de dépendance et d'effets dangereux « au moins équivalents » à ceux du fentanyl et de l'héroïne, eux-mêmes classés parmi les produits stupéfiants249(*). Les nitazènes font l'objet d'une surveillance intensive par l'agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) dans le cadre de l'Early Warning System.
• Enfin, l'une des difficultés de la lutte contre les NOS tient au fait que ces substances sont peu détectables et que les nouvelles molécules de synthèse sont souvent utilisées comme produits de coupe d'autres substances, à l'insu des consommateurs.
Tel est le cas des nitazènes, mélangés à d'autres substances telles que l'héroïne, dont la composition se trouve adultérée, sans que les consommateurs n'en aient conscience. À ce titre, la Fédération Addiction alerte sur le fait qu'« une crise de moindre ampleur, liée à la circulation de substances hautement puissantes et peu détectables, demeure une possibilité qu'il convient d'anticiper »250(*). Ce risque exige d'autant plus de vigilance et d'anticipation de la part des pouvoirs publics que l'émergence régulière de nouvelles molécules relevant des NOS complexifie encore davantage la lutte contre ces substances.
Alerte sur les cannabinoïdes
Les cannabinoïdes appartiennent aux nouveaux produits de synthèse (NPS) qui émergent sur le marché des drogues. Les cannabinoïdes sont des substances psychoactives fabriquées en laboratoire qui miment les effets du principal composé actif du cannabis, le THC (Delta-9-tétrahydrocannabinol). Ils utilisent le même mécanisme d'action, en se liant à certains récepteurs cérébraux, mais présentent des effets jusqu'à 200 fois plus puissants en agissant comme des agonistes complets des récepteurs cannabinoïdes, alors que le THC naturel n'agit que comme agoniste partiel.
Ils ne sont pas des opioïdes mais peuvent apparaître comme produits de coupe dans certains opioïdes de synthèse, le plus souvent à l'insu des consommateurs. L'OFDT relève également que l'héroïne est de plus en plus souvent adultérée soit avec des opioïdes soit avec des cannabinoïdes, donnant lieu à des incidents sanitaires circonscrits mais dont les conséquences peuvent s'avérer particulièrement graves251(*).
Initialement développés à des fins thérapeutiques pour soulager des douleurs intenses, leur utilisation clinique demeure limitée en raison de l'importance de leurs effets indésirables252(*).
Outre leur potentiel addictif élevé, la consommation de cannabinoïdes expose à des effets immédiats tels que tels que des vomissements, une perte de connaissance ou un coma, des convulsions, une paranoïa, une hypertension artérielle, une tachycardie. Ils présentent également des effets à long terme potentiellement graves, notamment des troubles psychiatriques (psychoses, anxiété, dépression), cognitifs (mémoire, concentration) ainsi que des atteintes à certains organes vitaux (coeur, foie, reins).
En France, la quasi-totalité des cannabinoïdes de synthèse sont inscrits sur la liste des stupéfiants depuis 2017 et l'ANSM a, en mai 2024, élargi la liste des cannabinoïdes figurant sur cette liste. Actuellement, plus de 200 cannabinoïdes de synthèse ont été identifiés en Europe. Principalement fabriqués en Asie, ils sont vendus sur le darkweb et le marché de rue sous des formes variées (herbes à fumer, huiles, liquides pour cigarette électronique, poudre ou résine) et divers noms commerciaux (Pète ton crâne ou PTC, Buddha Blue, Mad Hatter, Spice).
2. Renforcer la politique de réduction des risques vis-à-vis des usagers
a) Favoriser l'accès aux traitements par agonistes opioïdes et à la naloxone
• Les crises américaine et canadienne montrent à quel point l'absence d'accès organisé à des traitements de substitution aux opioïdes peut contribuer à une dégradation rapide de la situation sanitaire et à une explosion dramatique du nombre de décès.
Ces exemples témoignent de l'importance de mener une action sur le plan de la prévention et de la réduction des risques, en accompagnant les usagers. À partir de 2022, les États-Unis ont réagi en renforçant l'accès aux produits de substitution et en s'assurant d'une meilleure diffusion de la naloxone, l'objectif étant à la fois de gérer les situations de dépendance et de prévenir les surdoses d'opioïdes.
• La France se caractérise par un bon accès aux TAO, c'est-à-dire à la buprénorphine et à la méthadone.
Marie Jauffret-Roustide, auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat, soulignait ainsi que « la France est l'un des pays européens dont le taux de traitements de substitution aux opiacés est parmi les plus élevés. En 2023, 78 % des personnes dépendantes à l'héroïne ont pu bénéficier d'un traitement de substitution. Plus de 155 000 personnes étaient sous TAO en ville, dont la moitié d'entre eux étaient traités par méthadone, l'autre moitié des patients étant traités par buprénorphine »253(*).
Précisément, en 2023, 155 762 personnes ont bénéficié d'un remboursement de traitement par agonistes opioïdes254(*). La buprénorphine représente plus de la moitié des TAO remboursés, et la part de méthadone augmente à 46,3 %.
En outre, une nouvelle forme de buprénorphine à action prolongée est désormais disponible en solution injectable, hebdomadaire ou mensuelle (BUVIDAL). L'ANSM indique avoir engagé une réflexion sur la possibilité d'administrer la buprénorphine injectable en dehors du milieu hospitalier ou des CSAPA, rejoignant sur ce point la préoccupation exprimée par le Groupe Santé Addictions pour stabiliser des usagers fortement dépendants (cf. supra).
• Le nombre de bénéficiaires de remboursement de TAO en ville apparaît relativement stable ces dernières années255(*) pour un montant remboursé par l'assurance maladie de 71,3 millions en 2023.
Toutefois, l'accès aux TAO pâtit d'inégalités territoriales importantes, notamment concernant la méthadone. Cet accès est relativement plus faible en Île-de-France et dans les territoires ultra-marins (cf. infra). Ces inégalités s'expliqueraient en partie par la saturation des structures d'addictologie, allongeant les délais d'initiation des traitements, et par un manque d'accompagnement des patients par les médecins généralistes « qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas suivre des patients sous TSO »256(*). Face à cette situation, le conseil national de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de l'ordre des médecins ont, en juillet 2024, réaffirmé leur engagement pour améliorer la prise en charge des conduites addictives, et actualisé leurs recommandations relatives à la prescription et à la dispensation des TAO257(*).
Nombre de bénéficiaires de TAO en
ville pour 100 000 habitants
de
15 à 74 ans (2023)
Source : OFDT, Traitements par agonistes opioïdes en France - Bilan 2024, d'après les données issues du système national des données de santé (SNDS)
Dans un contexte où les primo-prescriptions de certains TAO (méthadone) ne peuvent être réalisées que par des médecins hospitaliers ou exerçant en CSAPA, et compte tenu des durées limitées de prescription des TAO - 14 à 28 jours selon la forme -, il apparaît nécessaire de réfléchir à des mesures de nature à sécuriser la situation des patients dépendants et à favoriser la continuité des traitements.
Face au risque que des usagers dépendants ne se tournent vers le marché noir pour s'approvisionner en opioïdes, les rapporteures souscrivent à la nécessité de renforcer l'accès aux TAO. Sous réserve d'une évaluation favorable par l'ANSM, elles préconisent d'autoriser la dispensation de buprénorphine à libération prolongée en ville.
Recommandation : Améliorer la disponibilité des traitements de substitution aux opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée.
En outre, les médecins et les acteurs associatifs indiquent que la méthadone et la buprénorphine ne permettent pas d'équilibrer tous les patients dépendants. Cette situation entretient le détournement du Skénan LP - forme à libération prolongée -, médicament à base de sulfate de morphine indiqué dans le traitement de douleurs intenses ou rebelles à d'autres analgésiques. En effet, le sulfate de morphine présente deux caractéristiques recherchées par beaucoup d'usagers de drogues illicites auxquelles ils renoncent difficilement : le médicament est injectable (contrairement à la méthadone) et produit l'impression d'un pic de sensation, avec une descente progressive (contrairement à la buprénorphine)258(*). Son usage hors cadre thérapeutique connaît une recrudescence depuis les années 2010.
Pour améliorer l'adhésion des usagers d'opioïdes aux TAO et renforcer l'efficacité de la politique de réduction des risques, les rapporteures soutiennent l'ouverture par les autorités sanitaires une réflexion sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme TAO.
Recommandation : Engager une réflexion avec les autorités sanitaires sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme traitement agoniste aux opioïdes.
• Alors que l'accès aux TAO est globalement bon, l'accès à la naloxone demeure en revanche très insuffisant. Son administration permettrait pourtant d'empêcher 4 décès par overdose sur 5.
Le ministère de la santé rappelle que 80 % des décès par surdose sont dus aux opioïdes, consommés dans un cadre légal ou illégal. La naloxone est un médicament qui fonctionne comme un antidote aux surdoses mortelles d'opioïdes.
Sa disponibilité demeure pourtant limitée. Parmi les freins identifiés, certains relèvent du cadre réglementaire, d'autres d'un déficit d'information des professionnels de santé et des usagers.
La naloxone, antagoniste des récepteurs opioïdes et antidote de l'overdose
La naloxone, antidote aux surdoses d'opioïdes, permet de prévenir les effets symptomatiques de l'overdose, en particulier la dépression respiratoire. Elle agit en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau à la place des opioïdes eux-mêmes, qu'elle déloge, bloquant ainsi leurs effets.
Disponible sous forme de seringue préremplie pour injection intra-musculaire ou sous forme de spray nasal, son mécanisme d'action est particulièrement rapide - 2 à 3 minutes - ce qui permet de rétablir l'état de conscience normal de la personne ainsi que sa mécanique respiratoire. En revanche, sa durée d'action étant limitée, les effets de l'overdose peuvent réapparaître après l'administration de la naloxone. Une surveillance continue de la personne est donc nécessaire dans les heures suivant l'administration.
Les consommateurs peuvent se procurer de la naloxone soit auprès d'une officine pharmaceutique soit dans les structures d'addictologie. Son administration ne nécessite pas de compétence médicale particulière. Un autre avantage de la substance réside dans le fait qu'elle n'induit aucun effet secondaire, que son absorption ait été précédée ou non d'une consommation d'opioïdes.
Aux États-Unis et au Canada, les vagues successives de décès liés à l'usage des opioïdes ont conduit les gouvernements à développer des programmes ambitieux forts, bien que tardifs, de mise à disposition de la naloxone. Les services de police et les pompiers sont ainsi munis de kits de naloxone prêts à l'emploi et la FDA a autorisé la délivrance sans prescription de naloxone dans les officines pharmaceutiques. L'American Medical Association a également recommandé, en 2024, d'installer des distributeurs de naloxone dans les espaces publics.
• L'hétérogénéité des conditions de remboursement et de délivrance de la naloxone nuit à son accessibilité.
En principe, la naloxone peut être délivrée gratuitement aux usagers à risque dans les CSAPA et les Caarud, les établissements hospitaliers et les unités sanitaires en milieu pénitentiaire. En revanche, dans les pharmacies d'officine, seuls les médicaments à base de naloxone délivrés sur prescription médicale sont, en tout ou partie, remboursés par l'assurance maladie.
Le Ventizolve, nouvelle spécialité à base de naloxone disponible sans ordonnance, n'est ainsi pas pris en charge par l'assurance maladie, tandis que le Prexonad n'est remboursable que sur prescription médicale.
Or, compte tenu des difficultés d'accès à un médecin et de la réticence de certains usagers à s'orienter vers le corps médical, l'exigence d'une prescription médicale pour la délivrance de certains médicaments à base de naloxone constitue un obstacle à la prévention des overdoses. Si le Prenoxad, solution injectable disponible en seringue préremplie, fait l'objet d'une prescription facultative, le Nyxoïd, administré en pulvérisation nasale, demeure soumis à une prescription médicale obligatoire.
La HAS a pourtant recommandé aux pouvoirs publics d'améliorer la diffusion de ce médicament antidote grâce à « un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone »259(*). Selon la DGS, une prise en charge à 100 % de la naloxone, à volume constant, aurait un impact financier estimé à 20 000 euros260(*).
Les professionnels de santé, médecins et pharmaciens, sont par ailleurs peu sensibilisés aux problématiques de dépendance aux opioïdes, d'abus et au risque d'overdose. Ils méconnaissent la substance ou ignorent l'existence de kits de naloxone, ce qui ne les place pas en situation de pouvoir la proposer ni de la délivrer261(*). L'information des usagers eux-mêmes est lacunaire, voire inexistante. Face à la faible diffusion de la naloxone, l'ANSM envisagerait d'inscrire la possibilité de recourir à cet antidote dans les mentions d'alerte figurant sur les conditionnements d'opioïdes forts.
La mission recommande donc de lever ces obstacles en supprimant la condition de prescription de la naloxone pour favoriser sa diffusion et son emploi, et de systématiser sa délivrance en cas de prescription d'opioïdes de palier 3 ou de TAO et en sortie d'hospitalisation. Cette action doit s'accompagner d'une communication active auprès du réseau des professionnels de santé en ville, ainsi que dans les unités hospitalières - notamment les services d'urgences - et des structures spécialisées en addictologie.
Recommandation : Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitement par agonistes opioïdes et en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde.
À l'instar des expériences nord-américaines, les services de police et de secours, notamment les pompiers, les ambulanciers, les équipes de la protection civile et de la Croix-Rouge, devraient également être sensibilisés aux risques liés aux surdoses d'opioïdes, équipés de kits de naloxone prêts à l'emploi et formés à agir en situation d'urgence.
Recommandation : Former les services de police et de secours à l'utilisation de la naloxone et les équiper de kits de naloxone prêts à l'emploi.
b) Promouvoir une politique de réduction des risques non stigmatisante à destination d'un public large
Alors que 17 % de la population adulte bénéficie d'un remboursement d'antalgique opioïde au cours de l'année et qu'au moins 20 % des Français sont touchés par des douleurs chroniques, une politique de réduction des risques visant de façon large les professionnels de santé et les consommateurs d'opioïdes apparaît indispensable.
Les acteurs associatifs regrettent que « la politique de réduction des risques en France soit [une] politique confidentielle qui ne bénéficie d'aucune promotion en population générale »262(*) et qu'elle souffre, en outre, d'un prisme moralisateur qui ne favorise pas l'adhésion des usagers aux dispositifs qu'elle déploie. Ainsi que le rappelle la Mildeca, « loin d'être une politique permissive, la réduction des risques et des dommages mobilise un ensemble d'interventions et de dispositifs publics et privés, encadrés précisément par la loi, dans l'objectif de venir en aide à des individus souvent fragiles et longtemps stigmatisés »263(*).
Les rapporteures considèrent que la politique de réduction des risques doit être renforcée à plusieurs niveaux, grâce au déploiement d'un panel d'outils adaptés à la variété des situations des usagers concernés par des troubles de l'usage.
• En premier lieu, la réduction des risques nécessite de renforcer la communication à l'égard du grand public.
En effet, les mésusages relèvent de situations extrêmement variées : prise d'anti-douleurs à la suite d'une intervention chirurgicale ou pour soulager des douleurs chroniques, automédication, consommation récréative régulière ou ponctuelle...
Dans le cadre de la feuille de route 2019-2022 « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes », le ministère de la santé a fait réaliser des affiches illustrant la diversité de ces situations, susceptibles d'engendrer une dépendance aux opioïdes et/ou à risque de surdoses d'opioïdes. De tels visuels permettent de déstigmatiser les consommateurs et de sensibiliser tous les usagers aux risques encourus. Ils mériteraient de bénéficier d'une diffusion plus large.
Recommandation : Mener une campagne nationale non stigmatisante sur le bon usage et les risques associés à la consommation de médicaments opioïdes à destination du grand public.
Affiches du ministère de la santé
pour sensibiliser
au risque de surdose d'opioïdes et à
l'utilité de l'emploi de la naloxone
Source : Site internet du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
• En deuxième lieu, la réduction des risques passe par le déploiement d'actions de prévention en proximité des usagers, par une démarche « d'aller vers ».
« L'aller vers » permet de toucher des populations qui se rendent peu dans les lieux précisément destinés à traiter certaines pathologies, soit parce qu'ils sont peu connus ou peu accessibles, soit parce que les usagers ne se sentent pas concernés par une problématique de santé publique ou se détournent volontairement d'espaces « institutionnels ». Ainsi, les CSAPA et les CAARUD peuvent échouer à capter deux catégories d'usagers : d'une part, des consommateurs d'antalgiques opioïdes percevant ces structures comme principalement dédiées à l'accueil de toxicomanes et, d'autre part, des usagers d'opioïdes illicites en situation de marginalisation sociale. En ce sens, « l'aller vers » constitue un mode d'action efficient pour déployer une politique de prévention.
Le programme POP (pour « Prévention et réduction des risques des surdoses liées aux Opioïdes en région PACA »), imaginé par le CEIP-A des régions Provence Alpes-Côte d'Azur et Corse, constitue un modèle d'intervention de ce type. Ce programme, financé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, déploie depuis 2020 des actions préventives auprès des usagers et des professionnels de santé pour anticiper et éviter les surdoses d'opioïdes en agissant sur les pratiques professionnelles, en informant et en responsabilisant les usagers, en particulier les plus à risque de surdoses, et en soutenant la diffusion de la naloxone. Ses résultats probants devraient conduire les autorités ministérielles à généraliser sa mise en oeuvre à l'ensemble du territoire national d'ici la fin d'année 2025264(*). Elle s'appuierait sur le réseau des CEIP-A et, du point de vue budgétaire, sur le fonds de lutte contre les addictions (FLCA).
• En troisième lieu, il existe les actions ciblant des publics plus spécifiques, en situation de dépendance chronique, devraient être consolidées. Le dispositif des haltes soins addiction (HSA) s'inscrit dans ce cadre. Ouvertes depuis 2016, les deux HSA de Paris et de Strasbourg sont actuellement toujours sous statut expérimental.
Les HSA participent à la politique de réduction des risques tout en contribuant à sécuriser l'espace public. Elles visent à offrir aux usagers de drogues un accueil anonyme, inconditionnel et gratuit pour leur permettre de consommer dans un cadre sécurisé, sous la supervision de professionnels qualifiés. Les usagers peuvent ainsi être accompagnés dans leur consommation pour en réduire les risques. La spécificité des HSA tient précisément à la possibilité qu'elles offrent de consommer des substances illicites sous couvert d'une immunité pénale. Les HSA peuvent également constituer une porte d'entrée vers un parcours de soins adapté et favoriser la réinsertion sociale de publics en situation de marginalisation.
Les HSA : un dispositif récent en
France, mobilisé de longue date
dans de nombreux pays du
monde
En 2023, l'Inspection générale des affaires sociales indique avoir dénombré 151 salles de consommation supervisée dans 16 pays du monde, dont 39 au Canada, 3 aux États-Unis et 106 dans les différents pays européens, notamment en Suisse (14), en Allemagne (32), aux Pays-Bas (26) et en Espagne (16). Plusieurs études ont démontré les impacts positifs de ce type de dispositif, en termes de mortalité par surdose, d'hospitalisations et plus largement, de complications aiguës associées aux injections (endocardites, risques infectieux, etc.).
En France, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a ouvert la possibilité de créer des salles de consommation à moindre risque, à titre expérimental, pour une durée de six ans. La loi prévoit notamment que « ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés » et que les « usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place »265(*).
Deux HSA ont été ouvertes en 2016, à Paris et à Strasbourg. Elles accueillent une file active d'environ 1600 personnes (781 à Paris et 823 à Strasbourg), soit moins de 1 % des 342 000 usagers problématiques de drogues estimés en France en 2023. La HSA de Paris, réservée aux consommations par injection, accueille néanmoins un volume de consommations huit fois supérieur à celui de la HSA de Strasbourg266(*), en raison d'une fréquentation plus importante du lieu par ses usagers.
En 2021, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a publié un rapport confirmant l'intérêt des HSA comme dispositif de santé publique267(*). Plus récemment, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a recommandé l'inscription des HSA dans le droit commun pour pérenniser les structures existantes et pour en ouvrir de nouvelles, dans les territoires jugés les plus opportuns par les autorités ministérielles.
Ce sujet, plus éloigné du coeur de la thématique de la présente mission d'information, ne fait pas l'objet de recommandations de la commission
3. Agir en faveur de la prévention et de la dépendance
a) Encourager l'éducation thérapeutique des patients
De nombreux patients sous traitement opioïde n'ont aujourd'hui pas conscience des risques associés à la consommation de ces médicaments, a fortiori lorsqu'ils sont consommés sur des durées longues ou en dehors du cadre de prescription initiale, en automédication.
• La sensibilisation des patients à ces risques est une mesure à laquelle adhèrent l'ensemble des professionnels auditionnés. Au-delà, les professionnels de la douleur appellent unanimement à renforcer l'éducation thérapeutique des patients pour les rendre davantage acteurs et responsables de leur prise en charge. L'éducation thérapeutique vise en effet à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique268(*).
• Plusieurs outils peuvent permettre de développer les connaissances et l'éducation thérapeutique des usagers, notamment :
- l'inscription de mentions d'alerte claires et visibles sur les boîtes de médicaments opioïdes qui constituerait une mesure de prévention utile et aisée à mettre en oeuvre ;
- l'utilisation systématique, à l'occasion d'une consultation chez le médecin traitant, d'outils permettant aux patients d'évaluer et de réévaluer leur douleur, tels que les échelles visuelles analogiques (EVA) et les échelles verbales simples (EVS) et d'échelles d'évaluation des risques de mésusage des médicaments opioïdes (auto-questionnaires de type POMI269(*)) ; ces outils pourraient opportunément être mis à la disposition des patients dans les salles d'attente des cabinets médicaux, les officines pharmaceutiques et les services d'accueil des urgences ;
- l'initiation d'une éducation thérapeutique du patient dès le diagnostic, sur la base d'une évaluation partagée de la douleur entre le médecin et le patient ; sur ce point, la HAS souligne que les objectifs de la prise en charge doivent résulter d'une décision médicale partagée avec le patient, seul à même d'apprécier l'intensité de sa douleur ainsi que de décrire la tolérance d'un traitement et ses effets secondaires ;
- le développement de programmes d'éducation thérapeutique du patient douloureux, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, pour renforcer l'implication du patient dans la gestion de sa douleur et de sa pathologie ; le format de ces programmes permet d'inclure des activités et thérapeutiques variées, y compris des thérapies comportementales ou cognitives, de l'hypnose ou de l'activité physique adaptée ;
- sans stigmatiser les patients, l'impulsion d'une campagne de sensibilisation de la population aux signes des troubles de l'usage et de l'addiction aux opioïdes.
Recommandation : Renforcer l'éducation thérapeutique des patients par la mise à disposition dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les services de médecine d'urgence, d'outils d'auto-évaluation de la douleur et du risque de dépendance.
Extrait de présentation de l'échelle verbale simple (EVS)
Source : Réseau Interclud Occitanie
b) Repositionner les opioïdes au sein d'un arsenal thérapeutique large incluant des alternatives médicamenteuses ou non
• La HAS, saisie par le ministère de la santé dans le cadre de la feuille de route « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes », a établi en 2022 des recommandations de bonnes pratiques sur le bon usage des médicaments opioïdes. Ces recommandations sont récentes, pour ne pas dire tardives au regard des évolutions constatées ces dernières années.
Il importe désormais d'en assurer la diffusion auprès des professionnels de santé pour leur permettre de s'en saisir et de leur conférer une portée effective. Les conseils des ordres professionnels ont évidemment un rôle essentiel de promotion à jouer en la matière, qu'ils peinent pourtant à assurer. Une coopération renforcée entre les ordres et la HAS pourrait contribuer à une meilleure pénétration de ces référentiels dans les cabinets médicaux.
Des actions conventionnelles impulsées par la Cnam peuvent également contribuer à l'appropriation de ces bonnes pratiques et au contrôle de leur mise en oeuvre, à l'instar de la campagne menée fin 2024 par les délégués de l'assurance maladie auprès des prescripteurs sur le bon usage des spécialités à base de tramadol, de même que la mise en place et le financement d'un entretien proposé par le pharmacien aux patients sous traitement opioïde de palier 2, à l'occasion du renouvellement de l'ordonnance, afin d'alerter sur les risques de dépendance270(*).
Recommandation : Développer la coopération entre les conseils des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et la Haute Autorité de santé pour favoriser la diffusion des référentiels de bonnes pratiques et des outils d'aide à la prescription et à la dispensation des opioïdes.
• La HAS rappelle que dans la mesure du possible, l'utilisation de médicaments opioïdes doit s'inscrire dans une prise en charge multimodale associant des antalgiques non opioïdes et/ou des approches non médicamenteuses. Cette précaution permet non seulement d'optimiser l'efficacité antalgique du traitement prescrit, mais aussi d'éviter l'escalade thérapeutique dont les patients deviennent victimes.
À cet égard, la SFETD rappelle que « toute prescription médicamenteuse doit s'accompagner d'un projet de déprescription »271(*). Pour cela, la situation du patient doit pouvoir être régulièrement réévaluée, pour adapter le traitement et diminuer progressivement les doses prescrites jusqu'à l'arrêt.
• En outre, selon la SFETD, l'absence totale de douleur ne doit pas nécessairement constituer un objectif thérapeutique, même si cette affirmation peut être difficile à assumer face à des patients en souffrance.
En effet, l'objectif du « zéro douleur » favorise les prescriptions inadaptées et les dérives vers des situations d'accoutumance. À rebours de ces pratiques, elle préconise au contraire de développer des prises en charge sur « un modèle biopsychosocial, global, intégratif, incluant les prises en charge corporelles, comme l'activité physique adaptée, les contre-stimulations ; psychocorporelles, comme la relaxation ou l'hypnose ; psycho-comportementales, comme l'alliance thérapeutique, le soutien relationnel, les psychothérapies ; socio-éducatives, comme l'éducation thérapeutique et la e-santé »272(*).
Recommandation : Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur.
4. Faire évoluer la formation des médecins et consolider la structuration d'une offre de soins spécialisée
a) Améliorer la formation des médecins en matière de prise en charge de la douleur ainsi que de repérage et de gestion des conduites addictives
Qu'il s'agisse des médecins, des pharmaciens, des infirmiers ou des psychologues, il existe un déficit de formation des acteurs du premier recours en matière de repérage, d'évaluation et de traitement des conduites addictives. Le manque de professionnels formés constitue un obstacle important à la prévention des troubles de l'usage des opioïdes et à une prise en charge adaptée des situations de dépendance.
• Les données issues de l'enquête conduite pour le « Livre blanc sur la naloxone », rédigé par un collectif d'associations, illustrent la relative méconnaissance et le défaut d'appropriation des outils d'évaluation des risques de mésusage existants (questionnaires ORT et POMI, cf. supra)273(*), qui permettraient aux médecins de repérer plus aisément les patients à risque de mésusage ou de dépendance.
Outre la faible diffusion des recommandations de bonnes pratiques, le manque d'échanges interdisciplinaires ne favorise pas l'appropriation des outils de repérage et de gestion des conduites addictives par les acteurs du premier recours. À cet égard, des réunions de concertation périodiques, en présentiel ou à distance, associant au sein d'un même territoire les professionnels de ville - médecins et pharmaciens - et les structures spécialisées et hospitalières contribueraient utilement à la sensibilisation des professionnels libéraux du premier recours. Plus largement, le développement de programmes de formation continue de tous les professionnels du premier recours, dans des formats aisément accessibles, est une nécessité.
• En formation initiale, les rapporteures préconisent d'inscrire un module obligatoire renforcé sur la prise en charge de la douleur et sur les addictions dans les études des professionnels de santé concernés. Le module consacré aux addictions permettrait d'aborder les propriétés pharmacologiques des opioïdes, l'identification des facteurs favorisant la vulnérabilité aux opioïdes, les modalités de repérage du risque et d'évaluation des troubles de l'usage, les principes de la réduction des risques et les principales actions de prévention. Celui consacré à la prise en charge de la douleur intègrerait des principes généraux issus des recommandations les plus récentes en la matière.
Au cours du troisième cycle des études médicales, les rapporteures recommandent par ailleurs de soutenir l'ouverture de terrains de stage dans des structures ou services d'addictologie pour les DES de médecine générale, de psychiatrie, de santé publique et d'hépato-gastro-entérologie.
Recommandation : Intégrer un module obligatoire renforcé sur le traitement de la douleur et la lutte contre les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés.
Enfin, les rapporteures souscrivent à la proposition formulée par la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD) visant à intégrer le dépistage de la douleur aux consultations de prévention aux âges clés de la vie déployées depuis l'été 2024274(*). Dans cette perspective, le déploiement de programmes de formation continue et l'adaptation des programmes de la formation initiale des médecins apparaît indispensable.
b) Consolider une offre de soins de proximité coordonnée entre médecine générale et structures spécialisées
Les difficultés d'accès aux dispositifs de prise en charge spécialisés et les lacunes du premier recours rendent d'autant plus nécessaire de penser la coordination des parcours patients entre tous les acteurs. Le risque de mésusage est en effet d'autant plus important que l'organisation territoriale des soins favorise les ruptures de parcours et le non-recours aux soins, comme c'est le cas aujourd'hui.
• Cette coordination renforcée suppose une meilleure connaissance réciproque des acteurs et de leurs missions respectives - par exemple, des CSAPA et des CAARUD par les médecins généralistes - et l'utilisation d'outils de transmission pour améliorer la qualité du suivi du patient. De ce point de vue, il conviendrait de réfléchir aux modalités d'une incitation plus forte à l'alimentation du dossier médical partagé (DMP), précisément pour éviter des prescriptions inadaptées ou redondantes, et limiter les prolongations injustifiées de traitements.
• Concernant l'organisation de la prise en charge de la douleur, si le nombre de structures spécialisées de prise en charge de la douleur chronique a connu une augmentation progressive depuis leur création, force est de constater que celui-ci demeure insuffisant et que les moyens dont elles disposent sont sous-dimensionnés par rapport aux besoins des usagers. Une donnée permet d'illustrer la fragilité du fonctionnement de ces structures : en 2021, seuls 18 % des médecins des SDC y exerçaient la médecine de la douleur à temps plein275(*).
Les rapporteures recommandent de fixer un objectif relatif à la proportion de patients accédant aux SDC - actuellement, seuls 3 % des patients souffrant de douleurs chroniques y accèdent effectivement - et un objectif relatif au délai entre l'orientation du patient et sa prise en charge effective par une SDC. Ces indicateurs permettraient de déterminer les conditions de montée en charge progressive des SDC, en termes de couverture territoriale et de files actives de patients.
Recommandation : Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur.
• De même, les CSAPA et les CAARUD ne sont bien souvent pas en capacité d'augmenter leurs files actives de patients, compte tenu de leur modèle de financement qui conduit à brider les conditions d'exécution de leurs missions. Cette situation engendre des retards de prise en charge, c'est-à-dire des initiations tardives de traitements qui ne permettent pas toujours de prévenir la dépendance. Des associations mentionnent ainsi des délais de prise en charge de trois à six mois, au sein des CSAPA, après orientation d'un usager276(*).
Sur ce sujet, la DGS fait état de travaux menés conjointement avec la direction générale de l'offre de soins (DGOS) visant à réviser l'organisation des filières addictologiques, à améliorer le parcours des patients entre la ville, l'hôpital et le secteur médico-social et à adapter les modalités de financement des CSAPA avec hébergement277(*).
TRAVAUX DE LA COMMISSION
___________
I. COMPTE RENDU DE L'AUDITION EN RÉUNION PLÉNIÈRE
Audition de Mme Marie Jauffret-Roustide, sociologue
(Mercredi 9 avril 2025)
M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, nous entendons ce matin Mme Marie Jauffret-Roustide, sociologue à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), dans le cadre de notre mission d'information sur les dangers liés aux médicaments opioïdes, dont les rapporteures sont Patricia Demas, Anne-Sophie Romagny et Anne Souyris.
Je vous informe que cette audition fait l'objet d'une captation. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera disponible en vidéo à la demande.
Nous connaissons à la fois l'intérêt réel des médicaments opioïdes, notamment dans le domaine du traitement de la douleur, et les dangers inhérents à l'usage de ce type de substance. Les ravages sanitaires constatés dans un pays comme les États-Unis du fait d'une utilisation inadéquate de ces médicaments et de l'accoutumance qu'ils peuvent créer constituent un exemple frappant de ce qu'il convient d'éviter.
Nous nous interrogeons donc sur la pertinence de notre cadre législatif et réglementaire, ainsi que sur les pratiques concrètes des professionnels de santé et des patients, afin d'évaluer si nous ne risquons pas de laisser germer une situation dangereuse.
Madame, je vous laisse la parole pour un propos liminaire, en vous fondant notamment sur les nombreux travaux que vous avez conduits.
Mme Marie Jauffret-Roustide, sociologue. - Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre invitation. Au préalable, permettez-moi d'indiquer que je suis à la fois chercheur à l'Inserm, membre du conseil scientifique de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, dite Euda (European Union Drugs Agency), et du comité « psychotropes, stupéfiants et addictions » de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Voilà maintenant trente ans que je travaille sur ces questions dans une perspective à la fois française, européenne et nord-américaine.
Pour vous parler de la crise liée aux overdoses d'opioïdes, je commencerai naturellement par évoquer les États-Unis, pays où cette crise a débuté et où elle est la plus profonde. Là-bas, on distingue quatre vagues.
La première, la plus médiatisée, a débuté dès les années 1990 et s'est prolongée jusqu'au début des années 2010 : elle est essentiellement due aux surprescriptions d'opioïdes par les médecins et aux mauvaises pratiques des laboratoires pharmaceutiques, qui ont délivré des informations erronées et mensongères sur le risque de dépendance à ces substances, ainsi qu'au système de santé américain, très différent du nôtre.
La deuxième vague s'est déroulée à partir des années 2010 : les États-Unis ont décidé de restreindre considérablement les prescriptions d'opioïdes, ce qui a poussé les personnes dépendantes à se reporter vers l'héroïne de rue.
Une troisième crise a suivi, celle liée au fentanyl, qui est à l'origine d'une explosion du nombre de décès outre-Atlantique : on dénombre ainsi plus de 100 000 décès par overdose chaque année aux États-Unis. Il s'agit là-bas de la première cause de mortalité chez les jeunes adultes et de la principale raison pour laquelle l'espérance de vie a diminué.
Aujourd'hui, on distingue une quatrième vague, caractérisée par la consommation de stimulants, de cocaïne et de méthamphétamine. Cette crise intéresse la France, puisque l'on observe une très forte hausse de la consommation de cocaïne dans notre pays et que le fentanyl est utilisé comme produit de coupe de ces stimulants.
À ce stade de mon propos, il est utile de préciser que le fentanyl est un produit fabriqué de manière illicite, dont la teneur est très variable - il peut être vendu comme de l'héroïne ou contenu dans des pilules contrefaites -, un opioïde de synthèse aux effets imprévisibles, qui se révèle 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, ce qui est à l'origine d'un nombre extrêmement élevé d'overdoses. Ce produit est facile à fabriquer et à transporter et très peu cher, ce qui explique sa large diffusion.
Je vous livre quelques éléments chiffrés sur l'évolution du nombre de décès par overdose entre 2003 et 2023 aux États-Unis. Ce chiffre est en constante progression, surtout depuis les années 2010 : on dénombre ainsi plus de 30 décès pour 100 000 habitants en 2023, contre 10 décès pour 100 000 habitants en 2003, dont une majorité chez les hommes puisqu'on compte parmi eux près de 45 décès pour 100 000 habitants en 2023. La répartition des décès par overdose selon l'âge est également notable : la majorité des personnes concernées a entre 25 ans et 64 ans, avec un pic entre 35 ans et 44 ans, tranche d'âge où le nombre de décès atteint 61 pour 100 000 habitants.
Contrairement à une idée répandue, la méthadone n'est pas la principale substance responsable des décès par overdose aux États-Unis. En réalité, la plupart de ces décès sont dus aux opioïdes synthétiques tels que le fentanyl, avec une très forte hausse des morts à partir de 2013 due à la cocaïne et aux psychostimulants de manière générale. J'insiste sur ce point, car la consommation de cocaïne a été multipliée par huit en France ces trente dernières années. C'est la drogue dont la consommation augmente le plus dans notre pays.
En Europe, le nombre de décès par overdose d'opioïdes est nettement plus faible qu'aux États-Unis. En 2020, on y a enregistré moins de 9 000 décès par an. Même si tout décès par overdose est un drame, il faut noter que la France est relativement protégée et que c'est l'Europe du Nord, et tout particulièrement les pays baltes, qui est la plus concernée.
La crise liée aux overdoses d'opioïdes s'explique en partie par la situation géopolitique. C'est d'ailleurs pourquoi, même si l'Europe est pour le moment relativement peu touchée par rapport aux États-Unis, il faut rester prudent en la matière.
Depuis 2022, on constate une restriction considérable de la production d'opium en Afghanistan - la baisse est de 95 % -, résultante d'une décision prise par le régime des talibans. En 2000, ces mêmes talibans avaient pris une décision similaire, ce qui avait conduit à une augmentation considérable des overdoses en Europe et à l'arrivée du fentanyl dans les pays baltes, en Estonie notamment, et dans le nord de l'Europe. J'ajoute que l'Irlande et les Pays-Bas ont aussi connu ces dernières années des clusters d'overdoses en lien avec les opioïdes de synthèse utilisés comme produits de coupe. En 2023, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues a également observé l'arrivée sur le sol européen de nitazènes, impliqués dans 150 cas d'overdose.
Évidemment, cette situation n'a rien à voir avec ce que l'on constate aux États-Unis, mais il convient d'être attentif à l'ensemble de ces signaux faibles.
En matière de lutte contre les opioïdes, la France dispose de plusieurs atouts. Un constat tout d'abord : notre pays est relativement épargné, puisqu'il a enregistré 450 décès par overdoses liées aux opiacés en 2019, soit 0,67 décès pour 100 000 habitants, à comparer aux 21,6 décès pour 100 000 habitants aux États-Unis.
Les travaux que je mène, en particulier avec Honora Englander, professeure à l'Université de Portland, et Benjamin Rolland, spécialiste en addictologie à Lyon, m'ont permis de dégager les principaux points forts de notre pays.
D'abord, la France mène une politique de réduction des risques qui est soutenue par l'État. Cela contribue à protéger la population de la crise qui frappe aujourd'hui les États-Unis. À l'inverse, les politiques de réduction des risques sont peu efficaces outre-Atlantique, notamment parce qu'elles sont principalement menées par des fondations privées.
Ensuite, en France, cette politique de réduction des risques permet de prendre en charge tous les publics, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur statut migratoire ; aux États-Unis, les personnes racisées et les pauvres sont exclus des soins, dans la mesure où ceux-ci sont payants, contrairement à la France, où l'accès aux traitements par agonistes opioïdes (TAO), qui permettent de lutter contre la dépendance à l'héroïne, est gratuit.
En outre, dans notre pays, l'addictologie est une discipline médicale reconnue depuis les années 1990, ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique. Notre modèle organisationnel de la médecine de ville a aussi favorisé la diffusion des TAO dès le milieu des années 1990. Aux États-Unis, pour prescrire des traitements de ce type, tout praticien doit suivre une formation complémentaire, longue et coûteuse - ce n'est pas le cas chez nous -, ce qui freine beaucoup la propagation des traitements.
D'autres raisons expliquent l'absence de crise liée aux overdoses d'opioïdes en France.
Le marché des drogues y est différent : le fentanyl n'est quasiment pas présent dans notre pays. On observe aussi l'existence d'un marché sécurisé, avec la présence d'un marché illicite de sulfates de morphine, qui est un facteur qui nous protège de l'arrivée du fentanyl. Je fais partie d'un groupe d'experts au sein de l'ANSM qui réclame un accès facilité, mais sécurisé à ces sulfates de morphine, car nous estimons qu'il permettrait de prévenir une éventuelle crise liée aux overdoses d'opioïdes chez nous.
La France offre une large accessibilité aux TAO, avec la prescription de buprénorphine et de méthadone dans les cabinets médicaux en ville, dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) ou dans des bus dits « à bas seuil ».
La France se caractérise par le respect effectif accordé aux patients. Ces derniers sont rarement soumis à des contrôles urinaires - on leur fait confiance - et les durées de prescription peuvent être allongées pour favoriser leur vie sociale. Aux États-Unis, tout est contrôlé, ce qui explique les très fortes réserves des médecins à prescrire ce type de traitement, ainsi que les réticences des patients à entrer dans des programmes de suivi pouvant, de fait, les empêcher de travailler.
Cela étant, pour ce qui concerne les opioïdes de manière générale, consommés par près de 11 millions de personnes en France, l'ANSM surveille de très près les éventuels risques. Cet encadrement est également un atout majeur pour notre pays. Il est d'ailleurs beaucoup plus performant qu'aux États-Unis. La publicité pour les opioïdes est interdite chez nous, alors qu'outre-Atlantique, les publicités mensongères ont longtemps prospéré, ce qui a favorisé la diffusion de la crise.
Autre force, nous exerçons un contrôle strict des conflits d'intérêts. Aux États-Unis, à l'inverse, certaines décisions concernant les médicaments opioïdes ont été prises par des personnes qui percevaient de l'argent des laboratoires.
Je vais désormais retracer une rapide perspective historique de la situation française.
Les traitements de substitution aux opiacés en France se sont diffusés à partir de 1995. On distingue différentes étapes ; elles ont systématiquement donné lieu à des conférences de consensus qui ont permis de définir de bonnes pratiques. La France est l'un des pays européens dont le taux de traitements de substitution aux opiacés est parmi les plus élevés. En 2023, 78 % des personnes dépendantes à l'héroïne ont pu bénéficier d'un traitement de substitution. Plus de 155 000 personnes étaient sous TAO en ville, dont la moitié d'entre eux étaient traités par méthadone, l'autre moitié des patients étant traités par buprénorphine.
Je m'arrête un instant sur l'importance accordée par les médias au nombre de décès liés à la méthadone en France. Soyons clairs sur ce point : on dénombre 450 décès par overdose d'opiacés dans notre pays, dont 40 % sont dus à la méthadone, soit environ 200 décès. Ce chiffre est à comparer aux plus de 100 000 morts enregistrés chaque année aux États-Unis en lien avec les overdoses d'opioïdes, décès qui s'expliquent justement en partie par le manque de méthadone.
La méthadone peut effectivement causer des décès, mais le risque est faible en comparaison de ses bénéfices thérapeutiques et de la protection que ce produit offre face à une potentielle crise liée à la surconsommation d'opioïdes.
Un médicament existe pour lutter contre les overdoses : la naloxone. En France, la mise à disposition de ce produit a augmenté de 40 % ces dernières années, mais elle reste très insuffisante. En effet, alors que 160 000 personnes suivent un traitement de substitution aux opiacés, et que 11 millions de prescriptions sont délivrées chaque année, moins de 30 000 doses de naloxone sont vendues. Un effort doit être fait sur cette question.
J'ai parlé des forces de notre pays, mais les études que je mène avec mon équipe ou que mènent d'autres chercheurs avec qui nous travaillons montrent que nous avons également des faiblesses. Les études réalisées dans le cadre du programme de prévention des opioïdes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dit programme POP, lancé par la professeure Joëlle Micaleff, ont montré la faiblesse de la diffusion de la naloxone en France par rapport aux risques d'overdose et une méconnaissance des médecins et des patients quant à l'intérêt de cette substance.
De même, l'étude ANRS-Coquelicot, que j'ai menée avec mon équipe en 2023, met en évidence une augmentation des refus de soins à l'égard des personnes usagères de drogues en France : 20 % des personnes que nous avons interrogées dans vingt-sept villes nous ont dit s'être vu refuser la délivrance d'un traitement de substitution en pharmacie ou la prescription d'un traitement par un médecin. Cette dynamique est extrêmement préoccupante et fragilise notre modèle de protection contre les overdoses.
Il existe un paradoxe français : alors que les addictions sont fortement médicalisées, ce qui est protecteur, la politique de prohibition qui est menée favorise les attitudes de stigmatisation des personnes en situation d'addiction par les professionnels de santé, lesquels valident les refus de soins que je viens d'évoquer.
Au-delà de la question sanitaire, d'autres facteurs entrent en jeu, à commencer par une forme de paupérisation de la société française, qui va mal. En effet, l'une des causes de l'épidémie d'overdoses d'opioïdes aux États-Unis réside dans les inégalités structurelles de la société américaine. Le livre Deaths of Despair and the Future of Capitalism montre que les surprescriptions d'opioïdes sont certes liées aux laboratoires pharmaceutiques, mais aussi au désespoir engendré par la crise économique et les inégalités sociales, qui a poussé une partie de la population à se réfugier dans les opiacés.
Selon les données récentes publiées par l'Euda, si la France est le pays d'Europe qui délivre le plus de traitements par agonistes opioïdes - ce qui explique le faible nombre d'overdoses -, elle délivre également moins de seringues que ses voisins. Il s'agit d'un problème lié à la stigmatisation des usagers. Ainsi, la distribution de seringues est deux fois inférieure au volume nécessaire pour assurer une prévention efficace du VIH et de l'hépatite C.
Compte tenu des résultats de nos recherches, nous recommandons d'améliorer l'accès à la naloxone, en en élargissant la distribution non seulement aux consommateurs de drogues, mais également à leurs proches. Nous allons lancer un programme s'inspirant du programme québécois Profan 2.0 - prévenir et réduire les overdoses, former et accéder à la naloxone -, consistant à distribuer et à informer sur la naloxone.
Pour que ce produit fonctionne, quelqu'un doit se trouver aux côtés de la personne en situation d'overdose. Une stratégie de réduction des risques consiste donc à encourager les personnes à ne jamais consommer seules.
Nous recommandons également de renforcer les mesures de réduction des risques dont les effets positifs ont été validés par les données scientifiques.
Il convient donc de développer les haltes soins addictions (HSA), dont une équipe de recherche impliquant des chercheurs de l'Inserm, mais aussi du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et des universités de Strasbourg, d'Aix-Marseille et de Bordeaux a montré qu'elles permettaient de diminuer le nombre d'overdoses. Des études menées au Canada ont abouti aux mêmes conclusions.
De même, les stratégies de testing doivent être développées pour que les usagers sachent ce qu'ils consomment. En effet, le fentanyl est parfois consommé à leur insu par des personnes pensant consommer de l'héroïne ou de la cocaïne, car il est utilisé comme produit de coupe. Il convient de mettre en place des systèmes d'alerte précoces et d'élargir un accès aux sulfates de morphine et à des programmes d'administration encadrée de diacétylmorphine, comme cela existe en Suisse.
Par ailleurs, il est nécessaire de lutter contre la stigmatisation des personnes usagères de substances par les professionnels de santé pour favoriser leur accès aux soins.
Pour agir sur les causes de la consommation, il convient de réaliser des actions de prévention primaire sur les environnements de vie dès le plus jeune âge, d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale et de favoriser l'insertion sociale et l'accès au logement. Cette question doit faire l'objet d'une approche non seulement sanitaire, mais aussi sociale, ainsi que d'une volonté politique très forte.
De même, les dispositifs d'encadrement et de gestion de la douleur doivent être développés, sans pénaliser les patients.
Enfin, il convient d'approfondir les recherches pour prévenir l'arrivée du fentanyl en France. Honora Englander, Benjamin Rolland et moi-même venons d'achever un projet de comparaison des États-Unis et de la France. Une autre étude, financée par l'Institut pour la recherche en santé publique (Iresp), que je dirige, va être réalisée durant les deux prochaines années pour étudier les signaux à la fois pharmacologiques et sociologiques sur la question. En outre, je viens d'obtenir la création d'une équipe au sein du CNRS, constituée autour de Florence Noble et Nicolas Marie, pour étudier la susceptibilité des patients à consommer du fentanyl et déterminer une prise en charge adaptée.
Enfin, je profite de cette audition pour exprimer mon soutien à mes collègues américains, dont le travail est actuellement menacé. Les scientifiques de l'Inserm se tiennent à leurs côtés par le biais du mouvement Stand up for Science. Grâce à eux, j'ai pu vous fournir des données scientifiques aujourd'hui. Peut-être que je ne le pourrai plus dans quelques années, à cause des politiques américaines actuelles, qui entravent la recherche scientifique sur le sujet.
Mme Céline Brulin. - Très bien !
Mme Anne Souyris, rapporteure. - Nous essayons à la fois de comprendre la croissance des prescriptions d'opioïdes et de déterminer comment prévenir une crise des opioïdes en France. Comme vous l'avez dit, nous avons des atouts pour lutter contre une épidémie telle que celle qui a lieu aux États-Unis, que ce soit en matière de protection sociale, d'encadrement du médicament ou de régulation des conflits d'intérêts.
Toutefois, le risque d'importation d'une telle crise n'étant pas nul, il convient d'agir de manière préventive auprès des personnes usagères de drogues pour que cela n'advienne pas, mais aussi de prendre de l'avance en formalisant des protocoles si jamais cela devait advenir. La commission des affaires sociales se concentre tout particulièrement sur la question de la santé publique, celle du trafic illicite ne relevant pas de son domaine de compétence.
Vous avez évoqué le fait que des consommateurs de drogues ne savent pas que le produit qu'ils achètent dans la rue est coupé avec du fentanyl. Il s'agit en effet d'un problème important. En revanche, vous n'avez pas évoqué la méconnaissance des patients à l'égard des opioïdes qui leur sont prescrits. Ceux-ci ne savent pas toujours que les antidouleurs qu'ils prennent sont en réalité des opioïdes très forts, que ce soit le fentanyl ou, dans une moindre mesure, le tramadol. De même, si les médecins sont sensibilisés à cette question au cours de leur formation initiale, des lacunes demeurent.
Avez-vous travaillé sur le niveau d'information des consommateurs de drogues, qu'elles soient illégales ou prescrites, sur la contenance des produits qu'ils consomment et sur leur propre dépendance ? Il me semble que cette question est un angle mort.
Dans le cas du VIH, avant la politique de réduction des risques menée au cours des années 1990, la plupart des psychiatres considéraient qu'on ne pouvait pas aider les usagers de drogues, car ils seraient des personnes irresponsables. Or les faits ont prouvé le contraire : la responsabilisation des usagers, même lorsqu'ils sont dépendants, permet de réduire l'usage, mais surtout d'empêcher des morts.
Comment faire évoluer nos dispositifs - vous avez notamment évoqué le testing - pour progresser sur la connaissance des produits ? Les médecins sont-ils bien informés sur l'évolution des usages ? Vous avez abordé le fentanyl et les nitazènes, mais l'oxycodone est également de plus en plus consommé, en particulier au Royaume-Uni, c'est-à-dire très proche de nous. Ce phénomène peut-il s'étendre à la France ?
Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - J'axerai mes questions sur la prise en charge de la douleur. Celle-ci constitue une avancée thérapeutique importante et a été érigée en priorité de santé publique depuis la fin des années 1990, ce qui s'est concrétisé en 1998 par le premier plan national de lutte contre la douleur.
Toutefois, cette volonté d'une meilleure prise en compte de la douleur peut également conduire à des dérives quant à l'usage d'antalgiques opioïdes. Aux États-Unis, l'élargissement des conditions de prescription de l'OxyContin, un analgésique très puissant, a ouvert la voie à la crise des opioïdes.
Quel regard portez-vous, en tant que sociologue, sur cette question de l'appréhension et du soulagement de la douleur ?
L'augmentation des prescriptions hors indication thérapeutique du tramadol, de la codéine ou du fentanyl constitue-t-elle un signal inquiétant ? Doit-elle nous alerter sur un risque d'importation d'une crise des opioïdes en France ?
Le système de santé français permet d'organiser l'accès à des TSO et d'accompagner les usagers, dans une démarche de réduction des risques. C'est l'un des points qui distinguent notre pays des États-Unis. Toutefois, l'usage de la méthadone suscite des débats, car cette substance est actuellement responsable de plus de 40 % des décès par overdose en France.
En dehors de la lutte contre les trafics illicites, un renforcement de l'accès à des TSO est-il selon vous la priorité pour endiguer une éventuelle importation en France de la crise des opioïdes ? Le cas échéant, comment mieux encadrer ces traitements pour éviter les risques de surdose associés ?
Mme Patricia Demas, rapporteure. - Le tramadol, qui est classé comme un opioïde dit faible, est la substance faisant le plus fréquemment l'objet d'ordonnances falsifiées. Le nombre de personnes dépendantes le désignant comme le produit dont la consommation a entraîné leur addiction a été multiplié par dix-sept en dix ans. Depuis mars 2025, l'ANSM a mis en place de nouvelles règles pour renforcer la vigilance et sécuriser la prescription d'opioïdes en France.
Ces nouvelles règles réduiront-elles selon vous les cas de mésusage de manière significative ? Permettront-elles de mieux encadrer les pratiques de prescription et de protéger les patients contre les risques de dépendance et de surdosage ? Comment pourraient-elles influencer les dynamiques sociales et les comportements à la fois des prescripteurs et des usagers ?
Plus largement, selon les données dont vous disposez, le risque de mésusage en France porte-t-il davantage sur les opioïdes dits faibles, dont l'usage se banalise, ou sur les opioïdes dits forts, comme le fentanyl ou l'oxycodone ?
Enfin, plusieurs acteurs que nous avons auditionnés regrettent des conditions d'accès à la naloxone insuffisantes et appellent, pour certains d'entre eux, à des prescriptions systématiques en cas de prescription d'opioïdes. Qu'en pensez-vous ? Comment les autorités sanitaires pourraient-elles faciliter la mise à disposition de naloxone ? Est-il envisageable de systématiser sa prescription dans certaines situations ?
Mme Marie Jauffret-Roustide. - Je travaille depuis trente ans sur ces questions. J'ai donc connu la crise du Sida au début de mes recherches. Celle-ci a permis de créer la figure du malade réformateur, qu'il conviendrait d'appliquer aux personnes usagères de drogues. Cette démarche a eu des effets très positifs dans la lutte contre le VIH en responsabilisant les individus.
Comme je l'ai évoqué, nous sommes confrontés en France au paradoxe de la médicalisation et de la prohibition : notre système de soins est beaucoup plus efficace que ceux d'autres pays, mais nous sommes l'un des pays d'Europe les plus répressifs à l'égard des usagers de drogues. Or si la répression vis-à-vis de l'offre de drogues et du trafic est très importante, la répression des usagers les éloigne des soins et favorise des attitudes de stigmatisation et des représentations sociales erronées. Ce faisant, cela peut contribuer à la survenue d'une crise des overdoses d'opioïdes en France.
L'accès à la méthadone ou à la buprénorphine est un facteur de protection très fort contre les overdoses. Le fait que des professionnels de santé refusent de prescrire ces substances à cause de représentations sociales négatives à l'égard des personnes toxicomanes constitue une faiblesse de notre système de soin. C'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont confrontés à la crise actuelle.
Sur cette question, il est extrêmement important de renforcer l'information des médecins, notamment en faisant venir des patients dépendants dans les formations médicales, pour qu'ils témoignent de leur vécu et de leurs représentations. En parallèle, il faut développer l'éducation thérapeutique, pour que les patients soient véritablement informés et responsabilisés.
Dans le cadre de mes recherches, je suis conduite à interroger à la fois des personnes usagères de drogues, des personnes dépendantes aux opiacés et des médecins. Comme d'autres chercheurs qui travaillent sur ces questions, je constate souvent le décalage provoqué par les préjugés qui persistent de part et d'autre.
Pour la plupart, les médecins connaissent mal les questions d'addictions, excepté évidemment les addictologues. De leur côté, les patients se sentent parfois très jugés ; ils ont des réticences à confier leurs difficultés aux médecins. En résultent des prises en charge qui ne sont pas toujours très adaptées. Les équipes de Joëlle Micallef, qui ont travaillé sur le programme POP, ont ainsi constaté une très grande méconnaissance de la naloxone, du côté des patients comme du côté des médecins.
Un certain nombre de dispositifs en vigueur ont été évalués par la science. À l'évidence, ils fonctionnent.
Je pense au travail de pair-aidance, consistant à embaucher dans les équipes soignantes ou dans les hôpitaux des médiateurs de santé, personnes ayant elles-mêmes vécu des situations de dépendance, pouvant jouer un rôle d'intermédiaire entre les patients et les médecins et améliorer les connaissances des professionnels de santé au quotidien.
Je pense aussi au testing, qui renforce la capacité des personnes à agir. Quand une personne consomme un produit illicite, elle peut connaître les produits de coupe que ce dernier contient, et choisir de ne pas le consommer, par exemple s'il contient du fentanyl.
Je pense également aux HSA, que de nombreux pays à travers le monde, dont la France, jugent extrêmement efficaces pour prévenir les overdoses, donc limiter la mortalité.
La prise en charge de la douleur est un sujet complexe. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'enjeu est de trouver un équilibre pour assurer un encadrement sans pénalisation du patient.
Longtemps en France, on a très mal soigné la douleur, en particulier la douleur des enfants. L'héritage de notre culture judéo-chrétienne permet notamment de l'expliquer ; la recherche historique le démontre. On partait du principe que la souffrance faisait partie de la vie. Heureusement, notre monde a changé. Les médecins sont plus à l'écoute des patients. Des centres anti-douleurs ont vu le jour. Divers dispositifs d'évaluation de la douleur par le patient ont été développés, via toute une série de technologies.
J'ajoute que les opioïdes ne sont pas les seuls à même de soulager la douleur : il y a aussi, entre autres, le cannabis thérapeutique, pour lequel la France est très en retard.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Bien sûr !
Mme Marie Jauffret-Roustide. - Je faisais partie du groupe de l'ANSM qui, en 2018-2019, a préconisé l'expérimentation du cannabis thérapeutique après avoir entendu des patients, des soignants, des scientifiques et des acteurs politiques de différents pays qui en autorisent l'usage. Le cannabis thérapeutique est un outil extrêmement intéressant pour faire face à la douleur ; on peut y avoir recours plutôt que de prescrire un opioïde. Mais encore faut-il qu'il soit autorisé en France. Cette question doit être au centre du débat relatif à la prise en charge thérapeutique.
Je reviens sur la crise des overdoses d'opioïdes. La première phase de cette crise était liée non seulement à la surprescription médicale, mais aussi aux mensonges dont les laboratoires se sont rendus coupables. Ni les médecins, ni les patients, ni les familles n'ont été informés quant aux risques de dépendance.
Il est très important d'informer le patient, qu'il s'agisse des bénéfices ou des risques des médicaments qu'il va prendre. À ce titre, on a besoin d'un dialogue ouvert avec le médecin, ce qui renvoie à des questions plus structurelles. De combien de temps les praticiens disposent-ils aujourd'hui pour mener leurs consultations ? Comment forme-t-on les médecins ? Comment revalorise-t-on les différentes professions de santé ? La question de la suppression du numerus clausus s'inscrit dans ce cadre.
En parallèle, pour penser aux différentes options thérapeutiques, il faut travailler sur les représentations sociales. Chez les élus, certaines représentations sont encore erronées. On peut ainsi considérer, à tort, que l'autorisation du cannabis thérapeutique ouvrira la voie à la légalisation du cannabis. À l'inverse, son recours permettra selon moi de limiter un certain nombre de risques. J'ajoute que la prescription de certains opioïdes sur ordonnance sécurisée pourra entraîner un report vers d'autres opioïdes. Il faut avoir une approche globale, en examinant toutes les options thérapeutiques pour limiter le recours aux opioïdes.
Au total, 40 % des décès par overdose d'opiacés sont certes dus à la méthadone, mais pour un total de 450 personnes, quand on déplore 100 000 morts aux États-Unis. La méthadone protège en fait la France de la crise des overdoses par opioïdes, tout comme la buprénorphine et les sulfates de morphine.
Comment prévenir les overdoses ? Le groupe de l'ANSM n'est pas favorable à la primo-prescription de la méthadone par le médecin généraliste. Selon nous, cette primo-prescription doit continuer d'avoir lieu dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), ou en milieu hospitalier.
L'accès à la méthadone est, certes, plus facile en France qu'il ne l'est aux États-Unis, mais plusieurs formes de régulation sont prévues. Elles viennent renforcer l'information du patient et permettent un certain nombre de relais.
En France, on dispose actuellement de la méthadone et de la buprénorphine. Mais, sur le marché noir, on trouve aussi beaucoup de sulfates de morphine. Or - on le sait - certains patients sont en échec avec la méthadone et la buprénorphine, alors même que les sulfates de morphine constituent, pour eux, une option thérapeutique intéressante. Ces derniers doivent, à mon sens, faire partie de la palette des traitements pouvant être prescrits par les médecins en substitution aux opiacés.
J'ai déjà répondu à la question relative au tramadol, en évoquant les ordonnances sécurisées et les risques de reports. Il faut se pencher sur la formation médicale et sur la question du numerus clausus, pour que la France dispose d'un plus grand nombre de médecins. Ces derniers doivent avoir le temps nécessaire pour informer leurs patients.
La naloxone devrait, selon moi, être proposée à tout patient ayant une prescription d'antalgiques forts et présentant, en conséquence, un risque d'overdose. Le Québec a opté pour une diffusion très large de la naloxone en lien avec des dispositifs profanes, dont la formation par les pairs. Ce programme a été jugé très efficace.
Il faut également informer les familles, ce qui suppose d'ouvrir le dialogue au sujet de la dépendance et de lutter contre certaines représentations sociales. Il faut arrêter de stigmatiser les personnes usagères de drogues. Contrairement à ce que l'on peut entendre dans les médias, les personnes usagères de drogues ne sont pas foncièrement différentes des autres. Il peut s'agir d'un voisin, d'un proche, voire d'un membre de sa propre famille. Toute personne peut, au cours de sa vie, être confrontée à une dépendance aux opioïdes. La déstigmatisation est un outil majeur pour la prévention de la crise des overdoses opioïdes.
M. Bernard Jomier. - À l'évidence, nous sommes face à un problème de représentation des opiacés, y compris chez les soignants. La prescription de morphine est encore parfois refusée, même à un patient qui, en se réveillant à la sortie du bloc opératoire, se plaint de douleurs intenses. Elle a, certes, progressé, mais pas suffisamment pour que l'on atteigne un équilibre satisfaisant. Dans les urgences des hôpitaux, on a systématiquement recours au tramadol : on est en situation de surprescription. En revanche, pour certains morphiniques, on déplore une sous-prescription.
Avant 1995, c'est-à-dire avant la légalisation des traitements substitutifs, les usagers de drogues entretenaient des rapports très violents avec les soignants. Cette population se précarisait, les surdoses se multipliaient et les indicateurs infectieux étaient très mauvais ; je pense à la fois au VIH, à l'hépatite C et aux septicémies. La population considérée restait en dehors du système de soins.
En 1995, Simone Veil, ministre de la santé, autorise les TSO, et le rapport de soignant à soigné s'améliore rapidement. Les médecins de ville sont de plus en plus nombreux à prescrire des TSO. De plus en plus de pharmaciens s'associent à l'effort entrepris, la prise en charge sanitaire progresse et les résultats sont immédiats, en particulier en matière de santé.
Aujourd'hui, j'ai l'impression d'assister à un nouveau basculement. De plus en plus de mes confrères médecins refusent de prendre en charge les usagers de drogues. De plus en plus de pharmaciens refusent de délivrer de la méthadone ou de la buprénorphine, et de plus en plus d'usagers de drogues se détournent des soignants.
L'approche par produit est bien sûr très intéressante, mais l'approche par les usagers est elle aussi fondamentale. C'est toute une population d'usagers de drogues qui, tout en se développant, se précarise, plonge dans la violence et dans la délinquance. Les indicateurs sont de nouveau très mauvais, qu'il s'agisse de la santé ou de la sécurité publique. On n'arrive plus à avancer.
Les HSA en sont l'illustration même. Je connais bien les évaluations menées à Paris, notamment par l'Inserm : grâce aux solutions déployées par le passé, tous les indicateurs s'étaient améliorés, y compris la tranquillité publique. Mais, malgré le travail législatif accompli, aucune nouvelle halte n'a été créée depuis le vote de la loi. Ce basculement, qui va de pair avec une nouvelle stigmatisation, m'inquiète au plus haut point.
Que pensez-vous de ces signaux épars ? Selon vous, assistons-nous à un changement d'époque ?
Mme Corinne Imbert. - Le fentanyl représente le danger le plus important : facile à produire, peu onéreux, il inonde un certain nombre de pays, notamment les États-Unis.
Parmi les points forts de notre pays que vous avez évoqués, vous auriez pu insister davantage sur la sécurité de la chaîne du médicament, de sa fabrication à sa dispensation. Au-delà des seuls opioïdes, une enquête publiée voilà quelques années démontrait que la France était moins touchée que d'autres pays par le trafic de faux médicaments.
Selon moi, le niveau d'information du patient est satisfaisant. Ce dernier sait très bien, s'agissant des opioïdes forts - fentanyl, oxycodone, buprénorphine, méthadone - ce que le médecin lui a prescrit et ce que le pharmacien lui délivre, compte tenu des conditions dans lesquelles la prescription et la délivrance se font. Vous avez donc raison de dire que la buprénorphine et la méthadone, aujourd'hui, le sulfate de morphine, peut-être demain, dans un certain sens, protègent la France.
Comme Bernard Jomier, je souhaiterais en savoir davantage sur l'enquête de 2023.
Par ailleurs, je ne dis pas que la stigmatisation de la part des médecins et des pharmaciens n'existe pas, mais il s'agit d'un phénomène très rare. Si nous constations une chute du nombre de boîtes de Subutex délivrées ainsi qu'une moindre délivrance de buprénorphine ou de méthadone, nous pourrions nous interroger.
N'oublions pas que le comportement des patients varie selon la périodicité des conditions de délivrance : hebdomadaire, par quinzaine, sur vingt-huit jours. Ne reprochons pas à un pharmacien de s'opposer à un patient qui souhaite « gratter » deux ou trois jours parce qu'il a consommé plus que nécessaire.
Sur l'accessibilité aux soins, ne tombons pas dans la caricature : des progrès ont été réalisés en trente ans. À l'époque où le médicament à base de buprénorphine a été délivré, remboursé par la sécurité sociale, les forces de l'ordre ont immédiatement constaté la diminution des vols d'autoradios. Cela vous paraît peut-être trivial, mais cela a été l'un des premiers constats réalisés à l'époque.
Plutôt que de stigmatiser les professionnels, veillons à mieux accompagner les patients, mais aussi les familles. Sur la naloxone, je n'ai pas forcément d'avis ; je fais confiance aux spécialistes.
Mme Laurence Muller-Bronn. - À Strasbourg, dans le Bas-Rhin, de nombreuses inquiétudes s'expriment sur l'arrêt, à la fin de l'année, de l'expérimentation des HSA. Celle de Strasbourg, ouverte en 2016, portée politiquement de manière transversale, s'est révélée très positive. L'espace d'hébergement qui lui est attenant est aussi remis en question.
Sur ce sujet, qui relève bien plus de la santé publique que de la politique, les seules salles ouvertes l'ont été à Paris et à Strasbourg. Chez nous, nous ressentons grandement l'influence des frontières allemande et suisse, pays beaucoup plus ouverts à ce type de prise en charge.
Je reviens sur la carte que vous avez projetée au début de votre exposé. J'ai été étonnée que les pays du nord de l'Europe, présentés comme très sociaux, sans inégalités et où il fait prétendument bon vivre, soient aussi concernés par une consommation de masse en la matière.
Mme Silvana Silvani. - Merci du soutien que vous avez apporté à vos confrères américains. En l'absence de données scientifiques, sur ce sujet comme sur d'autres, tout un chacun se retrouverait dans un désert intellectuel et culturel qui empêcherait le moindre échange.
Il est intéressant de vous entendre dire que la politique de réduction des risques en France est manifestement efficace. Je note que la question de la stigmatisation des consommateurs par les soignants était l'un des freins, pas le seul évidemment, à la prise en charge. Peut-être la répression est-elle un peu trop forte et toujours dirigée unilatéralement vers les consommateurs.
Vous avez également évoqué les représentations sociales non seulement chez les soignants, mais aussi chez les politiques. En tant que sociologue, vous savez à quel point les représentations sociales ont la vie dure. Quelles pistes pouvez-vous suggérer ?
Mme Marie Jauffret-Roustide. - Les signaux issus de nos études laissent supposer que nous sommes à un moment dangereux, sans aller jusqu'à parler de basculement, pour la préservation de notre modèle français, qui pourrait ensuite nous fragiliser par rapport à une crise possible des overdoses aux opioïdes.
Sur le traitement de la douleur, s'il y a eu des progrès, ils ne sont pas suffisants. Il est des patients qui, faute d'une prescription par le médecin de médicaments opioïdes, vont essayer de s'en procurer par d'autres moyens. C'est exactement ce qui se passe avec le cannabis thérapeutique.
Ayant participé au groupe de réflexion sur l'expérimentation au sein de l'ANSM, j'ai été extrêmement frappée d'apprendre, au fil des auditions, que des patients qui avaient des douleurs vraiment réfractaires à différents médicaments et pour lesquelles le cannabis fonctionnait se voyaient contraints de demander à leurs petits-enfants d'aller leur acheter du cannabis sur le marché illégal. Cela prouve toute l'absurdité de la situation.
Il y a encore des progrès à faire : mal soulager la douleur, donc devoir s'approvisionner sur un marché illégal ou ne pas avoir d'informations éclairées de la part de son médecin, expose à des risques beaucoup plus importants.
La question des représentations sociales liées aux prescriptions a été étudiée aux États-Unis parce qu'y sont collectées des données ethno-raciales, ce qui n'est pas le cas en France. Différentes études ont montré que, à douleur égale, les personnes d'origine hispanique ou afro-américaine avaient beaucoup moins accès aux médicaments opiacés que les personnes blanches au début de l'épidémie. Si les personnes blanches étaient surreprésentées parmi les victimes, c'est donc pour des raisons de racisme médical.
En France, les études disponibles montrent les inégalités existant en matière de prescription selon les classes sociales. Idem en matière de genre : on prescrit beaucoup plus de médicaments aux femmes qu'aux hommes, considérant que les femmes seront moins en capacité de prendre sur elles pour gérer leur douleur. Le médecin est un humain comme un autre : il a des représentations et des préjugés qui lui sont propres.
Je reviens sur l'enquête Coquelicot, une étude représentative réalisée auprès de plus de 2 000 usagers de drogues dans vingt-sept villes : 20 % déclarent avoir subi des refus de prescription ou de délivrance ; ce pourcentage, alors même qu'il s'agit de médicaments autorisés, pose question.
L'idée est non pas de jeter l'opprobre sur la profession médicale ou sur les pharmaciens, bien au contraire, mais de s'interroger sur les raisons de tels refus. Celles-ci sont multiples : attitudes parfois violentes des patients, troubles de santé mentale, mais, surtout, cette conception morale selon laquelle se droguer est mal ; c'est vraiment ce qui est le plus souvent ressorti des entretiens que nous avons menés.
Cela renvoie aussi à la dimension politique, avec un discours médiatique ambiant selon lequel faire la chasse aux personnes qui consomment des drogues serait bon pour la collectivité. Certains professionnels de santé ont justifié leur refus de prescrire en soutenant que cela entretenait la toxicomanie.
Une telle minorité existe. La profession elle-même en fait un sujet de préoccupation : elle a effectué des testings, pour documenter le refus de délivrance de TSO ou de seringues. Un représentant de l'Académie nationale de pharmacie a d'ailleurs tenu des propos extrêmement violents, relayés dans les médias, sur les usagers de drogues, en appelant à leur stérilisation. L'Académie s'est déclarée très choquée, rappelant son attachement à la politique de réduction des risques.
Oui, la majorité des pharmaciens et des médecins sont sensibles à de telles questions, mais il y a une minorité qui s'exprime, comme sur d'autres thématiques sociétales à forte dimension morale : contraception, avortement...
Il importe que l'ensemble des patients puissent avoir accès à des soins de qualité. Parallèlement, il faut garantir aux médecins et aux pharmaciens des conditions de travail satisfaisantes. Avec le numerus clausus, nous manquons de médecins et de pharmaciens, d'où la nécessité de mettre en place des politiques structurelles.
Les études tant qualitatives que quantitatives le montrent, la stigmatisation augmente, en partie parce que les nouvelles générations de pharmaciens et de médecins n'ont pas vécu l'hécatombe du sida, laquelle a frappé toute une génération dans les années 1980.
L'expérimentation des haltes soins addictions a été évaluée de manière positive dans le monde entier. En France, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) a demandé leur pérennisation. Le problème survient quand un discours de sécurité publique prend le pas sur le discours de santé publique. Or, dans le cadre de l'évaluation, nous avons mis en évidence que ces HSA, au-delà d'améliorer la santé publique et de prévenir les overdoses, ont un effet positif sur la sécurité publique.
La stigmatisation est en effet liée à l'importance de la répression. Travaillant sur ces questions depuis trente ans, je vois l'évolution : auparavant, seul le groupe des écologistes était favorable à la réduction des risques, tenant un discours très critique sur la pénalisation, tandis que les autres groupes politiques restaient sur une dimension très répressive. Aujourd'hui, des politiques de tous bords demandent une politique plus humaniste, moins axée sur la répression des consommateurs.
Pour agir, il faut encourager les politiques à ne pas se centrer uniquement sur leur idéologie et sur le fait de penser que le retour à l'autorité va tout résoudre. Si c'était un moyen de résoudre la question des drogues, la France n'aurait pas un des niveaux de consommation de cannabis le plus élevé d'Europe. On voit que cela ne fonctionne pas.
Regardons ce qui se passe à l'étranger. Dans les années 1990, le Portugal a été touché par une crise des overdoses par opioïdes et par l'épidémie de sida, avec le record de décès en Europe. À la demande des familles, l'État portugais a décidé de décriminaliser l'usage de drogues et a réinvesti l'argent économisé sur la répression dans des politiques de soins et de réduction des risques. Désormais, grâce à sa politique volontariste, humaniste et pragmatique, le pays a un taux de mortalité et de morbidité parmi les plus bas d'Europe.
Concernant les pays du Nord, c'est parce que le fentanyl y est bien plus implanté qu'en France, et non en raison d'une plus grande consommation globale, que les statistiques sont plus élevées.
M. Philippe Mouiller, président. - Je vous remercie : c'était passionnant !
Cette audition a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
II. EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 9 juillet 2025, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport d'information de Mmes Patricia Demas, Anne-Sophie Romagny et Anne Souyris, sur les dangers liés aux opioïdes.
M. Philippe Mouiller, président. - Nous allons entendre la communication de Patricia Demas, Anne-Sophie Romagny et Anne Souyris à l'issue des travaux de la mission d'information qu'elles ont conduite sur les dangers liés aux médicaments opioïdes.
Je vous rappelle que les travaux de nos collègues s'inscrivent dans le programme de contrôle de la commission pour la session 2024-2025. Il devait s'agir initialement d'une mission flash, lesquelles doivent durer quelques semaines, avec un nombre d'auditions limité, pour donner lieu à un rapport d'une vingtaine de pages. Finalement, avec mon accord, la réflexion s'est transformée en une véritable mission d'information. J'indique que, l'année prochaine, afin de veiller à la bonne tenue de notre programme de travail, je veillerai, lorsque l'on créera une mission flash, à ce que le format prévu dans ce cadre soit respecté.
Je vous rappelle également que nous avons entendu sur ce sujet, en audition plénière, la sociologue Marie Jauffret-Roustide, le 9 avril dernier.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - En un quart de siècle, la « crise des opioïdes » a directement causé plus de 800 000 décès par surdose sur le territoire américain. Il s'agit là d'une catastrophe sanitaire d'une ampleur rarement observée outre-Atlantique, qui n'a fait que s'aggraver jusqu'en 2023, année durant laquelle près de 110 000 morts ont été à déplorer.
Les opioïdes désignent l'ensemble des substances dérivant du pavot à opium, qu'elles soient naturelles comme la morphine, semi-synthétiques comme l'héroïne, ou synthétiques comme le fentanyl. Utilisés à des fins thérapeutiques pour leurs vertus antalgiques, les opioïdes n'en sont pas moins des substances à risques, caractérisées par de nombreux effets secondaires, notamment psychotropes et, surtout, par un fort risque de dépendance.
Les opioïdes regroupent à la fois des médicaments bien connus comme le tramadol ou la codéine, et des produits stupéfiants illicites comme l'héroïne. Parfois, les mêmes substances actives qui servent de médicaments lorsqu'ils sont prescrits médicalement et délivrés en pharmacie alimentent un marché de rue à destination d'usagers dépendants : tel est le cas, notamment, du Skénan ou du fentanyl.
C'est en observant la gravité de la situation aux États-Unis, sur laquelle je reviendrai, que nous avons souhaité nous interroger sur les causes de cette crise, et évaluer la capacité du système de santé français à résister à un tel phénomène. Nos travaux nous ont conduites à mener dix-neuf auditions, faisant intervenir vingt-sept organismes ou personnalités qualifiées issus de tous les champs. Professionnels de santé, administrations et autorités sanitaires, structures de réduction des risques, industriels et usagers, ont tous été entendus.
Afin d'éclairer les réflexions que nous allons vous livrer sur le système de santé français, il nous a semblé nécessaire de vous présenter l'émergence et l'évolution de la crise américaine, qui s'est déroulée en quatre phases.
La crise des opioïdes américaine est d'abord, et peut être avant tout, une crise médicale de surprescription. Dans un contexte marqué par une demande croissante de soulagement des douleurs aiguës et chroniques, la prescription d'opioïdes s'est libéralisée aux États-Unis dans les années 1990. En cause, des stratégies commerciales agressives de la part des exploitants, qui ont stimulé l'offre par une politique de lobbying auprès des médecins, et encouragé la demande par la promotion de certains médicaments comme l'OxyContin auprès du grand public. Le tout, en occultant ou en minimisant les risques de dépendance associés à la consommation d'opioïdes. Entre 2007 et 2012, 780 millions d'antidouleurs ont été délivrés sur prescription en Virginie-Occidentale, soit 433 pilules par habitant.
Prenant conscience de la crise sanitaire émergente, les pouvoirs publics ont brutalement resserré les conditions de prescription de ces médicaments, causant un effondrement de la délivrance d'opioïdes prescrits. Les patients pharmacodépendants ne pouvant plus se fournir sur le marché légal se sont notamment déportés vers le marché des opioïdes de rue, alors porté par l'héroïne. La consommation d'opioïdes et la qualité des substances sont alors devenues incontrôlables.
L'arrivée sur le territoire américain de nouveaux dérivés synthétiques du fentanyl, les fentanyloïdes, autour des années 2015, marque la troisième phase de la crise. Ces substances, 25 à 50 fois plus puissantes que l'héroïne et moins chères que cette dernière, ont eu tôt fait d'inonder le marché américain, mais leur puissance et l'hétérogénéité de leur composition les rend très difficiles à doser. Les consommateurs sont donc exposés à des risques de surdose accrus, particulièrement en cas d'association avec des psychostimulants. C'est la quatrième vague de la crise, toujours en cours aujourd'hui. Le fentanyl et ses dérivés sont devenus la principale cause de décès des Américains de 18 à 49 ans : ils sont responsables des trois quarts des overdoses aux États-Unis, avec 75 000 décès en 2023.
Mme Patricia Demas, rapporteure. - Si la situation américaine est sans commune mesure avec celle de la France, nous constatons aussi, depuis plusieurs années, une augmentation sensible de la consommation des médicaments opioïdes forts et de leurs mésusages. Les enquêtes menées par le réseau français d'addictovigilance font état de données préoccupantes qui doivent nous inciter à prendre toute la mesure d'un risque de banalisation des prescriptions et des usages des médicaments opioïdes.
La consommation de médicaments opioïdes reste globalement circonscrite, celle-ci représentant 22 % de la consommation d'antalgiques en France, dont 20 % d'opioïdes dits faibles ou de palier 2, et 2 % d'opioïdes dits forts ou de palier 3. Des évolutions significatives doivent néanmoins être relevées : à titre principal, une progression marquée de la consommation des opioïdes forts au détriment des opioïdes faibles, de façon assez spectaculaire pour certains médicaments comme l'oxycodone.
À cet égard, les autorités sanitaires relèvent que le nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation de médicaments opioïdes a plus que doublé entre 2006 et 2015. Deux médicaments sont particulièrement représentés : le tramadol et l'oxycodone. Qu'il s'agisse du nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'opioïdes obtenus sur prescription médicale, ou du nombre de décès liés à l'usage de ces mêmes médicaments, les indicateurs recensés depuis quinze ans doivent nous alerter. Le nombre de décès comptabilisés, hors usagers à risques, s'est ainsi accru de 20 % entre 2018 et 2022.
Au-delà des cas les plus graves, les mésusages, qui recouvrent notamment des consommations à visée thérapeutique non ou mal encadrées médicalement, ne cessent de progresser en France. Le nombre de signalements de mésusages de tramadol recensés par les centres d'addictovigilance a doublé depuis 2017. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol sont en situation de mésusage, dont la moitié pour une finalité autre qu'antalgique.
Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de sous-estimation généralisée des risques associés à la consommation d'opioïdes, par les patients comme par les professionnels de santé.
Parmi les effets indésirables, il y a, bien sûr, le risque de dépendance, physique et psychologique qui, même lorsqu'il est connu, est souvent minimisé : selon une étude, 36 % des usagers de codéine et 47 % des usagers de tramadol auraient des difficultés à arrêter leur traitement.
L'insuffisante prise en considération de ce risque favorise les mésusages, imputables tant aux patients qu'aux professionnels de santé, au système de soins et aux pouvoirs publics. Disons-le d'emblée : la responsabilité est collective.
En premier lieu, on observe une déconnexion inquiétante entre les recommandations de bon usage des opioïdes publiées par la HAS et les pratiques des prescripteurs. Selon une étude, plus de 80 % des prescriptions de codéine concernent des indications pour lesquelles le recours aux opioïdes n'est pas recommandé en première intention, telles que la lombalgie ou les douleurs dentaires, voire formellement déconseillé, par exemple pour les céphalées.
Le problème plus profond est celui du défaut de formation des professionnels de santé sur les questions de prise en charge de la douleur et de repérage des conduites addictives. Nous y reviendrons en détail lorsque nous aborderons nos préconisations.
Du côté des patients, l'automédication et le partage de traitements, pratiques largement banalisées associées à des surdosages et au développement incontrôlé d'une pharmacodépendance, sont notamment en cause.
Face aux risques encourus, il faut faire sortir les patients d'un rôle de « consommateur » passif pour en faire des acteurs du bon usage. Malheureusement, l'information des patients, érigée en droit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, et constitutive d'une obligation déontologique incombant aux professionnels, demeure très insuffisante : près d'un praticien sur cinq admet ne pas informer systématiquement les patients des risques liés aux opioïdes.
Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - Vous l'avez compris, mes chers collègues, face à la volonté tout à fait légitime de soulager la douleur, les opioïdes sont en quelque sorte devenus un réflexe, tant pour les patients qui les réclament que pour les professionnels qui les prescrivent.
Dans ces conditions, faut-il craindre une importation de la crise américaine ? Malgré le faisceau de signaux préoccupants que nous vous avons décrit, il ressort des auditions que ce scénario, s'il ne doit pas être écarté, ne semble pas le plus probable. La France peut en effet capitaliser sur des atouts construits sur le long cours, et compter sur la réactivité des autorités sanitaires, qui ont récemment resserré les conditions d'accès aux opioïdes.
D'abord, la France se distingue des États-Unis par son encadrement strict de la promotion des médicaments. Dès le XXe siècle, le législateur a fait le choix d'interdire la publicité grand public pour les médicaments à prescription médicale obligatoire, dont font partie les opioïdes : des campagnes marketing comme celles à l'origine de la crise américaine seraient donc inenvisageables ici. Quant à la publicité auprès des professionnels, elle est subordonnée à un visa de publicité délivré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), laquelle vérifie l'objectivité du contenu et sa conformité aux recommandations de bon usage.
La France peut également compter, de longue date, sur des réseaux d'addictovigilance et de pharmacovigilance performants, qui jouent un rôle d'alerte auprès des autorités sanitaires en recensant et en quantifiant les mésusages et usages détournés le plus tôt possible. Il nous faut consolider ces acquis en donnant aux centres d'addictovigilance, particulièrement peu pourvus au regard de leurs missions, les moyens nécessaires à leur bonne exécution, et accentuer les efforts de testing, afin d'en savoir plus sur l'évolution des substances sur le marché et leurs risques pour la santé.
Prenant acte des signaux préoccupants évoqués plus tôt, les pouvoirs publics ont récemment réagi par une batterie de mesures visant à limiter ou circonscrire les mésusages. Entre garantie de l'accès aux antalgiques pour les patients qui le nécessitent, et encadrement suffisant de la prescription pour limiter les mésusages, la ligne de crête est mince. L'action des pouvoirs publics repose aujourd'hui sur quatre principaux piliers, dont deux restent particulièrement à consolider.
D'abord, les autorités sanitaires ont décidé un resserrement des conditions de prescription des opioïdes. Tous les opioïdes sont désormais soumis à prescription médicale obligatoire, y compris, depuis 2017, les sirops codéinés. Afin de limiter la survenue d'une pharmacodépendance, la prescription d'opioïdes est désormais presque systématiquement encadrée dans sa durée. L'ANSM a ainsi décidé de limiter à douze semaines les prescriptions de tramadol en 2020, et de soumettre les spécialités codéinées à la même limitation le 1er mars dernier. Ce faisant, elle a souhaité rapprocher les conditions de prescription de ces médicaments de celles des médicaments stupéfiants, dont font partie la majorité des opioïdes de palier 3. Ces derniers ne peuvent être prescrits pour plus de quatre semaines. La durée maximale de prescription concerne désormais tous les opioïdes à l'exception de la poudre d'opium, de la nalbuphine et d'une spécialité de buprénorphine.
Les autorités sanitaires ont également souhaité renforcer la sécurisation des ordonnances d'opioïdes, particulièrement touchées par la falsification. Pour ce faire, l'ANSM a aligné, le 1er mars dernier, le régime du tramadol et de la codéine sur celui des médicaments stupéfiants, en exigeant la production d'une ordonnance dite sécurisée pour autoriser la délivrance. Seules la poudre d'opium et la nalbuphine ne sont pas concernés par une telle obligation.
Cette décision a reçu un accueil mitigé. Bien que pertinente, celle-ci pourrait en effet induire un risque de transmission de la demande du marché légal au marché illégal, selon le schéma survenu outre-Atlantique. Si la France n'a pas connu le même phénomène de surprescription que celui qui a été observé aux États-Unis, il convient toutefois de demeurer vigilant à ce que l'exigence d'un encadrement plus strict ne dérive pas en un durcissement contre-productif et inopportun des conditions d'accès aux antalgiques opioïdes. Il apparaît donc nécessaire d'évaluer cette mesure avant de l'élargir, le cas échéant, à l'ensemble des opioïdes, d'autant que les usages détournés, visant des effets psychoactifs, suivent eux aussi une trajectoire préoccupante, et prennent des formes toujours plus diversifiées. Dans un contexte d'effondrement de la production d'héroïne par l'Afghanistan, de nouveaux opioïdes de synthèse comme les nitazènes ou les fentanyloïdes, plus puissants et plus dangereux, arrivent sur le marché noir. Il convient d'accorder une attention toute particulière à la pénétration de ces produits en France, encore embryonnaire mais déjà bien présente chez certains de nos voisins européens.
Concernant l'étiquetage et le conditionnement des opioïdes, des travaux ont été engagés par les autorités sanitaires, mais demeurent à ce jour moins matures. Face aux enjeux, il est nécessaire d'agir sans précipitation, mais avec vélocité.
Le conditionnement des médicaments opioïdes est parfois inadapté aux posologies recommandées, ce qui conduit les patients à accumuler des boîtes d'antalgiques non terminées dans leur armoire à pharmacie. Cela renforce naturellement les risques d'automédication. Sur le modèle du travail conduit pour la réduction de la taille des boîtes de tramadol, il doit être envisagé de revoir le conditionnement de certaines spécialités comme le Dafalgan codéiné.
Enfin, l'étiquetage des opioïdes constitue un vecteur d'information essentiel pour le patient : il apparaît donc nécessaire de faire apparaître sur l'ensemble des boîtes de spécialités opioïdes des mentions d'alerte relatives au risque de pharmacodépendance encouru, comme aux États-Unis ou en Australie. Une telle évolution est en bonne voie pour le tramadol et la codéine, mais elle doit être étendue à l'ensemble des opioïdes, de palier 2 comme de palier 3.
Mme Patricia Demas, rapporteure. - Si la situation américaine est sans commune mesure avec celle de la France, les évolutions constatées ces dernières années témoignent de fragilités que l'on ne saurait ignorer ni laisser perdurer. Le constat auquel nous sommes parvenues nous conduit à préconiser d'inscrire la lutte contre la douleur et la prise en charge des conduites addictives parmi les priorités de santé publique. Trois axes nous semblent ainsi devoir donner lieu à la formalisation d'une feuille de route nationale : réinvestir dans la lutte contre la douleur ; renforcer la politique de réduction des risques en matière d'addictions ; former les professionnels de santé et accompagner l'évolution des pratiques. Nous les évoquerons tour à tour.
S'agissant, pour commencer, de la lutte contre la douleur, il faut se souvenir que celle-ci a constitué une véritable priorité de santé publique entre 1998 et 2010, avec la succession de trois plans nationaux dédiés, portés au niveau ministériel. Bernard Kouchner avait impulsé le premier plan, qui a notamment permis de simplifier les conditions de prescription de certains antalgiques, dont les stupéfiants, et contribué à structurer progressivement la prise en charge de la douleur au sein des établissements de santé et en ville. Malgré les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, le quatrième plan national de lutte contre la douleur qui était attendu n'a jamais vu le jour. La douleur figure certes dans la loi, depuis 2016, parmi les objectifs auxquels doit concourir la politique de santé publique, mais elle n'apparaît plus, en pratique, comme une priorité.
Or, la part des Français souffrant de douleurs chroniques est estimée entre 20 % et 30 %. La douleur constitue la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'urgences. Pourtant, seuls 37 % des patients douloureux chroniques se déclarent satisfaits de leur prise en charge. Ce bilan témoigne de carences persistantes pour permettre une prise en charge adaptée des usagers. Relevons que les structures spécialisées « douleur chronique » (SDC) pâtissent d'une accessibilité limitée, du fait des délais de prise en charge excessivement longs, et d'une inégale répartition sur le territoire. En conséquence, seuls 3 % des patients douloureux chroniques y ont aujourd'hui accès, alors que 70 % d'entre eux ne reçoivent pas de traitement approprié.
Les SDC se trouvent en situation de fragilité au regard des moyens qui leur sont actuellement dédiés, et la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD) alerte sur la pérennité de certaines structures. Nous recommandons que leur situation soit de toute urgence consolidée. La recherche d'une meilleure coordination de tous les acteurs de l'offre de soins est également indispensable : à cet égard, des dispositifs incitatifs à l'utilisation du dossier médical partagé devraient être soutenus, pour éviter les prescriptions redondantes et les prolongations injustifiées de traitements.
Plus largement, nous préconisons que soit formalisé un nouveau plan national de lutte contre la douleur, pour apporter à la problématique des mésusages d'opioïdes des réponses globales en matière d'offre de soins, de la prévention à la prise en charge.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - J'en viens maintenant à la nécessité de renforcer notre politique de réduction des risques en matière de lutte contre les addictions.
Si nous pouvons nous satisfaire d'une chose, c'est que la France figure parmi les pays européens dans lesquels l'accès des usagers aux traitements par agonistes opioïdes (TAO) est le plus élevé. Cet accès mérite toutefois d'être soutenu et davantage sécurisé, compte tenu des conditions restrictives de prescription de ces traitements, et du refus de certains médecins de les prescrire. Ces refus de soins sont multifactoriels et peuvent s'expliquer, tant par un manque de formation des médecins, que par un refus de principe de suivre certains profils de patients. En tout état de cause, cela justifie de réfléchir aux conditions permettant de sécuriser la situation des patients dépendants. Sur ce point, nous proposons d'envisager un élargissement de l'offre de TAO, par exemple en autorisant la dispensation en ville de la buprénorphine à libération prolongée.
En revanche, la France a pris un retard coupable sur les conditions d'accès à la naloxone, cet antidote aux surdoses d'opioïdes qui permettrait d'éviter jusqu'à quatre décès sur cinq par overdose. Ce point doit indéniablement constituer une autre priorité d'action. Actuellement, l'hétérogénéité des conditions du remboursement et des modalités de délivrance de la naloxone nuit à sa disponibilité. La HAS a pourtant recommandé, dès 2022, d'améliorer sa diffusion grâce à un accès facilité, sans prescription, à toutes les formes de naloxone. Il est grand temps que le Gouvernement prenne les mesures utiles pour mettre en pratique cette recommandation de la HAS.
Enfin, il nous semble nécessaire de donner une portée plus large à la politique de réduction des risques, presque exclusivement tournée vers des publics marginalisés et encore trop confidentielle. Les démarches « d'aller vers » menées dans le cadre de politiques de prévention ciblées doivent être promues, notamment envers les usagers les plus à risques. Les haltes soins addictions (HSA) déployées à titre expérimental depuis 2016 visent précisément à répondre à cette préoccupation. J'aurais souhaité que ce rapport formule des préconisations à cet égard, mais je vous précise qu'en l'attente du rapport d'évaluation final de la direction générale de la santé et faute d'un consensus, de ce fait notamment, difficile à trouver, tel n'est pas le cas, et je le regrette. Je précise que les rapports intermédiaires dont est issue cette évaluation sont tous favorables en termes de santé publique - les HSA sauvent des vies - et de sécurité publique. Je tiens également à préciser que l'expérimentation touche à sa fin le 31 décembre prochain, et que pour que les quelques milliers de personnes en grandes déshérence et en grand danger qui sont littéralement sauvées par ces structures, je pense qu'il sera utile que nous prenions leur avenir en main, en dépassant les clivages partisans comme nous savons le faire ici, et comme Strasbourg a d'ores et déjà su le faire.
Au-delà de telles actions « d'aller vers », il convient de saisir toute la diversité des profils concernés par les mésusages d'opioïdes : ceux-ci incluent des patients devenus tolérants du fait de prescriptions prolongées suite à une intervention chirurgicale lourde ou en raison d'une douleur chronicisée. De ce point de vue, l'éducation thérapeutique constitue un levier à développer pour responsabiliser les patients et les rendre acteurs de leur prise en charge. Les professionnels de la douleur appellent unanimement à ce qu'elle soit renforcée, par des campagnes dédiées et par la mise à disposition d'outils d'autoévaluation du risque de dépendance.
Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - Enfin, l'enjeu de formation des professionnels de santé et plus largement, d'accompagnement de ces professionnels dans l'évolution de leurs pratiques, est tout à fait décisif.
Un premier constat s'impose : le médecin généraliste est aujourd'hui l'acteur central de la prise en charge de la douleur. Son rôle a d'ailleurs été renforcé par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, qui lui confie la mission d'administrer et de coordonner les soins visant à soulager la douleur. Les médecins généralistes prescrivent 86 % des médicaments opioïdes faibles et 89 % des médicaments opioïdes forts. Ils ne bénéficient pourtant de formation complète et adaptée ni sur le traitement de la douleur ni sur la gestion des conduites addictives. La SFETD indique en outre que la réforme du troisième cycle des études médicales aurait conduit à une diminution de moitié du temps de formation consacré à la douleur.
Ces carences dans la formation initiale étant partagées par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, l'une de nos recommandations consiste à prévoir un module renforcé sur la prise en charge de la douleur et des conduites addictives dans les formations initiales des professionnels de santé.
Le développement de programmes de formation continue qui soient aisément accessibles aux professionnels en exercice apparaît également nécessaire, a fortiori dans l'optique que préconise la SFETD d'intégrer le dépistage de la douleur aux consultations de prévention aux âges clés de la vie.
S'agissant de l'évolution des pratiques à soutenir, il ressort de nos auditions que le médecin généraliste se trouve bien souvent isolé et démuni, confronté à des douleurs qu'il ne sait pas gérer autrement que par le recours aux opioïdes. Cette situation favorise l'escalade thérapeutique, alors que les spécialistes recommandent au contraire d'accompagner toute prescription initiale d'opioïde d'une stratégie de déprescription, et de favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des antalgiques non opioïdes. Ces bonnes pratiques, nous l'avons évoqué, sont encore largement méconnues des médecins. L'absence de repérage précoce des troubles de l'usage accentue encore les situations d'impasse thérapeutique pour des patients devenus tolérants puis dépendants, sans toujours ressentir de soulagement de leurs douleurs.
Les professionnels de santé doivent donc être accompagnés dans l'évolution de leurs pratiques. De ce point de vue, les ordres professionnels ont un rôle clair à jouer, en coopération avec la HAS, pour assurer la diffusion et la promotion des référentiels de bonnes pratiques sur la prescription des opioïdes. L'élimination systématique de toute douleur ne doit pas constituer un objectif thérapeutique ultime, et il est essentiel de positionner l'usage des médicaments opioïdes dans une prise en charge multimodale globale, recourant notamment à des approches non médicamenteuses.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - En conclusion, la France dispose d'un système de santé bien armé pour prévenir la survenue d'une crise des opioïdes telle que les États-Unis l'ont vécue. Si un tel phénomène apparaît à ce stade peu probable dans notre pays, rien ne nous prémunit toutefois contre une aggravation des tendances constatées concernant les mésusages de médicaments opioïdes. Si elles ne sont pas rapidement corrigées par un plan d'action approprié, la situation, déjà préoccupante, devrait poursuivre sa dégradation.
En matière de santé publique et de prévention, nous le savons, il est essentiel d'anticiper les risques pour les traiter efficacement. L'ensemble des vingt recommandations que nous formulons sont aisées à mettre en oeuvre et peu ou pas coûteuses. Nous espérons qu'elles pourront être déployées sans délai.
M. Khalifé Khalifé. - Vous êtes-vous intéressées au développement de plantations d'opium à visée thérapeutique en France, comme il en existe en Inde ? Les produits naturels sont moins toxiques que les produits de synthèse. De même, avez-vous inclus le captagon dans le champ de votre étude ?
Mme Frédérique Puissat. - Je remercie nos rapporteures d'avoir respecté l'esprit qui préside à nos missions d'information. Celles-ci visent à contrôler l'action du Gouvernement et à évaluer les politiques publiques. Même si nos positions peuvent diverger, nous parvenons toujours, dans ce cadre, à des consensus, qui font que nos rapports font référence. Ils sont très précis et constituent des mines d'information pour ceux qui veulent se renseigner sur un sujet.
Je souhaite revenir sur les salles de shoot, dénommées « haltes soins addictions ». J'entends les propos de l'une de nos rapporteures sur le sujet, mais je ne souhaite pas m'y associer. En la matière, il faut marcher sur deux jambes : la santé et la sécurité. La proximité de ces salles peut entrainer certaines difficultés pour les voisins.
Mme Patricia Demas, rapporteure. - Non, Monsieur Khalifé, nous n'avons pas abordé la question de la culture d'opium en France.
Mme Anne-Sophie Romagny, rapporteure. - Notre mission visait les opiacés et les opioïdes de synthèse. Le captagon n'est pas un opioïde : il s'agit d'un mélange d'amphétamine et de théophylline.
Mme Anne Souyris, rapporteure. - Notre rapport ne comporte pas de recommandation sur les salles de shoot. Ce sujet n'est pas central dans notre mission, mais il a été évoqué à de nombreuses reprises dans nos auditions. Je n'en ai parlé qu'à titre personnel, sans esprit polémique. Il n'en demeure pas moins que l'expérimentation des salles de shoot arrivera bientôt à son terme et que des choix politiques devront être faits.
M. Alain Milon. - Les salles de shoot ont été créées par la loi Touraine du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dont j'étais rapporteur au Sénat. C'est une bonne idée. Il était question d'en installer un peu partout. Le Sénat a demandé que les salles soient installées dans les hôpitaux, afin qu'elles soient supervisées par des professionnels de santé. Je voterai ce rapport.
M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, je mets aux voix les recommandations de nos rapporteures, ainsi que le rapport d'information.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
___________
Auditions
· Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
Alexandre de la Volpilière, directeur général adjoint en charge des opérations
Philippe Vella, directeur de la direction médicale 2 en charge des opioïdes
Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance
· Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom)
Dr Sophie Desmedt-Velastegui, conseillère ordinale nationale membre de la section Santé publique
· Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop)
Alain Delgutte, membre du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens
· Association des Centres d'Addictovigilance
Pr Caroline Victorri-Vigneau, présidente de l'Association des Centres d'Addictovigilance et responsable du CEIP-A de Nantes
Pr Joëlle Micallef, présidente honoraire de l'Association des Centres d'Addictovigilance et responsable du CEIP-A de Marseille
Pr Hélène Peyrière, responsable du CEIP-A de Montpellier
Dr Maryse Lapeyre-Mestre, responsable du CEIP-A de Toulouse
Dr Amélie Daveluy, responsable du CEIP-A de Bordeaux
· Haute Autorité de santé (HAS)
Charlotte Masia, cheffe du service évaluation des médicaments
Valérie Izard, cheffe de projet au service de l'évaluation des médicaments
Albert Scemama, chef de projet au service des bonnes pratiques
· Fédération française d'addictologie (FFA)
Dr Nicolas Bonnet, vice-président, pharmacien et directeur du Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions
Dr Bernard Basset, secrétaire général
Morgane Merat, chargée de mission politiques publiques
· Les Entreprises du médicament (Leem)
Céline Kauv, directrice des affaires pharmaceutiques
Marion Barreau, juriste en droit de la santé et lutte contre la falsification
Antoine Quinette, responsable affaires publiques France
· Fédération Addiction
Catherine Delorme, présidente
· Halte Soins Addictions de Strasbourg
Gauthier Waeckerle, directeur général
Nicolas Ducournau, chef de service Argos 1 (Strasbourg)
Jean Suss, chef de service Argos 2 (Strasbourg)
· Direction générale de la santé (DGS)
Emmanuelle Cohn, sous directrice politique des produits de santé, qualité des pratiques et des soins
Augustin Clergier, conseiller-expert pharmaceutique, bureau du médicament
Simone Alexe, cheffe du bureau de la prévention des addictions, sous-direction santé des populations, prévention des maladies chroniques
Laure Boisserie-Lacroix, conseillère médicale
· Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Dr Catherine Grenier, directrice des assurés
Véronika Levendof, chargée des relations avec le Parlement
· Autosupport des usagers de drogues (ASUD)
Fabrice Olivet, co-fondateur et secrétaire général
· SAFE
Dr Anne Batisse, présidente
Catherine Duplessy, directrice
· Dr Evelyne Renault-Tessier, médecin spécialiste douleur et soins palliatifs, cheffe de service pôle soins de support préventifs UTEP, Institut Curie
· Pr Benjamin Rolland, psychiatre et addictologue (Faculté de médecine et maïeutique Lyon-Sud)
· Michel Gandilhon, membre de l'observatoire des criminalités internationales
· Bertrand Monnet, professeur à l'Edhec, spécialiste de l'économie du crime
· Société Française d'Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD)
Pr Nicolas Authier, administrateur
· Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca)
Nicolas Prisse, président
· Observatoire Français des Drogues et des Conduites Addictives (OFDT)
Guillaume Airagnes, directeur
Ivana Obradovic, directrice adjointe
· Ambassade de France au Canada
Ronan Parent, conseiller politique
Colonel Charles Hugonnet, attaché de Sécurité intérieure
· Ambassade de France aux États-Unis
Benoit Sevcik, conseiller santé, travail et affaires sociales
· Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EUDA)
Isabelle Giraudon, principal scientist - health consequences
· Halte soins addictions (HSA) de Paris
Jamel Lazic, chef de service
Dr Elisabeth Avril, médecin généraliste et addictologue
· Dr Sibylle Mauries, praticien hospitalier à l'hôpital Bichat-Claude Bernard
Contributions écrites
· Agence européenne sur les drogues (EUDA)
· Groupe Santé Addictions
· Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) Boréal de Paris
TABLEAU DE MISE
EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
___________
|
N° |
Recommandations |
Acteurs concernés |
Support |
|
1 |
Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes |
ANSM, professionnels de santé |
Mesure administrative |
|
2 |
Renforcer l'éducation thérapeutique des patients par la mise à disposition dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les services de médecine d'urgence, d'outils d'auto-évaluation de la douleur et du risque de dépendance |
Ministère de la santé, ANSM, professionnels de santé |
Mesure administrative |
|
3 |
Faire apparaître une mention du risque de dépendance sur les boîtes de médicaments opioïdes, y compris de palier 2 |
Ministère de la santé, ANSM, exploitants |
Voie réglementaire |
|
4 |
Mener une campagne nationale non stigmatisante sur le bon usage et les risques associés à la consommation de médicaments opioïdes à destination du grand public |
Ministère de la santé, ANSM |
Mesure administrative |
|
5 |
Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur |
Ministère de la santé, ARS |
Voie réglementaire |
|
6 |
Systématiser l'évaluation par un médecin spécialiste ou formé à la prise en charge de la douleur ou à l'addictologie au-delà de 3 mois de traitement ou en cas de prise d'une dose journalière supérieure à l'équivalent de 120 mg de morphine |
Ministère de la santé, ANSM, HAS, professionnels de santé |
Voie réglementaire |
|
7 |
Sensibiliser et informer les professionnels soignants par une campagne permettant le dialogue, l'information et l'orientation des patients sur l'usage et les risques des opioïdes |
Ministère de la santé, ANSM |
Mesure administrative |
|
8 |
Évaluer l'impact de l'obligation de recourir à des ordonnances sécurisées pour le tramadol et la codéine et, le cas échéant, envisager de soumettre l'ensemble des opioïdes à une obligation d'ordonnance sécurisée |
Ministère de la santé, ANSM et réseau d'addictovigilance |
Mesure administrative |
|
9 |
Accélérer le calendrier de déploiement d'un dispositif de prescription entièrement numérique partout où cela est possible |
Ministère de la santé |
Mesure administrative |
|
10 |
Travailler sur le conditionnement des médicaments opioïdes pour réduire le nombre de comprimés par boîte lorsque le conditionnement ne correspond pas aux posologies recommandées |
Ministère de la santé, ANSM, exploitants |
Mesure administrative |
|
11 |
Intégrer un module obligatoire renforcé sur le traitement de la douleur et la lutte contre les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés |
Ministère de la santé, unités de formation et de recherche en santé |
Voie réglementaire |
|
12 |
Développer la coopération entre les conseils des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et la Haute Autorité de santé pour favoriser la diffusion des référentiels de bonnes pratiques et des outils d'aide à la prescription et à la dispensation des opioïdes |
Cnom, Cnop, HAS |
Mesure administrative |
|
13 |
Faire apparaître, dans les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation certifiés par la HAS, des messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes, le risque de dépendance et le risque de surdoses |
Éditeurs de logiciels, Ministère de la santé, HAS |
Voie réglementaire |
|
14 |
Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur |
HAS, assurance maladie |
Mesure administrative, conventions professionnelles |
|
15 |
Élaborer des recommandations spécifiques sur la rédaction des supports promotionnels des opioïdes par les laboratoires (constitution d'un cahier des charges, mention explicite des risques de dépendance et de comorbidité, et des indications de prescription en première et deuxième intention établies par les autorités sanitaires) |
ANSM, HAS |
Mesure administrative |
|
16 |
Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitements par agonistes opioïdes ou en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde |
Ministère de la santé, assurance maladie |
Voie réglementaire, mesure administrative |
|
17 |
Former les services de police et de secours à l'utilisation de la naloxone et les équiper de kits de naloxone prêts à l'emploi |
Ministère de l'intérieur, Ministère de la santé |
Mesure administrative |
|
18 |
Améliorer la disponibilité des traitements de substitution aux opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée |
Ministère de la santé, ANSM, assurance maladie |
Mesure administrative |
|
19 |
Engager une réflexion avec les autorités sanitaires sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme traitement agoniste aux opioïdes |
Ministère de la santé, ANSM et réseau d'addictovigilance |
Mesure administrative |
|
20 |
Consolider le réseau national d'addictovigilance en renforçant les moyens humains à la disposition des CEIP-A et développer des dispositifs d'analyse des drogues permettant d'évaluer précocement les évolutions des produits et leurs conséquences sur la santé humaine |
Ministère de la santé, ANSM, CEIP-A, structures de soins et de réduction des risques |
Mesure administrative |
ANNEXES
TABLEAU
RÉCAPITULATIF
DES CONDITIONS DE PRESCRIPTION DES
OPIOÏDES
___________
Source : ANSM
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
___________
Mmes Patricia Demas, Anne-Sophie Romagny et Anne Souyris, rapporteures pour la commission des affaires sociales, ont souhaité permettre à l'ensemble des personnes entendues de faire figurer leur contribution écrite ou leurs réponses au questionnaire en annexe du présent rapport.
Ne figurent ci-après que les contributions dont les auteurs ont accepté la publication.
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (CNOP)
___________
Consommation d'opioïdes et risques associés
1. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ? Quelles substances disponibles sur le marché français sont les plus concernées et sous quelle forme ? Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Le nombre de Français traités par des antalgiques opioïdes forts (morphine, fentanyl ou oxycodone) a presque doublé (+ 45 % entre 2006 et 2017) en 10 ans et cela principalement pour des douleurs non liées au cancer ( source ANSM, 2019).
Les antalgiques opioïdes sont consommés par environ 12 millions de Français par an.
Profils des patients ( source ANSM, 2019)
En 2015, les utilisateurs d'antalgiques sont majoritairement des femmes, que ce soit pour les opioïdes faibles (57,7 %) ou pour les opioïdes forts (60,5 %). Les utilisateurs d'opioïdes forts sont plus âgés que ceux d'opioïdes faibles (âge médian de 64 ans et 52 ans). La prescription intervient le plus fréquemment dans le cadre d'une affection longue durée (ALD) en cours (69,3 % et 34,5 %) ; les patients concernés ont été plus souvent hospitalisés dans l'année (57,6 % et 31 %) et ont consulté un médecin spécialiste (hors médecine générale) (79,4 % et 74,6 %).
Les prescripteurs d'antalgiques opioïdes sont des médecins généralistes dans la grande majorité des cas (86 % pour les opioïdes faibles et 89 % pour les opioïdes forts) puis des dentistes (2,8 % et 0,3 %), des rhumatologues (2,2 % et 1,7 %) et des orthopédistes (1,9 % et 1,3 %).
Il est important de préciser que la dépendance pharmacologique, le syndrome de sevrage, la tolérance, ou encore un usage non conforme des traitements antalgiques prescrits à un patient dont la douleur est incorrectement prise en charge ou insuffisamment soulagée (dans ce dernier cas, la “pseudo-addiction” disparaît avec l'amélioration de la prise en charge antalgique) ne sont pas des signes d'un mésusage. Ce-dernier correspond en effet à une utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit, non conforme à l'autorisation de mise sur le marché ou à l'enregistrement, ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques ; il peut survenir à toutes les étapes de la chaîne de soins - prescription, délivrance administration, utilisation - et concerner les indications, la posologie, le schéma d'administration, la durée du traitement, les contre-indications... Il recouvre aussi le phénomène de surprescription ou de troubles de l'usage des opioïdes (les critères diagnostiques des troubles de l'usage des opioïdes sont décrits dans le DSM5 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5).
Tendances mésusage et décès
L'exposition aux opioïdes est restée stable sur environ 10 ans mais l'évolution des hospitalisations pour intoxication aux antalgiques opioïdes et celle des décès est significativement en hausse en France.
Contrairement aux idées reçues, ce sont majoritairement les personnes qui utilisent des antalgiques opioïdes qui sont victimes de surdoses (2 586 hospitalisations en 2017, et au moins 2 à 300 décès, le tramadol étant la molécule la plus souvent impliquée dans les décès) et non les usagers de drogues illicites.
Concernant les décès directs liés (139) à la consommation de médicaments opioïdes, 4 molécules sont principalement impliquées : le tramadol n=48 (en baisse), la morphine n=34 (en légère baisse), l'oxycodone n=27 et la codéine n=26 (en augmentation, plus marqué pour l'oxycodone) - source : addictovigilance.fr, 2022.
Principaux mésusages constatés ( source : ANSM, 2019)
• Usage problématique de la codéine :
> Les cas d'usage problématique sont rapportés majoritairement après obtention de la codéine sur prescription médicale (53 %).
> Un autre usage problématique de la codéine est son usage récréatif chez les jeunes. La codéine est ainsi mélangée avec d'autres médicaments et du soda pour obtenir la boisson communément appelée “purple drank” ou “lean.
• Usage problématique du tramadol seul ou associé au paracétamol :
> Le motif initial de la consommation du tramadol est une prise en charge de la douleur (87 % des cas renseignés) et le mode d'obtention du tramadol renseigné est principalement sur prescription médicale (71 %).
> Le tramadol est consommé à des fins autres qu'antalgiques dans 38,6 % des cas. L'usage détourné du tramadol dans un contexte de polytoxicomanie avec recherche d'effets psychoactifs est en augmentation avec 40 cas en 2016 (26 en 2015).
• Usage problématique de l'oxycodone : L'oxycodone est l'antalgique opioïde dont la consommation a le plus fortement augmenté (+ 738 % en 10 ans).
> L'origine de la consommation est le traitement de la douleur dans 73,7 % des cas.
> L'obtention de l'oxycodone est illégale dans 18,4 % des cas.
> Un usage récréatif hors contexte douloureux est rapporté dans 7 % des cas et une utilisation hors AMM de l'oxycodone en tant que médicament de substitution aux opioïdes dans 1,7 % des cas.
• Usage problématique du sulfate de morphine : Le sulfate de morphine est l'antalgique opioïde fort le plus consommé en ville et ayant le taux de notifications le plus important (en particulier la spécialité Skénan qui représente 81 % cas). Deux situations sont décrites dans les notifications d'addictovigilance :
> la première concerne des sujets ayant développé une dépendance à la suite de la prescription de sulfate de morphine comme antalgique.
> la deuxième comprend des usagers de drogues consommant du sulfate de morphine soit en usage récréatif, soit en tant que médicament de substitution aux opioïdes.
Facteurs favorisants ces évolutions :
- Sensibilisation et promotion auprès des professionnels de santé de la prise en charge de la douleur notamment par les opioïdes (indication dans les douleurs non cancéreuses) dans un objectif de réelle prise en compte et amélioration de celle-ci, mais recommandations de bonnes pratiques tardives ( HAS, publication en 2022).
- Méconnaissance par les professionnels de santé des propriétés des opioïdes sur le psychisme (anxiolyse, euphorie, diminution de l'insomnie...)
- Facteurs sociaux (performance, injonction au bonheur, valeurs individualistes, instantanéité et intensité, consommation de biens matériels, croyance qu'il existe toujours un produit disponible pour modifier l'humeur, le malaise, la pensée ou les performances), dégradation de la santé mentale de la population, difficulté d'accès aux soins => favorise le mésusage dans un but autothérapeutique.
2. Décrivez les principaux effets indésirables associés aux médicaments opiacés et opioïdes et leur prévalence.
Identifiez-vous des populations particulièrement vulnérables ?
Effets indésirables les plus fréquents
• Communs à tous les antalgiques faibles et forts :
- Constipation (le plus fréquent) ?
co-prescription recommandée d'un laxatif (
HAS
2022)
- Nausées, vomissements
- Troubles de la vigilance
- dépression respiratoire
- Maux de tête
- Effets dysphoriques
- sécheresse buccale
- Anémie (manque de globules rouges qui entraîne un état de fatigue)
• Spécifiques au tramadol (action à 70 % aminergique) :
- Crises convulsives,
- Troubles visuels,
- Syndrome sérotoninergique,
- Hyponatrémie,
- Hypoglycémie
Le CNOP ne dispose pas de données concernant la prévalence de ces effets indésirables autres que celles mentionnées dans les RCP.
Lors de l'étude DANTE (une Décennie D'ANTalgiques En France), 222 questionnaires sur la codéine ont été analysés. Il était demandé aux patients qui prenaient de la codéine tous les jours ou plusieurs fois par semaine (95 patients sur 222), s'ils ressentaient des effets indésirables. Plus du tiers d'entre eux (n=33) ont répondu “oui”. Les effets indésirables cités sont la somnolence (n=10), les nausées (n=5), la constipation (n=5) et les douleurs abdominales (n=5). Neuf patients ont cité d'autres effets indésirables dont trois des effets psychoactifs (dépendance, accoutumance ou manque). ( ANSM 2019)
Populations vulnérables
? Effets indésirables plus fréquents : Sujets âgés, insuffisants rénaux, selon le contexte pathologique.
? Risques accrus de surdoses : consommateurs d'autres substances dépressives du système nerveux central (alcool, benzodiazépines, ...) et insuffisants respiratoires, enfants, antécédents de surdose, reprise après une période d'arrêt, changement d'opioïdes sans titration, période d'initiation, recherche désespérée d'un effet antalgique suite à une accentuation de la douleur.
? Risques accrus de mésusage ou de trouble de l'usage : antécédents d'addiction, antécédents de troubles psychiatriques.
3. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et de politique de réduction des risques ?
Le système de santé français par lui-même apporte certaines garanties de protection contre une telle crise :
- La sécurisation de la chaîne du médicament par l'intervention de pharmaciens à ses différents maillons permettant de réduire les risques de contrefaçon et de contamination.
- Le rôle du pharmacien dispensateur dans la promotion du bon usage des médicaments.
- La mise en place de programmes observationnels d'addictovigilance ( DTA, ASOS, OSIAP, DRAMES, OPPIDUM etc) - à maintenir et promouvoir.
En complément, au cours des dernières années, la France a mis en place différentes mesures visant à préserver la santé publique dans ce domaine, telles que :
- l'encadrement des avantages, la charte de la visite médicale
- l'encadrement de la publicité pour les médicaments de PMO
- l'encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments opioïdes (stupéfiants et assimilés)
- l'élaboration et la diffusion aux professionnels de recommandations de bonnes pratiques sur le traitement de la douleur et l'usage des opioïdes (HAS : Utilisation des médicaments opioïdes, Diagnostic du trouble de l'usage d'opioïdes et prévention du risque de surdose, Juste prescription des opioïdes pour un bon usage)
- La mise en place d'une politique publique de réduction des risques et des dommages intégrant notamment :
- une feuille de route gouvernementale pour prévenir les surdoses d'opioïdes : Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes : feuille de route 2019-2022
- la promotion de l'accès à la naloxone (préventif et curatif),
- le lancement d'appels à projets par les ARS permettant le déploiement de programmes de sensibilisation aux risques de surdose (ex : projet POP), destinés aux patients et à leur entourage,
- l'accès à l'analyse des produits permettant aux consommateurs de connaître la composition exacte des substances qu'ils s'apprêtent à consommer, réduisant ainsi les risques de surdose liés à des produits plus puissants non anticipés
4. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
• Marché des nouveaux opioïdes de synthèse :
- Circulation de nitazènes comprenant de nombreuses molécules et faisant partie des nouveaux opioïdes benzimidazolés (meto-, isoto- proto-).
- Il s'agit d'agonistes particulièrement puissants (isonitazene 500 fois plus puissant que la morphine) et sélectifs des récepteurs opioïdes u, synthétisés à la fin des années 50 comme potentiels médicaments antalgiques, mais dont le développement a été interrompu en raison d'un rapport bénéfice/risque défavorable.
- Ces produits ne sont pas détectables par les dispositifs d'analyse de drogues ni par les screening toxicologiques de routine, nécessitant d'avoir recours à des méthodes de dosage spécifique type spectrométrie de masse (analyse via Sintes) et de confronter à la clinique.
- Réapparition de cette famille de molécules en 2019 avec l'isotonitazène puis diversification et renouvellement régulier des nitazènes détectés au niveau mondial comme en France.
Trois séries d'incidents sanitaires liés à des usages de substances opioïdes ont été rapportées en 2023. Si elles ont toutes été temporaires, leur gravité a donné lieu à des alertes sanitaires et a engendré une mobilisation nationale afin d'informer les usagers et les professionnels et de favoriser des mesures de RdRD (diffusion massive de naloxone, recours à l'analyse de drogues, etc.).
- La première série d'incidents a eu lieu à Montpellier où, suite à la consommation d'une poudre blanche vendue sous l'appellation d'« héroïne chinoise » mais contenant en réalité un puissant opioïde de synthèse, l'isotonitazène, neuf surdoses engendrant des dépressions respiratoires sévères ont été rapportées, dont l'une a engendré un décès.
- La deuxième série d'incidents a été rapportée en Seine-Saint-Denis où des échantillons revendus comme héroïne mais contenant en réalité un mélange de cannabinoïdes de synthèse et de substances opioïdes ont provoqué plusieurs dizaines de surdoses mêlant symptômes physiques et neuropsychiatriques, allant parfois jusqu'à des hospitalisations.
- Enfin, sur l'île de La Réunion, treize cas d'intoxications à un autre opioïde de synthèse, le protonitazène, ont été rapportés, dont sept ont eu lieu en détention. Trois d'entre eux ont conduit à des décès, quatre à des hospitalisations en réanimation. ( Source OFDT, déc.2024)
• Dangers identifiés :
- Risques de tolérance et de dépendance plus importantes
- Mélanges (avec des médicaments...), contrefaçon
- Tromperies et adultérations des produits habituels
- Distribution non-contrôlée, marché illicite
- Risque accru d'overdose sévère, avec mise en jeu du pronostic vital, voire décès
- Réversion des effets par la naloxone, cependant souvent la dose de naloxone nécessaire est supérieure à celles utilisées en cas d'overdose par héroïne ou par morphine, et peut même nécessiter des administrations répétées.
Remarque : En ce qui concerne le narcotrafic, les consommateurs doivent être informés et bénéficier de mesures de RdRD adaptées aux nouvelles molécules.
5. Quelles mesures pourraient-elles, en France, contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène et, plus largement, à circonscrire les mésusages et risques de dépendance observés ?
• Maintenir et promouvoir les programmes observationnels d'addictovigilance ( DTA, ASOS, OSIAP, DRAMES, OPPIDUM, etc.).
• Permettre une meilleure appropriation des nouvelles règles de prescription et de dispensation des médicaments stupéfiants et assimilés par les professionnels de santé.
• Renforcer la coopération interprofessionnelle et l'accès aux soins :
- renforcer la coopération avec les médecins (ou les infirmiers en pratique avancée notamment en cas de douleurs cancéreuses) pour une juste prescription et dispensation des médicaments opioïdes.
-Proposer un objectif de santé publique commun médecins/pharmaciens relatif au bon usage des opioïdes dans le cadre des conventions avec l'Assurance Maladie.
- Promouvoir une prise en charge pluridisciplinaire algologue-addictologue dans la gestion des cas complexes.
- Promouvoir l'orientation vers un addictologue en cas de troubles de l'usage des opioïdes et la mise en place d'un éventuel traitement de substitution aux opiacés.
- Améliorer l'accès aux centres antidouleur ou rendre possible la tenue de réunions de concertation pluriprofessionnelle présentielles et distancielles entre les services spécialisés et la ville.
Remarque : Les algologues ont tendance à déprescrire très progressivement et de façon personnalisée les antalgiques opioïdes (qui ne sont indiqués qu'en troisième intention dans les douleurs chroniques neuropathiques ou nociplastiques).
• Lancer une campagne nationale de communication grand public sur le bon usage et la vigilance liés à la prise de médicaments opioïdes.
• Renforcer la qualité de la prescription antalgique :
- Respect des recommandations et bonnes pratiques en matière de prise en charge de la douleur ( HAS, 2022),
- Amélioration de l'étude de l'origine de la douleur
- Évaluation du risque de mésusage avant et pendant
- Évaluation de la douleur à chaque consultation
- Consultations rapprochées notamment en titration : prescription en faveur des formes à libération prolongée (LP) plutôt qu'à libération immédiate (LI)
- En l'absence de bénéfices après 3 mois ou la prise d'une dose > 120 mg équivalent morphine, une évaluation par un spécialiste est nécessaire
- Recherche et évaluation d'une éventuelle hyperalgésie induite par les opioïdes par des spécialistes en ville.
• Élargir l'accès à la naloxone pour prévenir les surdoses.
- Prescription et dispensation systématique de naloxone lors de la prescription/dispensation d'un opioïde.
- Autoriser la mise à disposition en prescription médicale facultative (PMF) de toutes les spécialités de naloxone et une prise en charge par l'Assurance Maladie de la naloxone sur prescription pharmaceutique (à l'instar du dispositif mis en place pour la contraception d'urgence).
- Développer un programme type programme POP à l'échelle nationale.
Encadrement de la prescription et de la délivrance d'opioïdes et prévention des mésusages
6. Décrire l'encadrement actuel de la prescription et de la dispensation d'opioïdes en France.
Réglementation imposée aux pharmaciens pour les médicaments stupéfiants
• Conservation des médicaments stupéfiants dans une armoire sécurisée et fermée à clé ne contenant que des médicaments stupéfiants.
• Application du délai de carence de l'ordonnance (présentation dans les 3 jours pour exécution de la totalité de l'ordonnance).
• Vérification de la validité de l'ordonnance sécurisée, la qualité du prescripteur et des mentions obligatoires à apposer sur l'ordonnance (le ou les numéros d'enregistrement à l'ordonnancier ; la date d'exécution ; les quantités délivrées en unités de prise, prescription en toutes lettres, prescription limitée à 28 jours).
• Pour certains médicaments stupéfiants : délivrance fractionnée.
• Identité du porteur de l'ordonnance ? vérification et inscription dans l'ordonnancier des stupéfiants.
• Tenue d'un registre comptable des stupéfiants.
• Destruction des stupéfiants réglementée.
Réglementation des médicaments antalgiques opioïdes dits “assimilés stupéfiants”
? Certains médicaments antalgiques relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumis en totalité ou en partie au régime particulier des stupéfiants par décision du directeur général de l'ANSM. C'est le cas des médicaments à base de codéine et de tramadol (Article R5132-39 du CSP).
• Médicaments (dont antalgiques) à base de codéine :
- 2017 : Médicament soumis à prescription médicale obligatoire (sirops en liste II et autres formes pharmaceutiques en liste I)
- 2025 : Ordonnance sécurisée obligatoire et prescription limitée à 12 semaines non renouvelable.
• Médicaments à base de tramadol :
- 2020 : Prescription limitée à 12 semaines non renouvelable
- 2025 : Ordonnance sécurisée obligatoire.
7. Quels critères doivent être pris en compte par les médecins lors de la prescription d'opioïdes afin de garantir leur usage médical approprié et pour déterminer le caractère favorable ou défavorable de la balance bénéfices-risques ?
• Évaluation du risque de mésusage ou de dépendance avant prescription à l'aide d'un questionnaire ORT (= opioid risk tool). Prise en compte de critères tels que les antécédents personnels ou familiaux d'addiction, les antécédents personnels ou familiaux de troubles psychiatriques. Ces critères n'interdisent pas la prescription de médicaments opioïdes si elle s'avère nécessaire mais incitent à un suivi plus rapproché.
• Respect des AMM et des recommandations ( HAS, 2022 et SFETD, 2016) :
- Prescription à la dose efficace la plus faible
- Prescription pour la durée la plus courte possible (14 jours maximum pour permettre une réévaluation rapide et systématique de la pertinence du traitement).
Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser les antalgiques opioïdes dans la prise en charge de douleurs chroniques liées à des céphalées primaires, notamment les migraines car il exacerbent les nausées, ou à des douleurs nociplastiques (dysfonctionnelles) ( source HAS, 2022).
• Raccourcir les durées de prescription à l'initiation de traitement, effectuer des réévaluations rapprochées et fractionner quand c'est possible les dispensations.
• Systématisation du travail pluriprofessionnel médecin-pharmacien dès la première prescription.
8. Une des causes fréquemment évoquées de la crise des opioïdes aux États-Unis est le défaut de formation des professionnels sur le risque de dépendance associé à la consommation d'opioïdes. La formation des médecins et des pharmaciens en France souffre-t-elle selon vous de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
? Formation initiale :
- Renforcer la formation des médecins et pharmaciens au repérage des risques et des dommages (RPIB) et à l'évaluation d'un trouble de l'usage, à la connaissance de propriétés euphorisantes anxiolytiques des opioïdes, à l'orientation vers l'offre de soins en addictologie (CSAPA, CAARUD, CJC, services d'addictologie, pôles ou coordination en addictologie = SRAE, COREADD, GRAND EST ADDICTIONS...)
- Renforcer la formation initiale des pharmaciens sur la prise en charge de la douleur
Orientations prioritaires de l'ANDPC 2023-2025 :
- fiche n° 3 Amélioration de l'évaluation, du traitement et de la prise en charge de la douleur
- fiche n° 19 Repérage, accompagnement et prise en charge des pratiques addictives
La prise en charge de la douleur fait l'objet de plusieurs programmes de formation agréés DPC (à compléter)
- Faire connaître la formation aux entretiens POMI (voir question 10)
? Recommandations de bonnes pratiques ( HAS et SFETD) :
La HAS a lancé un p rogramme visant à préciser et encadrer les stratégies thérapeutiques en matière de prescription et consommation d'opioïdes et ainsi limiter les risques de mésusage : recommandations de bonnes pratiques concernant l'utilisation des médicaments opioïdes, le diagnostic du trouble de l'usage d'opioïdes et la prévention du risque de surdose, la juste prescription pour un bon usage, la prise en charge de la douleur aiguë et chronique par traitement antalgique opioïde.
L'objectif de ces recommandations est de permettre une juste prescription des opioïdes sans en limiter l'accès et de faire le point sur toutes les bonnes pratiques en matière d'indications, d'instauration du traitement, de suivi et d'arrêt, de modalités d'utilisation, de durée de la prescription, d'effets indésirables et surdosages ainsi que d'informations délivrées aux patients.
=> Il semble nécessaire de renforcer la communication autour de ces bonnes pratiques et leur prise en main par les professionnels.
=> Renforcer la promotion d'outils d'aide à la prescription et à la dispensation des opioïdes ( ex : livret Médicaments antalgiques opioïdes du RESPADD).
9. Comment les ordres encouragent-ils les professionnels de santé à actualiser leurs connaissances sur les recommandations sanitaires concernant l'usage et la délivrance des opioïdes, et à assurer leur respect ?
Pour l'Ordre national des pharmaciens :
• L'Ordre veille à la compétence des pharmaciens et est chargé du contrôle du DPC.
• Encouragement par des partenariats et travaux communs avec les institutions :
- élaboration de recommandations conjointes avec le CNOM sur la prescription et la dispensation des traitements de substitution aux opiacés (TSO) (annexe sur les modalités de prescription et dispensation des stupéfiants) - 2024.
- élaboration d'un document professionnel sur la réduction des risques et des dommage s ( RDRD ), 2023 dans le champ de l'addiction aux opioïdes, traitant notamment le repérage des personnes à risque de surdose aux opiacés (partenariat avec la MILDECA et les associations d'usagers de drogues IV).
• mise à disposition et promotion auprès des pharmaciens et des médecins d'un site dédié aux médicaments à dispensation particulière à l'officine rappelant les règles de dispensation notamment des stupéfiants : Meddispar.
• mise à disposition et promotion d'outils professionnels (procédure Démarche Qualité à l'Officine sur la dispensation des médicaments stupéfiants, documents d'information professionnelle sur le site du Cespharm).
• Relai des actualités des institutions et sociétés savantes sur les différents sites de l'Ordre ( Cespharm, Meddispar, Ordre des pharmaciens, DQO...).
• Partenariat avec la Fédération Addiction la diffusion d'une affiche dans toutes les pharmacies (PUI et officines) avec un courrier co-signé pour sensibiliser les patients à l'utilisation de la naloxone (2021).
• En cas de non respect des règles de délivrance entraînant une atteinte à la santé du patient ou un mésusage ou trafic, possibilité de poursuites disciplinaires pour le pharmacien (de même pour le médecin en cas d'atteinte à la santé publique).
10. Existe-t-il des outils de suivi des prescriptions d'opioïdes ? Si oui, comment évaluez-vous leur efficacité ?
• Depuis le 8 janvier 2025, les pharmaciens d'officine peuvent proposer des entretiens d'accompagnement aux patients sous antalgiques opioïdes palier II (molécules concernés tramadol, poudre d'opium, codéine, dihydrocodéine).
L'objectif est de repérer ou prévenir un mésusage ou une dépendance à ces médicaments. Ces entretiens sont proposés par le pharmacien au premier renouvellement d'une prescription d'un de ces médicaments, c'est-à-dire à la seconde délivrance.
Au cours de ces échanges, le pharmacien doit informer sur les risques associés aux opioïdes de palier II et rappeler les règles de bon usage.
L'entretien comporte également une évaluation du risque de mésusage à l'aide du questionnaire POMI en 5 questions. En cas de suspicion de surdosage ou de mésusage, le pharmacien alerte le prescripteur ou le médecin traitant, avec l'accord du patient.
Des outils sont mis à la disposition des pharmaciens par l'Assurance pour la conduite de ces entretiens ( disponibles en ligne sur le site du Cespharm).
Compte-tenu de la récente mise en place de ce dispositif, nous ne disposons pas de données d'évaluation à ce jour.
• Le programme d'observation d'addictovigilance ASOS : enquête annuelle auprès de 500 pharmacies d'officine tirées au sort, avec pour objectif de décrire la population traitée par antalgiques et les modalités de prescription, évaluer le respect des règles de prescription et voir l'évolution dans le temps des traitements par antalgiques opioïdes.
• Par ailleurs, le Dossier Pharmaceutique permet un suivi des dispensations de médicaments.
La consultation du DP par le pharmacien permet de visualiser les médicaments dispensés (remboursés ou non, prescrits ou non) au cours des 12 derniers mois (3 ans pour les médicaments biologiques et 21 ans pour les vaccins) et contribue ainsi à la sécurisation de la dispensation quant aux redondances et interactions médicamenteuses.
La consultation du DP peut aussi permettre au pharmacien de repérer de potentiels cas de mésusage et d'orienter.
11. (Pour le Cnom uniquement) Quel rôle joue l'Ordre des Médecins dans la mise en place de stratégies alternatives aux opioïdes pour la prise en charge de la douleur ?
L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Les conditions de réévaluation périodique des traitements par médicaments opioïdes vous paraissent-elles adaptées ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?
12. (Pour le Cnop uniquement) Les pharmaciens disposent-ils de protocoles clairs pour la vérification des prescriptions d'opioïdes ? Quelle différence l'usage d'ordonnance sécurisée induit-elle pour le pharmacien ? Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?
Protocoles pour la vérification des prescriptions et la dispensation de médicaments opioïdes
• Promotion et diffusion des b onnes pratiques de dispensation, encadrant chaque analyse pharmaceutique et chaque dispensation.
• Dans le cadre de la démarche qualité à l'officine (DQO), la procédure P03 : Dispensation des médicaments stupe'fiants : propose une conduite à tenir détaillée pour les différentes étapes de la dispensation des stupéfiants : vérification de l'ordonnance, analyse pharmaceutique, validation de l'ordonnance, etc.
• Le site Meddispar propose une page dédiée aux médicaments stupéfiants et assimilés stupéfiants rappelant les règles de dispensation de ces médicaments.
Ordonnance sécurisée pour la dispensation de Tramadol et de Codéine
? L'usage de l'ordonnance sécurisée induit pour les pharmaciens un critère supplémentaire d'analyse de la recevabilité de l'ordonnance.
NB : L'Ordre a été consulté par l'ANSM en juillet 2024 quant à l'obligation de prescription sur ordonnance sécurisée du tramadol et de la codéine. À l'occasion de cette consultation, l'Ordre a émis un avis favorable accompagné de certaines réserves :
En parallèle de ces mesures additionnelles, il paraît indispensable d'intensifier la sensibilisation des prescripteurs aux bonnes pratiques de prescription des opioïdes, notamment conformément aux recommandations de la HAS et de renforcer la communication sur les ordonnances sécurisées, certains logiciels d'aide à la prescription se présentant comme “sécurisés”, ce qui peut être source de confusion pour les prescripteurs.
Le déploiement de la e-prescription nous semble une mesure plus efficace et plus concrète pour sécuriser la prescription et la délivrance de molécules susceptibles d'abus et de détournement, dont la codéine.
13. (Pour le Cnop uniquement) Comment le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens contribue-t-il à la surveillance de la délivrance des opioïdes en pharmacie, notamment en cas de prescription douteuse ?
• Promotion des bonnes pratiques de dispensation : [...] conformément à l' article R. 4235-61 du code de la santé publique, lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
• Un pharmacien peut refuser de délivrer une ordonnance en cas de non-conformité aux obligations réglementaires liées au médicament prescrit. Lors de l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, le rôle du pharmacien est, entre autres, de procéder aux vérifications réglementaires de la prescription. Il doit refuser la délivrance si elles ne sont pas respectées et prendre contact avec le prescripteur afin qu'il y apporte les modifications nécessaires.
• Le déploiement de la e-prescription et l'utilisation par le pharmacien lors de la dispensation permet une surveillance renforcée et limite les falsifications d'ordonnance.
• Le Dossier Pharmaceutique peut permettre un suivi des dispensations de médicaments. La consultation du DP par le pharmacien permet de visualiser les médicaments dispensés (remboursés ou non, prescrits ou non) au cours des 12 derniers mois (3 ans pour les médicaments biologiques et 21 ans pour les vaccins) et contribue ainsi à la sécurisation de la dispensation. La consultation du DP peut permettre au pharmacien de repérer de potentiels cas de mésusage et d'orienter. Il présente l'intérêt d'accéder à la dispensation de médicaments non pris en charge par l'Assurance Maladie (ex : prontalgine, néo-codion).
• Autres mesures ne relevant pas de l'Ordre des pharmaciens :
- Connexion en vue de déclaration et/ou de récupération des cas de falsifications d'ordonnances et de nomadisme à une fréquence hebdomadaire sur ASAFO-pharma
- Existence de systèmes d'alerte aux pharmaciens sur les falsifications d'ordonnances et les cas de nomadisme via les instances locales ARS, CPAM, syndicats, certains CROP...
14. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui adapté aux risques de mésusage constatés ?
Un certain nombre de conditionnements ont été récemment adaptés par l'ANSM (par exemple pour le tramadol en boite de 10 unités).
Avis du CNOP transmis à l'ANSM lors de la consultation concernant la prescription du tramadol sur ordonnance sécurisée en juillet 2024 : Il semble important de faire connaître plus largement aux pharmaciens la mise à disposition de conditionnements limités à 10 unités pour certaines présentations de tramadol.
? Il serait intéressant d'adapter les conditionnements de certains opioïdes en fonction des posologies recommandées de façon à ajuster au mieux la dispensation aux besoins du patient.
Exemples
• Cas de l'Ixprim (tramadol + paracétamol) : l'unique conditionnement commercialisé en France est composé de 20 comprimés ce qui, souvent, n'est pas adapté aux besoins des patients et aux prescriptions : il serait nécessaire de proposer, comme pour le Tramadol des boites de 10 et de 30 comprimés.
• Cas du Dafalgan codéiné : même remarque que pour l'Ixprim, le Dafalgan codéiné contenant 16 comprimés est inadapté aux posologies recommandées.
• Tramadol en gouttes (utilisation majoritairement pédiatrique) ? compte-goutte inadapté à risque de surdosage élevé.
• Oramorph en gouttes ? fractionnement ou délivrance adaptée impossible.
15. L'ANSM a décidé d'aligner la durée maximale de prescription de la codéine sur celle du tramadol, soit douze semaines. D'autres réductions de la durée maximale de prescription vous semblent-elles opportunes ?
Non.
16. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Comment les médecins et les pharmaciens peuvent-ils mieux collaborer pour garantir une gestion sécurisée de la prescription et de la délivrance des opioïdes ?
Par définition, un patient en mésusage ou en usage auto-thérapeutique ou en trouble de l'usage des opioïdes aura du mal, de par son ambivalence, à confier aux soignants sa difficulté de gestion et les bénéfices secondaires engendrés. Le défaut de coordination des professionnels aggrave la situation.
Les Ordres des médecins et des pharmaciens ont travaillé sur l'élaboration de recommandations conjointes sur la prescription et la dispensation des traitements de substitution aux opiacés (TSO) (annexe sur les modalités de prescription et dispensation des stupéfiants). L'essence même de ce document collaboratif des Ordres est d'inciter à un partenariat médecin/pharmacien dans un objectif d'amélioration de la prise en charge et de sécurisation du patient et des professionnels.
Travail pluriprofessionnel comme pour toute maladie chronique :
- Dispensation fractionnée si besoin.
- Mise en place d'objectifs de soin partagés, de consultations rapprochées et de remontées du pharmacien au médecin par téléphone, messagerie sécurisée ou via mon espace santé avec l'accord du patient.
- Proposition : Dès l'instauration des médicaments opioïdes, à l'instar de la prescription des médicaments de substitution aux opiacés ou agonistes aux opiacés, le médecin prescripteur pourrait indiquer le nom de la pharmacie dispensatrice désignée par le patient sur l'ordonnance et établir un contact avec le pharmacien dispensateur par téléphone, messagerie sécurisée ou via mon espace santé.
- Proposition : Établir un objectif de santé publique commun médecins/pharmaciens relatif au bon usage des opioïdes dans le cadre des conventions avec l'Assurance Maladie.
17. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liée soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opiacés pour avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
• La communication autour des risques de mésusages et de dépendance serait à renforcer auprès du public et auprès des professionnels de santé.
• Au sujet des mentions d'alertes sur les conditionnements, le CNOP a été consulté en novembre 2024 par l'ANSM sur l'apposition de telles mentions sur les médicaments opioïdes antalgiques de palier III et TSO :
“Concernant les opioïdes de palier III, l'Ordre s'interroge sur l'impact d'une mention apposée sur le conditionnement extérieur de ces médicaments, dans la mesure où la grande majorité des opioïdes forts relèvent de la réglementation des médicaments stupéfiants et sont soumis à déconditionnement au moment de la dispensation. De fait, les patients peuvent ne pas avoir accès aux conditionnements secondaires de ces médicaments.
L'Ordre des pharmaciens tient également à rappeler que la notice patient reste un élément que le pharmacien doit encourager à consulter. L'Ordre s'interroge, enfin, sur l'absence d'une telle mention sur d'autres médicaments à risque de surdosage fatal également.
Enfin, dans le cadre d'une communication auprès des professionnels de santé lors de la mise en place de cette mesure, il nous semble important d'insister sur la recommandation d'une coprescription de naloxone avec les médicaments opioïdes antalgiques ou TSO et sur l'accessibilité de certaines formes de naloxone sans ordonnance en pharmacie”.
18. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
? Proposer la prescription et la dispensation systématique de naloxone avec la dispensation d'un opioïde.
? Une prise en charge par l'Assurance Maladie de la naloxone sur “prescription pharmaceutique” serait pertinente pour en faciliter l'accès (à l'instar du dispositif mis en place pour la contraception d'urgence).
? Intégrer les données du DP dans le DMP pour permettre l'accès aux médecins des données de dispensation des médicaments.
? Proposer un objectif de santé publique commun médecins/pharmaciens relatif au bon usage des opioïdes dans le cadre des conventions avec l'Assurance Maladie.
ASSOCIATION DES
CENTRES D'ÉVALUATION
ET D'INFORMATION SUR LA
PHARMACODÉPENDANCE-ADDICTOVIGILANCE (CEIP-A)
___________
1. Certaines publications distinguent les opiacés et les opioïdes, les premiers renvoyant aux dérivés naturels du pavot, les autres désignant des composés semi-synthétiques ou synthétiques. Validez-vous cette distinction ? D'un point de vue pharmacologique, est-il pertinent de différencier les deux notions ? Quelles différences établissez-vous entre elles ?
2. Décrivez l'évolution quantitative et qualitative des signalements enregistrés pour dépendance et mésusage des principaux médicaments opiacés et opioïdes depuis 2010.
Indiquez si ces cas s'inscrivent dans le cadre d'un traitement thérapeutique médicamenteux ou d'une consommation illicite. Dans le cas de traitements médicamenteux prescrits, indiquez quels sont les principaux prescripteurs de ces médicaments.
Indiquez l'évolution du nombre d'hospitalisations et de décès liés aux mésusages ou aux surdoses d'opioïdes.
Indiquez également si les personnes font l'objet d'un suivi ou d'un accompagnement au titre de la réduction des risques.
3. Décrivez les principaux effets indésirables associés aux médicaments opiacés et opioïdes et leur prévalence.
Identifiez-vous des populations particulièrement vulnérables ?
4. En termes de bonnes pratiques, quelles différences convient-il d'établir entre les modalités d'usage des opioïdes dits forts et des opioïdes dits faibles ?
5. Décrivez les principaux mésusages observés des médicaments opiacés et opioïdes :
- concernant la prescription par les professionnels de santé ;
- concernant la consommation par les patients et usagers.
Indiquez également, sous forme de classement, les médicaments opiacés et opioïdes faisant le plus souvent l'objet de détournements en France.
6. À partir de quand peut-on diagnostiquer un trouble de l'usage chez un consommateur d'opioïdes ?
7. Présentez les dispositifs de surveillance mis en oeuvre au titre de la pharmacovigilance, de l'addictovigilance et de la toxicovigilance pour repérer les situations de mésusage, d'abus ou de dépendance des médicaments opiacés et opioïdes.
Quelles actions permettraient-elles d'améliorer la connaissance de la prévalence des usages problématiques d'opioïdes chez des patients ayant un traitement initié dans un cadre antalgique ?
Plus largement, le système de surveillance et d'alerte mériterait-il d'être renforcé ?
8. Comment les CEIP-A appréhendent-ils le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse, initialement développés à des fins thérapeutiques et désormais produits dans des laboratoires clandestins ? Quels dangers identifiez-vous ?
9. Indiquez les principales mesures prises, ces dernières années, visant à sécuriser la prescription et la dispensation des médicaments opiacés et opioïdes.
Le cadre juridique actuel vous paraît-il adapté à la maîtrise et au contrôle des prescriptions et de la dispensation de ces médicaments ?
10. Disposez-vous d'informations sur les fuites de médicaments opiacés et opioïdes hors du circuit légal ? Dans la mesure du possible, retracez les évolutions constatées ces dernières années.
11. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
12. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
13. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
14. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
15. Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?
16. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
17. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
Nous vous remercions de nous donner l'opportunité de témoigner aujourd'hui au nom du réseau d'addictovigilance dans le cadre de cette mission d'information sur les dangers des opioïdes.
Votre volonté de mieux caractériser les risques de santé publique liés à la prescription et à la consommation d'opioïdes à des fins antalgiques rejoint pleinement les missions fondamentales de notre réseau. En tant qu'acteurs de la surveillance et de l'évaluation des substances psychoactives, nous avons à coeur d'apporter un éclairage scientifique et objectif sur cette question majeure de santé publique.
Vous nous avez transmis un questionnaire détaillant de nombreux points sur lesquels vous souhaitez un éclairage. Afin d'assurer une présentation claire et structurée, nous avons pris l'initiative de regrouper ces questions par thème, de manière à répondre au mieux à vos attentes.
Nous ne nous prononcerons pas spécifiquement sur certaines questions relevant du champ de compétences d'autres instances et ne relevant pas de celui des pharmacologues médicaux spécialisés en addictovigilance :
Question 10 : entre dans le domaine de l'ANSM (obligation de déclaration des vols de médicaments, notamment stupéfiants...).
Question 11 : qui concerne la coordination des professionnels de santé : cette question est cruciale, et la nécessité de cette articulation a été soulignée dans les recommandations de 2022 de la HAS pour favoriser le bon usage des opioïdes.
Question 15 : qui concerne l'impact des structures de RDR et de PEC des usagers d'opioïdes : les CEIP-A travaillent avec ses structures clés, mais n'évaluent pas l'impact de ces dispositifs en santé publique.
Question 16 : l'addictovigilance identifie et caractérise des risques sanitaires, mais il n'est pas dans ses missions de mettre en oeuvre la politique de RD.
Nous vous proposons pour répondre à l'ensemble des questions le plan suivant d'une part sous forme de synthèse puis en annexe développé.
1. Introduction
Le réseau d'addictovigilance (inclus réponse question 7) Les TUS (inclus réponses question 6)
Les opioïdes (inclus réponse questions 1 et 4)
Une surveillance continue (inclus réponse question 8) et renforcée
2. Surveillance des opioïdes
1/ Action spécifique précoce/crise : DANTE, COVID
2/ Surveillance continue par les outils épidémiologiques de l'addictovigilance (inclus parties réponse question 2, 3, 5) : Les opioïdes dans OSIAP, OPPIDUM, DRAMES, DTA, Soumission chimique et ASOS
3/ La caractérisation des problèmes spécifiques : analyse des Nots (inclus parties réponses questions 2, 3, 5) : exemple du tramadol Et de l'oxycodone.
3. Mesures et réduction des risques
Mesures et accès à la naloxone (questions 9 et 14)
4. Communications opioïdes, formations (réponse question 12 et 13)
5. Autres points, moyens
Renforcement des systèmes de surveillance (inclus réponse questions 7, 17)
SYNTHÈSE
Le réseau national d'addictovigilance est composé de 13 Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance (CEIP-A) répartis sur l'ensemble du territoire national (Départements et régions d'outre-mer compris), et dirigés par des pharmacologues médicaux.
L'addictovigilance est la vigilance sanitaire coordonnée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ( www.ansm.sante.fr) (https://addictovigilance.fr/) ayant pour objectif la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'abus, d'usage détourné et de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives à l'exception de l'alcool éthylique seul et du tabac (art 5132-98 du Code de la Santé Publique).
L'addictovigilance cherche à identifier ces situations et leurs conséquences sur la santé le plus tôt possible, à quantifier et à caractériser le signal, à alerter les autorités sanitaires et à informer les professionnels de santé, et dans certains cas, les populations ciblées pour minimiser les risques pour la santé publique.
Ce réseau est unique dans sa thématique mais surtout dans l'originalité de son approche multimodale. Comme toute vigilance sanitaire, l'addictovigilance s'appuie sur la notification spontanée. Ces notifications permettent de caractériser les troubles de l'usage dont le diagnostic repose sur des critères bien définis, ciblant (i) la perte de contrôle (quantité ou durée supérieures à ce qui était envisagé, impossibilité d'arrêt, craving) ; (ii) les risques et dommages (temps passé, problèmes physiques, conséquences sociales) et (iii) la dépendance pharmacologique (tolérance et sevrage). En fonction du nombre de critères présents, le TUS est caractérisé de léger à sévère. Les CEIP évaluent ces items et le détournement d'usage des substances (1,2).
En complément le réseau a mis en place de nombreux outils pharmacoépidémiologiques originaux qui nécessitent un maillage régional sans égal. Ces outils développés par les CEIP-A (OPPIDUM, OSIAP, DRAMES, DTA, Soumission chimique et ASOS), complémentaire de la notification évaluent différentes facettes des problématiques afin de disposer d'une vision globale et intégrée.
Une telle approche multidimensionnelle incluant une surveillance proactive par ces outils et également par plusieurs sources de données hétérogènes (bases hospitalières et bases de remboursement des médicaments) est capable de détecter précocement des signaux et des alertes d'addictovigilance d'autant qu'y est associée l'expertise des pharmacologues de ce réseau (3,4). Il constitue un dispositif unique au monde, reconnu au niveau international (5).
Les opioïdes agissent tous sur les récepteurs aux opioïdes ; Ils ont des puissances pharmacologiques différentes. Néanmoins tout est question de dose (une forte dose d'un agoniste peu puissant aura un effet similaire à une faible dose d'un agoniste puissant) (6). La surveillance active des opioïdes par le réseau des CEIP-A est ancienne : les opioïdes font l'objet de rapports d'expertise réguliers depuis plus de 10 ans, qu'ils soient antalgiques ou Traitement de Substitution aux Opioïdes (TSO). En raison de leur puissance supérieure (effet plus important pour une même dose), les principaux risques liés à l'usage des opioïdes de synthèse sont l'overdose et le décès. La dernière alerte de ce type concernait une famille émergente d'opioïdes de synthèse, les nitazènes que ce soit en métropole (7) ou dans l'océan indien (8) et une alerte a été diffusée dès 2023 sur ce sujet par notre réseau (9).
I. SURVEILLANCE DES OPIOÏDES
1/ Les contextes récents, internationaux et de crise sanitaire, ont amené les CEIP-A à renforcer leur surveillance des opioïdes en mettant en place des études spécifiques en plus de la surveillance habituelle par tous les outils du réseau. Ainsi l'étude DANTE (une Décennie D'ANTalgiques En France) en réponse à une modification du panorama des antalgiques commercialisés dans les années 2010 avait pour objectif principal de décrire l'utilisation des antalgiques en France et son évolution au cours des dix dernières années, en présentant les caractéristiques des usagers, les médicaments utilisés et des modalités de leur prescription et de délivrance. Cela a notamment permis de faire un état des lieux de la consommation des antalgiques en France entre 2006 et 2015, à partir des données de remboursement de l'Assurance Maladie, données qui ont été reprises par la suite dans l'État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes réalisé par l'ANSM en février 2019 (10,11).
De même, dès le premier confinement instauré lors de la crise du COVID-19, le réseau d'addictovigilance a mis en place un dispositif de surveillance active visant à identifier les événements préoccupants et les évolutions significatives en matière de consommation de substances. Cette vigilance accrue a permis de détecter des changements d'usage de certaines substances ainsi que des situations à risque. Une attention particulière a été portée aux opioïdes, notamment le tramadol et la méthadone (12). La méthadone est actuellement le médicament opioïde qui suscite le plus d'inquiétude en termes de risques sanitaires compte tenu notamment de l'augmentation croissante depuis plusieurs années du nombre de décès (Point spécifique en annexe).
2/ Surveillance continue par les outils pharmacoépidémiologiques de l'addictovigilance
Les opioïdes dans OSIAP : une place prépondérante du tramadol, mais aussi de la codéine
Cette enquête s'appuie sur la vigilance de pharmaciens sentinelles, qui signalent des ordonnances qu'ils suspectent comme falsifiées et/ou volées, et pour lesquelles sont analysés sans a priori, les médicaments présentés sur ces ordonnances, et le profil des personnes qui les présentent. Ces signalements sont analysés à l'échelle nationale et avec une déclinaison par région. Enfin, pour tenir compte du niveau d'usage en population générale, un taux de détournement est estimé, permettant de comparer les médicaments selon leur potentiel d'abus possible à l'échelle de la population : les analgésiques opioïdes sont en tête de ce classement (et plutôt en augmentation) : dihydrocodéine, fentanyl, tramadol, oxycodone ; morphine, et codéine associée au paracétamol. On notera que les médicaments avec le taux de détournement le plus élevé correspondent à ceux mésusés dans le cadre du purple drank par des sujets jeunes (20-25 ans, majoritairement des hommes).
Les opioïdes dans OPPIDUM : une augmentation des usages problématiques des analgésiques opioïdes (tramadol, oxycodone) depuis les années les plus récentes, un détournement de la voie d'administration de la morphine. En parallèle, l'oxycodone citée comme 1er produit ayant entraîné la dépendance a doublé, entre 2022 et 2023
Cette enquête réalisée un mois par an (octobre) collecte les substances utilisées par les personnes prises en charge dans des structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques et permet une photographie annuelle, incluant les modes d'usage des substances.
Les données OPPIDUM montrent également une augmentation du nombre de sujets actuellement demandeurs de soins d'addictologie, dont le premier produit ayant entrainé une dépendance est le tramadol ainsi que la codéine associée au paracétamol.
Les opioïdes dans DRAMES (13,14) : les antalgiques opioïdes moins impliqués que la méthadone, la cocaïne ou l'héroïne
L'enquête DRAMES (Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances s'intéressent aux décès survenant chez des sujets avec des antécédents d'abus/dépendance, hors suicide.
Dans l'enquête Drames 2022 (derniers résultats disponible), les principales substances psychoactives impliquées dans des décès sont les médicaments de substitution aux opioïdes (300 décès soit 47 %) : la méthadone est impliquée dans 257 cas de décès soit 40.3 % des décès. Les autres substances illicites représentent 385 cas soit 60 % des décès : les principales substances impliquées sont la cocaïne (140 décès) et l'héroine (121 décès). Les antalgiques opioïdes sont impliqués dans 50 décès, soit 7.9 % des décès directs.
Les opioïdes dans DTA (13,15) : le tramadol en première position
L'enquête annuelle prospective Décès Toxiques par Antalgiques (DTA) a pour objectifs de recueillir les cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, d'identifier les médicaments impliqués, d'évaluer leur dangerosité et d'estimer l'évolution du nombre de ces décès.
Depuis le début de l'enquête (2013), le premier médicament antalgique impliqué dans les décès est le tramadol qui représente entre 30 et 45 % des décès selon l'année (35 % en 2022). Les autres antalgiques opioïdes retrouvés sont la morphine (entre 20 et 30 % des décès, 25 % en 2022), la codéine (environ 15 % des décès, 18 % en 2022) et l'oxycodone (entre 7 et 20 % des décès, 20 % en 2022).
Les opioïdes dans l'enquête soumission chimique : les antalgiques opioïdes sont retrouvés mais ne sont pas les principales substances identifiées
La soumission chimique (SC) est l'administration d'une substance psychoactive à l'insu de la victime ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles. Elle a pour objectif de préciser les substances principalement impliquées et les modes opératoires associés. Dans les résultats 2022, les antalgiques opioïdes représentent la 3è classe de médicaments retrouvés dans des cas de soumission chimique derrière les benzodiazépines et les anti- histaminiques H1.
Les opioïdes et l'enquête ASOS (16,17) : Oxycodone en augmentation et confirmation de la prescription de fentanyl transmuqueux hors AMM, prescription des opioïdes stupéfiants en majorité dans les douleurs rhumatologiques
L'enquête ASOS (Antalgiques Stupéfiants et Ordonnances sécurisées) est une étude transversale, réalisée tous les ans pendant une semaine, auprès d'un échantillon national tiré au sort de pharmacies d'officine (métropole et départements d'Outre-Mer) sur la prescription d'antalgiques stupéfiants. Les objectifs sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d'évaluer le respect des règles de prescription et de suivre l'évolution dans le temps de ces données. Cette étude ne s'intéresse qu'aux antalgiques opioïdes stupéfiants, soit les opioïdes dits forts.
3/ Caractérisation des problèmes spécifiques : analyse des Nots
Afin de rester en phase avec l'actualité, nous avons choisi l'exemple du tramadol et de l'oxycodone.
Le suivi d'addictovigilance du tramadol a débuté en 2009. Dès les premiers rapports d'addictovigilance, deux modes d'usage problématique ont été identifiés :i) contexte de douleur initiale, avec un usage persistant du tramadol pour lutter contre les signes de sevrage et/ou soulager d'autres symptômes (anxiété, troubles du sommeil), et ii) un usage récréatif de tramadol, notamment chez les jeunes, avec une recherche d'euphorie ou effet stimulant (dopage sportif).
Jusqu'au début des années 2010, le suivi national de l'addictovigilance à l'oxycodone, initié en 2002, n'a pas révélé de signal particulier. Malgré la situation alarmante aux États-Unis, la situation en France était différente, l'oxycodone n'étant initialement indiquée que pour les douleurs modérées à sévères chez les patients atteints de cancer. Le nombre de cas a augmenté à partir de 2019. Comme pour le tramadol, deux profils principaux ont été mis en évidence pour l'oxycodone : (i) une population féminine âgée de 50 ans, souffrant de douleurs chroniques (principalement des douleurs non cancéreuses, avec des comorbidités psychiatriques telles que l'anxiété- dépression ou des antécédents de troubles liés à l'usage de substances) ; (ii) Une population plus jeune et plutôt masculine, avec des sujets qui consomment plusieurs substances psychoactives, exposés à l'oxycodone dans un contexte de mésusage à visée récréative, avec des surdoses nécessitant des soins intensifs et l'utilisation de naloxone.
Pour le premier profil ; les troubles de l'usage surviennent le plus souvent à la suite d'une prescription médicale à des fins analgésiques, donc la principale cible pour minimiser ces risques reste les professionnels de la santé, en particulier les prescripteurs.
Pour le second profil, la dangerosité de l'oxycodone, en particulier lorsqu'elle est associée à d'autres substances, est probablement mal identifiée par les professionnels de santé, puisqu'elle est très accessible. Le risque de complications peut également dépendre des caractéristiques individuelles (polymorphisme génétique du CYP2D6) et des modes d'utilisation (aiguë ou chronique). Pour cette population, le manque de connaissances liées aux caractéristiques pharmacologiques de l'oxycodone et la sous-utilisation de la naloxone semblent maintenant être les priorités d'amélioration.
II. MESURES ET REDUCTION DES RISQUES
Les données du réseau d'addictovigilance constituent le socle essentiel pour identifier les problèmes et permettre aux autorités de santé de mettre en oeuvre des mesures de prévention des risques ; A titre d'exemple : Codéine ; Tramadol.
Par ailleurs, deux CEIP-A ont mis en place des programmes régionaux pour améliorer l'accessibilité à la naloxone (18-20) avec les programme POP à Marseille et SINFONI à Nantes.
Pour améliorer la diffusion de la naloxone, un travail de proximité en profondeur est essentiel. Dans les deux cas précédents, ce travail n'a été possible que grâce au financement des Agences Régionales de Santé (ARS) concernées. Il est désormais indispensable de mobiliser des ressources à l'échelle nationale afin d'élargir et de pérenniser ces initiatives. L'extension nationale du programme POP, soutenu par la MILDECA et la DGS a été acté, sera coordonné par l'ANSM, et s'appuiera sur les pharmacologues des 13 CEIP-A fort de leur maillage territorial, de leur implantation régionale, et de leur travail en circuit court avec l'ensemble des acteurs/cibles concernés.
III. COMMUNICATIONS OPIOÏDES/FORMATIONS
Le Réseau Français d'Addictovigilance est mobilisé sur les actions de communication, permettant de vectoriser de l'information pertinente, utile, actualisée d'autant plus que ces informations proviennent de leur mission de vigilance sanitaire sur ces produits et leurs risques et qu'ils sont pharmacologues. A ce titre, rappelons que c'est le Réseau Français d'Addictolovigilance qui a alerté en premier sur les complications de l'usage du protoxyde d'azote le 5 novembre 2019.
Cette communication autour des risques de mésusages et de dépendance des opioïdes est plurielle à tous les niveaux (loco-régional, national, international) et via différents vecteurs/canaux afin d'atteindre des cibles différentes (professionnels de santé -MG et autres spécialistes, pharmaciens, ...) et mode d'exercice (hospitalier, libéral, officinaux, établissements medico-sociaux CSAPA, CAARUD, ...). Ainsi le réseau organise des manifestations scientifiques loco-régionales, nationales et internationales ; il publie des rapports nationaux d'expertise sur ces médicaments opioïdes (21-23), des communiqués (9,24,25), des bulletins d'addictovigilance (26-31), des publications scientifiques dans des revues nationales et internationales (32) et participe à des ouvrages (33,34) et des pour la presse écrite généraliste ou spécialisée (APM news) et audiovisuelle.
Les pharmacologues des CEIP-A, travaillant au sein de CHU, sont impliqués dans les formations initiales des futurs professionnels de santé (médecins et pharmaciens, paramédicaux) ou via des diplômes spécialisés (DESU, capacité douleur, capacité d'addictologie...). Ces programmes de formation méritent d'être à la hauteur de cette problématique qui reste sous-estimée par les professionnels de santé car insuffisamment enseignée. Ces programmes universitaires nécessitent d'être en phase avec les problématiques émergentes et d'être déployés en lien avec les CEIP-A qui sont présents dans tous les territoires et notamment les CHU.
IV. AUTRES POINTS, MOYENS
Trois points sont particulièrement à souligner :
* Actuellement avec moins de 30 ETP au total, le Réseau Français d'Addictovigilance est sous dimensionné (i) Pour mener à bien l'ensemble de ses missions régionales et nationales, alors même qu'il constitue le socle central/la colonne vertébrale, en lien avec l'ANSM et les ARS ; (ii) Pour les réaliser sur un périmètre évolutif, dynamique et croissant : le panorama des substances psychoactives s'est diversifié et amplifié, avec la place des opioïdes et l'indispensable vigilance sur les opioïdes, et également des problématiques sur d'autres produits qui ne doivent pas être négligées (ampleur de l'usage et des complications sanitaires du protoxyde d'azote, de la cocaïne, problématiques avec d'autres médicaments (prégabaline, gabapentine, méthadone, GHB/GBL...) ou l'émergence des produits de synthèse (plus de 1 000 recensés dont les opioïdes de synthèse, les cannabinoïdes de synthèse...).
Les CEIP-Addictovigilance fonctionnent à hauteur de 90 % grâce à une subvention de l'ANSM, qui reçoit cette dotation de l'Assurance Maladie. Cependant, l'enveloppe de ces subventions n'évolue pas alors que le coût de la masse salariale des Centres a nettement augmenté (mesures Ségur, réforme du statut de Praticien Hospitalier, ...). Par conséquent, on assiste à une paupérisation inquiétante des Centres, en totale inadéquation avec l'augmentation de l'activité (problématique émergente, élargissement du périmètre des produits et des missions, ...). Dès lors, il est indispensable d'accorder des moyens nécessaires aux CEIP-Addictovigilance afin qu'ils puissent continuer à fonctionner efficacement, comme régit par les textes réglementaires, et ce dans l'intérêt de la sécurité des patients, des usagers et de leur santé, et notamment qu'ils puissent amplifier ses actions de formations et d'informations, qu'ils sont les plus à même de porter.
** Toutes ces actions de communications méritent d'être à la fois amplifiées, de s'inscrire dans la durée, et d'être soutenues, notamment en ce qui concerne les opioïdes.
*** Nos travaux soulèvent des questions essentielles nécessitant des réponses fondées sur des données robustes : études de prévalence, analyses ciblées sur différentes populations... Or, à ce jour, lorsqu'un besoin urgent se fait sentir, une seule option s'offre à nous : les Appels à Projets (AAP) de recherche, un mécanisme souvent long et incertain. Pour garantir une réactivité adaptée aux défis sanitaires, il est indispensable de doter nos dispositifs d'outils pérennes et de financements dédiés, permettant des études plus rapides et mieux ciblées. Seule une approche proactive pourra assurer une prise de décision éclairée et efficace.
Il est essentiel de valoriser et positionner le rôle central du réseau officiel d'addictovigilance en le mentionnant spécifiquement dans le texte, compte tenu de son importance dans l'évaluation des conséquences sanitaires liées aux substances addictives. L'ANSM représente l'autorité de santé responsable de l'évaluation de la sécurité sanitaire des substances. Ce réseau joue également un rôle clé dans la diffusion de formations et d'informations auprès des professionnels concernés. En tant qu'infrastructure officielle, il fonctionne en étroite collaboration avec les Agences Régionales de Santé (ARS), garantissant ainsi une action coordonnée et efficace à tous les niveaux, dans l'intérêt des usagers et des patients.
Références
1. Victorri-Vigneau C, Hardouin JB, Rousselet M, Gerardin M, Guerlais M, Guillou M, et al. Multicentre study for validation of the French addictovigilance network reports assessment tool. Br J Clin Pharmacol. 2016 Oct ;82(4) :1030-9.
2. Victorri-Vigneau C, Jolliet P. Scoring pharmacodependence seriousness : a novel CEIP's evaluation tool. Therapie. 2006 ;61 :517-22.
3. Daveluy A, Perino J, Gibaja V, Le Boisselier R, Batisse A, Miremont-Salamé G, et al. From regional signal to alert in addictovigilance. Therapie. 2024 Oct 22 ; S0040-5957(24)00 172-0.
4. Micallef J, Jouanjus É, Mallaret M, Lapeyre Mestre M. [Safety signal detection by the French Addictovigilance Network : Innovative methods of investigation, examples and usefulness for public health]. Therapie. 2019 Dec ;74(6) :579-90.
5. Carmona Araújo A. The French Addictovigilance Network - A multidisciplinary successful journey in the protection of public health. Therapie. 2024 Dec 4 ; S0040-5957(24)00 211-7.
6. Haute Autorité de Santé. Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses. 2022 ; Recommandation de bonnes pratiques. Available from : https:// www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf.
7. Bendjilali-Sabiani JJ, Eiden C, Lestienne M, Cherki S, Gautre D, Van den Broek T, et al. Isotonitazene, a synthetic opioid from an emerging family : The nitazenes. Therapie. 2024 ;79(6) :655-8.
8. Guyon J, Maillot A, Bastard S, Weisse F, Daveluy A, Mété D. Psychoactive cocktail consumption on Reunion Island : A case report. J Anal Toxicol. 2025 Feb 15 ;bkaf009.
9. Association Française des Centres d'Addictovigilance. CIRCULATION DES NITAZENES, NOUVEAUX OPIOÏDES DE SYNTHESE ET RISQUE POUR LES USAGERS. Communiqué. 2023.
10. Daveluy A, Micallef J, Sanchez-Pena P, Miremont-Salamé G, Lassalle R, Lacueille C, et al. Ten-year trend of opioid and nonopioid analgesic use in the French adult population. Br J Clin Pharmacol. 2021 Feb ;87(2) :555- 64.
11. Daveluy A, Bryan MC, Miremont-Salamé G, Lassalle R, Lacueille C, Grelaud A, et al. Analgesic switching in chronic users of dextropropoxyphene in France. Fundam Clin Pharmacol. 2024 Apr ;38(2) :389-97.
12. Lapeyre-Mestre M, Boucher A, Daveluy A, Gibaja V, Jouanjus E, Mallaret M, et al. Addictovigilance contribution during COVID-19 epidemic and lockdown in France. Therapie. 2020 ;75(4) :343-54.
13. Revol B, Willeman T, Manceau M, Dumestre-Toulet V, Gaulier JM, Boucher A, et al. DRAMES and DTA databases : Complementary tools to monitor drug-related deaths in France. Therapie. 2024 Oct 23 ;S0040-5957(24)00 175-6.
14. Revol B, Willeman T, Manceau M, Dumestre-Toulet V, Gaulier JM, Fouilhé Sam-Laï N, et al. Trends in Fatal Poisoning Among Drug Users in France From 2011 to 2021 : An Analysis of the DRAMES Register. JAMA Netw Open. 2023 Aug 1 ;6(8) :e2 331 398.
15. Revol B, Willeman T, Manceau M, Dumestre-Toulet V, Gaulier JM, Eysseric-Guérin H, et al. Trends in fatal poisoning among medical users of analgesics in France from 2013 to 2022 : an analysis of the DTA register. Public Health. 2024 Nov ;236 :381-5.
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
___________
1. Décrivez l'évolution quantitative et qualitative des prescriptions des principaux médicaments opiacés et opioïdes depuis 2010, au global, en ville, et à l'hôpital.
Indiquez quels sont les principaux prescripteurs de ces médicaments.
Indiquez l'évolution du nombre d'hospitalisations et de décès liés aux mésusages ou aux surdoses d'opioïdes.
La répartition des remboursements de médicaments opiacés et opioïdes entre antalgiques et traitements de substitution aux opioïdes (TSO) est relativement stable sur la période 2021-2024 (Figure 1).
Depuis 2021, le nombre de boîtes de médicaments opiacés et opioïdes remboursés, toutes classes ATC confondues (analgésiques, TSO) a diminué de 6 % (Figure 1). En 2024, la consommation de médicaments opioïdes analgésiques remboursés était de 70,3 millions de boîtes (contre 74,9 millions en 2021), tandis que la consommation de TSO était de 21,6 millions de boîtes (contre 22,9 millions en 2021). Quelle que soit la classe ATC, les prescriptions de ces médicaments sont majoritairement effectuées par des prescripteurs de ville (environ 80 % des ordonnances).
En 2023, 155 762 personnes bénéficiaient d'un remboursement de TSO en médecine de ville.278(*) Ce nombre s'élevait à 162 500 en 2017. Les médecins prescripteurs de TSO en ville sont principalement des médecins généralistes, qui constituent 90,4 % des prescripteurs en 2023 (environ 37 000 médecins généralistes prescripteurs sur 40 000 prescripteurs). Les psychiatres représentent 3,3 % (n = 1 349) des prescripteurs.
Figure 1 : Évolution du nombre de boîtes remboursées entre 2021 et 2024. Les données sont extraites de la base de données Médic'AM279(*) qui permet une sélection des données par classe ATC ou code CIP. Ces données ne concernent que les spécialités inscrites sur la liste des spécialités remboursées et pour lesquelles une demande de remboursement a été faite. Toutes les spécialités des classes Emphra/ATC (N02A et N07F) ont été sélectionnées.
Figure 2 : Évolution du nombre de boîtes vendues en ville entre 2021 et 2024. Les données sont extraites du GERS280(*). Ces données concernent le `Sell in' c'est-à-dire toutes les spécialités pharmaceutiques (remboursées ou non) livrées aux officines de ville dans la France métropolitaine et DOM-TOM. Toutes les spécialités opioïdes des classes Emphra (N02A et N02B) ont été sélectionnées.
En 2024, le nombre d'Unités Communes de dispensation (UCD) d'antalgiques opioïdes vendues à l'hôpital a atteint 42,2 millions et le nombre d'UCD de TSO vendues à l'hôpital s'élevait à 3 millions (Figure 3).
Figure 3 : Évolution du nombre d'UCD vendues à l'hôpital entre 2021 et 2024. Les données sont extraites du GERS281(*). Ces données concernent le `Sell in' c'est-à-dire toutes spécialités pharmaceutiques livrées aux établissements hospitaliers dans la France métropolitaine et DOM-TOM. Toutes les spécialités des classes Emphra/ATC (N02A et N07F) ont été sélectionnées.
Dans un rapport publié en février 2019, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait réalisé un état des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques. Les chiffres de vente en ville et à l'hôpital, les données de remboursement de l'assurance maladie et les données de prévalence et d'incidence montraient toutes une augmentation de leur consommation entre 2006 et 2017.282(*) Cette augmentation était un indicateur d'amélioration de la prise en charge de la douleur ; la mise à disposition et une utilisation plus large des médicaments opioïdes dans le traitement de la douleur avaient grandement contribué à l'amélioration de cette prise en charge283(*).
Dans les enquêtes pharmacodépendance-addictovigilance en France284(*), les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances (enquête DRAMES mise en place depuis 2005) et les décès toxiques par antalgiques (enquête DTA mise en place depuis 2013) sont notifiés à l'ANSM et au CEIP-Addictovigilance de Grenoble (coordonnateur de l'enquête) par des toxicologues analystes volontaires et experts judiciaires ainsi que par les CEIP-A répartis sur le territoire français. Ces enquêtes permettent :
- de recueillir les cas de décès liés l'usage abusif de substances psychoactives et à l'usage de médicaments antalgiques ;
- d'identifier les substances psychoactives (médicaments ou drogues illicites) et les médicaments impliqués, d'évaluer leur dangerosité ;
- d'estimer l'évolution du nombre de ces décès.
Le nombre de décès liés à l'usage abusif de substances psychoactives (médicaments et substances illicites) tend à augmenter, mais reste sans commune mesure avec la situation observée aux États-Unis ; Il est estimé à 432 en 2017 : stupéfiants illicites (51 %), MSO (45 %) [dont méthadone (37 %), et buprénorphine (8 %)], opioïdes licites hors MSO (14 %).
Il est estimé à 638 en 2022 (627 en 2021, 567 en 2020) : stupéfiants illicites (53 %), MSO (47 %) [dont méthadone (40 %), buprénorphine (7 %)], héroïne (121), cocaïne (140)] ; opioïdes licites hors MSO (8 %).
Parmi ces substances psychoactives, le nombre de décès directs liés à l'usage d'antalgiques opioïdes est estimé à 136 en 2022 (135 en 2021, 117 en 2020, 105 en 2017). Quatre molécules sont principalement impliquées : le tramadol [n=48 (35 %) dont 12 dans un contexte suicidaire (CS)], la morphine [n=34 (25 %) dont 11 CS], l'oxycodone [n=27 (20 %) dont 4 CS] et la codéine [n=26 (19 %) dont 6 CS].
Seize décès sont imputables au paracétamol (antalgique non opioïde) ; dans la moitié des cas en association avec un opiacé ou un opioïde.
2. Décrivez les principaux effets indésirables associés aux médicaments opiacés et opioïdes et leur prévalence.
Identifiez-vous des populations particulièrement vulnérables ?
Les opioïdes constituent une vaste classe pharmacologique réunissant des dérivés naturels de la plante papaver somniferum (opium, morphine, codéine) ainsi que des composés semi-synthétiques (héroïne, hydromorphone, oxycodone, buprénorphine) et synthétiques (fentanyl, méthadone, tramadol).
Les effets indésirables des opioïdes sont communs à cette classe pharmacologique, mais de fréquence et intensité variables selon l'individu, la durée de l'exposition, les doses et les caractéristiques pharmacologiques de la molécule. Ils peuvent apparaître ou être majorés que lorsque l'usage d'opioïde se prolonge, à la suite de la stimulation répétée des récepteurs impliqués, donc lors d'un usage chronique.
Les effets indésirables les plus fréquents : constipation, nausées et vomissements, somnolence, étourdissements et vertiges, prurit, sécheresse buccale et cutanée, dépression respiratoire.
En outre, dans le cadre d'un traitement chronique, peuvent être recensés des effets endocriniens, des troubles cognitifs et thymiques, des troubles de la libido, des troubles du sommeil, une hyperalgésie induite par les opioïdes285(*).
Les propriétés psychotropes des opioïdes peuvent être à l'origine d'un trouble de l'usage (TUO) :
- mésusage, c'est-à-dire utilisation non conforme à la prescription (indication, dosage, voie d'administration, bénéficiaire, etc.) ;
- et/ou une addiction avec impossibilité d'arrêter la consommation, assortie d'un besoin impérieux de consommer la substance.
Certains effets des opioïdes concernent directement le TUO et les surdoses d'opioïdes :
- la désensibilisation des centres respiratoires à l'hypercapnie et l'abolition du réflexe de toux liée aux opioïdes peuvent conduire à une réduction de la fréquence ventilatoire, favorisant le risque de dépression respiratoire. Ce risque est majoré par l'usage concomitant de substances les favorisant, comme l'alcool, les benzodiazépines et les gabapentinoïdes. Conjugués aux effets sédatifs parfois décrits avec les opioïdes, ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient.
- les opioïdes activent en parallèle les circuits dopaminergiques et inhibent l'activité GABAergique. Ces actions favorisent le maintien de leur usage dans le temps pour d'autres raisons que le soulagement de la douleur. Ils interviennent aussi dans les mécanismes d'adaptation au stress, avec une valence anxiolytique.
- les opioïdes sont à l'origine d'effets nooanaleptiques, psychoanaleptiques, thymoanaleptiques et euphorisants, favorisant l'usage hédonique et psychostimulant de ces molécules.
- des effets dysphoriques, psychotomimétiques, psychodysleptiques et anorexigènes sont aussi décrits et parfois recherchés par certains patients286(*).
Les traitements antalgiques opioïdes au long cours aboutissent fréquemment à une dépendance physique entraînant un risque de symptômes de sevrage en cas d'arrêt brutal ou trop rapide des prises. La dépendance physique aux opioïdes résulte d'un processus physiologique lié à la tolérance progressive de l'individu. La conséquence indirecte est une perte progressive d'efficacité du traitement, nécessitant d'accroître ses posologies pour retrouver l'effet escompté. La dépendance physique se traduit cliniquement par la nécessité de maintenir les prises d'opioïdes pour éviter l'apparition d'un syndrome de sevrage désagréable. Ce dernier est caractérisé par l'association de symptômes dits « de manque » (bâillements avec rhinorrhées et larmoiements, arthralgies et myalgies diffuses accompagnées de crampes musculaires, désordres digestifs, frissons et tremblement des extrémités, hyperhidrose, irritabilité accompagnée d'agitation, de troubles anxieux et d'insomnie). Ces symptômes physiques et psychiques désagréables peuvent en eux-mêmes amener le sujet à maintenir sa consommation pour éviter leur apparition et à augmenter la consommation de la substance au-delà de la dose tolérée par l'organisme. Les intoxications aux opioïdes peuvent entraîner des conséquences graves allant jusqu'au décès. Les trois caractéristiques cliniques classiques de l'intoxication aux opioïdes sont la dépression respiratoire, la diminution de l'état de conscience et le myosis. Le délai d'installation et la durée des troubles sont néanmoins fortement variables selon les propriétés, la formulation et le mode d'administration du morphinomimétique en cause.
Certains patients peuvent développer une addiction aux opioïdes, définie comme un trouble chronique caractérisé par des conduites compulsives de recherche de la substance et un besoin irrépressible de la consommer (« craving »), accompagnées d'une perte de contrôle vis-à-vis de son usage malgré les problèmes socioprofessionnels et personnels qu'elle entraîne et l'émergence de perturbations thymiques.
Plusieurs populations consommant des opioïdes présentent un risque accru de surdose287(*) :
- usagers ayant une perte de tolérance aux opioïdes à la suite d'un arrêt de consommation ou d'une période de plus faible consommation (sortie d'incarcération, sortie d'un centre de soins résidentiel, sortie de sevrage) ;
- usagers ayant des antécédents récents de surdose ;
- patients recevant un médicament de substitution aux opioïdes (en particulier la méthadone) lors de l'instauration du traitement ou dans le mois suivant l'arrêt du traitement ;
- patients traités par des antalgiques opioïdes faisant un mésusage de leur traitement (augmentation non contrôlée des doses pour soulager une douleur mal prise en charge, recherche d'effets psychotropes) ou ayant développé une dépendance physique ;
- usagers d'opioïdes recherchant les effets psychoactifs de ces produits, parfois naïfs (n'ayant jamais consommé d'opioïdes) ;
- usagers d'opioïdes en « auto-substitution » pour soulager une opio-dépendance.
Les patients naïfs d'opioïdes doivent également faire l'objet d'une vigilance accrue lors de l'instauration d'un traitement antalgique opioïde. Par ailleurs, un risque d'intoxication aiguë accidentelle existe chez l'enfant. La prise concomitante d'autres dépresseurs du système nerveux central (ex. : gabapentinoïdes, benzodiazépines, alcool, etc.) augmente le risque de surdose.
De nombreux facteurs influent sur le risque de surdose (le type d'opioïde, sa puissance et la quantité absorbée dans le sang notamment). Plusieurs facteurs individuels (tels que la tolérance, l'état de santé, la durée d'utilisation, des influences génétiques) ajoutent à la complexité des situations de surdose d'opioïdes.
3. Décrivez les principaux mésusages observés des médicaments opiacés et opioïdes :
- concernant la prescription par les professionnels de santé
- concernant la consommation par les patients et usagers
Concernant la prescription par les professionnels de santé
Dans le cadre d'une enquête du Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale menée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)288(*) consacrée aux pratiques de prévention et de prise en charge des conduites addictives par les médecins généralistes libéraux (décembre 2019 - mars 2020), 2 412 médecins ont été interrogés sur la dépendance aux opiacés et le mésusage des traitements antalgiques opioïdes. Une large majorité (81 %) des praticiens déclarent informer systématiquement leurs patients faisant l'objet d'une prescription d'antalgiques opioïdes des risques de mésusage et de dépendance.289(*) La moitié des médecins généralistes (52 %) se considèrent suffisamment formés pour repérer les signes de mésusage de ces traitements ; 75 % d'entre eux indiquent disposer des coordonnées d'un professionnel ou d'une structure spécialisée qui peut les aider dans la prise en charge de ces patients. Près de six praticiens sur dix (58 %) estiment être souvent confrontés à des difficultés pour respecter les recommandations quant à la durée maximale de traitement antalgique opioïde pour leurs patients ayant des douleurs chroniques non cancéreuses.
Une étude qualitative sur l'usage des médicaments opioïdes antalgiques (EMOA) menée en 2021-2022 par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) auprès de 23 médecins généralistes a permis de documenter les pratiques de prescription dans le cadre du traitement opioïde de la douleur chronique non liée au cancer en France.290(*) L'analyse de la manière dont les médecins s'organisent pour les prendre en charge fait ressortir trois positionnements différenciés des médecins :
- une « internalisation » des problèmes avec les médicaments opioïdes antalgiques, quand les ressources et les moyens sont suffisants pour les prendre en charge sur place (médecine intégrée dans des réseaux de correspondants) ;
- une « externalisation » du traitement vers des collègues jugés plus compétents ;
- une « minimisation » de ces problèmes et de leur gravité (médecine peu intégrée dans des réseaux de prévention ou de prise en charge des additions, ex. cabinet libéral), lorsque les cas de dépendance ou d'addiction sont adressés aux spécialistes de la douleur de manière exclusive.
« Outre les manques de formation à la prescription et/ou d'expérience en addictologie (souvent reprochés aux généralistes), l'analyse montre que les difficultés rencontrées tiennent surtout aux difficultés de coopération entre les acteurs du système de soins. Le contexte d'exercice des médecins (cabinet libéral, maison de santé, centre de santé, etc.), de nature à mettre les acteurs de soins en relation, à renforcer leur capacité d'agir sur des cas critiques et à modifier la place de la médecine générale dans la prise en charge d'une dépendance ou d'une addiction médicamenteuse, est crucial pour comprendre la pluralité des pratiques. »
Concernant la consommation par les patients et usagers
Le trouble de l'usage peut être de l'ordre du mésusage, c'est-à-dire d'une utilisation non conforme à la prescription d'un antalgique ou d'un TSO (indication, dosage, voie d'administration, bénéficiaire, etc.), et/ou de l'ordre de l'addiction, avec impossibilité d'arrêter la consommation en dépit de ses conséquences négatives pour l'individu et/ou son entourage, assortie d'un besoin impérieux de consommer la substance (« craving »).
Un traitement antalgique opioïde au long cours est parfois nécessaire, aboutissant alors fréquemment à une dépendance physique (due à une tolérance pharmacologique) avec un risque de symptômes de sevrage en cas d'arrêt brutal ou trop rapide des prises.
Une enquête réalisée en 2021 pour l'Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) et l'Institut Analgesia sur un panel d'environ 1 000 adultes consommateurs de tramadol ou de codéine291(*) (médicaments opioïdes antalgiques les plus prescrits en France, indiqués dans le traitement de douleurs modérées à sévères) a mis en évidence des usages inappropriés et à risques de ces deux substances, probablement en partie dus à une connaissance imparfaite de ces médicaments par les patients mais aussi des prescriptions non conformes aux indications et recommandations :
- non respect des recommandations - le premier motif de prise de codéine dans cette enquête sont les céphalées et migraines, avec 46 % des usagers ;
- mésusage - 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol présentaient un comportement de mésusage de leur traitement, dont respectivement 14 % et 24 % pour une finalité autre qu'un effet antalgique (anxiété, sommeil, stimulant...) ;
- automédication - respectivement 41 et 42 % des patients traités par codéine ou tramadol déclarent avoir déjà partagé leur traitement avec une personne de leur entourage ;
- sevrage difficile - respectivement 36 à 47 % des usagers de codéine et tramadol déclarent avoir des difficultés à arrêter ou diminuer leur traitement ;
- méconnaissance des risques - 9 usagers de tramadol ou codéine sur 10 ignorent le risque d'arrêt respiratoire en cas de surdosage de ces médicaments.
Les résultats de cette enquête rappellent d'une part la nécessité pour les médecins d'assurer une juste prescription de ces médicaments et d'autre part de mieux informer les patients sur le bon usage des médicaments antalgiques opioïdes.292(*) Des recommandations sur le bon usage des médicaments opioïdes et la prévention des surdoses ont été publiées en mars 2022 par la Haute Autorité de Santé293(*).
4. Les conditions d'évaluation de la douleur chronique et aiguë, en ville et à l'hôpital, vous paraissent-elles satisfaisantes ?
Le rôle des dispositifs spécialisés, tels que les consultations et les centres d'évaluation et de traitement de la douleur chronique, pourrait-il être renforcé ?
En France, la douleur est la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'accueil d'urgence. La douleur chronique est une douleur qui persiste au-delà de 3 mois. Elle s'oppose à la douleur aiguë, qui ne persiste pas dans le temps et cède au traitement. La prise en charge des douleurs par des équipes spécialisées a fait l'objet de recommandations de bonne pratique depuis une vingtaine d'années, successivement par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), la HAS et sous l'impulsion de Sociétés Savantes, principalement la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD). La qualité des soins s'est significativement améliorée à l'appui de ces référentiels mais il reste d'importantes marges de progression294(*).
La douleur chronique touche plus de 20 % de la population française. Les conditions d'évaluation et de traitement de la douleur chronique ne sont pas encore satisfaisantes en ville et à l'hôpital, même si l'évaluation de la douleur s'est largement améliorée (pratique intégrée aux actes de soins infirmiers en hospitalisation et aux urgences) depuis une vingtaine d'année. Les délais de prise en charge sont très éloignés des recommandations internationales en la matière. Le défaut de coordination des professionnels de santé en ville et ville-hôpital est source de prises en charge non optimales voire inadaptées des douleurs chroniques et potentiellement d'une utilisation inadaptée des morphiniques voire de leur mésusage en ville.
Selon les recommandations internationales, l'évaluation et le traitement de la douleur chronique relève d'une prise en charge globale centrée sur le patient, qui implique une approche intégrée biopsychosociale, en équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire et un traitement multimodal, médicamenteux et non médicamenteux.
En France, les structures douleur chronique (SDC), pluriprofessionnelles, constituent un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques. Ces structures doivent contribuer à réduire l'errance diagnostique et thérapeutique. Les SDC sont des structures de recours spécialisées, accessibles sur avis préalable d'un médecin généraliste ou spécialiste295(*). Les SDC sont hébergées en établissements de santé et sont labellisées par les Agences Régionales de Santé (ARS). Depuis 2023, certaines structures se distinguent par leur spécialisation pédiatrique, oncologique, ou en lien avec les douleurs de l'endométriose. Il existe plusieurs types de SDC :
- les consultations, structures de proximité assurant une prise en charge en équipe (médecin, infirmière, psychologue) ;
- les centres, qui regroupent des médecins de plusieurs spécialités (neurologue, psychiatre, orthopédiste, rhumatologue, etc.), et peuvent comporter des lits d'hospitalisation ;
- les permanences avancées où des consultations réalisées par des professionnels rattachés à une structure labellisée sont proposées, dans les zones impliquant un volume de consultations inférieur à ceux des centres.
Trois plans nationaux de lutte contre la douleur se sont succédé de 1998 à 2010. Le 4e plan douleur n'a pas été déployé. Le rapport d'évaluation du 3e plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 du Haut Conseil de la santé publique296(*) concluait que l'on devait « sortir d'une prise en charge hospitalo-centrée, pour une offre et une organisation de qualité à l'hôpital et en ville, avec une meilleure structuration de l'offre de soins, notamment en milieu de ville ». Dans son projet, le 4ème plan national de lutte contre la douleur devait répondre à certains de ces objectifs, mais ce plan n'a jamais vu le jour.
La SFETD dénombrait 245 SDC dans son Livre Blanc 2017297(*). Depuis la labellisation effectuée en 2023 par les services du ministère de la santé, ce chiffre est porté à 274 tous types confondus298(*). La stratégie décennale des soins d'accompagnement 2024-2034 publiée par le Gouvernement prévoit de développer ces structures « douleur chronique » via des incitations - visant à en créer 15 en cancérologie et 12 pour les mineurs (mesure n° 6).299(*) Ces SDC devraient être pérennisées et renforcées dans le cadre plus large d'une collaboration et coordination ville-hôpital, préconisée par la HAS. Afin d'améliorer l'accompagnement des patients souffrant de douleur chronique, la HAS a publié en partenariat avec le Collège de médecine générale (CMG) et la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) un guide sur le « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » (janvier 2023). « Ce parcours propose une gestion optimale des ressources disponibles en ville et à l'hôpital. Il est hiérarchisé selon trois niveaux, capable de fournir à tous les niveaux des soins et un accompagnement pluriprofessionnel et pluridisciplinaire de qualité. Le niveau 1, les soins de premier et second recours en ville, qui doit être en mesure de gérer l'essentiel des personnes souffrant de douleur chronique ou l'essentiel de leur parcours, si nécessaire avec le soutien de la SDC du territoire (interface). Le niveau 2, les consultations et centres d'évaluation et de traitement de la douleur (dans leur missions communes) et les services hospitaliers de spécialité. Le niveau 3, les centres d'évaluation et de traitement de la douleur (dans leurs missions spécifiques). Ce parcours nécessite la création d'une « interface ville-hôpital » : services de télésanté (télémédecine, télésoin et e-learning) et outils de partage des données par les SDC du territoire à destination de la ville. »
Dans le cadre de ce partenariat avec le CMG et la SFETD, la HAS a également publié une fiche « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » (décembre 2024) à destination des professionnels de terrain. Cette fiche décline le parcours de santé (profils des patients, ressources professionnelles mobilisables, évaluations réalisables et les traitements médicamenteux et non médicamenteux validés) pour quatre catégories de patients présentant une douleur chronique (adultes, enfants/adolescents, personnes en situation vulnérables et patients atteints d'un cancer). L'objectif est de renforcer la prévention, de réduire les délais de prise en charge et de favoriser la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette prise en charge. Ce parcours donne une place prépondérante à la médecine de ville, à sa collaboration avec les structures douleurs chroniques ainsi qu'à la juste mobilisation des services hospitaliers de spécialité300(*).
Ce partenariat a également conduit à produire une série d'outils pour l'évaluation de la douleur chronique en ville et pour la coordination ville/SDC.
Malgré une couverture territoriale importante, ces structures sont aujourd'hui menacées. La SFETD avait réalisé une enquête auprès des responsables de l'ensemble des SDC labellisées par les ARS de juin à septembre 2021. Les responsables des SDC étaient invités à renseigner un questionnaire en ligne sur les caractéristiques de la SDC et les données démographiques du personnel médical et non médical. 91 % des SDC ont répondu.301(*) Cette enquête a révélé plusieurs menaces sur la pérennité des SDC affectant la prise en charge de patients souffrant de douleur chronique :
- des SDC inégalement réparties sur le territoire (moyenne de 0,59 ETP médecin douleur exerçant en SDC pour 100 000 habitants) ;
- des délais de prise en charge importants (délais entre la demande de rendez-vous d'un patient et la première consultation : 5 à 730 jours, avec un délai médian de 90 jours) ;
des ressources humaines en inadéquation avec les besoins actuels et futurs (départ à la retraite de 177 médecins sous cinq ans, couverture limitée à 1,4 % des patients douloureux chroniques, seuls 58 % des médecins sont titulaires) ;
- un manque d'attractivité de la médecine de la douleur auprès des jeunes médecins (18 % des médecins avec activité douleur à temps plein, disparition du DESC douleur/soins palliatifs en 2016, réduction de moitié du temps de formation).
5. Comment évaluez-vous les conditions d'accès aux médicaments antalgiques opioïdes et non opioïdes en France ? Cet accès est-il suffisant pour assurer une bonne prise en charge de la douleur chronique et aiguë ? L'usage des antalgiques opioïdes vous paraît-il excessif en comparaison de l'usage des antalgiques non opioïdes et des possibilités de recours à ces derniers ?
La mise à disposition et une utilisation plus large des médicaments opioïdes dans le traitement de la douleur ont grandement contribué à l'amélioration de cette prise en charge.
En France, le paracétamol et les AINS (ibuprofène et aspirine) sont les médicaments les plus utilisés en automédication comme antalgiques (anti-douleurs) ou antipyrétiques (anti-fièvre) chez les adultes et les enfants. Ces médicaments sont sûrs et efficaces lorsqu'ils sont correctement utilisés, mais présentent des risques lors d'une utilisation inadéquate. Ces médicaments sont présentés depuis janvier 2020 derrière le comptoir du pharmacien et non plus en libre accès dans la pharmacie afin de favoriser le bon usage de ces médicaments d'utilisation courante mais ils restent disponibles sans ordonnance.
Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants (morphine, oxycodone, fentanyl) sont également soumis à une réglementation stricte de leur production, circulation et usages. En particulier, ils ne sont délivrés que sur prescription médicale, rédigée sur une ordonnance spécifique dite « sécurisée » et pour une durée limitée à 7, 14 ou 28 jours selon le médicament concerné. L'ordonnance doit être présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement. Le chevauchement n'est pas autorisé, sauf mention contraire apportée par le prescripteur et le renouvellement est interdit (sauf autorisation exceptionnelle due au premier confinement Covid).
Les médicaments opioïdes dits faibles, indiqués pour les douleurs d'intensité modérée à sévère, sont délivrés uniquement sur prescription médicale, non renouvelable sauf mention contraire.
Face à la persistance des cas de mésusage et de présentation d'ordonnances falsifiées, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer les règles de prescription des médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine (cf. réponse à la question 10).
Enfin, la publicité auprès du grand public est interdite, comme pour tout médicament sur prescription médicale obligatoire.
La prescription des médicaments de substitution aux opioïdes (MSO) se fait sur ordonnance sécurisée. La prescription doit être subordonnée à l'établissement d'un protocole de soins pour la buprénorphine et la méthadone sirop en cas de mésusage ou d'abus, et pour la méthadone gélule dès son initiation.
Les antalgiques opioïdes les plus consommés, à savoir la codéine, la poudre d'opium, le tramadol, l'oxycodone, le sulfate de morphine, le fentanyl transdermique et le fentanyl à action rapide, font l'objet d'une surveillance renforcée par les Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A), réseau d'addictovigilance de l'ANSM.
En plus des notifications spontanées de cas d'abus, de dépendance, d'usage détourné et de mésusage rapportés par les professionnels de santé, les antalgiques opioïdes font l'objet d'une attention particulière dans chaque enquête annuelle du réseau d'addictovigilance :
- « Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances » (DRAMES) ;
- « Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse » (OPPIDUM) ;
- « Ordonnances suspectes, indicateur d'abus possible (OSIAP), en complément de celles qui leur sont spécifiques concernant notamment, les « Décès toxiques par antalgiques » (enquête DTA) et les « Antalgiques stupéfiants et ordonnances sécurisées » (ASOS).
Un Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) a été créé en novembre 2017 à partir de travaux financés par l'ANSM. Il a pour missions principales de participer à la pharmacosurveillance et de promouvoir le bon usage des médicaments antalgiques en France.
6. Les conditions de réévaluation périodique des traitements par médicaments opioïdes vous paraissent-elles adaptées ?
Des réévaluations régulières par le praticien sont nécessaires pour évaluer le bénéfice du traitement et la survenue d'effets indésirables. Le renouvellement des prescriptions ne doit être envisagé qu'en cas de persistance d'une indication clinique justifiant la prescription d'opioïde, avec réévaluation de la balance bénéfices/risques au décours de la prescription antérieure. Il est recommandé de rechercher une dépendance physique aux opioïdes (symptômes de sevrage) à l'examen clinique ; il existe des outils d'évaluation comme les échelles de dépistage « Clinical Opiate Withdrawal Scale » (COWS) et « Subjective Opiate Withdrawal Scale » (SOWS). Un usage prolongé d'antalgiques opioïdes pour des douleurs aiguës per- ou post-opératoires requiert une réévaluation attentive de la douleur. Si l'éventualité d'une substitution n'est pas retenue par le patient et si le patient souhaite un sevrage rapide (en moins d'une semaine), une hospitalisation est recommandée, avec réévaluation post-hospitalisation à court terme (15 jours à 1 mois) et suivi au plus long cours302(*).
7. Quels critères doivent être pris en compte pour déterminer le caractère favorable ou défavorable de la balance bénéfices-risques dans l'usage et la consommation de médicaments antalgiques opioïdes ? Existe-t-il un outil ou un modèle décisionnel pour aider les professionnels de santé à évaluer cette balance bénéfices-risques ?
Comme le rappellent les recommandations HAS « Bon usage des médicaments opioïdes » (mars 2022), quelle que soit la puissance pharmacologique des antalgiques opioïdes, leur balance bénéfices/risques est corrélée à la dose utilisée. Les risques, notamment celui de développer un trouble de l'usage ou de surdose, sont communs à tous ces médicaments opioïdes.
Les médicaments antalgiques opioïdes sont recommandés en première intention pour le traitement de la plupart des douleurs aiguës et sévères (score à l'échelle numérique = 6/10). Les médicaments antalgiques opioïdes sont indiqués dans la douleur liée au cancer. Ils peuvent être envisagés dans certaines douleurs chroniques de lombalgie/lomboradiculalgie, d'arthrose, voire neuropathiques et autres maladies évolutives (maladies neurodégénératives, situations palliatives évoluées non liées au cancer, etc.) lorsque les alternatives thérapeutiques, médicamenteuses ou non, ont été essayées. Toutefois, dans certaines situations cliniques, même en cas de douleur aiguë sévère, les médicaments antalgiques opioïdes ne sont pas recommandés en première intention en raison de leur balance bénéfices/risques défavorable (à titre non exhaustif) : douleurs dentaires, lombalgie aiguë, traumatismes simples du rachis (contractures musculaires, syndrome du whiplash cervical - i.e. « coup du lapin ») et distaux des membres (entorses ou blessures mineures sans signes de lésions tissulaires), colique néphrétique. Par ailleurs, les médicaments antalgiques opioïdes ne sont pas recommandés, même en deuxième intention, dans la crise migraineuse, quelle que soit l'intensité de la douleur303(*).
Au cours de la primo-prescription et avant tout renouvellement, il faut :
i. Déterminer si la balance bénéfices/risques du traitement opioïde est favorable pour le patient en fonction des données cliniques et des objectifs de la prise en charge. Les critères de détermination du caractère favorable ou défavorable sont les mêmes que ceux des autres médicaments antalgiques à savoir la balance entre critères d'efficacité (réduction de l'intensité douloureuse dans la durée) et critères de tolérance (ex. nausées, vomissements, sédation, effets dysphoriques chez les sujets âgés). L'analyse de cette balance est à l'origine de modifications fréquentes de la posologie et des modes d'administration des opioïdes.
ii. Évaluer l'apparition d'une dépendance physique avec ou sans trouble de l'usage d'opioïdes à chaque consultation, en renouvelant si nécessaire la cotation des échelles de dépistage - « Prescription Opioid Misuse Index Scale » (POMI), « Clinical Opiate Withdrawal Scale » (COWS), « Subjective Opiate Withdrawal Scale » (SOWS).
8. Dans votre guide relatif au « bon usage des médicaments opioïdes », vous indiquez qu'en cas de traitement par opioïde, les objectifs de la prise en charge doivent « résulter d'une décision médicale partagée avec le patient ». Pouvez-vous préciser le rôle que devrait jouer le patient, selon la HAS, dans la validation du traitement ?
En matière de traitement de la douleur, le patient est un acteur central car il est le seul à apprécier l'intensité de la douleur qui n'est pas quantifiable par des paramètres physiques. Il est également le seul à même de décrire la tolérance du traitement et les effets secondaires qui doivent conduire à une adaptation thérapeutique.
Une fois le diagnostic établi et l'évaluation globale réalisée, il est recommandé de définir les objectifs de la prise en charge. Ceux-ci doivent résulter d'une décision médicale partagée avec le patient, tenant compte de ses préférences, de sa situation globale, de l'évaluation de la balance bénéfices/risques des stratégies thérapeutiques. Une situation de vulnérabilité sociale ou psychologique doit être recherchée.304(*)
9. En termes de bonnes pratiques, quelles différences convient-il d'établir entre les modalités d'usage des opioïdes dits forts et des opioïdes dits faibles ?
Les recommandations de bonne pratiques édictées par la HAS concernant les médicaments opioïdes à visée antalgique ou substitutive, s'adressent à tous les opioïdes, qu'ils soient dits faibles ou forts.
Les médicaments opioïdes dits faibles (antalgiques de palier II selon l'OMS) sont indiqués dans la prise en charge de douleurs aiguës ou chroniques, d'intensité modérée à sévère, non soulagées par les antalgiques de palier I - tels que le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - auxquels ils sont fréquemment associés.
Les médicaments opioïdes classés stupéfiants (et assimilés) sont disponibles dans le cadre de deux catégories d'indications : antalgie et substitution aux opioïdes. L'encadrement légal de leur délivrance est plus strict que pour les médicaments sur liste I. Ces médicaments sont indiqués pour la prise en charge de douleurs sévères ou résistantes aux antalgiques de palier inférieur, et en particulier celles liées au cancer. À ce titre, ils sont qualifiés d'opioïdes « forts » (opioïdes de « palier 3 »), en rapport avec leur puissance pharmacologique supérieure aux molécules de palier inférieur. La plupart (morphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone) n'ont qu'une indication antalgique, tandis que la buprénorphine et la méthadone possèdent en plus une indication dans le traitement substitutif de la « pharmacodépendance » aux opioïdes et sont alors appelées « médicaments de substitution aux opioïdes » (MSO)305(*).
Il existe donc un ordre de prescription qui prend en compte l'intensité de la douleur. Cependant, chez des patients ayant des douleurs nociceptives dans un contexte de pathologie cancéreuse, il peut être utile d'utiliser d'emblée des opioïdes forts.
10. Indiquez les principales mesures prises, ces dernières années, visant à sécuriser la prescription et la dispensation des médicaments opiacés et opioïdes.
Le cadre juridique actuel vous paraît-il adapté à la maîtrise et au contrôle des prescriptions et de la dispensation de ces médicaments ?
Les recommandations HAS « Bon usage des médicaments opioïdes » (mars 2022) rappellent qu'il est préconisé d'utiliser la dose d'opioïde efficace la plus faible possible pendant la durée la plus courte possible et d'utiliser des formulations d'opioïdes à libération immédiate en évitant de commencer à utiliser des formulations à longue durée d'action ou à libération prolongée (y compris le fentanyl transdermique) pour le traitement de la douleur aiguë. Il est recommandé d'utiliser la voie d'administration orale dans la mesure du possible.306(*)
Les médicaments opioïdes, tels que le tramadol et la codéine, nécessitent une attention accrue en raison des risques de dépendance, d'abus et de surdosage. Face à la persistance des cas de mésusage et de présentation d'ordonnances falsifiées, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer les règles de prescription. De nouvelles règles de prescription et délivrance sont entrées en vigueur le 1er mars 2025307(*) :
- les médecins doivent prescrire les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine sur ordonnance sécurisée. Le dosage, la posologie et la durée du traitement doivent être rédigés en toutes lettres ;
- pour toute nouvelle prescription, les pharmaciens ne peuvent dispenser ces traitements que sur présentation d'une ordonnance sécurisée ;
- la durée de validité des ordonnances de médicaments contenant de la codéine est réduite à 12 semaines, comme pour le tramadol. Une nouvelle ordonnance est nécessaire pour prolonger le traitement.
Ces mesures visent à limiter les abus et à réduire les cas d'ordonnances falsifiées. Les professionnels de santé sont également invités à prescrire ces médicaments pour des durées courtes, en particulier pour les douleurs aiguës, et à réévaluer les traitements tous les trois mois dans le cadre des douleurs chroniques. Des mentions d'alerte devraient également être ajoutées sur les boîtes de médicaments à l'avenir. Ces modifications doivent permettre une meilleure prise en charge analgésique des patients en sécurisant les prescriptions et en instaurant des réévaluations nécessaires. Chaque prescripteur doit se poser la question de la nécessité d'une prescription d'opioïdes chez un patient, qui ne peut être une prescription automatique.
Afin de réduire les risques d'abus et de dépendance associés au tramadol, certains laboratoires, sur demande de l'ANSM, ont réduit la taille des conditionnements : depuis fin 2023, ces laboratoires proposent des boîtes de 10 unités (comprimé ou gélule). Les spécialités de tramadol associé au paracétamol sont en boîte de 20 unités.
L'avenant 1 à la convention nationale des pharmaciens signée le 10 juin 2024 permet la réalisation d'entretiens dédiés au suivi des patients sous traitement opioïdes de palier II (dispositif mis en place en janvier 2025).308(*) L'objectif de cet entretien est de lutter contre la dépendance aux opioïdes en accompagnant les patients dans la prise de leur traitement. Les patients éligibles à cet entretien sont les patients de plus de 18 ans sous traitement par antalgique de palier II à l'occasion de leur 2e délivrance (tramadol, poudre d'opium, codéine et dihydrocodéine) pour mesurer leur degré de dépendance.
11. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Les entretiens approfondis réalisés dans le cadre de l'étude sur les médicaments opioïdes antalgiques (EMOA) menée en 2021-2022 par l'OFDT auprès de 23 médecins généralistes et 25 patients en difficulté traités par antalgique opioïde pour un douleur chronique (non liée au cancer) a analysé les difficultés rencontrées par ces médecins dans le processus de prescription (notamment lorsqu'ils ne sont pas à l'origine de l'initiation) et par ces patients dans leur parcours de médication. Cette analyse suggère que le premier facteur d'usage chronique est lié à l'éclatement de la prise en charge de la douleur entre différents professionnels, et que ce phénomène est plus significatif lorsque les patiente habitent dans des zones de faible activité médicale. En corollaire, les patients se sentent contraints de consulter des professionnels de leur propre initiative et parfois en dehors de leurs réseaux, avec comme conséquence l'absence de communication avec leur médecin traitant. Plusieurs problématiques soulevées par les patients interrogés sont associées à ce morcellement de la prise en charge, souvent à l'origine d'une chronicisation de la prise d'antalgiques opioïdes sur ordonnance : habiter dans un « désert médical » avec un accès aux soins difficile, notamment en territoires ruraux ou semi-ruraux, avoir subi la perte de son médecin traitant (en raison de son départ ou d'un déménagement du patient)309(*).
« Le maintien de l'usage de MOA par les patients présentant une DCNC répond à une accumulation de problèmes de santé, dont la prise en charge est caractérisée par un manque de communication, voire de coordination, entre les professionnels intervenants. En effet, nombreux sont les patients insatisfaits qui mettent en exergue ce manque de communication du médecin traitant avec ces autres intervenants, et l'énoncent de manière explicite comme un manque d'organisation dans leurs soins. ». « La proximité étroite avec un médecin traitant qui connaisse non seulement leur état de santé et leurs préférences en termes de soins, mais aussi leur mode de vie, leurs exigences et leurs dynamiques quotidiennes de vie, semble vraiment importante pour les patientes et patients interrogés. Or, l'enquête EMOA montre des cas de chronicisation de l'usage par manque d'encadrement médical coordonné. »
Plusieurs pistes d'amélioration de la prise en charge de la douleur chronique par les SDC pourraient être envisagées :
- décloisonnement entre services au sein des établissements (pluridisciplinarité et pluriprofessionnalité sont des fondamentaux de l'organisation des SDC) ;
- décloisonnement entre mondes sanitaire (ambulatoire, SDC), médico-social (médecine du travail, médecin-conseil...), et social (assistant social CPAM, CAF...) ;
- liens Ville-Hôpital (références et outils de parcours au service des équipes de soins primaires, coopération entre SDC et libéraux/équipes de soins primaires)310(*).
12. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Il est toujours nécessaire de conduire des actions de formations continue et d'actualiser régulièrement les recommandations de bonnes pratiques sur les traitements opioïdes. Dans le cadre du « Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale » (décembre 2019 - mars 2020)311(*) :
- seuls 52 % des médecins généralistes interrogés se considéraient suffisamment formés pour repérer les signes de mésusage des antalgiques opioïdes, et une très large majorité (81 %) des praticiens déclaraient informer systématiquement leurs patients faisant l'objet d'une prescription d'antalgiques opioïdes des risques de mésusage et de dépendance ;
- seuls 45 % des médecins ayant initié ou renouvelé un TSO dans l'année déclaraient se sentir suffisamment formés pour cette prise en charge, cette perception étant nettement plus fréquente parmi les praticiens ayant initié un TSO (64 %) que parmi les praticiens ayant uniquement renouvelé un TSO dans l'année (35 %).
En ce qui concerne le traitement de substitution aux opioïdes, comme indiqué dans les recommandations HAS « Bon usage des médicaments opioïdes » (mars 2022), il est nécessaire - au-delà de l'amélioration de l'accès aux dispositifs de soins (disparités régionales de la démographie médicale) - de renforcer le soutien et la formation des professionnels, notamment pour les acteurs de premier recours, de les sensibiliser à une intervention précoce et sans stigmatisation sur les situations à risque et à l'intérêt d'une meilleure coordination entre les professionnels concernés.312(*)
13. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
a. Conditions d'accès à la naloxone
Conformément aux recommandations HAS « Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes »313(*) (mars 2022), il est recommandé d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription et d'une dispensation de naloxone (antidote des opioïdes) sous forme « prête à l'emploi » lors de la prescription d'un opioïde, notamment en cas de vulnérabilité (évènement de vie, sortie d'hospitalisation, d'incarcération, etc.) pour traiter en urgence, le cas échéant, un surdosage aux opioïdes avec risque vital y compris par un tiers (en dehors d'un contexte de soin). En guise de recommandation aux pouvoirs publics, la HAS rappelait qu'un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone permettrait de faciliter sa diffusion et son utilisation314(*).
Dans sa dernière enquête annuelle (enquête n° 53, octobre 2023), l'OPPIDUM315(*) rapporte une connaissance et un accès de la naloxone en augmentation mais encore trop faible : parmi les 72 % des sujets consommateurs de substances psychoactives (dont 54 % de médicaments) qui étaient consommateurs d'opioïdes, 67 % avaient connaissance de la mise à disposition de kits de naloxone (61 % en 2022), seuls 34 % avaient un kit à disposition et 3 % en avaient utilisé un dans l'année. Conformément aux recommandations HAS « De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes »316(*) (mars 2022), afin d'anticiper la prise en charge d'une surdose, il est recommandé de prescrire ou délivrer de la naloxone sous forme de kit prêt à l'emploi aux patients à risque de surdose et à leur entourage (familial ou non), en les informant des modalités d'administration de la naloxone et la nécessité de prévenir immédiatement les services de soins d'urgence en cas de surdose. Le kit de naloxone doit être conservé dans un endroit accessible à tous les intervenants susceptibles d'y avoir recours.
Entre 2021 et 2023, la mise à disposition de la naloxone a augmenté de près de 40 %317(*).
Les structures autorisées à délivrer gratuitement les médicaments à base de naloxone aux usagers à risque sont les suivantes :
- les CSAPA318(*) dans les conditions fixées par l'article L.3411-5 du code de la santé publique ;
- les CAARUD319(*) (y compris lors de leurs actions hors les murs) dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1003 du 10 mai 2017 ;
- les établissements hospitaliers (sorties d'hospitalisation en service d'addictologie ou des urgences) ;
- les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (sorties de détention) ;
- les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif dans les conditions de l'article L.6325-1 du code de la santé publique.
Les spécialités à base de naloxone disponibles en France sont :
i Les spécialités dispensables uniquement dans les structures médicalisées, à prescription médicale obligatoire :
• NARCAN 0,4 mg/mL, solution injectable en ampoule de 1 mL et génériques
ii Les spécialités disponibles en ville et à l'hôpital (kits prêts à l'emploi), administrables par un tiers non issu du corps médical :
• PRENOXAD 0,91 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie (IM) - non soumis à prescription médicale - est disponible depuis mai 2019 dans les établissements de santé, en CSAPA, en CAARUD et dans les pharmacies de ville ;
• NYXOID 1,8 mg, solution pour pulvérisation nasale (IN) - liste I - disponible depuis septembre 2021 dans les établissements de santé et dans les pharmacies de ville ;
• VENTIZOLVE 1,26 mg, solution pour pulvérisation nasale (IN) - non soumis à prescription médicale commercialisé depuis octobre 2023 et dispensé dans certains CAARUD et CSAPA à gestion associative. La spécialité n'est actuellement inscrite que sur la liste collectivités.
b. Conditions d'accès aux traitements de substitution aux opioïdes (TSO)
Deux dispositifs permettent de dispenser des traitements de substitution aux usagers de drogues illicites : le dispositif des structures spécialisées en addictologie (CSAPA, hôpitaux, unités de soins intervenant en milieu pénitentiaire) et le dispositif généraliste (médecins généralistes et pharmaciens d'officine essentiellement).
En milieu pénitentiaire, les conditions de délivrance des TSO sont affectées par le détournement ou mésusage de buprénorphine haut dosage (BHD) et le risque de surdose de méthadone. Si le cadre réglementaire d'organisation des soins en détention autorise des modalités d'initiation et de renouvellement des TSO identiques à celles existant en milieu libre, d'importantes disparités existent encore dans l'accessibilité, la diversification ainsi que les modalités de prescription ou de dispensation de ces thérapeutiques.320(*) Le Guide des traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral publié par le Ministère de la Santé et de la prévention souligne que les pratiques doivent être axées sur la continuité des soins et le maintien d'une proximité clinique avec les patients. Il rappelle notamment :
- que le mésusage de la BHD traduit souvent, comme au dehors, des modalités de prise en charge inadaptées à la situation clinique et globale du patient ;
- que le détournement de la BHD (prescrite par l'unité de soin ou en provenance de l'extérieur) comme monnaie d'échange ne relève plus du soin ou de la pratique addictive ;
- qu'il est très important d'établir une distinction entre mésusage et détournement afin que les décisions thérapeutiques relatives aux TSO relèvent uniquement d'une logique de soin.
14. Quelles mesures préconiseriez-vous pour renforcer l'accompagnement des usagers d'opioïdes dans une démarche de réduction des risques d'une part et de prévention des troubles de l'usage d'autre part ?
Afin d'améliorer l'accompagnement des patients souffrant de douleur chronique, la HAS a produit en partenariat avec le Collège de médecine générale (CMG) et la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) un guide sur le « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » (janvier 2023) permettant d'apporter une réponse graduée et adaptée à chaque patient atteint d'une douleur chronique, dans des délais médicalement et éthiquement acceptables321(*). L'objectif est de renforcer la prévention, de réduire les délais de prise en charge et de favoriser la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette prise en charge. Ce parcours donne une place prépondérante à la médecine de ville, à sa collaboration avec les SDC ainsi qu'à la juste mobilisation des services hospitaliers de spécialité.
La prévention des troubles de l'usage d'opioïdes (TUO) et des surdoses ou décès par opioïdes débute par l'application stricte des règles de prescription des médicaments opioïdes (indication, posologie, etc.).
Conformément aux recommandations HAS « De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes »322(*) (mars 2022), une évaluation globale du patient est nécessaire avant l'instauration du traitement afin de rechercher des facteurs de risque de trouble de l'usage. Il est recommandé d'interroger le patient sur ses antécédents médicaux, ses comportements addictifs et ses consommations (traitements prescrits ou autoadministrés ou substances habituellement consommées) afin d'évaluer les risques d'interactions médicamenteuses. Cette évaluation initiale doit rechercher la présence d'éventuelles comorbidités somatiques, psychiatriques, et troubles de l'usage de substances (passés ou actuels). Une situation de vulnérabilité sociale ou psychologique doit être recherchée en interrogeant le patient sur sa situation socio-judiciaire et environnementale. Les potentiels troubles comorbides doivent être pris en charge de manière simultanée à l'aide de soins pluridisciplinaires afin d'éviter que le patient ne pérennise un usage d'opioïde en auto-soulagement de ses comorbidités, plutôt que pour l'indication établie pour laquelle l'opioïde est prescrit.
D'après les recommandations HAS « Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes »323(*) (mars 2022), une fois le diagnostic établi et l'évaluation globale réalisée, il est recommandé de définir les objectifs de la prise en charge. Ceux-ci doivent résulter d'une décision médicale partagée avec le patient, tenant compte de ses préférences, de sa situation globale, de l'évaluation de la balance bénéfices/risques des stratégies thérapeutiques. Ces objectifs sont partagés avec le patient et entre tous les acteurs des soins afin d'éviter toute persistance ou inflation inappropriée des prescriptions, dont peut découler un TUO. Un traitement opioïde est instauré par titration, qu'il soit à visée antalgique ou substitutive, pour atteindre respectivement le soulagement de la douleur ainsi que la réduction ou l'arrêt de la consommation d'un opioïde. Il est recommandé de réévaluer très régulièrement le traitement en fonction de la balance bénéfices/risques attendue, préalablement discutée avec le patient. Il est recommandé d'évaluer cliniquement le patient pour rechercher un risque de TUO ; le repérage des patients à risque peut être facilité par le recours à des outils d'évaluation avant la première prescription d'opioïdes (Opioid Risk Tool - ORT) et avant un renouvellement (Prescription Opioid Misuse Index - POMI, version validée en français). L'avis d'un expert en addictologie est souhaitable dans un contexte de détournement suspecté ou avéré, ainsi que pour des conseils en matière de réduction des risques.
La prévention des TUO repose également sur :
- un encadrement étroit des conditions de prescription et de délivrance des médicaments opioïdes (cf. réponse à la question 10 sur les nouvelles règles de prescription et de délivrance des médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine) ;
- une offre sanitaire spécialisée en addictologie en ville et à l'hôpital incluant soins et réduction des risques (CSAPA et CAARUD notamment) ;
- une offre de soins structurée pour la prise en charge de la douleur (cf. réponse à la question 4 sur les structures douleur chronique notamment) ;
- un dispositif de surveillance au niveau national, en particulier les enquêtes de pharmacodépendance et addictovigilance324(*) ex. DRAMES (Décès en Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) et OPPIDUM (Observation des Produits psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) et le dispositif TREND de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
La politique de réduction des risques et des dommages s'appuie notamment sur la mise à disposition de matériel à usage unique, sur l'incitation au dépistage (VIH, hépatites) et à la vaccination, ainsi que sur la diffusion des traitements de substitution aux opiacés. Une autre finalité majeure de cette politique est de favoriser l'accès des usagers de drogues aux soins et aux droits sociaux (logement, formation, emploi...), notamment pour les plus démunis et désocialisés. Des dispositifs ont été initiés, comme le lancement en 2016 d'une expérimentation nationale de salles de consommation à moindre risque (SCMR)325(*), expérimentation prolongée jusqu'au 31 décembre 2025 et le développement d'un programme de distribution de kits de naloxone en CSAPA et en Caarud.
Le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022326(*) visait notamment à :
- poursuivre l'adaptation des salles de consommation à moindre risque déjà autorisées ;
- développer la formation et les outils d'accompagnement des professionnels de santé, notamment concernant la prescription et délivrance des MSO et la mise à disposition de la naloxone ;
- veiller à l'accessibilité physique et économique de la naloxone, en particulier la délivrance de la naloxone par des structures spécialisées et non spécialisées (kits de naloxone prêts à l'emploi).
LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT (LEEM)
___________
1. Quels enseignements peut-on tirer, en France, des carences dans l'encadrement des pratiques de commercialisation et de prescription des médicaments opioïdes ayant favorisé l'émergence de la crise américaine des opioïdes ?
La crise de santé publique qui a lieu actuellement aux États-Unis relative aux opioïdes est née en premier lieu de prescriptions abusives principalement des opioïdes dits forts. Elle tient notamment d'un cadre règlementaire qui permet la libre promotion et un circuit de délivrance moins strict. Elle concerne particulièrement les opioïdes dits « forts ».
Au sein de l'Union européenne, et plus particulièrement en France, le cadre règlementaire est plus strict. On relève notamment le fait que la publicité et la commercialisation des médicaments sont particulièrement encadrés.
En France, comme présenté dans les réponses aux questions ci-dessous, le cadre réglementaire est bien défini tant au niveau de la réglementation (prescription de dispensation, promotion, ...), la distribution que de l'information/communication : code de la santé publique/Charte de l'information promotionnelle/Responsabilité du Pharmacien Responsable (pénale et personnelle).
2. Le cadre applicable en France vous semble-t-il suffisamment protecteur pour éviter l'importation de cette crise ?
Le Leem et l'ensemble de ses adhérents considèrent que le cadre règlementaire actuel permet de suffisamment protéger les citoyens et les patients Français d'une telle crise. Pour autant, il est nécessaire de relever que la consommation d'opioïdes ne relève pas que du circuit de délivrance des médicaments mais de circuits de commercialisation mises en place par des organisations criminelles et par un trafic important d'ordonnances et de médicaments falsifiés.
Vous trouverez ci-dessous le détail de l'ensemble des mesures réglementaires existant en France pour encadrer la prescription et la délivrance de ces médicaments.
A. Rappels sur les médicaments prenant en charge la douleur
1/ Antalgiques non opiacés (palier 1)
Exemples :
- Paracétamol ;
- Aspirine Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
À noter : pour l'ensemble de ces spécialités, les traitements doivent être de courte durée et ne pas perdurer sur une ordonnance.
- Néfopam.
2/ Opioïdes faibles (palier 2)
Exemples :
- Tramadol plus ou moins associé avec paracétamol (dans le traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses) ;
- Codéine et dihydrocodéine ;
- Opium en association avec le paracétamol.
3/ Opioïdes forts (palier 3)
Avant toute prescription, il est nécessaire de rechercher des facteurs de risque de mésusage des antalgiques opioïdes. L'existence de facteurs de risque n'interdit pas la prescription, mais justifie une attention et un suivi renforcés.
Exemples :
- Morphine orale, antalgique de référence dans les douleurs sévères, classé stupéfiant.
À noter : ne pas poursuivre un antalgique opioïde fort au-delà de 3 mois en l'absence de bénéfice significatif sur au moins l'un des aspects suivants :
- soulagement de la douleur ;
- amélioration de la fonction ;
- amélioration de la qualité de vie.
B. Rappels sur les médicaments opioïdes
Opiacé = dérivé naturel de l'opium extrait à partir du pavot (morphine, codéine). Utilisé pour ses propriétés analgésiques ou antitussives.
Opioïde = composé hémi-synthétique (oxycodone, héroïne) ou entièrement synthétique (fentanyl, méthadone). Les propriétés analgésiques peuvent être beaucoup plus puissantes que les opiacés.
Aujourd'hui, par abus de langage, on parle d'opioïde de manière générale pour faire référence à toutes ces substances.
1/ Résumé des catégories d'opioïdes proposé par la Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé - Opioïdes : prévenir le risque de surdose
Les opioïdes exposent à des risques de dépendance physique, d'addiction, de mésusage. Ils peuvent provoquer de fortes sensations de manque ou craving.
Les médicaments opioïdes regroupent :
- les dérivés naturels de l'opium ou opiacés : codéine, morphine, opium ;
- les composés semi-synthétiques : buprénorphine, dihydrocodéine, hydromorphone, nalbuphine ;
- Les composés synthétiques : fentanyl, méthadone, oxycodone, tramadol.
2/ Réglementation des opioïdes en France
La quasi-totalité des substances médicamenteuses opioïdes obéissent à la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés (cf. la liste ci-dessous pour plus de détails), en ce sens qu'elles nécessitent, entre autres mesures :
- Pour le suivi des prescriptions : le recours à l'ordonnance sécurisée impliquant :
- L'indication de la quantité à délivrer par unités de prise ;
- Indication en toutes lettres le nombre d'unités par prise, le nombre de prises, le dosage/la concentration ;
- La limitation de la durée maximale de prescription.
- Pour le suivi de la délivrance :
- Présentation de l'ordonnance dans les 3 jours suivant sa date d'établissement ;
- Conservation des ordonnances par le pharmacien durant 3 ans ;
- Délivrance en personne au patient, ou, si le porteur de l'ordonnance n'est pas le patient, enregistrement du nom et de l'adresse du porteur, demande de justification d'identité ;
- Tenue d'un registre d'entrée/sortie de tout médicament stupéfiant par tous les acteurs de la chaine de distribution (y compris le pharmacien d'officine), la mise sous clé des médicaments concernés.
Prescription des médicaments opioïdes :
Opioïdes faibles (codéine, buprénorphine, tramadol) : Liste I / Prescription sur ordonnance sécurisée (depuis 1er mars 2025) / limitée à 12 semaines (durée de Px pour la codéine réduite et alignée sur celle du tramadol depuis 1er Mars 2025)
Opioïdes forts (opium, morphine, dihydrocodéine, hydromorphone, fentanyl, méthadone, oxycodone) : Stupéfiant/Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée/ prescription limitée à 4 semaines
Les mesures de suivi particulières peuvent être les suivantes :
- L'administration doit être effectuée dans un établissement de santé ;
- Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée
- Prescription restreinte
- hospitalière
- réservée aux médecins exerçant dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Fentanyl : Stupéfiant/Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée/ prescription limitée à 4 semaines/délivrance fractionnée de 7 jours.
Ce cadre implique un suivi strict à toutes les étapes de fabrication, prescription, dispensation des médicaments stupéfiants.
C. Cadre renforcé pour les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine
Face à la persistance des cas de mésusage et de présentation d'ordonnances falsifiées, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de faire évoluer les règles de prescription.
Deux nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2025.
- Une prescription sur ordonnance sécurisée depuis le 1er mars
Tous les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine doivent obligatoirement être prescrits sur une ordonnance sécurisée, qu'ils soient seuls ou associés à d'autres substances (paracétamol, ibuprofène, etc.).
Sur cette ordonnance, le pharmacien doit voir inscrites en toutes lettres les mentions suivantes :
- le dosage ;
- la posologie ;
- la durée du traitement.
Si l'ordonnance sécurisée ne comporte pas ces mentions obligatoires, la délivrance ne sera pas possible.
Pour rappel, l'ordonnance sécurisée répond à la norme de l'Association française de normalisation (Afnor) NF280.
Les professionnels de santé prescripteurs (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes) doivent commander ces ordonnances auprès d'un imprimeur agréé Afnor.
- Une limitation de la durée maximale de prescription
La durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine (ou de la dihydrocodéine) est alignée sur celle du tramadol, soit 12 semaines (3 mois).
Au-delà de cette période, une nouvelle ordonnance sécurisée sera requise pour poursuivre le traitement. Ce qui permet au médecin l'intérêt thérapeutique de renouveler la prise en charge de la douleur.
L'ANSM a par ailleurs publié des informations quant à cette nouvelle réglementation :
Tramadol et codéine devront être prescrits sur une ordonnance sécurisée sur le site de l'ANSM.
Une lettre aux professionnels de santé (DHPC) a été envoyée le 2/12/2024 à tous médecins (toutes spécialités médicales), libéraux et hospitaliers (exerçant en établissements de santé publics ou privés), chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et pharmaciens d'officine et hospitaliers (PUI). Elle rappelle les nouvelles modalités de prescription, les conduites à tenir par les prescripteurs et les pharmaciens, les mises en garde et mesures de prudence.
Parallèlement, la mise en place de mesures supplémentaires pour mieux informer les patients sur les risques de dépendance et de surdosage liés à ces médicaments est en cours de réflexion. À titre exemple : apposer des mentions d'alerte sur la face principale des boîtes de médicaments contenant du tramadol ou de la codéine. (prévision d'application en mars 2026).
Des réflexions à l'Europe plus globales sont en cours pour harmonisation des messages entre tous les opioïdes (exemple : warning box sur notice à la suite des recommandations de l'Europe d'augmenter l'information à destination des patients).
D. Historique des mesures prises par l'ANSM sur spécialités opioïdes à base de codéine, de dihydrocodéine ou de tramadol, seuls ou en association à d'autres substances (ex : paracétamol, ibuprofène...) :
À la suite des enquêtes de pharmacodépendance et d'addictovigilance suivant les cas de mésusage (abus, surdosages), de dépendance et de présentation d'ordonnances falsifiées pour ces médicaments, de nombreuses mesures ont été mises en place sous l'égide de l'ANSM :
- depuis 2017, tous les médicaments contenant de la codéine sont soumis à une prescription médicale ;
- en avril 2020, l'ANSM a réduit la durée maximale de prescription des médicaments contenant du tramadol à 12 semaines (trois mois) ;
ï Demande aux industriels commercialisant des médicaments contenant du tramadol la mise sur le marché de boîtes contenant moins de comprimés, adaptées aux traitements de courte durée, en complément des boîtes déjà disponibles.
L'ANSM a également sensibilisé à plusieurs reprises les prescripteurs sur la nécessité de prévenir et traiter les troubles liés à l'usage des antalgiques opioïdes.
Sur la stratégie commerciale des industriels
3. Rappeler le cadre applicable en matière de publicité pour les médicaments. Existe-t-il des restrictions spécifiques pour les médicaments opioïdes ? Ce cadre devrait-il, selon vous, connaître des évolutions, et dans quel sens ?
La publicité à destination du grand public est interdite en France pour ces spécialités à prescription médicale obligatoire (article L5122-6 Code de la Santé publique - CSP)
La publicité à destination des professionnels de santé est soumise à une validation a priori et un visa accordé par l'ANSM valide pendant 2 ans. Les supports promotionnels doivent contenir les informations essentielles du bon usage des médicaments, telles que décrites dans la recommandation « Présentation des données de sécurité » de l'ANSM. En particulier dans le cas des opioïdes l'indication, la durée de prescription, les contre-indications, les évènements indésirables, les données de sécurité obligatoires (les risques d'abus, mésusages et d'overdose) et règles de prescription et délivrance : ordonnance sécurisée pour tramadol/codeine/dihydrocodeine.
Toute communication d'un laboratoire sur un médicament répond à la définition du médicament et doit suivre les obligations réglementaires précitées et être autorisées par l'ANSM.
4. Comment les laboratoires assurent-ils que leurs pratiques commerciales respectent les normes éthiques et n'encouragent pas une surprescription des opioïdes ?
Il n'est pas possible en France d'exercer de pratique commerciale auprès des prescripteurs. L'information promotionnelle est très encadrée et en particulier pour les personnes en charge de l'information promotionnelle par la charte de l'information promotionnelle et le référentiel de certification de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments de l'industrie pharmaceutique.
Les visites réalisées par les visiteurs médiaux auprès des professionnels de santé sont rigoureusement suivies et évaluées par les laboratoires, sous la responsabilité du Pharmacien Responsable :
- d'un point de vue quantitatif avec le nombre de visites pour ne pas faire de surfréquence ;
- et d'un point de vue qualitatif : discours oral favorisant le bon usage du médicament, validé par une évaluation, afin de vérifier sa conformité avec les informations obligatoires de l'AMM du médicament dont les rubriques de bon usage, et avec les recommandations de bon usage des médicaments opioïdes (recommandations de la HAS 2022).
Les personnes en charge de l'information promotionnelle sont formées annuellement au bon usage des opioïdes, aux règles de déontologie en termes d'encadrement des avantages octroyés aux professionnels de santé (Loi d'encadrement des avantages).
Ces activités/données sont également auditées tous les ans dans le cadre de la certification de la visite médicale.
Une enquête est réalisée auprès des prescripteurs sur les pratiques des visiteurs médiaux pour évaluer la satisfaction et les éventuelles non-conformités.
Les visiteurs médicaux ont également l'obligation de remonter tous les événements indésirables et tous les usages non conformes à l'AMM constatés lors de leurs échanges avec les professionnels de santé prescripteurs ou dispensateurs.
5. Quelles actions sont entreprises pour sensibiliser les médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé aux risques liés à l'utilisation des opioïdes, et à la nécessité de respecter des critères stricts pour leur prescription ?
Les mesures additionnelles de réduction du risque (MARRs) sont des outils destinés à prévenir ou réduire la survenue d'évènements indésirables, leur gravité ou leur impact sur le patient. Différents types de supports peuvent être envisagés (lettres aux professionnels de santé aussi appelées DHPC, documents d'information, brochures, cartes-patients etc.) en fonction du destinataire (professionnels de santé ou patients).
C'est aux titulaires d'AMM qu'incombent la mise en place de ces outils, qui sont avec leurs modalités de diffusion, soumis à l'ANSM pour être autorisés avant d'être diffusés.
(Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) - ANSM)
- À titre d'exemple, dans le cadre des nouvelles mesures prises par l'ANSM sur les médicaments contenant du tramadol ou de la codéine/ dihydrocodéine, une DHPC a été envoyée le 2/12/2024 à tous médecins (toutes spécialités médicales), libéraux et hospitaliers (exerçant en établissements de santé publics ou privés), chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et pharmaciens d'officine et hospitaliers (PUI). Elle rappelle les nouvelles modalités de prescription, les conduites à tenir par les prescripteurs et les pharmaciens, les mises en garde et mesures de prudence.
- Des MARRs sont notamment autorisés et diffusés actuellement sur les médicaments opioïdes suivants : Buprénorphine, Fentanyl, Methadone.
Liste de toutes les MARRs en cours : Mesures additionnelles de réduction du risque (MARR) - ANSM
Visite médicale : Comme évoqué dans le détail des réponses à la question n° 4, les visiteurs médicaux des laboratoires ont pour objectif de promouvoir le bon usage des médicaments de leur entreprise à l'aide de supports promotionnels validés, à l'occasion des visites auprès des professionnels de santé. Ils sont à cette occasion des acteurs essentiels de la pharmacovigilance, en étant tenus de relayer toutes les informations relatives aux effets indésirables et aux informations de mésusage qui seraient partagées par le professionnel de santé visité.
Information sur le médicament (notice à destination des patients, et résumé des caractéristiques du produit (RCP) à destination des prescripteurs) : Il existe des mises en garde spéciales mentionnées dans la notice et sur l'étiquetage sur les risques d'addiction et de surdosage. Cela permet notamment d'alerter directement le patient.
Le rôle des professionnels de santé est clé : au niveau du prescripteur (éducation thérapeutique du patient) et du pharmacien d'officine (alerte des patients sur les posologies).
6. Quelle est la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dans la gestion des risques liés à l'usage des opioïdes ? Quels engagements ont-ils été pris pour prévenir les abus et réduire les risques associés à leur commercialisation ?
Système de pharmacovigilance : Il est de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques de surveiller l'usage des spécialités qu'ils commercialisent. Cela passe par la tenue d'un système de pharmacovigilance :
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et, en particulier, de mettre en oeuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance (Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance (Articles L5121-22 à L5121-26) - Légifrance)
Cette responsabilité passe par :
- la surveillance des effets indésirables et des situations spéciales (collecte, enregistrement et déclaration aux autorités de santé) ;
- la détection de signal (qualitative et quantitative et dont l'augmentation anormale des ventes fait partie) ;
- le plan de gestion de risques ou PGR (qui vise à mieux caractériser, quantifier, prévenir ou minimiser les risques d'un médicament, à obtenir des usages dans les conditions réelles d'utilisation).
Un PGR est requis pour tout médicament contenant une nouvelle substance active. Il peut aussi être mis en place après la commercialisation du produit si des changements significatifs interviennent (nouvelle indication, nouveau dosage, nouvelle voie d'administration, nouveau procédé de fabrication) ou si un risque important a été identifié après la mise sur le marché.
Usage non conforme (UNC) : La surveillance de l'utilisation du médicament en vie réelle peut permettre de détecter des mésusages et usages non-conformes aux termes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Les entreprises exploitant une spécialité pharmaceutique signalent à l'ANSM ces situations dont elles ont connaissance, dès que les conclusions de l'analyse de risque sont disponibles. Les risques d'un effet indésirable augmentent d'ailleurs de 50 % lors des utilisations d'un médicament hors AMM. Les laboratoires ont l'obligation de déclarer à l'ANSM les usages non-conformes identifiés. Sont inclus dans ces signalements uniquement les usages médicamenteux non conformes intentionnels et dans un but médical, identifiés sur le territoire national.
Cela permet d'identifier des situations de mésusage et d'évaluer leur impact en termes de santé publique pour mettre en place des mesures prévenant ou réduisant ces usages.
Enquêtes de addictovigilance : Les entreprises travaillent en collaboration avec l'ANSM et les CEIP/CRPV dans le cadre des enquêtes d'addictovigilance = suivis spécifiques et renforcés de pharmacodépendance et d'addictovigilance de certains opioïdes (analyses régulières des données françaises : revue de la littérature, surveillance des cas d'abus et de dépendance, usage détourné, mésusage, analyse de cas graves...).
7. Quelles alternatives thérapeutiques non opioïdes sont actuellement développées ou recommandées pour traiter la douleur, et comment les laboratoires soutiennent-ils la recherche et l'accès à ces traitements pour limiter la dépendance et les risques associés aux opioïdes ?
La réponse du Leem à cette question appelle à une réflexion plus large : quelle politique de santé publique pour une meilleure prise en charge de la douleur ? Selon la HAS, cela touche 20 millions de français qui ressentent des douleurs chroniques.
L'ensemble des mesures qui sont réfléchies pour mieux encadrer la délivrance d'opioïdes doivent faire l'objet d'études d'impact sur la disponibilité de ces produits à l'ensemble des Français.
De façon générale, la très grande majorité des produits commercialisés pour prendre en charge la douleur sont des médicaments anciens et il existe quelques exemples de nouveaux médicaments qui arriveraient ou sont arrivés récemment sur le marché afin de lutter contre cette problématique de santé publique.
Des alternatives non opioïdes sont disponibles pour traiter la douleur telles que les topiques anesthésiques.
Par ailleurs, l'ANSM a également récemment initié un cadre de prescription compassionnelle pour un antalgique topique dans la douleur neuropathique périphérique, ceci afin de favoriser l'accès à de nouvelles alternatives thérapeutiques non opioïdes.
Aujourd'hui la stratégie recommandée est l'analgésie multimodale visant à utiliser plusieurs traitements analgésiques avec un mode d'action différent et à petites doses afin de capitaliser sur la synergie d'action et limiter les effets secondaires.
Pour les classes thérapeutiques, pour les paliers 3 il existe peu de classes thérapeutiques différentes des opioïdes : kétamine, ou protoxyde d'azote, néfopam.
De plus il est recommandé en traitement chronique d'associer les traitements médicamenteux et non médicamenteux.
Certains laboratoires s'engagent et font promotion de solutions antalgiques complémentaires non médicamenteuses telles que l'APA (activités physiques adaptée), hypnose...
Les Laboratoires travaillent également étroitement avec les Société savantes telles que ANALGESIA ou la SFETD pour soutenir la recherche dans le domaine de la douleur.
L'innovation thérapeutique est probablement la meilleure réponse possible à cette crise. L'objectif de la recherche est de trouver des options thérapeutiques qui permettent de soulager la douleur avec autant d'efficacité que les opioïdes (meilleurs antalgiques actuellement disponibles) sans engendrer de risque d'addiction, pour une tolérance au moins comparable.
Cette solution ne devrait pas conduire à contraindre la prescription pour éviter ou limiter le risque d'addiction, qui peut avoir pour conséquence potentielle une prise en charge de la douleur non optimale pour le patient.
Où en est la recherche sur ce point ?
Des traitements avec des mécanismes d'action innovants sont en cours de développement et un médicament est même d'ores et déjà commercialisés depuis début 2025 aux États-Unis. En effet, l'agence américaine du médicament, la FDA, a autorisé en janvier 2025 une nouvelle molécule antalgique pour la prise en charge des douleurs aiguës modérées à sévères chez l'adulte, revendiquant une efficacité comparable aux opioïdes mais sans le risque de dépendance et considérée comme « une étape importante de santé publique », par la FDA. En effet, il s'agit de la première nouvelle classe de médicaments contre la douleur approuvée depuis plus de 20 ans, après des années d'efforts de recherche et de tentatives de développement de médicaments similaires.
La nouveauté de cette molécule de type `bloqueur sélectif des canaux sodiques', est qu'elle cible uniquement le canal sodique `Nav1.8' des neurones responsables de la transmission du signal de douleur depuis les nerfs périphériques (donc hors du cerveau) au système nerveux central (le cerveau). Elle bloque ainsi le signal douloureux avant que celui-ci ne parvienne au cerveau. De ce fait, elle n'est pas sensée agir sur le circuit central, contrairement aux opioïdes et n'aurait donc pas de potentiel addictogène.
Ce même traitement est par ailleurs en cours de développement dans d'autres indications, notamment la douleur chronique, avec un essai clinique de phase 3 dans la neuropathie diabétique et prochainement dans les douleurs sciatiques.
D'autres molécules ciblant d'autres canaux ioniques de façon tout aussi spécifique font l'objet de travaux, par de nombreux laboratoires et pourraient être le cas échéant combinés pour un effet optimal.
Sur les conditions de prescription des opioïdes
8. Une récente décision de l'ANSM a rendu obligatoire l'utilisation d'ordonnances sécurisées pour la dispensation de tramadol et de codéine. Quels opioïdes peuvent-ils aujourd'hui être prescrits sans ordonnance sécurisée ? Estimez-vous que l'ordonnance sécurisée soit un moyen efficace pour limiter les risques liés à la dispensation d'opioïdes ?
Comme vu précédemment, deux nouvelles dispositions sont effectivement entrées en vigueur le 1er mars 2025.
- Une prescription sur ordonnance sécurisée depuis le 1er mars pour tous les médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine, qu'ils soient seuls ou associés à d'autres substances (paracétamol, ibuprofène, etc.).
- Une limitation de la durée maximale de prescription des médicaments contenant de la codéine (ou de la dihydrocodéine) à 12 semaines (3 mois).
Au-delà de cette période, une nouvelle ordonnance sécurisée sera requise pour poursuivre le traitement.
L'ordonnance sécurisée est un moyen efficace pour limiter les risques et sécuriser la prescription et la délivrance des opioïdes, comme constaté avec les paliers 3. Elle est aussi un moyen d'aider et de protéger le prescripteur devant l'insistance de certains patients. Il est trop tôt pour mesurer l'impact et l'efficacité de ces mesures applicables depuis début mars 2025, mais un suivi doit être mis en place pour les mesurer.
Aujourd'hui, au sein des antalgiques opioïdes, seules les spécialités à base de poudre d'opium peuvent être prescrites sans ordonnance sécurisée.
Cependant, tous les antalgiques opioïdes, quelle que soit leur puissance analgésique, présentent des risques d'abus et d'addiction tels que mentionnés dans le RCP des différentes molécules, les données sur la plateforme data.ansm ainsi que celles rappelées en 2022 dans les bonnes pratiques de la HAS.
9. Les entreprises exploitantes prennent-elles en compte les risques de dépendance et de mésusage associés à la consommation d'opioïdes dans le conditionnement des médicaments ? Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui bien calibré à ces risques ?
Il est important de rappeler que la détermination de la taille d'un conditionnement suit un processus impliquant les autorités de santé compétentes. En effet, dans le cadre d'une demande d'AMM, un laboratoire doit proposer des tailles de conditionnement en se basant notamment sur l'indication concernée, la posologie, et les éventuels risques liés à cette spécialité. L'AMM approuvée par l'autorité de santé inclue la taille du conditionnement qui sera mis à disposition sur le marché français.
Lorsque le médicament est commercialisé, il peut arriver que des mesures soient mises en place (à l'initiative ou non de l'autorité de santé) afin d'en garantir la bonne utilisation, comme, à titre d'exemples :
- La mise à disposition par boites de 10 ou 15 comprimés/gélules de tramadol à la suite d'une demande de l'ANSM datant de janvier 2023. Cela permet de couvrir les traitements de courte durée sans que le patient se retrouve avec un excès de médicament. Les boites de 30 comprimés existent encore pour couvrir les traitements plus longs ;
- L'apposition d'un pictogramme relatif au risque d'addiction et de surdosage dangereux pour toutes les spécialités à base de tramadol et de codéine à la demande de l'ANSM (mise en oeuvre sur le marché attendue d'ici à mars 2026) ;
Ces mesures ont fait l'objet de communications de l'ANSM et des laboratoires concernés, notamment à l'aide de DHPC auprès des professionnels de santé prescripteurs de ces spécialités.
Pour les spécialités à base de codéine en association avec du paracétamol, le nombre de comprimé est déjà restreint afin de limiter les risques de surdosage en paracétamol.
Pour les spécialités buvables à base de tramadol, et à la suite d'erreurs médicamenteuses chez l'enfant, des mesures ont été prises pour renforcer l'information aux utilisateurs sur le mode d'administration et les risques de surdosage. Deux encadrés sont notamment ajoutés sur les boites des spécialités concernées.
10. Quel regard portez-vous sur la récente décision de l'ANSM d'aligner la durée maximale de prescription de la codéine sur celle du tramadol ? Avez-vous des remarques sur les modalités de fixation des durées maximales de prescription des médicaments opioïdes ? Celles-ci vous semblent-elles proportionnées aux risques ?
D'une manière générale, le Leem et ses adhérents soutiennent toutes les mesures en faveur du bon usage des médicaments et de la protection des patients.
La réduction de la durée de prescription de la codéine devrait permettre aux patients un meilleur suivi médical et une meilleure réévaluation du traitement du fait du renouvellement de la prescription nécessaire par le médecin.
11. Quelles stratégies sont-elles mises en oeuvre pour minimiser les risques de dépendance et de mésusage des opioïdes chez les patients, tout en répondant à leurs besoins thérapeutiques ?
Il existe des mises en garde spéciales mentionnées dans la notice et sur l'étiquetage sur les risques d'addiction et de surdosage. Cela permet notamment d'alerter directement le patient.
Le rôle des professionnels de santé est clé tant au niveau du prescripteur (éducation thérapeutique du patient) que du pharmacien (alerte des patients sur les posologies).
La limitation de la durée de prescription et le pictogramme sont des mesures minimisant les risques pour le tramadol et codéine.
La mise en place d'une distribution contrôlée reste très contraignante pour les patients.
12. Estimez-vous opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opiacés afin d'avertir les patients du risque de mésusage et de dépendance associé ?
L'ajout d'une mention d'alerte sur les boites de médicaments opiacés pour alerter les patients sur les risques associés à la prise des médicaments opioïdes est en cours de déploiement pour les spécialités contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine et devrait entrer en vigueur en 2026.
Il est cependant important de rappeler que les boites des médicaments sont extrêmement chargées par les différentes mentions et pictogrammes déjà obligatoires (pictogramme grossesse, pictogramme conduite et utilisation de machine, pictogramme spécifique pour les formes buvables cf. réponse à la question n° 6.) et qu'il est important que ce dispositif soit évalué pour en estimer la pertinence et avant d'envisager sa généralisation. Un excès d'information sur les conditionnements externes pourrait conduire à une invisibilisation des messages que l'on souhaite pourtant faire passer.
Il est nécessaire de conduire une analyse sur l'impact de ce dispositif sur les abus liés au tramadol et à la codéine en France, qui devrait agir en synergie avec la mise en place de la prescription sur ordonnance sécurisée.
Car cette solution ne sera pas suffisante, notamment dans le cas où l'usage de ces médicaments opiacés est détourné et qu'ils sont obtenus à l'aide d'ordonnances falsifiées. La mention d'alerte n'aura pas d'impact sur la consommation de son utilisateur.
Il est important d'associer à ces actions d'autres acteurs :
- Autorités de tutelles, CNOM, Centre d'Addicto-vigilance (CEIP), et les autorités de police (exemple : OCLAESP)
- Avant d'être mises à disposition des patients, ces médicaments doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin, puis d'une dispensation en pharmacie. A ces deux étapes, l'ensemble des informations indispensables à la prise du traitement et aux effets secondaires devraient être données au patient, qui pourra lui-même se renseigner davantage en consultant la notice produit inclue dans la boîte.
Suivi et maîtrise de la consommation d'opioïdes
13. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Côte industries du médicament, toute information proposée sur un médicament peut être assimilée à de la promotion, tel que décrit en réponse à la question n° 3 ou doit s'intégrer dans une information sur le bon usage (type DHPC, MARR, en accord et sous réserve de validation des autorités de santé compétentes). Aussi la formation des professionnels de santé doit être organisée à un niveau holistique et doit intégrer :
- formation des professionnels de santé (médecins généralistes ou spécialistes, pédiatres, professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de la douleur et dans le suivi d'addictovigilance, dispensateurs, et tout autre professionnel de santé pouvant être confronté à la problématique) sur la prise en charge de la douleur, les stratégies médicamenteuses et leurs risques ainsi que sur les signaux d'alerte d'un surdosage/dépendance ;
- campagnes de prévention et de sensibilisation auprès du grand public (et notamment des principales populations cibles) sur le risque de consommation des opioïdes, éventuellement en complément ou en partenariat avec les actions menées par le ministère de la Santé, la CNAM, l'ANSM voire le CNOP et le CNOM.
Les médecins sont également confrontés à un manque de temps pour effectuer les évaluations des risques lors de l'initiation et sevrage des médicaments opioïdes en particulier opioïdes faibles.
14. Quel système de surveillance existe-t-il pour suivre l'usage des opioïdes en France ? Les entreprises du médicament opèrent-elles un suivi particulier de l'évolution de la consommation de ces médicaments ? Des mécanismes d'alerte existent-ils ?
Cf. réponses apportées à la question n° 6.
15. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
Il est important :
- de bien distinguer dans les réponses au questionnaire les « opioïdes dits forts » (statut de stupéfiant) des « opioïdes dits faibles » ;
- de sécuriser leur usage sans en restreindre l'accès aux patients qui en ont besoin notamment dans un contexte de vieillissement de la population où les symptômes douloureux peuvent être prépondérants (notamment liés à la pathologie cancéreuse).
Le recours aux médicaments antalgiques opioïdes a grandement contribué à l'amélioration de la prise en charge de la douleur, qui constitue une priorité de santé publique en France, avec notamment la mise en place depuis 1998 de plans d'action successifs de lutte contre la douleur.
En France, 20 millions d'adultes souffrent de douleurs chroniques et 70 % d'entre eux ne reçoivent toujours pas, en 2023, une prise en charge appropriée selon le guide « parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique » publié par la Haute Autorité de Santé et validé par le Collège le 11 janvier 2023.
Le traitement de la douleur en France est un véritable sujet de société tant il est facteur d'exclusion sociale, familiale et professionnelle. La douleur est traitée inéquitablement et dépend des moyens alloués, des spécificités territoriales, de la reconnaissance de « maladies invisibles » pourtant réputées douloureuses et de la prise en compte de populations plus vulnérables. Les Pouvoirs Publics devraient s'emparer de ce sujet de santé publique et un nouveau plan Douleur devrait être mis en place.
L'enjeu consiste donc à sécuriser au mieux l'usage des opioïdes, sans en restreindre l'accès aux patients qui en ont besoin, notamment dans un contexte de vieillissement de la population où les symptômes douloureux peuvent être prépondérants.
Bien que cela sorte du champ de votre mission, il est important de préciser que les dangers relatifs à la consommation des opioïdes sont en partie causés par un mésusage de la consommation du médicament ou un détournement de son usage, accentué par l'augmentation du trafic de médicaments en France lié aux réseaux de criminalité organisée.
Parmi les médicaments concernés par les trafics figurent notamment les médicaments qualifiés de stupéfiants (pour la majorité des cas).
À ce titre, il est important de mentionner quelques actions mises en place par le Leem et ses entreprises adhérentes :
- Au niveau national :
- le Leem est engagé via un comité de lutte contre la falsification aux côtés de la gendarmerie et les douanes ;
- le Leem est partie prenante du comité national anti-contrefaçon et travaille régulièrement sur la contrefaçon/falsification des médicaments avec son président, le député Christophe Blanchet ;
- le Leem a le statut d'Observateur au sein du Comité des Parties de la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe ;
- le Leem et l'OCLESP ont signé une déclaration de principe en 2014 pour renforcer leur lutte commune contre les médicaments falsifiés et détournés ;
- le Leem a adressé un courrier aux ministres Roland Lescure et Catherine Vautrin en avril 2024 pour les sensibiliser sur les dangers de l'évolution du trafic de médicaments en France et proposer des propositions d'action.
- Au niveau international, notamment en Afrique subsaharienne, le Leem forme (en lien avec les autorités de contrôle françaises) les autorités nationales afin de les sensibiliser aux phénomènes de falsification/contrefaçon et notamment avec les agences nationales de règlementaires pharmaceutiques africaines pour développer les différents axes de collaboration.
En conclusion
Le Leem souhaite :
- une évaluation du dispositif d'ordonnance sécurisée un an après sa mise en place, soit en mars 2026 associant l'ensemble des parties prenantes ;
- une collaboration plus étroite avec l'ANSM sur la réflexion de l'affichage et notamment sur les pictogrammes afin d'éviter l'infobésité qui risque de nuire à la compréhension des risques par le patient ;
- le lancement d'une mission d'évaluation à l'échelle nationale sur le trafic de médicaments, afin de mieux comprendre le phénomène et disposer d'éléments chiffrés pour mettre en place les actions les plus adaptées.
FÉDÉRATION ADDICTION
___________
1. Décrivez brièvement les missions des différentes structures que vous représentez, leur rôle en matière de prévention des addictions, d'accompagnement et de prise en charge des usagers.
La Fédération Addiction est le principal réseau d'associations et de professionnels de l'addictologie de France : elle représente 850 établissements et services de santé adhérents et plus de 500 adhérents individuels (professionnels du soin, de l'éducation, de la prévention, de l'accompagnement et de la réduction des risques). Nos adhérents représentent 80 % du secteur médico-social (CSAPA - centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, CAARUD - centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, établissements de soins résidentiels, HSA - haltes soins addictions) et une partie du secteur sanitaire (services hospitaliers, ELSA - équipe de liaison et de soins en addictologie). Les médecins et pharmaciens de ville adhérents à la Fédération Addiction forment par ailleurs le pôle « MGAddiction ».
2. Indiquez le nombre de personnes accueillies dans vos structures (par type de structure) chaque année ainsi que le nombre de personnes accueillies pour un motif d'usage ou de dépendance à un opiacé ou à un opioïde.
Comment ces personnes sont-elles le plus souvent orientées vers vos structures ?
Identifiez-vous des difficultés concernant l'adressage ou l'accès de consommateurs ou d'usagers d'opioïdes à vos structures ? Si oui, les quelles ?
Selon les données de l'OFDT, en 2021, 210 665 personnes ont été accueillies en CSAPA, tandis qu'en 2018, 89 602 personnes ont été reçues dans les CAARUD. (Par ailleurs, en 2019, le nombre de personnes bénéficiant d'un traitement de substitution aux opioïdes était estimé à 177 000). Les orientations vers ces structures se font principalement par le bouche-à-oreille, mais aussi via la justice, les partenaires sociaux et la médecine de ville.
Cependant, plusieurs difficultés entravent le bon fonctionnement de ces dispositifs :
• Le manque de moyens humains au sein des structures retarde l'initiation des traitements.
• La stigmatisation persistante des usagers freine leur accès aux soins et à la réduction des risques.
• Il existe un déficit de formation des acteurs de premier recours, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, sociaux ou éducatifs (médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux, etc.).
• De manière plus générale, le manque de professionnels formés dans ce champ constitue un frein important.
• Enfin, des difficultés d'articulation entre les différents niveaux du parcours de soins - médecine de ville, hôpital et structures spécialisées - compliquent l'accompagnement global des personnes.
3. Identifiez-vous des profils spécifiques de consommateurs d'opioïdes ? Les personnes accueillies dans vos structures souffrant d'un trouble de l'usage ou d'une dépendance sont-elles quasi exclusivement ou exclusivement hors cadre thérapeutique ?
Au sein des structures, plusieurs profils de consommateurs d'opioïdes peuvent être identifiés :
• Des personnes sous traitement antalgique opioïde, avec ou sans situation d'addiction avérée.
• Des patients sous traitement de substitution aux opiacés (TSO), dans un cadre thérapeutique prescrit.
• Des usagers d'opioïdes dits « de rue » (héroïne, méthadone hors prescription, sulfate de morphine, etc.), souvent en situation de grande précarité ou d'exclusion sociale.
Concernant le cadre thérapeutique, une majorité des personnes accueillies dans les structures pour un suivi en lien avec un TSO présentent une consommation hors cadre médical, même si, dans certains cas, cette consommation a débuté dans un cadre thérapeutique prescrit, notamment à la suite de douleurs chroniques ou aiguës.
4. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ?
a. Quelles sont les substances disponibles sur le marché français les plus concernées, et quels sont les principaux modes d'approvisionnement ?
Sur le marché français, les opioïdes disponibles se répartissent en deux grandes catégories :
1. Les opioïdes pharmaceutiques détournés ou revendus :
? Méthadone
? Buprénorphine
? Sulfate de morphine
? Tramadol
? Codéine
? Autres antalgiques opioïdes
? Fentanyl
? Oxycodone
? Etc.
2. Les opioïdes classés comme stupéfiants :
? Héroïne
? Opioïdes de synthèse utilisés comme adultérants, tels que les nitazènes
? Opium (de manière plus marginale)
Les modes d'approvisionnement sont variés :
• Usage détourné de prescriptions médicales, par les patients eux-mêmes ou via des tiers.
• Marché noir de rue, structuré autour de réseaux informels ou organisés.
• Achat via les réseaux sociaux, avec livraison directe, notamment dans les grandes villes.
• Utilisation du dark net, permettant l'accès à des substances difficiles à obtenir par d'autres canaux.
b. Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Les modes de mésusage des opioïdes observés sur le terrain sont multiples et parfois à haut risque. Parmi les plus fréquents, on peut citer :
• L'augmentation des doses pour compenser la tolérance développée à la substance.
• L'injection ou l'inhalation de médicaments initialement conçus pour une administration orale (comme la méthadone), ce qui expose à des complications sanitaires sévères.
• La combinaison avec d'autres substances, notamment l'alcool ou les benzodiazépines, majorant les risques de surdose et de dépression respiratoire.
Plusieurs facteurs structurels et individuels contribuent à l'émergence et à la persistance de ces mésusages :
• Des vulnérabilités économiques, sociales, psychologiques ou médicales, qui fragilisent les personnes.
• Des difficultés d'accès aux soins psychiatriques et somatiques.
• Un accès limité aux droits et à la couverture santé (comme la Sécurité sociale, la CMU ou l'AME), qui freine le recours aux dispositifs de prévention, de soin et d'accompagnement.
5. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
La France reste pour l'instant relativement épargnée par le développement massif des nouveaux opioïdes de synthèse. Cela s'explique notamment par une bonne couverture en traitements de substitution aux opioïdes (TSO) sur le territoire, ainsi que par la persistance d'un marché noir structuré autour d'opioïdes pharmaceutiques comme le sulfate de morphine.
Toutefois, des signaux préoccupants commencent à émerger. On a ainsi observé l'apparition sur le territoire de nitazènes, une classe d'opioïdes de synthèse extrêmement puissants, utilisés comme produits de coupe, et qui ont déjà provoqué plusieurs décès. Ces substances sont encore plus présentes dans d'autres pays européens, notamment au Royaume-Uni, où elles ont entraîné plusieurs dizaines de morts.
En parallèle, des surdoses liées à de l'héroïne adultérée avec des cannabinoïdes de synthèse ont également été recensées en France. Combinés à un contexte incertain autour de l'approvisionnement mondial en héroïne, ces éléments renforcent le risque d'une diffusion plus large des opioïdes de synthèse sur le territoire.
Une crise de l'ampleur de celle que connaissent les États-Unis, liée notamment à une surprescription massive d'opioïdes médicaux, ne semble pas aujourd'hui directement transposable au contexte français. Néanmoins, il serait imprudent d'exclure totalement cette hypothèse pour l'avenir. Une crise de moindre ampleur, liée à la circulation de substances hautement puissantes et peu détectables, demeure une possibilité qu'il convient d'anticiper.
6. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et de politique de réduction des risques ?
En matière de pratiques commerciales et d'encadrement des prescriptions, la France dispose d'un système de surveillance du médicament et de pharmacovigilance relativement solide, qui limite considérablement le risque de dérives commerciales conduisant à une vague massive de dépendances aux opioïdes, comme cela a pu être observé aux États-Unis.
S'agissant de la politique de réduction des risques, les expériences nord-américaines -- aux États-Unis comme au Canada -- montrent combien l'impréparation des systèmes de santé face à l'arrivée d'opioïdes de synthèse et à la montée en flèche des surdoses a été dramatique. Avant le début de la crise, les outils de réduction des risques spécifiques à la prévention des surdoses (analyse de drogues, diffusion de naloxone, formations à la gestion des surdoses, accès rapide aux TSO, dépénalisation des usages, sensibilisation des secours et des professionnels de première ligne...) étaient très peu implantés. Ces dispositifs n'ont été développés que tardivement, une fois la crise installée, et n'ont permis que d'en limiter partiellement les effets, sans parvenir à l'endiguer. Pour la France, l'un des principaux enseignements est donc la nécessité d'anticiper.
Développer dès maintenant une politique volontariste de réduction des risques, notamment axée sur la prévention des surdoses, serait un levier essentiel pour éviter qu'une crise similaire ne s'installe.
7. L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?
Le cadre réglementaire français en matière de prescription des opioïdes constitue un socle relativement protecteur face au risque de mésusage mais reste insuffisant s'il n'est pas accompagné d'une formation solide et d'une sensibilisation effective des prescripteurs.
Les données issues de l'enquête réalisée dans le cadre du livre blanc sur la naloxone montrent que seuls 8 % des médecins interrogés se disent conscients du risque de surdosage lié aux opioïdes, et seulement 20 % déclarent utiliser un outil d'évaluation du risque de mésusage. Ces chiffres témoignent d'un déficit de formation et de vigilance. Il existe également un manque de continuité et de coordination entre les prescripteurs hospitaliers (notamment les chirurgiens, qui initient souvent des prescriptions post-opératoires) et les médecins généralistes, qui assurent le suivi en ville. Ce défaut de transmission d'informations favorise les prescriptions prolongées sans réévaluation du bénéfice/risque, augmentant ainsi les risques de dépendance.
Pour garantir un meilleur équilibre entre accès aux antalgiques pour les patients qui en ont besoin et prévention des mésusages, plusieurs leviers doivent être activés :
• Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé sur les risques liés aux opioïdes, conformément aux recommandations de la HAS, notamment sur le repérage des facteurs de vulnérabilité à la dépendance ou à la surdose ;
• Améliorer l'information des patients sur les risques associés aux opioïdes prescrits et les signes de dépendance ou de surdosage ;
• Développer un discours de réduction des risques spécifique pour les personnes qui consomment déjà des drogues et sont exposées à des opioïdes sur prescription ;
• Renforcer le lien ville-hôpital par des outils de coordination, de transmission des prescriptions et de suivi des patients après une prescription initiale hospitalière ;
• Encourager l'usage d'outils standardisés d'évaluation du risque de mésusage lors de la prescription.
8. Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?
L'instauration de l'obligation d'ordonnance sécurisée pour la délivrance de tramadol et de codéine constitue une mesure pertinente de régulation. Toutefois, cette mesure ne suffit pas à elle seule à sécuriser les usages. Elle ne remplace ni la formation des prescripteurs, ni la sensibilisation des patients, qui sont des leviers tout aussi essentiels pour prévenir les risques de dépendance et de surdose.
Par ailleurs, il est important d'être attentif aux effets pervers potentiels de cette obligation : elle peut, en l'absence d'accompagnement, engendrer des réactions défensives ou d'évitement de la part des prescripteurs, notamment face à des patients perçus comme à risque. Cela pourrait conduire à un moindre accès aux antalgiques opioïdes pour les personnes qui en ont légitimement besoin, ou à une rupture dans la continuité des soins.
9. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit adapté aux risques de mésusage constatés ?
Il faut un conditionnement en fonction des besoins du patient avec des possibilités de fractionnement plus simples permettant de donner juste le nombre de dose nécessaire selon la prescription. Il est nécessaire de travailler avec l'industrie pharmaceutique et les pharmaciens pour des conditionnements souples et adaptés.
10. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
La communication actuelle autour des risques de dépendance, de mésusage et de surdose liés à la consommation d'opioïdes antalgiques reste largement insuffisante. Une part importante des patients à qui ces médicaments sont prescrits n'a pas conscience de leur potentiel addictif ni des risques graves qui peuvent en découler, en particulier lorsqu'ils sont consommés sur une longue durée ou en dehors du cadre médical initial.
Dans ce contexte, l'introduction d'un étiquetage clair et visible sur les boîtes de médicaments opioïdes, mentionnant explicitement les risques de dépendance et de mésusage, constituerait une mesure de prévention utile et accessible. Cet étiquetage permettrait de sensibiliser directement les usagers, y compris ceux peu ou pas informés des risques associés.
Par ailleurs, il serait pertinent de généraliser la prescription concomitante de naloxone, notamment pour les patients à risque élevé de surdose (traitement prolongé, antécédents d'usage problématique, polyconsommation, etc.).
Cela permettrait de renforcer la prévention des surdoses et d'installer une culture de vigilance partagée autour de l'usage des opioïdes.
11. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
La formation des professionnels de santé en matière d'opioïdes présente encore des lacunes, tant sur les usages et les effets de ces substances que sur les recommandations de bonnes pratiques.
L'addictologie demeure une discipline trop peu abordée, aussi bien dans les cursus de formation initiale que dans la formation continue des soignants, qu'il s'agisse des médecins, des pharmaciens, des infirmiers ou d'autres professionnels du soin. Pour y remédier, il conviendrait d'intégrer des modules obligatoires sur l'addictologie dans les formations initiales de toutes les professions de santé, incluant un volet spécifique sur les opioïdes (usages thérapeutiques, risques, alternatives, prévention des surdoses, etc.) et de renforcer la formation continue des professionnels en exercice, avec des contenus actualisés sur les recommandations de bonnes pratiques, les outils d'évaluation du risque de mésusage, et les stratégies de réduction des risques.
Par ailleurs, les recommandations existantes, notamment celles de la HAS, restent encore insuffisamment connues ou appliquées.
12. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Le manque de coordination entre professionnels de santé constitue un facteur majeur de risque de mésusage des opioïdes.
Lorsqu'un prescripteur n'assure pas le suivi de son patient ou ne communique pas avec le médecin traitant, cela fragilise la prise en charge et peut conduire à des prescriptions inadaptées ou à une prolongation non justifiée des traitements. De même, un patient douloureux qui ne parvient pas à accéder à une consultation spécialisée peut se retrouver dans une impasse thérapeutique, propice à un usage inapproprié ou prolongé d'opioïdes.
Le lien entre médecins généralistes et structures spécialisées comme les CSAPA est également essentiel, notamment pour ajuster au mieux les traitements de substitution aux opiacés (TSO) -- éviter à la fois la sous-prescription et le surdosage.
De nombreux exemples illustrent aujourd'hui un manque d'articulation entre la ville, l'hôpital et le médico-social, ce qui augmente mécaniquement le risque de mésusage. Il est donc nécessaire de sécuriser les parcours de soins via une meilleure coordination, mais sans instaurer de barrières qui limiteraient l'accès aux traitements -- ce qui serait contre-productif et générateur d'erreurs.
13. L'articulation des structures que vous représentez avec la médecine de ville d'une part et avec les structures hospitalières d'autre part vous paraît-elle satisfaisante ? Sinon, décrivez pourquoi. Le cas échéant, comment pourrait-elle être améliorée ?
L'articulation des structures médico-sociales avec la médecine de ville et les établissements hospitaliers demeure insuffisante et trop hétérogène selon les territoires. Plusieurs freins structurels et culturels persistent :
• Un manque de formation et de sensibilisation des professionnels de santé, en particulier en médecine de ville, sur les questions d'addictologie et de réduction des risques ;
• Une méconnaissance des missions, des compétences et des modalités d'intervention des CSAPA et CAARUD qui conduit à un recours insuffisant à ces ressources spécialisées ;
• Des canaux de communication encore trop faibles entre les secteurs hospitaliers, les structures médico-sociales et les médecins libéraux, en particulier lors des transitions de soins (sorties d'hospitalisation, relais d'un traitement de substitution, etc.).
Ces dysfonctionnements nuisent à la qualité de la prise en charge, génèrent des ruptures de parcours et augmentent les risques de mésusage, de rupture de traitement ou de non-recours aux soins. Pour y remédier, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées :
• Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé sur les dispositifs spécialisés en addictologie et les outils de réduction des risques ;
• Faciliter les échanges et la coordination interprofessionnelle, via des protocoles partagés, des outils de liaison ou des temps réguliers de concertation ;
• Développer des postes de coordination ou de liaison entre les CSAPA/CAARUD et les structures de soins de ville ou hospitalières ;
• Et valoriser des pratiques collaboratives existantes qui permettent d'éviter à la fois les ruptures de soins et les mésusages.
14. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les structures que vous représentez dans l'exécution de leurs missions ?
Les structures intervenant dans le champ de l'addictologie font face à plusieurs obstacles majeurs dans la mise en oeuvre de leurs missions :
• Un manque de moyens humains et financiers, qui limite la capacité d'accueil, retarde l'initiation des traitements et complique le suivi des usagers.
• Une insuffisante reconnaissance du travail et de l'expertise du secteur, en particulier sur le plan salarial, ce qui nuit à l'attractivité des métiers et fragilise la stabilité des équipes.
• La stigmatisation persistante des usagers de drogues, qui pèse non seulement sur les parcours de soins, mais également sur la légitimité et la reconnaissance du travail des professionnels engagés auprès de ces publics.
15. Entretenez-vous des relations avec les agences régionales de santé pour mettre en oeuvre des politiques de prévention et de réduction des risques en addictologie dans vos territoires d'implantation ?
Oui cependant cette relation est variable selon les régions : elle dépend fortement des dynamiques locales, de l'investissement des ARS sur ces sujets, et de leur niveau de connaissance des enjeux spécifiques liés à l'addictologie et à la RdR.
16. Comment évaluez-vous la politique de réduction des risques en France ? Notamment, comment évaluez-vous l'efficacité des programmes de distribution de matériel de prévention (comme les seringues stériles) dans la réduction des risques liés à l'usage d'opioïdes ?
La politique de réduction des risques (RdR) en France a connu des avancées notables ces dernières années, avec une reconnaissance institutionnelle renforcée et le développement de dispositifs innovants. Cependant, elle reste encore incomplète et inégalement déployée, ce qui limite son efficacité, en particulier dans la prévention des risques liés à l'usage d'opioïdes. Plusieurs freins majeurs persistent :
• Les délais d'accès aux traitements de substitution aux opiacés (TSO) constituent un obstacle important, notamment en cas de situation d'urgence ou de risque de surdose. Le relais en médecine de ville et en officine reste insuffisamment mobilisé, et les professionnels de premier recours manquent parfois de formation ou d'outils pour accompagner ces démarches rapidement.
• La distribution de matériel de réduction des risques, et en particulier de seringues stériles, demeure inégale selon les territoires. Si des progrès ont été faits dans certains lieux fixes ou via les automates, l'accès reste trop limité en pharmacie, ce qui freine une couverture réellement large et continue.
• Les dispositifs de réduction des risques à distance, comme l'envoi postal de matériel stérile, offrent des solutions pertinentes, notamment pour les usagers isolés ou vivant dans des zones peu couvertes. Ces dispositifs devraient être renforcés, financés durablement, et généralisés à l'échelle nationale.
• En milieu carcéral, la mise à disposition de matériel de RdR reste quasi inexistante, alors même que l'usage de drogues y est bien documenté. Cette situation va à l'encontre du principe d'équivalence des soins entre milieu libre et milieu fermé inscrit dans la loi, et constitue une rupture d'égalité en matière de santé publique.
• La distribution de naloxone, médicament essentiel pour prévenir les surdoses, et la formation à son utilisation, restent trop limitées. Il est impératif d'en élargir l'accès à l'ensemble des acteurs de premier recours : urgences, médecine générale, structures sociales, services d'hébergement, etc.
• La pair-aidance, approche efficace et complémentaire dans les démarches de RdR, reste sous-développée et trop peu reconnue dans les dispositifs institutionnels, alors qu'elle permet un lien direct, horizontal, et souvent plus engageant avec les usagers.
• Enfin, les haltes soins addictions (HSA) et les espaces de consommation à moindre risque, pourtant efficaces pour prévenir les surdoses, réduire les pratiques à risque, et faciliter l'accès aux soins, restent bien trop peu nombreux sur le territoire pour répondre aux besoins.
En résumé, si les fondations de la politique de réduction des risques sont posées, son déploiement reste encore trop partiel et inégal. Pour répondre efficacement aux enjeux posés par les opioïdes -- et plus largement par l'évolution des usages de substances --, il est nécessaire d'en faire une priorité de santé publique, en renforçant l'accessibilité, les moyens, et la coordination des dispositifs sur tout le territoire.
17. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
L'accès à la naloxone demeure aujourd'hui insuffisant en France, alors même qu'il s'agit d'un outil fondamental. Sa mise à disposition reste encore trop limitée dans le circuit de droit commun, et repose souvent sur des initiatives locales ou des projets pilotes. Il est indispensable de généraliser l'accès à la naloxone, notamment en l'intégrant pleinement dans les pratiques des professionnels de premier recours : services d'urgence, médecine générale, structures sociales, acteurs de la réduction des risques, équipes mobiles, etc.
Sa prescription systématique lors de toute délivrance d'un opioïde à visée antalgique devrait également être envisagée, comme c'est le cas dans d'autres pays confrontés à la crise des opioïdes.
Quant aux traitements de substitution aux opiacés (TSO), la France bénéficie d'une offre globalement structurée et bien implantée. Toutefois, des freins importants persistent à l'initiation rapide des traitements, en particulier en situation d'urgence ou pour les personnes en grande précarité. Les délais d'accès aux TSO peuvent être longs, faute de disponibilité ou de mobilisation suffisante des professionnels en ville. Les médecins généralistes et pharmaciens, qui sont pourtant des maillons essentiels du parcours de soin, sont encore trop peu formés ou peu accompagnés pour proposer une initiation ou un suivi des traitements.
18. Quel regard portez-vous sur l'expérimentation des haltes soins addictions dans l'accompagnement des usagers et dans la politique de réduction des risques ?
Ces structures répondent à un besoin bien identifié : celui de proposer un accueil inconditionnel, de proximité, à bas seuil, qui articule soins, accompagnement social et réduction des risques pour des publics souvent éloignés des dispositifs traditionnels.
L'ensemble des données disponibles, tant en France qu'à l'étranger, confirment l'impact positif des haltes soins addictions tant en termes de réduction des risques, d'accès à un premier accompagnement médico-social et de tranquillité des quartiers où elles sont installées. Le récent rapport IGAS-IGA sur la question souligne en outre l'importance des HSA dans une offre coordonnée de réduction des risques et de soins.
Toutefois, le fait qu'il n'existe aujourd'hui que deux HSA en France limite fortement la portée de cette réponse. Ce nombre est largement insuffisant au regard des besoins identifiés que ce soit en Île-de-France ou dans de nombreuses autres agglomérations. Les publics ciblés par les HSA -- usagers en grande précarité, souvent en errance ou sans hébergement, en rupture avec les parcours classiques de soins -- sont présents bien au-delà des seuls territoires couverts par l'expérimentation.
Il est donc indispensable de pérenniser ces dispositifs au-delà de l'expérimentation actuelle, et surtout de les développer sur l'ensemble du territoire national, en les adaptant aux contextes locaux. Cela suppose des moyens adaptés, une reconnaissance institutionnelle claire, et une inscription dans une politique cohérente de santé publique.
Au-delà des HSA, nous souhaitons souligner l'importance de l'analyse de produits à visée de réduction des risques. Celle-ci est présente très inégalement sur le territoire ce qui pose un enjeu d'inégalité en santé, notamment hors des grandes métropoles.
19. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
Il y a besoin de construire avec le ministère de la santé, les représentant du secteur sanitaire, la MILDECA, les usagers de drogues et les associations engagées dans la prévention des surdoses d'une feuille de route pour prendre la suite de la feuille de route sur la prévention des surdoses opioïdes 2018-2022.
Cette feuille de route pourra renforcer les dispositifs existants et s'inspirer des solution mises en place en Amérique du Nord pour prévenir les surdoses :
• Développement des HSA et des espaces de consommation supervisé ;
• Renforcement de l'analyse de drogues ;
• Distribution, prescription et formation à la Naloxone ;
• Accès facilité aux TSO dont injectable avec élargissement des possibilités de prescription à la médecine de ville ;
• Clarifier l'AMM concernant les sulfates de morphine ;
• Développement d'un accès à des traitements basés sur la substitution par la diacétylmorphine (forme pharmaceutique de l'héroïne) pour des usagers dont les accompagnements classiques n'ont pas fonctionné.
HALTE SOINS ADDICTIONS DE STRASBOURG
___________
Fonctionnement, missions et activités de la HSA de Strasbourg
1. Décrivez brièvement les missions de votre structure et ses spécificités par rapport à la halte soins addictions (HSA) de Paris. Indiquez les moyens qui lui sont alloués depuis le début de l'expérimentation et leur évolution.
Les missions sont celles d'une HSA avec un accent sur un accueil sanitaire où les usagers de drogues peuvent utiliser des produits, sous la supervision de professionnels qualifiés. Elle leur offre un espace convivial, permettant une consommation sécurisée des produits apportés, un temps de récupération après la consommation, des soins et des contacts individualisés avec un médecin, un infirmier, un travailleur social, un psychologue, un psychiatre. De même, y sont dispensés des conseils individualisés pour minimiser les risques liés à l'injection et aux autres pratiques de consommation.
Coût de fonctionnement annuel de 2016 à 2024, avec détail par sous-catégorie : Voir document joint à ce questionnaire
2. Parmi la file active totale, indiquez le nombre de personnes accueillies consommant des opiacés ou opioïdes.
53 % déclarent à l'inclusion avoir consommés des opioïdes dans les 30 jours précédents, par ailleurs 66 % déclarent consommer de la cocaïne.
Comment les personnes accueillies sont-elles le plus souvent orientées vers la HSA ?
70 % par le bouche à oreille entre usagers, et le reste essentiellement via des structures d'accueil et de soins (CAARUD et CSAPA).
Quelles sont selon vous les principales difficultés concernant l'adressage et l'accès de consommateurs ou d'usagers à la HSA ?
La politique actuelle de pénalisation est un frein. La prohibition, même si il n' y a pas de contrôle policiers aux abord de la salle, fait qu'un certain nombre d'usagers ne souhaitent pas se rendre visibles. Il n'est déjà pas facile de venir « à découvert » et montrer à des professionnels que l'on est en difficulté avec ses consommations, et cela l'est encore moins à partir du moment où il est possible d'être interpellé et poursuivi pour possession de drogues illicites.
La question de l'emplacement, car ce n'est pas forcément accessible à tous, il faut imaginer des possibilités d'avoir des espaces de consommation de proximité (possibilité de créer des espaces de consommations dans les CAARUD et CSAPA, en unité mobile).
3. Identifiez-vous des profils spécifiques de consommateurs d'opioïdes ? Les personnes accueillies à la HSA souffrant d'un trouble de l'usage ou d'une dépendance sont-elles quasi exclusivement ou exclusivement hors cadre thérapeutique ?
Depuis 2021 à la HSA de Strasbourg : Usagers injecteurs de fentanyl en augmentation chaque année en nombre.
Le fentanyl étant le plus utilisé 36,9 % en 2024 (29,4 % en 2023, 20,6 % en 2022), au détriment des autres substances opioïdes (sulfate de morphine, buprénorphine).
Par ailleurs un certain nombre de personnes fréquentant la HSA bénéficient d'un traitement de substitution aux opiacés en CSAPA ou en ville, en 2024 32 % déclarent avoir une prescription, mais cela reste déclaratif, les personnes étant libres ou non de donner ces informations.
4. Comment expliquez-vous que malgré une file active comparable à celle de la HSA de Paris, le taux de consommation y soit bien inférieur ?
Moins d'heures d'ouverture que la salle parisienne ; moins de densité populationnelle (10 fois moins d'habitants) ; la HSA n'est pas directement située sur une scène ouverte contrairement à celle de la gare du Nord ; les missions et l'activité de la HSA ne se limitent pas à la consommation, il y a énormément d'actions de type CAARUD : Accueil, échange de matériel, consultations, etc.., avec moins de pression que la salle parisienne nous pouvons consacrer plus de temps à l'accompagnement.
5. L'articulation de la HSA avec la médecine de ville et avec les structures hospitalières vous paraît-elle satisfaisante ? Sinon, décrivez pourquoi. Le cas échéant, comment pourrait-elle être améliorée ?
Les relations sont très bonnes mais :
Difficultés d'orientation pour accès au MSO, du fait de la saturation des dispositifs existants (manque de places CSAPA et pas assez de médecins de ville, de places en psychiatrie, etc...Envisager plus de places et de moyens à l'existant, d'ouvrir de nouveaux dispositifs permettrait un plus grand accès aux soins des personnes qui en sont le plus éloignées.
Même question concernant vos relations avec les CSAPA, les CAARUD et les consultations jeunes consommateurs. Idem plus haut
6. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre HSA dans l'exécution de ses missions ?
Le nombre d'évaluations et de rapports très conséquents, une expérimentation qui dure depuis 9 ans et qui met dans l'incertitude le dispositif, les salariés et les usagers en sont les premiers impactés par une inquiétude grandissante sur un éventuel arrêt. Le manque de mesures nouvelles et de crédits d'investissement depuis 9 ans ne nous permettent pas de faire avancer le projet, et nous mettent en difficulté sur l'existant. Un cahier des charges contraignant qu'il faudrait faire évoluer suite à notre expérience et les résultats des différentes évaluations/inspections dont nous avons fait l'objet.
Le principe même de nos actions est de s'adapter au public et aux usages qui évoluent dans le temps (exemple : autoriser l'analyse de produits au sein d'une HSA pour une meilleure connaissance des produits circulants et de leurs contenus, le partage de produits en salle, revoir l'obligation systématique de la présence infirmière en espace de consommation, ...).
Les difficultés d'orientations pour des accès aux soins et des accompagnements au long cours par saturation des différents dispositifs de soins et d'accueil.
La question de la santé mentale, avec des situations de personnes en grande difficulté ne trouvant pas de lieux pour les accompagner, de fait ils se retrouvent depuis de nombreuses années dans nos dispositifs.
7. Entretenez-vous des relations avec l'agence régionale de santé pour mettre en oeuvre votre projet et, plus largement, sur la mise en oeuvre de politiques de prévention et de réduction des risques en addictologie sur le territoire ?
Oui régulièrement, l'ARS nous soutient depuis le début pour la HSA et nos autres projets, elle nous sollicite au besoin.
8. Quel regard portez-vous sur les recommandations de l'Igas visant à inscrire les HSA dans le dispositif de veille sanitaire des produits stupéfiants ? Que peuvent apporter les HSA aux dispositifs existants ?
Nous faisons partie du dispositif SINTES pour la veille sanitaire mais il a ses limites, notamment le temps de réponse après récolte et l'envoi d'échantillons pour analyse.
Il faudrait aller plus loin et développer l'analyse in situ (dans les HSA), car c'est un lieu où nous avons directement accès aux produits circulants et consommés ; c'est un véritable observatoire des pratiques et des produits en temps réel ; de plus les personnes sont plus enclines à faire analyser leurs produits dans ce contexte car au sein d'une HSA il n'y a pas de tabou ni de risques à posséder et montrer des produits, et nous pouvons apporter une réponse rapide en cas de produits dangereux ou suspects.
Consommation d'opioïdes et risques associés
9. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes ?
a. Quelles sont les principales substances consommées et, à votre connaissance, quels sont les principaux modes d'approvisionnement ?
Utilisation du fentanyl depuis 4 ans et baisse significative des autres produits opiacés (Skénan, héroïne, buprénorphine...). Les modes d'approvisionnement sont majoritairement via des prescriptions qui sont revendues ou détournées.
b. Quels sont les principaux mésusages constatés ?
Cuisine du patch de Durogésic (fentanyl), nous avons fait des essais et il se trouve que ce mode de préparation optimise au maximum l'extraction du principe actif, donc dosage fort et grande disponibilité du principe actif. Risque accru de surdose si cette consommation n'est pas accompagnée et encadrée.
Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Héroïne peu dosée et peu disponible sur le marché, des habitudes de consommation de certains groupes de consommateurs qui ont une forte tolérance aux opiacés et qui recherchent des produits à forte teneur ; Gestion des douleurs avant de pouvoir accéder à des soins.
10. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
Risque que le marché du fentanyl actuel « prescrit » se tarissent et que faute d'accès à des soins et des traitements adaptés (MSO) les usagers se retournent vers les opioïdes de synthèse via des labos clandestins ( le fentanyl est moins cher que l'héroïne, de plus il pourrait se trouver dans les produits à l'insu des consommateurs). Un point d'attention sur l'évolution des usages dans la société et le recours aux antidouleurs en France (exemple : Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes, OFDT https://www.ofdt.fr/publication/2023/pratiques-de-prescription-et-d-usage-d-antalgiques-opioides-une-analyse
Avec deux seules HSA, la France ne pourrait pas absorber une crise majeure, et au vu du contexte de réduction budgétaire les dispositifs existants sont déjà saturés.
Encadrement de la prescription et de la délivrance d'opioïdes et organisation de l'offre de soins
11. L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?
L'encadrement actuel semble insuffisant rendant l'équilibre entre contrôle et prévention inefficient. En effet, la prévention est faible, et nous remarquons une banalisation de la prescription de certains opioïdes (Tramadol, fentanyl...).
Le contrôle actuel se fait uniquement par le département « stupéfiants » de la CPAM, ce qui apporte une action retardée face au nomadisme médical. Et la difficulté de la personne usagère à qui on a suspendu le remboursement n'est que peu prise en compte. Cela entraîne une errance de ces personnes en difficulté, avec une réponse inadaptée des dispositifs existants du fait des moyens trop faibles.
Quelques pistes d'amélioration :
- formation et information des professionnels de santé.
- information de la population générale.
- information ciblée des populations spécifiques (usagers de drogue) et enrichissement du discours RDR.
12. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
Malheureusement, pas de campagnes de communication nationales à ce sujet, qui pourtant seraient bien utiles ; le risque est pourtant une réalité en France, que ce soit via la prise d'antidouleurs ou par l'automédication, les consommations festives et à risques, et la dépendance. Quid de la naloxone pour tous ...et la formation des professionnels qui sont en contact avec ces différents publics à ce sujet. Le simple marquage ne suffit pas, il faut l'accompagner de messages de prévention, notamment via les prescripteurs.
13. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Très peu ou pas de réelles formations sur la question des produits et des addictions dans les différentes formations ; il faudrait plus de temps formation en addictologie et en Réduction des risques, notamment pour les infirmiers et les médecins.
La formation est insuffisante et manque de discours pluridisciplinaire. Les recommandations de bonnes pratiques existent et sont adaptées, mais parfois l'application sur le terrain est plus complexe.
Il faut augmenter les interventions des acteurs de terrain auprès des futurs professionnels du milieu médical et social.
Favoriser l'ouverture de terrain de stage en addictologie pour les futurs professionnels.
Favoriser les rencontres des professionnels ville/Structures spécialisées/Hôpital au sein d'un même territoire.
14. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
La question de la coordination des parcours de soins est essentielle et elle se construit dans le cadre de partenariats effectifs sur le terrain, encore faut-il que les partenaires soient en mesure d'accueillir les usagers concernés. Pour illustrer la difficulté, lorsque nous faisons attendre un usager qui a décidé d'entreprendre une démarche de soin et d'entrer dans un programme de substitution par la méthadone, pendant des semaines voire des mois. Nous passons ainsi à côté et loupons l'occasion que la personne puisse entrer dans une démarche de soins. Le risque étant un mésusage avant l'entrée « officielle » dans un programme et un parcours.
Il faut raccourcir les délais en renforçant les moyens aux CSAPA, favoriser la prescription de méthadone en ville (souhaits formulés par les acteurs depuis plus de 20 ans...), réfléchir à une meilleure prise en compte de la médecine de ville et leur place et rôle essentiels dans l'accompagnement.
Nous avons depuis 1999 mis en place un dispositif en médecine de ville appelé microstructure médicale addictions (MSMA), c'est une organisation souple, en appui au médecin traitant sur son lieu d'exercice, permettant une prise en charge pluriprofessionnelle pour les patients présentant des parcours complexes liés aux addictions. Elle est constituée d'un médecin généraliste libéral, d'un travailleur social salarié détaché par une structure médico-sociale spécialisée en addictologie et d'un psychologue. Elle est en passe d'entrer dans le droit commun sous le nom d'Equip'addict après une expérimentation Article 51.
Il s'agit d'améliorer le maillage territorial des prises en charge et l'accès à des soins de proximité pour les patients avec une ou plusieurs conduites addictives et présentant une situation complexe par une approche pluriprofessionnelle centrée autour du médecin traitant.
Il s'agit notamment de :
- faciliter l'accès des patients à une offre de prise en charge pluridisciplinaire et de proximité en soins primaires des addictions ;
- développer une offre de soin de l'addiction de proximité en soins primaires ;
- améliorer la cohérence et la coordination de la prise en charge ;
- articuler les secteurs de prise en charge des addictions et développer la transversalité intersectorielle pour fluidifier les parcours de prise en charge en addictologie.
Comment travaillez-vous, à la HSA de Strasbourg, pour organiser des parcours de prise en charge des usagers au-delà de la seule fréquentation de la salle ?
Nous avons des permanences hebdomadaires de médecins, psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux in situ qui permettent de commencer des démarches puis d'orienter et d'accompagner les personnes vers les partenaires extérieurs.
Un partenariat solide avec de multiples dispositifs de soins et sociaux, un travail étroit avec le CSAPA d'Ithaque qui a mis en place des créneaux spécifiques d'accueil, avec les autres CSAPA du territoire, avec les services hospitaliers somatiques et psychiatriques, seul frein des délais parfois longs liés à la saturation pour obtenir un rdv et une prise en charge.
Politiques de réduction des risques
15. Comment évaluez-vous la politique de réduction des risques en France ? Notamment, comment évaluez-vous l'efficacité des programmes de distribution de matériel de prévention (comme les seringues stériles) dans la réduction des risques liés à l'usage d'opioïdes ?
La France fut un temps, était plutôt en pointe en ce qui concerne la politique de réduction des risques, avec des résultats probants via notamment les programmes d'échange de seringues et la mise en place des traitements de substitution, tels que l'éradication du VIH chez les usagers de drogues, la baisse très importante des contaminations du virus de l'hépatite C. La RDR est fondée sur des résultats validés, des interventions peu coûteuses et adaptées aux pratiques, avec des effets bénéfiques sur les personnes et la santé de toutes et tous, le fait d'avoir une approche visant à proposer des alternatives au discours d'abstinence contribue grandement à entrer en contact avec les usagers et leur permet d'entreprendre des soins sans jugement ni stigmatisation. Si les logiques répressives et uniquement répressives prennent le dessus, tout ce travail s'en trouvera endigué.
Le rapport IGA/IGAS est très complet en la matière et illustre tout l'intérêt et les résultats du travail de RDR via les HSA, qui malheureusement, ne bénéficie pas d'une réelle communication publique sur les résultats et le bien-fondé de cette politique de santé publique mise en place France depuis plus de trente ans.
Ce dernier précise : « Enfin, la politique publique de réduction des risques, dont les HSA sont parties intégrantes, doit bénéficier d'un portage assumé et univoque à tous les niveaux ».
16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
L'accès aux TSO est mis en difficulté par l'augmentation des demandes et les faibles moyens des dispositifs existants, et par la disparité des moyens alloués en France. La multiplication des types d'opioïdes consommés et l'émergence de nouvelles pratiques demandent à actualiser les connaissances des professionnels (groupes de travail).
Il reste encore beaucoup de discrimination envers la population des usagers de drogues par les professionnels de santé, notamment par le manque d'information et de formation de ces derniers.
L'accès à la Naloxone reste limité, la diffusion d'information devrait être élargie.
La police, les pompiers et autres professionnels devrait être formé à l'utilisation de la Naloxone, à l'image du modèle Nord-Américain.
17. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
Déployer et renforcer les dispositifs d'analyse de drogues ; prendre exemple sur d'autres pays européens qui proposent des traitements basés sur la substitution par la diacétylmorphine (forme pharmaceutique de l'héroïne) qui s'adresse aux personnes qui souffrent d'une dépendance grave à l'héroïne ; développer les HSA et les espaces de consommation supervisés (espaces de consommations en CAARUD, CSAPA, en Unités mobiles et dans les hébergements par exemple.
AUTO SUPPORT ET RÉDUCTION DES RISQUES
PARMI LES
USAGERS DE DROGUES (ASUD)
___________
1. Décrivez brièvement les missions de l'organisme que vous représentez, son rôle en matière de prévention des addictions, d'accompagnement et de prise en charge des usagers. Indiquez également s'il bénéficie de subventions
Auto Support et réduction des risques parmi les Usagers de Drogues (ASUD) est une association créée en 1993 pour la défense des personnes qui consomment ou qui ont consommé des substances illicites. Notre but est de représenter auprès des pouvoir publics les usagers.eres de drogues(UD) - appelées aussi personnes qui utilisent des drogues (PUD) - et diffuser des messages de santé publique destinés à réduire les risques liés à l'usage de substances psychotropes. Depuis le 8 décembre 2007 ASUD « est agrée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique... » dans le cadre de la loi sur le droit des malades du 4 mars 2002 (arrêté du 06 juillet 2012).
ASUD a été soutenue financièrement depuis 1993 par différentes instances publiques et privées qui ont peu à peu cesser d'être présentes à nos côtés. En 2024 est toujours soutenue par la Direction Générale de la Santé et la Mairie de Paris (Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques).
ASUD n'a pas renouvelée ses demandes de financement en 2025.
2. Indiquez le nombre de personnes accueillies ou orientées chaque année dans vos structures, ainsi que le nombre de personnes accueillies pour un motif d'usage ou de dépendance à un opiacé ou à un opioïde.
Comment ces personnes sont-elles le plus souvent orientées vers vos structures ?
Nous n'avons pas de structures d'acceuil dans nos locaux. Notre lien avec la communauté des personnes qui consomment des drogues passe par le journal (10 000 exemplaires et 66 numéros publiés entre 1992 et 2024) et le site interactif asud.org. Nous avons conduit de nombreuses enquêtes sur le ressenti des bénéficiaires des services délivrés en addictologie dans le cadre de notre Observatoire du droits de usagers (ODU).
Notre action est identifiée comme historiquement liée à l'usage d'opioïdes et particulièrement d'héroïne.
3. Identifiez-vous des difficultés concernant l'adressage ou l'accès de consommateurs ou d'usagers d'opioïdes à des structures de repérage, de prise en charge et d'accompagnement ? Si oui, lesquelles ?
La principale difficulté relevée par 30 ans de représentation des usagers auprès des services est la stigmatisation qui pèse sur les usagers d'opioïdes qui se traduit concrètement par des refus de soins de la part des praticiens ou de délivrance de médicaments en pharmacies. Les usagers accueillis en CAARUD ou même en CSAPA sont plus souvent des personnes à faible revenu et en difficulté sociale pour lesquelles le stigmate pèse moins que la vulnérabilité économique. Par contre plus une personne est insérée et plus le stigmate de sa consommation va peser sur sa capacité à réduire les risques.
4. Identifiez-vous des profils spécifiques de consommateurs d'opioïdes ?
Depuis la fin des années 1990, la consommation d'héroïne est en recul. Elle continue d'être consommée par une minorité de personnes appartenant aux générations concernées qui n'ont pas pu ou souhaité rompre avec ce produit et qui sont souvent en traitement de substitution (méthadone ou buprénorphine) tout en consommant ponctuellement. La consommation d'opioïde concerne aussi des communautés spécifiques de personnes migrantes originaires d'Europe de l'Est qui injectent le plus souvent des traitements opioïdes anti douleurs détournés (sulfates de morphine). Les opioïdes (héroïne, sulfates de morphine, méthadone ou BHD) peuvent aussi être utilisés pour gérer la « descente » par des personnes utilisatrices de psychostimulants : cocaïne basée appelée « crack » dans les scènes ouvertes, cathinones, amphétamines...
a. Les personnes accueillies dans vos structures souffrant d'un trouble de l'usage ou d'une dépendance relèvent-elles de situations de consommation illégale ou d'un traitement antalgique initié dans un cadre thérapeutique ?
Le plus souvent ce sont des personnes qui utilisent des drogues et/ou des TSO.
b. Font-elles l'objet d'un suivi thérapeutique du fait de leurs troubles de l'usage ou de leur dépendance ?
Oui dans le cas des TSO.
5. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ?
L'histoire du « mésusage » des médicaments opioïdes est aussi vieille que l'usage d'opioïdes lui-même. Il faut rappeler que l'héroïne et la morphine doivent leur passage au marché de illicite au « mésusage » opéré par les médecins prescripteurs eux-mêmes. Plus près de nous, rappelons que l'usage massif de codéinés a accompagné la montée des consommations d'héroïne. En l'absence de substitution le Neo Codion en vente libre a servi de substitution de fait jusqu'à la mise sur le marché des TSO et même au-delà. Ensuite la buprénorphine a fait l'objet de prescriptions « détournées » qui ont débouché sur la mise sur le marché d'une Buprénorphine Haut Dosage en 1996 qui a fait elle-même ensuite l'objet d'un détournement en IV par certaines personnes usagères de drogues. Enfin les sulfates de morphines (Skénan , Moscontin) font également l'objet d'un « mésusage » ou « usage alternatif » selon le point de vue, au point d'avoir suscité un dispositif réglementaire « la circulaire Girard » qui permet encore aujourd'hui de prescrire des SDM en TSO.Rappelons également que de nombreuses personnes utilisatrices d'opioïdes ( PUDO) ont été initiées aux TSO par le « mésusage » ( achats ou consommation venus du marché illicite) pour ensuite s'intégrer à la prescription . Enfin précisons ici que les autorités sanitaires n'ont jamais évalué les conséquences du passage brutal des médicament codéinés en prescription obligatoire en juillet 2017 (nombre de passages au marché illicite, nombre de surdoses avec d'autres opioïdes etc ...). Cette mesure a suscité une vague de panique chez les PUDO à propos de laquelle ASUD avait communiqué via la commission des stupéfiants.
a. Quelles sont les substances disponibles sur le marché français les plus concernées, et quels sont les principaux modes d'approvisionnement ?
La baisse de la consommation d'héroïne est explicable par les conséquences dramatiques de l'épidémie de sida notamment dans les quartiers populaires, évènement qui a marqué cette substance d'une forte stigmatisation, y compris parmi les PUD. Le recul de l'injection comme mode de consommation principal est probablement lié aux mêmes causes. Cependant il reste une frange de consommateurs.trices, parfois insérés.es et non problématiques qui s'approvisionnent via le marché illicite des « fours » qui acceptent de vendre ce produit très décrié ( souvent en livraison à domicile ) ou bien via le dark web qui propose aussi des opioïdes de synthèse vendus sous l'appelation « hero ».
Les chiffres de l'OFDT indiquent une forte montée de la prescription de Tramadol. Il est à noter que cette population ne bascule pas nécessairement dans la dépendance de long terme à d'autres opioïdes.
b. Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Voir réponse à la question 5.
6. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
La « crise des opioïdes » aux États Unis est un phénomène complexe lié aux contextes culturels, politiques et sociaux étasuniens. Il est difficile de développer ici une analyse des ressorts spécifiques de cette catastrophe sanitaire qui reste sujet à interprétations divergentes y compris aux USA.
Pour répondre à la question, en trente ans d'exercice au sein d'ASUD j'ai été personnellement interrogé à propos de trois risques d'importation d'une crise liée à la consommation massive d'une substance illicite : le crack, la métamphétamine, et depuis une dizaine d'années l'oxycodon puis le fentanyl. Pour les deux premières crises les craintes étaient absolument comparables à celles d'aujourd'hui (catastrophes constatées outre Atlantique et premières indications d'une importation en France). La suite a montré l'importance de deux facteurs explicatifs :
A) le contexte culturel et social d'un pays est l'élément prépondérant qui structure une demande de drogues ;
B) c'est la demande et non pas l'offre de drogues qui favorise une crise.
Ces deux facteurs expliquent que la consommation de « crack » n'a jamais eu en France une amplitude comparable à celle des USA, idem pour la métamphétamine.
Cette explication vaut pour la « crise des opioïdes. Une faible appétence de la part des PUD, un système de prescription légal d'opioïdes (anti douleurs et TSO) fortement structuré et contrôlé par l'État, un système de prise en charge de la précarité sociale incomparable, autant de facteurs qui rendent peu probable l'importation d'une crise en France.
7. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis ? Quelles mesures pourraient-elles, en France, contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène et, plus largement, à circonscrire les mésusages et risques de dépendance observés ?
Faire ce que nous n'avons jamais fait : une grande campagne d'information nationale sur la réduction des risques et la prescription d'opioïdes en France. Informer le grand public de la réalité de nos succès mondiaux en matière de lutte contre le sida hépatites et en même temps sur le succès de notre politique très libérale de TSO. Libérer la parole sur ces sujets fera émerger un discours également plus fluide sur les risques d'addiction en général en particulier avec les médicaments opioïdes anti douleurs. Pour rappel jamais aucune communication grand public n'a été mise en place autour de ce succès remarquable que constitue la RDR à la française, à l'exception de l'initiative de la regrettée Nicole Maestracci, à l'époque présidente de la MILDT, à savoir la campagne intitulée « savoir plus risquez moins » en 2001.
8. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
La communication doit d'être globale et doit porter autant sur les risques que sur les bénéfices attendus de ces prescriptions. L'une des leçons de la crise US porte sur les conséquences de la restriction qui a frappé la prescription d'opioïdes à la suite des scandales à répétition qui ont ciblé l'industrie pharmaceutique et les grande firmes, restriction qui a conduit des milliers de PUDO à se reporter sur l'héroïne puis le fentanyl.
9. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ?
À ma connaissance la formation des médecins en addictologie est actuellement facultative quand les problèmes d'addiction sont aujourd'hui banalisés pour les substances licites (alcool/tabac). Idem nos contacts avec l'ordre national des pharmaciens confirment le manque de connaissance des pharmaciens d'officine sur le sujet, une ignorance qui est souvent invoquée pour ne pas délivrer de TSO ou de ne pas commander de naloxone.
10. Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?
Un impact positif mais très minoritaire. Le manque de publicité faite autour de la RDR en France et l'absence de campagne grand public non stigmatisante sur la consommation d'opioïdes et sur les addictions a cantonné la RDR à un public précaire demandeur de services sociaux en priorité. Les chiffres de la prescription de TSO indiquent que la grande majorité des PUDO ont plutôt affaire à a médecine générale (plus de 80 % des files actives pour la buprénorphine et 60 % pour la méthadone).
11. Le défaut de coordination des différents acteurs, du repérage à la prise en charge des usagers (associations, Csapa, Caarud, médecine de ville, structures hospitalières, etc.), est-il un facteur favorisant les mésusages ?
Comment cette coordination pourrait-elle être améliorée pour offrir un parcours de soins intégré, structuré et cohérent aux usagers d'opioïdes ?
12. Quel regard portez-vous sur l'expérimentation des haltes soins addictions dans l'accompagnement des usagers et dans la politique de réduction des risques ?
ASUD est à l'origine de la première salle de consommation initiée en Francs (ASUD Montpellier en 1996), puis également à l'origine du projet inter associatif qui a débouché sur la création de la Salle Jean Pierre Lhomme à Paris. Ces dispositifs étaient innovants dans les années 1980. Ils ont été mis en place chez nos voisins dans les années 1980-90 en pleine expansion de l'héroïne injectée et du sida, phénomènes identitaires pour ASUD. Aujourd'hui leur utilité reste indéniable auprès d'une population précarisée qui n'est paradoxalement pas la plus touchés par les surdoses d'opioïdes. Il serait peut-être utile d'insister sur la question sociale plutôt que sur la spécificité de l'injection quand le sujet des HSH est évoqué. Souvent le prétexte de la RDR cache une difficulté beaucoup plus large à venir en aide à des personnes souffrant de multi vulnérabilité à la fois économiques, sociale psychique avec de fréquentes co-morbidités psychiatriques. L'arbre de la HSH cache la forêt de l'indigence de l'aide consacrée à la très grande précarité.
13. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos associations dans l'exécution de leurs missions ?
ASUD meurt de ses difficultés financières jamais résolues sur le long terme malgré un soutien incontestable de l'État durant les années sida.
14. Entretenez-vous des relations avec les agences régionales de santé ou avec les collectivités territoriales pour mettre en oeuvre des politiques de prévention et de réduction des risques en addictologie dans vos territoires d'implantation ?
Non, plus depuis que l'ARS a cessé de nous financer en 2021.
15. Comment évaluez-vous la politique de réduction des risques en France ? Notamment, comment évaluez-vous l'efficacité des programmes de distribution de matériel de prévention (comme les seringues stériles) dans la réduction des risques liés à l'usage d'opioïdes ?
La politique de RDR est une réussite incontestable et incontestée. Elle est surtout évidente en matière de TSO qui place la France en tête des pays démocratiques en matière de prescription et surtout en termes d'accessibilité. À noter également que cette forte accessibilité ne se traduit pas par une montée spectaculaire des surdoses. La méthadone est effectivement le premier produit à l'origine d'une surdose mortelle mais le nombre global de ce type de décès en France reste inférieur à celui de pays voisins et comparable comme la Suisse ou le Royaume Uni.
La fourniture de matériel stérile est également un succès attesté par les chiffres de contamination en constante diminution chez les PUDO. Peut-être serait-il nécessaire de déplacer le curseur sur d'autres modes de consommation beaucoup plus fréquemment adoptés (sniff, fumée / chasse au dragon »)
16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
Les conditions d'accès à la naloxone souffrent d'un manque évident de communication en direction des PUDO mais aussi du grand public, cible potentielle d'une information claire et non anxiogène sur les opioïdes, leurs usages, leurs bénéfices et leurs risques. On peut imaginer que chaque armoire à pharmacie familiale pourrait contenir un kit naloxone au même titre qu'elle contient probablement déjà une boite d'opioïdes non utilisée.
17. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers
L'ensemble des réponses apportées à ce questionnaire peut être résumé par trois point cruciaux :
- Le vieillissement du dispositif
Le dispositif de rdr dévolu à la consommation d'opioïdes est toujours focalisé sur les grands enjeux de la pandémie du sida : matériel stérile, problèmes liés à l'injection, précarité sociale, dispositif médicosocial. Ce constat ne doit pas mettre en cause les services sociaux indispensables à la survie de populations vulnérables. Elles ne constituent plus la cible prioritaire de la lutte contre les surdoses d'opioïdes mais ce changement doit permettre de rompre avec l'hypocrisie qui masque la faiblesse des moyens alloués à la lutte contre la précarité sociale ;
- L'absence de campagne nationale grand public non stigmatisante consacrée aux opioides et aux addictions en général
Le modèle c'est la campagne « savoir plus risquez moins » de la MILDT en 2001, hélas interrompue un an plus tard pour cause de changement de majorité. La consommation d'opioïdes, ses risques, ses bénéfices thérapeutiques tant en addictologie qu'en matière de lutte contre la douleur, la nécessité de libérer la parole des PUDO mais aussi du grand public, la banalisation de la naloxone, autant de thèmes incontournables à cette initiative.
- L'absence d'informations fiables sur les surdoses et leur contexte
Améliorer le dispositif DRAM et le compléter pour mieux comprendre l'origine des surdoses de méthadone, de tramadol et des autres anti douleurs. L'hypothèse d'ASUD est la trop grande proportion de néo utilisateurs, jeunes non dépendants, consommateurs d'autres drogues mais peu informés sur les opioïdes, exactement la cible d'une grande campagne de déstigmatisation et de promotion de la RDR.
ASSOCIATION DE RÉDUCTION DES RISQUES SAFE
___________
1. Décrivez brièvement les missions de l'organisme que vous représentez, son rôle en matière de prévention des addictions, d'accompagnement et de prise en charge des usagers. Indiquez également s'il bénéficie de subventions.
L'association SAFE est une association de santé publique, qui conduit des actions d'aide humanitaires et sociales.
Depuis 35 ans, la principale activité de SAFE en France est la réduction des risques auprès des usagers de drogues et d'autres publics présentant des conduites à risques (par exemple : pratiques sexuelles, injections d'hormones, stéroïdes...).
En volume, SAFE est le plus gros distributeur national de matériel de réduction des risques.
Notre association assure notamment :
- la gestion du parc d'automates de réduction des risques (échangeurs de seringues, distributeurs de pipes à crack et distributeurs de préservatifs en région Île-de-France) ;
- le conseil et l'appui opérationnel aux communes et équipes associatives, pour le développement du parc d'automates de réduction des risques sur tout le territoire national ;
- la coordination du dispositif national de réduction des risques à distance (accueil et accompagnement des usagers par téléphone, mail, visio... + envoi postal des matériels de prévention), et la prise en charge des usagers pour les régions Île-de-France, Normandie, Corse et Outre-Mer ;
- une consultation infirmière spécialisée dans la prise en charge des plaies et complications liées aux consommations (principalement les injections) et dans la réalisation d'ateliers d'éducation à l'injection fonctionnant sur le modèle de l'éducation thérapeutique du patient ;
- la mise en oeuvre de recherche-actions pour le développement d'outils innovants en réduction des risques et des dommages ;
- le développement et la gestion du site internet www.naloxone.fr qui vise à informer et former sur la prévention et la prise en charge des surdoses d'opioïdes.
En outre, la directrice de SAFE siège :
- au groupe expert « Traitement et réduction des risques en addictologie » du Ministère de la santé ;
- au groupe expert « RDR en prison » de Sidaction.
L'association bénéficie de subventions pour ses activités de réduction des risques (environ 1 million d'euros/an) :
- de la direction générale de la santé ;
- de la MILDECA ;
- des ARS Île-de-France et Normandie ;
- de collectivités territoriales (principalement mairie de Paris et région Île-de-France).
2. Indiquez le nombre de personnes accueillies ou orientées chaque année dans vos structures, ainsi que le nombre de personnes accueillies pour un motif d'usage ou de dépendance à un opiacé ou à un opioïde.
Comment ces personnes sont-elles le plus souvent orientées vers vos structures ?
2a. Dans le cadre du dispositif de réduction des risques à distance, nous accompagnons une file active de 2 900 personnes.
Parmi elles, 30 % sont accueillies pour un motif d'usage ou de dépendance à un opiacé ou un opioïde (dans 16 % des cas opioïde non médicamenteux, dans 14 % médicament opioïde).
Ces personnes sont le plus souvent orientées par le bouche-à-oreille entre usagers ; les autres orientations se font par :
1) des professionnels (CSAPA, Caarud, médecins libéraux...) ;
2) le conseil des forums communautaires ;
3) l'information disponible en ligne et sur les réseaux sociaux ;
4) les informations disponibles sur des événements (festivals par exemple).
2b. Le dispositif d'automates d'échange de seringues d'Île-de-France touche environ 2 000 usagers différents, bien qu'il ne soit pas possible de comptabiliser précisément le nombre de bénéficiaires.
Les produits consommés varient significativement d'un territoire à l'autre/ d'un appareil à l'autre. Nous les identifions grâce à un programme d'analyse chimique des résidus de drogues présents dans les seringues usagées, mené en partenariat avec l'université Paris Saclay. Sur certains sites, les opioïdes sont quasiment absents, alors que sur d'autres (notamment en Seine St Denis, ou dans le nord-ouest parisien), les opioïdes peuvent être détectés dans 40 % voire 90 % des seringues. En moyenne, sur la campagne 2023, l'héroïne était retrouvée dans 31,72 % des seringues, la morphine dans 6,91 %, la buprénorphine dans 6,54 %, la méthadone dans 1,11 %.
Les utilisateurs des automates connaissent ces dispositifs :
1) par le bouche-à-oreille entre usagers* ;
2) par les affiches et flyers mis à disposition dans les Caarud, CSAPA, CeGIDD ;
3) par le biais de pochettes d'information mises à disposition dans les pharmacies de ville, et remises aux usagers lorsqu'ils achètent des trousses de prévention de type steribox ou kit exper' ;
4) par les sites internet, forums communautaires et réseaux sociaux.
3. Identifiez-vous des difficultés concernant l'adressage ou l'accès de consommateurs ou d'usagers d'opioïdes à des structures de repérage, de prise en charge et d'accompagnement ? Si oui, lesquelles ?
3a. La première difficulté d'accès des consommateurs aux structures de repérage et de prise en charge provient du fait que la politique de réduction des risques en France est une politique confidentielle qui ne bénéficie d'aucune promotion en population générale.
Les usagers les plus insérés ne savent pas même qu'une telle politique existe. Bon nombre d'entre eux nous disent qu'ils sont arrivés chez nous par hasard en découvrant notre existence sur internet, et qu'ils n'imaginaient même pas que des structures étaient spécialisées dans la réduction des risques. Les structures de soin sont bien sûr davantage connues. Ou elles sont recherchées au moment où les usagers sont déjà en difficulté avec leur consommation, c'est-à-dire bien tardivement par rapport aux prises de risques et leur ancrage dans une addiction.
3b. La deuxième difficulté provient de la Loi de 1970 qui fait de l'usager de drogues un délinquant. Pour cette raison, bon nombre d'usagers vont cacher le plus possible leur consommation, fuir l'échange avec le médecin ou tout autre professionnel de la réduction des risques, par peur des conséquences de dévoiler l'usage d'une substance illicite et de la stigmatisation.
Ce carcan législatif devient un carcan moral : beaucoup d'usagers se cachent le plus possible et le plus longtemps possible par peur du jugement moral, de la mise au ban de la société / d'un groupe...
3c. Une troisième difficulté est le manque de places dans les CSAPA et/ou le fait que les rotations de file active ne sont pas assez rapides. Nous pouvons être coincés pendant plusieurs semaines pour pouvoir adresser des usagers qui ont besoin d'une prise en charge. Parfois les délais peuvent être de 3 à 6 mois.
Certains vont dire qu'il n'y a pas d'urgence en addictologie et que ces délais restent raisonnables. Ce n'est pas notre point de vue et les délais d'orientation peuvent créer des catastrophes (évolution d'une consommation problématique à une addiction sévère, décès par surdosage en raison d'automédication/ suicide, rupture professionnelle, familiale...).
3d. L'éloignement des structures de RDR pour nombre d'usagers et leurs heures d'ouverture difficilement compatibles pour les usagers insérés socialement qui travaillent
4. Identifiez-vous des profils spécifiques de consommateurs d'opioïdes ?
Parmi les consommateurs d'opioïdes accompagnés à SAFE, nous enregistrons des :
- consommateurs d'héroïne de niveaux d'insertion divers ;
- consommateurs de médicaments de substitution et de médicaments opioïdes, pris à usage de drogue ;
- consommateurs de sulfate de morphine pris à usage de traitement antalgique ;
- injecteurs de médicaments antalgiques, pris de manière non conforme à l'AMM et à la prescription, parce qu'ils ne sont pas correctement soulagés de leurs douleurs.
Les usagers concernés sont de :
- toutes les tranches d'âge, de jeunes majeurs à des personnes retraitées ;
- toutes CSP.
Nous notons que des personnes consomment des opioïdes sans le savoir (non informées que leur traitement est un opioïde ou drogue coupée à l'insu de l'usager avec un opioïde).
Les personnes accueillies dans vos structures souffrant d'un trouble de l'usage ou d'une dépendance relèvent-elles de situations de consommation illégale ou d'un traitement antalgique initié dans un cadre thérapeutique ?
Les deux situations existent parmi les personnes accueillies à SAFE, même si la majorité relèvent de situations de consommation illégale. L'une pouvant découler de l'autre.
Font-elles l'objet d'un suivi thérapeutique du fait de leurs troubles de l'usage ou de leur dépendance ?
La majorité de ces personnes font l'objet d'un suivi thérapeutique mais pas toutes, pour des raisons diverses parmi lesquelles :
- elles n'en ressentent pas le besoin ou l'envie ;
- elles ont eu une expérience antérieure qui s'est mal passée et elles ne souhaitent pas retourner en CSAPA ou en cure ;
- l'accès aux soins est compliqué sur leur territoire (25 % des usagers accompagnés par SAFE habitent dans des communes de faible voire très faible densité urbaine) ;
- les modalités d'accès au traitement de substitution ne conviennent pas aux usagers : par exemple des personnes contraintes de faire 2 heures de trajet aller-retour chaque jour pour accéder à la méthadone.
- elles ont renoncé après avoir appelé plusieurs structures de leur territoire qui ont annoncé des délais d'inclusion de plusieurs mois.
5. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ?
a. Quelles sont les substances disponibles sur le marché français les plus concernées, et quels sont les principaux modes d'approvisionnement ?
Les produits opioïdes que nous relevons le plus auprès des personnes que nous accompagnons sont les suivants :
- Héroïne
- Buprénorphine haut dosage
- Sulfate de morphine / Skénan
- Tramadol /codéine
- Méthadone
- Oxycontin
- Les « purple drank » avec divers médicaments opiacés (chez les plus jeunes)
Nous voyons de manière épisodique/rare :
- Des opioïdes de synthèse (U47 700, Pinky, MT45...)
- Des fentanyloïdes (7 repérages dans les automates, une dizaine en RDR à distance) + carfentanyl
- Des nitazènes (5 repérages en RDR à distance)
À noter : des personnes achètent des produits stimulants qui sont coupés aux opioïdes à l'insu de l'acheteur. Cela amène des cas de surdoses dans des groupes pas du tout préparés à ce type de risque.
Les modes d'accès sont :
- Les dealers / vente en ligne ou livraison
- Les dealers en rue
- L'achat en pharmacie
- La pharmacie familiale
b. Quels sont les principaux mésusages constatés ?
- Consommation non conforme à la prescription (quantité)
- Consommation non conforme à la prescription (voie d'administration)
Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Ces évolutions ont été favorisées par :
- la plus grande disponibilité globale des produits, notamment avec le commerce en ligne (Internet comme catalyseur) ;
- crise des opioïdes en Amérique du Nord ;
- changement règlementaire en Chine sur l'interdiction de précurseurs des fentanyls
6. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
La France est possiblement en partie protégée d'une crise majeure des opioïdes grâce à :
1) Son niveau d'accès à la méthadone et à la buprénorphine haut dosage (BHD), plutôt bon même s'il peut encore être amélioré.
2) L'absence de promotion agressive des médicaments anti-douleurs et une certaine « régulation » du niveau des prescriptions.
3) La veille sanitaire spécifique des cas d'abus, dépendance ainsi que la surveillance des décès via l'addictovigilance.
4) Les changements réglementaires protecteurs mis en place par l'ANSM en lien avec l'addictovigilance comme les changements de règles de prescription et délivrance pour garantir le bon usage (dernier en date avec le passage sur ordonnance sécurisée du Tramadol et des codéinés).
Contrairement à l'Amérique du Nord où la crise a commencé avec la prescription des opioïdes médicamenteux, une crise des opiacés en France proviendrait vraisemblablement du marché de rue via le trafic international.
Le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse est une réalité dans le monde et il n'y a aucune raison qu'il ne touche pas la France compte-tenu des circuits de circulation des produits. La question n'est pas de savoir si ce marché va se développer en France mais quand il va se développer.
L'étude europénne ESCAPE, qui consiste en une analyse comparative des produits retrouvés dans les seringues usagées (étude dans laquelle SAFE est le représentant pour la France) montre une diversité des produits en circulation selon les pays et/ou le décalage temporel de leur présence. Si la France y détient le record des consommations de stimulants de synthèse de la famille des cathinones, nous ne sommes pas touchés par les nitazènes comme d'autres pays européens, notamment les états baltes/Royaume Unis. Mais nous ne sommes absolument pas protégés de l'arrivée de ces produits.
Plusieurs éléments nous amènent à penser que le risque d'une crise des opioïdes existe pour les années à venir :
- Si nous avons peu repéré aujourd'hui de circulation des fentanyloïdes (un point de deal dans les Yvelines en 2025), il est à noter que le terme « fentanyl » revient de plus en plus souvent dans les entretiens avec les usagers, parce qu'ils cherchent à l'expérimenter, ou en ont entendu parler, que ce soit favorablement ou défavorablement. La puissance du produit est à mettre en balance avec le risque encouru, et tous n'ont pas le même rapport au risque.
- La circulation d'héroïne coupée avec des cannabinoïdes de synthèse en Ile de France depuis 2023 montre que le mélange avec des nouveaux produits de synthèse est déjà une pratique.
- La puissance des NOS est telle qu'une faible quantité est suffisante pour la mise en place d'un trafic ; cela invisibilise de fait ces éventuels trafics.
- Dans le milieu très fermé des « sex tours », il semblerait que les fentanyloïdes et les nitazènes circulent. Nous accompagnons quelques travailleuses du sexe concernées et l'une d'elles rapporte l'accroissement de l'administration de ces produits avec leurs clients. Nous n'avons pas une file active suffisante de personnes concernées pour vérifier l'ampleur du phénomène.
- L'absence d'offre consolidée pour les patients qui ne supportent pas ou ne sont pas équilibrés par les traitements par méthadone ou par BHD : l'autorisation de prescription de sulfate de morphine (Skénan) à visée de substitution devrait être établie, au-delà de l'expérimentation autorisée en 2015 auprès d'un petit nombre de CSAPA.
- Les risques de rupture d'approvisionnement en héroïne au regard de la tension dans certains pays producteurs : si les rumeurs de baisse de la disponibilité sur certains marchés sont avérées, il est probable que les dealers et consommateurs auront recours à des opioïdes synthétiques ou médicamenteux.
- La rumeur persistante que la France ferait partie des pays ciblés par les cartels sud-américains pour diffuser le fentanyl et ses dérivés.
7. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis ? Quelles mesures pourraient-elles, en France, contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène et, plus largement, à circonscrire les mésusages et risques de dépendance observés ?
Des mesures simples auprès des médecins et pharmaciens peuvent contribuer à prévenir ou freiner les mésusages et risques de dépendance :
- Former les médecins sur la douleur et sa prise en charge, et la prescription des antalgiques opioïdes ;
- Coordonner la prise en charge de la douleur en équipe pluridisciplinaire ;
- Faciliter l'accès aux consultations spécifiques sur la douleur et résoudre le renvoi d'ascenseur entre les équipes addictologie - psychiatrie - algologues quand un patient se présente avec un usage problématique d'opioïde, chacun renvoyant le patient vers un autre au motif qu'il ne relève pas de sa spécialité, ou qu'il doit « d'abord avoir réglé ses autres problèmes » avant d'être pris en charge ;
- Limiter la durée des prescriptions d'opioïdes pour renouveler les évaluations ;
- Accorder aux médecins et pharmaciens le financement d'un temps dédié à l'accompagnement de la prescription et de la délivrance du médicament opioïde, pour expliquer les risques associés et la bonne observance nécessaire du traitement ; assurer en fait une éducation thérapeutique du patient comme cela est fait pour d'autres traitements.
- Déstigmatiser la pharmacodépendance dans la population médicale et soignante afin d'améliorer le dialogue entre patients et soignants.
- Déstigmatiser la pharmacodépendance dans la population générale en informant.
Dans le champ de la réduction des risques :
- Les programmes d'analyse de produits devraient être renforcés et plus accessibles, afin d'anticiper les consommations accidentelles de produits coupés aux opioïdes synthétiques, fentanyl, nitazènes... (en s'assurant que les résultats sont communiqués à la veille sanitaire afin de réaliser les alertes au plus tôt).
- La fourniture de bandelettes de détection du fentanyl pourrait être développée (c'est déjà une demande de nos usagers à laquelle nous ne répondons pas pour le moment faute de moyens financiers pour acheter ces outils).
- La parole des usagers devrait être davantage recueillie pour être au plus proche de leur besoin et qu'ils deviennent également des lanceurs d'alerte (empowerment sur cette thématique).
- Des mesures progressistes pourraient être mise en oeuvre, en particulier des programmes de prescription d'héroïne médicale ; idéalement, des HSA assurant la prescription et la possibilité de prise sur place de diacétylmorphine permettraient de réduire le recours aux opioïdes de rue et d'assurer un bon équilibrage des patients les plus en difficulté.
- Diversifier l'offre de MSO : MSO par voie IV, MSO à libération prolongée...
L'expérience nord-américaine devrait aussi être une source d'inspiration pour :
- assurer une communication grand public ;
- renforcer l'enseignement des gestes qui sauvent ;
- diversifier les modalités de diffusion de la naloxone.
8. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
Nous estimons que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes est très insuffisante. Cet avis est étayé par les études que nous avons pu mener auprès des professionnels pharmaciens, médecins, et acteurs de l'addictologie et de la réduction des risques, qui considèrent tous que l'information est insuffisante tant au niveau collectif qu'individuel.
Ainsi, 20 % des pharmaciens que nous avons interrogé considèrent que la lutte contre les surdoses d'opioïdes ne peut progresser qu'en menant une action d'information des patients :
- En population générale : avec une campagne massive par presse écrite et télévisée et sur les réseaux sociaux, mais aussi par des brochures qui pourraient être créées par santé publique France, les centres d'addictovigilance, le cespharm ; la sensibilisation est à mener au niveau de la population générale car beaucoup d'individus seront confrontés à une prise d'opioïdes à un moment de leur vie.
- Au niveau individuel : si l'information collective est indispensable, elle ne suffit pas. Elle doit être complétée par un message personnalisé au moment où le patient reçoit sa prescription et/ou son traitement opioïde. Ce point est tout à fait fondamental car nous avons pu constater, de manière expérientielle, que de nombreux patients ne sont pas informés que le médicament qui leur est prescrit est un opioïde ; ils ne peuvent donc faire le lien d'emblée entre leur traitement et une campagne d'information générale. Prévoir une consultation de sevrage ou de déprescription à la mise en place d'un traitement opiacé pourrait permettre d'aborder cela avec le patient de façon systématique et permettrait une prise en charge au plus tôt si celui-ci s'est installé.
Du côté des acteurs de l'addictologie et de la réduction des risques, près d'un tiers des professionnels soulignent le manque d'information des usagers, des patients et du grand public sur les surdoses d'opioïdes et la naloxone. Une campagne de communication est nécessaire. Le manque de sensibilisation globale de la population et donc de conscience collective empêchent la mise en oeuvre de geste réflexes.
Nous sommes favorables à un étiquetage adapté sur les boîtes de médicaments.
Nous soulignons que ces deux sujets (communication en population générale et étiquetage sur les boîtes de médicaments) doivent être traités de sorte à ne pas nuire à l'observance des traitements. Une campagne ou des marquages trop anxiogènes pourraient entraîner une moindre observance du traitement, voire un refus de prise du médicament, avec des conséquences négatives sur la qualité de vie et la santé globale du patient.
9. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ?
Les carences existent et nous avons pu les mettre en évidence dans le cadre des enquêtes préalables à la rédaction du livre blanc du groupe inter-associatif « Réflexe Naloxone ». Nous présentons des extraits des résultats qui illustrent ce déficit de formation et la demande des professionnels pour monter en compétences :
Du côté des pharmaciens :
a. Dans le cadre du remplissage du questionnaire, il a été porté à la connaissance des répondants l'information suivante :
« En 2017, 2 586 hospitalisations et 207 décès étaient liés à une intoxication accidentelle aux opioïdes. 44 % des décès en lien direct avec des antalgiques sont imputables au tramadol. Les opioïdes sont utilisés dans 3 à 5 % des tentatives de suicide. Dans le dernier rapport de l'ANSES 2024 sur les expositions accidentelles à des toxiques chez les enfants : ce sont les médicaments qui sont les plus fréquemment en cause dans les cas graves avec en premier la classe des médicaments du système nerveux (comme pour tous les cas de cette étude) qui à eux seuls représentent 57 % des cas graves dus aux médicaments. Parmi les médicaments du système nerveux, ce sont les analgésiques opioïdes, les antipsychotiques et les antiépileptiques qui sont le plus fréquemment en cause. »
Le partage de cette information modifie la perception du risque de surdosage des antalgiques opioïdes chez 76 % des pharmaciens qui disent réaliser que le risque est plus important qu'ils ne le croyaient.
b. 77 % des pharmaciens indiquent ne pas connaître d'outils permettant d'évaluer le risque de mésusage chez les patients traités par antalgiques opioïdes.
Pour les autres, 19 % connaissent le questionnaire POMI tandis que 4 % évaluent le risque de mésusage lors d'un entretien d'accompagnement individuel.
c. 97 % des pharmaciens interrogés déclarent qu'ils connaissaient la molécule naloxone avant de répondre à ce questionnaire.
Pour autant, quand on leur demande quels noms de spécialités de naloxone ils connaissent, 22 % ne savent citer aucune marque. Les spécialités connues par 58 % des pharmaciens sont les seules formes hospitalières (naloxone générique et Narcan) ; 42 % connaissent les formes à emporter chez soi.
d. 21 % des pharmaciens de ne savent pas où et comment se procurer la naloxone.
Du côté des médecins :
a. Après qu'on a rappelé à ces médecins qu'en 2017, 2 586 hospitaliers et 207 décès étaient liés à une intoxication accidentelle par opioïde, 38 % d'entre eux indiquent que le risque de surdosage est plus important qu'ils ne le pensaient.
b. Parmi ceux qui ont répondu à la question, 30 % des médecins indiquent qu'ils n'ont jamais été formés sur la prise en charge de la douleur et 37 % qu'ils n'ont pas eu de formation en dehors de leur formation initiale. Seuls un tiers des médecins ont bénéficié d'un DESC, d'un DU ou d'une capacité spécifique.
c. Seuls 1/3 des médecins interrogés utilisent un questionnaire permettant d'évaluer le risque de mésusage chez les patients traités par antalgiques opioïdes, 20 % utilisant le questionnaire ORT et 14 % le questionnaire POMI.
d. Si la quasi-totalité connaissent les spécialités hospitalières de naloxone, à peine la moitié connaissance une forme de naloxone à prendre avec soi (« take home naloxone »).
Du côté des acteurs de l'addictologie et de la réduction des risques
De nombreuses difficultés de formation sont mises en exergue :
- Près d'un quart des professionnels ressentent un déficit de formation, notamment les « nouveaux professionnels », sachant que le turn-over est important. Beaucoup ne se disent pas assez formés pour proposer et distribuer la naloxone.
- Les manques de formation et de sensibilisation sur le sujet se reflètent dans une vision négative de la posture de certains professionnels, qui montrent peu d'intérêt et de motivation, et freinent l'accès à la naloxone en raison de stéréotypes et préjugés sur les consommateurs d'opioïdes. Les équipes se plaignent aussi de la désorganisation de l'accès à la naloxone par manque de clarté des textes réglementaires, évoquant ainsi la réticence de professionnels de santé (médecins) vis-à-vis d'une distribution des kits par des professionnels non médicaux (infirmiers, éducateurs...), du manque de connaissance et de compréhension de la démarche de réduction des risques, de la difficulté pour le corps médical de déléguer aux autres professionnels l'accompagnement de la prévention des surdoses. À l'inverse, les soignants soulignent que les non-soignants sont réticents à distribuer car ils ne se sentent pas compétents, pas suffisamment formés et se déchargent d'autant plus volontiers de cette tâche quand il y a un professionnel de santé sur place.
Certains disent que faute de formation, ils rencontrent des difficultés pour trouver les ressorts pour échanger sur les risques opioïdes avec les usagers, les motiver et leur faire accepter la naloxone : ils évoquent ainsi « une culture de l'évitement », « la peur de faire plus de mal que de bien », « la peur du médicament ».
Un autre frein identifié, lié au manque de formation, est la minoration des risques par les professionnels, qui ont pour idée reçue que les surdoses ne concernent que les injecteurs / « les junkies » et qui n'évaluent pas les pratiques réelles des patients traités par médicaments de substitution aux opioïdes.
10. Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?
Les CSAPA et Caarud (et leurs précurseurs les « CSST » et « boutiques ») ont depuis 30 ans un impact majeur dans la prise en charge des usagers d'opioïdes :
- Ils ont réduit l'incidence et la prévalence du VIH.
- Ils ont réduit l'incidence et la prévalence de nombreuses autres infections et complications dont le VHC et les candidoses.
- Ils ont réduit la mortalité par surdose.
- Grâce à la substitution, ils ont amélioré la qualité de vie de milliers de personnes, au niveau médical, familial, professionnel, social.
- Ils ont fait quasiment disparaître les scènes de violences qui étaient enregistrées dans les pharmacies dans les années 80 et 90, tant pour l'accès aux matériels d'injection qu'aux médicaments opioïdes en raison des crises de manque.
- Néanmoins, ces structures concernent le plus souvent des usages de substances illicites et ne sont pas toujours perçues comme ressource pour les près de 2 millions de patients présentant un trouble de l''usage d'opiacés médicamenteux (tramadol, codéine ou opiacés de pallier 3) bien que certains CSAPA aient mis en place des consultations spécifiques sur la pharmacodépendance médicamenteuse.
11. Le défaut de coordination des différents acteurs, du repérage à la prise en charge des usagers (associations, Csapa, Caarud, médecine de ville, structures hospitalières, etc.), est-il un facteur favorisant les mésusages ?
Comment cette coordination pourrait-elle être améliorée pour offrir un parcours de soins intégré, structuré et cohérent aux usagers d'opioïdes ?
Le défaut de coordination est effectivement l'un des facteurs favorisant les mésusages. Parmi les sujets remontés par nos bénéficiaires, nous notons par exemple :
- Délai d'attente trop longs avant d'entrée en soins ;
- Absence de relais méthadone lors de vacances, déménagements...
- Messages contradictoires entre les établissements ;
- Entrées en sevrage mal préparées ou vécues comme des contraintes ;
- Absence de prise en compte des spécificités prévues lors de l'orientation (par exemple sevrage non réalisé car le patient avait besoin d'une prise en charge de son chien et au dernier moment cela n'a plus été possible) ;
- Difficultés pour orienter vers des obstétriciens accompagnant les femmes enceintes consommatrices d'opioïdes.
Dans ces diverses situations, les usagers ont pu être amenés à cacher des consommations, acheter des produits dans la rue pour compléter les traitements, etc.
La coordination pourrait être améliorée avec :
- des professionnels ayant du temps de travail dédié pour assurer cette coordination ;
- des organisations simples de relais pendant les périodes de congés ou d'absence de médecins dans certains CSAPA ;
- des personnes ressources qui pourraient accompagner les médecins de ville peu expérimentés dans leurs prises en charge et pour leurs prescriptions ;
- des systèmes d'orientation simplifiés. Un usager qui a été suivi en CAARUD ou autre équipe de RDR doit souvent refaire tout un parcours d'inclusion en rencontrant plusieurs professionnels au CSAPA ou à l'hôpital. Ce parcours est long, souvent fastidieux, et donne l'impression que l'accès aux soins et au traitement se mérite, après avoir démontré sa motivation et sa compliance.
12. Quel regard portez-vous sur l'expérimentation des haltes soins addictions dans l'accompagnement des usagers et dans la politique de réduction des risques ?
SAFE a fait partie des associations qui ont demandé l'ouverture de salles de consommations à moindres risques en France, dès 2009 dans le cadre du « collectif du 19 mai ».
En effet, notre association est présente sur le territoire de Paris Gare du nord depuis le début des années 2000 pour la gestion des automates d'échange de seringues. Nous avons observé la scène ouverte qui s'est développée au fil des années, en particulier :
- le deal et la consommation à ciel ouvert ;
- la présence des dealers et consommateurs de drogues sur un territoire élargi ;
- l'insalubrité publique avec risque infectieux pour tous, UD comme riverains et autres personnes fréquentant le territoire ;
- l'insécurité ressentie et/ou avérée, renforcé par le côté « inconnu » de personnes qui arrivent par la gare pour fréquenter la scène ;
- l'incapacité des acteurs associatifs à subvenir aux besoins des usagers ni en termes de RDR ni d'accès aux soins, l'incapacité à apaiser les tensions.
Nous avons donc voulu qu'une nouvelle offre de réduction des risques puisse être offerte sur le territoire, au bénéfice de tous : riverains, usagers de drogues, professionnels.
Les résultats de la HSA Gaia Paris, nous les constatons au quotidien sur le terrain.
SUR LE PLAN QUANTITATIF
Nous constatons :
- la diminution significative du nombre de seringues distribuées par automates secteur Gare du Nord, depuis l'ouverture de la salle de consommation (seul secteur de Paris où une baisse est constatée dans la durée) qui traduit une meilleure réponse aux besoins des usagers, notamment des plus précarisés d'entre eux. Nous sommes passés de 174 517 seringues diffusées secteur Gare du Nord en 2017 à 91 926 seringues diffusées en 2023.
En parallèle, nous notons la stagnation de la distribution de pipes à crack par automates, logique puisque la SCMR n'est pas une salle d'inhalation (25 000 pipes par an, ce qui est le maximum de la capacité de distribution des appareils).
Nous constatons aussi la diminution très importante du nombre de contacts avec les usagers dans la rue depuis l'ouverture de la HSA, surtout depuis l'élargissement des horaires de GAIA. Entre 2017 et 2023, nous sommes passés de 5 612 contacts par an à environ 400 contacts par an. La scène ouverte que nous avons connue dans les années 2000 à 2010 a quasiment disparu, nous ne voyons que très peu d'usagers dehors.
SUR LE PLAN QUALITATIF
Nous constatons :
- la pacification de l'ambiance sur le terrain pour les professionnels de SAFE la très grande majorité du temps (réduction des agressions et actes d'incivilité) : en 2016/2017, nous devions réaliser des tournées à 2 professionnels sur le secteur gare du nord compte-tenu des tensions, ce n'est désormais plus un sujet pour l'équipe de SAFE, les intervenants travaillent seuls sur ce territoire comme sur le reste de la région ;
- la réduction des problèmes de salubrité publique, étayée par l'arrêt des sollicitations des sociétés de parking EFFIA / VINCI, de la société DECAUX (sanisettes) et de la SNCF pour récupérer les DASRI dans leurs espaces ; cela s'accompagne de la quasi disparition des ramassages de matériel usagé par SAFE autour des machines ;
- l'amélioration du ressenti des habitants du quartier, étayée par l'arrêt des plaintes des riverains sur les gênes rencontrées autour des automates ;
- la réduction des demandes de la SNCF pour intervenir auprès de leurs agents : jusqu'à l'ouverture de la HSA, nous devions assurer des temps de sensibilisation des agents pour leur parler des consommations de drogues, de la réduction des risques, et mener des actions de réassurance. Tout cela a complètement disparu.
Les usagers qui fréquentent la salle et que nous accompagnons aussi vont indéniablement mieux sur le plan sanitaire et social.
L'expérimentation de HSA en France n'a fait que redémontrer s'il en était besoin ce qui était déjà démontré par la littérature internationale, à savoir le bénéfice de ce type de dispositif pour la santé publique et la tranquillité publique.
Les HSA sont une composante essentielle de la politique de réduction des risques et devraient être davantage déployées en France (incluant un renforcement à Paris). Le sujet est désormais de les déployer là où il y a des scènes ouvertes de consommation et non là où on juge que ce serait acceptable, sans lien avec la réalité des consommations sur un territoire.
Le nombre de surdose rapporté en addictovigilance par le Caarud d'Aulnay-sous-Bois illustre bien cette nécessité.
13. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos associations dans l'exécution de leurs missions ?
- La première difficulté rencontrée par SAFE est l'insuffisance de financements : l'équipe est au maximum de sa capacité d'accompagnement faute de pouvoir recruter du personnel supplémentaire, mais aussi sous-dotée pour pouvoir assumer le coût de tous les matériels de prévention nécessaire.
- Cela conduit à la situation absurde de ne pas communiquer davantage sur l'offre de services pour freiner l'arrivée de nouveaux publics et ne pas plonger l'association dans un déficit budgétaire que nous ne pourrions absorber.
- Malgré cela, la file active augmente chaque année et nous nous demandons comment nous allons réussir à absorber cette activité. Jusqu'à maintenant nous n'avons jamais refusé d'inclusion ni restreint les matériels et services, mais cela devient difficilement tenable.
- La seconde difficulté est le cadre règlementaire qui contraint en permanence à chercher des solutions pour résoudre des problèmes qui devraient être levés par les textes encadrant la réduction des risques. À titre d'exemples :
- les associations de réduction des risques ne peuvent pas acheter l'eau PPI nécessaire à la préparation pour injection utilisée par l'usager car c'est un médicament. Il faut donc trouver un médecin prescripteur pour acheter ces doses ou payer les services d'un pharmacien ;
- l'envoi postal de naloxone pour les usagers les plus éloignés de la prévention et des lieux d'accueil a nécessité un montage avec une pharmacie de ville, car l'envoi postal de médicaments est réservé aux seuls pharmaciens de ville. Cette contrainte règlementaire entraîne une complexification du dispositif, des surcoûts de ressources humaines pour nous, un coût pour la prestation du pharmacien... Il n'y a aucune valeur ajoutée pour les bénéficiaires mais une majoration de quasiment 50 % du coût du dispositif !
- Les actions innovantes sont freinées par la difficulté à obtenir des autorisations d'expérimentation. Ainsi, dans le contexte d'accroissement des surdoses, nous souhaitons expérimenter des distributeurs de naloxone, comme cela existe déjà en Amérique du Nord ou en Australie. Le dossier est à l'arrêt depuis 18 mois, faute d'espaces de dialogue et de concertation pour pouvoir aboutir. Cet outil permettrait notamment de mettre en évidence la demande des usagers. L'évolution des chiffres de distribution formerait une surveillance de la demande, reflet de l'intérêt par les usagers, voire de l'utilisation de la naloxone.
- Une troisième difficulté est le durcissement des relations avec les collectivités territoriales, de moins en moins enclines à accepter les actions de RDR sur leurs territoires, en particulier la pose des distributeurs de matériels de prévention.
14. Entretenez-vous des relations avec les agences régionales de santé ou avec les collectivités territoriales pour mettre en oeuvre des politiques de prévention et de réduction des risques en addictologie dans vos territoires d'implantation ?
Oui, l'association SAFE entretient de longue date des relations avec les agences régionales de santé (ARS) et les collectivités territoriales pour mettre en oeuvre les politiques de prévention et de réduction des risques. C'est d'ailleurs un préalable indispensable à la réussite des actions et parfois même une obligation pour mettre en place certains projets, comme le déploiement des automates de réduction des risques sur la voie publique.
Nous soulignons :
- les difficultés croissantes pour convaincre les mairies d'accepter la pose d'automates distributeurs de matériels de prévention sur les territoires ;
- le désengagement financier de nombreuses communes et départements sur les sujets de réduction des risques, au motif que ce n'est plus leur mandat ;
- l'iniquité territoriale d'accès à la réduction des risques et la disparité des services accessibles, compte-tenu de l'autonomie des ARS ;
- les difficultés posées par la fongibilité de certaines lignes de financement et la réaffectation de budgets sur des lignes qui n'étaient pas celles initialement prévues ; ainsi des budgets dévolus à la RDR à distance ont été réaffectés dans des budgets généraux Caarud, des budgets naloxone également...
15. Comment évaluez-vous la politique de réduction des risques en France ? Notamment, comment évaluez-vous l'efficacité des programmes de distribution de matériel de prévention (comme les seringues stériles) dans la réduction des risques liés à l'usage d'opioïdes ?
15.1. Notre évaluation de la politique de réduction des risques en France
La politique de réduction des risques (RDR) en France s'est considérablement développée depuis son inscription tardive dans la Loi en 2004 ; nous pouvons évaluer la politique actuelle à la lumière des évolutions des 10 dernières années. Cette évaluation doit être menée en prenant en considération l'augmentation des addictions et des problèmes de santé physique et psychique liée à la pandémie de COVID-19.
Nous pouvons d'abord souligner les nombreuses avancées de la RDR des années 2010-2020, avancées qui ont été construites grâce à une forte coopération entre les services de l'État, les professionnels de la réduction des risques, les représentants des usagers, et des équipes de recherche.
Les professionnels de la RDR peuvent s'appuyer sur les réels progrès de la dernière décennie qui a vu arriver :
- les Salles de Consommation à Moindres Risques ;
- l'Analyse de Produits ;
- l'AERLI c'est-à-dire l'accompagnement et l'éducation aux risques liés à l'injection ;
- la possibilité pour les usagers de drogues d'accéder au traitement du VHC sans la contrainte d'arrêt des consommations ;
- et puis bien sûr l'accès à la PrEP, si importante pour nos usagers avec le développement de la pratique du chemsex.
Nous sommes aussi satisfaits de tous les outils et dispositifs de RDR qui permettent désormais d'accompagner les usagers à domicile :
- la possibilité d'avoir de la naloxone chez soi, avec la mise sur le marché successive des spécialités Nalscue, Prenoxad et Nyxoïd puis Ventizolve ;
- le développement du dispositif de RDR à distance et de toutes les modalités de e-RDR, c'est-à-dire les informations en ligne, les forums, les lignes d'écoute pour les conseils et la réassurance : c'est ce qui nous permet de proposer par téléphone, par mail, par visio les conseils, l'accompagnement, l'éducation à l'injection, les dépistages, l'accès à la naloxone, l'analyse de produits et pour ce qui concerne la RDR à distance l'envoi de matériels.
Nous pouvons nous réjouir :
- de l'amélioration progressive des matériels de réduction des risques disponibles, avec par exemple la mise sur le marché des kits exper' qui permettent de faire des progrès significatifs en matière de lutte contre les contaminations virales, bactériennes et fongiques ;
- des travaux en cours pour remettre en état le parc national d'automates distributeurs de kits d'injection qui était vieillissant et dysfonctionnel. Sa modernisation, son adaptation aux kits exper' et le déploiement des premiers distributeurs de pipes à crack sont des avancées très positives.
Ces éléments positifs doivent cependant être mis en regard de nombreuses difficultés, qui relèvent à la fois de problèmes structurels persistants et de retards dans l'adaptation aux changements de publics et de pratiques.
Il est hélas encore besoin de rappeler l'inadaptation du cadre réglementaire, avec la Loi de 1970 complètement obsolète. Mais même dans ce carcan, des choses pourraient évoluer pour résoudre des situations inacceptables :
- la RDR en milieu carcéral est toujours réduite à peau de chagrin ; l'échange de seringues en prison n'y existe que dans de rares centres pénitentiaires, par des volontés individuelles de médecins qui prennent personnellement le risque de mettre en oeuvre ces programmes.
- neuf ans après l'extension de la loi santé, le décret d'application n'est toujours pas publié et la loi n'est toujours pas respectée ;
- les équipes mobiles des Caarud ou les véhicules des intervenants de SAFE en charge de la gestion des automates de RDR sont parfois obligées de partir de leurs emplacements autorisés par les ARS et les communes, sous contrainte de la police ;
- nous voyons encore les forces de l'ordre mettre les seringues aux caniveaux et détruire les pipes à crack.
- Nous ne comprenons pas les tergiversations pour permettre aux équipes de premiers secours, police, pompiers, secouristes, de disposer de la naloxone.
Les questions réglementaires continuent de nous alerter quand on se penche sur les matériels de consommation à moindres risques disponibles pour les usagers. La récente étude PROPICE qui était focalisée sur les matériels d'inhalation du crack a permis de mettre en évidence l'absence de normes pour une grande partie du matériel distribué : à l'exception des matériels d'injection et d'une partie des outils de prévention en matière de santé sexuelle qui sont normés, tout le reste est fabriqué et distribué sans cadre réglementaire et sans matériovigilance, ce qui pose de vraies questions sur les garanties d'innocuité de ces matériels pour nos bénéficiaires.
En matière réglementaire encore, on peut s'étonner de l'absence de diplôme ou de formation qualifiante en réduction des risques, et d'une forme d'inadaptation des formations à la pratique réelle de terrain. On peut se déclarer experts en RDR, en chemsex ou encore en accompagnement à l'injection, sans qu'aucune formation scientifiquement validée ne soit nécessaire. Au regard de l'état et du déficit d'information d'une partie des usagers que nous accompagnons et qui ont déjà bénéficié d'accompagnement par des professionnels de la réduction des risques, nous pouvons nous interroger sur les risques de continuer à travailler ainsi. Nous appelons donc de nos voeux la création de formations qualifiantes mais aussi la mise en place effective des masters IPA avec la mention addictologie, annoncés comme priorité dans le cadre du Ségur de la Santé il y a 5 ans, et qui ne sont toujours pas d'actualité.
Les difficultés structurelles ne sont pas seulement liées aux questions règlementaires et de cadre. Elles sont aussi liées aux manques de ressources, manques de lieux et de personnels. Il est préoccupant que la France ne compte toujours que 2 HSA et qu'il n'y ait toujours pas de salle de consommation pour les fumeurs de crack, alors que cela serait bénéfique tant en termes de santé publique que de sécurisation et pacification des espaces urbains.
On peut également s'interroger sur le faible niveau d'accès aux seringues, comme cela a été démontrée par plusieurs expertises : celle de l'INSERM d'abord indiquant que la distribution correspond à ¼ à ½ seringue par usager et par jour, puis celle de de l'IGAS aboutissant à la conclusion que la réduction des risques couvre environ 50 % des besoins réels en seringues.
Les volets santé et social de la politique de réduction des risques française pâtissent des campagnes de communication gouvernementales qui semblent émaner systématiquement du ministère de l'intérieur. Ces campagnes qui culpabilisent et stigmatisent les consommateurs ne font que les éloigner de la prévention et du soin : car comment parler de sa consommation à un professionnel quand on est accusé de « nourrir des réseaux et être complice de fait », « être responsable d'assassinats et de financement du terrorisme » ?
La politique de réduction des risques mériterait au contraire une campagne nationale orientée santé, qui parle ouvertement de consommation de drogues, de réduction des risques, de possibilité d'accéder anonymement et gratuitement aux Caarud et CSAPA. Le déficit d'information du grand public et les faibles moyens de communication des acteurs de la RDR font que nous sommes toujours en retard pour contacter et accompagner les nouveaux publics : les arrivées sont tardives, les personnes présentant des dommages qui auraient pu être en grande partie évités.
Le déficit de formation initiale et continue des intervenants et le manque d'investissement sur l'innovation et la recherche en réduction des risques entraînent des délais dommageables pour la mise en oeuvre des actions les plus pertinentes et performantes :
- Les équipes courent après les informations disponibles sur les nouveaux produits consommés, notamment les produits de synthèse.
- Nous avons des années de retard pour construire une vraie stratégie et des vrais outils de RDR pour accompagner le chemsex. Il est nécessaire de renforcer l'accès à des quantités importantes de matériels d'injection si on ne veut pas prendre de plein fouet l'augmentation du VIH et du VHC auprès de ce public, mais aussi d'adapter les types de matériels adaptés à cette pratique au regard de la spécificité des plaies et complications observées.
- Pour les chemsexers slameurs mais de manière plus globale pour tous les injecteurs, il manque un réel parcours d'éducation thérapeutique du patient axé sur l'éducation à l'injection. Pour réduire les prises de risques somatiques des injecteurs, il convient de proposer très tôt dans le parcours des usagers une réelle éduction à l'injection. Pas seulement des sessions dîtes « AERLI » mais un réel programme d'ETP, effectué par des infirmiers.
L'institutionnalisation de la réduction des risques (inscription dans la Loi puis décret et référentiel CAARUD) au début des années 2000 a permis d'obtenir des financements plus conséquents et bon nombre d'avancées.
Mais cette institutionnalisation n'a pas eu que des effets positifs. La prétendue professionnalisation des acteurs du champ n'en est pas vraiment une, puisque les critères de recrutement sont sur la base de diplômes / métiers non spécialistes en réduction des risques. Au fil des années, les acteurs sont moins militants, moins spécialisés, et la place des pairs est réduite. Entre l'époque humanitaire des années 90 où les ONG humanitaires telles Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, et les acteurs autonomes comme SAFE fondaient la RDR française, et le champ de la réduction des risques aujourd'hui, nous observons que les difficultés réglementaires et politiques se sont considérablement accrues. Probablement parce qu'il n'y a plus l'urgence du VIH ni l'image dégradée des junkies pour pousser les politiques à agir.
Mais beaucoup reste à faire pour ne pas risquer de nouvelles crises (chemsex, crise des opioïdes, crise des surdoses de stimulants, santé pulmonaire des crackers...). Pour faire évoluer la politique de réduction des risques, il est nécessaire de décloisonner et faire travailler ensemble et de manière convergente les élus, l'État, les professionnels, les usagers, les chercheurs.
Or le peu d'instances existantes semblent à l'arrêt ou au ralenti. À titre d'exemple, le groupe « T2RA » - traitement et réduction des risques en addictologie réuni par le Directeur Général de la Santé, qui a tant fait avancer les dossiers sur son mandat 2014-2018 n'a été réuni que 3 fois depuis 2019 et ne permet plus de faire progresser la politique nationale de RDR. Rappelons que c'est grâce à ce groupe que nous avons obtenu l'expérimentation de la distribution de sulfate de morphine comme médicament de substitution ou encore l'expérimentation de la naloxone sous sa forme « take home » ; il est dommageable que ce groupe expert ne puisse pas continuer sa mission pour soutenir et faire performer la politique de RDR française.
15.2. L'efficacité des programmes de distribution de matériel de prévention dans la RDR liés à l'usage d'opioïdes
Les programmes de distribution de matériel de prévention s'avèrent particulièrement efficaces dans la réduction des risques et des dommages liés à l'usage d'opioïdes, sur plusieurs aspects :
a. La distribution de seringues et de tous les matériels utilisés pour l'injection des substances a drastiquement réduit l'incidence du VIH et du VHC chez les personnes concernées, mais aussi les infections bactériennes et fongiques ;
b. La distribution des matériels de prévention utilisés pour les autres modes de consommation des opioïdes (feuilles d'aluminium, pipes, kits d'atomisation nasale) réduisent également les risques de contamination par le VHC et d'autres complications somatiques. En particulier, la pratique d'atomisation nasale réduit les dommages ORL.
c. Les entretiens de réduction des risques et les accompagnements sont autant d'occasion de travailler avec les usagers sur leur consommation de substances et la gestion de ces consommations, repérer les envies de changement et faciliter l'entrée en soins et les orientations vers la substitution ou les sevrages.
16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
Chaque année, près de 12 millions de personnes prennent des opioïdes avec un nombre de décès et dhospitalisations liés à des surdoses qui ne cesse daugmenter. Malgré des recommandations explicites de la HAS et des rapports clairs et précis, la prévention de ces surdoses et la diffusion de la naloxone ne progressent pas.
La pratique d'évaluation du risque de surdose d'opioïdes reste peu développée. La naloxone, un antidote pourtant simple à administrer et sans risque, reste difficile à se procurer.
Les conditions d'accès à la naloxone ne sont pas optimales :
- les prescriptions sont insuffisantes ;
- les remises en mains propres dans les centres spécialisés ne sont pas toujours organisées faute de budgets ad hoc ;
- la distribution en Caarud et autres équipes de RDR non médico-sociales est freinée par le cadre réglementaire ;
- l'accessibilité en pharmacie est faible faute d'obligation de disposer d'au moins une boîte en stock comme c'est le cas au Canada ;
- L'absence d'accord sur le prix de la spécialité Ventizolve a entraîné la situation absurde que la seule spécialité intranasale ne nécessitant pas de prescription ne soit pas disponible en pharmacie.
SAFE fait partie du collectif « Réflexe naloxone » qui propose et demande l'application de 12 mesures simples pour parvenir à mieux lutter contre les surdoses :
|
1 |
Faire évoluer les RCP des médicaments opioïdes et le paramétrage des logiciels de prescription et de délivrance pour y intégrer les deux recommandations HAS pour tous les opioïdes : (1) nécessité d'évaluation du risque lié aux opioïdes, (2) prescription de naloxone chez les patients à risque de surdose. |
|
2 |
Mentionner le risque de surdose, la conduite à tenir et l'existence d'un antidote sur les notices et boites de médicaments opioïdes, conformément aux recommandations de la HAS. |
|
3 |
Attribuer de manière pérenne les crédits nécessaires à l'achat de la naloxone à toutes les structures qui en distribuent en fonction des besoins de leur file active, justifiés par les indicateurs appropriés dans leur rapport d'activité. |
|
4 |
Établir des modalités réglementaires spécifiques à la naloxone permettant l'approvisionnement, le financement, la conservation, la délivrance, l'administration pour tous les acteurs de proximité pouvant être amenés à distribuer de la naloxone en l'absence de médecin ou de pharmacien. |
|
5 |
Intégrer dans les modules de formation initiale et continue pour les médecins (DPC/EPP) et les pharmaciens les recommandations de la HAS sur l'usage d'antalgiques opioïdes : (1) repérage des risques de surdose d'opioïdes et (2) prise en charge des surdoses incluant la prescription de naloxone. |
|
6 |
Renforcer la diffusion des recommandations de la HAS en matière de gestion des risques de surdoses d'opioïdes par tout média pertinent auprès des médecins et des pharmaciens. |
|
7 |
Modéliser l'accompagnement en pharmacie des patients traités par antalgique de palier II et III incluant : (1) une information et une évaluation sur le risque de surdose (2) une information sur la naloxone et (3) une recommandation de prescrire et/ou délivrer la naloxone chez les patients à risque. |
|
8 |
Imposer et financer 1 boîte de naloxone en stock dans toutes les pharmacies de ville. Permettre l'implantation de distributeurs automatiques de naloxone. Subventionner les kits de naloxone pour permettre un accès gratuit ou à coût symbolique. |
|
9 |
Systématiser le repérage des usagers d'opioïdes, la proposition et la remise de l'antidote par tous les intervenants des structures médicosociales. Mettre en place des formations et le suivi des prescriptions, des délivrances et de l'utilisation de la naloxone. |
|
10 |
Former le personnel pénitentiaire et sensibiliser les détenus et co-cellulaires au risque de surdose et à l'administration de naloxone. Mettre la naloxone à leur disposition durant la détention et lors de la sortie d'incarcération. |
|
11 |
Faire appliquer le cadre légal imposant l'accès aux outils de RdR pour les personnes détenues. |
|
12 |
Assurer l'information du grand public par tous les médias pertinents sur : - Le risque de surdose d'opioïdes (produits, situations et personnes concernées) - L'usage de la naloxone, ses bénéfices et l'absence de risques associés - Les moyens de se procurer de la naloxone facilement |
17. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
Si la naloxone reste l'antidote principal contre les surdoses d'opioïdes, cela ne doit pas nous faire oublier qu'elle s'inscrit en complément d'autres solutions qui permettent déjà de réduire le risque de surdose, mais qui nécessiteraient d'être renforcées ou améliorées :
a. L'accès facilité aux traitements de substitution aux opioïdes (buprénorphine haut dosage, méthadone) : plusieurs pistes d'améliorations sont à envisager telles que i/ renforcer le nombre de places et accélérer les inclusions, ii/ assurer un plus fort relais en ville pour faciliter la rotation des files actives, iii/ améliorer l'accessibilité des médicaments de substitution aux opiacés, bon nombre de pharmaciens n'en ayant pas en stock et refusant leur délivrance (moins de 25 % délivrant la méthadone et moins de 60 % la buprénorphine HD dans les enquêtes déclaratives menées par SAFE dans les pharmacies d'Île-de-France).
b. La mise en place des HSA : elles sont trop peu déployées en France, leurs implantations devraient être renforcées pour une meilleure couverture territoriale, là où des scènes ouvertes de consommation existent.
c. L'organisation de la continuité des soins entre les services de santé, notamment lors des transitions entre le milieu carcéral et la vie en liberté : les semaines suivant les sorties de prison sont une période particulièrement à risque pour les surdoses chez les consommateurs d'opioïdes, et nous entendons chaque mois des témoignages de personnes sorties de détention sans le relais de soins nécessaire et sans naloxone, avec parfois pour conséquence des surdoses et des décès.
d. L'analyse des produits psychoactifs : ce dispositif permet aux consommateurs de ces substances de connaître leur composition avant de les consommer et/ou pour comprendre des effets indésirables avant de re-consommer. Cela évite les risques de surdoses liés à des produits plus puissants que ceux attendus et/ou coupés avec des produits opioïdes inattendus. Actuellement, les systèmes d'analyse de produits sont difficilement accessibles pour les usagers d'une partie du territoire, et tous les dispositifs ne donnent pas la même qualité de résultats. Un nivellement par le haut serait nécessaire. Le dispositif d'analyse à distance, accessible pour les usagers les plus éloignés des grandes villes et donc des lieux d'analyse, devrait être renforcé.
Nous rappelons une nouvelle fois le manque d'une campagne de communication nationale, qui reste essentielle pour sortir la politique de RDR de sa confidentialité ; elle permettrait de toucher les usagers de drogues les plus éloignés de la prévention et les plus isolés avec leur pratique.
Par ailleurs, la question de la formation des intervenants en réduction des risques est un sujet de fond. Aujourd'hui, il n'existe pas de diplôme spécifique pour intervenir en réduction des risques et des dommages, si ce n'est quelques diplômes universitaires et des formations dispensées par certaines associations du champ.
Bon nombre d'intervenants des établissements sont recrutés sur des critères de diplômes (infirmiers, psychologue, éducateur spécialisé...) sans pour autant qu'ils aient de compétences spécifiques dans le domaine de la réduction des risques.
Nous en arrivons à la situation incongrue où les associations et intervenants eux-mêmes se définissent comme experts en accompagnement à l'injection, en chemsex... alors que leurs actions ne sont pas évaluées par des méthodes scientifiques qui permettent d'en apprécier la qualité, la pertinence et la performance.
Nous voyons ainsi arriver à la consultation infirmière de SAFE des injecteurs de drogues qui présentent un état très dégradé alors qu'ils sont accompagnés depuis des années par des équipes de RDR, tout simplement parce que les professionnels qu'ils ont rencontrés jusqu'alors n'ont pas de connaissances approfondies sur les matériels et les actes d'injection (de la préparation à la réalisation), et n'ont pas la compétence pour former sur l'injection, qui reste un acte médical.
L'association SAFE demande depuis plusieurs années à ce qu'une formation à la réduction des risques soit créée, pour améliorer la qualité de la prise en charge.
De plus, dans le cadre du groupe Traitement et réduction des risques en addictologie T2RA, nous avons travaillé à la mise en place d'un Guides des outils recommandés en réduction des risques. Ce document établi en 2017 a été diffusé par les autorités de santé en 2020. Il est désormais obsolète, puisque des travaux de recherche ont permis de démontrer que certains outils recommandés ne garantissent pas l'innocuité lors de l'utilisation par les usagers, tandis que d'autres qui n'existaient pas en 2017 ont démontré à l'inverse leur pertinence et leur performance. Cette liste mériterait d'être revue et mise à jour.
Le même groupe avait travaillé sur une liste du matériel de réduction des risques et des dommages recommandés en prison. La liste n'a jamais été publiée et cela reste un réel frein à l'accès à la réduction des risques et la lutte contre les surdoses d'opioïdes en milieu carcéral et en sortie de détention, notamment parce que la distribution de seringues reste un tabou alors que cela devrait être un droit.
18. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
Nous soulignons d'abord que le système de recueil de données sur les surdoses est insuffisant ; celles-ci sont minorées en raison des systèmes de codage (d'autant plus que la T2A dans les hôpitaux peut conduite à notifier des causes de décès autres que surdose), ce qui entraîne que les données épidémiologiques sont erronées et en-deçà de la réalité.
Nous portons un point de vigilance sur les risques potentiels associés aux difficultés d'accès aux traitements opioïdes pour les patients douloureux (problème d'accès à une consultation, ordonnance sécurisée...) : si ces problèmes ne sont pas gérés, ils peuvent amener à recourir aux achats en ligne ou en rue, avec tous les risques potentiels associés à ces pratiques.
Pour avancer significativement sur la disponibilité et la dispensation de la naloxone, il nous semble indispensable de traiter le sujet des opioïdes par le prisme de la population générale traitée pour la douleur et pas des usagers de drogues.
Tant que la naloxone sera considérée comme l'antidote des « overdoses des toxicomanes », elle restera peu prescrite, peu disponible et peu diffusée.
Il serait par ailleurs nécessaire d'accompagner les nouvelles missions confiées depuis le début d'année aux pharmaciens d'officine (entretien lors de la délivrance des opioïdes, avec repérage des risques de dépendance et/ou de surdosage) par une autorisation de prescription de la naloxone par ces professionnels.
La question de la possibilité d'une auto-évaluation par les patients a été posée par les sénatrices. Cette auto-évaluation doit, tout comme l'information, être réalisée dans un contexte de déstigmatisation que ce soit du personnel soignant et médical que de la population générale.
Le corollaire est la nécessaire formation des médecins au dépistage/prise en charge/orientation de ces patients.
Nous précisons que certains signes négatifs qui signent une dépendance - signes négatifs uniquement sans recherche d'effets positifs - n'apparaissent qu'à l'arrêt du traitement, ce qui peut rendre difficile l'auto-évaluation (par exemple : insomnie importante à l'arrêt).
Enfin, nous soulignons l'importance d'un suivi de toute prescription d'opiacés avec notamment la prévision d'une consultation de déprescription / réévaluation de la juste prescription. La proposition de proposer de façon systématique à chaque prescription d'opiacés (palier 2 ou 3), une prescription de naloxone a été faite en expliquant que c'était la meilleure façon d'aborder le risque d'accroche/syndrome de sevrage.
PR BENJAMIN ROLLAND, PSYCHIATRE ET ADDICTOLOGUE
___________
Consommation d'opioïdes et risques associés
1. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ? Quelles substances disponibles sur le marché français sont les plus concernées et sous quelle forme ? Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Je n'ai pu avoir accès aux derniers chiffres des prescriptions d'opioïdes issues de l'OFMA, mais il me semble que Marie Jauffret-Roustide, qui doit être auditionnée également, a pu les avoir par mon collègue Nicolas Authier. De ce qu'en sait, les prescriptions d'opioïdes antalgiques ont légèrement augmenté, avec une prépondérance d'usage pour le tramadol, mais sans qu'il n'y ait de signal d'alerte réel au niveau national. Au niveau des ventes de rue, l'héroïne reste en France l'opioïde le plus répandu à la vente (OFDT, 2024), avec derrière les traitements de substitution (méthadone et buprénorphine) dont la vente de rue peut aussi constituer une alternative à l'accès parfois trop compliqué dans les CSAPA.
2. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et d'organisation du système de santé ?
La crise des opioïdes survenue aux États-Unis est en réalité une succession de plusieurs phases. On considère ainsi qu'il y a eu quatre « vagues » dans cette épidémie (CDC, 2023 ; Rawson et al., 2023 ; Pieters, 2023). La première vague, qui a commencé à la fin des années 1990 et s'est terminée au début des années 2010, est le fruit de prescriptions rapidement croissantes et inappropriées d'antalgiques opioïdes par les médecins américaines, dans un contexte réglementaire très différent du système français, et avec une pression commerciale massive de certains laboratoires pharmaceutiques.
Les quatre « vagues de la crise des
opioïdes aux USA »
(image issue de Pieters,
2023)
La deuxième vague de l'épidémie américaine a eu lieu à partir des années 2010, lorsqu'une partie croissante de la population s'est tournée vers la vente d'opioïdes de rue, au départ essentiellement de l'héroïne.
Certains experts (voir par exemple Pieters, 2023) considèrent aujourd'hui que cette évolution a été favorisée à l'époque par une réaction exacerbée de la Food & Drug Administration (l'agence américaine du médicament et des produits alimentaires), qui avait décidé de limiter drastiquement les possibilités de prescriptions des opioïdes médicamenteux à cette époque, ce qui aurait alors poussé de nombreuses personnes déjà dépendantes vers le marché de rue pour s'approvisionner.
La troisième vague, survenue à partir de 2013-2014, a vu la vente illicite d'héroïne progressivement supplantée par l'arrivée de produits encore plus dangereux et faciles à fabriquer, essentiellement des opioïdes de synthèse dérivés du fentanyl. Cette troisième vague a vu une explosion des décès par surdose, approchant puis dépassant les 100 000 morts par an ces dernières années, d'autant qu'une quatrième vague, marquée par l'association entre opioïdes fentanylés et psychostimulants (cocaïne et amphétamines), est décrite depuis la période pré-COVID, et a constitué un facteur supplémentaire de mortalité (Rawson et al, 2023 ; Pieters, 2023).
Le système français est partiellement protégé de certaines caractéristiques du système américain. En particulier, concernant ce qui a provoqué la première vague d'opioïdes aux USA, la publicité pour les médicaments est interdite, alors qu'elle aurait constitué un facteur favorisant aux USA. De la même façon, le démarchage des médecins par l'industrie est beaucoup plus encadré, et les dérives constatées avec certaines laboratoires américains ne seraient pas possible en France. Une autre caractéristique censée protéger la France est l'accès en théorie facile et rapide aux traitements de substitution opioïdes. Peut-être qu'au départ de la seconde vague, si celle-ci était survenue en France, beaucoup de personnes dépendantes auraient pu bénéficier d'un accès rapide vers de la méthadone ou de la buprénorphine par des services d'addictologie, ce qui leur aurait évité de chercher des produits beaucoup plus addictifs et dangereux dans la rue. C'est en tout cas ce qui résulte d'opinions de différents groupes de travail d'experts franco- américains (Englander et al., 2024 ; Sud et al., 2023). Il n'est pas certain non-plus que l'ANSM aurait réagi d'une manière aussi abrupte que la FDA, même s'il est bien sûr difficile d'en être sûr.
3. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ? Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
De nombreux experts européens estiment que les facteurs qui ont précipité les différentes vagues de l'épidémie américaine ne sont pas présents en France et en Europe, pour les raisons citées au-dessus. C'est le cas par exemple du directeur de l'Agence Européenne des Drogues (EuDA) Alexis Goosdeel, qui n'a jamais, à ma connaissance jamais formellement écrit sur le sujet (en tout cas publiquement), mais s'est exprimé en français dans l'émission Affaires Étrangères sur France Culture, le 11 janvier dernier.
Malgré tout, il faut rester prudent et l'arrivée d'opioïdes de synthèse pourrait être différente du scénario américain. Le contexte international est chaotique, et l'Europe est la cible de nombreuses menaces que les sénateurs connaissent probablement bien davantage que les experts auditionnés ce jour. Un chercheur en économie a ainsi interviewé des narcotrafiquants mexicains avec publication de sa vidéo dans Le Monde en novembre 2023. Ces derniers affirmaient que leur prochain marché était l'Europe (même si rien de spectaculaire n'a été observé depuis lors). On voit ça-et-là apparaître des ventes et de la consommation de nitazènes, c.à.d., un autre type d'opioïdes de synthèse différents des fentanylés, mais ce phénomène reste sporadique, et les échantillons remontés via les usagers, ou bien les saisies d'opioïdes de synthèse n'ont pas particulièrement augmenté ces dernières années en Europe (EUDA, 2024 ; voir figures au-dessous).
4. L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?
La question des TSO étant abordée plus loin, je me limiterai à celle des opioïdes antalgiques, vue de la position d'un addictologue. Selon moi, la prévention du mésusage mais aussi de prescriptions inadaptées (les patients ne sont pas toujours à l'origine des mésusages c'est important de le rappeler), serait améliorée si des consignes de durée de traitement étaient ajoutées aux AMM, comme cela est le cas pour les benzodiazépines, mais surtout, si la CPAM avait la consigne de surveiller non pas seulement les doses prescrites, mais aussi les durées de prescriptions. Nous ne serons peut-être pas d'accord avec ma collègue spécialiste de la douleur, mais de nombreuses études suggèrent que plus les prescriptions d'opioïdes durent dans le temps, plus elles sont inefficaces, et plus elles exposent à des risques d'addiction (voir notamment Volkow & McLellan, 2016). Il est crucial que les patients ayant des douleurs aiguës d'intensité sévère puissent bénéficier de prescriptions d'opioïdes.
Il est non moins crucial que les médecins anticipent l'arrêt de ces traitements au moment même de leur initiation, avec une bonne éducation thérapeutique du patient. Cette évolution passe par la formation médicale continue, mais pourrait être favorisée par des contraintes de durée de prescription, et une surveillance réelle des prescriptions inadaptées en termes de durée. Le rôle et la formation des pharmaciens d'officine est crucial également, et leur intervention doit être respectée par les médecins prescripteurs, car les pharmaciens ont une coresponsabilité vis-à-vis des médicaments prescrits et délivrés aux patients. L'autorisation exceptionnelle de prescrire au-delà d'une certaine durée pourrait s'organiser dans le cadre de concertation entre centres spécialisés (douleurs et/ou addictologie) et médecins et pharmaciens conseil de la CPAM, avec des systèmes à organiser, par exemple des RCP et décisions collégiales pour l'accompagnement au long cours de dépendances sévères avec éventuelles douleurs résiduelles.
5. Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?
Dans le passé, la sécurisation des prescriptions de certains médicaments à risque addictif a entrainé une diminution des prescriptions, et notamment des prescriptions à haut-dosage, même si cela n'a pas non plus constitué une solution miraculeuse aux problèmes de mésusage et de détournement. Cela a été notamment le cas pour le zolpidem (Aquizerate et al. 2023) ou plus récemment pour la prégabaline (de Ternay et al., 2025). Il est donc à espérer que cette mesure pourra, parmi d'autres, permettre un contrôle de la prescription de ces molécules opioïdes, en particulier des prescriptions aberrantes par leur dose.
6. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui adapté aux risques de mésusage constatés ?
Je pense que des pharmaciens seraient plus légitimes et informés que pour moi pour répondre à cette question.
7. Quel regard portez-vous sur l'organisation de la prise en charge de la douleur dans le système de santé français ? Estimez-vous que la prise en charge de la douleur soit excessivement orientée sur les solutions médicamenteuses ?
Je ne suis pas spécialiste de la douleur. De la place qui est la mienne, j'ai l'impression :
1. Que les médecins générales, psychiatres, etc., qui prennent en charge des patients douloureux ne sont pas assez formés à un repérage ni à une prise en charge efficaces de la douleur de leurs patients.
2. Que les structures spécialisées sont débordées avec des délais d'attentes démesurément longs.
3. Que les structures spécialisées ont des pratiques extrêmement hétérogènes et non-consensuelles entre elles, certaines étant très axés sur l'emploi de traitements pharmacologiques (avec, dans certains cas, un nombre de traitements et des doses de traitements très élevés, correspondant parfois à des pratiques médicales dont le rapport bénéfice-risque n'a pas été évalué scientifiquement), d'autres étant au contraire très axés sur les prises en charge non-pharmacologiques. Cette hétérogénéité interroge parfois, pour des centre experts censés baser leurs pratiques sur les données de la science.
8. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant en ville ou à l'hôpital dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Argumentez votre réponse. Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Le niveau de recours de l'hôpital par la ville est très aléatoire selon les médecins. La disponibilité de l'hôpital n'est pas toujours optimale non-plus. Le problème est que de nombreux médecins prescrivant des opioïdes ne s'aperçoivent que tardivement que leurs prescriptions ont entrainé un mésusage voire une situation d'addiction. La prescription en soins primaires pourrait être limitée dans le temps, avec recours à un avis spécialisé au bout d'une certaine durée, pour que le remboursement CPAM soit maintenu. Encore faut-il que le niveau de recours arrive à offrir une évaluation en temps voulu.
9. Comment l'organisation de la prise en charge de la douleur pourrait-elle être améliorée ? Faudrait-il qu'elle s'inscrive dans un cadre plus pluridisciplinaire ?
S'il n'est pas possible d'accroitre les moyens des consultations douleur ou des CETD, il faudrait réfléchir à la possibilité de professionnels libéraux (médecins ou Infirmiers de Pratique Avancée) aptes à évaluer et soigner les patients. Les pharmaciens pourraient aussi jouer un rôle dans certaines situations. Il est important toutefois que les pratiques restent relativement homogènes afin d'éviter des disparités de qualité de soins en fonction des praticiens et des territoires.
10. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que les recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Il existe des carences manifestes qui sont en partie générationnelles. Les recommandations de bonnes pratiques sont toujours nécessaires, mais, au final, elles sont souvent peu lues et peu connues chez les médecins ou soignants non-spécialistes. Des formations courtes (DPC) ou plus longues (DU) devraient être recommandées pour les médecins qui souhaitent prescrire des opioïdes antalgiques.
11. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Des mesures spécifiques seraient-elles nécessaires pour participer à l'éducation thérapeutique des patients souffrant de douleurs chroniques traitées par opioïdes ?
Ces risques sont encore trop méconnus par les patients comme par les prescripteurs, comme le montrent les témoignages de nombreux patients pris en charge dans notre Consultation de Recours Lyonnais pour les Addictions Médicamenteuses (CERLAM). J'invite ainsi la Commission à lire et écouter le témoignage d'un de nos patients, récemment publié en format article par Le Monde, puis diffusé en podcast par L'Heure du Monde. Si une durée maximale de traitement est définie par l'ANSM par exemple, le franchissement de la barrière pourrait nécessiter une consultation spécialisée en médecin de la douleur ou bien en addictologie, avec éducation thérapeutique. Toutefois, l'éducation thérapeutique devrait en théorie se faire idéalement dès le part, dans le cadre d'un projet de déprescription planifiée conjointement élaboré avec le patient ou la patiente.
12. Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
C'est une mesure à considérer en effet. Il faut toutefois évaluer les risques adverses qui consisteraient à voir des patients se détourner de traitements qui leur seraient utiles en raison d'une peur exacerbée de devenir dépendants.
13. Les tests ou autotests visant à prévenir ou à repérer des situations de mésusage (ORT, POMI) sont-ils des outils utiles pour réduire les risques associés aux opioïdes ? La diffusion de ces questionnaires devrait- elle être accrue, selon vous ? Si oui, dans quels lieux estimeriez-vous utile qu'ils soient mis à disposition ?
C'est selon moi une fausse bonne idée. Ces outils sont incomplets et ils ont une piètre validité scientifique en termes de sensibilité (en particulier l'ORT). Par ailleurs, les médecins sont parfois rétifs à l'idée d'utiliser des questionnaires. Mieux des soignants formés que des questionnaires.
14. Estimez-vous qu'une consultation auprès d'un addictologue devrait être systématisée en cas de prescription d'opioïdes excédant une certaine durée ?
Addictologue ou centres experts, car les problématiques médicamenteuses ne sont pas forcément toujours bien accueillies selon les structures d'addictologie, et nécessitent une expertise spécifique. L'idée est intéressante, mais la question de la faisabilité se pose puisque les structures médicosociales d'addictologie sont saturées. Un système de bilan en centre expert sous forme de séjour Hôpital de Jour avec bilan multidisciplinaire (médecin - pharmacien - psychologue, par exemple) pourrait être envisagé.
15. Comment la France peut-elle utiliser l'expérience américaine pour réduire les risques de surdoses mortelles ?
La France doit tirer les leçons des erreurs américaines (Englander et al., 2024), en maintenant un accès large aux TSO et une approche de réduction des risques qui vise avant tout à offrir un cadre d'accompagnement à des usagers de substances parfois illicites ou achetées dans la rue, en évitant toute décision réglementaire des autorités non-concertées avec les acteurs de santé et d'accompagnement médico-social, et en soutenant le travail de ses centres d'addictovigilance qui constituent un dispositif de veille unique en Europe et dans le monde. Le rôle de pharmaciens d'officine doit aussi être développé (comme évoqué plus haut).
16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Pourraient- elles être améliorées et si oui, comment ? Concernant la naloxone, sa prescription devrait-elle être automatique pour toute prescription longue d'opioïdes, ou pour certains opioïdes comme la méthadone, par exemple ?
Le principe des kits de naloxone a constitué un échec en France, pour des raisons diverses (peu de surdoses létales, CSAPA et CAARUD pas toujours investies, utilisation des fonds pas toujours correctement incitée par les ARS...). La distribution plus ou moins régulière de naloxone devrait pourtant être systématique pour toute prescription d'opioïdes, que ce soit TSO ou opioïde antalgique. Cela participerait d'ailleurs à l'éducation du patient sur les risques de surdose, pour le patient, mais aussi pour son entourage, notamment en cas de consommation accidentelle (p.ex., pédiatrique).
Pour les TSO, la France n'a su prendre le virage des traitements retard, avec un accompagnement réglementaire lourd et une réticence idéologique et/ou médico-économique de certaines administrations. Le résultat est que très peu de patients sont sous TSO retard en France, comparativement à d'autres pays européens ou bien à des pays comme l'Australie (Rolland et al., 2024), alors que ces traitements apportent une vraie plus-value en matière de stabilité addictologique (voir par exemple Marsden et al., 2023) et de satisfaction des patients (voir par exemple Ling et al., 2019).
Enfin, il est important d'être vigilant sur la communication faite autour de la méthadone, parfois présentée comme un médicament dangereux car associé à des risques de surdoses, alors qu'il faut différencier l'accès à de la méthadone en CSAPA, et l'accès à de la méthadone de rue, par défaut d'accès à de la méthadone en CSAPA. Le second cas de figure est certainement plus dangereux en termes de risque de surdose, que le premier.
17. Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?
Les CSAPA et Caarud ont une place centrale dans le modèle français que nous envient de nombreux pays. Toutefois, le modèle de financement de ces structures, basé sur des enveloppes ARS à peu près fixes quelle que soit la performance réelle, et l'impuissance de l'État à définir des objectifs, à les vérifier par des contrôles efficaces d'activité, et à ajuster le financement des structures selon l'atteinte des objectifs, aboutit à des écarts majeurs de performance entre structures, et ainsi à des disparités de soins et une utilisation de l'argent publique souvent suboptimale. Il faudrait revoir le modèle et créer un système des données de santé pour ces structures (similaire au SNDS auquel elles ne sont pas rattachées) afin d'avoir une transparence sur l'activité produite, et une remontée utile d'information sur l'état de santé des populations soignées dans ces centres.
18. Quel bilan tirez-vous de l'expérimentation des haltes soins addictions dans l'accompagnement des usagers et dans la politique de réduction des risques ? Préconiseriez-vous l'inscription de ces structures dans le droit commun, et l'ouverture d'autres sites ?
Les HSA n'ont pas été expérimentées puisque les deux seules structures ouvertes en France dans le cadre de l'expérimentation sont des Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR), dont le modèle est différent de celui des HSA défini par l'article L. 3411-8 du code de la santé publique du 23 février 2022. Tous les projets de structures de type HSA ont été jusqu'à présent bloqués par les préfectures pour des raisons de « sécurité publique ». Il est compliqué de tirer un bilan de structures qui n'ont jamais pu voir le jour. C'est dommage, car ces structures pourraient apporter une vraie innovation en matière de soins aux populations d'usagers de drogues précaires, et, ironiquement, en matière de sécurité publique.
19. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
La politique de réduction des risques consiste à accompagner des personnes qui utilisent des substances psychoactives, souvent illicites, afin de ne pas les laisser en dehors du système de soins, et pour éviter que leur état de santé ne s'aggrave mais aussi pour éviter qu'elles ne propagent des maladies transmissibles ou que leur usage souvent réalisé dans des conditions précaires ne dégrade l'espace publique et ne perturbe la tranquillité publique. L'État est souvent mal à l'aise face à cette approche, car certains fonctionnaires ou certains élus ont l'impression qu'une telle posture constitue une acceptation tacite et un encouragement à l'usage de drogues. Ces réticences freinent le développement de programmes de RdR, par exemple avec l'expérimentation des HSA, ou bien dans le milieu carcéral.
La légalisation de l'IVG (voulue par une femme de droite, et qui semble aujourd'hui devenir un droit constitutionnel) n'a jamais été un encouragement à l'avortement par l'État, mais une volonté d'encadrer une pratique qui, lorsqu'elle était illégale, conduisait à des dégâts terribles. La politique de réduction des risques n'est pas un encouragement à l'usage de drogues, mais simplement une approche pragmatique qui postule que, ce que l'on ne peut éradiquer, il faut le canaliser.
20. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
Je tiens à signaler des liens d'intérêt avec des laboratoires commercialisant des TSO, et qui doivent être pris en compte dans la lecture de certains passages au-dessus. Néanmoins, j'ai tenté dans mes propos et affirmations, de me baser sur les données d'articles scientifiques, et non sur d'éventuelles convictions ou opinions personnelles. Je laisse donc les rapporteures juger de l'impartialité de mes écrits.
Références
Aquizerate A, Laforgue EJ, Istvan M, Rousselet M, Gerardin M, Jouanjus E, Libert F ; French Addictovigilance Network ; Guerlais M, Victorri-Vigneau C. French national addictovigilance follow-up of zolpidem between 2014 and 2020 : evolution of drug abuse, misuse and dependence before and after the regulatory change. European Journal of Public Health. 2023 ; 33(2) :169-175.
CDC (Center for Disease Control and prevention). Understanding the Opioid Overdose Epidemic. 2023. https:// www.cdc.gov/overdose-prevention/about/understanding-the-opioid-overdose-epidemic.html
de Ternay J, Meley C, Guerin P, Meige S, Grelaud N, Rolland B, Chappuy M. National impact of a constraining regulatory framework on pregabalin dispensations in France, 2020-2022. International Journal of Drug Policy. 2025 ; 135 :104 660.
Englander H, Chappuy M, Krawczyck N, Bratberg J, Potee R, Jauffret-Roustide M, Rolland B. Comparing methadone policy and practice in France and the US : Implications for US policy reform. International Journal of Drug Policy 2024 ; 129 :104 487.
Ling W, Nadipelli VR, Solem CT, Ronquest NA, Yeh YC, Learned SM, Mehra V, Heidbreder C.
Patient-centered Outcomes in Participants of a Buprenorphine Monthly Depot (BUP-XR) Double-blind, Placebo- controlled, Multicenter, Phase 3 Study. J Addict Med. 13(6) :442-449.
Marsden J, Kelleher M, Gilvarry E, Mitcheson L, Bisla J, Cape A, Cowden F, Day E, Dewhurst J, Evans R, Hardy W, Hearn A, Kelly J, Lowry N, McCusker M, Murphy C, Murray R, Myton T, Quarshie S, Vanderwaal R, Wareham A, Hughes D, Hoare Z. Superiority and cost-effectiveness of monthly extended-release buprenorphine versus daily standard of care medication : a pragmatic, parallel-group, open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 3 trial. EClinicalMedicine. 2023 ; 66 :102 311.
OFDT. Héroïne et opioïdes - Synthèse des connaissances. 2025. https:// www.ofdt.fr/heroine-et-opioides-synthese- des-connaissances-1729
Pieters T. The Imperative of Regulation : The Co-creation of a Medical and Non-medical US Opioid Crisis. Psychoactives. 2023 ; 2(4) :317-336.
Rawson RA, Erath TG, Clark HW. The fourth wave of the overdose crisis : Examining the prominent role of psychomotor stimulants with and without fentanyl. Preventive Medicine 2023 ; 176 :107 625.
Rolland B, Matheson C, Kaski A, Kosim M, Roncero C, Vorspan F. Compared implementation of the long-acting buprenorphine treatment buvidal in four European countries. Expert Opinion on Drug Delivery. 2024 ; 21(5) :809-815.
Sud A, Chiu K, Friedman J, Dupouy J. Buprenorphine deregulation as an opioid crisis policy response - A comparative analysis between France and the United States. International Journal of Drug Policy 2023 ; 120 :104 161.
Volkow ND, McLellan AT. Opioid Abuse in Chronic Pain--Misconceptions and Mitigation Strategies. New England Journal of Medicine. 2016 ; 374(13) :1253-63.
MICHEL
GANDILHON,
EXPERT ASSOCIÉ AU PÔLE
SÉCURITÉ-DÉFENSE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
ME'TIERS (CNAM)
___________
1. Quelles sont les principales routes des opioïdes consommés en France (de la production à la commercialisation) ?
Le principal opioïde illégal consommé en France est l'héroïne n° 3 dite brune. Elle est produite en Afghanistan et alimente le marché européen via la route des Balkans. Celle-ci part de l'Afghanistan, traverse l'Iran et la Turquie pour déboucher en Europe du Sud-Est. Une partie de l'héroïne est ensuite redirigée vers les Pays-Bas et la Belgique, qui constituent les deux zones de redistribution secondaire du produit en Europe occidentale. Les trafiquants installés en France s'y approvisionnent, de même que de multiples réseaux d'usager-revendeurs. Il existe aussi des filières, actives depuis la Suisse, dominées par la mafia albanaise327(*).
S'agissant des opioïdes de synthèse, il existe des trafics par colis postaux à partir de commandes réalisées sur le darkweb. Ce trafic demeure toutefois relativement marginal.
2. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ?
a. Quelles substances disponibles sur le marché français sont les plus concernées et sous quelle forme ?
b. Quels sont les principaux mésusages constatés (de la part des professionnels de santé et des usagers) ?
c. Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
d. La France se distingue-t-elle de ses voisins européens sur ces questions ?
L'héroïne reste centrale dans la configuration des usages d'opioïdes en France. Ces dernières années ont été marquées, avec plus d'une tonne, par des saisies sans précédent sur le territoire français qui placent la France en tête des pays européens. Entre 2017 et 2023, l'expérimentation du produit a fortement augmenté passant de 1,3 % de la population des 18-64 ans à 2 %. Les usages dans l'année ont crû de 0,2 à 0,3 % (OFDT, 2024)328(*). En 2023, la France compterait près de 850 000 personnes qui ont expérimenté l'héroïne (contre 500 000 en 2017), tandis que le marché actif doit compter environ 150 000 personnes. Le profil type du consommateur est un homme âgé de 35-44 ans. Il s'agit souvent d'une personne engagée dans un traitement de substitution aux opiacés qui consomme occasionnellement de l'héroïne. En 2023, près de 160 000 personnes suivaient un traitement de substitution en France. Il existe aussi un mésusage des traitements de substitution aux opiacés (méthadone, buprénorphine haut dosage). Ce mésusage est fondé généralement sur un petit trafic de rue alimenté par des détournements de prescription.
Le mésusage d'opioïdes légaux prescrits dans le cadre de traitements de la douleur serait en augmentation329(*).
S'agissant de l'héroïne, les évolutions du marché s'expliquent par la forte dynamique de l'offre afghane jusqu'en 2023. Le pays a vu sa production d'opium exploser ces dernières années provoquant une abondance d'héroïne dont le produit est accessible et de meilleure « qualité ». Les prix de détail sont en baisse et la pureté en hausse. Il est relativement aisé de se procurer de l'héroïne en allant la chercher aux Pays-Bas ou en Belgique.
La France du nord-est est relativement affectée par un phénomène qui touche des territoires périurbains, en général de vieilles terres industrielles, en voie de déclassement. Elle est une expression des fractures territoriales qui traversent le pays330(*).
3. Comment appréhendez-vous le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ?
Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ? Quels facteurs géopolitiques peuvent-ils y contribuer ?
Jusqu'à maintenant, la consommation du fentanyl et de ses analogues est marginale en France dans un contexte où l'Europe est largement épargnée par les consommations. Les prévalences sont marginales, hormis dans certains pays baltes, alors que le nombre de décès n'est en aucun cas comparable avec la situation qui prévaut aux États-Unis. Selon les dernières données disponibles, en 2021, 137 personnes étaient décédées à la suite d'une consommation de fentanyl ou de l'un de ses dérivés contre plus de 70 000 aux États-Unis331(*). L'inquiétude des autorités sanitaires en Europe porterait plutôt sur les nitazènes à l'origine de quelques dizaines de morts en Irlande et en Grande-Bretagne. Une préoccupation existe toutefois depuis l'effondrement de la production d'opium en Afghanistan qui pourrait provoquer une pénurie d'héroïne sur le marché européen et français.
Entre 2022 et 2023, les superficies de pavots sont en effet passées de 233 000 ha à 10 800 ha, tandis que la production chutait de 6 300 tonnes à 330 tonnes, soit, à peu de choses près, le niveau de la production de 1979, quand l'Armée rouge a franchi la frontière. Dans un tel contexte le fentanyl pourrait pallier le manque d'héroïne. Une telle configuration s'est retrouvée dans les pays baltes confronté à une pénurie en 2010 laquelle a été comblée par des opioïdes de synthèse. À la fin de l'année 2023, l'EMCDDA, l'Observatoire européen des drogues, par la voix de certains de ses membres dans la revue Addiction, s'en est inquiété : « Des informations provenant de la surveillance par satellite et d'autres sources suggèrent que les actions des Talibans ont entraîné une réduction spectaculaire de la culture du pavot en 2023. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait entraîner une pénurie d'héroïne en Europe à partir de la fin de l'année 2024. Une précédente pénurie d'héroïne de courte durée a entraîné des changements dans les habitudes de consommation d'opioïdes dans certains pays, qui ont persisté même lorsque la disponibilité de l'héroïne a augmenté. Il est trop tôt pour spéculer sur l'éventualité d'une pénurie, mais si c'est le cas, cela pourrait augmenter la demande d'opioïdes synthétiques à court terme, ce qui pourrait persister à l'avenir même si l'héroïne redevient disponible. À l'heure actuelle, la production d'opioïdes synthétiques en Europe serait très faible, mais des saisies de laboratoires et de précurseurs ont été récemment observées. L'Europe est également un centre de production de drogues synthétiques et des liens existent avec des groupes produisant des opioïdes synthétiques pour le marché nord-américain. Il y a donc peu de raisons de penser que la production d'opioïdes synthétiques ne pourrait pas être rapidement augmentée si les conditions du marché étaient favorables332(*) ».
À ce jour, et d'après des informations en provenance de l'EUDA, aucune pénurie d'héroïne n'a été constatée sur les différents marchés européens. Les stocks d'opium accumulés depuis des années permettent d'assurer une continuité de la production d'héroïne. En France, l'importance des médicaments de substitution aux opiacés dans le traitement des addictions, de même que la disponibilité sur le marché parallèle des sulfates de morphine, sont un facteur de protection contre le recours à des opioïdes de synthèse plus puissants. Cependant, la vigilance doit être de mise. Les Pays-Bas et la Belgique disposent de toutes les infrastructures techniques pour se lancer si nécessaire dans une production. C'est déjà le cas depuis cinq ans avec la méthamphétamine produite qui plus est avec les conseils techniques de certains membres des cartels mexicains333(*). Une affaire intervenue en février 2024 d'importation de carfentanil en France par go-fast depuis les Pays-Bas en est l'illustration334(*).
4. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et de politique de réduction des risques ?
Les enseignements sont clairs. La crise des opioïdes aux États-Unis est née des pratiques commerciales abusives de l'industrie pharmaceutique dans le cadre d'une promotion de substances antidouleurs très puissantes335(*). L'encadrement en France est beaucoup plus strict. Il est interdit par exemple de faire de la publicité auprès du public pour les médicaments remboursables par la Sécurité Sociale, et/ou pour les médicaments inscrits sur une liste de substances vénéneuses.
5. Quelles mesures pourraient-elles, en France, contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène et, plus largement, à circonscrire les mésusages et risques de dépendance observés ?
La sensibilisation des médecins généralistes à la problématique de la prescription des médicaments opioïdes est centrale., de même que la sensibilisation aux signes d'éventuelles dépendances.
6. Quelles devraient être selon vous les priorités d'actions en matière de lutte contre la disponibilité et l'usage des opioïdes illicites en France ?
La vigilance sur la question des cybertrafics d'opioïdes de synthèse doit être centrale.
La question de la réponse pénale en matière de répression des réseaux albanais de l'héroïne est posée, de même que la lutte contre les filières géorgiennes qui sont au coeur des trafics de médicaments opioïdes en France depuis 25 ans336(*).
7. L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?
Globalement oui.
8. Selon vous, existe-t-il un risque sérieux qu'un resserrement des conditions d'accès à certains opioïdes (ex : instauration d'une ordonnance sécurisée pour le tramadol) se traduise par un report des consommateurs et usagers vers le marché illégal ? Pouvez-vous argumenter et illustrer ce risque par des exemples historiques ?
Les risques existent, mais ils sont inévitables. Il faut raisonner ici en termes de coûts/bénéfices.
9. Dans ce contexte, identifiez-vous des risques accrus d'utilisation d'ordonnances falsifiées ?
10. La sociologue Marie Jauffret-Roustide considère que le marché illégal des sulfates de morphine permet un approvisionnement relativement sécurisé en traitements agonistes aux opioïdes (TAO). Qu'en pensez-vous ?
Le marché illégal des opioïdes comprend l'héroïne, le Subutex, la méthadone et les sulfates de morphine. Ce marché permet aux usagers de drogues non inscrits dans des parcours thérapeutiques d'avoir accès à un panel de substances qui constitue un moindre mal par rapport à des produits comme le fentanyl et ses analogues.
11. Certains acteurs regrettent que les sulfates de morphine soient cantonnés au marché illégal et ne soient pas reconnus par un TAO, pour intégrer la substance dans un cadre légal. Quel regard portez-vous sur cette question ?
Oui les sulfates de morphine pourraient venir élargir opportunément l'offre thérapeutique de TAO.
12. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ?
13. Au global, comment évaluez-vous la politique de réduction des risques en France ?
La politique de RDR en France est globalement un succès. Elle a permis depuis 30 ans de diminuer considérablement les surdoses d'héroïne et d'autres drogues illégales et de faire baisser drastiquement les contaminations au virus VIH et VHC. En France, en 2022, les opioïdes ont tué 477 personnes, 81 000 aux USA.
14. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
Oui, sur la question de la prise en charge des usagers dépendants des opioïdes et notamment de l'héroïne. La critique que l'on pourrait faire au système français est qu'il est trop centré sur les traitements de substitution aux opiacés, ce que certains professionnels qualifient de « tout TSO ». Contrairement à d'autres pays européens, comme l'Italie, l'offre de centres de sevrage est notoirement insuffisante et mériterait d'être développée.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'ÉVALUATION
ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (SFETD)
___________
1. Les conditions d'évaluation de la douleur chronique et aiguë, en ville et à l'hôpital, vous paraissent-elles satisfaisantes ? Le rôle des dispositifs spécialisés, tels que les consultations et les centres d'évaluation et de traitement de la douleur chronique (CETD ou SDC), pourrait-il être renforcé ?
La douleur chronique est aujourd'hui considérée comme une maladie par l'OMS. Elle touche 30 % de la population française dans une enquête nationale de 2004 (STOP-NET), et 42 % dans une nouvelle enquête de 2025 (PREVA-DOL, OFDA (Observatoire Français de la Douleur et des Antalgiques) avec OpinionWay) dont 27 % un traitement antalgique opioïde dans les 3 mois précédant l'enquête. Seulement 37 % sont satisfaits de leur prise en charge et 16 % pratiquent l'automédication.
Les soins primaires doivent absolument être davantage impliqués dans sa prise en charge. En effet, les structures douleur chronique SDC, quoique réparties sur le territoire, ne peuvent intervenir qu'en 2e voire 3e ligne dans le parcours des patients, à savoir pour les patients les plus complexes.
Actuellement, les SDC ne reçoivent simultanément que 3 % des patients souffrant de douleur chronique et les 97 % restants ne sont souvent pas toujours suivis en soins primaires pour cette maladie qu'est la douleur chronique, faute de formation des professionnels, faute de dépistage systématique, faute de valorisation suffisante des consultations longues nécessaires à une évaluation convenable de cette maladie complexe et de son retentissement.
Pour la douleur aiguë, la formation des soignants a été améliorée au fil des années. Le besoin de recommandations, de guides, de protocoles, se fait sentir, plus facilement disponibles dans les établissements de santé à travers le travail des comités de lutte contre la douleur Clud.
2. Comment évaluez-vous les conditions d'accès aux médicaments antalgiques opioïdes et non opioïdes en France ? Cet accès est-il suffisant pour assurer une bonne prise en charge de la douleur chronique et aiguë ? L'usage des antalgiques opioïdes vous paraît-il excessif en comparaison de l'usage des antalgiques non opioïdes et des possibilités de recours à ces derniers ? Estimez-vous que la prise en charge de la douleur soit excessivement orientée sur les solutions médicamenteuses ?
L'accès aux médicaments semblait adéquat (il faudra évaluer l'impact du changement des conditions de prescription des 2 antalgiques les plus prescrits depuis le 1er mars 2025), mais une formation (initiale et continue) à leur juste prescription est insuffisante. Toute prescription médicamenteuse doit s'accompagner d'un projet de déprescription. Il est nécessaire de former davantage les professionnels à leur juste prescription, selon l'évaluation de la douleur et de ses retentissement chez chaque patient, de sensibiliser la population aux signes de mésusage, dépendance et addiction en prenant soin de ne pas stigmatiser ces médicaments. Leur place dans la stratégie thérapeutique de la douleur chronique n'est pas assez connue des professionnels de 1er recours (médecins généralistes, autres spécialistes, infirmiers...)
Les médicaments opioïdes ne représentent qu'une partie des traitements antalgiques médicamenteux. Les opioïdes dits faibles (liste 1 substance vénénéuse) étaient peut-être trop facilement prescrits. Les opioïdes dits forts (liste des stupéfiants) sont sûrement insuffisamment prescrits.
Tant que la prise en charge financière sera quasi-exclusivement tournée vers les médicaments, et que la recherche du zéro douleur chronique fera partie des objectifs thérapeutiques, les stratégies thérapeutiques seront dominées par ces types de traitements et non orientées selon un modèle bio-psychosocial, global, intégratif, incluant les prises en charge 1.corporelles, comme l'activité physique adaptée, les contre-stimulations, 2.psycho-corporelles, comme la relaxation ou l'hypnose, 3.psycho-comportementales, comme l'alliance thérapeutique, le soutien relationnel, les psychothérapies, 4.socio-éducatives, comme l'éducation thérapeutique et la e-santé
3. Les conditions de réévaluation périodique des traitements par médicaments opioïdes vous paraissent-elles adaptées ?
Une réévaluation mensuelle en soins primaires, notamment en début de traitement, pouvant atteindre 3 mois pour les médicaments classés substances vénéneuses (tramadol, opium, codéine), paraît adaptée à condition que le professionnel puisse prendre le temps nécessaire à une juste réévaluation du rapport bénéfices / risques de la prescription (revoir l'indication, évaluer les risques de mésusage et dépendance, réévaluer le projet thérapeutique global...).
4. Comment l'organisation de la prise en charge de la douleur pourrait-elle être améliorée ? Faudrait-il qu'elle s'inscrive dans un cadre plus pluridisciplinaire ?
Amélioration en soins primaires :
Consultation longue valorisée justifiée par la complexité et la vulnérabilité des patients.
Une éducation thérapeutique systématique du patient, dès le diagnostic de douleur chronique (après 3 mois d'évolution) par une IDE formée type infirmière Asalée ou IPA.
Financement au forfait des thérapies non-médicamenteuses proposées.
Pour les SDC :
Reconnaissance de la médecine de la douleur comme une spécialité, pour améliorer l'attractivité médicale et pérenniser le fonctionnement des SDC.
Valoriser financièrement les équipes mobiles « douleur » hospitalières qui ne le sont pas actuellement et dont les frais sont à la charge des établissements. Cela afin d'optimiser les prescriptions de sortie d'hospitalisation notamment des médicaments antalgiques opioïdes.
Mettre en place des protocoles de coopération, délégation de tâches, pour libérer du temps médical qui serait alors dédié à la télé-expertise.
Déployer la télé-expertise pour permettre un soutien et de l'accompagnement en soins primaires.
Formation et recrutement d'IPA douleur.
5. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ? Quels sont les principaux mésusages constatés ? Quelles substances sont les plus concernées et sous quelle forme ?
Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
À partir des données du SNDS analysée par l'OFDA (Observatoire Français de la Douleur et des Antalgiques), entre 2014 et 2024, nous sommes passés de 11 544 598 français majeurs (soit 17,5 % de la population) bénéficiant d'au moins une ordonnance remboursée dans l'année de ces médicaments à 11 535 016 français majeurs (soit 16,9 % de la population). En 2023, 57 % des délivrances en pharmacie étaient uniques (1 ordonnance par an), 66 % pour le tramadol et 70 % pour la codéine. Les cas de décès liés au opioïdes recensés par le système CépiDC de l'Inserm sont stables depuis 2020 à environ 540 décès par an (toutes substances opioïdes confondues ; données disponibles jusqu'en 2022). Depuis 2014, les trois substances dont les prescriptions (en nombre de patients) ont diminué sont le tramadol (- 17 %), la codéine (- 8,4 %) et le fentanyl (- 14 %). Suite aux mesures de l'ANSM, on observe au premier trimestre 2025 une prescription de poudre d'opium devenue majoritaire sur celles de tramadol ou de codéine.
Concernant les décès par antalgiques opioïdes évalués dans l'enquête DTA, ils montrent une évaluation linéaire à la baisse pour la codéine, le tramadol et la morphine depuis 2013. En 2022, ils concernaient (hors suicides) 36 personnes pour le tramadol et 20 personnes pour la codéine, à rapporter à 4 939 628 et 4 358 115 français ayant bénéficié d'ordonnances remboursées de ces médicaments respectivement. Il faut noter qu'on ne peut pas connaître dans cette étude l'origine de ces médicaments (automédication, prescription, marché noir) et plus spécifiquement pour la codéine, sans connaître le type de médicament à l'origine du surdosage : anti-tussif ou antalgique. Les premiers étant plus souvent impliqués dans les cas de falsifications d'ordonnances selon l'enquête OSIAP.
Les facteurs favorisant le mésusage pour le patient sont des antécédents de troubles psychiques, d'addiction à d'autres substances, un âge « jeune » et des antécédent d'agressions (cf échelle d'évaluation du risque de mésusage ORT proposée dans les recommandations de la HAS). Ces risques ne constituent pas une contre-indication à la prescription de ces médicaments mais doivent inciter à une surveillance des comportements de mésusage plus rigoureuse (échelle POMI-5F proposée dans les recommandations de la HAS).
Il peut y avoir des prescriptions inadaptées aux mécanismes douloureux ; la réponse est la formation.
Attention, il peut y avoir des prises de médicaments à posologie insuffisante, par crainte de dépendance qui alors favorise l'échec thérapeutique et donc le mésusage ; la réponse est l'information.
6. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et d'organisation du système de santé ?
Fonctionnement très différent en France et aux US, les risques sont beaucoup plus surveillés et maîtrisés en France. La France a observé le phénomène aux USA et a adapté sa stratégie de pharmaco-surveillance de ces médicaments via son réseau d'addictovigilance. Elle a aussi pris des mesures réglementaires pour améliorer l'information des patients (message sur les boites), inciter à la réévaluation plus fréquente par les médecins (limitation du nombre de renouvellement automatique de l'ordonnance à 3 mois). Elle a aussi proposé, en mars 2022, des recommandations sur le bon usage des médicaments opioïdes mais leur diffusion reste probablement trop limitée. Elle a aussi mis en place un accès aux kits de Naloxone en pharmacie et dans les structures d'addictologie. Il faut aussi prendre le temps de mesurer l'impact de ces différentes mesures qui favorisent le bon usage et la juste prescription, plutôt que de contraindre l'accès à certains de ces médicaments et donc prendre le risque (à évaluer) d'une moindre accessibilité aux antalgiques et d'un moindre soulagement des douleurs aiguës et chroniques.
7. L'augmentation des prescriptions hors indication thérapeutique du tramadol, de la codéine ou du fentanyl doit-elle nous alerter sur un risque d'importation d'une crise des opioïdes en France ? Face à ce constat, quelles actions faudrait-il engager ?
Opioïdes en douleur chronique surtout prescrits en soins primaires, du fait du nombre de médecins généralistes et de leur position en première ligne dans les soins. Le médecin cherche à soulager son patient. Mais il méconnaît parfois les autres thérapeutiques, médicamenteuses et non-médicamenteuses, associé à une non-prise en charge financière de nombre de ces thérapies non-médicamenteuses.
Certaines de ces prescriptions ne relèvent pas de la prise en charge de la douleur mais restent très minoritaires. Certaines de ces substances ne sont pas acquises via le système de santé et un accès rendu plus difficile à certains médicaments peut voir se développer des sources déjà en place et notamment les commandes au marché noir sur internet.
8. Le nombre de personnes dépendantes ayant désigné le tramadol, opioïde dit faible, comme premier produit ayant entraîné leur addiction a été multiplié par 17 en 10 ans. Or les opioïdes faibles sont régis par un cadre législatif et réglementaire moins restrictif que les opioïdes dits forts. Le risque porte-t-il principalement sur les opioïdes dits faibles, notamment le tramadol et la codéine, plutôt que sur les opioïdes dits forts, comme le fentanyl ou l'oxycodone ?
L'appellation `opioïdes faibles' porte en effet à confusion. Les risques ne sont pas faibles et ce sera bien la dose et la durée de prescription qui pourront conditionner les risques notamment de dépendance. La différence de conditions de prescription est une source de confusion qui peut effectivement faire croire à un moindre risque pour certaines substances. Cependant la réalité de terrain et l'absence d'ordonnance numérique rédigeables par tous les médecins, transmises directement à la pharmacie du patient, quel que soit leur mode d'exercice, sont inadaptées aux ordonnances sécurisées manuscrites tous les 28 jours pour la majorité des antalgiques. Une sensibilisation des prescripteurs serait plus adaptée dans ce contexte.
9. Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?
Bonne idée en théorie, à condition que la contrainte des conditions de prescription ne restreigne pas l'accès à des médicaments essentiels pour le soulagement de certaines douleurs, aiguës ou chroniques. En pratique, il y a un risque d'observer une diminution des prescriptions, devenues trop contraignantes, de ces médicaments, partiellement compensées par des prescriptions accrues du seul opioïde non concerné (poudre d'opium associée au paracétamol) et nous pouvons poser l'hypothèse qu'une moindre prescription puisse aussi être un risque d'une prise en charge insuffisante de certaines douleurs. Pour ne pas impacter la prise en charge de la douleur tout en sécurisant les prescriptions, prescrire sur une ordonnance sécurisée n'est pas la garantie d'un choix pertinent du médicament. Cela limite surtout le risque de falsification pour des patients en situation d'abus. Selon l'enquête OSIAP du réseau d'addictovigilance, on retrouve aux 3 premiers rangs des médicaments concernés en France : le paracétamol, le tramadol et la codéine (à visée antitussive et non antalgique). Stratégiquement, le déploiement préalable pour toutes les prescriptions médicamenteuses des ordonnances numériques et leur télétransmission directe aux pharmacies aurait évité de prendre des mesures à risques de sous-prescription de certains antalgiques opioïdes.
10. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui adapté aux risques de mésusage constatés ?
La diminution d'un nombre d'unités de prise par boite peut permettre de limiter les comportements secondaires d'automédication par le patient ou son entourage. Cela n'a pas fait, à notre connaissance, l'objet d'une évaluation.
11. Le défaut de coordination des professionnels de santé intervenant en ville ou à l'hôpital dans la prise en charge d'un patient est-il un facteur favorisant les mésusages ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Il faut que les soins primaires soient davantage impliqués dans les prises en charge douleur chronique (cf. plus haut)
12. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
Carence générale sur l'évaluation, le traitement et le retentissement des douleurs chroniques. La meilleure connaissance et donc des prescription plus justes des médicaments opioïdes s'inscrit dans ce cadre. Trop peu d'heures sont consacrées à la formation sur les diagnostics et traitements de la douleur en faculté de médecine, au regard de sa prévalence en population générale et sa place importante dans les motifs de consultation en soins primaires.
13. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit suffisante ? Des mesures spécifiques seraient-elles nécessaires pour participer à l'éducation thérapeutique des patients souffrant de douleurs chroniques traitées par opioïdes ?
Mesures de sensibilisation semblent vécues de façon anxiogène et coercitive aussi bien par les patients que par les professionnels de santé. Nécessité de mettre en place de l'éducation thérapeutique à la douleur chronique en ville, avec éventuelle intégration de modules spécifiques sur la place des opioïdes.
Nécessité de campagnes d'information grand public (comme les antibiotiques et les benzodiazépines plus récemment) sans stigmatiser pour autant leurs usages.
14. Les tests ou autotests visant à prévenir ou à repérer des situations de mésusage (ORT, POMI) sont-ils des outils utiles pour réduire les risques associés aux opioïdes ? La diffusion de ces questionnaires devrait-elle être accrue, selon vous ? Si oui, dans quels lieux estimeriez-vous utile qu'ils soient mis à disposition ?
Ce sont les outils recommandés par la HAS, depuis mars 2022. Oui, diffusion plus large et implication des pharmaciens lors de consultations pharmaceutiques dédiées.
15. Estimez-vous qu'une consultation auprès d'un addictologue devrait être systématisée en cas de prescription d'opioïdes excédant une certaine durée ?
Difficile de la systématiser ; cela se confrontera aux disponibilités de ces médecins. Mais il ne faut pas oublier que l'évaluation d'un médicament se fait sur son rapport bénéfices / risques. Donc, il faudrait envisager, en théorie, une évaluation pluridisciplinaire car les addictologues maitrisent la question des risques de dépendance et les médecins de la douleur celle du choix et de l'évaluation des traitements de la douleur. Cela n'a d'intérêt populationnel que si cela peut se mettre en place sur tout le territoire. Une telle mesure nécessiterait probablement du temps humain supplémentaire, compte tenu du nombre de patients traités au long cours avec des opioïdes (24 % des patients traités par exemple par tramadol ou codéine depuis plus de 3 mois). La télé-expertise y contribuerait.
16. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ?
Sensibilisation à renforcer. Rappel de l'intérêt de prescrire la naloxone, de manière large, en cas de prescription des opioïdes.
17. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
Mieux prescrire (formation), mieux surveiller (formation et information), patient acteur du bon usage des traitements.
Proposer des prescriptions de naloxone aux patients traités par antalgiques opioïdes dans les conditions suivantes (selon HAS 2022).
Plusieurs populations usagères d'opioïdes antalgiques sont à risque de surdose :
- usagers ayant une perte de tolérance aux opioïdes, liée à un arrêt ou une période de plus faible consommation ou en cours de sevrage ;
- usagers ayant des antécédents de surdose d'opioïde ;
- patients traités par des médicaments antalgiques opioïdes, en cas de trouble de l'usage (augmentation non contrôlée des doses pour soulager une douleur mal contrôlée, recherche d'effets psychoactifs ...) ou ayant développé une dépendance physique ;
- utilisateurs occasionnels d'antalgiques opioïdes recherchant les effets psychoactifs des opioïdes ;
- association à des substances potentialisant le risque de surdose (ex. : gabapentinoïdes, benzodiazépines, alcool, etc.).
18. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteures ?
Moins prescrire (ce qui arrivera avec les ordonnances sécurisées non numériques) ne peut-être la seule solution pour mieux prescrire. Contraindre indifféremment la prescription de certains antalgiques opioïdes peut s'avérer très délétère pour des patients qui ne bénéficieront pas des traitements adaptés à leurs douleurs (aiguës ou chroniques).
OBSERVATOIRE
FRANÇAIS DES DROGUES
ET DES CONDUITES ADDICTIVES (OFDT)
___________
Sur l'évolution du contexte relatif à la consommation d'opioïdes en France
1. Quelles sont les principales routes des opioïdes consommés en France (de la production à la commercialisation) ?
Jusqu'à la période récente, l'héroïne consommée (ou en transit) en France provenait majoritairement d'Afghanistan (héroïne brune), transitant via l'Iran vers l'Europe par la route des Balkans (Turquie, Grèce, Albanie). Cependant, l'année 2023 a été marquée par un « choc d'offre » : si la production mondiale d'opium reste estimée à un niveau élevé (autour de 1 990 tonnes en 2023), celle-ci a diminué de 74 % en une année, du fait de l'interdiction en avril 2022 de la culture du pavot en Afghanistan, premier pays producteur de pavot à opium jusqu'alors (qui produisait jusqu'alors 80 % de l'opium mondial). Du fait de la chute de production en Afghanistan, la Birmanie est devenue le premier producteur mondial de pavot à opium, avec un doublement du volume de production, passant de 423 tonnes en 2021 à 1 080 tonnes en 2023. Ce choc d'offre sur l'héroïne, dont la principale voie du trafic, de l'Afghanistan vers l'Europe via la « route des Balkans », est allé de pair avec l'essor des opioïdes de synthèse dont les routes du trafic sont distinctes.
A. Les routes de l'héroïne
Le marché européen de l'héroïne, et par conséquent celui de la France, repose essentiellement sur l'opium produit à partir du pavot à opium d'Afghanistan. Selon l'Agence de l'Union Européenne des drogues (EUDA), une fois transformée, l'héroïne est stockée en divers points le long des routes de trafic, avant d'être acheminée vers l'Europe à travers quatre routes principales :
1. La route des Balkans constitue historiquement l'axe principal de circulation de l'héroïne entre l'Afghanistan et l'Europe. Cette route passe par l'Iran et la Turquie, puis se divise en plusieurs branches permettant de rejoindre l'Union européenne.
- La branche Sud traverse la Grèce et l'Albanie ou emprunte des voies maritimes en Méditerranée ;
- La branche centrale traverse quant à elle la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie, avant d'atteindre l'Italie ou l'Autriche ;
- La branche Nord relie la Bulgarie à la Roumanie, puis rejoint les marchés d'Europe centrale et occidentale.
Cette route est principalement terrestre et repose sur des véhicules utilitaires légers, des voitures privées ou des camions dans lesquels l'héroïne est dissimulée. On observe également l'utilisation du vecteur maritimes, notamment pour acheminer l'héroïne des ports turcs aux ports en Croatie, en Italie ou en Slovénie. Cette route sert aussi à l'acheminement de précurseurs chimiques (surtout dans le sens contraire : Europe ? Afghanistan) comme l'anhydride acétique, utilisés pour transformer l'opium en héroïne. Toutefois, il semble que l'utilisation de cette route a un peu diminué au cours des dernières années, en particulier à cause du renforcement des contrôles douaniers mis en place à la suite de la crise migratoire de 2015 et des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.
2. La route du Sud : Elle part de l'Afghanistan, traverse l'Iran ou le Pakistan, où elle rejoint les ports longeant le golfe d'Oman. Depuis ces ports, l'héroïne est chargée sur des navires en direction de la péninsule arabique, en particulier les Émirats arabes unis, ou vers l'Afrique de l'Est, notamment la Tanzanie et le Kenya. L'héroïne est ensuite expédiée vers l'Europe via les différents ports africains ou de la péninsule arabique. Ce trajet repose essentiellement sur le transport maritime, que ce soit par des navires commerciaux, des voiliers ou des conteneurs dissimulant la marchandise au sein de cargaisons légales. Cette route est particulièrement prisée pour l'acheminement de grandes quantités, facilité par l'usage des conteneurs maritimes. L'EUDA émet l'hypothèse que cette route s'est beaucoup développée depuis 2021 comme peuvent en attester certaines saisies dans les ports européens, comme par exemple les 2,6 tonnes d'héroïne interceptées à Rotterdam en provenance du Sierra Leone.
3. La route du Caucase : depuis l'Afghanistan, l'héroïne passe par l'Iran, puis par l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, avant d'atteindre la Géorgie. Elle traverse ensuite la mer Noire, généralement par ferry, pour atteindre la Bulgarie, la Roumanie ou, avant 2022, l'Ukraine. De là, elle poursuit sa course vers les pays d'Europe occidentale. Cette route combine le transport terrestre et maritime. Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, il semblerait que son utilisation a fortement diminué.
4. La route du Nord est un itinéraire terrestre moins utilisé par les trafiquants que les 3 autres routes, mais reste encore actif. À partir de l'Afghanistan, la drogue traverse le Tadjikistan, puis le Kirghizistan ou l'Ouzbékistan, avant de rejoindre le Kazakhstan. Elle entre ensuite en Russie, puis transite vers la Biélorussie, les pays baltes, la Pologne, et parfois jusqu'à l'Allemagne ou la France. Cette route est exclusivement terrestre et dessert principalement les marchés d'Asie centrale, de Russie et d'Europe de l'Est. Toutefois, certaines saisies effectuées en Biélorussie, en Roumanie et en Ukraine suggèrent qu'une part de la marchandise est également destinée à l'Europe occidentale.
Une fois arrivée en Europe, l'héroïne transite majoritairement par les Pays-Bas, qui constituent l'un des principaux centres logistiques du trafic d'héroïne en Europe de l'Ouest. Les cargaisons, issues de différentes routes, y sont réceptionnées, stockées, puis redistribuées vers les principaux marchés de consommation du continent. Ce rôle central des Pays-Bas dans la chaîne de valeur du trafic d'héroïne s'explique notamment par la coopération étroite entre des réseaux criminels néerlandais et des organisations criminelles transnationales, en particulier des Balkans.
En France, le trafic d'héroïne est très atomisé et relativement diversifié : aux côtés des organisations criminelles étrangères, notamment turques, géorgiennes et albanaises, on observe de petites équipes issues de la périphérie des métropoles, qui s'approvisionnent principalement aux Pays-Bas. Le rôle des micro-réseaux d'usagers-revendeurs, qui s'approvisionnent aux Pays-Bas et en Belgique, est essentiel pour expliquer la disponibilité de l'héroïne en France, en particulier dans le nord-est du pays. Par ailleurs, les réseaux dits de « cités » sont de plus en plus impliqués dans le trafic d'héroïne ces dernières années. Leur implication contribue à l'expansion de la disponibilité de l'héroïne dans les périphéries de plusieurs agglomérations françaises.
Il est important de noter la production d'opium en Afghanistan a drastiquement baissé depuis 2023. Cette baisse résulte de l'interdiction totale de la culture du pavot à opium imposée par les Talibans en avril 2022. La mesure a pleinement pris effet pour la récolte de 2023, réduisant de 95 % la production d'opium dans le pays, qui est passée de 6 200 tonnes en 2022 à 333 tonnes en 2023. En 2024, une augmentation de 19 %, par rapport à 2023, de la surface cultivée a été rapportée, cependant cela reste très éloigné des niveaux de culture observés avant l'interdiction. Ce choc sur l'héroïne en destination de l'Europe occidentale a le potentiel de modifier dans le temps les routes et les pays d'approvisionnement des réseaux de trafics d'héroïne. En effet, la réduction de la production en Afghanistan pourrait être compensée, en partie, par une hausse de la production dans d'autres régions. La Birmanie, désormais premier producteur mondial d'opium, a vu sa production plus que doubler en deux ans, passant de 423 tonnes en 2021 à 1 080 tonnes en 2023.
B. Les routes des opioïdes de synthèse
Selon l'EUDA, la majorité des opioïdes synthétiques illicites disponibles sur le marché européen provient de pays situés en dehors de l'Union européenne. Les principaux pays sources identifiés sont la Chine, l'Inde et, dans une moindre mesure, la Russie. Bien qu'une production locale, incluant de nouveaux opioïdes de synthèse, puisse ponctuellement exister au sein de l'UE, elle demeure marginale par rapport à la fabrication d'autres drogues illicites. Des installations de découpe et de conditionnement de ces produits sont plus fréquemment détectées sur le territoire européen que des laboratoires de production.
La Chine étant le principal pays producteur, les changements de régulation locales tels que l'interdiction d'une molécule et/ou de ses précurseurs a un impact sur l'offre d'opioïdes de synthèse au niveau européen, et également national.
De manière générale, les chaînes d'approvisionnement en opioïdes de synthèse à destination de l'Europe ou circulant à travers celle-ci restent encore largement méconnues. Ces substances semblent souvent acheminées par voie postale, notamment à la suite d'achats effectués sur le dark web. En France, selon l'OFAST, des opioïdes de synthèse entrent sur le territoire par l'envoi de colis en provenance des États-Unis et de Chine, contenant généralement entre quelques dizaines et plusieurs centaines de grammes.
Le marché illicite des opioïdes de synthèse en Europe repose à la fois sur le détournement de médicaments opioïdes issus du circuit légal et les opioïdes de synthèses fabriqués clandestinement. Les médicaments initialement destinés à un usage thérapeutique peuvent être détournés à différents niveaux : dans la chaîne de distribution (chez les fabricants, grossistes ou pharmacies), dans les établissements de santé (hôpitaux ou professionnels corrompus), ou directement auprès des patients, par vol ou cession. Des produits médicaux contenant du fentanyl détournés du circuit légal sont fréquemment saisis en Europe sous forme de patchs, sprays ou pastilles.
En France, le trafic de médicaments opioïdes repose principalement sur le détournement de la buprénorphine (Subutex®), de la morphine (Skénan®) et de la méthadone. Selon le Commandement pour l'environnement et la santé (CESAN), l'approvisionnement de ce trafic repose sur le nomadisme médical et pharmaceutique, facilité par l'usage de fausses ordonnances obtenues sur les réseaux sociaux ou Internet, ainsi que sur des vols commis chez les grossistes.
2. Présentez les données les plus récentes collectées par l'OFDT concernant la consommation de médicaments opioïdes en France.
Les médicaments opioïdes (composés comprenant des substances naturelles ou synthétiques qui possèdent des actions similaires à celles de l'opium) sont le plus souvent utilisés pour leurs propriétés antalgiques et sédatives. La posologie de ces médicaments doit être scrupuleusement respectée afin d'éviter tout risque de surdosage et de dépendance. Il existe 11 types de composés comportant des substances opioïdes, divisés en trois familles de médicaments opioïdes :
- les médicaments à base de dérivés naturels de l'opium (ou opiacés) : codéine, morphine, opium ;
- les médicaments semi-synthétiques : buprénorphine, dihydrocodéine, hydromorphone, nalbuphine ;
- les médicaments contenant des composés synthétiques : fentanyl, méthadone, oxycodone, tramadol.
Depuis sa création en 1993, l'OFDT, observatoire public des drogues, est chargé de mesurer la consommation de drogues (licites ou illicites) en France par des enquêtes épidémiologiques qu'il conduit en propre et de suivre les données de consommation de produits utilisés à des fins psychoactives (incluant donc les médicaments détournés de leur usage ou consommés hors protocole médical, dans une perspective d'auto-médication). Cependant, l'OFDT ne pilote pas en propre des enquêtes sur la consommation de médicaments opioïdes en France. Cette mission appartient à l'ANSM, dans une démarche de surveillance globale de l'utilisation des médicaments utilisés dans la prise en charge de la douleur. Depuis 2013, l'enquête annuelle prospective Décès Toxiques par Antalgiques (DTA) de l'ANSM a pour objectif de recueillir les cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, d'identifier les médicaments impliqués, d'évaluer leur dangerosité et d'estimer l'évolution du nombre de ces décès.
- Évolution de l'usage des consommations par type d'opioïde et exposition de la population à la consommation d'antalgiques opioïdes (opioïdes forts et opioïdes faibles).
Selon les données de l'assurance maladie, près de 10 millions de Français ont eu une prescription d'antalgique opioïde en 2015. En 2017, les trois antalgiques opioïdes les plus consommés en France étaient le tramadol, puis la codéine en association, et la poudre d'opium associée au paracétamol, devant la morphine, premier antalgique opioïde fort, l'oxycodone, désormais autant consommé que la morphine, puis le fentanyl transdermique et transmuqueux à action rapide.
Selon le dernier état des lieux publié par l'ANSM (en 2019), la consommation d'antalgiques opioïdes a fortement augmenté en dix ans, ainsi que les situations de mésusage, les intoxications et les décès liés à l'utilisation d'antalgiques opioïdes, qu'ils soient faibles (par exemple tramadol, codéine et poudre d'opium) ou forts (par exemple morphine, oxycodone et fentanyl). Par exemple, la prescription d'opioïdes forts a augmenté d'environ 150 % entre 2006 et 2017, en particulier celle d'oxycodone qui marque l'augmentation la plus importante. À l'inverse, la consommation globale des opioïdes faibles est restée relativement stable. Depuis le retrait du dextropropoxyphène en 2011, une hausse de la consommation des autres opioïdes faibles a été observée, en particulier du tramadol qui est devenu l'antalgique opioïde le plus consommé (forts et faibles confondus) avec une hausse de plus de 68 % entre 2006 et 2017.
Malgré cet essor de la consommation de médicaments opioïdes, la situation est sans commune mesure avec celle observée aux États-Unis et au Canada.
- Prévalence des troubles de l'usage par type d'opioïde ; parmi ces consommateurs, quelle part relève d'un trouble né d'une consommation sur prescription médicale dans un cadre thérapeutique, et quelle part relève d'une consommation illicite.
Les antalgiques opioïdes les plus consommés (codéine, tramadol, poudre d'opium, sulfate de morphine, oxycodone, fentanyl transmuqueux et fentanyl transdermique), font l'objet d'une surveillance par les Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance (CEIP-A), réseau d'addictovigilance de l'ANSM, sur la base de plusieurs sources qui permettent de documenter l'usage problématique des antalgiques opioïdes :
- les notifications spontanées (NotS) de cas d'abus, de dépendance, d'usage détourné et de mésusage rapportées par les professionnels de santé,
- les enquêtes annuelles du réseau : OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse), OPEMA (Observation des Pharmacodépendances En Médecine Ambulatoire), OSIAP (Ordonnances suspectes - indicateurs d'abus possible), enquête soumission chimique),
- les enquêtes DRAMES, DTA et ASOS.
Le nombre de notifications spontanées de cas d'addictovigilance rapportées au réseau des CEIP-A augmente régulièrement pour la codéine en association (deuxième antalgique opioïde le plus consommé en France). Le trouble de l'usage de la codéine touche une population plutôt féminine (58 %) et l'âge moyen est de 40 ans.
- Évolution des hospitalisations et des décès dus à la consommation d'opioïdes.
Selon l'ANSM (2019), le nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale a augmenté de 167 % entre 2000 et 2017 passant de 15 à 40 hospitalisations pour un million d'habitants.
Le nombre de décès liés à la consommation d'opioïdes a augmenté de 146 % en quinze ans (2000-2015), occasionnant désormais au moins 4 décès par semaine. Selon les données les plus récentes de l'ANSM, 136 décès directement liés à consommation d'antalgiques opioïdes étaient recensés en 2022 (source : DTA). Les principales molécules impliquées sont le tramadol, la morphine, l'oxycodone, la codéine et le paracétamol (dont 6 sur 16 cas dans un contexte suicidaire). S'agissant du fentanyl qui focalise l'attention publique, en 2022, on recensait en France 5 décès qui lui seraient directement imputables (voir : https://ansm.sante.fr/uploads/2024/05/29/20 240 529-plaquette-dta-2022.pdf).
3. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des opioïdes en France ?
a. Quelles substances disponibles sur le marché français sont les plus concernées et sous quelle forme ?
Selon les observations du dispositif TREND de l'OFDT, la circulation des médicaments opioïdes consommés dans le cadre de mésusages repose majoritairement sur le troc et les échanges informels (« dépannage ») entre patients, sur le marché de rue. Les marchés de rue restent cantonnés à certaines agglomérations régionales et sont principalement animés par des patients/usagers-revendeurs qui y revendent une partie de leur traitement. Ces marchés de rue sont souvent intermittents et d'ampleur restreinte (à l'exception de Paris, où la revente est plus installée et quasi-permanente). Ils concernent le Tramadol®, la buprénorphine (Subutex®, généralement revendu entre 2 et 5 euros le comprimé de 8 mg) et la méthadone (revendue au prix courant de 5 euros la fiole de 60 mg, entre 3 et 5 euros la gélule de 40 mg). Les sulfates de morphine (Skénan®) font également l'objet de revente à Paris et dans certaines métropoles (au prix courant de 5 à 10 euros la gélule de 100 ou 200 mg). À noter que les contrôles des médecins prescrivant du Skénan® dans le cadre de traitement de substitution par l'assurance-maladie peuvent rapidement tarir ces marchés de rue (ce fut par exemple le cas ces dernières années à Lyon).
b. Quels sont les principaux mésusages constatés (de la part des professionnels de santé et des usagers) ?
La grande majorité des patients bénéficiant d'un traitement à base de médicaments opioïdes observe leur traitement. Certaines personnes ne respectent toutefois pas complètement le protocole thérapeutique défini par leur médecin. D'autres ne disposent pas de prescription et se procurent des médicaments opioïdes auprès d'autres patients sous traitement ou sur le marché noir.
Le « mésusage » des médicaments opioïdes peut revêtir plusieurs formes : dépassement des posologies, recours à d'autres voies d'administration (très principalement sniff et injection), association des médicaments avec d'autres substances (psychostimulant, alcool, héroïne, etc.) pour obtenir des effets spécifiques ou gérer les effets d'autres substances, etc. Ce type de « mésusages » est observé par le dispositif TREND depuis sa création, en1999, époque du développement des prescriptions de TSO.
Concernant les médicaments faisant l'objet d'usages hors protocole thérapeutique, les observations de l'OFDT via TREND pointent les tendances récentes s'agissant des modalités de ce mésusage :
- L'injection de gélules de méthadone, pratique marginale, reste régulièrement citée par les professionnels de certains CAARUD. Elle est le fait d'usagers (peu nombreux) en situation de grande précarité dont une part importante est originaire du Caucase ou de l'est de l'Europe. L'injection de la forme sirop n'est presque plus observée ces dernières années (à mesure que la forme gélule est davantage prescrite) ;
- L'injection de comprimés de buprénorphine (Subutex®) est de moins en moins observée. Elle serait le fait d'usagers précaires et vieillissants, et concernerait très peu de nouveaux consommateurs (le syndrome des « mains de Popeye », résultant de l'injection du médicament, est plus rare que dans les années 2000 selon les soignants) ;
- L'injection de sulfates de morphine (Skénan®) est bien identifiée à Paris et observée de manière plus ou moins pérenne sur certains autres territoires, majoritairement auprès d'usagers en situation de précarité, dont la plupart consomment ainsi une partie de leur traitement ;
- Les pratiques d'injection de fentanyl, à partir des patchs, restent toujours très marginales et circonscrites à des personnes, principalement d'origine géorgienne en situation de grande précarité ;
- L'usage de sirops codéinés (mélangés à un soda - mélange appelé lean ou purple drank - et ingéré) par des adolescents ou de jeunes adultes à a très fortement décliné après la restriction des modalités de délivrance en juillet 2017 (accessibilité limitée aux détendeurs d'une ordonnance depuis cette date) ;
- L'usage de Tramadol® concerne des personnes aux profils variés : alors que certains patients ont progressivement perdu le contrôle et consomment des doses excédant largement les posologies initialement prescrites (étant, pour certains, contraints alors de se livrer au nomadisme médical ou de se procurer du Tramadol® auprès d'autres patients ou au marché noir), d'autres y ont recours pour réguler les effets jugés trop intenses de psychostimulants comme la cocaïne.
c. Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
Les niveaux et les modalités de prescription et de délivrance des différents médicaments opioïdes déterminent en partie leur disponibilité (sur les marchés de rue, après d'usagers revendeurs, etc.) et donc l'ampleur des usages « détournés ». Ainsi, la hausse des prescriptions et de la délivrance de méthadone sous forme de gélule contribue pour partie à expliquer l'existence d'usages détournés, davantage rapportés par les intervenants des CAARUD et les usagers ces dernières années. Il n'en demeure pas moins que la grande majorité des patients sous traitements à base de médicaments opioïdes respectent scrupuleusement leur traitement et ne le détournent pas.
4. Comment l'OFDT appréhende-t-il le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ?
Certains éléments rendent-ils aujourd'hui plausible, selon vous, une importation de la crise américaine des opioïdes ?
Dans un contexte de diminution de l'offre d'héroïne en Europe consécutive à l'interdiction de la production d'opium en Afghanistan, la circulation de nouveaux opioïdes de synthèse sur les marchés illicites apparaît comme une menace de santé publique émergente. Dans son rapport 2024 (publié en mars 2025), l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) souligne à quel point les drogues de synthèse transforment rapidement le commerce mondial de la drogue, alimentant une crise de santé publique croissante. Contrairement aux drogues à base de plantes, ces substances peuvent être fabriquées n'importe où, sans qu'il soit nécessaire de les cultiver à grande échelle, ce qui les rend plus faciles et moins chères à produire et à distribuer pour les trafiquants. L'essor d'opioïdes puissants comme le fentanyl (en Amérique du Nord) et les nitazènes (en Europe) - suffisamment puissants pour provoquer des overdoses avec de minuscules doses - a aggravé la crise, entraînant un nombre record de décès.
Si la présence de fentanyl est rarement rapportée en France et en Europe, alors même que ce produit est majoritairement impliqué dans la crise des opioïdes en Amérique du Nord, d'autres opioïdes de synthèse pouvant servir d'alternative à l'héroïne sont apparus en France, en particulier les nitazènes, une catégorie d'opioïdes de synthèse très puissants, présentant un risque élevé d'overdose en raison d'une puissance pharmacologique élevée. Certaines de ces molécules ont été à l'origine développées par l'industrie pharmaceutique en traitement de la douleur, mais elles n'ont jamais été autorisées en raison du risque trop élevé d'overdose. Les nitazènes sont notamment vendus sous la forme de poudre et de comprimés (parfois associés à des benzodiazépines).
La première identification nationale de nitazènes, effectuée par le dispositif SINTES de l'OFDT, date de 2021. Il s'agissait alors d'un échantillon d'héroïne, supposé acheté sur le Darknet, contenait un NPS opioïde de synthèse, l'étonitazepyne. La même année, une deuxième identification de métodesnitazène a été réalisée dans le cadre d'une saisie puis une troisième en 2022 (premier cas français d'usage de métonitazène). En 2023, plusieurs dérivés benzimidazolés ont été identifiés de façon isolée ou dans le cadre de clusters d'intoxications aiguës (voire fatales). En 2023, des produits contenant des nitazènes ont fait l'objet de deux alertes sanitaires de la part de l'OFDT auprès de l'Early Warning System de l'EUDA : la première concernait de l'isotonitazène vendu en tant qu'héroïne à Montpellier (5 cas d'intoxication en mars 2023) ; le second concernait la circulation de protonitazène à La Réunion, vendu en tant que « chimique » (tabac imbibé d'alcool et mélangé à une poudre contenant habituellement des cannabinoïdes de synthèse).
Les nitazènes sont désormais placés sous surveillance intensive dans le cadre de l'Early Warning System de l'EUDA. En France, l'ANSM a, en juillet 2024, classé comme stupéfiants les substances appartenant à la famille chimique des benzimidazolés, dite des nitazènes. La dernière génération de nitazènes, les nitazènes N-désalkylés, ont été classés d'emblée comme stupéfiants au niveau national car contenant le noyau benzimidazole.
La perspective d'arrivée de nouveaux agonistes opioïdes inquiète la communauté scientifique, avec l'arrivée d'analogues de la brorphine (dérivés benzimadozolones piperidine), qui sont déjà identifiés aux États-Unis. Une 1re identification de cychlorphine a été réalisée par le dispositif SINTES de l'OFDT en France en 2024 (produit non reconnu en drug checking). Même si leur circulation est encore limitée en Europe, ils sont désormais détectés en France, occasionnant une offre potentiellement en essor qui reste donc à surveiller. En outre, l'Europe connaît actuellement la circulation de comprimés contrefaits d'oxycodone. Les analyses de l'OFDT (SINTES) ont conduit à l'identification de plusieurs substances en lieu et place de cet opioïde, telles que des nitazènes, parfois en association avec des NPS benzodiazépines (benzodiazepines designers). Les réseaux TREND et SINTES de l'OFDT sont mobilisés et en veille active sur ce type de produit, et plus généralement sur les opioïdes de synthèse.
À noter que les risques occasionnés par le marché des nouveaux opioïdes de synthèse tiennent au fait qu'ils sont souvent consommés à l'insu des consommateurs, qui pensent souvent acheter sur le marché de détail de l'héroïne.
Une des conséquences de la baisse de la production mondiale d'héroïne a été de réduire la disponibilité de l'héroïne en Europe, provoquant une situation de pénurie, allant de pair avec une hausse du prix et d'une baisse des teneurs moyennes en principe actif de l'héroïne vendue sur le marché de détail. En outre, de plus en plus souvent, l'héroïne est adultérée avec des opioïdes de synthèse (ou des cannabinoïdes de synthèse), donnant lieu à des vagues d'incidents sanitaires, sporadiques et circonscrites territorialement, mais aux conséquences parfois particulièrement graves. Ainsi, en 2023, 14 % des échantillons d'héroïne supposée collectés par le dispositif SINTES de l'OFDT ne contenaient pas d'héroïne. Des non-conformités inédites ont été observées, comme l'adultération du produit voire son remplacement par un nouvel opioïde de synthèse. Aujourd'hui, l'héroïne disponible sur le marché de détail est souvent adultérée. À ce stade, aucune adultération à la xylazine (sédatif à usage vétérinaire), au fentanyl ou aux benzodiazépines n'a été mise en évidence par le dispositif SINTES de l'OFDT. Selon l'ONUDC, la restructuration du marché de l'héroïne consécutive à la baisse de sa production mondiale devrait se déployer dans un délai de deux ans, ce qui suggère des effets différés sur plusieurs années, pleinement observables à compter de 2024-2025.
5. Quels enseignements la France peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et de politique de réduction des risques ?
L'épidémie des opioïdes qui fait rage aux États-Unis depuis la fin des années 1990 s'est déployée en quatre vagues, occasionnant plus de 800 000 décès directement attribuables aux opioïdes en 25 ans. L'épidémie a d'abord été liée à la consommation d'opioïdes prescrits comme médicaments (1999-2010), puis à l'héroïne (2011-2015), au fentanyl (2016-2020) et, plus récemment, à la consommation conjointe de fentanyl et de stimulants illicites (2020-2025)337(*). Aujourd'hui, la consommation d'opioïdes de synthèse, en particulier le fentanyl et ses dérivés, combinée aux drogues stimulantes (cocaïne et amphétamines), représente le fer de lance de l'épidémie.
L'analyse de la crise des opioïdes aux États-Unis permet de tirer des enseignements utiles. Avant tout, il faut souligner que cette crise s'inscrit dans le contexte d'une demande croissante des patients pour soulager la douleur, aiguë ou chronique, demande prégnante aux États-Unis tout comme en France. Les opioïdes ayant comme propriété principale d'être des analgésiques puissants, l'accessibilité de ces produits constitue un des ressorts explicatifs de cette crise. À cet égard, il faut pointer les différences majeures de contexte entre la France, où le circuit de mise sur le marché et de surveillance des médicaments est très contrôlé, et les États-Unis, où la promotion et la publicité sur les médicaments à l'intention du grand public sont autorisées.
Aux États-Unis, trois phénomènes concomitants ont contribué à la survenue d'une crise des opioïdes d'une telle ampleur. Tout d'abord, l'utilisation accrue des analgésiques opioïdes aux États-Unis a été le fait de prescriptions médicales excessives et inadéquates, favorisées par la circulation de publications minimisant le risque de dépendance lié aux opioïdes - à l'image de l'article paru dans la revue médicale New England Journal of Medicine, prétendant démontrer l'absence de risque de développer une dépendance en cas de prise au long cours d'un opioïde analgésique alors qu'il ne s'agissait que d'une étude observationnelle de faible portée, portant sur un petit effectif de patients, sans valeur de démonstration ni validation externe. Deuxièmement, le recours à la prescription large de ces médicaments a été porté par des stratégies de marketing agressif déployées par certains laboratoires pharmaceutiques, notamment Purdue Pharma, qui faisait la promotion de son produit à base d'oxycodone auprès des médecins, pharmaciens et patients, contribuant à l'essor rapide des prescriptions inadéquates d'opioïdes analgésiques. Enfin, l'absence de contrôle strict des prescriptions médicales par les autorités sanitaires fédérales a fait perdurer ce phénomène de sur-prescription non-contrôlée jusqu'en 2010, date de décision de retrait du marché de l'oxycodone du laboratoire Purdue Pharma, qui était alors devenu la principale cause de décès par surdose aux opioïdes aux États-Unis.
Après le retrait du marché de l'oxycodone de Purdue Pharma et son remplacement par une formulation à libération retardée ne pouvant être pilée (et transformée en poudre pour être injectée), les patients, devenus dépendants, se sont déportés d'abord vers l'héroïne, puis vers le fentanyl (produit à moindre coût dans des laboratoires de synthèse principalement au Mexique, à partir de matières premières importées de Chine ou d'Inde). L'offre de fentanyl et de ses dérivés s'est démultipliée avec l'arrivée sur le marché illicite de puissants analogues du fentanyl, synthétisés au départ comme de possibles candidats-médicaments par l'industrie pharmaceutique, sont alors devenus les principaux opioïdes sources des décès et de l'accélération de la crise de morts aux États-Unis. Ainsi, malgré une baisse rapide de la consommation d'opioïdes obtenus sur prescription à partir de 2010, les décès par surdose ont continué à augmenter et à s'amplifier jusqu'en 2024.
Ces constats invitent à considérer la nécessité d'améliorer la prise en charge de la douleur, constituée comme une priorité de santé publique en France, au regard des enjeux de contrôle de l'essor des prescriptions d'antidouleurs opioïdes. La littérature scientifique pointe l'intérêt des mesures permettant de contrôler les conditions de prescription, voire de délivrance, des médicaments opioïdes, et de favoriser le bon usage des antidouleurs opioïdes sans pour autant priver les patients qui en ont besoin d'un accès satisfaisant aux traitements de lutte contre la douleur : renforcement des circuits de surveillance du médicament, ordonnances sécurisées et contrôles renforcés, mise en place d'une observation nationale et d'un monitoring systématique.
6. Quelles mesures pourraient-elles, en France, contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène et, plus largement, à circonscrire les mésusages et risques de dépendance observés ?
L'OFDT n'a pas de rôle de recommandation aux pouvoirs publics. Ce rôle échoit à l'ANSM s'agissant de mésusage de médicaments.
7. Décrivez les dispositifs de surveillance et d'alerte pilotés par l'OFDT.
Quelles actions permettraient-elles d'améliorer la connaissance de la prévalence des usages problématiques d'opioïdes ? Plus largement, le système de surveillance et d'alerte mériterait-il d'être renforcé ?
Les dispositifs de détection précoce et d'identification des phénomènes émergents de l'OFDT - TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) et SINTES (système national d'identification des toxiques et des substances) -contribuent depuis 1999 à la veille sanitaire et à l'information des décideurs publics en temps réel quant aux tendances nouvelles de consommation et aux situations à risque en matière de produits psychoactifs. Ces deux dispositifs assurent une remontée d'informations en continu grâce à une coordination nationale pour chaque dispositif, qui s'appuie sur des coordinateurs locaux qui recueillent des informations directes auprès des usagers de drogues et des professionnels à leur contact, ainsi que des échantillons de substances (faisant ensuite l'objet d'une analyse toxicologique). La remontée et la triangulation de ces informations localisées contribue à comprendre les dynamiques d'offre et de consommation en France, ainsi que les spécificités territoriales.
En termes de fonctionnement
- Le dispositif TREND s'appuie sur un réseau de coordinations implantées dans 9 métropoles régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse, La Réunion), qui mettent en oeuvre des méthodes qualitatives communes (observations, entretiens) pour repérer et documenter les phénomènes émergents et les évolutions en matière de drogues illicites et de médicaments consommés hors protocole médical. Ces coordinations recueillent leurs informations auprès d'acteurs divers (usagers, intervenants du secteur socio-sanitaire et de l'application de la loi, etc.) dont l'ancrage local contribue à la compréhension des spécificités territoriales. Deux espaces particulièrement concernés par les usages de produits psychoactifs sont investigués : l'espace de la marginalité urbaine (rues, squats, zones de deal, etc.) et l'espace festif techno regroupant la scène alternative (free parties) et commerciale (clubs, bars, festivals).
- En complément, le dispositif SINTES, outil d'observation de la composition des produits psychoactifs illicites et outil de veille sanitaire au niveau national et européen, s'appuie sur un réseau de 17 coordinations locales portées par autant de structures partenaires en addictologie regroupant plusieurs centaines de collecteurs. En lien avec une série de laboratoires d'analyse toxicologique, il assure la veille de la composition des produits psychoactifs collectés auprès d'usagers de substances, permettant d'identifier des nouvelles substances et de suivre leur diffusion sur le territoire national, en lien permanent avec le réseau national d'addictovigilance et le CORRUSS. En tant que point focal français pour l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (European Union Drugs Agency, EUDA), l'OFDT concourt, à travers SINTES, à la remontée à l'Agence européenne des drogues des informations concernant les nouvelles substances psychoactives, via l'Early warning system (EWS) sur les NPS et l'European Drug Alert System (EDAS) sur les menaces émergentes.
Parmi les thématiques prioritaires explorées par TREND et SINTES, un socle commun s'intéresse à l'usage et à l'offre d'héroïne, d'opioïdes et à l'accès à la RdRD et aux soins (donc aux traitements de substitution). Au titre de SINTES, la détection et l'identification des NPS constituent un enjeu stratégique de l'anticipation de l'arrivée des nouveaux agonistes opioïdes. La plus-value du dispositif SINTES est de garantir dans la durée la capacité à pouvoir détecter rapidement des opioïdes de synthèse, dont les structures chimiques sont de plus en plus diversifiées, et aux propriétés pharmacologiques encore méconnues.
Malgré leur intérêt reconnu, et le soutien financier conjoint de certaines agences régionales de santé (ARS) et du fonds national de lutte contre les addictions (FLCA), ces deux dispositifs rencontrent toutefois des difficultés pour bénéficier de financements pérennes. Ainsi, les financements actuels ne permettent pas de couvrir l'ensemble du territoire français (le dispositif
TREND n'étant pas implanté dans toutes les régions) et certaines zones (rurales, etc.) comme certains sujets (dont celui des opioïdes), mériteraient des investigations approfondies.
Encadrement de la prescription et de la délivrance d'opioïdes et prévention des mésusages
8. L'encadrement actuel de la prescription d'opioïdes en France vous paraît-il concilier un bon équilibre entre le contrôle et la prévention des mésusages d'une part, et la garantie d'avoir accès aux antalgiques opioïdes pour les usagers qui le nécessitent d'autre part ? Quelles évolutions préconiseriez-vous pour garantir ou améliorer cet équilibre ?
Voir réponse à la question n° 15 concernant l'accès aux TAO.
9. Quel regard portez-vous sur l'obligation, récemment instaurée, de présenter une ordonnance sécurisée en vue de la délivrance de tramadol et de codéine ?
En France, depuis le 1er mars 2025, les médicaments contenant de la codéine, de la dihydrocodéine ou du tramadol doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée. Si cette mesure, récente, n'a pas encore été évaluée, les observations TREND de l'OFDT soulignent qu'elle pourrait avoir pour effet de diminuer, au moins dans un premier temps, la disponibilité de ces médicaments détournés sur les marchés de rue, contribuant à l'objectif attendu de diminuer les usages détournés. Cependant, cette mesure est susceptible d'engendrer plusieurs conséquences inattendues, en favorisant par exemple le développement de nouvelles filières d'approvisionnement des marchés noirs, soit via l'importation illégale de médicaments détournés en provenance de pays étrangers, soit via la fabrication clandestine et l'importation de substances de synthèse (via le darknet). Au prisme des observations récentes du dispositif TREND de l'OFDT pour une autre substance médicamenteuse, la prégabaline (Lyrica®), il s'avère que la restriction des modalités de prescription et de délivrance ne constitue donc pas une garantie suffisante pour que les usages détournés diminuent de manière significative et durable. Par ailleurs, la restriction des modalités de délivrance de la codéine et du tramadol du fait de la mise en place des ordonnances sécurisées présente le risque de compliquer l'accès à ces médicaments pour des personnes qui, du fait de leur situation de précarité (sociale, administrative, etc.), sont éloignées des dispositifs de soins et de la médecine de ville.
10. Estimez-vous que le conditionnement des opioïdes soit aujourd'hui adapté aux risques de mésusage constatés ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation qui, sur ce type de questionnement, relève davantage des agences sanitaires.
11. La formation des professionnels de santé souffre-t-elle de carences concernant les usages et les effets des opioïdes, ainsi que leur connaissance des recommandations de bonnes pratiques ? Quelles recommandations pourriez-vous formuler à ce propos ?
La coordination entre les différents acteurs (Csapa, Caarud, médecine de ville, structures hospitalières, etc.) vous paraît-elle satisfaisante pour offrir un parcours de soins intégré, structuré et cohérent aux usagers d'opioïdes ? Sinon, comment cette coordination pourrait-elle être améliorée ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation. Ses dispositifs d'information et d'enquête permettent néanmoins de souligner les difficultés rencontrées par les usagers d'opioïdes dans leurs parcours de soins, du fait de l'absence de médecins généralistes en nombre suffisant dans certains territoires (cf. observations TREND). Cette sous-couverture a pour effet d'emboliser la file active des CSAPA, car les patients stabilisés dans leur traitement à base de méthadone ne trouvent pas de relais en médecine de ville. Elle a également pour effet d'allonger la durée d'attente d'un rendez-vous d'initialisation à un traitement à base de méthadone dans un centre de soins.
12. Estimez-vous que la communication autour des risques de mésusage et de dépendance liés à la consommation d'opioïdes soit aujourd'hui suffisante ? Estimez-vous qu'il serait opportun d'imposer un étiquetage intégrant une mention d'alerte sur les boîtes de médicaments opioïdes afin d'avertir du risque de mésusage et de dépendance associé ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation, qui reviendrait plutôt à la MILDECA sur ce type d'enjeu.
Sur l'accompagnement des usagers et les politiques en matière de réduction des risques
13. Au global, comment évaluez-vous la politique de réduction des risques en France ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation.
14. Comment évaluez-vous l'efficacité des programmes de distribution de matériel de prévention (comme les seringues stériles) dans la réduction des risques liés à l'usage d'opioïdes ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation. On peut néanmoins souligner, sur la base des données scientifiques, la difficulté d'accéder à la réduction des risques en milieu carcéral.
15. Quel regard portez-vous sur les conditions d'accès à la naloxone et aux TSO en France ? Vous paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées et si oui, comment ?
En France, l'accès aux TSO, ou TAO (traitements par agonistes opioïdes, terme qui remplace progressivement celui de TSO),
Au regard des observations du dispositif TREND de l'OFDT, l'accès à un traitement à base de BHD (Subutex®) apparaît comme relativement satisfaisant du point de vue des patients, du fait de modalités de délivrance relativement aisées en France. En revanche, l'accès à un traitement à base de méthadone se caractérise par des inégalités territoriales importantes. Au sein des métropoles régionales (et de certaines villes de taille plus restreinte), des CSAPA permettent certes contribuer à initier ce type de traitement mais les délais d'attente sont parfois de plusieurs mois. De ce fait, certaines personnes continuent de se fournir en méthadone sur le marché de rue ou auprès de leurs proches (amis, conjoint, connaissances) dans l'attente d'un rendez-vous. De même, l'accès à des dispositifs proposant des protocoles d'inclusion à « bas seuil d'exigence » (comme les « bus méthadone » à Marseille ou à Paris), permettant un accès facilité aux TAO, font défaut sur certains territoires urbains. Ces protocoles s'adressent à des personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent pas immédiatement devenir abstinentes à l'héroïne et sont souvent en situation de grande précarité sociale et sanitaire. Ils visent la réduction des dommages et la diminution de l'usage d'héroïne et de morphine en proposant un cadre thérapeutique souple (accès rapide et simplifié aux traitements, délivrance quotidienne et sans rendez-vous, etc.) adapté aux conditions de vie caractérisées par la grande précarité.
Dans les territoires ruraux ou éloignés des métropoles, l'accès aux TAO (Subutex® et méthadone) reste particulièrement difficile, du fait de plusieurs facteurs qui se cumulent : manque de structures de soins en addictologie (permettant l'initialisation d'un traitement à base de méthadone), manque de médecins généralistes (primo-prescripteurs de traitements à base de Subutex® ou autorisant un relais vers la méthadone), problèmes de mobilité rencontrés par de nombreux usagers (absence transports en commun, de véhicule personnel, de permis de conduire, etc.). Ces difficultés contraignent parfois les intervenants des structures à véhiculer les usagers de drogues. Dans certaines zones rurales, ces difficultés d'accès aux TAO sont d'autant plus conséquentes que leurs habitants peuvent aisément accéder aux drogues illicites (héroïne, cocaïne, etc.), les réseaux de trafiquants leur proposant souvent des livraisons à domicile, dans une démarche d'incitation à la consommation et de maintien de leurs clientèles. De même, dans les zones éloignées des métropoles, des difficultés d'accès à du matériel stérile de consommation persistent, malgré l'essor du dispositif de RdRD à distance (envoi de matériel par voie postale).
Selon les professionnels des CSAPA et des CAARUD interrogés par le dispositif TREND de l'OFDT, l'amélioration de l'accès aux TAO pourrait passer par le développement de dispositifs proposant des inclusions à bas seuil d'exigence dans les métropoles qui en sont dépourvues, et par le renforcement de la présence sur les territoires ruraux des centres de soins et des médecins autorisés à prescrire de la méthadone.
Concernant l'accès à la naloxone, en 2023, trois spécialités de naloxone étaient disponibles en France : le Prenoxad®, le Nyxoid® et le Ventizolve®. L'accès à la naloxone s'est développé au regard de la hausse des commandes de naloxone des pharmacies, hôpitaux et CSAPA/CAARUD (+ 40 % entre 2021 et 2023), passant de 18 132 à 29 676 kits de naloxone prêts à l'emploi commandés. Ces chiffres témoignent de l'amélioration de la disponibilité de la naloxone. Il existe néanmoins une difficulté d'évaluation de la distribution effective de ces kits et du nombre de kits réellement utilisés.
Quel est, selon vous, l'impact des dispositifs de réduction des risques, tels que les Csapa et les Caarud, dans la prise en charge des usagers d'opioïdes en France ?
Le suivi des patients accueillis en CSAPA assuré par le dispositif RECAP de l'OFDT montre que 33 000 personnes ont été prises en charge en CSAPA au titre de leur consommation d'héroïne (en 2022). L'héroïne constitue le deuxième motif de prise en charge en CSAPA (représentant environ 10 % des patients de la file active), loin derrière la consommation d'alcool. En outre, la méthadone et la buprénorphine haut dosage occasionnent 2 % des recours en CSAPA.
En termes d'évolutions récentes, la source RECAP de l'OFDT montre la baisse de la part d'injecteurs parmi les nouveaux patients pris en charge pour un usage d'héroïne (17 % vs 22 % chez les patients en suivi continu). Elle souligne également la stabilité des modes de consommation : l'héroïne est le plus souvent sniffée (57 %), fumée/inhalée (25 %), et parfois injectée (17 % des patients). Enfin, elle met en lumière la fréquence et l'ancienneté de la consommation déclarées par les usagers d'héroïne : près des trois quarts de ces patients (72 %) consomment de l'héroïne tous les jours et la quasi-totalité (79 %) a commencé il y a 10 ans ou plus.
Souvent adossés aux CSAPA au sein du dispositif médico-social, les CAARUD demeurent la principale « porte d'entrée » vers la réduction des risques (accès à du matériel stérile de consommation, dépistage des IST, accès à consultations médicales et des prestations sociales, etc.) pour un très grand nombre d'usagers en situation de grande précarité qui ne pourraient pas trouver d'accueil équivalent ailleurs (notamment du fait de la stigmatisation dont ils font l'objet, de leurs difficultés d'adaptation au fonctionnement des administrations et des structures sanitaires existantes).
17. Quel regard portez-vous sur l'expérimentation des haltes soins addictions ? Préconiseriez-vous l'inscription de ces structures dans le droit commun, et l'ouverture d'autres sites ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation. Néanmoins, son rôle est de relayer les données probantes issues de la littérature scientifique internationale. À ce titre, il convient de souligner que les bénéfices des salles de consommation supervisée (appelées en France HSA) ont été évalués et démontrés dans une abondante documentation (Hedrich et al., 2010 ; Potier et al., 2014 ; EUDA, 2018338(*)).
L'intérêt de telles structures de consommation de drogues est démontré, d'abord, du point de vue du lien social et institutionnel qu'elles permettent avec des populations-cibles fortement marginalisées (occasion d'un premier contact et de maintien de ce contact), allant de pair avec des améliorations immédiates en termes d'hygiène et de sécurité des usagers de drogues (par ex. Small et al., 2008, 2009 ; Lloyd-Smith et al., 2009). L'efficacité des salles de consommation supervisée est aussi pointée en termes de santé et d'ordre public. Ainsi les travaux de recherche démontrent-ils l'existence d'un lien entre la fréquentation d'une salle de consommation de drogues et la réduction des comportements à risque liés à l'injection, comme l'échange de seringues. Accéder à une salle de consommation supervisée réduit aussi les comportements à risque en matière de transmission du VIH et de mortalité par surdose (par ex., Stoltz et al., 2007 ; Milloy and Wood, 2009). Il faut rappeler toutefois que l'impact des salles de consommation de drogues sur la réduction de l'incidence du VIH ou du virus de l'hépatite C dans la population des usagers de drogues par voie intraveineuse reste difficile à appréhender (Hedrich et al., 2010 ; Kimber et al., 2010), d'abord parce que les structures n'atteignent qu'une partie limitée de leur population-cible mais aussi parce que la méthodologie ne permet pas d'isoler cet impact des effets des autres types d'interventions. Enfin, une série d'études montrent que les salles de consommation de drogues peuvent contribuer à la réduction des décès liés à l'usage de drogues à l'échelle d'une ville (Poschadel et al., 2003 ; Marshall et al., 2011). En outre, la fréquentation d'une salle de consommation est associée à une hausse des entrées dans un parcours de soins contre la dépendance aux drogues, et une hausse des demandes de traitement de substitution aux opiacés (Wood et al., 2007 ; DeBeck et al., 2011).
En France, les différentes évaluations menées sur les HSA expérimentées depuis 2016 ont souligné leur efficacité en termes de santé publique et de tranquillité urbaine (rapport INSERM de 2021, rapport IGA-IGAS de 2024) : réduction significative des risques de contamination par le VIH et par l'hépatite C ; réduction des nuisances publiques (ainsi par exemple, le nombre de seringues collectées autour de la HSA parisienne est passé de 150 à moins de 10 par jour) ; amélioration de l'accès aux soins (hausse des orientations vers des traitements adaptés, hausse du nombre de consultations médicales et sociales) ; maintien du lien social avec un public très précarisé et socialement désaffilié (incluant 79 % de sans-abri, 49 % sans couverture sociale, 65 % sans ressources).
En somme, cette offre sanitaire et sociale spécifique permet d'atteindre des publics particulièrement précaires et difficiles à toucher par des dispositifs de droit commun. Comme le souligne le dispositif TREND de l'OFDT, les consommations de drogues, particulièrement en injection, aggravent les dommages sanitaires induits (absence de filtration, abcès, « poussières », surdoses, etc.) dès lors qu'elles sont effectuées dans des lieux inappropriés (rue, toilettes publiques, halls d'immeubles, souterrains, etc.) et/ou dans des conditions délétères (conditions d'hygiène insuffisantes, pas d'accès à l'eau, dans la précipitation, etc.).
18. Quelles actions supplémentaires ou améliorations préconisez-vous pour renforcer la politique de réduction des risques en matière d'opioïdes et mieux répondre aux besoins des usagers ?
L'OFDT n'a pas de rôle d'évaluation des politiques publiques ou de recommandation.
AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS
___________
1. Quelles ont été les premières manifestations de la crise des opioïdes aux États-Unis, et comment les autorités ont-elles pris conscience de l'ampleur du phénomène ?
Les premiers signes d'une consommation abusive d'opioïdes sont apparus au début des années 2000, notamment dans des communautés défavorisées de la ceinture appalachienne. Ces communautés locales ont alerté les autorités fédérales en nombre croissant permettant une prise de conscience progressive. Les statistiques reflétent une augmentation des surdoses liées aux analgésiques opioïdes dès 1999-2000. Les premiers rapports nationaux significatifs des CDC sont publiés en 2003. Il faut cependant attendre 2011 pour que l'Office of national Drug Control Policy (ONDCP) parle enfin de "crise de santé publique".
2. Pouvez-vous décrire les différentes phases de la crise des opioïdes aux États-Unis, en mettant en évidence l'évolution de la consommation d'opioïdes prescrits, l'émergence du fentanyl et l'augmentation des surdoses ?
On distingue trois phases de la crise des opioïdes aux États-Unis.
La première phase a débuté à la fin des années 90 avec une augmentation des décès liés à des prescriptions d'opioïdes.
La seconde phase a débuté dans les années 2000 avec une augmentation des décès liés à la consommation d'héroïne.
La troisième phase a débuté en 2013 avec l'augmentation des décès liés à la consommation d'opioïdes de synthèse, notamment le fentanyl.
Les données publiées par la Drug Enforcement Administration (DEA) confirment l'évolution de la crise des addictions aux États-Unis : les utilisateurs ont d'abord été très dépendants aux analgésiques sur ordonnance, puis se sont tournés vers des drogues de rue moins chères et plus facilement disponibles (fentanyl et héroïne) après que 39 États ont eu adopté des lois et des règlements limitant la prescription ou la délivrance d'opioïdes.
Le nombre d'analgésiques opioïdes délivrés sur ordonnance aux États-Unis a chuté d'environ 45 % entre 2011 et 2019 (7,1 milliards de pilules), alors même que les surdoses mortelles atteignaient des niveaux record (110 000 morts en 2022 selon les Centers for Diseases Control).
Les surdoses mortelles dues au fentanyl illicite ont augmenté de 94 % entre 2019 et 2021 et sont alors devenues la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 49 ans.
3. Quels sont les principaux facteurs qui ont conduit à l'augmentation de la consommation des opioïdes aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les pratiques de prescription et la distribution des médicaments ?
Plusieurs explications peuvent être avancées à la surprescription de ces médicaments (quelques 780 millions d'antidouleurs ont été vendus en Virginie occidentale entre 2007 et 2012, soir 433 pilules par habitant) :
- un mouvement social et médical de lutte contre la douleur qui a été en partie subventionné à dessein par les laboratoires pharmaceutiques ;
- la libéralisation de la prescription des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non liée au cancer ;
- les campagnes marketing des industries pharmaceutiques qui ont modifié l'attitude des médecins.
Ces facteurs expliquent en grande partie la légèreté de nombreux médecins : en 2014, 99 % d'entre eux prescrivaient des médicaments opioïdes hautement addictifs pour une durée supérieure aux trois jours recommandés par les CDC, selon les chiffres du National Safety Council, organisation spécialisée dans la sécurité sanitaire. Près du quart (23 %) déclarait même prescrire à leurs patients au moins un mois d'opioïdes, alors que le NSC avançait des preuves que des prescriptions supérieures à trente jours impactent le cerveau de manière irréversible.
À cette légèreté s'ajoute la manipulation de nombreux médecins, pharmaciens et infirmières par des laboratoires pharmaceutiques pour doper les ventes. Par exemple, Insys Therapeutics, dont le fondateur a été poursuivi par la justice américaine pour escroquerie, a été l'un des premiers bénéficiaires de l'épidémie. Son Subsys, un spray sublingal à base de fentanyl, a été autorisé par la FDA en 2012. Malgré son coût (un mois de traitement coûtait jusqu'à 20 000 dollars), Le médicament a rencontré un succès immédiat : les ventes ont connu un pic à 330 millions de dollars en 2015, avec une marge supérieure à 90 %. L'enquête a montré que pour convaincre les médecins d'inscrire ce médicament dans leurs ordonnances, alors que la majorité des prescriptions ont bénéficié à des patients qui ne souffraient pas de cancer, Insys versait des dessous de table ou les rémunéraient généreusement pour des interventions dans des conférences. En 2013, un neurologue du Michigan a rédigé des prescriptions de Subsys pour un coût de 6,4 millions de dollars à Medicare (l'assurance-santé publique pour les plus de 65 ans), faisant de lui le premier prescripteur du pays. Certains réseaux de pharmaciens ayant refusé de délivrer du Subsys s'il n'est pas prescrit à des patients atteints de cancer, sous la pression de la direction de l'entreprise, des commerciaux se sont fait passer pour des médecins, afin de déclarer que les patients en question avaient bien un cancer, bien que cela soit faux.
La journaliste Beth Macy a remarquablement décrit les mécanismes de manipulation des prescripteurs en milieu rural dans son ouvrage Dopesick (Dealers, Doctors and the Drug company that addicted America) publié en 2018 (voir également la mini-série fictionnelle éponyme de 2021 avec Michael Keaton dans le rôle d'un généraliste de Virginie occidentale).
Dans leur ouvrage Deaths of despair publié en 2021, les universitaires Anne Case et Angus Deaton délivrent une analyse sociologique liant cette épidémie à celles de l'alcoolisme et du suicide qui ont particulièrement impacté la communauté blanche américaine défavorisée.
4. Comment les États-Unis ont-ils réagi (initialement) face à cette crise ? Quels mécanismes ont-ils été mis en place pour garantir un meilleur contrôle de la prescription des opioïdes et limiter leur distribution abusive ? Quels sont les principaux défis rencontrés par les autorités sanitaires américaines pour gérer cette crise, et comment les politiques de santé publique ont-elles évolué au fil des années ?
Jusqu'en 2017, la réaction de l'État fédéral n'a clairement pas été à la hauteur de l'enjeu. Différentes mesures ont été prises, essentiellement en matière de prévention, mais la crise des opioïdes n'a fait l'objet d'aucune action d'ampleur face au puissant lobbying déployé par l'industrie pharmaceutique. En 2014, la Drug Enforcement Administration (DEA) a interdit la délivrance de médicaments sur simple coup de téléphone du praticien. En février 2016, Barack Obama avait proposé de consacrer un milliard de dollars dans le budget 2017 pour que les personnes concernées aient accès à des produits de substitution ou à des centres de traitement (selon le Surgeon General, seulement une personne dépendante sur 10 recevait un traitement). Mais la mesure est restée lettre morte. Une loi votée en avril 2016 a privé la Drug Enforcement Agency (DEA) de son arme la plus puissante contre les industries pharmaceutiques soupçonnées d'inonder le marché avec leurs opioïdes. Cette loi rendait pratiquement impossible pour la DEA le gel des envois de stupéfiants suspects de la part des entreprises. Elle a été adoptée à la suite d'un intense lobbying de l'industrie du médicament, et a eu pour effet d'entraver le combat mené par la DEA contre les distributeurs et les grossistes en médicaments qui fournissaient les médecins. Son principal promoteur a pourtant été nommé responsable de la lutte contre la crise des opioïdes dès la nomination du président Trump en 2017. Le 26 octobre 2017, le président Donald Trump déclare officiellement l'épidémie des opioïdes comme une urgence de santé publique. Cela permettait de débloquer des fonds et de mobiliser les agences fédérales. Cette urgence a été renouvelée pour 90 jours fin mars 2025 par le Secrétaire à la Santé Kennedy. Lors de son intervention au sommet Rx and illicit drug à Nahsville le 26 avril 2025, ce dernier a insisté sur la nécessité de poursuivre les programmes en cours et de soutenir le lien social au sein des communautés (lien avec l'isolement social). Le HHS consacrerait $6 milliards par an pour soutenir les programmes de prévention, de substitution et d'accès aux antidotes.
Principales mesures d'encadrement des prescriptions
- En 2016 - recommandations des CDC : les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié des lignes directrices pour limiter les prescriptions d'opioïdes, incitant les médecins à prescrire des alternatives non addictives et à réduire les doses et durées de prescription.
- En 2018 - le SUPPORT Act (Substance Use-Disorder Prevention that Promotes Opioid Recovery and Treatment for Patients and Communities Act) est une loi fédérale adoptée sous l'administration Trump, qui encourage le traitement de la dépendance, renforce le contrôle des prescriptions électroniques, améliore la détection des envois illicites d'opioïdes par la poste.
Principales mesures contre la distribution d'opioïdes de synthèse
- Depuis 2019, Le gouvernement fédéral a intensifié ses efforts pour intercepter les importations illégales de fentanyl, notamment via la coopération avec la Chine et le Mexique.
- De 2021à 2023, l'administration Biden a annoncé des plans d'action contre le trafic de fentanyl, avec un renforcement des contrôles des douanes, des saisies et de la surveillance des colis internationaux.
5. Quelles actions juridictionnelles ont-elles été entreprises à l'encontre des laboratoires pharmaceutiques et/ou à l'encontre des États ?
Une série de règlements financiers totalise plus de 50 milliards de dollars entre entreprises pharmaceutiques et collectivités affectées.
En 2020 - Purdue Pharma (fabricant de l'OxyContin) a été accusé d'avoir causé l'épidémie par marketing trompeur et a accepté un accord judiciaire de plus de 8 milliards de dollars, L'entreprise s'est déclarée en faillite et a accepté une restructuration. En 2021 et 2022, des dizaines d'États américains ont remporté des actions en justice contre Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health, etc., pour des dédommagements totalisant des milliards.
Le cabinet de conseil McKinsey & Company a accepté le 13 décembre 2024 de payer 650 millions de dollars pour mettre fin à une enquête criminelle menée par le ministère de la Justice sur son rôle dans la promotion des ventes d'OxyContin, un opioïde addictif, ont annoncé les procureurs. L'affaire découle des conseils stratégiques donnés par McKinsey à Purdue Pharma, visant à « stimuler » les ventes de ce médicament, contribuant ainsi à la crise des opioïdes aux États-Unis. Entre 2004 et 2007, malgré des condamnations antérieures contre Purdue, McKinsey a conseillé la société sur des stratégies agressives pour cibler les médecins et augmenter les ventes, y compris par des prescriptions médicalement inutiles. Des consultants accompagnaient même les représentants commerciaux de Purdue. McKinsey avait déjà versé 989 millions de dollars pour régler des poursuites de la part d'États, collectivités locales et autres parties touchées par la crise des opioïdes.
Une étude récente339(*) de KFF Health News en lien avec Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health et l'ONG Shatterproof a mis en lumière que les fonds ont souvent été utilisés à des fins sans lien avec le traitement des addictions (Oregon City, Oregon : $30,000 sur le dépistage des maladies cardiaques ; Flint, Michigan, $10,000 pour la signalétique d'un bâtiment communautaire ; Robeson County, North Carolina, $10,000 pour un robot ambulance. S'il existe bien des recommandations nationales sur l'utilisation des dédommagements, la supervision est faible et de grandes marges d'interprétation sont ouvertes. Un parallèle peut être fait avec les dédommagement obtenus de la part de l'industrie du tabac dans les années 90 qui avaient principalement financé des baisses d'impôts au profit des plus favorisés et dont 3 % seulement avaient financé des programmes de prévention.
6. Quelles sont les statistiques récentes concernant les surdoses liées aux opioïdes, en particulier au fentanyl, aux États-Unis ? Quelles zones et quels groupes démographiques sont les plus affectés par cette crise ?
Selon les Centers for Disease Control and Prevention, on a enregistré une baisse de 25.5 % des surdoses durant les douze mois précédant octobre 2024 en comparaison avec la même période en 2023. 150 Américains meurent cependant chaque jour de surdose liée des opioïdes de synthèse et les surdoses sont la principale cause de décès chez les Américains de 18 à 44 ans. Un maximum historique de 110 000 morts avait été enregistré en 2022. Rahul Gupta, directeur du White House Office of National Drug Control Policy, anticipait en octobre 2024 même une baisse de 20 % sur l'ensemble de l'année 2024. Une étude de KFF, publiée fin septembre340(*), relève pour sa part que la baisse du nombre de décès concernerait prioritairement la communauté blanche et que le nombre de décès continuerait d'augmenter chez les plus de 65 ans.
Les données fédérales ont révélé une légère diminution des nouveaux décès par surdose aux États-Unis en 2023, avec un nombre de décès estimé à 107 500 (24 pour 100 000), soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente, la première baisse en cinq ans. Des baisses notables ont été observées dans des États du Midwest (Nebraska, Indiana, Kansas) contre des hausses constatées dans l'ouest du pays (Washington, Nevada, Oregon et Alaska). Les opioïdes synthétiques, principalement le fentanyl, sont à l'origine d'environ 75 % des décès par surdose. En outre, 296 323 passages aux urgences étaient liés à des surdoses en 2023 (129,3 pour 100 000) dans les 26 États collectant ces données.
7. Quelles sont les principales conséquences économiques et sociales de cette crise sur les populations locales ?
Différentes études ont notamment étudié l'impact négatif de la crise sur le taux de participation au marché du travail durant la première vague. Une étude de 2016 sur des hommes de 25 à 54 ans sans activité a montré que la moitié déclaraient consommer des antidouleurs quotidiennement dont 2/3 sur prescription médicale contre respectivement 54 % et 50 % pour les femmes de la même catégorie d'âge. Cet effet négatif sur le taux de participation a été renforcé durant la deuxième et la troisième vagues en raison des peines liées au caractère illégal des produits consommés. La crise des opioïdes expliquerait 43 % de la baisse du taux de participation des hommes entre 1999 et 2015 (25 % pour les femmes). Au sein de la population active, 12,6 % des actifs recevraient une prescription d'opioïdes chaque année et selon le National Safety Council341(*) 75 % des employeurs auraient rencontré des difficultés liées à leur consommation (absences imprévues, turn over, accidents du travail ...). Une étude des CDC342(*) a montré que les décès liés à la surconsommation d'opioïdes se concentraient dans certains secteurs d'activité (construction, extraction, préparation alimentaire, santé et services d'aide à domicile). Ces secteurs sont ceux engendrant le plus d'accidents du travail et où l'accès aux arrêts maladie est le plus difficile. Ces facteurs entraînent une prescription d'opioïdes plus courante. En outre, les comtés où l'épidémie a été la plus virulente sont également ceux dans lesquels les entreprises ont le plus investi dans les technologies de l'information et les dispositifs de substitution à la main-d'oeuvre humaine (automatisation) face aux pénuries et aux coûts induits (du fait notamment du financement direct de l'assurance santé par les employeurs).
8. Quels sont les principaux défis rencontrés par les autorités sanitaires américaines et canadiennes pour gérer cette crise, et comment les politiques de santé publique ont-elles évolué au fil des années ?
Voir question 4.
9. Comment les programmes de substitution aux opioïdes, tels que la méthadone et la buprénorphine, ont-ils été mis en place aux États-Unis, et quel a été leur impact sur la réduction des dépendances et des surdoses ?
En ce qui concerne la buprénorphine, l'accès a été élargi progressivement dès 2015. Mais avant 2021, les médecins devaient obtenir une certification spéciale (X-waiver), nécessitant une formation de 8 à 24 heures pour pouvoir prescrire la buprénorphine. Cela limitait le nombre de prescripteurs (surtout en zones rurales), et freinait l'accès au traitement. En avril 2021, l'administration Biden, annonce que les médecins n'ont plus besoin de la X-waiver pour traiter jusqu'à 30 patients. Cette mesure temporaire a permis d'élargir rapidement l'accès. La loi Consolidated Appropriations Act (fin décembre 2022) a aboli l'exigence de X-waiver pour début 2023. Tous les médecins titulaires d'une licence DEA peuvent prescrire la buprénorphine pour les troubles liés aux opioïdes, sans formation spécifique.
L'impact de ces mesures apparaît dans la forte augmentation du nombre de prescripteurs à partir de 2023 qui a permis à davantage de patients de commencer un traitement, notamment dans les zones rurales ou mal desservies. Entre 2020 et 2023, les prescriptions de buprénorphine ont augmenté de près de 15 % dans plusieurs États touchés par la crise. Des études montrent que les patients sous buprénorphine sont 50 % à 80 % moins susceptibles de rechuter ou d'overdoser.
En ce qui concerne la méthadone, elle ne peut être prescrite que dans le cadre d'Opioid Treatment Programs certifiés, et généralement, les patients doivent se rendre quotidiennement dans des centres pour obtenir leur dose. Cette obligation crée des obstacles, notamment pour ceux vivant loin des cliniques ou ayant des contraintes de travail. Durant la pandémie de COVID-19, des assouplissements temporaires sont mis en oeuvre par les autorités fédérales qui autorisent les “take-home doses” jusqu'à 28 jours de méthadone pour les patients stables, jusqu'à 14 jours pour ceux en début de traitement mais jugés “fiables”. L'administration Biden a proposé de pérenniser ces assouplissements. En décembre 2023, la SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) a proposé une règle pour maintenir les take-home doses, assouplir l'accès, et permettre des soins à distance (télémédecine). Ces mesures ont amélioré la rétention dans les traitements : les patients abandonnent moins leurs traitements, les soins à distance ont permis d'atteindre de nouveaux publics. Selon les données fédérales, environ 2 000 cliniques fournissent des soins de méthadone à au moins 300 000 patients, soit une fraction des quelque 2,1 millions de personnes souffrant de troubles liés à l'utilisation d'opioïdes aux États-Unis. Mais l'accès reste limité : seuls les OTP peuvent la prescrire, ce qui ralentit les progrès, surtout en dehors des grandes villes. L'American Association for the Treatment of Opioid Dependence a relevé en 2023 une augmentation récente du nombre de décès par surdose liés à la méthadone et alerté sur les risques de déréglementer largement la méthadone, qui est elle-même un médicament addictif. Mais ces surdoses à la méthadone ne représentent qu'une petite fraction du nombre total.
Globalement, l'impact de ces mesures a été limité par la crise du fentanyl même si le nombre de surdoses a stagné ou diminué dans les régions qui ont élargi l'accès au traitement (dans les États du Vermont et de Rhode Island, qui ont investi tôt dans les traitements, les surdoses ont progressé moins vite qu'ailleurs).
10. Les États-Unis ont-ils mis en place des salles de consommation supervisée pour lutter contre les overdoses liées aux opioïdes ? Si oui, quels ont été les résultats de ces initiatives, et sont-elles considérées comme une solution viable à long terme ?
Les salles de consommation supervisée sont encore peu nombreuses aux États-Unis où le débat reste vif. La ville de New York a été pionnière mais d'autres villes développent des expérimentations.
En 2021, New York City est devenue la première ville américaine à ouvrir officiellement deux centres de consommation supervisée, appelés Overdose Prevention Centers (centres de prévention des overdoses). Ces sites permettent aux personnes d'utiliser des drogues qu'elles apportent elles-mêmes, sous la supervision de personnel formé, avec accès immédiat à des soins en cas de surdose. Des centaines de surdoses ont été évitées sur place. Sur le plan légal, ces salles restent techniquement en infraction avec la loi fédérale américaine sur les drogues (“Controlled Substances Act”). Elles fonctionnent grâce au soutien local et municipal, mais sans reconnaissance fédérale.
D'autres villes ont aussi développé des projets, mais se heurtent encore à des obstacles politiques et juridiques. L'organisation Prevention Point Philadelphia propose depuis 1991 des services de réduction des risques, notamment un programme d'échange de seringues, des soins médicaux, et des conseils en matière de dépendance. Bien qu'un projet de site de consommation supervisée ait été envisagé, des obstacles juridiques et politiques ont retardé sa mise en oeuvre. Le programme Boston Health Care for the Homeless a mis en place en 2016 le SPOT (Supportive Place for Observation and Treatment), un espace où les personnes peuvent être surveillées médicalement après avoir consommé des substances, afin de prévenir les overdoses. Bien que SPOT ne soit pas un site de consommation supervisée au sens strict, il représente une approche innovante pour réduire les risques liés à la consommation de drogues. En 2021, le Rhode Island est devenu le premier État américain à légaliser les sites de consommation supervisée. En février 2024, la ville de Providence a approuvé l'ouverture du premier site autorisé par l'État, qui sera géré par Project Weber/RENEW en partenariat avec CODAC Behavioral Healthcare. Ce centre offrira des services tels que la supervision de la consommation, des soins médicaux, des tests de dépistage du VIH, des douches, des repas, et un accompagnement vers des traitements.
Le cadre légal des centres de consommation supervisée reste flou au niveau fédéral.
Des études récentes aux États-Unis ont évalué l'impact des centres de prévention des surdoses (Overdose Prevention Centers, OPC) sur la santé publique et la sécurité des quartiers.
New York City (OPCs d'OnPoint NYC) : depuis leur ouverture en novembre 2021, les deux OPCs de New York ont été utilisés plus de 100 000 fois, avec plus de 1 200 interventions pour prévenir des overdoses, sans aucun décès enregistré sur place. Une étude publiée en novembre 2023 dans JAMA Network Open a révélé que l'ouverture des OPCs n'a pas entraîné d'augmentation significative des crimes violents ou contre les biens dans les quartiers environnants. En fait, les appels au 911 pour des urgences médicales ont diminué de 50 % près des centres, tandis que les arrestations pour possession de drogue ont chuté de 83 %. Les OPCs ont contribué à réduire la consommation de drogues en public et les déchets associés, améliorant ainsi la qualité de vie dans les quartiers concernés.
Rhode Island (Providence) : Brown University mène une étude pour évaluer l'impact du centre sur les surdoses, l'accès aux soins et les coûts pour le système de santé. Les résultats préliminaires suggèrent que les OPCs peuvent réduire les décès liés aux surdoses et les coûts associés aux soins d'urgence.
11. Quels efforts ont été réalisés pour améliorer l'accès à la naloxone, un antidote aux surdoses, et quelle a été son efficacité dans la réduction du nombre de décès par surdose ?
Au niveau fédéral, l'administration Biden (2021-2024) a fait des efforts significatifs pour que ce médicament soit plus largement disponible et a autorisé les services de santé locaux et des États à utiliser des fonds fédéraux pour acheter de la naloxone. En outre, la FDA et certains États ont assoupli les restrictions sur les médicaments contre les opioïdes, y compris le Narcan. Le médicament Narcan, une version en spray nasal de la naloxone, est désormais disponible sans ordonnance (over-the-counter) dans les supermarchés, les petits magasins et les stations-services américains. Certains États achètent ou reçoivent de la naloxone dans le cadre des accords sur les opioïdes conclus avec des sociétés pharmaceutiques, des pharmacies et des distributeurs impliqués dans la crise des opioïdes. Les CMS ont déclaré qu'ils encourageraient les assureurs à promouvoir un accès abordable à la naloxone. Une étude nationale343(*) (2023-2024) a montré le bénéfice à distribuer directement la naloxone aux consommateurs.
En Caroline du nord344(*), la mise en oeuvre de programmes de distribution de naloxone dans les années 2010 a permis de diminuer le taux de décès de 12 % dans les comtés participant par rapport aux comtés dépourvus de tels programmes.
La Californie vient de lancer un programme345(*) qui permet d'acheter de la naloxone en ligne pour $24 les deux doses (programme CalRx).
DR SIBYLLE MAURIES, PRATICIEN HOSPITALIER
___________
Le PTC : un cannabinoïde de synthèse
Définition et origine
Le PTC (« pète ton crane » ou 5F-AKB4), fait partie intégrante des cannabinoïdes de synthèse. Les cannabinoïdes de synthèse sont des substances psychoactives fabriquées en laboratoire pour imiter les effets du THC (Delta-9-tétrahydrocannabinol), le principal composé actif du cannabis naturel, sans en contenir. Ils se lient aux mêmes récepteurs cérébraux (CB1/CB2) que le THC, mais la plupart ont une action plus puissante et complète, ce qui explique des effets souvent plus intenses et imprévisible. Apparues dans les années 2000 en tant que « nouveaux produits de synthèse » (NPS), ces molécules sont produites principalement en Asie et diffusées via Internet ou des circuits parallèles, sous des noms commerciaux variés (PTC, Buddha Blue, Mad Hatter, Spice, etc.).
Mécanismes d'action et différences avec le cannabis naturel
Les cannabinoïdes de synthèse sont des agonistes complets des récepteurs cannabinoïdes, alors que le THC naturel est un agoniste partiel. À dose égale, ils suractivent le système endocannabinoïde, ce qui peut entraîner des effets beaucoup plus puissants et dangereux. Contrairement au cannabis naturel, ils ne contiennent pas de cannabidiol (CBD), qui module les effets psychoactifs du THC et limite certains effets indésirables. L'absence de CBD expliquerait la fréquence accrue des effets négatifs (anxiété, tachycardie, etc.) des cannabinoïdes de synthèse. Leur tolérance s'installe rapidement, poussant à l'augmentation des doses et à des risques accrus d'intoxication.
Évolution du phénomène en France
Le phénomène est apparu en France au début des années 2010, d'abord par importation ou via Internet. En 2017, un premier ensemble de substances a été classé comme stupéfiant. Depuis, plus de 200 cannabinoïdes de synthèse ont été identifiés en Europe, avec une émergence régulière de nouvelles molécules (OFDT).
En 2017, le Baromètre de Santé publique France rapportait que 1.3 % des 18-64 ans déclaraient avoir déjà fumé des cannabinoïdes de synthèse (niveau d'usage similaire à celui de l'héroine) (OFDT).
Concernant l'usage en population adolescente, en 2014, 3.8 % des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà essayé des NPS (enquête ESCAPAD, OFDT), essentiellement des cannabinoïde de synthèse. (OFDT).
Publics et milieux concernés
Les usagers réguliers sont principalement de jeunes hommes (1.7 % vs 0.8 % de femmes), de moins de 35 ans) en situation précaire, souvent déjà consommateurs d'autres substances. Le phénomène reste marginal dans les milieux festifs et la population générale, mais les adolescents y sont exposés via les réseaux sociaux (OFDT).
Formes et modes de consommation
Les cannabinoïdes de synthèse se présentent sous plusieurs formes :
• Herbes imprégnées à fumer (« Spice »)
• Liquides pour cigarette électronique (PTC, Buddha Blue)
• Poudres ou résines, parfois diluées artisanalement
• Supports insolites comme papiers buvards ou aliments.
Effets recherchés et vécus
Les usagers recherchent des effets similaires à ceux du cannabis : relaxation, euphorie, modification des perceptions. Cependant, les effets sont souvent imprévisibles : confusion, agitation, anxiété, sont fréquents. La frontière entre dose efficace et dose toxique est très mince, rendant l'usage risqué.
Risques et effets toxiques à court terme
Les cannabinoïdes de synthèse exposent à des risques aigus importants :
• Troubles neuropsychiques sévères : agitation, hallucinations, paranoïa, comportements violents ou bizarres, crises épileptiques, comas
• Complications cardiovasculaires : tachycardie, hypertension, troubles du rythme, infarctus, AVC
• Troubles digestifs, hyperthermie, atteintes rénales aiguës
• Risque de décès par surdosage, arrêt cardiaque ou comportement létal sous influence
Complications chroniques et dépendance
Les effets à long terme sont encore mal connus, mais incluent des troubles psychiatriques persistants (psychoses, anxiété, dépression), des troubles cognitifs (mémoire, concentration), et des atteintes organiques (coeur, foie, reins). Le potentiel addictif est élevé, avec une dépendance psychique et physique pouvant s'installer rapidement, accompagnée d'un syndrome de sevrage intense (irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, etc.).
Conséquences en santé publique
Malgré un nombre d'usagers limité, la gravité des intoxications engendre une hausse des passages aux urgences et des hospitalisations en réanimation.
Cadre légal et surveillance
En France, la quasi-totalité des cannabinoïdes de synthèse sont classés comme stupéfiants depuis 2017, avec une approche par familles chimiques pour anticiper les nouvelles molécules. Les autorités surveillent activement le marché via des dispositifs comme SINTES (Système d'identification national des toxiques et substances de l'OFDT), CEIP-A (centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance) et TREND (les centres antipoison) (OFDT).
Prévention, prise en charge et recommandations
La prévention vise à informer les publics vulnérables (jeunes, usagers précaires) sur les dangers de ces substances, à renforcer la formation des professionnels de santé. La prise en charge des intoxications est symptomatique, sans antidote spécifique, et le traitement de la dépendance repose sur l'accompagnement addictologique classique. Les recommandations incluent une veille sanitaire renforcée, l'adaptation des dispositifs de soins, la prévention ciblée chez les jeunes, et le soutien à la recherche pour mieux comprendre et traiter ces addictions. Il apparaît également crucial d'agir sur l'environnement numérique des adolescents, compte tenu du rôle de ces plateformes dans la diffusion de contenus.
Références :
[1] J. Grigg, V. Manning, S. Arunogiri, D.I. Lubman, Synthetic cannabinoid use disorder : an update for general psychiatrists, Australas. Psychiatry 27 (2019) 279-283.
[2] M. C. de Oliveira, M. C. Vides, D.L.S. Lassi, J. Torales, A. Ventriglio, H.S. Bombana, V. Leyton, C. de A.-M. Périco, A.B. Negrão, A. Malbergier, J.M. Castaldelli-Maia, Toxicity of Synthetic Cannabinoids in K2/Spice : A Systematic Review, Brain Sci. 13 (2023) 990.
[3] P. Yoganathan, H. Claridge, L. Chester, A. Englund, N.J. Kalk, C.S. Copeland, Synthetic Cannabinoid-Related Deaths in England, 2012-2019, Cannabis Cannabinoid Res. 7 (2022) 516-525.
AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LES DROGUES (EUDA)
(Avril 2025)
Note d'introduction
- Les réponses ci-dessous se focalisent sur la perspective européenne des aspects santé et marché des drogues et non sur les particularités de la situation Française. L'OFDT, qui est le représentant français du réseau Reitox de l'EUDA, possède toutes les informations spécifiques pour répondre aux questions à caractère national.
- Les indicateurs et sources cités sont consultables sur le dernier rapport annuel Européen des drogues ainsi que sur le dernier bulletin statistique (EUDA, 2025a, 2025b) - l'Agence Européenne des médicaments pourrait compléter certaines réponses portant sur les prescriptions et les médicaments. En effet, le mandat de l'EUDA se limite aux drogues illicites et aux usages d'autres substances lorsque celles-ci sont utilisées en poly-usage avec des drogues illicites.
- Les données concernant les décès et les intoxications sont à analyser avec prudence. En effet, la plupart des cas impliquent plusieurs substances, l'identification d'une drogue lors des examens post mortem ne signifie pas que la drogue a causé le décès ; certains pays ne rapportent pas ou peu d'information sur les drogues identifiées lors des analyses post mortem, et les capacités et procédures d'analyses varient entre pays. La présence de certaines drogues telles que les nouvelles substances psychoactives (new psychoactive substances (NPS)) et les nouveaux opioïdes de synthèse (par exemple les nitazenes) est vraisemblablement sous-estimées.
1. Présentez les données les plus récentes collectées par l'EUDA et un panorama général relatif à la consommation de médicaments opioïdes en Europe.
- Évolution des prescriptions et des consommations par type d'opioïde / Exposition de la population à la consommation d'antalgiques opioïdes (opioïdes forts et opioïdes faibles) ;
- Évolution des hospitalisations et des décès dus à la consommation de médicaments opioïdes.
L'agence Européenne des Médicaments sera en mesure de répondre à cette question, pour ce qui concerne les prescriptions et les estimations de consommation d'antalgiques opioïdes au niveau de la population générale. Des données d'hospitalisations et de décès en population générale pourraient également être disponibles auprès de cette agence.
Comme noté en introduction, le mandat de EUDA permet le monitorage des consommations et dommages dans le cadre de poly-consommation qui associent drogues illicites et autres substances. Dans ce cadre, les données récentes mettent en évidence qu'une large part des overdoses rapportées en Europe sont associées à des opioïdes tels que l'héroïne ainsi que, dans certains pays des traitements agonistes opioïdes tels que la méthadone, ou plus rarement (en Finlande en particulier) la buprénorphine (EUDA, 2025a).
L'EUDA collecte des informations à partir de nombreuses sources (Griffiths, Seyler, De Morais, Mounteney, & Sedefov, 2023; Seyler, Giraudon, Noor, Mounteney, & Griffiths, 2021) et les dernières revues disponibles à partir de l'analyse de ces données concluent de la manière suivante : «En conclusion, bien qu'il soit difficile d'établir des parallèles directs entre l'Europe et l'Amérique du Nord, l'expérience américaine fournit un exemple de la manière dont les changements dans l'utilisation des opioïdes peuvent se produire rapidement avec des implications importantes pour la santé publique. Il est difficile de spéculer sur l'avenir, mais une évaluation de la situation européenne actuelle suggère que les changements dans la disponibilité et l'utilisation des opioïdes synthétiques constituent une menace crédible pour la santé publique, en particulier si certaines des nouvelles formes disponibles s'avèrent attrayantes pour un groupe plus large de consommateurs. Il serait prudent d'accroître notre préparation à la détection et à la réaction rapide à tout changement significatif dans la consommation d'opioïdes, en particulier s'il existe des preuves d'une plus grande consommation parmi les cohortes d'âge plus jeunes. À court terme, une éventuelle pénurie d'héroïne pourrait nous obliger à augmenter l'offre de traitement, mais dans le pire des cas, à plus long terme, nous pourrions également devoir répondre aux nouveaux défis posés par la disponibilité et l'utilisation accrues d'opioïdes synthétiques puissants. (Griffiths et al., 2023).
2. Quelles évolutions et quelles tendances constatez-vous en matière de mésusage et de dépendance à des médicaments opioïdes en Europe ?
a. Substances disponibles ;
b. Principaux mésusages constatés (de la part des professionnels de santé et de la part des usagers) ;
c. Quels facteurs ont-ils, selon vous, favorisé ces évolutions ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question.
Si la situation est sans commune mesure avec la crise sanitaire qui touche l'Amérique du Nord (et dont la première vague était associée au mésusage de médicaments opioïdes), l'EUDA observe néanmoins des signaux faibles chez certaines populations d'usagers, souvent dans le cadre d'une poly-consommation. Les derniers résultats d'une étude qui analyse le contenu d'un échantillon de seringues usagées dans 21 villes de l'Union Européenne montrent par exemple des traces de tramadol, de codéine et de fentanyl en Grèce et en Espagne, et d'oxycodone en Irlande et en Estonie. Mais ce phénomène reste marginal comparé à la consommation d'autres opioïdes parmi ces mêmes populations d'usagers (comme l'héroïne, la méthadone ou la buprénorphine - c'est deux derniers médicaments étant prescris comme traitements par agonistes opioïdes et dont le mésusage est documenté depuis longtemps). La situation concernant l'usage des dérivés du fentanyl et des nitazènes dans les pays Baltes est plus préoccupante (voir paragraphe suivant), mais ces opioïdes de synthèse proviennent de productions illégales et non pas de prescriptions.
3. Comment l'EUDA appréhende-t-elle le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ?
Certains pays européens sont-ils plus fortement exposés que d'autres ? Pour quelles raisons ?
L'EUDA monitore ces développements au moyen de ses points focaux nationaux et d'autres réseaux d'information sur des indicateurs de disponibilité, de marché d'usage, de dommages et de réponse aux problèmes de drogues (EUDA, 2025a). Concernant les NPS et les nouveaux opioïdes, l'Early Warning System' (System d'alerte précoce pour les nouvelles drogues) joue un rôle important de détection, de monitorage et de partage d'alertes. Les nitazènes font l'objet d'un monitorage intense de l'EWS. Plus de détails sont disponibles dans les chapitres relatifs aux NPS et aux opioïdes, dans le dernier rapport européen
(EUDA, 2025a).
La Lettonie et l'Estonie en particulier ont vu une nette augmentation des décès impliquant des nitazènes depuis 2021 - ces produits ayant remplacé d'autres opioïdes qui étaient disponibles sur le marché (héroïne il y a quelques années et fentanyls plus récemment). Par ailleurs, la faible couverture sanitaire et sociale, et les difficultés d'accès aux traitements pour la dépendance aux opioïdes (agoniste opioïdes tels que la méthadone ou la buprénorphine) contribuent à la vulnérabilité des personnes dépendantes aux opioïdes dans ces pays (Giraudon, Abel-Ollo, Vanaga-Arâja, Heudtlass, & Griffiths, 2024).
Des `clusters' ou cas groupé d'intoxications, ont été rapportés en Europe dans plusieurs pays et il y a un danger de diffusion accrue dans de nombreux pays Européens. Des signaux de diffusion sont mis en évidence depuis 2019 par des saisies, de décès et des intoxications, pour les nitazènes en particulier. En 2024-2025, des alertes ont été émises par la France (La Réunion), l'Irlande, la Finlande et l'Allemagne à la suite de cas groupés et de décès (Negrault et al., 2025). Certains incidents sont en rapport avec de l'héroïne mais aussi de faux médicaments (par exemple des comprimés d'oxycodone) qui contiennent des nitazènes. Des alertes ont été émises par plusieurs pays en 2023-2025 (Bayerische Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen, 2025; Health Service Executive Ireland, 2023; Trimbos Institute, 2025).
4. Quelle est la réglementation en vigueur, à l'échelle de l'Union européenne (UE), concernant la production et la distribution des médicaments opioïdes ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question.
5. Dans la mesure du possible, présentez les principaux profils de réglementation en vigueur dans les États de l'UE concernant la production et la distribution des médicaments opioïdes.
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question.
6. En France, la durée maximale de prescription pour les opioïdes de palier 2 (opioïdes faibles) est limitée à 12 semaines, et celle pour les opioïdes de palier 3 (opioïdes forts) est limitée à 4 semaines.
Comment évaluez-vous ces durées du point de vue du risque de développer un trouble de l'usage ?
Comment se situe la France par rapport à d'autres réglementations de pays membres de l'UE ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question.
7. En France, on constate une augmentation des prescriptions hors indication thérapeutique du tramadol, de la codéine et du fentanyl. Cette tendance s'observe-t-elle également dans d'autres pays de l'UE ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question.
8. Un renforcement du cadre réglementant l'usage de certains médicaments opioïdes, notamment des opioïdes de palier 2 (ex : tramadol) peut-elle selon vous entraîner un risque d'approvisionnement par les usagers sur des marchés illégaux ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question concernant le cadre réglementant l'usage des médicaments. Néanmoins, un rapport de l'EUDA pourra être utile du point de vue des marchés illégaux, et la problématique d'assurer l'accès aux traitements de substitution aux opiacés tout en prévenant leur détournement. Le rapport concluait de la façon suivante : `Selon des études européennes, ne pas être en traitement de substitution aux opiacés (TSO) demeure l'un des facteurs les plus importants dans le mésusage des TSO et dans ce cas, les TSO sont utilisés principalement à des fins d'automédication. Il est clair que c'est un défi, mais aussi une responsabilité, pour les acteurs impliqués dans la fourniture des TSO, de garantir la disponibilité et l'accessibilité de ce traitement efficace, tout en élaborant et en mettant en et de mettre en oeuvre des politiques efficaces de lutte contre le détournement. (EMCDDA, 2021).
9. Une importation de la crise américaine des opioïdes dans certains pays d'Europe vous paraît-elle plausible ?
C'est une possibilité, mais certains facteurs semblent limiter le risque de voir l'Union Européenne confrontée à un tel scénario. Le contexte est différent en particulier parce que les prescriptions sont contrôlées, il n'y a pas de publicité pour les médicaments et les personnes qui présentent une dépendance aux opioïdes ont, relativement, mieux accès à des soins de santé primaires et des soins spécialisés. Il s'agit, entre autres interventions, des traitements de substitution aux opiacés tels que la méthadone et la buprénorphine pour les lesquels il existe de fortes preuves scientifiques qu'ils réduisent le risque de morts pas overdose et de morts par autres causes, parmi les personnes dépendantes aux opioïdes.
Même si les données dont nous disposons nous montrent que, comparée aux Etats-Unis, l'UE est pour l'instant relativement épargnée (exception faite des pays Baltes), la vigilance reste de mise face nouveaux opioïdes de synthèse. Si l'un des facteurs déclencheurs de la crise américaine a été la sur-prescription d'antidouleurs opioïdes, d'autres facteurs pourraient amener à une augmentation de l'usage des opioïdes de synthèse et de leur l'impact sanitaire en Europe. Pour l'Europe, cela pourrait venir, par exemple, d'une éventuelle pénurie d'héroïne (la production d'opium est en baisse en Afghanistan) couplée à une réorganisation des réseaux de production et de distribution des dérivés du fentanyl et des nitazènes. Comme rapporté plus haut, les marchés sont dynamiques et l'expérience des clusters récents, et du pic d'overdose dans les pays Baltes appellent à une grande vigilance (Griffiths et al., 2023). Certains pays sont plus vulnérables du fait des limites de leurs systèmes de santé et des niveaux sous-optimaux de la prévention, de la réduction des risques et des traitements - voir les chapitre `Traitement agonistes opioïdes' et `Réduction des risques' dans le rapport annuel européen (EUDA, 2025a).
10. Quels enseignements l'Europe peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et de politique de réduction des risques ?
L'agence Européenne des Médicaments sera en mesure de répondre à cette question pour ce qui concerne les pratiques commerciales et l'encadrement des prescriptions.
L'expérience des USA nous alerte sur le besoin de programmes de réduction des risques et de traitements de la dépendance aux opioïdes (voir les réponses et références indiquées pour répondre à la question ci-dessus) (EUDA, 2025a). Plus largement, l'EUDA a appelé à une approche coordonnée à la fin de l'année 2024 (EUDA, 2024). Il s'agit notamment de développer des services innovants d'alerte et d'évaluation des menaces liées aux drogues à l'échelle de l'UE et de coopérer avec les États membres pour mettre en place un nouveau réseau de laboratoires médico-légaux et toxicologiques, qui produiront des données et échangeront des informations sur les nouveaux développements et les nouvelles tendances.
11. Quelles mesures peuvent-elles contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène, au niveau européen et au niveau des États membres ? Des travaux ont-ils été conduits sur cette question au niveau de l'Union européenne ?
Les mesures recommandées (traitement et réduction des risques pour les personnes qui présentent une dépendance aux opioïdes), ainsi que les couvertures estimées sont revues dans le rapport annuel Européen (voir les chapitres traitements et réduction des risques mentionnés ci-dessus).
En amont, assurer un large accès aux interventions de prévention fondées sur des données probantes dans les communautés, les écoles et les familles est essentiel, en particulier auprès des plus jeunes pour prévenir les addictions et les comportements à risques (Ministère de l'Éducation Nationale, 2025). Comme noté dans la récente revue basée sur l'analyse des données européennes en matière de changement des risques liés aux opioïdes en Europe: « Il serait prudent d'accroître notre préparation à la détection et à la réaction rapide à tout changement significatif dans la consommation d'opioïdes, en particulier s'il existe des preuves d'une plus grande consommation parmi les cohortes d'âge plus jeunes (Griffiths et al., 2023) ». Certains pays tels que la Finlande et l'Autriche ont déjà rapporté une augmentation du nombre d'overdose parmi les jeunes âgés de moins de 20 ans (EUDA, 2025a). Par ailleurs, de jeunes usagers sont rapportés dans les alertes récentes liées à des clusters de décès (Bayerische Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen, 2025).
12. Des discussions sur les étiquetages et les conditionnements des boîtes de médicaments opioïdes ont-elles eu lieu à l'échelle de l'UE ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question.
13. Décrivez les dispositifs de surveillance et d'alerte pilotés par l'EUDA.
Quelles actions permettraient-elles d'améliorer la connaissance de la prévalence des usages problématiques d'opioïdes ?
Le système d'alerte précoce de l'UE sur les nouvelles substances psychoactives, bien établi, reste un élément clé de la préparation de l'UE en matière de drogues. En outre, notre nouveau système européen d'alerte antidrogue facilite l'échange rapide d'informations en cas de risques sanitaires, sociaux et sécuritaires graves liés à la drogue. Ce système garantit que les parties prenantes concernées reçoivent des informations vitales, en temps, et exploitables, afin d'apporter des réponses fondées sur des données probantes. En complément, notre système européen d'évaluation des menaces sanitaires et sécuritaires renforce la capacité de l'UE à prévoir les menaces émergentes et à y répondre efficacement. Ensemble, ces systèmes jouent un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité publiques dans l'UE.
Les dispositifs de surveillance et d'alerte, ainsi que l'analyse de leurs données sont présentés dans le rapport annuel européen. Ils comprennent des indicateurs clés, rapportés annuellement au niveau national (nombre de décès, nombre de personnes qui entrent en traitement, saisies...) ainsi qu'un système d'alerte précoce et des réseaux `sentinelles' locaux, tels que le réseau sentinelles hospitalier, l'analyse des eaux usées et des seringues usagées, les enquêtes en ligne, le réseau de services d'analyse (`drug-checking'), etc. dont les deniers chiffres sont disponibles dans le bulletin statistique.
14. Quels pays européens sont-ils les plus proactifs en matière de réduction des risques ?
Le choix des pays varie, en fonction des programmes de traitements de substitution aux opiacés et des actions de réduction des risques en place tels que les services d'analyse (`drug-checking'), les programmes de distribution de seringues, les salles de consommation à moindre risque, les programmes de formation aux premiers secours et d'administration de la naloxone (`take home naloxone'), dans la communauté, ainsi qu'en prison et en prévision de la sortie de prison. Le point sur la disponibilité et le déploiement des ces services de santé est disponible, par pays, dans le rapport annuel européen et dans le bulletin statistique paru (EUDA, 2025a, 2025b).
15. Quelles politiques convient-il de promouvoir, selon vous, en matière d'accès à la naloxone et aux traitements de substitution aux opiacés ?
Les deux interventions sont soutenues par des preuves scientifiques. Elles contribuent à réduire les risques de dommages liés aux drogues. Elles doivent être pensées dans une continuité et une cohérence avec d'autres interventions qui permettent d'améliorer la santé mentale, les autres problèmes de santé (au-delà des dépendances) ainsi que les problèmes de pauvreté, de logement et de stigmatisation - les niveaux de mise en place des programmes sont parfois en dessous des recommandation internationales - voir la situation des différents pays dans les chapitres traitement et réduction des risques du rapport annuel européen (EUDA, 2025a). Il est important de garantir un accès et une couverture satisfaisants pour les usagers de drogues. Plus de ressources sont disponibles dans les publications de l'Agence, qui donnent un aperçu des aspects les plus importants à prendre en compte lors de la planification ou de la mise en oeuvre des réponses sanitaires et sociales aux décès liés aux opioïdes en particulier. Ces rapports examinent la disponibilité et l'efficacité des réponses ainsi que les implications pour les politiques et la pratique (EMCDDA, 2017, 2023)
16. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteurs ?
L'accent peut être mis sur l'offre de nombreuses alternatives de vie saine et sur l'engagement communautaire. Un équilibrage des interventions en faveur de la prévention, au profit des soins de santé primaire, du dépistage et de la prévention pourrait être encouragé.
Références
Bayerische Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen. (2025). Aktuelle Warnung: Lebensgefahr durch synthetische Opioide in Bayern [Current warning: Danger to life from synthetic opioids in Bavaria. Alerte actuelle : danger de mort dû aux opioïdes synthétiques en Bavière]. Retrieved from https://www.condrobs.de/aktuelles/synthetische-opioide-in-bayern/
EMCDDA. (2017). Health and social responses to drug problems: a European guide. Luxembourg.
EMCDDA. (2021). Balancing access to opioid substitution treatment (OST) with preventing the diversion of opioid substitution medications in Europe: challenges and implications. Retrieved from
EMCDDA. (2023). Opioid-related deaths: health and social responses. Retrieved from Lisbon: https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/opioid-related-deaths-health-and-social-responses_en
EUDA. (2024). EUDA Executive Director issues Call to action on new synthetic opioids at European Parliament. [Press release]. Retrieved from https://www.euda.europa.eu/news/2024/euda-executive-director-issues-call-action-new-synthetic-opioids-european-parliament_en
EUDA. (2025a). European Drug Report 2024: trends and developments. Retrieved from Luxembourg: https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2025_en
EUDA. (2025b, 06/2025). Statistical bulletin. Retrieved from https://www.euda.europa.eu/data/stats2025_en
Giraudon, I., Abel-Ollo, K., Vanaga-Arâja, D., Heudtlass, P., & Griffiths, P. (2024). Nitazenes represent a growing threat to public health in Europe. Lancet Public Health, 1. doi:/10.1016/S2468-2667(24)00024-0
Griffiths, P. N., Seyler, T., De Morais, J. M., Mounteney, J. E., & Sedefov, R. S. (2023). Opioid problems are changing in Europe with worrying signals that synthetic opioids may play a more significant role in the future. Addiction. doi:10.1111/add.16420
Health Service Executive Ireland. (2023). HSE issues warning to heroin users following cluster of overdoses in Dublin. Retrieved from https://www.hse.ie/eng/services/news/media/pressrel/hse-issues-warning-to-heroin-users-following-cluster-of-overdoses-in-dublin.html.
Ministère de l'Éducation Nationale, d. l. E. s. e. d. l. R. (2025). Développer les compétences psychosociales chez les élèves. Eduscol Retrieved from https://eduscol.education.fr/3901/developper-les-competences-psychosociales-chez-les-eleves.
Negrault, N., Puech, B., Guyon, J., Daveluy, A., Bastard, S., Mete, D., & Maillot, A. (2025). Case series of severe intoxications associated with new psychoactive substances on Reunion Island: Clinical description and diagnostic challenges. Toxicologie Analytique et Clinique. doi: https://doi.org/10.1016/j.toxac.2025.01.096
Seyler, T., Giraudon, I., Noor, A., Mounteney, J., & Griffiths, P. (2021). Is Europe facing an opioid epidemic: What does European monitoring data tell us? Eur J Pain, 25(5), 1072-1080. doi:10.1002/ejp.1728
Trimbos Institute. (2025). Waarschuwing: Namaak-oxycodonpillen met het levensgevaarlijke isotonitazepyne in omloop [Warning: Counterfeit oxycodone pills containing the life-threatening isotonitazepyne in circulation. Avertissement : Des pilules d'oxycodone contrefaites contenant de l'isotonitazepyne, une substance potentiellement mortelle, sont en circulation.]. Retrieved from https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/waarschuwing-namaak-oxycodonpillen-met-het-levensgevaarlijke-isotonitazepyne-in-omloop/
AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LES DROGUES (EUDA)
(Juin 2025)
Note d'introduction
Cette note répond au questionnaire reçu le 10 Juin et complète l'audition réalisée le même jour. Elle reprend en partie la contribution écrite de l'Agence au premier questionnaire reçu en Avril 2025 et met à jour certains éléments à la lumière du rapport Européen des drogues publié le 5 juin 2025 (EUDA 2025).
- Les réponses ci-dessous se focalisent sur la perspective européenne des aspects santé et marché des drogues et non sur les particularités de la situation Française. L'OFDT, qui est le représentant français du réseau Reitox de l'EUDA, possède toutes les informations spécifiques pour répondre aux questions à caractère national.
- Les indicateurs et sources cités sont consultables sur le dernier rapport annuel Européen des drogues ainsi que sur le dernier bulletin statistique (EUDA 2025, EUDA 2025).
- L'Agence Européenne des médicaments pourrait compléter certaines réponses portant sur les prescriptions et les médicaments. En effet, le mandat de l'EUDA se limite aux drogues illicites et aux usages d'autres substances lorsque celles-ci sont utilisées en poly-usage avec des drogues illicites.
- Les données concernant les décès et les intoxications sont à analyser avec prudence. En effet, la plupart des cas impliquent plusieurs substances, l'identification d'une drogue lors des examens post mortem ne signifie pas que la drogue a causé le décès ; certains pays ne rapportent pas ou peu d'information sur les drogues identifiées lors des analyses post mortem, et les capacités et procédures d'analyses varient entre pays. La présence de certaines drogues telles que les nouvelles substances psychoactives (new psychoactive substances (NPS)) et les nouveaux opioïdes de synthèse (par exemple les nitazenes) est vraisemblablement sous-estimée.
1. Présentez les données les plus récentes collectées par l'EUDA et un panorama général relatif à la consommation de substances opioïdes illégales en Europe.
- Évolution des prescriptions et des consommations par type d'opioïde ;
- Évolution des hospitalisations et des décès dus à la consommation de substances opioïdes ;
- Principales substances consommées.
Comme noté en introduction, le mandat de EUDA permet le monitorage des consommations et dommages dans le cadre de poly-consommation qui associent drogues illicites et autres substances. L'agence ne receuille pas de données systématiques sur les évolutions des prescriptions.
Les données nationales concernant les évolutions des hospitalisations ne sont pas disponibles ou pas rapportées systématiquement à l'EUDA par les pays membres. En revanche, le réseau des hôpitaux sentinelles Euro-DEN met en évidence que les opioïdes, tels que l'héroïne, sont impliqués dans des présentations aux urgences dans certains hôpitaux, mais que la part liée à l'héroïne a baissé dans plusieurs d'entre eux - par exemple, de 2018 à 2023 : la proportion des présentations aux urgences avec mention d'héroïne est passée de 34 % à 13 % à Dublin, Ireland ; de 22 % à 2 % à Vilnius, Lithuania ; et de 21 % à 11 % à Ljubljana, Slovenia (EUDA 2024).
Concernant les consommations, des estimations des taux d'usage d'opioïdes (`High risk opioid use' or `Problem opioid use') sont disponibles dans 20 pays et se situent entre 0.96/1000 adultes (15-64 ans) (Grèce) et 7.65/1000 adultes (15-64 ans) (Finland). La dernière estimation pour la France est de 5.98//1000 adultes (15-64 ans) (EUDA 2025). Ces estimations de la prévalence de l'usage sont relativement stables dans le temps mais ne font pas la distinction entre différents types d'opioïdes.
Concernant les dommages, les données récentes mettent en évidence qu'une large part des overdoses rapportées en Europe sont associées à des opioïdes tels que l'héroïne ainsi que, dans certains pays des traitements agonistes opioïdes tels que la méthadone, ou plus rarement (en Finlande en particulier) la buprénorphine (EUDA 2025). Le dernier rapport européen illustre au moyen de données disponibles dans certains pays (Autriche, Slovénie, Norvège) la part importante des overdoses liées à l'héroïne qui impliquent des poly-intoxications associant d'autres opioïdes, des drogues illicites tels que des stimulants (amphétamines, cocaïne), des médicaments psychoactifs (benzodiazepines en particulier) et de l'alcohol -(EUDA 2025).
- Dans certains pays, les fentanyls et dérivés (Lithuanie, carfentanyl) ainsi que les nitazenes (Estonie, Lettonie) sont impliqués dans un part importante des décès en 2023-24 ; la Suède, la Norvège, l'Allemagne, l'Irlande et la France ont également rapporté de nombreuses intoxications fatales et non fatales en 2023-24, impliquant différents nitazènes, et souvent associées à d'autres drogues -(EUDA 2025).
- L'EUDA collecte des informations à partir de nombreuses sources (Seyler, Giraudon et al. 2021, Griffiths, Seyler et al. 2023) et les dernières revues disponibles à partir de l'analyse de ces données concluent que bien qu'il soit difficile d'établir des parallèles directs entre l'Europe et l'Amérique du Nord, l'expérience américaine fournit un exemple de la manière dont les changements dans l'utilisation des opioïdes peuvent se produire, avec des implications importantes pour la santé publique : « Il est difficile de spéculer sur l'avenir, mais une évaluation de la situation européenne actuelle suggère que les changements dans la disponibilité et l'utilisation des opioïdes synthétiques constituent une menace crédible pour la santé publique, en particulier si certaines des nouvelles formes disponibles s'avèrent attrayantes pour un groupe plus large de consommateurs. Il serait prudent d'accroître notre préparation à la détection et à la réaction rapide à tout changement significatif dans la consommation d'opioïdes, en particulier s'il existe des preuves d'une plus grande consommation parmi les cohortes d'âge plus jeunes. À court terme, une éventuelle pénurie d'héroïne pourrait nous obliger à augmenter l'offre de traitement, mais dans le pire des cas, à plus long terme, nous pourrions également devoir répondre aux nouveaux défis posés par la disponibilité et l'utilisation accrues d'opioïdes synthétiques puissants ». (Griffiths, Seyler et al. 2023).
2. Quels facteurs ont favorisé ces évolutions ? (contexte géopolitique notamment)
Parmi les facteurs qui ont favorisé ces évolutions, on note que les nouveaux opioïdes synthétiques sont souvent très puissants, ce qui signifie qu'une petite quantité peut suffire à produire un grand nombre de doses sur le marché illicite et peut présenter un risque accru d'empoisonnement potentiellement mortel. Depuis 2012, deux vagues distinctes d'opioïdes puissants ont constitué une menace pour la santé publique en Europe. La première, entre 2012 et 2019, a été causée par 38 dérivés du fentanyl et a entraîné au moins huit épidémies d'empoisonnement documentées (niveau local ou national), entraînant environ 285 décès. Les contrôles légaux aux États-Unis, en Europe et en Chine ont conduit à la raréfaction de ces drogues. Depuis 2019, ils ont été remplacés par des opioïdes « nitazènes » à base de benzimidazole très puissants. Des données récentes suggèrent que la disponibilité et les risques associés aux opioïdes nitazéniques augmentent.
Sept nouveaux opioïdes synthétiques ont été officiellement notifiés en 2024 au système d'alerte précoce de l'UE, tous étant des nitazènes, soit le nombre le plus élevé notifié en une seule année. Depuis 2019, au moins 21 États membres de l'UE ont désormais signalé la présence d'un nitazène.
Par ailleurs, il est important de noter qu'aux États-Unis, la sur-prescription a été en grande partie à l'origine de la crise de santé publique liée aux abus d'opioïdes. Alors que ces médicaments étaient largement prescrits, les évolutions des prescriptions n'étaient pas suivies systématiquement dans l'ensemble du pays et cela a empêché les autorités d'observer cette tendance négative à temps. Si la situation est sans commune mesure avec la crise sanitaire qui touche l'Amérique du Nord (et dont la première vague était associée au mésusage de médicaments opioïdes antalgiques), l'EUDA observe néanmoins des signaux faibles de mésusage de médicaments opioïdes chez certaines populations d'usagers, souvent dans le cadre d'une poly-consommation. Les derniers résultats d'une étude qui analyse le contenu d'un échantillon de seringues usagées dans 21 villes de l'Union Européenne montrent par exemple des traces de tramadol, de codéine et de fentanyl en Grèce et en Espagne, et d'oxycodone en Irlande et en Estonie. Mais ce phénomène reste marginal comparé à la consommation d'autres opioïdes parmi ces mêmes populations d'usagers (comme l'héroïne, la méthadone ou la buprénorphine). La situation concernant l'usage des dérivés du fentanyl et des nitazènes dans les pays Baltes est plus préoccupante (voir paragraphes ci-dessus et suivants), mais ces opioïdes de synthèse proviennent de productions illégales et non pas de prescriptions.
3. Comment l'EUDA appréhende-t-elle le développement du marché des nouveaux opioïdes de synthèse ? Quels dangers identifiez-vous ?
L'EUDA appréhende les développements du marché des nouveaux opioïdes de synthèse par le monitorage à travers ses points focaux nationaux et d'autres réseaux d'information qui produisent des indicateurs de disponibilité, de marché, d'usage, de dommages et de réponse aux problèmes liés aux drogues (EUDA 2025). Concernant les NPS et les nouveaux opioïdes, l''Early Warning System' (Système d'alerte précoce pour les nouvelles drogues) joue un rôle important de détection, de monitorage et de partage d'alertes. Les nitazènes font l'objet d'un monitorage intense de l'EWS. Plus de détails sont disponibles dans les chapitres relatifs aux NPS et aux opioïdes, dans le dernier rapport européen (EUDA 2025).
La Lettonie et l'Estonie en particulier ont vu une nette augmentation des décès impliquant des nitazènes depuis 2021 - ces produits ayant remplacé d'autres opioïdes qui étaient disponibles sur ces marchés nationaux (héroïne il y a quelques années et fentanyls et dérivés plus récemment). En Estonie, le nombre de décès impliquant des drogues est passé de 82 cas en 2022 à 119 en 2023, ce qui représente un taux de mortalité due aux drogues de 135 par million d'habitants (dans la classe d'âge des 15-64 ans), soit six fois la moyenne de l'UE. Les nitazènes, principalement le métonitazène et le protonitazène, ont été impliqués dans plus de la moitié (52 %) de ces décès. En Lettonie, les statistiques nationales et les registres médico-légaux ont provisoirement fait état d'une augmentation du nombre total de décès impliquant des drogues, qui est passé de 63 en 2022 à 154 en 2023, soit un taux de mortalité de 130 par million d'habitants (dans la classe d'âge des 15-64 ans), plus de cinq fois (5,3) la moyenne de l'UE. Les nitazènes ont été identifiés dans 101 (66 %) de ces cas, ce qui explique cette augmentation (EUDA 2025). Par ailleurs, la faible couverture sanitaire et sociale, et les difficultés d'accès aux traitements pour la dépendance aux opioïdes (agoniste opioïdes tels que la méthadone ou la buprénorphine) contribuent à la vulnérabilité des personnes dépendantes aux opioïdes dans ces pays (Giraudon, Abel-Ollo et al. 2024).
Des `clusters' ou cas groupés d'intoxications, ont été rapportés en Europe dans plusieurs pays et il y a un risque de diffusion accrue dans de nombreux pays Européens. Des signaux de diffusion sont mis en évidence depuis 2019 par des saisies, de décès et des intoxications, pour les nitazènes en particulier : en 2023-2025, des alertes ont été émises par la France (La Réunion), l'Irlande, la Finlande et l'Allemagne à la suite de cas groupés et de décès (EUDA 2025, Negrault, Puech et al. 2025). En Suède, plus de 30 décès associés au métonitazène ont été rapportés entre janvier 2023 et septembre 2024, soit plus d'un par mois en moyenne, avant de diminuer à l'automne 2024. En Norvège, environ 35 décès liés au nitazène (principalement au métonitazène) ont été enregistrés entre juin 2023 et août 2024, soit plus de 2 par mois en moyenne, avant que l'incidence ne diminue fortement à partir de septembre 2024 (EUDA 2025).
Enfin, parmi les dangers identifiés, on note que les rapports transmis au système d'alerte précoce de l'UE font état d'une augmentation récente et significative de la disponibilité de faux médicaments contenant des opioïdes nitazénés en Europe. Ces produits imitent généralement des médicaments légitimes délivrés sur ordonnance, en particulier l'oxycodone et, dans une moindre mesure, les benzodiazépines. Les inquiétudes portent notamment sur la possibilité qu'ils se propagent au-delà des utilisateurs d'opioïdes à haut risque à des populations plus larges qui n'ont pas de tolérance aux opioïdes, y compris des populations plus jeunes (EUDA 2025). Des alertes ont été émises par plusieurs pays (Allemagne, Hollande, Irlande) en 2023-2025 (Health Service Executive Ireland 2023, Bayerische Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen 2025, Trimbos Institute 2025).
4. Quels sont les circuits d'importation et de distribution de ces nouvelles drogues ? Des sites de production sont-ils implantés en Europe ?
Concernant les circuits d'importation et de distribution de ces nouvelles drogues, les opioïdes synthétiques illicites identifiés en Europe semblent provenir d'autres pays (Chine en particulier) et être importés à la suite de commandes en ligne ou achetés à des vendeurs de proximité.
5. Certains pays européens sont-ils plus fortement exposés que d'autres ? Pour quelles raisons ? Comment caractériseriez-vous la situation française ?
Les pays qui semblent les plus affectés pour le moment par les nouveaux opioïdes de synthèse sont les pays Baltes : la Lettonie, la Lithuanie et l'Estonie. Cela peut être mis en rapport avec les taux importants d'usage à haut risque d'opioïdes (correspondant à plusieurs milliers de personnes dépendantes aux opioïdes), de faibles taux estimés de couverture sanitaire et sociales (soins de santé primaires, treatment agonistes avec des opioïdes, faible accès à la réduction des risques ; et de la diminution de la disponibilité des fentanyls et dérivés, remplacés en Lettonie et en Estonie par les nitazènes.
D'autres pays, où les prévalences estimées d'usage des opioïdes sont moindre et ou l'accès au traitement et à la réduction des risques est meilleures rapportent néanmoins des usages et des dommages. La France a connu des épisodes d'intoxication liées aux nitazènes, dans la communauté et en prison dans diverse régions au cours des derniers mois (C. Eiden; M.Lestienne; H.Peyriere 2023, Bendjilali-Sabiani, Eiden et al. 2024).
L'OFDT, qui est le représentant français du réseau Reitox de l'EUDA, possède toutes les informations spécifiques pour répondre aux questions à caractère national, en s'appuyant sur les partenariats avec les CEIP et d'autres sources d'information.
6. Établissez-vous une corrélation entre un recours plus strict ou plus encadré aux opioïdes légaux (ex : encadrement plus fort des prescriptions de tramadol ou de codéine) et une augmentation de la consommation d'opioïdes illégaux ? Autrement dit, un renforcement du cadre réglementant l'usage de certains médicaments opioïdes, notamment des opioïdes de palier 2 (ex : tramadol) peut-elle selon vous entraîner un risque d'approvisionnement par les usagers sur des marchés illégaux ?
L'agence Européenne des Médicaments pourrait répondre à cette question concernant le cadre réglementant l'usage de certains médicaments opioïdes. D'une manière générale, le monitorage de la prescription de tous les opioïdes est un moyen important pour repérer les risques potentiels de dommages qu'ils peuvent occasionner.
Aux États-Unis, la réglementation plus stricte des antalgiques opioïdes semble avoir entraîné certains patients à se tourner vers le marché illicite (notamment l'héroïne puis les opioïdes de synthèses illicites) ; mais la première vague de dépendance avait déjà été créée en grande partie par la sur-presciption de médicaments. Ce qui n'est pas comparable à la situation européenne.
Enfin, un rapport de l'EUDA pourra être utile du point de vue des marchés illégaux, et la problématique d'assurer l'accès aux traitements, agonistes aux opiacés en particulier, tout en prévenant leur détournement (EMCDDA 2021).
7. Une importation de la crise américaine des opioïdes dans certains pays d'Europe vous paraît-elle plausible ?
Une importation de la `crise américaine des opioïdes' dans certains pays d'Europe est une possibilité, mais certains facteurs semblent limiter le risque de voir l'Union Européenne confrontée à un tel scénario. Le contexte est différent en particulier parce que les prescriptions sont contrôlées, il n'y a pas de publicité pour les médicaments et les personnes qui présentent une dépendance aux opioïdes ont, relativement, mieux accès à des soins de santé primaires et des soins spécialisés. Il s'agit, entre autres interventions, des traitements de substitution aux opiacés tels que la méthadone et la buprénorphine pour les lesquels il existe de fortes preuves scientifiques qu'ils réduisent le risque de morts pas overdose et de morts par autres causes, parmi les personnes dépendantes aux opioïdes.
Même si les données dont nous disposons nous montrent que, comparée aux Etats-Unis, l'UE est pour l'instant relativement épargnée (exception faite des pays Baltes), la vigilance reste de mise face aux nouveaux opioïdes de synthèse. Si l'un des facteurs déclencheurs de la crise américaine a été la sur-prescription d'antidouleurs opioïdes, d'autres facteurs pourraient amener à une augmentation de l'usage des opioïdes de synthèse et de leur l'impact sanitaire en Europe. Pour l'Europe, cela pourrait venir, par exemple, d'une éventuelle pénurie d'héroïne (la production d'opium est en baisse en Afghanistan) couplée à une réorganisation des réseaux de production et de distribution des dérivés du fentanyl, des nitazènes, sans oublier d'autres opioïdes qui émergent (UNODC 2025). Comme rapporté plus haut, les marchés sont dynamiques et l'expérience des clusters récents, et du pic de décès dans les pays Baltes appellent à une grande vigilance (Griffiths, Seyler et al. 2023). Certains pays sont plus vulnérables, en partie du fait des limites de leurs systèmes de santé et des niveaux sous-optimaux de la prévention, de la réduction des risques et des traitements - voir les chapitre `Traitement agonistes opioïdes' et `Réduction des risques' dans le rapport annuel européen, mais d'autres pays peuvent aussi voir ces problèmes se développer (EUDA 2025).
8. Quels enseignements l'Europe peut-elle tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, en matière de pratiques commerciales, d'encadrement des prescriptions et de politique de réduction des risques ?
L'agence Européenne des Médicaments sera en mesure de répondre à cette question pour ce qui concerne les pratiques commerciales et l'encadrement des prescriptions.
Parmi les enseignements que l'Europe peut tirer de l'émergence et de l'évolution de la crise des opioïdes aux États-Unis, l'expérience de l'Amérique du Nord nous alerte sur le besoin de programmes de réduction des risques et de traitements de la dépendance aux opioïdes (voir les réponses et références indiquées ci-dessus en réponses à la question 7) (EUDA 2025). Plus largement, l'EUDA a appelé à une approche coordonnée à la fin de l'année 2024 (EUDA 2024). Il s'agit notamment de développer des services innovants d'alerte et d'évaluation des menaces liées aux drogues à l'échelle de l'UE et de coopérer avec les États membres pour mettre en place un nouveau réseau de laboratoires médico-légaux et toxicologiques, qui produiront des données et échangeront des informations sur les nouveaux développements et les nouvelles tendances. Cet appel à l'action souligne que : « Ensemble, nous devons renforcer nos réponses aux menaces identifiées et agir. Ce faisant, nous augmenterons ensemble l'échange d'informations à l'échelle de l'UE et l'apprentissage de politiques et d'actions fondées sur des données probantes ».
9. Quelles mesures peuvent-elles contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène, au niveau européen et au niveau des États membres ? Des travaux ont-ils été conduits sur cette question au niveau de l'Union européenne ?
En complément de l'approche coordonnée mentionnée ci-dessus (EUDA 2024), les mesures pouvant contribuer à prévenir ou freiner un tel phénomène, au niveau européen et au niveau des États membres incluent l'accès au traitement et la réduction des risques pour les personnes qui présentent une dépendance aux opioïdes. Les couvertures estimées sont revues dans le rapport annuel Européen (voir les chapitres `Traitements' et `Réduction des risques' mentionnés ci-dessus) (EUDA 2025).
En amont, assurer un large accès aux interventions de prévention fondées sur des données probantes dans les communautés, les écoles et les familles est essentiel, en particulier auprès des plus jeunes pour prévenir les addictions et les comportements à risques (EUDA 2025, Ministère de l'Éducation Nationale 2025). Comme noté dans la récente revue basée sur l'analyse des données européennes en matière de changement des risques liés aux opioïdes en Europe: « Il serait prudent d'accroître notre préparation à la détection et à la réaction rapide à tout changement significatif dans la consommation d'opioïdes, en particulier s'il existe des preuves d'une plus grande consommation parmi les cohortes d'âge plus jeunes (Griffiths, Seyler et al. 2023) ».
Concernant les adolescents et jeunes adultes, certains pays tels que la Finlande et l'Autriche ont déjà rapporté une augmentation du nombre surdoses parmi les jeunes âgés de moins de 20 ans avec des taux de mortalité dans ces tranches d'âge plus élevées que dans la population générale dans ces pays (EUDA 2024) (EUDA 2025). Par ailleurs, une part importante de jeunes usagers a été rapportée dans les alertes récentes liées à des clusters de décès (Bayerische Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen 2025).
10. Décrivez les dispositifs de surveillance et d'alerte pilotés par l'EUDA. Quelles actions permettraient-elles d'améliorer la connaissance de la prévalence des usages problématiques d'opioïdes ?
Il existe de nombreux dispositifs de surveillance et d'alerte pilotés par l'EUDA. La multiplicité et la diversité des indicateurs permet la triangulation des informations. Les dispositifs de surveillance et d'alerte, ainsi que l'analyse de leurs données sont présentés dans le rapport annuel européen. Ils comprennent des indicateurs clés, rapportés annuellement au niveau national (nombre de décès, nombre de personnes qui entrent en traitement, saisies,...) ainsi qu'un système d'alerte précoce et des réseaux `sentinelles' locaux, tels que le réseau sentinelles hospitalier, l'analyse des eaux usées et des seringues usagées, les enquêtes en ligne, le réseau de services d'analyse (`drug-checking'), etc. dont les deniers chiffres sont disponibles dans le bulletin statistique (EUDA 2025).
Les actions suivantes permettraient d'améliorer la connaissance de la prévalence des usages problématiques d'opioïdes : étendre la couverture géographique des différents réseaux `sentinelles' existants ; renforcer la capacité laboratoire, ce que fait l'EUDA avec le nouveau réseau de laboratoires.
11. Quels pays européens sont-ils les plus proactifs en matière de réduction des risques ?
Le choix des pays européens en matière de réduction des risques varie en fonction des programmes de traitements de substitution aux opiacés et des actions de réduction des risques autorisées et mises en place telles que les services d'analyse (`drug-checking'), les programmes de distribution de seringues, les salles de consommation à moindre risque, les programmes de formation aux premiers secours et d'administration de la naloxone (`take home naloxone'), dans la communauté, ainsi qu'en prison et en prévision de la sortie de prison. Le point sur la disponibilité et le déploiement de ces services de santé est disponible, par pays, dans le dernier rapport annuel européen (Voir le chapitre 'Réduction des risques') et dans le bulletin statistique (EUDA 2025).
12. Avez-vous d'autres points à porter à l'attention des rapporteurs ?
Compte tenu du nombre croissant de décès par overdose chez les jeunes dans certains pays et de l'augmentation de la prévalence des problèmes de santé mentale chez les adolescents dans de nombreux pays (ESPAD Group 2025 ) les interventions auprès de ce groupe peuvent être intéressantes.
L'accent peut être mis sur l'offre de nombreuses alternatives de vie saine et sur l'engagement communautaire. Un équilibrage des interventions en faveur de la prévention, au profit des soins de santé primaire, du dépistage et de la prévention pourrait être encouragé.
La Finlande a conduit en 2024 une enquête nationale visant à comprendre les circonstances exactes des décès par overdose parmi les adolescents et les jeunes adultes. Cette enquête a mis en évidence les facteurs de risque dans les trajectoires de vie (Safety Investigation Authority 2024, Sanna Rönkä, Heta Konttinen et al. 2024, Rönkä, Konttinen et al. 2025)(voir aussi Questions fréquentes sur les overdoses en Europe et leur prévention (EUDA 2024). Cette méthode et cette analyse pourraient s'avérer utiles pour informer la surveillance et les réponses dans d'autres pays européens.
Références
Bayerische Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen (2025). Aktuelle Warnung: Lebensgefahr durch synthetische Opioide in Bayern [Current warning: Danger to life from synthetic opioids in Bavaria. Alerte actuelle : danger de mort dû aux opioïdes synthétiques en Bavière], BAS.
Bendjilali-Sabiani, J. J., C. Eiden, M. Lestienne, S. Cherki, D. Gautre, T. Van den Broek, O. Mathieu and H. Peyriere (2024). "Isotonitazene, a synthetic opioid from an emerging family: The nitazenes." Therapie 79(6): 655-658.
C. Eiden; M.Lestienne; H.Peyriere (2023). "Nouvelle famille d'opioides de synthèse: les nitazènes." Bulletin d'information de pharmacologie clinique de la région occitane(2): 2.
EMCDDA (2021). Balancing access to opioid substitution treatment (OST) with preventing the diversion of opioid substitution medications in Europe: challenges and implications: 50.
ESPAD Group (2025 ). Key findings from the 2024 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). EUDA. Lisbon.
EUDA (2024). EUDA Executive Director issues Call to action on new synthetic opioids at European Parliament. . EUDA.
EUDA (2024). European Drug Emergencies Network (Euro-DEN Plus): data and analysis. Lisbon.
EUDA. (2024, 30/08/2024). "Frequently asked questions (FAQ): drug overdose deaths in Europe." Retrieved 15/06/2025, 2024, from https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe_en.
EUDA (2025). Best practice portal. Xchange prevention registry.
EUDA (2025). European Drug Report 2024: trends and developments. Luxembourg.
EUDA (2025). European Drug Report 2024: trends and developments. Drug-induced deaths - the current situation in Europe. Luxembourg.
EUDA. (2025, 06/2025). "Statistical bulletin." Retrieved 06/06/2025, 2025, from https://www.euda.europa.eu/data/stats2025_en.
Giraudon, I., K. Abel-Ollo, D. Vanaga-Arâja, P. Heudtlass and P. Griffiths (2024). "Nitazenes represent a growing threat to public health in Europe." Lancet Public Health: 1.
Griffiths, P. N., T. Seyler, J. M. De Morais, J. E. Mounteney and R. S. Sedefov (2023). "Opioid problems are changing in Europe with worrying signals that synthetic opioids may play a more significant role in the future." Addiction.
Health Service Executive Ireland (2023). HSE issues warning to heroin users following cluster of overdoses in Dublin.
Ministère de l'Éducation Nationale, d. l. E. s. e. d. l. R. (2025). Développer les compétences psychosociales chez les élèves, Eduscol.
Negrault, N., B. Puech, J. Guyon, A. Daveluy, S. Bastard, D. Mete and A. Maillot (2025). "Case series of severe intoxications associated with new psychoactive substances on Reunion Island: Clinical description and diagnostic challenges." Toxicologie Analytique et Clinique.
Rönkä, S., H. Konttinen, P. Kriikku, P. Hakkarainen, M. Häkkinen and K. Karjalainen (2025). "Exploring the risk matrix of drug overdose deaths of young people: drug use patterns, individual characteristics, circumstances, and environment." Drug and Alcohol Dependence: 112757.
Safety Investigation Authority (2024). Accidental Drug-Related Deaths Among Young People in Finland in 2023: 159.
Sanna Rönkä, Heta Konttinen, Margareeta Häkkinen and K. Karjalainen (2024). The circumstances of drug-poisoning deaths among young people - Perspectives on prevention (Nuorten huumemyrkytyskuolemien olosuhteet - Näkökulmia ehkäisyyn). Study in Brief, THL. 24/2024: 13.
Seyler, T., I. Giraudon, A. Noor, J. Mounteney and P. Griffiths (2021). "Is Europe facing an opioid epidemic: What does European monitoring data tell us?" Eur J Pain 25(5): 1072-1080.
Trimbos Institute (2025). Waarschuwing: Namaak-oxycodonpillen met het levensgevaarlijke isotonitazepyne in omloop [Warning: Counterfeit oxycodone pills containing the life-threatening isotonitazepyne in circulation. Avertissement : Des pilules d'oxycodone contrefaites contenant de l'isotonitazepyne, une substance potentiellement mortelle, sont en circulation.].
UNODC (2025). Emerging analogues of brorphine. Laboratory and Scientific Service Portal Vienna, UNODC.
* 1 Les opioïdes sont une classe de substances naturelles, semi-synthétiques ou synthétiques dérivées du pavot à opium aux propriétés antalgiques et psychotropes, comprenant des médicaments comme le tramadol et des produits stupéfiants comme l'héroïne.
* 2 Ces dérivés naturels peuvent être désignés par le terme « opiacé ».
* 3 Article L. 5132-1 du code de la santé publique.
* 4 HAS, Guide de bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge des troubles de l'usage et des surdoses, mars 2022.
* 5 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 3.
* 6 Circulaire DGS DH n° 98 47 du 4 février 1998 relative à l'identification des structures de lutte contre la douleur chronique rebelle.
* 7 Les structures sont labellisées pour une durée de cinq ans par les agences régionales de santé, dans le cadre d'appels à candidatures nationaux. Le dernier appel à candidatures correspond à l'instruction n° DGOS/MQP/2022/191 du 21 juillet 2022 relative à l'organisation de l'appel à candidatures destiné au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur chronique en 2023, et à leur activité 2022.
* 8 SFETD, Livre blanc de la douleur 2017, p. 199.
* 9 Réponse de la HAS au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 10 Article L. 1112-4 du code de la santé publique.
* 11 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 6.
* 12 Sa création figurait parmi les mesures inscrites dans le deuxième plan national de lutte contre la douleur (2002-2005).
* 13 HCSP, Évaluation du plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, mars 2011.
* 14 Article L. 1411-1 du code de la santé publique.
* 15 SFETD, Accompagner pour mieux soigner la douleur en France, dossier de presse, 6 juin 2024.
* 16 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 17 Réponse de la SFETD au questionnaire transmis par les rapporteures, faisant référence à une enquête conduite par l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques (OFDA) avec Opinion Way.
* 18 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 19 SFETD, Livre blanc de la douleur 2017 - État des lieux et propositions pour un système de santé éthique, moderne et citoyen, 2017 ; cité par la Haute Autorité de santé, Parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique, janvier 2023, p. 10.
* 20 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 21 La dotation comprend désormais trois compartiments : un compartiment gé-populationnel, un lié à l'activité des structures et un relatif à la qualité.
* 22 Fiche MIG, P04, Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique, mars 2022.
* 23 Ministère des solidarités et de la santé, « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes - Feuille de route 2019-2022 ».
* 24 Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie.
* 25 Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues.
* 26 Article D. 3411-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 27 Article R. 3121-33-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 28 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 29 Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.
* 30 Il s'agit de la sous-section 48-04 du CNU : Thérapeutique-Médecine de la douleur ; Addictologie.
* 31 Réponse de la SFETD au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 32 Gouvernement, Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes, Feuille de route 2019-2022.
* 33 SFETD, Accompagner pour mieux soigner la douleur en France, dossier de presse, 6 juin 2024, p. 7.
* 34 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 18.
* 35 Ibid.
* 36 Article 68 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, modifiant l'article L. 4130-1 du code de la santé publique.
* 37 Sénat, rapport d'information sur les perspectives de la politique d'aménagement du territoire de cohésion territoriale sur le volet « renforcer l'accès aux soins », fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, par B. Rojouan, mars 2022.
* 38 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 39 OFDT, Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique, juillet 2023.
* 40 La primo-prescription de méthadone ne peut être réalisée que par un médecin exerçant à l'hôpital ou en CSAPA, seuls les renouvellements de traitements peuvent être prescrits en ville.
* 41 Dans la littérature relative à l'usage des drogues, le terme de « traitement par agonistes opioïdes » (TAO) est aujourd'hui privilégié à celui de « traitement de substitution aux opiacés » (TSO). Cette évolution tient au fait que la notion de TAO permet de mieux caractériser le fait que les traitements concernés visent à réduire les symptômes du sevrage et non seulement à sevrer les usagers.
* 42 OFDT, Traitements par agonistes opioïdes en France - Bilan 2024, p. 5.
* 43 Paracétamol, aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens.
* 44 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 12 (données de 2017).
* 45 Réponse de l'ANSM au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 46 La dose définie journalière est une unité de référence mesurant une dose recommandée de médicament par jour pour un adulte.
* 47 HAS, Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses, mars 2022.
* 48 Classification proposée par Lussier et Beaulieu au sein de l'International Association for the Study of Pain en 2010.
* 49 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 18.
* 50 Ibid., p. 6.
* 51 Données issues de l'enquête OPPIDUM.
* 52 Réponse des CEIP-A au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 53 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 29.
* 54 Réponse de la direction générale de la santé au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 55 Données issues de l'enquête DTA ; réponse des CEIP-A au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 56 Périmètre de l'enquête DRAMES.
* 57 Données de l'enquête DRAMES, en 2022, communiquées aux rapporteures par l'ANSM.
* 58 Gouvernement, « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes », Feuille de route 2019-2022, p. 10.
* 59 Autorisation de mise sur le marché.
* 60 La définition donnée par la DGS inclut une notion d'intentionnalité, que les rapporteures n'ont pas retenue dans leur étude.
* 61 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 62 Voir supra.
* 63 Selon le réseau des CEIP-A, « en 2023, 298 structures ont participé, incluant 5 358 sujets, avec 11 035 modalités de consommation de substances (dont la moitié des médicaments) ».
* 64 Voir infra.
* 65 Comme Lil Wayne.
* 66 Comme Freeze Corleone.
* 67 Voir infra.
* 68 Contribution écrite de Safe au questionnaire des rapporteures.
* 69 Contribution écrite de Safe au questionnaire des rapporteures.
* 70 Article R. 5132-97 du code de la santé publique.
* 71 Voir infra.
* 72 OFMA et Institut Analgesia « Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine » 13 avril 2022.
* 73 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 74 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.
* 75 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 76 Voir supra.
* 77 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 78 D'un niveau supérieur ou égal à 6/10.
* 79 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.
* 80 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.
* 81 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.
* 82 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 83 Réponses écrites de la DGS au questionnaire des rapporteures.
* 84 Réponses écrites de la Dr Evelyne Renault-Tessier au questionnaire des rapporteures.
* 85 Voir infra.
* 86 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.
* 87 Voir infra.
* 88 Réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.
* 89 Réponses écrites du Pr Benjamin Rolland au questionnaire des rapporteures.
* 90 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 91 Réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.
* 92 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 93 Livre blanc de la naloxone, 14/11/2024,
https://safe.asso.fr/images/Documents/LIVRE_BLANC_DE_LA_NALOXONE_V19-prefinal.pdf
* 94 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 95 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 96 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.
* 97 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 98 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 99 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.
* 100 Réponses écrites de la DGS au questionnaire des rapporteures.
* 101 Arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2023 à 2025.
* 102 Notamment l'université Bourgogne Europe, l'université de Toulouse, l'université Paris-Saclay, ou l'université Paris Cité.
* 103 Article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.
* 104 Delage et al., 2021, Validation transculturelle d'une version franco-européenne de l'échelle de mésusage des prescriptions d'opioïdes (POMI-5F).
* 105 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 106 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.
* 107 Réponses écrites de la FFA au questionnaire des rapporteures.
* 108 Réponses écrites de la Fédération Addiction au questionnaire des rapporteures.
* 109 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.
* 110 Réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.
* 111 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 112 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 113 OFMA et Institut Analgesia, « Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine », 13 avril 2022.
* 114 Dont 18 dans un contexte suicidaire.
* 115 Réponses écrites de la FFA au questionnaire des rapporteures.
* 116 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
* 117 Article L. 1111-2 du code de la santé publique.
* 118 Depuis 1995 pour les médecins, par exemple.
* 119 Article R.4127-35 du code de la santé publique.
* 120 Article L. 1111-2, R. 4127-35 et R. 4312-13 du code de la santé publique, notamment.
* 121 Réponses écirtes de la Mildeca au questionnaire des rapporteures.
* 122 Réponses écrites de SAFE au questionnaire des rapporteures.
* 123 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 124 Voir infra.
* 125 Voir infra.
* 126 Voir infra.
* 127 Voir infra.
* 128 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 129 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 130 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 131 OFMA et Institut Analgesia, « Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine », 13 avril 2022.
* 132 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.
* 133 Voir infra.
* 134 Citons par exemple les réponses écrites au questionnaire des rapporteures de la FFA : « Le système de santé français comporte des garde- fous de nature à protéger de ce genre de dérive aux conséquences sanitaires effroyables pour ce qui concerne les prescriptions médicamenteuses », de la SFETD : « Les risques sont beaucoup plus surveillés et maîtrisés en France », du Leem : « Le Leem et l'ensemble de ses adhérents considèrent que le cadre réglementaire actuel permet de suffisamment protéger les citoyens et les patients français d'une telle crise ».
* 135 Réponses écrites de l'Ambassade de France aux États-Unis au questionnaire des rapporteures.
* 136 Réponses écrites de l'OFDT au questionnaire des rapporteures.
* 137 Réponses écrites de l'Ambassade de France aux États-Unis au questionnaire des rapporteures.
* 138 Réponses écrites de l'OFDT au questionnaire des rapporteures.
* 139 Réponses écrites de l'Ambassade de France aux États-Unis au questionnaire des rapporteures.
* 140 Réponses écrites de l'Ambassade de France aux États-Unis au questionnaire des rapporteures.
* 141 Réponses écrites de l'Ambassade de France aux États-Unis au questionnaire des rapporteures.
* 142 Réponses écrites de l'Ambassade de France aux États-Unis au questionnaire des rapporteures.
* 143 Réponses écrites de l'OFDT au questionnaire des rapporteures.
* 144 Voir supra.
* 145 Ce qui n'est plus le cas d'aucun opioïde depuis l'obligation de prescription pour les spécialités codéinées en vertu de l'arrêté du 12 juillet 2017 portant modification des exonérations à la réglementation des substances vénéneuses.
* 146 Article L. 5122-6 du code de la santé publique.
* 147 Article L. 5122-8 du code de la santé publique.
* 148 Article L. 5122-6 du code de la santé publique.
* 149 Article L. 5122-1 du code de la santé publique.
* 150 Article L. 5122-2 du code de la santé publique.
* 151 Article L. 5122-9 du code de la santé publique.
* 152 Site internet de l'ANSM.
* 153 Réponses écrites du Leem au questionnaire des rapporteures.
* 154 Article R. 5132-99 du code de la santé publique.
* 155 Cela découle de la lecture de l'article R. 5132-98 du code de la santé publique.
* 156 Article R. 5132-104 du code de la santé publique.
* 157 Article R. 5132-102 du code de la santé publique.
* 158 Article R. 5132-103 du code de la santé publique.
* 159 Réponses écrites du Leem au questionnaire des rapporteures.
* 160 Réponses écrites du réseau des CEIP-A au questionnaire des rapporteures.
* 161 Voir l'encadré dédié supra.
* 162 Réponses écrites du réseau des CEIP-A au questionnaire des rapporteures.
* 163 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 164 Article L. 5121-22 du code de la santé publique.
* 165 Articles L. 5121-24 et L. 5121-25 du code de la santé publique.
* 166 Article L.5121-14-3 du code de la santé publique.
* 167 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 168 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 169 Arrêté du 12 juillet 2017 portant modification des exonérations à la réglementation des substances vénéneuses.
* 170 Site internet de l'ANSM.
* 171 Voir notamment Volkow & McLellan, 2016.
* 172 À l'exception d'une spécialité de buprénorphine.
* 173 2° de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique.
* 174 Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.
* 175 Article R. 5132-30 du code de la santé publique.
* 176 Article R. 5132-30 du code de la santé publique.
* 177 Sauf le fentanyl à action prolongée.
* 178 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 179 Aux termes de l'article L. 5132-6 du code de la santé publique, la liste I comprend les médicaments « présentant les risques les plus élevés pour la santé ». Dans les faits, la grande majorité des opioïdes est inscrite sur la liste I, certains sirops antitussifs codéinés faisant exception.
* 180 Arrêté du 13 janvier 2020 fixant la durée de prescription des médicaments à base de tramadol administrés par voie orale.
* 181 Comme la spécialité Ixprim, contenant du tramadol et du paracétamol.
* 182 L'entrée en vigueur de cette mesure était initialement prévue au 1er décembre 2024.
* 183 Décision du 24/09/2024 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants et fixant des durées de prescription (tramadol/codéine), modifiée par les décisions du 27/11/2024 et du 26/02/2025.
* 184 Voir infra pour l'obligation de recours à une ordonnance sécurisée.
* 185 Réponses écrites du Leem au questionnaire des rapporteures.
* 186 Voir supra.
* 187 Qui préférait « un avis spécialisé après 3 mois de prescription et 150mg jour Equivalent Morphinique ».
* 188 Qui préférait « après 3 mois et 150mg d'équivalent opiacé, dans les douleurs non cancéreuses, un avis spécialisé douleur chronique [...] et/ou addictologue ».
* 189 Réponses écrites de la DGS au questionnaire des rapporteures.
* 190 Articles L. 4071-1 à L. 4071-3 du code de la santé publique.
* 191 Article L. 4071-3 du code de la santé publique.
* 192 Article R. 4073-2 du code de la santé publique.
* 193 Article L. 4071-4 du code de la santé publique.
* 194 Article R. 4073-1 du code de la santé publique.
* 195 Article R. 5132-5 du code de la santé publique.
* 196 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 197 Les ordonnances sécurisées doivent en effet répondre à la norme Afnor NF280
* 198 Réponses écrites de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 199 Prévue par l'article R. 5132-39 du code de la santé publique.
* 200 Décision du 24/09/2024 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants et fixant des durées de prescription (tramadol/codéine), modifiée par les décisions du 27/11/2024 et du 26/02/2025.
* 201 Lorsque l'ordonnance n'est pas dématérialisée.
* 202 Les citations de ce paragraphe sont tirées des réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.
* 203 Réponses écrites du Pr Benjamin Rolland au questionnaire des rapporteures.
* 204 Approuvée par l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 205 Réponses écrites de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 206 Réponses écrites de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 207 Réponses écrites de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 208 Réponses écrites de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 209 Réponses écrites de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 210 Article R. 5132-33 du code de la santé publique.
* 211 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 212 Article R. 5132-33 du code de la santé publique.
* 213 La SFETD indique, par exemple, dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteures, que : « La diminution d'un nombre d'unités de prise par boite peut permettre de limiter les comportements secondaires d'automédication par le patient ou son entourage ».
* 214 Réponses écrites du Cnom au questionnaire des rapporteures.
* 215 Réponses écrites du Dr Evelyne Renault-Tessier au questionnaire des rapporteures.
* 216 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 217 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 218 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.
* 219 Réponses écrites de la Dr Evelyne Renault-Tessier au questionnaire des rapporteures.
* 220 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 221 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.
* 222 « Caution : Opioid can cause dependance », soit : « Attention : les opioïdes peuvent provoquer une dépendance ».
* 223 Réponses écrites du Leem au questionnaire des rapporteures.
* 224 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 225 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.
* 226 Plus largement, les fentanyloïdes, auxquels appartient le carfentanyl, sont des dérivés non pharmaceutiques du fentanyl.
* 227 National Center for Health Statistics, Drug Overdose Deaths in the United States, 1999-2016, december 2017.
* 228 Audition de Marie-Jauffret Roustide par la commission des affaires sociales du Sénat, le 9 avril 2025.
* 229 Réponse de la Fédération Addiction au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 230 Réponse du Groupe Santé Addictions au questionnaire envoyé par les rapporteures.
* 231 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Afghanistan Opium Survey 2023.
* 232 L'évolution des cultures est présentée en hectares de surfaces cultivées et l'évolution de la production en tonnes.
* 233 OFDT, Héroïne et opioïdes, synthèse des connaissances, 2023.
* 234 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 235 Bertrand Monnet, film documentaire « Narco business : au coeur des labos du fentanyl », 2023.
* 236 David le Pabic, « Fentanyl en France : l'épidémie qui vient ? », revue Swaps n °109, hiver 2024.
* 237 Réponse de Michel Gandilhon au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 238 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 239 Réponse de l'EUDA au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 240 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 241 H. Englander, M. Jauffret-Roustide, B. Rolland, « Le fentanyl pourrait-il remettre en question certains aspects du paradigme du traitement des addictions et de la réduction des risques en France ? », revue Swaps n° 109, hiver 2024.
* 242 OFDT, Drogues et addictions - Chiffres-clés, 2022, p. 7.
* 243 M. Gandhilon, « Héroïne : l'Europe en sevrage forcé ? », revue Swaps n° 109, hiver 2024.
* 244 European Union Drugs Agency (EUDA), Comprendre le phénomène des drogues en Europe en 2025 - principales évolutions, juin 2025, p. 20.
* 245 UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2023.
* 246 Réponse de la Mildeca au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 247 Réponse de la HSA de Strasbourg au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 248 M. Martinez et M. Gandilhon, État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France, octobre 2021.
* 249 Réponse de l'ANSM au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 250 Réponse de la Fédération Addiction au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 251 Réponse de l'OFDT au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 252 La DGS a indiqué aux rapporteures qu'il est envisagé de pérenniser l'usage de certains médicaments à base de cannabinoïdes, dans la continuité d'une expérimentation initiée par la LFSS pour 2020, pour traiter des douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, des douleurs cancéreuses rebelles liées au cancer ou au traitement anticancéreux, ainsi que pour les situations palliatives avancées.
* 253 Audition de la sociologue Marie Jauffret-Roustide par la commission des affaires sociales du Sénat, 9 avril 2025.
* 254 OFDT, Traitements par agonistes opioïdes en France - Bilan 2024, décembre 2024.
* 255 Les données présentées par l'OFDT dans ses notes de bilan annuelles sur les TAO font apparaître une baisse sensible du nombre de bénéficiaires, imputable à un changement de la méthodologie de dénombrement de ces bénéficiaires (utilisation des données d'Open Médic jusqu'en 2022, exploitation du SNDS depuis 2023). Après correction de ce biais, les données montrent une baisse légère, qui conduit l'OFDT à considérer que le nombre de bénéficiaires de TAO est globalement stable.
* 256 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par les rapporteures. De telles situations sont rapportées en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et le Grand Est.
* 257 Cnom et Cnop, « Les ordres des médecins et des pharmaciens réaffirment leur engagement dans la prise en charge des conduites addictives, communiqué de presse, 9 juillet 2024.
* 258 OFDT, L'usage de sulfates de morphine par les usagers de drogues en France, note 2014-10 du dispositif TREND, 10 juillet 2014.
* 259 HAS, Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses, mars 2022, p. 12.
* 260 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 261 Une enquête conduite en 2024 par un collectif d'associations montre que 97 % des pharmaciens et 87 % des médecins répondants connaissent la naloxone, mais 58 % des pharmaciens et 72 % des médecins ne connaissent pas les spécialités susceptibles d'être vendues directement aux patients en pharmacie de ville. Les résultats de l'enquête sont mentionnés dans le « Livre blanc de la naloxone - Réduire le risque de surdose d'opioïdes en améliorant la diffusion de la naloxone ».
* 262 Réponse de l'association Safe au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 263 Site internet de la Mildeca, « L'essentiel sur... La réduction des risques et des dommages : une politique entre sciences, humanisme et pragmatisme ».
* 264 Réponse de la direction générale de la santé au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 265 Article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 266 En 2023, la HSA de Paris enregistre 70 866 passages avec consommation, contre 8 958 pour la HSA de Strasbourg.
* 267 Inserm, Salles de consommation à moindre risque en France : rapport scientifique, mai 2021.
* 268 Définition de l'éducation thérapeutique pour l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1996.
* 269 L'usage du questionnaire POMI (Prescription Opioid Misuse Index) est recommandé par la HAS.
* 270 Article 5 de l'avenant n° 1 à la convention nationale du 9 mars 2022 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, signé le 10 juin 2024.
* 271 Réponse de la SFETD au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 272 Ibid.
* 273 Livre blanc de la naloxone - Réduire le risque de surdose d'opioïdes en améliorant la diffusion de la naloxone, p. 22.
* 274 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.
* 275 SFETD, Menaces sur la prise en charge de patients souffrant de douleur chronique en France.
* 276 Réponse de l'association Safe au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 277 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par les rapporteures.
* 278 https://www.ofdt.fr/publication/2024/traitements-par-agonistes-opioides-en-france-bilan-2024-2469
* 279 Medic'AM est une base de données de l'assurance maladie qui contient des informations détaillées sur les médicaments remboursés par l'ensemble des régimes d'assurance maladie, en France entière
* 280 Le GERS est un groupement d'intérêt économique créé par les entreprises du médicament. Les données recueillies ne concernent que les laboratoires et grossistes adhérents.
* 281 Le GERS est un groupement d'intérêt économique créé par les entreprises du médicament. Les données recueillies ne concernent que les laboratoires et grossistes adhérents.
* 282 Cette croissance avait été plus marquée en 2011, année du retrait du marché de l'association dextropropoxyphène-paracétamol. Cette mesure faisait suite à la décision de la Commission européenne du 14 juin 2010.
* 283 https://ansm.sante.fr/uploads/2020/10/19/20 201 019-rapport-antalgiques-opioides-fev-2019-3-pdf-2019-03-06.pdf
* 284 https://ansm.sante.fr/page/resultats-denquetes-pharmacodependance-addictovigilance
* 285 HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
* 286 HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
* 287 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_prevention_des_surdoses_opioides-juillet_2019.pdf.
* 288 Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients - Résultats du Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale LES DOSSIERS DE LA DREES n° 80 • juillet 2021.
* 289 Parmi les médecins ayant initié ou renouvelé un TSO dans l'année, 45 % considèrent « se sentir suffisamment formés pour cette prise en charge », cette perception étant nettement plus fréquente parmi les praticiens qui ont initié un TSO (64 %) que parmi ceux qui ont uniquement renouvelé ce type de traitement dans l'année (35 %).
* 290 Duprat L., Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique. Paris, OFDT, juillet 2023.
* 291 Dans cette enquête, deux tiers des consommateurs utilisent ces médicaments depuis plus de trois mois et un tiers depuis plus d'un an. Lombalgies, céphalées et douleurs articulaires sont les 3 principaux motifs de prise de ces traitements.
* 292 OFMA et Institut Analgesia "Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine" 13 avril 2022.
* 293 HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
* 294 Guide de bonnes pratiques publié en 2019 dirigé par le Pr Frédéric Aubrun, Président de la SFETD. https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/uploads/2019/12/guidebp.pdf
* 295 https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/article/les-structures-specialisees-douleur-chronique-sdc
* 296 Haut conseil de la santé publique. Evaluation du plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006- 2010. Paris : La Documentation française ; 2011. https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20 110 315_evaldouleur20 062 010.pdf
* 297 https://www.cnrd.fr/getfile.php ?file=/14/document_public/1926/1/livre_blanc-SFETD-interactif-bis.pdf
* 298 https://www.cnrd.fr/14/page/8082/les_structures.html
* 299 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_decennale_soins_d_accompagnement.pdf
* 300 has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/guide._parcours_de_sante_dune_personne_presentant_une_douleur_chronique.pdf
* 301 SFETD - Menaces sur la prise en charge des patients souffrant de douleur chronique en France Une formation et des structures douleur chroniques fragilisées
* 302 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf
* 303 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf
* 304 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf
* 305 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf
* 306 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco_opioides.pdf
* 307 Actualité - Tramadol et codéine : les nouvelles règles de prescription et délivrance entrent en vigueur le 1er mars 2025 - ANSM.
* 308 Accompagnement des patients sous traitement antalgique de palier II | ameli.fr | Pharmacien
* 309 Duprat L., Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique. Paris, OFDT, juillet 2023.
* 310 Guide de bonnes pratiques publié en 2019 dirigé par le Pr Frédéric Aubrun, Président de la SFETD. https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/uploads/2019/12/guidebp.pdf
* 311 Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients • Résultats du Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale LES DOSSIERS DE LA DREES n° 80 • juillet 2021.
* 312 Recommandation HAS • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022
* 313 Fiche HAS • Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/principes_generaux_dutilisation_des_medicaments_opioides_-_fiche.pdf
* 314 Fiche HAS • Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
* 315 OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) est un dispositif de pharmacosurveillance et de veille sanitaire sur les substances psychoactives (SPA) du Réseau Français d'Addictovigilance existant depuis plus de 30 ans. Il repose sur des enquêtes transversales, nationales et multicentriques menées chaque année au mois d'octobre. Il recueille, sur l'ensemble du territoire, grâce à une collaboration de proximité avec les structures spécialisées dans les addictions, des informations sur les modalités de consommation des SPA prises la semaine précédant l'enquête par les patients présentant un abus, une dépendance, ou sous médicaments de substitution aux opiacés (MSO).
https://ansm.sante.fr/uploads/2024/09/11/20 240 911-plaquette-oppidum-2023.PDF
* 316 Fiche HAS • De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
* 317 OFDT • Traitements par agonistes opioïdes en France Bilan 2024 • décembre 2024.
https://www.ofdt.fr/publication/2024/traitements-par-agonistes-opioides-en-france-bilan-2024-2469
* 318 Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
* 319 Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
* 320 http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_TSO_en_milieu_carceral.pdf
* 321 has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/guide._parcours_de_sante_dune_personne_presentant_une_douleur_chronique.pdf
* 322 Fiche HAS • De la prévention du trouble de l'usage et des surdoses à la prise en charge des surdoses d'opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022.
* 323 Fiche HAS • Principes généraux d'utilisation des médicaments opioïdes • Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses • mars 2022 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/principes_generaux_dutilisation_des_medicaments_opioides_-_fiche.pdf
* 324 Résultats d'enquêtes pharmacodépendance-addictovigilance - ANSM
* 325 Les SCMR ont été renommées Haltes Soins Addictions (HSA) par la loi française n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
* 326 https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190 212_web.pdf
* 327 Au coeur des trafics d'héroïne en France, les filières albanophones | Cairn.info
* 328 Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2023 | OFDT
* 329 Crise des opioïdes : comment l'Agence du médicament compte éviter l'emballement en France
* 330 L'héroïne en milieu rural en France : une réalité ignorée
* 331 European Drug Report 2024 : Trends and Developments : source data | www.euda.europa.eu
* 332 Griffiths Paul et al., Opioid problems are changing in Europe with worrying signals that synthetic opioids may play a more significant role in the future, Addiction, December, 2023.
* 333 Laniel Laurent, « La méthamphétamine, les Pays-Bas et les cartels mexicains : la coopération sans frontières », Observatoire des criminalités internationales, IRIS, 2021.
* 334 « Île-de-France : le trio importait de la drogue de synthèse contenant du carfentanil », Le Parisien, 17 février 2024.
* 335 États-Unis : la crise des opioïdes comme révélateur social et... politique | vih.org
* 336 La Géorgie et les drogues illicites : trafics, usages et politiques publiques. Drogues, enjeux internationaux n° 13 - documentation-administrative.gouv.fr
* 337 Obradovic I. La tragédie des drogues aux Etats-Unis. Enjeux et perspectives d'une urgence. In : Ramses 2025. Entre puissances et impuissance, de Montbrial T., David D., Ifri (Dir.). Paris, Dunod, 2024, p. 134-139.
* 338 https://www.euda.europa.eu/publications/pods/drug-consumption-rooms_en
* 339 https://opioidprinciples.jhsph.edu/
* 340 https://www.kff.org/mental-health/issue-brief/opioid-deaths-fell-in-mid-2023-but-progress-is-uneven-and-future-trends-are-uncertain/
* 341 https://www.nsc.org/community-safety/safety-topics/opioids/prescription-drug-misuse ?srsltid=AfmBOorxY8ILiZ5ktXNoPQSPPgobbuyz5onUejKGIKUjHQ3gpUqu6hj1.
* 342 https://www.cdc.gov/niosh/substance-use/opioids-and-work/index.html# :~ :text=A %20National %20Safety %20Council %20survey,part %2Dtime %20jobs %20in %202 021.
* 343 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12 889-025-22 210-8 ?utm_source=chatgpt.com
* 344 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31 494 440/
* 345 https://apnews.com/article/california-naloxone-opioid-reversal-drug-newsom-362035177cb6c1ae0fa2c518e071a46e