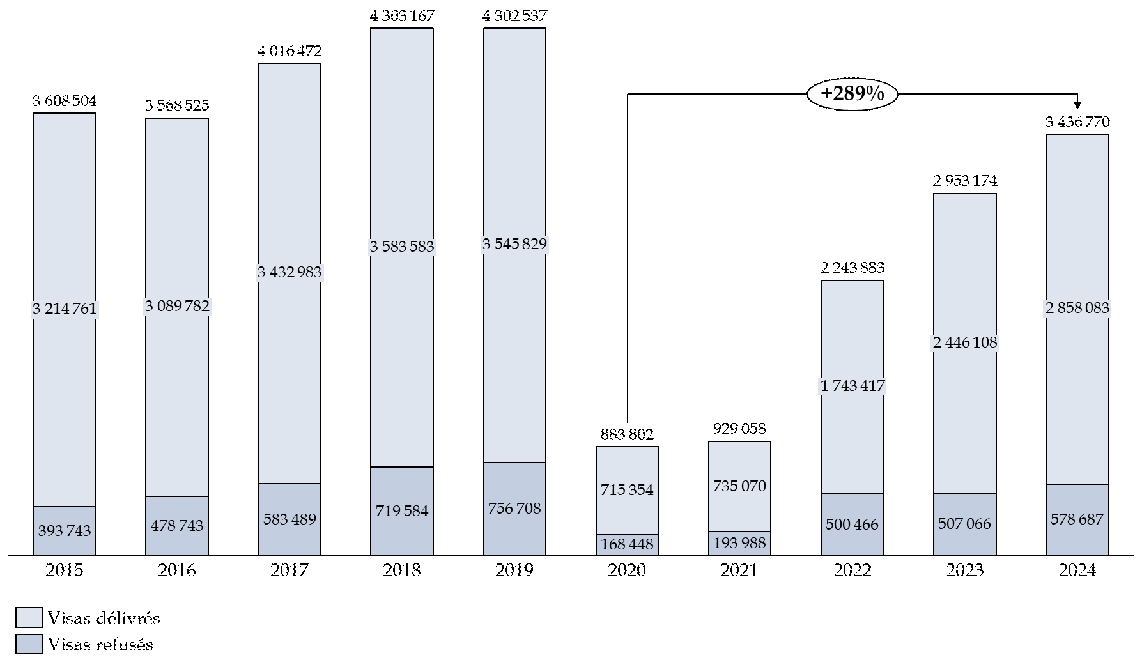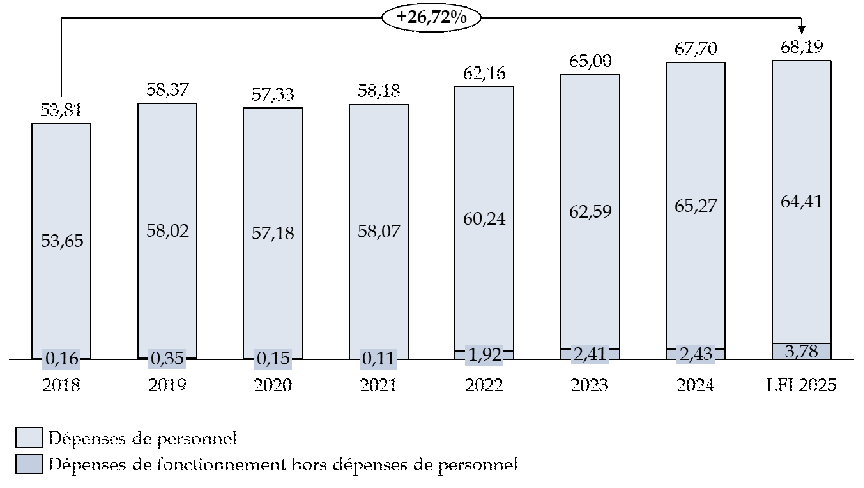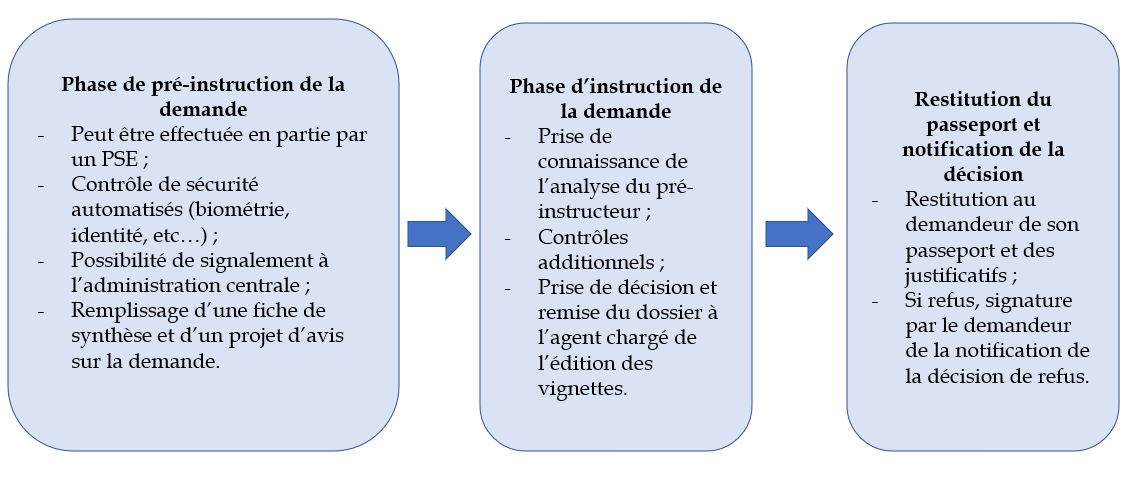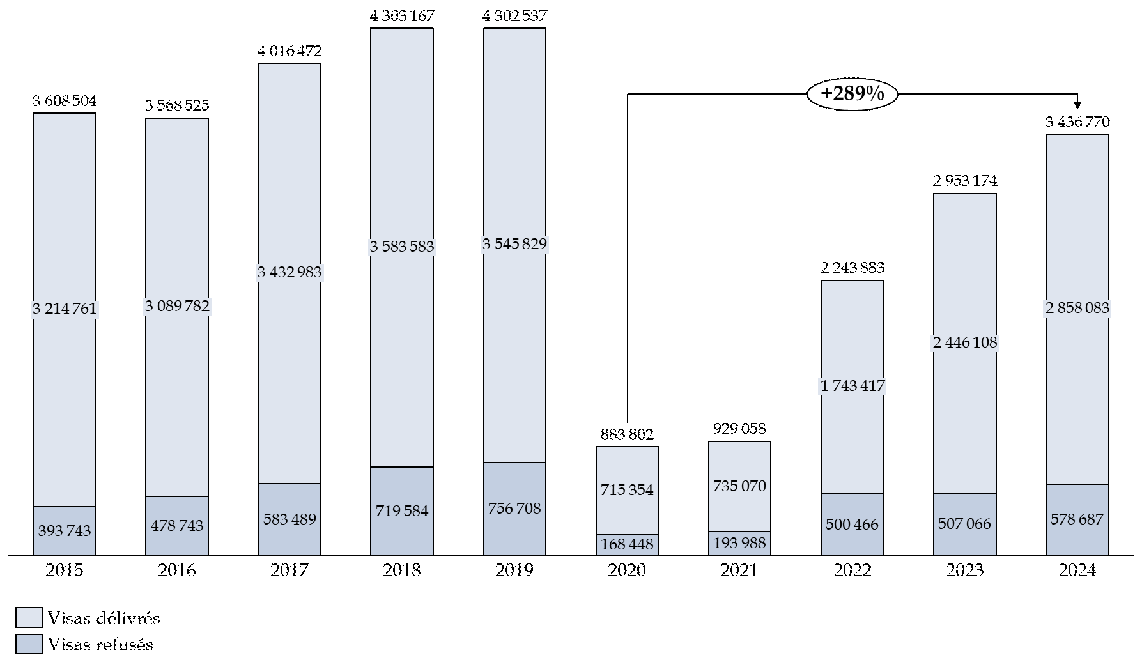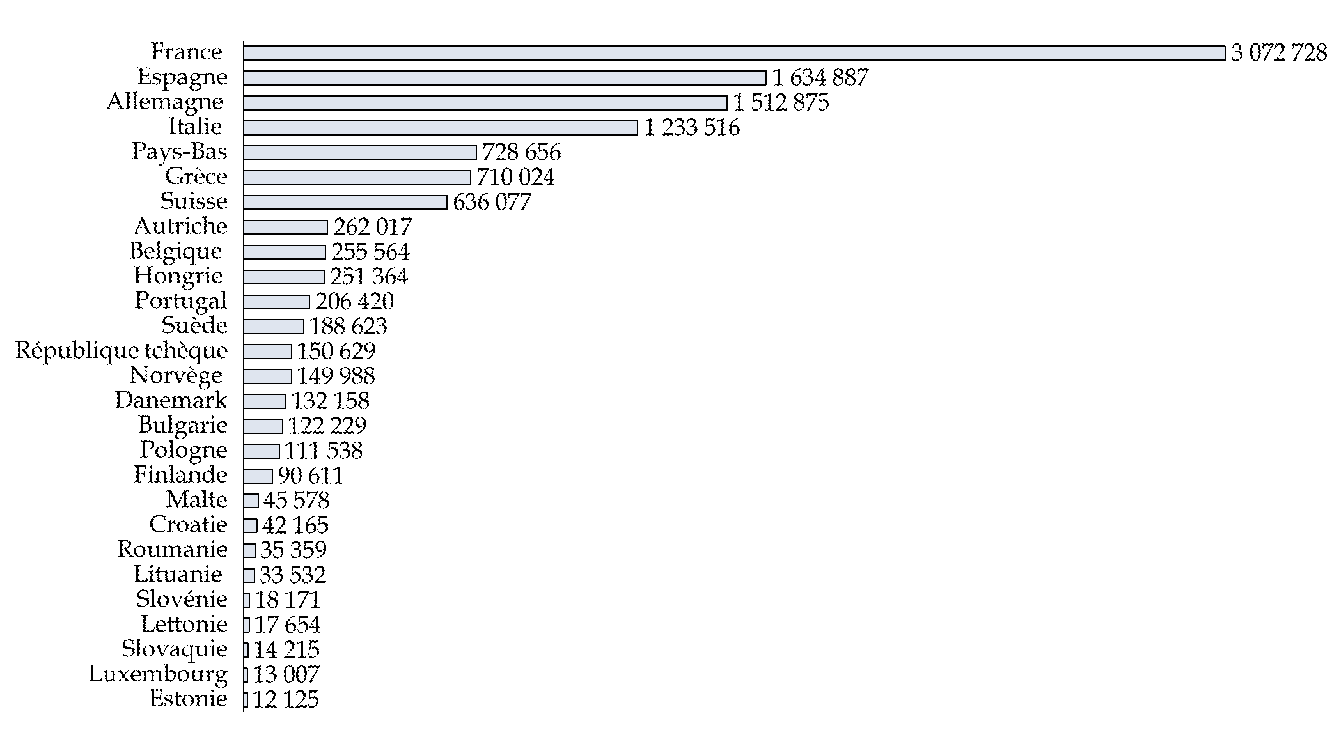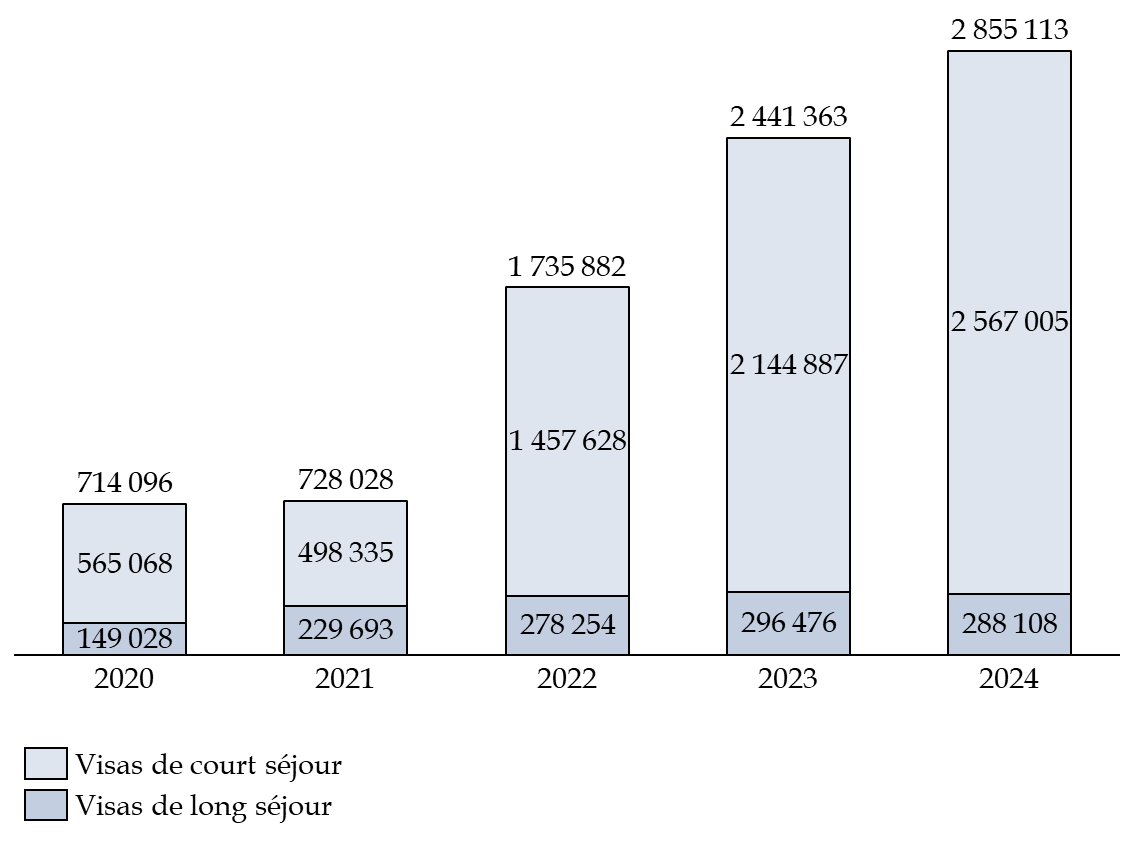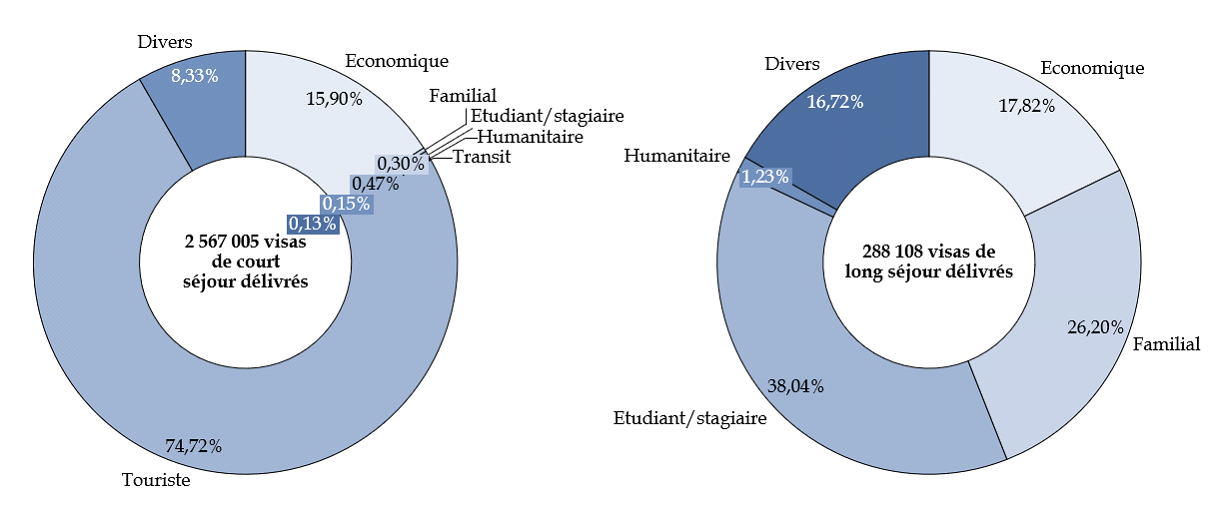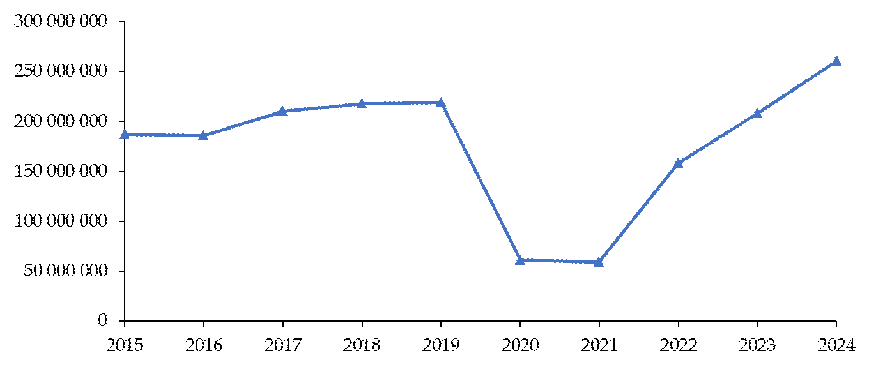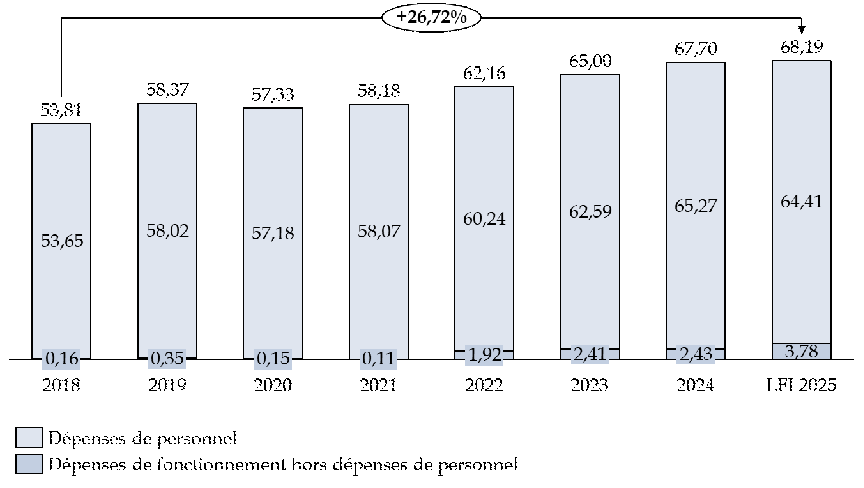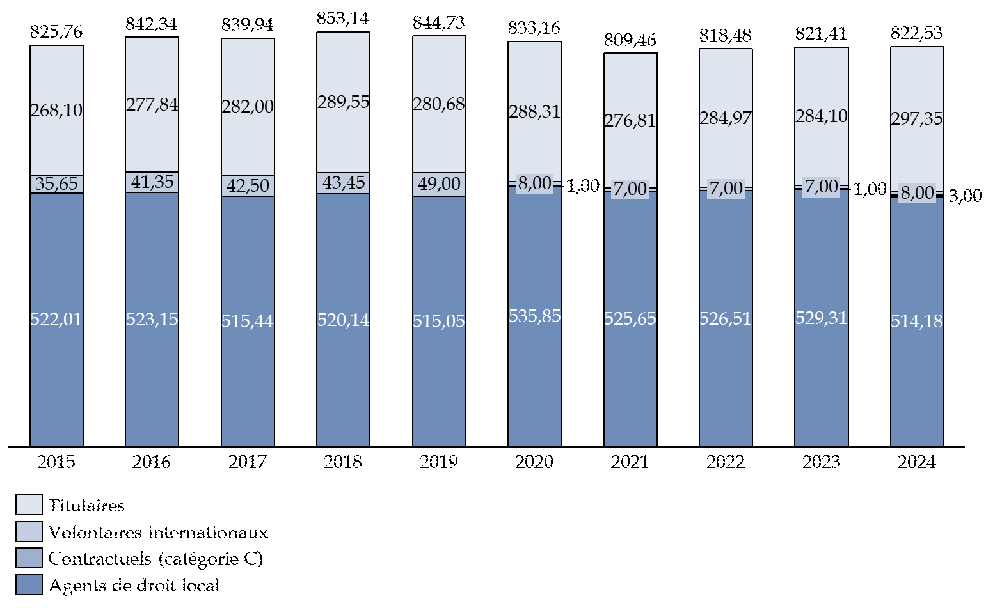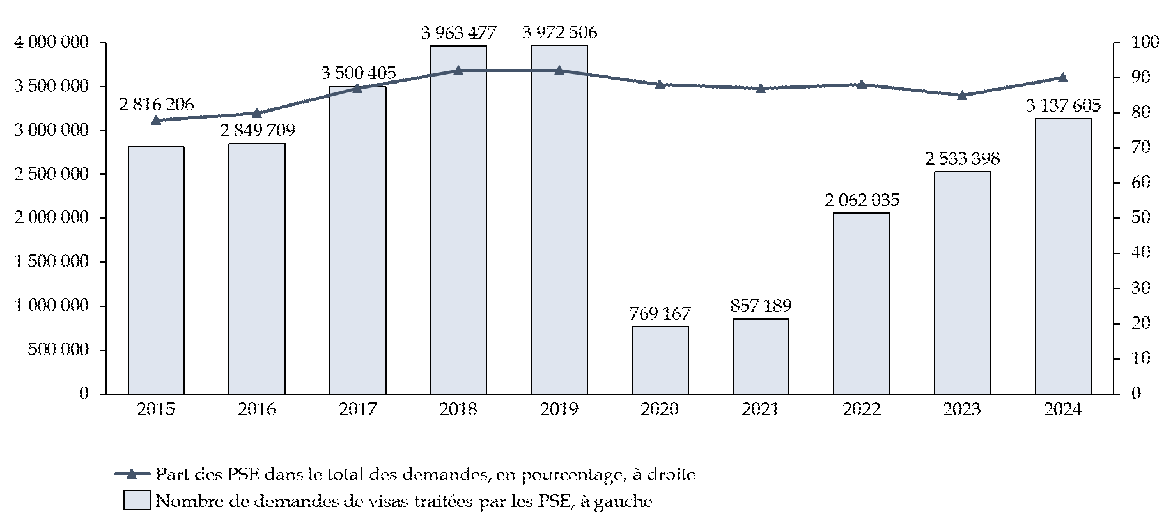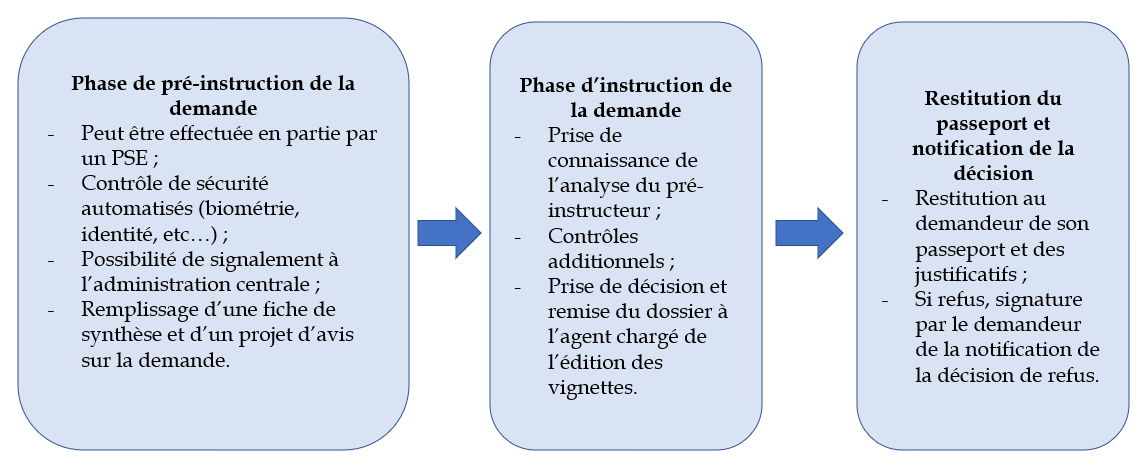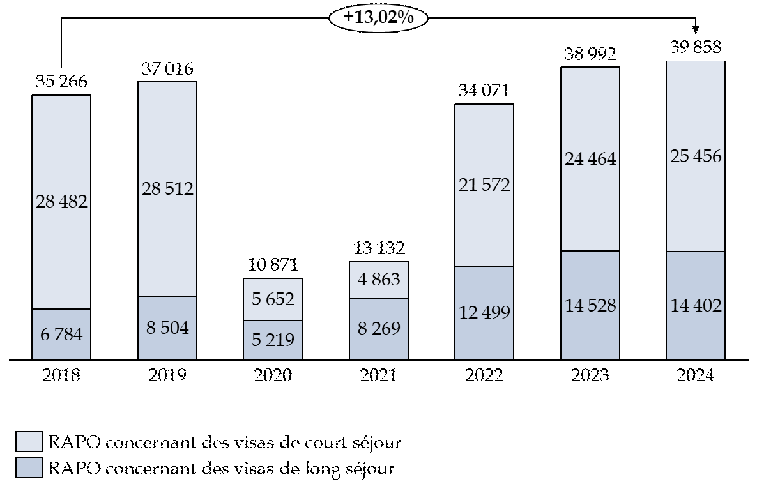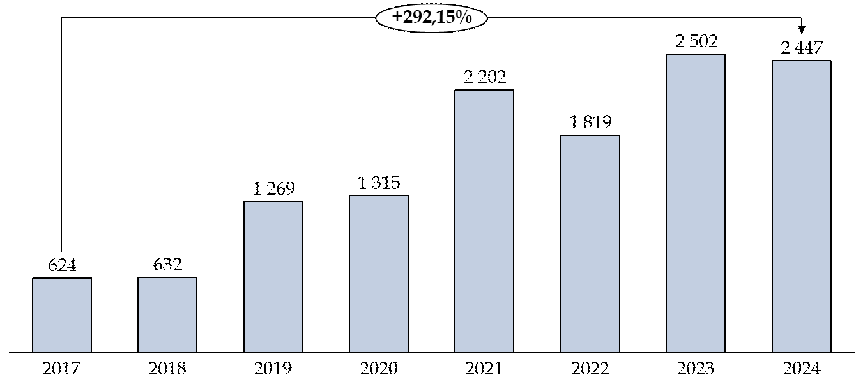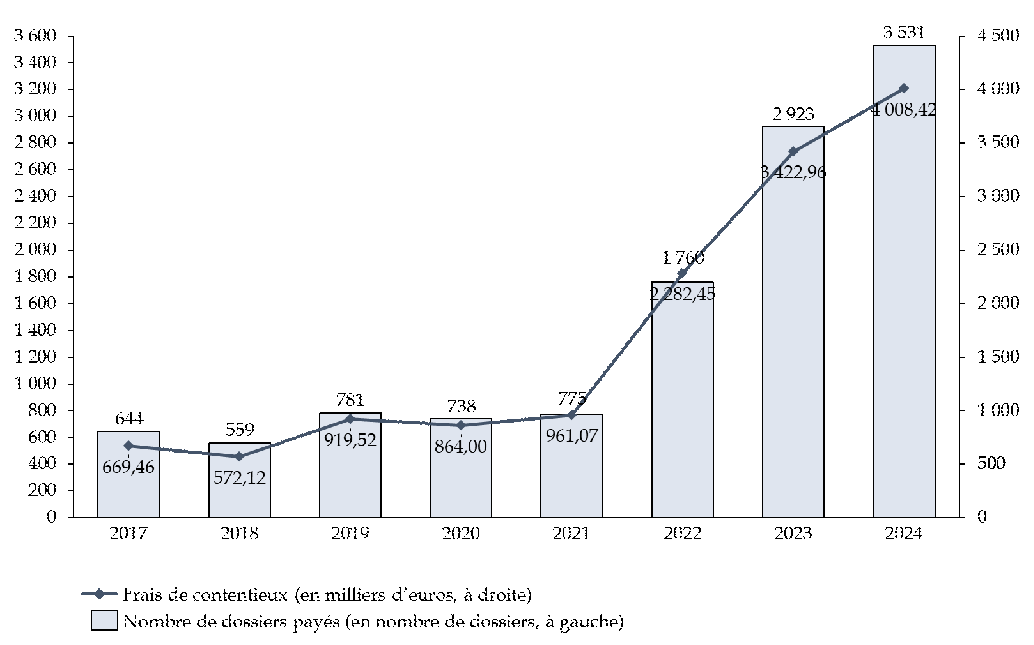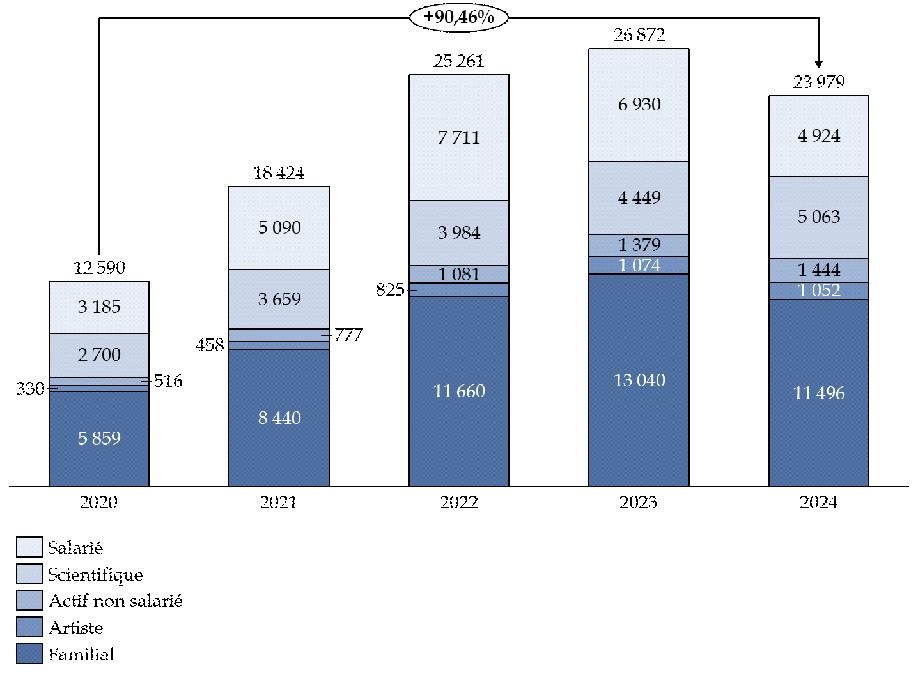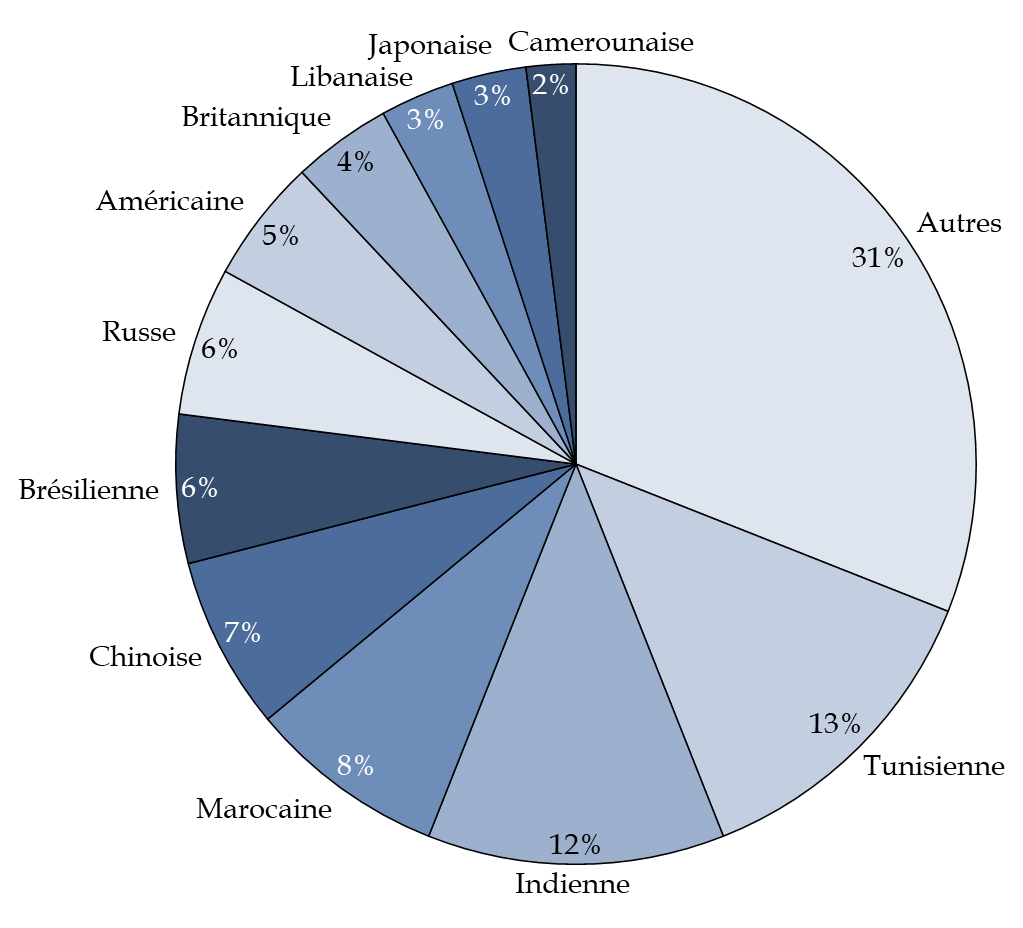- L'ESSENTIEL
- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
- PREMIÈRE PARTIE
LA DÉLIVRANCE DES VISAS,
UNE ACTIVITÉ AU PILOTAGE BICÉPHALE
SOUS PRESSION DE LA HAUSSE DES DEMANDES
- DEUXIÈME PARTIE
LA DÉLIVRANCE DES VISAS, UNE ACTIVITÉ AU COÛT LIMITÉ AU REGARD DU DYNAMISME DES FRAIS DE VISA
- I. LES DROITS DE VISAS, UNE RECETTE NON FISCALE QUI
CONNAÎT UNE CROISSANCE SOUTENUE
- II. UNE PROGRESSION DES DÉPENSES
LIÉES À L'INSTRUCTION DES VISAS...
- III. ...TEMPÉRÉE PAR UNE
DÉMARCHE D'EXTERNALISATION ANCIENNE PERMETTANT DE PALLIER LE MANQUE
D'EFFECTIFS POUR UN COÛT BUDGÉTAIRE LIMITÉ
- I. LES DROITS DE VISAS, UNE RECETTE NON FISCALE QUI
CONNAÎT UNE CROISSANCE SOUTENUE
- TROISIÈME PARTIE
LA DÉLIVRANCE DES VISAS
FACE À UNE TRIPLE CONTRAINTE D'EFFICACITÉ,
DE SÉCURITÉ ET D'ATTRACTIVITÉ
- I. POURSUIVRE LA MODERNISATION DES SERVICES
CONSULAIRES
- A. LA NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE
MAÎTRISE DES DÉLAIS D'INSTRUCTION, SANS EN AUGMENTER EXCESSIVEMENT
LES COÛTS
- B. UNE DÉMARCHE DE REGROUPEMENT QUI DOIT
ÊTRE PROLONGÉE DE MANIÈRE PLUS VOLONTARISTE
- C. LA DÉMATÉRIALISATION DU
TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS : UN CHANTIER ENCORE INACHEVÉ
- 1. France Visas : une rénovation
profonde des outils numériques de la délivrance des visas
- 2. Trois enjeux principaux pour le futur de France
visas : la poursuite de la dématérialisation des demandes,
l'interopérabilité avec les différents systèmes
d'information et la mise en place de la plateforme européenne des visas
- 1. France Visas : une rénovation
profonde des outils numériques de la délivrance des visas
- A. LA NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE
MAÎTRISE DES DÉLAIS D'INSTRUCTION, SANS EN AUGMENTER EXCESSIVEMENT
LES COÛTS
- II. DEUX PROBLÉMATIQUES ACCOMPAGNENT LA
HAUSSE DES DEMANDES : LA FRAUDE ET LA MASSIFICATION DU CONTENTIEUX
- A. UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE DE LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX VISAS
- B. LE CONTENTIEUX DES VISAS : UNE
MASSIFICATION QUI PÂTIT DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
ENTRE MINISTÈRES
- A. UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE DE LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX VISAS
- III. LA DÉLIVRANCE DES VISAS AU CoeUR DE LA
POLITIQUE MIGRATOIRE
- I. POURSUIVRE LA MODERNISATION DES SERVICES
CONSULAIRES
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- ANNEXE
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 904
SÉNAT
2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur la délivrance des visas,
Par Mme Nathalie GOULET et M. Rémi FÉRAUD,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
I. UNE ACTIVITÉ À LA MERCI DE LA HAUSSE DES DEMANDES
A. LA DÉLIVRANCE DES VISAS, UNE ACTIVITÉ SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU QUAI D'ORSAY ET DE BEAUVAU...
Trois objectifs principaux s'attachent à la politique des visas : une dimension sécuritaire (limiter les menaces à l'ordre public), une dimension migratoire (encadrer les entrées sur le territoire) et une dimension d'influence et d'attractivité (attirer les profils contribuant au rayonnement de la France).
Compte tenu de cette diversité d'objectifs, depuis 2007, la compétence ministérielle sur la politique des visas est partagée entre le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et le ministère de l'intérieur, même si elle incombe principalement à ce dernier.
Si ce double pilotage paraît indispensable, sa mise en oeuvre concrète est complexe : en l'absence de priorisation entre les trois objectifs de la délivrance des visas (sécuritaire, migratoire et attractivité), les services consulaires se trouvent parfois confrontés à des injonctions contradictoires.
B. ...SOUS LA PRESSION D'UNE PROGRESSION CONTINUE DES DEMANDES DE VISAS
Dans la période précédant la crise sanitaire, les demandes de visas connaissaient une progression continue et régulière chaque année. Entre 2015 et 2019, le nombre de demandes est passé de 3,6 millions à 4,3 millions de demandes, soit une augmentation de 19 % sur la période. La crise sanitaire a toutefois porté un coup d'arrêt à cette évolution, la fermeture des frontières ayant entraîné une réduction drastique des déplacements internationaux et, par conséquent, des demandes de visas de court séjour.
Consécutivement à la réouverture des frontières et à la fin des restrictions liée à l'épidémie de covid-19, la progression des demandes de visas a repris depuis 2021, avec une croissance de 289 % sur cinq ans. Toutefois, le nombre de demandes est encore sensiblement inférieur au niveau atteint en 2019. Avec 3,4 millions de demandes de visas, l'activité des services consulaires équivaut en 2024 au niveau de l'année 2014.
La France est le pays de l'espace Schengen recevant le plus de demandes de visas de court séjour
La reprise des demandes de visas est largement portée par la progression des demandes de visas de court séjour. De manière générale, ces derniers forment la très grande majorité des visas délivrés par la France (près de 90 % des visas délivrés en 2024).
Évolution des demandes de visas sur la période 2015-2024
(en nombre de visas)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
II. UNE ACTIVITÉ « AUTOFINANCÉE » PAR LA PERCEPTION DES DROITS DE VISAS
A. LE DYNAMISME DE LA RECETTE LIÉE AUX VISAS PERMET DE COMPENSER LE COÛT CROISSANT DE L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE VISAS
Sur le volet recettes, la demande de visa donne lieu au paiement par le demandeur de droits de visas d'un montant de 90 euros pour le droit commun et de 35 ou de 45 euros pour certaines catégories d'étrangers bénéficiant d'un tarif réduit. Cette recette non fiscale est particulièrement dynamique : elle s'élevait en 2024 à près de 261 millions d'euros, soit une progression de 19 % par rapport au niveau atteint en 2019 (219 millions d'euros). De manière insolite, une partie de son produit permet, au travers d'une affectation de produits (dans la limite de 0,75 % des recettes de l'année précédente), de financer des mois de vacation dans les services d'instruction.
Toutefois, les frais de visa ne représentent pas la totalité du coût de la demande de visa supporté par l'étranger. Le demandeur peut en effet régler, le cas échéant, des frais de services additionnels au prestataire de services extérieurs lorsque l'accueil des demandeurs et la constitution des données est externalisé.
Sur le volet dépenses, la grande majorité du coût de l'instruction des demandes de visas correspond aux dépenses de personnel liées au traitement des demandes de visa dans les services consulaires (64,41 millions d'euros en 2025). De fait, les effectifs consacrés à l'instruction des visas représentent une part sensible des personnels de l'administration consulaire (administration centrale et réseau consulaire confondus). En 2024, ce sont 26 % des 3 170 ETP inscrits sur les activités du programme 151 qui relevaient de l'activité de délivrance des visas. Au total, sur les dix dernières années, l'évolution des effectifs sous plafond consacrés à l'activité « visas » est plutôt stable, avec environ 826 ETP en 2015 contre près de 823 ETP en 2024.
Évolution des dépenses liées
à l'instruction des visas inscrites
sur le programme 151 pour
la période 2018-2025
(en millions d'euros et en crédits de paiement)
Note : À compter de la LFI 2025, les dépenses de personnel concourant à l'instruction des visas ont été transférées du programme 151 vers le programme 105 de la mission AEE.
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
B. UNE DÉMARCHE ANCIENNE D'EXTERNALISATION A PERMIS DE LIMITER LA PROGRESSION DES DÉPENSES DE PERSONNEL
Depuis le début des années 2010, compte tenu de la très forte hausse des demandes de visas et dans un contexte budgétaire contraint, la France, comme plusieurs de ses partenaires européens, a choisi d'externaliser la collecte des demandes de visas et des pièces justificatives. Cette démarche visait à améliorer les conditions d'accueil des demandeurs, accélérer le traitement des demandes et maîtriser le volume de la masse salariale.
Formellement, l'externalisation de l'accueil des demandeurs de visas est neutre pour les finances publiques. Dans le cadre des marchés passés avec l'État, les prestataires de services extérieurs ne perçoivent pas de rémunération directe de la part des pouvoirs publics. Leur rémunération repose sur les frais de services additionnels acquittés par les demandeurs.
Missions liées à la
délivrance des visas pouvant ou non faire l'objet
d'une
externalisation à un prestataire de services
extérieurs
|
Tâches externalisables auprès d'un
prestataire |
Tâches non externalisables, obligatoirement
assurées |
|
- Fourniture d'informations générales sur les conditions d'obtention des visas ; - information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d'une liste récapitulative ; - recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat ou aux autorités centrales ; - perception des droits de visa ; - gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur ; - recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat ou des autorités centrales et restitution de ceux-ci au demandeur. |
- Examen des demandes de visas ; - entretiens éventuels avec le demandeur ; - prise de décision sur la demande de visa ; - consultation du VIS ; - impression et apposition des vignettes-visas. |
Source : commission des finances d'après l'article 43 du code communautaire des visas
Au total, les prestataires de services extérieurs (PSE) conventionnés avec la France animent 147 centres d'accueils. En 2024, ils traitaient 90 % des demandes de visas reçues par la France. Plus de 2 000 agents sont mobilisés par les PSE pour l'exécution des marchés passés avec la France. Par comparaison, en 2015, le taux de traitement des demandes par les PSE était de 74 %, avec 66 centres d'accueil pour 39 postes consulaires.
III. UNE TRIPLE CONTRAINTE D'EFFICACITÉ, DE SÉCURITÉ ET D'ATTRACTIVITÉ PÈSE SUR LA DÉLIVRANCE DES VISAS
A. POURSUIVRE LA MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE DES VISAS
Premièrement, il importe de conserver une maitrise des délais d'instruction. Pour les demandeurs, le délai de traitement constitue l'indicateur principal de la qualité du service rendu par les services consulaires français. Sans majorer de manière excessive les coûts de traitement, reposant essentiellement sur des dépenses de personnel, ni sacrifier les exigences de sécurité, il importe de conserver une durée raisonnable de traitement des dossiers.
Déroulement de l'instruction d'une demande de visa
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Les capacités de traitement des demandes de visas par les services dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les effectifs figurent en première place, l'instruction étant limitée par la capacité individuelle des agents à traiter un stock de dossiers. Sur les postes de Casablanca et Rabat, des quotas d'instruction ont été attribués aux agents : une quarantaine de dossiers par pré-instructeur par jour et entre 80 et 85 demandes par instructeur et par jour. Des facteurs calendaires peuvent également affecter les délais de traitement des demandes. Les services consulaires connaissent ainsi des pics saisonniers, en particulier à l'été.
Deuxièmement, la démarche de regroupement des services d'instruction doit être poursuivie. La France a, en effet, effectué dans plusieurs pays un regroupement des services de visas sur un ou plusieurs sites, en fonction de la taille du réseau consulaire dans le pays hôte. Cette démarche vise à disposer de services d'instruction d'une taille suffisante pour répondre aux variations du volume de demandes.
Troisièmement, la dématérialisation des demandes de visas doit être achevée. Si la mise en oeuvre de l'application France visas, achevée en 2023, a permis de moderniser l'instruction des demandes, son interopérabilité avec les autres plateformes est insuffisante. Par ailleurs, le déploiement de la plateforme commune de demande de rendez-vous pour les demandeurs Schengen (EU-VAP) devrait constituer le principal défi technique auquel sera confronté France visas dans les années à venir.
B. LIMITER LA FRAUDE ET ACCÉLÉRER LE PAIEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX
En premier lieu, si le taux de refus, tous motifs confondus, a retrouvé un niveau similaire à 2019, le nombre de refus pour fraude progresse depuis 2021 avec un doublement des décisions. La part des refus pour fraude dans le total des décisions de refus se stabilise autour de 9 % en 2024. La progression des demandes de visas, toutes catégories confondues, fait « naturellement » augmenter le nombre de dossiers frauduleux, qu'il s'agisse de fraude interne (soit la fraude par des agents des services) ou externe (soit l'ensemble des fraudes affectant directement la demande de visa comme les faux justificatifs).
De plus, la délivrance des visas par les services consulaires est fréquemment parasitée par les activités d'officines locales. En particulier, dans les pays à forte demande, ces officines organisent une captation des créneaux de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas auprès des prestataires de services extérieurs, afin de les revendre de manière illégale aux demandeurs.
L'activité des officines perturbe l'instruction des demandes et suscite des frustrations chez les usagers
En second lieu, la contestation des refus de demandes de visas, de court comme de long séjour, s'est imposée au cours des dernières années comme un contentieux de masse. Le nombre de condamnations de l'État a progressé de 292,25 % entre 2017 et 2024, pour atteindre 2 447 décisions en 2024. Or, si la sous-direction des visas (SDV) du ministère de l'intérieur assure le suivi du contentieux, le MEAE est responsable de l'ensemble des frais. Compte tenu des retards constatés dans le paiement des dossiers, il paraît nécessaire de clarifier la répartition des compétences entre les deux ministères.
C. CONSERVER UNE DÉMARCHE D'ATTRACTIVITÉ
Dans un contexte de concurrence accrue entre les États de l'espace Schengen, la France a tardé à se doter d'une vision claire d'attractivité permettant d'orienter sa politique de visas. Le rapport, commandé à M. Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini, en 2023, a permis de dégager une doctrine pour les services consulaires.
Dans le prolongement de ces travaux, les postes ont engagé une révision des procédures d'instruction des demandes de visas, par une identification des « publics cibles » (étudiants, professionnels non-salariés et « talents) puis par une accélération du traitement des demandes émanant de ces profils. Cette approche apparait complémentaire avec la dimension migratoire de la délivrance des visas : les publics cibles qui se voient proposer prioritairement des rendez-vous présentent un risque moins élevé de fraude ou de détournement de l'objet du visa.
Cette stratégie, dont la mise en oeuvre demeure inachevée, constitue à la fois un outil nécessaire d'attractivité et un mécanisme de rationalisation de l'instruction des demandes de visas. Elle gagnerait toutefois à être complétée par des actions de communication plus proactives notamment sur les conditions d'instruction des demandes et sur le caractère sélectif de la délivrance des visas.
LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Recommandation n° 1 : pour les postes où la demande de visa est faible, envisager une mutualisation des services des visas avec nos partenaires Schengen (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
Recommandation n° 2 : poursuivre la démarche de regroupement de l'instruction des visas pour atteindre un seuil critique d'effectifs et de moyens par poste et envisager, pour les plus petits postes, un regroupement régional (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
Recommandation n° 3 : poursuivre l'interconnexion de France visas avec les systèmes d'information pertinents, en priorité ceux liés à l'administration des étrangers en France (ministère de l'intérieur).
Recommandation n° 4 : permettre un retour d'information aux postes diplomatiques sur le suivi des décisions de délivrance de visas, pour améliorer leurs procédures d'instruction et de lutte contre la fraude (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
Recommandation n° 5 : anticiper les conséquences de la mise en oeuvre de la plateforme EU-VAP en préparant la formation des agents à ce nouvel outil, en révisant l'organisation des services consulaires et en prévoyant une évolution des missions confiées aux prestataires de services extérieurs (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
Recommandation n° 6 : généraliser l'attribution automatique des plages de rendez-vous pour limiter les possibilités de détournement de la procédure par les officines (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, consulats).
Recommandation n° 7 : regrouper le suivi et le paiement des frais de justice et intérêts moratoires liés au contentieux des visas au sein du ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France, ministère de l'intérieur).
Recommandation n° 8 : accélérer la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin s'agissant de l'identification des publics cibles et de l'adaptation des procédures d'instruction et opérer un suivi de cette démarche (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
Recommandation n° 9 : adapter la procédure de sélection des candidats à l'enseignement supérieur en France pour faire coïncider les délais de délivrance des visas étudiants avec les résultats d'admission sur la plateforme « Études en France » (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'intérieur, universités).
Recommandation n° 10 : renforcer la communication sur la délivrance des visas, en harmonisant les informations diffusées par les services consulaires et en adoptant une posture transparente sur la sélectivité des procédures (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, direction de la communication et de la presse).
PREMIÈRE PARTIE
LA
DÉLIVRANCE DES VISAS,
UNE ACTIVITÉ AU PILOTAGE
BICÉPHALE
SOUS PRESSION DE LA HAUSSE DES DEMANDES
I. UN CADRE JURIDIQUE LARGEMENT CONTRAINT PAR LE DROIT EUROPÉEN
Le visa peut être défini comme une vignette apposée par un État sur le passeport d'un ressortissant étranger et permettant l'entrée et le séjour sur son territoire pour une durée déterminée. Comme le relève le professeur Emmanuel Aubin, le visa « évoque d'emblée l'idée d'un contrôle par l'État (ou un groupe d'États au sein d'une organisation internationale intégrée comme l'Union européenne) des personnes étrangères souhaitant séjourner sur son territoire ou sur un territoire donné (à l'image de l'espace Schengen). »1(*)
L'essentiel des visas délivrés par les services consulaires s'inscrit dans deux catégories principales, distinguées selon un critère de durée de séjour : d'une part, les visas de court séjour, qui constituent l'écrasante majorité des demandes de visas et, d'autre part, les visas de long séjour. L'encadrement de ces documents relève de deux ordres juridiques : du droit de l'Union européenne, dès lors qu'ils permettent la circulation au sein de l'espace Schengen et du droit interne, dans la mesure où l'installation et le séjour sont des compétences des États. À noter que le visa ne confère pas à son détenteur un droit d'entrée irrévocable : l'administration peut toujours opposer un refus d'entrée sur le territoire, sur le fondement d'une menace à l'ordre public notamment2(*).
A. LES VISAS DE COURT SÉJOUR : UN ENCADREMENT PAR LE DROIT EUROPÉEN
Les visas de court séjour, ou visas « Schengen », sont régis par le droit de l'Union européenne, dans le code communautaire des visas3(*). Valables sur le territoire de l'espace Schengen, ils visent donc des séjours de courte durée, inférieurs à trois mois. Ils sont délivrés par les 29 États membres de l'espace Schengen, soit 25 des 27 États membres de l'Union européenne4(*) auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
Trois catégories de visas de court séjour peuvent être distinguées selon leur objectif.
Tout d'abord, les visas de court séjour permettent aux ressortissants étrangers d'entrer et de séjourner dans l'espace Schengen pour une durée maximale de trois mois (renouvelables après une durée de six mois). Ce type de visa peut être sollicité pour différents motifs5(*).
Ensuite, les visas de transit aéroportuaire visent à autoriser le transit des ressortissants étrangers dans une zone internationale aéroportuaire de l'espace Schengen. Ils ne permettent pas l'entrée sur le territoire.
Enfin, certains visas ont une validité territoriale limitée à un ou plusieurs États membres de l'UE. Aux termes de l'article 5 du code frontières Schengen, il s'agit de visas subsidiaires, intervenant lorsque les conditions requises pour un visa de court séjour ne sont pas remplies ou lorsqu'un État membre ne reconnait pas le document de voyage du demandeur. Ce document est délivré « pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. »
Cependant, l'accord et la convention de Schengen permettent la conclusion, avec des pays tiers, d'accords d'exemption de l'obligation de possession d'un visa de court séjour pour le franchissement des frontières extérieures. Les pays dont les ressortissants bénéficient d'une telle exemption sont énumérés par le règlement (EU) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 20186(*). Dans ce cadre, sous réserve de réciprocité, les ressortissants de ces États tiers peuvent entrer sur le territoire de l'espace Schengen pour un court séjour sans visa.
En l'état du droit, l'Union européenne est liée par un régime d'exemption avec 61 États tiers, deux régions administratives spéciales de la République populaire de Chine7(*) et une autorité territoriale non reconnue comme État par au moins un État membre de l'UE (Taïwan). Au total, sont notamment dispensés de visas de court séjour les ressortissants des pays d'Amérique du Nord, d'une grande partie des pays d'Amérique du Sud, de la Corée, du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ou encore des Émirats arabes unis.
De plus, l'Union a conclu des accords de facilitation de la délivrance de visas de court séjour avec d'autres pays tiers qui prévoient une simplification des procédures (simplification des pièces justificatives, frais de visas réduits, délais de traitement raccourcis, etc.). Cinq accords de facilitation sont actuellement en vigueur, dont deux font l'objet d'une suspension totale (Russie) ou partielle (Biélorussie).
Le règlement (UE) 2018/1806 permet également aux États membres, à son article 6, d'accorder des exceptions à l'obligation de visa à certaines catégories de personnes, notamment les titulaires de passeports officiels. Au niveau de l'Union européenne, 67 accords avec des États tiers prévoient une telle exemption, tandis que la France dispose de 28 accords bilatéraux.
B. LES VISAS DE LONG SÉJOUR : UNE RÉGLEMENTATION RELEVANT DAVANTAGE DU DROIT INTERNE
Les visas de long séjour permettent une résidence sur le territoire comprise entre trois mois et un an8(*). Son encadrement juridique relève, à titre principal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France (Ceseda).
Selon le motif et la durée du séjour de l'étranger en France, différents types de visas de long séjour peuvent être distingués :
- premièrement, le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), d'une durée de quatre mois à un an. Créé en 2009, dans un objectif de simplification des démarches, il dispense le détenteur de solliciter une carte de séjour auprès de la préfecture ;
- deuxièmement, le visa de long séjour temporaire (VLS-T), d'une durée comprise entre quatre et six mois et valant autorisation temporaire de séjour en France, dispense de demander un titre de séjour. Il peut être délivré pour différents motifs (suivi d'un enseignement court, exercice d'une activité artistique ou visite) ;
- troisièmement, le visa mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée », permet l'entrée en France mais oblige son détenteur à solliciter une carte de séjour en préfecture ;
- quatrièmement, le visa « vacances-travail », d'une durée maximale d'un an, délivré uniquement si le pays du demandeur est lié avec la France par un accord bilatéral ;
- cinquièmement, le visa pour scolariser un mineur en France, d'une durée maximal d'onze mois. Les mineurs ne sont pas soumis à la délivrance d'une carte de séjour.
À noter qu'il existe une catégorie spécifique de visas, de court ou de long séjour, pour les collectivités d'outre-mer, qui ne font pas partie intégrante du territoire de l'espace Schengen. Ces visas relèvent, par conséquent, uniquement du Ceseda. Ce type de visa représente cependant un très faible flux sur le volume de délivrance de visas sur le territoire français (0,6 % en 2024).
II. SANS AVOIR RETROUVÉ LE NIVEAU ATTEINT EN 2019, LE NOMBRE DE DEMANDES DE VISAS EST EN FORTE AUGMENTATION
A. APRÈS UN BRUTAL RALENTISSEMENT CAUSÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, LE VOLUME DE DEMANDES DE VISAS A REPRIS SA PROGRESSION
Dans la période précédant la crise sanitaire, les demandes de visas connaissaient une progression continue et régulière chaque année. Entre 2015 et 2019, le nombre de demandes est passé de 3,6 millions de demandes à 4,3 millions de demandes, soit une augmentation de 19 % sur la période.
La crise sanitaire a toutefois porté un coup d'arrêt à cette évolution, la fermeture des frontières ayant entraîné une réduction drastique des déplacements internationaux et, par conséquent, des demandes de visas de court séjour.
L'adaptation de la délivrance des visas au contexte de crise sanitaire
S'agissant des visas de long séjour, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à prolonger leur validité par voie d'ordonnance. En miroir, et pour limiter les entrées sur le territoire, le Gouvernement a suspendu la délivrance de visas aux bénéficiaires de la réunification familiale et du regroupement familial admis au séjour en France9(*). Cette mesure, en vigueur plus de dix mois, a toutefois été suspendu par le juge des référés10(*).
Concernant l'organisation des services de visas, les postes ont mis en place, conjointement avec l'administration centrale, des plans de continuité de l'activité. Les agents chargés de l'instruction ont été redéployés sur d'autres missions, en particulier l'assistance aux Français de l'étranger. Si les nouvelles affectations d'agents instructeurs ont été gelées dans l'attente de la reprise de l'activité, le réseau consulaire n'a pas procédé à une réduction de ses effectifs et a notamment conservé l'ensemble de ses agents de droit local.
Des mesures de soutien aux prestataires de services extérieurs, dont l'activité économique a été largement affectée par la crise sanitaire, ont également été prises. Une augmentation exceptionnelle des frais de services a été autorisée pour leur permettre de préserver une part de leurs recettes. Dans le même temps, afin de leur assurer une plus grande visibilité économique, une partie des contrats en cours a fait l'objet d'une reconduction. La durée des contrats a, par ailleurs, été étendue de trois à cinq ans.
Source : commission des finances
Consécutivement à la réouverture des frontières et à la fin des restrictions liée à l'épidémie, la progression des demandes de visas a repris depuis 2021, avec une croissance de 289 % sur cinq ans. Toutefois, le nombre de demandes est encore sensiblement inférieur au niveau atteint en 2019. Avec 3,4 millions de demandes de visas, l'activité des services consulaires équivaut en 2024 au niveau de l'année 2014.
Évolution des demandes de visas sur la période 2015-2024
(en nombre de visas)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Pour autant, la brusque reprise des demandes de visas, au sortir de la crise sanitaire (+ 142 % entre 2021 et 2022 et + 32 % entre 2022 et 2023), a pris les services consulaires de court et les a placés dans une situation de grande difficulté. L'augmentation soudaine des demandes, concentrée dans plusieurs pays a rapidement saturé les capacités de traitement des services. Il en a résulté un allongement significatif des délais de traitement, suscitant des mécontentements au sein de ces pays, relayés au niveau bilatéral par leurs autorités.
Évolution du taux de refus des demandes de visas sur la période 2018-2025
(en points de pourcentage)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Taux de refus |
15,9 % |
16,2 % |
19,1 % |
20,9 % |
22,3 % |
17,1 % |
16,8 % |
16,4 % |
Source : commission des finances d'après les données transmises par la direction de l'immigration
Le taux de refus dans l'instruction des demandes de visas est stable depuis 2018, à l'exception de la période de crise sanitaire entre 2020 et 2022. Au cours de cet intermède, la diminution du nombre de demandes a mécaniquement conduit à une progression de la part des décisions de refus. Au-delà de cette moyenne, on constate une forte disparité selon les zones géographiques : la Somalie a connu un taux de refus de 66,9 % en 2024 tandis que la moyenne des pays d'Amérique du Nord s'élevait à seulement 4 % la même année. Au sein d'une même zone géographique, plusieurs pays peuvent avoir des taux de refus fortement hétérogènes, en dépit de la similarité des profils des demandeurs11(*).
Il importe cependant de souligner que les taux de refus de demandes de visas ne constituent pas un indicateur complètement fiable de la « sélectivité » de l'instruction des visas. Dans un contexte de forte hausse de la demande, la sélection s'opère en réalité au stade de la prise de rendez-vous. De fait, un dossier présentant peu de chances d'obtenir un visa - schématiquement une personne seule, sans qualification ni ressources et sans attaches garantissant le retour - se verra plus difficilement accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
Au sein de l'espace Schengen, la France demeure le premier pays destinataire de demandes de visas, largement devant l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.
Demandes de visas dans les pays de l'espace Schengen en 2024
(en nombre de demandes)
Source : commission des finances d'après la base de données Schengen
B. LES VISAS DE COURT SÉJOUR REPRÉSENTENT LA MAJORITÉ DES VISAS DÉLIVRÉS
La reprise des demandes de visas est largement portée par la progression des demandes de visas de court séjour. Cette reprise d'activité a toutefois été inégale selon les pays. En particulier, la Chine n'a levé les entraves à la circulation de ses ressortissants qu'au début de l'année 2023.
De manière générale, les visas de court séjour forment la très grande majorité des visas délivrés par la France (près de 90 % des visas délivrés en 2024). Au sein de cet ensemble, les visas touristiques représentent une large majorité, la reprise des flux touristiques expliquant en grande partie l'augmentation des demandes de visas au cours des dernières années. Sur les 2,6 millions de visas de court séjour délivrés en 2024, près de 75 % correspondaient à un motif « tourisme ». Selon Atout France, opérateur chargé du développement touristique de la France, l'activité touristique poursuit son rebond consécutif à la crise sanitaire, avec 71 milliards d'euros de recettes constatés en 2024 (+ 12 % par rapport à l'année précédente)12(*).
Évolution
de la délivrance de visas sur la période 2020-2024,
en
distinguant visas de court et de long séjour
(en nombre de visas)
Source : commission des finances d'après les données de la DGEF
À l'inverse, la délivrance de visas de long séjour se stabilise sur la période 2020-2024. Après un pic de 296 476 visas délivrés en 2023, le nombre de visas de long séjour recule pour se situer autour de 290 000 en 2024, seuls les visas pour motifs familiaux conservant une dynamique haussière. Hormis un ralentissement constaté en 2020, au pic de la crise sanitaire, la délivrance de visas de long séjour a été bien moins impactée que la délivrance de visas de court séjour par les mesures de fermeture des frontières.
Répartition des visas
délivrés en 2024 par motif,
à gauche pour les visas de
court séjour et à droite pour les visas de long
séjour
(en pourcentage et en nombre de visas)
Source : commission des finances d'après les données de la DGEF
Visas de court et de long séjour confondus, l'analyse des nationalités représentées dans la délivrance des visas permet d'identifier les dynamiques sous-jacentes à la progression des demandes, déjà signalées par les rapporteurs spéciaux Éric Doligé et Richard Yung en 201513(*).
D'une part, on constate une forte croissance des flux touristiques en provenance des grands émergents. Le nombre de visas accordés aux ressortissants chinois, russes et turcs est en effet en constante augmentation depuis 2020. Ces nationalités s'orientent essentiellement vers des visas de court séjour de type économique ou touristique.
À cet égard, la Chine représente le principal pays d'origine des demandes de visas. La seule croissance des visas délivrés à des ressortissants chinois constitue un facteur déterminant de la progression des entrées. Selon les analyses de la direction générale des étrangers en France, cette croissance explique à elle seule près de la moitié de la hausse totale des visas délivrés en 2024. Cependant, avec 562 505 visas, le volume de visas délivrés à des ressortissants chinois demeure largement inférieur au niveau de 2019 (735 000 visas).
D'autre part, il est possible d'observer des mobilités des ressortissants de pays comprenant des diasporas importantes en France. Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) figuraient en 2024 parmi les dix premières nationalités concernées par la délivrance des visas, avec une forte proportion de visas de long séjour.
Au total, le dynamisme de la délivrance de visas devrait se poursuivre au cours des prochaines années, en particulier s'agissant des visas de court séjour, portés par l'activité touristique.
Les dix principales nationalités représentées dans la délivrance des visas
(en visas délivrés et en pourcentage)
|
Nationalité |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Évolution 2020/2024 |
Part dans les visas de long séjour en 2024 |
|
Chinoise |
71 454 |
23 428 |
100 036 |
372 499 |
562 505 |
+ 51,0 % |
2,9 % |
|
Marocaine |
98 627 |
69 408 |
142 921 |
241 574 |
283 023 |
+ 17,2 % |
11,6 % |
|
Algérienne |
73 276 |
63 649 |
131 264 |
209 723 |
250 095 |
+ 19,3 % |
7,2 % |
|
Indienne |
41 642 |
45 319 |
158 619 |
214 084 |
237 863 |
+ 11,1 % |
5,4 % |
|
Saoudienne |
14 082 |
60 292 |
91 754 |
109 832 |
153 971 |
+ 40,2 % |
0,3 % |
|
Turque |
37 017 |
43 671 |
103 307 |
130 964 |
141 891 |
+ 8,3 % |
5,5 % |
|
Russe |
78 701 |
12 498 |
68 645 |
116 401 |
141 458 |
+ 21,5 % |
3,6 % |
|
Tunisienne |
49 458 |
46 069 |
86 636 |
97 907 |
108 142 |
+ 10,5 % |
18,6 % |
|
Libanaise |
22 481 |
36 321 |
56 843 |
60 388 |
58 557 |
- 3,0 % |
8,2 % |
|
Philippine |
15 881 |
17 829 |
44 176 |
54 995 |
50 910 |
- 7,4 % |
2,2 % |
Note : les dix nationalités sont classées dans l'ordre de 2024.
Source : commission des finances d'après les données de la DGEF
III. UNE POLITIQUE PARTAGÉE ENTRE LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A. LA POLITIQUE DES VISAS, DU FAIT D'UNE PLURALITÉ D'OBJECTIFS, COMPORTE UN CARACTÈRE ÉMINEMMENT INTERMINISTÉRIEL
La répartition de la compétence d'attribution des visas entre les deux départements ministériels traduit la pluralité des objectifs attachés à cette politique. En effet, trois dimensions principales peuvent être identifiées :
- premièrement, une dimension sécuritaire. Les contrôles sécuritaires menés au stade de l'instruction des visas, notamment par la consultation des systèmes d'information sécuritaires, permet de prévenir l'entrée sur le territoire d'individus présentant une menace pour l'ordre public. Cette dimension sécuritaire s'étend au-delà du territoire national, dans le cadre de l'espace Schengen. Dans un contexte de tensions internationales accrues, les contrôles ont pu être renforcés à l'égard des ressortissants de certains pays compétiteurs de la France14(*) ;
- deuxièmement, une dimension migratoire, découlant de l'objet même du visa, qui permet l'entrée et la circulation de ressortissants étrangers sur le territoire. La délivrance des visas constitue l'un des leviers de contrôle des flux migratoires, par un pilotage des entrées sur le territoire, pour ce qui est de l'immigration légale, et par le refus de délivrer des visas aux individus présentant un risque de détournement du titre et de maintien sur le territoire au-delà de la période prévue par le visa, pour ce qui est de l'immigration illégale. Lors des procédures d'instruction et de pré-instruction des demandes de visas, les services consulaires s'attachent à identifier et écarter les profils et dossiers présentant le plus de risques en matière migratoire. Dans le même sens, le travail de lutte contre la fraude aux visas contribue à limiter le risque de détournement du visa ;
- troisièmement, une dimension d'influence et d'attractivité. La politique de délivrance des visas peut, par des outils et procédures adaptés, prioriser la délivrance de visas au profit de profils spécifiques. Il s'agit de publics professionnels, étudiants ou contribuant au rayonnement de la France. Complémentaire de l'approche migratoire, cette dimension d'attractivité s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'immigration choisie.
B. DEUX MINISTÈRES SONT COMPÉTENTS POUR LA DÉFINITION ET LA MISE EN oeUVRE DE LA POLITIQUE DES VISAS
Au sein du Gouvernement, depuis 200715(*), la compétence ministérielle sur la politique des visas, traditionnellement rattachée au ministre chargé des affaires étrangères, a été transférée à titre principal au ministre de l'intérieur. En l'état du droit, le décret n° 2024-29 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur et des outre-mer dispose, à son article 2, que ce dernier est « chargé, conjointement avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de la politique d'attribution des visas ». Si cette compétence se trouve par conséquent partagée entre les deux ministres, elle incombe principalement au ministre de l'intérieur. Ainsi, le décret n° 2024-37 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne mentionne pas la compétence de ce dernier en matière de visas.
La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire (DFAE) soutient cette dyarchie en matière de visas en soulignant que « le double pilotage de la politique des visas par le MEAE et le MI est pertinent compte tenu des enjeux de politique étrangère liés aux visas (grande sensibilité de nos partenaires à la question, possibilité d'utilisation de cet outil comme levier politique, rôle du chef de poste diplomatique pour analyser les enjeux de la relation bilatérale et les meilleurs leviers à utiliser) et du pilotage par le MEAE du réseau consulaire. »16(*)
Au sein de l'administration centrale, les deux ministères disposent de services chargés du suivi de la délivrance des visas, tous deux établis à Nantes :
- la sous-direction de la politique des visas (SDPV) de la DFAE, dotée de quinze agents, pour le MEAE ;
- et la sous-direction des visas, de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, dotée de 107 agents (dont 83 agents du MEAE en position normale d'activité au ministère de l'intérieur et 24 agents du ministère de l'intérieur).
Au niveau des postes, les chefs de postes consulaires et diplomatiques sont compétents pour la délivrance des visas, aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008. Les demandes de visas sont instruites sur le fondement des instructions ministérielles relatives à l'attribution des visas. Le décret du 13 novembre 2008 distingue :
- d'une part, les instructions générales, qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'immigration. Ces instructions, signées par les ministres, sont « destinées à orienter, de manière générale ou pays par pays, le travail des postes consulaires dans le traitement des demandes de visas, ainsi que des indications relatives aux modalités d'établissement des visas demandés »17(*) ;
- d'autre part, les instructions particulières qui relèvent, pour les visas délivrés sur les passeports ordinaires, du ministre chargé de l'immigration et, pour les visas sur passeports officiels, les visas relatifs aux procédures internationales d'adoption et les visas de politique étrangère, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
À noter que, dès lors que la communication de l'instruction générale des visas « porterait atteinte au secret de la politique extérieure »18(*), l'accès à ce document est restreint, dans des conditions définies par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008
relatif aux attributions des chefs
de mission diplomatique et des chefs de
poste consulaire en matière de visas
Article 1er : La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire.
(...)
Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire.
Article 2 : Par dérogation à l'article 1er, la compétence pour délivrer des visas aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale à ses fonctionnaires appartient aux chefs de mission diplomatique.
Elle n'est exercée par le chef de poste consulaire que dans les pays où aucun chef de mission diplomatique n'est accrédité, ou si le chef de poste consulaire a reçu délégation dans les conditions prévues par l'article 5.
Article 3 : Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Article 4 : Pour le traitement des dossiers individuels de demande de visa, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment aux instructions particulières qui leur sont adressées par le ministre chargé de l'immigration.
Toutefois, sont délivrés conformément aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères :
a) Les visas relevant de l'article 2 ;
b) Après consultation du ministère chargé de l'immigration, les visas relatifs à des cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ;
c) Les visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
Source : Légifrance
Ce double pilotage de la délivrance des visas, qui découle de la pluralité des objectifs attachés à cette politique, n'est pas contesté, dans son principe, par les différentes parties prenantes entendues par les rapporteurs spéciaux. Les services du ministère de l'intérieur comme les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères défendent un maintien de ce dualisme.
Pour autant, la mise en oeuvre concrète de ce double pilotage paraît complexe. En l'absence de priorisation entre les trois objectifs de la délivrance des visas (sécuritaire, migratoire et attractivité), les services consulaires se trouvent confrontés à des injonctions contradictoires. D'un côté, ils sont incités, dans un objectif d'attractivité et d'influence, à délivrer davantage de visas à une diversité de profils. De l'autre, ils sont encouragés à durcir les contrôles et la lutte contre la fraude. Respecter la doctrine fixée par le rapport Hermelin (accorder davantage de visas aux « publics cibles ») peut entrer en opposition avec la volonté de renforcer la maîtrise des entrées sur le territoire.
Au niveau central, un « comité stratégique migrations » (CSM) a été créé, à l'occasion du conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) du 14 octobre 2022, pour renforcer la coopération interministérielle pour l'ensembles des thématiques relevant de la dimension externe des migrations (DEM), notamment entre le MEAE et le ministère de l'intérieur19(*). Un ambassadeur thématique, l'ambassadeur chargé des migrations en assure le secrétariat général20(*). L'ambassadeur travaille en étroite coopération, en matière de visas, avec la SDPV et la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur. Instance de coordination, le CSM pourrait gagner, selon l'ambassadeur chargé des migrations, à être confortée comme une véritable instance de pilotage en matière de visas, notamment par la définition d'une stratégie nationale déclinée selon les types de publics.
De fait, sur le terrain, les injonctions contradictoires et changeantes peuvent créer des difficultés pour les agents instructeurs dans la conduite de leurs missions, selon les priorités du moment. Lors du déplacement de la mission de contrôle au Maroc, les services des consulats généraux de Rabat et de Casablanca ont souligné que l'épisode de la « crise des visas » entre la France et les trois pays du Maghreb (exposée infra) a conduit les agents à changer du jour au lendemain leur grille de lecture des dossiers de demandes21(*).
La direction de l'immigration regrette, quant à elle, la complexification du pilotage de la délivrance des visas dans le cadre duquel le ministère de l'intérieur rédige la plupart des instructions mais n'a pas la main sur les services des visas, en « l'absence d'autorité, y compris fonctionnelle, du ministère de l'Intérieur sur les services en charge de la délivrance des visas à l'étranger, dont la très grande majorité concerne des ressortissants de pays tiers sous passeport ordinaire. »22(*) Une mission inter-inspections sur la délivrance des visas, mandatée au premier semestre 2025, devait notamment formuler des propositions sur cette organisation. À la date d'écriture de ce rapport de contrôle, la mission inter-inspections n'a pas encore rendu ses conclusions.
Si les rapporteurs spéciaux estiment qu'une coordination plus fine des deux ministères doit être recherchée dans la définition des objectifs assignés aux services consulaires dans la délivrance des visas, il ne paraît pas opportun de transférer l'intégralité de cette activité au seul ministère de l'intérieur.
DEUXIÈME PARTIE
LA DÉLIVRANCE DES VISAS, UNE
ACTIVITÉ AU COÛT LIMITÉ AU REGARD DU DYNAMISME DES FRAIS DE
VISA
I. LES DROITS DE VISAS, UNE RECETTE NON FISCALE QUI CONNAÎT UNE CROISSANCE SOUTENUE
Le code communautaire des visas dispose, à son article 16, que la demande de visa donne lieu au paiement par le demandeur de droits de visas d'un montant de 90 euros pour le droit commun et de 45 ou de 35 euros pour certaines catégories d'étrangers bénéficiant d'un tarif réduit. D'autres catégories, précisées dans le tableau infra, sont exemptées du paiement de frais de visa.
Dans sa version initiale, le code communautaire de visas prévoyait un montant fixe pour les frais de visa23(*). Afin de garantir des recettes suffisantes pour couvrir les frais de traitement des demandes de visas, le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 201924(*) a modifié l'article 16 du code communautaire des visas pour introduire une adaptation du montant des droits de visas, tous les trois ans, en fonction de « critères d'évaluation objectifs ». La Commission européenne, par la voie d'actes déléguées pris sur le fondement de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), est chargée de cette actualisation. En application de ce nouveau cadre, elle a procédé à deux adaptations, respectivement entrées en vigueur en février 2020 et en juin 2024.
À noter que les frais de visa ne représentent pas la totalité du coût de la demande de visa supporté par l'étranger. Le demandeur peut en effet régler, le cas échéant, des frais de services additionnels au prestataire de services extérieurs lorsque l'accueil des demandeurs et la constitution des données est externalisé, comme exposé infra.
Frais de visa demandés par la France selon
la catégorie de visa
depuis le 11 juin 2024
(en euros)
|
Type de visa |
Plein tarif |
Tarif réduit |
Exemption |
|
Visa Schengen |
90 euros |
45 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; 35 euros pour les ressortissants des pays faisant l'objet d'un accord de facilitation |
Enfants de moins de 6 ans, conjoints de ressortissants français et membres de famille de ressortissant de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse |
|
Visa de court séjour pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy |
60 euros |
35 euros pour les enfants de 6 à 12 ans |
Enfants de moins de 6 ans, conjoints de ressortissants français et membres de famille de ressortissant de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse |
|
Visa de long séjour |
99 euros |
50 euros pour les étudiants dont le dossier a été examiné par un Centre pour les études en France |
Conjoints de ressortissants français |
|
Visa de court séjour pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises |
9 euros |
Enfants de moins de 6 ans, conjoints de ressortissants français et membres de famille de ressortissant de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse |
Source : commission des finances d'après le ministère de l'intérieur
L'introduction d'une clause d'adaptation du montant des frais de visas a permis de réduire l'écart entre les droits exigés pour les visas Schengen et les frais de visas demandés par le Royaume-Uni ou les États-Unis. Pour autant, par comparaison, les droits de visas Schengen demeurent relativement peu élevés.
Comparaison des frais de visa demandés
par l'Allemagne, les États-Unis et le Japon
(en euros et en dollars américains)
|
Allemagne |
États-Unis |
Japon |
|
90 euros pour les visas C (Schengen) et 75 euros pour les visas D (nationaux) |
Entre 185 et 345 dollars selon le type de visa25(*) |
18 euros pour les visas d'entrée générale, 37 euros pour les visas à entrées multiples et 18 euros pour la prolongation de la validité des permis de réadmission |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs
Au sein du budget de l'État, le produit des droits de visas est comptabilisé parmi les « Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires », comme recette non fiscale.
Cette recette se caractérise par un dynamisme soutenu, découlant à la fois de l'augmentation du nombre de visas délivrés et de la hausse des tarifs appliqués à chaque vignette. Si une baisse du produit de cette recette a pu être constatée en 2020 (61 millions d'euros) et en 2021 (56 millions d'euros), il s'élevait en 2024 à près de 261 millions d'euros, soit une progression de 19 % par rapport au niveau atteint en 2019 (219 millions d'euros).
Évolution de la recette issue des visas sur la période 2015-2024
(en euros)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
II. UNE PROGRESSION DES DÉPENSES LIÉES À L'INSTRUCTION DES VISAS...
Le coût de l'instruction des demandes de visas correspond à trois principaux postes de dépenses :
- premièrement, les dépenses de personnel liées au traitement des demandes de visa dans les services consulaires, de l'ordre de 64,41 millions d'euros en programmation initiale pour 2025 ;
- deuxièmement, les dépenses de fonctionnement hors titre 2, qui représentent 3,71 millions d'euros en 2025 et correspondent aux frais de justice et destiné au paiement des contentieux de refus de demandes de visas d'entrée. D'autres dépenses de fonctionnement peuvent être imputées à l'activité « visas », notamment les frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, les dépenses de sécurité de l'accès aux services des visas ou de dépenses d'équipement. Ni la direction du budget, ni la DFAE n'ont été en mesure d'isoler ces dépenses ;
- troisièmement, les dépenses d'investissement, dont l'estimation est malaisée. En effet, une partie des dépenses d'investissement, correspondant à la rénovation des locaux ou à des programmes spécifiques de modernisation des outils d'instruction, peut être isolée et faire l'objet d'un suivi spécifique. En revanche, il est difficile d'identifier la part des investissements immobiliers, au sein des dépenses immobilières du réseau consulaire, qui contribue à l'activité « visas ».
Aux dépenses du MEAE s'ajoutent des crédits pris en charge par le ministère de l'intérieur sur la mission « Immigration, asile et intégration » et la mission « Administration générale et territoriale de l'État » pour le financement des systèmes d'information. Pour le seul programme France visas, la dotation demandée en 2025 s'élève à 11,8 millions d'euros26(*).
En raison des difficultés de Bercy comme du Quai d'Orsay à évaluer le coût total de l'instruction des demandes de visas, il n'est pas possible aux rapporteurs spéciaux de déterminer le coût moyen de l'instruction de visas. La DFAE a ainsi précisé que « n'ayant qu'une connaissance partielle des coûts à prendre en compte, elle n'est pas en mesure d'évaluer de manière satisfaisante le coût d'instruction moyen par visa. »27(*) Une estimation a minima, se fondant uniquement sur les dépenses dédiées du programme 151 et du programme 105, serait de 19,8 euros par demande de visa et de 23,9 euros par visa délivré en 2024.
Évolution des dépenses liées
à l'instruction des visas inscrites
sur le programme 151 pour
la période 2018-2025
(en millions d'euros et en crédits de paiement)
Note : À compter de la LFI 2025, les dépenses de personnel concourant à l'instruction des visas ont été transférées du programme 151 vers le programme 105 de la mission AEE.
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Les crédits inscrits sur l'action 03 « Instruction des demandes de visas » du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » de la mission AEE permettent de retracer les dépenses de titre 2 et une partie des autres dépenses de fonctionnement consacrées à cette activité. À compter de la loi de finances pour 2025, les dépenses de personnel concourant à l'instruction des demandes de visas ont néanmoins été transférée sur le programme 105 dans le cadre du regroupement des crédits de titre 2 sur ce programme support de la mission.
Antérieurement à cette évolution de périmètre, l'action 03 du programme 151 représentait entre 15 et 20 % des crédits de ce dernier.
A. LES COÛTS DE L'INSTRUCTION DES DÉPENSES DE VISAS CORRESPONDENT ESSENTIELLEMENT À DES DÉPENSES DE PERSONNEL, RELEVANT DE LA MISSION « ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT »
1. Un renforcement des moyens humains de traitement des demandes, visant à reconstituer les capacités antérieures à la crise sanitaire
La crise sanitaire et la brutale réduction des demandes de visas sur les exercices 2020 et 2021 ont stoppé une progression ininterrompue des effectifs sous plafond consacrés à l'instruction des visas. De fait, sur la période 2015-2019, le nombre d'ETP a progressé de 2,3 % ; une augmentation principalement imputée sur les titulaires et les volontaires internationaux. La baisse des demandes de visas a, à l'inverse, conduit à une réduction de 2,8 % du nombre d'agents affectés à cette mission.
Cependant, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a engagé, à compter de 2022, un renforcement des effectifs des services consulaires dans le but de reconstituer les capacités de traitement pré-crise sanitaire et d'instruire le stock de demandes de visas formé au cours de la « crise des visas ».
L'activité « visa » a pleinement bénéficié du réarmement du ministère engagé à la suite des états généraux de la diplomatie en mars 202328(*), avec une progression de la masse salariale dédiée à la délivrance des visas de l'ordre de 12 % entre 2018 et 2024. Cette progression s'est traduite :
- sur l'exercice 2024, par l'affectation de 18 ETP aux services consulaires (pour partie découlant des quelques 100 ETP nouvellement créés, le reste correspondant à des redéploiement d'effectifs) ;
- sur l'exercice 2025, par 13 ETP, dont 10 nouvellement créés29(*), qui ont permis de renforcer les capacités de traitement des visas.
S'agissant de l'exercice 2026, il n'est pas encore possible de savoir combien de nouveaux postes seront dédiés à l'instruction des visas. Faute de programmation initiale de la répartition des emplois, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères n'est, en effet, pas en mesure de préciser ces affectations au stade de l'examen de la loi de finances.
Nombre d'ETP consacrés à
l'activité « visas » dans les postes consulaires,
par catégorie d'emploi, sur la période 2015-2024
(en nombre d'ETP)
Note : la comptabilisation des ETP dans l'activité « visas » a fait l'objet d'un changement de méthodologie à compter de septembre 2023, une partie des ETP étant désormais recensés au titre de l'activité transversale de lutte contre la fraude.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Les effectifs consacrés à l'instruction des visas représentent une part sensible des personnels de l'administration consulaire (administration centrale et réseau consulaire confondus). En 2024, ce sont 26 % des 3 170 ETP inscrits sur les activités du programme 151 qui relevaient de l'activité de délivrance des visas.
Au total, sur les dix dernières années, l'évolution des effectifs sous plafond consacrés à l'activité « visas » semble se traduire par une relative stabilité avec environ 826 ETP en 2015 contre près de 823 ETP en 2024. Pour autant, il s'agit d'une stabilité en trompe-l'oeil, qui peut être relativisée par le fait que certaines mesures de renforcement des moyens humains dédiés à l'instruction des visas ne sont pas comptabilisées dans l'activité « visas ».
De fait, à compter de septembre 2023, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a établi une nouvelle méthodologie de comptabilisation des activités de ses agents. Un effort transversal à l'ensemble du réseau consulaire ayant été accordé à la prévention et à la lutte contre la fraude, certains ETP dédiés à la fraude documentaire ont cessé de relever formellement de l'instruction des visas.
Par ailleurs, il importe de préciser que toutes les catégories d'agents ne peuvent pas procéder à l'instruction d'une demande de visa. Au sein des services consulaires, l'instruction des demandes de visas est réservée aux agents titulaires ou aux contractuels ; les agents de droit local ne peuvent effectuer que des missions de pré-instruction. Alors que le rapport de la mission gouvernementale confiée à M. Hermelin30(*) avait proposé d'évaluer la possibilité de confier aux recrutés locaux l'instruction de demandes de visas, la DFAE estime que le code communautaire des visas ne permet pas cet élargissement. L'article 37 du code prévoit en effet que « pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d'exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de l'organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes. L'accès en consultation au VIS, au SIS et à d'autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment habilités. »31(*)
Dans le même sens, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ne peut plus mobiliser les volontaires internationaux. Jusqu'en 2020, ces derniers pouvaient être affectés à l'instruction des demandes de visas et habilités à prendre des décisions sur ces dossiers. Toutefois, un jugement du tribunal administratif de Paris32(*), en date du 23 janvier 2020, a mis fin à cette possibilité en estimant que l'affectation à mission d'instruction, correspondant à des activités à caractère purement administratif, méconnaissait les termes de l'article L. 122-4 du code du service national, qui dispose qu'« au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde, notamment en matière d'aide publique au développement, d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire ». En conséquence, la quarantaine de postes d'instructeurs confiés à des VIA a dû être pourvue par des titulaires et des contractuels.
Cependant, dans l'objectif assumé de sécuriser cette pratique, l'article 56 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a introduit à l'article L. 122-4 précité la possibilité que les VIA « concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l'État à l'étranger ». Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ne s'est néanmoins pas saisi de cette possibilité, estimant que la nouvelle rédaction ne permet de revenir sur le jugement du tribunal administratif. La DFAE estime ainsi que « s'il était décidé d'affecter de nouveau des VIA sur des fonctions visas, en cas de recours les décisions seraient très probablement jugées contraires à l'article L122-4 par le juge administratif. »33(*)
Une autre explication de cette position, plus significative, tient à un engagement du ministère vis-à-vis des organisations syndicales de confier, à titre principal, les fonctions d'instruction des demandes de visas à des agents titulaires et, subsidiairement et en l'absence de candidatures internes, à des contractuels.
2. Un financement insolite du recrutement de vacataires supplémentaires dans les services des visas, sous forme d'attribution de produits
L'instruction des demandes et la délivrance des visas font, depuis 2015, l'objet d'un mécanisme budgétaire atypique : une attribution de produits, au sens du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances34(*), de la recette « visas ». Le décret n° 2015-1819 du 30 décembre 2015 portant attribution de produits au budget du ministère des affaires étrangères et du développement international dispose qu'une partie des frais de visas est reversée au MEAE, pour le recrutement de vacataires supplémentaires dans les services des visas. Cette attribution de produits s'effectue dans la limite de 0,75 % des recettes des droits de visa de l'année précédente.
Sa création, en 2015, répondait à la volonté du ministère, dans un contexte de rattachement de la compétence tourisme au Quai d'Orsay, d'introduire un « intéressement » des services consulaires à la délivrance des visas afin de stimuler les flux touristiques. Dans le même esprit, Atout France, opérateur consacré au tourisme international, a bénéficié jusqu'en 2023 d'une attribution de produits de la recette visa pour financer la promotion internationale de la destination France35(*).
En pratique, cet instrument permet au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de financer des mois de vacation pour répondre aux rebonds de l'activité d'instruction des demandes de visas. La répartition des crédits de vacation est réalisée sur la base des demandes exprimées par les postes dans le cadre de la programmation annuelle des effectifs.
Toutefois, la comparaison entre les besoins en moyens humains exprimés par les services consulaires et le montant des vacations effectivement financé par ce mécanisme révèle un décalage certain, accentué par la chute des recettes de visas consécutive à la crise sanitaire. L'attribution du produit des recettes de visas de 2020 n'a ainsi permis de financer que 237 mois de vacation en 2021.
En raison de cette forte baisse des recettes de visas sur la période 2020-2022 et pour faire face à la remontée soudaine des demandes, le Quai d'Orsay a obtenu en 2023 une augmentation exceptionnelle de 0,75 % à 1,35 % de l'attribution de produits. Pour l'année 2024, la quote-part a été ramenée à son niveau initial. En contrepartie, dans ses négociations budgétaires, le ministère a obtenu que la différence entre les besoins de vacation et les mois de vacations effectivement financés par l'attribution de produits soit comptabilisée « hors plafond », pour éviter de ponctionner davantage l'enveloppe budgétaire du programme 151.
Comparaison entre les besoins de vacation des
services et leur financement
par l'attribution du produit de la recette
« visas »
(en mois de vacation et en millions d'euros)
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Besoins identifiés par les services consulaires |
1 004 mois |
1 131 mois |
1 200 mois |
1 034 mois |
|
Durée de vacation financée par l'attribution de produits |
237 mois (+ 400 mois sous plafond d'emploi) |
941 mois |
738 mois (+ 739 mois hors plafond d'emploi) |
775 mois |
Note : l'année 2023 correspond à un relèvement temporaire du plafond de l'attribution de produits à 1,35 % des recettes de l'année n-1.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Estimant devoir répondre à un besoin de vacation compris entre 1 000 et 1 200 mois par an, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, conjointement avec la direction des affaires financières, s'est exprimée au cours de son audition par les rapporteurs spéciaux en faveur d'un relèvement de la quote-part de l'attribution de produits, de 0,75 % à 1,35 %, a minima. Selon la DFAE, ce relèvement permettrait de sécuriser son enveloppe de financement de vacation et d'accroître la visibilité des postes sur les renforts ponctuels dont ils pourraient disposer. Dans le même sens, le rapport de la mission gouvernementale confiée à M. Hermelin avait recommandé d'affecter une part supérieure de l'attribution de produits de la recette « visas » aux services consulaires et de créer un mécanisme incitatif d'intéressement en corrélant l'accroissement du pourcentage attribué à l'activité des visas à l'augmentation des recettes36(*).
Une orientation alternative, soutenue par la direction du budget, consisterait à supprimer ce mécanisme de liaison entre recettes et dépenses de l'activité « visas ».
En premier lieu, la suppression de cette attribution de produits se justifierait par un argument de lisibilité budgétaire. Certes, il peut être utile, dans une démarche de comptabilité analytique, de mettre en rapport les dépenses et les recettes d'une activité de service public pour évaluer sa performance. Pour autant, en application du principe d'universalité budgétaire, il ne paraît pas opportun de lier aussi directement les recettes et les dépenses d'une activité de service public.
En second lieu, cette attribution de produits ne permet pas de répondre aux objectifs qui lui sont fixées. Le montant de l'attribution de produits est déterminé en fonction des recettes et, par conséquent de l'activité, de l'année passée. Le financement des moyens humains des services consulaires se trouve ainsi décorrélé du niveau d'activité de l'année en cours.
Pour autant, les rapporteurs spéciaux ne se prononcent pas en faveur d'une telle suppression. Si ce mécanisme budgétaire présente de réelles limites techniques, il constitue une liaison entre l'activité de délivrance des visas et son objectif d'attractivité. Le souci de conserver l'équilibre qui s'attache à la politique des visas justifie le maintien de cette attribution de produits, neutre sur le budget de l'État et d'un montant limité.
En tout état de cause, la mise en oeuvre de la plateforme européenne commune de traitement des demandes de visas Schengen (voir infra II.A.1.) devrait conduire à une évolution de la perception des frais de visas et, par conséquent, au fonctionnement de ce dispositif. Dans cette nouvelle configuration, la Commission européenne serait amenée à centraliser les frais de visas, avant de les reverser aux États membres au prorata du nombre de visas délivrés. Sans aucune certitude sur les délais de collecte et de reversement de cette recette par la Commission, le principe d'une telle affectation devrait faire à l'objet d'une réflexion à moyen terme.
B. L'ACTIVITÉ DE DÉLIVRANCE DES VISAS : UN LEVIER DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS EUROPÉENS
Depuis le début des années 2010, la sous-direction de la politique des visas met en oeuvre des actions financées sur fonds européens.
L'instruction des demandes de visas par les services consulaires bénéficie de financements européens, au titre de l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV). Cet instrument constitue, avec le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et le Fonds Asile Migration Intégration (FAMI), du Fonds européen pour les frontières extérieures (FFE). La direction générale des étrangers en France constitue l'autorité de gestion de ces trois instruments, en France.
Doté de 215 millions d'euros au sein du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, l'IGFV comporte deux volets :
- d'une part, un volet « gestion des frontières », doté de 157 millions d'euros, destiné à financer des actions de gestion des frontières extérieures de l'Union européenne ;
- d'autre part, un volet « politique commune des visas », doté de 46 millions d'euros, dédié au financement d'actions d'harmonisation de la délivrance des visas et de prévention des risques sécuritaires et migratoires.
Pour la programmation de l'IGFV 2021-2027, la France s'est engagée sur trois objectifs, détaillés dans le document de présentation du programme de l'État membre au titre de cet instrument37(*), à savoir :
- améliorer les moyens structurels des consulats (rénovation des services de visas et investissements immobiliers dans les consulats à forte représentation de partenaires Schengen) ;
- contribuer à la mise en réseau d'équipes composées d'experts dans la lutte contre la fraude, renforcer l'accompagnement auprès des centres externalisés afin de mesurer l'efficacité, l'impact de l'externalisation et le suivi de la biométrie et garantir l'application uniforme de l'acquis de l'Union ;
- renforcer la mise en oeuvre de systèmes d'exploitation et de maintenance de systèmes d'information à grande échelle, y compris concernant l'interopérabilité de ces systèmes d'information et de leur infrastructure de communication.
Sur la période 2022-2025, trois projets pilotés par la sous-direction de la politique des visas ont été financés par ce biais.
Projets financés sur les crédits de
l'IGFV sur le programme 151
sur la
période 2022-2025
(en euros)
|
Intitulé |
Nature du projet |
|
Fonctionnement des services consulaires visas - Externalisation - Règlementation |
Soutien au fonctionnement des postes pour améliorer la qualité du service tout en préservant le niveau de sécurité et d'intégrité des procédures d'instruction (missions de conseil et d'audit auprès des PSE et formations des agents des services consulaires) |
|
Rénovation des services des visas des ambassades et des consulats |
Financement de travaux d'aménagement ou de rénovation des services des visas des postes représentant un ou plusieurs États Schengen (amélioration des conditions de travail des agents et d'accueil du public dans les services non externalisés, transformation des locaux suite à l'externalisation de la collecte des demandes de visas ou aménagement des zones d'archivage) |
|
Cellule de lutte contre la fraude aux visas |
Financement d'une part de la rémunération des agents de la cellule chargés de cartographier les phénomènes de fraude, prévenir les comportements frauduleux et remédier à la fraude au travers de missions d'audit |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Sur le plan budgétaire, deux fonds de concours retracent le versement de ces subventions :
- d'une part, s'agissant des dépenses hors titre 2, le fonds de concours 1-1-00009 « Remboursement par les Fonds européens des dépenses liées à la politique des visas », créé en 2009 et rattaché au programme 151, retrace les remboursements européens destinés au financement des projets en matière de politique des visas ;
- d'autre part, pour les dépenses de titre 2, un fonds de concours 1-3-00333 « Remboursement par les Fonds européens des dépenses de personnel liées à la politique des visas », créé en 2014, retrace les remboursements à hauteur de 75 % des salaires des agents de droit local sur certains postes. À noter que, dans le cadre du regroupement des dépenses de personnel de la mission AEE au sein du programme 105, ce fonds de concours y a également été transféré depuis le programme 151.
Comme pour la plupart des financements sur fonds européens, les versements interviennent a posteriori, ce qui induit un décalage dans la programmation de ces financements. De plus, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souligne la lourdeur des pièces justificatives à fournir à la Commission, au regard de la faiblesse des montants en cause. La constitution des dossiers de remboursement mobilise les services de la sous-direction de la politique des visas comme les services comptables des postes.
III. ...TEMPÉRÉE PAR UNE DÉMARCHE D'EXTERNALISATION ANCIENNE PERMETTANT DE PALLIER LE MANQUE D'EFFECTIFS POUR UN COÛT BUDGÉTAIRE LIMITÉ
A. UNE POSSIBILITÉ OUVERTE PAR LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
Depuis le début des années 2010, compte tenu de la très forte hausse des demandes de visas et dans un contexte budgétaire contraint, la France, comme plusieurs de ses partenaires européens, a choisi d'externaliser la collecte des demandes de visas et des pièces justificatives. Cette démarche d'externalisation poursuivait différents objectifs :
- tout d'abord, améliorer les conditions d'accueil des demandeurs au moment du dépôt de la demande de visa. Jusqu'alors, les services de visas constituaient le premier contact du demandeur avec la France. Les files d'attente et des services saturés contribuaient, dès lors, à dégrader sensiblement l'image de notre pays ;
- ensuite, réduire les délais d'instruction, en concentrant l'activité des services consulaires sur le traitement au fonds des demandes de visas par un transfert de tâches au prestataire ;
- le tout, sans majorer les effectifs des services consulaires.
Le choix de l'externalisation correspond à une possibilité ouverte par l'article 43 du code communautaire des visas, qui permet aux États membres de recourir à un prestataire de services extérieurs (PSE) pour assurer des tâches limitativement énumérées. Les services consulaires conservent cependant un monopole sur l'exercice de certaines missions, de nature régalienne.
En application de ce cadre, la France pratique deux types d'externalisation en matière de visas :
- d'une part, l'externalisation partielle, portant uniquement sur les prises de rendez-vous pour les demandes de visa, pratiquée dans huit pays dont deux pourraient prochainement basculer en externalisation complète38(*) ;
- d'autre part, l'externalisation complète, portant sur l'ensemble des activités susceptibles d'être externalisées, soit les activités allant de l'information du demandeur de visa au recueil des documents et justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande.
À noter que ces activités peuvent comprendre la perception des frais de visas. Le III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 permet en effet à l'État par convention écrite de « confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. »
Missions liées à la
délivrance des visas pouvant ou non faire l'objet
d'une
externalisation à un prestataire de services
extérieurs
|
Tâches externalisables auprès d'un prestataire de services extérieurs |
Tâches non externalisables, obligatoirement assurées par les services consulaires |
|
- Fourniture d'informations générales sur les conditions d'obtention des visas ; - information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d'une liste récapitulative ; - recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat ou aux autorités centrales ; - perception des droits de visa ; - gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur ; - recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat ou des autorités centrales et restitution de ceux-ci au demandeur. |
- Examen des demandes de visas ; - entretiens éventuels avec le demandeur ; - prise de décision sur la demande de visa ; - consultation du système d'information sur les visas (VIS) ; - impression et apposition des vignettes-visas. |
Source : commission des finances d'après l'article 43 du code communautaire des visas
Historiquement, l'externalisation des prises de rendez-vous et de la collecte des dossiers s'est effectuée en priorité sur les postes traitant les plus gros volumes de demandes. Actuellement, sur l'ensemble du réseau consulaire, huit postes ont fait le choix d'opérer une externalisation des prises de rendez-vous tandis que 69 postes, répartis dans 59 pays, ont recours à une externalisation « complète ». Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères indique que de nouveaux postes pourraient prochainement y recourir.
La sélection des prestataires est opérée à la suite d'une consultation des postes. Contrairement à d'autres États membres de l'espace Schengen, comme les Pays-Bas, la France ne choisit pas un prestataire unique pour son réseau consulaire mais sélectionne par région ou pays. Cette méthodologie permet une meilleure mise en concurrence entre les PSE39(*) et évite de dépendre d'un seul prestataire pour l'ensemble des postes.
Part des demandes de visas traitées par les
prestataires de services extérieurs
sur la période 2015-2024
(en pourcentage et en nombre de demandes)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Au total, les prestataires de services extérieurs conventionnés avec la France animent 147 centres d'accueils. En 2024, les PSE traitaient 90 % des demandes de visas reçues par la France. Plus de 2 000 agents sont mobilisés par les PSE pour l'exécution des marchés passés avec la France. Par comparaison, en 2015, le rapport d'information de nos collègues Éric Doligé et Richard Yung40(*) indiquait un taux de traitement des demandes par les PSE de l'ordre de 74 %, avec 66 centres d'accueil pour 39 postes consulaires.
Le marché de l'externalisation est cependant assez restreint : seulement trois sociétés, qui travaillent également avec d'autres États, assurent ces activités pour le compte de la France. Il est cependant possible que la liste des prestataires de services extérieurs s'élargisse à d'autres opérateurs.
Prestataires de services extérieurs intervenant pour le compte de la France
|
Société |
Implantation et détention |
Activité pour le compte de la France |
Personnels affectés |
|
Société VF Worldwide Holdings Ltd (VFS) |
Société indienne immatriculée à Dubaï, détenue majoritairement par le fonds Blackstone |
Les principales opérations pour le compte de la France se font en Inde, en Turquie, en Iran et en Arabie Saoudite |
709 personnes |
|
Société TLS |
Filiale de la société Téléperformance, société cotée à la bourse de Paris dont 76 % est détenue par 530 investisseurs institutionnels |
Les principales opérations pour le compte de la France se font en Chine, au Maroc, en Tunisie et aux États-Unis |
1 054 personnes |
|
Capago |
Société française dont le siège social est basé à Gif-sur-Yvette (91) |
Les principales opérations se font au Koweït, au Qatar et prochainement en l'Algérie |
290 personnes (cet effectif devrait doubler avec l'ouverture de centres en Algérie) |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux et l'audition conjointe de TLS et Capago
B. UNE EXTERNALISATION NEUTRE POUR LES FINANCES PUBLIQUES
Formellement, l'externalisation de l'accueil des demandeurs de visas est neutre pour les finances publiques. Dans le cadre des marchés passés avec l'État, les prestataires de services extérieurs ne perçoivent pas de rémunération directe de la part des pouvoirs publics. Leur rémunération repose sur les frais de services additionnels acquittés par les demandeurs.
L'article 17 du code communautaire permet la perception de ces frais par les prestataires et précise :
- que ces frais sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d'une ou plusieurs des tâches ;
- et qu'ils ne peuvent dépasser la moitié du montant des frais de visas, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas.
De plus, les PSE peuvent proposer aux demandeurs des services annexes et optionnels, destinés à simplifier leurs démarches. Ces services peuvent ainsi comprendre un accueil premium, une collecte à domicile des dossiers et des données numériques, un retour du passeport par courrier sécurisé ou une aide à la constitution du dossier. À titre d'exemple, les centres de la société TLS contact proposent des salons « premium », permettant aux demandeurs de patienter dans des conditions de confort amélioré. L'offre de services ne peut néanmoins pas conduire le prestataire à accélérer l'instruction du dossier des demandeurs. L'administration assure un contrôle du caractère optionnel des services proposés.
Toutefois, les postes conservent la possibilité d'exempter certains demandeurs de frais de services : une clause du cahier des charges prévoit 5 % de gratuité annuelle pour les demandeurs désignés par les postes.
Au-delà de la neutralité du coût des contrats d'externalisation pour les finances publiques, cette opération n'a pas permis de dégager, à proprement parler, d'économies budgétaires sur l'activité d'instruction des demandes de visas, en particulier s'agissant des dépenses de titre 2. L'externalisation n'a pas conduit les postes consulaires à réduire leurs effectifs pour compenser le transfert de ces charges. À l'inverse et comme indiqué supra, les effectifs ont cru de 4 % sur la période 2006-2015 et de 2,3 % sur la période 2015-2019.
Deux éléments d'explication ont été avancés par la Cour des comptes en 2017 dans son évaluation de la démarche d'externalisation41(*) :
- d'une part, l'externalisation n'a pas conduit à limiter la progression du volume de demandes de visa. Les postes les plus exposés à l'afflux de demandes, s'étant engagés prioritairement dans la démarche d'externalisation, ont dû redéployer leurs effectifs pour assurer l'instruction des dossiers. En ce sens, l'externalisation a simplement permis de limiter la hausse des moyens humains des services consulaires ;
- d'autre part, les services consulaires n'ont pas mené de démarche d'adaptation consécutive à l'externalisation d'une partie de leurs activités. Comme le notait la Cour, « alors que l'externalisation aurait dû conduire à une réorganisation des services des visas, leur activité étant désormais recentrée sur l'instruction et la décision de délivrance relevant de la seule compétence des agents titulaires, la composition des effectifs n'a que peu évolué dans les consulats. »42(*)
Sur un plan plus qualitatif et au-delà du seul angle budgétaire, l'externalisation de la prise de rendez-vous et la collecte des pièces justificatives a conduit à une nette amélioration des conditions d'accueil des demandeurs. Sans constituer un échantillon représentatif, la visite de la mission de contrôle dans les centres de TLS contact à Rabat et Casablanca s'est faite dans des locaux respectant parfaitement les exigences posées par le ministère. La qualité de service proposée par le PSE dépend toutefois du niveau d'exigence et de suivi des services consulaires.
TROISIÈME PARTIE
LA DÉLIVRANCE DES VISAS
FACE À
UNE TRIPLE CONTRAINTE D'EFFICACITÉ,
DE SÉCURITÉ ET
D'ATTRACTIVITÉ
I. POURSUIVRE LA MODERNISATION DES SERVICES CONSULAIRES
A. LA NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE MAÎTRISE DES DÉLAIS D'INSTRUCTION, SANS EN AUGMENTER EXCESSIVEMENT LES COÛTS
1. Limiter la progression des délais de traitement : un objectif qui doit demeurer prioritaire
Pour les demandeurs, le délai de traitement constitue l'indicateur principal de la qualité du service rendu par les services consulaires français. Sans majorer de manière excessive les coûts de traitement, reposant essentiellement sur des dépenses de personnel, ni sacrifier les exigences de sécurité, il importe de conserver une durée raisonnable de traitement des dossiers.
Le sous-indicateur « visa de court séjour » de l'indicateur de performance 1.2 du programme 151 retrace dans les documents budgétaires le délai de traitement des demandes pour ce type de visa. De treize jours en 2022, il a été ramené à huit jours en 2023 avant de remonter à neuf jours pour les années 2024 et 202543(*). Le stade de l'instruction est par conséquent relativement rapide et se décompose entre une phase de pré-instruction, partagée entre le PSE et les services consulaires, et une phase d'instruction.
Il importe de noter que le délai de traitement des demandes de visas ne recouvre pas le délai réel d'obtention du visa par le demandeur : il court à compter du dépôt de la demande auprès du prestataire ou du consulat. Or, le dépôt est effectué sur rendez-vous, fixé par le prestataire de services extérieurs en fonction du nombre de créneaux déterminé par le consulat. Ce dernier établit le nombre de rendez-vous en prenant en compte ses propres capacités de traitement. Le délai d'obtention d'une plage de rendez-vous peut prendre des semaines selon le type de visa demandé et se trouve, dans les pays à forte demande, perturbé par les pratiques de certaines officines locales.
Déroulement de l'instruction d'une demande de visa
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Les capacités de traitement des demandes de visas par les services dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les effectifs figurent en première place. En effet, l'instruction est limitée par la capacité individuelle des agents à traiter un stock de dossiers. Sur les postes de Casablanca et Rabat, des quotas d'instruction ont été attribués aux agents : une quarantaine de dossiers par pré-instructeur par jour et entre 80 et 85 demandes par instructeur et par jour.
Sur l'ensemble du réseau consulaire, un sous-indicateur « visa » de l'indicateur « nombre de documents délivrés par ETPT » du programme 151 permet de suivre les capacités moyenne de traitement par agent : 240 visas par ETP ont été délivrés en 2022, contre 307 en 2023. Des cibles respectivement de 440 et 350 visas ont été fixées pour les années 2024 et 2025. La baisse des objectifs affichés entre 2024 et 2025 s'explique par le renforcement des effectifs des services consulaires et la réorganisation des procédures de traitement.
Des facteurs calendaires peuvent également affecter les délais de traitement des demandes. Les services consulaires connaissent ainsi des pics saisonniers, en particulier à l'été où se cumulent les demandes de visas tourisme, de visas étudiants et de visas saisonniers. Le consulat général de Rabat, dont le délai moyen de traitement s'élevait à neuf jours au premier semestre, a atteint une trentaine de jours en août en raison de cet afflux estival. Faute de pouvoir lisser cette demande, les services d'instruction peuvent accumuler des retards de traitement. Dans ce type de situation, le stade de l'instruction apparaît comme un potentiel « goulet d'étranglement ».
Par ailleurs, le délai de traitement varie selon le type de dossier ou de visa demandé. Les dossiers présentant peu de chances d'obtention d'un visa sont, par exemple, plus aisés à traiter.
2. Les retours d'expérience des difficultés de la « crise des visas » invitent à renforcer la réactivité des services consulaires
Si les difficultés apparues lors de la « crise des visas », consécutive à la brutale remontée du volume de demandes post-crise sanitaire, ont pu être maitrisée par une reconstitution des effectifs et une refonte des procédures, les difficultés ponctuelles de traitement, évoquées supra ne devraient pas disparaitre. La saisonnalité des demandes de visas entraine nécessairement des périodes plus intenses pour les services. Si leur organisation interne permet une forme de lissage des demandes, par une communication à l'égard des demandeurs et une priorisation de certaines catégories de demandes, des périodes de plus grande pression sont inévitables.
Pour pallier les difficultés ponctuelles rencontrées dans le traitement des demandes, trois dispositifs coexistent actuellement au Quai d'Orsay :
- tout d'abord, un vivier de missionnaires permanents, de l'ordre de 29 agents, prêts à être mobilisés sur des missions à l'étranger dans divers domaines ;
- ensuite, des missionnaires occasionnels, à savoir des vacataires extérieurs, qui peuvent répondre à des offres publiées sur le site du MEAE ;
- enfin, un « centre de soutien consulaire », constitué à la suite de la « crise des visas » et fort de cinq agents de catégorie C spécialistes dans le domaine des visas et de 25 missionnaires, spécialisés dans l'administration des Français de l'étranger.
Concernant le centre de soutien consulaire, davantage qu'une structure permanente et organisée, il s'agit d'un vivier d'agents en poste qui peuvent effectuer une à deux missions de renfort par an, sous réserve des nécessités de service. En ce sens, il correspond plus à une forme de « réserve opérationnelle » d'agents consulaires potentiellement mobilisables qu'à une véritable cellule de soutien. Cette solution présente à la fois le mérite de la souplesse et de ne pas peser excessivement sur les dépenses de personnel de la mission. Pour autant, ce dispositif ne suffit pas à répondre à l'ensemble des besoins. À titre d'exemple, sur l'année 2023, si 52 agents instructeurs missionnaires avaient été déployés dans les pays où la demande était la plus forte, 22 demandes de vacation n'avaient pas pu être satisfaites44(*).
Il paraît donc nécessaire d'élargir cette réserve en identifiant un plus grand nombre d'agents susceptibles d'effectuer des missions de renfort en cas de besoin. Cela implique pour la DFAE un travail d'identification et de formation des agents, prioritairement dirigé vers les services présents à Nantes sur les visas.
B. UNE DÉMARCHE DE REGROUPEMENT QUI DOIT ÊTRE PROLONGÉE DE MANIÈRE PLUS VOLONTARISTE
1. Une solution écartée par la France : la mutualisation des centres d'instruction de visas au niveau européen
En matière de délivrance des visas, le code communautaire des visas permet une coopération consulaire entre les États membres. Son article 40 précise que si « chaque État membre est responsable de l'organisation des procédures relatives aux demandes »45(*), ces derniers « coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre d'accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire. »46(*)
L'ancien article 41 du code communautaire des visas, récemment supprimé47(*), ouvrait la possibilité de recourir à deux modalités de coopération communautaire en matière de délivrance des visas. La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire estime que la suppression de cet article n'emporte pas d'incidence sur le fond.
D'une part, l'ancien article 41 permettait une colocalisation des services des visas, en prévoyant que « le personnel des consulats d'un ou de plusieurs États membres exécute les procédures ayant trait aux demandes (y compris le recueil des identifiants biométriques) qui lui parviennent dans les locaux du consulat d'un autre État membre, dont il partage l'équipement. »
D'autre part, il autorisait la création d'un centre commun de traitement des demandes entre au moins deux États membres. Ces derniers peuvent ainsi regrouper leurs services des visas dans une même localisation et partager les coûts de gestion. Le centre commun de traitement permet une mutualisation du recueil des demandes de visas, les demandeurs étant ensuite dirigés vers l'État membre responsable de la demande.
Le rapport d'information d'Éric Doligé et Richard Yung48(*), publié au nom de la commission des finances du Sénat, recommandait, en 2015, d'envisager la mise en place de centres uniques de traitement des visas pour l'ensemble des États membres de l'espace Schengen dans quelques sites pilotes. Le choix des sites concernés répondait à des critères précis en excluant :
- en premier lieu, les pays où les postes consulaires connaissent une faible demande et où tous les États membres de l'espace Schengen ne sont pas représentés ;
- en second lieu, les postes consulaires de première importance, installés dans des pays où la « concurrence » pour les publics cibles est intense et où les services consulaires disposent des moyens matériels et immobiliers les plus conséquents.
Les États envisagés par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances en 2015 correspondaient à des sites symboliques, où les représentations consulaires des États membres sont confrontées à des difficultés analogues et où une mutualisation des moyens présente des avantages logistiques et politiques, comme l'Iran ou la Birmanie.
Dans le même sens, le rapport de la mission gouvernementale confiée à Paul Hermelin envisageait, pour les petits services de visas, de recourir à une mutualisation avec d'autres pays de l'espace Schengen49(*).
Interrogée par les rapporteurs spéciaux sur la mise en oeuvre de ces recommandations, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a indiqué que le MEAE n'y était pas favorable. Plusieurs arguments sont avancés par le ministère au soutien de cette position.
La principale justification tient à la crainte d'une concurrence entre États membres pour la délivrance des visas ; les publics cibles des politiques d'attractivité des États membres présentent de fait des profils similaires. Conserver un consulat autonome permet de capter des flux de travailleurs qualifiés qui répondent aux besoins des États européens.
En outre, le ministère juge que le recours au centre commun de dépôt des demandes de visas soulève des difficultés pratiques : la démarche d'externalisation et le recours aux prestataires de services extérieurs seraient difficile à concilier avec cette mutualisation et l'organisation interne de centres communs impliquerait des surcoûts de gestion (afin d'organiser la répartition des droits de visas sur le plan comptable et la gestion des ressources humaines).
Par ailleurs, la France, comme d'autres États de l'espace Schengen, envisage son réseau consulaire comme un attribut de souveraineté. La délivrance des visas constitue une compétence régalienne par laquelle un État maîtrise les entrées sur son territoire. De plus, les chefs de postes consulaires disposent d'une marge de manoeuvre ponctuelle pour les dossiers les plus politiques.
En matière de coopération consulaire, la France s'est donc davantage orientée vers des modalités plus souples.
Tout d'abord, elle pratique, dans plusieurs pays, un partage des locaux, comme à Dacca (Bengladesh) avec l'Allemagne. Cette pratique se distingue de la colocalisation en ce que le partage ne porte que sur les locaux consulaires. Les équipements demeurent séparés entre les services des deux États.
Ensuite, la France assure la représentation d'autres États membres dans des pays tiers50(*), dans le cadre d'accords bilatéraux de représentation. Cette faculté, ouverte par l'article 8 du code communautaire des visas, consiste pour un État à « représenter un autre État membre compétent (...) en vue d'examiner les demandes et de se prononcer sur celles-ci pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques. »51(*) En 2024, la France assurait la représentation de 23 États de l'espace Schengen dans 62 pays tiers. En miroir, elle était représentée par 14 partenaires Schengen dans 36 États tiers.
Enfin, elle a pu s'engager dans la coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres, ou « coopération locale Schengen » (CLS), organisée par le titre V du code communautaire des visas. Dans ce cadre, sous l'égide de la délégation de l'Union européenne dans le pays hôte, les services consulaires des États membres peuvent partager leurs expériences, bonnes pratiques et statistiques dans le but d'harmoniser les pratiques de traitement des demandes (par la détermination d'une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, la traduction commune du formulaire de demande, une information commune des demandeurs ou la mise en oeuvre locale de la délivrance de visas à entrées multiples). Les consulats des États membres proposent des adaptations locales qui sont transmises par la délégation de l'Union à la Commission européenne pour l'adoption de décisions d'exécution, sur avis du comité des visas.
Modalités de coopération consulaire entre États membres de l'espace Schengen
|
Modalité de coopération consulaire |
Caractéristiques |
|
Colocalisation |
- Partage des procédures et des équipements ; - Répartition des droits de visas. |
|
Centre commun de traitement des visas |
- Partage des locaux et des coûts de gestion ; - Mise en commun du dépôt des demandes et orientation des demandeurs vers l'État membre responsable de la décision ; - Un seul État chargé des relations diplomatiques avec le pays hôte. |
|
Partage des locaux |
- Partage des locaux consulaires ; - Pas de partage des équipements. |
|
Représentation |
- Représentation d'un autre État pour l'examen des demandes et la délivrance des visas. |
|
Coopération locale Schengen |
- Partage de bonnes pratiques ; - Harmonisation des listes de documents justificatifs au niveau local ; - Dérogation aux règles générales de délivrance des visas à entrées multiples. |
Source : commission des finances d'après le code communautaire des visas et les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Pour autant, la recommandation déjà formulée par la commission des finances en 2015, à savoir mutualiser les services de visas avec nos partenaires Schengen sur des postes avec une faible demande, apparait toujours d'actualité dans des États à forte dimension symbolique et où la concurrence pour les publics cibles est faible.
Recommandation : pour les postes où la demande de visa est faible, envisager une mutualisation des services des visas avec nos partenaires Schengen (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
De manière générale, les rapporteurs spéciaux notent que la coopération Schengen pourrait être encore approfondie. À l'occasion de son entretien avec la mission de contrôle, le consul général d'Espagne à Rabat a ainsi émis le souhait d'organiser des échanges et visites mutuelles entre services de visas pour comparer et potentiellement dupliquer les pratiques des États membres52(*).
2. Le regroupement de l'instruction des visas : une adaptation bienvenue et à poursuivre
a) Une démarche qui vise à atteindre un « seuil critique » d'effectifs dans les services d'instruction des visas
Plutôt que de s'engager dans une démarche de mutualisation des moyens entre les pays de l'espace Schengen, la France a amorcé dans plusieurs pays un regroupement des services de visas sur un ou plusieurs sites, en fonction de la taille du réseau consulaire dans le pays hôte. Cette démarche vise à disposer de services d'instruction d'une taille suffisante pour répondre aux variations du volume de demandes ; des services disposant d'effectifs limités ne sont en effet pas en mesure de répondre aux pics d'activité. Comme l'externalisation du recueil des demandes de visas, cette réforme du réseau des services consulaires permet de répondre à la double contrainte pesant sur l'instruction des visas : l'augmentation continue des demandes et la nécessaire limitation de la progression des effectifs du programme 151. Cette rationalisation permet une meilleure mobilisation du personnel instructeur à l'échelle du pays hôte, sans création de nouveaux ETP.
Le premier regroupement a été réalisé entre 2012 et 2015 en Russie. Depuis lors, des regroupements ont été opérés aux États-Unis, au Maroc, au Canada et en Afrique du Sud. De nouvelles réorganisations sont en cours au Congo (pour un regroupement sur Brazzaville à l'automne 2025), en Chine (pour un regroupement sur les trois sites de Pékin, Shanghai et Canton à l'été 2026), en Inde (pour un regroupement sur Bangalore et New Dehli entre l'été 2026 et l'été 2027) et au Cameroun (pour un regroupement sur Yaoundé à l'automne 2026). Le Quai d'Orsay a identifié d'autres pays où les services des visas pourraient être regroupés dans les années à venir (le Nigéria, l'Algérie, le Vietnam et l'Arabie Saoudite).
Si le regroupement sur un seul site est privilégié, une réorganisation sur plusieurs sites peut être opérée, en raison des spécificités du pays hôte : la taille de l'État concerné (comme dans le cas de l'Inde ou de la Chine) ou le nombre et la diversité des demandes (comme dans le cas du Maroc).
Le regroupement des services visas au Maroc
Le réseau consulaire français au Maroc s'étend sur six postes consulaires (Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger).
Depuis le regroupement de l'instruction des visas, finalisé en 2020, seuls les postes de Rabat et Casablanca sont dotés d'un service de visas. Ces deux services disposent chacun de 35 agents et assurent l'ensemble de l'instruction des demandes de visas pour le Maroc. La répartition du traitement des demandes entre les deux postes est de nature géographique ; le poste de Rabat assure le traitement des demandes de la zone nord et le poste de Casablanca celui de la zone sud. Une spécialisation thématique des postes a également été opérée avec une concentration du traitement des demandes de visa pour les travailleurs saisonniers sur le poste de Casablanca.
Selon les données de la plateforme France visas, pour les demandes de visa de court séjour depuis le Maroc, l'instruction nécessite sept à dix jours minima et jusqu'à trois semaines en haute saison. Pour les demandes de visa de long séjour, l'instruction peut durer entre trois semaines et trois mois.
En matière d'attractivité, les services consulaires se sont saisis de la possibilité de nouer des partenariats avec des acteurs de référence issus de la société civile et des milieux économiques pour mieux identifier les « publics prioritaires », tel que la chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.
Depuis 2014, le recueil des demandes de visas est confié au Maroc à la société TLS contact, qui gère sept centres d'accueil des demandeurs dans le pays (Agadir, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Rabat, et Tanger)53(*).
Dans le contexte de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le prestataire de services extérieurs TLS devrait étendre son service de recueil des demandes de visas à Laayoune et à Dakhla, principales villes de ce territoire54(*). Cette extension prendra la forme, à Laayoune, d'un point de collecte ouvert tous les quinze jours et, à Dakhla, d'un recueil direct des demandes auprès des entreprises et des particuliers.
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
L'initiative du regroupement est partagée entre les remontées des postes et l'administration centrale, qui identifie préalablement les potentiels de réorganisation. La décision d'opérer un regroupement associe la direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, la direction générale de l'administration et de la modernisation, l'inspection générale des affaires étrangères, la direction géographique concernée et les postes visés55(*).
Une fois prise la décision de regrouper l'instruction des visas dans un pays, un comité de pilotage technique est mis en place. Il associe les services du MEAE (DFAE, direction des ressources humaines, direction de la sécurité diplomatique, direction des immeubles et de la logistique, direction du numérique, direction géographique concerné), la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur et les postes.
b) Un bilan positif qui devrait être prolongé par des regroupements au niveau régional
Les regroupements réalisés depuis 2012 permettent désormais de disposer d'une première évaluation in itinere de cette démarche dont le bilan apparaît essentiellement positif.
Sur le plan organisationnel, le regroupement de l'instruction des visas permet aux services d'instruction d'atteindre une taille critique, nécessaire à leur bon fonctionnement. À cet égard, le rapport Hermelin identifie un dimensionnement minimal des services des visas à cinq ETP instructeurs et au double d'agents de droit local. L'atteinte de ce seuil critique facilite la gestion, par le service, des ressources humaines disponibles et de mieux répondre aux pics d'activité résultant de la saisonnalité de certaines catégories de demandes de visas (visas touristiques et étudiants notamment). Il en résulterait une plus grande qualité de service, du fait de la réduction des délais de traitement.
En outre, un seuil minimal d'agents ouvre la voie à une spécialisation par catégorie de visas, en particulier pour celles qui présentent une technicité plus importante (visas de regroupement familial ou de réunification familiale ou visas de long séjour passeport talent). Un rassemblement des instructeurs sur un nombre limité de postes consulaires devrait également contribuer à renforcer leur niveau d'expertise et le partage des bonnes pratiques, notamment en matière de détection de la fraude.
Sur le plan des méthodes de travail, limiter le nombre de services d'instruction des demandes de visas d'entrée conduit à éviter des divergences dans les méthodes de traitement des dossiers. Le regroupement offre une vision d'ensemble des différents types de demandes de visa et leurs spécificités respectives. De plus, lorsque plusieurs postes sont maintenus (comme en Russie ou au Maroc) les échanges se trouvent simplifiés.
Toutefois, les retours sur expérience des regroupements déjà réalisés ont également permis d'identifier plusieurs points d'attention :
- tout d'abord, s'agissant des agents, le regroupement des instructeurs sur un seul site peut demander un temps d'adaptation et de familiarisation à l'égard du contexte local. Dans le cas plus spécifique des agents de droit local, ces derniers n'ont pas toujours la volonté ou la possibilité de déménager ce qui implique de nouveaux recrutements et un temps de formation ;
- ensuite, si le regroupement permet de simplifier la gestion des relations avec les prestataires de services extérieurs (qui voient le nombre de leurs interlocuteurs dans les postes diminuer), la distance entre le lieu de regroupement et les centres d'accueil des PSE peut soulever une difficulté. Le suivi et le contrôle des activités des PSE devient plus coûteux et nécessite de mobiliser davantage d'agents pour les visites sur place ;
- enfin, les demandeurs de visas doivent s'acquitter d'un surcoût de frais de services, pour financer le transfert des dossiers depuis les centres des PSE vers les services d'instruction (compris entre un et deux euros). Pour autant, le maillage territorial assuré par les centres de recueil des demandes animés par les PSE demeure identique et le regroupement de l'instruction des visas n'impose, en principe, pas de frais de déplacement additionnels pour les demandeurs.
Recommandation : poursuivre la démarche de regroupement de l'instruction des visas pour atteindre un seuil critique d'effectifs et de moyens par poste et envisager, pour les plus petits postes, un regroupement régional (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
À noter que le regroupement des services d'instruction des visas ne constitue pas la seule modalité de rationalisation de l'organisation des services consulaires. D'autres États, à l'instar du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ont fait le choix de centraliser l'instruction des visas en administration centrale. L'adoption d'une telle organisation implique cependant de confier l'instruction des demandes de visas au ministère chargé de l'immigration, en contradiction avec le caractère bicéphale de la politique française des visas.
C. LA DÉMATÉRIALISATION DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS : UN CHANTIER ENCORE INACHEVÉ
1. France Visas : une rénovation profonde des outils numériques de la délivrance des visas
Lancé en 2017, le portail France visas constitue l'outil de gestion de l'ensemble du parcours des demandes de visas émises par les ressortissants de pays tiers à l'espace Schengen. Il intervient en remplacement de l'application Réseau mondial visas (RMV), devenue obsolète et insuffisamment sécurisée, et accompagne l'usager depuis sa recherche d'information sur les conditions de délivrance d'un visa d'entrée en France jusqu'à la décision d'octroi ou de refus. L'interface France visas est disponible en six langues56(*). Engagé en juin 2021 et achevé en mai 2023, le déploiement de France visas auprès des services consulaires a permis une modernisation sensible de l'instruction des visas. L'ensemble des 822 agents des services consulaires affectés à l'activité « visas » ont désormais recours à cette interface.
Les modules de France visas peuvent être regroupés en deux grandes catégories.
En premier lieu, France visas - Grand public est orienté vers les usagers. Ces derniers peuvent s'assurer, grâce à la mise en ligne d'une information relative à la règlementation en vigueur, de la nécessité du dépôt d'une demande de visa et de la liste des pièces justificatives qui s'y attachent. Les étrangers peuvent directement déposer sur le portail France visas un formulaire de demande de visa, accompagné des pièces justificatives. L'enregistrement des données biométriques se fait également sur la plateforme, au travers des solutions BIODEV (postes consulaires) ou BIONET (si l'opération est réalisée dans un centre géré par un PSE). Cette étape est réalisée soit par les agents des services consulaires, soit par les agents des prestataires de services extérieurs lorsque le dépôt des demandes fait l'objet d'une externalisation.
En second lieu, France visas - Administration assiste les agents de l'administration tout au long de la phase d'instruction des demandes, qu'il s'agisse :
- de la phase de consultation des systèmes d'information, nationaux ou européens, à des fins de contrôles sécuritaires ou migratoires ;
- du recueil d'avis de la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur et de la sous-direction de la politique des visas du MEAE ;
- de l'impression de la vignette qui devra être apposée sur le passeport du demandeur ou des lettres de refus de délivrance des visas ;
- ou du recueil de statistiques sur l'activité d'instruction et de délivrance des visas.
L'achèvement du déploiement de la plateforme et le retour progressif à un volume de demandes équivalent à un niveau pré-crise sanitaire permettent de visualiser ce que devrait être le « rythme de croisière » de l'application. En 2024, France visas a ainsi enregistré 13,5 millions de visites, pour un total de 3,5 millions de demandes.
Toutefois, dans les premiers mois de sa mise en oeuvre, la plateforme France visas a sensiblement affecté la productivité des services consulaires. Plusieurs mois ont été nécessaires à une pleine appropriation par les agents, habitués à l'application RMV. L'ajout de nouvelles fonctionnalités et étapes dans la procédure et les difficultés techniques inhérentes à un déploiement sur l'ensemble du réseau consulaire ont allongé les délais de traitement des demandes de visas, dans un contexte compliqué par le rebond des demandes. Le rapport de la mission Hermelin a ainsi pu noter « que l'accueil de France-Visas par les agents des services consulaires est souvent réservé voire défavorable parce qu'il provoque une baisse sensible de la productivité. »57(*)
Dans sa réponse à la question écrite du rapporteur spécial des crédits de la mission AEE au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères reconnaissait en août 2023 que « France-Visas est la traduction technique d'une volonté politique de renforcer les contrôles sécuritaires qui a, effectivement, un impact sur le temps de traitement des dossiers. »58(*) Interrogée par les rapporteurs spéciaux, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a estimé que « comme pour tout nouveau système d'information déployé, les utilisateurs ont eu besoin d'un temps d'adaptation ayant conduit à une baisse temporaire de la productivité pendant une période de 2 à 3 mois »59(*), tout en indiquant que les délais de traitement avaient désormais atteint un niveau comparable à ceux de l'ancienne application RMV. La DFAE met en avant plusieurs avantages de la nouvelle plateforme France visas :
- d'une part, l'intégration de la consultation des bases de données sécuritaires dans les fonctionnalités de France visas constitue un indéniable gain de temps ;
- d'autre part, les modalités d'historisation des actions et l'introduction d'indicateurs permettent un pilotage plus fin des services d'instruction tandis que la création d'un module de statistiques permet de suivre plus précisément l'évolution des délais de traitement.
2. Trois enjeux principaux pour le futur de France visas : la poursuite de la dématérialisation des demandes, l'interopérabilité avec les différents systèmes d'information et la mise en place de la plateforme européenne des visas
a) Une interopérabilité encore insuffisante avec les autres plateformes
En l'état d'avancement de France visas, ce portail est connecté à plusieurs plateformes :
- pour opérer des contrôles sécuritaires, par la consultation du fichier Cristina de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), du fichier des personnes recherchées (FPR) et du système d'information Schengen (SIS) ;
- et pour vérifier les antécédents des demandeurs, sur les bases de données des visas nationaux (VISABIO) et européens (système d'information sur les visas, VIS) et prochainement sur le système d'entrées/sorties (EES) et sur les bases de données du ministère de l'intérieur (notamment sur l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France60(*)).
Toutefois, l'information des services d'instruction des demandes de visas pourrait bénéficier d'une interopérabilité élargie avec différentes plateformes d'information opérantes au sein de l'administration. Du point de vue des agents instructeurs, l'accès à ces plateformes devrait permettre une meilleure circulation de l'information et une fiabilisation des décisions. Pour les demandeurs, cette interconnexion leur permettrait d'éviter de redéposer une nouvelle fois, au cours de leur parcours en France, documents et pièces justificatifs.
En matière d'antécédents migratoires, le déploiement programmé de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) au 1er septembre 2025 devrait faciliter la vérification des antécédents migratoires depuis France visas. Diverses plateformes intervenant dans le parcours des demandeurs de visas pourraient également faire l'objet d'une interconnexion avec France visas :
- premièrement, la plateforme études en France (EEF) afin d'accéder, lors de l'instruction des demandes de visas étudiants, aux avis émis par les services de coopération et d'action culturelle (Scac) sur les projets d'études des demandeurs ;
- deuxièmement, en matière d'antécédents médicaux, les services consulaires pourraient bénéficier d'un accès aux demandes d'aide médicale d'État (AME) pour vérifier si les demandeurs ont déjà bénéficié ou bénéficient de l'AME, d'une part, et des données de l'assurance-maladie pour identifier l'existence d'une éventuelle dette hospitalière, d'autre part ;
- troisièmement, le casier judiciaire pour améliorer les criblages sécuritaires ;
- quatrièmement, les applications de la sous-direction des visas pour renforcer l'information des postes sur les dossiers de réunification familiale et sur les suites des contentieux contre les refus de visas devant les juridictions administratives.
Ces nouvelles interconnexions devraient en priorité permettre aux services consulaires d'obtenir un retour sur le détournement des visas qu'ils délivrent. Cette recommandation, portée à l'attention des rapporteurs spéciaux par l'ambassadeur chargé des migrations et le consulat général de France à Rabat, parait donc essentiel, en ce qu'elle permettrait aux postes de disposer d'un tableau de bord précis de leurs résultats en matière de prévention de la fraude et, au besoin, d'adapter leurs procédures. En effet, en l'état actuel du schéma d'interconnexions de France visas, les postes ne sont pas en mesure d'évaluer précisément leur stratégie de délivrance.
Recommandation : poursuivre l'interconnexion de France visas avec les systèmes d'information pertinents, en priorité ceux liés à l'administration des étrangers en France (ministère de l'intérieur).
Recommandation : permettre un retour d'information aux postes diplomatiques sur le suivi des décisions de délivrance de visas, pour améliorer leurs procédures d'instruction et de lutte contre la fraude (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
b) Les incertitudes tenant à la mise en place d'une plateforme commune de demande de rendez-vous pour les demandeurs Schengen
La plateforme commune de demande de rendez-vous pour les demandeurs Schengen (EU-VAP) devrait constituer le principal défi technique auquel sera confronté France visas dans les années à venir. Introduit dans une communication de la Commission européenne, en date du 14 mars 2018, « Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis », le projet de mise en oeuvre d'un visa Schengen électronique a été précisé dans le cadre du pacte « Asile et immigration », présenté en mars 2020.
Une plateforme commune de demande de rendez-vous pour les demandeurs Schengen devrait ainsi être développée et opérationnelle d'ici 202861(*). Les ressortissants de pays tiers déposeront désormais leur demande de visa en ligne sur cette plateforme commune, quel que soit l'État membre visé. Cet outil sera en mesure de déterminer l'État compétent pour examiner la demande de visa lorsque le séjour envisagé se déroule sur plusieurs États membres. Si la demande est acceptée, le demandeur recevra un visa numérique, sous la forme d'un code-barres 2D crypté. La réforme supprimera ainsi l'étape de la pose de la vignette autocollante.
La mise en oeuvre de cette plateforme commune aurait trois avantages principaux, tant pour les demandeurs que pour l'administration consulaire :
- d'une part, du point de vue des demandeurs, la nouvelle plateforme devrait grandement simplifier leurs démarches en permettant un processus plus rapide et moins onéreux, en limitant leurs déplacements en présentiel et en supprimant la vignette autocollante, désormais disponible en format numérique. La plateforme devrait également protéger davantage les données personnelles des usagers ;
- d'autre part, pour les services consulaires, la plateforme EU-VAP devrait limiter le risque de falsification et de contrefaçon des visas et permettre une plus grande harmonisation des pratiques et des procédures de délivrance entre les États membres.
Pour autant, des points d'attention significatifs ont été identifiés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères quant à l'introduction de cette plateforme commune. D'autres pourraient émerger au fur et à mesure de l'avancement des textes d'application relatifs à l'organisation d'EU-VAP.
Sur le plan technique, l'introduction de cette plateforme unique est exposée à différents risques. Au stade du basculement des outils nationaux vers un système unifié, le maintien de certains modules nationaux62(*) dans la nouvelle structure représente un défi pour les services en charge de cette adaptation. S'agissant de la maintenance de la nouvelle plateforme, disposer d'un système unique et relativement centralisé rend l'ensemble des systèmes nationaux vulnérables à une défaillance au niveau européen. La nouvelle plateforme devra supporter un flux particulièrement conséquent d'information et nécessitera des ressources importantes pour en assurer le bon fonctionnement. Cet outil devra également, tout en conservant un objectif de dématérialisation de l'ensemble de la procédure, conserver une accessibilité pour les usagers, y compris dans des pays où l'accès à internet n'est pas une évidence.
De plus, en termes d'adaptation des équipes, le basculement de France visas vers EU-VAP soulèvera une problématique de formation et d'évolution de l'organisation des services.
D'une part, le précédent du déploiement de France visas suggère que l'introduction d'une nouvelle plateforme conduirait à un allongement du délai de traitement des demandes, le temps pour les agents d'assimiler leur nouvel outil. Une partie significative des modules de France visas, relatifs aux visas de court séjour, seraient remplacés par la nouvelle plateforme européenne.
D'autre part, si la mise en place du visa numérique devrait supprimer certaines étapes de la procédure de délivrance des visas (notamment celle de la vignette), la charge de travail des consulats pourrait s'en trouver in fine alourdie. En outre, il en résultera un rôle accru pour la Commission européenne en matière de gestion et de maintenance de la plateforme EU-VAP. Les États membres n'auraient plus la maîtrise des adaptations techniques à apporter à cet outil.
Pour ces différentes raisons, la France a demandé à bénéficier d'une période de transition de sept ans pour rejoindre la plateforme, jusqu'en 2035. Cette période lui permettra également d'amortir les coûts de développement de France visas, de l'ordre de 48 millions d'euros63(*).
Recommandation : anticiper les conséquences de la mise en oeuvre de la plateforme EU-VAP en préparant la formation des agents à ce nouvel outil, en révisant l'organisation des services consulaires et en prévoyant une évolution des missions confiées aux prestataires de services extérieurs (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
II. DEUX PROBLÉMATIQUES ACCOMPAGNENT LA HAUSSE DES DEMANDES : LA FRAUDE ET LA MASSIFICATION DU CONTENTIEUX
A. UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX VISAS
1. Les risques de fraude et de détournement du visa
a) Fraude interne et fraude externe aux visas : un phénomène recrudescent depuis la fin de la crise sanitaire
En matière de visas, deux types de fraude peuvent être distingués.
En premier lieu, il existe une fraude interne aux services consulaires, dont le suivi relève de la compétence du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Elle concerne des pratiques frauduleuses auxquelles peuvent participer des agents des services consulaires64(*), qu'il s'agisse de titulaires ou d'agents de droit local. La fraude interne consiste, pour l'agent impliqué, à octroyer indûment un rendez-vous au demandeur ou à mener favorablement l'instruction d'un dossier. Un cas de fraude interne peut être détecté à l'occasion de contrôles du chef du service des visas ou d'un signalement.
Pour l'année 2024, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a recensé onze cas de fraude interne65(*). À la différence de la fraude externe, concentrée sur certaines zones géographiques, comme exposée infra, la fraude interne concerne l'ensemble du réseau consulaire, aucun pays n'étant a priori prémuni de ce type de dérive.
En second lieu, la fraude externe regroupe l'ensemble des pratiques de fraude affectant directement la demande de visa. Elle recoupe essentiellement la fraude aux documents d'identité, difficile à détecter, et la fraude documentaire, qui concerne l'ensemble des pièces justificatives66(*). La fraude externe concerne également les pratiques frauduleuses internes aux prestataires de services extérieurs.
Si le taux de refus, tous motifs confondus, a retrouvé un niveau similaire à 2019, le nombre de refus pour fraude progresse depuis 2021 avec un doublement des décisions. La part des refus pour fraude dans le total des décisions de refus se stabilise autour de 9 % en 2024.
Refus de visas motivés par la présence d'un document frauduleux
(en nombre de décisions et en pourcentage)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Évolution 2021/2024 |
|
|
Total des refus pour fraude |
26 464 |
44 190 |
39 315 |
51 341 |
+ 96 % |
|
Part des refus pour fraude dans le total des refus de visas |
13,6 % |
8,8 % |
7,8 % |
8,9 % |
/ |
|
Refus pour fraude en raison de faux justificatifs |
25 801 |
42 404 |
37 756 |
49 662 |
+ 96 % |
|
Refus pour fraude en raison de faux titres d'identité et de voyage |
99 |
772 |
503 |
190 |
+ 92 % |
|
Refus pour fraude en raison de faux actes d'état civil |
564 |
1 014 |
1 056 |
1 489 |
+ 164 % |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Cette progression sur les quatre derniers exercices résulte, selon la DFAE, de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la progression des demandes de visas, toutes catégories confondues, fait « naturellement » augmenter le nombre de dossiers frauduleux. De plus, les difficultés rencontrées par les services consulaires pour traiter le surcroît de demandes consécutivement à la fin des restrictions sanitaires a conduit à un effet de rattrapage. En outre, la période de pandémie aurait été mise à profit par les fournisseurs de documents faux ou contrefaits en Afrique francophone, où la fraude documentaire a connu un développement particulièrement dynamique : les marges de manoeuvre offertes par les réglementations locales ont été davantage exploitées avec un recours accru aux jugement supplétifs et aux actes récognitifs. Enfin, il n'est pas exclu que les efforts engagés par la DFAE et la DGEF dans la lutte contre ces pratiques depuis 2020-2021 ait contribué à renforcer la détection de dossiers frauduleux.
Classement des dix pays avec le taux de fraude le plus important en 2024
(en pourcentage, en nombre de visas et en nombre de demandes de visas)
|
Pays |
Taux de fraude |
Nombre de dossiers de visas concernés |
Nombre de demandes de visas |
|
Comores |
24,3 % |
1 474 |
6 067 |
|
Ghana |
22,8 % |
2 098 |
9 185 |
|
Djibouti |
14,5 % |
841 |
5 809 |
|
Malaisie |
13,7 % |
328 |
2 394 |
|
Israël/Territoires palestiniens |
12,9 % |
466 |
3 604 |
|
Irak |
11,4 % |
2 274 |
20 039 |
|
Arménie |
7,9 % |
1 060 |
13 414 |
|
Tanzanie |
6,6 % |
175 |
2 655 |
|
Centrafrique |
6,3 % |
242 |
3 871 |
|
Nigéria |
6,1 % |
3 586 |
58 778 |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
Contrairement à la fraude interne, qui peut concerner l'ensemble du réseau consulaire, la fraude externe est plus concentrée géographiquement. Certains pays connaissent un niveau de fraude documentaire endémique, liées aux défaillances de l'état civil local et au niveau de corruption.
Le dynamisme de la fraude, combiné à l'activité des officines, a ainsi pu augmenter les difficultés rencontrées pour traiter les demandes de visas par les postes consulaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, aux Comores ou au Cameroun. Au-delà de la seule Afrique francophone, les services des visas de la corne de l'Afrique, notamment l'Éthiopie, ont dû faire face à des problématiques similaires.
Classement des pays les plus concernés par la fraude en matière de visas en 2024, selon le type de fraude
(en nombre de documents frauduleux détectés)
|
Faux justificatifs |
Faux titres d'identité et de voyage |
Faux actes d'état civil |
|||
|
Pays |
Nombre de documents |
Pays |
Nombre de documents |
Pays |
Nombre de documents |
|
Inde |
9 752 |
Afrique du Sud |
70 |
Vietnam |
296 |
|
Algérie |
7 448 |
République démocratique du Congo |
40 |
Cameroun |
225 |
|
Nigéria |
3 496 |
Côte d'Ivoire |
17 |
Comores |
163 |
|
Chine |
3 243 |
Éthiopie |
12 |
Côte d'Ivoire |
128 |
|
Irak |
2 274 |
Gabon |
8 |
Kenya |
101 |
|
Ghana |
2 098 |
Algérie |
6 |
Nigéria |
88 |
|
Côte d'Ivoire |
1 997 |
Sénégal |
6 |
Bénin |
73 |
|
Vietnam |
1 601 |
Arabie Saoudite |
6 |
Centrafrique |
69 |
|
Congo |
1 460 |
Bengladesh |
4 |
Djibouti |
65 |
|
Cameroun |
1 400 |
Congo |
4 |
République démocratique du Congo |
62 |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
b) La zone grise des officines
La délivrance des visas par les services consulaires est fréquemment parasitée par les activités d'officines locales. Ces structures, généralement des sociétés de droit local ou des entités relevant de l'économie souterraine, proposent aux demandeurs un accompagnement dans la constitution de leurs dossiers, en amont de leur rendez-vous auprès du prestataire de services extérieurs.
D'une part, les services consulaires constatent que ces officines organisent une captation des créneaux de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas auprès des prestataires de services extérieurs, afin de les revendre de manière illégale aux demandeurs. Il en ressort une perturbation de la procédure de demande de visas, avec une saturation immédiate des plages de rendez-vous mises en ligne par les PSE. Les usagers ayant recours à la procédure normale se trouvent rapidement démunis, ce qui nourrit parmi les demandeurs une frustration croissante. Le développement des nouvelles technologies permet à ces sociétés de capter plus rapidement les créneaux, par le recours à des « bots », contre lesquelles les services consulaires disposent de peu de moyens.
D'autre part, dans une démarche de marchandisation de la procédure de demande de visas, ces officines peuvent proposer un accompagnement des demandeurs dans la constitution de leurs dossiers et leurs démarches auprès des services consulaires. Dans leur assistance à la constitution des dossiers des demandeurs, elles sont susceptibles d'insérer parfois des documents frauduleux parmi les pièces justificatives.
Par ailleurs, non contentes d'exploiter les failles de la procédure de prise de rendez-vous et d'en perturber le fonctionnement, les officines peuvent également mener des actions de communication agressives à l'égard des services français de délivrance des visas. Ces sociétés ont en effet tout intérêt à propager de fausses informations ou exagérer les délais d'examen des dossiers par les consulats français. La mise en avant de leurs propres services contribue par conséquent à dégrader l'image de la France dans des régions où cette dernière a pu connaître d'importants revers dans l'opinion publique.
En outre, leur action diffuse une perception erronée du « prix » de la demande de visas, en incluant le coût de leurs propres services, alors que les frais de dossiers pour la délivrance d'un visa, comme les frais de services demandés par les PSE, sont strictement encadrés.
c) Le détournement des visas à des fins migratoires
Les motivations qui s'attachent à la fraude aux visas, tant externe qu'interne, sont essentiellement de nature migratoire. La délivrance de visas à des ressortissants étrangers comporte de fait un « risque » migratoire : le détournement par le bénéficiaire de ce document par un maintien sur le territoire au-delà du délai prévu. Pour la direction générale des étrangers en France, « toute demande de visa, par nature, présente le risque d'être détournée. Pour le ressortissant de pays tiers désireux de se maintenir en France, le visa est le moyen régulier de traverser la frontière extérieure dans le but de se maintenir sur le territoire en engageant le cas échéant des démarches pour régulariser sa situation administrative. »67(*) Néanmoins, le visa court séjour présente un fort potentiel de détournement aux fins de s'établir en France.
La quantification du détournement de visas est malaisée au niveau central comme au niveau des services consulaires. Ces derniers ne disposent pas du taux de détournement des visas délivrés par le poste, rendant dès lors le pilotage de l'instruction difficile pour les services de visas. La documentation de ce phénomène devrait cependant être fiabilisée avec le règlement relatif au système d'entrée et sortie (EES), progressivement mis en place à compter d'octobre 2025, qui affectera le processus de franchissement des frontières extérieures des ressortissants de pays tiers (RPT) en court séjour. En principe, les données consolidées permettront au ministère d'établir le volume des dépassements de la durée du séjour et d'améliorer l'évaluation du risque de détournement du visa.
2. Un effort louable de structuration de la lutte contre la fraude aux visas qui devra être prolongé
a) La lutte contre la fraude, nouvelle priorité de la politique des visas
Depuis 2020-2021, la lutte contre les pratiques frauduleuses a été érigée au rang de priorité par les deux ministères compétents en matière de délivrance des visas.
En premier lieu, concernant la fraude interne, la DFAE a structuré deux niveaux institutionnels de prévention et de répression :
- en 2021, une cellule de lutte contre la fraude interne a été créée au sein du bureau de la réglementation et de la lutte contre la fraude interne de la sous-direction de la politique des visas. Chargée d'assister les postes dans la gestion de ce risque, la cellule propose des actions de formation et de conseil aux postes pour les assister dans leur organisation et diffuser de bonnes pratiques de vigilance. Au-delà de cette dimension préventive, la cellule constitue également le guichet unique de signalement de potentielles fraude interne par les postes. Lorsqu'un poste saisit la cellule, cette dernière peut mener des actions d'investigation (entretiens formels, recherches dans les archives...) ;
- en 2024, un groupe de réaction rapide contre la fraude interne a été créé, placée sous la co-présidence de la directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et du directeur général de l'administration et de la modernisation. Cette instance, dont le secrétariat est assuré par la cellule précitée, se réunit à un rythme bimensuel et rassemble l'ensemble des services impliqués au sein du MEAE (DFAE, direction des ressources humaines et inspection générale des affaires étrangères). Son rôle est d'assurer le suivi, au niveau de l'administration centrale, de l'ensemble de la chaîne de traitement d'un signalement de fraude interne. Le groupe de réaction rapide se prononce sur la nécessité d'une mission d'enquête, émet un avis à l'autorité compétente sur la mise en oeuvre de mesures conservatoires et assure le suivi des enquêtes.
En second lieu, s'agissant de la fraude externe, la compétence est partagée entre le ministère de l'intérieur et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Du côté du Quai d'Orsay, le suivi de la fraude externe est assuré tant au niveau de l'administration centrale que des postes. Ainsi :
- un pôle fraude, compétent sur l'ensemble de la fraude consulaire, est placé auprès de la DFAE et chargé du suivi de la thématique fraude, de la coordination et de la formation du réseau consulaire. Il participe également aux travaux interministériels sur la lutte contre la fraude ;
- un centre d'information Oscar (pour « outil de suivi consulaire par analyses et restitutions ») assure la compilation et la diffusion d'un ensemble d'indicateurs dédiés à la fraude ;
- des référents fraude ont été désignés au sein de chacun des postes diplomatique ou consulaire et sont chargés de la documentation du phénomène de fraude, de la coordination et de la prévention au sein du poste et des échanges avec l'administration centrale et les organismes sociaux ;
- pour les postes les plus à risques, il a été demandé aux services consulaires de créer des cellules transversales de lutte contre la fraude regroupant l'ensemble des services intéressés68(*), à l'échelle du poste, du pays ou de la région (par exemple, une cellule pilotée par l'ambassade à Addis Abeba coordonne l'action des services pour l'ensemble de la zone Afrique de l'Est-Océan indien) selon l'ampleur des risques.
Concernant le ministère de l'intérieur, les services de la DGEF interviennent à plusieurs niveaux pour lutter contre la fraude aux visas. La sous-direction des visas peut être consultée, a priori, par les services consulaires au stade de l'instruction d'une demande de visa. Les services du ministère constatent, a posteriori, le détournement des visas par un maintien au-delà de la limite de séjour sur le territoire national. De plus, le ministère pilote les révisions de la législation en vigueur afin de dissuader les pratiques frauduleuses. À titre d'exemple, l'article 47 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (dite « loi CIAI ») a inséré dans le Ceseda un nouvel article L. 312-A qui permet de refuser la délivrance d'un visa de long séjour à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai imparti.
b) Les prolongements possibles
Au cours de son audition par les rapporteurs spéciaux, la direction de l'immigration a évoqué une piste d'évolution du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile visant à renforcer la lutte contre la fraude documentaire. Une disposition, introduite dans la loi CIAI mais censurée par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 45 de la Constitution, prévoyait ainsi de subordonner expressément l'opposabilité en France des actes d'état civil étrangers, prévue par l'article 47 du code civil, et des jugements étrangers, prévue par la jurisprudence, à leur légalisation préalable lorsque cette formalité est exigible69(*).
Ensuite, s'agissant des activités des officines, les services consulaires sont confrontés à une « course aux armements » avec ce secteur de l'économie parallèle qui a recours à des outils de plus en plus sophistiqués. Une solution plus efficace, expérimentées dans plusieurs postes, consiste à prévoir une attribution automatique des rendez-vous auprès des PSE, plutôt que de proposer différents créneaux. La lutte contre les pratiques des officines comporte également une dimension communicationnelle, comme développé infra.
Recommandation : généraliser l'attribution automatique des plages de rendez-vous pour limiter les possibilités de détournement de la procédure par les officines (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, consulats).
Enfin, des améliorations plus spécifiques à certains profils peuvent être envisagées. La situation des travailleurs saisonniers constitue une particularité ; les postes consulaires constatent depuis plusieurs mois un taux de retour trop faible des saisonniers. En Tunisie, pour l'année 2024, l'antenne de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) indiquait que 871 des 3 325 primo-demandeurs ne se sont pas présentés pour faire valider leur retour. L'antenne de l'Ofii à Casablanca, avec laquelle la mission de contrôle s'est entretenue au cours de son déplacement, a confirmé cette tendance, estimant à près de 20 % le « taux d'évaporation ». Cette situation s'expliquerait par un affaiblissement du contrôle des autorisations de travail, à la suite de la mise en place en avril 2021 d'une instruction centralisée au sein des plateformes interrégionales des services de main-d'oeuvre étrangère (SMOE)70(*). Des accords de partenariats locaux avec des tiers de confiance, comme celui mis en place à Casablanca avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (Anapec, équivalent au Maroc de France travail), peuvent réduire le risque de fraude. Pour autant, un renforcement du contrôle des autorisations de travail en France paraît nécessaire.
Plus largement, s'agissant de l'immigration professionnelle, les rapporteurs spéciaux estiment que les services déconcentrés de l'État sont insuffisamment équipés pour obtenir une connaissance fine des besoins de main-d'oeuvre dans les départements. Si le contrôle budgétaire n'a pas permis d'aborder en profondeur cette question, la problématique du suivi du parcours migratoire des médecins étrangers en France constitue un sujet d'intérêt, qui justifierait des travaux ultérieurs du Sénat.
B. LE CONTENTIEUX DES VISAS : UNE MASSIFICATION QUI PÂTIT DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE MINISTÈRES
1. Un contentieux de masse qui représente un coût budgétaire croissant
La contestation des refus de demandes de visas, de court comme de long séjour, s'est imposée au cours des dernières années comme un contentieux de masse, dont le traitement place les administrations comme les juridictions sous tension. Trois explications sont avancées par la direction de l'immigration pour expliquer la multiplication des recours71(*) :
- tout d'abord, la hausse des demandes de visas, accompagnée d'une stabilité du taux de refus, fait mécaniquement augmenter le nombre de recours dirigés contre les décisions de refus ;
- ensuite, l'évolution de la structure des demandes de visas et de la nature des visas demandés peut contribuer à un accroissement des recours. L'augmentation des demandes de réunification familiale, résultant de la hausse des demandes d'asile et de la protection accordée par l'Ofpra, a conduit à une augmentation des refus de visas pour ce motif (les publics concernés ne respectant généralement pas les conditions de ressources nécessaires). La contestation de ces décisions représente aujourd'hui un tiers de l'activité du tribunal administratif de Nantes ;
- enfin, le ministère de l'intérieur note une judiciarisation du droit des étrangers, avec un recours accru des demandeurs à un accompagnement juridique.
Afin de répondre au développement de ce contentieux, deux adaptations de la procédure administrative contentieuse et précontentieuse ont été opérées au cours des dernières années :
- d'une part, depuis 2000, les étrangers qui souhaitent contester une décision de refus de visa devant les juridictions administratives doivent obligatoirement saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). Ce recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est codifié aux articles D. 312-3 et suivants du Ceseda. Pour le professeur Vincent Tchen, la mise en place de ce RAPO « visait à éviter dans la mesure du possible une issue contentieuse en corrigeant les irrégularités commises par les autorités consulaires. »72(*)
- d'autre part, depuis 2010, la compétence de premier ressort des litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires est attribuée au tribunal administratif de Nantes73(*). Auparavant, ces litiges, nés hors des territoires relevant de la compétence des tribunaux administratifs, ressortait de la compétence de premier ressort du Conseil d'État.
Plus récemment, deux décrets en date du 29 juin 202274(*) ont poursuivi cette démarche de rationalisation de la procédure précontentieuse et contentieuse en matière de refus de visa d'entrée.
Premièrement, ces deux textes ont transféré de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vers le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le soin d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires75(*). La CRRV demeure compétente pour les recours dirigés contre les décisions de refus de visa de long séjour.
Deuxièmement, le décret n° 2022-962 a confirmé le principe selon lequel en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif contre une décision de refus de visa est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée.
Troisièmement, le délai d'exercice des recours devant la CRRV a été réduit de deux mois à trente jours.
Quatrièmement, le décret a supprimé la voie de l'appel pour les jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes à l'égard des refus de délivrance de visas de court séjour.
Cette réforme visait en partie à répondre aux remarques du Conseil d'État, publiées dans une étude à la demande du Premier ministre en octobre 202076(*), qui soulignait les dysfonctionnements de la CRRV, incapable de rendre des décisions motivées sur l'ensemble des RAPO. De fait, entre 2011 et 2024, le nombre de saisines de la commission avait été multiplié par 7,5, pour atteindre près de 40 000 recours. Une situation qui avait conduit, selon le Conseil d'État, à l'apparition d'un contentieux « parasite » sur la communication des motifs des décisions implicites, en raison d'un traitement à moyens constants.
Nombre de saisines de la commission de recours
contre les décisions de refus
de visa d'entrée en France
entre 2018 et 2024
(en nombre de recours et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données transmises par la direction de l'immigration
Pour autant, la progression des contestations de refus de visa demeure soutenue. Entre 2019 et 2024, le tribunal administratif de Nantes a connu une augmentation de 42 % du nombre total de recours, essentiellement du fait de la massification de ce contentieux. Sur la même période, les recours dirigés contre des refus de visas d'entrée en France ont augmenté de 115 %. Pour le seul exercice 2024, cette juridiction a enregistré environ 7 200 recours au fond et 2 150 référés77(*).
Évolution du nombre de condamnations de l'État devant la juridiction administrative en matière de refus de délivrance de visas
(en nombre de dossiers et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
S'agissant du « résultat » de ce contentieux, en 2024, une faible majorité des décisions de la juridiction administrative était favorable à l'administration (54 %) et une portion non négligeable défavorable (31 %)78(*).
2. Une répartition inadéquate des compétences entre ministères qui invite à une réorganisation du suivi du contentieux des visas
Il résulte du double pilotage de la politique des visas par Beauvau et le Quai d'Orsay une répartition parfois difficilement lisible des compétences en la matière. Ainsi, en application de la convention du 12 avril 2013 de répartition des charges communes et des charges propres relatives aux frais de fonctionnement du Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration occupant les locaux du ministère des affaires étrangères, ce dernier est responsable de l'ensemble des frais de fonctionnement, parmi lesquels figurent les frais de justice et intérêts moratoires découlant du contentieux des visas.
De plus, depuis septembre 2021, le budget alloué aux frais de justice et destiné au paiement des contentieux de refus de demandes de visas d'entrée en France est inscrit sur le programme 151. Un avenant à la convention, en date du 31 mai 2023, à la convention de 2013 désigne la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire comme ordonnatrice des dépenses de frais de justice et intérêts moratoires liés au contentieux sur les visas.
Il s'ensuit une répartition des compétences entre :
- d'une part, le bureau du contentieux de la sous-direction des visas (SDV) du ministère de l'intérieur, qui assure la défense de l'État devant les juridictions administratives ;
- d'autre part, le bureau des frais de justice et du contentieux des visas qui assure la mise en paiement des frais irrépétibles et, lorsque cela est nécessaire, des dommages pour préjudice moral et astreintes en cas de délivrance tardive des visas.
Si le paiement des frais de justice aux bénéficiaires est assuré intégralement par la sous-direction de la politique des visas de la DFAE, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères bénéficie d'un remboursement partiel en année N+1. Ainsi, par un système de refacturation interne, 50 % des frais engagés par le MEAE est remboursé l'année suivante par le ministère de l'intérieur.
Évolution des frais de contentieux visa sur la période 2017-2024
(en nombre de dossiers et en milliers d'euros)
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
La bonne articulation entre ces deux services impose une prompte transmission des décisions de justice par le ministère de l'intérieur au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Or, la hausse continue des recours contre les refus de délivrance de visas a accru la pression sur les services. Elle s'est accompagnée d'une réforme de l'organisation interne des juridictions administratives à Nantes, avec l'ouverture de nouvelles chambres au tribunal administratif pour répondre au développement du contentieux des visas79(*).
Cette réorganisation a sensiblement accéléré les délais de traitement des recours et a mécaniquement augmenté le stock des décisions en attente d'exécution. Les délais de paiements des décisions de justice par le MEAE ont atteint un niveau préoccupant. À l'occasion des auditions menées par les rapporteurs spéciaux, la DFAE et la direction de l'immigration ont indiqué que Cour des comptes s'était inquiétée, au cours de l'année 2024, de l'allongement de ces délais.
Pour répondre à ces difficultés, les deux ministères ont engagé des efforts de rationalisation : le bureau de gestion des frais de justice en lien avec les contentieux visas (FJCV) a vu ses effectifs portés de deux à six agents, les outils à la disposition de ce service ont été modernisés (avec une refonte des tableaux de suivi, une dématérialisation des procédures et une automatisation des calculs d'intérêts) et les deux sous-directions compétentes se sont efforcées de réduire les délais de transmission.
En dépit de ces efforts, la répartition actuelle des compétences entre les deux ministères ne paraît pas satisfaisante :
- premièrement, la fluidité des échanges entre les deux ministères paraît excessivement dépendre du stock de dossiers en cours d'examen, davantage que des procédures internes aux deux services. Plus que les mesures de simplification engagées au cours des derniers mois, c'est l'apurement du stock de dossiers en attente qui a permis de réduire les difficultés rencontrées par la sous-direction de la politique des visas ;
- deuxièmement, le principe selon lequel le service qui assure la défense de l'État devant les juridictions ne s'acquitte pas des frais de justice paraît déresponsabilisant. La refacturation de 50 % des dépenses en année N+1 ne comporte aucun caractère incitatif pour les services du ministère de l'intérieur ;
- troisièmement, l'engagement de l'intégralité des dépenses de contentieux par le MEAE et la refacturation de 50 % des frais au ministère de l'intérieur l'année suivante nuit à la lisibilité des financements du programme 151. Comme l'ont regretté les rapporteurs spéciaux, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 202580(*), et la Cour des comptes, à l'occasion de l'examen de l'exécution de l'exercice 202481(*), ce programme budgétaire pâtit d'une multiplicité de canaux de financement et dépend de transferts budgétaires d'autres départements ministériels.
Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît nécessaire de clarifier la répartition des compétences entre les deux ministères en regroupant le suivi et le paiement des décisions de justice au sein du seul ministère de l'intérieur. La mise en oeuvre de cette recommandation impliquera, bien entendu, un transfert des moyens humains et budgétaires afférents entre les deux ministères.
Recommandation : regrouper le suivi et le paiement des frais de justice et intérêts moratoires liés au contentieux des visas au sein du ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France, ministère de l'intérieur).
III. LA DÉLIVRANCE DES VISAS AU CoeUR DE LA POLITIQUE MIGRATOIRE
A. UN EFFORT D'ATTRACTIVITÉ À INSCRIRE DANS LA DURÉE
1. Dans un contexte de concurrence accrue entre États européens, la France tente de se doter d'une doctrine d'attractivité
Comme indiqué supra, la délivrance des visas poursuit un objectif d'attractivité du territoire. L'enjeu, dans une démarche d'immigration choisie, est d'attirer sur son territoire les ressortissants étrangers qui répondent à des besoins économiques ou politiques.
Il existe toutefois une concurrence accrue entre États européens pour capter les bénéfices de la délivrance des visas, qui peuvent prendre différentes formes.
Tout d'abord, la délivrance des visas constitue une source de recettes. Il s'agit, pour l'État, des recettes de frais de visas, supérieures au coût de la délivrance de ces documents. Plus indirectement, la délivrance des visas peut s'accompagner d'un soutien de l'État à des secteurs économiques. À titre d'exemple, l'Espagne, en parallèle d'une démarche volontariste à l'égard des profils les plus attractifs, met en avant la compagnie aérienne Air Iberia et entend promouvoir l'aéroport de Madrid comme le premier point d'entrée de l'espace Schengen.
Ensuite, la manne touristique fait l'objet de fortes rivalités entre États européens, compte tenu du poids de ce secteur économique dans un certain nombre d'États membres.
Enfin, la concurrence au sein de l'espace Schengen se porte de plus en plus sur les profils prioritaires de la délivrance des visas, désignés par le rapport Hermelin comme les « publics cibles » de cette politique. Il s'agit de profils présentant des intérêts spécifiques pour le pays d'accueil : entrepreneurs porteurs de projets d'investissement, chercheurs et doctorants, personnes hautement qualifiées, artistes et sportifs, étudiants, etc.
Depuis 201682(*), figure dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France une mention « talent » pour la délivrance de visas de long séjour. Les étrangers salariés ou non-salariés qui veulent contribuer à l'attractivité économique de la France en y séjournant plus de trois mois peuvent solliciter la délivrance :
- d'un visa de long séjour mention « passeport talent », permettant, dans les deux mois suivants l'arrivée en France, de demander une carte de séjour pluriannuelle d'une durée identique au contrat de travail, dans la limite de quatre ans ;
- ou, lorsque le contrat de travail n'excède pas douze mois, d'un visa de long séjour valant titre de séjour.
Délivrance de visas de long séjour mention « talent » sur la période 2020-2024
(en nombre de visa)
Source : commission des finances d'après les données de la DGEF
De 2021 à 2023, la délivrance de visas « talents » a connu une progression significative. L'exercice 2024 a cependant marqué un recul, de l'ordre de 11 % du nombre de visas accordés sur ce motif. Trois pays concentrent un tiers de la délivrance des visas « talents » : la Tunisie, l'Inde et le Maroc.
La diminution du volume de visas « talents » délivrés s'inscrit, selon Business France, auditionné par les rapporteurs spéciaux, dans un contexte de recul de la capacité de la France à attirer une main-d'oeuvre internationale hautement qualifiée. La France se positionne ainsi au 24e rang du classement international 2024 de l'International Institute for Management Development83(*), derrière notamment, en Europe, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche ou le Danemark.
Délivrance en France de visas talents par nationalité en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de la DGEF
Dans ce contexte de concurrence entre les États de l'espace Schengen pour la délivrance des visas, la France a tardé à se doter d'une doctrine claire d'attractivité permettant d'orienter sa politique de visas. Certes, sous le précédent quinquennat, le Quai d'Orsay avait élaboré une « feuille de route de l'influence »84(*) mettant en valeur les facteurs d'attractivité de notre territoire. Pour autant, ce document demeurait essentiellement programmatique et n'envisageait pas l'attractivité sous angle qualitatif. La « crise des visas » de 2023 a fait figure d'élément déclencheur pour le gouvernement de l'époque : les deux ministres compétents sur la politique des visas ont ainsi chargé M. Paul Hermelin, président du conseil d'administration de la société Capgemini, de mener une évaluation de la délivrance des visas en l'envisageant sous l'angle de l'attractivité.
Ce rapport, remis en avril 2023 aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères, est aujourd'hui présenté comme la doctrine des services consulaires en matière de délivrance des visas85(*).
2. L'appropriation par les services consulaires d'une démarche d'attractivité doit être accélérée
Suite à la remise du rapport Hermelin, les ministères en charge de la politique des visas et les postes consulaires ont engagé une adaptation de leur doctrine et des procédures d'instruction des demandes de visas pour les publics prioritaires, essentiellement à droit constant. Dans le prolongement de ces travaux, une instruction conjointe du directeur de l'immigration et de la directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du 16 novembre 202386(*) a précisé ces nouvelles orientations.
En premier lieu, elle fixe une définition des publics cibles de la politique de délivrance des visas. Tout d'abord, au niveau central, des lignes directrices fixées par les ministres et les directions compétentes identifient trois grandes catégories de publics cibles : les personnes pouvant bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mention « talent », au sens de l'article L. 421-7 du Ceseda ; les professionnels qualifiés ne relevant pas du visa talent et les « meilleurs » étudiants. Ensuite, en application d'un principe de subsidiarité, la déclinaison des publics cibles est renvoyée aux postes. Ces derniers sont invités à élaborer « sous l'impulsion de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice [...] une définition aussi précise que possible de ces publics, dans le cadre d'une stratégie partagée entre les différents services de l'ambassade et des consulats. »87(*) Un comité « attractivité » doit être établi dans chaque poste, sous l'autorité du chef de poste.
En second lieu, l'instruction énumère l'ensemble des outils et procédures dont les postes doivent se saisir pour mettre en oeuvre la priorisation des publics cibles. Les outils juridiques existants (visa de long séjour valant titre de séjour et visas de circulation notamment) peuvent être mobilisés, tout comme des allègements de procédures pour les demandeurs prioritaires. En particulier, lorsque cela est possible, les services sont invités à alléger les procédures pour les demandeurs bona fide, sur le fondement d'une présomption de solvabilité et d'absence de risque migratoire. Les accords de partenariats avec des entités locales, « tiers de confiance », sont également encouragés.
Les partenariats locaux
Afin de faciliter l'identification des « publics cibles » et d'accélérer, pour ces profils, l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une demande de visa, les postes diplomatiques et consulaires peuvent conclure des « partenariats locaux » avec des organismes tiers. Il s'agit d'accords administratifs, généralement conclus avec des organismes tels que les chambres de commerce, les associations patronales ou les instituts français. Tout en regrettant l'absence d'évaluation de ce dispositif, le récent rapport d'information de la commission des lois du Sénat sur la diplomatie migratoire recensait 93 accords de partenariat de cette nature à Alger, 48 pour le poste d'Oran et dix accords en Tunisie88(*).
Ces accords avec des tiers de confiance permettent aux consulats de raccourcir, pour les publics cibles, le délai d'obtention d'un rendez-vous. S'agissant de certains profils spécifiques, comme les travailleurs saisonniers, les partenariats avec des organismes tiers réduisent le risque de fraude.
Pour autant, pour le publics professionnel, l'existence de ces accords peut faire naître certaines frustrations. De fait, les tiers de confiance détiennent un quasi-monopole dans l'accès aux rendez-vous pour certaines catégories de visas.
Source : commission des finances
Les rapporteurs spéciaux notent que cette stratégie va dans le sens d'une approche plus positive de la délivrance des visas. En ce sens, elle présente trois avantages principaux.
Premièrement, elle constitue un outil de régulation du volume de demandes de visas. Le critère de priorisation des publics cibles permet de rationaliser le déroulement de l'instruction des demandes par les services consulaires et de raccourcir les délais de traitement.
Deuxièmement, l'effort porté sur le traitement des demandes présentées par les publics cibles fait mécaniquement baisser le taux de refus au niveau du poste. Or les taux de refus de demandes de visas sont regardés avec attention par les pays de départ et constituent un élément non négligeable de la relation bilatérale.
Troisièmement, cette approche apparait complémentaire avec la dimension migratoire de la délivrance des visas : les publics cibles qui se voient proposer prioritairement des rendez-vous présentent un risque moins élevé de fraude ou de détournement de l'objet du visa.
En dépit de ces améliorations, la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin n'apparaît pas totalement aboutie. D'un point de vue quantitatif, le tableau de suivi transmis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères indique que, deux ans après la remise de ce rapport, seulement 19 des 40 recommandations ont été entièrement réalisées et 18 seraient en cours de réalisation. Trois recommandations n'ont pas été retenues par le ministère89(*).
Sur le plan qualitatif, l'identification des publics cibles n'a pas été effectuée par tous les postes consulaires90(*). Plus précisément, tous les postes implantés dans les quinze pays dits prioritaires de notre politique migratoire n'ont pas réalisé une telle identification. Par conséquent, l'ensemble des postes n'est pas doté d'une liste des publics cibles et n'a pas adapté les procédures de délivrance. Alors que l'instruction de la direction de l'immigration et de la DFAE a été publiée il y a presque deux ans, ces retards interrogent.
Outre ces retards, il importe de noter que la réussite de la mise en oeuvre de cette doctrine repose en partie sur la nécessité d'en opérer le suivi, par l'administration centrale. Sans un pilotage par les deux ministères responsables de cette politique d'attractivité, les adaptations des procédures d'instruction pourraient s'essouffler et n'être finalement que de faible portée. En matière d'attractivité universitaire, le précédent du faible portage de la stratégie « Bienvenue en France », rappelé infra, incite à la prudence.
De plus, la persistance de difficultés de traitement des demandes de visas dans certains postes affecte nécessairement la mise en oeuvre de procédures prioritaires pour les publics cibles. La captation des demandes de rendez-vous par des officines et les pics saisonniers de demandes de visas sont autant de facteurs qui entravent l'instruction des demandes prioritaires. En ce sens, la démarche d'attractivité est ralentie par la croissance continue du volume de demandes.
Recommandation : accélérer la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin s'agissant de l'identification des publics cibles et de l'adaptation des procédures d'instruction et opérer un suivi de cette démarche (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).
3. Une réflexion inachevée sur la sélectivité accrue du public étudiant
Les étudiants étrangers prennent indéniablement part à notre politique d'attractivité : l'accueil d'étudiants étrangers participe d'une politique d'influence, contribue au financement des établissements et répond à un besoin de main d'oeuvre qualifiée et de participation à la recherche universitaire.
Les étudiants étrangers hors Union européenne et Espace économique européen suivent une procédure spécifique de demande de visa, parallèle ou postérieure à leur candidature à des formations en France.
Pour le dépôt des voeux d'admission dans l'enseignement supérieur, la très grande majorité des étudiants obtenant un visa (95 %) suivent la procédure de candidature sur une plateforme dédiée, « Études en France ». Dans une logique similaire à la plateforme Parcoursup, les candidats peuvent formuler jusqu'à sept voeux. L'animation du réseau de 500 agents en charge de la procédure « Études en France », sous l'autorité des services de coopération et d'action culturelle (Scac), est assurée par la direction générale de la mondialisation (DGM) du MEAE. La DGM assure également le pilotage des espaces Campus France (ECF)91(*), présents dans 134 pays et rattachés aux Scac.
En parallèle de ce volet académique, les candidats à des études en France doivent déposer une demande de visa. Le sérieux et la cohérence de leur projet académique sont contrôlés par les espaces Campus France au cours d'un entretien, à la suite duquel le service de coopération et d'action culturelle émet un avis sur les voeux du candidat sur recommandation de l'ECF. Les services consulaires s'appuient sur ces éléments pour l'instruction de la demande de visa, tout en opérant les contrôles sécuritaires et migratoires nécessaires. Le travail des ECF paraît essentiel pour les rapporteurs spéciaux, en ce qu'il procède à une évaluation de la crédibilité de la demande de visa, indispensable dans une démarche d'immigration choisie.
Toutefois, selon l'opérateur Campus France92(*), plusieurs difficultés persistent dans le cadre de ce fonctionnement :
- tout d'abord, le calendrier d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur paraît trop tardif au regard des délais d'instruction des demandes de visa étudiant. En particulier, comme le relève la Cour des comptes93(*), les universités rendent tardivement leurs décisions d'admission en examinant l'ensemble des candidature, toutes nationalités confondues, et ce en contradiction avec les délais réglementaires fixés par arrêté94(*). Or, l'instruction des visas comporte des délais incompressibles, d'autant plus que les candidats préfèrent généralement attendre la validation de leur candidature pour déposer leur demande. Il en résulte, pour ces étudiants étrangers, une entrée tardive en formation, au-delà de la rentrée universitaire ;
- ensuite, Campus France note qu'à ce calendrier resserré s'ajoutent des délais de vérification des dossiers de demande de visa par les prestataires de services extérieurs parfois excessivement longs ;
- enfin, l'opérateur souligne l'émergence d'établissements privés lucratifs qui n'entrent pas dans la procédure « Études en France » et peuvent adopter des comportements « prédateurs ». Les candidats admis dans ces écoles peu sélectives peuvent se retrouver en difficulté pour leur demande de visa, les services de l'État n'ayant aucun moyen de vérifier le niveau académique voire la réalité du fonctionnement de ces établissements.
La stratégie interministérielle « Bienvenue en France » et ses limites
La stratégie interministérielle « Bienvenue en France », présentée en 2018, visait à aborder la mobilité internationale dans une approche exhaustive et à repositionner la France dans la concurrence internationale pour l'accueil des étudiants étrangers. Elle a notamment défini un objectif quantitatif d'un demi-million d'étudiants accueillis en France en 2027. La Cour des comptes, dans un récent rapport public thématique95(*), a sévèrement jugé cette stratégie en soulignant deux faiblesses principales :
- d'une part, « Bienvenue en France » correspondait davantage à un plan d'action qu'à une stratégie, la Cour notant « l'incapacité des ministères à prioriser les objectifs associés à l'attractivité » ;
- d'autre part, à compter de la crise sanitaire de 2020, cette stratégie a été reléguée au second plan et son portage politique s'est étiolé, rendant plus qu'improbable l'atteinte de l'objectif de 500 000 étudiants étrangers en 2027.
Source : commission des finances d'après les travaux de la Cour des comptes
Comme indiqué supra, l'instruction du 16 novembre 2023 identifie les seuls « meilleurs » étudiants comme relevant de la catégorie des publics cibles. L'orientation adoptée en matière d'attractivité universitaire depuis la remise du rapport Hermelin se distingue ainsi de celle proposée en 2018 dans le cadre de la stratégie « Bienvenue en France ». Plutôt qu'un objectif quantitatif, il s'agit d'envisager une approche plus sélective, centrée sur certains profils étudiants.
En ce sens, le ministère de l'intérieur comme le ministère de l'Europe et des affaires étrangères entendent prioriser la délivrance de visas mention « étudiant » à quatre grands types de profils : les étudiants d'excellence, qui répondent aux critères d'attribution des bourses du Gouvernement français, les élèves bacheliers du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), les alumni de l'enseignement supérieur français et les titulaires d'un visa « concours ». Selon l'Ambassadeur chargé des migrations, « une approche plus sélective est désormais envisagée tenant compte davantage du risque migratoire présenté par chaque pays et des besoins universitaires et économiques de notre pays. »96(*)
Pour autant, si des réflexions sur une plus grand sélectivité dans l'accueil des étudiants étrangers sont en cours - le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a promu cette orientation dans le cadre du comité interministériel pour le contrôle de l'immigration de février 2025 -, elles n'ont pas encore abouti sur une doctrine formalisée. Dans l'hypothèse où cette position serait adoptée, il paraitrait nécessaire de préciser et de communiquer clairement les critères de sélection des candidats à des études en France.
En tout état de cause, quelle que soit l'évolution de notre doctrine d'accueil, il paraît indispensable de corriger les faiblesses de la procédure de sélection et de candidature à des études en France pour mieux l'articuler avec l'instruction de la délivrance des visas :
- en amont de la procédure, une identification des personnes correspondant aux critères des publics cibles étudiants devrait être engagée par les équipes des Scac et des espaces Campus France, en coordination avec le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, afin de les encourager à s'engager vers l'enseignement supérieur français et à les accompagner dans leurs démarches ;
- au niveau de l'examen des candidatures par les universités, le respect des délais réglementaires de rendu des décisions d'admission devrait être plus strictement appliqué ;
- au stade de l'instruction de la demande de visa, les espaces Campus France devraient encourager le dépôt précoce de demande de visa pour les publics cibles. Parallèlement, les services consulaires pourraient adapter leurs procédures et contrôler le respect des délais d'instruction par les PSE.
Un préalable à cette évolution serait de faire de la plateforme « Études en France » le seul canal de candidature à des établissements d'enseignement supérieur en France. Privilégier cette plateforme aurait pour conséquence de mettre de côté les établissements privés qui n'y ont pas recours.
Recommandation : adapter la procédure de sélection des candidats à l'enseignement supérieur en France pour faire coïncider les délais de délivrance des visas étudiants avec les résultats d'admission sur la plateforme « Études en France » (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'intérieur, universités).
B. LA DÉLIVRANCE DES VISAS : LEVIER DES NÉGOCIATIONS MIGRATOIRES ?
La politique des visas figure parmi les principaux vecteurs de la dimension extérieure des migrations. Par conséquent, dans le cadre d'une politique migratoire globale, l'instrument de la délivrance des visas est apparu, au cours des dernières années, comme un levier de négociations avec les pays d'immigration ou de transit.
À titre d'exemple, entre septembre 2021 et décembre 2022, le Gouvernement a pris la décision de restreindre la délivrance des visas dans les trois pays du Maghreb, afin d'inciter ces derniers à une plus ample coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire. Le Gouvernement avait, dans ce cadre, fixé des objectifs de taux de refus de délivrance de 30 % pour la Tunisie et 50 % pour l'Algérie et le Maroc. Comme l'avait souligné la Cour des comptes dans un rapport sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière97(*), l'efficacité de cette mesure avait été limitée et le conflit a été débloqué par des initiatives diplomatiques plus larges. Le déplacement de la mission de contrôle au Maroc a confirmé cette analyse dont il ressort que :
- cette cible entrait en contradiction avec les objectifs d'attractivité fixés aux services consulaires, qui se sont vus obligés de refuser des visas à des profils attractifs (étudiants, chercheurs, médecins, entrepreneurs...) ;
- la marge de manoeuvre dont disposent les services d'instruction est limitée par critères fixés par le droit européen et le droit interne.
Ces deux facteurs avaient empêché les services consulaires d'atteindre les cibles de taux de refus fixées. L'image de la France auprès des demandeurs de visa, disposant de liens substantiels avec la France, s'était en outre trouvé particulièrement dégradée. S'agissant du Maroc, les représentants du secteur économique rencontrés par la mission de contrôle lors de son déplacement ont rappelé leur déception à l'égard de cette mesure.
Sans volonté de reproduire les mesures restrictives déployées à l'égard des pays du Maghreb en 2021-2022, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur ont indiqué aux rapporteurs spéciaux travailler au déploiement d'instruments permettant de mobiliser la délivrance des visas en matière de coopération migratoire de manière plus ciblée :
- d'une part, au niveau de l'Union européenne, la France propose de faciliter le recours au dispositif du « levier visa-réadmission » prévu à l'article 25 bis du code communautaire des visas98(*). Utilisé à deux reprises à l'encontre de la Gambie et de l'Éthiopie, l'article 25 bis permet à la Commission européenne, lorsqu'elle considère qu'un pays tiers ne coopère pas suffisamment en matière de réadmission, de suspendre l'application de certaines dispositions du code communautaire des visas99(*). L'effet de ce mécanisme est cependant affaibli par la faible portée des mesures restrictives, limitées à un allongement des délais de délivrance, une hausse des frais de visas et une suspension des accords de facilitation. La France propose par conséquent de faciliter le recours à l'article 25 bis tout en renforçant les mesures restrictives (notamment en permettant une suspension de la délivrance des visas) et en ouvrant aux États membres la possibilité d'adopter des mesures additionnelles ;
- d'autre part, au niveau interne, l'article 47 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (dite loi CIAI) a ouvert la possibilité de refuser la délivrance d'un visa de court séjour au titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service, d'une part, et la possibilité de refuser la délivrance d'un visa de long séjour pour tout type de demandeur, d'autre part, pour les ressortissants d'un État « coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. » Le comité interministériel de contrôle de l'immigration (Cici) du 26 février 2025 a validé les instructions interministérielles d'application de cette disposition.
La position conjointe des deux ministères est de privilégier la mise en oeuvre de mesures au niveau européen, pour renforcer leur impact et limiter le coût réputationnel et politique pour la France. Si des mesures restrictives devait être menées au niveau national, elles devraient être proportionnées, ciblées et réversibles. En ce sens, le rapport Hermelin recommandait d'exclure des mesures de restriction les personnes reconnues d'intérêt pour la France et ne représentant pas de risques sécuritaires ou migratoires.
C. UN NÉCESSAIRE EFFORT DE COMMUNICATION SUR LA DÉLIVRANCE DES VISAS
Les auditions menées par les rapporteurs spéciaux ont unanimement souligné l'existence d'une marge significative de progression en matière de communication sur la délivrance des visas.
Deux axes de progression peuvent être identifiés en matière de communication.
En premier lieu, les services consulaires gagneraient à mener des actions de communication plus proactives sur la délivrance des visas et les conditions d'instruction des demandes, afin de répondre aux critiques pouvant émaner du public. Cette communication devrait assumer une transparence sur les facteurs d'allongement des délais (notamment la saisonnalité des demandes de visa selon les catégories). Elle devrait être plus assertive à l'égard des officines, en insistant sur le fait que le « coût » de la demande de visa n'inclut par les honoraires de ces sociétés. Le montant des frais engagés par les demandeurs dans leur démarche d'obtention d'un visa fait fréquemment l'objet de campagnes de presse hostiles.
Une harmonisation des informations transmises aux demandeurs par les postes pourrait ainsi être engagée, en s'inspirant des bonnes pratiques des postes les plus actifs en matière de communication et en s'appuyant sur la direction de la communication et de la presse (DCP).
En second lieu, il pourrait être envisagé de communiquer sur le caractère sélectif de la délivrance des visas. Une partie des crispations des demandeurs découle de l'absence de communication sur les critères d'examen des dossiers. Cette sélectivité peut être assumée, en amont, en insistant sur les conditions d'obtention des différentes catégories de visa et, en aval, par une motivation plus pédagogique des décisions de refus de demandes de visas.
Dans son rapport, Paul Hermelin recommandait d'adopter « un discours de transparence et de vérité vis-à-vis des demandeurs ». La mission d'évaluation estimait ainsi qu'une communication axée sur la sélectivité de la délivrance des visas permettrait d'expliquer aux demandeurs la contradiction apparente entre les objectifs d'attractivité et de contrôle de l'immigration attachés à la politique des visas.
À l'inverse, le rapport de la mission flash de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale100(*), publié en 2021, proposait d'adopter une communication plus « positive » sur les visas, en valorisant les opportunités d'accueil en France. Si cette approche semble pertinente à l'égard des publics cibles, il semble néanmoins que la démarche de communication doit inclure une dimension d'alerte sur les critères de délivrance des visas.
À propos de la sélectivité de la délivrance des visas, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est déclaré réticent à adopter une communication trop ouverte. D'une part, une transparence assumée sur la démarche de sélectivité comporterait un effet réputationnel potentiellement négatif. En effet, les publics cibles, au sens du rapport Hermelin, appartiennent généralement à des catégories socio-professionnelles aisées et la priorité qui leur serait accordée peut générer des frustrations parmi les autres demandeurs. D'autre part, une communication détaillée soulèverait un risque d'opposabilité et pourrait ainsi nourrir un contentieux. Pour ces deux raisons, les recommandations du rapport Hermelin en matière de communication n'ont été que partiellement réalisées.
Recommandation : renforcer la communication sur la délivrance des visas, en harmonisant les informations diffusées par les services consulaires et en adoptant une posture transparente sur la sélectivité des procédures (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, direction de la communication et de la presse).
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 24 septembre 2025 sous la présidence de M. Pascal Savoldelli, vice-président, la commission a entendu une communication de Mme Nathalie Goulet et M. Rémi Féraud, rapporteurs spéciaux, sur la délivrance des visas.
M. Pascal Savoldelli, président. - Nous poursuivons nos travaux par un contrôle budgétaire sur la délivrance des visas.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur spécial. - Nous avons l'honneur, avec mon collègue Rémi Féraud, de vous présenter les conclusions de notre travail annuel de contrôle de la mission « Action extérieure de l'État ». Nous avons choisi de travailler sur la délivrance des visas par les services consulaires.
Il s'agit d'un sujet récurrent pour notre commission, puisque nos anciens collègues Adrien Gouteyron, Éric Doligé et Richard Yung y avaient déjà travaillé. Cette attention particulière tient à la grande attractivité de la France, premier pays de l'espace Schengen en nombre de demandes de visa, à 2,9 millions en 2024, dont 90 % de court séjour. Notre taux de refus se situait, cette même année, à 17 %, ce qui est peu. Chacun d'entre nous a l'expérience de recours, parfois sans succès, auprès de nos services consulaires...
En premier lieu, la politique des visas fait l'objet d'un double pilotage entre le ministère de l'intérieur et celui de l'Europe et des affaires étrangères, puisqu'elle soulève des questions d'attractivité, d'une part, et sécuritaires et migratoires, d'autre part. Ainsi, la conciliation sur le terrain de ces trois dimensions est parfois complexe, et les ministères peuvent éprouver des difficultés de communication.
Il importe, en outre, de souligner la progression constante du nombre de demandes de visa au cours des dernières années. Si la crise sanitaire avait réduit leur nombre, leur volume a progressé de 289 % sur cinq ans, avec 3,4 millions de demandes. Il s'agit ainsi de la principale contrainte pesant sur les services consulaires, dont la capacité de traitement est limitée. Par exemple, au consulat général de Rabat, qu'a visité Rémi Féraud, un instructeur traite 85 dossiers par jour. L'ensemble des réformes ayant concerné la délivrance des visas a donc eu pour objectif de répondre à cette demande croissante.
D'un point de vue budgétaire, la délivrance des visas est traditionnellement présentée comme étant autofinancée. Ainsi, les frais, de 90 euros pour un visa Schengen, viendraient compenser le coût de l'instruction des demandes. Si cette analyse contredit le principe d'universalité du budget de l'État, elle n'est pas sans fondement. En effet, les recettes des frais de visas s'élevaient en 2024 à 260 millions d'euros, alors que les coûts de l'instruction représentaient moins de 70 millions d'euros. Ces derniers correspondent essentiellement aux dépenses de personnel, de l'ordre de 64 millions d'euros en 2025, auxquelles s'ajoutent des dépenses d'investissement et de fonctionnement plus difficiles à isoler au sein de la mission « Action extérieure de l'État ».
Pas moins de 822 équivalents temps plein (ETP) concourent à l'instruction des visas. Il s'agit à la fois d'agents titulaires ou contractuels, chargés de l'instruction au fond des dossiers, et d'agents de droit local, qui assurent une pré-instruction des demandes. Les dépenses de personnel sont d'ailleurs partiellement couvertes par un mécanisme pour le moins baroque d'attribution d'une fraction du produit des frais de visas, soit 0,75 % des recettes de l'année précédente. Nous nous sommes largement interrogés sur ce dispositif, que ce soit en matière de rectitude budgétaire ou d'efficacité, même s'il semble difficile de le supprimer ou de l'améliorer.
Pour maîtriser à la fois l'augmentation des dépenses de personnel et l'allongement des délais d'instruction, les services consulaires ont mené deux réformes organisationnelles.
D'une part, depuis 2010, le recueil des demandes de visa fait l'objet d'une externalisation auprès de prestataires de service extérieurs (PSE). Ces entreprises privées recueillent aujourd'hui 90 % des demandes et animent 147 centres avec plus de 2 000 agents pour le compte de la France. L'externalisation a permis aux services consulaires de concentrer leur activité sur le fond de l'instruction, limitant la progression des effectifs. De plus, l'accueil des demandeurs se fait dans des locaux sécurisés et accueillants. Enfin, l'externalisation est neutre pour le budget de l'État, les PSE se rémunérant par des frais additionnels facturés aux demandeurs.
D'autre part, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a organisé, dans plusieurs pays, un regroupement sur un ou plusieurs sites, afin de disposer de services d'instruction d'une taille suffisante pour répondre aux pics d'activité. Cette rationalisation permet une meilleure mobilisation du personnel instructeur à l'échelle du pays hôte, sans création de nouveaux ETP. Ainsi, au Maroc, le regroupement sur les sites de Rabat et Casablanca a permis de réduire les délais de traitement.
Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur le sujet transversal du parcours des médecins étrangers, qui concerne également les missions « Immigration, asile et intégration » et « Administration générale et territoriale de l'État ». Un contrôle budgétaire consolidé sur ce point serait fort intéressant. En effet, dans tous nos départements, nous sommes confrontés à des difficultés. Or nous savons que pas un seul hôpital ne fonctionne sans médecins étrangers. En conséquence, je propose que notre commission envisage de mener un travail consolidé entre les rapporteurs spéciaux sur les missions budgétaires concernées.
M. Rémi Féraud, rapporteur spécial. - Les services consulaires sont confrontés au défi de traiter un nombre croissant de demandes, sans augmenter ni la durée de traitement - nous en avons mesuré l'importance au Maroc - ni le coût de l'instruction, tout en préservant les exigences de sécurité.
Au cours de nos travaux de contrôle, nous avons pu constater que lesdits services, conscients de cette contrainte, ont engagé des transformations importantes pour y répondre. Elles nous paraissent aller dans le bon sens, même s'il reste des pistes d'amélioration.
Premièrement, il faut poursuivre la modernisation, notamment numérique. Ainsi, depuis 2021, les agents travaillent sur la plateforme France-Visas. Cet outil, au prix de certaines adaptations pour le personnel, a permis de renforcer la qualité des contrôles et des échanges entre administrations.
Cependant, les procédures sont loin d'être entièrement dématérialisées : ainsi, toutes les pièces justificatives sont déposées en papier et les locaux des services consulaires sont remplis de caisses de dossiers, soulevant un enjeu de stockage et d'archivage. De plus, France-Visas n'est pas encore interopérable avec l'ensemble des systèmes d'informations utiles à l'instruction des demandes de visa, comme les plateformes Études en France ou Administration numérique pour les étrangers en France. En particulier, en matière de fraude, d'importants progrès restent possibles.
Une future plateforme commune de prise de rendez-vous pour l'ensemble des demandeurs Schengen devrait répondre à ces limites à moyen terme, mais le basculement vers ce nouveau logiciel soulève d'autres interrogations. Nous avons ainsi été surpris de constater que, si les services centraux semblent conscients de l'enjeu de cette plateforme européenne, les consulats, y compris d'autres pays européens, nous ont paru bien moins avertis.
Deuxièmement, il importe de maîtriser les externalités négatives de la progression des demandes de visa : le développement de la fraude et la massification du contentieux.
D'une part, la hausse des demandes s'est accompagnée d'une progression mécanique des comportements frauduleux, lesquels peuvent aller de la falsification la plus grossière des pièces justificatives jusqu'à des trafics plus sophistiqués impliquant des agents des PSE. De plus, l'instruction des demandes de visa est parasitée par l'activité d'officines qui, dans certains pays, captent de manière illégale les créneaux de rendez-vous. En outre, pour des catégories spécifiques de demandeurs, comme les saisonniers, le détournement de visa apparaît comme un risque structurel. J'ai pu voir, au Maroc, la manière dont les services consulaires s'organisaient pour limiter ces difficultés.
D'autre part, la contestation des refus de demandes de visa s'est imposée comme un contentieux de masse. Sur ce point, la répartition des compétences entre ministère de l'intérieur et ministère des affaires étrangères n'est pas adaptée. La communication entre l'intérieur, qui défend l'État devant la juridiction administrative à Nantes, et les affaires étrangères, qui assurent le paiement des frais de justice, n'est pas satisfaisante et conduit à d'importants retards de paiement.
Troisièmement, il faut aller au bout de la démarche d'attractivité. Les conclusions de la mission confiée à M. Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini, rendues en 2023, ont permis au Gouvernement d'adapter les procédures de délivrance des visas à droit constant. Dans un objectif d'attractivité, les postes consulaires doivent désormais identifier des « publics cibles » prioritaires en matière de délivrance des visas - entrepreneurs, artistes, étudiants, saisonniers - et prévoir un allègement des procédures de délivrance pour ces demandeurs. Cette approche apparaît cohérente avec la dimension migratoire de la délivrance des visas, les publics cibles présentant un risque plus faible de fraude.
Cette démarche nous paraît être la bonne et permet de s'adresser prioritairement à des publics qui contribueront au rayonnement de la France. Il convient cependant de continuer à mettre en oeuvre le rapport Hermelin. Je pense tout particulièrement aux étudiants étrangers, qui font l'objet d'une procédure dérogatoire avec une sélection sur la plateforme Études en France et une évaluation du sérieux du projet académique par les espaces Campus France. Nous avons tous les outils nécessaires pour sélectionner les étudiants les plus prometteurs et répondant à nos besoins, davantage que les autres pays européens. Il faut donc renforcer cette démarche.
Pour répondre à ces grands enjeux, nous avons formulé dix recommandations.
Nous tirons de ce contrôle l'impression que l'instruction des demandes de visa ne présente plus de difficultés majeures, comme celles qui avaient émergé après la crise sanitaire. La problématique principale pour les services consulaires sera donc, dans la durée, de transformer l'essai de la modernisation de l'instruction dans un contexte où l'augmentation de la demande se pérennise, de même que les risques de fraude.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. -Il y a quelques années, au moment de la crise sanitaire, nous avions souligné l'existence d'un certain nombre de carences. Certes, des difficultés d'organisation demeurent, mais le système fonctionne beaucoup mieux qu'auparavant et son financement est maîtrisé.
S'agissant de la double tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères, quelle serait votre préférence dans l'optique d'une éventuelle simplification ?
Nos rapports d'information consistent souvent à pointer des carences. En l'occurrence, celui-ci montre surtout que nous avons eu raison de nous emparer du sujet et il souligne que les pouvoirs publics et les opérateurs privés sont parvenus à maîtriser les coûts d'un système rendu désormais plus satisfaisant, car il fonctionne dans des délais plus courts.
M. Albéric de Montgolfier. - Disposons-nous d'éléments de comparaison avec les autres pays de l'espace Schengen sur le coût des visas ainsi que sur leur fiabilisation ? Comment les Allemands ou les Italiens procèdent-ils en la matière ? Notre administration apparaît parfois très en retard par rapport à d'autres secteurs : par exemple, certaines applications bancaires semblent plus sécurisées que les visas. Qu'en est-il ?
M. Michel Canévet. - Les recommandations nos 3 et 4 mentionnent l'interconnexion de France-Visas avec les systèmes d'information pertinents et le retour d'information aux postes diplomatiques sur le suivi des décisions de délivrance de visas. Existe-t-il des fichiers informant, d'une part, de l'existence éventuelle de demandes antérieures qui auraient été traitées et, d'autre part, de décisions de justice qui auraient pu être prises en France à l'encontre de certains ressortissants ? Le système qui fonctionne aujourd'hui est-il fiable et opérationnel, ou bien tout cela reste-t-il à construire, ce qui rendrait la tâche des instructeurs plus difficile ?
De plus, le dispositif est autofinancé, puisqu'il générerait plus de 260 millions d'euros de recettes pour un peu moins de 70 millions d'euros de dépenses. Dans ce contexte, au regard de ce que font les autres pays autour de nous, est-il envisageable d'augmenter encore légèrement le coût des visas ?
M. Thierry Cozic. - Ma question porte sur le deuxième point que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'activité autofinancée par la perception des droits de visa. Un point me paraît quelque peu baroque, à savoir l'affectation de produits, dans la limite de 0,75 % des recettes de l'année précédente, au profit du ministère des affaires étrangères. D'un point de vue budgétaire, est-il opportun de maintenir cette affectation ou ne faudrait-il pas plutôt la supprimer ?
M. Marc Laménie. - Pourriez-vous nous donner davantage d'informations sur le cheminement des dossiers et sur les délais d'instruction ? La procédure implique de fournir un certain nombre de justificatifs et semble très complexe. Quelle est la durée moyenne pour l'instruction d'une demande de visa ?
L'administration préfectorale joue aussi un rôle dans la délivrance des visas. Comment opère le lien entre les différents acteurs ?
M. Arnaud Bazin. - Vous avez mentionné les prestataires de service extérieurs, qui constituent la première étape du parcours du demandeur de visa. Or, dans certains pays, leur efficacité et leur niveau de fiabilité d'un point de vue éthique sont mis en cause. Avez-vous des préconisations complémentaires à formuler sur ces prestations ? Quel en est le coût, puisqu'il s'ajoute, si j'ai bien compris, aux 90 euros que coûte le visa ? Quel est, selon vous, l'avenir de ces prestations, même si nous avons bien compris qu'elles présentent l'avantage de soustraire une partie de la dépense du budget national ?
M. Pierre Barros. - Lors d'un récent déplacement en Palestine et à Jérusalem, nous avons été reçus de manière très professionnelle par les services du consulat de Jérusalem et, de manière plus large, je tiens à saluer le travail remarquable qu'accomplissent les consulats. Ils incarnent la présence de la France dans l'ensemble des pays et leurs agents, qui ont un parcours souvent brillant, déploient des compétences qui font honneur à l'action de la France à l'international.
Comme Arnaud Bazin, j'ai eu vent de certaines interrogations portant sur les prestataires extérieurs qui travaillent avec les consulats sur la délivrance des visas. Que ce soit en matière de coût ou de fonctionnement, leur contrôle doit être revu : comment ces opérateurs sont-ils évalués et comment rendent-ils compte de leur action ? En effet, il existe des pratiques frauduleuses : les demandeurs qui disposent de moyens importants semblent obtenir plus facilement leurs documents que ceux qui en ont un peu moins. Certes, le phénomène n'est pas généralisé, mais la tendance peut être inquiétante et ne donne pas une très bonne image de notre administration.
M. Pascal Savoldelli, président. - Que signifie exactement la recommandation n° 9 : « adapter la procédure de sélection des candidats à l'enseignement supérieur en France pour faire coïncider les délais de délivrance des visas étudiants avec les résultats d'admission sur la plateforme Études en France » ? Le sujet mérite réflexion et a fait l'objet de débats dans l'hémicycle. Selon vous, quel type d'adaptation de la procédure convient-il d'envisager ?
Mme Nathalie Goulet, rapporteur spécial. - Pour ce qui est de l'adaptation de la procédure de sélection, il existe un décalage de temps qui a pour conséquence que des étudiants admis n'obtiennent pas leur visa à temps pour la rentrée. Il faudrait donc prévoir, dans le cadre de cette procédure numérisée et déléguée, un ciblage particulier pour les étudiants, de façon à ce que leur visa arrive au moment du début de l'année scolaire et non après.
Ces étudiants représentent pour nos universités une cible d'attractivité particulière et le sujet est revenu à plusieurs reprises au cours des auditions. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'il fasse l'objet de l'une de nos préconisations. Nous souhaitons en effet qu'il soit pris en compte dans le cadre de futurs contrôles ou discussions budgétaires portant sur l'enseignement supérieur.
Quant à la double tutelle, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé sans parvenir à une solution idéale. Chacun des deux ministères tient absolument à sa tutelle et nous n'avons pas trouvé la martingale. Les services communiquent et échangent. Pour l'instant, c'est le statu quo.
M. Rémi Féraud, rapporteur spécial. - Nous avons comparé notre système avec ceux des autres pays européens au Maroc. Il est clairement apparu que les procédures françaises étaient meilleures. Tous les pays européens qui délivrent un grand nombre de visas font appel à des prestataires extérieurs. La question du contrôle de ces opérateurs me paraît en effet importante, car leurs pratiques sont souvent critiquées. Au Maroc, j'ai constaté que la société TLScontact avec laquelle travaillent nos services, tout comme ceux de la Belgique et de l'Allemagne, était soumise à un contrôle de grande qualité de la part des autorités consulaires françaises, beaucoup plus important que celui qui est exercé par les autres pays.
En tout état de cause, il ne serait pas possible de réinternaliser ce service, car les demandes de visa sont trop nombreuses de sorte qu'il faudrait des centaines, voire des milliers, de fonctionnaires et d'agents publics supplémentaires. Tout l'enjeu est donc dans le contrôle.
L'Espagne, me semble-t-il, lance un appel d'offres unique pour le monde entier, si bien qu'elle dépend d'un seul prestataire pour tous les pays, rendant impossible la comparaison entre opérateurs. Je crois que ce n'est pas un modèle à suivre et la France privilégie une sélection par pays ou par lot. La relation avec les prestataires est essentielle et il faut que la durée des contrats représente un équilibre entre un nécessaire renouvellement et l'importance pour les prestataires d'amortir un certain nombre d'investissements, notamment pour la création des centres d'accueil.
Pour les personnes qui demandent un visa, le recours à un prestataire extérieur représente un coût supplémentaire qui vient s'ajouter à celui des 90 euros pour la demande de visa. Le coût de 90 euros vaut pour tous les pays de l'espace Schengen, mais il faut y ajouter 45 euros, a minima, à payer aux prestataires qui proposent souvent un service « premium » en plus du service de base.
Encore une fois, l'enjeu est surtout que les services consulaires puissent contrôler les prestataires. Lors de notre déplacement au Maroc, nous avons pu constater qu'ils exerçaient ces prérogatives et avaient mis en place des procédures efficaces.
Monsieur Laménie, concernant le rôle des préfectures, il me semble que votre question porte sur les titres de séjour en France. Ce qui est certain, et nous l'avons vu par exemple sur la question des saisonniers, c'est que l'attribution de visas nécessite une relation entre les consulats, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et les préfectures. De l'avis général, la suppression des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) n'a pas aidé dans l'exercice du contrôle de la réalité du travail saisonnier, du sérieux des employeurs, etc. Pour les médecins étrangers dont parlait Nathalie Goulet, il est vrai qu'il serait intéressant de prévoir un contrôle budgétaire commun, notamment avec la mission « Administration générale et territoriale de l'État » dont Florence Blatrix Contat est rapporteure. Pour l'instant, il nous semble qu'il n'y a pas de procédure efficace en place.
La perception des droits de visa, à hauteur de 0,75 % des recettes de l'année précédente, par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères correspond à une incitation mise en place il y a une dizaine d'années, sur l'initiative de Laurent Fabius, pour développer le tourisme en France. C'est tout de même du bricolage budgétaire. Toutefois, nous n'avons pas proposé de supprimer ce dispositif parce que, dans la période actuelle, cette part de 0,75 %, qui ne représente que 2 millions d'euros, permet d'embaucher des vacataires, ce qui évite que les délais ne s'allongent pour l'attribution des visas alors que les demandes sont très nombreuses. En outre, la suppression de ce dispositif aurait pu être interprétée comme une volonté de mettre les visas uniquement sous la tutelle du ministère de l'intérieur.
Sur ce sujet, monsieur le rapporteur général, il est illusoire de croire que le ministère de l'intérieur ne se mêlera plus de la question des visas compte tenu des risques migratoires ou des questions de sécurité. À l'inverse, enlever la cotutelle des affaires étrangères reviendrait à supprimer toute vision en matière d'attractivité et à réduire les enjeux à ceux qui préoccupent le ministre de l'intérieur. Ce n'est vraiment pas ce que je recommanderais.
Quant aux échanges avec les plateformes d'autres pays européens, ils existent, notamment dans le cadre de Schengen, avant l'attribution des visas. Toutefois, ce type d'échanges reste encore embryonnaire. À la suite de l'adoption du pacte « Asile et immigration », une plateforme dédiée est en cours d'élaboration à l'échelon européen. La France ne bloque pas sa mise en oeuvre mais a proposé de repousser l'intégration de France visas à 2035.
Pour ce qui est des échanges avec d'autres plateformes nationales, nos recommandations visent à ce que les agents consulaires aient davantage d'informations sur les demandeurs et à ce que celles-ci soient plus précises dès lors qu'apparaît la mention d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). L'OQTF ne doit pas être inutilement bloquante et, pour cela, il faut savoir si le demandeur a déjà fait d'autres demandes dans des pays de l'espace Schengen, s'il a été poursuivi ou s'il a respecté les délais de son précédent visa. Aujourd'hui, ces informations ne sont pas disponibles et des progrès sont possibles.
Mme Nathalie Goulet, rapporteur spécial. - Concernant les cas de fraude, il est clair que des situations de corruption existent, qui relèvent des différents services d'inspection. Le service « premium » sert parfois à déguiser d'une élégante façon un service davantage rémunéré pour accélérer le traitement du dossier. Il existe aussi, dans un certain nombre de pays, d'autres procédures très dérogatoires voire frauduleuses pour obtenir un rendez-vous plus vite. Ces situations doivent être réglées au cas par cas.
Pour ce qui est de l'interconnexion d'un certain nombre de fichiers, la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic prévoit d'intégrer les services consulaires dans les échanges d'informations qui ont lieu dans le cadre d'un certain nombre de dispositifs, comblant ainsi un manque important. Cela pourrait d'ailleurs aussi servir aux services de la sécurité sociale. Par exemple, lorsqu'une personne demande un visa pour venir en France, elle doit apporter la preuve de sa capacité contributive, notamment du fait qu'elle bénéficie d'une assurance pour être soignée. Mais, une fois sur le territoire national, cette personne peut solliciter des aides sans que les organismes de sécurité sociale se renseignent auprès des services consulaires pour vérifier qu'elle n'a pas de moyens. La communication doit donc mieux se faire pour éviter ce type de fraude.
Les auditions ont également fait apparaître des situations problématiques où un précédent refus de visa n'avait pas été indiqué. Il y a donc des progrès à faire.
Toutefois, comme l'a dit le rapporteur général, le système fonctionne beaucoup mieux qu'auparavant. L'an dernier, notre rapport d'information Le centre de crise et de soutien : un service exceptionnel au financement hors normes a déjà montré que le fonctionnement de nos dispositifs était en nette amélioration par rapport à ceux de nos voisins. Nous n'avons pas à rougir du service de nos diplomates, qui font un travail remarquable dans des conditions qui sont parfois difficiles.
M. Pascal Savoldelli, président. - Je remercie nos deux rapporteurs spéciaux. Nous avons pris note de leur demande concernant l'exercice d'un contrôle budgétaire sur les médecins étrangers. Elle pourra être examinée par le bureau de notre commission lors de l'établissement de notre programme de contrôle.
La commission a adopté les recommandations des rapporteurs spéciaux et autorisé la publication de leurs communications sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- M. Cyrille BAUMGARTNER, ambassadeur chargé des migrations ;
- M. Jean-François SALIBA, adjoint de l'ambassadeur.
Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire
- Mme Pauline CARMONA, directrice ;
- Mme Minh-Di TANG, cheffe de la mission de gestion administrative et financière ;
- Mme Marianne BARKAN-COWDY, sous-directrice de la politique des visas ;
- Mme Nathalie LEMAIRE, chargée de mission à la sous-direction de la politique des visas ;
- M. Thierry GALAIS, chef de bureau à la sous-direction de la politique des visas.
Direction des affaires financières du ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- M. Alexandre MOROIS, directeur ;
- Mme Laurence BERNARDI, sous-directrice de la stratégie et de la synthèse budgétaires ;
- Mme Pascale GAY-GRESSIN, chef du bureau de la synthèse budgétaire ;
- M. Matthieu GERYEZ, adjoint à la chef du bureau de la synthèse budgétaire ;
- Mme Yasmine SIDLOCH, chargée de programmes ;
- M. Paul BAROUH, chargé de programmes.
Ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - 7ème sous-direction Budgets de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, des affaires rurales, de l'aide publique au développement, de l'action extérieure de l'État, de l'immigration, de l'asile et de l'intégration
- M. Louis PASQUIER DE FRANCLIEU, sous-directeur ;
- M. Thomas CALTAGIRONE, chef du bureau des affaires étrangères et de l'aide au développement.
Ministère de l'Intérieur - Direction de l'immigration
- M. Jérôme GUERREAU, directeur adjoint ;
- Mme Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, adjointe à la sous-directrice des visas.
Capgemini
- M. Paul HERMELIN, président du conseil d'administration.
Campus France
- Mme Donatienne HISSARD, directrice générale ;
- Mme Roxane LUNDY, chargée de mission auprès de la direction générale.
Business France
- M. Benoit TRIVULCE, directeur général par intérim ;
- Mme Sandrine COQUELARD, directrice de département à la direction Invest de Business France.
Capago International
- M. Laurent MALLET, président directeur général.
TLS Contact
- M. Olivier RIGAUDY, directeur général adjoint du groupe Teleperformance et président du groupe TLScontact ;
- M. Antoine RAULT, directeur commercial.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Déplacement au Maroc (2 au 5 septembre 2025)
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- M. Cyrille BAUMGARTNER, ambassadeur chargé des migrations ;
- M. Jean-François SALIBA, adjoint de l'ambassadeur.
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Ambassade de France au Maroc
- M. Christophe LECOURTIER, Ambassadeur de France au Maroc ;
- M. Guillaume MARCENY, directeur de l'Espace Campus France à Rabat.
Consulat général de France à Rabat
- M. Olivier RAMADOUR, consul général de France à Rabat ;
- M. Fabien KOPP, chef du service des visas ;
- M. Cédric GUILLAUD, adjoint au chef de service.
Consulat général de France à Casablanca
- M. Aymeric CHUZEVILLE, consul général de France à Casablanca ;
- Mme Nathalie SOIRAT, consule générale adjointe ;
- Mme Elisabeth MARTINET, cheffe adjointe du service.
Office français de l'immigration et de l'intégration
- M. Ahmed CHTAIBAT, directeur de la représentation de l'OFII au Maroc.
Chambre des conseillers du Royaume du Maroc
- M. Mohamed ZIDOUH, président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des conseillers.
Consulat général d'Espagne à Rabat
- M. Alfonso BARNUEVO, consul général d'Espagne à Rabat.
Société TLS Contact
- M. Antoine RAULT, directeur des activités Schengen ;
- M. Bassem MISSAOUI, directeur régional Afrique du Nord-Afrique de l'Ouest ;
- Mme Souhir CHERKAOUI, directrice régionale zone Nord du Maroc.
ANNEXE
TABLEAU DE SUIVI DU RAPPORT DE PROPOSITIONS
POUR UNE AMÉLIORATION DE LA DÉLIVRANCE
DES VISAS, DIT
« RAPPORT HERMELIN »
|
Intitulé de la recommandation |
État d'avancement |
|
1. Acter une liste exhaustive des publics cibles et l'adapter dans les postes en catégories simples et lisibles |
Réalisée et suivi à poursuivre |
|
2. Produire une instruction sur la politique d'attractivité et l'intégrer dans l'instruction générale sur les visas (IGV) |
Réalisée |
|
3. Promouvoir la politique d'attractivité auprès des décideurs de l'administration |
En cours de réalisation |
|
4. Désigner référent ministériel l'ambassadeur chargé des migrations rebaptisé « ambassadeur chargé des migrations et de l'attractivité » |
Non retenue |
|
5. Désigner un référent « migrations & attractivité » et instaurer un comité migrations et attractivité dans chaque poste diplomatique |
Réalisée |
|
6. Fixer des objectifs généraux et locaux concernant le traitement des publics prioritaires et gérer en conséquence les agents des services consulaires |
Réalisée et suivi à poursuivre |
|
7. Généraliser les visas de circulation pour les publics cibles (immédiat) |
Réalisée |
|
8. Etendre au maximum la durée de validité des visas de circulation - supprimer l'application de la cascade pour les publics cibles (juillet 2023) |
Réalisée |
|
9. Attribuer un visa de circulation à tous les Alumni détenteurs d'un diplôme français de niveau master ou plus et faciliter en conséquence leur traitement |
Réalisée |
|
10. En faire l'annonce et lancer une campagne de communication lors des `France Alumni Days' (mai 2023) |
Non retenue |
|
11. Systématiser l'attribution d'un VLS-TS d'une durée d'un an au Passeport-Talent |
En cours de réalisation |
|
12. Simplifier les catégories de Passeport-Talent en 5 profils maximum |
Non réalisée |
|
13. Elargir le vivier des potentiels Passeports-Talents en assouplissant les conditions de ressources pour les débuts de carrière |
En cours de réalisation |
|
14. Développer l'information et l'orientation accessibles gratuitement à tous (dont les critères d'éligibilité) et généraliser l'auto-évaluation par l'étudiant de son projet d'études |
En cours de réalisation |
|
15. Faire de la procédure Etudes en France la voie unique d'admission pour les étudiants étrangers (rentrée 2024/2025) |
En cours de réalisation |
|
16. Accroître le rôle des Espaces Campus France dans l'évaluation des demandes de visa pour études |
Réalisée |
|
17. Charger les Espaces Campus France de gérer directement les rendez-vous de dépôt des demandes de visa pour études auprès des prestataires de services externalisés (PSE) |
En cours de réalisation |
|
18. Désigner des « référents métiers » comme porte d'entrée aux rendez-vous pour les publics prioritaires |
En cours de réalisation |
|
19. Attribuer des rendez-vous prioritaires aux demandeurs de visas long séjour « passeport talent » |
Réalisée |
|
20. Signaler les dossiers des publics cibles et les faire traiter de façon prioritaire par une équipe identifiée et formée (instructeurs et agents de droit local) |
Réalisée |
|
21. Réserver les décisions négatives à un responsable (chef du service des visas ou consul adjoint) |
Réalisée |
|
22. Développer de façon volontariste les conventions avec des partenaires de confiance en vérifiant régulièrement leur fiabilité |
Réalisée |
|
23. Alléger l'instruction des dossiers sur la base d'une présomption de solvabilité et d'absence de risque migratoire pour les demandeurs présentés par les partenaires de confiance ou par les services de l'Etat |
Réalisée |
|
24. Donner aux prestataires de services externalisés la possibilité, sous le contrôle du consulat, de signaler un dossier à la suite de l'entretien avec le demandeur |
Réalisée |
|
25. Assumer publiquement la posture de sélectivité |
En cours de réalisation |
|
26. Encourager et outiller les ambassadeurs et les consuls généraux pour une communication externe dynamique, pro-active et pédagogique |
En cours de réalisation |
|
27. Homogénéiser les informations sur les sites consulaires, les sites des prestataires et France-Visas |
Réalisée |
|
28. Assurer la viabilité des services de visas par la détermination d'une configuration minimale |
En cours de réalisation |
|
29. Procéder au regroupement des services de visas à l'échelle des pays (été 2025) et étudier les conditions de regroupements complémentaires par sous-région |
En cours de réalisation |
|
30. Constituer un dispositif central pour traiter les demandes d'asile et assurer ponctuellement l'appui des services de visas à l'étranger |
Réalisée |
|
31. Mettre l'utilisateur au centre des réflexions pour améliorer la productivité - Organiser une communication bidirectionnelle entre l'équipe France-Visas et les services consulaires |
Réalisée et suivi à poursuivre |
|
32. Prioriser dans la feuille de route du programme France-Visas : 1/ la dématérialisation de l'ensemble des demandes de visa - 2/ l'interfaçage de France-Visas avec EES - 3/ l'interfaçage de France-Visas avec l'ANEF |
En cours de réalisation |
|
33. Prioriser le développement d'une interface entre France-Visas et les systèmes d'information des prestataires de services externalisés et expérimenter un dispositif automatique d'attribution des rendez-vous aux demandeurs par les PSE |
En cours de réalisation, avec des difficultés |
|
34. Mettre en place un indicateur précis de suivi des délais d'attribution des rendez-vous auprès des prestataires de services externalisés |
En cours de réalisation |
|
35. Expérimenter un algorithme de pré-sélection des dossiers de demande de visa |
En cours de réalisation, avec des difficultés |
|
36. Créer un module « attractivité » dans les cycles de formation aux visas des agents praticiens et dans les programmes de séminaire des cadres ; développer les formations de formateurs, le tutorat et les réseaux d'échanges entre praticiens |
Réalisée |
|
37. Reconstituer les effectifs d'agents instructeurs dans les postes, en priorité dans les pays cibles en termes d'attractivité |
Non réalisée |
|
38. Etudier la possibilité juridique de confier à des recrutés locaux l'instruction de dossiers simples |
Réalisée |
|
39. Affecter une part supérieure de l'attribution de produit des visas aux services consulaires et créer un mécanisme incitatif d'intéressement en corrélant l'augmentation de cette proportion à l'augmentation des recettes visas |
Réalisée en 2024 Non réalisée, à ce stade, en 2025 |
|
40. Réfléchir, pour les petits services visas, à une mutualisation des services des visas avec d'autres pays de l'espace Schengen, au-delà des accords de représentation existants |
Non retenue |
Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Envisager, pour les postes où la demande de visa est faible, une mutualisation des services des visas avec nos partenaires Schengen. |
Direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires (DFAE) |
2027 |
Négociations bilatérales avec nos partenaires Schengen |
|
2 |
Poursuivre la démarche de regroupement de l'instruction des visas pour atteindre un seuil critique d'effectifs et de moyens par poste et envisager, pour les plus petits postes, un regroupement régional de l'instruction des visas. |
DFAE |
2026 |
Toutes mesures nécessaires |
|
3 |
Poursuivre l'interconnexion de France visas avec les systèmes d'information pertinents, en priorité ceux liés à l'administration des étrangers en France. |
DFAE, direction de l'immigration (Dimm) |
Dès que possible |
Toutes mesures nécessaires |
|
4 |
Permettre un retour d'information aux postes diplomatiques sur le suivi des décisions de délivrance de visas, pour améliorer leurs procédures d'instruction et de lutte contre la fraude. |
DFAE, Dimm |
2026 |
Instruction interministérielle |
|
5 |
Anticiper les conséquences de la mise en oeuvre de la plateforme EU VAP en préparant la formation des agents à ce nouvel outil, en révisant l'organisation des services consulaires et en prévoyant une évolution des missions confiées aux prestataires de services extérieurs. |
DFAE, Dimm |
Dès que possible |
Toutes mesures nécessaires |
|
6 |
Généraliser l'attribution automatique des plages de rendez-vous pour limiter les possibilités de détournement de la procédure par les officines. |
DFAE, consulats |
2026 |
Instruction aux consulats |
|
7 |
Regrouper le suivi et le paiement des frais de justice et intérêts moratoires liés au contentieux des visas au sein du ministère de l'intérieur. |
DFAE, ministère de l'intérieur |
2026 |
Projet de loi de finances pour 2027 |
|
8 |
Accélérer la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin s'agissant de l'identification des publics cibles et de l'adaptation des procédures d'instruction et opérer un suivi de cette démarche. |
DFAE, Dimm |
2026 |
Toutes mesures nécessaires |
|
9 |
Adapter la procédure de sélection des candidats à l'enseignement supérieur en France pour faire coïncider les délais de délivrance des visas étudiants avec les résultats d'admission sur la plateforme « Études en France ». |
Ministère de lEurope et des affaires étrangères, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'intérieur, universités |
Rentrée universitaire 2026 |
Toutes mesures nécessaires |
|
10 |
Renforcer la communication sur la délivrance des visas, en harmonisant les informations diffusées par les services consulaires et en adoptant une posture transparente sur la sélectivité des procédures. |
DFAE, direction de la communication et de la presse |
2026 |
Instruction aux postes diplomatiques et consulaires |
* 1 Emmanuel Aubin, « L'européanisation de la politique des visas : les nouvelles frontières du droit des étrangers », RFDA, 2017, p. 914.
* 2 Article L. 311-2 du Ceseda.
* 3 Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), entré en vigueur le 5 avril 2010 et modifié par le règlement UE 2019/1155 du 20 juin 2019.
* 4 L'Irlande, non membre de l'espace Schengen, et Chypre où les contrôles aux frontières intérieures n'ont pas encore été levés, délivrent uniquement des visas nationaux.
* 5 Tourisme, études, concours, visites familiales ou privées, ascendant d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, voyages d'affaires, activité professionnelle en France, soins médicaux.
* 6 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
* 7 Hong Kong et Macao.
* 8 Par principe, tout « étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an » (art. L. 312-2 du Ceseda).
* 9 Circulaire du Premier ministre n° 6239/SG du 29 décembre 2020 relative à la fermeture des frontières extérieures.
* 10 Conseil d'État, juge des référés, 21 janvier 2021, n° 447878.
* 11 Pour les trois pays du Maghreb, les taux de refus sont de 34,8 % pour l'Algérie, de 21,2 % pour la Tunisie et de 12,5 % pour le Maroc.
* 12 Atout France, « Une année 2024 record pour le tourisme français grâce à la croissance des recettes internationales et à la solidité du marché domestique qui dessine un horizon prometteur pour 2025 », communiqué de presse, 21 janvier 2025.
* 13 Rapport d'information n° 127 (2015-2016) fait par Éric Doligé et Richard Yung, au nom de la commission des finances, sur la délivrance des visas, 29 octobre 2015.
* 14 Par exemple, la presse s'est récemment faite l'écho du renforcement des contrôles de sécurité dans l'instruction des demandes de visas déposées par des ressortissants russes. Voir Le Monde, « La France refuse en masse des demandes de visa venant de Russie, craignant l'infiltration d'espions », Jacques Follorou, publié le 25 avril 2025, consulté le 22 juillet 2025.
* 15 Et le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
* 16 Réponses de la DFAE au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 17 Conseil d'État, 9/8 SSR, 17 février 1997, n° 150242.
* 18 Ibid.
* 19 Quatre thématiques prioritaires structurent les travaux du CSM : le dialogue et les partenariats avec les pays tiers prioritaires, la politique des visas, l'attractivité et les migrations légales et les programmes de coopération migratoire au sein de l'aide publique au développement.
* 20 M. Cyrille Baumgartner occupe les fonctions d'ambassadeur chargé des migrations depuis le 13 novembre 2024, après MM. Pascal Teixeira et Christophe Léonzi.
* 21 Le retour à la normale faisant suite à la détente franco-marocaine a conduit à un retour aux pratiques antérieures.
* 22 Réponses de la direction de l'immigration au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 23 D'une valeur de 60 euros pour le tarif plein et de 45 euros pour le tarif réduit.
* 24 Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
* 25 Les catégories de visas aux États-Unis sont distinguées en fonction du motif et non de la durée.
* 26 Le développement de ces applications est cependant éligible aux instruments européens de financement. Le montant des crédits octroyés au ministère de l'intérieur au titre de l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et la politique des visas s'élevait à 6,3 millions d'euros sur 2022-2023.
* 27 Réponses de la DFAE au questionnaire complémentaire des rapporteurs spéciaux.
* 28 Pour mémoire, le Président de la République avait annoncé en mars 2023 la création de 700 ETP d'ici 2027 au sein du MEAE. Cet effort correspondait à la création de 800 ETP sur la durée de la législature (100 ETP étaient déjà inscrits dans la Loi de finances de 2023), mais a été revu à la baisse compte tenu de la dégradation des comptes publics au cours des exercices 2024 et 2025.
* 29 Soit 50 % des effectifs nouvellement ouverts sur le programme 151 au titre de la loi de finances initiale pour 2024, qui avait créé un total de 165 ETP sur la mission AEE.
* 30 Paul Hermelin, rapport à l'attention du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, « Propositions pour une amélioration de la délivrance des visas », avril 2023.
* 31 Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
* 32 Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2020, n° 18200838/6-3, Union syndicale des agents de corps de chancellerie des affaires étrangères.
* 33 Réponses de la DFAE au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 34 « Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'État peuvent, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné. »
* 35 Cette attribution de produits a été supprimée en 2023 pour être remplacée par des crédits budgétaires dans le cadre du plan Destination France entre 2022 et 2025.
* 36 Paul Hermelin, rapport à l'attention du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, « Propositions pour une amélioration de la délivrance des visas », avril 2023.
* 37 Programme France - IGFV4.
* 38 Les postes concernés sont : Addis-Abeba, Luanda, Islamabad, Ndjamena, Port-aux-princes, Nouakchott, Skopje et Tachkent.
* 39 Compte tenu du nombre limité de prestataires potentiels, la concurrence sur ce marché demeure relative.
* 40 Rapport d'information n° 127 (2015-2016) fait par MM. Éric Doligé et Richard Yung, au nom de la commission des finances, sur la délivrance des visas, 29 octobre 2015.
* 41 Cour des comptes, Rapport public annuel 2017, « L'externalisation du traitement des demandes de visa à l'étranger : une réforme réussie, un succès à conforter », février 2017.
* 42 Idem.
* 43 Ce délai ne concerne toutefois que les demandes de visas qui reçoivent une réponse positive.
* 44 Par comparaison, pour l'année 2025, 20 missions de renfort ont d'ores et déjà été effectuées.
* 45 Point 1 de l'article 40 du code communautaire des visas.
* 46 Point 2 de l'article 40 du code communautaire des visas.
* 47 Par le règlement UE 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas.
* 48 Rapport d'information n° 127 (Sénat, 2015-2016) fait par Éric Doligé et Richard Yung, au nom de la commission des finances, sur la délivrance des visas, 29 octobre 2015.
* 49 Recommandation n° 40 du rapport de M. Paul Hermelin à l'attention du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, « Propositions pour une amélioration de la délivrance des visas », avril 2023.
* 50 À noter que, jusqu'en 2023 et la dénonciation d'accords de représentation, la France assurait également la représentation de huit États africains pour la délivrance des visas de court séjour (Burkina Faso, République Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Mauritanie, Sénégal et Togo).
* 51 Point 1 de l'article 8 du code communautaire des visas.
* 52 Entretien avec M. Alfonso Barnuevo, consul général d'Espagne à Rabat, 3 septembre 2025.
* 53 Soit six centres ouverts dans les villes où siègent les consulats généraux à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir, Fès, ainsi qu'un centre délocalisé à Oujda, actuellement rattaché au consulat général à Fès.
* 54 Actuellement, le centre le plus proche de TLS se situait à Agadir, à plusieurs centaines de kilomètres du Sahara occidental.
* 55 Sur la base d'une liste préalablement validée par le cabinet du ministre.
* 56 Français, anglais, espagnol, chinois, arabe et russe.
* 57 Paul Hermelin, rapport à l'attention du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, « Propositions pour une amélioration de la délivrance des visas », avril 2023, page 29.
* 58 Réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en date du 29 août 2023, à la question écrite n° 8533 du député Karim Ben Cheikh sur la délivrance des visas, du 6 juin 2023.
* 59 Réponses de la DFAE au questionnaire d'audition des rapporteurs spéciaux.
* 60 AGDREF, dont la consultation est obligatoire pour toute les demandes de visa de long séjour.
* 61 Avec, pour les États le souhaitant, une période transitoire jusqu'en 2035.
* 62 Pour la France, un espace sécurisé pour les demandeurs, un espace pour les PSE, un espace pour les visas de long séjour, et un module pour les visas outre-mer et les cas dérogatoires.
* 63 Cour des comptes, La conduite des grands projets numériques de l'État, communication à la commission des finances du Sénat, juillet 2020.
* 64 Les pratiques de fraude auxquelles participent les agents des prestataires de services extérieurs sont considérées comme relevant de la fraude externe.
* 65 Quatre en Afrique, trois en Asie, deux en Amérique, un au Moyen-Orient et un en Europe.
* 66 Soit les bulletins de salaire, relevés bancaires, actes d'état-civil, attestation de travail, diplômes, ou acte de mariage avec un conjoint français, etc.
* 67 Réponses de la direction de l'immigration au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 68 42 cellules ont été créées dans 34 pays.
* 69 Pour présenter un document émis par un État auprès d'autorités étrangères, l'authentification préalable de la signature de l'autorité ayant délivré le document peut être exigée. La légalisation est la procédure d'authentification préalable de la signature de l'autorité ayant délivré le document.
* 70 Auparavant, le contrôle était assuré par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS).
* 71 Audition de la direction de l'immigration par les rapporteurs spéciaux.
* 72 Vincent Tchen, JurisClasseur administratif, Fasc. 233-54 : ÉTRANGERS. - Entrée en France. - Régime général, Lexis360, publié le 25 juillet 2024, dernière mise à jour au 1er avril 2025.
* 73 Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives.
* 74 Le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, d'une part, et le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France.
* 75 Le sous-directeur des visas de la DGEF est également compétent pour les recours administratifs contre les refus de délivrance d'autorisations de voyage.
* 76 Conseil d'État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l'intérêt de tous », étude à la demande du Premier ministre, octobre 2020.
* 77 Tribunal administratif de Nantes, Bilan annuel 2024, 3 avril 2025.
* 78 Pour le reste, il s'agit essentiellement de situations dans lesquelles le juge administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les recours, le visa demandé ayant d'ores et déjà été délivré ou d'autres demandes ayant été déposées.
* 79 L'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 15 mai 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a fait passer de dix à douze le nombre de chambres au tribunal de Nantes tandis que l'arrêté du 25 février 2025 a porté ce nombre à treize.
* 80 Annexe n° 1 faite par Mme Nathalie Goulet et M. Rémi Féraud, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Action extérieure de l'État », au rapport général n° 144 (2024-2025) fait par M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale, pour 2025.
* 81 Cour des comptes, Analyse de l'exécution budgétaire 2024, Mission Action extérieure de l'État, avril 2025, page 28.
* 82 Et la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
* 83 IMD, « World Talent Ranking 2024 », 2024.
* 84 Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « Feuille de route de l'influence », décembre 2021.
* 85 Certaines nuances ont toutefois été perçues par les rapporteurs spéciaux au cours des auditions. Plusieurs auditionnés ont laissé entendre que le rapport de la mission Hermelin mettait un accent sur l'attractivité, au détriment des enjeux sécuritaires et migratoires.
* 86 Instruction NDI-2023-0467637 du 16 novembre 2023.
* 87 Instruction précitée.
* 88 Rapport d'information n° 304 (2024-2025) fait par Mme Muriel Jourda et M. Olivier Bitz au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire.
* 89 Parmi ces trois recommandations, deux pourraient être qualifiées de faible portée. La troisième, plus significative, concernait le principe d'une mutualisation des services consulaires avec nos partenaires Schengen.
* 90 Selon les éléments transmis par l'Ambassadeur chargé des migrations.
* 91 Qui ne dépendent pas de l'opérateur Campus France.
* 92 Audition de Campus France, 2 juin 2025.
* 93 Cour des comptes, « Une évaluation de l'attractivité de l'enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux », rapport public thématique, mars 2025.
* 94 Au 30 avril pour la rentrée 2023-2024.
* 95 Cour des comptes, « Une évaluation de l'attractivité de l'enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux », rapport public thématique, mars 2025.
* 96 Réponses de l'Ambassadeur des migrations au questionnaire des rapporteurs spéciaux.
* 97 Cour des comptes, « La politique de lutte contre l'immigration irrégulière », rapport public thématique, janvier 2024.
* 98 Introduit par le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
* 99 Paragraphe 5 de l'article 25 bis du CCV.
* 100 Rapport d'information n° 3728 (XVe législature) de M. M'Jid El Guerrab et Mme Sira Sylla, au nom de la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission flash constituée le 8 janvier 2020, sur la politique des visas, le 12 janvier 2021.