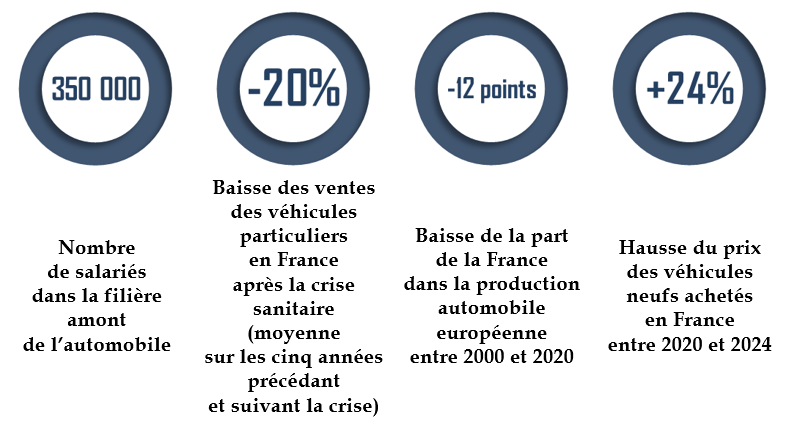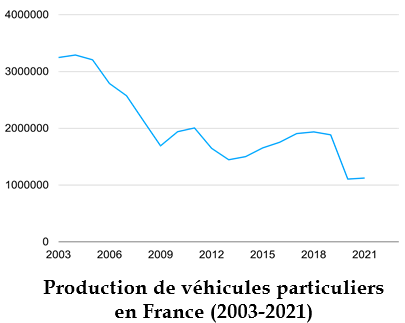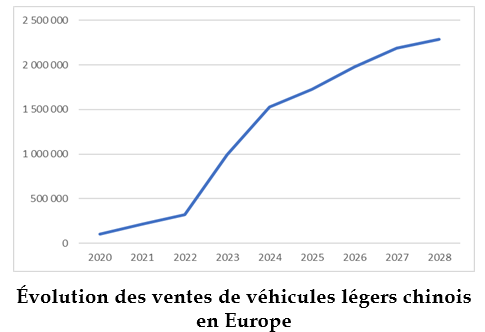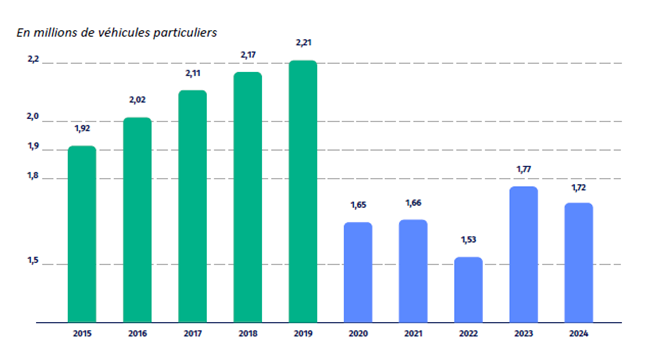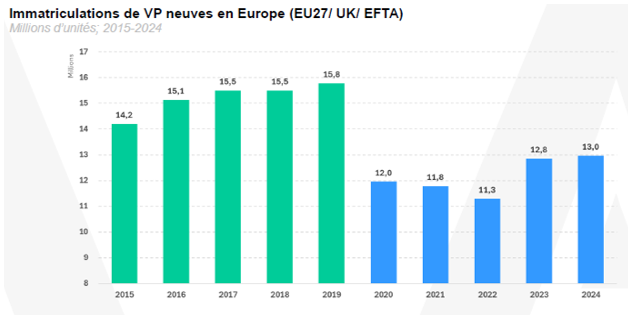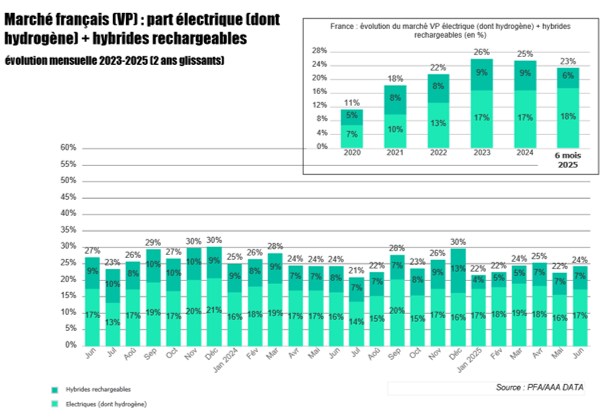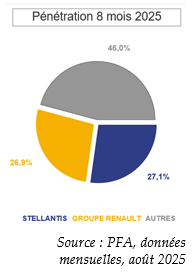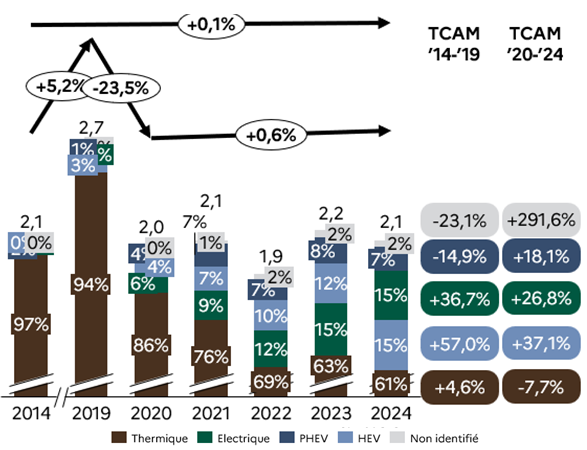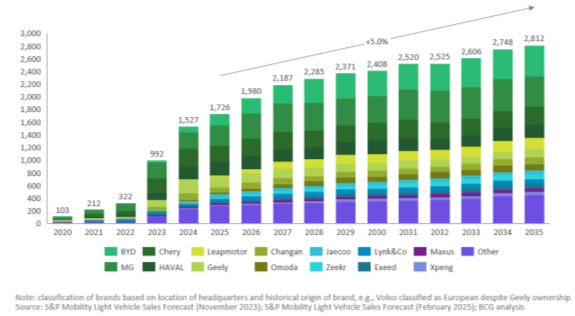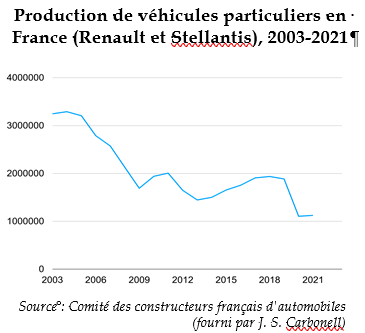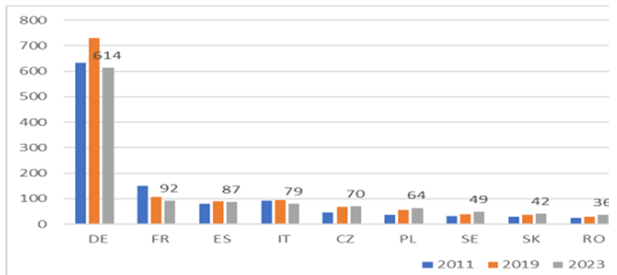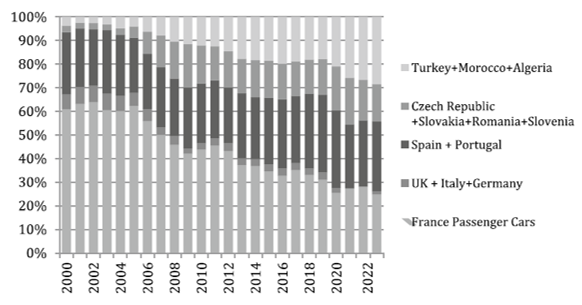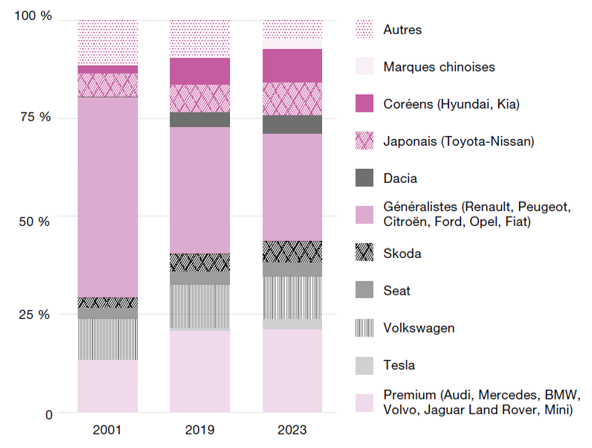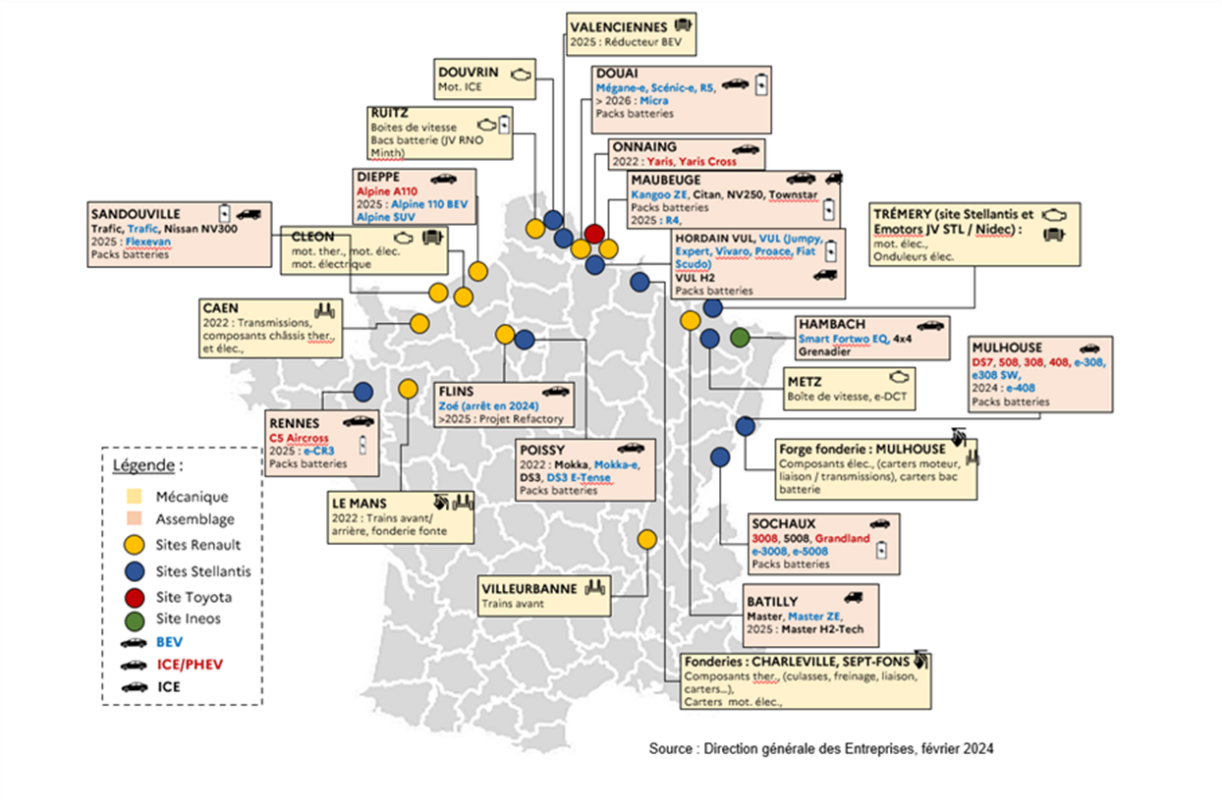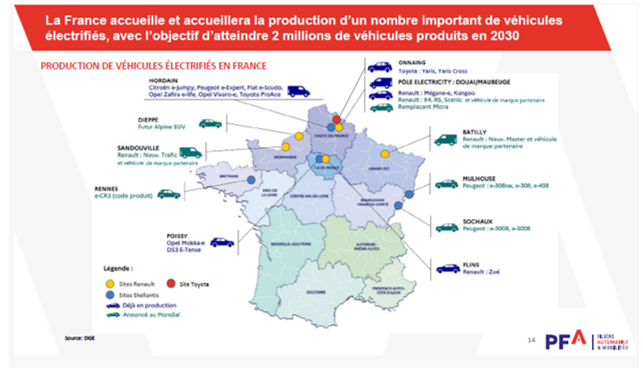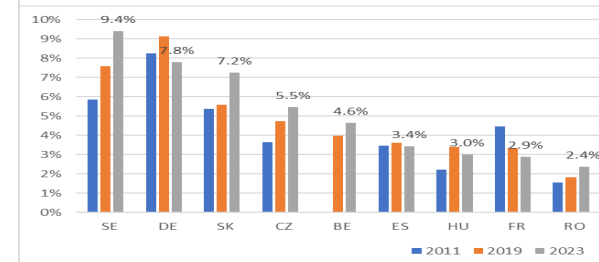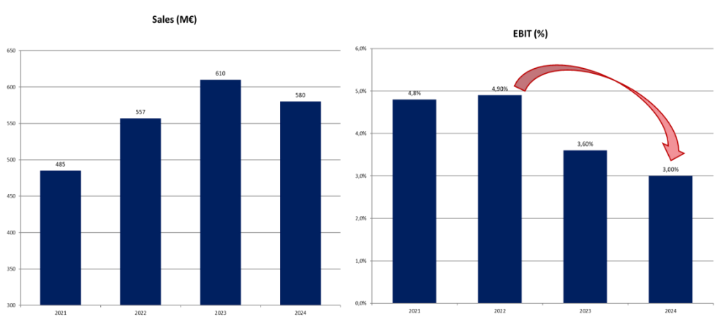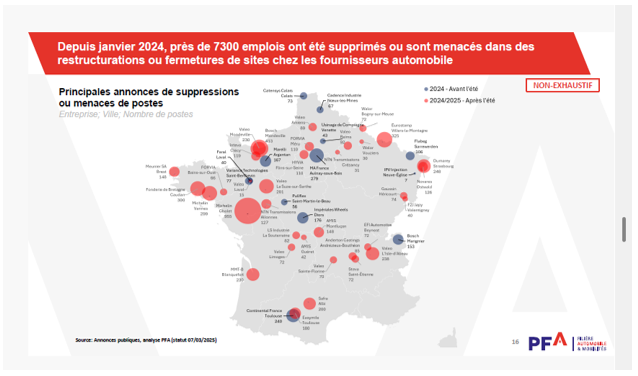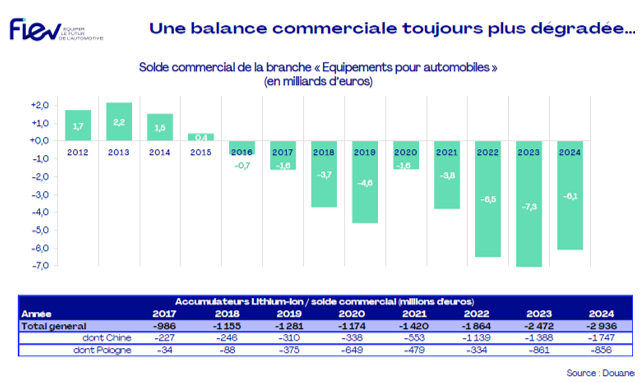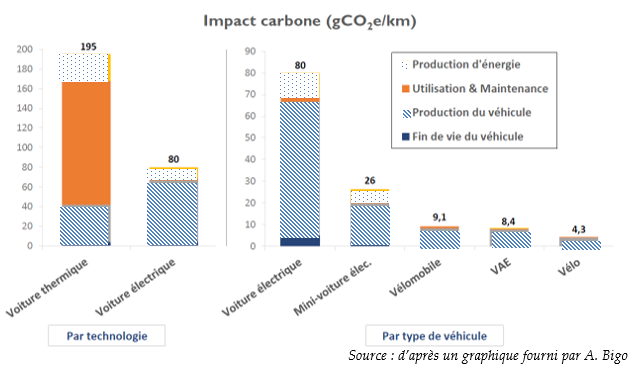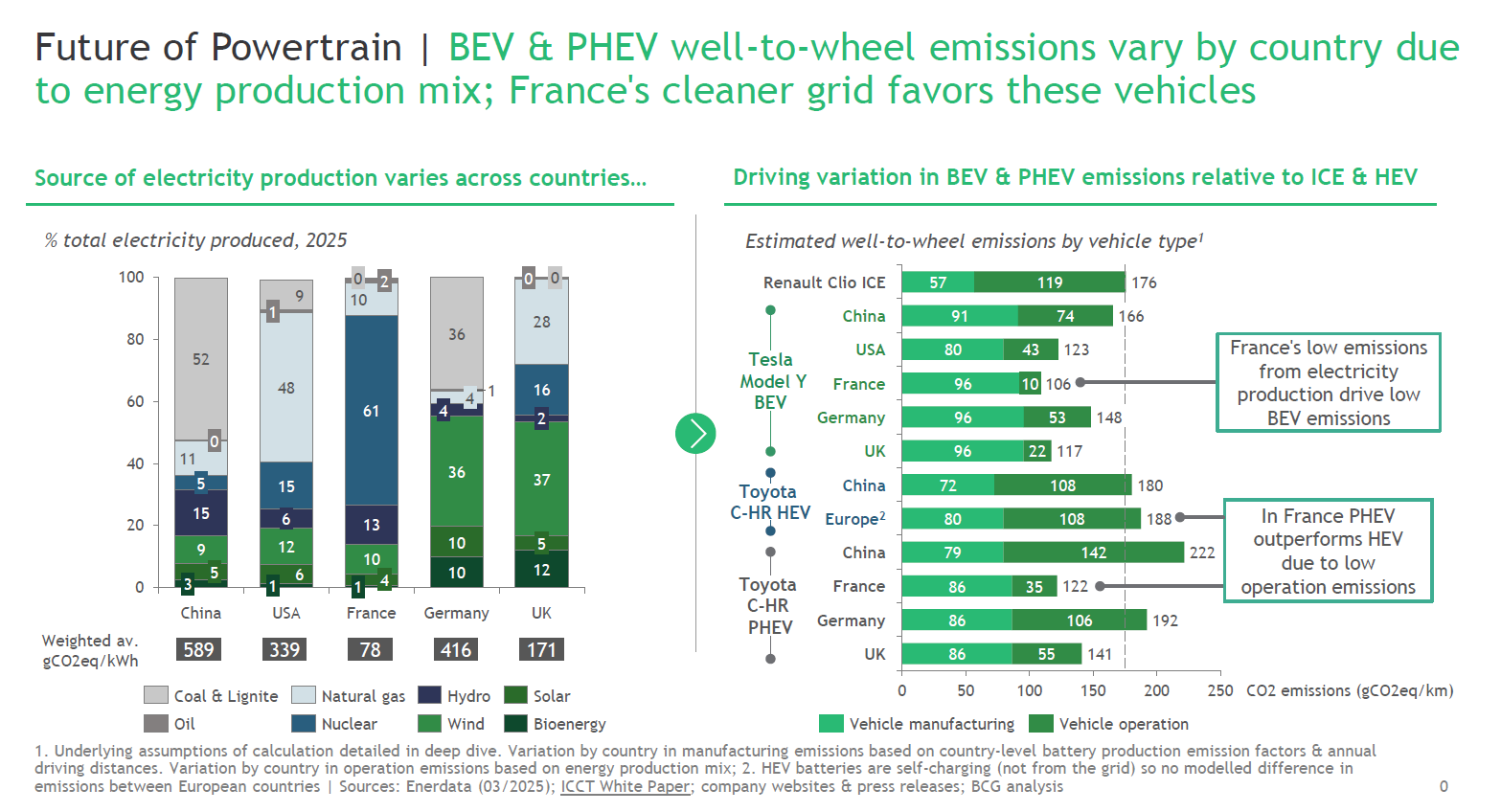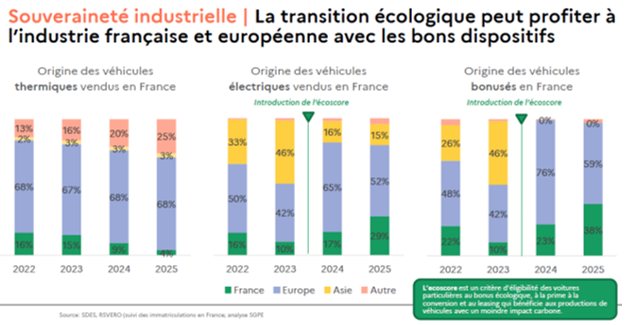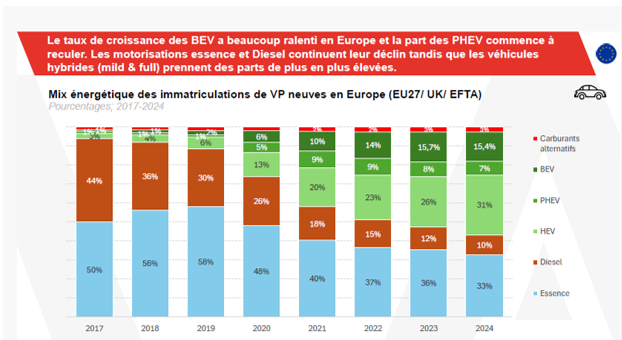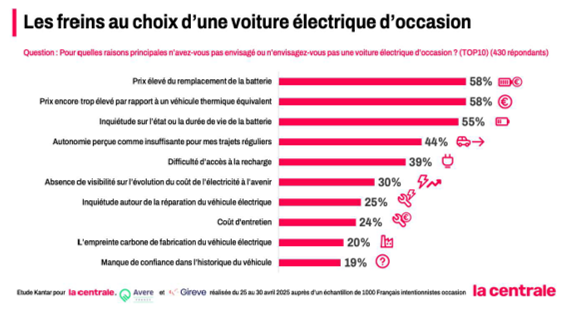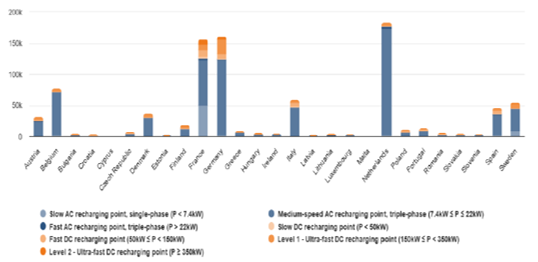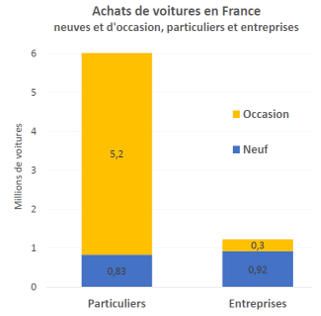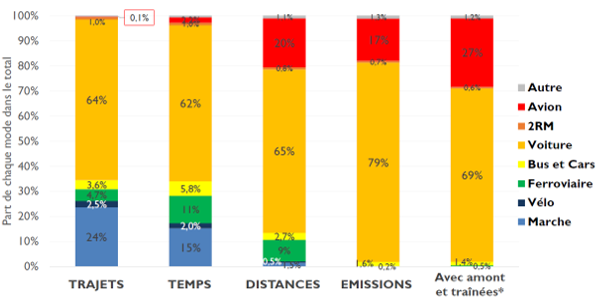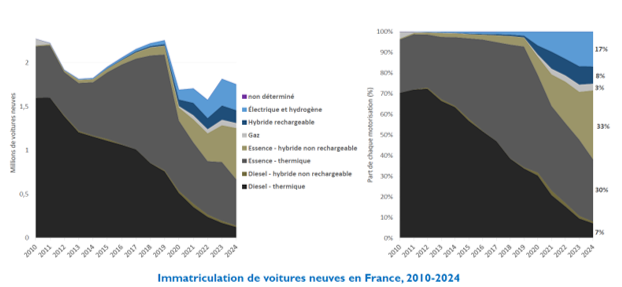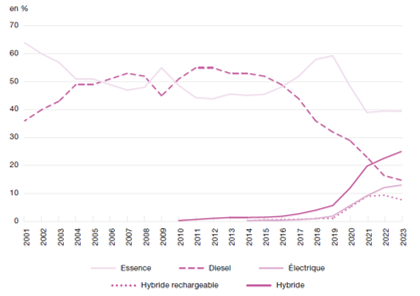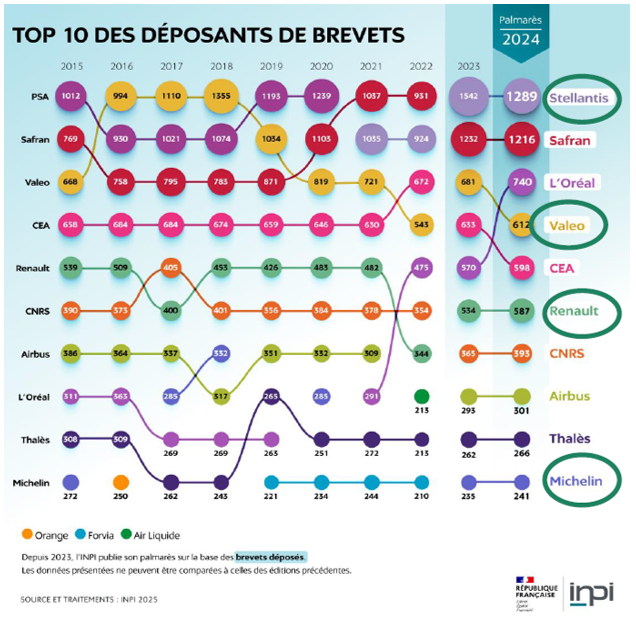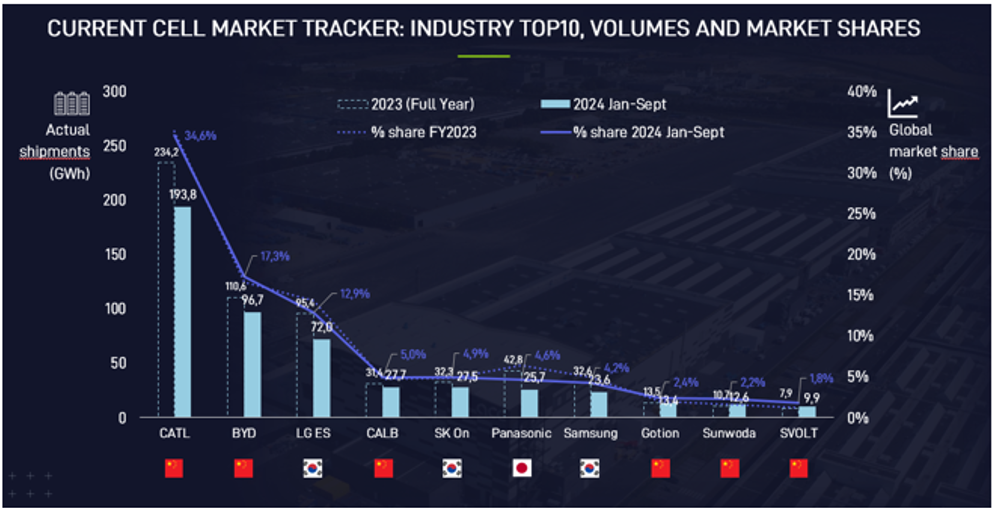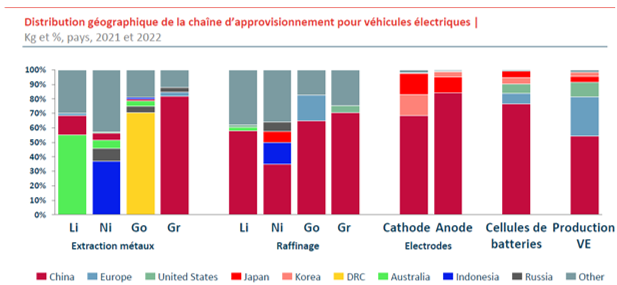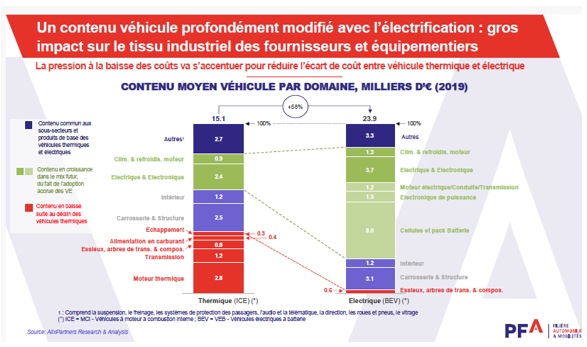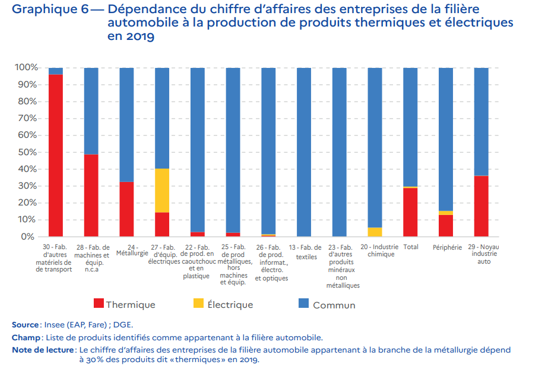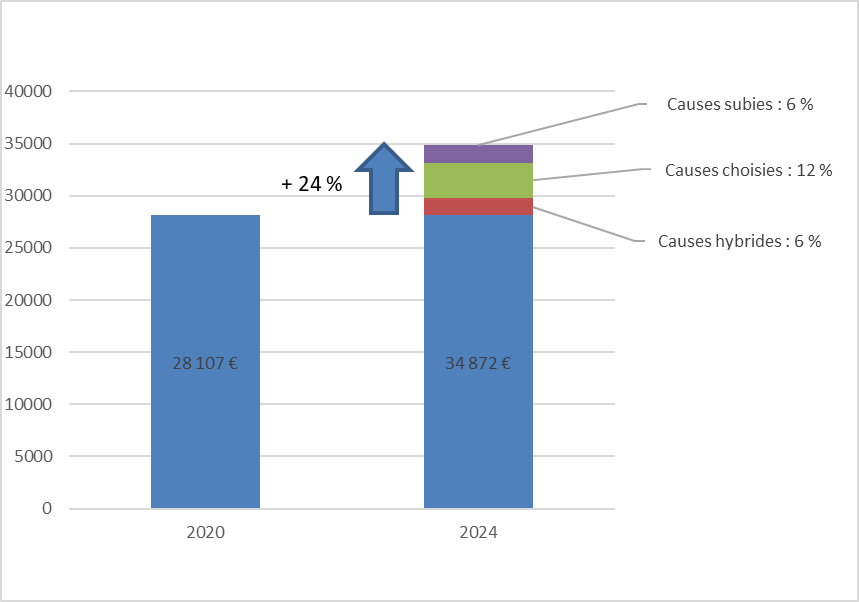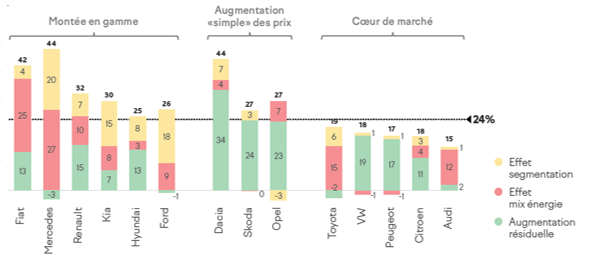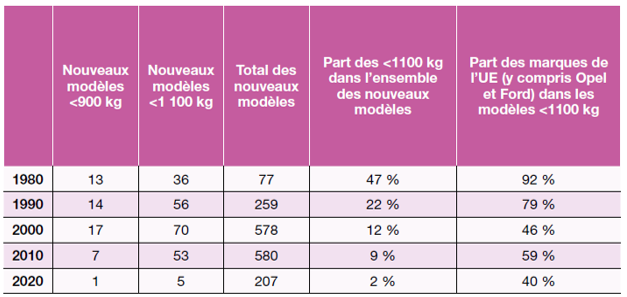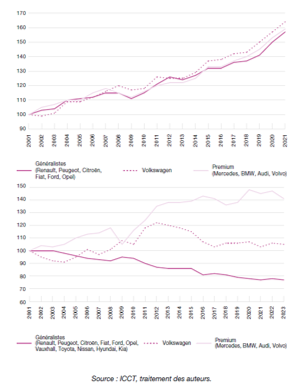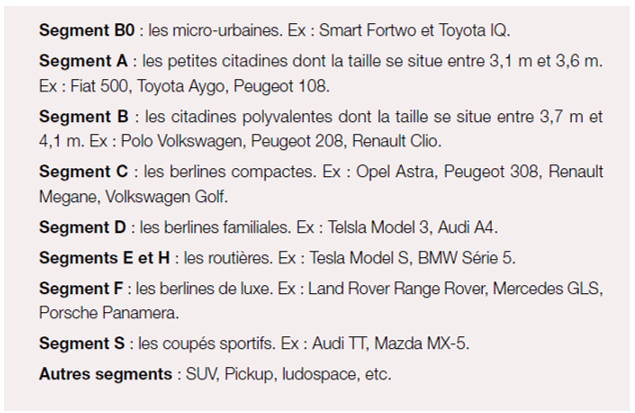- L'ESSENTIEL
- I. UNE INDUSTRIE STRUCTURANTE AU BORD DU
CRASH
- II. DONNER À L'INDUSTRIE LES MOYENS DE
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉLECTRIQUE POUR ASSURER SA
PÉRENNITÉ
- I. UNE INDUSTRIE STRUCTURANTE AU BORD DU
CRASH
- CONTRE UN CRASH
PROGRAMMÉ :
18 MESURES D'URGENCE
POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE
- I. L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE :
UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE EN SITUATION DE PÉRIL
MORTEL
- A. DES BAISSES DRASTIQUES DES VENTES...
- B. ... QUI ACHÈVENT DE FRAGILISER UN TISSU
INDUSTRIEL MINÉ PAR DEUX DÉCENNIES DE
DÉLOCALISATIONS
- 1. Les stigmates de la crise Covid
- 2. Une industrie automobile française
fragilisée par deux décennies de délocalisations
- 3. Une structure de production toujours puissante,
mais fragilisée par de nouveaux défis
- a) Un tissu industriel fort sur le territoire
national
- (1) Un maillage du territoire par les sites de
production automobiles, principalement des équipementiers
- (2) Le virage pris de la production de
véhicules électriques
- b) Des acteurs fragilisés par les mutations
récentes de l'industrie automobile
- (1) Des investissements colossaux des
constructeurs dans l'électrique et le numérique
- (2) Les équipementiers, premières
victimes des réductions de coût
- a) Un tissu industriel fort sur le territoire
national
- 1. Les stigmates de la crise Covid
- C. SAUVER L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
FRANÇAISE : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ
- A. DES BAISSES DRASTIQUES DES VENTES...
- II. MESURES D'URGENCE POUR L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE
- A. PROTÉGER LE MARCHÉ
EUROPÉEN POUR LAISSER LE TEMPS À L'INDUSTRIE FRANÇAISE ET
EUROPÉENNE DE RATTRAPER SON RETARD
- 1. Protéger les constructeurs et les
équipementiers de la concurrence étrangère
- 2. Favoriser les contenus européens pour
les véhicules vendus en Europe
- a) L'instauration d'un contenu local et le
renforcement de la solidarité de filière
- (1) Une augmentation exponentielle des composants
extra-européens dans les véhicules européens
- (2) Instaurer un pourcentage minimal de contenu
européen pour les véhicules vendus en Europe
- (3) Une solution non consensuelle
- b) Une mesure complémentaire :
généraliser l'éco-score à l'échelle
européenne
- a) L'instauration d'un contenu local et le
renforcement de la solidarité de filière
- 1. Protéger les constructeurs et les
équipementiers de la concurrence étrangère
- B. ALLÉGER LA CONTRAINTE DU 100 %
ÉLECTRIQUE
- 1. Des objectifs de réduction des
émissions fixés dans le cadre du Green Deal sans
anticipation
- 2. Une prise de conscience tardive mais
réelle
- 3. Assouplir l'objectif 2035 : une
nécessité vitale pour l'industrie
- a) Alléger la contrainte 2035 pour
mieux coller aux réalités du marché et de l'industrie...
et pour accélérer la décarbonation
- (1) L'objectif « 100 %
électrique » en 2035, un objectif
disproportionné
- (2) Des cas d'usage peu adaptés à
l'électrique
- (3) Décarboner le parc existant, une mesure
de bon sens écologique
- (4) Miser sur des modèles hybrides
- b) La neutralité technologique : un
impératif logique et pratique
- (1) L'hydrogène vert
- (2) Les biocarburants et e-carburants, une
solution complémentaire adaptée à certains types
d'usages
- c) Assurer la stabilité de la
réglementation
- a) Alléger la contrainte 2035 pour
mieux coller aux réalités du marché et de l'industrie...
et pour accélérer la décarbonation
- 1. Des objectifs de réduction des
émissions fixés dans le cadre du Green Deal sans
anticipation
- C. SOUTENIR LE CONSOMMATEUR POUR RENDRE LA VOITURE
ÉLECTRIQUE ABORDABLE
- 1. La question du coût : rendre les
véhicules électriques abordables en soutenant la demande
- a) L'augmentation des prix des véhicules
neufs ces dernières années alimente le sentiment de
déclassement d'une partie de la population et contribue à
l'attrition de la demande
- b) L'électrique, une solution dont le
coût d'entrée demeure élevé, mais globalement
avantageuse sur le plan économique
- c) Soutenir la demande en véhicules
électriques des ménages les plus modestes sans pénaliser
excessivement les finances publiques
- d) Développer le marché de
l'occasion
- (1) Un marché compliqué de
l'occasion électrique, pourtant déterminant pour la
pénétration globale du marché
- (2) Rassurer sur l'autonomie des batteries
- a) L'augmentation des prix des véhicules
neufs ces dernières années alimente le sentiment de
déclassement d'une partie de la population et contribue à
l'attrition de la demande
- 2. Poursuivre l'effort de déploiement des
bornes de recharge pour lever les freins psychologiques à l'achat de
véhicules électriques
- 3. Favoriser l'électrification des flottes
d'entreprise
- 1. La question du coût : rendre les
véhicules électriques abordables en soutenant la demande
- A. PROTÉGER LE MARCHÉ
EUROPÉEN POUR LAISSER LE TEMPS À L'INDUSTRIE FRANÇAISE ET
EUROPÉENNE DE RATTRAPER SON RETARD
- III. RÉCONCILIER
COMPÉTITIVITÉ ET TRANSITION POUR REFAIRE DE LA FRANCE UN
TERRITOIRE D'INDUSTRIE AUTOMOBILE
- A. INVESTIR DANS L'ÉLECTRIQUE : UNE
NÉCESSITÉ
- B. DES STRATÉGIES POUR RATTRAPER LE RETARD
TECHNOLOGIQUE ACCUMULÉ
- 1. Soutenir le rattrapage technologique
- a) Imposer aux acteurs extra-européens
implantés en Europe des transferts de technologie
- (1) La tentation des alliances avec les acteurs
chinois : une fausse bonne idée ?
- (2) Favoriser les implantations sur le sol
européen et les transferts de technologies à grande
échelle
- b) Miser sur l'innovation pour être
reprendre le leadership sur la prochaine génération de
véhicules
- (1) Un écosystème de recherche et
développement performant et prometteur
- (2) Investir le logiciel
- a) Imposer aux acteurs extra-européens
implantés en Europe des transferts de technologie
- 2. Batteries et matières critiques :
sortir de la dépendance asiatique
- a) Un approvisionnement en batteries marqué
par une dépendance à la Chine
- b) Assumer le soutien à la filière
européenne de la batterie
- (1) Des débuts prometteurs...
- (2) ... mais des difficultés de
montée en cadence
- (3) Une nécessaire adaptation du cadre des
aides européennes, en faveur de la production
- c) Muscler la stratégie européenne
visant à sécuriser l'approvisionnement en matériaux
critiques
- a) Un approvisionnement en batteries marqué
par une dépendance à la Chine
- 1. Soutenir le rattrapage technologique
- C. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT POUR REFAIRE DE LA
FRANCE UN TERRITOIRE D'INDUSTRIE AUTOMOBILE
- 1. Restaurer la compétitivité de
l'industrie automobile française : une gageure ?
- 2. Soutenir l'émergence de petits
véhicules électriques abordables
- a) Une stratégie continue de
« premiumisation » dont les constructeurs font
aujourd'hui les frais
- (1) Les hausses continues des prix des
véhicules depuis 20 ans ne sont que minoritairement imputables
à l'électrification
- (2) Le poids des normes
- b) Simplifier la réglementation pour
favoriser la production de petites voitures abordables
- a) Une stratégie continue de
« premiumisation » dont les constructeurs font
aujourd'hui les frais
- 3. Vers un Airbus européen de
l'automobile ? Partager l'innovation et la production au niveau
européen
- 1. Restaurer la compétitivité de
l'industrie automobile française : une gageure ?
- A. INVESTIR DANS L'ÉLECTRIQUE : UNE
NÉCESSITÉ
- I. L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE :
UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE EN SITUATION DE PÉRIL
MORTEL
- ANNEXE 1
- ANNEXE 2
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- 1. Mesures d'urgence en faveur de l'industrie
automobile
- 2. Accompagner l'industrie automobile pour
réussir la transition
- a) Faire baisser les prix pour dynamiser le
marché de l'électrique
- b) Augmenter la confiance dans la solution
électrique
- c) Restaurer la compétitivité et la
souveraineté de la filière
- (1) Protéger la filière naissante de
la production de batteries
- (2) Agir sur le facteur-coût
- (3) Soutenir la réorientation de la
stratégie industrielle
- d) Reprendre le leadership en matière
technologique
- (1) Rattraper et continuer d'innover
- (2) Tirer parti de l'excellence française
en matière de numérique
- a) Faire baisser les prix pour dynamiser le
marché de l'électrique
- 1. Mesures d'urgence en faveur de l'industrie
automobile
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
N° 37
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la filière automobile,
Par M. Alain CADEC, Mme Annick JACQUEMET et M. Rémi CARDON,
Sénateurs et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
L'ESSENTIEL
Le mercredi 15 octobre 2025, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté les conclusions de la mission d'information relative à l'avenir de la filière automobile française.
Pilier de l'industrie française, l'industrie automobile est entrée depuis plusieurs mois dans une crise profonde.
Pour les rapporteurs, la survie de l'industrie automobile française passera nécessairement par un assouplissement des règles européennes, et notamment le report de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs. Ils appellent à mettre en place des mesures d'urgence pour sauver la filière en la protégeant de la concurrence internationale et en améliorant l'efficacité des mesures de soutien à la demande. Pour pouvoir consolider ses efforts de recherche et développement et se positionner en leader sur les véhicules du futur, notamment sur le volet numérique, l'industrie automobile française doit restaurer ses marges. Pour cela, les rapporteurs appellent les pouvoirs publics à agir sur les coûts et adapter la réglementation pour favoriser la création de petits véhicules abordables.
I. UNE INDUSTRIE STRUCTURANTE AU BORD DU CRASH
A. UNE INDUSTRIE FRAGILISÉE PAR DE MULTIPLES FACTEURS
1. Un long déclin accéléré par la crise de la covid
La crise sanitaire, à laquelle ont succédé la crise des semi-conducteurs puis la crise énergétique, ont lourdement affecté les ventes de véhicules particuliers : entre 2019 et 2024, le marché automobile européen a perdu plus de 2 millions d'unités. Cette tendance à la baisse s'est confirmée dans la période la plus récente, l'essor des voitures électriques n'ayant pas été aussi rapide qu'escompté. Après un pic en 2023, la part des ventes de voitures « tout électrique » et hybrides rechargeables a même baissé en France en 2024 et 2025, pour s'établir à moins d'un quart des ventes.
Face à ces chocs, l'industrie française, fragilisée par deux décennies de délocalisations vers les pays à bas coût, a moins bien résisté que celle de ses voisins européens : en 2023, la production domestique était encore de 40 % inférieure à celle de 2019.
2. Le coup de grâce d'une transition électrique menée à marche forcée
Le Pacte vert européen a fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions carbone des véhicules, avec notamment l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves sur le sol européen à compter de 2035. Or cet objectif, pris sans réelle étude d'impact ni prise en compte des capacités industrielles, fragilise les constructeurs européens pris en étau entre les investissements colossaux auxquels ils doivent faire face pour assurer la transition électrique et la contraction du marché.
Prenant acte de ces difficultés, la Commission européenne a lancé début 2025 un plan d'action en faveur de l'industrie automobile, qui reste néanmoins largement à concrétiser juridiquement pour produire des effets concrets.
B. SAUVER L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ
1. La colonne vertébrale de l'industrie française
L'industrie automobile emploie quelque 350 000 salariés, sur environ 4 000 sites industriels. Industrie de volume, elle est structurante pour l'ensemble du tissu industriel national, mais aussi local, en alimentant autour d'elle un écosystème de sous-traitants, actifs dans des domaines aussi divers que les produits métalliques, le caoutchouc, la chimie ou l'informatique, et dont certains sont peu délocalisables.
La filière automobile joue également un rôle crucial en matière de recherche et développement et d'innovation technologique, dont profite l'ensemble de l'industrie. Plus de la moitié des brevets déposés en France émanent ainsi du secteur automobile.
2. Des enjeux de souveraineté directs et indirects
La pérennité de l'industrie automobile est d'abord un enjeu de souveraineté économique : alors que 80 % des batteries utilisées en Europe proviennent d'Asie, la non-maîtrise par les acteurs européens des technologies de base nécessaires à la fabrication des véhicules électriques grève la souveraineté industrielle des constructeurs européens. De même, le traitement des données des véhicules connectés par des acteurs extra-européens, sans possibilité de contrôle de la part des Européens, pose des questions de sécurité. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, cela représente une menace directe sur nos capacités de mobilité.
En outre, certaines compétences utilisées dans l'automobile sont cruciales pour l'industrie de défense. La disparition, faute de commandes suffisantes dans le secteur automobile, de certains sous-traitants fournissant en part minoritaire les industries d'armement, affaiblirait notre capacité de production militaire.
II. DONNER À L'INDUSTRIE LES MOYENS DE RÉUSSIR LA TRANSITION ÉLECTRIQUE POUR ASSURER SA PÉRENNITÉ
A. CONTRER LA CONCURRENCE DÉLOYALE DES PAYS À BAS COÛT
L'industrie automobile européenne est confrontée à la concurrence de la Chine, qui a investi de longue date sur les technologies électriques : en 2023, la Chine assurait ainsi près des deux tiers de la production mondiale de véhicules électriques, et les exportations de voitures chinoises au niveau mondial ont plus que quadruplé entre 2021 et 2023, grâce à des prix de vente environ 30 % inférieurs à celui des voitures européennes, pour des produits de qualité au moins équivalente.
Face à cette situation, les mesures compensatoires mises en place par l'Union européenne sont insuffisantes : ce sont tous les produits de la chaîne de valeur, et non pas seulement les produits finis, qui doivent être temporairement taxés, à des taux suffisamment élevés pour protéger l'industrie européenne naissante des batteries et du véhicule électrique. Afin de préserver l'emploi et le savoir-faire des équipementiers et sous-traitants européens sur le long terme, et, partant, la souveraineté de toute la chaîne de valeur, des règles en matière de contenu local des véhicules devraient parallèlement être mises en place (80 % au moins de la valeur des véhicules, hors batteries).
B. CONSOLIDER LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRIQUE TOUT EN ASSOUPLISSANT LES OBJECTIFS EUROPÉENS
1. Repousser la sortie du thermique
Parallèlement, afin de laisser le temps à l'industrie de rattraper son retard dans l'électrique, et de développer d'autres technologies de décarbonation, les rapporteurs recommandent de :
- repousser la fin des ventes de voitures thermiques neuves, tout en confiant à la Commission européenne le soin de fixer, en concertation avec l'industrie, une trajectoire réaliste en ce sens ;
- mettre réellement en oeuvre le principe de neutralité technologique qui prévaut dans la réglementation européenne, afin de valoriser par exemple les biocarburants. Les efforts de R&D en faveur des carburants neutres en carbone doivent continuer à être soutenus.
2. Consolider le marché de l'électrique en faisant baisser les coûts
Afin de soutenir le marché des voitures électriques sans grever excessivement les finances publiques nationales, les mécanismes de soutien à la demande devaient être mieux ciblés et harmonisés au niveau européen.
En vue d'améliorer la confiance dans les performances des véhicules électriques, notamment sur le marché de l'occasion, la mission recommande en outre la création d'un diagnostic batterie certifié obligatoire.
En outre, les rapporteurs recommandent de créer une nouvelle catégorie réglementaire de petits véhicules aux exigences de sécurité allégées, mais soumises en contrepartie à des restrictions de gabarit et de vitesse. Cela permettrait aux constructeurs de proposer ces modèles à un prix plus abordable et de relancer un marché de volume, à rebours de la stratégie de montée en gamme observée ces dernières années chez les constructeurs français.
C. RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE
L'industrie automobile française souffre tant d'un déficit de compétitivité-coût que de compétitivité-hors-coût, et doit donc agir sur ces deux facteurs pour assurer sa survie.
1. Rattraper le retard sur l'électrique et devenir pionnier sur le véhicule du futur
Afin de rattraper son retard en matière de véhicules électriques, l'Europe devrait agir sur tous les leviers :
- en amplifiant son effort de R & D ;
- en soutenant ses gigafactories, y compris en phase d'industrialisation ;
- mais aussi en imposant des transferts de technologies aux acteurs industriels qui souhaitent s'installer en Europe pour accéder au marché européen.
Pour reprendre le leadership technologique sur les prochaines générations de véhicules, les rapporteurs recommandent d'investir massivement dans le logiciel, domaine d'excellence français.
2. Dégager des marges de manoeuvre pour assurer les investissements nécessaires à assurer l'avenir
Afin des restaurer la compétitivité-coût, il est crucial de faire baisser en France le coût du travail et de l'énergie, mais aussi de rééquilibrer les règles de concurrence intra-européenne, afin d'éviter les délocalisations vers les pays d'Europe de l'Est ou du pourtour méditerranéen.
LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
|
Dans l'immédiat |
À moyen terme |
À long terme |
|
Assurer des débouchés pour les constructeurs français |
Donner à la filière du temps pour se
mettre à niveau |
Devenir leader sur le véhicule du futur |
|
Lutter contre la concurrence déloyale et protéger le marché européen · Instaurer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois au moins équivalents à ceux appliqués par la Chine · Imposer un contenu local européen (80 %) pour les véhicules vendus en Europe et fixer un objectif d'au moins 40 % de batteries produites localement en 2035 Soutenir le marché électrique • Harmoniser les politiques de soutien à la demande au niveau européen • Développer un marché de l'occasion des véhicules électriques en créant un diagnostic batterie certifié obligatoire |
Sortir du « tout électrique » · Repousser l'interdiction de la vente des voitures thermiques · Mettre en oeuvre le principe de neutralité technologique Assurer la souveraineté française et européenne en matière de véhicules électriques · Soutenir le développement et le passage à l'échelle des gigafactories européennes · Mettre en application dans les meilleurs délais la stratégie européenne sur les matériaux critiques et soutenir la création de « hubs minéraux » pour l'approvisionnement et la transformation des matériaux critiques · Contraindre les acteurs extra-européens qui souhaitent s'implanter en Europe à des transferts de technologie |
Regagner en compétitivité · Accompagner la restructuration de la filière en mettant en place un plan national et européen d'accompagnement pour les équipementiers · Harmoniser les règles relatives à l'investissement au sein de l'UE et réduire le coût du travail et de l'électricité en France. · Adapter la réglementation et flécher les soutiens publics pour favoriser la production de petits véhicules abordables Soutenir et amplifier l'effort de R & D · Sanctuariser les mécanismes de soutien à la recherche, notamment le principe du crédit d'impôt recherche (CIR) · Soutenir l'émergence d'un écosystème européen du véhicule numérique |
CONTRE UN CRASH
PROGRAMMÉ :
18 MESURES D'URGENCE
POUR L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE FRANÇAISE
I. L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE : UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE EN SITUATION DE PÉRIL MORTEL
A. DES BAISSES DRASTIQUES DES VENTES...
1. Un marché européen en berne...
Les difficultés rencontrées actuellement par le secteur automobile, que ce soit en France ou en Europe, résultent d'une combinaison de facteurs d'ordre conjoncturel et structurel, agissant à court, moyen et long termes.
a) Un recul des ventes brutal et persistant depuis la crise de la Covid
La voiture représente actuellement quasiment deux tiers des mobilités des Français, que ce soit en termes de nombre de déplacements, en temps de transport ou en kilomètres parcourus. Elle est majoritaire pour les déplacements jusqu'à 1 000 km.
Pourtant, après avoir connu un pic dans les années qui ont immédiatement précédé la crise sanitaire de 2020-2021, avec respectivement plus de 2,2 M et près de 16 M de véhicules particuliers neufs vendus1(*), les marchés automobiles français et européen ont connu après la crise sanitaire une chute brutale et durable des ventes : malgré un léger mieux à partir de 2023, ces dernières s'élevaient respectivement, en 2024, à 1,7 M (- 22 %) et 13 M (- 18 %). À court terme, la pandémie de Covid-19 a en effet profondément perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en provoquant un net recul de la demande : entre 2019 et 2024, le marché automobile européen a enregistré une perte de plus 2 millions d'unités, soit l'équivalent du marché français2(*).
Évolution du marché français pour les véhicules particuliers (2015-2024)
Source : PFA
Évolution du marché
européen
(Union européenne, Royaume-Uni, Islande,
Liechtenstein, Norvège
et Suisse) pour les véhicules
particuliers neufs (2015-2024)
Source : PFA
Selon les chiffres les plus récents de la PFA3(*), la tendance est à nouveau à la baisse en 2025, avec un marché français des véhicules particuliers neufs en baisse de 7,9 % au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.
b) Un décollage moins vigoureux qu'escompté des ventes de véhicules électriques
La baisse agrégée des ventes de véhicules particuliers ces dernières années s'explique notamment par le décollage moins vigoureux qu'espéré des ventes de véhicules électriques, dont le développement est pourtant encouragé par la réglementation européenne4(*). Quasiment inexistants il y a une dizaine d'années, ces derniers représentent actuellement plus d'un tiers des ventes de véhicules neufs, mais leur part a désormais tendance à stagner.
Plus précisément, en mars 2025, les immatriculations de voitures neuves en France se répartissent comme suit5(*) :
|
Véhicules thermiques (essence et diesel) |
26 % |
71,7 % |
|
Véhicules hybrides non rechargeables (essence et diesel) |
45,7 % |
|
|
Véhicules hybrides rechargeables |
5,3 % |
24,2 % |
|
Véhicules électriques |
18,9 % |
Au cours des derniers mois, le marché automobile français a été marqué par une baisse significative des ventes des véhicules thermiques (essence et diesel), au profit de motorisations hybrides (rechargeables et non rechargeables), tandis que la part des véhicules « tout électrique » s'est stabilisée. Pour la première fois, en 2024, l'hybride est devenue la motorisation la plus vendue. Toutefois, les baisses les plus récentes ont affecté particulièrement les véhicules électriques (tout électrique et hybrides rechargeables), dont la part est passée de 26 % en 2023 à 23 % sur les six premiers mois de l'année 2025.
Source : PFA, données mensuelles juin 2025
Malgré ces réelles difficultés, les constructeurs français demeurent en bonne place sur le marché français, puisque Stellantis et Renault assurent à eux deux plus de la moitié des ventes de véhicules particuliers neufs en France, avec notamment les marques Renault (14,9 %), Peugeot (13,4 %) et Dacia (9,4 %), suivies de près par Toyota - seule marque étrangère dans le « top 5 » (7,4 %) - et Citroën (5 %).
Évolution des ventes de véhicules particuliers par motorisation6(*) (2014-2024)
Source : DGE (données Inovev). Données Inovev retraitées par la DGE
2. ... une concurrence internationale accrue...
L'industrie automobile a longtemps été caractérisée par une structure hautement oligopolistique, avec un petit nombre de producteurs, issus d'un petit nombre de pays aux économies avancées : en 2005 encore, 80 % de la production mondiale était assurée par seulement 11 pays7(*).
Les évolutions technologiques récentes - type de motorisation et place croissante du logiciel - ont profondément modifié cet état de fait.
Pionnier du véhicule électrique, l'Américain Tesla a longtemps dominé le marché européen sur ce segment. En dépit de la brusque décrue des ventes observée au premier semestre 2025, en raison de la mauvaise image de son patron Elon Musk en Europe, l'entreprise profite encore des surcapacités de son usine de Shanghai pour vendre de gros volumes sur le marché européen (950 000 véhicules électriques importés en Europe depuis Shanghai en 2024).
Néanmoins, le principal compétiteur, pour les années à venir, des constructeurs européens sur leur propre marché est la Chine, qui s'est érigée en quelques années comme l'acteur principal de la transition électrique. En 2023, la Chine assurait ainsi 62 % de la production mondiale de véhicules électriques, et 78 % de la production de batteries pour l'automobile, ce qui en fait le leader incontesté dans ce domaine, au niveau mondial.
Même si la part de marché des constructeurs chinois en Europe est encore limitée à environ 5 %8(*) du total, la courbe de croissance est exponentielle, en particulier dans l'électrique, où elle atteint un quart9(*). Rien qu'entre 2021 et 2023, les exportations de voitures chinoises au niveau mondial ont bondi de 2 à presque 9 millions, ce qui place également la Chine au premier rang des exportateurs dans le secteur. Les véhicules électriques représentent un quart des exportations de voitures chinoises10(*). D'après les chiffres fournis par Business France, la plus forte progression pour les importations de véhicules en Europe par rapport à 2019 concerne la Chine, avec une augmentation de... + 1 591,3 % !
Évolution des ventes de véhicules
légers chinois en Europe
(historique et projections, en milliers
d'unités)
Source : Boston Consulting Group (gracieusement fourni par X. Mosquet)
Selon les projections de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea), la part des véhicules électriques sur le marché européen pourrait atteindre 30 % d'ici 2030.
(1) Une irrésistible compétitivité prix ?
Les raisons de la percée des Chinois sur le marché automobile européen sont à rechercher en premier lieu dans la compétitivité des prix pratiqués : selon Xavier Mosquet, spécialiste de l'industrie automobile auditionné par les rapporteurs, les véhicules électriques chinois sont vendus en moyenne, en Europe, entre 5 000 et 10 000 € moins chers que des véhicules équivalents produits en Europe, soit un différentiel de prix moyen de 30 %.
Plusieurs facteurs expliquent cet écart de prix, et en premier lieu :
- une politique industrielle volontariste de développement : le plan « Made in China 2025 », dévoilé en 2015, reconnaissait déjà l'importance pour la Chine de produire des « new energy vehicles » (« véhicules à énergie nouvelle ») pour développer l'économie du pays11(*). Contrairement à l'Union européenne et même aux États-Unis, la politique d'électrification, en Chine, n'a pas d'abord été pensée en raison de son impact environnemental, mais a été, selon les mots employés par X. Mosquet, « entièrement guidée par une volonté d'indépendance énergétique et une politique industrielle »12(*). Cette volonté politique de développer une industrie automobile nationale, notamment électrique, se traduit par toute une série de facilités accordées au secteur, notamment un accès facilité au capital, y compris au capital public : depuis 2010, l'administration chinoise aurait fourni plus de 230 Md$13(*) d'aides directes au marché de l'électrique, dont l'essentiel en avantages à l'achat aux consommateurs, et 25 Md$ d'aides en R&D14(*) ;
- des capacités de mobilisation du capital humain sans commune mesure avec la situation européenne : ainsi qu'a pu le constater sur place la délégation de la commission des affaires économiques qui s'est rendue en Chine en septembre 2024, l'industrie automobile chinoise est marquée par le gigantisme. Dans ce domaine, les paramètres de production chinois diffèrent profondément de ceux qui prévalent en Europe, tant en termes de nombre de travailleurs mobilisables que de durée de travail ou d'infrastructures de production : l'usine du constructeur BYD à Shanghai se déploie ainsi sur environ 6 km sur 5.
La combinaison de ces facteurs débouche sur une capacité annuelle de production de véhicules évaluée à environ 40 M, dont 15 M de véhicules électriques, pour une capacité d'absorption du marché domestique chinois de 30 M de véhicules, dont un peu plus de 8 M de véhicules électriques. Cette surcapacité installée et entretenue ne concerne d'ailleurs pas uniquement les véhicules finis, mais l'ensemble de la chaîne de valeur, comme l'avait par exemple exposé devant la commission des affaires économiques Florent Menegaux, président de Michelon, lors de son audition le 22 février 2025.
La fermeture du marché états-unien aux exportations chinoises risque d'ailleurs d'augmenter cet effet « surcapacité », au détriment de l'Europe, que les véhicules chinois inondent le marché européen ou soient détournés vers d'autres marchés tiers où ils entreront en concurrence avec les productions européennes : au premier semestre 2025, tous secteurs confondus, les exportations industrielles chinoises ont ainsi augmenté de 26 % vers l'Afrique et de 23 % vers les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean)15(*).
D'autres facteurs, moins directement liés aux caractéristiques démographiques ou de régime de la Chine, entrent en outre en ligne de compte :
- des batteries peu coûteuses, du fait de l'avance nationale dans ce secteur, mais aussi de l'intégration par certains constructeurs de la fabrication de batteries : représentative de la très forte intégration verticale des entreprises automobiles chinoises, BYD produit par exemple l'ensemble de ses composantes, à l'exception des pneus et des vitres ;
- des cycles de développement plus courts (18 mois à deux ans estimés pour « sortir » un nouveau modèle, contre encore trois à cinq ans en France16(*)).
(2) Une incontestable avance technologique
En plus de leur caractère bon marché, les véhicules électriques chinois se distinguent par une incontestable avance technologique : selon un cadre de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea), entendu par les rapporteurs à Bruxelles, les constructeurs chinois auraient « vingt ans d'avance » sur leurs compétiteurs européens sur quasiment toutes les technologies électriques et numériques, notamment en ce qui concerne les performances des batteries (autonomie, temps de recharge et infrastructure de recharge), l'utilisation du logiciel (y compris les véhicules autonomes), et l'expérience utilisateur (interfaces homme-machine et systèmes de navigation).
Les industriels chinois, tant constructeurs qu'équipementiers, se distinguent en outre par une R&D active, puissante et généreusement financée, capable de produire de manière répétée des innovations de conception.
3. ... et un marché mondial au ralenti
De plus en plus mondialisée, l'industrie automobile est de ce fait d'autant plus vulnérable aux chocs asymétriques.
a) La contraction du marché en Chine déstabilise les acteurs européens
Premier producteur mondial, la Chine est également devenue le premier marché automobile mondial, avec 30 millions de voitures vendues annuellement, dont 50 % de véhicules électriques, soit près du double du marché européen.
Terrain de jeu historiquement privilégié par les constructeurs allemands, plutôt que par les Français, le marché intérieur chinois voit cependant la part des acteurs étrangers se réduire drastiquement depuis quelques années, au profit des nouveaux constructeurs chinois, puisqu'elle est passée de 57 % en 2020 à seulement 44 % en 2024. Cette dynamique, couplée au ralentissement général des ventes sur le marché chinois, s'est traduite par une brusque diminution des ventes pour les constructeurs européens. Traditionnellement bien implanté en Chine, Volkswagen Group France, interrogé par les rapporteurs, a fait état de ventes en fort recul en Chine, impactées par une concurrence accrue, une baisse drastique des prix et une accélération de l'électrification de l'offre. La presse s'est également fait l'écho, durant l'été 2025, des difficultés de Porsche et Mercedes-Benz, notamment du fait de la « contraction drastique du marché en Chine », selon Oliver Blume, patron de Porsche17(*).
Source : Valeo
Si les constructeurs français sont moins impactés par cette nouvelle donne en Chine, les grands équipementiers français sont davantage exposés : évoluant dans un monde très mondialisé, présent dans 28 pays et fort de plus de 100 000 collaborateurs dans le monde entier, l'équipementier Valeo a par exemple indiqué comporter parmi ses principaux clients à la fois des constructeurs européens (groupe Volkswagen, Renault Group, Stellantis, Mercedes-Benz et BMW), mais aussi des constructeurs internationaux comme General Motors, Ford, Toyota, Hyndai-Kai, Honda, Nissan, BYD et d'autres constructeurs chinois en forte croissance.
La même situation se retrouve chez la plupart des équipementiers, comme l'illustre par exemple le graphique ci-dessous en ce qui concerne l'équipementier Lisi, équipementier produisant des fixations métalliques (fournisseur notamment de l'Allemand ZF, Stellantis, Renault et Volvo), entendu également par les rapporteurs dans le cadre de la mission.
Source : Lisi
b) La fermeture du marché américain pourrait également avoir un profond effet déstabilisateur
Les États-Unis - avant les annonces du président Trump relatives aux droits de douane - et l'Inde étaient en revanche vus comme des relais de croissance, cette dernière grâce en particulier à une meilleure stabilité politique et à une dynamique commerciale de relance de la consommation.
Avant les « tarifs Trump », les exportations européennes de voitures vers les États-Unis étaient soumises à des droits de douane de 2,5 %. Relevé temporairement de 25 % (taux qui s'ajoutait au taux antérieur) en avril 2025, ce taux a été fixé à 15 %, à compter du 1er août, dans le cadre de l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne annoncé le 27 juillet 202518(*).
La guerre douanière déclenchée par le président américain Donald Trump pourrait donc affecter fortement l'industrie automobile européenne. Le surplus commercial européen avec les États-Unis était en effet, avant le relèvement des taux, de plus de 30 Md€, un cinquième des exportations européennes de véhicules se faisant vers les États-Unis (soit environ 730 000 véhicules, selon Business France, en 2024). Les effets peuvent être à la fois directs, en restreignant l'accès au marché américain, et indirects, en détournant les productions de pays tiers empêchées d'accéder au marché américain vers l'Europe, ou encore vers des pays tiers où elles entreraient alors en concurrence avec les productions européennes.
Selon les informations transmises par la presse, Stellantis chiffrait à mi-année à 300 millions d'euros sur le seul premier semestre 2025 les pertes liées à la guerre commerciale ouverte par Donald Trump au printemps 2025, et Volkswagen à 1,3 milliard d'euros19(*).
Les véhicules exportés vers les États-Unis étant essentiellement des véhicules haut de gamme thermiques et hybrides avec un fort taux d'équipements, les constructeurs allemands seront les plus impactés, mais indirectement, tous les équipementiers qui les fournissent en subiront les répercussions.
B. ... QUI ACHÈVENT DE FRAGILISER UN TISSU INDUSTRIEL MINÉ PAR DEUX DÉCENNIES DE DÉLOCALISATIONS
1. Les stigmates de la crise Covid
La baisse des ventes a des conséquences directes sur les chiffres de la production, sur tous les continents : la production automobile a ainsi reculé au troisième trimestre 2024 de 6,9 % en Europe, de 4,7 % aux États-Unis et 2,6 % en Chine.
De manière plus générale, la crise de la Covid - qui avait fortement perturbé la demande -, puis la crise des semi-conducteurs, qui a engendré d'importants retards de production, une volatilité accrue et une hausse inédite des coûts de fabrication, ont provoqué un fort recul de la production européenne de véhicules particuliers : après avoir connu un plus haut en 2017 avec 18,9 millions d'unités produites, elle a dégringolé à 14,5 millions d'unités en 2024, avec en outre un recul de la part de l'Europe de l'Ouest dans cette production, passée de près des trois quarts à moins du tiers.
La France a moins encore bien résisté que les autres pays européens à la crise sanitaire : en 2023, la production était encore de 40 % inférieure à celle de 2019 (et 61 % si on considère uniquement les véhicules particuliers). Plus de 19 000 emplois ont été perdus sur la période, soit 10 % environ du total20(*).
2. Une industrie automobile française fragilisée par deux décennies de délocalisations
a) Une baisse drastique de la production domestique depuis le début des années 2000
Le recul de la production française n'est cependant pas imputable à la seule crise sanitaire, mais résulte au contraire d'un mouvement engagé depuis déjà une vingtaine d'années. Selon la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) au ministère du travail, l'analyse des motifs économiques des 79 plans de sauvegarde de l'emploi initiés entre 2022 et le 1er trimestre 2025 au sein de la filière automobile montre que 75 % d'entre eux justifient leur projet de restructurations tant par des difficultés structurelles que conjoncturelles.
De fait, alors que la France a longtemps été le deuxième producteur européen de véhicules particuliers, elle est désormais dépassée par la République tchèque, l'Espagne et la Slovaquie. La production domestique est ainsi passée de 3,3 M en 2000 à 1,5 M en 2023, soit son niveau de production des années 1960, près de deux tiers en-dessous de son pic de production, en 2003. La part de la France dans la production automobile européenne est tombée de 20 à 8 % entre 2000 et 2020, loin derrière l'Allemagne (30 %, 5 M d'unités), l'Espagne (13 %, passée de 1 M à près de 3 M de véhicules produits entre 2000 et 2024), la République tchèque (9 %, aux alentours de 1,5 M) et la Slovaquie (7 %).
Durant cette période, l'écart s'est creusé avec les autres pays européens producteurs, tant en termes de production qu'en termes de valeur ajoutée : la France a été le seul pays à voir diminuer l'une et l'autre entre 2000 et 2019. Ainsi, entre 2004 et 2019, la part de l'industrie automobile dans le total de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière est passée de 9 à 4,5 % en France, tandis qu'elle passait de 15 à 19 % en Allemagne21(*) !
La part de la production automobile française est passée de 5,6 % de la production mondiale en 2000 à seulement 1,6 % en 202322(*).
Initialement limité à la production finale, ce mouvement de délocalisation s'est peu à peu propagé aux sous-traitants, « priés » par les donneurs d'ordre de maîtriser leurs coûts.
Ce recul de la production sur le sol national a eu des effets dramatiques en termes d'emploi : au total, 125 000 emplois ont été perdus (- 44 % entre 2004 et 202223(*)), avec des fermetures ou des restructurations totales de sites emblématiques, comme à Choisy ou Flins.
Cette baisse ne touche pas uniquement les constructeurs, puisque selon la Fiev, les effectifs chez les équipementiers ont été divisés par deux depuis 2007 (57 000 personnes actuellement) et ont baissé de près de 20 % rien qu'entre 2019 et 2024). Selon les chiffres fournis par la DGEFP, au total, le nombre de salariés de la filière amont automobile serait même passé de 506 000 en 2007 à 352 000 en 2023, les secteurs les plus touchés sont ceux de la fonderie (fonte avec - 41 % des effectifs) et de l'acier (- 48 %), la construction de véhicules (- 43 %) et la fabrication de moules et modèles (- 46 %).
Cette dynamique de contraction de l'activité et de l'emploi sur le moyen terme n'a pas été partagée par les autres pays européens, ni même par les pays d'Europe de l'Ouest, mais semble spécifique à la France, comme le montre le graphique ci-dessous.
Nombre d'emplois dans l'industrie automobile
amont
(en milliers d'emplois)
Source : CFTC, chiffres Eurofound
b) Des délocalisations massives dans les pays à bas coût
Davantage que par des fermetures « sèches » d'usines, ces pertes d'emploi sont également dues à la délocalisation croissante, pour comprimer les coûts, de la production des modèles des segments A et B vers les nouveaux États membres de l'Europe de l'Est à bas coûts, intégrés dans l'Union en 2004 et 2008. La date de bascule est à situer entre 1999, date d'introduction de l'euro, qui empêche d'utiliser l'arme de la dévaluation pour maintenir la compétitivité des industries nationales, et 2004, date d'adhésion à l'Union des pays d'Europe de l'Est, et à laquelle les capitaux ont acquis une plus grande mobilité au sein de l'Union.
Ce mouvement coïncide par ailleurs avec l'internationalisation croissante du capital des constructeurs français historiques. Après la privatisation partielle de Renault en 1996, l'alliance quelques années plus tard avec le Japonais Nissan a été le prélude à une internationalisation du capital qui prévaut encore aujourd'hui : si la présidence du groupe demeure française, l'État ne détient plus que 15 % de l'entreprise. Même si l'évolution a été plus progressive, la décennie 2000-2010 a également été marquée, chez PSA, par la réduction graduelle de l'actionnariat traditionnel de la famille Peugeot, qui s'est accélérée au cours de la décennie suivante, avec notamment la prise de participation du chinois Dongfeng. La fusion avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et la création de Stellantis, en 2021, a achevé l'internationalisation du groupe, où la famille Peugeot et l'État français (via Bpifrance) détiennent à eux deux moins de 15 % du capital.
Cette dynamique de délocalisation s'est prolongée dans des pays tiers périphériques comme la Turquie, le Maroc (où est par exemple produite la Dacia Logan) et l'Algérie, à la faveur d'accords de libre-échange signés à la même époque.
En conséquence, la part de production réalisée en France par les constructeurs français a été divisée par deux entre 2003 et 2019, passant de 64 % à 31 %. Elle est encore réduite depuis, et ne représente plus en 2024 qu'environ un quart de leur production totale.
Production de véhicules particuliers par
les constructeurs français,
par pays (2000-2023)
Source : Pardi 2025, p. 152
Le surplus historique généré par l'industrie automobile française (12,7 Md€ en 2004) s'est alors transformé en gigantesque déficit (24,9 M€ en 2023).
Cette baisse de la production et ces mouvements de délocalisation ont été la conséquence de pertes constantes de parts de marché des constructeurs français, généralistes et plutôt positionnés sur les segments A et B, sur le marché européen : Renault, Citroën et Peugeot ont vu leurs parts de marché dans l'Union européenne passer de 25 à 15 % entre 2001 et 2023. Dans le même temps, les marques premium, principalement allemandes (Mercedes, BMW, Audi et Volvo) passaient de 13 à 21 % de part de marché.
De fait, la quasi-totalité des pertes d'emploi dans l'industrie automobile européenne au cours des vingt dernières années a eu lieu dans les pays où étaient produites les marques automobiles généralistes : France (- 87 000), Italie (- 30 000) et Espagne (- 116 000). De fait, les seules marques généralistes ayant augmenté leur part de marché au cours de cette période étant celles exclusivement fabriquées dans ces pays (Hyundai-Kia en Slovaquie, Dacia en Roumanie et Skoda en République tchèque)24(*).
Part de marché dans l'UE-27 par marque et groupe de marques généralistes historiquement implantés en Europe (2001-2023)
Source : Alochet et al. 2024, p. 42
Au final, même si les crises financières de 2008-2009 et de l'euro en 2013-2014 ont amplifié les chutes de production, le déclin de l'industrie automobile française a été quasiment constant sur ces deux décennies25(*).
3. Une structure de production toujours puissante, mais fragilisée par de nouveaux défis
a) Un tissu industriel fort sur le territoire national
(1) Un maillage du territoire par les sites de production automobiles, principalement des équipementiers
Forte d'une longue histoire, l'industrie automobile française dispose néanmoins encore aujourd'hui d'une base industrielle solide et d'un savoir-faire d'excellence sur le territoire national. Plusieurs constructeurs et équipementiers français ont une envergure mondiale : notamment Renault (environ 50 Md€ de chiffre d'affaires monde en 2023) ; Stellantis (environ 200 Md€), et les équipementiers Valeo (environ 20 Md€), Forvia (environ 30 Md€), et Plastic Omnium - désormais OPmobility (environ 10 Md€)26(*).
La France attire aussi de nombreux groupes étrangers, notamment Toyota pour la production de véhicules particuliers, sur le site d'Onnaing, mais également des équipementiers, notamment allemands (Bosch, Schaeffler, Continental). En tout, ce sont une douzaine de sites de production et d'assemblage de véhicules légers qui sont actuellement actifs en France (Stellantis, Renault, Toyota)27(*).
|
Toyota, seul constructeur étranger implanté en France Troisième constructeur présent en France bien que n'étant pas de nationalité française, Toyota a produit en 2024 10,8 millions de véhicules dans le monde. Présent en Europe depuis 1963, le groupe y a commercialisé 1,2 million d'unités en 2024 (830 000 véhicules produits en Europe). En France, Toyota est présent en tant qu'acteur industriel depuis 2001, avec plus de 1,5 Md€ investis. À Onnaing, sont produits les deux modèles phares de Toyota pour l'Europe, la Yaris et la Yaris Cross. Toyota revendique 12 000 emplois directs en France, dont 5 000 sur le site de Valenciennes. Aujourd'hui, Onnaing est le site qui produit le plus en France (près de 280 000 véhicules annuels), et le plus gros site de production de Toyota en Europe. |
Sites de production automobile en France (2024)
Nota bene : 12 modèles de véhicules électriques sont actuellement produits en France par Stellantis, Renault et Toyota et 8 doivent s'y ajouter d'ici 2027.
Renault a un objectif de production 100 % électrique en France d'ici 2030 (14 Mds€ d'investissements) en particulier sur le Pôle ElectriCity (aide publique de 81,5 M€, dont 60 M€ par l'État) pour 400 000 VE produits par an dès 2025 dans les Hauts-de-France.Selon les chiffres transmis par la DGE, la filière automobile française emploie actuellement plus de 800 000 personnes en France, dont environ 330 000 dans la seule filière amont, réparties en environ 4 000 entreprises.
(2) Le virage pris de la production de véhicules électriques
La France s'est fixé pour objectif de produire 2 millions de véhicules électriques d'ici à 203028(*). Selon les administrations interrogées, la trajectoire actuelle est en phase avec cet objectif (cf. ci-dessous).
Production de véhicules sur le territoire français, par type de motorisation (véhicules particuliers et utilitaires légers, en milliers)29(*)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Total production France |
2100 |
1290 |
1320 |
1360 |
1480 |
1330 |
|
dont électriques |
80 |
110 |
130 |
160 |
170 |
180 |
|
dont hybrides |
120 |
160 |
260 |
300 |
340 |
300 |
|
dont thermiques |
1900 |
1020 |
930 |
900 |
980 |
850 |
Source : DGE, données producteurs
Davantage que les productions thermiques, ces productions électriques devraient être relocalisées sur le territoire français, comme l'illustre la carte ci-dessous :
b) Des acteurs fragilisés par les mutations récentes de l'industrie automobile
(1) Des investissements colossaux des constructeurs dans l'électrique et le numérique
Le recul brutal des ventes affecte durement la profitabilité des constructeurs et leur capacité à investir. S'il est vrai que ces derniers ont connu ces dix dernières années - excepté ces tout derniers mois - des niveaux de profitabilité record, avec une marge avant investissement et intérêt régulièrement située entre 9 et 10 %30(*) (voire légèrement plus en sortie de crise sanitaire, grâce à des prix gonflés par la pénurie d'offres), en 2024, cette profitabilité moyenne n'était plus que de 7,1 %. Industrie à forts coûts fixes, l'industrie automobile voit en effet sa profitabilité fortement affectée dès que les marges baissent. Le premier semestre 2025 a également été marqué par un recul important de la profitabilité chez les deux constructeurs français, traduit par une perte nette de 2,3 Md€ pour Stellantis et une réduction de la marge opérationnelle pour Renault.
Or ces mauvais résultats financiers affectent des entreprises qui ont massivement investi dans l'électrique : selon Luc Chatel, président de la PFA, auditionné par la commission des affaires économiques du Sénat le 2 octobre 2024, l'industrie automobile européenne aurait investi au total environ 200 Md€ sur trois ans - et doivent continuer de le faire. La transition vers l'électromobilité impose en effet aux constructeurs des investissements massifs dans le développement de nouvelles technologies, en particulier dans les domaines des batteries, des motorisations alternatives et des infrastructures industrielles associées. Ces derniers sont évalués à 10 à 30 Md€ par constructeur31(*). À titre d'exemple, les investissements de Volkswagen sur la période 2025-2029 s'élèveront à quelque 165 Md€, dont deux tiers consacrés à l'électrification et à la numérisation, tandis que Toyota a indiqué aux rapporteurs avoir prévu sur la période 2022-2030 56 M€ d'investissements pour l'électrification, dont la moitié pour les batteries, y compris les batteries solides, et la moitié pour les autres motorisations (hybride, hybride rechargeable et hydrogène32(*)).
Selon l'un des acteurs interrogés par la mission, Renault aurait engagé plus de 10 Md€ entre 2021 et 2025 via Ampere, ElectriCity et des partenariats avec AESC et Verkor, en vue de produire 1 million de véhicules électriques par an d'ici 2030. Quant à Stellantis, il aurait mobilisé plus de 50 Md€ d'ici 2030, dans le cadre de son plan « Dare Forward ».
Cette mutation structurelle exerce une pression notable sur les marges opérationnelles et requiert une profonde adaptation des outils de production. Or paradoxalement, réaménager une usine existante pour y produire des véhicules électriques nécessite fréquemment des investissements plus importants que la construction d'une usine complètement nouvelle, faisant de la longue histoire industrielle de l'Europe, paradoxalement, plutôt un handicap qu'un atout.
Et ce, alors que l'évolution des comportements et des attentes des consommateurs - notamment la montée en puissance des services de mobilité partagée, la digitalisation de l'usage automobile et le recul de la notion de propriété - impose aux constructeurs une réorientation stratégique profonde, fondée sur une diversification de l'offre et une plus grande agilité.
Outre-Rhin, le puissant groupe Volkswagen, affecté en particulier par le recul de ses ventes en Chine, a entrepris à l'automne 2024 un réalignement structurel, négocié avec les syndicats, baptisé « Zukunft Volkswagen » (« Futur Volkswagen »), destiné à assurer la soutenabilité de l'entreprise dans les années à venir, via : un allègement durable des coûts de personnel (1,5 Md€ par an jusqu'en 2030, notamment grâce à une réduction des effectifs de plus de 35 000 personnes d'ici 2030) ; un ajustement de la capacité de production en Allemagne, avec une réduction d'environ 730 000 unités, notamment par l'arrêt progressif de la production de véhicules à Dresde et Osnabrück33(*), ainsi que la rationalisation des lignes de production dans d'autres sites allemands. L'objectif de cet ensemble de mesures est d'engendrer des économies de plus de 4 Md€ à moyen terme, pour un total de plus de 15 Md€ d'ici 2030.
(2) Les équipementiers, premières victimes des réductions de coût
La mission a bien évidemment tenu à rencontrer les principaux équipementiers français, ainsi que ses représentants. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev), les équipementiers représentent en effet 85 % du prix de revient industriel des véhicules, et environ 56 000 emplois en France.
Bien que ne servant pas uniquement les constructeurs nationaux, les équipementiers français et européens ont subi les conséquences, dans la dernière décennie, des baisses de production en Europe de l'Ouest - et ce, malgré un gros effort fait pour maintenir l'empreinte industrielle en France, comme l'a souligné devant les rapporteurs le président de Valeo, qui a fermé seulement quatre usines entre 2007 et 2024 (de 27 à 23 usines).
Part de la filière automobile amont (équipementiers et fournisseurs uniquement) dans l'industrie manufacturière
Source : CFTC (données Eurofound)
En outre, dans la période récente, la dynamique suivie par la profitabilité des équipementiers a été inverse de celle des constructeurs, avec un point bas en 2022, dû à l'effet ciseau de l'inflation des coûts des matières premières, de la main-d'oeuvre et de l'énergie, et de la pression des constructeurs, doublée de volumes de commandes relativement faibles. Malgré un léger sursaut en 2023, leur profitabilité est à nouveau faible en 2024, certains des équipementiers interrogés ayant fait état de moins de 1 % de profit. Elle risque en outre de se détériorer encore, en raison de la volonté des constructeurs de s'approvisionner à bas coût, qui se traduit soit par une pression sur les prix, soit par un sourçage extra-européen.
82 %des équipementiers automobiles français ont ainsi vu leur chiffre d'affaires baisser entre 2019 et 2024, avec même et pour près d'un quart d'entre eux, une baisse supérieure à 30 % ! En « bout de chaîne », les fournisseurs de rang 2 et 3 sont les plus pénalisés.
À titre d'exemple, l'équipementier Lisi, déjà mentionné34(*), a partagé ces chiffres avec les rapporteurs :
Par suite de cette perte de profitabilité, plusieurs restructurations et fermetures d'usines ont été annoncées à l'automne 2024 et au printemps 2025. Selon une enquête menée par la Fiev auprès de 35 équipementiers produisant en France, 45 % d'entre eux estiment que des sites français sont menacés, et la Fiev évaluait au printemps 2025 que 10 sites d'équipementiers supplémentaires pourraient fermer en France dans les 12 prochains mois. Parmi les cas emblématiques de fermetures, non liées à l'électrification, on peut citer la fermeture à l'automne 2024 d'Imperial Wheels, dernier fabricant de jantes en aluminium, mais aussi de l'usine de Valeo à La Suze-sur-Sarthe au printemps 2025.
En effet, même si la situation est contrastée entre des acteurs de rang mondial, qui ont eu les moyens d'anticiper les récentes évolutions du marché, et les « petits équipementiers » très spécialisés dans des produits peu adaptés aux nouveaux véhicules électriques, dans un contexte de baisse massive et durable des volumes des ventes en Europe, et de perte de compétitivité massive de l'Europe, même les acteurs aux « reins solides » comme Valeo ont des difficultés : le plan Valeo Power Up, annoncé à l'automne 2024, prévoit à la fois une poursuite des investissements dans la R&D et dans certains sites compétitifs, comme Étaples (moteurs électriques), Sablé-sur-Sarthe (électronique de puissance) ou Amiens (nouvelles générations d'embrayages) et une fermeture de site (La Suze-sur-Sarthe), assortie de réductions de postes (un peu moins de 700 départs contraints) sur huit autres sites.
OPmobility (ex Plastic Omnium) a également fait part aux rapporteurs de son très grand pessimisme sur l'avenir de la filière, estimant trop important le nombre de problèmes structurels.
Déplacement de la mission d'information dans le Doubs (12 juin 2025)
Lors d'un déplacement dans le département du Doubs, autour du site de Stellantis à Sochaux-Montbéliard, territoire historique de l'industrie automobile française, les trois rapporteurs ont pu découvrir tout un écosystème extrêmement performant de sous-traitants attachés à l'usine Stellantis, néanmoins fragilisé par la « nouvelle donne » de l'industrie automobile.
La visite de l'usine Stellantis de Sochaux-Montbéliard, site emblématique de l'industrie automobile nationale, a révélé l'ampleur des transformations en cours, pour partie pleinement appréhendées, avec des chaînes de montage « dernier cri », massivement robotisées et automatisées (près de 1 070 véhicules sortent quotidiennement des lignes, soit une voiture par minute), la plateforme STLA Medium permettant d'assurer une polyvalence entre motorisations thermique, hybride et électrique, pour répondre progressivement aux objectifs de 2035, mais aussi affectées par les baisses de volumes : l'usine, qui produisait encore 514 000 véhicules en 2019, table désormais sur une production annuelle de 250 000 unités en 2025, pour une capacité maximale de 400 000 véhicules.
Les échanges avec les responsables du site Stellantis de Sochaux, les élus locaux, les services déconcentrés de l'État et un panel d'équipementiers (Flex-N-Gate, IPM, FMX, F2J Japy), ont cependant mis en lumière une réalité industrielle et sociale particulièrement préoccupante, celle d'un écosystème en profonde mutation, qui peine à trouver sa place dans la trajectoire imposée du « tout électrique ». Un constat s'est imposé avec force : la transition engagée apparaît, pour une large partie des acteurs rencontrés, non pas comme une opportunité, mais comme une menace existentielle, d'autant que la stratégie industrielle du groupe, centrée sur des véhicules de gamme moyenne sans positionnement différenciant, interroge sur sa capacité à s'imposer face à la concurrence mondiale.
De leur aveu même, l'instabilité réglementaire constitue aujourd'hui l'un des principaux freins à l'investissement et à la projection stratégique. L'incertitude sur les normes environnementales, l'accélération des calendriers européens, le manque de visibilité sur les motorisations autorisées, ainsi que les coûts de l'énergie, alimentent une perte de confiance croissante. Plusieurs acteurs expriment désormais leur intention de se détourner du marché européen, jugé imprévisible, au profit de zones géographiques plus stables.
Consciente des risques liés à la disparition progressive des motorisations thermiques, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place une task force destinée à accompagner les sous-traitants. Cette démarche, menée en bonne intelligence avec les élus locaux, et qu'il convient de saluer, vise à encourager les reconversions vers d'autres filières industrielles (défense, nucléaire, hydrogène), mais elle se heurte à des obstacles structurels : faible mobilité de la main-d'oeuvre, concurrence salariale exercée par les cantons suisses voisins, et surtout, une implication limitée de Stellantis dans l'entraide avec son réseau de fournisseurs locaux.
C. SAUVER L'INDUSTRIE AUTOMOBILE FRANÇAISE : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ
L'industrie automobile française et européenne se trouve à un point de bascule : en l'absence d'inflexion rapide, des pans entiers de l'industrie pourraient disparaître à court terme, et des compétences être irrémédiablement perdues, ce qui signifierait, pour l'Europe, ne plus maîtriser l'intégralité de la chaîne de la valeur de la production automobile, y compris dans le thermique.
1. L'industrie automobile, colonne vertébrale de l'industrie française
a) Les plus gros bataillons de l'industrie française
Le risque le plus immédiat est bien entendu un risque social, lié aux pertes d'emplois induites par les fermetures de sites : en 2023, près de 350 000 salariés travaillaient dans la filière amont de l'automobile, dans environ 4 000 sites industriels35(*), pour environ 800 entreprises36(*).
Les sous-traitants représentent un peu plus de la moitié (53 %) des entreprises de la filière et 45 % de ses effectifs. Parmi eux, les secteurs les plus importants, que ce soit en termes de nombre d'entreprises, d'effectifs ou de chiffre d'affaires réalisé dans l'automobile, sont la fabrication de produits métalliques, les produits informatiques et les produits en caoutchouc. Ces derniers représentent plus d'un tiers des entreprises de la filière, pour 27 % des effectifs et 20 % de chiffre d'affaires réalisé dans l'automobile37(*).
L'aval de la filière, qui représente en 2024 environ 560 000 actifs, dans des domaines aussi divers que les garages, les auto-écoles ou encore les parkings, semble à première vue moins spécifiquement impacté par les difficultés propres aux constructeurs européens, mais bien plutôt de manière plus générale par les évolutions des modes de production - par exemple le gigacasting (littéralement : « méga-moulage ») qui réduit les possibilités de réparation - et la place croissante du logiciel dans les véhicules.
Certes, il est loin le temps où « Quand Billancourt éternue, la France s'enrhume », cependant, l'industrie automobile continue de faire office de baromètre de la santé économique du pays. Or 75 000 emplois seraient menacés d'ici 2035, dont 19 000 chez les équipementiers38(*), pour une perte nette de 56 000 emplois, compte tenu des embauches dans de nouveaux métiers39(*). Ces destructions d'emplois, qui s'ajouteraient aux 40 000 emplois déjà perdus depuis 2020, seraient très coûteuses d'un point de vue social.
b) L'industrie automobile, une industrie structurante pour l'industrie française
Industrie de volume, l'industrie automobile est structurante pour l'ensemble du tissu industriel national comme au niveau local, en structurant autour d'elle tout un écosystème de sous-traitants, dont certains sont peu délocalisables, de par la nature des composants produits, trop onéreux à transporter sur de très longues distances (pare-chocs, sièges...).
Remontant la chaîne de valeur, les acteurs de l'industrie chimique, entendus par les rapporteurs, ont également alerté sur les risques que faisait courir à l'industrie chimique la faiblesse des commandes de l'industrie automobile, qui représente une part non négligeable de ses carnets de commandes, et ce alors même que l'industrie chimique est elle-même confrontée à des problématiques de compétitivité et de concurrence internationale. Pour exemple, les débouchés dans le secteur automobile représentent environ 15 % de l'activité de l'entreprise Syensqo, spin-off40(*) de Solvay, qui estime que ses produits sont présents dans environ une voiture sur deux vendue sur le marché européen. Les produits de la chimie utilisés dans l'industrie automobile sont très divers, et plus ou moins impactés par les évolutions en cours sur le marché et dans l'industrie automobile : pour illustration, BASF a indiqué avoir à la fois une activité « coatings » (« revêtements » : solutions de revêtements haute performance, à savoir pré-traitement, peintures et anticorrosion) et une activité dédiée aux batteries.
Dans une période compliquée pour l'industrie chimique, l'électrification des véhicules représente un fort gisement de croissance et d'innovation pour la chimie, notamment les matériaux de spécialité (non seulement pour la chimie des batteries, mais également pour les revêtements et matériaux d'isolation électrique, ou encore pour de nouveaux matériaux plastiques à la fois résistants et légers, pour contrebalancer la masse supplémentaire représentée par la batterie...), tout comme la numérisation (production par exemple de fluoropolymères à haute performance en vue de fabriquer les semiconducteurs performants nécessaires, ou encore pour développer des technologies de peinture présentant une transparence ou une réflectivité permettant le bon fonctionnement des dispositifs de détection présents dans les véhicules).
Pour toutes ces raisons, une baisse prolongée de la demande induirait donc un risque de baisse pérenne de production dans des usines chimiques déjà fragilisées, l'imprévisibilité dans la filière des batteries étant particulièrement pénalisante pour la chimie de spécialité.
Or, au contraire des produits finis, un certain nombre de produits chimiques souffrent difficilement le transport. La fermeture de sites de production de chimie de base aurait donc un impact sur toute la chaîne aval de la chimie, qui ne disposerait plus des matières premières nécessaires à ses activités. À terme, c'est ainsi toute la chaîne de la chimie qui sera en danger avec des industriels en aval qui dépendront donc de la chimie hors Europe, fragilisant en retour l'industrie européenne.
Syensqo a par exemple cité aux rapporteurs le cas du polyfluorure de vinylidène (PVDF), matériau critique pour la production de batteries, qui n'est produit que sur deux sites en Europe : la fragilisation d'un seul de ces deux seuls sites pourrait compromettre la prétention de l'Europe à la souveraineté pour la production de batteries pour les véhicules électriques, mais aussi, par ricochet, pour d'autres industries qui utilisent ces mêmes matériaux).
Enfin, l'industrie automobile a un effet d'entraînement particulièrement fort pour le R&D41(*).
2. Un enjeu de souveraineté
a) Conserver sur le sol national des compétences critiques pour l'industrie de défense
Le secteur automobile est l'un des principaux débouchés pour beaucoup de filières : de la sidérurgie à la plasturgie en passant par le textile, le verre et céramique ainsi que la chimie. Mais un certain nombre des sous-traitants de la filière travaillent également, en part minoritaire, pour l'industrie de défense. Le maintien des compétences des équipementiers automobiles est donc aussi crucial pour assurer le maintien sur le territoire national de compétences et d'outils de production capables de fabriquer également du matériel militaire.
Réciproquement, d'ailleurs la montée en puissance des capacités de production de matériel militaire pourrait servir de relais de croissance pour certains équipementiers fragilisés par la baisse des volumes dans le secteur automobile : c'est notamment l'exemple des Fonderies de Bretagne, qui à la suite de leur rachat par Europlasma, ont entamé leur reconversion dans la production d'obus, à la suite du désengagement de Renault.
b) Un enjeu sécuritaire sur les données
Même si, compte tenu de son ampleur, ils n'ont pas pu approfondir le sujet, les rapporteurs tiennent à alerter sur les risques liés à la protection des données personnelles et non personnelles traitées par les logiciels contenus dans les véhicules.
Ces risques peuvent être liés :
- d'une part, à des performances insuffisantes en matière de sécurité, susceptibles de créer des fuites de données personnelles et non personnelles potentiellement préjudiciables non seulement à la protection de la vie privée, mais également à la sécurité des véhicules. Compte tenu de la complexité croissante des véhicules intelligents, les vulnérabilités potentielles - susceptibles d'augmenter avec les capacités croissantes des pirates informatiques -, doivent être sérieusement étudiées. Pour les constructeurs, l'octroi à des tiers d'un accès général et illimité aux données, aux fonctions et/ou aux ressources d'un véhicule ne ferait qu'augmenter les risques en matière de cybersécurité, tout l'enjeu étant de calibrer ces restrictions d'accès de manière à ce qu'elles soient suffisantes, sans toutefois constituer d'entraves injustifiées à l'activité économique ;
- d'autre part, au contrôle effectué de facto par des constructeurs extra-européens sur leurs véhicules vendus sur le marché européen, qui leur donne virtuellement la capacité de bloquer le trafic à distance. Même si le taux de pénétration du marché européen rend actuellement la menace relativement peu inquiétante, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, on peut s'interroger sur l'impact d'une telle situation sur notre souveraineté.
Pour ces deux raisons, la cybersécurité devrait être considérée comme une problématique fondamentale, dans le domaine de l'automobile. Les rapporteurs notent d'ailleurs que les États-Unis interdisent la commercialisation sur leur sol de véhicules chinois connectés, pour des raisons de sécurité intérieure. Les atouts de l'Europe en matière de numérique, et en particulier de cybersécurité, devraient lui permettre, sans risque d'une perte de qualité du service rendu, de mettre en place des normes strictes, garantissant que les véhicules connectés produits hors de l'Union européenne ne présentent pas de risques de prise de contrôle à distance ou autres failles de cybersécurité.
Au-delà de ce risque sécuritaire direct, il est également évident que l'industrie automobile européenne - comme l'ensemble des activités économiques européennes - est trop dépendante de l'Amérique du Nord pour la gestion de ses données et, partant, pour les gisements d'innovation future.
II. MESURES D'URGENCE POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
A. PROTÉGER LE MARCHÉ EUROPÉEN POUR LAISSER LE TEMPS À L'INDUSTRIE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE DE RATTRAPER SON RETARD
1. Protéger les constructeurs et les équipementiers de la concurrence étrangère
a) Des barrières douanières ont déjà été mises en place, pour contrer la concurrence déloyale et le dumping, mais elles demeurent insuffisantes
(1) L'Union européenne a instauré des droits anti-subvention...
Le droit européen, en accord avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), permet sous certaines conditions d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations dans l'Union européenne, lorsqu'elles menacent de causer un préjudice économique aux producteurs de l'Union, et que ce préjudice découle de pratiques jugées déloyales, qu'il s'agisse de pratiques de dumping42(*) (pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national, ou même inférieurs au prix de revient) ou de subventionnement indu43(*). Ces droits de douane supplémentaires visent à rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union.
En ce qui concerne les subventions indues, les droits de douane compensatoires qui peuvent être imposés correspondent au niveau de la marge de subvention dont l'existence a été établie.
En ce qui concerne les importations d'automobiles, l'Union européenne a, après s'être auto-saisie et avoir ouvert une enquête pour pratiques commerciales anticoncurrentielles en octobre 2023, édicté en juillet 2024 des mesures provisoires (devenues définitives en octobre) de relèvement des droits de douane contre certaines productions extra-européennes, allant de 7,8 % pour Tesla à 35,3 % pour les entreprises non-coopérantes, notamment le Chinois SAIC44(*).
Suite à l'imposition de ces mesures, les volumes d'importation de véhicules chinois ont diminué de près de 20 % : la part de marché des importations chinoises sur le marché européen, qui avait atteint 27 %, se situe à présent légèrement en-dessous de 20 %. La Commission n'a observé aucune augmentation significative du prix des véhicules chinois vendus sur le marché européen45(*).
Pour rappel, au-delà de l'Union européenne, d'autres pays comme le Brésil, le Canada, la Turquie et les États-Unis (taxe de 100 % avant même les récents relèvements) ont également imposé des droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois.
Pour utiles qu'ils soient, ces droits compensateurs sont cependant arrivés trop tard, et leur champ d'application demeure trop limité, puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux produits finis, et non aux importations de composants, ni même aux véhicules semi-finis : le député européen François Kalfon, interrogé par les rapporteurs, a cité le cas de conteneurs remplis de voitures chinoises en attente d'entrée sur le territoire européen, auxquelles ne manquaient que les quatre roues, ce qui leur permettait d'échapper aux barrières douanières. Aucun droit compensateur ne touche notamment les batteries, qui bénéficient d'un taux de 1,3 % seulement. Enfin, ces droits compensateurs ne concernent que les véhicules « tout électrique » (y compris lorsqu'ils sont équipés de prolongateurs d'autonomie), à l'exclusion notamment des véhicules hybrides, sur lesquels les importations chinoises sont également en forte progression.
En outre, la Commission n'a activé contre les véhicules chinois que l'outil anti-subvention, et non pas l'outil antidumping, qui, de l'avis de nombreux experts, aurait sans aucun doute également pu être mobilisé.
De fait, comme l'a exposé aux rapporteurs Denis Redonnet, directeur général adjoint à la DG Trade, la réaction de la Commission avait comme unique objet de rééquilibrer les prix, et non pas de fermer le marché européen aux producteurs chinois. Il a également indiqué que la position de la Commission vis-à-vis des États-Unis était également d'assurer des règles du jeu équitables (dites souvent : « level playing-field »).
(2) ... mais ces derniers ne suffiront pas à sauver l'industrie européenne
Au vu des limites de la doctrine européenne sur les droits de douane, dictée par un respect scrupuleux des règles de l'OMC, il semble indispensable, comme l'a exprimé aux rapporteurs M. Olivier Prost, avocat spécialiste du commerce international et conseiller du commerce extérieur, de « réinventer l'équilibre entre commerce international et politique industrielle », que l'OMC n'a selon lui pas su préserver, et ce, en exploitant toute la palette des outils juridiques de commerce international, « des instruments de défense commerciale aux règles d'origine, en passant par les règles d'accès aux marchés, la réciprocité ou encore le contenu local ».
À sa suite, même si les rapporteurs demeurent attachés au cadre du multilatéralisme et de l'ouverture réciproque des marchés, ils estiment légitime de s'interroger sur le respect unilatéral par l'Union européenne de ces règles.
Pour O. Prost en effet, « les règles de l'OMC sont extrêmement flexibles et [...] tant les États-Unis que la Chine ont constamment testé les limites de cette flexibilité pour adopter des mesures servant leurs intérêts économiques, que ce soit protection de la sécurité intérieure, objectifs environnementaux ou sociaux. Il serait difficile de comprendre pourquoi l'Europe n'utiliserait pas les mêmes flexibilités pour protéger des industries stratégiques, assumer ses objectifs climatiques et maintenir son modèle social ».
Par conséquent, les rapporteurs recommandent d'imposer des barrières douanières massives vis-à-vis des acteurs chinois de l'industrie automobile - comme, du reste, la Chine l'a fait elle-même dans les années 2000 - afin de protéger l'industrie européenne, et en particulier l'industrie naissante des batteries et du véhicule électrique, le temps que ces dernières arrivent à maturité, en assumant un effet d'éviction temporaire du marché européen des constructeurs chinois. Il s'agit d'un outil indispensable pour obliger les acteurs chinois à s'implanter en Europe, et à faire bénéficier les acteurs européens de transferts de technologie46(*). Les lacunes de régulation ou la régulation très partielle par l'OMC de nombreux domaines comme l'investissement, la fiscalité, les subventions industrielles ou encore les marchés publics47(*), justifient pleinement cette politique.
Même si, compte tenu de l'instabilité actuelle des taux douaniers, toute proposition chiffrée demeure hasardeuse, les marges importantes des constructeurs chinois sur le marché européen imposent que ces relèvements soient massifs, faute de quoi les constructeurs chinois pourront maintenir leurs importations en Europe en « rognant » sur leurs marges.
Il sera en outre indispensable de s'assurer que ces nouveaux droits de douane seront respectés, en renforçant les contrôles pour éviter toutes sortes de fraudes (fraudes à l'origine, à la classification douanière, à l'évaluation en douane...), et trouver des parades contre l'établissement d'usines « tournevis » destinées à les contrecarrer48(*). Ils devront en outre s'appliquer, pour ne pas pouvoir être contournés, à toute une série de composants-clés.
Ces droits de douane devront en revanche être strictement temporaires, en donnant de la visibilité aux industriels sur l'échéance de leur disparition progressive. En effet, ainsi que l'a souligné également Olivier Prost devant les rapporteurs, « vouloir traiter le défi industriel chinois n'exonère en rien les Français et les Européens de faire "le ménage chez eux", bien au contraire ». Pour soutenir la dynamique de montée en puissance des industriels européens, et l'innovation, notamment dans l'électrique, et, de manière plus globale, renforcer leur compétitivité, les quelque 500 M€ déjà récoltés par l'imposition de surtaxes à l'entrée de véhicules tiers dans l'Union - selon la DG Trade - pourraient être utilisés pour soutenir la filière.
En effet, sur le long terme, les mécanismes tels que les droits compensateurs apparaissent généralement peu adaptés pour renforcer durablement la compétitivité de l'industrie automobile européenne : une durée excessivement prolongée de ces droits renforcés ne ferait qu'accentuer le retard européen et creuser l'écart de compétitivité. Chance pour le consommateur européen, l'arrivée de nouveaux concurrents extra-européens plus performants et compétitifs constitue également pour les industriels européens, comme l'a souligné devant les rapporteurs l'un des constructeurs interrogés, un levier puissant d'innovation et de progrès technologique.
C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Acea, et plusieurs industriels allemands, plus exposés en Chine, sont réservés sur une telle proposition. Pour elle, les barrières douanières ne pourront découler que sur des « ghettos technologiques », et desservir in fine l'industrie européenne.
Les sous-traitants français soutiennent en revanche farouchement cette méthode.
Recommandation n° 4 : Relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois afin de limiter drastiquement les importations et de rétablir une concurrence équitable sur le marché européen, le temps que les acteurs européens se « mettent à niveau ».
2. Favoriser les contenus européens pour les véhicules vendus en Europe
a) L'instauration d'un contenu local et le renforcement de la solidarité de filière
(1) Une augmentation exponentielle des composants extra-européens dans les véhicules européens
Du fait des fortes pressions exercées par les constructeurs sur les coûts, les importations de pièces automobiles en provenance de Chine n'ont cessé d'augmenter au cours des dix dernières années. Le déficit de l'Union européenne sur les pièces détachées avec la Chine en 2024 est de 1,6 M€ hors batteries (21 Md€) si l'on inclut les batteries, contre un excédent de 7,7 Md€ en 2014. Si l'on exclut l'Allemagne, le déficit pour tous les autres pays de l'Union en 2024 est de 7,6 M€ (contre 0,5 M€ en 2014). Même pour l'Allemagne, qui bénéficie de volumes importants de voitures allemandes exportées et fabriquées en Chine, l'excédent commercial des pièces automobiles avec la Chine a diminué de 2,2 milliards d'euros depuis 2014.
En France également, les statistiques du commerce extérieur montrent clairement que la part des importations extra-européennes augmente, pour toute une série d'équipements (même si cette part de sourçage extra-européen demeure pour l'instant inférieure à 20 %). Selon une enquête menée par la Fiev auprès de 35 équipementiers produisant en France, 85 % d'entre eux ont fait l'objet ou identifié un risque de « dessourcing »49(*) en France et en Europe, au profit de concurrents basés dans les pays à bas coût.
Selon Christophe Périllat, directeur général de Valeo, le contenu européen est de 90 % sur les véhicules thermiques, mais n'est plus que de 40 % à 60 % sur les véhicules électriques.
Une étude toute récente commandée par le Clepa, syndicat européen des équipementiers, confirme que l'industrie européenne des composants automobiles pourrait perdre près du quart de sa valeur créée et 350 000 emplois d'ici 2030, en l'absence de réaction.
Source : Fiev
(2) Instaurer un pourcentage minimal de contenu européen pour les véhicules vendus en Europe
Afin d'éviter un bouleversement encore plus massif de la chaîne d'approvisionnement, plusieurs des acteurs interrogés par les rapporteurs, tant équipementiers qu'économistes, ont suggéré l'instauration d'un pourcentage minimal de contenu européen dans les véhicules vendus en Europe, oscillant entre 75 % et 80 %.
À l'initiative de Christophe Périllat (Valeo), les trois premiers équipementiers français (Valeo, Forvia et OPmobility) ont, avec leurs homologues italiens (Brembo et Adler Plastic), demandé officiellement à la Commission européenne l'instauration d'un tel seuil de « contenu local » dans les voitures vendues en Europe.
Les rapporteurs soutiennent cette demande, et s'appuient pour cela sur une étude du Groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile (Gerpisa) qui démontre qu'entre 2009 et 2024, plus de 5 000 politiques de contenu local ont été mises en place, sur tous les marchés, dont moins de 1 % en Europe (principalement, outre la Chine (notamment sur les batteries et les semi-conducteurs) au Brésil, aux États-Unis, en Inde, en Arabie saoudite, en Indonésie, en Russie et au Canada)50(*), avec une accélération dans la période post-Covid. Au sein de l'accord de libre-échange nord-américain, les États-Unis imposent au Mexique et au Canada un seuil de contenu minimal, tout comme la Chine, qui impose fréquemment une production locale, voire, pour les acteurs étrangers, une co-entreprise avec des acteurs chinois. De même, l'Accord de coopération commerciale avec le Royaume-Uni oblige à l'utilisation de matériaux actifs de cathode d'origine européenne pour bénéficier d'une exonération de droits de douane sur les véhicules électriques exportés, ce qui a eu un impact positif sur les décisions d'investissement dans ce domaine.
Selon la même étude du Gerpisa, 14 % de ces politiques concernent l'industrie automobile. Les auteurs de l'étude n'ont en outre trouvé aucune preuve d'augmentation des prix ou de réduction de la compétitivité internationale à long terme suite à la mise en place de ces politiques.
Les rapporteurs soutiennent donc cette initiative, remarquant d'ailleurs que le renforcement des droits de douane aux États-Unis, en rendant l'accès au marché européen plus crucial pour les acteurs évincés du marché états-unien, crée des conditions favorables pour la mettre en place.
Ils soulignent en outre que ces règles de contenu européen doivent concerner non seulement les véhicules électriques et les batteries, mais également l'ensemble des équipements automobiles, et non uniquement les batteries, comme le prévoit pour l'instant le plan d'action industriel en faveur de l'industrie automobile de la Commission européenne. Cette dernière représente en effet 30 à 40 % « seulement » de la valeur d'un véhicule électrique, ce qui laisserait « sur le banc » l'ensemble des autres équipementiers. Compte tenu de l'état des marchés sur les matières premières par exemple, il serait illusoire d'exiger dans l'immédiat un taux trop élevé en ce qui concerne les batteries.
Elles devront également s'appliquer aux équipements automobiles spécifiques aux véhicules thermiques : comme l'ont indiqué aux rapporteurs les équipementiers auditionnés, dans les difficultés de court terme des équipementiers (3-5 ans), ce sont ces équipements thermiques qui assurent le plus gros des revenus, plus des trois quarts des ventes de véhicules neufs concernant encore des véhicules thermiques.
En outre, imposer un seuil trop bas serait sans effet puisque, selon la DGE, 40 % des pièces d'une voiture sont de toute façon produites localement, car elles sont difficilement transportables (grosses pièces d'emboutissage, des pare-chocs, sièges assemblés, planches de bord, panneaux de porte assemblés ou système d'échappements).
Ces mesures de contenu local pourraient soit prendre la forme d'obligations directes sur les constructeurs, soit de conditions pour l'obtention de certains financements ou marchés nationaux ou européens. (la Fiev recommande par exemple de les utiliser notamment dans les marchés publics, les programmes de décarbonation des flottes d'entreprise, les politiques d'incitation à l'achat de véhicules zéro émission).
Elles ne pourraient dans tous les cas, entrer en vigueur que dans plusieurs années, le sourçage, dans l'industrie automobile, se faisant à 3 à 5 ans.
(3) Une solution non consensuelle
Si elle est fortement soutenue par les équipementiers français, cette solution ne fait pas l'unanimité, ni au sein de la filière ni entre États membres.
Matthias Zink, président-directeur général de l'équipementier allemand Schaeffler, ou Ola Källenius, président de Mercedes-Benz, ont ainsi plusieurs fois exposé dans la presse les éventuels impacts d'une telle stratégie sur leurs propres chaînes d'approvisionnement, craignant des mesures de rétorsion de la part de la Chine, d'autant plus préjudiciable que l'industrie automobile européenne a besoin de certains matériaux qui ne sont produits qu'en Chine.
Comme eux, Volkswagen a fait part aux rapporteurs de ses réticences face à cette solution, contraire selon lui aux règles de libre-échange, tout comme Toyota, dont les représentants ont indiqué aux rapporteurs qu'« il ne faut pas empêcher les constructeurs de se fournir là où ils veulent ». Il y a un équilibre à trouver entre ne pas trop contraindre les constructeurs dans la réduction de leurs coûts, et ces enjeux. De même, Toyota indique qu'elle « n'encourag[e] pas les mesures protectionnistes : les partenariats stratégiques et le maintien d'un environnement de marché concurrentiel étant nécessaires pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement à long terme ». Forte de son expérience, Toyota estime ainsi que « l'industrie construira la chaîne d'approvisionnement locale dès que le marché atteindra une dimension critique », en s'appuyant sur le cas des HEV Toyota, initialement importées du Japon, et pour lesquels Toyota a localisé sa production dans l'Union européenne dès que la demande locale a atteint un certain niveau.
Les acteurs allemands ne sont pas les seuls à être précautionneux : les Scandinaves et les Pays-Bas, attachés au multilatéralisme, veulent aussi que l'Europe se tienne aux règles de l'OMC.
De fait, François-Xavier Bellamy, député européen, a exposé aux rapporteurs combien cette solution paraît très « franco-française » à certains de nos partenaires européens moins en peine à l'export, et leur apparaît comme une pirouette pour compenser les insuffisances de la France en termes de compétitivité, et notamment de coût du travail.
Les rapporteurs notent d'ailleurs que les constructeurs français, qui « profitent » également des conditions avantageuses de production en Chine et se fournissent abondamment dans les pays à bas coût (Renault, historiquement français, produit désormais seulement 17 % de ses véhicules en France et réalise plus de 80 % de sa production hors d'Europe, son alliance stratégique avec Nissan et Mitsubishi renforçant son caractère international grâce à des chaînes logistiques et technologiques intégrées à l'échelle mondiale), sont restés discrets sur le sujet.
Cependant, les autres mesures de protection contre les importations chinoises semblent à ce stade insuffisamment efficaces. En ce qui concerne, par exemple, le mécanisme de « taxe carbone aux frontières », les réels progrès accomplis par les fournisseurs chinois en matière de décarbonation et le coût limité en CO2 du transport maritime l'empêchent de constituer un filtre efficace pour protéger la filière équipementière européenne - ceci étant valable également pour certains pays africains où les concurrents chinois sont installés en « nearshoring »51(*) (par exemple au Maroc qui a une énergie fort décarbonée).
Une autre critique contre le mécanisme met d'ailleurs en lumière les relations dégradées entre constructeurs et fournisseurs, et met en cause les stratégies des premiers. L'un des équipementiers interrogés a par exemple exposé que « les relations entre fournisseur et donneur d'ordre reposent sur des mises en concurrence régulières et des « demandes de gain de productivité » annuelles (i.e. réduction des coûts unitaires au cours du contrat) » et que pour les équipementiers, les incertitudes sur les volumes de production de chaque modèle « génèrent des surcoûts et des complexités (stop-and-go, recours à l'activité partielle, paiement partiel des dépenses de conception et d'investissement...) ».
Les syndicats interrogés par les rapporteurs se sont montrés particulièrement critiques des stratégies adoptées par les deux constructeurs français vis-à-vis des équipementiers, dénonçant pêle-mêle des conditions générales d'achat déséquilibrées ; une ingérence dans les stratégies d'implantations industrielles (en poussant les équipementiers à délocaliser vers le Maroc ou la Turquie) ; des baisses brutales des volumes, sans possibilité de compensation ; des hausses de volumes tout aussi brutales, sans délai de prévenance, nécessitant la mise en place d'heures supplémentaires, l'emploi d'intérimaires, et engendrant la désorganisation du travail ; des demandes tarifaires ne prenant pas en compte les hausses des coûts des matières premières et de l'énergie. De même Toyota estime qu'« [i]l est primordial de soutenir les fournisseurs de rang 1 à 5, avec une proximité géographique avec des sites de production. La désindustrialisation commence par la fuite des fournisseurs. Il faut éviter la situation qu'a connue l'Angleterre avec le départ de ses équipementiers ; pour rappel, les fournisseurs représentent 80 % du coût de la voiture ».
Pour autant, tous ne soutiennent pas l'idée d'un contenu local minimum : la CFTC notamment estime qu' « il faut laisser le marché relativement libre », et plutôt parier sur un « fabri-score » (équivalent de l'éco-score, avec en outre la prise en compte des conditions sociales de fabrication).
Ainsi, la modification des règles ne serait, pour eux, pas nécessaire, pour peu que les constructeurs « jouent le jeu ». Pour les rapporteurs, un rééquilibrage de la relation entre constructeurs et équipementiers serait d'autant plus bienvenu que la relation entre les constructeurs et les « grands équipementiers » ont récemment évolué d'une relation de donneur d'ordres à exécutant vers davantage de co-développement, ce qui favorise l'innovation. Les ingénieurs logiciels de Valeo sont par exemple co-localisés avec ceux de Renault pour le SDV. Renault et Valeo ont également travaillé étroitement avec leur équipe de design sur la R5 pour réinterpréter les lignes historiques de cette dernière, et notamment de ses systèmes d'éclairage, tout en s'adaptant à la réglementation et aux technologies actuelles.
« Mieux traiter » les équipementiers pourrait ainsi contribuer à accroître la compétitivité et le rythme d'innovation, dans un contexte de concurrence avec la Chine. Cela permettrait en outre aux constructeurs de s'assurer du maintien en Europe, sur le long terme, de capacité de fournitures nécessaires à leur propre activité.
Recommandation n° 5 : Imposer un contenu local européen pour les véhicules vendus en Europe, de l'ordre de 80 % pour les composants hors batterie, et fixer un objectif d'au moins 40 % des batteries utilisées dans les véhicules vendus en Europe produites localement, à partir de 2035.
b) Une mesure complémentaire : généraliser l'éco-score à l'échelle européenne
L'une des critiques souvent faites à la réglementation européenne est que, en s'intéressant uniquement aux émissions « à l'échappement », elle favorise les véhicules électriques - sur lesquels les constructeurs européens sont peu compétitifs - quel que soit leur lieu de production, sans prendre en compte les émissions tout au long du cycle de vie du véhicule, de la production à la revalorisation. En effet, alors que pour les véhicules thermiques, plus des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre sont liées à leur usage, la production représentant moins d'un quart, pour les voitures électriques, c'est de l'ordre des trois quarts de l'impact climatique qui se concentrent sur la production du véhicule, tandis que l'usage émet peu de CO252(*).
Par conséquent, sur ce type de véhicules, l'analyse en cycle de vie (ACV) des émissions est particulièrement pertinente pour favoriser les productions localisées dans des États utilisant de l'énergie décarbonée : prendre en compte les émissions lors de la production amoindrit considérablement l'avantage environnemental représenté par les véhicules produits en Chine.
Émissions « du puits à la roue » des véhicules électriques et hybrides53(*)
Source : gracieusement fourni par Xavier Mosquet
Forte de son énergie nucléaire décarbonée, la France est particulièrement bien positionnée par rapport non seulement aux acteurs chinois, mais également à ses concurrents européens, dont elle excède les performances en matière d'émission de gaz à effet de serre, dans une approche « du puits à la roue », ainsi que le montre le graphe ci-dessus.
Pour cette raison, la PFA suggère de conditionner les aides en Europe à un contenu local significatif des véhicules permettant de concilier les enjeux écologiques (éco-conditionnalité), industriels et sociaux (souveraineté et emplois) avec le maintien d'un marché ouvert et compétitif.
De fait, en France, les aides à l'achat de véhicule électrique ont intégré depuis la fin de l'année 2023 des critères environnementaux (éco-score) basés sur l'ACV, afin de mieux valoriser les productions réalisées en Europe, ce qui a permis, selon la DGE, de diviser par plus de deux la part des véhicules électriques vendus en France provenant de Chine.
Source : Secrétariat général à la planification écologique, avril 2025 (document fourni par A. Bigo)
Dans le même temps, la part des véhicules électriques fabriqués en France et vendus localement a augmenté significativement, passant de 17 % en 2024 à 29 % en 2025, tandis que les constructeurs français n'ont pas observé une évolution similaire à l'échelle mondiale, leurs ventes et parts de marché dans d'autres régions clés étant restées relativement stables.
Les rapporteurs estiment donc utile de légiférer au niveau européen sur le contenu CO2 de la production de véhicules, mais aussi de batteries, et d'autres productions clés comme l'acier, afin de mieux valoriser l'électricité nucléaire et de prendre en compte le mix énergétique très carboné de la Chine dans sa production de batteries. L'ONG T&E a également fait une proposition en ce sens, qui, au niveau européen, combinerait des critères d'efficacité énergétique (en kWh/100 km) et l'empreinte carbone de la batterie, de l'acier et de l'aluminium employés au stade de la production, qui représentent ensemble près des trois quarts de l'empreinte carbone des voitures électriques.
L'absence de critères communément acceptés et uniformément appliqués concernant un tel éco-score risque cependant d'entraîner une fragmentation du marché européen et une incertitude réglementaire susceptible de décourager les investissements dans la filière électrique. Aussi, les rapporteurs suggèrent la mise en place d'un éco-score harmonisé au niveau européen.
Recommandation n° 6 : Créer un éco-score européen harmonisé, intégrant, outre l'empreinte carbone à l'échappement, l'empreinte carbone de l'ensemble de la production du véhicule (a minima l'assemblage et la production des matériaux et composants clés), de la fabrication de la batterie et du transport.
B. ALLÉGER LA CONTRAINTE DU 100 % ÉLECTRIQUE
1. Des objectifs de réduction des émissions fixés dans le cadre du Green Deal sans anticipation
a) Des objectifs politiques, fixés en dépit des réalités industrielles
« Grand oeuvre » de la première mandature d'Ursula van der Leyen à la tête de la Commission européenne, le Pacte vert pour l'Europe (« Green Deal ») a fixé un objectif de neutralité carbone pour l'Union européenne à horizon 2050. Dans ce cadre, il a notamment été décidé en 2023 l'interdiction en 2035 de la vente de voitures et véhicules utilitaires légers neufs54(*).
Les véhicules particuliers sont en outre soumis depuis 2021 aux termes de la réglementation européenne dite « Cafe » (« Corporate Average Fuel Economy »), à des obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à cette date. En 2025, les émissions de CO2 devaient ainsi avoir baissé de 15 %par rapport à 2020.
Dans le cadre du Pacte vert, le ciblage sur l'automobile n'a, en soi, rien d'illégitime : en France, la route est responsable de près d'un tiers des émissions de CO2 (20 % environ pour les véhicules particuliers, voitures et utilitaires55(*)), ce qui fait d'elle le principal poste d'émission du pays, et contrairement aux émissions des autres secteurs, celles du transport n'ont pas diminué depuis les années 1990, en raison de l'accroissement continu du nombre de kilomètres parcourus et de la hausse du poids de véhicules. Une toute récente étude de Santé publique France estime à 40 000 le nombre de décès attribuables chaque année en France à la pollution de l'air en général56(*).
Cependant, les rapporteurs remarquent que l'Union européenne est quasiment la seule entité politique au monde à avoir décidé la fin des véhicules émetteurs de CO2 (à l'exception de la Californie, qui s'est fixé également un objectif de fin des ventes de véhicules thermiques à horizon 2035)57(*). En Europe hors Union européenne, le Royaume-Uni, qui avait annoncé l'interdiction des motorisations non électriques en 2030, a récemment reporté l'échéance en 2035.
Cependant, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035 a été adoptée à la suite d'un calcul mathématique assez simpliste : le parc automobile se renouvelant en moyenne tous les 15 ans, et l'Union s'étant fixé un objectif de neutralité carbone en 2050, c'est en 2035 que les ventes de véhicules neufs aux émissions non neutres devaient être interdites. Aucune étude d'impact sérieuse n'a préalablement évalué les conséquences de cette décision sur l'industrie automobile européenne.
Comme le résumait dans une tribune au Monde en avril dernier Tommaso Pardi, chercheur au CNRS et directeur du Gerpisa à l'ENS Paris-Saclay - par ailleurs entendu par les rapporteurs, « l'Union européenne a mis la charrue avant les boeufs [...] se fixant comme objectif 100 % de véhicules zéro émission vendus d'ici à 2035, mais sans s'assurer alors qu'on ait les matériaux, les technologies et les capacités industrielles pour produire des batteries européennes ni se donner les moyens de politique industrielle pour structurer cette nouvelle filière », au rebours de l'approche de la Chine, où le pari de l'électrique a été « conç[u] dès le départ [...] comme le moyen de créer une nouvelle industrie de taille mondiale »58(*).
« Pour transformer son marché
automobile, l'Union européenne
a mis la charrue avant les
boeufs ».
Tommaso Pardi, chercheur
Ainsi que l'exprime encore limpidement l'un des constructeurs entendus par la mission, « [l]e législateur européen a remplacé l'ingénieur sans écouter le client et sans étude d'impact suffisante pour décider si une technologie naissante devait remplacer toutes celles qui étaient maîtrisées et toutes celles en cours de développement. Les décisions d'hier ont, comme nous l'avions annoncé depuis plusieurs années, des conséquences sur le futur en conduisant à réorienter les investissements. » Ainsi, « [l]e cadre réglementaire actuel pour les objectifs de réduction des émissions de CO2 des voitures et des camionnettes ne tient [...] pas compte des réalités dans lesquelles nous vivons. Pour lutter contre le changement climatique, il est essentiel de réduire les émissions de CO2 le plus rapidement possible. Cependant, l'approche réglementaire adoptée par l'UE ces dernières années a indéniablement fait peser une grave menace sur la compétitivité des entreprises européennes. Bien que la nécessité de décarbon[er] soit incontestable, il est tout aussi vital de veiller à ce que l'industrie automobile européenne conserve sa position de puissance automobile. Pour conserver notre position de leader, ou pour la rétablir là où elle est menacée, la réglementation doit être suffisamment souple pour s'adapter à un environnement en mutation, à de nouvelles situations géopolitiques ou à une évolution de la demande et de l'acceptation des clients. L'industrie automobile doit rester performante sur le plan économique afin de financer sa propre transition ».
Dans une récente tribune59(*), Olaf Källenius, patron de Mercedes, appelait à nouveau à « Dépasser l'idéalisme pour reconnaître les réalités industrielles et géopolitiques ».
Le scandale du Dieselgate, quelques années auparavant, explique en partie le manque de crédit porté à l'époque aux mises en garde des industriels. Après la période Covid, la profitabilité des constructeurs, qui avaient bénéficié d'aides d'État exceptionnelles, a en outre entretenu la méfiance entre l'industrie et les gouvernants, convaincus que cette dernière aurait les reins assez solides pour affronter la transition électrique.
Il convient en outre de rappeler qu'en dépit de leurs prises de position actuelles, à l'époque de l'élaboration du Green Deal, les constructeurs européens étaient très allants - ou faisaient mine de l'être - sur la fin des moteurs thermiques, pressés de rivaliser avec le pionnier Tesla, la France et l'Italie en particulier, qui avaient déjà perdu 40 % de leur emploi dans l'automobile, et voyaient alors dans l'électromobilité un relais de croissance, ainsi que l'a rappelé aux rapporteurs Karima Delli, ancienne présidente de la commission des transports au Parlement européen.
b) Un déficit de rentabilité
À l'approche des échéances 2025 et 2035, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées parmi les constructeurs européens pour réclamer un assouplissement de la réglementation européenne sur les baisses d'émissions et sur la fin des moteurs thermiques.
Interrogée par les rapporteurs à Bruxelles, l'Acea, qui représente 16 des principaux constructeurs européens, a tenu à insister auprès des rapporteurs sur le fait que ces derniers ne remettent pas en cause la transition écologique, mais constatent simplement que le marché n'est pas au niveau escompté, et que par conséquent, en l'absence de débouchés suffisants les constructeurs ne sont pas payés de retour pour leurs investissements, qui, comme indiqué précédemment60(*), ont été colossaux.
Or actuellement, la production de véhicules électriques en Europe n'est pas rentable. Selon la récente enquête de l'Union européenne sur la situation économique de son industrie automobile, menée dans le cadre de l'enquête sur les aides d'État illégales de la Chine61(*), les ventes de véhicules électriques réalisées par les constructeurs européens se sont soldées en moyenne par un taux de profit négatif de - 10,8 % entre le 30 septembre 2022 et le 1er octobre 2023. Il convient donc de trouver des mécanismes pour qu'elle le devienne, soit par une augmentation des marges, soit par une modification des structures de marché (augmentation des volumes des ventes).
2. Une prise de conscience tardive mais réelle
a) Un plan d'action européen pour mieux prendre en compte les contraintes de l'industrie
En réponse aux inquiétudes de plus en plus fortes et de plus consensuelles exprimées par l'industrie automobile européenne, sous la menace d'amendes colossales en cas de non-atteinte de leurs objectifs à l'horizon 2025, la Commission européenne a lancé au début de l'année 2025 un « dialogue stratégique » avec l'industrie automobile européenne, visant à préparer un « plan d'action industriel en faveur du secteur automobile », dévoilé le 5 mars dernier, et qui vise notamment à :
- soutenir l'innovation et la transition numérique du secteur, via une nouvelle alliance européenne d'entreprises en matière de véhicules connectés et autonomes et des assouplissements réglementaires pour l'innovation, ainsi que des investissements financiers ;
- favoriser la demande de véhicules propres via un soutien à des flottes d'entreprises plus favorables à l'environnement, des incitations pour le consommateur, notamment grâce au leasing social, l'accélération du déploiement des stations de recharge et des mesures renforçant la confiance des consommateurs dans les performances des batteries ;
- garantir la résilience des chaînes d'approvisionnement, notamment via des investissements massifs dans ce domaine ;
- améliorer les compétences et remédier à la « casse sociale » induite par le passage à l'électromobilité.
La Commission se proposait également de maintenir voire renforcer l'usage des instruments de défense commerciale, et de simplifier la réglementation applicable aux constructeurs automobiles européens - comme elle se propose du reste de le faire pour l'industrie dans sa globalité.
Excellent signal donné à l'industrie, cette initiative, qui n'a que le statut de « communication » de l'exécutif européen, doit cependant désormais être concrétisée par des textes législatifs et réglementaires.
b) Un lissage sur 3 ans des objectifs 2025 marqueur d'une prise de conscience
Un premier pas très concret a déjà été fait au printemps, puisque, en accord avec la Commission, qui l'avait également annoncé, les députés européens et le Conseil ont approuvé la prise en compte sur trois ans - de 2025 à 2027 - au lieu de la seule année 2025, des émissions, pour évaluer l'atteinte des normes Cafe, évitant ainsi aux constructeurs des amendes dès 2026.
Les rapporteurs se félicitent donc de la décision prise par la Commission, qui évite aux constructeurs de devoir payer de coûteuses amendes, qui auraient encore affaibli leur position par rapport à leurs concurrents extra-européens, et notent que même Volkswagen, qui a atteint en 2024 ses objectifs, mais s'inquiétait, pour les années à venir, de sa capacité à combler l'écart qui pourrait survenir en raison de la montée en puissance plus lente de la mobilité électrique, en particulier en Allemagne, estime que « [c]haque euro investi dans d'éventuelles pénalités serait un euro bien mal investi » et estime que le plan de lissage constitue un point de départ essentiel pour renforcer la compétitivité de l'automobile européenne à un moment critique.
c) Le nouveau dialogue stratégique : vers une révision anticipée de l'objectif 2035 ?
Les travaux du « dialogue stratégique » se poursuivant, la Commission a annoncé à l'issue de la réunion du 12 septembre dernier son intention de réviser de manière anticipée le règlement fixant à 2035 la fin des moteurs thermiques (qui devait se tenir au plus tard en 2026), une consultation publique sur le sujet ayant été ouverte par l'exécutif européen étant en cours depuis le mois de juillet. Un nouveau « round » du dialogue stratégique a été annoncé pour décembre.
3. Assouplir l'objectif 2035 : une nécessité vitale pour l'industrie
a) Alléger la contrainte 2035 pour mieux coller aux réalités du marché et de l'industrie... et pour accélérer la décarbonation
(1) L'objectif « 100 % électrique » en 2035, un objectif disproportionné
L'ensemble des acteurs auditionnés par la mission s'accorde sur le fait que l'électrique sera, à terme, la technologie la plus répandue, mais la quasi-totalité des acteurs industriels62(*) estime, comme l'a résumé l'Acea, qu'il serait délétère pour l'industrie européenne de l'imposer trop brutalement à court terme. Compte tenu des dynamiques de marché, fixer un niveau d'ambition de 70 à 80 %, voire un peu plus, de véhicules électriques en 203563(*) semblerait suffisant pour assurer la « victoire finale » de l'électrique : avec une telle pénétration du marché, si l'électrique se révèle la solution la plus évidemment avantageuse, les dynamiques du marché assureront sa diffusion plus largement encore. En revanche, le coût marginal des quelques pour cent différentiels pourrait avoir un coût démesuré pour l'Europe en termes d'emplois et de souveraineté.
Le principe raisonné de proportionnalité impose donc de revoir l'échéance 2035. Les rapporteurs rappellent d'ailleurs qu'en février 2025, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE)64(*), l'Assemblée nationale avait supprimé l'article 35 du texte, qui transposait dans le droit français cette échéance, et que le Sénat ne l'avait pas rétabli.
(2) Des cas d'usage peu adaptés à l'électrique
Ce principe de proportionnalité se double d'un principe de réalité : il serait en effet hasardeux pour la France et pour l'Europe de faire reposer la transition écologique du secteur automobile sur le seul véhicule « tout électrique » à batterie65(*), dont le rythme d'adoption est incertain et dont une partie de la chaîne de valeur n'est pas (encore) localisée en Europe, alors même que la part de marché des véhicules 100 % électriques a reculé dans l'Union européenne en 2024 à 13,6 %, soit un point de moins que l'année précédente, soit en 2023.
En outre, quels que soient les effets des mécanismes de soutien à l'électrique qui seront déployés dans les années à venir, certains usages demeureront pendant de longues années plus adaptés au thermique qu'à l'électrique, notamment pour les véhicules roulant peu, mais effectuant ponctuellement de longs trajets.
(3) Décarboner le parc existant, une mesure de bon sens écologique
Les rapporteurs notent en outre que, compte tenu du mix énergétique chinois actuel, mettre « sur pause » le déploiement de l'électrique, le temps de mettre en place des capacités de production en Europe, grâce à une énergie décarbonée, aurait écologiquement un sens. Cela aurait l'avantage de maintenir un niveau d'innovation dans le thermique, qui pourrait favoriser la baisse des émissions immédiatement.
En effet, malgré la hausse des ventes, la part des véhicules électriques dans l'ensemble du parc reste limitée à un peu plus de 3 % actuellement en France66(*). Alors qu'il fallait, en 1990, 12 ans pour renouveler le parc en Europe, puis 15 ans en 2000 ; ce chiffre a quasiment doublé : il faut aujourd'hui 25 ans (et même 50 ans pour les pays d'Europe de l'Est !)67(*).
Pour IFP Énergies nouvelles (IFPEN), acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, « [l]a décarbonation du transport routier passera [ainsi] par un mix de solutions, dont l'efficacité en termes de réduction des émissions de CO2 doit être mesurée par des analyses de cycle de vie sur l'ensemble de la chaîne. Les solutions peuvent varier en fonction des zones géographiques, des usages et du contenu carbone du mix énergétique de la zone considérée. Il faut également considérer différentes options pour décarboner les parcs existants, des solutions déployables sans modification des infrastructures et des motorisations avec un impact immédiat (carburants liquides bas carbone de type biocarburants, biocarburants avancés et électro-carburants) et des solutions nécessitant un renouvellement des parcs pour avoir un impact significatif ». Si l'électrification semble à terme la solution la plus pertinente, de l'aveu de la très grande majorité des acteurs interrogés, pour les usages intensifs où l'utilisation directe de l'électricité n'est pas pertinente du fait de la taille de la batterie et/ou du temps de recharge nécessaire, l'utilisation d'un vecteur énergétique secondaire à l'électricité comme l'hydrogène ou les électro-carburants sera nécessaire au prix d'un rendement de transformation supplémentaire.
(4) Miser sur des modèles hybrides
L'hybride est actuellement la première technologie électrique vendue en France, et continue de croître. La situation est la même en Europe68(*).
Source : PFA
Les véhicules hybrides rechargeables devraient, selon les rapporteurs, être davantage soutenus, et considérés pleinement comme des véhicules électriques. En effet, même si plusieurs études ont montré, comme cela leur est souvent reproché par les tenants du « tout électrique », que leurs émissions réelles sont supérieures aux émissions théoriques, évaluées lors de tests officiels, du fait d'un usage relativement plus important de la motorisation thermique (trois quarts du temps en réalité, contre 20 % dans les tests, selon une récente étude de l'ONG Transport & Environnement (T&E)), des efforts de pédagogie envers les acheteurs, notamment concernant le coût relativement moindre de la charge électrique, par rapport au carburant, pourraient permettre d'inverser la tendance.
En outre, dans un contexte de frilosité des consommateurs par rapport au « tout électrique », due notamment aux doutes sur l'autonomie des batteries et la disponibilité des infrastructures de charge69(*), la disponibilité d'un moteur thermique en complément de la batterie a un effet de réassurance certain.
Paradoxalement donc, dans un marché atone, et sous ressources contraintes, l'hybride rechargeable pourrait même accélérer la décarbonation. En effet, comme l'ont exposé aux rapporteurs les représentants de Toyota, « [p]our décarboner l'automobile, à quantité de batteries égale, il est plus efficace de répartir de nombreuses petites batteries dans des véhicules hybrides, qui les utiliseront de manière plus intensive, plutôt que de les concentrer dans quelques véhicules 100 % électriques, qui n'exploiteront qu'une faible partie de leur capacité, privant ainsi le reste du parc automobile de ces précieuses batteries et composants. Avec la quantité de batteries de 1 BEV [véhicules électriques à batterie (ou « tout électrique »)], il est possible d'équiper 6 PHEV [véhicules hybrides rechargeables] et 90 HEVs [véhicules hybrides non rechargeables] »70(*), avec un impact d'autant plus fort sur la décarbonation du parc. Ce choix pourrait être particulièrement porteur pour la France, qui dispose d'électricité décarbonée en masse. Dans ces conditions, la PHEV est la technologie « propre » qui, à court terme, génère le plus de souveraineté, grâce à l'emploi limité de batteries et le recours à l'électricité comme énergie principale.
Cette analyse est partagée par exemple par les représentants du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) entendus par les rapporteurs, qui estiment qu'« il est important de développer d'autres technologies à faible empreinte carbone, parallèlement à la technologie des batteries. D'une part, parce que les ressources en matières premières ne permettent pas d'électrifier tout le parc actuel et parce que les batteries ne sont pas adaptées à tous les usages, en particulier pour le transport lourd ».
Plus largement, et comme l'a résumé le représentant de l'équipementier Lisi devant les rapporteurs, « [l]a bonne approche est celle des pays asiatiques (dont la Chine) avec les NEV (New Energy Véhicules) [catégorie moins restrictive que les véhicules « tout électrique »] autorisant par exemple les prolongateurs d'autonomie de batterie avec un petit moteur thermique qui recharge la batterie (range extender) matérialisé par le plan technologique de Toyota n° 1 mondial qui propose la meilleure technologique en fonction des cas d'usage ».
Enfin, afin de contribuer à la décarbonation du parc existant, les rapporteurs recommandent également de continuer à encourager le rétrofit, qui constitue un levier important pour la transition du parc existant.
Recommandation n° 1 : Repousser l'interdiction de la vente de moteurs thermiques et confier à la Commission européenne le soin de fixer, en accord avec les industriels, une trajectoire dégressive soutenable pour atteindre cet objectif.
b) La neutralité technologique : un impératif logique et pratique
En complément de l'assouplissement de l'objectif « zéro émission » à horizon 2035, et en cohérence avec cet assouplissement, les rapporteurs appellent également à une réelle mise en oeuvre, au niveau européen, du principe de neutralité technologique. Principe général du droit européen, ce dernier est également applicable en théorie à l'objectif 2035 fixé par le droit européen, puisque l'article 1er du règlement de 2023 fixe seulement un objectif au 1er janvier 2035 de « réduction de 100 % de l'objectif de 2021 », pour les émissions moyennes. Il n'a ensuite pas été mis en oeuvre, tout ayant été mis en place pour favoriser de fait les technologies électriques - de manière paradoxale, puisque c'était la technologie sur laquelle l'Union avait le plus de retard !
Or, comme l'ont exposé aux rapporteurs plusieurs interlocuteurs, l'électrification en Europe a été privilégiée au niveau européen non seulement à l'initiative des associations environnementales, mais aussi du puissant groupe Volkswagen, qui souhaitait se positionner sur l'électrique pour demeurer sur un marché chinois en pleine électrification, et ce au détriment des technologies alternatives.
De fait, en l'état actuel des technologies, seuls les véhicules « tout électrique » permettent d'atteindre une telle performance. Toutefois, l'analyse en cycle de vie évoquée ci-dessus, tout comme la problématique de décarbonation du parc existant, amènent à relativiser, au moins à court et moyen termes, l'univocité de l'efficacité des technologies électriques.
En outre, il conviendrait de reconnaître la distinction entre le CO2 issu de carburants fossiles, et le CO2 biogénique (issu de la combustion de la biomasse), récemment séquestré dans la biomasse, et dont le rejet dans l'atmosphère ne fait donc pas augmenter le volume global de CO2 présent à la surface du globe.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que tous les autres pays producteurs dans l'industrie automobile ont choisi des voies réglementaires plus échelonnées, ou technologiquement différenciées, par rapport à l'Union, sur la décarbonation71(*).
C'est d'ailleurs ce que demande, comme la plupart des acteurs de la filière interrogés, l'Acea, qui appelle à « ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier ».
Les deux technologies les plus prometteuses à ce stade sont l'hydrogène et les carburants alternatifs.
(1) L'hydrogène vert
Selon France Hydrogène, interrogée par les rapporteurs, l'hydrogène, qui permet notamment une recharge rapide, est particulièrement adapté pour des profils d'utilisation intensifs et contraints, lorsque l'autonomie, la disponibilité continue ou la charge utile des véhicules rendent les batteries insuffisantes. Ce serait le cas pour environ 10 à 15 % du parc des fourgons à horizon 2035, dont l'activité (longs trajets, équipements énergivores, utilisation quasi continue) exige une solution « zéro émission » compatible avec ces contraintes. Bien que minoritaire, cette fraction représente à elle seule 75 % des émissions du parc de véhicules utilitaires légers, car elle regroupe les usages les plus intensifs. Des besoins existeraient également pour les véhicules lourds, notamment les camions et les autocars : pour France Hydrogène, l'hydrogène devient pertinent au-delà de 80 000 km/an pour des usages de distribution.
La technologie demeure néanmoins actuellement très coûteuse : pour décarboner la production d'hydrogène, traditionnellement produit à partir d'énergies fossiles, par vaporeformage du méthane (un procédé émetteur de CO2), plusieurs solutions existent. La solution privilégiée est l'électrolyse de l'eau, qui permet de produire de l'hydrogène sans émissions directes, à condition d'utiliser une électricité bas carbone (renouvelable ou nucléaire). Cette technologie est néanmoins coûteuse, du fait d'importantes déperditions d'énergie. Selon France Hydrogène, d'autres voies prometteuses sont en cours de développement, comme la thermolyse de la biomasse, qui pourrait produire de l'hydrogène renouvelable. Enfin, des gisements d'hydrogène naturel ont récemment été découverts, mais leur exploitation reste à un stade exploratoire.
De ce fait, pour la plupart des acteurs interrogés, le déploiement massif de solutions « hydrogène » pour l'automobile semble peu crédible, du fait :
- d'une part, du coût : selon le Bureau européen des consommateurs (Beuc), les véhicules personnels à hydrogène sont beaucoup plus coûteux que les véhicules essence et diesel, y compris dans les conditions de production de l'hydrogène les plus favorables (énergie solaire à bas coût notamment) : la voiture à hydrogène de Toyota, en pointe sur ce secteur, est commercialisée à pas moins d'environ 70 000 € ! Ce coût élevé s'explique par des contraintes physiques (déperditions d'énergie trop importantes) ;
- d'autre part, de l'insuffisante disponibilité en hydrogène, qui lorsqu'il est réalisé par électrolyse de l'eau, nécessite une utilisation massive de la ressource en eau.
De fait, même pour France Hydrogène, « les véhicules légers ne constitu[e]nt pas les segments prioritaires pour lesquels l'hydrogène est considéré comme pertinent »72(*). Stellantis a d'ailleurs annoncé en juillet l'arrêt de son programme de développement d'hydrogène, « [e]n l'absence de perspectives à moyen terme pour le marché de l'hydrogène », et la production de véhicules utilitaires utilisant cette technologie, qui aurait dû débuter en 2025, a été annulée.
Pour autant, les rapporteurs appellent à ne pas cesser tout soutien à la filière hydrogène, qui pourrait notamment, comme indiqué ci-dessus, trouver des débouchés intéressants dans le secteur de la mobilité lourde. Ils notent que par rapport à la filière des batteries, la filière hydrogène présente de meilleures garanties en matière d'accès aux matériaux critiques, et donc de souveraineté, même si certains matériaux précieux comme le platine (pour les piles à combustible) et l'iridium (dans certains électrolyseurs) présentent également des enjeux de criticité. Les acteurs entendus ont en outre souligné que même si la Chine n'était pas encore performante sur les technologies hydrogène, elle avait depuis quelques années réorienté ses investissements, et risquait de rattraper son retard à court terme : les Européens ont donc tout intérêt à conserver leur avance dans ce domaine. Selon IFPEN en effet, « [l]a France a une position de leader en termes d'innovation dans le domaine [...] de l'hydrogène », IFPEN ayant été le second organisme déposant de brevets au niveau mondial, dans le domaine, sur la période 2011-2020.
Selon IFPEN, « [l]a France a une position de leader en termes d'innovation dans le domaine des carburants bas carbone et de l'hydrogène ». IFPEN est ainsi sur la période 2011-2020 le premier organisme déposant de brevets à l'échelle mondiale dans le domaine et biocarburants, et le second dans le domaine de l'hydrogène.
Comme l'a indiqué aux rapporteurs un des équipementiers entendus, « [p]our l'hydrogène et les carburants verts, les lois de la physique contraignent les optimisations. C'est pour cela que nous croyons surtout à l'électrique. » De fait, les technologies alternatives apparaissent coûteuses, et destinées à rester « de niche ».
(2) Les biocarburants et e-carburants, une solution complémentaire adaptée à certains types d'usages
Les carburants renouvelables sont l'une des solutions alternatives ou complémentaires à l'électrique déjà mise en oeuvre. Ils visent à remplacer les carburants traditionnels issus de sources fossiles par des carburants comportant du carbone déjà présent à la surface de la Terre, qu'il soit capté dans l'atmosphère ou à partir de rejets de sites industriels (e-fuels) ou séquestré dans la biomasse.
Si les e-fuels sont encore au stade de la démonstration, les biocarburants de première génération sont d'ores et déjà distribués à la pompe (éthanol produit à partir de maïs, blé ou betteraves dans le pool essence et biodiesel ou huiles végétales hydrotraitées produits principalement à partir de colza dans le pool gazole). Leur usage est potentiellement très large puisque selon Bioéthanol France, le bioéthanol est immédiatement utilisable dans les véhicules essence existants, à un taux pouvant aller jusqu'à 10 %, et même 85 % lorsque le véhicule est équipé d'un boîtier de conversion.
Les principaux avantages des biocarburants, en France, sont les suivants :
- des réductions d'émission de CO2 significatives par rapport à la référence fossile, de l'ordre de - 85 % à - 95 % selon IFPEN. Selon Bioéthanol France, un hybride rechargeable flex 85 émettait en 2022 sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule, autant de CO2 qu'un véhicule électrique à savoir 13 tonnes.
Les biocarburants pourraient donc jouer un rôle transitoire majeur dans la réduction accélérée des émissions de CO2, notamment dans le parc existant, d'autant que la fiscalité avantageuse qui leur est actuellement applicable les rend particulièrement accessibles et, selon Bioéthanol France, « permet aux ménages les moins aisés de contribuer à la décarbonation sans se ruiner » (un véhicule flex E85 coûte le même prix qu'un véhicule thermique essence et substantiellement moins cher qu'un véhicule « tout électrique » ; à l'usage, il constitue une des solutions de décarbonation les moins chères, après le véhicule « tout électrique ».
L'usage de biocarburants ne nécessite en outre pas de modifier les infrastructures de recharge existantes, ni les motorisations, grâce à la possibilité de mélanger directement ces carburants avec les carburants traditionnels (« drop-in ») ;
- une opportunité de renforcer l'indépendance énergétique et la souveraineté de la France et de l'Europe, notamment grâce à :
- des technologies développées par des acteurs français comme IFPEN, l'Inrae ou le CEA, et des acteurs industriels français pour les industrialiser en France et dans le monde (Axens, TotalEnergies, Avril, etc.).
La France est en outre bien positionnée sur les moteurs permettant d'utiliser des biocarburants : même si Ford est aujourd'hui le seul constructeur automobile à proposer des voitures flex fuel d'origine, Horse, filiale de Renault en charge des moteurs thermique et hybride, a présenté avec Aramco au dernier Salon de l'auto de Shanghai un concept de moteur multi-énergies qui pourrait rouler avec des e-fuels ou de l'E85 possiblement 100 % renouvelable, et pourrait être commercialisé dans des voitures pour le marché européen dès 2028 ;
- une ressource biomasse (résidus agricoles et sylvicoles) abondante sur le territoire, permettant chaque année d'éviter d'importer de l'ordre de 800 000 m3 d'essence, soit une valeur approximative de 500 à 700 M€, selon Bioéthanol France ;
- une synergie avec la production alimentaire (sucrerie et amidonnerie) particulièrement intéressante dans une perspective de souveraineté alimentaire, qui permet à la fois d'en soutenir la compétitivité, mais aussi de soutenir le revenu des agriculteurs (actuellement, en France, les deux tiers de la production d'alcool agricole sont consacrés aux biocarburants, le reste étant fléché vers les secteurs traditionnels (boissons, pharmacie, cosmétiques, etc.), et plus de 50 000 agriculteurs ont au moins une partie de leur revenu lié au bioéthanol) et de générer de coproduits destinés à l'alimentation animale dont l'Union européenne est déficitaire.
Le secteur agricole a d'ailleurs beaucoup investi en faveur des biocarburants depuis une quinzaine d'années (1 Md€ investis).
La production française de bioéthanol mobilise 0,7 % SAU nette des coproduits destinés à l'alimentation animale. Si le SGPE a émis des doutes quant à la disponibilité de quantités suffisantes de biomasse pour couvrir les besoins en carburant (« non-bouclage biomasse »), les rapporteurs notent qu'il n'existe pas motif décisif pour déclasser a priori son usage pour la production d'énergie au profit d'autres.
Efficace, la solution des biocarburants se heurte toutefois à plusieurs obstacles. En premier lieu, elle souffre d'un déficit de compétitivité par rapport aux États-Unis et au Brésil, où les producteurs bénéficient de prix de l'énergie, de la matière première et de la main-d'oeuvre beaucoup plus bas qu'en Europe, mais aussi d'une politique de soutien stable pour les biocarburants depuis 50 ans, qui leur a permis de générer des économies d'échelle importantes.
En second lieu, les investissements sont découragés par le manque de visibilité sur le sort des biocarburants à horizon 2035 : en toute hypothèse, selon le principe de neutralité technologique rappelé précédemment, les véhicules neufs vendus sur le marché européen fonctionnant avec des carburants neutres en carbone devraient être autorisés. Le règlement prévoit explicitement, à ce propos, que « la Commission présentera une proposition concernant l'immatriculation après 2035 des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 conformément au droit de l'Union, en dehors du champ d'application des normes applicables aux parcs de véhicules et conformément à l'objectif de neutralité climatique de l'Union »73(*).
La proposition dévoilée par la Commission en septembre 2023 restreignait cependant la définition des carburants neutres en CO2 aux seuls « e-fuels » (carburants de synthèse). Rejetée par un certain nombre d'États membres, qui demandaient que cette définition inclue tous les carburants renouvelables respectant les critères de durabilité fixés dans la directive « RED », et notamment les biocarburants, cette proposition doit être retravaillée, avec cette fois, en toute hypothèse, le soutien de l'Allemagne, où le contrat de coalition de l'actuel gouvernement mentionne la promotion des carburants alternatifs y compris les biocarburants.
Les rapporteurs regrettent que le gouvernement français ne promeuve pas davantage au niveau européen les biocarburants, essentiels pour nos agriculteurs74(*), et souhaitent que l'inclusion des biocarburants dans les carburants « neutres en carbone » autorisés à la vente de véhicules neufs après 2035 soit inscrite au plus vite dans la réglementation européenne.
Les acteurs du secteur ont en effet besoin dans les meilleurs délais de perspectives de long terme, leur permettant de s'engager sur une durée longue (20 à 30 ans au moins), correspondant à la durée de vie des unités industrielles, et aux acteurs de la R&D de développer de nouvelles solutions. Ces solutions ne devraient toutefois être soutenues que dans le cas où le bilan énergétique à la production demeure positif.
Recommandation n° 2 : Mettre en oeuvre le principe de neutralité technologique ; reconnaître en particulier le caractère de carburants « neutres en carbone » des biocarburants.
Recommandation n° 3 : Poursuivre la R&D dans le domaine des moteurs thermiques moins émetteurs de CO2.
c) Assurer la stabilité de la réglementation
Quelle que soit la solution finalement retenue, et même si les orientations prises au niveau européen ne devaient pas correspondre intégralement aux positions prises dans le cadre du présent rapport, les rapporteurs insistent sur la nécessité, après la révision de l'objectif 2035 annoncée par la présidente de la Commission européenne pour la fin de l'année 2025, d'assurer une réelle stabilité à la réglementation en vigueur, et de donner ainsi de la visibilité aux acteurs.
Les deux producteurs de batteries - industries à capex élevé, - entendus par les rapporteurs, notamment, ont insisté sur le fait que l'instabilité réglementaire sur la perspective de fin du moteur thermique en 2035 les avait conduits, dans l'incertitude, à geler des décisions d'investissement, ce qui pourrait être préjudiciable à leur activité future, quand bien même la réglementation ne serait in fine pas modifiée.
C. SOUTENIR LE CONSOMMATEUR POUR RENDRE LA VOITURE ÉLECTRIQUE ABORDABLE
1. La question du coût : rendre les véhicules électriques abordables en soutenant la demande
a) L'augmentation des prix des véhicules neufs ces dernières années alimente le sentiment de déclassement d'une partie de la population et contribue à l'attrition de la demande
Entre 2020 et 2024, le prix des véhicules neufs achetés en France a augmenté de près d'un quart. Conséquence directe de cette hausse, les dépenses des ménages en transport individuel représentent désormais, en moyenne, trois quarts de leur budget transport, qui s'élève lui-même, en 2023, à 14 % de leur budget total, en hausse de plus de plus de 10 % par rapport à la situation qui prévalait avant la crise sanitaire75(*).
Une part de l'augmentation des prix, dans la période récente, est directement liée à l'électrification : une récente étude de l'Institut mobilités en transition (IMT) et du cabinet C-Ways l'a évaluée à 6 % environ en moyenne76(*). Selon Luc Chatel, président de la PFA, le coût d'une voiture électrique serait en moyenne de 30 à 50 % supérieur à celui d'une voiture thermique77(*).
S'ajoute en outre, le coût des bornes de recharge domestique, à tel point que Stellantis a décidé de les offrir à ses clients, ce qui néanmoins, selon Sandrine Bouvier, directrice mobilité électrique du constructeur, ne suffit pas à lever toutes les réticences.
Cette augmentation des prix a un effet direct sur la demande. Selon le député européen François Kalfon, entendu par les rapporteurs, la leçon de Henry Ford, pour qui les ouvriers de ses propres usines devaient pouvoir s'offrir les automobiles qu'ils fabriquaient, créant ainsi leur propre marché, a été oubliée : selon OPmobility, alors que le prix de la R5, au moment de son lancement, correspondait à six mois de salaire moyen, celui du nouveau modèle correspond plutôt à 12 à 18 mois de salaire moyen, ce qui rend même ce petit véhicule inabordable pour beaucoup de nos concitoyens.
Or, le secteur des véhicules particuliers est particulièrement sensible au phénomène d'élasticité des prix : selon Thierry Mayer, économiste, entendu par les rapporteurs, une augmentation de 10 % du prix fait baisser la demande de 40 % ! De fait, selon une enquête CSA de janvier 2025, commandée par la PFA, 77 % des acheteurs potentiels renonceraient à l'acquisition d'un véhicule électrique sans les aides à l'achat associées.
De fait, les classes populaires et moyennes, qui représentaient 43 % du marché en 2019 ne représentent plus que 31 % des acheteurs en 2024, car ce sont les classes les plus sensibles à l'augmentation des prix des véhicules neufs78(*).
Au total, le coût des mobilités, et en particulier de la voiture individuelle, souvent seul moyen de transport dans les zones rurales, est ainsi devenu un accélérateur de la fracture sociale et territoriale, qu'il est urgent de combler.
La baisse des ventes de véhicules neufs a en outre des effets directs en termes d'émissions de CO2, puisque, selon les données transmises aux rapporteurs par BMW, une augmentation d'un an de l'âge moyen du parc équivaudrait à la production de 15 M de tonnes de CO2 supplémentaires ! De fait, c'est dans les franges de la population qui ont le moins accès aux voitures récentes que les émissions de CO2 des voitures ont le plus augmenté au cours des trente dernières années (+ 246 % dans les pays d'Europe centrale et orientale et + 39 % dans les pays d'Europe du Sud, contre - 13 % dans les pays d'Europe du Nord)79(*).
b) L'électrique, une solution dont le coût d'entrée demeure élevé, mais globalement avantageuse sur le plan économique
En dépit de son coût d'entrée élevé, il est désormais bien établi que dans les conditions actuelles de prix de l'énergie, le coût global (acquisition et usage) de l'électromobilité est, pour le consommateur, inférieur au coût du thermique, comme l'ont assuré aux rapporteurs les représentants du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc). Cette affirmation est corroborée par plusieurs études, dont, en dernier lieu, une étude de l'UFC-Que-Choisir80(*), qui indique que - si l'on ne tient pas compte des primes à l'achat - le choix de l'électrique ne devient rentable qu'au bout de deux ans de possession pour une Volkswagen ID.3, cinq ans s'agissant d'une Peugeot e- 208 et huit ans avec une Tesla Model Y, compte tenu des coûts d'acquisition et de carburants ou recharge (mais en excluant les frais d'entretien et d'assurance).
De fait, selon la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) aux ministères de l'économie et des finances et de la transition écologique, compte tenu des prix actuels des carburants et de l'électricité, la recharge à domicile serait environ trois fois moins onéreuse qu'un plein de carburant, les tarifs de recharge pouvant encore être plus avantageux en heures creuses ; même si elles sont plus onéreuses, les recharges sur bornes publiques restent plus économiques qu'un plein d'essence équivalent.
Selon une étude citée par l'ONG T&E, les dépenses moyennes associées à l'utilisation d'une voiture s'élèvent en effet à 2 380 euros par an, dont 1520 € pour le carburant. Les ménages les moins aisés sont naturellement les plus impactés81(*), l'électromobilité pourrait donc, au contraire des idées reçues, faire globalement baisser la facture de la mobilité individuelle, notamment pour les consommateurs les plus aisés, d'autant que le développement, dans un avenir proche, d'offres de recharge intelligente (« smartcharging ») devrait permettre de réduire encore ces coûts. Volkswagen a par exemple fait état de solutions développées avec Électricité de France (EDF), permettant de proposer jusqu'à 2 500 km de recharge gratuite, ainsi qu'une réduction globale des coûts pouvant atteindre 40 % en Allemagne, grâce à un partenariat avec la société norvégienne spécialisée dans le photovoltaïque Otovo.
En ce qui concerne les frais d'entretien, une autre étude réalisée en 2021 par l'UFC-Que Choisir82(*) estimait que le coût d'entretien courant (hors batterie et réparations majeures) des voitures électriques était similaire à celui des voitures thermiques, en raison de la présence moins importante de pièces d'usures et, partant, d'interventions régulières moins fréquentes (la révision d'une voiture électrique étant par exemple conseillée tous les 30 000 km, contre 15 000 à 20 000 km pour les véhicules thermiques83(*).
Cette réalité est d'ailleurs bien appréhendée par les consommateurs, puisque selon un sondage réalisé en avril 2025 par La Centrale, 60 % des Français ayant l'occasion d'acheter un véhicule électrique d'occasion le font parce qu'ils pensent que rouler en véhicule électrique permet de réduire les dépenses d'énergie, et 37 % de réduire les dépenses d'entretien84(*).
La diminution progressive du coût des batteries et, partant, des véhicules électriques, au fur et à mesure de la massification du marché, devrait en outre permettre de baisser les prix d'achat des véhicules électriques dans les années à venir.
c) Soutenir la demande en véhicules électriques des ménages les plus modestes sans pénaliser excessivement les finances publiques
En dépit de la réalité économique exposée ci-dessus, le coût d'acquisition demeure un frein important pour l'acquisition de véhicules électriques, notamment pour les ménages les plus modestes. Ainsi qu'indiqué précédemment, plus des trois quarts des acheteurs potentiels indiquaient en janvier 2025 qu'ils renonceraient à l'acquisition d'un véhicule électrique s'ils ne pouvaient pas bénéficier des aides à l'achat associées. L'efficacité de ces mécanismes publics de soutien à la demande est évidente : leur suppression brutale en Allemagne fin 2023 avait immédiatement provoqué une baisse des ventes de véhicules électriques de 16 % au cours du premier semestre 202485(*).
Afin de soutenir le déploiement des véhicules électriques, en France, le leasing social (« location sociale ») mis en place en janvier 2024 offrait aux ménages modestes la possibilité, pour 100 € par mois (pour des voitures compactes, et 150 € par mois pour des familiales), la possibilité de louer des voitures électriques sur la longue durée. Le programme, victime de son succès, a été suspendu après seulement six semaines d'existence (90 000 demandes pour 25 000 voitures disponibles). Efficaces, ces mesures sont cependant coûteuses pour les finances publiques (13 000 € par véhicule, dans la première mouture du dispositif).
Le Gouvernement a annoncé la réactivation d'un mécanisme de leasing à compter du 30 septembre prochain, pour les Français des cinq premiers déciles (revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 €) qui dépendent de leur véhicule pour leur activité professionnelle. Les rapporteurs approuvent ce recentrage sur les bénéficiaires les plus fragiles et les plus affectés par la transition, en phase avec les recommandations de l'Institut mobilités en transition, qui avait mis en lumière le fait que les ménages les plus aisés avaient le plus profité du précédent dispositif86(*).
En contrepartie de la suppression au 1er juillet dernier du bonus écologique pour les voitures particulières, a en outre été mis en place, pour les achats ou locations de véhicules électriques, un « coup de pouce véhicules particuliers électriques » engagés avant le 31 décembre 2025. Le dispositif vise les petites voitures (catégories M1) d'un coût total inférieur à 47 000 €, et obéissant à des critères environnementaux (de masse et de score environnemental), d'un montant de l'ordre de 3 000 à 4 000 € environ, variant selon la composition et les revenus du ménage.
À compter du 1er octobre 2025, cette aide sera en outre doublée d'une aide de 1 000 € supplémentaires, pour les véhicules assemblés en Europe et dotés d'une batterie européenne.
Les rapporteurs approuvent le renforcement de ces critères de « made in Europe » (« fabriqué en Europe »).
Ils alertent néanmoins sur le coût pour les finances publiques de tels dispositifs, dont ils observent que rien ne garantit, en l'état actuel des critères, qu'ils bénéficieront en priorité aux constructeurs français, et a fortiori aux productions localisées sur le sol national. Les règles du marché unique européen interdisant toute discrimination entre les États membres, les rapporteurs estiment urgent que des politiques d'incitation à l'achat soient mises en oeuvre de manière harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, afin d'assurer une cohérence européenne sur la pénétration du véhicule électrique entre États membres, sans que le coût en soit assuré par certains États membres plus vertueux seulement. Une telle harmonisation est d'autant plus pertinente que les objectifs européens de réduction des émissions et de neutralité carbone des véhicules à compter de 2035 ont été fixés au niveau européen et que leur atteinte dépend des performances de l'ensemble des États membres.
Les pays comme l'Espagne ou l'Italie ayant un faible taux d'électrification et un PIB par habitant relativement élevé pourraient en effet constituer des relais de croissance importants pour les producteurs de véhicules électriques, de même que, dans une moindre mesure, les pays d'Europe de l'Est, très peu électrifiés.
La Commission européenne a annoncé réfléchir à la mise en place de telles solutions, notamment de leasing social, sans avoir pour l'heure concrétisé cette ambition, M. Moumen Hamdouche, chef d'unité à la DG Move, ayant indiqué que l'Union ne disposait actuellement pas de ressources pour ce faire. Les rapporteurs estiment cependant urgent de mettre en place de tels dispositifs à l'échelle européenne, sans attendre le nouveau cadre financier pluriannuel (CPF), qui n'entrera en vigueur qu'en 2028. Les rapporteurs soulignent que ces aides devraient être calibrées en fonction d'indicateurs de pouvoir d'achat propres à chaque pays, afin de maximiser l'effet d'incitation à l'achat, sans pénaliser les États membres à plus fort pouvoir d'achat, comme la France.
Recommandation n° 7 : Harmoniser les politiques de soutien à l'achat ou à la location de véhicules électriques au niveau européen.
Tout en n'ignorant pas les contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur le calibrage des dispositifs de soutien au véhicule électrique, dans un contexte d'instabilité politique, les rapporteurs rappellent également que la stabilité des dispositifs fiscaux et de soutien à la demande constituent un facteur décisif, tant pour les consommateurs que pour les décisions d'investissement des industriels, ainsi mis en situation de mieux anticiper l'état du marché. Alors que, selon l'un des constructeurs interrogés, la fiscalité relative à l'achat de véhicules a changé en France... 17 fois en cinq ans, les rapporteurs appellent à fixer des trajectoires de moyen terme pour l'ensemble des dispositifs d'aide à l'achat et de « coup de pouce » fiscaux.
Recommandation n° 8 : Assurer la stabilité du cadre fiscal et des aides à l'achat ou à la location de véhicules.
d) Développer le marché de l'occasion
(1) Un marché compliqué de l'occasion électrique, pourtant déterminant pour la pénétration globale du marché
Entre janvier 2021 et décembre 2024, le marché du véhicule électrique d'occasion en France a été multiplié par 7. Quoique les véhicules d'occasion électriques représentent désormais près de 10 % des véhicules d'occasion récents (13 à 59 mois)87(*), le marché du véhicule électrique d'occasion demeure plus compliqué que celui du véhicule thermique, avec des délais de revente plus longs88(*) et des durées de possession inférieures à celle des véhicules thermiques d'occasion. En effet, alors que les premiers retours de véhicules sur le marché de l'occasion, notamment des premiers contrats de leasing, augmentent l'offre, les baisses des prix des véhicules électriques neufs depuis une dizaine d'années grèvent l'avantage-prix des véhicules d'occasion, d'autant que les performances des véhicules neufs ont également bondi entre-temps : les progrès technologiques rapides en termes de vitesse de charge et de performance d'autonomie font que les performances des véhicules d'occasion sont perçues comme dépassées, et ce alors même qu'elles pourraient être adaptées aux usages recherchés.
(2) Rassurer sur l'autonomie des batteries
En plus de ces éléments objectifs, les rapporteurs observent que les freins au développement d'un marché de l'occasion de l'électrique sont également largement des biais de perception, des craintes demeurant quant aux performances des batteries, et ce alors même qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'âge des véhicules, la part de la valeur résiduelle de ces dernières au sein du véhicule augmente (du fait qu'elle concentre des matériaux à coût élevé, et de leur complexité technologique) : 58 % des acheteurs potentiels de véhicules électriques d'occasion se disent inquiets du prix élevé du remplacement de la batterie et 55 % de l'état ou la durée de vie de la batterie, selon une étude réalisée par l'Avere. Ainsi, « [l]'anxiété d'autonomie reste très présente, surtout chez les primo-accédants de voitures électriques. Cette anxiété est exacerbée dans l'occasion, où la performance énergétique est perçue comme moins stable »89(*).
Source : Avere 2025, p. 52
Or ces performances sont meilleures qu'initialement attendu : la durée de vie des batteries de véhicules électriques est estimée pour les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) jusqu'à 2 000 cycles de recharge, soit plus de 500 000 km90(*), tandis qu'ACC fait état d'une durée de vie a minima de 10 ans pour ses batteries.
De fait, à l'enjeu économique de la batterie et les incertitudes initiales quant à la durée de vie et à la dégradation de son état de santé, la plupart des constructeurs offrent des garanties commerciales étendues sur les batteries, généralement fixées à 8 ans et/ou 160 000 km, avec un seuil minimal garanti de capacité énergétique résiduelle. Sandrine Bouvier, directrice mobilité électrique de Stellantis, a par exemple indiqué que les véhicules électriques vendus par Stellantis disposaient actuellement d'une garantie de 8 ans, et que plus d'une vente sur cinq se faisait en location. Cette garantie est un levier puissant pour rassurer les acheteurs potentiels de voitures électriques, neuves ou d'occasion91(*).
L'état de santé de la batterie, qui est l'un des points couverts par ces garanties, est aujourd'hui mesuré par un indicateur de « SoH (« State-of-Health »92(*)) énergétique », qui indique son niveau de performance énergétique résiduelle par rapport à sa capacité d'origine. Or le SoH reste davantage une estimation qu'une grandeur exacte, et surtout sa méthode précise de calcul est à ce jour propre à chaque constructeur, avec peu de transparence et de visibilité sur le sujet. Comme le suggère l'Avere dans l'étude précitée, la standardisation de la méthode de calcul du SoH demeure donc un défi important pour renforcer la fiabilité et la comparabilité des informations93(*).
Aussi, les rapporteurs recommandent de lever ces freins psychologiques à l'achat de véhicules d'occasion, notamment ceux relatifs à l'autonomie de la batterie via :
- des campagnes d'information visant à rassurer les acheteurs potentiels de véhicules électriques d'occasion, en communiquant notamment sur les bonnes performances résiduelles des batteries ;
- renforcer l'information des consommateurs au moment de l'achat, via la mise en place d'un label européen de garantie, au moins pour les véhicules électriques d'occasion, le certificat SoH n'étant actuellement pas suffisamment répandu auprès des usagers94(*). Ce label européen de garantie induirait une standardisation des méthodes de calcul, permettant d'augmenter la transparence à ce sujet, et la comparabilité des véhicules de différents constructeurs.
Un tel certificat, qui s'appliquerait tant aux véhicules neufs que d'occasion, rassurerait également les acquéreurs de véhicules neufs sur la possibilité de revendre ensuite leurs véhicules sur le marché de l'occasion.
Les rapporteurs insistent également sur la nécessité de mieux communiquer auprès des acheteurs de véhicules d'occasion pour leur permettre de mieux arbitrer en fonction de leurs besoins, et non pas en fonction de l'état de l'art du neuf : les professionnels du véhicule d'occasion devraient être mieux formés pour disposer des compétences techniques nécessaires pour bien conseiller les potentiels acheteurs.
Recommandation n° 10 :
Développer un marché de l'occasion des véhicules électriques, notamment en mettant en place un label européen de garantie pour les véhicules électriques d'occasion, incluant un diagnostic batterie certifié.
Mettre en place un plan de communication sur les performances des batteries.
2. Poursuivre l'effort de déploiement des bornes de recharge pour lever les freins psychologiques à l'achat de véhicules électriques
L'insuffisante disponibilité de points de recharge est souvent avancée comme facteur explicatif des difficultés d'adoption de l'électrique en France et en Europe.
Cette affirmation ne semble cependant pas justifiée, en France, en l'état actuel du déploiement : d'après les données Enedis et le baromètre de l'Avere-France, au 30 mars 2025, près de 2 466 000 points de recharge sont déployés dont :
- 55 % installés à domicile (+ 340 % entre 2021 et 2025, selon les données Enedis) ;
- 38 % installés en entreprise (+ 250 %) ;
- 7 % sont ouverts au public, soit près de 170 000 points, répartis sur plus de 50 000 stations de recharge2 (+ 30 % sur un an).
Globalement, le rythme de déploiement des points de recharge s'est très fortement accéléré depuis 2021 (+ 372 % entre 2020 et 2024 contre + 121 % entre 2016 et 2020).
La France est désormais l'un des trois pays les mieux équipés de l'Union européenne avec l'Allemagne et les Pays-Bas.
Source : document fourni par l'Avere
Compte tenu de la tendance observée, l'objectif de 7 millions de points de recharge ouverts au public et privés à horizon 2030, fixé dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 201595(*), puis réaffirmé par le Gouvernement en mai 2025, semble tout à fait réalisable. S'agissant de l'objectif plus spécifique des 400 000 points de recharge ouverts au public, également récemment réaffirmé, l'Avere-France considère qu'au rythme actuel des déploiements, l'objectif pourrait être atteint avant 2030. Dans une étude comparative de 2023, l'Avere-France estimait le besoin entre 330 000 et 480 000 points de recharge, en cohérence avec l'objectif annoncé.
Même si le déploiement de la recharge dans le résidentiel collectif, bien que limité encore aujourd'hui (< 5 % des immeubles équipés) s'accélère avec les projets d'infrastructures collectives validés (13 % des immeubles). Par ailleurs, la loi d'orientation des mobilités (LOM) de 201996(*) impose l'équipement de 5 % des places de stationnement en points de recharge pour les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels (tertiaire, ERP, ERT, etc.) disposant de plus de 20 places de stationnement d'ici au 1er janvier 2025. Cette obligation contribue notamment à ce que les entreprises s'équipent en points de recharge et électrifient leur flotte. La transposition prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD)97(*) renforcera ces obligations en fixant un objectif d'équipement de 10 % des places de stationnement des bâtiments non résidentiels d'ici au 1er janvier 2027.
La répartition entre bornes privées et bornes ouvertes au public est cohérente avec les usages, puisque 80 % des actes de recharge se font à domicile ou au travail. Les bornes de recharge ouvertes au public jouent un rôle crucial de réassurance pour les utilisateurs.
En termes de répartition géographique, le nombre de points de recharge, ainsi que la puissance de recharge totale déployée, est globalement proportionnel au nombre d'habitants par région avec en moyenne 249 points de recharge pour 100 000 habitants. D'après les données partagées par RetailSonar, fournies par Avere, 88 % des Français vivent aujourd'hui à moins de 15 minutes d'un point de recharge de plus de 50 kW - soit un meilleur maillage qu'une station-service (même si la fréquence de recharge et l'autonomie ne sont pas identiques dans les deux cas). Ainsi, l'argument de la faible disponibilité des bornes de recharge semble-t-il, pour la France, injustifié. Selon Moumen Hamdouch, chef d'unité à la DG Move, il ne l'est pas davantage à l'échelle de l'Union, les objectifs du règlement Afir étant à ce jour atteints ou en passe de l'être98(*).
Cependant, à la suite des acteurs auditionnés, les rapporteurs retiennent trois points de vigilance :
- si les points de recharge sont aujourd'hui globalement en nombre suffisant, les déploiements doivent continuer, notamment dans les zones péri-urbaines et rurales, mais aussi dans certains centres urbains densément peuplés, à fort trafic, et disposant d'un parc important de logements collectifs avec pas ou peu de places de stationnement, les zones blanches n'étant pas toujours là où on l'imagine.
L'offre de recharge devra également s'adapter aux besoins et aux usages, avec un mix évolutif entre les bornes privées et publiques, lentes ou à haute puissance ;
- le déploiement des bornes doit se poursuivre au rythme de diffusion des véhicules électriques dans le parc, le règlement Afir fixant des objectifs dynamiques liant l'un à l'autre.
De ce fait, le dimensionnement du réseau électrique sera également un enjeu important, la recharge des véhicules électriques devant compter pour pas moins de 8 % de la consommation totale d'électricité en France en 2035, selon les prévisions de RTE. Dans ces conditions, la DGEC craint une saturation du réseau électrique à horizon de 3 à 5 ans, qui impliquerait ensuite de longs délais d'attente pour ouvrir de nouvelles bornes, comme c'est actuellement le cas aux Pays-Bas (pourtant actuellement en première place au niveau européen sur le plan du déploiement des bornes de recharge), que les investissements massifs de RTE et Enedis (de l'ordre de 100 Md€ chacun sur 5 ans afin de développer le réseau électrique) pourraient ne pas suffire à empêcher. La DGEC a toutefois indiqué aux rapporteurs travailler à planifier ces nouvelles ouvertures de station, de manière proactive, afin d'éviter cet écueil ;
- troisièmement, des progrès restent à faire sur la transparence des tarifs et la possibilité de les anticiper, ainsi que sur l'interopérabilité.
Recommandation n° 9 :
Poursuivre le déploiement des infrastructures de recharge en priorisant les zones rurales et périurbaines.
Soutenir également l'installation de bornes de recharge à domicile et en copropriété en simplifiant les démarches administratives (notamment en facilitant l'accord des copropriétés et en incitant les bailleurs à équiper les logements sociaux).
3. Favoriser l'électrification des flottes d'entreprise
À côté des ventes aux particuliers, les flottes d'entreprise représentent plus de la moitié des ventes de véhicules neufs. Or, selon les représentants de Stellantis entendus par les rapporteurs, les véhicules électriques ne représentent qu'environ 10 % du total des achats de véhicules neufs des entreprises, contre 31 % pour les ventes de véhicules aux particuliers.
Source : graphique fourni par A. Bigo
La loi LOM précitée a introduit l'obligation pour les entreprises d'intégrer dans leurs flottes de plus de 100 voitures particulières et véhicules utilitaires légers une part de véhicules à faibles émissions. Cette obligation a été supprimée par la loi de finances pour 2025, au profit d'une taxe incitative portant sur les flottes de plus de 100 véhicules légers, visant à pénaliser l'écart avec les cibles de verdissement des flottes.
Compte tenu de l'importante part de marché représentée par les flottes d'entreprise, et de l'effet de levier important qu'aurait sur le marché - y compris le marché de l'occasion - une meilleure diffusion des véhicules électriques au sein de ces flottes, des mécanismes incitatifs au verdissement des flottes devraient être encouragés.
Les rapporteurs insistent cependant sur la nécessité d'une part de coordonner cette action, comme tous les mécanismes de soutien à l'achat, au niveau européen, et se félicitent donc de l'annonce de la mise en place d'un tel dispositif au niveau européen, faite par la Commission dans le cadre du plan d'action en faveur du secteur automobile.
Compte tenu de la conjoncture économique dégradée, ils appellent en revanche à la plus grande prudence vis-à-vis de mécanismes punitifs, qui pourrait venir grever encore la compétitivité des entreprises.
III. RÉCONCILIER COMPÉTITIVITÉ ET TRANSITION POUR REFAIRE DE LA FRANCE UN TERRITOIRE D'INDUSTRIE AUTOMOBILE
Face à l'ampleur des bouleversements auxquels est confrontée l'industrie automobile, industrie structurante et fortement pourvoyeuse d'emplois, tant en France qu'en Europe, les pouvoirs publics ont le devoir de la soutenir dans ses efforts pour retrouver sa compétitivité et redevenir leader sur les véhicules du futur. Pour ce faire, les actions sur le marché ne suffiront pas. En effet, comme l'a suggéré aux rapporteurs le chercheur Tommaso Pardi, « [l]e principal problème de l'approche du gouvernement français consistant à miser sur l'électrification rapide pour inverser le déclin historique du secteur automobile français était en effet qu'elle ne s'attaquait pas à sa cause structurelle principale, à savoir la dérive réglementaire vers le haut de gamme ». C'est donc sur les fondamentaux industriels qu'il convient d'agir pour réussir la transition, y compris dans l'électromobilité.
A. INVESTIR DANS L'ÉLECTRIQUE : UNE NÉCESSITÉ
1. Une révolution en marche
Malgré les réels assouplissements proposés à la réglementation européenne, pour sortir du « tout électrique », les rapporteurs sont, comme l'ensemble des personnes auditionnées, convaincus que l'électrification sera la solution gagnante pour décarboner les mobilités individuelles.
En effet, ainsi qu'indiqué plus haut, l'automobile représente actuellement environ deux tiers des mobilités des Français. De ce fait, les autres leviers de décarbonation des mobilités de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) - modération des distances parcourues, report modal et augmentation du remplissage des véhicules, notamment par le covoiturage -, ne pourront, dans l'immédiat, qu'apporter une contribution marginale à la décarbonation.
Part de la voiture dans les mobilités des Français
Source : document fourni par A. Bigo
Parallèlement, malgré les récents reculs, et si sa part dans le parc total reste minoritaire, la part des véhicules électriques (« tout électrique » et hybrides rechargeables99(*)) dans les ventes de véhicules neufs a rapidement augmenté sur le moyen terme, en France (de 1,9 % en 2019 à 17 % actuellement100(*)), en Europe et dans le monde (de 2,1 M à 13,8 M entre 2018 et 2023101(*)), malgré une pénétration a été très inégale selon les régions.
Source : A. Bigo
Part des ventes de voitures neuves dans l'Union
européenne
par type de motorisation (2001-2003)
Source : Alochet mai 2024, p. 37, données Acea
La révolution en marche en Europe est en réalité, au niveau mondial, toujours tirée par la Chine. Si aux États-Unis, la part des ventes de véhicules électriques représentait seulement 16 % en 2023, et 4 % au Japon, la tendance à l'électrification est également en marche dans certains pays du Sud, comme au Vietnam ou en Turquie, où la part des ventes de véhicules électriques se situe déjà autour de 10 % - de même en Thaïlande, où l'absence totale de barrières douanières sur les véhicules chinois assure leur pénétration rapide du marché102(*).
De ce fait, à l'exemple chinois, des pays émergents comme le Brésil et l'Inde commencent à structurer des politiques industrielles visant à développer la production de véhicules électriques103(*). Les constructeurs européens ne peuvent donc pas rester en-dehors du jeu. Les rapporteurs ne peuvent par conséquent que souscrire à l'ambition portée par le président Macron, qui voulait, à la sortie de la crise Covid, faire de la France le leader de la production de véhicules électriques, et avait fixé un objectif de production de 2 millions de véhicules électriques produits en France à horizon 2030104(*), avec un « point de passage » à 1 million en 2027.
Ils notent d'ailleurs avec satisfaction que des investissements massifs ont été engagés par les constructeurs et l'État pour tenir cette trajectoire, et portent déjà leurs fruits : selon les informations fournies par la DGE, le site Renault à Douai est ainsi passé d'une production entièrement thermique en 2019 à 100 % électrique en 2024 et renoue déjà avec les volumes connus avant la Covid-19 ; Stellantis, Renault et Toyota proposent désormais 12 modèles électriques fabriqués en France ; le site de Toyota à Onnaing n'a jamais autant produit qu'en 2024, avec une gamme quasi entièrement électrifiée.
Cela ne signifie naturellement pas qu'il faut abandonner la production de véhicules thermiques : en vue de servir notamment les marchés du Sud, certains constructeurs comme Toyota développent d'ailleurs une stratégie « multicanal », précurseur sur l'hybride ; Renault a, pour sa part, choisi de scinder ces deux activités, en conservant avec sa division Horse une production innovante de moteurs thermiques), à rebours par exemple de la stratégie « New Auto » de Volkswagen, tournée toute entière vers l'électrique.
2. Un enjeu de souveraineté
La sortie des énergies fossiles pour les mobilités revêt également un enjeu de souveraineté énergétique : le pétrole utilisé pour les mobilités particulières représente environ 500 TWh, l'importation de produits pétroliers raffinés pesant lourdement sur la balance commerciale française (près de 26 Md€ en 2024 ont été consacrés à l'approvisionnement en carburants pour le transport routier, qui représente 91 % de la consommation pétrolière nationale). Or l'équivalent en électricité serait de 100 TWh, ce qui est exactement l'électricité exportée par la France tous les ans. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles améliorerait donc la balance commerciale de la France. Or, de l'aveu même de leurs représentants, les autres solutions de mobilité décarbonée, en totalité ou partiellement, ne pourront pas couvrir l'ensemble des besoins du parc : Bioéthanol France estime que si la production de biocarburants en France « montait » à 1 % de la surface agricole utile (contre 0,7 % actuellement, ce qui semble devoir être le maximum pour ne pas créer d'éviction d'usage agricole, c'est moins de 20 % du parc total qui pourrait utiliser des biocarburants, grâce à des motorisations hybrides rechargeables.
B. DES STRATÉGIES POUR RATTRAPER LE RETARD TECHNOLOGIQUE ACCUMULÉ
1. Soutenir le rattrapage technologique
a) Imposer aux acteurs extra-européens implantés en Europe des transferts de technologie
(1) La tentation des alliances avec les acteurs chinois : une fausse bonne idée ?
Ainsi qu'indiqué précédemment, et comme avait pu le constater sur place une délégation de la commission des affaires économiques lors de son déplacement en Chine en septembre 2024, les acteurs chinois de l'industrie automobile ont une avance technologique considérable sur les véhicules électriques, en raison de leurs performances non seulement sur les batteries et les technologies électriques proprement dites, mais également sur la numérisation des véhicules (certains « nouveaux constructeurs » comme Xiaomi étant d'ailleurs issus du monde de la tech).
Partant de ce constat, de nombreux constructeurs européens ont fait le pari d'accord de coopération avec des acteurs chinois, afin d'accélérer leur rattrapage sur ces technologies : Renault a des alliances avec Envision Energy (cellules et batteries), Minth (packs de batteries), Geely (pour la division thermique) et Dongfeng (pour le développement et la production de la Dacia Spring en Chine), tandis que Stellantis est associé à Leapmotor, pour la production de petites citadines en Chine et en Pologne, pour le marché européen.
Volkswagen, qui avait noué une coentreprise en Chine avec SAIC il y a 40 ans, fondant ainsi l'une des premières coentreprises internationales dans la région, a récemment prolongé cet accord de partenariat jusqu'en 2040, tout en le doublant d'un accord de coopération stratégique avec FAW pour la coentreprise FAW-Volkswagen, en vue de servir le marché chinois. Le constructeur a également signalé avoir signé un partenariat stratégique avec XPENG, en vue d'une coopération technologique à long terme dans les domaines de l'électromobilité, des logiciels et de la conduite autonome. L'entreprise développe également l'architecture électronique de ses véhicules en partenariat avec le Chinois XPeng en Chine.
Très favorable à des alliances avec les constructeurs chinois pour rattraper le retard technologique européen, l'Acea souligne cependant que les constructeurs, dans cette démarche, doivent se garder de toute naïveté.
Les rapporteurs partagent cette dernière appréciation, et estiment que ce type de partenariats risque au contraire de faire courir le risque d'une dépendance stratégique encore accrue à l'égard des acteurs chinois, sur toute la chaîne de valeur. Ainsi que l'exprimait l'universitaire spécialiste de l'automobile Tommaso Pardi au journal Le Monde dans une récente tribune, « [a]u lieu de structurer autour d'une politique industrielle européenne digne de ce nom une riposte collective au défi chinois, les constructeurs s'apprêtent à négocier, chacun de son côté, les conditions de la reddition, sous la forme de "collaborations stratégiques" ».
Peu confiants dans l'intention des acteurs chinois de partager effectivement leurs technologies les plus avancées à leurs concurrents européens, les rapporteurs estiment que cette stratégie risquerait, à terme, de les fragiliser encore davantage. À ce propos, l'un des acteurs majeurs de la filière, auditionné par les rapporteurs, a comparé la situation de l'industrie automobile européenne à celle de l'électronique grand public, il y a quelques années : ne resteraient en Europe, dans les années à venir, que les usines d'assemblage, tant qu'existeraient des barrières douanières ; à la levée de ces dernières, même ces usines d'assemblage seraient, à terme, délocalisées.
(2) Favoriser les implantations sur le sol européen et les transferts de technologies à grande échelle
Les rapporteurs estiment au contraire intéressant d'attirer sur le sol français et européen des acteurs industriels extra-européens, à l'image de Business France, qui soutient idée que l'implantation d'acteurs chinois en Europe pourrait bénéficier aux acteurs européens. Les entreprises asiatiques, notamment les entreprises chinoises, possèdent en effet des technologies de pointe en matière de batteries. Leur implantation en France permettrait d'accélérer la souveraineté française dans ce domaine.
L'investissement de la société sino-japonaise Envision AESC est un exemple probant des effets positifs des investissements étrangers. Cette usine de production de cellules, annoncée en 2021, commencera à produire en masse en 2025. Afin de sécuriser la chaîne de valeur des batteries en France, il est crucial de maintenir un équilibre entre des entreprises émergentes telles qu'ACC et Verkor, et des entreprises étrangères disposant déjà du savoir-faire technologique. Les 3,5 M€ qui ont été versés par la France entre 2019 et 2023 pour soutenir la chaîne de valeur de la batterie en vue de la création de gigafactories (« méga-usines ») ont d'ailleurs pour partie bénéficié à AESC et au Taïwanais Prologium105(*).
Les rapporteurs estiment que ces transferts de technologie devraient être plus systématiquement imposés, pour les entreprises extra-européennes désireuses de s'implanter sur le sol européen ou dans des pays couverts par des accords de libre-échange. Il ne s'agirait d'ailleurs que de répliquer à ce que la Chine a mis en oeuvre depuis de longues années, sous la forme des co-entreprises.
À l'heure où les barrières commerciales états-uniennes renchérissent la valeur du marché européen pour les constructeurs chinois, et où les critères d'éco-conditionnalité favorisent les productions effectuées sur le sol européen, les rapporteurs soulignent que les circonstances sont favorables, pour imposer des conditions supplémentaires à l'installation d'usines sur le sol européen, sous la forme de tels transferts de technologies. Pour illustration, BYD a déjà implanté une usine à Szeged, en Hongrie, dont devrait sortir dès la fin de l'année 2025 la future Dolphin Surf, et une seconde usine destinée à servir le marché européen devrait ouvrir à Manisa, en Turquie, courant 2026106(*), BYD envisageant une troisième implantation, dont la localisation exacte reste à définir. On peut également mentionner, parmi d'autres, l'implantation de Chery en Espagne et de Tesla en Allemagne.
Denis Redonnet, directeur- adjoint à la DG Trade à la Commission européenne, a d'ailleurs indiqué aux rapporteurs que cette dernière réfléchit à conditionner les investissements directs étrangers (IDE) dans l'Union, notamment chinois, à des éléments de politique industrielle, mais sans que la réflexion ait pour l'instant abouti.
La présence de constructeurs même extra-européens sur le sol français pourrait en outre être une chance pour la filière et pour l'emploi locaux, comme ce fut le cas avec l'arrivée de Toyota sur le site de Valenciennes en 1998, alors même que son annonce avait suscité beaucoup d'inquiétudes des constructeurs français : au final, de l'aveu général, l'arrivée de Toyota en France a eu des retombées positives très significatives, avec plus de 5 000 personnes employées sur le site de Valenciennes, et des investissements continus (plus de 1,5 Mds€ investis en France depuis 2021), et une entreprise très ancrée dans le territoire qui fait fonctionner le tissu de sous-traitants locaux.
Recommandation n° 16 : Contraindre les acteurs extra-européens installés en Europe à des transferts de technologie.
b) Miser sur l'innovation pour être reprendre le leadership sur la prochaine génération de véhicules
(1) Un écosystème de recherche et développement performant et prometteur
L'industrie automobile française et européenne peut s'enorgueillir de capacités et de résultats performants en matière de recherche et développement (R&D). Selon la Fiev, l'industrie automobile investit chaque année environ 60 Md€ par an dans la R&D, ce qui représente environ un tiers des dépenses totales de R&D du secteur industriel. Cet effort a globalement été maintenu ces dernières années, chez la majorité des acteurs français majeurs du secteur. Résultat : quatre entreprises industrielles automobiles sont parmi les dix premiers déposants de brevets en France en 2024. Selon la PFA, plus de la moitié des brevets déposés en France en 2024 émaneraient du secteur automobile. Cette bonne tenue de la R&D française et européenne concerne également les équipementiers : les équipementiers affirment consacrer pas moins de 6 à 7 % de leur chiffre d'affaires à la R&D, soit 1,5 Md€ par an au total et Valeo s'affirme aujourd'hui comme le premier déposant français de brevets dans le monde (plus de 1 600 brevets déposés en 2024).
Les nouveaux acteurs de la mobilité automobile ne sont pas en reste : en ce qui concerne la production de batteries, ACC a déposé en 2024 pas moins de 130 brevets, se plaçant donc à la 36e place du classement Inpi - Verkor figure également dans le top 50.
Source : document fourni par la Fiev
Lors de leur déplacement en Bourgogne-Franche-Comté, les rapporteurs ont pu échanger à propos du pôle Véhicule du futur, implanté dans la région ainsi que dans la région Grand Est, et qui fédère quelque 630 projets de recherche, pour constater la grande qualité des travaux menés. Selon l'Acea, entendue par les rapporteurs à Bruxelles, l'industrie automobile européenne aurait fait « plus de progrès technologiques ces cinq dernières années sur les véhicules électriques que la Chine sur les cinq premières années de la stratégie `Made in China 2025' ».
Les principaux axes de recherche actuellement déployés en France et en Europe dans l'industrie automobile sont les secteurs des batteries, de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes.
Du point de vue de la R&D, la France demeure attractive, de l'aveu des acteurs interrogés : outre le vivier de talents français et la proximité géographique de Saft, ACC indique par exemple avoir ancré ses activités de R&D en France du fait des financements publics permis par le mécanisme de Projet important d'intérêt européen commun (Piiec) et du fait de l'existence du Crédit d'impôt recherche (CIR) (non cumulatif avec les financements Piiec, mais qui permet d'en prendre partiellement le relais après l'extinction de ces derniers). Pour les rapporteurs, il est indispensable de sanctuariser le principe de cet outil107(*).
Les constructeurs et équipementiers peuvent en outre s'appuyer sur des infrastructures de recherche de très haute qualité, dont les liens avec l'industrie automobile sont souvent anciens. Les rapporteurs ont ainsi eu l'occasion d'entendre des représentants de l'Université de technologie de Compiègne (UTC), dont les liens avec l'industrie automobile sont anciens, historiquement via une chaire Saint-Gobain sur les « vitrages du futur », et qui continuent de s'incarner à travers deux laboratoires dédiés respectivement au véhicule autonome (Sivalab, partenariat ancien entre le CNRS et Renault) et aux aciers employés dans l'industrie automobile, notamment à travers le prisme de la décarbonation (FuseMetal, partenariat entre ArcelorMittal et l'unité de recherche Roberval).
Bien qu'elle demeure performante et de haut niveau, les rapporteurs notent cependant que cette R&D n'est pas exempte de fragilités. Elle souffre tout d'abord, lorsqu'on la compare aux capacités chinoises, d'un problème d'échelle : ACC a cité le nombre de 20 000 scientifiques employés par le géant chinois des batteries CATL, contre 800 « seulement » chez ACC. Le constructeur BYD a annoncé en employer... 110 000108(*) (!), rien que dans sa branche strictement automobile.
Le déséquilibre est également intra-européen : selon Stephen Marvin, président du pôle de compétitivité Vedecom et directeur R&D de la PFA, la filière automobile compterait en France environ 28 000 chercheurs aujourd'hui, contre... 157 000 en Allemagne !
Or cette situation risque de ne pas s'améliorer, dans la mesure où les acteurs de la filière ont alerté sur le manque d'attractivité de l'industrie automobile pour les jeunes chercheurs, en raison de salaires peu élevés par rapport à d'autres filières, en raison des baisses de marges, chez les constructeurs et a fortiori chez les équipementiers. Les syndicats interrogés ont d'ailleurs fait état de déménagements récents de centres de recherche hors d'Europe, notamment en Inde, et appelé à une stratégie de R&D dans le secteur automobile au niveau européen. Comme le souligne la CGT, « la conception de la C3 et de la Twingo électrique hors de l'Hexagone n'est clairement pas un bon signe ».
Les acteurs institutionnels de la recherche, interrogés par les rapporteurs, ont en outre pointé, en plus de la faiblesse globale du financement de la recherche, et notamment de la recherche partenariale directe avec les partenaires socio-économiques, les modalités de financement par projets, qui empêchent selon eux d'installer une vision de long terme pour faire face aux transitions auxquelles l'industrie doit faire face et permettre que les résultats de la recherche puissent être traduits en termes d'activité industrielle. Sur ce point, le CNRS a souligné la difficulté à reconduire des accords-cadres de long terme avec des industriels pour qui il est de plus en plus difficile, du fait des incessants changements de réglementation, de s'engager à moyen terme sur une technologie plutôt qu'une autre. Or le déficit de R&D ainsi induit pourrait, à terme, être très pénalisant pour les capacités d'innovation de l'ensemble de la filière.
Il convient aussi de noter que ces mêmes acteurs institutionnels ont souligné l'intérêt de soutenir également une activité de R&D interne au sein des entreprises, qui, selon eux, améliore considérablement le dialogue et l'intégration des résultats de la R&D dans l'activité industrielle. En ce sens, il conviendrait de favoriser l'emploi des doctorants et de docteurs dans l'industrie pour leur compréhension des exigences d'une recherche efficace, alors que les salaires des doctorants demeurent peu compétitifs en France, vis-à-vis notamment de la Belgique ou de l'Allemagne.
Ces efforts de R&D devront s'étendre sur toute la chaîne de valeur, et concerner notamment les batteries. Si l'avance asiatique semble irrattrapable, l'entreprise Verkor a fait valoir aux rapporteurs le rôle pionnier des Français dans la mise au point notamment des batteries LFP (lithium-fer-phosphate), dont les brevets auraient été copiés par nos compétiteurs chinois avant de tomber dans le domaine public.
La multiplicité des types de batteries, avec chacune leurs atouts et leurs contraintes, laisse le jeu ouvert aux Européens pour reprendre la main.
Les différentes technologies de batteries
|
Technologie |
Caractéristiques principales |
Avantages |
Inconvénients |
|
LFP |
Chimie sans cobalt Densité énergétique modérée. |
• Très bonne stabilité thermique (faible
risque d'incendie) |
• Autonomie plus limitée (densité
énergétique plus faible) |
|
NMC |
Technologie dominante Bon compromis entre puissance |
• Densité énergétique
élevée (grande autonomie) |
• Moins stable |
|
NCA |
Technologie proche du NMC, utilisée notamment |
• Densité
énergétique |
• Moins stable que LFP |
|
Sodium-ion |
Nouvelle technologie |
• Coût très bas (matières
abondantes) |
• Densité énergétique
inférieure au lithium-ion |
|
Lithium-ion générique |
Famille de technologies incluant LFP, NMC, NCA... utilisée depuis les débuts du véhicule électrique. |
• Technologie mature |
• Risque thermique selon la chimie utilisée
|
ACC a d'ailleurs indiqué aux rapporteurs travailler sur plusieurs scénarios de diversifications technologiques avec ses équipes internes ou par voie de partenariats, afin de satisfaire la demande de ses clients pour des alternatives plus économiques que la chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt), actuellement dominante en Europe.
Les stratégies des constructeurs divergent sur ce point109(*), mais Volkswagen Group a par exemple confié investir dans la R&D sur les batteries solides, offrant une plus grande puissance et des vitesses de charge plus rapides, tandis que Toyota a indiqué miser parallèlement sur les batteries financièrement abordables grâce à la technologie Lithium Fer Phosphate (LPF) et les batteries solides.
Recommandation n° 17 :
Sanctuariser les mécanismes de soutien à la recherche en entreprise, notamment le principe du CIR et les dispositifs relatifs à l'emploi des doctorants.
Encourager en particulier la recherche sur les batteries.
(2) Investir le logiciel
Si l'avance de la Chine est incontestable sur les batteries, elle est beaucoup moins nette pour les autres grandes évolutions qui affectent les mobilités et l'industrie automobile.
L'ensemble des constructeurs cherche en effet actuellement à développer le « Software Defined Vehicle »110(*) (SDV), une plateforme permettant d'offrir des systèmes d'aide à la conduite avancés, allant jusqu'à la conduite automatisée, et visant à améliorer le confort des conducteurs grâce à une personnalisation à la demande, tout en permettant des mises à jour et une maintenance continues. Or en dépit de la conversion en constructeurs de quelques acteurs chinois de la tech, et de la débauche d'outils numériques affichée dans certains véhicules chinois, dans le domaine du développement du véhicule numérique, avec le développement des technologies d'info-divertissement, de la connectivité et des fonctions de conduite autonome, mais aussi de la sécurité active, les Européens disposent de solides arguments à faire valoir.
Cette appréciation est partagée tant par l'Acea que par les acteurs institutionnels : pour Moumen Hamdouche, chef d'unité à la DG Move à la Commission européenne, « la partie digitale et logicielle n'a pas encore été perdue par l'Union européenne, et il faudrait sans doute "mettre le paquet" là-dessus ».
De fait, le CNRS a indiqué que parmi les quatre domaines dans lesquels les Français et les Européens sont en pointe, deux (la robotique et le numérique et le traitement de données) concernent le numérique. Comme le résumait Luc Julia, spécialiste de l'intelligence artificielle, directeur scientifique de Renault, devant la commission des affaires économiques le 18 juin dernier : « Concernant la place de la France et la qualité de nos chercheurs [dans le domaine numérique], il faut affirmer un point : nous sommes les meilleurs ».
Or le rôle croissant des logiciels redéfinit l'ensemble de la chaîne de valeur automobile et peut constituer un important relais de croissance : alors qu'aujourd'hui, les constructeurs réalisent leur bénéfice sur le prix de vente du véhicule, à l'avenir, les logiciels devraient permettre de créer de la valeur pendant les 15 ou 20 ans de la durée de vie du véhicule, via des abonnements ou la mise à disposition d'options.
Le développement du logiciel peut également avoir des effets directs sur les coûts de production des autres composantes du véhicule, par les mutualisations qu'il permet : Xavier Mosquet a ainsi évoqué le cas des phares des véhicules Tesla, complètement standardisés sur l'ensemble des véhicules vendus dans le monde, mais dont le logiciel peut adapter le comportement aux réglementations locales, ce qui, à long terme, contribue à réduire les coûts.
Les rapporteurs notent d'ailleurs avec intérêt que dans ce domaine, plus peut-être que dans tous les autres, la relation traditionnelle entre constructeurs et équipementiers est rebattue, évoluant nécessairement vers un co-développement, comme le montre par exemple le partenariat noué par Valeo avec Renault, au sein d'un écosystème plus large, qui comprend également des acteurs du numérique comme Qualcomm et Google. Ils saluent l'engagement des équipementiers français en faveur du numérique, avec par exemple la création par Valeo de sa division Valeo Brain, leader mondial des produits liés aux véhicules autonomes et connectés, et fournisseur de capteurs, calculateurs et logiciels, qui emploie pas moins de 200 ingénieurs dans son centre de recherche dédié à l'électrique, etc. : Valeo se positionne ainsi en spécialiste pour faire le lien entre les acteurs de la tech et le monde automobile, avec des partenariats structurants avec Google, Amazon ou encore Qualcomm, ce qui pourrait lui permettre de « tirer son épingle du jeu » dans les années à venir.
Les constructeurs automobiles européens ont donc les moyens de se positionner dans ce domaine, et même de devenir des pionniers dans les véhicules autonomes. Dans ce champ également, un financement ciblé de la politique industrielle pourrait contribuer à soutenir ce chantier d'avenir, sur la base duquel il pourrait être possible d'établir, à moyen terme, une chaîne de valeur européenne de référence dans le domaine des systèmes d'IA pour la conduite autonome, en vue de poser les fondations d'un leadership technologique d'ici 2035.
Recommandation n° 18 : Soutenir l'émergence d'un écosystème français et européen du véhicule numérique en favorisant le développement d'entreprises spécialisées dans les logiciels embarqués et les systèmes de conduite intelligente, pour renforcer la compétitivité et l'autonomie technologique de la filière automobile.
Créer un Airbus européen du logiciel embarqué.
2. Batteries et matières critiques : sortir de la dépendance asiatique
a) Un approvisionnement en batteries marqué par une dépendance à la Chine
La filière des batteries est actuellement très majoritairement asiatique, particulièrement chinoise : les dix premiers producteurs de batteries mondiaux sont asiatiques, dont six chinois ; le premier producteur, CATL, détient ainsi plus de 35 % du marché mondial. En 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie, 80 % des batteries utilisées en Europe venaient d'Asie111(*) : Toyota a par exemple indiqué importer ses batteries hybrides du Japon, tandis que Stellantis se fournit pour l'instant auprès de CATL pour la fourniture des batteries de la Citroën ë-C3 et de véhicules utilitaires.
Cette situation crée une évidente dépendance à la Chine, qui, dans une optique de souveraineté européenne, n'est pas acceptable, les constructeurs européens se trouvant à la merci des fournisseurs de batteries chinois, tout autant en ce qui concerne la fourniture même des batteries que leur prix.
Cette dépendance s'étend en outre sur les outils de production : il a été suggéré aux rapporteurs que les machines installées dans l'usine ACC, produites en Chine, poseraient d'importants problèmes de protection des données industrielles et, partant, de souveraineté.
Part de marché des principaux producteurs mondiaux de batteries
Source : document transmis par ACC
b) Assumer le soutien à la filière européenne de la batterie
(1) Des débuts prometteurs...
Outre les filiales de fabricants de batteries asiatiques, se sont développées en Europe plusieurs jeunes entreprises qui se sont lancées dans la production de batteries pour véhicules électriques, notamment le Suédois Northvolt (aujourd'hui en grande difficulté et en partie reprise par le groupe américain Lyten), PowerCo, filiale de Volkswagen, et les français ACC et Verkor.
Ces acteurs doivent être fermement soutenus, tant pour des motifs de souveraineté que parce que la filière des batteries constitue une opportunité de réindustrialisation, dans les régions mêmes affectées par la crise de l'industrie automobile : selon la PFA, citée par Verkor dans sa contribution écrite, la filière batterie pourrait générer jusqu'à 35 000 emplois directs d'ici 2030, dont près de 12 000 dans les seules usines de batteries et de moteurs électriques. Il s'agit en outre d'emplois qualifiés.
Comme pour les usines de voitures, il est en outre important d'éviter que les producteurs extra-européens de batteries s'implantent en Europe en lieu et place des producteurs européens, comme l'a par exemple fait le Coréen ESCA en Allemagne, si ces implantations ne s'accompagnent pas de transferts massifs et complets de technologie112(*).
Parmi les pionniers de la batterie en Europe se trouvent deux entreprises françaises, que les rapporteurs ont auditionnées :
- créée en 2020 et détenue par Stellantis (45 %), Mercedes (30 %) et Saft/TotalEnergies (25 %), elle est implantée en France sur quatre sites, dont la gigafactory de Billy-Berclau-Douvrin, qui emploie (début 2025) environ 1 000 salariés.
Elle produit des batteries pour Stellantis et Mercedes.
ACC est le premier fabricant européen dont les batteries sont commercialisées, avec une capacité de production qui, en mars 2025, permettait d'équiper environ 200 à 300 voitures par semaine.
Un second bloc de production est en cours d'installation.
Les batteries produites par ACC sont de type NMC ;
- lancée également en 2020, Verkor compte un actionnariat plus varié, qui comprend notamment Renault Group, qui est également son principal client.
La production de cellules de batteries Verkor est actuellement faite sur son site de R&D de Grenoble, et équipe les Alpine A390 de Renault. C'est cependant la gigafactory en cours de création à Dunkerque qui a vocation à assurer la production de masse. Selon l'industriel, la production devrait démarrer début 2026, pour de premières ventes commerciales au 1er semestre 2026, avec un objectif à terme (2028) d'équiper 200 000 véhicules par an. À terme, l'usine devrait employer environ 1 200 personnes.
En Allemagne, Volkswagen a également développé une filiale, PowerCo SE, qui est actuellement le plus grand fabricant de cellules de batterie en Europe, avec des sites de production à Salzgitter (Allemagne) et Valence (Espagne), mais aussi au Canada.
(2) ... mais des difficultés de montée en cadence
Or, ces entreprises pionnières rencontrent des difficultés de montée en cadence, qui menacent leur viabilité.
La réalité de ces difficultés a été illustrée par la faillite retentissante du Suédois Northvolt, pourtant puissamment financé, et soutenu par des clients et actionnaires de poids, notamment Volkswagen et BMW. Si, selon les experts entendus, la stratégie d'intégration verticale de Northvolt (de l'extraction des matières premières au recyclage), peut être mise en cause, cet échec illustre bien la délicatesse de la phase de montée en puissance. Au temps pour maîtriser les processus et les équipements de fabrication des cellules, qui se compte en années, s'ajoute en effet le temps nécessaire pour atteindre un rendement et des coûts économiquement viables, similaires à ceux des producteurs asiatiques. Ainsi, ACC, estime que sa cadence de production devrait être multipliée par 20 entre le printemps et la fin 2025 pour que l'entreprise puisse être viable, alors même que la production, partant d'un niveau quasi nul, a déjà été multipliée par 20 en deux mois début 2025.
En effet, la fabrication de batteries pour les véhicules électriques exige un investissement initial important dans la conception du produit par les équipes de R&D, le développement d'une ligne pilote à petite échelle pour définir le process industriel avant qu'il ne soit déployé à grande échelle, la construction de la gigafactory, les installations, l'équipement et la technologie, ainsi que les dépenses pour les matières premières, la main-d'oeuvre et l'entretien. Le coût d'un bloc ayant une capacité de production d'environ 15 GWh est ainsi estimé à 1 milliard d'euros, selon les données fournies par ACC.
Du fait de ce coût gigantesque, ACC a par exemple indiqué aux rapporteurs que le montant cumulé des aides publiques européennes, nationales et locales reçues s'élevait actuellement à près de 850 M€, dont 690 M€ de la part de l'État français, notamment grâce au statut de Projet important d'intérêt européen commun (Piiec), qui autorise, dans un certain nombre de secteurs, en cas de démonstration de l'impossibilité économique de mener à bien le projet sans aide, le versement d'aides d'État. Verkor indique que l'investissement dans son usine de Dunkerque a été au total d'environ 1,5 Md€, dont 659 M€ de l'État français et 60 M€ environ des collectivités.
Cependant, ces soutiens demeurent insuffisants, au regard des difficultés de mise en production rencontrées dans les premiers mois de fonctionnement : la presse s'est ainsi fait l'écho de taux de rebut très importants dans la production d'ACC, d'autant plus préjudiciables que les niveaux de dépenses opérationnelles sont également élevés : Verkor a ainsi évoqué, en début de production, une consommation de 1 M€ de matières premières tous les trois jours, soit 100 M€ par an !
(3) Une nécessaire adaptation du cadre des aides européennes, en faveur de la production
Or, comme l'a résumé aux rapporteurs Christophe Perillat, patron de Valeo, « [l]e cadre du droit européen empêche de larges programmes de soutien à la compétitivité de l'industrie européenne : les régimes d'aide ne permettant de financer que de l'innovation, à un moment où l'industrie a besoin de pouvoir allier R&D et compétitivité de ses investissements industriels (Capex). Le seul outil qui permet ce type de soutien est le Piiec (IPCEI en anglais), mais dont la mise en place est lourde et complexe (puisque s'appuyant entre autres choses sur une notification à la Commission européenne). Une simplification de ces processus est nécessaire pour permettre un soutien effectif au secteur en période de fragilité économique et face à des mécanismes d'aide beaucoup plus efficaces hors d'Europe (IRA aux États-Unis, aides en Chine, etc.) ». Cette appréciation est partagée par Volkswagen Group, qui estime que pour rester compétitive dans les technologies zéro émission l'Union européenne doit non seulement investir dans la recherche et développement, mais également dans le passage à l'échelle industrielle des technologies clés comme la production de cellules de batteries en Europe, ce qui nécessite une réforme en profondeur du cadre des aides d'État, permettant notamment le financement ciblé des dépenses d'exploitation (Opex), et ce dans l'ensemble de l'Union, sur le modèle de l'Inflation Reduction Act américain. Cette analyse est également partagée par la PFA.
Cette situation semble avoir été prise en compte par la Commission européenne, puisque les règles d'accès à l'Innovation Fund ont été assouplies afin de permettre à l'Innovation Fund 24 Battery de financer la finalisation de l' « ingénierie produit » d'ACC et l'amélioration de ses procédés de production, à hauteur de 852 M€113(*).
Cette dynamique doit être maintenue : alors que la Commission européenne a annoncé que le futur Fonds de compétitivité qui devrait être mis en place dans le cadre du prochain budget pluriannuel pourrait, à son tour, financer certains projets en phase d'industrialisation, les oppositions, notamment au Parlement européen, à la nouvelle architecture globale des vecteurs de financement européen, pourraient compromettre cette ambition pourtant essentielle. Les rapporteurs appellent ainsi à être très attentifs à ce que ce futur Fonds de compétitivité, ou un fonds équivalent, permette le financement de nouveaux projets au stade de l'industrialisation, ou la modernisation de sites stratégiques, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries.
Cette stratégie ne signifie naturellement pas de cesser le financement de la R&D dans le secteur des batteries. Au contraire, la diversification des technologies de batteries complexifie effectivement l'équation qui se pose aux producteurs de batteries naissants, puisqu'il leur est demandé, en plus de faire parvenir à maturité la production de batteries NMC, de se mettre à niveau sur la technologie LFP, déjà maîtrisée par les Chinois. Plusieurs experts auditionnés s'accordent même à dire que le retard structurel de la France et de l'Europe sur les générations actuelles de batteries impose de se positionner sur d'autres technologies (par exemple la batterie sodium-ion, qui offre d'autres performances que la batterie lithium, notamment en termes de temps de recharge et de sécurité, ou le recyclage des batteries usagées, qui permettrait de réduire non seulement l'impact environnemental, mais aussi la dépendance aux matériaux critiques et à l'Asie).
Les rapporteurs partagent cependant plus l'avis exprimé par l'expert Xavier Mosquet, selon lequel il est d'abord nécessaire de permettre à ACC et aux autres producteurs européens de stabiliser leurs technologies actuelles, afin qu'elles puissent servir d'« accroche » pour les innovations qui suivront, qui ne pourront être qu'incrémentales. En ce sens donc, le rattrapage sur les technologies actuelles fait partie des dépenses nécessaires à l'innovation future. Il faut dès lors à la fois monter en compétence sur les technologies existantes, et renforcer notre portefeuille d'innovations et les moyens du passage des idées à leur validation à l'échelle industrielle.
C'est d'ailleurs le pari fait par ACC, qui se donne pour l'instant d'abord pour objectif de maîtriser les technologies actuellement matures d'honorer les contrats passés, en fournissant des produits répondant aux attentes du marché européen, plutôt que de chercher à développer des batteries aux performances plus ambitieuses (par exemple les fameuses batteries capables de se recharger en 5 minutes, récemment annoncées par le constructeur BYD).
ACC et Verkor ont également souligné devant les rapporteurs l'enjeu fondamental de la compétitivité-coûts, qui demeurera réelle, même une fois passée la phase d'apprentissage, et suggèrent d'accompagner de manière transitoire les pionniers européens de la batterie par des aides directes à la production (aides en €/KWh), sur le modèle de l'Inflation Reduction Act américain, pour compenser l'écart de compétitivité-coûts liée à leur manque d'expérience, à l'insuffisant effet d'échelle et à l'absence d'une chaîne de valeur locale. Comme eux, les rapporteurs estiment que sans un tel dispositif compensatoire capable de rendre la production locale compétitive avec celle fabriquée en Asie, il est illusoire de considérer que les constructeurs automobiles européens s'approvisionneront durablement et significativement en cellules et modules européens. Ces aides devraient être dégressives, et d'une durée limitée au strict minimum.
Une telle aide impliquerait également de revoir la stratégie européenne en matière d'aides à la production et de droit de la concurrence. La doctrine communautaire est opposée aux aides à la production pour des considérations de droit de la concurrence.
Recommandation n° 11 :
Soutenir le développement et le passage à l'échelle des gigafactories européennes en adaptant le cadre européen des aides d'État ; mieux mobiliser les fonds européens en ce sens, notamment en s'assurant que le futur Fonds de compétitivité pourra financer des projets en phase d'industrialisation.
Doubler ce soutien d'aides dégressives à la production, afin d'assurer la compétitivité des acteurs européens par rapport à leurs compétiteurs asiatiques.
c) Muscler la stratégie européenne visant à sécuriser l'approvisionnement en matériaux critiques
La production de batteries nécessite de disposer de métaux rares en grande quantité. Ainsi, les acteurs de la filière de l'électromobilité anticipent une explosion de la demande mondiale en minéraux critiques d'ici à 2035, avec une demande multipliée par deux pour les terres rares et quasiment par six pour le lithium.
Or les capacités de production de tels matériaux sur le sol européen demeurent très limitées - même si la France devrait à compter de 2030 disposer de capacités de production sur le sol nationale, avec la mine d'Echassières (Allier). Les ressources sont concentrées en Chine (qui possède par exemple 90 % du graphite mondial, 70 % des terres rares nécessaires aux voitures électriques et 16,5 % des ressources mondiales de lithium114(*)) et dans d'autres pays tiers à l'Union européenne comme l'Australie, le Chili ou l'Indonésie. Surtout, la Chine détient plus de 70 % des capacités de raffinage de lithium, 40 % de celles du cuivre et 90 % de celles des terres rares. Elle raffine également 61 % du cobalt mondial115(*).
Source : PFA
Ainsi, en dépit de la création de capacités de productions de batteries sur le sol européen, la dépendance stratégique aux pays fournisseurs de matières premières critiques risque bel et bien de demeurer.
L'Union européenne a déjà entrepris des actions visant à limiter cette dépendance, en instaurant un règlement sur les matières premières critiques116(*), visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement intérieures et à diversifier les partenariats avec les pays extra-européens fournisseurs, en fixant des objectifs à horizon 2030 de couverture des besoins de l'Union assurés à 10 % par l'extraction réalisée sur le sol européen, à 40 % par la transformation réalisée sur le sol européen, et à 25 % par le recyclage. En outre, 65 % maximum des besoins annuels de l'Union dans une matière première donnée pourra provenir d'un seul État extra-européen. Cette stratégie a été concrétisée par l'annonce début 2025 de deux vagues de labellisation de projets stratégiques de traitement, substitution, extraction ou recyclage appelées à être soutenues par l'Union, mais aussi par la mise à jour, par exemple, de l'accord commercial avec le Chili, riche en métaux critiques, entrée en vigueur au 1er février 2025.
Cette stratégie européenne est doublée depuis 2022 par une stratégie nationale visant à assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement en métaux rares117(*).
Les rapporteurs se félicitent bien entendu de cette prise de conscience et des actions déjà engagées, et ont accueilli avec satisfaction l'assurance donnée par le commissaire européen Stéphane Séjourné que l'Europe devrait, selon toute vraisemblance, être souveraine sur sa production de lithium d'ici à 2030.
Ils notent cependant, à la suite de la Cour des comptes118(*), que la concurrence entre les différents acteurs européens freine la mise en oeuvre de stratégies de diversification des approvisionnements efficaces - au contraire, par exemple, de ce qui s'observe dans l'industrie aéronautique, plus fortement oligopolistique. Ils invitent donc les différents acteurs européens de la chaîne de valeur à accroître leurs coopérations en vue de créer des synergies dans ce domaine, et notent avec intérêt l'annonce par la Commission européenne, dans le cadre du plan d'action industriel en faveur du secteur automobile, la création en 2026 d'un centre dédié aux matières premières critiques afin d'agréger l'offre et la demande, et l'intention de la Commission de faciliter les investissements conjoints du secteur privé dans la chaîne de valeur amont de l'électromobilité.
Les rapporteurs invitent également à examiner la disponibilité d'autres matériaux moins rares, et cependant cruciaux pour la production de véhicules électriques, comme le cuivre (dont la quantité nécessaire pour la production d'une voiture électrique est, selon le Pr. Chalmin, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine, économiste spécialiste des marchés des matières premières, deux à trois fois supérieure à la quantité nécessaire pour fabriquer une voiture thermique). La production de masse de voitures électriques pourrait en effet induire également une dépendance aux métaux « non rares » d'autant plus préoccupante que, contrairement à la plupart des autres métaux, le cuivre n'est pas substituable.
Enfin, sans avoir réellement pu, faute de temps, examiner plus avant la question, les rapporteurs invitent également à étudier les conditions de mise en place d'une filière efficace de recyclage des batteries. En effet, les contraintes liées aux mutations de la filière automobile et aux incertitudes quant aux technologies d'avenir empêchent pour l'instant sa constitution de manière spontanée par les acteurs industriels, en l'absence d'incitations publiques119(*). Or le recyclage présente à la fois d'évidents avantages environnementaux - et à ce titre, la réglementation européenne120(*), qui fixe un seuil de matériaux recyclés dans les batteries à compter de 2028, pourrait devenir un levier stratégique pour créer de la valeur en Europe -, et en matière de lutte contre les dépendances stratégiques, puisqu'ACC indique par exemple que la chimie NMC permet un taux de recyclage supérieur à 90 %, ce qui devrait permettre d'assurer la moitié des besoins européens en matières premières à horizon de 15 ans121(*).
Recommandation n° 12 :
Mettre en application dans les meilleurs délais la stratégie européenne sur les matériaux critiques.
Soutenir la création de « hubs minéraux » pour l'approvisionnement, le traitement et la transformation des matériaux critiques, regroupant plusieurs acteurs pour obtenir des effets d'échelle.
Favoriser la création d'une filière du recyclage des batteries.
C. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT POUR REFAIRE DE LA FRANCE UN TERRITOIRE D'INDUSTRIE AUTOMOBILE
1. Restaurer la compétitivité de l'industrie automobile française : une gageure ?
a) Accompagner le changement
Le passage à l'électromobilité entraînera fatalement d'importantes évolutions dans le tissu industriel. Comme indiqué ci-dessous, ce sont au total 75 000 emplois qui seraient menacés en France d'ici 2035, pour une perte nette de 56 000 emplois, compte tenu des nouveaux emplois liés à l'électrification qui pourraient être créés, notamment dans les domaines de la chimie et de l'électronique de puissance122(*).
Source : PFA
Du fait de la modification de la répartition de la valeur au sein du produit fini, occasionnée par le passage à l'électrique, ce dernier occasionnera inévitablement d'importantes recompositions dans le paysage des équipementiers, d'autant que les modifications dans la nature des composants se doublent d'une réduction globale de leur nombre par véhicule.
Tous les équipementiers ne sont certes pas exposés de la même manière, comme l'illustre le graphique ci-dessous :
Dépendance du chiffre d'affaires des
entreprises de la filière automobile
à la production de
produits thermiques et électriques (2019)
Source : DGE
Ainsi Valeo, leader mondial dans toute une série de domaines, est aujourd'hui organisé en trois divisions qui reflètent tout à fait les défis de l'industrie automobile d'aujourd'hui (Valeo Power pour l'électrification, Valeo Brain pour la voiture autonome et connectée, et Valeo Light, qui a diversifié l'activité primaire de systèmes d'éclairage de Valeo pour élargir ses activités vers le design, la sécurité et la personnalisation). L'équipementier a indiqué avoir pris le virage de l'électromobilité dès 2009. D'autres, comme les producteurs de réservoirs classiques ou de systèmes de dépollution, seront naturellement davantage impactés par la transition.
Selon la DGEFP, les secteurs qui seront les plus impactés, et dans lesquels les pertes d'emplois seront les plus massives, sont ceux liés à la fabrication de moteurs thermiques (forge, fonderie fonte, décolletage/usinage), mais aussi des métiers administratifs liés à la digitalisation des outils ou à l'externalisation de ces fonctions (comptabilité, secrétariat...).
Au contraire, des emplois seront créés dans les différents secteurs de la chaîne de valeur de l'automobile en particulier l'électrification (compétences liées à la motorisation électrique, à l'électronique de puissance, fabrication des batteries, technologies d'assemblage, mise en forme des matériaux, automatisme/robotique, fabrication additive), l'électronique (électronique de puissance, gestion électronique des véhicules, logiciel, capteurs, aides à la conduite, etc.), l'informatique (architecture logiciel, informatique industrielle, gestion des données, réseaux 5 G, cybersécurité, etc.), l'intelligence artificielle, la chimie, mais aussi la conception des véhicules (écoconception, matières composites, chimie du végétal, etc.), mais aussi les compétences transverses (conduite de projet, transfert des compétences vers les collaborateurs, langues, etc.) et le recyclage/reconditionnement (gestion des matériaux, recyclage des batteries, remise en état des véhicules d'occasion)123(*).
En outre, l'électrification implique également trois effets indirects sur les équipementiers, qui induiront également de profondes modifications du paysage industriel français et européen : une forte exposition à la concurrence chinoise sur la chaîne de traction électrique, mais aussi, compte tenu de la montée en puissance de la Chine dans tous les domaines de l'automobile, sur les composants ; une forte pression des constructeurs sur les coûts d'achats pour compenser le surcoût lié à la batterie ; la nécessité d'investir massivement pour développer de nouveaux composants pour les véhicules électriques.
Enfin, alors que l'industrie automobile bénéficiait jusqu'à une période récente d'un marché quasi captif : comme l'a rappelé devant les rapporteurs le député européen François Kalfon, la voiture était jusqu'à récemment un bien « statutaire » et un symbole de réussite sociale, dont l'achat, au-delà même des besoins réels de mobilité, apparaissait comme une évidence pour quiconque disposait des moyens requis. Ce n'est aujourd'hui plus le cas : au-delà même de l'électrification, les modifications dans l'usage de l'automobile et le développement d'autres types de mobilités conduisent à une baisse globale de la demande qui devra également être prise en compte par les acteurs du secteur.
Le patron de Lisi, déjà mentionné, estime que l'avenir des équipementiers se résume à quatre paramètres : nombre de voitures vendues en 2030 ; part d'électrique dans ces ventes ; part des clients des équipementiers français et européens dans ces ventes ; part des composants utilisés par ces équipementiers dans leurs produits. Des évaluations même optimistes de ces différents paramètres amènent à projeter une contraction d'a minima 40 % du chiffre d'affaires des équipementiers de l'industrie automobile, dans le meilleur des cas, alors que, selon le même interlocuteur, ces derniers seraient en moyenne en mesure d'absorber une baisse de 10 % maximum. Selon lui, seul un équipementier sur quatre au maximum devrait résister à cette nouvelle donne, sauf à se reconvertir vers d'autres secteurs utilisant les mêmes technologies, les deux constructeurs français étant « condamnés » à resserrer leur panel d'équipementiers.
Cette solution de la diversification n'est cependant pas universelle, la Fiev indiquant que parmi les sous-traitants hors équipementiers de rang 1, la moitié environ dépend fortement de la filière automobile, avec même près d'un tiers (28 %) des entreprises qui réalisent plus de 80 % de leur chiffre d'affaires dans l'automobile.
En outre, les nouveaux emplois créés ne seront pas forcément sur les mêmes sites que les emplois détruits, ce qui occasionnera notamment un besoin de formation très important des employés de la filière et nécessitera d'anticiper les mobilités géographiques. Il est donc nécessaire d'accompagner les équipementiers dans leur reconversion ou, lorsque cela n'est pas possible, de s'assurer de la reconversion des salariés.
Les rapporteurs notent que la problématique est bien appréhendée, tant au niveau des représentants des acteurs industriels que de la part des pouvoirs publics : l'accord d'engagement de développement de l'emploi et des compétences (Edec) de la filière automobile a été signé en 2019 entre l'État et les acteurs de la filière automobile et mis en oeuvre jusqu'en juin 2025, avec un budget global de 1,7 million d'euros (dont une participation de l'État de 600 000 euros), a notamment permis des actions d'appui aux PME de la filière, en particulier sur leur stratégie de diversification, l'élaboration d'une feuille de route RH pour le comité stratégique de filière automobile, et la mise en oeuvre d'actions territoriales suite à un appel à projets pour des actions territoriales liées à l'anticipation des mutations, à l'accompagnement des entreprises et des salariés et à l'attractivité des métiers.
La DGE a pour objectif de suivre individuellement les quelque 800 plus gros équipementiers de la filière automobile, pour les aider à anticiper les évolutions à venir et les aider à se diversifier, en tirant parti notamment des subventions de France 2030, ainsi que du fonds Avenir automobile, opéré par Bpifrance. Selon la DGE, ces différentes formes d'aides représentent un total de 300 M€ d'investissement de l'État et bénéficient d'un fort effet de levier.
Parallèlement, les rapporteurs saluent les efforts de reconversion déployés : l'État, Renault et Stellantis ont créé en 2021 un fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés pour motif économique dans la filière automobile, doté de 50 millions d'euros, dont 20 millions d'euros apportés par les constructeurs et 30 millions d'euros apportés par l'État. Géré par France Travail, il s'adresse aux salariés des entreprises sous-traitantes de la filière automobile et licenciés pour motif économique entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2025 dans le cadre de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et permet de financer diverses mesures visant à renforcer l'accompagnement de droit commun vers le retour à l'emploi des salariés licenciés du secteur automobile (prestations d'accompagnement, financements en matière de formation, de création/reprise d'entreprises et de prime de reclassement, aides à la mobilité et aides aux familles, indemnités différentielles de revenu en cas de reprise d'un emploi durable moins rémunéré...). Selon le dernier bilan réalisé par France Travail, ce fonds a accompagné plus de 2 700 salariés issus de 26 entreprises différentes, le taux de reclassement des salariés en ayant bénéficié s'échelonnant entre 40 et 92 % en fonction des entreprises, des spécificités des territoires concernés et des caractéristiques des salariés (chiffres supérieurs à ceux constatés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs de reclassement de droit commun).
L'État a également par exemple accompagné, via le dispositif Transco, l'intégration de 800 personnes, la reconversion de salariés travaillant sur le site de Douvrin à la fabrication de moteurs thermiques pour acquérir les compétences nécessaires à la fabrication de batteries électriques dans le cadre de la joint-venture entre Stellantis et ACC, avec une cinquantaine de salariés concernés en 2023 et une centaine en 2024, et un objectif d'environ 120 en 2025. La montée en charge moins rapide que prévue sur l'électrique et le maintien des commandes de véhicules thermiques à un niveau élevé a cependant amené Stellantis, selon les informations transmises, à donner provisoirement la priorité à l'exécution du plan de charge concernant la production de moteurs thermiques.
Selon la DGEFP, ces reconversions sont facilitées par le fait que plusieurs compétences présentes dans l'automobile sont assez facilement transférables dans d'autres domaines très en demande, comme le sanitaire et social, sous réserve de formations de 6 à 24 mois environ.
Le troisième axe d'accompagnement du changement concerne le déploiement de nouvelles formations adaptées aux nouveaux besoins du secteur, qui passe par exemple par l'Appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » (AMI-CMA), doté d'un budget de 1,5 Md€ au total sur cinq ans, et qui permet de financer des projets de diagnostics et de formation accompagnant le développement des compétences liées aux stratégies d'innovation du Programme d'investissements d'avenir (PIA) 4 et des dix priorités de France 2030 : l'AMI-CMA a permis de consacrer près de 85 M€ à neuf projets de formation et d'attractivité pour la filière automobile, tant amont qu'aval, y compris sur l'électronique de puissance (Former à l'électronique de puissance - Forep-Vé2030) et les batteries (École de la batterie - EDLB), portés notamment autour de Verkor en région Aura, ainsi que le projet Battena en Nouvelle-Aquitaine), ainsi que la cybersécurité (Cybersécurité mobilité des véhicules électriques - Cymove) dans la région Grand Est.
Pour les rapporteurs, ces initiatives bienvenues gagneraient à être complétées par des actions de promotion de l'industrie, et en particulier de l'industrie automobile, qui souffre d'un déficit d'image et d'attractivité auprès des plus jeunes, et en détourne nombre de jeunes travailleurs, notamment les plus qualifiés.
Au total, les rapporteurs saluent l'ensemble de ces initiatives visant à accompagner la restructuration du tissu industriel automobile français, en en anticipant les mutations, et appellent à les maintenir et à les renforcer. Ils se réjouissant que l'« administration du déclin » de l'industrie automobile, qui prévaut depuis une vingtaine d'années, mise en évidence par le chercheur Juan Sebastian Carbonell (à savoir une réduction permanente de la force de travail et des capacités de production, mais hors périodes de crise, sans forcément de fermetures d'usines, avec une dégradation des conditions de travail) soit enfin mise en question. Cette stratégie, qui a pu un temps permettre de conserver des emplois sur le sol français, trouve aujourd'hui ses limites, et accélère à présent la « course vers l'abîme en termes de conditions de travail et d'emploi », mais aussi de l'ensemble de la filière.
Les rapporteurs ont d'ailleurs pu constater, lors de leur déplacement à Sochaux-Montbéliard, le fatalisme de la plupart des équipementiers rencontrés, conscients des possibilités limitées de reconversion ou de diversification. De fait, la restauration de la compétitivité de l'industrie automobile française passera fatalement par une restructuration profonde d'un tissu d'entreprises dont certaines ne sont plus en adéquation avec les besoins exprimés par le marché. Il sera dès lors essentiel de veiller à ce que cette inévitable restructuration évite autant que faire se peut la « casse sociale ». À ce titre, la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) doit être encouragée, une proposition de révision du règlement européen pertinent étant actuellement pendante, qui prévoit d'étendre le soutien du FEM aux travailleurs exposés à un risque imminent de licenciement, en introduisant une action préalable, et à vocation préventive, au licenciement et non plus uniquement corrective (alors que le dispositif actuel ne concerne que des salariés déjà licenciés) : les rapporteurs soutiennent cette initiative qui permettrait de mieux financer les actions engagées au niveau national.
Pour autant, ainsi qu'indiqué précédemment, la course à la rentabilité et la pression sur les coûts pour faire face à la concurrence internationale ne doivent pas non plus servir d'« alibi » aux constructeurs pour faire pression de manière inconsidérée sur leurs fournisseurs, dont il ne peut être exigé qu'ils absorbent à eux seuls l'essentiel des coûts de l'électrification et de la numérisation : outre les mesures de contenu local proposées précédemment124(*), les rapporteurs appellent à un meilleur partage de l'effort entre les constructeurs et les équipementiers, et à un rééquilibrage au sein de la filière.
Recommandation n° 13 :
Mettre en place un plan national et européen d'accompagnement pour les équipementiers, articulé autour de dispositifs de reconversion, de formation et de soutien à la diversification des activités, en mobilisant notamment le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Instaurer un dialogue régulier et structuré entre équipementiers et constructeurs afin d'anticiper les mutations de la filière et de sécuriser l'emploi dans les territoires.
b) Agir sur les fondamentaux de la compétitivité industrielle
Globalement, tous les acteurs constatent que, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les constantes de puissance sont très défavorables à la France et à l'Europe : selon la PFA, depuis 2019, l'industrie automobile européenne a perdu 20 à 25 % de compétitivité par rapport à la Chine.
Ce déficit de compétitivité tient à plusieurs facteurs.
Premièrement, pour tous les industriels interrogés, le prix de l'électricité appliqué aux usages professionnels constitue le paramètre stratégique, devenu d'autant plus crucial que la construction de véhicules électriques est environ deux fois plus énergivore que la construction de véhicules thermiques125(*).
Dans ce domaine, le manque de compétitivité de l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis se double d'un déficit de compétitivité français face à l'énergie solaire disponible à bas coût, par exemple, en Espagne.
Une politique énergétique compétitive est donc attendue par les industriels, de la part des pouvoirs publics, incluant une tarification plus favorable pour l'électricité destinée à la mobilité. La PFA demande d'ailleurs, parmi les mesures d'urgence face à la crise, de « prévoir un mécanisme permettant de garantir la disponibilité et des prix d'énergie décarbonée pour le secteur automobile ».
Même si la main-d'oeuvre ne représente pas l'essentiel du coût de production d'un véhicule (15 % selon la CGT), ce qui devrait tendre à diluer ce facteur et paradoxalement rééquilibrer les facteurs de compétitivité au profit de la France, plusieurs acteurs ont également mentionné parmi les causes du déficit de compétitivité de l'industrie automobile française le coût du travail - problématique transverse à l'industrie, puisque la France concentre structurellement ses aides à l'emploi sur les très bas salaires alors que ceux de l'industrie se situent à des niveaux proches du salaire médian -, et la fiscalité - problématique également transverse, mais plus spécifique à l'industrie automobile, dans la mesure où les impôts de production tels que la C3S sont particulièrement pénalisants pour des industries lourdes à faible marge).
c) Rééquilibrer la concurrence intra-européenne
Afin de réduire le différentiel de compétitivité des usines françaises par rapport à leurs concurrents, les rapporteurs estiment qu'il serait également nécessaire de réviser les règles prévalant au sein de l'Union sur les subventions à l'installation, puisqu'aujourd'hui, paradoxalement, les pays ayant le plus faible coût de main-d'oeuvre ont aussi des montants les plus élevés de subventions européennes, au titre notamment de la politique régionale, qui vise à l'égalisation des niveaux de richesse au sein de l'Union. De même, le Cadre temporaire de crise et de transition (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF), mis en place pendant la crise sanitaire pour assouplir le régime des aides d'État, autorisait des aides différenciées selon le niveau de développement des régions où avait lieu l'investissement. Or, compte tenu des difficultés rencontrées aujourd'hui par les industries automobiles « historiques », notamment en France, les rapporteurs estiment que ce cadre n'est plus justifié. En effet, alors qu'au niveau européen global, on assiste à une relative stabilité du secteur de l'industrie automobile, dans le détail, celui-ci augmente en Europe de l'Est et baisse en Europe de l'Ouest, les « accords de compétitivité » qui se sont multipliés ces dernières années n'étant d'ailleurs que la conséquence d'une tentative des constructeurs de s'aligner sur les conditions de travail prévalant en Europe de l'Est.
La situation est la même avec des pays situés en périphérie de l'Union et qui bénéficient avec elle d'accords de libre-échange, comme la Turquie ou le Maroc : lors de leur déplacement dans ce pays en septembre 2025, les commissaires des affaires économiques ont pu, à l'occasion de leur visite de l'usine Renault de Tanger (plus de 310 000 véhicules produits en 2024), constater les atouts de ce pays, tant en termes de coût du travail et d'énergie (solaire et éolien) bon marché que de puissance de l'administration de l'économie.
Ce différentiel de compétitivité intra-européen entrave la relocalisation de la production sur le sol national : en dépit de ses déclarations antérieures, Renault, « rattrapé » par la conjoncture, rencontre de réelles difficultés à rapatrier la production de ses nouveaux véhicules électriques en France : la Twingo électrique sera finalement assemblée en Slovénie, et la R5 ne devait finalement plus, au moins dans un premier temps, être équipée de batteries produites en France...
Notant que cette problématique des différentiels de compétitivité excède celle de l'industrie automobile, les rapporteurs appellent à réfléchir aux moyens d'assurer une concurrence loyale au sein de l'Union européenne, afin de tempérer les effets néfastes sur les vieux pays industriels d'un dumping social de fait, et d'éviter que les différentiels de coût du travail ne motivent les délocalisations de productions au sein de l'Union. Une harmonisation minimale des conditions de travail et de protection sociale devait, à leur sens, être envisagée, ainsi qu'une harmonisation des conditions de soutien aux entreprises.
Recommandation n° 14 :
Harmoniser les règles relatives aux aides publiques, notamment à l'investissement, au sein de l'Union européenne.
Mettre en oeuvre des mesures permettant de réduire le coût du travail et de l'énergie en France.
2. Soutenir l'émergence de petits véhicules électriques abordables
a) Une stratégie continue de « premiumisation » dont les constructeurs font aujourd'hui les frais
(1) Les hausses continues des prix des véhicules depuis 20 ans ne sont que minoritairement imputables à l'électrification
Contrairement à ce qui est souvent avancé, les récentes hausses des prix des véhicules ne sont pas exclusivement imputables au passage au véhicule électrique : l'étude de l'Institut mobilités en transition (IMT) et du cabinet C-Ways précitée relativise le poids de ce facteur dans l'augmentation des prix des véhicules particuliers dans les toutes dernières années126(*), au profit des facteurs endogènes découlant de stratégies d'augmentation générale des prix, sur chacun des segments (« pricing power »127(*)), initiées par les constructeurs, ainsi que de montée en gamme128(*), ces deux facteurs jouant respectivement pour un tiers et deux tiers du total des facteurs endogènes129(*).
Augmentation du prix moyen des véhicules particuliers (2020-2024)
Source : données du rapport IMT / C-Ways
Sur la période la plus récente, ces stratégies de montée en gamme ont été incarnées par la stratégie « Renaulution » de Renault, et par l'ère Tavares chez Stellantis. Ainsi, les petites berlines de segments A et B ont perdu, entre 2019 et 2024, 7 points de part de marché, avec la disparition à la vente neuve de modèles iconiques comme la Twingo130(*) (et un recentrage de Renault sur le segment C-SUV principalement). Comme le soulignent les auteurs du rapport précité, « les constructeurs ont fait le choix de ne pas renoncer aux gros véhicules et aux SUV. »131(*)
Augmentation des prix par effet par marque
(en
pourcentage du prix initial, 2020-2024)
Source : rapport IMT/C-Ways
Parallèlement, en sortie de crise sanitaire, la crise des semi-conducteurs, en introduisant un déséquilibre entre offre et demande, a permis aux constructeurs d'augmenter les prix en décorrélation totale avec la réalité de la qualité des produits.
Ainsi, au total, les stratégies de redressement des constructeurs français - et, européens - auraient été élaborées sur la base d'un « accident de parcours », à savoir la crise sanitaire, les difficultés actuelles ne correspondant qu'à un retour à la réalité du marché. Les surcapacités sont en effet un problème récurrent de l'industrie automobile, appelées en outre à durer dans les années à venir, du fait de la désaffection générale pour la voiture.
Plus grave, des recherches récentes ont mis en évidence le fait que cette stratégie de « premiumisation » a en réalité été celle suivie par l'industrie automobile européenne au cours des deux dernières décennies, qui correspondent très exactement aux années d'attrition de l'industrie automobile française132(*).
Cette montée en gamme s'est notamment traduite par une augmentation moyenne, sur la période 2011-2021, du poids des véhicules (+ 18 %), de la puissance (+ 38 %) et de la taille (+ 5 % en longueur) et, en conséquence, par une augmentation des prix de 66 % en moyenne, sur la période (à comparer avec une inflation à 38 % sur la période).
Nouveaux modèles lancés en
Europe
et part relative des modèles de moins de 1 100 kg
par décennie
Source : Alochet et al. 2024, données Inovev
Entre 2010 et 2023, le véhicule électrique moyen vendu en Europe a ainsi gagné 810 kg et est devenu le plus cher au monde, avec une moyenne de 66 864 €, contre 31 165 € en Chine133(*).
Parallèlement, la part de marché des voitures de moins de 1 100 kg n'a cessé de diminuer en Europe depuis les années 1990, à la suite de la diminution du nombre de nouveaux modèles de cette catégorie à partir des années 2010. Interrogée par les rapporteurs, la CFE-CGC métallurgie a ainsi évoqué des voitures « bodybuildées » : l'évolution de la Clio est emblématique de cette évolution, puisqu'entre son lancement au début des années 1990 et la nouvelle mouture de Clio attendue en 2026, sa masse devrait avoir augmenté de pas moins d'une demi-tonne134(*).
Cette « premiumisation » explique largement, selon Tommaso Pardi, les vagues de délocalisation subies par l'industrie automobile dans les années 2000 et 2010, qui visaient à compenser les coûts élevés et la baisse des marges associées à la montée en gamme, en particulier sur les segments A et B, devenus moins rentables, au contraire de l'industrie automobile allemande, traditionnellement positionnée sur des modèles plus haut de gamme. De fait, la part des marques européennes dans la fabrication de ces petits véhicules légers avait déjà régulièrement diminué dans les années précédentes, passant de 92 % dans les années 1980 à 40 % dans les années 2000135(*).
Prix moyen et part de marché par groupe de marques (base 100 en 2001)
Source : Alochet et al. 2024, p. 41
Or, les effets délétères de cette montée en gamme sont bien identifiés dans le secteur : un équipementier interrogé cite ainsi, parmi les facteurs des difficultés actuelles du secteur automobile français et européen, « [u]ne stratégie haut de gamme non payante (prix des véhicules trop élevés) ».
(2) Le poids des normes
Cette stratégie de montée en gamme découle-t-elle seulement de la recherche irraisonnée de profit, de la part des constructeurs, comme on l'entend parfois, ou ne découle-t-elle pas plutôt de l'abondance de normes qui régissent la production automobile, comme le mettent en avant les constructeurs ?
Même si dans le rapport IMT/C-Ways précité, l'impact de l'enrichissement réglementaire sur les prix de vente n'a pas pu être isolé pour la période très récente. Selon le chercheur Tommaso Pardi136(*), spécialiste de l'automobile, les raisons de la montée en gamme, sur le long terme, sont bel et bien à rechercher dans l'harmonisation des normes pour les véhicules mis sur le marché européen, au début des années 1990, alignée sur les standards plus contraignants des pays d'Europe du Nord.
Le règlement européen sur la réception137(*) définit les critères pour la mise sur le marché des différents véhicules à moteur, qui sont classés par catégories, dont certaines peuvent être limitées par des caractéristiques techniques, notamment le poids, les voitures particulières appartenant à la catégorie M1 (« véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur »).
L'introduction de règles de plus en plus strictes, notamment relatives à la sécurité, a puissamment contribué à l'augmentation du gabarit et du prix des véhicules138(*) :
- les règles relatives à la sécurité passive ont particulièrement contribué à l'augmentation du poids des véhicules, figurant dans le General Safety Regulations 2 (GSR2)139(*) ;
- les règles de sécurité active ont surtout contribué à augmenter le prix des véhicules, en raison de dispositifs électroniques d'assistance à la conduite de plus en plus sophistiqués140(*).
Or le coût relatif d'introduction de ces technologies dans les petits véhicules est, logiquement, plus élevé pour les petits véhicules que pour les modèles premium, raison pour laquelle les constructeurs allemands, mieux positionnés sur ce segment, sont globalement plus allants que les Français sur ce sujet - d'aucuns les accusant même de pousser au durcissement de telles normes pour favoriser leurs modèles et « tuer la concurrence ». Au contraire, cette augmentation subie des prix est très pénalisante pour les constructeurs positionnés principalement sur de petits modèles, comme Renault et Stellantis. Coïncidence ou effet direct, des modèles tels que la Zoe, la Twingo ou la Peugeot 108, mais aussi la Ford Ka n'ont pas été renouvelés lors de l'entrée en application de la norme GRS2.
En second lieu, l'entrée en vigueur de normes relatives aux émissions de CO2 a également eu, paradoxalement, pour effet d'avantager les plus gros véhicules, puisque, à la demande des constructeurs allemands, alors soutenus par leur gouvernement, ces objectifs étaient pondérés en fonction du poids141(*), ce qui a eu pour effet d'empêcher les producteurs de véhicules plus légers de tirer parti de réductions de poids ou de dimensions pour réduire leurs émissions. En outre, pour se conformer aux objectifs de réduction des émissions, les constructeurs ont, dans un premier temps, privilégié les motorisations diesel, plus lourdes, et nécessitant donc une motorisation plus puissante, contribuant ainsi à la montée en gamme142(*). Cette pondération favorable aux véhicules les plus lourds a cependant été amendée au 1er janvier 2025, avec l'adoption d'un paramètre négatif pour le calcul des objectifs de CO2 en fonction de la masse moyenne des voitures neuves vendues143(*), ce qui devrait désormais inverser la tendance.
Enfin, les règles de négociation des réglementations européennes, qui se font en silo, au sein de conseils distincts qui calculent le bénéfice des nouvelles réglementations « toutes choses égales par ailleurs », sans prendre en compte les évolutions concomitantes, ont débouché au fil du temps sur un empilement de règles parfois incompatibles entre elles, difficilement soutenable pour les acteurs économiques.
b) Simplifier la réglementation pour favoriser la production de petites voitures abordables
Face à cette situation, il est nécessaire d'aider les constructeurs à sortir de la spirale de la « premiumisation ». Selon le rapport IMT/C-Ways précité, en effet, le simple fait de revenir à la répartition segmentaire de la décennie passée ferait mécaniquement baisser, en moyenne, le prix des véhicules particuliers de plus de 2 000 €144(*), contribuant à lever la barrière-prix qui bride aujourd'hui le marché.
Les constructeurs l'ont d'ailleurs bien compris, et ont déjà engagé ce retournement, avec l'arrivée effective ou imminente sur le marché européen d'une offre renouvelée de petits véhicules électriques (ë-C3, R5, Twingo électrique...). Le succès des voitures sans permis (VSP), dont les ventes ont triplé par rapport à la période pré-covid, illustre cette appétence de certains segments de la population (notamment les jeunes et les seniors) pour ce type de véhicules compacts, économes en équipements et aux performances réduites, mais adaptées à leurs besoins, mais aussi au coût réduit : la Citroën Ami, mise en vente aux alentours de 8 000 €
En l'état actuel du marché cependant, il semble peu probable que ces nouveaux modèles atteignent rapidement des volumes de vente suffisants pour compenser les marges moins élevées observées par rapport aux modèles premium. Afin d'augmenter ces marges, les rapporteurs recommandent un passage en revue de l'ensemble des normes applicables aux véhicules de type M1, afin de vérifier leur pertinence et leur nécessité ; dans le cas contraire, une suppression devrait être envisagée.
En complément, les rapporteurs soutiennent la création d'une nouvelle catégorie de véhicules particuliers « très légers », à la suite de la suggestion du Groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile (Gerpisa)145(*), récemment déclinée dans plusieurs publications, tant académiques que grand public, avec l'objectif de « faire du volume », ce qui pourrait contribuer à rendre aux constructeurs français la profitabilité recherchée. Adaptés à des usages, y compris quotidiens, sur courtes distances, sur le modèle des « kei cars » japonaises, ces petits véhicules pourraient dès lors se satisfaire de batteries relativement petites, et disposant d'une autonomie limitée, et donc moins lourdes. Privilégier ce type de petites voitures permettrait en effet, selon des estimations convergentes, de proposer à la vente des véhicules neufs autour de 15 000 €.
Les kei cars, un modèle japonais de mini-voitures à succès
Au Japon, les kei cars (pour « keijidosha : « voitures légères ») représentent près de 40 % du marché japonais (près de 1,55 million d'unités vendues en 2024)
Catégorie réglementaire créée à la fin des années 1940 pour remplacer les véhicules à trois roues, les kei cars sont revenues en grâce dans les années 1990, en réaction à la montée en gamme des voitures les plus compactes, qui a accru le différentiel de prix de ces derniers avec les kei cars, dont les caractéristiques physiques sont réglementairement limitées, accroissant ainsi l'attractivité de ces dernières.
Les kei cars se distinguent en effet par des normes très strictes, à savoir une longueur maximale de 3,40 mètres, une largeur de 1,48 mètre, une hauteur de 2 mètres, un poids inférieur à 900 kg, et un moteur à essence limité à 660 cm pour une puissance maximale de 64 chevaux. Malgré leur format réduit, elles offrent généralement cinq places et existent dans toutes les formes de carrosserie, y compris en version utilitaire.
Par leur légèreté, leur compacité et leur usage urbain, les kei cars facilitent également le passage à l'électrification : en 2023, la version électrique de la Nissan Sakura, est devenue le véhicule électrique le plus vendu au Japon, devant la Tesla, avec une autonomie de 165 km pour un prix d'environ 16 000 euros. Utilisées quotidiennement mais sur de courtes distances, cumulant en moyenne moins de 600 km par mois, elles peuvent donc se satisfaire de batteries relativement petites et de peu d'autonomie146(*), ce qui limite leur surcoût par rapport aux modèles thermiques équivalents (entre 2 500 et 4 000 €, actuellement couvert, au Japon, par une prime gouvernementale147(*)).
Les kei cars sont en outre reconnus comme jouant un rôle social important en offrant un accès abordable à la mobilité personnelle, dans des zones où les transports publics sont moins développés - dans les zones à faible densité, elles représentent jusqu'à 70 % du parc automobile des ménages, contre 49 % en population générale.
La production de kei cars est concentrée entre quatre fabricants (Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi et Honda), dont les trois premiers produisent aussi des kei cars pour Toyota, Nissan, Subaru et Mazda. Le nombre d'emplois directs générés par la production de kei cars au Japon est donc estimé à environ 50 000 emplois (chez les seuls constructeurs)148(*).
Les rapporteurs notent avec intérêt que lors de son discours annuel sur l'État de l'Union le 10 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, faisant suite aux « appels du pied » des industriels149(*), a d'ailleurs annoncé son intention, confirmée le 12 septembre dans le cadre du dialogue stratégique, de présenter une « initiative relative aux voitures abordables et de petite taille »150(*).
Concrètement, afin de stimuler la production de petits véhicules abordables, et d'intéresser les constructeurs à leur production, il pourrait s'agir de créer une nouvelle catégorie de véhicules « M0 » dont la vitesse serait limitée (par exemple à 110 km/h), et aux exigences réglementaires allégées, par exemple en termes de normes anticollision, et dont, en contrepartie, la masse et les dimensions seraient également capées151(*).
Il s'agirait en quelque sorte d'une catégorie intermédiaire entre les actuels véhicules M1 et les quadricycles, dont les règles sont définies dans un autre règlement152(*), relatif également aux véhicules à moteur à deux et trois roues : si certaines des règles auxquelles doivent se conformer les quadricycles sont similaires à celles de la catégorie M1 (celles sur les émissions notamment), d'autres, comme celles relatives à la sécurité, sont moins contraignantes, en raison de la vitesse limitée de ces quadricycles.
Si l'adoption, puis l'entrée en vigueur d'une telle réglementation pourraient prendre plusieurs années, un engagement ferme des pouvoirs publics en ce sens pourrait donner un signal fort aux constructeurs.
Si, pour parvenir au prix modéré nécessaire à assurer le succès de ces petites voitures (moins de 15 000 euros), un effort sur les coûts de production153(*) peut être attendu des constructeurs, cette nouvelle catégorie pourrait par ailleurs disposer de conditions de mise sur le marché avantageuses, soit qu'on leur réserve certains dispositifs d'aide à l'achat ou à la location longue durée, soit qu'elles bénéficient temporairement d'une pondération favorable, pour l'atteinte des objectifs de réduction des émissions154(*).
La recherche académique a mis en évidence que l'appétence conjoncturelle pour de petits véhicules de type kei cars, telle qu'on l'observe par exemple en Chine actuellement, ne suffit pas, sur le long terme, à assurer le succès de la catégorie et donc la pérennité de sa production. Les kei cars japonaises ont d'ailleurs bénéficié d'une série d'aides directes et indirectes qui ont encore réduit leurs coûts d'acquisition et de possession (réduction des taxes d'assurance, réduction sur les péages, baisse des frais d'inspection et exemption des exigences en matière d'espace de stationnement dans les villes moyennes et les zones rurales), permettant de proposer des modèles à des prix très abordables, à partir de 12 000 € environ. De même en Chine, même si le cadre réglementaire n'a pas particulièrement favorisé les petites voitures par rapport aux autres segments, le marché de petites voitures connaît une croissance significative, pour des raisons tenant tant aux caractéristiques générales de la consommation chinoise (les primo-acquérants se tournant vers des modèles peu onéreux) qu'aux incitations financières à l'achat portées principalement par les autorités locales, et donc plutôt adaptées à des trajets de courte distance, principalement en milieu urbain, ce qui correspond au cahier des charges des kei cars155(*).
Recommandation n° 15 : Encourager la production de petits véhicules électriques accessibles sur le modèle des kei cars japonaises en créant une catégorie réglementaire ad hoc et en fléchant sur ces modèles des dispositifs d'incitation à l'achat.
3. Vers un Airbus européen de l'automobile ? Partager l'innovation et la production au niveau européen
En conclusion, les rapporteurs insistent sur le fait que la majorité des combats en faveur de l'industrie automobile française doit être portée au niveau européen : parce que c'est l'Union européenne qui a fixé les objectifs ambitieux de transition verte de la filière, l'obligeant à s'adapter à marche forcée, et parce que l'atteinte de ces objectifs est évaluée à l'échelle européenne ; parce que la réglementation européenne régit les conditions de mise sur le marché des véhicules ainsi que les conditions d'accès au marché intérieur, les conditions d'investissement et de concurrence et, demain, peut-être, les conditions de travail et de protection sociale.
Pour toutes ces raisons, et comme indiqué plus haut, les rapporteurs appellent l'Union à mettre en place une réelle politique industrielle, en créant en particulier, comme le recommandait le rapport Draghi156(*), des conditions d'investissements public et privé dans l'industrie plus favorables.
Pour avancer sur ce chemin, une vision convergente de la France et de l'Allemagne est nécessaire ; or, même si les positions se sont récemment rapprochées, les divergences d'intérêt des industries automobiles allemande et française, positionnées de manière très différente, ont trop souvent fragilisé nos constructeurs. La période de turbulences que traverse actuellement l'ensemble de l'industrie automobile européenne pourrait paradoxalement être l'occasion de surmonter ces divergences et de créer de véritables synergies entre les deux pays ainsi qu'avec les autres États membres, pour permettre à l'Union de parler réellement d'une seule voix face à ses compétiteurs.
Dans la même logique, les rapporteurs estiment que les acteurs industriels de l'automobile devraient rechercher à mutualiser davantage leurs activités, tant de R&D que de production, observant par exemple qu'au Japon, la production de kei cars est assurée en majorité par trois producteurs, qui fournissent la quasi-totalité des marques. Les options prises par la Commission dans les mois à venir devraient s'efforcer de faciliter de telles synergies, nécessaires pour que l'industrie automobile française et européenne puisse continuer à tenir son rang.
ANNEXE 1
Les différents segments de véhicules
NB : cette segmentation relève de conventions de classement qui peuvent varier d'un pays à un autre et qui n'ont pas une dimension réglementaire
Source : Alochet et al. 2024, p. 29
ANNEXE 2
Les principaux types de motorisation électrique
|
Véhicules électriques à batterie (ou « tout électrique ») |
BEV |
Alimentés uniquement par de l'électricité, stockée dans des batteries rechargeables |
|
Véhicules hybrides non rechargeables |
HEV |
Dotés d'un moteur thermique et de moteurs électriques, qui sont alimentés uniquement par le freinage (batteries non rechargeables |
|
Véhicules hybrides rechargeables |
PHEV |
Dotés d'un moteur thermique et de moteurs électriques, dont les batteries peuvent être rechargées |
|
Véhicules électriques à autonomie étendue |
REEV |
Alimentés principalement par de l'électricité stockée dans des batteries rechargeables, mais dotés d'un moteur thermique, permettant de charger les batteries en cas de besoin, afin d'augmenter la portée du véhicule |
LISTE DES RECOMMANDATIONS
1. Mesures d'urgence en faveur de l'industrie automobile
a) Sortir du « tout électrique »
Recommandation n° 1 : Repousser l'interdiction de la vente de moteurs thermiques et confier à la Commission européenne le soin de fixer, en accord avec les industriels, une trajectoire dégressive soutenable pour atteindre cet objectif.
Recommandation n° 2 : Mettre en oeuvre le principe de neutralité technologique ; reconnaître en particulier le caractère de carburants « neutres en carbone » des biocarburants.
Recommandation n° 3 : Poursuivre la R&D dans le domaine des moteurs thermiques moins émetteurs de CO2.
b) Protéger le marché le temps de restaurer des règles du jeu équitables
Recommandation n° 4 : Relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois afin de limiter drastiquement les importations et de rétablir une concurrence équitable sur le marché européen, le temps que les acteurs européens se « mettent à niveau ».
Recommandation n° 5 : Imposer un contenu local européen pour les véhicules vendus en Europe, de l'ordre de 80 % pour les composants hors batterie, et fixer un objectif d'au moins 40 % des batteries utilisées dans les véhicules vendus en Europe produites localement, à partir de 2035.
Recommandation n° 6 : Créer un éco-score européen harmonisé, intégrant, outre l'empreinte carbone à l'échappement, l'empreinte carbone de l'ensemble de la production du véhicule (a minima l'assemblage et la production des matériaux et composants clés), de la fabrication de la batterie et du transport.
2. Accompagner l'industrie automobile pour réussir la transition
a) Faire baisser les prix pour dynamiser le marché de l'électrique
Recommandation n° 7 : Harmoniser les politiques de soutien à l'achat ou à la location de véhicules électriques au niveau européen.
Recommandation n° 8 : Assurer la stabilité du cadre fiscal et des aides à l'achat ou à la location de véhicules.
b) Augmenter la confiance dans la solution électrique
Recommandation n° 9 :
Poursuivre le déploiement des infrastructures de recharge en priorisant les zones rurales et périurbaines.
Soutenir l'installation de bornes de recharge à domicile et en copropriété en simplifiant les démarches administratives (notamment en facilitant l'accord des copropriétés et en incitant les bailleurs à équiper les logements sociaux).
Recommandation n° 10 :
Développer un marché de l'occasion des véhicules électriques, notamment en mettant en place un label européen de garantie pour les véhicules électriques d'occasion, incluant un diagnostic batterie certifié.
Mettre en place un plan de communication sur les performances des batteries.
c) Restaurer la compétitivité et la souveraineté de la filière
(1) Protéger la filière naissante de la production de batteries
Recommandation n° 11 :
Soutenir le développement et le passage à l'échelle des gigafactories européennes en adaptant le cadre européen des aides d'État ; mieux mobiliser les fonds européens en ce sens, notamment en s'assurant que le futur Fonds de compétitivité pourra financer des projets en phase d'industrialisation.
Doubler ce soutien d'aides dégressives à la production, afin d'assurer la compétitivité des acteurs européens par rapport à leurs compétiteurs asiatiques.
Recommandation n° 12 :
Mettre en application dans les meilleurs délais la stratégie européenne sur les matériaux critiques.
Soutenir la création de « hubs minéraux » pour l'approvisionnement, le traitement et la transformation des matériaux critiques, regroupant plusieurs acteurs pour obtenir des effets d'échelle.
Favoriser la création d'une filière du recyclage des batteries.
(2) Agir sur le facteur-coût
Recommandation n° 13 :
Mettre en place un plan national et européen d'accompagnement pour les équipementiers, articulé autour de dispositifs de reconversion, de formation et de soutien à la diversification des activités, en mobilisant notamment le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Instaurer un dialogue régulier et structuré entre équipementiers et constructeurs afin d'anticiper les mutations de la filière et de sécuriser l'emploi dans les territoires.
Recommandation n° 14 :
Harmoniser les règles relatives aux aides publiques, notamment à l'investissement, au sein de l'Union européenne.
Mettre en oeuvre des mesures permettant de réduire le coût du travail et de l'énergie en France.
(3) Soutenir la réorientation de la stratégie industrielle
Recommandation n° 15 : Encourager la production de petits véhicules électriques accessibles sur le modèle des kei cars japonaises en créant une catégorie réglementaire ad hoc et en fléchant sur ces modèles des dispositifs d'incitation à l'achat.
d) Reprendre le leadership en matière technologique
(1) Rattraper et continuer d'innover
Recommandation n° 16 : Contraindre les acteurs extra-européens qui souhaitent s'implanter en Europe à des transferts de technologie.
Recommandation n° 17 :
Sanctuariser les mécanismes de soutien à la recherche en entreprise, notamment le principe du CIR et les dispositifs relatifs à l'emploi des doctorants.
Encourager en particulier la recherche sur les batteries.
(2) Tirer parti de l'excellence française en matière de numérique
Recommandation n° 18 : Soutenir l'émergence d'un écosystème français et européen du véhicule numérique en favorisant le développement d'entreprises spécialisées dans les logiciels embarqués et les systèmes de conduite intelligente, pour renforcer la compétitivité et l'autonomie technologique de la filière automobile.
Créer un Airbus européen du logiciel embarqué.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 15 octobre 2025, la commission des affaires économiques a examiné le rapport d'information de M. Alain Cadec, Mme Annick Jacquemet et M. Rémi Cardon sur l'avenir de l'industrie automobile française.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nos collègues Annick Jacquemet, Alain Cadec et Rémi Cardon vont maintenant nous présenter les conclusions de leur mission d'information transpartisane sur l'avenir de la filière automobile.
Mme Annick Jacquemet, rapporteure. - L'industrie automobile française traverse aujourd'hui une crise profonde, et durable. Luc Chatel, président de la Plateforme automobile française, nous l'avait prédit il y a tout juste un an, lorsque notre commission l'avait auditionné : cette industrie peut, à court terme, disparaître. Ce qui semblait alors une menace assez théorique se concrétise malheureusement mois après mois. Après les plans sociaux chez les équipementiers Michelin et Valeo à l'automne dernier, les usines de Stellantis à Sochaux, Mulhouse et Poissy vont être partiellement mises à l'arrêt, faute de commandes suffisantes.
Où chercher l'origine de ce désastre ? Tout d'abord, dans une contraction sans précédent du marché : depuis la crise sanitaire, les ventes de véhicules neufs ont fortement chuté, d'environ 20 %. Les ventes de véhicules électriques, pourtant « boostées » par la législation européenne, ont connu une croissance moins dynamique qu'escompté : après un pic en 2023, la part des ventes de voitures « tout électrique » et hybrides rechargeables a même baissé en France en 2024 et 2025, pour s'établir à environ un tiers des ventes de véhicules neufs.
Les constructeurs français et européens sont en outre concurrencés par les acteurs extra-européens, au premier rang desquels la Chine, aujourd'hui premier pays producteur de véhicules électriques dans le monde : cette dernière assure près des deux tiers de la production mondiale, et ses exportations ont été multipliées par quatre en deux ans !
Les raisons de ce succès chinois, nous les connaissons : politique industrielle volontariste et planificatrice, mais surtout subventions colossales - on a évoqué le chiffre de près de 230 milliards de dollars d'aides directes - et coûts de production ultra-compétitifs. Résultat : des prix de vente inférieurs d'environ 30 % à ceux des véhicules produits en Europe, pour une qualité égale, voire supérieure. Les différents acteurs que nous avons interrogés nous l'ont en effet tous confirmé, la Chine est en avance technologiquement dans tous les domaines : batteries, mais aussi numérique et logiciels embarqués.
Cette situation a en outre vocation à s'aggraver avec le retour du protectionnisme américain, qui, en plus de nuire directement aux exportations européennes, amplifie encore les surplus de production que la Chine cherche à écouler sur le marché européen, et exacerbe la concurrence avec la Chine sur les marchés tiers.
Cette concurrence chinoise ne concerne pas uniquement les véhicules finis, mais aussi les batteries : 80 % des batteries actuellement utilisées en Europe viennent d'Asie, et notamment de Chine.
Résultat de la contraction du marché : en 2023, la production automobile française était encore inférieure de 40 % à celle de 2019, avec à la clé la destruction de quelque 19 000 emplois, dans une filière déjà minée par deux décennies de déclin.
Depuis les années 2000, la France a connu une baisse structurelle de sa production, en raison de délocalisations massives vers les pays à bas coût de main-d'oeuvre, d'abord en Europe de l'Est, puis vers la Turquie ou le Maghreb - certains collègues ont d'ailleurs pu en avoir un aperçu lors du déplacement de la commission au Maroc, au début du mois de septembre. La part de la France dans la production automobile européenne est ainsi passée de 20 % en 2000 à seulement 8 % en 2020.
Dans ce contexte, les difficultés actuelles risquent de donner le coup de grâce, d'autant qu'elles frappent une filière qui a consenti des investissements considérables pour se mettre au diapason de la transition verte, qu'il s'agisse de décarbonation des modes de production ou de passage à l'électro-mobilité - on parle de dizaines de milliards d'euros. Or, nous l'avons constaté lors de notre déplacement à Montbéliard, malgré de très importants efforts de modernisation, la production de l'usine Stellantis a déjà été divisée par deux, car le marché « ne suit pas ». Les sous-traitants locaux s'inquiètent tout simplement pour leur avenir. Pour la plupart d'entre eux, la transition vers l'électrique n'est pas une opportunité, mais une menace existentielle.
Or la survie de notre industrie automobile est un enjeu de souveraineté. Il ne s'agit pas simplement de maintenir des usines et des emplois, mais aussi de préserver notre indépendance économique, industrielle, technologique et même militaire.
Il y a bien sûr d'abord un enjeu économique et social : l'industrie automobile fait vivre pas moins de 350 000 salariés, répartis sur plus de 4 000 sites, très structurants pour les territoires concernés. Mais elle irrigue aussi de nombreux autres secteurs, comme la chimie, la métallurgie, le caoutchouc, ou encore l'informatique. On peut véritablement parler de « colonne vertébrale » de l'industrie française. La disparition de certains sous-traitants, faute de commandes suffisantes de la part du secteur automobile, aurait ainsi des conséquences dramatiques sur des industries comme la chimie ou la métallurgie, qui sont des industries de souveraineté. À terme, notre capacité de production militaire, notamment, pourrait s'en trouver affaiblie.
L'enjeu sécuritaire découle aussi, plus immédiatement, de la non-maîtrise par les Européens des chaînes de valeur de certaines technologies clés : les batteries bien sûr, mais aussi les logiciels embarqués, souvent développés hors d'Europe, avec les risques que cela représente en matière de fuite de données, de piratage, voire de contrôle à distance des véhicules. Dans un monde de plus en plus instable, céder le contrôle de ces technologies à des puissances étrangères, c'est prendre un risque majeur pour notre autonomie.
C'est pourquoi nous avons besoin d'une stratégie claire et ambitieuse pour éviter que la France - et plus largement l'Europe - ne devienne simple consommatrice de produits et de technologies sur lesquels elle aurait perdu la maîtrise.
Pour cela, nous proposons d'abord des mesures d'urgence pour contrer la concurrence déloyale des pays à bas coût.
La Commission européenne a déjà instauré en 2024 des droits de douane compensatoires pouvant aller jusqu'à 35 % pour contrecarrer les subventions dont bénéficient les acteurs chinois. Ces mesures ont déjà produit leurs effets, puisque les importations en Europe de véhicules chinois ont depuis baissé de près de 20 %. Mais elles restent insuffisantes. D'abord, elles ne concernent que les véhicules finis. Or la part des composants « sourcés » hors d'Europe, dans les pays à bas coût, ne cesse de grimper. Cette tendance va d'ailleurs s'aggraver avec l'électrification, dans la mesure où la valeur du contenu européen, estimé à 90 % en moyenne sur les véhicules thermiques, tombe à 60 % voire 40 % sur les véhicules électriques, notamment des batteries !
Nous estimons donc que l'Europe doit utiliser toute la palette des outils de défense commerciale à sa disposition pour rééquilibrer la concurrence, comme le font du reste les États-Unis ou la Chine dans d'autres domaines. Nous recommandons ainsi d'imposer temporairement des droits de douane massifs sur les véhicules chinois et sur certains composants clés, d'instaurer un seuil minimal de contenu européen dans les véhicules vendus en Europe (à hauteur de 80 % pour les composants hors batterie) et de fixer un objectif de 40 % de batteries produites sur le sol européen d'ici à 2035. Cela aurait pour effet d'obliger les constructeurs étrangers qui souhaitent accéder au marché européen à s'implanter en Europe, avec à la clé des transferts de technologie et des créations d'emplois. Il s'agit d'un levier puissant de relocalisation, qui nous permettrait de conserver sur notre sol l'entièreté de la chaîne de valeur.
Cette mesure devrait être doublée par la mise en place d'un éco-score à l'échelle européenne, qui prendrait en compte l'ensemble du cycle de vie du véhicule, pour déterminer l'éligibilité à certains mécanismes de soutien public. En effet, la réglementation favorise aujourd'hui les véhicules électriques en se fondant uniquement sur leurs émissions à l'échappement. Or, dans une voiture électrique, jusqu'à 75 % des émissions totales de CO2 sont occasionnées par la fabrication. Écologiquement plus juste, ce mode de calcul bénéficierait en outre particulièrement à la France, grâce à son énergie nucléaire décarbonée.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Ce travail de plus de quatre mois nous a permis de procéder à plus de trente auditions, concernant environ soixante institutions ou entreprises.
Je précise que notre objectif, avec la mesure qui vient de vous être présentée, n'est pas de s'extraire durablement de la compétition internationale, mais de laisser le temps à notre industrie de se transformer pour redevenir compétitive. C'est une stratégie de survie, car sans protections douanières, sans règles strictes sur l'origine des composants, dans quelques années, dans quelques mois, comme l'a dit ma collègue, c'en est fini de l'industrie automobile française, et même européenne.
Évidemment, ces mesures devront être temporaires et dégressives, car il ne s'agit pas d'offrir sans contreparties à nos industriels un marché captif, ni de nous dispenser de nous interroger sur les raisons de notre manque de compétitivité. J'y reviendrai, mais c'est un point très important pour que nous, Français, puissions faire entendre notre voix à Bruxelles. En effet, nos partenaires européens, et en premier lieu nos « amis » allemands - en matière industrielle, il convient de toujours mettre le mot « ami » entre guillemets -, qui ont globalement moins de difficultés que nous à exporter, ont souvent tendance à nous soupçonner d'invoquer la souveraineté pour masquer nos propres turpitudes, ce qui affaiblit nos positions.
Or nous avons des demandes à présenter à nos partenaires européens et à la Commission. Vous le savez, le Pacte vert européen, ou Green Deal, a fixé la fin de la vente de véhicules thermiques neufs en Europe à 2035 - une clause de revoyure, qui devait être étudiée en 2026 le sera en 2025, selon ce qu'a déclaré hier le commissaire européen Stéphane Séjourné. Cependant, cet objectif de réduire les émissions de CO2 des véhicules heurte de plein fouet la réalité industrielle. La date a été fixée au doigt mouillé : l'Europe visait la neutralité carbone en 2050, le parc automobile mettait en moyenne quinze ans à se renouveler complètement, il fallait donc arrêter d'y faire entrer des voitures thermiques en 2035. Et tout cela sans consultation des industriels - il est vrai que, après le Dieselgate, ils n'étaient plus très en cour à Bruxelles -, sans vérifier préalablement que l'Europe disposait des capacités technologiques et industrielles, des compétences et matières premières pour produire des batteries. Or, comme le dit Luc Chatel, réglementer n'a jamais fait une ambition industrielle. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui : comme dans beaucoup de domaines, en Europe, nous avons mis la charrue avant les boeufs.
Je remarque d'ailleurs que l'Europe est la seule entité politique au monde à s'être fixé un objectif aussi rigide - à part la Californie. Ne nous y trompons pas : si la Chine est en pointe sur l'électrique, ce n'est pas par vertu, c'est parce qu'elle a parié sur cette technologie, dans une logique de planification industrielle. Alors que l'Union européenne a, encore une fois, choisi de réglementer le marché...
Pourtant, les constructeurs européens ont joué le jeu. Ils ont investi pour engager la transition, mais le marché « patine » et ils ne s'y retrouvent pas. À court terme, la situation semble insoluble.
La Commission européenne a fini par entendre les appels à l'aide de l'industrie : au début de 2025, elle a lancé un « dialogue stratégique », qui a débouché, en mars, sur un plan d'action en faveur de l'industrie automobile et sur un assouplissement de l'objectif intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2025 - je rappelle que sans cet assouplissement, nos constructeurs auraient dû payer des milliards d'euros de pénalités. Même si le réveil est un peu tardif, on ne peut que saluer ce plan, qui prévoit notamment un soutien à l'innovation et aux batteries, la poursuite du développement des infrastructures de recharge, un soutien à la demande et un accompagnement à la reconversion de salariés touchés par la transition. Il s'agit pour l'instant d'annonces, qui devront se concrétiser dans des textes réglementaires - or il faut se méfier des annonces, quelle que soit leur nature, mes chers collègues !
Alors que préconisons-nous ? Notre première recommandation est de reporter la date l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe. Si nous maintenons la date de 2035, nous avons la certitude que notre industrie automobile sera balayée, comme avant elle la sidérurgie ou la téléphonie. Les Chinois ont dix à vingt ans d'avance sur les technologies électriques - nous avons pu le constater lors du déplacement en Chine de notre commission l'an dernier ; nous devons laisser le temps à nos industriels de monter en compétence. La date d'extinction du thermique devra être fixée au niveau européen, après consultation des acteurs industriels, et être précédée par une trajectoire de décrue, afin que la transition se fasse sans heurts. À terme, l'électrique deviendra de toute façon beaucoup plus compétitif, et s'imposera ensuite naturellement dans tous les usages pour lesquels il est adapté.
Au contraire, s'arc-bouter sur le 100 % électrique en 2035 aurait un coût économique, mais aussi social et écologique. En effet, dans les zones très rurales, ou pour les utilisateurs occasionnels qui ne font que de longs trajets, l'électrique n'est, pour l'heure, pas adapté. Pourquoi braquer ces utilisateurs que le passage à marche forcée à l'électrique risquerait de priver de toute solution de mobilité ? Pas plus tard que la semaine dernière, l'Institut Montaigne alertait sur le risque d'un rejet en bloc par les citoyens des solutions de mobilité verte, trop coûteuses et mal adaptées à leurs besoins - nous devrions y prendre garde !
Lorsqu'on parle de décarbonation, il faut aussi prendre en compte la vitesse de renouvellement du parc, qui est deux fois plus lente qu'en 1990, pour s'établir aujourd'hui à vingt-cinq ans en moyenne en Europe. De ce fait, pour faire baisser les émissions à court terme, les solutions décarbonées pour le thermique ont un rôle majeur à jouer.
L'assouplissement de l'objectif 2035 permettrait notamment de mieux tirer parti des « hybrides rechargeables ». Elle réduit massivement les émissions tout en rassurant les usagers sur l'autonomie de leurs véhicules. Ces derniers ont été très critiqués, on a dit qu'ils fonctionnaient en fait presque exclusivement grâce à leur moteur thermique, mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, car les pratiques ont changé. En outre, compte tenu de nos capacités limitées de production de batterie, ne vaut-il pas mieux les utiliser pour équiper une demi-douzaine d'hybrides rechargeables à autonomie électrique réduite, qui fonctionnera de temps en temps à l'essence, plutôt qu'une seule « super voiture » électrique que personne n'achètera, compte tenu de son coût trop élevé ? Là aussi, c'est une question de réalisme. On nous a aussi beaucoup parlé des prolongateurs d'autonomie, les range extenders, qui se répandent en Chine et qui permettent de recharger la batterie avec un petit moteur thermique d'appoint, avec très peu d'émissions de CO2 : cela nous semble une solution intéressante à diffuser, en dépit des caricatures.
Notre deuxième recommandation, en plus de cet assouplissement paramétrique du « zéro véhicules thermiques neufs en 2035 », est d'appliquer réellement le principe de neutralité technologique, qui figure d'ailleurs déjà dans le règlement européen. À cela, il y a une raison quasi philosophique : le politique doit fixer des caps, mais ce n'est pas son rôle de faire des choix technologiques. Tenons-nous-en aux objectifs, et laissons à l'industrie le soin de trouver les meilleurs moyens de les atteindre. Je pense naturellement aux biocarburants et aux e-carburants, qui sont des solutions intéressantes, que, contrairement à l'électrique, nous maîtrisons complètement ; elles peuvent donc être mises en oeuvre immédiatement et à moindre coût, car elles ne nécessitent de modifier ni les motorisations ni les infrastructures. Sans compter que la production de biocarburants permet, en France notamment, de soutenir les revenus des agriculteurs. Il ne s'agit en aucun cas de favoriser indûment ces technologies, mais d'ouvrir le champ des possibles, à charge pour les industriels de faire leurs calculs de rentabilité.
La Commission s'est dite prête à réinterroger ces deux points : l'échéance de 2035 et le principe de neutralité technologique. Nous en sommes évidemment satisfaits et demeurerons très attentifs au contenu exact des futures propositions législatives en ce sens.
J'en reviendrai pour finir aux questions de compétitivité. Comme je l'ai déjà dit, si la France veut sauver son industrie automobile, elle a aussi un examen de conscience à faire, sur le coût du travail, mais aussi sur le coût de l'énergie, qui pénalise particulièrement la production de véhicules électriques - plus énergivore que celle des véhicules thermiques. On ne pourra pas en faire l'économie.
Mais nous appelons aussi à des ajustements des règles européennes en matière d'investissement, qui sont plus favorables pour les pays d'Europe centrale et orientale, ce qui fausse la concurrence au sein même de l'Union européenne, alors que ces pays sont déjà avantagés par leurs coûts du travail réduits !
Enfin, les règles européennes en matière d'aides d'État doivent également évoluer pour nous permettre de soutenir puissamment l'industrie des batteries, qui est la brique de base de notre future souveraineté automobile, y compris au stade de l'industrialisation.
M. Rémi Cardon, rapporteur. - Alain Cadec a parlé des conditions de production, je reviendrai pour ma part d'abord sur les conditions de marché. Aujourd'hui, le coût des véhicules électriques demeure un frein à l'achat pour beaucoup de Français.
Il est désormais bien établi que, sur le long terme, rouler en véhicule électrique coûte moins cher que de rouler en véhicule thermique : pour un usage quotidien, la recharge à domicile est environ trois fois moins chère qu'un plein d'essence, et l'entretien est également moins fréquent. Des études dont nous avons eu connaissance estiment que la voiture électrique devient globalement rentable au bout de deux à cinq ans.
Il n'en demeure pas moins que le coût d'entrée est élevé, puisqu'une voiture électrique coûte en moyenne 30 % à 50 % plus cher qu'une voiture thermique, ce à quoi peut s'ajouter le coût de l'installation de bornes de recharge domestiques. C'est un véritable frein à l'achat, particulièrement pour les classes populaires et moyennes, qui sont pourtant celles qui ont le plus souvent besoin de leur véhicule pour se rendre à leur travail.
Nous n'allons pas préempter les discussions budgétaires à venir, mais l'une de nos recommandations est d'assurer désormais la stabilité de ces aides dans le temps, afin de donner de la visibilité aux acheteurs, mais aussi aux industriels, sur les conditions de marché.
Plus fondamentalement, nous estimons que, à moyen terme, c'est au niveau européen que les mécanismes de soutien à la demande de véhicules électriques devraient être mis en place. Car actuellement, concrètement, ce sont les impôts des Français qui financent la production en Chine, mais aussi et surtout en Roumanie ou en Slovaquie... Si les objectifs en matière de baisse des émissions sont fixés au niveau européen et si leur atteinte est évaluée au niveau européen, les mécanismes de soutien au marché doivent aussi être fixés au niveau européen - pondérés, le cas échéant, en fonction du pouvoir d'achat de chaque pays, afin d'éviter des effets d'entraînement trop disparates.
Mais il existe aussi des voies non budgétaires pour soutenir le marché. La première tend à miser sur le marché de l'occasion électrique, qui est en progression, mais demeure moins fluide que celui de l'occasion thermique, en raison, notamment, d'inquiétudes persistantes sur les performances des batteries anciennes, alors que ces dernières sont plutôt meilleures que ce qui était anticipé. Afin de soutenir ce marché, nous recommandons donc de créer un « diagnostic batterie certifié » propre à rassurer les acheteurs, et qui serait exigible lors de la vente de tout véhicule électrique, neuf ou d'occasion.
Notre dernière préconisation pour soutenir le marché ne produira ses effets qu'à moyen terme, car elle nécessite un « changement de logiciel » dans les stratégies des constructeurs français. En effet, l'augmentation des prix moyens des véhicules, si pénalisante pour le marché, n'est pas principalement due à l'électrification, qui n'est arrivée que ces toutes dernières années. Depuis une vingtaine d'années, les constructeurs se sont engagés dans une stratégie de montée en gamme, qui n'a fait que s'accélérer en sortie de crise du Covid-19, dans un contexte de pénurie de l'offre qui a augmenté le « pricing power » des constructeurs. De fait, dans les gammes des constructeurs français, les petites voitures ont quasiment disparu. Or ce sont elles qui faisaient les volumes.
Les industriels ont sans doute leur part de responsabilité dans ces choix stratégiques qui apparaissent aujourd'hui délétères, mais le poids croissant des exigences normatives européennes, notamment en matière de sécurité, a également lourdement pénalisé les industriels français, dont les modèles légers sont devenus plus chers à produire, moins rentables, et donc moins attractifs pour les constructeurs - à la différence des berlines allemandes, relativement moins impactées. Résultat : des constructeurs français aujourd'hui incapables de proposer une offre abordable et qui ne cessent de perdre des parts de marché. Le tir est d'ailleurs en train d'être corrigé, avec l'arrivée de nouveaux modèles comme la ë-C3 ou la Twingo électrique. Mais, de l'avis des experts que nous avons auditionnés, notamment du groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile (Gerpisa) du CNRS, le retour à ces modèles ne suffira pas à combler l'écart de prix occasionné par l'électrification.
Aussi, nous estimons nécessaire de modifier le cadre réglementaire pour créer une nouvelle catégorie de véhicules très légers, avec des exigences matérielles de sécurité allégées, mais, en retour, des restrictions en matière de vitesse, taille, puissance, etc. sur le modèle des kei cars japonaises. Compactes et légères, ces voitures aux performances limitées - intermédiaires entre les véhicules classiques et les voiturettes sans permis - permettent malgré tout de répondre à une large part des besoins, notamment pour les trajets du quotidien. Leur coût réduit, synonyme de large diffusion, devrait permettre aux constructeurs de renouer avec les volumes.
Un autre enseignement à tirer du succès des kei cars japonaises, dont la production est mutualisée entre les différents constructeurs pour faire baisser les coûts, est que, face à la compétition mondiale, seule une politique industrielle commune, portée par une vision partagée entre la France, l'Allemagne et les autres États membres de l'Union européenne, permettra de garantir l'avenir de l'automobile européenne.
C'est ce que nous recommandons sur le long terme. Car, même si le tableau est sombre, il y a des lueurs d'espoir pour l'avenir. Nous avons des atouts, en France et en Europe, pour redevenir leaders sur le véhicule de demain. Mais cela suppose que les acteurs européens, institutionnels et industriels, jouent collectif. La tentation de certains constructeurs de passer des alliances avec les Chinois pour rattraper « individuellement » leur retard technologique ne peut qu'accroître, à terme, le risque de dépendance envers la Chine, notamment sur des technologies clés comme les batteries. Nous suggérons au contraire de tirer parti des futures règles de contenu local européen et d'écoconditionnalité pour encourager l'implantation sur le sol européen de ces acteurs chinois, sous condition de transferts de technologie - comme ils l'ont, du reste, fait chez eux ! Alors que le marché états-unien se ferme, l'Europe, forte de ses presque 450 millions de consommateurs, est plus attractive que jamais : elle est en mesure de fixer ses conditions.
Sur le plus long terme, la France et l'Europe ont également de solides atouts en matière de R&D. Plus de la moitié des brevets déposés en France le sont par l'industrie automobile et quatre des dix premières places au classement des déposants de brevets sont occupées par des entreprises de la filière automobile. Même si, en termes d'effectifs, l'Europe n'est pas en mesure de concurrencer la Chine - on parle de 20 000 chercheurs et ingénieurs rien que chez le producteur de batteries CATL ! -, la France et l'Europe disposent de pôles de recherche de grande qualité et d'un vivier de talents reconnus dans des secteurs clés comme les batteries, l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes. Dans les batteries notamment, le rattrapage sur les technologies matures n'exclut pas en parallèle les recherches sur les technologies d'avenir, par exemple les batteries solides, qui pourraient offrir de meilleures performances.
Afin de préserver un haut niveau d'innovation, il nous apparaît donc essentiel de sanctuariser des dispositifs comme le crédit d'impôt recherche (CIR), unanimement cité par les acteurs de la filière comme l'un des atouts majeurs de la France, mais aussi de renforcer les liens entre la recherche académique et l'industrie. Cela ne signifie naturellement pas que ces dispositifs ne doivent pas être ajustés - nous aurons sans doute l'occasion d'en débattre lors de l'examen du projet de loi de finances.
La France pourrait notamment tirer son épingle du jeu dans le domaine du logiciel, grâce à sa formation de haut niveau dans les domaines du numérique et de l'intelligence artificielle. Des entreprises comme Valeo sont en pointe dans ce secteur. Or, alors qu'aujourd'hui, les constructeurs réalisent leur bénéfice sur le prix de vente du véhicule, à l'avenir, les logiciels pourraient permettre de créer de la valeur pendant quasiment toute la durée de vie du véhicule. Plus encore que dans l'électrification, c'est sans doute là que réside la prochaine révolution de l'industrie automobile. Face à la force de frappe des Gafam et autres BYD, il est donc indispensable de soutenir l'émergence d'un écosystème européen du véhicule numérique.
Naturellement, ces mesures de long terme n'auront un sens que si notre industrie survit jusque-là.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Merci à nos rapporteurs. La liste des préconisations vous a été distribuée, place aux questions !
M. Franck Menonville. - Permettez-moi d'exprimer mon désarroi face à ce naufrage industriel, comparable à celui que nous vivons dans l'agriculture ou l'énergie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, en raison de politiques européennes inadaptées, nous abandonnons encore une fois un secteur où nous disposions d'une souveraineté.
Il ne s'agit pas d'opposer l'électrique au thermique. Mais nous devons répondre à un enjeu de temporalité : quand on ne maîtrise pas de manière souveraine une technologie, on ne lui fait pas une place sur le marché sans s'y être préparé. Or c'est ce que nous avons fait. Il faut inverser la tendance.
La voiture électrique a toute sa place sur certains marchés, mais cette technologie ne peut pas être généralisée. La Chine a quinze ans d'avance sur nous et elle ne va pas nous laisser la rattraper !
En outre, nos constructeurs n'ont pas la capacité financière pour être présents sur toutes les technologies.
D'ailleurs, j'ai fait l'expérience du véhicule hybride rechargeable : on consomme plus qu'avec une voiture thermique !
M. Alain Cadec, rapporteur. - Ce n'est plus vrai aujourd'hui.
M. Franck Menonville. - Peut-être encore en milieu rural, ou bien était-ce une question de modèle. En tout cas, il faut donc continuer à développer les petits moteurs thermiques qui ont encore des marges de progrès et les e-carburants, tout en développant l'électrique dès que c'est possible.
Certains constructeurs misent sur le tout-électrique, mais de nombreux territoires de la planète n'auront toujours pas accès à l'électricité après 2035 : qui va prendre ces marchés ?
Mme Marie-Lise Housseau. - J'ai rencontré des représentants de Mobilians et je retrouve leurs demandes dans ce rapport. Ils estiment bien évidemment que l'échéance de 2035 est ingérable. Selon eux, la R&D permettra de développer des moteurs thermiques consommant très peu, si on leur en laisse le temps. Ils soulignent également que le renouvellement du parc ralentit, à l'inverse de ce que l'on souhaiterait. Par ailleurs, étant élue d'un département très rural, le passage au tout-électrique me paraît utopique.
Enfin, les réglementations actuelles imposent aux constructeurs d'installer des aides à la conduite dont la plupart des conducteurs ne se servent pas, mais qui augmentent le prix des véhicules de 20 % à 30 %...
M. Daniel Gremillet. - Je remercie les rapporteurs pour leurs recommandations courageuses - en particulier la première, sur le report de l'interdiction des ventes de voitures thermiques neuves -, parce qu'elles vont à l'encontre de décisions européennes prises sans aucun recul. Nous sommes aussi à la veille d'une fracture sociale et sociétale, avec l'interdiction du véhicule thermique à l'horizon de 2035 : les chiffres que vous avez donnés sur l'écart de prix montrent combien cela limite le champ des possibles, alors que la mobilité est un enjeu majeur dans notre société.
Je serais tenté de dire qu'il ne faut pas fixer de butoir : il faut laisser la recherche avancer et permettre à la technologie d'évoluer. Des véhicules thermiques de nouvelle génération apporteront peut-être une partie des réponses attendues.
Vous avez également raison de parler dès le début des biocarburants, car ils permettront à un certain nombre de Français qui ne pourront pas acheter un véhicule électrique d'être acteurs de la mobilité décarbonée. Cette prise de position va à l'encontre des politiques actuelles, mais nous aurons l'occasion d'en débattre lors du débat budgétaire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le rétrofit hydrogène des moteurs diesel ? Nous disposons d'un savoir-faire qui permettrait une meilleure accessibilité à la mobilité décarbonée.
Il serait judicieux que le CIR, s'il est maintenu, soit conditionné au développement industriel en France et en Europe des résultats de la recherche ainsi financée. Par ailleurs, il faut être très exigeant sur le recyclage : le futur appartiendra aux pays qui auront mis en place une capacité de recyclage. L'Union européenne devra avoir une politique beaucoup plus incitative.
Mme Amel Gacquerre. - Je remercie les auteurs du rapport, notamment pour leurs propositions concrètes et de court terme.
Vous l'avez dit, les batteries sont notre point faible, mais elles risquent de le rester. Le grand projet de « vallée de la batterie » devait initialement comporter cinq gigafactories. Actuellement, ACC, à Billy-Berclau, qui devait créer 2 000 emplois, n'en a créé que 600, son rythme de production étant insuffisant ; Envision, à Douai, est la gigafactory la mieux avancée, qui a commencé à produire ; Verkor, à Dunkerque, ne va pas produire avant 2026. Ces résultats ne sont pas à la hauteur pour nous permettre d'avancer.
J'ai interrogé hier le commissaire Séjourné sur l'implantation du constructeur chinois BYD en Hongrie sans qu'il réponde clairement. Vous estimez, quant à vous, que c'est une menace. Que faire pour freiner ce mouvement ? Si vous pensez que notre filière automobile a vraiment un avenir - ne cédons pas au fatalisme ! -, lequel ?
M. Yannick Jadot. - Nous ne soutenons pas l'analyse développée dans ce rapport.
Tout d'abord, les derniers chiffres sur les ventes de voitures électriques montrent une reprise, grâce à l'arrivée de petits véhicules.
Ensuite, il faut parler de ce sujet avec précaution, car il est anxiogène. En matière de transition énergétique, le sujet de la voiture électrique vient en tête dans la désinformation. La date de 2035 marque l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs et non pas l'interdiction des véhicules thermiques.
M. Alain Cadec, rapporteur. - C'est bien ce que nous avons dit.
M. Yannick Jadot. - Il y a un an, dans le cadre de diverses commissions d'enquête, nous avons auditionné MM. Senard et Tavares, qui nous disaient qu'ils seraient prêts en 2030...
M. Alain Cadec, rapporteur. - M. Tavares est parti !
M. Yannick Jadot. - Ils nous ont dit qu'ils appliqueraient la nouvelle règle, qu'ils étaient des industriels performants et qu'ils voulaient être les premiers, mais qu'il fallait cesser de changer les règles. Le même raisonnement s'applique aux gigafactories : s'il n'y a plus de commandes de batteries électriques, elles vont devoir courir après les subventions pour tenir ! La Chine a de l'avance, certes, mais la solution ne consiste pas à descendre du train...
M. Alain Cadec, rapporteur. - Il s'agit de le ralentir !
M. Yannick Jadot. - On ne ralentira pas le train de la Chine. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans cinq ans, 50 % des voitures vendues dans le monde seront électriques. Ce n'est pas en reculant l'échéance en Europe que nous aiderons nos industriels à satisfaire le marché européen tout en étant compétitifs à l'échelon international. En Chine, au Brésil, en Thaïlande, en Indonésie, les véhicules électriques sont moins chers que les véhicules thermiques, sans subventions publiques, parce que les constructeurs ont fait le choix de véhicules adaptés à la demande.
La crise automobile en France a 40 ans ! Depuis 40 ans, la filière française a régulièrement perdu des dizaines de milliers d'emplois. Ce n'est pas dû à la voiture électrique. Le moment est venu de relocaliser la production. La Renault 5 électrique va être produite en France. La production des petites voitures a été jusqu'à maintenant délocalisée. L'électrique est une opportunité de relocalisation de la production en France.
Il s'agit donc de ne pas réduire nos ambitions européennes sur cette transition, mais de nous donner les moyens d'être au rendez-vous, en rattrapant ceux qui ont pris de l'avance et en relocalisant notre industrie autour de l'électrique.
Quant aux e-carburants, pour la voiture, ils sont dix fois plus chers qu'un carburant classique. Si vous voulez faire du social... Le premier à avoir développé cette idée, c'est Porsche, suivi par Ferrari ! Les e-carburants seront nécessaires pour les avions, mais pas pour les voitures.
M. Fabien Gay. - Je remercie nos trois rapporteurs pour ce travail sérieux. Je peux partager certains constats, notamment sur le besoin de protectionnisme ; d'autres constats m'inspirent des doutes ; enfin, je déplore des manques.
Comme Yannick Jadot, je pense que les industriels de nombreux secteurs - l'automobile, le nucléaire ou l'aéronautique - ont besoin de règles stables et, pour investir dans le long terme. Dans le même temps, il faut clairement préparer la transition vers les mobilités d'avenir. Pour autant, la question de l'impact écologique de la batterie électrique doit aussi être posée, comme celle des carburants. Nous verrons cohabiter pendant un certain temps l'électrique et le thermique, puis nous basculerons vers le tout-électrique, sachant que dans dix ou vingt ans, malgré les efforts d'économies d'énergie, avec la voiture électrique, les objets connectés, etc., la question de la production d'électricité va se poser. Les gigafactories sont à peine naissantes ; si nous donnons le signe aujourd'hui que les règles pourraient changer, un pan du secteur disparaîtra, faute d'investissements, et nous prendrons du retard. C'est un constat qui va au-delà des divergences de fond.
Deuxième point qui me frappe : la France est en train de s'hyperspécialiser, mais elle perd tout le reste de la chaîne de valeur. Nous assumons la conception des produits et parfois la production finale, mais le reste va se faire ailleurs. On observe déjà ce phénomène dans l'industrie du médicament. Depuis la crise du Covid-19, nous voyons les sous-traitants fermer et délocaliser. Dans mon département, l'un des derniers sous-traitants de Stellantis a fermé pour produire en Turquie. Une réflexion manque sur ce point.
Sur la recommandation n° 14, j'approuve le premier point - harmoniser les règles relatives aux aides publiques -, mais je ne peux que contester le deuxième - réduire le coût du travail. La réponse à ces questions d'avenir ne peut pas être dans le moins-disant social et environnemental. On trouvera toujours moins cher pour produire ailleurs !
Enfin se pose la question des véhicules dont nous avons besoin. Nous construisons des véhicules trop chers, quand les Chinois produisent de petits véhicules à moins de 10 000 euros. Le prix des voitures neuves, chez nous, a augmenté de 40 % en quinze ans...
M. Alain Cadec, rapporteur. - À cause des normes européennes !
M. Fabien Gay. - Aujourd'hui, le premier achat d'un véhicule neuf intervient à l'âge de 57 ans en moyenne ! Les jeunes ne peuvent donc pas accéder à des voitures propres. Il faut donc faire prendre un vrai virage stratégique à notre industrie.
M. Henri Cabanel. - Je partage ce qui vient d'être dit sur la demande de clarté des industriels. Si les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules thermiques, le coût de la recharge et de l'entretien est nettement moins élevé : on ne le dit pas assez.
Je partage vos propositions sur les tarifs douaniers. Il faut aller plus loin, avec des primes à l'achat qui devraient être réservées à l'achat de véhicules électriques européens. Il faut également distinguer entre les véhicules légers et les poids lourds. Quant aux biocarburants, pensons au biogaz, issu de la méthanisation des déchets agricoles, mais aussi des stations d'épuration : cette solution peut être intéressante pour les véhicules lourds.
M. Daniel Salmon. - Je ne partage pas non plus les conclusions des rapporteurs. Notre commission fait d'ordinaire preuve de volontarisme, elle aime montrer sa capacité à innover. En l'espèce, j'ai le sentiment d'entendre des propos d'arrière-garde...
M. Alain Cadec, rapporteur. - On fait un constat !
M. Daniel Salmon. - Nos constructeurs automobiles, depuis longtemps, commettent des erreurs stratégiques et ils ont beaucoup procrastiné. L'avenir n'appartient pas au véhicule thermique. Les bilans écologiques sont largement en faveur du véhicule électrique. On oublie souvent que le véhicule thermique implique l'importation d'énergies fossiles pour 70 milliards d'euros chaque année. On sait également que pour respecter notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut agir sur les transports : or c'est là que nous sommes en retard.
Nous avons besoin d'une politique très volontariste si nous voulons avoir une chance de nous en sortir. Nos constructeurs ont fait une erreur en ne travaillant pas assez tôt sur le véhicule électrique, ils ont fait également une erreur en se concentrant sur des véhicules trop lourds et en abandonnant les véhicules plus légers, sans parler des innombrables gadgets inutiles qui pèsent sur le prix à la vente.
Rappelons enfin que l'objectif 2035, c'est uniquement la fin de la vente de véhicules thermiques neufs. Ce n'est pas en tergiversant que nous aiderons notre industrie à se développer.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Je retiens deux axes qui nous interpellent : la compétitivité de nos industriels, pour relever le défi de l'électrique, et la capacité des Français à financer l'achat de véhicules électriques.
S'agissant des conditions de marché évoquées dans la recommandation n° 8, à l'approche du débat budgétaire, nous entendons parler d'une extension du malus écologique aux véhicules d'occasion. Comment les Français pourront-ils y faire face ? En ce qui concerne les conditions de production, on constate les effets de la politique tarifaire du président Trump : Stellantis prévoit d'investir 13 milliards d'euros aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Dans ce contexte, comment avancer dans le sens que vous préconisez ?
M. Christian Redon-Sarrazy. - De quelque façon qu'évolue le marché, nous aurons besoin d'installer des bornes de recharge, notamment en zone rurale, par exemple avec les aires de covoiturage. Or les collectivités sont souvent à l'initiative de ces projets et les financent (directement ou indirectement), contrairement à ce qui se faisait dans le passé avec les stations-service, où les industriels contribuaient. Le modèle économique serait peut-être à revoir.
En ce qui concerne le CIR et la relocalisation, les Chinois ne sont pas prêts à nous rendre ce qu'ils nous ont pris... Pour autant, il ne faut pas être défaitistes. La réindustrialisation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'opérations de R&D, mais aussi de production. J'insiste sur la question des données qui représente un enjeu énorme. Dans ce domaine, la souveraineté est fondamentale et il ne faudrait pas laisser la main à d'autres acteurs.
Mme Martine Berthet. - J'approuve entièrement les recommandations de nos rapporteurs.
S'agissant de la recommandation n° 12 sur les matériaux critiques, je me permets d'insister sur les difficultés actuelles de la filière de la fibre de verre, qui produit notamment pour la filière automobile, dont les usines ferment en Europe, à cause de la concurrence chinoise qui contourne les mesures européennes de protection.
En ce qui concerne les batteries, des appels à projets avaient été lancés par l'Union européenne, auxquels avait répondu Tokai Cobex, pour la production de carbone spécifique à ces batteries. Cette entreprise japonaise renonce finalement à ce projet, à cause de notre instabilité politique et du coût de l'énergie. Sur ce dernier sujet, EDF commence à avancer des propositions plus favorables aux industriels et plus conformes à leurs besoins, mais il faudrait trouver une solution pour redonner de la confiance aux investisseurs étrangers.
Pour ce qui est du recyclage des batteries, on observe également des difficultés : Ugitech essaie de mettre en place la filière Ugi'Ring sur un ancien site industriel, mais se heurte à la complexité des études environnementales, ce qui ralentit la mise en oeuvre de ce projet d'économie circulaire vertueux, ce qui est regrettable.
Enfin, s'agissant du maintien du CIR et des dispositifs relatifs à l'emploi des doctorants, le sujet avait également été mis en avant lors des travaux de la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Nous faisons le constat d'un naufrage, mais notre rapport n'a pas pour objet d'opposer l'électrique au thermique.
Plusieurs d'entre vous ont évoqué Mobilians, que nous avons auditionné et qui sera destinataire de notre rapport, comme tous les organismes auditionnés.
D'autres collègues ont évoqué les carburants alternatifs, comme l'hydrogène : ces technologies ne peuvent pas être rapidement mises en oeuvre et les industriels sont assez frileux, même si la recherche continue. En revanche, le biogaz peut être intéressant pour les gros véhicules, d'autant qu'il est désormais possible de le liquéfier.
Mme Gacquerre a évoqué le problème des batteries. Nous sommes très loin derrière la Chine en termes de production et tous les composants de nos batteries sont chinois ! Nous sommes dépendants des matières premières, qui proviennent de Chine ou de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, on ne sait pas non plus recycler les batteries...
Monsieur Jadot, votre position est trop caricaturale. Vous évoquez la nouvelle Renault 5 : son prix de vente est de 30 000 euros, c'est trop élevé pour des ménages modestes. Leapmotor est le seul constructeur qui vende des véhicules électriques à moins de 20 000 euros, mais ils sont fabriqués en Chine.
Quand nous sommes allés à Montbéliard, le responsable du site nous a dit qu'il était incapable de fabriquer des véhicules électriques...
M. Rémi Cardon, rapporteur. - ... de manière rentable, pour être précis !
M. Alain Cadec, rapporteur. - Et ce ne sont pas seulement les patrons qui nous le disent, les syndicats aussi !
Quand M. Jadot dit que, dans cinq ans, 50 % du parc automobile mondial sera électrique...
M. Yannick Jadot. - 50 % des ventes de véhicules neufs !
M. Alain Cadec, rapporteur. - ... j'ai du mal à y croire.
Nous partageons la nécessité de produire des véhicules plus petits et plus abordables.
Par ailleurs, le coût d'utilisation des véhicules électriques est peut-être moins élevé que celui des véhicules thermiques, mais il faut aussi traiter la problématique de l'installation des bornes de recharge, notamment dans les copropriétés, et dans le logement social.
M. Jadot a cité Carlos Tavares, mais son successeur, Antonio Filosa, demande de la flexibilité dans la réglementation, pour aller vers la décarbonation en maintenant l'activité industrielle.
M. Yannick Jadot. - Les constructeurs veulent avant tout éviter les pénalités sur les émissions de CO2 !
M. Alain Cadec, rapporteur. - Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut aller vers l'électrique, mais pas n'importe comment ! L'Europe et la Californie sont prêtes à s'équiper en voitures électriques, mais le reste du monde ?
M. Yannick Jadot. - Même l'Indonésie est en train de rattraper l'Europe sur le taux de pénétration !
M. Alain Cadec, rapporteur. - En Chine, les véhicules électriques circulent uniquement dans les zones urbaines. Dans la campagne chinoise, on circule avec des véhicules thermiques. Et l'électricité y est produite par des centrales à charbon...
Pour terminer, je rappelle que la filière automobile représente 850 000 emplois : 350 000 en amont, 450 000 en aval. On risque d'en perdre une grande partie, c'est insupportable ! S'il suffit de faire un petit effort en décalant l'échéance, on doit pouvoir le faire. Le chancelier Merz lui-même a d'ailleurs demandé hier au Conseil un tel assouplissement.
Mme Annick Jacquemet, rapporteure. - Lors des auditions, nous avons entendu un cri d'alarme de tous les acteurs, auquel nous ne pouvons pas rester insensibles. En ce qui concerne le report de l'échéance de 2035, nous demandons à la Commission d'agir « en accord avec les industriels », il faut examiner la capacité de l'ensemble des acteurs à répondre aux besoins du marché
Monsieur Jadot, quand la R5 est sortie dans les années 1970, son prix équivalait à six mois de salaire moyen ; le prix de la nouvelle R5 représente entre douze et dix-huit mois de salaire. Cette petite voiture n'est pas à la portée de toutes les bourses. En moyenne, les Français peuvent consacrer 15 000 euros à l'achat d'un véhicule d'occasion, et 25 000 euros pour un véhicule neuf. Or le prix des voitures a augmenté de 25 % entre 2020 et 2024 : on comprend que le marché soit atone.
Nous avons auditionné tous les constructeurs de batteries. Ils se trouvent dans la « vallée de la mort » : ils ont mis au point les techniques, mais il leur faut trouver les financements pour passer à l'industrialisation. Ils souhaiteraient pouvoir compter sur des financements européens, mais sauf exception, ceux-ci ne bénéficient qu'à l'innovation et aux nouveaux projets, pas ceux en phase d'industrialisation.
Notre recommandation n° 8 insiste sur la stabilité du cadre fiscal et des aides à l'achat, car effectivement, les entreprises ont besoin de stabilité. En cinq ans, les réglementations ont connu dix-sept changements.
Enfin, les batteries NMC sont recyclables à 90 %, voire 100 %. C'est pourquoi nous insistons sur le développement du recyclage, car la grande majorité de l'extraction et surtout du raffinage des métaux rares se fait pour le moment en Chine.
M. Rémi Cardon, rapporteur. - Comme l'a dit Yannick Jadot, c'est surtout la taxe « Cafe », sur les émissions de CO2, qui fait peur pour l'instant aux constructeurs. La date butoir de 2035 les préoccupe moins, parce qu'ils ont déjà investi massivement.
L'accessibilité des véhicules électriques en termes de coût est un enjeu majeur. Il faut une politique de demande bien plus offensive. Par exemple, le leasing social est réservé à des catégories très modestes, il relève davantage de la politique de communication que d'une vraie politique sociale. C'est un sujet qui devra être abordé lors de l'examen du projet de loi de finances.
Nous sommes à dix ans de l'échéance : il faut faire preuve de volontarisme plutôt que de céder à la fatalité, sinon notre retard de quinze ans va se creuser.
Je vous invite à lire notre rapport, car nos préconisations sont plus modérées que ce qui est parfois ressorti de nos échanges.
M. Yannick Jadot. - Avez-vous abordé la question des flottes d'entreprise ?
M. Alain Cadec, rapporteur. - Nous avons reçu les observations des gestionnaires de flotte et nous en avons tenu compte dans nos recommandations.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je vous propose d'adopter, par un vote global, le rapport d'information et ses dix-huit recommandations.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 18 mars 2025
- Table ronde
· Plateforme automobile : M. Marc MORTUREUX, directeur général, et Mme Louise d'HARCOURT, responsable des affaires publiques et parlementaires ;
· Renault : M. Nicolas TCHENG, responsable des relations institutionnelles ;
· Stellantis : Mme Sandrine BOUVIER, directrice Mobilité électrique.
Mercredi 19 mars 2025
- Transport et environnement (T&E) : Mme Marie CHÉRON, responsable Politiques véhicules, et M. Léo LARIVIÈRE, responsable Transition automobile.
- Boston consulting group : MM. Xavier MOSQUET, Senior Partner Emeritus (associé senior émérite), Mikaël LE MOUËLLIC, directeur associé, et Mme Camille GODEAU, directrice Communication.
Mardi 25 mars 2025
- Automotive Cells Company (ACC) : M. Matthieu HUBERT, secrétaire général, et Mme Natasha CASTRO-POUGET, directrice des affaires publiques.
- Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM) : Mmes Athina ARGYRIOU, présidente déléguée, et Marie DEFRANCE, adjointe à la présidente déléguée.
- M. Bernard JULLIEN, maître de conférences en économie et spécialiste des marchés, des services et de l'industrie automobile à l'Université de Bordeaux.
Mardi 1er avril 2025
- BMW France : MM. Vincent SALIMON, président du directoire, et Ludovic LEGUEM, directeur délégué à la communication et aux affaires publiques.
- Valeo : MM. Christophe PÉRILLAT, directeur général, et Jean-Luc di PAOLA-GALLONI, vice-président Affaires publiques et développement durable.
- Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises (DGE) : Mme Julia ROUSSOULIÈRES, directrice de projet automobile, et M. Romain CHAMBRE, sous-directeur chargé des matériels de transport de la mécanique et de l'énergie.
- Toyota : MM. Florian ARAGON, président-directeur général de Toyota France, Rodolphe DELAUNAY, président-directeur général du site de production de Toyota à Valenciennes-Onnaing, et Mme Sophie GLÉMET, responsable des affaires institutionnelles.
Mardi 8 avril 2025
- Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) : MM. Jean Louis PECH, président, et Charles ARONICA, directeur général.
- Mobilians : M. Xavier HORENT, délégué général, Mmes Dorothée DAYRAUT, directrice des affaires publiques, et Xénia ARRIGNON, chargée d'affaires publiques.
- Verkor : M. Benoît LEMAIGNAN, co-fondateur et président, et Mme Florence MELIN, directrice des affaires publiques.
- OPmobility : M. Laurent FAVRE, directeur général, Mme Clara CUNIOT, vice-présidente, directrice de la communication, et M. Romain CAMPILLO, chef de cabinet.
Mercredi 9 avril 2025
- Fédération nationale de l'automobile (FNA) : MM. Bruno CHOIX, président de la branche Maintenance vente, Aliou SOW, secrétaire général, et Mme Émilie REPUSSEAU, secrétaire générale adjointe.
- Banque publique d'investissement (Bpifrance) : MM. Nicolas DUFOURCQ, directeur général, Alexandre OSSOLA, directeur du fonds Avenir automobile, et Jean-Baptiste MARIN-LAMELLET, directeur des relations institutionnelles.
Mardi 6 mai 2025
- Table ronde « Alternatives à l'électrique »
· Bioéthanol France : Mme Valérie CORRE, présidente, et M. Nicolas KURTSOGLOU, responsable Carburants ;
· France Hydrogène : M. Yves FAURISSON, directeur des activités Hydrogène du groupe Michelin, et membre du conseil d'administration de France Hydrogène, et Mme Anjali ARMOUDOM, chargée de mission Mobilités ;
· IFP Énergies nouvelles (IFPEN) : M. Jean-Philippe HÉRAUD, responsable de programmes ;
· Syndicat des énergies renouvelables (SER) : M. Alexandre ROESCH, délégué général.
- Table ronde « Concurrence internationale »
· Business France : Mme Laurence de TOUCHET, directrice des programmes Export, M. Julien COUCHOURON, chef du service Industrie et cleantech, département Grands comptes et partenaires sectoriels, et Mme Ophélie LEFEBVRE, chef de service Grands projets stratégiques ;
· Commission européenne - Direction générale du commerce (DG Trade) : MM. Denis REDONNET, directeur général adjoint, et Nicolas DROSS, conseiller commerce ;
· M. Thierry MAYER, professeur d'économie à Sciences Po et conseiller scientifique au Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Cepii) ;
· M. Clément MALGOUYRES, chargé de recherche en économie au Centre de recherche en économie et statistique (Crest) au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
· M. Olivier PROST, avocat spécialisé en commerce international et régulation.
Mercredi 7 mai 2025
- Table ronde « Compétences et emploi »
· Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles - Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : Mmes Rachel BECUWE, cheffe de service, adjointe au délégué général, Camille DOJKA, adjointe au chef de mission à la sous-direction des mutations économiques et de la sécurisation de l'emploi, et M. Alexandre BIZEUL, adjoint au chef de mission ;
· Force ouvrière : M. Olivier LEFEBVRE, secrétaire fédéral de la fédération FO Métaux ;
· Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : MM. Bruno AZIÈRE, délégué national en charge de la transition économique, et Bertrand MAHÉ, délégué national en charge de l'emploi ;
· Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : M. Albert FIYOH NGNATO, responsable national des services de l'automobile, et Mme Carole COGNARD, secrétaire générale adjointe Fédération Métallurgie ;
· Confédération française démocratique du travail (CFDT) : MM. Benoît OSTERTAG, secrétaire fédéral de la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM), et Francisco MARTINEZ, chargé de mission Politique industrielle à la Fédération Chimie-énergie ;
· Confédération générale du travail (CGT) : M. Denis BRÉANT, délégué de Valéo Mondeville.
Mardi 13 mai 2025
- Parlement européen : M. François KALFON, député européen.
- Table ronde « Recherche et développement »
· Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : MM. Franck GUILLARD, responsable de la coopération avec les filières aéronautique et automobile, et Thomas BOREL, responsable des affaires publiques ;
· Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) : M. Colas WAKSMAN, directeur de l'ingénierie à l'unité commerciale Freins de Hitachi Astemo France ;
· Université de technologie de Compiègne (UTC) : MM. Jérôme FAVERGEON, professeur des universités, directeur du laboratoire de recherche Roberval (mécanique, énergie et électricité), et Frédéric LAMARQUE, professeur des universités, directeur à la recherche ;
· Laboratoire FuseMetal : Mme Marion RISBET, professeure des universités, directrice du laboratoire FuseMetal ;
· Plateforme automobile (PFA) : M. Stephen MARVIN, président du pôle de compétitivité Vedecom, directeur Recherche et développement (R&D) de la PFA, et Mme Louise d'HARCOURT, responsable des affaires publiques et parlementaires.
- Institut Louis Bachelier : M. Aurélien BIGO, chercheur associé de la chaire Énergie et prospérité.
- Conseil régional des Hauts-de-France : Mme Karima DELLI, présidente du groupe « Pour le climat, pour l'emploi », ancienne députée européenne.
Mercredi 14 mai 2025
- Table ronde « Matières premières et amont »
· Arkema : M. Laurent TELLIER, directeur général adjoint Polymères de haute performance, et Mme Virginie GUÉRIN, directrice des relations institutionnelles ;
· BASF : MM. Jérôme DUPRÉ, responsable Grand compte Renault Group, et Olivier TEILLAC, responsable Affaires publiques et développement durable ;
· France chimie : M. Mathias GIRARD, directeur des affaires publiques ;
· Syensqo : MM. Christophe COUESNON, président France, et Geoffroy SIGRIST, directeur des affaires publiques et institutionnelles France ;
· Plateforme automobile (PFA) : M. Gildas BUREAU, pilote du groupe de travail Filière automobile et mobilité ;
· M. Philippe CHALMIN, professeur, responsable du master « Affaires internationales » à l'Université Paris Dauphine.
- Lisi automotive : M. François LIOTARD, président-directeur général, et Mme Laurence CHÉRILLAT, déléguée générale chez Artema.
Mercredi 21 mai 2025
- Table ronde « Infrastructures de recharge »
· Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere France) : M. Aubin BERNARD, responsable des relations institutionnelles, Mme Brune LETHIER, chargée de mission Relations institutionnelles Mobilités lourdes, et M. Quentin FOURNIER, chargée de mission Relations institutionnelles Véhicules légers ;
· Charge France : MM. Aurélien de MEAUX, président-directeur général d'Electra, Adrien RAMBAUD, collaborateur de M. Aurélien de Meaux, et Jean BARYLA, responsable des affaires publiques et gouvernementales de Fastned France ;
· Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche - Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : M. Claude RENARD, coordonnateur pour l'installation de recharge de véhicules électriques (IRVE).
Mercredi 4 juin 2025
- M. Juan Sebastian CARBONELL, sociologue du travail et des relations professionnelles à l'université de Liège.
Mercredi 18 juin 2025
- École nationale supérieure (ENS) Paris-Saclay : M. Tommaso PARDI, directeur du Groupe d'étude et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile (Gerpisa) et chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Mercredi 9 juillet 2025
- Table ronde « Sécurité »
· Centre national de prévention et de protection (CNPP) : M. Damien ROUBINEAU, expert Nouvelles énergies et mobilités ;
· Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) : M. Franck MAILLARD, animateur de la commission Prévention et anticipation des risques ;
· Groupe Renault : Mme Aurélie DEBART, experte Sécurité Batterie chez la filiale de Renault Ampère, MM. Nicolas GRANIER, lieutenant-colonel Sapeur-pompier, conseiller technique d'urgence sur véhicules au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 78 et au groupe Renault, et Nicolas TCHENG, chargé des relations institutionnelles.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Advanced Systems of Protection (ASP SAS)
- Biomotors
- Lhyfe
- Mobivia
- Schrader Pacific
- Sneci
- Syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des Mobilités (Sesamlld)
- Syntec-Ingénierie
- Union des industries du véhicule de loisirs (UNI VDL)
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Jeudi 10 avril 2025
DÉPLACEMENT À BRUXELLES
- Entretien avec MM. Pierre-Olivier MILLETTE, responsable Technologie, Jocelyn DELATRE, responsable Mobilité intelligente et affaires juridiques, et Massimiliano VASCOTTO, responsable des affaires publiques de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea).
- Échange de vues avec M. François-Xavier BELLAMY, député européen.
- Déjeuner de travail avec :
· MM. Raphaël BORBOTTI-FRISON, conseiller Mertens, Alexis CHALOPIN, conseiller Harmonisation technique (véhicules à moteur, produits de construction), Jacques WANG, conseiller Climat, biodiversité, eau, OGM, contentieux, et Mme Ségolène MILAIRE, conseillère Politique industrielle et harmonisation technique, à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;
· M. Arthur CORBIN, conseiller chargé des entreprises au cabinet de M. Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle.
- Entretien avec :
· M. Stéphane SÉJOURNÉ, vice-président chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, ainsi que M. Arthur CORBIN et Mme Helena ROBYN, membres de son cabinet ;
· M. Joaquim NUNES DE ALMEIDA, directeur Décarbonation, mobilité, matières premières, et Mme Lorena IONITA, cheffe adjointe de l'unité Stratégie industrielle et chaînes de valeur, à la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (DG Grow) de la Commission européenne.
- Entretien avec M. Moumen HAMDOUCH, chef de l'unité Transport intelligent et durable à la direction générale de la mobilité et des transports (DG Move) de la Commission européenne.
- Entretien avec MM. Robin LOOS, chef adjoint de l'énergie, des transports et du développement durable, chargé des transports durables, et Dimitri VERGNE, responsable de l'énergie et du développement durable, au Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc).
Jeudi 12 juin 2025
DÉPLACEMENT DANS LE DOUBS
- Visite de l'usine de Stellantis de Sochaux-Montbéliard avec M. Manuel GENTILE, directeur, et Mme Monique JEANNAUX, directrice des relations publiques, du site de Sochaux-Montbéliard.
- Table ronde sur l'état des lieux de la filière automobile dans le département du Doubs avec :
· Mme Marie-Guite DUFFAY, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
· M. Bruno VINCENT, directeur à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Doubs ;
· MM. Charles DEMOUGE, président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et président de l'agence de développement Nord Franche-Comté, et Didier KLEIN, vice-président à l'économie de PMA ;
· M. Thierry TOURNIER, président du pôle de compétitivité Véhicule du Futur ;
· Mme Domitille LEGRAND, responsable du service économique régional à la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (Dreets) de Bourgogne-Franche-Comté.
- Table ronde avec les sous-traitants départementaux du secteur automobile avec :
· M. Philippe PEROZ, directeur, Mme Soline PEROZ, chef de projet, de FMX Découpe ;
· MM. Bertrand SOLLIET, président, et Olivier DEL RIZZO, directeur du site de Vieux-Charmont, d'IPM France ;
· M. Yves-Laurent BOUKHENNOUS, directeur du site de Montbéliard du groupe Bertrandt ;
· M. Grégoire GILLE, président de l'entreprise Jean-Paul Martini ;
· M. Jérôme RUBINSTEIN, président du groupe F2J ;
· MM. Nahim GUEMAZI, délégué à l'accompagnement des reconversions professionnelles, et Pascal MARTIN, directeur départemental adjoint, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Doubs.
- Visite de l'entreprise Flex-N-Gate à Audincourt avec :
· MM. Michael VERMOT, directeur exécutif de l'ingénierie Europe, Samuel JACQUET, directeur exécutif des ventes, Mme Carole LAMELOISE, responsable de la communication européenne, MM. José ANDRÉ, responsable de la fabrication, responsable de l'ingénierie de Flex-N-Gate, ainsi que M. Marc PETIT, directeur, et Mme Émilie HAVRET, responsable des ressources humaines de l'usine d'Audincourt.
· M. Martial BOURQUIN, maire d'Audincourt, ancien sénateur.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
des principales recommandations de la mission
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 1 : SORTIR DU « TOUT ÉLECTRIQUE » |
||||
|
1 |
Repousser l'interdiction de la vente de moteurs thermiques et confier à la Commission européenne le soin de fixer, en accord avec les industriels, une trajectoire dégressive soutenable pour atteindre cet objectif |
Union européenne |
Au plus tard |
Règlement européen |
|
2 |
Mettre en oeuvre le principe de neutralité technologique ; reconnaître le caractère de carburants « neutres en carbone » des biocarburants |
Union européenne |
Au plus tard |
Règlement européen |
|
AXE 2 : PROTÉGER LE MARCHÉ LE
TEMPS DE RESTAURER |
||||
|
4 |
Instaurer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, au moins équivalents à ceux appliqués par la Chine |
Commission européenne |
Dès que possible |
Règlement d'exécution |
|
5 et 6 |
Imposer un contenu local européen pour les véhicules vendus en Europe, de l'ordre de 80 % pour les composants hors batterie, et fixer un objectif d'au moins 40 % des batteries utilisées dans les véhicules vendus en Europe produites localement à partir de 2035 Créer un éco score européen harmonisé, sur la base d'une analyse en cycle de vie |
Union européenne |
Dès que possible |
Règlement européen |
|
AXE 3 : DYNAMISER LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRIQUE |
||||
|
7 |
Harmoniser les politiques de soutien à l'achat ou à la location de véhicules électriques au niveau européen |
Union européenne |
Dès que possible |
Règlement européen |
|
10 |
Mettre en place un label européen de garantie pour les véhicules électriques d'occasion, incluant un diagnostic batterie certifié |
Union européenne |
Dès que possible |
Règlement européen |
|
Mettre en place un plan de communication sur les performances des batteries |
DGEC / DGE |
Dès que possible |
Campagne de communication dans les médias |
|
|
15 |
Encourager la production de petits véhicules électriques accessibles sur le modèle des kei cars japonaises en créant une catégorie réglementaire ad hoc |
Union européenne |
Dès que possible |
Règlement européen |
|
AXE 4 : RESTAURER LA
COMPÉTITIVITÉ ET LA SOUVERAINETÉ |
||||
|
11 |
Soutenir le développement et le passage à l'échelle des gigafactories européennes en adaptant le cadre européen des aides d'État |
Union européenne |
Dès que possible / 2028 |
Règlement européen / cadre financier pluriannuel |
|
14 |
Harmoniser les règles relatives aux aides publiques, notamment à l'investissement, au sein de l'Union européenne |
Union européenne |
Dès que possible |
Règlement européen |
|
Mettre en oeuvre des mesures permettant de réduire le coût du travail et de l'énergie en France |
Gouvernement et Parlement |
Avant la fin 2025 |
PLF |
|
|
AXE 5 : REPRENDRE LE LEADERSHIP EN MATIÈRE TECHNOLOGIQUE |
||||
|
16 |
Contraindre les acteurs extra-européens qui souhaitent s'implanter en Europe à des transferts de technologie |
Union européenne |
Dès que possible |
Règlement européen |
|
18 |
Soutenir l'émergence d'un écosystème français et européen du véhicule numérique |
Union européenne / DGE |
Dès que possible |
Piiec / appels à manifestation d'intérêt (AMI) |
|
Créer un Airbus du logiciel embarqué |
Acteurs industriels |
Dès que possible |
Consortium |
|
* 1 Chiffres fournis par la Plateforme automobile (PFA).
* 2 Chiffres X. Mosquet.
* 3 PFA, données mensuelles du marché.
* 4 Cf. ci-dessous, p. II.B.1, p. 54.
* 5 Statistique publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement.
Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 6 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 7 Sturgeon et al. 2008, « Value chains, networks, and clusters : refraiming the global automotive industry », Journal of Economic Geography, mai 2008, vol. 8, n° 3, p. 297-321.
* 8 Chiffres fournis par X. Mosquet.
* 9 Tommaso Pardi, « Is Electrification an Opportunity or a Threat ? The French Automotive Industry at the Crossroads », in Global Shifts in the Automotive Sector Markets. Firms and Technologies in the Age of Geopolitical Disruption, éd. Martin Krzywdzinski, Grzegorz Lechowski, Tommaso Pardi et John Humphrey, 2025, p. 162 (ci-après respectivement Pardi 2025 et Krzywdzinski et al. 2025).
* 10 Krzywdzinski et al. 2025, p. 359 et 360.
* 11 Sur la politique chinoise de politique industrielle dans l'automobile, voir notamment Boy Lüthje & Wei Zhao, « Between Covid and Geopolitics : Emerging Production Networks in the New Energy Vehicle Industry in China », in Grzegorz et al. 2025, op. cit., p. 203-228.
* 12 Compte tenu du mix énergétique chinois, l'impact de l'électrification en matière de CO2 est d'ailleurs négligeable : un véhicule électrique produit en Chine et utilisé en Chine émet à peu près autant de CO2 qu'un véhicule à essence.
* 13 Estimations citées par Verkor et autres.
* 14 Marc Alochet , Bernard Jullien, Samuel Klebaner et Tommaso Pardi, « Légère et abordable : les clés d'une voiture électrique à succès », La Fabrique de l'industrie, 2004 (ci-après Alochet et al. 2024), p. 71, parle d'« au moins 110-160 Md€ pour la partie visible de l'iceberg à fin 2022.
* 15 Le Figaro, 20 septembre 2025.
* 16 Nicolas Tcheng, responsable des affaires publiques chez Renault.
* 17 https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/07/30/en-allemagne-les-rois-du-luxe-automobile-porsche-et-mercedes-benz-s-enfoncent-dans-la-crise_6625562_3234.html
* 18 Pour rappel, les États-Unis ont quadruplé en mai 2024 les droits de douane sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine, pour les porter à 100 %.
Par comparaison, selon les informations fournies par la DG Trade de la Commission européenne, la Chine applique un taux de 15 % aux importations de véhicules européens.
* 19 https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/07/28/droits-de-douane-des-premiers-impacts-douloureux-pour-les-entreprises-de-l-automobile-du-textile-et-de-la-chimie_6624 767_3234.html
* 20 Pardi 2025, p. 163.
* 21 Pardi 2025, p. 143-171.
* 22 « Portrait de la filière automobile à l'heure de sa transition vers l'électrique », Les Thémas de la DGE, oct. 2024.
* 23 Chiffre fourni par J. S. Carbonell.
* 24 Alochet et al. 2024, p. 38.
* 25 Pardi 2025, p. 143-171.
* 26 Données fournies par la direction générale des entreprises (DGE) au ministère de l'économie
* 27 Mais aussi, hors du champ du présent rapport, 12 sites de production et d'assemblage de véhicules lourds (notamment Renault Trucks, Scania et Iveco), mais également des sites de production de véhicules dits « intermédiaires » (notamment Ligier, Goupil).
* 28 Annonce faite par le Président Macron au Mondial de l'Auto 2022.
* 29 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 30 Chiffres fournis par X. Mosquet.
* 31 Chiffres fournis par X. Mosquet.
* 32 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 33 https://investir.lesechos.fr/actu-des-valeurs/la-vie-des-actions/allemagne-volkswagen-et-les-syndicats-concluent-un-accord-au-bout-de-longues-negociations-2139056
* 35 Données fournies par la DGEFP.
* 36 Selon l'Acea, en Europe, l'industrie automobile emploie directement 2,6 M de personnes, et indirectement près de 13,8 M, soit environ 6,1 % des salariés européens et 11,4 % des emplois industriels (chiffres 2018).
* 37 Données fournies par la DGE (chiffres 2019).
* 38 Étude Xerfi réalisée à la demande de la filière automobile.
* 39 Chiffres cohérents avec ceux fournis par la DGE (55 000 personnes environ dans des activités appelées à disparaître avec la transition électrique) ; en 2021, le cabinet AlixPartners, mandaté par la PFA, avait chiffré une perte prévisionnelle de 15 à 30 % des effectifs de production en raison de la transition électrique, à horizon 2030.
* 40 Société anciennement filiale d'une autre, devenue indépendante.
* 41 Cf. ci-dessous, III.B.1.b), p. 87.
* 42 Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne.
* 43 Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.
* 44 Dans le détail : Tesla 7,8 %, BYD 17 %, groupe Geely (Mercedes, Volvo, Smart, Zeekr, Geely) 18,8 %, autres producteurs coopérants 20,7 %, SAIC et autres producteurs non coopérants 35,3 %.
* 45 Informations fournies par la DG Trade.
* 46 Cf. ci-dessous, III.B.1.a), p. 84.
* 47 Indication fournie par O. Prost.
* 48 Cf. ci-dessous, II.A.2, p. 45.
* 49 Baisses de la demande adressée aux équipementiers et sous-traitants, au profit d'autres équipementiers et sous-traitants implantés dans d'autres régions.
* 50 Cf. notamment Tommaso Pardi, Marc Alochet, Bernard Jullien et Alexandra Kuyo, Made in Europe. Local content policy for the European automotive industry, Actes du Gerpisa, n° 44, avril 2025 (ci-après Pardi et al. 2025).
* 51 Pratique consistant à rapprocher les infrastructures de production des lieux de consommation des produits.
* 52 Données fournies par A. Bigo, réponses à un questionnaire écrit.
* 53 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 54 Règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l'ambition accrue de l'Union en matière de climat.
* 55 Données transmises par T&E.
* 56 https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2025/asthme-accident-vasculaire-cerebral-diabete-quels-impacts-de-la-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-sante-et-quel-impact-economique
* 57 L'administration Biden avait par ailleurs fixé un objectif de moitié des ventes de véhicules électriques en 2030, mais qui n'avait pas valeur réglementaire.
* 58 https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/04/05/l-union-europeenne-doit-se-donner-rapidement-les-moyens-de-combler-l-ecart-de-competitivite-avec-la-chine-en-matiere-de-vehicule-electrique_6591 404_3234.html
* 59 The Economist, 16 juillet 2025.
* 61 Règlement d'exécution (UE) 2024/1866 de la Commission du 3 juillet 2024 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de nouveaux véhicules électriques à batterie conçus pour le transport de personnes originaires de la République populaire de Chine, Journal officiel de l'Union européenne L4.7.2024.
* 62 Même si certains constructeurs, comme Volkswagen, continuent à critiquer « la tentation de remettre en cause nos engagements au premier signe de difficulté », se bornant à réclamer que les cibles intermédiaires de réduction des émissions de CO2 soient « ajustées de manière réaliste en fonction des dynamiques propres à chaque région ».
* 63 Proposition de X. Mosquet.
* 64 Devenu loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 parue au JO n°103 du 2 mai 2025.
* 65 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 66 Chiffres fournis par A. Bigo.
* 67 Chiffre cité par T. Pardi.
* 68 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 69 Cf. ci-dessous, II.C.2, p. 76.
* 70 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 71 Krzywdzinski et al. 202, p. 352.
* 72 Il pourrait cependant être utilisé pour des usages de niche, notamment des usages intensifs (taxi Hysetco à Paris, selon Toyota) ; certains pensent aussi qu'il faudra dans certains pays aussi de l'hydrogène pour de grosses voitures individuelles, par exemple au Japon où pas assez d'électricité est produite ou dans les pays du Golfe où il n'est pas coûteux de produire de l'hydrogène grâce au solaire.
* 73 Considérant (11).
* 74 Selon les informations fournies par la DGE en revanche, le coût important de la production d'e-fuels (en raison des importantes quantités d'énergie requises) devrait amener à reprioriser leur usage vers d'autres secteurs ne disposant pas d'autres solutions pour se décarboner, comme l'aéronautique ou le maritime.
* 75 Statistique publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, Chiffres clés des transports, mars 2025.
* 76 Jean-Philippe Hermine (IMT) & Clément Dupont-Roc (C-Ways), Le vrai du faux sur les causes de l'augmentation des prix des véhicules entre 2020 et 2024, mai 2025 (ci-après Hermine et Dupont-Roc 2025).
* 77 Audition devant la commission des affaires économiques, 2 octobre 2024.
* 78 Hermine & Dupont-Roc 2025, p. 1 et 8.
* 79 Alochet et al. 2024, p. 43 : les auteurs estiment que la mise en place d'une sous-catégorie pour les voitures électriques légères et abordables pourrait contribuer à réduire les émissions de CO2 du parc automobile de 24 % en 2035 et 38 % en 2050 (p. 105).
* 80 https://www.quechoisir.org/enquete-automobile-l-electrique-vaut-elle-le-cout-n164 944/
* 81 Données fournies par B. Jullien, à partir des données de l'enquête du budget des ménages de Yoann Demoli, la comptabilité nationale et le SOES.
* 82 https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-cout-de-detention-des-vehicules-la-voiture-electrique-a-contre-courant-des-idees-recues-n92 038/
* 83 Avere, Étude de marché du véhicule électrique d'occasion. Un enjeu clé pour la démocratisation de la mobilité électrique, juillet 2025 (ci-après Avere 2025), p. 35.
* 84 Avere 2025, p. 50.
* 85 https://www.transportenvironment.org/te-france/articles/lallemagne-freine-les-ventes-de-vehicules-electriques-en-europe-au-premier-semestre-2024
* 86 Recommandations convergentes avec celles de l'ITM : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/premiere-edition-du-leasing-social-lecons-dun-succes-mal
* 87 Avere 2025.
* 88 Avere 2025, p. 19 sqq.
* 89 Avere 2025, p. 56.
* 90 Avere 2025, p. 27.
* 91 Avere 2025, p. 29.
* 92 Littéralement : « état de santé ».
* 93 Avere 2025, p. 29.
* 94 Avere 2025, p. 30.
* 95 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
* 96 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
* 97 Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).
* 98 Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
* 99 Les différents types de motorisation électriques sont détaillés en Annexe 2, p. 124.
* 100 Chiffres fournis par A. Bigo.
* 101 Chiffres fournis par A. Bigo.
* 102 Krzywdzinski et al. 2025.
* 103 Krzywdzinski et al. 2025, p. 355.
* 104 Comité stratégique de la filière automobile. (2021). Avenant au contrat stratégique de la filière automobile 2018-2022.
* 105 Pardi 2025, p. 158.
* 106 La Turquie bénéficie depuis 1995 d'un accord douanier avec l'Union européenne qui lui permet de ne pas acquitter des droits de douane auxquels sont soumis les pays tiers pour les importations de véhicules.
* 107 Ce qui n'exclut pas des ajustements dans ses modalités de calcul et son ciblage (cf. notamment le rapport pour avis n° 145 (2024-2025), tome V, de M. Patrick Chaize, sur le volet « Recherche et enseignement supérieur » du projet de loi de finances pour 2025, déposé le 21 novembre 2024.
* 108 Chercheurs et ingénieurs.
* 109 Voir par exemple Grzegorz Lechowski & Nathan Weis, « The German Industrial Model in Transition : Electromobility Challenges in the Automotive Sector », et John Humphrey, “Incumbents Responses to the Challenges of Producing Connected, Autonomous, Shared and Electric Vehicles”, in Krzywdzinski et al. 2025, p. 115-141 et 41-65.
* 110 Littéralement : « véhicule défini par le logiciel ».
* 111 The International Energy Agency : Global EV outlook 2023 (cité par Verkor).
* 112 Cf. ci-dessus, III.B.1.a) ,p. 84.
* 113 https://www.acc-emotion.com/fr/stories/acc-winner-innovation-fund-24
* 114 Chiffres F. Kalfon.
* 115 Chiffres X. Mosquet.
* 116 Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020.
* 117 https://www.economie.gouv.fr/gouvernement-devoile-strategie-securiser-approvisionnement-metaux-critiques
* 118 Cour des comptes, La sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques, juillet 2025, p. 37.
* 119 Ibid., p. 42-43.
* 120 Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.
* 121 Au contraire, les batteries LFP ne peuvent retraiter que 75 % à 80 % de leurs composants, et en outre le fer et le phosphate présentent une valeur marchande inférieure au coût du recyclage, ce qui empêche la création d'un modèle économique de recyclage soutenable.
* 122 PFA-Alix Partners, « Fit for 55 : Quelles conséquences pour la filière automobile française », 2021.
Les estimations concurrentes sont toutes de l'ordre de grandeur de plusieurs dizaines de milliers de suppressions d'emploi, et estiment qu'il y aura moins de création d'emplois que de destruction.
* 123 Voir notamment Afpa, « Comment adapter les cursus de formation pour répondre aux besoins émergents de l'industrie automobile (électronique embarquée, IA, etc.) », juin 2025.
Voir aussi Palliet, E., Lefeuvre, A.-G, Sonzogni, M., De-Laat-Barrios, M., Appere, B., & Giacolone, F. (2021). « Électrification de l'automobile et emploi en France ». Syndex, Fondation Hulot pour la Nature et l'Homme.
Les acteurs de l'aval de la filière, notamment les réparateurs, devront également être accompagnés pour affronter les évolutions des technologies et la sophistication croissante des composants. L'électrification du parc entraîne l'avènement de nouveaux profils de compétences et de nouveaux risques liés aux nouvelles technologies telles que la gestion, l'entretien, la réparation et le traitement des batteries.
* 124 Cf. ci-dessus, II.A.2.a)(2), p. 46.
* 125 Estimation mentionnée lors de son audition par Nicolas Tcheng, responsable des relations institutionnelles de Renault.
* 126 Hermine & Dupont-Roc 2025.
* 127 Littéralement : « pouvoir de fixation des prix ».
* 128 Hermine & Dupont-Roc 2025, p. 2.
* 129 Hermine & Dupont-Roc 2025, p. 3.
* 130 Hermine & Dupont-Roc 2025, p. 10.
* 131 Hermine & Dupont-Roc 2025, p. 9.
* 132 Cf. Vincent Frigant & Bernard Jullien, « L'automobile en France : Vers la fin d'une vieille industrie ? », Revue d'économie industrielle, p. 127-162, 2018, p. 162, et Pardi 2025.
* 133 Jato, EV Price Gap : A Divide in the Global Automotive Industry, 2024, cité par Alochet et al. 2024.
* 134 Alochet et al. 2024, p. 46.
* 135 Alochet et al. 2024.
* 136 Pardi 2025.
* 137 Règlement (UE) 2018/858 amendé par le règlement (EU) 2019/2144.
* 138 Les normes européennes récemment entrées en vigueur concernent la dépollution (Euro 6.d Full), en 2021), la sécurité (GSR 2), en 2024, ainsi que le durcissement progressif de la norme Cafe relative aux émissions de CO2.
* 139 Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route).
* 140 Alochet et al. 2024
* 141 Pardi 2025.
* 142 Alochet et al. 2024, p. 32.
* 143 Alochet et al. 2024, p. 35.
* 144 Alochet et al. 2024, p. 4.
* 145 Tommaso Pardi, Marc Alochet, Bernard Jullien et Samuel Klebaner, « European regulations for an affordable sustainable (battery) electric vehicle”, Actes du Gerpisa, n° 43, octobre 2024.
* 146 Alochet et al. 2024, p. 65.
* 147 Alochet et al. 2024, p. 51 sqq.
* 148 Alochet 2024, p. 69.
* 149 Cette solution avait d'ailleurs été préconisée dès 2023 par Luca de Meo, alors directeur général de Renault et président de l'Acea (Acea, 2023, Manifesto for a competitive European auto industry, driving the mobility revolution ; idée reprise notamment dans sa « Lettre à l'Europe » en mars 2024).
* 150 https://france.representation.ec.europa.eu/informations/discours-sur-letat-de-lunion-2025-de-la-presidente-von-der-leyen-2025-09-10_fr
* 151 Alochet mai 2024, p. 80 sqq.
* 152 Règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
* 153 Qui devraient passer sous la barre des 10 000 € par unité, ce qui est jugé soutenable par l'économiste Marc Alochet, si dans le même temps les volumes de vente augmentent (Alochet et al. 2024).
* 154 Alochet et al. 2024, p. 82 sqq ; la Fabrique des mobilités recommande même de rendre éligible au leasing social les Veli (https://lafabriquedesmobilites.fr/blog/veli_leasing_social).
* 155 Alochet mai 2024, p. 72 sqq.
* 156 https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en