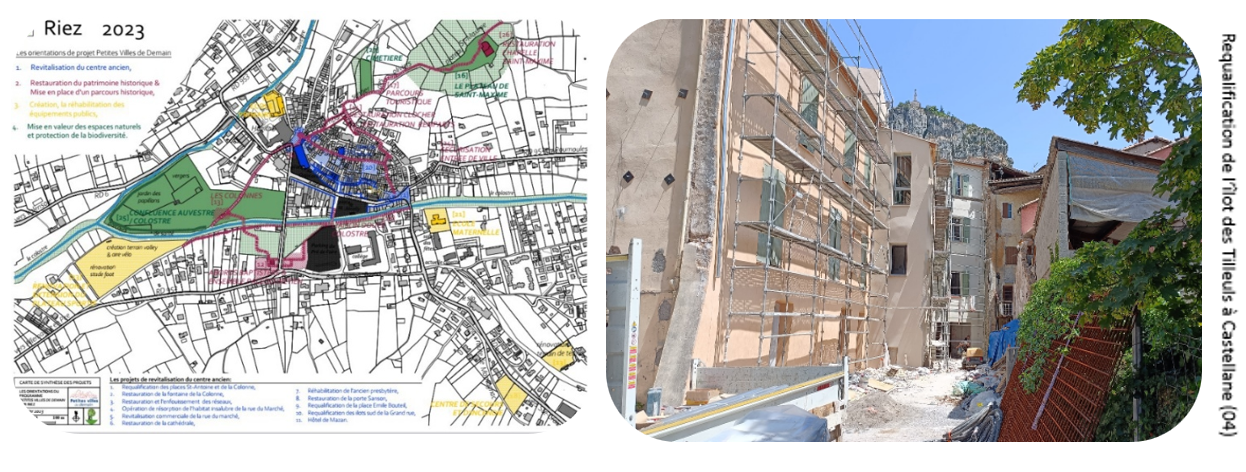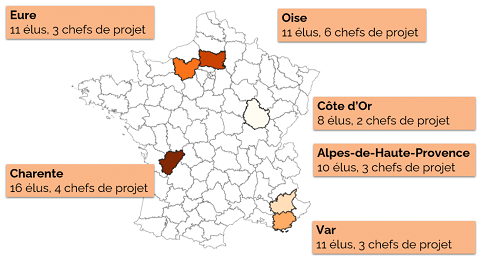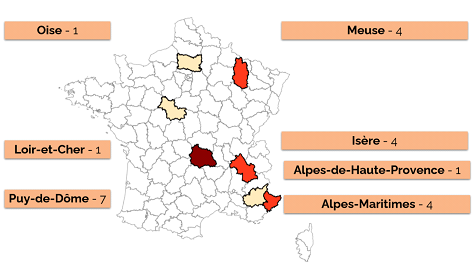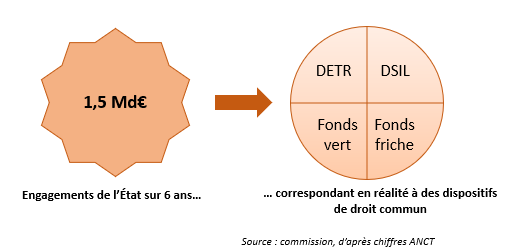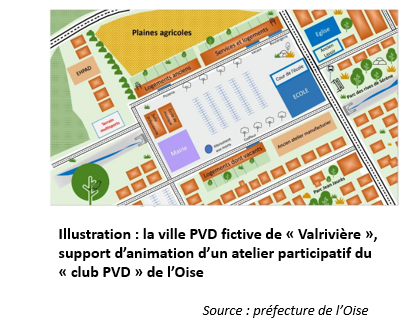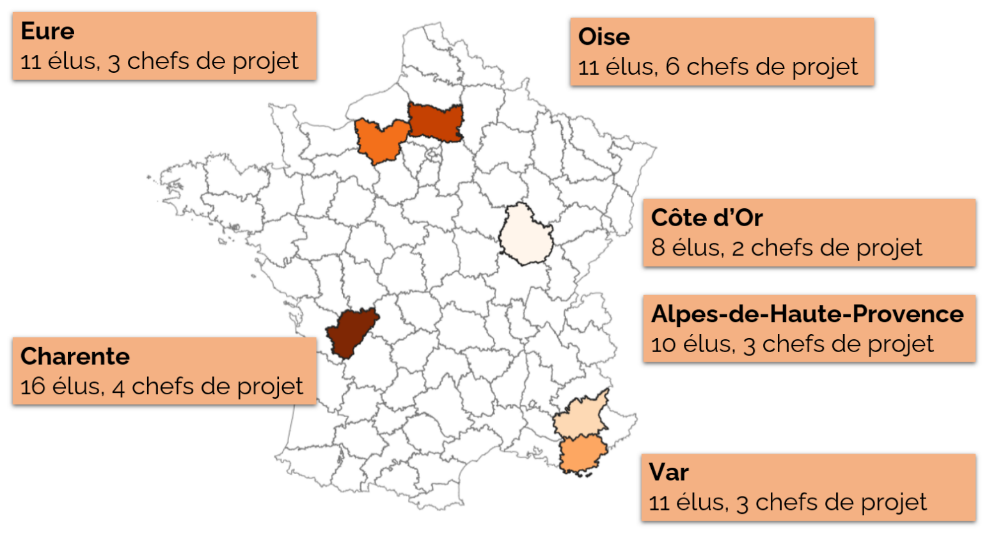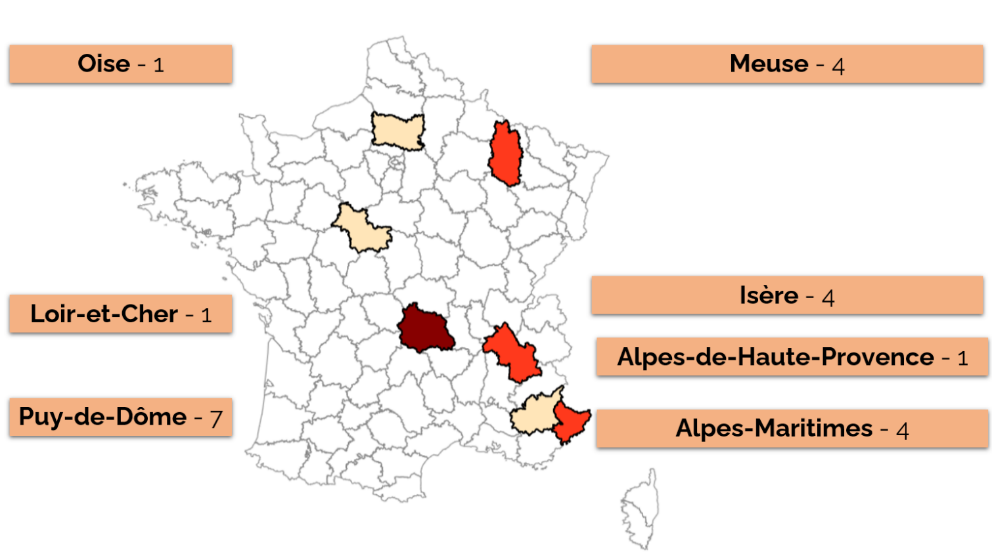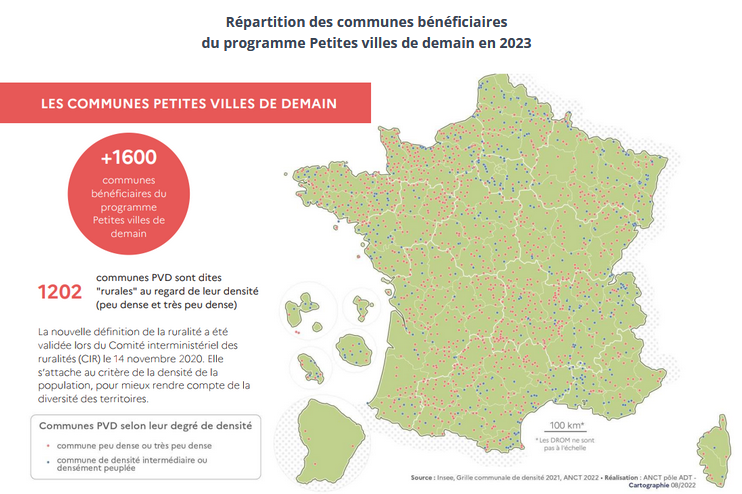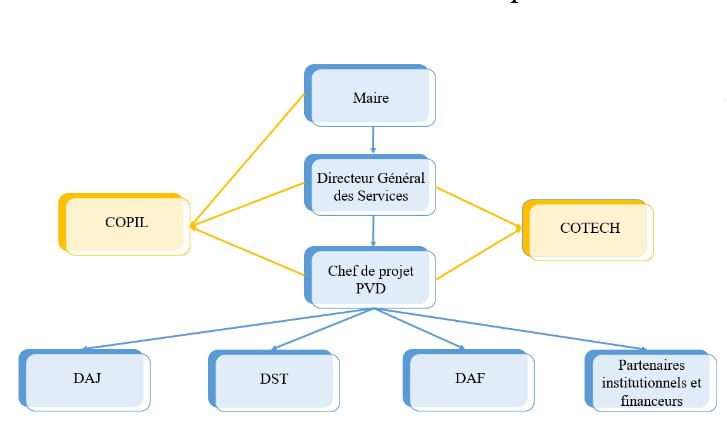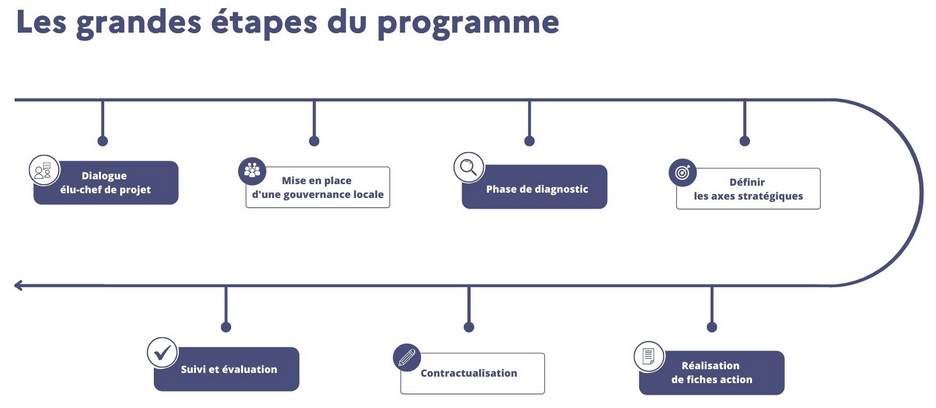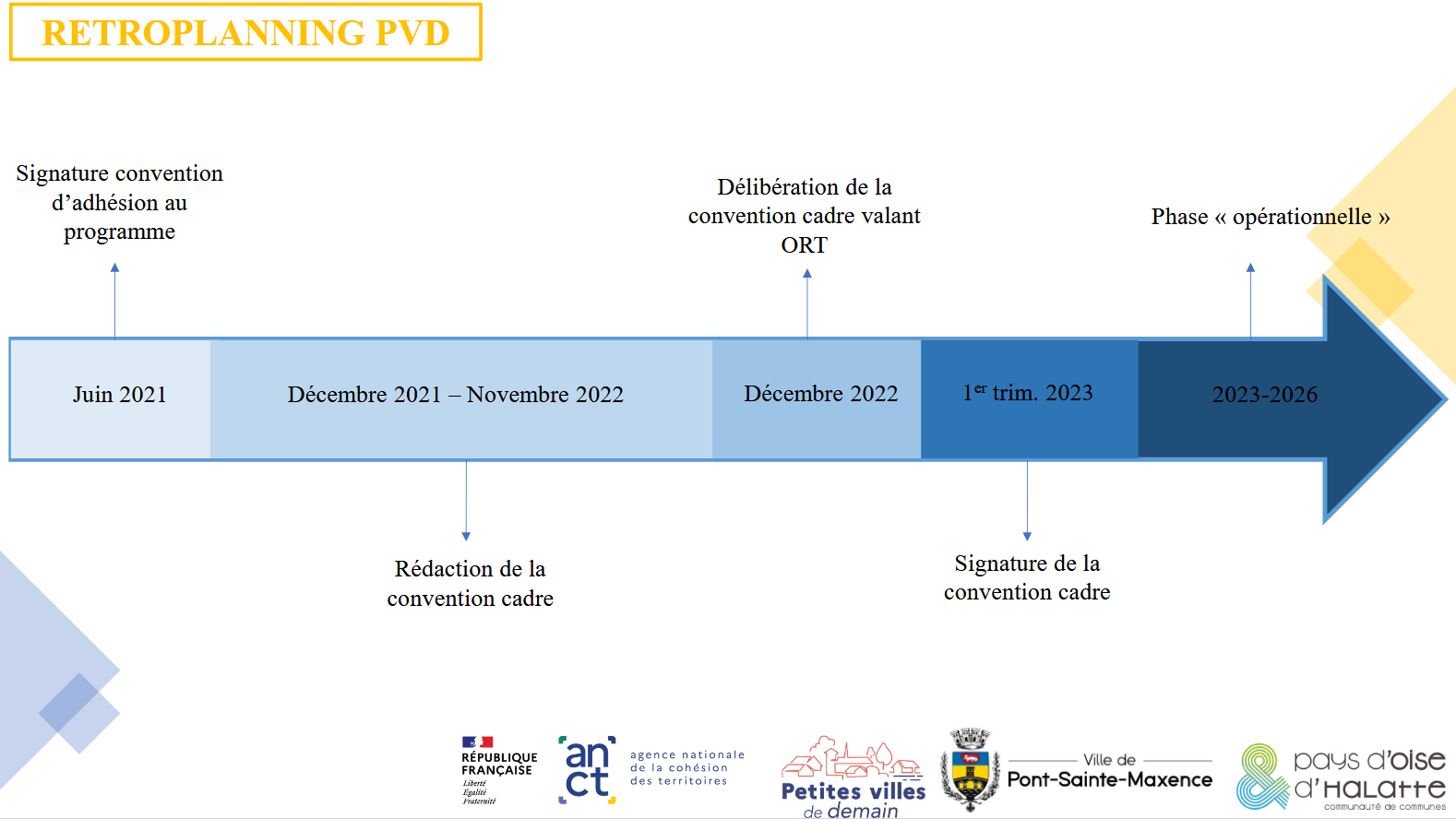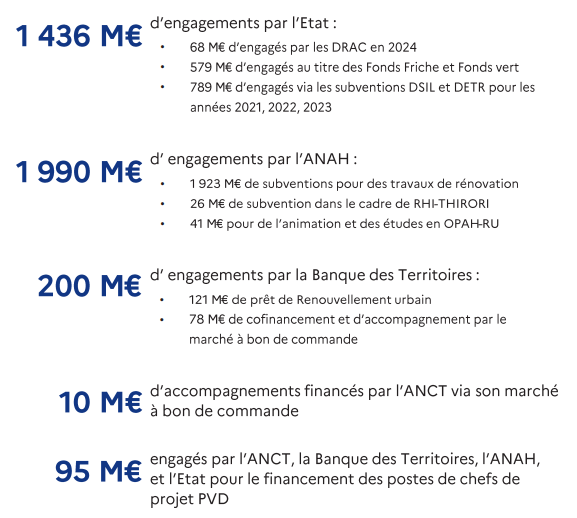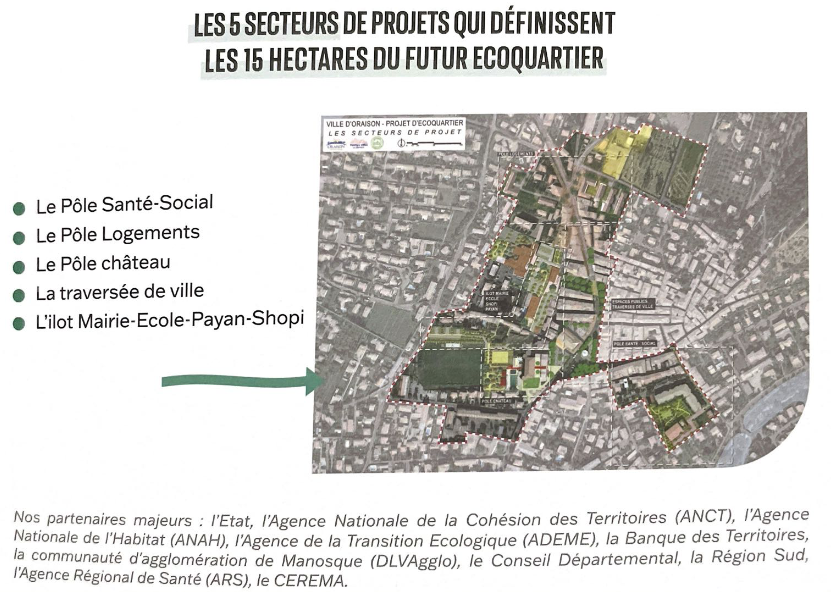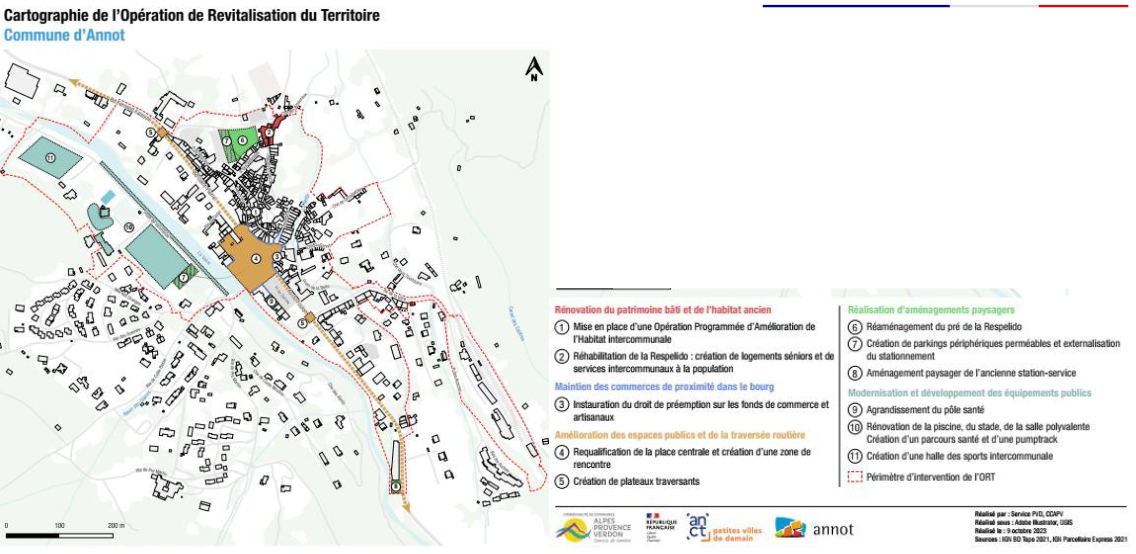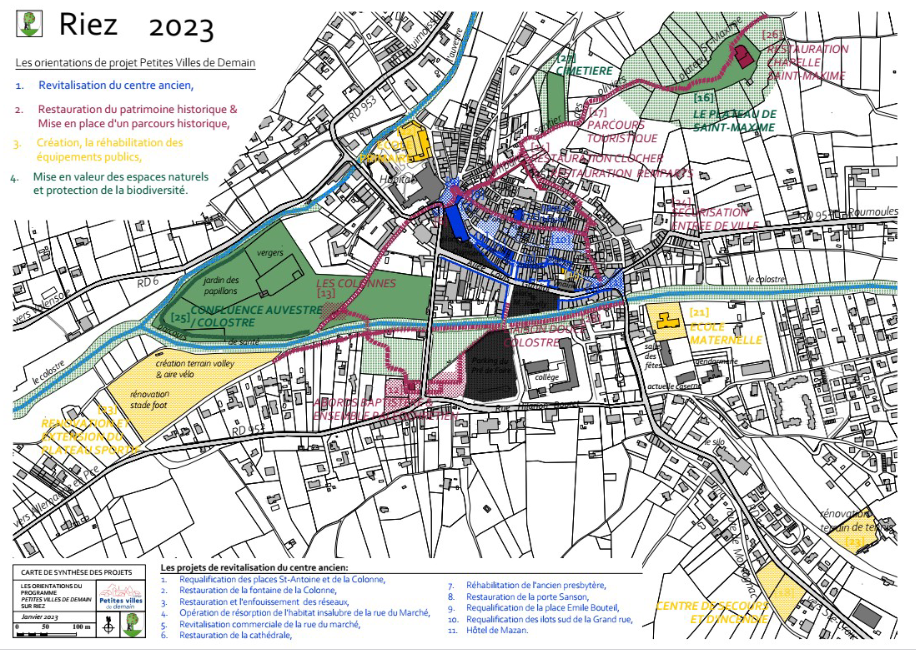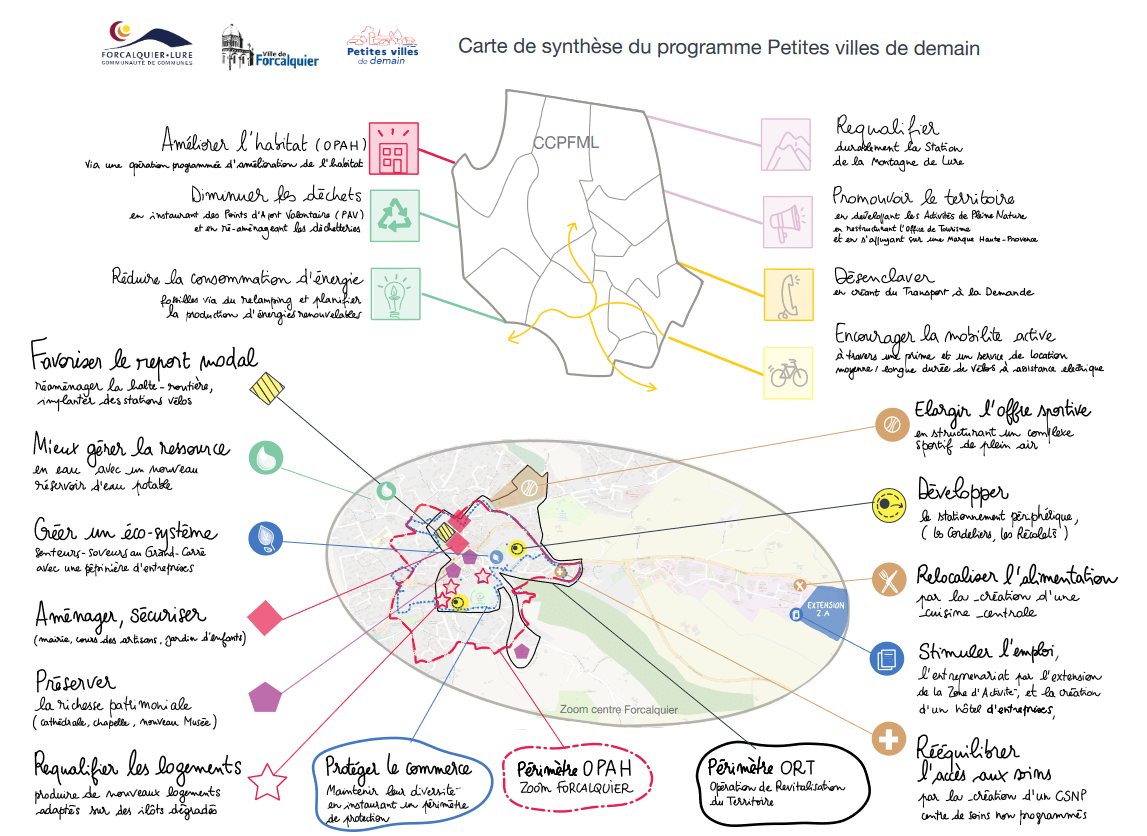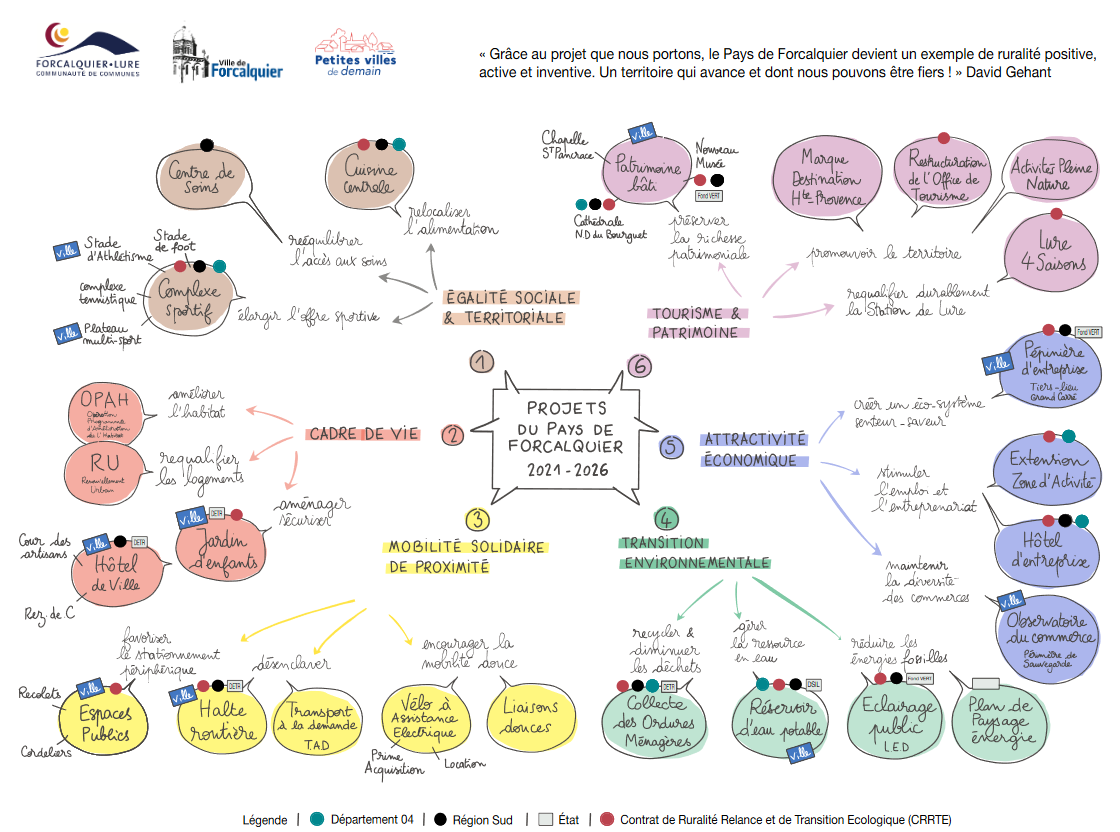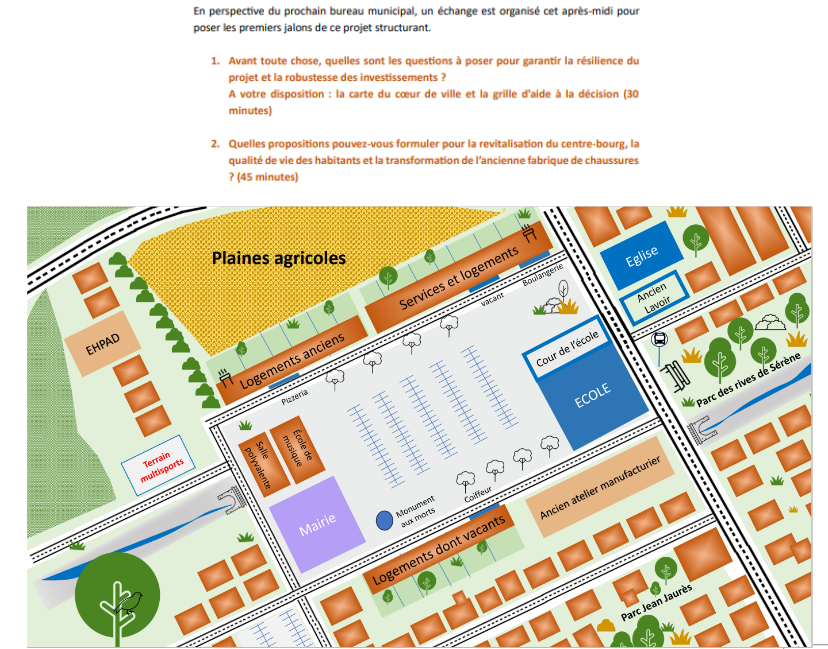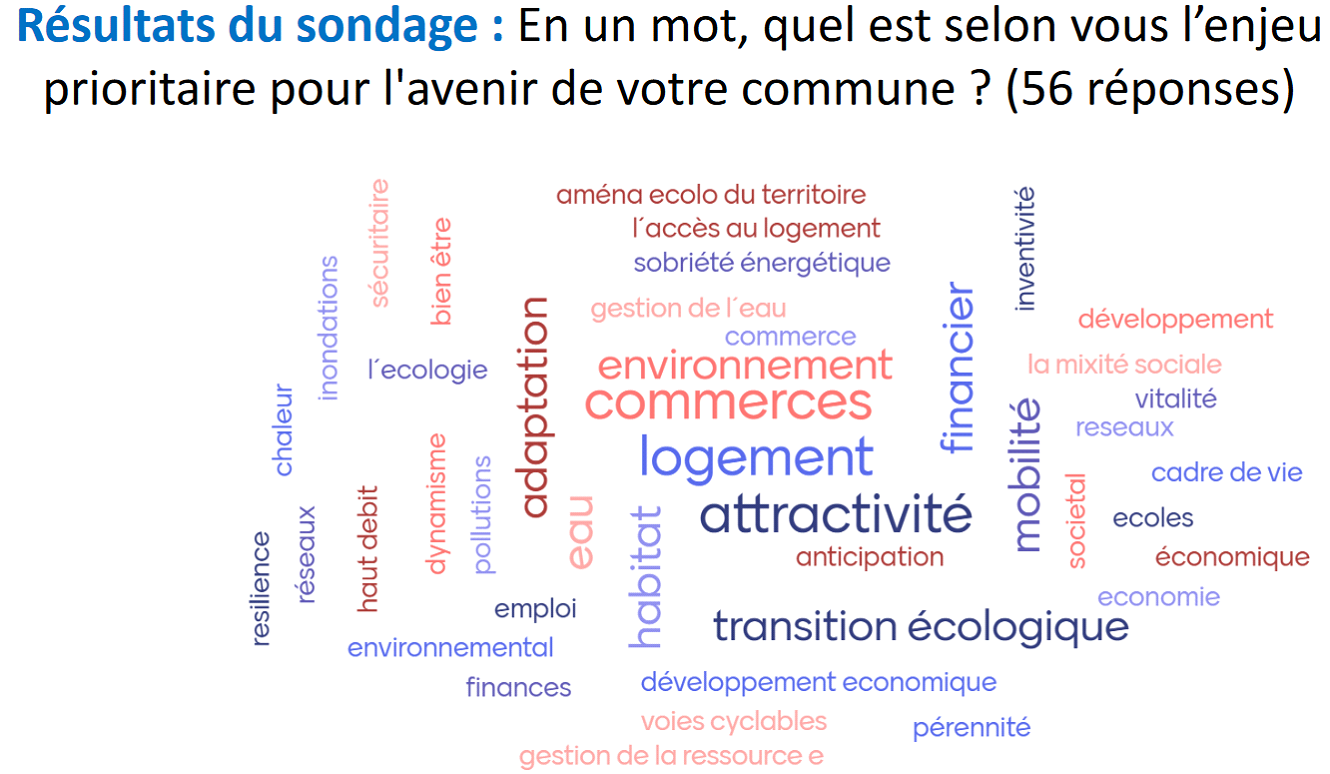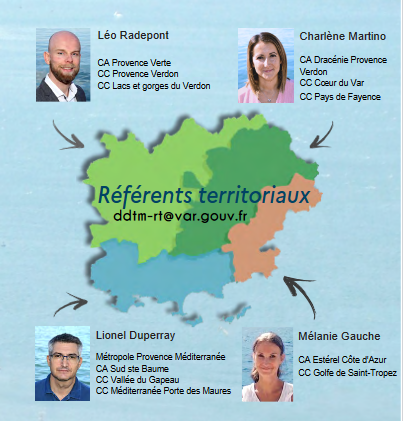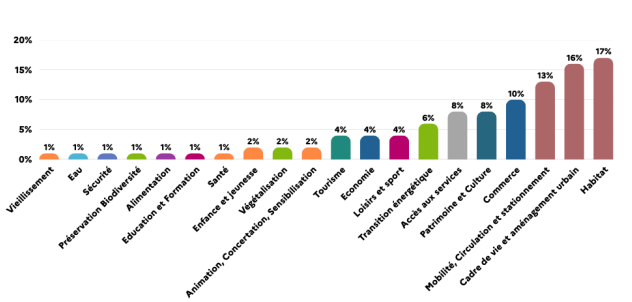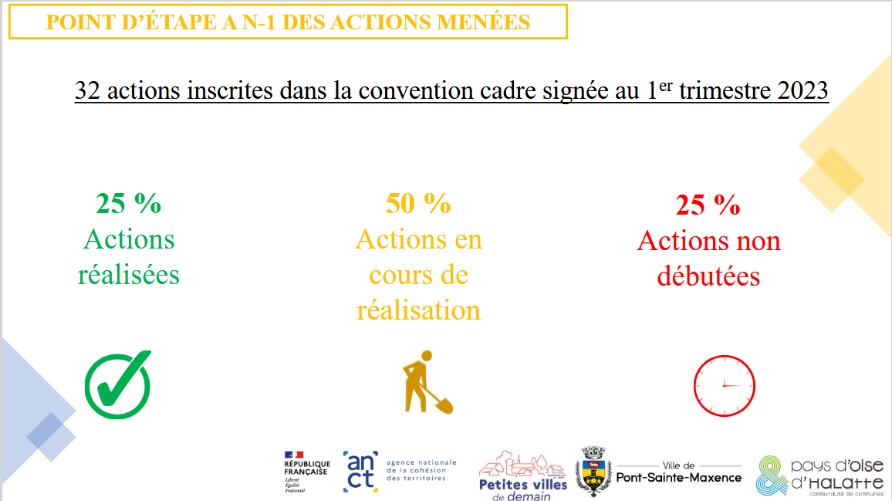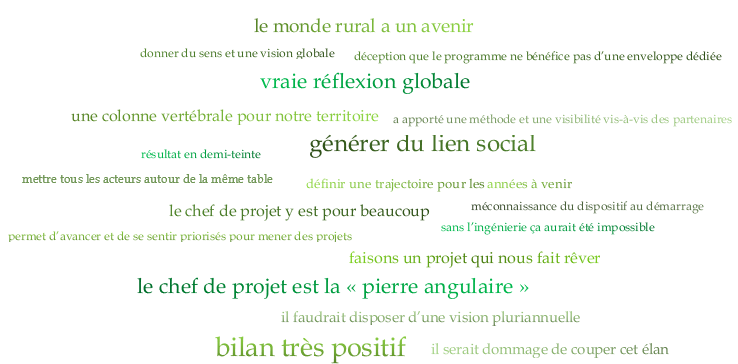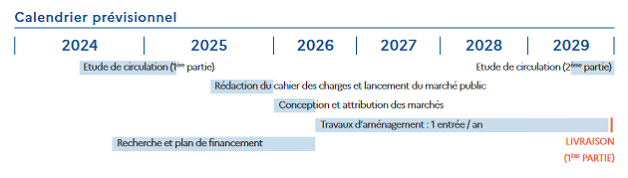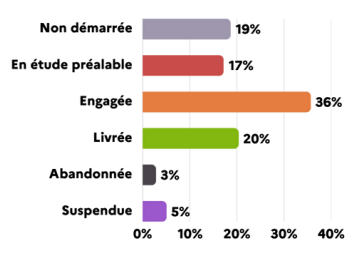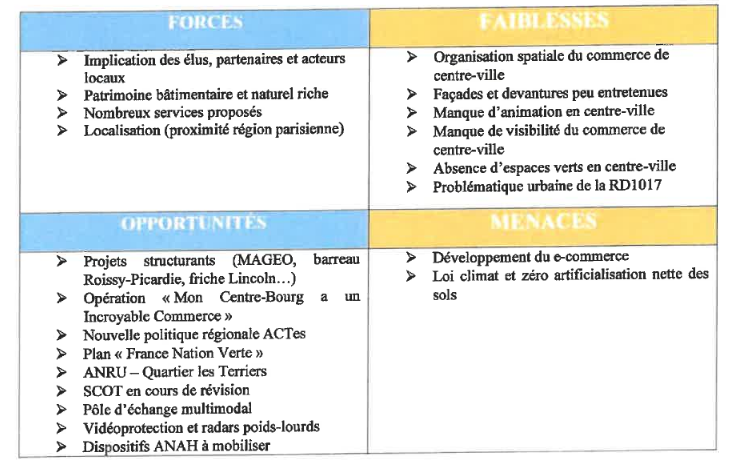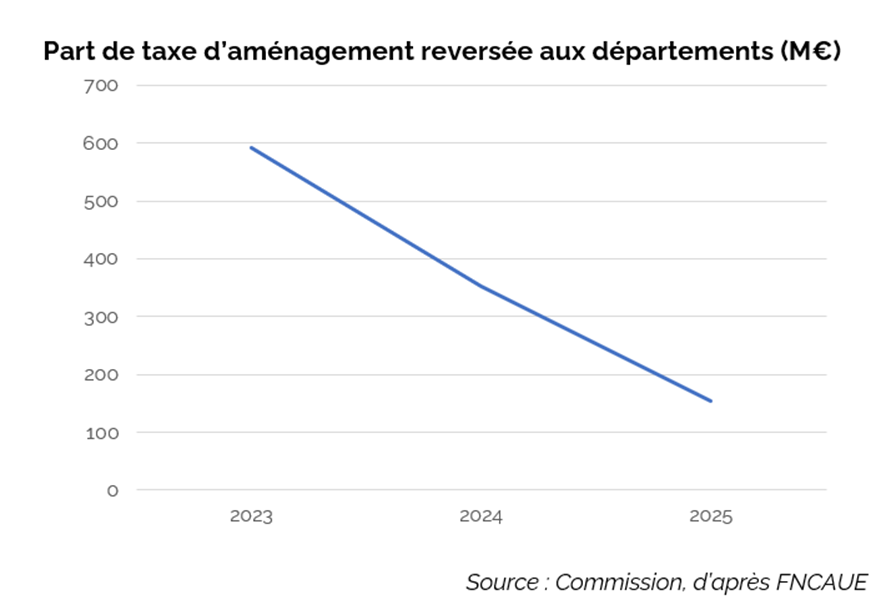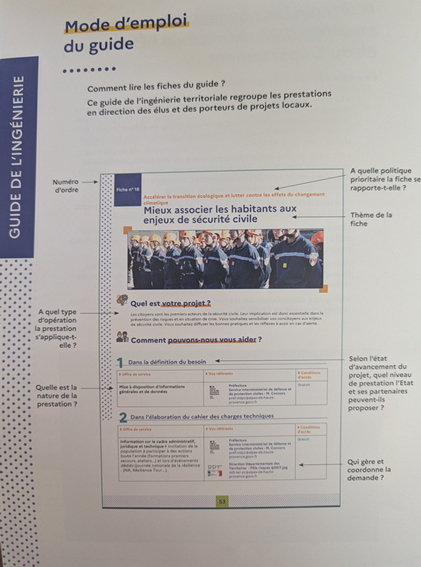- L'ESSENTIEL
- I. L'OBJECTIF : LE NÉCESSAIRE
CONTRÔLE DE PROXIMITÉ D'UN PROGRAMME NATIONAL EMBLÉMATIQUE
DE L'« AGENDA RURAL »
- II. UN DISPOSITIF AMBIGU QUI REPOSE SUR LA
CRÉATIVITÉ
DE L'ÉTAT TERRITORIAL
- III. SUR LE TERRAIN, UNE EXPÉRIENCE
LARGEMENT POSITIVE VÉCUE COMME UNE « MARQUE DE
CONSIDÉRATION »
- IV. LA POSTÉRITÉ DU PROGRAMME
APRÈS 2026 : CAPITALISER
SUR LA DÉMARCHE PVD POUR STRUCTURER LES TERRITOIRES
DE DEMAIN
- I. L'OBJECTIF : LE NÉCESSAIRE
CONTRÔLE DE PROXIMITÉ D'UN PROGRAMME NATIONAL EMBLÉMATIQUE
DE L'« AGENDA RURAL »
- OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
- I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES
VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER
LES PETITES CENTRALITÉS
- A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA
GENÈSE
- B. COMMENT CE PROGRAMME A-T-IL ÉTÉ
CONÇU ? LE LANCEMENT
- 1. Une approche « bottom-up »
(ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de
revitalisation
- 2. PVD : un dispositif reposant sur un cadre
contractuel
- 3. Une gouvernance multi-partenariale associant les
échelles nationale et locale
- 4. Une confusion de départ sur les
modalités de financement du dispositif
- 1. Une approche « bottom-up »
(ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de
revitalisation
- A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA
GENÈSE
- II. LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME :
APPROPRIATION ET DIFFÉRENCIATION TERRITORIALES
- A. SUR LE TERRAIN, DES DIFFÉRENCES
DÈS LE DÉMARRAGE : UNE MISE EN PLACE À PLUSIEURS
VITESSES
- B. L'APPROPRIATION DU PROGRAMME PAR LES
TERRITOIRES
- 1. Exemple
n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans
d'action par des outils cartographiques
- 2. Exemple n° 2 (Oise) : animer
le réseau PVD par des échanges participatifs
- 3. Exemple n° 3 (Var) :
disposer au sein des services déconcentrés de l'État d'un
maillage territorialisé de référents sur la question de
l'ingénierie
- 1. Exemple
n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans
d'action par des outils cartographiques
- A. SUR LE TERRAIN, DES DIFFÉRENCES
DÈS LE DÉMARRAGE : UNE MISE EN PLACE À PLUSIEURS
VITESSES
- III. LE BILAN « PVD » VU DES
TERRITOIRES
- A. UN VÉCU LARGEMENT POSITIF POUR LES
ÉLUS LOCAUX, MALGRÉ UNE DÉCEPTION QUANT AU FINANCEMENT DU
DISPOSITIF
- B. UN DISPOSITIF PERTINENT ET EFFICACE SELON LES
ÉLUS LOCAUX, VÉRITABLE CATALYSEUR DE PROJETS
- C. DES POINTS DE DIFFICULTÉ
SIGNIFICATIFS
- D. PVD ET LA QUESTION DU TEMPS LONG EN
MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- A. UN VÉCU LARGEMENT POSITIF POUR LES
ÉLUS LOCAUX, MALGRÉ UNE DÉCEPTION QUANT AU FINANCEMENT DU
DISPOSITIF
- IV. QUEL HÉRITAGE POUR PVD APRÈS
2026 ?
- I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES
VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER
LES PETITES CENTRALITÉS
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
N° 40
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le programme « Petites villes de demain »,
Par Mme Nicole BONNEFOY et M. Louis-Jean de NICOLAY,
Sénatrice et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Mme Annick Girardin, MM. Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.
L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 15 octobre 2025, le rapport d'information de Nicole Bonnefoy et Louis-Jean de Nicolaÿ visant à évaluer le programme national « Petites villes de demain » (PVD), dont l'arrivée à échéance est prévue en mars 2026.
Lancé en 2020, le dispositif PVD vise à soutenir la revitalisation des petites centralités de moins de 20 000 habitants - conformément aux engagements pris lors de l'Agenda rural de 2019 -, à travers un appui en ingénierie, sur le modèle du programme « Action coeur de ville » dédié aux villes moyennes.
Dresser un bilan du dispositif et envisager sa postérité au-delà de 2026 : telle a été la mission confiée aux rapporteurs. Le programme PVD ayant déjà fait l'objet d'évaluations quantitatives à l'échelle nationale, la commission a résolument adopté une approche plus qualitative et territorialisée, fidèle à l'identité du Sénat et s'inscrivant pleinement dans la méthodologie du « contrôle de proximité » qu'il entend développer.
Grâce à de nombreux déplacements et témoignages d'acteurs locaux qui sont les véritables artisans de ce programme, la mission d'information a pu recueillir une matière empirique particulièrement riche. Celle-ci reflète la manière différenciée - et souvent créative et ingénieuse - dont les écosystèmes locaux ont su s'approprier cet outil.
Sur cette base, la commission a adopté 7 recommandations selon un objectif clair : capitaliser sur l'héritage de PVD pour aider les territoires ruraux à appréhender leur avenir à plus vaste échelle.
I. L'OBJECTIF : LE NÉCESSAIRE CONTRÔLE DE PROXIMITÉ D'UN PROGRAMME NATIONAL EMBLÉMATIQUE DE L'« AGENDA RURAL »
A. UNE ÉVALUATION TERRITORIALISÉE...
La mission d'information s'est attachée à évaluer la mise en oeuvre de PVD à partir de la réalité du terrain : dès lors, elle s'est appuyée sur les retours d'expérience des collectivités territoriales - à commencer par ceux des élus locaux et de leurs chefs de projet - et des services déconcentrés de l'État, selon la méthodologie du « contrôle de proximité » propre au Sénat.
Pour ce faire, afin de compléter la matière issue d'une dizaine d'auditions au Sénat, les rapporteurs se sont rendus dans six départements et ont recueilli le témoignage écrit d'élus locaux issus de sept départements : au total, la mission d'information a ainsi pu bénéficier du témoignage de près de 90 élus locaux et de plus de 20 chefs de projet.
Déplacements réalisés par la mission d'information
Contributions écrites d'élus locaux recueillies par la mission d'information
B. ... D'UN PROGRAMME NATIONAL EN FAVEUR DES PETITES CENTRALITÉS EN MILIEU RURAL
Piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le dispositif PVD, créé en 2020 en tant que volet de l'Agenda rural, vise à soutenir la revitalisation des petites communes de moins de 20 000 habitants ayant une fonction de centralité, à travers un appui en ingénierie. Au total, 1 646 communes ont été sélectionnées pour bénéficier du dispositif sur proposition des préfets de département, représentant 7,3 millions d'habitants.
La mise en oeuvre de PVD repose sur une approche ascendante, décentralisée et déconcentrée : en cela, le dispositif rompt avec la logique « classique » des appels à projets pour faire émerger des projets « sur mesure », adaptés aux besoins de chaque territoire.
Les chefs de projet PVD, qui font l'objet d'un co-financement de l'État (dans la limite de 75 % du coût annuel), constituent la clé de voûte de cet édifice : en lien étroit avec les élus locaux, ils ont pour mission de piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et l'animation du projet territorial de revitalisation.
II. UN DISPOSITIF AMBIGU QUI REPOSE
SUR LA CRÉATIVITÉ
DE L'ÉTAT TERRITORIAL
A. L'AMBIGUÏTÉ ORIGINELLE SUR LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF
Lors de la présentation du dispositif, en octobre 2020, il avait été annoncé que les moyens lui étant affectés correspondraient à une enveloppe de trois milliards d'euros sur six ans. Ce montant a toutefois fait l'objet d'un malentendu dès l'origine, portant sur deux points.
En premier lieu, cette enveloppe ne correspondait pas à des moyens supplémentaires affectés au dispositif mais à des dotations et fonds de droit commun - DETR, DSIL, fonds friche et fonds vert - lissés sur six ans, en ce qui concerne les 1,47 Md€ correspondant aux crédits engagés par l'État.
Source : commission, d'après les chiffres de l'ANCT
L'autre ambiguïté initiale qui portait sur le financement du dispositif était la suivante : l'enveloppe annoncée ne correspondait pas à proprement parler à un soutien à l'investissement des communes lauréates, mais seulement à un soutien en ingénierie via des crédits de fonctionnement. Un tel calibrage financier a dès l'origine constitué une « déception » pour l'ensemble des acteurs concernés. Ce sentiment témoigne du caractère incomplet, voire bancal du dispositif, entre sa conception, qui reflète l'idée qu'ingénierie et investissement vont de pair, et son déploiement effectif. Ainsi, en raison des arbitrages relatifs au financement de ce programme, il était logique que celui-ci suscite chez les bénéficiaires la « frustration » quasi-unanime que les rapporteurs ont pu constater sur le terrain.
« Cela a été une déception qu'il n'y ait pas eu d'enveloppe dédiée pour l'investissement au sein de ce programme. »
Caroline Cayeux, ancienne ministre du partenariat avec les
territoires
et de la décentralisation, à l'occasion d'un
déplacement
de la mission d'information à Beauvais
le 23 juin 2025
B. UNE MISE EN oeUVRE QUI REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR L'ÉTAT TERRITORIAL
Si le programme a été conçu dès l'origine comme une « boîte à outils » nationale, son déploiement effectif et concret a essentiellement reposé sur les services déconcentrés de l'État, qu'il s'agisse du portage, de la gouvernance ou encore de l'animation de la démarche. Les rapporteurs ont ainsi pu constater dans l'ensemble des départements au sein desquels ils se sont rendus un fort degré d'engagement de l'État territorial, malgré le poids que l'appui au programme a représenté à moyens constants pour les équipes des préfectures et directions départementales des territoires (DDT) / directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).
Les rapporteurs ont en outre été très favorablement impressionnés par la créativité dont ont fait preuve les services déconcentrés de l'État dans l'animation de ce dispositif. Ils ont ainsi relevé plusieurs initiatives locales de fort potentiel qui mériteraient à leurs yeux d'être répliquées dans d'autres contextes tant elles paraissent porteuses de sens et d'efficacité pour la conduite de projets structurants :
· Valoriser les plans d'action par des outils cartographiques et visuels, à l'exemple des Alpes-de-Haute-Provence ;
· Animer le réseau PVD par des échanges et ateliers participatifs, comme cela est par exemple le cas dans l'Oise (voir figure ci-contre) ;
· Disposer d'un maillage territorialisé de référents en matière d'ingénierie, comme c'est par exemple le cas dans le Var.
C. LE RISQUE D'UNE CONCURRENCE TERRITORIALE ACCRUE
1. Un déploiement à plusieurs vitesses
La capacité des collectivités lauréates à pouvoir entamer le processus PVD et à être en mesure d'entrer concrètement dans le programme a constitué un facteur majeur de différenciation entre les collectivités lauréates. De fortes disparités se sont ainsi dessinées dès le démarrage de PVD, creusant d'une collectivité à l'autre des écarts non résorbables. La cause la plus courante de cette entrée différenciée dans le dispositif était la difficulté à recruter et à fidéliser un chef de projet PVD d'un territoire à l'autre.
2. Une polarisation fréquente au niveau intercommunal
Les rapporteurs relèvent que dans les communes où les relations avec la communauté de communes sont complexes, le programme accentue encore cette crispation. Ces difficultés fréquentes dans les relations entre communes et EPCI trouvent leur origine logique dans l'ambivalence du programme dès sa conception. En effet, celui-ci se focalise sur une centralité, créant ainsi le risque de polariser les relations avec les territoires perçus de facto comme périphériques.
3. Une difficulté majeure : la coopération entre certains financeurs
Les témoignages recueillis font souvent état d'un manque de coordination, voire d'une attitude non coopérative entre certains financeurs. Le constat est très fréquent de calendriers non concordants en matière de recherche de financements, voire, comme le relève un élu, de calendriers « concurrents et non cohérents ».
III. SUR LE TERRAIN, UNE EXPÉRIENCE LARGEMENT POSITIVE VÉCUE COMME UNE « MARQUE DE CONSIDÉRATION »
Il ressort nettement des témoignages recueillis par les rapporteurs le sentiment que PVD a constitué une expérience positive et profitable : les élus ont été très nombreux à percevoir le label PVD comme une « marque de considération » et de « reconnaissance » et un gage de « visibilité renforcée » et ce, d'autant plus que leurs territoires ne se vivaient pas comme des priorités en matière d'aménagement du territoire.
Les élus locaux ont largement souligné la valeur ajoutée de l'appui en ingénierie offert par le programme, qui a permis l'élaboration de projets « structurants », « ambitieux », « porteurs de sens pour nos concitoyens », et s'inscrivant dans une stratégie globale et cohérente pour leurs territoires.
Ce bilan positif est néanmoins tempéré par quelques bémols, à commencer par l'absence d'enveloppe financière consacrée à l'investissement dans les projets ayant émergé du programme et, bien que de manière plus contrastée, le manque de souplesse et la lenteur de la comitologie sur laquelle s'appuie son déploiement.
IV. LA
POSTÉRITÉ DU PROGRAMME APRÈS 2026 :
CAPITALISER
SUR LA DÉMARCHE PVD POUR STRUCTURER LES TERRITOIRES
DE
DEMAIN
A. À COURT TERME, ASSURER LA CONCLUSION DU CYCLE PVD
Le programme PVD arrivera à échéance en mars 2026. Or, selon les données de l'ANCT, seules 20 % des actions prévues par les conventions-cadres PVD avaient déjà été livrées au 31 décembre 2024. Dès lors, les rapporteurs soulignent la nécessité de ne pas porter un coup d'arrêt à la dynamique ainsi enclenchée. En effet, les élus locaux rencontrés par la mission d'information expriment de concert le souhait d'une prolongation du programme :
« Nous commençons tout juste
à entreprendre les travaux,
il serait dommage de couper cet
élan »
Un élu du Loir-et-Cher
« Il est essentiel que le soutien au financement de postes de chefs de projet persiste afin que nous puissions mener à bien les projets structurants qui ont été identifiés dans les plans-guide et les ORT »
Un élu des Alpes-Maritimes
Recommandation n° 1 : Conserver le label « PVD » pour les communes en ayant bénéficié et prolonger le co-financement des chefs de projet de deux ans afin d'assurer la concrétisation des projets lancés.
B. AU-DELÀ DE 2028, ESSAIMER L'ESPRIT PVD À
TRAVERS
LES « TERRITOIRES DE DEMAIN »
1. Passer des « petites villes de demain » aux « territoires de demain »
Le programme PVD a produit des résultats incontestablement positifs : il a permis d'outiller les communes dans la conception de projets structurants de territoire, mais aussi de diffuser en leur sein une culture et une méthode de travail précieuses pour réfléchir à leur avenir.
Aussi, les rapporteurs préconisent de continuer à faire vivre et d'essaimer les acquis de cette expérience à une échelle territoriale plus vaste (au niveau des EPCI ou pôles d'équilibres territoriaux par exemple), à travers le déploiement d'une démarche qui pourrait s'appeler « Territoires de demain ».
Recommandation n° 2 : À partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit « PVD » en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants.
2. Assurer la coopération de l'ensemble des acteurs et soutenir l'ingénierie publique existante
Les rapporteurs émettent plusieurs recommandations en ce qui concerne les modalités selon lesquelles pourrait se déployer la démarche qui capitaliserait sur l'expérience PVD.
Premièrement, il apparaît stratégique que le soutien apporté à l'ingénierie s'appuie principalement sur l'ingénierie publique existante. En effet, nos territoires bénéficient largement d'une ingénierie déjà existante, publique, performante, bien implantée et bien au fait des spécificités locales, et souvent gratuite, comme dans le cas, par exemple, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (les CAUE). Dans le contexte dégradé qui caractérise actuellement nos finances publiques, privilégier l'existant, le local et ce qui est déjà immédiatement opérationnel apparaît comme un levier significatif d'efficience. Cela implique en outre de mieux faire connaître aux porteurs de projet l'ingénierie publique locale existante.
Recommandation n° 4 : Apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique aux « Territoires de demain » afin que le recours local à l'ingénierie puisse s'appuyer prioritairement sur l'ingénierie publique existante, tout en respectant le code de la commande publique.
Recommandation n° 5 : Établir à destination des élus « Territoires de demain » un recensement exhaustif de l'ingénierie publique existante sur le territoire.
Sur le plan de la gouvernance, il est proposé la mise en place pour chaque « territoire de demain » d'un pilotage qui soit co-construit avec l'ensemble des acteurs. En particulier : au lieu de consacrer un temps conséquent à présenter leur projet à chaque financeur potentiel selon un calendrier et des critères d'évaluation différents, les porteurs de projets doivent pouvoir bénéficier d'un comité de financeurs exhaustif et coopératif, qui puisse évaluer une bonne fois pour toutes, de manière cohérente et concordante, si les projets élaborés et sélectionnés sont finançables et, si oui, selon quelles modalités.
Recommandation n° 3 : À partir d'un diagnostic de territoire partagé, appuyer la démarche « Territoires de demain » par la co-construction, sur la base d'une proposition initiale formulée par les services de l'État, d'une comitologie adaptée aux particularismes et contextes locaux.
3. Mettre en cohérence les outils contractuels de demain
La séquence 2026-2027 constituera un jalon structurant pour l'aménagement du territoire : de nombreux dispositifs de contractualisation (contrats de réussite de la transition écologique, contrats de plan État-région, programmes « Action coeur de ville » et « Villages d'avenir », etc.) atteindront leur terme à cette échéance.
Pour les rapporteurs, il s'agit d'une opportunité de mettre en cohérence l'ensemble de ces outils et, ainsi, de doter les « Territoires de demain » d'une vision pluriannuelle renforcée en matière de financements. Par ailleurs, il importe que les dispositifs contractuels qui seront élaborés pour la prochaine séquence intègrent, de manière plus systématique et transversale, les enjeux liés à l'adaptation aux effets du changement climatique. Cet impératif doit en particulier être au coeur de la démarche des « Territoires de demain » qu'ils appellent de leurs voeux.
Recommandation n° 6 : Profiter de la fin du cycle PVD pour une mise en cohérence globale de l'ensemble des dispositifs de contractualisation et de planification locaux.
Recommandation n° 7 : Renforcer la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de manière transversale, dans tous les territoires de demain.
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
Alors que le programme « Petites villes de demain » (PVD) lancé en 2020 arrivera à échéance en mars 2026 - sous sa forme actuelle1(*)-, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a souhaité en évaluer la mise en oeuvre à travers une mission d'information.
Dresser un bilan approfondi et territorialisé du dispositif national après cinq ans de mise en oeuvre et proposer un cap pour les lendemains de PVD : telle a été la mission confiée aux deux rapporteurs, Louis-Jean de Nicolaÿ et Nicole Bonnefoy. Le programme PVD a déjà fait l'objet d'évaluations quantitatives à l'échelle nationale effectuées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Banque des territoires - deux opérateurs au coeur de sa mise en oeuvre - selon une approche essentiellement quantitative. Afin de compléter ces éléments statistiques d'un regard plus qualitatif et fidèle à l'identité du Sénat, la mission d'information s'est attachée à évaluer la mise en oeuvre de PVD à partir du vécu des collectivités territoriales, à commencer par les élus locaux et leurs chefs de projet. Dès lors, cette initiative s'inscrit pleinement dans la nouvelle forme de « contrôle de proximité » que le Sénat entend développer, au plus près des réalités du terrain2(*).
Pour ce faire, en parallèle des auditions organisées au Sénat3(*), des déplacements dans six départements leur ont permis de prendre le pouls des territoires, en allant à la rencontre des acteurs qui sont en première ligne dans la mise en oeuvre du dispositif et en étudiant des projets d'aménagements PVD. Ils ont par ailleurs recueilli la contribution écrite d'élus locaux issus de sept départements différents faisant état de leur retour d'expérience sur le dispositif. Les cartographies ci-après présentent les départements ainsi représentés dans les travaux de la mission d'information.
Déplacements réalisés par la mission d'information
Contributions écrites d'élus locaux
recueillies
par la mission d'information
Au total, la mission a ainsi pu recueillir le témoignage de près de 90 élus locaux et de plus de 20 chefs de projet.
I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER LES PETITES CENTRALITÉS
A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA GENÈSE
Le 19 septembre 2019, lors de l'ouverture du Congrès de l'Association des petites villes de France (APVF), Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait annoncé l'élaboration d'un programme d'aide à la revitalisation pour les petites communes, en lien avec Jacqueline Gourault, alors ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Le programme « Petites villes de demain » (PVD) a été lancé le 1er octobre 2020 pour soutenir les communes de moins de 20 000 habitants en situation de fragilité grâce à un accompagnement en ingénierie dans la réalisation de leurs projets structurants. Son objectif est double : conforter le rôle de centralité de ces communes, au profit des territoires ruraux avoisinants, et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, environnementaux et sociaux à venir. Ce programme traduit l'un des 181 engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de l'Agenda rural4(*) de 2019, qui a été complété et prolongé par le plan France ruralités lancé en juin 2023.
Ce dispositif, piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et dont le déploiement est prévu pour six ans, est inspiré du programme de redynamisation « Action coeur de ville » lancé en 2018 dédié, quant à lui, à l'échelon démographique supérieur, soit aux villes moyennes.
Le programme « Action coeur de ville », dispositif « grand frère » de PVD
Piloté par l'ANCT, le programme « Action coeur de ville » (ACV) a été lancé en 2018 pour cinq ans afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants des villes moyennes et de conforter leur rôle moteur dans le développement territorial. Il s'agit d'un programme transversal, dont l'objectif principal est de fournir aux villes moyennes des outils juridiques, financiers et fiscaux pour soutenir la redynamisation de leurs centres-villes. 243 villes jouant un rôle de pôle d'attractivité étaient bénéficiaires de ce programme au 4e trimestre 2024.
ACV a été conçu selon une logique ascendante et un mode de gestion étatique déconcentré et décentralisé : ce dispositif d'accompagnement des villes moyennes dans la conduite de leurs projets de revitalisation repose sur le co-financement d'un chef de projet par l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et des conventions transversales passées avec des partenaires financiers et opérationnels multiples (la Caisse des dépôts et consignations, Action logement, l'Anah, le Cerema, le CNFPT, l'Anru et l'Ademe notamment).
Alors qu'il devait initialement s'achever en 2023, le programme ACV a été prolongé pour la période 2023-2026. Dans le cadre de cette nouvelle phase, le périmètre d'action du programme a été élargi aux entrées de ville et aux quartiers de gare, avec un accent mis sur la transition écologique et l'adaptation face au changement climatique (verdissement, sobriété foncière, lutte contre l'étalement urbain, évolution des mobilités, etc.).
Le programme ACV a fait l'objet d'une mission d'évaluation de l'Assemblée nationale, dont les travaux se sont achevés le 25 juin 20255(*).
D'après le site internet de l'ANCT, on dénombrait 2 099 communes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité en 2020, pour un territoire d'influence couvrant 38 % de la population française.
Tandis que ces communes présentent de nombreux atouts et assurent des fonctions essentielles pour la population de leur bassin de vie grâce à la mise à disposition de services et équipements, nombre d'entre elles présentent des fragilités (déprise commerciale, déclin et vieillissement démographique, vacance de logements ou offre de logement inadaptée, dégradation du bâti ancien, etc.), accentuées par les phénomènes d'urbanisation. Elles sont en outre caractérisées par un manque de ressources en matière d'ingénierie technique et administrative et un accès difficile aux financements, rendant complexe la conception et la conduite de projets de revitalisation.
Les discours ayant présidé au lancement de PVD témoignent d'une volonté de remédier à ces vulnérabilités, tout en mettant en avant la place des petites centralités dans le maillage territorial en milieu rural et en développant les liens d'interconnaissance et de confiance avec l'État, ses services et ses opérateurs.
Extrait du dossier de présentation du programme « Petites villes de demain » (octobre 2020) - Propos de Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales
« Les petites villes occupent une place à part dans le coeur des Français. Ces centralités de moins de 20 000 habitants constituent en effet, pour des millions de nos concitoyens, la trame de leur existence quotidienne. Depuis plusieurs années, elles sont déjà le support de nombreux projets et innovations qui réinventent le visage de notre pays. Aujourd'hui, alors que le Premier ministre a annoncé un Plan de relance d'une ampleur considérable, particulièrement ambitieux pour les territoires, le programme “Petites villes de demain” va être un formidable accélérateur des transitions territoriales, notamment en termes d'écologie et de résilience.
Ces “Petites villes” disposent en effet de nombreux atouts, régulièrement mis en avant par nos concitoyens. Je pense notamment à la qualité de vie, la souplesse d'organisation, la capacité à fédérer les acteurs locaux ou encore la proximité avec la nature. Tous ces facteurs d'attractivité ont d'ailleurs été particulièrement soulignés depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays. Ces dernières années, cependant, un certain nombre d'entre elles ont rencontré des difficultés, incarnées souvent par la conjugaison d'une difficulté d'accès aux services publics, à la vacance commerciale et à une consommation excessive de terres agricoles. [...]
Aussi, dans le cadre de la “nouvelle donne territoriale” appelée de ses voeux par le Président de la République, nous avons conçu main dans la main, avec les territoires concernés, un programme d'action très ambitieux pour revitaliser mille premières centralités. Ce dernier incarne la méthode que nous mettons en place depuis 2017, et que j'appelle le “ sur-mesure”, ou le “cousu-main”, en articulant une offre nationale - à commencer par des moyens conséquents : 3 milliards d'euros pour les six prochaines années - et locale, au plus près des réalités concrètes et des besoins des territoires. D'autant que, dans beaucoup d'endroits, les collectivités, et au premier chef les régions et les départements, ont déjà développé des actions d'accompagnement.
C'est d'ailleurs le premier programme porté en propre par l'Agence nationale de cohésion des territoires, créée le 1er janvier 2020, pour accompagner en ingénierie les territoires dans leurs projets. Les préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'Agence, ont pleinement vocation à être accompagnateurs et facilitateurs, aux côtés des porteurs de projet. [...} ».
En pratique, le dispositif PVD vise à soutenir la revitalisation de ces communes à travers trois axes :
· un soutien en ingénierie, en particulier à travers le co-financement par l'État d'un poste de chef de projet jusqu'à 75 % ;
· des financements sur des mesures thématiques ciblées, en fonction du projet de territoire ;
· l'accès au réseau « Club petites villes de demain » pour favoriser le partage d'expériences.
L'État met en avant cinq objectifs guidant son action dans le programme PVD6(*) :
· « partir des territoires et de leur projet : l'État n'impose pas sa vision » ;
· « apporter une réponse sur- mesure » : éviter les réponses standardisées au profit de réponses adaptées à chaque territoire ;
· « mobiliser davantage de moyens et rechercher des formes nouvelles d'intervention » : mobiliser les ressources des partenaires nationaux et permettre aux préfets d'être des facilitateurs aux côtés des chefs de projets ;
· « combiner approche nationale et locale » : l'État tient compte des actions d'accompagnement existant déjà sur les territoires, pour articuler l'offre nationale et locale ;
· « se donner du temps, [soit] six ans à compter du renouvellement municipal ».
B. COMMENT CE PROGRAMME A-T-IL ÉTÉ CONÇU ? LE LANCEMENT
1. Une approche « bottom-up » (ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de revitalisation
Le dispositif PVD est guidé par une approche sur mesure : il s'agit de sortir de la logique d'appel à projet pour favoriser l'émergence et accompagner des projets locaux, partant des territoires. Dès lors, l'État se positionne comme un facilitateur chargé d'accompagner les stratégies définies par les communes en fonction de leurs besoins.
Cette méthode de travail ascendante s'est traduite dès l'étape de la désignation des communes bénéficiaires du programme ainsi que, plus tard, au moment de la phase de conception de leurs projets.
· Les communes bénéficiaires ont été désignées par les préfets de département, à l'issue d'un processus en trois étapes.
Tout d'abord, un pré-ciblage des communes exerçant des fonctions de centralités intermédiaires et présentant des signes de fragilité a été établi, sur la base des résultats d'une étude réalisée par l'ANCT, le Centre d'économie et de sociologie appliquées à la recherche (Cesaer) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae)7(*). Cette étude classe les communes françaises selon cinq niveaux de centralité, en fonction de la diversité des équipements présents et à partir de la base permanente des équipements de l'Insee.
À partir de ces éléments, une pré-liste de communes a été transmise aux préfets afin qu'ils affinent cette sélection. Une instruction leur a également été transmise, précisant la cible nationale envisagée (1 000 collectivités) ainsi que des objectifs par région, tenant compte du poids démographique des départements. Les préfets étaient invités à privilégier les communes de moins de 20 000 habitants, ayant un niveau de centralité et ne bénéficiant pas du programme « Action coeur de ville ». Une attention particulière devait en outre être portée aux communes déjà engagées dans des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et à celles bénéficiant du dispositif expérimental de revitalisation des centres-bourgs8(*).
Ainsi, les préfectures ont été amenées à préciser le pré-ciblage réalisé au niveau national, à partir de leur expertise de terrain et à la suite de procédures consultatives.
En définitive, afin de tenir compte des propositions des préfets, l'objectif initial de 1 000 communes a été revu à la hausse : 1 646 communes au total ont été désignées, représentant 7,3 millions d'habitants. 73 % de ces communes sont des communes rurales au sens de l'Insee.
Les données transmises par l'ANCT révèlent les particularités des communes PVD par rapport aux communes bénéficiaires du dispositif ACV. Tandis que les communes ACV appartiennent majoritairement aux catégories urbaines (67 % sont des centres urbains intermédiaires), les communes PVD ont des profils davantage différenciés : ainsi, 15 % sont des communes rurales à habitat dispersé ou très dispersé, 58 % des bourgs ruraux et 20 % des petites villes ou ceintures urbaines. Les communes PVD se caractérisent en outre par un dynamisme démographique et économique plus faible que les communes ACV, et un indice de vieillissement de la population supérieur. Elles sont en grande majorité (73 %) des petites polarités mixtes ou industrielles ou artisanales, tandis que 14 % sont des ruralités touristiques, 8 % des ruralités productives et 5 % des ruralités résidentielles.
La carte ci-après présente la répartition des communes bénéficiaires de PVD en 2023, selon leur degré de densité.
Source : rapport général tome III
Annexe 6 (2023-2024) du rapporteur spécial Bernard Delcros
sur
la mission « Cohésion des territoires » (PLF
pour 2024), 23 novembre 2024
· PVD vise à apporter des réponses sur- mesure aux problèmes rencontrés dans chaque territoire : la mise en oeuvre de cette différenciation, qui nécessite d'identifier les enjeux propres à chaque commune afin de définir une réponse adaptée, repose sur un travail étroit entre le maire et son chef de projet « PVD ».
Le dispositif PVD permet aux communes labellisées de bénéficier d'un co-financement de l'État pour recruter un chef de projet (ANCT, Banque des territoires et Agence nationale de l'habitat) à hauteur de 75 % de son coût annuel.
Les chefs de projet sont la cheville ouvrière de la mise en oeuvre du programme : ils ont pour principales missions d'aider à la conception du projet territorial de revitalisation, de le mettre en oeuvre, d'en organiser le pilotage et d'en assurer l'animation avec les différents partenaires et, enfin, de contribuer à la mise en réseau des communes PVD au niveau local et national. Dès lors, ils sont amenés à travailler en « mode projet », en faisant collaborer de façon transversale différents services, opérateurs et partenaires publics et privés.
Le mode projet, qu'est-ce que c'est ?
Le mode projet est une méthode de travail permettant de mobiliser, de manière transversale, plusieurs services et acteurs peu habitués à travailler ensemble afin de mettre en oeuvre des projets complexes et ce, dans un objectif, un périmètre et une temporalité précis.
Il repose sur une méthodologie définie, qui implique notamment :
- une phase de « pré-cadrage » destinée à identifier le but à atteindre. Il s'agit, à partir de travaux de collecte d'informations, de réflexion et de dialogue, de parvenir à clarifier les attentes des acteurs et d'identifier un objectif précis et cohérent, et de faire une première évaluation des ressources à mobiliser. Des techniques favorisant la co-construction sont à privilégier pour garantir la convergence de l'objectif avec les besoins exprimés par les acteurs. Cette étape peut conduire à l'élaboration d'un cahier des charges formalisant l'intention du projet et sa viabilité ;
- la mise en place d'une gouvernance adaptée. Le mode projet nécessite l'intervention coordonnée d'acteurs dotés de différentes compétences ; dès lors, il implique la mise en place d'instances de pilotage et la clarification préalable des périmètres d'intervention de chacun. Le commanditaire et le chef de projet sont au coeur de cette gouvernance : le premier est le porteur de la vision stratégique et le décisionnaire ; le second est responsable de la réalisation du projet et rend compte régulièrement au commanditaire. Le chef de projet est amené à coordonner et valoriser les différentes expertises et à animer le collectif entourant le projet ;
- la définition d'un calendrier précis de réalisation du projet, adapté aux objectifs.
Source :
Diffuser
la culture du mode projet dans la fonction
publique,
ministère de l'action et des comptes
publics, édition 2019
Afin de les outiller au mieux sur la gestion en « mode projet », une formation initiale dédiée a été proposée aux chefs de projet par l'ANCT, en partenariat notamment avec l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et la Banque des territoires.
Cette méthode de travail conduit à conférer au chef de projet un positionnement transversal dans l'organisation administrative de la collectivité.
Le positionnement du chef de projet au sein d'une collectivité PVD
Le chef de projet, chargé du pilotage et de l'animation du projet territorial, bénéficie à ce titre d'un positionnement hiérarchique transversal qui lui permet d'assurer une fonction de secrétaire exécutif de la comitologie PVD. Cette dernière est classiquement constituée d'un comité de pilotage stratégique qui fixe les orientations générales du projet et rend les arbitrages (Copil), et d'un comité technique chargé de structurer le projet dans le détail et de soumettre au Copil les arbitrages (Cotech).
Dans cette configuration, le chef de projet est placé auprès du directeur général des services (DGS) avec une interface transversale, en interne, sur l'ensemble des directions de la collectivité, et en externe, auprès des interlocuteurs institutionnels, comme le figure ci-après un exemple d'organigramme PVD :
Source : rapport d'activité annuel de
Mme Hélène Pérez,
cheffe de projet PVD de la
commune de Ponte-Saint-Maxence dans l'Oise
2. PVD : un dispositif reposant sur un cadre contractuel
Le programme PVD prend appui sur la signature de conventions transversales avec l'État et ses partenaires, qui permettent de formaliser des partenariats et de bénéficier de dispositifs fiscaux.
Deux étapes contractuelles importantes jalonnent la mise en oeuvre du dispositif au niveau local :
- en début de processus, la signature d'une convention d'adhésion actant l'engagement des collectivités bénéficiaires et de l'État dans le programme PVD : cette étape permet à la collectivité d'engager l'élaboration ou la consolidation de son projet de territoire et de bénéficier du co-financement d'un poste de chef de projet ;
- la signature d'une convention-cadre formalisant le projet de territoire qui vaut opération de revitalisation du territoire (ORT)9(*) au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette convention permet, sur la base d'un diagnostic, d'une stratégie de revitalisation et d'un plan d'actions élaboré au préalable, de formaliser l'engagement des différents partenaires (État, opérateurs, collectivités territoriales, partenaires privés) et les moyens associés. En principe, elle doit être signée dans les 18 mois suivant la signature de la convention d'adhésion.
Les grandes étapes de la mise en oeuvre du programme PVD dans une commune labellisée
- Extrait du site internet de l'ANCT -
1. Dialogue entre l'élu et le chef de projet
En étroite collaboration avec l'exécutif de la commune et de l'intercommunalité, le chef de projet conduit l'élaboration d'une stratégie globale et opérationnelle visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner le territoire dans sa transition écologique en prenant en compte ses besoins spécifiques. Il en assure la concrétisation en pilotant la mise en oeuvre du plan d'actions qui en découle, en lien avec les partenaires.
2. Mise en place d'une gouvernance locale
Le programme PVD obéit à une logique déconcentrée et décentralisée : c'est au niveau local que sont élaborés et validés les soutiens aux projets, dans le respect des règles de gestion des partenaires. Il est demandé aux collectivités de mettre en place deux types d'organisation au niveau local :
Un comité de projet : c'est le comité de pilotage au niveau intercommunal. Il valide la stratégie d'action et les documents, permet aux acteurs de se coordonner et pilote l'avancement du projet.
Sous la présidence des élus, il réunit périodiquement les signataires de la convention d'adhésion : représentants de la ou des commune(s) bénéficiaire(s) et de l'intercommunalité (élus, chef de projet, services), le préfet de département, avec les services techniques mobilisés, ainsi que les représentants désignés par les financeurs. En fonction des configurations locales, ce comité inclura tout autre acteur local pertinent et engagé dans le projet de revitalisation, de manière permanente ou suivant les ordres du jour (notamment chambres consulaires, associations et représentants des commerçants, établissements publics, investisseurs locaux, acteurs immobiliers, etc.).
Des « comités participatifs » représentant les habitants des territoires concernés pourront être mobilisés pour accompagner la co-construction du projet, notamment en recueillant les propositions et avis de la population et des acteurs de la société civile (associations, entreprises, etc.) dans sa conception et son déploiement.
Lorsque les communes et EPCI ont déjà mis en place une instance de pilotage dans le cadre de dispositifs locaux de soutien à la revitalisation, ces dernières pourront s'appuyer sur cette instance qui tiendra alors lieu de comité de projet « Petites villes de demain » (et élargir sa composition au besoin pour intégrer l'ensemble des partenaires signataires de la convention). Les acteurs associés à la gouvernance locale sont a minima :
- les exécutifs de la commune et de l'intercommunalité (EPCI) ;
- le chef de projet « Petites villes de demain » ;
- le préfet de département, délégué territorial de l'ANCT, ou son représentant ;
- les autres signataires de la convention d'adhésion.
Suivant les configurations locales, pourront également être associés :
- les partenaires associés au programme : agences, chambres consulaires, établissements publics, etc. ;
- les organismes de logement social intervenant sur la commune ;
- des acteurs privés et associations pouvant être impliqués dans le projet ;
- des « comités participatifs » représentant les habitants ;
- tout autre acteur local jugé pertinent.
Une équipe projet : sous la supervision du chef de projet, elle assure la mise en oeuvre du projet à mener (le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations), la maîtrise d'ouvrage de certaines actions et la coordination des maîtres d'ouvrage pour d'autres actions. Elle regroupe les différents acteurs techniques du projet (chef de projet, services techniques municipaux et intercommunaux) et anime les réunions / comités techniques thématiques. Cette équipe s'appuie sur les experts techniques mobilisés au sein des services déconcentrés de l'État et des partenaires.
3. Phase de diagnostic
La réalisation d'une phase de diagnostic est un moment clé de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Elle résume les principales caractéristiques du territoire et les enjeux auxquels le programme Petites villes de demain pourra répondre. Elle vise à identifier les processus localement à l'oeuvre dans la dévitalisation du territoire pour identifier les leviers d'action.
Ce diagnostic est bien entendu spécifique à chaque territoire en fonction de son histoire, de ses forces, ses faiblesses et ses potentialités, la géographie de ses acteurs locaux, son potentiel économique, mais aussi ses dépendances, ses menaces et ses vulnérabilités. Le diagnostic s'appuiera en tant que de besoin sur les documents d'urbanisme et de planification déjà existants (Scot, Plui, SPR, PCAET, PAT...).
Le diagnostic peut s'appuyer par exemple sur :
- des données quantitatives et qualitatives existantes (Insee, Observatoires des territoires, DGF, Dataviz PVD, portail l'environnement en France, observatoires régionaux, les données « Parc privé potentiellement indigne » (PPPI) ou fiches de synthèse du parc privé de l'Anah...) sur le territoire, en particulier sur les informations concernant l'emploi, l'offre de mobilité, le bâti, l'économie, etc. ;
- une ou des cartographies illustrant les différentes problématiques ;
- une expertise architecturale, urbanistique et/ou paysagère ;
- une synthèse des démarches stratégiques engagées (les projets existants aux différents niveaux territoriaux et les contractualisations passées) ;
- l'identification d'initiatives structurantes, publiques comme privées, sur le territoire ;
- ou nécessiter la conduite d'études spécifiques qui peuvent faire l'objet de financements dans le cadre du programme.
4. Définir les axes stratégiques
Sur la base du diagnostic, il convient de déterminer un projet partagé et cohérent du territoire au regard de ses priorités, avec une approche transversale et intégratrice des enjeux. Le projet territorial pourra évoluer et être complété.
Les axes stratégiques doivent prendre en compte :
- les priorités et enjeux du territoire (habitat, vacance commerciale, implantation de services publics, emploi...) ;
- les orientations du contrat de relance et transition écologique dans lequel le territoire s'inscrit ;
- des objectifs transversaux de transition écologique et de cohésion territoriale ;
- les secteurs stratégiques et d'intervention prioritaires dans la perspective d'établir le périmètre de l'ORT.
Chaque axe stratégique comprend :
- une description des enjeux auxquels cet axe répondra, et des partenaires mobilisés ;
- des indicateurs de mise en oeuvre et de résultat ;
- la précision de l'échelle concernée s'il y a lieu.
5. Établir un plan d'action opérationnel
À partir des axes stratégiques définis, la collectivité, des acteurs territoriaux et les partenaires établissent un plan d'action opérationnel en identifiant des projets à soutenir et à mettre en oeuvre sur le territoire. Le plan d'action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions. Il définit le ou les périmètres en fonction des thématiques, le programme global, un calendrier prévisionnel et la maquette financière correspondante.
6. Réaliser des fiches-action
Les actions du programme « Petites villes de demain » sont décrites dans des « fiches-action », rassemblées dans le plan d'action qui est évolutif, et examinées en comité de projet. Elles ont vocation à alimenter directement le plan d'action du CRTE du territoire concerné.
7. La contractualisation
« Petites villes de demain » est un programme pluriannuel et global. Il permet une accélération et un renforcement des actions planifiées et menées dans le cadre de contractualisations territoriales, et en particulier les opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Ainsi, la convention « Petites villes de demain » ne constitue pas un outil de contractualisation supplémentaire, mais vient enrichir, et le cas échéant, initier la contractualisation entre l'État et la collectivité.
Pour les communes et intercommunalités bénéficiaires et leur EPCI, la démarche d'accompagnement donne lieu à la signature d'une convention d'adhésion, puis à la signature d'une convention-cadre, valant opération de revitalisation du territoire (ORT). Signée par la (ou les) commune(s) bénéficiaire(s) du programme, la ville principale de l'EPCI, et l'EPCI, l'État, les collectivités locales qui le souhaitent (régions, départements) et les partenaires associés au programme, et éventuellement la Banque des territoires, cette convention-cadre acte les engagements respectifs des partenaires.
En pratique, plusieurs années sont généralement nécessaires pour clore la phase contractuelle, comme en témoigne l'exemple figurant ci-après de la commune de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise.
Source : document transmis à la
mission d'information
par la cheffe de projet de Pont-Sainte-Maxence dans
l'Oise
Les projets de territoire doivent en outre s'inscrire dans les Contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE) - anciennement nommés contrats de relance et de transition écologique - dont la coordination nationale est assurée par l'ANCT. Également lancés en 2020 pour six ans, les CRTE ont vocation à être le cadre privilégié de territorialisation de la planification écologique. Cette articulation est, en principe, précisée dans la convention-cadre PVD.
3. Une gouvernance multi-partenariale associant les échelles nationale et locale
La gouvernance de PVD articule un pilotage au niveau national et une comitologie sur laquelle s'appuie son déploiement au niveau local.
· La mise en oeuvre de PVD est pilotée par l'ANCT, par l'intermédiaire de ses délégués territoriaux, les préfets de département, chargés de jouer un rôle de facilitateur pour accompagner les porteurs de projet au niveau local.
Le programme repose sur un fonctionnement partenarial à travers l'implication de nombreux opérateurs de l'État sur le plan financier et opérationnel :
- s'agissant du financement de PVD, outre de multiples ministères, sont impliqués l'ANCT, la Banque des territoires, l'Anah, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et l'Ademe ;
- s'agissant de la réalisation des projets, des dizaines d'opérateurs sont engagés dans le programme (notamment 'l'Association des petites villes de France, 'l'Autorité des marchés financiers, la CCI France, la CMA France, la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la Fondation du patrimoine, le Cerema, etc.) à travers la mise à disposition d'une offre de services ou encore la production de ressources destinées aux chefs de projets et aux élus locaux (modules de formation, participation au club PVD national ainsi qu'à des évènements nationaux et à des webinaires, etc.).
L'engagement des partenaires dans la mise en oeuvre de PVD
- L'exemple du Cerema -
Dans le cadre de l'appui national au programme, le Cerema assure des actions de formation et un accompagnement en ingénierie au profit des communes labellisées PVD.
S'agissant de la formation, l'offre du Cerema, destinée aux chefs de projets et aux élus locaux, comprend un socle initial et des modules complémentaires. Le socle de formation initial avait vocation à outiller les chefs de projets dans la phase de prise de fonctions ainsi que sur des sujets techniques de développement territorial, en lien avec la revitalisation (connaissance de l'écosystème local, construction d'un projet de territoire appuyé sur un diagnostic, méthodologie de la gestion de projet, connaissance des outils opérationnels et offre d'ingénierie des partenaires du programme PVD). Un module a été proposé en format webinaire national en deux sessions en juin 2021 et janvier 2022. Concernant les modules complémentaires, le Cerema a déployé des séquences thématiques sous un format webinaire en 2022 (réaménagement des espaces publics ; santé et aménagement ; attractivité immobilière des petites villes), 2023 (nature et biodiversité dans les coeurs de ville ; sobriété foncière) et 2025 (résilience des territoires). L'offre de formation du Cerema, de même que celle des autres partenaires du programme, est diffusée dans un guide de la formation PVD, diffusé par l'ANCT.
S'agissant de l'accompagnement des collectivités, au 30 avril 2025, 239 missions d'ingénierie avaient été réalisées par le Cerema auprès de 210 communes et EPCI PVD, correspondant à près de 4 000 jours d'intervention et pour un montant évalué à 1,6 M€. Les accompagnements ont concerné les thématiques suivantes : les mobilités, l'aménagement des espaces publics, la construction du projet de territoire, la nature en ville, la résilience des territoires, la sobriété foncière et les friches et les bâtiments.
Le Cerema intervient majoritairement dans la phase amont des projets, dans la construction de la stratégie territoriale et dans la conception du projet. Il intervient également, de manière plus ponctuelle, dans la phase pré-opérationnelle des projets, par exemple sur la faisabilité économique d'une opération d'aménagement en recyclage foncier.
En principe, les interventions du Cerema en matière d'accompagnement s'inscrivent dans la convention-cadre « ANCT-Cerema », qui définit le périmètre d'intervention, les modalités de coordination et d'appui en ingénierie et la répartition des financements. Ces interventions font l'objet d'un co-financement de l'ANCT une fois instruites et validées par celle-ci.
Néanmoins, depuis le changement de gouvernance du Cerema en 2023 à la suite de la loi dite « 3DS »10(*) de 2021, des collectivités labellisées PVD et adhérentes de cette instance sont amenées à solliciter le Cerema directement pour des missions d'accompagnement ou d'expertise, en dehors de la convention passée avec l'ANCT. Cette évolution témoigne d'un renforcement de la visibilité de l'ingénierie mise à disposition par cet acteur au profit des collectivités territoriales.
Source : réponses du Cerema au questionnaire écrit des rapporteurs
Les principaux partenaires nationaux sont réunis dans un comité de pilotage opérationnel (Copo) sous l'égide de l'ANCT.
Au niveau local, outre les acteurs précités, le programme bénéficie de l'implication de partenaires volontaires, qu'il s'agisse de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes) ou d'opérateurs locaux (établissements publics fonciers et agences d'urbanisme notamment). À titre d'exemple, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) constituent souvent des partenaires privilégiés des communes PVD compte tenu de leur connaissance fine des territoires et de leur expertise transversale et polyvalente.
Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE) :
un exemple emblématique
d'ingénierie territoriale de proximité
Les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) sont des structures associatives d'ingénierie territoriale à l'échelle départementale, ayant pour mission d'intérêt public la promotion de la qualité du cadre de vie. Créés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ce sont désormais 92 CAUE qui couvrent la quasi-totalité du territoire national, métropolitain comme ultramarin.
Les CAUE mènent des actions transversales d'information, de conseil ou de sensibilisation dans divers domaines, tels que l'architecture et l'urbanisme, ainsi que l'environnement et le paysage. Leurs interventions, qui sont réalisées à titre gratuit, s'adressent aussi bien aux porteurs de projets publics et privés qu'aux professionnels. Ils proposent ainsi aux territoires un accompagnement neutre et indépendant, couvrant des thématiques variées telles que la sobriété foncière, la rénovation énergétique, la revitalisation des centres-bourgs, la renaturation ou encore les mobilités.
La FNCAUE (Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) note néanmoins une « implication très variable » des CAUE dans le cadre de PVD. Dans certains cas, l'implication faible ou tardive du CAUE a pu résulter, selon la FNCAUE, d'un manque de connaissance de l'écosystème institutionnel de la part des chefs de projet, accentué par un important phénomène de « turnover » les concernant. S'agissant des modalités de leur implication, cet acteur indique :
« Généralement, les CAUE participent aux instances PVD, donnent des avis techniques sur le fond des projets voire fournissent un appui au chef de projet dans l'élaboration du projet de territoire, notamment dans la construction d'une vision stratégique du territoire.
Lorsque l'implication du CAUE est particulièrement forte, les CAUE réalisent des fiches-conseils, des ateliers méthodologiques ou encore des visites de sites déjà engagés dans des projets de revitalisation. Le CAUE est souvent envisagé comme personne / structure ressource. Ils ont souvent été sollicités sur la méthode et la connaissance du territoire, notamment par les chefs de projet peu expérimentés. »
À titre d'exemple, le CAUE de l'Aisne a été fortement mobilisé dans la mise en oeuvre de PVD : « Anticipant un nécessaire renforcement de la culture de projet de territoire, il a créé un cycle alliant sensibilisation et formation pour accompagner les territoires lauréats. Il vise à associer les élus, les chefs de projet et les directeurs de service. Pensé sur deux ans, il suit la temporalité du programme PVD avec trois modules : compréhension du territoire, définition d'une stratégie et d'un plan d'action, puis mise en oeuvre. Pour chaque module, différentes actions sont articulées pour outiller les parties prenantes : des conférences, des rencontres et des ateliers pratiques avec un travail sur des cas concrets. »
De même, le CAUE de la Gironde a participé à la réalisation du dispositif PVD dans 11 communes PVD du département (sur 16). Cet investissement pour le CAUE représente sur la période 2021-2025 l'équivalent de 542 jours de travail dédié et un budget global de 208 145 € soit 52 000 € par an. Le CAUE a ainsi consacré 110 jours de travail dans le programme PVD pour assister la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, dont 25 jours pour assister la communauté de communes de l'Estuaire à réaliser son plan local d'urbanisme intercommunal11(*).
· Le déploiement du programme s'appuie sur des instances locales de pilotage, sous la direction des préfets de département, appuyés par les sous-préfets et les directions départementales des territoires (DDT)/directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). En pratique, ces comités de pilotage locaux - qui rassemblent les différents partenaires du programme - ont pour objet de mobiliser les moyens nécessaires à la concrétisation des projets qui sont définis dans les conventions-cadres. La mobilisation des partenaires nationaux et locaux dans ces instances de gouvernance a pour but de faciliter l'adaptation des projets aux besoins et spécificités de chaque territoire. Selon l'ANCT, sous l'égide des préfets, la plupart des départements organisent une réunion annuelle de ce comité de pilotage, afin de réaliser des points d'avancement avec les élus.
Les préfets de département organisent en outre régulièrement des réunions de « clubs départementaux »12(*) avec les chefs de projets et maires des communes PVD, afin de présenter les dispositifs nationaux, régionaux ou départementaux susceptibles de leur bénéficier, ou de mettre en lumière certaines initiatives remarquables et de favoriser les échanges entre pairs.
4. Une confusion de départ sur les modalités de financement du dispositif
En 2021, le Gouvernement avait annoncé doter le programme PVD d'une enveloppe de 3 Mds€ sur six ans. En définitive, cette cible a été dépassée puisque l'engagement financier de l'État et des partenaires nationaux du programme s'élevait à 3,7 Mds€ au 31 décembre 2024, selon les chiffres fournis par l'ANCT.
La décomposition de cette enveloppe de même que la nature et la provenance de ces crédits n'avaient, néanmoins, pas été précisées lors du lancement de PVD. Alors que l'annonce initiale du Gouvernement a pu laisser espérer une enveloppe nouvelle et spécifiquement dédiée au déploiement du programme, ces moyens ont intégralement reposé sur des financements existants émanant de l'État et de ses opérateurs partenaires du programme. Le schéma ci-après présente cette décomposition.
Répartition des crédits
engagés par l'État
et les partenaires nationaux de
PVD
Source : ANCT
Si l'ingénierie a été financée pour l'essentiel par les opérateurs, notamment à travers les marchés à bon de commande de l'ANCT, les dépenses d'investissement ont été soutenues par des dispositifs de droit commun, via la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et d'autres dispositifs comme le fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ou encore le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (dit « fonds vert »). De fait, la concrétisation des projets PVD dépend donc de la disponibilité de ces différents fonds, qui sont par ailleurs fortement sollicités pour financer d'autres dispositifs et dont les moyens sont nécessairement limités. Cette situation a été de nature à générer une incompréhension - doublée d'une certaine « frustration » - de la part des élus locaux et chefs de projets (cf. infra).
Les rapporteurs relèvent d'ailleurs que, dès le départ, le calibrage financier du dispositif a constitué une déception, y compris selon les dires de Caroline Cayeux, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en 2022, qui a déclaré à l'occasion d'un échange en préfecture de l'Oise13(*) : « cela a été une déception qu'il n'y ait pas eu d'enveloppe dédiée pour l'investissement au sein de ce programme. Nous n'avons pas pu [bénéficier de cet arbitrage]. Ce que nous avons pu obtenir, c'est [la création d']une enveloppe pour l'ingénierie. »
De telles déclarations témoignent du caractère incomplet, voire bancal du dispositif, entre sa conception, qui reflète l'idée qu'ingénierie et investissement vont de pair, et son déploiement effectif, qui ne favorise que de la seule ingénierie via des crédits de fonctionnement.
Ainsi, en raison des arbitrages relatifs au financement de ce programme, celui-ci s'est trouvé frappé d'une ambiguïté originelle : il était donc logique que celle-ci suscite chez les bénéficiaires la frustration que les rapporteurs ont pu constater sur le terrain.
II. LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME : APPROPRIATION ET DIFFÉRENCIATION TERRITORIALES
A. SUR LE TERRAIN, DES DIFFÉRENCES DÈS LE DÉMARRAGE : UNE MISE EN PLACE À PLUSIEURS VITESSES
Au-delà des outils communs mis au service du programme PVD à l'échelle nationale, la mission a pu relever sur le terrain que de grandes disparités se sont creusées dès le moment où les collectivités bénéficiaires ont été désignées.
C'est à dessein que les rapporteurs utilisent la métaphore cinétique d'une mise en place à plusieurs vitesses : ce vocabulaire a été largement employé dans les échanges avec, par exemple, le témoignage d'un élu de l'Oise qui a évoqué un « sérieux retard à l'allumage » pour sa commune, celui d'une élue du Var pour qui le programme « a pris un train de retard » dans sa collectivité... Cette mise en place différée a creusé ainsi, d'une commune PVD à l'autre, des écarts non résorbables. À titre d'exemple, un élu de l'Eure a décrit la manière dont il a « presque réussi à rattraper les deux ans de retard » pris lors de la mise en place du programme dans sa commune ; toutefois, il précise qu'en dépit de cette « accélération », le dispositif PVD « n'a pas eu le rendement initialement espéré ».
Plusieurs facteurs, parfois cumulatifs, sont à l'origine de ce démarrage plus ou moins rapide :
- des calendriers différenciés de démarrage du programme et de recrutement des chefs de projet. Ce calendrier est parfois tributaire d'un contexte politique compliqué entre la commune labellisée et son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En témoigne un élu rencontré par la mission : « le début a été très poussif, car [la communauté de communes] a piloté le dispositif de manière verticale. La procédure était très lourde, on s'est sentis dépossédés [du programme]. Si j'avais su le temps qu'on mettrait à démarrer, j'aurais été plus égoïste ! » ;
- des disparités territoriales dans la capacité à mobiliser les outils du programme : appels à projets, ORT, OPAH-RU..., notamment dans les territoires les moins dotés en ingénierie ou ceux où l'articulation entre commune et EPCI est la plus complexe sur le plan administratif.
Il ressort cependant que le principal facteur de cette différenciation, souvent à l'origine de tous les autres, est constitué par la difficulté de recrutement et de fidélisation du chef de projet. Dans de nombreuses communes lauréates, l'absence de chef de projet au démarrage du programme a entravé la structuration de la gouvernance locale, le dialogue avec l'ensemble des partenaires et la formalisation du projet de territoire. Cela a mécaniquement ralenti l'accès aux dispositifs d'accompagnement technique et financier.
En outre, la mission a fréquemment rencontré des élus PVD qui ont connu 3, voire 4 chefs de projets différents depuis le lancement du programme, avec à chaque fois des délais incompressibles liés au processus de recrutement, à la formation et à l'acculturation d'un chef de projet aux spécificités du territoire en question et à la montée en compétences de la nouvelle recrue. Un élu de l'Eure qui en était à son quatrième recrutement sur ce poste a déclaré à la mission : « si c'était à refaire, je compléterais le financement qui nous avait été alloué pour le poste de chef de projet » par la Banque des territoires.
Parmi les facteurs susceptibles d'expliquer cette forte mobilité des chefs de projet, la mission relève, outre le niveau de la rémunération proposée, qui correspond souvent au seul montant du financement de la Banque des territoires :
- la forte concurrence entre les collectivités PVD qui ont toutes cherché à recruter en même temps sur le même type de compétences, avec des territoires plus ou moins attractifs ;
- le profil très recherché d'un chef de projet qui soit à la fois polyvalent et technique : un élu de Côte-d'Or a indiqué que leur cheffe de projet était « tellement compétente qu'elle a vite été débauchée » par un autre employeur, un cas de figure relevé à plusieurs reprises lors des déplacements de la mission. Plusieurs chefs de projet varois ont confirmé que cette fonction constituait pour eux « une réelle opportunité professionnelle » et « un vrai plus sur un CV » ;
- le mauvais fonctionnement du binôme élu-chef de projet ;
- la lourdeur du poste pour certains profils peu expérimentés. Une cheffe de projet de l'Eure a ainsi déclaré à la mission : « le fait d'avoir un profil senior m'a aidée pour porter le programme. J'ai pu m'appuyer sur mes expériences professionnelles antérieures ; à l'inverse, j'ai vu des collègues plus jeunes être en grande difficulté ».
À l'échelle nationale, un taux de
vacance de 10 %
et un « turn-over non
quantifié »
Selon le point d'avancement du programme au 31 décembre 2024 établi par l'ANCT, le taux d'occupation des postes de chef de projet s'élevait alors à 90 %. L'ANCT, dans sa contribution écrite, a indiqué « ne pas avoir identifié un profil particulier de villes rencontrant des difficultés de recrutement, les éventuelles difficultés remontées relevant essentiellement de contextes très locaux » ; toutefois, ce dernier point ne concorde pas avec la teneur et l'ampleur des témoignages recueillis par la mission.
En ce qui concerne la forte mobilité au fil du programme, l'ANCT indique avoir « relevé un certain turn-over au cours de l'année 2023, au moment de la signature des conventions-cadres, phase particulière amenant une évolution nécessaire des missions du chef de projet pour passer dans l'opérationnel et le suivi des actions ». Ce turn-over, identifié comme un « signal d'alerte », n'a toutefois « pas été quantifié. »
Un autre élément d'explication de cette forte mobilité émerge des chiffres fournis par l'ANCT. En effet, ceux-ci mettent en lumière la précarité du statut de chef de projet : 75 % des postes correspondent à des CDD, dont 64 % pour une durée inférieure à 3 ans. L'Agence reconnaît ainsi « des difficultés constatées sur la gestion des contrats de chefs de projet, résultant notamment d'un manque de visibilité sur les conditions de la poursuite du programme ».
De manière générale, un point soulevé par l'ANCT qui paraît pertinent est de mettre en regard ces difficultés de recrutement sur les postes de chef de projet avec le contexte général de difficultés de recrutement d'agents publics territoriaux à l'échelle nationale.
B. L'APPROPRIATION DU PROGRAMME PAR LES TERRITOIRES
Le programme « Petites villes de demain » a été initialement conçu comme une « boîte à outils14(*) » et un « cadre souple » mis à la disposition des acteurs locaux (services de l'État et collectivités bénéficiaires) afin d'alimenter la structuration de leur démarche. Dans ce contexte, les rapporteurs relèvent une appropriation très différenciée de l'esprit du programme par les acteurs locaux, fortement dépendante de l'implication institutionnelle et personnelle des différents partenaires ainsi que de la fluidité de leurs relations.
Au sein de ce cadre souple, de nombreuses initiatives locales, tant sur le plan des outils que de la méthode, se sont déployées à l'occasion du programme PVD et ont très favorablement marqué les rapporteurs par leur créativité et leur efficacité quant à l'atteinte des objectifs initialement définis.
Les différentes illustrations qui suivent visent à diffuser, au-delà des cercles de partage de bonnes pratiques animés par l'ANCT15(*), des leviers à fort potentiel susceptibles d'essaimer dans d'autres territoires.
1. Exemple n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans d'action par des outils cartographiques
Parmi les axes méthodologiques proposés aux collectivités PVD par la direction départementale des territoires (DDT) des Alpes-de-Haute-Provence figure l'accent mis sur la représentation visuelle des plans d'action.
Les modalités de représentations qui ont été choisies par les communes, en fonction des finalités du support de présentation ou, très fréquemment, des outils disponibles, sont susceptibles de prendre des formats variés :
- un plan masse, comme à Oraison (figure 1) ;
- une cartographie thématique des projets PVD, comme à Riez (figure 2), ou de l'ORT, comme à Annot (figure 3) ;
- une cartographie à la fois symbolique et thématique, comme à Forcalquier (figure 4) ;
- une carte mentale, comme à Forcalquier (figure 5).
Figure 1 : extrait du périodique municipal « Vivre à Oraison », incluant un plan masse du projet PVD, soit l'aménagement d'un écoquartier de 15 hectares
Figure 2 : cartographie de l'Opération de revitalisation du territoire (ORT) d'Annot, laquelle constitue l'outil conventionnel élaboré grâce à l'ingénierie PVD et qui matérialise la stratégie PVD de la commune
Figure 3 : cartographie des
orientations thématiques des projets PVD de Riez, avec un focus
détaillé et exhaustif sur les projets de revitalisation
du
centre ancien
Figure 4 : carte de synthèse du programme PVD à Forcalquier, avec classification des projets par finalités et par domaine d'intervention
Figure 5 : carte mentale des actions PVD à Forcalquier, associées par axes stratégiques, avec représentation des partenaires institutionnels
Les rapporteurs relèvent le caractère vertueux de ce type d'outils, permettant aux élus de s'approprier un programme conçu à l'échelle nationale et d'y associer une vision stratégique surplombante qui soit à la fois cohérente et concrète. Ces outils synthétiques et faciles d'accès constituent en outre d'excellents supports d'échanges vis-à-vis des interlocuteurs et partenaires du programme. Ils peuvent être utiles pour mettre en place une démarche de consultation et d'association de la population à la conception des projets en amont, comme par exemple à Oraison, où les réunions publiques et groupes de travail participatifs consacrés aux projets PVD ont été animés sur la base des outils visuels élaborés dans ce cadre. Ils permettent également de témoigner de la robustesse d'un projet dans le cadre d'un dialogue institutionnel et partenarial et dans la perspective d'une recherche de leviers de financement.
Cette démarche de représentation visuelle peut se prêter à des finalités variées (voir tableau comparatif ci-après) et paraît à la fois aisément réplicable et particulièrement adaptée pour la structuration d'une vision d'ensemble d'un territoire.
|
Format de présentation |
Avantages associés à chaque type de format |
|
Plan masse |
- permet de visualiser différents zonages et phasages des aménagements envisagés ; - convient aux projets d'aménagement à la fois étendus, localisés et complexes. |
|
Cartographie thématique |
- permet de visualiser l'ensemble d'une stratégie ou d'un support (convention, recueil de fiches actions...) de manière à la fois globale et exhaustive ; - permet de dégager de manière synthétique les principales orientations de la stratégie d'ensemble par la typologie thématique. |
|
Cartographie symbolique et thématique |
- mêmes avantages que pour une cartographie thématique, avec en outre la possibilité de détailler les orientations stratégiques et les finalités associées à chaque projet ; - les pictogrammes associés aux actions offrent une représentation à la fois efficace et valorisante des projets. |
|
Carte mentale |
- permet la représentation à la fois exhaustive et synthétique de l'ensemble des contributeurs et partenaires de chaque axe des fiches actions ; - ce support innovant constitue un support de communication adapté pour des interlocuteurs institutionnels, grâce à la visualisation des leviers juridiques et budgétaires associés. |
2. Exemple n° 2 (Oise) : animer le réseau PVD par des échanges participatifs
L'ensemble des communes et chefs de projets PVD à l'échelle départementale, soit le « réseau PVD », constitue un espace de partage et d'échanges dont la vitalité, voire l'existence, est très variable en fonction des contextes locaux. Cet espace est en cela révélateur de l'appropriation du programme par les élus d'un département, et témoigne du dynamisme de l'émulation au sein d'un territoire.
Différentes formules ont été adoptées par les services de l'État en termes d'animation du réseau PVD. Un choix plutôt fréquent est de mettre en relation les chefs de projet PVD du département et de leur laisser ensuite la possibilité de se réunir s'ils le souhaitent, comme dans le Var. Cette formule souple et horizontale est susceptible, en fonction des dynamiques locales et interpersonnelles, de stimuler les déclinaisons locales du programme. Comme en témoigne une cheffe de projet PVD de l'Eure : « la mise en contact et l'animation de la DDTM nous a permis de pouvoir aller chercher chez les collègues cette dynamique [PVD]. J'ai moi-même copié une de mes homologues pour la mise en place d'une guinguette éphémère au sein de ma commune. »
Une autre formule choisie dans l'Oise consiste à proposer aux collectivités PVD une ambitieuse animation de réseau sur un format participatif et collaboratif, avec des ateliers de travail et de réflexion organisés chaque semestre au sein d'une PVD avec l'ensemble du réseau et axés sur les thématiques du programme (requalification de friches, renaturation de cours d'école, aide à l'installation du commerce...).
Figure 6 : extrait d'un cas pratique sur lequel a travaillé le réseau PVD de l'Oise : la requalification du centre de la ville fictive de « Valrivière »
Ce type d'animation de réseau a encore été encore renforcé par le recours à une facilitation à la fois thématique et formelle pour l'organisation d'une « journée d'inspiration PVD » en mars 2025 sur le thème de l'adaptation au changement climatique. Des animations telles que le sondage instantané sur mobile créant un nuage de mots, classiques dans le domaine de la conduite professionnelle d'ateliers, ont constitué un apport intéressant à la réflexion locale sur le programme, en faisant ressortir de manière hiérarchisée les volets d'action que les élus PVD présents considéraient comme prioritaires (figure 7).
Figure 7 : le nuage de mots
constitué par le résultat du sondage proposé
lors de la
journée d'inspiration PVD de l'Oise
du 7 mars 2025
Un grand avantage de cette animation de réseau dynamique est qu'elle permet de faire le lien entre PVD et d'autres dispositifs, et entre l'aménagement du territoire et d'autres politiques publiques : les services de l'État dans l'Oise associent ainsi les chefs de projet PVD à d'autres comitologies, telles que celle relative à la planification écologique (les COP régionales).
Un programme national dont la réussite repose sur l'État territorial
Dans sa contribution écrite, l'ANCT identifie comme « décisif » et « essentiel » le rôle des services déconcentrés de l'État en matière « d'appui et de portage actif » du programme. L'Agence reconnaît toutefois le poids que cela représente à moyens constants pour les équipes des préfectures et DDT / DDTM en ce que « le coût d'organisation est à la charge des services ».
3. Exemple n° 3 (Var) : disposer au sein des services déconcentrés de l'État d'un maillage territorialisé de référents sur la question de l'ingénierie
La mission a très fréquemment relevé sur le terrain un fort engagement des services déconcentrés de l'État dans l'accompagnement des collectivités bénéficiaires. Toutefois, en complément de l'implication personnelle remarquable des agents des équipes compétentes, la structuration interne de ces services constitue un levier qu'il est possible et pertinent de mobiliser au service d'une politique de cohésion territoriale.
En témoigne par exemple la présence dans l'organigramme de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var de 4 « référents territoriaux », soit un réseau d'interlocuteurs de proximité sur les questions d'ingénierie. La DDTM décrit leur mission de la manière suivante : il s'agit de constituer « l'interface active entre la DDTM et les acteurs du territoire, collectivités, porteurs de projets et sous-préfets d'arrondissements dans tous les domaines nécessitant un portage territorialisé et transversal des enjeux et des politiques publiques16(*). »
Ce maillage (figure 8) se traduit également dans les modalités d'activité des référents, avec une majeure partie de leur temps en itinérance dans les collectivités de leur secteur : les élus concernés ont indiqué aux rapporteurs apprécier cette proximité de leurs interlocuteurs, leur garantissant une fluidité et une qualité des échanges.
Figure 8 : extrait de la plaquette de présentation de la DDTM 83
Cette structuration de l'organigramme de la DDTM offre aux porteurs de projets une complémentarité au guichet unique institutionnel que constitue la sous-préfecture d'arrondissement, avec un appui en ingénierie spécialisée par thème (figure 9). Une telle organisation paraît particulièrement adaptée à des programmes à la fois ciblés et transversaux comme PVD et Action coeur de ville, nécessitant un appui à la fois en ingénierie de projet, en ingénierie administrative et en ingénierie réglementaire et juridique.
Figure 9 : extrait d'une
plaquette intitulée « un écosystème
d'ingénierie
au service des territoires varois »,
présentant les thèmes de compétence
des
référents territoriaux en matière
d'ingénierie
Cette proximité entre porteurs de projet et référents thématiques est bénéfique dans les deux sens : elle permet également, selon les termes de la sous-préfète de Brignoles, Mme Anne-Cécile Vialle, de pouvoir territorialiser l'accompagnement de l'État grâce au statut de « portes d'entrée » que constituent les chefs de projet PVD pour l'État en tant que points de contact privilégiés sur le terrain.
III. LE BILAN « PVD » VU DES TERRITOIRES
A. UN VÉCU LARGEMENT POSITIF POUR LES ÉLUS LOCAUX, MALGRÉ UNE DÉCEPTION QUANT AU FINANCEMENT DU DISPOSITIF
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont recueilli des témoignages particulièrement positifs de la part des élus locaux sur PVD. À titre d'exemple, un élu expérimenté des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré à la mission qu'il s'agissait « sûrement [d'] un des plus beaux programmes que les élus aient eu à gérer, surtout dans des communes qui n'avaient pas nécessairement eu de projets d'envergure auparavant ».
Nombre d'entre eux ont en effet perçu le programme comme une marque de « reconnaissance » de l'État vis-à-vis de leurs communes et, plus largement, de l'importance des petites communes dans la vie quotidienne des Français et dans la cohésion territoriale et la transition écologique, alors que les territoires ruraux expriment souvent le sentiment d'un manque de visibilité dans les politiques publiques en général.
En outre, de manière très concrète, grâce à un accès facilité à des financements et à un accompagnement sur mesure de la part de l'État et de ses opérateurs et partenaires, le dispositif a permis aux communes de porter des projets qu'elles n'auraient, en temps normal, pas eu les moyens de mener à bien.
Pour ne prendre que quelques exemples, des élus locaux et chargés de projets rencontrés par les rapporteurs ont déclaré :
- « PVD nous permet de nous sentir considérés et de faire passer les dossiers au-dessus de la pile » (un élu de Côte d'Or) ;
- « PVD nous permet de bénéficier d'une visibilité renforcée et de mettre en avant nos centres-bourgs, notamment auprès des partenaires administratifs et de l'État » (un élu du Puy-de-Dôme) ;
- « PVD nous permet de bénéficier d'une forme de solidarité, d'avoir la même ambition que des communes plus riches et d'être en mesure de faire, nous aussi, des choses remarquables » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « PVD, et les possibilités de financement associées - notamment l'accès aux fonds européens - a constitué une marque de reconnaissance et de considération » (un chef de projet du Var).
Les rapporteurs observent que le label PVD a également permis de compenser, pour certaines communes, le sentiment d'avoir été lésés par le redécoupage cantonal de 2014. Les élus de nombreuses communes qui bénéficiaient du statut de chefs-lieux de canton avant cette date indiquent que PVD a permis à leur collectivité de retrouver une forme de « fierté » ; un élu local rencontré lors d'un déplacement en Charente estime ainsi que le dispositif a permis à sa commune, ancien chef-lieu de canton, « de revenir dans l'arène ».
Néanmoins, les élus locaux font part d'une réelle déception s'agissant de l'absence d'enveloppe dédiée pour financer le dispositif, au regard de l'annonce initiale du Gouvernement de consacrer 3 Mds€ à PVD.
Ce constat vaut pour la phase amont dédiée aux études préalables, mais aussi pour la concrétisation des projets ainsi que le souligne l'ANCT : « au regard des financements, les élus regrettent une absence d'enveloppe dédiée à la réalisation de projets définis dans les conventions-cadres »17(*).
L'Association des maires de France (AMF), entendue par les rapporteurs, met en avant la même déception :
« Une autre difficulté concerne la mise à disposition de financements dédiés en dehors de financements existants. D'après des élus de l'AMF, hormis le financement d'études par la Banque des territoires (20 000 euros pour Vorey sur Arzon par exemple), les ressources financières de PVD viennent principalement de la DETR.
Il existe donc des craintes quant au financement des actions PVD en dehors de financements dédiés avec un fléchage plus systématique des aides existantes (DETR) vers les collectivités lauréates au détriment des collectivités hors programme.
En outre, certains élus ont signalé à l'AMF que les financements croisés étaient parfois complexes à mettre en place. Par exemple, la région Rhône-Alpes-Auvergne ne finance pas les actions de PVD et les financements européens ne sont pas fléchés.
Par ailleurs l'AMF estime que les modalités d'accès à ces fonds, en réponse aux très nombreux appels à manifestation, ou encore dans le cadre de la nouvelle contractualisation État/collectivités, créent des inégalités d'accès ».18(*)
De même, Intercommunalités de France fustige l'absence de fonds propres dédiés à PVD ainsi que l'accès « non prioritaire » des collectivités aux dotations d'investissement de l'État dans ce cadre, évoquant un « sentiment fort de frustration » des élus. Au total, cet acteur estime que « les crédits mobilités restent trop limités au regard des enjeux » et qu'ils ne « couvrent pas l'ensemble des besoins d'ingénierie, d'acquisition ou de travaux liés aux transformations attendues ».19(*)
Les rapporteurs ont pu constater le caractère largement partagé de cette déception au cours de leurs travaux. À titre d'illustration, un élu d'Isère a ainsi déclaré : « l'État n'est pas au rendez-vous dans son aide en termes d'aides à l'investissement », se plaignant de l'absence de certitudes quant aux subventionnements. Un élu local de l'Oise indique quant à lui : « l'absence de financement dédié nous a fait tomber de haut ». Deux autres élus de ce département évoquent une « déconvenue » et une « déception » liée à l'absence d'enveloppe financière dédiée.
Au-delà du débat de fond sur les modalités de financement du dispositif, les rapporteurs déplorent l'ambiguïté originelle qui a prévalu sur cette question et qui s'est traduite par de nombreuses déceptions et incompréhensions parmi les élus locaux.
B. UN DISPOSITIF PERTINENT ET EFFICACE SELON LES ÉLUS LOCAUX, VÉRITABLE CATALYSEUR DE PROJETS
Les rapporteurs ont recueilli de nombreux témoignages au cours de leurs travaux quant à l'efficacité et à la valeur ajoutée du dispositif. Ces retours d'expérience se répartissent en cinq thématiques.
· Premièrement : PVD permet d'assurer la transversalité et la cohérence globale des projets conduits
De manière très large, les élus locaux ont apprécié le fait que PVD, grâce au co-financement d'un chef de projet et à son approche « sur mesure » et partenariale, permette de concevoir des projets relatifs à des thématiques aussi diverses que transversales mais s'inscrivant dans une vision de territoire, en évitant un phénomène de dispersion.
Les principales thématiques des actions PVD
Quatre thématiques représentent 56 % des actions PVD : l'habitat (mise en place 'd'Opah-RU, opérations de lutte contre la vacance de logement, requalification de friches, etc.), le cadre de vie et l'aménagement urbain (aménagement de rues et places publiques, végétalisation, etc.), la mobilité, la circulation et le stationnement (création de pistes cyclables, voies vertes, études de mobilité, réaménagement de places de parking ou requalifications de voirie) et le commerce (embauche d'un manager de commerce, animation des associations de commerçants, travail sur les vitrines de centre-ville, création d'un schéma d'accueil de commerçants, etc.).
Néanmoins, la faible représentation de certaines thématiques peut s'expliquer par des facteurs intrinsèques au programme. En effet, les projets PVD étant eux-mêmes caractérisés par une forte transversalité, certaines actions classées dans ces quatre catégories relèvent parfois d'autres catégories : à titre d'exemple, les actions relatives à la transition écologique peuvent être classées parmi les projets liés à l'habitat, à la mobilité, à la végétalisation ou encore à la transition énergétique.
Le diagramme ci-après présente la répartition des actions PVD par thématique principale.
Source : ANCT
Il ressort que la méthode de travail associée à PVD a été particulièrement pertinente : grâce aux études et diagnostics préalables, au travail des chefs de projet et avec l'appui des nombreux partenaires du programme, PVD a aidé les élus locaux à se poser les « bonnes questions » pour l'avenir de leur territoire et à définir pour ce dernier une stratégie globale structurante. Dans les communes dans lesquelles des projets étaient déjà identifiés, le dispositif a permis de les inscrire dans une réflexion globale, tournée vers le long terme, et de passer à l'étape de la mise en oeuvre concrète en s'appuyant sur une méthodologie précise.
À titre d'exemple, les rapporteurs ont recueilli les témoignages suivants :
- « PVD permet de donner du sens aux actions conduites et une vision globale » (un élu du Var) ;
- « PVD a permis de réaliser une ORT et le dispositif est devenu le fil conducteur de nombreux projets » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « PVD nous a permis d'avancer sur des sujets qui étaient identifiés mais sur lesquels nous n'étions pas armés, tout en ayant une vision globale et concertée et en apportant de la cohérence » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « PVD nous a obligés à réfléchir à une colonne vertébrale pour notre territoire » (un élu du Var) ;
- « PVD nous a apporté une méthode et une organisation, tout en permettant à des partenaires de se pencher sur des territoires auxquels ils s'intéressaient peu auparavant » (un élu de Charente).
Un maire d'Isère a également indiqué : « le dispositif permet de prendre de la hauteur sur les projets communaux et il nous pousse à travailler à une échelle globale et sur le long terme. Il s'agit d'élaborer un vrai projet de territoire, une trajectoire pour les années à venir »20(*).
· Deuxièmement : la valeur ajoutée de l'accès à l'ingénierie permis par PVD
Les élus locaux rencontrés par les rapporteurs sont unanimes - à quelques exceptions près - quant à la valeur ajoutée que représente PVD en matière d'accès à l'ingénierie à travers la réalisation d'études via les marchés à bon de commande des opérateurs et, surtout, le recrutement de chefs de projet. Ce constat est d'autant plus marqué que les communes rurales pâtissent d'un considérable manque de ressources en la matière, dont il résulte des difficultés à concevoir et mener à bien des projets et à mobiliser des financements. Ainsi, certains élus ont déclaré :
- « en matière d'ingénierie sur le plan financier, de l'urbanisme et sur le plan technique, nous sommes un peu démunis ; les maires ont des projets mais ils ne sont pas des techniciens de l'urbanisme ni des financiers ; si nous n'avons pas de techniciens auprès de nous, nous ne pouvons mener à bien nos projets » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « avant, j'avais des projets mais il n'y avait pas le déclic, dès que le chargé de projet est arrivé, on a eu la technique, le suivi, l'ingénierie ; aujourd'hui, on est en train de réaliser des projets qui étaient dans les placards depuis plusieurs années ; on ne pourrait pas se passer du chargé de mission » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « on n'aurait pas été capables de mener nos projets si on n'avait pas eu l'appui PVD, à travers l'ingénierie et l'appui financier, c'est un plus que les communes rurales ne peuvent pas avoir toutes seules. Pour la construction du projet et son engagement, la recherche de subventions, il est déterminant d'avoir un chef de projet » (un élu du Var) ;
- « notre chef de projet nous a permis de matérialiser nos idées. On avait les idées et le programme qui nous a aidés. L'ingénierie a été indispensable » (un élu de Côte d'Or) ;
- « PVD nous a permis de réaliser des études jusqu'au stade opérationnel [...] et d'enclencher une vraie dynamique en matière de réflexion auprès des élus, en association avec différents partenaires et acteurs du département (CD63, Aduhme21(*), établissement public foncier, État, ANCT, EPCI...) mais aussi avec les acteurs locaux. Cela a également permis de travailler en réseau, de bénéficier d'expertise, de retours d'expériences et d'engager un vrai process de concertation participatif avec les habitants, les associations locales, les acteurs économiques... » (le maire de Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme) ;
- « bien que le programme ne prévoie pas d'enveloppe financière propre au programme, la capacité à mobiliser les financements de droit commun (DSIL, DETR, fonds vert, fonds régional), n'a été possible que grâce à la veille et au suivi des dossiers par une personne dédiée. Au-delà des financements, l'ingénierie de projet apportée par la Banque des territoires à travers notamment ses marchés à bon de commande a constitué le déclencheur du programme d'actions en produisant rapidement un plan-guide d'aménagement et une étude sur l'état de santé du commerce dans le village. [...] Les acteurs locaux et nationaux, les outils techniques et financiers sont déployés sur l'ensemble du territoire, mais leur mobilisation concrète au service d'un périmètre à enjeux n'est possible que par la mise en place d'un dispositif animé par un chef de projet, et porté politiquement par une équipe municipale rassemblée autour d'un programme de revitalisation globale » (contribution écrite de Jean-Marc Delia, sénateur des Alpes-Maritimes et élu de Saint-Vallier-de-Thiey) ;
- « le chef de projet est le “rouage essentiel” de la réussite de PVD » (un élu de Charente).
· Troisièmement : PVD comme « catalyseur » et « accélérateur », créateur d'une « alchimie »
PVD est également présenté comme un véritable catalyseur pour la conduite des projets des communes labellisées, grâce à l'appui en ingénierie proposé et au fonctionnement multi-partenarial du programme :
- « PVD est un catalyseur d'énergies, il permet de visualiser les enjeux et de ne pas se disperser. PVD simplifie, catalyse ; grâce à l'aide de tout le monde, on démultiplie l'efficacité » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « PVD nous a permis de travailler de façon structurée, avec l'aide des partenaires, et d'avancer ; les projets PVD sont de bien meilleure qualité que ceux auxquels on serait parvenus sans le programme » (un élu de Charente) ;
- « les centres anciens sont désertés et se paupérisent, c'est un casse-tête. PVD permet de “faire monter la mayonnaise” avec tous les partenaires » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « PVD est un accélérateur de particules ; il faut qu'on soit au rendez-vous de la confiance qui nous a été accordée quand on nous a sélectionnés et appuyés » (un élu de l'Eure).
· Quatrièmement : PVD constitue souvent la pierre angulaire d'un mandat
Lancée en 2020 pour six ans, la temporalité de PVD a été alignée sur celle du mandat municipal. De fait, nombre d'élus entendus par les rapporteurs ont souligné l'intérêt de cette concordance :
- « PVD a été le moment fort de notre début de mandat, il nous a permis de définir une vision municipale et d'en déduire notre projet pour ce mandat et le suivant » (un élu de l'Eure) ;
- « PVD constitue la pièce maîtresse de notre mandat » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « notre mandat s'est construit sur PVD ; nous avons fait de nombreuses études, le prochain mandat sera celui de l'aboutissement de ces projets » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « avant PVD, nous étions dans le général ; PVD nous a permis de structurer pour ce mandat un projet concret et généreux avec 50 fiches-action opérationnelles » (un élu de l'Eure) ;
- « j'ai été élu en 2001, mais PVD a fait une grosse différence sur ce mandat-ci » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence).
· Axe n° 5 : un besoin de continuité et de visibilité
En définitive, les élus locaux rencontrés par les rapporteurs réclament un prolongement du dispositif au-delà de mars 2026 afin de pouvoir concrétiser leurs projets et mener à bien la phase opérationnelle du programme. Ils déclarent ainsi :
- « on arrive dans la phase opérationnelle, cela devient enfin concret pour les habitants, après une phase plus abstraite consacrée à la réalisation d'études » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « nos élus attendent de pouvoir entrer dans la phase concrète du programme » (un DGS d'une commune PVD de l'Oise) ;
- « dans ce mandat, nous avons mené beaucoup d'études et de réflexions, le prochain mandat sera l'aboutissement de ces projets et du suivi » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence) ;
- « PVD nous a permis de mieux capter les appuis mais là on est dans le concret ; si nous n'avons plus de chef de projet dédié, le projet rentrera dans un placard et n'en sortira plus » (un élu des Alpes-de-Haute-Provence).
Ce sentiment d'inachevé illustre le fait que la plupart des collectivités concernées ne sont qu'à la moitié du gué à l'approche de la fin du programme, telle que par exemple la commune de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise22(*) :
En synthèse, le nuage de phrases ci-après présente les principaux propos d'élus locaux recueillis par les rapporteurs concernant le dispositif.
C. DES POINTS DE DIFFICULTÉ SIGNIFICATIFS
1. Les relations institutionnelles et politiques entre les communes et les EPCI
Plusieurs témoignages recueillis par la mission d'information ont fait état de fortes crispations et de tensions entre certaines intercommunalités et communes bénéficiaires, avec des propos parfois très virulents : « le seul problème du programme, c'est la “ComCom”` » ; « quand le chef de projet est rattaché à l'interco, ça coince » ; « politiquement parlant, le programme n'a pas marché ».
Même lorsque la situation n'est pas aussi dégradée, les relations entre les différentes entités du bloc communal, selon que le chef de projet est rattaché à la commune ou à l'intercommunalité, apparaissent souvent inconfortables, même si cette situation n'est pas toujours insurmontable, comme en témoigne une élue du Var : « au début, l'articulation entre commune et interco a posé des difficultés ; par exemple, cela a bousculé les calendriers respectifs, notamment dans le schéma de mobilités. Au début, c'est nous qui étions en position de demandeurs par rapport à cette dynamique, mais maintenant, nous sommes en position de moteurs pour toute l'interco. Grâce au succès de projets tels que la définition du Plan alimentation durable ou du Schéma tourisme, on peut valoriser notre démarche PVD. Maintenant l'interco comprend [l'intérêt du dispositif], alors qu'au début ils disaient qu'il n'y en avait que pour nous ».
Ces difficultés fréquentes dans les relations entre commune et EPCI trouvent leur origine logique dans l'ambiguïté du programme dès sa conception. En effet, celui-ci se focalise sur une centralité selon le constat documenté qu'elle « irrigue le territoire rural aux alentours » et que « les habitants des territoires ruraux accèdent à un certain nombre d'équipements et de services en se rendant dans une PVD23(*) ». Cependant, cette focalisation du dispositif sur la centralité crée le risque de polariser les relations avec les territoires perçus de facto comme périphériques. Par ailleurs, l'effet du programme sur les territoires qui jouxtent les PVD n'est quant à lui pas documenté : les indicateurs de suivi et d'évaluation du programme ont ainsi été conçus à la seule échelle de la commune PVD.
2. La coopération entre certains financeurs
Les témoignages recueillis font souvent état d'un manque de coordination, voire d'une attitude non coopérative entre certains financeurs. Le constat est très fréquent de calendriers non concordants en matière de recherche de financements, voire, comme le relève un élu, de calendriers « concurrents et non cohérents » : « les critères choisis par la Région [en matière de petites centralités] ne sont pas les mêmes que pour PVD. Nous sommes obligés de remettre sans cesse à plat notre projet pour le faire rentrer dans les cases et cela nous retarde ».
Dans un département au sein duquel la mission s'est déplacée, les services de l'État ont indiqué « avoir relevé que les élus déplor[ai]ent le temps que prenait la sollicitation de chaque financeur un par un. Nous avons en conséquence formulé la proposition d'un comité des financeurs locaux, où l'on s'accorderait ensemble en examinant les projets un par un. Mais la Région n'a pas souhaité donner suite à notre proposition, et pour le Département nous ne mutualisons les réunions que sur certains sujets. Il s'agit d'un axe d'effort évident, qui simplifierait le processus et ferait gagner beaucoup de temps ».
D. PVD ET LA QUESTION DU TEMPS LONG EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. PVD « dégage du temps pour réfléchir »... mais cela « prend du temps »
La question de la temporalité et du long terme a constitué un point récurrent des témoignages recueillis par la mission : selon la formule d'un élu de l'Eure, « PVD nous a donné du temps, le temps de nous poser et de structurer notre vision de l'avenir ».
Cette vision porte sur des sujets structurants et de long terme, comme en témoigne par exemple une cheffe de projet de l'Oise qui a détaillé à la mission « 31 actions s'étendant au-delà de 2030 » qui ont émergé grâce à son travail dans le cadre du programme PVD (voir ci-après, figure 10).
Figure 10 : la nécessité du temps long : le calendrier prévisionnel associé à une fiche-action formulée dans l'Oise dans le cadre de PVD. Cette fiche-action portant sur les entrées de ville s'inscrit dans les priorités stratégiques « nature en ville » et « transition écologique » de la commune concernée
Source : fiche-action d'une commune PVD transmise à la mission d'information
Comme en témoigne un autre chef de projet de l'Oise : « il nous faut du temps pour monter les projets, car plus on avance dans la réflexion et plus on s'aperçoit que ce sont [des champs d'action] complexes », notamment pour les projets de grande ampleur.
Quelques facteurs qui « prennent du
temps » :
le témoignage de la commune de
Forcalquier
Sollicitée par la mission d'information sur la nature des projets PVD restant à réaliser, à moins d'un an du terme fixé pour le programme la commune de Forcalquier a adressé aux rapporteurs la contribution écrite suivante :
« Si nous faisons le tour de tous les projets, ces derniers seront réalisés à 90 %.
En revanche, d'ici mars 2026, il restera quelques projets qui n'ont pas encore pu aboutir pour 4 raisons :
- le temps : les projets complexes et structurants nécessitent du temps ;
- la non-maîtrise du foncier : les négociations et démarches sont longues ;
- l'absence ou le partage de compétences - par exemple, sur la mobilité ;
- la recherche de coûts maîtrisés.
Par exemple :
- le projet d'extension de la zone d'activité : les négociations sont longues pour acquérir les parcelles ;
- la création de l'hôtel d'entreprise était conditionnée par la disponibilité foncière (projet en cours, s'inscrivant dans le temps long) ;
- la cuisine centrale : les scénarios préconisés par les assistances à maîtrise d'ouvrage (AMO) sont très ambitieux ; aussi, nous avons besoin de temps supplémentaire pour chercher une solution alternative, toujours localement, dans le respect de la loi Égalim, mais avec des coûts plus maîtrisables ;
- les liaisons douces : si nous pouvons agir localement sur un petit périmètre (ce que nous avons pu faire), les liaisons structurelles sur des axes plus importants ne relèvent pas de la collectivité. C'est au département de prioriser, et aux vues des nombreuses routes, ponts et du coût de ce type de travaux, le sujet est complexe et chronophage.
[...]
Les projets engagés seront terminés à horizon mars 2026. Les nouveaux, ou ceux qui nécessitent plus de temps de par leur complexité, sont travaillés sur le seul plan technique, en attendant les directives du prochain mandat. »
2. Comment les PVD perçoivent leur avenir
Les PVD pour lesquelles le vécu a été le plus positif ont pu s'appuyer sur la réussite locale de la dynamique pour se projeter vers l'avenir de manière optimiste et confiante : selon un élu PVD des Alpes-de-Haute-Provence, « le monde rural a bel et bien un avenir, et nous y oeuvrons en travaillant de manière prioritaire sur le logement, afin d'accueillir de futurs habitants ». Un autre élu du même département évoque son « ambition d'ouvrir une cité millénaire aux usages du XXIe siècle ».
La question de l'adaptation du cadre de vie (aux nouveaux usages, au dérèglement climatique...) a en effet pris de l'ampleur au fil du programme par rapport à la question du rattrapage socio-économique qui avait été mis en avant à l'origine. Cette évolution de la manière de concevoir la finalité du programme est visible dans les termes de la circulaire transmise aux préfets le 24 mai 2023 par la ministre d'alors Dominique Faure :
« Pour répondre efficacement aux transitions écologiques, démographiques et économiques auxquelles nous sommes confrontés, l'ensemble de nos outils de politiques publiques doivent être mobilisés. Le programme Petites villes de demain doit donc désormais intégrer, chaque fois que possible, les enjeux liés à ces transitions ».
Le lien est d'ailleurs établi par certains élus PVD entre la confiance en l'avenir induite par le programme et la confiance des citoyens dans la capacité de l'action publique à changer leur quotidien : selon un élu de l'Eure rencontré par la mission, le programme permet de « présenter des projets sérieux et de les mettre en oeuvre : en cela, il permet une crédibilisation de l'action publique ». De même, selon le maire de Bresles, dans la contribution écrite qu'il a adressée à la mission d'information : « au vu du contexte des finances publiques et de la difficulté à mobiliser de l'ingénierie efficiente [et] sachant que les collectivités de notre strate sont les dernières représentations qui permettent l'investissement public pour l'amélioration du quotidien des habitants, il serait nécessaire de reconduire le programme. Il permettra de consolider le développement territorial de nos villes pour accueillir les nouveaux usages et les prochaines générations de Breslois ».
IV. QUEL HÉRITAGE POUR PVD APRÈS 2026 ?
A. L'APRÈS MARS 2026 : COMMENT CONCLURE LE CYCLE PVD ?
Après six ans de mise en oeuvre, le programme PVD doit arriver à échéance en mars 2026, soit quelques mois après la publication du présent rapport. Or, selon les chiffres transmis par l'ANCT, au 31 décembre 2024, seules 20 % des actions prévues par les conventions-cadres PVD étaient d'ores et déjà livrées. Si 36 % sont engagées, 17 % sont encore en phase d'étude préalable et 19 % n'avaient pas encore démarré au 31 décembre 2024 (cf. graphique ci-après).
Source : point d'avancement du programme au 31 décembre 2024 établi par l'ANCT
80 % des actions prévues par les conventions-cadres n'ont donc pas encore pu se concrétiser. Ces chiffres s'expliquent par la longueur des délais qui ont été nécessaires, d'une part, au lancement du programme (recrutement du chef de projet et élaboration puis signature de la convention-cadre) et, d'autre part, à la conduite de la phase d'études préalables.
Alors que le dispositif doit arriver à échéance en mars 2026, les rapporteurs soulignent, dans un souci d'efficacité, l'importance de ne pas y mettre un coup d'arrêt : il importe d'accompagner les collectivités labellisées jusqu'à la concrétisation de leurs projets.
De manière unanime, les élus locaux et chefs de projets dont les témoignages ont été recueillis par les rapporteurs appellent à prolonger le co-financement des chefs de projet au-delà de mars 2026, pour permettre aux communes PVD d'achever - voire d'entamer dans de nombreux cas - la phase opérationnelle du programme et ne pas freiner la dynamique enclenchée :
- « après les études, nous entrons désormais dans la phase opérationnelle et nous avons besoin d'un accompagnement » (un élu du Puy-de-Dôme) ;
- « la reconduction de l'ingénierie est nécessaire ; sinon, il y aura une rupture dans la mise en oeuvre de nos actions » (un élu de l'Oise) ;
- « nous avons besoin de temps, nous devons pouvoir poursuivre nos projets » (un élu de l'Oise) ;
- « nous commençons tout juste à entreprendre les travaux, il serait dommage de couper cet élan » (un élu du Loir-et-Cher) ;
- « il est essentiel que le soutien au financement de postes de chefs de projet persiste afin que nous puissions mener à bien les projets structurants qui ont été identifiés dans les plans guides et les ORT » (un élu des Alpes-Maritimes) ;
- « la pérennisation de l'ingénierie est la clé de la réussite, il faut conserver ce travail partenarial pour la seconde phase de PVD, sans quoi les plans-guide que nous avons élaborés lors de la première phase resteront lettre morte » (un représentant de la région Nouvelle-Aquitaine) ;
- « la première phase a permis de faire émerger un projet de territoire et une dynamique, il faudra une deuxième phase pour entrer dans l'opérationnel » (un chef de projet de l'Oise).
Selon une enquête24(*) menée par l'association des petites villes de France en 2025 sur le programme Petites villes de demain, 93 % des maires interrogés souhaitent une reconduction du programme sur la prochaine mandature.
Le 13 juin 2025, François Bayrou, alors Premier ministre, avait annoncé la poursuite du programme au-delà de 2026, sans toutefois en préciser les modalités. Néanmoins, le contexte actuel d'instabilité gouvernementale fait peser des incertitudes sur ces annonces.
Les rapporteurs estiment essentiel de maintenir la dynamique de revitalisation initiée. Dès lors, ils préconisent de maintenir au-delà de 2026 le label « PVD » pour les communes qui en ont bénéficié ainsi que le co-financement des postes de chefs de projet qui y est associé. Compte tenu des chiffres relatifs à l'avancement des projets et des contraintes budgétaires pesant aujourd'hui sur la France, un prolongement de ce co-financement pour une durée de deux ans leur semblerait adéquat.
Recommandation n° 1 : Conserver le label « PVD » pour les communes en ayant bénéficié et prolonger le co-financement des chefs de projet de deux ans afin d'assurer la concrétisation des projets lancés (acteurs concernés : État et ses opérateurs).
B. FAIRE VIVRE L'« ESPRIT PVD » : DES « PETITES VILLES » AUX « TERRITOIRES DE DEMAIN »
Le programme PVD a incontestablement produit des résultats particulièrement positifs : il a permis d'outiller des petites villes dans la conception et la concrétisation de leurs projets de territoire, de conforter leur rôle dans l'équilibre territorial et la transition écologique, mais aussi de diffuser en leur sein une culture et une méthode de travail précieuses pour réfléchir à leur avenir et conduire des actions structurantes sur leur territoire.
Aussi, les rapporteurs estiment indispensable, au-delà de l'arrivée à échéance du dispositif qu'ils envisagent en 2028, de continuer à faire vivre l'esprit et la méthode de travail « PVD » et de l'essaimer à une échelle territoriale plus vaste. Dès lors, ils souhaitent que les territoires volontaires et souhaitant mener à bien des projets structurants et tournés vers l'avenir puissent continuer à bénéficier d'un accompagnement à cette fin : selon les cas, les intercommunalités ou les pôles d'équilibre territorial et rural (PETR) pourraient créer des postes de chefs de projet - le cas échéant en recrutant d'anciens chargés de mission PVD de leur territoire - afin d'accompagner les communes de leur ressort dans la conduite de leurs projets. Cette démarche, qui pourrait bénéficier de l'appellation de « Territoires de demain », permettrait d'entériner et de pérenniser les acquis de l'expérience PVD.
Afin d'assurer la bonne articulation entre PVD et cette nouvelle démarche, les communes labellisées PVD souhaitant la rejoindre seraient invitées à remettre, en 2028, aux services de l'État dans le département un livrable présentant la manière donc elles pourraient s'insérer dans un « Territoire de demain » et les projets qu'elles pourraient conduire dans ce cadre.
Recommandation n° 2 : À partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit « PVD » en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants (acteurs concernés : État et ses opérateurs, services déconcentrés et élus).
C. LES MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT DES « TERRITOIRES DE DEMAIN »
1. Garantir la coopération de l'ensemble des acteurs
La coopération de tous les acteurs sera absolument déterminante pour la réussite de la démarche « Territoires de demain » : services de l'État, différents échelons de collectivités, partenaires institutionnels et financiers... Comme l'ont formulé à plusieurs reprises les élus locaux rencontrés : en ce qui concerne la difficulté à mettre en place un comité unifié des financeurs locaux, « mettre tout le monde autour de la table » constituerait un « gain de temps » significatif et un levier de simplification majeur pour favoriser l'émergence de projets structurants et une réflexion sur l'avenir des territoires concernés.
Un élément autour duquel pourrait se fédérer l'ensemble des acteurs et partenaires concernés serait l'élaboration conjointe d'un diagnostic partagé de territoire. Cette démarche réflexive et prospective pourrait précisément partir de la base qui avait été élaborée à l'échelle des PVD lors de la convention valant opération de revitalisation de territoire (ORT), comme l'illustre par exemple le diagramme suivant, issu d'une des conventions ORT dont les rapporteurs ont pu prendre connaissance :
Source : extrait de la convention valant ORT d'une
commune PVD,
transmise à la mission d'information
L'objectif serait à la fois d'élargir l'échelle du diagnostic et que la réflexion correspondante puisse fédérer l'ensemble des acteurs concernés.
Sur la base de ce diagnostic de territoire partagé, pourrait ainsi émerger la comitologie de chaque « Territoire de demain ». Cette comitologie serait coconstruite à l'échelle locale, en fonction des contextes et des particularités locaux, sur une proposition des services de l'État qui s'appuierait sur les conclusions du diagnostic.
Le comité « Territoire de demain » constitué selon ces modalités aurait pour vocation d'aiguillonner et d'évaluer la maturité et la qualité de la vision d'avenir des territoires concernés. Il lui incomberait également le rôle d'un comité de revue de financements, lequel serait chargé : d'étudier la faisabilité économique et budgétaire des projets structurants ; de garantir que les projets élaborés et sélectionnés sont finançables, à quelle échéance, et selon quelles modalités de financement ; de coordonner les leviers de financement, et notamment les fonds structurels européens.
Recommandation n° 3 : À partir d'un diagnostic de territoire partagé, appuyer la démarche « Territoires de demain » par la co-construction, sur la base d'une proposition initiale formulée par les services de l'État, d'une comitologie adaptée aux particularismes et contextes locaux (acteur concerné : services déconcentrés de l'État et ensemble des acteurs et partenaires compétents).
2. Apporter un soutien volontariste à l'ingénierie publique existante
Dans le contexte dégradé qui caractérise les finances publiques, les rapporteurs estiment qu'il est primordial d'optimiser le soutien public apporté à l'ingénierie. En ce sens, le recours à des prestations de conseil via des marchés nationaux à bon de commande paraît moins efficient que le recours à l'écosystème d'ingénierie publique qui existe déjà sur les territoires. Ces prestations, souvent gratuites pour les communes bénéficiaires (comme dans le cas des CAUE), présentent en outre l'avantage d'être familières des spécificités locales.
Ces nombreux outils publics existants, performants, sont souvent structurés à l'échelle départementale et reflètent la variété et la pluralité des contextes au sein des territoires. Ils peuvent résulter d'interventions internes du conseil départemental, qui mobilise des organes qu'il soutient financièrement ou des organismes dédiés (sociétés d'économie mixte, sociétés publiques locales...).
En particulier, les CAUE, investis par la loi d'une « mission d'intérêt public » (cf. supra), déploient une expertise, notamment sur la notion de projet, qui en fait des pôles d'ingénierie qui méritent d'être consolidés, au vu de la plus-value certaine et de l'efficience de leur action au sein de dispositifs tels que PVD.
Ces instances sont néanmoins confrontées à de graves difficultés de financement (cf. encadré ci-après), liées à la récente réforme de la taxe d'aménagement. À plus long terme, leur modèle de financement, qui repose pour l'essentiel sur cette taxe, pourrait en outre être fragilisé par la mise en oeuvre du dispositif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) prévu par la loi dite « Climat et résilience »25(*) de 2021.
La situation financière préoccupante des CAUE
Les CAUE sont financés en grande partie par la part départementale de la taxe d'aménagement, qui représente en moyenne 80 % de leurs ressources financières. Or, la collecte de cette taxe rencontre de graves dysfonctionnements depuis septembre 2022.
En application de l'article 155 de la loi de finances initiale pour 2021, le paiement de la taxe est désormais dû dans les trois à neuf mois suivant la date d'achèvement des constructions ou aménagements, et non plus lors de la déclaration de permis de construire. De plus, les modalités de perception de la taxe ont fortement évolué : désormais l'ensemble des opérations de liquidation et de recouvrement échoient aux services fiscaux de l'État (directions départementales des finances publiques) dans un contexte dégradé de baisse des effectifs et de dysfonctionnements des outils métiers correspondants. Enfin, le ralentissement de l'activité du secteur de la construction conduit à une érosion de la base taxable, ce qui réduit en conséquence le montant de la recette fiscale.
Compte tenu de ces difficultés, en trois ans, le montant de la taxe d'aménagement perçu par les départements a diminué de deux tiers, selon les estimations communiquées à la mission d'information par la FNCAUE. De fait, cette situation fragilise les ressources des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE). Selon la FNCAUE, compte tenu de ces difficultés, seuls 154 M€ de taxe d'aménagement avaient été reversés aux départements au 31 août 2025 depuis le début d'année, un montant qui s'élevait, à titre de comparaison, à 352 M€ en 2024 et à 591 M€ en 2023.
Dans ce contexte, selon cet acteur, certaines structures ont vu leurs ressources issues de la taxe diminuer de plus de moitié en 2024 ce qui, de fait, menace leur existence. Ainsi, le CAUE de la Manche serait menacé de liquidation et d'autres CAUE risqueraient la cessation de paiement ; par ailleurs, plusieurs CAUE ont dû procéder à des suppressions de postes (77 entre début 2024 et mi-2025).
Les rapporteurs jugent cette situation particulièrement alarmante pour l'avenir de l'ingénierie publique locale et appellent le Gouvernement à trouver rapidement des solutions pour sortir de la crise.
Source : Commission, d'après FNCAUE
On peut également relever d'autres structures bénéficiant elles aussi d'un statut associatif, telles que les agences d'urbanisme, dont l'action au sein du programme PVD illustre la pertinence pour les territoires qui en bénéficient.
Les agences d'urbanisme, des structures d'ingénierie publique mutualisée
Les agences d'urbanisme sont des outils de réflexion commune aux élus d'une même agglomération, et de concertation entre les collectivités territoriales et les administrations. Elles constituent une expérience originale par leur structure même, leur mode de fonctionnement et l'évolution des pratiques d'urbanisme qu'elles ont favorisées.
On compte aujourd'hui 53 agences d'urbanisme rassemblées dans un réseau national permettant d'échanger les expériences et de capitaliser les savoir-faire. Chaque agence est différente mais elles réunissent en général les communes et les communautés, les EPCI spécialisés (SCOT, AOT...), la région et le département, l'État et ses services déconcentrés, les chambres consulaires, l'université, le port, les établissements publics, etc.
Dotées d'un statut associatif, leur gouvernance repose sur un conseil d'administration rassemblant les principaux membres, qui décident, collectivement, du programme de travail, à charge pour un comité technique partenarial d'en assurer le suivi. Elles sont principalement financées par les cotisations et subventions de leurs membres.
Elles regroupent des équipes pluridisciplinaires qui travaillent en amont des projets dans la préparation et la planification d'une stratégie en matière d'aménagement.
Il existe, en complément, de nouveaux outils d'ingénierie déployés au niveau départemental, destinés aux petites collectivités victimes de la disparition des prestations autrefois fournies par les anciennes DDE et DDA : les agences techniques départementales, souvent constituées en EPA ; les sociétés publiques locales (SPL) ; les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA)...
L'ensemble de ces structures témoignent du dynamisme et de la diversité d'une ingénierie publique bien implantée localement. Les rapporteurs estiment en ce sens qu'il est primordial d'optimiser le soutien à l'ingénierie en privilégiant l'ingénierie publique existante. Ceci impliquerait, pour l'entité qui sera chargée de piloter au niveau national la démarche « Territoires de demain », de ne pas reconduire à l'identique les marchés nationaux à bon de commande qui avaient été conclus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires à hauteur de 10 millions d'euros. À l'inverse, une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique pourrait être apportée aux territoires afin qu'ils puissent favoriser le recours à l'ingénierie publique existante au niveau local dans leurs appels d'offres, tout en respectant le code de la commande publique.
En ce qui concerne l'échelle locale, de nombreuses initiatives sont mises en place par les services déconcentrés de l'État pour mieux faire connaître les ressources locales existantes en matière d'ingénierie : la mise en place d'un guichet unique de l'ingénierie depuis l'instruction ministérielle du 28 décembre 2023 ; la réalisation de nombreuses cartographies des ressources locales existantes en matière d'ingénierie...
Toutefois, comme le reconnaissait en mars 2025 la ministre déléguée chargée de la ruralité26(*) d'alors, Françoise Gatel, la « finalisation » de ces cartographies demeure un objectif à atteindre. À l'inverse, un exemple de ce type de recensement achevé qui a semblé particulièrement efficace aux rapporteurs privilégiait une typologie des besoins rencontrés en matière d'ingénierie plutôt qu'une typologie des acteurs locaux de l'ingénierie (figure 11). Il a ainsi semblé aux rapporteurs que la présentation choisie répondait mieux aux préoccupations des élus locaux, et que les cartographies qui restaient à finaliser dans d'autres départements pourraient utilement adopter la même méthodologie en deux temps : en premier lieu, le type de besoin rencontré ; puis, en correspondance, les prestations existantes dans ce domaine d'activité, classées en fonction de chaque étape du projet.
Figure 11 : le mode d'emploi du « guide de l'ingénierie territoriale » élaboré par les services de l'État dans les Alpes-de-Haute-Provence. Chaque fiche est structurée selon la double entrée : « quel est votre besoin ? »/« comment pouvons-nous vous aider ? ». Cette seconde entrée est elle-même structurée selon chaque phase du projet : définition du besoin ; élaboration du cahier des charges ; étapes réglementaires préalables ; plan de financement du projet ; suivi de la réalisation du projet.
Recommandation n° 4 : Apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique aux « Territoires de demain » afin que le recours local à l'ingénierie puisse s'appuyer prioritairement sur l'ingénierie publique existante, tout en respectant le code de la commande publique (acteur concerné : entité qui pilotera au niveau national la démarche « Territoires de demain »).
Recommandation n° 5 : Établir à destination des élus « Territoires de demain » un recensement exhaustif de l'ingénierie publique existante sur le territoire (acteur concerné : services déconcentrés de l'État).
D. DES
« TERRITOIRES DE DEMAIN » À LA
« CONTRACTUALISATION
DE DEMAIN »
En termes de calendrier, la séquence 2026-2027 constituera un jalon structurant pour l'aménagement du territoire. Elle correspond en effet au terme prévu pour de nombreux dispositifs de contractualisation et documents de planification locale : les contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) ; les contrats de plan État-Région (CPER) ; les programmes « Action coeur de ville », « Territoires d'industrie » et « Villages d'avenir »...
En ce sens, la fin du cycle « Petites villes de demain » constitue une opportunité de mise en cohérence de l'ensemble de ces outils et de constitution d'une vision pluriannuelle des financements disponibles pour les projets d'avenir structurants.
Les rapporteurs estiment par ailleurs qu'il est stratégique que les dispositifs contractuels qui seront élaborés pour la prochaine séquence puissent répondre pleinement aux enjeux d'avenir, et en particulier celui de l'adaptation aux conséquences déjà visibles du dérèglement climatique. Ce thème au coeur des préoccupations des élus locaux a fait l'objet d'une montée en puissance notable au fil du déploiement du programme PVD : la Banque des Territoires comme le Cerema ont indiqué aux rapporteurs avoir relevé une demande croissante formulée en ce sens par les porteurs de projets PVD.
Ainsi, comme l'ont déjà perçu la majorité des élus PVD, l'adaptation climatique constitue un enjeu transversal à intégrer de manière prioritaire dans l'ensemble des domaines d'action qui caractériseront la réflexion que les territoires ruraux doivent développer sur leur avenir. Il est donc nécessaire que les dispositifs contractuels de demain soient explicitement articulés avec la démarche de territorialisation de la planification écologique et en particulier les COP régionales mises en place depuis 2024 sous l'égide du Secrétariat général à la transition écologique (SGPE), lesquelles ont intégré depuis 2025 l'adaptation climatique comme un axe d'action transversal.
Recommandation n° 6 : Profiter de la fin du cycle PVD pour une mise en cohérence globale de l'ensemble des dispositifs de contractualisation et de planification locaux (acteur concerné : État).
Recommandation n° 7 : Renforcer la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de manière transversale, dans tous les territoires de demain (acteur concerné : élus et chefs de projet).
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Conserver le label « PVD » pour les communes en ayant bénéficié et prolonger le co-financement des chefs de projet de deux ans afin d'assurer la concrétisation des projets lancés (acteurs concernés : État et ses opérateurs).
Recommandation n° 2 : À partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit « PVD » en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants (acteurs concernés : État et ses opérateurs, services déconcentrés de l'État et élus).
Recommandation n° 3 : À partir d'un diagnostic de territoire partagé, appuyer la démarche « Territoires de demain » par la co-construction, sur la base d'une proposition initiale formulée par les services de l'État, d'une comitologie adaptée aux particularismes et contextes locaux (acteur concerné : services déconcentrés de l'État et ensemble des acteurs et partenaires compétents).
Recommandation n° 4 : Apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique aux « Territoires de demain » afin que le recours local à l'ingénierie puisse s'appuyer prioritairement sur l'ingénierie publique existante, tout en respectant le code de la commande publique (acteur concerné : entité qui pilotera au niveau national la démarche « Territoires de demain »).
Recommandation n° 5 : Établir à destination des élus « Territoires de demain » un recensement exhaustif de l'ingénierie publique existante sur le territoire (acteur concerné : services déconcentrés de l'État).
Recommandation n° 6 : Profiter de la fin du cycle PVD pour une mise en cohérence globale de l'ensemble des dispositifs de contractualisation et de planification locaux (acteur concerné : État).
Recommandation n° 7 : Renforcer la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de manière transversale, dans tous les territoires de demain (acteur concerné : élus et chefs de projet).
EXAMEN EN COMMISSION
Désignation d'un
rapporteur
(Mercredi 9 avril 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Je souhaite vous rendre compte en quelques mots des décisions de notre réunion de bureau qui s'est tenue ce matin.
Le Bureau de la commission a en effet acté le principe de la création d'une mission d'information sur le programme « Petites villes de Demain » (PVD).
Ce dispositif, mis en place en 2020, vise à soutenir le rôle structurant des villes de moins de 20 000 habitants dans le développement des territoires ruraux.
Ce programme arrivera à son terme en 2026. Le calendrier est donc propice pour évaluer le dispositif après bientôt 5 ans de déploiement et pour envisager les suites à y donner.
L'objet et le périmètre de cette mission constituent par ailleurs une occasion de mettre en pratique la méthodologie du « contrôle de proximité », conformément aux directives données par le Président Larcher, dans le but de territorialiser davantage les travaux de contrôle du Sénat.
Une attention particulière serait donc portée à l'expérience et au point de vue des maires des communes ayant bénéficié de la première génération du programme.
J'appelle ainsi votre attention sur le fait que vous serez très prochainement destinataires d'un bref questionnaire à destination des membres de la commission, ce qui nous permettra dès à présent de pouvoir bénéficier d'un premier retour précieux, en amont des déplacements qui seront réalisés à l'occasion de cette mission.
En termes de calendrier, ces travaux s'effectueront selon un format « flash » de deux mois.
Afin d'associer le plus largement possible les commissaires à ces travaux, il a été décidé qu'un co-rapporteur issu d'un groupe minoritaire serait désigné.
J'ai reçu les candidatures de Louis-Jean de Nicolaÿ et de Nicole Bonnefoy.
Je vous propose donc de les désigner conjointement rapporteurs.
La commission désigne Mme Nicole Bonnefoy et M. Louis-Jean de Nicolaÿ rapporteurs de la mission d'information sur le programme « Petites villes de demain ».
Examen du rapport
d'information
(Mercredi 15 octobre 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Nous sommes réunis ce matin pour l'examen du rapport d'information de nos collègues Nicole Bonnefoy et Louis-Jean de Nicolaÿ sur le programme national « Petites villes de demain » (PVD), mesure phare de l'Agenda rural de 2019 qui visait à soutenir le rôle structurant des villes de moins de 20 000 habitants dans le développement des territoires ruraux.
Après six ans de mise en oeuvre, « Petites villes de demain » arrivera à son terme en mars 2026. Notre commission a souhaité opportunément anticiper cette échéance en lançant, en avril dernier, une mission flash et transpartisane : l'objectif assigné aux rapporteurs était de dresser un premier bilan du dispositif afin, notamment, d'en évaluer la plus-value pour les territoires ruraux et de tracer des perspectives pour l'après 2026. Le format retenu a été celui du contrôle de proximité, conformément à la volonté du Président du Sénat de favoriser une plus forte territorialisation de nos travaux.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. - Les petites villes constituent la trame de l'existence quotidienne de millions de Français et elles tiennent une place centrale dans le maillage territorial des espaces ruraux. Elles bénéficient de nombreux atouts, à commencer par un cadre de vie qui suscite un attrait grandissant depuis la crise sanitaire liée à la covid-19. Loin d'être des espaces figés, elles sont traversées par une multitude d'idées et d'initiatives en prise directe avec les transitions socio-économiques, démographiques, environnementales et climatiques contemporaines.
Néanmoins, les membres de cette commission savent bien qu'elles cumulent également des facteurs de vulnérabilité - la déprise commerciale, le déclin et le vieillissement démographiques, la vacance de logements ou encore la dégradation du bâti ancien - et que le manque de ressources financières, associé à un accès difficile à l'ingénierie technique et administrative, y rend difficile l'émergence de projets de territoire structurants.
En octobre 2020, afin de traduire l'un des engagements de l'Agenda rural de 2019 et de remédier à ces fragilités, le Gouvernement a lancé le programme « Petites villes de demain » sous le pilotage de l'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Son objectif était simple : soutenir la revitalisation des petites communes de moins de 20 000 habitants ayant une fonction de centralité à travers un appui en ingénierie, sur le modèle du programme « Action coeur de ville » impulsé en 2018 pour les villes moyennes. Prévu sur une période de six ans, le programme PVD arrivera à échéance dans quelques mois à peine, en mars 2026 : dès lors, la commission nous a confié la mission d'en faire une évaluation et de réfléchir à sa postérité au-delà de 2026.
Le programme PVD ayant déjà fait l'objet d'évaluations quantitatives à l'échelle nationale, nous avons choisi de compléter ces éléments statistiques par une approche approfondie et territorialisée, fidèle à l'ADN du Sénat. Notre méthodologie a donc été celle du contrôle de proximité, impulsée par le président Larcher : nous sommes partis de l'expérience concrète des élus locaux et de leurs chefs de projets, recueillie à partir de déplacements dans six départements - l'Eure, l'Oise, la Côte-d'Or, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et la Charente - et des témoignages écrits d'élus issus de sept de vos circonscriptions, dont vous avez eu la gentillesse de nous faire part au commencement de nos travaux.
Au total, nous avons ainsi pu bénéficier des retours d'expérience de près de quatre-vingt-dix élus locaux et de plus de vingt chefs de projet à travers la France. Cette matière empirique, venue compléter la dizaine d'auditions réalisées au Sénat, constitue la chair du rapport d'information que nous allons vous présenter.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur la genèse du programme PVD et sur la philosophie qui l'a animé dès sa conception.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure. - À l'instar du programme « Action coeur de ville », le dispositif « Petites villes de demain » a été pensé selon une logique ascendante, décentralisée et déconcentrée : il s'agit de sortir de l'approche standardisée des appels à projets qui caractérise trop souvent la posture de l'État en matière d'aménagement du territoire pour favoriser l'émergence de projets sur mesure, adaptés aux besoins de chaque commune.
Cette philosophie s'est traduite dès l'étape de la désignation des 1 646 communes bénéficiaires, puisqu'elles ont été sélectionnées sur proposition des préfets, après établissement d'un préciblage national sur la base de critères de centralité et de fragilité communs. Les communes ainsi sélectionnées et leurs aires d'influence représentent 7,3 millions d'habitants. Si elles sont de tailles relativement diversifiées, au regard de leur densité, 73 % d'entre elles sont des communes rurales au sens de l'Insee.
La logique ascendante du programme s'est exprimée de manière plus visible encore dans ses modalités de mise en oeuvre : le programme PVD repose sur le recrutement d'un chef de projet, grâce à un co-financement de l'État pouvant aller jusqu'à 75 % du coût annuel. Le chef de projet a vocation à piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et l'animation du projet territorial de revitalisation, en lien étroit avec les élus locaux. La synergie et l'acculturation réciproques entre le maire et son chef de projet sont véritablement la clé de voûte du programme.
Sur le plan opérationnel, PVD constitue une boîte à outils particulièrement souple, reposant sur un cadre contractuel et sur une gouvernance multipartenariale.
Des dizaines d'opérateurs nationaux se sont engagés dans la mise en oeuvre du programme, à travers la mise à disposition de financements, d'une offre de services ou encore la production de ressources destinées aux élus et aux chefs de projet. Au niveau local, des partenaires volontaires ont aussi pu apporter un appui déterminant aux communes grâce à leur connaissance fine de leur territoire, à l'instar des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), qui ont été nombreux à mettre à profit l'expertise transversale et polyvalente dont ils disposent.
Une fois qu'une commune a été labellisée PVD, une convention-cadre vient formaliser le projet de territoire, l'engagement des différents partenaires, publics et privés, et les moyens financiers associés. Dans chaque département, l'ensemble des partenaires des projets PVD ont été rassemblés dans des instances de pilotage, sous l'égide des préfets.
Si cette mécanique a été clairement posée, un élément a néanmoins été source de confusion - voire de déception - dès le lancement du dispositif : le calibrage financier.
En 2021, le Gouvernement avait annoncé qu'une enveloppe de 3 milliards d'euros serait consacrée au dispositif sur six ans, laissant espérer aux élus locaux des moyens dédiés pour mener à bien tant les phases d'études que de concrétisation des projets PVD. Or, si l'ingénierie a été financée pour l'essentiel par les opérateurs partenaires, les investissements n'ont été soutenus que par des dispositifs de droit commun via la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou d'autres dispositifs comme le fonds vert, qui sont soumis à une forte concurrence d'usages et dont les moyens sont donc nécessairement limités. Cette ambiguïté originelle a créé un décalage entre l'esprit initial du dispositif, qui repose sur un lien indissociable entre ingénierie et investissement, et son déploiement effectif, qui a pu susciter des frustrations sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.
Ces éléments liminaires étant précisés, venons-en à la mise en oeuvre concrète du programme dans les territoires.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. - Nous avons décrit le contexte - l'Agenda rural de 2019 - ; nous avons décrit les accessoires - la boîte à outils que constitue le programme PVD. Il nous reste maintenant à vous présenter le décor et les principaux protagonistes, qui sont les territoires dans toute leur diversité. Ce sont en effet sur les acteurs locaux que repose le déploiement effectif du programme, du portage à la gouvernance en passant par l'animation et, je dirais même, par la créativité : nous avons en effet été très impressionnés de relever, au sein des six départements dans lesquels nous nous sommes rendus, la manière très différente et souvent très ingénieuse dont les écosystèmes locaux se sont approprié cette boîte à outils.
Comme vous pourrez le voir dans les nombreux exemples illustrés qui figurent dans le rapport, nous avons consigné dans notre « carnet de voyage PVD » de nombreuses initiatives territoriales qui mériteraient d'être dupliquées dans d'autres contextes, tant elles nous paraissent porteuses de sens et d'efficacité pour la conduite de projets d'avenir. Nous vous laisserons en particulier prendre connaissance d'une très belle « carte mentale PVD » bas-alpine, ou encore de supports d'ateliers participatifs conduits dans l'Oise à partir d'un cas pratique fictif permettant d'aborder de manière concrète un sujet qui n'est quant à lui absolument pas fictif : les conséquences du dérèglement climatique à anticiper pour les petites centralités. Nous y reviendrons.
Sur une note plus préoccupante, nous avons pu relever un autre élément majeur de différenciation entre les collectivités lauréates : la lenteur de certains territoires à entamer le processus et à pouvoir entrer concrètement dans le programme. Cela est souvent le cas de territoires peu attractifs qui ont rencontré des difficultés à recruter et à fidéliser un chef de projet. Notre contrôle de proximité a ainsi mis en lumière de fortes disparités dès le démarrage, avec un programme qui s'est clairement déployé à plusieurs vitesses.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure. - J'en viens maintenant au bilan de ce programme. Il a déjà été produit de foisonnantes statistiques nationales mises à disposition en open data sur le site de la Banque des territoires, grâce à un bel outil d'agrégation et de traitement de données. Au-delà de ces infographies quantitatives, il nous a paru que notre vraie valeur ajoutée était d'appréhender ce bilan de manière territorialisée et qualitative. C'est bel et bien sur le terrain que se joue le programme : il était ainsi essentiel d'aller y recueillir le ressenti des acteurs.
Ce qui ressort très nettement et de manière globalement majoritaire dans les témoignages qui nous ont été apportés, c'est le sentiment que le programme PVD a constitué une expérience profitable pour les collectivités concernées. Un thème est revenu très largement : le label PVD constitue, je cite, une « marque de considération » et de « reconnaissance » pour des territoires qui ne se vivaient pas nécessairement comme une priorité en matière d'aménagement du territoire. Ceux-ci accèdent désormais à une « visibilité renforcée » et en tirent de la « fierté ». De nombreux élus se sont montrés particulièrement enthousiastes : un élu expérimenté des Alpes-de-Haute-Provence nous a ainsi déclaré qu'il s'agissait « sûrement [d']un des plus beaux programmes que les élus aient eu à gérer, surtout dans des communes qui n'avaient pas nécessairement eu de projets d'envergure auparavant ». Cet enthousiasme est souvent issu du sentiment de bénéficier du temps et des ressources nécessaires en ingénierie pour pouvoir élaborer des projets, je cite, « structurants », « ambitieux », « cohérents » et « porteurs de sens pour nos concitoyens ».
Cependant, le revers de cet enthousiasme nous est apparu tout aussi nettement : les bénéficiaires sont très largement déçus des modalités de financement qui ont été associées à ce programme. Pouvoir élaborer des projets ambitieux sans aucune certitude d'être en mesure de les financer génère, chez les élus, une frustration logique.
Un autre élément qui se dégage de ce bilan : nous avons pu relever des points d'achoppement très nets du programme sur le terrain.
Premièrement, dans les communes où les relations avec la communauté de communes sont compliquées, le programme accentue encore cette polarisation. C'est en effet une des ambiguïtés du programme : mettre la focale sur la centralité, c'est risquer de renforcer le sentiment que les autres communes se vivent comme une périphérie.
Deuxième difficulté : l'action non coordonnée, voire non coopérative de certains financeurs. Les porteurs d'initiatives gagneraient un temps et une énergie considérables à présenter leur projet une bonne fois pour toutes devant un comité des financeurs aux critères et aux calendriers, sinon concordants, du moins cohérents.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. - À la lumière de ce bilan, une question s'est naturellement imposée à nous : quel héritage concevoir pour PVD au-delà de 2026 ? Notre rapport propose d'y répondre en quatre axes et sept recommandations.
En premier lieu, il importe de déterminer une stratégie pour conclure le cycle PVD qui doit arriver à échéance en mars 2026. En effet, seules 20 % des actions prévues par les conventions-cadres avaient déjà été livrées au 31 décembre 2024, compte tenu des délais associés au lancement du programme et à la réalisation des études préalables. De manière unanime, les élus locaux que nous avons rencontrés soulignent un besoin de délais supplémentaires et la nécessité de ne pas mettre un coup d'arrêt à la dynamique enclenchée.
Dès lors, notre recommandation n° 1 vise à prolonger le label « PVD » ainsi que le co-financement des chefs de projets pendant encore deux ans, afin d'assurer la concrétisation des projets lancés.
En deuxième lieu, le dispositif PVD a assurément produit des résultats positifs : il a démontré qu'avec les moyens et l'accompagnement adéquats, la ruralité a de l'avenir et qu'elle peut même être à l'avant-garde des mutations que connaît notre pays. Le dispositif a également permis aux communes bénéficiaires d'acquérir une culture de la conduite de projets et des méthodes de travail précieuses, dont il importe à présent d'assurer la pérennité et la diffusion à plus vaste échelle.
Notre recommandation n° 2 est la suivante : à partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit PVD en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants.
À travers cette recommandation, nous souhaiterions que des territoires volontaires, organisés au niveau d'un EPCI ou d'un pôle d'équilibre territorial par exemple, puissent continuer à bénéficier d'un accompagnement en ingénierie pour mener à bien des projets structurants pour leur avenir. Ces territoires pourraient recruter à leur compte un ou plusieurs chefs de projet, en capitalisant sur l'expérience acquise par les chefs de projets PVD, et bénéficier de marchés à bons de commande pour réaliser des diagnostics et des études préalables, comme ce fut le cas pour les communes labellisées PVD.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure. - Le troisième axe de nos propositions détaille les modalités selon lesquelles pourrait se déployer cette démarche « Territoires de demain », afin d'élargir la dynamique PVD.
Un enjeu est crucial : il est absolument stratégique que le soutien apporté à l'ingénierie s'appuie principalement sur l'ingénierie publique existante. En effet, nos territoires bénéficient déjà largement d'une ingénierie publique performante, bien implantée, bien au fait des spécificités locales et souvent gratuite, comme dans le cas des CAUE. Dans le contexte qui caractérise actuellement nos finances publiques, l'efficience est davantage à rechercher dans l'existant, le local et ce qui est déjà immédiatement opérationnel, plutôt qu'en des prestations onéreuses, standardisées et lentes à mettre en place.
Nous recommandons dès lors de mieux faire connaître aux porteurs de projet l'ingénierie publique locale existante, en préconisant que les services de l'État finalisent, là où elle n'est pas achevée, la cartographie de l'existant. Cela correspond à la recommandation n° 5. Nous recommandons que cette cartographie parte des besoins rencontrés par les élus locaux, plutôt qu'elle ne prenne la forme d'un simple catalogue d'interlocuteurs, afin que cela soit réellement lisible et utile aux porteurs de projets.
Enfin, à travers notre recommandation n° 4, nous préconisons que l'entité qui pilotera au niveau national la démarche « Territoires de demain » ne reconduise pas à l'identique les marchés à bon de commande nationaux qui avaient été conclus par l'ANCT. Ceux-ci avaient été ouverts à hauteur de 10 millions d'euros pour proposer aux collectivités PVD l'appui ponctuel de cabinets de conseil privés. À l'inverse, l'entité qui sera la pilote de cette nouvelle démarche pourra utilement apporter aux porteurs de projets une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique afin que les territoires puissent privilégier le recours à l'ingénierie publique locale existante, tout en respectant le code de la commande publique.
Un autre point nous paraît impératif pour capitaliser sur l'expérience PVD et pour transformer l'essai : nous proposons qu'il soit mis en place pour chaque territoire de demain un pilotage et une gouvernance qui soient co-construits avec l'ensemble des acteurs. En particulier, au lieu de passer leur temps à présenter leur projet à chaque financeur potentiel selon un calendrier et des critères d'évaluation différents, les porteurs de projets doivent pouvoir bénéficier d'un comité de financeurs exhaustif et coopératif, pour que tout le monde soit autour de la table et puisse évaluer une bonne fois pour toutes, de manière cohérente et concordante, si les projets élaborés et sélectionnés sont finançables et, si oui, selon quelles modalités.
Notre recommandation n° 3 détaille le fonctionnement que nous proposons pour ce comité local qui serait mis en place pour chaque « Territoire de demain ». Selon nous, l'étape préalable à la constitution de ce comité correspondrait à l'élaboration commune, par l'ensemble des acteurs, d'un diagnostic de territoire partagé. En effet, pour pouvoir envisager une vision robuste de l'avenir, il convient que tout le monde puisse partager la même vision de l'existant.
Enfin, en dernier lieu, nous vous proposons d'élargir la focale et d'envisager, non plus les « Petites villes de demain », ni même les territoires de demain, mais bel et bien la cohésion territoriale de demain.
Notre mission avait pour horizon temporel l'année 2026, soit le terme qui était initialement fixé pour le programme PVD. Cependant, en adoptant une vision plus large, nous constatons que la fin du cycle PVD correspond aussi à la fin de nombreux autres cycles : les contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE), les contrats de plan État-région (CPER), les programmes « Action coeur de ville », « Territoires d'industrie », « Villages d'avenir », etc.
C'est pourquoi nous recommandons, en sixième lieu, de voir dans la fin du programme PVD l'opportunité, pour l'État, d'opérer une mise en cohérence globale de l'ensemble des dispositifs locaux de contractualisation et de planification. C'est en effet une constante des témoignages que nous avons recueillis : il est plus que temps de pouvoir disposer d'une vision pluriannuelle des financements disponibles pour les projets d'avenir structurants.
La dernière des recommandations que nous soumettons aujourd'hui à votre approbation nous semble absolument primordiale, non seulement pour tous les territoires de demain, mais aussi pour tous les territoires qui souhaitent, demain, et même dès aujourd'hui, préparer leur avenir. Je parle bien entendu de l'adaptation aux effets déjà visibles du dérèglement climatique. Ces conséquences désastreuses frappent les territoires selon des intensités et des modalités qui varient très fortement. Cependant, il est bien documenté que la préexistence de vulnérabilités socio-économiques et géographiques constitue un facteur aggravant d'exposition aux risques climatiques ; or, c'est très souvent le cas des petites centralités qui ont été sélectionnées pour bénéficier du programme PVD.
Notre dernière recommandation vise ainsi à renforcer la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de manière transversale, dans tous les territoires de demain.
Lorsque l'on parle de cohésion territoriale, il est souvent question de préparer l'avenir en aménageant les territoires. Avec mon collègue, nous vous proposons un nouveau paradigme. Les territoires que nous avons visités ont souvent été les victimes de phénomènes difficiles : déprise commerciale, désindustrialisation, dynamiques démographiques défavorables, etc. Pour les élus et les habitants concernés, préparer l'avenir, c'est se mettre en mesure de dépasser ces vulnérabilités et à nouveau pouvoir se projeter dans des projets structurants. Face à des phénomènes socio-économiques et climatiques éprouvants, la priorité que nous vous proposons, c'est que le XXIe siècle puisse privilégier, à l'aménagement du territoire, le nouvel objectif suivant : le ménagement des territoires.
M. Rémy Pointereau. - Nous avions travaillé sur les PVD il y a quelques années, et je constate que les problèmes perdurent.
Parlons du programme « Action coeur de ville », qui s'adresse aux villes de plus de 20 000 habitants. L'espoir était réel : les centres-villes se sont embellis, même si des commerces continuent de partir vers des zones périphériques.
Concernant les PVD, les inquiétudes portent, comme toujours, sur le co-financement des postes de chef de projet. Par souci de regroupement, les opérations s'adressent souvent à deux ou trois communes : le travail est encore plus important, ce qui exige la présence de techniciens. Or les maires n'ont aucune assurance que cela soit effectivement le cas et sont parfois déçus.
Nous parlons de sommes importantes. La DSIL et la DETR ne peuvent suffire à financer l'intégralité des projets associés, et les régions ou départements ne sont pas toujours en mesure de pouvoir apporter le co-financement complémentaire qui serait nécessaire. Or nous ne pouvons décevoir les élus qui se sont engagés dans le programme PVD, avec des projets dont le coût se chiffre en millions d'euros. L'effort financier que représente pour les collectivités le co-financement est un problème réel.
Vous êtes-vous adressés lors de vos auditions aux représentants des associations d'élus correspondant aux échelons régionaux et départementaux pour comprendre comment ils peuvent travailler sur des conventions pluriannuelles de financement, afin que le bloc communal puisse entreprendre des projets de long terme ?
M. Ronan Dantec. - Les propositions que vous formulez sont vraiment intéressantes, même si elles ne vont pas tout à fait au bout de la logique que vous avez développée. Il s'agit bel et bien de reconstruire la relation entre l'État et les territoires, sur le fondement de contrats de territoires intégrés, à rebours de la logique de saupoudrage qui prévaut actuellement et qui s'appuie sur le fonds vert et la multiplication des appels à projets.
Le programme PVD a été un signe fort pour les élus, qui leur a permis de montrer aux habitants qu'ils oeuvraient pour eux.
Continuons nos travaux pour définir un outil de contractualisation qui soit réellement intégrateur - je pense en particulier que le levier qui pourrait s'y prêter correspond aux contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE). Il faut travailler sur la contractualisation avec l'État, sur ce que ce dernier met en avant comme constituant des priorités - climat, cohésion sociale - et sur ses engagements, par exemple en matière d'accompagnement et d'ingénierie.
Les travaux menés par Mme Lavarde dans le cadre de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État nous ont fait perdre beaucoup d'énergie et nous envoient dans la mauvaise direction.
Votre rapport d'information, quant à lui, va dans le bon sens. Il prend une autre direction, qui propose de disposer de moins d'agences, mais que celles-ci soient des structures spécialisées et qui puissent accompagner directement les collectivités territoriales. Le programme PVD ne peut fonctionner qu'en se reposant sur l'appui du seul préfet, il nécessite la mise à disposition d'une ingénierie spécifique. Allons donc dans votre sens pour définir la forme de contractualisation qui serait pertinente pour l'avenir, compte tenu des besoins en ingénierie et du contexte de raréfaction de l'argent public.
La question de l'adaptation au changement climatique et de ses coûts sera un élément important de la contractualisation, demain, entre les territoires et l'État.
Nous devons absolument préserver le fonds territorial climat, qui suit totalement la logique de votre réflexion. Dans ce cadre, à l'inverse de ce qui est actuellement le cas pour le fonds vert, ce seraient les intercommunalités qui feraient remonter les projets.
Ce rapport d'information formule beaucoup de bonnes idées. À condition de mettre de côté le dogmatisme ambiant concernant les agences, je suis convaincu que nous pourrions mettre sur la table un vrai projet collectif partagé qui puisse être audible pour l'État.
M. Hervé Gillé. - Je valide l'idée selon laquelle il faut mettre en avant la démarche « Territoires de demain ». J'estime que nous n'allons pas assez loin en matière de planification territoriale, afin que celle-ci soit vraiment aboutie. Les territoires s'organisent autour de pôles d'équilibre territorial et rural (PETR) et de syndicats mixtes de territoire. Dans l'idéal, quand ces PETR et syndicats mixtes sont porteurs de schémas de cohérence territoriale (Scot) intégrateurs, nous disposons alors d'une vraie vision de développement territorial.
Utiliser ces démarches claires de planification dans une perspective de développer le progrès dans les territoires est une vision tout à fait pertinente. Ainsi, nous replacerions dans la vision du territoire l'intérêt que représentent les pôles urbains et intermédiaires, autour d'une offre de services équilibrée. L'État ne prend pas assez ses responsabilités pour que la planification aboutisse. Il y a trop de trous dans la raquette : pas assez de PETR, de syndicats mixtes de territoires et de Scot. Pour ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi), nous n'allons pas assez loin en matière d'outils d'organisation.
Il est possible de défendre la différenciation territoriale dans une approche commune de planification, mais ne faisons pas de la dentelle trop fine, au risque de créer de la confusion.
Grâce à ce rapport d'information, le débat est posé ; nous pourrons ainsi avancer.
M. Jean-Yves Roux. - Dans les Alpes-de-Haute-Provence, onze communes ont pu bénéficier du programme PVD, ce qui a lancé une véritable dynamique. Nous avons concrétisé des projets qui auraient été irréalisables pour de petites communes rurales sans l'appui du programme. Nous avons impulsé un élan qui a amélioré les conditions de vie des habitants de ces petites villes.
Je suis très favorable à ce rapport d'information et à ses recommandations.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. - L'important est bien que, au-delà du programme PVD, les territoires se prennent en main pour se projeter dans l'avenir : une communauté de communes, un PETR, un arrondissement, etc.
La question est de savoir comment contractualiser avec chaque partie prenante : l'État, mais aussi le département, la région, voire l'Union européenne. Il faudrait qu'après les élections municipales de 2026 les élus puissent se lancer dans ces nouvelles politiques publiques d'avenir - industrielle, économique, artisanale, protection du patrimoine, écologique... -, et ce, dès 2028, pour qu'à la fin de leur mandat leur travail issu du programme PVD se soit concrétisé.
Tous les élus souhaitent que l'ingénierie soit maintenue, notamment l'ingénierie publique.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure. - Les communes qui ont ce label sont très fières d'avoir été retenues, elles qui se sentaient loin de tout, voire abandonnées. L'État, en apportant son aide, en particulier un chef de projet et une ingénierie publique, a joué son rôle : sans ingénierie, il n'y aurait pas de vision structurante, on ne ferait que du saupoudrage. Toutes les questions - urgence sociale et climatique, déprise commerciale, logement... - sont pensées de manière globale dans une logique d'avenir.
Les élus nous ont dit leur fierté de prendre part à ce programme, partagée avec les habitants.
Reste à mettre en oeuvre les projets et à trouver les financements nécessaires à leur déploiement. Ce programme mérite de perdurer au-delà de 2026. Ainsi, les communes bénéficiaires peuvent se projeter dans l'avenir. L'ingénierie publique locale est essentielle ; il faut la préserver et lui donner les moyens d'exister.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 20 mai 2025
- Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) : Mmes Catherine DUMAS, directrice du CAUE de la Meuse et Éléonore CHAMBRAS LAFUENTE, chargée de mission.
Mercredi 21 mai 2025
- Table ronde d'élus locaux
· Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) : Mmes Véronique POUZADOUX, vice-présidente, co-présidente de la commission Aménagement du territoire, présidente de la communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne, présidente des maires de l'Allier et maire de Gannat, Nathalie FOURNEAU, responsable du département Aménagement du territoire, Charlotte DE FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement.
· Association des petites villes de France (APVF) : Mme Laurence PORTE, maire de Montbard (Côte d'Or), vice-présidente de l'APVF et référente PVD, M. Philippe LE GOFF, maire de Guingamp et référent PVD et M. Elias MAAOUIA, responsable relations institutionnelles.
· Association des maires ruraux de France (AMRF) : M. Gilles NOËL, vice-président de l'AMRF en charge des questions de santé et de l'agenda rural, président de l'association des maires ruraux de la Nièvre, maire de Varzy.
- Direction générale des collectivités locales (DGCL) : Mme Blandine GEORJON, adjointe au sous-directeur de la cohésion et de l'aménagement du territoire.
Mardi 27 mai 2025
- Audition conjointe
· Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) : Mme Annabelle FERRY, directrice Territoires et Ville.
· Banque des territoires : MM. Michel-François DELANNOY, directeur du département appui aux territoires, Direction du réseau et des territoires, Banque des Territoires, Franck CHAIGNEAU, responsable du service programme Petites villes de demain à la direction du réseau et des territoires, Banque des Territoires, Christophe CHARENTON, conseiller relations institutionnelles, Caisse des dépôts ;
- Association des départements solidaires : M. Franck BAZIN, président du Conseil départemental de la Nièvre, membre de Départements Solidaires.
- Audition conjointe
· Intercommunalités de France : M. Christophe BAZILE, président de Loire Forez agglomération, Mme Claudine COURT, vice-présidente à l'habitat et à la politique des centres-bourgs et centres-villes, M. Clément BAYLAC, conseiller attractivité, M. Clément PEYRILLES, en charge d'une étude sur l'économie de proximité ;
· Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) : M. Michaël RESTIER, directeur, Mme Marie-Christine LOYER, présidente du pôle territorial du Perche.
- Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) : M. Stanislas BOURRON, directeur général.
Lundi 23 juin 2025
- Personnalité qualifiée : M. Bernard DELCROS, sénateur du Cantal, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Mardi 8 juillet 2025
- Personnalité qualifiée : Mme Dominique FAURE, ancienne ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Alpes-de-Haute-Provence :
Commune de Forcalquier
- Alpes maritimes :
Commune de Guillestre
Commune de Peymeinade
Commune de Puget-Théniers
Commune de Saint-Vallier-de-Thiey
- Isère :
4 communes anonymisées dont le témoignage a été recueilli par le sénateur de l'Isère Damien Michallet
- Loir-et-Cher :
Commune de Fréteval
- Meuse :
Commune de Commercy
Commune d'Étain
Commune de Saint-Mihiel
Commune de Vaucouleurs
- Oise :
Commune de Bresles
Commune de Formerie
Commune de Grandvilliers
Commune de Pont-Sainte-Maxence
- Puy-de-Dôme :
Commune de Brassac les Mines
Communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans
Communauté de communes Entre Dore et Allier
Commune de Giat
Communauté de communes Plaine Limagnes
Commune de Puy-Guillaume
LISTE DES DÉPLACEMENTS
CÔTE D'OR
Dijon
Mardi 3 juin 2025
Échange croisé « Petites villes de demain » à Dijon
Services de l'État
- M. Sébastien LANOYE, sous-préfet de Montbard ;
- Mme Christelle DA SILVA, directrice adjointe à la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial (DCPPAT) en préfecture de la Côte-d'Or ;
- Mme Virgnie BROCHOT, cheffe adjointe du service urbanisme, connaissance et appui des territoires à la direction départementale des territoires (DDT) de la Côte-d'Or.
Élus de collectivités territoriales bénéficiaires du programme « Petites villes de demain »
- Mme Laurence PORTE, maire de Montbard ;
- M. Jacques-François COIQUIL, maire d'Auxonne ;
- Mme Marie-Line DUPARC, maire de Saint-Jean-de-Losne ;
- M. Thierry DARPHIN, maire d'Is-sur-Tille ;
- Mme Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois ;
- M. Hervé LOUIS, 1er adjoint de Saulieu, vice-président de la communauté de communes Saulieu-Morvan.
Chefs de projet de « Petites villes de demain »
- Mme Caroline LIAGRE, cheffe du projet « Petites villes de demain » de Saulieu ;
- Mme Anaëlle MARTIN RABALLAND, chargée de mission « Petites villes de demain » de Pouilly-en-Auxois.
OISE
Beauvais
Lundi 23 juin 2025
Échange croisé « Petites villes de demain » à Beauvais
Services de l'État et opérateurs
- M. Frédéric BOVET, secrétaire général de la préfecture de l'Oise en charge de la ruralité ;
- Mme Anne GABRELLE, cheffe du Service de la coordination de l'action départementale (Scad) ;
- M. Charles COSTA, chef adjoint du Scad ;
- Mme Carole DOBEL, chargée de mission en ingénierie territoriale au Scad.
Direction départementale des territoires
- M. David WITT, directeur ;
- Mme Béatrice BAILLARD-HERLEM, chargée de l'animation territoriale.
Banque des territoires
- Mme Anne-Laure CATTIN, directrice territoriale.
Mme la Ministre Caroline CAYEUX, présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis
Élus de collectivités territoriales bénéficiaires du programme « Petites villes de demain »
- M. Jean-Michel DUDA - président de la CC du Pays de Bray ;
- Mme Fabienne CUVELIER - présidente de la CC de la Picardie Verte ;
- M. Johnny CARMINATI - maire d'Auneuil ;
- M. Dominique CORDIER - maire de Bresles ;
- M. Lionel OLLIVIER - maire de Clermont (en visio) ;
- M. Aymeric BOURLEAU - maire de Crèvecoeur-le-Grand ;
- M. William BOUS - maire de Formerie ;
- M. Frédéric DOUCHET - maire de Grandvillers ;
- Mme Paulette GRUET - adjointe au maire de La Chapelle-aux-Pots ;
- M. Alain LEVASSEUR - maire de Saint-Germer-de-Fly.
Directeurs généraux des services (DGS) de « Petites villes de demain »
- Mme Eloïse BERTHOGLI - DGS CC du Pays de Bray ;
- Mme Patricia LEQUET - DGS de la CC de la Picardie Verte ;
- Mme Corinne JEANNY-GAUTIER - DGS de Bresles ;
- M. Thomas DECARY - DGS de Clermont (en visio).
Chefs de projet de « Petites villes de demain
- Mme Ophélia COEFFIER - cheffe de projet - CC du Pays de Bray ;
- Mme Chloé FERREYROLLES - cheffe de projet - Communauté de communes de la Picardie Verte ;
- M. Soudaissi OUSMANOU - chef de projet - Auneuil-Bresles-Crèvecoeur-le-Grand ;
- Mme Hélène PEREZ - cheffe de projet - Pont-Saint-Maxence ;
- Mme Sophie DHOURY-LEHNER - cheffe de projet Communauté de communes Pays du Clermontois (en visio) ;
- Mme Théa DUVIEUX - cheffe de projet Méru.
VAR
Brignoles, Barjols
Jeudi 26 juin 2025
Échange croisé « Petites villes de demain » à Brignoles et visite de terrain à Barjols dans le quartier des anciennes tanneries
Services de l'État et opérateurs
- Mme Anne-Cécile VIALLE, sous-préfète de Brignoles, chargée de la ruralité ;
- M. Serge ORTIS, secrétaire général de la sous-préfecture de Brignoles ;
- Mme Claire CHAPELAND, cheffe de bureau de l'ingénierie territoriale à la sous-préfecture de Draguignan ;
- M. Léo RADEPONT, référent territorial à la direction départementale des territoires et de la mer.
Banque des territoires
- M. David de ARAUJO, directeur Var ;
- M. William VINAY, chargé d'appui territorial.
Élus et représentants de collectivités territoriales bénéficiaires du programme « Petites villes de demain »
- M. Alain DECANIS, maire de Saint-Maximin ;
- M. Antoine FAURE, maire d'Aups ;
- Mme Catherine VENTURINO-GABELLE, maire de Barjols ;
- Mme Marie-Laure TORTOSA, maire de Salernes ;
- M. Jean CAYRON, maire de Roquebrune-sur-Argens ;
- M. Édouard FRIEDLER, maire du Beausset ;
- M. Pierre BEDRANE, Conseiller municipal - 4e adjoint du Luc-Le Cannet ;
- M. Nicolas DANI, 1er adjoint de Salernes ;
- M. David JONES, directeur général des services techniques de Cogolin.
Chefs de projet de « Petites villes de demain »
- Mme Sylvie LARTIGUES, chef de projet « Petites villes de demain » d'Aups ;
- Mme Manon Meyer, cheffe de projet « Petites villes de demain » de Barjols ;
- M. Arthur RECOULES, chef de projet « Petites villes de demain » du Luc-Le Cannet.
Autres représentants de collectivités territoriales
- Mme Sabra GALIEZ, directrice de l'habitat et de la cohésion sociale à Dracénie Provence Verdon agglomération ;
- Mme Christine AMRANE, vice-présidente du conseil départemental.
Mme Françoise DUMONT, sénatrice du Var
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Digne-les-Bains, Oraison,
Forcalquier
Vendredi 27 juin 2025
Échange croisé « Petites villes de demain » à Digne-les-Bains et visites de terrain à Oraison et à Forcalquier
*
Services de l'État
- M. Marc CHAPPUIS, préfet des Alpes-de-Haute-Provence
- M. Dominique CEAUX, sous-préfet de Castellane
Direction départementale des territoires
- M. Éric DALUZ, directeur ;
- M. Sylvain DAILLE, chef de pôle ;
- M. Éric PUGET, chargé de mission.
Élus de collectivités territoriales bénéficiaires du programme « Petites villes de demain »
- M Yvan BOUGUYON - maire de Barcelonnette ;
- M. Christophe BIANCHI - maire de Riez ;
- M. Bernard LIPERINI - maire de Castellane ;
- M. Benoît GAUVAN - maire d'Oraison ;
- M. Laurent PASCAL - maire de Seyne ;
- Mme Marion COZZI - maire d'Annot.
Chefs de projet de « Petites villes de demain »
- M. Romain PARDO - chef de projet « Petites villes de demain » de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon ;
- M. Raphaël BACETTI - chef de projet « Petites villes de demain » de Barcelonnette ;
- Mme Nadia CHABAL - cheffe de projet « Petites villes de demain » de Château-Arnoux-Saint-Auban.
CHARENTE
Angoulême, Châteauneuf-sur-Charente
Lundi 1er septembre 2025
Échange croisé « Petites villes de demain » à Angoulême et visite de terrain à Châteauneuf-sur-Charente
Services de l'État et opérateurs
- M. Jérôme HARNOIS, préfet de la Charente ;
- M. Jean-Charles JOBART, secrétaire général de la préfecture de la Charente ;
- Mme Adeline BARD, sous-préfète de Confolens chargée de la mission ruralité ;
- Mme Nathalie CLARENC, sous-préfète de Cognac ;
- Mme Amélie AVERLAN, cheffe du Bureau de la coordination interministérielle et de l'appui territorial à la préfecture de Charente.
Direction départementale des territoires
- Mme Nathalie LARRAUX, directrice adjointe ;
- M. Bastien GARCIA, adjoint au chef de la mission appui et accompagnement des territoires.
Banque des territoires
- M. Amaury DE BARBEYRAC, directeur régional adjoint ;
- M. Zili FU, directeur territorial ;
- M. Alexandre BRANCHESI, chargé de développement territorial 16-24.
Élus et représentants de collectivités territoriales bénéficiaires du programme « Petites villes de demain »
- M. Patrick VERGEZ, maire de Villebois-Lavalette ;
- Mme Nelly VERGEZ, adjointe au maire de Villebois-Lavalette ;
- M. Jean-François BARNY, premier adjoint au maire de Segonzac ;
- M. Gwenhaël FRANÇOIS, maire de Montbron ;
- M. Thomas PAILLARD, directeur général des services de Montbron ;
- M. Philipe GESSE, maire de Jarnac ;
- M. Jean-Louis LEVESQUE, maire de Châteauneuf-sur-Charente ;
- Mme Karine GAI, maire adjointe en charge de l'urbanisme, de la stratégie urbaine, de l'habitat et du développement du commerce à Châteauneuf-sur-Charente ;
- M. Mickaël VILLÉGER, maire adjoint en charge des finances et des ressources humaines à Châteauneuf-sur-Charente et vice-président à la communauté d'agglomération du Grand Cognac ;
- M. Jean-Louis MARSAUD, maire de la Rochefoucauld-en-Angoumois ;
- M. Olivier BERNIOLLES, directeur général des services de la Rochefoucauld-en-Angoumois ;
- M. Dominique HYVERNAUD, conseiller municipal, représentant de Renaud COMBAUD, maire d'Aigre ;
- M. Michel CARTERET, maire de Mouthiers ;
- M. André MEURAILLON, maire de Barbezieux ;
- M. Jean-Michel BOLVIN, maire de Montmoreau ;
- M. Jérôme SOURISSEAU, président du Grand Cognac Agglomération ;
- M. Clément GUILLEMOT, directeur de cabinet du Grand Cognac Agglomération ;
- M. Jean-Marc BROUILLET, président de la Communauté de communes La Rochefoucauld porte du Périgord ;
- Mme Sophie MEVELLEC, directrice générale des services de la communauté de communes - Coeur de Charente ;
- M. Thierry BASTIER, maire de Ruffec ;
- M. Jean-Yves AMBAUD, président de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne ;
- M. Fabien PORTAL, directeur général adjoint de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne ;
- M. Jean-Noël DUPRE, vice-président de la communauté de communes de Charente Limousine ;
- M. Emmanuel JOUASSIN, vice-président de la communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord ;
- Mme Anaïs DELAGE, chargée d'aménagement du territoire à la Communauté de communes du Rouillacais.
Chefs de projet de « Petites villes de demain »
- Mme Graziella RASSAT, cheffe de projet « Petites villes de demain » de Montbron et de la communauté de communes La Rochefoucauld porte du Périgord ;
- Mme Loé DESVIGNES, cheffe de projet « Petites villes de demain » de Grand Cognac Agglomération ;
- Mme Pia BARALE, cheffe de projet « Petites villes de demain » de la communauté de communes - Coeur de Charente ;
- Mme Mélanie BLANC, Cheffe de projet « Petites villes de demain » de Ruffec.
Autres représentants de collectivités territoriales
- Mme Sandrine HERNANDEZ, conseillère régionale déléguée à la revitalisation des centres-bourgs, au foncier et à l'urbanisme de la Région Nouvelle-Aquitaine ;
- Mme Marie-Cécile BERNARD, chargée de mission au département de la Charente ;
- M. Ronan MEVELLEC, directeur de l'agence technique de la Charente ;
- Mme Céline GARRY, responsable du Pôle AMO de l'agence technique de la Charente.
Établissements publics et partenaires du programme
- M. Philippe MAYLIN, directeur de Territoires Charente de la SAEML ;
- M. Stéphane CAUMET, directeur du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Charente ;
- Mme Véronique MARENDAT, directrice du développement et du patrimoine de Logelia ;
- M. Fabrice MELON, directeur de l'Agence rurale de Logelia ;
- Mme Annabelle VIGNON, directrice de Soliha ;
- M. Mouloud BENHENOU, directeur stratégie patrimoniale et innovation de Noalis ;
- M. Sylvain BRILLET, directeur général de l'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
EURE
Évreux
Jeudi 4 septembre 2025
Échange croisé « Petites villes de demain » à Évreux
Services de l'État
- M. Alaric MALVES, sous-préfet d'Évreux et secrétaire général de la Préfecture de l'Eure ;
- M. Philippe FOURNIER-MONTGIEUX, sous-préfet de Bernay, en charge de la ruralité.
Direction départementale des territoires et de la mer
- M. François LANDAIS, directeur ;
- Mme Agnès HURSAULT, directrice adjointe ;
- Mme Nathalie THOMAS, responsable de l'unité Conseil aux territoires (CAT) ;
- M. Raphaël GUIGNARD, responsable du service Appui et conseil aux territoires.
Élus de collectivités territoriales bénéficiaires du programme « Petites villes de demain »
- M. Pascal CALAIS, maire de Charleval ;
- M. Richard JACQUET, maire de Pont-de-l'Arche ;
- M. Thomas DURAND, maire de Vexin-sur-Epte ;
- Mme Marie-Lyne VAGNER, maire de Bernay ;
- M. Valéry BEURIOT, maire de Brionne ;
- Mme Frédérique REPESSE, adjointe, représentant M. Denis GUITTON, maire de Rugles ;
- M. Jérôme PASCO, maire de Conches en Ouche ;
- M. Jean-Loup JUSTEAU, maire de Nonancourt ;
- M. Franck BERNARD, maire de Saint-André de l'Eure.
Chefs de projet « Petites villes de demain »
- Mme Anne-Fleur TRAVERSE, cheffe de projets de Pont de l'Arche ;
- M. Ababacar DIENE, chef de projets de Bernay ;
- Mme Virginie FABBRO, ex-cheffe de projets de Bernay ;
- M. Clément LOQUIN, chef de projets de Conches en Ouche ;
- M. François DYCKE, chef de projet de Nonancourt.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Conserver le label « PVD » pour les communes en ayant bénéficié et prolonger le co-financement des chefs de projet de deux ans afin d'assurer la concrétisation des projets lancés |
État et ses opérateurs |
PLF et engagements des opérateurs de l'État |
|
|
2 |
À partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit « PVD » en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants |
État et ses opérateurs, services
déconcentrés |
Circulaire |
|
|
3 |
À partir d'un diagnostic de territoire partagé, appuyer la démarche « Territoires de demain » par la co-construction, sur la base d'une proposition initiale formulée par les services de l'État, d'une comitologie adaptée aux particularismes et contextes locaux |
Services déconcentrés de l'État et
ensemble des acteurs |
Circulaire |
|
|
4 |
Apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique aux « Territoires de demain » afin que le recours local à l'ingénierie puisse s'appuyer prioritairement sur l'ingénierie publique existante, tout en respectant le code de la commande publique |
Entité qui pilotera au niveau national la
démarche « Territoires |
Guide de bonnes pratiques |
|
|
5 |
Établir à destination des élus « Territoires de demain » un recensement exhaustif de l'ingénierie publique existante sur le territoire |
Services déconcentrés |
Instruction ministérielle |
|
|
6 |
Profiter de la fin du cycle PVD pour une mise en cohérence globale de l'ensemble des dispositifs de contractualisation et de planification locaux |
État |
Outils de contractualisation entre l'État et les collectivités |
|
|
7 |
Renforcer la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de manière transversale, dans tous les territoires de demain |
Élus locaux et chefs de projet |
Bonnes pratiques |
* 1 Sa reconduction a été annoncée pendant les travaux de la mission d'information, le 13 juin 2025, par le Premier ministre d'alors, François Bayrou. Toutefois, à l'heure de l'achèvement du présent rapport d'information, aucune modalité concrète de cette reconduction n'a encore été évoquée et il n'est pas possible d'entrevoir quels pourraient être les contours de l'éventuelle postérité de ce programme.
* 2 Communication du Bureau du 25 janvier 2024.
* 3 Voir liste des personnes entendues.
* 4 La mesure n° 23 de l'Agenda rural visait à « lancer un plan en faveur de la revitalisation des petites villes et bourgs-centres ».
* 5 Rapport d'information n° 1647 (XVIIème législature) du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, 26 juin 2025.
* 6 Source : Dossier de présentation PVD, octobre 2020, Gouvernement/ANCT.
* 7 Étude « Centralités, comment les identifier et quels rôles dans les dynamiques locales et intercommunales ? » (Inrae-Cesaer, ANCT, 2020).
* 8 Ce dispositif avait été lancé en 2014, sous le pilotage du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) - prédécesseur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour une durée de six ans.
* 9 L'ORT est un outil à disposition des collectivités territoriales depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique visant à faciliter la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux et, plus globalement, du tissu urbain d'une commune. Elle se matérialise par une convention signée entre l'intercommunalité, sa commune principale et les communes volontaires, l'État et ses établissements publics. La convention ORT permet de bénéficier de dispositifs juridiques et fiscaux (aides de l'Anah, éligibilité au dispositif Denormandie, dispositifs expérimentaux, droits de préemption renforcés, etc.).
* 10 Article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 11 Source : contribution écrite du CAUE de Gironde transmise aux rapporteurs.
* 12 Selon l'appellation définie par l'ANCT.
* 13 À l'occasion du déplacement de la mission à Beauvais le 23 juin 2025.
* 14 Selon le terme employé à plusieurs reprises lors de l'audition par les rapporteurs le 27 mai 2025 des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
* 15 Tels que le « club PVD », décrit par l'ANCT comme « l'outil phare du programme » et qui selon l'Agence « répond à un besoin d'échanges et d'inspiration ». Cette instance de partage d'expérience se décline selon plusieurs échelles (nationale, régionale, départementale) et plusieurs formats (webinaires, rencontres nationales et régionales, saisons thématiques, Ateliers in situ).
* 16 Source : l'organigramme de la DDTM 83 de mai 2025, disponible sur le site internet de la préfecture du Var (consulté le 20 septembre 2025).
* 17 Source : réponses de l'ANCT au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 18 Source : réponses de l'AMF au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 19 Source : réponses d'Intercommunalités de France au questionnaire écrit des rapporteurs.
* 20 Source : contribution écrite recueillie par le Sénateur Damien Michallet et transmise à la mission d'information.
* 21 Agence locale des énergies du Puy-de-Dôme.
* 22 Source : support de présentation du Copil PVD de la commune en date du 2 avril 2025.
* 23 Selon le résumé que dresse l'ANCT, dans sa contribution écrite transmise aux rapporteurs, de l'étude Inrae-Cesaer sur laquelle se fonde le diagnostic qui a donné lieu à la création du programme. Cette étude présentée en juin 2020 s'intitule : « Centralités : comment les identifier et quels rôles dans les dynamiques locales et intercommunales ? ».
* 24 Étude de l'APVF, Enquête à destination des élus des communes, juin 2025.
* 25 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 26 Dans sa réponse du 27/03/2025 à la question écrite n° 02 808 posée par M. Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, intitulée « Complexité des dispositifs d'aides aux communes ».