II. L'AVENIR PLUS LOINTAIN DE L'ONAC : UNE RÉFLEXION À MENER
Pour
assurer son avenir proche, l'ONAC doit donc relever certains
défis : il lui faut adopter une gestion moderne et efficace,
reconsidérer son parc de maisons de retraite et s'entourer d'un
personnel plus qualifié. Ces réformes ne paraissent cependant pas
hors de portée. Certaines ont d'ailleurs déjà
été lancées et les dirigeants de l'ONAC semblent
être conscients de leur caractère indispensable pour assurer la
pérennité de l'Office.
Toutefois, le débat sur l'avenir de l'ONAC est plus complexe. En effet,
même si ce dernier parvient à se réformer en profondeur, il
ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur son avenir
à moyen terme.
En effet, sauf conflit majeur, l'activité des services
départementaux est amenée à diminuer fortement. Il est
donc impératif de réfléchir sur la restructuration de ses
services d'ici à cinq ans.
L'occasion aurait pu être saisie lors de la restructuration du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants. En réalité,
l'accent a été mis sur le renforcement du rôle et des
missions de l'ONAC. Or, ce renforcement de l'activité ne pourra
être que temporaire.
A. L'ONAC : UNE INSTITUTION DONT L'ACTIVITÉ EST DESTINÉE À FORTEMENT DIMINUER
Depuis
quelques années, le volume d'activité des services
départementaux a fortement augmenté en raison de la recrudescence
des demandes de cartes et titres et de la montée en puissance du
dispositif du fonds de solidarité. Les services ont été
rapidement saturés faute d'effectifs suffisants et ont dû faire
appel à du personnel supplémentaire pour faire face à cet
afflux d'activités.
Au 1
er
janvier 1996, 276 contrats
" emploi solidarité " étaient employés dans
les services départementaux. Ils représentaient alors plus de
41 % des effectifs budgétaires.
Lorsque votre rapporteur avait visité certains services de
proximité, il s'était étonné du nombre important
des emplois précaires parmi le personnel. En réalité, il
s'agit d'un choix délibéré de la part de l'ONAC qui
résulte du caractère temporaire de la recrudescence
d'activité.
A long terme, le volume d'activité devrait au contraire fortement
diminuer en raison de la baisse du nombre de demandes de cartes et titres
à partir de 2002, de la disparition progressive du fonds de
solidarité, de la stabilité de l'action sociale à
destination des ressortissants traditionnels et, enfin, du déclin
général du nombre des ressortissants de l'Office
.
1. La baisse de l'activité relative aux cartes et titres à partir de 2002.
L'assouplissement des conditions d'attribution des cartes et
des
titres a conduit à une recrudescence des demandes, surtout en ce qui
concerne le titre de reconnaissance de la Nation et la carte du combattant
d'Afrique du Nord.
Toutefois, comme le rappelle un récent rapport du secrétariat
d'Etat aux anciens combattants
23(
*
)
, "
l'engorgement actuel de
l'activité est temporaire. Le flux de nouvelles demandes relatif
à la deuxième guerre mondiale est circonscrit aux
opérations effectuées pendant la campagne de 1940 et aux quelques
poches de résistance de 1944 pour lesquelles la règle des
90 jours de présence de feu ne pouvait s'appliquer. De plus,
l'élargissement des conditions de reconnaissance des droits aux anciens
d'AFN a atteint ses propres limites. Le nombre de dossiers
déposés au titre de l'Algérie s'établit
actuellement à 1.500.000 demandes.
Ce chiffre représente
86 % du nombre total des militaires ayant servi en AFN au cours de la
période 1952-1962
tel que l'indiquent les statistiques officielles
du ministère de la défense
".
Selon un rapport de l'inspection générale des anciens
combattants
24(
*
)
de 1998, la
carte du combattant en Afrique du Nord devrait continuer à être
attribuée jusqu'à ce que toute la population encore en vie soit
reconnue combattante. En conséquence, 50.000 titres devraient
encore être délivrés sur 5 ans, soit jusqu'en 2003. En
outre, 3.000 cartes nouvelles par an devraient être accordées pour
les forces engagées dans les nouveaux conflits. Le nombre des victimes
du terrorisme prises en charge par le fonds de garantie des assurances est
réputé augmenter de 50 par an.
A partir de 2003, le nombre de demandes de cartes et titres devrait donc
fortement chuter.
2. La disparition progressive du fonds de solidarité
La mise
en place de nouveaux dispositifs d'assistance avait également
contribué à augmenter l'activité des services
départementaux de l'ONAC.
En effet, suite à la création du fonds de solidarité, ces
derniers sont devenus responsables de l'instruction de l'allocation
différentielle, l'une des deux allocations délivrées par
ce fonds.
De 1993 à 1996, le nombre de bénéficiaires est
passé de moins de 6.000 à plus de 38.000, avec un maximum de
38.919 en juin 1996. Ce nombre s'est ensuite réduit, notamment en raison
de la montée en puissance de l'allocation de préparation à
la retraite.
Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué, le nombre de
bénéficiaires devrait continuer à chuter jusqu'en 2002,
date à laquelle les derniers bénéficiaires basculeront
dans le dispositif de droit commun pour l'assistance aux personnes
âgées.
Or, cette diminution de l'activité des services départementaux de
l'Office ne sera pas compensée par une recrudescence des actions
sociales traditionnelles.
3. La stabilité de l'action sociale à destination des ressortissants traditionnels
L'action
sociale à destination des ressortissants traditionnels, à savoir
les anciens combattants, constituée par les secours et les prêts,
s'est fortement élargie à d'autres catégories de
ressortissants, notamment les veuves d'anciens combattants non
pensionnés. Les services départementaux ont su s'adapter à
la diversité des situations sociales.
Cette évolution est cependant essentiellement d'ordre
quantitatif.
Depuis 1991, le volume total des dossiers traités a
diminué. Il est passé de 33.153 en 1991 à 23.388 en 1998.
Cette diminution de l'activité est liée à la baisse du
nombre de secours accordés par le biais de la subvention de l'Etat, qui
n'a pas été compensée par une augmentation des secours
financés sur les ressources affectées de l'ONAC.
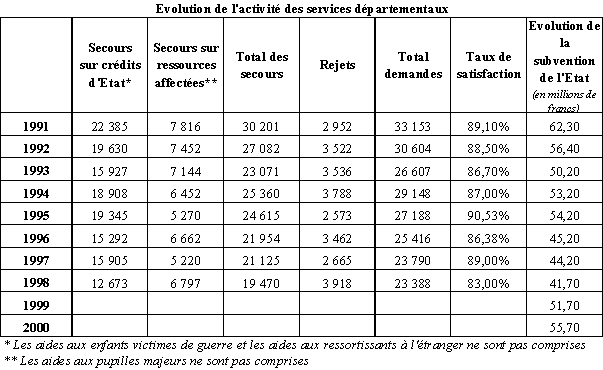
Cette baisse s'explique par la montée en puissance du fonds de
solidarité, qui a pris en charge jusqu'à
43.259 ressortissants en mars 1997. Ce chiffre était de
29.728 en juin 1999.
Depuis 1999, la subvention de l'Etat augmente de nouveau. Toutefois, il est peu
probable que cette hausse ait une influence significative sur le volume
d'activité des services départementaux. En effet, la
priorité devrait être donnée à une revalorisation
des aides moyennes accordées et non à une augmentation sensible
du nombre des bénéficiaires.
Les chiffres recueillis par votre rapporteur sur les aides
financières aux veuves d'anciens combattants confirment cette
hypothèse.
En 1998, 10,6 millions de francs avaient
été accordés à 5.934 veuves, le montant moyen de
l'aide s'élevant donc à 1.788 francs. En 1999, l'Etat a
consenti 5 millions de francs de crédits supplémentaires
pour les veuves d'anciens combattants. Au premier semestre 1999,
7 millions de francs avaient été accordés à
2.991 veuves, soit une aide moyenne de 2.340 francs. Il apparaît
donc bien que sur l'année 1999, le nombre de veuves aidées sera
à peu près le même qu'en 1998, soit 2.991 x 2 = 5.982. En
revanche, le montant de l'aide perçue par chaque veuve a
progressé puisqu'il est passé de 1.788 francs à
2.340 francs, soit une augmentation de 30,6 %.
La sortie du fonds de solidarité d'un nombre croissant de ressortissants
risque d'entraîner une augmentation du nombre des dossiers
déposés auprès des services départementaux. Pour
autant, l'activité de ces derniers ne devrait pas être
profondément modifiée. En effet, l'aide apportée par
l'ONAC ne constitue qu'un secours temporaire, qui n'a pas vocation à se
substituer au dispositif d'aide sociale de droit commun. Les services
départementaux ont donc surtout comme mission d'informer les
ressortissants sur leurs droits et de les orienter vers le dispositif national
de protection sociale. La création de 20 postes d'assistantes sociales
pour 2000 confirme cette évolution.
Il apparaît donc bien que
les missions des services de proximité de l'ONAC ont vocation à
évoluer en qualité, mais non en quantité.
Cette tendance est en grande partie liée à la diminution
inexorable du nombre de ressortissants.
4. Le déclin général du nombre des ressortissants de l'Office
L'évolution prospective présentée par l'étude précitée 25( * ) sur la période 1998-2018 est à ce titre tout à fait instructive.
Les générations du feu
L'histoire de France est jalonnée par une succession
presque
ininterrompue de batailles et de guerre. Le 20
ème
siècle en est, plus que tout autre, un exemple douloureux. La
première guerre mondiale, puis la deuxième guerre mondiale, ont
profondément marqué la première moitié du
siècle.
Les guerres de décolonisation vont ensuite se succéder sans
interruption, au point que, du point de vue du code des pensions, la guerre
d'Indochine, puis de Corée et l'expédition de Suez sont
considérées comme le prolongement de la deuxième guerre
mondiale.
La guerre d'Algérie, qui se réduira pendant longtemps à de
simples opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, va ensuite
nécessiter la mobilisation massive du contingent. Enfin, la fin du
siècle fait appraître de nouvelles formes de conflits. La
volonté réaffirmée par la communauté
internationale, en particulier par l'ONU, du maintien de la paix dans le monde
et d'une intervention armée pour raisons humanitaires, justifie de
nouveaux engagements militaires auxquels participe la France.
Par ailleurs, la mobilisation et la préparation des forces imposent
" hors guerre " une mise en condition des forces armées ;
elle s'accompagne d'infirmités contractées à
l'entraînement.
Enfin, l'émergence, depuis une vingtaine d'années, d'une nouvelle
manifestation de conflits sous forme de terrorisme, se traduit par de nouvelles
vicissitudes qui frappent indistinctement la population ; les victimes du
terrorisme et les orphelins des fonctionnaires tués en services
commandés sont venus s'adjoindre à la cohorte des victimes de
guerre.
L'attribution de la carte du combattant, selon des conditions uniformes, ne
permettrait pas de tenir compte de la spécificité de chaque
conflit et pourrait restreindre injustement la reconnaissance du statut de
combattant. C'est la raison pour laquelle les ressortissants sont
distingués selon le conflit dont ils sont issus.
Ainsi, la première génération du feu correspond aux
ressortissants issus de la première guerre mondiale.
La seconde génération du feu est constituée par tous les
anciens combattants de la seconde guerre mondiale.
La troisième génération du feu vise l'ensemble des
personnes ayant participé à la guerre d'Algérie, mais
également aux opérations lancées au Maroc et en Tunisie.
Enfin, la quatrième génération du feu est issue des
nouveaux conflits (intervention de militaires français au Tchad, au
Congo, au Zaïre...) et, notamment, de la participation de la France aux
opérations de maintien ou de rétablissement de la paix
décidées par l'Organisation des Nations Unies (Liban, Somalie,
ex-Yougoslavie).
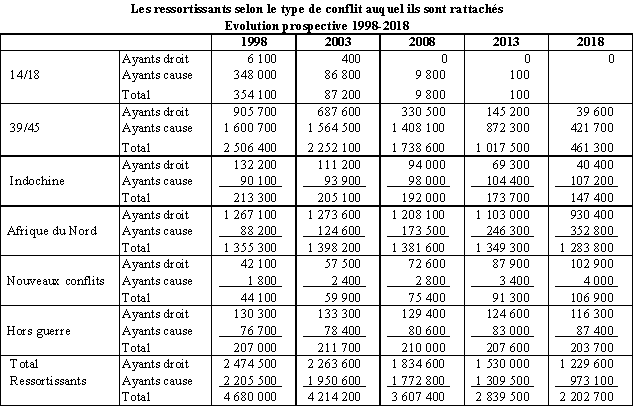
La première génération du feu
, qui n'est
aujourd'hui plus guère représentée que par les orphelins
de guerre et les veuves d'anciens combattants, va disparaître
entièrement d'ici 2003.
La seconde génération du feu
, encore majoritaire dans le
monde combattant, devrait connaître, sur les vingt prochaines
années, une évolution identique à celle qu'a connue la
première génération du feu : d'ici 2003, 24,1 %
de cette fraction de population devrait disparaître, tandis que le
diminution des ayants-cause devrait se produire à partir de 2008. En
2018, le nombre des ressortissants issus de la deuxième guerre mondiale
sera devenu marginal (461.100 contre 2,5 millions en 1998). Une
évolution équivalente va se produire s'agissant des
ressortissants issus de la guerre d'Indochine.
La troisième génération du feu
devrait
connaître une évolution inverse à celle des
précédentes. Le nombre des ayants droit va encore progresser
légèrement pendant 5 ans avant de se stabiliser à
partir de 2003 à 1,2 million, puis de décroître
à partir de 2010 de 2,5 à 3,5 % par an. Le nombre de
veuves, peu important actuellement, va être multiplié par 4 en
20 ans pour atteindre 352.800 personnes.
La quatrième génération du feu
devrait voir ses
effectifs doubler en 20 ans pour atteindre 106.900 personnes.
Or, les conclusions tirées par les deux inspecteurs de cette
évolution sont alarmantes pour la pérennité de
l'ONAC :
"
Un premier constat s'impose. Si le Ministère a
réussi, sur les dix dernières années, à stabiliser
la population de ses ressortissants par intégration dans celle-ci des
veuves de combattant ou de victimes civiles, il ne lui reste plus de
subterfuges pour l'avenir. Dès lors, celle-ci va inéxorablement
se réduire dans les vingt prochaines années à un rythme de
plus en plus soutenu : de 2 % par an jusqu'en 2008 et puis 3 %
au delà. Au total, en vingt ans, la population aura chuté de
moitié. [...]
Une deuxième observation peut être formulée. Le
déclin général de la population touche de manière
similaire toutes les catégories de ressortissants. Le nombre des
pensionnés devrait représenter tout au long de la période
environ 8 % de la population totale ; les bénéficiaires
d'un titre de combattant ou de victime de guerre représenteront autour
de 45 % de la population, les veuves 38 %, les orphelins 7 % et
les ascendants 0,3 %. [...]
Le fait que la baisse va toucher de manière similaire toutes les
catégories de ressortissants va se traduire par une décrue
équivalente de toutes les missions qu'assume le Ministère. Nous
n'assisterons pas, comme certains le pressentaient de façon intuitive,
à un transfert des missions régaliennes vers les missions
sociales. Toutes les populations déclinent au même rythme, il
convient donc de s'attendre à une réduction simultanée de
toutes les missions du Ministère, sauf celles qui ont trait à la
mémoire, dont la dynamique n'est pas directement lié au niveau
des populations assistée
s
".
Il apparaît donc bien qu'à partir de 2003, l'activité de
l'Office chutera. A cette date, non seulement l'ensemble des cartes d'anciens
combattants d'Afrique du Nord auront été délivrées,
mais également les derniers bénéficiaires du fonds de
solidarité seront sortis du dispositif. Par ailleurs, la diminution du
nombre de ressortissants commencera à être significative :
(ils seront 4,2 millions en 2003 contre 4,7 millions en 1998).







