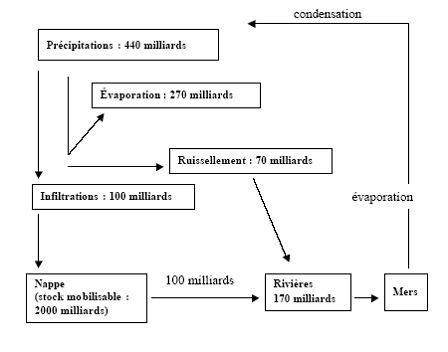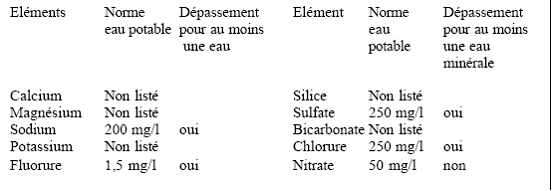Rapport de l'OPECST n° 215 (2002-2003) de M. Gérard MIQUEL , fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scient. tech., déposé le 18 mars 2003
Disponible au format Acrobat (893 Koctets)
-
REMERCIEMENTS
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE I - LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE EN
EAU
-
I. LA QUALITÉ DE L'EAU DE PLUIE
-
II. LES EAUX SOUTERRAINES
-
A. LA CONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES
-
B. LES POLLUTIONS HISTORIQUES
-
C. LES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES
-
D. LES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE
-
A. LA CONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES
-
III. LES EAUX DE SURFACE
-
IV. LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
-
I. LA QUALITÉ DE L'EAU DE PLUIE
-
CHAPITRE II - LA QUALITÉ DE L'EAU
DISTRIBUÉE
-
I. LES NORMES DE QUALITÉ
-
II. LES TRAITEMENTS DE L'EAU
-
A. LES SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
-
B. INTERROGATIONS ET DIFFICULTÉS
-
A. LES SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
-
III. LA DISTRIBUTION DE L'EAU
-
I. LES NORMES DE QUALITÉ
-
CHAPITRE III - LA QUALITE DE
L'ASSAINISSEMENT
-
I. L'ÉPURATION DES EAUX USÉES
-
II. LES SOUS PRODUITS DE L'ASSAINISSEMENT
-
I. L'ÉPURATION DES EAUX USÉES
-
CHAPITRE IV - CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
-
A. UN DOUBLE CONSTAT D'ÉCHEC
-
B. PROPOSITIONS
-
1. Définir l'eau comme un enjeu
stratégique
-
2. Déterminer des zones de sanctuarisation
des ressources stratégiques
-
3. Fixer un objectif géographique de
reconquête de qualité
-
4. Etablir des protections des cours d'eau
-
5. Réformer la politique de
prévention des pollutions diffuses d'origine agricole
-
6. Préserver la ressource souterraine en
contrôler mieux les prélèvements d'eau
-
7. Prévenir les pollutions individuelles
en milieu rural
-
8. Réformer le régime des
périmètres de protection
-
9. Réformer en profondeur l'organisation de
la police de l'eau
-
10. Réformer en profondeur l'organisation
de la gestion locale de l'eau
-
11. Mieux informer l'usager
-
12. Mieux former le citoyen
-
13. Préparer l'application des normes
européennes
-
14. Agir sur la qualité du sol
-
15. Donner un statut aux boues de stations
d'épuration
-
16. Simplifier la tarification de l'eau
-
1. Définir l'eau comme un enjeu
stratégique
-
A. UN DOUBLE CONSTAT D'ÉCHEC
-
EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE PARLEMENTAIRE
D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
|
N° 705
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N°
215
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
Annexe au procès verbal de la séance
|
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
RAPPORT
sur «la qualité de l'eau et de l'assainissement en France»
par M. Gérard MIQUEL,
Sénateur
|
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Claude BIRRAUX Président de l'Office |
Déposé sur le Bureau du Sénat par M. Henri REVOL Premier-Vice Président de l'Office |
||||
LETTRE DE SAISINE DE L'OFFICE
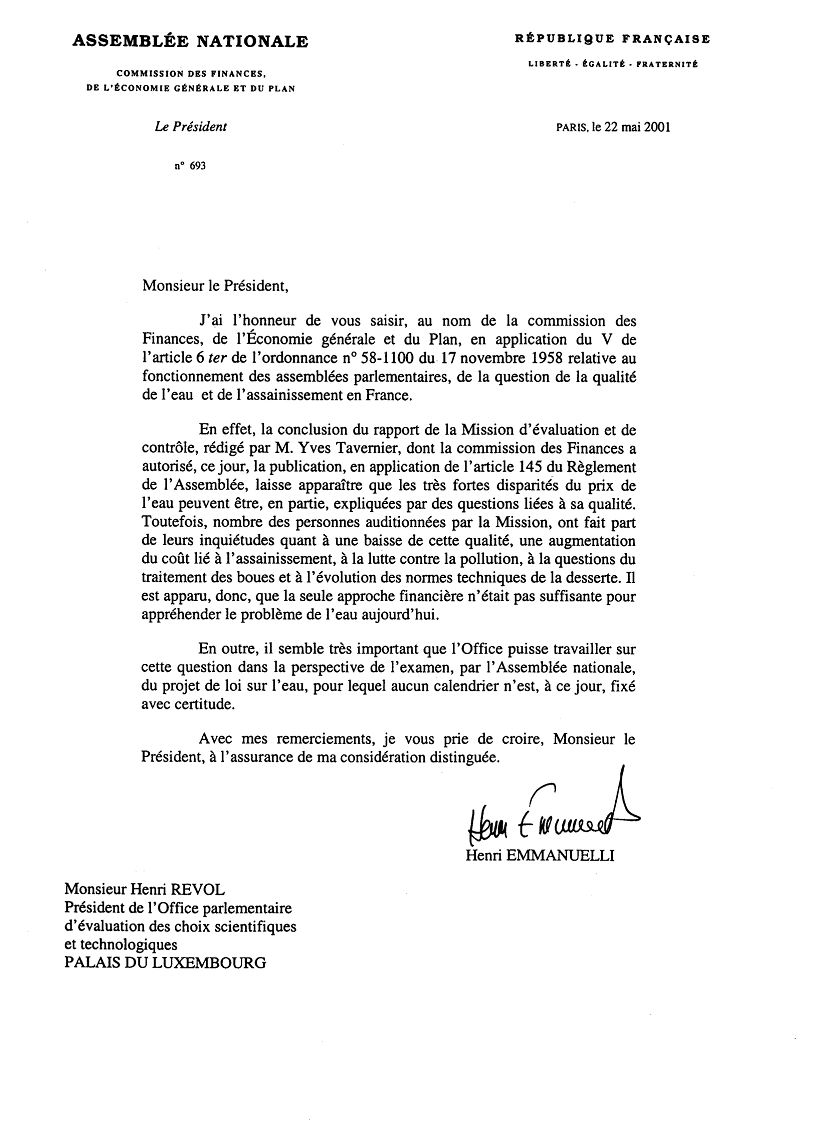
REMERCIEMENTS
La présente étude a été conduite avec l'appui d'un comité de pilotage composé d'experts. Leur contribution a été décisive. Grâce à eux et avec eux, plus de cent auditions, entretiens et visites sur le terrain, toujours passionnantes, ont été organisés.
Le comité était composé des personnalités suivantes :
|
Rapporteur |
M. Gérard MIQUEL, sénateur du Lot (soc.) auteur de rapports sur « les nouvelles techniques de valorisation des déchets ménagers et des déchets industriels banals » et « les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé » mel g.miquel@wanadoo.fr |
|
|
Comité de pilotage |
M. Jean-Claude DEUTSCH Professeur à l'Ecole des Ponts |
|
|
M. Michel MEYBECK Directeur de Recherches CNRS Université Paris VI Pierre et Marie Curie |
||
|
M. Antoine MONTIEL Directeur Qualité Environnement à la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP) |
||
|
M. Jean-Luc VASEL Professeur à la Fondation Universitaire Luxembourgeoise mel vasel@ful.ac.be |
||
|
Secrétariat |
M. Nicolas-Jean BREHON Conseiller des services du Sénat mel nj.brehon@senat.fr |
INTRODUCTION
Les saisines de l'Office Parlementaire d'évaluation des Choix Scientifiques et Technologique (OPECST) fonctionnent comme un baromètre de l'opinion. Elles révèlent les interrogations, les inquiétudes de nos concitoyens. La demande de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale, portant sur « la qualité de l'eau et de l'assainissement en France » confirme que l'environnement et la santé sont devenus des thèmes majeurs de réflexion de notre société en mutation. Le quart des rapports de l'Office concerne ces sujets, mais leur écho est grandissant, montrant ainsi que l'Office fait oeuvre utile en tentant d'apporter sinon des réponses, du moins un éclairage aussi neutre et complet que possible à des questions d'actualité.
Le présent rapport est une synthèse d'un an de travail, d'auditions et de visites sur le terrain, toujours passionnantes.
L'eau, élément indispensable à la vie, « patrimoine de la nation » (article 1 er de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau), est évidemment une préoccupation constante de toutes les époques et de tous les lieux. Seuls les mots (les maux ?) changent. Encore trop souvent, quand il y a excès ou pénurie, l'eau est une question de vie et de mort: Dans nos régions, les préoccupations ont évolué. Autrefois, on s'interrogeait sur la salubrité ou la potabilité des eaux, désormais on s'inquiète de leur qualité. A priori, pourtant, le constat est rassurant. L'eau distribuée au robinet est de bonne qualité, et les Français sont, dans une large majorité, satisfaits de l'eau qui leur est fournie.
Néanmoins, l'inquiétude progresse et les contentieux se multiplient. Aux questions rituelles sur le goût et le calcaire, touchant à l'agrément, s'ajoutent aujourd'hui les craintes liées aux pollutions agricoles voire à la menace d'attaques bactériologiques. Derrière la question simple, se cache l'appréhension des risques liés à la sécurité alimentaire. L'eau, élément vital, est un bien fragile où se concentrent les peurs du monde.
Cette peur est-elle justifiée ? Dans notre société de consommation, le marketing, la publicité, la médiatisation, qui donne un écho national à un incident local, et la recherche de sensationnel, contribuent à former les opinions et induire des comportements. La peur est un créneau et beaucoup s'y engouffrent pour vendre du papier, des filtres ou des bouteilles. Beaucoup de ces réactions sont excessives ou irrationnelles, mais il faut considérer cette inquiétude comme une donnée de fait, presque une donnée politique.
Sur ce genre de sujets, qui mêlent technique et politique, qui s'adressent aux consommateurs et aux citoyens, l'Office parait être un lieu privilégié d'échanges et d'analyse. Trois raisons peuvent justifier son implication :
- L'attente contradictoire de l'opinion , dont témoigne ce curieux sondage : les Français n'ont guère confiance dans les pouvoirs publics pour les informer sur la sécurité alimentaire, mais quand on leur demande « qui doit les informer ? » ils se tournent vers les mêmes pouvoirs publics. Ainsi, l'opinion dénonce et appelle en même temps. L'Office, au coeur des institutions mais en marge des querelles politiques, peut trouver sa place dans ce dispositif ;
- L'écoute des élus locaux , en particulier des maires. La gestion de l'eau est l'affaire des collectivités locales.. Elles se trouvent en première ligne dans l'entretien et l'efficacité des réseaux de distribution et d'assainissement, mais aussi en cas d'incident. Pourtant, s'ils sont exposés sur le plan politique, juridique, médiatique, les maires ne sont pas toujours bien armés face à l'adversité et aux questions de leurs concitoyens. Que répondre à un interlocuteur qui craint pour sa santé, à un contradicteur qui évoque le risque de cancer, voire, comme on l'a entendu au cours de cette mission, de « génocide hydrique » L'eau est aussi une science qui renvoie à des connaissances, des sigles, inaccessibles au plus grand nombre, y compris à la plupart des élus.
L'Office a voulu travailler pour eux. Ce rapport a d'abord été conçu comme un outil d'information, un outil pédagogique à destination des élus.
- L'ambition d'une vision prospective . L'information sur l'eau est abondante, surabondante même. Mais cette année d'étude a permis de penser qu'il manquait parfois de repères, d'orientations stratégiques. Même si les techniques de traitement sont au plus haut niveau, il semble que la France aborde au 21 e siècle cette question cruciale de la gestion et de la qualité de l'eau avec des structures et des mentalités du 19 e siècle, accrochées à l'image des fontaines du village où l'eau était pure et gratuite...
Des réformes paraissent inévitables. A tous les niveaux et dans tous les secteurs (agriculture, structures de gestion, services de contrôle ...). Mais si des choix s'imposent, le courage manque parfois pour les imposer...
Pourtant, les conditions paraissent réunies pour entreprendre. L'inquiétude, la pression environnementale, la politique européenne, le droit à l'expérimentation sont autant de facteurs de mobilisation. Le présent rapport, qui se veut pédagogique et prospectif, trouve sa place dans ce contexte et est l'une des expressions de ce débat citoyen.
CHAPITRE I - LA QUALITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU
Globalement, la France ne manque pas d'eau. Les besoins annuels sont estimés à 16 milliards de m 3 répartis en trois composantes d'égale importance : la fourniture d'eau potable à la population, l'arrosage ou l'irrigation agricole, et l'industrie (hors production d'énergie). Face à ces besoins, la France dispose de ressources potentielles très importantes : les précipitations annuelles représentent 440 milliards de m 3 , le stock mobilisable d'eaux souterraines est estimé à 2.000 milliards de m 3 , et les 270.000 km de cours d'eau ont un débit de 170 milliards de m 3 par an.
Les besoins peuvent donc être satisfaits sans inquiétude, même si localement, ou temporairement, un déficit d'eau peut apparaître.
L'eau utilisée pour produire de l'eau potable vient à 63 % d'eaux souterraines et à 37 % d'eaux dites superficielles, issues des cours d'eau ou des lacs. Ces deux sources sont alimentées directement par l'eau de pluie participant ainsi au fameux cycle de l'eau qui se présente selon le schéma présenté ci-dessous (schéma 1).
L'eau, au cours de son parcours dans le sol ou dans les rivières, se charge de différents polluants d'origine naturelle et/ou d'origine humaine (1 ( * )) , qui devraient être traités ou éliminés avant que l'eau ne soit distribuée à la population. Un schéma (schéma 2) présente ce large éventail des pollutions de l'eau.
La qualité des eaux, et d'une façon générale, des milieux aquatiques, doit être évaluée aujourd'hui dans le contexte de la directive cadre européenne du 23 octobre 2000 qui impose une révision profonde de la méthode d'analyse et des objectifs de qualité attendus : en 2015, la ressource en eau, toutes catégories confondues (cours d'eau, eaux souterraines, eaux littorales...) doit être en « bon état ». Ce bon état est évalué à partir de critères de qualité physico-chimique de l'eau et de critères biologiques.
Schéma 1
Présentation
schématique du cycle de l'eau
(en m
3
)
Les différentes origines des produits rencontrés dans l'eau
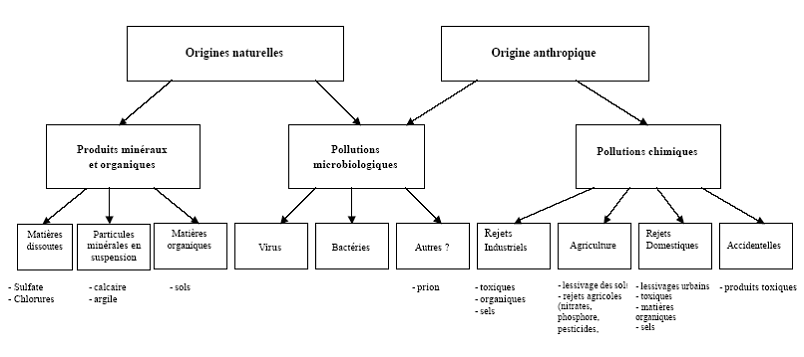
Apprécier la qualité de la ressource conduit à analyser les caractéristiques des eaux souterraines et des eaux de surface et par conséquent, en amont, les caractéristiques de l'eau de pluie.
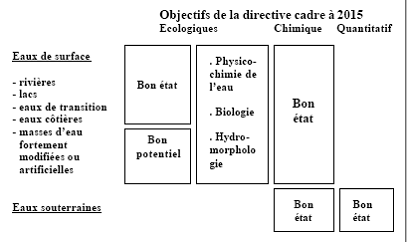
I. LA QUALITÉ DE L'EAU DE PLUIE
Les nappes souterraines et les rivières dans lesquelles est prélevée l'eau destinée à la fabrication d'eau potable ont une même origine : les précipitations atmosphériques constituées en France à 93% d'eau de pluie. Bien qu'évidente, cette affirmation n'a pas été analysée dans toutes ses conséquences, et les analyses de l'eau de pluie, dite aussi « eau météorite » sont récentes et encore rares.
Toute la gestion de l'eau (accès à la ressource, traitement, distribution, évacuation et assainissement des eaux usées ...), s'est organisée en faisant abstraction de la qualité de l'eau originale, considérée, presque par postulat, comme étant de très bonne qualité. Les récentes études montrent qu'il n'en est rien. Nous avons la pluie que notre société fabrique . Et sa qualité n'est pas bonne.
On observera toutefois qu'il n'existe pas de véritable norme de qualité de l'eau de pluie. Il est d'usage de se rapprocher des normes appliquées pour l'eau potable. Une eau polluée au départ ne peut qu'entraîner une eau polluée à l'arrivée, en rivière et dans les nappes. Par ailleurs, si l'homme ne boit pas l'eau de pluie, les animaux la boivent.
En France métropolitaine, en arrivant au sol, l'eau de
pluie s'évapore (à 61%), s'infiltre (à 23%) ou ruisselle
(à 16%) et rejoint les cours d'eau. La température et la nature
du sol vont déterminer la part respective de chaque processus.
L'importance du ruissellement est une variable déterminante car au cours
de son parcours au sol, l'eau se charge de divers résidus et polluants,
qui vont transformer sa composition. L'analyse de l'eau météorite
doit être complétée par celle de l'eau
récupérée. On distingue en général les deux
par des appellations distinctes : l'eau de pluie est dite aussi
« eau météorite », tandis que l'eau
récupérée par ruissellement est dite « eau
pluviale ».
A. L'EAU MÉTÉORITE
La formation de la pluie résulte pour l'essentiel de la condensation de l'eau contenue dans l'air, mais l'air contient aussi des particules et des gaz d'origine naturelle et/ou d'origine humaine, qui se dispersent, circulent dans l'atmosphère, et vont se redéposer au sol, soit par temps sec, soit par temps humide. Au contact de l'eau, les gaz se transforment en acides. La pluie va donc naturellement se charger de particules et d'acides. Il y a un lien naturel entre pollution atmosphérique et pollution de la pluie (2 ( * )) . L'évolution des caractéristiques de la pluie traduit l'évolution de la pollution atmosphérique.
L'analyse des précipitations a été effectuée avant tout dans un but quantitatif et rarement dans un but qualitatif. Les rares exceptions historiques n'étaient pourtant pas sans intérêt (en révélant par exemple qu'au milieu du 19 ème siècle, les pluies de Paris étaient chargées d'ammoniaque dégagé par l'urine des chevaux), mais il a fallu attendre les années 1980, avec l'émergence d'un droit international de l'environnement (conventions de Genève sur la pollution atmosphérique de 1979 créant une obligation de surveillance) et la médiatisation des « pluies acides » (3 ( * )) liées à l'augmentation de dioxyde de soufre, devenues symbole de la crise environnementale annoncée, pour que l'analyse s'organise.
Depuis dix ans, l'eau est surveillée à partir d'un réseau de collecte dans plus de 200 sites répartis dans cinq régions. Plusieurs paramètres sont analysés (acidité, sulfate, ammonium, nitrates (4 ( * )) ...). Quelques réseaux locaux étudient par ailleurs les métaux lourds (programme PIREN Seine pour l'Ile de France) et les pesticides (études de l'INRA sur la Bretagne). Les observations permettent de dégager quelques tendances et caractéristiques.
• La composition moyenne de l'eau de pluie en France
Il n'existe pas de norme de qualité de l'eau de pluie. Les analyses reprennent les paramètres utilisés pour l'eau potable. L'eau de pluie naturelle est acide (pH 5). Elle contient en plus ou moins grande quantité, des sulfates, du sodium, du calcium, de l'ammonium, et même des nitrates. Les pesticides n'ont été mesurés par ce réseau qu'à partir de 2002, mais d'autres études dédiées aux pesticides confirmeraient la présence, parfois importante, de pesticides dans les eaux de pluie (5 ( * )) . Les différents paramètres analysés sont présentés en annexe.
• L'évolution dans le temps
Sur les dix dernières années, les caractéristiques de l'eau de pluie sont relativement stables, en moyenne annuelle. On note toutefois quatre évolutions significatives :
- la baisse de la présence de sulfates , surtout marquée au cours des années 80, lors de l'abandon des centrales thermiques et leur remplacement par des centrales nucléaires. Ce paramètre est essentiel dans la détermination de l'acidité de l'eau
- la baisse de l'ammonium . Le gaz ammoniac se transforme en ammonium au contact de l'eau.
- la hausse tendancielle de la présence de nitrates avec retombées de 180 mg/m 2 et par an en moyenne en 1990-1991, 296 mg/m 2 en moyenne, dix ans plus tard, 1999-2000, soit 0,3 mg/litre d'eau de pluie.
- la stabilité, en moyenne annuelle, marque des différences considérables selon les mois. L'acidité est l'un des principaux paramètres de mesure de la qualité de l'eau. C'est par l'acidité que l'eau dissout, corrode les toitures, attaque les minéraux et remet en solution (c'est-à-dire mélange aux liquides) des éléments solides. Dans un même lieu, l'acidité peut ainsi varier entre 3,8 (eau très agressive) à 7 (eau neutre). L'écart est encore plus important quand on le mesure entre plusieurs sites.
• Les différences régionales
Les différences régionales sont liées pour l'essentiel à la proximité de la façade atlantique et au voisinage des zones industrielles car les retombées atmosphériques s'accumulent par temps sec et sont entraînées avec la pluie :
- le Nord-Est est fortement exposé aux pluies acides. Mais les maxima peuvent être atteints dans d'autres régions. Les écarts entre départements peuvent être considérables : entre un pH de 7,8 mesuré dans le département des Alpes-Maritimes, et un pH de 3,8, soit une eau très acide, dans le département de l'Ardèche.
- les départements et régions qui reçoivent le plus de pluies acides sont aussi ceux qui reçoivent le plus de soufre et de nitrates.
- les régions océaniques ont une pluie naturellement chargée en chlorures, en potassium, calcium, magnésium et sodium (jusqu'à 100 kg/hectare et par an). Sur le littoral atlantique, les pluies contiennent plus de 10 mg de chlorures par litre. Cette teneur décroît progressivement, mais l'influence naturelle maritime se fait encore sentir jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. Après 100 km, la teneur en chlorures ne dépasse pas 2,5 mg par litre.
|
Le décret 2001-1220 de 2001 fixant les critères de potabilité distingue les « références de qualité » ou valeurs limites applicables à l'eau distribuée et les valeurs limites -valeurs guides ou valeurs impératives- des eaux destinées à la production d'eau pour la consommation humaine. Une eau potable et/ou une eau destinée à la fabrication d'eau potable doit respecter 48 paramètres parmi lesquels on compte 6 des 9 paramètres suivis dans l'eau potable (le potassium, ainsi que le calcium et le magnésium, qui déterminent la dureté de l'eau, sont suivis dans l'eau de pluie mais ne figurent pas parmi la réglementation de l'eau potable). En appliquant la grille d'analyse de l'eau potable à l'eau de pluie, on constate que les valeurs limites applicables à l'eau potable sont souvent dépassées sur deux paramètres : l'acidité (pH) très supérieure à la limite de potabilisation, et l'ammonium. En d'autres termes, si une part de l'eau de pluie peut être consommable en l'état dans certaines régions. Dans de nombreuses autres régions françaises, l'eau de pluie est trop acide et trop chargée d'ammonium pour être classée parmi les eaux susceptibles d'être utilisées pour la production d'eau potable. En outre, les premières analyses sur les pesticides révèlent que les concentrations peuvent être parfois supérieures aux seuils autorisés pour l'eau potable (0,1 microgramme par litre - 0,1 ug/l - 1 ug = 1 millionième de gramme). Une analyse d'eau de pluie en Bretagne a même enregistré un niveau de 24 ug par litre soit 240 fois le seuil limite autorisé pour l'eau potable. Un réseau de surveillance spécifique serait à mettre en place. Les dépassements, en moyenne annuelle, sont cependant mineurs et par conséquent, il se peut que localement et à certains moments, l'eau de pluie respecte les critères de potabilité ou de potabilisation. Il n'y a donc pas de conclusion simple sur la potabilité des eaux de pluie tant il existe de variations régionales et de variations temporelles. Néanmoins, le gisement eau de pluie mériterait une attention plus grande de la part des pouvoirs publics, en particulier pour l'alimentation des petites localités isolées. |
B. L'EAU PLUVIALE
1. La transformation de l'eau de pluie
a) L'effet du ruissellement en milieu urbain
En hydrologie urbaine, on appelle eau pluviale, l'eau de pluie récupérée après ruissellement. Arrivée au sol, l'eau s'évapore, s'infiltre dans le sous-sol ou ruisselle. La part prise par chaque processus dépend de la température, de la nature du sol, notamment de sa perméabilité. Au cours de son parcours vers son exutoire (ruissellement - canalisations - rivières), la pluie va se charger de différents dépôts polluants, notamment sous forme particulaire.
Ces particules vont générer des matières en suspension qui augmentent la turbidité de l'eau. La décomposition des matières organiques est elle aussi source de pollution (6 ( * )). 75 % à 85 % de la pollution contenue dans l'eau pluviale sont imputables au ruissellement (15 % à 25 % sont déjà contenus dans la pluie météorite). La pollution est à plus de 90 %- sous forme solide, et non sous forme dissoute. Cette caractéristique est très importante. Elle conditionne les modes de traitement éventuels car la pollution solide peut être éliminée par aspiration, par filtration et par décantation.
b) L'eau de pluie en ville
La ville réunit toutes les conditions pour contaminer de façon massive l'eau météorite : l'eau ruisselle sur des surfaces qui sont pour la plupart imperméables (toitures, chaussées), très vulnérables à la corrosion (zinc des gouttières, crochets de plomb des toitures) et/ou très chargées de dépôts polluants liés au trafic automobile et à l'activité industrielle. Entre le quart et la moitié de la pollution que l'on trouve dans les eaux de ruissellement est lié au trafic automobile. Le ruissellement va donc constituer une source majeure de particules (matières en suspension), de matières organiques, et surtout de polluants métalliques, notamment de plomb et de zinc (issus des toitures). Dans les années 90, avant l'interdiction du plomb dans l'essence, on estimait que le dépôt annuel de plomb à Lyon était de 100 grammes par hectare, soit 6 tonnes de plomb sur les 60.000 hectares de l'agglomération.
A Paris, les concentrations de plomb ou de zinc, à l'arrivée des eaux de ruissellement urbain dans la Seine sont, respectivement, de vingt fois et cent cinquante fois supérieures à ce qu'elles étaient dans l'eau météorite (7 ( * )) .
Zinc et plomb figurent dans la réglementation sur l'eau apte à la potabilisation parmi les « substances indésirables » et les « paramètres toxiques ». Les seuils atteints après écoulement sur les différentes surfaces urbaines sont de cinq à quarante fois plus élevés que les seuils réglementés (20 mg/l au lieu de 3 mg/l pour le zinc ; 2 mg/l au lieu de 0,05 mg/l pour le plomb).
Ainsi, il apparaît clairement que si l'eau de pluie n'est pas toujours potable en milieu rural, les eaux de ruissellement sont manifestement toxiques en milieu urbain. Cette toxicité est particulièrement aggravée par le ruissellement des eaux sur les chaussées.
|
Il est souvent affirmé que les premières eaux sont particulièrement chargées en polluants, parce qu'elles drainent les polluants accumulés par temps sec. Cette idée est connue sous le nom d' « effet de premier flot » : le premier flot serait plus pollué au début de l'événement pluvieux que dans la suite de son déroulement. Ce supplément serait dû aux concentrations de polluants dans l'eau météorite, au lavage des surfaces urbaines (le premier flot d'orage collecte les polluants accumulés pendant la période sèche) et surtout à la remise en suspension des matériaux à l'intérieur du réseau d'évacuation. La validité de cette hypothèse est très importante pour déterminer les stratégies de traitement des pollutions pluviales (en retenant ou en traitant le premier débit par exemple). Les études effectuées ne mettent pas en évidence un effet de premier flot massif et significatif. L'effet de premier flot, faible, est surtout issu de la remise en suspension des matériaux accumulés à l'intérieur du réseau d'évacuation. Ceci est particulièrement net en cas de réseau unitaire (qui mêle eaux de pluie et eaux usées). Mais l'essentiel des dépôts par temps sec est constitué par des matériaux relativement grossiers (sables) qui ne suivent pas le débit de l'écoulement des pluies, mais qui sont transportés par charriage, à des vitesses plus faibles, de telle sorte que le premier flot n'est guère plus pollué que les suivants. Ainsi, la pollution serait légèrement plus importante après les premières pluies sans que l'effet de premier flot soit suffisamment net pour adopter des techniques et des moyens de prévention spécifiques. On estime qu'il faudrait stocker 20 % du volume d'eau pour traiter 30 % de la pollution des eaux de ruissellement. Le rapport coût efficacité ne milite pas pour la mise en place d'un tel dispositif. |
2. Les conséquences pour la gestion des eaux
La connaissance de la pollution des eaux pluviales est
très importante pour la gestion des eaux, y compris pour la production
d'eau potable, dont une partie est issue des eaux de surface, exutoire final
des eaux pluviales.
a) L'évacuation des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont évacuées dans les canalisations du système d'assainissement. Ce système peut être unitaire ou séparatif. Dans le système unitaire, en général plus ancien, les eaux de pluie sont mélangées aux eaux usées, évacuées par les habitants et les industries, et remettent en mouvement les particules déposées dans les canalisations au cours de la période sèche. L'ensemble est transféré normalement vers une station d'épuration. Dans le cas d'un système séparatif, les eaux pluviales sont séparées et s'écoulent directement dans le milieu naturel, généralement sans aucun traitement. Le choix, normalement réglementé en fonction des débits prévisibles d'eaux pluviales, est largement imposé par l'histoire (la plupart des réseaux ont été construits pendant la période de reconstruction après la seconde guerre mondiale) et l'espace disponible.
L'aménagement récent le plus courant consiste à stocker les eaux pluviales dans des bassins de retenue. Ce dispositif représente un tournant radical par rapport au système antérieur, puisque le réseau séparatif consistait au contraire à évacuer au plus vite l'eau pluviale dans la rivière. Les réseaux strictement séparatifs sont l'exception, du moins en grande ville.
Dans tous les cas, l'eau pluviale constitue une source de pollution majeure du cours d'eau (l'eau arrive généralement sans aucun traitement et par conséquent très chargée de polluants), et est une source de difficulté pour les stations de traitement des eaux usées, en cas de réseau unitaire. Ce phénomène sera traité dans la troisième partie du rapport.
Les inconvénients des rejets d'eaux de ruissellement
sont encore aggravés lorsqu'ils ont lieu à proximité ou en
amont de sites de captage d'eau destinés à la fabrication d'eau
potable pour la consommation humaine. L'eau est alors trop chargée de
matières en suspension et de polluants (ammoniaque et matières
organiques) et perturbe le fonctionnement des installations de potabilisation.
Le risque est loin d'être théorique puisque les jours d'orage,
certaines stations de pompage situées sur la Marne, alimentant la
population de la région parisienne, sont arrêtées pendant
quelques heures. Les jours d'arrêt des stations coïncident
pratiquement avec les jours d'orage.
b) La prévention contre les pollutions des eaux pluviales
La pollution issue du ruissellement des eaux de pluie est inévitable, mais ses inconvénients peuvent être limités par quelques mesures simples.
Il faut partir du constat que l'essentiel de la pollution des eaux de ruissellement est sous forme particulaire et peut donc être aisément stoppée par décantation. Les procédés de rétention d'eau (bassins tampon, chaussées réservoirs, fossés...) sont simples et efficaces et tout ce qui favorise cette décantation doit être encouragé. A défaut de ce type de traitement, les polluants s'accumulent dans les sédiments, générant des pollutions qui sont évacuées vers l'aval lors des épisodes de hautes eaux et qui devront être traitées dans l'avenir (il n'y a encore pratiquement rien de fait sur ce sujet).
Dans cette optique, l'imperméabilisation massive des sols est évidemment un non-sens . Les effets sur les inondations sont connus. Les effets sur la pollution des eaux de pluie le sont moins mais sont tout aussi importants. L'imperméabilisation aggrave la pollution des eaux de ruissellement. Il faut donner à la pluie des espaces d'écoulement, de stockage provisoire. Ce constat conduit à encourager plusieurs dispositifs connus sous le nom de « techniques alternatives » afin que l'urbanisation ne conduise pas inéluctablement à l'imperméabilisation des sols.
Trois types de disposition peuvent être évoqués :
§ L'entretien des surfaces au sol
Les actions de sensibilisation de personnels appelés
à utiliser des produits polluant l'eau doivent être
encouragées (personnels des parcs et jardins, pompiers...
(8
(
*
)))
. Une réflexion sur de
nouveaux modes d'entretien des voiries doit aussi être lancée. Le
nettoyage des trottoirs par balayage, comme le lessivage des chaussées,
est souvent inutile, voire contre productif. 50 % de polluants sont
fixés sur des particules inférieures à 40 microns
(40 millièmes de millimètre) qui ne sont pas enlevés
par balayage. Certains revêtements de chaussée ont un pouvoir
filtrant très important et ont une grande capacité d'absorption,
mais ils sont très vulnérables au colmatage lors des
infiltrations. Dans ces deux cas, des techniques d'aspiration paraissent mieux
adaptées.
§ L'aménagement urbain
La régulation des débits est traditionnellement
obtenue par des techniques centralisées, de type bassin de
rétention, en amont des villes. Les techniques alternatives misent
davantage sur les micro-stockages au sein même de la ville :
chaussée réservoir, espaces verts aménagés,
fossés aménagés en centre ville (rebaptisées
« noues »), toits stockants (à l'exception
évidemment des toits en zinc ou à fixations en plomb...). Ces
aménagements peuvent être intégrés dans les
équipements publics tels que l'utilisation des sous-sols du stade de
France à Paris et des parkings inondables à Marseille (un
« étage mort » représente 15.000
m
3
et permet de descendre le niveau de l'eau de 3 à 4 cm, un
impact apparemment faible mais qui permet parfois de descendre au-dessous du
seuil d'inondation).
§ La réglementation
Ces équipements peuvent être complétés par une action réglementaire, sous forme de sorte de « plans de zonage pluvial » visant à stopper le processus d'imperméabilisation des sols. La ville de Bordeaux, a innové en 1987 en intégrant ce risque dans les plans d'occupation des sols, en prévoyant que tout aménagement ne devait rejeter que le débit correspondant à une imperméabilisation de 30 % de la surface. A Rennes, la limite d'imperméabilisation est fixée hors centre ville à 40 %. Les constructeurs et aménageurs qui ne peuvent respecter ce coefficient doivent réduire les débits de ruissellement par des systèmes de stockage provisoire.
Un tel zonage est prévu par l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales (9 ( * )) mais cette obligation légale prévue dans des cas très restrictifs est mal respectée.
Ce système pourrait utilement être généralisé dans les grandes villes ; et dans toutes les villes situées en amont de prises d'eau utilisées pour la fabrication d'eau potable.
.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 1 - Les polluants
Annexe 2 - Pluie et pollution atmosphérique
Annexe 3 - Les pluies acides
Annexe 4 - L'analyse des pluies en France
Annexe 5 - Les pesticides dans les eaux de pluie
Annexe 6 - Le ruissellement des eaux de pluie
Annexe 7 - Les eaux pluviales à Paris
Annexe 8 - La pluie sur les autoroutes et les aéroports
Annexe 9 - Le régime juridique des eaux pluviales
Annexe 49 - Les pesticides dans les eaux de ruissellement
II. LES EAUX SOUTERRAINES
Il est d'usage de distinguer les eaux souterraines et les eaux de surface, bien qu'il s'agisse d'une même eau circulant en permanence dans les bassins versants et alimentant les fleuves en période de basses eaux. La différence entre les deux tient au mode d'exploitation, au rythme de renouvellement et aux protections dont elles bénéficient. Le caractère peu renouvelable des eaux souterraines s'oppose à la fluidité des eaux de surface. Tandis que les eaux de surface sont immédiatement contaminées par des pollutions ponctuelles et accidentelles, les eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions diffuses, longues à produire leurs effets, qui se manifestent souvent après un temps d'accumulation. Quand la dégradation est constatée, la restauration de la qualité des eaux souterraines est d'autant plus difficile et longue, de quelques années à quelques dizaines d'années, ce qui souligne l'importance de préserver ce patrimoine pour l'avenir.
Il existe en France environ 200 nappes d'eaux souterraines profondes exploitables contenant 2.000 milliards de m 3 d'eau pouvant servir à la fourniture d'eau et plusieurs centaines de nappes d'accompagnement des rivières, qui constituent surtout des réservoirs d'eau alimentant les cours d'eau notamment en période d'étiage (on estime que 100 milliards de m 3 d'eau passent des nappes aux cours d'eau) : 7 milliards de m 3 sont puisés chaque année dans l'un des 31.000 forages d'eau, 50 % des prélèvements sont utilisés pour l'eau potable, assurant ainsi 63 % des besoins domestiques.
Les nappes plus ou moins abondantes, et plus ou moins renouvelables, sont donc fondamentales à l'activité et même à la vie humaine. Le suivi de leur qualité est donc particulièrement important.
Le résultat est connu : la qualité des eaux
souterraines s'est dans l'ensemble beaucoup dégradée. Même
si les responsabilités sont partagées, les pollutions d'origine
agricole restent les premières responsables de la dégradation
récente.
A. LA CONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES
1. La qualité naturelle des eaux souterraines
Les nappes d'eaux souterraines sont formées par la percolation de l'eau de pluie et de ruissellement à travers les sols et les roches (10 ( * )) . Le processus d'infiltration est plus ou moins rapide selon les caractéristiques du sous-sol et la nature des roches, mais au cours de ce transfert, qui peut durer de quelques jours à plusieurs dizaines d'années, l'eau acide dissout les roches et se charge de quelques uns de ses éléments chimiques les plus solubles. Ainsi, l'eau des nappes supposée être de très bonne qualité après le filtre naturel du sous-sol ne l'est pas toujours.
La qualité naturelle des eaux souterraines, va donc être naturellement influencée par ce que les géologues appellent le « fonds géochimique ». Certains minéraux et métaux sont rendus mobiles par l'acidité de l'eau et/ou le contact de l'air libre (les roches sont mises en contact avec l'air par les mines, les galeries), et l'eau se charge alors de ces éléments dont quelques uns à doses modérées, sont bons pour la santé (les eaux minérales, à l'origine, étaient d'ailleurs vendues en pharmacie) tandis que d'autres peuvent être indésirables. La charge est variable selon les roches. Les eaux souterraines drainant les roches plutoniques, les plus anciennes (granit du massif central et du massif armoricain) peuvent être naturellement chargées en arsenic, aluminium, fer et manganèse. Les eaux des calcaires, très sensibles à l'acidité de l'eau, sont naturellement chargées en calcium, magnésium, parfois en fer, fluor, manganèse. Les eaux souterraines acides peuvent être naturellement chargées en aluminium.
Dans la quasi-totalité des cas, ces charges sont évidemment infinitésimales, mais sur une surface aussi étendue que le territoire français, il ne peut pas ne pas y avoir quelques exceptions ou « anomalies géochimiques », liées à la proximité des gisements en minerais, entraînant alors des dosages exceptionnels, en l'absence de toute contamination d'origine humaine (11 ( * )).
C'est en particulier le cas pour l'arsenic, le fer, le fluor, le bore, dont les doses naturelles dans les eaux souterraines peuvent être localement plus de cent fois supérieures aux valeurs requises pour la potabilisation des eaux. Ainsi, de même que les eaux de pluie, les eaux de source, issues des nappes souterraines peuvent être naturellement impropres à la consommation et à la fabrication d'eau potable. Comme le résume parfaitement M. Thierry POINTET, hydrogéologue au BRGM « dans la nature, toutes les eaux ne sont pas bonnes à boire ». Il convient cependant de distinguer une eau impropre à la consommation et une eau polluée (l'eau de mer, par exemple, n'est pas polluée naturellement, mais est impropre à la consommation).
Cette connaissance est importante pour faire cesser tout mythe d'une nature idéalisée et pour connaître l'« état zéro » d'une nappe, en vue, le cas échéant, de la traiter en vue de la potabiliser, comme c'est de plus en plus le cas pour certaines eaux minérales trop chargées en arsenic, en fer, etc...
2. Le transfert des polluants dans les eaux souterraines
Malgré ces quelques anomalies naturelles, rares et très localisées, la qualité des eaux souterraines en France est telle qu'elles constituent une ressource privilégiée pour l'alimentation en eau de la population. Là où elles existent, les nappes sont souvent accessibles, abondantes et fournissent une eau n'exigeant que peu de traitement pour être distribuée aux consommateurs. Cette qualité naturelle est largement due au filtre que constitue le transit de l'eau dans le sol.
Pourtant, au sol, la vie animale et surtout l'activité humaine génèrent des quantités de polluants, naturels (excréments) ou chimiques, occasionnels (accidents) ou diffus (origine agricole). Ce filtre est-il suffisant pour assurer la dépollution de l'eau issue des activités de surface ? La connaissance des transferts éventuels des polluants du sol vers les eaux souterraines est évidemment fondamentale pour assurer la protection durable de la ressource en eau. La dégradation -mal mesurée mais bien connue- des eaux souterraines et l'amélioration des connaissances sur les mécanismes de transfert conduisent à avoir une vision plutôt pessimiste. Le sol, entre la surface et la nappe est un « filtre vivant » imparfait. La migration des polluants vers les nappes est avérée. Pour Michel VAUCLIN, chercheur auditionné en février 2002, «l'euphorie passée que la tranche de sol située entre la surface et la nappe puisse constituer un filtre vivant capable de retenir et de dégrader les substances polluantes ou toxiques, a fait place, ces dernières années, à une réalité douloureuse : leur migration vers l'environnement plus profond est une évidence à la probabilité d'occurrence importante ».
Les modalités et temps de transfert des polluants sont très variables selon les types de polluants, selon les sols et font appel à trois processus distincts : les caractéristiques des sols et leur humidité, les réactions chimiques des molécules avec l'eau et le milieu, l'activité microbienne. Ainsi, une nappe peut être protégée pour un type de pollution et pas contre une autre. La nappe des sables de Fontainebleau est bien protégée des pollutions microbiologiques grâce au pouvoir filtrant des sables, mais ceux ci restent inefficaces faces aux pollutions chimiques solubles dans l'eau. Ces processus sont présentés plus en détails en annexe (12 ( * )) .
Les différents mécanismes sont résumés dans le tableau suivant :
Typologie des transferts de polluants dans les eaux
souterraines
|
|
|
|
|
|
Vitesse des transferts
|
- végétation
|
- structure du sol
|
- nature de la roche,
|
|
Transformation
|
- transformation biologique ; action des bactéries |
- transformation chimique abiotique - dissolution/précipi-tation /oxydation |
- transformation chimique abiotique - dissolution/précipi-tation /oxydation |
Ce large éventail des mécanismes de transfert constitue une difficulté pour la bonne connaissance des processus de filtration. Outre les difficultés d'étude dans chaque discipline (pédologie, chimie, microbiologie), l'approche pluridisciplinaire est encore peu courante en France et présente des handicaps spécifiques : délais plus importants, difficultés de valorisation des travaux du point de vue des chercheurs (il n'existe que très peu de publications interdisciplinaires, et quand elles existent, leur impact professionnel est beaucoup plus faible que celui des revues spécialisées propres à chaque discipline).
Malgré ces difficultés, une bonne connaissance
des mécanismes de transfert est fondamentale pour aider les
décideurs à préserver de façon durable la ressource
d'eau souterraine et à effectuer les arbitrages qui s'imposent :
étendue des périmètres de protection, nature des
changements éventuels dans les pratiques agricoles à mettre en
oeuvre, éventuellement sélection de sites à geler pour la
protection des nappes... Les choix sont ouverts, mais partent du constat simple
et amer : il est clair que
le passage lent dans le sol constitue
une filtration naturelle mais souvent insuffisante pour éliminer les
éventuelles pollutions de surface.
3. L'évaluation de la qualité des eaux souterraines
Le suivi de la qualité des eaux souterraines ne s'est
développé que récemment et reste incomplet. Pour
répondre aux inquiétudes croissantes de l'opinion, la
réponse la plus facile consiste à multiplier les analyses,
à produire des statistiques, des cartes et des rapports, pas toujours
cohérents entre eux. Les réseaux d'analyses présentent des
limites qu'il convient de connaître.
a) Le réseau de suivi des eaux souterraines
« Pour 100 personnes qui suivent les eaux de surface, il n'y en a qu'une pour suivre les eaux souterraines ». Alors que la ressource est capitale pour l'alimentation en eau potable, l'attention portée aux eaux souterraines a été tardive et partielle. Le nombre, la profondeur, et parfois l'importance des nappes semblaient constituer des garanties suffisantes. Le suivi des eaux de surface était techniquement plus simple. Ainsi, le suivi des eaux souterraines n'est pas apparu prioritaire et ne s'est imposé qu'à la suite des périodes de sécheresse (1964, 1976 ...). L'objet du suivi était alors essentiellement d'ordre quantitatif, par la voie du suivi piézométrique, c'est-à-dire l'étude du niveau des nappes. Ce biais quantitatif est encore marqué aujourd'hui.
Les aspects qualitatifs ont été appréhendés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) qui procèdent depuis les années 60 à une analyse des prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine.
Le besoin d'informations sur la qualité des eaux souterraines n'a été ressenti que dans les années 90, soit plusieurs années après que l'évolution des teneurs en nitrates sur les rares points de suivis à long terme ait révélé une dégradation sensible d'une ressource que l'on croyait préservée. Trois décisions marquent cette période : d'une part, l'élaboration -difficile- d'un instrument d'évaluation, le Système d'Evaluation de la Qualité des eaux souterraines (SEQ - eaux souterraines) (13 ( * )) fondé sur une appréciation des altérations de l'eau (14 ( * )) . D'autre part, le lancement de campagnes de mesures dédiées à certains paramètres (notamment nitrates et pesticides). Enfin, la création très tardive, décidée en 1999 mais encore inachevée, d'un réseau national des eaux souterraines, le RNES, après signature d'un protocole entre la Direction chargée de l'environnement et les Agences de l'eau.
Le réseau ainsi formé est articulé autour d'entités distinctes qui obéissent à des logiques et des objectifs différents. On distingue principalement le réseau patrimonial destiné à suivre l'évolution quantitative de la ressource et les réseaux de contrôle qualitatif destinés à suivre la qualité de l'eau prélevée pour l'eau potable, la qualité des eaux souterraines dans leur globalité, ou seulement quelques paramètres (15 ( * )) .
L'évaluation de la qualité des eaux pose d'ailleurs des problèmes de méthode. Trois options sont possibles :
- la qualité d'une eau est évaluée par rapport à des usages (les qualités d'une eau destinée à la consommation d'eau potable sont évidemment différentes de celles attendues d'une eau d'irrigation ou à usage industriel),
- la qualité d'une eau est évaluée par rapport à un état naturel. Dans ce cas, on mesure la dégradation mais cela suppose de connaître l'état naturel. (une eau naturelle pouvant parfaitement être impropre à la consommation - présence d'arsenic naturel par exemple),
- la qualité d'une eau est évaluée par un
indice synthétique, constitué à partir des deux modes
d'appréciation précédents.
b) Les insuffisances des réseaux
Aucun de ces réseaux ne donne une vision exhaustive et satisfaisante de la situation des nappes en France.
§ La première limite est celle du maillage et des
retards dans la mise en place d'un réseau d'observation
qualitatif.
Des différences sensibles existent entre les
régions. Certaines régions sont parfaitement
équipées et réalisent un travail remarquable (Seine
Normandie, Artois Picardie)
(16
(
*
))
. D'autres régions sont moins
avancées.
L'existence d'un réseau ne suffit pas pour
garantir le recueil des données. On signalera à ce propos la
paralysie qui a affecté le réseau des DDASS, en 1999 et 2000
(certaines DDASS ne rentraient pas les données transmises par les
laboratoires d'analyses, d'autres ne les communiquaient pas au
Ministère...).
§ La seconde limite est d'ordre qualitatif. Le
réseau de contrôle sanitaire des DDASS sur les captages d'eau
potable est sans doute le plus contestable.
D'une part, les mesures sur
les lieux de forages, pourtant prévues par la réglementation,
sont délaissées au profit de mesures après traitement de
potabilisation ou après mélange des eaux (lorsque l'eau provenant
de différents captages est mélangée par l'interconnexion
entre les réseaux), gommant ainsi les analyses des eaux les plus
dégradées. D'autre part, les captages fermés et
abandonnés ne sont pas suivis. Ainsi, comme l'observe la direction de
l'Agence Artois Picardie, «
la représentativité de
la qualité de la ressource est de plus en plus tronquée en
fonction de l'abandon des ouvrages. En effet, les mauvais captages étant
fermés, le réseau (des DDASS) donne un aperçu optimiste de
la situation des nappes »
.
c) Les travers méthodologiques des analyses
Les analyses d'eaux, et plus encore les comparaisons, demandent une grande rigueur scientifique (17 ( * )). L'observateur doit se poser plusieurs questions sur les différents points suivants.
§ Quelle est la
représentativité des lieux de mesure ?
Le
choix des sites est évidemment déterminant, puisqu'on peut
parfaitement, par un choix judicieux, ou bien surévaluer une pollution,
ou bien la sous-estimer. Faute de sélection, la dérive consiste
à multiplier les mesures et les points de prélèvements. Il
s'agit d'une dérive coûteuse et inutile. Pour M. Philippe CROUZET,
Chef de mission à l'Institut Français de l'Environnement (IFEN),
« il n'y a pas besoin de plus de recherche, ni de plus de
mesures ; il y a juste besoin de mesures mieux documentées et plus
représentatives ».
§ La fréquence des analyses est-elle
adaptée ?
Certains réseaux choisissent des
mesures périodiques, à des périodes fixes et
déterminées à l'avance, ce qui permet d'évaluer une
moyenne de contamination. D'autres réseaux dédiés
(nitrates et surtout pesticides) mesurent les pollutions après les
événements à risques, ce qui permet de bien évaluer
les pics de pollution.
La fréquence doit dépendre du type d'eau analysée. Les pollutions des eaux de surface sont beaucoup plus irrégulières que la pollution des eaux souterraines surtout dans les petits bassins et/ou sous climat méditerranéen. Les professionnels considèrent qu'on ne gagne que très peu d'informations en multipliant le nombre de points et de fréquence de contrôles. D'ailleurs, la fréquence des mesures a beaucoup moins d'importance que leur pérennité et leur qualité.
§ L'appréciation des
analyses
Il n'existe pas -pas encore- de norme de
qualité des eaux souterraines. L'évaluation passe donc par une
grille d'analyses, fondées sur des altérations. Ces
altérations sont appréciées par des spécialistes...
de plus en plus spécialisés. Le responsable doit cependant
veiller à se garder des chapelles et des modes. L'opinion est sensible
aujourd'hui à la dégradation par les nitrates et pesticides. Il
existe pourtant bien d'autres risques sur lesquels il y a moins de
données, moins de communication, mais qui sont tout autant
préoccupantes : l'intrusion marine (pour les nappes),
l'eutrophisation (pour les cours d'eau), les contaminations bactériennes
sont des risques certainement plus importants.
§ La représentation de
données
La diffusion des informations est
généralement assurée par une cartographie et des couleurs.
On ne saurait assez mettre en garde chacun contre l'effet écrasant et
trompeur de carte de qualité, tant il est facile de multiplier les
« points bleus » (où tout est bon) ou, au contraire,
les « points rouges » (où tout est mauvais) selon
l'objectif recherché.
En conclusion, il apparaît que la dérive
statistique, la mesure anecdotique et la précipitation doivent
être bannies. Un réseau pertinent et opérationnel doit
être représentatif, ce qui suppose un travail méthodique de
la communauté scientifique .Il doit aussi s'inscrire dans la
durée ce qui suppose un engagement sans faille des responsables
politiques. Ces derniers doivent se garder d'être trop dépendants
d'une spécialité scientifique, quelle qu'elle soit, et des modes.
Dans cette politique de l'environnement, les élus ont besoin de
généralistes de haut niveau qui sachent faire la synthèse
entre les spécialités, et qui soient capables de
communiquer.
4. Perspectives - La directive cadre
La connaissance de l'état des nappes est malaisée et incomplète. Des retards sont constatés. Force est de reconnaître que cette situation n'est pas propre à la France, mais est quasi générale en Europe, à l'exception, peut-être, du Royaume-Uni, de l'Irlande, et de l'Autriche.
La directive cadre européenne (18 ( * )) constitue une contrainte et une opportunité pour améliorer la connaissance de l'état des eaux souterraines. Elle reconnaît l'importance stratégique des eaux souterraines, en opérant l'articulation nécessaire entre les eaux de surface et les eaux souterraines et en fixant des objectifs de qualité comparables. A l'échéance 2015, les eaux souterraines devront atteindre « un bon état chimique » et « un bon état quantitatif ». Les obligations et différentes échéances sont présentées en annexe. En dépit de l'avancée majeure que représente cette directive cadre, certaines difficultés demeurent.
En premier lieu, le SEQ eaux et la directive sont dans une complémentarité difficile. Après près de dix ans d'efforts et de difficultés, les agences de bassin ont réussi à élaborer un système d'évaluation des eaux souterraines, mais à peine abouti, le SEQ eaux souterraines devra s'adapter aux nouveaux critères et aux besoins d'analyse de la directive.
Le SEQ eaux s'applique à des nappes, les aquifères, alors que la directive s'applique à des masses d'eau. Les deux notions sont voisines mais distinctes. Il peut y avoir une masse d'eau pour plusieurs nappes (cas des nappes superposées) et une aquifère pour plusieurs masses d'eau (cas des très grandes nappes dont les caractéristiques changent selon les sites).
De même, tandis que le SEQ eaux français choisit un classement selon quatre ou cinq classes de qualité, la directive européenne ne retient que deux classes (bon ou médiocre). On retiendra d'ailleurs sur ce point que le SEQ eaux paraît plus performant en permettant une continuité qui n'est pas prévue dans la directive.
En second lieu, les difficultés sont liées à l'évaluation internationale.
La directive cadre renvoie à une « directive fille » adaptée aux eaux souterraines, alors que l'échéance programmée -la directive eaux souterraines était prévue pour décembre 2002- est d'ores et déjà reportée. S'agissant de la première échéance annoncée par la directive cadre, ce report laisse mal augurer de la suite... La Commission a indiqué qu'elle préparerait une proposition de directive pour mi-2003 pour une adoption par le Parlement européen et le Conseil entre 2003 et 2005...
Ce retard illustre en fait les très grandes difficultés méthodologiques à établir des objectifs et des paramètres précis acceptables par les Quinze aujourd'hui, par les vingt-cinq Etats membres demain. Ce « bon état » suppose que l'information soit disponible, que les paramètres d'évaluation soient déterminés, que les objectifs soient quantifiés et enfin que les mesures d'amélioration soient identifiées. Ce travail d'analyse est en cours, mais les difficultés sont nombreuses. Il y a donc une « bataille des chiffres » prévisible.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 10 - Formation et caractéristiques des nappes
Annexe 11 - Concentrations maximales en métaux observés dans les eaux souterraines d'origine naturelle
Annexe 12 - Les mécanismes de transferts des pollutions dans les eaux souterraines
Annexe 13 - Le système d'évaluation de la Qualité des eaux souterraines ( SEQ - eaux souterraines)
Annexe 14 - Les altérations des eaux souterraines
Annexe 15 - Les Réseaux de suivi des Eaux souterraines
Annexe 16 - L'évaluation de la qualité des eaux souteraines en Seine-Normandie
Annexe 17 - Observation de la méthode sur les analyses d'eau
Annexe 18 - Les objectifs de la directive cadre concernant les eaux souterraines
B. LES POLLUTIONS HISTORIQUES
L'état des nappes dépend du contexte hydrogéologique et des activités de surface actuelles ou passées. Contrairement à l'opinion ancienne, les eaux souterraines ne sont pas durablement et fiablement protégées contre les apports de matières polluantes. C'est en particulier le cas lorsque ces apports sont massifs, durables et concentrés. Le sous-sol hérite de ce qui se passe en surface et par conséquent, les eaux souterraines héritent des pollutions du passé. Deux situations sont à prendre en compte : les sites industriels et les décharges.
1. Les eaux souterraines et l'héritage industriel
a) Les effets de l'activité industrielle sur les eaux
L'impact de l'activité industrielle sur la qualité des eaux est très différente selon que l'on considère l'activité en cours ou l'activité passée - l'héritage.
La pollution industrielle est liée à l'énergie consommée (hydrocarbures), aux matériaux transformés (minerais) et aux procédés de fabrication utilisés (solvants et autres produits toxiques).
L'impact de l'activité industrielle actuelle concerne avant tout les eaux de surface, cours d'eau et surtout mers et océans qui restent le principal exutoire des pollutions industrielles. La pollution de l'eau découle de l'usage et du rejet des eaux et prend plusieurs formes dont les principales sont le rejet des matières en suspension, et son corollaire, la demande chimique en oxygène (Voir D - La qualité des eaux de surface). Plusieurs dispositions réglementaires limitent les rejets polluants.
L'impact de l'héritage industriel est radicalement différent. Il concerne moins les eaux de surface (par l'intermédiaire des sédiments pollués) que les eaux souterraines. La pollution de l'eau prend d'autres formes et procède d'autres voies. Les dangers viennent de l'exploitation et surtout des résidus, concentrés sur des espaces réduits. Outre les terrils des résidus miniers, des substances dangereuses ou toxiques ont été manipulées et entreposées, pouvant contaminer les eaux de surface et/ou les eaux souterraines.
La voie principale est celle liée à l'infiltration des eaux de pluie. Les terrains chargés en hydrocarbures et métaux, les dépôts accumulés à proximité des exploitations (terrils miniers, dépôt goudronneux des anciennes cokeries), les vestiges de l'activité industrielle (huiles de vidange, bois traités...) offrent prise au lessivage par les eaux de pluie qui peuvent atteindre les nappes souterraines, et modifier avec le temps le fond géochimique (19 ( * )).
L'autre voie, moins connue, est celle de la remobilisation des polluants. Tandis que dans la première voie, la pollution était faible mais continue, et liée à la pluviométrie et aux conditions de transfert de polluants dans le sol, dans ce second cas, la pollution est plus concentrée mais surtout décalée.
Les sols pollués sont la conséquence de notre
passé industriel. Pourtant, ce n'est pas tant la présence de
polluants dans le sol qui pose un problème, mais le fait qu'ils puissent
être mobiles, solubles et atteindre les eaux souterraines. Certains
polluants, fixés au sol depuis plusieurs années, voire plusieurs
dizaines d'années, peuvent être mobilisés à la suite
de travaux ou d'apports de matériaux qui entrent en réaction avec
les polluants et favorisent leur migration vers la nappe. Un exemple de ce
phénomène est la contamination de la nappe de Louvres, dans le
Val d'Oise, par des cyanures abandonnés il y a plus de 50 ans, mais
rendus solubles par l'apport de chaux consécutif à des travaux de
terrassement
(20
(
*
)).
b) Des effets variables selon les régions
Lorsque l'activité industrielle a été un point dans le paysage et une parenthèse, la pollution est localisée et ponctuelle et peut être combattue. Lorsque l'activité industrielle et minière a forgé l'histoire, la géographie et la culture d'une région entière, entraînant des bouleversements humains, économiques, affectant le paysage et la stabilité des sols, les séquelles sont alors durables et pour certaines, irrémédiables.
La région du Nord Pas-de-Calais illustre parfaitement cette situation. L'extraction minière, la sidérurgie, la carbochimie sont des activités très polluantes et génèrent des quantités énormes de déchets solides et/ou d'effluents. Le choix des sites, pour l'essentiel au 19 ème siècle, commandé par la localisation de gisements n'a évidemment jamais tenu compte de la présence d'éventuelles nappes. Lorsqu'une nappe est proche, les conséquences sur l'eau peuvent être irréparables.
Ce constat est connu et parfaitement analysé par le Directeur de l'Agence de l'eau Artois-Picardie. « Dans son histoire industrielle, la région Nord Pas-de-Calais a aujourd'hui un passif environnemental lourd à assumer. 200 km de cours d'eau, naturels ou artificiels sont pollués par des sédiments toxiques, 200 km 2 de nappes très productives ont vu leur qualité irrémédiablement détruite. Dans certains lieux, les pratiques industrielles du 19 ème siècle ont laissé un champ de ruines écologique. »
L'activité minière laisse notamment des
séquelles considérables, modification des sites, affaissements
provoqués par les exploitations souterraines, modification des
écoulements d'eau, pollution des eaux d'exhaure, infiltrations des eaux
issues des terrils
(21
(
*
))
... La prise de conscience est récente et
remonte à une génération. Il faut bien reconnaître
que longtemps, ces évolutions ont été suivies sans
inquiéter, et que tant que la gestion était totalement prise en
charge par les grandes sociétés exploitantes, personne ne s'en
occupait vraiment. L'alerte a souvent été donnée de
façon fortuite, parfois par l'industriel lui-même et pour des
raisons industrielles (en constatant par exemple que l'eau d'un site
ennoyé n'était même plus utilisable à des fins
industrielles tant elle était chargée en sulfates). Avec la
fermeture des exploitations, la multiplication des sites orphelins et la
montée de préoccupations environnementales, la
collectivité s'est progressivement impliquée sur ces
questions.
c) La prévention actuelle contre les pollutions des eaux souterraines
La pression politique et sociale et la réglementation des activités industrielles ont permis de réduire sensiblement les risques de pollution des eaux. Les dispositions principales du code de l'environnement sont issues de l'ancienne législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les ICPE doivent être autorisées par arrêté préfectoral accompagné de prescriptions techniques parmi lesquelles on compte une étude d'impact, des dispositifs de prévention (capacité de stockage, cuvettes de rétention, bassins de confinement en cas de déversement accidentel...) et de surveillance régulière des eaux souterraines pour les activités où le danger potentiel est le plus élevé (deux puits en aval du site, deux relevés piézométriques annuels pour treize types d'activités). L'arrêté ministériel du 3 août 2001 étend le champ d'application de cette obligation. Entre 2.000 et 3.000 installations sont aujourd'hui concernées par cette surveillance régulière des eaux souterraines, contre 500 auparavant.
D'une façon générale, les sites industriels sont aujourd'hui beaucoup mieux surveillés qu'avant : les sites industriels appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (3.000 sites) sont répertoriés dans une base de données dite BASOL. Les sites industriels sur lesquels il convient de conserver une mémoire (300.000 sites) sont répertoriés sur une base de données dite BASIAS, toutes deux accessibles par Internet.
2. Les eaux souterraines et l'héritage domestique : l'impact des décharges
a) Un constat globalement rassurant
L'opinion publique est souvent moins sensible aux effets de pollutions industrielles qu'aux risques que pourraient représenter les décharges. Le risque est associé à la visibilité et à la proximité. Cette inquiétude apparaît excessive. Le risque est globalement réduit, même si localement des problèmes demeurent et méritent une attention plus soutenue qu'elle n'est aujourd'hui.
La mise en décharge a été longtemps la solution de facilité, la moins coûteuse, la plus répandue de se débarrasser des déchets. Même si, fort heureusement, la situation s'est radicalement transformée en dix ans, grâce à la mise en place du tri sélectif, d'un réseau de déchetteries et des techniques de valorisation des déchets, la France reste parsemée de décharges non autorisées et de dépôts sauvages.
Ainsi, outre les décharges légales autorisées -dites centres d'enfouissement technique- pour lesquelles le risque de pollution des eaux est extrêmement réduit, on compte plusieurs milliers -entre 9.000 et 12.000- décharges brutes non autorisées mais assimilables à des décharges classiques et plusieurs dizaines de milliers de dépôts sauvages pour lesquels le risque de pollution existe.
Aucune région de France n'échappe à ce travers, ni les régions riches (comme la spectaculaire décharge de St-Martin de Crau, entre Aix-en-Provence et Marseille), ni les régions touristiques (comme quelques départements d'outre mer qui possèdent des décharge d'ordures ménagères « les pieds dans l'eau »...). On peut même s'étonner que de telles décharges aient pu être créées par l'initiative locale et tolérées par l'Etat, lorsqu'à l'évidence, d'autres techniques alternatives, moins dégradantes pour l'environnement, permettraient d'y mettre fin.
Certes, l'activité de ces décharges a été réduite. Les quantités de déchets orientées vers les décharges brutes ne représentent plus que 3 % du total des déchets mis en décharges, contre 97 % dans les installations autorisées, et les déchetteries constituent une solution alternative efficace à la plupart des dépôts sauvages. Mais ces derniers, véritables verrues de l'environnement, peuvent aussi présenter des risques pour la qualité des eaux (déchets toxiques pouvant libérer des éléments toxiques par accumulation). Ces risques sont évidemment renforcés lorsque ces décharges se situent sur des zones à risques (bords de rivières, zones inondables, etc...).
En réponse à ces interrogations, l'ADEME a réalisé un guide méthodologique simple, accessible aux élus, permettant d'évaluer les impacts environnementaux de décharges et de les classer en fonction de la gravité des situations observées (22 ( * )) .
Les premières applications ont montré que peu de
sites (de l'ordre de 5 % à 10 %) auraient un impact significatif
sur la qualité de l'eau. Le constat est donc globalement rassurant. Ce
constat doit cependant être corrigé par le fait que même
lorsqu'un risque élevé est diagnostiqué, la situation
reste souvent en l'état.
b) Les difficultés de réhabilitation
La résorption des décharges ayant des risques élevés pour la qualité des eaux se trouve en effet confrontée à plusieurs handicaps :
- le diagnostic simplifié doit être complété par un diagnostic approfondi qui nécessite donc des études complémentaires,
- la résorption passe souvent par des opérations de réhabilitation (suppression des sources de pollution), beaucoup plus coûteuses que de simples réaménagements (couverture et végétalisation des sites).
- délai et crainte de coûts élevés s'accumulent pour retarder les opérations et les rendre, de fait, improbables, surtout lorsque les opérations cessent d'être subventionnables. Ainsi, les demandes de subvention auprès de l'ADEME au profit de la résorption des décharges ne sont plus recevables depuis juillet 2002. Le retrait d'un cofinanceur qui assurait 30 ou 40 % du coût d'une opération est évidemment rédhibitoire...
- enfin, on ne peut exclure que les responsables locaux privilégient d'autres opérations plus visibles. Protection des paysages et des riverains, « contre » protection de la qualité de l'eau..., les termes de l'arbitrage ne sont évidemment pas ceux-là, mais le résultat revient à cela. Lorsqu'il faut choisir, les élus peuvent privilégier le confort et la vue de riverains plutôt que la préservation de la ressource en eau. Il n'est pas question de juger. Nul doute que plusieurs raisons militent pour un tel arbitrage. Mais le constat demeure que la protection de la ressource en eau apparaît rarement comme prioritaire.
Ces handicaps sont parfaitement illustrés par les difficultés de mise en oeuvre du plan départemental de résorption des décharges dans les Pyrénées-Orientales (23 ( * )) . Tandis que les principaux sites classés à impacts potentiels élevés pour les riverains et les paysages devraient être réhabilités prochainement, les principaux sites classés à risques pour la qualité de l'eau ne seront réhabilités ... qu'ultérieurement.
Si les réhabilitations de décharges anciennes se font parfois attendre, il convient de noter que les nouvelles décharges ne présentent pratiquement aucun risque sur la qualité des eaux souterraines (24 ( * )).
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 19 - Contribution des activités industrielles à l'état géochimique des eaux souterraines
Annexe 20 - La pollution de la nappe de Louvres
Annexe 21 - Impact des terrils houillers sur la qualité des eaux de la nappe de la Craie
Annexe 22 - L'incidence des décharges sur la qualité de la ressource en eau
Annexe 23 - Diagnostic et résorption des décharges dans les Pyrénées-Orientales
Annexe 24 - Les décharges réglementées et l'eau souterraine
C. LES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES
Et si une part de la pollution de l'eau souterraine provenait de ceux qui la prélèvent ? La question paraît impertinente. La réponse est paradoxale : les forages peuvent, en effet, être une source potentielle de pollution. Ce constat, bien connu des scientifiques et techniciens, est curieusement totalement méconnu des maîtres d'ouvrages, responsables des forages, et du grand public. Ainsi, s'il existe des pollueurs qui se cachent, il existe aussi des pollueurs qui s'ignorent.
1. Le développement de forages
a) Le développement des forages
Chaque année, les Français font creuser plusieurs milliers de forages afin de prélever l'eau des nappes souterraines. Ces nouveaux forages viennent abonder un stock déjà important, estimé à environ 80.000. 80 % sont essentiellement destinés à l'irrigation (forages agricoles, golfs, alimentation animale) et à l'alimentation animale ; 20 % sont des forages d'eau potable (à l'initiative des collectivités, des campings, des particuliers...). Les forages d'eau ne représentent eux-mêmes qu'une petite fraction des forages totaux, non destinés à la fourniture d'eau.
Cette activité aurait connu un très fort développement au cours des dernières années. Bien qu'imparfaites, les statistiques officielles rendent compte de cet engouement. Le nombre de nouveaux forages autorisés ou déclarés a augmenté de 65 % en deux ans (il est toutefois possible qu'une part de cette augmentation provienne aussi d'un meilleur suivi administratif des forages). On compterait en 2001 de l'ordre de 60.000 forages d'irrigation, très inégalement répartis entre les départements, entre quelques dizaines et plusieurs milliers par département (25 ( * )).
Plusieurs facteurs seraient à l'origine de cet essor.
L'inquiétude sur l'évolution du prix de l'eau, l'apparente disponibilité de l'eau souterraine et des propositions de forages à très bas prix (moins de 1 000 euros par forage) sont des facteurs incitatifs qui peuvent séduire un particulier, tenté de posséder « son » eau.
En outre, les forages sont utilisés pour de nouveaux besoins. Outre la réponse à des besoins touristiques (golfs, enneigement artificiel), la technique en plein essor aujourd'hui est celle des forages géothermiques. L'objet d'un forage géothermique est de récupérer la chaleur du sous-sol. La température du sol est de 12° C pendant 3 mètres, et progresse de 1° C par 100 mètres de profondeur. Le forage géothermique est un forage en boucle : l'eau, prélevée en surface, est plongée dans le sous-sol où la température est plus chaude ; elle remonte réchauffée, ce qui permet des gains de consommation d'énergie importants. Cette technique connaît un très grand développement, de l'ordre d'une centaine de forages de ce type par an.
Enfin, on ne saurait exclure que le développement de
forages vient aussi d'un certain laxisme dans l'application de la
réglementation.
b) Les difficultés d'encadrement
La situation administrative est caractérisée par un certain désordre révélant ainsi les carences dans le fonctionnement des pouvoirs publics. Les dispositions légales et réglementaires encadrant l'activité des forages (26 ( * )) sont confuses, partielles et/ou inappliquées.
Selon le Code de l'environnement, « les installations, ouvrages ou travaux permettant les prélèvements (d'eau) sont soumis à autorisation ou déclaration ». La différence entre autorisation et déclaration est fonction du débit (#177; 80 m 3 /heure). Les seuils sont abaissés pour les forages situés dans des « zones de répartition des eaux ». Par ailleurs, le code minier réglemente les forages supérieurs à 10 mètres de profondeur, qu'ils soient ou non destinés aux prélèvements d'eau. Le principe est que les prélèvements sont soumis selon les débits prélevés, à autorisation ou à déclaration. Une analyse rapide permet pourtant de constater que plusieurs situations échappent à tout cadre légal.
C'est le cas de forages peu profonds, puisque les forages inférieurs à 10 m de profondeur échappent en fait à tout contrôle.
C'est aussi le cas des forages à petit débit, inférieurs à 8 m3/heure. Les forages familiaux et les forages pour l'alimentation du bétail sont en fait pratiquement inconnus.
C'est également le cas des nouveaux forages géothermiques, évoqués ci dessus. Ce nouveau procédé échappe, de fait, à tout cadre légal. Les forages réglementés sont les forages miniers et les forages d'eau. Le forage géothermique n'est ni l'un, ni l'autre, puisqu'il n'y a aucun prélèvement à proprement parler, mais seulement utilisation de la chaleur.
Une série de difficultés pratiques tenant aux incohérences des réglementations, mais aussi à la disponibilité et la compétence des hommes, ont renforcé les inconvénients de cette réglementation et ont rendu son application aléatoire. Ainsi, selon une estimation du Syndicat des entrepreneurs de forages, la moitié des forages, au mieux, respectent l'obligation légale de déclaration. La situation serait cependant très variable selon les régions. L'Agence de l'Eau Artois Picardie estime bien connaître les forages d'eau dans ce périmètre. En revanche, la situation dans le Sud de la France serait beaucoup moins maîtrisée.
En 1999, la DIREN de la région Languedoc-Roussillon, alertée par la baisse préoccupante de la nappe dite « de l'Astien », au sud de l'Hérault, a réalisé une enquête sur les prélèvements d'eau. Sur les 700 forages recensés dans les 450 km 2 couverts par la nappe (un inventaire non exhaustif qui exclut notamment les petits forages familiaux), moins de 15 % étaient déclarés. Aucune de ces situations n'a fait l'objet d'une quelconque sanction.
Ainsi, selon toute vraisemblance, plus la ressource est rare et moins les règles sont respectées.
Cette situation serait toutefois en cours d'amélioration sous l'effet d'une règle nouvelle de la politique agricole commune introduite en 1999 : l'écoconditionnalité. Elle consiste à subordonner le versement de certaines aides agricoles européennes au respect de pratiques environnementales. En 2000, la France a décidé de subordonner le versement de certaines primes agricoles, au respect de la législation sur les prélèvements d'eau, à savoir déclaration/autorisation et pose de compteurs.
Le nombre de dossiers instruits et le nombre de demandes de subventions aux agences de l'eau pour la mise en place de compteurs a très rapidement augmenté en quelques mois.
2. Les risques qualitatifs
Ce relatif désordre, où chacun « creuse son trou » sans rendre compte à quiconque, serait sans gravité, sinon sans conséquence, si les travaux étaient réalisés avec soin, et si seules la morale et la loi étaient bafouées. Ce n'est, hélas, pas le cas. Le non respect de la règle de droit s'accompagne de dommages écologiques et de risques de pollution.
Des forages mal conçus, mal réalisés, mal
entretenus, mal fermés conduisent à plusieurs types de risques de
pollution
(27
(
*
))
.
a) Les risques de contamination pendant l'exploitation
Le premier risque est celui de la contamination d'une nappe par une autre. Le forage, sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres, traverse plusieurs couches de sols, tantôt perméables, tantôt imperméables (argiles, marnes), avant d'arriver à la nappe à capter.
En règle générale, la pollution est liée à la profondeur de la nappe. Ainsi, avant d'arriver à la nappe à capter, par hypothèse non polluée, le forage peut traverser d'autres nappes moins profondes qui, elles, peuvent être polluées. Ces deux nappes sont au départ superposées, donc indépendantes, mais le forage fait communiquer les eaux dégradées et la nappe profonde.
La communication sous forme d'infiltration de polluants, de la nappe supérieure vers la nappe inférieure, se fait par deux biais. Lorsque le forage est mal réalisé, le défaut d'étanchéité entre la cavité creusée dans le sol et le tubage génère un drain vertical et un écoulement continu. C'est le cas des anciens captages. A l'époque où les nappes étaient de bonne qualité, les forages étaient réalisés sans cimentation. L'écoulement peut aussi provenir de la canalisation elle-même, lorsque le forage a été mal conçu ou mal entretenu, entraînant la corrosion ou la perforation du tubage, la dislocation des joints... Une pratique assez courante consiste à prolonger les forages anciens. Les premiers puits permettaient de capter l'eau des nappes peu profondes, mais lorsque les puits sont approfondis par perforation, l'eau pompée correspond à un mélange des différentes sources et la pollution de la nappe superficielle est directement dirigée vers la nappe profonde.
Ces risques sont d'autant plus grands que, contrairement à la plupart des ouvrages de construction, l'ouvrage de captage est totalement invisible et se prête assez facilement aux malfaçons.
Les difficultés de ce type vont vraisemblablement s'amplifier dans les prochaines années sous le double effet de la concurrence des entreprises de forages et du vieillissement des installations. Plus de 600 entreprises de forages travaillent en France. L'expansion de l'activité a généré une offre abondante. La profession n'étant pas réglementée, n'importe qui peut s'improviser foreur et la concurrence est vive, notamment venant de sociétés d'Europe du Sud, qui proposent des forages à très bas prix. Il va sans dire que, dans de nombreux cas, la vigilance aux questions d'environnement est extrêmement réduite, et le forage en question se résume à un puits, à peine gainé, muni d'une pompe. Ces ouvrages, de plus en plus nombreux, entraîneront de graves déconvenues plus tard.
Par ailleurs, selon une estimation du Syndicat des entrepreneurs de puits et forages d'eau, 40 % des forages ont été réalisés il y a plus de 30 ans, ce qui est la durée de vie normale d'un forage, et près de 10 % ont plus de 50 ans. Ainsi, alors même que plusieurs milliers de forages sont réalisés chaque année et qu'un grand nombre de forages sont menacés d'usure, le Syndicat estime que « pas plus de 10 % des forages sont contrôlés régulièrement ». Il s'agit d'un risque inutile auquel il devrait être remédié en prévoyant des contrôles réguliers.
b) Les abandons de forages et les risques de contamination après l'exploitation
Ces risques évoqués sont amplifiés
lorsque ces forages cessent d'être exploités. Car il faut bien
distinguer les prélèvements d'eau et les forages. Les premiers
peuvent cesser, les seconds demeurent... Les abandons de captages tendent
à se multiplier en raison de la baisse de la qualité des
prélèvements d'eau, aux fermetures imposées...
|
La France compte un peu plus de 35.500 captages d'eau potable (hors captages privés) dont 95 % exploitent les eaux souterraines. Ces captages, très inégalement répartis (entre quelques unités et plusieurs centaines par département) fournissent 63 % du volume d'eau distribuée en France. Cette situation n'est pas figée. Elle évolue avec les besoins, le rendement et la qualité des prélèvements. Chaque année, plusieurs dizaines de nouveaux captages sont réalisés, plusieurs dizaines de captages sont fermés (on peut estimer le nombre annuel de fermetures à une centaine). La détérioration de la qualité des eaux prélevées, et dans une moindre mesure, les difficultés, voire l'impossibilité, de protection du captage, sont les principales causes d'abandon. Ce dernier facteur, longtemps secondaire, devrait être déterminant à l'avenir. Le Préfet du Pas-de-Calais a même demandé à 54 maires du département de prendre une délibération de fermeture des captages, dès lors que ces derniers ne pouvaient bénéficier de la protection des captages prévue par le code de la santé publique, soit parce que la ressource était « improtégeable », soit parce que la qualité des eaux était « déjà (trop) mauvaise » (voir annexe précitée). Les abandons de captage ont des conséquences importantes. Ils constituent, en premier lieu, un signal d'alerte insuffisamment pris en compte. L'abandon des captages d'eaux souterraines en raison des dépassements des normes de potabilisation est révélateur d'une dégradation sensible d'une ressource que l'on croyait préservée et renouvelable. Pourquoi s'inquiéter d'une fermeture de captage quand l'interconnexion (une eau médiocre est mélangée à une eau de meilleure qualité) permet de contourner la difficulté ? Ou bien encore quand un autre captage de meilleure qualité est aussitôt mis en oeuvre ailleurs ? Mais il s'agit de solutions provisoires, car comme l'observe le directeur de l'Agence Artois-Picardie : « le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ailleurs... » Les abandons de captage entraînent, en second lieu, un travers méthodologique non négligeable. Le principal réseau d'évaluation de la qualité des eaux est celui des DDASS, qui analysent les eaux prélevées dans les captages destinés à l'alimentation en eau potable. Les captages abandonnés ne sont donc plus suivis, puisqu'ils ne contribuent plus à l'alimentation en eau potable. Enfin, les abandons de captage ne sont pas réalisés avec suffisamment de précaution et constituent des sources potentielles de pollution des eaux souterraines pour l'avenir. |
Il faut être pourtant conscient qu'un forage abandonné sans précaution est un tuyau de pollution creusé dans le sol, puisque les défauts d'entretien, d'étanchéité, la corrosion, potentiels pendant l'exploitation, deviennent presque inévitables.
Avec la fréquence accrue des abandons de captage , cette menace devient tout à fait sérieuse, d'autant qu'il n'existe, à ce jour, aucune réglementation relative aux abandons de captage. C'est donc en toute légalité que les maîtres d'ouvrage créent les conditions propices aux pollutions de demain.
Cette situation est évidemment inadmissible. De même qu'il est inacceptable que les services techniques de l'Etat dans le département et les conseils généraux, répondent aux maires qui les sollicitent à ce sujet que « rien n'est prévu ». La réponse est formellement exacte mais irrecevable compte tenu des enjeux environnementaux.
Un suivi de la qualité des eaux des captages
abandonnés peut s'avérer utile. Dans le cas contraire, les
fermetures de captages devraient s'accompagner d'une cimentation des parois, et
ne pas se contenter d'un simple bouchon de surface, un dispositif notoirement
insuffisant pour prévenir les risques de pollution. Ces dispositions,
qui figurent d'ailleurs parmi la charte de qualité de puits et forages
d'eau, doivent être encouragées.
3. Les risques liés à la surexploitation
a) Les risques quantitatifs
L'état quantitatif d'une nappe est un solde entre les sorties d'eau en surface -écoulement vers les rivières (soutien du débit d'étiage) et les prélèvements d'origine anthropique (irrigation et alimentation en eau potable)- et la capacité de recharge de la nappe (par infiltration des eaux de pluie et des eaux de rivière). Un équilibre s'instaure lorsque l'écoulement et les prélèvements d'eau n'excèdent pas la recharge naturelle des nappes.
Les risques de surexploitation étaient connus sans être mesurés. Peu d'institutions reconnaissaient publiquement que « les eaux souterraines ne bénéficient pas d'une gestion rationnelle » (Sdage - Adour Garonne - 1996) et que « sur certaines d'entre elles, la pression des prélèvements est déjà forte alors que leur réalimentation est très lente » (tableau de bord du Sdage/Loire Bretagne - 2000). Ces risques sont aujourd'hui mieux appréciés. Toutes les agences ont développé et soutenu des programmes de suivi piézométrique et les résultats sont parfois préoccupants. La nappe carbonifère autour de Lille par exemple baisse en moyenne de 1 mètre par an et aurait perdu 60 mètres depuis le début des mesures en 1950. La directive cadre fait d'ailleurs de l'« état quantitatif » des nappes un élément d'appréciation de leur « état écologique ».
Cet état doit être surveillé là
où les risques de prélèvements excessifs sont les plus
importants. Tel était le sens de l'article L 211-3 du code de
l'environnement faisant référence aux «
zones de
sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique
pour l'approvisionnement actuel ou futur de l'eau potable
».
Cette appellation a été rarement retenue par les agences de l'eau
qui lui ont préféré d'autres concepts
(«
nappes réservées en priorité à
l'alimentation en eau potable
» et «
nappes
intensément exploitées
-NIE » en Loire
Bretagne, «
aquifères patrimoniaux »
dans
les agences de l'eau Rhône Méditerranée Corse et Adour
Garonne, «
nappes prioritaires
» dans l'Agence de
l'eau Seine Normandie...). Une meilleure coordination entre agences aurait
permis d'avoir une vision plus claire et plus globale de la situation
française. Mais quel que soit le mot finalement retenu, l'idée et
le concept de ressource stratégique doivent être gardés et
valorisés. Il est essentiel que toutes les actions des différents
acteurs - agences, collectivités locales, Etat - se coordonnent et se
concentrent sur ces ressources stratégiques. Tout n'est pas possible
partout, mais sur ces ressources stratégiques, tout doit être
tenté pour préserver la qualité et la quantité de
la ressource en eau.
b) Les conflits d'usage
Une des illustrations connues des difficultés engendrées par les prélèvements excessifs concerne les conflits d'usage : lorsque la ressource est rare, les différents utilisateurs peuvent se trouver en conflit pour partager cette ressource. Ces conflits, localisés, sont souvent prévenus par des restrictions d'usage imposées par arrêté préfectoral. Les usages d'agrément (arrosage des jardins, lavage des voitures...) sont touchés en priorité. L'irrigation agricole peut être menacée à son tour. Mais d'autres conflits d'usage liés au développement des équipements touristiques peuvent survenir.
§ L'exemple le plus connu est celui
des
golfs
(29
(
*
)).
La
consommation d'eau moyenne des golfs est de l'ordre de 6.800 m
3
par jour, soit, au total, de l'ordre de 36 millions de m
3
/an.
20 % seraient issus des forages d'eaux souterraines. Cette consommation
importante ne génèrerait cependant qu'assez peu de conflits
d'usage. Ils peuvent survenir néanmoins en période de
sécheresse. Il faut en effet rappeler que le surarrosage est
fréquent, que la consommation générale d'eau n'est pas
négligeable, que 20 % des golfs ont leur propre forage et que, en
1996, faute de dispositifs de comptage, de nombreux golfs n'avaient pas
d'idée précise des prélèvements qu'ils
opéraient...
Les prélèvements d'eau au bord des
côtes, notamment lorsqu'il y a des risques d'intrusion marine (intrusion
de l'eau de mer dans les nappes du littoral) doivent évidemment
être surveillés de très près. On retiendra par
exemple que c'est dans l'Hérault, département où les
risques d'intrusion marine sont les plus graves, que se trouvait le golf le
plus important de la région (90 ha dont 77 ha
irrigués). Il avait les prélèvements d'eau les plus
massifs de toute la région Rhône Méditerranée Corse
(590.000 m
3
/an, avec une pointe de 100.000 m
3
/ mois
pendant l'été1991)
Il y a donc des situations où le
développement touristique peut être porteur de menaces
potentielles pour la ressource en eau. On pensera en particulier aux 56 golfs
des départements riverains de la Méditerranée
situés sur des zones fragiles (du point de vue de la ressource en eau).
Dans ces situations fragiles, il est impératif d'améliorer la
connaissance en imposant le comptage des prélèvements. Par
ailleurs, la réutilisation des eaux usées, pratique courante aux
Etats-Unis, pourrait être développée.
§ Un autre exemple d'un nouveau type de conflit d'usage
est celui de l'enneigement artificiel
(30
(
*
))
. Les prélèvements d'eau liés
à l'enneigement artificiel représentent de l'ordre de 20 millions
de m
3
dans les Alpes. La qualité des eaux de consommation
d'une commune en aval de communes de montagnes qui pratiquent l'enneigement
artificiel se serait subitement dégradée sous l'effet du cumul
des prélèvements d'eau (en rivière cette fois) et des
rejets massifs d'eaux usées. Cet incident encore unique appelle
néanmoins une grande vigilance.
c) La surexploitation
Le troisième risque est lié à la surexploitation d'une nappe. L'utilisation intensive, supérieure aux capacités de recharge en eau, peut entraîner un assèchement progressif conduisant à terme à l'abandon des captages. Les nappes situées en bordure du littoral sont, elles, particulièrement vulnérables au risque de pollution saline. Ce phénomène est connu sous le nom de « biseau salé » ou d' « invasion marine » : lorsque la nappe continentale descend trop bas, les écoulements d'eau s'inversent (de la mer à la terre, et non de la terre à la mer) entraînant l'intrusion d'eau salée dans les nappes d'eau douce continentale (voir encadré ci après).
Quand elle survient, la pollution est quasi irréversible. Ce phénomène est parfaitement illustré par la situation de la nappe de l'Astien, dans l'Hérault.
|
Les aquifères côtiers sont fragilisés par des prélèvements massifs concentrés sur une courte période de l'année, avec le cumul des prélèvements destinés à l'eau potable pendant la saison touristique et les forages destinés à l'irrigation. Des pompages excessifs d'eau douce peuvent entraîner des dépressions, comblées par les eaux de mer voisines. L'eau de mer pénètre par le sous-sol et par effet de contraste de densité entre l'eau douce continentale et l'eau salée (l'eau de mer contient en moyenne 30 grammes de sel par litre, et est donc plus dense et plus lourde que l'eau douce). Ce phénomène est connu sous le nom d'intrusion de biseau salé.
En Méditerranée, ce risque a été évoqué pour onze nappes (d'Ouest en Est) : - nappe du Roussillon (région de Perpignan) - nappe de la Basse Vallée de l'Aude (région de Lézignan - Narbonne) - nappe de la Vallée de l'Orb (région de Béziers) - nappe de l'Astien (région de Béziers) - nappe de la vallée de l'Hérault (région d'Agde) - nappe de Maugio-Lunel (région de Montpellier) - nappe de Crau (région d'Arles)
- nappe de Gapeau (région d'Hyères)
Source - Tableau de bord du SDAGE Rhône
Méditerranée Corse panoramique 2000 - page 86.
La nappe de l'Astien est une importante ressource en eau du département de l'Hérault, entre Agde et Béziers. La nappe couvre une superficie de 450 km 2 et fournit entre 3 et 5 millions de m 3 /an, soit 15 % de l'alimentation en eau de ce secteur. Sa bonne qualité et sa faible profondeur (pour l'essentiel entre 20 et 100 mètres) ont favorisé le développement de nombreux forages. Suite à l'inquiétude provoquée par la baisse de rendement et de la qualité des prélèvements, des analyses ont été conduites dans les années 80. Les constats furent particulièrement préoccupants : 1 er constat : la très mauvaise connaissance des forages. Un inventaire a permis de recenser plus de 700 forages, dont plus de 80 % concernaient l'alimentation en eau à usage domestique (eau potable ou arrosage), et près de 50 % étaient réalisés par des particuliers. Moins de 15 % des forages avaient été déclarés. La plupart n'avaient pas de connaissance des prélèvements opérés. 2 ème constat : la mauvaise qualité des forages, conduisant à « mettre en communication l'aquifère astien et les aquifères superficiels de médiocre qualité, d'où des risques de pollution ». 3 ème constat : la baisse continue, voire, en bordure littorale, l'effondrement du niveau piézométrique, c'est-à-dire de la hauteur de la nappe, générant un risque majeur de salinisation de l'eau par intrusion d'eau salée dans l'aquifère astien où il aboutit à la mise en place d'un « biseau salé ». Devant ce « risque de pollution irréversible », une structure locale de gestion, réunissant les différents acteurs concernés par l'utilisation de la ressource (communes, département, chambres consulaires) a été créée en 1990 (le Syndicat mixte d'études et de travaux de l'Astien, SMETA), aboutissant, en 1996, à la conclusion d'un « contrat de nappe », entre l'Etat, l'Agence de l'eau, le conseil général et le syndicat, afin de réduire les prélèvements (par délestage et raccordements sur d'autres sources, par incitation à la pose de compteurs...) et de préserver la qualité (bouchage des puits abandonnés, contrôle des forages...). Alors que le premier contrat de nappe s'achève, il apparaît que les améliorations sont limitées et fragiles . La baisse des prélèvements constatée entre 1988 et 1993, favorisée par une forte médiatisation du risque et une pluviométrie suffisante, est interrompue. Le retour à des conditions climatiques défavorables (sécheresse) et l'arrêt de la médiatisation ont entraîné une reprise des consommations. La connaissance des prélèvements reste aléatoire (notamment auprès des campings) « La menace de dégradation irréversible de la ressource sur le littoral reste toujours présente du fait de l'absence de planification des ressources alternatives et d'une insuffisante gestion économe de la nappe » (...). « La protection de la qualité de la ressource est compromise. La faible maîtrise des forages privés, liée à l'absence d'encadrement réglementaire des petits forages et au droit inaliénable de la propriété privée, rend difficile la pérennisation d'une véritable protection de la nappe contre les pollutions par les milieux superficiels ». |
Le développement mal maîtrisé et l'abandon anarchique des forages sont des vecteurs de pollution des eaux souterraines. Ce volet n'est pas suffisamment pris en compte. Toute réforme dans ce domaine doit s'inspirer de deux impératifs : la simplicité et l'efficacité.
Tel n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. L'ancien projet de loi sur l'eau contenait même des dispositions (31 ( * )) compliquant encore davantage un dispositif déjà trop compliqué. De très nombreux forages échappent à toute règle de droit, ne sont ni déclarés, ni autorisés, ni connus, sans pratiquement qu'aucune sanction ne soit jamais appliquée.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 25- Statistiques sur les forages d'eau souterraine
Annexe 26- Le régime juridique des forages destinés aux prélèvements d'eau
Annexe 27- Schémas de pollution des eaux souterraines pour les forages
Annexe 28 - Données statistiques sur les abandons de captage
Annexe 29 - Les golfs et l'eau
Annexe 30 - Incidence de l'enneigement artificiel sur la ressource en eau
Annexe 31 - Les dispositions de l'ancien projet de loi sur l'eau relatives aux prélèvements d'eau
D. LES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE
1. Les nitrates
La dégradation des eaux souterraines liée à la présence du nitrate est connue et incontestable. De très nombreux rapports l'attestent. Les auditions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n'apportent aucune information supplémentaire qui ne soit déjà connue, sauf, peut-être une tonalité alarmiste. Quelques améliorations ponctuelles et localisées ne doivent pas faire oublier que le mouvement d'ensemble est largement négatif, avec parfois des pics localisés très préoccupants. L'évolution de la qualité des eaux souterraines, au cours des trois dernières années, montrerait la poursuite de la dégradation d'ensemble. Quelques observateurs et responsables administratifs relèvent des « dégradations colossales » dans certaines régions. Plusieurs notent l'urgence d'intervenir avant que la dégradation ne soit trop catastrophique.
La rédaction de cette partie a
été confiée à M. Ghislain de MARSILY, Professeur
à l'Université Paris VI
.
(32
(
*
))
a) Les sources naturelles de nitrates dans les sols
En l'absence de toute fertilisation azotée, on trouve néanmoins toujours des nitrates dans les sols. Ceux-ci proviennent de la fixation de l'azote atmosphérique par certaines espèces végétales, les légumineuses, qui sont capables, grâce à des bactéries qui vivent en symbiose avec elles, de capter l'azote et de le transformer en matière organique azotée dans leur racines. Quand la plante a fini son cycle saisonnier, cette matière organique azotée est peu à peu décomposée par les bactéries nitrifiantes du sol, et transformée en nitrates. Ces nitrates sont à leur tour utilisés par les autres espèces végétales pour leur propre croissance, car on rappelle que pour se développer, les végétaux ont besoin de trouver dans le sol trois éléments majeurs : nitrates, phosphates, et potassium, qui sont d'ailleurs les principaux fertilisants apportés par l'agriculture industrielle. On estime qu'un sol normal contient environ 1000 kg d'azote (N) par hectare, sous forme de matière organique plus ou moins fraîche ou en cours de décomposition, le cycle de cette matière organique dans les sols pouvant être très long (plusieurs dizaines d'années de résidence). Chaque année, seule une fraction de cet azote est transformée en nitrates (on dit minéralisé), mais en régime normal, cette fraction minéralisée est remplacée par de la matière organique fraîche, si bien que le stock d'azote est constant. Si la majorité de ces nitrates « naturels » est consommée par la végétation en place, une légère fraction est cependant toujours « lessivée » par l'infiltration de l'eau de pluie en hiver, et se retrouve dans les nappes en profondeur. On estime la concentration « naturelle » en nitrates des eaux souterraines en l'absence de fertilisation à 5 à 15 mg/l (en NO 3 ).
Cependant, tout changement de l'occupation du sol peut venir perturber ce cycle naturel. On sait par exemple que le labourage d'une prairie, le défrichage d'une forêt, l'assèchement d'une zone marécageuse engendrent immanquablement une augmentation du flux de nitrates vers les nappes, car le stock de matière organique se décompose et s'oxyde plus vite, libérant ainsi des nitrates. Même sans apport d'engrais, de tels changements d'occupation du sol peuvent entraîner une augmentation pendant quelques dizaines d'années des teneurs en nitrates dans les nappes sous-jacentes, jusqu'à ce que le système retrouve un nouvel équilibre (En Israël, des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines dans une zone tourbeuse en cours de drainage ont été relevées au-delà des 50 mg/l alors qu'aucune fertilisation n'était encore pratiquée).
Une dernière source naturelle de nitrates dans les eaux est due à l'urine des animaux. Celle-ci contient de l'ammoniac et de l'urée (contenant de l'azote), qui peuvent être rapidement oxydés en nitrates dans les sols. En général, en pays tempérés, cette source de nitrates est diffuse, et négligeable devant les nitrates d'origine atmosphérique. Mais dans les pays arides, les animaux viennent s'abreuver autour des rares points d'eau, et en général urinent en buvant. Les alentours des points d'eau sont alors en général riches en nitrates. Il en va de même des déjections humaines, qui contiennent aussi de l'ammoniac et de l'urée, et qui, si elles sont concentrées en un point, vont engendrer un excès de nitrates. Ainsi à Madagascar, on a observé des teneurs en nitrates pouvant aller jusqu'à 300 mg/l dans certains forages, alors que les populations n'utilisent pas d'engrais, simplement parce qu'autour de ces forages viennent s'abreuver les troupeaux, et sont rejetées les eaux usées domestiques des villages.
Pour être exhaustif, ajoutons que les éclairs
peuvent fabriquer des nitrates avec l'azote de l'air, que les termites
produisent aussi des nitrates, enfin qu'au Maroc il a été
démontré que les cimetières (par décomposition des
cadavres) engendrent aussi des nitrates. Mais ces sources là sont
entités négligeables devant celles déjà
citées.
b) Les sources anthropiques de nitrates dans les sols.
Le changement d'occupation des sols peut être une source d'origine anthropique des nitrates dans les sols, mais la source majeure est l'apport d'engrais azotés. Cet apport peut se faire soit directement sous forme de nitrates, soit sous forme d'ammoniac, ou d'urée, lesquels se transformeront dans le sol en nitrates, comme cela se fait pour l'ammoniac de l'urine ou la matière organique naturelle azotée. Dans le cas d'épandage de lisiers d'élevage, c'est la forme ammoniaquée qui domine. Certains engrais cumulent les deux formes, par exemple le nitrate d'ammonium, qui dans les sols libérera immédiatement les nitrates, puis plus lentement produira un flux de nitrates issu de l'oxydation de l'ammoniac.
Les apports en azotes aux cultures se chiffrent en kilo d'azote par hectare. Les agriculteurs parlent en « unité d'azote ». 200 unités, par exemple, signifient un apport de 200 kg par hectare de N, quelle que soit la forme où l'azote est apporté (nitrates, ammoniac, urée, etc...). Les apports varient en général entre 150 et 300 unités. La majorité de cet azote est consommé par les plantes. Cependant, comme pour les nitrates d'origine naturelle, une fraction des nitrates présents dans les sols est lessivée par l'eau de pluie et peut rejoindre soit directement les cours d'eau (par ruissellement ou écoulement dans le réseau de drains enterrés, s'ils existent) soit s'infiltrer vers les nappes. Pour l'agriculteur, il est nécessaire que les nitrates soient présents au niveau des racines des cultures au moment de leur croissance, quand elles en ont besoin. Il fera donc des apports peu après les semis, sous forme directement assimilable (nitrates). Si une pluie survient juste après l'épandage, les nitrates peuvent être lessivés et emportés, source de pollution des eaux, et il faudra refaire un apport. Si l'agriculteur utilise un engrais moins directement assimilable (ammoniac, urée), il faudra que la décomposition de cet apport (fonction de l'humidité du sol, de la température, etc...) se fasse au rythme de la demande de la végétation, ce qui est plus hasardeux, à moins d'en mettre en excès. L'idéal pour la protection des eaux serait qu'à la fin de la saison culturale, la végétation ait consommé tous les nitrates apportés, afin que la saison pluvieuse qui suive ne puisse lessiver que peu de nitrates. Il faudrait donc viser très juste, et ne mettre que ce dont les cultures ont réellement besoin. C'est faisable, il faut bien mesurer le stock d'azote déjà présent dans le sol en début de culture, et n'apporter que parcimonieusement l'engrais, en plusieurs fois. Mais l'engrais n'est pas cher, le mettre en une fois est moins cher, et, du point de vue du rendement, un excès d'azote est de bien loin préférable à un manque, il est donc fréquent de surfertiliser les sols. La meilleure preuve en est que les doses de fertilisation ont été peu à peu réduites ces dernières années, sans que les rendements en soient affectés (programme FERTMIEUX par exemple, mis en place par les Ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement).
Faisons un rapide calcul. Supposons que l'apport d'azote soit
de 200 unités, et que 90 % de cet azote soient
consommés par la plante. Supposons que les 10 % en excès
soient lessivés par la pluie, et se retrouvent dans la nappe. Sachant
qu'il s'infiltre chaque année environ 150 mm de pluie, soit 1500 m3/ ha,
l'eau de la nappe recevra une alimentation contenant déjà
près de 60 mg/l en nitrates. On voit donc qu'une très faible
erreur (10 %) dans le dosage de l'apport d'azote peut engendrer une
très forte contamination des nappes. Si ceci se produit pendant de
nombreuses années, l'eau de la nappe sera finalement entièrement
contaminée à des concentrations dépassant la norme des 50
mg/l pour l'eau de boisson. Une saison pluvieuse ou froide, où les
rendements des cultures sont moindres, aura le même effet, l'apport
d'azote prévu pour une année normale à rendement
élevé sera en excès par rapport à la consommation,
et cet excès sera lessivé.
c) La migration des nitrates vers les nappes en profondeur
Produits naturellement dans le sol superficiel, ou
apportés sous forme d'engrais, les nitrates en excès vont
être entraînés vers la profondeur par l'eau de pluie qui
s'infiltre dans les sols. Cette infiltration va se faire en hiver parce que la
pluie qui tombe au printemps et en été ne s'infiltre en
général pas en profondeur, elle est reprise rapidement par la
végétation et évaporée. Les nitrates descendent
donc vers la profondeur, mais cette migration est lente, de l'ordre de 1
à 2 m/an. Cette lenteur s'explique parce que le sol contient
déjà de l'eau, maintenue sur le profil vertical par
capillarité, et que l'eau nouvelle doit donc pousser vers le bas et
remplacer. Si la nappe aquifère sous-jacente est par exemple à 10
m sous la surface du sol (on définit le sommet de la nappe comme la
surface de l'eau que l'on peut observer dans les puits), alors il faudra
environ entre 5 et 10 ans pour que les nitrates arrivent à la nappe.
Sous les plateaux crayeux, par exemple, où la nappe peut être
à 50 m sous le sol, c'est cinquante ans après la première
fertilisation azotée que l'on va voir commencer à monter les
concentrations dans la nappe. Mais cette lente migration vers le bas est
inexorable, une fois en route, les nitrates poursuivent leur migration vers le
bas sous les sols, ils ne sont en général ni retenus ni
dégradés dans ces milieux qui sont en contact avec
l'atmosphère.
d) La migration dans la nappe
Une fois arrivées dans la nappe, les eaux d'infiltration s'écoulent des points hauts vers les points bas. Ces points bas sont les sources, ou encore les forages de captages, ou enfin les rivières qui sont alimentées par les nappes. Au bord de la mer ou des lacs, les nappes se vidangent directement dans ces plans d'eau. Les vitesses de migration des eaux dans les nappes sont également lentes, de l'ordre du mètre par jour ou moins. Il faut donc plusieurs années pour que les nitrates qui sont transportés par l'eau progressent de l'amont à l'aval. Pour une nappe dont un captage se trouverait à 10 km en aval d'une parcelle qui reçoit un excès de nitrates, c'est encore 10.000 jours, ou 27 ans, qu'il faudra attendre pour que les nitrates se retrouvent dans le captage, sans compter le temps de migration vertical déjà cité. Rien d'étonnant dès lors que l'on constate en France que la concentration en nitrates dans les nappes continue à croître, au rythme d'environ 1mg/l de plus par an, alors que l'apport de la fertilisation azotée artificielle a véritablement commencé à se généraliser dans les années 50. Il semblerait cependant que ce rythme d'augmentation commence à se ralentir, bien que cela ne soit en rien certain.
Les nitrates disparaissent-ils naturellement des eaux de la nappe ? La réponse est en général non : une fois arrivés en profondeur, ils subsistent dans la nappe, pendant tout le temps où ils y migrent. Il y a cependant trois cas importants où une élimination naturelle des nitrates peut se produire. Le premier est le cas où la roche dont est constituée la nappe contient un minéral assez rare, la pyrite. C'est un sulfure de fer, qui est se trouve sous forme de très petits minéraux non visibles à l'oeil nu. Ce sulfure réagit avec l'oxygène contenu dans l'eau et s'oxyde en sulfate de fer, qui est soluble. En l'absence d'oxygène, la pyrite est oxydée par les nitrates, pour former aussi des sulfates de fer, et de l'azote gazeux, qui s'échappe vers l'atmosphère. Cette réaction est réalisée par des bactéries dénitrifiantes du milieu. Cette disparition des nitrates peut être totale, elle se traduit cependant par une augmentation des sulfates dans l'eau, lesquels ont cependant une norme de potabilité plus forte, de 250 mg/l en SO4, si bien que l'augmentation en sulfates liée à la réduction des nitrates ne rend en général pas les eaux non potables. En France, on trouve de la pyrite en Bretagne, dans les roches cristallines, les granites ou les schistes métamorphiques, en profondeur, car la pyrite proche de la surface a été consommée par l'oxygène de l'air ou dissout dans l'eau. Certaines eaux de Bretagne, si elles circulent assez profond, sont exemptes de nitrates, alors que l'origine de l'eau est superficielle et fortement chargée en nitrates. Mais ce phénomène de dénitrification naturelle n'est en général pas suffisant pour épurer les eaux, et très rares sont les forages Bretons où les nitrates sont absents, tout au plus peut-on se réjouir qu'une partie des nitrates aient disparu. Plus les forages sont profonds, meilleure est la probabilité de réduction de la concentration en nitrates, mais malheureusement plus les forages sont profonds, moins la quantité d'eau que l'on peut y pomper est élevée. Cette réduction des nitrates consomme la pyrite, donc cet effet positif n'aura qu'un temps, mais en vérité ce temps est long, plusieurs dizaines ou centaines d'années selon les cas. On rencontre aussi cette pyrite dans certaines zones du Massif Central, dans les Pyrénées, et de façon fréquente en Allemagne du Nord, par exemple.
Un deuxième cas de dénitrification naturelle se produit sans la présence de pyrite, dès que la nappe se trouve isolée de l'atmosphère. Il faut en général que la nappe plonge vers la profondeur, et qu'elle soit surmontée par une couche d'argile formant un écran. L'air du sol ne peut plus communiquer avec l'eau de la nappe, et on constate alors que les bactéries présentes dans l'eau de la nappe et qui ont besoin d'oxygène pour vivre vont le chercher dans l'ion nitrate, dès que l'oxygène dissout a été consommé. Les nitrates disparaissent alors comme par enchantement, l'azote produit diffuse et retourne à l'atmosphère. On explique ainsi, dans le Nord de la France, l'absence de nitrates dans certains forages dans la nappe de la craie, alors qu'en général cette nappe de la craie est très chargée en nitrates. Il faut simplement que la nappe soit surmontée d'une couche d'argile isolante, ce qui ne se produit que rarement.
Un dernier cas à citer est celui des nappes alluviales
proches de certains cours d'eau. On constate que la teneur en nitrates diminue
dans la nappe quand on se dirige de la bordure de la plaine alluviale, au
contact des coteaux, jusqu'à la rivière. On constate même
que la concentration de l'eau dans la rivière peut être environ la
moitié de celle de la nappe, quand bien même l'eau de la
rivière provient en totalité de la dite nappe comme en
étiage estival ! Ceci a été mis en évidence en
région Parisienne, pour les grands cours d'eau comme la Seine ou la
Marne, ou sur la Garonne près de Toulouse, mais se produit presque pour
chaque rivière. A ceci, il y a deux explications. La première est
que la végétation alluviale qui borde le fleuve puise son eau
dans la nappe, et y consomme une partie des nitrates dont elle a besoin. La
seconde explication, plus significative, est que, dans les alluvions, on
constate très souvent que les parties graveleuses en profondeur,
là où l'eau circule, sont surmontées par des
dépôts fins limoneux. Ce dépôt de limons fins joue
alors le rôle de la couche d'argile citée plus haut, et permet une
certaine dénitrification naturelle dans les graviers sous-jacents,
dénitrification qui n'est en général pas totale, faute de
temps pour se réaliser.
e) La nuisance des nitrates dans l'eau des nappes, traitements
La nuisance des nitrates pour la consommation des eaux des nappes pour la boisson mise à part, les nitrates dans les nappes ont d'autres effets pervers. D'abord, ils finissent par arriver dans les rivières, les lacs ou la mer, qui sont les exutoires naturels des nappes. Ils y engendrent l'eutrophisation (voir l'annexe « les nitrates dans les eaux de surface »). De plus, ils modifient les conditions d'oxydo-réduction du milieu, et donc la teneur en certains autres éléments en solution. En Bangladesh et en Inde par exemple, la présence excessive d'arsenic dans les eaux de la plaine du Gange serait à mettre en relation avec les nitrates, ceci est encore à l'étude. Il se pourrait aussi que l'écologie de ces milieux souterrains soit affectée (bactéries, micro-invertébrés souterrains vivant dans les nappes), ceci a été peu étudié jusqu'ici. Si on remonte dans les sols, on sait cependant que l'excès de nitrates peut y engendrer une modification de la végétation naturelle, certaines plantes ne supportant pas les fortes concentrations en nitrates. Ceci a été déjà observé en Hollande, pas encore à ma connaissance en France.
Peut-on traiter les eaux souterraines in situ pour les débarrasser des nitrates ? Certaines expériences ont été tentées dans ce but. La méthode proposée est limitée au voisinage immédiat d'un captage pour l'eau potable. On fore autour de ce captage un grand nombre de trous (une dizaine, par exemple) à une distance de l'ordre de 10 m, et on injecte dans l'eau de la nappe un composé organique tel que du méthanol, ou un sucre, qui va fournir aux bactéries dénitrifiantes le substrat qui alimente leur métabolisme. Si la nappe est profonde ou protégée de la surface par un écran argileux, alors les bactéries n'auront pas assez d'oxygène pour respirer, et se mettront à consommer les nitrates. Quelques expériences positives ont été effectuées en France par le BRGM, mais n'ont pas été généralisées, le procédé étant onéreux et à mettre en balance avec une dénitrification en surface, dans des réacteurs où le même apport de substrat permet la dénitrification, mieux contrôlée que dans la nappe. Mais cette dénitrification en surface est également chère, de l'ordre d'un demi euro par m 3 , et est difficile à réaliser quand il fait froid.
La vraie façon de se protéger des nitrates est d'abord d'en moins utiliser en agriculture, éventuellement d'en moduler les apports en fonction des propriétés locales des sols (ce qu'on appelle l'agriculture de précision), et surtout de protéger les bassins versants des captages en en faisant des « Parcs Naturels Hydrologiques ».
2. Les pesticides
La contamination des eaux par les pesticides est surtout manifeste dans les eaux de rivière et ce dossier sera examiné plus complètement dans le reste du rapport. Si cette contamination des rivières ne surprend guère, quand elle suit notamment les périodes de pulvérisation dans les zones de grandes cultures, elle touche aussi, à des degrés moindres, les autres catégories d'eau, c'est-à-dire les eaux souterraines et même les eaux de pluie, à des niveaux parfois très élevés (une mesure « record » de 24 ug/l a été enregistrée dans l'eau de pluie en 1996 - Bretagne).
La contamination des eaux souterraines aux pesticides est incontestable. Selon l'expression curieuse de la DDASS du Nord Pas-de-Calais, « les produits phytosanitaires réussissent -sic- à atteindre les ressources souterraines et à les polluer à des degrés divers ».
Les contaminations sont évidemment variables selon les types de nappes (les nappes alluviales suivent naturellement les contaminations des rivières, tandis que les nappes captives sont plus préservées des pollutions de surface), selon les sols, l'usage des sols et par conséquent selon les régions. Un même département peut compter des nappes pratiquement indemnes de toute pollution et des nappes très dégradées (c'est le cas du département de Seine-et-Marne avec la nappe de calcaire de Brie, au sud du département, et la nappe de calcaire de Champigny, au nord). Par ailleurs, il existe fort heureusement des nappes sans aucune trace de pesticides. Dans son rapport sur les pesticides dans les eaux, publié en 2001, l'IFEN estimait que le quart des captages d'eaux souterraines était encore de très bonne qualité, dans un état naturel ou quasi naturel.
Malgré cette grande variabilité, l'évolution est dans l'ensemble nettement défavorable. Dans son étude, l'IFEN avait relevé que plus de 60 % des captages étaient altérés par les pesticides et près de 30 % à un niveau qui n'aurait pas permis leur utilisation pour l'eau potable.
Dans les régions qui suivent très précisément l'état des eaux souterraines, tous les indicateurs révèlent une dégradation sensible. Ainsi, en Seine Normandie par exemple, la fréquence de détection des pesticides augmente, la présence de molécules de la famille des triazines, herbicides du maïs, tend à se généraliser. Plus de la moitié des captages est aujourd'hui dans une situation marquée par une dégradation importante (au-delà de 0,1 ug/l) ou très importante (au-delà de 0,5 ug/l) (cf. Annexe 16). Comme pour les eaux de rivières, la très grande majorité des captages est contaminée par des molécules du groupe des triazines. Cette situation n'est, hélas, pas propre aux eaux souterraines. En revanche, certaines spécificités méritent d'être notées :
- les eaux souterraines sont moins contaminées par les molécules contenues dans les pesticides que par leur métabolite (produits de transformation qui apparaissent après dégradation de la molécule mère). En Seine Maritime, par exemple, certaines molécules n'étaient pratiquement pas détectées, jusqu'à ce qu'on cherche leurs métabolites. Le taux de détection de l'atrazine et de son métabolite est alors passé de moins de 1 % à plus de 10 %...
- la fréquence de détection et les niveaux atteints par les contaminations sont très inférieurs à ceux relevés dans les eaux de surface. Le rapport est de l'ordre de 1 à 5.
Comparaison des contaminations aux pesticides
des
eaux superficielles et des eaux souterraines
|
Fréquence de détection |
Relevés maximum enregistrés |
|||
|
Eaux de rivières |
Eaux souterraines |
Eaux de rivières |
Eaux souterraines |
|
|
Atrazine |
58 % |
50 % |
12 ug/l |
5,7 ug/l |
|
DEA |
52 % |
52 % |
2 ug/l |
0,9 ug/l |
|
Diuron |
40 % |
< 10 % |
20,4 ug/l |
3 ug/l |
|
Isoproturon |
28 % |
< 10 % |
10,5 ug/l |
1,5 ug/l |
|
Simazine |
20 % |
15 % |
0,8 ug/l |
0,6 ug/l |
Source : IFEN - Les pesticides dans les eaux -
sélection
Atrazine : désherbant du maïs / DEA :
métabolisme de l'atrazine / Diuron : désherbant mixte /
Isoproturon : désherbant du blé /Simazine :
désherbant de la vigne et désherbant arboricole
Cette relative modération n'est cependant pas un motif de satisfaction. Si comme on l'a dit, la contamination des rivières peut se comprendre par l'effet du ruissellement des eaux de pluie, la contamination des eaux souterraines est le signe d'une dégradation profonde et durable des eaux. On notera par exemple que les mesures de limitation d'épandage et de dosage des pesticides n'ont eu pratiquement aucun effet sur les concentrations relevées dans les eaux souterraines.
III. LES EAUX DE SURFACE
A. LA CONNAISSANCE DES EAUX DE SURFACE
1. Le réseau de mesures
Il existe 525.000 kilomètres de cours d'eau de plus d'un kilomètre, et 26.000 plans d'eau de plus d'un hectare. Contrairement aux eaux souterraines, suivies avec une certaine méthode depuis seulement le milieu des années 90, les eaux de surface, ou « eaux superficielles » sont suivies depuis plusieurs dizaines d'années, au moins localement. On remarquera que le tout premier rapport publié par l'IFEN -Institut Français de l'Environnement- en 1994 portait sur « la qualité des eaux superficielles, quelle évolution depuis 20 ans » , qui faisait le bilan du réseau mis en place en 1971.
Les eaux de surface bénéficient incontestablement d'une priorité dans les analyses. En témoigne cette disposition curieuse de la directive cadre européenne selon laquelle « les eaux souterraines doivent contribuer à la réalisation des objectifs fixés aux eaux de surface » alors que l'inverse aurait été tout autant justifié.
L'effort d'équipement est organisé autour de cinq types de réseaux (33 ( * )) :
- le réseau national de bassin (RNB),
- les
réseaux complémentaires de bassin (RCB) au niveau
départemental,
- le réseau d'usage (contrôle de
qualité des points de prélèvement destinés à
l'eau potable),
- les réseaux locaux,
- les réseaux
dédiés, spécifiques à certains paramètres
(pesticides, réseaux piscicoles...).
Cette présentation simplifiée rend mal compte des nombreuses difficultés associées à ces réseaux. Ces difficultés sont pour une part inéluctables en raison de la très grande hétérogénéité des eaux, entre le ru local et le Rhin, frontière internationale, la très grande diversité des usages (irrigation, alimentation en eau potable, loisirs, pêche, navigation...) et par conséquent la très forte pression locale ou professionnelle visant à mettre en oeuvre « son » réseau.
Mais cette difficulté est amplifiée par une organisation mal maîtrisée.
Le premier problème est celui de la représentativité. Malgré l'importance du réseau, certains sites sont mal représentés et mal analysés. C'est le cas des petites rivières secondaires et des ruisseaux qui forment l'essentiel du linéaire (le « chevelu ») qui seraient encore de bonne qualité, mais qui sont mal suivies, et des plans d'eau. Mais à l'inverse, les réseaux se sont multipliés, spécialisés, sous la pression locale ou politique, sans que l'on s'interroge suffisamment sur la représentativité des points de mesure. Ce problème a déjà été évoqué pour les eaux souterraines. Il existe une incontestable dérive statisticienne qui consiste à multiplier les points de mesure ou les fréquences des analyses, alors que dans la plupart des cas, elles n'apportent que très peu d'informations complémentaires faute de s'être interrogé sur la représentativité des points.
Le second problème est lié à la cohérence du système ainsi mis en place. Cette fuite en avant s'est traduite par une certaine incohérence et une déperdition d'énergie, d'investissements, de coûts. Cette cohérence est normalement assurée par les agences de bassin, co-financeurs de la plupart des stations de réseaux (à l'exception des réseaux d'usage des DDASS) mais la coordination reste très insuffisante. Ainsi, dans le bassin Loire Bretagne, on dénombre plus de 2.000 stations relevant de 11 réseaux différents, organisés par au moins 13 services différents (13 services identifiés), selon des articulations spécifiques à chaque département, pour un coût de 3,7 millions d'euros. Il n'est pas rare que plusieurs réseaux surveillent les mêmes stations avec les mêmes paramètres, mais sans concertation.
L'immense besoin de simplification et de classification demandé par la plupart des personnes rencontrées au cours de cette étude commence par les réseaux de mesures et d'analyse. Cette réorganisation se heurtera à de nombreuses difficultés pratiques, mais cet effort est indispensable. La situation actuelle montre l'impératif de disposer d'une véritable stratégie dans l'action comme dans la connaissance. L'échelon local même intercommunal n'est pas le meilleur niveau dans ce domaine. La coordination serait incontestablement mieux assurée au niveau départemental.
2. Analyses et objectifs de qualité
Tableau récapitulatif des sources de pollution des eaux de surface
|
Source |
Macropolluants |
Micropolluants |
|||
|
Caractéristiques générales MES/DBO |
Azote/Phosphore |
Métaux |
Pesticides |
Organiques autres que pesticides |
|
|
Naturelle |
x |
- |
x |
- |
- |
|
Industrielle |
xx |
x |
x |
- |
x |
|
Rejets urbains |
xx |
xx |
x |
x |
x |
|
Agricoles |
x |
xx |
x |
xx |
- |
MES : Matières en suspension - DBO : Demande biologique en oxygène
§ Le système d'évaluation : le SEQ-eau
Le système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau -SEQ- eau-développé depuis 1971, repose sur les mesures effectuées de la qualité physicochimique de l'eau, à partir des indices courants (micropolluants organiques -nitrates et phosphore-, paramètres d'oxygénation de l'eau... et de la qualité biologique des cours d'eau, à partir d'un inventaire des végétaux, des invertébrés ou des poissons. Le SEQ-eau est fondé sur la notion d'altération. Un ou plusieurs paramètres contribuent à des altérations : micropolluants minéraux (métaux), micropolluants organiques (pesticides, hydrocarbures), matières phosphorées ou matières azotées contribuant à l'eutrophisation...
Les altérations sont appréciées selon les
usages de l'eau (eau potable, irrigation...).
§ La directive cadre européenne (34 ( * ))
La directive cadre européenne fixe pour les cours d'eau
deux objectifs pour 2015 : un bon état chimique et un bon
état écologique. Le bon état chimique est
déterminé par le respect de seuils de concentration de substances
prioritaires et de substances dangereuses. Le bon état écologique
est déterminé par l'absence de ces substances et la
présence d'indicateurs de faune et de flore. La directive cadre a
été très influencée par le système
français du SEQ-eau.
B. LES POLLUTIONS INDUSTRIELLES
L'industrie et les mines furent à l'origine de la plupart des pollutions des eaux de surface (34 bis). Les rejets étaient directs, délibérés. Les principaux polluants industriels sont les matières en suspension, liées en particulier aux matières organiques, les métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb, mercure...) et des polluants organiques persistants parmi lesquels on trouve les hydrocarbures, les acides et les bases qui modifient le pH de l'eau.
Les pollutions industrielles dans les eaux ont, dans l'ensemble, beaucoup diminué. Cette réduction est le résultat d'un effort d'équipement (mini stations d'épuration) pour traiter les rejets avant leur évacuation dans les eaux, d'une volonté de changer d'image, en réponse à la sensibilité croissante de l'opinion aux questions environnementales et à la colère qui fait suite aux pollutions accidentelles, d'une réglementation stricte, imposant les pollutions, dans les deux sens du terme (rendant obligatoire des traitements et taxant les rejets), ainsi qu'à la disparition de beaucoup d'activités parmi les plus polluantes (mines, tanneries, traitements de surfaces ...) (35 ( * )) .
Outre les accidents, toujours possibles, quelques situations méritent d'être soulignées
En premier lieu, on observera que les rejets dans les grands fleuves, quoique importants, sont aujourd'hui dans l'ensemble très inférieurs aux rejets en mer, qui demeurent le principal exutoire des pollutions industrielles (36 ( * )) .
En deuxième lieu, l'amélioration constatée sur le long terme marque le pas. Les gros pollueurs ont disparu ou se sont équipés. Mais des pollutions demeurent liées à l'héritage industriel (traces de DDT trouvées dans une rivière trente ans après la fermeture de l'usine). La carbochimie par exemple a été une activité très polluante pour les eaux. L'aluminium est fabriqué par une action de l'eau sur un charbon chauffé, ce qui génère des rejets d'eau ammoniacale. De même, les pollutions issues d'industries ou d'artisanats isolés sont souvent problématiques (rejets d'huiles et de solvants par les garages et carrosseries de campagne...). Ces pollutions sont très difficiles à éliminer.
En troisième lieu, la pollution industrielle est moins directe qu'autrefois et arrive dans les eaux par des voies détournées, notamment par l'intermédiaire des eaux de pluie. La contamination de l'atmosphère par les polluants liés aux combustions associées aux activités industrielles ou à l'incinération des ordures ménagères, et aux volatilisations des résidus des anciennes friches industrielles se retrouvent, pour une bonne part, dans les eaux de pluie qui seront à leur tour évacuées dans les eaux des rivières (voir supra).
En quatrième lieu, les pollutions industrielles dans les eaux sont aussi moins visibles, mais peuvent entraîner à terme des déconvenues quand il faudra traiter la pollution ignorée parce qu'invisible. Si quelques polluants se dissolvent dans l'eau, beaucoup d'autres (plomb, mercure, HAP, PCB...) sont adsorbés par les particules en suspension. Des traces de pollutions anciennes subsistent dans les sédiments mais une grande part est transportée dans les cours d'eau, par à coups, alternant les phases de dépôt, où elles sont stockées au fond de la rivière, et la remise en suspension, au moment des plus forts débits. Les particules se déplacent donc en aval, portées par le courant, mais à des vitesses dix fois plus lentes. Les pollutions se concentrent dans les estuaires.
Dans une plaquette réalisée par le PIREN Seine (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnement) du CNRS, ce dernier évoquait même « les particules en suspension : des bombes à retardement ». En d'autres termes, la pollution industrielle a incontestablement régressé, mais elle continue de s'accumuler.
Enfin, si le lien entre pollution des eaux de surface et pollution des eaux souterraines est naturel, au moins dans les nappes alluviales où les échanges entre les deux eaux sont constants, on peut aussi évoquer un cas plus rare et curieux où la pollution des eaux de surface est liée... à la dépollution des eaux souterraines. L'exemple est celui de la dépollution des mines de potasse en Alsace (37 ( * )). L'eau des nappes, gravement contaminée par les chlorures issus de terrils est pompée et rejetée dans l'eau du Rhin entraînant des rejets jusqu'à 10.000 tonnes par jour de sel.
C. LES POLLUTIONS URBAINES ET D'ORIGINE DOMESTIQUE
La plupart des grandes villes sont situées près des rivières et des fleuves, qui ont été à la fois la première source d'alimentation en eau potable et la première infrastructure de transport. Les rejets d'eaux domestiques, dites « eaux usées » ont depuis toujours altéré la qualité des cours d'eau, par l'entraînement de matières organiques susceptibles d'engendrer des contaminations bactériennes. Ce phénomène a été diminué par le traitement des eaux usées, mais n'a pas été éliminé. L'amélioration de la qualité des rejets (voir 3 ème partie du rapport) est compensée par un effet quantitatif. Le volume des eaux usées, traitées à des degrés divers est considérable. Pour l'agglomération parisienne, les eaux usées produites par les 10 millions d'habitants représentent 30 m 3 /seconde, soit l'équivalent du débit moyen d'une rivière moyenne (l'Orne, l'Aude, l'Isère, la Drôme ont des débits moyens de l'ordre de 20 à 25 m 3 /seconde. Les petites stations d'épuration peuvent même devenir à certaines périodes la principale source d'alimentation des cours d'eau.
Les eaux usées génèrent quatre types de
pollutions.
1. Les pollutions traditionnelles, matières en suspension, demandes en oxygène
Les rejets d'eaux usées apportent avec eux des
quantités de matières en suspension et de micro organismes
générant de la turbidité et surtout, une grande
consommation d'oxygène. Cette contamination est liée à
l'oxydation de la matière organique contenue dans les eaux usées
et de l'ammonium présent lui aussi dans les eaux usées et produit
par la dégradation de la partie azotée de la matière
organique. Ces pollutions urbaines traditionnelles sont amplifiées par
le ruissellement des eaux de pluie, qui entraîne vers l'exutoire final,
c'est-à-dire vers les rivières, des quantités de
matières en suspension, des hydrocarbures et des métaux
toxiques.
2. Les contaminations bactériennes
Le deuxième effet bien connu est lié aux contaminations bactériennes causées par les microorganismes d'origine fécale, potentiellement pathogènes.
Il existe en effet une corrélation entre la présence de bactéries, témoin d'une contamination fécale et la présence de bactéries pathogènes. C'est en particulier le cas des bactéries dites coliformes, surtout présentes dans les intestins des animaux à sang chaud. Dans les eaux brutes, le nombre de coliformes est un indicateur de probabilité de la présence de bactéries pathogènes. Dans les eaux traitées, la présence de coliformes est un indicateur d'inefficacité de la station d'épuration.
Le nombre de germes (calculés à partir des
germes coliformes fécaux) peut être multiplié par 1.000
après les rejets urbains (à Paris, le nombre de coliformes
fécaux passe de 1.000 à 1 million par millilitre, 60
kilomètres après Paris). Cette présence massive a
évidemment un effet sur la qualité du cours d'eau qui peut
être impropre à la baignade et aux activités nautiques,
voire impropre à la production d'eau potable.
3. Le phosphore
Le phosphore est utilisé dans les engrais agricoles (c'est avec l'azote le deuxième facteur limitant qui conditionne la croissance des plantes) et dans l'industrie chimique, mais il est surtout utilisé dans les lessives où un de ses dérivés constitue un adoucisseur d'eau qui facilite le lavage. Il est à ce titre massivement présent dans les eaux usées d'origine urbaine. Malgré sa diminution notable dans les lessives, le phosphore reste utilisé. Peu de sociétés ont respecté l'engagement professionnel de limiter la proportion de phosphore à 20 %. On compte environ 70.000 tonnes de rejets de phosphore par an, dont 51 % d'origine urbaine. A proximité des grands centres urbains, cette part peut aller jusqu'à 95 %.
Tandis que le phosphore d'origine agricole reste dans le sol et dans la plante, le phosphore d'origine domestique se trouve directement dans les eaux usées qui agissent alors en vecteur de pollution.
Le phosphore, naturellement peu présent dans l'eau, cesse d'être un facteur limitant et, au contraire, favorise la prolifération algale qui est l'un des principaux signes de l'eutrophisation des eaux. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les eaux stagnantes (38 ( * )). L'eutrophisation engendre de nombreuses conséquences négatives pour l'homme avec, d'une part, la diminution des usages des plans d'eau (pêche, loisirs), et d'autre part, une diminution de l'efficacité des traitements d'eau potable liée à la multiplication des matières en suspension et à la transformation des caractéristiques de l'eau (acidité, odeurs, goût).
C'est pourquoi les fabricants de lessives s'étaient engagés, en 1990, à créer au moins une lessive sans phosphates par marque et à réduire la teneur des nouveaux produits à un maximum de 20 % de phosphates. Tous les consommateurs avertis peuvent voir que certaines marques commerciales ne respectent pas cet engagement.
L'attention portée aux nitrates et la diminution des phosphates dans les lessives ont fait oublier que le risque phosphates n'est pas écarté. Même moins nombreuses qu'avant, des quantités de phosphates continuent de se déverser dans les rivières. Très peu d'usines de traitement des eaux usées possèdent des installations de déphosphatation et plusieurs experts craignent que l'eutrophisation ne perdure.
4. Les micropolluants d'origine domestique
Les micropolluants d'origine domestique recouvrent une large gamme de molécules chimiques utilisées dans la vie quotidienne : additifs, enzymes utilisés dans les lessives, solvants, plastifiants que l'on retrouve dans les combustions, produits cosmétiques, médicaments... La plupart de ces molécules sont éliminées ou véhiculées dans l'eau, par lavage, ou dans les urines. Elles sont parfaitement connues, mais jusqu'à ces dernières années n'étaient pas mesurées, la recherche de molécules de quelques nanogrammes (milliardièmes de grammes) étant très délicate.
Mais quand l'infiniment petit est multiplié par des millions de personnes, il devient un problème. On rappellera que l'Europe consomme 10.000 tonnes d'antibiotiques, répartis pour moitié entre la consommation humaine et l'usage vétérinaire, 2.500 tonnes d'analgésiques... qui, un jour ou l'autre, se retrouvent dans les eaux.
A quel niveau et dans quelles proportions ? Il n'y a pratiquement pas d'étude en France, mais les études aux Etats-Unis ont montré que les cours d'eau étaient contaminés par des dizaines de molécules issues, par ordre d'importance décroissante, de métabolites des détergents, de stéroïdes utilisés dans l'alimentation du bétail, de plastifiants ainsi que, dans une moindre mesure, de médicaments, d'hormones reproductives, etc... (39 ( * ))
La qualité des cours d'eau est donc bien très directement influencée par la vie sociale et les nouvelles habitudes de consommation.
Ces contaminations suscitent des inquiétudes croissantes sur la santé humaine (voir 2 ème partie). L'inquiétude vient du cumul de molécules. Certaines de leurs caractéristiques, notamment le fait qu'elles soient peu biodégradables, qu'elles soient bioaccumulables (elles s'accumulent dans l'organisme), qu'elles soient toxiques, et encore très peu traitées dans les stations d'épuration ont permis d'ores et déjà de mettre en évidence des impacts négatifs sur la faune.
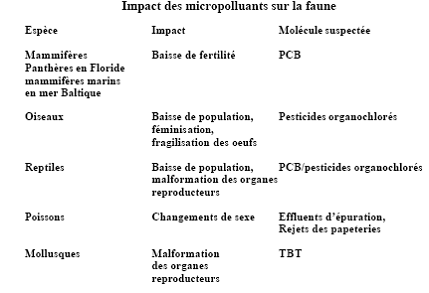
Source : Professeur Yves LEVI - Audition OPECST
PCB : polychlorobiphényles -plus connus sous le nom de pyralène, utilisés comme fluide dans les transformateurs électriques, ou dans les peintures et les solvants.
Organochlorés : famille de pesticides, à base de chlore, surtout utilisés comme insecticides.
TBT : tributhyletain biocide puissant qui entre dans la composition des peintures navales, qui empêche la formation d'algues.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 33 - Les réseaux de mesures de qualité de l'eau superficielle
Annexe 34- Les objectifs de la directive cadre européenne concernant les eaux de surface
Annexe 34 bis - La contamination du Lot par le cadmium
Annexe 35- Réglementation et mesure des pollutions industrielles dans l'eau de surface
Annexe 36 - Principaux rejets industriels dans les eaux
Annexe 37- La dépollution des mines de potasse d'Alsace
Annexe 38 - Le rôle du phosphore dans l'eutrophisation des eaux stagnantes
Annexe 39 - Les micropolluants dans les cours d'eau. L'exemple américain
D. LES POLLUTIONS DIFFUSES D'ORIGINE AGRICOLE
1. Les nitrates
La rédaction de cette partie a
été confiée à M. Ghislain de MARSILY,
Professeur à l'Université Paris VI, et M. Michel MEYBECK,
Directeur de Recherche au CNRS
Malgré l'existence de nombreux dispositifs visant à prévenir la pollution d'origine agricole (40 ( * )) , d'origine azotée, les résultats de ces actions sont médiocres. Les règles très confuses (41 ( * )) , générant également de nombreux contentieux (42 ( * )) .
a) Les sources de nitrates dans les rivières
Les nitrates dans les rivières ont deux origines principales : les apports par les nappes souterraines, que nous avons déjà décrits au paragraphe « Les nitrates dans les eaux souterraines », sont pour l'essentiel d'origine agricole. La deuxième source de nitrates est les rejets d'eaux usées urbaines, qui contiennent des nitrates, mais aussi de l'ammonium, s'il n'a pas été détruit (c'est-à-dire transformé en nitrates) par une station d'épuration. L'ammonium, aux pH >9 couramment rencontrés dans les cours d'eau très eutrophes (Loire), se transforme en ammoniac, gaz dissous, très toxique pour les poissons. L'ammonium s'oxyde lentement en nitrates dans la rivière (bactéries nitrifiantes), et consomme de l'oxygène. C'est ainsi que les rejets d'ammonium dans la Seine de la station d'Achères, en aval de Paris, conduisaient autrefois à des conditions d'anoxie en été bien plus bas en aval, dans la zone estuarienne, du fait de la lenteur de la nitrification à se produire. Aujourd'hui la situation a été améliorée par la nitrification partielle à Achères de l'ammonium, qui est transformé en nitrates et rejeté dans la Seine. Certaines industries peuvent aussi rejeter des eaux usées chargées en nitrates, par exemple dans l'agro-alimentaire.
L'apport de nitrates peut enfin aussi résulter du lessivage par la pluie des nitrates agricoles, particulièrement en hiver et à la suite d'orages importants peu après les épandages d'engrais, si le ruissellement (ou l'évacuation par les drains) apporte directement aux ruisseaux et rivières les eaux chargées en nitrates sans passer par les nappes. Beaucoup de cours d'eau français présentent une forte saisonnalité des nitrates avec un maximum de concentrations et de flux en hiver et un minimum en hiver.
La décomposition aérobie de la matière organique morte au sein de la rivière (ou plus exactement dans les sédiments accumulés et déposés au fond de la rivière, si le système reste en conditions aérobies) peut aussi produire des nitrates, mais cette source est, en général, très petite par rapport à l'origine agricole citée plus haut.
Dans la Seine, à l'arrivée dans l'estuaire, les travaux du PIREN-Seine estiment que 70 % des nitrates sont d'origine agricole, et 30 % d'origine urbaine.
b) L'effet des nitrates sur les eaux de surface
Dans la colonne d'eau de la rivière, les nitrates ne sont pas décomposés, car l'eau est en général aérée, sauf dans des circonstances de condition extrême. Cependant, le flux de nitrates n'est pas entièrement conservé. En effet, des échanges importants se font entre le fleuve et sa nappe alluviale, et l'eau du fleuve pénètre par endroit dans cette nappe pour revenir au fleuve un peu plus loin. Au cours de son trajet dans les alluvions, une partie des nitrates se décompose par dénitrification, selon le mécanisme décrit dans l'annexe « les nitrates dans les eaux souterraines ». De plus, dans les sédiments déposés au fond de la rivière, riches en matières organiques, cette matière peut parfois se décomposer en créant des conditions anaérobies favorables à la dénitrification. On observe alors une consommation des nitrates par le fond de la rivière. Sur le bassin de la Seine, on estime à 45 % des apports la fraction des nitrates qui est décomposée par ces deux mécanismes.
L'effet majeur des nitrates sur les eaux de surface est de les conduire à l'eutrophisation. Ce processus se déclenche quand les eaux sont trop chargées en nitrates et en phosphates, ces deux nutriments qui permettent la croissance des algues. Quand ils sont tous les deux en grande quantité dans l'eau, les algues microscopiques (phytoplancton) et les végétaux fixés (macrophytes) se développent de façon excessive. La matière organique présente dans le fleuve augmente démesurément (la rivière devient parfois verte tellement les algues y pullulent), et quand les algues meurent, cette matière organique se décompose en consommant tout l'oxygène de la colonne d'eau, induisant ainsi l'anoxie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène dans l'eau, et donc la mort de tous les poissons et invertébrés du milieu. Cette anoxie ne se produit pas en général dans le réseau fluvial mais dans les estuaires turbides où le transit de l'eau est fortement ralenti et où la décomposition l'emporte sur la production algale. Le phénomène d'eutrophisation fluvial se produit principalement au printemps et en été, quand l'ensoleillement est fort, permettant la photosynthèse par les algues, et la température élevée (43 ( * )).
Le rapport entre les nitrates et les phosphates qui conduit au développement optimal des algues est appelé le rapport de Redfield. Il est de l'ordre de 7 en poids de N/P, c'est celui que l'on mesure dans les végétaux aquatiques. Si le rapport de N/P dans la colonne d'eau est supérieur à 7, ceci signifie que le phosphore est le facteur limitant : c'est lui qui va arrêter la croissance des algues, quand il aura été consommé. C'est l'inverse qui est vrai quand le rapport de Redfield est inférieur à 7, ce sont les nitrates qui vont être le facteur limitant de la croissance des algues. Selon la valeur du rapport de Redfield, on peut donc déterminer sur lequel de ces deux nutriments il vaut mieux porter ses efforts pour lutter contre l'eutrophisation. Le phosphore est à 90% d'origine urbaine, et 10% seulement d'origine agricole. En général, le phosphore est le facteur limitant dans les parties amont des bassins, et l'azote devient limitant quand les rejets urbains des grandes villes à l'aval ont saturé la rivière en phosphore. Quand on arrive en mer, c'est toujours les nitrates qui sont le facteur limitant de l'eutrophisation, car dans les zones côtières, les rejets de nutriments par les fleuves engendrent également des phénomènes d'eutrophisation des eaux côtières.
Les teneurs en nitrates qui permettent d'éviter l'eutrophisation des cours d'eau sont beaucoup plus basses que les teneurs admissibles pour l'eau de boisson. Au lieu des 50 mg/l en NO3, pour l'eau de boisson, c'est dès 1 mg/l dans les eaux de rivière ou de lacs que le risque d'eutrophisation peut se déclencher, en commençant par les eaux stagnantes (lacs, réservoirs).
Il est très difficile de lutter contre les nitrates d'origine agricole, si ce n'est en réduisant les apports en fertilisant. Pour éviter l'eutrophisation, à défaut de pouvoir agir sur les pratiques agricoles, il vaut donc mieux jouer sur les phosphates, soit en déphosphatant les eaux usées urbaines, soit en luttant contre l'érosion dans les terres agricoles, car le phosphore est en général entraîné dans les cours d'eau sous forme adsorbée aux particules solides qui sont érodées et emportées en temps de crue. Ceci conduit à ne pas laisser les sols nus en hiver, ce qui de plus a pour avantage de consommer une partie des nitrates présents dans les sols. Dans certaines régions menacées, on envisage de subventionner ces cultures hivernales protégeant les sols et réduisant les flux de nitrates.
Les principaux lacs qui étaient en cours d'eutrophisation il y a 20 ans ont été sauvés en luttant contre les apports en phosphore. Pour le lac Léman, les Suisses ont interdit l'usage des lessives aux phosphates en 1985, et ont également traité les eaux usées urbaines avant de les rejeter. Pour le lac du Bourget, par exemple, une ceinture d'égout a été mise en place autour du lac pour récolter les eaux usées domestiques avant qu'elles n'arrivent au lac, évitant ainsi les apports de phosphates. Il n'a pas été possible de jouer sur les nitrates.
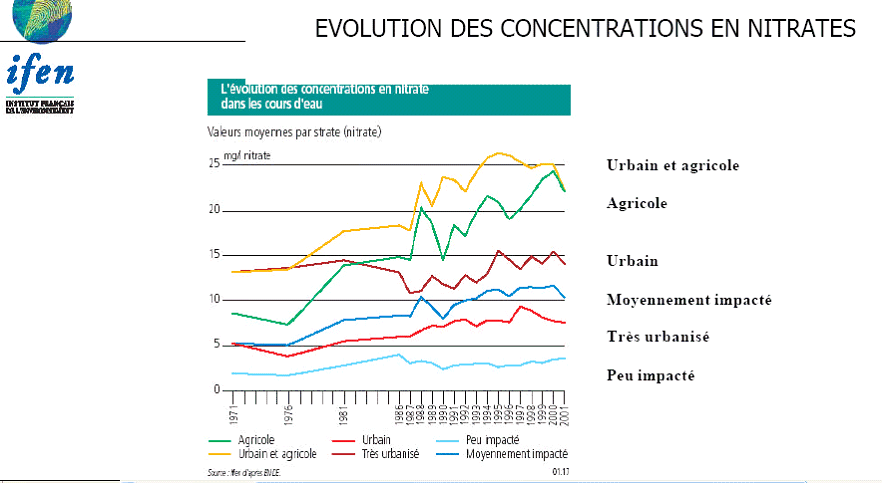
2. Les pesticides
C'est avec les nitrates, l'autre « valeur test » largement connue du grand public : l'eau se charge en pesticides (44 ( * )). Même si le produit sert à « tuer les fléaux », son efficacité s'est retournée contre lui. Le pesticide évoque la destruction, l'atteinte à la nature. Le mot est à lui seul chargé d'angoisse. Le dossier est par essence émotionnel.
Mais il a aussi un fondement bien réel. La France est le troisième consommateur mondial de pesticides (100.000 tonnes par an, dont 90 % utilisés en agriculture) (45 ( * )) et la contamination est le signe d'une détérioration de l'eau et de l'environnement dans son ensemble.
Le présent rapport ne peut que confirmer une situation
bien connue. Quelques précisions apparaissent cependant
nécessaires dans la mesure où sur ce dossier, où les
passions se déchaînent (« les pesticides,
génocide du XXIème siècle... »), la rigueur
n'est pas toujours au rendez-vous.
a) Observation de méthode
Il y a un incontestable effort de mesure des contaminations des eaux par les pesticides. Un effort louable mais pas toujours couronné de succès tant les réseaux d'observation sont complexes. Dans son rapport sur les pesticides dans les eaux -1998-1999- (rapport IFEN Etudes et travaux n° 34), l'IFEN décrit l'enchevêtrement des réseaux, qui comprend un réseau national de bassin, chargé de suivre l'état de la ressource globale, un réseau d'usage, chargé de suivre la ressource utilisée pour les prélèvements destinés à l'eau potable, et des réseaux dédiés, locaux chargés de suivre au plus près les « bouffées de contamination » ou les effets des actions de réduction.
Chaque réseau obéit à sa propre logique et les résultats peuvent ne pas être toujours cohérents. Il a déjà été souligné que les réseaux d'usage donnent une vision optimiste de la situation puisque les captages les plus mauvais sont abandonnés ; mais à l'inverse, les réseaux dédiés ciblés sur les sites à risques et sur les moments à risques (après la pluie au moment où le ruissellement est à son maximum), grossissent les difficultés. La médiatisation donne alors un effet loupe à un problème local.
La comparaison entre sites et entre périodes différentes appelle une grande rigueur scientifique Les nombreuses difficultés et les « pièges » d'interprétation sont évoqués dans une annexe spécifique (46 ( * )).
Il convient aussi d'observer qu'aucun réseau, si complet soit-il, ne peut prétendre à donner une image parfaitement fidèle des contaminations des eaux aux pesticides. Pour la simple raison qu'une telle représentation n'existe pas.
Il ne peut s'agir d'un bilan exhaustif. Il existe plus de 1.000 molécules utilisées dont moins d'un tiers est recherché dans les eaux. L'IFEN a déterminé des molécules prioritaires, en fonction de leur stabilité, leur dégradation, les quantités épandues et la fréquence d'épandage.
Sur ces critères, certaines molécules n'ont pas été sélectionnées. C'est notamment le cas du chlorate de soude, principal herbicide utilisé par les particuliers, qui se dégrade très vite, ou de l'imidaclopride, substance active du gaucho, insecticide utilisé sur les semences de tournesol, absent des mesures parce qu'on a considéré que le risque était si faible de le trouver dans les eaux qu'il était inutile de le chercher.
Par ailleurs, la plupart des molécules actives se transforment dans le temps, générant des métabolites qui doivent faire l'objet de recherches spécifiques, compliquant encore davantage la tâche de ceux chargés de suivre l'évolution des contaminations. C'est en partie le cas de l'atrazine et de son métabolite (47 ( * )).
Ces remarques de méthode doivent être
gardées en mémoire.
b) Quelques résultats
La contamination des eaux aux pesticides est avérée. L'inquiétude de l'opinion, diffuse, se confirme au vu des analyses, désormais bien connues, sur la contamination des eaux. Il n'y a pas une agence de l'eau qui ne mette en évidence « la contamination importante des eaux par les produits phytosanitaires » (Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse), « l'augmentation de la pollution par les pesticides » (Agence de l'eau Adour Garonne), « les contaminations chroniques à certains pesticides » (Agence de l'eau Loire Bretagne), « la progression de la contamination par les pesticides » (Agence de l'eau Seine Normandie)...
Le constat est donc bien connu. Et, même si l'IFEN n'écrit jamais le mot en raison des difficultés d'établir des comparaisons dans le temps, la dégradation est avérée.
Pour illustrer cette évolution, on se contentera de rappeler certaines mesures tirées des documents qui ont été remis au cours de l'étude, et qui toutes dépassent 10 ug/l, soit 100 fois la norme applicable aux eaux destinées à la production d'eau potable pour l'alimentation humaine.
Quelques « records » de
contamination des eaux aux pesticides*,
|
Substance |
Mesures |
Source |
|
Atrazine (herbicide du maïs) |
2 000 ug/l eau de surface |
Audition agence de l'eau Seine Normandie |
|
Atrazine (herbicide du maïs) |
29 ug/l
|
Etude Corpep sur la contamination des rivières de Bretagne 2000 |
|
Diuron
|
20,2 ug/l
|
IFEN - Les pesticides dans les eaux - 2000 |
|
Isoproturon
|
15 ug/l
|
IFEN - Les pesticides dans les eaux - 2000 |
|
Carbendazine
|
16 ug/l
|
Agence de l'eau RMC Composés phytosanitaires dans les eaux - 2000 |
|
Tetrachloro méthane
|
16 ug/l
|
IFEN - Les pesticides dans les eaux - 2000 |
|
Trichlorobenzène
|
11 ug/l
|
IFEN - Les pesticides dans les eaux - 2000 |
|
Chlordecone
|
10,3 ug/l
|
Rapport de l'IGAS sur les pesticides en Guadeloupe |
|
Alachlore
|
24 ug/l
|
Etude pluies en Bretagne - Audition OPECST |
|
Atrazine
|
13,5 ug/l
|
IFEN - Les pesticides dans les eaux - 2000 |
* Liste non exhaustive, sélection de documents remis au cours de la mission de l'OPECST
Cette contamination est d'autant plus préoccupante qu'elle est
- très répandue sur l'ensemble du territoire, parfois à des niveaux élevés (48 ( * )) ,
- et durable. Des traces de pesticides se retrouvent dans les eaux de ruissellement (49 ( * )),
Des traces de pesticides sont encore détectées plusieurs années après l'arrêt des épandages. Des traces de DDT et de dieldrine, un insecticide utilisé en bananeraie, ont été détectées dans les cours d'eau de Guadeloupe... 27 ans après avoir été interdites !
A l'exception de la toxicité des pesticides qui sera débattue dans la deuxième partie du rapport, consacrée à l'eau potable, deux débats doivent être évoqués. Le premier, récurrent, concerne les responsabilités. Le second concerne la pertinence de la réponse des pouvoirs publics.
Comment limiter l'utilisation des pesticides ? Interdire l'usage ou réduire les doses ?
Face à la contamination des eaux aux pesticides, la
première réaction consiste à intervenir sur les
quantités utilisées. Deux voies sont ouvertes : interdire
l'usage ou réduire les doses. Les professionnels craignent, non sans
raison, que les mesures d'interdiction soient plus fondées sur des
pressions médiatiques que sur des raisons scientifiques. Les pouvoirs
publics considèrent, à l'expérience, que les mesures de
limitation partielle n'ont, au mieux, qu'un effet limité. En
réalité, interdiction et réduction des doses sont deux
mesures complémentaires.
c) L'interdiction d'usage
C'est évidemment la formule la plus radicale. Périodiquement, la commercialisation et/ou l'utilisation de molécules sont interdites, soit localement (c'est le cas du HCH bêta et du chlordecone, insecticides utilisés en bananeraies, interdits en 1987 et 1993), soit temporairement (arrêté d'interdiction d'épandage de l'atrazine pendant certaines périodes de l'année ou à proximité de certains sites), soit par une mesure générale (décision, en 2001, d'interdiction de l'atrazine et de quelques autres produits phytosanitaires).
Malgré leur apparente simplicité, l'application
de ces mesures ne donne pas toujours les résultats attendus et se heurte
à plusieurs difficultés.
§ Tout d'abord, il y a, le plus souvent,
un
délai
entre l'annonce de l'interdiction et son application
réglementaire. L'interdiction suit en fait trois
étapes :
-
L'avis aux opérateurs
, qui
notifie le retrait de l'autorisation ; cet avis est donné non par
molécule, mais par produit (exemple dans le cas de l'atrazine, on compte
34 produits commercialisés).
-
L'interdiction de la
commercialisation
qui peut être immédiate, ou plus souvent
décalée d'un an, le temps d'écouler les stocks
déjà produits.
-
L'interdiction de l'utilisation
qui, elle, est aussi le plus souvent décalée d'un ou deux
ans, le temps d'écouler les stocks détenus par les agriculteurs.
Dans le cas de l'atrazine, l'avis de retrait a été publié
le 27 novembre 2001, avec une date limite d'utilisation des stocks
fixée au 30 septembre 2003.
Ce délai entre la
décision d'interdiction et le retrait effectif a été
parfois critiqué. Il paraît pourtant compréhensible et
justifié. D'une part, le produit a été utilisé
pendant quarante ans et il n'y a pas d'urgence au mois près. D'autre
part, les agriculteurs avaient stocké des produits et il paraît
difficile d'interdire d'utiliser des produits légalement achetés.
Comme dit l'un d'entre eux :
« c'est comme si vous
remplissiez votre cuve de mazout et qu'on vous disait, une fois qu'elle est
remplie, que vous ne pouvez plus vous en servir ».
Certes. On
appréciera moins, cependant, que quelques semaines avant l'interdiction,
les intéressés procèdent « par
précaution » à des achats massifs d'atrazine.
§ Ensuite,
les résultats
de
l'interdiction sont
souvent
assez
longs à se
manifester
. Les résidus sont encore présents dans les
sols traités et dans les eaux brutes. On ne peut exclure que certains
produits soient toujours utilisés malgré l'interdiction. Les cas
sont probablement rares, mais délibérés. C'est avec
beaucoup de franchise que les services départementaux de Martinique par
exemple reconnaissaient que,
« a priori, les produits interdits
ne sont plus utilisés ... ».
A priori...
Une
mesure d'interdiction bien conduite appelle en réalité une
gestion rigoureuse de l'après interdiction. Que faire de stocks
entreposés ? Les délais accordés pour l'utilisation
ne sont parfois pas suffisants, et les stocks demeurent. Dans ce même
département, un mois avant la visite du rapporteur, un stock de 6 tonnes
de HCH bêta, molécule interdite quinze ans auparavant, avait
été découvert dans un hangar, à même le sol.
L'interdiction doit s'accompagner d'une opération de
récupération gratuite pour l'exploitant.
§ Enfin, on ne peut exclure
certains effets
pervers
ou inattendus.
Le premier concerne le remplacement de
molécules interdites, soit par des produits relativement comparables,
auquel cas les doses sont multipliées et l'interdiction est
compensée par des apports encore plus massifs d'autres produits, soit
par de nouvelles molécules de substitution, que l'on retrouve, elles
aussi, assez rapidement dans le sol et dans les eaux. C'est le cas de
l'atrazine en Bretagne. Les dernières campagnes de
prélèvement ont détecté des molécules de
substitution, déjà au-delà de 0,1 ug/litre.
Le
second effet pervers concerne les achats massifs par anticipation, une fois
l'annonce de l'interdiction connue.
Le troisième effet pervers
concerne les exportations aux concurrents. La molécule interdite est
aussitôt envoyée dans d'autres zones de production concurrentes
dans lesquelles la molécule reste autorisée. L'interdiction
s'accompagne alors d'un accroissement de la compétition... Aux Antilles,
dans les trois ans qui ont suivi le bannissement du chlordecone, plusieurs
dizaines de tonnes ont été exportées... dans les
bananeraies d'Afrique et des Caraïbes.
d) La réduction des doses
C'est l'autre solution. La diminution de la contamination des eaux est attendue d'une réduction des doses épandues. Ce type de solution a la préférence des fabricants et des agriculteurs qui préfèrent l'habitude à un produit connu, aux performances annoncées des molécules de substitution.
Périodiquement, les doses d'épandage font ainsi l'objet de mesures de limitation. Pour l'atrazine, les doses sont passées successivement de 2,5 kg/ha/jour à 1,5 kg pour 1 kg/ha/an, avant d'être finalement interdites. Des mesures similaires concernent aujourd'hui le diuron, désherbant sélectif (1.800 gr/ha/an en 2000, 1.500 gr en 2002, 1.200 gr en 2003) et l'isoproturon, désherbant du blé (1.800 gr/ha/an en 2000, 1.200 gr annoncés en 2003-2004).
Ces mesures sont cependant discutées.
D'une part, l'impact environnemental est souvent très faible. L'interdiction de l'atrazine a été décidée lorsque les mesures de limitation de dosage ont montré leur inefficacité. Certes, les pics de concentration diminuaient, mais la fréquence de détection augmentait. La réduction des dosages n'avait pratiquement aucun effet sur la contamination des eaux, compte tenu des délais de transferts de la molécule dans les sols et dans les eaux. Un dosage est en outre pratiquement impossible à contrôler.
D'autre part, les utilisateurs peuvent aussi manifester des réticences à la diminution des doses. Dans la grande majorité des cas, la diminution des doses réduit l'efficacité du produit. Dans le cas du diuron, par exemple, il est établi que le passage à 1.200 gr/ha/an diminue l'efficacité de 15 %. Cette baisse est plus que compensée par les bénéfices environnementaux attendus. Mais les baisses sur d'autres produits sont plus difficiles à faire accepter lorsque la diminution du dosage s'accompagne d'une trop grande perte d'efficacité (la discussion est en cours sur la diminution du glyphosate, désherbant total, pour laquelle les fabricants sont très réticents).
Enfin, d'autres solutions sont encore envisagées. Une formule consiste à calculer le dosage par type de sol. L'Allemagne notamment suit ce type de démarche et les dosages sont définis par Land et par sol. Il s'agit d'une approche extrêmement fine. Le bilan coût/efficacité est cependant discutable. L'analyse des sols devrait être menée, par région, voire par parcelle, ce qui conduit à des coûts extrêmement importants (pour un bassin versant, une analyse de sol est estimée à 1 million d'euros).
Une autre formule consiste à analyser l'efficacité des mélanges de molécules. L'efficacité d'un produit peut être démultipliée par l'association avec un autre produit, ce qui permet de réduire les dosages. Les betteraviers de l'Artois ont réussi par ce genre de calculs à réduire les épandages d'un coefficient 10.
En fait, interdiction et réduction ne s'opposent pas,
mais se complètent. L'interdiction de l'atrazine qui n'est que
partiellement justifiée pour des raisons scientifiques a
été très clairement un signal politique fort d'une
détermination des pouvoirs publics à enrayer des contaminations
des eaux. L'interdiction est une mesure radicale qui est toujours possible sur
d'autres produits. Elle a vivement incité les producteurs à
accepter les réductions sur d'autres molécules.
3. L'agriculture en position d'accusé
90 % des pesticides sont utilisés à des fins agricoles. 95 à 100.000 tonnes par an de matières actives sont répandues chaque année, ce qui fait de la France le troisième utilisateur mondial. Dans la quasi totalité des cas pour les nappes et dans la très grande majorité des cas pour les rivières, les pesticides détectés dans les eaux sont d'origine agricole.
Il n'est nullement question de faire le procès de qui
que ce soit, de participer aux accusations simplistes et aux procès
conclus avant même d'être engagés. Mais il est clair que
l'agriculture est très impliquée et dans cette
dégradation, que l'agriculteur est interpellé.
a) Les bons arguments
Que disent les agriculteurs ?
Les agriculteurs ne manquent pas d'argument pour se défendre contre une accusation qu'ils estiment injuste. La pertinence de ces arguments est cependant variable.
§ Ils rappellent, et ils ont raison, que l'agriculture
des années 60 s'est engagée dans la recherche de
productivité, et que les objectifs fixés par la politique
agricole commune ont été atteints. Ce succès s'est fait
grâce à une révolution de la profession et des pratiques
agricoles avec notamment le recours à la production intensive, l'usage
massif d'engrais chimiques et de pesticides de synthèse. C'était
un choix politique, stratégique et européen. Cette politique a eu
le mérite de délivrer les citoyens européens des risques
de pénurie alimentaire. Peut-on être coupable d'avoir atteint les
objectifs fixés par la collectivité ?
§ Ils rappellent, et ils ont raison, que si la France est
un très gros utilisateur de pesticides, sans doute l'est-elle parce
qu'elle est aussi le premier producteur agricole de l'Union, et notamment le
premier producteur de maïs, gros consommateur de pesticides.
§ Ils rappellent, et ils ont raison, qu'ils n'utilisent
que des produits autorisés, et autorisés après une
procédure longue et contraignante
(50
(
*
)).
Peut-on être coupable d'utiliser un produit
régulièrement autorisé ?
§ Ils rappellent, et ils ont raison, que l'utilisation de
ces produits répond à une nécessité agricole
(protection des végétaux), économique (concurrence des
marchés mondiaux) et commerciale (le consommateur achète des
fruits calibrés, sans parasite et sans tâche - l'exemple typique
et caricatural est ce qu'on appelle la « banane plastique »
non seulement parce qu'elle pousse protégée par un sac plastique,
mais aussi parce qu'elle est parfaitement jaune, et si parfaitement lisse
qu'elle ressemble ... à une fausse banane).
§ Ils rappellent, et ils ont raison, que la politique
communautaire sur ce sujet est très contradictoire et même
incohérente, en exigeant de plus en plus de précautions
environnementales des productions européennes, tout en opérant
une baisse massive des prix intérieurs et en ouvrant toujours plus
largement le marché communautaire aux produits non communautaires
très souvent cultivés avec les produits interdits.
b) Les arguments discutables
Que disent également les agriculteurs ?
§ Ils rappellent, et ils n'ont pas tort, que les agriculteurs ne sont pas les seuls utilisateurs de pesticides et que les entretiens de jardins, des voiries, des talus, par les particuliers, les collectivités locales et les transports présentent aussi des risques.
§ L'argument est en partie fondé. Les
études sur les produits phytosanitaires dans les rivières de
Bretagne ont montré la présence d'herbicides à usage mixte
-agricole et non agricole- sans qu'il soit possible de déterminer la
part relative de chacune (cas de l'aminotriazole, du glyphosate -
herbicides-, du triclopyr - débroussaillant utilisé dans les
fossés...).
Cet impact des autres utilisateurs (particuliers,
collectivités locales, voiries...) est cependant sans commune mesure
avec celui des pesticides agricoles. Sauf exception, la fréquence des
détections et les niveaux relevés sont très
inférieurs aux résultats enregistrés sur les pesticides
agricoles.
Il n'est pas établi que les autres utilisateurs de
pesticides soient plus pollueurs que les agriculteurs. Il existe des pollutions
ponctuelles. La difficulté principale, que l'on rencontre chez les
particuliers et les personnels d'entretien des collectivités locales,
est très liée aux déversements directs dans les
réseaux d'évacuation des eaux. Il y a, sur ce point, de graves
lacunes. Mais à cette exception près, et contrairement à
ce qui est souvent affirmé, les quantités utilisées par
les utilisateurs non agricoles rapportées à l'hectare, sont du
même ordre de grandeur que les quantités utilisées en
agriculture
(51
(
*
)).
Concernant l'entretien des voies de la SNCF,
par exemple, grâce à la réduction importante des
consommations de pesticides et à l'efficacité des trains
désherbeurs (l'utilisation des pesticides par la SNCF chute de 40 %
entre 1984 et 2001, alors que la consommation en agriculture est restée
pratiquement constante), l'épandage de pesticides à l'hectare est
aujourd'hui pratiquement identique à celui des agriculteurs
(52
(
*
)).
§ Ils rappellent, et ils n'ont pas tort, que la
profession n'est pas immobile et sourde aux inquiétudes. Deux actions
ont ainsi été conduites. Il s'agit, d'une part, de la
récupération de produits non utilisés (80 à
100 tonnes par département ont ainsi été
récupérés) et d'autre part, d'une palette d'actions de
sensibilisation sur le modèle de « ferti-mieux »
appliqué aux engrais, dont un programme
« phyto-mieux », pour éviter les surdosages
comportant notamment une action « pulvi-mieux », programme
de vérification des pulvérisateurs. Un bilan mené en 1990
avait montré que seulement un tiers des pulvérisateurs
fonctionnait de façon satisfaisante, un tiers des pulvérisateurs
imposait des réglages, et un tiers était inapte. Le programme
phyto-mieux s'appliquerait dans 68 départements.
Ces actions
professionnelles et volontaires ont cependant les limites des actions
volontaires. Elles peuvent se heurter à quelques difficultés
d'application (dans le secteur viticole en particulier).
§ Ils rappellent, et ils n'ont pas tort, qu'il n'existe aujourd'hui pas de véritable solution alternative aux pesticides, au moins pour les herbicides des grandes cultures céréalières. Dans de nombreux cas, les agriculteurs sont prêts à utiliser d'autres produits, mais lesquels ? Aux seuils indiqués (0,1ug/l), pratiquement tous les produits se retrouveront dans les eaux. La situation est presque bloquée. Des traitements de substitution peuvent être trouvés par les insecticides et les fongicides. Les procédés de l'agriculture biologique (par la promotion de la biodiversité, les insectes bénéfiques, les « tisanes naturelles », la rotation des cultures) doivent être mieux connus, mais ne doivent pas être surestimés. On ne traitera pas des centaines de milliers d'hectares de cultures céréalières à la main et aux « tisanes naturelles ».
§ Il y a donc une situation de blocage que les acteurs
pressentent confusément mais que personne n'ose exprimer. Sauf à
remettre en cause l'activité agricole elle même, ou au moins
certaines productions, quelques solutions permettant de sortir de ce blocage
mais aucune n'est satisfaisante. La solutions de rechange permettant de
réduire les doses seraient de recourir à des produits hyper
concentrés qui ne se retrouveraient pas dans les eaux tellement les
doses seraient faibles mais dont on ne saurait pas le comportement à
long terme. La seule solution qui permettrait aux plantes de résister
aux parasites serait... les semences génétiquement
modifiées.
§ Ils rappellent, et il n'ont pas tort, que la « crispation » sur les pesticides dans l'eau est peu fondée sur le plan scientifique puisque à l'exception de pics toujours possibles, les niveaux de contamination enregistrés restent modestes, et que, selon l'avis du Conseil Supérieur de l'Hygiène publique en France, une eau reste consommable jusqu'à une teneur de 0,4 ug/litre, et que la norme de l'OMS est de 2 ug/l. Il s'agit cependant d'une fausse sécurité. La dégradation est continue et il ne faut pas attendre d'être hors limite pour commencer à réagir. Par ailleurs de nombreuses interrogations se font jour sur les conséquences à long terme des pesticides pour la santé.
c) Les possibles erreurs d'appréciation
La position des agriculteurs est donc solide et argumentée. La profession doit toutefois se garder de quelques erreurs d'appréciation.
• D'une part, dans le domaine de l'eau, la plupart des autres acteurs contribuant à la pollution des eaux ont fait leur révolution. La pollution industrielle est maîtrisée et le plus souvent accidentelle. Les collectivités locales ont fait des efforts importants pour améliorer les rejets d'eaux usées. L'agriculture a fait sa révolution professionnelle, mais elle n'a pas encore fait sa « révolution écologique ». C'est aujourd'hui son tour.
• D'autre part, la profession sous-estime l'ampleur et la
nature de l'inquiétude des Français. L'importance symbolique de
la contamination des eaux souterraines en pesticides est déterminante.
Les pesticides dans l'eau des nappes surtout, révèlent une
atteinte profonde à l'environnement, une sorte de
dégénérescence et engendre une angoisse face à
l'avenir.
Comme l'analyse parfaitement Mme Isabelle ROUSSEL,
Présidente du Comité régional NPDC de l'association pour
la prévention et la pollution atmosphérique,
«après un demi-siècle de pratiques, les peurs de
l'empoisonnement ont remplacé les peurs séculaires de la
pénurie. C'est essentiellement par la mobilisation autour de l'eau que
les excès de l'agriculture ont été
dénoncés ».
• Les agriculteurs bénéficient toujours d'un certain crédit dans l'opinion française. Mais ce crédit est fragile. Il serait irresponsable de se laisser entraîner vers une situation où il faudrait choisir entre la préservation de la qualité de l'eau et les agriculteurs.
• Enfin, la profession appréhende probablement trop la réforme de la politique agricole commune. La prise en compte des préoccupations environnementales est non seulement souhaitable, nécessaire, mais aussi acquise. Seules les modalités doivent être aujourd'hui définies. Loin d'être appréhendée, cette réforme est une chance à saisir. Après avoir été les fautifs -malgré eux- de la dégradation de l'eau, les agriculteurs peuvent devenir actifs dans sa reconquête.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 40 - Les dispositions de lutte contre les pollutions azotées d'origine agricole
Annexe 41 - Les règles d'épandage des engrais
Annexe 42 - Les contentieux dans le domaine de l'eau
Annexe 43 - Les marées vertes en Bretagne
Annexe 44 - Les pesticides - Présentation générale
Annexe 45 - Données statistiques sur les pesticides
Annexe 46 - Les difficultés d'établir des comparaisons dans la contamination des eaux aux pesticides
Annexe 47 - L'atrazine
Annexe 48 - La contamination des rivières de Bretagne aux pesticides
Annexe 49 - Les pesticides dans les eaux de ruissellement
Annexe 50 - La commercialisation des produits phytosanitaires
Annexe 51 - Les utilisations non agricoles de pesticides
Annexe 52 - La SNCF et les pesticides
IV. LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
Plusieurs dispositions sont destinées à
protéger la ressource en eau. La plupart ont été vues ou
évoquées dans le cours du rapport. Le rapport récent du
Conseil national d'évaluation, du Commissariat Général du
Plan, consacré à la politique de préservation de la
ressource en eau (documentation française - septembre 2001) constitue
par ailleurs une remarquable analyse des principaux instruments juridiques,
contractuels, financiers, qui devraient permettre de protéger la
ressource. Il suffira donc d'un bref rappel. L'approche qui est choisie pour le
présent rapport est une tentative d'évaluation de
l'efficacité de ces dispositifs. Cette efficacité est pour le
moins variable. Au mieux modeste et perfectible quand elle n'est pas seulement
médiocre.
A. LES DISPOSITIFS PEU EFFICACES
1. La réglementation des prélèvements d'eau
Les prélèvements d'eau sont soumis à une réglementation complexe, qui résulte de dispositions combinées du code de l'environnement (qui réglemente les prélèvements d'eau) et du code minier (qui réglemente les forages). Le principe est que « les installations, ouvrages ou travaux permettant les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou déclaration... » . Le seuil dépend des zones. En règle générale, la déclaration est requise lorsque le débit est supérieur à 8 m 3 /heure. L'autorisation est requise lorsque le débit est supérieur à 80 m 3 /heure. Les seuils sont décalés dans certaines régions classées en zones dites « de répartition des eaux ». Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende.
Une analyse rapide permet pourtant de constater que plusieurs situations échappent à tout cadre légal.
C'est le cas de forages peu profonds, puisque les forages inférieurs à 10 m de profondeur échappent en fait à tout contrôle.
C'est aussi le cas des forages à petit débit puisque, en règle générale (sauf dans les zones de répartition des eaux) les forages dont les prélèvements d'eau sont inférieurs à 8m3/heure ne sont pas soumis à déclaration. Les forages familiaux sont en fait pratiquement inconnus. On sait juste qu'ils sont « extrêmement nombreux ». Les contrôles éventuels se heurtent au principe constitutionnel de la protection de la propriété privée de telle sorte que, en pratique, les propriétaires considèrent que l'eau du sous-sol est la leur. Tandis que l'eau des rivières est assimilée à un bien collectif, curieusement, les Français se sont appropriés l'eau des nappes.
Les conditions d'examen des dossiers d'instruction rendent l'autorisation à la fois très longue à obtenir et quasi systématique. Ce régime de l'autorisation préalable avait déjà été critiqué en 1996 par le rapporteur de l'étude du Conseil Général des Mines sur les eaux souterraines. M. Yves MARTIN : « La loi sur l'eau de 1998, au nom de l'unité de la ressource (eaux de surface et eaux souterraines) a commis l'erreur de soumettre de façon très générale les captages d'eaux souterraines à autorisation préalable . Une telle procédure est généralement inutile et s'avère impraticable. Plusieurs milliers de forages sont réalisés par an (...) L'examen est nécessairement sommaire et les autorisations sont alors quasi systématiques ». Le rapporteur préconisait d'ailleurs de réserver la procédure d'autorisation aux forages dans les nappes alluviales, qui ont un effet direct sur les débits des rivières. Il observait que la procédure d'autorisation, faute de moyens et de compétences, n'avait pas atteint son objectif
Enfin, la menace de poursuites pénales est toute
théorique. La rigueur des formalités et les délais des
procédures (procès-verbal, transmission au juge, décision
de poursuite, procédure contentieuse...), la part d'arbitrage des
magistrats (qui peuvent considérer que les contentieux liés aux
déclarations de forages ne sont pas prioritaires), et la faiblesse des
sanctions financières éventuelles (avec un risque d'amende
maximum de 1.500 €) conduisent à une impunité de fait.
Sur les 600 forages recensés et non déclarés lors du
recensement des puits de la nappe de l'Astien (voir supra) aucun maître
d'ouvrage n'a fait l'objet d'une quelconque sanction.
2. Les périmètres de protection
a) Présentation
Les périmètres de protection (PP) sont destinés à prévenir les contaminations par des substances polluantes autour des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités publiques.
On distingue trois types de périmètres :
§ Le périmètre de protection immédiate (PPI) dans lequel toutes les activités sont interdites en dehors de celles qui sont en liaison directe avec l'exploitation de captage. Les terrains compris dans ce périmètre doivent être acquis en pleine propriété par le bénéficiaire du périmètre. L'ordre de grandeur est variable. Il peut être de quelques mètres carrés, en n'incluant que la tête d'ouvrage, à 2/300 mètres de diamètre pour les grands captages sollicitant une nappe phréatique ;
§ Le périmètre de protection rapprochée (PPR) dont l'étendue est calculé après évaluation de caractéristiques hydrogéologiques du secteur (nature de la roche, fissures...), de la vulnérabilité de la nappe, et des risques de pollution. Les terrains compris dans ces périmètres font l'objet de servitudes : certaines activités sont interdites, d'autres activités sont réglementées, soumises à des conditions d'exploitation ou des prescriptions destinées à la protection des eaux (techniques d'assainissement des eaux usées, stockage de produits dangereux, épandages...) ;
§ le périmètre de protection
éloignée. Il renforce le précédent contre les
pollutions permanentes ou diffuses, à des distances plus
éloignées du lieu de captage, mais n'est que facultatif.
Les périmètres de protection bénéficient aux collectivités locales et à leurs groupements. L'établissement du périmètre de protection suit une procédure complexe (53 ( * )) . L'initiative appartient à la collectivité. Le périmètre et les servitudes qui lui sont liées sont arrêtés par le préfet du département sous forme d'un arrêté de déclaration d'utilité publique constituant la protection.
Conformément aux lois sur l'eau de 1964 et 1992, l'établissement des périmètres de protection est obligatoire, depuis le 12 décembre 1964, pour tout nouveau captage créé après cette date et depuis le 5 janvier 1997, pour tous les autres captages.
En 2001, sur les 35.171 points de prélèvements
d'eau destinés à la consommation humaine, 12.786, soit
35,3 % seulement bénéficiaient de périmètres
de protection. En excluant les procédures en cours, près de
22.800 captages ne bénéficient pas des périmètres
de protection obligatoires depuis, selon les cas, 8 ou 37 ans... Les
résultats sont très variables selon les régions, avec
notamment de très bons résultats en Alsace (72 % des
captages bénéficient de PP) et en particulier dans le Haut-Rhin
(avec un taux record de 87 %), mais dans douze départements, le
pourcentage des captages couverts par un périmètre de protection
est inférieur à 10 %
(54
(
*
)).
Dans son rapport sur la politique de
préservation de la ressource en eau , le Conseil national
d'évaluation estime «
qu'au rythme observé, il
faudrait environ 20 ans pour que tous les captages soient dotés de
périmètres de protection ».
b) Les causes de l'échec des périmètres de protection
L'échec est donc patent. Le rapport du Conseil d'évaluation analyse parfaitement les causes de cet échec.
La raison essentielle est liée à la procédure, signalée en annexe, qui est particulièrement lourde. Elle crée plus de problème qu'elle n'en résout. Le verrou principal réside dans l'inscription des servitudes aux hypothèques, très longue et coûteuse. Ce blocage est parfaitement connu et on s'étonnera qu'il n'y soit toujours pas remédié.
Il est également établi que le dispositif n'est pas efficace partout (le degré de protection que l'on peut assurer en terrains karstiques, avec des fissures, n'est pas le même que dans le cas d'un aquifère homogène) ni surtout, contre toutes les pollutions. Le dispositif, instauré en 1964, est adapté aux pollutions accidentelles (servitude de stockage des produits dangereux) ou identifiées (assainissement, épandages...) mais n'est pas un instrument efficace pour réduire les effets des pollutions diffuses, notamment les pollutions azotées d'origine agricole, qui sont aujourd'hui majoritaires. « L'affirmation est cependant à nuancer pour les produits phytosanitaires, qui justifient de porter un effort particulier sur les zones les plus proches du captage ».
Enfin, même si le Conseil d'évaluation n'en fait pas un argument prioritaire, le coût ne doit pas être sous estimé. Il correspond aux dépenses de la phase administrative (coût des études, publicité foncière... de l'ordre de 10.000 euros), et aux dépenses des prescriptions (achats de terrains, travaux d'aménagement ou de dépollution, éventuellement indemnisations des servitudes... de l'ordre de 12.000 euros).
La rencontre avec de très nombreux élus et professionnels permet d'être plus sévère encore.
Les causes de cet échec sont largement partagées. Il ne faut pas nier la responsabilité des élus des communes. L'initiative du déclenchement de procédures leur incombe. Mais l'Etat est leur premier complice. Les défauts majeurs des procédures sont parfaitement connus depuis 30 ans. L'Etat avait les moyens non seulement pour corriger ces défauts, mais aussi pour obliger les communes à respecter cette obligation légale. Après 30 ans d'inertie et de silence complice, beaucoup de situations sont irréversibles.
Tout retard s'accumule et l'on devine que, après 35 ans d'urbanisation et d'activités, les périmètres de protection, encore possibles dans les années 70, ne le sont plus dans les années 2000. Devant cette situation bloquée, certains préfets ont d'ailleurs décidé d'imposer des fermetures de captages.
Mais d'autres difficultés pratiques permettent d'avoir des doutes sur l'efficacité des périmètres de protection.
§ Compte tenu des difficultés prévisibles et des oppositions des propriétaires aux servitudes imposées, les collectivités locales ont intérêt à faire des périmètres les plus petits possibles, avec des servitudes les moins contraignantes possibles. L'évaluation des périmètres de protection permettrait sans doute de constater ce semi échec.
§ Si le coût est supportable, la question de la répartition du financement doit être posée. Aujourd'hui les périmètres de protection sont décidés à l'initiative de la commune (ou de son groupement) pour les captages situés dans leur territoire. Il y a donc un décalage entre, d'une part, une opération de protection de la ressource, au bénéfice de tous, et, d'autre part, les contraintes et les servitudes, qui ne vont peser que sur la seule commune sur laquelle se trouve le point de captage à protéger. En d'autres termes, pourquoi une commune paierait-elle, dans tous les sens du terme, pour les autres ? La protection de la ressource est l'affaire de la collectivité dans son ensemble et non d'une commune en particulier.
§ Enfin, c'est par erreur que l'on présente
souvent le périmètre de protection comme une mesure de protection
de la ressource alors que le périmètre de protection ne
protège -au mieux- que les lieux de captage. Une ressource souterraine
potentielle ne bénéficie à ce jour d'aucune
protection.
Il y a donc un décalage total entre l'enjeu
stratégique, qui suppose une responsabilité collective, et la
mise en oeuvre et le financement d'une procédure qui reposent
aujourd'hui sur les maires et les communes.
L'échelon communal
n'est pas le bon échelon de la protection des eaux.
3. La maîtrise contractuelle des pollutions agricoles
a) Panorama des dispositifs
Sous l'impulsion du droit communautaire et de la pression politique, les pouvoirs publics comme les professionnels tentent d'engager des actions de protection de l'environnement dans l'agriculture par le recours à des instruments juridiques basés sur l'accord et le volontariat. Des aides financières accompagnent ces actions. Les mesures les plus connues sur le « plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole » -PMPOA-, « les contrats territoriaux d'exploitation » -CTE- et la qualification d'« agriculture raisonnée ».
§ Le PMPOA est la traduction administrative de l'accord conclu entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles le 8 octobre 1993. L'Etat s'engage avec les agences de l'eau et les collectivités locales qui le souhaitent, à apporter un concours financier au programme d'investissement nécessaire à la mise aux normes des bâtiments d'élevage, qui doit permettre de réduire les pollutions.
§ Les contrats territoriaux d'exploitation -CTE, créés par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, sont eux aussi destinés à encourager des pratiques respectueuses de l'environnement (par extensification des productions animales, les rotations ou conversions de cultures...). L'objet concernait également le domaine économique et l'emploi.
§ La qualification des exploitations au titre de « l'agriculture raisonnée », introduite en 2002 est subordonnée elle aussi au « respect de l'environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé, la sécurité au travail et le bien être des animaux ».
Cette démarche contractuelle a certainement fait ses
preuves entre partenaires privés (voir sur ce point la protection de
périmètres de protection des eaux minérales). Elle
élargit la gamme des instruments proposés aux
intéressés pour parvenir à une meilleure protection de
l'environnement. En revanche, elle s'accompagne de nombreux effets pervers,
tant sur le plan juridique
(55
(
*
))
et
(56
(
*
))
.que pratique. Le bilan environnemental de cette
panoplie d'actions -en attendant celui sur l'agriculture raisonnée qui
vient de démarrer- est très médiocre et plusieurs rapports
ont déjà dressé un bilan extrêmement critique du
PMPOA.
b) Appréciations critiques
Le constat est connu. Les limites sont en premier lieu d'ordre juridique liées aux incohérences et aux effets pervers de ces initiatives, précisées dans deux annexes qui donnent une analyse juridique des instruments contractuels ainsi mis en oeuvre :
- La confusion entre la norme, qui s'impose et le contrat, associé au respect de la norme. Ce paradoxe a été parfaitement identifié dans le rapport d'évaluation du PMPOA : « un paradoxe apparent qui s'explique par des contraintes politiques. Les pouvoirs publics paient pour que des normes, obligatoires par définition, soient appliquées ».
- La dérive des coûts et l'effet possible de substitution. On observera sur ce point que certaines agences ont clairement dit qu'elles ne pouvaient pas financer à la fois les aides aux agriculteurs et les aides aux collectivités locales. Une concurrence de fait tend à s'établir.
- La marginalisation des procédures répressives.
- La complexité des dispositifs et la cannibalisation des objectifs, notamment dans le cas du CTE qui en visant plusieurs objectifs environnementaux et économiques, s'est transformé en contrat de filière.
- La faible lisibilité pour le consommateur face au nouveau « label » d' « agriculture raisonnée ».
En second lieu, l'application pratique se heurte à de
très nombreuses difficultés et surtout enregistre des
résultats très décevants. Les différents
interlocuteurs ont évoqué le « temps de
réponse » des politiques contractuelles, façon
élégante d'évoquer leur relatif échec. Les
politiques contractuelles fonctionnent lorsqu'il y a un petit nombre
d'agriculteurs. Dans les grosses zones agricoles, les résultats sont
beaucoup plus aléatoires. La profession est par ailleurs
« habituée aux négociations » et la
conclusion de contrats est extrêmement longue et pointilleuse. Cette
implication forte de la profession dans toute forme de contrainte se retrouve
dans l'élaboration des réglementations. Les soixante-treize pages
de l'article du précédent projet de loi sur l'eau relatif
à la redevance pour pollution de l'eau, comme les douze distances
différentes réglementant l'épandage des effluents
agricoles, sont les signes parmi d'autres de ces difficultés.
4. La police de l'eau
La police de l'eau consiste à assurer le respect des réglementations relatives à l'eau et aux milieux aquatiques. La police de l'eau est assurée par les services déconcentrés de l'Etat dans le département. C'est de l'avis unanime des observateurs et même des intéressés, le « maillon faible ».
Les critiques traditionnelles et bien connues portent sur
l'organisation. Les nombreuses rencontres de cette mission conduisent à
être plus sévère.
a) L'organisation de la police de l'eau
L'organisation de la police de l'eau est particulièrement complexe et même inextricable, et probablement, en pratique, ingérable (57 ( * )).
Les directions départementales de l'équipement (DDE), de l'agriculture et de la forêt (DDAF), les affaires sanitaires et sociales (DDASS), les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), les voies navigables (VN), les services vétérinaires (SV), les cellules qualité des eaux littorales (CQEL), les services maritimes (SM), les brigades départementales du Conseil européen de la pêche (CSP), et probablement encore quelques autres services, participent à la police de l'eau pour contrôler les dispositions relatives à l'eau, à savoir quatre grandes familles de contrôle : les cours d'eau, l'eau potable, l'assainissement et la pêche.
Au total, 500 services participent à la police de l'eau sans oublier les services de gendarmerie et les agents de police judiciaire.
Une telle « organisation » ne peut
qu'entraîner de difficultés de tous ordres. De gestion,
d'orientation, et même de recueil d'informations. Ainsi, entre le quart
et la moitié des départements ignorent ou ne font pas remonter
l'information à l'administration centrale concernant la
situation :
- des prélèvements agricoles, 25 non
réponses,
- des compteurs sur les points de
prélèvements agricoles, 33 non réponses,
- les
aménagements de cours d'eau, 11 non réponses,
- les rejets en
mer, 16 non réponses sur les 26 départements
concernés.
b) Les compétences
Il est évidemment difficile de critiquer les compétences des services de l'Etat, mais l'argument a été si souvent évoqué, à mots plus ou moins couverts, qu'omettre de le faire ne serait pas une représentation fidèle de ces quelques mois de travaux. D'ailleurs, des personnalités incontestables -et pourtant « du sérail » ont osé. Lors d'une présentation du rapport du Conseil Général des Mines sur les eaux souterraines, le rapporteur, M. Yves MARTIN, observait ... -cruellement- « La denrée la plus rare n'est pas l'eau souterraine, mais les fonctionnaires compétents pour en assurer la police ».
Les compétences sont liées aux effectifs, à la formation des personnels, à l'organisation du travail, aux priorités définies.
§ Les effectifs.
La situation est connue, et
dans de nombreux départements, critique. Il est apparu au cours de cette
année d'entretiens que les services de la police de l'eau sont
particulièrement démunis et de moins en moins en mesure d'assurer
les prestations que les textes et la société leur demandent
concernant la ressource en eau : les cours d'eau, la protection contre les
inondations, la qualité de l'eau potable, l'assainissement... Il est
clair qu'aujourd'hui, le nombre et la formation des personnels des
préfectures ne leur permettent plus de faire face aux attentes de la
collectivité.
§ La formation.
La formation en
hydrogéologie n'est prioritaire dans aucune des sections techniques qui
forment les corps techniques dans les départements. Curieusement, alors
que la corporation des hydrogéologues avait considéré que
la loi sur l'eau de 1992 allait enclencher un vaste mouvement de recrutement,
à tous niveaux (communes, cabinets de conseil, départements,
Etat), il n'en a rien été. De très nombreux
hydrogéologues ont du abandonner cette voie.
§ L'organisation du travail.
Les personnels sont
mutés trop rapidement, empêchant d'avoir un suivi efficace des
dossiers, pourtant parfois très longs à aboutir. Les vacances de
postes sont aussi parfois très longues, les personnels ne sont
remplacés qu'après un long délai.
Par ailleurs, la
juxtaposition de missions de contrôle et d'ingénierie, au profit
des petites communes, est une survivance d'un passé révolu et une
aberration (même si le contrôle et le conseil ne sont pas
assurés par les mêmes personnes, ni les mêmes services, il
est très difficile de faire juxtaposer un conseil de la DDE pour des
travaux de canalisations ou d'interconnexion par exemple, et un contrôle
de la DDA sur les rejets...).
L'ingénierie, le service de
conseils assuré par l'Etat au profit des petites communes sont source de
confusion. Indépendamment de cette situation qui tend heureusement
à être de moins en moins fréquente, certains observateurs
notent que les contrôles assurés par certains services font preuve
de beaucoup de complaisance pour les fautifs.
« La DDAF peut elle
assurer la police de l'eau auprès des
agriculteurs ? »
§ Les priorités.
Où vont les
priorités de contrôle ? Sur les quelque 6.100
procédures administratives (constats) et judiciaires
(procès-verbaux transmis au Procureur de la République) en cours
en 2001, 90 % concernaient des infractions à la loi sur la
pêche et 10 % seulement à la police de l'eau proprement
dite.
Tout confirme que la priorité annoncée sur la protection de la ressource n'en est pas une. La plupart de ces réglementations se sont montrées plutôt inefficaces à protéger convenablement la ressource, notamment l'eau souterraine.
Tous les dispositifs ne sont pas aussi manifestement
inefficaces. Plusieurs dispositions, dans certains cas, ont été
suivies de résultas encourageants.
B. LES DISPOSITIFS PLUS EFFICACES
1. La réglementation des rejets d'eaux usées
La réglementation des rejets d'eau concerne surtout les industries et les collectivités locales. Le bilan est globalement positif.
Les principaux rejets industriels sont soumis pour l'essentiel aux dispositions des installations classées pour l'environnement, contrôlées par la DRIRE. Les résultats sont encourageants, même si la réglementation n'empêche ni les rejets délictueux qui doivent être poursuivis avec la plus extrême rigueur, ni les difficultés issues des petites industries isolées.
Les rejets des collectivités locales seront
examinés dans la deuxième partie du rapport. Beaucoup a
été fait en matière de stations d'épuration.
Beaucoup reste à faire non seulement pour poursuivre les
équipements, mais aussi pour assurer les contrôles.
2. L'implication forte des collectivités locales
La coopération intercommunale et les partenariats avec l'Etat et les agences de l'eau sont une première réponse. On compte ainsi plusieurs centaines de contrats de rivière, contrats de bassin, contrats de nappe... Cette superposition n'est pas toujours efficace et est plutôt le signe clair de l'inadaptation de l'échelon communal, voire de l'échelon intercommunal classique (syndicat intercommunal de pompage, de distribution, d'assainissement, à géométrie variable et sans lien avec les groupements de communes... aux problèmes de gestion de l'eau et de lutte contre la pollution des eaux.
La seconde réponse est à rechercher dans le partenariat avec les professionnels. L'efficacité des actions volontaires de maîtrise de pollution est très améliorée lorsque le volontariat est encouragé et soutenu politiquement et financièrement par les collectivités locales.
Certes, quelques opérations médiatisées et bien connues n'ont pas toujours eu les résultats attendus. Nous avons été surpris, en particulier au cours de notre mission, par l'importance des déceptions, les désillusions, du découragement, entraînés par les opérations « Bretagne eau pure », après dix ans d'application. La mobilisation des énergies et l'intense médiatisation n'ont pas suffi à faire reculer de façon significative la pollution des eaux aux nitrates et aux pesticides. Soit « les temps de réponse aux changements de pratiques agricoles » ont été sous-estimés, soit les changements évoqués ont été insuffisants...
En revanche, l'instance d'évaluation du plan évoque plusieurs succès. Ils ont en commun d'avoir été conduits à des niveaux inférieurs à celui de « Bretagne eau pure », qui part d'une convention de financement entre l'Etat, la région Bretagne, les quatre départements bretons et l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Des collectivités locales ont proposé aux agriculteurs qui exploitent à proximité de leur captage de s'engager à respecter un cahier des charges de pratiques agricoles, et à percevoir en contrepartie une aide annuelle. Ce cahier de charges est assez contraignant. Il porte sur la suppression de la culture du maïs, le compostage des déjections animales, la suppression des produits phytosanitaires, des limites strictes de fertilisation azotée, qui prennent en compte les apports de déjections animales compostées, des rotations de cultures...
L'instance d'évaluation cite en particulier en exemple
la ville de Lons le Saunier, dans le Jura, et de Munich en Allemagne. Le
coût de ces dispositifs est estimé respectivement à 2
centimes et 1 centime d'euro par m
3
.
3. L'exemple des eaux minérales et la protection de la ressource par les sociétés privées
Une eau minérale doit répondre à quatre critères :
- c'est une eau souterraine, naturellement propre à la consommation, qui ne doit subir que des traitements physiques élémentaires avant sa distribution (aération, décantation, filtration...),
- c'est une eau dont la composition physicochimique doit être stable,
- c'est une eau riche en éléments, notamment en minéraux susceptibles de lui donner des vertus thérapeutiques. Ce bénéfice doit être reconnu par l'Académie de médecine,
- une eau qualifiée par arrêté ministériel, sous forme d'une déclaration d'intérêt public (DIP), associée à un périmètre de protection.
Ainsi, la qualité de la ressource est au fondement même de la qualité -l'appellation- « d'eau minérale » et fait l'objet d'une extrême attention par la société exploitante, compte tenu, notamment, des enjeux économiques et financiers (le chiffre d'affaires lié à la consommation d'eaux minérales est évalué à 2,2 milliards d'euros), toute détérioration pouvant entraîner des dommages irrémédiables en termes d'image, puis une fermeture de l'exploitation.
Cette protection est assurée par deux voies :
a) La réglementation
La qualification d'une eau minérale se traduit par une déclaration d'intérêt public et par la définition d'un périmètre de protection. Cette juxtaposition est très ancienne puisqu'elle remonte à une loi du 11 juillet 1856. La reconnaissance d'intérêt public entraîne ipso facto et de jure la définition d'un périmètre de protection (ces deux procédures sont distinctes dans le cas des eaux potables classiques). En revanche, la mise en oeuvre du périmètre est subordonnée au respect des procédures habituelles (enquête publique...).
L'application de ce périmètre de protection entraîne des contraintes particulières sur les exploitations artisanales et industrielles (toutes les activités devant être déclarées au titre de la législation sur les installations classées par la protection de l'environnement - ICPE- doivent être autorisées : les forages sont interdits, les conditions de rejet des eaux issues des stations d'épuration sont renforcées...
La société Vittel bénéficie d'un périmètre de protection de 4.000 hectares. La société Evian, qui bénéficie d'un périmètre de protection de 50 hectares a demandé son extension à 1.600 hectares. Ce changement d'échelle est dû aux craintes suscitées par le développement de forages d'irrigation et de forages géothermiques.
b) La contractualisation
L'outil du périmètre est nécessaire, mais pas suffisant. On observera en particulier que le dispositif réglementaire n'apporte aucun changement aux pratiques agricoles. Ces changements ont été apportés par une autre démarche, plus partenariale. Dès le début de la dégradation de la ressource, avec l'émergence d'une petite pollution aux nitrates, les sociétés d'eaux minérales ont immédiatement réagi par une série de dispositifs fondés sur un cahier des charges, des acquisitions foncières et des aides financières (58 ( * )). Ce dispositif est présenté en annexe.
Sans nier l'importance des moyens financiers mis en oeuvre
(à la hauteur des enjeux financiers que représente la
distribution d'eau minérale), on observera qu'une partie du coût
est partagé par les collectivités locales car toute la
collectivité dans son ensemble a intérêt à la
protection de cette ressource patrimoine. Lorsque la ressource est
stratégique, les moyens méritent d'être engagés.
L'exemple des eaux minérales montre que lorsque la volonté existe
et que les moyens sont dégagés, il est possible de
protéger la ressource en eau.
4. L'écoconditionnalité
Le principe de l'écoconditionnalité consiste à subordonner le paiement d'aides ou de crédits agricoles au respect de normes environnementales. Le principe a été introduit dans le droit communautaire lors de la deuxième réforme de la politique agricole commune (PAC) en 1999. au moment de la création du deuxième pilier de la PAC, qui, en parallèle aux mesures traditionnelles du marché (aides à la production) et aux aides directes au revenu, faisait apparaître une nouvelle action consacrée au développement rural, très axée sur la protection de l'environnement.
L'écoconditionnalité qui existe dans d'autres régions, notamment en Suisse (où elle couvre 100 % des surfaces agricoles utiles) est donc aussi prévue par le droit communautaire, mais son application dans l'Union européenne est laissée à l'appréciation des Etats membres, qui ont le choix de déterminer les conditions effectivement requises au versement des aides.
La France applique en partie l'écoconditionnalité depuis 2001.
En 1992, la grande réforme de la PAC a consisté à basculer le système d'aides à la production, à un système d'aides directes au revenu. Ces aides compensaient l'importante baisse des prix imposée sur les céréales. Les producteurs ayant investi pour irriguer se trouvaient donc doublement pénalisés puisqu'ils subissaient une baisse des prix après avoir investi. Ce fut le cas des producteurs de maïs, gros consommateurs d'eau, qui bénéficiaient donc, en sus de leur aide directe compensatrice, d'une surprime, dite « prime au maïs irrigué ».
En 2001, la France, en application du principe d'écoconditonnalité, a décidé de subordonner le versement de cette prime au respect de certaines règles relatives à l'eau, en particulier à la régularisation des autorisations ou déclarations de prélèvements et à la pose de compteurs d'eau. L'annonce de l'arrêt prochain des subventions à l'équipement des compteurs par les agences de l'eau a été un argument de plus auquel ont été sensibles les agriculteurs.
L'effet a été immédiat. Le nombre de déclarations de prélèvements d'eau auprès des services de l'Etat, et surtout le nombre de demandes d'aides aux agences de l'eau pour la pose de compteurs a sensiblement augmenté au cours des 18 derniers mois. Les agriculteurs les plus récalcitrants dans les bassins déjà bien équipés ont été convaincus de s'équiper de compteurs (le taux d'équipement en Loire Bretagne est passé de 65 à 82 % ). Les retards constatés dans les bassins versants les moins performants ont été très vite rattrapés (le taux d'équipement en Adour Garonne est passé de 10 à 80 %). Ainsi, l'argument financier positif (subvention) et négatif (menace de suppression de prime en l'absence de compteurs) a été très vite compris.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 53 - Le régime juridique des périmètres de protection
Annexe 54 - Situation des périmètres de protection en 2001
Annexe 55 - Les limites juridiques de l'articulation entre le règlement et le contrat
Annexe 56 - Les limites du recours à des instruments juridiques volontaires
Annexe 57 - La police de l'eau
Annexe 58- La protection de la ressource par les sociétés d'eaux minérales
CHAPITRE II - LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE
I. LES NORMES DE QUALITÉ
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1. La réglementation des eaux destinées à la consommation humaine
La qualité de l'eau distribuée est définie par sa conformité par rapport à des limites et références de qualité, communément appelées « normes ». Ces valeurs sont réglementées par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales. Ce texte reprend pour l'essentiel les dispositions de la directive européenne 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les limites et références de qualité sont applicables à compter du 25 décembre 2003.
Ce texte fixe des limites et références de qualité pour les eaux de consommation et les eaux brutes destinées à la production d'eau, à partir de paramètres biologiques et chimiques. Sur un tel texte, clef de voûte de la réglementation de l'eau, on sera surpris de constater que le souci pédagogique a été totalement occulté tant les dispositions se mêlent avec incohérence : les paramètres chimiques sont classés par liste alphabétique pour les eaux distribuées mais par nature de risques pour les eaux de rivière ; les paramètres biologiques apparaissent en début de liste pour les eaux distribuées et en fin de liste pour les eaux de rivière ; la présentation des paramètres des eaux souterraines est encore différente...
Il y a un immense besoin de simplification et de pédagogie. A commencer par l'Etat .
Les principales dispositions réglementaires sur la qualité de l'eau se présentent comme suit (59 ( * )) :
|
Le contenu du décret - Le décret concerne les eaux destinées à la consommation (« l'eau du robinet ») et les eaux de surface destinées à la production d'eau destinée à la consommation (l'eau brute), - Concernant l'eau destinée à la consommation, le décret distingue les limites de qualité qui sont impératives et les références de qualité , qui sont des indicateurs du bon fonctionnement des installations de production et de distribution des eaux. Les procédures à suivre en cas de dépassement diffèrent selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre critère. - Concernant l'eau destinée à la consommation , la qualité est définie par 48 paramètres. Ces paramètres sont mesurés sur les lieux de consommation de l'eau ou à l'entrée dans le réseau de distribution. Le décret fixe la fréquence des contrôles, variable selon l'importance des volumes distribués. - Concernant les eaux de surface , le décret fixe des limites de qualité, définies par 49 paramètres. Contrairement aux eaux de consommation pour lesquelles il y a une valeur unique à respecter par paramètre, les limites de qualité des eaux brute sont fixées par seuil. Le décret distingue trois seuils. Les valeurs mesurées dans l'eau brute déterminent les traitements minimum à mettre en oeuvre afin d'assurer la distribution d'eau de consommation. Ce qui n'est pas dans le décret - Le décret n'utilise pas l'expression « d'eau potable ». Une eau qui ne respecterait pas les critères de qualité peut être potable. D'ailleurs, la distribution d'eau qui dépasse les références de qualité, peut être autorisée. - Les limites de qualité définies concernent les eaux brutes de surface. Les limites de qualité des eaux souterraines sont prévues en annexe III du décret. Les paramètres listés sont moins nombreux, distincts, et avec des seuils qui peuvent être différents des paramètres applicables aux eaux de surface, (pour les nitrates par exemple, la limite de qualité est de 100 mg/l pour les eaux souterraines et 50 mg/l pour les eaux de surface). - Les limites de qualité ne concernent pas toutes les eaux de boisson. Elles s'appliquent aussi aux eaux de source, mais ne s'appliquent pas aux eaux minérales naturelles qui peuvent donc être distribuées en bouteille sans respecter les limites de qualité de l'eau distribuée au robinet. |
2. La fixation des normes
La fixation des limites de qualité suit un processus complexe. La plupart des limites françaises et européennes traduisent des « valeurs guides » recommandées au niveau international et adoptées -parfois aussi adaptées- par les Etats (60 ( * )) . Ces seuils, déterminés sur des bases scientifiques avec d'importantes marges de sécurité font de l'eau un des produits les plus surveillés du monde.
Cette démarche, essentiellement scientifique n'exclut
cependant pas une part d'arbitraire, dont des considérations
économiques et sociales ne sont pas absentes. Plusieurs
phénomènes méritent d'être rappelés.
a) L'arbitrage entre précaution et prévention
Une politique de précaution vise à supprimer le danger. Elle consiste à ne pas avoir recours à des pratiques potentiellement dangereuses, en attendant que l'amélioration des connaissances scientifiques vienne démontrer le contraire. L'un des risques de cette démarche est de stopper toute initiative et de conduire à des situations de blocage, car en vérité, une fois qu'un choix est pris sur ce principe, il est très difficile d'en sortir, même lorsque les connaissances scientifiques progressent.
Une politique de prévention vise à maîtriser les risques. Elle part du principe que toute activité humaine présente des dangers, mais qu'il faut minimiser les risques, les rendre acceptables dans la vie quotidienne. Cette démarche est beaucoup plus exigeante que la simple politique de précaution. Elle impose une identification des dangers, une évaluation des expositions et des risques, une information permanente, des options possibles en fonction de l'évolution des connaissances.
b) L'implication insuffisante de la France dans la fixation des normes internationales
Les seuils proposés par la communauté scientifique recouvrent aussi des enjeux économiques et sociaux parfois considérables. Ainsi la nouvelle valeur de référence du plomb dans l'eau (fixée à 10 ug/l au 25 décembre 2013), suppose une totale élimination des conduites en plomb, ce qui pourrait entraîner une dépense de l'ordre de 10 milliards d'euros en France. Beaucoup d'experts continuent de penser que l'efficacité sanitaire aurait pu être obtenue avec un seuil moins sévère et pour un coût très inférieur. Au-delà de cet argument financier, un seuil fixé pour un contaminant dans un aliment par exemple, peut aussi condamner une profession. Tout contribue à ce que les valeurs guides ou les concentrations maximales admissibles fassent l'objet d'une bataille de chiffres, d'une bataille d'experts, recouvrant aussi, il faut le reconnaître, des enjeux moins scientifiques et plus politiques.
Avant d'être retenues et fixées en Europe sous forme de directive du Conseil, ces valeurs ont été longuement discutées au sein de comités techniques. Il paraît inutile d'insister sur l'importance de ces comités et sur l'importance d'y être représenté par des personnels qualifiés, compétents, préparés et même « aguerris » aux négociations scientifiques internationales.
De nombreux professionnels ont déploré que la
représentation de notre pays dans ce type d'institutions n'était
pas toujours à la hauteur des enjeux. Si l'on en croit ces observateurs,
une certaine impréparation technique, et une méconnaissance du
fonctionnement de ces aréopages, se traduirait par une relative
inefficacité qui contraste avec la rigueur et les pratiques d'autres
Etats membres. Ce serait le cas de l'Allemagne, du Royaume Uni et des pays du
Nord de l'Europe.
« Quand ces derniers envoient des experts
professionnels, qui connaissent tout et tout le monde, les Français
envoient le permanent du Ministère disponible ce jour là....
Même quand il connaît bien le sujet en discussion, il ne
connaît personne et n'est pas écouté
».
Même caricatural, cet avis d'observateur recouvre une situation maintes
fois déplorée.
La France semble mal
représentée dans ces institutions. Il paraît indispensable
d'améliorer cette situation
.
c) Le rôle croissant des normes.
Au départ, la fixation de valeurs limites de qualité d'eau correspondait à des objectifs de santé publique. La norme était une garantie de protection de la santé et était fixée avec de telles marges de sécurité que chacun se sentait protégé et acceptait des dépassements provisoires jugés sans conséquence.
La société a fait évoluer
considérablement le rôle des normes. Tout d'abord, une confusion
est entretenue entre la norme sanitaire et la norme environnementale. Le choix
de fixer, en Europe, un seuil de pesticide dans l'eau à 0,1 ug/l
correspond au départ à un choix politique et environnemental (pas
de pesticide dans les eaux) plus qu'à un choix sanitaire (d'ailleurs
l'OMS accepte des seuils plus élevés pour l'eau et les seuils
appliqués aux aliments n'ont pas été modifiés).
D'autre part, ces normes sont instrumentalisées à d'autres fins.
Les valeurs limites correspondaient à une garantie sanitaire. Elles sont
aujourd'hui des seuils qui permettent d'enclencher des procédures
contentieuses, de déterminer le choix de sites d'implantations
industrielles (les entreprises sont de plus en plus sensibles à la
qualité de la ressource en eau), de vendre des produits destinés
à rassurer, de lancer des polémiques. Le seuil sanitaire est
devenu un seuil judiciaire, commercial et politique.
B. LA QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU
|
On appelle risque infectieux, le risque microbiologique, lié aux bactéries, parasites et virus. Ce risque s'oppose au risque toxique, lié aux polluants minéraux (métaux lourds) ou organiques (pesticides...). On assimile à tort qualité microbiologique et qualité bactérienne car les bactéries ne sont qu'un des éléments de la microbiologie qui comprend aussi l'analyse des parasites et des virus. Bactéries : première forme de vie cellulaire et premiers organismes vivants apparus sur la Terre. Les bactéries n'appartiennent ni au règne animal ni au règne végétal. Elles se reproduisent par scissiparité, c'est-à-dire par division des cellules. Elles sont présentes partout, parfois dans des conditions extrêmes, et se trouvent donc dans l'air, la terre, le corps et dans l'eau. Les bactéries se présentent par famille notamment selon leurs conditions de développement (bactéries aérobies ou anaérobies, c'est-à-dire qui vivent avec ou sans oxygène) ou leur taille. Les principales bactéries se présentent sous forme de bâtonnet (les bacilles) ou spiralée (les vibrions). Sur les millions de bactéries, certaines peuvent être pathogènes, c'est-à-dire avoir un effet négatif sur la santé. Le bacille du choléra, la salmonelle ... , sont les bactéries pathogènes véhiculées par l'eau les plus connues. Parasites : C'est un agent unicellulaire du règne animal qui vit aux dépens de son hôte, végétal ou animal. La définition courante englobe la plupart des agents infectieux. Parmi les parasites présents dans l'eau, se trouvent les protozoaires. Virus : Les virus sont les plus petits parasites et sont les derniers agents infectieux découverts. Leur taille, 10 à 100 fois moins importante que celle des bactéries, n'est pas étrangère à ce retard. Tandis que les bactéries vivent de façon autonome, les virus ne sont pas capables de vivre seuls. Dans l'environnement le virus survit sous une forme inerte, « le virion ». Le virus se développe quand il a trouvé son hôte (animal, végétal, bactérie...). |
1. La situation actuelle - la surveillance du risque bactérien
a) Le risque bactérien
§ Le risque bactérien
d'origine hydrique
a été historiquement le plus grave et le plus fréquent. En
Europe, au 19
ème
siècle, plusieurs
épidémies mortelles ont été transmises par l'eau
(typhoïde, choléra). L'eau est un milieu favorable au
développement des bactéries et des parasites. Les
déjections animales ou les rejets des matières fécales
d'origine humaine ont été les principales sources de
contamination bactérienne de l'eau. Ce risque a été
considérablement réduit par la mise en place de
procédés de désinfection des eaux et des installations de
traitement des eaux usées, mais il n'a pas disparu. L'eau reste
aujourd'hui à l'origine de la mort de 3 à 10 millions de
personnes dans le monde, contaminées par des bactéries d'origine
hydrique.
Le contrôle de la qualité microbiologique de
l'eau repose sur la recherche d'indicateurs de contamination fécale, qui
est la contamination bactérienne la plus répandue. Elle peut
être aisément suivie par la présence d'une bactérie
témoin : l'
escherichia coli
, ou
E. coli
, germe
habituel de la flore intestinale des animaux et des hommes, qui se
répand dans les matières fécales. La présence
d'
E coli
dans l'eau révèle une contamination
fécale.
§ Les contaminations de ce type se traduisent par des
diarrhées, ou des gastro-entérites
(diarrhées+vomissements+fièvre) plus ou moins graves, mais
susceptibles d'engager le pronostic vital pour les personnes les plus
fragiles.
§ Selon une estimation de l'Institut de veille sanitaire, des eaux non conformes à la réglementation pourraient être la cause de 10 à 30 % du total de gastro-entérites aiguës observées dans les secteurs desservis par ces eaux.
b) Les voies de contaminations
Les contaminations de ce type, quoique rares, restent toujours possibles.
Le cas le plus fréquent est celui d'une mise en contact accidentelle d'eaux usées et de l'eau destinée à la distribution. Ce phénomène arrive plus souvent qu'on ne le croit habituellement. Une épidémie au Canada (suivie de 400 intoxications et 5 cas mortels) avait été provoquée par une inondation qui avait fait déborder des égouts et souillé le réservoir d'eau potable de la ville, diffusant alors des bactéries de contamination fécale. Une autre situation classique consiste à relier, par erreur, les installations de distribution d'eau et les installations de traitement d'eaux usées ou au réseau d'eau non potable. Le lien est normalement interdit, mais il peut arriver que l'eau potable soit utilisée pour laver les installations d'épuration et que, par différence de pression, les eaux usées remontent jusqu'aux eaux de distribution.
Les maires doivent être très vigilants
sur ce point et s'assurer qu'en cas de proximité entre les deux
installations, il n'existe aucun lien physique, aucune conduite entre les deux
circuits (d'éventuelles vannes destinées à éviter
les remontées d'eau usées pouvant être hors d'usage ou
inefficaces).
§ Une autre situation à risque est liée aux
remises en service de canalisations, après arrêt de plusieurs
semaines Les eaux stagnantes constituent un milieu favorable au
développement de films bactériens propices aux contaminations
(cas d'une contamination bactérienne des eaux distribuées
à Strasbourg en 2000).
Sans nier l'importance ni surtout la gravité des
contaminations bactériennes d'origine hydrique, il faut néanmoins
observer que le principal vecteur de contamination reste le manque
d'hygiène. Selon une publication de Médic'eau (dossiers
thématiques réalisés à l'initiative du Centre
d'information sur l'eau), 4 % des personnes ont des
Escherichia coli
sur les mains avant d'aller aux toilettes et 25 % de sujets sont
porteurs de ce germe en sortant... Après lavage des mains, le taux
d'
Escherichia coli
devient insignifiant. L'hygiène reste le
premier moyen de prévention contre les contaminations
bactériennes.
c) Les contrôles de qualité
Parmi les critères de qualité de l'eau distribuée, le paramètre bactériologique mérite la plus grande vigilance car il reflète le risque immédiat pour la santé du consommateur. La réglementation impose la recherche d'indicateurs de contamination fécale cultivables l' Escherichia coli et les entérocoques . Selon la réglementation, l'eau distribuée ne doit comporter aucun de ces deux types de bactérie dans 100 ml d'eau. Ces contrôles sont réalisés par les DDASS .
Les critères et les seuils sont différents pour les eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine. D'une part, il existe un paramètre supplémentaire : les coliformes fécaux qui sont des bactéries spécifiques d'origine fécale, qui apparaissent en grandes quantités dans les déjections humaines ou animales. D'autre part, il n'y a pas de valeur limite impérative pour les eaux brutes, mais seulement des valeurs guides fixées à 10.000 entérocoques, 20.000 E. coli , et 50.000 coliformes fécaux par 100 ml d'eau.
Malgré cette importance majeure pour la santé, plusieurs millions de personnes sont confrontées à des contaminations bactériologiques d'origine hydrique de façon plus ou moins régulière.
Le risque d'exposition à des eaux non conformes sur le plan bactériologique est sans commune mesure avec le risque d'exposition à des eaux non conformes sur les critères nitrates et pesticides. Il n'y pas de moyenne nationale tant les situations varient selon les régions, mais on peut estimer que globalement la population concernée par le risque bactériologique est au minimum cinq fois plus nombreuse que la population concernée par les excès des nitrates et pesticides. En Adour Garonne par exemple, 1,3 million de personnes ont été confrontées au risque bactériologique contre 60.000 personnes seulement au risque nitrate et 170.000 au risque pesticide.
La situation est cependant très inégale selon les régions et le type de l'habitat. Selon les statistiques de la DDASS dans la région Rhône Méditerranée Corse, le taux de non conformité des unités de distribution serait de 5 % pour les communes supérieures à 5.000 habitants, 30 % pour les communes inférieures à 5.000 habitants. La population desservie par des unités de distribution inférieures à 500 habitants serait particulièrement touchée. Selon une étude sur la qualité bactériologique des eaux en Corse en 1995, sur les 360 communes de l'Ile, moins de 20 % distribuaient une eau de bonne qualité bactériologique, tandis que 28 % distribuaient une eau avec un taux de non conformité supérieure à ... 60 % ! Au total, 27 % de la population de l'Ile, soit 70.000 personnes, disposaient d'une eau de mauvaise qualité bactériologique. Dans quatre cas sur cinq, l'exploitation était en régie.
Le risque bactériologique est donc clairement un risque lié pour l'essentiel à la ruralité. Dans ces communes, l'absence ou l'inadaptation des traitements, l'insuffisance des investissements et de la connaissance des risques, le défaut d'entretien des exploitations, mais aussi le poids de l'habitude, voire une certaine nostalgie de l'eau de la fontaine du village, sont des facteurs de blocage et des facteurs de risque.
Beaucoup d'élus sont souvent ignorants des enjeux juridiques d'une telle situation. Ils sont en réalité extrêmement vulnérables et sont à la merci de n'importe quelle crise sanitaire et de n'importe quelle procédure contentieuse.
Les épidémies d'origine hydrique identifiées correspondent à environ 150 cas annuels dont deux épidémies de gastro entérite aiguë dont l'origine hydrique a été prouvée ou fortement suspectée (Strasbourg, Sète, Gourdon dans le Lot, Serre Chevallier). Mais il existe une très grande marge d'incertitude. Selon une estimation de l'Institut de veille sanitaire, moins de un cas d'origine hydrique pour 10.000 a été identifié comme tel, ce qui montre l'imperfection des systèmes de surveillance.
2. Les nouveaux risques de contamination hydrique
Jusqu'à ces dix dernières années, le premier critère de qualité de l'eau distribuée était de garantir l'absence de contamination bactérienne d'origine fécale. Les paramètres indicateurs de contamination fécale étaient simples à identifier et les bactéries étaient simples à éliminer par désinfection/chloration. Une évolution profonde est en cours depuis dix ans, et ce dans deux domaines :
- la reconnaissance de limites des indicateurs de contamination fécale,
- la découverte de nouveaux agents pathogènes difficiles à repérer et insensibles aux traitements de désinfection classique,
Ces évolutions, méconnues du grand public, vont
entraîner de profondes transformations dans la gestion de l'utilisation
de l'eau dans les prochaines années.
a) La reconnaissance des limites des contrôles de contamination fécale
La recherche de ces paramètres bactériologiques crée souvent un malentendu. La réglementation impose la recherche d`indicateurs de contamination fécale à partir de bactéries cultivables et faciles à observer mais n'impose pas une analyse exhaustive des millions de micro organismes présents dans l'eau. De telle sorte que l'eau distribuée sera toujours une eau chargée de micro organismes évalués à 1 à 10 millions par litre d'eau !... Même si une infime fraction est pathogène, il en reste suffisamment pour entraîner des complications intestinales sous forme de diarrhées ou de gastro-entérites.
Le rapport entre la maladie et l'origine hydrique est très difficile à établir. Un médecin voit en moyenne un cas de gastro entérite par jour. S'il en voit dix d'un seul coup, il se doutera d'une possible épidémie -qui évidemment peut avoir d'autres origines qu'hydriques !-. S'il en voit deux ou trois, il n'y prêtera pas attention. La contamination hydrique passera inaperçue.
|
Une fraction des microorganismes introduits dans le réseau, et s'y multipliant principalement au niveau du biofilm dans les canalisations, représente un danger pour le consommateur. Certains de ces microorganismes entraînent des symptômes gastro-entériques (diarrhées et vomissements), bien que les quantités d'eau du robinet ingérées sans aucune transformation (comme chauffer l'eau pour le café ou le thé) soient faibles, voisines de 400 ml d'eau par jour et par habitant en moyenne. Les travaux épidémiologiques publiés mettent en évidence un taux de 0,02 à 0,1 incident gastro-intestinal par personne et par an résultant de la consommation d'une eau respectant les normes de potabilité. D'autres équipes, travaillant sur les enfants, rapportent des valeurs encore plus élevées voisines de 4 troubles digestifs/personne-an et 1 épisode diarrhéique/personne-an. Ces épisodes endémiques de contamination à faible bruit (par opposition aux contaminations massives de caractère épidémique) ne sont pas identifiés par le système médical classique. Ils sont mis en évidence par des études spécifiques des populations exposées. On estime que le nombre de gastro-entérites de type endémique associé à l'ingestion d'eau potable est 3 à 10 fois plus élevé que le nombre de troubles gastro-intestinaux de type épidémique (accidents massifs avec déclaration des cas). Les simulations fondées sur des hypothèses issues de ces études montrent alors que le nombre de jours de travail perdus en Europe du fait de la consommation d'eau répondant aux normes bactériologiques de la directive européenne est de 500.000 à 1.600.000 /an. |
b) Les nouveaux agents de contamination microbiologique
L'épidémie de Milwaukee en 1993 aux Etats-Unis a été un tournant dans l'histoire du traitement de l'eau. En quelques mois, 400.000 cas de gastro-entérite ont été identifiés (dont 80 cas mortels), et si l'origine hydrique de la contamination était suspectée, aucun indicateur de suivi de la qualité de l'eau n'avait bougé, aucun dépassement de norme bactérienne n'avait été enregistré. L'agent microbiologique finalement identifié était un parasite protozoaire, le cryptosporidium .
Cette épidémie constatée aux Etats-Unis signifiait un triple échec :
- un échec de la surveillance : Cette surveillance est exercée par les DDASS. L'histoire, l'habitude et la facilité des mesures et l'efficacité des traitements ont conduit les DDASS à privilégier le contrôle bactérien. Probablement à l'excès. L'Institut de veille sanitaire évoque même « la focalisation des DDASS sur le risque bactérien, à l'exclusion des risques viraux et parasitaires ». L'indicateur de contamination représentatif de bactéries pathogènes était un mauvais indicateur des contaminations d'origine microbiologique. Même une eau potable pouvait entraîner des épidémies.
- un échec de la connaissance : En sus des contaminations bactériennes bien connues, les contaminations massives pouvaient provenir d'autres agents microbiologiques, les parasites et les virus. Les contaminations microbiologiques d'origine hydrique font l'objet d'importantes recherches aux Etats-Unis. Plus de 100 germes ont déjà été recensés (61 ( * )). Malgré ces progrès, de très nombreuses incertitudes demeurent, notamment sur les quantités infectieuses et sur le repérage des agents pathogènes. Il fallait plusieurs millions de vibrions du choléra ou de salmonelles pour entraîner la maladie. Il suffit probablement de 10 à 100 unités de protozoaires et de 1 à 10 unités de virus pour entraîner des effets pathogènes. Un niveau qui rend l'identification difficile et coûteuse : la recherche de la bactérie E. coli coûte de l'ordre de 20 euros ; la recherche du criptosporidium coûte de 500 à 1.000 euros...
- un échec des traitements de désinfection : La virulence de l'épidémie a montré que la désinfection traditionnelle, par voie de chloration notamment, élimine les bactéries pathogènes, mais est parfois sans effet sur d'autres agents microbiologiques. Même avec un matraquage de l'eau au chlore, quelques virus et parasites demeurent !....
L'inadaptation des critères d'identification des risques et des méthodes de désinfection a été un formidable défi pour la communauté scientifique et les professionnels de l'eau. Ce défi a été relevé. Les techniques membranaires constituent une barrière de protection efficace contre tous les risques microbiologiques connus. Cette technologie encore émergente progresse rapidement.
C. LA QUALITE PHYSIQUE ET CHIMIQUE DE L'EAU
1. La turbidité
L'augmentation lente mais régulière de la turbidité des eaux brutes est une source de préoccupation des gestionnaires de l'eau.
Une eau turbide est une eau trouble. Cette caractéristique vient de la teneur de l'eau en particules en suspension, associées au transport de l'eau, notamment après la pluie. Au cours de ce parcours, l'eau se charge de quantités énormes de particules, qui troublent l'eau. Les matières, mêlées à l'eau, sont de natures très diverses : matières d'origine minérale (argile, limon, sable...), micro particules, micro organismes...
La turbidité se mesure par la réflexion d'un rayon lumineux dans l'eau. La turbidité est mesurée par un test optique qui détermine la capacité de réflexion de la lumière (l'unité de mesure est le « NFU » - unités néphélométriques). La turbidité maximale fixée par la réglementation française est de 0,5 ou 2 NFU selon les lieux de mesure.
La turbidité joue un rôle très important dans les traitements d'eau.
- Elle indique une probabilité plus grande de présence d'éléments pathogènes. Le ruissellement agricole remet en circulation des germes pathogènes et il existe un lien direct entre pluies et gastroentérites. Il existe deux pics de gastroentérites, à l'automne, après les premières grosses pluies qui succèdent à l'été, et en janvier.
- La turbidité perturbe la désinfection. Le traitement par ultraviolets est inefficace et le traitement par le chlore perd son efficacité.
- La matière organique associée à la turbidité favorise la formation de biofilms dans le réseau et par conséquent, le développement de bactéries insensibles au chlore notamment.
- La turbidité révèle une évolution préoccupante de l'état des sols, sur laquelle il faudra être très vigilant.
|
Pourquoi, parfois, l'eau du robinet
La turbidité de certaines eaux souterraines influencées par des eaux de surface est brutalement aggravée à l'occasion des pluies. Ce phénomène est à l'origine de nombreuses difficultés - la turbidité entraîne des difficultés de fonctionnement des unités de distribution. Très peu sont équipées de systèmes de traitement de la turbidité. La plupart des petites stations rurales notamment sont seulement équipées de traitement de désinfection, inopérants en l'espèce. - la turbidité apporte des pollutions supplémentaires . Il existe une corrélation directe entre turbidité et hydrocarbures, entre turbidité et pesticides, et surtout entre turbidité et contaminations fécales. Les particules en suspension ont un pouvoir d'adsorption et constituent des supports aux bactéries. Cette contamination bactérienne ou parasitaire, peut être à l'origine de crises de gastroentérite. Ce lien a été mis en évidence par l'expérience (une surveillance épidémiologique des pharmaciens du Havre avait noté un doublement des gastroentérites après les crues de février 1995) et par l'analyse : la teneur en cryptosporidium (parasite à l'origine d'une partie des gastroentérites dues à l'eau) est directement corrélée à la turbidité. Le nombre d'unités de cryptosporidium est multiplié par cent en quelques jours après l'augmentation de la turbidité. - la turbidité est un masque qui rend les tests de contamination microbiologiques aveugles et inopérants. Ces tests fonctionnent à partir de germes isolés de l'eau par filtration et mis au contact avec un milieu de culture. Leur développement est un indicateur de pollution. Mais avec la turbidité, les germes sont protégés et ne se développent pas. - la turbidité réduit l'efficacité des désinfectants . Elle accroît la consommation de chlore (principal désinfectant utilisé) tout en diminuant son efficacité. Pour toutes ces raisons, la consommation d'eau du robinet peut être déconseillée, voire interdite. Le risque est cependant variable selon les unités de traitement. L'effet taille est très important. Les grandes unités sont mieux équipées et plus capables d'assurer des préventions. La SAGEP, société anonyme de gestion des eaux de Paris, cesse de prélever l'eau de source lorsque la turbidité dépasse 2 NTU, même s'il est possible de mélanger les eaux avec des eaux claires pour faire baisser la turbidité. Les petites unités offrent moins de garanties. Il est même arrivé que l'eau distribuée dépasse cent fois la norme... |
2. L'arsenic
L'arsenic est naturellement présent dans le sol et se
trouve par conséquent dans les aquifères correspondantes. Il
s'agit de l'un des toxiques que l'on trouve communément dans les eaux
(62
(
*
)).
Certaines
activités industrielles ont également utilisé l'arsenic
dont les traces se retrouvent dans les rivières plusieurs années
après la fin de l'exploitation. L'inquiétude sur les
conséquences cancérigènes de l'arsenic a conduit à
abaisser les limites de qualité à 10 ug/l. Plus de 200.000
personnes sont concernées par cette nouvelle norme
(63
(
*
)).
3. Les nitrates
Le décret 2001-1220 fixe les limites de qualité des eaux en nitrates, en distinguant les différentes eaux ainsi qu'il est indiqué ci-dessous :
- eaux de consommation 50 mg/l
- eaux de rivière destinées 50 mg/l avec une
valeur
à la production d'eau de consommation guide de 25 mg/l
- eaux souterraines destinées 100 mg/l
à la
production d'eau de consommation
Le risque nitrate est lié à la faculté de l'organisme humain de transformer les nitrates en nitrites, qui réduisent les capacités de transport de l'oxygène par l'hémoglobine (une substance de globules rouges de sang qui contient du fer). Lorsque l'hémoglobine est oxydée en méthémoglobine, le transport de l'oxygène ne se fait plus. Chez l'adulte, ce risque est très faible car une enzyme réduit la méthémoglobine en hémoglobine. En revanche, cette enzyme n'est pas activée chez le nourrisson et ne devient fonctionnelle que vers quatre mois. Or, les nitrates sont des oxydants de telle sorte qu'ils provoquent une méthémoglobinémie, dite aussi maladie bleue du nourrisson.
Cette valeur de 50 mg/l est aujourd'hui très contestée. D'une part, le fondement scientifique de ce seuil paraît à de nombreux professionnels mal établi. Cette valeur a été fixée à la fin des années 50, puis formellement adoptée par l'OMS en 1962, à la suite de l'analyse des méthémoglobines dans le sang des nourrissons. L'origine suspectée étant l'absorption de nitrates dans le lait et le jus de carotte. Les analyses poursuivies depuis ont montré que c'était moins la présence de nitrates qui était en cause que les conditions de conservation de produits entraînant une prolifération bactérienne favorable à la transformation de nitrates en nitrites.
La deuxième critique porte sur une relative incohérence de la norme. Les apports en nitrates viennent de 70 à 80 % de l'alimentation et de 20 à 30 % de l'eau. Les teneurs en nitrates contenus dans les légumes peuvent atteindre 2, voire 4,5 grammes par kilo (salades, épinards...). Une ou deux feuilles de laitue contient autant de nitrates qu'un litre d'eau. Un végétarien absorbe entre 175 et 195 mg de nitrates par jour... Il y a une certaine incohérence à fixer des normes rigoureuses sur un seul produit qui, de surcroît, ne représente pas la plus grande part de l'exposition.
Si cette contestation paraît argumentée, une remise en cause paraît cependant totalement inopportune, tant pour des raisons scientifiques que politiques.
Sur le terrain scientifique, les inquiétudes ont glissé sur les effets cancérigènes des nitrites. Cette cancérogénicité a pu être mise en évidence de façon expérimentale chez de nombreuses espèces animales. Chez l'homme, malgré de fortes présomptions, les données toxicologiques ne permettent pas de tirer de conclusion définitive.
Sur le terrain politique, il est clair qu'aucune évolution dans le sens d'un desserrement des contraintes n'est envisageable. On observera que l'Union européenne a fixé une valeur guide de 25 mg/l et que ce seuil a été choisi comme limite de potabilité des eaux dans certains pays, notamment la Suisse. La dégradation des ressources liées à l'augmentation des nitrates constitue un point de fixation et a bénéficié d'une très forte médiatisation. « Les nitrates sont devenus, avec le nucléaire, un cheval de bataille politique ». Il y a une incontestable crispation sur le sujet.
Cette crispation justifiée sur le plan environnemental
est très probablement excessive sur le plan sanitaire. Il y a
incontestablement, une confusion des genres, en faisant jouer aux normes
sanitaires un rôle environnemental qui n'est pas le leur. Le Conseil
supérieur de l'hygiène publique de France, dans un avis rendu en
1998, a considéré que tout relèvement de cette valeur
favoriserait la poursuite de la dégradation des ressources et risquerait
de nuire aux efforts entrepris pour réduire la pollution. Il s'agit
d'une position de sagesse.
4. Les pesticides
a) Les valeurs limites
Les valeurs limites des pesticides dans l'eau destinée à la consommation sont fixées par le décret 2001- 1220 du 20 décembre 2001. Ce texte reprend pour l'essentiel les normes fixées en 1989, qui elles-mêmes avaient été établies sur la base des connaissances vieilles de cinq ans, et l'on peut dire que les normes actuelles ont été donc été établies il y a 20 ans (64 ( * )).
Ces références de qualité applicables aux eaux destinées à la consommation humaine sont les suivantes : 0,1 ug/l par substance individualisée (sauf quatre d'entre elles, pour lesquelles la limite est de 0.03 ug/l) et 0,5 ug/l pour le total des pesticides quantifiés. Contrairement à la précédente réglementation fixée en 1989, ces seuils s'appliquent désormais non seulement aux molécules mères utilisées mais aussi à leurs sous produits, les métabolites, ainsi qu'aux produits de dégradation. Ces seuils s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine et non aux eaux brutes, pour lesquelles les seuils sont de 2 ug par substance et 5ug pour le total.
Contrairement aux autres limites et références
de qualité qui sont déterminées sur des
considérations scientifiques, le choix des normes européennes en
matière de pesticides relève moins d'analyses toxicologiques que
d'une prise de position visant à se rapprocher du risque zéro. Il
s'agit donc moins d'un choix de santé publique que d'un choix politique
et environnemental : dès lors que dans l'état naturel, il
n'y a pas de pesticide dans l'eau, il ne doit pas y en avoir non plus dans les
eaux de consommation. La fixation des teneurs en pesticides a été
donc fixé à 0.1 ug/l, seuil minimum de détection à
l'époque.
b) Les controverses
La fixation d'un seuil unique de pesticides dans l'eau fait l'objet de nombreuses controverses.
-
La première critique porte sur
seuil unique. Il est observé que ce choix du seuil unique est un choix
européen qui n'a pratiquement aucun équivalent au monde. Pour les
pesticides, l'OMS a déterminé 40 valeurs guides (VG)
différentes, adaptées aux différentes
molécules.
-
La deuxième critique porte sur le
niveau choisi, beaucoup plus strict que les valeurs internationales et que les
niveaux retenus par d'autres compétiteurs, notamment américains.
Le rapport entre les valeurs limites européennes et les valeurs guides
internationales peut varier de 1 à 3000 (pour le bentazone, la VG est de
300ug/l). L'Agence américaine de Protection de l'Environnement a
fixé le seuil de l'alachlore, de l'atrazine et de la simazine, trois
herbicides, à respectivement 2 ug/l, 3 ug/l et 17 ug/l, soit un
niveau de 20 à 170 fois plus élevé que la norme
européenne.
-
La troisième critique porte sur une
certaine incohérence dans la détermination des seuils. Tandis que
l'attention était focalisée sur l'eau, les limites de
résidus sur les produits d'alimentation traités aux pesticides
n'ont pas été modifiées. On relèvera par exemple
que les limites de résidus sur les fruits peuvent être
jusqu'à 100 000 fois plus importantes que les teneurs acceptées
dans l'eau
(65
(
*
))
. Cette
situation suggère une sévérité excessive sur l'eau
et que les normes appliquées à l'eau n'ont pas été
fondées sur des raisons sanitaires.
-
La dernière critique porte sur une
situation de blocage. On rappellera que les seuils actuels ont
été fixés initialement il y a 25 ans. Pour le professeur
Hartemann de la faculté de Nancy, «
on pouvait fixer une
norme de 0,1 ug/l, par précaution, quand les connaissances
scientifiques étaient encore limitées mais à partir du
moment où l'on connaît mieux, il faudrait accepter de
réviser les seuils ».
Il n'en a rien été.
c) Les nouveaux débats
Cette situation paraît aujourd'hui figée. Une proposition de modification visant à adapter les seuils de référence a été proposée il y a quelques années. Sans succès. Il n'y aura aucune autre initiative, et encore moins aucune majorité relative au sein du Conseil pour changer cette règle. Et ce, d'autant moins que de nouvelles interrogations apparaissent.
D'une part, l'incertitude demeure sur la toxicité des pesticides. Seule la toxicité aiguë du produit qui résulte de l'absorption d'une dose importante de produit est connue. L'étude fait d'ailleurs partie du dossier d'homologation des produits. En revanche, la toxicité chronique à très faible dose est mal établie. Les effets cancérogènes n'ont pas été démontrés mais quelques molécules ont été classées parmi les cancérogènes possibles. Les risques aujourd'hui envisagés portent plus sur les effets mutagènes et sur les effets sur la reproduction qui résulteraient des expositions répétées à très faibles doses. Plus de 50 molécules ont été classées parmi d'éventuels perturbateurs endocriniens.
D'autre part, la capacité de rémanence des
pesticides s'est révélée très longue. On trouve
toujours des traces de pesticides dans les eaux, 20 ans après que le
produit ait été interdit. Enfin, l'on s'intéresse
aujourd'hui moins aux molécules épandues qu'à leurs
métabolites, c'est à dire les molécules
transformées qui apparaissent au cours de la dégradation des
produits. Ces métabolites ouvrent un nouveau champ d'analyse.
d) Les contrôles des pesticides
Les contrôles sont réalisés par les DDASS. Ils portent sur les eaux brutes et les eaux distribuées. La fréquence des contrôles est adaptée à la taille des unités de distribution de l'eau. Il y a souvent confusion entre dégradation de la ressource et dégradation de l'eau distribuée. La première n'entraîne pas forcément la seconde. Le traitement des eaux, encore coûteux, mais surtout les mélanges de eaux permet d'éviter les dépassements de seuils. En 1993, 20 % de la population française était alimentée par une eau dépassant la norme de 0,1ug/L. En 2001, cette proportion est tombée à 5%. Des restrictions d'utilisation ont été prononcées dans 193 unités de distribution alimentant 416.000 personnes. 62 % concernaient trois départements (Seine-et-Marne, Oise et Loiret).
Les pesticides dans les eaux peuvent être éliminées par des traitements de filtration membranaires (nanofiltration) ou par adsorption sur charbon actif. Ces techniques ne sont pas forcément accessibles aux petites unités. Les unités de distribution concernées par les mesures de restrictions d'usage en 2001 étaient dans leur grande majorité inférieures à 5.000 habitants.
II. LES TRAITEMENTS DE L'EAU
A. LES SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Les réseaux publics
a) L'organisation des réseaux
A l'exception de quelques captages familiaux, la quasi totalité de la population française est desservie par un réseau de distribution publique organisé en unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur de distribution où l'eau est de qualité homogène, gérée par un même exploitant et appartenant à la même entité administrative (commune ou groupement de communes).
Les 26.680 UDI sont alimentés par 36.581 captages. 95 % des captages exploitent les eaux souterraines et produisent 63 % de l'eau distribuée. 5 % des captages prélèvent des eaux superficielles et produisent 37 % du volume distribué .
La gestion des UDI relève de divers modes
d'exploitation. Les régies directes ou assistées
(c'est-à-dire la gestion directe par les communes ou leurs groupements
concerne un tiers des UDI. La majorité est donc sous le régime
des sous-traitances (concessions et affermages)
(66
(
*
))
. La diversité des
situations a aussi entraîné une grande diversité des prix
(67
(
*
))
.
b) La surveillance des réseaux
Les modalités de surveillance de la qualité de l'eau sont fixées par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001. La fréquence des analyses de l'eau brute varie selon les débits prélevés. La fréquence des analyses de l'eau distribuée varie selon la population desservie.
|
Dans quelles conditions une eau est-elle considérée comme non conforme ? Les eaux brutes sont non conformes aux limites de qualité lorsque les valeurs observées sont supérieures aux valeurs réglementées dans plus de 5 % des échantillons. Les eaux distribuées sont non conformes lorsque les limites et références de qualité sont dépassées, même une fois. Que se passe-t-il lorsque ces critères de qualité sont dépassés ? 1. L'information des usagers. Les modes d'information sont à l'initiative du maire, sauf l'affichage qui est obligatoire. 2. L'enquête est diligentée pour déterminer les causes de non conformité. 3. L'appréciation de la gravité des dépassements Les dangers pour la santé varient selon l'importance et la nature du dépassement. Une eau non conforme aux critères de qualité n'est pas nécessairement une eau non potable. Certains dépassements mineurs peuvent être bénins. - Le dépassement de limites de qualité bactériologique est le plus grave, et le signe d'un risque sanitaire, à court terme, qui appelle des mesures d'urgence. - Le dépassement des limites de qualité chimiques est le signe d'un risque sanitaire à moyen ou long terme. Le dépassement des références de qualité est le signe d'une dégradation de la ressource et d'un mauvais fonctionnement des installations. Le risque est plutôt à moyen et long terme. 4. L'adoption de mesures correctives - Les mesures d'interdiction de distribution - Les mesures de restriction d'utilisation (eau de boisson) - La recherche d'autres sources d'alimentation par interconnexion - Le contrôle des activités dans les périmètres de protection s'ils existent. 5. Les dérogations de distribution Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution, des dérogations triennales peuvent être accordées. Elles supposent un engagement sur des valeurs limites et un programme de travaux. - La dérogation locale, demandée par le maire au préfet, est accordée par arrêté préfectoral après avis du Conseil départemental d'hygiène. - La dérogation peut être renouvelée à deux reprises. Les deux premières dérogations doivent être déclarées par le Ministère chargé de la Santé à la Commission européenne. La troisième doit être acceptée par la Commission européenne. |
2. Les procédés de traitements
Comment passer d'une eau « brute » à une eau destinée à la consommation ? La qualité des eaux superficielles détermine les traitements nécessaires à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ces traitements, présentées en annexe (68 ( * )), sont classés en trois catégories :
A1 - traitement physique simple et désinfection
A2 - traitement physique et chimique normal avec désinfection
A3 - traitement physique et chimique poussé avec affinage et désinfection.
a) Les procédés physiques de base
Il s'agit des procédés utilisés presque systématiquement. L'essentiel repose sur des processus de filtration Les procédés physiques comprennent le dégrillage qui arrête les gros déchets, le tamisage qui est un filtrage plus fin, la décantation qui consiste à laisser déposer la matière sous l'effet de la gravité, et la filtration réalisée sur des matériaux classiques ou adsorbants.
La filtration consiste à faire passer l'eau au travers d'un filtre, à mailles de plus en plus fines. Les particules sont donc retenues par le filtre, soit en surface, soit adsorbé par les grains du filtre. Le filtre le plus classique est un filtre à sable.
La filtration suit plusieurs étapes : Le filtre le plus grossier, dit « dégrossisseur », est d'un diamètre de l'ordre de 3 mm de diamètre. Il élimine les macro particules. Le temps de passage est de l'ordre de 5 minutes. Un filtre plus fin, dit « pré-filtre » de l'ordre de 1 mm de diamètre permet d'éliminer 90 % de colloïdes. Le temps de passage est de l'ordre de 10 minutes. Le filtre, dit « bassin filtrant » est constitué d'une couche de sable très fin, de l'ordre de 0,5 mm de diamètre, sur 60 cm de hauteur. Le temps de passage est de l'ordre de 6 à 12 heures. Le temps d'écoulement est suffisamment long pour que les bactéries se fixent sur le sable. Elles vont utiliser les substances arrêtées par le sable pour se développer, et par conséquent, commencer à éliminer une part de substances dissoutes. Le sable est en quelque sorte colonisé par les bactéries, qui vont développer une couche dite « membrane biologique ». Ces filtrations n'ont pas arrêté les micropolluants restant en solution dans l'eau.
Tous les filtres doivent être soigneusement entretenus.
Un filtre non entretenu est non seulement inutile mais aussi potentiellement
dangereux car il permet une prolifération bactérienne. Le
nettoyage est une opération délicate. Le nettoyage par injection
d'air et d'eau remet en suspension les microorganismes, mais peut aussi
entraîner un mélange entre le sable et les particules, et la phase
de redémarrage est l'une des plus délicates.
b) Les procédés chimiques de base
La désinfection est une étape commune à tous les traitements. Elle consiste à éliminer les germes pathogènes qui peuvent être présents dans l'eau brute. Elle est réalisée principalement par trois agents désinfectants : le chlore, le bioxyde de chlore et l'ozone.
Le chlore est un produit très utilisé pour la désinfection des eaux dans la plupart des pays, notamment aux Etats-Unis, dans les pays en développement ou dans les pays à petites unités de distribution. L'Allemagne ne pratique pas la chloration et préfère un traitement aux ultraviolets mais cela suppose une eau parfaitement claire. En France, les grandes unités utilisent également un traitement à l'ozone mais cette technologie est plus complexe et plus coûteuse. Le traitement au chlore est accessible aux petites unités de distribution rurales (un flacon peut être déversé dans les stations de distribution les plus modestes).
Cette désinfection opère principalement par
oxydation : le chlore ou l'ozone agit sur les métaux, sur les
matières organiques et détruit ou inactive les
bactéries.
c) Les procédés physico chimiques
La clarification peut aussi prendre la forme d'une opération dite de « coagulation floculation décantation». Elle a pour objet d'assurer la coagulation des matières colloïdales. Une fois que la coagulation est opérée, les matières floculent et tombent au fond du bassin. Cette coagulation est assurée par un apport de sels minéraux qui génèrent, outre la coagulation des particules, des sortes de flocons -dit floc- qui « ramassent » les particules coagulées et qui tombent lentement.
La clarification consiste à éliminer les
matières en suspension, générant la turbidité de
l'eau et/ou sa couleur. Ces matières en suspension sont présentes
dans l'eau sous forme colloïdale, c'est-à-dire de micro particules,
qui absorbent la plus grande partie de la pollution chimique ou
microbiologique. L'élimination des matières en suspension n'est
pas à elle seule suffisante pour garantir une eau de qualité,
puisqu'elle n'a aucune incidence en particulier sur les matières
dissoutes (nitrates, pollutions chimiques par les pesticides...) mais elle est
une condition nécessaire.
d) Les procédés physiques poussés : les membranes
Le filtre traditionnel est le sable. Les traitements de
rétention membranaire, quant à eux, font appel à des
filtres constitués de polymères ou de fines poudres
métalliques dont la porosité est très faible. Elles
permettent donc de retenir les bactéries. Les membranes sont des fibres
creuses et poreuses à base de cellulose ou de poudre métalliques.
Tandis que les filtres classiques à sable sont des filtres
superposés (l'eau s'infiltre par percolation), les filtres à
membranes sont sous forme de cylindres verticaux. L'eau, sous pression, se
répartit le long des fibres et traverse la paroi poreuse. Les filtres se
distinguent par la taille des pores de la membrane Le tableau ci-dessous
illustre les différents procédés membranaires et les
contaminants qui peuvent être arrêtés par chacun d'eux
(69
(
*
))
.
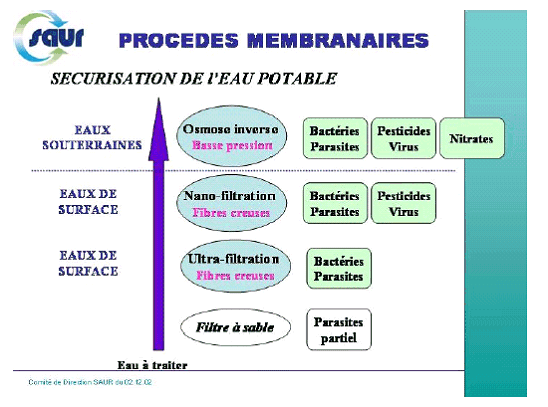
e) L'affinage
Les bactéries et les virus n'ont pas été arrêtés par la filtration (sauf par l'ultra filtration membranaire et l'osmose inverse). Leur élimination suppose donc une troisième étape, dite affinage.
L'affinage a lieu par réaction chimique, par ozonation, gaz oxydant qui va permettre de réduire considérablement, d'« abattre » le nombre de germes. Le gaz est produit par décharge électrique dans de l'air ou de l'oxygène introduit dans l'eau. L'ozone a un double rôle, de désinfectant et d'oxydant. Il va transformer les substances dissoutes dans l'eau et non biodégradables en substances biodégradables.
L'affinage peut aussi avoir lieu par un procédé physico chimique : le traitement par charbon actif. Le charbon actif est une sorte de charbon de bois (fabriqué à partir de produits carbonés minéraux (houille) ou végétaux (noix de coco...), calciné à très haute température et haute pression, produisant un composé carboné à très haut pouvoir adsorbant, composé de milliers de micro infractuosités, (un gramme de charbon représente une surface de 6 m 2 , un gramme de charbon actif présente une surface de 1.000 m 2 à 1.500 m 2 , soit une surface équivalente à huit terrains de tennis). Il reste alors une sorte de squelette de carbone extrêmement poreux qui peut retenir, par effet de paroi, des minuscules molécules. C'est notamment le cas des pesticides, mal détruits par l'ozonation, mais qui vont se « coller » sur le charbon actif (Aux Antilles, par exemple, un m 3 de charbon actif traitant 15.000 m 3 d'eau récupère 32 grammes de chlordecone).
Le charbon actif peut être utilisé de deux façons :
- soit en poudre : il est retiré très vite après son utilisation. Un à deux jours pour les systèmes couplés à une étape de clarification ; un à deux mois pour les nouveaux réacteurs à charbon actif en poudre;
- soit en grains : dans des filtres ; il peut dans ce cas rester des années avant d'être régénéré ou changé
Le charbon actif est très efficace mais coûteux
et doit être changé périodiquement.
f) Les traitements spécifiques
Les métaux lourds présents dans les eaux brutes d'origine naturelle, et en provenance de l'industrie ou des villes sont éliminés par décantation, dès lors qu'ils se présentent sous une forme insoluble. Cette opération passe par l'utilisation d'un oxydant.
L'ammoniaque est éliminée par un traitement biologique qui consiste à développer des bactéries sur un lit filtrant qui permet l'oxydation de l'ammonium en nitrites, et l'oxydation des nitrites en nitrates.
Les nitrates sont éliminés soit par dénitrification avec utilisation d'un substrat carboné, soit par échange d'ions. La dénitrification biologique met en jeu des microorganismes qui ont la propriété d'utiliser l'oxygène des nitrates. Il peut s'agir d'une résine « échangeuse d'ions » qui adsorbe les ions nitrates et libère en échange des ions chlorures...
Les pesticides comme les autres micro polluants sont éliminés soit par utilisation de charbon actif, soit par des procédés d'oxydation notamment par ozone.
B. INTERROGATIONS ET DIFFICULTÉS
1. Limites et sous produits de la désinfection
a) Limites de la désinfection par la chloration
La très grande facilité d'usage du chlore présente quelques inconvénients en donnant notamment une fausse sécurité. Certains gestionnaires d'UDI n'hésitent pas à procéder au matraquage du chlore, pensant ainsi éliminer tout risque. L'augmentation de la chloration depuis les événements du 11 septembre 2001 participe à cette croyance d'une arme quasi absolue. On sait aujourd'hui qu'il n'en n'est rien. Outre un effet très désagréable sur le goût qui conduit une part de la population à se détourner de l'eau du robinet, quatre défauts méritent d'être signalés.
En premier lieu, les crises sanitaires d'origine hydrique ont montré que certaines bactéries, et plus encore certains virus et parasites résistaient au chlore. Le chlore n'est donc pas un système totalement efficace. L'on peut même exprimer des doutes sur son efficacité contre une éventuelle attaque bactériologique sur les réseaux. Le chlore est une protection illusoire dans de nombreux cas.
En second lieu, le chlore est inefficace dans la phase de transport de l'eau dans le réseau de distribution (850.000 km de réseaux). Au cours de cette phase, se crée un biofilm qui va abriter et protéger des millions de micro organismes qui de fait vont devenir insensibles à l'action du chlore.
En troisième lieu, les recherches les plus récentes ont montré que le chlore était non seulement peu efficace contre la biomasse dans le réseau mais était même dangereux en donnant aux bactéries une sorte d'accoutumance qui leur permet d'être de moins en moins vulnérables au chlore. Selon les experts, il vaut mieux avoir de fortes doses de chlore de temps en temps qu'un « bruit de fond de chlore » constant qui va réduire l'efficacité des actions désinfectantes ultérieures : « le principe de précaution actuel peut dans certains cas se révéler préjudiciable pour des actions d'urgence ultérieures » (70 ( * )).
Enfin, des recherches sont en cours pour analyser les effets
nocifs des sous produits de désinfection notamment les
trialométhanes formés par réaction du chlore avec des
composés organiques présents dans l'eau. Des effets sur le cancer
et sur la reproduction humaine sont suspectés. Les risques d'une
exposition prolongée ne sont pas connus. Dans ce cas, seul le rôle
de signal d'alarme peut être reconnu, il faut donc prévoir la
surveillance du résiduel de chlore.
b) Les risques liés à l'utilisation de l'aluminium
L'aluminium est un métal que l'on retrouve très fréquemment dans la consommation courante : dans l'alimentation, comme additif alimentaire ou comme contenant (barquette, canette), en cosmétique (dans les anti-transpirants), dans les médicaments (il neutralise l'acide gastrique et agit contre les « brûlures d'estomac ») et aussi dans les traitements d'eau. Les usines utilisent du sulfate d'aluminium, qui joue le rôle d'agent coagulant, qui favorise l'agglomération des particules qui peuvent alors être plus facilement éliminées par décantation. Une enquête de la Direction générale de la Santé en 2001 a recensé 706 installations utilisant des traitements à base d'aluminium.
Ces usages doivent bien évidemment être limités car les effets neurotoxiques de l'aluminium sont connus. Il pénètre dans le cerveau, provoquant une dégénérescence, une démence caractérisée par des troubles du comportement, parfois même quelques cas mortels (cas de patients dialysés, le liquide de dialyse étant très chargé en aluminium et de victimes d'une surconsommation de médicaments, comme ce fut le cas pour une fillette dont la mère avait consommé plusieurs dizaines de comprimés d'anti-acides par jour pendant sa grossesse).
C'est pourquoi l'Organisation Mondiale de la Santé et son comité d'experts des additifs alimentaires (JECFA) ont défini des doses limites. La dose hebdomadaire tolérable est de 7 mg/kg de poids corporel (soit 60 mg pour un adulte de 60 kg). Compte tenu des différentes sources d'exposition (95 % de l'apport d'aluminium provient des aliments), l'OMS a adopté une valeur guide pour l'aluminium dans l'eau de boisson de 200 ug/l. Ce seuil a été repris par la directive européenne n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 et par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. Ce seuil n'est cependant pas un paramètre de santé, mais seulement un « paramètre indicateur de qualité témoin du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau ».
Ses effets neurotoxiques connus ont conduit à émettre l'hypothèse d'un lien entre l'aluminium dans l'eau de boisson et la maladie d'Alzheimer, maladie qui touche essentiellement les personnes âgées, caractérisée par des pertes de mémoire et des troubles du comportement.
Des études ont été conduites aux Etats-Unis, puis en France, sur ce sujet. Sans résultat irréfragable. En premier lieu, les études sont controversées. L'étude française dite ALAMA- (Aluminium- Alzheimer), est un volet d'une étude plus globale menée par l'INSERM dite « cohorte paquid » visant à étudier le vieillissement cérébral après 65 ans. La conduite de l'étude s'est heurtée à de nombreuses difficultés (double démarchage à domicile d'un psychologue, puis d'un neurologue, refus des familles de prélever des tissus dans le cerveau des défunts, faible nombre de communes -4- distribuant des eaux chargées à plus de 100 ug/l, faible nombre de cas de démence -17- identifiés....). L'étude a donc souffert d'une très faible puissance statistique. Les conclusions sur de si faibles échantillons peuvent être discutables.
En second lieu, les résultats sont contradictoires. Les premières études américaines en 1989, suggérant un risque en relation avec l'aluminium de l'eau de boisson, ont été infirmées quelques années plus tard. L'étude française conclut que « les sujets vivant dans les communes distribuant une eau supérieure à 100 ug/l auraient deux fois plus de risques de développer la maladie , (mais une eau riche en silice réduit voire annule le risque) et toutes les personnes exposées à l'aluminium ne développent pas la maladie ; (...) la prédisposition génétique paraît plus importante que les facteurs environnementaux et, un seul facteur environnemental tel que la présence d'aluminium dans l'eau n'est pas une explication suffisante ».
On rappellera en outre que l'eau de boisson ne constitue que
5 % de l'apport d'aluminium quotidien alors que 95 % sont issus de
l'alimentation.
2. L'élimination des pesticides
Partie rédigée par M. Antoine MONTIEL, membre du Comité de Pilotage de l'étude.
Mis à part leur action de protection des plantes, les pesticides n'ont rien de commun entre eux, il est donc très difficile d'avoir une méthode de traitement pour tous ces types de composés. Le meilleur moyen pour ne pas retrouver ces composés dans les eaux brutes de surface ou souterraines à des teneurs nécessitant des traitements, est de mettre en place des actions préventives par la sensibilisation des applicateurs ou l'interdiction dans certaines zones vulnérables.
Ces actions de prévention, la prise en compte de ce problème par les applicateurs (agriculteurs, services de l'Etat : SNCF, municipalités ...) ont des répercussions mesurables. Mais elles n'ont aucune action sur tout ce qui a été déposé dans les sols dans le passé. La Directive européenne 98/83 reprise en France par le décret 2001-1220 fixe des teneurs limites aux pesticides mais précise qu'il faut aussi inclure dans cette catégorie, les produits de dégradation ou de réaction de ces molécules, issus des produits utilisés plusieurs années auparavant qui se sont décomposés lentement dans les sols.
Cet ajout n'est pas sans conséquence puisque si les actions préventives sont efficaces pour le futur, elles n'ont aucune action sur le passé. Cela explique que l'on ait et que l'on aura de plus en plus de ressources à traiter. Les composés les plus souvent rencontrés sont surtout ceux qui sont ajoutés directement dans ou sur le sol. Ce sont essentiellement des herbicides, des insecticides ou des fongicides du sol.
Pour le traitement, quand celui-ci est incontournable, il n'y a que deux solutions :
- soit les transformer par des traitements chimiques notamment par ozonation. Pour ces derniers traitements, des moyens ont été développés faisant appel à l'ozone ou à des couplages : ozone + rayonnements UV en ozone + eau oxygénée ou eau oxygénée + rayonnements UV. Ces traitements n'avaient pour but que de transformer les molécules en « métabolites ». La Directive est très claire sur ce point, ces traitements ne sont pas à recommander. Il ne reste donc que les traitements de rétention.
- soit retirer ces composés de l'eau par utilisation d'un charbon actif qui adsorbe les molécules, ou par la rétention sur membranes (nanofiltration, osmose inverse).
Les traitements d'adsorption utilisent le charbon actif qui permet de retenir une très grande diversité de molécules. Par contre, certains composés très solubles dans l'eau sont mal retenus, voire pas du tout, ou pendant un temps très court.
Le choix du type de charbon actif sera donc primordial. Il est indispensable de connaître les molécules à retenir pour faire les meilleurs choix. Le charbon actif en grains peut rester de longues périodes avant d'être changé. Durant ce temps, ces bactéries peuvent, dans les filtres, se sélectionner et devenir aptes à transformer les pesticides en « métabolites » qui sont moins retenus et traversent les filtres à charbon. C'est la raison pour laquelle, lors de l'agrément de chaînes de traitement utilisant la filtration sur charbon actif en grains, le Ministère de la Santé informe les pétitionnaires qu'ils auront à effectuer des régénérations à fréquence de l'ordre de l'année afin de s'assurer que ces « métabolites » ne se retrouvent pas dans les eaux traitées.
Ces traitements d'adsorption sont donc très efficaces pour des molécules hydrophobes (qui n'aiment pas l'eau : plutôt solubles dans les huiles et les graisses) et beaucoup moins, voire pas du tout, pour les molécules hydrophiles (qui aiment l'eau, très solubles dans l'eau). Ces dernières molécules sont cependant de plus en plus utilisées car elles sont très faciles à éliminer par lavage et ne s'accumulent pas dans la chaîne alimentaire, tous les nouveaux pesticides étant plutôt hydrophiles.
Les traitements de rétention membranaire, quant à eux, font appel à des filtres dont la porosité est très faible. Elles permettent donc de retenir les bactéries. Les membranes sont des fibres creuses et poreuses à base de cellulose ou de poudre métalliques. Tandis que les filtres classiques à sable sont des filtres superposés (l'eau s'infiltre par percolation), les filtres à membranes sont sous forme de cylindres verticaux. L'eau, sous pression, se répartit le long des fibres et traverse la paroi poreuse. Les filtres se distinguent par la taille des pores de la membrane. Les membranes d'ultra filtration offrent un « seuil de coupure » de 0,01 micron ce qui garantit l'arrêt des algues, des micropolluants, des bactéries, et de la plupart des virus.
La nanofiltration retient des molécules de poids moléculaire de l'ordre de 200 ou plus. Pour retenir les molécules plus petites, seule l'osmose inverse sera utilisable. Il ne faudra pas oublier que la transformation d'une molécule conduit toujours à une molécule de taille inférieure. Là aussi, le choix doit être dicté par les molécules à éliminer. Pour la nanofiltration, la porosité de la membrane (sa capacité à retenir les molécules d'une taille donnée) est un paramètre primordial en fonction des molécules à retirer.
Si la plupart des recherches visent à améliorer les traitements, l'INRA de son côté, étudie aussi des voies de prévention afin de favoriser la dégradation des pesticides par le biais de bactéries ou de champignons. Une collection européenne de bactéries dégradant les pesticides a ainsi été constituée.
En conclusion : les pesticides sont des molécules
chimiques largement utilisées dans le passé et qui le resteront
dans le futur. Les actions préventives sur le choix de nouvelles
molécules, la définition de zones vulnérables,
l'information des applicateurs est à maintenir et à amplifier.
3. Les nouveaux risques microbiologiques
Partie rédigée par M. Antoine MONTIEL, membre du Comité de Pilotage de l'étude
Une eau potable est une eau qui ne fait courir aucun risque pour la santé. Pendant très longtemps, l'eau potable était définie comme l'eau de la boisson, de la préparation des aliments et de l'industrie alimentaire. Cette définition limitait l'usage de l'eau à l'alimentation, elle ne devait donc pas conduire à une maladie intestinale.
Le risque microbiologique était donc bien identifié et correspondait à des pathogènes ne pouvant se multiplier que dans le système digestif. Cela avait conduit à toute une stratégie de garantie de qualité microbiologique de l'eau qui utilisait des témoins de contamination fécale ou des indicateurs d'efficacité de traitement.
Avec la modification de la définition de l'eau potable qui est maintenant aussi l'eau des autres usages domestiques dont la toilette corporelle, de nouveaux risques microbiologiques sont à prendre en compte :
- les risques d'inhalation de l'eau : pathogènes du système respiratoire (légionelles, mycobactéries ...)
- les risques de contact avec l'eau : pathogènes de la peau et des muqueuses (staphylocoques, pseudomonas ...)
Avec le changement du point de contrôle de la qualité de l'eau qui est passé du compteur (point de mise à disposition de l'eau chez le consommateur) au robinet du consommateur, les réseaux de distribution privés ont été pris en compte et surtout l'eau chaude qui doit, elle aussi, être conforme à la législation des eaux potables. Les légionelles sont des bactéries qui se développent dans les eaux chaudes à 35-45° C, elles peuvent conduire par inhalation à des maladies (pneumonies). Elles sont donc à prendre en considération.
Le suivi de populations immunodéficientes a permis de mettre en évidence de « nouvelles » maladies d'origines hydriques dues à des parasites : Cryptosporidium, Giardia. Ces germes pathogènes, surtout Cryptosporidium, sont très résistants aux traitements biocides et ne peuvent être éliminés de l'eau que par rétention.
Dès 1992, l'Organisation Mondiale de la Santé a recommandé pour la désinfection des eaux, l'usage de traitements multi barrières pour la garantie microbiologique de l'eau. La garantie de désinfection d'une eau de surface n'est obtenue que par une clarification efficace et d'une étape de désinfection. Au niveau français, cette obligation s'est traduite dans le décret dans l'annexe I.2 (référence de qualité) par une limite de 0.5 NFU sur l'eau filtrée.
Comme certaines eaux souterraines pouvaient, à certaines périodes de l'année, être réalimentées par des eaux de surface mal filtrées par le sol, le Ministère de la Santé a séparé les eaux souterraines en deux catégories :
- D'une part, les eaux souterraines très bien filtrées par le sol qui ne nécessitent soit aucun traitement de désinfection, soit qu'une simple désinfection par un biocide ;
- D'autre part, les eaux souterraines influencées par des eaux de surface, dont la turbidité dépasse de façon périodique 2 NFU, lors d'épisodes pluvieux importants. Ces eaux devront dorénavant, comme les eaux de surface pour être convenablement désinfectées, subir un traitement de clarification (turbidité 0.5 NFU après filtration) et un traitement de désinfection par un biocide.
En conclusion : l'extension de la définition de l'eau potable élargie à l'eau pour les autres usages domestiques, la prise en compte de la qualité de l'eau au robinet du consommateur ont introduit la prise en compte de nouveaux risques microbiologiques : risque d'inhalation, risque de contact. Pour ces deux nouveaux risques, les pathogènes n'ont pas une origine fécale.
Les études épidémiologiques ont mis en évidence des maladies hydriques dont le pathogène était très résistant aux traitements biocides.
La garantie d'efficacité de désinfection n'est aujourd'hui possible que par des chaînes de traitement faisant appel à des multi barrières : traitement de rétention et traitement biocide de transformation (les microorganismes vivants sont transformés en microorganismes morts).
Ces traitements de rétention permettent d'arriver
à l'étape ultime de désinfection par biocide avec un
nombre très faible de microorganismes ce qui réduit la
probabilité d'avoir des organismes qui résistent à ces
traitements. « On ne désinfecte que ce qui est
propre ».
4. Conclusion : appréciation générale sur les traitements d'eau
La France comme de nombreux pays développés
connaît une nouvelle révolution de l'eau. Cette révolution
issue de la crise américaine de Milwaukee de 1993 est technique mais
aussi politique.
a) Les erreurs d'analyse
Quelques erreurs sont fréquemment commises.
La confiance excessive dans les traitements d'eau. Il existe une large panoplie des traitements visant à assurer une distribution d'eau de qualité. Ces procédés existent. Les différentes crises et problèmes soulevés montrent que le risque zéro n'existe pas.
§ L'absence de surveillance . En pratique, les petites unités ne sont pas surveillées. Le risque microbiologique est alors considérablement accru. Le nettoyage des filtres est indispensable mais suppose une compétence, un vrai savoir-faire. La remise en fonctionnement d'un filtre à sable dans des conditions de sécurité optimale est assurément plus exigeant que le nettoyage des cuves et le versement d'un flacon de chlore dans un réservoir.
§ La confiance excessive dans la chloration . Dans de nombreux cas, le gestionnaire se prémunit contre les risques par la chloration, parfois jusqu'au « matraquage ». Ces comportements n'ont que des inconvénients. Ajouter du chlore à une eau non filtrée est en pratique inutile. L'excès de chlore détourne l'usager qui se plaint du goût, et ne garantit nullement la qualité microbiologique de l'eau, puisqu'une partie des agents pathogènes échappe au chlore et qu'une fraction parvient même à s'adapter à la chloration.
§ L'absence de connaissance. On note un traitement insuffisant de la turbidité . L'Institut de veille sanitaire estime qu'au moins 10 % des installations de production d'eau potable sont mal gérées et de fait inutiles.
§ L'absence d'investissement . Les gestionnaires d'UDI sont confrontés régulièrement à des risques sanitaires, souvent liés à une turbidité excessive non maîtrisée. Mais « les préfets ne veulent pas aller à l'épreuve de force. Ils interdisent provisoirement la consommation, jusqu'au retour à la normale. Il s'agit en fait d'une solution hypocrite. Tout le monde est complice. L'Etat, qui fait acte d'autorité mais qui en fait accepte le statu quo, les maires qui préfèrent une mesure d'interdiction provisoire plutôt qu'investir dans un système de filtration coûteux » .
Ainsi, par petites touches, on assiste à une
dégradation de la qualité du service. Il paraît
nécessaire de procéder à une évaluation du risque
hydrique, en fonction des UDI et leur mode de gestion, recenser les
comportements à risques, et établir alors un guide à
l'usage des élus, leur permettant d'assurer de meilleurs
contrôles.
b) Les nouveaux clivages
La technologie a répondu aux différents défis. Les nouvelles techniques de filtration et de traitements arrêtent tout ce qui est connu aujourd'hui. Ce perfectionnement technologique est-il inéluctable ? Beaucoup le pensent. « Dans 15 ans, il faudra choisir : soit on ira vers le tout membrane, soit vers le tout eau minérale ». Cette évolution semble irréversible mais ses conséquences n'ont pas toutes été appréhendées.
Cette évolution technique n'est pas neutre sur la cohésion sociale. Les risques hydriques sont essentiellement des risques liés à la ruralité. A travers l'eau, c'est une partie de la société qui est menacée.
En premier lieu, l'aspect financier doit être évoqué. Ces techniques ont un coût qui ne peut être supporté par toutes les collectivités. Ainsi se dessine peu à peu un clivage entre les grandes unités de distribution suffisamment riches pour se doter des meilleures techniques de prévention des pollutions et les autres unités pour lesquelles ces investissements seront inaccessibles. La France rurale est la première concernée. Elle est non seulement la première touchée par les risques, mais sera la dernière à pouvoir les surmonter.
Cet investissement n'aurait cependant qu'une incidence relativement modérée pour l'usager, compte tenu des débits partagés entre des millions d'abonnés, le coût pour l'usager dans ces grandes unités est de l'ordre de 15 à 50 centimes d'euros.
Pourtant, l'argument financier ne paraît pas constituer le bon critère de choix. D'une part, le coût de traitement peut être évalué mais personne n'a évalué le coût du non traitement, probablement très supérieur. D'autre part, l'analyse strictement financière risque d'entraîner la collectivité vers de mauvais choix. Le coût de la reconquête de la qualité de la ressource est certainement très supérieur au coût du traitement de l'eau, même le plus sophistiqué. Il est beaucoup plus coûteux de prévenir les pollutions que de traiter une eau polluée. Ainsi, si l'argument financier devait prévaloir, il n'y aurait pas d'action de reconquête de la qualité de la ressource. Le choix de la préservation de la ressource est un choix de société avant d'être un choix financier.
En second lieu, cette évolution technologique pose surtout un problème de solidarité sociale, ou, en l'espèce, ce qui est plus grave, un choix entre différentes solidarités.
La médiatisation des risques chimiques, l'application trop systématique du principe de précaution faute d'avoir fixé des limites claires dans l'acceptation des risques, l'inquiétude, dont profitent certains professionnels de la peur (annonçant « la vache folle de l'eau » ou « le génocide hydrique »), ont mobilisé la recherche technologique. Le défi a été relevé. On observera d'ailleurs que s'il existe une « école française de l'eau », la technologie elle, est plutôt américaine.
Ce choix technique, qui consiste à ne rien laisser passer, ni bactérie, ni virus, et bien sûr ni nitrate, ni pesticide, correspond à un choix implicite de solidarité envers les populations à risques, dites aux Etats-Unis les « Yopis » (young, old, pregnant, immunodeficients - jeunes, vieux, femmes enceintes et immunodéficients), plus vulnérables aux risques hydriques. Si tout le monde peut souffrir de diarrhée bénigne d'origine hydrique, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves chez cette fraction de population (la quasi totalité des décès de l'épidémie de Milwaukee concernait des personnes atteintes de SIDA). La société, par l'allongement de la durée de vie et les soins sophistiqués, a produit une catégorie de population plus sensible aux risques hydriques. La société, par solidarité envers ces catégories, a choisi des seuils de qualité d'eau extrêmement rigoureux et des technologies adaptées.
Mais il est clair que cette technologie est inaccessible et d'ailleurs inadaptée aux petites stations rurales au moins pour des raisons de taille, et même aux stations moyennes. Ainsi, sans qu'on s'en rende compte, se creuse par petites touches, mais de façon irréversible, un clivage entre la France urbaine et la France rurale, entre l'eau des villes, bientôt nanofiltrée, et l'eau des champs, toujours tamisée au filtre à sable...
Ainsi, la solidarité entre générations s'effectue aussi au détriment d'une solidarité entre régions. Cette évolution est probablement irréversible. Il est très regrettable qu'elle se déroule de façon insidieuse, sans débat clair, sans vision stratégique, en générant de nouveaux exclus de progrès. La nouvelle loi et la prochaine charte de l'environnement sont des occasions d'une réflexion à ce sujet.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 59 - Le décret 2001-1220
Annexe 60 - La fixation des normes de la qualité de l'eau
Annexe 61 - Les risques microbiologiques et l'eau
Annexe 62 - Les caractéristiques de l'eau prélevée
Annexe 63 - L'arsenic dans les eaux de boisson
Annexe 64 - La réglementation des teneurs en pesticides dans l'eau
Annexe 65 -Les pesticides dans l'eau et les fruits
Annexe 66 - L'organisation du service de l'eau
Annexe 67 - Le prix de l'eau
Annexe 68 - Les procédés de traitements de l'eau destinée à la consommation humaine
Annexe 69 - Les membranes et l'eau potable
Annexe 70 - Intérêt et limites de la chloration pour maîtriser la qualité biologique de l'eau distribuée
III. LA DISTRIBUTION DE L'EAU
A. LE TRANSPORT DE L'EAU
Chaque année, en France, de l'ordre de 5,6 milliards de
m
3
sont distribués par un réseau de canalisations
compris entre 800 et 850.000 km. L'attention portée à cet
équipement est très récente, mais les conclusions d'une
enquête diligentée en 1999 par l'association des
départements de France étaient préoccupantes. Le parc des
canalisations est ancien et le rythme de renouvellement est
particulièrement faible, autour de 0,6 % par an, ce qui conduit
à un renouvellement du parc en un siècle. Cette situation n'est
pas satisfaisante et risque de se traduire par des perturbations sur la
qualité de l'eau distribuée, en particulier en milieu
rural.
1. Le transport de l'eau, facteur d'instabilité biologique de l'eau
L'eau est un milieu vivant. L'eau potable sortie d'usine avec le meilleur filtre de traitement contient de 1 à 10 millions de microorganismes par litre dont 1% sont vivants, ce qui fait quand même encore de l'ordre de 10.000 à 0,1 million...La quasi totalité sont des germes banals mais même s'il n'y a que 1% ou 1 pour mille de germes pathogènes, il en reste toujours suffisamment pour entraîner une contamination d'un usager.
L'eau est aussi un milieu favorable au développement de la vie. Dans la plupart des réseaux d'eau potable, le transport de l'eau s'accompagne d'une multiplication du nombre de micro organismes qui disposent là d'un milieu favorable pour s'accrocher sur les parois des canalisations. En effet, l'interface eau-matériau constitue le lieu privilégié d'accumulation de matière organique et de multiplication des bactéries constituant ce qu'il est convenu d'appeler un biofilm. L'analyse des surfaces dans les différents réseaux met en évidence de l'ordre de 1à 10 millions de cellules par cm2 ! La prolifération des microorganismes est suivie de leur détachement ou de leur arrachage et de leur transport par l'eau circulante. Ce biofilm sera d'autant plus important que les conditions de vie s'y prêtent (température élevée, nourriture...). La constitution de ce biofilm est inévitable, mais s'il se développe trop, les bactéries se décrochent, partent au fil de l'eau et rejoignent le circuit de distribution de l'usager. Ainsi, le biofilm final est le résultat de trois composantes : l'apport de cellules, lié à la vitesse de circulation et à la densité cellulaire des eaux distribuées, la multiplication de la biomasse, et le relargage des bactéries lorsqu'il y a prolifération.
La biomasse bactérienne qui se multiplie dans le
réseau est le point de départ d`une chaîne trophique au
sein de laquelle on observe la multiplication de protozoaires, consommateurs de
bactéries, mais aussi véhicules potentiels de microorganismes
pathogènes. Comme on le verra, le chlore est très peu efficace
contre cette contamination bactérienne. Le chlore agit sur les
particules en suspension mais il n'atteint pas sa cible lorsqu'elle est
protégée au sein du biofilm. Il est impossible de
désinfecter 850.000 km de réseaux !...
2. L'état des réseaux de distribution
Si le transport de l'eau est naturellement un facteur de reviviscence microbienne, plusieurs éléments viennent renforcer ce risque.
- La qualité du matériau utilisé : L'effort d'équipement a été intense à partir du milieu des années 60, et a été facilité par l'utilisation de nouveaux matériaux plastiques, surtout le PVC, qui a supplanté la fonte. Ainsi, les anciennes canalisations sont en fonte, les nouvelles en PVC, mais il existe aussi quelques canalisations en acier, en amiante ciment, voire de façon marginale et localisée (dans les Vosges notamment), en plomb (l'utilisation massive du plomb porte sur les branchements en plomb et non sur les canalisations). Certains de ces matériaux sont sensibles à la corrosion et peuvent être dissous notamment lorsque les eaux sont agressives (acides et douces).
- Le temps de séjour : Les réseaux les plus longs entraînent un allongement des temps de séjour dans les réseaux, à l'origine de contaminations bactériennes. Ce phénomène se retrouve surtout en milieu rural.
- L'état du réseau : Les canalisations peuvent être rompues, les joints peuvent être distendus sous l'influence de mouvements du sol, des travaux en surface, et surtout du vieillissement du parc (71 ( * )) . En effet, le potentiel de dégradation s'accroît avec le temps, surtout lorsque le réseau est déjà très ancien, ce qui est le cas en France. Près de la moitié des canalisations a plus de 30 ans, 10 % a plus de 50 ans, et le rythme de renouvellement du parc est extrêmement lent.
Ainsi, les difficultés sont prévisibles, en particulier pour les communes rurales qui cumulent les handicaps avec un réseau long, des matériaux anciens, et très peu d'investissements. Ainsi, l'intercommunalité entraîne un surplus d'équipement, des matériaux modernes (PVC), mais elle entraîne aussi un allongement des réseaux, du fait de l'interconnexion entre les captages et les distributions, ce qui est un facteur de vulnérabilité.
Il est très probable que dans les dix prochaines années, les communes rurales seront confrontées à cette difficulté, liée au transport de l'eau. Dans la plupart des cas, elles ne pourront y faire face. L'IFEN rappelle d'ailleurs que « l'investissement pour développer la desserte a été subventionné par les aides publiques (des agences de l'eau) alors que le renouvellement n'est pas éligible » . Le coût pour résorber les matériaux à risques et les matériaux anciens est évalué à 53 milliards d'euros, soit 2 euros par m 3 .
Ainsi, une fois encore, il apparaît clairement que l'échelon communal n'est plus adapté à la gestion de l'eau. L'échelon départemental peut sans nul doute mieux assurer la cohérence et la cohésion.
B. LA DISTRIBUTION DE L'EAU CHEZ L'USAGER
1. Le plomb dans les réseaux
a) Les réseaux de distribution
Après avoir été transportée par canalisation, l'eau est délivrée à l'usager par un réseau de distribution intérieure qui se compose de deux parties distinctes :
- Les branchements. Il s'agit de la partie qui permet le raccordement au réseau de distribution. Cette partie est comprise entre la canalisation et le compteur individuel. Le branchement se trouve pour l'essentiel dans le domaine public.
- Les réseaux intérieurs d'immeuble, dites aussi conduites d'eau (par opposition aux canalisations ) , situées sur la partie privative et qui se prolongent jusqu'au robinet individuel.
Cette phase de transport peut entraîner des modifications importantes dans la qualité finale de l'eau distribuée aux robinets. Cette modification concerne le plomb.
Jusqu'à cette phase de distribution ultime chez
l'usager, il n'y a pratiquement pas de plomb dans l'eau. D'une part, les
contaminations des eaux brutes souterraines par le plomb sont extrêmement
rares et très localisées. Sauf exception locale ou survivance
historique (le plomb a été utilisé pour distribuer l'eau
depuis l'époque romaine), le plomb n'a pas été
utilisé dans les canalisations depuis la première guerre
mondiale. Sauf exception, l'eau n'est donc pas en contact avec le plomb,
à l'exception des joints des anciennes conduites en fonte posées
avant la première guerre mondiale. D'autre part, les traitements mis en
oeuvre dans les installations de production d'eau potable retiennent
parfaitement les traces métalliques.
b) Le plomb dans les réseaux
En revanche, l'utilisation de plomb dans les réseaux de distribution -branchements et surtout conduites- a été très fréquente. Elle a été formellement interdite en 1995, mais les propriétés construites avant 1949 sont dans leur grande majorité concernées par le plomb. Environ 35 % du nombre d'habitations en France (et 2/3 à Paris) sont concernés par une exposition directe au plomb, par le biais de la distribution intérieure (Le phénomène a aussi ses spécificités locales, telles les « caisses d'eau » -doublées en plomb- à Marseille qui permettaient de stocker l'eau dans des réservoirs intermédiaires pour assurer un débit constant dans les habitations)
Ainsi, plusieurs études ont montré des teneurs de l'eau en plomb... en l'absence de toute canalisation en plomb ! On trouve du plomb dans de nombreux points des conduites intérieures. Le zinc utilisé pour la galvanisation des conduites en acier contient 1 % de plomb. Les conduites en cuivre sont souvent assemblées par des soudures à l'étain, qui contiennent environ 60 % de plomb. L'eau qui séjourne dans des conduites en cuivre peut atteindre 20 ug/l. Même certains matériaux plastiques comme les tubes PVC fabriqués en Europe (sauf en France) contiennent un additif à base de plomb. Une eau ayant stagné dans une conduite en PVC neuve peut dépasser 10 ug/l.
Au total, des teneurs de plusieurs centaines de microgrammes
par litre ont été relevées immédiatement
après l'ouverture du robinet alors que le réseau ne comptait pas
de conduites en plomb !
c) Le plomb dans l'eau
Cette contamination des eaux de distribution est liée à la corrosion du plomb mis au contact de l'eau. La corrosion conduit à la consommation d'oxygène et à l'émission d'ions de plomb dans l'eau. Ces réactions sont plus ou moins importantes selon l'ancienneté du matériau, mais surtout selon les caractéristiques de l'eau. La solubilité du plomb dépend très largement de :
- L'acidité de l'eau (plus le pH est faible et plus l'eau est acide, plus l'eau est corrosive vis-à-vis du plomb, de manière exponentielle).
- La dureté de l'eau. Plus une eau est pauvre en calcaire -l'eau est alors dite douce- plus l'eau est corrosive. Une eau douce et acide est très corrosive vis-à-vis du plomb et les teneurs dépassent alors 50 ug/l au robinet lorsqu'une partie du réseau est en plomb.
- La teneur en phosphates. La solubilité du plomb est diminuée en présence de phosphates, qui conduit à un abattement des teneurs en plomb de 70 %.
- La température de l'eau , la solubilité croît à mesure que la température de l'eau s'élève. La solubilité est multipliée par deux lorsque la température passe de 12 à 25°.
- La longueur des canalisations et le temps de
séjour de l'eau dans les conduites
. Pour un même point de
prélèvement, la teneur en plomb peut varier dans un rapport de 1
à 10, selon les moments de la journée et la durée de
stagnation. La concentration maximale est variable selon le diamètre des
canalisations (de l'ordre de 5 à 6 heures pour une conduite en
plomb de 10 mm de diamètre).
2. Le respect des normes de qualité concernant le plomb
a) Les normes
Les effets du plomb sur la santé sont bien identifiés. Le plomb est un neurotoxique entraînant des troubles du comportement, des séquelles invalidantes (épilepsie), des retards dans le développement intellectuel. Au début des années 80, on dénombra plus de 200 cas d'hospitalisation pour intoxication saturnine liée à la circulation de l'eau dans des canalisations en plomb. Ces conséquences sont surtout marquées au cours de deux périodes critiques : la petite enfance car l'absorption de plomb est beaucoup plus importante qu'à l'âge adulte, et la vieillesse, car le plomb, fixé dans les os pendant la vie, est alors relargué dans le sang.
L'eau est l'un des facteurs d'exposition. Ainsi, la
réglementation abaisse progressivement la teneur limite autorisée
dans l'eau destinée à la consommation humaine de 50 ug de plomb
par litre/l à 10 ug/l d'ici le 24 décembre 2013. Un valeur
transitoire de 25 ug/l doit être respectée à partir du 24
décembre 2003
(72
(
*
)).
Les concentrations sont relevées au robinet
de l'usager.
b) Le respect des normes
Sans revenir sur la pertinence des seuils indiqués, toujours très discutés -voir annexe précitée-, ces normes sont très contraignantes.
- D'une part, la gestion pratique d'un double seuil échelonné dans le temps est très difficile. L'usager a tendance à considérer que puisque le seuil, à terme, est fixé à 10 ug/l, tout autre seuil intermédiaire constitue en fait une mise en danger de la vie d'autrui.
- La norme intermédiaire de 25 ug/ l n'impose pas un changement total des conduites en plomb. Il existe de nombreux facteurs favorisant la corrosion et on peut donc assez facilement limiter la dissolution du plomb en agissant sur les caractéristiques physicochimiques de l'eau. L'acidité et la faible minéralisation sont les deux principales caractéristiques qui rendent l'eau corrosive. 3,7 millions de Français seraient touchés par une eau trop acide ou trop faiblement minéralisée (dans les zones granitiques du Massif Central, des Alpes et des Pyrénées, Vosges, Bretagne). Les traitements préventifs et leurs effets secondaires sont présentés ci-après.
|
Constat |
Traitement |
Limite |
|
Une eau acide augmente la corrosion |
Augmenter le pH (autour de 8) |
Un pH trop élevé nuit à la désinfection par le chlore |
|
Une eau douce augmente la corrosion |
Reminéraliser les eaux
|
Une eau trop calcaire génère des dysfonctionnements de traitements d'eau et des appareils électroménagers |
|
La solubilité du plomb décroît avec la teneur en biocarbonate |
Décarbonatation de l'eau |
|
|
La corrosion est le vecteur de dissolution du plomb |
Injecter des phosphates en particulier orthophosphates qui limitent la corrosion |
Un apport de phosphates dans une eau calcaire entraîne un précipité de phosphate et une augmentation de la turbidité |
|
Les teneurs en plomb sont mesurées au robinet |
Filtrer l'eau en captant le plomb avant l'usage de l'eau |
Les filtres anti-plomb doivent être régulièrement chargés, sinon ils deviennent de vrais « nids bactériens » |
- En revanche , la norme de 10 ug/l ne pourra être respectée en 2013 sans d'importants travaux d'aménagement qui passent au minimum, par la suppression de toutes les conduites et branchements au plomb, mais aussi vraisemblablement par la rénovation des conduites sans plomb mais avec des joints ou des métaux associés à du plomb (zinc, acier, cuivre, étain -une soudure à l'étain contient 60 % de plomb ...)
Plusieurs dizaines de milliers d'habitations sont concernées par cette échéance, surtout dans les grandes villes. Les estimations de coût, initialement évaluées à 20 millions d'euros sont périodiquement revues à la baisse pour être estimées aujourd'hui à 10,5 millions d'euros et sans doute moins (l'installation de conduites flexibles en plastique à l'intérieur des conduites de grande dimension permettrait de réduire considérablement les coûts). Mais sauf à remettre en cause ce seuil (un nouveau seuil de 20 ug, voire 15 ug/l permettrait de réduire la facture), le coût est inévitable.
Il faut bien distinguer les deux opérations : le
changement des branchements sera opéré par le distributeur. La
dépense ne sera pas répercutée sur l'usager individuel,
mais le coût sera mutualisé sur l'ensemble des habitants de la
commune. Le coût est estimé à 750 €. En revanche,
le changement des conduites sera exclusivement financé par le ou les
propriétaires de l'immeuble. L'essentiel ne portera pas sur les travaux
de plomberie (estimés à 60 € le mètre de tuyauterie)
mais sur la maçonnerie associée (démolition de cloisons,
reconstruction...). Le coût total par logement est estimé entre
1.500 et 15.000 €.
c) Proposition
L'idée est de lier l'obligation de rénovation plomb à l'obligation de ravalement prévue par le code de la construction (article L.132-1 à 6) qui dispose que « les façades des immeubles doivent être constamment tenues en état de propreté ». Le rythme est cependant à l'initiative des communes. A Paris et dans la plupart des grandes villes -où le risque plomb est concentré- le ravalement est obligatoire tous les dix ans.
Concernant l'application de la norme plomb (10 ug/l à l'échéance 2013), qui exige le changement des branchements et des conduites intérieures en plomb, il est proposé de surseoir pendant quelques années à l'obligation de ravalement, pour les immeubles qui doivent changer leurs canalisations en plomb, afin de leur permettre de réaliser ces modifications.
3. Les légionelles dans les réseaux de distribution
Les légionelles sont des bactéries qui vivent dans l'eau. On compte une quarantaine de bactéries de cette famille dont une pathogène, la légionnella pneumophila . Elles ne peuvent être éliminées durablement car quand elles sont éliminées (par stérilisation de l'eau ou chauffage au-dessus de 60°), elles reviennent. Elles se multiplient dans les réseaux de distribution des eaux quand elles rencontrent des conditions favorables, à savoir la stagnation des eaux, la présence d'un biofilm dans les canalisations et, surtout, une montée en température. Les légionelles sont très sensibles à la température de l'eau : elles végètent dans une eau inférieure à 15°/20°, elles se développent entre 25° et 40° et meurent à plus de 60°. Les légionelles se développent donc dans les canalisations où l'eau stagne près d'une source de chaleur (conduite à proximité de chaudières par exemple).
La légionellose est une pathologie induite par la légionelle, qui se caractérise par une fièvre suivie d'une infection pulmonaire aiguë mettant en jeu le pronostic vital dan 15 % des cas. La maladie doit être déclarée, mais cette procédure est encore rarement respectée (en 1998 seulement 1/3 des 1.200 cas de légionellose diagnostiquée avait été déclaré).
La légionellose se contracte par inhalation, et non par ingestion. Il est parfaitement possible de boire une eau riche en légionelle. En revanche, l'inhalation affecte les poumons. La légionelle se transmet donc par les circuits d'eau générant des embruns, qu'il s'agisse de circuits d'eau chaude ou de climatisation utilisant l'eau pour réduire la température ambiante, et de tous les systèmes utilisant la nébulisation (bains bouillonnants, jacuzzi, brumisateurs, équipements pour traitements respiratoires...).
La légionellose est une maladie opportuniste, ce qui signifie qu'elle a besoin d'un milieu favorable pour se développer. Ainsi, si la maladie peut affecter n'importe qui, elle se développe plus particulièrement sur un terrain favorable, constitué par une population à risques. Ces facteurs de risques sont liés au sexe et à l'âge (la légionellose est plutôt une maladie touchant les hommes de plus de 70 ans), à certaines maladies (cancer, insuffisance rénale) et surtout à l'immunodépression, quelle qu'en soit l'origine (rougeole, sida...).
En couplant les modes de transmission et les facteurs de risques, la légionellose trouve donc son terrain propice au développement dans les hôpitaux et les hôtels (la « maladie du légionnaire » a été ainsi nommée car elle a été identifiée pour la première fois à la suite d'un congrès d'anciens combattants américains -l'American legion- dans un hôtel de Philadelphie en 1976. Le facteur suspecté fut le système d'aération de l'hôtel, site de la convention). Ainsi, si les légionelles existent dans l'eau, la légionellose est une maladie du progrès, liée au chauffage et aux équipements de confort.
Les actions de prévention portent sur les installations de distribution des eaux, qui ne doivent pas être couplées au chauffage et qui doivent éviter les stockages, et sur une vérification des températures. Il faut en effet veiller à ne pas chauffer l'eau froide (pour éviter un développement bactérien à partir de 25°) et ne pas refroidir l'eau chaude qui doit être maintenue au-dessus de 60°.
C. L'EAU AU DOMICILE
1. Quand la méfiance s'installe
a) Les Français et l'eau
En 1950, la moitié des Français n'avaient pas « l'eau courante » comme on disait alors. La quasi totalité de la population est aujourd'hui desservie par une eau potable, traitée, distribuée et consommée... à toutes autres choses que la boisson qui ne représente que 1 % de l'eau potable distribuée (73 ( * )).
Ainsi, les Français, dans leur grande majorité, apprécient l'eau du robinet... mais surtout pour les autres usages que la boisson. Les Français, dans leur grande majorité, apprécient l'eau du robinet...mais ils boivent de plus en plus d'eau en bouteille...
Il est clair que les Français se détournent de l'eau du robinet. Les enquêtes d'opinion montrent qu'ils apprécient toujours à une très large majorité l'eau du robinet, ils sont satisfaits, confiants, mais que les réactions de méfiance, les critiques sur le calcaire ou le goût, et surtout le basculement vers la consommation d'eau en bouteille progressent. Ainsi, non seulement, il n'y a que 1 % de la consommation d'eau totale qui soit utilisée pour la boisson mais cette part se réduit chaque année un peu plus !...
Une part de cette évolution vient de la perception de la dégradation de la qualité de la ressource. Celle ci est avérée, même si elle est le plus souvent localisée. Mais la médiatisation donne immédiatement un retentissement national à des contaminations locales, et chacun se sent concerné. Par ailleurs, en raison d'une certaine ignorance, compréhensible, sur l'efficacité des traitements d'eau, l'opinion a tendance à assimiler dégradation de la ressource en eau, à dégradation de l'eau distribuée. Ces deux phénomènes ont généré une certaine appréhension sur la qualité de l'eau distribuée.
Cette évolution s'est produite dans un contexte déjà fragilisé par quelques crises sanitaires. « L'eau ne figure pas spontanément parmi les peurs alimentaires des Français. Ces derniers attendent néanmoins une information sur la qualité de l'eau, même s'ils demeurent plutôt incrédules. Les messages des pouvoirs publics leur paraissent suspects (...) Les enquêtes qualitatives d'opinion montrent que deux courants se distinguent : les « méfiants » et les « fatalistes ». Les méfiants suspectent tout ce qui attaque la nature « l'anti-naturalité ». La confiance dans la capacité de traitement des eaux n'entame pas leur regret d'un monde perdu. Les fatalistes suspectent tout discours officiel. Surtout depuis l'accident de Tchernobyl et l'affaire du sang contaminé, qui ont révélé l'importance et la permanence des mensonges d'État. Désormais, rien ne pourra les rassurer »... (Extrait de l'audition de Mme Monique Chotard, directrice du Centre d'information sur l'eau, 13 mars 2002).
La demande était latente, n'attendant qu'à
être satisfaite. Le marché y a répondu par une offre de
produits destinés avant tout à rassurer : les traitements
d'eau à domicile et les eaux minérales.
b) Les menaces contentieuses
Plusieurs millions de personnes consomment chaque année une eau qui ne répond pas strictement aux critères réglementaires de consommation. On considérait jusqu'à présent que si l'eau n'était pas conforme, cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas potable. Ce qui est parfaitement exact (à commencer par les eaux minérales qui ne sont pas non plus conformes aux normes de consommation). Les Français acceptaient cette marge d'incertitude d'autant plus facilement qu'elle était supposée transitoire. La situation s'est renversée. Le dépassement des valeurs réglementaires ne veut certes pas dire que l'eau n'est pas potable mais signifie quand même qu'elle n'est pas conforme. Ce qui est tout aussi exact. Ce qui était accepté comme une part de risque acceptable sert aujourd'hui à fonder des contentieux .
Cette tendance ne fait qu'émerger. Mais les exigences et la sociologie de la population évoluent ; les peurs et l'aversion aux risques augmentent. Il est probable que les distributions d'eau non conformes génèrent d'avantage de contentieux, dès lors que les dépassements sont permanents, que les évolutions sont connues, et n'ont pas entraîné de réaction adaptée de la part des autorités nationales ou locales pour les faire cesser. La jurisprudence est encore rare mais bien établie. La condamnation de la collectivité (ou de la société concessionnaire) est quasi systématique (Bretagne, Drôme...), générant des réparations calculées sur un barème simple fondé sur trois paramètres : le besoin en eau (2 litres par jour) multiplié par le prix de l'eau de source en bouteille multiplié par le nombre de jours de distribution de l'eau non conforme.
Sur ces bases, ce coût devient vite très important. En Guadeloupe, l'Etat a imposé la fermeture d'un captage, pour excès de teneurs en pesticides, avant mise en place d'un système de traitement par charbon actif (6 millions d'euros payés par le maître d'ouvrage). Dans l'attente de cet équipement, la population concernée (10.000 personnes) a été desservie en eau en bouteille soit un coût de 250.000 euros. Dans ce département, l'équipement et les bouteilles ont été cofinancées par la région, l'Etat, et les fonds structurels européens. « Est-ce à l'Union européenne de financer les bouteilles d'eau de source ? ». La parade à la dégradation de la ressource conduit rapidement à des situations inextricables et ubuesques !
Le débat sur les responsabilités est à peine engagé. Qui est responsable ; le concessionnaire, la collectivité locale, l'Etat ? Dores et déjà, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2001 reconnaissant que la responsabilité de l'Etat était engagée pour la mauvaise qualité de l'eau distribuée par un concessionnaire est une étape cruciale dans ce débat.
Il serait navrant que seule la menace de contentieux et de condamnations parvienne à mobiliser suffisamment l'Etat et les collectivités responsables dans cette lutte nécessaire contre la dégradation de la qualité de la ressource.
2. Les traitements d'eau à domicile
Il s'agit des adoucisseurs d'eau, destinés à réduire le calcaire dans l'eau distribuée (74 ( * )) et des filtres aux points de distribution, destinés à améliorer le goût et enlever les métaux notamment le plomb (75 ( * )) .
Ces dispositifs sont des équipements de confort qui n'interviennent pas ou que très peu sur la qualité de l'eau, au sens réglementaire et sanitaire. Le goût et le calcaire sont deux paramètres qui ne sont pas suivis dans la réglementation sanitaire et la qualité de l'eau.
Ces dispositifs sont souvent inutiles (un adoucisseur d'eau n'est utile que lorsque l'eau est calcaire, mais pas dans les autres cas, ce qui est le cas dans plusieurs régions de France), partiellement efficaces car ils s'attaquent au calcaire et au goût, éventuellement au plomb et aux pesticides, qu'ils arrêtent, mais n'ont aucun effet sur les nitrates, et les contaminations bactériennes virales par exemple) et même potentiellement dangereuses. Les filtres notamment doivent être changés régulièrement, faute de quoi ils deviennent des réservoirs à bactéries et loin d'améliorer la qualité de l'eau deviennent des sources de contamination !
Les publics les plus fragiles, isolés, sont aussi les
plus vulnérables aux démarches à domicile,
fréquentes sur ce produit. Sans compter que l'impact de la
publicité et du marketing face à la très faible
connaissance technique des caractéristiques de l'eau conduit parfois
à des aberrations : acheter un adoucisseur d'eau dans une
région où l'eau est naturellement douce (en Bretagne par exemple)
pour enlever le calcaire (alors qu'il n'y en a pas) et les nitrates (alors que
l'adoucisseur ou le filtre n'a aucun effet sur ce paramètre), puis
acheter de l'eau minérale pour boire une eau « riche en
calcium » (alors que le calcaire n'est pas autre chose qu'un
dérivé du calcium).
3. La consommation d'eau en bouteille
Pour des raisons diverses tenant au goût de l'eau du robinet (76 ( * )) , à la défiance vis-à-vis de sa qualité, mais aussi à la mode, aux effets d'un marketing subtil mettant en avant le côté naturel du produit et d'une publicité performante, les Français plébiscitent l'eau en bouteille. Il est tout à fait clair que, pour leur boisson, de plus en plus de Français se détournent de l'eau du robinet et deviennent des consommateurs mixtes. La consommation d'eau en bouteille par habitant a été multipliée par deux en vingt ans. Elle est aujourd'hui de 130 litres par an et par habitant, derrière l'Italie.
On distingue sur ce marché florissant deux produits distincts : les eaux de source et les eaux minérales.
- Une eau de source est, en France, une eau souterraine naturellement propre à la consommation, qui ne nécessite, avant conditionnement, que des traitements physiques élémentaires (aération, décantation, filtration...).
- Une eau minérale est une eau de source qui a en outre trois caractéristiques supplémentaires : ses composants doivent être permanents, ses qualités thérapeutiques sont reconnues par l'Académie de médecine ; enfin, elle est exploitée après arrêté ministériel (un arrêté préfectoral suffit pour les eaux de source) sous forme d'une déclaration d'intérêt public -DIP-, associée à un périmètre de protection. Les teneurs en sels minéraux, très fréquentes dans les eaux minérales, ne sont pas une condition obligatoire. Il existe certaines eaux très peu minéralisées. Toutes les eaux minérales contiennent trois éléments de base : les bicarbonates, les sulfates et les chlorures, mais les éléments mineurs (brome, silicium) ou sous forme de trace (oligoéléments, tels que manganèse, sélénium...) font la particularité de chaque eau.
Il existe environ 700 eaux de source ou minérales commercialisées sous une centaine de marques. Le marché de l'eau en bouteille est de 9 milliards de litres dont 25 % sont exportés et répartis comme suit :
Répartition du marché des eaux en
bouteille
|
Production
|
Consommation par habitant (litres) |
|||
|
1992 |
2001 |
1992 |
2001 |
|
|
Eaux de source |
1.450 |
2.500 |
27 |
38 |
|
Eaux minérales |
5.200 |
6.500 |
70 |
94 |
|
Total |
6.650 |
9.000 |
97 |
132 |
Il ne saurait être question de revenir sur un courant aussi puissant, sur une pratique culturelle établie, qui présente à certains égards de nombreux côtés positifs.
Le premier effet bénéfique pour la santé est moins celui lié à leur teneur en minéraux ou en oligoéléments qui peuvent être des compléments nutritionnels intéressants (apport en magnésium, calcium et fer), qu'à leur facilité d'usage qui permet de favoriser la consommation d'eau et de combler une part du déficit constaté (un Parisien consomme 1,15 litre d'eau par jour au lieu de 2,5 litres jugés nécessaires). Outre cet effet pour la santé, on rappellera aussi que l'eau représente un marché considérable de l'ordre de 2,2 milliards d'euros.
Sans revenir sur cette pratique, on rappellera toutefois
quelques données qui justifieraient une utilisation plus
raisonnée. Car la consommation d'eau minérale au lieu et place de
l'eau du robinet repose sur quelques ambiguïtés.
|
La question est -volontairement- choquante et paradoxale, mais certaines caractéristiques de l'eau minérale doivent être rappelées : - la réglementation de l'eau de consommation (décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001) ne s'applique pas aux eaux minérales. La plupart des critères contribuant à l'effet bénéfique de l'eau minérale ne figurent pas parmi les critères de potabilité de l'eau destinée à l'alimentation humaine. - si on appliquait la réglementation de l'eau potable aux eaux minérales, de nombreuses eaux ne seraient pas conformes et seraient donc qualifiées « non potables ». Ainsi, plusieurs des critères communs à l'eau du robinet et l'eau minérale ne sont pas respectés par plusieurs eaux minérales comme indiqué ci-après.
Ainsi, si quelques Français se détournent de l'eau du robinet -potable, parce qu'ils craignent une dégradation, ils se tournent parfois vers des eaux ... non potables ! Par ailleurs, on pourra s'étonner des miracles du marketing, qui arrive à faire passer de l'arsenic pour un oligoélément et à vendre des bouteilles riches en calcium et des adoucisseurs d'eau pour enlever le calcaire...alors qu'il s'agit de la même chose ! Enfin, on rappellera qu'il est important de changer régulièrement d'eau minérale et que certains éléments mineurs ne sont bénéfiques pour la santé qu'à faibles doses. C'est notamment le cas des sulfates et du fluor. Le fluor, à faible dose, est bénéfique pour la santé en prévention des caries ou comme traitement de l'ostéoporose (diminution de tissus osseux). En revanche, le produit devient toxique quand il est absorbé à fortes doses (à partir de 1 mg de fluor par kilo) générant nausées, diarrhées... La présence de fluor dans l'eau (jusqu'à 9 mg/l) s'ajoute au fluor déjà présent dans le sol, le dentifrice, parfois les médicaments, au risque d'être alors en excédent. |
4. L'information sur l'eau
L'opinion s'estime mal informée sur l'eau. Ce regret
n'exclut pas une certaine incohérence dont témoignent les curieux
résultats de ce sondage diligenté par le Centre d'information sur
l'eau. Deux questions étaient posées :
En qui avez-vous
confiance pour obtenir une information sur la sécurité
alimentaire ? Qui doit vous informer ?
Les résultats sont
édifiants : en qui a-t-on le moins confiance ? Les pouvoirs
publics. Qui doit nous informer ? Les pouvoirs publics. Ainsi l'opinion
dénonce et appelle en même temps.
a) Le dispositif d'information
Les modalités d'information sont les suivantes :
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 prévoit les obligations générales d'information sur la qualité de l'eau. Les procédures ont été mises en oeuvre par le décret n° 1994-841 du 26 septembre 1994, qui prévoit les données qui doivent figurer dans les analyses de qualité de l'eau distribuée et les règles de communication (affichage en mairie...).
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et son décret d'application du 6 mai 1995 ont prévu que les communes (et leurs groupements) qui assurent la gestion du service de distribution de l'eau et d'assainissement publient un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Un rapport est établi par le maire, un autre par le gestionnaire du service de l'eau. Le rapport est présenté au Conseil municipal et adressé au préfet. Dans les communes de plus de 3.500 habitants, il doit être mis à la disposition du public.
La transparence est assurée par des règles financières. Il s'agit d'une part d'un budget annexe, distinct du budget de la commune. Le budget regroupe les opérations liées à l'eau potable et à l'assainissement, mais ces deux opérations doivent apparaître de façon distincte dans le budget Ce budget annexe est un instrument de transparence. Cette procédure est obligatoire pour les communes de plus de 3.500 habitants. Elle est facultative pour les communes de moins de 3.500 habitants. Il s'agit d'autre part de la facture d'eau, dont le contenu est précisé par l'arrêté du 10 juillet 1996.
La concertation est également assurée par de très nombreux relais. Les comités de bassin, les commissions locales de l'eau, les enquêtes publiques sont également des lieux et des occasions d'échange et d'information. Plusieurs initiatives permettent aussi une meilleure information sur l'eau. C'est le cas des agences de l'eau qui diffusent de très nombreux documents sur la qualité de l'eau et la préservation de la ressource. Plusieurs agences ont mis en place une action spécifique destinée aux plus jeunes notamment dans le cadre de « classes d'eau ».
Les distributeurs d'eau ont également multiplié
leurs actions de communication sous forme de numéros verts qui informent
les usagers de la qualité de l'eau distribuée.
b) Appréciation
Ces dispositifs appellent une appréciation nuancée.
Il faut en premier lieu écouter l'opinion qui, dans sa grande majorité, s'estime mal informée sur la qualité de l'eau. La matière est technique et l'ignorance sur ce sujet reste grande. Y compris chez les personnes chargées d'informer l'opinion.
Il ne faut pas nier les très grandes difficultés de l'information en matière environnementale. L'information, destinée à expliquer et parfois à rassurer, inquiète. La médiatisation donne un retentissement national à des problèmes locaux.
Ces difficultés n'exonèrent pas d'une réflexion critique sur l'actuel dispositif d'information sur l'eau.
En premier lieu, la formation générale paraît très insuffisante. Il serait souhaitable que la connaissance sur l'environnement puisse être intégrée dans les programmes scolaires. Un meilleur rééquilibrage des programmes de géographie permettrait d'assurer cette formation. Une éducation aux problèmes d'environnement qui se posent dans notre pays s'impose avec urgence. La charte de l'environnement pourrait être une occasion de préciser ce point.
En second lieu, sans nier l'importance de la transparence, maître mot de l'action publique moderne, il faut oser voir et accepter les limites et les effets pervers des procédures mises en place. Cette critique porte en particulier sur la procédure de l'enquête publique. Les permanences des enquêteurs en semaine sont des règles souvent inadaptées à la vie moderne. L'information des dossiers doit être ouverte et accessible sans qu'il soit besoin de mettre en place des procédures inutilement lourdes et compliquées. Une information locale plus interactive, à des dates plus accessibles, en fin de semaine ; des procédures d'enquête publique allégées... C'est toute une philosophie du service public de proximité qui est en jeu.
En troisième lieu, l'information communale est inadaptée. Nous avons pouvons exprimer quelques doutes sur l'opportunité du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau. Il y a une grande confusion entre la qualité du service de l'eau et la qualité de l'eau distribuée. Le premier rapport présenté au Conseil municipal concerne les taux de raccordement, les volumes distribués, alors que ce qui intéresse l'opinion est la qualité de l'eau distribuée. Cette procédure paraît inutile et pourrait être remplacée par une communication sur la qualité de l'eau distribuée.
L'information des distributeurs est elle aussi inadaptée. L'obligation d'information concerne les abonnés et non les usagers. Dans le cas d'immeubles collectifs, l'information est transmise au syndic de l'immeuble, à charge pour lui de transmettre l'information aux co-propriétaires, qui devraient à leur tour la transmettre aux éventuels locataires. Autant d'intermédiaires qui éloignent l'information initiale de sa cible : l'usager à domicile
Il serait souhaitable que ces dispositifs touchant l'information puissent faire l'objet d'une évaluation. L'information doit être améliorée dans son contenu et dans ses relais. L'affichage en mairie paraît inutile et désuet. L'information sur la santé doit être martelée, le plus souvent possible, dans le plus de lieux possibles, et le plus simplement possible.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 71 - Les canalisations du réseau d'eau potable
Annexe 72 - Les normes du plomb dans l'eau potable
Annexe 73 - Les Français et l'eau
Annexe 74 - Le calcaire dans l'eau distribuée
Annexe 75 - Les procédés de traitement de l'eau à domicile
CHAPITRE III - LA QUALITE DE L'ASSAINISSEMENT
I. L'ÉPURATION DES EAUX USÉES
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1. L'assainissement
a) Du » tout à l'égout » à la protection du milieu
La notion d'épuration des eaux et le concept d'assainissement qui lui est associé a évolué au cours des dernières décennies.
Initialement conçu comme un concept de santé publique, l'assainissement des eaux usées a durant longtemps consisté à évacuer les eaux usées «le plus loin et le plus rapidement possible » des agglomérations. Il s'agissait d'éviter la stagnation des eaux putrides près des habitations et à éloigner ainsi les risques sanitaires associés, ainsi que les inconvénients les plus manifestes (détritus, odeurs, présence de vermines, ...). Cette pratique a conduit durant les années 1960-1970 à la généralisation du «tout à l'égout » y compris dans des localités de taille réduite. Elle représente à présent un confort que peu seraient prêts à remettre en cause, même si l'assainissement collectif n'est pas la seule façon de pratiquer puisqu'il existe également des possibilités d'assainissement individuel ou semi-collectif.
Cependant, cette facilité a eu aussi pour conséquence de concentrer des rejets polluants sur des points précis du réseau hydrographique (sorties des collecteurs) alors qu'ils étaient dispersés auparavant sur des zones plus vastes. Il s'en est suivi une dégradation des milieux aquatiques et la notion d'assainissement a dû être élargie pour répondre à ces nouveaux problèmes. A présent l'assainissement des eaux usées pourrait être défini comme l'ensemble des techniques destinées à collecter les eaux, les évacuer et les traiter jusqu'à un niveau «acceptable » par le milieu récepteur. Dans la pratique cela consiste à fixer des normes de rejets de manière à garantir les différents usages de l'eau (eaux potabilisables, eaux de baignade, ...).
Le concept d'assainissement s'est progressivement modifié au cours des dernières années. Les premières stations d'épuration visaient à réduire principalement la pollution visible (les matières en suspension), puis la pollution organique par le traitement secondaire. A présent, de plus en plus de stations nouvelles sont équipées d'un traitement tertiaire visant à éliminer l'azote et le phosphore. Le travail d'épuration s'arrête-t-il là, ou doit-on prévoir la mise en place d'étapes supplémentaires destinées à éliminer d'autres polluants ?
b) Quelles sont les pollutions redoutées provenant des eaux usées ? :
L'épuration n'est pas destinée à produire de l'eau potable mais à réduire les pollutions issues des eaux usées. Plusieurs phénomènes polluants sont redoutés.
- les matières en suspension, qui provoquent la mort de les poissons et empêchent la lumière solaire de pénétrer dans les eaux ;
- les matières oxydables, qui consomment de l'oxygène et entraînent l'asphyxie de divers vivants,
- les substances à effets toxiques, c'est à dire des substances qui peuvent entraîner une mortalité immédiate ou des effets néfastes différés sur les milieux aquatiques telles que métaux toxiques (METOX), micropolluants adsorbés sur charbon actif, matières inhibitrices (MI)
- sels solubles, qui modifient la composition ionique des eaux
- composés azotés et matières phosphorées, responsables de l'eutrophisation des rivières (développement incontrôlé des végétaux)
L'azote (N) et le phosphore (P) sont deux éléments importants des cycles bio géochimiques. Ils ont un rôle privilégié dans le métabolisme des cellules vivantes, ce qui explique qu'ils constituent les éléments principaux des engrais utilisés depuis longtemps pour accroître les productions végétales. Cependant les apports d'azote et de phosphore dans l'environnement ne sont pas limités aux seules activités agricoles : ainsi chaque habitant rejette par jour 9 à 12 g d'azote (essentiellement associé aux urines) et 3 à 4 g de phosphore qui, quant à lui, provient principalement des détergents et des poudres à lessiver, où son usage vise à limiter les inconvénients (entartrage) induits par la dureté de l'eau.
On les retrouve ainsi sous différentes formes solides et dissoutes dans les eaux usées et, finalement, en partie tout au moins dans les milieux aquatiques, en particulier les eaux de surface.
Arrivés dans ces milieux aquatiques, ces nutriments vont provoquer un développement accru des différentes formes de végétation présentes (algues, végétaux flottants, ...), de la même manière que cela se produit dans les écosystèmes agricoles. Ce phénomène peut atteindre un niveau excessif, appelé eutrophisation, qui se manifeste parfois de manière très tangible : mortalités piscicoles, pH extrêmes, prolifération d'espèces envahissantes, gêne à la navigation et à la baignade, etc...
2. Les perspectives
a) L'échéancier prévu par la directive européenne de 1991
Le cadre juridique de l'assainissement est fixé par la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991. Les échéances et les obligations diffèrent selon la taille des agglomérations et leur situation géographique (77 ( * )) .
La Directive opère une distinction entre la collecte et le traitement.
La collecte des eaux usées doit être réalisée avant le 31 décembre 1998 pour les agglomérations en zone sensible de plus de 10.000 équivalents habitants ; avant le 31 décembre 2000 pour les agglomérations de plus de 15.000 équivalents habitants ; avant le 31 décembre 2005 pour les agglomérations comprises entre 2.000 et 15.000 équivalents habitants.
Un traitement secondaire (destiné à attaquer la pollution dissoute et colloïdale, le plus souvent réalisé par voie biologique) est requis d'ici le 31 décembre 2000 dans les agglomérations de plus de 15.000 équivalents habitants et d'ici le 31 décembre 2005 pour les agglomérations comprises entre 2.000 et 15.000 équivalents habitants.
Dans les zones sensibles, il est prévu un traitement spécifique de l'azote et du phosphore.
b) Les problèmes techniques annoncés
Quels sont les problèmes techniques auxquels le monde de l'assainissement devra faire face dans les prochaines décennies ?
- l'extension du traitement dans les zones sensibles pour les agglomérations < 2000 habitants et la fiabilisation des performances
- la gestion des boues de station d'épuration
- la gestion des eaux pluviales circulant dans les réseaux unitaires
- vérifier la présence éventuelle de nouveaux polluants, étudier leurs effets et mettre au point les filières d'élimination appropriées.
A cet égard il faut insister sur le fait que la nouvelle directive européenne 2000/60 met en place, vis-à-vis de la gestion de l'eau, non plus une obligation de moyens pour respecter des normes, mais une obligation de résultat pour obtenir des masses d'eau de qualité.
Les échéances étant relativement rapprochées au regard des temps de réponse des écosystèmes aquatiques, cela implique la poursuite des efforts déjà entrepris, la mise en oeuvre de nouveaux équipements. Parallèlement ces investissements devraient permettre de générer de nouveaux métiers dans le domaine de l'eau et d'ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises de ce secteur.
B. L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1. Les techniques
a) Les principales étapes de l'épuration
L'épuration des eaux passe ainsi par une série d'étapes successives dont chacune vise un type de polluant particulier.
On parle ainsi des prétraitements, destinés à éliminer les polluants les plus grossiers (branches, cailloux, sable, ...), puis de traitement primaire où on retient la fraction décantable et donc la plus visible de la pollution (les matières en suspension).
Le traitement secondaire, qui est le plus souvent un traitement biologique, est destiné à s'attaquer à la pollution sous sa forme dissoute ou colloïdale. Durant cette étape, c'est principalement la matière organique qui est dégradée. Les composés carbonés (dont le carbone est le constituant principal) sont transformés : une fraction est oxydée, aboutissant via le processus de respiration bactérienne, à la production de CO 2 . L'autre fraction conduit à la synthèse de nouvelles cellules bactériennes, ce qu'on a l'habitude d'appeler les boues de stations d'épuration, conséquence inévitable du traitement. Ainsi l'épuration secondaire consiste plutôt en un processus de transformation de la matière organique plutôt qu'en une élimination complète de cette dernière. Cela génère ainsi un nouveau problème environnemental : celui de la gestion de ces boues d'épuration. Dans beaucoup de stations d'épuration, le traitement reste arrêté pour l'instant à ce niveau du traitement secondaire.
Cependant la nécessité de protéger les milieux récepteurs vis-à-vis des risques d'eutrophisation amène de plus en plus souvent à mettre en place un traitement supplémentaire, appelé alors traitement tertiaire. Dans ce dernier, les polluants ciblés sont principalement l'azote et/ou le phosphore.
De nombreuses mises en oeuvre différentes existent et continuent à faire l'objet de développements technologiques visant à accroître l'efficacité des systèmes et à en réduire les coûts
b) Les procédés de traitement
La dépollution des eaux usées nécessite une succession d'étapes faisant appel à des traitements physiques (filtration) physico-chimiques (adjonction de sels de fer ou d'aluminium qui a pour effet de faire coaguler les micro particules) et biologiques (en favorisant l'action des bactéries qui se développent en utilisant les matières organiques comme nutriments). L'épuration doit permettre, au minimum, d'éliminer la majeure partie de la pollution carbonée (78 ( * )).
Dans les zones dites « zones sensibles » qui présentent des risques d'eutrophisation, l'épuration porte aussi sur l'azote et le phosphore, à condition que les stations d'épuration aient été conçues dans ce but (79 ( * )).
Jusqu'à présent, on suit la dépollution à travers des mesures globales telles que la demande chimique et biochimique en oxygène qui mesure l'importance des matières organiques dans les effluents. Mais il existe des micropolluants qui ne sont pas sensibles aux bactéries et qui ne se dégradent que très difficilement (médicaments, pesticides, métabolites de détergents...). La présence de ces « nouveaux polluants » suppose de mettre en oeuvre de nouveaux types de traitement appelés parfois traitements quaternaires (80 ( * )).
2. Les performances épuratoires
Il faut distinguer les performances épuratoires des stations, très réglementées, et l'efficacité globale de l'assainissement au niveau du bassin.
a) Les performances épuratoires des stations
Elles sont fixées soit en concentrations maximales, calculées en sortie de station, soit en rendement minimal calculé en faisant le rapport entre la pollution sortante et la pollution entrante.
Les paramètres suivis pour toutes les stations sont la demande biochimique en oxygène et la demande chimique en oxygène pour mesurer la pollution organique, ainsi que les matières en suspension.
On observera que, dans le cas général, le rendement n'a qu'une valeur très relative, calculée par rapport aux seules matières organiques. Deux paramètres sont exclus dans ce calcul. Il s'agit d'une part de l'azote ou du phosphore, pris en compte dans les seules zones sensibles aux risques d'eutrophisation, et d'autre part du risque bactériologique qui n'est pas pris en compte, sauf indirectement par l'évaluation de la matière organique résiduelle.
Ces paramètres sont mesurés à deux occasions.
L'arrêté du 22 décembre 1994 impose un double niveau de contrôle : une auto surveillance, qui permet de suivre l'ensemble des paramètres reflétant la fiabilité du système (débits, production de boues...) et des visites-bilan sur 24 heures qui permettent de mesurer les performances épuratoires fixées par la réglementation.
Ni l'autosurveillance ni la visite-bilan, n'apparaissent suffisantes. Très peu de collectivités respectent leurs obligations réglementaires liées à l'autosurveillance des réseaux. Les visites-bilans, menées avec le concours des services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration -SATESE-, mises en place par les agences de l'eau et les départements sont également extrêmement variables (jusqu'à être pratiquement inexistantes !).
L'efficacité de l'épuration est prise en compte dans le calcul des primes pour épuration versées aux communes ;, qui vient par conséquent en déduction de la redevance pollution payées par les communes (voir supra)
b) Quelques critères d'appréciation de l'assainissement
Le taux de collecte, le taux de rendement, le taux de dépollution. Il n'y a pas de règle européenne unique pour le calcul de l'efficacité globale de l'assainissement, dans un bassin versant. La méthode française est la suivante :
|
Taux de collecte, rendement et taux de dépollution Le taux de collecte . C'est le rapport entre la pollution, raccordée au réseau, et la pollution produite par les agglomérations.
La pollution est exprimée en tonnes de matières
oxydables par jour, selon la formule suivante : MO =
1 DCO + 2 DBO
5
Une part importante peut ne pas être raccordée au réseau ou ne pas arriver à la station (mauvais branchements, mauvais état des réseaux...). Exemples (Agence Adour Garonne) Pollution domestique 313 tonnes Pollution industrielle raccordée 77 tonnes Pollution produite 390 tonnes Pollution raccordée au réseau 261 tonnes Taux de collecte 67 % C'est le premier indicateur d'élimination des pollutions. Rendement. C'est le pourcentage d'abattement des différents paramètres de pollution. La réglementation fixe des seuils minima de rendement mais ces seuils peuvent évidemment être dépassés. matières organiques 79 % matières en suspension 84 % azote 45 % phosphore 45 % Le principal paramètre est celui des matières organiques. Taux de dépollution . C'est le produit du taux de collecte par le rendement, calculé sur les matières organiques. Soit, en l'espèce 67 % X 79 % = 0,53 soit 53 %. D'autres pays ont des méthodes de calcul différentes. Les différences peuvent venir de l'estimation de la pollution produite, selon que l'on prend ou non en compte la pollution industrielle, et selon la pondération attribuée à la population touristique. |
Le plan national pour l'environnement approuvé en 1991 prévoyait à l'horizon 2000 la collecte de 80 % de la pollution urbaine et l'élimination de la pollution organique reçue par les stations d'épuration, soit un taux de dépollution de 64 %.
L'effort d'équipement a été considérable depuis une génération : 2.115 stations en 1970, 7.542 stations en 1980, 11.500 en 1990, 14.377 fin 2000. Néanmoins, dans la plupart des bassins, les résultats sont très inférieurs aux objectifs. Le retard se constate tant dans le taux de collecte, notamment dans la collecte de la pollution industrielle raccordée, que dans les rendements avec des retards fréquents dans la mise aux normes des stations et des retards d'équipement. Ainsi, concernant les agglomérations concernées par l'échéance du 31 décembre 1998 (les agglomérations de plus de 10.000 équivalents habitants en zone sensible) seulement 54 % des agglomérations étaient équipées de procédés correspondants de dénitrification et de déphosphatation fin 2000, soit deux ans après l'échéance.
Il est fort probable que l'équipement des agglomérations de 2000 à 10.000 équivalents habitants réservera à son tour de mauvaises surprises. Les petites agglomérations de 2000 à 5000 habitants vont certainement s'équiper de stations, mais, après cet investissement lourd, n'auront plus la capacité financière d'investir dans les réseaux de collecte. On se retrouvera donc dans une situation absurde où les communes auront investi dans les stations d'épuration qui ne seront pas exploitées, faute de raccordements de la population.
c) Le lien entre les redevances et l'efficacité épuratoire
Les pollutions sont soumises à redevances. Trois types de pollutions sont soumises à redevance : la pollution domestique, la pollution industrielle, et la pollution agricole selon des modalités extrêmement et inutilement complexes.
La redevance de pollution domestique est due par les communes de plus de 400 habitants qu'elles soient ou non équipées de stations d'épuration, calculée sur la base de la quantité de pollution, pondérée par des pointes de fréquentation et un coefficient d'agglomération. La redevance de pollution industrielle varie selon l'activité, la pollution produite, la pollution épurée...
L'agence de l'eau verse aux communes qui ont une station une prime pour épuration, calculée sur l'efficacité du traitement et le sort des boues de stations.
Tous les opérateurs déplorent l'extrême complexité de ce système et appellent à des mesures de simplification. Une mesure simple consisterait à appliquer un taux unique décidé au niveau national et appliqué au m3.
3. L'impact des réseaux unitaires sur l'efficacité des traitements des eaux usées
Les eaux pluviales constituent la principale source de pollution lorsqu'elles sont collectées dans un réseau unitaire et se trouvent mélangées avec les eaux usées. Ainsi, la charge en matières en suspension des eaux de ruissellement est cinq à dix fois supérieure à celle des eaux usées domestiques rejetées par temps sec après traitement dans les stations d'épuration.
Le fait de mêler eaux pluviales et eaux usées perturbe également beaucoup le fonctionnement des stations d'épuration. La quantité à traiter n'est pas seulement en cause, la composition des eaux est très différente, avec notamment les pics de matières en suspension et une faible proportion de matières organiques, diminuant l'efficacité des traitements biologiques, notamment la nitrification (transformation biologique de l'azote).
Origine des pollutions dans un réseau
unitaire
|
Matières en suspension
|
Demande biochimique en
oxygène
|
Demande chimique en oxygène
|
Hydro-carbures |
Plomb (données 1992) |
|
|
Eaux de ruissellement |
50 % |
45% |
25 % |
50 % |
65 % |
|
Eaux usées |
30 % |
35 % |
55 % |
40 % |
10 % |
|
Dépôts en réseau (1) |
20 % |
20 % |
20 % |
10 % |
25 % |
(1) Dépôts remis en suspension avec la
pluie
Source : Encyclopédie d'hydrologie urbaine - B. Chocat
1992
Vaut-il mieux promouvoir un réseau unitaire ou un réseau séparatif ? La solution dépend essentiellement de l'histoire des collectivités et des conditions locales ( 81 ( * )).
C. L'ASSAINISSEMENT EN ZONE RURALE
1. L'assainissement collectif adapté aux petites collectivités
En application du décret 94-469 du 3 juin 1994, les communes de moins de 2.000 EH ne sont pas tenues d'avoir un système collectif de collecte des eaux usées. Mais, évidemment, il n'y pas de superposition entre assainissement non collectif et milieu rural. De même qu'une commune urbaine peut parfaitement prévoir une zone d'assainissement non collectif, une commune rurale peut parfaitement décider de se doter d'un système d'assainissement collectif. Le zonage en assainissement collectif signifie que, à terme, tous les terrains de la zone seront desservis par un réseau public collectif (82 ( * )).
Le choix d'une filière de traitement doit prendre en compte plusieurs facteurs techniques, financiers et environnementaux. Ce dernier volet constitue une démarche nouvelle pour la plupart des maires ruraux. Les performances sont très variables selon les techniques utilisées mais peuvent être proches de celles d'équipements plus importants (83 ( * )).
L'expérience montre cependant que les performances effectives sont souvent inférieures aux performances annoncées. Plus encore que dans les moyennes et grandes stations, les petites stations rurales se trouvent confrontées à plusieurs difficultés :
- Le mauvais dimensionnement . Le cas le plus fréquent en zone rurale est le surdimensionnement lié à trois effets : un optimisme sur l'évolution de la population, une définition de l'équivalent habitant (60 grammes de DBO5 par EH) peu adaptée aux secteurs ruraux. Le FNDAE propose d'ailleurs 50 grammes) et une évolution lente des raccordements. La réalisation des travaux de collecte est prévue en plusieurs tranches afin d'échelonner les dépenses et il est souvent constaté que après l'investissement réalisé sur la station, la totalité des tranches de collecte des eaux usées n'est pas réalisée.
- Le manque d'entretien et de surveillance . Par exemple, les filtres à sable doivent avoir des « périodes de repos » qui sont dans les faits peu respectées.
- La vulnérabilité aux surcharges hydrauliques liées aux événements pluvieux. Or, les coefficients de pointe sont d'autant plus élevés que la population raccordée est peu nombreuse.
- L'absence de prise en compte du sort de la filière boues. Quelle que soit leur taille, les stations produisent des boues et le problème du sort des boues reste posé. Dans les communes rurales, de plus en plus d'agriculteurs sont sensibles aux recommandations des organisations professionnelles et se refusent ou se rétractent à accepter l'épandage des boues. Autant de raisons qui militent pour une utilisation très raisonnée de l'assainissement collectif.
2. L'assainissement non collectif
a) Présentation générale
L'assainissement non collectif (ANC), dit aussi assainissement individuel, a sa place dans les dispositifs d'assainissement des communes (84 ( * )). D'une part, l'assainissement non collectif peut être une alternative intéressante à la mise en place coûteuse et risquée d'un système d'assainissement collectif. D'autre part, il est connu qu'un assainissement individuel bien réalisé et bien entretenu vaut mieux qu'un assainissement collectif mal conçu et mal entretenu. Enfin, même si l'assainissement individuel reste essentiellement un mode d'assainissement en milieu rural, ce type d'installation peut également convenir à des zones semi urbanisées voire à des zones urbaines pour éviter des raccordements coûteux. (Il existe encore quelques maisons individuelles de la proche couronne de la banlieue parisienne équipées de dispositifs d'assainissement individuel). On estime que 10 % de la population française soit 4 millions d'installations au total sont concernées par l'assainissement individuel.
Néanmoins, l'assainissement individuel est un défi pour de nombreuses communes.
Un défi juridique en premier lieu. Les communes se trouvent confrontées à des obligations juridiques nouvelles auxquelles elles sont très peu préparées. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 impose aux communes de réaliser un zonage entre zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif. Pour ce dernier cas, les communes doivent mettre en place un service public d'assainissement non collectif - SPANC- destiné à contrôler les ouvrages individuels (les ouvrages nouveaux et les ouvrages existants). Ce SPANC ne sera pas financé par le budget de la commune mais sera financé par une redevance prélevée sur les bénéficiaires du service, c'est à dire les personnes ayant un dispositif d'assainissement individuel.
On imagine aisément les difficultés de mise en oeuvre pratique et financières d'un tel service.
Un défi technique et environnemental en second lieu. Il est très vraisemblable que le bilan de ces contrôles ne soit pas satisfaisant.
Ainsi, des résultats disponibles jusqu'à
présent, il apparaît que si les différents
procédés présentent de bonnes performances à
l'installation, les contrôles réalisés par la suite
montrent cependant que 80 % des installations ne fonctionnent pas dans les
conditions souhaitables.
b) Les difficultés de l'ANC
Les défauts les plus fréquents sont les suivants :
Plusieurs erreurs sont faites au départ. La plupart des installations apparaissent rapidement sous dimensionnées. On note l'absence de prise en compte de la nature du sol. Quand le sol est perméable, l'infiltration a lieu sans difficulté, sur un sol imperméable, l'installation est très vite engorgée et l'épuration ne se fait plus. On déplore aussi un manque de professionnalisme au moment de l'installation. Les installateurs omettent par exemple de prendre en compte les caractéristiques du milieu très fermentescible qui crée des gaz de fermentation très corrosifs pour le béton ce qui n'est pas toujours pris en compte par les fabricants.
Il y a surtout un défaut général d'entretien. Les systèmes d'assainissement autonome sont les derniers postes auxquels s'attache un propriétaire individuel quand il fait construire (dans une opération de lotissement, l'assainissement n'est pas un bon argument de vente) En l'absence de nuisances personnelles graves, notamment olfactives, les systèmes restent en l'état sans entretien. Les performances épuratrices sont alors des plus limitées.
Ainsi, s'il est parfaitement exact qu'un système d'assainissement individuel bien réalisé et bien entretenu vaut mieux qu'un assainissement collectif mal conçu et mal entretenu, le problème vient du fait que l'assainissement individuel actuel n'est ni toujours bien réalisé et très rarement entretenu...
Il s'agit donc d'un défi majeur pour les petites collectivités rurales. Le choix de l'assainissement non collectif est une solution intéressante sous réserve que quelques dispositions soient prises.
La première voie est à chercher dans une action de formation et d'information. Il y a un immense besoin de formation et d'information technique et juridique des maires et des équipes de collectivités locales. Il serait souhaitable que l'Etat (ou le département ?) anime des structures de formation à partir d'un large partenariat réunissant les services de l'Etat, le centre national de formation du personnel territorial et l'association des maires, voire les associations professionnelles.
Le second volet concerne l'entretien. C'est le point d'achoppement des systèmes d'assainissement des petites collectivités. L'entretien des microstations appliquées à des immeubles ou des lotissements doit être amélioré. Il paraît nécessaire de réfléchir aux modalités d'une prise en charge collective de l'entretien des équipements. Un tel système peut être prévu dès l'origine. On peut ainsi prévoir une obligation pour le lotisseur de créer une structure associative qui aurait la responsabilité de l'entretien et qui devrait rendre compte régulièrement à la commune.
Enfin, on n'imagine pas que les collectivités rurales puissent réaliser leur SPANC sans l'appui massif d'autres collectivités territoriales. Le département paraît le mieux à même d'assurer ce rôle.
Notons que les systèmes de l'ANC dans la gamme 0-50 Equivalents/Habitants feront prochainement l'objet d'une norme européenne de produit et d'un marquage CE, qui devrait contribuer à améliorer le niveau des équipements mis sur le marché.
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 77 - Règles et échéances en matière d'assainissement
Annexe 78 - Etapes et procédures de traitement des eaux usées
Annexe 79 - L'élimination de l'azote et du phosphore
Annexe 80 - L'élimination des micropolluants dans les stations d'épuration
Annexe 81 - Les réseaux unitaires
Annexe 82 - Le cadre réglementaire : zonage et schéma d'assainissement
Annexe 83 - L'assainissement collectif en milieu rural
Annexe 84 - La réglementation de l'assainissement non collectif
II. LES SOUS PRODUITS DE L'ASSAINISSEMENT
A. LES EAUX USÉES APRÈS TRAITEMENT
1. La qualité des eaux rejetées
Une idée largement répandue dans le public et qu'il convient de corriger est que l'épuration des eaux est destinée à produire de l'eau potable. Sauf cas exceptionnel les eaux épurées sont renvoyées vers les rivières et réintègrent ainsi le cycle de l'eau. Plus en aval, l'eau de la même rivière pourra éventuellement être pompée pour la production d'eau potable : elle subira alors une série de traitements destinés à atteindre les normes de qualité relatives à l'eau potable, évidemment différentes des normes de rejets des effluents traités !
La directive européenne du 21 mai 1991 ainsi que la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 précisée par les décrets d'application du 29 mars 1993 et du 3 juin 1994 réglementent la qualité de l'eau rejetée par les stations d'épuration en tenant compte de la taille de la station et de la sensibilité du milieu - cours d'eau, plan d'eau, mer - qui reçoit les effluents rejetés par la station.
La sensibilité se réfère à l'importance du risque d'eutrophisation. L'eutrophisation est due à la prolifération de végétaux (notamment des algues) dans des eaux riches en nutriments (azote, phosphore) sous l'effet de la photosynthèse ; elle entraîne des risques d'asphyxie due à la respiration des végétaux, la production d'éléments toxiques pour la faune et une pollution dite organique liée à la décomposition des végétaux morts. Les plans d'eau, les estuaires et les eaux côtières difficilement renouvelées sont généralement considérés comme des milieux sensibles . Il faut y ajouter les eaux douces de surface destinées au captage d'eau potable et menacées d'un excès de nitrates. D'autres milieux, baies ouvertes, estuaires et eaux côtières avec un bon échange d'eau sont, au contraire, réputés peu ou moins sensibles (que la moyenne) s'ils peuvent accepter des rejets sans risque d'eutrophisation et sans diminution sensible de leur teneur en oxygène.
Les eaux rejetées dans des milieux qui ne sont réputés ni sensibles ni moins sensibles sont débarrassées de l'essentiel de leurs matières en suspension et de leur matière organique, afin de limiter les risques d'asphyxie des cours d'eau (la matière organique consomme l'oxygène) et leur dégradation visuelle. Des normes fixent des valeurs limites. Quand les eaux sont rejetées dans des milieux sensibles , il convient en outre d'éliminer les nutriments (azote et/ou phosphore) causes de l'eutrophisation. Les rejets dans les milieux moins sensibles peuvent faire l'objet de traitements plus sommaires que dans les deux cas précédents.
Des exigences notablement supérieures peuvent être imposées par les préfets pour protéger les usages des cours d'eau ou des plans d'eau qui reçoivent les rejets, notamment dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Une désinfection des eaux usées (visant à éliminer les micro-organismes pathogènes à proximité de lieux de baignade, par exemple) ou la suppression totale ou saisonnière des rejets (pour en finir avec l'eutrophisation de plans d'eau) peuvent être imposées. Ces cas étaient assez exceptionnels jusqu'à maintenant mais on observe une tendance vers plus de rigueur. Les préoccupations relatives aux micro-polluants organiques non éliminés actuellement par les stations d'épuration - notamment les résidus médicamenteux -, et dont on discerne encore mal les effets sanitaires, entraîneront vraisemblablement des renforcements des traitements à moyen terme.
La directive fixe aussi un calendrier de mise en conformité, avec des échéances qui s'étalent entre 2000 et 2005. Il est incontestable que sa mise en oeuvre a contribué à accélérer l'équipement des collectivités locales en moyens d'épuration. La pollution rejetée ne devrait plus constituer que moins du tiers de la pollution produite.
La qualité des rejets est contrôlée selon le principe de l'autosurveillance mais aussi par les agences de l'eau et les SATESE (services d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration).
Le résultat de cette généralisation de
l'équipement du territoire en moyens d'épuration est globalement
positif. Cependant, il conduit souvent à la dégradation des
petits cours d'eau. En effet, dans de nombreuses communes rurales,
l'assainissement individuel a été remplacé par un
réseau d'égout. L'assainissement individuel renvoit la pollution
dans le sol où, quand les conditions sont favorables, elle se
résorbe sans impact sur les ressources en eau. Les eaux usées
collectées doivent passer par une station d'épuration, puis elles
sont rejetées dans un cours d'eau - ou le lit d'un cours d'eau. Or, pour
des raisons de coût, la gestion des petites stations d'épuration
peut être assez aléatoire ; les dispositifs de
sécurité trop coûteux, de telle sorte que les pannes ont
pour effet des rejets massifs d'eau usée non traitée. De tels
incidents ont de graves conséquences pour la vie du cours d'eau,
particulièrement en période d'étiage.
2. La réutilisation des eaux usées
Réutiliser les eaux usées d'une collectivité consiste à récupérer les eaux issues des stations d'épuration, les stocker et les utiliser pour des usages variés qui n'exigent pas de l'eau potable: arrosage en milieu urbain, utilisations industrielles, irrigation agricole voire en recharge de nappe souterraine. Le principe de la réutilisation des eaux usées (REU) a été prévu par la loi sur l'eau de 1992 mais dans l'attente d'une réglementation fixant les conditions d'utilisation, quelques règles d'usage ont été proposées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (85 ( * )) .
La REU est une pratique très répandue dans les régions du Monde affectées par des pénuries de ressources en eau. En France, certaines collectivités commencent à réutiliser les eaux usées, soit afin d'éviter un prélèvement excessif sur d'autres ressources, soit dans le but d'éviter des rejets d'eaux usées dans un milieu fragile (86 ( * )) .
B. LES BOUES D'ÉPURATION
1. Présentation générale
a) La production de boues
Les boues sont les sous produits recueillis au cours des différentes étapes de la dépollution des eaux usées . Les boues sont constituées d'eau et de matières minérales et organiques sous forme de matières en suspension ou de matières dissoutes. Les boues sont un sous- produit de l'assainissement. Les traitements des eaux usées en station d'épuration génèrent plusieurs sortes de sous-produits. Il y a, d'une part, les refus de dégrillage, les matières de dessablage, les matières grasses du déshuilage qui sont éliminés dans le circuit des déchets municipaux, et, d'autre part, les boues qui résultent des dépôts de la pollution particulaire et des matières organiques dissoutes traitées.
Une station d'épuration génère trois catégories de boues. Les boues de traitement primaires produites par décantation des matières un suspension ; les boues de traitement physique ou chimique composées de matières organiques solubles ou colloïdales agglomérées dans les eaux traitées par addition d'un réactif coagulant (sels de fer ou d'aluminium) ; les boues issues du traitement biologique formées par les bactéries qui se sont nourries de matières organiques contenues dans les eaux usées.
1 m 3 d'eaux usées domestiques donne, après traitement, 350 à 400 grammes de boues de matières sèches.
On mesure la quantité de boues par leur siccité c'est à dire par la part des matières sèches qu'elles contiennent : 1.000 habitants génèrent 73.000 m 3 /an d'eau usées qui produisent après dépollution 15 à 25 tonnes de matières sèches. Une usine de 500.000 équivalents/habitants/produit environ 30 tonnes de matières sèches par jour. Elle doit donc évacuer chaque jour 100 tonnes de boues à 30% de siccité.
En application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, les collectivités locales vont être amenées à renforcer la collecte et le traitement des eaux usées. Tous les indicateurs montrent que la production de boues va augmenter dans des proportions significatives : la collecte des eaux usées et le rendement des stations d'épuration vont progresser, le taux de dépollution devrait passer de 42 % à 65 %. Avant que les recherches sur le traitement eaux usées sans boues n'aboutissent, l'importance des volumes ira en s'amplifiant avec les techniques de traitement des eaux usées de plus en plus poussées. On estime ainsi que la déphosphatation produit une masse de boues de 20 à 30 % supérieure à une filière sans déphosphatation.
Selon les industriels, entre la publication de la directive sur les eaux résiduaires urbaines de 1991 et l'échéance de 2005, la production de boues devrait augmenter de 50 % en France et doubler en Europe En France, le volume à traiter de l'ordre de 1 million de tonnes de matières sèches en 1998 passerait à 1,3 million de tonnes en 2005. Le volume à traiter en Europe serait de 15 à 20 millions de tonnes en 2005.
Face à cette évolution ; les possibilités d'utilisation des boues se restreignent. Jusqu'en 1998, les boues étaient dirigées vers trois filières : la mis en décharge pour 20 à 25 %, la valorisation agricole, pour 60 % et l'incinération pour 15 à 20 %. Ces options sont remises en cause.
D'une part, la mise en décharges -requalifiées de centres d'enfouissement techniques- est normalement réservée aux déchets ultimes c'est-à-dire aux déchets qui ne sont plus susceptibles d'être valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment. La mise en décharge devrait donc être réservée aux seuls centres munis de dispositifs de récupération de biogaz mais cette technique n'émerge pas.
D'autre part, malgré les recherches concordantes sur l'intérêt de l'épandage agricole, les garanties sur le contenu des boues et sur leur traçabilité, l'épandage des boues en agriculture est de plus en plus contesté.
Ainsi, la réglementation amène à produire
de plus en plus de boues tandis que dans le même temps, pour des raisons
politiques et sociales, les possibilités d'utiliser ces boues sont de
plus en plus limitées. Alors même que les besoins seraient
croissants et que les techniques pour améliorer la qualité des
boues produites sont connues et fiables, la réglementation des usages
des produits issus des boues reste figée. Le dossier boues est un
exemple des difficultés mais aussi des incohérences des
politiques publiques en matière environnementale. Le dossier boues est
probablement l'un des plus grands défis des prochaines
années.
b) Les caractéristiques des boues
Les boues se composent d'eau et de matières organiques et minérales qui séchées produisent des matières sèches (MS). Les boues sont ensuite dirigées vers trois filières : la mise en décharge, l'élimination (incinérations), la valorisation agricole (87 ( * )) .
Quelle que soit la destination finale, les boues en sortie de station subissent des traitements préalables consistant à réduire les volumes. Le volume des boues est lié à leur teneur en eau ou, inversement, leur teneur en matières sèches, dite aussi siccité. Une boue brute sans traitement contient 1 % de MS, une boue épaissie contient 5 % de MS. Une boue déshydratée contient 25 % de MS. Une boue sèche contient 90 % de MS.
La pratique la plus simple et la plus courante consiste à épandre les boues sur des terres cultivées. C'est ce qu'on appelle l'épandage agricole. Cet épandage est lié à la valeur agronomique des boues d'épuration. A l'inverse, les boues contiennent aussi des éléments indésirables qui doivent être contrôlés et limités.
- L'intérêt agronomique des boues
En premier lieu, les boues sont utilisées comme engrais. Les plantes fabriquent leurs aliments à partir du carbone et de l'oxygène de l'air par le mécanisme de la photosynthèse. Mais il leur faut aussi de l'eau et des nutriments qu'elles prélèvent dans le sol (azote, phosphore, potassium...) ainsi que des oligo-éléments qui sont des éléments traces devant être consommés en très petites quantités (fer, manganèse, cuivre...).
La matière sèche contenue dans les boues renferme la plupart de ces éléments nutritifs utiles aux plantes, notamment l'azote, le phosphore, le calcium.
Certaines boues ont ainsi des compositions voisines de celles des engrais achetés pour l'agriculture. Elles présentent un intérêt d'autant plus grand que les boues sont livrées gratuitement par les producteurs des boues (livraison dite « rendue racine »). La valorisation agricole des boues peut même constituer une économie par rapport à l'achat de fertilisant.
En second lieu, les boues sont utilisées comme amendement. Le rôle de l'amendement n'est pas d'apporter des éléments nutritifs aux plantes mais d'améliorer la structure du sol. Les amendements agissent sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol. Ils permettent de réduire l'acidité du sol (amendement par des boues chaulées), de réduire la battance des sols limoneux (séchage du sol à l'origine de la formation de croûtes). Ils améliorent ainsi la structure du sol et entretiennent la teneur du sol en humus évitant ainsi un phénomène d'érosion.
- Les contaminants chimiques
Les contaminants chimiques sont essentiellement les métaux lourds présents dans les boues sous forme d'éléments traces. Il s'agit essentiellement du cadmium, du mercure, du plomb, du zinc... L'essentiel des contaminations chimiques vient des rejets industriels et dans une moindre mesure des rejets domestiques (utilisation de solvants de déchets de bricolage...). Toutes ces valeurs sont étroitement réglementées avant éventuel épandage et supposent par conséquent un strict contrôle des rejets des eaux usées.
Les transferts d'éléments traces métalliques dépend de leur aptitude à être libérés dans l'eau du sol et leur faculté d'assimilation par la plante. Il existe des grandes différences d'assimilation selon les plantes et selon les sols. L'importance des métaux lourds dans les boues des stations d'épuration a fait l'objet d'une partie du précédent rapport de votre rapporteur (« les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé » - doc. AN 11 ème législature n° 2979 - Sénat 2000-2001 n° 261).
L'étude a notamment été menée sur le cadmium. Il est aujourd'hui établi que les boues n'apportent pas plus de cadmium que les engrais, que les teneurs de cadmium des grains de maïs cultivés sur des boues ne sont pas plus élevées (au contraire !) que sur les parcelles fertilisées par engrais chimiques classiques. Cet effet limité viendrait notamment du fait que les boues contiennent aussi du zinc qui diminue l'absorption du cadmium.
- les microorganismes
Enfin, les boues contiennent des milliards de microorganismes vivants dont une partie est pathogène : virus, bactéries protozoaires, champignons, etc... La plupart viennent des excréments d'origine humaine ou animale.
Il faut cependant noter que l'épandage des boues d'épuration ne constitue pas des circonstances favorables à la survie des microorganismes pathogènes qui sont pour la plupart mal adaptés au milieu extérieur. L'épandage accélère leur destruction en les soumettant aux variations climatiques et aux effets du sol. La plupart des microorganismes ont une durée de vie limitée dans le sol. Seuls certains organismes comme les vers parasites peuvent prendre des formes de résistance
2. La valorisation agricole des boues
a) Les conditions de la valorisation agricole
Cette valorisation suppose de faire la part entre l'intérêt agronomique des boues et des éléments indésirables, tels que métaux lourds et contaminations pathogènes.
D'une part, les contaminations chimiques doivent être évitées par une action de prévention visant à réduire les rejets polluants. Cela suppose une bonne connaissance du milieu pour identifier les principaux rejets polluants industriels. Les contaminations d'origine domestique sont moins importantes mais plus difficiles à maîtriser. La prévention passe par une action de sensibilisation, pour éviter les rejets toxiques dans les eaux usées (solvants, peintures, acides...). On citera aussi le cas des pollutions artisanales ou issues des professions libérales, notamment des rejets mercuriels issus des cabinets dentaires (liés à l'utilisation d'amalgames dentaires) qui représentent des masses insoupçonnées et facilement disqualifiantes. Au cours d'une précédente étude de l'office sur les effets de l'amalgame dentaire sur la santé, quelques évaluations avaient été faites : un dentiste rejette entre 100 et 200 grammes de mercure par an ; les sédiments mercuriels présents dans les égouts sont évalués entre 16 et 33 tonnes ! Les rejets d'un ou deux cabinets dentaires peuvent disqualifier des boues pour un éventuel usage agricole
Les contaminations microbiologiques ne peuvent être prévenues en amont des rejets puisque les éléments pathogènes sont indissociables des rejets des eaux domestiques. L'élimination des risques passe cette fois par les procédés de traitement des eaux usées sous forme de stabilisation ou d'hygiénisation. Une montée en température accompagnée, le cas échéant, de la transformation du milieu pour le rendre impropre à la survie des micro-organismes (élévation du pH par chaulage par exemple) ce qui permet de détruire ces éléments indésirables.
b) Le blocage
La valorisation agricole des boues a été le moyen le plus simple et le plus courant d'utiliser ces boues. D'une part, le gestionnaire des stations trouvait un moyen économique d'évacuer les boues. D'autre part, même si la profession agricole s'en défend souvent, les boues présentent un intérêt agronomique pour l'agriculteur dans la mesure où les boues peuvent avoir des caractéristiques voisines de celles des engrais.
Encore faut-il reconnaître que les avantages que chacun tire de l'épandage des boues sont inégaux. Sans nier l'intérêt agronomique des boues, il faut admettre que l'épandage est une solution qui intéresse avant tout le producteur de boues (l'épandage lui évite notamment d'avoir à recourir à l'incinération dont le coût est considérablement plus élevé que le coût de l'épandage). La pratique montre d'ailleurs que la profession agricole sait parfaitement faire valoir ce service rendu à la collectivité
Cette situation est aujourd'hui bloquée.
Une conjonction particulière d'événements survenus dans le domaine agricole et agro alimentaire tend à freiner l'épandage en agriculture. Les critiques croissantes portées à l'encontre des agriculteurs sur les dommages qu'ils entraîneraient sur l'environnement n'est pas de nature à infléchir cette position.
Nous avons déjà eu l'occasion d'analyser ce blocage dans notre précédent rapport sur les métaux lourds où nous évoquions le phénomène du « parapluie gigogne » où chacun à son niveau prend une marge de sécurité supplémentaire par rapport à son prédécesseur (Union Européenne - Etat membre - industrie agro alimentaire,- coopérative agricole - agent de plaine et agriculteur) de telle sorte qu'à la fin, au stade ultime chez l'exploitant, celui-ci, en application du principe de précaution n'accepte plus les boues. Cette contestation est inégale selon les régions car certains agriculteurs restent « preneurs de boues », mais le mouvement de fond va incontestablement dans le sens d'une restriction des possibilités d'épandage.
Les nombreuses garanties offertes sur le plan réglementaire paraissent contre productives . L'épandage des boues est soumis à de très nombreuses conditions visant à assurer la traçabilité du produit (avec tenue d'un cahier d'épandage, prévision d'un plan de fumure...). Malgré ces garanties ou peut-être à cause d'elles, les réticences demeurent et les oppositions se multiplient. Ces garanties sont autant de procédures pénalisantes pour celui qui accepte l'épandage.
Pas plus que les procédures mises en oeuvre, les nombreuses garanties scientifiques (88 ( * )) ne parviennent à enrayer ce phénomène
Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'il existe dans le même temps un besoin non satisfait de matière organique dans le sol pour éviter les phénomènes d'érosion.
3. Un constat préoccupant : le déficit des sols en matières organiques
La dégradation de la qualité de la ressource en eau est avérée. Mais après l'air, puis l'eau, d'autres défis, d'autres menaces apparaissent. La prise de conscience de la dégradation de la qualité des sols est récente, mais le constat est aujourd'hui établi : les sols manquent de plus en plus de matière organique.
La matière organique constitue en moyenne de 5 à 10 % du sol (la plus grande partie du sol étant les particules minérales). Cette matière organique est composée d'humus (70 % à 90 %) et d'une fraction active issue de la décomposition des débris végétaux, notamment sous l'action des micro-organismes vivants. La matière organique libère les composés minéraux issus des débris végétaux.
La matière organique a trois fonctions dans le sol. Elle constitue une ressource pour la nutrition des plantes (carbone, azote, phosphore et sels minéraux), elle augmente la capacité de rétention d'eau, et elle stabilise la structure du sol. Un déficit de matière organique est aisément repérable par la formation d'une « croûte de battance », suivie de ravine, éléments précurseurs d'une érosion des sols.
Ce phénomène est préoccupant à deux titres. En premier lieu, il favorise le ruissellement des eaux de pluies. Un sol labouré est trente fois plus perméable qu'un sol rendu imperméable par une croûte de battance. L'infiltration, qui est de l'ordre de 30 millimètres par heure pour un sol labouré n'est plus que de un millimètre par heure. Ce ruissellement qui aboutit aux rivières entraîne une augmentation de la turbidité de l'eau. Beaucoup de responsables ont ainsi relevé l'augmentation générale de la turbidité des eaux brutes. Or, cette turbidité est statistiquement associée à des risques de contamination microbienne et réduit l'efficacité des traitements d'eau. Même si les études sont encore balbutiantes, il existe vraisemblablement un lien entre dégradation de la qualité du sol et dégradation de la qualité de l'eau.
En second lieu, lorsque les conditions s'y prêtent, le sol devenu instable peut être emporté par les ruissellements. Les coulées de boues sont évidemment dues aux événements pluvieux de type torrentiel, mais peuvent être aussi le signe d'une érosion des sols. Entre 1985 et 1995, près de 6.000 communes ont été affectées par une coulée boueuse.
Le déficit de matière organique est avéré lorsque la proportion de matière organique est inférieure à 2 % du sol. Si toutes les régions de France sont touchées par cette diminution, les situations de carence de matière organique se retrouvent dans trois régions principales : le grand Sud-ouest, au-dessous d'une diagonale comprise entre Bordeaux et Béziers, le couloir rhodanien, et la région des grandes cultures qui couvre le bassin parisien et la région Centre.
Ce phénomène se retrouve aussi dans les départements d'outre mer. L'évolution de l'activité agricole avec l'abandon de l'élevage au profit des grandes cultures fruitières a entraîné une diminution des apports de matière organique. Au cours de cette mission, il a même été évoqué une situation où un exploitant agricole s'était trouvé obligé d' importer de la matière organique de métropole et d'Amérique du Sud !
Une augmentation de 10 % de la matière organique dans les sols déficitaires nécessiterait un apport annuel de matière organique compris entre 3,7 et 5,5 millions de tonnes. Ce besoin n'est pas couvert aujourd'hui par les apports de matière organique, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau suivant :
|
Besoin en matières organiques :
|
Disponibilité de matières organiques :
200.000 tonnes d'amendements industriels
Total : 1 million de tonnes |
Source : communication INRA/Vivendi/ONYX/ORVAL - Assises nationales des déchets d'Agen - septembre 2002
Les besoins sont donc largement supérieurs aux disponibilités actuelles et cette évolution ne peut se poursuivre sans dommage grave. Il s'agit d'un défi agricole et environnemental.
Tout comme la loi sur l'eau de 1992 avait déclaré l'eau patrimoine de la nation, il paraît nécessaire aujourd'hui de qualifier à son tour le sol, patrimoine de la nation. Ce patrimoine doit être préservé.
4. Quelles solutions ?
La situation actuelle est totalement paradoxale. Alors que les besoins en matières organiques apparaissent, que les garanties sur la qualité des boues s'accroissent, les refus d'épandage se multiplient. Alors que les communes éprouvent de plus en plus de difficultés à créer des équipements de traitement thermique des ordures ménagères, notamment des incinérateurs, l'une des voies conseillées pour éliminer les boues qui contiennent au départ plus de 95 % d'eau est de les brûler ! N'y aura-t-il pas d'autre issue que l'incinération des boues dont le coût est de 50 % à 100 % plus cher que celui de l'épandage ?
Le doute quant à la qualité et la parfaite innocuité du produit et les difficultés pratiques d'épandage conduisent à cette situation de blocage.
Lever le doute et en finir avec la complexité est possible.
La valorisation des boues passe par la définition technique et juridique d'un nouveau produit issu des boues.
Le point de départ du blocage est clairement identifié : il s'agit de l'article 2 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées : « les boues (issues des installations de traitement des eaux usées) ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 ». Certes, le décret fait échapper à la réglementation les produits composés en tout ou partie de boues qui bénéficient d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente. Mais il s'agit d'une exception et à notre connaissance, seule la commune de Saint Brieuc aurait entamé une procédure visant à disposer de cette homologation (89 ( * )).
Il faut revenir sur cette situation et distinguer clairement les boues brutes issues des stations qui sont des déchets, et les produits issus des boues hygiénisées et/ou compostées sur des supports carbonés qui respectent des normes de qualité et qui sont une véritable matière première fertilisante, comparable à un engrais. La future réglementation pourrait utilement s'inspirer de la classification retenue pour définir les mâchefers issus d'incinération qui distingue les mâchefers valorisables directement , les mâchefers valorisables après maturation et les mâchefers non valorisables.
Les produits issus des traitements des eaux usées sur
ce modèle seraient répartis en trois catégories : les
boues non valorisables destinées à être
éliminées, les produits issus des boues hygiénisées
et les produits issus des boues compostées sur un support
carboné, qui eux, sont des produits et des matières
premières secondaires.
5. L'élimination des boues
Il existe plusieurs situations où la valorisation agricole n'est pas possible : boues en trop grandes quantités, manque de surfaces d'épandage, refus d'épandage, ou plus généralement, qualité insuffisante des boues et des sous produits (teneurs en métaux lourds...). Dès lors que la mise en décharge n'est plus possible, la solution ultime consiste à éliminer les boues. Cette élimination peut passer par le traitement thermique.
Le traitement thermique le plus courant consiste à incinérer les boues, préalablement séchées, soit dans des installations dédiées à l'incinération des boues, soit en co-incinération avec d'autres déchets (ordures ménagères). Cette solution est de plus en plus compromise compte tenu des difficultés de mise en place des usines d'incinération et des techniques alternatives, comme la thermolyse, assimilées à tord à l'incinération. Le coût de l'incinération est de l'ordre de 50 à 100 % plus cher que celui de l'épandage agricole avec d'importantes différences liées aux économies d'échelle dans les grandes stations (seule la co-incinération de boues pâteuses avec les ordures ménagères se situe à des niveaux de coûts comparables avec ceux de l'épandage de boues pâteuses chaulées pour les grandes stations de plus de 300.000 habitants).
Une nouvelle voie est ouverte avec le traitement thermique par voie humide. L'oxydation (le brûlage) a lieu en milieu liquide, sous pression et avec un apport d'oxygène. La matière organique présente dans les boues peut être soit détruite par chauffage à haute température à haute pression, soit transformée en matière soluble dans l'eau. Le principal intérêt de ce type de traitement est d'une part de travailler à partir des boues seulement épaissies et non séchées ou déshydratées, d'autre part de donner un sous produit très réduit et totalement inerte. La société OTV possède un démonstrateur dans la ville de Toulouse. La ville de Bruxelles vient de se doter d'un équipement de ce type (90 ( * )).
Pour en savoir plus sur cette partie, voir aussi les annexes suivantes consultables à l'adresse ( http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-2.html ) :
Annexe 85 - La réglementation de la réutilisation des eaux usées
Annexe 86 - La réutilisation des eaux usées urbaines
Annexe 87 - Les procédés de traitement des boues
Annexe 88 - L'épandage des boues : est-il potentiellement dangereux ?
Annexe 89 - La réglementation des boues d'épuration
Annexe 90 - Les nouveaux procédés de traitement thermique des boues : l'oxydation par voie humide
CHAPITRE IV - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
A. UN DOUBLE CONSTAT D'ÉCHEC
1. Le bilan très médiocre des actions de protection de la ressource
Les réglementations relatives à la protection des eaux et les actions de prévention des pollutions diffuses ont, au mieux, un bilan médiocre. Lorsqu'un contrôle fait apparaître que 10 % seulement des prélèvements d'eau sont régulièrement déclarés ou autorisés, lorsque l'on constate que guère plus d'un tiers des captages fait l'objet de périmètres de protection, alors qu'il s'agit, pour certains captages, d'une obligation légale vieille de près de 40 ans, lorsque la police de l'eau, handicapée par une organisation anarchique, est absente ou inefficace, lorsque les sanctions ne sont que théoriques, lorsque la loi est régulièrement bafouée et n'est pas appliquée parce qu'elle est inapplicable, alors tout confirme que la protection des eaux, souvent présentée comme une priorité, n'en est pas une .
Les propositions doivent s'inspirer de quelques idées simples. D'une part, il paraît inutile de poursuivre dans des voies qui ont montré leurs limites. Quand une loi n'est pas appliquée pendant 10 à 30 ans, il y a peu de chance qu'elle le devienne sans modification substantielle. La principale modification attendue par tous - par ceux qui gèrent l'eau et par ceux qui la contrôlent-, est la simplification. Aucune réforme ne sera efficace si elle ne parvient pas à simplifier cet enchevêtrement inextricable de dispositions inapplicables.
D'autre part, il n'y a pas d'application efficace qui ne soit soutenue par une volonté politique forte. Il peut être observé que les règles de protection de la ressource sont à peu près les mêmes pour les trois secteurs impliqués dans la qualité de l'eau : l'industrie, les collectivités locales et l'agriculture.
Mais l'efficacité repose sur trois piliers : l'image que souhaite donner une profession, la réglementation et les subventions, ou, en d'autres termes, le désir, la contrainte et l'argent. Quand l'un manque, le succès tarde. Quand les trois sont coordonnés, les résultats apparaissent. Le succès de l'industrie est sur ce point incontestable. La volonté de changer d'image, d'éviter d'être en position d'accusé, la réglementation des installations classées et les subventions des agences de l'eau ont permis des améliorations très sensibles des rejets industriels. Il en va de même pour les collectivités locales qui ont massivement investi dans l'assainissement des eaux usées, longtemps responsables d'une part importante des pollutions des cours d'eau. Même si des accidents restent possibles, même si des efforts restent à conduire, les avancées dans ces deux secteurs sont significatives.
C'est au tour maintenant de l'agriculture de faire sa révolution environnementale .
Elu local depuis trente ans, agriculteur de formation, c'est avec regret que je voyais l'agriculture au banc des accusés, alors qu'elle avait atteint les objectifs que la collectivité lui avait fixés il y a quarante ans. L'agriculture n'est pas seule en cause. La ressource en eau est dégradée parce que l'environnement est dégradé ; il existe aussi de multiples sources de pollutions ponctuelles, individuelles, qui sont dédaignées. L'origine des pollutions est multiple et les responsabilités sont partagées mais il ne faut non plus nier l'évidence : l'agriculture est bien à l'origine de la plupart des pollutions en cause aujourd'hui.
La prise de conscience fait son chemin. Le temps de l'action est venu. La reconquête de la qualité de l'eau se fera avec les agriculteurs et grâce à eux, ou ne se fera pas.
2. L'inadaptation du cadre communal
La gestion de l'eau dans la France d'aujourd'hui est articulée autour de deux structures : une compétence locale au niveau des communes, et une réflexion et une planification régionale au niveau du bassin versant. La première a deux siècles et vient de la Révolution française. La seconde est issue de la première grande loi sur l'eau de 1964. Ces deux niveaux sont aujourd'hui intouchables.
Et pourtant...
Il est délicat et même audacieux de revenir sur cette situation, aujourd'hui solidement appuyée sur des milliers de syndicats intercommunaux des eaux, c'est-à-dire aussi des milliers de présidents de syndicats, des milliers de secrétaires, des milliers de parts de pouvoir constituant autant de réticences aux changements et d'occasions de blocage.
Une situation d'autant plus embarrassante que ces structures constituées au coup par coup s'enchevêtrent (syndicats de pompage des eaux, de barrage, de distribution , d'assainissement) sans rapport avec les autres structures intercommunales plus ambitieuses que sont les communautés de communes par exemple.
C'est même avec appréhension et peine que votre rapporteur, élu local depuis trente ans, ose avancer quelques propositions contre ses propres amis et tout ce qui fit sa vie, mais il ne semble pas que l'échelon communal soit aujourd'hui l'échelon le mieux adapté à la gestion des eaux.
Comment avoir des attentes du XXIème siècle avec des technologies du XXème et des mentalités du XIXème siècle ? Comment ne pas voir que l'action de préservation de la ressource exige des moyens qu'une commune, qu'un petit groupement de communes, ne peut avoir ? Comment ne pas admettre que les traitements des eaux exigent des techniques sophistiquées et surtout un entretien qui ne sont plus accessibles à la plupart des communes. ? Comment ne pas craindre que les communes rurales en particulier, ne soient les plus vulnérables parce que les plus fragiles aux pollutions bactériologiques et les moins contrôlées ?
La France ne gagnera pas la bataille de l'eau si elle ne parvient pas à réduire le nombre d'acteurs. En matière d'environnement et dans le domaine de l'eau en particulier, il faut reconnaître que la commune est probablement un maillon faible dans l'organisation.
Votre rapporteur considère qu'entre les communes et le bassin versant, il y a place pour une structure intermédiaire : le département. Le département, sur ce sujet, a deux atouts : c'est à la fois une structure de proximité qui a les moyens de conduire une véritable stratégie territoriale de préservation de la ressource. La planification doit rester au niveau du bassin versant et les agences de l'eau sont aujourd'hui des outils irremplaçables dans l'élaboration de stratégies globales mais le département est probablement l'un des meilleurs niveaux opérationnels.
Cette action du département doit aller bien au-delà des schémas d'aménagement des eaux (SAGE), simple déclinaison des Schémas directeur d'aménagement des eaux (SDAGE). Elle doit aller bien au-delà des services d'assistance mis en oeuvre pour aider les communes à élaborer leurs schémas d'assainissement (SATESE...).
Cette implication des départements peut se faire dans trois directions.
D'une part, la volonté politique pourrait passer par la définition dans chaque département, de ressources stratégiques préservées, « sanctuarisées » même, dans le cadre de « zones de protection des eaux ». Cela implique une solidarité intercommunale, et une péréquation des charges et des coûts que seul le département peut assurer.
D'autre part, le département peut devenir une véritable structure de gestion ou, à défaut, de coordination des instruments de gestion de la ressource en eau et de la potabilisation des eaux (l'assainissement restant dans le domaine communal, essentiellement pour des raisons techniques). L'une des missions serait de regrouper les structures communales, et peut-être parvenir à créer, dans les 10 ans, un syndicat départemental de l'eau sur le modèle des syndicats départementaux des déchets Cela ne sera pas possible partout mais si cela est possible, cela doit être fait.
Enfin, ce mouvement doit s'inscrire dans un vaste mouvement de décentralisation dans le domaine environnemental qui suppose une redistribution des moyens, financiers et humains, entre l'Etat, auquel incombe la police de l'eau, et les départements et les régions.
B. PROPOSITIONS
1. Définir l'eau comme un enjeu stratégique
Constat - La dégradation de la qualité de la ressource est quasi générale. Les mélanges d'eau qui permettent de traiter une eau de qualité acceptable ne constituent pas une solution durable. L'eau constitue un enjeu stratégique et doit être au coeur des politiques de développement et d'aménagement du territoire. Tout indique que la priorité annoncée sur la protection de la ressource en eau n'en est pas une. Elle doit le devenir.
Proposition 1
L'eau doit être définie comme un enjeu
stratégique et être au coeur des politiques de
développement et d'aménagement du territoire.
2. Déterminer des zones de sanctuarisation des ressources stratégiques
Constat - Les actions de reconquête sont trop limitées et trop peu efficaces pour que l'on puisse s'en satisfaire.
Proposition 2
Créer dans chaque département de véritables « zones de protection des eaux » où les ressources stratégiques seraient sanctuarisées et protégées sur le plan quantitatif et qualitatif, et dans lesquelles toutes les activités seraient étroitement mais sérieusement contrôlées.
Proposition 3
En dehors de ces zones de protection des eaux, la
prévention de la qualité de la ressource doit être
sérieusement revue.
3. Fixer un objectif géographique de reconquête de qualité
Constat - L'artificialisation du territoire progresse chaque année de 1,6 %. A chaque avancée de l'urbanisation doit correspondre une protection équivalente de la ressource en eau.
Proposition 4
L'objectif politique serait de parvenir à classer
1 % du territoire de chaque département en « zone de
protection des eaux » ou « zone de sanctuarisation des
eaux », (dans tous les départements où cela n'est pas
impossible).
4. Etablir des protections des cours d'eau
Constat - Les périmètres de protection ne sont pas adaptés aux pollutions diffuses d'origine agricole qui affectent notamment les cours d'eau.
Proposition 5
Introduire des servitudes sur les rives des cours d'eau en zone agricole, établissant des sortes de « couloirs de protection », encadrant strictement les cultures génératrices de pollution et favorisant, avec compensations financières, la création de zones tampon boisées ou enherbées, frein efficace et peu coûteux aux transferts des pollutions agricoles.
Proposition 6
Favoriser, dans les zones rurales, le rachat de rives des cours d'eau par les collectivités locales, après un travail de cadastre permettant un redécoupage parcellaire.
5. Réformer la politique de prévention des pollutions diffuses d'origine agricole
Constat - Il faut dresser un bilan des actions de prévention des pollutions notamment d'origine agricole. L'agriculture n'a pas fait sa révolution environnementale. Elle doit la faire. Les outils réglementaires et/ou incitatifs sont au mieux décevants. Les mesures doivent être prises afin d'assurer une mobilisation urgente et massive de la profession agricole.
Proposition 7
Envisager un recours plus systématique à
l'éco-conditionnalité, qui consiste à subordonner le
paiement de soutiens à l'agriculture, au respect de pratiques
environnementales.
6. Préserver la ressource souterraine en contrôler mieux les prélèvements d'eau
Constat - Tandis que l'eau de surface est perçue comme un bien collectif, curieusement, l'eau des nappes est perçue comme le prolongement de la propriété individuelle. Il faut affirmer clairement que l'eau est le patrimoine de la nation, qu'elle soit ou non sous une propriété individuelle.
Proposition 8
Réformer le régime de déclaration/autorisation des forages en généralisant le système des déclarations de forages assorti de conditions d'exploitation.
Le principe de déclaration des forages doit prévaloir. Le régime de l'autorisation est inadapté compte tenu de la disponibilité des services instructeurs. La procédure pourrait être déconcentrée. Les déclarations pourraient être faites en mairie ,
- ce régime très simple et libéral doit être conditionné à la pose obligatoire de compteurs,
- tous les forages, y compris les forages familiaux devraient ainsi être déclarés,
- Ces forages doivent être réalisés par des entreprises respectant une charte de qualité. Ils doivent être entretenus et vérifiés régulièrement,
- sur le modèle des contrôles de l'exposition au plomb, à l'amiante ou aux termites, les mutations de propriété pourraient être subordonnées à la vérification et au respect de ces règles.
- réserver la procédure plus lourde de
l'autorisation
au niveau départemental aux forages les
plus importants mais aussi aux zones de sanctuarisation de la ressource.
7. Prévenir les pollutions individuelles en milieu rural
Constat - Un forage abandonné constitue une colonne à pollution.
Proposition 9
Prévoir, en cas d'abandon de forage pour des raisons de
pollution de la ressource, que les forages doivent être rebouchés
et cimentés.
8. Réformer le régime des périmètres de protection
Constat - L'instrument juridique des périmètres de protection n'est pas adapté aux enjeux actuels de la dégradation de l'eau. En particulier, il n'est pas adapté aux pollutions diffuses. Dans le cas où cet instrument serait conservé, il convient de le réformer profondément. La loi n'est pas appliquée. 7 ou 36 ans selon les cas, après qu'ils aient été rendus « obligatoires », un tiers seulement des points de captages bénéficie des périmètres de protection.
Proposition 10
Simplifier le régime des périmètres de protection.
Concernant les périmètres de protection immédiats, permettre leur adoption par simple arrêté du maire après avis technique.
Concernant les périmètres de protection rapprochés, réserver les enquêtes publiques aux prélèvements les plus importants, les propriétaires concernés étant prévenus par voie individuelle et supprimer l'obligation de publication de servitudes avec hypothèques, l'information du public étant assurée par une annexe du Plan Local d'Urbanisme.
9. Réformer en profondeur l'organisation de la police de l'eau
Constat - L'Etat aujourd'hui a, dans le domaine de l'eau, deux missions : une mission de conseil et une mission de contrôle, et n'est pas en mesure d'assurer l'une et l'autre dans des conditions satisfaisantes. Plus de 500 services de l'Etat participent à la police de l'eau. Cette organisation, ou plutôt cette inorganisation, n'est pas à la hauteur des enjeux.
Proposition 11
L'Etat doit être avant tout le garant de la qualité de l'eau. Sa mission de contrôle est primordiale. Il faut à cette fin créer une véritable police de l'eau, au niveau régional, avec antennes départementales, sur le modèle des DRIRE.
Ce contrôle ne pourra être efficace que s'il est
assorti de sanctions réelles et dissuasives. Les barèmes doivent
être revus à cet effet.
10. Réformer en profondeur l'organisation de la gestion locale de l'eau
Constat - Ni les communes, ni même les structures communales traditionnelles ne sont l'échelon pertinent pour la gestion de l'eau ou la prévention des pollutions. On ne peut avoir des attentes du XXI ème siècle, avec une organisation du XX ème et des mentalités du XIX ème siècle.
Proposition 12
Faire du département, ou au moins expérimenter dans un département pilote, le gestionnaire de l'eau afin de parvenir à terme, à une qualité de l'eau et un prix de l'eau homogènes dans le département.
Engager dans chaque département, le regroupement des
structures communales et intercommunales de gestion de l'eau et parvenir,
lorsque cela est possible, à l'institution de syndicats
départementaux de gestion de l'eau sur le modèle des syndicats
départementaux de gestion des déchets (élimination des
ordures ménagères).
11. Mieux informer l'usager
Constat - La population s'estime mal informée sur la qualité de l'eau. Certains outils d'information sont inadaptés : affichage en mairie sur des critères incompréhensibles du grand public, présentation d'un rapport annuel sur la qualité du service de l'eau qui ne donne aucune indication sur la qualité de l'eau distribuée, information administrative de type binaire (bon/mauvais) basée sur le respect des valeurs réglementaires ne donnant pas d'indication sur la dégradation...
L'information par l'intermédiaire des médias généralistes est utile mais peut donner une vision erronée des situations en donnant un retentissement national à des difficultés localisées.
Proposition 13
Etablir un diagnostic des dispositifs existant en
matière d'information sur l'eau, en mairie et auprès des
abonnés et repenser l'information en abandonnant les pratiques inutiles
et en répondant aux vraies préoccupations des usagers sur la
qualité et l'évolution de la qualité de l'eau qu'ils
reçoivent.
12. Mieux former le citoyen
Constat - Il y a une grande méconnaissance des composantes et des risques liés à l'eau. L'eau est devenue un dossier émotionnel qui laisse une large part à l'irrationnel. Les vrais risques sont cependant mal évalués. Il y a une confusion entre le risque environnemental et le risque sanitaire mais la peur est le créneau des marchands d'illusions. Beaucoup s'y engouffrent pour vendre du papier, des filtres ou des bouteilles. Il y a une part de vérité mais souvent beaucoup d'excès dans ces réactions.
Proposition 14
La formation aux questions environnementales doit commencer à l'école. Il serait souhaitable que l'éducation nationale envisage une meilleure intégration des questions d'environnement dans les programmes de géographie, susceptibles de faire l'objet de contrôle au baccalauréat.
Proposition 15
Cette formation générale doit être
complétée par une formation technique aux différents
niveaux impliqués dans la qualité de l'eau. Qu'il s'agisse de la
formation dans les établissements d'enseignement agricole, dans les
centres de formation du personnel territorial, dans l'école de
magistrature.
13. Préparer l'application des normes européennes
Constat - La quasi totalité des normes appliquées en France est d'origine européenne. Ces normes, jusqu'à présent, ont pris la forme de règlements du Conseil adoptés par les Etats membres. Malgré cet accord des Etats, au moins implicite, beaucoup de normes sont considérées par la suite comme des contraintes. Il y a probablement un manque de préparation auquel il serait utile de remédier.
Proposition 16
Il convient de créer une véritable équipe de négociateurs techniques et scientifiques formés aux négociations internationales. Il y a en France un grave manque en ce domaine.
Proposition 17
Concernant l'application de la norme plomb (10 ug/l à
l'échéance 2013), qui exige le changement des branchements et des
conduites intérieures en plomb, il est proposé de surseoir
pendant quelques années à l'obligation de ravalement, pour les
immeubles qui doivent changer leurs canalisations en plomb, afin de permettre
aux propriétaires de réaliser ces modifications.
14. Agir sur la qualité du sol
Constat - Une partie de la dégradation de la qualité de l'eau à l'arrivée des installations de potabilisation est liée à la turbidité. Ce phénomène, amplifié par les pluies violentes et d'une façon générale les excès climatiques, est dû en particulier à la dégradation de la qualité des sols et à leur érosion.
Proposition 18
Qualifier le sol patrimoine de la nation au même titre que l'eau, qualifiée ainsi dans la loi du 3 janvier 1992.
15. Donner un statut aux boues de stations d'épuration
Constat - Il y a un déficit de matières organiques dans les sols intensément exploités en agriculture. Cette matière organique peut être apportée par les boues de stations d'épuration, sous réserve que les éléments indésirables soient éliminés soit par un contrôle en amont de la qualité des eaux entrantes en stations d'épuration (prévention contre les métaux lourds), soit par un traitement assurant l'hygiénisation des boues. Cette situation n'est guère possible aujourd'hui dès lors que les boues sont qualifiées de déchets.
Proposition 19
Sortir les boues de leur statut de déchets et
distinguer les boues déchets, qui doivent être
éliminées, des boues hygiénisées ou
compostées qui constituent des réserves de matières
organiques insuffisamment exploitées et qui sont des produits utiles
à la valorisation des sols.
16. Simplifier la tarification de l'eau
Constat - La redevance pour détérioration de la qualité de l'eau dite aussi « redevance pollution » est l'une des principales redevances payés par les usagers au bénéfice des agences de l'eau mais aussi la plus inutilement et excessivement complexe.
Proposition 20
Il faut simplifier les modalités de calcul de la redevance pollution sous forme d'un taux unique en France et calculée au m 3 .
EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Lors de sa réunion du mardi 18 mars 2003, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a procédé à l'examen du rapport présenté par M. Gérard Miquel, sénateur, sur « la qualité de l'eau et de l'assainissement en France ».
M. Gérard Miquel, sénateur, rapporteur , a présenté les objectifs et les conclusions de son étude. Il a formulé quelques propositions (voir rapport).
A l'issue de cette présentation, M. Claude Birraux, député, président de l'Office, a observé que la détermination des périmètres de protection était très complexe et supposait des études hydrogéologiques poussées. Il a interrogé le rapporteur sur la présence de métaux lourds dans les boues des stations d'épuration, et la possibilité de certification des systèmes d'assainissement non collectifs.
M. Claude Saunier, sénateur, a considéré qu'il y avait dans certains départements une sorte de « connivence politico-économico-administrative » entre les élus, l'Etat et les professions impliquées dans la dégradation de la ressource en eau. Il a estimé que l'Etat avait les moyens de connaître la réalité du terrain et les pratiques agricoles, mais qu'il n'exerçait pas ses responsabilités. Il a jugé qu'aucune amélioration ne serait possible sans volonté politique forte. Il a souligné les incohérences de la réglementation qui limite par exemple l'épandage d'effluents agricoles, en raison des apports en azote, tout en laissant libre l'épandage d'engrais minéraux, qui peuvent doubler la dose d'azote. Il a considéré que même si la profession agricole avait pris conscience de ses responsabilités, les perspectives d'amélioration pourraient largement venir de la pression des consommateurs. Il a partagé l'avis du rapporteur sur la nécessaire simplification des règles et des structures intercommunales. Il a estimé que cet imbroglio était un facteur supplémentaire d'opacité dont tiraient parti les sociétés fermières. Il a insisté sur le rôle nécessaire de l'Etat dans la police de l'eau.
Mme Marie-Christine Blandin, sénateur, a rappelé que le brouillard était encore plus chargé de pesticides que la pluie. Elle a estimé que la poursuite des plans de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) ne pourrait s'envisager qu'après une évaluation des résultats. Elle a souligné les résultats positifs de certains programmes initiés par les professions agricoles, de type « ferti-mieux », notamment pour récupérer les déchets toxiques. Concernant le plomb, elle a observé que la majorité de la population de sa région n'était pas concernée car l'eau était parfois tellement chargée en calcaire qu'elle n'était pas consommée, et que paradoxalement, la population qui s'était équipée en adoucisseurs d'eau était la plus exposée au plomb.
M. Claude Gatignol, député, a observé que 2 % seulement de l'eau distribuée était utilisée à des fins alimentaires. Il s'est interrogé sur le bien-fondé de l'investissement et de l'utilisation de technologies avancées (type filtre à membrane) pour des usages non alimentaires. Il a interrogé le rapporteur sur l'évolution des contaminations des eaux à l'atrazine.
M. Jean-Claude Etienne, sénateur, a suggéré que la partie du rapport consacrée aux boues de stations d'épuration fasse davantage référence au précédent rapport de M. Gérard Miquel relatif aux métaux lourds. Il s'est interrogé sur le rôle de la luzerne dans la dénitrification naturelle, et sur la répartition des moyens de police de l'eau entre le département et la région.
En réponse aux intervenants, M. Gérard Miquel, sénateur, rapporteur, a précisé que :
- le système d'assainissement non collectif n'avait pas été assez développé et soutenu, alors même qu'il peut éviter des déconvenues prévisibles des systèmes d'assainissement collectifs dans les petites communes ;
- l'évaluation des pesticides était préoccupante, dans la mesure où les métabolites étaient beaucoup moins connus et donc beaucoup moins facilement repérés que les molécules mères, alors qu'ils peuvent être tout aussi dangereux ;
- les perspectives d'évolution des boues devraient distinguer clairement les boues-déchets, chargées en métaux lourds, et les produits valorisables, issus de boues transformées.
Le rapporteur a estimé que la profession agricole pouvait utilement s'orienter vers un système qui couplerait la certification et l'éco-conditionnalité. Il a indiqué que les réticences professionnelles fortes, au départ, pouvaient s'estomper à l'expérience, comme ce fut le cas pour les quotas laitiers. Il a considéré que si des quotas avaient été adoptés sur le porc et les volailles, une partie des problèmes liés à l'épandage des rejets d'élevage aurait été réglée.
Il a craint que la pression du consommateur ne se fasse surtout sur la base d'une contestation croissante vis-à-vis de l'alourdissement du prix de l'eau.
A la suite de cet échange, l'Office parlementaire a adopté les conclusions du rapporteur, à l'unanimité des membres présents.
* (1) Annexe 1 - Les polluants.
* (2) Annexe 2 - Pluie et pollution atmosphérique.
* (3) Annexe 3 - Les pluies acides.
* (4) Annexe 4 - L'analyse des pluies en France.
* (5) Annexe 5 - Les pesticides dans les eaux de pluie.
* (6) Annexe 6 - Le ruissellement des eaux de pluie.
* (7) Annexe 7- Les eaux pluviales à Paris.
* (8) Annexe 8 - La pluie sur les autoroutes et les aéroports : les exercices de lutte contre les incendies constituent des sources ponctuelles de pollution des eaux par rejets de kérosène qui pourraient être aisément atténuées par l'aménagement de fossés.
* (9) Annexe 9 - Le régime juridique des eaux pluviales.
* (10) Annexe 10 - Formation et caractéristiques des nappes.
* (11) Annexe 11 - Concentrations maximales en métaux observées dans les eaux souterraines d'origine naturelle.
* (12) Annexe 12 - Les mécanismes de transferts des pollutions dans les eaux souterraines.
* (13) Annexe 13 - Le Système d'Evaluation de la Qualité des eaux souterraines (SEQ - eaux souterraines).
* (14) Annexe 14 - Les altérations des eaux souterraines.
* (15) Annexe 15 - Les Réseaux de Suivi des Eaux Souterraines.
* (16) Annexe 16 - L'évaluation de la qualité des eaux souterraines en Seine-Normandie.
* (17) Annexe 17 - Observations de méthode sur les analyses d'eau.
* (18) Annexe 18 - Les objectifs de la directive cadre concernant les eaux souterraines.
* (19) Annexe 19 - Contribution des activités industrielles à l'état géochimique des eaux souterraines.
* (20) Annexe 20 - La pollution de la nappe de Louvres.
* (21) Annexe 21 - Impact des terrils houillers sur la qualité des eaux de la nappe de la Craie.
* (22) Annexe 22 - L'incidence des décharges sur la qualité de la ressource en eau.
* (23) Annexe 23 - Diagnostic et résorption des décharges dans les Pyrénées-Orientales.
* (24) Annexe 24 - Les décharges réglementées et l'eau souterraine.
* (25) Annexe 25 - Statistiques sur les forages d'eau souterraine.
* (26) Annexe 26 - Le régime juridique des forages destinés aux prélèvements d'eau.
* (27) Annexe 27 - Schémas de pollution des eaux souterraines pour les forages.
* (28) Annexe 28 - Données statistiques sur les abandons de captage.
* (29) Annexe 29 - Les golfs et l'eau.
* (30) Annexe 30 - Incidence de l'enneigement artificiel sur la ressource en eau.
* (31) Annexe 31 - Les dispositions de l'ancien projet de loi sur l'eau relatives aux prélèvements d'eau. Voir notamment l'article 49 relatif aux conditions de calculs des prélèvements d'eau.
* (32) Annexe 32 - La dénitrification naturelle.
* (33) Annexe 33- Les réseaux de mesures de qualité de l'eau superficielle.
* (34) Annexe 34 - Les objectifs de la directive cadre concernant les eaux de surface.
* (34 bis) Annexe 34 bis - La contamination du Lot par le cadmium.
(35) Annexe 35 - Réglementation et mesure des pollutions industrielles dans l'eau de surface.
* (36) Annexe 36 - Principaux rejets industriels dans les eaux.
* (37) Annexe 37 - La dépollution des mines de potasse d'Alsace.
* (38) Annexe 38 - Le rôle du phosphore dans l'eutrophisation des eaux stagnantes.
* (39) Annexe 39 - Les micropolluants dans les cours d'eau. L'exemple américain.
* (40) Annexe 40 - Les dispositifs de lutte contre les pollutions azotées d'origine agricole.
* (41) Annexe 41 - Les règles d'épandage des engrais.
* (42) Annexe 42 - Les contentieux dans le domaine de l'eau.
* (43) Annexe 43 - Les marées vertes en Bretagne.
* (44) Annexe 44 - Les pesticides - Présentation générale.
* (45) Annexe 45 - Données statistiques sur les pesticides.
* (46) Annexe 46 - Les difficultés d'établir des comparaisons dans la contamination des eaux aux pesticides.
* (47) Annexe 47 - L'atrazine.
* (48) Annexe 48 - La contamination des rivières de Bretagne aux pesticides.
* (49) Annexe 49 - Les pesticides dans les eaux de ruissellement.
* (50) Annexe 50 - La commercialisation des produits phytosanitaires.
* (51) Annexe 51 - Les utilisations non agricoles de pesticides.
* (52) Annexe 52 - La SNCF et les pesticides.
* (53) Annexe 53 - Le régime juridique des périmètres de protection.
* (54) Annexe 54 - Situation des périmètres de protection en 2001.
* (55) Annexe 55 - Les limites juridiques de l'articulation entre le règlement et le contrat, l'exemple du PMPOA.
* (56) Annexe 56 - Les limites du recours à des instruments juridiques volontaires.
* (57) Annexe 57 - La police de l'eau.
* (58) Annexe 58 - La protection de la ressource par les sociétés d'eaux minérales.
* (59) Annexe 59 - Les principaux paramètres de qualité de l'eau dans le décret 2001 - 1220.
* (60) Annexe 60 - La fixation des normes de la qualité de l'eau.
* (61) Annexe 61 -Microbiologie et maladies hydriques.
* (62) Annexe 62 - Les caractéristiques de l'eau prélevée.
* (63) Annexe 63 - L'arsenic dans les eaux de boisson.
* (64) Annexe 64 - La réglementation des teneurs en pesticides dans l'eau.
* (65) Annexe 65 - Les pesticides dans l'eau et dans les fruits.
* (66) Annexe 66 - L'organisation du service de l'eau.
* (67) Annexe 67 - Le prix de l'eau.
* (68) Annexe 68 - Les procédés de traitements de l'eau destinés à la consommation humaine.
* (69) Annexe 69 - Les membranes et l'eau potable.
* (70) Annexe 70 - Intérêt et limites de la chloration pour maîtriser la qualité biologique de l'eau distribuée.
* (71) Annexe 71 - Les canalisations du réseau d'eau potable.
* (72) Annexe 72 - Les normes de plomb dans l'eau potable.
* (73) Annexe 73 - Les Français et l'eau.
* (74) Annexe 74 - Le calcaire dans l'eau distribuée.
* (75) Annexe 75 - Les procédés de traitement de l'eau à domicile.
* (76) Annexe 76 - Le goût de l'eau.
* (77) Annexe 77 - Règles et échéances en matière d'assainissement.
* (78) Annexe 78 - Etapes et procédés de traitement des eaux usées.
* (79) Annexe 79 - L'élimination de l'azote et du phosphore.
* (80) Annexe 80 - L'élimination des micropolluants dans les stations d'épuration.
* (81) Annexe 81 - Les réseaux unitaires.
* (82) Annexe 82 - Le cadre réglementaire : zonage et schéma d'assainissement.
* (83) Annexe 83 - L'assainissement collectif en milieu rural.
* (84) Annexe 84 - La réglementation de l'assainissement non collectif.
* (85) Annexe 85- La réglementation de la réutilisation des eaux usées.
* (86) Annexe 86 - La réutilisation des eaux usées urbaines.
* (87) Annexe 87 - Les procédés de traitement des boues.
* (88) Annexe 88 - L'épandage des boues : est-il potentiellement dangereux ?
* (89) Annexe 89 - La réglementation des boues d'épuration.
* (90) Annexe 90 - Les nouveaux procédés de traitement thermique des boues : l'oxydation par voie humide.