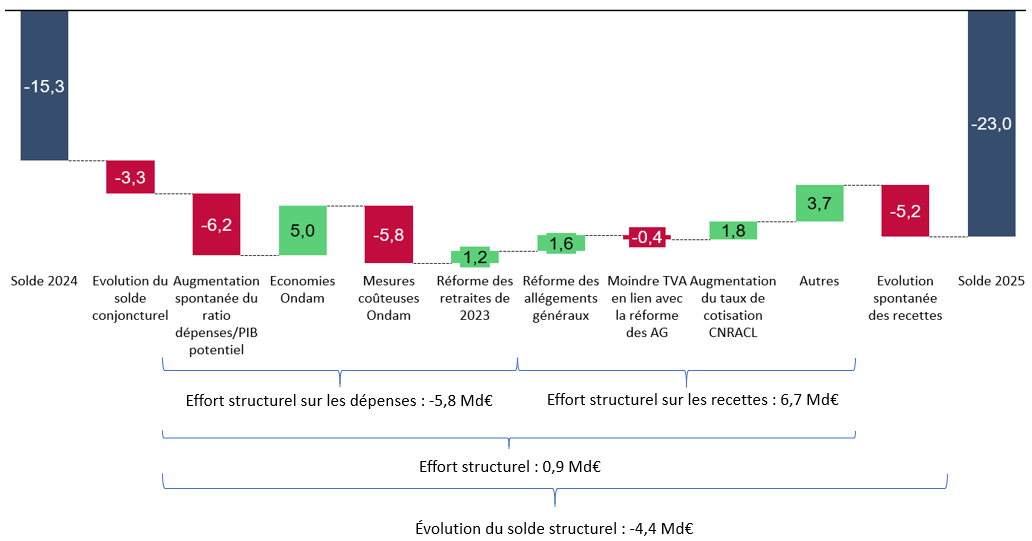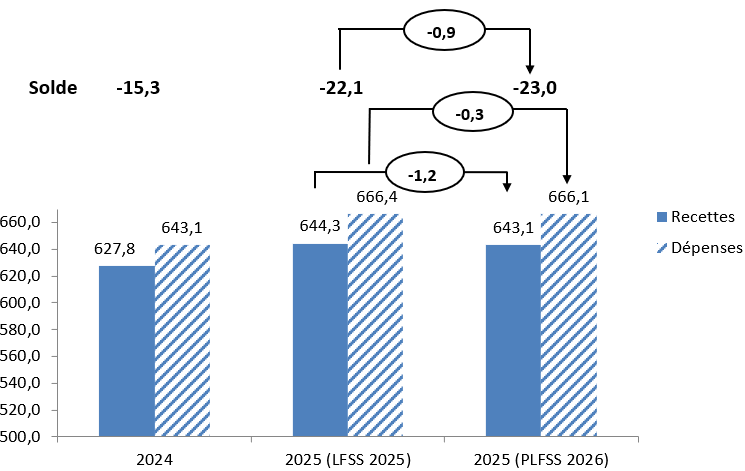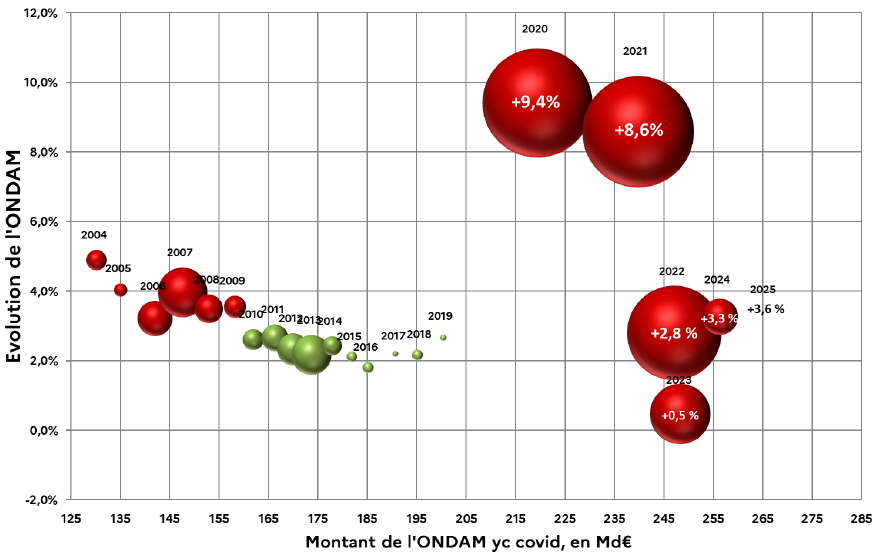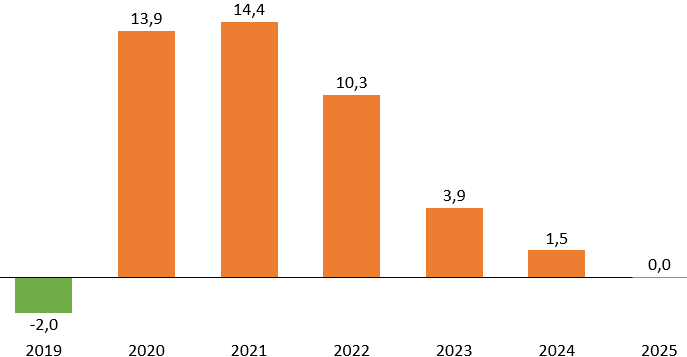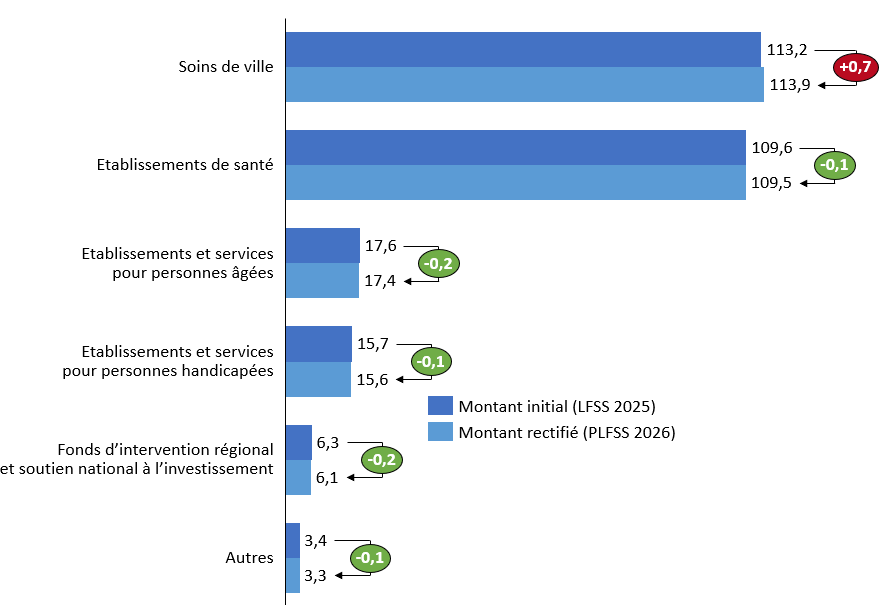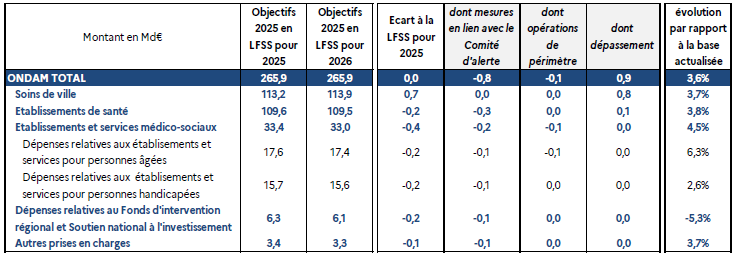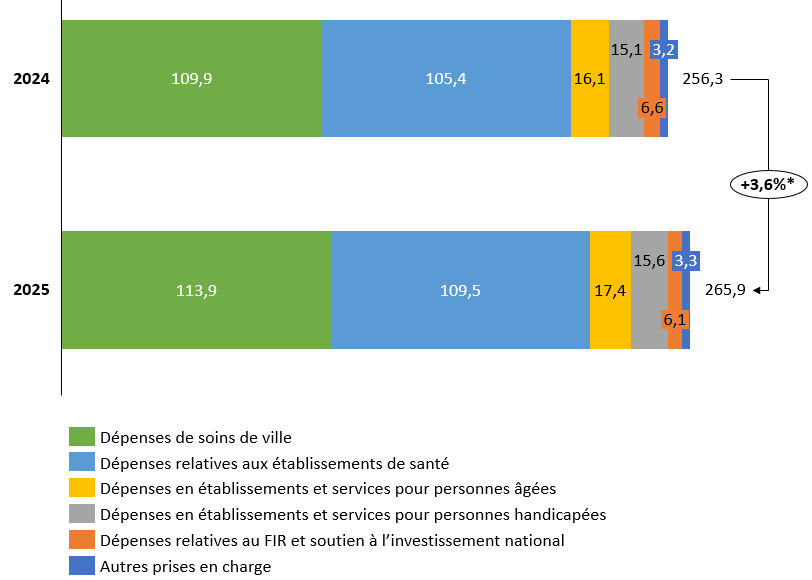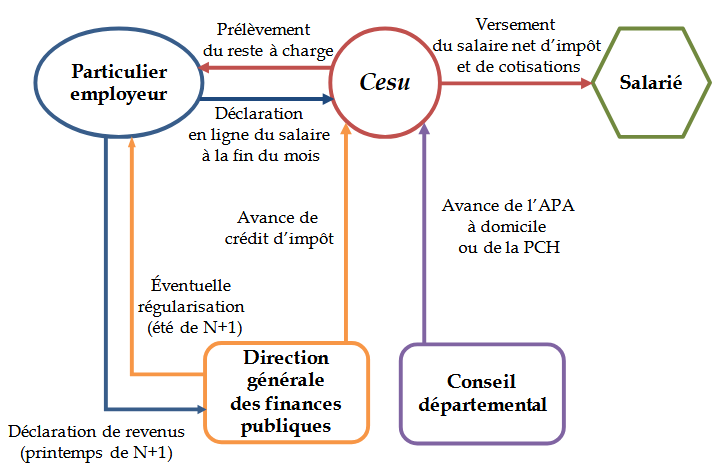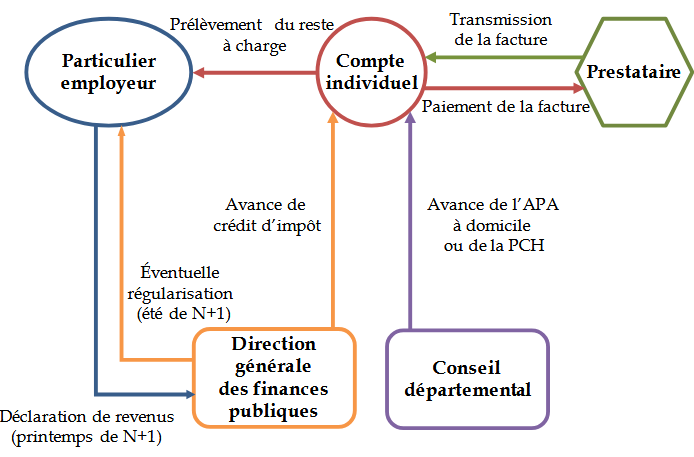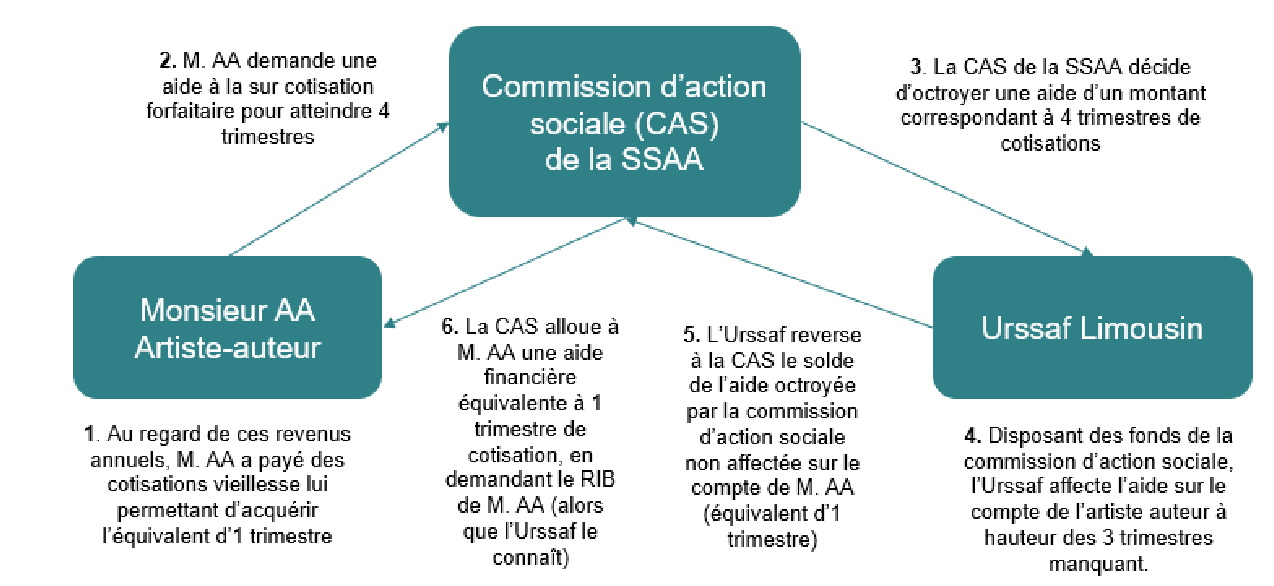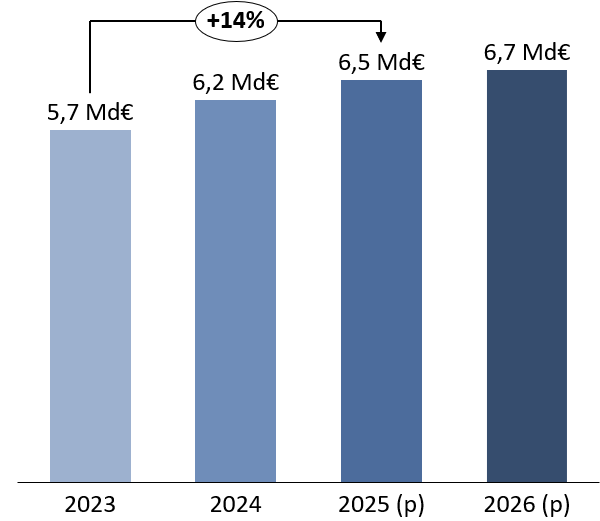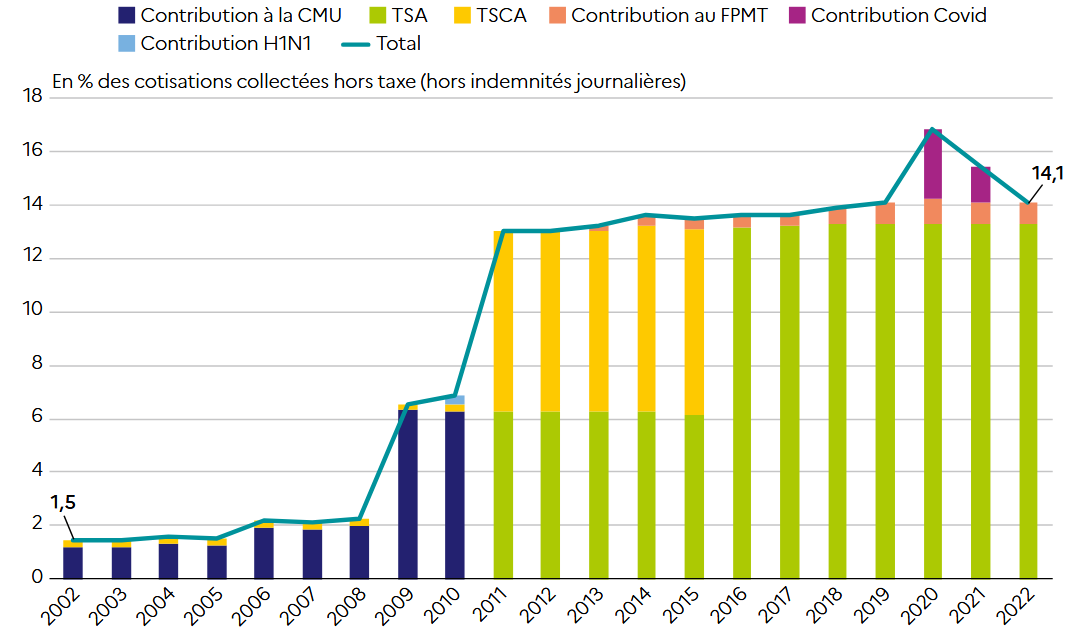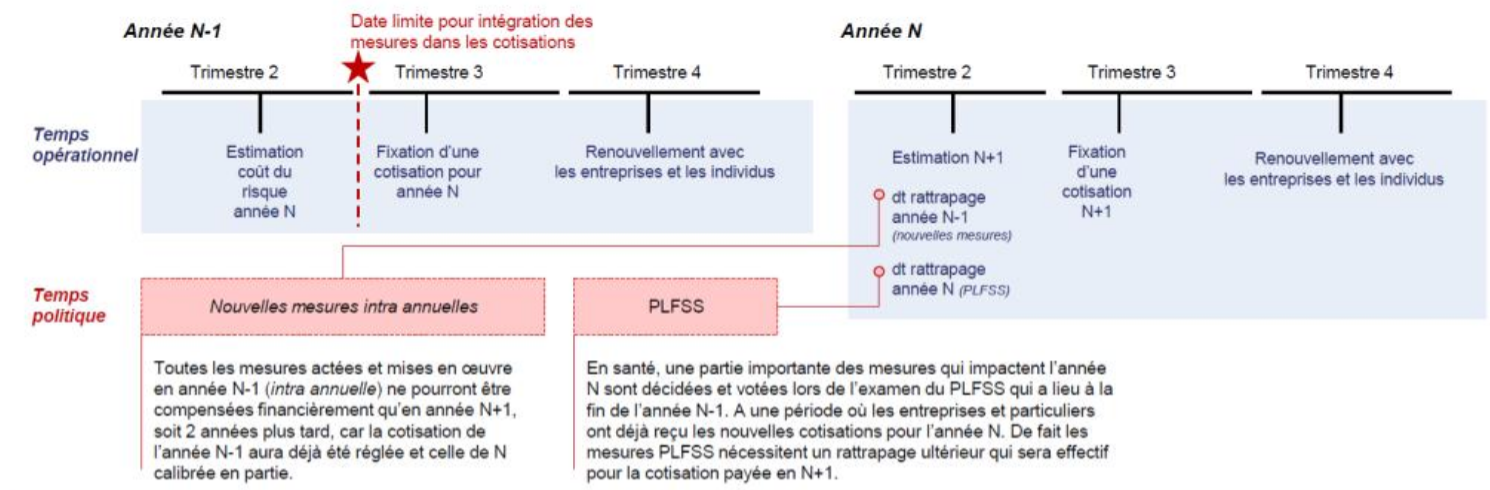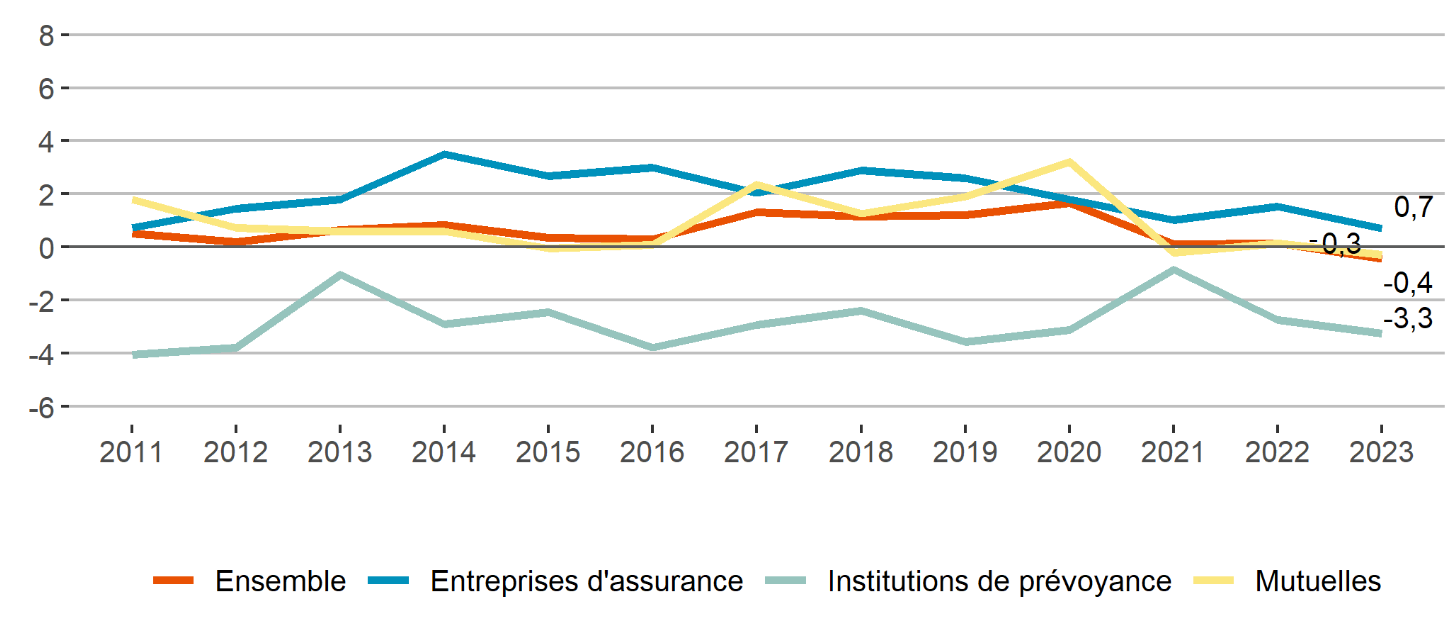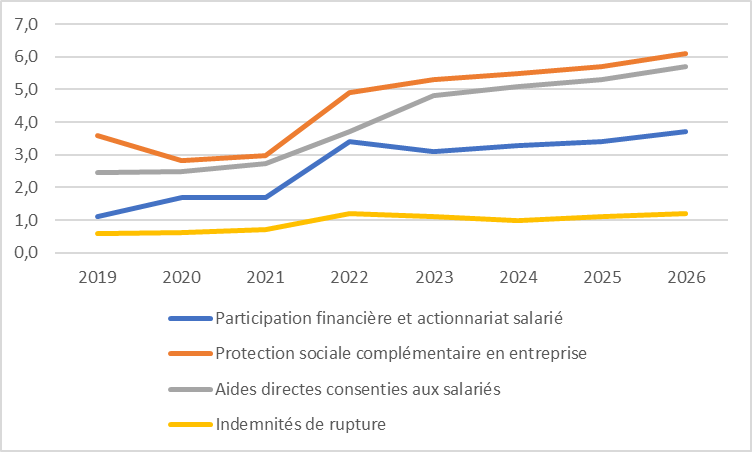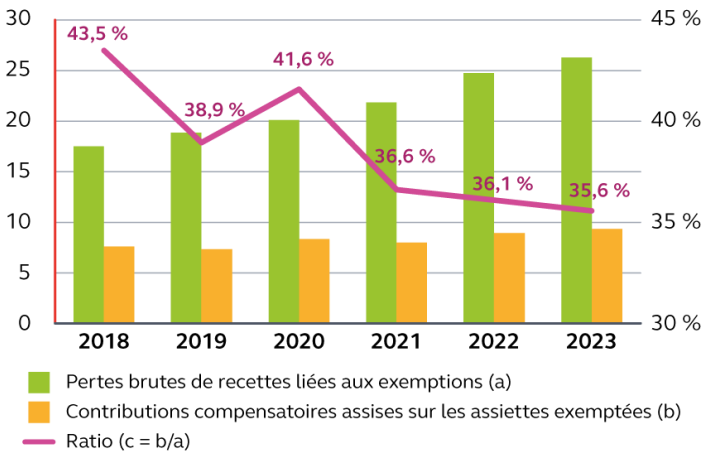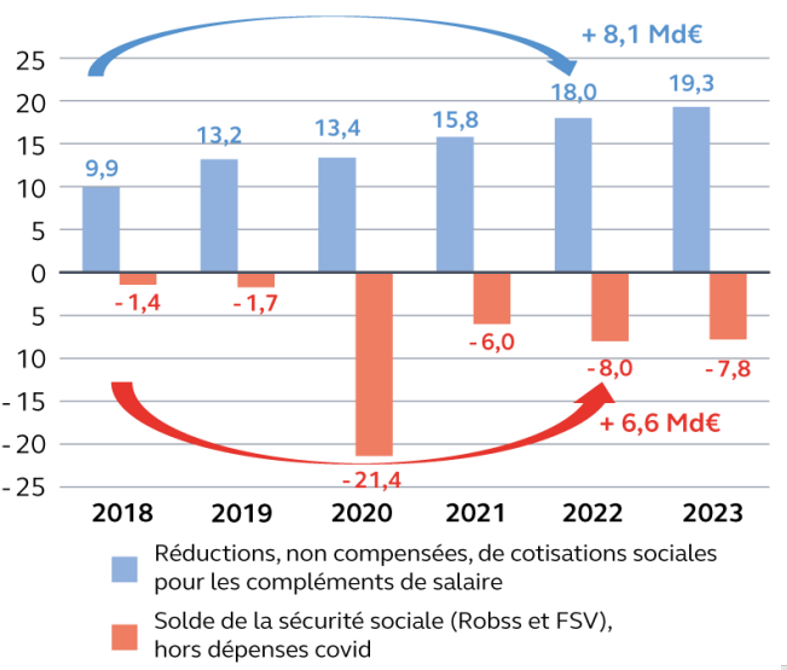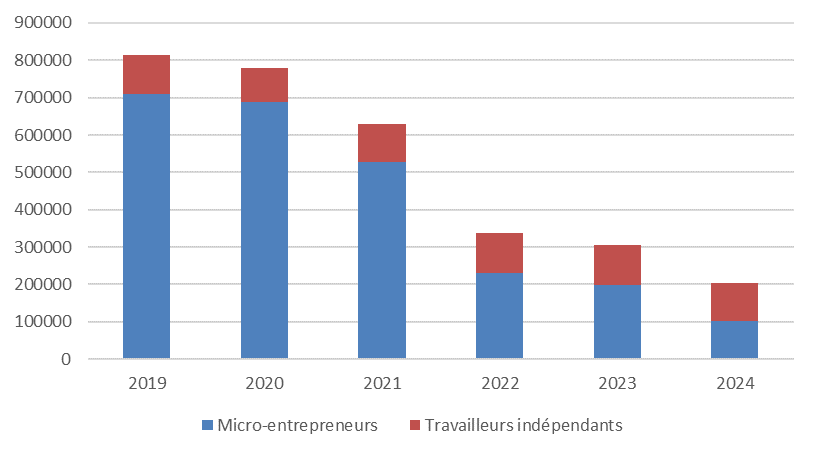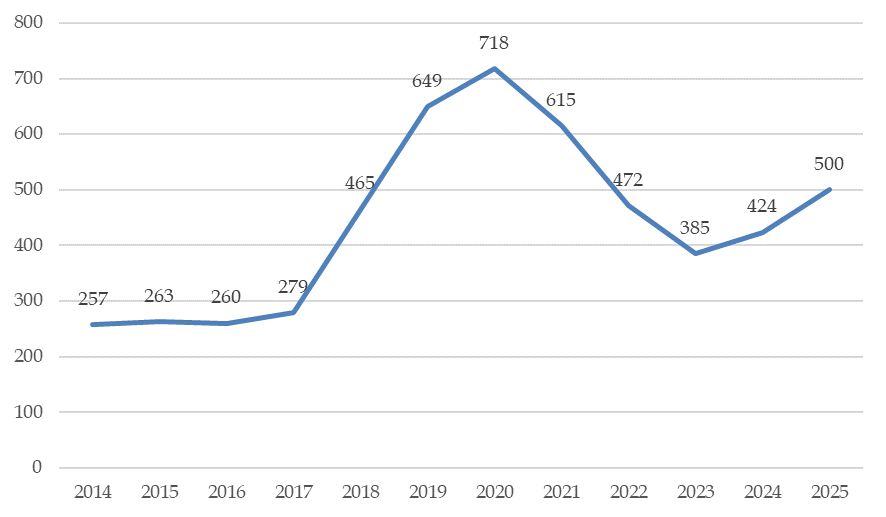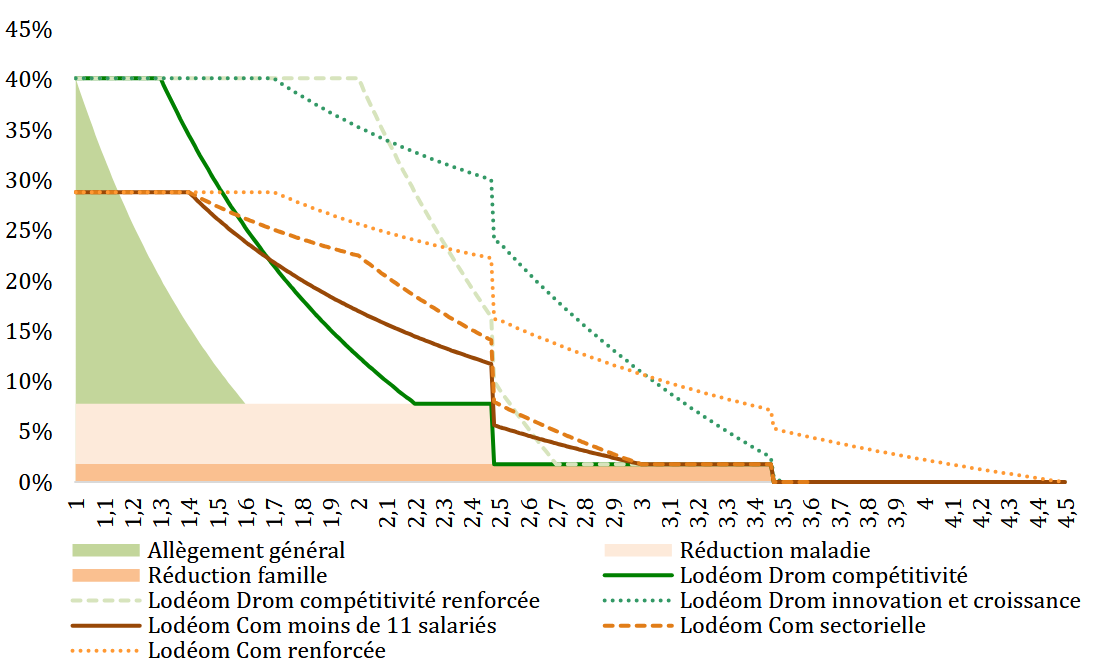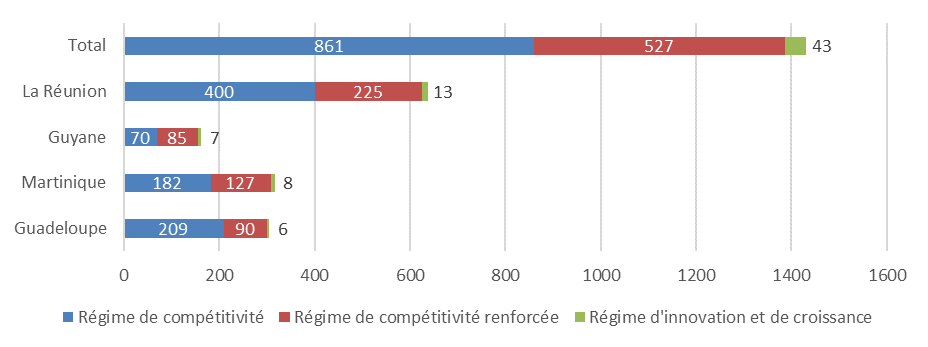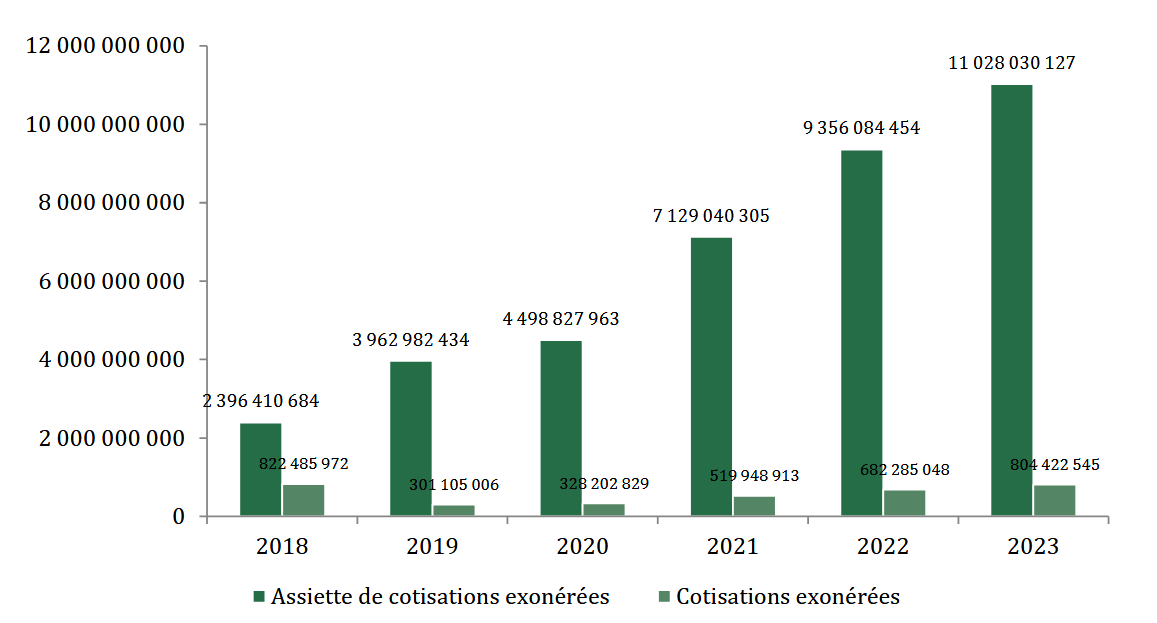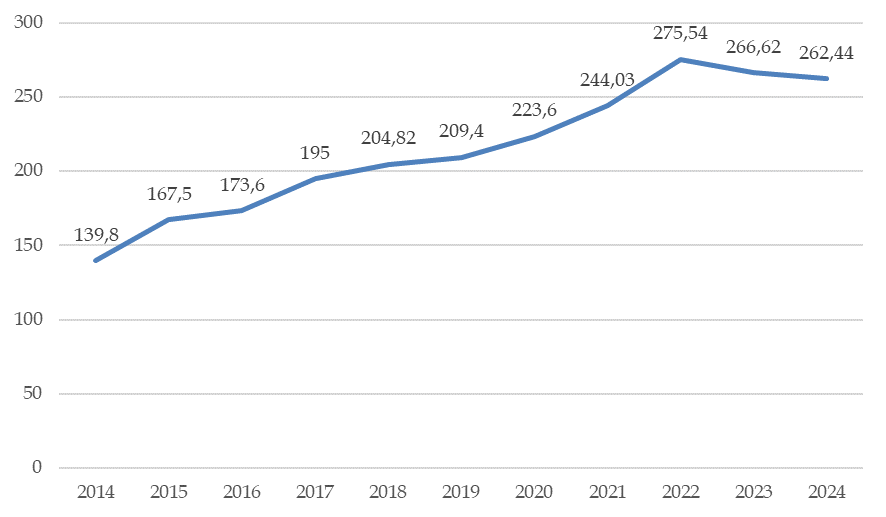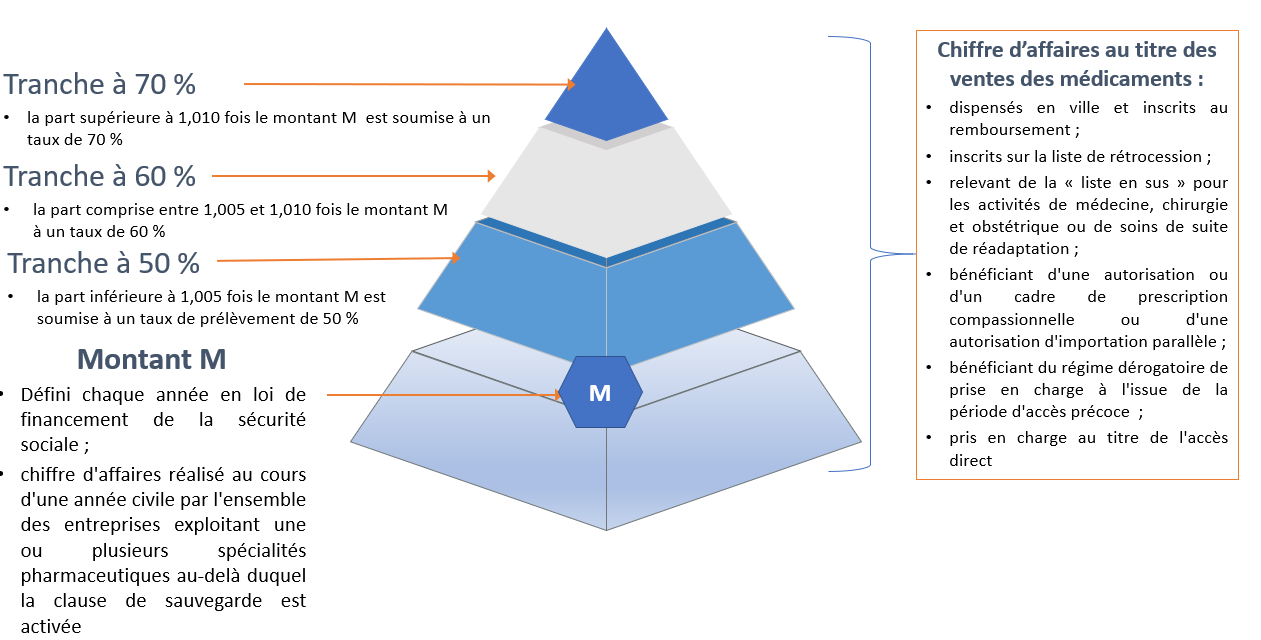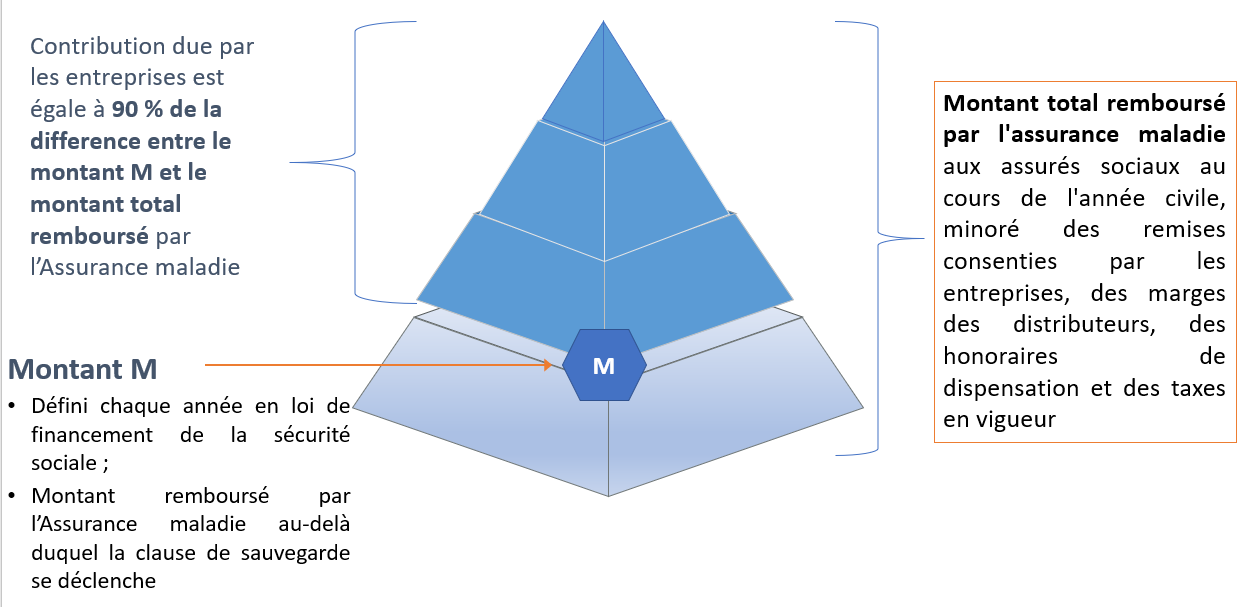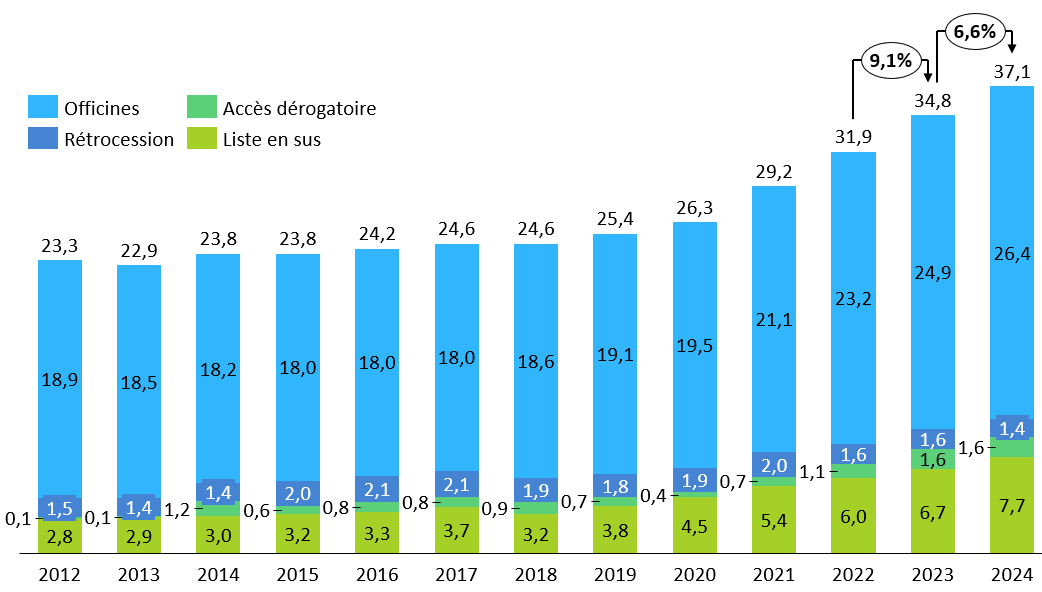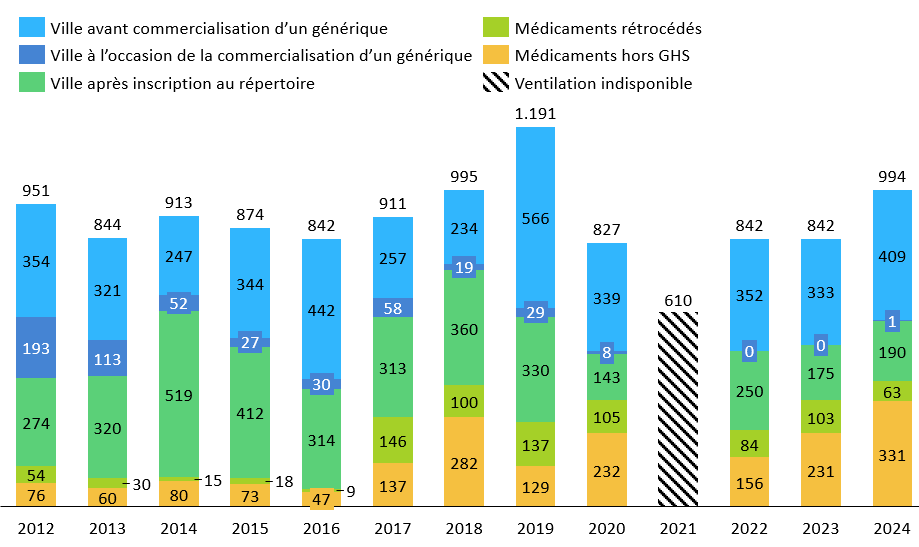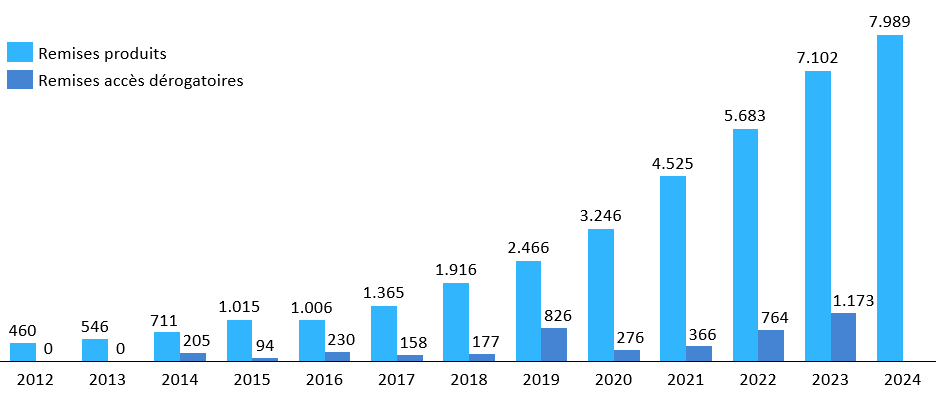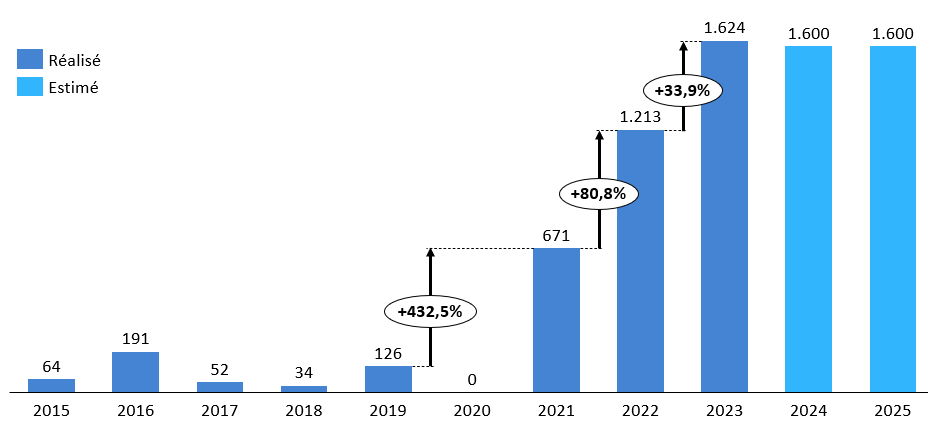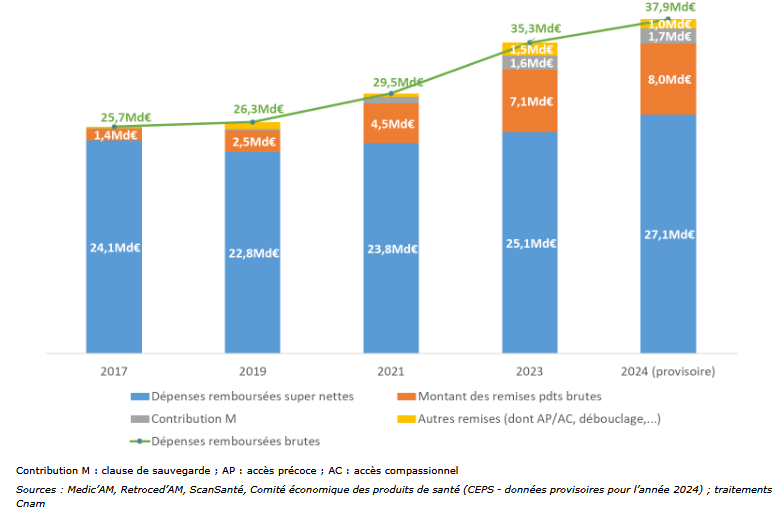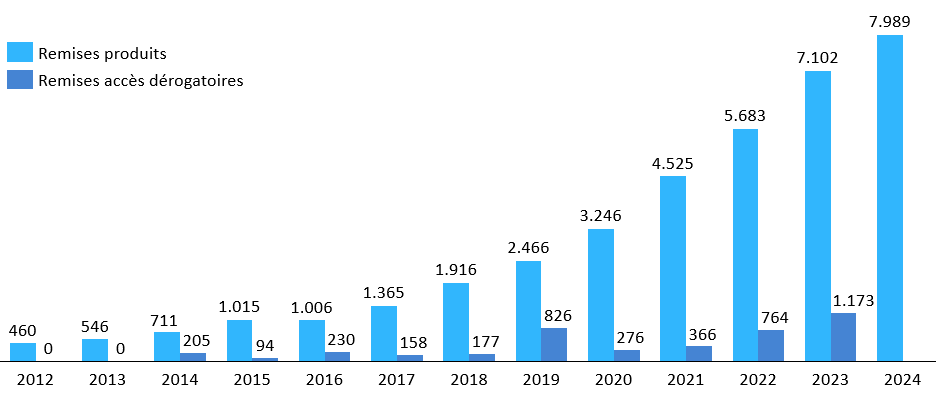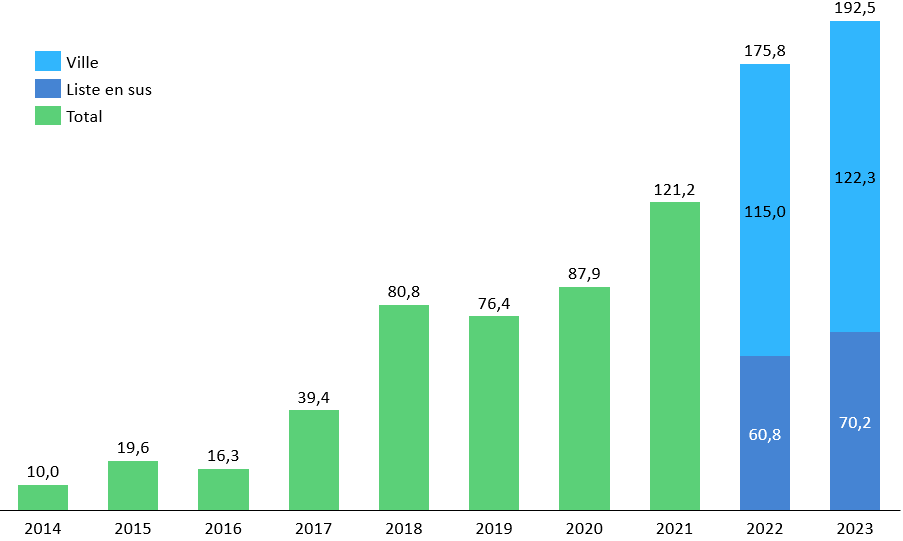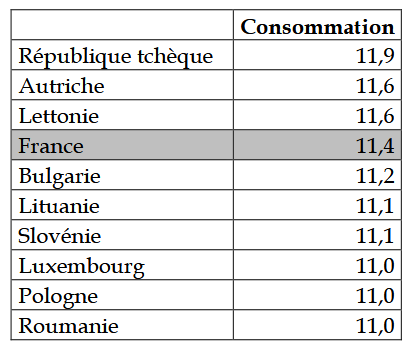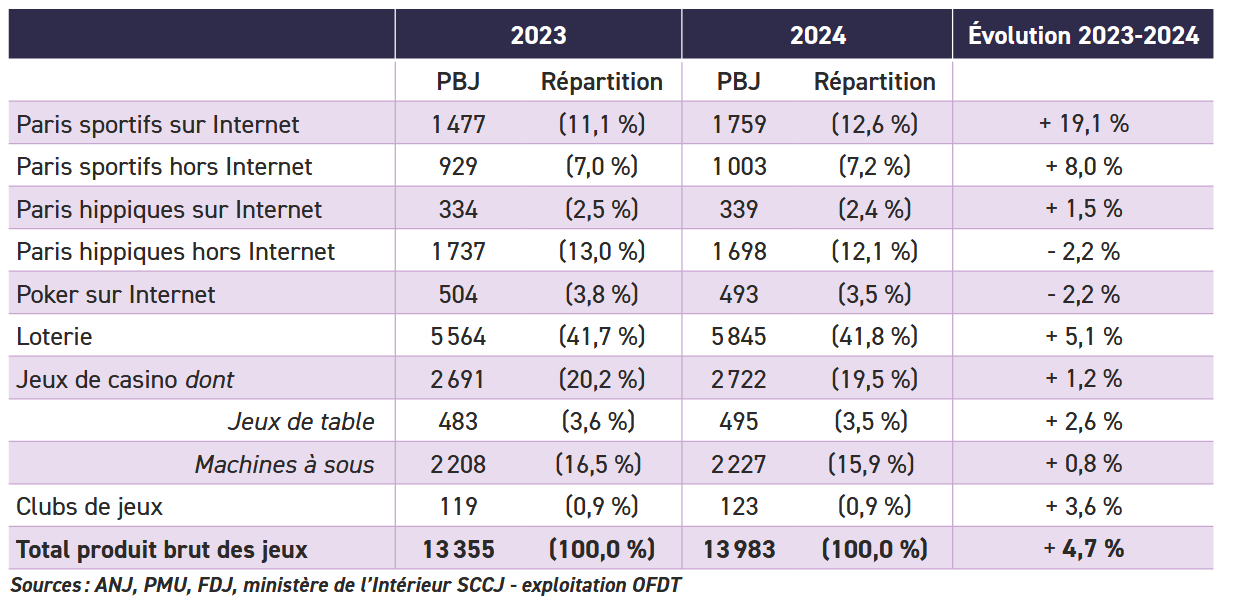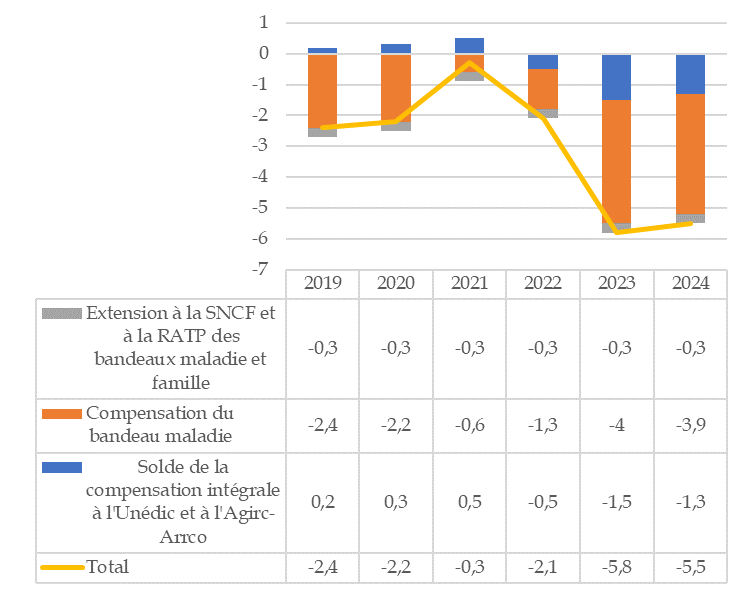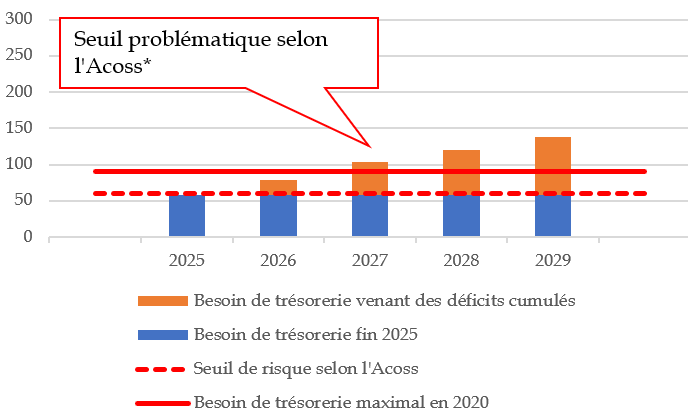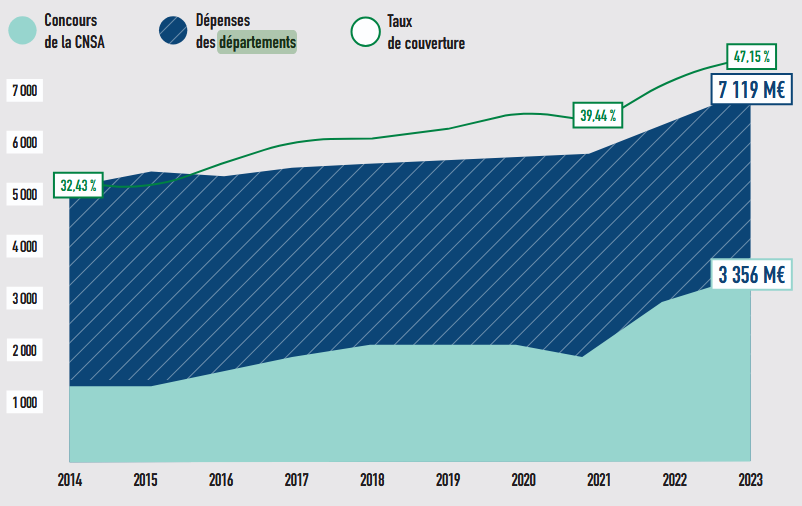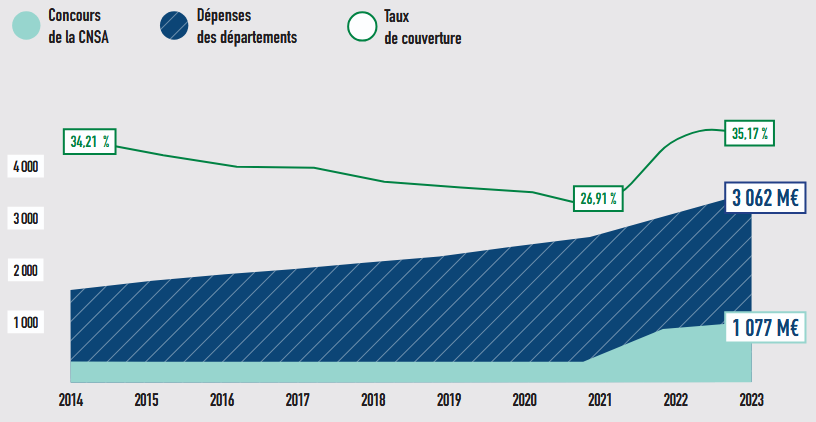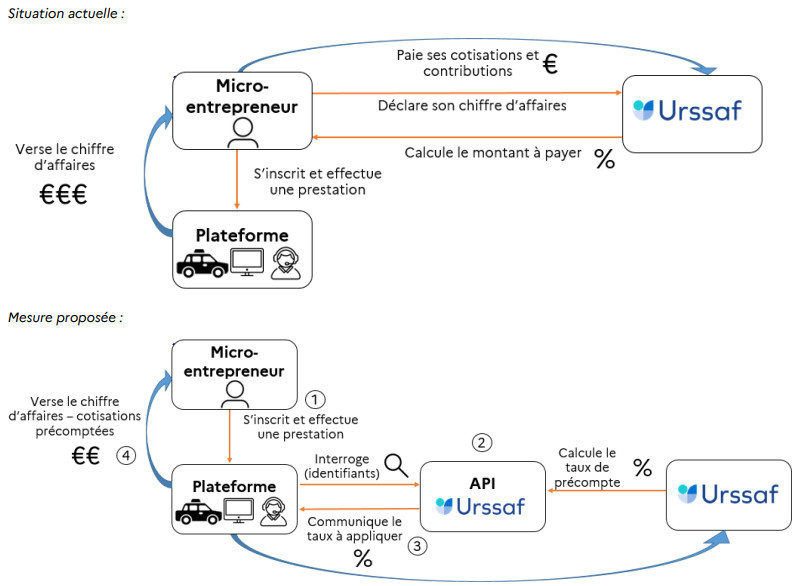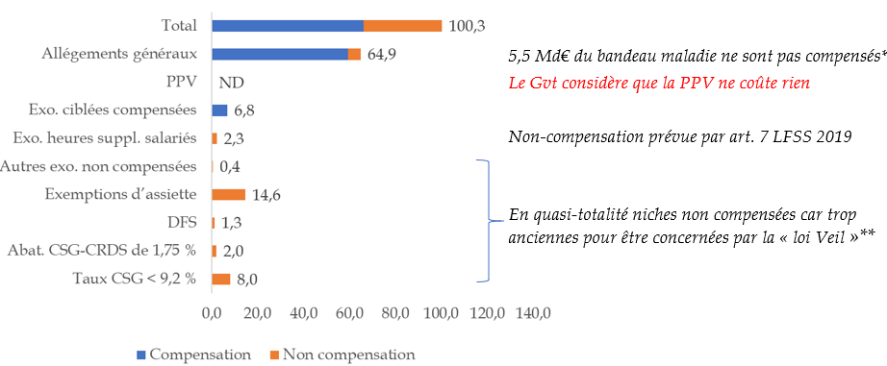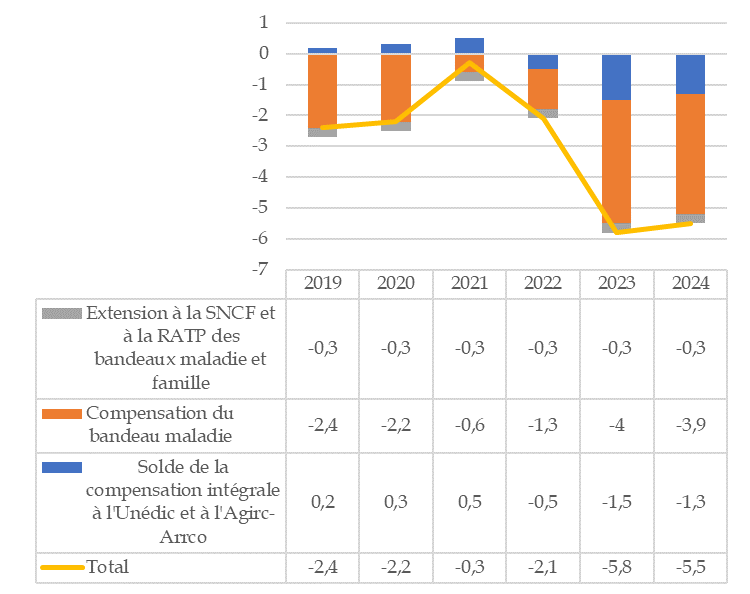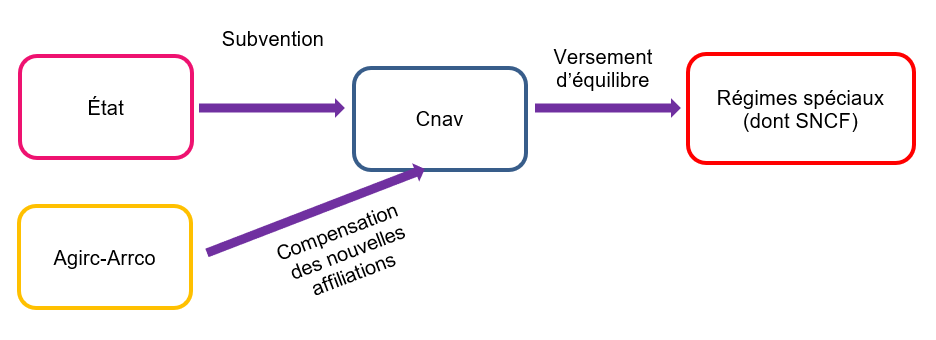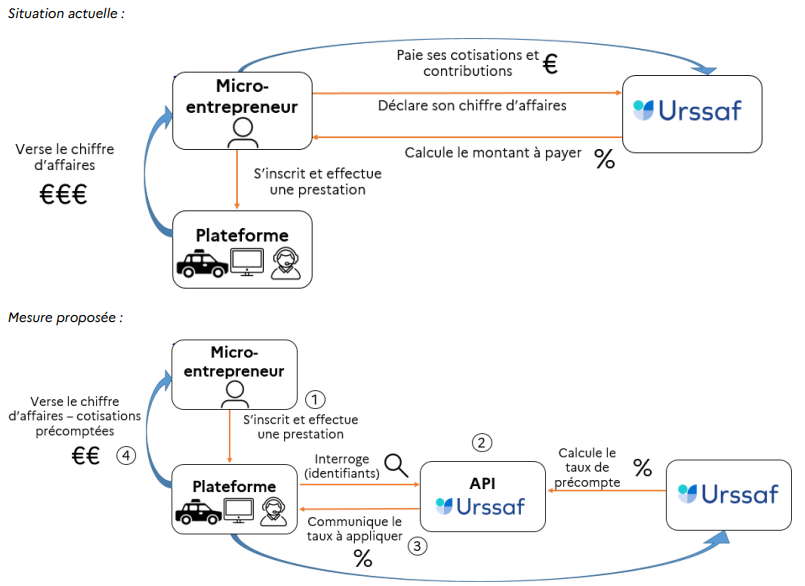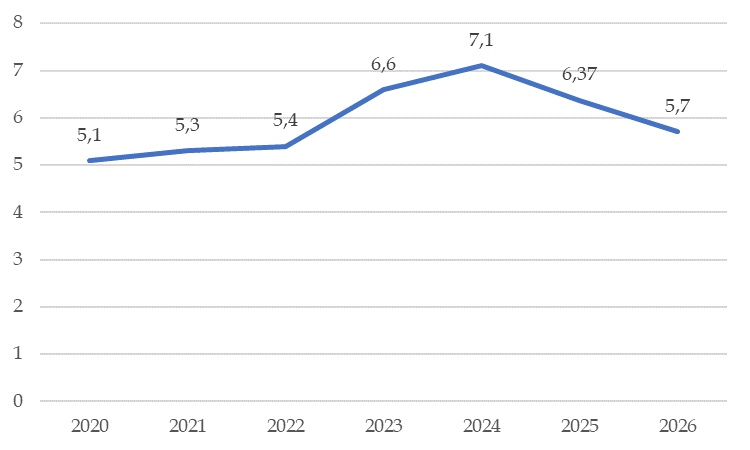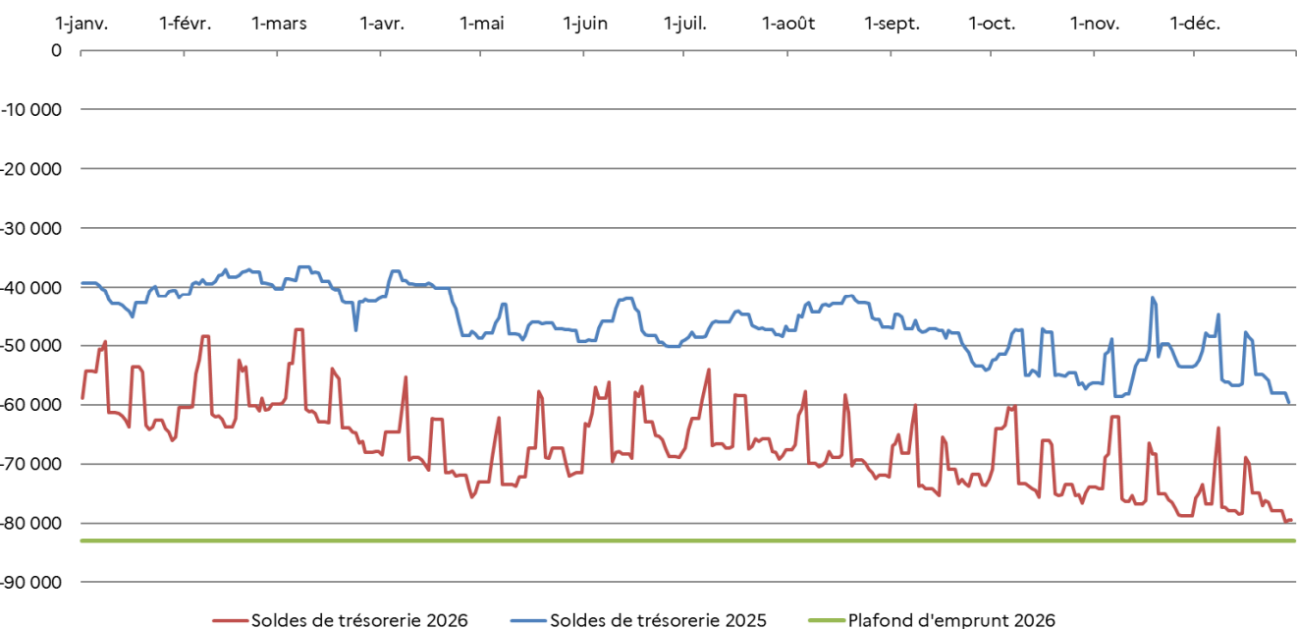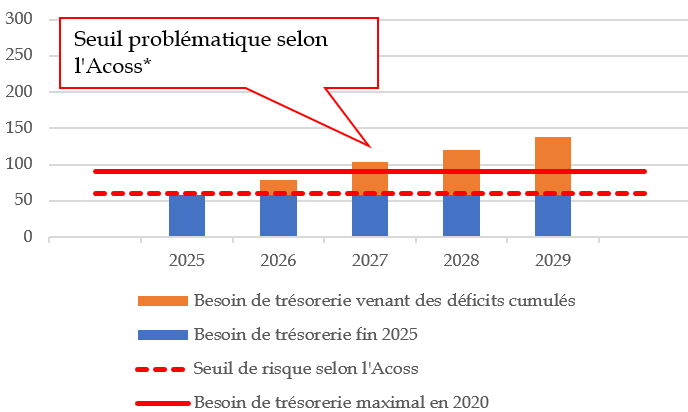- EXAMEN DES ARTICLES
- Article liminaire (supprimé)
- Article 1er (supprimé)
Rectification des tableaux d'équilibre
- Article 2 (supprimé)
Rectification de l'Ondam et des sous-objectifs de l'Ondam
- Article 3 (supprimé)
Rectification de la contribution des régimes d'assurance maladie au FMIS
- Article 4
Renforcer les pouvoirs de recouvrement des organismes
- Article 4 bis (nouveau)
Décalage de la généralisation du service d'avance immédiate de crédit d'impôt pour certains services à la personne
- Article 5
Simplifier l'affiliation, la déclaration de revenu, l'action sociale
et la gouvernance de la sécurité sociale des artistes-auteurs
- Article 5 bis (nouveau)
Subordination de l'affiliation des bailleurs à métayage au régime
des non-salariés agricoles à une participation effective
à l'activité de l'exploitation agricole
- Article 5 ter (nouveau)
Exonération partielle de cotisations sociales pour les collaborateurs de chef d'exploitation agricole qui choisissent de devenir chef d'exploitation
- Article 5 quater (nouveau)
Mise en place d'un plan d'action ou d'une négociation dans les entreprises de plus de 300 salariés sous peine d'un malus sur les cotisations vieillesse
- Article 6 (supprimé)
Maintenir les seuils de revenus pris en compte pour le calcul de la CSG sur certains revenus de remplacement
- Article 6 bis (nouveau)
Passage de 9,2 % à 10,6 % du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements
- Article 6 ter (nouveau)
Extension de la règle de lissage du revenu pris en compte dans le cas des allocations chômage et des pensions de retraite et d'invalidité pour la détermination du taux de CSG
- Article 7 (supprimé)
Institution d'une taxe exceptionnelle sur les cotisations versées aux complémentaires santé
- Article 7 bis (nouveau)
Instauration de niches sociale et fiscale en faveur de coopératives pharmaceutiques
- Article 7 ter (nouveau)
Soumission des contrats de complémentaire santé à destination des agriculteurs retraités à un taux réduit de taxe de solidarité additionnelle
- Article 8
Réduire les niches sociales applicables aux compléments salariaux
- Article 8 bis (nouveau)
Expérimentation permettant aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours
- Article 8 ter (nouveau)
Ajustement et pérennisation du régime social des outils de fidélisation des salariés par leur association au capital
- Article 8 quater (nouveau)
Précision relative à la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants par la LFSS 2024, dans le cas des exploitants agricoles
- Article 8 quinquies
(nouveau)
Possibilité pour les travailleurs indépendants agricoles d'exclure
les plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale
- Article 8 sexies
(nouveau)
Réduction des allégements généraux pour les branches
dont les minima sont inférieurs au Smic
- Article 8 septies (nouveau)
Extension aux entreprises de plus de 250 salariés du dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires
- Article 8 octies (nouveau)
Rapport d'évaluation de la réforme de la protection sociale
des indépendants réalisée par l'article 15 de la LFSS pour 2018
- Article 9
Rationaliser certaines exonérations spécifiques
- Article 9 bis (nouveau)
Prise en charge par les employeurs d'une partie des intérêts des prêts immobiliers des salariés primo-accédants
- Article 9 ter (nouveau)
Harmonisation du calcul des cotisations et contributions sociales pour les agriculteurs louant des meublés de tourisme
- Article 9 quater (nouveau)
Suppression de l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers de l'exonération dégressive pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE)
- Article 9 quinquies (nouveau)
Exonération de cotisations à la mutualité sociale agricole des dons en nature effectués par les agriculteurs
- Article 9 sexies (nouveau)
Extension du dispositif de la Lodéom aux chambres d'agriculture
et aux chambres de commerce et d'industrie des outre-mer
- Article 9 septies
(nouveau)
Réintégration de certaines entreprises d'armement maritime
dans le dispositif d'exonération de contributions sociales
- Article 10
Transférer le rendement de la clause de sauvegarde
au sein d'une nouvelle contribution
- Article 10 bis (nouveau)
Exclusion des médicaments génériques et biosimilaires du calcul
de la clause de sauvegarde
- Article 10 ter (nouveau)
Introduction d'un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde
- Article 11
Instaurer un mécanisme d'acompte des remises
relatives aux produits de santé
- Article 11 bis (nouveau)
Extension du périmètre de la taxe sur les boissons prémix
- Article 11 ter (nouveau)
Taxer les produits n'affichant pas le Nutri-score
- Article 11 quater (nouveau)
Ajustement de la contribution sur les dépenses de publicité des jeux d'argent et de hasard
- Article 11 quinquies
(nouveau)
Allègement de la taxe sur les ventes en gros aux officines pharmaceutiques
- Article 11 sexies (nouveau)
Fixation par la loi du plafond des remises commerciales
- Article 11 septies (nouveau)
Contribution spécifique sur les entreprises qui importent,
produisent ou commercialisent de l'hexane
- Article 12
Clarifier les transferts financiers au sein des administrations
de sécurité sociale (« article-tuyau »)
- Article 12 bis (nouveau)
Affectation d'une fraction de CSG aux départements et réduction, à due concurrence, de la fraction affectée à la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie
- Article 12 ter (nouveau)
Annuler la participation de l'assurance maladie à la prise en charge des cotisations des professionnels de santé en cas de fraude
- Article 12 quater (nouveau)
Exclusion des micro-commerçants du dispositif de précompte des cotisations sociales par les plateformes
- Article 12 quinquies (nouveau)
Suppression de certaines dérogations au principe de compensation fixé
par la « loi Veil »
- Article 12 sexies
(nouveau)
Instauration d'une cotisation obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires titulaires d'un visa de long séjour
- Article 12 septies (nouveau)
Suppression de la possibilité pour le Gouvernement de minorer la compensation à l'Unédic des allégements généraux de cotisations patronales
- Article 12 octies
(nouveau)
Suppression de la possibilité de fixer par décret le montant
de la contribution d'équilibre aux régimes spéciaux fermés versée
par les régimes de retraite complémentaire et le régime général
- Article 12 nonies
(nouveau)
Augmentation des majorations de redressement pour travail dissimulé
- Article 12 decies
(nouveau)
Suppression de la réduction de majoration en cas de paiement rapide
des montants redressés pour travail dissimulé
- Article 12 undecies
(nouveau)
Modification des maxima de pénalités prononcées en cas de non-respect
de l'obligation de transmission à l'Urssaf des données des vendeurs
et prestataires recourant à des plateformes de vente en ligne
- Article 13
Approbation du montant de la compensation des exonérations
mentionné à l'annexe 4
- Article 14
Tableau d'équilibre 2026
- Article 15
Objectif d'amortissement de la dette sociale et prévisions de recettes du Fonds de réserve pour les retraites
- Article 16
Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes habilités à recourir à des ressources non permanentes
- Article 16 bis
(nouveau)
Réduction de la capacité de l'Acoss à s'endetter sur les marchés
- Article 17 (supprimé)
Approbation du rapport sur l'évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale
- Article liminaire (supprimé)
N° 131
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
le projet de loi
de financement de la
sécurité sociale, dont le Sénat
est saisi en application
de l'article 47-1, alinéa 2, de la
Constitution, pour 2026,
Par Mme Élisabeth DOINEAU,
Rapporteure générale,
Mmes Corinne IMBERT, Pascale GRUNY, M. Olivier HENNO,
Mmes Marie-Pierre RICHER et Chantal DESEYNE,
Rapporteures et
Rapporteurs
Sénatrices et Sénateurs
Tome II
Examen des articles
Fascicule 1
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Alain Milon, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, M. Jean Sol, Mmes Nadia Sollogoub, Anne Souyris.
Voir les numéros :
|
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
1907, 2049 et 2057 |
|
Sénat : |
122 et 126 (2025-2026) |
EXAMEN DES ARTICLES
Article liminaire (supprimé)
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement, présente, pour l'exercice en cours et pour l'année à venir, l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.
La commission propose de rétablir cet article, qui est une disposition obligatoire des LFSS.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-3-2 du code de la sécurité sociale
« Dans son article liminaire, la loi de financement de l'année présente, pour l'exercice en cours et pour l'année à venir, l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale. »
L'intégration de cet article liminaire dans la LFSS a été souhaitée par le législateur organique.
En effet, si le Parlement, au moment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne peut se prononcer, pour l'essentiel, que sur les mesures ayant un effet sur les régimes obligatoires de base (Robss), les organismes ou des organismes concourant à leur financement (FSV1(*)), à l'amortissement de leur dette (Cades) ou à la mise en réserve de recettes à leur profit (FRR), c'est bien le champ plus large des administrations de sécurité sociale (Asso) qui est considéré par l'Insee dans le calcul des comptes des administrations publiques (selon les concepts de la comptabilité nationale), et utilisé pour l'application du pacte de stabilité et de croissance.
Au demeurant, l'État accorde sa garantie de droit ou de fait à plusieurs organismes et régimes situés en dehors du périmètre des Robss.
C'est pourquoi, à défaut d'élargir formellement le périmètre des LFSS, comme l'avait proposé le Sénat2(*), le législateur organique a au moins souhaité que le Parlement dispose d'une vision financière globale des administrations de sécurité sociale au moment de l'examen des lois de financement, tant par la création de nouvelles annexes relatives à l'assurance chômage, aux régimes complémentaires de retraite et aux établissements de santé que par la création de cet article liminaire.
Sur le fond, les prévisions de cet article sont retracées dans le tableau ci-après.
Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 au sens de la comptabilité nationale
(en points de produit intérieur brut)
|
2025 |
2026 |
|
|
Recettes |
26,7 |
26,7 |
|
Dépenses |
27,0 |
26,6 |
|
Solde |
- 0,3 |
0,1 |
Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Prises dans leur ensemble, les Asso, dont les dépenses et les recettes représentent plus d'un quart du PIB, présenteraient donc, selon le Gouvernement, un déficit de 0,3 point de PIB en 2025 et un excédent + 0,1 point de PIB en 2026.
Les administrations de sécurité sociale (Asso)
Les administrations de sécurité sociale regroupent les régimes d'assurance sociale et les organismes dépendant des assurances sociales (principalement les hôpitaux à financement public) (Odass).
Les régimes d'assurance sociale comprennent principalement :
- le régime général ;
- divers fonds : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), mais aussi Fonds commun pour les accidents du travail (FCAT), Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), Service social d'allocation aux personnes âgées (Saspa), Fonds de compensation des organismes de sécurité sociale (FCOSS), etc. ;
- les autres régimes de base des salariés (régimes spéciaux d'entreprises et d'établissements publics, salariés agricoles, etc.) ;
- les régimes des non-salariés (dont la mutualité sociale agricole) ;
- l'Unédic ;
- les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des salariés (Agirc-Arrco...) ;
- depuis un reclassement effectué en 2011 par l'Insee, la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) et le Fonds de réserve des retraites (FRR), jusqu'alors considérés comme des organismes divers d'administration centrale (Odac).
Les organismes dépendant des assurances de sécurité sociale (Odass), qui dépendent des administrations de sécurité sociale, comprennent :
- les hôpitaux de l'assistance publique, ainsi que les hôpitaux privés financés par la dotation globale hospitalière (attribuée par les caisses de sécurité sociale) ;
- les oeuvres sociales intégrées aux organismes de sécurité sociale (oeuvres sociales de la Cnaf, écoles d'infirmiers) ;
- France Travail.
Comme le montre le tableau ci-après, en 2025 comme en 2026, l'écart entre le déficit de la sécurité sociale et l'excédent global des administrations de sécurité sociale proviendrait essentiellement de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).
Capacité de financement des administrations de sécurité sociale
(en milliards d'euros)
|
2025 |
2026 |
|
|
Asso |
-8,4 |
3,4 |
|
Recettes |
796,6 |
817,7 |
|
Dépenses |
805 |
814,4 |
|
Régime général + Fonds de solidarité vieillesse |
-21,6 |
-16,9 |
|
Recettes |
549,5 |
542,5 |
|
Dépenses |
571,0 |
559,5 |
|
Unédic |
0,3 |
0,6 |
|
Recettes |
45,2 |
44,4 |
|
Dépenses |
44,8 |
43,8 |
|
Régimes complémentaires des salariés |
1,5 |
2,1 |
|
Recettes |
111,6 |
114,3 |
|
Dépenses |
110,1 |
112,2 |
|
Cades |
15,7 |
16,0 |
|
Recettes |
19,0 |
18,8 |
|
Dépenses |
3,3 |
2,8 |
|
FRR - Fonds de réserve des retraites |
-0,7 |
-0,7 |
|
Recettes |
0,9 |
0,9 |
|
Dépenses |
1,6 |
1,6 |
|
Organismes divers de sécurité sociale |
-2,4 |
-2,0 |
|
Recettes |
135,1 |
138,0 |
|
Dépenses |
137,5 |
140,0 |
Asso : administrations de sécurité sociale. Cades : Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Source : Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2026
L'hypothèse d'un fort excédent des régimes complémentaires de retraite, dont la commission avait souligné l'irréalisme à l'occasion de l'examen du PLFSS 2024, est donc abandonnée.
II. Le dispositif transmis au Sénat
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale3(*).
III - La position de la commission
Comme indiqué dans le tome I du présent rapport, le Haut Conseil des finances publiques juge les prévisions du Gouvernement pour 2026 plutôt optimistes.
On rappelle toutefois que le présent article est purement prévisionnel.
Par ailleurs, l'article liminaire est une disposition obligatoire des LFSS (article L.O. 111-3-2 du code de la sécurité sociale). Son absence susciterait un risque d'inconstitutionnalité de l'ensemble du PLFSS.
Aussi, la commission a adopté un amendement n° 585 de sa rapporteure générale tendant à rétablir l'article.
La commission propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RECETTES
ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
POUR L'EXERCICE 2025
Article 1er
(supprimé)
Rectification des tableaux d'équilibre
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement, a pour objet de rectifier pour 2025, exercice en cours, les tableaux d'équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base, ainsi que le tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse.
La commission propose de rétablir cet article, qui est une disposition obligatoire des LFSS.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément à la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale (extrait)
« Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de l'année :
1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;
2° Rectifie les objectifs de dépenses, par branche, de ces régimes (...) ;
3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit. »
A. Un déficit 2025 de 23 milliards d'euros (au lieu de 22,1 milliards d'euros)
Le présent article propose deux tableaux, le premier pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss), le deuxième pour le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Depuis la LFSS 2023, cette partie rectificative ne comporte plus de tableau spécifique au régime général de sécurité sociale, conformément au nouveau cadre organique qui focalise les votes du Parlement sur l'ensemble des régimes obligatoires de base.
Le déficit, de 15,3 milliards d'euros en 2024, augmenterait fortement en 2025, pour atteindre 23 milliards d'euros.
1. Un effort structurel à peine positif
Comme indiqué dans le tome I du présent rapport, l'effort structurel (c'est-à-dire la part discrétionnaire de l'évolution du déficit4(*)) serait à peine positif (0,9 milliard d'euros). En effet, les mesures d'économies et de hausses de recettes parviendraient juste à compenser la tendance spontanée des dépenses à augmenter plus rapidement que le PIB. Cela proviendrait notamment, dans le cas de l'Ondam, de mesures coûteuses supérieures aux mesures d'économie.
D'autre part, les facteurs d'évolution indépendants de l'action du Gouvernement aggraveraient le déficit de 8,5 milliards d'euros. En effet, la dégradation de la conjoncture (le Gouvernement prévoyant une croissance de 0,7 % en 2025) se traduirait par une dégradation du solde conjoncturel d'environ 3,3 milliards d'euros. Par ailleurs, hors mesures nouvelles (du fait notamment de cette conjoncture défavorable), les recettes tendraient spontanément à diminuer de 5,2 milliards d'euros par rapport à ce qui proviendrait d'une croissance au même rythme que le PIB potentiel.
Décomposition indicative de
l'évolution du solde de la sécurité sociale
entre 2024
et 2025 (Robss+FSV)
(en milliards d'euros)
Un montant positif (bâtons verts) correspond à une amélioration du solde, un montant négatif (bâtons rouges) à une dégradation du solde.
Lecture : En 2025, l'écart de l'évolution spontanée des dépenses par rapport à celle du PIB potentiel dégraderait le solde de 6,2 milliards d'euros.
Solde effectif : PLFSS pour 2026. Soldes conjoncturel et structurel calculés par la commission des affaires sociales d'après les estimations du PIB potentiel de la Commission européenne (mai 2025). Economies Ondam : 4,3 milliards d'euros prévus par la LFSS 2025 (source : annexe 5 au PLFSS pour 2026) moins le montant des révisions à la baisse de mesures par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie dans son avis de juin 2025 (moindres économies sur les médicaments pour 0,7 milliard d'euros et abaissement du taux plafond de remises commerciales sur les génériques pour 0,1 milliard d'euros) plus le montant des mesures correctives jugées crédibles par le comité d'alerte dans son avis de septembre 2025 (1,5 milliard d'euros). Impact de la réforme des retraites : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025. Mesures nouvelles sur les recettes : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025.
AG : allégements généraux de cotisations sociales patronale. CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. FSV : Fonds de solidarité vieillesse. Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale. TVA : taxe sur la valeur ajoutée.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après les sources indiquées
2. Un déficit 2025 provenant de la branche maladie et dans une moindre mesure de la branche vieillesse
Le déficit correspondrait très majoritairement à celui de la branche maladie, celui de la branche vieillesse, bien qu'en augmentation, demeurant nettement moins élevé.
Prévisions de solde des différentes branches par le présent PLFSS (2025)
(en milliards d'euros)
|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
|
Maladie |
245,1 |
262,3 |
- 17,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
16,9 |
17,5 |
- 0,5 |
|
Vieillesse |
297 |
303,4 |
- 6,3 |
|
Famille |
60,2 |
59,3 |
0,8 |
|
Autonomie |
41,7 |
42 |
- 0,3 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
642,3 |
665,8 |
- 23,5 |
|
Toutes branches (hors transferts entre
branches), |
643,1 |
666,1 |
- 23,0 |
Source : PLFSS 2026
3. Un supplément de déficit en 2025 par rapport à la LFSS 2025 provenant de moindres recettes et concentré sur la branche maladie
a) Par rapport à la LFSS 2025, un supplément de déficit en 2025 provenant de moindres recettes
Par rapport à la prévision de la LFSS 2025, le supplément de déficit, de 0,9 milliard d'euros, proviendrait essentiellement de recettes inférieures de 1,2 milliard d'euros aux prévisions, alors que les dépenses ne seraient que légèrement inférieures aux prévisions (- 0,3 milliard d'euros).
Recettes et dépenses de la sécurité sociale en 2025 (Robss + FSV)
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
L'annexe à la future LFSS prévoit que l'Ondam serait strictement égal à la prévision de la LFSS 2025, soit 265,9 milliards d'euros5(*).
b) Par rapport à la LFSS 2025, une révision à la hausse du déficit concernant essentiellement la branche maladie
Le tableau suivant détaille, par branche, l'évolution des prévisions de soldes pour 2025.
On observe que la révision à la hausse du déficit, de 0,9 milliard d'euros, provient essentiellement de la branche maladie (déficit revu à la hausse de 1,8 milliard d'euros), et dans une moindre mesure de la branche AT-MP (déficit revu à la hausse de 0,7 milliard d'euros). Dans le cas de la branche vieillesse, l'amélioration du solde, de 1,2 milliard d'euros, est de 1,6 milliard d'euros sur l'ensemble constitué par la branche vieillesse et le FSV.
Prévisions de recettes, de dépenses et de solde des Robss et du FSV pour 2025
(en milliards d'euros)
|
|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
LFSS 2025 |
|||
|
Maladie |
246,4 |
261,8 |
-15,4 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
17,1 |
17,0 |
0,2 |
|
Vieillesse |
296,6 |
304,1 |
-7,5 |
|
Famille |
59,9 |
59,5 |
0,4 |
|
Autonomie |
41,9 |
42,6 |
-0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
643,0 |
666,1 |
-23,0 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
644,3 |
666,4 |
-22,1 |
|
PLFSS 2026 |
|||
|
Maladie |
245,1 |
262,3 |
-17,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
16,9 |
17,5 |
-0,5 |
|
Vieillesse |
297,0 |
303,4 |
-6,3 |
|
Famille |
60,2 |
59,3 |
0,8 |
|
Autonomie |
41,7 |
42,0 |
-0,3 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
642,3 |
665,8 |
-23,5 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
643,1 |
666,1 |
-23,0 |
|
Écart |
|||
|
Maladie |
-1,3 |
0,5 |
-1,8 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
-0,2 |
0,5 |
-0,7 |
|
Vieillesse |
0,4 |
-0,7 |
1,2 |
|
Famille |
0,3 |
-0,2 |
0,4 |
|
Autonomie |
-0,2 |
-0,6 |
0,4 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
-0,7 |
-0,3 |
-0,5 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
-1,2 |
-0,3 |
-0,9 |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après les textes indiqués
B. La rectification de l'objectif d'amortissement de la Cades
Le présent article révise légèrement l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) fixé par la LFSS 2025.
Cet objectif s'établirait à 16,2 milliards d'euros, au lieu de 16,28 milliards d'euros en LFSS 2025.
C. La confirmation de l'absence de recettes affectées au FRR
Comme prévu par la LFSS 2025, les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.
II. Le dispositif transmis au Sénat
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale6(*).
III - La position de la commission
La prévision de déficit du présent article (23,0 milliards d'euros) est égale à celle figurant dans le rapport d'octobre 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale.
Le présent article est une disposition obligatoire des LFSS (article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale). Son absence susciterait un risque d'inconstitutionnalité de l'ensemble du PLFSS.
Aussi, la commission a adopté un amendement n° 586 de sa rapporteure générale tendant à rétablir l'article.
La commission propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.
Article 2
(supprimé)
Rectification de l'Ondam et des sous-objectifs de
l'Ondam
Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, propose de maintenir l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) au montant de 265,9 milliards d'euros fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Il procède en revanche à une rectification des sous-objectifs qui le composent pour tenir compte du dynamisme des soins de ville et des mesures infra-annuelles de maîtrise des dépenses, adoptées par le Gouvernement à la suite du déclenchement de la procédure d'alerte de risque de dépassement de l'Ondam.
La commission propose de rétablir cet article modifié par un amendement visant à augmenter les financements attribués aux établissements de santé.
I - Le dispositif proposé : un Ondam 2025 inchangé mais des rééquilibrages entre sous-objectifs
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, au titre de l'article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale.
Il a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Un montant d'Ondam inchangé à la suite de mesures de maîtrise des dépenses en cours d'année
1. Un montant d'Ondam fixé à 265,9 milliards d'euros en février 2025, à un niveau supérieur de 2 milliards d'euros à la prévision initiale du Gouvernement en octobre 2024
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, promulguée le 28 février 2025, a fixé l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) à 265,9 milliards d'euros pour l'année 2025.
Ce montant est supérieur de 2 milliards d'euros à la prévision initiale du Gouvernement, l'Ondam pour 2025 ayant été fixé à 263,9 milliards d'euros lors du PLFSS déposé par le Gouvernement le 10 octobre 2024.
Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, la commission avait déploré les variations multiples des prévisions budgétaires du Gouvernement au cours de la navette, avec des ajustements à la hausse, puis à la baisse, puis de nouveau à la hausse de l'Ondam, en conséquence notamment de l'évolution de mesures réglementaires souvent mal définies.
Le montant finalement fixé tenait en partie compte du risque élevé de dépassement de l'Ondam que soulignait le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie dès le dépôt du PLFSS.
2. Un montant prévisionnel de l'Ondam inchangé par rapport à la loi initiale de financement de la sécurité sociale, pour la première fois depuis 2019
Le Gouvernement présente, dans le PLFSS pour 2026, un montant d'Ondam inchangé par rapport à la prévision de la LFSS, et ce pour la première fois depuis 2019.
Si, de 2010 à 2019, les dépenses constatées étaient, chaque année, inférieures à celles prévues initialement, la crise sanitaire de la covid-19 avait interrompu cette tendance.
L'Ondam a connu une nette progression au cours des six dernières années, sous l'effet de la crise sanitaire mais aussi de mesures de revalorisation salariale et de soutien à l'attractivité des établissements de santé dans le cadre du Ségur de la santé et d'une inflation très élevée en 2023. Il est ainsi passé de 200,2 milliards d'euros en 2019 à 265,9 milliards d'euros en 2025, soit une augmentation de 33 %.
Sur cette période, la hausse des dépenses a été systématiquement supérieure en exécution aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale initiale. Le dépassement de l'Ondam a ainsi été supérieur à 10 milliards d'euros en 2020, 2021 et 2022, puis a retrouvé des niveaux plus limités en 2023 et 2024, avant d'être, cette année, annoncé comme nul.
Évolution de l'Ondam entre 2004 et 2025 : montant exécuté, écart par rapport aux prévisions et évolution par rapport à l'année précédente
Note de lecture : en abscisses figure le niveau de dépenses constaté en milliards d'euros et en ordonnées le taux d'évolution associé ; la taille de la bulle représente l'ampleur du dépassement (en rouge) ou de la sous-exécution (en vert). Ainsi, en 2024, les dépenses totales dans le champ de l'Ondam atteindraient 256,1 milliards d'euros, soit une évolution à périmètre constant de 3,3 %. Le dépassement en 2025 n'apparaît pas car il est nul cette année.
Source : Annexe 5 au PLFSS pour 2026
Écarts de l'Ondam par rapport à l'objectif initial de la LFSS
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, données des PLFSS
Un maintien de l'Ondam 2025 au niveau prévu lors de la LFSS 2025 correspond à une progression de 3,6 % par rapport au niveau constaté en 2024. Ce taux est légèrement plus élevé que le taux d'évolution envisagé lors de la construction de la LFSS 2025 (3,4 %), en raison de l'actualisation de la base 2024.
3. Une absence de rectification rendue possible par des mesures de maîtrise des dépenses en cours d'exercice
Dès avril 2025, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a estimé qu'il existait des « risques importants » de dépassement de l'Ondam 2025 à défaut d'un encadrement effectif des dépenses de soins de ville7(*). Il déplorait, dans ce cadre, l'absence de mises en réserves en début d'année sur les financements destinés aux soins de ville, permettant de compenser un dépassement éventuel, comme pour les autres sous-objectifs.
Dans son avis publié le 18 juin 2025, le comité d'alerte a estimé qu'il existait un « risque sérieux » que les dépenses d'assurance maladie dépassent le seuil d'alerte, fixé à 0,5 % du montant prévisionnel de l'Ondam8(*), soit en 2025 1,3 milliard d'euros9(*). Ce risque était principalement lié à des dépenses de soins de villes dynamiques, notamment dans le champ des médicaments et des indemnités journalières, et à une activité hospitalière dans les établissements publics et privés non lucratifs plus élevée que prévu.
Le comité a donc décidé de déclencher la procédure d'alerte prévue par le code de la sécurité sociale10(*).
Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie
Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a été créé par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie.
Au titre de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, il est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'Ondam voté par le Parlement.
Chaque année, il publie a minima trois avis :
- au 15 avril, il publie un avis dans lequel il analyse les anticipations de réalisation de l'Ondam de l'année précédente et en déduit les conséquences sur le respect de l'Ondam de l'année en cours ;
- au 1er juin, et en tant que de besoin, il rend un avis sur le respect de l'Ondam pour l'exercice en cours, en se fondant notamment sur l'analyse de l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie ;
- au 15 octobre, il rend un avis sur le respect de l'Ondam de l'année en cours et sur l'élaboration de l'Ondam pour l'année à venir.
L'article L. 114-4-1 prévoit la procédure suivante en cas de risque sérieux de dépassement de l'Ondam :
- lorsque le comité considère qu'il existe un « risque sérieux » que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'Ondam de plus de 0,5 %11(*), il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie ;
- les caisses nationales d'assurance maladie proposent alors des mesures de redressement ;
- le comité rend un avis sur l'impact financier des mesures de redressement proposées par les caisses nationales d'assurances maladies et, le cas échéant, de celles que l'État entend prendre ;
Cette procédure a été déclenchée pour la première fois en mai 2007.
Elle a été déclenchée en juin 2025 pour la seconde fois.
À la suite de l'avis du comité d'alerte, le Gouvernement a annoncé des mesures d'économies à hauteur de 1,74 milliard d'euros, reprenant des mesures proposées par les caisses nationales d'assurance maladies ainsi que des mesures additionnelles, afin d'assurer le respect de l'Ondam 2025.
Ces mesures infra-annuelles de redressement ont principalement porté sur l'annulation de crédits aux établissements de santé et médico-sociaux mis en réserve en début d'année, une diminution des dotations au fonds de modernisation et d'investissement en santé (FMIS) et au fonds d'intervention régional (FIR), des mesures de baisses de prix sur les produits de santé et des actions renforcées de maîtrise médicalisée des dépenses.
En outre, de façon automatique dès lors que le risque de dépassement était imputable aux dépenses de soins de ville12(*), l'entrée en vigueur des revalorisations conventionnelles des professionnels de santé libéraux a été suspendue.
B. Des rectifications portant sur les sous-objectifs de l'Ondam
Le présent article propose de rectifier les montants des sous-objectifs sont rectifiés pour tenir compte à la fois de dynamiques de dépenses inégales et des mesures infra-annuelles de maîtrise des dépenses engagées par le Gouvernement.
Les rectifications des sous-objectifs de l'Ondam 2025 proposées par cet article
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, données du PLFSS 2026
· Les dépenses de soins de ville ont été plus dynamiques qu'anticipé (+0,7 milliard d'euros), tirées principalement par :
- un effet volume des indemnités journalières (+0,5 milliard d'euros), en raison d'une forte augmentation des indemnités journalières pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) et des indemnités maladie de plus de trois mois ;
- un dépassement des autres soins de ville (+0,1 milliard d'euros), en raison d'une montée plus rapide que prévu des aides à la télésurveillance et des honoraires de psychologues notamment via le dispositif « Mon soutien psy » ;
- un dépassement des dépenses d'honoraires des chirurgiens-dentistes, médecins spécialistes et infirmiers libéraux et de transports sanitaires ;
- les dépenses de produits de santé de ville nets des remises (+0,5 milliard d'euros), en raison d'économies inférieures à celles envisagées lors de la LFSS 2025 et de volumes plus dynamiques que prévu.
En revanche, à la suite de l'avis du comité d'alerte, les revalorisations conventionnelles non encore entrées en vigueur au moment de la publication de l'avis (masseurs-kinésithérapeutes, médecins spécialistes et généralistes) ont été repoussées au 1er janvier 2026. En outre, en raison de retards dans les négociations conventionnelles, les provisions inscrites en LFSS pour 2025 n'ont pas été consommées.
Au global, les dépenses de soins de ville progresseraient de 3,7 % en 2025 par rapport à la base actualisée de 202413(*).
· Les dépenses relatives aux établissements de santé seraient inférieures à celles de la LFSS (-0,2 milliard d'euros).
L'activité en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) a été plus dynamique qu'anticipée, ce qui devrait susciter un dépassement des dépenses (+0,3 milliard d'euros).
En revanche, les dotations forfaitaires seraient sous-exécutées (-0,3 milliard d'euros), à hauteur du montant du gel définitif des mises en réserves de début d'année, décidé à la suite de l'alerte du comité d'alerte.
Au global, les dépenses relatives aux établissements de santé progresseraient de 3,8 % en 2025 par rapport à la base actualisée de 202414(*).
· Les dépenses de l'Ondam médico-social, relatives aux établissements et services pour personnes âgées (3e sous-objectif) et à ceux pour personne handicapées (4e sous-objectif), sont inférieures à l'objectif initial (-0,4 milliard d'euros) en raison du gel des crédits mis en réserve et de mesures de périmètre.
· Les dépenses relatives au Fonds d'intervention régional (FIR) et au soutien national à l'investissement seraient inférieures aux prévisions initiales (-0,2 milliard d'euros) en raison de mesures décidées à la suite du déclenchement de la procédure d'alerte : des annulations de crédits mis en réserve au début de l'année, un report au 1e janvier 2023 de l'entrée en vigueur de la majoration de la rémunération des gardes des praticiens libéraux en établissement de santé et une baisse de la dotation au FMIS.
· Les dépenses correspondant aux autres prises en charge (6e sous- objectif) seraient sous-consommées (-0,1 milliard d'euros) à la suite des annulations de crédits mis en réserve au début de l'année.
Synthèse de la révision de l'Ondam 2025
Remarque de la rapporteure générale : les montants de la colonne « Écart à la LFSS pour 2025 » ne correspondent pas exactement à ceux indiqués supra dans le présent commentaire. En effet, le présent commentaire compare les montants de la LFSS 2025 et du PLFSS 2026, précis à la centaine de millions près. Ce tableau compare quant à lui les prévisions de la direction de la sécurité sociale, plus précises et qui conduisent à certains arrondis.
Source : Direction de la sécurité sociale
Évolution des sous-objectifs de l'Ondam entre 2024 et 2025 (en exécution)
* Variation par rapport à la base actualisée.
Source : Commission des affaires sociales, données du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025
II - La position de la commission
A. Un respect de l'Ondam bienvenu, mais à confirmer
· La commission se félicite du respect de l'Ondam, pour la première fois depuis 2019.
Elle plaidait ces dernières années pour que l'Ondam retrouve son rôle initial de régulation des dépenses, ce qui suppose à la fois que l'Ondam initial soit correctement évalué et que des mesures de régulation puissent être prises en cours d'exercice afin de s'assurer du respect de l'Ondam voté.
La construction et la régulation de l'Ondam 2025 semblent satisfaire à cette double exigence, ce que la commission ne peut que saluer.
· Cependant, la commission relève que le strict respect de l'Ondam n'est pas encore entièrement garanti et suppose la bonne mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de régulation annoncées par le Gouvernement et l'absence de concrétisation d'aléa haussier.
Dans son avis publié le 17 septembre 2025, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie estime que les mesures annoncées par le Gouvernement ont été calibrées pour assurer un respect de l'Ondam mais qu'elles pourraient ne pas complètement suffire15(*). Il évalue le montant des mesures sécurisées à 1,5 milliard d'euros, contre 1,74 milliard d'euros pour le Gouvernement.
Ainsi, s'il considère comme étant sécurisées les économies associées aux baisses de prix de médicaments et aux réductions de dotations, il estime que 240 millions d'euros d'économies paraissent devoir être écartées :
- le montant de 200 millions d'euros d'économies attendues des actions ciblées de maîtrise médicalisée des dépenses serait incertain et ne ferait que conforter la réalisation de l'objectif initial, sans économies supplémentaires ;
- les effets de la nouvelle convention de juillet 2025 avec les taxis pourraient être surévalués de 15 millions d'euros.
Au vu de l'avis du comité d'alerte, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) juge, dans son avis du 9 octobre 2025 sur le PLFSS, qu'un dépassement modeste reste vraisemblable. Il relève en outre que la situation financière des hôpitaux est très dégradée et pourrait l'être davantage compte tenu des réductions de leurs dotations.
Dans son dernier avis publié le 4 novembre 2025, le comité d'alerte estime qu'« il est probable que l'ONDAM qui sera constaté s'écartera de la prévision, à la baisse ou à la hausse, dans une mesure que le comité d'alerte n'est pas en mesure d'évaluer, mais qui apparaît en tout état de cause devoir être inférieure au seuil d'alerte de 1,3 milliard d'euros »16(*).
Il identifie un risque de dépassement sur le poste des dépenses des médicaments en ville, sous l'effet d'une entrée en vigueur plus tardive que prévu d'une partie des mesures de baisses de prix annoncées par le Gouvernement. Des dépassements de moindre ampleur sont par ailleurs susceptibles d'intervenir pour d'autres postes, tels que les dispositifs médicaux et les actes de biologie médicale.
Dans son rapport de novembre 2025 sur la situation financière de la sécurité sociale17(*), la Cour des comptes estime que « l'exécution de l'Ondam 2025 reste affectée par de nombreuses incertitudes, et les aléas sont haussiers », en raison d'un montant des économies mises en oeuvre en 2025 inférieur à celui envisagé lors de la construction de l'Ondam en LFSS, d'un rythme de progression des indemnités journalières qui reste soutenu et mal anticipé, et d'une activité dynamique des établissements.
La Cour note toutefois que, sur les crédits destinés aux établissements de santé et médico-sociaux mis en réserve en début d'année 2025, il reste une réserve complémentaire de 420 millions d'euros qui pourrait être mobilisée par le Gouvernement en fin d'année pour assurer le respect de l'Ondam. Une telle annulation signifierait cependant une dégradation supplémentaire de la situation financière des établissements de santé.
B. Des dépassements systématiques des dépenses de soins de ville qui conduisent à s'interroger sur la construction et la régulation de ce sous-objectif
La commission constate que le sous-objectif relatif aux soins de ville connaît des dépassements systématiques depuis 2020, y compris hors effets de crise.
Alors que les différents sous-objectifs de l'Ondam font l'objet de mises en réserve en début d'année, aucune procédure de ce type n'est prévue pour les financements destinés aux soins de ville.
La commission appelle, comme elle le fait régulièrement, à mobiliser les mécanismes conventionnels et de régulation des dépenses, en partenariat avec les professionnels de santé, afin de freiner la croissance dynamique des soins de ville.
C. Des ajustements au sein de l'Ondam préoccupants pour les établissements de santé
La commission s'inquiète des conséquences sur la situation financière des hôpitaux des mesures de redressement prises en 2025, à la suite du déclenchement de la procédure d'alerte, alors même que leur situation financière est d'ores et déjà dégradée.
Certes, les établissements de santé ont bénéficié d'une reprise d'activité depuis 2023, qui s'est accélérée en 2024 et plus encore en 2025.
La Fédération hospitalière de France (FHF) indique ainsi une augmentation de 4 % du nombre de séjours en 2024 et une hausse équivalente sur l'année 2025, l'activité réalisée correspondant désormais à l'activité attendue au vu de l'évolution démographique et du taux de recours constaté avant la période de la crise sanitaire.
Cependant, la situation financière des établissements de santé continue de se dégrader. Le déficit des hôpitaux atteindrait près de 3 milliards d'euros fin 2024. Le taux d'endettement des hôpitaux publics ne diminue pas, restant stable depuis plusieurs années, à environ 45,5 %.
Selon des études de la FHF, la dégradation de la situation financière des hôpitaux publics est intégralement due à des effets prix - inflation et mesures de revalorisation salariale - et à leur sous-financement, qui pèse sur la trésorerie des établissements, dont le délai de paiement des fournisseurs s'accroît chaque année, et sur leur dette sociale et fiscale.
Devant la commission, le directeur général de la Cnam a reconnu que les mesures de revalorisations salariales du Ségur de la Santé n'ont pas été entièrement compensées.
En ne couvrant pas les charges effectives des établissements, le Gouvernement laisse se constituer de nouveaux déficits et se développer la dette.
La commission souhaite marquer sa préoccupation quant à un juste niveau de financement des établissements de santé en modifiant la ventilation de l'Ondam par la majoration de 200 millions d'euros du deuxième sous-objectif de l'Ondam, sans modifier toutefois le montant global de l'Ondam pour 2025. Cette majoration est donc compensée par une minoration de 200 millions d'euros du sixième sous-objectif. Elle a adopté un amendement n° 587 de sa rapporteure rétablissant l'article 2 avec cette nouvelle ventilation des sous-objectifs.
Sous ces réserves, la commission propose de rétablir cet article ainsi modifié.
Article 3
(supprimé)
Rectification de la contribution des régimes
d'assurance maladie au FMIS
Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, propose de diminuer de 60 millions d'euros le montant de la contribution de l'assurance maladie au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) en 2025, pour l'établir à 463 millions d'euros.
La commission propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.
I - Le dispositif proposé : une diminution de la dotation au FMIS pour 2025
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. En 2025, le FMIS est de nouveau mobilisé pour financer des investissements immobiliers et numériques en santé
L'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 202318(*) a fixé la dotation au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) à 633 millions d'euros pour 2025, dont 523 millions d'euros de contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie et 86 millions d'euros de contribution de la branche autonomie du régime général.
Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé
À la suite des conclusions du Ségur de la santé en 2020, l'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a transformé le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) en un nouveau fonds pour la modernisation et l'investissement en santé.
Ce fonds constitue le principal vecteur financier du volet « investissement » du Ségur de la santé. Il permet de soutenir les investissements immobiliers et numériques au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Son périmètre s'étend également aux structures d'exercice coordonné en ville. En particulier, il accompagne les projets validés au niveau national dans le cadre de l'ancien Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins (Copermo) puis du Comité national de l'investissement en santé (Cnis) qui lui a succédé dans le cadre du Ségur.
Les ressources du fonds sont principalement constituées de dotations de l'assurance maladie et de la branche autonomie.
Le montant des dotations est défini tous les ans, dans le cadre de la LFSS.
Sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
En 2025, les crédits FMIS ont été principalement mobilisés, pour la cinquième année consécutive, pour accompagner les investissements immobiliers et numériques au sein des établissements de santé et médico-sociaux, dans le cadre des engagements du Ségur de la santé. 400 millions d'euros ont été délégués pour les projets d'investissement prioritaires des établissements de santé, 100 millions d'euros pour l'accompagnement de leur investissement courant et 56 millions d'euros pour l'investissement numérique dans le secteur médico-social.
Les crédits FMIS ont également soutenu les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), dans le cadre du plan pluriannuel visant à atteindre 4 000 MSP sur le territoire national d'ici 2027, à hauteur d'environ 15 millions d'euros.
Enfin, ils ont été mobilisés pour soutenir divers projets :
- les investissements immobiliers et en équipements nécessaires pour la formation pratique des étudiants en chirurgie dentaire dans le cadre des nouvelles facultés d'odontologie ;
- le raccordement IP des services d'aide médicale urgente (Samu) et les équipements en jumelles de vision nocturne des équipages HéliSMUR ;
- la numérisation de l'anatomocytopathologie, dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers (17 millions d'euros) ;
- la modernisation de structures sanitaires de soins accueillant des accidentés de la route (50 millions d'euros)19(*).
B. La dotation au FMIS est réduite en cours d'exercice en raison d'un risque de dérive de l'Ondam 2025
Le présent article réduit le montant de la dotation de l'assurance maladie au FMIS, le ramenant à 463 millions d'euros pour l'année en cours, soit une diminution de 60 millions d'euros. En revanche, la contribution de la branche autonomie au FMIS demeure inchangée.
Le Gouvernement indique, dans l'exposé des motifs, que cette révision à la baisse s'inscrit dans le cadre des mesures de maîtrise des dépenses de l'Ondam prises à la suite du déclenchement de la procédure d'alerte en juin 2025.
II - La position de la commission
La commission prend acte de la révision à la baisse de la dotation au FMIS, justifiée par la nécessaire maîtrise des dépenses dans un contexte de « risque sérieux » de dépassement de l'Ondam.
Elle déplore cependant l'absence de précisions quant aux crédits affectés et aux conséquences de cette diminution sur les projets portés par le fonds.
La commission propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale, en adoptant l'amendement n° 719.
DEUXIÈME
PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À
L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR L'EXERCICE 2026
TITRE
IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT
ET À LA TRÉSORERIE
Article
4
Renforcer les pouvoirs de recouvrement des organismes
Cet article propose :
- afin de rendre plus effectif le privilège de la sécurité sociale, qui lui donne le droit d'être payée par préférence aux autres créanciers, de supprimer l'obligation de publicité de ce privilège ;
- d'instaurer une expérimentation tendant à légaliser certaines délégations de signature des Urssaf aux présidents de commission des chefs de services financiers et des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) ;
- d'étendre à douze mois, comme pour l'administration fiscale, le délai permettant de convertir une déclaration provisionnelle de créance sociale en déclaration définitive ;
- de supprimer la disposition du code rural et de la pêche maritime autorisant certaines remises contraires au code de la sécurité sociale en les alignant ainsi sur des modalités identiques à celles du régime général.
L'objectif est de rapprocher les règles applicables au recouvrement forcé dans les sphères fiscale et sociale.
La commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé
A. La suppression de l'obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale
1. En l'état actuel du droit, les créanciers sociaux perdent les privilèges de leurs créances s'ils ne parviennent pas à les inscrire à temps auprès des tribunaux
a) L'obligation d'inscription des créances privilégiées à un registre public
La créance privilégiée, développée aux articles 2284 à 2488-12 du code civil, est une sûreté20(*), qui en cas d'insolvabilité du débiteur, confère à un créancier le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers.
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dispose qu'au-delà d'un montant fixé par décret, les créances privilégiées « doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ». Le privilège peut être conservé pendant deux ans et demi à compter du jour où la créance a fait l'objet de son inscription, sans possibilité de renouvellement. Le débiteur obtient automatiquement la remise de ses majorations et de ses pénalités de retard ainsi que des frais de justice en cas d'ouverture d'une procédure collective, afin de ne pas grever davantage ses comptes pour que cette procédure aboutisse21(*).
Lorsqu'une créance est inférieure au montant du seuil d'inscription obligatoire, elle bénéficie de facto du privilège de la sécurité sociale mentionné. Les seuils sont de 10 000 euros pour les créances des travailleurs indépendants, de 15 000 euros pour les créances d'employeurs de moins de 50 salariés et de 20 000 euros pour les autres créances.
L'article 1929 quater du code général des impôts dispose que les créances sociales doivent faire l'objet d'une publicité, à la diligence de l'administration chargée du recouvrement, et de l'émission d'un titre exécutoire lorsque le montant des créances dépasse le seuil précité. Il existe de substantielles dérogations, notamment lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement de sa dette ou a déposé une réclamation d'assiette redevable assorti d'une demande de sursis.
À titre informatif, en 2024, l'Urssaf a encaissé 571 milliards d'euros auprès de 11,8 millions d'usagers. Au 30 mars 2025, le taux de restes à recouvrer était de 0,98 % pour les employeurs du secteur privé. Plus de 90 % des créances sont recouvrées dans les 360 jours qui suivent leur émission. Les inscriptions de privilèges concernent une faible part des créances, avec 23 996 inscriptions de privilèges pour 1,5 milliard d'euros de créances en 202422(*).
b) Des conditions de remboursement dégradées à défaut d'inscription
La publicité d'une créance, encadrée à l'article L. 622-24 du code de commerce, vise à informer les créanciers de l'ouverture d'une procédure collective en leur permettant de déclarer leurs créances dans un délai imparti afin d'établir la liste définitive des créances admises.
À défaut d'inscription, les créances sont réputées chirographaires, c'est-à-dire sans sûreté particulière, et peuvent le cas échéant être soumises à des conditions de remboursement dégradées, par exemple en cas de liquidation judiciaire.
Les créanciers publics sont souvent informés tardivement du basculement d'une entreprise débitrice en procédure collective, alors que l'inscription des privilèges a pu être repoussée par le passé afin d'aider sur le plan réputationnel une entreprise. En effet, la publicité du privilège fait que les fournisseurs d'une entreprise sont susceptibles de réduire les délais octroyés pour assurer le règlement de leurs factures, entraîne un accès réduit à des crédits de court-terme auprès d'établissements bancaires et peut favoriser la perte de clients ou de marchés publics.
L'inscription des créances au registre des sûretés n'est généralement pas automatisée et s'avère le cas échéant particulièrement lourde. Dans certaines situations, comme lorsque l'entreprise bascule de façon rapide et non anticipée en procédure collective, les privilèges ne sont pas inscrits à temps.
En 2024, des créances d'un montant total de 1,2 milliard d'euros ne sont pas couvertes par la publicité du privilège. Ces créances peuvent être couvertes par le privilège occulte ou non couvertes par un quelconque privilège. Ces créances font l'objet, à hauteur de 89 % en 2025, d'une régularisation qui intervient dans les 12 mois suivant leur date d'exigibilité23(*).
Il est difficile d'estimer le nombre de dossiers où l'ouverture rapide d'une procédure collective a empêché l'inscription des privilèges. Le non-respect d'un plan d'apurement, suivi immédiatement par une procédure collective, notamment pour les entreprises multi-établissements ou les groupes, en constitue le facteur déterminant. Par exemple, un groupe d'entreprises a récemment fait l'objet d'une procédure collective rapide, rendant impossible l'inscription des privilèges sur environ 3,3 millions d'euros de passif Urssaf, sur la moitié d'un passif total de 6,5 millions d'euros24(*).
L'effet limité des inscriptions de
privilège dans le recouvrement
des créances en liquidation
judiciaire
Entre 2017 et octobre 2025, les liquidations judiciaires des entreprises ont généré 9,6 milliards d'euros de créances. Dans les six mois suivant la liquidation, 572 millions d'euros ont été encaissés, soit 6 % du total. Au-delà de cette période, les encaissements atteignent 135 millions d'euros, soit 1,4 % des créances25(*). L'Urssaf rencontre ainsi de grandes difficultés pour encaisser les créances au cours d'une liquidation judiciaire26(*).
Les procédures incluant au moins une inscription de privilège représentent 6,4 % du total. Leur taux de recouvrement à six mois, d'environ 2 % est inférieur à celui des procédures sans inscriptions de privilèges, estimé à 9,2 %, mais cette différence s'explique par la nature des créances. En effet, le montant moyen des procédures entièrement couvertes par une inscription de privilège, à hauteur de 130 000 euros est bien plus élevé que celui des procédures sans inscription de privilège 16 000 euros. La présence d'une inscription de privilège n'est donc pas la cause du faible recouvrement, mais reflète plutôt le profil des créances concernées27(*).
2. Le dispositif proposé vise à supprimer l'obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale afin de faciliter le recouvrement des créances sociales
Le 2° du I de l'article 4 vise à modifier le premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, en supprimant la durée fixe d'un an à partir de la date d'exigibilité pendant laquelle le paiement des cotisations et des majorations et des pénalités de retard dues est garanti par un privilège sur les biens meubles du débiteur. Il renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination de la durée et des modalités d'exercice du privilège.
Dans sa décision n° 85-142 du 13 novembre 1985, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions qui mettent en cause l'existence même des droits de créances privilégiées sont de nature législative puisqu'elles touchent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. En revanche, le délai d'inscription des privilèges ne relève pas d'un principe touchant fondamentalement à ces obligations.
Le 3° du même I vise à supprimer les cinq premiers alinéas de l'article L. 243-5 dudit code. Cette modification éliminerait l'obligation d'inscription au registre des créances dépassant des seuils fixés par décret et permet ainsi de rendre le privilège automatiquement opposable sans publicité quel que soit le montant de la créance.
L'article L. 243-5 demeurerait mentionné dans le code de la sécurité sociale car il est nécessaire de faire état des dispositions en vigueur en matière de remise des majorations et pénalités de retard.
Par voie de conséquence, le 3° du même I supprimerait :
- la possibilité, caduque en cas d'adoption de la disposition, de différer l'inscription au registre tant que le débiteur respecte un calendrier ;
- la sanction pour défaut d'inscription en procédure collective qui était susceptible d'entraîner la perte du privilège ;
- les différentes modalités de radiation totale ou partielle des inscriptions.
Le 1° dudit I modifierait l'article L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale afin d'effectuer des coordinations de légistique visant à supprimer la référence à l'article L. 243-5 du code précité afin de ne conserver que la mention de l'article L. 243-4 dudit code. Le 4° du I de l'article 4 procèderait à une coordination de même nature.
Le V du même article préciserait que les dispositions du I n'entreraient en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2026 afin de répondre aux délais d'adaptation de l'organisation et des systèmes d'information des Urssaf et des caisses de la mutualité sociale agricole.
B. Une expérimentation tendant à légaliser certaines délégations de signature des Urssaf aux présidents de CCSF
1. Les délégations des Urssaf aux présidents de CCSF : une pratique usuelle mais contraire au code de la sécurité sociale
Les Urssaf peuvent déléguer une signature d'acte de garantie, c'est-à-dire un document juridique par lequel ces dernières s'engagent à suspendre ou d'aménager leurs actions de recouvrement à l'encontre d'une entreprise en difficulté, au président d'une commission des chefs de services financiers et des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) pour les entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement des créances sociales.
Bien qu'usuelle et fondée par ses résultats, la pratique contrevient à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la représentation des Urssaf est assurée par leurs directeurs dans tous les actes de la vie civile et qu'ils peuvent donner mandat à certains agents de leur organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. En revanche, l'article ne prévoit pas explicitement l'hypothèse d'un mandat accordé à l'administration fiscale.
À titre d'exemple, dans un dossier suivi en 2023 par la direction de la sécurité sociale, près de trois garanties différentes avaient été octroyées au bénéfice de cinq Urssaf différentes, avec près de 10 opérations de signatures distinctes uniquement pour les créanciers sociaux : la lourdeur administrative était conséquente.
Le risque juridique entourant cette pratique, consistant à ce qu'un débiteur en conteste la garantie à des fins d'annulation de créance, existe. Il est donc nécessaire de permettre à l'Acoss d'établir légalement cette délégation qui fluidifie considérablement le processus de sécurisation des créances dans les dossiers impliquant une multiplicité de signataire.
En 2024, près de 6 400 dossiers ont fait l'objet d'un délai accordé par les CCSF pour un montant total de 459,1 millions d'euros28(*).
2. Le dispositif proposé instaurerait l'expérimentation d'un mécanisme de mandatement
Le IV du présent article instaurerait, pour une durée expérimentale de trois ans à compter du 1er janvier 2026, un mécanisme de mandatement permettant aux directeurs des organismes de recouvrement de base de la sécurité sociale de déléguer aux directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, assurant la présidence des commissions des chefs de services financiers, la prise, l'inscription, la gestion et la réalisation des sûretés et garanties.
Ce dispositif s'appliquerait aux entreprises faisant l'objet d'un examen conjoint par différents créanciers publics et vise à faciliter le remboursement des dettes sociales quand des échéanciers de paiement sont accordés par différents créanciers publics.
L'objectif est de donner une faculté discrétionnaire au directeur des organismes de sécurité sociale afin qu'il puisse juger au cas par cas de l'opportunité de donner mandat au président de la commissions des chefs de services financiers pour la bonne gestion d'un dossier.
C. L'allongement du délai permettant de convertir une déclaration provisionnelle en déclaration définitive pour les créances sociales vise à aligner leur régime sur celles des créances fiscales
1. En l'état actuel du droit, la sécurité sociale ne bénéficie pas, comme l'administration fiscale, de la possibilité d'établir le montant définitif de ses créances sous un délai étendu à douze mois
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose que les créances de la sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Leur établissement définitif doit être effectué, à peine de forclusion, dans un délai fixé par les tribunaux de commerce à l'occasion d'un litige29(*), généralement inférieur à douze mois.
En revanche, pour les créances fiscales, lorsque la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel « doit être effectué par l'émission d'un titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture »30(*). Le délai dont bénéficie les créanciers fiscaux est ainsi plus long que celui fixé par les tribunaux.
Lorsqu'une procédure de contrôle de l'impôt est effectuée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet peut être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai est suspendu en cas de recours amiable.
Les contrôles ne sont jamais déclenchés sur une entreprise faisant déjà l'objet d'une procédure collective. Ainsi, sur 30 000 actions de contrôle comptable d'assiette initiés par le réseau des Urssaf en 2023 et en 2024, seulement 236 entreprises ont par la suite fait l'objet d'une procédure collective entre l'envoi de la première lettre d'observation et la date de dépôt au greffe, et 678 dans les six mois suivant la date de dépôt, représentant au total moins de 3 % des actions de contrôle engagées. Le réseau des Urssaf ne joue pas ainsi un rôle moteur dans le basculement d'une entreprise vers une procédure collective31(*).
Dès lors, il apparaît que « le délai laissé aux services fiscaux pour établir le montant définitif des créances à prendre en compte dans le cadre d'une procédure collective est plus longue que pour les créanciers sociaux »32(*).
2. Le présent article propose de permettre à la sécurité sociale de bénéficier du délai de douze mois actuellement applicables aux créanciers fiscaux
Le 1° du II du présent article modifie l'article L. 622-24 du code de commerce afin de modifier le champ d'application des dispositions relatives à l'établissement définitif des créances. La disposition allonge ainsi le délai permettant de convertir une déclaration provisionnelle en déclaration définitive pour les créances sociales.
Le 2° du II modifie également le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce en procédant à une coordination d'ordre rédactionnelle par une factorisation. Il s'agit de clarifier que seul le délai concernant l'établissement définitif des créances fiscales peut être suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales33(*).
La nouvelle rédaction proposée institue une symétrie parfaite pour le traitement des créances fiscales et des créances sociales, à l'exception de la suspension du délai pour la durée du recours aux commissions amiables34(*).
D. L'alignement des conditions de remise des pénalités et majorations de retard en cas d'ouverture de procédure collective du régime agricole sur celles du régime général
1. En l'état actuel du droit, l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions contradictoires avec celles de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit, entre autres dispositions, que les remises de pénalités ou majorations de retard ne sont possibles que si le passif déclaré ne résulte pas d'une infraction au travail dissimulé35(*).
Pourtant, l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime dispose « qu'en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis ».
L'article L. 725-5 précité et l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale apparaissent dès lors en contradiction manifeste.
L'article L. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit explicitement que « les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard due aux régimes légaux de protection sociale agricole ». L'objet de l'article L. 725-5 dudit code partage ainsi le même objet que l'article L. 725-9 précité tout en définissant des règles différentes.
2. La disposition abroge l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime afin de faire cesser cette incohérence
Le III de l'article 4 du présent article tend à abroger l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime afin de faire cesser la contradiction entre le régime des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par un redevable du même code avec celles prévues par la rédaction actuelle de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et celle proposée par le présent article 4.
Ainsi, les créances sociales verraient leur traitement uniformisé indifféremment du régime de sécurité sociale concerné.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels : l'amendement n° 2291 et l'amendement n° 2292.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission constate que cet article vise à mettre en place des dispositifs facilitant le recouvrement des créances sociales.
Partageant cet objectif de rendement et de justice fiscale, elle propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement n° 588 qu'elle a adopté.
Article 4 bis (nouveau)
Décalage de la
généralisation du service d'avance immédiate de
crédit d'impôt pour certains services à la personne
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de :
- décaler la prise en compte des activités de garde d'enfants de moins de six ans dans le cadre du service d'avance immédiate de crédit d'impôt pour les services à la personne du 1er juillet 2026 au 1er septembre 2027 en raison du risque majeur d'erreurs quant au rattachement de l'enfant à charge ;
- décaler la fin d'expérimentation de l'avance des aides aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) du 1er juillet 2027 au 1er septembre 2027 ;
L'objectif est de laisser le temps aux Urssaf et à la DGFiP de réunir les conditions techniques indispensables pour le succès des dispositifs.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La généralisation du versement contemporain des crédits d'impôts du complément du libre choix du mode de garde, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap ne sont pas possibles en l'état actuel.
1. Les principes généraux du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants, du complément de libre choix du mode de garde, de l'expérimentation de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap
L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 199136(*) instaure le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables domiciliés en France.
Le crédit d'impôt vise :
- l'emploi d'un salarié assurant la garde d'enfants, les services à domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité ;
- le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ;
- le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale.
Le montant du crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses afférentes nettes des aides perçues au titre de l'emploi du salarié à domicile dans la limite d'un plafond dépendant de la composition du foyer fiscal. Il ne bénéficie aux particuliers que six à dix-huit mois après le paiement de la prestation de services, à l'occasion de l'émission de l'avis d'imposition.
Fonctionnement du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne au particulier employeur
Source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, tome II (n° 99, 2023-2024)
Fonctionnement du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne au particulier client d'un prestataire de services
Source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, tome II (n° 99, 2024-2024)
L'article 1665 bis du code général des impôts dispose que l'acompte d'une partie du crédit d'impôt versé chaque année en janvier est réduit du montant des avances versées au cours des huit premiers mois de l'année précédente.
L'allocation personnalisée pour l'autonomie à domicile et la prestation de compensation du handicap ne sont perçues par le bénéficiaire qu'un mois après le paiement de la prestation de services par ce dernier. Également, le complément de libre choix du mode de garde n'est pas éligible à l'avance du crédit d'impôt. Le motif avancé est que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer qu'à des salaires ou des factures qui ne font pas l'objet d'une déduction préalable par d'autres dispositifs.
L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 202037(*) a prévu l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne. Le mécanisme vise à permettre aux personnes recourant aux services éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile d'adhérer à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couvertes par les aides auxquelles elles sont éligibles.
Les activités de garde d'enfants de moins de six ans étaient prévues dans le dispositif expérimental mais n'ont pas été mises en oeuvre en raison des difficultés techniques rencontrées par l'existence du complément du libre choix du mode de garde.
Par la suite, l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 202238(*) en a approuvé la généralisation progressive à l'ensemble des aides sociales et fiscales, dont l'APA et la PCH mais pour lesquelles la mise en oeuvre définitive a été reportée à 2023.
Les plafonds annuels de l'avance du crédit d'impôt s'élèvent à 6 000 euros39(*). L'employeur ou le salarié qui déclare des prestations fictives est exclu du dispositif pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans40(*). En 2023, près de 300 000 particuliers employeurs et 500 000 clients de prestataires ont eu recours au versement immédiat des aides fiscales et sociales aux services à la personne41(*). En revanche, les pratiques frauduleuses sont très nombreuses. Par exemple, des structures temporaires sont créées dans l'objectif de percevoir des sommes prétendument versées au titre de prestations fictives.
2. Le report de l'avance des aides aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap
L'harmonisation des outils informatiques et des pratiques de travail, ainsi que la mise en place de flux financiers et de données entre l'Acoss et les conseils départementaux, ont entraîné un nouveau report de la généralisation du versement immédiat des aides aux bénéficiaires de l'APA et de la PCH à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2024.
L'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a acté un report supplémentaire de cette généralisation au 1er juillet 2027.
Aujourd'hui, il s'avère que ces dispositifs ne sont toujours pas prêts, nécessitant un dernier report, estimé au 1er septembre 2027.
3. Le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants et le complément de libre choix du mode de garde
L'article 200 quater B du code général des impôts dispose que le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants correspond à 50 % des dépenses engagées par le contribuable pour la garde, en dehors du domicile, d'un enfant de moins de six ans à sa charge. Ces dépenses doivent être confiées à un assistant maternel agréé ou à un établissement de garde. L'article 20 de la loi de finances pour 202342(*) a limité à 3 500 euros annuels le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Si le montant du crédit d'impôt dépasse celui de l'impôt dû, l'excédent est remboursé au contribuable.
L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale dispose que le complément du libre choix de mode de garde est une aide versée aux ménages ou aux personnes employant un assistant maternel agréé ou une garde d'enfant à domicile. Il se compose de deux parties :
- une part liée au montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération de la personne assurant la garde ;
- une part calculée sur la base de la rémunération nette de cette même personne.
Pour en bénéficier, le ménage ou la personne doit exercer une activité professionnelle, sauf dans les cas suivants :
- poursuite d'études par la personne ou les deux membres du couple ;
- signature d'un contrat de service civique par la personne ou l'un des membres du couple ;
- perception de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation de solidarité spécifique ;
- statut de bénéficiaire du revenu de solidarité active avec inscription dans une démarche d'insertion professionnelle.
L'avance d'impôt pour les enfants de plus de six ans a pu être mise en oeuvre dès septembre 2022, soit un an plus tôt que prévu car n'étant pas éligible au complément du libre choix du mode de garde, sa mise en oeuvre était plus simple que celle pour les enfants de moins de six ans.
Pour les enfants de moins de six ans, l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 202443(*) a reporté sa mise en oeuvre au 1er juillet 2026 ainsi que la clôture du cadre expérimental du dispositif au 1er juillet 2027. Pour rappel, le dispositif existait dans l'expérimentation prévue par l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 202044(*) mais n'avait pas été mise en oeuvre. Toutefois, il est souhaitable de conserver la possibilité d'enclencher une expérimentation afin d'aider les caisses d'allocations familiales dans une éventuelle généralisation.
L'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 202445(*) prévoit que le complément de libre choix du mode de garde doit voir son mode de calcul évoluer, avec la possibilité de partager la prestation en cas de garde alternée et son application à la garde des enfants de six à douze ans pour les familles monoparentales, entraînant de nouvelles difficultés pour la contemporanéisation de son versement.
Ainsi, en l'état actuel, les modes de garde pour les enfants de moins de six ans ne permettent pas de bénéficier d'une avance de crédit d'impôt.
Le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Thibault Bazin, a indiqué, lors de la seconde séance publique du mardi 4 novembre 2025, qu'il semblait nécessaire de reporter une nouvelle fois la prise en compte des activités de garde d'enfants dans l'avance immédiate des services à la personne. Il précise que « le calendrier ne semble plus compatible avec le déploiement du service dans des conditions de sécurité satisfaisantes [...] et que les interactions entre les systèmes d'information de l'Urssaf caisse nationale et ceux de la DGFiP ne permettent pas, à ce jour, d'exclure les risques d'erreur ou de fraude s'agissant du rattachement correct de l'enfant à charge ou l'identification de l'état civil des enfants »46(*).
La ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin s'est déclarée favorable à cette proposition du député Thibault Bazin en précisant que si la mise en oeuvre pouvait être plus rapide que le nouveau calendrier proposé, elle le serait mais qu'en l'état les systèmes d'information des caisses d'allocations familiales n'étaient pas encore suffisamment agiles pour éviter des situations de dégrèvement ou de remboursement qui pénaliseraient les familles.
B. Le dispositif proposé visé à reporter la date de la fin de l'expérimentation de l'avance de l'APA et de la PCH ainsi que celle pour la prise en compte dans l'avance de crédit d'impôt des activités de garde d'enfants de moins de six ans
L'amendement n° 1644 du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Thibault Bazin, adopté par l'Assemblée nationale, a inséré le présent article.
Le 1° du I de cet article 4 bis modifierait l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale en reportant la date de la fin de l'expérimentation de l'avance des aides aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) du 1er juillet 2027 au 1er septembre 2027. En revanche, la date de la généralisation demeure fixée au 1er juillet 2027 dans la situation où les services seraient en mesure d'assurer sa mise en oeuvre avant la fin de l'expérimentation.
Le 2° du même I décalerait la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la durée de l'expérimentation de l'avance des aides aux bénéficiaires de l'APA et de la PCH à une date correspondant à la fin de ladite période d'expérimentation, en lieu et place du 31 décembre 2023.
Le II modifierait l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale afin de reporter la prise en compte des activités de garde d'enfants de moins de six ans dans l'avance immédiate des services à la personne du 1er juillet 2026 au 1er septembre 2027.
II - La position de la commission
La commission regrette cet énième décalage dans la mise en oeuvre de l'avance du versement du crédit d'impôt pour la garde des enfants de moins de six ans alors que de nombreuses familles, notamment les plus fragiles, présentent des besoins de trésorerie pour faire garder leurs enfants.
Elle souligne aussi que les multiples reports de la contemporanéisation du crédit d'impôt pour l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap nuisent à la situation des personnes concernées en créant de l'incertitude.
Afin de faciliter le travail des caisses d'allocations familiales pour la mise en oeuvre des dispositifs, la commission soutient l'adoption de cet article.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
5
Simplifier l'affiliation, la déclaration de revenu, l'action
sociale
et la gouvernance de la sécurité sociale des
artistes-auteurs
Cet article propose de transférer à l'Urssaf du Limousin certaines missions exercées par la sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA), à savoir :
- la gestion individuelle des demandes d'affiliation et de contrôle du champ du régime ;
- la gestion opérationnelle des dossiers individuels de l'action sociale et la prise en charge du recouvrement de l'ensemble des cotisations des artistes-auteurs.
L'article propose d'agréer une association de représentation entre les assurés et l'État :
- chargée de la détermination du champ de l'affiliation et du traitement des recours des décisions d'affiliation de l'Urssaf du Limousin ;
- et aidée d'un médiateur qui interviendrait en situation de litige entre un artiste-auteur et un organisme de sécurité sociale.
L'objectif est d'améliorer la prise en charge des affiliés de la sécurité sociale des artistes-auteurs grâce au transfert de ses missions à l'Urssaf du Limousin.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. En l'état actuel du droit, la sécurité sociale des artistes-auteurs assure une gestion dysfonctionnelle des droits sociaux de ses assurés
1. L'organisation de la protection sociale des artistes-auteurs est caractérisée par une inefficience de longue date qui pénalise directement ses assurés
a) Les difficultés passées de l'association parente de la sécurité sociale des artistes-auteurs
Depuis 1975, les artistes-auteurs sont rattachés à ce titre au régime général de la sécurité sociale47(*) pour leur couverture de base, qui leur verse les prestations maladie, retraite et famille.
Des organismes agréés - jusqu'en 2018 l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) et la Maison des artistes - étaient historiquement chargées de l'affiliation, du recouvrement des cotisations, de l'action sociale et de l'information des assurés.
• Le transfert du recouvrement des cotisations vieillesse aux Urssaf (2019)
Face aux difficultés rencontrées par l'Agessa pour le recouvrement des cotisations vieillesse, l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 201848(*) a acté le transfert au 1er janvier 2019 du recouvrement des cotisations vieillesse des artistes-auteurs au réseau des Urssaf.
Le décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 en a fixé les modalités de mise en oeuvre. Ainsi, les cotisations antérieures au 1er janvier 2019 relèvent toujours de la responsabilité de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Le montant des créances antérieures au 1er janvier 2029 restant à recouvrer est estimé à 5,9 millions d'euros pour un volume de 2 174 affiliés49(*).
• Le remplacement de l'Agessa et de la Maison des artistes par la SSAA (2020-2022)
L'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'affiliation au régime général est prononcée par des organismes agréés. L'article L. 382-2 du même code dispose que ces organismes doivent être administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés ainsi que des représentants de l'État. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de désignation des représentants des artistes-auteurs. Les articles L. 382-1 à L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale définissent le cadre de la prise en charge par le régime général des artistes-auteurs pour leur protection sociale.
Jusqu'à décembre 2020, les organismes agréés étaient l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) pour les artistes-auteurs du cinéma et de la télévision, photographes, compositeurs et écrivains, ainsi que la Maison des artistes pour les graphistes et les plasticiens. La sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) a été créée le 21 décembre 2020 à partir de l'Agessa et a intégré le 5 septembre 2022 la Maison des artistes pour les activités de cette dernière relevant de la protection sociale des artistes-auteurs.
L'agrément du 1er décembre 2022 a acté la responsabilité de la sécurité sociale des artistes-auteurs dans l'affiliation de ses nouveaux membres et le contrôle du champ d'application des règles spécifiques aux artistes-auteurs. En outre, la sécurité sociale des artistes-auteurs dispose d'un secrétariat en charge de la commission d'action sociale ainsi que de guichets d'information sur les prestations sociales auxquelles les artistes-auteurs peuvent prétendre. En dehors de la décision d'affiliation, de l'action sociale et du recouvrement des cotisations antérieures au 1er janvier 2019, les activités relevant du champ de la sécurité sociale sont exercées par les administrations de sécurité sociale du régime général.
L'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dispose que le fonds de l'action sociale de la sécurité sociale des artistes-auteurs, dont le maintien est prévu par l'article 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, est financé par une fraction fixée à 2 % de la contribution diffuseur qui lui est directement affectée.
Les dysfonctionnements passés de l'Agessa et de la Maison des artistes
La création de la sécurité sociale des artistes-auteurs visait à répondre aux nombreux dysfonctionnements relatifs à la gouvernance de l'Agessa et de la Maison des artistes, à la reconnaissance du statut d'artiste-auteur, la mise en oeuvre de l'action sociale ainsi qu'au recouvrement des cotisations vieillesse.
Les artistes-auteurs pouvaient d'abord rencontrer des difficultés à identifier à laquelle des deux structures ils devaient s'affilier. Par exemple, les infographistes, à la frontière du numérique et de l'illustration, étaient régulièrement en incertitude quant auquel des deux organismes il fallait s'adresser. L'Agessa et la Maison des artistes entretenaient de surcroît une distinction complexe entre la catégorie d'affiliés et celle des assujettis, mises en avant par les commissions professionnelles d'affiliation, correspondant historiquement à la différence entre les artistes dits professionnels et ceux dits amateurs50(*).
Surtout, l'Agessa et la Maison des artistes rencontraient des difficultés dans le recouvrement des cotisations. Ces dysfonctionnements ont causé des préjudices très importants aux artistes. La faiblesse des effectifs au sein de ces deux organismes, évalués à 50 salariés pour chaque institution, empêchait le recouvrement efficace des cotisations à l'occasion des opérations de vente volontaire ou issues des galeries artistiques51(*).
Le décalage temporel dans le calcul des cotisations des artistes-auteurs engendrait une perte de droits à la retraite. En effet, les revenus perçus l'année n correspondaient à des cotisations comptabilisées en année n+2 seulement. Lors de la liquidation de la pension, la dernière année d'activité n'était ainsi pas prise en compte malgré le versement effectif des cotisations. Cette anomalie affectait particulièrement la population des artistes-auteurs, aux carrières incomplètes et aux revenus irréguliers52(*).
L'assujettissement aux cotisations vieillesse des artistes-auteurs présentait également de nombreux dysfonctionnements. Les revenus artistiques sont assujettis aux prélèvements au titre de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour l'acquisition de droits à la retraite de base. Toutefois, l'Agessa ne prélevait ces cotisations que sur demande d'affiliation volontaire de l'intéressé, contrairement à la Maison des artistes qui y procédait automatiquement. Dès lors, de nombreux artistes-auteurs non-affiliés, croyant erronément avoir cotisé via le précompte sur droits d'auteur, découvraient tardivement des carrières incomplètes lors de la liquidation de leurs droits, occasionnant des pensions substantiellement réduites53(*).
L'absence de convention d'objectifs et de gestion conclue avec les ministères de tutelle a aggravé les difficultés existantes pour promouvoir une politique de protection sociale ambitieuse au bénéfice des artistes-auteurs.
b) La gestion mise en oeuvre par l'Urssaf du Limousin pour la protection sociale des artistes-auteurs
En 2024, l'Urssaf recense 456 056 artistes-auteurs immatriculés, définis comme ayant eu, au moins une fois sur les cinq dernières années, une assiette sociale. Parmi ces immatriculés, 408 587 personnes sont affiliées au régime de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Ce chiffre marque une progression de 48 % par rapport à 2021, où 276 046 affiliés étaient dénombrés. Cette croissance soutenue s'explique principalement par la réforme de 2018, qui a supprimé le seuil d'affiliation, permettant désormais une affiliation dès le premier euro précompté ou dès la création d'une activité d'entrepreneur individuel, même en l'absence d'une activité économique significative54(*).
En 2018, le montant des cotisations recouvrées est de 307 millions d'euros. En 2024, ce nombre est estimé à 433 millions d'euros, soit une progression de 43 %55(*).
Près de 27 % des artistes-auteurs actifs sont considérés comme sans activité déclarée pour les revenus de l'année 2024. Cette catégorie inclut les artistes-auteurs n'ayant pas fait de déclaration, ceux en taxation d'office, et ceux précomptés avec un revenu nul. Les artistes-auteurs ayant déclaré une activité déficitaire en BNC sont, quant à eux, intégrés dans les déclarations avec une assiette nulle. Le nombre de comptes en taxation d'office diminue progressivement, l'objectif étant d'inciter les concernés à déclarer leurs revenus réels56(*).
Le revenu médian issu de l'activité artistique en 2022 s'élevait à 598 euros, un montant très inférieur au seuil de 600 Smic horaires requis pour l'ouverture de droits sociaux pleins, notamment les indemnités journalières et la validation de quatre trimestres de retraite. Cette donnée illustre la fragilité économique du secteur et la disparité entre l'affiliation administrative et la réalité de l'activité artistique. La majorité des affiliés perçoivent des revenus trop faibles pour en tirer un statut professionnel viable57(*).
Lors de la campagne 2024 pour les revenus perçus en 2023, l'Urssaf a enregistré 357 345 déclarations de revenus, dont 93,6 % étaient dématérialisées. En 2025, seulement 2,97 % des déclarations ont été effectuées par voie papier. La dématérialisation a progressé de 6,3 points entre 2022 et 2024, reflétant l'adoption croissante des outils numériques par les artistes-auteurs58(*).
L'augmentation des effectifs affiliés ne traduit pas une explosion de la création artistique, mais plutôt un élargissement juridique du périmètre du régime, incluant désormais des profils très hétérogènes. Dès lors, la sécurité sociale des artistes-auteurs est régulièrement sollicitée par des assurés contestant leur affiliation.
L'Urssaf du Limousin assure également le remboursement du trop-versé des cotisations vieillesse. La gestion est opérée par un automate qui vérifie annuellement les données des affiliés à la clôture de la campagne déclarative. Fin juin 2025, 2 881 artistes-auteurs ont fait l'objet d'un remboursement pour un montant cumulé de 2 371 000 euros. Enfin, l'Urssaf du Limousin a instruit 122 recours contentieux relatifs à son activité de recouvrement59(*).
2. Malgré les réformes passées, la sécurité sociale des artistes-auteurs continue de rencontrer des difficultés croissantes
a) Les décisions d'affiliation
La sécurité sociale des artistes-auteurs, en charge de l'affiliation des nouveaux artistes-auteurs, doit transmettre au régime général ses décisions d'affiliation dans un délai de deux mois à compter du premier précompte des cotisations sociales sur les revenus de l'artiste-auteur ou après la date d'inscription de ce dernier auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle.
Le circuit d'échange des données relatives à l'affiliation est dysfonctionnel. Ainsi, depuis 2019, près de 6 000 décisions de rejet d'affiliation, soit 2,5 % du total des décisions, n'ont pas été prises en compte dans le référentiel des cotisants du Limousin, avec des conséquences directes sur le financement de la sécurité sociale. Par exemple, des affiliés - à tort - peuvent bénéficier de la possibilité de surcotiser forfaitairement pour acquérir quatre trimestres de retraites supplémentaires ou de s'acquitter de cotisations à des taux sous-évalués60(*).
Plus préoccupant encore, le contrôle de l'affiliation opéré par la sécurité sociale des artistes-auteurs, ne se fait qu'a priori. Une fois l'affiliation actée et transmise à l'Urssaf du Limousin, il n'existe aucun contrôle a posteriori de la réalité de la nature artistique des activités du nouvel affilié. Il s'agit même d'une régression par rapport à ce que faisait l'Agessa qui s'attachait à contrôler les factures des artistes-auteurs61(*).
Les dysfonctionnements persistants de la sécurité sociale des artistes-auteurs
En 2024, le budget de fonctionnement alloué à la sécurité sociale des artistes-auteurs s'est élevé à 4 624 000 euros62(*).
L'effectif de l'association demeure inadapté aux missions résiduelles exercées, cette inadéquation résultant principalement de l'incapacité du conseil d'administration à prendre des mesures efficaces de gestion. La composition des ETP de la sécurité sociale des artistes-auteurs illustre cette anomalie : fin 2023, l'association comptait deux agents de direction, dix-sept cadres, mais seulement sept employés. Le taux d'encadrement, supérieur à 70 %, apparaît manifestement disproportionné au regard des missions aujourd'hui résiduelles de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Le taux d'absentéisme est anormalement élevé, à près de 16,8 % en 2023, soit près de trois fois la moyenne nationale, établie à 6,1 %63(*).
Le salaire moyen s'élevait à 56 435 euros en 2022, montant supérieur de 29 % à celui observé dans les organismes de sécurité sociale. Les primes représentent 17 % des rémunérations, dont 83 % qui ne sont aucunement modulés selon la performance individuelle. Par exemple, l'association verse une prime de performance collective d'un montant total de 17 833 euros en 2023. Des primes exceptionnelles totalisant 32 470 euros ont été distribuées en 2023 sans décision motivée. La rémunération des cadres a progressé de 15 % entre 2019 et 2023, tandis que celle des employés est demeurée stable64(*).
L'accord d'entreprise prévoit au minimum 46 jours de congés annuels pour les salariés à temps plein, auxquels s'ajoutent divers congés supplémentaires, portant le total à une cinquantaine de jours par an. Le télétravail concerne 74 % des agents bénéficiant de l'indemnité forfaitaire associée. Ces éléments, combinés au taux d'absentéisme élevé, aboutissent à un taux d'occupation des locaux particulièrement faible65(*).
La gestion immobilière illustre cette inadéquation des moyens aux besoins. L'association supporte un loyer annuel de 643 000 euros en 2023 pour des locaux surdimensionnés, représentant un ratio de près de 40 mètres carrés par salarié. Elle a conservé 80 % de la superficie de ses anciens locaux malgré le transfert de l'essentiel de ses missions. Les dépenses immobilières et mobilières sont estimées à 785 000 euros pour l'année 2024, sur un budget de fonctionnement total de 4 624 000 euros. Cette situation nécessite des ajustements structurels significatifs pour rétablir l'adéquation entre les moyens déployés et les missions effectivement exercées par l'association66(*).
Le transfert d'activité prévu par l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale implique le transfert d'une partie du personnel de la sécurité sociale des artistes-auteurs chargés de l'affiliation vers l'Urssaf. La future structure aurait besoin de seulement trois personnes pour assurer ses missions résiduelles.
Source : Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs, janvier 2025
Le traitement de l'affiliation par la sécurité sociale des artistes-auteurs est déclenché dès la création d'une entreprise individuelle enregistrée à l'institut national de la propriété intellectuelle. Le flux est transmis automatiquement par le système d'information de la sécurité sociale des artistes-auteurs qui s'attache à la vérification de la cohérence de l'activité déclarée. En cas d'échec, un agent de la sécurité sociale des artistes-auteurs intervient manuellement, pendant une durée pouvant s'étendre jusqu'à dix jours selon la complexité du dossier67(*).
Ensuite, pour les dossiers dont les revenus du foyer dépassent le seuil de 1 500 Smic horaires par part fiscale, la demande d'affiliation est présentée à la commission plénière de la sécurité sociale des artistes-auteurs, se réunissant une fois par trimestre, avec un délai d'instruction moyen de 54 jours. Pour les dossiers inférieurs au seuil cité, la gestion se fait sans passage en commission et le délai d'instruction moyen est de 37 jours68(*).
En 2024, la sécurité sociale des artistes-auteurs déclare avoir enregistré 33 800 nouvelles demandes d'affiliation69(*).
b) La surcotisation forfaitaire
L'article 109 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 permet aux artistes-auteurs de régulariser leurs cotisations vieillesse s'ils n'ont pas cotisé avant 197670(*). La commission de l'action sociale de la sécurité sociale des artistes-auteurs peut assurer la prise en charge du versement afin de soutenir financièrement ces derniers. Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des sommes devant être versées. Malgré l'existence de règles précises, aucun critère objectif et explicite n'est communiqué par la sécurité sociale des artistes-auteurs quant aux motifs d'acception ou de rejet de telles prises en charge de régularisation de cotisations. Une telle opacité pose des difficultés quant à la nécessaire transparence de l'organisation à l'égard de ses affiliés71(*).
La sécurité sociale des artistes-auteurs propose une cotisation forfaitaire de 430 euros aux artistes-auteurs dont les revenus issus de leur activité artistique sont inférieurs au seuil leur permettant de bénéficier de droits sociaux. Cette cotisation leur permet de valider quatre trimestres de retraite. En 2023, les administrateurs de la sécurité sociale des artistes-auteurs n'ont pas voulu reconduire les critères existants de fixation du plafond de revenus au-delà lesquels la cotisation forfaitaire n'est plus possible, sans explicitation du motif de rejet. De surcroît, l'octroi de l'aide est parfois pris en l'absence totale de motifs objectifs de pondération de la décision72(*).
Enfin l'existence de flux financiers multiples entre la sécurité sociale des artistes-auteurs et l'Urssaf du Limousin suscite une inefficience dans la gestion de la surcotisation forfaitaire. Le processus implique trois acteurs : la sécurité sociale des artistes-auteurs établit les décisions d'attribution, l'Urssaf du Limousin vérifie les dettes de cotisations vieillesse et effectue d'éventuelles compensations, puis la sécurité sociale des artistes-auteurs verse le solde résiduel. Cette procédure en cascade, impliquant des transferts successifs pour des montants souvent modestes, alourdit considérablement la gestion administrative sans véritable valeur ajoutée73(*).
Illustration du processus d'octroi des aides à la surcotisation forfaitaire
Source : Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs, janvier 2025
c) Le manque de démocratie interne
Les membres du conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs ont fait l'objet d'une nomination par un arrêté conjoint en date du 1er décembre 2022 pris par le ministre de la culture et le ministre de la santé et de la prévention74(*).
Une enquête de représentativité, contestée par diverses organisations professionnelles des artistes-auteurs75(*), a été organisée en raison des nombreuses difficultés rencontrées pour déterminer précisément le corps électoral pour l'élection du conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs. En effet, l'organisation d'élections professionnelles se heurte à la difficulté de définir le caractère pleinement professionnel d'une profession libérale comme celle des artistes-auteurs et du seuil de revenus à considérer.
L'Urssaf du Limousin considère lors de l'immatriculation des artistes-auteurs chaque euro de rémunération afin d'en collecter les cotisations sociales afférentes, quel que soit le statut du cotisant. Traditionnellement, la jurisprudence administrative définit deux critères afin de sanctionner le caractère professionnel d'une activité76(*) : l'activité doit être exercée à titre constant et dans un but lucratif. Ainsi, le fait que l'activité artistique soit exercée parallèlement à une autre profession qui assure de manière principale son mode de subsistance n'empêche pas cette même activité artistique d'être reconnue comme professionnelle.
Les organisations syndicales et professionnelles entendues par la rapporteure générale se sont pour partie montrées particulièrement critiques envers la gouvernance actuelle du conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs, héritière de l'ancienne Agessa. L'absence d'élection pour la désignation des représentants constitue une singularité manifeste pour une association agréée par l'État. De nombreuses organisations réclament en outre davantage de collégialité dans la prise de décision et la concertation au sein des instances de la sécurité sociale des artistes-auteurs.
d) La diffusion de l'action sociale
Les organisations professionnelles consultées par la rapporteure générale ne cessent de rappeler les difficultés rencontrées auprès des artistes-auteurs afin de leur faire connaître les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Par exemple, près d'un artiste-auteur sur deux éligible au remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée n'en fait pas la demande77(*).
Le service de la sécurité sociale des artistes-auteurs, malgré ses nombreuses difficultés, propose une offre d'information du public complète et exhaustive, comme en témoignent les enquêtes de satisfaction des usagers qui parviennent à y accéder. La sécurité sociale des artistes-auteurs a reçu 25 000 appels en 2024. En revanche, dès que les artistes-auteurs doivent avoir recours aux services proposés par la sécurité sociale des artistes-auteurs, le taux de satisfaction chute brutalement : moins de 55 % des artistes-auteurs en sont satisfaits78(*).
En comparaison, près de 87 % des usagers se déclarent satisfaits de l'accès à leur compte en ligne de l'Urssaf du Limousin. Elle a assuré le traitement de 204 000 appels d'artistes-auteurs avec un taux de satisfaction s'élevant à 91 %79(*).
B. Le dispositif proposé vise à finaliser le transfert des missions de gestion à l'Urssaf et à renforcer le rôle de la sécurité sociale des artistes-auteurs comme organe agréé de représentation
1. La finalisation du transfert des missions de gestion à l'Urssaf
Le 1° du I de l'article 5 vise à modifier le dernier alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale afin de clarifier que l'organisme chargé de la décision d'affiliation des artistes-auteurs est celui désigné par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l'Urssaf. Dans le même objectif, le 6° du I procèderait à une coordination rédactionnelle au premier alinéa de l'article L. 382-14 du même code.
Le 3° du I tend à supprimer l'obligation, prévue à l'article L. 382-3-2 dudit code, visant à ce que pour bénéficier de la régularisation par l'Urssaf du montant des cotisations dues lorsque les revenus d'un assuré dépassent le plafond défini à l'article L. 241- 3 du code précité, l'assuré en fasse formellement la demande. L'objectif est de faciliter la démarche administrative des usagers en consacrant le principe d'une administration proactive.
Le 3° du I précise que le délai de quatre mois pour engager cette régularisation se compterait désormais à partir du dépôt de la déclaration de revenus de l'assuré afin de clarifier davantage la nature de ce délai dans la loi.
Le 4° du I modifierait le premier alinéa de l'article L. 382-6 dudit code afin de contraindre les assurés d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration du versement de leurs cotisations au régime de la sécurité sociale des artistes-auteurs.
Le 5° du I tend à modifier la première phrase de l'article L. 382-7 du même code afin d'acter la mise en oeuvre par l'Urssaf de l'action sociale au profit des artistes auteurs.
Le II procèderait à la modification de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 201880(*) afin d'acter que la mission de recouvrement des cotisations est assurée par l'Urssaf et ce à la fois pour les cotisations ultérieures au 1er janvier 2019 mais également pour celles qui y sont antérieures.
2. Le renforcement du rôle de la sécurité sociale des artiste-auteurs comme organe agréé de représentation
Le 2° du I tend à modifier l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale afin de préciser les missions exercées par l'organisme agréé pour le compte des artistes-auteurs, qui seraient désormais de « fixer les orientations générales de l'action sanitaire et sociale [...], veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application des règles relatives à la protection sociale »81(*) et de rendre un avis sur tout projet de mesure législative et réglementaire qui la concernerait. Le Gouvernement a indiqué vouloir renouveler l'agrément de l'actuelle sécurité sociale des artistes-auteurs qui est ainsi visé par les mots « organisme agréé pour le compte des artistes-auteurs ».
L'association serait administrée par des représentants des assurés, des représentants des organismes de gestion collective et des représentants de l'État. La composition du conseil d'administration telle que prévue actuellement par les statuts de la sécurité sociale des artistes-auteurs serait maintenue. Un décret pris en Conseil d'État doit préciser les conditions de nomination de ces autorités82(*).
3. Modalités de mise en oeuvre de la réforme
Le IV vise un calendrier avec un délai d'entrée en vigueur différé afin de permettre la transition opérationnelle de gestion entre l'organisme agréé et l'Urssaf du Limousin. La prise en charge de l'affiliation interviendrait à compter du 1er avril, tandis que le recouvrement afférent aux périodes antérieures au 1er janvier 2019 serait transféré à compter du 1er juin.
Le III de l'article 5 précise que les personnels chargés au sein de cet organisme de l'affiliation des assurés seraient transférés dans les effectifs de l'Urssaf.
Le IV précise le calendrier d'entrée en application de certaines dispositions de l'article 5, en indiquant que celles du 1° du I entreraient en vigueur le 1er avril 2026 et celles du 2° et du 5° du I puis du II entreraient en vigueur le 1er juin 2026.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
À l'initiative du rapporteur général de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité explicite, pour les artistes-auteurs affiliés qui ne sont pas en mesure de souscrire leurs déclarations auprès de l'Urssaf par voie dématérialisée, de continuer à le faire selon les modalités actuellement mises en oeuvre83(*).
À l'initiative de la députée Galliard-Minier, l'Assemblée nationale a :
- prévu l'instauration d'une commission professionnelle en cas de refus d'affiliation d'un artiste-auteur par l'Urssaf, afin d'éclairer l'instruction de la demande déposée devant la commission de recours amiable de l'Acoss84(*) ;
- prévu que seule l'association agréée pouvait prendre la dénomination « Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs »85(*) ;
- prévu que « les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d'administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes auteurs », un décret en Conseil d'État précisant les « critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs »86(*) ;
- supprimé la présence des organismes de gestion collective au sein du conseil d'administration de l'association agréée87(*).
Elle a en outre adopté sept amendements rédactionnels de son rapporteur général.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission se réjouit de la volonté du Gouvernement d'engager la refonte de la sécurité sociale des artistes-auteurs afin de mettre fin à ses trop nombreux dysfonctionnements qui pénalisent directement ses affiliés. En outre, au regard de la situation des finances publiques, la mauvaise gestion financière de la sécurité sociale des artistes-auteurs appelle à davantage d'exemplarité.
La commission considère que les modalités de fonctionnement de l'association agréée doivent être les plus proches possibles de celles du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants car la situation des indépendants est proche de celle des artistes auteurs. Ainsi, elle a souhaité fixer des principes relatifs à la composition du conseil d'administration mais elle considère qu'il appartient à un décret en Conseil d'État d'en fixer les modalités précises. Dès lors, elle a considérablement réécrit le a) du 2° du I du présent article.
La commission a souhaité réintégrer les organismes de gestion collective dans le conseil d'administration de l'association agréée en raison de leur rôle dans l'action sociale des artistes auteurs.
Enfin, elle a supprimé la dénomination de « conseil national de la protection sociale des artistes auteurs » car il ne revient pas à la loi de fixer le nom d'une association, même agréée.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements n°°589 et 590 qu'elle a adoptés.
Article 5 bis (nouveau)
Subordination de
l'affiliation des bailleurs à métayage au régime
des
non-salariés agricoles à une participation effective
à
l'activité de l'exploitation agricole
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de subordonner l'affiliation des bailleurs à métayage au régime des non-salariés agricoles à une participation effective à l'activité ou à la direction de l'exploitation agricole.
L'objectif est de faire en sorte que les bailleurs à métayage ne soient plus considérés comme des exploitants agricoles afin de les exonérer du paiement de cotisations sur les revenus issus du métayage.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. L'affiliation des bailleurs à métayage à la mutualité sociale agricole
L'article L. 722-7-1 du code rural et de la pêche maritime88(*) dispose que dans un bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés comme des chefs d'exploitation, mais sous réserve de ne pas être assujettis au régime des assurances sociales des salariés agricoles ou de ne pas recevoir une allocation intégrale d'un régime qui n'est pas celui de la mutualité sociale agricole89(*). L'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale vise justement à éviter toute double affiliation.
L'affiliation à la mutualité sociale agricole obéit aux règles générales d'assujettissement applicables aux salariés non agricoles. Le bailleur à métayage est affilié à cette dernière car il participe à la mise en valeur de son exploitation agricole, même indirectement.
Le bailleur à métayage dispose d'un revenu en nature ou en espèces, versé par le preneur, sur lequel sont payées des cotisations qui permettent d'ouvrir des droits. Il doit mettre fin à son bail en cessant donc cette activité afin de pouvoir liquider sa retraite, sauf à spécifiquement utiliser le dispositif de cumul emploi retraite.
Sur le fondement de l'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime, les préfets peuvent arrêter une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le bailleur et le preneur. Traditionnellement, le preneur supporte l'essentiel des charges d'exploitation tandis que le bailleur métayer conserve à sa charge les dépenses d'investissement de long terme de l'exploitation. En Champagne, pour des raisons propres à la spécificité de ce territoire, une telle dérogation a été accordée. Dès lors, ces bailleurs métayers ne participent pas aux dépenses d'investissement de long terme et c'est à ce titre qu'il pourrait être considéré qu'ils ne doivent plus être affiliés à la mutualité sociale agricole.
B. Les difficultés que peuvent poser l'affiliation au régime agricole
L'article 5 bis est issu de l'amendement n° 721 du député Charles de Courson, dont l'exposé des motifs indique que l'affiliation obligatoire au régime agricole pour les bailleurs métayers entraîne des « cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés et surtout l'impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage ». Le I du présent article vise donc à proposer une rédaction globale de l'article L. 722-7-1 du code rural et de la pêche maritime, disposant que « dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d'exploitation » et que « le bailleur à métayage n'est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s'il participe effectivement à l'activité ou à la direction de l'exploitation ».
Cet article, de même que deux autres amendements du même auteur, non adoptés par l'Assemblée nationale90(*), a pour objet de résoudre les problèmes posés par un mode de bail particulier, existant notamment en Champagne, dans lequel les propriétaires, appelés tiers-franquistes et quart-franquistes, sont rémunérés en nature. Selon l'auteur de l'amendement, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) avait donné instruction aux caisses locales de considérer ces propriétaires comme des exploitants agricoles, même quand ils avaient loué leurs terres après leur départ en retraite, ce qui les empêchait de percevoir leur pension.
II - La position de la commission
La commission note que l'adoption d'un tel article permettrait à certains bailleurs de ne plus être affiliés à la mutualité sociale agricole tout en pouvant cumuler leur pension de retraite avec des revenus d'exploitation en espèce.
La commission considère que toute forme de production de richesse doit être soumise à cotisation.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, la ministre de l'action et des comptes publics a considéré que ces propriétaires devaient être assujettis aux cotisations sociales et qu'ils devaient pouvoir percevoir leur pension de retraite. Elle s'est engagée à faire le point avec la mutualité sociale agricole afin d'apprécier la nécessité d'une mesure législative91(*).
La commission a adopté un amendement n° 591 de suppression de cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 5 ter
(nouveau)
Exonération partielle de cotisations sociales pour les
collaborateurs de chef d'exploitation agricole qui choisissent de devenir chef
d'exploitation
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'exonérer partiellement de cotisations sociales pendant cinq ans les collaborateurs de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui choisissent de le devenir à leur tour, sur le modèle du dispositif existant pour les jeunes agriculteurs.
L'objectif est d'inciter le conjoint du chef d'une exploitation ou d'entreprise agricole à opter pour ce statut.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le droit en vigueur
L'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole peut y exercer son activité professionnelle comme collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Le statut de conjoint collaborateur ne propose que des droits sociaux très limités.
Le statut de conjoint collaborateur, créé en 199992(*), permettait aux personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec un chef d'exploitation d'exercer une activité non rémunérée sur l'exploitation tout en bénéficiant d'une protection sociale moyennant des cotisations sociales relativement faibles. La limitation à cinq années de ce statut, introduite depuis le 1er janvier 2022, impose désormais aux intéressés d'opter soit pour le statut de co-exploitant, soit pour celui de salarié.
La loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles93(*) limite à cinq années la durée pendant laquelle le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut conserver le statut de collaborateur.
La disposition est applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022. En conséquence, près de 10 000 personnes devront choisir un autre statut au 1er janvier 2027. Par défaut, les conjoints collaborateurs basculeraient vers le statut de salarié agricole, à moins de formuler la demande de devenir chef d'exploitation.
L'objectif initial de la loi était de protéger les conjoints collaborateurs en leur permettant de devenir salarié ou chef d'exploitation agricole. Aujourd'hui, le statut de chef d'exploitation agricole est plus avantageux. En effet, par exemple, s'agissant de la retraite, les conjoints collaborateurs cotisent actuellement sur une assiette forfaitaire qui leur confère 16 points par annuité au titre de la retraite proportionnelle, alors que les chefs d'exploitation valident entre 23 et 114 points selon leur revenu professionnel.
La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 202594(*) a réformé le mode de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles en fusionnant la pension de retraite forfaitaire et la pension de retraite proportionnelle en une pension de retraite de base unique. Cette modification s'est accompagnée d'une refonte de l'assiette de cotisations, les différents statuts de non-salariés agricoles étant soumis à un taux de cotisation unique de 17,87 %, aligné sur celui des travailleurs indépendants, et sur une assiette minimale unique de 450 Smic horaire.
En contrepartie, cette réforme a étendu le bénéfice des minima de pensions aux conjoints collaborateurs. Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, le bénéfice de la pension majorée de référence et du complément différentiel de points de retraite complémentaire sera étendu aux non-salariés exerçant leur activité à titre secondaire, en contrepartie d'une augmentation de leur effort contributif.
Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 bien que les décrets d'application ne soient toujours pas publiés à la date de la rédaction du présent rapport.
Par ailleurs, l'article introduit l'ouverture de droits à pension au titre des années incomplètes et des périodes d'exercice d'un mandat local, ainsi que la simplification du dispositif de surcote parentale. Ces dispositions visent à améliorer la protection sociale des conjoints collaborateurs et à faciliter leur transition vers un statut offrant une meilleure couverture en matière de retraite, conformément à l'objectif de revalorisation des pensions agricoles les plus faibles.
Malgré ces dispositions ayant revalorisé le statut de conjoint collaborateur, celui de chef d'exploitant ou d'entreprise agricole demeure plus avantageux.
B. Le dispositif proposé
L'article 5 ter, introduit par l'amendement n° 389 de la députée Danielle Brulebois95(*), vise à encourager les conjoints des exploitants agricoles à devenir à leur tour chefs d'exploitation ou d'entreprises.
L'article précité propose de modifier l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime en le complétant par un II disposant que « les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole [...] qui choisissent le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à l'issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l'exonération partielle de cotisations ».
L'article préciserait que l'exonération serait possible sous les conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S'engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans ».
L'article alignerait le régime social des conjoints collaborateurs devenant chef d'entreprise ou d'exploitation agricole avec le régime social des jeunes agriculteurs qui deviennent chef d'entreprise ou d'exploitation agricole, bénéficiant ainsi d'exonérations identiques à celles prévues pour ces derniers à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
II - La position de la commission
La commission des affaires sociales était favorable aux modifications portées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 au système de retraite agricole.
Le président de la commission, Philippe Mouiller, et le rapporteur de la branche vieillesse, Pascale Gruny, ont respectivement été auteur et rapporteur d'une proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non-salariés des professions agricoles, qui a été adopté en première lecture au Sénat. Cette proposition de loi portait déjà la réforme du mode de calcul de la retraite des non-salariés agricoles sur les 25 meilleures années de revenus.
La commission se félicite ainsi de l'alignement des assiettes et taux de cotisations entre non-salariés agricoles et travailleurs indépendants réalisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En particulier, cette réforme ouvre l'accès des conjoints collaborateurs aux minima de pension.
Pour autant, la mesure d'exonération souhaitée n'est pas justifiée dans la mesure où la loi oblige déjà le conjoint collaborateur à opter au bout de cinq ans pour le statut de salarié agricole ou de chef d'exploitation.
Par ailleurs, la situation des conjoints collaborateurs devenant chef d'exploitation est fondamentalement différente de celles des jeunes agriculteurs, dont le régime particulier s'explique par les difficultés économiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés à la création de leur entreprise ou exploitation agricole.
En outre, dans un contexte de fort déficit de la branche vieillesse96(*), la commission ne saurait soutenir une mesure d'exonération de cotisations dont l'impact n'est pas renseigné.
Le système de retraite agricole est financé à plus de 80 % par le mécanisme de compensation démographique, qui incombe en premier lieu à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière (CNRACL). Or, la CNRACL connaît une situation démographique préoccupante, et son déficit cumulé aurait représenté en 2027 les trois quarts du déficit de la branche vieillesse si le pouvoir règlementaire n'avait pas augmenté son taux de contribution employeur de douze points par an d'ici à 2028 à raison d'une augmentation de 3 points par an97(*).
En conséquence, la commission a adopté l'amendement n° 592 de suppression de cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 5 quater (nouveau)
Mise en place d'un
plan d'action ou d'une négociation dans les entreprises de plus de
300 salariés sous peine d'un malus sur les cotisations
vieillesse
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés un plan d'action ou une négociation pour le maintien en emploi des salariés les plus âgés sous peine d'un malus sur les cotisations vieillesse. L'objectif est d'améliorer le taux d'emploi des seniors.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Les entreprises doivent déjà engager une négociation sur l'emploi des seniors si elles ont plus de 300 salariés
1. Rappel sur la négociation interprofessionnelle pour le nouveau pacte de vie au travail
En transmettant aux partenaires sociaux le 21 novembre 2023 un document d'orientation, sur le fondement de l'article L. 1 du code du travail, le Gouvernement a lancé une invitation aux partenaires sociaux à engager des négociations en vue d'élaborer un « nouveau pacte de la vie au travail ».
Ce guide d'orientation définissait trois axes principaux de négociation. Il s'agissait, d'une part, d'améliorer l'articulation entre la carrière et les temps de vie des salariés, notamment par la création d'un compte épargne-temps universel. D'autre part, l'objectif était d'atteindre le plein emploi des seniors et, enfin, d'encourager la progression des carrières, les possibilités de reconversion professionnelle, ainsi que la lutte contre l'usure professionnelle.
En parallèle, les partenaires sociaux étaient également appelés à adapter les règles de l'assurance-chômage, afin de prendre en compte l'allongement des carrières. Le Gouvernement avait d'ailleurs subordonné l'agrément de la convention d'assurance chômage à la conclusion de ce « pacte de la vie au travail ». Cependant, après un premier échec des négociations au début de l'année 2024 et le refus gouvernemental d'agréer un accord sur l'assurance chômage, les partenaires sociaux ont été relancés en octobre 2024 pour reprendre spécifiquement les discussions concernant l'emploi des seniors.
Ces négociations ont abouti, le 14 novembre 2024, à la signature d'un accord national interprofessionnel sur l'emploi des salariés expérimentés. Cet accord, composé de sept articles, s'articule autour de quatre grands axes : la mobilisation du dialogue social au niveau des branches et des entreprises, la préparation de la deuxième partie de carrière, la levée des obstacles au recrutement des demandeurs d'emploi seniors grâce à la création d'un « contrat de valorisation de l'expérience », ainsi que la facilitation des aménagements de fin de carrière. Il a été signé par les trois organisations patronales représentatives et par quatre des cinq organisations syndicales de salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont également conclu un second accord national interprofessionnel portant sur l'évolution du dialogue social. Ce texte a été signé par le Medef et l'Union des entreprises de proximité (U2P) pour le patronat, ainsi que par l'ensemble des cinq organisations syndicales. Enfin, une convention relative à l'assurance chômage a été finalisée le 15 novembre 2024.
2. Les bénéfices pour les seniors de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels
La loi du 24 octobre 2025 a assuré la transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social98(*).
L'article 1 rétablit une négociation obligatoire au moins tous les quatre ans au niveau des branches professionnelles sur des thèmes relatifs à l'emploi des seniors : recrutement des seniors, maintien dans l'emploi, aménagements de fin de carrière, et transmission des savoirs. Cette obligation, qui avait disparu du code du travail depuis 2017, permet aux branches de définir des plans d'action types pour les entreprises de moins de 300 salariés, applicables en cas d'échec des négociations locales. L'article 2 étend cette obligation aux entreprises de 300 salariés et plus, en intégrant ces enjeux comme un thème autonome dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour lever les obstacles au recrutement des demandeurs d'emploi expérimentés, l'article 4 crée le contrat de valorisation de l'expérience. Ce contrat à durée indéterminée cible les seniors en recherche d'emploi et permet à l'employeur de procéder à leur mise à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge du taux plein. Le dispositif s'accompagne d'une exonération de la contribution employeur sur l'indemnité de mise à la retraite, rendant le recrutement des seniors plus attractif.
L'article 3 institue des rendez-vous clés tout au long de la carrière, notamment la visite médicale de mi-carrière et les entretiens professionnels bisannuels, pour aborder les aménagements possibles et prévenir l'usure professionnelle. L'entretien conduit vers le soixantième anniversaire du salarié devient un moment privilégié pour évoquer les transitions vers la retraite. Les articles 5 et 6 renforcent les droits des salariés en encadrant strictement les refus employeurs concernant les demandes de temps partiel ou de retraite progressive, limités aux cas où la réduction du temps de travail perturberait significativement l'activité de l'entreprise. Par ailleurs, les partenaires sociaux pourront négocier, au niveau des branches ou des entreprises, un versement anticipé et échelonné de l'indemnité de départ à la retraite pour les salariés optant pour un temps partiel, assurant ainsi un maintien total ou partiel de leur rémunération.
B. Le présent article vise à créer un malus applicable aux cotisations vieillesse pour les entreprises de plus de 300 salariés si elles ne mettent pas en place une négociation destinée à favoriser l'emploi des seniors
L'article 5 ter, introduit par l'amendement n° 1349 par le député Michel Castellani, tend à insérer dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 241-3-3.
Aux termes de cet article L. 241-3-3, « les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1 du code du travail99(*) sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage » si elles ne mettent pas en oeuvre :
- une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail ;
- ou un plan d'action annuel destiné à favoriser l'emploi des seniors expérimentés.
Les modalités du malus seraient fixées par la voie réglementaire, en prenant en compte les efforts mis en oeuvre par les entreprises en faveur de l'emploi des seniors.
II - La position de la commission
La commission considère que l'article est déjà en partie satisfait par le droit existant. En effet, comme indiqué supra, l'article premier de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social100(*) prévoit l'obligation de mettre en oeuvre une négociation sur l'emploi des seniors.
La commission considère que l'aggravation des prélèvements obligatoires pour les entreprises qui ne parviendraient pas à mettre en oeuvre cette négociation ne s'inscrit pas dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors. De plus, l'article sanctionnerait les entreprises sur le seul motif d'une absence de négociation, alors que les entreprises peuvent présenter des résultats concluants sur le taux d'emploi des seniors.
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou, a précisé lors de la séance publique à l'Assemblée nationale101(*) que l'article risquait de poser une difficulté technique quant à l'intégration au système de retraite de la majoration des cotisations d'assurance vieillesse puisque par principe, toute cotisation doit entraîner l'ouverture d'un droit102(*).
La commission a adopté l'amendement n° 593 de suppression.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 6
(supprimé)
Maintenir les seuils de revenus pris en compte pour le
calcul de la CSG sur certains revenus de remplacement
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement, propose de figer à leur niveau de 2025 les seuils de revenus pris en compte pour le calcul de la cotisation sociale généralisée (CSG) sur certains revenus de remplacement (allocations chômage, pensions de retraite et d'invalidité). À partir de 2027, ces seuils pourront être réactualisés chaque année par la LFSS, sur le modèle de la revalorisation annuelle par la loi de finances du barème de l'impôt sur le revenu.
La commission propose de limiter ce gel à la seule année 2026.
La commission propose de rétablir cet article ainsi modifié.
I - Le dispositif proposé
A. La cotisation sociale généralisée
La cotisation sociale généralisée (CSG) a été instaurée en 1991 pour financer la sécurité sociale. Son produit prévisionnel pour 2025 est de 130,9103(*) milliards d'euros.
1. Les différents taux de CSG
Les revenus d'activité et les revenus du patrimoine et de placements sont imposés au taux de 9,2 %.
Les revenus de remplacement sont en revanche imposés à des taux plus faibles (0 %, 3,8 %, 6,2 %, 6,6 %, 8,3 %), qui dans le cas des allocations chômage et des pensions de retraite et d'invalidité dépendent du revenu fiscal de référence (RFR) du foyer (cf. tableau).
Rappel des différents taux de CSG et des contributions associées
|
Nature des revenus |
CSG |
Partie CSG déductible pour l'impôt sur le revenu |
CRDS |
Casa |
Cotisation maladie |
Prélèvement de solidarité |
|
Revenus d'activité |
||||||
|
Revenus d'activité |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|||
|
Revenus de remplacement |
||||||
|
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) |
6,2 % |
3,8 % |
0,5 % |
|||
|
Allocations chômage |
0 % |
- |
Exonération |
|||
|
Taux réduit de 3,8 % |
3,8 % |
0,5 % |
||||
|
Taux normal de 6,2 % |
3,8 % |
0,5 % |
||||
|
Préretraites |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|||
|
Pensions de retraite et d'invalidité |
||||||
|
Taux zéro |
0 % |
- |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
|
|
Taux réduit |
3,8 % |
3,8 % |
0,5 % |
Exonération |
Exonération |
|
|
Taux médian |
6,6 % |
4,2 % |
0,5 % |
0,3 % |
1 % sur les retraites complémentaires |
|
|
Taux normal |
8,3 % |
5,9 % |
0,5 % |
0,3 % |
1 % sur les retraites complémentaires |
|
|
Patrimoine et placements |
||||||
|
Revenus du patrimoine et de placements |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
7,5 % |
||
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après le code de la sécurité sociale et l'annexe 9 au présent PLFSS (évaluations préalables)
2. Des revenus de remplacement dont le taux d'imposition à la CSG dépend du revenu global
Les différents taux applicables aux revenus de remplacement (allocations chômage d'une part, retraites et pensions d'invalidité d'autre part) dépendent de seuils de revenu fiscal de référence104(*), déterminés par les articles L. 136-1-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément au III ter de l'article L. 136-8 précité, ces seuils sont revalorisés annuellement en fonction de l'inflation de l'avant-dernière année. Aussi les seuils applicables ne sont-ils pas ceux figurant dans le code de la sécurité sociale. Les seuils applicables en 2025 sont définis par la lettre ministérielle D-24-019252 du 4 décembre 2024.
Le tableau ci-après synthétise les différents seuils applicables, ainsi que leur base juridique.
Seuils de revenu fiscal de référence
utilisés pour la détermination
des taux de CSG (revenus de
remplacement)
(en euros)
|
Nature des revenus |
Taux de CSG |
Seuil de revenus de l'avant-dernière
année applicable en 2025 |
||||
|
Revenus compris |
Base juridique (CSS) |
Remarque |
||||
|
entre : |
et : |
|||||
|
Allocations chômage |
0 % |
1re part |
0 |
< 12 817 |
Art. L. 136-1-2 (II 4°) |
Renvoi au seuil du 1° du III de l'article L. 136-8 |
|
3,8 % |
1re part |
12 817 |
16 755 |
Art. L. 136-8 (III) (min : 1° ; max : 2°) |
Cette disposition prévoit également des seuils spécifiques à l'outre-mer |
|
|
Demi-part supplémentaire |
3 422 |
4 474 |
||||
|
6,2 % |
1re part |
> 16 755 |
- |
Art. L. 136-8 (1° du II) |
Taux de droit commun pour les allocations chômage (le seuil résulte du 2° du III de l'art. L. 136-8) |
|
|
Pensions de retraite et d'invalidité |
0 % |
1re part |
0 |
< 12 817 |
Art. L. 136-1-2 (II 1°) |
Renvoi au seuil du 1° du III de l'article L. 136-8 |
|
3,8 % |
1re part |
12 818 |
16 755 |
Art. L. 136-8 (III) (min : 1° ; max : 2°) |
Cette disposition prévoit également des seuils spécifiques à l'outre-mer |
|
|
Demi-part supplémentaire |
3 422 |
4 474 |
||||
|
6,6 % |
1re part |
>16 755 |
< 26 004 |
Art. L. 136-8 (III bis) |
Cette disposition prévoit également des seuils spécifiques à l'outre-mer |
|
|
Demi-part supplémentaire |
4 474 |
|||||
|
8,3 % |
1re part |
26 004 |
- |
Art. L. 136-8 (2° du II) |
Taux de droit commun pour les retraites et pensions d'invalidité (le seuil résulte du 2° du III bis de l'art. L. 136-8) |
|
CSS : code de la sécurité sociale.
Remarques :
- les seuils figurant actuellement à l'article L. 136-8 du CSS ne sont pas ceux qui s'appliquent en 2025, car, conformément au III ter de l'article L. 136-8, ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'inflation de l'avant-dernière année. Le présent tableau indique les seuils actualisés ;
- depuis la LFSS 2019, un contribuable ne perd le bénéfice du taux réduit de 3,8 % que si ses revenus dépassent le seuil supérieur deux années de suite (2° du III de l'article L. 136-8) ;
- pour faciliter la lecture, les seuils propres à l'outre-mer (figurant à l'article L. 136-8) ne sont pas indiqués dans le présent tableau.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après le code de la sécurité sociale et la lettre ministérielle D-24-019252 du 4 décembre 2024
B. Le dispositif proposé
1. Présentation du dispositif
Le dispositif proposé consiste :
- à remplacer, dans le code de la sécurité sociale, les seuils (non actualisés) par ceux (actualisés) applicables en 2025. Ces seuils figurent tous à l'article L. 136-8 de ce code ;
- à abroger le III ter de l'article L. 136-8 précité, qui prévoit une indexation sur l'inflation de l'avant-dernière année.
Ce gel du barème a pour effet de modifier les taux de CSG, mais aussi d'assujettir certains ménages à la CRDS, à la Casa ou à la cotisation maladie de 1 % (cf. tableau du I. A. 1 du présent commentaire).
Comme le souligne l'évaluation préalable, « la LFSS pourra procéder au 1er janvier 2027, à l'instar de ce qui est prévu pour le barème de l'impôt sur le revenu en loi de finances, à une réindexation de ce barème sur l'inflation 2025 ».
2. Conséquences pour l'assujettissement à la CRDS et à la Casa
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale prévoit, dans son article 14, que l'assiette de la CRDS est la même que celle de la CSG. Aussi, l'exonération de CSG implique celle de CRDS.
Par ailleurs, l'article L. 137-41 du code de la sécurité sociale prévoit que les bénéficiaires de pensions assujettis à la CSG au taux de 0 % ou 3,8 % ne sont pas assujettis à la Casa (ainsi qu'à la cotisation d'assurance maladie de 1 % assise sur les retraites complémentaires).
3. Rendement et impact sur les redevables
a) Rendement
Selon l'évaluation préalable, le rendement de la mesure à partir de 2026 serait de 0,3 milliard d'euros.
L'effet de la mesure est réduit par le fait que depuis la LFSS 2019, un contribuable ne perd le bénéfice du taux réduit de 3,8 % que si ses revenus dépassent le seuil supérieur deux années de suite (2° du III de l'article L. 136-8).
L'évaluation préalable ne chiffre pas l'effet d'une éventuelle absence de revalorisation des seuils par la LFSS 2027. Le seuil étant alors dépassé deux années de suite pour davantage de contribuables, l'effet pourrait être plus important.
b) Impact sur les redevables
Selon l'évaluation préalable, « la mesure de gel proposée, par rapport à une situation d'augmentation des seuils de 1,8 %, ferait passer de l'ordre de 1 % des foyers de l'exonération au taux réduit, environ 1 % des foyers du taux réduit au taux médian, et environ 1 % des foyers du taux médian à l'assujettissement au taux maximal de CSG ».
L'évaluation préalable précise qu'« à titre d'illustration, un foyer composé d'un retraité dont la pension mensuelle, qui serait son unique revenu, s'élève à 2 700 euros brut, en cas de franchissement du dernier seuil, verrait ses contributions augmenter de 1,7 point, soit 46 euros par mois ».
II. Le dispositif transmis au Sénat
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale105(*).
III - La position de la commission
Cet article se place dans le cadre de l'« année blanche », figurant dans les propositions du Sénat au Premier ministre du 8 juillet 2025 et mise en oeuvre par les textes initiaux du PLF et du PLFSS. L'année blanche concerne également, notamment, les cotisations de retraite et diverses prestations sociales (article 44 du présent PLFSS), ainsi que le barème de l'impôt sur le revenu (dont le projet de loi de finances ne prévoit pas la revalorisation).
Comme le souligne l'étude préalable, cet article a un effet pour seulement 3 % des foyers fiscaux.
Par ailleurs, cet article a un rendement de 0,3 milliard d'euros.
Aussi, la commission propose, par un amendement n° 594 de sa rapporteure générale, de le rétablir, tout en limitant le gel du barème à la seule année 2026.
La commission propose de rétablir cet article ainsi modifié.
Article 6 bis
(nouveau)
Passage de 9,2 % à 10,6 % du taux de la CSG sur les revenus
du patrimoine et des placements
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de porter de 9,2 % à 10,6 % le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La hausse du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements
Le 1° du I de cet article résulte de trois amendements identiques106(*), adoptés avec un avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement.
Le Gouvernement a en effet souhaité garder la possibilité d'une hausse de CSG, dans l'hypothèse où cela apparaîtrait nécessaire au cours de la navette pour maintenir le déficit de la sécurité sociale sous le seuil de 20 milliards d'euros en 2026.
L'explicitation par la ministre de l'action et des
comptes publics de l'avis favorable du Gouvernement à l'augmentation du
taux de CSG
sur les revenus du patrimoine et des
placements107(*)
« Mme Amélie de Montchalin, ministre.
[...]
Nous devons regarder la réalité en face et assumer notre responsabilité, qui est d'assurer la pérennité de notre système social. Il est très important de nous fixer collectivement l'objectif de ne pas dépasser un déficit de la sécurité sociale de 20 milliards d'euros en 2026, alors qu'il était déjà de 23 milliards en 2025. Je le rappelle, un déficit supérieur à 20 milliards en 2026 signifierait porter le plafond d'endettement de l'Acoss à plus de 85 milliards, ce qui mettrait notre système en danger.
Vous avez fait une série de propositions auxquelles le gouvernement n'était pas initialement favorable. Nous sommes en première lecture et nous entrons, vous le savez, dans un processus d'entonnoir : dans le cadre de la navette, il y aura des discussions. Compte tenu des équilibres politiques que nous connaissons au Sénat, affirmer ce soir que je suis défavorable à l'ensemble de ces amendements en discussion commune signifierait faire disparaître la CSG dite patrimoine de l'ensemble du processus budgétaire.
M. Erwan Balanant
Ce serait dommage !
Mme Amélie de Montchalin, ministre
Aussi, je donne un avis de responsabilité et de méthode sur l'amendement n° 1020 de M. Jérôme Guedj, ce qui signifie que je suis favorable à ce que, dans le cadre de ce débat, nous contribuions à équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Je le dis avec beaucoup de solennité : le gouvernement se mobilise pour trouver des économies et accompagnera les nombreux députés qui y travaillent, mais il ne souhaite pas prendre le risque de mettre la sécurité sociale en difficulté en se privant, dans la navette, de l'outil que constitue la CSG patrimoine. Je formule donc un avis de responsabilité et de méthode, je le répète, pour que nous puissions revenir sur le sujet dans la navette, en deuxième lecture, au vu des économies qui, je l'espère, seront proposées d'ici là et qui nous éviteraient d'utiliser cet outil outre mesure. »
Source : Assemblée nationale, compte rendu des débats, deuxième séance du mercredi 05 novembre 2025
Le 1° du I de cet article tend à porter de 9,2 % à 10,6 % le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements. Il modifie pour cela le 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui fixe le taux de CSG applicable à ces catégories de revenu.
Comme le montre le tableau du I.A du commentaire de l'article 6 synthétisant les différents taux de CSG, les revenus du patrimoine et des placements seraient alors ceux dont le taux d'imposition serait le plus élevé.
En incluant la CRDS et le prélèvement de solidarité, les prélèvements sociaux passeraient de 17,2 % à 18,6 %. En prenant en compte le prélèvement forfaitaire au titre de l'impôt sur le revenu, le prélèvement global (le prélèvement forfaitaire unique, ou « flat tax ») passerait de 30 % à 31,4 %.
Imposition des revenus du patrimoine et de placements, selon le droit actuel et selon le droit proposé
(en %)
|
Nature des revenus |
CSG |
CRDS |
Prélèvement de solidarité |
Total prélèvements sociaux |
Prélèvement forfaitaire au titre de l'IR |
Total général (PFU, ou « flat tax ») |
|
A |
B |
C |
D [A+B+C] |
E |
F [D+E] |
|
|
Droit actuel |
9,2 |
0,5 |
7,5 |
17,2 |
12,8 |
30,0 |
|
Droit proposé |
10,6 |
0,5 |
7,5 |
18,6 |
12,8 |
31,4 |
IR : impôt sur le revenu. PFU : prélèvement forfaitaire unique.
NB : Les prélèvements autres que les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas à tous les revenus du patrimoine et produits de placement. Par exemple, l'assurance vie est soumise, outre aux prélèvements sociaux (de 17,2 %, portés à 18,6 % par cet article), à l'impôt sur le revenu ou à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) diminuant avec l'âge du contrat.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
Sur la base du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025, on peut évaluer le rendement du présent article à environ 2,8 milliards d'euros.
Estimation du rendement du présent article
(en millions d'euros)
|
Montant* |
Valeur du point |
Rendement du présent article |
|
|
A |
B [=A/9,2] |
C [=B×1,4] |
|
|
CSG sur les revenus du patrimoine |
7 138 |
776 |
1 086 |
|
CSG sur les revenus de placement |
11 100 |
1 207 |
1 689 |
|
Total |
18 238 |
1 982 |
2 775 |
Le présent article prévoit d'augmenter le taux d'imposition de 1,4 point (passage de 9,2 points à 10,6 points).
* Source : rapportà la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
B. L'assiette concernée
1. La CSG sur les revenus du patrimoine
La CSG sur les revenus du patrimoine est définie par les articles L. 136-6 à L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale.
Elle porte en particulier sur les revenus fonciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values immobilières.
2. La CSG sur les produits de placement
La CSG sur les produits de placement est quant à elle définie par l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Sont exclus le livret A, le livret d'épargne populaire (LEP), le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire (LDDS), les plans épargne logement (PEL) de moins de 12 ans et les comptes épargne logement (CEL) souscrits avant 2018.
En revanche, entrent dans l'assiette, notamment, les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement (CEL) et des plans d'épargne-logement (PEL), les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et à l'assurance vie, les produits des plans d'épargne populaire (PEP), le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un PEA.
II - La position de la commission
La commission prend acte du fait que, comme indiqué supra, la ministre de l'action et des comptes publics a clairement indiqué que l'avis favorable du Gouvernement aux amendements tendant à augmenter le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements provenait du souhait de conserver jusqu'à la fin de la navette la possibilité d'augmenter ce taux, dans l'hypothèse où cela serait nécessaire pour éviter un déficit de la sécurité sociale supérieur à 20 milliards d'euros.
Par ailleurs, elle relève que divers rapports préconisent une augmentation de la fiscalité de l'épargne ou du patrimoine pour financer la protection sociale. Ainsi, le « rapport Vachey »108(*) de 2020 proposait d'instaurer un prélèvement de 0,8 % sur les transmissions ou une tranche de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 25 % pour les transmissions entre 284 128 euros et 552 324 euros. L'augmentation du taux de CSG applicable aux revenus du capital est quant à elle explicitement envisagée par le récent rapport109(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre110(*).
Toutefois, la commission n'est pas favorable, par principe, aux hausses de la fiscalité. Elle considère en effet que les réductions de dépenses doivent être la manière privilégiée de réduire le déficit.
Aussi, elle a adopté un amendement n° 595 de sa rapporteure générale, tendant à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 6 ter
(nouveau)
Extension de la règle de lissage du revenu pris en compte
dans le cas des allocations chômage et des pensions de retraite et
d'invalidité pour la détermination du taux de CSG
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'étendre la règle de lissage du revenu pris en compte dans le cas des allocations chômage et des pensions de retraite et d'invalidité pour la détermination du taux de CSG.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le 1° et le 2° du I de cet article résultent d'un amendement111(*) adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Actuellement, le passage, pour les allocations chômage et les pensions de retraite et d'invalidité, du taux de 3,8 % à un taux supérieur (6,2 % pour les allocations chômage ; 6,6 % ou 8,3 % pour les pensions de retraite et d'invalidité) n'a lieu que si le seuil de revenu correspondant est franchi deux années de suite112(*).
Selon l'exposé sommaire, « l'amendement proposé vise à étendre le lissage lors de chaque passage à un taux supérieur uniquement si les revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d'assujettissement à un taux supérieur ».
Le 1° du I de cet article a semble-t-il pour objet d'étendre ce « lissage » au passage du taux zéro au taux de 3,8 %. Toutefois en pratique il assujettit au taux de 3,8 %, outre les contribuables ayant franchi le seuil l'avant-dernière année (comme actuellement), ceux l'ayant franchi l'antépénultième année.
Le 2° du I de cet article étend le lissage au passage du taux de 6,6 % au taux normal de 8,3 % (qui ne concerne que les pensions de retraite et d'invalidité).
II - La position de la commission
Comme cela a été souligné par le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, cet amendement, en rendant plus difficile le passage d'un taux à un taux supérieur, susciterait des pertes de recettes. Selon les estimations transmises par le ministère de l'action et des comptes publics à la commission, celles-ci seraient de 200 millions d'euros.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur le risque de constituer un précédent, qui conduirait de proche en proche à doter chaque barème progressif de dispositifs de lissage analogues.
On rappelle en outre que le taux maximal applicable aux pensions de retraite est de 8,3 %, ce qui est inférieur au taux de 9,2 % applicable aux revenus d'activité.
En conséquence, la rapporteure générale a proposé un amendement n° 596 de suppression du présent article, adopté par la commission.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 7
(supprimé)
Institution d'une taxe exceptionnelle sur les cotisations
versées aux complémentaires santé
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement, propose d'instituer une taxe exceptionnelle sur les cotisations versées aux complémentaires santé. Instituée pour la seule année 2026, celle-ci abonderait pour 1,0 milliard d'euros la branche maladie et, en vertu de la lettre rectificative déposée par le Gouvernement, pour 0,1 milliard d'euros la branche vieillesse.
La commission considère qu'il convient de le rétablir, sans la majoration de 0,1 milliard d'euros résultant de la lettre rectificative.
La commission propose de rétablir cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. La taxation des contrats de complémentaire santé, qui repose essentiellement sur la taxe de solidarité additionnelle, est perçue comme excessive par les organismes
Les complémentaires santé, quelle que soit leur forme, permettent de limiter le reste à charge des assurés en remboursant tout ou partie des frais de santé non déjà solvabilisés par l'assurance maladie, à l'instar du ticket modérateur113(*) ou des dépassements d'honoraires.
Les complémentaires santé financent 12,4 % de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) en 2023, une proportion qui suit une trajectoire légèrement baissière (13,0 % en 2013). Les 34,9 milliards d'euros114(*) de prestations qu'elles servent jouent donc un rôle déterminant pour maintenir le reste à charge des assurés français parmi les plus bas d'Europe, contenu à 7,5 % en moyenne en 2023. Leur implication s'avère particulièrement indispensable pour certains secteurs comme les soins dentaires (43,9 % de la CSBM) ou les biens médicaux (21,3 % de la CSBM).
En contrepartie des prestations que l'assuré perçoit de sa complémentaire santé, il est tenu de s'acquitter d'une cotisation ou de primes d'assurance, qui varient généralement en fonction de l'âge de l'assuré, mais pas de son état de santé observable, permettant une certaine mutualisation intragénérationnelle, mais aussi intergénérationnelle115(*).
Ces cotisations sont soumises à un régime fiscal spécifique, dont la taxe de solidarité additionnelle est la clé de voûte.
1. La taxe de solidarité additionnelle frappe les cotisations versées aux complémentaires santé pour un rendement de 6,2 milliards d'euros en 2024, affecté notamment au financement de la complémentaire santé solidaire
a) L'assiette de la taxe de solidarité additionnelle est constituée de 43,3 milliards d'euros de primes d'assurance maladie ou incapacité complémentaires
La taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire116(*) (TSA) frappe les sommes perçues par les organismes complémentaire d'assurance maladie au titre de leurs prestations en santé ou en prévoyance, pour ce qui concerne les indemnités complémentaires aux indemnités journalières. Les sommes stipulées s'entendent également de tous accessoires dont les organismes bénéficient du fait de l'assuré117(*). Quelques exemptions d'assiette s'appliquent118(*), notamment les éventuelles participations des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire119(*).
Cette assiette s'élève, en 2023, à 43,3 milliards d'euros, dont 42,0 milliards collectés au seul titre des prestations en santé.
Elle est due, selon les mêmes conditions, par les trois catégories d'organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam), représentant 388 organismes dont 263 mutuelles, 100 entreprises d'assurance et 25 institutions de prévoyance.
Les acteurs du marché de l'assurance complémentaire santé en France
En France, les organismes d'assurance peuvent être régis par trois codes :
(i) Le code de la mutualité. Les organismes relevant du code de la mutualité sont dénommés « mutuelles ». Ces mutuelles sont des organismes à but non lucratif qui appartiennent à leurs assurés et réinvestissent à leur profit les bénéfices qu'elles peuvent réaliser. Le code de la mutualité autorise les mutuelles à exercer essentiellement sur le champ des risques sociaux (santé, incapacité, invalidité, dépendance, décès, retraite, emploi, famille). Elles peuvent exercer quelques activités hors de ce champ (caution immobilière, protection juridique, assistance et capitalisation) mais celles-ci restent en pratique très marginales.
(ii) Le code de la sécurité sociale. Les institutions de prévoyance, qui relèvent de ce code120(*), sont également à but non lucratif. Elles appartiennent à leurs adhérents et participants et réinvestissent à leur profit les bénéfices qu'elles peuvent réaliser. Le code de la sécurité sociale ne leur permet d'exercer que des activités sur le champ des risques sociaux. Les institutions de prévoyance sont spécialisées sur la couverture des entreprises ou des branches professionnelles (contrats collectifs) et sont des organismes dits « paritaires » : leurs conseils d'administration comportent, à égalité, des représentants des salariés et des employeurs des entreprises adhérentes.
(iii) Le code des assurances. Les organismes relevant de ce code, qui sont majoritairement des entreprises d'assurance, peuvent exercer une plus grande variété d'activités d'assurance (assurance automobile, habitation, responsabilité civile, catastrophes naturelles, dommages aux biens, capitalisation et assurance vie, etc.). Les entreprises d'assurance peuvent être des mutuelles d'assurance (ou sociétés d'assurance mutuelles) ou des compagnies d'assurance. Les mutuelles d'assurance sont des organismes à but non lucratif qui appartiennent à leurs adhérents, nommés « sociétaires », et qui ont ainsi un fonctionnement proche de celui des mutuelles. Les compagnies d'assurance sont quant à elles des entreprises à but lucratif, qui appartiennent à leurs actionnaires.
Source : Drees, Rapport 2024 sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé, 2024
b) Des taux différenciés en fonction des huit sous-assiettes prévues par la loi
Les différents contrats des complémentaires santé
On distingue plusieurs catégories de contrats de complémentaires santé, associés à des caractéristiques propres. Il peut s'agir :
- de contrats solidaires et responsables, classiques ou agricoles, largement majoritaires sur le marché puisqu'ils représentent 96,4 % des cotisations perçues121(*). Ils sont qualifiés de responsables en ce qu'ils encouragent le respect du parcours de soins coordonnés, et de solidaires en ce qu'ils excluent le recueil d'informations médicales et voient leurs cotisations définies indépendamment de l'état de santé des assurés122(*). Ils bénéficient, en contrepartie, d'un régime socio-fiscal avantageux.
Ces contrats suivent un cahier des charges législatif et réglementaire123(*) prévoyant notamment le remboursement, sauf exception, de l'intégralité du ticket modérateur124(*) sur les soins125(*), un encadrement de la prise en charge des dépassements d'honoraires et l'interdiction de solvabiliser les franchises et participations forfaitaires126(*).
- de contrats non responsables ou non solidaires, qui ne remplissent pas les conditions mentionnées supra. Ces contrats, classiques ou agricoles, représentent 3 % du marché de la complémentaire santé ;
- de contrats dits « au premier euro », destinés aux personnes qui ne bénéficient pas d'une affiliation à l'assurance maladie obligatoire, notamment des travailleurs frontaliers. L'assurance n'est alors, à proprement parler, pas une « complémentaire » santé mais une assurance santé primaire. De tels contrats représentent 0,2 % des cotisations versées en 2023 ;
- de contrats dits « du 1° de l'article 998 du code général des impôts », marginaux (0,3 % des cotisations versées en 2023), concernant des contrats d'entreprises bénéficiant d'un régime fiscal avantageux sous réserve que 80 % de leurs cotisations soient affectées à la prévoyance et non aux prestations en nature.
Le taux de la TSA est fixé, par l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, à 13,27 % pour les contrats classiques lorsque ceux-ci sont solidaires et responsables.
Les contrats solidaires et responsables disposent d'un avantage fiscal qui garantit leur compétitivité : les contrats non solidaires ou non responsables sont ainsi soumis à un taux de TSA majoré de sept points127(*), à 20,27 % pour les contrats classiques.
Le même article prévoit des régimes fiscaux dérogatoires pour différents types de contrats :
- les contrats agricoles solidaires et responsables sont soumis à un taux de TSA de 6,27 % ;
- les contrats responsables portant des garanties de versement des indemnités journalières (IJ) complémentaires se voient appliquer un taux de 7 % de TSA128(*) ;
- les contrats au premier euro sont soumis à un taux de TSA de 14 % ;
- les contrats du 1° de l'article 998 du CGI se voient appliquer un taux de TSA de 6,27 %.
Taux de TSA applicable par type de contrat
|
Type de contrats |
Classique |
Agricole |
IJ |
Au premier euro |
1° de l'article 998 du CGI |
|
Solidaire et responsable |
13,27 % |
6,27 % |
7 %129(*) |
14 % |
6,27 % |
|
Non solidaire ou non responsable |
20,27 % |
20,27 % |
14 % |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après Légifrance
c) Un rendement de 6,2 milliards d'euros affecté au financement de la complémentaire santé solidaire et de la branche maladie
La TSA a produit un rendement de 6,2 milliards d'euros en 2024, soit 8,7 % de plus qu'en 2023, dans un contexte de forte hausse des primes de complémentaire santé130(*). Sa dynamique devrait rester favorable en 2025, avec une hausse de 5,2 % pour atteindre un rendement de 6,5 milliards d'euros.
La TSA sur les garanties d'indemnités journalières complémentaires représente une centaine de millions d'euros, le reste du rendement étant le fait des contrats de complémentaire santé.
Évolution du rendement de la TSA depuis 2023
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après les données du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025
Historique sur la taxation des complémentaires santé
La taxe de solidarité additionnelle résulte de la fusion, en 2016131(*), de l'ancienne taxe de solidarité additionnelle et de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA). Cette fusion avait pour objectif de simplifier et rationaliser la fiscalité sur les complémentaires santé.
• L'institution de la couverture maladie universelle (CMU) s'accompagne d'une taxe appelée contribution à la CMU132(*), mise à la charge des complémentaires santé pour les faire participer au financement de cette prestation. Cette contribution à la CMU a connu un changement d'assiette en 2011, assortie d'un changement de nom puisqu'elle est alors devenue l'ancienne taxe de solidarité additionnelle133(*).
• Cette taxe coexistait alors avec la TSCA, une taxe créée en 1944134(*) applicable à divers contrats d'assurance et dont le champ a été étendu en 2002 pour toucher les trois catégories d'organismes complémentaires santé. Cette taxe ne frappait, dans un premier temps, que les contrats non solidaires et responsables, mais elle s'est finalement appliquée aux contrats responsables et solidaires selon un taux réduit à compter de 2011135(*), dans un objectif de redressement des comptes sociaux.
Bien que la fusion de l'ancienne TSA et de la TSCA ait rendu cette dernière inapplicable aux cotisations versées sur les contrats de complémentaires santé, la TSCA frappe toujours les assurances automobiles ou les assurances contre les incendies136(*).
Prélevée par les Ocam, la TSA est versée trimestriellement137(*) à l'Urssaf d'Île-de-France138(*), par voie dématérialisée139(*). Le produit de cette taxe est ensuite affecté au fonds de financement de la complémentaire santé solidaire (C2S), pour une fraction140(*), et au fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité, pour une autre fraction141(*). Le solde, s'il existe, est affecté au financement de la branche maladie du régime général142(*). Dans les faits, ce solde avoisine 3 milliards d'euros en 2023.
La fraction affectée au fonds de financement de la C2S varie chaque année ex post143(*), de sorte que l'ensemble des dépenses afférentes à la complémentaire santé solidaire soient, à l'euro près, couvertes par la TSA, après déduction des participations versées144(*).
La complémentaire santé solidaire (C2S)
La LFSS pour 2019145(*) a procédé, au 1er novembre 2019, à la fusion entre les dispositifs de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), créé en 2000, et d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), institué en 2004.
A ainsi été créée la complémentaire santé solidaire146(*), un dispositif à deux niveaux permettant aux assurés modestes de bénéficier d'une couverture complémentaire à l'assurance maladie obligatoire.
La C2S gratuite (C2SG) ouvre droit, sans participation financière, à une couverture complémentaire pour les assurés les plus précaires, disposant de ressources inférieures à 10 339 euros pour une personne seule147(*) ou 18 609 euros pour un couple avec enfant148(*), par exemple.
La C2S avec participation (C2SP) permet la couverture santé complémentaire des assurés dont le niveau de ressources est inférieur au seuil de la C2SG majoré de 35 %149(*), soit par exemple 13 957 euros pour une personne seule, en contrepartie du versement de primes modérées150(*), dépendant de l'âge de l'assuré et variant entre 8 euros et 30 euros par mois.
7,7 millions d'assurés ont bénéficié, en 2024, de la complémentaire santé solidaire, dont 6 millions au titre de la C2SG et 1,7 million au titre de la C2SP, pour une dépense totale de 3,8 milliards d'euros à la charge du fonds de financement de la C2S, un fonds sans personnalité juridique créé au sein de la Cnam.
2. Les complémentaires santé doivent s'acquitter d'une contribution au forfait patientèle médecin traitant, pour un rendement inférieur
Depuis 2018, un forfait patientèle médecin traitant (FPMT)151(*) a été introduit par la convention médicale152(*) afin de valoriser les missions spécifiques du médecin traitant dans le suivi de sa patientèle, en remplacement de divers forfaits préexistants (forfaits ALD ou post-ALD, forfait médecin traitant, majoration personnes âgées...).
Le FPMT rémunère forfaitairement le médecin pour chaque patient dont il est le médecin traitant, en fonction de ses caractéristiques. Une majoration s'applique lorsque la part des assurés bénéficiaires de la C2S dans la patientèle médecin traitant est supérieure à la moyenne nationale.
Rémunération forfaitaire par patient en patientèle médecin traitant
|
Âge du patient |
Statut |
Valorisation |
|
0 à 6 ans |
ALD |
46 euros |
|
Non ALD |
6 euros |
|
|
7 à 79 ans |
ALD |
46 euros |
|
Non ALD |
5 euros |
|
|
80 ans et plus |
ALD |
70 euros |
|
Non ALD |
46 euros |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après la convention médicale
Ce forfait est cofinancé par l'assurance maladie et les complémentaires santé.
Les Ocam s'acquittent ainsi depuis 2019153(*) d'une contribution à la Cnam équivalant à 0,8 % des cotisations collectées en santé154(*), soit 0,3 milliard d'euros en 2023 et 0,4 milliard d'euros en 2024. Cette contribution a, elle aussi, remplacé une précédente taxe, alors proportionnelle au nombre de personnes couvertes par l'organisme. Le recouvrement de la contribution FPMT est concomitant à celui de la TSA.
Du remplacement du FPMT à une
évolution de la contribution
à la charge des
complémentaires santé ?
La convention médicale actuellement en vigueur155(*) prévoit la fusion du FPMT et de la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp) en un forfait médecin traitant (forfait MT)156(*), au 1er janvier 2026157(*). Cette évolution entend permettre de simplifier, revaloriser et renforcer les forfaits existants.
Le forfait MT se compose :
- d'une part fixe, composée d'un forfait socle, reprenant en les revalorisant les montants du FPMT158(*), et d'une majoration forfaitaire appliquée pour chaque patient bénéficiaire de la C2S au sein de la patientèle médecin traitant du praticien ;
- de majorations proportionnelles pour les médecins installés en zone sous-dense ou âgés de 67 ans et plus ;
- d'une part variable au titre des majorations de prévention.
L'article 21-1 de la convention prévoit, dans ce contexte, de « mettre en place dès 2024 un groupe de travail conventionnel destiné à examiner les évolutions possibles des modalités de participation des Ocam au financement du forfait MT », sans qu'aucune modification à la contribution au FPMT ne figure à ce stade dans le présent PLFSS.
3. Une fiscalité considérée comme excessivement lourde par les complémentaires santé
Les complémentaires santé déplorent fréquemment la fiscalité qui leur est imposée, qu'elles estiment excessive.
En tenant compte de l'ensemble de la fiscalité qui leur est applicable, les complémentaires santé ont été soumises, en 2022, à un taux effectif de prélèvement de 14,1 %, un niveau proche de la somme des taux théoriques de contribution FPMT et de TSA sur les contrats classiques responsables et solidaires (14,07 %), qui représentent 94 % du marché.
Évolution du taux effectif de
prélèvement sur les contrats
de complémentaire
santé
Source : Drees
Ce taux de prélèvement a connu une hausse de 12,6 points depuis 2002, mais est globalement stable depuis 2014, hors contributions exceptionnelles159(*). Il suit en effet principalement les évolutions du taux applicable à la TSA et aux taxes qui l'ont précédée, inchangé depuis cette date.
Évolution des taux de TSA et taxes qui l'ont précédée, depuis 2002
|
oct. 2002 à 2005 |
2006 à 2007 |
2008 |
2009 à 2010 |
jan. à sept. 2011 |
oct. 2011 à 2013 |
2014 à 2015 |
Depuis 2016 |
|
|
Classiques, responsables et solidaires |
1,75 |
2,5 |
2,5 |
5,9 |
9,77 |
13,27 |
13,27 |
13,27 |
|
Classiques, non responsables et solidaires |
8,75 |
9,5 |
9,5 |
12,9 |
13,27 |
15,27 |
20,27 |
20,27 |
|
1° art. 998 CGI |
1,75 |
2,5 |
2,5 |
5,9 |
6,27 |
6,27 |
6,27 |
6,27 |
|
Agricoles, responsables et solidaires |
1,75 |
2,5 |
2,5 |
5,9 |
6,27 |
6,27 |
6,27 |
6,27 |
|
Agricoles, non responsables et solidaires |
1,75 |
2,5 |
9,5 |
12,9 |
13,27 |
15,27 |
20,27 |
20,27 |
|
Au 1er euro |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
14 |
14 |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
Note de lecture : Les évolutions constatées en janvier 2011 sont liées à un changement d'assiette à rendement constant, sauf, pour 3,5 points, sur les contrats classiques solidaires et responsables.
Dans un communiqué commun en date du 27 janvier 2025, France Assureurs, la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTip) regrettent qu'« en France, un soda ou un hamburger [soit] moins taxé qu'un contrat de complémentaire santé ». Ces organisations estiment que les français sont « champions d'Europe » de la fiscalité des contrats d'assurance santé, ceux-ci étant « exemptés en Allemagne, taxés à 0,15 % en Espagne et à 2,5 % en Italie ».
B. Un complément de fiscalité exceptionnel, similaire à ceux régulièrement mis en oeuvre lors de crises sanitaires, annoncé dès janvier 2025
1. Lors de crises sanitaires, le législateur a sollicité une contribution exceptionnelle des complémentaires santé
Les complémentaires santé ont été appelées par le législateur à contribuer à l'effort de financement de la santé lors de crises sanitaires à deux reprises lors des quinze dernières années.
a) Une taxe exceptionnelle au titre de la contribution à la gestion de l'épidémie de grippe aviaire
Afin de faire participer les complémentaires santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de grippe aviaire H1N1, survenue en 2009, le législateur a instauré, lors de la LFSS pour 2010160(*), une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie.
Cette contribution, représentant 0,34 % des cotisations de complémentaires santé collectées en 2010, a généré un rendement de 0,1 milliard d'euros.
b) Une augmentation transitoire de la fiscalité des Ocam en 2020 et 2021 dans un contexte de forte sollicitation de l'AMO par l'épidémie de covid-19 et de repli des dépenses des complémentaires santé
L'assurance maladie obligatoire a assumé un investissement exceptionnel pour pallier les conséquences de la crise sanitaire liée aux épidémies de covid-19, à l'origine de surcoûts totaux avoisinant 50 milliards d'euros dont 18,3 milliards d'euros en 2020, 18,3 milliards d'euros en 2021 et 11,7 milliards d'euros en 2022.
Parallèlement aux dépenses liées à la crise sanitaire, la consommation de soins et de biens médicaux a reculé en raison de déprogrammations d'interventions en établissement de santé et d'une moindre activité des professionnels libéraux, particulièrement durant les périodes de confinement. En conséquence, les complémentaires santé ont paradoxalement été moins sollicitées en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire.
Par conséquent, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021161(*) a instauré une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie, frappant leurs cotisations en santé d'un taux de 2,6 % en 2020 et 1,3 % en 2021.
La contribution a généré un rendement de 1,5 milliard d'euros, dont 1 milliard d'euros au titre de l'année 2020 et 0,5 milliard d'euros au titre de l'année 2021. Selon la mission d'information du Sénat sur les complémentaires santé, « ces montants sont inférieurs aux moindres dépenses des organismes complémentaires engendrées par la crise sanitaire »162(*).
2. Une taxe transitoire envisagée dès janvier 2025, en raison de la répercussion supposée sur les tarifs des complémentaires santé d'une hausse de ticket modérateur finalement non advenue
L'annexe 5 au PLFSS pour 2025 faisait figurer, parmi les mesures réglementaires de maîtrise des dépenses envisagées, « la hausse du ticket modérateur sur les consultations ». Cette mesure, chiffrée à 1,0 milliard d'euros en ville, devait concerner « les consultations des médecins et sage-femmes », avec une baisse de 10 points du taux de prise en charge de l'assurance maladie, obligatoirement compensée par les complémentaires santé dans le cadre du contrat responsable et solidaire.
Le Gouvernement s'était dit, au cours des discussions parlementaires, prêt à évoluer sur la question, pour frapper plutôt les médicaments et, dans une moindre mesure qu'initialement envisagée, les consultations des médecins. Une telle évolution aurait généré un transfert de prise en charge de l'ordre de 900 millions d'euros de l'assurance maladie vers les complémentaires santé.
Pour autant, à l'issue de la censure du Gouvernement en date du 4 décembre 2024, le Premier ministre François Bayrou a annoncé, dans sa déclaration de politique générale du 14 janvier 2025, renoncer à cette mesure, sous-tendant ainsi une moindre sollicitation des complémentaires santé.
Afin de ne pas dégrader le solde de la branche maladie, Catherine Vautrin, alors ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, a annoncé le 15 janvier 2025 que « l'État demandera[it] aux mutuelles la restitution de cette somme, ce qui permettra de contribuer au financement supplémentaire des dépenses de santé ».
Le Gouvernement justifiait alors cette taxe transitoire par l'intégration indue de la hausse du ticket modérateur par les complémentaires santé dans la fixation de leurs cotisations 2025. L'exposé des motifs du présent article défend ainsi que « pour 2025, les organismes complémentaires ont de nouveau annoncé des augmentations de cotisations de l'ordre de 6 %, par anticipation d'une hausse du ticket modérateur des actes médicaux et des médicaments, annoncée par le Gouvernement, qui n'a finalement pas été mis[e] en oeuvre. Pour autant, la progression des cotisations a été maintenue ».
Un contexte de crispation persistante autour des
hausses tarifaires des complémentaires santé, jugées
excessives par le Gouvernement
et par une mission d'information
sénatoriale
Ces annonces s'inscrivent dans un contexte de tension entre les complémentaires santé et le Gouvernement depuis deux ans, autour de la dynamique des primes réclamées aux assurés, jugée « pas tenable » et « excessi[ve] » en décembre 2023 par Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention. Face aux annonces de hausses tarifaires annoncées entre 8 % et 10 %163(*) pour 2024, celui-ci avait ajouté qu'« une augmentation de 4 à 5 % serait logique, 8 % ça n'a pas de sens, 10 % a fortiori ».
La mission d'information sénatoriale précitée avait quant à elle abouti, à l'issue de ses travaux, à une hausse des tarifs explicable pour 2024 de l'ordre de 4,5 % à 6,5 %, en fonction des scénarios de coût.
3. Les organismes complémentaires d'assurance maladie contestent le fondement d'une telle contribution, qu'ils jugent « incompréhensible » et « injustifiée »
Dans un communiqué commun aux principales fédérations des trois familles de complémentaires santé en date du 27 janvier 2025, les Ocam ont fait savoir leur opposition au projet de taxe, qualifié par la suite de « TVA sur la santé » par Séverine Salgado, directrice générale de la FNMF.
• Les complémentaires défendent, d'abord, qu'elles n'ont pas répercuté la hausse de ticket modérateur sur leur campagne tarifaire 2025. Florence Lustman, présidente de France Assureurs, affirme ainsi dans le communiqué que « les complémentaires santé ont été informées par le gouvernement Barnier d'une nouvelle mesure de déremboursement le 10 octobre dernier, alors que la plupart d'entre elles avaient déjà fixé leurs tarifs pour 2025 au printemps. Elles n'ont donc pas pu intégrer ces transferts ». La Mutualité française rappelle que les cotisations sont fixées « au plus tard le 30 septembre 2024 pour les contrats collectifs »164(*). Dans ses réponses écrites au questionnaire de la rapporteure générale, France Assureurs fait valoir que « pour être en mesure d'indemniser les sinistres de l'année N, il faut [...] estimer le coût du risque de cette année N en année N-1 et donc, in fine, définir la cotisation de l'année N en année N-1 ». Cela n'apparaît toutefois pas formellement faire obstacle à des révisions tarifaires au dernier trimestre de l'année N-1 pour les contrats individuels, compte tenu du fait que les renouvellements s'opèrent au dernier trimestre.
Chronologie de la détermination des paramètres des campagnes tarifaires annuelles, selon France Assureurs
Source : France Assureurs
• Les complémentaires déplorent, en outre, les effets qu'une telle taxe est susceptible d'engendrer sur l'accès financier à la complémentaire santé. La présidence paritaire du CTip fait ainsi valoir qu'« envisager une nouvelle taxe sur les complémentaires santé se traduirait nécessairement par des coûts supplémentaires à la charge des ménages et des entreprises, ce qui est insensé dans le contexte actuel ».
• S'ajoute enfin une opposition quant à la méthode et au rôle des complémentaires santé. Éric Chenut, président de la FNMF, défend ainsi que « le rôle des mutuelles est de couvrir des risques en santé et prévoyance, de financer l'accès aux soins et aux biens médicaux. Nous n'avons pas vocation à être les supplétifs de l'Urssaf pour lever des financements pour l'assurance maladie ».
Le précédent gouvernement a fait savoir aux complémentaires santé, par ses ministres compétents, qu'il n'envisageait pas de renoncer à cette mesure dans le courant du mois de mars.
La complémentaire santé, un secteur faiblement lucratif
Le marché de la complémentaire santé est peu lucratif par rapport aux autres marchés de l'assurance.
En 2023, après deux années où l'assurance santé parvenait à peine à l'équilibre technique (0,1 % en 2022), le secteur a connu, pour la première fois depuis onze ans, un résultat technique global négatif, à hauteur de - 0,4 % des cotisations hors taxe. Seuls les assureurs disposent d'un résultat technique très légèrement positif, à hauteur de 0,7 % des cotisations hors taxe. Le résultat du secteur est tiré à la baisse par les contrats collectifs (- 3,9 %), sur lesquels la concurrence tarifaire est plus marquée.
Évolution des résultats techniques en santé par famille d'organismes
Source : Drees
Selon le rapport d'information précité de la mission d'information du Sénat sur les complémentaires santé, « le défaut de rentabilité sur les activités de complémentaire santé est lié aux caractéristiques très spécifiques de ce marché, partagé entre organismes à but lucratif et organismes sans but lucratif représentant 64 % du marché et tirant structurellement les prix vers le bas. Aussi, afin de dégager une rentabilité suffisante, les complémentaires santé comptent sur leur résultat financier et, pour les institutions de prévoyance et entreprises d'assurances, sur des résultats d'exploitation favorables dans d'autres champs.
En fait, l'incitation pour les acteurs du secteur à gagner des parts de marché ne réside pas dans le gain financier direct qui en découlerait, mais plutôt dans une meilleure mutualisation des prestations et dans la réalisation de gains financiers indirects via la vente croisée. »
C. Le dispositif proposé : une contribution exceptionnelle assise sur les cotisations perçues par les complémentaires santé en 2026
1. Le dispositif proposé dans le PLFSS déposé : une contribution exceptionnelle assise sur les cotisations perçues par les complémentaires santé en 2026
Le présent article, dans sa version déposée, prévoyait d'instituer une contribution de 2,05 % sur les cotisations perçues au titre de garanties d'assurance maladie complémentaire par les organismes soumis à la TSA, pour la seule année 2026.
Le présent article renvoie la définition de l'assiette à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la TSA : l'assiette de la contribution est donc identique à celle de la TSA.
Cette contribution sera recouvrée par le même organisme que celui chargé du recouvrement de la TSA, concomitamment à cette dernière. Elle pourra faire l'objet d'une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les modalités prévues pour la TSA. Elle est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Comme pour la TSA, les déclarations et versements s'opéreront par voie dématérialisée, sous peine d'une majoration fixée au plus à 0,2 % et versée à l'organisme chargé du recouvrement de la TSA.
L'étude d'impact initiale indiquait un rendement de 1,02 milliard d'euros pour cette contribution, un total cohérent avec l'ampleur du transfert de prise en charge envisagé, puis abandonné.
2. Une modification du taux et de l'affectation de la contribution par lettre rectificative
Le Gouvernement a modifié le présent article par voie de lettre rectificative en date du 23 octobre 2025.
Le présent article fixe désormais à 2,25 % le taux de la contribution.
Il prévoit, en son II165(*), que le produit de la contribution soit affecté à la branche maladie pour le taux initialement envisagé, soit 2,05 %.
Le II du présent article affecte à la branche vieillesse le solde de la contribution, soit 0,2 % des cotisations, qui devrait représenter un montant avoisinant 100 millions d'euros.
Il s'agit là d'une manière de ne pas dégrader le solde de cette branche en 2026 malgré l'intégration au PLFSS d'un article 45 bis décalant l'entrée en vigueur de la réforme des retraites portée par la LFRSS pour 2023166(*).
Au global, le rendement de la contribution devrait atteindre, selon l'étude d'impact, 1,12 milliard d'euros, dont 1,02 milliard affecté à la branche maladie et 0,1 milliard d'euros à la branche vieillesse.
II. Le dispositif transmis au Sénat
Ont été adoptés douze amendements identiques de députés issus des groupes La France insoumise - Nouveau Front populaire, Gauche Démocrate et Républicaine, Socialistes et apparentés, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Ensemble pour la République, Droite Républicaine, Union des droites pour la République et Rassemblement national.
Ces amendements craignent en effet que la hausse transitoire de la fiscalité sur les contrats de complémentaire santé soit répercutée sur les cotisations versées par les assurés. Certains d'entre eux déplorent également que le produit de cette taxe transitoire soit affecté à la branche vieillesse au titre du financement de la suspension de la réforme des retraites.
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
• La commission ne remet pas en cause les déclarations des organismes complémentaires d'assurance maladie concernant la temporalité de la fixation des évolutions tarifaires annuelles. Le CTip indique d'ailleurs qu'« au 30 juin 2025, l'évolution des prestations sur le premier semestre montre que ces augmentations de cotisations étaient dans l'ensemble justifiée[s] »167(*).
Elle ne souscrit donc pas aux arguments du Gouvernement, selon lequel la hausse du ticket modérateur a bien été prise en compte dans la définition des cotisations à percevoir pour l'année 2025.
Elle ne souscrit pas davantage aux analyses figurant dans l'exposé des motifs, tendant à faire passer pour contradictoires la baisse de la part qu'assume l'assurance maladie complémentaire dans les dépenses de santé et la hausse de leurs cotisations.
En effet, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) croît à un tel rythme qu'en dépit de la diminution de la part de l'AMC dans son financement, le montant des prestations versées par les complémentaires santé168(*) a augmenté de 25,8 milliards d'euros en 2013 à 32,5 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de 26 %.
La commission rappelle par ailleurs que le secteur de la complémentaire santé est peu, voire pas rentable : près des deux tiers du marché sont d'ailleurs des acteurs mutualistes ou paritaires sans but lucratif.
Il n'y a donc rien de surprenant à ce que l'augmentation des prestations que versent les complémentaires santé soient intégralement répercutées dans l'évolution de leurs primes ou cotisations.
• Pour autant, la commission note qu'à en croire les complémentaires santé, les évolutions tarifaires pour 2026 ont été fixées au printemps 2025.
Or le Gouvernement a, dès le 15 janvier 2025, indiqué qu'il comptait renforcer transitoirement la fiscalité sur les complémentaires santé afin de ne pas dégrader le solde malgré l'abandon de la hausse du ticket modérateur.
Le Gouvernement a, en outre, confirmé en mars dernier qu'il avait l'intention de mettre en oeuvre cette mesure, malgré la vive opposition du secteur.
Par conséquent, il apparaît que les complémentaires santé ont fixé leurs primes pour 2026 sans pouvoir ignorer que celles-ci devraient leur permettre de dégager les marges de manoeuvre nécessaires au financement de la contribution supplémentaire demandée.
Aussi, si la rapporteure générale regrette avec force la hausse tarifaire qui découle, pour les assurés, de l'instauration de cette taxe, cet effort semble désormais inévitable dès lors que les complémentaires ont déjà figé leurs évolutions tarifaires en prenant en compte les effets de la contribution exceptionnelle. Les cotisations des complémentaires santé pour 2026 sont donc, à ce stade, indépendantes de l'adoption ou du rejet du présent article.
Au surplus, la mission d'information précitée du Sénat sur les complémentaires santé a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d'allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ». Rien n'indique donc que l'absence de mise en oeuvre de cette taxe puisse aboutir au reversement aux assurés de son rendement estimé, via des baisses de cotisations en 2027.
Le milliard d'euros de rendement qu'elle produira est, par ailleurs, indispensable afin de maîtriser le déficit de l'assurance maladie pour 2026, en attendant l'entrée en vigueur de diverses mesures d'économies du présent projet de loi, qui prendront effet ou monteront en charge en 2027.
Dans la seule mesure où, compte tenu du calendrier de fixation des tarifs des complémentaires santé, la hausse des primes découlant de la taxe n'est pas subordonnée à l'adoption effective de cette mesure, la commission a adopté un amendement n° 597 de sa rapporteure générale rétablissant la contribution transitoire demandée aux complémentaires santé, au taux fixé dans le projet de loi initial.
Concernant le relèvement de 0,2 point du taux de la taxe par lettre rectificative, outre que la commission ne souscrit nullement à la suspension de la réforme des retraites, il apparaît tout à fait inapproprié d'en faire porter le coût aux complémentaires santé et, en définitive, aux patients. La commission note en effet que, contrairement à la taxe affectée à la branche maladie, celle affectée à la branche vieillesse n'a pas été anticipée et se traduira donc par une hausse des cotisations évitable. La commission ne saurait donc revenir, en tout état de cause, à la rédaction du présent article tel qu'elle ressort de la lettre rectificative. La commission fait sienne l'analyse de la Mutualité française qui dénonce un « mélange [d]es genres »169(*) : la fiscalité sur les contrats de complémentaires santé n'a aucunement pour objet le financement de la branche vieillesse.
Il va toutefois sans dire que le levier de la taxation pérenne des complémentaires santé n'a rien d'adéquat pour répondre aux problématiques structurelles de l'équilibre financier de la branche maladie. De telles mesures, qui ne sont rien d'autre que des taxes différées sur les assurés, ne portent en effet aucune amélioration à notre système de santé ni à la pertinence des soins, et ont pour seul effet de restreindre l'accessibilité financière aux complémentaires santé. La commission se serait donc, en toute autre hypothèse, opposée à l'institution d'une taxe pérenne ou d'une taxe qui n'aurait pas été irrémédiablement anticipée par les organismes complémentaires.
La commission appelle par ailleurs, à l'avenir, le Gouvernement à davantage de coordination et de coopération avec les complémentaires santé. Elle souscrit pleinement aux recommandations du rapport sénatorial précité quant aux évolutions à apporter en matière de gouvernance, particulièrement la relance du Comité de dialogue avec les organismes complémentaires sous un format revu, avec un ordre du jour partagé.
La commission propose de rétablir cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 7 bis
(nouveau)
Instauration de niches sociale et fiscale en faveur de
coopératives pharmaceutiques
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'instaurer une exonération de prélèvements sociaux et un taux forfaitaire réduit d'impôt sur les sociétés, en faveur de coopératives pharmaceutiques.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : l'instauration d'une niche sociale et d'une niche fiscale en faveur de coopératives pharmaceutiques
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article adopté, qui résulte d'un amendement de Cyrille Isaac-Sibille, avec un avis défavorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, a pour objet - selon les explications données en séance par son auteur - d'inciter les groupements des différents maillons de la chaîne de la pharmacie -? fabricants, distributeurs et réseaux de pharmaciens - à s'organiser sous forme de coopérative plutôt que de société.
Pour ce faire, cet article prévoit que dans le cas des coopératives pharmaceutiques visées :
- les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu bénéficient d'une niche fiscale : « la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d'excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 % » ;
- les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'une niche sociale : « la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d'excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d'imposition forfaitaire réduit de 15 % ».
Selon l'exposé sommaire, il s'agit ainsi de lutter contre « la financiarisation croissante de la pharmacie d'officine », au profit d'un modèle dont l'auteur de l'amendement considère qu'il « garantit la liberté et l'indépendance des pharmaciens et favorise la solidarité territoriale et la préservation des petites officines ».
Selon l'auteur de l'amendement, les groupements sous forme de société « sont généralement détenus par des fonds de pension, qui prélèvent une part importante - de l'ordre de plusieurs centaines de millions - de la valeur créée par la filière du médicament. Pour lutter contre cette financiarisation, il faut donc privilégier le mode coopératif »170(*).
Le dispositif proposé serait décrit par un nouvel article L. 136-8-1 du code de la sécurité sociale. Le I de cet article L. 136-8-1 définit les dividendes concernés, son II précise les sociétés concernées (en fixant notamment l'exigence d'une présidence ou d'une direction effective par un pharmacien), son III précise l'éligibilité des distributions perçues, son IV fixe certaines règles relatives aux revenus, son V fixe le montant des niches fiscale et sociale, son VI concerne les obligations de transparence vis-à-vis de l'administration fiscale.
II - La position de la commission
La commission partage le souci de l'auteur de l'amendement de lutter contre la financiarisation de la santé.
A. Une instauration de niches sociale et fiscale qui pose plusieurs problèmes de principe
1. La commission n'est pas favorable à l'instauration de nouvelles niches sociales
Toutefois, la commission n'est, d'une manière générale, pas favorable à l'instauration de nouvelles niches sociales. Tel est encore moins le cas dans le contexte actuel des finances sociales.
2. Cet article instaure non seulement une niche sociale, mais aussi une niche fiscale
On remarque par ailleurs que cet article tend à instaurer non seulement une niche sociale, mais aussi une niche fiscale, c'est-à-dire concernant le budget de l'État.
Or, l'instauration d'une niche fiscale ne relève pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, tel que défini par l'article L.O. 111-3-6 du code de la sécurité sociale. Le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a ainsi suggéré que l'amendement tendant instaurer cet article aurait pu être déclaré irrecevable171(*).
3. Les deux niches proposées ne sont pas limitées dans le temps
On peut également relever que ces deux niches ne sont pas limitées dans le temps. Or :
- selon l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027172(*), « les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée après le 1er janvier 2024 sont applicables pour une durée qui est précisée par la loi les instituant et qui ne peut excéder trois ans » ;
- de même, selon l'article 21 de la loi précitée, « les créations ou les extensions [de niches sociales] qui sont instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue ».
B. Un dispositif dont le coût est inconnu
Aucun élément de coût n'a été évoqué, que ce soit dans l'exposé sommaire de l'amendement ou lors des débats en séance.
C. Un dispositif qui ne paraît pas pleinement opérationnel
En séance publique, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a estimé que l'amendement pourrait être mal ciblé173(*).
Ce dispositif semble donc, a minima, à retravailler. En conséquence, à l'initiative de la rapporteure générale, la commission a adopté un amendement n° 598 supprimant le présent article.
Article 7 ter (nouveau)
Soumission des contrats de
complémentaire santé à destination des agriculteurs
retraités à un taux réduit de taxe de solidarité
additionnelle
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de soumettre les contrats de complémentaire santé souscrits par les agriculteurs en retraite à un taux réduit de taxe de solidarité additionnelle.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Des taux réduits de taxe de solidarité additionnelle s'appliquent aux contrats agricoles solidaires et responsables
La taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire (TSA), définie à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, constitue le pilier de la fiscalité applicable aux contrats d'assurance maladie et d'indemnités journalières (IJ) complémentaires : elle représente 95 % des recettes fiscales perçues au titre de ces contrats.
La TSA a produit un rendement de 6,2 milliards d'euros en 2024, affecté par priorité à la couverture des dépenses des fonds de financement de la complémentaire santé solidaire174(*) et de l'allocation supplémentaire d'invalidité175(*) et, pour son solde représentant approximativement la moitié de son produit, à la branche maladie du régime général.
Cette taxe est assise sur le montant total des cotisations perçues par chaque organisme d'assurance maladie complémentaire - mutuelle, entreprise d'assurance ou institution de prévoyance - au titre de ses activités en santé et en complément d'indemnités journalières, sur chacune des huit sous-assiettes prévues par le législateur176(*).
Les sous-assiettes, qui recoupent des catégories de contrats de complémentaire santé et de prévoyance IJ, sont associées à des taux différenciés en fonction des caractéristiques de chaque type de contrat, avec une dose de fiscalité incitative.
Sont ainsi distingués cinq grands types de contrats de complémentaire santé ou IJ, pour certains déclinés en sous-catégories.
• Les contrats de complémentaire santé classiques, qui s'adressent au grand public, sont très majoritaires sur le marché : ils représentent 96,6 % des cotisations perçues. Ils sont conclus par les étudiants, les salariés, les fonctionnaires, les indépendants, les inactifs et les retraités, soit dans le cadre d'un contrat individuel, soit dans le cadre d'un contrat collectif le plus souvent souscrit par l'employeur au bénéfice de ses employés.
Au sein des contrats classiques, il convient de différencier les contrats solidaires et responsables de ceux qui ne le sont pas. Pour revêtir une telle qualité, un contrat doit :
- être responsable177(*), c'est-à-dire encourager au respect du parcours de soins coordonnés et respecter un cahier des charges normatif encadrant les prestations. Pour être responsable, un contrat doit notamment prévoir la prise en charge de l'intégralité du ticket modérateur178(*) sur un vaste panier de soins179(*), une solvabilisation limitée des dépassements d'honoraires et la non-couverture des participations visant à responsabiliser le patient, notamment participations forfaitaires180(*), franchises181(*) et majoration de ticket modérateur pour non-respect du parcours de soins coordonnés182(*) ;
- être solidaire183(*), c'est-à-dire exclure le recueil d'informations médicales sur les souscripteurs et appliquer des cotisations qui, bien qu'elles puissent dépendre de l'âge, sont indépendantes de l'état de santé individuel de chaque assuré.
Les contrats classiques responsables et solidaires bénéficient d'un régime fiscal plus avantageux que ceux qui ne répondent pas à ces conditions : le taux de TSA qui leur est applicable est de 13,27 %, contre 20,27 % pour les contrats classiques non solidaires ou responsables. Cet avantage fiscal leur assure une forte pénétration sur le marché : les contrats classiques responsables et solidaires représentent 93,6 % des cotisations perçues au titre de la complémentaire santé en 2023.
• Les contrats agricoles, qui s'adressent aux « personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une [...] [profession agricole ou connexe] à l'agriculture ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu'elles vivent avec elle »184(*). Ces contrats, concernant donc les non-salariés et salariés agricoles actifs, composent 3 % du marché de la complémentaire santé. Dans leur vaste majorité, ces contrats sont solidaires et responsables et se voient appliquer un taux réduit de 6,27 % de TSA. Les contrats agricoles non solidaires et responsables, qui pèsent pour moins de 0,1 % du marché, sont frappés par la TSA au même taux que les contrats classiques non solidaires et responsables, soit 20,27 %.
• Les contrats au premier euro sont destinés aux personnes qui ne bénéficient pas d'une affiliation à l'assurance maladie obligatoire, notamment aux travailleurs frontaliers. L'assurance n'est alors, à proprement parler, pas une « complémentaire » santé mais une assurance santé primaire. De tels contrats représentent 0,2 % des cotisations de complémentaire santé versées en 2023 et sont frappés d'un taux de 14 % de TSA.
• Les contrats dont les garanties assurent le versement d'indemnités journalières ne sont, à proprement parler, des contrats de complémentaire santé mais de prévoyance dont l'objet est de garantir un maintien de salaire partiel ou total aux assurés en arrêt de travail, en sus de l'indemnisation fournie par la sécurité sociale. Lorsqu'ils sont solidaires, il leur est appliqué un taux de 7 % de TSA tandis que le taux atteint 14 % pour les contrats IJ non solidaires.
• Enfin, les contrats relevant du 1° de l'article 998 du code général des impôts sont des contrats d'entreprise dont plus de 80 % des cotisations sont affectées à la prévoyance plutôt qu'à la couverture des frais de santé. Rares, puisque seules 0,2 % des cotisations de complémentaire santé sont collectées à ce titre, ces contrats disposent d'un régime fiscal avantageux et le taux de TSA en vigueur est fixé à 6,27 %.
Taux de TSA applicable par type de contrat
|
Type de contrats |
Classique |
Agricole |
IJ |
Au premier euro |
1° de l'article 998 du CGI |
|
Solidaire et responsable |
13,27 % |
6,27 % |
7 %185(*) |
14 % |
6,27 % |
|
Non solidaire ou non responsable |
20,27 % |
20,27 % |
14 % |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après Légifrance
Le commentaire de l'article 7 fournit des éléments plus détaillés sur la TSA, ses caractéristiques, son historique et ses modalités de recouvrement.
B. Le dispositif proposé : l'inclusion des retraités des régimes agricoles dans le champ des contrats agricoles, bénéficiant d'un régime de TSA plus favorables que les contrats classiques
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 7 ter, introduit par deux amendements identiques, l'un de Justine Gruet et Éric Liégeon (Droite Républicaine) et l'autre de Hubert Ott et plusieurs de ses collègues des groupes Les Démocrates et Ensemble pour la République, vise à alléger la fiscalité des contrats de complémentaire santé souscrits par des assurés retraités du régime agricole. Ces amendements avaient reçu un avis de sagesse du rapporteur général, et un avis défavorable du Gouvernement.
En son I, l'article 7 ter prévoit de faire désormais relever les salariés et non-salariés agricoles retraités du régime des contrats de complémentaire santé agricoles. L'article 7 ter modifie en ce sens l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la TSA.
Les contrats responsables et solidaires des retraités agricoles sortiraient alors du champ des contrats classiques, soumis à un taux de 13,27 % de TSA. À la place, les assurés concernés seraient susceptibles de bénéficier du taux de TSA réduit pour les contrats responsables et solidaires agricoles à 6,27 %.
Cette modification serait toutefois sans effet sur la fiscalité pour les souscripteurs de contrats non solidaires et responsables, les taux de TSA étant alors identiques et fixés à 20,27 %, que le contrat soit classique ou agricole.
Le II de cet article consiste en un gage pour les organismes de sécurité sociale.
II - La position de la commission
La commission souscrit bien sûr à l'intention de cet article.
• Celle-ci a eu l'occasion, a plusieurs reprises, de s'émouvoir du faible niveau des pensions auxquels sont éligibles les agriculteurs. En 2021, la pension mensuelle moyenne de droit direct des retraités affiliés à titre principal au régime des non-salariés agricoles s'élevait à 840 euros, contre 1 530 euros pour l'ensemble des retraités.
En mars 2024, la commission avait soutenu une proposition de loi de son président, adoptée par le Sénat, visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non-salariés des professions agricoles. Par le passé, elle s'était également prononcée favorablement sur les différentes lois dites Chassaigne et Dive, qui ont permis de revaloriser les pensions de non-salariés agricoles, en particulier les plus modestes.
• En outre, un rapport sénatorial de Marie-Claire Carrère-Gée et Xavier Iacovelli186(*) a démontré l'existence d'un « triple effet ciseaux » pour les assurés au moment de leur départ en retraite provoquant « une hausse soudaine du taux d'effort au titre de la complémentaire santé, qui ne trouve aujourd'hui pas véritablement de réponse » dans les mécanismes existants. Celui-ci découle :
« - d'une part, une perte de revenus qui augmente mécaniquement le taux d'effort, même à cotisations constantes ;
- d'autre part, la perte des avantages fiscaux ou des aides de l'employeur - [pour ce qui concerne les salariés agricoles]. La fin de cette prise en charge peut représenter, pour les assurés partant à la retraite, un doublement, voire un triplement du poids des cotisations [...] ;
- en outre, le passage à la retraite est corrélé à des augmentations tarifaires sur les contrats de complémentaires santé liées à l'âge, qui peuvent de surcroît être renforcées en cas de basculement d'un contrat collectif vers un contrat individuel ».
Il est donc indubitable qu'il existe, pour les retraités des professions agricoles ne bénéficiant pas de la complémentaire santé solidaire, un enjeu spécifique d'accès financier à la complémentaire santé, qui appelle le législateur à agir.
La commission relève que le levier du taux de TSA n'apparaît toutefois pas, pour ce faire, le plus efficace. En effet, une baisse du taux de TSA transitera par les organismes complémentaires d'assurance maladie, qui seront libres de répercuter ou non cet allégement de la fiscalité sur les cotisations à verser. Le rapport sénatorial précité a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d'allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ».
Le Gouvernement doute lui aussi que « moduler le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) soit la bonne réponse, eu égard au coût d'une telle mesure mais aussi à la difficulté de s'assurer qu'elle bénéficiera bien, in fine, aux retraités agricoles ».
Par ailleurs, la rédaction retenue manque de précision : l'inclusion des pensionnés de droit dérivé n'est, à cet égard, pas certaine.
D'après ses chiffrages, la rapporteure générale estime, en ne retenant que les assurés titulaires d'au moins une pension de droit direct et en estimant le coût moyen des contrats de complémentaire santé à 120 euros par mois187(*), TSA incluse188(*), que cette mesure réduirait de plus de 220 millions d'euros le rendement de la taxe de solidarité additionnelle.
Compte tenu à la fois du coût que représenterait la mesure et du caractère incertain de ses répercussions effectives sur les primes de complémentaire santé des retraités des régimes agricoles, la rapporteure générale a déposé un amendement n° 599 tendant à supprimer l'article 7 ter.
La commission propose de supprimer cet article.
Article
8
Réduire les niches sociales applicables aux compléments
salariaux
Cet article propose d'assujettir au forfait social au taux de 8 % les aides directes versées aux salariés (titres restaurant, chèques-vacances, avantages financés par les conseils sociaux et économiques, Cesu préfinancé) et d'augmenter de 10 points la contribution patronale s'appliquant aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite (remplacement de la contribution spécifique de 30 % par un forfait social au taux de 40 %). Selon l'évaluation préalable du présent article, le rendement de ces deux mesures serait de respectivement 950 millions d'euros et 260 millions d'euros.
Cet article réécrit en outre les autres dispositions relatives à l'assiette du forfait social et précise les dispositions relatives à l'assiette des cotisations sociales.
L'Assemblée nationale n'a conservé de cet article que le passage de 30 % au taux de 40 % du taux d'imposition des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Des exemptions d'assiette particulièrement dynamiques
1. Un doublement des exemptions d'assiette depuis 2019
Les exemptions relatives aux compléments de salaire sont particulièrement dynamiques.
Ainsi, le coût net189(*) des exemptions d'assiette passerait de 7,8 milliards d'euros en 2019 à 16,7 milliards d'euros en 2026 (avant mesures du présent PLFSS).
Le graphique et le tableau ci-après indiquent le coût net des différentes exemptions d'assiette. Les lignes surlignées correspondent à celles concernées par le présent article.
Coût net* des exemptions d'assiette
(en milliards d'euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026** |
|
|
Participation financière et actionnariat salarié (partage de la valeur) |
1,1 |
1,7 |
1,7 |
3,4 |
3,1 |
3,3 |
3,4 |
3,7 |
|
Participation aux résultats de l'entreprise |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,3 |
|
Intéressement |
0,4 |
0,9 |
0,8 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
|
Plan d'épargne en entreprises (PEE) |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
|
Stock options et attributions gratuites d'actions |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,7 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Protection sociale complémentaire en entreprise |
3,6 |
2,8 |
3,0 |
4,9 |
5,3 |
5,5 |
5,7 |
6,1 |
|
Santé et Prévoyance complémentaire |
3,4 |
2,6 |
2,8 |
4,6 |
4,9 |
5,1 |
5,2 |
5,6 |
|
Retraite supplémentaire (y compris retraites chapeaux) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Plan d'épargne retraite collective (Perco) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
Aides directes consenties aux salariés |
2,5 |
2,5 |
2,7 |
3,7 |
4,8 |
5,1 |
5,3 |
5,7 |
|
Titres restaurant |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,7 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
|
Chèques-vacances |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Avantages accordés par les comités sociaux et économiques (CSE) |
0,9 |
0,8 |
0,9 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
|
Cesu préfinancé |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Sous-total |
2,5 |
2,5 |
2,7 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,4 |
4,5 |
|
Participation aux frais de transport |
ND |
ND |
ND |
ND |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
|
Indemnités de rupture |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
|
Indemnités de licenciement |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
|
Indemnités de mise à la retraite |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Indemnités de rupture conventionnelle |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
Total |
7,8 |
7,6 |
8,1 |
13,3 |
14,3 |
14,9 |
15,5 |
16,7 |
Les lignes surlignées correspondent aux exemptions concernées par le présent article.
Remarques :
• La série n'est homogène que sur 2023-2026 (période couverte par l'annexe 4 au présent PLFSS).
• Les niches sociales sur les compléments de salaire comprennent essentiellement, outre les exemptions d'assiette, la part salariale de l'exonération des heures supplémentaires (2,3 milliards d'euros en 2024) et l'exonération de la prime de partage de la valeur (1,1 milliard d'euros en 2023 selon la Cour des comptes, le Gouvernement considérant quant à lui, de manière manifestement injustifiée, que la prime ne se substituerait à aucun élément de salaire, et n'aurait donc pas de coût pour la sécurité sociale).
* C'est-à-dire après prise en compte des taxes compensatoires éventuelles (comme le forfait social).
** Les chiffres 2026 ne prennent pas en compte les mesures du PLFSS 2026.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après les PLFSS et Placss
2. Un fort dynamisme souligné par la Cour des comptes
Le fort dynamisme des exemptions d'assiette, et plus généralement des niches sociales sur les compléments de salaire, a été souligné par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application de loi de financement de la sécurité sociale (Ralfss)190(*) de mai 2024.
Le fort dynamisme des exemptions d'assiette et
autres niches
sur les compléments de salaire, selon la Cour des
comptes191(*)
Dans son rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024192(*), la Cour des comptes souligne le fort dynamisme des exemptions d'assiette.
Le graphique ci-après indique les pertes brutes liées aux exemptions d'assiette, c'est-à-dire les pertes avant prise en compte des taxes compensatoires. La part des pertes brutes compensée par les taxes compensatoires est de plus en plus faible.
Évolution du rendement des taxes
compensatoires assises
sur les compléments de salaire
exemptés
(en milliards d'euros)
Lecture : en 2022, les pertes brutes de recettes pour la sécurité sociale liées aux exemptions de cotisations sociales sont estimées à 24,8 milliards d'euros. Elles sont atténuées par des taxes compensatoires à hauteur de 8,9 milliards d'euros. Les pertes de recettes liées aux exemptions sont ainsi compensées à proportion de 36,1 %.
D'après le PLFSS 2024 (annexe 4) et le « jaune » budgétaire du PLF 2024.
Source : Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
Le graphique ci-après prend en compte le montant (net) des exemptions d'assiette, majoré des exonérations des heures supplémentaires (part salariale) et de deux niches ne figurant pas dans l'annexe (prime de partage de la valeur et remboursements des frais de transport domicile-travail)193(*). Il souligne qu'entre 2018 et 2022, l'augmentation de cet agrégat a été proche de celle du déficit de la sécurité sociale (hors dépenses covid).
Évolutions comparées de la perte de
recettes liée aux compléments
de salaire et du déficit
de la sécurité sociale hors covid
(en milliards d'euros)
D'après le PLFSS 2024 et l'extraction de la déclaration sociale nominative par l'Acoss pour la Cour des comptes.
Source : Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
3. Le cas des aides directes et des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite
Le présent article propose de réduire les exemptions nettes dont bénéficient les aides directes et les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
À périmètre constant194(*), le coût net des aides directes (titres restaurant, chèques-vacances, avantages accordés par les comités d'entreprises, Cesu195(*) préfinancé) passerait de 2,5 milliards d'euros en 2019 à 4,5 milliards d'euros en 2026 (également avant mesures du présent PLFSS).
Comme le souligne la Cour des comptes, les aides directes bénéficient du « régime dérogatoire le plus favorable », dans la mesure où, contrairement aux autres assiettes, elles sont exemptées non seulement de cotisations sociales, mais aussi de « toute taxe compensatoire ». Deux exemptions correspondent à la quasi-totalité du coût : celles sur les titres restaurant et sur les avantages accordés par les comités sociaux et économiques (CSE).
Le coût net des indemnités de rupture conventionnelle est d'une centaine de millions d'euros, et celui des indemnités de mise à la retraite est peu significatif.
B. Les mesures proposées par le présent article
Le présent article :
- assujettit les aides directes versées aux salariés au forfait social au taux de 8 % ;
- pour les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, remplace la contribution spécifique de 30 % par un forfait social au taux de 40 % ;
- réécrit les autres dispositions relatives à l'assiette du forfait social ;
- précise l'assiette des cotisations sociales.
1. L'assujettissement des aides directes versées aux salariés au forfait social au taux de 8 %
a) L'assiette et les taux actuels du forfait social
La règle générale, définie par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, est que sont soumis au forfait social les revenus d'activité assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations.
Cette règle admet des exceptions, dans un sens ou dans l'autre (cf. tableau).
En particulier, deux types de revenus visés par le présent article (en gras) sont explicitement exclus de l'assiette du forfait social :
- les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle (soumises à une contribution spécifique de 30 %) ;
- les chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire.
Assiette du forfait social
|
Droit actuel |
|
|
Règle générale d'assujettissement |
Revenus d'activité assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations |
|
Revenus d'activité inclus spécifiquement dans l'assiette du forfait social |
Intéressement |
|
Rémunération des administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) |
|
|
Prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire versées pendant les six premiers mois d'un congé pour événement familial (congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale) |
|
|
Revenus d'activité exclus spécifiquement de l'assiette du forfait social en raison de leur nature |
Attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et attributions d'actions gratuites (existence d'une contribution patronale spécifique) |
|
Indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi |
|
|
Indemnités de rupture ; mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés |
|
|
Indemnités de licenciement Indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle (soumises à une contribution spécifique) |
|
|
Chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire |
|
|
Revenus d'activité exclus spécifiquement de l'assiette du forfait social en raison des effectifs de l'entreprise |
Primes de participation et abondements de l'employeur à un plan d'épargne salariale pour les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un accord de participation (entreprise de moins de 50 salariés ou unité économique et sociale - UES - de moins de 50 salariés) |
|
Primes d'intéressement, pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés |
|
|
Contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance, pour les entreprises qui emploient moins de 11 salariés |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après le code de la sécurité sociale
Le taux du forfait social est fixé par l'article L. 137-16 du même code.
Le tableau ci-après synthétise les différents taux applicables, compris entre 8 % et 20 %.
Taux du forfait social
|
Droit actuel |
|
|
Taux de droit commun |
20 % |
|
Contribution des employeurs privés et publics au financement de la prévoyance complémentaire mise en place au profit de ses salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit |
8 % |
|
Sommes affectées à la réserve spéciale de participation dans les sociétés coopératives de production (Scop) tenues de mettre en place un accord de participation (art. L. 3323-3 du code du travail) |
8 % |
|
Abondement d'un plan d'épargne servant à acquérir des titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée (art. L. 3332-11 du code du travail) |
10 % |
|
Plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco), sous réserve que le pourcentage de titres PEA - PME soit au moins égal à 10 % (art. L. 224-2 du code monétaire et financier) |
16 % |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale
Comme le souligne l'évaluation préalable de cet article, « le versement d'un complément de salaire assujetti à forfait social au taux de 20 %, soit le taux maximal, reste plus avantageux que le versement d'un salaire de base, soumis à cotisations sociales ainsi qu'aux cotisations patronales, dont le taux effectif, après prise en compte des allègements généraux, peut rapidement dépasser 20 % dès que les rémunérations s'éloignent du Smic ».
b) Le non-assujettissement actuel au forfait social des aides directes versées aux salariés
Le non-assujettissement actuel au forfait social des aides directes versées aux salariés (titres restaurant, chèques-vacances, avantages financés par les CSE, Cesu préfinancé) provient de diverses dispositions.
• La participation de l'employeur aux titres restaurant
Les titres restaurant peuvent être attribués par l'employeur, qui en paie alors de 50 % à 60 % du montant, le solde étant à la charge du salarié.
La participation de l'employeur aux titres-restaurant n'est pas assujettie à la CSG (dans la limite de 7,26 euros par titre émis en 2025), en application du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 137-15 du même code fixant la règle que, sauf disposition contraire, seuls sont soumis au forfait social les revenus d'activité assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations sociales, cette participation (par ailleurs exonérée de cotisations sociales196(*)) n'est en conséquence pas non plus assujettie au forfait social.
Le régime fiscal des titres restaurant pour le salarié
Pour le salarié, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7,26 euros par titre émis en 2025197(*).
Dans les mêmes conditions, cette contribution de l'employeur est exclue de l'assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS198(*).
• Les chèques-vacances
Les chèques-vacances sont des titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), acquis par les salariés avec la contribution de leur employeur et leur permettant d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances.
Comme indiqué ci-avant, le code de la sécurité sociale prévoit explicitement que ne sont pas assujettis au forfait social les chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire. En effet, le 4° de l'article L. 137-15 précité exclut de l'assiette du forfait social « l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme », c'est-à-dire les chèques-vacances. Les chèques-vacances étant exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la CSG199(*), une dérogation explicite est en effet nécessaire pour qu'ils ne soient pas automatiquement assujettis au forfait social, en application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale200(*).
Dans le cas des autres entreprises, il n'existe pas de disposition législative spécifique. Toutefois, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985201(*) indique que les chèques-vacances acquis par le comité d'entreprise202(*) s'intègrent dans ses activités sociales et ne constituent pas une rémunération, et sont donc totalement exonérées de cotisations et contributions sociales. En revanche, les chèques-vacances acquis par l'employeur constituent un complément de rémunération, assujetti aux cotisations et contributions sociales.
• Avantages accordés par les comités sociaux et économiques (CSE)
L'article L. 2312-81 du code du travail prévoit que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique (CSE) est fixée par accord d'entreprise.
L'article L. 2312-78 du même code dispose que le CSE « assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles » (ASC)203(*).
En application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 précitée, les avantages accordés par les comités sociaux et économiques (CSE) sont exonérés de cotisations et contributions sociales.
• Le Cesu préfinancé
L'article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière du CSE ou de l'entreprise est exclue de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG quand elle a pour objet de financer le dispositif de chèque emploi service unique (Cesu) dit « préfinancé », permettant au salarié de rémunérer un emploi à domicile204(*).
L'article L. 137-15 du même code fixant la règle que, sauf disposition contraire, seuls sont soumis au forfait social les revenus d'activité assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations, le Cesu préfinancé n'est en conséquence pas non plus assujetti au forfait social.
c) L'assujettissement des aides directes au forfait social au taux de 8 % proposée par le présent article
Le présent article propose d'assujettir les aides directes au forfait social au taux de 8 %.
Le tableau ci-après synthétise le dispositif proposé.
Assujettissement des aides directes versées
aux salariés
au forfait social au taux de 8 %
|
Disposition du présent article |
Article modifié |
Nature de la modification |
|
I. 2° |
L. 137-15 CSS |
Suppression de la disposition excluant les chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés Inclusion : - des « sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant » ; - de « l'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail » (Cesu) - des « avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés » - des « contributions des employeurs pour le financement d'activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l'article L. 2312-81 du code du travail » (contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique). |
|
I. 3° b) |
L. 137-16 CSS |
Fixation du taux de 8 % pour les titres restaurants, les prestations sportives, le Cesu et les chèques-vacances |
|
I. 3° c) |
L. 137-16 |
Rédactionnel |
|
I. 3° d) |
L. 137-16 |
Coordination dans le cas des plans d'épargne retraite collectifs (Pereco) |
|
III. |
L. 411-9 CT |
Coordination pour les chèques-vacances (assujettissement au forfait social dans les entreprises de moins de cinquante salariés) |
CSS : code de la sécurité sociale. CT : code du tourisme.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après le présent article et les dispositions concernées
2. Dans le cas des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, remplacement de la contribution spécifique de 30 c% par un forfait social au taux de 40 %
Actuellement, l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) une contribution de 30 % (pour la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale) assise sur :
- les indemnités versées à l'occasion de la mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur ;
- la rupture conventionnelle.
Le présent article propose de remplacer cette contribution de 30 % par un assujettissement au forfait social, à un nouveau taux de 40 %.
Le tableau ci-après synthétise le dispositif proposé.
Remplacement de la contribution spécifique
de 30 % applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de
mise à la retraite
par un forfait social au taux de
40 %
|
Disposition du présent article |
Article modifié |
Nature de la modification |
|
I. 1° |
L. 137-12 CSS |
Suppression de l'art. L. 137-12 CSS, relatif à la contribution de 30 % |
|
I. 3° e) |
L. 137-16 CSS |
Instauration d'un taux de forfait social de 40 % pour les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite |
|
II. 1° |
L. 241-3 CSS |
Coordination avec le le 1° du I (ajustement de la liste des ressources de l'assurance vieillesse) |
CSS : code de la sécurité sociale.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après le présent article
3. Une re-rédaction des dispositions relatives à l'assiette du forfait social
Le 2° du I de cet article, qui assujettit les aides directes versées aux salariés au forfait social au taux de 8 %, re-rédige en grande partie l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, afin de clarifier l'assiette du forfait social, en particulier en ce qui concerne les seuils applicables.
Le b) du 3° réalise en outre des coordinations à l'article L. 137-16 (relatif au taux du forfait social).
4. Des précisions relatives à l'assiette des cotisations sociales
Le 2° du II du présent article205(*) précise des références dans l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette des cotisations sociales, dans le cas des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
5. Une entrée en vigueur au 1er janvier 2026
Le IV du présent article prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
C. Selon l'évaluation préalable, des recettes supplémentaires de 1,21 milliard d'euros pour la branche vieillesse
Selon l'évaluation préalable, des recettes supplémentaires seraient en 2026 de 1,21 milliard d'euros pour la branche vieillesse.
Elles se répartiraient entre 0,95 milliard d'euros pour l'assujettissement des aides directes au forfait social au taux de 8 % et 0,26 milliard d'euros pour le passage de l'imposition des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite du taux de 30 % au taux de 40 %.
Ces montants sont cohérents avec les assiettes prévues par l'annexe 4 au présent PLFSS (cf. tableau ci-après).
Chiffrage des mesures proposées par le présent article
|
Assiette prévue pour 2026 par l'annexe 4 au PLFSS* |
Augmentation de taux proposée par le présent article |
Chiffrage par la commission |
Chiffrage par l'évaluation préalable de cet article |
|
|
A |
B |
C=A×B |
D |
|
|
En milliards d'euros |
En % |
En millions d'euros |
||
|
Aides directes consenties aux salariés |
11,9 |
952 |
950 |
|
|
Titres restaurant |
5,7 |
8 |
456 |
|
|
Chèques vacances |
1,1 |
8 |
88 |
|
|
Avantages accordés par les comités d'entreprises |
4,9 |
8 |
392 |
|
|
CESU préfinancé |
0,2 |
8 |
16 |
|
|
Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite |
2,3 |
230 |
260 |
|
|
Indemnités de mise à la retraite |
0,1 |
10 |
10 |
|
|
Indemnités de rupture conventionnelle |
2,2 |
10 |
220 |
|
|
Total |
14,2 |
1 182 |
1 210 |
|
* Avant mesures du PLFSS.
Source : Commission des affaires sociales, d'après les sources indiquées
II. Le dispositif transmis au Sénat
A l'initiative de Jérôme Guedj, l'Assemblée nationale a adopté un amendement ne conservant de cet article que le passage de 30 % au taux de 40 % du taux d'imposition des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
Par ailleurs, cette augmentation prendrait la forme d'une augmentation du taux de l'actuelle contribution définie par l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale, et non de la création d'un taux supplémentaire du forfait social.
Sur la base des chiffrages figurant dans l'évaluation préalable, le rendement de cet article, de 1 210 millions d'euros dans le texte initial, serait donc ramené à 260 millions d'euros.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
A. Des propositions pertinentes sur un plan purement technique
Les propositions du présent article, dans sa rédaction initiale, peuvent sembler pertinentes sur un plan purement technique.
1. Comme les autres compléments de salaire, les aides directes se substituent à d'autres éléments de salaire
Tout d'abord, bien que la loi dispose que les compléments de salaires ne peuvent se substituer ni à des augmentations de rémunération ni à des primes déjà prévues, sur le long terme ils déforment mécaniquement la rémunération des salariés en faveur des assiettes exemptées.
Autrement dit, ils se substituent à d'autres éléments de rémunération.
Cet effet a été souligné, notamment, par la Cour des comptes.
La substitution des compléments de salaire aux autres éléments de rémunération, selon la Cour des comptes
« De 2014 à 2017, les compléments de salaire, hors heures supplémentaires, et les salaires de base du secteur privé ont évolué au même rythme, sans effet visible de substitution. En revanche, de 2018 à 2023, la progression des versements de compléments de salaire exemptés est devenue plus rapide (7,8 % par an) que celle des salaires de base (4,1 % par an).
Les progressions les plus dynamiques ont porté, d'une part, sur les attributions gratuites d'actions et sur les stock-options, dont la taxe compensatoire a été diminuée (+ 36,1 % par an), d'autre part sur le chèque emploi-service universel (+ 10,2 % par an), qui bénéficie du régime social le plus dérogatoire. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de la prime de partage de la valeur sont les plus volatils (1,9 Md€ en 2021, 5,3 Md€ en 2022 et en 2023).
L'Insee estime entre 15 et 40 % la part de rémunération versée sous forme de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou de prime de partage de la valeur qui s'est substituée à une augmentation de salaire 179. Le Conseil d'analyse économique souligne aussi les effets de substitution aux salaires des dispositifs de partage volontaires de la valeur. Ils sont un moyen pour les entreprises d'arbitrer, pour la part de la valeur ajoutée qu'elles entendent réserver à leurs salariés, entre des augmentations de salaire pérennes et des distributions ponctuelles et réversibles selon l'évolution de la conjoncture.
L'augmentation des compléments de salaire au détriment des salaires de base contribue donc à l'érosion de la base contributive des cotisations sociales. »
Source : Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
Dans le cas des aides directes, comme le souligne l'évaluation préalable du présent article, « les effets de substitution sont bien documentés, et se manifestent par exemple par la mention fréquente de ces avantages dans les offres d'emploi, par la mention fréquente des titres-restaurant comme d'un élément de rémunération important par les salariés ou par l'évolution des usages (partage du titre-restaurant avec les proches, diversification des achats), alors que le dispositif avait initialement pour but d'offrir une alternative à l'obligation de mise en place d'un local de restauration dans les petites entreprises ».
2. Les aides directes sont les seules assiettes exemptées ne faisant l'objet d'aucune taxe compensatoire
Ensuite, comme le souligne la Cour des comptes, parmi les niches sur les compléments de salaire, les aides directes bénéficient du « régime dérogatoire le plus favorable », dans la mesure où, contrairement aux autres assiettes, elles sont exemptées non seulement de cotisations sociales, mais aussi de « toute taxe compensatoire ».
Il ne semblerait donc pas illégitime a priori de les assujettir au taux le plus faible du forfait social, de 8 %.
3. L'effet probable de cet article sur le montant des aides directes : une brève stabilisation, suivie de la reprise d'une hausse plus rapide que celle des éléments de rémunération non exemptés
Par ailleurs, les conséquences concrètes d'une imposition des aides directes au forfait social au taux de 8 % ne doivent pas être surestimées.
En effet, il s'agit fondamentalement d'augmenter le coût du travail d'environ 1 milliard d'euros, soit moins de 0,1 %. L'effet sur l'emploi et sur la rémunération des salariés serait donc négligeable.
Quant à l'effet sur le montant des aides directes, il s'agirait vraisemblablement, après la forte hausse constatée depuis 2019 :
- d'une légère baisse, voire d'une simple stabilisation pendant quelques années. En effet, en faisant l'hypothèse conventionnelle d'une élasticité unitaire des aides directes à leur coût pour l'entreprise, l'augmentation de celui-ci de 8 % ne les ferait baisser que de 8 %, ce qui correspondrait à un montant en 2026 de 13,6 milliards d'euros en 2026, soit un montant analogue à celui de 2024206(*). Il est toutefois possible que certaines entreprises stabilisent temporairement ces aides plutôt que de les réduire, en particulier dans le cas des titres restaurant207(*) ;
- puis de la reprise d'une augmentation plus rapide que celle des éléments de rémunération non exemptés. En effet, une taxation moyenne d'environ 25 % de l'assiette208(*) dans le cas de la protection sociale complémentaire en entreprise n'a pas empêché les exemptions concernées de voir leur coût net passer de 3,6 milliards d'euros en 2019 à 5,7 milliards d'euros en 2025, ce qui est une évolution comparable à celle constatée pour les aides directes (passage de 2,5 milliards d'euros à 5,3 milliards d'euros).
Le présent article, dans sa rédaction initiale, n'enrayerait donc probablement pas l'augmentation de la part des aides directes dans la rémunération totale.
Par ailleurs, il n'est pas évident que la diminution (ou la moindre croissance) des compléments de salaire au profit d'autres éléments de rémunération, dont le salarié pourrait par nature disposer librement, soit toujours mal perçue par les salariés.
B. De fortes oppositions
1. De fortes oppositions dans le cas de l'assujettissement des aides directes au forfait social
Le présent article suscite toutefois de fortes oppositions dans le cas de l'assujettissement des aides directes au forfait social, en particulier dans le cas des titres restaurant, qui représentent environ la moitié du rendement attendu de la mesure (environ 0,5 milliard d'euros sur 1 milliard d'euros).
a) Une mesure souvent présentée comme « antisociale »
Tout d'abord, certaines entreprises n'ayant pas inscrit dans leurs contrats de travail le montant de la contribution de l'employeur aux titres restaurant vont nécessairement réduire le montant de celle-ci. Une entreprise pourrait par exemple, pour des titres restaurant de 10 euros, faire passer la part de l'employeur de 6 euros209(*) à 5,5 euros pour neutraliser l'effet pour l'employeur de l'assujettissement au forfait social. Cela réduirait le revenu des salariés concernés d'une centaine d'euros par an.
Ensuite, l'imposition des titres restaurant est bien sûr défavorable aux émetteurs de titres restaurants, dont les principaux sont Sodexo, Edenred, UpDéjeuner et Swile. Ainsi, selon l'évaluation préalable du présent article, dans le cas des titres restaurant, les « commissions étaient estimées à 4 % en 2023 (dont 99 % concentrés sur quatre opérateurs) selon un avis du 12 octobre 2023 de l'Autorité de la concurrence ».
Par ailleurs, les aides directes concernent potentiellement tous les salariés, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des stock options et des attributions gratuites d'actions, ou des retraites chapeau.
b) La principale piste pour réduire le coût des titres restaurant : ne pas prolonger l'extension de l'utilisation aux aliments non directement consommables au-delà du 31 décembre 2026 ?
Les pistes d'évolution envisagées publiquement avant le dépôt du présent PLFSS pour réduire le coût de l'exemption relative aux titres restaurant semblaient plutôt porter sur un recentrage de ceux-ci sur leur vocation première ou sur certains publics.
Ainsi, selon le récent rapport210(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « il pourrait être proposé de ne pas prolonger l'extension de l'utilisation aux aliments non directement consommables et de limiter le plafond journalier et de revenir à la logique initiale des titres restaurants, en limitant l'exemption aux situations où le travailleur n'est pas à son domicile. Au vu des progressions constatées sur les pertes de cotisations, la mesure représenterait un surcroît de recettes de l'ordre de 0,2 Md€ à 0,5 Md€ selon les modalités retenues. On pourrait également réinterroger l'objectif de l'exonération attachée aux titres restaurants (par exemple, doit-elle bénéficier pleinement à toutes les catégories de revenus, ou serait-il opportun de la flécher sur les revenus les plus faibles ?) ».
Le Sénat est à l'origine de l'extension de l'utilisation des titres restaurants aux denrées non directement consommables, alors destinée à lutter contre la crise inflationniste. Si la commission en a jusqu'à présent toujours soutenu la prolongation, bien que les conditions initiales ne soient plus remplies, elle ne considère pas que cette disposition doive devenir permanente (cf. encadré). Selon le droit actuel, elle doit s'éteindre au 31 décembre 2026.
L'instauration par le Sénat puis les
prolongations de la dérogation
d'utilisation des titres
restaurant
Lors de la discussion de la loi portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat du 16 août 2022211(*), pour lutter contre la crise inflationniste, la rapporteure Frédérique Puissat a proposé d'assouplir les règles qui encadrent l'utilisation du titre restaurant en l'étendant aux produits alimentaires non directement consommables.
Cette dérogation, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2023, a été prolongée par le législateur, à l'initiative de l'Assemblée nationale212(*), jusqu'au 31 décembre 2024213(*), puis, toujours à l'initiative de l'Assemblée nationale214(*), jusqu'au 31 décembre 2026215(*).
Lors de cette dernière prolongation, la commission, à l'initiative de sa rapporteure Marie-Do Aeschlimann, a adopté un amendement tendant à la limiter au 31 décembre 2025. Toutefois, la loi ne pouvant être promulguée avant le 1er janvier 2025 en raison de la censure du Gouvernement, la date du 31 décembre 2026 a été rétablie en séance publique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission a préféré maintenir le statu quo en s'en tenant à la rédaction de l'Assemblée nationale.
2. La réduction de l'exemption relative aux indemnités de rupture conventionnelle : une mesure plus consensuelle
La réduction de l'exemption relative aux indemnités de rupture conventionnelle est plus consensuelle. De fait, elle a été maintenue par l'Assemblée nationale.
Il s'agit d'ailleurs d'une proposition du rapport précité des trois Hauts Conseils au Premier ministre sur la manière de ramener la sécurité sociale à l'équilibre.
Ainsi, ce rapport s'interroge sur la pertinence de l'exemption relative aux indemnités de rupture conventionnelle (qui coûte environ 0,1 milliard d'euros par an). En particulier, il souligne que si l'indemnité de licenciement a pour objet de compenser un préjudice, tel n'est pas le cas de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Il considère en conséquence « qu'une évolution des règles d'assujettissement est envisageable ».
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 bis
(nouveau)
Expérimentation permettant aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient
calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels
de l'année en cours
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose, dans le cadre d'une expérimentation, de permettre aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré à l'initiative du rapporteur général de sa commission des affaires sociales216(*), avec un avis de sagesse du Gouvernement.
Actuellement, les agriculteurs ont le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l'assiette triennale de droit commun, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l'assiette optionnelle, qui permet de cotiser sur les revenus de l'année précédente.
Cet article propose d'instaurer, à titre expérimental, un troisième régime.
Son I prévoit qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2028, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole « peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours, sous réserve d'une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues par l'article L. 731-14 du même code ».
Selon son II, un décret définit les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation. Il détermine notamment « le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée audit alinéa préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation ».
Son III prévoit une entrée en vigueur le 1er octobre 2026.
II - La position de la commission
La commission est favorable au principe de cet amendement.
En séance publique la rapporteure générale s'y était déclarée favorable, et le président de la commission avait invité à adopter l'amendement, quitte à le retravailler dans le cadre de la navette. Aussi, malgré un avis défavorable du Gouvernement217(*), cet amendement avait été adopté.
L'amendement de Henri Cabanel est ainsi devenu l'article 21 de la LFSS pour 2025.
Le dispositif proposé par le présent article est très proche de celui de l'article 21 de la LFSS pour 2025, comme le montre le tableau ci-après.
Comparaison du présent article et de l'article 21 de la LFSS pour 2025
|
Article 21 de la LFSS pour 2025 |
Présent article |
|
I. - L'État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime. |
I. - À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours, sous réserve d'une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l'article L. 731-14 du même code. |
|
II. - Les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions. |
II. - Un décret définit les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée au même I avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. |
|
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation. |
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026. |
L'article 21 de la LFSS pour 2025, qui prévoyait que le Gouvernement avait juste la possibilité (mais pas l'obligation) de réaliser l'expérimentation, et que le décret correspondant devait être pris « au plus tard le 1er octobre 2025 », est désormais caduc.
Si le II du présent article est plus précis que celui de l'article 21 précité sur le contenu du décret pour ce qui concerne la nature de l'expérimentation, il ne précise pas le nombre de régions concernées.
Enfin, contrairement à l'article 21 précité, le présent article ne prévoit pas de rapport d'évaluation.
Lors de l'examen par l'Assemblée nationale de l'amendement insérant le présent article, la ministre a suggéré qu'il pourrait être retravaillé au Sénat218(*).
La commission a adopté un amendement de précision n° 600 de sa rapporteure générale.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 8 ter
(nouveau)
Ajustement et pérennisation du régime social des
outils de fidélisation des salariés par leur association au
capital
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose :
- d'ajuster le volet social de la niche fiscale et sociale instaurée par l'article 93 de la loi de finances pour 2025 pour la rémunération des dirigeants d'entreprises dans le cadre des dispositifs dits de fidélisation de « management package » ;
- de pérenniser dès à présent, soit au bout d'un an, cette niche sociale, qui conformément à l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale (inséré lors de la révision organique de 2022) n'avait pu être instaurée par la LFSS pour 2025 que pour trois ans (soit jusqu'au 31 décembre 2027).
La commission ne s'oppose pas aux ajustements proposés. En revanche, elle considère que la pérennisation de cette niche sociale au bout de seulement une année, et sans qu'aucun élément d'évaluation soit transmis au Parlement, est contraire à l'esprit de l'article L.O. 111-3-16 précité. La pérennisation éventuelle de cette niche sociale pourra, le cas échéant, être réalisée dans la cadre de la LFSS pour 2027, au vu des éléments d'évaluation qui devront alors avoir été transmis par le Gouvernement.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article résulte d'un amendement de Paul Midy219(*), adopté avec un avis favorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement.
A. Le droit existant : l'article 93 de la loi de finances pour 2025
L'article 93 de la loi de finances pour 2025, inséré par le Sénat à l'initiative de Vanina Paoli-Gagin220(*), avec un avis favorable du Gouvernement, a modifié le code général des impôts pour réduire les impôts et cotisations reposant sur les « management packages ».
1. Un allégement des prélèvements fiscaux et sociaux sur certains revenus des dirigeants
Les management packages sont des mécanismes sui generis consistant à rémunérer les dirigeants d'entreprise, par exemple au moyen d'actions de leur entreprises, afin d'aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs financiers.
Avant la promulgation de la loi de finances pour 2025, suivant trois arrêts du Conseil d'État du 13 juillet 2021, les gains issus des management packages subissaient les prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu) et sociaux (cotisations sociales) applicables aux revenus d'activité.
Depuis lors, deux régimes distincts cohabitent :
- le gain d'acquisition inférieur à trois fois la valeur réelle de l'entreprise est assujetti à la flat tax de 30 %221(*) et à des cotisations salariales de 10 % ;
- le gain d'acquisition supérieur à trois fois la valeur réelle demeure assujetti au régime fiscal et social issu de la jurisprudence de 2021 précité, soit celui, moins favorable à l'assujetti, applicable aux revenus d'activité.
2. Dans le cas des prélèvements sociaux, un dispositif en vigueur seulement jusqu'au 31 décembre 2027, du fait de l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale
Contrairement à ses autres dispositions, le III de l'article 93 précité, relatif au volet social de la réforme (CSG sur les revenus d'activité222(*), CSG sur les revenus du patrimoine223(*), cotisations sociales224(*), institution d'une contribution salariale libératoire de 10 % au profit de la Cnaf225(*)), ne s'appliquait qu'aux « dispositions, cessions, conversions ou mises en location » réalisées jusqu'au 31 décembre 2027.
En effet, l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale, créé par la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création ou la modification de niches sociales dont la durée serait de trois ans ou plus.
B. Les modifications proposées par cet article
1. Des ajustements du volet social de la réforme résultant de l'article 93 de la loi de finances pour 2025
Le I du présent article tend à réaliser divers ajustements au volet social de la réforme résultant de l'article 93 de la loi de finances pour 2025.
Pour (selon les termes de son exposé sommaire) « conforter l'identité de champ entre les régimes fiscal et social applicables aux gains issus de « management packages », il propose de modifier le code de la sécurité sociale conformément au tableau ci-après.
La modification du volet social de la
réforme résultant de l'article 93
de la loi de finances
pour 2025 proposée par le présent article
|
Article du code de la sécurité sociale |
Droit résultant de l'article 93 de la loi de finances pour 2025 |
Droit proposé par le présent article |
|
|
CSG sur les revenus d'activité |
a bis du 3° du III de l'article L.136-1-1 |
a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ; |
a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa |
|
Prélèvement de 10 % au profit de la Cnaf |
Premier alinéa de l'article L. 137-42 |
Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l'article L. 136-1-1 qui sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. |
Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l'article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa. |
Le III du présent article précise que ces modifications s'appliquent « aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025 ».
2. La pérennisation du volet social de la réforme de l'article 93 de la loi de finances pour 2025
Le II du présent article propose de pérenniser le volet social de la réforme de l'article 93 de la loi de finances pour 2025.
En effet, comme indiqué supra, l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création ou la modification de niches sociales dont la durée serait de trois ans ou plus.
II - La position de la commission
La commission des affaires sociales n'a pas d'objection aux ajustements proposés par le I de cet article.
Elle relève toutefois que si l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création ou la modification de niches sociales dont la durée serait de trois ans ou plus, c'était, dans l'esprit du législateur organique, afin de permettre au Parlement de se prononcer au terme de ces trois ans sur l'opportunité de prolonger ou de pérenniser la niche.
Or, dans le cas présent, le présent article propose de pérenniser au bout d'un an une niche sociale instaurée par la loi de finances pour 2025, sans que la commission des affaires sociales dispose du moindre élément d'évaluation, que ce soit sur l'efficacité de la niche ou sur son coût pour les finances sociales.
Les débats à l'Assemblée nationale, très succincts226(*), ne lui permettent pas d'éclairer son opinion.
La commission propose donc, par l'amendement n° 601 de la rapporteure générale, de supprimer le II du présent article, qui pérennise le volet social de la niche. La niche ne demeurerait ainsi valide, à ce stade, que pour les « dispositions, cessions, conversions ou mises en location » réalisées jusqu'au 31 décembre 2027. Le législateur pourrait, dans le cadre du PLFSS pour 2027, décider le cas échéant, au vu des éléments d'évaluation qui devront alors avoir été transmis par le Gouvernement, de prolonger ou de pérenniser cette niche sociale.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement n° 601 qu'elle a adopté, à l'initiative de sa rapporteure générale.
Article 8 quater
(nouveau)
Précision relative à la réforme de l'assiette
sociale des travailleurs indépendants par la LFSS 2024, dans le cas des
exploitants agricoles
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de préciser l'assiette sociale des exploitants agricoles issue de la réforme de la LFSS 2024.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré par trois amendements identiques227(*), sous-amendés228(*) par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, avec un avis favorable de son rapporteur général et du Gouvernement.
A. La réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants par la LFSS 2024, précisée par la LFSS 2025
L'assiette sociale des travailleurs indépendants a été réformée par l'article 18 de la LFSS 2024, inséré à l'Assemblée nationale par le Gouvernement.
Cette réforme a déjà été ajustée par l'article 13 de la LFSS 2025, inséré à l'Assemblée nationale par le Gouvernement, qui a modifié l'assiette des cotisations et contributions de différentes catégories de travailleurs indépendants.
En particulier, l'article 13 précité a modifié l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles, pour réintégrer dans l'assiette des contributions sociales les activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles.
B. La précision proposée par cet article
La rédaction actuelle de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale reste très large, en visant toutes activités BIC et BNC, quel que soit le régime social dont ces activités relèvent. Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole...) rentrent dans l'assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent article tend à préciser l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, afin de le limiter à ces seules activités relevant du régime social agricole.
II - La position de la commission
La commission est favorable à cet article, qui apporte une utile précision technique.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8
quinquies (nouveau)
Possibilité pour les travailleurs
indépendants agricoles d'exclure
les plus-values professionnelles
à court terme de leur assiette sociale
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de préciser l'assiette sociale des exploitants agricoles issue de la réforme de la LFSS 2024, en exonérant de la CSG sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles les plus-values à court terme.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article résulte de trois amendements identiques229(*), adoptés avec un avis favorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement.
A. La réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants par la LFSS 2024
Le présent article tend à préciser la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants par l'article 18 de la LFSS 2024, inséré à l'Assemblée nationale par le Gouvernement.
Il résulte notamment de cette réforme que le IV de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la CSG sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles est assise sur le montant des bénéfices, sous réserve de l'exclusion, notamment :
- du montant des recettes de la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
- de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
B. La précision proposée par cet article
Cet article propose d'exonérer également de la CSG sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles « les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ».
II - La position de la commission
La ministre de l'action et des comptes publics a indiqué en séance publique à l'Assemblée nationale que cette mesure avait un coût limité, et relevait avant tout de la simplification230(*).
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 sexies (nouveau)
Réduction des allégements
généraux pour les branches
dont les minima sont
inférieurs au Smic
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de réduire les allégements généraux pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré à l'initiative de Paul-André Colombani231(*), avec un avis défavorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement.
Il propose de modifier l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, relatif au barème des allégements généraux de cotisations patronales, afin de prévoir que le coefficient de réduction des cotisations patronales « est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise », dans le cas des « entreprises qui relèvent d'une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, [...] est inférieur au salaire minimum de croissance ».
Les conditions d'application de cette disposition, « notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives », seraient déterminées par décret.
Bien entendu, la rémunération des branches concernées ne peut être inférieure au Smic. Selon les termes de l'exposé sommaire de l'amendement, il s'agit « d'inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima ».
II - La position de la commission
A. Un article quasiment identique à la rédaction proposée par la CMP relative au PLFSS 2025
Cet article est quasiment identique à la disposition analogue adoptée à l'initative de Jérôme Guedj par la commission mixte paritaire (CMP) du PLFSS 2025. La principale différence est que le présent article renvoit à un décret pour préciser les règles s'appliquant aux entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives.
Après la censure du gouvernement de Michel Barnier, qui avait engagé sa responsabilité sur le texte de la CMP, cette disposition n'avait pas été réintroduite par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Comparaison de la rédaction proposée
par la CMP du PLFSS 2025
et la rédaction proposée par le
présent article
(article L. 241-13 du code de la sécurité sociale)
|
Conclusions de la CMP du PLFSS 2025
(article 6 du PLFSS, devenu article 18 |
Rédaction proposée par le présent article |
|
VIII. - Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. |
III bis. - Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l'entreprise, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. |
|
Cette dérogation s'applique aux entreprises qui relèvent d'une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l'année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d'entreprise ni aucune décision unilatérale de l'employeur n'a prévu au cours de l'année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable. |
Cette dérogation s'applique aux entreprises qui relèvent d'une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l'année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d'entreprise ni aucune décision unilatérale de l'employeur n'a prévu au cours de l'année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable. |
|
Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation, le présent VIII n'est pas applicable. |
Le présent III bis n'est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation. Les conditions d'application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. |
B. Un article qui n'est pas techniquement abouti et qui pourrait détruire de nombreux emplois
Comme le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale l'a souligné lors de la discussion de l'amendement insérant le présent article, celui-ci présente divers problèmes techniques. Par exemple, il ne prévoit pas ce qui se passe dans le cas des conventions collectives comprenant plusieurs grilles salariales différentes, avec des minima distincts.
Par ailleurs, cet article pose un problème d'équité, voire de conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. En effet, deux entreprises menant la même politique salariale pourraient être traitées différemment selon que la branche à laquelle elles appartiennent dispose ou non de minima inférieurs au Smic, et ce, même si leurs salaires sont élevés.
Surtout, traiter un sujet de droit du travail (la revalorisation des minima de branche) au moyen des allégements généraux conduirait à d'importants effets non souhaités. En effet, les branches visées par cet article sont celles qui emploient une forte proportion de salariés rémunérés au Smic, c'est-à-dire celles qui ont le plus besoin des allégements généraux, et pour lesquelles il est le plus difficile de revaloriser leur grille de salariale. Réduire les allégements généraux pour ces branches pourrait donc avoir pour principal effet, non de susciter des hausses de salaire, mais de détruire des emplois.
La question de la revalorisation des minima de branche semble en fait plutôt relever des négociations annuelles obligatoires (NAO). Une future « loi travail » serait vraisemblablement un véhicule plus approprié qu'un PLFSS.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté l'amendement n° 602 de suppression de cet article proposé par la rapporteure générale.
Article 8 septies
(nouveau)
Extension aux entreprises de plus de 250 salariés du
dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur
les heures supplémentaires
Cet article, par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'étendre aux entreprises de plus de 250 salariés du dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Son coût est estimé par le Gouvernement à 150 millions d'euros.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article résulte de deux amendements identiques de Laurent Wauquiez232(*) et du rapporteur général de sa commission des affaires sociales233(*), adoptés avec un avis de sagesse du Gouvernement.
A. Les niches sociales et fiscale relatives aux heures supplémentaires
Le dispositif dérogatoire relatif aux heures supplémentaires a été instauré par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite « loi Tepa »).
Il consiste actuellement en deux niches sociales et une niche fiscale :
- une déduction forfaitaire de cotisations patronales, pour les seules entreprises de moins de 250 salariés (pour un coût de 0,9 milliard d'euros en 2024234(*)) ;
- une exonération de cotisations salariales (pour un coût de 2,2 milliards d'euros en 2024235(*), hors droits retraite acquis gratuitement) ;
- dans le cas du budget de l'État, une exonération de l'impôt sur le revenu (pour un coût de 1,8 milliard d'euros en 2024236(*)).
L'encadré ci-après rappelle l'historique du dispositif.
Les niches sociales relatives aux heures supplémentaires
Le dispositif dérogatoire relatif aux heures supplémentaires a été instauré par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite « loi Tepa »), avec un volet salarial (exemption) et un volet patronal (déduction forfaitaire).
La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé l'exonération salariale et n'a maintenu la déduction forfaitaire patronale que pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Dans le contexte du mouvement des « gilets jaunes », la LFSS pour 2019 a recréé un nouveau dispositif en faveur des salariés, cette fois sous la forme d'une exonération (et non plus d'une exemption) de cotisations salariales. Le recours à une exonération a pour conséquence que les heures supplémentaires sont prises en compte pour le calcul des droits à la retraite. La LFSS pour 2019 prévoit explicitement que, contrairement à la déduction forfaitaire patronale, l'exonération salariale n'est pas compensée237(*).
La loi n° 1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat instauré un dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires réalisées dans les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés, d'un montant de 0,50 euro par heure supplémentaire ou complémentaire. Cette déduction forfaitaire fait l'objet d'une compensation par l'État sous forme de crédits budgétaires sur le budget du ministère chargé du travail.
En 2024, la déduction forfaitaire patronale a coûté 0,9 milliard d'euros et l'exonération salariale 2,2 milliards d'euros. S'y ajoute, dans le cas du budget de l'État, une exonération de l'impôt sur le revenu, pour un coût de 1,8 milliard d'euros en 2024, ce qui en fait la dixième dépense fiscale la plus coûteuse.
Dans son rapport de mai 2024 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale238(*), la Cour des comptes recommande de « compenser par crédits budgétaires le manque à gagner pour la sécurité sociale de l'exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires ».
B. La mesure proposée par cet article : étendre la déduction forfaitaire de cotisations patronales aux entreprises de 250 salariés et plus
Actuellement, l'article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « dans les entreprises dont l'effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire [...] ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d'un montant fixé par décret ». Ce montant a été fixé à 0,50 euro.
Le présent article propose de supprimer le plafond d'effectif de 250 salariés actuellement mentionné au sein de cet article L.241-18-1.
Comme cela a été souligné lors des débats à l'Assemblée nationale, cette mesure permet de supprimer une différence de traitement entre salariés. Le rapporteur général de la commission des affaires sociales et le Gouvernement ont tous deux estimé le coût de la mesure à 150 millions d'euros.
Après un avis défavorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rejeté deux amendements239(*) tendant à exonérer les heures supplémentaires de CSG et de CRDS, pour un coût estimé par le rapporteur général et le Gouvernement à 2 milliards d'euros.
II - La position de la commission
Si la commission juge nécessaire d'encourager le travail, elle est aussi soucieuse de réduire le déficit de la sécurité sociale.
A. La nécessité d'une vision d'ensemble avec l'article 2 sexies du projet de loi de finances
Au sein du projet de loi de finances (PLF), l'Assemblée nationale, avec un avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, a adopté deux amendements identiques240(*) insérant un article 2 sexies, supprimant le plafond annuel de 7 500 euros pour l'exonération des heures supplémentaires de l'impôt sur le revenu. Le coût de la mesure a été estimé à « 1 milliard d'euros » (lors de l'examen du PLF241(*)) ou à « entre 500 millions et 1 milliard d'euros » (lors de l'examen du PLFSS242(*)) par la ministre de l'action et des comptes publics.
La ministre de l'action et des comptes publics a estimé, lors de l'examen du PLF, que la situation des finances publiques ne permettait pas de conserver en l'état à la fois la mesure proposée par le présent article et la mesure proposée par l'article 2 sexies du PLF243(*). Elle a suggéré un recalibrage de la mesure proposée par le présent article244(*). Elle a également exprimé sa préférence pour la mesure proposée par le présent article, considérant que la suppression du plafond annuel de 7 500 euros bénéficierait surtout aux cadres dirigeants245(*).
B. Une mesure présentant un coût raisonnable
Comme indiqué supra, le coût du présent article est estimé à 150 millions d'euros.
La commission est favorable à la mesure proposée qui étend le dispositif adopté au sein de la loi « pouvoir d'achat » du 18 août 2022 à l'initiative de Frédérique Puissat. Par ailleurs, celle-ci est nettement moins coûteuse que celle proposée par l'article 2 sexies du PLF (environ 1 milliard d'euros selon le Gouvernement). Il sera possible le cas échéant de l'ajuster au cours de la navette, au vu notamment du maintien ou non en l'état de l'article 2 sexies du PLF.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 octies (nouveau)
Rapport d'évaluation de la
réforme de la protection sociale
des indépendants
réalisée par l'article 15 de la LFSS pour 2018
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er avril 2026 un rapport d'évaluation de la réforme de la protection sociale des indépendants réalisée par l'article 15 de la LFSS pour 2018.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré à l'initiative de Max Mathiasin246(*), le rapporteur général ayant demandé l'avis du Gouvernement, lequel a rendu un avis de sagesse.
La protection sociale des indépendants, auparavant gérée par le régime social des indépendants (RSI), est depuis 2020 intégrée au régime général de la sécurité sociale.
Cet article prévoit la remise avant le 1er avril 2026 d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'article 15 de la LFSS 2018, qui a réalisé cette réforme.
Il est précisé que ce rapport :
- « évalue la fiabilité du système national version 2 sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l'ancien régime social des indépendants et du régime actuel, ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues » ;
- « analyse les éléments liés à l'acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation ».
II - La position de la commission
La commission n'est, par principe, pas favorable aux demandes de rapport.
Elle relève par ailleurs que la ministre de l'action et des comptes publics s'est engagée à ce que le directeur de l'Acoss247(*) fasse un point spécifique avec les parlementaires ultramarins.
Elle a donc adopté un amendement n° 603 de suppression de cet article.
Article
9
Rationaliser certaines exonérations spécifiques
Cet article propose :
- dans le cas du dispositif d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (Acre), de réduire le montant maximal de l'exonération pour les travailleurs indépendants et de recentrer le dispositif sur les demandeurs d'emploi et les publics les plus vulnérables ;
- de supprimer le barème d'innovation et de croissance de la loi d'orientation pour le développement économique des outre-mer (dite Lodéom) ainsi que de diminuer ses autres barèmes ;
- de supprimer le dispositif d'exonération de cotisations salariales des apprentis ;
- et enfin d'augmenter le niveau nécessaire de dépenses en recherche et en développement pour qu'une entreprise puisse bénéficier du dispositif de jeune entreprise innovante (JEI).
L'objectif est de réduire le coût de dispositifs d'exonérations qui n'atteignent pas entièrement les objectifs qui leur sont fixés, à savoir le retour à l'emploi des chômeurs, l'aide à l'emploi dans les outre-mer, l'incitation au développement de l'apprentissage et le soutien à l'innovation.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Les dispositifs sont coûteux et présentent des résultats mitigés
1. Le dispositif d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise se caractériserait par une absence d'effets positifs et l'existence d'un effet d'aubaine
a) Le dispositif est né pour venir en soutien aux chômeurs mais à la suite de de nombreux élargissements, il s'est éloigné de son objectif initial
L'article 2 et l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979248(*) créent le dispositif visant à aider à la création et à la reprise d'une entreprise.
L'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'il s'agit d'un dispositif proposant une exonération de cotisations de sécurité sociale accordée au créateur ou repreneur d'entreprise pour la fraction de son revenu inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération concerne toutes les cotisations à l'exception de celle relative à la retraite complémentaire. Au-delà de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant de l'exonération décroît linéairement.
Le dispositif est ouvert aux personnes mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail. Il a fait l'objet de nombreuses modifications afin d'ajouter de nouvelles catégories de bénéficiaires. Par exemple, la loi de finances rectificative pour 2009249(*) accorde le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise pour les micro-entrepreneurs.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018250(*) a élargi les conditions d'éligibilité au dispositif à tous les créateurs ou repreneurs d'entreprise. Initialement réservé aux demandeurs d'emploi indemnisés, le dispositif bénéficie désormais à dix catégories de publics, incluant notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leurs concubins, les salariés repreneurs de leur entreprise en période de redressement judiciaire, et les entrepreneurs implantés en zones urbaines sensibles. Ces évolutions n'ont pas fait l'objet d'évaluation a priori ou a posteriori251(*).
Les critères d'éligibilité demeurent plus favorables pour les travailleurs indépendants que ceux existants avant la réforme de 2018 car il leur est possible d'en bénéficier sans être demandeur d'emploi alors que cette condition est requise pour les créations de micro-entreprises.
La loi de finances pour 2020252(*) a engagé un premier recentrage du dispositif au niveau des micro-entrepreneurs, sur ceux qui sont les plus vulnérables afin de favoriser leur reprise d'une activité économique. Elle a par ailleurs procédé à la suppression de la possibilité de prolonger par décret le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise au-delà de la première année d'activité pour les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, tout en étendant son bénéfice aux conjoints-collaborateurs des créateurs ou repreneurs d'entreprise.
Évolution des bénéficiaires
de l'aide à la création
ou à la reprise d'une
entreprise (Acre)253(*)
(en nombre de bénéficiaires)
Source : Projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, annexe 2
b) L'efficacité du dispositif n'est pas prouvée mais son coût est de nouveau croissant depuis 2023
Le dispositif s'inscrit dans un ensemble d'aides protéiforme comprenant plusieurs milliers de dispositifs d'aide à la création d'entreprise, incluant celles des collectivités territoriales. Sa valeur ajoutée spécifique n'a jamais fait l'objet d'une évaluation formelle, faute d'instrument de mesure permettant d'évaluer les effets de cet abaissement du coût du travail sur le taux de survie des entreprises et leur taux d'embauche à trois ans. Il est donc impossible de prouver que l'aide remplit les objectifs qu'elle se fixe dans l'aide à la création et au maintien d'entreprises254(*).
Le dispositif, antérieur à la loi du 25 juillet 1994, compensé par l'État, représente une charge significative pour les finances publiques. En 2025, il est estimé que l'aide à la création et la reprise d'entreprise représente un coût annuel pour les finances publiques de 425 000 000 euros pour 317 000 bénéficiaires255(*).
L'existence d'effets d'aubaine ne peut être écartée. De surcroît, le dispositif tend à devenir une aide automatique : 70 % des chômeurs créateurs d'entreprise en bénéficient. Par ailleurs, l'obtention de cette exonération constitue un préalable permettant de mobiliser d'autres aides, dont le nombre se chiffre actuellement à plusieurs milliers256(*).
Les travailleurs indépendants continuent de bénéficier de critères d'éligibilité plus favorables que ceux existant avant 2018, puisqu'il leur est possible d'en bénéficier sans être demandeur d'emploi alors que cette condition est désormais requise pour les micro-entrepreneurs. Le coût du dispositif repart donc à la hausse.
Coût du dispositif de l'aide à la création et à la reprise des entreprises
(en millions d'euros)
Source : Projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, annexe 2, déposé sur le bureau de la présidence du Sénat le 11 juin 2025
2. L'efficacité du dispositif de la compensation des exonérations créées par la loi d'orientation pour le développement économique des outre-mer de 2009 (Lodéom) est contestée par un récent rapport d'inspection alors que son coût ne cesse d'être en forte hausse
a) La situation économique des départements et régions des outre-mer continue de justifier l'existence de politiques publiques dédiées pour y encourager l'emploi et le développement économique malgré un progressif rapprochement avec l'Hexagone
Les départements et régions des outre-mer partagent des défis économiques liés à leur géographie insulaire ou enclavée et à leur éloignement de l'Hexagone. Ces caractéristiques limitent la taille des marchés intérieurs, réduisent la demande locale et empêchent les entreprises de bénéficier d'économies d'échelle, alourdissant leurs coûts fixes. Malgré une biodiversité riche et un potentiel touristique, ces atouts génèrent des surcoûts. L'économie locale est ainsi très concentrée, notamment dans la distribution et le secteur portuaire. Le secteur public y joue un rôle prépondérant, représentant 37,8 % de la valeur ajoutée et 45,3 % de l'emploi257(*).
Les départements et régions d'outre-mer subissent de fortes inégalités et un taux de pauvreté qui demeure préoccupant. Les indices de Gini y sont supérieurs de 13 à 16 points par rapport à la France hexagonale.
Indice de Gini par territoire entre 2017 et 2020
|
Territoire (année) |
Indice de Gini |
|
Guadeloupe (2020) |
0,42 |
|
Guyane (2017) |
0,43 |
|
Martinique (2020) |
0,45 |
|
La Réunion (2018) |
0,36 |
|
France hexagonale (2020) |
0,29 |
Développé par le statisticien italien Corrado Gini, l'indice de Gini permet de mesurer le degré d'inégalité des revenus d'un pays. Il est compris entre 0 et 1. Plus il est petit plus les inégalités sont faibles.
Source : Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024
La productivité des entreprises des départements et régions d'outre-mer demeure inférieure à celle des entreprises de l'Hexagone avec un écart moyen de 21 %. La sous-capitalisation des entreprises et la moindre qualification des salariés en sont les principaux déterminants. La balance commerciale des départements et régions d'outre-mer est particulièrement préoccupante, avec un déficit estimé à 15,3 milliards d'euros en 2023258(*).
En revanche, les départements et régions d'outre-mer sont engagés dans un processus de convergence de long terme avec la France hexagonale, hors Île-de-France. Ainsi, alors que le niveau de produit intérieur brut par habitant des départements et régions d'outre-mer représentait en 2000 près de 63 % du produit intérieur brut métropolitain hors Île-de-France, il a atteint 80 % de ce dernier en 2022. En outre, entre 2000 et 2022, le taux de croissance annuel moyen du revenu disponible brut des ménages par habitant a été supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, à l'exception de la Guyane259(*).
Produit intérieur brut en valeur par habitant entre 2000 et 2022
(en euros courants)
|
Territoires |
2002 |
2022 |
Taux de croissance annuel moyen |
PIB par habitant par rapport à la France hexagonale en 2000260(*) |
PIB par habitant par rapport à la France hexagonale en 2022261(*) |
|
Guadeloupe |
13 120 |
25 903 |
3,1 % |
62 % |
77 % |
|
Martinique |
13 864 |
27 179 |
3,1 % |
65 % |
80 % |
|
Guyane |
11 814 |
15 656 |
1,3 % |
56 % |
46 % |
|
La Réunion |
13 218 |
24 663 |
2,9 % |
62 % |
73 % |
|
France hexagonale262(*) |
21 248 |
33 780 |
2,1 % |
N/A |
N/A |
Source : Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024
Enfin, selon un récent rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales263(*), les entreprises bénéficiant du dispositif de la loi d'orientation pour le développement économique des outre-mer présentent des taux de marge supérieurs à ceux de la France hexagonale. Ainsi, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le taux de marge moyen des entreprises en 2021 était de 44,6 %, contre seulement 32 % en France hexagonale. La fédération des entreprises des outre-mer (Fedom), entendue par la rapporteure générale, considère toutefois que l'année 2021 n'est pas représentative, en raison de la crise sanitaire.
Taux de marge des entreprises par territoire en 2021
(en pourcentage)
|
Territoires |
Taux de marge |
|
Guadeloupe |
33,8 % |
|
Martinique |
38,5 % |
|
Guyane |
35,8 % |
|
La Réunion |
35,0 % |
|
Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
44,6 % |
|
France hexagonale |
31,6 % |
Source : Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024
b) Les entreprises des départements et régions des outre-mer bénéficient de dispositifs spécifiques qui viennent s'ajouter aux dispositifs de droit commun
(i) Les dispositifs de droit commun
Les entreprises, départements et régions d'outre-mer profitent, comme les entreprises de l'Hexagone, des allègements généraux de cotisations patronales.
Ainsi, elles bénéficient actuellement des allégements dégressifs de cotisations patronales jusqu'à 1,6 Smic et des allégements uniformes de cotisations maladie et famille jusqu'à 2,25 et 3,3 Smic, dits bandeau maladie et bandeau famille.
De même, elles bénéficieront à compter du 1er janvier 2026 du dispositif se substituant aux allégements précités, dit réduction générale dégressive unique (RGDU).
(ii) Les dispositifs dérogatoires au droit commun
Les territoires des outre-mer bénéficient en surcroît de dispositifs qui leur sont spécifiques.
Les exonérations de cotisations se divisent en trois catégories : le régime de la Lodéom pour les départements et régions d'outre-mer, à savoir pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion ; le régime de la Lodéom dans les collectivités d'outre-mer, à savoir pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; et le régime de la loi de programme pour l'outre-mer (Lopom), spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon264(*).
Les bandeau maladie et bandeau famille, qui disparaîtront au 1er janvier 2026 dans le dispositif de droit commun mais seront maintenus dans le cadre du dispositif Lodéom265(*), sont cumulables avec les dispositifs de la Lodéom. L'allègement général des cotisations, de même que la future RGDU, n'est pas cumulable avec les dispositifs ultramarins.
La loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 a instauré les exonérations de cotisations spécifiques aux territoires d'outre-mer jusqu'à 1,3 Smic. De nombreuses réformes, intervenues jusqu'en 2009, ont élargi le niveau des rémunérations concernées par les dispositifs d'exonération ainsi que les secteurs éligibles, comme le tourisme ou les compagnies aériennes.
La structure actuelle du dispositif de la Lodéom est instituée par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 puis complétée par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Selon l'exposé des motifs de la loi, l'objectif principal était de soutenir le développement de l'emploi.
Pour les trois dispositifs, l'objectif est de soutenir les très petites entreprises (TPE) ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME). Il existe trois barèmes avec des critères d'éligibilité qui leur sont propres.
Seuils et barèmes pour les dispositifs de la Lodéom
Source : Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024
Les dispositifs de la Lodéom sont particulièrement avantageux par rapport aux dispositifs de droit commun. Par exemple, le barème de compétitivité renforcée et le barème d'innovation et de croissance permettent une exonération totale des cotisations jusqu'à 2 et 1,7 Smic, pour des rémunérations qui ne seraient pas exonérées au titre de l'allègement général commun dans l'Hexagone, s'éteignant à 1,6 Smic. La Lodéom vient donc en aide à des salaires bien supérieurs au Smic.
(iii) Les barèmes de la Lodéom pour les départements et régions d'outre-mer
L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le barème de compétitivité s'applique aux TPE de moins de 12 salariés, ainsi qu'aux entreprises du bâtiment et des travaux publics et les compagnies aériennes et maritimes quel que soit leur nombre de salariés. Les exonérations sont dégressives à partir de 1,3 Smic et s'éteignent à 2,2 Smic.
Pour ces mêmes territoires, le barème de compétitivité renforcée cible les petites et moyennes entreprises, jusqu'à 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, exerçant une activité dans le secteur du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie et de l'agroalimentaire. Les entreprises doivent également entrer dans le champ du dispositif du perfectionnement actif, défini par l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen, c'est-à-dire qu'elles importent des marchandises extérieures à l'Union européenne sans être soumises à des droits à l'importation, en raison de leur activité de transformation de ces dernières. L'exonération de cotisations est totale jusqu'à 2,2 Smic et est donc particulièrement avantageux.
Le barème innovation et croissance, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ne s'applique qu'aux entreprises des secteurs des technologies de l'information et des communications. Au sein de ces entreprises, seules les dépenses salariales qui relèvement directement de l'innovation sont éligibles266(*). Les réductions de cotisations s'appliquent de façon dégressive jusqu'à 3,5 Smic.
(iv) Les barèmes de la Lodéom pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin
L'article L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités des réductions et exonérations de cotisations patronales pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec trois barèmes distincts.
Le barème pour les entreprises de moins de 11 salariés s'applique sans condition de secteur. Le taux d'exonération est maximal jusqu'à 1,4 Smic, l'exonération est dégressive à partir de deux Smic et l'exonération devient nulle à trois Smic.
Le barème d'exonération sectorielle concerne les entreprises qui exercent une activité dans le secteur du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie et de l'agroalimentaire, sans restriction sur le nombre de salariés. Le taux d'exonération est maximal jusqu'à 1,4 Smic, devient dégressif à partir de 1,3 Smic et est nulle à compter de trois Smic.
Le barème d'exonération renforcée concerne les entreprises éligibles au dispositif de réduction d'impôt relevant de l'investissement productif267(*) et qui exercent également une activité dans le secteur de la recherche, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, du tourisme, de l'environnement, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou bien relevant du régime de perfectionnement actif. Le taux d'exonération maximal est fixé à 1,7 Smic, est dégressif à partir de 2,5 Smic et devient nul à compter de 4,5 Smic.
c) L'évolution du coût des dispositifs de la Lodéom pour les finances publiques est particulièrement haussière alors que la Lodéom ne présente pas d'effets significatifs sur l'emploi
En 2023, près de 1 525 millions d'euros sont consacrés à la compensation des exonérations du dispositif de la Lodéom, en hausse de 155 millions d'euros par rapport à 2022. Entre 2019 et 2023, le coût du dispositif a augmenté de 33 %. Cette évolution demeure en proportion néanmoins inférieure à l'augmentation sur l'ensemble du territoire français du dispositif des allègements généraux sur la même période, à savoir 44 %268(*).
Le montant des exonérations augmente principalement en raison de l'élévation de la masse salariale dans les territoires des outre-mer. Entre 2019 et 2023, la masse salariale y a augmenté de 22,5 %. Cependant, la croissance de la masse salariale n'est pas le seul élément explicatif de l'évolution du coût des dispositifs de la Lodéom. L'augmentation des exonérations a été plus forte que l'augmentation de la masse salariale. En effet, le tassement des rémunérations au niveau des plus bas salaires dans les outre-mer a accru le taux d'exonération apparent, c'est-à-dire le rapport entre le montant total des exonérations et la masse salariale. Ce taux était de 11 % en 2019, pour 12,1 % en 2023269(*).
L'avantage différentiel global est défini comme l'écart entre le montant d'exonération total issu de la Lodéom et le montant d'exonération total dont auraient bénéficié les entreprises sous le régime de l'allègement général. Cet avantage est estimé à 694 millions d'euros en 2023 pour les entreprises bénéficiant du dispositif de la Lodéom, soit 45,5 % du montant des exonérations actuelles270(*).
Les exonérations du dispositif de la Lodéom concernent principalement les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité, pour 61 % du total des exonérations, soit 861 millions d'euros. Les exonérations du barème d'innovation et de croissance sont faibles : elles ne représentent que 34 millions d'euros, soit moins de 2 % du total des exonérations. Les principaux secteurs tirant parti des exonérations de la Lodéom sont le commerce, la construction et l'hébergement-restauration, pour environ 55 % du total des exonérations271(*).
Répartition du montant des
exonérations accordées
en fonction du barème en
2023
(en millions d'euros)
Source : Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024
Selon l'évaluation économétrique des barèmes de la Lodéom réalisée par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales dans leur rapport précité, les effets seraient non significatifs sur la rentabilité des entreprises et sur les salaires, et seraient très limités sur l'emploi.
Selon ce rapport, « toutes choses égales par ailleurs, la modélisation montre que le fait d'avoir été favorisé par la refonte des exonérations de cotisations sociales Lodéom en 2019 (soit avoir bénéficié d'une baisse de 1 % à 14 % du coût du travail) n'a engendré aucun effet significatif sur l'emploi des entreprises de 2 à 11 salariés ». Pour les entreprises de plus de 11 salariés, il n'est pas possible d'établir avec certitude que les dispositifs de la Lodéom ont présenté un effet significatif ou non significatif. Pour les salaires et les indicateurs de rentabilité, il n'existe également aucun effet significatif des barèmes de la Lodéom.
3. L'exonérations de cotisations salariales en faveur des apprentis présentait une dynamique haussière mais elle est désormais en légère baisse du fait des mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
a) Le cadre juridique et les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
L'article L. 6221-1 du code du travail définit l'apprentissage comme un contrat de travail particulier conclu entre un apprenti et un employeur. Le salaire versé par l'employeur dépend de l'âge et du diplôme préparé par l'apprenti272(*). En retour, l'employeur s'engage à participer à la formation professionnelle de l'apprenti.
La loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 relative à l'apprentissage a instauré la prise en charge par l'État des cotisations sociales salariales des apprentis. L'article L. 6243-2 du code du travail précise que leur rémunération est soumise à cotisation au-delà de 79 % du Smic. L'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne leur sont également pas applicables pour la part du revenu excédant 50 % du Smic. Enfin, l'article 81 bis du code général des impôts dispose que la rémunération des apprentis est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur d'un Smic annuel.
L'article 22 de la loi n° 2025-199 de financement de la sécurité sociale pour 2025273(*) a réduit la part de rémunération de l'apprenti qui était totalement exonérée de cotisations salariales. Elle est passée de 79 % à 50 % du Smic et à l'initiative de la commission, cette mesure a été limitée aux contrats conclus à compter du 1er mars 2025. L'effet financier de la mesure est estimé à un gain de 294 millions d'euros en année pleine.
Ce même article a assujetti la rémunération des apprentis à la CSG ainsi qu'à la CRDS afin d'élargir leur assiette. Le gain financier est estimé à 360 millions d'euros en année pleine.
b) Le dispositif d'exonérations de cotisations sociales représentait un coût croissant du fait de la dynamique de l'apprentissage mais ses dépenses sont désormais en baisse
Les effets bénéfiques de l'apprentissage sur l'emploi ne sont plus à démontrer. En effet, deux ans après leur sortie d'études, 74 % des apprentis de niveau CAP à BTS occupent un emploi salarié, contre seulement 63 % pour les non-diplômés274(*).
En 2024, près de 1 040 000 apprentis étaient en formation, contre 479 000 en 2019, soit une augmentation moyenne annuelle de 17 % par an275(*). Leur rémunération s'élève en moyenne à 1 042 euros par mois en 2024276(*).
En 2022, le coût moyen par contrat d'apprentissage pour les administrations publiques est estimé à 23 800 euros par an. Les exonérations de cotisations sociales en représentent 3 700 euros, soit 15 % du total.
En 2025, le coût du dispositif d'exonération de cotisations sociales des apprentis a été de 1,07 milliard d'euros, contre 1,08 milliard d'euros en 2024, soit une baisse de 1,2 %. Sans les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le coût du dispositif d'exonérations était estimé à 1,19 milliard d'euros. En 2026, avant mesures du PLFSS, le coût du dispositif est estimé à 1,004 milliard d'euros, soit une baisse de 6 % par rapport à 2025277(*).
Jusqu'en 2023, la dynamique des montants de cotisations exonérées était particulièrement haussière, mais cette tendance semble s'inverser au regard des données de l'année 2025 et des prévisions pour 2026. Ce dynamisme s'expliquait principalement par la très forte augmentation de l'assiette de cotisations exonérées, en raison de la hausse du nombre de contrats d'apprentissages conclus278(*).
Selon le Gouvernement, la suppression du dispositif d'exonérations de cotisations sociales pour les nouveaux contrats proposée par le présent article présenterait un gain de 320 millions d'euros en 2026, puis de 1,2 milliard d'euros en 2027, correspondant ainsi à l'effacement total du coût pour les finances publiques des exonérations de cotisations sociales pour les apprentis.
Évolution des montants de cotisations
exonérées
et de leurs assiettes de 2018 à
2023
(en euros)
Source : Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Revue des dépenses publiques d'apprentissage et de formation professionnelle, annexe 2, mars 2024
Le dispositif des exonérations de cotisations sociales pour les apprentis peut être interrogé. Selon l'évaluation préalable de cet article, « il n'est [...] pas démontré que ce dispositif constitue en soi une incitation forte au développement de l'apprentissage, lequel dépend largement d'autres facteurs et notamment de l'offre de formation et d'emplois adaptés en entreprises ». Le développement de l'apprentissage s'explique notamment par la disposition de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel279(*), qui a créé une aide unique à l'apprentissage pouvant aller jusqu'à 6 000 euros lors de l'embauche.
En revanche, le dispositif d'exonération de cotisations salariales en faveur des apprentis est unique car les cotisations salariales ne font pas par principe l'objet d'une exonération. Il s'agit également d'une inégalité de traitement entre un jeune salarié, soumis au dispositif des allègements généraux, et un apprenti, qui n'est pas nécessairement moins productif qu'un jeune salarié même s'il est encore en formation et qui dispose de ce dispositif particulièrement dérogatoire au droit commun de la sécurité sociale.
En effet, les exonérations existantes de cotisations sociales des apprentis ne présentent aucun effet sur leurs droits sociaux contributifs en raison de la compensation de leurs cotisations à la sécurité sociale par le budget de l'État. Ainsi, les apprentis sont éligibles à l'indemnisation chômage à la sortie du contrat et les trimestres effectués au titre du contrat d'apprentissage sont pris en compte pour le calcul de l'assurance-retraite.
Cependant, il est nécessaire de reconnaître que le dispositif profite directement au pouvoir d'achat des apprentis en limitant les prélèvements sur leur revenu brut afin de préserver leur revenu net. Pour rappel, près de 20 % des 18-24 ans vivent sous le seuil de pauvreté, contre 10 % pour les 30-49 ans280(*).
4° L'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) favorise le financement de l'innovation et de l'emploi dans les secteurs innovants, pour un coût maîtrisé ces dernières années
L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts dispose qu'une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement lorsqu'elle respecte les conditions suivantes :
- il s'agit d'une entreprise de moins de 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- l'entreprise est créée depuis moins de huit ans ;
- les dépenses de recherche et de développement281(*) de l'entreprise représentent au moins 20 % des charges déductibles ou l'entreprise est dirigée par des diplômés valorisant leurs travaux de recherche ;
- le capital de l'entreprise doit être détenu à 50 % minimum par des personnes physiques ou entités éligibles ;
- l'entreprise ne doit pas être issue d'une restructuration ou d'une reprise d'activité.
L'objectif de ces dispositifs est de favoriser les dépenses de recherche des petites et moyennes entreprises récemment créées en soutenant la diffusion de l'innovation. Aucun critère qualitatif n'a été retenu, afin de simplifier le dispositif au maximum, et parce que l'instruction approfondie de chaque dossier par l'administration ne serait pas possible dans un système auto-déclaratif.
Sur le plan fiscal, l'article 13 de la loi de finances pour 2004282(*) a mis en place une exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes en créant un nouvel article 44 sexies A qui dispose que « les jeunes entreprises innovantes sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire », cette période ne pouvant dépasser 12 mois. Les entreprises bénéficient également, après délibération du conseil municipal, d'une exonération pour sept années de la cotisation foncière des entreprises283(*) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties284(*).
Les dépenses éligibles correspondent à l'assiette du crédit impôt recherche (CIR), avec un contrôle effectué selon les normes définies par l'organisme de coopération et de développement économique285(*). En 2024, un groupe de travail réunissant la direction générale des finances publiques et la direction générale des entreprises a mis à jour le protocole de contrôle et de traitement des rescrits. Le cumul avec le crédit impôt recherche et compétitivité est possible, favorisant selon la direction générale des entreprises l'essor d'un écosystème technologique particulièrement innovant en France par rapport à ses voisins européens.
Sur le plan du régime social, l'article 131 de la même loi de finances dispose que les jeunes entreprises innovantes bénéficient d'une exonération de cotisations à la charge de l'employeur pour les revenus d'activité versés aux salariés participant à titre principal aux projets de recherche. Le dispositif des jeunes entreprises innovantes est ainsi entré en vigueur le 1er janvier 2004 et le dispositif des jeunes entreprises universitaires le 1er janvier 2008.
Les exonérations de cotisations patronales sont limitées à l'assiette des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic, et plafonnées à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elles s'appliquent à une échelle de rémunération bien supérieure à celle des allégements généraux, qui est de 3,5 Smic286(*).
L'évolution du dispositif
d'exonérations de cotisations patronales
pour les jeunes entreprises
innovantes
À l'origine du dispositif, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale concernait également la cotisation AT-MP. Il n'existait ni plafond de rémunération, ni plafond de montant par établissement. L'exonération était octroyée à taux plein jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise.
L'aide octroyée a été revue à plusieurs reprises.
L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008287(*) a exclu du champ de l'exonération les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, comme pour la plupart des autres dispositifs ciblés d'exonération.
L'article 175 de la loi de finances pour 2011288(*) a introduit un double plafonnement de l'aide : un plafond de rémunération mensuelle brute pour la part de rémunération versée au salarié inférieure à 4,5 Smic et un montant maximum d'exonération applicable par établissement et par année civile égal à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce même article a instauré une dégressivité dans le temps : le taux d'exonération passait à 75 % la quatrième année, 50 % la cinquième année, 30 % la sixième année et 10 % la septième année.
La loi de finances rectificative pour 2011289(*) a relevé les taux d'exonération dégressifs en fonction de l'âge de l'entreprise. L'entreprise bénéficiait d'une exonération à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant sa création. Ce taux passait à 80 % la quatrième année, 70 % la cinquième année, 60 % la sixième année et 50 % la septième année.
La loi de finances pour 2014290(*) a supprimé, à compter du 1er janvier 2014, la dégressivité de l'exonération dans le temps.
Le décret n° 2014-1179291(*) a instauré une proratisation du plafond du montant maximal dont peut bénéficier une entreprise créée ou supprimée en cours d'année. La limite correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale est ainsi réduite proportionnellement au nombre de mois d'existence de l'entreprise dans l'année.
La loi de finances pour 2021 a relevé à 11 ans la limite d'éligibilité à cette exonération.
La loi de finances pour 2022 a ramené à huit ans la limite d'éligibilité à cette exonération. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 sont donc éligibles à cette exonération jusqu'à la veille de leur huitième anniversaire.
L'article 44 de la loi de finances pour 2024292(*) a créé le statut de jeune entreprise de croissance (JEC), destiné aux entreprises partageant des critères similaires aux jeunes entreprises innovantes, mais dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 5 % de leurs charges déductibles, en plus de répondre à des critères de performance sont éligibles au dispositif d'exonération de cotisations sociales à partir du 1er janvier 2024. La direction générale des entreprises estime qu'environ 160 entreprises profitent du dispositif des jeunes entreprises de croissance, pour un coût annuel d'environ 10 millions d'euros, bien qu'il ne soit pas encore possible de mesurer précisément le nombre d'entreprises bénéficiaires293(*).
L'article 69 de la loi de finances pour 2024294(*) a modifié le dispositif des jeunes entreprises innovantes en créant le statut de jeune entreprise universitaire295(*). Le statut de jeune entreprise universitaire vise à encourager la création d'entreprises par les étudiants et les personnes impliquées dans les travaux de recherche des établissements d'enseignement supérieur.
Les jeunes entreprises universitaires
Le dispositif des jeunes entreprises universitaires constitue une variante spécifique du régime des jeunes entreprises innovantes.
Pour bénéficier du statut de jeune entreprise universitaire, l'entreprise doit remplir les conditions générales applicables aux jeunes entreprises innovantes auxquelles s'ajoutent des critères particuliers. L'entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche auprès de la banque publique d'investissement296(*).
L'entreprise qualifiée de jeune entreprise universitaire est exonérée de cotisations sociales patronales pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ainsi que les personnels chargés de tests pré-concurrentiels affectés à des travaux de recherche et développement ou d'innovation297(*).
Le coût des exonérations de cotisations sociales attribuées au titre des jeunes entreprises innovantes a connu une progression significative, passant de 139 millions d'euros en 2014 à 270 millions d'euros en 2023. Le coût s'est établi à 300 millions d'euros en 2024.
Cette dynamique haussière a subi un ralentissement du fait de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025298(*), qui a relevé le seuil d'intensité en recherche et développement pour que l'entreprise soit éligible au dispositif, en passant de 15 % à 20 % des charges déductibles de l'entreprise. Cette mesure de recentrage du dispositif devait permettre de réaliser une économie budgétaire de 50 millions d'euros. Le coût du dispositif est estimé à 218 millions d'euros en 2026, puis 225 millions d'euros en 2027 et 230 millions d'euros en 2028.
Évolution du coût du dispositif des jeunes entreprises innovantes
(en millions d'euros)
Source : Projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024299(*)
La mission de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances de revue de dépenses sur les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques de juin 2015 a porté une évaluation positive sur le dispositif des jeunes entreprises innovantes300(*). Elle reprend notamment les conclusions de l'étude de 2012 de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services qui conclut à l'efficacité du dispositif des jeunes entreprises innovantes au regard de la croissance des entreprises bénéficiaires.
En revanche, cette même mission a porté une évaluation négative sur le dispositif des jeunes entreprises universitaire, s'appuyant notamment sur la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport d'évaluation sur les dispositifs de soutien à la création d'entreprises de 2012301(*), de suppression du dispositif des jeunes entreprises universitaires ou de fusion avec le dispositif des jeunes entreprises innovantes en raison de son faible taux de recours et des coûts liés à la gestion séparée de deux dispositifs.
En 2021, une étude économique réalisée par l'Insee a conclu « qu'il existerait, pour une proportion potentiellement faible mais significative des entreprises bénéficiaires évaluées, un effet du recours au dispositif des jeunes entreprises innovantes sur l'emploi salarié total et dédié à la recherche et au développement, qui ne s'accompagne pas d'un effet sur la rémunération versée aux salariés »302(*).
B. Les dispositions de l'article visent à réduire le coût des dispositifs pour les finances publiques en les recentrant sur leur cible initiale ou en les supprimant
1. La réduction de l'exonération de l'aide à la création et à la reprise des entreprises (Acre) passerait par la diminution du niveau maximal de l'exonération pour les travailleurs indépendants et par le recentrage du dispositif sur sa cible initiale
Le 1° du A du I du présent article recentrerait le dispositif de l'aide à la création et à la reprise des entreprises (Acre) en modifiant le I de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale sur sa cible initiale, à savoir les demandeurs d'emploi et les publics les plus vulnérables. Le dispositif serait en effet recentré sur les personnes qui :
- sont des demandeurs d'emploi ;
- sont des demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à France Travail ;
- sont des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique ;
- sont âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
- sont en situation de handicap et âgées de moins de 30 ans ;
- sont salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- ont conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ;
- ont créé ou repris une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la ville ;
- sont bénéficiaires du complément de libre choix d'activité303(*).
Le 2° du A précité modifierait le deuxième alinéa du II du même article afin de limiter le montant de l'exonération à un plafond de 25 % de l'assiette des cotisations dont est redevable une personne au titre de son activité professionnelle. En outre, il serait précisé que le montant de l'exonération serait fixé par voie réglementaire et que pour les revenus entre 75 % et 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, la dégressivité de l'aide serait conservée.
Le IV dudit article affirme que ces dispositions devraient entrer « en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et [ne] s'appliquent qu'aux créations et reprises d'entreprise intervenant à compter de cette date ».
Dans l'étude d'impact du présent article, le Gouvernement présente son intention du publier par décret une adaptation des dispositions de l'aide à la création et à la reprise des entreprises pour les auto-entrepreneurs
La diminution du niveau maximal de l'exonération pour les travailleurs indépendants et la modification des conditions d'accès au dispositif permettraient un gain de 92 millions d'euros en 2026 et de 184 millions d'euros en année pleine.
2. Dans le cas du dispositif Lodéom, la suppression du barème « innovation et croissance » et le recentrage des barèmes « compétitivité » et « compétitivité renforcée » sur les salaires inférieurs à 1,6 et 1,9 Smic
Le 1° du B du I du présent article tend à intégrer Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la liste des territoires concernés par le dispositif Lodéom d'exonérations de cotisations sociales et de contributions patronales. Il modifierait à cette fin l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
Le c du 1° substituerait, s'agissant d'une liste d'employeurs304(*), le taux de 30 % applicable à la majoration du Smic définissant le seuil en deçà duquel l'exonération est totale par un taux de 20 %, abaissant ainsi ce seuil de 1,3 Smic annuel à 1,2 Smic annuel. Parallèlement, il substituerait le taux de 120 % définissant le plafond au-delà duquel l'exonération devient nulle par un taux de 60 %, réduisant ainsi ce plafond de 2,2 Smic annuel à 1,6 Smic annuel.
Ce même c opérerait, s'agissant d'une liste d'employeurs305(*), une substitution du taux de 100 % applicable à la majoration du salaire minimum de croissance annuel définissant le seuil d'exonération totale par un taux de 50 %, abaissant ainsi ce seuil de deux Smic annuel à 1,5 Smic annuel. Concomitamment, il substituerait le taux de 170 % définissant le plafond d'extinction de l'exonération par un taux de 90 %, réduisant ainsi ce plafond de 2,7 Smic annuel à 1,9 Smic annuel. Le c) acterait enfin la suppression du barème « innovation et croissance » du dispositif de la Lodéom en abrogeant le C de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
Le 2° du présent article procèderait à l'abrogation de l'article L. 752-3-3 du même code afin de supprimer le dispositif dérogatoire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le dispositif Lodéom.
Le V du présent article préciserait que ces dispositions ne rentrent en vigueur qu'à compter du « 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes d'activités courant à compter de cette date ».
L'adoption du dispositif gouvernemental permettrait une économie de 350 millions d'euros en 2026, en plus d'une élévation de 20 % de l'impôt sur les sociétés sur le montant économisé en année n306(*).
En revanche, « l'effet-retour de l'intégration dans le dispositif des allègements généraux des entreprises bénéficiant de la Lodéom est estimé à un coût de 100 millions d'euros mais serait en grande partie compensé, à hauteur de 90 millions d'euros, par la réduction du coût des exonérations proportionnelles de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales maintenues au 1er janvier 2026 pour ces entreprises. L'effet net est donc estimé à 10 millions d'euros »307(*).
La suppression du seul barème « innovation et croissance » entraînerait une économie d'environ 10 millions d'euros en raison du basculement des entreprises éligibles vers les allègements généraux308(*).
3. L'exonération des cotisations pour les apprentis serait supprimée et les entreprises devraient consacrer au moins 25 % de leurs dépenses à l'innovation afin d'être qualifiées de jeunes entreprises innovantes
Le II de l'article 9 abrogerait l'article L. 6243-2 du code du travail, mettant ainsi fin au régime d'exonérations de cotisations sociales pour la part de la rémunération des apprentis qui n'excède pas 50 % du Smic.
Le VI de l'article 9 préciserait que ces dispositions ne « s'appliquent [que] pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026 ».
Le III de l'article 9 modifierait le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts afin de porter de 20 % à 25 % la part de dépenses de recherche309(*) nécessaires pour qu'une entreprise puisse être qualifiée de jeune entreprise innovante. L'objectif est de conserver le taux et la durée des exonérations existantes mais de les recentrer sur les entreprises qui réalisent le plus de dépenses de recherche et de développement. En effet, il s'agit des entreprises qui nécessitent le plus de soutien car une forte concentration des dépenses en recherche et développement signifie que l'entreprise demeure éloignée de son horizon de rentabilité. La disposition ainsi modifiée conduirait à l'exclusion de 400 entreprises du dispositif des jeunes entreprises innovantes310(*).
L'effet de la mesure relative aux apprentis est estimé à une économie de 320 millions d'euros en 2026 puis à 1,2 milliard d'euro à compter de 2027311(*).
Le recentrage du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes permettrait une économie annuelle de 25 millions d'euros312(*). Sur 4 000 entreprises, le nouveau dispositif exclurait 400 entreprises, soit 10 %. À titre de comparaison, avec un seuil de dépenses en recherche et en développement fixé à 30 %, près de 70 % des entreprises seraient exclues313(*).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé la quasi-totalité de cet article.
Pour mémoire, le rendement attendu en 2026 des différentes mesures proposées par le texte initial, environ 780 millions d'euros, en quasi-totalité pour l'État314(*), se répartissait de la façon suivante :
- 340 millions d'euros pour la réforme du dispositif Lodéom ;
- 320 millions d'euros pour la fin de l'exonération de cotisations salariales des apprentis ;
- 92 millions d'euros pour la réforme du dispositif Acre ;
- 25 millions d'euros pour le recentrage du dispositif JEI.
Seule subsiste la partie de la réforme du dispositif Acre correspondant à son recentrage. Celui-ci a toutefois été légèrement atténué par un amendement du rapporteur général de la commission des affaires sociales maintenant dans le dispositif Acre l'ensemble des travailleurs indépendants procédant à une création ou à une reprise d'entreprise au sein d'une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) ou d'une zone France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR+). Cette mesure est cohérente avec le maintien par le présent article dans le champ du dispositif des personnes créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Les autres mesures du présent article ont été supprimées par l'Assemblée nationale, qui a adopté :
- un amendement porté par la députée Sandrine Rousseau, supprimant la disposition réduisant à 25 % l'exonération de cotisations sociales du dispositif Acre315(*) ;
- un amendement du député Max Mathiasin supprimant les dispositions réformant le dispositif Lodéom316(*) ;
- un amendement du député Jean-Claude Raux supprimant les dispositions mettant en extinction l'exonération des cotisations salariales sur la rémunération des apprentis317(*) ;
- et enfin un amendement du député Laurent Mazaury supprimant l'augmentation du taux de dépenses de recherche et développement pour qu'une entreprise soit qualifiée de jeune entreprise innovante318(*).
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission salue la volonté du Gouvernement de procéder à une rationalisation des niches sociales, qu'elle appelle depuis longtemps de ses voeux.
Elle déplore toutefois que l'Assemblée nationale ait supprimé la quasi-totalité de l'article, sans proposer de mesures en compensation de cette dégradation du solde.
Dans un objectif de contribution à l'effort de redressement des comptes de la sécurité sociale, la commission propose de rétablir la version initiale du texte pour le dispositif de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise ainsi que pour la suppression de l'exonération de cotisations sociales des apprentis.
En effet, elle considère qu'il est essentiel de maîtriser le coût du dispositif de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et qu'il n'existe pas d'argument permettant de justifier la différence de traitement des apprentis par rapport à de jeunes salariés.
La commission ne juge en revanche pas opportun de rétablir le texte initial s'agissant des dispositifs issus de la Lodéom. Elle invite en revanche le Gouvernement à s'engager dans un processus d'ampleur de refonte de ces aides en concertation avec les acteurs locaux. Le dispositif initial présenté par le Gouvernement semble ne pas avoir fait l'objet d'une concertation suffisante pour assurer l'acceptabilité de la mesure.
Enfin, concernant le relèvement du seuil de dépenses en recherche et développement pour qu'une entreprise soit qualifiée de jeune entreprise innovante, la commission considère qu'il serait regrettable de s'attaquer à un dispositif qui a montré son efficacité pour le financement de l'innovation. Elle s'oppose à une simple mesure de rabot qui ne s'appuie pas sur des argumentaires économiques étayés ou une comparaison en droit convaincante.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements n° 605 et 604 qu'elle a adoptés.
Article 9 bis
(nouveau)
Prise en charge par les employeurs d'une partie des
intérêts des prêts immobiliers des salariés
primo-accédants
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de soutenir l'accession à la propriété pour les primo-accédants en laissant la possibilité aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des intérêts d'un crédit immobilier.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le droit existant
L'accès à la propriété pour les primo-accédants en France est devenu particulièrement difficile depuis plusieurs années. Cette tendance s'explique par le durcissement des conditions d'octroi de crédit, et notamment par l'exigence d'un apport personnel beaucoup plus élevé. Entre 2019 et 2024, le nombre de primo-accédants a chuté de 36,2 %, soit une baisse de 228 400 ménages. Ce recul s'explique en partie par le renforcement des politiques bancaires, obligeant les ménages modestes à présenter un apport supérieur de 40 % par rapport à 2019. Cette contrainte exclut de nombreux candidats à l'achat de leur première résidence principale.
Les entreprises françaises disposent de leviers pour faciliter l'accès à la propriété de leurs salariés, en particulier grâce à des partenariats avec Action Logement. Le prêt accession action logement, proposé à un taux préférentiel de 1 %, peut atteindre 30 000 euros pour un achat immobilier dans le neuf ou l'ancien et se cumule facilement avec d'autres prêts aidés comme le prêt à taux zéro ou le prêt d'accession sociale. Certaines grandes entreprises travaillent également avec l'entreprise Sofiap319(*), permettant à leurs salariés d'accéder à des prêts subventionnés où l'employeur prend en charge une partie des intérêts. Ce type de prêt, à des conditions largement plus favorables que celles du marché, augmente sensiblement la capacité d'achat et représente un avantage valorisé jusqu'à 15 000 euros, bénéficiant d'une exonération partielle de contributions et de cotisations sociales. D'autres dispositifs, moins connus, existent comme l'avance Loca-Pass pour le dépôt de garantie ou des primes d'aide à l'installation, rendant ainsi l'accession à la propriété plus accessible et sécurisée pour les primo-accédants.
B. Le dispositif proposé
L'article 9 bis, introduit par un amendement du député Lionel Causse320(*), identique à un amendement du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, complèterait la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation par un nouvel article L. 313-6-1 qui disposerait que :
- les employeurs occupant au moins 50 salariés, à l'exception des organismes publics, « peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n'ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté » ;
- l'employeur verse chaque mois au salarié la somme correspondante et que la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de cette somme ;
- les sommes versées sont exonérées de cotisations sociales et de contributions patronales, dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale321(*), à l'exception de la contribution sociale généralisée322(*), du forfait social323(*) et de la contribution au remboursement de la dette sociale324(*).
L'article 9 bis souhaiterait également compléter l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant les sommes versées par l'employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue à l'article précité du code de la construction et de l'habitation à la liste des exclusions de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
II - La position de la commission
La commission considère que cet article viendrait créer une nouvelle niche sociale et affecterait ainsi, même modestement, l'objectif global de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. De plus, il créerait une distorsion entre les entreprises car le dispositif ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés.
La commission considère que si les entreprises peuvent librement accompagner les salariés dans l'accès au logement, cette aide ne doit pas être exemptée de contributions et cotisations sociales.
La ministre du budget et des comptes publics, Amélie de Montchalin, considère que la mise en place d'un forfait social à 20 % comme proposé dans le dispositif pourrait entraîner « un coût de centaines de millions d'euros voire de milliards d'euros »325(*).
La commission a adopté un amendement n° 606 de suppression du présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 9 ter
(nouveau)
Harmonisation du calcul des cotisations et contributions sociales
pour les agriculteurs louant des meublés de tourisme
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose une précision rédactionnelle, relative à l'harmonisation du calcul des cotisations et contributions sociales pour les agriculteurs louant des meublés de tourisme.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La rédaction de l'article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime organise déjà l'harmonisation des contributions sociales et des cotisations sociales pour les agriculteurs louant des meublés de tourisme
L'article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme des exploitations agricoles sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l'article 50-0 du code général des impôts, mais dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés du tourisme à l'échelle locale326(*).
L'article 50-0 du code général des impôts définit l'assiette et le taux de l'imposition sur les sociétés.
La loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés du tourisme à l'échelle locale a modifié le régime fiscal des meublés de tourisme en abaissant l'abattement fiscal :
- à 50 % pour les meublés classés et chambres d'hôtes dans la limite de 77 700 euros de revenus locatifs annuels (contre auparavant 71 % dans la limite de 188 700 euros) ;
- à 30 % pour les meublés non classés dans la limite de 15 000 euros de revenus locatifs annuels (contre aujourd'hui 50 % dans la limite de 77 700 euros).
L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025327(*) a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de tourisme. Son adoption a permis d'aboutir à l'écriture actuelle de l'article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime.
L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale présente les conditions d'assujettissement à la contribution des revenus professionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. L'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit justement que les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assises sur l'assiette de l'article précitée du code de la sécurité sociale.
B. Le dispositif vise à effectuer une modification déjà inscrite dans le code rural et de la pêche maritime
L'article 9 ter, introduit par amendement du député Julien Dive, prévoit à son I d'insérer de l'article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime la mention à l'article L. 136-14 du code de la sécurité sociale afin de clarifier le fait que les dispositions de cet article L. 136-14 s'appliquent bien à l'assiette sociale de la location meublée de tourisme.
Le Gouvernement et le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ont émis un avis favorable à l'amendement.
II - La position de la commission
Cet article vient inscrire dans la loi une disposition déjà existante. En effet, l'article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime dispose déjà que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme au sein d'exploitations agricoles relèvent du régime initial de l'article 50-0 du code général des impôts, avant l'adoption de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés du tourisme à l'échelle locale, qui a modifié le régime fiscal des meublés de tourisme328(*).
Toutefois, la commission considère, bien que cette disposition n'entraîne aucun effet dans le droit existant, que l'article permettrait d'effectuer une coordination entre les assiettes visées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale avec l'article L. 731-14-1 A du code rural et de la pêche maritime.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 quater
(nouveau)
Suppression de l'exclusion des tâches
réalisées par des entreprises de travaux forestiers de
l'exonération dégressive pour l'embauche de travailleurs
occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE)
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le bénéfice de l'exonération dégressive de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Les travailleurs occasionnels des entreprises de travaux forestiers sont exclus de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime
1. Présentation du droit existant
L'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient ».
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales.
L'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime dispose à son troisième alinéa que les travailleurs occasionnels pour des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers sont exclus de l'exonération prévue pour les employeurs visés supra.
Le dispositif actuel d'exonération pour les travailleurs saisonniers agricoles prévoit une réduction de 38,96 points sur les cotisations patronales pour les salaires allant jusqu'à 1,25 Smic, relevé à ce niveau par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025329(*), similaire à la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019330(*).
Pour les rémunérations dépassant 1,2 Smic, cette exonération diminue progressivement selon un coefficient de dégressivité défini par décret, jusqu'à s'annuler complètement à 1,6 Smic, comme c'est le cas pour les allègements généraux. Au-delà de ce plafond, seules les réductions ciblées sur les bandeaux famille (1,8 point jusqu'à 3,5 Smic) et maladie (6 points jusqu'à 2,5 Smic) continuent de s'appliquer331(*).
Jusqu'à 1,6 Smic, ce régime spécifique reste plus avantageux pour les employeurs agricoles que les allègements de droit commun. Par ailleurs, les exploitants ont la possibilité, conformément au VI de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, de basculer vers les allègements dégressifs standard si la durée d'emploi du saisonnier dépasse 119 jours par année civile.
2. Historique du dispositif et présentation de ses principaux enjeux
Le principe d'une exonération spécifique de cotisations sociales pour l'emploi de travailleurs saisonniers agricoles, déjà ancien, vise à soutenir la compétitivité des entreprises agricoles. Le travail saisonnier représente plus de 30 % des heures travaillées du salariat agricole332(*). L'article 62 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture333(*) a introduit pour la première fois un dispositif de réduction des taux de cotisations d'assurances sociales dues pour ces travailleurs, calculée sur le salaire réel. Auparavant, les cotisations étaient calculées sur une base forfaitaire prévue par arrêté, ce qui permettait une exonération de moitié.
Le dispositif a évolué à plusieurs reprises, notamment lors de la refonte des allègements généraux opérée par l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019334(*). Initialement, cet article prévoyait la suppression pure et simple du régime d'exonération lié à l'emploi des travailleurs occasionnels et des demandeurs d'emploi, mais il avait été finalement décidé de le maintenir temporairement avant son basculement vers les allègements généraux.
L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021335(*) a repoussé son abrogation au 1er janvier 2023 mais l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025336(*) a prévu la pérennisation de l'exonération à champ constant.
Le dispositif bénéficiait en 2023 à plus de 69 541 exploitations agricoles pour 913 943 contrats concernés. Le salaire moyen versé aux saisonniers agricoles (1,14 Smic) et la durée moyenne plutôt courte (21 jours) rendent l'exonération totale dans la plupart des cas337(*).
B. L'article vise à élargir aux entreprises de travaux forestiers l'exonération dégressive pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TODE)
L'article 9 quater, introduit par l'amendement n° 1202 du député Julien Dive, identique à l'amendement n° 1700 du rapporteur général de la commission des affaires sociales Thibault Bazin, modifie l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime en supprimant l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers du dispositif.
La députée Katiana Levavasseur indique en séance publique que les entreprises de travaux forestiers « sont injustement exclues [du dispositif d'exonération] alors qu'elles réalisent les mêmes tâches que les exploitants agricoles, comme l'entretien, le reboisement, les coupes ou encore le débroussaillage »338(*).
II - La position de la commission
La commission considère, comme les années précédentes, qu'il n'est pas opportun d'élargir de nouveau la réduction « TO-DE » à un nouveau secteur, a fortiori dans le contexte budgétaire actuel.
Par ailleurs, le présent article est proche d'amendements régulièrement présentés à l'Assemblée nationale et au Sénat lors des discussions des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Dans le cas du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, onze amendements de ce type ont été rejetés, après avoir reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
La commission relève toutefois des divergences de chiffrage entre le Gouvernement et la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le présent article ne vise que les entreprises de travaux forestiers (ETF), ce qui, selon la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, restreint son coût à 5 millions d'euros339(*). La ministre de l'action et des comptes publics a toutefois considéré que le coût de cet article demeure « compris entre 40 et 80 millions ».
La commission a adopté un amendement n° 607 de suppression du présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 9 quinquies
(nouveau)
Exonération de cotisations à la mutualité
sociale agricole des dons en nature effectués par les agriculteurs
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'exonérer de cotisations à la mutualité sociale agricole les dons en nature effectués par les agriculteurs.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le droit en vigueur
L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution due au titre de l'activité des travailleurs indépendants agricoles est assise sur le montant des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent. Il énumère ensuite la liste des produits exclus d'une telle contribution.
L'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles définit l'aide alimentaire comme « la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ».
Pour information, l'article 238 bis du code général des impôts fixe les modalités de la réduction d'impôt pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
B. Le droit proposé
L'article 9 quinquies, introduit par l'amendement n° 886 du député Guillaume Garot, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, vise à modifier l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale en précisant que « le montant des dons en nature de produits [...] effectuée à destination de personnes morales habilitées au titre de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles » serait exclu des produits faisant l'objet d'une contribution sociale au titre de l'activité des travailleurs indépendants agricoles.
Le dispositif ne prévoit pas de plafond à l'exemption.
II - La position de la commission
La commission considère, au regard de la situation des comptes sociaux, qu'il n'est pas opportun de créer une nouvelle niche sociale.
La commission a adopté un amendement n° 608 de suppression du présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 9 sexies
(nouveau)
Extension du dispositif de la Lodéom aux chambres
d'agriculture
et aux chambres de commerce et d'industrie des outre-mer
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le dispositif de la Lodéom aux chambres d'agriculture et aux chambres de commerce des outre-mer.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le droit existant
L'article L. 510 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chambres d'agriculture ont une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elles assurent la mise en oeuvre d'un service public industriel et commercial et relèvent donc de ce statut.
L'ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 et la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche leur confient de larges missions auprès des agriculteurs. Elles assurent l'accompagnement technique et économique des exploitations agricoles, la formation professionnelle des agriculteurs, la participation à l'aménagement du territoire rural, et la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics. Leur financement repose principalement sur la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, acquittée par les propriétaires fonciers, complétée par des prestations de services facturées aux exploitants et des subventions publiques ciblées340(*).
L'article L. 710-1 du code de commerce dispose que les chambres de commerce et d'industrie représentent les entreprises commerciales, industrielles et de services implantés sur leur territoire. Elles exercent des missions d'appui au développement économique, par l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises, les services à l'export et à l'internationalisation, la gestion d'infrastructures économiques tels que les ports maritimes, les aéroports et la formation professionnelle via leurs établissements d'enseignement supérieur. Leur financement provient de la taxe pour frais de chambres, calculée sur la cotisation foncière des entreprises, ainsi que des revenus générés par leurs activités commerciales et la gestion de leurs équipements.
Les dispositions de la loi pour l'ouverture et le développement économique des outre-mer (Lodéom) visent à dynamiser l'emploi salarié ultramarin en proposant une exonération dégressive de cotisations patronales. Le dispositif est critiqué par l'inspection générale des finances, qui le considère inefficient et peu lisible341(*).
La commission renvoie au commentaire de l'article 9 pour davantage de précisions sur le dispositif de la Lodéom.
B. Le droit proposé
L'article 9 sexies, introduit par l'amendement n° 1977 de la députée Béatrice Bellay, complèterait l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, en disposant que l'exonération s'appliquerait aux chambres d'agriculture342(*) et aux chambres de commerce et d'industrie343(*).
L'avis du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des affaires sociales sur l'amendement étaient défavorables344(*).
II - La position de la commission
La commission considère que les dispositifs de la loi pour l'ouverture et le développement économique de l'outre-mer345(*) (Lodéom) doivent faire l'objet d'une concertation avec les acteurs économiques locaux afin de réformer l'ensemble du dispositif, particulièrement coûteux et qui manque de lisibilité. Elle considère aussi qu'il n'est pas opportun d'étendre son champ.
La commission relève également que les allègements généraux de cotisations patronales et les exonérations spécifiques, comme la Lodéom, ne concernent que les employeurs assujettis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage. Les chambres consulaires, en tant qu'établissements publics administratifs employant majoritairement des agents publics, en sont donc exclues, d'autant que leur budget repose principalement sur des subventions et une fiscalité affectée. Bien que ces chambres exercent à la fois des missions de service public et des activités industrielles et commerciales, étendre ces exonérations soulève des difficultés pratiques majeures. En effet, il est complexe de distinguer, pour un même agent, les tâches relevant d'une activité concurrentielle de celles liées au service public.
La commission insiste ainsi sur le fait qu'il est risqué de brouiller la frontière entre des entreprises concurrentielles et des organismes parapublics. L'adoption de l'article pourrait contraindre les chambres à dissocier leurs activités afin de respecter le droit de la concurrence et nuirait in fine à la cohérence des politiques publiques qu'elles déploient.
Elle a donc adopté l'amendement n° 609 de suppression du présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 9 septies
(nouveau)
Réintégration de certaines entreprises d'armement
maritime
dans le dispositif d'exonération de contributions
sociales
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de réintégrer les navires de fret et la plupart des navires de service dans le dispositif d'exonérations de contributions patronales d'assurance chômage et d'allocations familiales.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le droit en vigueur
Le régime spécial de sécurité sociale des marins, géré par l'Établissement national des invalides de la marine (Énim), repose sur un système de cotisations calculées non sur le salaire réel mais sur un salaire forfaitaire fixé par arrêté pour chacune des 280 fonctions maritimes. Les entreprises d'armement bénéficient actuellement de deux types d'exonérations : les « charges Enim » (cotisations maladie et vieillesse) instituées en 2005 pour tous les armateurs, et les « charges non-Enim » (allocations familiales et assurance chômage) créées en 2007346(*) pour les navires de passagers puis étendues en 2016347(*) à l'ensemble des navires de commerce par la loi pour l'économie bleue. Ces exonérations visent à renforcer la compétitivité des navires français face à la concurrence internationale.
L'article L. 5553-11 du code des transports soumet le bénéfice des exonérations « charges non-Enim » à des conditions cumulatives. Le navire doit battre pavillon français ou d'un État membre de l'Union européenne, ou partir à l'Espace économique européen ou de la Suisse et être dirigé depuis un établissement stable en France. Il doit être affecté à des activités soumises à une concurrence internationale conformément aux orientations européennes348(*) Au moins 25 % de l'équipage doit être composé de ressortissants européens ou suisses. En 2021, ce dispositif concernait 382 navires et environ 10 000 marins, soit un tiers des affiliés Enim, représentant un manque à gagner de cotisations estimé à 47 millions d'euros349(*).
L'interprétation extensive de la notion de « concurrence internationale » inclut des activités peu exposées comme le transport fluvial ou le nettoyage de navires à quai, interrogeant la pertinence du dispositif. Par ailleurs, les rémunérations élevées des marins sur les navires de fret et de service démontrent une faible sensibilité à la compétitivité-prix. Seuls les navires de transport de passagers, employant des personnels moins qualifiés, sont réellement exposés à une concurrence internationale significative basée sur les coûts salariaux350(*).
L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025351(*) a recentré les exonérations employeur de cotisations familiales et de contributions à l'assurance chômage au bénéfice des seuls navires de transports de passagers. Lors de la commission mixte paritaire du même projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025352(*), il a été en outre décidé de maintenir l'exonération pour les navires câbliers et les navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables, compte tenu du caractère stratégique de ces activités.
B. Le dispositif proposé
L'article 9 septies, introduit par l'amendement n° 388 du député Didier Le Gac, vise à modifier l'article L. 5553-11 du code des transports afin de réintégrer l'ensemble des entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article dans le champ de l'exonération des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'assurance chômage.
Les entreprises concernées seraient toutes celles qui affectent des navires à des activités de transport ou à des activités de services maritimes qui relèvent des orientations de l'Union européenne sur les aides d'État au transport maritime et qui sont soumises à titre principal à une concurrence internationale.
II - La position de la commission
La commission considère qu'il n'est pas opportun de revenir sur l'équilibre trouvé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025353(*).
En outre, la commission estime que le contexte budgétaire ne permet pas de rajouter de nouveaux dispositifs qui élargissent le champ des niches sociales existantes.
Elle a donc adopté un amendement n° 610 tendant à supprimer le présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article
10
Transférer le rendement de la clause de sauvegarde
au sein
d'une nouvelle contribution
Cet article prévoit de transférer le rendement actuel de la clause de sauvegarde (dont le mécanisme serait maintenu) au sein de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques due au titre de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Il prévoit ainsi la création d'une contribution individualisée, dite « supplémentaire », sur le chiffre d'affaires de chaque entreprise.
La commission propose de supprimer cette réforme non concertée.
I - Le dispositif proposé
A. La clause de sauvegarde est devenue un outil de régulation budgétaire pérenne
1. Conçue comme un outil de régulation de dernier recours, la clause de sauvegarde a été profondément réformée en 2024
Créée par la LFSS pour 1999354(*), la clause de sauvegarde avait alors été conçue comme une « corde de rappel » budgétaire, destinée à permettre le respect de l'Ondam dans le cas où les outils de régulation infra-annuelle et microéconomique du secteur (remises355(*), baisses de prix négociées avec le CEPS356(*), etc.) ne permettraient pas de respecter le niveau de dépenses d'assurance maladie prévu.
Le dispositif a, depuis, subi de nombreuses modifications. Ainsi, il a vu depuis 2014 ses modalités de calcul modifiées quasiment chaque année. La LFSS pour 2024357(*) a profondément réformé l'assiette, les modalités de liquidation et d'appel de la clause de sauvegarde à compter du 1er janvier 2026, date repoussée au 1er janvier 2027 par la LFSS pour 2025358(*).
a) La clause de sauvegarde des médicaments est conçue comme un filet de sécurité budgétaire exceptionnel visant à respecter les objectifs de dépense
Lorsque le chiffre d'affaires, minoré des remises, réalisé au cours d'une année civile par l'ensemble des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est supérieur à un montant M fixé annuellement en LFSS, l'ensemble de ces entreprises est assujetti à une contribution, affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)359(*). Cette contribution ou « clause de sauvegarde » est conçue comme un outil de régulation budgétaire en dernier ressort ayant pour objectif d'inciter les industriels à maîtriser l'évolution de leur chiffre d'affaires.
• Un barème progressif est appliqué sur le chiffre d'affaires au-delà du montant M :
- la part entre le montant M et 1,005 fois ce montant est soumise à un taux de prélèvement de 50 % ;
- la part comprise entre 1,005 et 1,010 fois le montant M à un taux de 60 % ;
- la part supérieure à 1,010 fois le montant M, enfin, est soumise à un taux de 70 %.
• Le montant de la contribution collective est ensuite réparti individuellement en chaque entreprise :
- à concurrence de 70 %, au prorata de leur chiffre d'affaires - part dite « activité » ;
- à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente - part dite « croissance ».
• Des règles de plafonnement et d'abattement peuvent, enfin, conduire à moduler la contribution due par chaque entreprise :
D'une part, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut, en principe, excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des médicaments concernés réalisé en France métropolitaine et dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer concernés360(*).
D'autre part, un mécanisme d'abattement est prévu par le code de la sécurité sociale361(*) :
- les entreprises qui ont conclu avec le comité économique des produits de santé (CEPS) une convention362(*) portant sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments qu'elles exploitent peuvent signer un accord prévoyant le versement de l'ensemble ou d'une partie de la contribution « M » due au titre de la clause de sauvegarde sous forme de remises dites « exonératoires » versées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Si les remises « exonératoires » ainsi versées sont supérieures ou égales à 95 % du montant de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde (« contribution M »), alors l'entreprise est exonérée de cette dernière ;
- peuvent également être exonérées de la contribution au titre de la clause de sauvegarde (« contribution M »), les entreprises ayant accepté conventionnellement une baisse de prix net d'une ou plusieurs spécialités qu'elles exploitent dans les cas suivants :
o si les économies pour l'Assurance maladie générées par ladite baisse des prix sont inférieures ou égale à 0,70 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, alors cette dernière est exonérée de la « contribution M » lorsque le montant des remises « exonératoires » qu'elle verse représente 90 % du montant qu'elle aurait dû verser au titre de la « contribution M » ;
o ce dernier taux est abaissé à 85 % si les économies pour l'Assurance maladie sont comprises entre 0,70 % et 3 % du chiffre d'affaires et à 80 % lorsque les économies sont supérieures à 3 % du chiffre d'affaires363(*) ;
• L'assiette de la clause de sauvegarde a été progressivement élargie pour comprendre l'ensemble des médicaments pris en charge, entièrement ou partiellement, par l'assurance maladie.
Celle-ci correspond au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques.
Sont pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires les médicaments364(*) :
- dispensés en ville et inscrits au remboursement ;
- inscrits sur la liste de rétrocession et pouvant, en conséquence, être rétrocédés par des pharmacies à usage intérieur à des patients ;
- pris en charge en sus de la tarification à l'activité hospitalière et relevant de la « liste en sus » pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) ou de soins de suite de réadaptation (SSR) ;
- bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle ou d'une autorisation d'importation parallèle ;
- bénéficiant du régime dérogatoire de prise en charge à l'issue de la période d'accès précoce ;
- ceux pris en charge au titre de l'accès direct.
Depuis la LFSS pour 2023, sont également intégrés à l'assiette les médicaments acquis par Santé publique France pour faire face aux menaces sanitaires graves ou aux défaillances du marché. Les LFSS pour 2024 et 2025 ont quant à elles prévu un plafonnement pour les spécialités génériques.
Le chiffre d'affaires, ainsi calculé, est minoré du montant des remises conventionnelles consenties par les exploitants lors de la négociation avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) du prix de leurs spécialités.
L'assiette de la clause de sauvegarde des médicaments ne comprend ainsi que la part des ventes du secteur pharmaceutique ayant, in fine, donné lieu à une prise en charge totale ou partielle de l'assurance maladie.
Calcul de la clause de sauvegarde collective pour l'industrie pharmaceutique jusqu'au 1er janvier 2027*
* Que cet article ne propose pas de modifier.
Source : Commission des affaires sociales
La procédure de déclaration et de recouvrement de la clause de sauvegarde prévoit que les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un Urssaf la déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année avant le 1er avril de l'année n+1. Après phases d'analyse et d'échanges entre l'Urssaf, le CEPS et l'Acoss, le montant de la contribution due est transmis avant le 1er octobre pour un paiement qui doit survenir avant le 1er novembre de l'année n+1.
b) La LFSS pour 2024 a réformé la clause de sauvegarde des médicaments
La clause de sauvegarde des médicaments a été profondément réformée par la LFSS pour 2024 afin de simplifier la procédure de liquidation et d'appel de la clause en la rapprochant de celle applicable aux dispositifs médicaux. Cette réforme - que le présent article ne propose pas de modifier - doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquera, en conséquence, à la contribution due par les entreprises au titre de l'année 2026365(*).
• Cette réforme de la LFSS 2024 modifie, d'abord, l'assiette de la clause pour asseoir celle-ci non plus sur le chiffre d'affaires des entreprises, mais sur le montant remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l'année civile, minoré des remises consenties par les entreprises, des marges des distributeurs, des honoraires de dispensation et des taxes en vigueur.
Elle révise, en conséquence, la règle de calcul de la contribution en prévoyant que celle-ci sera égale, désormais, à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant M.
La contribution demeure, en revanche, répartie entre les entreprises assujetties, à concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elles exploitent, importent ou distribuent et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de ce montant remboursé par rapport à l'année précédente.
Enfin, le plafond de la contribution due par chaque entreprise est également adapté à la nouvelle assiette. Celui-ci ne s'élèvera plus à 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes, mais à 12 % du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue.
Calcul de la clause de sauvegarde collective pour
l'industrie pharmaceutique
à partir du 1er janvier
2027*
* Que cet article ne propose pas de modifier.
Source : Commission des affaires sociales
• La LFSS pour 2024 a, en conséquence, également revu les modalités de liquidation et d'appel de la clause.
Il n'appartiendra plus à chaque entreprise de déclarer son chiffre d'affaires, mais à la Cnam, à l'Atih et à Santé publique France de transmettre à l'Urssaf Caisse nationale, avant le 15 juillet de l'année n+1 et selon des modalités prévues par décret, les montants totaux remboursés par l'assurance maladie pour chaque entreprise. Le CEPS demeure, lui, chargé de transmettre à l'Urssaf Caisse nationale, pour la même date, les montants des remises prises en compte pour les entreprises redevables.
Le Gouvernement avait alors défendu cette réforme en indiquant que celle-ci visait à alléger les contraintes déclaratives des entreprises et résoudre les difficultés de liquidation et de recouvrement observées ces dernières années. Les règles actuelles faisant dépendre le calcul de la clause des déclarations transmises par les entreprises, chaque erreur ou retard individuel est, en effet, susceptible de ralentir la procédure collective de liquidation.
La commission avait quant à elle formulé des inquiétudes quant aux potentielles conséquences sur la répartition de la charge entre entreprises. Les entreprises concentrant leur activité sur des produits avec un taux de prise en charge élevé, notamment les médicaments innovants, seraient nécessairement soumis à un effort plus important. Par ailleurs, la commission avait regretté l'absence de documentation et d'étude d'impact réellement poussée sur les effets de cette réforme. C'est pourquoi, à l'initiative de la rapporteure générale, le Sénat avait repoussé au 1er janvier 2027 la mise en oeuvre de cette réforme. Force est de constater que l'absence de données sur les effets redistributifs de la réforme est toujours d'actualité.
2. Le fort dynamisme des dépenses de médicaments a considérablement augmenté le rendement de la clause de sauvegarde
La clause de sauvegarde sur le médicament a été presque systématiquement déclenchée ces dernières années, et ce, alors même que, par nature, le déclenchement de la clause n'est censé intervenir que de manière exceptionnelle. Tant et si bien que le rendement de la clause de sauvegarde est désormais pleinement intégré dans les hypothèses financières du Gouvernement lors de l'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale.
a) Le dynamisme des dépenses et l'insuffisance des outils de régulation
• Portées par le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques et les d'innovations récentes, les ventes de médicaments ont connu une croissance soutenue ces dernières années.
D'après le CEPS, le chiffre d'affaires global hors taxes des médicaments remboursables s'est ainsi établi, en 2024, à 37,4 milliards d'euros. En hausse de près de 7 % par rapport à 2023366(*).
Une telle tendance apparaît dans les deux principales catégories de dépenses :
- les médicaments délivrés en pharmacies d'officine, dont les ventes progressent de 6 % entre 2023 et 2024 pour atteindre 26,4 milliards d'euros. Cette progression est toutefois moins forte que les trois années précédentes (8,4 % en 2021, 9,7 % en 2022 et 7,7 % en 2023) ;
- le chiffre d'affaires hors taxes des médicaments hospitaliers remboursables, qui comprennent les médicaments inscrits sur la liste en sus des prestations d'hospitalisation, ceux rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur et ceux bénéficiant de dispositifs d'accès dérogatoires progresse de 8,5 % en 2024 pour atteindre environ 10,8 milliards d'euros. En son sein, les ventes de médicaments inscrits sur la liste en sus représentent la plus grande part avec 7,7 milliards d'euros, en hausse de 14,4 % par rapport à 2023.
Ventes de médicaments remboursables (2012-2024)
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données publiées par le CEPS (2025)
Dans un périmètre différent, incluant les médicaments rétrocédés comme les remises conventionnelles consenties par les industriels à l'assurance maladie, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux fait état d'une augmentation de la consommation de médicaments en ambulatoire de 5,5 % entre 2023 et 2024. Cette progression, constatée pour la quatrième année consécutive, contraste avec une baisse presque continue observée entre 2014 et 2020367(*).
• Deux principaux outils de régulation microéconomique permettent au CEPS de maîtriser l'augmentation des dépenses de l'assurance maladie, sans toutefois suffire à contenir le dynamisme observé ces dernières années.
D'une part, le comité procède à des campagnes de baisse de prix sur des produits d'ores et déjà inscrits au remboursement, selon des critères fixés par le code de la sécurité sociale ou dans certaines situations prévues par l'accord-cadre conclu avec Les entreprises du médicament (Leem)368(*).
Les économies attendues des baisses de prix sont, chaque année, précisées dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros. D'après le CEPS, ces baisses de prix se sont élevées, en 2024, à près de 994 millions d'euros (dont 663 millions d'euros de baisses dans le champ ville). L'annexe 5 au PLFSS pour 2025 prévoit un objectif de baisse de prix des médicaments et dispositifs médicaux pour 1,4 milliard d'euros.
Économies permises par les baisses de prix (2012-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données publiées par le CEPS (2025)
D'autre part, le CEPS négocie avec les entreprises des remises, remboursées par l'exploitant à l'assurance maladie sans venir pour autant réduire le prix facial affiché. Deux principaux types de remises peuvent être distingués369(*) :
- les remises dites « produits », qui peuvent être subordonnées à la réalisation d'une ou plusieurs conditions - accord prix/volume, plafonnement de la dépense totale, etc. - ou, au contraire, inconditionnelles - remises « à la première boîte » ;
- les remises associées aux procédures d'accès dérogatoires.
Remises « produits » et « accès dérogatoires » brutes (2012-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données publiées par le CEPS (2025) - montant des remises accès dérogatoires 2024 non disponible à date
Dans l'annexe au PLFSS déposé relative à l'Ondam370(*), le Gouvernement fait état d'une accélération de la progression des dépenses d'assurance maladie relatives aux produits de santé depuis 2019. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen des dépenses suivies s'est établi pour la période 2019-2023, hors covid-19, à 2,8 % : 2,1 % pour les médicaments et 3,7 % pour les dispositifs médicaux. En 2024, les dépenses de médicaments remboursés après déduction des remises et de la clause de sauvegarde ont progressé de + 5,7 %371(*).
Selon l'annexe précitée, sur la période cumulée 2024-2025, les produits de santé super nets372(*) progresseraient de + 3,7 % par an, soit environ un point plus rapidement que sur la période 2019-2023. La plus faible hausse du rendement des remises par rapport aux années précédentes expliquant en partie cette évolution373(*).
Malgré le maintien d'une forte dynamique spontanée de la dépense prévue pour 2026 (+ 6,6 %, après + 6,4 % pour 2025 en PLFSS 2025 et + 7,2 % en 2024), les dépenses de produits de santé super nettes se stabiliseraient (- 0,2 %, dont - 1,3 % pour les médicaments et + 2,7 % pour les dispositifs médicaux) en raison de mesures d'économies sur les produits de santé portées à 3,1 milliards d'euros, après 2,1 milliards d'euros en 2025 et 1,3 milliard d'euros en 2024.
b) L'augmentation du rendement de la clause de sauvegarde
• Sous l'effet du dynamisme des dépenses de médicaments précédemment évoqué et du fait de l'insuffisance des mécanismes de régulation microéconomique, la clause de sauvegarde, pourtant conçue comme devant être exceptionnelle, a agi ces dernières années en véritable dispositif fiscal, au rendement comparable à celui des outils de régulation traditionnellement mobilisés par le CEPS.
Depuis 2022, le Gouvernement tient d'ailleurs compte de cette évolution en anticipant, désormais, un déclenchement du dispositif et en estimant, en conséquence, un rendement attendu dans les annexes jointes aux PLFSS déposés.
Surtout, le produit de la clause de sauvegarde a très fortement augmenté ces dernières années. Alors qu'il demeurait, depuis 2015, inférieur à 200 millions d'euros, il s'est établi à 671 millions d'euros pour 2021 et 1,6 milliard d'euros pour 2023, d'après l'annexe 9 au PLFSS pour 2026.
Le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2023 soulignait l'importance prise par le dispositif, en indiquant que celui-ci suffit à ramener le taux de croissance annuel moyen des dépenses de produits de santé, pour la période 2019-2022, de 3,4 % à 2,5 %.
• Les LFSS pour 2024 et 2025 ont cherché à maîtriser cette croissance du rendement de la clause de sauvegarde en fixant un montant permettant d'assurer un niveau de rendement.
La LFSS pour 2024 a notamment révisé à la hausse le montant M pour 2023, réduisant de 120 millions d'euros la recette attendue au titre de la même année pour la maintenir à 1,6 milliard d'euros. La même loi a, d'autre part, fixé le montant M pour 2025 à 26,4 milliards d'euros, de manière à contenir le rendement de la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2024 au même montant de 1,6 milliard d'euros. Toutefois, preuve des difficultés d'estimation de ce montant, le rendement effectif de la clause au titre de l'année 2024 (et payé en 2025) devrait légèrement dépasser la prévision (1,7 milliard d'euros, soit + 0,1 milliard d'euros)374(*).
La LFSS pour 2025 avait fixé le montant M à 27,25 milliards d'euros permettant ainsi selon l'étude d'impact une progression de 5,6 % des dépenses tout en assurant une stabilisation du rendement de la clause de sauvegarde à 1,6 milliard d'euros.
Produit de la clause de sauvegarde des médicaments après abattements
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, sur la base de données publiées par le CEPS (2025)
La clause de sauvegarde et les mécanismes de remises constituent désormais une importante source de recettes avec un fort dynamisme pour l'Assurance maladie. Ainsi, les recettes issues des remises conventionnelles et de la clause de sauvegarde devraient augmenter de 16,3 % en 2025 et de 13,3 % en 2026375(*).
B. La contribution sur le chiffre d'affaires des industries pharmaceutiques
L'article 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a supprimé la taxe jusqu'alors prévue à l'article 1600-0 N du code général des impôts pour la remplacer par une contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Ledit article L. 245-6 du code de la sécurité sociale prévoit une contribution, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, portant sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques qui assurent l'exploitation, l'importation parallèle et la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques commercialisées en France. Cette contribution est composée d'une section dite « de base » et d'une section dite « additionnelle ». Son rendement est évalué à 1,2 milliard d'euros en 2024 et 2025376(*).
L'assiette de la contribution dite « de base » concerne le chiffre d'affaires hors taxes relatif aux spécialités pharmaceutiques ci-dessous mentionnées, que celles-ci soient ou non remboursables et/ou prises en charge par l'Assurance maladie. Elle porte donc sur l'ensemble des médicaments bénéficiant d'un enregistrement et ceux bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nationale ou européenne.
Le taux de cette contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France a été relevé à 0,20 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et n'a pas été modifié depuis.
Sont exclus certains médicaments génériques ne faisant pas l'objet d'un remboursement sur la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité ou dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du même groupe et les médicaments orphelins.
L'assiette de la contribution dite « additionnelle » est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes relatif aux spécialités pharmaceutiques inclus dans l'assiette dans la contribution dite « de base » et qui sont remboursables par l'Assurance maladie.
Le taux de cette contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France a été relevé à 1,6 % depuis sa mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Certains médicaments connaissent donc un taux agrégé de 1,8 %.
Pour la contribution dite « de base » comme pour la contribution « additionnelle », le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par l'entreprise. Le champ des « remises accordées par l'entreprise » fait l'objet d'un certain nombre de contentieux qui ont amené le Gouvernement à intégrer dans le PLFSS des dispositions interprétatives développées ci-après.
C. L'article opère le transfert du rendement de la clause de sauvegarde au sein d'une contribution supplémentaire dû au titre de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale
Le présent article prévoit de transférer le rendement actuel de la clause de sauvegarde au sein de la contribution due au titre de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Une contribution, dite « supplémentaire », est ainsi créée au sein de cette contribution, qui comporte déjà deux sections dites « de base » et « complémentaire ». Le périmètre des spécialités relevant de cette contribution « supplémentaire » est aligné sur celui de la clause de sauvegarde, dont les paramètres ne sont pas modifiés.
Le calcul de cette nouvelle section est individualisé, renforçant ainsi la lisibilité du montant dû par chaque entreprise. Le taux appliqué pourra être revu annuellement et sera minoré pour les spécialités génériques afin de limiter l'ampleur de la contribution due au titre de ces spécialités.
En contrepartie, le montant M est rectifié pour 2025 et fixé pour 2026 à un niveau permettant d'assurer un rôle de filet de sécurité et d'éviter une augmentation au global de la taxation des entreprises du secteur.
Enfin, l'article prévoit plusieurs dispositions de validation législative et interprétatives afin de préciser les modalités de calcul de l'assiette servant au calcul de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde et de la contribution au titre de l'article L. 245-6.
1. Précisions relatives à l'assiette de la clause de sauvegarde
Le 1° et le 2° du présent article visent à préciser, d'une part, que les remises commerciales mentionnées à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas déduites de l'assiette de calcul de la clause de sauvegarde (L. 138-10 et L. 138-11) et, d'autre part, les modalités de prise en compte des situations donnant lieu à des assiettes individuelles négatives.
Le 2° modifie ainsi l'article L. 138-11 afin de préciser que si la différence entre le chiffre d'affaires et le montant des remises minorées est négative alors les remises ne sont pas déduites de l'assiette de la contribution.
Les remises commerciales (article L. 138-9 du code de la sécurité sociale)
Le code de la sécurité sociale autorise les exploitants de médicaments à consentir des remises, ristournes et avantages commerciaux aux pharmacies d'officine, destinés à favoriser la pénétration de leurs produits et à adapter son prix aux réalités économiques.
Le code de la sécurité sociale prévoit que les gestes commerciaux consentis aux pharmacies d'officine par les fournisseurs doivent, sous peine de sanctions, être déclarés au Comité économique des produits de santé (CEPS).
Ces gestes commerciaux sont plafonnés par le code de la sécurité sociale, à hauteur :
- de 2,5 % du prix fabricant hors taxes (PFHT), pour l'ensemble des médicaments ;
- de 50 %, au plus, du PFHT, pour les médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du même groupe générique ou les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. Cette liste a été étendue par la LFSS pour 2025 aux médicaments biosimilaires et hybrides.
2. Validations législatives
Ces modifications sont accompagnées de deux mesures de validation législative prévues aux II et III du présent article.
En effet, comme toute décision administrative, les décisions du CEPS concernant les montants dus au titre de la clause de sauvegarde ou de la contribution sur le chiffre d'affaires au titre de l'article L. 245-6 sont susceptibles de faire l'objet de recours gracieux ou contentieux. Selon le rapport d'activité 2024 du CEPS, une vingtaine de recours sont enregistrés par an : 44 % des requêtes reçues en 2024 concernent les décisions du CEPS relatives à la clause de sauvegarde.
Les validations législatives
La validation législative tend à « soustraire au risque d'annulation par le juge un acte ou une série d'actes qui sont généralement des actes administratifs »377(*).
Au regard de la portée rétroactive de ces mesures et de leur impact potentiel sur la sécurité juridique, la jurisprudence a progressivement fixé plusieurs critères pour que ces mesures soient validées. Elles doivent ainsi :
- respecter les décisions de justice devenues définitives ;
- respecter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
- répondre à un objectif d'intérêt général suffisant à d'impérieux motifs d'intérêt général ;
- et avoir une portée limitée.
Le II prévoit ainsi que les montants dont sont redevables les entreprises au titre de la clause de sauvegarde pour les années 2021-2024 sont validés et ne peuvent plus faire l'objet de recours dès lors que ce recours porte sur :
- l'intégration des remises mentionnées à l'article L. 138-9 dans le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables ;
- la non-déduction de l'assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises (à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9) est négative.
Le III quant à lui vient valider les montants notifiés aux entreprises au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sur la période 2014-2024 qui ne peuvent plus faire l'objet de recours dès lors que ces derniers portent sur la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9. Il valide donc la non-déduction dans l'assiette des remises produits, des remises fixées par le CEPS, des remises relevant des accès dérogatoires et en liens avec des prescriptions hors AMM. Pour rappel, le IV de l'article L. 245-6 prévoit aujourd'hui que le chiffre d'affaires servant d'assiette « s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises ». La rapporteure générale s'étonne de l'étendue de la période couverte par cette mesure de validation législative (dix ans) et s'interroge sur la proportionnalité d'une telle mesure au regard des principes édictés par le Conseil constitutionnel. Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, à l'occasion du contrôle qu'il a exercé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003), une validation de nature strictement financière ne peut être justifiée que si les montants en cause sont susceptibles d'affecter de façon significative les équilibres budgétaires. Ainsi, dans la décision précitée, il a annulé une mesure tendant à valider les actions de recouvrement de la taxe sur la promotion de spécialités pharmaceutiques perçue sur le fondement de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, interprété de façon extensive par l'administration fiscale. Le Conseil a ainsi estimé « qu'eu égard au montant des recouvrements concernés, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ne pouvaient être affectées de façon significative en l'absence de validation ». La rapporteure générale ne dispose pas au moment de la rédaction de ce rapport des montants précis concernés par ces mesures de validation législative. Lors de son audition par la rapporteure générale, le Leem a toutefois estimé que les contentieux concernés pourraient représenter jusqu'à 1 milliard d'euros.
Il est important de noter que toutefois, en l'état, les dispositions des 1° et 2° seront, à compter du 1er janvier 2027, écrasées par la nouvelle rédaction du I de l'article L. 138-10 et de l'article L. 138-11 issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui prévoit une réforme des modalités de calcul de la clause de sauvegarde (cf supra).
3. Instauration de la « contribution supplémentaire »
Le 3° du présent article réécrit l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale afin de mettre en place une « contribution supplémentaire » ayant pour objectif d'intégrer de manière pérenne au budget de l'assurance maladie les recettes issues de la clause de sauvegarde, initialement conçue comme devant être activée de manière exceptionnelle.
• Concernant la contribution qui prend le nom de contribution « de base », le texte déposé ne modifie pas les paramètres de calcul. Il précise explicitement en revanche les remises qui ne doivent pas être déduites de l'assiette de calcul du chiffre d'affaires.
Ainsi, en lien avec la mesure de validation législative présentée ci-avant, la nouvelle rédaction de l'article L. 245-6 précise que ne doivent pas être déduites du chiffre d'affaires servant d'assiette les remises prévues :
- aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2 et L. 162-16-5-2, associées aux procédures d'accès dérogatoires (précoce et compassionnel) ;
- à l'article L. 162-17-5 s'agissant des remises que l'exploitant peut consentir afin de ne pas se voir appliquer les baisses de prix ou de tarif de responsabilité que le CEPS peut mettre en oeuvre au-delà d'un certain niveau de dépenses d'assurance maladie au titre des dispositifs médicaux visés ;
- aux L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dites « produits » qui peuvent être liées à la réalisation d'une condition - accord prix/volume par exemple - ou inconditionnelles comme les remises « à la première boîte ».
En revanche, il précise que les remises dites « commerciales » prévues à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale doivent être déduites du calcul du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution.
· Concernant la contribution « additionnelle », la nouvelle rédaction proposée par l'article 10 complète le périmètre des entreprises soumises à cette contribution. Pour rappel, la contribution additionnelle s'applique aux entreprises soumises à la contribution de base lorsque l'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement et figurent sur certaines listes (liste en sus par exemple). La rédaction proposée élargit ces listes en y ajoutant celles inscrites sur la liste en sus de soins médicaux et de réadaptation (SMR) (article L. 162-23-6) ainsi que les spécialités bénéficiant du régime dérogatoire de prise en charge à l'issue de la période d'accès précoce (L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale).
Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités répondant aux critères applicables à la contribution de base et inscrites sur les listes :
- dispensés en ville et inscrits au remboursement378(*) ;
- inscrits sur la liste de rétrocession et pouvant, en conséquence, être rétrocédés par des pharmacies à usage intérieur à des patients379(*) ;
- pris en charge en sus de la tarification à l'activité hospitalière et relevant de la « liste en sus » pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)380(*) ou de soins de suite de réadaptation (SSR)381(*) ;
- bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'autorisation d'accès précoce382(*) ;
- bénéficiant du régime dérogatoire de prise en charge à l'issue de la période d'accès précoce383(*) ;
- ceux pris en charge au titre de l'accès direct384(*).
• Enfin, la nouvelle rédaction proposée de l'article L. 245-6 crée au III une « contribution supplémentaire » correspondant au transfert le rendement attendu de la clause de sauvegarde en 2025 et 2026. Le rendement attendu de cette taxe par le Gouvernement est donc fixé à 1,6 milliard d'euros.
4. Assiette de la « contribution supplémentaire »
Le périmètre des médicaments relevant de cette contribution supplémentaire fixé au III. A est identique à celui pris en compte dans le cadre du calcul de la clause de sauvegarde.
Toutefois à la différence de la clause de sauvegarde dont le montant est calculé collectivement puis réparti individuellement entre chaque entreprise, le texte prévoit une contribution individualisée définie via deux taux :
- un taux de base assis sur les ventes au cours d'une année civile au titre des spécialités figurant sur les listes mentionnées ci-dessus sans déduction des remises produits (L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022), fixées par le CEPS (L. 162-17-5), relevant des accès dérogatoires et des remises en lien avec les prescriptions hors AMM (L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2 et L. 162-16-5-2) ainsi que des remises commerciales (article L. 138-9) ;
- un taux différencié minoré par rapport au taux de base et s'appliquant aux spécialités génériques afin de limiter le niveau de la contribution due au titre de ces spécialités.
La contribution dite « supplémentaire » est donc calculée sur une assiette différente de celle de la clause de sauvegarde telle que définie à l'article L. 138-10. Pour rappel, la clause de sauvegarde est assise sur une assiette du chiffre d'affaires déduction faite de toutes les remises (chiffre d'affaires « net »). La contribution supplémentaire de l'article L. 245-6 est quant à elle assise sur le chiffre d'affaires « brut » sans déduction de toutes les remises. Le Gouvernement précise dans l'annexe 9 au PLFSS que la non-déductibilité des remises permettra de « soutenir les spécialités dites matures, les génériques, les biosimilaires et les hybrides substituables ». En effet, ces médicaments, à la différence des médicaments innovants, ne bénéficient pas ou très peu de remises.
5. Taux de la « contribution supplémentaire »
Le VIII du présent article fixe les différents taux applicables à cette contribution supplémentaire : 4,24 % en 2025 et 4,01 % en 2026 pour le taux de base et 1,75 % et 1,65 % respectivement en 2025 et 2026 pour le taux différencié. Ces taux devront donc être revus annuellement par le Parlement.
Par ailleurs, comme cela est le cas pour la clause de sauvegarde et afin d'assurer la soutenabilité pour ces entreprises, le montant de la contribution supplémentaire est plafonné à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise minoré des remises à l'exception des remises commerciales.
Concernant les modalités de recouvrement, le texte prévoit, sur le modèle de ce qui existe pour les contributions de base et additionnelle, un mécanisme d'acompte avant le 1er juin de l'année en cours à hauteur de 95 % du produit du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente. La régularisation doit ensuite avoir lieu avant le 1er octobre de l'année n+1.
Enfin, un mécanisme de taxation d'office et de majoration forfaitaire en cas de déclarations manifestement erronées ou d'absence de déclaration dans les délais est institué au V de l'article L. 245-6 dans sa rédaction issue du présent article.
6. Fixation des montants M pour 2025 et 2026
Les V et VII du présent article fixent quant à eux les montants M pour 2025 et 2026.
Le Gouvernement propose ainsi de remonter le montant M adopté en LFSS 2025 en le portant à 30,60 milliards d'euros (contre 27,25 milliards d'euros initialement votés), afin de pouvoir permettre la mise en oeuvre de la contribution supplémentaire dès 2025 tout en évitant que le mécanisme de la clause de sauvegarde ne se déclenche.
Le montant M pour 2026 est fixé à 26,65 milliards d'euros soit un montant sensiblement identique à celui voté en LFSS 2024 (26,4 milliards d'euros). On peut noter que ce montant en 2024 avait déjà vocation à contenir le rendement de la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2024 au montant de 1,6 milliard d'euros. Le montant M pour 2026 est exprimé pour la première fois en montant remboursé par l'Assurance maladie, et non plus en chiffre d'affaires des entreprises du secteur, pour un premier appel sur cette base en 2027.
Dès lors, on peut s'interroger sur fait de fixer le montant M pour 2026 à ce niveau tout en attendant que le mécanisme ne se déclenche pas au regard de l'évolution tendancielle des dépenses de médicaments (taux de croissance annuel moyen de 4,6 % entre 2022 et 2024)385(*).
Évolution des dépenses
remboursées, des montants des remises produits,
des montants de la
contribution M, entre 2017 et 2024
(en milliards d'euros)
Source : Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025
Le VI fixe quant à lui le niveau du montant Z pour 2026. Ce montant Z constitue le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, dont l'assiette est calculée sur la base des montants remboursés au titre des produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance maladie et pris en charge « en sus » des prestations d'hospitalisation.
Ces montants s'entendent nets des remises conventionnelles. En 2024, les dépenses totales (hors remises) de dispositifs médicaux qui sont remboursées au titre de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) se sont élevées à 22,4 milliards d'euros, dont 11,5 milliards d'euros remboursées par l'Assurance maladie obligatoire, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2023386(*).
Le montant Z est ainsi fixé à 2,19 milliards d'euros en 2026, contre 2,26 milliards en 2025. Ce montant était fixé à 2,31 milliards d'euros en 2024 et à 2,21 milliards d'euros en 2023. Depuis sa création, le montant Z n'a jamais été atteint et les industriels n'ont jamais eu à s'acquitter d'une contribution au titre de la clause de sauvegarde. Toutefois, en raison du dynamisme des dépenses de dispositifs médicaux, les rendements attendus de cette clause pour 2025 (sur les montants remboursés en 2024) et 2026 (sur les montants remboursés en 2025) s'élèvent entre 100 et 150 millions d'euros387(*).
En cas de déclenchement de la clause de sauvegarde, la contribution est égale à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie, minoré des remises conventionnelles, et le montant Z. Ce montant est ensuite individualisé pour chacune des entreprises concernées au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des produits et prestations qu'il exploite.
II - Le dispositif transmis au Sénat
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Outre plusieurs amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur général, le texte transmis au Sénat intègre trois amendements adoptés par l'Assemblée.
Un amendement présenté par le groupe Socialistes et apparentés388(*) qui remplace le taux minoré pour les médicaments génériques et orphelins par une exonération complète des médicaments génériques, hybrides et biologiques du calcul de l'assiette de la contribution supplémentaire instauré par le présent article.
Un amendement présenté par Mme Karine Lebon et plusieurs de ses collègues, visant à obliger l'organisme de recouvrement à procéder à une taxation d'office du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée en cas de déclarations manifestement erronées.
Enfin, le présent article intègre un amendement389(*) porté par Michel Lauzzana (Ensemble pour la République) qui prolonge sur l'année 2026 le mécanisme de plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde pour les spécialités, génériques, les médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et pour les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décret.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
• Cet article propose d'intégrer en base les 1,6 milliard d'euros issus de la clause de sauvegarde dans un nouveau dispositif fiscal existant sans concertation ni étude d'impact sur la répartition de la charge entre les entreprises concernées. Cette contribution s'ajoute à la clause de sauvegarde conçue comme une mesure exceptionnelle, permettant de corriger, le cas échéant, les évaluations budgétaires des dépenses et besoins de santé relatifs aux médicaments.
• Si cette demande de prévisibilité a été portée par les industriels et notamment le Leem, le contexte dans lequel elle s'inscrit rend cette nouvelle taxe difficilement absorbable, notamment pour les TPE et PME du secteur. En effet, l'instauration de cette taxe pérenne s'accompagne d'un objectif de baisse de prix à un niveau élevé (1,4 milliard d'euros), ainsi que de la mise en oeuvre concomitante pour 2026 d'un système de paiement par acompte des remises (article 11 du PLFSS).
• Par ailleurs, aucune mesure d'abattement similaire à celle existant pour la clause de sauvegarde n'est mise en place. Entendu par la rapporteure générale, le CEPS a souligné le risque que pouvait représenter une telle absence dans ses négociations de remise avec les laboratoires en vue d'obtenir des baisses de prix.
•Au regard du caractère particulièrement imprévisible de la clause de sauvegarde, la commission s'interroge sur le risque de déclenchement de celle-ci en 2025 et 2026 dans des proportions non maîtrisées. Le montant dû au titre de la clause de sauvegarde au titre de l'année n n'est en effet connu des entreprises concernées qu'à la fin de l'année n+1. Ce montant viendrait alors s'ajouter à la nouvelle contribution due par les entreprises sur leur chiffre d'affaires créée par cet article.
• Concernant le montant Z, son déclenchement plus que probable au regard des montants prévus porte un risque pour les industriels du secteur et envoie un signal négatif en faveur de l'innovation. Lors de son audition par la rapporteure générale, le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) a estimé qu'en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde, environ 50 % de la charge devrait peser sur des TPE/PME. La rapporteure générale a souhaité déposer un amendement visant à rehausser le montant Z afin de limiter les effets du déclenchement de la clause de sauvegarde sur le tissu industriel (amendement n°613).
• La commission souligne le contexte international tendu dans lequel s'inscrit ce PLFSS. Au regard de la politique tarifaire sur les médicaments que souhaite mettre en oeuvre le Président Donald Trump pour baisser les prix des médicaments aux États-Unis (Most favoured Nation), la création d'une taxe perçue sur le chiffre d'affaires brut sur lequel les entreprises reversent des remises et affectant principalement les entreprises commercialisant des médicaments innovants pose question et envoie un signal négatif pour l'investissement dans notre pays.
C'est pourquoi la commission propose de supprimer la création de la contribution supplémentaire au titre du chiffre d'affaires prévue par cet article (amendement n°611). Afin d'éviter une perte de ressources pour l'Assurance maladie, la commission a toutefois fixé le montant M à un niveau permettant d'assurer un rendement d'1,6 milliards d'euros (amendement n°613).
· Par ailleurs, la commission a souhaité modifier le plafonnement existant au titre de la prise en compte du chiffre d'affaires liés aux médicaments génériques et matures. Il est en effet nécessaire d'adapter ce plafond aux nouvelles règles en vigueur pour le calcul de la clause de sauvegarde qui sera désormais sur les montants remboursés et non plus sur le chiffre d'affaires (amendement n°614). Il s'agit de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027 des nouvelles modalités de calcul de la clause de sauvegarde dont l'impact en termes de répartition de charge sur les entreprises reste encore à préciser.
· La commission a également adopté un amendement visant à supprimer la mesure de validation législative portant sur des contentieux couvrant une période de dix ans. Cette mesure, trop superficiellement présentée dans l'étude d'impact, interroge au regard des principes fixées par le Conseil constitutionnel concernant les mesures de validation législative (amendement n° 612).
• Enfin elle constate que malgré ses demandes répétées afin d'obtenir une véritable analyse de l'impact de la réforme des modalités de calcul de la clause de sauvegarde qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027, l'étude d'impact du PLFSS pour 2026 ne comporte toujours aucune information à destination du Parlement sur ce point. Interrogée à ce sujet, la direction de la sécurité sociale a simplement indiqué qu'il pouvait être « anticipé que les laboratoires dont le chiffre d'affaires est principalement composé de spécialités avec un taux de remboursement élevé voient leur contribution augmenter par rapport aux autres laboratoires », ce qui peut s'avérer contraire à l'objectif réitéré par la commission d'une clause de sauvegarde permettant de mieux tenir compte des enjeux de santé publique et de la criticité thérapeutique des médicaments.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 10 bis (nouveau)
Exclusion des médicaments
génériques et biosimilaires du calcul
de la clause de
sauvegarde
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'exclure de l'assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La clause de sauvegarde un outil de régulation budgétaire pérenne extrêmement complexe et imprévisible
Le principe, les modalités de fonctionnement et de calcul de la clause de sauvegarde sont largement présentés au commentaire de l'article 10 auquel le lecteur est invité à se reporter.
Le présent commentaire ne reprend donc pas ici ces développements.
B. La prise en compte des spécificités liées aux médicaments génériques, hybrides et biosimilaires dans le calcul de la clause de sauvegarde
La LFSS pour 2015390(*) a instauré une exonération pour les médicaments génériques, à l'exception de ceux qui sont remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ou dont le prix de vente n'est pas inférieur à celui de la spécialité de référence du groupe générique. En effet, ces derniers contribuent à faire diminuer le poids total des dépenses d'assurance maladie et il n'apparaît pas justifié de les faire contribuer via la clause de sauvegarde.
La LFSS pour 2019391(*) a supprimé l'exclusion des médicaments génériques et orphelins de l'assiette de la clause de sauvegarde. L'étude d'impact du texte justifiait alors leur intégration dans la régulation opérée par la clause de sauvegarde par le fort dynamisme de la dépense associée aux médicaments génériques et orphelins. Par ailleurs, cette évolution permet également simplifier la déclaration par les entreprises ainsi que le recouvrement par les Urssaf.
Lors de l'examen de la LFSS pour 2024, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à tenir compte de la nature des produits constituant le chiffre d'affaires des laboratoires dans le calcul de la clause de sauvegarde, et plus particulièrement du statut générique des produits exploités. L'article 28 de la LFSS pour 2024 prévoit ainsi un plafonnement spécifique du montant de la contribution due par chaque entreprise imputable :
- aux spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
- aux spécialités de référence auxquelles s'applique un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l'article L. 162-16 du code de la santé publique ou dont le prix est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique.
La contribution imputable à ces spécialités ne pouvait alors excéder 2 % du chiffre d'affaires réalisés au titre de ces derniers pour l'année 2024.
Aucune disposition spécifique ne prend aujourd'hui en compte les biosimilaires dans le calcul de la clause de sauvegarde.
C. Le dispositif proposé : Exclure le chiffre d'affaires issus des ventes de médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de l'assiette de la clause de sauvegarde
L'article 10 bis, introduit à l'Assemblée nationale par deux amendements identiques392(*) avec deux avis défavorables du Gouvernement et de la commission, vise à exclure du calcul de l'assiette de la clause de sauvegarde :
- les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
- les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
- les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article.
Il modifie en ce sens l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale en le complétant par un III permettant de préciser que ces spécialités ne sont pas prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution au titre de la clause de sauvegarde.
II - La position de la commission
Lors de l'examen de la LFSS pour 2025393(*), la commission a souhaité appliquer à la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2025, le plafonnement de la contribution des médicaments génériques et des spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) introduit en 2024. Cela correspondait alors à une demande forte de certains secteurs, présentant des taux de rentabilité faibles et pour lesquels le poids de la clause de sauvegarde apparaît inadapté.
Ainsi pour le calcul de la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2025 et versée par les industriels en 2026, le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et soumises au tarif forfaitaire de responsabilité ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités.
Par ailleurs, le présent article vise à insérer dans le code de la santé publique une disposition qui, en l'état, sera difficilement articulable avec la nouvelle rédaction de l'article L. 138-10 prévue par l'article 28 de la LFSS pour 2024. En effet, les montants de la clause de sauvegarde appelés en 2027 et dus au titre de l'année 2026 seront calculés sur le montant remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l'année civile, minoré des remises consenties par les entreprises, des marges des distributeurs, des honoraires de dispensation et des taxes en vigueur. Il n'est donc pas pertinent de prévoir un mécanisme d'exemption sur le chiffre d'affaires réalisé puisque ce dernier ne sera plus pris en compte au titre de l'année 2026.
Par ailleurs, au regard de l'évolution des dépenses liées aux biosimilaires et du modèle économique de ces médicaments qui, bien que moins chers que les médicaments de référence, ne peuvent être assimilés aux génériques (voir commentaire de l'article 33), le fait d'exclure entièrement du calcul de la clause de sauvegarde ces mêmes médicaments, comme le propose cet article, ne paraît pas soutenable dans le contexte financier actuel de l'assurance maladie.
L'article 10 dans sa rédaction transmise par le Gouvernement au Sénat intègre un dispositif de plafonnement de la contribution individuelle de la clause de sauvegarde due par chaque entreprise au titre des spécialités génériques et matures. La commission a souhaité modifier le dispositif prévu à l'article 10 afin de prendre en compte les nouvelles règles de calcul sur le montant remboursé pour le paiement de la clause de sauvegarde due au titre de l'année 2026 (voir commentaire article 10).
C'est pourquoi, la commission a adopté un amendement n° 615 tendant à supprimer ce dispositif.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 10
ter (nouveau)
Introduction d'un critère de territorialité dans
le calcul de la clause de sauvegarde
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, introduit un critère de territorialité dans le calcul de la contribution individuelle due par chaque entreprise au titre de la clause de sauvegarde.
La commission propose de supprimer cet article
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La clause de sauvegarde un outil de régulation budgétaire pérenne extrêmement complexe et imprévisible
Le principe et les modalités de fonctionnement et de calcul de la clause de sauvegarde sont largement présentés au commentaire de l'article 10, auquel le lecteur est invité à se reporter.
Le présent commentaire ne reprend donc pas ici ces développements.
B. Le dispositif proposé : introduire un critère de territorialité dans le calcul de la contribution individuelle due par chaque entreprise au titre de la clause de sauvegarde
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale après l'adoption de trois amendements identiques394(*) malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, modifie les règles de calcul de la contribution individuelle due par chaque entreprise au titre de la clause de sauvegarde.
Cette modification s'appliquerait à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 », c'est-à dire dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2027 pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2026.
Ainsi, il modifie les modalités de calcul à venir de cette contribution qui prévoient que le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l'article L. 138-10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente défini audit I. »
Le présent article remplace ces dispositions par la répartition des critères de calcul suivante :
- à concurrence de 50 % au prorata du montant remboursé ;
- à concurrence de 20 % toujours pour la progression du montant remboursé ;
- « à concurrence de 30 % » pour un nouveau critère fonction « du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie ».
II - La position de la commission
La commission partage l'objectif d'assurer la souveraineté en matière de médicament en favorisant certains lieux de production.
Toutefois, le mécanisme prévu viendrait complexifier le calcul de la contribution individuelle, alors même qu'une réforme d'ampleur va entrer en vigueur au 1er janvier 2027 et s'appliquer sur les montants dus au titre de l'année 2026. Comme évoqué dans les précédents commentaires, il semble essentiel de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027 des nouvelles modalités de calcul de la clause de sauvegarde dont l'impact en termes de répartition de charge sur les entreprises reste encore à préciser. Par ailleurs, l'impact sur la répartition de la charge des entreprises de ce nouveau critère mériterait d'être mieux documenté avant de modifier les critères de calcul dans la loi.
De plus, comme l'a précisé Stéphanie Rist, ministre de la santé, en séance à l'Assemblée nationale, ce dispositif risque d'entrer en conflit avec la politique mise en place par le CEPS pour faire baisser les prix de certains médicaments en tenant compte du lieu de production. L'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale prévoit à ce titre que le prix de vente au public des médicaments « tient compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de productions ».
Il apparaît plus pertinent de continuer à travailler sur les mécanismes de fixation des prix des médicaments et de négociation de remises afin d'améliorer la prise en compte du lieu de production.
À ce titre, le dispositif d'avoirs sur remises395(*) du Conseil stratégique des industries de santé, applicables à des laboratoires exploitant des produits pharmaceutiques, et qui pourraient être élargis aux dispositifs médicaux, visent à mieux prendre en compte les investissements sur le territoire français et le lieu d'implantation industrielle. Les avoirs sur remises au titre CSIS sont accordés aux entreprises ayant opéré ou devant opérer en Europe des investissements de nature à créer, accroitre ou maintenir des activités de production et de recherche dans le secteur des produits de santé. Ce sont ces dispositifs qui sont essentiels au maintien de la souveraineté nationale dans le secteur et qu'il apparait nécessaire de renforcer. Ainsi, le total des nouveaux avoirs CSIS octroyés au début de l'année 2024 et pouvant être utilisés pour le paiement des remises dues au titre de 2023 (ou reportés) a été de près de 160 millions d'euros, dont près de 73 millions d'euros au titre d'investissements devant être opérés396(*).
De plus, le CEPS prévoit également l'octroi de « périodes de stabilité de prix facial » pour certains produits, auxquels les investissements doivent être liés. Ces accords prennent notamment en compte les investissements en Europe et notamment en France concernant les capacités de production, la R&D et les solutions numériques.
Ces mécanismes de convention médicament par médicament permettent de suivre de manière plus précise et réactive l'évolution des projets d'investissement, de mieux identifier la réalité de ces investissements en CAPEX (dépenses en capital effectuées par une entreprise pour acquérir, améliorer ou maintenir des actifs à long terme) et non en sous-traitance ou encore d'assurer la traçabilité des produits. Ils constituent à ce titre une politique plus efficace pour assurer la souveraineté européenne et nationale que le mécanisme de calcul proposé par cet article.
C'est pourquoi, la commission a adopté un amendement n° 616 tendant à supprimer ce dispositif.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 11
Instaurer un mécanisme d'acompte des remises
relatives aux produits de santé
Le présent article met en oeuvre un mécanisme d'acompte des remises conventionnelles dont s'acquittent les industriels du secteur du médicament et du dispositif médical.
La commission propose d'adopter cet article avec modifications.
I - Le dispositif proposé
A. Les remises sur les produits de santé : un outil majeur de la régulation des dépenses de médicaments
1. La fixation du prix des produits de santé faisant l'objet d'un remboursement
Le prix des médicaments faisant l'objet d'un remboursement est fixé à la suite de négociations entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les entreprises qui souhaitent commercialiser leur médicament. Plusieurs critères sont alors pris en compte et notamment :
- la valeur thérapeutique du médicaments (ou amélioration du service médical rendu - ASMR). Cette échelle entre I (service médical rendu majeur) et V (service médicale rendu inexistant) est établie par la Haute Autorité de santé ;
- le niveau d'implantation de sites de fabrication sur le territoire français garantissant ainsi l'approvisionnement du marché français ;
- le volume des ventes attendues : plus le médicament s'adresse à une population limitée plus il nécessite un prix de vente élevé pour assurer la soutenabilité du laboratoire.
Ce prix de départ a tendance à diminuer avec le temps en fonction des réévaluations du rapport bénéfices-risques du médicament. Ces baisses de prix sont décidées par le CEPS.
Deux prix peuvent alors être fixés : le prix public et officiel dit « prix facial » et le prix « net », moins élevé, qui est le prix réellement payé par la collectivité et connu seulement du CEPS et de l'industriel. Ce prix négocié relève du secret des affaires.
Le passage du prix « facial » au prix « net » se fait par un mécanisme de remises qui consiste pour l'industriel à reverser à l'assurance maladie une partie du chiffre d'affaires réalisé sur le produit en question. Les remises permettent au final à l'assurance maladie de payer les médicaments (prix nets) moins chers que leur prix officiel (prix facial).
Le prix facial ainsi affiché sur le marché français, qui sert de référence notamment en Europe, permet aux industriels du médicaments de négocier plus facilement lorsqu'ils cherchent à s'implanter dans d'autres pays. Il permet aussi d'assurer une convergence des prix publics sur les différents marchés. Il permet enfin d'assurer la soutenabilité des dépenses en produit de santé.
Deux principaux types de remises peuvent être distingués :
- les remises conventionnelles « produits » définies à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. Ces remises peuvent être subordonnées à la réalisation d'une ou plusieurs conditions - accord prix/volume397(*), plafonnement de la dépense totale, etc. - ou, au contraire, inconditionnelles - remises « à la première boîte »398(*) ;
- les remises obligatoires associées aux procédures d'accès dérogatoires (accès précoce et accès compassionnel).
Concernant les remises « produits », un nombre limité de spécialités concentre la majorité des remises. Ainsi, selon le rapport d'activité provisoire du CEPS pour 2025, « la moitié du montant total des remises produits venues en déduction du coût effectivement supporté par l'assurance maladie obligatoire pour ces traitements est concentrée sur quatorze produits ».
Des dispositifs de remises existent également pour les dispositifs médicaux. Comme pour les médicaments, le CEPS est amené à négocier avec les entreprises des accords de prix entre un prix « facial » et un prix « net », fonction notamment du niveau d'amélioration du service attendu (ASA), pouvant se traduire par le versement de remises.
Ainsi figurent sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) les prix publics des dispositifs, les prix nets restant confidentiels. De nombreux pays étrangers utilisent dès lors la tarification publique française comme base pour leur tarification nationale. Ces remises peuvent être « dès la première unité », sur le fondement d'un accord prix-volume ou conditionnées à des clauses de performance ou de résultats.
L'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale prévoit les dispositifs associés à la fixation du prix ou du tarif d'un produit ou d'une prestation par le CEPS et pouvant se traduire par le versement de remises à l'assurance maladie. Comme pour les médicaments, ces remises peuvent être conventionnelles ou imposées. Le CEPS indique dans son rapport d'activité pour 2023 que les mécanismes de remises découlent pour la quasi-totalité d'accords conventionnels entre le CEPS et des entreprises.
Des remises existent également dans le cadre des dispositifs d'accès transitoire399(*). Elles s'appliquent lorsqu'un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge transitoire est inscrit au remboursement et que son prix est fixé par convention avec le CEPS au titre de l'une ou de plusieurs de ses indications. Selon le CEPS, aucune remise obligatoire d'accès transitoire n'a été appelée à ce titre en 2024.
Enfin, le code de la sécurité sociale autorise les exploitants de médicaments à consentir des remises, ristournes et avantages commerciaux aux pharmacies d'officine, destinés à favoriser la pénétration de leurs produits et à adapter son prix aux réalités économiques400(*).
Le code de la sécurité sociale prévoit un plafonnement des gestes commerciaux consentis à hauteur :
- de 2,5 % du prix fabricant hors taxes (PFHT), pour l'ensemble des médicaments ;
- de 50 %, au plus, du PFHT, pour les médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du même groupe générique ou les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. L'article 33 de la LFSS pour 2025 a inclus dans ce plafond dérogatoire, les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, pour les médicaments biologiques similaires substituables.
En cas d'absence de déclaration de ces gestes commerciaux dans les délais requis, ou lorsque celle-ci s'avère manifestement inexacte, le CEPS peut fixer une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur fautif, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes concernées401(*).
2. Le fort dynamisme des recettes liées aux dispositifs de remise
L'article L. 162-18 prévoit que les remises doivent être « exceptionnelles et temporaires ». Or leur usage et leur rendement sont en très forte progression depuis plusieurs années et les remises sont devenues un outil de régulation des dépenses de premier plan.
Remises « produits » et « accès dérogatoires » brutes (2012-2024)
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données publiées par le CEPS (2025) - montant des remises accès dérogatoires 2024 non disponible à date
En effet, depuis 2016, les taux de croissance des remises médicaments s'établissaient entre + 20 % et + 40 % par an. Les montants de remises conventionnelles appelés étaient de 460 millions en 2012 et 1,9 milliard en 2018. En 2022, hors clause de sauvegarde et dispositifs d'accès dérogatoires, elles s'élevaient à 5,7 milliards d'euros et 7,9 milliards sont attendus en 2024 (8,2 milliards en incluant les produits de santé).
À noter que la LFSS pour 2024, sur la base de prévisions arrêtées à l'été 2023, prenait en compte l'hypothèse d'un taux de croissance des remises de 20 %. In fine, le produit à recevoir devrait être plus faible et représenter une croissance de 8,7 % des remises entre 2023 et 2024. L'annexe 9 du présent PLFSS retient l'hypothèse d'une croissance du montant des remises de 10 % entre 2024 et 2025 pour un rendement attendu de près de 9 milliards d'euros.
Le montant total des remises sur les produits et prestations ne cesse également de croître depuis 2019. En 2023, la croissance du montant total des remises sur les produits et prestations, bien qu'inférieure à celle constatée au cours des trois années précédentes (+ 15 % en 2020, + 38 % en 2021 et + 45 % en 2022), atteint encore + 10 %402(*).
En 2023, les parts respectives que représentent les remises versées au titre des dépenses en ville représentent 64 % du total et celles au titre de produits de la liste en sus à l'hôpital, 36 %.
Montant des remises produits sur les dispositifs médicaux 2014-2024
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données publiées par le CEPS - rapport d'activité pour 2023 (décembre 2024)
B. La mise en place d'un mécanisme d'acompte permettant de faciliter la gestion de trésorerie de l'assurance maladie
Le présent article modifie les articles L. 162-18 (relatif aux remises conventionnelles dans le secteur du médicament) et L. 165-4 (relatif aux remises conventionnelles dans le secteur des dispositifs médicaux) du code de la sécurité sociale afin de faire évoluer les conditions de récupération desdites remises conventionnelles. En ce qu'il met en place un nouveau mécanisme d'acompte pour faciliter la trésorerie de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), cet article n'a qu'un effet limité sur l'équilibre budgétaire de l'assurance maladie. En revanche, il constitue un gain considérable pour l'Acoss. En effet, le versement par acompte en 2026 des remises pour un montant estimé à 8,2 milliards d'euros en 2024 diminuera sensiblement le besoin de financement prévisionnel de l'Acoss, qui sans cette mesure se serait établi à 86,5 milliards d'euros.
Actuellement, ces remises sont appelées à l'automne de l'année suivant l'année pour laquelle elles sont dues, à l'issue d'une phase d'échange entre le CEPS et chaque laboratoire pharmaceutique ou entreprise commercialisant un dispositif médical. Ce versement retardé entraîne des coûts de trésorerie important pour la Cnam, qui doit ainsi recourir à l'emprunt pour combler ses besoins.
Ainsi, son 1°a prévoit les modifications nécessaires de l'article L. 162-8 relatif aux remises conventionnelles des médicaments. Le i du même a corrige une erreur de référence afin de correctement viser la définition du prix, du tarif et du coût nets. Le ii dudit a quant à lui réécrit le III de l'article L. 162-8 afin de prévoir ainsi un mécanisme d'acompte des remises conventionnelles basé sur 95 % du montant dû au titre de « l'antépénultième année civile » c'est-à-dire du dernier appel de remise connu. La rapporteure note à ce titre une incohérence entre le texte du dispositif qui fait mention de l'antépénultième année civile (soit N-3) par rapport à l'année au cours de laquelle les remises sont versées à l'assurance maladie et l'étude d'impact qui mentionne l'année N-2, soit l'avant-dernière année comme année de référence pour établir le montant de l'acompte versé au cours de l'année N.
Il prévoit également que ces remises sont versées de manière provisionnelle « chaque trimestre de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». L'annexe 9 au PLFSS précise que le montant de 95 % des dernières remises connues permet d'éviter le risque de reversement de trop-perçu par l'Acoss auprès des industriels lors de la phase de régularisation.
Enfin, la régularisation portant sur la différence entre les acomptes versés et la somme réellement due intervient « pendant l'année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues ». C'est-à-dire en N+1 une fois le montant final des remises du au titre de l'année N connu et fixé par le CEPS.
Le même mécanisme est prévu au b du 1° du présent article qui modifie l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale concernant les remises applicables aux dispositifs médicaux.
Le 2° prévoit les dispositions transitoires concernant le secteur du médicament nécessaires à la mise en oeuvre de ce mécanisme d'acompte puis régularisation. Ces dispositions transitoires s'appliqueraient dès 2026 afin de permettre une mise en place du mécanisme en 2027.
Calendrier de la phase de transition et à compter de la pleine entrée en vigueur du dispositif (secteur du médicament uniquement)
|
Remises dues au titre de 2025 |
Remises dues au titre de 2026 |
Remises dues au titre de l'année 2027 |
|
Assiette d'appel des remises |
||
|
95 % des remises dues au titre de l'année 2024 |
95 % des remises dues au titre de l'année 2025 |
|
|
Calendrier de versement des remises |
||
|
1er juin 2026 |
25 % de l'assiette au 1er trimestre |
|
|
1er septembre 2026 25 % de l'assiette |
1er septembre 2026 50 % de l'assiette |
25 % de l'assiette au 2e trimestre |
|
1er décembre 2026 50 % de l'assiette |
25 % de l'assiette au 3e trimestre |
|
|
25 % de l'assiette au 4e trimestre |
||
|
Régularisation |
||
|
Au plus tard 31 décembre 2026 |
Au plus tard 31 décembre 2027 |
En 2028, une fois le montant final de l'année 2027 connu |
Compte tenu de l'évolution nécessaire du système d'information de l'Acoss, une année de transition est prévue en 2026 uniquement pour le secteur des médicaments.
Le 3° précise que les dispositions du 1° s'appliquent à compter des remises dues au titre de l'année 2027. Il inclut également à tort les dispositions du 2° qui concernent justement les modalités transitoires pour 2026 concernant le secteur du médicament.
Enfin, cet article prévoit en son 4° que les modalités d'appel des remises (calendrier, etc.) ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises en compte les situations spécifiques des industriels nouveaux entrants ou ayant quitté le marché ou ayant connu un changement de situation pouvant entraîner une variation significative de la remise due sont précisées par décret en Conseil d'État.
L'étude d'impact du PLFSS estime le gain attendu en droits constatés403(*) pour le régime général, lié à la moindre charge d'intérêt résultant du moindre recours à l'emprunt du fait de ce mécanisme d'acompte, à 102,8 millions d'euros en 2026 et 74,2 millions d'euros les années suivantes.
II - Le dispositif transmis au Sénat
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Outre un amendement de précision à l'initiative du rapporteur général, le texte transmis au Sénat intègre un amendement présenté par Hendrik Davi et plusieurs de ses collègues404(*) . Cet amendement adopté avec deux avis défavorables du Gouvernement et de la commission prévoit que l'Acoss rende public, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l'acompte.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
• La commission soutient pleinement ce dispositif de paiement des remises par acompte, qui permettra de réduire la charge d'emprunt de l'assurance maladie, et, ce qui revêt une importance particulière dans le contexte actuel, le besoin de financement de l'Acoss en 2026.
Comme indiqué dans le présent rapport, notamment dans son tome I et dans les commentaires des articles 12 et 16, du fait des déficits cumulés de la sécurité sociale, l'article 16 propose de porter le plafond d'emprunt de l'Acoss à 83 milliards d'euros en 2026. Pour mémoire, en 2020, lors de la crise sanitaire, le pic d'emprunt de l'Acoss, qui se finance à court terme sur les marchés, a été d'environ 90 milliards d'euros, ce qui, du fait de l'impossibilité de trouver la totalité de ce montant sur les marchés, a impliqué pour assurer le versement des prestations la mise en place en urgence d'un mécanisme de financement ad hoc impliquant la Caisse des dépôts et consignations et un pool de banques.
La prévision de besoin de financement maximal de l'Acoss en 2026, qui a servi à déterminer le plafond de 83 milliards d'euros indiqué ci-avant, est de 78,5 milliards d'euros (le plafond correspondant donc à une marge de sécurité de 4,5 milliards d'euros). Le présent article prévoit qu'en 2026, année de transition, l'Acoss percevra les remises au titre de 2025 et celles au titre de 2026. Il devrait donc réduire, uniquement en 2026, le « pic » du besoin de trésorerie de la sécurité sociale d'environ 8 milliards d'euros405(*).
Sans cet article, le besoin de financement maximal de l'Acoss en 2026 serait donc d'environ 86,5 milliards d'euros.
• Toutefois, un mécanisme d'acompte basé sur des données anciennes de deux ans pourrait potentiellement mettre en difficulté des entreprises confrontées, entre temps, à une situation financière compliquée.
• Par ailleurs, la commission estime important que les entreprises sur lesquelles reposera désormais l'effort de trésorerie puissent être accompagnées en cas de difficultés de paiement afin d'éviter d'affaiblir le tissu industriel.
La rapporteure générale a toutefois déposé deux amendements. Le premier vise à supprimer l'obligation de publication des remises accordées et des prix nets, tarifs nets et coûts nets des produits de santé. Ces informations relèvent des négociations directes entre le CEPS et les laboratoires et du secret des affaires (amendement n° 618). Le second corrige une erreur rédactionnelle concernant l'année de référence prise en compte pour le calcul du montant de l'acompte (amendement n° 617).
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 11 bis
(nouveau)
Extension du périmètre de la taxe sur les boissons
prémix
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'élargir le périmètre de la taxe sur les boissons prémix aux boissons énergisantes alcoolisées.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Un nouveau mode de consommation de l'alcool ayant justifié l'instauration d'une taxation spécifique : les boissons prémix
1. Les jeunes, cible privilégiée du marché des boissons prémix
L'alcool est responsable d'environ 41 000 décès par an. Sa consommation nocive présente un coût net pour les finances publiques évalué à 3,3 milliards d'euros par an, soit le double de celui du tabac406(*).
Alors que depuis les années 1990, la réduction du tabagisme fait l'objet d'une politique publique mobilisant de multiples leviers (augmentation de la fiscalité, interdiction de la fiscalité, développement des espaces sans tabac, prise en charge de substituts nicotiniques...), la lutte contre la consommation d'alcool se heurte en France à des résistances économiques. Malgré la baisse continue de la consommation moyenne d'alcool constatée depuis les années 1960, les indicateurs de consommation restent préoccupants, notamment parmi les jeunes. Ceux-ci représentent d'ailleurs une nouvelle cible pour les industriels, qui développent des produits ciblant spécifiquement cette clientèle.
Les boissons prémix407(*) font partie de ces produits qui facilitent l'initiation à l'alcool et favorisent une consommation régulière, en raison d'une perception amoindrie des risques sanitaires qu'elle comporte. Ces boissons, qui constituent des cocktails prêts à consommer, présentent un prix modéré qui attire les étudiants et un taux de sucres important qui facilite l'absorption rapide et excessive d'alcool. Toutes les boissons alcooliques contiennent pourtant la même quantité d'alcool pur, environ 10 grammes.
Une consommation fréquente des boissons prémix présente des risques importants pour la santé. Outre l'impact de la consommation d'alcool sur le cerveau, a fortiori chez des personnes jeunes dont le développement cérébral se poursuit, la forte concentration en sucres de ces boissons peut favoriser le surpoids et l'obésité. Ces conséquences sont d'autant plus graves que les jeunes commencent à boire plus tôt. La consommation d'alcool s'accompagne aussi fréquemment de pathologies psychologiques. Enfin, l'alcool est le premier facteur de risque du cancer colorectal.
Les dix États consommant le plus d'alcool par habitant, selon l'OCDE (2019)
(en litres d'alcool par personne de plus de 15 ans et par an)
Champ : les 49 États suivis par l'OCDE (les 38 États membres, plus Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chine, Croatie, Inde, Indonésie, Pérou, Roumanie, Russie).
Source : OCDE ( https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.htm#indicator-chart)
La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) alerte sur la forte exposition des jeunes à la publicité sur l'alcool, en raison de la visibilité croissante dont bénéficient ces boissons et des stratégies marketing offensives et décomplexées que développent les industriels.
L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) rappelle que l'alcool est la première substance psychoactive expérimentée à l'adolescence et que plus de 40 % des collégiens ont déjà bu au moins une fois une boisson alcoolisée au cours de leur vie (43,4 %). La législation encadrant la publicité en faveur des boissons alcooliques408(*) ne permet pas, en tout état de cause, de freiner l'exposition des jeunes à ce marketing. En particulier, la publicité pour l'alcool sur internet a été autorisée en 2009409(*) alors qu'internet constitue le premier média utilisé par les jeunes.
2. Une taxation spécifique des boissons prémix depuis 1997
En vertu de l'article L. 111-4 du code général des impositions des biens et des services, sont considérées comme des boissons alcooliques les boissons « dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol ».
Les boissons alcooliques sont soumises à plusieurs types de taxes, en particulier l'accise sur les alcools, la taxe sur les prémix, la cotisation de sécurité sociale et la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 1613 bis du code général des impôts prévoit une taxe sur les boissons prémix. Cette taxe a été créée par la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997410(*). Son périmètre a été élargi par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Une boisson prémix est constituée du mélange de plusieurs boissons alcoolisées, ou d'une boisson alcoolisée et d'une boisson non-alcoolisée. Plus précisément, la qualification de boisson prémix dépend de deux conditions, l'une tenant au titre alcoométrique volumique, l'autre à sa composition.
D'une part, la boisson doit présenter un titre alcoométrique volumique supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 12 % vol. Une boisson dont le taux est égal à 1,2 % ou à 12 % n'entre pas dans le champ de la taxe sur les prémix. Les boissons dont le titre est inférieur à 1,2 % vol. ou supérieur à 12 % vol. sont assujetties à l'accise sur les alcools et, si leur titre excède à 18 % vol., à la cotisation de sécurité sociale.
D'autre part, la boisson doit être constituée :
- soit d'un mélange d'une ou plusieurs boissons peu ou pas alcoolisées et de boissons alcooliques (a) du I. de l'article 1613 bis du code général des impôts) ;
- soit d'une boisson soumise à l'accise sur les alcools et contenant plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti (b) du I. de l'article 1613 bis du code général des impôts).
Une circulaire du 31 juillet 2025 relative au régime fiscal des boissons alcooliques et à la taxe sur certaines boissons dite taxe sur les boissons prémix présente plusieurs exemples de boissons entrant dans la première catégorie :
« - boisson composée de jus d'orange additionné de vodka, présentant un titre alcoométrique de 6,5 % volume. Une boisson non alcoolique et une boisson alcoolique préalablement constituées sont mises en oeuvre pour obtenir une nouvelle boisson ;
- boisson composée de cola additionné de whisky, d'un titre alcoométrique de 8 % vol ;
- boisson composée de vin rouge additionné de jus d'orange, d'un titre alcoométrique de 7 % vol. »
La même circulaire donne deux exemples de boissons relevant de la seconde catégorie :
- une boisson composée majoritairement de cidre, additionnée de 5 % de liqueur de cassis, contenant 65 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti, et présentant un titre alcoométrique de 4,5 % ;
- une boisson constituée à 95 % de bière, additionnée de rhum, contenant 70 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti et présentant un titre alcoométrique de 6,5 %.
Le tarif de la taxe sur les boissons prémix est défini par le II de l'article 1613 bis. Il s'élève à 3 euros par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services, et à 11 euros par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.
Il est à noter que les droits sur les alcools et les boissons alcooliques sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l`indice des prix à la consommation, hors tabacs, constaté entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision411(*).
Le produit de la taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Dans un récent rapport de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat portant sur la fiscalité comportementale dans le champ de la santé publique (mai 2024), les rapporteures de la mission d'information Élisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly, soulignaient que « le cas de la taxe « prémix » constitue une expérience réussie de fiscalité comportementale en France. Le tarif de cette taxe, fixé à 11 euros par décilitre d'alcool pur, a permis de réduire rapidement et significativement les ventes de ces boissons à base d'alcools forts consommées par les jeunes. Étendue en 2020 aux boissons aromatisées à base de vin sur une base de 3 euros par décilitre d'alcool pur, l'application de cette taxe comportementale confirme qu'une importante augmentation des prix permet d'atteindre des objectifs de santé publique en modifiant les choix des consommateurs »412(*).
B. Élargir la taxe sur les prémix aux boissons énergisantes alcoolisées
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Frédéric Valletoux, avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, propose de compléter le I de l'article 1613 bis du code général des impôts d'un nouvel alinéa pour élargir le périmètre d'application de la taxe sur les boissons prémix à de nouvelles boissons qui n'entrent pas dans le champ des deux catégories définies aux a) et b) du I.
Seraient ainsi soumises à la taxe prévue par l'article précité les boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol mélangées avec des substances énergisantes telles que la caféine, la taurine et la guaranine. La liste des substances énergisantes visées n'est pas exhaustive. En conséquence, des boissons dont le titre alcoométrique volumique excèderait 12 % vol. seraient soumises à cette taxe.
La liste précise des boissons relevant de ce champ serait définie par décret.
II - La position de la commission
Les travaux récents de la commission témoignent de son engagement sur les sujets de fiscalité comportementale. Elle a notamment adopté le rapport précité de la Mecss sur ce sujet, au printemps 2024, dont certaines des recommandations ont pu être reprises dans la LFSS pour 2025 (relèvement du barème de la taxe sur les boissons à sucres ajoutés et du barème de la taxe sur les boissons édulcorées). S'agissant de la fiscalité sur l'alcool, la commission avait recommandé qu'une réflexion soit ouverte sur un prix minimal et qu'une véritable politique de santé publique pour réduire la consommation nocive d'alcool soit menée par les pouvoirs publics. Elle constate que celle-ci fait malheureusement toujours défaut.
La taxe sur les boissons prémix a démontré des résultats intéressants, en s'accompagnant d'une chute importante de leur consommation. Pour s'adapter aux évolutions du marché et aux contraintes économiques, les industriels développent régulièrement de nouveaux produits dont certains ciblent spécifiquement les plus jeunes. Le Vody, cette boisson énergisante alcoolisée qui mélange de la vodka, de la caféine, de la taurine et du sucre, connaît ainsi un succès certain, malgré les dangers qu'elle présente. Sous les apparences inoffensives d'un soda, le Vody contient 22 % d'alcool dans des conditionnements de 25 centilitres, soit l'équivalent de 4 shots de vodka. La commission observe que la consommation de cette boisson se propage et s'accompagne de conséquences sanitaires graves. Ces boissons échappent pourtant, en l'état de la législation, aux taxes sur les boissons alcooliques et notamment, à celles sur les boissons prémix.
La commission salue le fait que l'Assemblée nationale se soit saisie de ce sujet et souscrit au principe d'une taxation. Alors que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a ouvert une enquête concernant un étiquetage inadapté du Vody, elle considère toutefois qu'un cadre de régulation plus large pourrait être utile, et considère a minima qu'une sensibilisation aux risques associés à la consommation de ces boissons et une interdiction de leur publicité sur internet seraient nécessaires.
La commission a adopté un amendement n° 619 visant à préciser le périmètre des boissons concernées par la taxe en fonction de leur titre alcoométrique et à fixer une date d'entrée en vigueur.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 11 ter
(nouveau)
Taxer les produits n'affichant pas le Nutri-score
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de soumettre à une contribution de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes les entreprises mettant sur le marché des denrées alimentaires n'affichant pas le Nutri-score.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le Nutri-score : un affichage en progression qui demeure facultatif
1. Un affichage facultatif
a) Des mentions obligatoires sur l'emballage des produits alimentaires strictement encadrées par la règlementation européenne
Le règlement (UE) n° 1169/2011, dit règlement Inco413(*), fixe les règles relatives à l'information des consommateurs et à l'étiquetage des produits alimentaires sur le marché européen.
Afin de garantir la protection de la santé des consommateurs et leur droit à l'information, il définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales en matière d'information des consommateurs sur les denrées alimentaires et, en particulier, d'étiquetage des denrées alimentaires. Le règlement s'applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à être livrées à des collectivités.
L'article 9 de ce règlement fixe ainsi la liste des affichages obligatoires applicables aux exploitants du secteur alimentaire :
« a) la dénomination de la denrée alimentaire ;
b) la liste des ingrédients ;
c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l'annexe II ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients ;
e) la quantité nette de denrée alimentaire ;
f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
g) les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation ;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire visé à l'article 8, paragraphe 1 ;
i) le pays d'origine ou le lieu de provenance lorsqu'il est prévu à l'article 26 ;
j) un mode d'emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire ;
k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis ;
l) une déclaration nutritionnelle. »
Le même règlement Inco restreint les mentions obligatoires apposées sur les emballages des denrées alimentaires à celles qu'il fixe. Toute réglementation nationale prévoyant d'autres affichages obligatoires contreviendrait au droit de l'Union européenne et constituerait une barrière non tarifaire à la libre circulation des marchandises.
Son article 35 prévoit que la valeur énergétique et les quantités de nutriments des denrées peuvent être exprimées sous d'autres formes ou présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres. Cette présentation est facultative et relève du droit d'initiative des États membres.
L'article 39 du même règlement circonscrit la possibilité pour les États d'adopter « des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires ».
b) Le Nutri-score, un affichage complémentaire non obligatoire
Le Nutri-score répond au cadre autorisé par l'article 35 du règlement Inco. Il a été créé par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016414(*). Désormais, l'article L. 3232-8 du code de la santé publique prévoit : « Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, [...] la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le [règlement Inco] peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles ».
Le Nutri-score est donc une présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire, qui peut prendre la forme de graphiques ou de symboles. Il donne une information sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée associant des lettres et des couleurs.
Un arrêté du 31 octobre 2017415(*) a fixé la forme du Nutri-score. Il a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté en date du 14 mars 2025. Au terme de travaux de réévaluation de l'algorithme visant à mieux prendre en compte les recommandations alimentaires et les connaissances scientifiques, cet arrêté actualise les modalités de calcul du score nutritionnel des denrées et les modalités de classement des denrées dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs.
L'utilisation du Nutri-score est libre, les entreprises souhaitant apposer le logo que les produits qu'elles commercialisent ayant simplement à s'enregistrer sur une plateforme de déclaration en ligne. Elle relève toujours d'une démarche volontaire des industriels, en raison du cadre fixé par le droit de l'Union européenne.
Des liens démontrés entre
qualité nutritionnelle des aliments consommés
sur
l'échelle du Nutri-score et santé publique
Plusieurs études françaises et internationales ont démontré la pertinence du classement des aliments par le Nutri-score au regard de leur impact sur la santé des consommateurs.
Une étude récente associant les équipes de l'Inserm, l'Inrae, le Conservatoire national des arts et métiers, l'Université Sorbonne Paris Nord et l'université Paris Cité, en collaboration avec des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (OMS-CIRC), a confirmé cette relation en se fondant sur la nouvelle version du Nutri-score. L'étude, conduite sur une cohorte de 345 533 participants dans 7 pays d'Europe établit un lien clair entre un risque majoré de maladies cardiovasculaires et la consommation d'aliments mal classés sur l'échelle du Nutri-score.
2. Un affichage en progression
Au niveau national, la part de marché estimée des marques engagées dans le Nutri-Score représente aujourd'hui 62 % des volumes de ventes.
En juin 2024, 1 377 entreprises de l'agroalimentaire étaient engagées dans la démarche du Nutri-Score et 98 % des marques de distributeurs sont parties prenantes de la démarche.
Toutefois, l'Observatoire de l'alimentation (Oqali) relève qu'après une forte progression de la diffusion du logo (en hausse de 18 points de pourcentage entre 2020 et 2021), celle-ci est plus modérée depuis 2021, voire se stabilise en 2023 et 2024. Des diminutions isolées de parts de marché concernées par la démarche ont été enregistrées, entre 2019 et 2022, sur les secteurs suivants : les compotes, les glaces et les sorbets, les margarines.
Enfin, un rapport sur la fiscalité comportementale adopté par la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat en 2024 relevait que « l'étiquetage « E » est le moins représenté (10,8 % des produits) alors que les produits de classe « A » sont les plus représentés (29 %). Ces données mettent en évidence la frilosité des industriels vis-à-vis de cet affichage pour les catégories de produits les plus mal classées »416(*).
Une étude de Santé publique France datée de 2020 montre que près d'un consommateur sur cinq se réfère au Nutri-Score comme critère d'achat pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits. Plus de la moitié de ces consommateurs déclare avoir modifié au moins l'une de ses habitudes de consommation grâce au Nutri-Score. Il est donc avéré que ce logo influence positivement les comportements d'achat des consommateurs.
Malgré son caractère non obligatoire, il suscite l'adhésion et la confiance des consommateurs, qui le plébiscitent assez largement. Selon Santé publique France, 94 % des Français y sont favorables.
Au niveau européen, six pays utilisent aujourd'hui le Nutri-score : la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. L'action de ces pays est coordonnée par un comité de pilotage qui siège depuis 2021.
B. Taxer les produits n'affichant pas le Nutri-score pour inciter les industriels à le diffuser
Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Sandrine Runel avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, propose de créer un nouvel article 1613 bis A dans le code général des impôts, au sein de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier de ce code. La section 3, relative aux contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, comprend actuellement un article unique, le 1613 bis, qui fixe la taxe sur les boissons prémix.
Ce nouvel article propose de soumettre les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d'application du règlement INCO, c'est-à-dire toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, à une contribution de 5 % assise sur le chiffre d'affaires hors taxes de ces entreprises.
Seraient exclus du champ de cette contribution les produits bénéficiant d'un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret. Cette précision vise à protéger les produits porteurs d'un label qualité tels que les appellations d'origine protégée (AOP), les appellations d'origine contrôlée (AOC) ou les indications géographiques protégées (IGP).
Par ailleurs, en seraient par principe exonérées les entreprises respectant les obligations prévues à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique, c'est-à-dire celles affichant le Nutri-score.
Les modalités de recouvrement et de contrôle de cette contribution seraient les mêmes que celles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Son produit serait affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
II - La position de la commission
La commission soutient la démarche de mise en oeuvre du Nutri-score au niveau national et européen. À l'occasion de l'adoption du rapport de la Mecss ayant porté sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé, au printemps 2024, elle a d'ailleurs soutenu une recommandation plaidant pour un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011.
La réglementation européenne en vigueur fixe toutefois un cadre juridique strict, qui interdit d'imposer des mentions additionnelles à celles qu'elle prévoit au titre du principe de libre circulation des marchandises. En commission, la rapporteure générale a donc exprimé ses doutes quant à la compatibilité de la mesure proposée avec le droit européen. En effet, celle-ci pourrait être interprétée comme une obligation déguisée d'affichage dans la mesure où elle aurait pour effet de taxer toutes les denrées alimentaires emballées à l'exception de celles affichant le Nutri-score. Malgré ces doutes, la commission a soutenu l'économie générale de la mesure.
La rapporteure générale a par ailleurs rappelé sa position en faveur d'une meilleure régulation du marketing alimentaire, en particulier vis-à-vis des publics jeunes, à la télévision et sur internet. À cet égard, elle considère que l'encadrement des publicités alimentaires par la loi Gattolin de 2016417(*) est aujourd'hui insuffisant et devrait être renforcé, en se fondant sur les conclusions des travaux menés par Santé publique France.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 quater
(nouveau)
Ajustement de la contribution sur les dépenses de
publicité des jeux d'argent et de hasard
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à clarifier le périmètre de la contribution sur les dépenses de publicité des jeux d'argent et de hasard instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, afin d'en exclure les activités non spécifiquement liées aux jeux, comme la restauration ou les spectacles, que développent notamment les casinos.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Une révision de la taxation des jeux d'argent et de hasard ainsi que des dépenses de publicité afférentes par la LFSS pour 2025
1. L'addiction au jeu, une problématique de santé publique
Sont désignées comme jeux d'argent et de hasard « toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants »418(*).
Le marché français des jeux d'argent et de hasard a connu une croissance particulièrement dynamique ces dernières années. En 2024, il a généré un produit brut de près de 14 milliards d'euros, en hausse de 4,7 % par rapport à 2023, année qui enregistrait déjà une croissance de 3,5 % par rapport à 2022. Parmi les secteurs en forte hausse figurent les paris sportifs, dont le produit brut des jeux augmente de 14,8 %, ainsi que les jeux de loterie, en progression de 5,1 %. L'offre des jeux de casinos connaît une progression modérée, avec un produit brut des jeux de 2,72 milliards d'euros, en hausse de 1,2 %.
L'observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) relève une augmentation continue du nombre de personnes prises en charge au sein des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) pour un problème d'addiction comportementale liée aux jeux d'argent et de hasard. En 2023, plus de la moitié des Français âgés de 18 à 75 ans ont joué au moins une fois à un jeu d'argent et de hasard au cours de l'année précédente. Parmi eux, 4,9 % des joueurs présentaient une pratique de jeu problématique, soit 2,5 % de la population des 18-75 ans. En 2024, le nombre de joueurs en ligne est en forte progression et s'établit à 3,9 millions de personnes. En revanche, la fréquentation des casinos se stabilise à 31 millions d'entrées en 2023 et 2024419(*).
Évolution du montant du produit brut des
jeux
entre 2023 et 2024 (en millions d'euros)
Source : OFDT, Le marché des jeux d'argent et de hasard en France en 2024
Aux termes de l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure, les jeux d'argent et de hasard font l'objet d'un encadrement strict « aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs ».
En outre, depuis l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, l'article L. 320-3 du code précité fixe parmi les objectifs poursuivis par l'État au titre de sa politique d'encadrement de l'offre et de la consommation des jeux la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs.
L'accessibilité aux jeux d'argent et de hasard et donc, l'exposition globale à ces jeux, se sont vues favorisées par l'ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010. L'Autorité nationale des jeux (ANJ) rappelle que l'exposition au jeu « est fortement influencée par la disponibilité, c'est-à-dire le type, le nombre, la répartition et l'accessibilité des activités de jeu, ainsi que par les stratégies promotionnelles déployées (notamment, la publicité et le marketing, les programmes de fidélité, la gestion de la relation client) ».
La loi autorise la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard à titre dérogatoire420(*). Elle est encadrée par l'article L. 320-14 du code de la sécurité intérieure. En vertu de cet article, le préfet peut déterminer un périmètre autour des établissements d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, qu'ils soient publics ou privés, dans lequel la propagande et la publicité directe ou indirecte en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les casinos, les enseignes des postes d'enregistrement des jeux de loterie, des paris sportifs ou des paris hippiques ni les messages et visuels promotionnels situés à l'intérieur et sur la devanture de ces derniers421(*).
Le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux a également fixé plusieurs dispositions visant à encadrer les communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard. Ces communications doivent notamment être assorties d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu422(*). Sont par ailleurs interdites les communications incitant à une pratique de jeu excessive, celles suggérant que jouer peut-être une solution à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques423(*), ainsi que toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci424(*).
2. Le renforcement de la fiscalité des jeux d'argent et de hasard et l'instauration d'une taxation des dépenses de publicité de ces jeux par la LFSS pour 2025
Face au dynamisme du marché des jeux d'argent et de hasard, et compte tenu des problématiques de santé publique associées, la commission a porté lors de l'examen de la LFSS pour 2025 un amendement visant à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard425(*). Cet amendement, déposé à l'initiative de la rapporteure générale et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, visait à relever les taux de taxation applicables au produit brut des jeux automatiques des casinos426(*), aux jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne427(*), aux paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne428(*) et aux jeux de cercle en ligne429(*).
En 2025, le rendement global attendu de la fiscalité applicable aux jeux d'argent et de hasard est estimé à 1,3 milliard d'euros, dont 81 millions euros proviendraient des mesures nouvelles votées en LFSS pour 2025.
Cet amendement proposait également d'instaurer une taxation des dépenses publicitaires et des offres promotionnelles des opérateurs de jeux. Plus précisément, il a permis de créer une contribution au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie pesant sur les opérateurs se livrant à l'exploitation de divers jeux d'argent et de hasard, notamment les casinos, les jeux de loterie, les paris sportifs en réseau physique de distribution et les paris sportifs et jeux de cercle en ligne430(*). La contribution est assise sur les dépenses de publication et des achats d'espaces publicitaires, sur les frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, ainsi que sur les prestations externalisées de même nature. Son taux est fixé à 15 %.
L'évaluation des recettes attendues au titre de cette nouvelle contribution n'est pas connue.
B. Exclure du périmètre de la taxe sur les dépenses de publicités des jeux d'argent les activités tierces exercées par les casinos
Le présent article, issu d'un amendement de M. Charles de Courson adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à préciser l'assiette de la contribution sur les dépenses de publicité des jeux d'argent et de hasard prévue à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale.
Après le premier alinéa de l'article précité, qui liste les opérateurs redevables de la contribution en fonction de la nature des activités qu'ils exploitent, ainsi que les activités exclues de ce périmètre, il est proposé d'insérer un alinéa précisant que seules sont incluses dans le champ des dépenses soumises à la contribution précitée celles afférentes à une activité de jeux d'argent pour les casinos431(*). Cette précision permet d'exclure du champ de la contribution les dépenses de publicité relatives à toute autre activité développée par ces établissements, notamment les activités de restauration et de spectacle ou d'animation culturelle.
Enfin, il est proposé de gager la perte de recettes résultant de cette exclusion sur une majoration de l'accise sur les tabacs.
II - La position de la commission
L'objet de la taxe ne portant que sur les jeux d'argent et de hasard, et non sur les activités tierces éventuellement développées par les opérateurs, la précision votée à l'Assemblée nationale apparaît bienvenue à la commission, qui y souscrit. Elle a adopté un amendement rédactionnel n° 620.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 11
quinquies (nouveau)
Allègement de la taxe sur les ventes en gros aux
officines pharmaceutiques
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'abaisser de 1,5 % à 1,3 % le taux de la première tranche de la taxe sur la vente en gros des médicaments remboursables.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Une dégradation continue de la santé financière du secteur de la répartition pharmaceutique qu'il convient d'endiguer
1. La situation économique du secteur de la répartition pharmaceutique est critique
Les grossistes répartiteurs assurent, dans le respect des obligations de service public auxquelles ils sont soumis432(*) (et qui se traduisent notamment par des exigences en matière de délais de livraison, de continuité de l'approvisionnement, de traçabilité des produits et de sécurité sanitaire), l'approvisionnement quotidien de près de 19 000 officines de pharmacie en médicaments et produits de santé.
Le modèle économique de la répartition pharmaceutique est également très encadré. Selon le code de la sécurité sociale, le prix public des médicaments remboursables (PPTTC) est constitué d'un prix fabriquant hors taxes (PFHT) auquel s'ajoutent des marges réglementées de distribution, fixées par arrêté, rémunérant notamment l'activité de vente en gros aux officines. Ainsi, la rémunération des grossistes répartiteurs est composée d'une marge de 6,93 % du prix du fabricant hors taxe, encadré par une marge plancher de 0,30 euros et une marge plafond de 32,50 euros433(*).
Au cours des quinze dernières années, plusieurs travaux ont fait état d'une dégradation préoccupante de la situation économique du secteur de la répartition pharmaceutique.
Dans un avis publié en 2019434(*), l'Autorité de la concurrence fait le constat d'un secteur fragilisé, les faibles niveaux de marge ne permettant pas aux grossistes répartiteurs de compenser leurs charges, et notamment le coût des obligations de service public auxquelles ils sont tenus. Déjà, en 2014, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) pointait dans un rapport435(*) « l'essoufflement du modèle économique » du secteur de la répartition pharmaceutique, en lien avec le mouvement continu de diminution du prix des médicaments, le développement des médicaments génériques et l'essor des médicaments innovants onéreux.
Ces difficultés se sont accentuées ces dernières années, les grossistes-répartiteurs devant concilier la hausse des coûts fixes qui a résulté de l'inflation avec la concurrence de la vente directe pratiquée par les laboratoires pharmaceutiques, tout en respectant les obligations de service public qui s'imposent à eux.
2. La réforme du circuit d'approvisionnement des produits de contraste aggrave cette situation
En 2024, une réforme du circuit d'approvisionnement et des modalités de financement des produits de contraste utilisés en radiologie est entrée en vigueur436(*). Il en résulte que ces produits ne sont plus pris en charge au titre de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, ni délivrés sur prescription médicale par les pharmacies d'officine aux patients.
En lieu et place, il revient aux centres ou cabinets médicaux de s'approvisionner directement auprès des laboratoires pharmaceutiques exploitant les produits de contraste, ces laboratoires étant autorisés à vendre directement des médicaments utilisés en diagnostic médical aux praticiens habilités437(*).
L'approvisionnement des pharmacies en produits de contraste représentant une partie de l'activité des grossistes répartiteurs, cette réforme implique une perte de revenus importante pour le secteur. Du fait de la réglementation stricte de leur rémunération, leurs marges de manoeuvre pour compenser cette perte de revenus sont quasi-nulles.
3. La taxe sur la vente en gros des médicaments remboursables : une variable d'ajustement pour soutenir le secteur de la répartition pharmaceutique
En application de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, la taxe sur les ventes en gros de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables438(*) est due par les opérateurs de la distribution en gros de spécialités pharmaceutiques auprès des pharmacies.
L'assiette de cette taxe repose sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre du produit de la vente en gros de médicaments remboursables, à l'exception des médicaments orphelins dont le CAHT n'excède pas 30 millions d'euros. La taxe se décompose en trois parts, chacune se voyant appliquer un taux spécifique :
- un taux de 1,5 % est appliqué à la première part, qui est constituée par le CAHT réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ;
- un taux de 2,25 % est appliqué à la deuxième part, qui est constituée par la différence entre le CAHT réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente ;
- et un taux de 20 % est appliqué à la troisième part, qui est constituée du montant de la marge rétrocédée par le distributeur au pharmacien, c'est-à-dire la différence entre la marge théorique que le distributeur peut réaliser sur les médicaments principes et la marge effectivement appliquée lors de la vente aux pharmaciens.
Le montant cumulé de la contribution due au titre des première et deuxième parts est plafonné à 2,55 % du CAHT de l'année civile, et ne peut être inférieur à 1,25 % du même CAHT.
En 2019, 26 grossistes-répartiteurs et 115 laboratoires pharmaceutiques étaient redevables de cette taxe, les premiers ayant contribué à hauteur de 85 % sur la première tranche439(*). Le produit de cette taxe s'est élevé, en 2024, à près de 239 millions d'euros440(*).
Déjà, en LFSS pour 2022441(*), le législateur avait allégé cette taxe pour permettre au secteur de la répartition pharmaceutique de retrouver une situation économique plus favorable, diminuant le taux appliqué à la première part de 1,75 % à 1,5 % pour un coût estimé à 35 millions d'euros (décomposés en un gain de 30 millions d'euros en année pleine pour les grossistes-répartiteurs et de 5 millions d'euros pour les laboratoires).
B. Le dispositif prévu au présent article : un allègement de la taxe sur la vente en gros des médicaments remboursables
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Issu d'un amendement du rapporteur général Thibault Bazin (Droite Républicaine) adopté contre l'avis du Gouvernement, il modifie l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale afin d'abaisser le taux appliqué à la première part de la taxe sur la vente en gros des médicaments remboursables de 1,5 % à 1,3 % (I). Aucune estimation du coût de cette mesure n'est fournie.
Le présent article s'applique à compter de l'exercice 2026 (II).
II - La position de la commission
La commission soutient cet article, au regard des difficultés économiques rencontrés par le secteur de la répartition pharmaceutique, seul maillon de la chaîne de distribution du médicament tenu à des obligations de service public pour garantir la continuité de l'approvisionnement du marché en médicaments essentiels.
Néanmoins, elle tient à souligner que la résolution des problèmes de financement du secteur ne saurait, à long terme, passer par des allégements successifs de la taxe sur la vente en gros des médicaments remboursables. Une refonte du modèle économique de la répartition pharmaceutique apparaît indispensable, les déterminants de la dégradation de la situation financière de ce secteur étant principalement d'ordre structurel.
Elle remarque en effet que si depuis plusieurs années, des efforts de diversification de l'offre de service sont conduits par le secteur et que ceux-ci doivent être salués, ils ne sauraient suffire à rétablir la santé financière d'une activité qu'il est impératif de préserver.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11
sexies (nouveau)
Fixation par la loi du plafond des remises commerciales
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, fixe dans la loi le plafond des remises commerciales mentionnées à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Les remises sur les produits de santé : un outil majeur de la régulation des dépenses de médicaments
Le principe et les modalités de fonctionnement et de calcul des remises sont largement présentés au commentaire de l'article 11 auquel le lecteur est invité à se reporter.
Le présent commentaire ne reprend donc pas ici ces développements à l'exception de ceux spécifiques aux remises commerciales visées à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
Ledit article L. 138-9 autorise les exploitants de médicaments à consentir des remises, ristournes et avantages commerciaux aux pharmacies d'officine, destinés à favoriser la pénétration de leurs produits et à adapter son prix aux réalités économiques. Cet article prévoit un plafonnement des gestes commerciaux consentis à hauteur :
- de 2,5 % du prix fabricant hors taxes (PFHT), pour l'ensemble des médicaments ;
- de 50 %, au plus, du PFHT, pour les médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du même groupe générique ou les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. L'article 33 de la LFSS pour 2025 a inclus dans ce plafond dérogatoire, les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du code de la santé publique, pour les médicaments biologiques similaires substituables.
En cas d'absence de déclaration de ces gestes commerciaux dans les délais requis, ou lorsque celle-ci s'avère manifestement inexacte, le CEPS peut fixer une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur fautif, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes concernées.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait transféré au pouvoir réglementaire le soin de fixer le plafond des remises, ristournes et avantages de toutes natures que les laboratoires pouvaient consentir aux pharmacies d'officine dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. En effet, préalablement à l'adoption de l'article 49 de la LFSS pour 2014, ce plafond était directement inscrit dans la loi et s'élevait à 17 % pour les génériques et pour les princeps soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité.
Issue d'un amendement de Christian Paul, alors rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, cette disposition visait à accompagner les mesures de transparence également inscrites dans cet article permettant de mieux évaluer le prix réel d'achat des médicaments génériques par les pharmacies d'officine. Un rapport de l'Igas avait en effet souligné l'existence d'un volume élevé de remises, ristournes, et avantages commerciaux et financiers assimilés pour un montant supérieur au plafond des remises autorisé par la loi et qui sortait de tout contrôle. Il était donc proposé de remonter le plafond dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxe ou du tarif forfaitaire de responsabilité afin de faciliter la baisse des prix négociée par le CEPS.
Ce plafond était, depuis le 22 août 2014, fixé à 40 %442(*). À la suite de l'adoption de l'article 33 de la LFSS pour 2025 étendant le bénéfice du plafond dérogatoire aux spécialités hybrides et biosimilaires substituables, ce plafond fut dans un premier temps maintenu à 40 % pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques et pour les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent443(*). Cet arrêté ne fixe alors pas de plafond pour les biosimilaires substituables qui restait alors fixé à 2,5 %.
Or, un arrêté du 4 août 2025 a prévu de ramener, à compter du 1er janvier 2028, les plafonds de ces remises à 20 % pour les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires. Cet arrêté prévoyait des taux transitoires de 30 et 25 % avant d'aboutir au plafond de 20 % (15 % pour les biosimilaires) par année civile, par ligne de produits et pour chaque officine444(*).
Un dernier arrêté du 6 octobre 2025 maintient finalement à titre transitoire un plafond transitoire de 40 % pour les génériques et les hybrides substituables et de 15 % pour les biosimilaires substituables.
Ces baisses du plafond autorisé des remises commerciales ont rencontré une forte mobilisation des représentants des pharmaciens d'officine. Ainsi l'USPO estime que cette baisse met en danger « la vitalité et l'importance du maillage officinal »445(*).
Dans son rapport d'activité provisoire pour 2024, le CEPS, destinataire des déclarations réalisées par tout fournisseur des officines de spécialités génériques des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques, indique que le montant des remises commerciales accordées au titre des génériques s'élevait à 1,16 milliard d'euros en 2023 et 1,11 milliard d'euros en 2024446(*).
B. Le dispositif proposé : fixer dans la loi le plafond des remises commerciales qui peuvent être accordées par les laboratoires aux pharmaciens pour les spécialités génériques, hybrides et biosimilaires
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale par huit amendements identiques447(*), dont un du rapporteur général de la commission des affaires sociales, fixe dans la loi le plafond des remises commerciales que peuvent accorder les laboratoires aux pharmaciens.
Il réécrit pour cela intégralement l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour inscrire dans la loi des plafonds de remises commerciales applicables à compter du 1er janvier 2026 de :
- 40 % du PFHT pour les spécialités génériques et de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
- 40 % du PFHT également pour les spécialités hybrides substituables et pour les spécialités de référence substituables figurant dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
- 40 % du PFHT enfin pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité ;
- 20 % du PHFT pour les médicaments biologiques similaires substituables ainsi que les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.
Ces plafonds désormais inscrits dans la loi, le législateur pourra le cas échéant les réviser à l'occasion de chaque loi de financement de la sécurité sociale.
Le régime d'infraction reste le même que précédemment à savoir celui fixé au titre V du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.
Le II prévoit un régime d'entrée en vigueur différé afin d'éviter toute période durant laquelle aucun plafond ne serait opposable.
Le III prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le niveau des remises commerciales pratiquées et son impact sur le marché des médicaments concernés, mais également sur des scénarios de transformation du modèle de rémunération des pharmaciens d'officine favorisant le maintien d'une offre pharmaceutique satisfaisante sur l'ensemble du territoire.
II - La position de la commission
La commission soutient pleinement les dispositions inscrites dans le présent article. Elle avait également estimé lors de l'examen du PLFSS 2025 que l'intégration des biosimilaires substituables dans le plafond dérogatoire des remises commerciales entraînerait l'augmentation des remises commerciales consenties par les laboratoires. Elle salue à ce titre la détermination d'un plafond de 20 % pour ces spécialités, qui favorisera leur pénétration et permettra de renforcer le processus de baisse de prix au bénéfice des assurés et de l'assurance maladie.
La baisse des plafonds programmée constituait un risque de perte financière majeure pour de nombreuses officines mettant en danger le maillage territorial. La commission souligne que la pharmacie constitue déjà dans de nombreux territoires le dernier lieu de santé de proximité. Le mouvement de raréfaction de l'offre officinale pourrait s'accélérer dans les prochaines années du fait notamment de la démographie déclinante des pharmaciens d'officine448(*).
Enfin, la commission salue le lancement de la mission flash conjointe Igas-IGF visant à analyser les flux financiers du circuit de distribution du médicament et faire la transparence sur les conditions d'achat des génériques et des médicaments en général. Elle constate toutefois avec regret que ce travail conduit en parallèle de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale ne permettra pas au Parlement de pouvoir bénéficier des conclusions des inspections dans le cadre de son examen.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 septies
(nouveau)
Contribution spécifique sur
les entreprises qui importent,
produisent ou commercialisent de
l'hexane
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'assujettir les entreprises qui importent, produisent ou commercialisent de l'hexane, une substance nocive pour la santé, à une contribution dont les recettes seraient fléchées vers le soutien à la conversion des outils de production et le financement d'action de prévention.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. L'hexane : une substance couramment utilisée dans l'industrie dont la nocivité est scientifiquement établie
Le n-hexane, ou simplement « hexane », est un produit chimique obtenu par le biais de la distillation du pétrole ou du gaz naturel. Il est utilisé par l'industrie comme solvant pour extraire les huiles végétales (des graines de soja, de tournesol, de colza) et dans divers procédés industriels.
Si les travailleurs des industries agroalimentaires sont les plus exposés, les consommateurs sont également susceptibles d'entrer en contact avec ce produit, des résidus d'hexane pouvant être présents dans certaines huiles alimentaires, margarines, laits infantiles ou plats préparés.
L'association Greenpeace, autrice d'un rapport sur l'hexane449(*), soulève les carences de la réglementation en vigueur : d'une part, celle-ci ne couvre que peu de produits alimentaires ; d'autre part, la limite maximale de résidus qu'elle fixe s'appuie sur des études datant de 1996.
Les deux tiers des usines françaises n'auraient plus recours à l'hexane aujourd'hui, mais la majorité des graines oléo-protéagineuses transformées le sont dans des sites utilisant l'hexane, d'où la persistance de résidus dans les produits alimentaires consommés. Le groupe alimentaire Avril, propriétaire des marques Lesieur et Isio 4, détient 62 sites industriels en France. Il assure la transformation de plus de la moitié des graines oléo-protéagineuses sur le territoire, dont plus de 90 % le sont dans des usines utilisant de l'hexane450(*).
Or, la dangerosité de cette substance est documentée depuis déjà plusieurs années.
Dès 2014, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pointait les atteintes irréversibles du système nerveux périphérique provoquées par l'hexane451(*). Par la suite, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a confirmé que l'hexane « peut provoquer des signes de dépression du système nerveux central », qu'il est « irritant pour les muqueuses oculaire et respiratoire » et qu'en cas d'exposition répétée, les intoxications les plus graves se traduisent principalement par « des atteintes du système nerveux, en particulier des polynévrites périphériques » (atteinte diffuse des nerfs périphériques) pouvant évoluer vers des paralysies452(*). Certaines études suggèrent également d'importantes corrélations entre l'exposition chronique à l'hexane et le développement de maladies neurodégénératives telle que Parkinson453(*). Il existe par ailleurs de fortes suspicions quant à ses effets reprotoxiques chez l'homme et la femme.
Le 30 septembre 2024, l'Agence européenne des produits chimiques a reclassé l'hexane en « neurotoxique avéré » et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a établi la nécessité, au regard des préoccupations soulevées, de réévaluer la sécurité de l'hexane en tant que solvant d'extraction dans la production alimentaire454(*).
L'utilisation de l'hexane constitue donc un enjeu majeur sur le plan de la sécurité sanitaire dont les pouvoirs publics comme les entreprises doivent se saisir, respectivement sur le plan de la réglementation et des processus de production.
Actuellement, la réglementation européenne fixe comme limite maximale de résidus présents dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits 1 milligramme par kilogramme dans la graisse, l'huile ou le beurre de cacao455(*).
En France, la réglementation définit ces limites maximales dans un arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires. Il vise notamment les denrées suivantes : beurre de cacao, germes de céréales dégraissées, graisses et huiles alimentaires, produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées.
B. Le présent article instaure une contribution sur les entreprises qui utilisent de l'hexane dans le but de modifier leurs processus de production
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Issu d'un amendement de M. Richard Ramos (Les Démocrates) ayant fait l'objet d'une demande de retrait du rapporteur de la commission des affaires sociales et d'un avis de sagesse du Gouvernement, il instaure une contribution sur les entreprises qui utilisent de l'hexane, appliquant le principe « pollueur-payeur » dans le but d'inciter les industries agroalimentaires à réduire l'usage de cette substance.
Il modifie l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution prélevée sur les entreprises du secteur du médicament (clause de sauvegarde), afin d'y insérer un nouvel alinéa disposant que toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d'affaires. Cette contribution est fixée à 0,3 centimes d'euros par litre (1° du I).
Deux autres alinéas sont insérés au sein du même article. Le premier prévoit que les sommes collectées permettent à hauteur de 50 % d'accompagner les industriels dans la conversion de leur outil de production à des solutions alternatives à l'utilisation de l'hexane, et à 50 % de financer des actions de prévention. Le second dispose que le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie (2° du I).
Aucune estimation n'est fournie sur le rendement de cette contribution.
L'entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2026 (II).
II - La position de la commission
La commission partage l'inquiétude de l'Assemblée nationale sur les conséquences de l'hexane sur la sécurité au travail et, plus largement, sur la santé publique. Il lui apparaît indispensable que les pouvoirs publics, au niveau national comme au niveau européen, se saisissent des dernières études scientifiques pour, si cela est jugé nécessaire, adapter la réglementation.
Néanmoins, elle considère que la mise en place d'une taxe n'est pas le meilleur moyen de parvenir à l'objectif visé, à savoir l'abandon progressif de cette substance. En effet, au-delà d'un niveau de fiscalité sur les entreprises déjà très élevé en France, les industries risquent de répercuter la contribution sur les prix plutôt que d'adapter leurs processus de production, ceci exigeant des investissements importants.
Elle estime qu'il est préférable de laisser aux autorités sanitaires le soin de poursuivre l'analyse des conséquences de l'hexane - l'EFSA conduit actuellement des travaux complémentaires sur le sujet - et, si toutefois les données scientifiques l'exigeaient, d'envisager un durcissement de la réglementation pouvant aller jusqu'à l'interdiction.
Au regard de ces éléments, la commission a adopté l'amendement de suppression n°621 présenté par la rapporteure générale.
La commission propose de supprimer cet article.
Article
12
Clarifier les transferts financiers au sein des administrations
de
sécurité sociale (« article-tuyau »)
Cet article est l'habituel « article-tuyau ». En modifiant la répartition entre branches de diverses recettes (essentiellement les prélèvements sur les stock-options, la CSG sur les revenus de remplacement et la taxe sur les conventions d'assurance), il transfère 5,7 milliards d'euros de la branche famille vers la branche vieillesse (3,9 milliards d'euros), la branche maladie (1,6 milliard d'euros) et la branche autonomie (0,2 milliard d'euros). Il s'agit de neutraliser l'effet sur les branches des dispositions du présent PLFSS et des textes réglementaires associés, mais aussi de tirer les conséquences de la proposition de l'article 40 du projet de loi de finances pour 2026 de transférer à l'État le gain résultant en 2026 pour la sécurité sociale de la réforme des allégements généraux de cotisations sociales patronales réalisée en 2025 et prévue pour 2026 (respectivement 1,6 milliard d'euros et 1,4 milliard d'euros, soit 3 milliards d'euros au total) et de réaliser un transfert « discrétionnaire » de 1,4 milliard d'euros de la Cnaf vers la Cnam.
En outre, le présent article :
- apporte diverses précisions liées à la suppression du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS pour 2025 ;
- reporte une nouvelle fois (au 1er janvier 2027) la mise en oeuvre du mécanisme de reversement des sommes dues (RSD) par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
- dans le cas de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg), prévoit le transfert de l'excédent éventuel des opérations relatives à la contribution tarifaire d'acheminement (TFA) à la Cnav.
La commission considère que la situation financière de l'Acoss ne permet pas de « jouer avec le feu » en aggravant artificiellement son déficit, déjà très élevé. Elle s'oppose donc au transfert vers l'État des 3 milliards d'euros de gain de la réforme des allégements généraux de 2025 et 2026.
Elle déplore le manque de moyens consacrés à la politique de la famille, et donc le transfert de 1,4 milliard d'euros de la Cnaf vers la Cnam, révélateur des insuffisances en la matière. Toutefois, compte tenu de la nécessité de ne pas entretenir de déséquilibres artificiels entre branches (les branches famille et maladie étant excédentaire et très déficitaire, même après cette mesure), elle ne s'oppose pas à ce transfert.
La commission propose en outre d'apporter une précision rédactionnelle au dispositif proposé.
Elle propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. La modification de la répartition de recettes fiscales entre branches
1. Les transferts entre branches proposés par cet article
Le présent article est indissociable de l'article 40 du projet de loi de finances (PLF), qui réduit modifiant la part de TVA affectée à la sécurité sociale de 9,1 milliards d'euros.
Les transferts entre branches réalisés par le présent article, tels qu'ils sont retracés par l'annexe 3 au PLFSS, sont synthétisés par le tableau page suivante (lignes grisées). Ce tableau indique en outre le montant global des mesures sur les recettes et les dépenses, la réduction de la TVA affectée à la sécurité sociale par l'article 40 du PLF 2026, et l'effet global de l'ensemble de ces mouvements.
Principales mesures du PLF, du PLFSS et des textes associés ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale (2026)
(en milliards d'euros)
|
Maladie |
AT-MP |
Vieillesse |
Famille |
Autonomie |
Total |
|
|
Mesures en recettes proposées par le PLFSS et les textes réglementaires associés (A) |
11,1 |
0,3 |
- 4,3 |
4,2 |
- 0,1 |
11,2 |
|
Mesures en dépenses proposées par le PLFSS et les textes réglementaires associés (B) |
6,1 |
0,2 |
2,1 |
0,9 |
- 0,2 |
9,1 |
|
Transferts entre l'État et la sécurité sociale (via ajustement de la TVA affectée par l'art. 40 du PLF 2026) (C) |
- 9,1 |
- 9,1 |
||||
|
Affectation de l'assujettissement des IJ ALD (via TVA) |
0,7 |
0,7 |
||||
|
Moindre TVA au titre de la rétrocession à l'Etat à compter de 2026 des économies sur les AG issues de la LFSS 2025 |
- 1,6 |
- 1,6 |
||||
|
Moindre TVA au titre de la modification en 2026 de la répartition du coût des AG entre la sécurité sociale d'une part, l'Agirc-Arrco, et l'Unédic d'autre part, résultant de la suppression des bandeaux |
- 6,8 |
- 6,8 |
||||
|
Moindre TVA au titre de la rétrocession à l'Etat du gain de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 (décret à venir) |
- 1,4 |
- 1,4 |
||||
|
Prolongation du transfert de l'État à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d'État (via TS)* |
0,07 |
|||||
|
Transferts internes à la sécurité sociale (présent article) (D) |
1,6 |
3,9 |
- 5,7 |
0,2 |
0,0 |
|
|
Rétrocession à la Cnam du gain réduction des niches sur les compléments de salaire (via TS) |
1,2 |
- 1,2 |
0,0 |
|||
|
Rétrocession à l'État à compter de 2026 des économies sur les AG issus de la LFSS 2025 (via TS) |
0,8 |
- 0,8 |
0,0 |
|||
|
Neutralisation des impacts par branche du nouveau dispositif RGDU issu de la LFSS 2025 (via TS) |
- 2,5 |
2,3 |
0,2 |
0,0 |
||
|
Neutralisation des impacts par branche du nouveau dispositif RGDU issu de la LFSS 2025 (via TSCA) |
1,5 |
- 1,5 |
0,0 |
|||
|
Neutralisation des impacts par branche du dispositif RGDU issu de la LFSS 2025 (via ex-TVS) |
1 |
- 1 |
0,0 |
|||
|
Neutralisation des impacts par branche du dispositif RGDU issu de la LFSS 2025 (via prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions) |
1,6 |
- 1,6 |
0,0 |
|||
|
Rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 (via TS) |
0,5 |
- 0,5 |
0 |
0,0 |
||
|
Rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 (via prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'ations) |
0,1 |
- 0,1 |
0,0 |
|||
|
Rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 (via paris/jeux) |
0,2 |
- 0,2 |
0,0 |
|||
|
Réaffectation de 0,65 pt de CSG remplacement de la Cnaf à la Cnam |
1,4 |
- 1,4 |
0,0 |
|||
|
Prolongation du transfert de l'État à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d'État (via TS)* |
- 0,07 |
0,07 |
0,0 |
|||
|
Total des mouvements (A+B+C+D) |
2,5 |
- 0,097 |
- 1,8 |
- 1,5 |
0,01 |
- 0,9 |
AG : allégements généraux. Agirc-Arrco : Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraite complémentaire. ALD : affection de longue durée. Cnam : Caisse nationale de l'assurance maladie. IJ : indemnités journalières. PLF : projet de loi de finances. RGDU : réduction générale dégressive unique. Unédic : Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. TS : taxe sur les salaires. TSCA : taxe sur les conventions d'assurance. TVS : taxe sur les véhicules de société.
* Transfert non mentionné par l'annexe 3 du fait de son faible montant mais mentionné dans l'évaluation préalable du présent article.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'annexe 3 au PLFSSComme le montre le tableau ci-avant, en modifiant la répartition entre branches de diverses recettes (essentiellement les prélèvements sur les stock-options, la CSG sur les revenus de remplacement et la taxe sur les conventions d'assurance), le présent article transfère 5,7 milliards d'euros de la branche famille vers la branche vieillesse (3,9 milliards d'euros), la branche maladie (1,6 milliard d'euros) et la branche autonomie (0,2 milliard d'euros).
c) La neutralisation de l'effet sur les branches des dispositions du PLFSS et des textes réglementaires associés
Comme d'habitude, il s'agit notamment de neutraliser l'effet sur les branches des dispositions du PLFSS et des textes réglementaires associés.
• La neutralisation de la suppression en 2026 des bandeaux famille et maladie
La principale de ces mesures est la neutralisation du transfert « spontané », du fait de l'article 49 du PLF pour 2026, de 6,8 milliards d'euros de recettes de la sécurité sociale vers l'Agirc-Arrco et l'Unédic, en conséquence de la suppression au 1er janvier 2026 des bandeaux famille et maladie résultant de l'article 18 de la LFSS 2025.
On rappelle que l'article 18 précité prévoit qu'à compter du 1er janvier 2026, les allégements généraux de cotisations sociales patronales ne seront plus constitués de la juxtaposition d'un allégement dégressif et des bandeaux famille et maladie (deux allégements non dégressifs concernant les cotisations affectées respectivement à la branche famille et à la branche maladie), mais uniquement d'un allégement dégressif, dénommé réduction générale dégressive unique (RGDU)456(*).
Actuellement, les bandeaux majorent le coût des allégements généraux pour les branches famille et maladie. Leur disparition au 1er janvier 2026 répartira donc différemment le coût des allégements généraux entre la sécurité sociale d'une part, l'Agirc-Arrco et l'Unédic457(*) d'autre part. Selon l'annexe 3 au PLFSS (p. 12), elle transférera de la première vers les secondes des recettes de 6,8 milliards d'euros.
Aussi, l'article 40 du PLF, qui réduit la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, intègre dans cette réduction ce montant de 6,8 milliards d'euros, et augmente à due concurrence la part affectée à l'Agirc-Arrco et à l'Unédic.
La branche maladie étant la seule à percevoir la TVA, cette réduction de la TVA affectée à la sécurité sociale réduit les seules recettes de la branche maladie.
Afin de répartir cette réduction des recettes de TVA entre branches de manière à neutraliser pour chacune d'elles la suppression des bandeaux, le présent article transfère diverses ressources fiscales entre branches, conformément au tableau ci-après.
Neutralisation de l'effet de la suppression des bandeaux en 2026
(en milliards d'euros)
|
Maladie |
AT-MP |
Vieillesse |
Famille |
Autonomie |
Total |
|
|
Suppression des bandeaux (art. 18 LFSS 2025) (A) |
9,4 |
- 0,1 |
- 6,2 |
3,9 |
- 0,2 |
6,8 |
|
Réduction de la TVA affectée (art. 40 PLF 2026) (B) |
- 6,8 |
- 6,8 |
||||
|
Présent article (C) |
- 2,5 |
0 |
6,4 |
- 4,1 |
0,2 |
0,0 |
|
Dont : |
||||||
|
Taxe sur les salaires (TS) |
- 2,5 |
2,3 |
0,2 |
0,0 |
||
|
Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) |
1,5 |
- 1,5 |
0,0 |
|||
|
Taxe sur les véhicules de société (ex-TVS) |
1,0 |
- 1,0 |
0,0 |
|||
|
Prélèvements sur les stock-options |
1,6 |
- 1,6 |
0,0 |
|||
|
Total des mouvements (A+B+C) |
0,1* |
- 0,1* |
0,2* |
- 0,2* |
0,0* |
0,0 |
* Calculs de la commission. Le fait que les montants ne soient pas totalement nuls peut s'expliquer par des arrondis.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'annexe 3 au PLFSS
• Le transfert à la Cnam du gain réduction des niches sur les compléments de salaire (article 8 du présent PLFSS)
L'article 8 du présent PLFSS prévoit de réduire les niches sur les compléments de salaire pour un montant de 1,2 milliard d'euros (cf. supra le commentaire de l'article 8).
Les transferts entre branches de taxe sur les salaires prévus par le présent article comprennent le transfert de la Cnav vers la Cnam du gain correspondant.
d) Le transfert discrétionnaire de 1,4 milliard d'euros de la Cnaf vers la Cnam
Le présent article propose de transférer, de manière discrétionnaire, 1,4 milliard d'euros de la Cnaf vers la Cnam (via la réaffectation de 0,65 point de CSG remplacement).
Selon l'évaluation préalable du présent article, ce transfert se justifie par le fait que « la situation des branches après application des mesures proposées dans la LFSS demeure très contrastée avec notamment un déficit important de la branche maladie et un excédent important et croissant de la branche famille. Pour corriger en partie cet effet et corriger les effets de structure liés au dynamisme des recettes sur lesquelles sont assises ces branches, cet article propose une mesure de transfert d'une fraction du rendement de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement qui bénéficie actuellement à la branche famille à hauteur de 1,4 milliard d'euros. La branche famille restera excédentaire malgré ce transfert ».
S'il convient en effet de ne pas maintenir artificiellement des déséquilibres importants entre branches, la commission déplore une fois de plus les insuffisances de la politique familiale, dont ce transfert n'est que la conséquence.
e) La prise en compte du transfert discrétionnaire par l'article 40 du PLF de 3 milliards d'euros, correspondant au gain résultant de la réforme des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2025 et en 2026
Le présent article tire les conséquences d'une autre mesure discrétionnaire, réalisée par l'article 40 du PLF pour 2026 : le transfert à l'État de 3 milliards d'euros, correspondant au gain résultant en 2026 pour la sécurité sociale de la réforme des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2025 (par l'article 18 de la LFSS pour 2025, qui correspond pour la sécurité sociale à un gain net de 1,6 milliard d'euros) et en 2026 (par un futur décret, correspondant à un gain supplémentaire de 1,4 milliard d'euros).
f) Prolongation du transfert de l'État à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d'État
Pour un montant plus anecdotique, le présent article tire les conséquences du transfert par l'article 40 au PLF pour 2026 de 70 millions d'euros de TVA de l'État vers la sécurité sociale, au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites de 2023 pour le régime de la fonction publique d'État.
La branche maladie étant la seule à percevoir la TVA, le présent article propose de transférer 70 millions d'euros de taxe sur les salaires de la branche maladie vers la branche vieillesse.
Certes, aucune disposition de la LFRSS 2023 ne prévoit de tel transfert.
Toutefois de tels transferts ont déjà été réalisés avec l'approbation de la commission : 194 millions d'euros par la LFSS 2024, puis 69 millions d'euros par la LFSS 2025.
Selon l'exposé des motifs du présent article, le montant de 70 millions d'euros vient du fait que le rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique de l'État passerait de 263 millions d'euros en 2025 à 333 millions d'euros en 2026.
2. Les modalités de réalisation des différents transferts
Le tableau ci-après synthétise les dispositions du présent article relatives aux affectations de recettes entre branches.
Dispositions du
présent article relatives aux affectations de recettes
entre
branches
|
Article modifié |
Modification de la répartition de recettes fiscales entre branches |
« Toilettage » de dispositions |
|
|
I. - |
|||
|
1° |
|||
|
a |
L. 131-8 CSS |
Modification de la répartition entre branches de la taxe sur les salaires |
|
|
b |
L. 131-8 CSS |
Transfert des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques de la branche famille vers la branche vieillesse |
|
|
c |
L. 131-8 CSS |
Modification de la répartition entre branches de la CSG sur les revenus de remplacement |
Précision rédactionnelle |
|
d |
L. 131-8 CSS |
Transfert de la branche famille à la branche vieillesse d'une fraction de taxe spéciale sur les conventions d'assurance automobile (TSCA) |
Correction d'une erreur de référence |
|
e |
L. 131-8 CSS |
Correction d'une erreur de référence |
|
|
f |
L. 131-8 CSS |
Modification de la répartition entre branche des prélèvements sur les stock-options et sur les attributions gratuites d'actions et du prélèvement sur les jeux et paris en ligne |
|
|
2° |
Coordination avec le I.1° f (contributions sur les stock-options et sur les attributions gratuites d'actions) |
||
|
3° |
L. 137-24 CSS |
Coordination avec le I.1° f (contributions sur les paris et les jeux) |
CSG : cotisation sociale généralisée. CSS : code de la sécurité sociale. TSCA : taxe sur les conventions d'assurance.
Source : Commission des affaires sociales, d'après le présent article
a) La modification de la répartition entre branches de la taxe sur les salaires
Le a du 1° du I du présent article modifie la répartition entre branches de la taxe sur les salaires par les ajustements des fractions des branches concernées conformément au tableau ci-après.
Transferts de taxe sur les salaires réalisés par le présent article
(en millions d'euros)
|
Fraction actuelle (en %) |
Fraction proposée (en %) |
Ecart (en points) |
Transfert correspondant calculé par la commission* |
Transfert correspondant selon l'évaluation préalable du présent article |
|
|
Vieillesse |
63,25 |
62,73 |
- 0,52 |
- 93 |
- 94 |
|
Maladie |
20,93 |
20,39 |
- 0,54 |
- 97 |
- 96 |
|
Famille |
|||||
|
Autonomie |
5,08 |
6,14 |
1,06 |
190 |
190 |
* Sur la base de la prévision pour 2026 de taxe sur les salaires du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025 (17 966 millions d'euros).
Source : Commission des affaires sociales
Le chiffrage par la commission des montants concernés ne présente pas de différence significative par rapport à celui de l'évaluation préalable du présent article.
Comme indiqué supra, ce transfert serait le résultat de cinq mouvements différents458(*).
b) Le transfert de l'ex-taxe des véhicules de société de la branche famille vers la branche vieillesse
Le b du 1° du I du présent article transfère les taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques (l'ex-taxe sur les véhicules de société) de la branche famille vers la branche vieillesse.
Les taxes concernées sont celles prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services : la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Depuis 2023, ces deux taxes remplacent la taxe sur les véhicules de société (TVS). Elles sont affectées à la branche maladie pour 24,1 % et pour la branche famille pour 75,9 %.
Le présent article propose que cette part de 75,9 % soit transférée à la branche vieillesse.
Selon l'évaluation préalable du présent article, le transfert correspondant serait de 984 millions d'euros. Le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025 indique toutefois qu'en 2026, à droit inchangé l'ex-TVS affectée à la branche famille serait légèrement inférieure à ce montant (918 millions d'euros).
Comme indiqué supra, il s'agit de contribuer, avec d'autres transferts, à la neutralisation des impacts sur les différentes branches de la suppression des bandeaux résultant de l'instauration de la RGDU au 1er janvier 2025459(*).
c) Le transfert de la Cnaf vers la Cnam de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité
Le c du 1° du I du présent article modifie la répartition entre branches du produit de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité.
Actuellement, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit un « fléchage » relativement complexe du produit de la CSG.
Le présent article prévoit que dans le cas de la contribution au taux de 8,3 % sur les pensions de retraite et d'invalidité (soit le taux « normal » pour ces pensions460(*)), 0,65 point de CSG est transféré de la Cnaf vers la Cnam, conformément au tableau ci-après.
CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité attribuée à la Cnaf et à la Cnam
(en points de CSG)
|
Taux actuel |
Taux proposé |
Écart |
|
|
Cnaf |
0,95 |
0,3 |
0,65 |
|
Cnam |
1,88 |
2,53 |
- 0,65 |
Source : Commission des affaires sociales, d'après le code de la sécurité sociale et le présent article
Ce transfert est chiffré par l'évaluation préalable du présent article à 1 411 millions d'euros, ce qui est cohérent avec les données dont dispose la commission461(*).
Comme indiqué supra, il s'agit d'un transfert discrétionnaire, dont l'objet n'est pas de neutraliser une mesure du PLFSS ou des textes réglementaires associés, mais de réduire l'excédent de la branche famille et le déficit de la branche maladie.
Le c du 1° du I du présent article propose également une précision rédactionnelle relatif à la part de CSG affectée à l'Unédic462(*).
d) Le transfert de la branche famille à la branche vieillesse d'une fraction de TSCA
L'ancienne taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) automobile et la contribution sur les véhicules terrestres à moteur ont été fusionnées à partir de 2016 dans une nouvelle TSCA. Son assiette porte sur les primes versées au titre de l'assurance sur les véhicules et sur les incendies notamment.
L'article 1001 du code général des impôts prévoit que le produit de la taxe est affecté aux départements, sauf 45 millions d'euros affectés à l'État et, pour un montant de 1,5 milliard d'euros en 2025463(*), diverses fractions de différentes assiettes de la taxe, qui sont affectées à la sécurité sociale.
L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit que 13,3 % de la part de la taxe au taux de 33 % (c'est-à-dire celle reposant sur les véhicules terrestres à moteur « de droit commun ») est affectée à la branche famille et que sa part au taux de 15 % (c'est-à-dire celle reposant sur les véhicules terrestres de plus de 3,5 tonnes) est affectée à la branche autonomie.
Le présent article propose de transférer la première de ces deux parts (celle sur les véhicules terrestres à moteur « de droit commun »), actuellement affectée à la branche famille, à la branche vieillesse.
Comme indiqué supra, il s'agit de contribuer, avec d'autres transferts, à la neutralisation des impacts sur les différentes branches de la suppression des bandeaux résultant de l'instauration de la RGDU au 1er janvier 2025464(*).
L'évaluation préalable du présent article chiffre le montant de ce transfert à 1 513 millions d'euros, ce qui correspond exactement à la prévision (à droit constant) pour 2026 de TSCA pour la branche famille du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025.
Le d et le e du 1° du I du présent article proposent également de remplacer deux occurrences d'une référence imprécise dans l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
e) La modification de la répartition entre branches des prélèvements sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions et du prélèvement sur les jeux et paris en ligne
Le f du 1° et les 2° et 3° du I du présent article proposent de réaliser les transferts ci-après.
Transferts de prélèvement sur les
stock-options et de contribution
sur les paris/jeux depuis la
branche famille en conséquence de la réforme en 2026
des allégements généraux (2026)
(en milliards d'euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Total |
|
|
Neutralisation des impacts par branche du dispositif RGDU issu de la LFSS 2025 (via prélèvements sur les stock-options et sur les attributions gratuites d'actions) |
1,6 |
- 1,6 |
0,0 |
|
|
Rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 (via prélèvements sur les stock-options et sur les attributions gratuites d'actions) |
0,1 |
- 0,1 |
0,0 |
|
|
Rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 (via contribution sur paris/jeux) |
0,2 |
- 0,2 |
0,0 |
RGDU : réduction générale dégressive unique.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après l'annexe 3 au PLFSS
• Transferts de prélèvements sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions
Actuellement, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la branche famille perçoit notamment les contributions suivantes :
- la contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts (stock-options) et au I de l'article 80 quaterdecies (attributions gratuites d'actions465(*)) du même code prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale ;
- la contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets afférents à des parts de gestionnaires de fonds d'investissement à rendement subordonné, dites de « carried interest » (article 80 quindecies du code général des impôts), prévue par l'article L. 137-18 du code de la sécurité sociale.
Chacun de ces deux articles du code de la sécurité sociale (articles L. 137-14 et L. 137-18) indique également, par coordination avec l'article L. 131-8 du même code, que la contribution est affectée à la Cnaf.
Le I du présent article propose :
- dans son f, de modifier l'article L. 131-8 pour prévoir que la contribution n'est plus affectée à la branche famille, mais à la branche vieillesse pour 93,98 % et à la branche maladie pour 6,02 % ;
- dans son 2°, de modifier par coordination les articles L. 137-14 et L. 137-18, en indiquant toutefois exclusivement, sur le modèle de leur rédaction actuelle, que les contributions sont affectées à la Cnav (sans référence à la branche maladie)466(*).
Comme indiqué supra, il s'agit :
- pour 1,6 milliard d'euros (transfert vers la branche vieillesse), de contribuer, avec d'autres transferts, à la neutralisation des impacts sur les différentes branches de la suppression des bandeaux résultant de l'instauration de la RGDU au 1er janvier 2025467(*) ;
- pour 0,1 milliard d'euros (transfert vers la branche maladie), de contribuer à la rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026.
L'évaluation préalable du présent article chiffre le transfert correspondant à 1 669 millions d'euros, dont 1 569 millions d'euros vers la branche vieillesse et 101 millions d'euros vers la branche maladie. Ces montants sont cohérents avec le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025468(*).
• Transfert des contributions sur les paris et les jeux
Actuellement, l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale prévoit que le produit brut des jeux au titre des paris hippiques (article L. 137-20 du même code), des paris sportifs (article L. 137-21 du même code) et des jeux de cercle en ligne (article L. 137-22 du même code) est affecté :
- à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique (ANSP, également connue sous le nom de Santé publique France) ;
- au-delà de ce plafond, à la Cnaf.
Le présent article propose que la part actuellement affectée à la Cnaf le soit désormais à la branche famille pour 66 % et à la branche maladie pour 34 %.
Comme indiqué supra, il s'agit de contribuer, avec d'autres transferts, à la neutralisation des impacts sur les différentes branches de la suppression des bandeaux résultant de l'instauration de la RGDU au 1er janvier 2025469(*).
L'évaluation préalable du présent article chiffre le transfert correspondant à 152 millions d'euros, ce qui est proche du montant que l'on peut calculer à partir du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025470(*).
B. Autres dispositions
1. Précisions liées à la suppression du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS pour 2025
Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été supprimé au 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS pour 2025.
L'article 24 précité (article 8 du texte initial) est l'article-tuyau de la LFSS pour 2025. Il a été complété au Sénat par un amendement du Gouvernement.
Les précisions concernées sont synthétisées par le tableau ci-après.
Précisions proposées par le présent article liées à la suppression du FSV à compter du 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS 2025
|
Subdivision du présent article |
Article modifié |
Précisions liées à la suppression du FSV à compter du 1er janvier 2026 par l'art. 24 de la LFSS 2025 |
|
I. 4° |
L. 222-2-1 CSS |
Suppression de références inutiles au régime général. |
|
II. |
L. 38 CPCM |
Suppression d'une référence désormais injustifiée au FSV. |
|
IV. |
49 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale |
Suppression d'une référence désormais injustifiée au FSV. |
|
VII. - |
Dérogation en 2025 à l'article L. 131-8 CSS (non codifiée) |
Précision qu'en 2025, la CSG affectée à la branche vieillesse par les dispositions actuelles de l'article L. 131-8 CSS est affectée au FSV |
CPCM : code des pensions civiles et militaires. CRCM : code rural et de la pêche maritime. CSS : code de la sécurité sociale. FSV : Fonds de solidarité vieillesse.
Source : Commission des affaires sociales, d'après le présent article
2. Report au 1er janvier 2027 de la mise en oeuvre du mécanisme de reversement des sommes dues (RSD) par la Caisse de mutualité sociale agricole (CCMSA)
Le 1° du III et le V du présent article proposent d'apporter les modifications ci-après.
Dispositions du présent article relatives la mise en oeuvre du mécanisme de reversement des sommes dues (RSD) par la CCMSA
|
Subdivision du présent article |
Article modifié |
Objet de la modification |
|
III. 1° |
L. 723-11 CRPM |
Renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les frais de gestion applicables par la CCMSA à ses attributaires, dans le cadre du mécanisme de RSD. |
|
II.2° |
L. 725-3 |
Précision des contributions concernées par le RSD. |
|
V. |
6 de la LFSS pour 2023 |
Report au 1er janvier 2027 de l'application par la CCMSA du mécanisme de RSD. |
CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. CRCM : code rural et de la pêche maritime. RSD : reversement des sommes dues.
Source : Commission des affaires sociales, d'après le présent article
a) La situation actuelle
En 2019471(*), le législateur a simplifié les relations financières entre les Urssaf et les organismes attributaires des sommes qu'elles recouvrent en instaurant, à compter du 1er janvier 2022, le reversement des cotisations sur la base des sommes dues.
Le mécanisme de reversement des sommes dues
(RSD)
applicable dans le cas des Urssaf
L'Urssaf Caisse nationale centralise l'ensemble des sommes recouvrées par les Urssaf dans l'Hexagone et les CGSS dans les Outre-mer et assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
À titre dérogatoire, pour certaines catégories de cotisations et de contributions sociales, le produit reversé n'est plus celui des sommes effectivement recouvrées, mais celui des sommes dues par les assurés, telles qu'elles ont été déclarées dans la DSN puis contrôlées, sans tenir compte des éventuels impayés472(*).
En contrepartie, l'Urssaf Caisse nationale applique aux sommes collectées un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes. Ce taux est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux Urssaf à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non-recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence473(*).
Le résultat financier généré par ce dispositif est affecté au régime général et réparti entre ses branches474(*), à hauteur, en 2023, de 90,7 % pour la branche maladie, de 7,5 % pour la branche vieillesse et de 1,8 % pour la branche autonomie475(*).
Au total, en faisant peser sur le régime général le risque de non-recouvrement des attributaires des cotisations recouvrées par les Urssaf, le reversement des sommes dues permet de garantir la prévisibilité des recettes des attributaires.
En compensation, l'Urssaf Caisse nationale prélève sur les sommes recouvrées des frais de gestion, tandis que le produit des majorations de retard et pénalités dues par les assurés est affecté au régime général et réparti entre ses branches476(*). Pour 2022, la clé de répartition retenue prévoit l'attribution de 41,4 % de ce produit à la branche maladie, de 33,2 % à la branche vieillesse, de 14 % à la branche famille, de 7,1 % à la branche autonomie et de 4,3 % à la branche AT-MP477(*).
D'après le Gouvernement, le dispositif a généré un excédent de 212,6 millions d'euros au profit du régime général en 2022, en raison, notamment, du recouvrement des dettes de cotisations sociales constituées pendant la crise sanitaire.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), quant à elle, reverse encore les seules sommes effectivement collectées à ses attributaires, notamment l'Agirc-Arrco, pour ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire des salariés agricoles et les autorités organisatrices de la mobilité dans le cadre du versement mobilité.
Afin d'offrir à ces organismes une visibilité accrue et d'harmoniser les modalités de reversement des sommes collectées entre l'Urssaf Caisse nationale et la CCMSA, l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023478(*) a prévu d'appliquer le reversement sur la base des sommes dues aux cotisations et contributions sociales collectées recouvrées par la CCMSA pour le compte de ses attributaires à compter du 1er janvier 2025.
Conformément au B du VI de l'article 6 de la LFSS pour 2023, ces dispositions étaient applicables aux cotisations et contributions reversées par la CCMSA à compter du 1er janvier 2025.
Cette date pouvait être reportée par décret, dans la limite d'un an. Ainsi, le décret n° 2024-1280 du 31 décembre 2024 a reporté au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur de cette réforme.
b) La mesure proposée
Compte tenu du retard pris dans la mise en oeuvre de cette mesure, le V du présent article propose de modifier l'article 6 de la LFSS pour 2023 afin de remplacer la référence au 1er janvier 2025 par une référence au 1er janvier 2027.
Par ailleurs, le 1° du III du présent article modifie le 1° du III de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que les frais de gestion applicables par la CCMSA à ses attributaires, dans le cadre du mécanisme de RSD, sont fixés par décret en Conseil d'État.
Enfin, le 2° du III du présent article modifie l'article L. 725-3 du même code pour préciser le champ des contributions concernées par le dispositif de RSD479(*).
3. Transfert de l'excédent éventuel des opérations de la Cnieg relatives à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) à la Cnav
Le VI du présent article propose de modifier l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004480(*) pour permettre le transfert de l'excédent éventuel des opérations de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) relatives à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) à la Cnav.
La CTA est une taxe assise sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport d'électricité et de gaz, affectée à Cnieg pour le financement des droits spécifiques passés régulés du régime de retraite.
Selon l'évaluation préalable du présent article, « les prévisions de recettes de CTA anticipent des recettes supérieures aux dépenses qu'elles financent. Cette dynamique constatée depuis 2019 pose la question de l'utilisation des excédents de CTA, qui en l'état actuel de son cadre juridique, ne peuvent être utilisés autrement que pour le financement des droits spécifiques passés régulés.
Le présent article propose de prévoir la possibilité d'affecter les excédents de la section comptable de la CTA au bilan de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), par conséquent sans impact sur le solde de l'année de la branche vieillesse du régime général mais ayant pour effet d'améliorer son report à nouveau ainsi que son besoin de trésorerie et par conséquent de diminuer son recours à l'emprunt ».
Selon les informations dont dispose la rapporteure générale, cette disposition a pour objet de résoudre un risque de contentieux, lié au fait que le droit de l'Union européenne impose une accise unique sur l'énergie.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels ou de précision du rapporteur général de sa commission des affaires sociales.
L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
Si les dispositions du présent article tendant à neutraliser les effets d'autres articles du présent PLFSS n'appellent pas, en leur principe, de commentaire particulier, on peut en revanche s'interroger sur deux propositions du Gouvernement ainsi que sur la mesure relative à la Cnieg.
A. Le transfert de 3 milliards d'euros de la sécurité sociale vers l'État, au titre de la réforme des allégements généraux de 2025 et 2026
Tout d'abord, comme on l'a indiqué, le présent article tire les conséquences pour les différentes branches de l'article 40 du PLF pour 2026, qui prévoit de réduire la TVA affectée à la sécurité sociale de 9,1 milliards d'euros.
Si cette réduction est pour l'essentiel « technique » et justifiée, tel n'est pas le cas des 3 milliards d'euros ayant pour objet de transférer à l'État le gain résultat pour la sécurité sociale en 2026 des réformes des allégements généraux en 2025 (de 1,6 milliard d'euros) et en 2026 (par un futur décret, correspondant à un gain supplémentaire de 1,4 milliard d'euros).
1. Des allégements généraux actuellement sous-compensés de 5,5 milliards d'euros
Lors de son audition par la commission le 23 octobre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics a justifié cette mesure par l'idée que, dès lors que les allégements généraux sont compensés par l'État à la sécurité sociale, leur réduction doit logiquement s'accompagner d'une réduction à due concurrence de cette compensation.
Toutefois, dans son rapport481(*) sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfs) de mai 2025, la Cour des comptes estime que la sous-compensation du « bandeau maladie » a été de 5,5 milliards d'euros en 2024482(*).
Effet sur le solde de la sécurité sociale de la création du bandeau maladie en 2019, selon la Cour des comptes
(en milliards d'euros)
Solde de la compensation intégrale à l'Unédic et à l'Agirc-Arrco : la sécurité sociale (Acoss) a bénéficié d'une fraction de TVA (5,18 points) à répartir chaque année entre l'Unédic et l'Agirc-Arrco pour leur assurer une compensation intégrale du bandeau maladie (ce dispositif pouvant avoir un solde positif ou négatif pour la sécurité sociale).
Compensation du bandeau maladie : compensation de la baisse de 6 points des cotisations maladie (19,8 milliards d'euros en 2019) par une fraction de 9,79 points de TVA (17,4 milliards d'euros en 2019).
Extension à la SNCF et à la RATP des bandeaux maladie et famille : cette extension n'a pas fait l'objet d'une compensation à la sécurité sociale.
Source : D'après Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025
Même si la sécurité sociale conservait les 3 milliards d'euros de gains résultant de la réforme des allégements généraux de 2025 et 2026, ceux-ci resteraient donc sous-compensés d'environ 2,5 milliards d'euros483(*).
2. Une réduction supplémentaire des allégements généraux en 2026 à confirmer
Par ailleurs, la réduction supplémentaire des allégements généraux annoncée par le Gouvernement pour 2026, de 1,4 milliard d'euros sur le périmètre de la sécurité sociale, reste à prendre d'ici la fin de l'année par décret.
En particulier, le décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, qui fixe actuellement le barème de la RGDU pour 2026, ne prévoit pas de telle réduction.
Il semblerait hasardeux d'inscrire dans la loi une disposition tirant les conséquences d'une mesure à ce stade inexistante.
Par ailleurs, malgré plusieurs demandes de transmission de document, la commission ne dispose, s'agissant du barème envisagé par le Gouvernement, que d'informations orales (selon lesquelles les allégements demeureraient inchangés au niveau du Smic, le rendement étant obtenu en augmentant la convexité de la courbe).
3. Une fragilisation supplémentaire de la capacité de l'Acoss à se financer
Surtout, le transfert de 3 milliards d'euros de la sécurité sociale vers l'État fragilisera davantage la situation de l'Acoss.
Le besoin de trésorerie maximal de l'Acoss, estimé d'après les prévisions de déficit du projet d'annexe à la LFSS 2026
(en milliards d'euros)
Pour 2025 et 2026, le besoin de financement maximal sur l'année correspond aux prévisions de l'Acoss transmises à la rapporteure générale.
La prévision pour 2026 prend en compte la réduction ponctuelle, d'environ 8 milliards d'euros, du besoin de financement maximal, résultant de l'article 11 du PLFSS (transition entre la perception par la sécurité sociale des remises sur les produits de santé au titre d'une année n l'année n+1 et sa perception l'année n, conduisant en 2026 à la perception des remises au titre de 2025 et 2026).
* Source : audition de l'Acoss par les rapporteures dans le cadre des travaux de la Mecss sur le financement de la sécurité sociale, 22 mai 2025.
Source : Actualisation du graphique figurant dans Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025
On rappelle que, du fait de la crise sanitaire, l'Acoss a connu en 2020 une crise de financement, avec un besoin de financement moyen de 63,4 milliards d'euros et un besoin de financement maximal d'environ 90 milliards d'euros, qui ont impliqué le recours à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à un pool bancaire afin de pouvoir payer les prestations.
L'Acoss considère qu'au-delà de ce montant de 90 milliards d'euros, elle aurait probablement du mal à se financer sur les marchés. Comme indiqué dans le récent rapport484(*) de la Mecss Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, l'Acoss considère qu'un plafond d'emprunt de par exemple 133 milliards d'euros (correspondant au montant alors envisageable pour 2028 sur la base de la LFSS pour 2025), n'était « en aucun cas réalisable par l'Urssaf ». À titre de comparaison, la trajectoire de déficit annexée au présent PLFSS suggère que le plafond d'emprunt pourrait atteindre 100 milliards d'euros en 2027, 115 milliards d'euros en 2028 et 135 milliards d'euros en 2029.
4. Un transfert auquel s'oppose explicitement la Cour des comptes
Dans sa récente communication à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur le PLFSS, la Cour des comptes s'oppose explicitement au transfert.
L'opposition de la Cour des comptes à la
captation par l'État des 3 milliards d'euros de gain en 2026
découlant des réformes
des allégements
généraux de 2025 et 2026
« Le montant total de ces recettes nouvelles (5,1 Md€) est sensiblement réduit par la récupération par l'État des économies liées aux réformes des allègements généraux de 2025 et 2026, par le biais d'une baisse de la TVA transférée à la sécurité sociale à hauteur de 3,0 Md€, soit 1,6 Md€ au titre de la réforme de 2025, prévue en LFSS 2025, et 1,4 Md€ au titre de la réforme qui s'appliquerait à partir de 2026. En 2025, sur les 2,0 Md€ de cotisations supplémentaires générées par la réforme, seuls les 0,4 Md€ de perte d'impôt sur les sociétés avaient fait l'objet d'une rétrocession à l'État. Si cette récupération peut être vue comme le pendant du principe de compensation des exonérations de cotisations, il est à souligner que les allègements généraux, et à leur suite la future réduction générale dégressive unique (RGDU) de cotisations, sont sous-compensés par l'État et occasionnent une perte pour la sécurité sociale, estimée par la Cour à 5,5 Md€ en 2024*. Au regard du niveau élevé du déficit de la sécurité sociale, la baisse de la TVA de 3,0 Md€ en 2026 est préjudiciable à la lisibilité des efforts consentis en matière de meilleure maîtrise des niches sociales ; elle revient de plus sur la décision prise en 2025 de laisser les 1,6 Md€ restants à la sécurité sociale afin de contribuer à son retour à l'équilibre financier, conformément à la recommandation de la Cour, et à réduire la sous-compensation des allègements. »
« * Cf. Cour des comptes, Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l'équilibre financier de la sécurité sociale, chapitre III du Ralfss 2025. »
Source : Cour des comptes, La situation financière de la sécurité sociale - Une perspective de redressement fragile en 2026, une impasse de financement préoccupante, communication à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, octobre 2025
5. Un transfert qui ne doit pas être maintenu
Ainsi, la commission considère que le transfert, via la TVA affectée, de 3 milliards d'euros de la sécurité sociale vers l'État correspondant au gain résultant en 2026 de la réforme des allégements généraux de 2025 et 2026, proposé par l'article 40 du PLF, ne doit pas être maintenu.
La commission a donc adopté un amendement n° 622 de sa rapporteure générale au présent article modifiant les transferts entre branches proposés. Il appartiendra au Gouvernement de réaliser la coordination avec l'article 40 du PLF.
B. Le transfert de 1,4 milliard d'euros de la branche famille vers la branche maladie, symptôme des insuffisances de la politique familiale
Du fait du ralentissement démographique, l'excédent de la branche famille tend structurellement à augmenter.
Aussi, le présent article propose de transférer 1,4 milliard d'euros de CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité de la branche famille vers la branche maladie, fortement déficitaire.
Après ce transfert, la branche famille demeurerait excédentaire de 0,7 milliard d'euros, et la branche maladie demeurerait déficitaire de 12,5 milliards d'euros.
Dans le cadre de l'examen du PLFSS 2024, le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a adopté un amendement majorant de 2 milliards d'euros la part de la taxe sur les salaires affectée à la branche famille et diminuant à due concurrence celle affectée à la branche maladie. Il s'agissait notamment de dénoncer l'absence d'ambition de la politique familiale du Gouvernement, alors même que l'évolution du taux de natalité aurait dû figurer au premier rang de ses préoccupations485(*).
La commission est toutefois consciente du fait qu'il convient d'éviter des excédents ou des déficits trop importants des différentes branches. Par ailleurs, en l'absence de dépenses supplémentaires, majorer de 1,4 milliard d'euros les recettes de la branche famille en 2026 n'aurait pas d'effet sur la natalité.
Aussi, la commission, tout en déplorant le manque d'ambition de la politique familiale actuelle, ne s'oppose pas à ce transfert de 1,4 milliard d'euros de la branche famille vers la branche maladie.
C. Un risque de dégradation ponctuelle du solde public de 0,7 point de PIB en 2026 en cas de transfert de l'excédent annuel de la Cnieg à la Cnav
Selon les informations dont dispose la commission, il existe un risque que le VI du présent article, qui tend à permettre le transfert de l'excédent éventuel des opérations de la Cnieg relatives à la CTA à la Cnav, suscite l'année de sa mise en oeuvre486(*) une augmentation du déficit des administrations publiques de plus de 20 milliards d'euros, soit 0,7 point de PIB.
Aussi, la commission juge préférable que le ministère de l'action et des comptes publics expertise le sujet de manière plus approfondie, en particulier en s'appuyant sur l'Insee, avant de prendre une décision. Elle a donc adopté un amendement n° 624 de sa rapporteure générale supprimant le VI de cet article.
La commission a en outre adopté un amendement de précision n° 623 de sa rapporteure générale.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 12 bis (nouveau)
Affectation d'une fraction de CSG aux
départements et réduction, à due concurrence, de la
fraction affectée à la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de réduire de 0,04 point en 2026 puis 0,04 point supplémentaire en 2027 la fraction de CSG affectée à la CNSA afin d'affecter cette part aux départements. Les recettes de la CNSA seraient amputées d'environ 0,7 milliard d'euros en 2026 et de 1,4 milliard d'euros à partir de 2027.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Les dépenses des départements au titre de l'autonomie ont fortement augmenté dans un contexte budgétaire contraint
1. Les dépenses des départements au titre de l'Apa et de la PCH sont très dynamiques
Les départements, chefs de file dans le domaine de l'action sociale, sont chargés du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)487(*) et de la prestation de compensation du handicap (PCH)488(*), qui bénéficient respectivement à 1,36 million et 407 000 personnes en 2023489(*).
Ces deux prestations visent à compenser les conséquences de la perte d'autonomie liée à l'âge et au handicap via, notamment, le financement du recours à une aide humaine et des aménagements du logement et du véhicule. Elles connaissent un très fort dynamisme en lien, d'une part, avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires et, d'autre part, avec les revalorisations et les réformes qui leur ont été appliquées sur décision du législateur ou du pouvoir réglementaire.
Ainsi, entre 2009 et 2023, les dépenses d'Apa versées par les départements sont passées de 5 à 6,5 milliards d'euros (+ 30 %) tandis que les dépenses de PCH sont passées de 0,8 à 2,9 milliards d'euros (+ 260 %).
Cette augmentation des dépenses sociales concourt aux difficultés financières que rencontrent, depuis plusieurs années, les départements. Ceux-ci subissent un « effet ciseaux » entre, d'une part, la chute des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et, d'autre part, la hausse des dépenses d'aides à la personne et de frais d'hébergement, qui reflète les revalorisations des prestations sociales et des tarifs des intervenants médico-sociaux, ainsi que l'augmentation de leurs bénéficiaires490(*).
2. Les concours versés par la CNSA aux départements ne couvrent pas entièrement la hausse des dépenses d'Apa et de PCH
Afin de couvrir une partie des dépenses qu'ils allouent à l'autonomie, la CNSA verse des concours financiers aux départements pour un montant de 5,9 milliards d'euros en 2025491(*). Les deux principaux concours, tels qu'ils résultent de la réforme introduite par la LFSS pour 2025492(*), permettent la compensation partielle des dépenses d'Apa et de PCH.
Si le taux de compensation de ces dépenses a connu d'importantes variations à la baisse, surtout pour la PCH, un redressement est opéré depuis plusieurs années et la réforme des concours garantit, à partir de l'année 2025, que ce taux ne pourra être inférieur à celui enregistré au titre de l'année 2024 ce qui correspond, compte tenu du dynamisme des dépenses, à un coût estimé à 200 millions d'euros pour la CNSA.
En 2024, les taux de compensation des dépenses d'Apa et de PCH atteignent respectivement 43 % et 30 %493(*) - ces taux pouvant considérablement varier d'un département à l'autre.
Le niveau de compensation reste donc, malgré un redressement, en-deçà des 50 % demandés par l'association Départements de France. À ce sujet, la CNSA a indiqué, au cours de son audition par la commission494(*), que les travaux sur la simplification des concours aux départements se poursuivaient et que l'objectif était, à terme, de parvenir à la compensation de la moitié des dépenses des départements au titre de l'Apa et de la PCH.
Évolution du taux de couverture des
dépenses des départements destinées
aux personnes
âgées depuis 2014
Source : CNSA
Évolution du taux de couverture des
dépenses des départements destinées
aux personnes en
situation de handicap depuis 2014
Source : CNSA
3. Si les recettes de la CNSA ont été dynamiques grâce à l'affectation d'une part de CSG supplémentaire, la branche autonomie est également en mauvaise santé financière
Si les départements éprouvent des difficultés financières pour mener à bien la politique de l'autonomie, la branche autonomie de la sécurité sociale, dont la CNSA assure la gestion financière495(*), manque également de moyens pour répondre aux besoins dans le champ de l'autonomie496(*).
Ses recettes, constituées à 89 % de la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) qui lui est affectée497(*), ont été globalement dynamiques. En 2024, l'affectation de 0,15 point de CSG supplémentaire s'est notamment traduite par un apport de recettes de 2,6 milliards d'euros. Toutefois, en parallèle, les dépenses ont été encore plus dynamiques, passant de 32,6 à 42 milliards d'euros entre 2021 et 2025 en lien avec les mesures nouvelles et le dynamisme des prestations que la CNSA finance.
En conséquence, les perspectives financières de la branche autonomie s'assombrissent : après un excédent de 1,3 milliard d'euros en 2024, elle devrait enregistrer un déficit de 0,3 milliard d'euros en 2025 et de près de 1,7 milliard d'euros de 2026 à 2029498(*).
B. Le présent article prévoit le transfert d'une fraction de CSG actuellement affectée à la CNSA vers les départements
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Issu de plusieurs amendements identiques portés par Sylvie Bonnet, Vincent Descoeur, Vincent Rolland (Droite Républicaine), Agnès Firmin Le Bodo (Horizons et Indépendants) et Yannick Monnet (Gauche Démocrate et Républicaine), adoptés avec un avis défavorable du rapporteur de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, il prévoit d'affecter une fraction de CSG aux départements et de réduire, à due concurrence, la fraction affectée à la CNSA.
À partir de 2027, l'impact financier serait de 1,4 milliard d'euros499(*) de perte de recettes pour la branche autonomie et de gain pour les départements.
Impact de cet article sur les recettes de la CNSA et des départements
|
2026 |
À partir de 2027 |
|
|
CNSA |
- 0,7 |
- 1,4 |
|
Départements |
0,7 |
1,4 |
Source : Commission des affaires sociales, d'après les données du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025
1. L'intégration du produit des contributions sociales dans les recettes fiscales des départements
Tout d'abord, l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, qui porte sur les recettes fiscales de la section de financement du budget des départements, est complété par un alinéa prévoyant que ces recettes fiscales comprennent le produit des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article L. 131-8 du même code (I).
2. La réduction de la fraction de CSG attribuée à la CNSA
L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la répartition du produit de la CSG aux différents organismes de sécurité sociale, est modifié afin de réduire le taux de la fraction attribuée à la CNSA et de prévoir, à due concurrence, une affectation aux départements.
Ainsi, il est prévu de réduire la fraction de CSG attribuée à la branche autonomie de 2,08 à 2,04 % à compter du 1er janvier 2026 (a) du 1° et du 4° du II et A du III), puis de 2,04 à 2,00 % à compter du 1er janvier 2027 (b) du 1° et du 4° du II et B du III), soit une réduction totale de 0,08 point de CSG.
3. L'affectation d'une fraction de CSG aux départements
Au sein du même article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, plusieurs alinéas sont insérés afin de prévoir qu'une fraction de 0,04 % du produit de la CSG est affectée aux départements à compter du 1er janvier 2026 (2° et 5° du II et A du III), cette fraction étant portée à 0,08 % à compter du 1er janvier 2027 (3° et 6° du II et B du III).
II - La position de la commission
La commission est consciente des difficultés financières des départements et des contraintes toujours plus fortes qui pèsent sur eux face au dynamisme des dépenses sociales, et s'associe au constat selon lequel les mécanismes de compensation prévus par l'État sont insuffisants.
Néanmoins, elle estime que la réponse à ces difficultés ne réside pas dans la réduction des recettes de la branche autonomie pour augmenter celles des départements : un tel mécanisme constitue un jeu à somme nulle, sans impact sur la qualité de la prise en charge des personnes en situation de perte d'autonomie. La réduction des recettes de la CNSA se répercuterait en partie sur les départements, puisque la caisse participe aux dépenses de ces derniers par le biais des concours financiers.
La commission rappelle également que plusieurs mesures ont été récemment adoptées pour conforter le soutien de la CNSA aux départements : la réforme des concours financiers inscrite en LFSS pour 2025 se traduit par une hausse de 200 millions d'euros de ces derniers et l'expérimentation de la réforme du financement des Ehpad leur est avantageuse sur le plan financier. Enfin, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, à l'article 33, une enveloppe de 300 millions d'euros pour soutenir les départements en difficulté.
Par ailleurs, la branche autonomie de la sécurité sociale accuse elle aussi une santé financière dégradée, avec un déficit prévisionnel de 1,7 milliard d'euros de 2026 à 2029, alors même que les besoins de financement ne cessent de croître en lien avec le vieillissement de la population et que la transformation de l'offre médico-sociale devra s'accompagner de moyens. Le présent article aurait pour effet de porter ce déficit prévisionnel à 2,4 milliards d'euros en 2026 et à 3,1 milliards d'euros de 2027 à 2029.
Comme cela a été souligné par la commission, en particulier dans le tome I du présent rapport et dans les commentaires des articles 12 et 16, les déficits élevés de la sécurité sociale rendent de plus en plus difficile le financement de l'Acoss sur les marchés.
Enfin, sur le plan des principes, la commission est très attachée au maintien de la CSG comme outil de financement de la sécurité sociale, telle qu'elle a été conçue depuis son origine. Il ne saurait y avoir de confusion de ce point de vue, avec les ressources financières des collectivités territoriales.
Au bout du compte, au dispositif prévu par le présent article, la commission préfère une réflexion plus structurelle sur le financement de la politique de l'autonomie et sur la répartition des compétences entre les départements et la sécurité sociale. Plusieurs axes semblent prioritaires : la détermination de ressources nouvelles pour la branche autonomie, l'aboutissement de la réforme des concours aux départements pour améliorer la compensation des dépenses au titre de l'Apa et de la PCH et la clarification des responsabilités dans le champ médico-social en font partie. La commission rappelle, à ce titre, que la représentation nationale est depuis de longues années en attente d'une grande loi-cadre relative à l'autonomie.
Au regard de ces éléments, la commission a adopté l'amendement de suppression n°625 présenté par la rapporteure générale.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 12 ter (nouveau)
Annuler la participation de l'assurance
maladie à la prise en charge des cotisations des professionnels de
santé en cas de fraude
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, vise à rendre automatique l'annulation de la prise en charge par les caisses d'assurance maladie des cotisations des professionnels de santé auteurs d'actes frauduleux sur la part des revenus obtenue frauduleusement.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Depuis le 1er janvier 2024, les caisses d'assurance maladie peuvent annuler la prise en charge des cotisations des professionnels de santé auteurs d'actes frauduleux
Dans le cadre du conventionnement des professionnels de santé avec l'assurance maladie, les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leur activité libérale500(*).
En cas de fraude de la part des professionnels de santé, les directeurs des caisses d'assurance maladie peuvent recouvrer les sommes indûment versées501(*) et prononcer des pénalités financières502(*). Ils ne peuvent, en revanche, recourir concurremment à ces dispositifs de pénalité et aux procédures de sanction conventionnelle visant les mêmes faits (interprétation du principe de non bis in idem interdisant le cumul des poursuites pour des mêmes faits)503(*).
En 2022, 300 professionnels de santé ont fait l'objet de pénalités financières pour fraude ou de plaintes pénales, pour un préjudice financier de 25 millions d'euros pour l'assurance maladie et un montant de prise en charge des cotisations sociales de 2 millions d'euros504(*).
Dans un souci d'amélioration de l'efficacité de la lutte contre la fraude, en 2023, le législateur a renforcé les sanctions applicables aux professionnels de santé reconnus coupables d'actes frauduleux505(*). Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, en application de l'article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux d'assurance maladie peuvent procéder, en sus du recouvrement des sommes indûment versées à un professionnel de santé, à l'annulation de tout ou partie de leur participation au financement des cotisations dues par celui-ci sur la part des revenus obtenue frauduleusement lorsque celui-ci fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux :
- d'une pénalité financière sanctionnant une fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire et prononcée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie506(*) ;
- d'une sanction ordinale prononcée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales de conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes507(*) ;
- ou d'une condamnation pénale pour escroquerie, faux et usage de faux, fraude aux prestations ou fausse attestation lorsque ces fraudes portent un préjudice aux organismes de protection sociale508(*).
Les sommes correspondantes sont recouvrées selon les mêmes modalités que les prestations indûment versées à un professionnel de santé509(*).
Concrètement, une fois que la caisse d'assurance maladie a notifié la pénalité ou a été informée d'une sanction ordinale ou d'une condamnation pénale, elle ouvre l'action en recouvrement en notifiant au professionnel le montant des cotisations annulées.
B. Le présent article propose d'automatiser l'annulation des cotisations sociales prises en charge par l'assurance maladie au bénéfice des professionnels de santé reconnus coupables de fraude
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Issu d'un amendement de Jérôme Guedj (Socialistes et apparentés) ayant obtenu un avis de sagesse du rapporteur général et du Gouvernement, il prévoit l'automaticité de l'annulation, par les caisses d'assurance maladie, des cotisations qu'elles ont prises en charge au bénéfice des professionnels de santé reconnus coupables de fraude.
L'article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale ne disposerait plus que l'organisme local d'assurance maladie « peut » procéder mais qu'il « procède » à cette annulation.
II - La position de la commission
La commission partage l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude sociale, et notamment celle des professionnels de santé. Elle avait soutenu, lors des débats sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, la mise en place du dispositif permettant aux caisses d'assurance maladie d'annuler les cotisations prises en charge au bénéfice des professionnels de santé frauduleux. Toutefois, elle considère qu'il est préférable, plutôt que de prévoir l'automaticité de l'annulation des cotisations sociales comme le prévoit le présent article, de laisser une marge de manoeuvre aux caisses de sécurité sociale dans la définition et la gradation de la réponse apportée face aux comportements frauduleux.
De plus, elle rappelle qu'un projet de loi relatif à la lutte contre les fraude sociales et fiscales est en cours d'examen par le Parlement, et que celui-ci comporte déjà des dispositions visant à durcir les sanctions contre les professionnels de santé coupables de fraude, notamment à l'article 17, qui prévoit la levée de l'interdiction du cumul d'une sanction conventionnelle et d'une pénalité financière en cas de fraude510(*). Elle juge donc que l'intention du présent article pourra être satisfaite dans le cadre de l'examen de ce projet de loi et qu'il est au demeurant préférable d'y concentrer la discussion sur les mesures contre la fraude, dans un souci de clarté des débats.
La commission a donc adopté un amendement n° 626 présenté tendant à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 12 quater
(nouveau)
Exclusion des micro-commerçants du dispositif de
précompte des cotisations sociales par les plateformes
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'une part, de réduire à un mois au lieu d'un an le délai maximal de communication entre la direction générale des finances publiques (DGFip) à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), et d'autre part, d'exclure les micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de ventes de biens du dispositif de précompte des cotisations sociales par les plateformes.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du député Paul Midy du groupe Ensemble pour la République511(*), avec un avis défavorable du rapporteur général de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.
A. L'obligation de transmission d'informations de l'administration fiscale vers l'Acoss et la Cnaf
1. Le droit existant : l'administration fiscale dispose d'un délai d'un an pour transmettre ses informations
L'article 1649 ter A du code général des impôts impose en son I aux opérateurs de plateformes qui mettent en relation des utilisateurs afin d'effectuer, par voie électronique, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier, de souscrire une déclaration relative à ces opérations auprès de l'administration fiscale.
L'article L. 144-19-1 du code de la sécurité sociale impose à l'administration fiscale de transmettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ce document au plus tard au 31 décembre dans l'année au cours de laquelle elle l'a reçu.
2. Le présent article propose de réduire ce délai à un mois
Le présent article prévoit de réduire le délai maximal de transmission du document mentionné au I. de l'article 1649 ter A du code général des impôts à un mois au lieu d'un an.
C. Afin de lutter contre la sous-déclaration, la LFSS pour 2024 a instauré un dispositif de prélèvement des cotisations et contributions par les plateformes de mise en relation
1. Le droit existant
L'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a mis à la charge des plateformes de mise en relation une obligation de déclaration et de précompte des cotisations dues par les quelque 206 000 micro-entrepreneurs qui l'utilisent.
Cette mesure, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, a pour principal objectif de lutter contre la sous-déclaration auprès de l'Urssaf Caisse nationale, qui estimait, selon l'étude d'impact de la mesure, que 69 % des micro-entrepreneurs utilisant une plateforme déclaraient des chiffres d'affaires inférieurs aux montants enregistrés par celles-ci, et que 55 % d'entre eux ne déclaraient rien.
Le chiffre d'affaires non déclaré par ces travailleurs est estimé à 814 millions d'euros en 2021 et à 927 millions d'euros en 2022. Les cotisations et contributions éludées se seraient dès lors élevées à 144 millions d'euros en 2021 et à 175 millions d'euros en 2022512(*).
Cette mesure de prélèvement concernera notamment les micro-entrepreneurs et les assimilés salariés relevant du régime « micro-RG ». Le dispositif de précompte s'appliquera aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu'aux taxes, et, en cas recours à cette option, au versement libératoire de l'impôt sur le revenu dus par ces derniers au titre de la part de leur chiffre d'affaires ou des recettes versées par la plateforme513(*).
Les micro-entrepreneurs étant exonérés de TVA sous condition de chiffre d'affaires514(*), la taxe sur la valeur ajoutée sera exclue de ce précompte.
La réforme du circuit de déclaration
et de paiement des cotisations
dues par les micro-entrepreneurs utilisant
des plateformes
portée par l'article 6 de la LFSS pour
2024
Source : Fiches d'évaluation préalable du PLFSS pour 2024 (annexe 9)
2. La modification proposée par le présent article : l'exclusion des micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens du dispositif de précompte de cotisations
Le présent article propose de restreindre le champ d'application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique peuvent leur donner mandat pour réaliser leurs démarches déclaratives de début d'activité, en le limitant aux seules plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et qui fixent son prix.
Concrètement, cela revient à exclure du dispositif de précompte les plateformes comme Le Bon Coin qui se limitent à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs putatifs, et laissent à ces derniers toute latitude pour fixer les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu ainsi que son prix.
II - La position de la commission
La commission des affaires sociales, fortement attachée à la poursuite de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, ne saurait cautionner l'exclusion de certaines plateformes qui abritent des micro-entrepreneurs du dispositif de précompte des cotisations et contributions sociales, lequel n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2027.
Pour cette raison, elle avait émis lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 un avis défavorable à l'amendement n° 361 rectifié à l'article 8 quinquies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont la rédaction était strictement identique au 2° du présent article.
En outre, la commission s'oppose à tout raccourcissement du délai de transmission des informations entre la DGFiP et l'Acoss en l'absence d'éléments techniques permettant d'assurer qu'une telle modification est matériellement possible.
Par cohérence, elle a adopté l'amendement n° 627 qui tend à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 12
quinquies (nouveau)
Suppression de certaines dérogations au principe
de compensation fixé
par la « loi Veil »
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit la compensation budgétaire de quatre niches sociales actuellement non compensées, la principale étant l'exonération des cotisations salariales dans le cas des heures supplémentaires.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré à l'initiative du rapporteur général de sa commission des affaires sociales515(*), avec un avis défavorable du Gouvernement516(*).
A. La compensation actuelle des niches sociales
1. Rappel des règles de compensation
a) La règle de droit commun : une compensation par crédits budgétaires
La règle de compensation « de droit commun » des niches sociales figure à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit d'une règle de compensation par crédits budgétaires, à l'euro près.
Le montant global de la compensation fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 2022517(*). Dans le cas du présent PLFSS, il figure à l'article 13.
Schématiquement, les mesures d'exonération (c'est-à-dire de taux réduit ou nul) relatives aux cotisations sont compensées si elles sont instaurées à compter de la « loi Veil » de 1994518(*), alors que pour les autres niches relatives aux cotisations (exemptions d'assiette) ou aux contributions (exonérations et exemptions) la compensation n'a lieu que si elles sont instituées à compter de 2004519(*).
Il en résulte que sauf exception, les niches sociales antérieures à 1994 (exonérations de cotisations) ou 2004 (autres niches relatives aux cotisations et aux contributions) ne sont pas compensées (que ce soit budgétairement ou non). Ainsi, du fait de leur ancienneté, la quasi-totalité des exemptions d'assiette ne sont pas compensées.
À la fin des années 2010, le budget de l'État continuant d'enregistrer des déficits significatifs, contrairement à celui de la sécurité sociale, il a été décidé, à la suite du rapport de 2018 de Christian Charpy et Julien Dubertret sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, que les nouvelles pertes de recettes de celle-ci ne donneraient plus lieu par principe à une compensation systématique. Ainsi, la mesure d'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires de la LFSS 2019 n'a pas été compensée.
b) La principale dérogation : la compensation des allégements généraux par affectation de TVA
L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale étant de nature législative, une autre disposition législative peut y déroger (ce qui relève du domaine exclusif des LFSS520(*)).
Il en résulte le paradoxe que les allégements généraux de cotisations sociales patronales, de loin la principale niche sociale, dérogent à la règle de droit commun, et sont aujourd'hui essentiellement compensés par des affectations de TVA réalisées pour « solde de tout compte ».
2. La compensation des principales niches
Contrairement à ce que prévoit l'article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale521(*), il n'existe pas de suivi exhaustif des compensations de niches sociales.
La Mecss du Sénat s'est efforcée, dans son récent rapport Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat522(*), de synthétiser les principales données disponibles, dans le graphique ci-après. Celui-ci, par nature approximatif, suggère que, sur plus de 100 milliards d'euros de niches sociales, seulement 65 milliards d'euros environ seraient compensés.
Cette sous-compensations résulte en quasi-totalité de l'application de la loi. On peut toutefois mentionner l'exemption de la prime de partage de la valeur, qui selon le Gouvernement ne coûte rien, mais dont la Cour des comptes évalue le coût à environ un milliard d'euros par an.
La compensation des niches sociales à la
sécurité sociale (2024)
Graphique
synthétique
(en milliards d'euros)
DFS : déduction forfaitaire spécifique. ND : non disponible. PPV : exemption de la prime de partage de la valeur.
Remarque : la Cour des comptes indique ne pas être en mesure de chiffrer le coût du dispositif PPV en 2024. Elle l'évalue toutefois à 1,1 milliard d'euros en 2022 comme en 2023.
* Source : Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025. Le caractère incomplet de la compensation résulte de l'application de la loi.
** La non-compensation peut aussi résulter d'une disposition spécifique (exemple : LFSS 2020 pour le taux intermédiaire de CSG à 6,6 %). L'annexe 2 au Placss 2024 indique que certaines exemptions d'assiette sont compensées.
Source : Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025
La compensation des allégements généraux était considérée comme à peu près équilibrée jusqu'à la réforme de 2019, qui a vu le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), créé en 2012, transformé en baisse de 6 points des cotisations maladie jusqu'à un seuil alors fixé à 2,5 Smic523(*) (ce qu'il est d'usage d'appeler le « bandeau maladie »).
Aussi, dans son rapport524(*) sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025, la Cour des comptes se contente de chiffrer la sous-compensation du « bandeau maladie ». Selon ses estimations, cette sous-compensation a été de 5,5 milliards d'euros en 2024.
Effet sur le solde de la sécurité sociale de la création du bandeau maladie en 2019, selon la Cour des comptes
(en milliards d'euros)
Solde de la compensation intégrale à l'Unédic et à l'Agirc-Arrco : la sécurité sociale (Acoss) a bénéficié d'une fraction de TVA (5,18 points) à répartir chaque année entre l'Unédic et l'Agirc-Arrco pour leur assurer une compensation intégrale du bandeau maladie (ce dispositif pouvant avoir un solde positif ou négatif pour la sécurité sociale).
Compensation du bandeau maladie : compensation de la baisse de 6 points des cotisations maladie (19,8 milliards d'euros en 2019) par une fraction de 9,79 points de TVA (17,4 milliards d'euros en 2019).
Extension à la SNCF et à la RATP des bandeaux maladie et famille : cette extension n'a pas fait l'objet d'une compensation à la sécurité sociale.
Source : D'après Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025
B. La modification proposée par le présent article : la compensation intégrale, par crédits budgétaires, de l'exonération de cotisations salariales applicable aux heures supplémentaires (2,2 milliards d'euros) et de quelques niches de moindre importance
1. La compensation de l'exonération de cotisations salariales applicable aux heures supplémentaires
Le I du présent article propose de modifier le 1° du II de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale afin de supprimer la disposition selon laquelle l'exonération de cotisations salariales applicable aux heures supplémentaires n'est pas compensée.
Pour mémoire, le coût de cette niche sociale a été de 2,2 milliards d'euros en 2024525(*), hors droits retraite acquis gratuitement.
Par ailleurs, dans son rapport de mai 2024 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale526(*), la Cour des comptes recommande de « compenser par crédits budgétaires le manque à gagner pour la sécurité sociale de l'exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires ».
2. La compensation des exonérations de cotisations employeur dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi
Le II du présent article propose de modifier le 1° de l'article L. 5134-31 du code du travail, pour supprimer la disposition selon laquelle les exonérations de cotisations employeur dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération ne sont pas compensées.
Cette niche a coûté 110 millions d'euros en 2024527(*).
3. La compensation des exonérations de cotisations et contributions applicables aux contrats de sécurisation professionnelle et aux stagiaires en milieu professionnel adapté
Le III du présent article propose d'abroger les II et III de l'article 31 de la LFSS pour 2007. Selon Légifrance, l'article 31 précité comprend seulement un III, prévoyant la non-compensation des exonérations de cotisations et contributions dans le cadre des contrats de transition professionnelle.
Selon l'exposé sommaire de l'amendement, il s'agit de supprimer l'exonération applicable aux contrats de sécurisation professionnelle.
Cette dernière exonération a coûté 90 millions d'euros en 2024528(*).
L'exposé sommaire de l'amendement mentionne également l'exonération de cotisations et contributions sociales des stagiaires en milieu professionnel adapté, qui a coûté 121 millions d'euros en 2024529(*).
II - La position de la commission
La commission attache habituellement une importance relative aux questions de compensation des niches à la sécurité sociale, considérant que ce qui importe, c'est le solde global des administrations publiques.
Toutefois la Cour des comptes, dans son rapport de mai 2024 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale530(*), recommande de « compenser par crédits budgétaires le manque à gagner pour la sécurité sociale de l'exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires ».
En outre, la commission considère que dans le contexte actuel des finances sociales, où les conditions de financement de l'Acoss sont de plus en plus incertaines, « tout euro est bon à prendre ». Tel est d'autant plus le cas dans le cas du présent PLFSS que l'article 40 du PLF réduit, de manière incompréhensible compte tenu de ces circonstances, la TVA affectée à la sécurité sociale de 3 milliards d'euros (cf. commentaire de l'article 12 du PLFSS).
Aussi, la commission propose de maintenir cet article.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 sexies (nouveau)
Instauration d'une cotisation
obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires titulaires d'un visa de
long séjour
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit de soumettre à une cotisation spécifique les ressortissants extracommunautaires titulaires d'un titre de séjour mention « visiteur » afin de leur ouvrir droit aux prestations de l'assurance maladie.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La protection universelle maladie permet à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière de bénéficier de la prise en charge des frais de santé
Depuis le 1er janvier 2016531(*), la protection universelle maladie (Puma)532(*) permet à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière d'avoir droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité533(*).
• La Puma s'adressant à toute personne travaillant en France, elle a notamment permis d'affilier à l'assurance maladie l'ensemble des salariés et travailleurs indépendants, quels que soient leur volume d'activité ou le montant des cotisations qu'ils ont acquittées534(*).
La cotisation subsidiaire maladie
Si l'affiliation à l'assurance maladie par la Puma est possible sans condition de revenus, certains bénéficiaires de cette protection sont tenus de s'acquitter d'une cotisation subsidiaire maladie (CSM)535(*). Il s'agit des assurés non titulaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente AT-MP, dont les revenus d'activité professionnelle sont inférieurs à 9 420 euros536(*) et les revenus du capital supérieurs à 23 550 euros.
Ces revenus, fonciers, issus de capitaux mobiliers, tirés de plus-values ou liés à des bénéfices non commerciaux ou commerciaux non professionnels, font l'objet d'une cotisation suivant un taux dégressif, fixé à 6,5 % en l'absence de revenus professionnels et à 0 % en présence de revenus professionnels à hauteur du plafond.
• La condition de résidence stable en France est remplie, quant à elle, par les assurés établis en France depuis plus de trois mois537(*), et dont le foyer ou le lieu de séjour principal, c'est-à-dire le lieu où ils résident plus de six mois par an, se situe dans l'Hexagone, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin538(*).
• Pour ce qui concerne la condition de résidence régulière en France, elle est acquise pour les ressortissants de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, justifiant de leur nationalité par une pièce d'identité. Pour les ressortissants d'autres États, elle est subordonnée à la production d'un titre de séjour et d'un acte d'état civil.
B. Les ressortissants extracommunautaires bénéficiant d'un titre de séjour se voient donc ouvrir des droits à l'assurance maladie, parfois sans contrepartie
Les ressortissants extracommunautaires peuvent séjourner de manière régulière et prolongée en France à condition de détenir un titre valide. Le présent commentaire s'attellera à décrire plus particulièrement les visas et cartes ouvrant droit à des séjours longs, d'une manière schématique.
1. Un visa de long séjour : la porte d'entrée privilégiée pour des séjours de plus de trois mois
Pour entrer et séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, les ressortissants extracommunautaires doivent, dans la majorité des cas539(*), détenir un visa de long séjour540(*), dit de type D.
Délivrés par les autorités consulaires, ces derniers peuvent prendre cinq formes principales :
- un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)541(*), accordé pour une durée de trois mois542(*) à un an543(*). Ces visas dispensent de l'obligation de solliciter un titre de séjour durant toute leur période de validité544(*) ;
- un visa de long séjour545(*) conduisant au dépôt d'une demande de titre de séjour, accordé aux étrangers ne bénéficiant pas de VLS-TS546(*) ;
- un visa pour mineur scolarisé en France, plafonné à onze mois, permettant aux parents extracommunautaires dudit mineur d'entrer en France le long de l'année d'études sans solliciter plusieurs visas ;
- un visa de long séjour temporaire, de quatre à douze mois547(*), permettant de suivre un enseignement, d'exercer une activité artistique ou de visiter un pays sans possibilité de prolonger le séjour durablement au-delà de sa validité ;
- un visa « vacances travail »548(*), accordé pour une durée au plus égale à un an pour les ressortissants extracommunautaires de seize pays partie à des conventions avec la France, sans possibilité de prolonger le séjour durablement au-delà de sa validité.
Le VLS-TS, sur lequel se concentre ce commentaire, peut notamment être accordé au titre d'une activité professionnelle549(*), à l'égard d'étudiants550(*) ou de stagiaires, aux conjoints de Français551(*) ou en qualité de visiteur552(*).
Dans ce dernier cas, qui concerne les visiteurs extracommunautaires à titre privé s'engageant à ne pas avoir d'activité professionnelle au cours du séjour, les conditions d'accès à la Puma sont susceptibles d'être remplies, même en l'absence de toute contribution aux charges publiques par la contribution sociale généralisée (CSG) ou par les cotisations.
2. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle permet de prolonger la présence régulière sur le territoire au-delà de la durée du VLS-TS
La présence régulière sur le territoire peut être maintenue après la fin de validité du VLS-TS, à condition que l'étranger extracommunautaire concerné émette une demande de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, selon les situations553(*). Réciproquement, la délivrance d'une telle carte est, sauf exceptions, subordonnée à l'obtention préalable d'un VLS ou d'un VLS-TS554(*).
Si cette demande est acceptée par la préfecture, le visiteur se voit remettre une carte de séjour de la mention correspondant à leur visa. En particulier, les titulaires d'un VLS-TS mention « visiteur » peuvent solliciter une carte de séjour temporaire mention « visiteur »555(*), d'une durée maximale d'un an renouvelable, au plus tard deux mois avant l'échéance de leur VLS-TS.
L'attribution de cette carte est subordonnée à un certain nombre de conditions pour le demandeur : celui-ci doit démontrer qu'il peut vivre de ses seules ressources, ce qui induit, aux termes de la loi, que ses revenus sur douze mois doivent excéder le salaire minimum de croissance (Smic) annuel, indépendamment de certaines prestations qui lui seraient versées556(*). Le demandeur doit, en outre, apporter la preuve qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et s'engager à ne pas avoir d'activité professionnelle pendant la validité de sa carte de séjour temporaire « visiteur ».
B. Le dispositif proposé : la subordination des prestations d'assurance maladie au versement d'une contribution pour les titulaires d'un visa long séjour valant titre de séjour motif « visiteur »
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 12 sexies, adopté à l'initiative de François Gernigon et Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons et Indépendants), conditionne le bénéfice de la Puma au versement d'une cotisation spécifique précisée par voie réglementaire pour les détenteurs d'un VLS-TS mention « visiteur ». Il modifie pour cela l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe le principe de la Puma.
À la faveur d'un sous-amendement de Paul Christophe (Horizons et Indépendants), l'article précise également que certaines populations peuvent être exemptées de cette cotisation en raison de conventions internationales.
L'objectif affiché par cet amendement est de faire obstacle au recours sans contrepartie à l'assurance maladie française par des titulaires d'un VLS-TS mention « visiteur », en particulier des retraités américains ou canadiens s'installant en France.
II - La position de la commission
La commission ne peut que souscrire à l'intention de cet article.
Comme l'a indiqué la ministre de l'action et des comptes publics lors de la séance publique, des conventions internationales dont la France est signataire « prévoient que certains ressortissants de pays du G20 peuvent être exonérés d'impôt, de CSG et de cotisation » et bénéficier, pour autant, d'une affiliation à l'assurance maladie dans le cadre de la Puma.
Dans un certain nombre de cas, la France ne bénéficie pas, au surplus, des garanties de réciprocité qui pourraient conférer une forme d'équité à un tel traitement.
Alors que les finances sociales, et tout particulièrement celles de l'assurance maladie, sont aujourd'hui exsangues, il n'est pas admissible que des ressortissants extracommunautaires puissent bénéficier, sans y contribuer, de l'assurance maladie française sans que soient appliquées, en retour, des conditions similaires pour les ressortissants français qui y sont installés.
La commission soutient donc sans réserve l'esprit de cet article, qui entend mettre un terme à cette situation qui fragilise notre système social, non seulement financièrement, mais également symboliquement en affectant le consentement à l'impôt des assurés contributeurs.
La rédaction retenue pour cet article pose toutefois un certain nombre de difficultés d'ordre juridique, que ce soit au regard du principe d'égalité ou de la notion de « cotisation », qui trouve mal à s'appliquer et pourrait avantageusement être retravaillée afin de prévoir une prise en charge non pas par les assurés extracommunautaires eux-mêmes, mais par les systèmes sociaux propres à leur pays d'origine. Une cotisation mutualisée permettrait, en ce sens, de ne pas complexifier le système de la Puma par des exceptions qui, pour nécessaires qu'elles soient, demeurent très ciblées.
En tout état de cause, la commission note que la question sous-jacente, celle de la réciprocité des accords internationaux ou celle de la participation des extracommunautaires à la protection sociale, relève moins du champ du droit de la sécurité sociale que de celui des conventions internationales.
La commission salue, en ce sens, l'engagement du Gouvernement de « réviser ces conventions pour s'assurer d'une participation à notre système social ou d'un mécanisme de réciprocité ».
Dans l'attente d'évolutions rédactionnelles lors de la séance publique, la commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 septies
(nouveau)
Suppression de la possibilité pour le Gouvernement de
minorer la compensation à l'Unédic des allégements
généraux de cotisations patronales
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de minorer la compensation à l'Unédic des allégements généraux de cotisations patronales, résultant de la LFSS 2024.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré à l'initiative de Ségolène Amiot557(*), avec un avis défavorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement.
A. Le droit actuel
L'article 16 de la LFSS 2024 (« article-tuyau ») a modifié le 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que la compensation par l'Acoss à l'Unédic du dispositif de réduction dégressive des contributions patronales d'assurance chômage se fait « dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ».
Ainsi, un arrêté du 27 décembre 2023558(*) prévoit que cette compensation est minorée de 2 milliards d'euros en 2023, 2,6 milliards d'euros en 2024, 3,35 millions d'euros en 2025 et 4,1 milliards d'euros en 2026.
Les moyens correspondants doivent permettre de financer France Compétences et France Travail.
B. La modification proposée par cet article
Cet article propose de supprimer, à compter du 1er janvier 2026, la disposition précitée selon laquelle compensation par l'Acoss à l'Unédic du dispositif de réduction dégressive des contributions patronales d'assurance chômage se fait « dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ».
II - La position de la commission
A. La commission s'est à plusieurs reprises déclarée favorable au principe de cet article
1. Lors de l'examen du PLFSS 2024
Lors de l'examen en première lecture du PLFSS 2024, le Sénat a adopté trois amendements identiques, dont un de sa commission des affaires sociales559(*), tendant à supprimer la disposition de l'« article-tuyau » insérant la disposition précitée.
En effet, cette mesure était contraire au principe de gestion paritaire de l'Unédic et suscitait une forte opposition des partenaires sociaux.
Toutefois, cette disposition a été rétablie en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
2. Lors de l'examen du PLFSS 2025
Lors de l'examen du PLFSS 2025, le Sénat, avec un avis favorable de sa commission des affaires sociales, a inséré, à l'initiative de Frédérique Puissat, un article 36, remplaçant la disposition précitée par une disposition selon laquelle le plafond de la compensation était fixé chaque année par la loi.
Cet article 36 a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février2025.
B. Toutefois cet article aggrave le besoin de financement de l'Acoss de 4,1 milliards d'euros en 2026
Cet article aurait pour effet d'empêcher le prélèvement de 4,1 milliards d'euros en 2026 sur l'Unédic actuellement prévu par l'arrêté précité.
Toutefois, la fraction de TVA affectée à l'Acoss par l'article 40 du projet de loi de finances (PLF) demeurant inchangée, cet article aurait également pour effet d'obliger l'Acoss à s'endetter de 4,1 milliards d'euros de plus en 2026, ce que sa situation financière ne lui permet pas.
C'est pourquoi, à l'initiative de la rapporteure générale, la commission a adopté un amendement n° 628 de suppression de cet article.
Article 12 octies (nouveau)
Suppression de la possibilité
de fixer par décret le montant
de la contribution d'équilibre
aux régimes spéciaux fermés versée
par les
régimes de retraite complémentaire et le régime
général
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de supprimer la possibilité de fixer par décret la compensation des nouvelles affiliations versée par les régimes de retraite complémentaires et le régime général aux régimes spéciaux fermés, en cas d'échec des négociations visant à établir ce montant par convention.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du député Hadrien Clouet560(*), avec un avis défavorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement561(*).
A. Le droit actuel
Le système de retraite français compte historiquement de nombreux régimes spéciaux de retraite, dont le plus ancien est la caisse de retraite des personnels de l'Opéra de Paris, fondée par Louis XIV.
L'évolution statutaire de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a conduit à la fermeture de ce régime au 1er janvier 2020562(*). Le régime de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a lui été fermé à compter du 1er septembre 2023563(*).
En conséquence, les personnels recrutés par la SNCF et ses filiales et de la RATP sont désormais affiliés au régime général.
Les modalités de compensation financière des régimes spéciaux fermés tels que la SNCF et la RATP, dont les nouvelles recrues sont affiliées au régime général, est effectuée par le biais d'une subvention d'équilibre fixée selon les termes d'une convention signée entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (Agirc-Arrco). Cette subvention d'équilibre se justifie par le fait que ces caisses perçoivent les cotisations des nouvelles recrues sans contrepartie de versement de pensions.
Le 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui résulte d'un amendement au PLFSS 2024 adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires sociales (cf. infra), prévoit que le montant de cette contribution d'équilibre est fixé par une convention entre les régimes de retraite complémentaire et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, et qu'à défaut de fixation d'une telle convention au 30 juin de l'exercice en cours, le montant de la contribution au titre de cet exercice est fixé par décret.
Nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés
Source : Commission des affaires sociales, d'après les documents budgétaires
B. La modification proposée par cet article
Cet article propose de supprimer la seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'à défaut de fixation, au 30 juin de l'exercice en cours, d'une convention entre les régimes de retraite complémentaires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, et le régime général, visant à établir le montant la subvention d'équilibre versée aux régimes spéciaux fermés, le montant de cette contribution est fixé par décret.
Selon l'exposé des motifs de l'amendement dont est issu le présent article, il vise à « empêcher toute ponction arbitraire de l'Agirc-Arrco par le Gouvernement ».
II - La position de la commission
Lors de l'examen du PLFSS pour 2024, le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a adopté un amendement limitant, dans le 7° de l'article L. 241-3 précité, le champ de la convention à la compensation des pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes spéciaux (alors que le texte initial prévoyait que cette convention pouvait poursuivre l'objectif, beaucoup plus large, de « solidarité financière au sein du système de retraite ») (cf. encadré ci-après).
Les modifications apportées par le Sénat à l'article 9 du PLFSS 2024
Dans sa rédaction initiale, l'article 9 du PLFSS 2024 (devenu article 15 du texte promulgué) prévoyait qu'une contribution des régimes complémentaires de retraite était déterminée par une convention entre ces régimes et le régime général, approuvée par arrêté, « au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite ». À compter du 1er janvier 2025, en l'absence de telle convention au 30 juin de l'exercice en cours, le Gouvernement pouvait fixer par décret le montant de cette contribution, mais seulement « pour tenir compte des conséquences financières [...] de la fermeture des régimes spéciaux ».
À l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que la convention avait pour objet de « compens[er] les pertes de ressources résultant de la fermeture des régimes ». Par ailleurs, il n'était plus question de conventions annuelles fixant chacune le montant de la contribution, mais d'une convention conclue avant le 1er juillet 2025, déterminant les modalités de calcul et de versement de la contribution. À défaut de telle convention, le Gouvernement pouvait déterminer par décret les modalités de calcul et de versement de la contribution.
Le texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale reprenait un amendement de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale tendant à rétablir le texte initial.
Toutefois le Gouvernement a également repris un sous-amendement du groupe Les Républicains, prévoyant que la convention avait pour objet de « participer à l'équilibre des régimes spéciaux mis en extinction » (la référence à la « solidarité financière au sein du système de retraite » étant donc supprimée).
Bien que ce système de convention annuelle soit moins opérationnel que la convention unique proposée par le Sénat, l'objectif essentiel du Sénat, qui était de limiter la contribution à l'équilibre des régimes spéciaux mis en extinction, était donc atteint.
La volonté du Sénat de limiter le champ de la convention à l'équilibre des régimes mis en extinction se justifiait par le fait qu'une telle ponction sur les excédents dégagés au prix des efforts consentis par les salariés du privé, dans le but de combler les déficits massifs du régime général, aurait constitué une atteinte inacceptable au paritarisme et une violation du droit de propriété des affiliés du régime de retraite complémentaire.
L'objectif poursuivi par le présent article, d'« empêcher toute ponction arbitraire de l'Agirc-Arrco par le Gouvernement », est donc satisfait par la rédaction actuelle du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la commission souligne la nécessité d'équilibrer les régimes spéciaux fermés, et s'oppose donc à la suppression de la possibilité, pour le Gouvernement, de fixer par décret le montant de la contribution d'équilibre versée par les régimes de retraite complémentaires et le régime général dans l'hypothèse où ceux-ci auraient échoué à s'accorder sur le montant d'une telle subvention.
En cohérence, la commission a adopté un amendement n° 629 de sa rapporteure générale visant à supprimer le présent article.
Article 12 nonies (nouveau)
Augmentation des majorations de
redressement pour travail dissimulé
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à augmenter les majorations du montant de redressement qui s'appliquent automatiquement en cas de redressement pour travail dissimulé.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du député Jérôme Guedj564(*), avec un avis favorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et un avis défavorable du Gouvernement, au motif que ces dispositions étaient actuellement examinées au Sénat dans le cadre du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
A. Le droit actuel
L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, et de 40 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, telles que l'emploi de mineurs soumis à obligation scolaire.
Ces majorations peuvent être minorées ou augmentées selon que la personne physique ou morale redressée s'acquitte rapidement de ses obligations, ou au contraire récidive.
En effet, l'article précité offre à la personne morale redressée la possibilité de bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration de redressement si elle s'acquitte du règlement intégral des sommes appelées au titre du recouvrement de cotisations, majorations et pénalités de retard dans les trente jours suivant la notification, ou si elle a présenté dans ce délai un plan d'échelonnement des paiements qui a été accepté par le directeur de l'organisme de recouvrement.
À l'inverse, en cas de récidive du constat d'un recours au travail dissimulé dans les cinq ans suivant une première condamnation, la majoration de redressement en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié est portée à 45 %, et celle résultant du constat de l'infraction de travail dissimulé avec circonstances aggravantes à 60 %.
B. Le dispositif proposé
Le présent article propose d'augmenter, à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de redressement en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, à 35 % au lieu de 25 %, et le montant de la majoration de redressement résultant du constat de l'infraction de travail dissimulé avec circonstances aggravantes, à 50 % au lieu de 40 %
II - La position de la commission
La commission rappelle que l'article 17 bis du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adopté en première lecture par le Sénat, et inséré à l'initiative de la sénatrice Raymonde Poncet Monge565(*), augmente déjà dans des proportions strictement identiques la majoration de redressement en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé.
En conséquence, la commission a adopté un amendement n° 630 de sa rapporteure générale visant à supprimer le présent article.
Article 12 decies (nouveau)
Suppression de la réduction de
majoration en cas de paiement rapide
des montants redressés pour
travail dissimulé
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'abroger la réduction de majoration consentie en cas de paiement rapide des créances sociales résultant du constat d'infraction au travail dissimulé.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le I de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de constat de travail dissimulé566(*), le montant du redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25 %. Cette majoration est portée à 40 % en cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes567(*).
Le II du même article prévoit que le taux peut toutefois être réduit de dix points en cas de paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dans un délai de trente jours ou de présentation, dans le même délai, d'un plan d'échelonnement du paiement, accepté par le directeur de l'organisme de recouvrement. Cette réduction de dix points est également applicable aux donneurs d'ordre tenus de payer solidairement les dettes sociales de leur cocontractant, dès lors que ces donneurs d'ordre ont manqué à leur devoir de vigilance. À noter cependant que cette réduction de majoration ne peut être consentie en cas de récidive de travail dissimulé.
Le présent article a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Jérôme Guedj568(*), avec une double demande de retrait. Il vise à abroger le II précité de l'article L. 243-7-7 afin de supprimer toute possibilité de réduire les majorations appliquées en cas de travail dissimulé.
II - La position de la commission
La commission et le Sénat ont rejeté de telles dispositions, proposées par amendement569(*), à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, considérant que cette réduction ne constituait nullement une libéralité au profit des auteurs d'infractions mais participait d'une législation incitant au paiement rapide des montants redressés et facilitant leur recouvrement.
En outre, ce même projet de loi propose, à l'article 22 adopté par le Sénat, que l'auteur de l'infraction bénéficie automatiquement de la réduction de dix points du redressement majoré, dès lors que celui-ci procède au règlement intégral des dettes sociales dans le délai de trente jours qui lui est imparti. De même, les majorations ne seraient pas exigibles pour les donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage qui auraient procédé au paiement des dettes sociales dans un délai prévu par voie réglementaire.
En cohérence, la commission a adopté un amendement n° 631 de sa rapporteure générale visant à supprimer le présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 12 undecies (nouveau)
Modification des maxima de
pénalités prononcées en cas de non-respect
de
l'obligation de transmission à l'Urssaf des données des vendeurs
et prestataires recourant à des plateformes de vente en ligne
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit de réformer le montant des maxima de pénalités applicables en cas de manquement, par les vendeurs et prestataires d'une part, et les opérateurs de plateformes d'autre part, à l'obligation de transmission de données à l'Urssaf, qui est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif de précompte des cotisations sociales par les plateformes.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales Thibault Bazin570(*), avec un avis défavorable du Gouvernement571(*).
A. Afin de lutter contre la sous-déclaration, la LFSS pour 2024 a instauré un dispositif de prélèvement des cotisations et contributions par les plateformes de mise en relation
1. Le droit existant : la sanction de la violation de l'obligation de transmettre aux Urssaf les données des vendeurs et prestataires
L'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a mis à la charge des plateformes de mise en relation une obligation de déclaration et de précompte des cotisations dues par les quelque 206 000 micro-entrepreneurs qui l'utilisent.
Cette mesure, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, a pour principal objectif de lutter contre la sous-déclaration auprès de l'Urssaf Caisse nationale. Cette mesure de prélèvement concernera notamment les micro-entrepreneurs et les assimilés salariés relevant du régime « micro-RG ». Le dispositif de précompte s'appliquera aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu'aux taxes, et, en cas recours à cette option, au versement libératoire de l'impôt sur le revenu dus par ces derniers au titre de la part de leur chiffre d'affaires ou des recettes versées par la plateforme572(*).
Les micro-entrepreneurs étant exonérés de TVA sous condition de chiffre d'affaires573(*), la taxe sur la valeur ajoutée sera exclue de ce précompte.
La réforme du circuit de déclaration
et de paiement des cotisations
dues par les micro-entrepreneurs utilisant
des plateformes
portée par l'article 6 de la LFSS
pour 2024
Source : Fiches d'évaluation préalable du PLFSS pour 2024 (annexe 9)
L'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale énonce en son II l'obligation, pour les vendeurs et les prestataires qui utilisent des plateformes, de transmettre à ces dernières les données permettant leur identification. Les opérateurs des plateformes sont ensuite tenus de transmettre ces données à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui exerce un pouvoir de tutelle et de contrôle sur les unions de recouvrement.
Cette obligation se justifie par la nécessité, pour les plateformes et les Urssaf, de déterminer les modalités du précompte de cotisations afin de pouvoir l'appliquer. La méconnaissance de cette obligation de transmission des données entraîne l'application d'une pénalité d'un montant maximal :
1- pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
2- pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
2. La modification proposée par le présent article : la modification des maxima de pénalité encourus pour renforcer la responsabilité pesant sur les plateformes
Le présent article propose de fixer le montant maximal de la pénalité encourue :
- par les vendeurs et prestataires, à 3250 euros au lieu de 7500 euros ;
- par les opérateurs de plateforme, à 15 000 euros au lieu de 7500 euros.
Selon le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, auteur de l'amendement ayant donné lieu au présent article, cette modification se justifie par la volonté de « répartir différemment les montants maximaux de pénalités pouvant être prononcés en cas de défaut de transmission des données nécessaires à l'identification des travailleurs afin de faire davantage peser la responsabilité sur les plateformes en divisant par deux le montant applicable aux travailleurs et en multipliant par deux celui applicable aux plateformes ».
II - La position de la commission
La commission des affaires sociales, fortement attachée à la poursuite de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, n'est pas favorable à la réduction du montant maximal de la pénalité encourue par les vendeurs et prestataires en cas de non-transmission des informations des données permettant leur identification aux plateformes de mise en relation. Elle relève par ailleurs que le dispositif de précompte des cotisations par les plateformes doit être mis en oeuvre au 1er janvier 2027, de sorte qu'il lui apparaît prématuré de modifier dès à présent le montant des sanctions des obligations qu'il prévoit.
En conséquence, la commission a adopté un amendement n° 632 de sa rapporteure générale visant à supprimer le présent article.
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
Article
13
Approbation du montant de la compensation des
exonérations
mentionné à l'annexe 4
Cet article a pour objet d'approuver le montant prévisionnel de la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale qui font l'objet de l'annexe 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-3-4 du code de la
sécurité sociale
(extrait)
« Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :
(...)
c) Approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 2° de l'article L.O. 111-4-1 du présent code ; »
Il propose d'approuver un montant de 5,7 milliards d'euros correspondant au montant prévisionnel de la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au présent PLFSS. Il s'agit des exonérations dites « ciblées compensées », faisant l'objet d'une compensation au moyen de crédits budgétaires inscrits au projet de loi de finances574(*).
Ce montant est l'arrondi de celui, de 5,673 milliards d'euros, figurant page 54 de l'annexe 4 au présent PLFSS.
Cette diminution confirme l'inflexion observée en 2025 par rapport à l'augmentation continue observée ces dernières années, comme le montre le graphique ci-après.
Montants approuvés par les LFSS 2020 à 2025 et par le présent PLFSS
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, d'après les LFSS 2020 à 2025 et le PLFSS 2026
Le tableau figurant page 54 de l'annexe 4 montre que cette diminution concerne en particulier les contrats d'apprentissage, les jeunes entreprises innovantes et le dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre), dont l'article 9 propose de rendre le régime moins favorable.
De manière plus générale, le montant global des allègements et exonérations recouvre des exonérations et allègements de différente nature que l'on peut distinguer comme suit :
Synthèse des exonérations par nature (Robss)
(en milliards d'euros)
|
2024 |
2025 (p) |
2026 (p) |
|
|
Allégements généraux |
64,9 |
62,2 |
61,8 |
|
Exonérations compensées |
7,0 |
6,8 |
6,9 |
|
Exonérations non compensées |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
Total |
74,7 |
71,8 |
71,5 |
Remarque : ces montants, exprimés en droits constatés, ne sont pas directement comparables aux montants prévisionnels des exonérations compensées inscrits dans les LFSS, exprimés en comptabilité de caisse. Ainsi, le montant prévu pour 2026, de 6,9 milliards d'euros selon le tableau, est de 5,7 milliards d'euros selon le présent article. Par ailleurs, dans le cas de 2026 ce tableau ne prend pas en compte les nouvelles mesures du PLFSS pour 2026.
Source : Annexe 4 au PLFSS pour 2026
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
Le Gouvernement a transmis cet article au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission a approuvé le présent article, dont il convient de rappeler qu'il présente un caractère estimatif et informatif - et non normatif. Il ne saurait évidemment constituer une quelconque limite aux crédits budgétaires que l'État consacrera à ces compensations en 2026.
On souligne par ailleurs que le présent article ne porte que sur une faible part des compensations d'exonérations. Selon l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, « toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application ». Cette compensation intégrale s'interprète comme une compensation par crédits du budget de l'État, à l'euro, des pertes de recettes occasionnées pour la sécurité sociale.
Toutefois, dans le cas des allégements généraux de cotisations sociales patronales, la compensation est en quasi-totalité réalisée par affectation de recettes fiscales (très majoritairement de la TVA) pour « solde de tout compte ». Ainsi, les recettes des régimes obligatoires de base peuvent se trouver fortement réduites quand, du fait d'une inflation élevée, une forte croissance du Smic suscite une croissance des cotisations sociales inférieure à celle de la masse salariale, comme cela s'est produit en 2023.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
14
Tableau d'équilibre 2026
Cet article détermine le tableau d'équilibre pour 2026 des différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ayant été supprimé au 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS pour 2025, cet article ne comprend plus qu'un unique tableau.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-3-4 du code de la
sécurité sociale
(extraits)
« Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :
(...)
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l'année :
a) Prévoit les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;
(...)
d) Retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
(...) »
Cet article présente le tableau d'équilibre contenant, par branche, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2026. Depuis la LFSS 2023, le nouveau cadre organique ne prévoit plus d'approbation des tableaux d'équilibre du régime général.
Ce tableau fait apparaître une prévision de déficit consolidé de 17,5 milliards d'euros selon la répartition par branche suivante.
Tableau d'équilibre des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale
pour l'année
2026
(en milliards d'euros)
|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
|
Maladie |
255 |
267,5 |
-12,5 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
17,1 |
18 |
-1 |
|
Vieillesse |
304,5 |
307,5 |
-3 |
|
Famille |
60,1 |
59,4 |
0,7 |
|
Autonomie |
41,8 |
43,5 |
-1,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
659,5 |
676,9 |
-17,5 |
NB : le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ayant été supprimé au 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS pour 2025, ce tableau ne comprend plus la ligne intitulée « Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse ».
Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Les prévisions pour 2026 ont été commentées par la rapporteure générale dans le tome I du présent rapport.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
Le Gouvernement a transmis cet article au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
En effet, l'Assemblée nationale n'ayant pas achevé l'examen du texte, le Gouvernement ne l'a pas mis à jour.
III - La position de la commission
L'approbation de cet article obligatoire est avant tout une prise d'acte des prévisions du Gouvernement par le Parlement.
Quant aux conséquences des votes de l'Assemblée nationale et du Sénat, il reviendra au Gouvernement d'en tenir compte dans la suite de la navette.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a approuvé l'adoption du présent article.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
15
Objectif d'amortissement de la dette sociale et prévisions de
recettes du Fonds de réserve pour les retraites
Cet article détermine, pour l'année 2026, l'objectif d'amortissement de la dette sociale ainsi que les prévisions de recettes du Fonds de réserve pour les retraites.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-3-4 du code de la
sécurité sociale
(extraits)
« Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :
(...)
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l'année :
(...)
b) Détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement et prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ; »
Le I du présent article fixe l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) à 16,4 milliards d'euros (après 16 milliards d'euros pour la LFSS 2024 et 16,28 milliards d'euros pour la LFSS 2025). Au 31 décembre 2026, l'amortissement cumulé représenterait ainsi 291,2 milliards d'euros. La dette nette à amortir par la Cades devrait s'élever à 105,3 milliards d'euros au 31 décembre 2025.
Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) n'étant plus affectataire d'aucune recette depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le II du présent article propose logiquement de maintenir l'absence de recettes du fonds en 2025.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
Le Gouvernement a transmis cet article au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
L'objectif d'amortissement de la dette sociale est purement prévisionnel. Il correspond à l'écart entre la prévision de ressources de la Cades (en quasi-totalité constituée par la CRDS et une fraction de CSG) et ses prévisions de charges (constituées par la charge d'intérêt).
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
16
Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes
habilités à recourir à des ressources non permanentes
Cet article fixe les limites de recours à des ressources non permanentes pour les organismes de financement de la sécurité sociale.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-3-4 du code de la
sécurité sociale
(extraits)
« Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de l'année :
(...)
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin, la loi de financement de l'année :
(...)
e) Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. »
Cet article propose d'habiliter l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)575(*), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie.
Il fixe les plafonds de recours à ces ressources non permanentes comme suit :
Proposition de plafonds pour 2026
(en millions d'euros)
|
Rappel des plafonds |
Rappel des plafonds |
Rappel des plafonds |
Plafonds proposés pour 2026 |
|
|
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) |
45 000 |
45 000 |
65 000 |
83 000 |
|
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) |
350 |
0 |
0 |
0 |
|
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) puis Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) |
950 |
945 |
300 |
360 |
|
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) |
7 500 |
11 000 |
13 200 |
13 400 |
Source : LFSS pour 2023, 2024 et 2025, PLFSS pour 2026
A. Le plafond d'emprunt de l'Acoss
1. Une marge de sécurité de 4,5 milliards d'euros par rapport au pic prévisionnel du besoin de financement
Le plafond d'emprunt de l'Acoss augmenterait à nouveau fortement, passant de 65 milliards d'euros à 83 milliards d'euros. Cela s'explique par le déficit prévisionnel important de la sécurité sociale en 2026 et l'absence de reprise de dette par la Cades.
Selon les indications fournies par l'Acoss, le pic prévisionnel de besoin de financement en 2026 est de 78,5 milliards d'euros, d'où une marge de sécurité de seulement 4,5 milliards d'euros.
L'article 11 du PLFSS, qui tend à améliorer la gestion de trésorerie du régime général en instaurant un mécanisme d'acompte des remises relatives aux produits de santé, doit réduire le « pic » du besoin de trésorerie de la sécurité sociale fin 2026 d'environ 8 milliards d'euros576(*). Cette mesure est prise en compte dans la prévision de 78,5 milliards d'euros indiquée ci-avant.
Prévisions de soldes de trésorerie de l'Acoss pour 2025 et 2026
(en millions d'euros)
Source : Annexe 3 du PLFSS pour 2026
2. Un besoin de financement prévisionnel de 65,9 milliards d'euros en moyenne annuelle
En moyenne annuelle, le besoin de financement de l'Acoss serait de 65,9 milliards d'euros.
Il se répartirait conformément au tableau ci-après.
Répartition du besoin de financement de l'Acoss en moyenne annuelle (2026)
(en milliards d'euros)
|
Montant |
|
|
Solde de trésorerie du régime général* |
[-] 39,2* |
|
Avances aux partenaires |
11,7 |
|
Pré-emprunt moyen de précaution |
15,0 |
|
Total |
65,9 |
* Résultant de déficits passés du régime général de 31,5 milliards d'euros et d'une variation de trésorerie du régime général de - 17,8 milliards d'euros.
Source : D'après les données transmises par l'Acoss
B. Une faible augmentation du plafond d'emprunt de la CNRACL
Après deux fortes augmentations en 2024 et en 2025, le plafond d'emprunt de la CNRACL augmenterait de seulement 0,2 milliard d'euros (13,4 milliards d'euros, après 13,2 milliards d'euros en 2025).
Cela provient notamment de la poursuite de l'augmentation du taux de cotisation employeur à la CNRACL, correspondant à des recettes supplémentaires de 1,8 milliard d'euros (après une augmentation identique en 2025).
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
Le Gouvernement a transmis cet article au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
Les montants d'emprunt à court terme semblent adaptés et laissent une marge de manoeuvre raisonnable aux différents organismes concernés.
Le cadre organique mis en place en 2022 offre au Parlement un meilleur suivi de ces autorisations, l'article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale prévoyant désormais que les décrets de relèvement soient pris en Conseil d'État, après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Comme souligné dans le tome 1 du présent rapport, les projections de la commission suggèrent, sur la base des prévisions de solde du projet d'annexe à la LFSS, que pic de besoin de financement de l'Acoss pourrait dépasser 100 milliards d'euros en 2027, ce qui selon l'Acoss pourrait ne pas être finançable sur les marchés.
Le besoin de trésorerie maximal de l'Acoss, estimé d'après les prévisions de déficit du projet d'annexe à la LFSS 2026
(en milliards d'euros)
Pour 2025 et 2026, le besoin de financement maximal sur l'année correspond aux prévisions de l'Acoss transmises à la rapporteure générale.
La prévision pour 2026 prend en compte la réduction ponctuelle, d'environ 8 milliards d'euros, du besoin de financement maximal, résultant de l'article 11 du PLFSS (année de transition entre la perception par la sécurité sociale des remises sur les produits de santé au titre d'une année n l'année n+ 1 (comme actuellement) et sa perception l'année n (à partir de 2027), conduisant en 2026 à la perception des remises au titre de 2025 et 2026).
* Source : audition de l'Acoss par les rapporteures dans le cadre des travaux de la Mecss sur le financement de la sécurité sociale, 22 mai 2025.
Source : Actualisation du graphique figurant dans le rapport d'Élisabeth Doineau et Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025
La nouvelle augmentation du plafond d'emprunt de l'Acoss proposée par le présent article n'est donc pas anodine.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 16 bis (nouveau)
Réduction de la capacité de
l'Acoss à s'endetter sur les marchés
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, a pour objet de faire que l'Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et non sur les marchés.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été inséré à l'initiative de Yannick Monnet577(*), avec un avis défavorable du rapporteur général de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement.
A. Le droit actuel
Actuellement, le premier alinéa de l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent provenir que de certains organismes : la Caisse des dépôts et consignations, des sociétés de financement ou établissements de crédit agréés et l'Acoss.
Le deuxième alinéa de l'article L. 139-3 précité prévoit une unique exception, dans le cas de l'Acoss, seule autorisée à émettre des titres de créances négociables, c'est-à-dire à se financer sur les marchés.
Depuis l'article 39 de la LFSS pour 2025, ces ressources non permanentes ne sont plus limitées à un an, mais doivent être souscrites « pour une durée inférieure ou égale à deux ans », avec une « durée moyenne annuelle pondérée [...] inférieure ou égale à un an ».
B. La modification proposée par cet article
Le dispositif de cet article ne correspond pas à son exposé sommaire.
1. Le dispositif de cet article : pour les organismes autres que l'Acoss (qui ne sont pas autorisés à se financer sur les marchés), un endettement prioritaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations
Le dispositif de cet article vise le premier alinéa de l'article L. 139-3 précité du code de la sécurité sociale, pour prévoir que les ressources non permanentes sont empruntées « prioritairement » auprès de la Caisse des dépôts et consignations et « subsidiairement » aux sociétés de financement ou établissements de crédit agréés et à l'Acoss.
2. L'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement : faire que l'Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations
L'intention des auteurs de l'amendement est toutefois que l'Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et seulement subsidiairement sur les marchés.
Ainsi, selon l'exposé sommaire de l'amendement : « si jusqu'en 2010, la part des concours bancaires via la Caisse des dépôts et consignations représentait 72 % du financement des besoins de l'Acoss, elle n'y a plus recours depuis 2021. Désormais, les instruments de marché contribuent à hauteur de 99 % à couvrir les besoins de trésorerie. [...] Au regard du transfert de dette de la Cades vers l'Acoss, il importe plus encore de rediriger les emprunts de l'Acoss vers la Caisse des dépôts et consignations ».
L'amendement insérant cet article a été soutenu en séance sans être présenté. Toutefois, dans le cas d'un amendement au dispositif analogue (non adopté)578(*), il a été clairement indiqué qu'il s'agissait bien de faire que l'Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations579(*).
II - La position de la commission
Comme indiqué supra, le dispositif de cet article ne correspond pas à l'intention de ses auteurs, qui est que l'Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et subsidiairement sur les marchés.
Surtout, comme la rapporteure générale l'a souligné notamment dans le tome I du présent rapport et dans les commentaires des articles 12 et 16, la situation financière de l'Acoss est déjà fragilisée.
L'expérience a montré que la Caisse des dépôts et consignations pouvait se révéler indispensable si l'Acoss n'était pas en mesure d'obtenir des marchés la totalité des financements requis, comme cela s'est produit en 2020 lors de la crise sanitaire580(*).
Aujourd'hui, une convention avec la Caisse des dépôts et consignations permet à l'Acoss d'obtenir de celle-ci 13 milliards d'euros de financement, en cas de besoin critique et imprévu. Cette facilité de dernier recours permet à l'Acoss de ne pas être en situation de dépendance par rapport aux marchés financiers en cas de crise.
En revanche, cet article obligerait l'Acoss à recourir d'abord à des prêts Caisse des dépôts et consignations, dont le montant ne pourrait couvrir qu'une part limitée de son besoin, les règles prudentielles empêchant la Caisse des dépôts et consignations d'avoir une exposition trop élevée sur l'Acoss.
Le besoin de financement maximal de l'Acoss en 2026 est évalué à 78,5 milliards d'euros (pour un plafond d'emprunt que l'article 16 propose de fixer à 83 milliards d'euros). Si les 13 milliards d'euros de financement de la Caisse des dépôts et consignations étaient saturés toute l'année, alors il resterait plus de 65 milliards d'euros à mobiliser sur les marchés. Cela aurait pour conséquence qu'en cas de difficulté à un moment de l'année, l'Acoss ne disposerait plus de cette sécurité des financements de la Caisse des dépôts et consignations.
Par ailleurs, le financement de marché est par construction le moins onéreux pour la sécurité sociale. En effet, c'est le niveau général des taux de la Banque centrale européenne (BCE) qui détermine avant tout le taux d'emprunt de l'Acoss et les charges d'intérêts. Emprunter directement sur les marchés permet de bénéficier du taux de marché le plus bas. En revanche, couvrir les besoins de trésorerie par de l'emprunt bancaire implique de passer par l'intermédiaire d'une banque, qui applique ce taux de marché augmenté d'une marge.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que pour prêter à l'Acoss, la Caisse des dépôts et consignations doit emprunter sur les marchés. Il y a dans ce cas un financement originel par les marchés avec une étape intermédiaire par la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté l'amendement de la rapporteure générale n° 633 tendant à supprimer cet article.
Article 17
(supprimé)
Approbation du rapport sur l'évolution
pluriannuelle du financement de la sécurité sociale
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement, propose d'approuver le rapport sur l'évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale constituant l'annexe à la future LFSS.
Le rapport prévoit une aggravation du déficit de la sécurité sociale, qui, sur la base d'hypothèses qui pourtant ne sont pas particulièrement prudentes en matière de croissance du PIB et de l'Ondam, passerait de 23 milliards d'euros en 2025 à 17,9 milliards d'euros en 2029.
La commission propose de le rétablir, ainsi que le rapport annexé modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément à la loi organique du 14 mars 2022.
Article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale
« Le projet de loi de financement de l'année est accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l'évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l'impact attendu des mesures nouvelles.
En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d'une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et d'autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.
Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »
Conformément aux dispositions organiques rappelées supra, le projet d'annexe de la future LFSS581(*) détaille, pour les années 2026 à 2029, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les soldes par risque pour les régimes obligatoires de base et par branche pour le régime général.
Le tableau ci-après reprend, par branche, les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des Robss figurant dans le rapport annexé qu'il est proposé d'approuver.
Prévisions des recettes, dépenses et
soldes
de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du
FSV
(en milliards d'euros)
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Maladie |
||||||
|
Recettes |
239,2 |
245,1 |
255 |
261,5 |
268,2 |
275,3 |
|
Dépenses |
253 |
262,3 |
267,5 |
275,3 |
283,2 |
291,4 |
|
Solde |
- 13,8 |
- 17,2 |
- 12,5 |
- 13,8 |
- 15,0 |
- 16,1 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
||||||
|
Recettes |
239,2 |
245,1 |
255,0 |
261,5 |
268,2 |
275,3 |
|
Dépenses |
253 |
262,3 |
267,5 |
275,3 |
283,2 |
291,4 |
|
Solde |
- 13,8 |
- 17,2 |
- 12,5 |
- 13,8 |
- 15,0 |
- 16,1 |
|
Famille |
||||||
|
Recettes |
58,9 |
60,2 |
60,1 |
61,8 |
62,9 |
64,1 |
|
Dépenses |
57,8 |
59,3 |
59,4 |
59,9 |
60,7 |
61,6 |
|
Solde |
1,1 |
0,8 |
0,7 |
1,9 |
2,2 |
2,4 |
|
Vieillesse |
||||||
|
Recettes |
288,2 |
297 |
304,5 |
311,3 |
319,9 |
326,9 |
|
Dépenses |
293,8 |
303,4 |
307,5 |
313,1 |
320,7 |
328,5 |
|
Solde |
- 5,6 |
- 6,3 |
- 3,0 |
- 1,8 |
- 0,8 |
- 1,6 |
|
Autonomie |
||||||
|
Recettes |
41,2 |
41,7 |
41,8 |
43,5 |
45,3 |
47,2 |
|
Dépenses |
39,9 |
42,0 |
43,5 |
45,2 |
47,0 |
48,8 |
|
Solde |
1,3 |
-0,3 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
|
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés |
||||||
|
Recettes |
626,4 |
642,3 |
659,5 |
676,0 |
694,3 |
711,4 |
|
Dépenses |
642,8 |
665,8 |
676,9 |
692,8 |
710,9 |
729,3 |
|
Solde |
- 16,4 |
- 23,5 |
- 17,5 |
- 16,8 |
- 16,6 |
- 17,9 |
|
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse |
||||||
|
Recettes |
627,8 |
643,1 |
659,5 |
676 |
694,3 |
711,4 |
|
Dépenses |
643,1 |
666,1 |
676,9 |
692,8 |
710,9 |
729,3 |
|
Solde |
- 15,3 |
- 23,0 |
- 17,5 |
- 16,8 |
- 16,6 |
- 17,9 |
Source : Projet d'annexe à la LFSS pour 2026
Cette programmation, et les hypothèses sous-jacentes, ont été présentées dans le tome I du présent rapport général.
Contrairement à ce qui était le cas dans le rapport annexé à la LFSS pour 2025, le présent projet de rapport est relativement imprécis sur les mesures devant être mises en oeuvre. Ainsi, il n'évoque pas le doublement des participations forfaitaires et des franchises.
II - Le dispositif transmis au Sénat
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale582(*).
III - La position de la commission
A. Un III précisant utilement que l'objectif est de ramener la sécurité sociale à l'équilibre, conformément à une proposition de la commission
1. La commission préconise d'adopter une véritable programmation financière de la sécurité sociale
Dans le cas du PLFSS pour 2024, le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a supprimé l'article portant approbation du rapport annexé, au motif que ce dernier prévoyait une aggravation du déficit de la sécurité sociale, qui devait alors passer de 8,7 milliards d'euros en 2023 à 17,2 milliards d'euros en 2027.
Dans le cas du PLFSS pour 2025, la commission des affaires sociales, prenant acte des efforts du Gouvernement pour réduire le déficit, a adopté un amendement précisant dans le rapport annexé que ses prévisions à moyen terme s'entendaient à politiques inchangées. Il s'agissait de bien spécifier que le déficit alors prévu pour 2028, de 19,9 milliards d'euros, ne correspondait pas à l'objectif poursuivi par le Gouvernement. Toutefois le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant globalement l'annexe, qui a fait tomber tous les autres amendements, dont celui-ci.
La commission des affaires sociales a réaffirmé la nécessité d'une programmation des finances de la sécurité sociale dans le récent rapport583(*) de la Mecss sur le retour de la sécurité sociale à l'équilibre. Ainsi, le « point d'accord » n° 4 des rapporteures consiste à « adopter rapidement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS 2026, une trajectoire crédible de solde de la sécurité sociale, garantissant un retour à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035 ». Le « point d'accord » n° 6 consiste quant à lui à « adopter annuellement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS, une programmation (et non une simple prévision à politiques inchangées) à moyen terme de recettes, de dépenses et de solde de la sécurité sociale ».
2. Une proposition partiellement mise en oeuvre par le III
La rapporteure générale se félicite de ce que la commission ait été partiellement entendue. En effet, le projet d'annexe à la LFSS comprend un III ainsi rédigé :
« III. - D'ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en oeuvre pour revenir à l'équilibre.
Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l'équilibre d'ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l'intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.
Le retour à l'équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de [18,3]584(*) milliards d'euros sur quatre ans, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-dessus. »
Jusqu'alors aucun document public, a fortiori législatif, n'indiquait clairement que l'objectif était de revenir à l'équilibre en 2029.
Cet objectif n'avait fait l'objet que de déclarations. Ainsi, la ministre chargée des comptes publics avait déclaré, le 19 avril 2025, que l'objectif était de ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2028-2029585(*). Elle l'avait confirmé au Sénat le 28 mai 2025, lors des questions d'actualité au Gouvernement586(*), puis le 23 juin 2025, lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes (Placss) pour 2024587(*). L'objectif de retour à l'équilibre en 2029 avait ensuite été affirmé par le Premier ministre588(*).
B. Un III à préciser
On peut toutefois se demander si le III précité, relativement discret et peu précis, suffira à rassurer les créanciers de la France, et en particulier de l'Acoss.
Aussi, la commission propose, dans l'attente d'une véritable programmation, de le rédiger de manière plus concrète, en précisant le montant annuel de mesures de réduction du déficit requise.
Cet amendement propose en outre d'actualiser le III afin de prendre en compte le déficit prévisionnel pour 2029 résultant de la lettre rectificative du 23 octobre (de 17,9 milliards d'euros, et non plus de 18,3 milliards d'euros comme indiqué dans le texte déposé le 14 octobre).
La commission propose de rétablir cet article et d'adopter le rapport annexé modifié par l'amendement n° 634 qu'elle a adopté.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le samedi 15 novembre 2025, sous la présidence de M. Alain Milon, vice-président, la commission procède à l'examen du rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 : Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale chargée des équilibres généraux, Corinne Imbert, rapporteure pour l'assurance maladie, Marie-Pierre Richer, rapporteure pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, Pascale Gruny, rapporteur pour l'assurance vieillesse, M. Olivier Henno, rapporteur pour la famille, et Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour l'autonomie.
M. Alain Milon, président. - Nous allons examiner ce matin le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.
Il s'agit d'un moment important au regard des politiques et des sommes en jeu. Il l'est d'autant plus cette année que, comme l'année dernière, l'Assemblée nationale n'a pas pu aller au terme de l'examen de ce texte. En application de l'article 47-1 de la Constitution et de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement a transmis au Sénat le texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements adoptés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui.
L'expiration du délai imparti à l'Assemblée nationale ayant expiré mercredi soir, juste avant minuit, nous devons nous réunir en ce moment atypique. Je remercie tout particulièrement les rapporteurs, dont les conditions d'instruction de ce PLFSS ont été singulièrement compliquées.
Je vous rappelle que la procédure d'adoption de cette loi financière diffère de celle des lois ordinaires : c'est le texte transmis par le Gouvernement qui sera examiné en séance publique par le Sénat.
Comme de coutume, nous procéderons à une discussion générale - c'est-à-dire, concrètement, à une présentation, suivie d'un échange -, d'abord de la rapporteure générale, puis de chacun des rapporteurs de branche. Ensuite, nous nous prononcerons sur les amendements que proposent les rapporteurs. Les amendements que nous adopterons seront, non pas intégrés au texte, mais défendus en séance la semaine prochaine par nos rapporteurs au nom de la commission.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Nous voici donc réunis pour examiner le PLFSS pour 2026, dans des conditions au moins aussi compliquées que l'année dernière.
Comme l'année dernière, les enjeux sont particulièrement importants et sensibles. Je vous les présenterai en m'appuyant sur une série de diapositives. (Mme la rapporteure générale projette un diaporama en complément de son propos.)
Tout d'abord, la situation des finances publiques en général, et des finances sociales en particulier, connaît une dégradation sans précédent hors période de crise.
Ensuite, la discussion du projet de loi de finances (PLF) et du PLFSS se passe plus que jamais sous la surveillance de l'Union européenne (UE) et des marchés financiers.
Dans le cas de l'UE, la France est de nouveau sous procédure de déficit excessif. Comme vous le savez, le pacte de stabilité a été réformé l'année dernière, et désormais les programmes de stabilité n'existent plus. Ce qui les remplace, c'est un document valable pendant quatre ans, intitulé « plan budgétaire et structurel à moyen terme », que le Gouvernement désigne par le sigle PSMT. Notre PSMT comprend l'engagement de revenir sous le seuil de 3 points de PIB en 2029.
Pour ce qui est des marchés financiers, la différence essentielle par rapport à l'an dernier est que, depuis le mois de septembre, la France est le pays de la zone euro qui emprunte aux taux les plus élevés. Nous sommes en effet passés devant l'Espagne, puis l'Italie. En cas de nouvelle crise de la dette, nous serions en première ligne.
Comme l'année dernière, l'absence de majorité à l'Assemblée nationale complexifie considérablement les modalités de discussion du PLFSS - qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse.
J'en viens aux conséquences d'un non-respect du délai de soixante-dix jours pour le PLF, de cinquante jours pour le PLFSS, ou d'une absence de loi au 1er janvier.
L'an dernier, nous ne savions pas précisément quel dispositif pourrait être mobilisé si le texte ne pouvait pas être promulgué avant le 1er janvier. Comme vous le savez, nous nous sommes « greffés » sur la « loi spéciale » prévue pour l'État, afin d'autoriser la sécurité sociale à emprunter. Cette solution a été rendue possible en vertu du principe constitutionnel de « continuité de la vie nationale ».
Cette année, si l'on en croit les déclarations des uns et des autres, nous pourrions bientôt tester les dispositions relatives aux ordonnances. En effet, si le Parlement ne parvient pas à adopter ou à rejeter le PLFSS dans le délai constitutionnel de cinquante jours, le Gouvernement aura la possibilité, s'il le souhaite, de mettre en oeuvre le PLFSS par ordonnance.
Dans le cas du dernier PLFSS, la discussion était mal partie dès le début, avec un texte déposé en retard du fait de la constitution tardive du Gouvernement et du non-respect par l'Assemblée nationale de son délai constitutionnel de vingt jours. Mais la commission mixte paritaire (CMP) a été un succès, pour la première fois depuis le PLFSS pour 2011.
Ensuite, le gouvernement Barnier a été censuré sur les conclusions de la CMP, ce qui nous a amenés à nous « greffer » sur la « loi spéciale » de l'État, pour autoriser la sécurité sociale à emprunter.
Comme l'Assemblée avait censuré le texte issu des travaux la CMP, elle devait nécessairement repartir du texte du Sénat. Mais les subtilités de l'article 45 de la Constitution font que nous avons dû nous aussi examiner le texte de la CMP, afin de ne pas nous exposer inutilement à un risque de censure pour non-respect de la lettre de l'article 45.
L'Assemblée a adopté le PLFSS en nouvelle lecture, puis le Sénat a adopté le texte conforme, le 17 février.
J'aborderai maintenant le déficit de la sécurité sociale.
Comme vous le savez, dans le cas du PLFSS pour 2025, les perspectives de déficit se sont considérablement dégradées au cours des débats. Cette dégradation des perspectives de solde entre les différents états du texte s'explique par l'abandon de mesures importantes d'amélioration du solde : les mesures nettes d'amélioration prévues pour 2025 ont été ramenées de 15 milliards à 9 milliards d'euros.
Les modalités de discussion du PLFSS s'annoncent également compliquées cette année.
Comme vous le savez, le Gouvernement a déposé le texte le 14 octobre, soit de nouveau en retard par rapport au délai organique du premier mardi d'octobre.
Le même jour, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a annoncé sa décision de ne pas recourir à l'article « 49-3 » de la Constitution, et de geler, dans le cadre de la réforme des retraites, l'âge d'ouverture des droits et la durée d'assurance requise jusqu'à janvier 2028.
La lettre rectificative a été déposée le 23 octobre.
Comme l'année dernière, l'Assemblée nationale n'est pas parvenue à examiner le texte dans le délai constitutionnel de vingt jours, qui expirait à minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Gouvernement a donc transmis le texte au Sénat, avec les amendements acceptés par lui - contrairement à l'an dernier, il a cette fois décidé de retenir l'ensemble des amendements adoptés par l'Assemblée nationale.
J'aborderai à présent les grands équilibres du texte initial. Par « texte initial », j'entends celui de la lettre rectificative.
Les principales mesures de rendement du PLFSS, supérieures à 10 milliards d'euros, sont très proches des propositions faites par la majorité sénatoriale au Premier ministre le 8 juillet dernier.
Les chiffres peuvent parfois différer de ceux que vous avez en tête, car cette analyse prend en compte le seul périmètre de la sécurité sociale et ignore toutes les mesures qui ne figurent pas dans le PLFSS dans les textes réglementaires associés.
Par exemple, le gel des prestations est chiffré à seulement 2,5 milliards d'euros, et pas à 3,6 milliards d'euros, car le gain de 1,1 milliard d'euros pour l'État n'est pas pris en compte - ce gain correspond au fait que la mesure lui permet de verser moins d'argent aux régimes dits « équilibrés ».
De même, les mesures sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) sont chiffrées à seulement 6 milliards d'euros, et pas à 7,1 milliards d'euros - montant souvent indiqué par le Gouvernement. Le montant de 7,1 milliards d'euros ne prend pas en compte les mesures coûteuses et intègre, parmi les mesures d'économies, la montée en puissance de mesures antérieures au PLFSS.
Les mesures du texte initial sont en réalité très proches de celles qui ont été proposées par la majorité sénatoriale - mis à part évidemment le décalage de la réforme des retraites.
Dans le cas de l'Ondam, la principale différence réside dans le fait que, tandis que la majorité sénatoriale proposait de transférer 1 milliard d'euros de charges aux complémentaires, le PLFSS prévoit de transférer 2,3 milliards d'euros aux assurés, sous la forme du doublement des franchises et participations forfaitaires.
Du côté des prélèvements obligatoires, la majorité sénatoriale proposait de réduire les allégements généraux d'environ 1,5 milliard d'euros, sous la forme d'un gel du barème. Le Gouvernement prévoit quant à lui de modifier par un futur décret la forme de la courbe des allégements généraux applicable en 2026, pour un rendement de 1,4 milliard d'euros. C'est une autre manière d'atteindre un résultat analogue.
J'en profite pour vous signaler que, selon les indications données par le cabinet de la ministre de l'action et des comptes publics, le projet de barème ne se traduirait pas par une diminution des allégements généraux au niveau du Smic. Il serait donc cohérent avec la position exprimée par la commission voilà un an.
Dans l'ensemble, le texte initial prévoit un peu plus de hausses de recettes que les propositions de la majorité sénatoriale ou celles de François Bayrou. Mais une fois pris en compte les transferts, le montant total des mesures reste à peu près équivalent.
Cette situation s'explique par le fait que le Gouvernement prévoit de reprendre à la sécurité sociale 3 milliards d'euros en 2026, sous la forme d'une moindre TVA affectée - en vertu de l'article 40 du PLF -, correspondant au gain en 2026 pour la sécurité sociale de la réforme des allégements généraux réalisée en 2025 et en 2026. On peut s'interroger sur la pertinence de ce transfert, qui va aggraver les difficultés de financement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) - désormais également dénommée Urssaf-Caisse nationale.
L'ensemble de ces mesures reposent très majoritairement sur les dépenses. En effet, 9 milliards d'euros concernent les dépenses, contre 4 milliards pour les recettes.
Toutefois, si l'on tient compte de la montée en charge de mesures antérieures et que l'on considère, pour les dépenses, que le seul « vrai effort » correspond à ce qui dépasse une simple stabilisation par rapport au PIB potentiel, la perception des mesures est quelque peu différente. En effet, selon cette approche, l'effort structurel serait à peu près équilibré entre recettes et dépenses.
S'agissant du décalage de la réforme des retraites, proposé par la lettre rectificative, je ne m'attarderai évidemment pas sur le dispositif, qui relève des compétences du rapporteur de branche, Pascale Gruny, et je me limiterai à l'effet de la mesure sur les grands équilibres.
Le chiffrage figurant dans l'évaluation préalable de l'article 45 bis - donc avant extension aux départs anticipés - met en évidence deux éléments principaux, en plus du très faible coût en 2026.
Tout d'abord, si l'on s'intéresse à la seule sécurité sociale, le coût de la mesure prévue dans le texte initial serait de 0,8 milliard d'euros seulement en 2027. L'écart avec le chiffre de 1,4 milliard d'euros généralement évoqué s'explique par le fait que ce dernier prend en compte l'ensemble du système de retraite, incluant l'État et les régimes complémentaires.
Ensuite, comme il s'agit juste d'un décalage d'une génération de la réforme de 2023, l'effet ne serait pas durable. L'âge d'ouverture des droits passerait à 64 ans en 2033 au lieu de 2032, mais en 2033 il n'existerait aucune différence. Le Gouvernement estime même que, comme les cotisations seraient légèrement moindres, les retraites seraient un peu plus faibles, d'où une très légère amélioration du solde cette année-là.
Dans le texte initial, la mesure coûtait 0,1 milliard d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027. Et en 2026, la mesure était financée par une majoration de la taxe exceptionnelle sur les complémentaires santé (article 7 du PLFSS) ; en 2027, elle était financée par une majoration de la sous-indexation des prestations (article 44 du PLFSS).
Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, la mesure a été étendue aux carrières longues, et coûte donc plus cher. Elle coûte 0,3 milliard d'euros en 2026 et 1,9 milliard d'euros en 2027.
Dans le texte transmis au Sénat, les articles 7 et 44 ont été supprimés. On peut toujours dire que la mesure est plus que financée par l'augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) sur le capital prévue par l'article 6 bis, qui rapporte 2,8 milliards d'euros ; mais comme les recettes ne sont bien sûr pas « fléchées » et que le solde est sorti considérablement dégradé de l'Assemblée nationale, ce financement semble largement théorique.
J'en viens maintenant aux perspectives à moyen terme, telles qu'elles résultent du texte initial.
Les perspectives à moyen terme sont toujours dégradées. Toutefois, le « progrès » réside dans le fait que, maintenant, la trajectoire à moyen terme indique, non plus une dégradation, mais une stabilisation.
Si l'on se concentre sur les années récentes, on constate que les prévisions retrouvent à peu près leur niveau de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024, qui prévoyait un déficit de 17,2 milliards d'euros en 2027. La LFSS pour 2025, et son actualisation par le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de juin dernier, montrent que la prévision de déficit est passée d'un niveau légèrement inférieur à 20 milliards d'euros à un niveau supérieur à 20 milliards d'euros, voire nettement supérieur en fin de période. Ce changement a constitué pour nous, vous vous en souvenez, un petit « choc » l'an dernier. Le PLFSS que nous examinons aujourd'hui retrouve, quant à lui, une trajectoire proche de celle de la LFSS pour 2024.
Que penser de ces projections préoccupantes ?
D'abord, elles reflètent, paradoxalement, un certain optimisme. Si l'on retient des hypothèses plus « naturelles » pour l'Ondam et la croissance du PIB, on parvient à un déficit de 30 milliards d'euros en 2029. Je vous indiquais des chiffres analogues voilà un an.
Mais il faut bien garder à l'esprit que les projections annexées aux LFSS ne sont pas de vraies programmations. Elles ne reflètent pas ce que le Gouvernement a l'intention de faire : celui-ci n'a évidemment pas prévu que le déficit atteigne encore 18 milliards d'euros en 2029. Ces projections prennent seulement en compte les mesures de la LFSS et les mesures réglementaires que le Gouvernement prévoit à ce moment-là - en supposant que l'Ondam est respecté. Par construction, elles n'intègrent aucune mesure pour les années suivantes.
J'en arrive à la projection de la dette sociale à l'horizon 2029.
Sans nouveau transfert de dette de l'Acoss à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), la dette sociale sera, à partir de 2027, essentiellement détenue par l'Acoss, qui en assumera plus de 120 milliards d'euros.
Une telle évolution serait dangereuse, comme vous le savez. Le projet de rapport comprend une actualisation des projections du besoin de financement maximal de l'Acoss que Raymonde Poncet Monge et moi-même avons récemment réalisées pour la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss), dans le cadre de nos travaux sur le financement de la sécurité sociale. Sur la base des prévisions à moyen terme de la LFSS, l'Acoss dépassera en 2027 le pic de besoin de financement atteint en 2020, en pleine crise sanitaire, période durant laquelle celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité d'emprunter la totalité des sommes demandées sur les marchés, et avait dû se tourner vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et un pool de banques. Cette situation suscite une certaine fébrilité, notamment au sein de l'Acoss.
Comme vous le savez, la Cour des comptes, dans le rapport sur lequel nous l'avons auditionnée mercredi dernier, évoque dans une note de bas de page un « petit » transfert de dette de 20 milliards d'euros de l'Acoss vers la Cades. Comme cette dernière prévoit que son stock de dette actuel serait amorti dès 2032, un tel « petit » transfert permettrait de ne pas dépasser l'échéance de 2033, fixée par la loi organique pour achever l'amortissement de la dette sociale.
À cet égard, l'article 11 du PLFSS relatif au calendrier de versement des acomptes des remises de produits de santé aura un effet financier important. En 2026, les laboratoires paieront les remises de deux années, ce qui devrait améliorer ponctuellement la trésorerie de l'Acoss d'environ 8 milliards d'euros. Cette conséquence n'apparaît pas dans l'évaluation préalable, mais elle est essentielle.
J'en viens maintenant aux grands équilibres du texte transmis au Sénat.
Il convient de distinguer l'effet des mesures sur la sécurité sociale seule et leur effet sur l'ensemble des administrations publiques (APU), c'est-à-dire non seulement la sécurité sociale, mais aussi l'État et les collectivités territoriales. Cette distinction est importante, car une mesure peut améliorer le solde de la sécurité sociale, mais pas celui de l'État - par exemple si des recettes fiscales sont transférées de l'État vers la sécurité sociale.
Venons-en au déficit résultant du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et aux modifications proposées. Comme vous vous en souvenez, le déficit prévu pour 2026 par le texte initial est de 17,5 milliards d'euros.
Le solde du texte de l'Assemblée transmis par le Gouvernement s'établit à 24 milliards d'euros, selon nos évaluations. Le chiffrage que nous a transmis le Gouvernement est légèrement différent, à 24,1 milliards d'euros, moyennant plusieurs petites différences qui n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes et qui se compensent à peu près.
L'Assemblée nationale a dégradé le solde de 6,5 milliards d'euros. Ce déficit de 24 milliards d'euros n'est évidemment pas acceptable. Il est supérieur à celui qui était prévu pour 2025, qui s'élevait à 23 milliards d'euros.
Le solde de la sécurité sociale résultant des propositions que les rapporteurs et moi-même vous faisons aujourd'hui s'élèverait à 15,1 milliards d'euros. Ce solde serait donc, en apparence, meilleur que le déficit de 17,5 milliards d'euros prévu par le texte initial. Toutefois j'attire votre attention sur le fait que cela vient notamment du fait que je vous propose de nous opposer à ce que l'État « prenne » à la sécurité sociale le gain résultant en 2026 de la réforme des allégements généraux de 2025 et 2026, d'un montant de 3 milliards d'euros.
Par ailleurs, si l'on raisonne au niveau de l'ensemble des administrations publiques, le solde tel qu'il se présenterait à l'issue des travaux du Sénat demeurerait dégradé de 3,8 milliards d'euros par rapport au texte initial. Les 2,4 milliards d'euros de mesures d'amélioration du Sénat ne permettraient pas de compenser totalement les 6,2 milliards d'euros de dégradation de l'Assemblée nationale.
J'en viens aux principales propositions que nous vous faisons.
Le rapporteur de la branche vieillesse vous présentera plus en détail la suppression de l'article 45 bis, relatif au décalage de la réforme des retraites.
En dehors de cette mesure, nos propositions visent essentiellement deux objectifs. Le premier est de se rapprocher autant que possible des propositions de la majorité sénatoriale adressées au Premier ministre François Bayrou le 8 juillet 2025.
Nous vous proposons donc de rétablir l'article 44 relatif au gel des prestations, ainsi que son corollaire, le gel du barème de la CSG. Le gel des prestations ne serait pas totalement rétabli ; les retraites de moins de 1 400 euros et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) seraient exclus, ce qui réduit le rendement de 800 millions d'euros environ, dont 600 millions d'euros pour la sécurité sociale.
Nous vous proposons également de rétablir la contribution des complémentaires santé, mais seulement pour 1 milliard d'euros, c'est-à-dire sans la majoration de 100 millions d'euros destinée à compenser le décalage de la réforme des retraites. Pour ne pas faire porter excessivement l'effort sur les recettes, nous vous proposons aussi de supprimer le passage du taux de la CSG sur le capital de 9,2 % à 10,6 %.
Le second objectif est de ne pas aggraver inutilement les difficultés de financement de l'Acoss. Cela implique : à l'article 40 du PLF, de revenir sur la réduction discrétionnaire de 3 milliards d'euros de la TVA affectée à la sécurité sociale, présentée comme la contrepartie de la réforme des allégements généraux ; de supprimer le transfert de CSG de la branche autonomie vers les départements ; de maintenir l'article 12 quinquies, prévoyant la compensation de diverses niches sociales, dont la part salariale du dispositif en faveur des heures supplémentaires ; et de supprimer l'article 12 septies, qui prévoit que l'Acoss compense à l'Unédic la totalité du coût des allégements généraux de cotisations patronales, sans la réduction de 4,1 milliards d'euros prévue en 2026 par l'arrêté du 27 décembre 2023. En effet, à défaut d'augmentation, par l'article 40 du PLF, de la part de TVA affectée à la sécurité sociale, cette disposition augmenterait le besoin de financement de l'Acoss à hauteur de 4,1 milliards d'euros.
Comment passe-t-on du solde spontané au solde effectif dans les textes du Gouvernement et de l'Assemblée nationale et dans celui que nous vous proposons ?
Le chiffre du solde spontané, c'est-à-dire sans le PLFSS et les textes réglementaires associés, se trouve dans le dernier rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale et le Gouvernement le reprend dans les annexes au PLFSS. Sans mesure, le déficit serait proche de 30 milliards d'euros.
Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, l'amélioration du solde résultant des mesures a été à peu près divisée par deux, passant environ de 11 milliards d'euros à 5 milliards d'euros.
Dans le texte que nous vous proposons, l'effort serait en apparence un peu plus grand que dans le texte initial. Toutefois, il faut tenir compte des 3 milliards d'euros dont je vous ai parlé de moindre réduction de la TVA affectée à la sécurité sociale, qui n'amélioreraient pas le solde global des administrations publiques.
Ces prévisions de solde supposent évidemment que l'ensemble des mesures réglementaires prévues soient effectivement prises. Elles impliquent en particulier le doublement des participations forfaitaires et franchises, pour 2,3 milliards d'euros, la poursuite de la hausse du taux de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), pour 1,8 milliard d'euros, et une réduction des allégements généraux de cotisations patronales par un décret à prendre d'ici à la fin de l'année, pour 1,4 milliard d'euros.
Enfin, il importe que l'Ondam soit bien respecté. Il semble que cela doive être le cas en 2025, ce qui serait une première depuis la crise sanitaire.
M. Bernard Jomier. - Nous ne pouvons pas adopter une LFSS prévoyant 24 milliards d'euros de déficit. En la matière, l'objectif de 15 milliards d'euros paraît raisonnable. Néanmoins, maintenant que cela a été dit, tout reste à faire.
L'objectif est de sortir notre pays du chaos politique dans lequel il se trouve depuis plusieurs années. Or la réforme des retraites n'est pas pour rien dans cette déstabilisation.
Une discussion a eu lieu, qui a abouti à l'idée de mettre cette question de côté jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Tout montre que cette initiative ne représente pas un coût déraisonnable. Il faut en outre mettre en regard le coût financier de cette mesure avec la stabilisation politique qu'elle apporterait au pays. La réaction des acteurs économiques a d'ailleurs été positive à l'annonce de l'accord la concernant. J'invite donc la majorité sénatoriale à faire preuve de responsabilité.
Nous connaissons votre position sur la réforme des retraites, elle est respectable. Mais il faut accepter que son décalage soit intégré à la LFSS, car il est facteur de stabilisation.
L'objectif de 15 milliards d'euros de déficit, qui nous place dans une trajectoire de retour à l'équilibre, est nécessaire, et atteignable. Nous sommes toutefois en désaccord avec plusieurs des mesures présentées par la rapporteure générale.
Mme Anne Souyris. - Nous espérons que les changements amorcés à l'Assemblée nationale se poursuivront ici, plutôt qu'un retour en arrière, qui ne serait pas une bonne nouvelle pour la démocratie.
Même s'il a légèrement remonté dernièrement, l'Ondam demeure particulièrement insuffisant par rapport aux niveaux des années précédentes, lesquels nous montraient chaque fois que le budget était insincère. Ce problème n'est jamais réglé, quels que soient les équilibres trouvés par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Quand nous en emparerons-nous ? Quand partirons-nous des besoins et des objectifs populationnels pour définir l'Ondam ?
Le déficit de 24 milliards d'euros est effectivement trop important. Mais il existe d'autres leviers pour le réduire que ceux qui sont présentés ici : la fiscalité environnementale, par exemple, ou comportementale, la limitation des exonérations de cotisations et contributions sociales à deux Smic - proposition étudiée à un moment donné par Michel Barnier, mais écartée depuis lors -, la reprise de la dette de la Cades par l'État, ou encore l'augmentation de la contribution des industriels pharmaceutiques. Il existe une palette de mesures susceptibles de rapporter des recettes.
Par ailleurs, s'agissant des dépenses, il est regrettable que la financiarisation de la santé ne soit pas regardée en face, car elle a un réel coût pour la sécurité sociale. Ainsi, doubler ou tripler inutilement des radiographies a un coût considérable. Il serait possible d'agir sur ce point. Or rien n'est prévu à cet égard.
M. Alain Milon, président. - Le rapport de la rapporteure générale portait uniquement sur les recettes, pour l'instant.
M. Olivier Henno. - Je salue le travail mené par la rapporteure générale dans des conditions particulièrement difficiles.
Le coût de notre modèle social ne peut continuellement excéder le niveau de la croissance et celui de l'inflation, car cela signifie que nous prélevons une part de plus en plus importante dans notre potentiel de richesse. Or les montants dépensés en matière sociale sont autant de sommes que l'on ne peut plus consacrer à l'éducation et à l'innovation - même s'il est vrai qu'il faut tenir compte du vieillissement de la population. Sans une maîtrise de nos prélèvements et de nos dépenses sociales, le risque de décrochage du pays est réel.
Selon un rapport de la commission des finances, un euro de déficit enregistré en 2006 représentera en 2026 2,50 euros de remboursement. D'aucuns prétendent que le fait de passer de 17 milliards d'euros à 24 milliards d'euros de déficit ne représente pas une si grande différence. Cependant, il faut d'abord que les prêteurs suivent, donc qu'ils aient confiance en notre pays. Ensuite, ces 7 milliards d'euros supplémentaires coûteront 20 milliards d'euros en 2046. Pensons à ceux qui devront assumer cette charge à ce moment-là : c'est notre obligation morale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Monsieur Jomier, le fait que nous partagions un même objectif est déjà positif. De même, Raymonde Poncet Monge et moi-même partageons l'objectif de sauver notre système de protection sociale, même si nous différons quant aux voies permettant d'y parvenir. Nous devons avancer les uns avec les autres.
En cette année qui marque l'anniversaire des 80 ans de la sécurité sociale, nous avons le devoir de sauver le système. Or je crains que nous n'y parvenions pas.
C'est une chose de compter sur la Cades pour l'amortissement de la dette en période de crise sanitaire, mais, hors période de crise, c'est le principe même de la solidarité sur lequel repose notre système qui risque de vaciller : solidarité entre ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas, et entre les actifs et les retraités. Nous reportons cette charge sur les générations à venir.
C'est la raison pour laquelle nous étions favorables à la réforme des retraites : il fallait garantir le paiement des pensions.
Le déficit de l'assurance maladie, qui s'établit à plus de 12 milliards d'euros pour l'année 2025, risque de s'aggraver encore davantage si nous ne faisons rien. Nous laissons aux générations à venir la dette issue de nos consultations et de nos soins : ont-elles mérité cela ?
Selon un récent sondage, plus de 60 % de la population déclarent ne plus croire au système de retraite par répartition, pourtant le plus solidaire. Je ne suis pas opposée à l'introduction d'une part de capitalisation. Le problème est qu'en France la politique du « tout ou rien » a tendance à prévaloir. Ne cassons pas le thermomètre pour chasser la fièvre !
Nous avons introduit un doute dans la tête des Français sur le système de retraite par répartition, au motif qu'il ne tiendrait pas financièrement.
Mme Monique Lubin. - Exactement.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Ils risquent donc de se projeter dans d'autres systèmes, pensant qu'ils pourraient s'avérer miraculeux.
Il faut effectivement sortir notre pays du chaos et réconcilier les Français. Mais les divisions entre partis politiques sont malheureusement trop nombreuses. La proposition de décalage de la réforme des retraites n'aboutit pas à une mise de côté, mais à une véritable hibernation !
S'il est certes confortable d'être dans l'opposition, en l'occurrence, il était nécessaire de réformer les retraites pour sauver le système. C'est pourquoi la majorité sénatoriale s'est montrée favorable à cette démarche.
Madame Souyris, j'espère que nos débats seront aussi sereins qu'ils ont l'habitude de l'être. Concernant l'Ondam, je laisserai Corinne Imbert vous répondre.
Monsieur Henno, nous laissons effectivement à nos enfants et nos petits-enfants une dette qui ne cesse de s'accroître. Nous retardons ainsi des innovations pourtant nécessaires. Certaines pathologies ne trouvent pas de réponse en France, car les recherches les concernant n'ont pas été assez financées. Cela me déçoit et m'attriste profondément. Je suis donc tout à fait d'accord pour essayer de renverser les chiffres.
Mme Corinne Imbert, rapporteure pour la branche maladie. - Cette année encore, je ne peux me satisfaire du PLFSS qui nous est transmis. Je commencerai donc par exprimer plusieurs regrets.
En premier lieu, j'ai été navrée de constater que le Gouvernement avait construit ce texte seul, sans prendre en considération les besoins du terrain. Lors des auditions que j'ai conduites, j'ai systématiquement demandé si des consultations avaient été menées avant le dépôt du texte et je n'ai reçu qu'une réponse : « non, à aucun moment ! » Le résultat était inévitable : un texte mal calibré, parfois mal compris, déconnecté des réalités et loin de répondre aux attentes. Pire encore, le texte a largement irrité les acteurs de la santé, avec - et non pas contre - lesquels il nous revient de bâtir un système de santé plus efficient et plus soutenable.
Le désordre politique n'excuse pas tout, bien au contraire. C'est même particulièrement dans ces temps incertains que la concertation est indispensable afin de garantir l'adhésion du plus grand nombre au projet proposé.
Pour ne rien arranger, les conditions d'examen du PLFSS sont particulièrement dégradées cette année. Faisant mine de redonner la main au Parlement pour que s'exprime pleinement sa volonté, le Gouvernement met en réalité les deux assemblées sous la pression d'un examen à marche forcée, débuté trop tardivement à l'Assemblée nationale et conduisant à une instruction précipitée du texte au Sénat. Le texte qui nous est transmis, amendé jusqu'à mercredi soir, compte désormais 56 articles pour la branche maladie, contre 22 au dépôt. Ces conditions nous ont laissé un temps exceptionnellement court pour travailler un PLFSS à rallonge, quoique pauvre sur le fond.
Enfin, le contenu même du PLFSS est globalement regrettable. Acculé par la pression budgétaire, le Gouvernement nous présente un PLFSS de rendement, structuré autour d'un seul but : dégager des économies. Si l'objectif n'est pas critiquable en tant que tel, il le devient lorsqu'il suffit à résumer l'essentiel de l'ambition gouvernementale pour le système de santé. Certes, la question du partage de la charge du financement mérite d'être posée ; mais elle ne justifie pas des solutions hâtives et, souvent, inopportunes.
Ce PLFSS ne comporte donc aucune ambition structurelle pour le système de santé ni pour l'accès aux soins des Français.
Après ces remarques liminaires, j'en viens, comme il est d'usage, à la situation financière de la branche maladie et à l'examen de l'Ondam.
En 2025, le déficit de la branche devrait s'accroître de 3,4 milliards d'euros par rapport à 2024, pour atteindre 17,2 milliards d'euros. La Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) attribue cette dérive, d'une part, aux dépenses liées au Ségur de la santé, qui représentent environ 13 milliards d'euros de charges annuelles pérennes, et, d'autre part, à des évolutions structurelles, telles que le vieillissement de la population et la croissance continue des maladies chroniques.
Pour 2026, le Gouvernement fixe un objectif de dépenses à 267,5 milliards d'euros pour la branche et annonce un redressement du déficit, qui reviendrait à 12,5 milliards d'euros.
Nous avons deux raisons d'être sceptiques. D'une part, ce redressement repose sur des hypothèses macroéconomiques et des économies peu crédibles. D'autre part, même s'il se produisait, il ne constituerait qu'un répit très temporaire. Dès 2027, le solde replongerait pour atteindre 16,1 milliards d'euros de déficit en 2029.
Aucune trajectoire de retour à l'équilibre ni même de réduction du déficit n'est présentée. Le Gouvernement navigue donc sans boussole financière. Il nous faudra bien, tôt ou tard, cesser les rustines pour engager un traitement de fond et redéfinir un financement crédible, soutenable et lisible dans le temps.
La projection d'Ondam qui nous est soumise pour 2026 est tout aussi préoccupante. Dans le texte initial, le Gouvernement proposait un Ondam à 270,4 milliards d'euros, soit une hausse limitée à 1,6 % à champ constant. Puis, il est parvenu en quelques jours à trouver 1 milliard d'euros supplémentaire, ce qui ne peut que nous laisser dubitatifs sur la façon dont le Gouvernement travaille et construit ses prévisions et ses arbitrages. Avec l'adoption de cet amendement, la hausse de l'Ondam serait finalement de 2 %.
Par rapport aux 4,8 % de hausse moyenne annuelle entre 2019 et 2025, il s'agit toutefois là d'un net resserrement.
Le respect de cette trajectoire repose sur un effort d'économies inédit, fixé à 7,1 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 900 millions d'euros de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie et la Cour des comptes ont tous relevé le caractère ambitieux de ces projections et le manque de documentation de certaines économies.
La trajectoire proposée relève donc davantage de l'incantation que de la planification. Or notre système de santé mérite une planification réaliste, à la hauteur des besoins : à commencer par ceux des établissements de santé, dont la situation financière ne cesse de se dégrader. Le déficit des hôpitaux publics a atteint 2,9 milliards d'euros en 2024 et près de la moitié des établissements privés sont également en déficit, en dépit d'une reprise d'activité. C'est le signe d'un sous-financement désormais structurel.
Au vu de ces éléments, l'Ondam qui nous est présenté paraît intenable, incohérent et, disons-le, globalement insincère : intenable, car il s'appuie sur des économies insuffisamment étayées et sur des paris budgétaires que je ne peux raisonnablement partager ; incohérent, car il ne répond ni aux besoins de santé de la population ni aux réalités des professionnels, qu'ils exercent en ville ou à l'hôpital ; insincère, enfin, car un Ondam aussi restreint serait nécessairement dépassé.
Des mesures de régulation seront peut-être prises, comme cette année, pour assurer malgré tout le respect de l'Ondam à marche forcée. En 2025, il devrait donc être à peu près respecté. Cependant, de telles mesures seront alors actées par le Gouvernement seul, sans associer le Parlement. Elles remettront en cause les engagements pris lors de la construction de l'Ondam et porteront donc atteinte à la prévisibilité nécessaire aux professionnels.
C'est pourquoi je vous proposerai un amendement de suppression de l'article 49, afin de rejeter la projection d'Ondam telle qu'elle nous est soumise.
J'en viens maintenant à la présentation des mesures de la partie « dépenses » pour la branche maladie.
Alors que seule une réforme structurelle d'ampleur pourra résoudre, à terme, le déficit de la branche, nous ne pouvons que regretter que ce texte prenne la forme d'une succession de rustines au rendement certain, mais sans colonne vertébrale, qui réduiront l'accès aux soins et pénaliseront les professionnels de santé.
L'élargissement du champ des participations forfaitaires et des franchises, à l'article 18, est peut-être l'une des mesures les plus emblématiques en la matière. Il est important de distinguer le doublement des montants et des plafonds des franchises, qui sera mis en oeuvre par voie réglementaire, et l'article 18 qui prévoit d'intégrer les chirurgiens-dentistes et les dispositifs médicaux dans le champ de ces participations et de réformer leur mode de collecte.
Il est permis de s'interroger sur l'objectif réel que poursuivent désormais les participations forfaitaires et les franchises. Initialement conçues comme des outils de responsabilisation vertueux, elles sont dévoyées, PLFSS après PLFSS, pour être transformées en leviers de rendement, d'autant plus commodes qu'ils laissent une large marge de manoeuvre au pouvoir réglementaire. Les renommer « forfaits de responsabilité », comme le fait la ministre, ne saurait suffire à masquer cette réalité. Rien n'indique en effet une surconsommation de soins dentaires qui justifierait de responsabiliser les assurés, mais bien plutôt une insuffisance de suivi en la matière, source de complications pour les assurés et de surcoûts pour l'assurance maladie.
Enfin, je m'oppose fermement, et avec moi tous les professionnels de santé, à faire collecter les franchises par les professionnels de santé. Une telle évolution réduirait le temps médical disponible et susciterait des tensions dans les cabinets, en plaçant les soignants dans un rôle de collecteur qui n'est pas le leur - sans compter les difficultés techniques de la collecte.
L'article 29 s'inscrit dans la même logique de pur rendement. L'idée de supprimer le régime des affections de longue durée (ALD) non exonérantes n'est pourtant pas mauvaise en soi. Il faut dire que ce dispositif, qui s'adresse à des assurés en arrêt long, le plus souvent pour dépression ou troubles musculo-squelettiques, n'offre à l'assuré ni suivi médical spécifique ni accompagnement particulier au retour à l'emploi : tout juste conduit-il à différer la perte de revenus en allongeant la durée de versement des indemnités journalières.
En se contentant de supprimer le régime, sans assortir l'article 29 de mesures d'accompagnement pour faciliter le retour à l'emploi ou renforcer les garanties de prévoyance, le Gouvernement ne résout pas le problème des arrêts de longue durée, mais cache la poussière sous le tapis. Tant pis si la santé mentale était la grande cause nationale en 2025. Là encore, je ne pourrai proposer de rétablir, en l'état, cette mesure à courte vue.
L'article 28 apporte également une fausse réponse à un vrai problème. Il prévoit de limiter par la loi la durée des arrêts maladie, sauf si le médecin en décide autrement, moyennant justification.
Je partage, comme beaucoup d'entre vous, la volonté que soit mieux maîtrisé le montant d'indemnités journalières versé. Mais force est de constater qu'avec seulement 0,3 % d'économies attendues, cette mesure ne remplit pas cet objectif.
Pour atteindre ce rendement mirifique, la mesure porte, qui plus est, une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de prescription et à l'accès aux soins. Alors que nous nous battons, proposition de loi après proposition de loi, pour libérer du temps médical et oeuvrer à la pertinence des soins, cette limitation arbitraire de la durée de prescription des arrêts de travail mobiliserait plusieurs centaines de milliers d'heures de consultations pour prolonger des arrêts dont il était, pour bon nombre d'entre eux, prévisible qu'ils devraient être prolongés. Cela démontre, je le crains, une certaine déconnexion du Gouvernement avec les réalités vécues par les patients, confrontés chaque jour davantage à la pénurie de médecins.
L'accès précoce, pourtant plébiscité par les industriels et reconnu pour son rôle déterminant dans l'accès aux médicaments innovants, serait largement réformé - et fragilisé - par l'article 34. Afin de préserver les patients atteints de maladies graves, je vous proposerai un certain nombre d'amendements pour conserver l'attractivité du dispositif.
Sur l'article 34, je m'oppose également à la prise en compte de prix extra-européens pour justifier à l'avenir des baisses tarifaires sur les produits de santé. Alors que les prix français ne sont pas particulièrement élevés, instaurer un tel mécanisme serait le meilleur moyen pour que les industriels délaissent le marché national, au mépris des risques pour l'approvisionnement.
L'article 35 prévoit d'expérimenter le référencement sélectif des médicaments thérapeutiquement équivalents, c'est-à-dire la sélection par appel d'offres des médicaments qui seront remboursés, pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans. Un tel dispositif, en excluant certains laboratoires, risque de fragiliser le tissu de l'industrie pharmaceutique en France, d'accroître les tensions d'approvisionnement, et à terme d'augmenter les prix. Je vous proposerai donc de le supprimer.
Non content de pénaliser les patients, ce PLFSS prévoit également de sanctionner les professionnels de santé et de fragiliser le dialogue conventionnel, cher à notre commission.
Les articles 24 et 24 bis visent à attribuer au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) et au Gouvernement un pouvoir de baisse unilatérale des tarifs dans des secteurs au sein desquels serait constatée une rentabilité excessive. D'abord, je récuse le terme de « rente », utilisé par le Gouvernement : il témoigne du peu de considération que celui-ci réserve aux professionnels de santé. Ensuite, s'il paraît légitime que le régulateur tienne compte, dans la négociation des tarifs, des gains de productivité et des taux de marge, une politique unilatérale de baisse des prix fondée uniquement sur la rentabilité serait contre-productive. La politique des « coups de rabot » peut favoriser le rachat de structures indépendantes par de grands groupes, seuls à même de supporter la modération tarifaire. Ce sont précisément les mesures de régulation trop importantes qui encouragent la financiarisation.
J'estime nécessaire de rappeler notre attachement à la négociation conventionnelle et au caractère négocié des tarifs applicables aux professionnels libéraux. Dès lors, je vous proposerai de supprimer la possibilité pour le directeur de l'Uncam de procéder à des baisses de tarifs unilatérales et de supprimer également l'article 24 bis. En revanche, je soutiens pleinement la mise en place d'un observatoire de la rentabilité dont les conclusions seront rendues publiques : celui-ci nous permettra de mieux appréhender la réalité économique des différents secteurs et de lutter contre les abus.
L'attachement à la négociation conventionnelle a également guidé les amendements de suppression aux articles 25 et 25 bis, qui intègrent les soins dentaires et l'ophtalmologie dans les accords de maîtrise des dépenses. L'évolution des dépenses dans ces secteurs ne comporte, à ce stade, pas de risques d'augmentation non maîtrisée et il paraît donc prématuré de déroger au principe conventionnel.
Dans la même veine, l'article 26, supprimé par l'Assemblée nationale, vise à surtaxer les dépassements d'honoraires en secteur 2, avec l'intention d'inciter les praticiens à modérer leurs pratiques, voire à opter pour le secteur 1. Un tel dispositif manquerait assurément sa cible et risquerait de conduire à un renchérissement des dépassements pratiqués, pour compenser le manque à gagner. Par ailleurs, il ne tient pas compte de sous-jacents expliquant l'évolution à la hausse d'une partie des dépassements d'honoraires, en particulier l'absence de revalorisation de certains actes techniques depuis vingt ans. Cette surtaxe pèserait enfin sur tout le secteur 2, alors qu'il aurait été opportun de ne cibler que les dépassements abusifs ou excessifs. Tel n'a pas été le choix du Gouvernement et je proposerai donc de maintenir la suppression de cet article.
Pour des raisons semblables et parce que le patient serait le premier à en pâtir, je vous proposerai de supprimer l'article 26 bis, qui vise à dérembourser les prescriptions des praticiens du secteur 3.
Concernant la pénalisation des professionnels de santé pour défaut d'utilisation du dossier médical partagé (DMP), prévue à l'article 31, la démarche du Gouvernement est à la fois regrettable et déconnectée du terrain. Elle risque d'altérer l'adhésion des acteurs à cet outil, sans lever les obstacles techniques qui persistent. Plutôt que de culpabiliser les professionnels, le Sénat avait préconisé, lors du dernier PLFSS, une démarche incitative. Ses propositions malheureusement censurées par le Conseil constitutionnel pourraient opportunément être reprises par le Gouvernement dans un autre vecteur législatif.
S'il ne revêt pas les mêmes conséquences, le manque de considération porté par ce texte aux professionnels de santé se ressent également à l'article 21 sexies. Celui-ci fait oeuvre utile en étendant les compétences de trois professions de l'appareillage afin de reconnaître à leur juste valeur l'expertise de ces professionnels et de dégager du temps médical. Pour autant, il ne prévoit nullement de les consulter sur les évolutions de leur pratique. Je vous inviterai donc à adopter l'amendement que j'ai déposé à cette fin.
Par ailleurs, deux articles régissent l'organisation de l'offre de soins dans les territoires, mais ne sauraient suffire à répondre aux enjeux. Je note au passage que, puisqu'ils relèvent de l'organisation des soins, nous pouvons nous interroger sur leur place dans un PLFSS.
L'article 21 contient quatre mesures différentes, pour partie issues du pacte de lutte contre les déserts médicaux.
S'agissant de la rémunération des docteurs juniors, le revirement du Gouvernement en cours d'examen du texte est symptomatique des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de la quatrième année de médecine générale, pourtant sur les rails depuis trois ans. Cette situation engendre de l'inquiétude chez les étudiants, préjudiciable à l'attractivité de la filière. Toutefois, cette réforme doit réussir : il revient au Gouvernement de sécuriser sa mise en oeuvre dans les plus brefs délais.
La création d'un contrat de praticien territorial en médecine ambulatoire conduirait, quant à elle, à empiler un nouveau dispositif semblable à d'autres, sans effet de levier sur l'installation. Je vous proposerai de supprimer ces dispositions pour leur substituer un dispositif de modulation de la rémunération des praticiens exerçant en zone sous-dense, que le Sénat avait adopté en mai dernier dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer l'offre de soins dans les territoires. Sur les structures de soins non programmés, je vous proposerai de reprendre la version qui avait fait l'objet d'un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat lors du dernier PLFSS, enrichie des dispositions financières du Gouvernement.
J'en viens maintenant à l'article 21 bis : un parfait exemple de mesure intégrée par voie d'amendement, sans aucune concertation. Cet article traduit l'engagement du Premier ministre de constituer un réseau de 5 000 « maisons France Santé » d'ici à 2027. Toutefois, le texte proposé par le Gouvernement ne vise qu'à labelliser l'existant à marche forcée, et ce sans lutter concrètement contre les déserts médicaux. Je soutiens, bien évidemment, l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins dans nos territoires, mais je refuse que cet enjeu majeur pour la santé de nos concitoyens se résume à une opération d'affichage politique. On assiste déjà dans les territoires à une course à la labellisation : je vous renvoie à la présentation du rapport de la Cour des comptes à ce sujet. Les structures signent des conventions, sans même savoir ce qu'elles recouvriront concrètement. J'ai pu lire que le fait de rejeter cette mesure reviendrait à renoncer aux 150 millions d'euros promis par le Gouvernement, mais rien n'empêche ce dernier de maintenir ces sommes pour lutter autrement contre les déserts médicaux. Dès lors, la suppression du dispositif que je propose est une invitation pour le Gouvernement à revoir sa copie afin d'apporter, dans le cadre d'un autre véhicule législatif, une véritable réponse aux besoins de santé des Français.
Je constate en outre que cette mesure monte les structures les unes contre les autres. Plutôt qu'une telle démarche de communication politique, je souhaiterais que l'on travaille sur le fond pendant plusieurs semaines pour y revenir ensuite. Avec le système tel qu'il est proposé, nous avons tout à perdre.
En revanche, la pérennisation du dispositif Osys (Orientation dans le système de soins), une mesure que nous avons déjà adoptée au printemps 2025, permettra d'améliorer concrètement l'accès aux soins dans les zones en difficulté.
Malgré ce sombre tableau, ce PLFSS contient quelques mesures utiles, notamment sur l'organisation des établissements de santé ou sur la prévention, que je vous proposerai de soutenir, bien qu'elles manquent d'envergure.
Évoquons d'abord trois mesures relatives aux établissements de santé.
L'article 27 crée un dispositif global d'incitation financière à l'efficience et la pertinence des soins au sein des établissements de santé et simplifie le mécanisme de surveillance des établissements dont les pratiques médicales s'éloignent le plus de la moyenne. Il rénove également le dispositif d'incitation financière à la qualité et la sécurité des soins, pour ne garder que l'aspect relatif à l'intéressement financier et supprimer les possibilités de pénalités financières. Je souscris naturellement aux objectifs visés par cet article, au bénéfice d'une amélioration de la prise en charge des patients et d'une meilleure utilisation des ressources. Je vous proposerai d'apporter quelques précisions aux dispositifs, notamment afin de récompenser davantage les établissements les plus engagés dans une démarche de maintien d'un haut niveau de qualité.
L'article 22 adapte ou pérennise quant à lui diverses dispositions relatives aux modalités de remboursement et de facturation des établissements de santé. Il s'agit notamment d'acter la dématérialisation de leurs échanges avec l'assurance maladie, déjà presque aboutie, et celle de leurs échanges avec les complémentaires santé. Ces évolutions supposeront un accompagnement des établissements. Parmi les autres mesures techniques contenues dans cet article, figure une restriction du périmètre du passage à la facturation directe, qui, pour nécessaire qu'elle soit, témoigne d'un manque d'anticipation des conséquences des réformes de financement en cours.
Je vous demanderai, sur l'article 23, une approche pragmatique. Nul ne peut se satisfaire du retard pris dans le déploiement de la protection complémentaire santé des hospitaliers, largement imputable par ailleurs au manque de diligence du Gouvernement. Mais le principe de réalité s'impose : les négociations pour définir le panier de soins ne peuvent en aucun cas aboutir d'ici au 1er janvier, de l'avis de l'ensemble des acteurs. Afin de ne pas mettre les établissements en difficulté, je vous proposerai de décaler l'entrée en vigueur de la mesure, mais d'un an seulement afin de créer un cadre de négociation dynamique pour favoriser une entrée en vigueur aussi rapide que possible de cette réforme, votée il y a déjà plus de quatre ans.
D'autres mesures contribueront à la pertinence des soins et des prescriptions, quoique de façon insuffisante au regard des enjeux.
Je citerai parmi celles-ci la possibilité de financer des systèmes d'aide à la décision médicale (SADM) en fonction de leur contribution réelle à la réduction des dépenses de prescription, et la cession de masques issus du stock stratégique de l'État à des établissements de santé et médico-sociaux publics. Cette dernière mesure, qui répond à une recommandation de la Cour des comptes, permettra d'éviter d'importants coûts de destruction des masques périmés et de limiter le gaspillage de produits de santé. Je vous proposerai toutefois un amendement pour encadrer ces cessions et sécuriser le stock national en toute circonstance.
Parmi les mesures à saluer figure également l'article 33, qui vise à favoriser la diffusion des biosimilaires. Pour rappel, en 2024, le taux de pénétration des biosimilaires en ville n'était que de 34 %, contre 90 % à l'hôpital. Au regard des économies que la diffusion de ces médicaments peut générer, il me paraît essentiel de soutenir les mesures visant à améliorer la diffusion des biosimilaires en ville. Tel est le cas du mécanisme de tiers payant contre les biosimilaires porté par cet article. Sur le modèle de ce qui existe pour les spécialités génériques, le tiers payant sera réservé aux patients acceptant la substitution pour un biosimilaire, sauf dérogations.
Je conclurai en regrettant qu'à l'instar du précédent, ce PLFSS manque son rendez-vous avec la prévention, pourtant indispensable pour infléchir la trajectoire des dépenses d'assurance maladie, largement soutenue par la progression de maladies chroniques évitables.
La création des parcours d'accompagnement préventifs, prévue à l'article 19, pourrait constituer une opportunité pour dépister plus précocement certaines pathologies et éviter leur dégradation en ALD. Le PLFSS n'apporte toutefois que peu de précisions sur le contenu de ces parcours, leur déroulé et leur suivi. Cette mesure soulève par ailleurs des inquiétudes légitimes liées aux conditions de son articulation avec le dispositif des ALD, dont les critères pourraient être, à terme, ajustés en conséquence par voie réglementaire, sous réserve d'un avis préalable de la Haute Autorité de santé (HAS). Malgré ces craintes, la mise en oeuvre de ces parcours d'accompagnement me semble pouvoir contribuer à ce virage préventif que nous appelons régulièrement de nos voeux, si les textes réglementaires d'application que publiera le Gouvernement en confirment l'ambition annoncée.
Ce PLFSS a également mis la politique vaccinale au coeur du débat, ce dont nous pouvons nous réjouir. Si l'extension des obligations vaccinales des professionnels de santé est globalement consensuelle et doit être soutenue, le principe d'une telle obligation pour les résidents des Ehpad me paraît en revanche inapproprié. Outre que 83 % des résidents sont déjà vaccinés contre la grippe, aucune conséquence concrète ne pourrait être sérieusement envisagée à l'encontre d'un résident récalcitrant. Je vous proposerai donc de supprimer ces dispositions, pour privilégier la promotion de la vaccination auprès de ces publics vulnérables. Enfin, je regrette que l'évolution des conditions d'habilitation et de financement des centres de vaccination des collectivités territoriales ait été insérée dans ce PLFSS sans même avoir fait l'objet d'une consultation des élus locaux. À nouveau, la méthode est regrettable.
Le PLFSS n'approfondit pas davantage la politique de prévention. À peine prolonge-t-il l'expérimentation des haltes soins addictions, débutée il y a presque dix ans, et crée-t-il une consultation de prévention au moment de la ménopause. Je vous proposerai de soutenir ces mesures, sans grand enthousiasme.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le Gouvernement est dans l'incapacité de proposer des mesures structurelles pour notre système de santé. Il nous est donc transmis un texte sans vision, réduit à une mécanique comptable. Fondé sur un Ondam insincère et des mesures non concertées, semblant parfois même improvisées, il ignore les besoins des patients comme ceux des professionnels, tout en affaiblissant le dialogue conventionnel. Je vous inviterai donc à ne l'adopter qu'avec les nombreux ajustements que je vous soumettrai.
M. Alain Milon, président. - J'ai été étonné de voir qu'une nouvelle maison France Santé avait été inaugurée hier dans l'Hérault, avant même que la proposition du Gouvernement n'ait été validée par le Parlement.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles. - Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale marque la fin d'une ère pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
D'emblée, je vous demanderai un petit effort de mémoire. En 2023, lorsque j'ai eu pour la première fois l'honneur de vous présenter la situation financière de cette branche, elle était au beau fixe. La branche AT-MP affichait alors un excédent historiquement élevé, à hauteur de 1,8 milliard d'euros, le dixième sur les onze derniers exercices.
Deux ans plus tard, la situation est tout autre. Pour la première fois depuis 2012, hors cas particulier de l'exercice covid, la branche accusera un déficit en 2025, à hauteur de 500 millions d'euros.
Il s'agit là de prévisions considérablement dégradées, tant en recettes qu'en dépenses, par rapport aux anticipations de la dernière LFSS, qui tablait sur un excédent de 0,1 milliard d'euros. La morosité de l'activité économique n'a pas permis aux cotisations de progresser autant qu'attendu, tandis que les indemnités journalières (IJ) ont dérapé, sur la lancée d'une dynamique qui semble aujourd'hui non maîtrisée, avec une hausse de 13 % en 2025. Les 5,5 milliards d'euros d'IJ versés en 2025 en font d'ailleurs, pour la première fois, le principal poste de dépenses du régime général, devant les rentes.
Il ne faut toutefois pas négliger, dans ce résultat financier défavorable, le rôle de la hausse des transferts. Ces derniers ont joué, autant que les prestations, sur la hausse des dépenses. La branche a ainsi vu plus de 600 millions d'euros de dotations supplémentaires être mis à sa charge en 2025, dont une hausse sans précédent de 400 millions d'euros du transfert pour la sous-déclaration.
J'aimerais, mes chers collègues, pouvoir vous dire que le déficit de la branche AT-MP est transitoire. Tel n'est toutefois pas le cas.
L'objectif de dépenses pour 2026 est contenu à 18 milliards d'euros, soit une progression de 3,3 %, par l'article 51 du PLFSS, grâce à la diminution des transferts aux fonds de l'amiante - 387 millions d'euros pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), 373 millions d'euros pour le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata) -, au gel du transfert à la branche maladie ainsi qu'à celui des prestations d'incapacité permanente. Malgré cela, la situation financière continuera à se dégrader en 2026, année lors de laquelle 700 millions d'euros de cotisations AT-MP seront réattribués à la branche vieillesse dans le cadre de la seconde partie du swap de taux acté lors de la réforme des retraites. Le déficit atteindra alors 1 milliard d'euros. Rappelons que la branche avait déjà vu ses cotisations amputées de 800 millions d'euros pour le même motif en 2024.
En 2027, c'est sous l'impulsion d'une nouvelle hausse de 400 millions d'euros du transfert au titre de la sous-déclaration que le solde se creusera encore, pour atteindre un déficit de 1,4 milliard d'euros, 8 % des recettes de la branche. Je le dis avec gravité : il s'agirait là très probablement du déficit le plus conséquent de l'histoire de cette branche.
Ne vous y trompez pas, mes chers collègues, ce n'est pas dans une hausse de la sinistralité qu'il faut chercher l'origine première de la dégradation de la situation financière de la branche, mais dans une suite d'arbitrages politiques hasardeux du Gouvernement.
Vous l'avez entendu, il n'est pas une année sans que la branche AT-MP soit mise à contribution à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires pour éponger, tour à tour, le déficit des branches maladie et vieillesse, dont la santé financière est plus chancelante encore.
Si ces ponctions au profit d'autres branches avaient été stabilisées à leur niveau de 2023, les projections sont inquiétantes. Malgré des excédents évalués à 700 millions d'euros en 2025, 900 millions en 2026 et même 1 milliard à l'horizon 2027, le déficit sera toujours là, accentué aussi par la dynamique des dépenses.
Il nous revient d'en prendre acte : par sa nature assurantielle, la branche AT-MP doit, plus qu'aucune autre, parvenir à un équilibre financier. La situation commande donc des mesures de redressement structurelles, auxquelles il conviendrait naturellement d'associer les partenaires sociaux - vous me savez très attachée à la garantie du paritarisme dans la gouvernance de la branche.
Certains ajustements doivent d'abord être mis en oeuvre concernant les dotations de la branche. J'ai réclamé, l'an dernier, que soit stabilisé le poids du transfert au titre de la sous-déclaration dans les dépenses de la branche. Il est prévu que celui-ci diminue de 9,1 % à 8,9 % entre 2025 et 2026, raison pour laquelle je ne porterai pas d'amendement sur le sujet. Il nous reviendra toutefois, le cas échéant, de prendre nos responsabilités si jamais le transfert augmentait à nouveau.
Il devient, en outre, plus que jamais urgent que l'État prenne toute sa part dans le financement du Fiva, auquel il ne contribue pour ainsi dire pas alors que 20 % des bénéficiaires, victimes environnementales ou agents de l'État, ne relèvent pas de la branche AT-MP.
Mais, au-delà de ces ajustements, le retour à l'équilibre ne pourra procéder que d'un changement de paradigme dans la politique de prévention de la branche. Seul le « choc de prévention » souhaité par les partenaires sociaux pourra conduire les dépenses afférentes à atteindre l'objectif de 7 % des charges de la branche à moyen terme, fixé par la Mecss que j'ai rapportée avec Annie Le Houerou.
Aujourd'hui, et malgré les appels en ce sens des parlementaires année après année, le compte n'y est pas. Il faut toutefois saluer la hausse de 29 % des dépenses de prévention du régime général, portées par la poursuite de la montée en charge du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (Fipu) à hauteur de 150 millions d'euros par an et l'enveloppe de 120 millions d'euros disponible d'ici à 2028, qui figure dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion (COG). Elles contribueront à dessiner, pour la branche, les ébauches du futur virage préventif.
Il importe désormais de mettre en oeuvre un véritable accompagnement ciblé des entreprises, dans une démarche d'aller-vers. Cette stratégie a déjà fait ses preuves, notamment avec le programme « troubles musculosquelettiques (TMS) Pros », qui se traduit par une réduction sensible des sinistres pour les entreprises qui le mettent en oeuvre, et dont les résultats prometteurs doivent conduire à poursuivre le développement.
Le Gouvernement partage le constat qu'il est nécessaire d'agir pour le retour à l'équilibre de la branche, mais manifestement pas les réponses à y apporter. Au détour d'une annexe de ce PLFSS, ce dernier annonce de manière sibylline une « mesure d'amélioration des recettes de 0,4 milliard d'euros ». Nul n'est dupe de cet euphémisme dont le Gouvernement a le secret : il s'agit bien là d'une hausse des cotisations pour les employeurs.
Parce que je ne saurais me résoudre à ce que des employeurs vertueux, investis pour diminuer la sinistralité, aient à payer les conséquences des choix politiques ayant conduit à dégrader considérablement et durablement les perspectives financières de la branche, je m'opposerai frontalement à toute mesure d'augmentation uniforme des cotisations. Je le répète avec force : la branche ne connaîtrait pas de déficit si ses excédents n'avaient pas été mobilisés au soutien des branches maladie et vieillesse.
Venons-en maintenant aux mesures nouvelles de ce PLFSS pour la branche AT-MP avec l'article 39, sur lequel se sont concentrées mes auditions. Celui-ci réforme la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, qui démontre aujourd'hui ses limites.
Rappelons d'emblée que l'on distingue deux voies d'accès à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Lorsque l'assuré souffre d'une pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qu'il prévoit s'applique la procédure dite principale. Dans le cas contraire, l'assuré relève de la procédure complémentaire, plus longue. L'article 39 apporte des modifications sensibles sur chacune des deux voies. Je commencerai par celles qui sont relatives à la procédure principale.
Aujourd'hui, plus de 60 tableaux de maladies professionnelles répertorient les modalités de diagnostic obligatoires pour accéder à la reconnaissance. Compte tenu de la vétusté de certains tableaux, qui n'ont pour certains pas été modifiés depuis plus de cinquante ans, les examens préconisés sont parfois obsolètes, peu accessibles sur le territoire, voire, dans certains cas, dangereux, même si ces cas sont minoritaires.
Plutôt que de les fixer dans des tableaux qu'il est difficile de faire évoluer, il serait préférable, comme le propose le Gouvernement, que les modalités de diagnostic soient définies de manière dynamique, par référence aux recommandations de la HAS et des sociétés savantes.
Certains partenaires sociaux nous ont dit leurs craintes d'être, en conséquence, dépossédés de ces prérogatives, et il faut les entendre. Il convient toutefois de souligner que la définition des modalités de diagnostic n'interfère pas sur la caractérisation du lien entre une pathologie et l'exposition à un risque professionnel donné, qui constitue le coeur des attributions des partenaires sociaux. Celle-ci relève plutôt de prérogatives strictement médicales.
Toutefois, afin de nous assurer de l'adhésion des partenaires sociaux à la réforme, nécessaire à son succès, je vous proposerai de soumettre à leur avis préalable les textes réglementaires d'application concernant les modifications de la voie principale.
Ce sont toutefois les évolutions apportées par l'article 39 à la voie complémentaire qui ont suscité les plus vifs débats.
Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) instruisent aujourd'hui l'ensemble des dossiers ne répondant pas à toutes les conditions d'un tableau (alinéa 6) ou traitant de pathologies hors tableaux (alinéa 7). Il s'agit de trinômes associant un médecin-conseil, un praticien hospitalier spécialiste en maladies professionnelles et un médecin du travail.
Les CRRMP sont à la fois confrontés à la démographie défavorable de certains des professionnels qui les composent - médecins du travail en tête - et à une charge de dossiers très dynamique, qui a doublé en dix ans. Ce sont, pour ne rien arranger, les dossiers de reconnaissance hors tableaux, les plus complexes, qui portent depuis une dizaine d'années l'évolution du volume de dossiers : leur nombre a été multiplié par seize depuis 2010.
Face à l'engorgement prévisible à court terme des CRRMP, les leviers réglementaires pour dégager des marges de manoeuvre ont pour ainsi dire tous été mobilisés : possibilité de se dispenser de médecin du travail pour les dossiers de l'alinéa 6, ouverture des CRRMP aux médecins retraités, délégations de dossiers à des CRRMP moins chargés... Malgré cela, les CRRMP ne disposent plus des capacités pour absorber la charge de dossiers qui leur incombe.
Par conséquent, en l'absence de modification du droit, seuls deux scénarios sont envisageables : soit les CRRMP consacreront moins de temps à l'ensemble des dossiers, au mépris de la qualité des décisions ; soit ils ne seront plus en mesure de tenir les délais qui leur sont réglementairement imposés, auquel cas ceux-ci devront être revus à la hausse, allongeant encore une procédure déjà perçue comme éreintante.
Il revient donc au législateur d'agir afin de garantir l'accès à la reconnaissance dans les délais réglementaires. Pour cela, l'article 39 fait preuve de pragmatisme, mais va certainement un peu trop loin. Il réserve l'action des CRRMP aux procédures prévues à l'alinéa 7, et confie plutôt à un binôme de médecins-conseils celles qui sont fixées à l'alinéa 6, réputées moins complexes.
Je comprends, bien sûr, les craintes des partenaires sociaux et de certaines associations de victimes autour des répercussions qui pourraient résulter de l'adoption de cet article, à la fois sur la qualité de la décision et sur les risques de recours contentieux. Si cette évolution n'est pas souhaitable dans l'absolu, puisqu'elle induit une perte de pluridisciplinarité, elle n'en reste pas moins nécessaire face aux écueils que je viens d'évoquer.
Je vous présenterai donc, face à cette mesure, une approche proportionnée au risque. Il serait en effet prématuré d'acter dès aujourd'hui le dessaisissement des CRRMP de l'ensemble des dossiers relevant de l'alinéa 6. Une approche plus nuancée est possible.
Dans un premier temps, je propose donc que seuls les dossiers relatifs à la non-vérification du délai de prise en charge prévu sur les tableaux soient confiés à un binôme de médecins-conseils. Ceux-ci représentent 45 % du flux de l'alinéa 6 et sont déjà, dans les faits, traités à la chaîne par la plupart des CRRMP puisqu'ils nécessitent une moindre expertise médicale. Les autres dossiers visés par l'alinéa 6 et ceux qui sont concernés par l'alinéa 7 demeureraient instruits par les CRRMP.
L'article 28 ajuste les conditions de versement des indemnités journalières afin d'assurer une meilleure adéquation entre la situation des assurés et les prestations servies.
Contrairement aux IJ maladie, les IJ AT-MP sont versées sans limite de durée, jusqu'à guérison ou consolidation. Pour autant, rappelons qu'en s'en tenant aux principes, l'indemnité journalière AT-MP ne saurait couvrir que les assurés dont l'incapacité de travail est temporaire, à l'exclusion de ceux qui présentent une incapacité permanente. Ces derniers ont droit à des prestations spécialement dédiées, mieux adaptées à leur situation : l'indemnité en capital et la rente.
Or l'effondrement inexpliqué de 75 % en sept ans de la pratique des certificats médicaux finaux par les médecins de ville conduit aujourd'hui certains arrêts de travail AT-MP à se prolonger d'une manière préoccupante, tant pour les perspectives de retour à l'emploi de l'assuré que pour la soutenabilité du système. Ce sont désormais 2,8 % des arrêts de travail AT-MP, représentant 10 % du volume d'IJ versées, qui datent de plus de trois ans, alors que de tels arrêts étaient autrefois exceptionnels.
La majorité du temps, ces assurés ne remplissent plus les conditions légales de versement des IJ, leur incapacité étant devenue permanente. Les contrôles réalisés par les médecins-conseils se traduisent ainsi, dans plus des trois quarts des cas, par une décision de consolidation.
Afin de s'assurer que chaque assuré relève en fait de la prestation qui lui est destinée en droit, l'article 28 instaure un plafond sur la durée de versement des IJ, que le Gouvernement envisage de fixer à quatre ans par voie réglementaire. Si l'incapacité persistait au-delà, elle serait réputée permanente, quelle que soit son ampleur, ouvrant droit au versement d'une indemnité en capital ou d'une rente pour l'assuré. Cet article ne créera donc pas de rupture de droit pour les assurés, d'autant moins que la dernière LFSS, en reconnaissant un caractère dual aux prestations d'incapacité permanente, conduira à les revaloriser sensiblement en juin prochain.
La rapporteure pour la branche assurance maladie et moi-même porterons un amendement visant à garantir, par la loi, que la durée maximale des IJ AT-MP soit toujours supérieure à celle des IJ maladie. Il convient en effet d'assurer le respect du principe de favorabilité des prestations AT-MP, gage de reconnaissance du préjudice spécial que constitue un sinistre professionnel et de l'incitation à relever de ce régime pour l'assuré afin de couper court à la sous-déclaration.
L'article 40 du texte permettra quant à lui d'ouvrir le bénéfice d'un capital de 3 977 euros aux ayants droit de non-salariés agricoles décédés à la suite d'un sinistre professionnel. Il s'agit là d'une mesure d'équité, que je vous inviterai à soutenir sans réserve.
Déjà versée de longue date en cas de décès d'un assuré du régime général ou des salariés agricoles, cette prestation l'est également, depuis 2022, après la disparition d'un non-salarié agricole, à condition toutefois qu'elle soit consécutive à un suicide, un accident ou une maladie de la vie privée. En raison d'une interprétation stricte de la lettre de la loi, les ayants droit de non-salariés agricoles victimes de sinistres professionnels fatals en sont à ce jour exclus, une anomalie au regard du principe de favorabilité des prestations AT-MP.
J'appellerai le Gouvernement, lors de la séance publique, à aller plus loin, en intégrant dans le champ du capital-décès les non-salariés agricoles titulaires d'une rente Atexa. Il en résulterait une harmonisation bienvenue avec le régime général qui conférerait une juste reconnaissance aux familles de ceux qui ont sacrifié leur corps pour nous nourrir.
Mes chers collègues, la branche AT-MP est à la croisée des chemins. Il nous reviendra, ces prochaines années, de restaurer son équilibre budgétaire par des choix responsables : prévention, paritarisme et adaptation des dispositifs, afin de garantir équité et soutenabilité.
Mme Pascale Gruny, rapporteur pour la branche vieillesse. - Permettez-moi tout d'abord, à titre liminaire, de déplorer les conditions du débat parlementaire autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Afin de pouvoir tenir les délais constitutionnels impartis au vote du budget, nous examinons en catastrophe un texte profondément remanié par les députés. Le dépôt par le Gouvernement, le 23 octobre dernier, d'une lettre rectificative afin d'introduire à l'article 45 bis une mesure de suspension de la réforme des retraites de 2023 a décalé le délai de vingt jours dont disposait l'Assemblée nationale pour examiner le texte.
Je forme ici le voeu que nos débats sénatoriaux soient plus apaisés et que nous cherchions, ensemble, à adopter des mesures cohérentes afin de redresser le déficit de la sécurité sociale. Notre visibilité sur l'équilibre budgétaire du texte est fortement altérée, ce qui ne facilite pas notre tâche.
En ma qualité de rapporteur de la branche vieillesse, je constate que le déficit de cette branche s'est aggravé de 700 millions d'euros entre 2024, où il était de 5,6 milliards d'euros et 2025, où il est estimé à 6,3 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par la hausse continue du nombre de retraités et l'augmentation du niveau de la pension moyenne, même si, cette année, les dépenses de pensions ralentissent spontanément en raison d'une moindre revalorisation sur l'inflation - 2,2 % au 1er janvier 2025, contre 5,3 % au 1er janvier 2024.
Je rappellerai pour mémoire que, jusqu'en 2017, la branche vieillesse était excédentaire de 2 milliards d'euros. Son déficit s'est depuis creusé, et les prévisions du Conseil d'orientation des retraites (COR) vont dans le sens d'une augmentation des dépenses du système de retraite, qui représenteraient entre 14,2 % et 14,7 % du PIB en 2032, contre 13,9 % en 2027.
Les projections du solde de la branche vieillesse qui figurent au présent PLFSS sont de prime abord plutôt rassurantes. Son déficit se réduirait à 3 milliards d'euros en 2026 et 1,6 milliard d'euros en 2029. Cette résorption du déficit projeté s'explique notamment par le relèvement, entre 2025 et 2027, du taux de cotisations des employeurs à la CNRACL à hauteur de quatre points par an, soit douze points au total, qui a été mise en oeuvre par un décret du 30 janvier 2025. Si la pilule est amère pour nos collectivités et nos hôpitaux, force est de constater que, sans cette mesure, le déficit cumulé de la CNRACL aurait atteint 38 milliards d'euros en 2028 et aurait représenté plus des trois quarts du déficit de la branche vieillesse.
Ne nous y trompons pas : cette trajectoire dépendra également de notre capacité à adopter des mesures visant à contenir les dépenses.
La principale mesure d'économies figurait à l'article 44 du texte du Gouvernement, avec un rendement estimé en 2026 à 3,6 milliards d'euros pour l'ensemble des administrations. Cette mesure, qui visait à geler en 2026 le montant des prestations et pensions de retraite - elles ne seraient donc pas revalorisées sur l'inflation de l'année précédente - a été supprimée par les députés. Il est de notre devoir envers les générations futures de contenir l'aggravation du déficit de la branche vieillesse, aussi, je vous propose de la réintroduire. Afin de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus fragiles, je suggère que ce gel ne s'applique ni à l'allocation aux adultes handicapés ni aux pensions de retraite inférieures à 1 400 euros - cela correspond peu ou prou au montant du Smic net, qui était de 1 426 euros au 1er janvier 2025. L'article 44 ainsi remanié aurait un rendement de 2 milliards d'euros.
Je l'ai répété, il nous faut participer activement à l'effort de redressement. Aussi, je souhaite que notre commission adopte cette mesure avec les modifications que je vous soumets, qui me semblent constituer des sources d'équité.
Ma proposition vise également à supprimer la mesure de sous-indexation des pensions sur l'inflation au titre des années 2027 à 2030. Cette sous-indexation devait initialement minorer le coefficient de revalorisation de 0,4 point. La lettre rectificative a ensuite prévu d'augmenter la sous-indexation à 0,9 point pour la seule année 2027, afin de financer à hauteur de 1,5 milliard d'euros la suspension de la réforme des retraites.
D'un point de vue constitutionnel, il n'est pas acquis que nous puissions déroger au principe d'annualité des lois financières. Je vous propose donc de nous recentrer sur les seules économies à réaliser au titre de l'année 2026.
J'en viens au second amendement que je défendrai devant vous, qui vise à supprimer la mesure de suspension de la réforme des retraites portée par l'article 45 bis. Pour reprendre une expression du Président de la République, cette mesure n'est que de la poudre de perlimpinpin. En premier lieu, elle permet à chaque génération née entre 1964 et 1968 de gagner un trimestre - un seul - par rapport à la hausse prévue de l'âge d'ouverture des droits à la retraite. En second lieu, elle permet aux générations nées en 1964 et 1965 de gagner un trimestre par rapport à la hausse prévue de la durée d'assurance requise pour obtenir le taux plein. Concrètement, cela signifie que l'âge de 64 ans s'imposerait à la génération 1969 et non plus à la génération 1968, et que la durée d'assurance minimale de 43 ans s'imposerait à la génération 1966 au lieu de la génération 1965.
Les députés ont élargi le gain d'un trimestre de durée d'assurance aux carrières longues et aux catégories actives et super-actives de la fonction publique, pour un coût estimé à 300 millions d'euros en 2026 et à 1,9 milliard d'euros en 2027.
Initialement, cette mesure avait un coût estimé à 100 millions d'euros pour 2026 et à 1,4 milliard d'euros pour 2027. De plus, elle devait être compensée à hauteur de 0,1 milliard d'euros grâce à une majoration de la contribution ponctuelle des organismes complémentaires, et à hauteur de 1,5 milliard d'euros au moyen d'une majoration de 0,5 point de la sous-indexation des pensions de retraite au titre de l'inflation pour l'année 2027. Au-delà du fait qu'il semble inéquitable de faire reposer le financement de cette suspension sur les retraités, nous nous retrouvons désormais avec une mesure de suspension que nous ne savons pas compenser.
Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a prononcé ces mots : « Suspendre pour suspendre n'a aucun sens. La suspension en préalable de rien serait irresponsable. Cette suspension doit installer la confiance nécessaire pour bâtir de nouvelles solutions. » J'appelle donc à rouvrir le débat et à trouver de nouvelles solutions pour prendre en compte la pénibilité dans le dispositif de départ en retraite anticipée pour les carrières longues, qui favorise aujourd'hui les seules carrières précoces. Les cadres issus des grandes écoles de la fonction publique, qui cotisent très tôt, en sont notamment bénéficiaires, ce qui me semble contestable.
J'en viens ainsi aux dernières mesures concernant les retraites. D'abord, la refonte du dispositif de cumul-emploi retraite, portée par l'article 43, vise à limiter les effets d'aubaine pour les cadres et les assurés bénéficiant du dispositif carrières longues. Cette mesure a été inspirée par le rapport 2025 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de la Cour des comptes. D'une part, 27 % des personnes recourant au cumul emploi-retraite sont des cadres et, d'autre part, 21,4 % des retraités cumulant un revenu d'activité sont issus du dispositif de départ anticipé pour carrières longues. Actuellement, le cumul emploi-retraite intégral leur est ouvert à compter de 62 ans et ces deux catégories sont celles qui ont le plus haut niveau de revenu.
Cette situation est paradoxale. En effet, le dispositif carrières longues vise à ouvrir un droit à la retraite anticipée aux assurés victimes d'usure professionnelle et non à permettre de reprendre une activité lucrative après avoir liquidé sa pension. Désormais, pour inciter ces personnes à recourir à la surcote et à rester en emploi, le cumul emploi-retraite sera plafonné jusqu'à 67 ans. Chaque euro de revenu perçu se substituera à un euro de pension pour ceux qui recourent au cumul emploi-retraite avant l'âge légal d'ouverture des droits. Pour les assurés entre 64 et 67 ans, le cumul sera plafonné dans des conditions définies par décret.
Ensuite, la seconde mesure technique portée par ce PLFSS est l'intégration des trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfant dans les trimestres réputés cotisés, au sein du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues.
Ces deux mesures vont dans le sens d'une plus grande justice sociale. Elles ont été identifiées par la délégation paritaire permanente des retraites et faisaient l'objet d'un consensus, selon Jean-Jacques Marette. Je vous invite à les adopter.
Ayant fini l'examen des mesures participant au redressement de la branche vieillesse, j'en viens à la réforme du mode de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles. Le Gouvernement n'a toujours pas rédigé les décrets d'application de cette réforme qui doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et qui est très attendue. Je m'en émeus et souhaite faire la lumière sur le calendrier projeté.
Le PLFSS de cette année est encore riche de mesures pour la branche vieillesse. Dans le contexte d'une situation financière fragile, je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités, tout en gardant à coeur la protection de nos citoyens les plus vulnérables. Je souhaite que nous rouvrions le débat sur le sens et la qualité de vie au travail, sur la pénibilité et sur l'équité des dispositifs de retraite anticipée. Je reste soucieuse de préserver notre système par répartition. Je rencontre de jeunes actifs, qui craignent de devoir cotiser toute leur vie pour leurs aînés et de ne pas recevoir de pension. Les générations du baby-boom ont profité des Trente Glorieuses, de l'allongement de l'espérance de vie et d'une retraite à 60 ans. Selon l'Insee, en 2019, le niveau de vie médian des retraités était supérieur de 9,5 % à celui de l'ensemble de la population. Protégeons les petites retraites, mais ne sacrifions pas notre jeunesse et tenons notre promesse de maintien du système par répartition.
Mme Monique Lubin. - Si j'en crois le rapport d'Élisabeth Doineau, la mesure de suspension de la réforme des retraites coûterait finalement assez peu. De plus, selon vos dires, madame Gruny, il ne s'agirait que de gagner un trimestre, ce qui serait anodin. Vous avez appelé à la responsabilité collective, mais prendrez-vous la responsabilité de faire exploser le consensus qui a fini par naître à l'Assemblée nationale, permettant de nous éviter le chaos, pour une mesure que vous trouvez si peu coûteuse et anodine ?
M. Martin Lévrier. - D'abord, je suis étonné qu'on se réjouisse du fait que le système des retraites sera l'un des sujets les plus importants de la prochaine élection présidentielle. Il s'agirait plutôt de donner des perspectives aux actifs et à notre jeunesse.
Ensuite, j'ai voté clairement le projet de reparamétrage du système des retraites et je voterai avec la majorité du Sénat sur sa suspension. En revanche, un problème de financement se pose. À cet égard, une solution pourrait exister, qui pourrait me faire changer d'avis. À titre d'exemple, les heures supplémentaires sont défiscalisées, mais comme il s'agit de travail, il ne serait pas idiot de les soumettre uniquement à cotisation de retraite pendant un an ou deux, ce qui rapporterait une certaine somme...
Mme Raymonde Poncet Monge. - Cela rapporterait 2,1 milliards d'euros.
M. Martin Lévrier. - Nous pourrions travailler en commun sur cette question.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. - Madame Lubin, je rappelle qu'un problème de financement se pose pour la partie rajoutée sur les carrières longues. En effet, l'article 44 a été supprimé et la modification de la sous-indexation des pensions pose problème.
De manière plus globale, plus personne ne me parlait des retraites, à part certains élus. Ce sujet a été remis sur la table à l'Assemblée nationale, pour des raisons de politique politicienne. Je trouve dommage d'avoir rallumé le feu dans le pays, et nous n'en sommes pas responsables.
Bien sûr, après la réforme, personne ne nous a remerciés. Cependant, beaucoup ont compris ce dont il s'agissait, parce qu'ils ont le sens des responsabilités. Le problème de cette réforme, c'est que nous n'avons pas pu intégrer la question de la pénibilité. Certaines personnes ont des professions difficiles et il nous faut travailler sur ce sujet. Il est dommage que nous n'ayons pas réussi à le faire, y compris lors du conclave.
Il est terrible de constater que certains jeunes commencent à être contre les retraités, de manière agressive.
L'emploi des jeunes et l'emploi des seniors constituent aussi des sujets de travail, même si nous avons avancé sur ce dernier. Si un plus grand nombre de personnes travaillent, il sera moins difficile de conserver notre système par répartition, en injectant peut-être un peu de capitalisation à côté, pour répondre aux enjeux démographiques.
Martin Lévrier, il faut discuter de la question des cotisations à retraite. Je ne suis pas forcément contre ; il y a peut-être un effort à faire.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Nous ne rencontrons pas les mêmes gens ! Je voudrais évoquer toutes les personnes qui se trouvent dans le sas de précarité, sont en fin de droit et doivent attendre parce que l'âge auquel elles pourraient liquider leurs droits a été déplacé ; ces personnes souhaitent un débat et un changement.
Concernant les jeunes, un sondage avait été effectué au moment de la réforme des retraites : 57 % d'entre eux étaient opposés à la réforme et se disaient favorables à une augmentation des cotisations. Les aspirations ont changé en matière de durée du travail, qui peut se réduire de manières différentes, au niveau de la journée, de la semaine, de l'année ou de l'ensemble de la vie. Sur l'ensemble de la vie, les jeunes n'ont pas envie de travailler jusqu'à un âge tardif.
Il faut nous poser la question des conditions de travail, de la pénibilité, de l'invalidité et de l'inaptitude en amont de toute discussion concernant l'âge de départ en retraite. Il n'y aura pas d'allongement efficace sans que cette question ne soit traitée.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. - Il faut effectivement travailler sur la question des personnes qui se trouvent dans le « sas de précarité » que vous évoquez. D'ailleurs, il peut s'agir de personnes qui auraient aimé rester en activité ou qui souhaiteraient retrouver un travail. Je regrette que la question de la pénibilité n'ait pas été intégrée à la réforme de 2023. Cette absence explique le peu d'acceptabilité de la réforme.
Les gens que je rencontre travaillent en entreprise et à tous les niveaux. Je vous assure qu'ils ne parlaient plus des retraites. Par ailleurs, les syndicats ne sont pas clairs sur ce qu'il conviendrait de modifier : l'âge de départ à la retraite, le niveau des pensions ou celui des cotisations. Finalement, on baisse le montant des pensions, ce que les gens n'ont pas intégré, y compris ceux qui partiront trois mois plus tôt.
Dans les sondages, quand on demande aux gens à quel âge ils veulent partir à la retraite, ils répondent qu'ils veulent partir très tôt. En revanche, quand on leur parle des déficits et de la possibilité de recevoir des pensions moindres, la réponse est moins nette ; ils sont inquiets.
M. Olivier Henno, rapporteur pour la branche famille. - Le solde de l'exercice 2026 s'établirait à 0,7 milliard d'euros, contre 0,8 milliard d'euros en 2025 et 1,1 milliard d'euros en 2024. Cette légère dégradation mérite d'être notée, d'autant qu'elle intervient dans un contexte où les dépenses ne progressent que de 0,1 % par rapport à 2025.
L'objectif de dépenses est fixé à 59,4 milliards d'euros et les recettes atteindraient 60,1 milliards d'euros. Ces chiffres appellent plusieurs observations.
Premièrement, la quasi-stagnation des dépenses résulte directement des mesures d'économies inscrites dans le présent projet de loi, qui représentent un montant total de 0,9 milliard d'euros. Cette contraction est due à trois mesures principales : le ralentissement de l'activité liée au fonds national d'action sociale (Fnas), qui génère une économie de 0,4 milliard d'euros ; le gel de la revalorisation des prestations, qui permet de dégager 0,3 milliard d'euros ; et le décalage de quatre ans de la majoration pour âge des allocations familiales, prévu par voie réglementaire, qui doit générer une économie de 0,2 milliard d'euros supplémentaires.
Je note que l'annexe 3 au projet de loi mentionne explicitement une ligne budgétaire relative à l'« anticipation d'économies sur les dépenses du Fnas ». Cette formulation suscite une interrogation légitime : comment concilier cette contrainte budgétaire avec l'objectif affiché de développement du service public de la petite enfance ?
Deuxièmement, le contexte démographique joue un rôle majeur dans la modération des dépenses. Les données sont sans ambiguïté : 647 000 naissances sont prévues en 2026, alors que ce nombre s'élevait à 742 100 en 2021. Malgré une légère hausse de 0,4 % du nombre de naissances par rapport à 2025, le niveau resterait historiquement bas. Cette situation générerait un effet baissier de 0,9 point sur les dépenses.
Troisièmement, seules les prestations extralégales conserveraient un dynamisme significatif, avec une croissance des dépenses estimée à 5,6 %. Cette évolution traduit la poursuite de l'investissement dans les structures d'accueil collectif, ce qui représente un effort qu'il convient de saluer.
Du côté des recettes, l'augmentation de 2,1 % proviendrait principalement de deux sources : les cotisations sociales, en croissance de 3,1 % et les impôts, taxes et autres contributions sociales, en progression de 6,2 %. Cette dernière hausse s'expliquerait notamment par le dynamisme de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, qui augmenterait de 13,5 % sous l'effet de la forte progression des primes d'assurance automobile et habitation.
Toutefois, je dois attirer votre attention sur un mécanisme qui affecte structurellement les ressources de la branche famille : les transferts financiers internes à la sécurité sociale. La branche rétrocéderait près de 4,3 milliards d'euros au titre de la réforme des allégements généraux, dont environ 0,3 milliard d'euros correspondent à une réduction nette. Il faut y ajouter la réaffectation de 1,4 milliard d'euros de CSG à la Cnam. S'ils répondent à une logique de solidarité entre branches, ces mouvements financiers amputent aussi les capacités d'action de la branche famille.
Le présent projet de loi contient deux dispositions spécifiques à la branche famille qu'il est nécessaire de mettre en avant. Pour rappel, le précédent PLFSS ne comportait aucune mesure pour la branche famille, malgré la multiplication des enjeux cruciaux rencontrés par cette dernière.
L'article 42 vise à instituer un congé supplémentaire de naissance d'une durée maximale de deux mois, pour chacun des deux parents. L'indemnisation suivrait un barème dégressif : 70 % du salaire net antérieur pour le premier mois et 60 % pour le second mois. Ce dispositif vise à accompagner les parents durant la première année suivant la naissance, en leur offrant la possibilité de consacrer davantage de temps à leur enfant, tout en préservant une partie de leurs revenus.
Néanmoins, cette mesure demeure en deçà des attentes exprimées par les professionnels et les familles. Elle ne constitue pas la réforme d'ensemble du congé parental dont les familles de notre pays ont besoin. La commission maintient son souhait de voir aboutir une refondation complète des congés parentaux, permettant d'optimiser les mille premiers jours de l'enfant, tout en facilitant le retour à l'emploi des parents.
L'Assemblée nationale a abondamment modifié le dispositif. Surtout, les députés ont introduit la possibilité pour les parents de fractionner le congé et ont instauré l'obligation qu'un mois du nouveau congé soit pris de manière indépendante par l'un des deux parents. Je propose à la commission de revenir sur ces modifications, car je crois en la nécessité de laisser les familles s'organiser en toute liberté, sans leur imposer de contraintes. De plus, le fractionnement du congé ne semble pas souhaitable pour l'enfant, qui doit pouvoir profiter de ses parents sur une période prolongée. De plus, l'Assemblée nationale a fixé la date du 1er janvier 2026 pour mettre en oeuvre ce congé supplémentaire de naissance, mais la tâche s'avère impossible pour les services des organismes de sécurité sociale, rendant nécessaire un report à 2027.
L'article 41 vise à renforcer l'efficacité du recouvrement des pensions alimentaires par l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa). À cet égard, trois modifications substantielles sont proposées : l'extension de la procédure de paiement direct, qui passerait de vingt-quatre mois à cinq années ; l'élargissement du recouvrement aux termes à échoir et non plus seulement aux termes échus ; et la suppression de la limite de deux ans permettant aux mères en monoparentalité de solliciter l'accompagnement de l'Agence.
Cette disposition répond à une réalité sociale documentée. Les familles monoparentales représentaient 27 % des familles avec enfants en 2021, proportion qui a quasiment triplé depuis 1975, où elle s'établissait à 9 %. Plus de 82 % de ces familles ont à leur tête des femmes, qui connaissent un risque de pauvreté deux fois plus élevé que la moyenne. Plus de 40 % des enfants de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté. Cette mesure constitue donc une avancée concrète afin de favoriser le versement de créances alimentaires aux mères en situation de monoparentalité.
J'en viens à la majoration pour âge des allocations familiales. Ce projet suscite beaucoup d'émoi chez les associations de familles et je m'y oppose fermement, car je considère que la branche famille dispose d'un excédent suffisant pour être en mesure de financer le congé supplémentaire de naissance sans devoir frapper les familles.
Je voudrais conclure en revenant sur les données financières de la branche. Les prévisions pluriannuelles indiquent un redressement progressif du solde : 1,9 milliard d'euros en 2027, 2,2 milliards d'euros en 2028 et 2,4 milliards d'euros en 2029. Cette trajectoire doit nous permettre de repenser l'ambition de notre politique familiale.
Les marges de manoeuvre financières qui se dessineraient à l'horizon 2027-2029 doivent permettre d'engager les réformes structurelles nécessaires. Les besoins sont identifiés : la refonte du congé parental, le congé supplémentaire étant insuffisant en l'état ; le soutien aux familles des classes moyennes souvent exclues par les seuils de ressources ; le renforcement du service public de la petite enfance ; et la lutte contre la pauvreté des familles au moyen du Fnas.
La trajectoire démographique de notre pays exige une action déterminée et une réponse politique à la hauteur de l'enjeu.
Mme Nadia Sollogoub. - Je comprends bien les enjeux démographiques auxquels nous faisons face. Cependant, je ne pense pas que nous relancerons la démographie en donnant des congés supplémentaires. De plus, je m'interroge sur l'impact pour les entreprises.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Parmi les freins à la natalité, on trouve la question du logement, mais aussi celle de l'accompagnement et de la garde. La prolongation des congés constitue donc aussi un moyen de faire baisser la tension sur ce sujet de la garde.
Mme Raymonde Poncet Monge. - La dépense afférente à la prolongation du congé de naissance a-t-elle été calculée ? S'agira-t-il bien d'indemnités que la branche famille remboursera à la branche maladie ?
M. Olivier Henno, rapporteur. - Il est difficile d'être très précis puisque cette dépense dépendra du comportement des familles. Selon les hypothèses, cette dépense devrait s'établir entre 200 et 300 millions d'euros. Les indemnités seront effectivement remboursées.
Mme Pascale Gruny. - Il faudra faire attention à ce que l'allongement du congé n'entraîne pas, pour les femmes, un éloignement du travail ; il ne s'agirait pas d'encourager un retour des femmes à la maison. Nous rencontrons déjà des difficultés autour de l'emploi des femmes.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Les mesures prises restent légères par rapport à la gravité de l'enjeu, dont il faut bien prendre la mesure : le nombre moyen d'enfant par femme est de 1,6 et, avec deux générations connaissant un tel nombre, on perdra 30 % de la population ! Il s'agit d'un enjeu existentiel.
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour la branche autonomie. - Ce PLFSS s'évertue, comme le précédent, à préserver la branche autonomie malgré la contrainte qui pèse sur les finances sociales. Une hausse de 3,5 % de l'objectif de dépenses est consentie pour l'année 2026, qui atteindrait 43,5 milliards d'euros. Certes, la progression des dépenses ralentit - la hausse s'élevait à plus de 6 % en 2024 et 2025 -, mais elle reste importante, si on la met en perspective des efforts demandés aux autres branches et de l'Ondam à 2 %.
Cette augmentation, qui représente 1,5 milliard d'euros, est principalement portée par l'objectif de dépenses des établissements et services médico-sociaux. Ces financements supplémentaires permettent de poursuivre le déploiement des mesures de renforcement de l'offre médico-sociale, les principales étant la création de places en services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), la mise en oeuvre du plan de création de 50 000 solutions dans le champ du handicap, et les recrutements en Ehpad. Le contexte budgétaire n'est pas sans incidence sur ces plans, puisque le rythme des recrutements et des créations de places ralentit, mais le Gouvernement nous assure que les objectifs restent inchangés.
En dehors du champ des structures médico-sociales, les dépenses de la branche autonomie devraient augmenter de 300 millions d'euros. Les deux tiers de cette hausse proviennent de la réforme des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) aux départements, votée l'année dernière en LFSS. Elle garantit un certain taux de couverture des dépenses des départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), ce qui induit mécaniquement, du fait du dynamisme de ces prestations, une hausse des concours. Le tiers restant de cette augmentation résulte de la progression des prestations avec l'inflation et le nombre de bénéficiaires, et du fléchage de 100 millions d'euros vers l'habitat inclusif.
J'en viens aux trois articles de ce PLFSS qui portent sur la branche autonomie, en précisant que l'Assemblée nationale ne les a pas examinés.
L'article 36 introduit une réforme structurelle du financement des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent les enfants et les jeunes adultes handicapés. Il s'agit de la réforme Serafin-PH, qui fait l'objet de travaux et de concertations entre la CNSA, les administrations et les différentes parties prenantes depuis plus de dix ans. À ce stade, seules les structures pour enfants et jeunes adultes, intégralement financées par les agences régionales de santé (ARS), sont concernées. L'entrée en vigueur est prévue pour 2027.
Le premier objectif de cette réforme est de renforcer l'équité dans l'allocation des financements, en prenant en compte des critères objectifs. Le financement repose aujourd'hui sur la reconduction de dotations historiques décorrélées de la réalité de l'activité, ce qui pénalise les structures accompagnant les publics les plus lourdement handicapés.
L'autre objectif, tout aussi important, vise à inciter à la transformation de l'offre médico-sociale, en lien avec les priorités fixées lors de la dernière Conférence nationale du handicap (CNH). Il s'agit de personnaliser le parcours des personnes accompagnées et de renforcer les interactions avec le milieu ordinaire en allant, au niveau de chaque structure, vers une logique d'offre de services coordonnés.
Pour cela, le Gouvernement propose de financer les structures médico-sociales par le biais de deux parts : une part fixe, qui prendrait en compte des critères objectifs comme la capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées et les besoins d'accompagnement des personnes ; et une part variable, modulable en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération entre les partenaires. Nous ne connaissons pas encore en détail l'équation tarifaire qui sera appliquée, car celle-ci doit faire l'objet d'ultimes concertations en 2026 et sera fixée par voie réglementaire.
Le Gouvernement a annoncé que 360 millions d'euros seraient fléchés vers la mise en oeuvre de cette réforme entre 2027 et 2030. Aucune structure ne serait lésée par le nouveau système de financement, et celles qui n'auraient pas encore pris le virage de la transformation de l'offre seraient accompagnées dans cette démarche.
Cette réforme est unanimement soutenue par les acteurs auditionnés, qu'il s'agisse des fédérations comme des acteurs associatifs. Tous, sans exception, ont été associés à l'élaboration de cette réforme, en louent les objectifs, et appellent à un maintien de cet article. Après de nombreuses années consacrées à la définition de cette réforme, il est temps d'avancer sur les mesures structurelles nécessaires pour le secteur, et d'impulser la transformation de l'offre qui s'impose pour garantir, partout, un meilleur accompagnement aux personnes handicapées.
Il va de soi que nous soutenons cette réforme, tout en restant attentifs aux travaux conduits en 2026 pour définir l'équation tarifaire. J'ai également retenu des auditions la crainte des acteurs sur le sujet de la prise en charge des coûts de transport, qui vont mécaniquement augmenter avec le mouvement de désinstitutionnalisation qui s'amorce. Il faudra veiller à ce que les structures aient les moyens de le financer, notamment dans les territoires ruraux.
L'article 37 prévoit la participation de la CNSA à la prise en charge du coût de l'accord du 4 juin 2024 pour les départements. Cet accord, qui a étendu la prime Ségur à l'ensemble des personnels du secteur médico-social privé à but non lucratif, se traduit par un surcoût estimé - et peut-être sous-estimé - à 170 millions d'euros annuels pour les départements. Cet article acte la prise en charge de la moitié de ce surcoût, soit 85 millions d'euros annuels, par la CNSA. Cela est conforme à l'accord trouvé lors du comité des financeurs du 29 avril dernier entre le Gouvernement et les départements.
Nous connaissons tous la situation des départements. Ce dispositif de compensation est important, et même indispensable ; mais il ne suffira pas face à la hausse continue des dépenses sociales et il n'est pas exclu, comme l'a rappelé l'Assemblée des départements de France (ADF) en audition, que certains départements ne puissent assumer pleinement le coût de l'accord malgré la participation de la CNSA. Dans cette situation, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion structurelle sur le financement de la politique de l'autonomie.
Une dernière mesure, à l'article 38, concerne la branche autonomie. L'article prévoit que les départements pourront déduire les indemnisations versées par les assurances et les fonds d'indemnisation de l'APA et de la PCH, afin que les dommages causés par les tiers responsables ne soient pas doublement couverts. Les postes de préjudice concernés sont principalement les coûts relatifs à l'aide humaine et à l'aménagement du logement ou du véhicule. Selon les estimations du Gouvernement, à terme, cette mesure rapporterait 17,7 millions d'euros aux départements et 10 millions d'euros à la CNSA.
Le principe posé par cet article me semble intéressant, dans un contexte où nous devons rechercher l'efficience de la dépense publique et l'équité entre les assurés sociaux. Il pose la question de la prise en charge par la solidarité nationale de coûts provoqués par un tiers responsable quand celui-ci est déjà tenu de les réparer. Il fait écho aux recours subrogatoires que les caisses de sécurité sociale peuvent réaliser auprès des assurances pour récupérer les dépenses supportées en lien avec les dommages causés par des tiers responsables.
J'identifie néanmoins de sérieux risques sur le plan opérationnel, notamment concernant la surcharge administrative pour les départements et les assurés, ainsi que les différences de temporalité entre la notification des droits par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et la détermination des indemnisations. Par ailleurs, j'ai été attentive à vos arguments sur l'importance de bien distinguer le droit à être indemnisé d'un préjudice du droit à compensation. Je remarque, enfin, que les associations n'ont pas été concertées sur cette mesure. Pour ces raisons, je vous proposerai la suppression de cet article 38.
Si ce PLFSS tâche de préserver la branche autonomie, le constat que nous dressons depuis plusieurs années demeure : la trajectoire financière est incompatible avec les besoins de financement et les ambitions affichées. En 2025, le déficit de la branche devrait s'établir à 300 millions d'euros. Il se creuse, dès 2026, jusqu'à 1,7 milliard d'euros, et devrait se stabiliser à ce niveau jusqu'en 2029.
Sans ressources nouvelles, il sera impossible de faire face au défi du vieillissement et de conduire jusqu'au bout les projets de transformation de l'offre. Réussir le virage domiciliaire, renforcer l'attractivité des métiers, augmenter le nombre de places en structures, développer massivement l'habitat intermédiaire : tout cela exige des moyens considérables, dont la CNSA, et encore moins les départements ne disposent pas à ce jour.
Des pistes existent : l'année dernière, nous avions proposé une deuxième journée de solidarité ; la mise en place d'une assurance dépendance obligatoire devrait également être mise sur la table, car l'ampleur des besoins ne pourra être absorbée par la seule solidarité nationale.
J'insiste également sur les moindres dépenses qui pourraient résulter d'une politique de prévention efficace dans le champ du grand âge. Il ne faut pas négliger cet aspect : en matière de prévention des chutes, de dénutrition et d'isolement social, nous savons que la marge de progrès est importante.
Au-delà de ces enjeux structurels, de nombreux Ehpad, ainsi que de plus en plus de structures pour personnes handicapées, sont au bord de la rupture financière. Le PLFSS ne prévoit pas, cette année, de fonds d'urgence pour aider ces établissements. Cette aide avait certes vocation à rester exceptionnelle, mais la situation est inquiétante et les personnes accompagnées sont les premières à en pâtir.
L'examen d'une grande loi sur l'autonomie, que nous avons maintes fois demandé, s'impose chaque année avec plus de vigueur. Sans cela, nous en resterons aux incantations, et les besoins de prise en charge et d'accompagnement de millions de Français resteront insatisfaits.
M. Alain Milon, président. - Si j'ai bien compris vos propos respectifs, nous devons répondre aux défis du financement, de la natalité et du vieillissement.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 585 vise à rétablir l'article liminaire supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 585 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 586 vise également à rétablir l'article 1er, supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 586 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 587 vise aussi à rétablir l'article 2 supprimé par l'Assemblée nationale. Je déplore que les mesures de redressement infra-annuelles se traduisent par une diminution d'environ 200 millions d'euros des dépenses relatives aux établissements de santé par rapport à la LFSS de 2025 initiale, selon l'annexe 5 au PLFSS pour 2026. En conséquence, je propose une majoration du sous-objectif relatif aux établissements de santé, à hauteur de 200 millions d'euros.
Mme Raymonde Poncet Monge. - L'exercice 2025 n'est-il pas achevé ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Il s'agit d'être cohérent avec ce que nous avions proposé l'an dernier. L'objectif est de redire que nous nous inquiétons de la situation catastrophique des établissements de santé.
L'amendement n° 587 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 719 tend à rétablir l'article 3 dans sa rédaction initiale, qui diminue de 60 millions d'euros le montant de la contribution de l'assurance maladie au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) en 2025, pour l'établir à 463 millions d'euros.
L'amendement n° 719 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - La suppression de l'obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale permet aux créances des organismes de recouvrement du régime général de bénéficier d'un privilège occulte, qui ne bénéficiait jusqu'à présent qu'à certaines créances. L'objectif est d'améliorer la performance du recouvrement des créances sociales.
Toutefois, la mesure pourrait avoir pour effet de limiter les capacités des tribunaux de commerce et judiciaires dans leur procédure d'identification des entreprises en difficulté sur leur territoire, affectant ainsi le déploiement de leurs actions de prévention.
L'amendement n° 588 vise à créer un nouvel article dans le code de la sécurité sociale, afin de prévoir la communication aux présidents des tribunaux concernés d'une information relative au montant du passif constitué par une entreprise auprès des organismes de sécurité sociale. La transmission de ces montants doit permettre aux tribunaux de continuer à mener à bien leur mission.
L'amendement n° 588 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'article 5 rétablit des droits pour les assurés. Plutôt que de m'engager sur une grande sécurité sociale pour les artistes-auteurs au travers d'un article de la loi, je privilégie l'efficacité et les aménagements techniques. L'amendement n° 589 tend à supprimer la modification insérée par l'Assemblée nationale déterminant le nom de la future association agréée pour la protection sociale des artistes-auteurs.
L'amendement n° 589 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 590 prévoit de supprimer l'introduction des élections professionnelles des artistes-auteurs par l'Assemblée nationale. Sur ce point, je n'irai pas plus loin que pour les travailleurs indépendants.
L'amendement n° 590 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'adoption de l'article 5 bis permettrait à certains bailleurs de ne plus être affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA), tout en pouvant cumuler leur pension de retraite avec des revenus d'exploitation en espèce. Le retour à l'équilibre des comptes sociaux oblige à maintenir sur l'ensemble du territoire national la règle énonçant que tout bailleur métayer est affilié à la MSA du fait de ses revenus de métayage et qu'à ce titre ces derniers sont soumis à cotisation. En conséquence, l'amendement n° 591 vise à supprimer cet article.
L'amendement n°591 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Il ne peut être question de soutenir une mesure d'exonération de cotisations dont l'effet financier n'est pas strictement renseigné. En conséquence, l'amendement n° 592 vise à supprimer cet article.
L'amendement n° 592 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'article 5 quater est déjà satisfait par le droit existant. L'article 1er de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social prévoit l'obligation de mettre en oeuvre une négociation sur l'emploi des seniors. En conséquence, l'amendement n° 593 vise à supprimer cet article.
L'amendement n° 593 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 594 vise à rétablir le gel du barème de la CSG. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement de la commission tendant à rétablir l'article 44 relatif au gel des prestations. Contrairement à ce qui était prévu dans le texte initial, le gel du barème ne concernerait que l'année 2026.
L'amendement n° 594 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'article porte le taux de la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %. En conséquence, l'amendement n° 595 vise à supprimer cet article.
L'amendement n° 595 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - En rendant plus difficile le passage d'un taux de CSG à un taux supérieur, l'adoption de cet article entraînerait des pertes de recettes. Selon les estimations transmises par le ministère de l'action et des comptes publics à la commission, celles-ci s'élèveraient à 200 millions d'euros. En conséquence, l'amendement n° 596 vise à supprimer cet article.
L'amendement n° 596 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Selon les complémentaires santé elles-mêmes, les tarifs pour l'année 2025 ont été fixés entre le printemps et la fin de l'été 2024, sans qu'elles aient pu répercuter la hausse annoncée, puis abandonnée, du ticket modérateur sur les tarifs. En suivant le même raisonnement, les complémentaires santé ont d'ores et déjà fixé entre avril et septembre leurs cotisations pour l'année prochaine.
Or, le Gouvernement a, dès le 15 janvier, annoncé qu'il comptait renforcer transitoirement la fiscalité sur les complémentaires santé, et il a confirmé, en mars dernier, son intention de mettre en oeuvre cette mesure, malgré la vive opposition du secteur. Il apparaît que les complémentaires santé ont fixé leurs primes pour 2026 sans pouvoir ignorer que celles-ci devraient leur permettre de dégager les marges de manoeuvre nécessaires au financement de la contribution supplémentaire demandée.
Je regrette la hausse tarifaire qui découle, pour les assurés, de l'annonce de cette taxe. L'effort semble désormais inévitable, dès lors que les complémentaires ont déjà fixé leurs évolutions tarifaires en prenant en compte les effets de la contribution exceptionnelle. Les cotisations des complémentaires santé pour 2026 sont désormais indépendantes de l'adoption ou du rejet du présent article.
Par ailleurs, la mission d'information conduite par nos collègues Mme Carrère-Gée et M Iacovelli sur les complémentaires santé a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d'allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ». Rien n'indique que l'absence de mise en oeuvre de cette taxe puisse aboutir au reversement aux assurés de son rendement estimé, via des baisses de cotisations en 2027. Le milliard d'euros de rendement que produira la contribution - transitoire, faut-il le rappeler - est indispensable pour maîtriser le déficit de l'assurance maladie en 2026.
En conséquence, l'amendement n° 597 vise à rétablir l'article dans sa version initiale.
L'amendement n° 597 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Bien qu'approuvant l'objectif de lutte contre la financiarisation de la santé, je ne suis pas favorable à l'instauration de nouvelles niches sociales. En conséquence, l'amendement n° 598 vise à supprimer cet article.
L'amendement n° 598 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Il existe un enjeu spécifique d'accès financier à la complémentaire santé pour les retraités des professions agricoles ne bénéficiant pas de la complémentaire santé solidaire, eu égard au faible montant des pensions perçues et des difficultés rencontrées par une large proportion des seniors à payer leurs complémentaires santé. Toutefois, le levier de la fiscalité des complémentaires santé n'est pas le plus efficace. En conséquence, l'amendement n° 599 vise à supprimer cet article.
L'amendement n° 599 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 600 apporte des précisions rédactionnelles.
L'amendement n° 600 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'alinéa 5 de l'article 8 ter prévoit d'ajuster le volet social de la niche fiscale et sociale instaurée par l'article 93 de la loi de finances de 2025 concernant la rémunération des dirigeants d'entreprise dans le cadre des dispositifs de « management package », et de pérenniser dès à présent, soit au bout d'un an, cette niche sociale qui, conformément à l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale, n'avait pu être instaurée par la LFSS de 2025 que pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027.
Je ne m'oppose pas aux ajustements proposés. En revanche, je considère que la pérennisation de cette niche sociale au bout de seulement une année, et sans qu'aucun élément d'évaluation ne soit transmis au Parlement, est contraire à l'esprit de l'article L.O. 111-3-16 précité. En conséquence, l'amendement n° 601 tend à supprimer cet alinéa 5.
L'amendement n° 601 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'article 8 sexies prévoit de réduire les allégements généraux pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic. Cet article est difficilement applicable en l'état et pourrait détruire des emplois. En conséquence, l'amendement n° 602 vise à supprimer cet article.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Un avenant portant sur la branche de l'aide à domicile indiquait que celle-ci n'était pas concernée par la décision de se tenir en deçà des minima. Cet avenant, signé entre les employeurs et les organisations syndicales, n'a pas été validé par le ministre du travail. Il serait donc absurde qu'un organisme comme la branche de l'aide à domicile, par exemple, soit pénalisé.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - C'est notamment en raison de ce type de situation que je propose de supprimer l'article.
L'amendement n° 602 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'article porte sur une demande de rapport ; l'amendement n° 603 prévoit de le supprimer.
L'amendement n° 603 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Cet amendement propose de rétablir l'alinéa 5 de l'article 9 dans sa rédaction initiale. Le dispositif de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise n'a fait l'objet d'aucune évaluation prouvant son efficacité, faute d'instrument de mesure permettant d'évaluer les effets de cet abaissement du coût du travail sur le taux de survie des entreprises et leur taux d'embauche à trois ans.
En 2025, il est estimé que l'aide à la création et la reprise d'entreprise représentent un coût annuel pour les finances publiques de 425 000 euros pour 317 000 bénéficiaires. Le dispositif, bien que compensé par l'État, demeure une charge significative pour les finances publiques. En conséquence, l'amendement n° 604 vise à rétablir l'alinéa dans une rédaction ad hoc.
L'amendement n° 604 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Dans un objectif de contribution à l'effort de redressement des comptes de la sécurité sociale, l'amendement n° 605 a pour objet de rétablir la version initiale du présent article concernant la suppression de l'exonération de cotisations sociales des apprentis.
En 2026, cette suppression permettrait une économie de 320 millions d'euros puis, annuellement, de 1 200 millions d'euros à l'horizon 2027. Aucune étude économique ne démontre que l'exonération constitue une incitation forte au développement de l'apprentissage. En réalité, la réussite de celui-ci dépend principalement de l'offre de formation et d'emplois adaptés en entreprise.
Enfin, il est difficile de justifier un dispositif d'exonération de cotisations sociales alors que les apprentis peuvent bénéficier de prestations sociales contributives. Surtout, le dispositif crée une inégalité avec les jeunes salariés qui n'en bénéficient pas, alors que leur profil est proche de celui des apprentis.
L'amendement n° 605 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 606 vise à supprimer l'article 9 bis, qui viendrait créer une nouvelle niche sociale. Mon argumentation vaudra aussi pour les amendements suivants.
L'amendement n° 606 est adopté.
Article 9 quater
L'amendement n° 607 est adopté.
Article 9 quinquies
L'amendement n° 608 est adopté.
Article 9 sexies
L'amendement n° 609 est adopté.
Article 9 septies
L'amendement n° 610 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 611 vise à supprimer la nouvelle contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques créée par l'article 10. Cette réforme vise à intégrer en base 1,6 milliard d'euros issu de la clause de sauvegarde dans un nouveau dispositif fiscal existant, sans concertation ni étude d'impact sur la répartition de la charge entre les entreprises concernées. Elle s'ajoute à la clause de sauvegarde conçue comme une mesure exceptionnelle, mais qui se déclenche de manière constante depuis plusieurs années.
Si cette demande de prévisibilité est demandée par les industriels, la réforme proposée par le Gouvernement s'inscrit dans un contexte qui rend cette nouvelle taxe difficilement absorbable, notamment pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur. En effet, l'instauration de cette taxe pérenne s'accompagne d'un objectif de baisse de prix des médicaments à un niveau élevé - 1,4 milliard d'euros -, ainsi que de la mise en oeuvre, concomitante pour 2026, d'un système de paiement par acompte des remises, comme précisé dans l'article 11 du PLFSS.
Par ailleurs, aucune mesure d'abattement similaire à celle existant pour la clause de sauvegarde n'est mise en place. Le Comité économique des produits de santé (CEPS) a souligné le risque que pouvait représenter une telle absence dans ses négociations de remise avec les laboratoires en vue d'obtenir des baisses de prix sur les médicaments.
Dans un contexte international tendu, cette nouvelle taxe sur les médicaments envoie un signal négatif pour l'investissement et l'innovation dans notre pays. Il apparaît nécessaire de retravailler le dispositif afin de pouvoir apporter la prévisibilité nécessaire aux entreprises, sans toutefois mettre en difficulté notre tissu économique et notre approvisionnement en médicament.
L'amendement n° 611 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - La présence au sein de cet article de deux mesures de validation législative portant, pour l'une d'entre elles, sur des contentieux qui couvrent une période de dix ans, pose question au regard du respect du principe de sécurité juridique et de proportionnalité de la mesure. En conséquence, l'amendement n° 612 vise à supprimer l'alinéa 42 de cet article.
L'amendement n° 612 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 613 a pour objet de fixer le montant M pour l'année 2026 à un niveau assurant le déclenchement de la clause de sauvegarde pour un rendement de 1,6 milliard d'euros, et ce afin que la suppression de la contribution supplémentaire ne se traduise pas par une perte de recettes pour l'assurance maladie.
Le Gouvernement ayant fixé le montant M à 26,65 milliards en prévision d'un rendement nul de la clause de sauvegarde au titre de 2026, le présent amendement vise à diminuer le montant M de 1,78 milliard afin d'obtenir un déclenchement de la clause pour un rendement estimé à 1,6 milliard d'euros. Je précise que ce rendement n'a pas vocation à perdurer via la clause de sauvegarde, celle-ci devant redevenir une véritable « corde de rappel ». Il s'agit là d'une solution transitoire pour inviter tous les acteurs à réfléchir à la meilleure solution possible.
L'amendement n° 613 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 614 a pour objet d'assurer, sur le modèle du plafonnement existant au titre de la prise en compte du chiffre d'affaires, que la contribution due par chaque entreprise au titre des médicaments génériques, des spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité et des spécialités de référence matures et peu onéreuses, ne peut excéder 2 % des dépenses remboursées au titre de ces mêmes spécialités pour chaque entreprise.
Le mécanisme prévoit également que ce plafonnement ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution, et que les réductions de contribution en découlant pour les entreprises concernées sont réparties entre celles-ci au prorata de la contribution due au titre des autres spécialités.
Par cohérence, je propose également un amendement de suppression de l'article 10 bis, qui visait à exclure de l'assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides.
L'amendement n° 614 est adopté.
Article 10 bis
L'amendement n° 615 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Assurer la souveraineté en matière de médicament en favorisant les investissements et la production sur le sol européen et français constitue un enjeu majeur. L'amendement n° 616 vise à supprimer l'article 10 ter, qui ne semble pas opérationnel.
L'amendement n° 616 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 617 corrige une erreur rédactionnelle.
L'amendement n° 617 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 618 tend à supprimer l'obligation de diffusion des remises accordées et des prix nets, tarifs nets et coûts nets des médicaments et des dispositifs médicaux. Ces informations relèvent de la confidentialité des négociations entre le CEPS et les laboratoires, et procéder à leur diffusion pourrait exposer l'Acoss ou le CEPS au délit de violation du secret des affaires.
L'amendement n° 618 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 619 précise la rédaction de l'article 11 bis. S'agissant d'une imposition, la loi doit être claire et précise sur l'assiette, le taux et l'échéance d'entrée en vigueur.
D'une part, l'amendement cible plus précisément les boissons concernées par la taxe, en fixant un plafond au titre alcoométrique acquis. Les « Vody », qui sont les boissons visées, ont en général un titre alcoométrique compris entre 18 % et 22 % de volume d'alcool. D'autre part, il renvoie la liste des substances énergisantes à un arrêté ministériel plutôt qu'à un décret. Enfin, il fixe une date d'entrée en vigueur pour cette nouvelle taxe.
L'amendement n° 619 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° ASOC.36 vise à supprimer cet article, qui va à l'encontre du droit européen, bien que je sois très attachée au Nutriscore.
M. Martin Lévrier. - J'y tiens également beaucoup : pourquoi ne pas réécrire cet article au lieu de le supprimer ?
M. Bernard Jomier. - L'argument qu'invoque la rapporteure ne tient pas : je rappelle qu'Ursula von der Leyen avait pour projet, lors de sa réélection à la tête de la Commission européenne, de généraliser le Nutriscore, qui n'est en rien contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Ce traité autorise, au nom d'un intérêt majeur de santé publique, à déroger au principe de libre circulation des marchandises. La France a ainsi obtenu gain de cause sur le dioxyde de titane - dont elle réclamait l'interdiction - devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), juridiction devant laquelle la généralisation du Nutriscore pourrait être aisément défendue.
L'affirmation selon laquelle il faudrait renoncer à cette mesure au nom de l'anticipation d'une possible interdiction est, de fait, l'argument employé par l'industrie agroalimentaire. En tant que législateurs, nous devons au contraire voter la généralisation du Nutriscore, qui n'est ni une taxe ni une interdiction : nous n'avons aucune raison de nous autocensurer.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - La mesure proposée par cet article semble bien contraire aux conventions européennes. Un affichage obligatoire sur les produits alimentaires n'est pas envisageable, car elle est assimilable à une obligation déguisée, contraire à la libre circulation des marchandises, mais nous pourrons en débattre.
Mme Véronique Guillotin. - Des mentions obligatoires - telles que le nombre de calories - figurent déjà sur les produits alimentaires, je ne vois donc pas pourquoi nous nous autocensurerions au sujet du Nutriscore.
M. Martin Lévrier. - C'est juste : de telles obligations ne sont donc pas interdites.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Je vérifierai ces aspects.
L'amendement ASOC.36 n'est pas adopté.
Article 11 quater
L'amendement rédactionnel n° 620 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Plusieurs études ont récemment attiré l'attention des pouvoirs publics sur la dangerosité de l'hexane, substance chimique dérivée du pétrole ou du gaz naturel et utilisée par l'industrie comme solvant d'extraction. En effet, de grandes marques transforment les graines oléagineuses destinées à la production d'huiles alimentaires, de margarines ou de préparations pour bébés dans des usines utilisant de l'hexane, des résidus de cette substance se retrouvant dans certains produits alimentaires.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) n'a pas démontré de dépassement des seuils autorisés, mais ceux-ci sont anciens et n'ont pas été réévalués. Il paraît urgent que les pouvoirs publics se saisissent des dernières études scientifiques pour, si cela est jugé nécessaire, adapter la réglementation.
Néanmoins, la mise en place d'une taxe n'est pas le meilleur moyen de parvenir à un abandon progressif de cette substance. Au-delà d'un niveau de fiscalité sur les entreprises déjà très élevé en France, les industries risquent de répercuter la contribution sur les prix plutôt que d'adapter leurs processus de production, ce qui exigerait des investissements importants. Il est donc proposé de supprimer cet article.
L'amendement n° 621 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Comme je l'expliquais précédemment, l'article 40 du PLF réduit la TVA affectée à la sécurité sociale de 3 milliards d'euros pour l'affecter à l'État, ce qui n'est pas pertinent, d'où cet amendement n° 622.
L'amendement n° 622 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel n° 623.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Le paragraphe VI de l'article 12 prévoit de modifier l'article 18 de la loi du 9 août 2004 pour permettre le transfert de l'excédent éventuel des opérations de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg) relatives à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) à la Cnav.
Cette disposition poursuit un objectif de sécurisation juridique, lié au fait que le droit de l'Union européenne impose une accise unique sur l'énergie.
Toutefois, il résulte des règles de la comptabilité nationale que si cette opération entraînait la requalification par le comptable national de la Cnieg, actuellement considérée comme une société non financière, en administration publique, le paragraphe VI du présent article pourrait susciter l'année de sa mise en oeuvre une augmentation du déficit des administrations publiques de plus de 20 milliards d'euros, soit 0,7 point de PIB.
Dans l'attente d'une analyse plus approfondie du sujet par l'Insee, il est proposé de supprimer le paragraphe VI du présent article.
L'amendement n° 624 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Cet article diminue la fraction de CSG affectée à la CNSA pour attribuer, à due concurrence, une fraction aux départements. La recherche légitime d'une réponse aux difficultés financières des départements ne saurait résider dans la diminution des recettes de la branche autonomie. C'est pourquoi je vous propose de supprimer cet article.
L'amendement n° 625 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Cet amendement n° 626 prévoit de supprimer l'article 12 ter, qui porte sur l'automaticité de l'annulation des cotisations prises en charge par l'assurance maladie au bénéfice des professionnels de santé coupables de fraude.
Sur le fond, l'automaticité priverait les caisses d'assurance maladie de marges de manoeuvre pour appliquer les sanctions de façon proportionnée.
Sur la forme, il est préférable de concentrer les dispositions sur la fraude dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui contient justement des dispositions sur la fraude des professionnels de santé.
L'amendement n° 626 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Afin de lutter contre la sous-déclaration des vendeurs de biens et prestataires de services qui opèrent sur les plateformes de vente en ligne comme Leboncoin ou Back Market, le PLFSS pour 2024 a créé un dispositif de précompte des cotisations qui doivent être récoltées par les plateformes sur le produit des ventes réalisées en leur sein et transmises aux Urssaf. Ce dispositif sera opérationnel au 1er janvier 2027.
L'article 12 quater exclut les plateformes comme Leboncoin qui se limitent à mettre en relation les vendeurs et les acheteurs du dispositif de précompte, afin d'exempter les micro-entrepreneurs de ce dispositif. Cela va à l'encontre de l'objectif de lutte contre la fraude que nous poursuivons, ce qui justifie cet amendement de suppression.
L'amendement n° 627 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'article 12 septies prévoit de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de minorer la compensation à l'Unédic des allégements généraux de cotisations patronales, résultant de la LFSS de 2024.
Le Sénat s'est à plusieurs reprises déclaré favorable au principe affirmé dans cet article. Ainsi, lors de l'examen en première lecture du PLFSS 2024, il a adopté trois amendements identiques, dont un de la commission des affaires sociales, tendant à supprimer la disposition précitée. En effet, cette mesure était contraire au principe de gestion paritaire de l'Unédic et suscitait une forte opposition des partenaires sociaux. Toutefois, cette disposition avait été rétablie en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
La commission est néanmoins défavorable à cet article, qui aggrave le besoin de financement de l'Acoss de 4,1 milliards d'euros en 2026. Je vous propose donc de supprimer cet article.
L'amendement n° 628 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Cet article, qui a été adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du député Hadrien Clouet, a pour conséquence de supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, de fixer par décret le montant de la subvention d'équilibre que doivent verser l'Agirc-Arrco et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) à l'État pour financer les pensions de retraite des régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF, dont les nouveaux entrants sont désormais affiliés au régime général.
Cette subvention d'équilibre doit être définie par convention, mais si l'Agirc-Arrco et la Cnav ne sont pas tombés d'accord au-delà du 30 juin, le Gouvernement peut la fixer par décret afin de sécuriser le paiement des pensions. Cette situation ne s'est jamais produite et supprimer cette possibilité revient à créer une insécurité sur le versement de pensions de nos concitoyens. Aussi, il est proposé de supprimer l'article 12 octies.
L'amendement n° 629 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Je propose de supprimer cet article, qui rentre dans le champ du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
L'amendement n° 630 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - De la même manière, cet article aurait pu figurer dans le projet de loi précité. Aussi, je vous propose de le supprimer.
L'amendement n° 631 est adopté.
Article 12 undecies
L'amendement de suppression n° 632 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Le dispositif de cet article ne correspond pas à l'intention de ses auteurs, à savoir que l'Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et subsidiairement sur les marchés.
Le besoin de financement maximal de l'Acoss en 2026 est évalué à 78,5 milliards d'euros, pour un plafond d'emprunt que l'article 16 prévoit de fixer à 83 milliards d'euros. Si les 13 milliards d'euros de financement de la CDC étaient saturés toute l'année, il faudrait alors mobiliser plus de 65 milliards d'euros sur les marchés. Ainsi, en cas de difficulté à un moment de l'année, l'Acoss ne disposerait plus de cette sécurité auprès de la CDC. Je vous propose donc de supprimer cet article.
L'amendement n° 633 est adopté.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'amendement n° 634 vise à rétablir l'article 17 et le rapport annexé.
Ce dernier - et en particulier ses tableaux pluriannuels - fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément à l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement a pour objet de rétablir le rapport annexé dans sa rédaction initiale, sauf le paragraphe III, qu'il prévoit de préciser. En effet, le III du rapport annexé est un apport essentiel du présent PLFSS. Jusqu'alors, l'objectif de ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, bien qu'annoncé par des membres du Gouvernement, ne figurait explicitement dans aucun document.
Toutefois, pour ce qui concerne le calibrage des mesures, le paragraphe III se contente d'indiquer que, dès lors que le déficit prévisionnel est d'environ 18 milliards d'euros en 2029, le retour à l'équilibre implique de réaliser d'ici là un effort de réduction de ce montant.
Cet amendement prévoit de préciser le montant des mesures à prendre chaque année, par rapport à la trajectoire prévue par le rapport annexé, mais aussi en tenant compte des économies nécessaires au respect de la trajectoire de l'Ondam.
Il actualise, en outre, le montant du déficit prévisionnel pour 2029 indiqué dans le paragraphe III, qui n'avait pas été actualisé depuis le texte déposé le 14 octobre et qui mentionnait donc toujours un déficit de 18,3 milliards d'euros, au lieu de 17,9 milliards d'euros.
L'amendement n° 634 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Le champ de cet article est circonscrit aux lentilles de contact et trouverait mieux sa place dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Je vous propose donc de le supprimer.
L'amendement n° 635 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 636 apporte des modifications rédactionnelles et vise à réduire de six mois à trois mois le délai dans lequel est rendu le rapport avant le terme de l'expérimentation, afin de laisser au dispositif le temps de faire ses preuves avant l'établissement de son bilan.
L'amendement n° 636 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - En cohérence avec la position constante de la commission, le présent amendement tend à supprimer une demande de rapport.
L'amendement n° 637 est adopté.
Article 19
L'amendement rédactionnel n° 638 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 639 prévoit que la liste des pathologies éligibles aux parcours d'accompagnement préventif soit fixée par décret après avis de la HAS.
L'amendement n° 639 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - La création des parcours d'accompagnement préventif s'inspire d'une recommandation formulée par la Cnam, qui préconisait notamment d'impliquer le médecin traitant dans cet accompagnement. Or, l'article ne l'évoque pas. Cet amendement n° 640 vise donc à introduire le rôle du médecin traitant dans l'accompagnement du patient et le suivi du parcours.
Je précise qu'un patient dépourvu de médecin traitant pourra être orienté vers un parcours d'accompagnement.
L'amendement n° 640 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 19 prévoit que la décision de l'assurance maladie concernant la prise en charge du parcours d'accompagnement préventif est notifiée à l'assuré et à son médecin traitant. Or le parcours d'accompagnement préventif pourrait tout à fait être prescrit par un autre médecin, par exemple un spécialiste : il importe donc que la décision de l'assurance maladie soit notifiée, le cas échéant, au médecin prescripteur.
L'amendement n° 641 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 642 prévoit, dans un souci de clarté, de renvoyer à un arrêté ministériel la liste des actes et prestations pris en charge.
L'amendement n° 642 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Cet article concerne la question de l'obligation vaccinale, qui ne se pose donc pas dans les mêmes termes pour les professionnels de santé et pour les résidents des Ehpad, même s'il s'agit d'un public vulnérable.
Je vous propose de supprimer ces dispositions et d'ajouter une mention relative à la promotion de la vaccination dans le contrat de séjour des résidents. En effet, si je suis favorable à la vaccination des résidents - le taux de couverture est proche de 83 % -, aucune conséquence concrète ne pourrait être tirée d'un refus de vaccination. Faisons donc la promotion de la vaccination pour les familles dans le contrat de séjour.
M. Martin Lévrier. - Ce contrat ne pourrait-il pas mentionner le fait que la vaccination est obligatoire ?
L'amendement n° 643 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel n° 644.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 20 bis vise à donner la possibilité au médecin de conserver des vaccins contre la grippe dans son cabinet. Je propose de le supprimer pour des raisons liées au respect du circuit pharmaceutique. Tous les médicaments injectés, à l'exception des vaccins contre le covid et la grippe, doivent obligatoirement être prescrits médicalement, ce qui génère, au-delà de la chaîne du froid, des contraintes en termes de suivi des lots et de sérialisation.
M. Bernard Jomier. - Tous les vaccins ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - J'ai bien précisé qu'elle n'était pas nécessaire pour le covid et la grippe.
M. Bernard Jomier. - Cette question de la simplification des circuits de soins est ancienne et ne doit pas être balayée.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Je l'entends, mais je souhaite que les mêmes conditions s'appliquent à tous. De réels enjeux logistiques sont en jeu.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Les médecins ne peuvent pas vacciner des patients auxquels ils rappellent pourtant l'importance de se protéger, et un certain nombre de patients ne vont pas au bout de la démarche si la vaccination n'est pas immédiate. Ne pourrions-nous pas préciser qu'une exception est permise pour certains vaccins, dont celui contre la grippe ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - La vaccination contre la grippe est déjà ouverte à d'autres professions, à commencer par les infirmiers et les pharmaciens. La diminution du taux de couverture l'an passé découle d'une mauvaise communication de la part de l'assurance maladie, les patients ayant compris qu'ils devaient impérativement être vaccinés contre le covid en même temps que contre la grippe. L'information étant désormais bien plus claire, la campagne de vaccination a démarré de manière plus dynamique.
Une fois encore, tous les acteurs doivent être soumis aux mêmes règles.
L'amendement n° 645 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 20 ter concerne tous les vaccins. Nous proposons de le supprimer.
L'amendement n° 646 est adopté.
Article 20 quater
L'amendement rédactionnel n° 647 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Cet article est déjà satisfait par la législation en vigueur. Nous proposons de le supprimer.
L'amendement n° 648 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Je vous soumets un amendement de sécurisation visant à prévoir explicitement que la quatrième région incluse dans le dispositif soit une région des outre-mer. Telle était l'intention des auteurs de l'amendement à l'Assemblée nationale, mais ils ont omis de le préciser.
L'amendement n° 649 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 650 a pour objet de supprimer cet article prévoyant une demande de rapport.
L'amendement n° 650 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 651 vise également à supprimer une demande de rapport.
L'amendement n° 651 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 652 tend aussi à supprimer une demande de rapport.
L'amendement n° 652 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement de suppression n° 653 concerne une demande de rapport.
L'amendement n° 653 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Les rapports sur la question certes prioritaire de l'accès à la santé des enfants au sein de la protection de l'enfance ne manquent pas. L'amendement n° 654 tend à supprimer cet article.
L'amendement n° 654 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 655 prévoit d'introduire une mesure adoptée par le Sénat en mai 2025 lors de l'examen de la proposition de loi visant à améliorer l'offre de soins dans les territoires présentée par Philippe Mouiller.
Il est ainsi proposé d'autoriser une modulation des rémunérations versées aux médecins exerçant dans les zones sous-denses, tenant compte de la part de la patientèle prise en charge dans ces zones et, donc, de la part d'activité que les praticiens y réalisent. Ces rémunérations modulées seraient négociées dans le cadre du dialogue conventionnel avec l'assurance maladie. Elles ne comporteraient pas de ticket modérateur pouvant rester à la charge du patient lorsque celui-ci n'est pas couvert par une complémentaire santé.
En parallèle, il est proposé de supprimer les alinéas correspondant à la création d'un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA). Ce dispositif, qui aurait vocation à cibler certaines zones prioritaires, s'accompagnerait d'une rémunération incitative sur laquelle l'article n'apporte aucune précision, alors qu'elle est déterminante pour juger de l'attractivité du nouveau contrat.
Le dispositif s'ajouterait aux dispositifs d'aide à l'installation déjà existants, alors que l'enjeu réside plutôt dans la simplification du paysage des aides à l'installation. De plus, il semble en partie faire doublon avec le dispositif des assistants universitaires de médecine générale (AUMG), qui vise à soutenir la médecine de premier recours dans les territoires en tension, à renforcer la filière universitaire de médecine générale et à élaborer des projets de soins territoriaux.
M. Dominique Théophile. - Les autres alinéas de l'article 21 sont-ils maintenus, par exemple son alinéa 18 ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement prévoit de supprimer les alinéas 10 à 20.
M. Dominique Théophile. - Prenons garde à ne pas supprimer des dispositions très importantes pour les départements et les régions d'outre-mer.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Ce qui est proposé ici concerne aussi les outre-mer.
M. Dominique Théophile. - Pas de la même manière.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Au printemps dernier, le Gouvernement s'était saisi de la proposition de loi de Philippe Mouiller pour faire une annonce politique. Je vais néanmoins approfondir la question de la situation des outre-mer.
L'amendement n° 655 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 21 prévoit par ailleurs d'autoriser la création d'une officine de pharmacie dans les communes de moins 2 500 habitants quand précédemment une officine y a fermé. Dans semblable cas de figure, on peut évidemment s'interroger sur les raisons - elles peuvent être multiples - de la fermeture de la première officine ; on ne perdra cependant pas non plus de vue les enjeux d'approvisionnement en médicaments dans certains territoires.
Une expérimentation, engagée à l'été 2024, concerne déjà la création d'antennes de pharmacie. Je regrette qu'elle soit limitée à six régions, avec un maximum de deux antennes par région.
Je vous propose donc, avec l'amendement n° 656, de réajuster le dispositif envisagé par le Gouvernement pour autoriser, à compter du 1er janvier 2027, l'ouverture, par des pharmaciens titulaires d'une officine, dans des communes limitrophes ou proches géographiquement d'antennes d'officines, dans la limite d'une antenne par officine, plutôt que d'autoriser l'ouverture de nouvelles officines.
Mme Véronique Guillotin. - Vous substituez donc la création d'antennes de pharmacie à celle d'officines de pharmacie ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - C'est bien cela. Au lieu de créer une officine, on créerait une antenne d'officine. Ce dispositif nous semble préférable.
M. Martin Lévrier. - Pourquoi ne pas laisser aux pharmaciens la liberté de choisir de créer l'une ou l'autre ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Tous, dans vos départements respectifs, avez été sollicités sur la situation économique des officines de pharmacie. Interrogeons-nous sur les raisons de leurs fermetures. Elles sont le plus souvent d'ordre économique ou tiennent à des départs à la retraite sans repreneur.
La proposition que je vous soumets n'est pas parfaite et peut-être ne réglera-t-elle que quelques situations. Mais comment croire qu'un pharmacien crée une officine avec une perspective de chiffre d'affaires relativement faible dans une commune où la précédente officine a fermé ? En quelques années, nous sommes passés de 25 000 à 20 000 officines en France. Il importe aussi de souligner que, à une époque où le rapport au travail a changé, les conditions d'exercice sont par surcroît exigeantes, car une pharmacie qui est le seul établissement de son genre dans une commune n'a pas le droit de fermer plus de 72 heures de suite.
Pour les communes de moins de 2 500 habitants, je préfère le système plus souple des antennes qui n'en assurera pas moins l'approvisionnement en médicaments des territoires isolés. Limiter le nombre de ces antennes à une par pharmacie permettra d'éviter les tentatives de financiarisation et de concentration.
L'amendement n° 656 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. -L'amendement n° 657 concerne les structures spécialisées en soins non programmés. Le Sénat avait adopté l'an dernier un article visant à encadrer l'activité de ces structures. La rédaction retenue avait fait l'objet d'un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Il est donc opportun de proposer une nouvelle rédaction du texte. En outre, l'amendement prévoit de supprimer les gages financiers, que l'Assemblée nationale a insérés, mais qui n'apparaissent plus nécessaires.
L'amendement n° 657 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 658 a pour objet de repousser au 1er janvier 2027, au lieu du 1er juin 2026 - un terme qui ne paraît pas raisonnable -, l'échéance de la négociation d'un avenant à la convention médicale sur les conditions de rémunération des soins non programmés.
L'amendement n° 658 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 659 tend à supprimer les dispositions relatives au réseau France Santé. Il ne s'agit pas de s'y opposer par principe, mais, sur la méthode, le nouveau dispositif mériterait que l'on y consacre quelque temps de présentation, de discussion et d'explications, afin de ne pas monter les professionnels les uns contre les autres et de ne pas détruire l'existant.
M. Alain Milon, président. - Et nous pourrions employer autrement les importants crédits qui lui sont affectés...
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - À ce titre, le Gouvernement annonce que 5 000 structures bénéficieraient de la nouvelle labellisation et obtiendraient alors chacune 50 000 euros, ce qui représente un total de 250 millions d'euros, et non pas seulement 130 ou 150 millions d'euros.
L'amendement n° 659 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Suivant les conclusions du récent rapport de la Cour des comptes sur les aides à l'installation des médecins, je propose la suppression de deux dispositifs : le contrat de début d'exercice (CDE) et l'aide correspondant à la prise en charge de cotisations sociales, qui n'ont jamais apporté la preuve de leur efficacité.
L'amendement n° 660 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'élargissement des compétences des orthoprothésistes, podo-orthésistes et des orthopédistes-orthésistes ne libérera utilement du temps médical qu'à condition que les professionnels adhèrent à ces évolutions et se les approprient pleinement. L'amendement n° 661 vise à les y associer.
L'amendement n° 661 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Il est indispensable que soit renforcé l'encadrement de la médecine esthétique, dont la pratique est l'objet de dérives bien documentées. Le Gouvernement et le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) ont engagé des travaux en ce sens, avec la volonté manifeste d'aboutir rapidement. Le Cnom a d'ailleurs déjà procédé à la reconnaissance d'un diplôme interuniversitaire pour exercer en médecine esthétique. Aussi l'ajout au PLFSS 2026 introduit dans ce domaine par l'Assemblée nationale paraît-il prématuré. L'amendement n° 662 prévoit de le supprimer.
L'amendement n° 662 est adopté.
Article 21 octies
L'amendement rédactionnel n° 663 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'efficacité de la mesure qui prévoit la désignation d'équipes de soins traitantes est douteuse, dès lors que l'accès aux médecins s'avère problématique.
Encourager l'exercice coordonné, favoriser l'installation des médecins dans les territoires peu denses, poursuivre le déploiement d'antennes pharmaceutiques sur le tout territoire : telles sont les priorités à soutenir pour améliorer l'accès aux soins. En revanche, ajouter une expérimentation qui nuirait à la lisibilité de l'organisation de l'offre n'apparaît pas opportun. Il vous est proposé de supprimer cet article.
L'amendement n° 664 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Quoiqu'il faille reconnaître les difficultés soulevées par les modalités actuelles de tarification de l'activité libérale au sein des établissements publics de santé, je vous propose de supprimer cet article, parce que ces établissements connaissent aujourd'hui une situation financière particulièrement dégradée et font face, avec l'Ondam, à un sous-financement chronique. Supprimer le remboursement des tarifs hospitaliers afférents à la prestation de radiothérapie, lorsque celle-ci est accomplie par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale, ne pourra qu'accroître leurs difficultés.
M. Alain Milon, président. - La demande de suppression de l'article a été formulée tant par la Fédération hospitalière de France (FHF) que par Unicancer.
L'amendement n° 665 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Le constat est le même cette fois-ci pour tout le champ de la tarification de l'activité libérale à l'hôpital. Je vous propose donc de supprimer également cet article.
L'amendement n° 666 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Avec l'amendement n° 667, je vous propose de reporter non de deux ans, mais d'un an seulement, au 1er janvier 2027, l'entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique.
M. Martin Lévrier. - Une telle décision ne risque-t-elle pas de grever l'Ondam ?
Mme Raymonde Poncet Monge. - Non, car nous savons déjà que le coût qui en résultera pour l'hôpital ne sera pas compensé. Là réside d'ailleurs le véritable problème.
M. Alain Milon, président. - Les établissements publics devront en effet participer pour partie au financement de la PSC comme ceux du secteur privé et ils n'obtiendront aucune compensation pour cela, à l'instar de ce qui s'est passé avec les accords issus du Ségur de la santé.
L'amendement n° 667 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 669 supprime la dérogation au principe conventionnel prévue pour la détermination du prix des forfaits techniques en imagerie.
L'amendement n° 669 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 670 prévoit de supprimer la possibilité pour le directeur de l'Uncam de baisser unilatéralement les tarifs des actes et prestations en cas de rentabilité excessive. En revanche, il vise à conserver et à renforcer la mise en oeuvre d'un mécanisme d'identification de ce type de situations.
L'amendement n° 670 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 24 prévoit pour 2027 l'extension au secteur libéral de la réforme des financements de la radiothérapie déjà engagée pour les établissements de santé. Cette réforme souhaitée par les professionnels permettra de mieux adapter la tarification des activités du secteur à l'évolution des technologies et de la prise en charge des patients. Il apparaît essentiel de procéder à une harmonisation de cette tarification entre les établissements et les cabinets.
Concernant les établissements de santé, je regrette une nouvelle fois que les conditions de mise en oeuvre de la réforme à l'horizon 2026 ne semblent toujours pas réunies. Je souligne l'importance de la mise en oeuvre concomitante de la réforme dans les établissements de santé et en secteur libéral, afin d'éviter les distorsions de tarifs, et je souhaite reporter sa mise en oeuvre au 1er janvier 2027.
Il ne serait donc pas pertinent de soumettre les secteurs de la radiothérapie et de la dialyse à des baisses de tarifs unilatérales en 2026 alors même que ces secteurs sont pleinement engagés dans une profonde réforme de leurs modalités de financement.
L'amendement n° 668 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 671 est un amendement de suppression destiné, de même, à éviter que des décisions de baisses de tarifs ne soient prises unilatéralement.
L'amendement n° 671 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Le secteur des soins dentaires ne semble aujourd'hui pas comporter de risques d'augmentation non maîtrisée des dépenses. L'amendement n° 672 a donc pour objet la suppression de dispositions qui semblent exagérées. Il ne remet cependant pas en cause le mécanisme de supervision de la rentabilité excessive prévu à l'article 24 du PLFSS.
L'amendement n° 672 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Pour les mêmes raisons, je vous propose un amendement de suppression de cet article concernant le secteur de l'ophtalmologie.
L'amendement n° 673 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 674 vise à supprimer le déremboursement des prescriptions des praticiens de secteur 3 introduit à l'Assemblée nationale. À mon sens, un tel déremboursement desservirait les patients.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Il n'existe néanmoins aucune possibilité de fixer des objectifs aux praticiens du secteur 3 qui sont non conventionnés. Aussi semble-t-il quelque peu paradoxal de les autoriser à prescrire comme ils l'entendent et de laisser ce secteur sans la moindre régulation.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Il s'agit avant toute chose de protéger les patients qui consultent les médecins de secteur 3 et je ne suis du reste pas sûre qu'ils consomment plus de médicaments que d'autres.
M. Alain Milon, président. - Quel que soit le secteur d'exercice, la surprescription n'a guère de sens d'un point de vue médical, d'autant que la HAS encadre précisément les traitements.
L'amendement n° 674 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Alors qu'une révision d'ampleur de la nomenclature des actes médicaux est en cours, l'article 26 ter prévoit la fixation des tarifs par voie réglementaire, si leur inscription dans la nomenclature n'est pas traduite dans la convention médicale dans un délai de six mois après la fin de l'évaluation technique. Il introduit une contrainte excessive et fera peser une pression inutile sur le déroulement des discussions.
Je considère que les tarifs des actes médicaux relèvent par nature de la négociation conventionnelle et vous propose un amendement de suppression.
L'amendement n° 675 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 676 prévoit la suppression de l'article pour les mêmes raisons de préservation de la négociation conventionnelle.
L'amendement n° 676 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Je soutiens la mise en place d'un mécanisme global d'incitation à la pertinence et à l'efficience des activités au sein des établissements de santé.
J'estime indispensable de tenir compte, dans ce cadre, des caractéristiques du territoire de santé et de l'établissement. En effet, les spécificités sociales, économiques et sanitaires de la patientèle de l'établissement, sa taille ou le manque de partenaires locaux peuvent expliquer le volume de certains actes et affecter les résultats obtenus par l'établissement sans que les pratiques médicales soient en cause.
Il devra également être tenu compte des spécificités et des impératifs opérationnels des hôpitaux des armées, auxquels le Gouvernement prévoit d'appliquer ce dispositif.
M. Dominique Théophile. - Ne pouvons-nous pas prévoir un amendement spécifique qui tienne compte de l'organisation propre aux établissements de santé des territoires d'outre-mer ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Je vous laisserai y travailler...
M. Dominique Théophile. - Avec votre bienveillance au banc ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Tout dépendra de la rédaction que vous me proposerez, cher collègue !
L'amendement n° 677 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Le dispositif actuel d'incitation financière à l'amélioration de la qualité (Ifaq) des soins fait l'objet de nombreuses critiques de la part des acteurs hospitaliers. L'amendement n° 678 vise à ce que soient récompensés les établissements ayant atteint un haut niveau de qualité des soins, en prévoyant que l'intéressement financier repose au moins pour moitié sur le niveau de qualité atteint.
L'amendement n° 678 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Il convient d'évaluer les effets produits par les plafonds de rémunération fixés par l'arrêté du 5 septembre 2025 sur la maîtrise des dépenses et l'organisation des soins. Supprimer la condition d'écart significatif de rémunération introduirait une contrainte supplémentaire non justifiée. Les plafonds, déjà étendus et précis, couvrent l'ensemble des professions les plus problématiques.
L'amendement n° 679 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Cet article vise à plafonner la rémunération, par les établissements publics de santé, des praticiens contractuels recrutés en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice au même niveau que celle des praticiens contractuels recrutés pour des besoins ponctuels.
Un plafonnement uniforme risque d'accroître les difficultés de recrutement de ces établissements publics de santé. Je vous propose par conséquent de supprimer cet article.
L'amendement n° 680 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 681, qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles, tend à corriger des erreurs matérielles présentes dans le texte qui nous a été transmis.
En vertu du principe de favorabilité des prestations AT-MP sur les prestations maladie, il prévoit, en outre, que la durée maximale de versement des indemnités journalières correspondantes ne puisse en aucun cas être inférieure au plafond défini pour la branche maladie.
L'amendement n° 681 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 682 vise à supprimer le plafonnement, par la loi, de la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé habilités. Une telle mesure porte en effet une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de prescription et à l'accès aux soins au regard des objectifs poursuivis. J'appelle le Gouvernement à la confiance envers les professionnels de santé dans le cadre conventionnel.
M. Martin Lévrier. - La confiance n'exclut pas le contrôle.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Nous en sommes d'accord et je suis évidemment contre les arrêts de travail excessifs. Le problème tient précisément à ce que, dans sa rédaction actuelle, l'article 28 n'est pas opérationnel en la matière.
L'amendement n° 682 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 683 vise à prendre en compte, à deux autres endroits du code de la sécurité sociale, que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont également habilités à prescrire des arrêts de travail, dans la limite de leurs compétences professionnelles respectives.
L'amendement n° 683 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement de coordination n° 684 vise à maintenir la même définition pour l'incapacité temporaire en maladie et en AT-MP.
L'amendement n° 684 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 30 mentionne une stratégie ministérielle sans déterminer laquelle. Pour une meilleure clarté, l'amendement n° 685 vise à supprimer la première partie de phrase.
L'amendement n° 685 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 30 fixe plusieurs prérequis que devraient respecter les logiciels d'aide à la décision médicale pour pouvoir bénéficier d'un financement de l'assurance maladie.
Il semble utile de confier à la HAS le soin d'élaborer un référentiel permettant d'évaluer la pertinence de ces outils au regard des objectifs qu'ils visent et d'en faire une condition supplémentaire à l'allocation des financements. Tel est le sens de l'amendement n° 686.
L'amendement n° 686 est adopté.
Les amendements rédactionnels n° 687 et n° 688 sont adoptés.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 689 vise à prévoir que la durée maximale du financement alloué dans le cadre du présent article doit être fixée par décret.
L'amendement n° 689 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'article 31, qui prévoit de sanctionner tous les acteurs de santé en cas de non-utilisation du dossier médical partagé, s'inscrit dans une logique punitive.
Lors du dernier PLFSS, le Sénat avait adopté des mesures incitatives à l'utilisation du DMP par les professionnels de santé. Toutefois, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. N'adhérant pas à l'esprit de pénalisation des acteurs de santé, je vous propose, par l'amendement n° 690, de supprimer cet article.
L'accès au DMP soulève en outre des difficultés techniques. Il serait souhaitable de sanctionner aussi les éditeurs de logiciels, qui font parfois preuve de mauvaise volonté.
M. Alain Milon, président. - L'accès au DMP est effectivement très compliqué.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Les jeunes y recourent plus aisément.
M. Martin Lévrier. - Il faudrait imposer l'interopérabilité, assortie de sanctions le cas échéant. La bonne volonté ne suffit plus : le sujet du DMP est récurrent, et il est urgent d'avancer.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - De telles mesures risqueraient de sortir du champ du PLFSS et de faire l'objet d'une nouvelle censure...
M. Martin Lévrier. - Imposer l'interopérabilité aux éditeurs de logiciels n'aurait pas d'incidence budgétaire.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Certes, mais, de ce fait, cela relève-t-il d'une LFSS ? Sur le principe, je suis d'accord avec vous : on a beaucoup financé les éditeurs de logiciels ; pourtant, au-delà de l'interopérabilité entre structures, le système peine à évoluer. Certains acteurs n'ont pas la capacité nécessaire et jouent la montre. Je privilégie l'incitation à la sanction.
L'amendement n° 690 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - La possibilité de céder à des établissements publics de santé ou médicosociaux des masques issus du stock stratégique de l'État avant leur péremption est une mesure de bonne gestion.
Toutefois, il ne paraît pas inutile de sécuriser les conditions de ces cessions pour s'assurer qu'elles ne conduisent pas à une diminution, même provisoire, du stock de l'État, qui pourrait mettre sous tension le système de santé en cas de survenue d'une situation d'urgence ou de crise sanitaire. D'où cet amendement n° 691.
L'amendement n° 691 est adopté.
Article 33
L'amendement rédactionnel n° 692 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Afin de favoriser la pénétration en France des médicaments biologiques similaires et de contribuer à la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie, l'amendement n° 693 vise à favoriser leur substitution. Pour ce faire, il prévoit de ramener de un an à six mois le délai d'inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables.
M. Alain Milon, président. - Surtout en ville.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Exactement ! C'est en ville que se pose principalement le problème.
L'amendement n° 693 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - La restriction prévue dans le texte est excessive, car elle crée des périodes où aucun dispositif d'accès dérogatoire n'est ouvert. L'amendement n° 694 vise donc à maintenir l'accès précoce post-AMM (autorisation de mise sur le marché) pour les médicaments n'ayant pas encore reçu d'avis de la Commission de la transparence. Il s'agit de garantir aux patients le maintien d'un accès direct à l'innovation.
M. Alain Milon, président. - Cette mesure est extrêmement importante pour les patients atteints de pathologies graves.
L'amendement n° 694 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 695 vise à rétablir la prise en charge partielle, par la sécurité sociale, de la période de continuité des traitements.
L'amendement n° 695 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 696 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 697 tend à préciser que l'existence de raisons sérieuses de craindre pour la sécurité des patients fait obstacle à toute autorisation d'accès compassionnel, y compris au titre d'une poursuite de traitement.
M. Alain Milon, président. - Cet amendement mérite d'être explicité.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'objectif est d'assurer la sécurité des patients. Si l'AMM a été retirée pour cette raison, le traitement peut être interrompu.
M. Alain Milon, président. - Même si le traitement est efficace chez le patient ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Les raisons de sécurité l'emporteraient sur l'accès compassionnel.
M. Alain Milon, président. - Il s'agit de patients qui n'ont plus d'autre option thérapeutique.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - La question est de savoir s'il faut maintenir le traitement malgré le retrait de l'AMM pour des raisons de sécurité.
M. Martin Lévrier. - Que devient le patient si le médicament lui est retiré ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - En d'autres termes, faut-il continuer à administrer le médicament ou exiger une décharge ?
Mme Raymonde Poncet Monge. - Il faudrait préciser « les raisons sérieuses relatives à la sécurité ». Le retrait de l'AMM est plus clair.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - C'est déjà prévu dans le texte. Je retravaillerai mon argumentation d'ici à la séance.
L'amendement n° 697 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 698 vise à s'opposer à des baisses tarifaires sur des produits de santé fondées sur des tarifs extraeuropéens.
L'amendement n° 698 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 699 vise à s'opposer à la fourniture à titre gracieux des médicaments bénéficiant d'un accès précoce au-delà de la troisième année. En effet, pour certains médicaments immatures, il peut être justifié que l'accès précoce dure trois ans ou plus, dans la mesure où l'industriel ne maîtrise pas les délais au terme desquels le médicament bénéficiera d'une AMM et d'une évaluation par la Commission de la transparence.
Pour ne pas pénaliser les patients, nous proposons que la sécurité sociale prenne encore en charge la moitié du prix du médicament dans pareille situation.
L'amendement n° 699 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 700 vise à corriger une erreur matérielle.
L'amendement n° 700 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 701 vise à supprimer l'article 35, qui prévoit de mettre en place, à titre expérimental, une procédure de référencement sélectif par le CEPS de certains groupes de médicaments substituables ou jugés équivalents sur le plan thérapeutique. Cette procédure dérogatoire risque d'accroître les risques de pénurie et d'aboutir à une augmentation des prix, en raison du monopole détenu par quelques laboratoires.
L'amendement n° 701 est adopté.
Article 36
L'amendement rédactionnel n° 702 est adopté.
Article 37
L'amendement rédactionnel n° 703 est adopté.
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. - L'amendement n° 704 vise à modifier les modalités de répartition de l'aide de la CNSA aux départements, en tenant compte du nombre de personnels concernés par la prime Ségur plutôt que du nombre de places.
L'amendement n° 704 est adopté.
Mme Chantal Deseyne, rapporteur. - L'amendement n° 705 vise à supprimer l'article 38.
L'amendement n° 705 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur, en remplacement de Mme Marie-Pierre Richer. - L'amendement n° 706 prévoit de soumettre à l'avis des partenaires sociaux représentatifs à l'échelle nationale le décret en Conseil d'État qui serait chargé, en application du présent article, de déterminer les modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies.
L'amendement n° 706 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur, en remplacement de Mme Marie-Pierre Richer. - L'amendement n° 707 vise à encadrer le champ du décret en Conseil d'État relatif aux modalités générales d'établissement du diagnostic des pathologies figurant sur les tableaux de maladies professionnelles, pour préciser que celui-ci doit tenir compte des données acquises de la science.
Il s'agit là de ne pas laisser carte blanche au Gouvernement dans la définition des modalités de diagnostic.
L'amendement n° 707 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur, en remplacement de Mme Marie-Pierre Richer. - L'amendement n° 708 vise à trouver un compromis en maintenant la compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour tous les dossiers visés par l'alinéa 6, sauf ceux qui ne sont relatifs qu'à une méconnaissance du délai de prise en charge. Ces derniers, qui représentent 45 % du flux de dossiers de l'alinéa 6, nécessitent une moindre expertise médicale et seraient traités par un binôme de médecins-conseils. Ils sont déjà, dans les faits, traités à la chaîne par la plupart des CRRMP.
En cela, cet amendement tire les conséquences de l'engorgement prévisible des CRRMP si rien n'est fait, tout en maintenant autant que faire se peut la qualité et la pluridisciplinarité de l'instruction des dossiers.
L'amendement n° 708 est adopté.
Article 41
L'amendement rédactionnel n° 709 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement n° 710 vise à abroger l'article 27 de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, car l'expérimentation du mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est terminée et le mécanisme a été pérennisé.
L'amendement n° 710 est adopté.
Article 42
L'amendement de coordination n° 711 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Le droit aux congés concerne également les agents stagiaires de l'État. L'amendement n° 712 vise à préciser que sont concernés les fonctionnaires civils ou les magistrats.
L'amendement n° 712 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement n° 713 vise à supprimer la possibilité pour les parents de fractionner leur droit à congé supplémentaire de naissance. Cette disposition, introduite par les députés, serait très complexe à mettre en oeuvre pour les administrations et les entreprises. Il tend à supprimer également l'obligation faite aux parents de prendre au moins un mois de congé supplémentaire de naissance de façon non simultanée.
L'amendement n° 713 est adopté.
M. Olivier Henno, rapporteur. - L'amendement n° 714 vise à modifier la date d'entrée en vigueur de la réforme du congé supplémentaire de naissance, que le Gouvernement avait fixée au 1er juillet 2027. L'Assemblée nationale l'a avancée au 1er janvier 2026, ce qui ne nous semble absolument pas réaliste. Nous proposons la date du 1er janvier 2027.
L'amendement n° 714 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. - L'amendement n° 715 vise à réintroduire l'article 44, supprimé par l'Assemblée nationale. Nous entendons rétablir le gel du montant des prestations sociales et des pensions de retraite pour 2026, à l'exception toutefois de l'AAH et des pensions de retraite inférieures à 1 400 euros.
M. Martin Lévrier. - Vous vous souvenez sans doute du mouvement des « gilets jaunes » ... Le relèvement de la CSG sur les pensions de retraite supérieures à 2 000 euros nets figurait alors parmi les sujets qui avaient mis le feu aux poudres. Le seuil de 1 400 euros est tout de même très faible.
L'amendement n° 715 est adopté.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. - l'amendement n° 716 vise à supprimer l'article 45 bis, introduit par la lettre rectificative du 23 octobre dernier, qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023.
L'amendement n° 716 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - Conformément au souhait formulé par notre commission, l'article 47 retrace précisément les dotations reçues par les douze opérateurs financés par l'assurance maladie. Nous souhaitons que ces opérateurs participent à l'effort collectif et nous proposons en conséquence de ramener toutes leurs dotations au niveau de 2025. Cela se traduirait par une hausse des crédits pour sept d'entre eux, et par une baisse pour cinq d'entre eux. Tel est l'objet de l'amendement n° 717.
Je m'interroge en particulier sur le montant très élevé de la dotation attribuée à l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), qui pourrait atteindre 225 millions d'euros en 2026, alors même qu'un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) a pointé les manquements de cette agence.
L'amendement n° 717 est adopté.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. - L'amendement n° 718 tend à supprimer l'article 49, qui fixe l'Ondam. Je m'en suis expliqué précédemment.
L'amendement n° 718 est adopté.
La commission propose au Sénat d'adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sous réserve de l'adoption de ses amendements.
TABLEAU DES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
|
Auteur |
N° |
Objet |
|
Article liminaire (Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
585 |
Rétablissement de l'article dans sa rédaction initiale |
|
Article 1er
(Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
586 |
Rétablissement de l'article dans sa rédaction initiale |
|
Article 2 (Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
587 |
Fixation de l'Ondam 2025 |
|
Article 3 (Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
719 |
Rectification de la dotation au Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) |
|
Article 4 |
||
|
Mme DOINEAU |
588 |
Garantie de la communication des privilèges de la sécurité sociale aux tribunaux de commerce. |
|
Article 5 |
||
|
Mme DOINEAU |
589 |
Suppression de la détermination par la loi du nom de la future association agréée pour la protection sociale des artistes-auteurs. |
|
Mme DOINEAU |
590 |
Suppression des élections professionnelles pour les artistes-auteurs en précisant les nouvelles modalités de nomination de leurs représentants. |
|
Article 5 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
591 |
Suppression de l'article |
|
Article
5 ter |
||
|
Mme DOINEAU |
592 |
Suppression de l'article. |
|
Article 5 quater |
||
|
Mme DOINEAU |
593 |
Suppression de l'article. |
|
Article 6 (Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
594 |
Rétablissement de l'article, avec limitation du gel du barème à 2026 |
|
Article 6 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
595 |
Suppression de l'article |
|
Article 6 ter |
||
|
Mme DOINEAU |
596 |
Suppression de l'article |
|
Article 7 (Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
597 |
Rétablissement de la contribution exceptionnelle pour les complémentaires santé à un taux de 2,05 % |
|
Article 7 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
598 |
Suppression de l'article |
|
Article 7 ter |
||
|
Mme DOINEAU |
599 |
Suppression du taux réduits de taxe solidarité additionnelle sur les contrats de complémentaire santé des retraités des régimes agricoles |
|
Article
8 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
600 |
Amendement de précision |
|
Article 8 ter |
||
|
Mme DOINEAU |
601 |
Suppression de la pérennisation de la niche |
|
Article 8 sexies |
||
|
Mme DOINEAU |
602 |
Suppression de l'article |
|
Article 8 octies |
||
|
Mme DOINEAU |
603 |
Suppression de l'article |
|
Article 9 |
||
|
Mme DOINEAU |
604 |
Rétablissement du dispositif de restriction de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. |
|
Mme DOINEAU |
605 |
Rétablissement du dispositif de suppression de l'exonération de cotisations sociales pour les apprentis. |
|
Article 9 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
606 |
Suppression de l'article. |
|
Article 9 quater |
||
|
Mme DOINEAU |
607 |
Suppression de l'article. |
|
Article
9 quinquies |
||
|
Mme DOINEAU |
608 |
Suppression de l'article. |
|
Article 9 sexies |
||
|
Mme DOINEAU |
609 |
Suppression de l'article. |
|
Article
9 septies |
||
|
Mme DOINEAU |
610 |
Suppression de l'article. |
|
Article 10 |
||
|
Mme DOINEAU |
611 |
Suppression de la contribution supplémentaire sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques |
|
Mme DOINEAU |
613 |
Fixation des montants Z et M pour l'année 2026 |
|
Mme DOINEAU |
614 |
Plafonnement de la prise en compte des génériques dans le calcul de la clause de sauvegarde |
|
Mme DOINEAU |
612 |
Suppression d'une mesure de validation législative |
|
Article 10 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
615 |
Suppression de l'article |
|
Article 10 ter |
||
|
Mme DOINEAU |
616 |
Suppression de l'article |
|
Article 11 |
||
|
Mme DOINEAU |
617 |
Correction d'une erreur de référence |
|
Mme DOINEAU |
618 |
Suppression de l'obligation de diffusion d'informations relevant du secret des affaires |
|
Article 11 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
619 |
Taxation des boissons alcoolisées énergisantes |
|
Article 11 quater |
||
|
Mme DOINEAU |
620 |
Amendement rédactionnel |
|
Article 11 septies |
||
|
Mme DOINEAU |
621 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 |
||
|
Mme DOINEAU |
622 |
Suppression des transferts de recettes entre branches résultant du transfert au Gouvernement par l'art. 40 du PLF du gain de la réforme des allégements généraux |
|
Mme DOINEAU |
623 |
Amendement rédactionnel |
|
Mme DOINEAU |
624 |
Suppression de la disposition permettant le transfert à la Cnav de l'excédent éventuel des opérations de la Cnieg relatives à la CTA |
|
Article 12 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
625 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 ter |
||
|
Mme DOINEAU |
626 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 quater |
||
|
Mme DOINEAU |
627 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 septies |
||
|
Mme DOINEAU |
628 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 octies |
||
|
Mme DOINEAU |
629 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 nonies |
||
|
Mme DOINEAU |
630 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 decies |
||
|
Mme DOINEAU |
631 |
Suppression de l'article |
|
Article 12 undecies |
||
|
Mme DOINEAU |
632 |
Suppression de l'article |
|
Article 16 bis |
||
|
Mme DOINEAU |
633 |
Suppression de l'article |
|
Article 17 (Supprimé) |
||
|
Mme DOINEAU |
634 |
Rétablissement de l'article et du rapport annexé, dans une rédaction modifiée |
|
Article 18 bis |
||
|
Mme IMBERT |
635 |
Suppression de l'article |
|
Article
18 ter |
||
|
Mme IMBERT |
636 |
Allongement du délai de communication du rapport sur l'expérimentation |
|
Article 18 quater |
||
|
Mme IMBERT |
637 |
Suppression de la demande de rapport sur le forfait patient urgences |
|
Article 19 |
||
|
Mme IMBERT |
638 |
Amendement rédactionnel |
|
Mme IMBERT |
639 |
Définition de la liste des pathologies éligibles aux parcours préventifs par un décret après avis de la HAS |
|
Mme IMBERT |
640 |
Définition du rôle du médecin traitant dans le suivi du parcours d'accompagnement préventif |
|
Mme IMBERT |
641 |
Ajout du médecin prescripteur parmi les destinataires de la décision de prise en charge des parcours d'accompagnement préventif |
|
Mme IMBERT |
642 |
Renvoi à un arrêté la liste des actes et prestations pris en charge dans le cadre des parcours d'accompagnement préventif |
|
Article 20 |
||
|
Mme IMBERT |
643 |
Suppression de l'obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad |
|
Mme IMBERT |
644 |
Rédactionnel |
|
Article 20 bis |
||
|
Mme IMBERT |
645 |
Suppression de l'article |
|
Article 20 ter |
||
|
Mme IMBERT |
646 |
Suppression de l'article |
|
Article 20 quater |
||
|
Mme IMBERT |
647 |
Rédactionnel |
|
Article 20 quinquies |
||
|
Mme IMBERT |
648 |
Suppression de l'article |
|
Article
20 septies |
||
|
Mme IMBERT |
649 |
Inclusion dans le champ de l'expérimentation d'une région régie par l'article 73 de la Constitution |
|
Article 20 octies |
||
|
Mme IMBERT |
650 |
Suppression de l'article |
|
Article 20 nonies |
||
|
Mme IMBERT |
651 |
Suppression de l'article |
|
Article 20 decies |
||
|
Mme IMBERT |
652 |
Suppression de l'article |
|
Article 20 undecies |
||
|
Mme IMBERT |
653 |
Suppression de l'article |
|
Article 20 duodecies |
||
|
Mme IMBERT |
654 |
Suppression de l'article. |
|
Article 21 |
||
|
Mme IMBERT |
655 |
Création de possibilités de rémunérations forfaitaires modulées des médecins exerçant en zones sous-denses |
|
Mme IMBERT |
657 |
Régulation des conditions de fonctionnement des structures spécialisées en soins non programmés |
|
Mme IMBERT |
658 |
Extension de la durée de renégociation des conditions de rémunération des soins non programmés |
|
Mme IMBERT |
656 |
Ouverture d'antennes d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2500 habitants |
|
Article 21 bis |
||
|
Mme IMBERT |
659 |
Suppression du label France Santé |
|
Article 21 quater |
||
|
Mme IMBERT |
660 |
Suppression d'exonérations sociales pour l'installation des médecins et report d'un an de la suppression des contrats de début d'exercice |
|
Article 21 sexies |
||
|
Mme IMBERT |
661 |
Recueil de l'avis des professionnels de santé concernés et d'instances scientifiques |
|
Article 21 septies |
||
|
Mme IMBERT |
662 |
Suppression de l'encadrement de l'activité de médecine esthétique |
|
Article
21 octies |
||
|
Mme IMBERT |
663 |
Insertion des dispositions relatives au service du contrôle médical des régimes agricoles dans le code rural et de la pêche maritime |
|
Article
21 decies |
||
|
Mme IMBERT |
664 |
Suppression de l'article |
|
Article 22 bis |
||
|
Mme IMBERT |
665 |
Suppression de l'article |
|
Article 22 ter |
||
|
Mme IMBERT |
666 |
Suppression de l'article |
|
Article 23 (Supprimé) |
||
|
Mme IMBERT |
667 |
Décalage d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière |
|
Article 24 |
||
|
Mme IMBERT |
669 |
Suppression des nouvelles modalités de fixation des prix des forfaits techniques |
|
Mme IMBERT |
670 |
Suppression du pouvoir décision unilatérale de baisse des tarifs lorsqu'une rentabilité excessive est constatée dans un secteur |
|
Mme IMBERT |
668 |
Report de l'entrée en vigueur de la réforme de la tarification de la radiothérapie et dialyse dans les établissements de santé et suppression des baisses de tarifs sur 2026 |
|
Article 24 bis |
||
|
Mme IMBERT |
671 |
Suppression de l'article |
|
Article 25 |
||
|
Mme IMBERT |
672 |
Suppression de l'article |
|
Article 25 bis |
||
|
Mme IMBERT |
673 |
Suppression de l'article |
|
Article
26 bis |
||
|
Mme IMBERT |
674 |
Suppression de l'article |
|
Article 26 ter |
||
|
Mme IMBERT |
675 |
Suppression de l'article |
|
Article 26 quater |
||
|
Mme IMBERT |
676 |
Suppression de l'article |
|
Article 27 |
||
|
Mme IMBERT |
677 |
Prise en compte des caractéristiques du territoire de santé et de l'établissement dans le cadre du mécanisme d'incitation à l'efficience et la pertinence |
|
Mme IMBERT |
678 |
Précision de certains indicateurs de qualité et sécurité des soins et de la pondération globale |
|
Article 27 bis |
||
|
Mme IMBERT |
679 |
Suppression de l'article |
|
Article 27 ter |
||
|
Mme IMBERT |
680 |
Suppression de l'article |
|
Article 28 |
||
|
Mme IMBERT |
681 |
Application du principe de favorabilité des prestations AT-MP concernant la durée maximale de versement des indemnités journalières |
|
Mme IMBERT |
682 |
Suppression de la limitation de la durée des primo-prescriptions et des renouvellements d'arrêts de travail |
|
Mme IMBERT |
683 |
Prise en compte de la possibilité pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes de prescrire des arrêts de travail dans la limite de leur compétence professionnelle |
|
Article 28 ter |
||
|
Mme IMBERT |
684 |
Fixation de la même définition de l'incapacité pour les arrêts de travail maladie et AT-MP |
|
Article 30 |
||
|
Mme IMBERT |
685 |
Précision rédactionnelle |
|
Mme IMBERT |
686 |
Prise en compte d'un référentiel de pertinence établi par la HAS pour allouer un financement |
|
Mme IMBERT |
687 |
Rédactionnel |
|
Mme IMBERT |
688 |
Rédactionnel |
|
Mme IMBERT |
689 |
Encadrement par décret de la durée maximale du financement alloué |
|
Article 31 |
||
|
Mme IMBERT |
690 |
Suppression de l'article |
|
Article 32 |
||
|
Mme IMBERT |
691 |
Sécurisation des conditions de cession des masques de l'État à titre gratuit |
|
Article 33 |
||
|
Mme IMBERT |
692 |
Rédactionnel |
|
Mme IMBERT |
693 |
Réduction du délai d'inscription automatique des médicaments biosimilaires sur la liste des biosimilaires substituables |
|
Article 34 |
||
|
Mme IMBERT |
694 |
Extension du champ de l'accès précoce post-AMM |
|
Mme IMBERT |
700 |
Alignement des conditions de prise en charge et de fixation des tarifs sur l'accès précoce pré-AMM |
|
Mme IMBERT |
696 |
Rédactionnel |
|
Mme IMBERT |
695 |
Prise en charge partielle par l'assurance maladie des continuités de traitements sur l'accès précoce |
|
Mme IMBERT |
697 |
Impossibilité de maintenir une autorisation d'accès compassionnel en cas de risque sérieux sur la sécurité des patients |
|
Mme IMBERT |
698 |
Suppression de l'ouverture de la liste des pays retenus pour la tarification des produits de santé à des pays extra-européens |
|
Mme IMBERT |
699 |
Fourniture du médicament à prix réduit après trois ans d'accès précoce |
|
Article 35 |
||
|
Mme IMBERT |
701 |
Suppression de l'article |
|
Article 36 |
||
|
Mme DESEYNE |
702 |
Rédactionnel |
|
Article 37 |
||
|
Mme DESEYNE |
703 |
Amendement rédactionnel |
|
Mme DESEYNE |
704 |
Répartition de l'aide de la CNSA en fonction de la masse salariale |
|
Article 38 |
||
|
Mme DESEYNE |
705 |
Suppression de l'article |
|
Article 39 |
||
|
Mme RICHER |
706 |
Soumission à avis des partenaires sociaux du décret en Conseil d'État déterminant les modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies professionnelles inscrites sur un tableau |
|
Mme RICHER |
707 |
Prise en compte des données acquises de la science dans les modalités d'établissement du diagnostic des pathologies figurant sur les tableaux de maladies professionnelles |
|
Mme RICHER |
708 |
Restriction aux seuls dossiers de l'alinéa 6 relatifs à la non-vérification du délai en prise en charge prévu sur le tableau de l'instruction par un binôme de médecins conseils |
|
Article 41 |
||
|
M. HENNO |
709 |
Rédactionnel |
|
M. HENNO |
710 |
Rédactionnel. |
|
Article 42 |
||
|
M. HENNO |
711 |
Rédactionnel |
|
M. HENNO |
712 |
Extension du congé supplémentaire de naissance aux agents stagiaires de l'État. |
|
M. HENNO |
713 |
Suppression de la possibilité de fractionner le congé supplémentaire de naissance ainsi que de l'obligation faite aux parents de le prendre de façon non simultanée durant au moins un mois. |
|
M. HENNO |
714 |
Décalage de la date d'entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance. |
|
Article 44 (Supprimé) |
||
|
Mme GRUNY |
715 |
Réintroduction du gel des prestations sociales et des pensions de retraite supérieures à 1400 euros, à l'exception de l'AAH |
|
Article 45 bis |
||
|
Mme GRUNY |
716 |
Suppression de l'article |
|
Article 47 |
||
|
Mme IMBERT |
717 |
Gel des dotations aux opérateurs financés par le 6e sous-objectif de l'Ondam |
|
Article 49 |
||
|
Mme IMBERT |
718 |
Suppression de l'article |
* 1 Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été supprimé au 1er janvier 2026 par l'article 24 de la LFSS pour 2025.
* 2 Voir notamment la proposition de loi organique n° 492 (2020-2021) tendant à renforcer le pilotage financier de la sécurité sociale et à garantir la soutenabilité des comptes sociaux de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et le rapport du Sénat n° 825 (2020-2021) sur la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
* 3 Amendements n° 1633 du groupe Rassemblement national et n° 1808 du groupe La France insoumise.
* 4 Les notions d'effort structurel et d'effort structurel sont explicitées dans le tome I du présent rapport.
* 5 Le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a publié le 18 juin un avis dans lequel il estime qu'il existe un « risque sérieux » que l'Ondam dépasse l'objectif fixé par la LFSS d'au moins 0,5 %, soit 1,3 milliard d'euros (le total des risques évoqués par le comité d'alerte étant toutefois supérieur à ce montant). Le 23 juin 2025, la Cnam et la MSA ont transmis au Gouvernement une proposition de mesures, pour un montant total de 1,7 milliard d'euros. Le 25 juin 2025, le Gouvernement a annoncé des mesures quasiment identiques, également pour un montant de 1,7 milliard d'euros. Dans son avis du 17 septembre 2025, le comité d'alerte, suggère que les mesures annoncées par le Gouvernement (qu'il évalue à 1,5 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros pour le Gouvernement) pourraient ne pas complètement suffire à respecter l'Ondam.
* 6 Amendements n° 1639 du groupe Rassemblement national et n° 789 du groupe La France insoumise.
* 7 Avis du Comité d'alerte n° 2025-1 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 15 avril 2025.
* 8 Article D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale.
* 9 Avis du Comité d'alerte n° 2025-2 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 18 juin 2025.
* 10 Article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 11 Ce seuil, fixé par décret, était initialement fixé à 0,75% et a été progressivement abaissé.
* 12 Article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 13 En tenant compte de la provision pour dépréciations sur créances portées sur la clause de sauvegarde 2024.
* 14 En tenant compte de la provision pour dépréciations sur créances portées sur la clause de sauvegarde 2024.
* 15 Avis du Comité d'alerte n° 2025-3 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 17 septembre 2025.
* 16 Avis du Comité d'alerte n° 2025-4 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 4 novembre 2025.
* 17 Cour des comptes, La situation financière de la sécurité sociale. Une perspective fragile en 2026, une impasse de financement préoccupante, novembre 2025.
* 18 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 19 Réponses du ministère de la santé .
* 20 Les sûretés désignent les garanties que la convention, la loi ou le juge accordent au créancier pour le recouvrement de sa créance.
* 21 L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'articule avec l'article D. 626-10 du code de commerce qui prévoit que les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal. Les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement est laissée à l'appréciation de la CCSF.
* 22 Réponse de l'Urssaf au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 23 Réponse de la direction de la sécurité sociale au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 24 Réponse de l'Acoss au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 25 Ibid.
* 26 Ibid.
* 27 Ibid.
* 28 Ibid.
* 29 Article L. 624-1 du code de commerce.
* 30 Article L. 622-24 du code de commerce.
* 31 Réponse de l'Acoss au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 32 Évaluation préalable du présent article.
* 33 Par exemple, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou la commission nationale des taxes aéronautiques.
* 34 Le recours devant les commissions de recours amiable des Urssaf n'a pas d'effet suspensif sur le recouvrement, à l'inverse des recours en matière fiscale, justifiant ainsi ce léger désalignement.
* 35 Article L. 8221-1 du code du travail.
* 36 Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificatives pour 1991.
* 37 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 38 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 39 Article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale.
* 40 Article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale.
* 41 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, tome II (n° 99, 2023-2024).
* 42 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 43 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 44 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 45 Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 46 Compte rendu des débats de la seconde séance publique du mardi 4 novembre 2025 de l'Assemblée nationale.
* 47 Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.
* 48 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 49 Réponse de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de la création artistique au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 50 Inspection générale des affaires sociales, inspection générale des affaires culturelles, L'unification des régimes de sécurité sociale des artistes-auteurs et la consolidation du régime, juin 2013.
* 51 Ibid.
* 52 Ibid.
* 53 Ibid.
* 54 Réponse de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de la création artistique au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 55 Ibid. La croissance des cotisations demeure inférieure à la croissance de la population en raison de la faiblesse du niveau moyen des revenus artistiques.
* 56 Ibid.
* 57 Ibid.
* 58 Ibid.
* 59 Ibid.
* 60 Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs, janvier 2025.
* 61 Ibid.
* 62 Ibid.
* 63 Ibid.
* 64 Ibid.
* 65 Ibid.
* 66 Ibid.
* 67 Réponse de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de la création artistique au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 68 Ibid.
* 69 Ibid.
* 70 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 sur le financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 71 Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs, janvier 2025.
* 72 Ibid.
* 73 Ibid.
* 74 Arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du conseil d'administration de l'organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
* 75 Inspection générale des affaires sociales, inspection générale des affaires culturelles, L'unification des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs et consolidation du régime, juin 2013.
* 76 Conseil d'État, 9 / 7 SSR, du 17 avril 1992, 82308, à propos d'une artiste-peintre : « qu'ainsi, et en dépit de la modicité des recettes effectivement tirée de son activité artistique, elle devait être regardée comme ayant exercé cette dernière en vue d'obtenir un revenu ; que, dès lors, ladite activité présentait le caractère d'une activité professionnelle au nombre de celles visées au 2°) du I de l'article 156 du code général des impôts ».
* 77 Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs, janvier 2025.
* 78 Ibid.
* 79 Cour des comptes, La sécurité sociale des artistes-auteurs, janvier 2025.
* 80 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 81 Extraits du 2° du I de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* 82 Le décret vise la modification des articles R. 382-1 à R. 382-37 du code de la sécurité sociale et devrait être élaboré à compter du premier trimestre 2026.
* 83 Amendement n° 2474.
* 84 Amendement n° 1945.
* 85 Amendement n° 1905.
* 86 Amendement n° 2563.
* 87 Amendement n° 2563.
* 88 Précédemment l'article L. 732-22 du code rural et de la pêche maritime.
* 89 Article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.
* 90 Visant respectivement à clarifier la distinction entre les baux à métayage en espèce ou en nature (n° 1017) et à prévoir qu'un bail à métayage dans lequel le bailleur ne participe pas à l'exploitation permet la conservation du cumul emploi-retraite (n° 722). L'amendement n° 1017 a été retiré et l'amendement n° 722 est tombé du fait de l'adoption de l'amendement n° 721.
* 91 « La rémunération en nature, a fortiori en espèces, doit-elle être soumise à une obligation de cotisation ? C'est la position du gouvernement. Nous ne souhaitons pas en exempter les bailleurs à métayage, qui touchent bien un revenu, et doivent ainsi contribuer à la protection sociale du monde agricole. Cela doit faire consensus.
La MSA doit-elle pour autant -? c'est votre préoccupation, monsieur le député de Courson - priver de retraite ceux qui ne s'acquitteraient pas de ces cotisations ? Je n'ai pas connaissance de cette décision ni de cette jurisprudence et de son fondement. Nous sommes en revanche prêts, avec Jean-Pierre Farandou, à faire le point avec la MSA. Nous verrons alors s'il est nécessaire de sécuriser, au cours de la navette parlementaire, une forme spécifique de cumul emploi-retraite. Les cotisations additionnelles dont ces retraités doivent s'acquitter ont vocation, en toute logique, à leur ouvrir des droits additionnels » (Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 5 novembre 2025).
* 92 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
* 93 Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles.
* 94 Articles 3 et 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 95 Amendement identique aux amendements n° 1312, n° 1768 et n° 2340.
* 96 Selon les projections de l'article 52 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le déficit de la branche vieillesse s'élève en 2025 à 6,3 milliards d'euros.
* 97 Celle-ci a été mise en oeuvre par le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les taux de cotisations seront de 34,65 % en 2025, de 37,65 % en 2026, de 40,65 % en 2027 et de 43,65 % en 2028.
* 98 Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
* 99 L'article L. 2242-1 du code du travail dispose que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
* 100 Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social.
* 101 Compte rendu des débats de la première séance publique du mercredi 5 novembre 2025 de l'Assemblée nationale.
* 102 Article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
* 103 Source : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025.
* 104 Le revenu fiscal de référence est défini par le IV de l'article 1417 du code général des impôts.
* 105 Amendements n° 122 de M. Guedj, n° 128 de Mme Lebon, n° 310 de M. Davi, n° 853 de Mme Mélin, n° 873 de M. Wauquiez, n° 1350 de M. Colombani, n° 1814 de Mme Amiot, n° 1892 de M. Ciotti, n° 2280 de M. Berger.
* 106 Amendements n° 127 de Jérôme Guedj, n° 131 de Yannick Monnet, n° 1817 d'Élise Leboucher.
* 107 Cette explicitation porte sur l'amendement n° 1020 de Jérôme Guedj, non adopté mais d'inspiration analogue à celle des trois amendements adoptés.
* 108 Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020.
* 109 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 110 « Le Haut Conseil souhaite souligner ici que, au regard de son rendement et de sa logique, la CSG doit demeurer une ressource essentielle de la sécurité sociale ; il souhaite toutefois ajouter que le caractère équitable du prélèvement peut être encore renforcé, certains revenus étant moins taxés que d'autres et qu'une progressivité plus forte peut être introduite, en majorant certains taux, notamment ceux pesant sur les revenus du patrimoine. »
* 111 Amendement n° 159 de Mme Rossi.
* 112 En application du 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
* 113 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 114 Données pour 2023.
* 115 La hausse des cotisations en fonction de l'âge n'est en effet pas toujours proportionnelle à la hausse des prestations versées par tranche d'âge, notamment chez certaines mutuelles.
* 116 Article L. 871-4 du code de la sécurité sociale.
* 117 Notamment les pénalités de résiliation.
* 118 Outre l'exemple figurant dans le commentaire, sont exemptés les contrats agricoles et relevant du 1° de l'article 998 du code général des impôts portant des garanties de versement des indemnités journalières complémentaires.
* 119 Voir infra.
* 120 Il est à noter que certaines institutions de prévoyance relèvent du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
* 121 93,6 % pour les contrats responsables et solidaires classiques, et 2,8 % pour les contrats responsables et solidaires agricoles.
* 122 Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
* 123 Articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
* 124 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 125 À l'exception des frais liés aux soins thermaux, aux médicaments servant à traiter des pathologies sans caractère habituel de gravité ou à faible service médical rendu et aux spécialités homéopathiques, en application de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
* 126 II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 127 Pour les contrats agricoles, l'écart de TSA entre les contrats solidaires et responsables et les contrats qui ne respectent pas ces caractéristiques est même de 14 points.
* 128 Les contrats IJ agricoles et « 1° de l'article 998 du CGI » sont exonérés.
* 129 Il s'agit plutôt stricto sensu de contrats solidaires, la notion de responsabilité ne trouvant pas à s'appliquer pour ces contrats.
* 130 La Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) a annoncé, pour cette année, des hausses de cotisation à hauteur de 8,1 %. Les données définitives restent à consolider.
* 131 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
* 132 Article 27 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
* 133 Article 190 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
* 134 Article 21 de la loi du 31 janvier 1944.
* 135 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
* 136 Article 991 et suivants du code général des impôts.
* 137 Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
* 138 Article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales unique pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurances.
* 139 En cas de méconnaissance des obligations de déclaration et de versement, une majoration pouvant aller jusqu'à 0,2 % peut s'appliquer.
* 140 Article L. 862-3 du code de la sécurité sociale.
* 141 Article L. 815-26 du code de la sécurité sociale.
* 142 Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
* 143 Dans le détail, en application du 8° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rendement de la TSA est affectée au fonds de financement de la complémentaire santé solidaire sur tous les types de contrat, sauf pour les classiques responsables ou non - qui représentent 96,5 % des cotisations versées en 2022. Pour ces derniers contrats, le montant de TSA affecté au fonds est déterminé ex post afin d'équilibrer le résultat financier du fonds.
* 144 8° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
* 145 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 146 Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
* 147 En application des articles L. 861-1 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale.
* 148 En application de l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
* 149 Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
* 150 Non soumises à la TSA en application de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
* 151 Article 15.4.1 de l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie signée le 25 août 2016.
* 152 En vertu du 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
* 153 Article 17 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 154 Article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale. À la différence de la TSA, les cotisations de prévoyance relatives aux IJ complémentaires ne figurent donc pas dans l'assiette de cette taxe.
* 155 Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, conclue le 4 juin 2024 et arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 156 Article 21-1 de la convention médicale conclue le 4 juin 2024.
* 157 Article 21-3 de la convention médicale conclue le 4 juin 2024.
* 158 Sauf pour les patients hors ALD âgés de 7 à 74 ans et les patients n'ayant pas consulté leur médecin traitant depuis deux années ou plus.
* 159 Voir infra.
* 160 Article 10 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
* 161 Article 3 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
* 162 Marie-Claire Carrère-Gée (présidente) et Xavier Iacovelli (rapporteur), Hausse des tarifs des complémentaires santé : l'impact sur le pouvoir d'achat des Français, rapport d'information n° 770 (2023-2024), mission d'information sur les complémentaires santé, 24 septembre 2024.
* 163 La Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) a annoncé, pour cette année, des hausses de cotisation à hauteur de 8,1 %. Les données définitives restent à consolider.
* 164 Réponses écrites de la FNMF au questionnaire de la rapporteure générale.
* 165 Une telle structure ne figurait pas dans le projet déposé.
* 166 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 167 Réponses écrites du CTip au questionnaire de la rapporteure générale.
* 168 Dans le champ de la CSBM.
* 169 Réponses écrites de la FNMF au questionnaire de la rapporteure générale.
* 170 Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du 6 novembre 2025.
* 171 « La mesure que vous proposez est irrecevable dans le cadre d'un PLFSS » (Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du 6 novembre 2025).
* 172 Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 173 « Ces amendements prévoient effectivement des exonérations trop larges. Je rejoins le rapporteur général sur la nécessité de lutter contre la financiarisation. Encore faut-il prendre soin de bien la définir, afin de ne pas y inclure des secteurs qui n'en relèvent pas. Vous avez entamé un travail en ce sens et nous sommes à vos côtés pour le poursuivre. J'espère que nous pourrons examiner des amendements qui se rapportent à cette question dans la troisième partie du PLFSS.
Je rappelle aussi qu'un travail a été lancé avec les pharmaciens pour revoir toute la chaîne de valeur et le modèle économique des pharmacies d'officine. Avis défavorable » (Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du 6 novembre 2025).
* 174 Une fois déduites des charges du fonds les participations versées au titre de la complémentaire santé solidaire avec participation (C2SP).
* 175 Article L. 862-3 du code de la sécurité sociale pour le fonds de financement de la complémentaire santé solidaire et article L. 815-26 du même code pour le fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
* 176 Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
* 177 Article L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
* 178 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 179 À l'exception des frais liés aux soins thermaux, aux médicaments servant à traiter des pathologies sans caractère habituel de gravité ou à faible service médical rendu et aux spécialités homéopathiques, en application de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
* 180 II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Se référer au commentaire de l'article 18 pour davantage de détails sur les participations forfaitaires et franchises.
* 181 III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Se référer au commentaire de l'article 18 pour davantage de détails sur les participations forfaitaires et franchises.
* 182 Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
* 183 Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
* 184 Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
* 185 Il s'agit plutôt stricto sensu de contrats solidaires, la notion de responsabilité ne trouvant pas à s'appliquer pour ces contrats.
* 186 Marie-Claire Carrère-Gée (présidente) et M. Iacovelli (rapporteur), Hausse des tarifs des complémentaires santé : l'impact sur le pouvoir d'achat des Français, rapport d'information n° 770 (2023-2024), mission d'information sur les complémentaires santé, 24 septembre 2024.
* 187 Soit un montant proche du montant moyen des primes versées par un assuré de 75 ans, qui atteignait 127 euros en 2021.
* 188 Il est fait l'hypothèse que le taux de TSA moyen chez les retraités concernés est égal au taux de TSA classique solidaire et responsable, qui représente plus de 93 % du marché.
* 189 C'est-à-dire après prise en compte des taxes compensatoires éventuelles, comme le forfait social.
* 190 Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 191 Cet encadré est issu de : Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 192 Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 193 L'annexe 4 au PLFSS pour 2024, utilisé par la Cour des comptes, évaluait pour 2022 les exemptions d'assiette à 14,5 milliards d'euros (contre 13,3 milliards d'euros selon le Placss 2024, utilisé pour le présent rapport) et l'exonération des heures supplémentaires (part salariale) à 2,2 milliards d'euros. La Cour des comptes ajoute à ces montants ses estimations de la prime de partage de la valeur (1 milliard d'euros) et des remboursements des frais de transport domicile-travail (0,3 milliard d'euros). Le total de l'agrégat retenu par la Cour est donc de 18 milliards d'euros en 2022.
* 194 Hors participation aux frais de transport (pour laquelle la commission ne dispose pas des données antérieures à 2023).
* 195 Chèque emploi service universel.
* 196 La participation de l'employeur aux titres restaurant de ses salariés est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 7,26 euros pour les titres émis en 2025.
* 197 Article 81 du code général des impôts.
* 198 Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 199 L'article L. 411-9 du code du tourisme et le 5° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les excluent des cotisations sociales, mais pas de la CSG et de la CRDS.
* 200 Selon l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, sauf disposition contraire, seuls sont soumis au forfait social les revenus d'activité assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations sociales.
* 201 Instruction relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales.
* 202 Désormais comité social et économique (CSE).
* 203 Selon l'article R. 2312-35 du même code, les ASC peuvent consister en des institutions sociales de prévoyance et d'entraide (institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels...), des activités sociales et culturelles (cantines, coopératives de consommation, logements, jardins familiaux, crèches, colonies de vacances...), des activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive, des institutions d'ordre professionnel ou éducatif (centres d'apprentissage et de formation professionnelle, bibliothèques, cercles d'études, cours de culture générale...), des services sociaux, le service de santé au travail.
* 204 L'exclusion de l'assiette de la CSG figure également au c du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 205 Son 1° est une disposition de coordination avec le remplacement de la contribution spécifique de 30 % applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite par un forfait social au taux de 40 % (cf. supra).
* 206 Selon l'annexe 4 au PLFSS, le montant de l'assiette exemptée au titre des aides directes serait de 13,1 milliards d'euros en 2023, 13,7 milliards d'euros en 2024, 14,2 milliards d'euros en 2025 et 14,8 milliards d'euros en 2026 (avant mesures du PLFSS).
* 207 En particulier, le contrat de travail peut contenir une clause prévoyant que l'employeur fournit un titre restaurant pour chaque jour de travail, et fixant la valeur faciale des titres restaurant et la part prise en charge par l'employeur.
* 208 Comme cela résulte du tableau figurant page 30 de l'annexe 4 au PLFSS.
* 209 Si l'employeur prend en charge le taux maximal, de 60 %.
* 210 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 211 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
* 212 Proposition de loi de Guillaume Kasbarian, Sylvain Maillard, Jean-Paul Mattei et Laurent Marcangeli.
* 213 Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables.
* 214 Proposition de loi des députés Anne-Laure Blin, Jean-Pierre Taite et Pierre Cordier.
* 215 Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire.
* 216 Amendement n° 2290.
* 217 La ministre a alors évoqué les travaux en cours pour mettre en oeuvre la réforme visant à instaurer une assiette sociale « super brute », votée l'année précédente.
* 218 « Pour l'amendement n° 2290, dont la rédaction garde l'idée d'une expérimentation, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. On pourra le retravailler au Sénat mais l'écriture proposée est intéressante » (Assemblée nationale, deuxième séance du jeudi 6 novembre 2025).
* 219 Amendement n° 2289.
* 220 Amendement n° I-1877 rectifié ter.
* 221 17,2 % pour la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, et 12,8 % pour l'impôt sur le revenu. Les dispositions actuelles de l'article 6 bis du présent PLFSS pourraient alourdir le taux de cette CSG de 44 points.
* 222 Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 223 Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
* 224 Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
* 225 Article L. 137-42 du code de la sécurité sociale.
* 226 « Mme la présidente. - La parole est à M. Paul Midy, pour soutenir l'amendement n° 2289.
M. Paul Midy. - Il concerne le partage de la valeur et vise à clarifier le régime des « management packages », qui permettent d'aligner les ambitions de l'entreprise et de son management. Afin d'éviter de pénaliser les entreprises, l'amendement propose de pérenniser le volet social du dispositif existant.
Mme la présidente. - Quel est l'avis de la commission ?
M. Thibault Bazin, rapporteur général. - Vous êtes bien plus expert en la matière que moi. Le régime en question a été créé par la loi de finances pour 2025 ; il s'agit donc presque d'un amendement de coordination. L'amendement n'a pas été examiné par la commission mais à titre personnel, j'y suis favorable.
Mme la présidente. - Quel est l'avis du gouvernement ?
M. Jean-Pierre Farandou, ministre. - Un travail de clarification a, en effet, été mené l'année dernière ; vous le confirmez par cet amendement en contrôlant cette niche fiscale -? on peut présenter la mesure ainsi. Tout cela va dans le bon sens. Avis favorable. » (Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance du jeudi 6 novembre 2025).
* 227 Amendements n° 67 (rect.) de Julien Dive, n° 1508 (rect.) de Lionel Vuibert, n° 1926 (rect.) de David Taupiac.
* 228 Sous-amendement n° 2633.
* 229 Amendements n° 77 de Julien Dive, n° 1507 de Lionel Vuibert et n° 1925 de David Taupiac.
* 230 « La clarification est bienvenue, notamment dans le domaine forestier. Elle répond à des attentes légitimes, pour un coût limité -? il s'agit davantage d'une mesure de simplification que d'une mesure budgétaire. » (Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance du 6 novembre 2025).
* 231 Amendement n° 1353.
* 232 Amendement n° 879.
* 233 Amendement n° 2283.
* 234 Source : annexe 4 au présent PLFSS.
* 235 Source : annexe 4 au présent PLFSS.
* 236 Source : fascicule « Voies et moyens », tome 2, annexé au PLF 2026.
* 237 Article 7 de la LFSS pour 2019.
* 238 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 239 Amendements n° 135 de Corentin Le Fur et n° 878 de Laurent Wauquiez.
* 240 Amendements n° 618 de Laurent Wauquiez et n° 922 de Fabien Di Filippo.
* 241 Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du samedi 25 octobre 2025.
* 242 Assemblée nationale, compte rendu de la troisième séance du jeudi 6 novembre 2025.
* 243 « Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, mais je souhaite alors que nous travaillions dans le cadre de la navette parlementaire afin d'aboutir à la meilleure disposition, tout en veillant à la cohérence entre les mesures qui seront votées dans le cadre du PLF et celles qui le seront dans celui du PLFSS » (Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du samedi 25 octobre 2025).
* 244 « Je tiens toutefois à faire savoir à la représentation nationale que cet avis [de sagesse] est lié à mon souhait de procéder à un recalibrage au cours de la navette, ou de revenir sur la mesure fiscale votée dans le PLF » (Assemblée nationale, compte rendu de la troisième séance du jeudi 6 novembre 2025).
* 245 « Cette disposition [celle proposée par le présent article] me semble plus efficace que celle votée dans le cadre du PLF, qui consiste à supprimer le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, fixé à 7 500 euros. Je rappelle qu'en moyenne, les cadres perçoivent environ 3 000 euros par an au titre des heures supplémentaires. Par conséquent, la suppression du plafond ne me semble profiter qu'à des cadres dirigeants dont le contrat permet la rémunération d'heures de travail au-delà de leur forfait jours » (Assemblée nationale, compte rendu de la troisième séance du jeudi 6 novembre 2025).
* 246 Amendement n° 91.
* 247 « Je m'engage à ce que la direction de l'Acoss, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous l'égide de son directeur général, fasse un point spécifique avec les parlementaires ultramarins au sujet des problèmes que vous évoquez -? cela me semble plus utile à court terme - et je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée sur cette demande de rapport » (Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du vendredi 7 novembre 2025).
* 248 Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 prévoyant diverses mesures en faveur des chômeurs indemnisés créant ou reprenant une entreprise.
* 249 Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.
* 250 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 251 Projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, annexe 2, déposé sur le bureau de la présidence du Sénat le 11 juin 2025.
* 252 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 253 Hors exploitants agricoles (13 166 en 2024).
* 254 Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Revue de dépenses sur les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques, annexe 2, juin 2015.
* 255 Réponse de la direction de la sécurité sociale au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 256 Ibid.
* 257 Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024.
* 258 Ibid.
* 259 Ibid.
* 260 Hors Île-de-France.
* 261 Hors Île-de-France.
* 262 Hors Île-de-France.
* 263 Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, novembre 2024.
* 264 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ; en l'état actuel du texte, le dispositif de la Lopom n'est pas modifié par l'article 9.
* 265 Ce maintien résulte d'une disposition de l'article 18 de la LFSS pour 2025 introduite à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat.
* 266 L'article D. 752-7 du code de la sécurité sociale dispose que « les projets innovants sont des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan des caractéristiques et de l'usage auquel il est destiné ».
* 267 Article 199 undecies B du code général des impôts.
* 268 Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, annexe 1, novembre 2024.
* 269 Ibid.
* 270 Ibid.
* 271 Ibid.
* 272 Article L. 6222-27 du code du travail.
* 273 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 274 Dares, « L'insertion professionnelle des apprentis de niveau CAP à BTS », mars 2023.
* 275 Insee, 13 octobre 2025.
* 276Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Revue des dépenses publiques d'apprentissage et de formation professionnelle, annexe 3, mars 2024.
* 277 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025.
* 278 La forte baisse entre 2018 et 2019 des cotisations exonérées est en lien avec la suppression de l'exonération spécifique de cotisations sociales patronales sur l'apprentissage par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 279 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
* 280 Insee, Portrait social de la France, novembre 2024.
* 281 Article 244 quater B et article 244 quater B bis du code général des impôts.
* 282 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 283 Article 1466 D du code général des impôts.
* 284 Article 1383 D du code général des impôts.
* 285 Manuel dit de Frascati.
* 286 Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante et modifié par le décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante.
* 287 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
* 288 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
* 289 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 290 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
* 291 Décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante.
* 292 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 293 Réponse de la direction générale des entreprises au questionnaire de la rapporteure générale en vue du présent projet de loi.
* 294 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 295 Décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d'enseignement supérieur pour l'application de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
* 296 Ibid.
* 297 Ibid.
* 298 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 299 Projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023, enregistré à la présidence du Sénat le 15 octobre 2024.
* 300 Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Revue de dépenses sur les exonérations et exemptions de charges sociales spécifiques, juin 2015.
* 301 Cour des comptes, Les dispositifs de soutien à la création d'entreprises, décembre 2012.
* 302 Institut national des statistiques et des études économiques, « Évaluation du dispositif Jeune entreprise innovante (JEI) Un exemple d'application du modèle d'analyse de sensibilité de Rosenbaum », 2021.
* 303 Article L. 5141-1 du code du travail.
* 304 À savoir les employeurs relevant du régime de droit commun prévu au III A de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les TPE de moins de 11 salariés tous secteurs confondus, les transporteurs aériens et maritimes mentionnés aux 3° et 4° du II du même article, les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics quel que soit leur effectif, ainsi que les entreprises de 250 salariés et plus ou réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et plus relevant des autres secteurs énumérés au 2° du II dudit article.
* 305 À savoir les employeurs relevant du régime dérogatoire prévu au III.B de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les PME de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires relevant des secteurs mentionnés au 2° du II du même article à l'exception du bâtiment et des travaux publics, des secteurs mentionnés au 5° du II en Guyane, ou bénéficiant du régime douanier de perfectionnement actif.
* 306 Étude d'impact du présent article.
* 307 Ibid.
* 308 Réponse de la direction de la sécurité sociale au questionnaire de la rapporteure générale.
* 309 La qualification des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, demeure inchangée.
* 310 Réponse de la direction générale des entreprises au questionnaire de la rapporteure générale, novembre 2025.
* 311 Étude d'impact du présent projet de loi.
* 312 Ibid.
* 313 Réponse de la direction générale des entreprises au questionnaire de la rapporteure générale.
* 314 Qui compense les allégements à la sécurité sociale.
* 315 Amendement n° 2159.
* 316 Amendement n° 55, identique aux amendements n° 57, n° 343, n° 350 et n° 811.
* 317 Amendement n° 54, identique aux amendements n° 353, n° 355, n° 384, n° 1301, n° 1824 et n° 2225.
* 318 Amendement n° 1691, identique à l'amendement n° 2326.
* 319 Sofiap (Société financière pour l'accession à la propriété) a été créée en 1921 par la SNCF pour aider les cheminots à accéder à la propriété. Depuis 2014, la Banque Postale est actionnaire majoritaire de Sofiap.
* 320 Identique aux amendements n° 1767 et n° 2051.
* 321 Article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
* 322 Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
* 323 Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
* 324 Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
* 325 Compte rendu de la deuxième séance publique du vendredi 7 novembre 2025 de l'Assemblée nationale.
* 326 Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
* 327 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 328 Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
* 329 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 330 Article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 331 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, (n° 344, 2024-2025).
* 332 Ibid.
* 333 Loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture.
* 334 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 335 Loi n° 2020 1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
* 336 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 337 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, (n° 344, 2024-2025).
* 338 Compte rendu des débats de la deuxième séance publique du vendredi 7 novembre 2025 de l'Assemblée nationale.
* 339 « M. Thibault Bazin, rapporteur général. - Je tiens à préciser le coût de cette mesure. L'extension du TODE à toutes les Etarf, que prévoyait l'amendement n° 361, aurait entraîné une perte de recettes de près de 18 millions d'euros. En ne ciblant que les ETF, elle ne serait plus que de 5 millions » (Assemblée nationale, compte tendu de la deuxième séance du vendredi 7 novembre 2025).
* 340 Assemblée nationale, rapport d'information n° 3702 relatif aux chambres d'agriculture et à leur financement, 16 décembre 2020.
* 341 Inspection générale des finances, inspection générale des affaires sociales, Évaluation des mesures d'exonérations de cotisations salariales spécifiques aux outre-mer, novembre 2024.
* 342 Mentionnées à l'article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime.
* 343 Mentionnées à l'article 7 et l'article L. 711-3 du code de commerce.
* 344 Compte rendu des débats de la deuxième séance publique de l'Assemblée nationale du 7 novembre 2025.
* 345 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
* 346 Article 137 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
* 347 Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, dite « loi Leroy ».
* 348 Communication C(2004) 43 de la Commission européenne.
* 349 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, (n° 344, 2024-2025).
* 350 Cour des comptes, L'établissement national des invalides de la marine, 2024.
* 351 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 352 Ibid.
* 353 Ibid.
* 354 Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* 355 Voir commentaire de l'article 11.
* 356 Comité économique des produits de santé.
* 357 Article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 358 Article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 359 Article L. 138-16 du code de la sécurité sociale.
* 360 Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.
* 361 Article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
* 362 En cours de validité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
* 363 Arrêté du 31 janvier 2022 fixant le barème prévu à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
* 364 Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
* 365 Article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 366 Comité économique des produits de santé, Rapport d'activité 2024.
* 367 Drees, Les dépenses de santé en 2024, Résultats des comptes de la santé, édition 2025.
* 368 Accord-cadre du 5 mars 2021 entre le Comité économique des produits de santé et Les entreprises du médicament.
* 369 Cf commentaire de l'article 11 du PLFSS 2026.
* 370 Annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* 371 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2025.
* 372 Dépenses dites « super nettes » c'est-à-dire déduites des remises et de la clause de sauvegarde reversées à l'assurance maladie.
* 373 La progression des remises médicaments a été de + 8,7 % en 2024 après environ 30 % en moyenne par an de 2016 (1,1 milliard d'euros) à 2023 (8,2 milliards d'euros).
* 374 Avis du Comité d'alerte n° 2025-1 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - 15 avril 2025.
* 375 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025.
* 376 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2025.
* 377 Sénat - Les validations législatives - Note de synthèse du service des études juridiques - 10 février 2006.
* 378 L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
* 379 L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
* 380 L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
* 381 L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale.
* 382 L. 162-16-5-1 code de la sécurité sociale.
* 383 L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale.
* 384 Article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 385 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025.
* 386 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2024.
* 387 Annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* 388 Amendement n°1388 présenté par Mme Pirès Beaune et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
* 389 Amendement n°777 présenté par Michel Lauzzana et plusieurs de ses collègues.
* 390 Article 14 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
* 391 Article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 392 Amendements n° 972 présenté par Mme Sylvie Bonnet et plusieurs de ses collègues, et 2177, présenté par Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues.
* 393 Article 29 de la loi.
* 394 Amendements identiques n° 407, présenté par Bertrand Bouyx, 2056, présenté par Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues et n° 2351, présenté par Michel Lauzzana et plusieurs de ses collègues.
* 395 L'article 35 de l'accord-cadre du 5 mars 2021 prévoit l'octroi d'avoirs sur remises pouvant venir en déduction de l'ensemble des remises dues à l'Assurance maladie : remises produits, remises d'accès dérogatoires, remises exonératoires de la clause de sauvegarde dues en cas de dépassement du montant M.
* 396 CEPS, rapport d'activité pour 2023, décembre 2024
* 397 Contrat visant à consentir des prix plus faibles au fur et à mesure du développement des volumes de ventes.
* 398 Versement du différentiel entre le prix facial et le prix net négocié dès la première unité vendue.
* 399 Article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 400 Article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
* 401 Article L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale.
* 402 CEPS, Rapport d'activité pour 2023, décembre 2024.
* 403 Comme les comptes de la sécurité sociale, ces montants sont exprimés en droits constatés (c'est-à-dire en rattachant les recettes à l'exercice où le droit correspondant est apparu, indépendamment de la date d'encaissement). Ainsi, ils ne prennent pas en compte le fait qu'en 2026, l'Acoss percevra, outre les remises au titre de 2025, les remises au titre de 2026, estimées à environ 8 milliards d'euros et qui devraient donc réduire son besoin de trésorerie de ce montant (cf. infra). Du fait du principe des droits constatés, cette modification du calendrier de versement n'a par elle-même pas d'impact sur les comptes de la sécurité sociale.
* 404 Amendement n°378 présenté par Hendrik Davi et plusieurs de ses collègues.
* 405 Les remises visées par la mesure devraient représenter environ 8,2 milliards d'euros en 2024 (remises produits et remises sur les dispositifs médicaux).
* 406 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023 2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
* 407 Ou boisson RTD, « ready to drink ».
* 408 Articles L. 3323-2 à L. 3323-6 du code de la santé publique.
* 409 Article 97 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST).
* 410 Article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997.
* 411 Article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et les services.
* 412 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024, p. 54.
* 413 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
* 414 Article 14 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 415 Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'État en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique.
* 416 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
* 417 Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les
programmes jeunesse de la télévision publique.
* 418 Article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.
* 419 Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), Les jeux d'argent et de hasard en France en 2024.
* 420 Article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure.
* 421 Article L. 320-14 du code de la sécurité intérieure.
* 422 Article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure.
* 423 Article D. 320-9 du code de la sécurité intérieure.
* 424 Article D. 320-10 du code de la sécurité intérieure.
* 425 Amendement n° 134.
* 426 III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
* 427 I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
* 428 Article L. 137-21 du code de la sécurité sociale.
* 429 Article L. 137-22 du code de la sécurité sociale.
* 430 Article L. 137-27 du code de la sécurité sociale.
* 431 Article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure.
* 432 Article L. 5124-17-2 du code de la santé publique.
* 433 Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu.
* 434 Avis de l'Autorité de la concurrence n° 19-A-08 du 4 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée.
* 435 Gaëlle Turan-Pelletier et Hayet Zeggar, La distribution en gros du médicament en ville, rapport n° 2014-004R3 de l'inspection générale des affaires sociales, juin 2014.
* 436 Décret n° 2023-1371 du 28 décembre 2023 modifiant les conditions de prise en charge et de distribution de certains médicaments nécessaires à la réalisation d'examens d'imagerie médicale.
* 437 Article R. 5124-43 du code de la santé publique.
* 438 Mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
* 439 Rapport n° 130 (2021-2022) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 par Mme Élisabeth Doineau, Mme Corinne Imbert, M. René-Paul Savary, M. Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller (commentaire de l'article 4).
* 440 Annexe au projet de loi de finances pour 2024, Évaluation des voies et moyens, Tome I.
* 441 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 5).
* 442 Arrêté du 22 août 2014 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
* 443 Arrêté du 6 mai 2025 fixant certains plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
* 444 Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
* 445 Communiqué du 24 septembre 2025.
* 446 CEPS, rapport d'activité provisoire pour 2024, octobre 2025.
* 447 Amendements identiques n° 5, présenté par Florence Buffet, 374, présenté par Sandrine Runel et les membres du groupe socialiste et apparentés, 472, présenté par Josiane Corneloup et plusieurs de ses collègues, 882, présenté par Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, 1164, présenté par Marcellin Nadeau et plusieurs de ses collègues, 1862, présenté par Joëlle Mélin et plusieurs de ses collègues, 1869, présenté par Guillaume Garot et plusieurs de ses collègues, et 2238, présenté Thibault Bazin, rapporteur général.
* 448 Selon le conseil national de l'ordre des pharmaciens au 1er janvier 2023, plus de 50 % des titulaires d'officine en France ont au moins 50 ans et la part des titulaires de plus de 60 ans a presque doublé en dix ans. Démographie des pharmaciens : panorama 2022.
* 449 Greenpeace France, Nos aliments contaminés à l'hexane, 2025.
* 450 R. Rubion, « Hexane : comment ce solvant dérivé du pétrole s'est-il retrouvé dans nos assiettes ? », National Geographic, octobre 2025.
* 451 Anses, Avis sur la valeur toxicologique de référence chronique par voie respiratoire pour le n-hexane, Rapport d'expertise collective, juillet 2014.
* 452 INRS, Fiche toxicologique synthétique n°113, Édition juin 2025.
* 453 Christian Cravotto, Anne-Sylvie Fabiano-Tixier, Ombéline Claux, Maryline Abert-Vian, Silvia Tabasso, Giancarlo Cravotto et Farid Chemat, Towards Substitution of Hexane as Extraction Solvent of Food Products and Ingredients with No Regrets, 28 octobre 2022.
* 454 EFSA, Technical Report on the need for re-evaluation of the safety of hexane used as an extraction solvent in the production of foodstuffs and food ingradients, 13 septembre 2024.
* 455 Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte).
* 456 Le Gouvernement pourra décider de manière quasi discrétionnaire de fixer le barème de la RGDU, la seule contrainte étant que le dispositif ne doit concerner que les salaires jusqu'à 3 Smic. Le décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 définit le barème de la RGDU à coût constant par rapport au barème de 2025, mais le Gouvernement a annoncé son intention de prendre d'ici la fin de l'année un second décret réalisant une économie supplémentaire de 1,4 milliard d'euros sur le périmètre de la sécurité sociale.
* 457 Et, de manière marginale, le Fonds national d'aide au logement (Fnal).
* 458 Rétrocession à la Cnam du gain réduction des niches sur les compléments de salaire ; rétrocession à l'État à compter de 2026 des économies sur les allégements généraux issus de la LFSS 2025 ; neutralisation des impacts par branche du nouveau dispositif RGDU issu de la LFSS 2025 ; rétrocession à l'État des gains de la mesure d'économie supplémentaire sur la RGDU à compter de 2026 ; prolongation du transfert de l'État à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d'État.
* 459 Cette neutralisation serait assurée par des transferts de taxe sur les salaires, de TSCA, de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS), de prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions).
* 460 Il existe également, en fonction du revenu du contribuable, un taux zéro, un taux réduit de 3,8 % et un taux médian à 6,6 %.
* 461 Le produit de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité au taux de 8,3 % affectée à la Cnaf peut être estimé à environ 1,9 milliard d'euros. En effet, selon les indications transmises par la DSS à la commission, le taux de 8,3 % sur les pensions de retraite et d'invalidité coûte 1,8 milliard d'euros par rapport à l'application du taux de 9,2 % applicable aux revenus d'activité. L'écart entre les deux taux, de 0,9 point, coûtant 1,8 milliard d'euros, un point de CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité coûte environ 2 milliards d'euros, ce qui correspond à des recettes globales de 8,3×216,6 milliards d'euros. Selon l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, la part actuellement affectée à la Cnaf est de 0,95 point, soit 0,95×21,9 milliard d'euros.
Selon le présent article, la part affectée à la branche famille passerait de 0,95 point à 0,3 point, ce qui correspondrait à un transfert d'environ 1,9/0,95×0,651,3 milliard d'euros.
* 462 Actuellement, le d de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Unédic perçoit 1,47 point de CSG sur « la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 » du code de la sécurité sociale. Le présent article propose de supprimer les mots « sur les revenus d'activité ».
* 463 Source : rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025.
* 464 Cette neutralisation serait assurée par des transferts de taxe sur les salaires, de TSCA, de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS), de prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions).
* 465 On rappelle que les attributions gratuites d'actions sont exemptées de cotisations patronales de sécurité sociale et ne sont soumises à la CSG et à la CRDS que sur les gains d'acquisition au-delà de 300 000 euros. En contrepartie, elles sont soumises à une contribution patronale, soumise à un régime spécifique, dont à l'initiative du Sénat le taux a été porté de 20 % à 30 % par la LFSS pour 2026. Les salariés paient en outre une contribution de 10 % au moment de la cession sur la fraction de la plus-value d'acquisition.
* 466 Sur le modèle de la rédaction actuelle, l'article L. 137-14 prévoirait qu'« il est institué, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution salariale de 10 %... » ; et l'article L. 137-18 que la contribution est « affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ».
* 467 Cette neutralisation serait assurée par des transferts de taxe sur les salaires, de TSCA, de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS), de prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions).
* 468 Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025, le prélèvement sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions, totalement affecté à la branche famille, serait de 1 669 millions d'euros en 2026 (à droit constant). L'application à ce montant de taux de 6,02 % et 93,98 % conduit à des transferts de respectivement 100 millions d'euros et 1 559 millions d'euros.
* 469 Cette neutralisation serait assurée par des transferts de taxe sur les salaires, de TSCA, de taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS), de prélèvements sur stock-options et attributions gratuites d'actions).
* 470 Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025, les contributions sur les paris et les jeux, totalement affectées à la branche famille, seraient de 462 millions d'euros en 2026 (à droit constant). L'application à ce montant d'un taux de 34 % conduit à un transfert de 157 millions d'euros.
* 471 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 18.
* 472 Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 473 L'article 18 de la LFSS pour 2020 a prévu que le taux de retenue pour frais de non-recouvrement soit plafonné au niveau du taux appliqué par la DGFiP dans le cadre des mécanismes existant dans la sphère fiscale, soit 3,6 %, si ce taux est inférieur au taux moyen de non-recouvrement des cotisations et contributions concernées observé l'année précédant celle du transfert de compétence. L'article 12 de la LFSS pour 2022 a supprimé ce plafond, dans la mesure où certains taux de non-recouvrement lui sont actuellement supérieurs.
* 474 Article L. 225-6 du code de la sécurité sociale.
* 475 Arrêté du 3 mars 2023 relatif à la répartition entre les branches du régime général du résultat financier généré par le dispositif de reversement des cotisations dues à certains attributaires pour l'année 2022, article 1er.
* 476 Article L. 225-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 477 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité sociale pour 2023, article 1er.
* 478 Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.
* 479 Il s'agirait d'en exclure les contributions relatives à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation agricole (article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime) et des pêcheurs (article L. 6331-53 du code du travail).
* 480 Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazière.
* 481 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 482 La compensation des allégements généraux était considérée comme à peu près équilibrée jusqu'à la réforme de 2019, qui a vu le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), créé en 2012, transformé en baisse de 6 points des cotisations maladie jusqu'à un seuil alors fixé à 2,5 Smic (ce qu'il est d'usage d'appeler le « bandeau maladie »).
* 483 Écart entre la sous-compensation actuelle (5,5 milliards d'euros) et le gain correspondant à la réforme des allégements généraux de 2025 et 2026 (3 milliards d'euros).
* 484 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 485 En effet, l'article 20 de la LFSS 2023 avait transféré à la Cnaf 60 % de la charge des indemnités journalières (IJ) pour congé de maternité et l'intégralité des IJ relatives à l'adoption et à l'accueil de l'enfant. Le Gouvernement n'avait pas transféré les ressources correspondantes. La commission a considéré à la fois, d'une part, que ce transfert ne se justifiait pas et, d'autre part, qu'il symbolisait l'absence d'ambition de la politique familiale du Gouvernement.
* 486 Si cette opération entraînait la requalification par le comptable national de la Cnieg, actuellement considérée comme une société non financière, en administration publique.
* 487 Articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
* 488 Articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
* 489 CNSA, 17e édition des Chiffres clés de l'aide à l'autonomie, 2025.
* 490 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, juin 2025.
* 491 CNSA, 17e édition des Chiffres clés de l'aide à l'autonomie, 2025.
* 492 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 81).
* 493 Source : CNSA.
* 494 Audition du mercredi 22 octobre 2025.
* 495 La branche autonomie de la sécurité sociale a été créée par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (article 5).
* 496 Voir le commentaire de l'article 54.
* 497 Rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, octobre 2025.
* 498 Annexe au PLFSS pour 2026.
* 499 Ce montant de 1,4 milliard d'euros est celui que la ministre de l'action et des comptes publics a évoqué en séance à l'Assemblée nationale : « Votre assemblée est souveraine, et je prends acte de votre vote. Néanmoins, je tiens à vous en préciser les conséquences : 1,4 milliard en moins pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 1,4 milliard en plus pour les départements » (Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du samedi 8 novembre 2025).
* 500 Article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
* 501 Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
* 502 Article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale.
* 503 Ibid.
* 504 Rapport n° 84 (session 2023-2024) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 par Élisabeth Doineau, Corinne Imbert, Pascale Gruny, Olivier Henno, Marie-Pierre Richer et Chantal Deseyne, déposé le 8 novembre 2023.
* 505 Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (article 7).
* 506 Article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale.
* 507 Article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
* 508 Article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.
* 509 Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
* 510 Rapport n° 111 (session 2025-2026) fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales par Frédérique Puissat et Olivier Henno, déposé le 5 novembre 2025 (commentaire de l'article 17, page 73).
* 511 Amendement n° 774.
* 512 Fiches d'évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2024 (annexe 9), pages 38 et 42.
* 513 Nouvel article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale.
* 514 Article 293 B du code général des impôts.
* 515 Amendement n° 1314 (rect.).
* 516 L'amendement a été retiré par le rapporteur général mais il a été repris par Hadrien Clouet.
* 517 Article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, prévoit que seules les LFSS peuvent créer ou modifier des niches sociales non compensées.
* 518 Plus précisément, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »).
* 519 Plus précisément, à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 520 Article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
* 521 Selon l'article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale, l'annexe au PLFSS relative aux niches sociales sur les cotisations et contributions indique « les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu ».
* 522 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 523 Seuil ramené à 2,25 Smic par la LFSS pour 2025.
* 524 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 525 Source : annexe 4 au présent PLFSS.
* 526 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 527 Source : annexe 4 au PLFSS.
* 528 Source : annexe 4 au PLFSS.
* 529 Source : annexe 4 au PLFSS.
* 530 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 531 Article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
* 532 Article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
* 533 Les majeurs sont affiliés à titre personnel. Les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant droit, en pratique de l'un de leurs parents.
* 534 Article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
* 535 Article L. 360-2 du code de la sécurité sociale.
* 536 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2025.
* 537 Cette condition est toutefois remplie sans délai pour les réfugiés, les allocataires ou revenu de solidarité active ou les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, notamment.
* 538 Article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
* 539 Sous réserve notamment de conventions particulières avec certains pays, comme l'Algérie.
* 540 Article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 541 Deuxième alinéa de l'article L. 312-2 et 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 542 Article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 543 Article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 544 Voir infra.
* 545 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 546 Par exemple visa pour vie privée ou familiale hors conjoints de Français.
* 547 Six dans certains cas.
* 548 4° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 549 Notamment 8° et 9° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectivement pour une activité professionnelle salariée et non salariée.
* 550 13° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 551 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 552 Deuxième alinéa de l'article L. 312-2 et 16° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 553 Article R. 431-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 554 Article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 555 Article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 556 Il s'agit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).
* 557 Amendement n° 1839.
* 558 Arrêté du 27 décembre 2023 fixant la répartition de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée affectée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que le plafonnement de la compensation prévu au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 559 Amendements n° 230 de la rapporteure générale, 839 rect. de Raymonde Poncet Monge et 1214 rect. d'Alexandre Ouizille.
* 560 Amendement n° 1032.
* 561 Comme l'a déclaré en séance Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics : « Le gouvernement n'a pas eu besoin de prendre de décret puisque la Cnav et l'Agirc-Arrco ont signé une convention. Les choses se sont faites dans une forme de dialogue social bien organisé et bien mené. L'amendement est inutile.
* 562 L'article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a autorisé la SNCF à recruter des personnels au sein du régime spécial jusqu'au 31 décembre 2019.
* 563 Article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 564 Amendement n° 500.
* 565 Amendement COM-62.
* 566 Articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
* 567 Article L. 8224-2 du code du travail.
* 568 Amendement n° 499.
* 569 Amendements n° 90 de M. Jean-Luc Fichet et n° 116 de Mme Raymonde Poncet Monge.
* 570 Amendement n° 1317.
* 571 Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics a déclaré en séance : « De nombreuses sanctions existent déjà en cas de méconnaissance par les plateformes de leurs nouvelles obligations. Intuitivement, je ne suis pas certaine qu'il faille modifier dès maintenant tous les paramètres ni que les mesures proposées représentent le meilleur moyen de faire appliquer le droit. D'autres outils sont à notre disposition. Je suis donc défavorable à [cet amendement]. ».
* 572 Nouvel article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale.
* 573 Article 293 B du code général des impôts.
* 574 Les montants de la compensation par l'État, reposant sur un calcul en comptabilité de caisse, ne peuvent pas être directement rapprochés des coûts des exonérations figurant dans les tableaux habituellement utilisés pour chiffrer le coût des exonérations, établis sur la base des droits constatés.
* 575 Malgré le changement de nom au 1er janvier 2021 de l'Acoss, devenue « Urssaf Caisse nationale », le code de la sécurité sociale se réfère toujours à l'« Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
* 576 Selon le droit actuel, les remises sont appelées à l'automne de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Ainsi, les remises au titre de 2024 (évaluées à environ 8 milliards d'euros) seront appelées à l'automne 2025. L'article 11 prévoit qu'à partir de 2027, les laboratoires s'acquitteront trimestriellement du montant des remises au titre de l'année en cours. L'année 2026, année de transition, sera donc marquée par la perception à la fois des remises au titre de 2025 (hors régularisation, 75 % au 1er juin et 25 % au 1er septembre) et des remises au titre de 2026 (hors régularisation, 50 % au 1er septembre et 50 % au 1er décembre). Dans les deux cas, ces acomptes seront égaux à 95 % des remises dues au titre de 2024, évaluées à 8 milliards d'euros. Le besoin de trésorerie de l'Acoss lors du « pic » de décembre 2026 devrait donc s'en trouver réduit d'environ 8 milliards d'euros.
* 577 Amendement n° 1083.
* 578 Amendement n° 1043.
* 579 Mme Élise Leboucher. - Au travers de cet amendement, nous souhaitons dénoncer la financiarisation de la sécurité sociale et insister sur la nécessité pour l'Acoss de se financer par l'emprunt, en priorité auprès de la Caisse des dépôts. [...] Il est grand temps d'arrêter de rémunérer des acteurs financiers à travers ce qui constitue un véritable transfert annuel de plusieurs milliards d'euros depuis les classes populaires et moyennes, qui supportent la CSG et la CRDS, vers les privilégiés qui disposent de titres financiers » (Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance du samedi 8 novembre 2025).
* 580 Cf. Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 581 Cette annexe se distingue en cela des annexes 1 à 9 du PLFSS, destinées à l'information du citoyen et du Parlement et qui n'ont pas vocation à être annexées à la future LFSS.
* 582 Amendement n° 590 de Yannick Monnet.
* 583 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 584 Ce montant n'a pas été actualisé par rapport au texte déposé le 14 octobre.
* 585 « En juin, le conclave sur les retraites se termine. On se penchera alors sur la sécurité sociale et ses 22 milliards d'euros de déficit. L'objectif est un retour à l'équilibre en 2028-2029 » (Amélie de Montchalin, interview au Parisien, 19 avril 2025).
* 586 « Nous nous fixons comme objectif de revenir à l'équilibre avant 2029 » (compte rendu intégral des débats, séance du 28 mai 2025).
* 587 « Nous sommes parvenus à rééquilibrer les comptes sociaux entre 2010 et 2019 ; entre 2020 et 2028, ou au plus tard en 2029, nous devrons avoir reconstruit une telle trajectoire » (compte rendu intégral des débats, séance du 23 juin 2025).
* 588 15 juillet 2025.