II. PRÉSENTATION PAR AGRÉGAT
La
réforme de l'ordonnance organique relative aux lois de finances
définie par la loi du 1
er
août 2001 a notamment pour
objet de passer d'un budget de moyens, ou d'instruments, à un budget
orienté vers les missions et les résultats.
Dans ce cadre, même si la réforme n'est censée être
pleinement opérationnelle que pour le budget 2006, l'analyse des
crédits au travers de la grille des
« agrégats » accompagnés de leurs objectifs
et de leurs indicateurs d'ores et déjà définis par le
ministère des Affaires étrangères suscite certaines
observations.
Dix objectifs pour le ministère des Affaires étrangères
•
Action diplomatique
- « contribuer à la sécurité
internationale »
- « promouvoir la paix et la démocratie »
- « construire l'Europe »
- « affirmer le rôle de la France dans les instances
multilatérales »
- « renforcer la présence de la France dans le
monde »
- « communiquer, expliquer l'action extérieure et valoriser
l'image de la France »
• Activités consulaires
- « développer l'appui aux français de
l'étranger »
- « améliorer l'accueil des étrangers en
France »
• Coopération internationale
- « assurer le rayonnement de la France et de la
francophonie »
- « soutenir la coopération technique et l'aide au
développement »
Source : Bleu 2002
A. « PERSONNEL, MOYENS ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES » (AGRÉGAT 1)
En
l'état actuel, ce qui correspond plutôt à un
« moyen » ou à un « instrument »
de mise en oeuvre de la politique extérieure de la France constitue
encore un « agrégat » à lui-seul.
Pour le ministère des Affaires étrangères, la
répartition de ses moyens par missions ou programmes apparaît
comme un objectif encore lointain, source de « difficultés
considérables », dans la mesure où « la
nomenclature budgétaire ainsi que l'organisation des réseaux
à l'étranger ne permettent qu'imparfaitement la ventilation des
missions par agrégat ».
Cette situation reflète bien la difficulté
générale qui a précisément justifié la
réforme de l'ordonnance organique : passer d'un budget de moyens
à un budget de missions. La « politique »
budgétaire menée actuellement se réduit trop souvent
à la seule gestion de ces moyens, c'est à dire en fait à
celle des effectifs du département : leurs
rémunérations, leurs moyens de fonctionnement, leur
mobilité (ou son refus)
7(
*
)
. Sans méconnaître cette
indispensable prise en compte, votre rapporteur estime souhaitable de parvenir
à terme à une réallocation de l'agrégat
« Personnel, moyens et équipement des services ».
Celui-ci ne saurait constituer une « mission » à lui
seul, mais devra être réparti en fonction des missions auxquelles
il participe.
1. Missions, objectifs, indicateurs
a) Objectif ou moyen ?
En
l'état actuel, l'agrégat 1 comporte quatre
« composantes » : l'« action
diplomatique », l'« action consulaire », la
« coopération internationale », et un
« pôle de gestion transversale ».
Le bleu 2002 fait apparaître pour la première fois un début
de répartition des effectifs par « composantes ».
Celle-ci s'établit comme suit pour 2001 :
- Action diplomatique : 25 % (2.308 agents en 2000)
- Action consulaire : 19 % (1.744 agents en 2000)
- Coopération internationale : 28 % (2.360 agents en 2000)
- Pôle de gestion transversale : 28 % (2.494 agents en 2000)
De fait, à l'exception de la composante « pôle de
gestion transversale », plus difficile à ventiler, on voit mal
ce qui s'oppose à rattacher les trois premières composantes
à chacun des agrégats concernés.
Cela éviterait d'ailleurs d'assigner ensuite à ces composantes
une cible intitulée « néant
»....
La composante « pôle de gestion transversale »
fait en revanche l'objet d'une définition particulièrement
concrète, détaillée et soignée de ses
« objectifs » et « cibles ». Ceci
traduit bien l'importance donnée par le ministère, et son
ministre, à la gestion de son administration et sa réforme.
b) La « grande réforme » du ministère : un bilan mitigé
Plusieurs chantiers ont été ouverts, plus ou
moins
concomitamment, concernant les méthodes de gestion du ministère
et des postes, et se traduisent à ce jour par des bilans divers.
Pilotée par un
Comité de management
réuni autour
du ministre, la modernisation de la gestion du ministère et du
réseau à l'étranger se traduit par une profonde
réforme des procédures budgétaires et comptables, qui
laisse parfois les postes plus désorientés que la centrale.
La
réforme comptable
, initiée en 1996, devait être
généralisée à l'ensemble du réseau en 2002.
Tous les ambassadeurs deviendront à terme ordonnateurs secondaires
uniques des dépenses de l'Etat, quelle que soit la nature de
celles-ci ; le trésorier-payeur-général pour
l'étranger deviendra le comptable unique des opérations de l'Etat
à l'étranger ; l'ordonnancement de délégation
sera substitué à l'ordonnancement provisionnel, pour
déboucher, à terme, sur une véritable
déconcentration.
La réforme semble avoir toutefois pris un certain retard, puisqu'elle
ne concerne à ce jour que 43 pays, soit une centaine de postes sur
les 166 du réseau. La date butoir est désormais repoussée
à 2004 (ou 2005, suivant les services auteurs des réponses...).
En 2002, la réforme comptable sera étendue à 40 pays
supplémentaires, soit une cinquantaine de postes. En 2001, la masse des
crédits délégués représente désormais
plus de la moitié de l'ensemble des crédits mis en place à
l'étranger (soit 1,4 milliard de francs sur 2,7 milliards de
francs). Un petit tiers de ces crédits -400 millions de francs-
sont déconcentrés.
Le projet de budget 2002 poursuivra la mise en oeuvre de la
déconcentration des crédits des services à
l'étranger
, avec de nouveaux transferts entre l'article 31
(crédits délégués) et l'article 41 (crédits
déconcentrés) du chapitre 37-90 affectés aux Moyens
généraux des services.
La
globalisation des moyens de fonctionnement,
introduite en 1994, a
été progressivement étendue au cours des années. En
2001, elle concerne 58 % du total des moyens de fonctionnement à
l'étranger. Elle enregistrera à nouveau un progrès notable
en 2002 avec l'intégration de la rémunération des
recrutés locaux dans le chapitre des moyens de fonctionnement.
Cette réforme a manifestement amélioré la souplesse, la
rationalité, l'efficacité de la gestion des postes à
l'étranger, en limitant les mouvements de crédits entre
l'administration centrale et les postes, et donc les coûts et les
délais induits.
Des
centres de gestion uniques
(CGU) avaient été
institués en janvier 1996 sur les postes pilotes, visant à
réunir les chefs de services des différentes administrations
représentées localement (MAE, Trésor, DREE, SCTIP, DATAR,
Intérieur), pour améliorer en commun la gestion de trois
dossiers : rémunération du personnel local, regroupement des
chats
locaux sur les réseaux informatiques, regroupement des
services sur un site géographique unique. Votre rapporteur regrette que
cette expérience, de nature à optimiser l'utilisation des deniers
publics, n'ait pas semblé devoir être développée.
Il estime que, sur le terrain, la mise en oeuvre concrète de
toutes ces différentes réformes n'est toutefois pas exempte de
difficultés.
Il apparaît d'abord souhaitable de développer et
généraliser totalement dans les meilleurs délais le
logiciel COREGE
, mieux adapté, et de parvenir à une
simplification accrue des procédures budgétaires et comptables.
Plus généralement, un effet important est consenti pour
moderniser les instruments de travail, avec
la mise en réseau de
l'ensemble des agents du département
: celle-ci suppose
l'interconnexion de l'ensemble des logiciels sur un serveur unique et la
modernisation des applications informatiques. Il s'agit là d'une
entreprise gigantesque, loin d'être achevée. Aucun moyen nouveau
n'est pourtant prévu à ce titre en 2002.
Ensuite,
la déconcentration des crédits de subventions
destinées notamment à des associations semble s'accompagner
localement de certaines difficultés de gestion.
Enfin, les
Centres culturels et de coopération à autonomie
élargie
mis en place à compter de 1996 sont désormais
en totale contradiction avec la réforme comptable. Leur suppression sera
d'ailleurs définitivement acquise courant 2002.
En réalité, pour être réussie, la
déconcentration des crédits nécessite sans doute un
renforcement des services administratifs, financiers et comptables à
l'étranger, ce qui ne va pas dans le sens du mouvement actuel. Elle
implique en outre un effort important au niveau de l'évaluation et du
suivi des opérations ainsi mises en oeuvre. Elle risque enfin
d'accentuer les effets des mouvements de parité franc dollar, ce qui
constituera une contrainte supplémentaire pour le budget du
ministère.
Ceci conduit votre rapporteur à formuler quelques réserves
liées à la difficulté de mener de front plusieurs
réformes de gestion concomitantes, voire parfois concurrentes.
En revanche, il estime que certaines autres évolutions structurelles,
rendues indispensables par celles du monde contemporain, ne sont pas encore
suffisamment prises en compte : ouverture du département sur
l'extérieur, avec un renforcement des mobilités
extérieures (autres que sur des postes
« institutionnels » ou multilatéraux) et de
l'accueil de personnels non diplomates, renforcement des compétences et
de la formation économique et financière, mise en oeuvre plus
systématique des capacités d'analyse prospective.
2. Évolution des moyens de l'agrégat 1 en 2002
a) Rémunérations et charges sociales
L'agrégat 1 comprend l'intégralité des
dépenses de rémunérations et de charges sociales de
l'administration centrale et des services à l'étranger.
A structure constante (hors recrutés locaux), les crédits de
rémunérations et charges sociales (y compris les dépenses
d'action sociale) devraient s'élever en 2002 à
733,8 millions d'euros (4,81 milliards de francs), soit une
progression de 2,8 % par rapport à l'exercice
précédent.
Avec 10,8 millions d'euros (70,84 millions de francs),
l'effet
change-prix explique 85 % de la progression du chapitre 31-90
«
Rémunérations des personnels
».
En dehors de cet effet, et de celui des mesures traditionnelles d'ajustement et
d'extension en année pleine, les crédits de
rémunération et de charges sociales bénéficient
seulement de 1,87 million d'euros (12,3 millions
de francs) de
mesures nouvelles, affectées comme suit :
- revalorisation des indemnités de l'administration centrale :
+ 1,08 million d'euros ;
- nouvelle bonification indiciaire pour l'encadrement
supérieur : + 0,37 million d'euros ;
- revalorisation des dotations d'action sociale : + 0,42 million
d'euros.
Par ailleurs, sept emplois nouveaux sont créés (0,17 million
d'euros, soit 1,1 million de francs) pour être mis à
disposition du Haut conseil de la coopération internationale (HCCI).
Ceci équivaut à une majoration de 20 % de la subvention de
fonctionnement du HCCI identifiée au chapitre 37-90, art. 88, reconduite
en francs constants.
b) Moyens généraux des services à l'étranger
Dans le cadre de la poursuite de la globalisation des moyens de fonctionnement, un chapitre nouveau est créé -chapitre 37-90 -« Moyens généraux des services », regroupant l'ancien chapitre 34-98 « Matériel et fonctionnement courant » et l'article 21 du chapitre 31-98 « Autres rémunérations d'administration centrale », relatif à la rémunération des recrutés locaux.
(1) La situation inquiétante des recrutés locaux
Le
regroupement des crédits de rémunérations des
recrutés locaux au sein des « Moyens généraux
des services » est bienvenu.
Réclamé de façon réitérée par la
plupart des chefs de poste, il vise à engager la déconcentration
totale de la gestion des recrutés locaux, et devrait être
mené dans 24 postes en 2002. Les postes retenus sont parmi ceux ayant
déjà intégré la réforme comptable et qui
sont soumis pour la plupart à de fortes fluctuations de change. Les
chefs de poste disposeront d'une enveloppe unique englobant les moyens de
fonctionnement du poste et la rémunération des recrutés
locaux, au sein de laquelle ils auront la possibilité d'opérer
les arbitrages qui leur paraîtront nécessaires, dans la limite
toutefois de leur budget annuel, et du respect des règles
générales de gestion des recrutés locaux.
En réalité, la situation actuelle ne peut se satisfaire d'une
réforme à coût constant
.
La détérioration considérable de la situation des
recrutés locaux dans les pays-dollarisés, à partir d'un
niveau déjà faible, inférieur à celui consenti par
d'autres administrations de l'Etat français, souvent voisines, parfois
même cohabitantes, et sans commune mesure avec celui du secteur
privé, ne peut durablement se poursuivre sans se traduire par la
détérioration qualitative d'un personnel qui représente
tout de même l'équivalent de 60 % des effectifs du
ministère rémunérés sur emplois budgétaires,
et donc la majorité du « personnel employé par la
France » à l'étranger.
Cette dégradation traduit en partie le refus de Bercy de prendre en
compte, en loi de finances initiale, la hausse mécanique des coûts
de rémunération des recrutés locaux liée à
l'effet-dollar. Depuis plusieurs exercices, celle-ci a lourdement pesé
sur les rémunérations, et n'a pu être que partiellement
compensée en gestion par prélèvement sur les ressources
propres du ministère.
Or, à nouveau, aucune mesure nouvelle n'est prévue au titre de
l'effet-change au budget 2002.
Par ailleurs, en l'état actuel, un tiers seulement des recrutés
locaux (1.633 agents) a bénéficié d'une revalorisation de
la grille des salaires depuis la mise en place du «
Plan d'action
pour la valorisation et l'amélioration de la gestion du recrutement
local
» de mars 1999, et toutes ces revalorisations ont
été financées par redéploiement interne des
crédits.
Enfin, 9 % seulement de l'effectif (530 agents) ont
bénéficié de la mise en place de 17 régimes
complémentaires de protection sociale. Selon les indications fournies,
un programme exhaustif de remise à niveau de la protection sociale,
représentant un coût total de 1,5 million d'euros,
«
sera mis en oeuvre sur les exercices 2002 et
2003
».
Votre rapporteur, qui n'a pas retrouvé trace de ce programme au titre
des mesures nouvelles 2002, regrette que cette décision, pourtant tout
à fait urgente aux regards des besoins constatés au cours des
différentes missions qu'il a effectuées, n'ait pu trouver un
financement global réel dès la loi de finances initiale 2002.
(2) Autres moyens généraux des services : poursuite de la déconcentration
Hormis
les crédits de rémunération des recrutés locaux, le
nouveau chapitre 37-90 recouvre, d'une part, les crédits
délégués ou déconcentrés aux services
à l'étranger et, d'autre part, les subventions de fonctionnement
de divers organismes.
L'évolution des crédits de fonctionnement des services à
l'étranger est essentiellement marquée par une
nouvelle
progression de la part relative des crédits
déconcentrés
. La progression globale des moyens correspond en
effet pour l'essentiel à des mesures de transferts internes en
provenance du titre IV (notamment les crédits de formation des
assistants techniques). L'incidence de l'évolution du dollar n'est pas
prise en compte.
c) Organismes divers
(1) Les organismes rattachés au chapitre 37-90 : reconduction des moyens en francs courants
La
totalité des organismes bénéficiant d'une dotation de
fonctionnement au titre des «
moyens généraux des
services
» voient leurs crédits strictement reconduits en
francs courants en 2002.
-
Secrétariat du Conseil de défense franco-allemand :
0,03 M€
Le secrétariat du Conseil de défense franco-allemand a
été mis en place en 1988 pour assurer le soutien administratif et
logistique des travaux du Conseil. Avec neuf membres permanents
rémunérés par leur administration d'origine, le budget est
pris en charge à parts égales par la France et l'Allemagne. La
partie française est versée pour moitié par le
ministère des Affaires étrangères et pour moitié
par le ministère de la Défense.
-
Mission de l'adoption internationale : 0,05 M€
La Mission de l'adoption internationale a bénéficié en
2001 d'un crédit exceptionnel versé par le ministère de
l'Emploi et de la solidarité pour la mise en oeuvre de la Convention
franco-vietnamienne sur l'adoption signée à Hanoï le
1
er
janvier 2000 (0,05 M€). Pour 2002, il n'a pas
été demandé d'augmentation de la subvention, même
s'il faut prévoir une montée en puissance des subventions
accordées aux organismes agréés pour l'adoption (OAA). La
MAI emploie 24 agents détachés (MAE, Justice, Emploi)
-
Maison des français de l'étranger : 0,11 M€
La mission de la Maison des français de l'étranger consiste
à « préparer les français à
l'expatriation ». Elle emploie 20 personnes. Les documents qu'elle
élabore sont commercialisés et le produit affecté à
un fonds de concours depuis 2001. Le budget prévisionnel pour 2002 est
fixé à 0,53 M€.
-
Commission coopération-développement : 0,20 M€
La Commission coopération développement est une commission
consultative interministérielle paritaire qui rassemble les
représentants des pouvoirs publics et les représentants du monde
associatif concernés par l'aide au développement et l'aide
humanitaire. Elle fonctionne avec deux postes permanents mis à
disposition par le ministère, et des vacataires financés sur son
budget de fonctionnement.
-
Le Haut Conseil de la coopération internationale :
0,88 M€
Le HCCI voit également sa subvention de fonctionnement reconduite en
francs courants. Il bénéficie toutefois de l'affectation de sept
emplois nouveaux du ministère créés à cet effet, ce
qui correspond à une majoration de 20 % de ses moyens globaux.
(2) L'OFPRA (chap. 34-30, art. 30) : une priorité du budget 2002
La
dotation de l'OFPRA fait partie des priorités affichées pour
2002. Elle bénéficiera de 3,05 millions d'euros de moyens
nouveaux destinés notamment à financer la création de
49 emplois non budgétaires. L'OFPRA fonctionne actuellement avec
379 personnes, dont 95 agents du ministère mis à disposition.
Ses résultats, désastreux (170 jours de délai pour traiter
un dossier, 1 dossier sur 2 faisant l'objet d'un entretien,
21 500 dossiers actuellement en souffrance), ne sont pas uniquement
imputables à l'accélération du nombre de démarches.
Une amélioration des méthodes de gestion et de fonctionnement,
réclamée d'ailleurs par la Cour des comptes dans le rapport
particulier extrêmement critique effectué sur cet organisme, devra
accompagner la nécessaire augmentation des moyens.
d) Voyages, réceptions, déplacements ministériels
Les deux
chapitres 34-03 : «
Frais de réception et de voyages
exceptionnels
», et 34-04 : «
Frais de
réceptions courantes et de déplacements
ministériels
» sont globalement légèrement
majorés de 0,16 million d'euros (1,05 million de francs).
Dans son Rapport sur l'exécution du budget 2000, la Cour des comptes a
critiqué l'importance de la sous-estimation de la dotation initiale de
ce chapitre. Pour couvrir les besoins réels, qui n'avaient aucun
caractère « urgent et imprévisible » au sens
de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, il a fallu recourir
à un transfert de crédits pour dépenses
« éventuelles ou accidentelles » (en provenance du
budget des Charges communes), à hauteur de 46,5 millions d'euros
(300 millions de francs), soit plus de trois fois le total
constitué par la dotation initiale et les reports.
e) Les opérations immobilières : une préemption lourde sur les prochains exercices
En 2001,
le ministère des Affaires étrangères est affectataire d'un
parc immobilier représentant 2.424.149 m
2
, dont 2.040.794
m
2
occupés par ses propres services. Le parc immobilier
à l'étranger représente 90 % du total. La France est
propriétaire de 75 % de ce parc, 23 % est en location et moins
de 2 % détenu au titre de baux emphythéotiques.
Depuis 1998, les investissements immobiliers à l'étranger sont
décidés en
Comité de Politique Immobilière
,
présidé par le ministre, et composé des responsables du
ministère et de personnels extérieurs. Cette méthode a
considérablement contribué à
« expertiser » les choix opérés. Votre
rapporteur tient également à saluer l'apport, en termes de bon
usage des deniers publics, des ingénieurs des travaux publics et de
l'équipement détachés pour suivre les travaux immobiliers
les plus importants (Berlin, Alger, Tokyo actuellement).
Les crédits mis en place pour 2002 s'élèvent à
67,84 millions d'euros (445 millions d'euros) pour les autorisations de
programme et à 54,12 millions d'euros (355 millions de francs)
pour les crédits de paiement. Les ressources 2002 devraient
bénéficier par ailleurs du rattachement par fonds de concours de
15 millions d'euros (98 millions de francs) environ correspondant
à la vente de terrains et propriétés à
l'étranger
8(
*
)
.
Les principales opérations envisagées pour 2002 appellent deux
observations.
D'une part, des opérations lourdes sont engagées, qui
pèseront durablement au cours des dix prochains exercices, dont ils
prédétermineront massivement les moyens :
Il s'agit des trois lycées de Moscou, Milan et Varsovie, d'une part,
ensuite de deux opérations envisagées sur l'ambassade de Tokyo et
sur le campus diplomatique (chancellerie + résidence + lycée) en
Chine, et enfin des opérations en Algérie.
D'autre part,
les projets algériens représentent un tiers de
l'enveloppe programmée pour 2002
: rénovation du
lycée Ben Aknoun, construction de logements dans le Parc Peltzer,
rénovation du consulat général d'Oran, construction du
consulat général d'Annaba.
Sans prétendre se prononcer sur le bien-fondé de cette
décision de grande ampleur, votre Rapporteur souhaiterait savoir si les
moyens de fonctionnement (et de sécurité) correspondants ont bien
été évalués et prévus. Il n'en voit pas la
trace en tout cas au budget 2002 et déplore que Bercy ait refusé
d'accorder la création des 51 emplois supplémentaires
demandés à ce titre. De fait, en l'état actuel, la
décision apparaît incohérente.
B. « ÉDUCATION ET SOLIDARITÉ »
(AGRÉGAT 2)
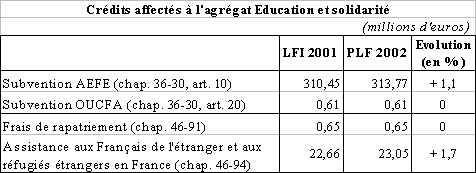
1. Missions, objectifs, indicateurs : des améliorations nécessaires
L'agrégat 2 comporte deux composantes :
- « action consulaire »
- « enseignement
français à l'étranger »
Tel qu'actuellement présenté, cet agrégat n'est pas
pleinement satisfaisant.
S'agissant de la composante «
action consulaire »
,
l'efficacité d'une analyse orientée sur les missions et les
objectifs impose que les moyens de fonctionnement, actuellement inscrits dans
l'agrégat 1, soient rapprochés des moyens d'intervention.
Par ailleurs, il paraît nécessaire d'améliorer les
« indicateurs » liés à l'action consulaire.
Aujourd'hui limités à deux : demandes d'emploi et
rapatriements, ils ne couvrent pas la totalité des missions qui lui sont
imparties.
En revanche, on peut s'interroger sur le bien-fondé du maintien des
crédits d'assistance aux réfugiés étrangers (art.
52 du chapitre 46-94) dans le chapitre portant les crédits d'assistance
aux Français à l'étranger. Cette
« agrégation » n'est pas nécessairement
bienvenue. Pourquoi ne pas les rapprocher plutôt des crédits de
l'OFPRA ?
S'agissant de la composante «
enseignement français
à l'étranger
», le traitement de l'AEFE
apparaît plus délicat. La tutelle est exercée par la DGCID,
instrument de la mission « coopération
internationale », mais l'AEFE exerce en réalité une
double mission de nature assez différente : la scolarisation des
enfants français à l'étranger, qui pourrait relever
plutôt de la mission « consulaire », et la
scolarisation d'enfants étrangers dans un système
français, qui ressort davantage de la mission
« coopération internationale ».
Parallèlement, le regroupement des crédits d'investissement
immobilier destinés aux établissements de l'AEFE en gestion
directe (chap. 57-10, art. 31) serait bienvenu (ils figurent actuellement
à l'agrégat 1).
2. Évolution des moyens de l'agrégat 2 en 2002
a) L'Agence pour l'Environnement du Français à l'étranger (AEFE)
(1) Vers l'assèchement du Fonds de réserve
La
subvention versée à l'AEFE (chapitre 36-30, art. 10) est
portée à 313,8 millions d'euros (2.058 millions de francs)
en 2002, soit une majoration nette de 3,32 millions d'euros
(21,8 millions de francs).
L'essentiel de cette majoration (2,84 millions d'euros, soit
20 millions de francs) correspond à la prise en compte de la
revalorisation du point fonction publique et de l'effet change-prix. On
rappellera que le budget 2001 avait prévu à ce titre
4,63 millions d'euros.
Les crédits sont parallèlement diminués de
1,7 million d'euros au titre de la non-reconduction des mesures
financées sur la réserve parlementaire 2001 (- 0,08 million
d'euros) et d'un transfert de crédits de gestion à la
DGCID (- 0,81 million d'euros), à la suite de la prise en
gestion directe du lycée de Prague.
L'AEFE bénéficie par ailleurs d'une mesure nouvelle de
1,37 million d'euros (9 millions de francs) en faveur des bourses
scolaires et d'excellence.
L'évolution ainsi retracée appelle plusieurs remarques :
- Le financement du
Plan de juin 2000
, destiné à
améliorer le système de
rémunération des
résidents
9(
*
)
,
évalué
à 135 millions de francs par an durant six ans, devrait en
principe être financé en partie par la transformation d'un certain
nombre de postes d'expatriés en postes de résidents durant
six ans et en partie par prélèvement sur le Fonds de
réserve de l'AEFE. Aucune mesure nouvelle n'est prévue à
ce titre dans le budget 2002.
- Les mesures nouvelles accordées au titre de l'évolution du
point fonction publique et des hypothèses de change-prix
représentent effectivement la moitié seulement des besoins
évalués par l'AEFE. Il manquerait près de 30 millions
de francs.
- Les mesures nouvelles prévues au titre des bourses représentent
les deux-tiers de ce qui a été jugé nécessaire
(12 millions de francs). On rappellera ici que, de 1997 à 2001, si
le budget global des bourses a augmenté de 30 % - de
28,2 millions d'euros à 36,9 millions d'euros -, le nombre
d'élèves bénéficiant de bourses a diminué de
17 790 à 17 725, en raison de l'augmentation
considérable du coût unitaire des bourses.
- Evalués à 8 millions de francs, les coûts
correspondant à la réouverture du lycée Ben Aknoun
d'Alger, pour lequel est mise en route une importante tranche de crédits
immobiliers, ne sont pas financés au budget 2002.
- Enfin l'AEFE ne bénéficiera en 2002 d'aucune mesure nouvelle au
titre des crédits d'investissements
10(
*
)
. Toute dépense
nécessaire dans un établissement conventionné devra
être pris en charge par prélèvement sur le Fonds de
réserve. Les besoins minima sont évalués à
40 millions de francs.
Il résulte de ces éléments que, outre le financement non
prévu du plan de juin 2000, l'AEFE devra, courant 2002, prélever
sur ses réserves un montant minimum de 60 millions de francs
(besoins 2002 non couverts par des ressources budgétaires plus
annulations 2001), soit, au total, un montant supérieur à
200 millions de francs.
De fait, le Fonds de réserve de l'AEFE, qui se situait
confortablement à plus de 300 millions de francs en 2000, sera
très vraisemblablement asséché à la fin de
l'exercice 2002
.
(2) Une nécessaire remise à plat
En
réalité, la configuration du réseau, comme ses
modalités de gestion, appellent une réflexion approfondie et
surtout des décisions politiques de fond
.
La comparaison du réseau entre la rentrée 1997 et la
rentrée 2000 montre que peu de modifications ont pu intervenir, à
l'exception de la diminution sensible du nombre d'établissements de la
Mission laïque française. Il semble pourtant qu'il existe une marge
non négligeable pour une rationalisation de ce réseau, qui
pourrait notamment passer par un recalibrage du réseau européen,
et la mise en place, chaque fois que cela est possible, d'écoles
bilingues dans le système public local.
L'analyse des ratios pédagogiques fait apparaître par ailleurs un
niveau de confort élevé, sans rapport avec les moyennes
nationales (22 élèves par classe en moyenne), qui contribue
nécessairement à celui des coûts de scolarisation, et
partant, à la charge qui en découle, pour le budget de l'Etat,
comme pour les parents d'élèves.
L'élaboration actuelle, en partenariat avec l'Education nationale, d'un
nouveau dossier d'homologation, ainsi que la mise en place d'inspections
générales et de missions d'audits, pourront utilement contribuer
à réduire le coût d'organisations pédagogiques
parfois sans impact réel sur les conditions d'études des
élèves.
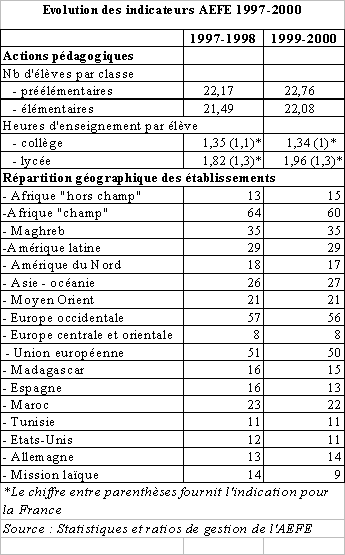
Les
modalités de gestion doivent également faire l'objet d'une
réflexion.
Il est clair que la gestion directe de l'ensemble des établissements est
exclue, compte tenu de son coût exorbitant pour les finances publiques.
Mais les insuffisances, les carences, ou les incohérences de la gestion
déléguée par des associations de parents
d'élèves majoritairement « mobiles », et donc
amenés à prendre (ou à ne pas prendre) des
décisions dont ils ne supporteront généralement pas les
conséquences, impliquent que soit explorée une
« troisième voie ».
Votre Rapporteur avait évoqué l'an dernier l'hypothèse
d'une tutelle conjointe avec l'Education nationale, partiellement
justifiée par la scolarisation d'enfants français, fût-ce
à l'étranger
11(
*
)
.
Cette solution se heurte évidemment à la question du partage de
la charge financière.
Une autre voie pourrait être utilement examinée, qui correspond
à une pratique assez répandue chez nos principaux
partenaires : le recours aux fondations.
Au minimum, il paraît souhaitable, en particulier dans un souci de
bonne gestion des fonds publics, que l'Etat conclue un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens, comportant, à partir d'un état des
lieux détaillé, un engagement sur les résultats.
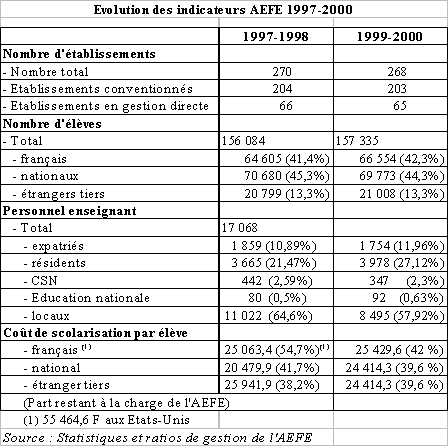
b) Les Français de l'étranger
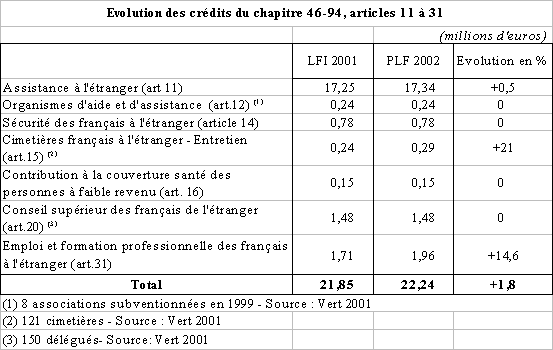
Le
Gouvernement souhaite insister sur la nouvelle progression des crédits
d'assistance aux Français de l'étranger. En
réalité, celle-ci est inférieure de moitié à
celle enregistrée en 2001
12(
*
)
, certes partiellement liée
à l'effet d'un transfert de crédits en provenance du budget de
l'emploi.
A 22,2 millions d'euros, la progression s'élève à
1,8 % en francs courants, après une hausse de 3,3 % en 2001.
Les efforts sont concentrés cette année sur l'assistance à
l'étranger (amputée de 1 million de francs en 2001, celle-ci
ne retrouve pas le niveau de 2000), l'entretien des cimetières
français qui en ont grand besoin, et surtout les crédits
affectés à l'emploi et à la formation professionnelle
(majorés de 4,43 millions de francs en 2001, partiellement grâce
à un transfert en provenance du budget de l'Emploi et de la
Solidarité).
En revanche, les crédits affectés à la
sécurité des Français à l'étranger ne
bénéficient d'aucune mesure nouvelle, et sont reconduits à
0,78 million de francs (soit à peine un peu plus de 5 millions
de francs). On rappelle qu'ils avaient atteint 10 millions de francs en
1998.
C. COOPÉRATION ET INTERVENTIONS INTERNATIONALES (AGRÉGAT 21)
1. Missions et objectifs
L'agrégat «
Coopération et
interventions
internationales
» réunit en définitive tout ce qui
ne relève pas des deux autres : «
Personnels et moyens
de fonctionnement et d'équipement
» et
«
Education et solidarité
».
De fait, la présentation et le contenu de l'agrégat
«
Coopération et interventions
internationales
», continuent de susciter un sentiment de
confusion, voire d'échec, partiellement lié à un domaine
trop étendu et donc hétérogène.
En l'état actuel, les missions, trop souvent réduites à
des catalogues d'actions non hiérarchisées et assez abstraites,
ne permettent pas de déboucher sur des objectifs clairs et corrects. Les
indicateurs retenus, peu nombreux, peu ambitieux, sont souvent
réducteurs, et ne sont même pas toujours
« servis ».
Les résultats sont dès lors généralement
décevants, pour ne pas dire quelque peu pitoyables : baisse des
postes occupés et des parts de marché dans les organisations
internationales, à partir de niveaux pourtant déjà bien
faibles (respectivement 6 % et 4 %) ; 20 % seulement des étudiants
étrangers en France issus de « pays
émergents »
13(
*
)
; 9 % des diplômes de
français délivrés par l'enseignement du français
à l'étranger permettant un accès à l'enseignement
supérieur français - la notion d'accessibilité à un
emploi n'est même pas évoquée... ; 1 % des travaux
scientifiques des pays de la ZSP publiés dans les revues
internationales ; moins du quart (22 %) des projets de
développement mis en oeuvre pour lutter contre la pauvreté et
satisfaire les besoins de base ; moins de 1,5 % des projets de
développement consacrés à l'intégration et à
la coopération régionale ; un seul critère pour
évaluer la coordination de l'état de droit : le nombre de
stagiaires...
2. Évolution des moyens en 2002
La
diminution depuis plusieurs exercices des moyens affectés à la
coopération et aux interventions internationales se traduit par une
dégradation des résultats constatés. L'évolution
des crédits prévus à ce titre pour 2002 ne permettra pas
d'inverser cette tendance.
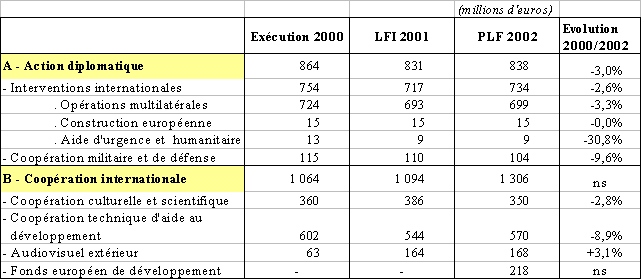
Source : bleu 2002
a) Une base fragilisée par les conditions d'exécution 2001
Dès le mois d'avril, 45 millions de francs ont
été annulés sur les chapitres de coopération (42-11
et 42-12).
A partir de mai ont été gelés en outre 205 millions
de francs en crédits de paiement
14
dont 18 millions de
francs sur la coopération culturelle, 67 millions de francs sur la
coopération technique et au développement (42-12) et
40 millions de francs sur la coopération militaire (42-29). Ainsi
que 100 millions de francs en autorisations de programme, dont 50
millions de francs sur le les crédits du Fonds de solidarité
prioritaire (68-91) et 50 millions de francs sur les crédits
mis en oeuvre par l'Agence française de développement (68-93).
Les services à l'étranger chargés de mettre en oeuvre les
crédits -en liaison le plus souvent avec nos partenaires
étrangers- en ont été avertis par télégramme
diplomatique le 27 juillet seulement.
L'analyse de la consommation des crédits début novembre
amène à estimer à près de 230 millions d'euros (1,5
milliard de francs), l'insuffisance des crédits votés en loi de
finances initiale 2001. Votre rapporteur avait
d'ailleurs
souligné ces « impasses » potentielles dès
l'examen du projet de loi de finances pour 2001.
Outre les rémunérations (en raison de l'insuffisante prise en
compte de l'effet dollar et d'une sous-évaluation de l'effet GVT), les
dépenses de réception et de déplacements, et les moyens de
l'OFPRA, les insuffisances devraient porter notamment sur les crédits de
paiement de l'AFD et, surtout, massivement, sur les contributions obligatoires,
sur lesquelles il devrait manquer près de 150 millions d'euros (1
milliard de francs).
Les modalités de construction du budget 2002 risquent de se traduire par
des impasses de même nature en cours d'exécution.
« Dernière minute » : les dispositions du collectif de fin d'année
Le
projet de loi de finances rectificative de fin d'année qui vient
d'être déposé par le Gouvernement comporte notamment les
mesures suivantes :
* Ouvertures demandées :
- 925 millions de francs pour la participation de la France à
des dépenses internationales (contributions obligatoires) ;
- 11 millions de francs pour financer une contribution à l'Office
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche Orient (OSTNU) et des travaux de rénovation des
bâtiments du siège de l'UNESCO (contributions volontaires) ;
- 3,66 millions de francs pour une aide à l'Inde pour la
reconstruction après le séisme de janvier 2001, et pour financer
un remboursement dans le cadre d'un projet de coopération maritime au
titre de la lutte contre la drogue dans les Caraïbes (coopération
technique et au développement) ;
- 196,8 millions de francs en crédits de paiement pour ajuster les
moyens de paiement de l'Agence française de développement.
* Annulations mises en oeuvre par l'arrêté du 14
novembre
- 5 millions de francs sur les crédits de matériel et de
fonctionnement courant ;
- 35 millions de francs sur les subventions aux établissements
publics (AEFE) ;
- 40 millions de francs, en crédits de paiement comme en
autorisations de programme, sur les crédits du Fonds de
solidarité prioritaire.
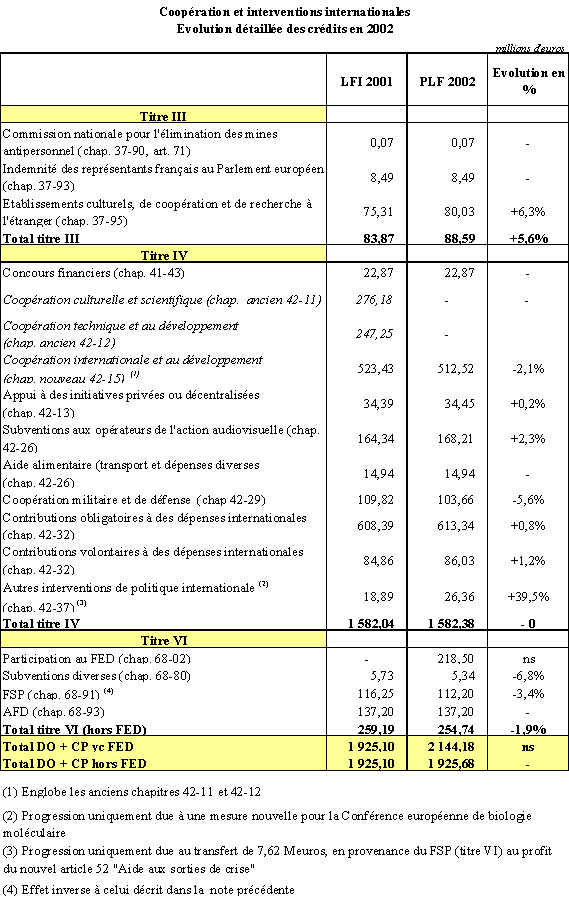
b) Les impasses du budget 2002 :
L'analyse de l'évolution des crédits 2002 fait ressortir des impasses conséquentes précisément sur des postes qui, dans la situation internationale actuelle, appellent sans doute un effort particulier : les contributions obligatoires et volontaires à des dépenses internationales, la coopération militaire et de défense, l'aide d'urgence et humanitaire, le financement de projets de développement, les concours financiers aux pays en développement 14( * ) .
(1) Contributions à des organismes internationaux (chap. 42-31 et 42-32) : une impasse minimale de 150 millions d'euros sur les opérations de maintien de la paix
Contrairement au budget 2001, qui avait intégré
de
très importantes mesures d'ajustement (853 millions de francs
supplémentaires) sur les opérations de maintien de la paix d'une
part, et pour tenir compte de l'effet change-prix d'autre part, le budget 2002
ne prévoit aucun crédit nouveau au titre des contributions
obligatoires
15(
*
)
. Le contexte
international et le maintien du dollar à un niveau supérieur
à celui des hypothèses du budget 2002 amènent dès
lors à estimer que l'impasse à régler en cours d'exercice
2002 risque d'être conséquente.
Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle ne saurait être une
surprise.
Dans son Rapport sur l'exécution du budget 2000, la Cour des comptes a
fustigé l'insuffisance des dotations en loi de finances initiale pour
couvrir les dépenses de participation de la France à des
opérations internationales : déjà en 2000 l'impasse
portait sur le cours du dollar et sur la mise en oeuvre de nouvelles
opérations. De fait, le chapitre 42-31 a dû être
abondé de 1.403 millions de francs en cours de gestion, soit
45 % de la dotation initiale
16(
*
)
.
Or, dans le cadre d'une réponse faite pour l'examen du projet de loi de
règlement du budget 2000, la Cour indique que « le montant de
l'insuffisance du chapitre devrait être du même ordre de grandeur
en 2001 (plus de 1 milliard de francs, soit 150 millions d'euros),
mais être
concentré
sur les opérations de
maintien de la paix » De fait, les crédits nécessaires
devront être ouverts en collectif de fin d'année. Reconduire en
francs courants pour 2002 le niveau des crédits initiaux 2001 se
traduira donc, d'entrée de jeu, par une impasse minimale de
1 milliard de francs.
Or, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de
décider, le 15 novembre, par la
Résolution 13-78
, le
principe de l'envoi en Afghanistan d'une force multinationale, dont les
contours et les modalités restent à préciser, mais dont
les missions, conséquentes, sont déjà clairement
définies
17(
*
)
. La
contribution 2002 de la France, membre du Conseil de sécurité, en
sera nécessairement majorée.
Or, en 2002, les crédits affectés aux contributions obligatoires
s'établissent à 613,4 millions d'euros (4 milliards de francs),
soit une progression de 0,8 % par rapport à la loi de finances initiale
2001, mais une baisse de 22,1 % par rapport à l'exécution 2001
(781 millions de francs).
Ces crédits, qui représentent 17 % du montant total du budget des
affaires étrangères, alimentent, outre les opérations de
maintien de la paix, 130 organisations internationales, de portée
diverse, les deux plus importantes, représentant 70 % du total.
Opérations de maintien de la paix
Le premier tiers est absorbé par les contributions au financement des
Opérations de maintien de la paix
, dont le montant a
été multiplié par 4,5 en dix ans (de 1990 à 2000).
Le montant total des opérations actuellement en cours devrait atteindre
près de 2.250 millions de dollars pour la période du
1
er
juillet 2001 au 30 juin 2002.
La contribution de la France, membre du Conseil de sécurité, a
été portée à 8,7% du total, depuis la
réforme du barème des contributions intervenue en décembre
2000 (contre 7,9 % précédemment)
18(
*
)
.
Les principales opérations d'ores et déjà en cours sont
les suivantes :
- Kosovo (MINUK)
- Liban (FINUL)
- Sierra Leone (MINUSIL)
- Timor-Oriental (ATNUTO)
- Sahara occidental (MINURSO)
- Bosnie-Herzégovine (MINUBH)
- Ethiopie-Erythrée (MINUEE)
- Congo (ex- Zaïre) (MONUC)
Fin 2001, le reste à régler sur la contribution de la France aux
opérations de maintien de la paix est de l'ordre de 135 millions de
dollars. Les crédits nécessaires devraient être inscrits
dans le cadre du prochain collectif de fin d'année.
Contributions obligatoires, hors OMP
Hors opérations de maintien de la paix, les
contributions
obligatoires
représentent un total de l'ordre de 500 millions
d'euros.
Un peu moins du tiers est affecté à sept organismes à
vocation scientifique, au premier rang desquels le Centre européen de
recherche nucléaire (CERN) dont la contribution est près de
quatre fois supérieure à celle de l' Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Le projet de budget pour 2002 prévoit une seule mesure nouvelle au titre
des contributions obligatoires, à hauteur de 5 millions d'euros, pour le
Laboratoire européen de biologie moléculaire
, au titre du
«
plan indicatif Conférence européenne de biologie
moléculaire
».
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Le LEBM
a été créé en 1974 et regroupe quinze pays
européens (dont la Suisse et la Norvège) et Israël. Son
objectif est de mener des recherches dans le domaine de la biologie
moléculaire qui ne pourraient pas l'être à l'échelle
d'un pays. Il s'agit de comprendre la logique des systèmes vivants en
termes moléculaires dans des applications comme la bioinformatique, la
génomique et la protéonomique.
Le LEBM dispose de plusieurs unités dont la plus importante se situe
à Heidelberg, également siège de l'organisation. Cinq
lignes de recherche y sont développées : biologie
structurale, expression génétique, biologie et biophysique
cellulaire, biologie du développement, instrumentation biochimique.
L'antenne de Hinxton héberge l'Institut européen de
bioinformatique (IEB) qui est appelé à se développer en
raison de l'importance de la saisie et du stockage des données
biologiques grâce aux biopuces.
A Grenoble, se trouve l'unité chargée de l'étude de la
biologie structurale qui travaille en liaison avec l'ESRF pour des
expériences de caractère plutôt physique. Des
expériences de nature similaire sont menées en liaison avec le
synchroton de Hambourg où se trouve aussi une petite unité du
LEBM.
Le LEBM se veut aussi une structure de formation à la recherche. Le
temps de séjour des chercheurs n'y dépasse pas, en principe, neuf
ans, souvent moins, à la suite duquel ils sont invités à
rejoindre leurs institutions nationales. En outre est pratiquée une
active politique de visiteurs (stagiaires, usagers des installations,
années sabbatiques).
Dans un domaine largement dominé par les anglosaxons, la
communauté scientifique française trouve dans le LEBM un moyen
d'accéder à la recherche internationale. La fréquentation
globale de nos chercheurs se situe au troisième rang (après
l'Allemagne et le Royaume-Uni, à égalité avec l'Italie)
à environ 12 % des effectifs.
Le budget du LEBM est de 52,374 M€ (343,55 MF) en 2001. La France y
contribue pour 16,71 %, soit 8,757 M€ (57,44 MF).
Source : réponse au questionnaire budgétaire.
Le reste des contributions obligatoires se répartit entre
105 organismes de portée diverse, pour des contributions qui vont
de moins de 1.500 euros (Tribunal d'arbitrage et de la commission de
règlement de l'accord sur les dettes extérieures allemandes)
à plus de 25 millions d'euros (Conseil de l'Europe). Outre l'ONU, les
contributions les plus importantes de la France concernent l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), le Conseil de l'Europe, l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'OTAN, l'UNESCO et
l'OCDE.
Votre rapporteur continue de s'interroger sur le bien-fondé du maintien
de certains organismes -certains paraissent parfois faire double emploi- ou,
à tout le moins, sur l'opportunité d'une redéfinition de
leurs besoins et des contributions qui leur sont affectées.
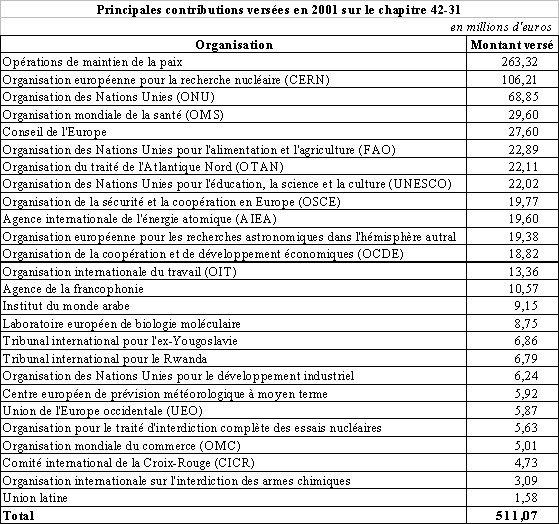
Contributions volontaires
S'agissant des contributions volontaires hors francophonie, essentiellement
consacrées aux programmes et aux fonds des Nations-Unies, on rappellera
qu'elles ont régressé de 67% entre 1993 et 1998.
Certes,
une reprise est enregistrée depuis 1999, mais elle ne cesse
de s'étioler
: + 58 millions de francs en 1999,
+ 29 millions de francs en 2000, + 15 millions de francs en
2001 et + 2,7 millions de francs en 2002... De fait, les
« indicateurs » sont éloquents : la France est
aujourd'hui « tombée » au 12
ème
rang mondial, alors que d'aucuns estiment que 70 millions, à peine,
suffiraient à la faire remonter dans les cinq premiers.
Globalement, la France reste clairement en arrière des autres donateurs,
notamment européens. Ne dépassant jamais le dixième rang
des donateurs pour les contributions volontaires, elle n'est pas à la
hauteur de son stratut de membre permanent du Conseil de
sécurité, et risque d'assister en spectateur à la mise en
oeuvre de l'important processus de réforme lancé par le
Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan.
Le retrait entamé à partir de 1994 a eu des conséquences
négatives pour la défense des intérêts
français au sein du système onusien. Il s'est traduit par un
recul des postes offerts à des experts français, au
détriment évident de notre influence dans ces enceintes, tant en
ce qui concerne la définition des politiques mises en oeuvre que, plus
pragmatiquement, le choix des projets retenus, et donc souvent celui des
marchés y afférent
19(
*
)
.
On notera qu'en revanche le Royaume-Uni a multiplié par trois ses
contributions volontaires.
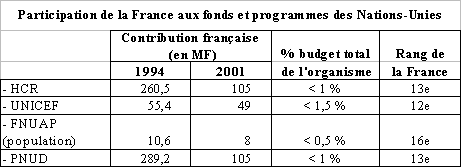
Assistant à la 56 ème Assemblée générale des Nations Unies à New-York début novembre, votre rapporteur regrette d'avoir dû constater que, lorsque le HCR monte une opération spécifique pour les réfugiés afghans, la France ne figure pas au rang des vingt pays ayant répondu présent à l'appel -dont le Chili et la République tchèque- pour un montant global de 52 millions de dollars 20( * ) .
(2) Transport de l'aide alimentaire (chap. 42-26) : une impasse de 28 millions d'euros
Les
crédits affectés au
transport de l'aide alimentaire
sont
strictement reconduits en francs courants à 14,94 millions d'euros
(98 millions de francs).
Or, à volume d'aide constant, ce poste est affecté par les
évolutions du cours du dollar et du baril de pétrole, et par la
nécessité de recourir à des moyens logistiques plus
onéreux dès lors qu'on assiste des personnes
déplacées par des conflits.
La situation actuelle en Afghanistan ne permet pas d'exclure la
nécessité d'une contribution de la France à ce niveau,
même si la préférence va toujours vers un monopole
européen en la matière.
En tout état de cause, pour 2002, le seul maintien de nos engagements au
titre de la convention de Londres nécessiterait une dotation de
25 millions euros. Il conviendrait d'y ajouter le règlement,
toujours en souffrance, des dettes au titre des années 2000 et 2001,
soit 18 millions d'euros.
En d'autres termes, il « manque » d'entrée de jeu,
et toutes choses égales par ailleurs, 28 millions d'euros (184 millions
de francs).
(3) Aide aux sorties de crise et aide d'urgence : aucun crédit supplémentaire
La
prise en compte de la spécificité des actions à mettre en
oeuvre pour faire face aux « situations de sortie de
crise », dans le prolongement immédiat ou en parallèle
des actions d'urgence et d'aide humanitaire, a conduit à
l'identification d'un article spécifique (art. 51) au sein du
chapitre 42-37. - «
Autres interventions de politique
internationale
», intitulé
«
Opérations exceptionnelles
-
aides aux sorties de
crise
».
Aucun crédit nouveau n'est toutefois prévu à ce titre. Le
nouvel article est en effet entièrement nourri par le transfert,
à niveau strictement reconduit en francs courants, des crédits
précédemment inscrits au chapitre 68-91, art. 20 :
Fonds de solidarité prioritaire - opérations
exceptionnelles
, soit 7,62 millions d'euros.
En 2001, la dotation initiale était de 7,6 millions d'euros
(50 millions de francs) à laquelle se sont ajoutés
9,53 millions d'euros de reports. Les affectations ont été
les suivantes pour le premier semestre :
- Aide à la reconstruction de la Serbie : 8 M€ (52
MF)
21(
*
)
. Balkans : 0,5 (schéma régional transport)
. Kosovo : 1,5 (complexe métallurgique et minier à Trepxca)
. Bulgarie : 6 (Pont Vidin Calafat sur Djambe)
- Contribution volontaire à l'UNWRA (réfugiés
palestiniens)
22(
*
)
: 0,76
M€ (5 MF)
Les crédits affectés au
Fonds d'urgence humanitaire
(chapitre 42-37, art. 21) sont également strictement reconduits en
francs constants à 9,3 millions d'euros. Ce chapitre fait
régulièrement l'objet d'abondements en cours de gestion en tant
que de besoin.
Ainsi, en 1999, la dotation initiale de 8,4 millions d'euros a
été majorée de 33 millions d'euros pour financer l'aide
aux réfugiés du Kosovo.
En 2000, le montant des crédits consommés a été
légèrement supérieur à 10 millions d'euros,
pour une trentaine d'opérations différentes.
La zone des Balkans a drainé l'essentiel des moyens (près de
7 millions d'euros). Viennent ensuite notamment une opération
Guinée (0,84 million d'euros), une opération Mozambique
(0,53 million d''euros), et une opération Ethiopie
(0,42 million d'euros).
En 2001, le montant des crédits consommés au 20 août
s'élevait à 4,06 millions d'euros pour 14 opérations.
Les principales opérations ont été les suivantes :
- Guinée : 0,85 M€
- Afghanistan : 0,78 M€
- Salvador : 0,48 M€
- Yougoslavie : 0,52 M€
- Inde : 0,50 M€
(4) Coopération militaire et de défense (chap. 42-29) : - 5,6 % en 2002
La
coopération militaire et de défense supporte seule l'essentiel
des mesures d'économies demandées en 2002 au
ministère : - 6,2 millions d'euros (40,7 millions de
francs), sur un total de 8,3 millions d'euros.
En deux ans, depuis la mise en oeuvre de la réforme du système
français d'aide au développement
(budget 1999)
, les
crédits de coopération militaire auront été
réduits de 100 millions de francs, alors que son champ
d'intervention aura été considérablement élargi
.
Les postes les plus touchés en 2002 seront les coopérants
techniques ,qui représentent environ la moitié de l'enveloppe (-
4,6 millions d'euros, soit - 7,3 % par rapport à 2001) et la
formation des stagiaires qui en représente environ le quart (- 1,9
million d'euros, soit - 7,8 % par rapport à 2001).
(5) Concours financiers : progression nulle
Les
crédits finançant les concours financiers aux pays en
développement sont eux aussi strictement reconduits en francs courants.
De fait, l'application concrète de l'initiative sur la dette en faveur
des pays pauvres très endettés, et la mise en oeuvre de son
corollaire, les contrats dette-déeloppement (CDD) se traduira
nécessairement par une forte remontée des besoins de financement.
Or aucun crédit nouveau n'est, à ce jour, prévu à
ce titre.
(6) Financement des projets de développement : poursuite de la baisse globale des moyens, au profit d'une prépondérance accrue de l'AFD
Hors
contribution française au Fonds européen de développement,
les crédits affectés au financement de projets de
développement relèvent, pour l'essentiel, du Fonds de
solidarité prioritaire (FSP) et de l'Agence française de
développement (AFD).
En 2002, ces crédits poursuivront l'évolution à la baisse
entamée depuis plusieurs exercices, avec un déséquilibre
croissant des moyens au profit de l'AFD.
Les moyens d'engagement du FSP, comme ceux de l'AFD diminuent. En 2002, les
crédits du FSP s'établiront à 150,2 millions d'euros en
autorisations de programme et à 112,2 millions d'euros pour les
crédits de paiement (+ 3,7 % par rapport à 2001). Ceux de l'AFD
s'établiront à 152,4 millions d'euros en autorisations de
programme (-21,4 % par rapport à 2001) et à 137,2 millions
d'euros en crédits de paiement (reconduction du montant 2001) Si les
moyens de paiement du FSP augmentent légèrement, ceux de l'AFD
sont strictement reconduits en francs courants, ce qui risque de se traduire
par un besoin d'ouverture de crédits en cours d'exécution.
De fait, la rupture croissante de l'équivalence entre autorisations de
programme et crédits de paiements constitue un facteur
supplémentaire d' « impasse budgétaire »
à terme : dès lors que la totalité des autorisations
de programme se trouverait engagée, il faudra faire face, au cours des
prochains exercices budgétaires, à un besoin
supplémentaire en moyens de paiement.
Celle-ci est déjà avérée pour les paiements de
l'AFD. En 2000, le décalage entre autorisations de programme et
crédits de paiement s'est traduit en clôture à un
déficit de 9,6 millions d'euros (63 millions d'euros). Compte tenu
des prévisions de décaissement pour 2001 (145 millions d'euros)
et du niveau de crédits de paiements ouverts, ce déficit pourrait
atteindre 17 millions d'euros fin 2001 (111 millions de francs),
qu'il faudra vraisemblablement couvrir en collectif de fin
d'année
23(
*
)
.
Réduit en 2002 à 15 millions d'euros pour l'AFD et atteignant
38 millions d'euros pour le FSP, l'écart entre autorisations de
programme et crédits de paiement demeure et conduit aux mêmes
risques sur l'exercice 2002.
c) Les priorités retenues pour 2002
Les
priorités retenues par le budget 2002 concernent le réseau des
établissements culturels, l'audiovisuel extérieur, l'accueil des
étudiants étrangers, et l'appui aux organisations de
solidarité internationale et à la coopération
décentralisée.
(1). Le réseau des établissements culturels et de recherche
Les crédits du chapitre 37-95 financent un réseau
particulièrement dense, qui comporte 151 établissements culturels
à vocation pluridisciplinaire, 27 centres de recherche, 4
établissements franco-étrangers, et 68 annexes.
En 2002, les crédits devraient s'élever à 80,03 millions
de francs (525 millions de francs), ce qui correspond à une
progression de 6,3 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2001
(+ 4,72 millions d'euros, soit 31 millions de francs).
Le réseau des établissements culturels et de recherche
bénéficie en effet d'une mesure nouvelle de 3,05 millions d'euros
(20 millions de francs), destinée pour moitié à
l'amélioration de la situation des recrutés locaux des
établissements à autonomie financière (harmonisation des
statuts et des grilles de salaires), et pour moitié au renforcement des
moyens des établissements.
La prise en compte de l'effet change-prix sur les rémunérations
des personnels mis à disposition des alliances françaises se
traduit par une majoration de 0,84 million d'euros (5,5 millions de
francs, contre 7,7 millions de francs en 2001). L'incidence de la
revalorisation du point fonction publique entraîne pour sa part une
augmentation mécanique de 0,56 million d'euros (3,7 millions
de francs).
Le chapitre 37-95 bénéficie en outre d'un transfert de 0,26
million d'euros en provenance du titre IV, correspondant au retour à
l'autonomie élargie des centres culturels de Pnom-Penh, Port-Louis,
Singapour et Le Caire.
La réforme attendue des établissements culturels
Le
réseau culturel demeure caractérisé par une profonde
disparité dans la répartition des établissements :
alliances françaises essentiellement sur le continent américain
et en Inde, instituts français, centres culturels français et
centres culturels et de coopération linguistique en Europe.
Outre la nécessaire disparition des centres culturels et de
coopération à autonomie financière, incompatibles avec la
réforme comptable, le ministère travaille toujours à une
restructuration du réseau, à partir de l'établissement
d'une typologie qui distinguerait cinq types de structures :
universitaires, « symboliques » situés
généralement dans les capitales des pays
développés, maisons de la coopération culturelle (dans les
pays de la ZSP), antennes culturelles légères à vocation
spécialisée et, enfin, à l'avenir et dans certains pays,
établissements européens.
La rénovation envisagée implique également une
professionnalisation accrue des personnels, la mise en place d'outils
d'évaluation de nature à identifier les coûts
d'activité, avec des ratios permettant des comparaisons, et le
recentrage des missions sur la dimension culturelle et scientifique, qui fait
l'objet d'un intérêt croissant de nos partenaires, celui-ci
s'accompagnant d'une mobilisation accrue des ressources locales
(mécénat d'entreprise et partenariat institutionnel).
En 2002, l'évolution de l'enseignement du français dans le
réseau, et les politiques de certification correspondantes, devraient
faire l'objet d'une attention prioritaire, justifiée si l'on croit les
indicateurs » actuellement fournis.
Est également envisagé le remplacement progressif de certains
emplois sur titre III par des recrutements locaux.
En 2001, la réallocation des moyens s'est traduite par la fermeture de
quatre instituts français en Allemagne : Kiel, Heidelberg,
Karlsruhe et Bonn, et l'ouverture du Centre culturel de Rangoon et de
l'Institut de recherche de Bangkok.
Les opérations envisagées en 2002 concernent la fermeture des
instituts de Hanovre, Rostock et Fribourg, et l'ouverture des centres culturels
de Tachkent et Tbilissi
2.
L'audiovisuel public extérieur
L'audiovisuel public extérieur devrait bénéficier en 2002
de 4,6 millions d'euros (30 millions de francs) de crédits
supplémentaires, affectés pour l'essentiel à TV5 (3,9
millions d'euros, soit 23 millions de francs) pour notamment améliorer
l'audience de la chaîne francophone aux Etats-Unis à la suite de
l'accord intervenu récemment avec les canadiens pour rapatrier en France
l'établissement de la grille de programmes. Ce montant correspond
à la moitié des besoins exprimés.
Un supplément de 0,76 million d'euros (5 millions de francs) a par
ailleurs été attribué à RFI, lequel, sous tutelle
pourtant du seul ministère de la Culture, bénéficie de
plus de la moitié des crédits Affaires étrangères.
Cette mesure nouvelle a été consentie au titre d'une
« participation du ministère des Affaires
étrangères aux nouveaux développements prévus par
RFI », c'est à dire à l'exclusion de tout financement
des majorations du budget de fonctionnement de cet opérateur :
celles-ci devraient être prises en charge à hauteur de 25 millions
de francs (3,81 millions d'euros) par le ministère de la Culture.
Les inéluctables augmentations de coûts liées à la
hausse du dollar, à l'impact des revalorisations salariales
conventionnelles, et à la pression sur le prix des programmes et des
droits contraindront donc les autres opérateurs, dont la dotation est
reconduite en francs courants, à redimensionner leurs programmes ou
à renoncer aux développements envisagés.
Outil essentiel de la présence française à
l'extérieur, le secteur audiovisuel a certes enregistré de
sensibles progrès au cours de la législature :
rationalisation du réseau ondes courtes, préservation de
RMC-Moyen Orient, mise en place de TV5-Monde, qui bénéficie
désormais du quart de la subvention du ministère des Affaires
étrangères, renforcement des programmes français et des
aides à l'exportation des produits culturels français.
Pour autant, la part des crédits d'intervention qui lui est
consacrée au sein du ministère -soit 5 % du total des
crédits d'intervention- demeure insuffisante, au regard des besoins et
de l'influence potentielle de ce vecteur contemporain
.
En particulier, le renforcement souhaité de la présence
française sur les
bouquets satellitaires
mérite
d'être concrétisé. La part des crédits
réservée à cet objectif demeure en effet inférieure
à 5 % du total des crédits du chapitre. De même, la part
réservée à
l'exportation des programmes
, soit
à peine plus de 1,5 % du total des crédits, reste
dérisoire, même si elle correspond à une progression par
rapport à 1997 (0,96 % du total).
3.
Le « recrutement » d'étudiants
étrangers
La volonté de renforcer l'accueil d'étudiants étrangers se
traduit par une mesure nouvelle de 15 millions de francs pour financer la mise
en place du programme de bourses « Major » destiné
à prendre le relais des bourses d'excellence de l'AEFE, après
l'admission de ses élèves étrangers dans les grandes
écoles ou en deuxième cycle universitaire en France.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique visant à renforcer
l'accueil d'étudiants étrangers dans notre système
d'enseignement supérieur.
Elle s'accompagne d'une amélioration importante, mise en place depuis
1998, des procédures de délivrance de visas pour études,
par le biais notamment d'une concertation accrue entre les services consulaires
et les services culturels. De fait, le nombre de visas délivrés
aux étudiants étrangers est passé de 22.025 en 1996
à 46.251 en 2000.
Bienvenue et importante, cette mesure devra toutefois, pour être
pleinement efficace, également veiller aux conditions d'accueil,
d'installation, d'hébergement et d'accompagnement des étudiants
étrangers en France. Actuellement très en-deçà du
niveau atteint par le système américain ou même canadien,
celles-ci constituent désormais un important facteur discriminatoire.
Il conviendra enfin d'être attentif au niveau et au type de formation des
étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur
français
24(
*
)
. Aucune
indication statistique n'est actuellement disponible à ce sujet, mais il
a été demandé, en principe, aux postes consulaires de
fournir désormais ce type de données.
4.
Coopération décentralisée et appui aux ONG
Le chapitre 42-13, qui finance les appuis à la coopération
décentralisée et aux organisations de solidarité
internationale, bénéficie de 0,915 million d'euros
(6 millions de francs) de crédits supplémentaires.
Les deux tiers de cet effort bénéficieront aux organisations
de solidarité internationale, le tiers restant étant
affecté aux crédits non déconcentrés de
coopération décentralisée.
Les associations de
volontaires (essentiellement l'AFVP - Association française des
volontaires du progrès), et les crédits
déconcentrés de coopération décentralisée ne
bénéficient d'aucun crédit supplémentaire.







