b) Un régime financier globalement satisfaisant
En contrepartie des obligations et des contraintes pesant sur eux, les propriétaires de monuments historiques bénéficient d'aides directes et d'avantages fiscaux.
(1) Les aides directes
Les
propriétaires privés peuvent bénéficier de
subventions. Il s'agit d'une possibilité présentée comme
un droit, en dépit de la lettre de l'article 11 du décret du 18
mars 1924 qui stipule que « le classement d'un immeuble n'implique
pas nécessairement la participation de l'État aux travaux de
restauration, de réparation ou d'entretien. Lorsque l'État prend
à sa charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixé en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de
son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des
sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres
intéressés à la conservation du monument ».
C'est la croyance, largement répandue, au droit au subventionnement, qui
est à l'origine de la multiplication des demandes de classement. La
preuve
a contrario
semble fournie par l'expérience de la
décentralisation en Corse où le quasi-alignement des aides entre
les immeubles présentant un intérêt patrimonial a
provoqué une immédiate désinflation des demandes de
protection...
L'imposition des propriétaires de monuments historiques dans l'Union
La
présente étude analyse les principales dispositions fiscales
prises par les pays voisins pour encourager la préservation du
patrimoine immobilier ancien par des particuliers, que ce patrimoine fasse ou
non l'objet d'une mesure de classement.
Trois questions ont donc été successivement examinées pour
chacun des pays retenus, c'est-à-dire pour
l'Allemagne, l'Angleterre
et le Pays de Galles, l'Espagne, l'Italie et la Suiss
e.
-
Au moment de l'acquisitio
n, à titre onéreux ou
à titre gratuit, l'acquéreur d'un immeuble ancien est-il
exempté, totalement ou partiellement, des droits d'enregistrement, de
succession ou de donation ?
Pendant la période de détentio
n, le
propriétaire a-t-il la possibilité de déduire ses
dépenses d'entretien ? Ses revenus locatifs sont-ils soumis à un
régime particulier ? Paie-t-il l'impôt sur la fortune ou
l'impôt foncier annuel à un taux réduit ?
-
Lors de la revent
e, bénéficie-t-il de mesures
dérogatoires, relatives aux plus-values par exemple ?
Cet examen fait apparaître que, à la différence de
l'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que de la Suisse, l'Allemagne,
l'Espagne et l'Italie ont mis en place un dispositif fiscal assez varié
au bénéfice des propriétaires d'immeubles anciens.
1) En Angleterre et au Pays de Galles, tout comme en Suisse, les mesures
fiscales favorables aux propriétaires d'immeubles anciens sont peu
nombreuses
Si par exemple la loi anglaise prévoit l'application de la TVA au taux
zéro à certains travaux effectués sur les immeubles
classés ou inscrits, cette mesure ne peut pas s'appliquer aux simples
travaux d'entretien ou de réparation. Quant à l'exemption de
l'impôt sur les successions, elle est accordée de façon
discrétionnaire par l'administration en fonction de l'importance que
représente le bien pour le patrimoine national.
En Suisse, pour les immeubles classés, les frais d'entretien sont
déductibles du revenu. En revanche, dans le cas des immeubles non
classés, la déduction n'est admise que si les frais
engagés n'augmentent pas la valeur de l'immeuble. Certes, les
dépenses non déductibles peuvent être
réintégrées au prix de revient au moment de la revente et
donc diminuer d'autant la plus-value, mais la non-déductibilité
d'une partie des frais d'entretien dissuade les particuliers d'acquérir
des immeubles anciens en mauvais état.
2) Les mesures fiscales favorables aux propriétaires d'immeubles
anciens sont beaucoup plus variées en Allemagne, en Espagne et en
Italie
Les textes relatifs aux différents impôts comportent des mesures
dérogatoires favorables aux propriétaires d'immeubles anciens. Le
bénéfice de ces mesures est généralement
réservé aux propriétaires d'immeubles classés.
Dans ces trois pays,
les frais d'entretien sont déductible
s, mais
selon des modalités différentes. En Allemagne, ils sont
déductibles du revenu, sur 10 ans à raison de 10 % par
an. En Espagne et en Italie, ils ouvrent droit à une réduction
d'impôt, respectivement limitée à 15 % et à 19 % de
leur montant. En outre, en Espagne, les frais susceptibles d'être pris en
compte à ce titre sont plafonnés à 10 % du revenu
imposable. Par ailleurs, en Espagne, les investissements réalisés
pour l'acquisition d'immeubles classés sont soumis au même
régime fiscal que les frais d'entretien.
Ces trois pays prévoient aussi l'exemption, totale ou partielle, de
plusieurs impôts ou retiennent une assiette réduite pour leur
calcul.
Ainsi, les biens classés sont exclus de l'assiette de
l'impôt
sur les successions
en Italie. En Allemagne, certains en sont
également exonérés totalement, tandis que d'autres le sont
à hauteur de 60 %. En Espagne, tous font l'objet d'un abattement de 95 %.
Pour
l'impôt sur les donation
s, l'Allemagne et l'Espagne
retiennent les mêmes règles que pour l'impôt sur les
successions, tandis que l'Italie prévoit une imposition forfaitaire d'un
montant négligeable (130 €).
En Allemagne et en Espagne, les immeubles classés sont exemptés
de
l'impôt foncier annue
l, perçu au profit des communes. En
Italie, où les immeubles classés ne sont pas exemptés de
cet impôt, une assiette favorable est toutefois retenue : la valeur
cadastrale la plus faible de la zone cadastrale où ils se trouvent.
En Espagne, les immeubles classés sont exemptés de
l'impôt annuel sur le patrimoin
e, qui n'existe ni en Allemagne ni
en Italie.
*
* *
Les
mesures fiscales prises en faveur des particuliers propriétaires
d'immeubles anciens sont très diverses d'un pays à l'autre et
sont complétées par des aides directes apportées sous
forme de subventions. En effet, l'absence de mesures fiscales
dérogatoires constitue souvent la contrepartie de la
préférence accordée aux aides directes.
Etude complète disponible à l'adresse suivante :
http://intranet.senat.fr/lc/lc101/lc101.html
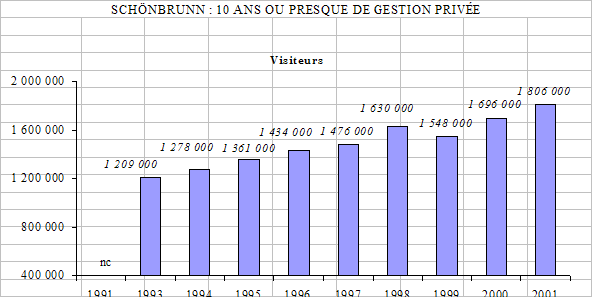
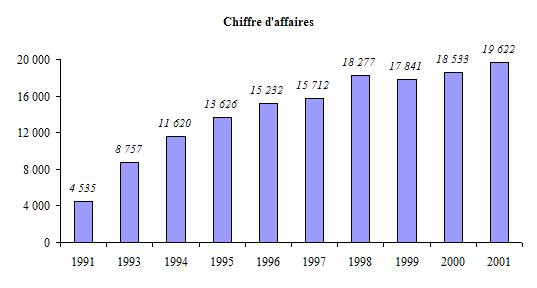
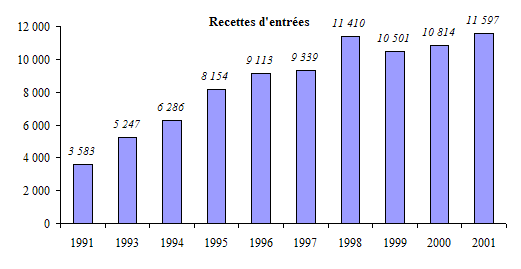
(2) Les avantages en matière d'impôt sur le revenu
Les articles 41 E à J de l'annexe du code général des impôts dispose que les charges foncières sont déductibles du revenu en totalité pour les monuments ouverts au public et à 50 % pour les autres, étant noté que ce taux est porté à 100 %, que le monument soit ouvert ou non, lorsque les travaux de réparation ou d'entretien sont subventionnés par le ministère de la culture.
Agrément délivré au titre de l'article
156
du code général des impôts
Le
1° ter du II de l'article 156 autorise, dans certaines conditions et
limites, la déduction des charges foncières afférentes
à certains immeubles faisant partie du patrimoine national et ne
procurant pas de recettes pour la détermination du revenu global du
propriétaire. Cette déduction est :
- de plein droit pour les immeubles classés monuments historiques ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
- subordonnée à l'obtention d'un agrément pour les
immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur
caractère historique ou artistique particulier.
Le 3° du I de l'article 156 autorise l'imputation, sur le revenu global,
des déficits fonciers afférents à des immeubles procurant
des recettes et répondant aux mêmes conditions.
Les statistiques en possession de la direction de la législation fiscale
ne permettent pas de distinguer le nombre d'agréments
délivrés
8(
*
)
par les
directeurs des services fiscaux compétents au titre de 1° ter du II
de l'article 156 de ceux accordés en vertu du 3° du I de cet
article. Cela dit, l'essentiel des agréments délivrés
concerne la déduction des charges foncières (1° ter du II).
Au total, le nombre d'agrément s'élève à :
- 68 en 2000,
- 220 en 2001.
La progression enregistrée en 2001 résulte des agréments
accordés au titre des immeubles labellisés par la Fondation du
Patrimoine (procédure visée à l'article 156, d'application
effective depuis l'année 2000). Pour les années 2000 et 2001, le
nombre d'agrément « Fondation du Patrimoine »
s'élève à 177, dont la grande majorité a
été délivrée en 2001.
Plus précisément, lorsqu'un immeuble classé monument
historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire, ou
agréé par le ministre de l'économie et des finances,
procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers
et n'est pas occupé par son propriétaire, ce dernier
détermine son revenu dans les conditions de droit commun,
c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet
immeuble les charges de la propriété
énumérées à l'article 31 du code
général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un
déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur
son revenu global, y compris, le cas échéant, pour la partie qui
provient des intérêts d'emprunt.
Lorsque l'immeuble classé, inscrit ou agréé, ne procure
aucune recette imposable (l'immeuble n'est pas ouvert à la visite ou est
ouvert gratuitement au public), le propriétaire peut, en application de
l'article 156-II-1° ter du code déjà cité,
déduire de son revenu global, dans les conditions et limites
fixées aux articles 41 E à 41 J de l'annexe III au CGI, tout ou
partie des charges foncières qu'il a engagées sur cet immeuble.
Dans le cas où l'immeuble procure des recettes imposables et est
occupé par son propriétaire -immeuble loué partiellement
ou dont certaines pièces sont ouvertes à des visites payantes-,
il convient de faire application concurremment des deux régimes
décrits ci-dessus : les charges foncières se rapportant
à la partie de l'immeuble ouverte au public sont prises en compte pour
la détermination d'un déficit foncier qui est imputable sans
limitation sur le revenu global ; les charges se rapportant à la partie
de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance sont
imputables sur le revenu global dans les conditions indiquées ci-dessus
(articles 41E à 41 J de l'annexe III au CGI).
La dépense fiscale en matière de monuments historiques
La
dépense fiscale résultant des avantages fiscaux accordés
en matière de monuments historiques est évaluée à
7,6 millions d'euros (50 millions de francs). Le ministère de la
Culture communique chaque année le montant des subventions
allouées pour la réalisation de travaux de réparation et
d'entretien aux propriétaires -particuliers et collectivités
locales- d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire.
La part des subventions affectées aux immeubles possédés
par les particuliers représente environ 15 % de cette somme. A
l'intérieur de ces 15 %, 90 % des subventions sont affectées aux
immeubles classés et 10 % aux immeubles inscrits. Ce mode
d'évaluation, fourni par le Ministère de la culture, s'explique
par le fait que les subventions accordées pour les immeubles
classés et pour les immeubles inscrits sont réparties entre ces
deux catégories d'immeubles à l'échelon des directions
départementales. La détermination précise de la part
affectée aux immeubles possédés par les particuliers
supposerait la consultation de l'ensemble des directions
déconcentrées.
Le montant des travaux réalisés est reconstitué en tenant
compte du taux de subventionnement accordé (50 % pour les immeubles
classés, 15 % pour les immeubles inscrits). Ces montants sont retenus
sous déduction des subventions perçues pour évaluer la
dépense fiscale. Aucune donnée concernant le nombre de foyers
fiscaux bénéficiant de cette déductibilité n'est
disponible.
On note qu'est parue le 22 janvier 2002 une instruction ( 5D-1-02) du
ministère des finances donnant satisfaction à une revendication
des
propriétaires de monuments historiques procurant des recettes
imposables
. Ceux-ci sont désormais
autorisés à
déduire pour leur montant réel les primes d'assurances se
rapportant aux locaux visités
, alors que la prime était
antérieurement comprise dans la réduction forfaitaire de
14 %.
(3) Le régime des monuments historiques au regard des droits de mutation et de l'ISF
Les
dispositions prévues à l'article 795 A autorisent
l'exonération des droits de mutation à titre gratuit
afférents aux transmissions de monuments classés ou inscrits et
des biens meubles qui en constituent le complément, ainsi qu'à
compter du 1
er
janvier 1995, des parts de SCI familiales
détenant des biens de cette nature, à condition qu'ait
été signée une convention assurant l'ouverture au public.
Le nombre de conventions intervenues depuis l'entrée en vigueur du
dispositif à la suite du vote de la loi de programme sur le patrimoine
monumental du 5 janvier 1988, soit moins d'une cinquantaine, témoigne
tout comme le nombre des conventions récemment signées, du peu de
succès de la procédure.
|
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Nombre de conventions |
6
|
5
|
5
|
2
|
|
Évaluation des immeubles (K€) |
1 456 |
2 043 |
1 700 |
206 |
|
Évaluation des meubles (K€) |
389 |
- |
676 |
62 |
*conventions portant également sur des meubles
Le coût global de la mesure est négligeable, comme en
témoigne le fait que la dépense fiscale soit mentionnée
dans le fascicule des voies et moyens, assortie de la mention
« », epsilon.
Depuis la mise en place du dispositif, une seule convention a fait l'objet d'un
retrait au cours de l'année 1999.
L'évaluation de la valeur des monuments historique au sens fiscal
L'estimation de la valeur vénale des monuments
historiques en
matière de monuments historiques et d'impôt de solidarité
sur la fortune est faite par les services fiscaux sur la base des principes
suivants.
Aux termes de l'article 666 du code général des impôts, les
droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe
proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.
Conformément à l'article L. 17 du livre des procédures
fiscales, l'administration fiscale peut prendre en compte la valeur
vénale réelle d'un bien chaque fois que le prix ou
l'évaluation fixé(e) par les usagers lui est inférieur(e).
La valeur vénale s'entend du prix qui pourrait être obtenu par le
jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel compte tenu de
l'état dans lequel se trouve le bien lors de la mutation et des clauses
de l'acte de vente (cass. com. 23 octobre 1984, aff. GFA de Plaimpied).
En pratique, et conformément à ces principes, l'estimation d'un
bien immobilier par l'administration fiscale repose sur la prise en compte
d'éléments réels d'ordre physiques
(caractéristiques du bien, confort, qualité architecturale,
état d'entretien...), socio-économiques (environnement,
urbanisation...) et juridiques (existence d'un bail, indivision...).
Ces règles générales sont applicables pour
l'évaluation des demeures et bâtiments classés monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Il est précisé que, pour l'évaluation des demeures et
bâtiments classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il est tenu
compte de la nature spécifique de ces biens, des charges souvent
importantes qui les grèvent, du nombre limité d'acquéreurs
potentiels et des difficultés qui, dans certains cas, en
découlent pour les vendre. II en va de même des contraintes qui
pourraient résulter, pour les propriétaires de tels biens, de
leur ouverture plus ou moins fréquente au public et de leur utilisation
à des fins d'animation collective dans un but essentiellement culturel
(en ce sens, R.M. Nicolas Dupont-Aignan, Dép. JO AN du 29juin 1998,
n° 13-318).







