a) L'effort variable des collectivités publiques induit une diversité des taux d'aide
La
France n'a pas les mêmes traditions locales, le même
« esprit de clocher », qui, à l'étranger,
fait du patrimoine un élément constitutif de la conscience
politique locale. Les républiques urbaines d'Italie, les villes libres
d'Empire et les villes des Flandres possèdent un patrimoine qu'elles
enrichissent depuis la fin du Moyen-age mais il faut attendre en France les
années récentes pour voir apparaître la
fierté
, jusque là étouffée par le
centralisme, des
collectivités locales pour leur
patrimoine.
Ce
réveil patrimonial des collectivités territoriales
s'est accompagné de la montée en puissance des interventions
financières des départements, surtout ainsi que, accessoirement,
des régions, aboutissant, compte tenu des aides de l'État et
aujourd'hui de l'Europe, à des taux d'aides éminemment variables
à travers le territoire national.
(1) Les aides européennes
Les
aides en provenance des fonds structurels européens sont fixées
pour une période qui va actuellement de 2000 à 2006. Pour en
bénéficier, il faut appartenir aux zones dites de
« catégorie 2 ».
L'aide communautaire présente un caractère complémentaire,
en ce sens qu'elle vient s'ajouter au soutien public ou privé. Elle est
distribuée sur la base des documents uniques de programmation, en
l'occurrence les contrats de plan État -région, dont le volet
culturel n'est qu'un aspect relativement limité.
Le taux d'intervention communautaire maximum est de 50 %, en application
du règlement n° 1260/1999 du 21 juin 1999.
Le tableau ci-dessous montre que
peu de régions profitent des Fonds
structurels européens.
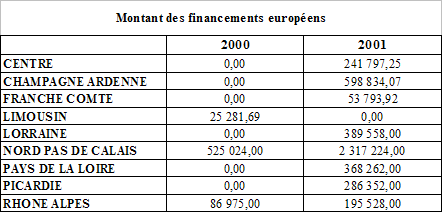
Il est impératif de profiter des facilités offertes à ce
titre dans la mesure où, d'une part, les enveloppes pour la
période d'après 2006 sont en cours de négociation mais
pourraient bien baisser après l'élargissement, et où
d'autre part à plus court terme, les aides non utilisées seront
désormais caduques si elles ne sont pas utilisées dans les deux
ans de l'engament des crédits, en application de la règle dite
« du dégagement d'office ».
(2) La diversité des taux d'intervention de l'État
Les
textes ne mentionnent aucun taux plafond pour les monuments classés,
bien qu'une circulaire de 1991 recommande de ne pas dépasser 80 %.
Pour les monuments inscrits, il résulte de la loi de 1913 que des
subventions peuvent être attribuées dans la limite de 40 % du
montant total des travaux.
En fonction des régions et des critères appliqués par le
CRMH, le taux d'intervention varie de 10 à 60 % pour les monuments
classés et de 10 à 40 % pour les monuments inscrits, pour
lesquels la moyenne serait de 20 %.
(3) Des compléments des collectivités territoriales éminemment variables
Les
interventions des collectivités territoriales ne reposent sur aucune
base réglementaire définie. Certains conseils
généraux rassemblent toutefois, dans un opuscule constituant un
guide des aides, les règles applicables.
Ces modalités sont très variables selon les régions ou les
départements ainsi que dans le temps.
L'étude lancée par La Demeure historique sur les cofinancements
publics concernant les monuments historiques privés,
protégés, classés ou inscrits, souligne la
diversité des taux selon les régions.
Pour les monuments classés, un certain nombre de régions
atteignent 50 % (Auvergne, Bretagne, Franche-Comté,
Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie,
Poitou-Charente, Provence-Côte d'Azur) avec un maximum de 60 % pour
le Limousin et le Centre.
Pour les monuments inscrits, les niveaux d'intervention effectifs sont beaucoup
plus faibles. Ils se situent entre 10 et 15 % pour l'Alsace, l'Aquitaine,
la Bretagne, le Centre, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays de la Loire. Seule la
région Limousin atteint le taux de 40 % pour cette catégorie
de monuments.
Les interventions des conseils régionaux sont relativement
limitées et concernent, en règle générale,
uniquement des monuments classés
, sauf pour les régions de
Bretagne, de Corse et des Pays de la Loire. Ainsi, les régions Alsace,
Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Basse-Normandie et Poitou-Charentes interviennent de façon,
présentée dans l'étude la Demeure historique, comme
limitée, voire exceptionnelle.
Au niveau départemental, le taux d'intervention des conseils
généraux est souvent le même pour les monuments
classés et inscrits.
Il varie de 5 à 50 % dans l'Oise et
dans le Nord, en passant par 40 % pour des départements comme la
Mayenne ou la Sarthe.
L'étude souligne la
diversité de l'attitude des conseils
généraux vis-à-vis des monuments inscrits
: soit
le taux d'intervention est supérieur à celui des
« classés » pour compenser la moindre participation
de la DRAC, tel est le cas des départements de l'Ain, de l'Isère,
de la Moselle, de l'Oise, de la Seine-Maritime et de la Somme ; soit, au
contraire, certains conseils généraux n'aident pas les
« inscrits » comme dans les départements de
l'Allier, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, des Deux-Sèvres, du Lot
et des Pyrénées Orientales.
En définitive, il faut souligner
qu'un bon tiers des conseils
généraux n'apporte aucun soutien aux travaux entrepris sur des
monuments privés
: Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube,
Aude, Corrèze, Creuse, Dordogne, Doubs, Essonne, Gard, Gers,
Haute-Garonne, Gironde, Marne, Haute-Marne, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire,
Loiret, Meuse, Nièvre, Orne, Pas-de-Calais, Hauts-de-Seine,
Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.
A ces différences de taux d'intervention, s'ajoutent des
différences d'assiette et de modalités de calcul. Tandis que la
subvention de l'État est définie à partir du montant total
TTC des travaux, les concours des conseils généraux sont
calculés, dans certains cas, sur les montants hors taxes et se basent
aussi bien sur l'ensemble du coût de l'opération que sur la seule
part restant à la charge du propriétaire.
Peu de départements fixent des seuils minima -ils sont par exemple de
2.200 €, soit 80.000 francs pour la Côte d'Or- ; en revanche,
l'État exige un montant minimum de travaux de l'ordre de
1.500 euros ou un montant minimum de subvention de l'ordre de la
moitié de ce montant.
Enfin, nombreux sont les départements qui fixent des plafonds pour le
montant des travaux qui vont, dans les cas les plus fréquents,
jusqu'à 150.000 € (un million de francs)
13(
*
)
.
(4) Décentralisation et égalité des monuments devant les aides publiques
Ce
rapide état des lieux, qui mériterait sans doute d'être
confirmé de source ministérielle, démontre la grande
variabilité des interventions publiques. Non seulement les taux globaux
d'intervention sont très variables selon les lieux, mais encore les
conséquences de la distinction entre monuments classés et
monuments inscrits sont très différentes selon les
départements.
La Demeure historique s'interroge sur ce qu'elle appelle
«
l'égalité des chances des monuments historiques
privés en matière de cofinancement public ».
La décentralisation est perçue comme un enjeu important
«
car elle pourra renforcer des contrastes existants ou, au
contraire, les rééquilibrer
»par l'association, qui
conclut à la nécessité de l'intervention de
l'État : «
de ce point de vue là, le rôle
régulateur de l'État demeure important...
».
Votre rapporteur spécial estime, en effet, la question importante, mais
il s'interroge sur la compatibilité entre la volonté de laisser
une plus grande autonomie aux collectivités locales, et le maintien
d'une stricte égalité face aux aides publiques.
Dans une logique de décentralisation, certaines collectivités
pourront faire des efforts variables dans tel ou tel domaine, et il est donc
évident que tous les citoyens ne seront pas sur le même pied du
point de vue de ce qu'ils peuvent attendre de la puissance publique.
A cet égard,
le rôle de l'État central est
précisément, non pas tant de compenser les
inégalités qui pourraient résulter des différents
engagements des collectivités territoriales, que de s'assurer que la
protection nécessaire et suffisante des monuments est bien mise en place
sur l'ensemble du territoire.







