b) Des perspectives inquiétantes pour les Pyrénées
Les transports trans-pyrénéens ont fait l'objet d'une récente étude du conseil général des Ponts et Chaussées 30( * ) , dite « rapport Becker », dont nous présentons ci-après les principaux éléments. Les perspectives semblent inquiétantes.
(1) Un trafic de marchandises en forte croissance et en quasi-totalité routier
La forte
augmentation du trafic routier de marchandises trans-pyrénéen
s'explique par le rattrapage économique de la péninsule
ibérique, dont le volume des échanges avec les autres pays de
l'Union européenne a progressé de 1990 à 2000 de plus de
65 %.
Ainsi, le trafic de poids lourds sur les autoroutes transfrontalières a
doublé de 1989 à 1998, comme l'indique le graphique
ci-après.
Evolution du transport de marchandises
trans-pyrénéen entre 1989 et 1998
En millions de tonnes
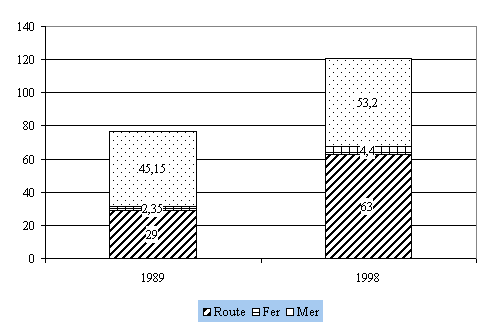
Source
: Conseil général des
ponts et
chaussées, Les transports à travers les Pyrénées,
enjeux et perspectives, mai 2001.
Cette forte augmentation du trafic routier suscite des phénomènes
de congestion et de pollution, en particulier près des
agglomérations de Bayonne et Saint-Sébastien, de Montpellier et
de Bordeaux.
Les axes autoroutiers trans-pyrénéens sont localisés de
part et d'autre de la chaîne, dans les corridors littoraux sans tunnel
transfrontalier. Ainsi, 96 % du trafic de marchandises utilisant le mode
routier passe par les axes du Perthus (A9) à l'est et du Biriatou (A63)
à l'ouest, avec respectivement 8.400 et 7.600 camions par jour en
l'an 2000 (à titre de comparaison, 2.000 camions traversaient
le tunnel du Mont-Blanc avant sa fermeture et 6.000 celui du Fréjus).
Dans les années récentes ont été conclus des
accords bilatéraux concernant :
- la réalisation du tunnel routier du Somport ;
- la construction et l'exploitation de la ligne ferroviaire à
grande vitesse entre Perpignan et Figueras, accessible aux trains fret, dont la
mise en service est prévue pour 2006.
Dans la liste des projets prioritaires arrêtés en 1994 à
Essen, le schéma des réseaux transeuropéens a retenu,
outre une branche atlantique pour le réseau ferré à grande
vitesse, la ligne Perpignan-Figueras.
287 millions d'euros, provenant de l'ouverture du capital des entreprises
publiques, doivent être consacrés en 2003 au financement de la
part française de la subvention publique prévue par le contrat de
concession de cette liaison.
Proposition n°
54.
: réaliser rapidement la
liaison Perpignan-Figueras.
Le tunnel du Somport
La
construction du tunnel du Somport a été décidée par
l'accord du 25 février 1991 conclu entre la France et l'Espagne.
Le projet a connu certaines vicissitudes :
- nombreuses manifestations (première occupation du chantier et de
ses abords le 27 août 1991) ;
- annulation par le tribunal administratif de Pau de l'arrêté
déclarant les travaux d'utilité publique (2 décembre
1992) ;
- report de l'ouverture du tunnel à la circulation, à cause
du caractère infructueux de l'appel d'offres européen
lancé à l'été 2001 pour désigner un
exploitant, et de la réalisation de travaux de sécurité
à la suite des catastrophes dans les Alpes (mars 2002).
Selon le conseil général des ponts et chaussées, «
l'ouverture du tunnel du Puymorens en 1993 n'a pas eu d'impact sur le trafic
poids lourds empruntant cet itinéraire. Le même
phénomène pourrait être constaté lors de la mise en
service du tunnel du Somport. Actuellement , la RN 134 supporte un trafic
plutôt stable de 130 poids lourds par jour à la
frontière correspondant à des échanges locaux. Mais aucun
élément ne permet de dire aujourd'hui que son ouverture va
attirer un trafic nouveau de poids lourds
».
A l'occasion de son déplacement dans le massif des
Pyrénées, la mission commune d'information a pu constater le
contraste entre l'aménagement routier de part et d'autre du tunnel, la
voie d'accès étant en France extrêmement étroite,
contrairement au côté espagnol. On ne peut que regretter ce
décalage, qui nuit à la coopération entre les deux pays.
(2) Un chemin de fer insuffisamment développé
La
structure du réseau ferroviaire est analogue à celle du
réseau autoroutier : les deux lignes principales, à doubles
voies et électrifiées, empruntent les corridors latéraux
et captent la totalité du fret ferroviaire existant et l'essentiel du
trafic voyageurs.
Le conseil général des ponts et chaussées estime que
«
le rôle et la fonction actuels du réseau
ferroviaire apparaissent (...) bien modestes au regard de l'importance des
échanges et des possibilités qu'on pourrait attendre de ce mode.
En 1998, 4,4 millions de tonnes ont été transportés
par mode ferroviaire à travers les Pyrénées,
principalement en provenance ou à destination de la France et de
l'Allemagne. Si l'on reprend la comparaison avec les Alpes, et en particulier
les Alpes françaises, force est de constater que la part du mode
ferroviaire dans les transports terrestres de marchandises au franchissement de
la frontière reste modeste dans les Pyrénées : 6,5 %
en fer-fer (10 % côté France, si on ajoute le trafic
rail-route) alors qu'elle atteint 20 % sur les Alpes françaises et
34 % sur l'arc Vintimille-Brenner
».
Ce phénomène s'explique par le fait que les infrastructures
ferroviaires sont insuffisantes, ce qui provient notamment d'un
écartement des rails différent entre la France et l'Espagne. En
effet, si pour les voyageurs, l'introduction déjà ancienne des
essieux à écartement variable (système Talgo) a permis de
surmonter ce handicap, pour les marchandises, il faut encore procéder
à des opérations de changement d'essieux ou de transbordement.
Ainsi, selon le conseil général des ponts et chaussées,
dans la traversée des Pyrénées, «
les camions
n'utilisant pas de tunnels à péage ne subissent aucune charge
particulière ou aucun délai d'attente qui pourraient en
résulter, alors que la même masse de marchandise [la masse par
wagon ou équivalent d'un poids lourd] utilisant le mode ferroviaire
subit un délai d'attente et doit acquitter une charge de 300 F
environ
».
Ce n'est que depuis peu qu'est menée une politique de
développement du fret international sur ces corridors, tant en Espagne
qu'en France. Ainsi, la SCNF poursuit un objectif de 100 milliards de t.km
de fret en 2010, et son homologue espagnole (la RENFE) vise un doublement en
cinq ans du transport combiné.
(3) Une saturation inévitable sans rééquilibrage modal ?
Selon le
conseil général des ponts et chaussées, l'augmentation
rapide des flux de marchandises inter-pyrénéens devrait se
poursuivre. Les flux augmenteraient de 110 MT environ, d'ici à
l'année 2020.
Le rapport distingue plusieurs scénarios d'évolution des
différents modes. Le scénario le plus favorable,
privilégié par le CGPC, est ambitieux puisqu'il suppose que les
modes ferroviaire et maritime parviennent à améliorer
suffisamment leur offre pour accroître leur part modale de manière
significative. Dans le cas des deux derniers scénarios
(défavorables, soit du fait d'une absence de
rééquilibrage, soit du fait d'une hypothèse haute de
croissance économique), le trafic de poids lourds sur chacune des deux
autoroutes atteint 14.000 à 15.000 véhicules par jour en
2015. Selon le CGPC, «
ces trafics sont compatibles avec des
autoroutes à 2 x 3 voies, mais ils constituent sans doute
une limite supportable qu'il convient de ne pas dépasser
».
Ainsi, la croissance du trafic routier continuerait de s'accroître
jusqu'en 2020, avec à cette date un risque de saturation,
le seul
scénario sans saturation (avec aménagement des autoroutes en
2 x 3 voies) étant celui retenant l'hypothèse de
référence de croissance économique, avec
rééquilibrage modal.
Ainsi, la mission commune d'information s'interroge sur les moyens à
mettre en oeuvre dans les Pyrénées.
Sans volonté
politique forte, des phénomènes de saturation semblent
inévitables.







