Rapport d'information n° 37 (2005-2006) de MM. Gérard DÉRIOT et Jean-Pierre GODEFROY , fait au nom de la mission commune d'information, déposé le 26 octobre 2005
Disponible au format Acrobat (1,2 Moctet)
-
INTRODUCTION
-
LES TRAVAUX DE LA MISSION COMMUNE
D'INFORMATION
-
REPÈRES CHRONOLOGIQUES SUR L'AMIANTE
-
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
PAR LA MISSION D'INFORMATION
-
PREMIÈRE PARTIE -UN DRAME
ÉVITABLE ?
-
I. UNE INDIFFÉRENCE SINGULIÈRE FACE
À UNE MENACE CONNUE DE LONGUE DATE
-
A. L'UTILISATION INTENSIVE DE L'AMIANTE EN
FRANCE
-
B. LA NOCIVITÉ DE L'AMIANTE EST CONNUE DE
LONGUE DATE
-
1. Un danger connu depuis le début du
XXe siècle
-
2. Une accumulation de données scientifiques
et médicales sur l'amiante
-
3. L'inscription des affections engendrées
par l'amiante au tableau des maladies professionnelles
-
4. Des événements
révélateurs qui auraient dû provoquer une prise de
conscience
-
5. La réglementation communautaire
-
6. Les rapports de la fin des années
1990
-
1. Un danger connu depuis le début du
XXe siècle
-
C. LA PASSIVITÉ DES « DONNEURS
D'ALERTE » INSTITUTIONNELS
-
A. L'UTILISATION INTENSIVE DE L'AMIANTE EN
FRANCE
-
II. L'ÉTAT
« ANESTHÉSIÉ » PAR LE LOBBY DE
L'AMIANTE
-
III. DES RESPONSABILITÉS MULTIPLES
-
A. LA RESPONSABILITÉ DES EMPLOYEURS
-
B. LA RESPONSABILITÉ DE
L'ÉTAT
-
C. QUELLE RESPONSABILITÉ
PÉNALE ?
-
A. LA RESPONSABILITÉ DES EMPLOYEURS
-
I. UNE INDIFFÉRENCE SINGULIÈRE FACE
À UNE MENACE CONNUE DE LONGUE DATE
-
DEUXIÈME PARTIE - MIEUX
RÉPARER : LE SUIVI MÉDICAL ET L'INDEMNISATION DES VICTIMES
DE L'AMIANTE
-
I. L'AMPLEUR DU DRAME DE L'AMIANTE A CONDUIT
À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES
VICTIMES
-
A. LE SUIVI MÉDICAL POST-PROFESSIONNEL DES
TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE
-
B. UN RÉGIME DE PRÉRETRAITE PROPRE
AUX VICTIMES DE L'AMIANTE : LE FCAATA
-
C. LE CHOIX DE LA RÉPARATION
INTÉGRALE ET LA CRÉATION DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L'AMIANTE (FIVA)
-
A. LE SUIVI MÉDICAL POST-PROFESSIONNEL DES
TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE
-
II. LA RAPIDE MONTÉE EN PUISSANCE DES
DÉPENSES DE RÉPARATION POSE LA QUESTION DE LA
RÉALITÉ DE LEUR FINANCEMENT
-
A. UN RYTHME SOUTENU DE PROGRESSION DES
DÉPENSES
-
B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES FONDS
DE L'AMIANTE À AMÉLIORER
-
A. UN RYTHME SOUTENU DE PROGRESSION DES
DÉPENSES
-
III. UN RÉGIME D'INDEMNISATION QUI N'A PAS
RÉPONDU À TOUTES LES ASPIRATIONS
-
A. LA PERSISTANCE D'UN IMPORTANT
CONTENTIEUX
-
B. UN RÉGIME DE
« PRÉRETRAITE AMIANTE » SOUMIS À DES
PRESSIONS CONTRADICTOIRES
-
1. Les modalités d'inscription des
établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice de
l'ACAATA font l'objet de vives critiques
-
2. Toutes les catégories de travailleurs
n'ont pas également accès à un régime de
préretraite amiante
-
3. Des dérives ont été
observées dans l'utilisation du FCAATA
-
4. Le coût croissant du dispositif suscite
des demandes de resserrement des conditions d'accès à
l'ACAATA
-
1. Les modalités d'inscription des
établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice de
l'ACAATA font l'objet de vives critiques
-
C. UN MODE DE FINANCEMENT QUI INCITERAIT PEU
À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
-
1. Une forte concentration des victimes de
l'amiante dans quelques entreprises
-
2. De puissants mécanismes de
mutualisation
-
3. Un faible nombre de recours subrogatoires
intentés par le FIVA
-
4. Une situation peu favorable à la
prévention des risques professionnels
-
5. Vers une moindre mutualisation des
dépenses ?
-
1. Une forte concentration des victimes de
l'amiante dans quelques entreprises
-
D. LE DRAME DE L'AMIANTE INVITE À
RÉEXAMINER LES MODALITÉS DE RÉPARATION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
-
A. LA PERSISTANCE D'UN IMPORTANT
CONTENTIEUX
-
I. L'AMPLEUR DU DRAME DE L'AMIANTE A CONDUIT
À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES
VICTIMES
-
TROISIÈME PARTIE - LE SOUCI DE
PRÉVENIR DE NOUVELLES CONTAMINATIONS
-
I. UN RISQUE AMIANTE ENCORE PRÉSENT
-
A. L'AMIANTE DIT
« RÉSIDUEL », MAIS OMNIPRÉSENT
-
1. Les diverses utilisations de l'amiante dans la
construction
-
2. L'amiante dans les bâtiments
publics
-
3. Les populations principalement
exposées
-
a) Les professions de « second
oeuvre » dans le secteur du bâtiment : le rôle
essentiel du DTA
-
b) Les personnels de maintenance et
d'entretien
-
c) Les ouvriers des chantiers de
désamiantage
-
(1) Une réglementation rigoureuse
-
(2) Des obligations de sécurité
difficiles à appliquer en raison des conditions de travail sur les
chantiers de désamiantage
-
(3) La nécessité de renforcer la
qualification des salariés du désamiantage
-
(4) Les opérations de traitement de
l'amiante-ciment ne sont aujourd'hui pas encadrées
-
(1) Une réglementation rigoureuse
-
a) Les professions de « second
oeuvre » dans le secteur du bâtiment : le rôle
essentiel du DTA
-
4. La prévention des risques d'exposition
« passive » à l'amiante : une
réglementation stricte mais mal appliquée
-
1. Les diverses utilisations de l'amiante dans la
construction
-
B. L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
-
1. L'amiante en Corse
-
2. L'amiante en Nouvelle-Calédonie
-
3. Le problème du suivi et du traitement
des déchets amiantés
-
4. Le risque d'importation en France de produits
contenant de l'amiante
-
1. L'amiante en Corse
-
A. L'AMIANTE DIT
« RÉSIDUEL », MAIS OMNIPRÉSENT
-
II. LA PRÉVENTION DE NOUVELLES
CONTAMINATIONS
-
A. DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION
RENFORCÉS
-
B. S'ASSURER DE L'INNOCUITÉ DES PRODUITS DE
SUBSTITUTION
-
C. UNE NÉCESSAIRE POLITIQUE DE
PRÉVENTION À L'ÉGARD DES PRODUITS CHIMIQUES
-
A. DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION
RENFORCÉS
-
I. UN RISQUE AMIANTE ENCORE PRÉSENT
-
LISTE DES PROPOSITIONS
-
CONTRIBUTIONS
-
COMPTES RENDUS DES DÉPLACEMENTS DE LA
MISSION
N° 37
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 2005 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission commune d'information (1) sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante ,
Par M. Gérard DÉRIOT,
Rapporteur,
et
M. Jean-Pierre GODEFROY,
Rapporteur-adjoint.
|
Tome I : Rapport |
(1) Cette mission commune d'information est composée de : M. Jean-Marie Vanlerenberghe, président ; M. Gérard Dériot, rapporteur ; M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur-adjoint ; MM. Paul Blanc, Jean-Léonce Dupont, Roland Muzeau, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, vice-présidents ; M. Gilbert Barbier, Mme Sylvie Desmarescaux, secrétaires ; M. Bernard Angels, Mme Marie-Christine Blandin, M. Philippe Dallier, Mme Michelle Demessine, MM. Jean Desessard, Ambroise Dupont, Pierre Fauchon, Bernard Frimat, Georges Ginoux, Francis Giraud, Alain Gournac, Mmes Adeline Gousseau, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, M. Roger Madec, Mme Catherine Procaccia, MM. Henri de Richemont et Jean-Marc Todeschini.
|
Santé publique. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le 2 février 2005, le Sénat a autorisé la création d'une mission d'information commune pour établir le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante.
Une telle initiative n'est pas nouvelle pour le Parlement puisque l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, saisi il y a plus de dix ans du dossier de l'amiante, a rendu ses conclusions en octobre 1997 dans un rapport 1 ( * ) qui reste largement d'actualité.
La création d'une mission d'information s'imposait cependant, pour évaluer la progression du drame sanitaire annoncé, qui est aujourd'hui loin d'avoir atteint son pic, pour mesurer l'efficacité et le coût des dispositifs d'indemnisation mis en place à la fin des années 90, pour faire le point sur les problèmes de responsabilité civile et pénale actuellement pendants devant les diverses juridictions, et d'une manière générale, pour essayer de comprendre comment une telle tragédie a pu se développer, en évitant cependant la tentation de juger et de rechercher des coupables en fonction des connaissances d'aujourd'hui, ce qui n'est pas la vocation d'une mission d'information.
Comme on le verra, la France n'est pas le seul pays touché par cette catastrophe sanitaire , mais le retard pris pour édicter des mesures de précaution et d'interdiction, alors que les dangers de l'amiante étaient déjà parfaitement documentés au milieu des années 60, et accessibles à nos décideurs, fait que la courbe des pathologies malignes dues à l'exposition, notamment des cancers de la plèvre, les mésothéliomes, est encore ascendante, alors que celle-ci est en baisse dans d'autres pays comme les États-Unis, où les entreprises ont pris vingt ans plus tôt des mesures de prévention.
Comme on le sait désormais, les prévisions établies par les scientifiques les plus autorisés, épidémiologistes et pneumologues, sont particulièrement sombres et ont d'ailleurs été confirmées par les deux ministres en charge de la santé et du travail devant la mission : alors que 35.000 décès peuvent être imputés à l'amiante entre 1965 et 1995, 60.000 à 100.000 morts sont attendues dans les 20 à 25 ans à venir, en raison du temps de latence de 30 à 40 ans du mésothéliome, auquel il convient d'ajouter environ 10 % des 25.000 cancers du poumon déclarés chaque année. Compte tenu de l'issue fatale de ces pathologies malignes, les scientifiques jugent l'épidémie à venir inéluctable et irréversible et son ampleur déterminée jusqu'en 2030.
La contamination par l'amiante apparaît donc comme un drame sanitaire majeur dont les conséquences sociales se prolongeront pendant plusieurs dizaines d'années, en France comme à l'étranger. L'Organisation internationale du travail (OIT) estime ainsi que 100.000 personnes mourront chaque année dans le monde en raison de l'usage massif qui a été fait ou qui est encore fait de ce matériau.
En effet, seuls 40 pays ont interdit l'amiante, dont les 25 pays de l'Union européenne, et on estime à 174 millions de tonnes l'amiante qui a été extrait et utilisé dans le monde au cours du siècle dernier : à titre d'exemple, 3.000 produits contenant de l'amiante ont été recensés dans notre pays et 100 millions de m 2 de nos bâtiments seraient encore amiantés.
Compte tenu de ses remarquables propriétés et de son faible coût, l'amiante a été massivement utilisé notamment dans les filatures, dans la sidérurgie, dans la réparation et la construction navale ; pour calorifuger les fours, les chaudières, les chauffe-eau, les équipements frigorifiques, les navires et les matériels ferroviaires ; pour protéger contre l'incendie les structures métalliques utilisées dans la construction ; pour étanchéifier et coller les revêtements de sol, les cloisons intérieures ; pour isoler thermiquement les cheminées, les appareils de chauffage ; pour fabriquer des faux plafonds, des portes coupe-feu, des appareils électroménagers d'usage courant...
Le « magic mineral » est ainsi rapidement devenu le compagnon de route du développement industriel, de la France de l'avant-guerre, jusqu'à la fin des Trente Glorieuses.
Comme on le sait, il a été utilisé à profusion pour prévenir le risque incendie des campus trop souvent à taille inhumaine des années 60 (Jussieu) et des cités universitaires, des immeubles de grande hauteur des quartiers d'affaires de la Défense et de Montparnasse afin que ceux-ci ne devinssent autant de tours infernales, des milliers de collèges à structure métallique construits à la hâte entre le milieu des années 60 et 70 pour répondre à l'explosion démographique dans l'enseignement secondaire, des bâtiments hospitaliers et notamment de la plupart des hôpitaux parisiens de l'assistance publique...
Quant à l'amiante-ciment 2 ( * ) , considéré comme moins dangereux, parce que non friable, il couvre encore de ses ondulations les maisons d'habitation, garages, appentis et abris de jardin de nos villes et de nos villages ; il évacue nos eaux pluviales et usées ; il abrite au grand dam des défenseurs de l'environnement, et quelles que soient les régions d'élevage, toutes les variétés de nos cheptels.
Bref, jusqu'à son interdiction tardive en 1997, l'amiante a fait l'objet d'une utilisation généralisée et fait encore partie de notre environnement quotidien.
Cependant, certaines populations ont été plus particulièrement exposées au « minerai miracle » avant son interdiction : bobineuses et cardeuses des filatures d'amiante de Condé-sur-Noireau ou de l'usine textile Amisol de Clermont-Ferrand, salariés des sous-traitants de l'automobile fabriquant des garnitures de frein et d'embrayage, ouvriers de la réparation et de la construction navale, notamment des arsenaux qui ont truffé d'amiante les bâtiments de la Royale, les sous-marins de notre force de dissuasion et nos porte-avions, dont on espère qu'ils ne sont pas promis aux désamianteurs aux pieds nus des chantiers indiens de démolition, mais aussi dockers et personnels portuaires de manutention de Dunkerque, de Marseille ou de Bastia qui ont longtemps déchargé sans protection les sacs de minerai importés du Canada, du Brésil ou provenant de la mine corse de Canari, ouvriers des entreprises de flocage et de calorifugeage des années 60...
Les effectifs concernés apparaissent considérables puisque l'Institut de veille sanitaire a récemment évalué à 27,6 % le pourcentage actuel des retraités masculins qui ont été exposés à l'amiante au cours de leur vie professionnelle.
Le risque d'exposition ou de contamination n'est pas derrière nous puisque les ouvriers de « second oeuvre » dans le bâtiment (électriciens, plombiers, couvreurs, chauffagistes...), les personnels d'entretien et de maintenance, souvent à statut précaire, les salariés des entreprises de désamiantage, dont les trois quarts ne respecteraient pas les obligations de sécurité, les ouvriers du BTP travaillant sur les terrains amiantifères de Bastia et du nord de la Haute-Corse... sont encore aujourd'hui exposés à l'amiante dit résiduel ou environnemental.
D'après les informations fournies à la mission, 80 % des mésothéliomes aujourd'hui observés le sont chez des salariés du bâtiment, qui ont été, comme les petites entreprises qui souvent les emploient, longtemps tenus dans l'ignorance des dangers de l'amiante, dont le repérage n'a été rendu obligatoire que tout récemment pour les bâtiments où ils sont conduits à intervenir, la fiabilité des diagnostics effectués étant par ailleurs souvent discutable compte tenu des conditions de leur réalisation.
La mission s'est légitiment interrogée sur le retard pris par notre pays pour mettre en oeuvre les premières mesures de prévention , avant l'interdiction complète et encore plus tardive de l'amiante.
On rappellera en effet que la Grande-Bretagne, dès 1931, et les États-Unis, dès 1946, ont édicté les premières réglementations limitant l'empoussièrement dans les usines concernées.
En dépit d'un premier signal lancé en 1906 par un inspecteur du travail de Caen ayant enquêté sur la surmortalité des ouvriers d'une usine de textile de Condé-sur-Noireau utilisant l'amiante, dont le rapport est resté lettre morte, de l'inscription en 1945 des fibroses pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières de silice ou d'amiante et de la reconnaissance en 1950 de l'asbestose dans les tableaux des maladies professionnelles, ce n'est qu'en 1976 que le tableau n° 30 prendra en compte le cancer du poumon et le mésothéliome, qu'en 1977 que sera interdit le flocage dans les immeubles d'habitation, et que sera réduite la concentration d'amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises.
C'est donc 46 ans après le Royaume-Uni, 31 ans après les États-Unis, mais aussi 13 ans après la réunion de la conférence internationale de New York en 1964 - dont les actes étaient pourtant consultables dès 1965 à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris, à quelques centaines de mètres du siège des ministères concernés - qui a documenté de manière complète les risques liés à l'amiante, que la France prendra les premières mesures de précaution.
Alors que le caractère cancérigène de l'amiante était souligné par une résolution du Parlement européen de janvier 1978, transmise au Conseil des ministres et à la Commission, ce n'est que 19 ans après que notre pays interdira l'amiante.
Plusieurs raisons sont traditionnellement évoquées pour expliquer l'inertie de nos décideurs :
- le fait que l'exposition à l'amiante concernait pour l'essentiel le monde ouvrier, qui n'avait pas les moyens de mesurer les risques : il a fallu attendre les révélations des enseignants-chercheurs de Jussieu au milieu des années 70, découvrant que leurs locaux étaient pour une large part floqués à l'amiante, et qui ont pu aisément effectuer des recherches dans une littérature scientifique déjà abondante, pour prendre la mesure des risques encourus par les salariés des usines de transformation de l'amiante ;
- les longs délais de latence des maladies de l'amiante qui ont longtemps conduit à sous-estimer les conséquences de l'exposition à ce matériau ;
- les incertitudes scientifiques relatives à la dangerosité de l'exposition à l'amiante à de faibles doses ;
- les carences de notre système de santé au travail et de prévention des risques professionnels : celles-ci résultent de l'absence, à l'époque, de systèmes de veille et d'alerte 3 ( * ) , du rôle ambigu de l'Institut national de recherche et de sécurité, de l'inadaptation et du manque de moyens de la médecine et de l'inspection du travail, et plus généralement de la traditionnelle sous-administration des départements ministériels en charge du travail et de la santé, comme l'ont révélé, notamment pour ce dernier, les crises sanitaires du sang contaminé et des farines animales ; la mise en place d'instruments nouveaux, comme l'InVS et le Plan santé au travail, à la condition qu'ils bénéficient de moyens adaptés, répond à ces insuffisances ;
- une pause dans la mobilisation : le contexte politique et social des années 80 jusqu'au milieu des années 90, conjugué à une dégradation de la situation de l'emploi, a contribué à réduire la mobilisation qui avait porté le dossier de l'amiante dans les années 70.
Enfin, la mission considère que le fait que le dossier de l'amiante ait été officieusement délégué dans le même temps, entre 1982 et 1995, à une structure informelle et singulière - le comité permanent amiante (CPA) - qui n'était en fait qu'un lobby de l'industrie dans lequel siégeaient également des scientifiques, les partenaires sociaux et des représentants des ministères concernés, et qui prônait l'usage contrôlé de l'amiante, a joué un rôle non négligeable dans le retard de l'interdiction de ce matériau en France.
Comme il sera vu plus loin, et en l'absence de toute tutelle ministérielle, le CPA a bénéficié de la caution de scientifiques éminents, mais aussi de jeunes chercheurs abusés et tenus dans l'ignorance de l'existence de produits de substitution et a participé à de nombreux et coûteux colloques à l'étranger - en particulier au Canada, dont on sait la position à l'égard de l'amiante - financés par les industriels et ayant pour objet de prolonger l'utilisation du « magic mineral » et d'en relativiser les risques, les organisations syndicales ayant été associées à cette démarche dans une conjoncture dégradée de l'emploi.
Le comité permanent amiante apparaît ainsi, selon la mission, comme un « modèle » de lobbying, de communication et de manipulation , et a su exploiter, en l'absence de l'État, de pseudo incertitudes scientifiques qui pourtant étaient levées, pour la plupart, par la littérature anglo-saxonne la plus sérieuse de l'époque.
Comme il a été dit, et compte tenu de la feuille de route qui lui a été assignée, la mission n'a pas vocation à se substituer à la justice pour établir des responsabilités dans ce dossier, mais à comprendre et à formuler des propositions.
Il reste que les risques de l'amiante, depuis quarante ans au moins, étaient connus, documentés, accessibles aux scientifiques, même si Internet n'existait pas, aux médecins, aux inspecteurs du travail, aux gestionnaires des régimes sociaux, aux fonctionnaires des administrations centrales concernées, pour peu que ceux-ci se donnassent la peine de chercher l'information et de la faire remonter aux décideurs, c'est-à-dire aux pouvoirs publics.
Si tout le monde était en mesure de savoir, à une certaine époque, certains en savaient plus que d'autres, notamment les industriels de l'amiante : les grands groupes multinationaux et leur organisation professionnelle en contact avec les trusts anglo-saxons de la production et de la transformation de l'amiante avaient en effet aisément accès aux études scientifiques sur ses dangers et, jusqu'au début des années 70, se sont efforcés de bâtir une stratégie pour leur permettre de continuer à utiliser le minerai.
Les entreprises moyennes, petites ou artisanales, si elles ne peuvent encourir le même reproche, ne sauraient cependant être exonérées de toute responsabilité, comme l'attestent les condamnations quasi-systématiques pour faute inexcusable de l'employeur.
Les organisations syndicales, qui disposent il est vrai d'informations et de moyens d'investigations moins complets que ceux des employeurs, n'ont pas non plus discerné la menace représentée par l'utilisation de l'amiante et ont souvent eu tendance à accorder la priorité à la préservation de l'emploi, au détriment des enjeux de santé au travail.
Sans déflorer les développements qui seront consacrés plus loin à la responsabilité des employeurs, notamment à la suite de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute inexcusable et aux procédures pénales actuellement pendantes devant les tribunaux, on rappellera que le Conseil d'État, par quatre décisions du 3 mars 2004, a confirmé la responsabilité de l'État pour défaut de réglementation spécifique à l'amiante avant 1977 et pour le caractère tardif et insuffisant de la réglementation après cette date, en suivant les conclusions sévères du commissaire du gouvernement qui estimait que la carence et l'inertie de l'administration engageaient cette responsabilité.
A la suite de la décision d'interdire l'amiante, la réparation du préjudice subi par les victimes de la contamination apparaissait comme une exigence : elle s'est traduite dès la fin des années 90 par la mise en place d'un dispositif spécifique de préretraite destiné à compenser la perte d'espérance de vie des personnes exposées, le FCAATA, puis par un dispositif dérogatoire au droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituant une indemnisation intégrale de leur préjudice, le FIVA.
Comme il sera vu, ces mécanismes de réparation sont susceptibles d'être améliorés afin notamment de rendre les indemnisations plus cohérentes et plus homogènes, de réduire les recours contentieux et de remédier aux dérives du dispositif de cessation anticipée d'activité, parfois utilisé comme instrument de gestion des effectifs dans des secteurs d'activité en difficulté. Il reste que les dépenses au titre de la prise en charge des victimes de l'amiante risquent de représenter entre 27 à 37 milliards d'euros dans les vingt années à venir , ce qui conduit à s'interroger sur les modalités de leur financement, alors que celui-ci est assuré pour l'essentiel par la branche accidents du travail-maladies professionnelles de la sécurité sociale, privilégiant ainsi la mutualisation du risque au détriment de la nécessaire prévention et de la responsabilisation des employeurs.
Au total, force est de constater que la gestion du problème de l'amiante en France a été défaillante, que cette défaillance met en cause la responsabilité de l'État, justifiant par là la mise en place de dispositifs de réparation pour les victimes, dont les défauts et dérives devraient être corrigés.
S'agissant de la responsabilité civile des employeurs, alors que celle-ci est désormais fréquemment reconnue par les tribunaux pour faute inexcusable, les victimes engagent de plus en plus des actions pénales qui devraient être désormais regroupées dans les pôles santé de Paris et de Marseille, et qui pourraient aboutir à des condamnations, sous réserve que la Cour de cassation les confirme et que leurs moyens d'instruction soient adaptés à l'importance d'un dossier pénal qui pourrait être le plus important du siècle, comme le montre l'exemple des États-Unis.
Contrairement à l'opinion généralement émise par les associations de victimes et leurs avocats, la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels ne devrait pas s'opposer, comme il sera vu plus loin, à la recherche d'une responsabilité pénale dans le dossier de l'amiante.
Enfin, le drame sanitaire de la contamination par l'amiante s'inscrit dans une problématique plus large de l'utilisation de produits dangereux pour la santé humaine et l'environnement, qu'il s'agisse des produits de substitution , comme les fibres céramiques réfractaires, dont la dangerosité semble aujourd'hui avérée, mais aussi des milliers de produits chimiques utilisés dans l'industrie et mis sur le marché, qu'une proposition de règlement communautaire, actuellement bloquée par le lobby des industriels, notamment allemands, se propose de réglementer.
A cet égard, le précédent de l'amiante doit servir de leçon pour qu'à l'avenir de tels drames sanitaires ne se reproduisent pas.
LES TRAVAUX DE LA MISSION COMMUNE D'INFORMATION
Les étapes de la constitution de la mission
- Lors de sa réunion du 2 décembre 2004, le bureau de la commission des Affaires sociales a examiné, à l'initiative de Mme Valérie Létard, de M. Gérard Dériot et de M. Roland Muzeau,, le principe de la constitution d'une mission d'information consacrée au drame sanitaire de la contamination par l'amiante et à ses répercussions sur le plan humain, social et financier, cette initiative étant soutenue par les représentants de l'ensemble des groupes.
- Compte tenu de l'ampleur des problèmes soulevés, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, a proposé à ses collègues présidents de commission de s'associer à cette démarche, par un courrier du 7 décembre 2004.
- Cette suggestion, qui a reçu un accueil favorable des commissions des lois, des finances, des affaires culturelles et des affaires étrangères, a fait l'objet d'une demande de création d'une mission d'information commune transmise dans un courrier du 20 décembre 2004 à M. le Président du Sénat.
- Par lettre du 21 décembre 2004, adressée au président About, M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, a décidé de s'associer à la démarche initiée.
- Lors de la réunion du 1 er février 2005, le Bureau du Sénat a approuvé la demande, formulée par les présidents des six commissions permanentes, de création d'une mission d'information commune sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante, dans les formes fixées par l'article 21 du Règlement.
- Le 2 février 2005, la mission a été nommée par le Sénat à la proportionnelle des groupes, après désignation de ses membres par les commissions.
- La mission s'est constituée le 9 février 2005 en nommant son bureau.
- Le 16 février 2005, la mission a approuvé les grandes lignes du calendrier et du programme de travail arrêtées au préalable par son bureau ; elle a ensuite procédé à la première audition.
- Lors de sa réunion du 19 octobre 2005, la mission a procédé à l'examen de son rapport et l'a adopté à l'unanimité des présents, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstenant.
Les auditions de la mission
Du 16 février au 28 septembre 2005, la mission a procédé à l'audition de 70 personnalités concernées à des titres divers par le dossier de l'amiante : épidémiologistes, toxicologues, pneumologues, cancérologues, représentants d'organismes scientifiques et de veille (INSERM, InVS, INRS, ...), gestionnaires de l'assurance maladie et des « fonds amiante », associations de victimes, avocats de ces associations et des employeurs, représentants de laboratoires d'études et de contrôle et de sociétés de diagnostic, professionnels du retrait et du traitement de l'amiante, responsables de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, assureurs, hauts fonctionnaires actuels et anciens des administrations centrales principalement concernées, président de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, journaliste, magistrate du pôle santé publique de Paris, représentant de la compagnie Saint-Gobain, ministres anciens et actuels, représentants des organisations syndicales et patronales entendus lors de tables rondes séparées...
Ne disposant pas des prérogatives de convocation des commissions d'enquête, la mission n'a pu recueillir que les témoignages de ceux qui ont bien voulu répondre à son invitation et nombre d'interlocuteurs qu'elle aurait souhaité entendre ont manqué à l'appel : des acteurs importants du comité permanent amiante ont ainsi refusé de comparaître, tel un éminent toxicologue, ancien responsable de la commission des maladies professionnelles qui défendit jusqu'au-delà du raisonnable devant l'Académie de médecine l'usage contrôlé de l'amiante ; d'autres, par la voix de leur secrétariat ou même de leur conjoint, ont décliné l'invitation qui leur était faite en arguant de leur grand âge, de leur état de santé, d'occupations prenantes, de déplacements à l'étranger, d'archives disparues, de l'oubli d'un dossier déjà bien ancien...
La mission tient à remercier en revanche les ministres actuellement en charge du travail, de la justice et de la santé, ainsi que deux de leurs prédécesseurs, M. Jacques Barrot et Mme Martine Aubry, qui lui ont apporté des informations précieuses, cette dernière ayant cependant regretté que d'autres anciens titulaires de départements ministériels, pourtant au moins autant concernés par le dossier amiante que ceux du travail et de la santé, n'aient pas jugé utile d'éclairer la mission de leur savoir.
Elle tient également à exprimer sa reconnaissance à certains de ses interlocuteurs, initiateur ou anciens membres du CPA, qui lui ont permis de se faire une religion sur le rôle véritable de cette structure informelle (M. Dominique Moyen, M. Patrick Brochard, M. Jean-Luc Pasquier...) ainsi qu'à M. Christophe Blanchard-Dignac, ancien directeur du budget qui a notamment évoqué les raisons de la dérive financière du chantier de Jussieu...
La mission doit par ailleurs relever une certaine désinvolture, parfois doublée de langue de bois, dans les déclarations, les réponses lapidaires ou les non réponses de certains hauts fonctionnaires qui semblaient témoigner d'un manque de curiosité à l'égard d'un dossier, certes transversal, et d'un attachement peut-être excessif à leur seul domaine ministériel de compétences.
Elle notera également la virulence des propos tenus par certains représentants des associations, dûment accompagnés de leurs conseils, notamment mettant en cause la loi dite Fauchon de juillet 2000 sur les délits non intentionnels, adoptée à l'unanimité par le Parlement, dont les initiateurs n'auraient eu, selon eux, que le souci de faire échapper les élus au droit commun de la responsabilité pénale.
Elle relèvera aussi le caractère parfois vif des déclarations des représentants des employeurs qui se sont refusé à assumer la responsabilité que certains voudraient leur imputer dans la contamination par l'amiante, au motif des incertitudes scientifiques de l'époque et de l'absence, pendant longtemps, de toute réglementation spécifique ou interdiction des pouvoirs publics.
Par ailleurs, sans mettre en cause l'intérêt des témoignages qui lui ont été apportés, la mission a cependant remarqué trop de similitudes dans l'argumentaire développé, aussi bien par les ministres que par leur administration, pour que celui-ci n'apparaisse pas comme une réponse aux considérants sévères du Conseil d'État, affirmant en 2004 la responsabilité de l'État, des déclarations convergentes des associations de victimes, illustrées souvent des mêmes exemples, des explications trop prudentes ou trop calibrées pour ne pas avoir été dictées par des services juridiques d'entreprise...
Bref, la mission a pu avoir le sentiment que l'ombre des juges planait sur certaines de ses auditions.
Elle a enfin noté l'extrême rigueur des gestionnaires des deux fonds « amiante » respectivement chargés des systèmes de préretraite et d'indemnisation, les seconds semblant toutefois plus soucieux de maintenir les difficiles compromis obtenus, notamment sur le barème des indemnisations, que de rechercher une réduction des recours des victimes devant les tribunaux, ce qui était la finalité du FIVA, ou d'exercer toutes les missions qui leur ont été assignées par le législateur, notamment en engageant des actions subrogatoires auprès des entreprises pour récupérer les sommes versées.
Les déplacements de la mission
Outre ces auditions traditionnelles, la mission a complété ses investigations en effectuant quatre déplacements.
|
- réunion avec des représentants des associations nationale et régionale des victimes de l'amiante ; - conférence de presse au siège de l'ARDEVA ; - à l'invitation de M. Alain Perret, sous-préfet de Dunkerque, déjeuner de travail à la sous-préfecture, en présence notamment de M. Jean-Pierre Decool, député, M. Jean-Philippe Joubert, procureur de la République, M. Naels, président de la CCI, M. Léchevin, directeur des relations humaines du Port autonome, M. Pierre Pluta, président de l'ARDEVA ; - table ronde avec les syndicats ; - audition des représentants de l'entreprise ARCELOR ; - table ronde avec des représentants de la CRAM et des médecins du travail ; - audition de l'APDA-CGT dockers. 14 avril 2005 - Déplacement à Cherbourg - réunion avec les représentants de l'entreprise Constructions mécaniques de Normandie (CMN) ; - réunion avec les représentants de l'entreprise DCN ; - à l'invitation de M. Denis Dobo-Schoenenberg, sous-préfet de Cherbourg, déjeuner de travail à la sous-préfecture, en présence notamment de M. le Capitaine de vaisseau Pierre Leroux, représentant du préfet maritime, M. Bernard Cazeneuve, maire de Cherbourg-Octeville, M. Michel Garraudoux, procureur de la République, M. Jean-Claude Camu, président de la CCI ; - réunion à la mairie de Cherbourg avec les représentants de l'association des victimes de l'amiante et des syndicats ; - conférence de presse à la mairie de Cherbourg. 11 mai 2005 - Déplacement à Jussieu - réunion avec les responsables de l'université Paris VII, de l'Institut de physique du Globe de Paris et de l'établissement public du campus de Jussieu ; - réunion avec les représentants du comité anti-amiante de Jussieu et les représentants des syndicats ; - visite du chantier de désamiantage et des locaux désamiantés d'une barre, en attente de sa nouvelle affectation. 2 et 3 juin 2005 - Déplacement en Corse 2 juin - déjeuner de travail à l'invitation de M. Jean-Luc Videlaine, préfet de la Haute-Corse ; - réunions de travail à la Préfecture de Bastia avec : . les représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse ; . les associations des victimes de l'amiante et notamment de l'ARDEVA PACA-Corse ; . des représentants de l'inspection et de la médecine du travail ; . la présidente du TASS, le procureur de la République de Bastia et une représentante de la CPAM de Haute-Corse ; . le président de la CCI de Haute-Corse ; . un pneumologue du centre hospitalier de Bastia ; . le délégué régional de l'ADEME. 3 juin - table ronde avec les élus à la mairie de Canari ; - déjeuner de travail avec les élus locaux à la Marine d'Albo sur la commune d'Ogliastro ; - visite du site de la mine de Canari ; - conférence de presse à la préfecture de Haute-Corse. |
Le choix des destinations de la mission d'information ne devait évidemment rien au hasard mais a été dicté par son souci d'appréhender sur le terrain les conséquences de la contamination qui a touché plus particulièrement certains sites, certains secteurs d'activité et certaines populations.
- A l'initiative, notamment de Mmes Sylvie Desmarescaux et Michelle Demessine, la mission a d'abord décidé de se déplacer à Dunkerque . Ce déplacement s'imposait compte tenu de l'exposition à l'amiante et de la forte contamination de la population des dockers du Port autonome, qui vient d'ailleurs récemment d'être condamné pour faute inexcusable de l'employeur, et des ouvriers de la sidérurgie.
Comme on le sait, les sénatrices et sénateurs de la région Nord-Pas-de-Calais ont joué un rôle important dans la création de la mission d'information, où ils siégeaient d'ailleurs en nombre, relayant les revendications légitimes des associations et des syndicats, comme celles du mouvement des « veuves de Dunkerque », qui ont porté, via les media, ce drame sanitaire douloureux à la connaissance de l'opinion, notamment à la suite des non-lieux rendus par la cour d'appel de Douai.
Lors de ses réunions au siège de l'ARDEVA, qui constitue aussi un lieu d'accueil, de conseil et de réconfort pour ses adhérents, la délégation de la mission a pu recueillir les témoignages émouvants des victimes et de leurs veuves, mesurer la détresse des malades, même atteints de pathologies dites bénignes, et les insuffisances du système d'indemnisation et de cessation anticipée d'activité.
Elle a entendu les reproches formulés à l'encontre de la loi Fauchon, que les membres de l'association, comme les conseils de l'ANDEVA dépêchés de Paris, rendent responsable du blocage des actions pénales. Enfin, les rencontres avec les organisations syndicales, les représentants d'ARCELOR, de la CRAM et des médecins du travail, ont révélé la méconnaissance jusqu'à une date tardive, de la nocivité de l'amiante par les salariés, de la prise de conscience relativement récente de ses dangers par les médecins du travail, de la difficulté de persuader les directions des entreprises et les CHSCT de prendre des mesures de précaution.
- A l'initiative de M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur-adjoint, qui apporta à la mission des informations tirées de son expérience professionnelle passée à la DCN, une délégation s'est ensuite rendue à Cherbourg .
En visitant les immenses hangars aujourd'hui sous-utilisés des Constructions Mécaniques de Normandie , elle a pris conscience de la crise qui touche nos chantiers de réparation et de construction navale, confrontés notamment à la concurrence polonaise et allemande.
Cette crise s'est traduite par une réduction des deux tiers des effectifs des CMN par rapport à l'âge d'or des années 80, lorsque les patrouilleurs rapides de Cherbourg tenaient la vedette, et par une tentative de restructuration et de diversification vers la plaisance de luxe.
Lors de ses entretiens, elle a pu notamment prendre la mesure de l'exposition massive des salariés affectés au flocage des vedettes rapides entre le milieu des années 60 et la fin des années 70 et constater que la multiplication des recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur est de nature à mettre en péril le fragile équilibre financier des CMN.
Sur le site industriel de DCN de Cherbourg, dédié aux sous-marins, la délégation a constaté que l'amiante avait été utilisé de façon massive dans leur construction, comme d'ailleurs dans les ateliers, magasins et entrepôts qui ont fait l'objet de diagnostics et d'opérations de désamiantage.
Lors de sa visite, elle a eu le privilège de voir l'état d'avancement du « Terrible », quatrième sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) de nouvelle génération de notre force de dissuasion, ainsi que la cale monumentale où un de ses prédécesseurs, l'« Indomptable », désarmé, débarrassé de son coeur nucléaire et de ses hélices, déjà tronçonné, est démoli après désamiantage.
Selon les responsables de DCN, l'entreprise s'est préoccupée très tôt du risque amiante, avant même la réglementation de 1977, et près d'un millier de déclarations de maladies professionnelles dues à l'amiante ont été recensées depuis cette date. Les personnels de DCN bénéficient, par ailleurs, inégalement du système de préretraite selon qu'ils relèvent du droit privé, qu'ils sont ouvriers d'État, fonctionnaires, contractuels ou à statut militaire.
Pour leur part, les représentants de l' ADEVA Cherbourg ont estimé que 12.000 salariés au total auraient été exposés sur l'agglomération, que trop d'établissements n'étaient pas inscrits sur les listes ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité, la situation des salariés des entreprises sous-traitantes étant particulièrement préoccupante, et que de nombreuses irrégularités étaient constatées sur les chantiers de désamiantage.
Les représentants des syndicats ont notamment critiqué les médecins qui auraient failli dans leur mission d'alerte, réclamé une revalorisation du FCAATA, dénoncé les conditions de désamiantage du site de DCN et le retard pris dans la mise en place des mesures de protection, certains regrettant l'absence d'une commission d'enquête parlementaire pour mieux établir les responsabilités.
- Une délégation de la mission s'est ensuite déplacée sur le campus universitaire de Jussieu .
Un tel déplacement s'imposait également parce que le chantier gigantesque de désamiantage du campus est présenté traditionnellement comme un modèle sur le plan de la sécurité, qu'il s'effectue sur un site occupé, à la différence de celui du Berlaymont à Bruxelles, mais aussi parce qu'il a connu toutes les dérives financières 4 ( * ) et de calendrier en raison notamment d'une absence de pilotage et d'opérations de restructuration non prévues à l'origine.
Lors de son déplacement sur le campus, la mission a pu constater l'importance des précautions retenues par les entreprises chargées du retrait de l'amiante.
Au cours de ses entretiens avec les représentants de l'université Paris VII et de l'Institut de physique du Globe de Paris , ceux-ci ont rappelé que des mises en examen avaient été prononcées à l'encontre de leurs établissements en tant que personnes morales, comme d'ailleurs à l'encontre de l'université Paris VI , dont le Président a choisi de ne pas participer à la réunion et de n'envoyer aucun représentant ; la mission n'a pu que regretter cette absence, d'autant que Paris VI sera la seule université à rester sur le campus rénové.
La réunion avec les représentants du comité anti-amiante de Jussieu et des syndicats a permis de rappeler comment l'alerte lancée par les personnels de recherche au milieu des années 70 avait permis une première prise de conscience nationale des dangers de l'amiante, qui n'étaient plus désormais circonscrits au seul monde ouvrier.
D'après une estimation basse, compte tenu des sous-déclarations, 110 personnes auraient été reconnues atteintes de maladie professionnelle causée par l'amiante au cours des dix dernières années ; le comité anti-amiante serait la seule structure à apporter soutien et assistance aux victimes et reproche au Président de Paris VI de s'être opposé à la mise en place du suivi médical par scanner. Les interlocuteurs de la délégation ont par ailleurs souligné la lenteur du chantier de désamiantage, l'achèvement du chantier, y compris de rénovation, devant intervenir entre 2012 et 2017, alors que le terme initial était fixé à 1999, les conditions de déroulement des travaux, le coût de location des locaux provisoires, l'absence de contrôle par l'inspection du travail des règles de sécurité pour les travaux d'entretien effectués par des intervenants extérieurs dans les bâtiments encore amiantés.
- A l'initiative de M. Roland Muzeau, une délégation de la mission s'est enfin rendue en Corse pour appréhender les conséquences de l'exploitation du gisement d'amiante de Canari et de la présence de roches amiantifères en Haute-Corse.
Lors de ses entretiens avec l'ARDEVA PACA-Corse, l'association a souligné la méconnaissance qu'avaient les mineurs de Canari , et aussi les dockers de Bastia, des dangers de l'amiante, ainsi que l'absence de mesures de précaution.
Des témoignages ont cependant rappelé la prospérité qu'avait apportée la mine à une région déshéritée, la fermeture du site en 1965, pour des raisons seulement économiques, ayant été vécue comme un drame pour la population. Il a été indiqué à la mission que les anciens mineurs de Canari bénéficiaient d'un suivi médical.
Les rencontres avec le représentant de l' ADEME et les élus locaux ont montré les difficultés et le coût de la sécurisation et de la réhabilitation du site de la mine, notamment compte tenu de la fréquentation touristique estivale, le problème des deux plages de stériles rejetés par la mine restant posé.
S'agissant de l'exposition des populations à l'amiante environnemental , qui a fait l'objet d'études dans les sites les plus amiantifères, notamment à Bastia et à Corte en relation avec le BRGM, d'une d'information générale en direction de la population et des chefs d'entreprise, la délégation a constaté que la réglementation existante en matière de sécurité au travail était inadaptée pour protéger les salariés des chantiers de travaux publics situés sur des terrains amiantifères, ceux-ci tendant à se multiplier avec les grandes opérations immobilières menées notamment à Bastia. Il en résulte une exposition des populations qui risque de se traduire par une explosion des pathologies dans 20 ou 30 ans, des plaques pleurales étant par ailleurs déjà découvertes chez les salariés du BTP.
Il conviendrait également de compléter la réglementation s'agissant du transport des déblais amiantés et de leur stockage, ces déblais étant actuellement fréquemment déposés dans des décharges sauvages.
*
* *
REPÈRES CHRONOLOGIQUES SUR L'AMIANTE
Du « magic mineral » à la pierre tombale
|
5500 (av. JC) : - en Carélie, nos ancêtres du néolithique utilisent déjà des fibres d'amiante, ajoutées à un mélange d'argile et de limon, pour fabriquer des poteries servant à la cuisson des aliments ; 1 er siècle : - Pline l'Ancien mentionne les dangers de l'amiante chez les esclaves romains ; 9 e siècle : - Charlemagne intrigue ses invités de marque en faisant jeter les nappes d'amiante au feu pour les nettoyer ; 13 e siècle : - Marco Polo rapporte la même scène dans le récit de son voyage en Sibérie orientale ; 1826 : - le chevalier Aldini, colonel des pompiers de Rome, professeur à l'université de Bologne, imagine d'utiliser l'amiante dans la confection d'un vêtement propre à faciliter l'attaque des incendies ; 1829 : - le physicien et chimiste anglais Faraday, lors d'une démonstration à l'Institut royal de Londres, encourage chaleureusement son homologue italien ; 1862 : - l'amiante canadien est présenté à l'Exposition internationale de Londres ; 1865 : - le dictionnaire Larousse présente l'amiante comme un gadget : « On en fait des tissus, des mèches, des dentelles, du papier et du coton incombustibles, mais les objets ainsi obtenus n'ont jamais été que des curiosités » ; 1868 : - l'Italie extrait déjà 200 tonnes d'amiante ; 1877 : - l'exploitation des gisements d'amiante débute au Québec après la découverte de Fecteau ; 1879 : - John Bell présente les applications de l'amiante pour le confinement des machines, qui sont rapidement adoptées par les marines anglaise et allemande : le « magic mineral » devient le « compagnon de route du capitalisme industriel » ;
1883 :
- l'extraction de l'amiante
commence dans la province du Cap ;
1884 : - 100 tonnes d'amiante canadien sont livrées à la fabrique de Rochdale en Angleterre qui donnera naissance à la société Turner and Newhall, l'un des quatre grands trusts mondiaux de l'amiante ; 1885 : - les gisements de l'Oural commencent à être exploités ; 1899 : - le Dr Henri Montagne Murray à Londres fait la première observation d'un décès lié à l'amiante : il diagnostique une fibrose pulmonaire d'origine mystérieuse chez un ouvrier ayant travaillé pendant quatorze ans dans l'atelier de cardage d'une filature d'amiante ; 1900 : - l'Autrichien Ludwig Hatschek dépose un brevet relatif à la fabrication de produits en fibrociment, qui sera utilisé notamment par Eternit et Saint-Gobain ; 1906 : - le ministère du travail est créé ;
- le Sénat vote le 10 juillet le principe du
repos hebdomadaire ;
1918 : - les compagnies d'assurances américaines refusent d'assurer les travailleurs de l'amiante ; 1922 : - la société Eternit France est créée par l'industriel Georges Cuvelier ; 1924 : - Nellie Kershaw, entrée comme bobineuse en 1917 à la filature d'une fabrique d'amiante, ultérieurement reprise par la Turner and Newhall, meurt par étouffement à 33 ans d'une « fibrose pulmonaire causée par l'inhalation de particules minérales » ; dix ans après la mort de Nellie, la Grande-Bretagne fera entrer l'asbestose dans le champ des maladies professionnelles indemnisables ; 1927 : - le filon d'amiante de Canari, au Cap corse, découvert par le géologue suisse Eggenberger, est mis en exploitation par l'industriel Georges Cuvelier, fondateur d'Eternit France ; 1930 : - l'amiante est enfin inscrit à l'ordre du jour de la conférence internationale consacrée à la santé des mineurs ; depuis 1910, la production mondiale d'amiante est passée de 128.000 à 339.000 tonnes ; 1931 : - la Grande-Bretagne édicte une première réglementation limitant l'empoussièrement dans les usines ; deux Britanniques, Klemperer et Rabin, découvrent le mésothéliome ou cancer de la plèvre ; 1943 : - la Turner and Newhall et huit autres industriels de l'amiante confient une première étude expérimentale sur les pathologies de l'amiante à un laboratoire américain : 80 % des souris testées développent un cancer du poumon en moins de trois ans. Les résultats de cette étude resteront secrets ; 1945 : - l'ordonnance du 2 août crée le tableau n° 25 des maladies professionnelles reconnaissant les fibroses pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières renfermant de la silice ou de l'amiante ; la revue « Archives des maladies professionnelles » signale déjà deux cas de cancer lié à l'asbestose ; 1946 : - les États-Unis édictent une réglementation limitant l'empoussièrement dans les usines ; 1950 : - le décret du 31 août crée le tableau n° 30 qui reconnaît l'asbestose comme maladie professionnelle ; 1954 : - John Knox, médecin du travail de l'usine Turner and Newhall de Leeds, confie à l'épidémiologiste Richard Doll une étude sur les ravages du « magic mineral » ; 1955 : - en dépit des pressions des industriels, l'étude épidémiologique de Richard Doll est publiée dans le « British Journal of Industrial Medecine », prouvant le lien entre amiante et cancer du poumon ;
1956 : -
un courrier entre les
responsables de la Turner and Newhall et la société
« L'amiante et ses applications » (Ferodo) évoque
les dangers pour les populations vivant aux abords des usines, lors du choix
d'un site français de transformation des fibres ;
1960 : - l'étude du docteur Wagner confirme que l'amiante est à l'origine du mésothéliome qui touche les mineurs en Afrique du Sud et révèle que le cancer de la plèvre atteint aussi les riverains des usines ; elle dénombre 33 cas de mésothéliomes dans la population des mineurs d'amiante dans la province du Cap ; 1962 : - dans une réponse adressée à la Présidence de la République, Raymond Barre, directeur de cabinet du ministre de l'industrie, plaide la cause des industriels concernant les problèmes de pollution nés de l'activité de la société minière de l'amiante à Canari, en Corse ; 1964 : - la conférence internationale sur les risques liés à l'amiante se réunit à New-York sous l'égide de l'académie des sciences ; les actes de cette conférence sont consultables dès 1965 à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris ; - le pneumologue Irving Selikoff, directeur de la division de médecine expérimentale du Mount Sinaï Hospital de New-York, publie la première grande étude épidémiologique, à la demande du syndicat des ouvriers de l'isolation ;
- le Sud-Africain J.G. Thomson retrouve des corps
asbestosiques dans les poumons d'un habitant sur quatre autopsié dans la
province de Captown ;
1965 : - le premier cas de mésothéliome pleural, diagnostiqué par le Français Jean Turiaf, est décrit dans le bulletin de l'Académie de médecine ; 1968 : - deux chercheurs britanniques, Morris Greenberg et T.A. Lloyd Davis, étudient les cas recensés dans le registre anglais des mésothéliomes et dénombrent 38 cas sans exposition à l'amiante, mais ayant habité au voisinage des sites de transformation (voisins, femmes et enfants d'ouvriers de l'amiante contaminés notamment par un contact avec des vêtements de travail) ; 1971 : - les industriels anglo-saxons et européens de l'amiante se réunissent à Londres pour bâtir une stratégie qui leur permettra de continuer à utiliser le minerai ; - le Comité français d'étude sur les effets biologiques de l'amiante (COFREBA), premier lobby de « l'or blanc », est créé ; 1973 : - les premiers procès ont lieu aux États-Unis ; 1974 : - quatre trusts contrôlent 50 % de la production et 25 % de la transformation de l'amiante dans les pays occidentaux : John-Manville (États-Unis), Turner and Newhall (Grande-Bretagne), Cape Ltd (Grande-Bretagne), Eternit (Belgique) ; 1975 : - les chercheurs du campus de Jussieu découvrent que leurs locaux universitaires sont pour une large part isolés à l'amiante et révèlent la situation des usines de transformation ; le collectif inter-syndical sécurité des universités Jussieu est créé (CFDT, CGT, FEN) ; 1976 : - le tableau n° 30 des maladies professionnelles est modifié et prend en compte le cancer du poumon et le mésothéliome ; 1977 : - le professeur Jean Bignon adresse au Premier ministre, Raymond Barre, une lettre dévoilant l'ampleur de l'hécatombe attendue : la chambre syndicale de l'amiante et le syndicat de l'amiante-ciment l'accusent dans un livre blanc de vouloir faire fermer les portes des industries de l'amiante, du bâtiment, de la mécanique, de l'automobile et de la construction navale ; - l'arrêté du 29 juin interdit le flocage dans les immeubles d'habitation et le décret du 17 août réduit la concentration d'amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises (deux fibres par cm 3 ) ; 1978 : - le décret du 20 mars interdit les flocages contenant plus de 1 % d'amiante pour l'ensemble des bâtiments ; - selon une résolution européenne, « l'amiante est un produit cancérigène et toutes les variétés utilisées dans le marché commun présentent un danger pour la santé humaine » ; 1980 : - la chambre syndicale de l'amiante devient l'association française de l'amiante ; - l'acteur Steve Mac Queen meurt d'un mésothéliome à l'âge de 50 ans ; 1982 : - la société américaine Johns-Manville, plus importante entreprise mondiale dans le secteur de l'amiante, invoque l'article 11 de la loi sur les faillites pour se protéger des centaines de milliers de procès qui lui sont intentés ; - une convention relative au dépistage des flocages d'amiante dans les établissements scolaires est passée entre le BGRM et le ministère de l'éducation nationale ; - le Comité permanent amiante (CPA) est créé en France, ce lobby étant mis en place à l'initiative du directeur général de l'INRS ; outre les industriels, il réunit des scientifiques, des fonctionnaires des ministères concernés, des représentants d'organismes publics comme l'INC, l'INRS et des syndicats ; - un « Symposium mondial sur l'amiante » se réunit à Montréal ; 1986 : - la Chase Manhattan Bank poursuit la société Turner and Newhall en lui réclamant une indemnisation de 185 millions de dollars pour le flocage à l'amiante de ses locaux ; - le conseil d'administration de l'INRS se propose d'octroyer une subvention au CPA dans la perspective d'un nouveau colloque à Montréal : le délégué de FO, dont l'organisation ne participe pas aux travaux du CPA, s'y oppose ; 1989 : - Marcel Valtat, secrétaire général du CPA, envoie une lettre au Premier ministre Michel Rocard, ainsi qu'à sept ministres, sous l'intitulé : « Usage contrôlé de l'amiante : utopie ou réalité ? » 1991 : - la sécurité sociale n'indemnise que 492 victimes de l'amiante, dont 56 cas de mésothéliome : sur 10 000 cancers professionnels annuels, moins de 2 % sont indemnisés ;
- l'Inserm recense 902 cas de
mésothéliome, contre 300 en 1968 ;
1994 : - l'association française de l'amiante verse 700 000 F au cabinet Europaxis ; - le comité anti-amiante de Jussieu organise en mars une conférence à l'université de Paris VII, en présence d'experts étrangers, dont Julian Peto ; - Jean Bignon et Patrick Brochard publient en novembre une étude sur le campus de Jussieu ; le CPA organise une conférence de presse ; - les veuves de plusieurs enseignants du lycée professionnel de Gérardmer, décédés d'un cancer, déposent une plainte ;
- les experts français se réunissent en
décembre au ministère du travail et confirment les dangers de
l'amiante ;
1995 : - le Lancet publie en mars l'étude de l'épidémiologiste Julian Peto qui révèle que le nombre de mésothéliomes est très élevé en Grande-Bretagne et aussi que ceux-ci se sont répandus bien au-delà des seuls salariés des usines de transformation de l'amiante, notamment chez les ouvriers du bâtiment ; - l'enquête de « Sciences et avenir » est publiée en mai ; - le CPA cesse de se réunir en septembre ; - le reportage d'Envoyé spécial, « Mortel amiante », est diffusé ; 1996 : - l'association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA) est créée en février ; le décret du 7 février oblige les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic sur la présence d'amiante ; - cinq malades, membres de l'ANDEVA, se portent partie civile et déposent une plainte contre X, le 25 juin ; - le rapport de l'Inserm, « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante », est rendu public le 2 juillet lors d'une conférence de presse ; - le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot, annonce le 3 juillet l'interdiction de « la fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante », à compter du 1 er janvier 1997 ; - le Président de la République Jacques Chirac annonce dans son intervention télévisée du 14 juillet, qu' « il n'y aura plus d'étudiants à Jussieu avant la fin de l'année » ; - le parquet de Paris ouvre le 6 septembre une information judiciaire contre X pour « blessures volontaires » à la suite d'une plainte déposée par un électricien atteint d'un mésothéliome de la plèvre : l'instruction débouche sur un non-lieu ; - l'amiante est interdit par un décret du 26 décembre : son utilisation est proscrite en France à partir du 1 er janvier 1997 ; après l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse, la France est le huitième pays à interdire totalement l'amiante ; 1997 : - pour la première fois une entreprise, la société Eternit, est condamnée pour faute inexcusable, à la suite d'une plainte d'un salarié de l'usine de Vitry-en-Charollais ; 1998 : - le Canada dépose une plainte contre la France devant l'OMC pour avoir interdit l'amiante ; le 19 décembre, la France met en place la retraite à 50 ans pour les salariés exposés au moins 30 ans dans des entreprises où l'amiante a été utilisé ; - l'Institut de veille sanitaire (InVS) est créé ; 1999 : - l'Union européenne interdit l'amiante ; 2000 : - le tribunal administratif de Marseille reconnaît la faute de l'État ; l'OMC donne raison à la France ; 2001 : - le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est créé ; les premiers procès contre la filiale américaine de Saint-Gobain (Certain Teed) s'engagent aux États-Unis ; 2002 : - dans plusieurs arrêts du 28 février, la Cour de cassation reconnaît la faute inexcusable de l'employeur pour les cas de maladie professionnelle : l'employeur a désormais une obligation de résultat concernant la prévention dans le cas des risques qu'il fait courir à ses salariés ; 2004 : - le Conseil d'État confirme la responsabilité de l'État dans l'affaire de l'amiante ; 2005 : - l'interdiction de l'amiante au niveau communautaire devient effective au 1 er janvier ; - le Sénat crée une mission d'information commune sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante. |
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES PAR LA MISSION D'INFORMATION
Mercredi 16 février 2005
M. le professeur Claude Got
Mercredi 2 mars 2005
Mme Ellen Imbernon , responsable du Département Santé & Travail de l'Institut de veille sanitaire et le professeur Marcel Goldberg , directeur de l'Unité de santé publique et d'épidémiologie sociale et économique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, conseiller scientifique à l'Institut de veille sanitaire
M. Henri Pézerat , toxicologue, directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique
Mercredi 9 mars 2005
Docteur Gilles Brücker , directeur général de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS)
M. Dominique Belpomme , cancérologue à l'Hôpital européen Georges Pompidou, président fondateur de l'Association pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse (ARTAC)
M. Patrick Brochard , chef du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle (CHU Bordeaux), professeur des universités en épidémiologie, économie de la santé et prévention (Université Victor Segalen Bordeaux II)
Mercredi 16 mars 2005
Mme Michèle Guimon , chef de projet « amiante et autres fibres », MM. Michel Héry , chargé de mission à la Direction scientifique, et Philippe Huré , responsable du Département « Risques chimiques et biologiques » à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)
MM. Roger Beauvois , président du conseil d'administration, et François Romaneix, directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
Mercredi 23 mars 2005
M. Daniel Bouige , président du Laboratoire Hygiène de Contrôle des Fibres (LHCF Environnement)
M. Dominique Moyen , ingénieur général du corps national des Mines, ancien directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité
M. Gilles Évrard , directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
Mercredi 30 mars 2005
Mme Rose-Marie Van Lerberghe , directrice générale, et M. Jean-Marc Boulanger , secrétaire général, de l'AP-HP
MM. Bernard Peyrat , président, et Gérald Grapinet , vice-président du Syndicat du retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA)
MM. Jacques Tonner , directeur général, et Claude Michel , ingénieur conseil régional adjoint, responsable de la direction des services techniques, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
Mercredi 6 avril 2005
Mme Florence Molin , ingénieur spécialiste en risques sanitaires et M. Daniel Ferrand , ingénieur spécialiste en diagnostics et interventions sur existants à la SOCOTEC (société de contrôle de l'audit et du conseil technique)
M. Jean-Marie Schléret , président de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur
M. Jean-Luc Pasquier , directeur délégué aux enseignements de radioprotection à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
Mercredi 13 avril 2005
M. François Martin , président de l'Association de défense des victimes de l'amiante (ALDEVA) de Condé-sur-Noireau
M. François Malye , journaliste et auteur de « Amiante : 100.000 morts à venir »
MM. François Desriaux , président, Michel Parigot , vice-président, André Letouzé , administrateur, Mme Marie-José Voisin , trésorière de l'association de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), et M. Michel Ledoux , avocat
Mercredi 4 mai 2005
Table ronde avec les représentants des organisations syndicales : MM. Didier Payen, Serge Dufour, Yves Bongiorno, Jean Bellier et Michel Beurier , représentants de la Confédération générale du travail (CGT), M. André Hoguet , représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), M. Jacqy Patillon et le Dr Bernard Salengro , représentants de la Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres (CFE-CGC), MM. Rémi Jouan et Dominique Olivier , représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), MM. Franck Urbaniak et Jean Paoli , représentants de Force ouvrière (FO)
M. Albert Lebleu , vice-président de l'association des anciens salariés de Metaleurop Nord, « Choeurs de fondeurs »
Mercredi 11 mai 2005
Me Jean-Paul Teissonnière, avocat
M. Alain Saffar , sous directeur de la justice pénale spécialisée à la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice
Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy , juge d'instruction, vice-présidente coordinatrice du pôle santé publique de Paris
Mercredi 1 er juin 2005
Organisations patronales : Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Dominique de Calan , président du groupe de travail amiante du MEDEF, délégué général adjoint de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), M. Bernard Caron , directeur de la protection sociale au MEDEF et le Dr François Pelé , membre du groupe de travail amiante et responsable de la santé au travail au MEDEF ; Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : Dr Pierre Thillaud , représentant de la CGPME au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Union professionnelle artisanale (UPA) : M. Daniel Boguet , membre de l'UPA, Mme Houria Sandal , conseiller technique
Mme Marianne Lévy-Rosenwald , présidente du Conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA)
Jeudi 9 juin 2005
M. Claude Imauven , directeur général adjoint de la Compagnie Saint-Gobain, directeur du pôle produits pour la construction
Mercredi 15 juin 2005
MM. Marcel Royez , secrétaire général, Arnaud de Broca et Philippe Karim Felissi , représentants au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), de l'association des accidentés de la vie (FNATH)
Communication de M. Pierre Fauchon, sénateur
Mercredi 22 juin 2005
M. Claude Delpoux , directeur, et Mme Valérie Dupuy , responsable de la coordination juridique nationale, direction des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)
Me Philippe Plichon, avocat
MM. Gérard Larcher , ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, accompagné de Jean-Denis Combrexelle , directeur des relations du travail
Mercredi 29 juin 2005
M. Christophe Blanchard-Dignac , ancien directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
M. Pascal Clément , ministre de la justice, garde des Sceaux
M. Xavier Bertrand , ministre de la santé et des solidarités
Mercredi 14 septembre 2005
MM. François Delarue , directeur général, et Alain Jacq , directeur adjoint, à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
Jeudi 22 septembre 2005
M. Jacques Barrot , ancien ministre, commissaire européen
Mercredi 28 septembre 2005
Mme Martine Aubry , ancien ministre
Dans les développements ci-après, la mission s'interrogera sur l'attitude des pouvoirs publics et des différents acteurs concernés face aux dangers de l'amiante.
Elle analysera ensuite les dispositifs d'indemnisation mis en place pour les victimes, ainsi que leurs insuffisances, et examinera les améliorations qui sont susceptibles d'y être apportées.
Elle tentera enfin d'appréhender les risques de nouvelles contaminations susceptibles d'être provoquées par l'exposition à l'amiante résiduel et environnemental, ainsi qu'aux fibres de substitution. Plus généralement, elle soulignera la nécessité d'une politique de prévention à l'égard des produits présentant un risque pour la santé humaine.
*
* *
PREMIÈRE PARTIE -UN DRAME ÉVITABLE ?
I. UNE INDIFFÉRENCE SINGULIÈRE FACE À UNE MENACE CONNUE DE LONGUE DATE
« Une erreur de gestion ». C'est ainsi que le professeur Claude Got, lors de son audition par la mission, a qualifié la manière dont le drame de l'amiante a pu se produire. Si l'erreur - ou plutôt la cascade d'erreurs - est avérée, c'est avant tout l'indifférence de l'ensemble des acteurs, employeurs et pouvoirs publics notamment, qui, dans cette affaire, est inexplicable.
M. Jacques Barrot, ancien ministre du travail et des affaires sociales, l'a lui-même reconnu devant la mission : « Je dois dire que je n'ai pas éclairé le mystère. Je ne comprends pas pourquoi, après 1978, il y a eu une très lente appréhension du problème par les ministères ».
Certes, comme l'a noté le professeur Got, dans un parallèle avec la silicose des mineurs de charbon, « on accepte la mort au travail d'une façon différente en fonction des époques ». Toutefois, la comparaison est à nuancer dans la mesure où les mineurs connaissaient ces risques, ce qui n'était apparemment pas le cas de ce qu'il est convenu d'appeler les « travailleurs de l'amiante ». En outre, la mission a pu se rendre compte qu'aucune mesure de sécurité au travail n'a été prise, des décennies durant, contre les dangers de cette fibre, pourtant connus avec une précision croissante. L'affaire de l'amiante illustre le faible intérêt qui a trop longtemps été porté aux questions de santé au travail. « Il y a tout de même eu une forme de négation de cette réalité du risque par les industriels » estimait le professeur Got. Hélas, la réalité de l'amiante a aussi été niée par les pouvoirs publics, tant il apparaît que l'administration s'est montrée incapable de passer de la connaissance à la prise de décisions .
M. François Malye, journaliste, auteur de Amiante : 100.000 morts à venir 5 ( * ) , a insisté sur « la véritable culture du mensonge » à laquelle il s'était heurté lorsqu'il a débuté son enquête sur l'amiante, en 1994, à une époque où ce matériau était toujours utilisé : « Il n'en reste pas moins que tous mentaient, un mensonge parfaitement organisé avec l'assentiment de l'État, ce qui rendait tout travail journalistique difficile et délicat. A l'époque, on comptait déjà 3.000 morts en Grande-Bretagne mais la France, elle, ne déplorait officiellement « que » 200 morts. Sécurité sociale, assureurs, patronat, le mensonge s'est installé à tous les niveaux, chacun craignant qu'éclate au grand jour un scandale aux immenses effets collatéraux. La classe politique prétendait ne pas être au courant et fuyait le problème par la création d'une structure dédiée à l'amiante. Cette stratégie du mensonge et le discours des communicants auront ainsi réussi à nier les conclusions de plusieurs milliers d'études épidémiologiques »... « De leur côté, les scientifiques français ont menti par omission. Ils n'ont pas tiré assez tôt le signal d'alarme. Or, les textes fondateurs de l'INSERM précisent clairement que la mission de l'Institut consiste aussi à alerter les pouvoirs publics », a-t-il ajouté.
A. L'UTILISATION INTENSIVE DE L'AMIANTE EN FRANCE
Pour ses qualités ignifuges, la France a abondamment utilisé l'amiante, de l'avant-guerre à son interdiction en 1997, plutôt tardive en Europe, en particulier au cours des décennies 1950 à 1970.
1. L'amiante, une fibre naturelle
Le terme amiante 6 ( * ) recouvre une variété de silicates formés naturellement au cours du métamorphisme des roches, qu'une opération mécanique appropriée transforme en fibres minérales utilisables industriellement . On distingue deux variétés d'amiante : les serpentines et les amphiboles.
Les serpentines ne comportent qu'une variété d'amiante, le chrysotile (ou amiante blanc), et les amphiboles comptent cinq variétés : l'anthophyllite, l'actinolite, la trémolite, l'amosite (ou amiante brun) et la crocidolite (ou amiante bleu), ces deux dernières variétés étant ou ayant été exploitées industriellement et commercialement. Les fibres d'amphiboles sont beaucoup plus dangereuses que celles de chrysotile.
L'amiante se distingue des matières fibreuses artificielles, telles que la laine de roche ou la fibre de verre, par sa structure cristalline et par l' extrême finesse de ses fibres . Dans le chrysotile, les fibres sont courbées et particulièrement fines, les fibres des amphiboles étant droites et d'un diamètre trois à dix fois plus gros selon la variété.
La finesse des fibres d'amiante, qui constituent en fait un ensemble formé de plusieurs dizaines ou centaines de fibrilles plus ou moins solidement agglomérées, est importante à deux titres :
- les propriétés physico-chimiques des fibres d'amiante sont propices aux phénomènes d'absorption et aux propriétés d'isolation ;
- leur dimension particulièrement réduite est en partie à l'origine des pathologies provoquées par ce matériau, puisque la taille et la géométrie des fibres sont les principaux facteurs qui déterminent la pénétration de l'amiante et sa distribution dans les voies respiratoires. Ainsi, la dimension des fibres est déterminante pour évaluer leurs effets sur la santé : plus une particule est petite, plus elle peut pénétrer profondément dans l'appareil respiratoire ; plus les fibres sont longues et fines, plus l'organisme a des difficultés à les éliminer, et plus elles sont dangereuses.
|
Caractéristiques des trois principales variétés d'amiante |
|||
|
SERPENTINE |
AMPHIBOLES |
||
|
Chrysotile |
Amosite |
Crocidolite |
|
|
Couleur |
blanc |
brun |
bleu |
|
Longueur max. des fibres |
40 mm |
70 mm |
70 mm |
|
Diamètre des fibrilles |
0,02 um |
0,1 um |
0,08 um |
|
Eléments associés aux SiO4 7 ( * ) |
Mg |
Mg, Fe |
Fe, Na |
|
Source : INRS |
|||
2. Les raisons de son utilisation intensive : le « magic mineral »
L'amiante présente des propriétés exceptionnelles, qui varient selon la variété considérée :
- une remarquable qualité de résistance à la chaleur et au feu ;
- une faible conductivité thermique, acoustique et électrique ;
- la résistance mécanique, à la traction, à la flexion et à l'usure ;
- la résistance aux agressions chimiques ;
- l'élasticité ;
- la possibilité d'être filé et tissé.
En outre, l'amiante est un matériau peu cher.
Ces qualités « exceptionnelles » ont d'ailleurs très longtemps constitué le fondement de l'argumentaire des industriels sur les « bienfaits » de l'amiante, argumentaire qui n'a d'ailleurs pas complètement disparu. Ainsi, M. Dominique de Calan, président du groupe de travail sur l'amiante au MEDEF et délégué général adjoint de l'UIMM 8 ( * ) , a tenu à souligner, au cours de la table ronde des représentants des employeurs organisée par la mission, que « l'amiante a été aussi un matériau qui, à un moment donné, a sauvé bien des vies par ailleurs ».
Toujours est-il que les qualités de l'amiante expliquent l'utilisation massive de cette fibre 9 ( * ) , particulièrement en France.
La consommation d'amiante en France a atteint un pic au milieu des années 1970, soit environ 150.000 tonnes par an en 1975 10 ( * ) .
Le tableau ci-dessous illustre la forte croissance de cette consommation entre 1951 et 1975 :
|
Consommation d'amiante brut en France par secteurs
d'activité
|
|||||
|
Consommation moyenne par an
|
1951-1955 |
1956-1960 |
1961-1965 |
1966-1970 |
1971-1975 |
|
Amiante-ciment |
38.450 |
59.320 |
78.030 |
93.600 |
103.900 |
|
Revêtement de sol |
1.830 |
5.060 |
8.060 |
9.190 |
12.140 |
|
Filature |
1.970 |
3.440 |
3.060 |
3.670 |
4.160 |
|
Cartons/papiers |
2.360 |
3.485 |
6.265 |
7.560 |
10.103 |
|
Joints |
790 |
995 |
1.160 |
1.560 |
1.935 |
|
Garnitures de friction |
645 |
1.175 |
2.055 |
2.970 |
4.180 |
|
Objets moulés et calorifuges |
2.260 |
2.180 |
2.730 |
2.790 |
2.715 |
|
Autres |
1.150 |
1.680 |
1.915 |
2.450 |
3.600 |
|
Source : Association française de l'amiante
(1996) ; citée par la Cour des comptes
|
|||||
Le matériau à base d'amiante le plus répandu est l'amiante-ciment. Il s'agit du matériau le plus utilisé en France dans le second oeuvre depuis la fin des années 1960, et c'est aussi l'un des matériaux de couverture les plus répandus dans le monde.
|
L'amiante à Saint-Gobain La compagnie Saint-Gobain a occupé un rôle leader sur le marché français et même au-delà, grâce à ses filiales, aux Etats-Unis et au Brésil en particulier, où elle avait acquis des mines d'amiante. Au cours de son audition, M. Claude Imauven, directeur général adjoint de la Compagnie et directeur du pôle produits pour la construction, a retracé l'histoire de l'amiante à Saint-Gobain. Saint-Gobain comporte trois branches historiques : - la branche canalisation, essentiellement la société Saint-Gobain PAM, anciennement Pont-à-Mousson ; - la branche isolation, connue en France essentiellement avec Saint-Gobain Isover ; - les activités de la branche matériaux de construction, en grande partie héritière du passif d'utilisation de l'amiante. L'amiante est entré dans le groupe avec la société Everitube qui fabriquait des tuyaux et des plaques en amiante-ciment, lors de la fusion avec Pont-à-Mousson en 1970. Pont-à-Mousson, qui fêtera ses 150 ans en 2006, a toujours été axée sur la fonte. Au début du XX e siècle, une concurrence avait vu le jour, essentiellement avec la société française Everite, qui commençait à mettre sur le marché des produits, de moins bonne qualité que la fonte, mais bien meilleur marché, qui étaient les tuyaux d'amiante-ciment. Ces tuyaux, utilisés pour l'assainissement et l'adduction d'eau potable, constituaient une concurrence redoutable pour Pont-à-Mousson. Les directions de l'époque ont jugé qu'il fallait réagir et prendre pied sur ce segment de marché. La première usine avait été créée, en dehors de Saint-Gobain, par Everite en 1917. Il s'agissait de Bassens, mais les titres ont été acquis par Pont-à-Mousson en 1933. En 1924 a été créée l'usine de Dammarie-les-Lys. Il y a alors eu fusion entre Everite et la société Sitube, avec la création d'Everitube, partie de Pont-à-Mousson. Une troisième usine est créée en 1964 par Everitube, l'usine de Descartes, puis une quatrième en 1966, Andancette. Ce sont les quatre premières usines historiques, destinées à fabriquer des tuyaux qui venaient compléter la gamme de Pont-à-Mousson. En 1971, l'usine de Saint-Etienne-du-Rouvray est créée et, en 1972, après la fusion avec Saint-Gobain, on assiste à des reclassements de titres. Everitube quitte Pont-à-Mousson et devient partie de Saint-Gobain Industries, avec différents changements de noms, et élargissement de la gamme à des produits de couverture. Des restructurations internes conduisent, en 1981, à l'arrêt et à la fermeture de Saint-Etienne-du-Rouvray, de Saint-Eloy-les-Mines en 1984, de Bassens en 1987. A ce moment, Everitube, qui ne fabrique plus de tubes, prend le nom d'Everite et, en 1989, la dernière usine qui fabriquait des tuyaux, Andancette, change à nouveau de propriétaire interne au sein de Saint-Gobain, revenant à Pont-à-Mousson. En 1993, Dammarie-les-Lys ferme et, en 1996, la production d'amiante-ciment cesse à Descartes, puis l'usine d'Andancette ferme, en raison de l'interdiction de l'amiante à compter du 1 er janvier 1997. La partie amiante-ciment relevait de la branche matériaux de construction, qui représentait environ 10 % du chiffre d'affaires. « La part de l'amiante-ciment à l'intérieur des matériaux de construction a toujours représenté quelques pour cent du chiffre d'affaires » selon M. Claude Imauven. Il y a actuellement entre 250 et 300 cas de salariés ou anciens salariés de Saint-Gobain touchés par une maladie causée par l'amiante. |
Plus de 3.000 produits à utilisation industrielle ou domestique ont ainsi été fabriqués à base d'amiante, perçu comme un matériau « miracle ». On peut les distinguer ainsi qu'il suit :
- l'amiante brut en vrac était utilisé pour l'isolation thermique en bourrage ou en flocage (c'est-à-dire en projection) ;
- l'amiante tissé ou tressé était aussi utilisé pour l'isolation thermique de canalisations, d'équipements de protection individuelle, de câbles électriques... ;
- l'amiante sous forme de plaques de papier ou carton d'épaisseur variable, de 5 à 50 mm, était utilisé pour l'isolation thermique d'équipements chauffants, de faux-plafonds, de joints... ;
- l'amiante sous forme de feutre servait surtout à la filtration ;
- l'amiante incorporé sous forme de poudre était présent dans des mortiers à base de plâtre, dans des mortiers-colles, des colles, des enduits de finition ;
- l'amiante mélangé à du ciment (amiante-ciment, ensuite dénommé fibre-ciment) a permis de fabriquer de multiples composés pour la construction : plaques ondulées, éléments de façade, gaines de ventilation, canalisations ;
- l'amiante comme charge minérale était incorporé à des peintures, des vernis, des mastics, des mousses d'isolation... ;
- l'amiante mélangé à des matières plastiques ou à des élastomères permettait de fabriquer des joints, des revêtements, des ustensiles ménagers, des garnitures de freins... ;
- l'amiante incorporé aux bitumes servait pour l'étanchéité des toitures, contre la corrosion, pour les revêtements routiers...
Le chrysotile est la variété qui a été la plus utilisée, l'amosite ayant été surtout employé pour l'isolation thermique et la crocidolite pour sa résistance mécanique et sa tenue aux acides.
Le rapport de l'expertise collective de l'INSERM de 1997 rappelle que, « à la fin des années 1970, 80 % du chrysotile mondial était produit par le Canada et la Russie, alors que l'essentiel de la crocidolite et de l'amosite provenait de l'Afrique du Sud. L'évolution de la production mondiale d'amiante de 1987 à 1990 montre un relatif maintien des quantités produites pour la plupart des pays producteurs. D'une manière générale, l'essentiel du tonnage mondial produit se retrouve sous la forme d'amiante-ciment (65 à 70 % du tonnage total) ».
De très nombreuses industries ont donc massivement utilisé l'amiante : le bâtiment, la construction navale, le textile, l'automobile, les matières plastiques, l'industrie alimentaire et pharmaceutique, l'étanchéité...
L' exposition professionnelle à l'amiante concerne les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle :
- produisaient l'amiante (extraction et transformation) ;
- utilisaient ce matériau directement pour diverses opérations de transformation (textile, amiante-ciment...) ou d'isolation thermique ou phonique ;
- intervenaient sur des matériaux contenant de l'amiante ; on peut rattacher à cette catégorie diverses activités parfois considérées comme une exposition para-professionnelle (vêtements de travail) et domestique (planche à repasser, panneaux isolants, grille-pain...).
En pratique, de très nombreux métiers étaient ainsi concernés par le risque amiante, tant dans le secteur privé que public. Selon l'Institut de veille sanitaire (InVS), un quart des hommes actuellement à la retraite ont été exposés professionnellement à l'amiante.
3. Comparaisons internationales : « la France dans une mauvaise moyenne »
Le risque lié à l'amiante a été sous-estimé davantage dans certains pays que dans d'autres.
Le professeur Got, de ce point de vue, tend à relativiser l'attitude de la France : « On n'a pas été les pires ; on n'a pas été les meilleurs. Je pense que l'on se situe plutôt dans une mauvaise moyenne. L'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande ont mieux géré le risque amiante que nous, mais la majorité des pays dans le monde utilisent encore l'amiante ».
Il convient en effet de rappeler qu'à ce jour, dans le monde, seuls 40 pays, soit 15 en dehors de l'Union européenne, ont interdit l'utilisation de l'amiante. Au cours d'une récente conférence de l'Organisation internationale du travail, une campagne de sensibilisation aux dangers de l'amiante a été engagée et l'OIT a demandé à tous les gouvernements d'interdire l'utilisation de ce matériau.
Au niveau communautaire, la directive 1999/77/CE du 26 juillet 1999 interdit l'amiante dans l'ensemble des Etats membres à compter du 1 er janvier 2005. Toutefois, le Portugal n'a toujours pas transposé cette directive, et entreprendrait des démarches à Bruxelles pour obtenir une dérogation à l'interdiction sur son territoire.
En 1998, le Canada, deuxième producteur mondial d'amiante, a engagé un recours contre la décision française d'interdire l'amiante devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour violation des règles de la liberté du commerce. Au cours de son audition, M. Jacques Barrot a d'ailleurs évoqué ses souvenirs sur le différend franco-canadien occasionné par ce dossier, estimant que « le lobbying le plus important est venu des autorités canadiennes et c'est là que j'ai failli avoir des difficultés ».
La France a finalement obtenu gain de cause, après une procédure qui a duré près de trois ans. Cette mesure nationale a été reconnue comme nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes, les instances juridictionnelles de l'OMC confirmant les conclusions d'un groupe spécial qui avait mis en évidence le caractère cancérogène du chrysotile, l'absence d'un seuil d'innocuité, l'importance des populations à risques, l'inefficacité de l'utilisation contrôlée et la moindre nocivité des produits de substitution.
Le Canada demeure en effet un gros producteur d'amiante et il est très attentif à son image sur ce dossier. M. Henri Pézerat, toxicologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, a ainsi rappelé que, suite à la diffusion d'un reportage télévisé sur l'amiante au Canada, le gouvernement avait réagi officiellement, et d'une manière, selon lui, peu crédible : « Le ministre des ressources naturelles du gouvernement québécois a tenu des propos mensongers sur les propriétés de l'amiante canadien. Selon lui, un an après avoir respiré de l'amiante, il est parfaitement possible, pour tout citoyen de respirer normalement dans la mesure où plus aucune trace d'amiante ne se trouverait dans ses poumons. Selon le ministre, aucun risque de séquelles n'est alors identifiable. Il est inutile de vous dire que les déclarations du ministre de ce gouvernement sont proprement mensongères. Nous assistons, de la part du gouvernement du Canada, incité en sous-main par les producteurs canadiens, à une attitude totalement irresponsable, d'autant que ce pays ne consomme pas l'amiante qu'il produit. La quasi-totalité de la production de l'amiante est, en effet, envoyée dans les pays du tiers-monde. Inutile de vous dire que la situation y est encore plus préoccupante ».
Il apparaît en outre que la production mondiale d'amiante a tendance, depuis quelques années, à augmenter. L'assemblée générale de l'Association internationale des sécurités sociales constate que la production mondiale d'amiante est à nouveau en hausse depuis quatre ans. Cette production est principalement originaire de la Russie, de la Chine, du Canada, du Brésil et du Kazakhstan.
B. LA NOCIVITÉ DE L'AMIANTE EST CONNUE DE LONGUE DATE
La mission considère qu'il est impossible de se retrancher derrière des incertitudes sur les effets de l'amiante sur la santé, tant la suspicion qui pesait sur cette fibre était forte, avant que ses dangers ne soient maintes fois démontrés au cours du siècle.
Les lésions pulmonaires résultant des poussières ont été l'une des premières questions abordées par la sécurité au travail, la lutte contre l'empoussièrement des ateliers ayant fait l'objet d'une loi dès 1893. En outre, la dangerosité de cette fibre a été mise en évidence au début du XX e siècle. Les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ont été prises en compte au titre des tableaux de maladies professionnelles dès 1945. De surcroît, les connaissances médicales concernant l'amiante se sont certes affinées avec le temps, mais toujours dans un sens plus alarmant qui aurait dû conduire à une prudence accrue. Enfin, l'histoire du risque amiante a été ponctuée de « crises » qui constituaient autant d'occasions de prendre conscience du danger.
Devant la mission, le Pr Marcel Goldberg, directeur de l'unité de santé publique et d'épidémiologie sociale et économique de l'INSERM et conseiller scientifique à l'InVS, a ainsi résumé la situation : « Les experts ont alerté sur les risques de l'amiante » mais « ils n'ont pas été écoutés ».
Le Pr Patrick Brochard, chef du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle au CHU de Bordeaux et professeur des universités en épidémiologie, économie de la santé et prévention à l'université Bordeaux II, qui a siégé au comité permanent amiante, a lui aussi estimé que « les industries de production connaissaient le dossier amiante , savaient comment protéger leurs salariés et participaient à tous les congrès relatifs à l'amiante. Par conséquent, leurs dirigeants ne pouvaient prétendre ignorer les dangers de l'amiante . Toutefois, l'information n'a pas été transmise aux utilisateurs de matériaux contenant de l'amiante, c'est-à-dire aux ouvriers du bâtiment (peintres, plombiers etc.) ».
Quant à M. Daniel Bouige, aujourd'hui président du laboratoire hygiène de contrôle des fibres (LHCF Environnement), mais qui a débuté sa carrière à la chambre syndicale de l'amiante et qui a longtemps participé aux réunions du comité permanent amiante, il a rappelé que « l'amiante était une question d'actualité importante », traitée dans de nombreuses conférences internationales donnant lieu à des débats entre experts et scientifiques.
Pourtant, aujourd'hui encore, certains industriels mettent en doute la connaissance des dangers par les entreprises, y compris les plus grandes d'entre elles. Ainsi M. Claude Imauven, directeur général adjoint de la Compagnie Saint-Gobain et directeur du pôle produits pour la construction, déclara-t-il devant la mission : « Il est difficile de dire aujourd'hui que l'on savait ». De même, dans un document présentant leur position commune, que le MEDEF, la CGPME et l'UPA ont remis à la mission, on peut lire que « la question de la responsabilité des différents acteurs, État et entreprises, est aujourd'hui encore assez confuse au regard des incertitudes scientifiques sur le sujet. Le développement d'une idéologie de la précaution qui regarde les faits d'hier avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui pousse à rechercher des responsabilités qui ne sont pas évidentes ».
En fait, les connaissances scientifiques relatives à l'amiante, même si elles ont naturellement évolué, ne datent pas d'aujourd'hui mais bel et bien d'hier, voire d'avant hier.
1. Un danger connu depuis le début du XXe siècle
C'est en 1906 que les premiers cas de fibrose sont découverts, chez les ouvriers des filatures.
Le Bulletin de l'inspection du travail de 1906 publie un document intitulé Note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d'amiante, par M. Auribault, inspecteur départemental du travail à Caen 11 ( * ) .
Denis Auribault notait ainsi : « En 1890, une usine de filature et de tissage d'amiante s'établissait dans le voisinage de Condé-sur-Noireau (Calvados). Au cours des cinq premières années de marche, aucune ventilation artificielle n'assurait d'évacuation directe des poussières siliceuses produites par les divers métiers ; cette inobservation totale des règles de l'hygiène 12 ( * ) occasionna de nombreux décès dans le personnel : une cinquantaine d'ouvriers et d'ouvrières moururent dans l'intervalle précité ».
|
[...] Au-delà du seul secteur de Condé-sur-Noireau et de la Vallée de la Vère, également surnommée « vallée de la mort », le Calvados est un département sinistré par l'amiante. [...] L'amiante est apparu à Condé-sur-Noireau à la fin du XIX e siècle, lorsque les usines textiles se sont progressivement tournées vers le filage des fibres d'amiante. L'essor de l'industrie automobile a accéléré cette reconversion et le bassin économique de Condé-sur-Noireau s'est fortement développé afin de répondre à la demande. Les filatures du secteur ont été peu à peu reprises par la société Valeo Ferodo, devenue ensuite Bendix puis Allied Signal. Cette entreprise a employé jusqu'à 2 400 salariés, chiffre qui n'inclut pas les personnels intérimaires et les nombreux sous-traitants. En conséquence, le nombre de victimes de l'amiante à Condé-sur-Noireau est très important. Il ne passe pas une semaine sans que nous enterrions une ou deux personnes. Dans un périmètre de cinq à dix kilomètres, tous les villages voisins sont également touchés. Chaque maison dans laquelle vous pénétrez, chaque famille que vous rencontrez ont eu à vivre le drame de la perte d'un être cher à cause de l'amiante [...]
Source : Procès-verbal de l'audition, devant la
mission, de M. François Martin,
|
Ainsi, dès 1906, le lien entre exposition aux fibres d'amiante et survenue de décès professionnels est clairement établi.
On rappellera en outre que, douze ans auparavant, en 1894, la Cour de cassation, commentant un décret d'application de la loi du 12 juin 1893 sur l'empoussièrement des ateliers, estimait que « la présence de poussière quelconque peut toujours présenter un danger ». Comment, dès lors, croire en la bonne foi de ceux qui prétendaient ne pas connaître, des décennies plus tard, la nocivité de l'amiante sur la santé ?
Du reste, il n'est pas anodin de noter qu'aux Etats-Unis, les compagnies d'assurance refusèrent, dès 1918, d'assurer sur la vie les travailleurs de l'amiante ! Dans ce pays, les accidents et les expositions liés au travail relevaient, en effet, de l'assurance privée, alors qu'en France, ils sont gérés par la sécurité sociale depuis 1946.
2. Une accumulation de données scientifiques et médicales sur l'amiante
Au cours de son audition, le professeur Got rappelait que « la connaissance sur le risque est bonne depuis environ 40 ans, que les moyens à mettre en oeuvre sont décrits, que l'insuffisance d'une sécurité fixée par le taux de fibres dans l'air est reconnue et exprimée dès 1965 ». Il a ainsi souligné la discordance complète entre le risque documenté et l'attitude qui pouvait exister dans les entreprises, dans les pratiques professionnelles, pour essayer de réduire ce risque . Il y avait, selon lui, une acceptation du risque liée à une sous-estimation considérable de son intensité.
C'est pourquoi la mission ne saurait souscrire aux propos de M. Bernard Caron, directeur de la protection sociale au MEDEF, pour qui « les industriels ont pris conscience de la dangerosité de ce matériau [...] progressivement. Au fur et à mesure que les connaissances scientifiques se sont affinées ».
En fait, les employeurs ont longtemps cherché à « banaliser » l'amiante et sont encore, parfois, tentés de le faire. Lors de la table ronde des organisations patronales, le Dr Pierre Thillaud, représentant de la CGPME au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, a ainsi déclaré à la mission : « Nous avons « choisi » [...] de privilégier un principe d'exception alors qu'il n'y avait pas véritablement de justification. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de l'amiante, mais nous pourrions parler de bien des expositions professionnelles qui auraient pu justifier un traitement d'exception ».
Pourtant, les membres du comité permanent amiante qui, le 9 novembre 1982, avaient organisé la journée d'étude intitulée Amiante : où en est-on en France ? , connaissaient suffisamment les dangers de l'amiante pour la santé pour demander, comme l'indique un compte rendu du CPA de 1982, que « l'AFA 13 ( * ) se charge de la présentation sous vitrine d'échantillons d'amiante, de produits semi finis et finis sous leurs emballages de protection ». Les risques devaient pourtant être bien moindres que pour des travailleurs de l'amiante...
a) Des connaissances de plus en plus précises et alarmantes : on en savait assez pour gérer le risque amiante en 1965
Le rapport de l'expertise collective de l'INSERM de 1997 rappelle les principales étapes des connaissances médicales relatives aux effets des expositions à l'amiante sur la santé.
Les risques de fibrose pulmonaire sont les premiers à avoir été établis : rappelons que des cas d' asbestose ont été décrits chez des sujets exposés à cette fibre dès 1906. La relation quantitative liant l'exposition cumulée à l'amiante et l'accroissement du risque d'asbestose était décrite en 1930. Du reste, la première réglementation visant à réduire le risque de cette pathologie a été mise en place en Grande-Bretagne l'année suivante, en 1931.
Le premier rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon a été publié en Grande-Bretagne en 1935 par Lynch. Quinze ans plus tard, rappelle le rapport de l'INSERM, un médecin britannique, Doll, « montrait d'une façon considérée pour la première fois comme rigoureuse que l'exposition professionnelle à l'amiante était responsable d'un accroissement du risque de cancer du poumon dans une population de travailleurs de l'amiante textile à Rochdale, en Grande-Bretagne ». Et c'est en 1967 que sont publiés les premiers éléments permettant de quantifier la relation entre le degré d'exposition à l'amiante et l'accroissement du risque de cancer du poumon. M e Jean-Paul Teissonnière et Mme Sylvie Topaloff, dans le supplément précité de la Semaine sociale Lamy consacré à l'affaire de l'amiante, de juillet 2002, rappellent ainsi que, « au début des années 1950, le milieu médical est acquis à l'idée que l'inhalation d'amiante puisse engendrer des cancers pulmonaires » .
Quant aux mésothéliomes , ils sont observés chez des mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud, en 1960, par Wagner. Le rapport de l'INSERM note que, « dans les années qui ont immédiatement suivi, des observations similaires ont été faites en Grande-Bretagne et au Canada chez les ouvriers ayant fabriqué des filtres de masques à gaz et, aux Etats-Unis, dans les fabriques de filtres de cigarettes. Il est également très vite devenu évident qu'un risque de mésothéliome pouvait être observé dans le secteur textile, et un risque particulièrement élevé chez les ouvriers des chantiers navals et chez les calorifugeurs ». Le premier cas de mésothéliome français est décrit en 1965 par le professeur Turiaf qui présente une communication devant l'Académie nationale de médecine.
Le professeur Got a rappelé, au cours de son audition, qu'il datait « la période où l'on a à peu près tout connu du risque lié à l'amiante en [se] référant à un congrès qui s'est tenu à New York en 1965 , et qui s'est concrétisé par un énorme volume de 732 pages, qui n'est pas loin d'ici, à la bibliothèque de la faculté de médecine. Tous les spécialistes mondiaux du risque amiante étaient là et chacun a expliqué ce qu'il savait des risques liés à l'amiante, avec des études épidémiologiques précises. Dans ce volume, pratiquement, il y a toute la connaissance dont on a besoin pour gérer le risque amiante. Or, on est en 1965 », ajoutant : « Je ne pensais pas que les points qui se sont révélés ensuite les plus importants étaient aussi explicitement connus dans ce rapport ».
M e Jean-Paul Teissonnière et Mme Sylvie Topaloff notent qu'« au congrès de l'Agence internationale de la recherche sur le cancer dépendante de l'OMS qui s'est tenu à Lyon en octobre 1972, toutes les études ont « renforcé les preuves » des années 1960 sur la relation amiante/cancer », tandis que des experts se réunissent à Genève, sous l'égide du Bureau international du travail (BIT), les 11 et 18 décembre 1973, et publient un rapport intitulé L'amiante : ses risques pour la santé et leur prévention , qui évoque, notamment, le cancer bronchique et le mésothéliome comme affections résultant de l'inhalation de poussières d'amiante. Ils estiment que « la présence des industriels français et des spécialistes qui travaillent à leur contact, atteste de la transmission immédiate de l'information ».
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe toutes les variétés d'amiante cancérogènes n° 1 en 1977 : depuis cette date, au moins, on sait que l'amiante est un cancérogène certain pour l'homme .
En 1982, la conférence de Montréal met en évidence l'absence de protection des valeurs limites d'exposition (VLE) contre le risque de cancer.
Est-il possible que tant de connaissances médicales accumulées au cours de décennies successives n'aient pas été relayées, aussi bien au niveau des administrations publiques que des industriels ? En fait, il semble bien qu'elles l'aient été.
Et la réaction n'a d'ailleurs pas tardé. Comme le rappelait le Pr Got, « la position de l'industrie était extrêmement dure vis-à-vis de ces scientifiques « irresponsables » », comme le professeur Jean Bignon qui avait alerté, par une lettre du 5 avril 1977, « une lettre d'alerte sanitaire » selon le Pr Got, le Premier ministre de l'époque, M. Raymond Barre, des dangers de l'amiante 14 ( * ) .
Au niveau de l'administration, les risques étaient également bien perçus.
Dès octobre 1981, dans un numéro de la revue du ministère du travail, Echange Travail , M. Jean-Luc Pasquier, alors chef du bureau CT 4 à la direction des relations du travail, écrivait que « l'amiante présente, s'il est inhalé, un risque grave pour la santé de l'homme. Ce matériau est rendu responsable, non seulement de l'asbestose et de ses complications mais aussi du mésothéliome en raison de la fréquence de cette affection observée ces dernières années chez les travailleurs de l'amiante ». Il indiquait également que, « pour toutes ces maladies, le délai s'écoulant entre l'exposition et les premiers signes pathologiques est très long (entre 10 et 40 ans) ». La perception par l'administration de ce qu'il y avait à savoir sur les maladies causées par l'amiante, y compris le temps de latence très important, était donc déjà bien établie 15 ans avant l'interdiction de l'amiante.
b) Les pathologies de l'amiante
« Les effets de l'amiante sont désormais parfaitement bien connus » a fait observer le Dr Ellen Imbernon, responsable du département santé et travail de l'Institut de veille sanitaire (InVS), lors de son audition, précisant qu'il s'agissait des effets d'une exposition professionnelle, car les effets qui sont liés aux expositions passives, le travail dans des locaux floqués par exemple, sont moins bien connus.
Comme le souligne le rapport du Gouvernement au Parlement, établi en application de l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, « en l'état actuel des connaissances et des constats épidémiologiques, le risque amiante est essentiellement un risque professionnel ».
Les pathologies provoquées par l'amiante présentent des degrés de gravité et d'évolutivité très différents. Toutefois, selon le même rapport, « quelques caractéristiques communes les rapprochent : temps de latence généralement élevé entre la première exposition et les premières manifestations radio cliniques (le plus souvent situé entre 30 et 40 ans), persistance du risque tout au long de la vie après la fin de l'exposition et peu ou pas de traitement médical curatif ». De surcroît, « le manque de données épidémiologiques sur le risque amiante est souvent souligné. Plus exactement, les données disponibles sont partielles et de niveaux différents selon la pathologie considérée d'une part et selon le type d'exposition de l'autre », les pathologies les plus lourdes étant généralement mieux connues.
L'amiante est à l'origine de maladies bénignes mais aussi de maladies malignes particulièrement redoutables, les fibres retenues dans les poumons pouvant interagir localement avec les tissus et provoquer une inflammation du poumon et/ou du tissu qui l'enveloppe, la plèvre.
Ces maladies ont un bilan humain considérable. Non seulement 35.000 personnes sont mortes, en France, d'une maladie de l'amiante, entre 1965 et 1995, mais entre 50.000 et 100.000 décès sont encore attendus d'ici 2025. Selon l'Organisation internationale du travail, 100.00 personnes meurent chaque année, dans le monde, du fait de l'amiante.
|
Au cours de son audition, le docteur Ellen Imbernon a estimé qu'au regard du nombre de malades qui allaient apparaître au cours des années à venir, le terme « épidémie » pouvait être employé. Le professeur Marcel Goldberg a dressé les perspectives accablantes de l'évolution du nombre de décès liés à l'amiante : « Deux études ont été réalisées à ce sujet. Leurs conclusions convergent sur les mêmes analyses. Nous attendons entre 50.000 et 100.000 décès par cancer en France durant les vingt prochaines années, dont les deux tiers seront causés par un cancer du poumon et le troisième tiers par les mésothéliomes pleuraux. Ces prévisions sont malheureusement inéluctables, à moins que survienne, entre temps, un progrès thérapeutique. Quoi qu'il en soit, le nombre de cas de cancers survenant jusqu'en 2025-2030 est fixé ». |
Les pathologies bénignes
Si certaines pathologies provoquées par l'amiante sont bénignes, elles n'en sont pas moins caractérisées par une absence de traitement médical.
Il s'agit :
1°) des plaques pleurales et des épaississements pleuraux : les plaques pleurales sont des lésions, le plus souvent asymptomatiques, de la plèvre pariétale qui apparaissent en général plus de 15 ans après la première exposition à l'amiante. Le rapport précité du gouvernement au Parlement note que « la littérature disponible indique que leur prévalence est élevée 15 ( * ) mais leur évolutivité est lente, voire nulle dans la presque totalité des cas. Elle souligne également que leur présence ne semble pas liée à un niveau d'exposition particulier, ni constituer un facteur de risque supplémentaire de survenue d'un mésothéliome ou d'un cancer broncho-pulmonaire ». La question des plaques pleurales demeure toutefois controversée : véritable maladie pour les uns 16 ( * ) , en particulier les victimes et leurs associations 17 ( * ) , « simple » cicatrice pour les autres. En revanche, les épaississements pleuraux constituent une pathologie à l'origine de douleurs, voire d'une altération de la fonction respiratoire ;
2°) de l'asbestose : il s'agit d'une fibrose interstitielle diffuse et progressive qui s'étend des régions péribronchiolaires vers les espaces sous-pleuraux et qui provoque une sclérose du tissu pulmonaire. L'affection, spécifique de l'amiante, apparaît en général 10 à 20 ans après le début de l'exposition et semble nécessiter des expositions importantes et durables, dont l'intensité minimale n'est pas bien définie, les spécialistes n'étant pas toujours d'accord entre eux sur ce point. Les symptômes initiaux de l'asbestose ne sont guère significatifs et se développent progressivement, en particulier une dyspnée 18 ( * ) progressive, d'abord limitée à l'effort, parfois accompagnée d'une toux. Avec le temps, la capacité pulmonaire et la capacité de diffusion de l'oxyde de carbone sont réduites. L'asbestose peut être associée à d'autres maladies : des atteintes broncho-pulmonaires bénignes telles que des bronchites chroniques, des désordres immunologiques, voire une insuffisance cardiaque. Il n'existe pas de traitement susceptible de faire régresser le processus.
Par ailleurs, certains membres de la mission ont été alertés sur l'apparition d'un nouveau symptôme qui pourrait être lié à l'amiante, certaines victimes développant en effet des nodules dont la cause et l'évolution restent mal connues.
Les pathologies malignes
Les pathologies malignes causées par une exposition à l'amiante sont essentiellement de deux types :
1°) le mésothéliome est une tumeur maligne des surfaces mésothéliales touchant principalement la plèvre, moins souvent le péritoine et plus rarement le péricarde. La survenue de cette maladie, parfois qualifiée de « cancer de l'amiante », cette fibre étant le seul facteur de risque reconnu pour ce type de cancer , n'est pas indicative d'un seuil minimal d'exposition et son traitement médical a un impact limité sur l'espérance de vie des malades, en général de 12 à 18 mois. Les premières manifestations retrouvées à l'examen clinique sont des douleurs thoraciques, souvent associées à un essoufflement et à un épanchement pleural récidivant, en général hémorragique. Le temps de latence entre la première exposition et le développement du mésothéliome est rarement inférieur à 20 ans, souvent de l'ordre de 30 à 40 ans, voire plus. Il ne semble pas exister de valeur seuil d'exposition en rapport avec un risque d'apparition. Le tabac ne joue aucun rôle dans le risque de survenue d'un mésothéliome. Il a été décrit des cas de mésothéliomes pleuraux survenant dans l'environnement familial proche des travailleurs exposés à l'amiante, les sujets étant exposés du fait de la contamination des locaux d'habitation ou lors de l'entretien de vêtements empoussiérés. Le rapport précité du Gouvernement au Parlement note que « l'enquête de l'INSERM établit que l'incidence du mésothéliome dans le nombre de décès par cancer est en constante augmentation et cette augmentation est de 25 % tous les trois ans. [...] le rapport s'efforce néanmoins à élaborer une projection à l'horizon 2020 qui établit que les cas de décès par mésothéliome pourraient se situer autour de 1.000 décès annuels ». D'autres enquêtes 19 ( * ) sont venues compléter celle de l'INSERM, qui demeure une référence. Ainsi, entre 1996 et 2020, 20.000 décès dans la population masculine et plus de 2.900 décès dans la population féminine pourraient être directement liés à la survenue d'un mésothéliome. Selon une autre enquête, le pic de mortalité se situerait entre 2025 et 2040 avec une hypothèse basse de mortalité annuelle chez les hommes de 50 à 79 ans de 1.140 et une hypothèse haute de 1.300. Entre 1997 et 2050, elle projette une mortalité par mésothéliome de 44.480 à 57.020 décès.
|
Tous les arguments convergent pour attribuer aux expositions professionnelles l'étiologie de la quasi-totalité des cas de mésothéliome dans les pays industrialisés . Ces arguments proviennent de très nombreux travaux, mettant à contribution tous les types d'étude et toutes les méthodes épidémiologiques : études de cas, études de cohorte et cas-témoins, études « écologiques », analyses de tendances évolutives. Ces innombrables travaux ont été menés dans des pays différents et ont concerné des populations et des groupes professionnels extrêmement diversifiés. Ils ont porté aussi bien sur l'étude de la mortalité que sur celle de l'incidence du mésothéliome. Ils permettent de considérer que, à l'instar du cancer du poumon, tous les types de fibre d'amiante, y compris le chrysotile, sont susceptibles d'induire des mésothéliomes . Une importante évolution des professions concernées s'est produite depuis quelques décennies, la majorité des mésothéliomes se rencontrant aujourd'hui, dans les pays industrialisés, dans des métiers très variés. Pour illustrer cette évolution, on peut rappeler que dans les années 60, les principales professions touchées étaient celles de la production et de l'utilisation de l'amiante : travailleurs du secteur de l'isolation, de la production et de la transformation de l'amiante, chauffagistes, travailleurs des chantiers navals . Par contraste, dans les années 80 et 90, le risque le plus élevé concerne les métiers impliquant des tâches d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante. Les professions les plus touchées sont les tôliers-chaudronniers (catégorie incluant les travailleurs des chantiers navals), et les carrossiers industriels ; on trouve ensuite les plombiers, les charpentiers et les électriciens. A eux seuls, les métiers du bâtiment contribuent actuellement au quart de tous les décès par mésothéliome , proportion considérée comme probablement sous-estimée. Actuellement, les expositions à l'amiante se rencontrent dans des professions extrêmement nombreuses ; à titre d'exemple, on peut citer parmi les métiers à risque élevé de mésothéliome, des professions aussi diverses que les soudeurs, les dockers, les techniciens de laboratoire, les peintres et décorateurs, les bijoutiers, les ajusteurs, les mécaniciens automobile, les travailleurs des chemins de fer, etc. Les niveaux d'exposition sont vraisemblablement moins élevés que dans le passé, mais ces professions occupent des effectifs importants, ce qui explique le grand nombre de cas de mésothéliomes qu'on y rencontre. De plus, ces professions n'étant habituellement pas considérées comme « à risque », elles font moins l'objet de surveillance et de mesures de protection adéquates. L'évolution concernant les professions touchées par le mésothéliome se comprend si on se rappelle que le temps de latence de cette maladie est en moyenne de 30 à 40 ans. Il a, en effet, tout d'abord fallu produire, manufacturer et mettre en place l'amiante dans des installations et des matériaux divers : ce sont donc les travailleurs concernés par ces activités qui ont été atteints par les premiers mésothéliomes, d'autant que pendant cette période, les niveaux d'exposition ont été très élevés. A l'échelle de l'ensemble de la population, le nombre total de cas attribuables à ces activités est cependant resté restreint, pour cette « première génération » de mésothéliomes, en raison du faible nombre des travailleurs concernés par rapport à la population active. Ultérieurement, de nombreuses professions ont été mises en contact avec l'amiante ainsi très largement disséminé. C'est pourquoi, avec un décalage temporel dû à la latence de la maladie, bien que les niveaux d'exposition de ces professions étaient vraisemblablement moins élevés (et ont, dans l'ensemble régulièrement diminué du fait des réglementations successives), on a vu, du fait de l'importance des effectifs de ces professions, apparaître une « seconde génération » de mésothéliomes, bien plus nombreux à l'échelle de l'ensemble de la population dans les pays industrialisés.
Source : Effets sur la santé des principaux
types d'exposition à l'amiante,
|
2°) les cancers broncho-pulmonaires représentent la première cause de mortalité des sujets ayant été exposés à l'amiante . Le temps de latence entre la première exposition et le développement de la maladie dépasse en général 20 ans. Aucune particularité clinique ou radiologique ne les distingue des cancers broncho-pulmonaires d'autres origines et leur développement est indépendant d'une fibrose pulmonaire. Le risque d'atteinte tumorale est majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, le tabac en particulier. Il existe une relation dose/effet entre l'intensité de l'exposition à l'amiante et le risque de cancer bronchique, sans qu'il soit possible de proposer de valeur seuil. En l'état actuel des évaluations épidémiologiques, celles réalisées par l'INSERM et par l'InVS, on estime entre 1.800 et 4.000 l'incidence annuelle de cancers broncho-pulmonaires attribuables à l'amiante.
3. L'inscription des affections engendrées par l'amiante au tableau des maladies professionnelles
Comment peut-on affirmer qu'« on ne savait pas », quand l'amiante est inscrit comme source d'affections au tableau des maladies professionnelles depuis 1945 ? A cette question, la mission n'a pas reçu de réponse convaincante.
La nocivité de l'amiante, mise en évidence sur le plan médical depuis le début du XX e siècle, trouve en quelque sorte sa « consécration » dans le milieu professionnel par l'inscription des maladies engendrées par les poussières d'amiante au tableau des maladies professionnelles, le 3 août 1945 20 ( * ) . Inscrites dans un premier temps avec la silice, elles font ensuite l'objet, par décret du 31 août 1950, d'un tableau spécifique, le n° 30, qui sera plusieurs fois modifié, la dernière fois par un décret du 14 avril 2000.
Un décret du 5 janvier 1976 inscrit parmi ces maladies le mésothéliome primitif, tandis que la fabrication de l'amiante-ciment, principal produit amianté, est retenue comme travail susceptible de provoquer des affections liées à cette fibre.
Un décret du 19 juin 1985 ajoute, au titre des maladies engendrées par les poussières d'amiante, le cancer broncho-pulmonaire quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée.
Un décret du 22 mai 1996 ajoute un tableau n° 30 bis qui intègre le cancer broncho-pulmonaire primitif, sous réserve d'une exposition de dix ans et à la condition que le salarié ait été employé dans l'un des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, cette liste étant limitative et non plus indicative.
4. Des événements révélateurs qui auraient dû provoquer une prise de conscience
Certes, ces événements sont à l'origine de la publication du décret du 17 août 1977, première réglementation française concernant le risque amiante au travail. Pourtant, ils n'ont pas eu les répercussions suffisantes pour mettre en place des mesures de protection efficaces qui auraient considérablement limité le nombre de victimes. Si « l'entreprise artisanale a toujours fait une utilisation de l'amiante en toute bonne foi », comme l'a déclaré M. Daniel Boguet, membre de l'Union professionnelle artisanale (UPA), devant la mission, ces événements, pas plus que les informations scientifiques, n'auront réussi à entamer sa bonne foi.
a) L'affaire Amisol
Les conditions de travail déplorables dans l'usine de textile Amisol de Clermont-Ferrand vont donner à l'utilisation professionnelle de l'amiante, au début des années 1970, une visibilité certaine. Ces conditions de travail sont telles - les ouvrières travaillent dans une atmosphère saturée par les poussières d'amiante - qu'elles provoquent une grève de 31 mois, avec occupation de l'usine.
M. Daniel Bouige, rappelant, devant la mission, qu'il était intervenu dans l'usine Amisol, note que son rapport démontrait clairement le mauvais état sanitaire de cette entreprise : « Les chiffres étaient particulièrement alarmants. Au regard du chiffre que vous venez d'évoquer, le niveau d'empoussièrement était de cent à plusieurs centaines de fibres par cm 3 ».
Amisol ne s'en remettra pas, et la société sera liquidée.
Toutefois, les ouvrières constatent, pendant les mois d'inactivité de la grève, que nombre d'entre elles tombent malades et que certaines meurent. Ce que le médecin du travail de l'entreprise n'avait pas vu, les ouvrières le comprennent fort bien.
Le professeur Got a d'ailleurs rappelé que « les médecins du travail ne voyaient donc pas mourir les ouvriers de leurs entreprises ! C'est évident quand on lit le texte qui a été publié dans la Revue du praticien par un médecin du travail d'Amisol, une entreprise de Clermont-Ferrand, resté célèbre par son inaptitude totale à gérer le risque amiante dans ses usines textiles, qui dit qu'on surévalue le risque amiante et qu'il ne voit pas de personnes malades de l'amiante dans son entreprise ».
Or, l'affaire Amisol va se produire quasiment au même moment que celle de Jussieu. Les chercheurs qui travaillent sur ce campus, et qui s'inquiètent des conséquences sanitaires du flocage des bâtiments universitaires, entrent en contact avec les ouvrières d'Amisol. Ils se rendent sur place pour visiter l'usine et dénoncent ensemble le scandale, dont la presse s'empare.
b) Jussieu
M. Henri Pézerat a rappelé, lors de son audition, les circonstances de l'apparition de l'affaire de l'amiante sur le campus de Jussieu, en 1974 : « Un jour, un de nos collègues est venu expliquer que la poussière que nous retrouvions sur nos paillasses trouvait son origine dans l'amiante qui se trouvait dans le flocage qui avait été fait au-dessus des faux plafonds. Nous ignorions totalement les conséquences de l'amiante sur la santé. Nous en avons pris conscience lorsque ce collègue nous a affirmé que l'amiante était probablement cancérigène » 21 ( * ) .
Ce qu'il est convenu d'appeler le « premier scandale de Jussieu » - le second, celui qui conduira au désamiantage 22 ( * ) , se produira au cours de la deuxième moitié des années 1990 - se déroule entre 1975 et 1980.
Il a été décidé de recouvrir l'amiante du rez-de-chaussée où se trouvaient de nombreux bureaux et laboratoires. En revanche, cette mesure n'a pas été appliquée dans les étages. Selon M. Henri Pézerat, cette décision a contribué à faire retomber la tension. Comme l'ont indiqué les représentants du comité anti-amiante de Jussieu, rencontrés lors du déplacement d'une délégation de la mission sur le campus, entre 1979 et 1994, le problème de l'amiante n'a plus retenu l'attention. Un programme de travaux a été annoncé en 1982 mais n'a jamais vu le jour.
Pourtant, si, en 1975, le nombre des victimes était encore limité, les chercheurs de Jussieu, réunis au sein d'un « collectif amiante », qui n'a pas de lien direct avec l'actuel comité anti-amiante, n'ont eu de cesse, selon M. Henri Pézerat, d'alerter les pouvoirs publics, insistant sur le fait que le problème risquerait de se poser avec plus d'acuité au cours des trente prochaines années.
En outre, le risque à Jussieu a été sous-estimé jusque très récemment, y compris par les autorités du campus. Cela semble être le cas de M. Claude Allègre, ancien directeur de l'Institut de physique du Globe.
M. Henri Pézerat a qualifié d'« idéologique » la position de M. Claude Allègre, estimant qu'il avait « traité par le mépris les dégâts qui ont été constatés à l'Institut de physique du Globe. Pour bien connaître cette partie du campus, je puis vous assurer qu'un certain nombre de personnes y ont été exposées très significativement. Cette position est proprement inqualifiable ».
L'affaire de Jussieu et le « premier scandale de l'amiante » sont presque concomitants.
Le 20 décembre 1976, la chambre syndicale de l'amiante et le syndicat de l'amiante-ciment adressent au Premier ministre de l'époque, M. Raymond Barre, une lettre mettant en cause le Pr Jean Bignon qui, au cours d'une conférence organisée par le Centre international de recherche sur le cancer, à Lyon, du 14 au 17 décembre 1976, avait attiré l'attention, avec d'autres experts internationaux, sur les dangers de l'amiante pour la santé.
Le professeur Bignon, répondant en quelque sorte à cette lettre, écrit à son tour au Premier ministre pour l'informer des dangers de l'amiante, par une lettre du 5 avril 1977 précitée. Dans celle-ci, il rappelle les conclusions des experts réunis quelques mois plus tôt à Lyon, qui sont fort différentes des considérations rassurantes du Livre blanc de l'amiante élaboré par les industriels. Le professeur Bignon écrit notamment : « Les responsables de cette industrie semblent adopter les normes internationales de « moins de 2 fibres/cm3 d'air ». Cependant, il faut rappeler que de telles normes ont été établies pour protéger les travailleurs contre l'asbestose, mais qu'elles sont sûrement insuffisantes comme protection vis-à-vis du cancer ». Il concluait - en avril 1977 rappelons-le : « Force est d'admettre que l'amiante est un cancérogène physique dont l'étendue des méfaits chez l'homme est actuellement bien connue ».
5. La réglementation communautaire
Les Communautés européennes ont entrepris de réglementer la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, en particulier la directive du 27 novembre 1980, qui prévoit l'établissement, au moyen de directives particulières, de valeurs limites et de prescriptions spécifiques pour les agents énumérés dans son annexe I, parmi lesquels figure l'amiante. La directive du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail constitue une de ces directives particulières. Elle fixe, notamment, des valeurs limites, considérant que « l'amiante est un agent nocif présent dans un grand nombre de situations de travail et que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé ».
Les scientifiques siégeant au comité permanent amiante semblent avoir tout ignoré de la réglementation communautaire en la matière. Au cours de son audition, le professeur Patrick Brochard a ainsi affirmé : « A cette époque, il est important de souligner que les textes européens sur le sujet n'existaient pas », ce qui est manifestement inexact, comme on vient de le voir.
Les dangers présentés par l'amiante avaient déjà été mis en évidence par le Parlement européen, dans sa résolution sur les risques sanitaires de l'amiante de janvier 1978, transmise au Conseil des ministres, à la Commission et au Conseil économique et social.
Ainsi, le Parlement européen, notamment :
- rappelait qu'« il existe suffisamment de preuves permettant de démontrer que l'amiante présente un danger tant pour les travailleurs de l'industrie de l'amiante que pour les personnes mises en contact avec l'amiante dans d'autres situations et qu'il est temps d'en tirer les conclusions qui s'imposent » ;
- soulignait que « l'amiante est un produit cancérigène » ;
- soulignait que « toutes les formes d'amiante utilisées dans la Communauté présentent un danger pour la santé humaine » ;
- demandait « l'interdiction de la crocidolite dans tous les Etats membres » ;
- espérait que « la proposition de directive sur la publicité mensongère, annoncée par la Commission, comportera certaines dispositions tendant à protéger le public contre toute campagne de publicité irresponsable du type de celle lancée sur l'amiante dans certains Etats membres » ;
- estimait qu'« il faudrait développer un maximum d'efforts pour développer des produits de remplacement sûrs pour l'amiante et que, lorsque ces produits de remplacement seront disponibles, l'utilisation de l'amiante doit être progressivement supprimée ; lorsque des produits de remplacement sûrs existent déjà, l'utilisation de l'amiante doit être interdite ».
Cette résolution de 1978 était rédigée en termes relativement alarmants. Elle semble n'avoir alarmé personne.
6. Les rapports de la fin des années 1990
a) Le rapport de l'INSERM de 1997 : « épidémie » de maladies liées à l'amiante et « pandémie » de mésothéliomes
En 1997, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), à la demande des ministères chargés du travail et de la santé, publia, au titre d'une expertise collective, un rapport intitulé Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante .
Ce rapport intervenait plus de dix ans après qu'un groupe d'experts, mis en place par l'administration américaine, se fût intéressé à l'évaluation des risques pour la santé liés aux expositions à l'amiante et après que cinq autres groupes d'experts américains, britanniques et canadiens se fussent prononcés sur cette question.
Selon M. Jean-Luc Pasquier, le rapport de l'INSERM est la conclusion d'une de ses initiatives : « Juste avant mon départ du ministère [1994] , j'ai sollicité mon directeur. Je lui ai indiqué que nous étions face à un vrai problème et que nous devions rassembler rapidement tous les experts travaillant sur le sujet. En l'espace de quatre jours, nous les avons tous réunis 23 ( * ) . Cela a donc été fait sans délai et cette réunion a débouché sur l'expertise collective de l'INSERM qui, elle-même, a été à l'origine des mesures des années 1990. J'assume la responsabilité de l'organisation de cette réunion. Le directeur des relations du travail n'a exprimé aucune objection à cette décision et a même annulé tous ses rendez-vous pour pouvoir présider, en personne, cette séance. Je détiens le procès-verbal de celle-ci. Vous constaterez, sur la base de ce document, que les experts qui réclamaient l'interdiction de l'amiante en 1995 et 1996, ne la demandaient pas à cette époque ».
Le rapport de l'INSERM était un rapport de synthèse rappelant :
- certains faits essentiels concernant l'amiante : principales caractéristiques physico-chimiques, grands types d'utilisation dans les pays industrialisés, méthodes de mesure, principales circonstances d'exposition des populations, réglementation de l'utilisation de l'amiante et de la protection des travailleurs et du public ;
- les risques pour la santé associés à l'exposition à l'amiante, avec un rappel des principales manifestations pathologiques induites par l'exposition à l'amiante et un résumé des données scientifiques provenant de l'expérimentation et de l'observation épidémiologiques ;
- les principales conséquences de la connaissance des risques pour la santé de l'exposition à l'amiante du point de vue de la gestion de ces risques.
D'une manière générale, le groupe d'experts a souhaité apporter des éléments de connaissance scientifique validés concernant les risques pour la santé associés à l'exposition à l'amiante mais il a considéré que la gestion de ces risques n'était pas de son ressort.
Le rapport de l'INSERM, a rappelé M. Jacques Barrot, a « mis en évidence la difficulté de maîtriser le risque lié à l'amiante en place dans les bâtiments et équipements du fait de sa large utilisation passée et fourni des prévisions élevées de nombre de décès par mésothéliomes ou cancers du poumon imputables à l'amiante. Ce rapport de l'INSERM était très clair ». Celui-ci a ainsi « établi que des expositions régulières ou répétées à faible dose ou des expositions ponctuelles à fortes doses pouvaient être dangereuses ».
Mme Martine Aubry a expliqué que l'expertise collective de l'INSERM « montre, à partir d'hypothèses non démontrées mais scientifiquement crédibles, qu'un risque de cancer significatif pourrait subsister même à de très faibles doses d'exposition », alors qu'il aurait été jusque-là généralement admis qu'une exposition à de faibles quantités de fibres était inoffensive.
Ce rapport a permis de faire prendre conscience de la nocivité de l'amiante pour la santé mais l'essentiel des données scientifiques et médicales qu'il comporte existait déjà puisque l'expertise ainsi conduite constituait une revue de près de 1.200 publications scientifiques mondiales.
C'est pourquoi le « choc » qu'il a créé, pour reprendre le terme employé par M. Claude Michel, ingénieur conseil régional adjoint et responsable de la direction des services techniques de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, apparaît bien tardif. M. Jacques Barrot a, lui aussi, indiqué qu'il avait été « très surpris » par les conclusions du rapport et qu'il ne pensait pas que « le risque était aussi considérable ».
L'introduction de la synthèse du rapport pose le problème en termes d' « épidémie » : « L'accroissement considérable de la production et des utilisations industrielles de l'amiante qui a commencé au début du siècle a été accompagné dans les décennies suivantes d'une « épidémie » majeure de fibroses pulmonaires, de cancers du poumon et de mésothéliomes parmi les travailleurs directement exposés. Il est également à l'origine d'une pollution du voisinage immédiat des sites industriels de production et de transformation de l'amiante. Le niveau général des fibres dans l'air, l'eau et les aliments est probablement plus élevé qu'il ne l'était avant cette période et croît peut-être encore du fait de la démolition des structures contenant des fibres d'amiante (navires, bâtiments, véhicules, canalisations d'eau, etc.), de la proximité d'installations industrielles polluantes, de l'accumulation de matériaux contenant de l'amiante et se détériorant. De plus, pendant les années 60 et 70, de très nombreux bâtiments ont été floqués à l'amiante, occasionnant une exposition des occupants de ces bâtiments. Il est donc légitime de chercher à évaluer les risques pour la santé dans diverses populations exposées à l'amiante, dans des conditions qui peuvent être très différentes ».
S'agissant des mésothéliomes dans les pays industrialisés, l'INSERM note que « l'analyse de l'évolution de l'incidence du mésothéliome chez les hommes des pays industrialisés montre qu'une véritable pandémie est apparue à partir des années 50, la progression étant environ de 5 à 10 % par an depuis cette période. Cette pandémie, et la dynamique de celle-ci, est en liaison étroite avec l'introduction et le développement de l'usage massif de l'amiante dans les pays industrialisés, qui a commencé à partir de la fin de la Première Guerre mondiale dans la plupart des pays ».
Le rapport de l'INSERM concluait, au sujet de l'estimation des risques liés aux expositions à l'amiante, qu'« il est, aujourd'hui, clairement établi que :
« - toutes les fibres d'amiante sont cancérogènes, quelle que soit leur provenance géologique,
« - les risques de cancer du poumon et de mésothéliome, « vie entière », sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées, précoces et durables,
« - le risque de cancer du poumon est plus élevé pour des fibres longues et fines, qu'il s'agisse de fibres d'amphiboles ou d'appellation commerciale « chrysotile », et le risque de mésothéliome est plus élevé pour les fibres d'amphiboles que pour les fibres d'appellation commerciale « chrysotile »,
« - la modélisation définie et discutée de façon détaillée dans le cadre du présent rapport rend bien compte des risques de cancer du poumon et de mésothéliome observés dans les populations ayant subi des expositions professionnelles continues (40 h/sem. x 48 sem./an = 1.920 h/an), à des niveaux allant de 1 à 200 f/ml.
« Les incertitudes relatives à l'estimation des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associés aux expositions à l'amiante à 1 f/ml et moins, sont de deux ordres :
« - il s'agit d'abord de la forme exacte de la relation dose-risque pour les expositions inférieures ou égales à 1 f/ml,
« - il s'agit ensuite d'incertitudes relatives aux expositions à l'amiante qui ont existé ou existent au sein de la population française ».
Mme Martine Aubry a estimé que, « si le rapport de l'INSERM était sorti dix ou vingt ans plus tôt, on aurait interdit » l'amiante. Elle a également expliqué qu'en 1996, « nous n'étions toujours pas devant des liens de causalité mais devant une présomption que nous n'avions jamais eue auparavant » et que « ce n'est qu'en 1994 et 1997 [...] qu'il est apparu non pas la certitude absolue mais la présomption que, même en dessous de ces niveaux, à partir des études qui ont été faites, notamment auprès de garagistes qui ont percé des éléments amiantés, il pouvait y avoir un risque ».
La mission rappelle que l'INSERM s'est appuyé sur des études existantes et qu'une telle présomption existait bien avant 1994 - l'étude du Britannique Julian Peto - et 1996 - l'expertise collective de l'INSERM.
Mme Martine Aubry a expliqué, prenant l'exemple de son action ministérielle concernant les éthers de glycol et l'importation de viande bovine britannique pendant l'affaire de la « vache folle », que, « sur ces sujets, il ne faut pas attendre : dès que l'on a un doute, même mineur, il faut saisir ceux qui peuvent répondre [...] Il faut des études, il faut que ceux qui savent puissent le dire et, s'il y a présomption que le risque est réel, il faut intervenir ».
Certes, « la connaissance n'était pas là » mais, alors que l'utilisation de l'amiante est désormais interdite, la certitude scientifique n'est toujours pas là. Dans ce cas, la thèse de l'adaptation de la réglementation en fonction de l'avancée des connaissances paraît fragilisée puisque, dans un cas de santé publique comme celui de l'amiante, les connaissances n'étaient pas indispensables pour prendre une décision d'interdiction, seule la présomption d'un risque étant suffisante.
La mission, même s'il n'y a pas eu de présomption avant 1994 et 1997 sur les faibles doses, se demande si l'ensemble des éléments présentés plus haut sur l'accumulation des connaissances scientifiques et médicales sur l'amiante n'était pas de nature à faire naître une présomption, quelles que soient les doses d'exposition, chez les décideurs publics.
b) Le rapport Got de 1998
Le 24 décembre 1997, Mme Martine Aubry, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, et M. Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la santé, écrivaient au professeur Claude Got, qui avait accepté de conduire une mission sur l'ensemble des questions posées aux pouvoirs publics par l'amiante, après l'interdiction de l'utilisation de cette fibre à compter du 1 er janvier 1997.
Les ministres souhaitaient notamment savoir si les mesures prises étaient adaptées à l'évolution des connaissances scientifiques relatives au risque lié à l'amiante et aux matériaux de substitution, sur la base de l'ensemble des travaux scientifiques français et étrangers. Il leur apparaissait également nécessaire d'améliorer l'information de l'administration, des professionnels et du grand public, concernant le risque lié à l'amiante, afin d'en accroître la connaissance et la surveillance.
Le rapport que le professeur Claude Got remit en avril 1998 comprenait 36 propositions regroupées en cinq thèmes : sécurité sanitaire dans les habitations ; sécurité sanitaire des travailleurs ; maladies professionnelles ; environnement ; autres problèmes (généraux ou particuliers).
C. LA PASSIVITÉ DES « DONNEURS D'ALERTE » INSTITUTIONNELS
Le professeur Marcel Goldberg, au cours de son audition, soulignait « le très grand retard de la Franc e » en matière de prévention. En fait, les donneurs d'alerte institutionnels de l'époque n'ont pas joué leur rôle.
1. L'absence d'un réseau d'alerte structuré
Avant la loi de sécurité sanitaire du 1 er juillet 1998, il n'y avait aucun organisme qui avait pour mission d'alerter les pouvoirs publics sur les risques qu'occasionnaient les produits toxiques, même s'il existait bien entendu des instances compétentes en matière de santé publique.
Au cours de son audition, le professeur Marcel Goldberg, citant le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels et le Conseil d'hygiène publique de France, a indiqué que « l'un et l'autre ne se sont, à ma connaissance, jamais saisi de ce dossier sous le seul angle que, du moins, vous évoquez. Vous avez cité l'expertise collective de l'INSERM. Je figurais parmi les experts qui ont alors réalisé ce travail. Nous avons analysé, pour cette mission, une somme considérable de documents. Je puis vous assurer que nous n'y avons trouvé aucune étude française de ce type et de quelque origine qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'université, de la recherche publique ou de la recherche privée. Ce problème n'a donc réellement été pris en compte qu'avec la loi [de sécurité sanitaire] de 1998 qui, je le répète, a permis de remédier à l'absence de tout organisme chargé de traiter ces questions ».
La responsabilité des professions médicales a également été soulignée, au cours de son audition, par le professeur Dominique Belpomme, cancérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou : « Les scientifiques sont également en cause. En 1996 par exemple, l'Académie de médecine estimait que l'amiante ne constituait pas un danger majeur : si elle recommandait d'en réduire l'utilisation, elle ne plaidait pas pour son interdiction. [...] Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, la responsabilité du monde scientifique est indéniable et importante ».
La création de l'Institut de veille sanitaire (InVS) a changé la donne. L'InVS s'est doté d'un département santé et travail, dirigé par le docteur Ellen Imbernon, que la mission a entendue. Ce département s'est saisi de la question de l'amiante, qui est le premier dossier liant une activité professionnelle à une pathologie grave, le mésothéliome. De ce point de vue, comme l'a expliqué le directeur général de l'InVS, le docteur Gilles Brucker, le premier registre de surveillance d'une pathologie majoritairement liée au travail a été établi. Il s'agit du programme national de dépistage du mésothéliome , développé en 1998. Initialement mis en place au sein de 17 départements, il a été étendu à 22 départements. Aujourd'hui, il constitue la première base de données disponible permettant de mesurer l'incidence de cette maladie en France. Ce registre a permis de suivre et de quantifier le problème.
2. Le rôle ambigu de l'INRS
Dans l'affaire de l'amiante, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) , association de type « loi de 1901 » créée en 1947, a indéniablement joué un rôle ambigu , dont sa composition paritaire (salariés et employeurs) est en partie à l'origine.
Tiraillé entre sa mission de recherche en matière de sécurité au travail et son souci du consensus, il apparaît que l'INRS n'a pas toujours adopté des positions aussi impartiales qu'il le dit , comme l'a d'ailleurs rappelé, au cours de son audition, M. Marcel Royez, secrétaire général de l'Association des accidentés de la vie (FNATH), pour qui l'INRS « est loin d'être indépendant. Il est géré paritairement et a été présidé pendant des décennies par les employeurs. Or un certain nombre de ses chercheurs qui ont eu l'outrecuidance non seulement de chercher, mais aussi de trouver et de vouloir publier ont été sanctionnés. Il faut absolument mettre la recherche et l'expertise en santé au travail à l'abri de telles influences ».
De fait, la manière dont l'amiante a été traité par l'INRS constitue manifestement un sujet d'embarras pour ses responsables, comme l'a montré l'audition de MM. Philippe Huré et Michel Héry, respectivement responsable du département risques chimiques et biologiques et chargé de mission à la direction scientifique de l'INRS. Qu'on en juge !
Ainsi M. Michel Héry affirma-t-il que « l'amiante, sauf exception, n'était nullement un sujet de polémiques ou de discussions au sein du conseil d'administration de l'INRS jusqu'en 1995. [...] Pour ma part, je ne considère pas que l'amiante constituait, jusqu'en 1995, le dossier sur lequel travaillait prioritairement l'INRS ». Une telle affirmation peut paraître surprenante, alors que c'est précisément le directeur général de l'INRS de l'époque, M. Dominique Moyen, qui est à l'origine de la création du comité permanent amiante en 1982.
M. Philippe Huré, n'hésitant pas à contredire son collègue, dut reconnaître que le conseil d'administration de l'INRS ne s'était pas désintéressé du sujet, précisant que « l'INRS a produit 334 documents entre 1950 et 2000 au sujet de l'amiante et sur les moyens de s'en protéger ». Il a alors fourni force exemples pour prouver le rôle actif de l'Institut en la matière. M. Dominique Moyen a d'ailleurs présenté le même argument au cours de son audition.
En fait, l'intérêt de l'INRS pour l'amiante a été inégal et s'est heureusement nettement accru avec le temps.
En effet, selon un document remis aux membres de la mission par MM. Philippe Huré et Michel Héry, l'Institut a été à l'origine, entre 1950 et 2004, de 362 publications et documents divers sur l'amiante et ses effets, notamment dans sa revue Travail et sécurité . On peut relever, par exemple, un article de 1954 sur la prévention technique de l'asbestose, un article de 1964 comportant des informations sur le mésothéliome, une note documentaire de 1967 conseillant d'utiliser des produits de substitution de l'amiante, conseils réitérés notamment en 1972, ou encore une autre note documentaire de 1975 proposant de fixer une valeur limite d'exposition.
Toutefois, au travers de ce seul paramètre, on notera que, sur ce total, 192 publications ont paru avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante en 1997, soit un peu plus de quatre publications par an en moyenne avant cette date, contre 170 publications entre 1997 et 2004, soit plus de 24 publications par an depuis l'interdiction ! Entre 1950 et 1977, date du premier texte réglementant l'emploi de cette fibre, l'INRS avait produit 35 publications, soit seulement un peu plus d'une publication par an pendant les années d'emploi massif de l'amiante.
La mission ne peut que se poser la question : les fonctionnaires des administrations compétentes, les employeurs et leurs collaborateurs, du moins dans les entreprises d'une certaine taille, les médecins du travail... ont-ils jamais pris connaissance de ces informations ? Ont-ils jamais lu les publications de l'INRS ?
De même, la mission ne peut que s'étonner que l'INRS, qui, à travers ces très nombreux documents élaborés au cours de plusieurs décennies, devait particulièrement bien connaître l'amiante et ses effets nocifs sur la santé des salariés, n'ait jamais officiellement décidé d'alerter les pouvoirs publics.
« L'INRS n'a pas un rôle d'alerte des pouvoirs publics, même s'il a eu l'occasion de les prévenir sur certains risques », expliqua M. Philippe Huré. Alors pourquoi pas sur l'amiante ?
Le docteur Ellen Imbernon a ainsi expliqué : « Je puis formellement vous assurer qu'aucun organisme n'était réellement chargé de l'évaluation des risques professionnels, si ce n'est l'Institut national de recherche et de sécurité. [...] L'INRS avait donc délégation, me semble-t-il, pour assurer la mission de l'évaluation des risques professionnels », même si « la mission d'évaluation des risques professionnels par l'INRS n'était pas formalisée ».
M. Henri Pézerat a dressé le même constat et regretté que l'INRS n'ait pas pris l'initiative d'alerter les pouvoirs publics : « Ses statuts auraient très probablement pu le lui permettre. Malheureusement, le paritarisme a conduit, dans de tels cas, à une inertie totale et à un blocage ».
Toutefois, l'INRS n'est pas toujours resté inerte ! Il a même joué un rôle déterminant, par la personne de son directeur général de l'époque, M. Dominique Moyen, dans la création du comité permanent amiante, ce lobby si efficace.
La mission considère que l'INRS n'a pas rempli toute la mission, même non écrite, qui aurait dû être la sienne dans cette affaire.
Il convient cependant de préciser que l'INRS n'est pas le seul acteur auquel ce type de reproches pourrait être adressé.
Tel est le cas également de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), qui développe d'ailleurs la même argumentation que l'INRS pour se dédouaner. Au cours de son audition, M. Gilles Evrard, directeur des risques professionnels de la CNAMTS, a ainsi indiqué que, « s'agissant de l'amiante, la branche n'a absolument pas attendu l'interdiction de 1996-1997 pour formuler un certain nombre de recommandations. Plusieurs centaines de communications ont été effectuées au sujet de l'amiante. La branche avait assez largement évoqué tous les aspects du problème. Le fait est que cette information, qui paraissait abondante, n'a peut-être pas été suffisamment diffusée. Je considère que la branche ATMP a rempli son rôle en produisant de nombreux documents sur ce sujet ».
M. Albert Lebleu, vice-président de l'association des anciens salariés de Metaleurop Nord, « Choeurs de fondeurs », s'est également montré sévère avec les CRAM, plus qu'avec l'INRS lui-même : « J'estime que le rôle de conseil de la CRAM a été insuffisant. Les ingénieurs-conseils dans le Nord-Pas-de-Calais, pendant toute cette période, par rapport à beaucoup de collègues que j'ai rencontrés dans les formations de sécurité, notamment à la CRAMIF, en Île-de-France, n'ont pas été très dynamiques. [...] L'INRS a donc fait beaucoup de choses et un très bon travail, mais j'estime que les ingénieurs-conseils de la CRAM ne l'ont pas suffisamment fait redescendre dans notre région Nord-Pas-de-Calais ». Il a tout de même ajouté, s'agissant de l'INRS : « Quand [les responsables de l'INRS] voyaient des choses alarmantes, toute la hiérarchie disait : « Attendez, il faut qu'on soit plus sûr », si bien que le temps passait et que des gens se décourageaient. Tout est à cette mesure ».
3. Le silence de la médecine du travail et de l'inspection du travail
La passivité de la médecine du travail et de l'inspection du travail face au drame de l'amiante a souvent été soulignée au cours des auditions et des déplacements de la mission. Ainsi, M. François Martin, président de l'ALDEVA de Condé-sur-Noireau, a estimé qu'« il est regrettable que la médecine du travail n'ait pas fait son travail de prévention à Condé-sur-Noireau. L'inspection du travail n'a pas été plus active ».
a) La médecine du travail
Les victimes, leurs associations de défense, mais aussi les représentants des organisations syndicales, ont sévèrement mis en cause la responsabilité de la médecine du travail dans le drame de l'amiante.
Ainsi M. Didier Payen, pour la CGT, a-t-il déclaré que « les médecins d'entreprise de l'amiante ont fait preuve d'une incroyable incompétence notoire. Ils avaient le devoir de veiller à la non-altération de la santé ; à aucun moment ils ne l'ont fait ». Selon les représentants de l'ARDEVA rencontrés à Dunkerque, les salariés travaillant au contact de l'amiante n'étaient, à l'époque, absolument pas informés des dangers de ce matériau ; certains ignoraient même qu'ils travaillaient au contact de l'amiante, y compris dans des établissements publics comme le Port autonome. Certains médecins du travail expliquaient même que l'amiante était sans danger ou que le risque pris n'était pas plus grand que le fait de fumer.
Les représentants de la CGT rencontrés à Dunkerque ont indiqué que les ouvriers de l'amiante, au cours de leur carrière, n'avaient jamais été avertis de la nocivité de ce matériau ni par la médecine du travail, ni par l'inspection du travail. On conseillait même, après usage, aux ouvriers de la sidérurgie, de secouer leur protection ignifugée contenant de l'amiante, ce qui avait pour conséquence de disperser les fibres. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 1990 que l'on a commencé à parler des risques sanitaires de l'amiante.
L'avis des médecins du travail rencontrés à l'occasion des déplacements de la mission est quelque peu différent. Ainsi, à Dunkerque, certains médecins du travail auraient observé des mésothéliomes dès 1966. Ils se sont alors intéressés à l'amiante-ciment ou à l'isolation, mais ont reconnu n'avoir jamais songé aux autres risques d'exposition, pour les dockers par exemple. Leur connaissance des pathologies liées à l'amiante a donc été progressive. Certains médecins du travail, confrontés à des cas de cancer du poumon dans la réparation navale, pour des opérations de carénage, au milieu des années 1980, n'avaient pas même émis l'hypothèse que l'amiante pouvait être la cause de la maladie. Mais, au milieu des années 1990, seul un pneumologue sur dix connaissait les risques de l'amiante.
En outre, selon ces médecins du travail, il était difficile, jusqu'au milieu des années 1980, de persuader les directions des entreprises et les CHSCT de prendre des précautions contre le risque amiante. Ainsi, à Usinor, à la fin des années 1970, la direction n'aurait pas pris en considération l'alerte donnée par le médecin du travail. En outre, le débat à l'époque portait sur la prime de risque : cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de débat sur l'existence d'un risque mais que celui-ci n'était pas abordé sous l'angle de la prévention mais sous celui de la réparation. De ce point de vue, on peut parler d'un échec de la prévention, voire d'un échec personnel pour les médecins du travail.
Il est vrai que le rôle de la médecine du travail a été ambivalent sur ce dossier. La mission rappellera à cet égard les « tribulations » de Mme Marianne Saux. Fonctionnaire à la direction des relations du travail, elle a été embauchée par la compagnie Saint-Gobain, en 1987, avant de revenir au ministère en 1991, où elle a dirigé la médecine du travail. Cette anecdote semble illustrer une certaine proximité, à l'époque, entre le ministère du travail et les industriels de l'amiante. Précisons que M. Claude Imauven, au cours de son audition, a affirmé que « Mme Saux n'a jamais travaillé sur l'amiante à Saint-Gobain ». Sur ce point, M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail, a noté, qu'« à l'époque, les questions de déontologie des fonctionnaires n'étaient pas aussi importantes qu'actuellement. Une telle situation serait désormais inenvisageable ».
Au cours de son audition, le docteur Ellen Imbernon a estimé que « les médecins du travail n'ont pas suffisamment alerté les autorités sur ce problème », ajoutant cependant que « ceux qui se sont risqués à le faire ont rencontré de graves difficultés » et relatant à l'appui de son affirmation son cas personnel : « La mise sur la place publique de certaines questions qui concernent la santé publique en relation avec le travail, dont l'exposition à l'amiante, a profondément déplu à une entreprise à laquelle j'ai appartenu », EDF, qui, à l'époque, était une entreprise publique.
Cette anecdote pose la question du statut du médecin du travail , qui est un salarié de l'entreprise dans laquelle il exerce. Il n'est donc pas indépendant par rapport à son employeur.
M. François Martin a lui aussi illustré ce problème, dans le cas de Condé-sur-Noireau : « Le médecin du travail de l'usine aurait dû informer l'employeur des dangers de l'amiante, dangers qu'il connaissait parfaitement puisqu'il avait participé à des réunions et congrès sur la question. Mais ce médecin était en poste sur le site et salarié par l'entreprise. Dans ces conditions, il lui a sans doute paru difficile d'aller à l'encontre de celui qui était aussi son employeur ».
Il a ajouté : « La médecine du travail a une responsabilité indéniable. Elle a l'obligation d'informer impérativement l'employeur et les salariés dès lors que ces derniers courent un danger. [...] La médecine du travail aurait dû intervenir au plus haut niveau en liaison avec les services de prévention de la direction départementale du travail et les CRAM » et a indiqué que « le médecin du travail de Condé-sur-Noireau a participé au comité permanent amiante ».
M. Jacques Barrot a d'ailleurs estimé qu'il n'était pas possible de « lier les problèmes passés de la prévention des risques liés à l'amiante en France à un manque d'indépendance des médecins du travail qui les aurait empêché de jouer convenablement leur rôle d'alerte. Même en l'état du statut antérieur de la médecine du travail, un médecin du travail attaché à ses missions, compétent et volontaire était en mesure de mener une action déterminée et efficace si lui-même avait conscience d'un risque important ».
M. Marcel Royez a noté que « peu de médecins du travail [...] se préoccupent des conditions dans lesquelles travaillent réellement les salariés. Les médecins du travail sont présents sur le respect de la réglementation mais sont absents sur les conditions d'hygiène et de sécurité. [...] Il existe donc un ensemble de dysfonctionnements qui tiennent à un manque de moyens, mais aussi d'une approche culturelle de la santé au travail dans l'entreprise ».
En outre, les médecins du travail sont souvent isolés et pâtissent de ne pas avoir d'interlocuteur public.
Ainsi, le docteur Ellen Imbernon a estimé que « rien n'est organisé dans le champ de la médecine du travail en faveur de la santé publique. Comme vous le savez, il existe un corps d'inspecteurs de la médecine du travail qui est constitué d'environ cinquante médecins. Ils disposent de réels pouvoirs régaliens et accordent aux services médicaux du travail des agréments. Ils sont cependant tous des contractuels. Ils ne sont pas des fonctionnaires et sont moins bien payés lorsqu'ils sont des contractuels du ministère ou des directions régionales du travail. Jusqu'à maintenant, aucun effort significatif n'a donc été accompli en ce domaine ».
Pour le docteur Gilles Brucker, « la situation de la médecine du travail en France, déconnectée de la santé publique et du ministère de la santé car placée sous la tutelle des ministères du travail et de l'environnement, soulève un certain nombre d'interrogations ». Il a estimé que « nous n'avions pas encore les moyens de mettre en place des réseaux de médecins du travail : en effet, les médecins du travail sont isolés et enfermés dans une logique d'aptitude à l'emploi, qui diffère d'une vraie logique de santé. Le développement d'un réseau de médecins du travail est donc un objectif prioritaire. Dans ce cadre, il convient de réfléchir à la définition d'une organisation cohérente avec les branches ou secteurs d'activités ».
b) L'inspection du travail
D'après M. Jean-Luc Pasquier, l'inspection du travail a été destinataire d'informations sur les effets de l'amiante sur la santé.
Ainsi, il avait rédigé, en 1981, un article dans la revue Échange Travail , destinée à l'inspection du travail. Dans celui-ci, il décrivait très précisément les risques de l'amiante en citant les infections qui étaient à redouter : l'asbestose, le cancer broncho-pulmonaire, le mésothéliome, etc. Dans ce même article, intitulé Protection des travailleurs contre les risques dus à l'amiante , il faisait le bilan de la campagne de mesures diligentée par la direction des relations du travail en liaison avec l'inspection du travail. Celle-ci avait permis de recenser environ 200 entreprises fabriquant ou utilisant de l'amiante comme produit de base. Cette première campagne avait conduit le ministère à s'interroger sur l'application de la réglementation dans les sociétés de maintenance. C'est pourquoi, dès 1983, la direction des relations du travail a établi une circulaire à l'inspection du travail demandant de relancer la campagne et de prêter une attention particulière à ce secteur, et, de manière plus générale, à tous les intervenants pouvant être exposés à l'amiante sans nécessairement l'utiliser comme matière première.
Par ailleurs, l'insuffisance des moyens de l'inspection du travail , à commencer par le trop faible nombre des inspecteurs eux-mêmes, est souvent dénoncée .
M. Michel Parigot, vice-président de l'ANDEVA et président du comité anti-amiante de Jussieu, a également souligné l'insuffisance de leurs compétences et de leur formation dans un dossier aussi complexe que l'amiante. Il a estimé que les inspecteurs du travail gagneraient à voir leur spécialisation renforcée.
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, au cours de son audition, a d'ailleurs estimé que, si l'inspection du travail, en France, doit conserver son caractère généraliste, « il est indispensable de recourir aux compétences de spécialistes ».
Dans leur rapport d'octobre 1997, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, nos collègues Henri Revol et Jean-Yves Le Déaut, notaient que, s'agissant d'une usine de la compagnie Saint-Gobain, « la recherche effectuée auprès du ministère des affaires sociales pour déterminer le nombre de rapports de l'inspection du travail entre les années 1975 et 1995 a été totalement négative : aucun rapport n'a pu être retrouvé entre ces deux dates ! » 24 ( * ) .
Cette observation est corroborée par les propos de M. Denis Hugelmann, directeur de l'entreprise Sollac-Atlantique à Dunkerque, que la délégation de la mission a rencontré dans cette ville. Il a en effet indiqué que l'inspection du travail n'avait envoyé à l'usine de Dunkerque aucun courrier relatif à l'amiante avant 1996.
Le professeur Got a d'ailleurs illustré cette indifférence de l'inspection du travail, comme celle de la médecine du travail, par un exemple concret : « La moitié des ouvriers qui ont fait des flocages à La Défense, à Jussieu, sont morts ; lorsque je les ai rencontrés, ils m'ont dit : « On ne voyait jamais personne venir sur notre chantier voir ce qui se passait. On ne voyait jamais un médecin du travail, ni d'inspecteur du travail. On voyait un nuage qui était projeté par les machines qui nous servaient à floquer et, parfois, on ne voyait même pas celui qui travaillait à 3 ou 5 mètres de nous » » .
M. Albert Lebleu a fait le même constat : « Nous ne voyions pas souvent les inspecteurs du travail. Je me souviens d'une période où j'étais ingénieur sécurité. Le CHSCT fonctionnait de façon assez correcte, mais nous n'avons vu l'inspecteur du travail qu'une fois en deux ans parce que le poste n'était pas pourvu et que l'inspecteur d'Arras qui était chargé de Lens devait assurer le chantier de l'échangeur entre l'A1 et l'A21, où il y a eu des accidents graves. L'inspecteur du travail faisait confiance au CHSCT ».
En réalité, l'inspection du travail n'a pas fait une priorité de la lutte contre les effets de l'amiante.
4. Des syndicats écartelés entre des objectifs contradictoires ?
Les syndicats de salariés n'ont pas toujours, eux non plus, accordé l'importance qu'aurait méritée le dossier de l'amiante.
A l'époque, en effet, les questions de santé et de sécurité au travail n'avaient pas la même importance qu'aujourd'hui, la priorité étant accordée à l'emploi et aux salaires.
Ainsi, M. François Malye a rappelé, devant la mission, qu'« à l'époque, les salariés concernés avaient besoin d'être rassurés. Leur emploi était en jeu. Il est difficile de s'entendre dire que sa vie est menacée par l'amiante. Certains ont du reste préféré bénéficier de primes plutôt que de perdre leur travail ».
M. Serge Dufour, pour la CGT, a également expliqué que la question de la responsabilité des organisations syndicales, qui participaient également aux réunions du CPA, devait être replacée dans un contexte de « chantage à l'emploi », qu'il a illustré avec l'anecdote suivante : « Mes camarades de Paray-le-Monial m'ont expliqué qu'en 1977, l'employeur leur a dit : « Vous avez raison, [l'amiante] est toxique, mais je vous donne le choix : on réunit le CE, les DP et le CHSCT et on délibère soit sur la décision de continuer à utiliser cette fibre, soit sur la décision d'en arrêter l'utilisation, auquel cas on ferme la boîte ! ».
De surcroît, les priorités des entreprises en termes de sécurité au travail ont évolué dans le temps.
M. Albert Lebleu a ainsi indiqué que, « pour les acteurs du CHSCT, le plomb était prioritaire sur l'amiante, dont on considérait que l'on pouvait s'en occuper plus tard et qu'il n'y avait pas d'urgence alors qu'avec le plomb, on risquait de ne plus pouvoir travailler et de s'abîmer la santé à court terme. C'était le grand cheval de bataille de l'inspection du travail ».
M. Jean-Claude Muller, directeur santé-sécurité de l'entreprise Arcelor, rencontré à Dunkerque, a lui rappelé que la sidérurgie était confrontée à l'époque à un grave problème de sécurité au travail lié aux brûlures. Son premier souci était alors de trouver une solution, la prise de conscience collective des risques de l'amiante ayant été beaucoup plus tardive. L'analyse des risques devrait être replacée dans le contexte de l'époque, le principal risque alors perçu étant la brûlure et le feu.
Ces propos ont d'ailleurs été confirmés par les représentants des employeurs. Comme l'a rappelé M. Bernard Caron, directeur de la protection sociale au MEDEF, l'amiante « répondait à une demande » et était « utilisé comme un élément de protection très important contre l'incendie et que ce matériau a eu une efficacité reconnue en termes de protection recherchée. Dans les priorités de l'époque, la protection contre l'incendie était un souci grave », citant le drame du lycée Pailleron.
Les travailleurs de l'amiante eux-mêmes n'ont pas toujours eu un comportement irréprochable face au risque , comme l'a rappelé M. Albert Lebleu : « quand on a 20 ans dans les années 1970, tout va bien. [L'amiante] est un matériau sauveur qui nous protège face à la chaleur et on a tendance à dire : « Ne venez pas nous emmerder, ça nous protège ! Mourir, on a le temps de voir dans 30 ou 40 ans !... » Vous savez combien il est difficile de changer les habitudes ».
D'autant plus difficile que l'amiante a parfois assuré la prospérité et l'emploi d'une région, comme ce fut le cas pour la mine de Canari. Ainsi, les anciens mineurs rencontrés par une délégation de la mission lors de son déplacement en Corse, s'ils ont évoqué les difficiles conditions de travail qu'ils ont connues pendant toute la durée d'exploitation de la mine, jusqu'en 1965, et souligné l'absence de mesure de prévention et d'information sur les dangers de l'amiante, dont ils ont affirmé que leur employeur avait pourtant pleinement conscience à l'époque 25 ( * ) , ont insisté sur la prospérité économique que l'exploitation de l'amiante, qui faisait vivre directement 300 personnes, sans compter les emplois induits, avait apportée au village et à sa région.
Plus généralement, le drame de l'amiante illustre aussi les limites, voire les contradictions de la gestion paritaire des dossiers de sécurité au travail , ainsi que l'a relevé M. Marcel Royez : « Il n'est pas possible d'être juge et partie. L'affaire de l'amiante l'illustre parfaitement. D'un côté, des industriels défendaient l'idée qu'il était possible de faire un usage contrôlé de l'amiante. [...] De l'autre côté, des organisations syndicales se pliaient à ce type de compromis pour défendre l'emploi. Il n'est pas possible de placer les travailleurs devant le dilemme du choix entre le cercueil et l'ANPE, c'est-à-dire travailler en risquant de mourir ou le chômage ».
II. L'ÉTAT « ANESTHÉSIÉ » PAR LE LOBBY DE L'AMIANTE
Pour M. François Malye, journaliste et auteur de Amiante : 100.000 morts à venir , la façon dont les différents ministères ont géré le dossier de l'amiante, « préférant le déléguer de fait à une structure de communication plutôt que de s'en emparer au travers de comités interministériels », est particulièrement critiquable.
De fait, si l'État s'est déchargé de sa responsabilité, le comité permanent amiante (CPA) s'est progressivement attribué le monopole de l'expertise sur ce dossier.
A. LE CPA : UN LOBBY REMARQUABLEMENT EFFICACE
M. François Malye évoque, à propos du comité permanent amiante, « une formidable mécanique reposant sur le mensonge et la dissimulation ». Assurément, son action était d'autant plus habile que, réunissant quasiment tous les acteurs du secteur de l'amiante, industriels, ministères, scientifiques, organisations syndicales de salariés et d'employeurs, il a créé l'illusion du dialogue social .
Devant la mission, M. Dominique Moyen, ancien directeur général de l'INRS et « père » du CPA, a indiqué être « profondément blessé que l'on prétende que [il ait] pu faciliter la vie aux industriels de quelque manière que ce soit ».
Pour la mission, il est cependant indéniable que le CPA a joué un rôle particulièrement ambigu dans cette affaire et qui ne saurait être réduit à celui d'un simple promoteur de la prévention en matière de sécurité au travail , comme l'a peut-être un peu trop rapidement affirmé M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, pour qui « le CPA a contribué à l'information et à la mise en oeuvre de mesures concrètes dont l'élaboration de brochures sur le diagnostic et sur le traitement des flocages à base d'amiante entre 1985 et 1990 ».
Il a au contraire entretenu la confusion « entre le travail scientifique d'évaluation des risques liés à des substances, le travail épidémiologique de mesure des expositions et des impacts sur la santé et le travail réglementaire et administratif de conception des textes et de contrôle de leur mise en oeuvre », dénoncée par M. Jacques Barrot, ancien ministre du travail et des affaires sociales.
Dans un ouvrage paru en 1999, intitulé Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque 26 ( * ) , MM. Francis Chateauraynaud et Didier Torny, sociologues et chercheurs à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), écrivent que « l'existence du CPA permet de continuer la transformation et l'usage de l'amiante en convoquant les différents intérêts en présence : ceux des producteurs, ceux des salariés qui sauvent leurs emplois et ceux des médecins ou des représentants de l'État qui peuvent exercer un contrôle normatif sur l'usage d'un produit tout en développant des programmes d'études et de recherches sur un certain nombre de maladies ».
Ils notent également : « On peut aussi faire l'hypothèse que tous les acteurs ne « voyaient » pas la même chose dans le fonctionnement du CPA ». Des divergences d'interprétation demeurent d'ailleurs, encore aujourd'hui, sur le rôle exact qu'a joué le CPA.
1. La mission initiale du CPA : des divergences d'interprétation
Sur la base des comptes rendus de ses travaux, disponibles sur Internet à l'initiative du professeur Claude Got, le comité permanent amiante, dans ses différentes formations - réunion plénière et groupes de travail - s'est réuni 98 fois entre le 20 septembre 1982 et le 25 septembre 1995. Au cours de cette dernière réunion, en effet, les représentants des différents ministères ainsi que ceux des organisations syndicales ont indiqué qu'ils ne siègeraient plus au sein du CPA.
Lors de son audition, le professeur Claude Got a rappelé le rôle et les circonstances de la création du CPA, en 1982 : « C'était un organisme informel ; le comité permanent amiante est une création de M. Moyen, directeur de l'INRS de l'époque, après un congrès sur l'amiante qui avait eu lieu à Montréal. Le lobby de l'amiante assurait qu'il s'agissait d'un produit merveilleux, mais qu'il valait mieux le gérer pour en réduire le risque. M. Moyen avait dit aux industriels et à quelques médecins : « Il faudrait que l'on ait une structure informelle où tous les gens qui ont à débattre du problème de l'amiante se réunissent périodiquement, fassent le point et améliorent la gestion de l'amiante ». Ils se sont mis d'accord et on a retrouvé autour de cette table les industriels, les ministères du travail et de la santé, les syndicats, sauf FO. [...] On demandait à l'INRS de voter des crédits pour participer à des congrès, pour faire fonctionner le CPA et surtout pour payer des frais de déplacement. En effet, le comité permanent amiante - et c'est déjà en soi une anomalie - était hébergé dans des locaux d'une société de communication payée par les industriels de l'amiante ! ».
Cette société de communication, qui existe toujours, s'appelle Communications économiques et sociales, dont les bureaux se trouvaient rue de Messine, dans le VIII e arrondissement de Paris. Elle était alors dirigée par Marcel Valtat, décédé depuis.
A l'origine, la création du CPA aurait été motivée par un souci de prévention des maladies professionnelles provoquées par cette fibre.
M. Dominique Moyen a relaté sa version des circonstances de la création du CPA : « En 1982, j'ai présidé une réunion organisée par le ministère du travail, qui réunissait des représentants patronaux et syndicaux du secteur de l'amiante. Je me souviens avoir conclu en regrettant que ce colloque [celui de Montréal] se termine car il constituait une belle occasion de se parler, de progresser techniquement et de dissiper les malentendus et idées reçues. [...] J'avais donc jugé pertinent de mettre en place une organisation qui nous permette de nous retrouver et de débattre sans engager les uns et les autres, afin de faire progresser la situation ». Selon lui, « le CPA n'a pas été un lieu où se manifestait la pression des industriels ».
M. Philippe Huré, responsable du département risques chimiques et biologiques à l'INRS, rappelant qu'« en 1982, les experts commençaient à prendre conscience que la valeur limite d'exposition professionnelle n'était pas une protection infaillible contre le risque de cancer », a noté que « Dominique Moyen a eu l'idée de rassembler les parties prenantes autour de l'INRS et d'animer une discussion. Il souhaitait impliquer les pouvoirs publics, les organisations syndicales, les industriels spécialisés dans la fabrication d'amiante et les scientifiques sur les thèmes des risques et de la situation française. C'est ce qui a donné naissance au CPA. Dominique Moyen, je puis en témoigner, poursuivait, à travers la constitution de cet organisme, un véritable objectif de prévention ». Ainsi, selon lui, l'objectif prioritaire du CPA était de veiller à la bonne application de la réglementation de 1977, en vertu de laquelle les industriels devaient effectuer des contrôles dans leurs entreprises de manière à repérer les zones d'empoussièrement et les valeurs atteintes en comparaison des valeurs limites.
La Compagnie Saint-Gobain continue d'ailleurs de défendre cette position. Ainsi M. Claude Imauven a-t-il indiqué qu'« il y avait autour de la table [du CPA] les personnes ad hoc pour apporter cette information ». C'est sans doute pour cette raison que le CPA « devait être le lieu où le groupe [Saint-Gobain] devait se tenir informé de l'évolution de la connaissance médicale sur le sujet ».
On notera que M. Claude Imauven s'exprime avec prudence sur le CPA, comme s'il parlait d'une structure qu'il ne connaissait pas autrement qu'à travers ce qu'il en avait lu ou entendu dire : « Je pense que le CPA n'avait pas d'existence juridique particulière qui lui donne une autorité pour fixer quoi que ce soit, mais je pense que c'était un lieu de dialogue. Si j'ai bien compris, il y avait autour de la table les professionnels, les représentants des ministères et autres syndicats ». Il a toutefois oublié de préciser que, d'après les comptes rendus des réunions du CPA, il avait rencontré une délégation de ce dernier, composée notamment du Pr Brochard et de Marcel Valtat, alors qu'il était chef du service des matières premières et du sous-sol au ministère de l'industrie, le 1 er mars 1991. Il devait donc bien connaître le rôle - et les revendications - du CPA !
|
La véritable mission du CPA : « ne réveillez pas le chat endormi » Au lendemain de la conférence internationale des organisations d'information sur l'amiante, qui s'est tenue à Londres les 24 et 25 novembre 1971, le président britannique de la conférence rédigeait un commentaire final 27 ( * ) dans lequel il exprimait son propre point de vue. Il est d'abord rappelé que la conférence s'est déroulée « à un moment critique de l'histoire de l'industrie de l'amiante. En Amérique du Nord, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays européens de graves attaques contre l'amiante et ses utilisations sont relayées par la presse, la radio et la télévision ». Ce document mentionne notamment les points suivants : - « en écoutant parler des problèmes auxquels se confronte de plus en plus l'industrie de l'amiante [...] , j'ai l'impression que les pressions vont s'accroître à plus ou moins long terme dans tous les domaines. Et à mon avis, cela risque de se produire bientôt. Je ne peux donc que vous inviter très sérieusement à vous préparer dès maintenant à faire face à une plus grande intervention des autorités publiques et à des attaques de plus en plus violentes » ; - « en ce qui concerne les réglementations gouvernementales à venir, il me semble tout à fait souhaitable que vous cherchiez à participer à leur élaboration à travers vos organisations. [...] sans le Conseil [de recherche sur l'asbestose] , qui a été créé de toutes pièces par l'industrie de l'amiante, les réglementations britanniques auraient été bien plus draconiennes » ; - « je vous invite tous à préparer votre défense dès maintenant. [...] avez-vous un comité d'action disposant des fonds nécessaires, mais aussi d'une expertise technique et médicale ? [...] êtes-vous en contact avec des consultants en relations publiques capables de vous donner de bons conseils ? » ; - « la maxime « ne réveillez pas le chat endormi » est tout à fait appropriée lorsque les choses vont lentement et que l'intérêt du public et de la presse reste faible. Mais les chats endormis peuvent se réveiller brutalement, faire entendre leur voix et montrer leurs griffes. [...] Vous devez vous préparer à l'avance ». Onze ans avant sa création, tous les ingrédients du CPA étaient réunis. |
Le CPA a su convaincre certains scientifiques de se joindre à ses travaux et, ce faisant, de lui fournir une caution scientifique incontestable.
Le professeur Patrick Brochard, aujourd'hui chef du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle au CHU de Bordeaux et professeur des universités en épidémiologie, économie de la santé et prévention à l'université Bordeaux II, présente ainsi sa participation aux réunions du CPA et y limite son rôle à celui d'expert : « J'ai rejoint le comité amiante relativement jeune, puisque j'étais alors chef de clinique. Mon responsable, le professeur Bignon 28 ( * ) , m'avait demandé d'y participer de manière informelle. Il nous avait été demandé de fournir des informations sur l'état des connaissances relatives au dossier amiante, de 1988 à 1995. De nombreux scientifiques participaient à ce comité. J'y appartenais au titre de la médecine du travail. Le Professeur Valleron y siégeait par exemple en qualité d'épidémiologiste. Notre rôle était de donner des informations sur l'état des connaissances ainsi que sur les nombreux congrès qui se succédaient sur le sujet. Bien entendu, nous n'intervenions que sur la partie médicale du dossier ».
Il ajoute : « Notre rôle était de déterminer des valeurs limites d'exposition permettant de continuer à utiliser ce matériau en limitant les risques, dans l'attente d'une éventuelle interdiction gouvernementale. [...] Notre intervention au sein du comité amiante n'avait donc pas pour objet de prononcer une interdiction de l'amiante. Elle était destinée à assurer la protection de la population dans les conditions prévues par la réglementation française de 1977. Progressivement, cette dernière a évolué ».
En présentant de façon aussi anodine le rôle des scientifiques qui siégeaient au CPA, le professeur Patrick Brochard a d'abord paru donner du crédit à la politique de l'usage contrôlé de l'amiante, défendue à l'époque par les industriels, comme s'il continuait de croire au bien-fondé de cette approche.
En revanche, certains acteurs de l'époque, qui ont participé aux réunions du CPA, continuent de défendre le bien-fondé de celui-ci. Ainsi, M. Daniel Bouige a estimé que « l'existence du CPA était, à [son] sens, tout à fait utile et répondait à une nécessité » et que « le CPA était une idée bonne et motrice dans une perspective de prévention ». Il s'agissait de réduire le risque à défaut de pouvoir le supprimer.
2. Le CPA a su profiter des carences des pouvoirs publics
Le drame de l'amiante démontre qu'en l'absence de décisions des pouvoirs publics, une structure de lobbying, certes particulièrement efficace, a réussi à se voir quasiment déléguer le dossier de l'amiante par le ministère.
Ainsi, MM. Francis Chateauraynaud et Didier Torny, dans leur ouvrage précité, notent que « le travail de mise en forme opéré pendant près de dix ans par le CPA a porté ses fruits. On en veut pour preuve la façon dont le gouvernement reprend à son compte, mot pour mot, les argumentaires développés par le Comité ».
M. Jean Paoli, représentant de Force ouvrière à la table ronde des organisations syndicales organisée par la mission, a d'ailleurs résumé la situation de la façon suivante : « Pourquoi le comité permanent amiante a-t-il existé ? Parce qu'il n'y avait rien à l'époque et que l'INRS ne faisait pas son travail, pas plus que la DRT, la DGS et la sécurité sociale ».
Au cours de son audition, M. Jean-Luc Pasquier, ancien chef du bureau CT 4 chargé, au sein de la direction des relations du travail, de la réglementation de l'hygiène en milieu de travail, et donc également de la réglementation des produits dangereux, a estimé que, s'agissant de l'amiante, « au vu des résultats connus aujourd'hui, on ne peut pas ne pas s'interroger sur sa propre action ».
De ce point de vue, en effet, l'État , même s'il n'en porte pas seul la responsabilité, a failli à sa mission de sécurité au travail . Le ministère du travail n'a pas su analyser la portée du risque amiante ni anticiper ses conséquences.
Le bilan du ministère de la santé est tout aussi négatif. Défini par le professeur Claude Got comme « un organisme informel de gestion d'un risque que l'on ne ferait jamais plus à l'identique maintenant », le CPA était « inadapté au rôle qu'il a joué en pratique ». Pour le professeur Got, il s'est substitué à la direction générale de la santé, « qui n'en avait pas les moyens à l'époque : à la DGS, personne n'avait en charge le problème de l'amiante », ce qui ne laisse pas d'étonner quand on considère les nombreuses publications sur les risques de l'amiante sur la santé !
Les pouvoirs publics, qui avaient en charge la sécurité sanitaire, n'ont pas été capables de mettre en place, à cette époque, des organismes qui auraient pu améliorer la gestion.
Par ailleurs, le retard accumulé en matière de connaissance de la toxicité de l'amiante tient aussi, selon le professeur Marcel Goldberg, à la séparation très nette qui prévalait en France entre l'administration du travail et celle de la santé : « Comme vous le savez, les risques professionnels étaient historiquement traités au sein du ministère chargé du travail alors que le ministère de la santé était chargé des problèmes de santé. Il existait pourtant un petit bureau au sein de la direction des relations du travail au ministère du travail qui était en charge de ces questions. Ce bureau microscopique était noyé au milieu d'une administration dont les préoccupations étaient éloignées de la santé. Symétriquement, la direction générale de la santé, dont la mission en matière de santé publique était primordiale, ne disposait d'aucun service qui était dédié aux problèmes de santé au travail. Cette situation a contribué de manière significative au retard qui a été pris ».
Le professeur Patrick Brochard a fait le même constat : « A l'époque de sa création [celle du CPA] , aucune agence indépendante ne permettait la réunion des compétences permettant d'éclairer les décisions de l'État. La solution choisie à l'époque, innovante, s'est avérée négative a posteriori ».
M. Daniel Bouige a parfaitement résumé la situation : pour lui, la création du CPA « correspondait au souci de remplir un vide ».
Il n'en demeure pas moins que le CPA avait beaucoup plus de pouvoirs que certains, à commencer par ses anciens membres, voudraient le laisser croire.
Ici encore, les déclarations de M. Daniel Bouige devant la mission sont importantes pour apprécier la réalité de l'influence du CPA, présenté comme un interlocuteur incontournable de l'administration : « Les structures administratives qui existaient à l'époque n'avaient pas la capacité de traiter un problème aussi complexe que [l'amiante] , avec le lourd passif et les diverses incertitudes qu'il comportait. [...] Il était nécessaire de rendre compte de l'action menée aux partenaires sociaux et aux représentants de l'administration. Telle était la raison d'être du comité ». Il s'agit là, indéniablement, d'une mission importante qui semble dépasser le cadre de la simple structure « informelle » souvent présentée.
D'ailleurs, le 14 septembre 1992, dans une réponse à une question écrite 29 ( * ) de notre collègue François-Michel Gonnot, député de l'Oise, adressée au ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le gouvernement « peut donner en exemple le travail accompli [...] au sein du CPA » en faveur de « la politique de la France vis-à-vis de l'amiante [qui] est celle de l'utilisation contrôlée de cette fibre par la suppression des causes qui ont rendu son emploi dangereux dans le passé » et qui « n'a pas lieu d'être modifiée ». Il paraît difficile de dénier le caractère référentiel d'un organisme « donné en exemple » à la représentation nationale par le gouvernement !
Au cours de son audition, M. Jean-Luc Pasquier a pourtant fermement démenti cette interprétation : « Pour le ministère du travail, le CPA n'a jamais représenté une structure jouissant d'un quelconque mandat. [...] Cette structure était informelle. Lors de sa création, en 1982, il ne nous apparaissait pas anormal de conseiller une entité de cette nature qui représentait l'ensemble des syndicats ouvriers, à l'exception de Force ouvrière, l'ensemble des experts recensés à l'époque et d'autres administrations comme, en particulier, le ministère de la santé et le ministère de l'environnement. En effet, notre objectif consistait à faire entrer dans les entreprises les prescriptions du décret d'août 1977. Or, le CPA avait pour but de rédiger, à l'intention du personnel d'encadrement, des industriels et des salariés, des notices explicitant les dangers de l'amiante et les moyens de s'en prémunir sur le lieu de travail. Le CPA constituait bien un groupe de travail qui n'avait aucune vocation à légiférer ou réglementer, mais qui travaillait sur la promotion et la diffusion de dispositions à caractère réglementaire et de données générales sur l'amiante. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, la politique du ministère du travail n'a jamais été élaborée au comité permanent amiante. Celui-ci n'a jamais joui d'un quelconque statut officiel et toutes les mesures que nous avons été conduits à prendre étaient présentées aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Aucun des « représentants » du CPA n'a jamais été invité à siéger dans les instances officielles du ministère du travail. Pour celui-ci, il constituait bien un groupe de travail, créé à l'initiative de l'INRS, dans lequel tous les acteurs qui avaient quelque chose à dire sur le dossier étaient présents ». Ainsi la direction des relations du travail considérait-elle le CPA, qui « ne revêtait pas d'enjeu particulier », comme « un épiphénomène ».
M. Jean-Luc Pasquier accordait si peu d'importance au CPA que ses supérieurs hiérarchiques ne savaient peut-être même pas, selon lui, que leur direction était représentée aux réunions du CPA.
Sa démonstration est apparue quelque peu fragile. Ainsi, si « aucun directeur ou sous-directeur, pas plus Martine Aubry que ses successeurs, ne [lui] a jamais donné d'instruction de modération lorsqu'il s'agissait de prendre des mesures de prévention » et si le CPA « représentait un outil parmi d'autres pour faire progresser la prévention dans les entreprises », alors pourquoi M. Jean-Luc Pasquier ne rendait-il pas compte à sa directrice des travaux du CPA et des échanges en son sein auxquels il assistait, d'autant plus que, « dès le début des années 1980, lorsqu'elle a pris la responsabilité de la direction des relations du travail, Martine Aubry nous a donné pour instruction de nous intéresser de très près aux cancérogènes professionnels » ?
Mme Martine Aubry, lors de son audition, a conforté les propos de M. Jean-Luc Pasquier. Elle a en effet indiqué à la mission qu'elle avait « découvert le CPA dans le rapport de Claude Got » et expliqué que « le ministère du travail participe à entre 200 et 400 groupes de travail, selon les périodes, sur tous les sujets concernant l'hygiène et la sécurité ». Elle a également affirmé que « le CPA n'a jamais joué un rôle important, ni même aucun rôle, si je puis dire, dans la façon dont les textes ont été élaborés ». Il paraît en effet évident à la mission que l'influence du CPA n'était pas aussi directe.
M. Jacques Barrot a lui aussi indiqué qu'il avait « surtout entendu parler [du CPA] à La marche du siècle ».
Interrogé sur la connaissance de l'existence du CPA par les directeurs des relations du travail ou les ministres, M. Jean-Denis Combrexelle, actuel titulaire de la fonction, a estimé, sans grande surprise pour la mission, que « ce comité était à l'époque une des nombreuses instances officieuses s'intéressant à la question. A l'évidence, il ne s'agissait pas d'un organisme officiel dont les membres du ministère avaient connaissance. Le CPA faisait partie d'un groupe d'instances dans lesquelles travaillaient des fonctionnaires mais l'attention ne se focalisait pas exclusivement sur lui ».
On rappellera toutefois que l'action de lobbying du CPA prenait parfois la forme d'envoi de courriers adressés à des ministres eux-mêmes, voire au Premier ministre 30 ( * ) . Comment dès lors auraient-ils pu ne pas être au courant de son existence ?
3. Le CPA a su exploiter les « incertitudes scientifiques » : le mythe de « l'usage contrôlé » de l'amiante
Déjà, en 1977, le professeur Jean Bignon, dans sa lettre au Premier ministre du 5 avril, notait que l'industrie de l'amiante, en diffusant son livre blanc, « cherche à semer le doute dans l'esprit des médecins et scientifiques non informés de tous les aspects techniques de ce problème et à influencer les pouvoirs publics ». Cinq ans plus tard, en 1982, la création du CPA permettra d'atteindre cet objectif.
En exploitant les incertitudes scientifiques, au demeurant de moins en moins nombreuses au fil du temps, le CPA a réussi à insinuer le doute sur l'importance du risque de l'exposition à l'amiante et ainsi à retarder au maximum l'interdiction de l'usage de l'amiante en France. Ses membres ont habilement soutenu la politique de « l'usage contrôlé » de l'amiante 31 ( * ) .
Devant la mission, M. Jean Paoli, représentant de Force ouvrière, a estimé que, à ses yeux, « le principal crime qui a été commis par le CPA, c'est l'affirmation qu'on pouvait contrôler l'usage de l'amiante, c'est-à-dire l'utilisation du chrysotile ».
L'usage contrôlé représente certes un principe couramment appliqué aux produits et substances dangereux : « « L'usage contrôlé » constitue le lot commun de la plupart des cancérogènes professionnels. Nous sommes face à des produits que nous savons dangereux et pour lesquels nous estimons que l'utilisation ne peut se faire que dans des conditions extrêmement restrictives » a déclaré M. Jean-Luc Pasquier devant la mission.
Deux principales raisons fondent le recours à « l'usage contrôlé ». D'une part, il vaut mieux utiliser un produit avec des restrictions fortes que de remplacer celui-ci par une autre substance dont les dangers ne seront pas connus avant un long délai de latence. D'autre part, les interdictions de produit démobilisent souvent les services de contrôle. Ceux-ci s'intéressent nettement moins aux substances interdites. « L'interdiction brute peut donc parfois s'avérer plus dangereuse qu'un usage contrôlé » a estimé M. Jean-Luc Pasquier.
La mission perçoit mal la portée d'une telle explication compte tenu de l'ampleur de la crise sanitaire causée par l'amiante. D'autant plus qu'à la conférence de Montréal, en 1982, une donnée médicale nouvelle avait été présentée : les valeurs limites édictées ne protègent pas du risque de cancer provoqué par l'amiante.
Or, c'est précisément au retour de cette conférence que les industriels français de l'amiante mettent en place le CPA.
Le professeur Patrick Brochard a parfaitement rappelé le contexte de l'époque : « A partir de 1977, il avait été établi que toutes les formes d'amiante étaient des agents cancérigènes. Dès lors, la France devait donc faire un choix : continuer à utiliser le matériau ou opter pour une autre voie ».
Le choix du CPA était clair : il fallait continuer à utiliser l'amiante et retarder le plus possible son interdiction. Les scientifiques siégeant au comité allaient l'y aider, sans être nécessairement informés de l'existence de matériaux de substitution : « A l'époque, il avait été dit [...] que l'industrie ne pouvait se passer de l'amiante, aucune solution de remplacement n'étant disponible. Aussi le comité se demandait-il s'il était possible de travailler avec de l'amiante tout en protégeant au maximum les populations exposées », précise le professeur Brochard.
M. Jacques Barrot a confirmé cette information : « Toute l'argumentation de ces milieux était de dire que, si on interdisait l'amiante, ils n'avaient pas de produits de substitution ». Il a même ajouté : « Je pense aussi que [le CPA] a répandu l'idée qu'il n'y avait pas de matériaux de substitution et qu'il a empêché la réflexion à ce sujet ».
|
La réaction du CPA ne s'est pas fait attendre. Il convient de citer le compte rendu de sa réunion du 26 mars 1986 : « Après avoir étudié le document publié par l'EPA, le GT [groupe de travail] scientifique a émis les conclusions suivantes : « - les auteurs de ce rapport n'ont pas de notoriété et ne semblent pas disposer de compétences spécifiques dans le domaine de l'amiante ; « - la bibliographie n'est pas exhaustive ; « - cette étude ne fournit aucune donnée nouvelle ; « - les données utilisées dans le programme n'ont pas été discutées. « La corrélation entre des mesures issues de modèles très différents ne peut mener qu'à des incertitudes. « De l'avis des scientifiques, ce document ne peut être considéré comme une étude reposant sur des données scientifiques indiscutables... C'est un rapport incomplet sur les connaissances actuelles des pathologies liées à l'amiante qui tire essentiellement sa valeur de son label « EPA ». « Compte tenu de la difficulté d'entreprendre une analyse approfondie de ce texte, le GT préconise de fonder l'analyse critique sur le caractère pseudo-scientifique d'un document utilisé à des fins politiques ». Au cours de sa réunion suivante, le 18 avril 1986, le CPA aborde de nouveau cette question et réfléchit à la manière de réagir à la proposition de l'EPA, dont « les conclusions sont tellement incertaines qu'on ne peut leur accorder de crédibilité ». Le CPA décide ainsi de rédiger une note d'orientation accompagnant le rapport du groupe de travail scientifique. Ces documents seront transmis aux ministres français de l'industrie, du travail, de la santé et de l'environnement, avec copie aux représentants de ces ministères au sein du CPA. « Ceux-ci veilleront à ce que le dossier suive bien la procédure officielle ». Ils seront également transmis à l'ambassadeur des Etats-Unis en France et à l'EPA, via l'ambassade de France à Washington. |
M. Claude Michel, ingénieur-conseil régional adjoint et responsable de la direction des services techniques de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a parfaitement résumé le rôle « scientifique » du CPA : « La difficulté que nous rencontrons est celle-ci : parfois les sommités scientifiques sont en désaccord. Les entreprises profitent de ces incertitudes pour nier l'existence de risques ».
Du reste, tirer parti des incertitudes scientifiques est aujourd'hui encore bien tentant , ainsi que la mission a pu s'en rendre compte au cours de la table ronde réunissant les organisations patronales.
Le docteur François Pelé, membre du groupe de travail sur l'amiante et responsable de la santé au travail au MEDEF, a continué d'entretenir le doute : « A partir de quel moment y a-t-il un risque ? C'est l'une des questions fondamentales. Vous verrez que je cite abondamment un livre sur l'amiante que vous connaissez sans doute très bien et qui a été écrit par les professeurs Brochard et Pairon. [...] ils disent par exemple, à partir d'extrapolations mathématiques, que l'on est maintenant à peu près sûr que l'amiante, à basse dose d'exposition, c'est-à-dire avec des doses environnementales, peut créer des mésothéliomes. Il reste à savoir combien. Cependant, pour ce qui est du cancer broncho-pulmonaire, ce n'est pas aussi sûr. Je vous invite donc à regarder cela de près ».
De même, une annexe technique remise à la mission par les trois organisations représentatives des employeurs conclut que « les considérations qui précèdent montrent également que les données scientifiques actuellement disponibles sur la toxicité de l'amiante sont loin de répondre à toutes les questions que l'on se pose et que, sur de nombreux points importants, le débat scientifique international est encore très ouvert ».
Quant à Me Philippe Plichon, l'avocat des employeurs dans les procès concernant l'amiante, il a indiqué que « seule une grande quantité de fibres d'amiante peut provoquer un cancer », ce qui est inexact.
4. L'évolution du CPA : une souplesse propice à la manipulation
M. Claude Imauven a estimé que « les moyens du CPA étaient vraiment bien petits pour exercer un quelconque lobby vis-à-vis de l'action publique ! ». Tout l'art du lobbyiste n'est-il pas précisément de se faire oublier et de faire croire que son avis est unanimement partagé ?
Le CPA, sans doute du fait de son caractère « informel », a démontré une grande capacité d'adaptation , que M. Philippe Huré a d'ailleurs reconnue implicitement : « Il est vrai que les discussions au sein du CPA ont été progressivement captées par les industriels. Je considère que cette évolution est survenue à la fin des années 1980 à un moment où le comité permanent amiante adressait un courrier au Premier ministre dans lequel il évoquait les risques que posaient les flocages qui avaient été réalisés dans de nombreux bâtiments. Le CPA a alors orienté les discussions sur le flocage. Cela n'a pas empêché les industriels de continuer à produire des matériaux en amiante. En agissant ainsi, le CPA avait le sentiment d'oeuvrer pour une bonne cause, celle de la lutte contre le flocage, même si la production et la mise sur le marché de multiples produits à base d'amiante-ciment ne cessaient pas ».
M. Daniel Moyen, initiateur du CPA, a fait la même analyse : « A un moment, effectivement, compte tenu de l'avancement des progrès réglementaires et des connaissances dans le domaine de l'amiante, le débat est devenu moins intense. A ce moment, à mon avis, le CPA avait rempli son rôle. Ensuite, les participants ont commencé à s'intéresser à la prévention des risques dus aux flocages existants ». Le CPA aurait-il échappé à ses créateurs ?
Pour le professeur Got, le CPA « a été un piège » : « Les médecins qui y participaient [...] n'étaient pas au courant des alternatives possibles et du fait que certains pays commençaient à mettre de la cellulose, des fibres synthétiques pour armer le ciment et remplacer les revêtements qui ont revêtu tous les hangars dans le monde agricole français, tous les poulaillers et tous les tubes collecteurs d'eaux usées. Le comité permanent amiante a été manipulé par une industrie dont l'intérêt était de poursuivre l'usage d'un produit bon marché, dans une logique de production économiquement intéressante ».
Le professeur Patrick Brochard a lui-même reconnu avoir été manipulé et a estimé que le CPA « n'aurait jamais dû exister » : « Le principe retenu lors de la création de ce comité était novateur et valable. Néanmoins, la direction de ce comité et sa pérennisation ne lui ont pas permis de fonctionner sur le modèle des agences actuelles ». De même, « en tant que médecins, nous nous sommes fait piéger. En effet, il nous avait été dit qu'aucun produit de substitution n'existait. A l'époque, j'ai le sentiment que les industriels et le ministère de l'industrie nous ont quelque peu abusés lors de leurs présentations ».
La mission, si elle comprend parfaitement ce sentiment de manipulation, se demande toutefois comment on peut être manipulé par un organisme pendant des années, sans adhérer, un tant soit peu, à ses objectifs !
Rappelons d'ailleurs qu'en juin 1995, le professeur Patrick Brochard avait cosigné avec le professeur Jean Bignon une lettre adressée à M. Pierre-André Périssol, alors ministre du logement, dans laquelle il écrivait que, « en toute objectivité, le CPA [...] a fait du très bon travail pendant les treize dernières années ».
L'administration elle-même a été manipulée par le CPA. Réagissant à une question sur le rôle de lobby du comité, M. Jean-Luc Pasquier a indiqué : « Nous n'étions pas naïfs ». La mission n'en est pas si sûre !
M. Jean-Luc Pasquier a ainsi estimé que, « pour notre part, le CPA avait pour finalité de rédiger des documents qui, dans le contexte de l'époque, n'apparaissent pas aberrants. Nous n'étions donc pas intéressés par les intentions des uns ou des autres, mais par le produit final et par les objectifs avancés. Ceux-ci, d'une certaine manière, nous convenaient ». Or, c'étaient bel et bien les intentions qui, en l'espèce, étaient importantes !
Le ministère du travail n'a pas compris que le CPA n'était rien d'autre que le « faux nez » des industriels. M. Jean-Luc Pasquier l'a d'ailleurs lui-même reconnu : « Que les industriels aient exercé des actions de lobbying et que M. Valtat ait joué, dans ce cadre, le rôle de bras séculier, cela me paraît presque évident. Nous nous en sommes rendu compte au début des années 1990 ». Le CPA ayant été créé en 1982, il aura donc fallu une dizaine d'années au ministère du travail pour se rendre compte de quelque chose d'évident !
B. LA RÉACTION TARDIVE ET INSUFFISANTE DES AUTORITÉS SANITAIRES
1. Le décret de 1977 : l'effet démobilisateur d'une réglementation tardive, insuffisante et de toute façon mal appliquée
a) Les précédents anglo-saxons
Bien que l'amiante ait été reconnu comme source de maladie professionnelle depuis 1945, son usage n'a été que tardivement réglementé en France, plus tard que dans plusieurs grands pays consommateurs.
Dans sa lettre du 5 avril 1977 au Premier ministre, le professeur Jean Bignon le relevait d'ailleurs : « Actuellement, la France est le seul pays du monde occidental à ne pas avoir de réglementation pour l'utilisation industrielle de l'amiante ».
Les premières mesures réglementaires ont été adoptées en 1931 en Grande-Bretagne , et visaient à limiter l'empoussièrement et à mettre en place un suivi médical. Les mesures ne furent cependant guère appliquées, sauf dans les usines traitant de l'amiante brut, et il a fallu attendre 1969 pour que le Royaume-Uni se dote d'une véritable réglementation en la matière.
Aux États-Unis , la première des recommandations de l' American College of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) concernant l'amiante date de 1946 . Elle visait à limiter le risque d'asbestose et recommandait une valeur limite de 15 fibres/ml. En 1969, cette valeur était réduite à 6 fibres/ml. En 1972, elle était à nouveau réduite à 5 fibres/ml, puis à 2 fibres/ml en 1976. En 1983, une valeur limite d'exposition professionnelle de 0,5 fibre/ml, identique pour les amphiboles et le chrysotile, était adoptée. En 1996, cette valeur était fixée à 0,1 fibre/ml.
Les conclusions du commissaire du gouvernement du Conseil d'État permettent de rappeler que la réglementation générale française sur l'empoussièrement n'a pas eu les mêmes vertus que la réglementation anglo-saxonne : « En Angleterre et aux Etats-Unis, une réglementation spécifique tendant à mieux protéger les travailleurs de l'amiante a été mise en place beaucoup plus tôt qu'en France : en 1931 en Angleterre et en 1946 aux Etats-Unis. Le ministre soutient que ces pays n'ont agi ainsi que parce qu'ils étaient dépourvus de réglementation générale sur les poussières, ce qui n'était pas le cas de la France. Mais d'une part, la mise en oeuvre d'une réglementation particulière a pour effet d'attirer l'attention des travailleurs et des employeurs sur la dangerosité des produits manipulés, et ce d'autant que le décret particulier doit être affiché sur les lieux de travail. [...] D'autre part, si le ministre souligne que le nombre de décès par mésothéliome en Angleterre est plus important qu'en France, ce qui est exact aujourd'hui, il oublie de faire état des développements suivants du rapport de l'INSERM, consacrés à l'évolution des maladies, dans lequel on trouve ces données et selon lequel, en 1996, on constate déjà une stagnation du nombre de cas de pathologie cancéreuse liée à l'amiante en Angleterre et dans d'autres pays en raison d'une protection plus précoce des travailleurs, alors qu'en France, on a l'impression d'être au début de l'épidémie ».
b) La réglementation française de 1977
En France, ce n'est qu'en 1977 que la première valeur moyenne d'exposition professionnelle sur 8 heures (VME) était adoptée. Elle était fixée à 2 fibres/ml par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante .
Le décret du 17 août 1977 concernait les parties des locaux et chantiers des établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. L'employeur était tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée à ces travaux de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devait être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail 33 ( * ) .
Les travaux concernés devaient être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression. En cas de travaux occasionnels et de courte durée, et s'il est techniquement impossible de respecter ces dispositions, des équipements de protection individuelle devaient être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières. L'employeur était tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.
Les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante devaient être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage.
Seules étaient prises en compte, dans la définition de la VME, les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède 3. Il s'agissait des fibres susceptibles d'atteindre les alvéoles pulmonaires.
L'atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée au moins une fois par mois, selon une méthode de mesure normalisée décrite en annexe d'un arrêté du 25 août 1977.
Par ailleurs, le personnel exposé était soumis à une surveillance médicale spéciale. Aucun salarié ne pouvait être affecté à des travaux l'exposant à l'amiante sans une attestation médicale spéciale renouvelée une fois par an après un examen comprenant une radiographie pulmonaire ainsi que, le cas échéant, une exploration fonctionnelle respiratoire. Un arrêté du ministre du travail du 8 mars 1979 est venu fixer les instructions techniques que devaient respecter les médecins du travail assurant cette surveillance.
On note que l'ensemble de cette réglementation impliquait les chefs d'entreprise, les directions départementales du travail, l'inspection du travail, la médecine du travail, les représentants du personnel et les comités d'hygiène et de sécurité.
La VME professionnelle a ensuite été progressivement réduite et la VME actuelle, fixée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, est de 0,3 fibre/ml sur 8 heures pour le chrysotile (il est prévu dans les textes que cette valeur soit ramenée par la suite à 0,1 fibre/ml) et de 0,1 fibre/ml sur 1 heure pour les mélanges de chrysotile et d'amphiboles.
Parallèlement, des mesures réglementaires ont été adoptées pour les expositions dites « passives » rencontrées dans les bâtiments.
Le flocage des bâtiments, massivement utilisé à partir des années 1960, a été interdit en France, par un arrêté du 29 juin 1977 pour les locaux d'habitation, et par un décret du 20 mars 1978 pour tous les bâtiments dès lors que la concentration d'amiante dépassait 1 % dans les produits utilisés. La réglementation adoptée en 1996 considère que les niveaux de concentration inférieurs à 0,005 fibre/ml ne traduisent pas un niveau de pollution élevé, que les niveaux de concentration supérieurs à 0,025 fibre/ml nécessitent la mise en oeuvre de travaux de correction, et que les valeurs intermédiaires nécessitent un régime de surveillance renforcée.
Plusieurs décrets ont réduit le nombre des applications possibles de l'amiante :
- en avril 1988, interdiction de produits à base d'amiante visant surtout la sécurité du grand public, tels les jouets ou les articles pour fumeurs... ;
- en juillet 1994, interdiction de tous les produits contenant des amphiboles ainsi que de nombreux usages du chrysotile.
Les produits à base d'amiante, essentiellement du chrysotile, autorisés jusqu'au 1 er janvier 1997, comprenaient principalement :
- les produits d'amiante-ciment (plaques ondulées, tuiles, ardoises de toiture...), plaques et panneaux de cloisons intérieures, faux-plafonds... ;
- les produits textiles (cordes ou tresses, joints ou bourrelets d'étanchéité et de calorifugeage, vêtements de protection contre la chaleur, presse-étoupe, filtres...) ;
- les garnitures de friction (freins et embrayages de véhicules automobiles et ferroviaires, ascenseurs, moteurs et machines diverses) ;
- le papier-carton pour l'isolation thermique ou électrique ;
- des produits divers (amiante imprégné de résines, compensateurs de dilatation, évaporateurs, diaphragmes pour électrolyse, embouts de remplissage de bouteilles d'acétylène, revêtements de sols, composés bituminés...).
Lors de son audition, Mme Martine Aubry a évoqué la préparation du décret de 1977 : « Nous étions très fiers de ce décret car nous pensions que nous étions très en avance - nous l'étions d'ailleurs - par rapport aux autres en matière d'amiante et nous étions absolument convaincus, car toutes les études le disaient, que nous pouvions, en prenant des précautions d'usage et de manipulation et en faisant en sorte que les salariés ne soient pas au contact avec les fibres d'amiante, exclure totalement le danger pour la santé des salariés ». Elle a également ajouté : « Nous étions très fiers de sortir de ce ministère des textes qui étaient en avance par rapport à tout le reste de l'Europe. [...] Le ministère pensait vraiment que nous étions en avance et que nous devions l'être ».
La mission tient cependant à rappeler que cette réglementation de 1977 consacre l'« usage contrôlé », alors qu'en Europe, les Pays-Bas ont purement et simplement interdit, dès l'année suivante, en 1978, l'utilisation d'une variété d'amiante, la crocidolite.
Par ailleurs, Mme Martine Aubry a souligné l'avance de la France par rapport à la réglementation américaine. Elle a en effet indiqué que « nous nous sommes mis alors en dessous des niveaux les plus sévères, puisque les plus sévères étaient les Etats-Unis, avec 5 fibres dans l'air par millilitre, et que nous nous sommes placés à 2 fibres par millilitre dans l'air ». Cependant, c'est en 1976, soit un an avant la France, que les Etats-Unis avaient fixé la valeur limite d'exposition à 2 fibres/ml, la valeur limite d'exposition ayant été fixée dans ce pays à 5 fibres/ml en 1972. Rappelons enfin, comme il a été indiqué plus haut, que la valeur limite a été fixée à 0,5 fibre/ml pour la crocidolite et à 1 fibre/ml pour les autres variétés d'amiante dans notre pays en 1987, alors que la norme de 0,5 fibre/ml était appliquée aux Etats-Unis pour toutes les variétés d'amiante dès 1983. D'ailleurs, dès 1946 les Etats-Unis avaient fixé à 15 fibres/ml la première valeur limite d'exposition. Les Etats-Unis ont interdit l'amiante en 1989. Toutefois, en 1991, à l'issue d'un procès perdu par l'État contre les producteurs d'amiante, ils ont été contraints d'autoriser de nouveau la fabrication de produits à base de cette fibre.
c) La portée limitée du décret de 1977
Le plus important est sans doute que la réglementation de 1977 s'est malheureusement révélée peu efficace.
D'une part, en effet, - et c'est un paradoxe apparent -, le décret de 1977 a eu un effet démobilisateur .
Ce fut le cas notamment à Jussieu, où les personnels s'étaient pourtant beaucoup impliqués, pour des raisons exposées par M. Henri Pézerat, au cours de son audition : « Pourquoi la crise a-t-elle diminué d'intensité de 1980 à 1993 ? Ceci s'explique par les mesures qui ont été prises pour limiter l'amiante dans le milieu industriel. Je pense, en particulier, au décret de 1977. Dès lors, les syndicats ouvriers, qui s'étaient joints à l'action de l'intersyndicale de Jussieu pour remettre en cause l'usage de l'amiante, se sont bornés à demander l'application du décret de 1977. [...] Les scientifiques universitaires, à partir de la fin des années 1970, se sont retrouvés totalement isolés. Il devenait inutile de poursuivre la démarche du « collectif Jussieu » que nous avions constitué. Nous avions le sentiment que plus personne ne nous écoutait ».
Dans les entreprises, dès lors que cette réglementation avait été édictée, certains salariés s'estimaient à l'abri et ne prenaient aucune précaution particulière.
D'autre part, le décret de 1977 a été mal appliqué .
Le professeur Patrick Brochard a insisté sur le fait que cette réglementation aussi insuffisante qu'elle ait été, n'a de toute façon pas été respectée, rappelant que, dans les chantiers navals, par exemple, les niveaux d'exposition constatés étaient de 100 à 1.000 fois supérieurs à ceux fixés par les normes.
Le ministère du travail n'ignorait d'ailleurs pas la médiocre application de cette réglementation.
M. Jean-Luc Pasquier écrivait ainsi, en octobre 1981, dans la revue du ministère du travail, Echange Travail , que « deux ans après son entrée en application effective, le décret n° 77-949 du 17 août 1977 a permis d'améliorer les conditions de travail des salariés concernés. Mais des difficultés subsistent. Le décret n'est pas entré en application partout où il devrait l'être : certaines entreprises échappent encore au contrôle. Un problème important devra également un jour être résolu : celui du recyclage de l'air filtré dans les ateliers. Pour des raisons compréhensibles d'économie d'énergie, l'air filtré recyclé charge l'atmosphère des lieux de travail de très fines particules (fibrilles élémentaires d'amiante) : on peut évidemment se demander si dans de telles circonstances, la validité de la norme comme indice de prévention est conservée ».
Dans une circulaire du 15 avril 1983 relative à l'application du décret du 17 août 1977, adressée aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et aux inspecteurs du travail, M. Jean-Luc Pasquier notait également qu'un premier bilan d'application du décret « montre qu'en 1979, seules les entreprises de première transformation de l'amiante avaient, semble-t-il, compris, assimilé et appliqué les principales dispositions du décret ». Il poursuivait : « En tout état de cause, les enseignements tirés de ce premier bilan sont suffisamment riches pour qu'il soit nécessaire d'actualiser et de compléter les données. En particulier, ce premier bilan qui a permis de recenser quelque 200 entreprises utilisatrices d'amiante, n'a pas apporté de réponse sur les utilisateurs occasionnels de produits à base d'amiante. La connaissance du risque dans des secteurs d'activité tels la réparation automobile ou la construction reste encore très imparfaite. De même, dans des domaines comme ceux de la démolition des bâtiments, les travailleurs sont soumis à un risque d'exposition non négligeable qui, semble-t-il, n'est pas actuellement évalué ».
Mme Martine Aubry, a expliqué que, lorsqu'elle était directrice des relations du travail, « le décret de 1977 a été pour [elle] et [ses] collaborateurs une préoccupation constante et c'est ainsi que des dizaines de textes concernant l'amiante [...] ont été pris entre 1984 et 1987, allant de l'interdiction du recours au travail temporaire pour les travaux exposant aux poussières d'amiante, en février 1985, jusqu'à des mesures de protection individuelle et collective de toute nature ». Elle a conclu sur ce point : « Quand on dit, sur ces problèmes [...] , qu'on ne s'en est pas occupé et que tout le monde les a ignorés, je réponds que ce n'est pas vrai : même à cette époque, nous prenions les textes que nous croyions efficaces et suffisants ».
Cette argumentation n'avait pas convaincu le Conseil d'État.
Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement, notant que « le gouvernement soutient que cette politique [l'usage contrôlé de l'amiante] était adaptée aux connaissances scientifiques du moment et a été durcie au fur et à mesure que d'autres connaissances étaient acquises », a réfuté ces moyens. D'abord, « en France, de 1975 à 1995, il n'y a pas eu davantage d'études scientifiques demandées aux instituts de recherche publique et notamment à l'INSERM et au CNRS, voire l'INRETS sur les propriétés de cette fibre et ses effets sur la santé, que par le passé. Il n'y a eu aucune enquête de l'inspection du travail diligentée auprès d'entreprises susceptibles d'être concernées par les mesures imposées par le décret de 1977 ». Ensuite, « la politique d'usage contrôlée, si elle était peut-être efficace dans les usines modernes, n'était pas adaptée à tous les autres endroits où, compte tenu de la diffusion de produits amiantés dans l'environnement, des ouvriers étaient amenés à travailler sur des produits contenant de l'amiante ou dans un environnement qui, à un moment, avait été isolé ou protégé avec de l'amiante ».
Le Conseil d'État a sérieusement contesté la qualité des mesures effectuées en application du décret de 1977 : « On voit que la mesure par microscope de la concentration moyenne de fibres d'amiante sur 8 heures de travail était radicalement inadaptée pour ces salariés ».
Une telle affirmation pourrait paraître un peu facile à avancer rétrospectivement. Pourtant, le caractère applicable du décret de 1977 a été contesté dès cette époque . Ainsi, dans leur ouvrage de 1977, Danger amiante 34 ( * ) , les chercheurs de Jussieu notaient que « le défaut principal de la norme définie comme une moyenne dans le temps est que cela permet les pires abus : par exemple, une machine très polluante fonctionnant deux heures par jour et polluant tout un atelier, peut très bien respecter la norme ». Ils écrivaient également : « Le chargement des machines, s'il a lieu seulement deux ou trois fois par jour, peut se faire aussi salement que l'on veut : la norme en moyenne sera respectée, vu le court laps de temps pendant lequel le travail a lieu ». Ainsi, le système des moyennes sur 8 heures que le décret de 1977 avait mis en place pour mesurer le risque n'était pas adapté pour saisir les pics d'empoussièrement que les experts considéraient comme une des principales causes des pathologies de l'amiante.
Mme Martine Aubry a estimé que le ministère du travail avait, à l'époque, « multiplié les avancées réglementaires ». La mission ne peut que constater que cette « multiplication » est intervenue dans un contexte qualifié par certains sociologues de « longue période muette ».
|
« Une longue période muette (1980-1994) » Dans leur ouvrage précité, MM. Francis Chateauraynaud et Didier Torny notent qu'« entre 1980 et 1994, le front de l'amiante ressemble un peu à ces drôles de guerres dont on finit par se convaincre qu'elles n'auront jamais lieu ». Ils avancent deux hypothèses pour expliquer le silence qui a entouré le dossier de l'amiante entre la publication du décret du 17 août 1977 et la médiatisation d'un certain nombre d'« affaires » au milieu des années 1990 : « - la première consiste à mettre en évidence une sorte de « trou configurationnel » qui marque précisément la période des années quatre-vingt et du début des années quatre-vingt-dix : on enregistre en effet une chute de potentiel de la critique sociale et des formes de luttes politiques qui avaient porté le dossier de l'amiante dans les années soixante-dix. Ce « trou configurationnel » a été entretenu par une des caractéristiques majeures des dégâts sanitaires causés par l'amiante : le temps de latence entre l'exposition du corps humain et le développement des pathologies portant sa signature ; « - la seconde hypothèse recoupe assez facilement la précédente : elle met l'accent sur l'absence de savoir-faire collectif en matière de traitement cognitif des alertes et sur la faible existence politique et médiatique des lanceurs d'alerte encore largement identifiés à des dénonciateurs ». A cet égard, les auteurs estiment qu'après la retombée de la mobilisation, « la plupart des protagonistes semblent remis dans une situation de confiance où l'État pallie aux dysfonctionnements, remplissant sa fonction première de garant de la sécurité des biens et des personnes. Du point de vue du lanceur d'alerte, il s'agit là d'un piège institutionnel ». Pourtant, les alertes locales ont existé en France au cours de ces années de « mise en sommeil » du dossier : en 1980, mairie de Montpellier ; en 1985, centre de tri de Saint-Lazare et mine d'Anglade, en Ariège ; en 1989, centre international de recherche sur le cancer à Lyon et tour Beaulieu à Nantes ; en 1990, prison de Fleury-Mérogis ; en 1991, école de Marcouville à Pontoise. Mais ces alertes n'ont jamais atteint un niveau national et n'ont pas permis de créer les conditions propices à la dénonciation publique d'un « scandale ». Ces deux sociologues rappellent également que « la dénonciation de l'amiante était fortement liée au dévoilement des conditions sociales des travailleurs les plus exposés. Les maladies déjà répertoriées concernaient avant tout des ouvriers et ressemblaient, comme la silicose, à une « maladie de classe » engendrée par l'exploitation capitaliste... ». |
S'agissant, enfin, de la transposition en droit français des directives communautaires réduisant la valeur d'exposition 35 ( * ) , le juge administratif a considéré que la question du délai de transposition, qui a été quasiment respecté, n'était pas essentielle. En effet, le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille puis par le Conseil d'État, a ainsi retenu la responsabilité pour faute de l'État pour l'intervalle allant du 1 er janvier 1987, date limite de transposition de la directive 83/477/CEE, au 27 mars 1987, date de la transposition effective 36 ( * ) . Surtout, il a jugé que la responsabilité de l'État est engagée dès lors que celui-ci a connaissance, par les directives communautaires, de l'inadaptation des seuils nationaux en vigueur, « sans qu'il soit utile de rechercher si le délai laissé par la France a été respecté ».
2. L'interdiction tardive de l'amiante en France
L'usage de l'amiante n'est interdit, en France, que depuis le 1 er janvier 1997 , par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation.
Son article premier dispose notamment que :
- au titre de la protection des travailleurs, sont interdites la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs ;
- au titre de la protection des consommateurs, sont interdites la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
A titre exceptionnel et temporaire, des dérogations ont été accordées, jusqu'au 1 er janvier 2002, pour certains usages existants du chrysotile, dès lors qu'il n'existe aucun substitut qui, d'une part, présente, en l'état actuel des connaissances, un risque moindre pour la santé des travailleurs, d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation. Une liste limitative de ces usages est établie par arrêté du même jour. L'exception à l'interdiction demeure pour la vente des véhicules d'occasion jusqu'à la fin 2003. Les entreprises bénéficiant de ces dérogations devaient se déclarer auprès du ministère du travail afin d'évaluer, année après année, le bien-fondé des dérogations.
La France se donnait quatre ans pour se débarrasser définitivement de l'amiante. En 1996, elle utilisait environ 35.000 tonnes d'amiante. Ce chiffre est tombé à 200 tonnes en 1997, 50 tonnes en 1998, puis 12 tonnes en 1999.
En revanche, la France a continué d'importer de l'amiante jusqu'en 2002. Cette année-là, les statistiques d'Eurostat montrent que certains pays européens avaient importé des quantités parfois non négligeables d'amiante : l'Allemagne (200 tonnes), la Grèce (1.900 tonnes), l'Espagne (3.060 tonnes), le Portugal (7.130 tonnes).
Cette décision d'interdiction est bien plus tardive que dans d'autres pays européens.
L'utilisation de certaines formes d'amiante a été interdite dans certains pays, et de toute forme d'amiante dans d'autres. En 1996, au moment de la rédaction du rapport de l'INSERM, c'était notamment le cas de plusieurs pays européens. Outre, la Norvège et la Suisse, il s'agissait des pays suivants :
- les Pays-Bas interdisent l'utilisation de la crocidolite en 1978, puis établissent une interdiction totale en 1993 ;
- le Danemark, en 1980, prohibe totalement la crocidolite et interdit avec des dérogations le chrysotile ;
- la Suède interdit la crocidolite en 1982 ;
- l'Italie interdit totalement l'amiante en 1993 ;
- l'Autriche et la Finlande en font autant en 1994, ainsi que l'Allemagne, mais avec des dérogations.
La Belgique interdit l'amiante en même temps que la France, en 1997.
La Nouvelle-Zélande décide l'interdiction de l'amiante en 1998, et le Royaume-Uni l'année suivante.
III. DES RESPONSABILITÉS MULTIPLES
Face à un drame sanitaire de l'ampleur de celui de l'amiante, se pose inévitablement la question des responsabilités. Or, dans ce dossier, celles-ci sont multiples et se sont cumulées, puisque les employeurs mais aussi l'État ont commis des fautes à l'origine du préjudice des travailleurs de l'amiante. Mais les victimes cherchent également à établir la responsabilité pénale des acteurs de ce drame, cette question étant actuellement pendante devant la Cour de cassation. La législation en vigueur constitue-t-elle un obstacle à la reconnaissance de cette responsabilité pénale, comme l'affirment les associations de défense des victimes de l'amiante ? La mission ne le pense pas.
A. LA RESPONSABILITÉ DES EMPLOYEURS
En dépit de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute inexcusable de l'employeur, du 28 février 2002, qui a conduit à une augmentation considérable des recours devant les tribunaux et à une condamnation quasi systématique des employeurs , certains d'entre eux continuent de minimiser leurs responsabilités dans le dossier de l'amiante .
Ainsi, au cours de la table ronde organisée par la mission avec les représentants des organisations patronales, M. Dominique de Calan, président du groupe de travail sur l'amiante au MEDEF et délégué général adjoint de l'UIMM, a indiqué : « Il est tout à fait clair que [la responsabilité des employeurs] ne saurait être exclusive ». « La recherche de responsabilité doit être partagée » a ajouté le docteur Pierre Thillaud, représentant de la CGPME au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, même si cette responsabilité « n'est pas nulle ».
M. Claude Imauven, directeur général adjoint de la Compagnie Saint-Gobain et directeur du pôle produits pour la construction, a également souligné « les nombreux investissements qui ont été faits pour se mettre en conformité avec la réglementation. [...] Au fur et à mesure que la connaissance sur l'amiante a évolué, les mesures ont été plus strictes et plus sévères. Saint-Gobain a, depuis toujours, pratiqué la même politique et appliqué la réglementation ». Ce n'est manifestement pas l'avis des magistrats lorsqu'ils ont condamné la Compagnie pour faute inexcusable de l'employeur.
1. Le rappel des règles de la responsabilité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
La loi du 9 avril 1898 avait fondé la responsabilité de l'employeur sur la notion de risque professionnel ou industriel, en contrepartie d'une réparation forfaitaire , et écartant la responsabilité contractuelle. Elle avait donc institué un régime de responsabilité sans faute de l'employeur , qui bénéficiait d'une immunité civile : aucune action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ne pouvait être exercée par le travailleur accidenté contre son employeur ou un préposé de la même entreprise. Une majoration de l'indemnité était prévue en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Toutefois, les lois instituant la sécurité sociale, en 1945 et 1946, ont substitué à la notion de risque professionnel celle de risque social, et les caisses de sécurité sociale assurent la réparation de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La loi du 9 avril 1898, en dépit de ses réelles avancées, aurait ainsi comporté un effet pervers tenant au désintérêt pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Comme l'écrit M. Pierre Sargos, président de la chambre sociale de la Cour de cassation, « cette réparation, pour limitée qu'elle soit, a ruiné la mise en oeuvre effective de la prévention des accidents [...] . La certitude de la réparation [...] a conforté l'idée perverse, mais objet pendant longtemps d'un consensus assez général qui a abouti au « crime sociétal » de l'amiante, qu'il n'était pas indispensable de faire les frais et l'effort de mettre réellement en oeuvre les mesures de sécurité dès lors que le dommage de l'homme était réparé » 37 ( * ) .
Il convient de rappeler que, jusqu'en 1976, il était interdit aux employeurs de s'assurer contre la reconnaissance d'une faute inexcusable. Puis, de 1976 à 1987, seule la faute inexcusable du substitué à la direction était considérée comme assurable.
A l'origine, en effet, il n'était pas possible de s'assurer contre le risque en cas de faute inexcusable. La sanction se limitait à une majoration de rente octroyée par la caisse dans le cadre du régime forfaitaire.
Comme l'a rappelé, au cours de son audition, Me Philippe Plichon, avocat des employeurs dans des procès relatifs à l'amiante, « cette situation perdurera jusqu'à la promulgation de la loi du 6 décembre 1976, une des références dans l'histoire de l'amiante ». Il a également noté que cette loi « est consécutive à la mise en garde à vue d'un dirigeant d'une filiale des Charbonnages de France après un accident mortel du travail ».
La loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail prévoit que les victimes sont désormais indemnisées par une majoration d'une rente et des préjudices complémentaires. Parallèlement, les employeurs ont la possibilité de s'assurer contre le risque de faute inexcusable. Celle-ci, a noté Me Philippe Plichon, « était une peine et devient un risque assurable par les patrons au profit de leurs préposés », définis comme les délégataires en matière d'hygiène et de sécurité, fonction qui n'existe pas toujours dans les petites entreprises.
2. Les nombreuses condamnations des employeurs consécutives aux arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002
Examinant une série de dossiers qui portent sur les suites données par les juridictions civiles à des demandes d'indemnisation consécutives à des maladies professionnelles dues à la contamination par l'amiante, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans ses arrêts du 28 février 2002 , a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur en termes d'obligation de sécurité de résultat , qui constitue, aux yeux d'une partie de la doctrine, « une révolution dans le domaine du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles » 38 ( * ) .
La faute inexcusable de l'employeur est une notion jurisprudentielle qui avait été définie par la Cour de cassation, dans son fameux arrêt Veuve Villa du 15 juillet 1941, de la manière suivante : « Constitue une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, toute faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel ». Jusqu'aux décisions du 28 février 2002, cette définition était restée la même. M. Pierre Sargos, dans son article précité, note que « la rigueur de cette définition a eu pour conséquence que pendant plusieurs dizaines d'années, le nombre de fautes inexcusables retenues a été faible, sinon insignifiant ».
La nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur ne se réfère plus à l'élément de gravité exceptionnelle de la faute et a désormais un fondement contractuel : « Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale 39 ( * ) , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».
La Cour de cassation a ainsi assoupli la définition de la faute inexcusable de l'employeur et en a réduit les critères de qualification à deux :
1°) un critère positif : la conscience du danger (qui existait déjà dans la précédente définition), c'est-à-dire l'évidence du danger, l'impossibilité de l'ignorer ou l'obligation morale ou légale de le connaître ;
2°) un critère négatif : le salarié doit prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver contre le danger : malgré la conscience qu'il avait ou qu'il aurait dû avoir du risque qu'il faisait courir à son salarié, il n'a pas été suffisamment diligent dans l'adoption de mesures préventives et ne s'est pas comporté en employeur avisé.
Ainsi le président de la chambre sociale de la Cour de cassation estime-t-il que, de la nouvelle définition de la faute inexcusable, « il résulte que la conjonction chez l'employeur de la connaissance des facteurs de risque - appréciée objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations - et de l'absence de mesures pour l'empêcher, signe à elle seule la faute inexcusable. Pour autant cette définition, qui se veut avant tout incitative à la prévention, n'implique aucune présomption de faute inexcusable [...] . Il appartient donc à la victime de démontrer la conscience du danger que devait avoir l'employeur » 40 ( * ) .
Pratiquement, si la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était difficile à établir avant les arrêts du 28 février 2002, la situation a profondément évolué par la suite, du fait de la reconnaissance désormais quasi systématique de la faute inexcusable . Ainsi, le nombre d'affaires dénombrées ayant trait à la reconnaissance d'une faute inexcusable est estimé par le FIVA à environ 1.500 jugements et arrêts.
Par exemple, plus de 700 procédures pour faute inexcusable ont été engagées à Condé-sur-Noireau. Toutes les victimes, sans exception, ont gagné leur procès. A l'heure actuelle, près de 450 dossiers sont instruits auprès des tribunaux de Caen, Saint-Lô et Alençon.
De même, Mme Lucciani, présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, a souligné que sa juridiction avait été saisie, depuis novembre 2003, de 37 demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en relation avec l'exploitation de la mine de Canari.
Quant à la Compagnie Saint-Gobain, pour les usines ayant exploité l'amiante, on compte entre 250 et 300 cas recensés en matière de recours pour faute inexcusable, essentiellement portés par Everite et en partie par Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, héritière d'Everitube. Par ailleurs, un certain nombre de cas sont liés à l'utilisation de l'amiante. Beaucoup de sociétés sont concernées : le vitrage, l'activité de Pont-à-Mousson pour la partie fonderie, les revêtements, la laine de verre, la distribution... Il y a exactement 57 procès en cours.
3. Des conséquences financières très lourdes pour les entreprises
A Saint-Gobain, le pôle de produits pour la construction, essentiellement à travers Saint-Gobain PAM, est aujourd'hui une « coquille vide » qui gère le passif d'Everite. En effet, la personne morale Everite existe toujours, mais seulement pour les besoins des procès en faute inexcusable intentés par d'anciens salariés. C'est, au sein du groupe Saint-Gobain, en France, l'entité qui doit assumer les conséquences de l'exploitation de l'amiante.
C'est d'ailleurs un souci majeur de Saint-Gobain en termes de procès puisque, du fait de l'activité historique de la société américaine Certain Teed, en grande partie avant son acquisition par Saint-Gobain, un certain nombre de procès complexes relevant du système juridique américain sont en cours.
D'ailleurs, la Compagnie a dû constituer des provisions pour indemniser les salariés. La plupart des provisions sont surtout destinées aux procès américains. Rappelons que, dans le système américain, qui est celui des « class actions », on n'est pas obligé d'avoir une pathologie déclarée pour pouvoir engager un procès.
Le cas de l'entreprise des Constructions mécaniques de Normandie (CMN), dont une délégation de la mission a rencontré les dirigeants au cours de son déplacement à Cherbourg, illustre également les difficultés auxquelles la charge de l'indemnisation des victimes expose les entreprises, et qui peut mettre en péril leur équilibre financier .
La reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % ouvre droit, pour un salarié ou ancien salarié, au bénéfice d'une rente égale à 100 % du salaire brut. En application des règles de tarification de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale, l'employeur se voit ensuite facturer une somme égale à 32 fois le salaire brut annuel du salarié, ce qui représente, en moyenne, entre 600.000 et 700.000 euros.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'une maladie liée à l'amiante peut notamment se voir attribuer une majoration de sa rente au titre de la faute de l'employeur qui vient s'ajouter à la réparation déjà intégrale accordée par le FIVA. Pour une personne dont le taux d'IPP est de 100 %, les réparations complémentaires accordées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale au titre du préjudice physique, moral et d'agrément s'échelonnent entre 110.000 et 300.000 euros. Il s'agit là de montants indéniablement difficiles à prendre en charge pour une entreprise à la situation financière fragile comme les Constructions Mécaniques de Normandie, qui emploie actuellement 350 salariés, contre 1.100 dans les années 1980, et qui a été contrainte de restructurer et diversifier sa production. Or, dans cette entreprise, ce sont 2.200 salariés qui, occupés au flocage des vedettes, ont subi une forte exposition à l'amiante entre 1966 et 1978. D'autres salariés ont subi une exposition plus faible en utilisant, de 1978 à 1984, des tapis, gants ou coussins de protection en amiante. Jusqu'en 1996, des salariés ont enfin pu être soumis à des expositions sporadiques à l'amiante, contenu notamment dans des joints.
On voit donc les sommes potentielles qui sont en jeu. Me Philippe Plichon a d'ailleurs attiré l'attention sur le fait que « si un ou deux cas de mésothéliome apparaissent, les CMN disparaîtront. En effet, un tel recours représente un coût considérable ».
D'ailleurs, aux Etats-Unis, les faillites liées aux indemnisations de l'amiante sont déjà relativement nombreuses.
Or, la faute inexcusable est systématiquement reconnue à l'encontre des CMN et aucune compagnie n'accepte plus, de ce fait, d'assurer contre ce risque. L'entreprise a dû faire face, jusqu'ici, à 110 recours en justice, dont une partie est encore en attente de jugement.
Me Philippe Plichon s'est inquiété de ce que « les assureurs refusent de couvrir le risque amiante. Les arrêts du 28 février 2002 ont été suivis, aussi souvent que possible, d'une dénonciation des polices. L'amiante n'est donc plus assurable ».
Depuis le début des années 1990, la plupart des assureurs de risques d'entreprise prévoient, dans leurs contrats, l'exclusion des risques liés à l'amiante. En effet, ces derniers n'étant pas mesurables, les assureurs ont considéré qu'ils ne pouvaient les prévoir dans la détermination de leurs tarifs. Jusqu'alors, ce risque n'était pas réellement tarifé. Il faisait partie de l'ensemble des garanties offertes dans les contrats d'assurance.
En effet, comme l'a souligné M. Claude Delpoux, directeur des assurances de biens et de responsabilités de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), la jurisprudence de la Cour de cassation « a totalement bouleversé l'idée que l'assurance se faisait du risque de la faute inexcusable pour des maladies professionnelles » et a « amené les assureurs à s'interroger sur la possibilité de couvrir, dans le cadre des contrats de responsabilité civile générale, la faute inexcusable. Ils acceptent ce risque dans des conditions permettant de limiter leurs engagements en montants ». En effet, les assureurs se soucient principalement de la maîtrise financière de leurs engagements en montants et en temps. Lorsqu'ils garantissent la faute inexcusable, ils incluent dans leurs contrats des plafonds de garantie et, pour des sinistres sériels, c'est-à-dire liés au même phénomène, un plafond global.
Il a ajouté que cette jurisprudence « crée une appréciation totalement différente du risque de l'amiante ou d'autres maladies professionnelles. Par conséquent, cette jurisprudence provoque un problème d'assurabilité . L'assureur ne peut en effet couvrir un risque que dans la mesure où il est capable de prévoir son engagement. S'agissant de sinistres pouvant toucher un nombre considérable de victimes, le montant de l'assurance correspondant au niveau des risques encourus est très difficilement déterminable ».
B. LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
Les préjudices causés par les poussières d'amiante mettent en cause la responsabilité de l'État à un double titre : en tant qu'employeur qui voit sa responsabilité pécuniaire « socialisée » avec celle des autres employeurs par l'entremise du FIVA, mais aussi en tant qu'État contrôleur depuis les décisions du Conseil d'État du 3 mars 2004.
1. La responsabilité de l'État employeur
Les représentants de la CGT-DCN, que la délégation de la mission a rencontrés lors de son déplacement à Cherbourg, ont considéré que les dirigeants de la direction des chantiers navals connaissaient parfaitement la dangerosité de l'amiante, dénoncée par la CGT de l'Arsenal dès les années 1950, mais n'avaient pas pris les mesures de protection nécessaires.
Les représentants de l'ADEVA Cherbourg ont évalué à plus de 1.000 le nombre de salariés contaminés à DCN.
Selon Me Jean-Paul Teissonnière, « en ce qui concerne la DCN, il s'agit effectivement d'une nouvelle entreprise et l'employeur responsable n'est pas cette entreprise créée récemment mais la DCN au moment où elle était une division du ministère de la défense, c'est-à-dire l'État. La question est donc réglée de ce côté : c'est l'État employeur qui supportera les conséquences des fautes qui ont été commises à l'époque ».
2. La responsabilité de l'État régalien
Des malades de l'amiante ou leurs ayants droit avaient saisi le tribunal administratif de Marseille qui, le 30 mai 2000, avait établi la responsabilité de l'État. Ce jugement, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille, le 18 octobre 2001, avait conduit le ministre de l'emploi et de la solidarité à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
La haute juridiction administrative, par quatre décisions du 3 mars 2004, a confirmé la responsabilité de l'État et l'a condamné à indemniser les victimes de l'amiante sur le fondement de la faute pour carence de l'action de l'État dans le domaine de la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante.
Or, le Conseil d'État, suivant les conclusions du commissaire du Gouvernement, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, a jugé que la responsabilité de l'État était établie à double titre :
- en l'absence d'une réglementation spécifique à l'amiante, c'est-à-dire avant 1977 41 ( * ) ;
- à partir de 1977, en présence d'une réglementation spécifique à l'amiante mais insuffisante et trop tardive 42 ( * ) .
Dans l'affaire de l'amiante, l'État a commis un double manquement :
- l'absence de suivi suffisant par l'inspection du travail de la dangerosité des poussières d'amiante, qui a eu pour conséquence la méconnaissance de l'ampleur de la contamination et le manque d'évolution de la réglementation ;
- l'inapplication par l'État des principes de prévention et de précaution.
Rappelons que l'État développait cinq moyens à l'appui de ses pourvois :
- la cour administrative d'appel de Marseille aurait insuffisamment motivé son arrêt ;
- elle aurait commis une erreur de droit en faisant reposer sur le défendeur la charge de la preuve ;
- elle aurait inexactement qualifié les faits en retenant que l'État avait commis une faute ;
- elle aurait admis à tort qu'il existait un lien direct entre la faute et les dommages ;
- elle aurait dû atténuer la responsabilité de l'État en raison des fautes commises par des tiers, les employeurs des victimes en l'espèce.
A cet égard, les conclusions de Mme Prada-Bordenave paraissent particulièrement sévères.
Pour le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'administration n'avait pas obligation d'agir puisqu'elle ne détenait que des informations scientifiques fragmentaires et parfois contradictoires et qu'il convient de distinguer le risque et le danger, la connaissance in abstracto de la dangerosité de l'amiante et la connaissance des risques in concreto ne pouvant être assimilées. On note que les employeurs développent aujourd'hui des arguments similaires.
Mme Prada-Bordenave conteste cette argumentation, du fait de « l'enracinement dans l'histoire tant de la mission étatique de protection de l'hygiène et la sécurité des travailleurs que les risques causés par l'amiante à ces derniers ». Elle estime également que, « si le système de protection des travailleurs contre les accidents et maladies professionnelles n'est pas nouveau, les maladies liées à l'amiante et la connaissance qu'en a l'administration du travail ne sont pas non plus nouvelles ». S'agissant des publications épidémiologiques sur les dangers de l'amiante, elle a considéré que, « contrairement à ce que soutient le ministre, il ne s'agit pas d'articles ponctuels plus ou moins assurés ou confidentiels, il s'agit dans tous les cas de communications scientifiques qui font suite à des études importantes et qui sont publiées dans des revues spécialisées ». Elle est même d'avis que les instances scientifiques spécialisées dans la prévention des risques au travail soit « n'ont pas lu ces articles, ce qui paraît peu probable et aurait en tout état de cause été une faute, soit elles n'ont pas relayé les informations qu'ils contenaient, soit elles ont bien relayé cette information mais il n'en a été tenu aucun compte ». Elle relève également l'absence en France de réglementation particulière concernant l'amiante, contrairement à d'autres pays industrialisés.
Mme Prada-Bordenave conclut : « Nous vous proposons de dire qu'en relevant que l'État n'avait pas fait procéder à des études particulières et ne s'était pas assuré de l'efficacité de la réglementation générale pour prévenir les dangers provoqués par l'amiante sur les travailleurs qui manipulaient cette fibre, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits. Puis, qu'en déduisant de ces constatations que l'État avait commis une faute constituée par une carence dans la mise en oeuvre de la mission de prévention dont il était chargé, elle n'a pas inexactement qualifié les faits ».
S'agissant de la période postérieure à 1977, la commissaire du gouvernement a estimé que « l'État s'est satisfait d'une réglementation sans vérifier qu'elle permettait une protection efficace dans tous les secteurs, il n'a pas cherché à comprendre, au vu des éléments statistiques dont il disposait pourquoi une épidémie se développait malgré les mesures d'usage contrôlé. Il n'a pas fait appel aux instances publiques de recherche, aux services de l'inspection du travail, ou bien encore à ceux de l'assurance maladie. Il s'est gardé de diffuser une information précise à tous les travailleurs, les mettant en garde contre les dangers de l'amiante alors que son caractère cancérigène était connu. Certes, il y a avait encore des controverses scientifiques sur les risques comparés de telle ou telle fibre, sur les effets de seuil mais pour reprendre les conclusions d'H. Legal dans l'affaire d'assemblée du 9 avril 1993 43 ( * ) , « face à un risque mortel pour un certain nombre de patients, une certitude scientifique n'est pas une condition nécessaire pour agir ». Le risque mortel était ici avéré et l'État devait agir et mettre tout en oeuvre pour s'assurer que son action était adéquate ».
Après avoir considéré que le comportement fautif reproché à l'État était une « carence » et une « inertie de l'administration », qui engage sa responsabilité, elle a ajouté que l'affaire de l'amiante donnait lieu à un « cumul de responsabilité ».
La mission considère que l'établissement de la responsabilité de l'État, s'il est naturellement essentiel pour faire toute la lumière sur les aléas de ce drame qui s'est déroulé sur plusieurs décennies, ne saurait être suffisant et constituer l'explication générale d'une responsabilité collective, tellement large qu'elle éluderait la question de l'enchaînement des responsabilités des différents acteurs.
Certaines personnes entendues au cours des auditions ont pu en effet donner cette impression.
C. QUELLE RESPONSABILITÉ PÉNALE ?
Force est de constater que, pour l'instant, le bilan judiciaire de l'affaire de l'amiante ne permet pas de tirer toutes les leçons de cette expérience tragique ; le renouvellement de ce type de situation n'est, en conséquence, pas exclu à l'avenir.
Le recours aux juridictions pénales est important dans ces affaires de santé publique dans la mesure où, pour les victimes, c'est souvent le dernier recours et la seule façon pour elles, même quand elles sont indemnisées, d' obtenir la transparence sur les éventuelles responsabilités en cause .
En outre, cette recherche de responsabilité apparaît d'autant plus importante pour les victimes qu'il existe une tentation de la diluer dans une responsabilité générale où, in fine , plus personne ne serait responsable. Au cours de son audition, le garde des Sceaux, M. Pascal Clément, s'est toutefois engagé auprès de la mission « à ce que ces procédures [pénales] puissent être menées à leurs termes dans des conditions satisfaisantes ».
Il convient en effet d'éviter, dans le drame de l'amiante notamment, que la personne qui, sans violer intentionnellement la loi pénale ni causer un dommage sans en avoir eu conscience, prendrait un risque de façon délibérée tout en espérant que ce risque ne provoque aucun dommage, ne soit pas sanctionnée.
Même s'il existait déjà une jurisprudence, parfois ancienne, sur la responsabilité pénale du chef d'entreprise, y compris en matière de respect des règles de sécurité, le débat en la matière s'est focalisé, au cours des travaux de la mission, sur la « loi Fauchon » qui n'épuise pourtant pas le sujet. Pour les associations de défense des victimes, en effet, le « blocage » des poursuites serait dû à l'inadaptation des dispositions introduites par cette loi.
1. Plusieurs plaintes jusqu'ici conclues par des non-lieux
a) Des procédures pénales au point mort : pourquoi ?
Le ministère de la justice ne connaît pas le nombre total de procédures engagées devant les juridictions pénales à l'encontre de chefs d'entreprise dont les salariés ont travaillé l'amiante, du fait de l'organisation décentralisée des parquets, même si, comme l'a précisé M. Alain Saffar, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la direction des affaires criminelles et des grâces, « dès lors que des informations judiciaires sont ouvertes, c'est-à-dire dès lors qu'un juge d'instruction a été saisi, il est vrai que les parquets pensent à faire remonter l'information afin que nous puissions suivre l'évolution de l'instruction ».
Une soixantaine d'affaires ont ainsi été suivies à la chancellerie pour ce type de situation, dont un certain nombre se sont achevées par des non-lieux, et le ministère en suit actuellement 17 . Sur les 17 informations judiciaires en cours ouvertes sous les chefs d'empoisonnements, d'homicides ou de blessures involontaires , deux ont été ouvertes en 1996, quatre en 1997, deux en 1998, une en 1999 et huit en 2000.
M. François Desriaux, président de l'association de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), a rappelé que « les premières plaintes en matière pénale ont été déposées en juillet 1996, sous l'impulsion de l'ANDEVA. Neuf ans plus tard, aucune procédure n'a abouti. Aucun procès de l'amiante n'a encore eu lieu. Force est de constater que les instructions en cours sont au point mort ».
M. Alain Saffar a rappelé les motifs de non-lieu dans les affaires liées à l'amiante.
Tout d'abord, les faits sont souvent très anciens et les expositions très longues, ce qui, du point de vue de la recherche des preuves, n'est pas toujours de nature à faciliter la tâche : « Quand on a du mal à établir l'exposition précise dans une ambiance amiantée, c'est au stade de la preuve que la victime ou la personne qui se présente comme telle aura du mal à faire valoir ses droits ».
Ensuite, quand bien même elle aurait réuni ces preuves par une série de témoignages, le décès de la personne qui a été mise en cause entraîne l'extinction de l'action publique à son égard et la fin de la recherche de sa responsabilité pénale.
Par ailleurs, il se pose un certain nombre de situations et de problèmes de prescription de l'action publique. Pour l'homicide et la blessure involontaires qui sont des délits, le délai de prescription est de trois ans.
Par conséquent, dès lors qu'une victime est décédée, si elle n'avait pas engagé l'action au pénal avant son décès ou si ses ayants droit n'engagent pas l'action au pénal dans le délai de trois ans, on va lui opposer la prescription.
Me Jean-Paul Teissonnière a lui aussi déploré ce blocage des procédures pénales : « Les procédures pénales qui sont en cours ont été déclenchées par les plaintes des victimes et elles ont beaucoup de difficultés à progresser, même s'il est prononcé un certain nombre de mises en examen soit pour homicide involontaire, comme c'est le cas à Valenciennes, soit pour empoisonnement, comme c'est le cas à Clermont-Ferrand, pour le dernier président-directeur général de la société Amisol, mais aucune de ces procédures n'a été engagée par le ministère public ».
Or, le parquet obéit à un principe de hiérarchie qui est rappelé par l'article 36 du code de procédure pénale, qui indique que le ministre de la justice peut dénoncer aux parquets généraux les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et leur enjoindre d'engager des poursuites. C'est le ministère de la justice qui est le responsable de l'action publique et des politiques d'action publique.
Dans ces circonstances, Me Jean-Paul Teissonnière a exprimé son incompréhension : pourquoi, « face à des centaines ou des milliers de jugements pour faute inexcusable rendus par les juridictions de sécurité sociale sous l'empire de l'ancienne définition de la faute inexcusable dont les conditions étaient plus difficiles à remplir que celles qui sont actuellement posées par la « loi Fauchon », aucun procureur de la République, aucun procureur général ni aucun garde des sceaux ne [s'est] avisé d'enjoindre d'engager des poursuites, comme le code de procédure pénale leur en laissait la possibilité » ? Selon lui, « il y a là une difficulté supplémentaire et une incompréhension qui est très largement partagée par les victimes ». Il s'est d'ailleurs montré très inquiet de la réaction des différents gardes des Sceaux face à la question de l'amiante. Pourtant, M. Alain Saffar a indiqué que les instructions données par le garde des Sceaux aux parquets, qui sont prévues par le code de procédure pénale, tendent à l'engagement de poursuites, « ce qui va dans le sens qui est souhaité par les victimes ».
b) L'incompréhension des victimes
Me Jean-Paul Teissonnière a également mis en évidence la déception et l'incompréhension des victimes consécutives à ce blocage judiciaire : « Il faut se mettre à la place des victimes de l'amiante qui, après avoir appris que le drame qu'elles vivent aurait été évitable, se heurtent aujourd'hui à une absence de volonté d'aboutir à un examen réel des responsabilités et de l'enchaînement des faits devant le juge pénal ». Cette incompréhension est d'autant plus grande que de très nombreuses procédures civiles ont conclu sans exception à l'existence d'une faute. Les victimes vivent cette situation comme un déni de justice au plan pénal.
C'est la raison pour laquelle la question du pénal est posée dans des termes aussi importants à l'heure actuelle. Elle constitue l'une des revendications majeures de l'ANDEVA et une demande forte des victimes, « sans doute parce que [...] la question de la prévention est actuellement au centre des préoccupations » a estimé Me Jean-Paul Teissonnière.
Au cours de son déplacement à Dunkerque, la délégation de la mission a entendu le témoignage particulièrement poignant de deux « veuves de l'amiante » qui ont exprimé le sentiment de gâchis familial et social engendré par l'amiante et qui n'aurait jamais dû survenir si leurs maris avaient travaillé ailleurs. Elles ont souhaité un procès pénal de l'amiante qui permettrait de désigner les responsables, non par souci de vengeance, mais pour qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais.
M. François Martin, président de l'association de défense des victimes de l'amiante (ALDEVA) de Condé-sur-Noireau, présente ainsi les aspects positifs, pour les victimes, de la procédure pénale : « La procédure pénale doit également pouvoir aller à son terme. Elle est essentielle à la réparation morale du préjudice subi par les victimes de l'amiante. Ces dernières ont besoin de comprendre et de connaître les responsabilités. Une condamnation pénale aura également valeur d'exemplarité. Nul ne souhaite que cette catastrophe sanitaire se reproduise ».
M. François Malye, journaliste, auteur de Amiante : 100.000 morts à venir , au cours de son audition, a souligné « la vertu de la pédagogie » d'un jugement pénal. Il a ajouté : « L'absence de jugement prononcé au terme d'une procédure pénale pose aujourd'hui problème. Un procès doit avoir lieu. Je conçois mal que le plus grand scandale de santé publique puisse ne pas être jugé ». Il a d'ailleurs estimé que les victimes, qui « veulent que justice soit rendue [...] sont déterminées. Elles n'abandonneront ni n'oublieront tant que la procédure pénale ne sera pas allée à son terme ».
Il a d'ailleurs indiqué qu'« il n'est pas exclu que les victimes attaquent la justice pour dysfonctionnement. Le risque existe au regard de l'incapacité de la justice française à juger cette affaire. La CEDH pourrait être saisie et pointer la responsabilité de l'appareil judiciaire dans la mesure où certaines instructions sont en cours depuis neuf ans ».
Il s'est également interrogé sur l'opportunité pour le ministère de la justice de voir s'ouvrir le « procès de l'amiante » : « Le garde des Sceaux devrait tout d'abord exiger des procureurs qu'ils fassent leur travail. [...] La défaillance de la justice est ici flagrante. Il n'y aucune volonté d'ouvrir ce procès. Personne n'ose y penser au regard de conséquences jugées dévastatrices ».
c) Un possible recours à la procédure de la citation directe ?
Les représentants de l'ANDEVA rencontrés à Dunkerque ont indiqué que, dans un article de La Voix du Nord , M. Pierre Fauchon aurait suggéré aux victimes de recourir à la citation directe dans le cas de l'amiante. Or, pour l'ANDEVA, cette procédure sans instruction, utilisée pour les affaires les plus simples, suppose des responsables identifiés et apparaît tout à fait inadaptée.
Notre collègue, au cours de sa communication devant la mission, a réaffirmé que la procédure de la citation directe pouvait être utilisée dans l'affaire de l'amiante.
Pourtant, plusieurs magistrats auditionnés ont noté que la complexité des dossiers liés à l'amiante rend extrêmement délicat le recours à la procédure de citation directe.
M. Alain Saffar a ainsi estimé qu'« il est nécessaire d'avoir une technicité et une recherche tellement approfondies qu'on ne peut pas se passer d'ouvrir une information et donc de saisir un juge d'instruction. [...] c'est beaucoup trop compliqué et il faut passer par l'instruction, ce qui implique nécessairement plus de temps ».
Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, coordinatrice du pôle santé publique de Paris, a confirmé cette analyse : « On a recours aux citations directes pour les vols à la tire ! [...] Les affaires dont je m'occupe représentent des années de travail dont on ne voit pas la fin. C'est donc complètement irréaliste ».
En revanche, la procédure de la citation directe peut être utilisée dans une affaire relative à l'amiante, lorsque la constatation ne suscite pas de difficultés particulières, par exemple s'il est établi que les ouvriers travaillant sur un chantier n'étaient pas suffisamment protégés ou si les dispositions du code du travail sont manifestement violées.
Ainsi, M. Fagny, procureur de la République à Bastia, a fait état devant la délégation de la mission d'une procédure initiée, en 2003, à l'encontre d'un promoteur immobilier, maître d'ouvrage d'un chantier situé près de Bastia. L'inspection du travail a constaté des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail et un défaut d'information des salariés sur le caractère amiantifère du terrain. Les déblais étaient de surcroît transportés dans des camions non bâchés et déversés quelques kilomètres plus loin sans précaution aucune.
L'inspection du travail a d'abord demandé, en référé, l'interruption du chantier, qui lui a été refusée : le juge a ordonné, d'une part, que des expertises soient conduites pour évaluer la présence d'amiante, d'autre part, que des mesures de protection des salariés soient appliquées, sous peine d'astreinte. L'inspection du travail a cependant rapidement constaté que ces mesures de protection n'étaient pas mises en oeuvre par l'entrepreneur et a dressé un nouveau procès-verbal constatant ces infractions. Il s'en est suivi une enquête préliminaire, débouchant sur une citation directe, par le parquet, devant le tribunal correctionnel.
2. La mise en cause de la « loi Fauchon »
a) Rappel sur la loi du 10 juillet 2000
Afin de replacer le débat sur la responsabilité pénale dans son contexte, la mission a entendu une communication de M. Pierre Fauchon qui a rappelé la genèse de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Dans le domaine particulier de l'imprudence, l'auteur des faits n'a pas voulu sciemment commettre une faute mais il a eu un comportement tel qu'il en est résulté un mal pour la victime. L'imprudence engage la responsabilité civile de l'auteur et l'oblige donc à une réparation.
En revanche, il est moins évident qu'elle engage sa responsabilité pénale. En effet, le code pénal considère que, dans une société civilisée, il n'y a pas de délit sans volonté de le commettre. Par exemple, si une blessure a été commise, il faut que l'auteur ait délibérément cherché à blesser pour que cet acte constitue un délit. A l'inverse, en l'absence de cette volonté, et même si la blessure a été causée par une imprudence de l'auteur, il ne s'agit pas d'un délit au sens de la philosophie du droit et de la conscience. Ceci étant, pour contraindre à la prudence, il est nécessaire de considérer que certains faits d'imprudence sont des délits. Dans ces conditions, l'auteur d'une imprudence risque d'être condamné à des amendes ou à de la prison.
Pendant très longtemps, le droit français a considéré qu'une même imprudence mettait en cause la responsabilité civile et la responsabilité pénale de son auteur. Les codes civil et pénal et la Cour de cassation jugeaient que la moindre imprudence, dès lors qu'elle avait la moindre conséquence, incapacité de travail, blessures, homicides, etc., mettait en jeu la responsabilité civile et pénale de l'individu.
Cela n'allait pas sans poser des problèmes qui se sont accentués au fur et à mesure du développement économique. Ainsi, on a vu se multiplier des affaires qui, à la fin du XIX e siècle, étaient très rares mais qui sont aujourd'hui beaucoup plus fréquentes. Ces affaires concernent maintenant les accidents du travail et de la circulation, les accidents dans les cliniques et les hôpitaux ou encore sur les terrains de sport. Des chefs d'entreprise, des maires, des directeurs de colonies de vacances ou des directeurs d'hôpitaux se sont ainsi vu reprocher de ne pas avoir pris certaines mesures qui entraient dans le cadre de leurs fonctions et qui auraient probablement, mais sans certitude, permis d'éviter certains accidents.
Considérant que de telles situations n'étaient plus tenables, la commission des lois du Sénat avait engagé une réflexion sur le sujet dans le cadre d'un groupe de travail, dont M. Pierre Fauchon avait été désigné rapporteur.
Comme celui-ci l'a rappelé, « les défenseurs des maires réclamaient une loi spéciale » en faveur des élus. Or, il n'est naturellement pas possible de voter une loi spécifique, la loi pénale étant égale pour tous.
Comme il l'a expliqué, « il fallait donc une loi générale qui contribue à plus de discernement, non pas en éliminant la responsabilité pénale pour imprudence, mais en faisant en sorte qu'elle soit appréciée de façon spécifique ».
Une première loi a été votée en 1996. Il s'agit de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour faits d'imprudence ou de négligence, qui, pour apprécier la responsabilité pénale de l'auteur de faits qui n'aurait pas accompli les diligences normales, nécessite du juge la prise en compte d'éléments concrets, tels que la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.
M. Pierre Fauchon a considéré que « cette loi n'a cependant pas suffi. Il fallait aller plus loin et donner une définition du délit d'imprudence qui ne soit pas la même que celle de la faute par imprudence ».
C'est ainsi qu'a été élaborée la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, plus connue sous l'appellation de « loi Fauchon », qui a fait l'objet de longs débats parlementaires et de nombreuses modifications au cours de la navette. Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. René Dosière, député, avait proposé que, pour que la responsabilité pénale soit retenue, il fallait être en présence d'une faute d'une exceptionnelle gravité, ce que le Sénat avait jugé trop restrictif.
Cette loi a notamment modifié les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal.
|
Article 121-3 du code pénal
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. |
Ainsi, le comportement de la personne auteur indirect d'un dommage peut être pénalement sanctionné s'il constitue une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que cette personne ne pouvait ignorer.
Dans sa circulaire du 11 octobre 2000, qui précise l'interprétation à donner de la loi du 10 juillet 2000, le garde des Sceaux note que « cette faute pourra ainsi être établie [...] même en l'absence de violation manifestement délibérée, même s'il n'existait qu'une réglementation générale et non particulière, même si cette réglementation n'avait pas pour origine la loi ou un règlement au sens administratif, mais qu'elle provenait d'une circulaire ou du règlement intérieur d'une entreprise, et même, le cas échéant, en l'absence de réglementation écrite préexistante ».
Deux aménagements particuliers ont également été introduits :
- la responsabilité ne s'applique que dans l'hypothèse où il y aurait une relation de causalité indirecte entre l'imprudence et le dommage. M. Pierre Fauchon a rappelé que « la raison de ce choix est extrêmement simple » : « Pour traiter de manière spécifique les accidents de la circulation, nous avons évoqué à part l'hypothèse de la causalité directe, puisqu'il s'agit toujours de causalité directe dans les accidents de la circulation » ;
- la non-application de cette responsabilité aux personnes morales.
b) Les reproches adressés à la loi du 10 juillet 2000
A l'occasion d'un recours devant la juridiction pénale, le juge d'instruction de Dunkerque et la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai se sont appuyés, dans l'ordonnance de non-lieu, sur la « loi Fauchon » pour rejeter les plaintes et clore ainsi l'instruction, un pourvoi en cassation non encore jugé ayant été formé contre ce non-lieu.
Toutefois, cette interprétation a été contestée, au cours de son audition, par Me Philippe Plichon, l'avocat des employeurs dans les procès portant sur l'amiante. Pour lui, la décision des juges de Douai aurait été motivée par plusieurs considérations :
- le témoignage d'un médecin du travail : « L'usine Sollac de Dunkerque, filiale du groupe Usinor, regroupait 10.000 salariés, cinq CHSCT et plusieurs médecins du travail. Celle qui a été entendue à l'audience travaillait dans cette entreprise depuis 1977. Elle connaissait parfaitement le dossier amiante et a tenté de sensibiliser le personnel. Personne ne l'a écoutée. En effet, les salariés ne pouvaient croire qu'ils tomberaient malades 40 ans plus tard. [...] De plus, la direction des relations du travail du ministère n'a pas soutenu ce médecin du travail. Elle n'a jamais reçu d'instructions » ;
- la difficulté rencontrée par le juge d'instruction pour obtenir des informations de la part des inspecteurs du travail : « Le ministère du travail leur avait en effet interdit de répondre sous prétexte d'un quelconque secret. Cette allégation est indiquée dans le dossier. La caisse régionale a finalement fait éclater la vérité. Elle a reconnu n'avoir mené aucune action de prévention jusqu'en 1995. L'employeur n'a donc pas été sollicité » ;
- l'inadéquation des mesures d'empoussièrement : « Le décret d'août 1977 définit la limite à deux fibres par centimètre cube dans l'air. Or les mesures d'ambiance de la sidérurgie font apparaître 0,6 fibre. En effet, un hall d'aciérie compte 80 mètres d'altitude et la ventilation y est très efficace. [...] les mesures d'empoussièrement ne sont pas significatives dans ces halls, ni nulle part ailleurs selon moi. L'employeur ne pouvait se sentir concerné par le décret d'août 1977 puisque ses relevés étaient largement en deçà des limites stipulées » ;
- les syndicats n'auraient pas rempli leur mission : « A l'instar de l'administration, ils n'ont rien entrepris alors qu'ils sont fortement représentés dans les CHSCT de la sidérurgie. [...] La dangerosité était donc identifiée mais les syndicats ne s'en sont pas préoccupés. Ils nous ont expliqué avoir été obnubilés par la silicose et ne pas s'être intéressés à l'amiante ».
M. Michel Parigot, vice président de l'ANDEVA et président du comité anti-amiante de Jussieu, a résumé de la manière suivante les reproches adressés à la loi du 10 juillet 2000 par les associations de victimes 44 ( * ) : « Nous reprochons à cette loi d'aller à l'envers de ce qu'il convenait de faire en matière de bonne gestion des risques. La distinction cause directe/cause indirecte est le principal problème de ce texte de loi. Les juristes interrogés à l'époque se sont du reste prononcés contre une telle séparation qui conduit à une inégalité entre les justiciables. Pour une faute de même importance, la condamnation dépend en définitive du caractère plus ou moins direct de la responsabilité dans le dommage. Cette innovation juridique va à l'encontre du principe de prévention des catastrophes sanitaires pour lesquelles les responsabilités sont précisément indirectes. [...] Selon nous, le fait de rendre plus difficile la recherche des responsabilités indirectes n'est pas seulement une erreur ; c'est une faute du point de vue de la gestion du risque. En matière de catastrophe sanitaire, il est important de pouvoir identifier l'ensemble des responsabilités, directes et indirectes, en les plaçant au même niveau ».
Les représentants de l'ANDEVA rencontrés lors du déplacement d'une délégation de la mission à Dunkerque ont estimé qu'en matière de santé publique, les dommages étaient forcément indirects et les responsables nombreux, voire très nombreux. Dans ces conditions, la « loi Fauchon » interdirait toute poursuite, d'autant plus qu'elle exige une faute caractérisée pour engager la responsabilité. Or, une telle faute serait précisément impossible à démontrer dans l'affaire de l'amiante, tant les acteurs étaient nombreux à s'être trompés.
Ils ont également considéré que la loi du 10 juillet 2000 a des conséquences sur la gestion des risques collectifs. Selon l'ANDEVA, le risque, dans une société aussi complexe que la nôtre, est beaucoup plus difficile à identifier qu'à l'époque de la rédaction du code pénal, les responsabilités étant souvent indirectes. Or la « loi Fauchon », qui a mis un terme à l'instruction des plaintes dans l'affaire de l'amiante, a envoyé un « message terrible » susceptible d'entraîner des conséquences négatives en termes de prévention. La « loi Fauchon » conduirait ainsi à punir davantage l'exécutant que le décideur dans un contexte où des catastrophes sanitaires pourraient se reproduire.
Me Jean-Paul Teissonnière a lui aussi exposé les reproches adressés à la « loi Fauchon » en développant une argumentation relativement proche : « La distinction entre auteur direct et auteur indirect n'est pas pertinente [...] le risque étant - si vous me passez l'expression - que l'auteur direct soit le « lampiste ». Autrement dit, en protégeant, dans une certaine mesure, l'auteur indirect, on a privilégié la condamnation du lampiste ou, en tout cas, on a pris le risque de condamner le lampiste. Je n'étais donc pas partisan d'une distinction entre auteur direct et auteur indirect ».
Il convient pourtant de rappeler, comme l'a indiqué M. Didier Saffar, que, pour l'instant, il n'existe pas encore de décision spécifique de la Cour de cassation faisant le lien entre l'existence de la loi du 10 juillet 2000 et le sort des procédures liées à l'amiante .
La chambre de l'instruction, dans ce cas d'espèce, a clairement dit qu'elle ne condamnait pas parce que la loi était venue mettre des conditions supplémentaires à la responsabilité pénale du chef d'entreprise et, plus généralement, de ceux qui ont une responsabilité indirecte dans la survenance des dommages et des préjudices.
3. La « loi Fauchon » : obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pénale des employeurs ?
a) La question de la modification éventuelle de la « loi Fauchon »
Il convient avant tout de noter que M. Pierre Fauchon ne s'est pas du tout montré hostile, par principe, à une modification de la loi du 10 juillet 2000 s'il était démontré qu'elle constituait un obstacle dans le règlement de l'affaire de l'amiante : « Il est tout à fait certain que, si la loi s'avère mal faite, il faut la corriger. Je serais le premier à proposer de le faire ».
La chancellerie n'envisage toutefois pas, pour l'instant, de modifier la loi du 10 juillet 2000. Ainsi, M. Alain Saffar a estimé que « la loi trouve elle-même un équilibre entre la volonté, d'un côté, de ne pas pénaliser à l'excès la vie sociale, d'une manière générale, qu'elle soit publique ou privée, et tous les comportements et, de l'autre, de faire en sorte que les gens qui sont dans des postes à responsabilités puissent les exercer : ils ont des pouvoirs particuliers pour cela et ils doivent assumer ces responsabilités. La loi trouve un équilibre entre ces deux écueils et il n'est pas envisagé d'en changer pour l'instant ». Au cours de son audition, le garde des Sceaux a réaffirmé cette position.
La loi du 10 juillet 2000 a-t-elle de toute façon besoin d'être modifiée pour permettre l'engagement de la responsabilité des chefs d'entreprise et le déroulement d'un « procès de l'amiante » ? La mission s'interroge.
Me Jean-Paul Teissonnière lui-même, évoquant la décision de la cour d'appel de Douai, qui a fondé le rejet de la plainte sur les dispositions du code pénal issues de la « loi Fauchon », a indiqué : « Je ne pense pas que la « loi Fauchon » interdise les condamnations des responsables dans l'affaire de l'amiante. Elle les rend simplement plus problématiques ». Sur ce point, les avocats des parties sont donc d'accord , Me Philippe Plichon ayant estimé que « affirmer que la « loi Fauchon » interdit de condamner les employeurs est absolument faux ». Il a même ajouté : « Je défends depuis des années des cadres délégataires en matière d'hygiène et de sécurité et je peux vous assurer qu'ils sont toujours aussi souvent condamnés. Depuis le vote de cette loi, aucun arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est favorable à un employeur ».
Me Jean-Paul Teissonnière s'est cependant interrogé sur la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la loi du 10 juillet 2000 à l'affaire de l'amiante, soulignant un problème de non rétroactivité de la loi pénale : « Bien entendu, on peut toujours se dire que, pour toutes les victimes actuelles, d'ores et déjà déclarées, on ferait application du texte de la « loi Fauchon », qui peut être considérée comme une loi pénale plus douce, et que, pour les victimes à venir après la réforme de la « loi Fauchon », on pourrait appliquer la nouvelle loi, plus sévère, mais je n'en suis même pas sûr. En effet, si la Cour européenne des droits de l'Homme était saisie, comme le fait fautif est antérieur à la modification de la loi [...] je ne suis pas sûr que, quand bien même les juridictions françaises appliqueraient la nouvelle loi, la Cour européenne nous interdirait de faire une application rétroactive dans une certaine mesure, compte tenu de l'ancienneté des faits ».
b) L'exigence d'une qualité accrue des instructions
La loi du 10 juillet 2000 a indéniablement rendu nécessaire la conduite d'instructions plus approfondies, ce qui ne peut que servir la cause des victimes.
Les dossiers liés à l'amiante en constituent une parfaite illustration.
Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy a pu parler d'un « travail d'archiviste », citant l'exemple des instructions relatives à l'affaire du sang contaminé ou à celle de l'hormone de croissance. Ce sont des investigations assez lourdes à effectuer, notamment aux Archives nationales et dans les administrations concernées : la direction générale de la santé, la direction des relations du travail, l'INRS, entre autres, pour l'amiante.
Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy a même considéré que « le pénal n'est pas en fait très adapté à ces affaires de santé publique » en raison des règles de la prescription de l'action publique. Par exemple, dans l'affaire de Jussieu, les infractions qui ne sont pas prescrites sont seulement les homicides involontaires, les trois ans de prescription débutant alors à la date du décès, et les blessures involontaires, ces trois ans débutant à partir du dernier certificat médical datant de plus de trois mois.
En outre, « c'est dans le lien de causalité que réside la grande difficulté dans les affaires de santé publique. Il est normal qu'il faille établir un lien de causalité entre un dommage et une faute, mais c'est vraiment difficile comme pour l'amiante de préciser une période de contamination ».
C'est cette instruction plus difficile, car plus exigeante à conduire que Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy visait quand elle a estimé, au cours de son audition, que la « loi Fauchon » constitue « une difficulté supplémentaire dans les affaires de santé publique ».
Elle a d'ailleurs précisé sa pensée : « Sans être trop critique à l'égard de certains collègues, on peut dire qu'il est plus facile de décider qu'il y a application de la « loi Fauchon » du fait d'un lien indirect que de rechercher vraiment la faute caractérisée et la connaissance du risque par l'auteur de la faute. En fait, tout dépend de la qualité de l'instruction. Avant le renvoi devant le tribunal correctionnel, il faut voir si la faute caractérisée a été recherchée, si les éléments des infractions ont été déterminés et si les investigations sur la connaissance du risque ont été faites. En ce qui concerne la connaissance du risque en matière de santé publique, il faut remonter parfois plusieurs dizaines d'années en arrière pour retrouver tous les articles scientifiques et toutes les connaissances qu'un décideur public pouvait avoir de telle pathologie et toutes informations de tel danger pour la santé publique qu'il détenait ».
Mme Martine Aubry, au cours de son audition, a estimé que « les termes « violation délibérée » qui sont dans la loi sont aussi importants que « faute caractérisée » » et a rappelé que « c'est sur ce fondement que la cour d'appel de Douai a dit que l'entreprise Sollac, à Dunkerque, n'avait pas respecté pleinement - c'est le problème de l'appréciation des faits - le décret de 1977, mais qu'elle ne l'avait pas fait de façon délibérée ». Cet exemple conforte l'idée que la loi du 10 juillet 2000 rend nécessaire la conduite d'instructions de meilleure qualité, tant il apparaît évident que, dans l'immense majorité des cas, les employeurs, dans les affaires liées à l'utilisation de l'amiante, n'ont pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Si c'est sur ce terrain que les magistrats entendent établir la responsabilité pénale des employeurs, il paraît presque certain que la plupart des affaires se termineront par un non-lieu.
Il apparaît donc difficile d'affirmer que la loi du 10 juillet 2000 rend impossible tout procès pénal de l'amiante.
c) L'application de la « loi Fauchon » par les juges
Les juges appliquent de manière de plus en plus sévère les nouvelles dispositions du code pénal introduites par la loi du 10 juillet 2000, à l'article 121-3.
Ainsi, lors de sa communication devant la mission, M. Pierre Fauchon a indiqué avoir consulté le site Internet de l'Observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales sur lequel il a trouvé une étude d'un juriste, dont il a lu la conclusion à la mission : « Faut-il y voir un revirement de jurisprudence ? Il est sans doute trop tôt pour en juger et ce d'autant que chaque cas d'espèce a ses particularités et que la Cour de cassation est juge du droit et non du fait. A ce titre, on peut émettre l'hypothèse qu'après une période de familiarisation avec le nouveau texte, les juges du fond sont désormais mieux à même de motiver en droit leurs décisions de façon à éviter une censure de la Cour de cassation. Toujours est-il que si l'on rapprochait ces deux arrêts avec le jugement du tribunal de Bonneville de 2003 condamnant, contre l'avis du parquet, le maire d'une station de ski à la suite d'une avalanche mortelle, on peut se demander si le temps de grâce immédiatement postérieur à la loi Fauchon n'est pas révolu pour les élus. A suivre ».
De même, dans un article récent, intitulé Responsabilité pénale des élus : le retour à la sévérité 45 ( * ) , Mme Marie-France Steinlé-Feuerbach, constatant, à propos de la condamnation du maire à trois mois de prison avec sursis dans l'affaire de l'avalanche qui a dévasté le hameau de Montroc dans la vallée de Chamonix, causant la mort de douze personnes, « un mouvement de « repénalisation » », pose la question : « La loi du 10 juillet 2000 perdrait-elle avec l'écoulement du temps ses effets bénéfiques pour les élus ? ».
Dans cette affaire, en effet, le juge a considéré que la principale erreur du maire avait été de ne pas s'être suffisamment informé de la situation à Montroc. La méconnaissance du risque pesant sur le hameau, ajoutée à la conscience aiguë du risque général d'avalanche sur la vallée - la conscience du danger existait chez les habitants du hameau alors que celui-ci n'était pas pris en compte par le plan d'évacuation -, est un élément de la faute caractérisée.
Le ministère de la justice a étudié l'évolution du nombre de condamnations prononcées par les juridictions pénales en matière d'homicides et de blessures involontaires dans le cadre du travail pour voir si un changement était intervenu après l'intervention de la « loi Fauchon ». Selon M. Alain Saffar, « il y a eu effectivement un décrochage puisque, avant cette loi, il y avait environ 700 condamnations par an et qu'ensuite, on a atteint un point d'équilibre entre 450 et 500 ». Il a toutefois précisé qu'« antérieurement à la loi et au décrochage que j'ai noté, il y avait déjà un mouvement de reflux du nombre de condamnations. Le nombre de condamnations a chuté un peu plus brutalement, mais il y avait déjà un certain reflux, peut-être du fait de mouvements pendulaires ».
Condamnations prononcées à l'encontre de
personnes physiques
pour homicides involontaires et blessures involontaires
délictuelles
commis dans le cadre du travail
|
Ensemble des délits
|
Homicides involontaires seuls |
|
|
1997 |
732 |
230 |
|
1998 |
681 |
191 |
|
1999 |
611 |
184 |
|
2000 |
605 |
187 |
|
2001 |
475 |
127 |
|
2002 |
535 |
149 |
|
2003 |
472 |
138 |
Source : ministère de la
justice ;
direction des affaires criminelles et des
grâces
d) La position de la mission
En ce qui concerne l'amiante, que M. Pierre Fauchon a qualifié de « plus grosse affaire pénale du siècle », un examen attentif des termes de l'article 121-3 du code pénal, en particulier de ses alinéas 3 et 4, ne permet pas, selon la mission, de conclure à un rejet systématique de la responsabilité pénale de toute personne physique 46 ( * ) .
Sans vouloir naturellement se substituer au juge, mais souhaitant préciser l'intention du législateur, la mission considère, aux termes de ses travaux, que certains acteurs de l'affaire de l'amiante pourraient entrer dans le cadre fixé par la loi pour voir leur responsabilité pénale engagée.
Au cours de l'audition des responsables de l'ANDEVA, le 13 avril 2005, M. Pierre Fauchon avait ainsi estimé que, « dans le cas de l'affaire de l'amiante, l'imprudence est du reste plus que caractérisée. En outre, il est précisé que cette imprudence caractérisée expose à « un danger que l'on ne peut ignorer » et non à un danger que l'on connaît. Vous jugerez peut-être cette rédaction insuffisante mais le législateur, en toute bonne foi, a pensé qu'elle induisait pour le responsable l'obligation de savoir », même si, « dans le Nord, il est vrai que les juridictions d'instruction ont décidé qu'elles n'étaient pas en présence d'une imprudence caractérisée ».
Pour la mission, il ne saurait en effet être exclu que certaines personnes physiques, « qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter », soient reconnues responsables pénalement dès lors que le juge, au terme d'une instruction approfondie, par conséquent nécessairement longue, aura établi qu'elles ont, notamment, « commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
Dans cette affaire, en effet, il paraît clair à la mission que certaines personnes physiques ont commis une faute caractérisée et qu'elles n'ignoraient pas les dangers de l'amiante.
La loi du 10 juillet 2000, afin d'empêcher la condamnation d'une personne n'ayant pas été en mesure d'avoir eu connaissance de l'existence d'une situation de danger, exige qu'il soit établi que la personne ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait autrui.
Selon la circulaire du 11 octobre 2000 précitée, « l'exigence posée par la loi sera remplie non seulement lorsqu'il apparaîtra des faits de l'espèce que la personne connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers, mais également lorsque cette personne ne sera pas en mesure de démontrer, malgré les présomptions de fait résultant des circonstances, qu'elle ignorait totalement l'existence d'un tel risque ou qu'elle avait des motifs légitimes de l'ignorer ».
De surcroît, la circulaire précise clairement que la loi du 10 juillet 2000 n'a pas pour conséquence d'écarter automatiquement la responsabilité des employeurs en matière d'accidents du travail, au contraire : « Sauf exception, il semble qu'il faille considérer qu'en matière d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur ou des personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité n'est qu'indirecte, et que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal doivent recevoir application ». « S'agissant par ailleurs de la violation de règles de sécurité, il ne sera le plus souvent pas possible, compte tenu de la nature de ces règles, que la personne chargée de les faire respecter puisse valablement soutenir que cette violation n'exposait pas autrui à un danger d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer. Il en résulte que, dans la plupart des cas, la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de son délégué sera encourue si la faute de ce dernier a indirectement causé un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
Bien entendu, cette appréciation s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal 47 ( * ) .
De ce point de vue, la mission partage l'avis de M. Daniel Boguet, représentant de l'UPA, qui a rappelé que « l'artisan employeur ne dispose pas des mêmes moyens que ceux qui existent dans les grandes entreprises. Or il est soumis aux mêmes obligations de sécurité à l'égard de ses salariés », ajoutant que « la « loi Fauchon » n'a donc pas absous les chefs d'entreprise de toute responsabilité pénale en la matière. Chaque situation doit simplement faire l'objet d'un examen attentif par la juridiction pénale, qui doit apprécier, en application des nouvelles dispositions, si l'effet reproché entre dans les limites fixées par la loi ». Tout est dit !
Il n'en demeure pas moins que, même si la loi du 10 juillet 2000, pour la mission, n'empêche pas d'engager la responsabilité pénale d'un employeur dans une affaire liée à l'amiante, le traitement judiciaire de ce type d'affaires est rendu plus difficile par la modestie des moyens dont dispose la justice pour les instruire.
4. La faiblesse des moyens alloués au traitement pénal
La durée des informations judiciaires ouvertes s'explique, selon le garde des Sceaux, M. Pascal Clément, « par les difficultés propres aux dossiers liés à l'amiante qui tiennent à l'ampleur des investigations policières, recherche des documents d'époque et des témoignages, et à la complexité des expertises médicales ». Elle est aussi liée à la faiblesse des moyens affectés au traitement pénal de ces dossiers.
Le pôle santé publique constitué au sein des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille - il existe un pôle santé « parquet » et un pôle santé « siège » - a été créé par la loi, dite « loi Kouchner », du 4 mars 2002.
A Paris, les affaires de santé publique ont été regroupées à l'annexe du pôle financier, rue des Italiens, au moment de la mise en place du pôle santé au tribunal de grande instance de Paris, en septembre 2003. La section du parquet qui se trouvait dans les locaux de cette annexe financière était compétente, notamment, pour les fraudes, les infractions à la consommation, le droit du travail et le droit de l'environnement, et a conservé ces compétences en y ajoutant toutes les affaires de responsabilité médicale individuelle et collective traitées jusqu'alors au Palais de Justice. Le dossier de l'amiante à Jussieu fait partie de ces anciennes compétences et était donc traité, avant la création du pôle de santé, par un juge financier.
M. Dominique Perben, lorsqu'il était garde des Sceaux, avait souhaité que puissent être regroupées les affaires concernant l'amiante auprès des pôles santé publique de Paris et Marseille.
Jusqu'à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « loi Perben II », entrée en application, sur ce point, le 1 er octobre 2004, il n'était pas possible de procéder au regroupement auprès des pôles santé parce que, jusque là, ceux-ci étaient compétents en matière de produits de santé ou de produits destinés à l'alimentation. L'amiante n'était donc pas concerné. Désormais, la loi du 9 mars 2004 vient étendre la possibilité de saisine des pôles santé, dans ce cas précis, aux produits qui exposent durablement la santé de l'homme à des dommages.
Lors de l'audition de M. Alain Saffar, le 11 mai 2005, les instructions venaient d'être données pour qu'il soit procédé à des regroupements auprès des pôles santé de Paris et de Marseille. On notera que Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, pourtant responsable du pôle de Paris, n'avait pas été mise au courant préalablement de cette décision ministérielle ! C'est la mission qui la lui a apprise...
Ainsi, la décision de regroupement s'est traduite par la circulaire adressée le 12 mai 2005 par la direction des affaires criminelles et des grâces aux procureurs généraux. Il leur est demandé de prendre les réquisitions nécessaires au transfert vers les pôles de santé publique compétents de l'ensemble des procédures concernant les expositions à l'amiante.
La mission approuve un tel regroupement auprès des pôles de santé publique, ce qui implique qu'ils disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leur mission.
Ces pôles, en effet, ne bénéficient que de faibles moyens, presque dérisoires compte tenu de l'ampleur des instructions à mener.
Ainsi, Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, au cours de son audition, a rappelé que ce pôle ne disposait que de trois juges d'instruction et de sept substituts. Et encore un des trois juges d'instruction a conservé un grand nombre d'affaires d'escroqueries et d'abus de confiance dont il était déjà saisi, tandis que les affaires de santé publique et de responsabilité médicale n'ont donné lieu à la création que d'un seul poste de substitut supplémentaire.
La faiblesse de ces moyens a également été soulignée par les représentants de l'Association nationale des accidentés de la vie (FNATH), pour laquelle les affaires relatives à l'amiante nécessiteraient, à elles seules, des moyens supérieurs à ceux actuellement affectés au pôle de Paris.
Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy a estimé que l'instruction de cette affaire allait représenter « un travail colossal ».
Rien que dans le dossier de l'amiante de Jussieu, plus de cent victimes ont déposé une plainte, ce qui implique autant de saisies de dossiers médicaux, d'expertises médicales, le cas échéant de contre-expertises et d'établissement des liens de causalité entre les pathologies et l'amiante et entre ces pathologies et les fautes susceptibles d'être relevées.
Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy n'a pas caché son inquiétude : « Il faudra relier une contamination avec tel responsable pendant telle période. Et comment déterminer la période de contamination ? Il faut savoir que nous sommes déjà très chargés à Paris avec de nombreuses autres affaires de santé publique, par exemple Tchernobyl, la vache folle, l'hormone de croissance. Ce sont des dossiers difficiles de par le nombre de victimes et l'ampleur des investigations. Nous n'avons pas de moyens suffisants ».
A cet égard, elle a tenu à rappeler qu'« avant la création du pôle santé, il y avait deux groupes de sept officiers de police judiciaire (OPJ) à la brigade de police spécialisée alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul groupe avec quatre OPJ. C'est vraiment catastrophique ! ». Ainsi, la commission rogatoire de l'amiante n'est même pas attribuée à un OPJ depuis plusieurs mois, dans la mesure où celui qui en était chargé est devenu chef de service et ne fait plus de procédure.
Le garde des Sceaux, M. Pascal Clément, a indiqué que « les besoins matériels de renforcement des effectifs de magistrats et fonctionnaires nécessaires à la mise en place de ces deux pôles de santé ont fait l'objet d'une évaluation dès l'année 2003 à la suite de laquelle les postes ont été créés et pourvus ». Selon lui, « les deux juridictions spécialisées sont donc parfaitement en mesure de mener des enquêtes, d'ouvrir des dossiers d'information ou de recueillir les dossiers les plus complexes sur dessaisissement d'autres tribunaux ».
Du reste, « il existe un écart entre Paris et Marseille » a indiqué le ministre. Actuellement, six magistrats du parquet, trois juges d'instruction et quatre assistants spécialisés, soit deux médecins inspecteurs de la santé publique, un inspecteur de la santé publique vétérinaire et un pharmacien inspecteur de la santé publique, sont en charge des quinze procédures en cours dans le pôle de Paris. Le pôle de Marseille monte en puissance. Pour le moment, une procédure lui a été transmise. Aujourd'hui, ce pôle compte un magistrat spécialisé, tandis que deux assistants, soit un médecin inspecteur de la santé publique et un inspecteur de la santé publique vétérinaire, vont renforcer cette structure à partir du 1 er septembre 2005.
DEUXIÈME PARTIE - MIEUX RÉPARER : LE SUIVI MÉDICAL ET L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Après la décision, prise en 1996, d'interdire l'amiante, la nécessité de réparer le préjudice subi par les victimes s'est rapidement imposée comme une exigence incontournable. Elle s'est traduite, dès 1999, par la mise en place d'un dispositif spécifique de préretraite destiné à compenser la perte d'espérance de vie des personnes contaminées. Puis un dispositif dérogatoire au droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) a été institué pour garantir une indemnisation intégrale de leur préjudice.
Dans un contexte de restriction de l'accès aux préretraites, et alors que la réparation des maladies professionnelles est habituellement forfaitaire, ces caractéristiques traduisent bien l'originalité du système d'indemnisation des victimes de l'amiante.
En dépit d'une forte augmentation de ses dépenses, il ne donne cependant pas encore entièrement satisfaction aux victimes, ce qui conduit à s'interroger sur le ciblage de certaines mesures, ou sur le montant des réparations accordées. Plus généralement, il nous invite à réfléchir à une possible évolution des modalités de réparation des risques professionnels.
I. L'AMPLEUR DU DRAME DE L'AMIANTE A CONDUIT À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU PROFIT DES VICTIMES
Avant d'aborder les questions relatives à l'indemnisation des victimes, qui constitueront l'essentiel des développements ci-après, il convient d'évoquer le suivi médical dont bénéficient les anciens salariés de l'amiante. Les personnes exposées à des substances cancérigènes bénéficient en effet d'une surveillance particulière, qui se justifie par leur probabilité plus élevée de développer une pathologie grave et par l'intérêt qu'il y a, sur le plan thérapeutique, à effectuer un diagnostic précoce. De plus, le recensement des personnes ayant été exposées à l'amiante, et ayant éventuellement développé des pathologies, est un préalable nécessaire à la mise en oeuvre des mécanismes de réparation.
A. LE SUIVI MÉDICAL POST-PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE
Depuis une dizaine d'années est organisé un suivi médical des anciens salariés exposés à des substances cancérigènes au cours de leur carrière. Des dispositions particulières s'appliquent aux anciens salariés de l'amiante qui bénéficient ainsi de garanties renforcées.
1. Des garanties légales renforcées pour les anciens travailleurs de l'amiante
L'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, issu d'un décret n° 93-644 du 26 mars 1993 modifié en 1995, institue, au profit de l'ensemble des salariés ayant été exposés au cours de leur carrière à des agents cancérogènes, un droit à une surveillance médicale post-professionnelle . Cette surveillance médicale est accordée sur présentation d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et par le médecin du travail. Son organisation est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à laquelle est rattaché le bénéficiaire et les dépenses imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
Pour faciliter la mise en oeuvre de ce droit, le décret n° 96-98 du 7 février 1996 est venu préciser les obligations incombant aux employeurs, dans les secteurs de la fabrication et de la transformation de matériaux contenant de l'amiante ou du retrait et du confinement de l'amiante. Afin de disposer de données sur les expositions passées, le dossier médical des salariés ayant inhalé des poussières d'amiante doit être conservé pendant quarante ans après que l'exposition a cessé, exigence qui tient compte de la très longue période de latence de plusieurs maladies de l'amiante. Au moment du départ en retraite du salarié, son dossier est confié à l'inspection médicale régionale du travail. Ce même décret précise qu'une attestation d'exposition, remplie par l'employeur et le médecin du travail, doit être remise par l'employeur au salarié lorsqu'il quitte l'établissement où l'exposition a eu lieu.
L'annexe II du décret indique que la surveillance médicale proposée consiste en un examen clinique effectué une fois tous les deux ans, complété par un examen radiologique du thorax et, éventuellement, par une exploration fonctionnelle respiratoire.
2. Une mise en oeuvre à améliorer
Si le cadre juridique de cette surveillance post-professionnelle apparaît satisfaisant, les auditions auxquelles a procédé la mission ont suggéré que leur mise en application s'avérait déficiente.
En premier lieu, elle note que la décision de se soumettre à ce suivi est facultative et qu'elle est laissée à l'initiative du salarié. Sans doute en raison d'un défaut d'information, on observe que le recours à ce dispositif est très peu fréquent, alors que son apport apparaît évident en termes de prévention. Les représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) ont noté qu'une dizaine seulement de demandes de suivi post-professionnel étaient recensées chaque année dans la région.
Une enquête réalisée par l'Institut de veille sanitaire (InVS) 48 ( * ) confirme que seule une faible proportion des salariés exposés à l'amiante au cours de leur carrière a ensuite recours au suivi post-professionnel. Pour les besoins de cette étude, l'InVS a sélectionné six CPAM-tests (Côtes d'Armor, Haut-Rhin, Loiret, Nord, Paris, Vienne) qui ont élaboré une méthode de recherche active des retraités ayant pu être exposés professionnellement à l'amiante, afin de les informer de leurs droits et de les accompagner dans leurs démarches administratives. L'InVS montre que l'application de cette procédure simple a permis de multiplier par 17 le nombre de prises en charge par rapport à un échantillon de CPAM témoins. Cette enquête a également permis d'évaluer à plus du quart (27,6 %) le pourcentage de retraités masculins ayant été exposés à l'amiante au cours de leur carrière .
En outre, l'InVS note que « seules les grandes entreprises nationales et les secteurs de la transformation de l'amiante ont mis en place des systèmes formalisés d'information de leurs retraités, alors que c'est dans des secteurs économiques très divers, comme la métallurgie, le BTP, les services, la production d'engins, la mécanique automobile, qu'on trouve la plus grande proportion d'exposés ».
Par ailleurs, des représentants des salariés, ainsi que des médecins du travail, ont, à plusieurs reprises, attiré l'attention de la mission sur la réticence de certains chefs d'entreprise à délivrer l'attestation d'exposition qu'ils sont pourtant tenus de remettre au salarié lorsqu'il quitte l'établissement qui l'emploie. M. Albert Lebleu, vice-président d'une association d'anciens salariés de l'entreprise Métaleurop Nord, a ainsi souligné « que peu de gens seulement disposent d'attestations d'exposition en bonne et due forme, signées par le médecin et par l'employeur ». Ce constat a été confirmé par les médecins du travail rencontrés par la mission lors de son déplacement à Dunkerque : ils ont estimé que la législation était mal appliquée et affirmé que certains médecins avaient parfois dû établir, de leur propre initiative, un certificat en faveur d'un salarié, ou signé un certificat établi par le salarié lui-même. Il semble que cette réticence de certains employeurs s'explique par leur volonté de ne pas donner au salarié un document qui pourrait ensuite être utilisé à leur encontre dans le cadre d'une procédure judiciaire, motivée par un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par exemple.
Les associations de victimes rencontrées par la mission ont également regretté que les anciens salariés de l'amiante bénéficient trop rarement d'examens au scanner , plus précis que les simples examens radiologiques, et que les recommandations de la « conférence de consensus » de 1999 ne soient pas toujours appliquées.
En 1999, une « conférence de consensus » , rassemblant de nombreux spécialistes, s'est en effet tenue à Paris, sous l'égide de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé (ANAES), pour élaborer des recommandations en matière de surveillance médicale clinique des personnes exposées à l'amiante. Elle s'est prononcée en faveur de bilans périodiques, plus ou moins fréquents selon l'intensité de l'exposition, et comportant dans certains cas un « examen tomodensitométrique thoracique », c'est-à-dire un examen au scanner. Elle recommande, par exemple pour les personnes fortement exposées à l'amiante, un examen tomodensitométrique une fois tous les six ans.
Dans ce contexte, le ministère en charge du travail et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ont décidé d'engager, depuis la mi-2003, une expérimentation dans trois régions (Aquitaine, Normandie et Rhône-Alpes) afin d'améliorer la procédure de suivi post-professionnel.
Les promoteurs de cette initiative poursuivent deux objectifs principaux : d'une part, promouvoir le dispositif auprès de ses bénéficiaires potentiels, d'autre part, évaluer l'apport du scanner dans la découverte des maladies liées à l'amiante. Pour ce faire, les personnes potentiellement concernées par une exposition à l'amiante reçoivent un courrier de leur CPAM, qui les informe de l'existence du dispositif et leur demande de remplir un questionnaire d'évaluation de l'exposition à l'amiante. Si cette exposition est avérée, la caisse adresse au patient un ensemble de documents devant être complétés par les professionnels de santé amenés à réaliser le protocole de surveillance. Ce protocole comprend une consultation initiale chez un généraliste ou un spécialiste, une exploration fonctionnelle respiratoire, une radiographie pulmonaire, un scanner et une consultation de synthèse.
L'évaluation des résultats de cette expérimentation devrait être rendue publique dans le courant du second semestre 2005.
Même si la mission ne dispose pas encore des éléments d'appréciation supplémentaires que fournira cette évaluation, il lui paraît souhaitable qu'un important effort d'information soit mené pour faire connaître le droit au suivi post-professionnel et encourager les salariés à y adhérer, afin de redonner au dispositif toute sa portée. Une première information pourrait être donnée par l'employeur, au moment où le salarié quitte l'établissement, puis serait complétée par des campagnes périodiques menées par les CPAM auprès des populations potentiellement concernées. Il conviendra, de plus, d'évaluer avec précision l'apport des examens par scanner, afin d'affiner les recommandations de la conférence de consensus de 1999. Enfin, une procédure nouvelle doit être imaginée pour pallier la mauvaise volonté des employeurs qui refusent de signer une attestation d'exposition, en violation de leurs obligations légales. L'intervention de l'inspecteur du travail pourrait par exemple être recherchée pour qu'il supplée l'employeur dans ce cas de figure. Assortir cette obligation d'une possibilité de sanction aurait sans doute aussi un caractère dissuasif.
L'objet de la surveillance médicale est de détecter d'éventuelles pathologies provoquées par l'amiante. La gravité de certaines de ces pathologies a été rappelée dans la première partie de ce rapport : un mésothéliome réduit l'espérance de vie du patient à environ dix-huit mois. C'est pourquoi la première réponse apportée par les pouvoirs publics au drame de la contamination par l'amiante a consisté en la mise en place d'un dispositif spécifique de préretraite, destiné à compenser la perte d'espérance de vie des personnes exposées.
B. UN RÉGIME DE PRÉRETRAITE PROPRE AUX VICTIMES DE L'AMIANTE : LE FCAATA
Un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il est organisé autour d'un fonds, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui finance l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ainsi que les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire de ses bénéficiaires.
1. Le principe du régime
Le FCAATA est assimilable à un régime de préretraite. Il vise à compenser la perte d'espérance de vie à laquelle sont confrontées, statistiquement, les personnes contaminées par l'amiante. Lors de l'audition de l'ANDEVA, M. André Letouzé, un des administrateurs de l'association, a, par exemple, indiqué que, dans la ville de Condé-sur-Noireau, particulièrement exposée aux poussières d'amiante, l'espérance de vie moyenne n'était plus que de 58 ans. La possibilité qui est offerte aux personnes exposées de partir en préretraite constitue une première forme de compensation.
2. L'organisation du fonds
Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 définit les modalités d'organisation du FCAATA, fonds ad hoc ne disposant pas de la personnalité juridique. Comme le note la Cour des comptes, « le dispositif qui en résulte est complexe » 49 ( * ) , la gestion du fonds étant partagée entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC), d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), d'autre part.
L'établissement de Bordeaux de la CDC remplit les fonctions suivantes :
- il perçoit la contribution de l'État au fonctionnement du FCAATA, qui consiste en une fraction des droits sur le tabac ;
- il verse aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) les cotisations dues par les bénéficiaires de l'ACAATA ;
- il verse, deux fois par an, à la branche AT-MP de la CNAMTS son solde semestriel des opérations sur le FCAATA s'il est positif, ou procède, dans le cas contraire, à un appel de fonds auprès d'elle.
Pour sa part, la branche AT-MP :
- gère les dossiers d'admission par l'intermédiaire des CRAM et verse l'ACAATA à ses bénéficiaires, après en avoir déduit les cotisations maladie et les contributions sociales CSG et CRDS ;
- verse à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) les cotisations d'assurance volontaire vieillesse dues par les salariés non agricoles bénéficiaires de l'ACAATA ;
- avance au FCAATA les financements nécessaires dans la limite de la contribution prévue en loi de financement de la sécurité sociale.
La CDC assure par ailleurs le secrétariat du conseil de surveillance 50 ( * ) du fonds et retrace une partie des opérations comptables, le solde étant traité par la CNAM/AT-MP et par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Après avoir dressé ce tableau complexe, la Cour des comptes indique qu'une simplification bienvenue pourrait être opérée en transférant à la sécurité sociale le soin de réaliser les opérations actuellement confiées à la Caisse des dépôts.
La mission a interrogé sur ce point Mme Marianne Lévy-Rozenwald, conseiller-maître à la Cour des comptes et présidente du conseil de surveillance du FCAATA, lors de son audition. Elle a d'abord expliqué que le choix de faire intervenir la CDC résultait apparemment surtout d'une volonté de ne pas donner l'impression que l'ACAATA était une nouvelle prestation de sécurité sociale. La préoccupation des pouvoirs publics était sans doute d'éviter que des demandes de généralisation d'un tel dispositif à l'ensemble des assurés sociaux ne se fassent jour. Elle a ensuite estimé que « l'on pourrait sortir la Caisse des dépôts du système sans inconvénient » et que cela « serait une simplification bénéfique ».
La mission ne peut qu'approuver ces observations et soutient la proposition de la Cour, qui permettrait d'économiser les frais de gestion résultant de l'intervention de la Caisse des dépôts. Ils s'élèvent, d'après le dernier rapport annuel du FCAATA, à 111.534 euros pour l'exercice 2004.
3. Les bénéficiaires de l'ACAATA
Plusieurs conditions doivent être remplies pour avoir droit au versement de l'ACAATA.
Le demandeur doit tout d'abord appartenir à l'une des trois grandes catégories de bénéficiaires visées par la loi :
- les salariés ou anciens salariés d'établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (liste 1) : il s'agit d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et d'établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;
- les salariés ou anciens salariés d'établissements de réparation ou de construction navale figurant sur une liste, établie par arrêté des mêmes ministres, et exerçant certains métiers figurant dans le même arrêté, les ouvriers dockers de certains ports et le personnel portuaire assurant la manutention (liste 2) ;
- les salariés ou anciens salariés du régime général ou du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité (asbestose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire, tumeur pleurale bénigne et plaques pleurales).
Outre l'appartenance à l'une de ces catégories, un salarié ou ancien salarié doit être âgé d'au moins cinquante ans pour pouvoir bénéficier de l'ACAATA. Il doit accepter de démissionner de son emploi s'il est encore salarié. Le versement de l'allocation s'interrompt dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein.
4. Le montant de l'allocation
Il est fixé par l'article 2 du décret n° 99-241 du 29 mars 1999 et équivaut à :
- 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale (soit 2.516 euros par mois en 2005) ;
- 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond.
Le salaire de référence correspond à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée. Ces rémunérations sont prises en compte dans la limite du double du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date d'ouverture du droit à l'allocation. Le montant de l'ACAATA ne peut être inférieur au montant journalier de l'allocation d'assurance chômage (soit 25,01 euros par jour), ni excéder 85 % du salaire de référence.
Les représentants des associations de victimes et des syndicats de salariés auditionnés par la mission se sont plaints du montant, jugé trop faible, de l'allocation. M. André Letouzé, administrateur de l'ANDEVA, a par exemple souligné « la faiblesse du niveau de l'allocation pour les ouvriers les moins qualifiés », estimant que « les sommes qui leur sont aujourd'hui octroyées dans le cadre de l'allocation de cessation d'activité ne leur permettent pas de vivre ». M. Yves Bongiorno a indiqué, au nom de la CGT, que le taux de remplacement de 65 % était « nettement insuffisant pour les petits salaires ». Le docteur Bernard Salengro, représentant la CFE-CGC, a quant à lui jugé « très limité » le niveau de rémunération offert par l'ACAATA aux anciens salariés de l'encadrement, en raison des mécanismes de plafonnement qui viennent d'être décrits.
Si la mission est favorable à une revalorisation du montant de l'ACAATA, elle constate cependant que le rythme actuel de l'augmentation des dépenses du FCAATA ne laisse que peu de marges financières pour procéder à une telle revalorisation. Elle est également sensible à l'argument de Mme Marianne Lévy-Rozenwald qui insistait sur la nécessité de maintenir un écart suffisant entre l'allocation et le salaire de référence, sous peine d'encourager des demandes abusives 51 ( * ) .
5. Les autres dispositifs de cessation anticipée d'activité
Une grande entreprise publique et des administrations de l'État ont mis en place des dispositifs de cessation anticipée d'activité, afin de pallier l'impossibilité dans laquelle se trouvent leurs agents de bénéficier du FCAATA, qui n'est accessible qu'aux salariés affiliés au régime général ou au régime agricole.
? La SNCF a ainsi mis en place un dispositif particulier de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante à la fin de l'année 2001.
? Au sein du ministère de la défense, un dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'exposition à l'amiante existe pour les ouvriers d'État, en application du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001.
L'article 96 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 institue un dispositif analogue au profit des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales du ministère de la défense et au profit des fonctionnaires et contractuels du même ministère reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Ce dispositif n'est pas encore entré en vigueur dans l'attente de la publication d'un décret en Conseil d'État qui doit en préciser les modalités d'application.
? L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) s'est également doté, depuis 2003, d'un dispositif de cessation anticipée d'activité.
En 2003, les prestations versées par ces différents employeurs se sont élevées à plus de 500 millions d'euros.
Outre la réduction de leur espérance de vie, les victimes de l'amiante subissent souvent d'autres préjudices considérables : incapacité de poursuivre une carrière professionnelle, souffrances physiques et psychologiques, perte de bien-être pour le malade comme pour ses proches, etc. Dans ces conditions, la réparation forfaitaire offerte par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale est rapidement apparue insuffisante, ce qui a motivé la création d'un fonds d'indemnisation, destiné à assurer aux victimes, dans des délais rapides, une réparation intégrale de leur préjudice.
C. LE CHOIX DE LA RÉPARATION INTÉGRALE ET LA CRÉATION DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
Un bref rappel des règles d'indemnisation de droit commun des accidents du travail et des maladies professionnelles s'impose pour comprendre l'originalité du dispositif d'indemnisation des pathologies provoquées par l'amiante. Ces règles d'indemnisation de droit commun reposent sur un « compromis historique », arrêté en 1898. Longtemps perçu comme favorable aux salariés, il est toutefois paru inadapté dans le cas du drame de la contamination par l'amiante.
1. Les règles de droit commun en matière de réparation des maladies professionnelles
La très grande majorité 52 ( * ) des contaminations par l'amiante étant intervenues dans un cadre professionnel sont, de ce fait, redevables d'une indemnisation par la branche AT-MP de la sécurité sociale.
Le système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur le « compromis » suivant : en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire , le salarié est dispensé d'avoir à démontrer la faute de l'employeur pour obtenir réparation. Toute maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est ainsi présumée d'origine professionnelle. Les tableaux 30 et 30 bis de la sécurité sociale sont relatifs aux maladies de l'amiante. De même, un accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle, sans que le salarié n'ait à établir la faute de l'employeur.
La victime perçoit des indemnités journalières et, le cas échéant, une rente si la maladie entraîne une incapacité permanente totale ou partielle.
En principe, le salarié n'a pas la possibilité d'agir en justice contre l'employeur pour obtenir réparation de la totalité du préjudice (principe d'immunité de l'employeur). Ce principe connaît cependant quelques exceptions : en cas de faute inexcusable de l'employeur , un recours en justice peut permettre d'obtenir une réparation complémentaire et une majoration de rente ; en cas de faute intentionnelle, le salarié peut exercer un recours de droit commun.
2. Les missions du FIVA : assurer une réparation intégrale et rapide du préjudice subi par les victimes de l'amiante
L'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a institué le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). L'exposé des motifs du projet de loi indique que le FIVA a été créé « afin que les victimes et leurs familles puissent obtenir une réparation intégrale en évitant des procédures longues et difficiles ». Beaucoup de victimes engageaient en effet des actions en justice pour percevoir une indemnisation supérieure à la réparation forfaitaire accordée par la branche AT-MP.
Mme Martine Aubry, même si elle n'était plus membre du Gouvernement au moment où la loi a été votée, est à l'origine de la création de ce fonds. Elle a indiqué avoir beaucoup travaillé alors avec l'ANDEVA et souligné la célérité avec laquelle le projet a été élaboré : « Les premières études concrètes de faisabilité de ce fonds, notamment de son financement, ont été menées en juin 2000 et, le 2 août, j'ai écrit au Premier ministre pour l'informer de mon souhait de voir se créer ce Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. L'article de loi qui l'a créé était au JO quatre mois plus tard. Nous n'avons pas perdu de temps parce que [...] nous pensions qu'il y avait urgence ».
Comme l'ont reconnu les dirigeants du FIVA lors de leur audition, la mise en place du fonds fut, en revanche, plus lente et laborieuse : il s'est écoulé plus de deux ans entre le moment où le principe de sa création a été adopté (décembre 2000) et la date des premiers versements définitifs (avril 2003). La parution du décret nécessaire à l'application de la loi n'est intervenue que dix mois après sa promulgation, six mois supplémentaires se sont écoulés avant que ne se tienne la première réunion du conseil d'administration, qui est parvenu à un accord sur un barème indicatif d'indemnisation après neuf mois de discussion.
Dans l'attente de la mise en place du FIVA, l'instruction des demandes d'indemnisation fut confiée au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA), en application d'une convention conclue en juin 2002 entre le FIVA et cet organisme. Ce choix, qui peut surprendre à première vue, est en réalité assez logique, puisque le FGA gère déjà plusieurs fonds d'indemnisation (des victimes d'actes de terrorisme depuis 1986, des victimes d'infractions depuis 1991, des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du sida depuis 1992) et dispose donc d'une grande expérience en la matière. Au total, 6.600 dossiers ont été traités par le FGA.
a) L'organisation du FIVA
Le FIVA jouit d'un statut d' établissement public administratif .
Le choix de ce mode d'organisation a été défendu par le président de son conseil d'administration, M. Roger Beauvois, lors de son audition par la mission : il a estimé que la gravité du drame de l'amiante et le nombre de dossiers à traiter plaidaient pour un « dispositif autonome qui ne soit pas animé des seuls réflexes d'assureurs ». Il est vrai que la présence des représentants des associations de victimes au sein du conseil d'administration du FIVA garantit que les intérêts de ces dernières seront pris en considération.
La Cour des comptes, dans son rapport 53 ( * ) remis à la commission des affaires sociales du Sénat, regrette que la voie d'une gestion du FIVA par un organisme d'indemnisation déjà existant n'ait pas été davantage explorée, estimant que cela aurait permis de réaliser des économies de gestion. Elle considère qu'aucun des arguments avancés par le FIVA pour justifier la création d'un établissement public distinct n'est véritablement décisif.
Confier l'indemnisation des victimes de l'amiante à un fonds existant, le FGA par exemple, aurait cependant imposé à ce dernier d'effectuer des recrutements importants pour faire face à l'afflux des dossiers. Les économies de gestion envisageables auraient donc été, en tout état de cause, fort limitées et auraient eu pour inconvénient une moindre lisibilité du dispositif pour le grand public, en raison de l'absence de spécialisation du fonds. Les dépenses de gestion administrative du FIVA représentent, en tout état de cause, moins de 1 % de son budget total en 2004, soit cinq millions d'euros sur 505 millions.
Par ailleurs, le FIVA s'est engagé, depuis deux ans, dans une démarche volontaire de mutualisation de ses moyens avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ce qui devrait être source d'économies de gestion. Cette démarche concerne non seulement des équipements (locaux, matériel informatique, équipements de bureau), mais aussi des membres du personnel (accueil, informatique, agence comptable).
Le FIVA est dirigé par un conseil d'administration composé de vingt-deux membres : cinq représentants de l'État, huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS (trois représentants des employeurs, cinq des salariés), quatre représentants des organisations d'aide aux victimes de l'amiante, quatre personnalités qualifiées (dont le directeur de la CNAMTS et un membre de l'IGAS). Il est présidé par un magistrat, nommé par décret, et choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers, en activité ou honoraires, à la Cour de cassation.
Les auditions auxquelles a procédé la mission ont révélé que le fonctionnement du conseil d'administration était souvent difficile , ce que confirme le rapport de la Cour des comptes. Il n'existe pas de majorité de gestion claire à l'intérieur de cette instance, alors qu'elle dispose de compétences étendues pour définir la politique d'indemnisation du fonds, mais aussi pour connaître de dossiers individuels lorsque ceux-ci sont susceptibles « d'avoir un retentissement particulier ou un impact financier important sur le fonds » 54 ( * ) . De forts conflits d'intérêt s'y expriment, opposant notamment les représentants des employeurs, qui sont les principaux « financeurs » du fonds, aux représentants des associations de victimes. Ils sont tranchés par les personnalités qualifiées ou par le président, ainsi placés en position d'arbitre. Ce manque de sérénité nuit à l'efficacité du fonds, comme l'illustre l'adoption tardive du barème d'indemnisation, due aux divisions à l'intérieur du conseil ; le barème fut finalement adopté à une voix de majorité (dix contre onze), ce qui explique qu'il ne possède qu'une faible légitimité aux yeux de certains membres du conseil d'administration et que les associations de victimes encouragent fréquemment leurs adhérents à contester en justice les offres d'indemnisation du FIVA. Il arrive également que les ministères de tutelle (santé et finances) refusent d'approuver des décisions du conseil d'administration.
b) La réparation intégrale offerte par le FIVA
Le FIVA a pour mission d'assurer la réparation intégrale du préjudice supporté par les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante ou qui ont été directement exposées à l'amiante en France.
Le principe de la réparation intégrale consiste à indemniser la victime de manière à la replacer dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit . En conséquence, doivent être pris en compte :
- les préjudices patrimoniaux (ou économiques) : indemnisation de l'incapacité fonctionnelle, du préjudice professionnel (perte de gains) et de tous les frais induits par la pathologie laissés à la charge de la victime ;
- les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) : préjudice moral et physique, préjudice d'agrément, préjudice esthétique.
Dans 95 % des cas, les victimes de l'amiante sont reconnues atteintes de maladie professionnelle et bénéficient donc d'une prise en charge par la branche AT-MP. Dans ce cas, le FIVA fait la somme des préjudices au titre de la réparation intégrale, puis en déduit l'ensemble des sommes versées par la sécurité sociale.
S'il n'y a pas eu reconnaissance de maladie professionnelle, le FIVA accorde l'indemnisation si la maladie dont est atteinte la victime figure sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. A défaut, il est encore possible d'obtenir une indemnisation si le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante est reconnu par la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante 55 ( * ) .
Le montant de l'indemnisation est évalué à l'aide d'un barème indicatif , qui vise à favoriser un traitement égal de l'ensemble des demandes. Il n'est qu'indicatif, dans la mesure où, dans un système de réparation intégrale, il est nécessaire de prendre en compte de manière spécifique les préjudices de chaque victime. Une offre d'indemnisation ne peut donc résulter de l'application automatique d'un barème.
Deux critères déterminants sont utilisés pour évaluer le montant de l'offre d'indemnisation :
- la pathologie dont est atteinte la victime et son degré de gravité mesuré suivant un barème médical d'incapacité ;
- l'âge de la victime au moment de la constatation du dommage.
Pour fixer l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle, le FIVA détermine d'abord un taux d'incapacité à partir d'un barème médical indicatif. Ce barème médical prend en compte les caractéristiques des différentes pathologies associées à l'amiante. Puis le montant de l'indemnisation est calculé en affectant une valeur de point au taux d'incapacité. La valeur du point n'est pas proportionnelle au taux d'incapacité mais évolue de manière progressive ( cf. tableau ). L'indemnisation est, en principe, servie sous forme de rente dès lors que son montant annuel est d'au moins 500 euros.
(en euros)
|
Taux d'incapacité |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
Rente FIVA (valeur 2004) |
406 |
855 |
1.346 |
1.880 |
2.457 |
3.077 |
3.739 |
4.445 |
5.193 |
5.983 |
|
Taux d'incapacité |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
|
Rente FIVA |
6.817 |
7.693 |
8.611 |
9.573 |
10.577 |
11.624 |
12.714 |
13.817 |
15.022 |
16.240 |
Source : FIVA
Après avoir pris en compte les autres préjudices patrimoniaux, le FIVA évalue le préjudice personnel :
- le préjudice moral représente la composante principale de l'indemnisation extrapatrimoniale et tient compte de l'impact psychologique des pathologies, en fonction de leur gravité et de leur évolution probable ;
- pour l'évaluation du préjudice physique (douleur), le barème définit une valeur de référence suivant la gravité de la pathologie, puis l'indemnisation peut être modulée en fonction de l'état de santé de la personne ;
- le préjudice d'agrément est évalué selon la même méthode que le préjudice physique et une modulation est opérée en fonction du retentissement de la pathologie sur les activités pratiquées par le malade ;
- le préjudice esthétique est évalué au cas par cas en fonction des constatations médicales (amaigrissement extrême, cicatrices, recours à un appareillage respiratoire, etc.).
Quelques exemples d'indemnisation
Les valeurs de référence suivantes peuvent être données à titre d'exemples* :
S'agissant d'une plaque pleurale, l'indemnisation est de l'ordre de 22.000 euros à 60 ans pour un taux d'incapacité de 5 %.
|
Age |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
Incapacité |
7.850 |
7.282 |
6.654 |
5.959 |
5.207 |
4.402 |
3.561 |
2.717 |
1.960 |
|
Extra patrimonial |
20.995 |
19.479 |
17.800 |
15.940 |
13.929 |
11.776 |
9.526 |
7.269 |
5.242 |
|
Total (arrondi) |
29.000 |
27.000 |
24.000 |
22.000 |
19.000 |
16.000 |
13.000 |
10.000 |
7.200 |
S'agissant d'une asbestose, l'indemnisation est de l'ordre de 30.000 euros pour une personne de 60 ans affectée d'un taux d'incapacité de 10 %.
|
Age |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
Rente annuelle servie à la victime |
16.529 |
15.335 |
14.013 |
12.549 |
10.966 |
9.271 |
7.499 |
5.723 |
4.127 |
|
Extra patrimonial |
22.764 |
21.120 |
19.300 |
17.283 |
15.103 |
12.768 |
10.328 |
7.881 |
5.684 |
|
Total (arrondi) |
39.000 |
36.000 |
33.000 |
30.000 |
26.000 |
22.000 |
18.000 |
14.000 |
10.000 |
Pour les mésothéliomes et les cancers graves, le malade reçoit une rente d'incapacité de 16.240 euros par an, ainsi que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. Le tableau suivant décrit l'indemnisation que la victime est susceptible de percevoir dans l'hypothèse d'un décès deux ans après la découverte de la maladie :
|
Age |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
Extra patrimonial |
150.000 |
139.000 |
127.000 |
114.000 |
100.000 |
84.200 |
68.200 |
52.000 |
37.500 |
|
Montant capitalisé de la rente annuelle servie à la victime |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
32.480 |
|
Total indemnisation de la victime (arrondi) |
182.000 |
171.000 |
159.000 |
146.000 |
132.000 |
117.000 |
101.000 |
84.000 |
70.000 |
Pour les cas de cancer ayant bénéficié d'un traitement chirurgical, l'indemnisation est fonction des séquelles post-opératoires et du retentissement fonctionnel, ainsi que du préjudice moral, toujours élevé. Elle peut ainsi varier dans une fourchette qui permet de prendre en compte les situations individuelles et qui peut être dépassée dans les cas les plus graves.
|
Age |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
Préjudice moral |
35.503 |
32.939 |
30.100 |
26.954 |
23.555 |
19.913 |
16.108 |
12.292 |
8.865 |
|
Préjudice physique et d'agrément (fourchette) |
3.538 à 329.429 |
3.283 à 27.303 |
3.000 à 24.950 |
2.686 à 22.342 |
2.348 à 19.525 |
1.985 à 16.506 |
1.605 à 13.352 |
1.225 à 10.189 |
884
à
|
|
Préjudices extrapatrimoniaux (fourchette) |
39.041 à 64.931 |
36.222 à 60.243 |
33.100 à 55.050 |
29.641 à 49.296 |
25.902 à 43.079 |
21.898 à 36.419 |
17.713 à 29.460 |
13.517 à 22.480 |
9.748 à 16.213 |
|
Incapacité pour les 5 premières années |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
61.200 |
|
Total indemnisation (fourchette et hors IPP après 5 ans) borne basse |
100.200
|
97.400
|
94.300
|
90.800
|
87.100
|
83.100
|
78.900
|
74.700
|
70.900
|
En cas de préjudice esthétique, l'indemnisation est fonction du préjudice subi et varie habituellement entre 500 et 8.000 euros.
* Les montants indiqués dans les tableaux ne portent que sur l'indemnisation de l'incapacité et les préjudices moral, physique et d'agrément. Les autres préjudices (esthétique, perte de revenu, frais non couverts par la sécurité sociale) dépendent de l'évaluation concrète de chaque dossier.
Source : FIVA
En cas d'aggravation de l'état de la victime, l'indemnisation peut être révisée et majorée. En cas de décès, le FIVA indemnise les ayants droit de la victime, au titre du préjudice économique et du préjudice moral. La qualification d'ayant droit dépend de l'existence d'une relation de proximité affective avec la victime.
c) Le délai de traitement des dossiers et la question des moyens en personnel du FIVA
Outre l'objectif d'une réparation intégrale du préjudice, le FIVA a également vocation à traiter les demandes qui lui parviennent dans des délais relativement brefs, afin que l'ensemble des victimes puissent bénéficier d'une indemnisation, même lorsqu'elles sont atteintes de pathologies malignes.
La loi fixe à six mois le délai maximum de traitement d'un dossier, délai au terme duquel le fonds doit faire une offre d'indemnisation à la victime ou lui faire part du rejet de sa demande. Pour tenir compte des difficultés inhérentes à la mise en place de tout nouveau dispositif, le FGA disposait cependant d'un délai de neuf mois pour traiter les dossiers reçus en 2002.
L'examen des données disponibles montre que le délai légal n'est pas toujours respecté. Dans son rapport, la Cour des comptes indique que le délai médian de traitement des dossiers est légèrement supérieur à six mois depuis septembre 2004, dès lors que le dossier fourni par le demandeur est complet. Autrement dit, au moment où l'enquête de la Cour fut réalisée, plus de la moitié des demandes étaient traitées dans un délai supérieur à six mois. Le délai de versement de l'indemnisation, à compter de l'acceptation par le demandeur de l'offre du FIVA est d'environ un mois et demi.
Tenant compte de cette situation, le FIVA a, dans l'intérêt des victimes, établi une priorité dans l'ordre de traitement des dossiers ; comme l'a indiqué son directeur, M. François Romaneix, au cours de son audition, « la priorité, en termes de traitement, a toujours été [...] accordée à celles des victimes souffrant d'un cancer de manière à leur proposer, dans des délais extrêmement rapides, des offres d'indemnisation ».
Les données statistiques recueillies par la Cour des comptes confirment que ces dossiers ont effectivement fait l'objet d'un traitement plus rapide que la moyenne 56 ( * ) . Etudiant les chiffres du mois de novembre 2004, la Cour relève que « les 44 dossiers de maladies graves ont été traités en moyenne en 5,26 mois » , et que le délai médian est de 4,72 mois. En revanche, « le traitement de 379 dossiers de maladies bénignes a été réalisé en moyenne en 6,59 mois avec une médiane de 6,31 mois » et « 427 dossiers de préjudice moral des proches ont été traités en moyenne en 6,74 mois » (délai médian de 6,68 mois). Les dossiers correspondant aux cas les plus graves ont donc effectivement fait l'objet d'un traitement de faveur, même s'il est sans doute un peu excessif de parler de « délais extrêmement rapides » , puisque le délai moyen de traitement de ces dossiers n'est finalement inférieur que de peu au délai légal normalement imparti au fonds.
Conscient de la nécessité, pour le FIVA, « d'accentuer son effort » , son directeur a également évoqué le renforcement des effectifs du fonds et l'accélération du délai de traitement des dossiers : « au cours du second semestre de l'année 2003, les moyens humains du fonds ont été renforcés de manière significative. Ces renforts doivent nous permettre [...] de réduire très fortement les délais de traitement et de paiement. Les premières statistiques qui ont été publiées au sujet de l'année 2005 prouvent qu'un mouvement semble se dessiner en ce sens. Il semble que les moyens humains complémentaires dont le FIVA s'est doté aient permis de réduire significativement les délais de traitement ».
|
? Le FIVA comptait trente-six salariés fin 2003, contre trente-neuf au titre du budget 2004, auxquels s'ajoutent cinq salariés recrutés en contrat à durée déterminée (CDD). Ces effectifs se répartissent en : - une équipe de direction de cinq personnes comprenant le directeur, la directrice-adjointe, l'agent-comptable, le directeur juridique et le médecin conseil ; - un effectif « cadres » de vingt-quatre personnes comprenant un adjoint à l'agent comptable, un chargé d'études et de statistiques, une équipe de seize juristes affectés au traitement des dossiers d'indemnisation, une équipe de cinq juristes en charge des actions contentieuses, et deux personnes affectées à la gestion des ressources humaines et du budget ; - une équipe technique de sept personnes. ? Les trois recrutements autorisés par le budget 2004 ont porté sur : un poste d'expert médical à plein temps, appelé à être l'interlocuteur des médecins et des caisses de sécurité sociale ; un poste d'assistante juridique, affectée à l'enregistrement des dossiers ; un poste destiné à renforcer le secteur indemnisation.
? Le dernier rapport d'activité du FIVA, qui
couvre la période juin 2004 - mai 2005, indique que la tendance à
l'accroissement des effectifs se poursuit. Le budget 2005 du FIVA
prévoit en effet quarante-huit postes budgétaires, ce qui va
permettre de pérenniser les postes ouverts en CDD et de renforcer encore
les moyens alloués à l'instruction des dossiers d'indemnisation
et à la procédure de paiement des indemnités.
|
Les premiers chiffres disponibles pour le début de l'année 2005 suggèrent une amélioration du délai d'instruction des dossiers, puisqu'au mois de mai 2005, 70 % des dossiers traités l'ont été dans les délais. Le rapport d'activité susmentionné précise que « l'objectif de la direction est de tendre vers un taux de dossiers traités dans les délais de 90 % d'ici la fin de l'année 2005 » .
La mission prend note avec satisfaction des progrès ainsi enregistrés, mais déplore leur caractère tardif. Le fonds a manifestement manqué, pendant les quelques années qui ont suivi sa création, des moyens humains qui lui auraient permis d'accomplir sa mission dans les délais prévus par la loi. Cette lacune s'explique, pour partie, par la montée en charge rapide, et au rythme parfois imprévisible, de l'activité des fonds amiante.
II. LA RAPIDE MONTÉE EN PUISSANCE DES DÉPENSES DE RÉPARATION POSE LA QUESTION DE LA RÉALITÉ DE LEUR FINANCEMENT
Les dépenses d'indemnisation des victimes de l'amiante ont progressé à un rythme soutenu depuis la création du FIVA et du FCAATA, dépassant rapidement les prévisions initiales. Principalement prises en charge par la branche AT-MP de la sécurité sociale, elles ont contribué à la dégradation de la situation financière de cette branche, ce qui conduit à s'interroger sur le caractère durable d'un tel dispositif ainsi que sur la juste participation de l'État à son financement.
A. UN RYTHME SOUTENU DE PROGRESSION DES DÉPENSES
L'augmentation du nombre de maladies professionnelles pèse sur les comptes de la branche AT-MP, qui assume, de plus, la plus grande part du financement des fonds de l'amiante.
1. Impact global des dépenses d'indemnisation
Le rapport relatif à « l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et pour les vingt années suivantes », remis par le Gouvernement au Parlement en 2003, en application de l'article 6 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, a proposé une évaluation de l'impact global de l'indemnisation de la contamination par l'amiante pour l'année 2003.
Cette évaluation suppose d'additionner :
- les dépenses directes du régime général de sécurité sociale (indemnisation de droit commun) ;
- les dépenses des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
- les dépenses du FIVA ;
- les dépenses du FCAATA ;
- les dépenses induites par les autres dispositifs de cessation anticipée d'activité.
Le tableau suivant présente les résultats de cette évaluation :
Estimation de l'impact financier de
l'indemnisation
des victimes de l'amiante et des mécanismes
financiers
spécifiques pour 2003
(en millions d'euros)
|
Régime général |
115,0 |
|
Régimes spéciaux |
|
|
SNCF |
11,5 |
|
RATP |
1,0 |
|
EDF/GDF |
7,3 |
|
ENIM |
0,7 |
|
Fonction publique |
|
|
État défense et autres |
1,8 |
|
territoriale |
0,1 |
|
hospitalière |
0,2 |
|
Sous-total sécurité sociale |
137,4 |
|
Faute inexcusable de l'employeur |
30,5 |
|
FIVA |
400,0 |
|
Sous-total indemnisation |
567,8 |
|
FCAATA |
505 |
|
SNCF |
0,3 |
|
Défense |
9,5 |
|
ENIM |
0,7 |
|
Sous-total cessation anticipée d'activité |
515 ,0 |
|
Total général |
1.083 , 0 |
Source : p. 24 du rapport au Parlement
Ces résultats doivent être considérés avec prudence, en raison de l'hétérogénéité des données utilisées. Alors que, pour les paiements directs, ont été retenus les montants de l'année 2002 - dernière année connue lors de l'élaboration du rapport - ce sont les résultats prévisionnels pour l'année 2004 qui ont été utilisés pour le FIVA et le FCAATA. Il aurait été peu significatif en effet, en particulier pour le FIVA, de retenir les dépenses engagées par les fonds avant leur montée en charge.
Ces chiffres soulignent que le régime général occupe une place prépondérante au sein des dépenses de sécurité sociale ; il fait face à des dépenses croissantes, conséquence de l'augmentation du nombre de maladies professionnelles causées par l'amiante, mais aussi des transferts qui lui sont imposés au profit des « fonds de l'amiante ».
2. Les dépenses directes de la branche AT-MP du régime général
Alors que le nombre d'accidents du travail est plutôt orienté à la baisse dans notre pays, le nombre de maladies professionnelles reconnues tend à s'accroître (+ 45 % entre 2000 et 2004).
La progression de deux grands types d'affections explique cette évolution défavorable : les affections périarticulaires, d'une part, causées par certains gestes ou postures de travail ; les pathologies causées par les poussières d'amiante, d'autre part (146 cas recensés en 1980, 5.750 en 2003).
M. Gilles Evrard, directeur des risques professionnels à la CNAMTS, a fourni à la mission des statistiques présentant, de manière détaillée, l'évolution du nombre de pathologies de l'amiante.
Evolution du nombre de maladies professionnelles
(déclarées, constatées, reconnues)
liées
à l'amiante de 1997 à 2003
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002* |
2003* |
||
|
MP30 |
||||||||
|
A0000 |
Non précisé |
1 |
||||||
|
A1500 |
Asbestose compliquée d'insuffisance ventriculaire droite |
3 |
35 |
70 |
71 |
98 |
103 |
|
|
AJ61X |
Asbestose avec fibrose pulmonaire |
143 |
161 |
236 |
276 |
315 |
304 |
257 |
|
AJ960 |
Asbestose compliquée d'insuffisance respiratoire aiguë |
21 |
37 |
23 |
19 |
21 |
16 |
12 |
|
B0000 |
Non précisé |
6 |
||||||
|
B1318 |
Plaques péricardiques |
8 |
11 |
5 |
8 |
6 |
9 |
7 |
|
BJ90X |
Pleurésie exsudative |
59 |
45 |
37 |
33 |
43 |
49 |
42 |
|
BJ920 |
Plaques pleurales |
876 |
1.112 |
1.617 |
1.931 |
2.815 |
3.342 |
3.217 |
|
BJ929 |
Epaississements pleuraux bilatéraux |
271 |
276 |
368 |
442 |
669 |
737 |
779 |
|
CC34X |
Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes |
77 |
89 |
107 |
127 |
168 |
172 |
144 |
|
DC450 |
Mésothéliome malin primitif de la plèvre |
142 |
174 |
267 |
250 |
339 |
324 |
334 |
|
DC451 |
Mésothéliome malin primitif du péritoine |
1 |
4 |
11 |
8 |
7 |
10 |
16 |
|
DC452 |
Mésothéliome malin primitif du péricarde |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
|
|
EC384 |
Autres tumeurs pleurales primitives |
47 |
25 |
20 |
19 |
20 |
21 |
21 |
|
ZR69X |
Multi-syndromes |
3 |
25 |
30 |
22 |
|||
|
MP30 |
Sous-total MP 30 |
1.652 |
1.939 |
2.728 |
3.187 |
4.502 |
5.115 |
4.958 |
|
MP30BIS |
Cancer broncho-pulmonaire primitif |
111 |
191 |
331 |
434 |
632 |
739 |
792 |
|
TOTAL |
1.763 |
2.130 |
3.059 |
3.621 |
5.134 |
5.854 |
5.750 |
* Dénombrement provisoire arrêté au 30.09.2004 Source : Statistiques trimestrielles des AT-MP
Le nombre de maladies reconnues a plus que triplé sur la période considérée (1997-2003) et a augmenté de plus de 150 % depuis 2000. Les plaques pleurales représentent, en 2003, 44 % du total des maladies reconnues. Le développement du cancer broncho-pulmonaire est particulièrement notable puisque sa fréquence a été multipliée par sept en six ans.
La plus grande fréquence des pathologies a inévitablement un impact sur le montant des dépenses engagées par la branche AT-MP : l'indemnisation des maladies répertoriées aux tableaux 30 et 30 bis coûtait 393 millions d'euros en 2001, 542 millions en 2002 et 585 millions en 2003, ce qui représentait environ 48 % du total des dépenses d'indemnisation des maladies professionnelles.
Dépenses de la branche AT-MP du régime
général
au titre des tableaux 30 et 30
bis
*
(en euros)
|
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
TOTAL |
393.821.330 |
542.628.129 |
585.741.240 |
|
Dont : |
|||
|
Prestations, indemnités journalières + frais médicaux + frais pharmacie + hospitalisation |
5.678.442 |
8.232.977 |
9.679.350 |
|
Indemnités en capital (IPP<10 %) |
3.276.946 |
4.367.387 |
5.578.758 |
|
Rentes (IPP>10 %) + indemnités décès |
384.865.942 |
530.027.765 |
570.483.132 |
* Prend en compte les maladies professionnelles réglées ayant entraîné soit un arrêt, soit l'attribution d'une rente l'année considérée.
Source : CNAMTS/DRP
3. Les dépenses des « fonds de l'amiante »
a) Des prévisions initiales rapidement dépassées
Rassurantes, les prévisions initiales concernant les dépenses des fonds d'indemnisation se sont vite révélées insuffisantes au regard des besoins.
Dans son rapport 57 ( * ) , la Cour des comptes rappelle que l'exposé des motifs de la loi créant le FCAATA annonçait que « plusieurs milliers de personnes seraient concernées dès 1999, pour un coût de 600 millions de francs » (94,47 millions d'euros). Une note prévoyait que le coût, au terme de la montée en charge, ne dépasserait pas 1,1 milliard de francs (168 millions d'euros). Après une montée en charge plus lente que prévu, le coût maximum prévu était dépassé dès 2002. En 2003, il était de 450 millions d'euros.
La création du FIVA ne s'est accompagnée d'aucune prévision concernant le niveau de ses dépenses à moyen terme, ce qui a conduit la commission des Finances du Sénat à dénoncer, à l'époque, le « flou » entourant les conditions financières de création de ce fonds 58 ( * ) .
b) Le rythme passé d'augmentation des dépenses et les prévisions à court terme
Comme l'a indiqué Mme Marianne Lévy-Rozenwald lors de son audition, le FCAATA est « un fonds dont la croissance a été très importante » et qui a vu ses dépenses s'accroître « de plus de 100 millions d'euros chaque année » . Elle a jugé « vraisemblable » que le fonds soit encore dans une phase de croissance en 2006.
Evolution des dépenses du FCAATA de 1999 à 2005
(en millions d'euros)
|
FCAATA |
1999 |
2000 |
% |
2001 |
% |
2002 |
% |
2003 |
% |
2004 |
% |
2005 |
% |
|
CHARGES |
8,6 |
54,4 |
533 |
166,4 |
206 |
324,6 |
95 |
515,7 |
59 |
660,3 |
28 |
752,8 |
14 |
Source : direction de la sécurité sociale
L'augmentation des dépenses du fonds, même si elle tend à se ralentir, demeure encore très rapide (+ 28 % en 2004 par rapport à 2003 ; + 14 % prévus en 2005).
Les dépenses du FIVA, qui sont d'un montant inférieur à celles du FCAATA, ont fortement augmenté entre 2002 et 2004, période correspondant à la mise en place du fonds et à une progression rapide du nombre d'offres d'indemnisations proposées.
Evolution des dépenses d'indemnisation
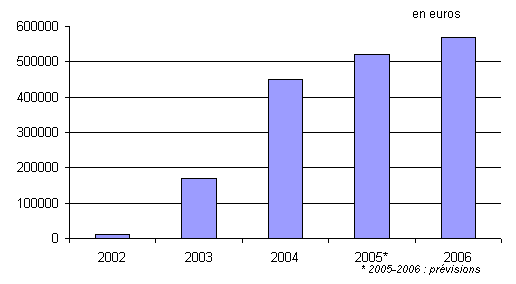
Source : FIVA
La prévision de dépenses pour 2005 est de 600 millions d'euros. Toutefois, dans son quatrième rapport d'activité, le FIVA indique que les tendances dégagées à partir des premiers mois d'activité de l'année semblent indiquer que les dépenses « pourraient être inférieures aux prévisions en raison, d'une part, du ralentissement de la hausse du nombre de dossiers reçus et, d'autre part, de la part croissante dans les dossiers reçus des pathologies bénignes dont le coût d'indemnisation est évidemment inférieur à celui des pathologies malignes » . Le montant mensuel de dépenses s'élève actuellement à 35 millions d'euros en moyenne. Pour 2006, le fonds estime le budget prévisionnel d'indemnisation à 570 millions d'euros, ce qui laisse penser que ses dépenses seraient en voie de stabilisation.
4. La hausse du nombre de bénéficiaires de l'indemnisation
L'augmentation des dépenses est bien sûr une conséquence de la montée en puissance des deux fonds, qui ont vu leur nombre d'allocataires fortement progresser.
a) Les bénéficiaires du FCAATA
La Cour des comptes note, dans son rapport, que le FCAATA est « un dispositif en expansion ». Mme Marianne Lévy-Rozenwald a expliqué ce phénomène par deux causes concomitantes :
« La première, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale a élargi à plusieurs reprises le champ des bénéficiaires.
« La deuxième, c'est qu'un certain nombre d'arrêtés élargissent également les périodes ouvrant droit au bénéfice de l'allocation pour les salariés de certains établissements. Concrètement, avaient droit au bénéfice de l'ACAATA les salariés des chantiers navals de telle date à telle date et, progressivement, on a été de l'année n, qui était l'année finale initiale, à l'année n+x et, de nouveau, à l'année n+x+x. Avec cet élargissement, il y a forcément de nouveaux bénéficiaires ».
La Cour des comptes a précisément retracé les étapes des élargissements successifs du périmètre d'intervention du FCAATA :
? Le dispositif initial créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 concernait :
- les personnes de plus de cinquante ans reconnues porteuses d'une maladie professionnelle causée par l'amiante ; l'arrêté initial excluait les plaques pleurales, comme la loi l'y autorisait ;
- les personnes travaillant ou ayant travaillé dans les établissements reconnus par arrêté comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.
? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a étendu le champ des bénéficiaires en y ajoutant :
- les salariés d'établissements, déterminés par arrêté, de flocage et de calorifugeage ;
- les salariés ayant exercé certains métiers de la réparation et de la construction navale et les dockers de certains ports.
? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 :
- a étendu les dispositions de l'ACAATA aux personnels de manutention dans les ports ;
- a réformé les règles de non-cumul en autorisant un cumul partiel de la prestation avec une pension de réversion, un avantage d'invalidité ou un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial sous forme de versement d'une indemnité différentielle.
? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a étendu les dispositions de l'ACAATA aux salariés agricoles.
Enfin, un arrêté du 3 décembre 2001 a ouvert le bénéfice de l'ACAATA aux malades souffrant de plaques pleurales.
Dans le même temps, comme le note la Cour des comptes, « la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA s'est accrue régulièrement pour atteindre 1442. Les périodes d'activité ont été progressivement étendues sans qu'il soit toujours possible de distinguer les motifs ayant conduit à retenir telle période ou telle autre. Ainsi les chantiers de l'Atlantique ont-ils fait l'objet de deux arrêtés, un premier du 7 juillet 2000 couvrant la période 1945 à 1975, un deuxième du 11 décembre 2001, portant de 1975 à 1982 la limite maximale. Un troisième étend cette limite jusqu'à 1996 » .
A la suite de ces élargissements successifs, le nombre de bénéficiaires de l'ACAATA a atteint plus de 27.400 en 2004 , contre seulement 3.785 en 2000. La hausse du nombre de sorties du dispositif, pour cause de décès ou de départ en retraite, contribue cependant à infléchir le rythme d'augmentation du nombre d'allocataires.
Evolution du nombre de bénéficiaires de l'ACAATA
|
Evolution annuelle (en %) |
|||||||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
|
|
Acceptations |
3.894 |
9.697 |
18.032 |
25.717 |
33.361 |
149 % |
86 % |
43 % |
30 % |
|
Sorties |
109 |
545 |
1.351 |
3.201 |
53952 |
400 % |
148 % |
137 % |
86 % |
|
dont décès |
24 |
86 |
196 |
312 |
517 |
||||
|
dont départs en retraite |
85 |
459 |
1.155 |
2.889 |
5.435 |
||||
|
Allocations en cours |
3.785 |
9.152 |
16.681 |
22.516 |
27.409 |
142 % |
82 % |
35 % |
22 % |
Sorties = décès + départs en retraite
Allocations en cours = acceptations - sorties
Source : Direction de la sécurité sociale
L'âge moyen des bénéficiaires au moment de leur entrée dans le dispositif est de 54,8 ans, leur âge moyen à la sortie de 59,7 ans.
b) Les bénéficiaires du FIVA
Le champ des bénéficiaires du FIVA est resté stable depuis sa création et la progression de ses dépenses s'explique donc simplement par l'augmentation du nombre de demandes d'indemnisations reçues et acceptées par le fonds.
Alors que le nombre de dossiers reçus en moyenne chaque mois était de 538 en 2002, ce chiffre est passé à 634 en 2003, puis à 686 en 2004. Il devrait rester stable en 2005, si les prévisions du FIVA se vérifient (cf. tableau). Au total, un peu plus de 20.000 demandes d'indemnisation ont été adressées du FIVA depuis sa création .
Evolution du nombre de bénéficiaires de l'ACAATA
|
Date |
FGA |
FIVA |
TOTAL |
|
|
Juil-02 |
470 |
470 |
||
|
Août-02 |
175 |
175 |
||
|
Sept-02 |
669 |
669 |
||
|
Oct-02 |
618 |
618 |
||
|
Nov-02 |
640 |
640 |
Moyenne 2002 |
|
|
Déc-02 |
657 |
657 |
538 |
|
|
Janv-03 |
633 |
633 |
||
|
Févr-03 |
643 |
643 |
||
|
Mars-03 |
614 |
614 |
||
|
Avr-03 |
644 |
644 |
||
|
Mai-03 |
660 |
660 |
||
|
Juin-03 |
140 |
446 |
586 |
|
|
Juil-03 |
28 |
644 |
672 |
|
|
Août-03 |
17 |
350 |
367 |
|
|
Sept-03 |
5 |
610 |
615 |
|
|
Oct-03 |
7 |
788 |
795 |
|
|
Nov-03 |
3 |
715 |
718 |
Moyenne 2003 |
|
Déc-03 |
3 |
658 |
661 |
634 |
|
Janv-04 |
0 |
557 |
557 |
|
|
Févr-04 |
0 |
661 |
661 |
|
|
Mars-04 |
0 |
865 |
865 |
|
|
Avr-04 |
0 |
757 |
757 |
|
|
Mai-04 |
0 |
561 |
561 |
|
|
Juin-04 |
0 |
767 |
767 |
|
|
Juil-04 |
0 |
714 |
714 |
|
|
Août-04 |
0 |
512 |
512 |
|
|
Sept-04 |
0 |
620 |
620 |
|
|
Oct-04 |
0 |
695 |
695 |
|
|
Nov-04 |
0 |
780 |
780 |
Moyenne 2004 |
|
Déc-04 |
0 |
744 |
744 |
686 |
|
Jan-05* |
0 |
626 |
626 |
Moyenne 2005* |
|
Févr-05* |
0 |
750 |
750 |
688 |
|
Moyenne globale |
||||
|
Total |
6.623 |
13.820 |
20.443 |
639 |
* Estimations Source : FIVA
Le directeur du FIVA, M. François Romaneix, a insisté lors de son audition sur l'augmentation brutale du nombre de dossiers intervenue dans les derniers mois de 2003 et sur ses conséquences sur le fonctionnement du fonds : « le nombre de dossiers reçus est [passé] de 603, durant les premiers mois de 2003, à 706 entre octobre 2003 et juillet 2004. Cette situation exceptionnelle a conduit à l'encombrement de tous nos services et à l'allongement des délais d'instruction » . Cette hausse de l'activité a favorisé l'augmentation des effectifs, mentionnée précédemment, qui a permis de ramener le nombre de dossiers en cours de traitement de 6.300 en novembre 2003 à environ 5.000 aujourd'hui. Le nombre d'offres d'indemnisation présentées depuis l'origine par le FIVA s'élève à un peu plus de 14.500 au début de l'année 2005.
Evolution du nombre d'offres présentées par le FIVA chaque mois
|
Date |
FGA |
FIVA |
TOTAL |
|
|
Mars-03 |
148 |
148 |
||
|
Avril-03 |
299 |
299 |
||
|
Mai-03 |
297 |
297 |
||
|
Juin-03 |
401 |
26 |
427 |
|
|
Juillet-03 |
420 |
41 |
461 |
|
|
Août-03 |
395 |
36 |
431 |
|
|
Septembre-03 |
443 |
51 |
494 |
|
|
Octobre-03 |
584 |
56 |
640 |
|
|
Novembre-03 |
541 |
86 |
627 |
Moyenne 2003 |
|
Décembre-03 |
633 |
230 |
863 |
469 |
|
Janvier-04 |
568 |
269 |
837 |
|
|
Février-04 |
499 |
309 |
808 |
|
|
Mars-04 |
461 |
387 |
848 |
|
|
Avril-04 |
254 |
574 |
828 |
|
|
Mai-04 |
47 |
682 |
729 |
|
|
Juin-04 |
65 |
691 |
756 |
|
|
Juillet-04 |
24 |
643 |
667 |
|
|
Août-04 |
19 |
561 |
580 |
|
|
Septembre-04 |
18 |
611 |
629 |
|
|
Oct-04 |
12 |
595 |
607 |
|
|
Nov-04 |
9 |
613 |
622 |
Moyenne 2004 |
|
Déc-04 |
3 |
550 |
553 |
705 |
|
Jan-05* |
0 |
782 |
782 |
Moyenne 2005* |
|
Févr-05* |
1 |
596 |
597 |
690 |
|
Total |
6.141 |
8.389 |
14.530 |
* Estimations Source : FIVA
L'augmentation du nombre de demandeurs n'a pas significativement altéré le « profil type » du bénéficiaire du FIVA. Les victimes sont à 95 % des hommes ; 77 % d'entre elles se situent dans la tranche d'âge 51-70 ans au moment du diagnostic de la maladie liée à l'amiante, avec un âge moyen de 60,3 ans.
La répartition des victimes en fonction de leur taux d'incapacité révèle la prépondérance, qui tend à s'accentuer, des pathologies bénignes dans le total des indemnisations accordées par le FIVA, mais aussi la présence d'une proportion non négligeable de pathologies très graves. Près de 60 % des personnes indemnisées sont en effet affectées d'une incapacité de 5 %, correspondant le plus souvent à des plaques pleurales, tandis que plus de 20 % d'entre elles sont affligées d'une pathologie maligne, telle qu'un mésothéliome ou un cancer broncho-pulmonaire.
Répartition des victimes par taux d'incapacité
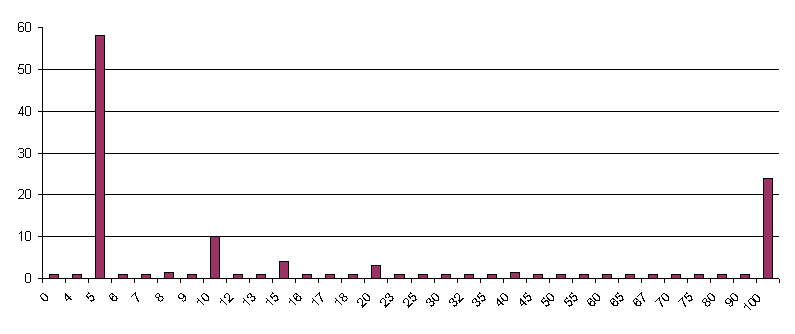 Source : FIVA
Source : FIVA
Un examen de l'origine géographique des bénéficiaires du FIVA et du FCAATA indique une concentration des contaminations par l'amiante dans quelques régions.
Quatre régions concentrent à elles seules près de 57 % des victimes indemnisées par le FIVA : Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Basse Normandie. Il s'agit de régions de forte présence industrielle ou marquées par l'importance de la construction navale.
Répartition géographique des victimes indemnisées par le FIVA
Région
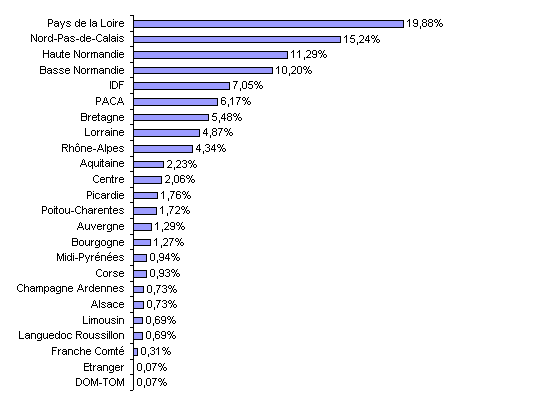
Source : FIVA
Une pondération du nombre de victimes par la population de chaque région ne remet pas en cause la prépondérance des quatre régions précitées, mais souligne que l'Ile-de-France, même si elle draine un nombre important de dossiers en valeur absolue, est en fait relativement peu touchée par la contamination par l'amiante.
Différence en points entre la répartition
FIVA et la répartition INSEE 2002
pour la France
métropolitaine
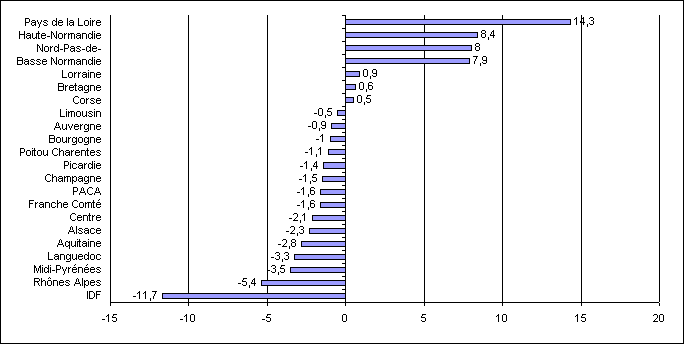 <= = Sous
représentation / Surreprésentation = =>>
<= = Sous
représentation / Surreprésentation = =>>
Lecture : L'axe des abscisses représente pour chaque région française la différence en points entre la répartition constatée au sein du FIVA et les données de l'INSEE de 2002. Ainsi, la région Pays de la Loire est surreprésentée à hauteur de 14,3 points : 19,9 % des victimes FIVA habitent cette région qui ne représente que 5,6 % de la population française.
Source : FIVA
Le rapport annuel du FCAATA présente une répartition de ses allocataires en fonction de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) à laquelle ils sont rattachés. Il indique que, depuis 2001, quatre CRAM versent près des deux tiers des paiements ; il s'agit des CRAM de Nord-Picardie, Sud-Est, Normandie et Pays de Loire.
Répartition par CRAM des paiements de l'exercice
2004
Synthèse des paiements 2004 hors régularisations
(1)
(en milliers d'euros)
|
CRAM |
Total |
% CRAM Total |
Taux de variation 2004/2003 |
|
Alsace-Moselle |
11.956 |
1,84 % |
37 % |
|
Aquitaine |
38.202 |
5,89 % |
51 % |
|
Auvergne |
5.737 |
0,89 % |
123 % |
|
Bourgogne Franche-Comté |
11.918 |
1,84 % |
30 % |
|
Bretagne |
54.934 |
8,48 % |
18 % |
|
Centre |
12.108 |
1,87 % |
13 % |
|
Centre Ouest |
10.630 |
1,64 % |
60 % |
|
Ile-de-France |
31.708 |
4,89 % |
29 % |
|
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon |
7.179 |
1,11 % |
26 % |
|
Nord-Est |
13.560 |
2,09 % |
82 % |
|
Nord-Picardie |
117.781 |
18,17 % |
21 % |
|
Normandie |
96.036 |
14,82 % |
28 % |
|
Pays de Loire |
94.461 |
14,57 % |
28 % |
|
Rhône-Alpes |
33.860 |
5,22 % |
49 % |
|
Sud-Est |
108.077 |
16,67 % |
14 % |
|
TOTAL |
648.147 |
100,00 % |
27 % |
(1) Le montant des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO, IRCANTEC et AGFF) ne comprend pas les régularisations sur exercices antérieurs d'un montant de 2.122.664,45 euros effectuées auprès de l'AGIRC et de l'ARRCO en 2004.
Source : FCAATAA
La répartition des allocataires du FCAATA ne se distingue de celle des bénéficiaires du FIVA que par la place qu'y occupe la région « Sud-Est » (Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse).
5. Les prévisions de dépenses à plus long terme
Ce point sur l'activité présente des fonds étant effectué, il convient de s'interroger sur les perspectives d'évolution des dépenses à plus long terme. A ce sujet, la mission peut s'appuyer sur le rapport relatif à « l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et pour les vingt années suivantes » précédemment mentionné.
a) Le coût de l'indemnisation des malades de l'amiante
La démarche retenue par les auteurs de cette étude a consisté à estimer, à partir des données épidémiologiques existantes, l'évolution probable du nombre de mésothéliomes, de cancers broncho-pulmonaires et de pathologies bénignes causés par l'amiante, puis à évaluer le montant de l'indemnisation accordée aux victimes. Les incertitudes demeurent bien sûr nombreuses, qui tiennent à la fragilité des connaissances épidémiologiques et aux hypothèses qu'il a fallu poser en matière d'indemnisation (taux de déclaration, pourcentage d'ayants droit, durée de perception des rentes, etc.).
De plus, seule une partie des dépenses occasionnées par la contamination par l'amiante fait l'objet de la projection. N'ont pas été prises en compte les dépenses accordées par les tribunaux au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, jugées trop incertaines.
Sous ces réserves, l'étude propose les résultats suivants :
- pour le mésothéliome : il ressort des estimations sur l'évolution de l'incidence de la maladie que le mésothéliome pourrait, en moyenne, sur la période, représenter 900 à 1.200 nouveaux cas par an en France, soit entre 18.000 et 24.000 victimes en vingt ans 59 ( * ) . Par ailleurs, et en l'état des connaissances épidémiologiques, la survenue d'un mésothéliome est dans la grande majorité des cas liée à une exposition professionnelle à l'amiante : on peut considérer que la part des mésothéliomes d'origine professionnelle est de 90 %, soit en moyenne entre 810 et 1.080 victimes par an. Le coût est également fonction du pourcentage de reconnaissance par les régimes de sécurité sociale, lui-même dépendant du nombre de déclarations ; les auteurs ont retenu une estimation haute de 80 %, soit en moyenne entre 648 et 864 victimes par an.
Le coût moyen annuel de la prise en charge des malades du mésothéliome par le régime général de la sécurité sociale en 2001 (dernière année renseignée) peut être estimé à 56.856 euros.
Sur cette base, en fourchette basse, le coût annuel moyen de prise en charge est ainsi estimé à 36,8 millions d'euros (648 victimes x 56.856 euros). En fourchette haute, le montant annuel moyen de la prise en charge par le régime AT/MP de sécurité sociale s'élèverait à 49,1 millions d'euros (864 victimes x 56.856 euros). Le coût total de la prise en charge des victimes par les régimes de sécurité sociale pour les vingt prochaines années serait compris entre 736,8 et 982,4 millions d'euros. Pour les ayants droit, en retenant l'hypothèse que l'on aura une indemnisation à verser dans 90 % des dossiers des victimes, le nombre de prises en charge est compris entre 583 et 778 pour un coût moyen estimé à 11.000 euros. Sur cette base, le coût annuel moyen de l'indemnisation des ayants droit par le régime de la sécurité sociale est estimé entre 51,4 et 63,2 millions d'euros, soit, sur vingt ans, entre 1 et 1,3 milliard d'euros. Ainsi, la prise en charge des victimes de mésothéliome et de leurs ayants droit par les régimes de sécurité sociale sur vingt ans serait comprise entre 1,8 et 2,8 milliards d'euros.
Par ailleurs, au titre de l'indemnisation, il faut aussi considérer la prise en charge par le FIVA de la réparation intégrale des victimes de l'amiante. Pour les premières indemnisations, le montant moyen de l'offre pour un mésothéliome est d'environ 131.484 euros.
Le mésothéliome étant considéré par le FIVA comme une pathologie spécifique, il paraît raisonnable de penser que l'ensemble des mésothéliomes pourrait être pris en charge, sous réserve qu'ils soient déclarés : sur une base de 80 % de déclarations, entre 720 et 960 victimes pourraient être prises en charge, en moyenne, chaque année. Le coût annuel moyen de la réparation par le FIVA se situerait dans une fourchette de 95 à 126 millions d'euros par an et de 1,9 à 2,5 milliards d'euros sur vingt ans.
Le coût total de la prise en charge de l'indemnisation des victimes de mésothéliome et de leurs ayants droit par la sécurité sociale et le FIVA se situerait ainsi dans une fourchette de 3,7 à 4,7 milliards d'euros sur les vingt prochaines années. Compte tenu de l'hypothèse d'augmentation de l'incidence de la maladie retenue et de l'effet cumulé des rentes d'ayants droit, le coût annuel en fin de période est très supérieur (dans un rapport de 4 à 6) au coût annuel en début de période ;
- pour les cancers broncho-pulmonaires : il ressort des estimations sur l'évolution de l'incidence des cancers broncho-pulmonaires que le nombre de cas liés à l'amiante se situerait dans une fourchette comprise entre 1.800 et 4.000 cas chaque année. En l'absence d'études plus affinées sur l'évolution à long terme, cette fourchette est reconduite tout au long de la période.
On peut considérer, comme pour le mésothéliome, que 90 % des cas sont d'origine professionnelle. En revanche, s'agissant d'une maladie plurifactorielle, le nombre de déclarations pourrait être plus faible et les auteurs ont retenu l'hypothèse de deux tiers de déclarations. Sous ces hypothèses, le nombre annuel de victimes prises en charge pourrait s'échelonner de 1.080 à 2.400.
Le coût annuel moyen de la prise en charge des malades de cancers broncho-pulmonaires par le régime général de la sécurité sociale peut être estimé à 44.226 euros. Sur cette base et sous certaines hypothèses de mortalité, en fourchette basse, le coût annuel moyen de prise en charge des cancers broncho-pulmonaires est estimé à 71,5 millions d'euros. En fourchette haute, le montant annuel de la prise en charge par la branche AT-MP s'élève à 159 millions d'euros. Sur vingt ans, la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires développés suite à une exposition à l'amiante se situerait entre 1,4 milliard d'euros et 3 milliards d'euros. Pour les ayants droit, selon les mêmes hypothèses, 972 à 2.160 dossiers pourraient être pris en charge en moyenne. En retenant un coût moyen annuel estimé de 11.000 euros, le montant annuel moyen de prise en charge est compris entre 10 millions d'euros et 21 millions d'euros. Sur vingt ans, le coût est estimé entre 1,9 et 4,3 milliards d'euros.
Ainsi, le coût de la prise en charge des victimes de cancers broncho-pulmonaires attribués à l'amiante et de leurs ayants droit par les régimes de sécurité sociale serait compris, sur vingt ans, entre 3,3 milliards d'euros en fourchette basse et 7,4 milliards d'euros en fourchette haute.
Là encore, l'importance de cette fourchette révèle combien l'exercice de prévision est délicat et souligne le caractère purement indicatif des ordres de grandeur avancés.
Pour ce qui concerne le coût de l'indemnisation des cancers broncho-pulmonaires par le FIVA, la question du nombre de dossiers pris en charge est plus délicate que pour le mésothéliome en raison du caractère multifactoriel du cancer broncho-pulmonaire et de l'impact de cet élément sur la déclaration. On peut cependant également retenir l'hypothèse de deux tiers de déclarations. Dès lors, entre 1.200 et 2.667 victimes seraient prises en charge en moyenne chaque année.
Le coût moyen des premières indemnisations versées par le FIVA est de 120.385 euros. Le coût moyen annuel se situerait ainsi dans une fourchette allant de 144 millions d'euros à 321 millions d'euros. A horizon de vingt ans, le coût supporté par le FIVA serait compris entre 2,9 milliards d'euros et 6,4 milliards d'euros.
Le coût total de la prise en charge de l'indemnisation des victimes de cancers broncho-pulmonaires et de leurs ayants droit, par la sécurité sociale et par le FIVA, se situerait en moyenne entre 310 et 690 millions d'euros par an et dans une fourchette de 6,2 à 13,8 milliards d'euros sur les vingt prochaines années. Compte tenu des mêmes hypothèses et effets que ceux retenus pour le mésothéliome, le coût annuel en fin de période est supérieur au coût constaté en début de période.
Au total, le coût annuel moyen de la prise en charge des pathologies malignes liées à l'amiante (victimes de mésothéliomes et cancers broncho-pulmonaires ainsi que leurs ayants droit) pourrait être compris entre 493 millions et 928 millions d'euros par an et, sur vingt ans, entre 9,9 et 18,5 milliards d'euros . Le coût annuel en fin de période devrait être nettement supérieur au coût constaté en début de période (rapport de 1 à 4 au moins) ;
- les pathologies bénignes : au titre de la prise en charge par le régime général, on se base sur l'hypothèse que les pathologies bénignes représentent 60 % des dossiers, qu'elles ont une origine professionnelle dans 90 % des cas et que le taux de reconnaissance est de 80 %. Le coût moyen annuel constaté de leur prise en charge par le régime général s'élève à 2.189 euros par personne. Le coût global de leur prise en charge pourrait osciller entre 7 et 13,7 millions d'euros par an et entre 141,9 et 273,2 millions d'euros sur vingt ans.
Pour ce qui est de la prise en charge par le FIVA, on estime que 3.600 des 6.933 dossiers pourraient être concernés chaque année avec un coût moyen constaté de 23.519 euros, ce qui représente un coût moyen annuel compris entre 84 et 163 millions d'euros et, sur vingt ans, un coût compris entre 1,7 et 3,3 milliards d'euros.
L'indemnisation des pathologies bénignes liées à l'amiante serait donc comprise au total entre 91 et 177 millions d'euros par an, en moyenne, et entre 1,8 et 3,6 milliards d'euros sur les vingt prochaines années, la quasi-totalité de l'indemnisation de ces pathologies étant prise en charge par le FIVA.
Synthèse : l'indemnisation des différentes pathologies liées à l'amiante
Le coût annuel de l'indemnisation de l'ensemble des pathologies liées à l'amiante (hors dispositif de cessation anticipée d'activité) serait compris entre 584 millions et 1,1 milliard d'euros par an en moyenne et le coût total sur vingt ans compris entre 11,7 et 22 milliards d'euros. L'essentiel de l'écart entre les hypothèses basse et haute s'explique par les écarts dans les prévisions épidémiologiques qui sont particulièrement importantes pour les cancers broncho-pulmonaires.
Indemnisation (hors FCAATA)
(en millions d'euros)
|
Coût annuel |
Coût sur vingt ans |
|||
|
Hypothèse basse |
Hypothèse haute |
Hypothèse basse |
Hypothèse haute |
|
|
Mésothéliomes |
183,2 |
238,3 |
3.700 |
4.700 |
|
Cancers broncho-pulmonaires |
310,0 |
690,0 |
6.200 |
13.800 |
|
Pathologies bénignes |
91,0 |
177,0 |
1.842 |
3.573 |
|
TOTAL |
584,2 |
1.105,3 |
11.742 |
22.073 |
b) Le coût de la cessation anticipée d'activité (le FCAATA)
La réalisation d'une étude prospective se révèle ici extrêmement délicate. La difficulté tient principalement à la prévision du nombre de personnes potentiellement concernées par le dispositif. On peut faire l'hypothèse d'un maintien de cohortes de bénéficiaires au titre des listes d'établissements assez nombreuses pendant quelques années puis d'une diminution progressive des entrées à ce titre. En revanche, il est probable que le nombre de personnes pouvant prétendre à l'accès au dispositif en raison de leur pathologie va continuer à croître suite à la poursuite, pendant encore plusieurs années, de la croissance du nombre de malades. A cet égard, l'absence de connaissances épidémiologiques tant sur le nombre actuel de personnes atteintes de plaques pleurales que sur l'évolution de l'incidence de cette pathologie constitue un facteur d'incertitude majeur quant au coût futur du dispositif.
Sous ces réserves, une simulation a été envisagée selon les hypothèses suivantes. En premier lieu, les auteurs ont considéré, sur la base des informations disponibles, que les personnes entrées dans le dispositif y demeuraient cinq ans en moyenne, puis quatre ans seulement à compter de 2015. On a considéré un taux de décès annuel avant cinq ans de l'ordre de 0,1 % et de départ à la retraite avant cinq ans de 3 %. Pour les salariés entrant dans le dispositif au titre des listes des établissements éligibles, l'hypothèse a été prise d'une entrée de 6.700 allocataires par an jusqu'en 2007, puis une baisse de 10 % par an. Pour ceux entrant dans le champ du dispositif au titre de la maladie professionnelle, on a considéré une croissance de l'effectif de 10 % par an pendant dix ans puis une stabilisation des entrées. Enfin, on a retenu un montant moyen mensuel de l'allocation de 2.036 euros.
Selon ces hypothèses, le nombre de bénéficiaires au titre des listes continuerait à augmenter jusqu'en 2006 pour atteindre un pic de près de 32.000 allocataires. Il commencerait ensuite une diminution progressive qui s'accélérerait pour atteindre environ 6.400 bénéficiaires à l'horizon 2022. Pour les salariés entrant dans le dispositif au titre de la maladie professionnelle, les projections produisent des résultats différents : la montée en charge du dispositif serait régulière jusqu'en 2016 avec un plafond de 14.395 bénéficiaires, stable jusqu'en 2022.
c) Synthèse générale
Sur la base des hypothèses présentées ci-dessus, on obtient une fourchette de coût de la prise en charge des victimes de l'amiante (indemnisation et cessation anticipée d'activité) large comprise entre 1,3 et 1,9 milliard d'euros par an et entre 26,8 et 37,2 milliards d'euros pour les vingt prochaines années. Ces estimations ne valent qu'à réglementation constante.
Sur le montant total, en hypothèse basse comme en hypothèse haute, la part de la prise en charge des victimes de l'amiante par les organismes de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle est relativement modeste. L'essentiel du coût résulte des mécanismes particuliers de cessation anticipée d'activité ou d'indemnisation liés à l'amiante.
Le tableau présenté ci-dessous reprend les estimations chiffrées des sommes qui devraient être à la charge des différents organismes intervenant dans la prise en charge des victimes de l'amiante.
Répartition du coût entre les différents organismes
(en millions d'euros)
|
Coût annuel |
Coût sur vingt ans |
|||
|
Hypothèse basse |
Hypothèse haute |
Hypothèse basse |
Hypothèse haute |
|
|
Sécurité sociale |
264 |
501 |
5.283 |
10.019 |
|
FIVA |
310 |
610 |
6.476 |
12.206 |
|
FCAATA |
91 |
751 |
15.013 |
15.013 |
|
TOTAL |
1.338 |
1.862 |
26.772 |
37.238 |
B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES FONDS DE L'AMIANTE À AMÉLIORER
Le FCAATA comme le FIVA sont financés, majoritairement, par une contribution de la branche AT-MP du régime général et, pour une plus faible part, par une contribution de l'État. Alors que cette dernière contribution a progressé de manière erratique, la contribution à la charge de la branche AT-MP s'est continûment alourdie, au point de remettre en cause durablement son équilibre financier. Cette situation a amené la mission à réfléchir à une éventuelle réforme de ces modalités de financement pour les rendre plus pérennes et équitables. De plus, l'augmentation des versements de la branche AT-MP n'a pas suffi à assurer l'équilibre financier du FCAATA, ce qui a justifié la création, en 2004, d'une contribution supplémentaire à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante.
1. Les ressources des « fonds de l'amiante »
Le FCAATA et le FIVA sont financés principalement par :
- une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dont le montant est fixé, chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale ;
- une contribution de l'État : pour le FCAATA, il s'agit d'une fraction du produit des droits de consommation sur les tabacs (recette affectée) ; pour le FIVA, il s'agit d'une dotation budgétaire fixée chaque année en loi de finances.
Les autres recettes de ces fonds sont plus marginales : depuis 2003, le FCAATA perçoit une contribution de la MSA, au titre du régime AT-MP des salariés agricoles, dont le montant est fixé par arrêté ; le FIVA peut percevoir des fonds au moyen d'actions subrogatoires (recours contentieux engagés contre les entreprises responsables de la contamination par l'amiante) ; le total des sommes recouvrées par le FIVA à ce titre s'élève, depuis l'origine, à 3,3 millions d'euros ; il peut également recevoir des dons et legs, recourir à l'emprunt ou bénéficier du produit de ses placements.
Une analyse de l'évolution des dotations depuis la création des « fonds de l'amiante » montre que l'essentiel de leur montée en charge a été assumé par la branche AT-MP, la contribution de l'État apparaissant plus volatile et globalement orientée à la baisse.
Dotations de l'État et de la branche AT-MP au FIVA et au FCAATA
(en millions d'euros)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 (prev) |
|
|
Total FCAATA |
6,6 |
133,4 |
237,3 |
334,3 |
482,3 |
530,9 |
|
Etat et tabac |
6,6 |
30,5 |
31,5 |
34,3 |
32,3 |
30,9 |
|
CNAMTS |
0 |
102,9 |
205,8 |
300 |
450 |
500 |
|
Total FIVA |
438 |
218 |
230 |
100 |
||
|
Etat |
38 |
40 |
||||
|
CNAMTS |
438 |
180 |
190 |
100 |
||
|
Total FCAATA+FIVA |
6,6 |
133,4 |
677 |
552,3 |
712,3 |
630,9 |
|
Etat |
6,6 |
30,5 |
33,2 |
72,3 |
72,3 |
30,9 |
|
CNAMTS |
0 |
102,9 |
643,8 |
480 |
640 |
600 |
Source : Cour des comptes
La branche AT-MP supportait 95 % du financement des fonds en 2004 contre 77 % en 2000.
Financement État et branche AT-MP du FIVA et du FCAATA
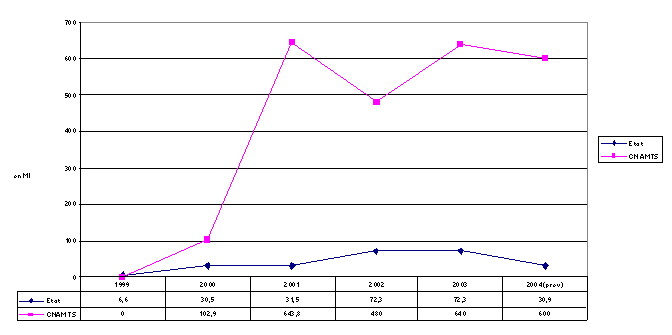 Source : Cour des
comptes
Source : Cour des
comptes
La contribution de la branche AT-MP au FCAATA a été multipliée par cinq en cinq ans, passant d'un peu moins de 103 millions d'euros en 2000 à 500 millions d'euros en 2004. La progression observée, jusqu'en 2004, des recettes générées par les taxes sur les tabacs a été compensée par une diminution de la fraction de ces droits affectée au FCAATA.
Evolution de la fraction du produit des droits de consommation sur les tabacs
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
0,43 % |
0,39 % |
0,39 % |
0,35 % |
0,31 % |
Source : FCAATA
La Cour des comptes note que « la part des droits à tabac dans le financement du FCAATA qui atteignait 23 % en 2000 a été ramenée à 7 % en 2003 » . Elle souligne qu' « une telle affectation complique pour le fonds les travaux de prévision » et que « l'intérêt essentiel de cette affectation paraît bien être plutôt de permettre de ne pas prendre en compte cette dépense dans le budget de l'État » 60 ( * ) , et d'afficher ainsi, optiquement, un moindre niveau de dépenses publiques.
La branche AT-MP a également financé en quasi-totalité les dépenses du FIVA. Comme la montée en charge du fonds a été très progressive, les dotations élevées qu'il a reçues au moment de sa création lui ont permis de se constituer des réserves, ce qui a autorisé une diminution de la contribution de la branche AT-MP depuis 2001. L'épuisement des réserves précédemment constituées nécessitera cependant de porter la contribution de la branche AT-MP à 200 millions d'euros en 2005. La dotation de l'État a évolué de manière aléatoire ; nulle en 2004, elle a été fixée à 52 millions d'euros par la loi de finances pour 2005.
2. La dégradation de la situation financière de la branche AT-MP
Alors que la branche AT-MP de la CNAM a longtemps été excédentaire, elle accumule, depuis quatre ans, des déficits de plus en plus conséquents.
Evolution du résultat net de la CNAMTS/AT-MP depuis 1995 (1)
(en millions d'euros)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005* |
|
|
Résultat net annuel |
169 |
26 |
42 |
239 |
215 |
350 |
19,5 |
-45,4 |
-475,6 |
-505 |
-704 |
(1) En encaissements-décaissements jusqu'en 1998, puis en droits constatés.
* prévision Source : Direction de la sécurité sociale
Une dégradation de la situation conjoncturelle, à partir de 2002, explique pour partie l'apparition de ce déficit, mais ne saurait en être la cause unique. Notre collègue André Lardeux notait, dès 2003, que le mode de financement du FCAATA et du FIVA conduit, toutes choses égales par ailleurs, « à peser durablement sur les comptes de la branche » . Il ajoutait que, dans ces conditions, « le retour durable à l'équilibre risque d'être difficile et pourrait même nécessiter, à moyen terme, la majoration du taux de cotisation, voire l'affectation de nouvelles recettes pour atteindre l'objectif d'équilibre » 61 ( * ) .
Sans aller jusque là, la Cour des comptes recommande de définir une clé de répartition des charges entre l'État et la CNAMTS. Une telle mesure empêcherait l'État de reporter la totalité de la charge sur la branche AT-MP et faciliterait la programmation financière des fonds et de la branche. Elle suggère également de substituer à la taxe affectée au FCAATA une dotation budgétaire, ce qui rendrait moins aléatoire l'évolution de ses recettes.
Une fois ces principes posés, la Cour souligne qu'il n'existe pas de règle permettant de définir, de manière objective, les contributions devant revenir, respectivement, à l'État et à la sécurité sociale.
L'État doit assumer une double responsabilité dans le drame de la contamination par l'amiante : en tant qu'employeur, mais aussi au titre de ses activités régaliennes. Comme on l'a vu, le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État pour sa carence fautive à prendre les mesures de prévention adéquates.
Il existe des éléments permettant d'apprécier la responsabilité de l'État employeur : 13 % des dossiers parvenant au FIVA concernent des salariés ayant relevé d'une entité publique et la part des indemnisations qui leur est consacrée est estimée entre 13 et 15 %. L'État employeur devrait donc assumer un peu moins d'un sixième des dépenses d'indemnisation. A la fin 2004, la dotation versée par l'État au FIVA a représenté 12,32 % des dépenses du fonds, ce qui n'est pas très éloigné de la proportion qui vient d'être indiquée. Ce résultat est cependant plus le fruit du hasard que d'une politique délibérée.
En revanche, « la responsabilité de l'État au titre de ses activités régaliennes peut difficilement faire l'objet d'une évaluation incontestable et relève essentiellement de la sphère du politique » 62 ( * ) . La mission propose que, si la juste contribution de l'État employeur au financement est estimée à 15 %, cette part soit doublée pour tenir compte de sa responsabilité en tant que puissance publique dans le drame de la contamination par l'amiante.
3. La dégradation de la situation financière du FCAATA et la création d'une nouvelle contribution
La situation financière du FIVA est, à ce jour, satisfaisante : les dotations qu'il a obtenues ont excédé ses dépenses jusqu'en 2003, ce qui lui a permis de se constituer d'importantes réserves.
Evolution des recettes du FIVA
(en millions d'euros)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
Contributions de la branche accidents du travail/maladies professionnelles |
438,3 |
180,0 |
190,0 |
100,0 |
200,0 |
|
Contributions de l'État |
0 |
380 |
40,0 |
0 |
52 |
|
Total dotations |
438,3 |
218,0 |
230,0 |
100,0 |
252,0 |
|
Dotations cumulées |
438,3 |
656,3 |
886,3 |
986,3 |
1.238,3 |
|
Dépenses |
0,0 |
14,1 |
176,7 |
470*0 |
535*0 |
|
Réserves |
438,3 |
642,2 |
695,5 |
325,5* |
42,5* |
* Prévisions Source : Direction de la sécurité sociale et FIVA
Le montant des réserves tend cependant à diminuer et devrait s'annuler en 2006. Les dotations au FIVA devront alors évoluer au rythme de ses dépenses pour que l'équilibre financier du fonds soit maintenu.
La situation financière du FCAATA s'est en revanche nettement dégradée ces dernières années : le fonds a accusé un déficit de 13 millions d'euros en 2003, qui s'est aggravé pour atteindre 122 millions d'euros en 2004.
Evolution globale des produits et des charges du FCAATA de 2000 à 2004
(en milliers d'euros)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
Total produits |
133.773 |
237.988 |
334.996 |
482.564 |
528.251 |
|
Total charges |
54.418 |
166.435 |
324.611 |
515.739 |
650.413 |
|
Résultat |
79.355 |
71.553 |
10.385 |
- 33.175 |
- 122.162 |
|
Résultat cumulé |
79.355 |
150.908 |
161.293 |
128.119 |
5.956 |
Source : FCAATA
Les ressources accumulées les années antérieures ont permis d'équilibrer la gestion en 2003 et 2004 mais elles tendent à s'épuiser.
C'est pourquoi l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a instauré une nouvelle contribution à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante .
Cette contribution est due par l'employeur pour chaque salarié, ou ancien salarié, admis au bénéfice de l'ACAATA, à compter du 5 octobre 2004 (sauf si ce dernier a plus de 60 ans au moment de l'admission).
Le montant de la contribution est égal à 21 % du montant annuel brut de l'ACAATA multiplié par le nombre d'années séparant l'âge d'entrée du bénéficiaire dans le dispositif et 60 ans.
Pour ne pas pénaliser les très petites entreprises, la contribution n'est pas due pour le premier salarié, ou ancien salarié, entré dans le dispositif au cours de l'année civile. La contribution est également plafonnée : elle n'est due que si son montant est inférieur à un double plafond, apprécié par année, égal à :
- 2 millions d'euros ;
- 2,5 % de la masse salariale de l'entreprise de l'année précédant la date d'exigibilité de la contribution.
La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée par les URSSAF.
Son rendement devrait être proche de 116 millions d'euros en 2005, selon les prévisions de la direction de la sécurité sociale. Il ne serait toutefois pas suffisant pour assurer un retour à l'équilibre du fonds en 2005.
Budget du FCAATA
(en milliers d'euros et en %))
|
FCAATA |
2004 |
% |
2005 prévisionnel |
% |
|
CHARGES |
650,4 |
26 |
766,7 |
18 |
|
Charges gérées par la CNAMTS AT-MP |
564,0 |
28 |
668,7 |
19 |
|
ACAATA brute (y compris cotisations maladie, CSG et CRDS) |
454,9 |
27 |
541,7 |
19 |
|
Prise en charge de cotisations d'assurance volontaire vieillesse |
99,8 |
30 |
116,2 |
16 |
|
Charges de gestion des CRAM |
9,2 |
29 |
10,8 |
18 |
|
Charges gérées par le CDC |
86,4 |
17 |
98,1 |
13 |
|
Prise en charge de cotisations de retraite complémentaire |
86,3 |
17 |
97,9 |
13 |
|
AGIRC + ARRCO |
71,0 |
26 |
78,4 |
11 |
|
IRCANTEC |
0,5 |
39 |
0,5 |
9 |
|
Retraite complémentaire à 60 ans (ASF + AGFF) |
14,9 |
- 14 |
19,0 |
27 |
|
Charges de gestion CDC |
0,1 |
2 |
0,1 |
30 |
|
PRODUITS |
528,3 |
9 |
759,9 |
44 |
|
Contributions de la CNAMTS AT-MP |
500,0 |
11 |
600,0 |
20 |
|
Contribution du régime AT-MP des salariés agricoles |
0,2 |
- |
0,0 |
- 100 |
|
Contribution de l'État |
||||
|
Droits sur les tabacs (centralisés par la DCC) |
27,9 |
- 14 |
29,0 |
4 |
|
Produits financiers CDC |
0,1 |
- 52 |
0,0 |
- 100 |
|
Nouvelle contribution employeurs |
0,0 |
115,9 |
||
|
Produit exceptionnel* |
15,0 |
|||
|
Résultat net |
- 122,1 |
- 6,8 |
||
|
Réserve cumulée depuis 2000 |
6,0 |
- 0,8 |
* Contribution employeur 2004 reportée sur l'exercice 2005
(Source : Direction de la sécurité sociale SDEPF/6C)
III. UN RÉGIME D'INDEMNISATION QUI N'A PAS RÉPONDU À TOUTES LES ASPIRATIONS
Les auditions et les déplacements auxquels a procédé la mission ont montré que le dispositif d'indemnisation, en dépit du niveau élevé des dépenses, ne donnait pas entièrement satisfaction. La création du FIVA n'a pas tari le contentieux devant les juridictions judiciaires, contrairement à ce qui avait été initialement escompté. Le régime de « préretraite amiante » est soumis à de fortes pressions, qui ont conduit à certaines dérives. Et le mode de financement de l'indemnisation, fortement mutualisé, incite peu à la prévention des risques professionnels.
A. LA PERSISTANCE D'UN IMPORTANT CONTENTIEUX
Comme cela a été indiqué précédemment, la création du FIVA devait permettre aux victimes de percevoir une indemnisation rapide, en évitant d'avoir à engager de longues procédures judiciaires. Même si un nombre croissant de victimes a recours aux services du FIVA (86 % des victimes ont été indemnisées par le FIVA en 2004), un contentieux non négligeable subsiste devant les tribunaux judiciaires, certaines cours d'appel octroyant en effet aux victimes des indemnités supérieures à celles du fonds.
1. Les procédures utilisées
Deux voies permettent aux victimes de saisir les tribunaux.
Elles peuvent choisir d'ignorer le FIVA et engager un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Si la faute inexcusable est reconnue, la victime a alors droit à une indemnisation plus étendue que celle accordée par la branche AT-MP : sont alors indemnisés, au titre des préjudices patrimoniaux, la perte de chance de promotion professionnelle et, au titre des préjudices personnels, les préjudices moral, de souffrance et d'agrément de la victime, ainsi que le préjudice moral de ses ayants droit les plus proches. De plus, la rente ou le capital perçu par la victime est majoré.
La modification de la jurisprudence de la Cour de cassation, intervenue en 2002, a rendu la condamnation de l'employeur pour faute inexcusable plus facile que par le passé. On constate d'ailleurs une forte croissance du nombre de jugements, passé de 300 en 2002 à 900 en 2003 et plus de 1.500 en 2004. Sur les 1.217 jugements rendus dans le premier semestre 2004, seuls 25, soit moins de 2 %, ne reconnaissaient pas la faute inexcusable de l'employeur.
Les victimes peuvent également, si elles ont choisi de s'adresser au FIVA, contester devant la cour d'appel, dans un délai de deux mois, l'offre d'indemnisation qui leur a été faite ; 5 % des offres du FIVA sont ainsi frappées de recours.
2. Des décisions très hétérogènes et des montants d'indemnisation souvent supérieurs à ceux accordés par le FIVA
La mission a perçu au cours de ses travaux l'importance que revêt, aux yeux des victimes, la condamnation de l'employeur responsable de leur contamination. Le fait d'intenter une action en justice, plutôt que de s'adresser au FIVA, comporte une dimension psychologique indéniable. Néanmoins, la recherche d'une indemnisation supérieure à celle du FIVA est aussi une motivation essentielle pour les victimes, souvent encouragées sur cette voie par leurs associations. On observe que la fréquence des recours contentieux est plus élevée lorsque les indemnisations versées par la cour d'appel sont plus généreuses.
a) L'hétérogénéité des décisions de justice
Le FIVA insiste, dans son dernier rapport annuel, sur le « caractère extrêmement hétérogène » de la jurisprudence : les tribunaux accordent des indemnisations de montants très différents pour des pathologies semblables.
Le président du conseil d'administration du FIVA, M. Roger Beauvois, a cité devant la mission l'exemple de décisions récentes du TASS de Marseille : « Le 1 er juillet dernier, le TASS de Marseille, que présidait un magistrat, a rendu onze décisions concernant l'indemnisation des victimes atteintes de plaques pleurales avec une incapacité de 5 %. Le montant de ces indemnisations variait de 3.500 euros, a minima, à 7.500 euros, a maxima. Quatre jours plus tard, la même juridiction présidée par un autre magistrat indemnisait les mêmes situations dans trois dossiers avec des montants variant de 30.000 au minimum à 45.000 euros au maximum ! ». S'étonnant de ces écarts, il a ajouté que « des pathologies bénignes sont mieux indemnisées devant certaines juridictions que des pathologies mortelles devant d'autres ». Me Jean-Paul Teissonière a confirmé l'hétérogénéité des décisions de justice, soulignant que les avocats étaient confrontés à « une mosaïque de décisions dont il est très difficile de tirer des leçons ».
Il est néanmoins possible d'esquisser une comparaison entre les indemnisations moyennes accordées par les tribunaux et celles versées par le FIVA.
b) Éléments de comparaison entre les indemnisations accordées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les indemnisations du FIVA
La comparaison des indemnités accordées par le FIVA et de celles versées par les tribunaux montre que les victimes ont, dans bien des cas, intérêt financièrement à engager une action en justice.
Comparaison pour les IPP de 5 % (plaques pleurales)
La comparaison pour les plaques pleurales est relativement aisée ; il n'y a pas, en effet, de préjudices annexes (frais de soins, tierce personne, préjudice professionnel) à prendre en compte et le montant versé par le tribunal au titre de la majoration d'incapacité est versé en capital, et non en rente. La majoration accordée par les juridictions correspond à un doublement de l'indemnité en capital, qui s'élève à 1.682,82 euros en 2005.
L'indemnisation du FIVA est globalement moins avantageuse que celle des tribunaux. Si l'indemnisation du FIVA au titre du préjudice patrimonial, qui dépend de l'âge de la victime, est d'un montant supérieur, le FIVA indemnise, en revanche, moins bien le préjudice extrapatrimonial que les juridictions.
Indemnisation moyenne jurisprudence et FIVA de 1999 à 2002
(en euros)
|
1999-2002
|
FIVA
|
Ecart FIVA/Jurisprudence
|
|
|
Moyenne extrapatrimonial |
22.263 |
15.000 |
- 34 % |
|
Patrimonial |
1.482 |
4.100 |
277 % |
|
Total |
24.904 |
19.100 |
- 21 % |
Source : Cour des comptes
Comparaison pour les IPP de plus de 9 %
Cette comparaison est plus délicate, dans la mesure où l'indemnisation de l'incapacité au-delà de 9 % est servie en rente, de même que le montant accordé par le tribunal au titre de la majoration d'incapacité.
Il apparaît cependant que, pour les taux d'incapacité compris entre 10 et 50 %, la majoration de rente est plus avantageuse financièrement que l'indemnisation par le FIVA. A compter d'un taux d'IPP de 51 %, plus le taux est élevé, plus l'avantage relatif à la majoration pour faute inexcusable se réduit, en raison notamment de la progressivité du barème du FIVA ; il devient nul pour un taux d'IPP de 100 %. Cependant, la diversité des pratiques de « consolidation » entre les caisses conduit à certaines variations dans les montants d'indemnisation et certaines victimes ne font pas l'objet d'une consolidation avant le décès 63 ( * ) .
Comparaison de l'indemnisation des ayants droit
En cas de décès de la victime, le conjoint survivant et les enfants de moins de seize ans (moins de vingt ans s'ils sont apprentis ou étudiants) bénéficient d'une majoration de leur rente. Si l'on retient l'exemple du conjoint survivant, celui-ci bénéficie d'une rente égale à 40 % du salaire de la victime s'il est âgé de moins de cinquante-cinq ans et de 60 % au-delà. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur conduit à porter la rente à 100 % du salaire de la victime. Il s'agit là d'une disposition plus favorable que la réparation intégrale qui n'indemnise que le seul préjudice économique du conjoint survivant, c'est-à-dire lui garantit que son revenu après décès soit au moins égal à son revenu avant décès, moins la part de consommation de la personne décédée.
On constate que, dans ces deux derniers cas de figure (incapacités de plus de 10 % et droits du conjoint survivant), le bénéfice retiré de la majoration de rente est supérieur à la réparation intégrale du FIVA. La victime a donc intérêt à ce que la faute inexcusable soit reconnue, quand bien même elle aurait perçu l'indemnisation du FIVA. C'est ce qui explique qu'un article de la loi créant le FIVA 64 ( * ) , introduit par voie d'amendement parlementaire, prévoit que dans ces situations la victime puisse bénéficier, suite au recours subrogatoire exercé par le FIVA, d'une « indemnisation complémentaire [...] susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur ». Autrement dit, si le recours subrogatoire intenté par le fonds aboutit à la reconnaissance de la faute inexcusable, la victime perçoit un complément indemnitaire.
Cependant, comme le FIVA n'exerce qu'un faible nombre de recours subrogatoires (environ 750 actions récursoires engagées depuis l'origine), les victimes peuvent être légitimement tentées d'engager elles-mêmes les recours en justice.
c) La jurisprudence des cours d'appel en matière de contestation des offres du FIVA
Cette jurisprudence se caractérise, là encore, par la grande hétérogénéité des décisions rendues.
A la mi-2005, 802 recours ont été engagés devant les cours d'appel pour contester les offres du FIVA et, dans 36 % des cas, une décision a été rendue. Les 284 décisions rendues correspondent à 503 demandes (il peut y avoir en effet, pour les victimes décédées, plusieurs demandes par affaire).
La majorité des décisions rendues sont défavorables au FIVA : 284 décisions ont infirmé l'offre du FIVA et 219 l'ont confirmé 65 ( * ) . La proportion de décisions favorables au FIVA diminue au fil des ans, le contentieux ayant tendance à augmenter devant les cours qui majorent les offres du fonds et à diminuer devant celles qui les confirment. Les quatre cours les plus saisies - Paris, Douai, Bordeaux et Aix -, qui infirment souvent les décisions du FIVA, représentent à elles seules 59 % du contentieux.
3. Comment diminuer le nombre de recours contentieux ?
La Cour des comptes formule, dans son rapport, plusieurs recommandations pour favoriser la baisse du nombre de recours.
a) Une majoration de l'indemnisation par le FIVA ?
Constatant que les indemnisations accordées sur le fondement de la faute inexcusable sont souvent supérieures à celles du FIVA, et que cela incite les victimes à intenter des actions en justice, et observant que la quasi-totalité des recours en faute inexcusable aboutit à la condamnation de l'employeur, la Cour des comptes propose d'instaurer une forme de « présomption de faute inexcusable » et de majorer l'indemnisation du FIVA en conséquence, pour la porter, dans tous les cas, au niveau atteint en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. De cette manière, les victimes n'auraient plus d'intérêt financier à aller en justice.
Le FIVA a évalué à 47,9 millions d'euros le coût d'une telle mesure en 2006. Si le fonds continue à n'intenter qu'un faible nombre de recours subrogatoires, la majoration pour faute inexcusable par la voie judiciaire devrait avoir un coût global de 17,6 millions d'euros en 2006 ; le coût de la reconnaissance automatique étant estimé à 65,5 millions d'euros, le surcoût lié à la mesure serait donc de 47,9 millions d'euros. Le surcoût maximum serait atteint en 2027 et s'élèverait à cette date à 150 millions d'euros. Un développement des recours subrogatoires du FIVA diminuerait bien sûr ce différentiel.
La Cour des comptes suggère de compenser cette dépense supplémentaire par des économies réalisées sur le budget du FCAATA, grâce à un resserrement des critères d'attribution de l'ACAATA. Si la mission approuve l'idée de majorer l'indemnisation versée par le FIVA, elle n'a, en revanche, pas été convaincue par cette dernière recommandation.
b) Désigner une cour d'appel unique ?
L'hétérogénéité des décisions de justice est ressentie douloureusement par les victimes de l'amiante. Comme l'a noté Me Jean-Paul Teissonnière, l'organisation des victimes au sein de l'ANDEVA rend plus perceptibles les différences de traitement : « Les victimes qui sont regroupées dans une association nationale, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres contentieux - je pense à celui des accidents de la circulation, qui est beaucoup plus dispersé et pour lequel les victimes ne sont pas unies de la même façon -, font des comparaisons absolument insupportables ».
La solution avancée par la Cour des comptes consisterait à regrouper les appels dans une seule cour, afin de favoriser un traitement plus équitable des victimes.
Intéressante, cette recommandation pose cependant plusieurs problèmes de mise en oeuvre :
- se pose, en premier lieu, la question du choix de la cour d'appel compétente : l'ANDEVA propose de retenir la première chambre de la cour d'appel de Paris, déjà spécialisée dans les affaires de santé ; cette cour ayant tendance à accorder des indemnisations particulièrement élevées, un tel choix risque toutefois d'entraîner une hausse du nombre de recours, d'affaiblir le rôle du FIVA et de susciter une inflation des dépenses difficile à contenir. A contrario , le choix d'une cour d'appel moins généreuse serait perçu par les victimes comme une manoeuvre destinée à porter atteinte à leurs droits et serait donc très mal ressenti ;
- elle va, ensuite, à l'encontre de l'objectif de proximité entre les citoyens et la justice : le regroupement des dossiers dans une cour d'appel unique compliquerait les démarches des victimes habitant en des points éloignés du territoire ;
- elle oblige, enfin, à doter de moyens importants la cour ainsi désignée, sans quoi le regroupement du contentieux entraînerait un encombrement de la juridiction et un fort allongement des délais de jugement.
Ces considérations expliquent que la FNATH (Association des accidentés de la vie) soit hostile au principe d'une cour d'appel unique et plaide pour que « les victimes du travail soient traitées dans le droit commun de l'ordre judiciaire » . Elle souligne que « les aléas de la jurisprudence sont tels qu'il n'est pas certain qu'un regroupement aboutirait à un alignement sur la jurisprudence la plus favorable aux victimes. Telle cour d'appel peut être aujourd'hui la plus favorable, mais ne plus l'être demain. C'est pourquoi la FNATH ne souhaite pas prendre un tel risque et bousculer l'ordre judiciaire établi » .
La mission, pour sa part, ne souhaite pas écarter d'emblée l'idée de regrouper le contentieux dans une cour d'appel unique. Mais elle souhaiterait cependant que des mesures plus simples soient d'abord mises en application pour essayer d'homogénéiser les décisions de justice :
- une meilleure information des tribunaux sur le barème du FIVA et sur la moyenne des indemnisations judiciaires réduirait sans doute les disparités, par un simple effet de comparaison ;
- comme l'a suggéré M e Philippe Plichon au cours de son audition, un haut magistrat de la Cour de cassation pourrait, à l'instar des présidents de cour d'appel qui réunissent les présidents de chambre et de tribunaux pour définir un niveau d'indemnisation, réunir les présidents de cour d'appel pour tenter de dégager des positions consensuelles ;
Si ces mesures échouaient à contenir les disparités entre tribunaux, l'option de la désignation d'une cour d'appel unique devrait alors être à nouveau envisagée.
B. UN RÉGIME DE « PRÉRETRAITE AMIANTE » SOUMIS À DES PRESSIONS CONTRADICTOIRES
En dépit des élargissements successifs du périmètre d'intervention du FCAATA, le fonctionnement du dispositif de cessation anticipée d'activité demeure inégalitaire. Les associations de victimes en demandent l'extension à de nouveaux publics, ce qui inquiète les employeurs, qui assument l'essentiel de son financement. Des dérives se sont enfin manifestées dans le passé, qu'il convient désormais de corriger.
1. Les modalités d'inscription des établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA font l'objet de vives critiques
Devant la mission, les associations de victimes et les syndicats de salariés ont vivement critiqué les modalités d'inscription des établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Les décisions d'inscription sur les listes sont souvent jugées arbitraires ; elles excluraient du dispositif un grand nombre de salariés qui ont pourtant été exposés aux poussières d'amiante.
C'est le point de vue défendu par l'ANDEVA, qui considère que « les listes d'établissement n'ont pas été établies de façon sérieuse et rigoureuse. Des sièges sociaux figurent ainsi dans les décrets alors que les filiales manipulant de l'amiante en sont exclues » . La FNATH juge pour sa part que les conditions d'accès à l'ACAATA « sont draconiennes et difficiles à mettre en oeuvre. Elles entraînent un certain nombre de dysfonctionnements et d'injustices. En effet, le travailleur en contact avec l'amiante, mais dont l'entreprise ne figure pas dans les établissements où celui-ci a été utilisé, ne sera pas bénéficiaire du système. Il existe donc, d'abord, un problème de fonctionnement du système avec l'existence d'une liste fermée. Par ailleurs, le dispositif consiste à faire remonter les informations au niveau national et confie au ministre le soin de déterminer les entreprises qui ont utilisé de l'amiante sur certaines périodes. En conséquence, le système est lourd. Il ne répond pas complètement à la problématique en termes d'appréhension des populations concernées. Enfin, il provoque un certain nombre d'injustices entre catégories de salariés ».
Lors de la table ronde réunissant les organisations syndicales, le Dr Bernard Salengro, représentant la CFE-CGC, a fait part, en termes très vifs, de l'incompréhension des salariés : « selon que vous êtes dans l'entreprise A ou B, vous y aurez droit ou non [à l'ACAATA]. Il suffit parfois de traverser la route ou de changer de raison administrative ! Combien de salariés ont la boule dans la gorge parce qu'ils ne sont pas pris en charge, ne peuvent pas sortir de ce guêpier et de cette situation et ne bénéficient pas du FCAATA ? » .
Mme Martine Aubry a estimé que « aujourd'hui, le vrai sujet est la difficulté de faire inscrire une entreprise qui, de façon évidente, a manipulé de l'amiante de manière intensive ». Elle a fait part de son engagement aux côtés des salariés de SI Energie, entreprise qui dépendait autrefois du groupe Alstom, et dont l'inscription sur les listes a été obtenue de haute lutte : « Nous avons commencé le combat en avril 2003, j'ai accompagné les salariés dans toutes les instances, j'ai été auprès d'eux, nous sommes intervenus auprès du ministère et ce n'est qu'en mars 2005 que nous avons obtenu gain de cause ».
M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur-adjoint de la mission, a également signalé, à l'occasion de l'audition du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, M. Gérard Larcher, le cas d'une entreprise de sous-traitance dont l'inscription sur les listes a été refusée, alors qu'elle fabriquait des joints en caoutchouc et amiante pour les sous-marins de la Défense nationale.
Au cours de la même audition, le directeur des relations du travail, M. Jean-Denis Combrexelle, a admis que le dispositif posait des problèmes « en termes de justice et d'équité ». Il a pointé deux difficultés qui peuvent expliquer les injustices ressenties par les personnes exposées à l'amiante :
- l'instruction des dossiers, lorsqu'un établissement demande à figurer sur les listes, est généralement difficile ; comme il n'existe pas en France « d'état civil des entreprises », il est extrêmement ardu de retracer l'activité passée de sociétés qui ont souvent changé de nom et d'adresse ; des erreurs peuvent donc avoir lieu au cours de l'instruction, éventuellement corrigées par des rectificatifs ;
- le dispositif n'a pas vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés exposés à l'amiante au cours de leur carrière, puisque le FCAATA ne concerne, de par la loi, que les établissements ayant oeuvré dans certains secteurs d'activité : fabrication de matériaux contenant de l'amiante, flocage, calorifugeage, construction et réparation navale. En conséquence, comme l'a rappelé M. Jean-Denis Combrexelle, il peut arriver qu'un « établissement dont un salarié a été exposé à l'amiante ne bénéficie pas pour autant de la cessation anticipée [ ... ] parce que son activité n'est pas définie par la loi » .
La mission considère que ce mode d'organisation pose un véritable problème en termes d'égalité de traitement. Tout en préconisant le maintien du système des listes pour les secteurs qui ont été de gros utilisateurs d'amiante, elle suggère de réfléchir à la mise en place d'une nouvelle voie d'accès à l'ACAATA , qui bénéficierait, sur une base individuelle, à des salariés ayant été exposés à l'amiante, de manière significative et durable, dans un établissement appartenant à un secteur non visé par la loi.
Il existe déjà des possibilités d'obtenir l'ACAATA de manière individuelle ; comme l'a rappelé Mme Martine Aubry, le ministère des affaires sociales, par circulaire commune avec la sécurité sociale, a reconnu aux épouses de salariés de l'amiante exposées à la fibre dans le cadre domestique la possibilité de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité. Les responsables de DCN rencontrés à Cherbourg ont également indiqué que les personnels des entreprises sous-traitantes ou d'intérim qui ont travaillé sur leur site pouvaient se voir reconnaître, au cas par cas, le bénéfice de l'ACAATA, après examen de leur situation par la direction départementale du travail et de l'emploi et la CRAM.
Il conviendrait cependant d'institutionnaliser davantage cette voie d'accès. Pour identifier plus facilement les salariés concernés, des comités de site , rassemblant l'ensemble des acteurs concernés (représentants de l'entreprise, des salariés, de l'État, de la caisse primaire d'assurance maladie...) pourraient être instaurés, afin de recouper, de manière contradictoire, les informations disponibles.
Un tel dispositif permettrait notamment de mieux prendre en compte les droits des salariés des entreprises sous-traitantes, ou des salariés intérimaires, qui ont pu travailler pendant des années dans des établissements utilisant l'amiante, sans faire partie de leurs effectifs salariés, et qui de ce fait n'ont pas droit aujourd'hui à l'ACAATA.
2. Toutes les catégories de travailleurs n'ont pas également accès à un régime de préretraite amiante
Le déplacement de la mission à Cherbourg, sur le site de la DCN, ancienne direction des constructions navales, désormais société de droit privé, lui a permis de mesurer les différences de traitement existant entre travailleurs relevant de régimes sociaux différents.
La direction de DCN a en effet indiqué que, parmi ses salariés :
- ceux relevant du régime général peuvent partir en préretraite grâce aux allocations du FCAATA ;
- les ouvriers d'État du ministère de la défense peuvent partir en préretraite sur la base du régime institué par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- bien qu'un dispositif de cessation anticipée d'activité ait été institué à leur profit par l'article 96 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003, les fonctionnaires et contractuels du ministère de la défense détachés auprès de DCN ne bénéficient pas encore d'un régime de préretraite, faute de parution des décrets d'application nécessaires ;
- les militaires du ministère de la défense ayant signé un contrat avec DCN, tout en conservant une attache avec le ministère, ne bénéficient d'aucun régime de préretraite et la création d'un dispositif s'adressant à cette catégorie de personnel n'est pas à l'ordre du jour.
L'exemple de l'entreprise DCN met en évidence les différences de traitement peu justifiées existant entre des personnes ayant travaillé sur les mêmes sites, mais relevant de statuts différents. La mission souhaite que la législation tende vers un traitement égalitaire de l'ensemble des personnels ayant été exposés à l'amiante. Elle note, qu'aujourd'hui, un fonctionnaire atteint d'une maladie de l'amiante n'a pas accès au FCAATA, puisque celui-ci ne s'adresse qu'aux salariés du régime général et du régime agricole, et qu'il n'existe pas de dispositif analogue au sein de la fonction publique, hormis bien sûr le régime applicable à certains agents du ministère de la défense qui vient d'être évoqué 66 ( * ) . Un groupe de travail pourrait utilement être mis en place, au sein de l'administration, pour évaluer les besoins, les dépenses prévisibles et les financements à mobiliser.
3. Des dérives ont été observées dans l'utilisation du FCAATA
Plusieurs indices convergents amènent à penser que le FCAATA a pu être détourné de sa vocation première pour devenir, dans certains cas, un simple instrument de gestion des effectifs.
La Cour des comptes cite dans son rapport une note de la direction des relations du travail, selon laquelle on ne peut ignorer la corrélation entre ces demandes [d'inscription sur les listes] et les plans sociaux en cours, en forte augmentation, et du réflexe quasi systématique désormais de la part des partenaires sociaux ou des élus, de solliciter l'inscription des entreprises en question sur les listes, en vue de gérer, au moins en partie ces plans sociaux. En effet, le dispositif de cessation anticipée d'activité est en passe de devenir un des rares dispositifs de « préretraite » aidés financièrement 67 ( * ) . Pour illustrer son propos, cette note mentionne un afflux récent de demandes d'établissements appartenant au groupe Alstom, qui fut menacé de déposer le bilan en 2004.
Mme Marianne Lévy-Rozenwald, présidente du conseil de surveillance du FCAATA, a admis, prudemment, qu'il y a « vraisemblablement des circonstances dans lesquelles l'ACAATA a été utilisée comme un élément de politique de restructuration » . Elle a déclaré penser « que l'extension de l'ACAATA aux personnels portuaires, aux dockers professionnels puis aux personnels de manutention, a été un moyen de résoudre la situation des dockers » .
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, a reconnu que « le passé n'est pas exempt de dérives » , citant en exemple le cas de l'entreprise Moulinex. Il a jugé « inacceptable de résoudre des problèmes de mutation économique au travers de ce fonds » .
Il est vrai que l'utilisation abusive du FCAATA affaiblit sa légitimité aux yeux de ses bénéficiaires comme aux yeux de ses financeurs et détourne de leur objet des ressources qui pourraient être utilisées pour inclure dans le dispositif de cessation anticipée des personnels qui n'y figurent pas aujourd'hui.
4. Le coût croissant du dispositif suscite des demandes de resserrement des conditions d'accès à l'ACAATA
Les dépenses du FCAATA sont principalement prises en charge par la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale, qui est intégralement financée par les employeurs.
Les représentants des organisations patronales ont jugé trop larges les conditions d'accès à l'ACAATA. M. Dominique de Calan, président du groupe de travail « amiante » du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), a ainsi déclaré, dans un propos liminaire où il exprimait la position de son organisation, mais aussi de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et de l'Union patronale de l'artisanat (UPA), que « le bénéfice de la cessation anticipée d'activité devrait être réservé aux seules personnes réellement malades ou ayant été reconnues comme exposées » . Plus précisément, le MEDEF demande, depuis trois ans, que les conditions d'accès au FCAATA s'inspirent de celles visées par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 applicable à certains ouvriers d'État relevant du ministère de la défense. Pour avoir accès à la cessation anticipée d'activité, ces personnels doivent remplir deux conditions cumulatives : avoir travaillé dans un établissement visé dans une liste et pendant des périodes définies par arrêté (condition identique à celle exigée pour le FCAATA) ; mais aussi avoir exercé une profession figurant sur une liste établie par arrêté. Cette modification permettrait de cibler le bénéfice de l'ACAATA sur les salariés ayant directement travaillé au contact de l'amiante, et non sur l'ensemble des salariés d'un établissement.
Le ministère du travail a jusqu'à présent toujours refusé d'accéder à cette demande, arguant qu'il serait extrêmement difficile de démontrer que tel salarié n'a pas exercé, au cours de sa carrière, une fonction l'ayant exposé à l'amiante. On peut ajouter que, dans les entreprises ayant massivement utilisé l'amiante, la dispersion des fibres sur les sites a conduit à l'exposition de salariés que leurs fonctions ne mettaient pas a priori directement au contact du matériau, des employés de bureau par exemple.
La Cour des comptes propose de resserrer de manière plus drastique encore les conditions d'accès au FCAATA, puisqu'elle recommande de réserver le bénéfice de l'ACCATA aux seules victimes de pathologies déclarées. Les économies ainsi réalisées permettraient de financer la majoration des offres d'indemnisation du FIVA précédemment évoquée, sans augmenter l'enveloppe globale allouée aux « fonds de l'amiante ». Pour justifier cette recommandation, la Cour note que 10 % seulement des bénéficiaires de l'ACAATA sont atteints d'une pathologie liée à l'amiante.
La mission n'est pas convaincue par cette proposition de la Cour. Elle observe que le chiffre avancé de 10 % ne tient pas compte des phénomènes de sous-déclaration et de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, qui conduiraient certainement à le majorer, et note qu'il s'explique aussi, au moins pour partie, par les dérives constatées dans la politique d'inscription des établissements sur les listes, dérives qui, si elles doivent être corrigées, ne sauraient justifier une remise en cause des fondements mêmes du FCAATA. En outre, le long délai de latence de plusieurs maladies de l'amiante rend cette évaluation très provisoire.
Surtout, elle ignore la vocation originale du FCAATA et transformerait l'ACAATA en un simple complément de la réparation par le FIVA. La raison d'être du FCAATA est de prendre en compte le fait que les personnes intensément exposées à l'amiante sont susceptibles de développer une maladie grave et voient leur espérance de vie statistiquement réduite. Il est logique, dans ces conditions, qu'elles bénéficient d'une préretraite sur la base d'une attestation d'exposition et non d'un diagnostic médical. De surcroît, la proposition de la cour n'aurait pas grand sens pour les victimes des pathologies les plus graves : quel intérêt trouverait une personne atteinte d'un mésothéliome à partir en préretraite une fois le diagnostic établi, alors que l'espérance de vie moyenne des malades, à ce stade, n'est que de dix-huit mois ?
Il serait enfin politiquement difficile de supprimer l'ACAATA à ceux qui en sont actuellement bénéficiaires ou de limiter drastiquement les conditions d'accès à cette prestation. Comme l'a rappelé Mme Marianne Lévy-Rozenwald, « l'ACAATA a été la première reconnaissance donnée aux victimes de l'amiante et [...] il y a beaucoup de passion à ce sujet ». Les bénéficiaires savent qu'ils peuvent développer une maladie et il est donc délicat de leur expliquer qu'il convient de revenir sur des droits acquis pour des raisons d'économie budgétaire.
Au total, la mission n'est pas favorable à une remise en cause des principes d'attribution de l'ACAATA et souhaite un traitement équitable de l'ensemble des personnes exposées à l'amiante au cours de leur carrière, quel que soit le régime social auquel elles se rattachent. Elle demande également une application rigoureuse des critères d'inscription sur les listes afin d'éviter les dérives constatées par le passé.
C. UN MODE DE FINANCEMENT QUI INCITERAIT PEU À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Bien que les victimes de l'amiante soient fortement concentrées dans quelques entreprises, le financement de l'indemnisation est largement mutualisé, ce qui incite peu les employeurs à investir dans la prévention des risques professionnels.
1. Une forte concentration des victimes de l'amiante dans quelques entreprises
La Cour des comptes a examiné les décisions de justice rendues en matière de contentieux de l'indemnisation des maladies de l'amiante et les offres du FIVA et mis en évidence une forte concentration des victimes dans quelques sociétés ou entités publiques.
Parmi les 2.195 décisions de justice rendues entre le 10 avril 1999 et le 2 février 2004, pour un total de 77 millions d'euros d'indemnisation, douze employeurs représentaient plus de 55 millions d'euros, soit 71,4 % du total. Quatre étaient des entités publiques au moment de l'exposition : direction des constructions navales (DCN), ministère de la défense, EDF et SNCF, condamnés à verser 8 millions d'euros.
Montant des indemnisations versées par les
employeurs
les plus concernés par les décisions
judiciaires
(en euros)
|
Everite |
13.446.295 |
|
Eternit |
13.322.549 |
|
Normed |
9.750.995 |
|
DCN |
5.527.264 |
|
Valeo |
4.276.000 |
|
Ascometal |
2.380.205 |
|
Atelier français de l'ouest |
2.325.000 |
|
Défense |
957.600 |
|
Alstom |
917.771 |
|
EDF |
859.500 |
|
SNCF |
749.300 |
|
Amisol |
661.467 |
|
55.173.946 |
Source : Cour des comptes
Une étude menée à partir d'un groupe de 1.526 victimes indemnisées par le FIVA a montré que 10 % des employeurs employaient à eux seuls plus de 43 % des victimes.
2. De puissants mécanismes de mutualisation
Des règles d'origine législative ou jurisprudentielle aboutissent néanmoins à une forte mutualisation du financement, qui concerne aussi bien les dépenses de la branche AT-MP que les dépenses du FCAATA et du FIVA.
a) Mutualisation des dépenses de la branche AT-MP
Les trois quarts des dépenses de la branche AT-MP au titre des maladies de l'amiante ont été, en 2002, imputées au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Ce compte regroupe les dépenses afférentes à des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles en 1993, en cas d'exposition à des risques antérieurs à cette date, et à des maladies contractées dans une entreprise disparue ou susceptibles d'avoir été contractées dans plusieurs entreprises, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle. L'inscription des dépenses sur ce compte a pour effet d'en répartir la charge sur l'ensemble des employeurs affiliés au régime général, qui supportent une majoration de leur taux de cotisation d'autant plus importante que leur masse salariale est élevée (majoration M3).
b) Mutualisation des dépenses du FCAATA et du FIVA
Le financement de ces fonds par une dotation budgétaire et par une dotation de la sécurité sociale aboutit, mécaniquement, à en mutualiser la charge.
En théorie, toutefois, le FIVA devrait pouvoir, en engageant des actions récursoires, récupérer les sommes versées auprès des entreprises responsables de l'exposition à l'amiante. Plus précisément, en cas de condamnation d'un employeur pour faute inexcusable, la branche AT-MP intervient comme un assureur pour le compte de l'entreprise : elle prend en charge les dépenses occasionnées et il lui appartient ensuite de se retourner contre l'employeur fautif.
Diverses règles législatives ou jurisprudentielles rendent cependant fréquemment impossible cette récupération, de sorte que les dépenses restent, in fine, à la charge de la branche AT-MP. Il en va de même lorsque les victimes engagent directement un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Les principaux mécanismes de mutualisation sont les suivants :
? Les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 :
L'article 40 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, modifié par l'article 35 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale du 29 décembre 1999, a levé les règles habituelles de prescription afin qu'il soit possible d'engager un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'une première constatation médicale est intervenue entre le 1 er janvier 1947 et le 27 décembre 1998. Pour éviter que les entreprises ne soient déstabilisées par un flux de recours inattendu, le même article prévoit cependant que les dépenses ainsi occasionnées sont supportées définitivement par la branche AT-MP du régime général ou, le cas échéant, du régime agricole. La loi interdit donc aux caisses de sécurité sociale d'intenter des actions pour récupérer, auprès des entreprises, les sommes versées aux victimes de l'amiante.
? Disparition de l'entreprise responsable :
En raison du long délai de latence de certaines maladies de l'amiante, il arrive fréquemment que l'entreprise responsable de la contamination ait disparu. Dans ce cas, la jurisprudence s'oppose à ce que les sommes versées soient récupérées sur le patrimoine personnel du chef d'entreprise et les caisses primaires sont dans l'impossibilité de se faire rembourser.
? Inopposabilité de la décision à l'employeur :
La Cour de cassation veille au respect du principe du contradictoire dans l'instruction menée par les caisses primaires d'assurance maladie pour décider de la prise en charge, ou non, d'un salarié au titre des maladies professionnelles.
Depuis un arrêt de la chambre sociale du 19 décembre 2002, elle impose aux CPAM d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité qui lui est ouverte de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'absence de l'un de ces éléments amène les tribunaux à déclarer la décision inopposable à l'employeur. La CPAM ne peut alors se retourner contre l'employeur pour récupérer les sommes versées. Comme les procédures suivies par les CPAM satisfaisaient rarement à toutes ces exigences, de nombreuses décisions ont été déclarées inopposables.
Il apparaît, par ailleurs, au vu de documents remis à la mission par M. Roland Muzeau, que certaines grandes entreprises développent des stratégies élaborées de contestation systématique des décisions de reconnaissance de maladie professionnelle et exploitent méthodiquement toutes les failles de la procédure pour que les décisions leur soient déclarées inopposables.
Ainsi la société Arkema , branche de chimie fine d'Atofina, a-t-elle rédigé un mémento à l'intention de ses chefs d'établissement, pour leur exposer la procédure à suivre. Ce document indique que l'établissement doit adresser à la CPAM une lettre de réserves, contestant l'origine professionnelle de la maladie, lorsqu'un doute existe sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, ce qui paraît raisonnable. Plus choquante, en revanche, est la recommandation selon laquelle « dans le cas où il est absolument évident que le salarié a été réellement exposé au sein d'Arkema à un risque pouvant déclencher une maladie professionnelle, et même lorsque le salarié a effectué l'intégralité de sa carrière professionnelle à Arkema, une lettre de réserves sera également rédigée. En effet, la Caisse sera alors tenue de procéder à une enquête contradictoire, ce qui pourra éventuellement nous permettre d'invoquer le non-respect du principe du contradictoire » .
Cette démarche traduit la volonté délibérée de cette société d'utiliser toutes les ressources de la procédure pour se soustraire à ses responsabilités financières vis-à-vis de la sécurité sociale.
3. Un faible nombre de recours subrogatoires intentés par le FIVA
Ces puissants mécanismes de mutualisation expliquent le peu d'empressement du FIVA à engager des actions subrogatoires, bien qu'il en ait l'obligation légale, en vertu de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, dès lors que la victime a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite.
Le président de son conseil d'administration, M. Roger Beauvois, a reconnu devant la mission que cette obligation n'était pas respectée : « Le nombre de dossiers qui devraient faire l'objet d'un recours subrogatoire, majoritairement dans l'intérêt du demandeur, est élevé. Il est très largement supérieur au nombre de recours qui sont effectivement en cours de résolution - dont le nombre n'excède pas 300 » .
Constatant que, du fait des règles de mutualisation qui viennent d'être décrites, les recours subrogatoires aboutissaient souvent à opposer le fonds à son principal financeur - la branche AT-MP - sans espoir de mettre à contribution les employeurs responsables, le conseil d'administration du FIVA a décidé de ne pas engager de recours, à moins que la victime ne puisse en attendre un complément indemnitaire. Ces recours mobilisent les services du FIVA, des CPAM, et encombrent les tribunaux, mais ne présentent pas d'intérêt pour les finances publiques.
Il apparaît également que le FIVA ne dispose pas des moyens humains qui lui permettraient de faire face à l'activité contentieuse requise par les textes, son service contentieux ne comptant que cinq juristes.
Dans son dernier rapport d'activité, le FIVA indique avoir obtenu, à ce jour, trente et une décisions reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle suite à un refus d'une caisse de sécurité sociale. De grandes entreprises ont été condamnées, comme Eternit, EDF, la SNCF, les chantiers de l'Atlantique, Valeo, la Société minière de Canari ou Saint-Gobain. Mais, à l'exception de la décision concernant EDF, aucune de ces condamnations n'a eu d'impact financier pour l'employeur.
Dans ce contexte, la mission souhaite que le FIVA soit doté des moyens nécessaires pour mener les recours subrogatoires utiles. Aujourd'hui, le fonds mène des actions en justice pour que les victimes puissent bénéficier du complément indemnitaire attaché à la reconnaissance de la faute inexcusable, même s'il est établi que l'entreprise fautive ne pourra être mise à contribution, à cause, par exemple, des règles légales touchant à la prescription. Si la suggestion, formulée supra , consistant à intégrer dans la réparation offerte par le FIVA le bénéfice attaché à la reconnaissance de la faute inexcusable était retenue, cette motivation disparaîtrait. Le fonds pourrait alors se concentrer sur les recours susceptibles de mettre l'entreprise à contribution, et l'obligation légale d'intenter des recours subrogatoires dans tous les cas pourrait être supprimée, sans pénaliser les victimes de l'amiante.
Le FIVA devrait pouvoir étoffer les effectifs de son service juridique pour mener à bien ces recours, sans qu'il soit argué d'une impossibilité budgétaire car, comme l'a indiqué Me Michel Ledoux, avocat de l'ANDEVA, « il suffirait de remporter deux procès par an » pour compenser le coût attaché à l'embauche d'un juriste supplémentaire.
4. Une situation peu favorable à la prévention des risques professionnels
Plusieurs interlocuteurs de la mission ont souligné que la forte mutualisation des dépenses incitait peu les entreprises à la prévention .
Pour Me Jean-Paul Teissonnière, « le jeu cumulé de la nouvelle jurisprudence sur la non-imputabilité de la charge de la faute inexcusable aux employeurs et de l'incapacité dans laquelle se trouve le FIVA d'exercer des actions récursoires, conduit à une déresponsabilisation des acteurs industriels » .
Le secrétaire général de la FNATH, M. Marcel Royez, et le représentant de la CFDT, M. Rémi Jouan, se sont appuyés sur le dernier ouvrage du sociologue Philippe Askenazy, Les désordres du travail 68 ( * ) , pour procéder à une comparaison entre le système français et le système américain d'assurance des risques professionnels. Philippe Askenazy montre en effet que les compagnies privées qui assurent les risques professionnels aux Etats-Unis ajustent très précisément le niveau de leurs primes au taux de sinistralité observé dans les entreprises, ce qui incite les employeurs a mener une politique vigoureuse de prévention, qui a permis de diminuer fortement le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Il semble, en d'autres termes, que la prévention constitue un investissement « rentable » aux Etats-Unis, ce qui ne serait pas le cas en France.
|
Aux Etats-Unis, les victimes de l'amiante qui désirent obtenir une indemnisation doivent obligatoirement emprunter la voie judiciaire. A ce jour, plus de 600.000 personnes ont déposé plainte dans des affaires relatives à l'amiante et certains experts estiment que le nombre de recours supplémentaires pourrait atteindre 2,7 millions.
Dans le système américain de procédure
accusatoire, il appartient aux plaignants de déterminer le produit
à l'origine de la contamination, de prouver le lien de causalité
entre cette contamination et la maladie et de démontrer la faute de
l'entreprise responsable de l'exposition à l'amiante. En pratique, ce
sont les avocats qui rassemblent les éléments nécessaires
à la tenue du procès, de sorte que les frais d'avocat atteignent
des montants élevés, pouvant représenter jusqu'à
40 % des indemnisations reçues par les victimes.
L'encombrement des tribunaux conduit à un allongement des délais de jugement préjudiciable aux victimes, notamment à celles atteintes de pathologies malignes. Le niveau des indemnisations accordées est très variable selon les tribunaux et certaines victimes ne reçoivent aucune compensation, parce que l'employeur à l'origine de la contamination a disparu ou parce que la source de la contamination ne peut être identifiée. Les recours ont été dirigés contre plus de 8.500 employeurs. Les entreprises condamnées, et leurs assureurs, ont déjà versé plus de 70 milliards de dollars de réparation. Plus de soixante-dix entreprises ont déposé le bilan en raison des frais occasionnés par ces condamnations, ce qui a entraîné la disparition de 60.000 emplois directs. Dans ce contexte, le président de la commission des affaires judiciaires du Sénat, M. Arlen Specter, a déposé une proposition de loi tendant à la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Ce texte a été approuvé par la commission compétente mais n'a pas encore été examiné par le Sénat en séance plénière. Ce fonds serait administré au niveau fédéral et indemniserait les victimes malades de l'amiante sans que celles-ci aient à prouver qu'une faute a été commise. Il serait doté de 140 milliards de dollars, financés, à hauteur de 90 milliards, par les entreprises à l'origine de la contamination et, à hauteur de 46 milliards, par les compagnies d'assurance. Le solde, de 4 milliards de dollars, serait prélevé sur les actifs des sociétés ayant déposé le bilan. Les versements exigés de ces contributeurs seraient fonction du montant des indemnités qu'ils ont déjà versé aux victimes de l'amiante.
Pour être éligibles au fonds, les demandeurs
devraient démontrer qu'ils ont été exposés à
l'amiante sur le territoire américain et établir, par un
diagnostic médical, qu'ils sont atteints d'une maladie causée par
l'amiante. Un barème déterminerait le montant des
indemnités qui leur seraient dues, montant compris entre une simple
prise en charge des frais médicaux, pour les personnes atteintes de
plaques pleurales sans restriction de leur capacité respiratoire, et une
somme de 1,1 million de dollars pour les personnes atteintes d'un
mésothéliome. Le montant de l'indemnisation serait réduit
lorsqu'il est établi que la maladie peut aussi trouver son origine dans
un comportement personnel de la victime : ainsi, un fumeur atteint d'un
cancer broncho-pulmonaire percevrait-il une somme moindre qu'un non-fumeur.
Pour les maladies les plus graves, les gestionnaires du fonds pourraient faire
varier le montant de l'indemnisation afin de tenir compte des
caractéristiques de chaque dossier, notamment de l'âge de la
victime. Les demandeurs disposeraient d'un délai de quatre-vingt-dix
jours pour contester les décisions du fonds devant la
Court of
Appeals
compétente.
|
5. Vers une moindre mutualisation des dépenses ?
La mission observe que deux évolutions récentes concourent à une plus grande individualisation du financement des dépenses d'indemnisation :
- la contribution créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 est versée par les entreprises dont les salariés bénéficient de l'ACAATA ; elle instaure donc un lien étroit entre la responsabilité dans l'exposition à l'amiante et le financement de la réparation ;
- les CPAM se sont adaptées à la jurisprudence de la Cour de cassation et ont conformé leurs procédures internes à ses exigences. En conséquence, comme l'a noté Me Philippe Plichon, « les cas d'inopposabilité sont petit à petit supprimés et les entreprises doivent supporter le poids des condamnations » .
La mission est également attentive aux réflexions en cours concernant la réforme de la branche AT-MP, qui pourraient aboutir à une plus grande individualisation de la tarification.
D. LE DRAME DE L'AMIANTE INVITE À RÉEXAMINER LES MODALITÉS DE RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Même si la mission n'a pas vocation à examiner de manière approfondie la question de la réforme du régime AT-MP, il lui paraît nécessaire d'évoquer les questions que soulève, en la matière, le drame de la contamination par l'amiante.
1. La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles
Le financement de la branche AT-MP peut être défini comme mixte, en ce sens qu'il est partiellement individualisé, et corrélé au nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles constaté dans une entreprise, et partiellement mutualisé. Les modalités de calcul du taux de cotisation varient avec la taille de l'entreprise.
|
Les principes de tarification Le système de tarification est fondé sur un triple principe : - une prise en charge par le seul employeur, - un souci de prévention, le montant de la cotisation étant fixé selon le risque survenu dans chaque entreprise, - un principe de mutualisation, intrinsèquement lié à la nature assurantielle de notre système de sécurité sociale. Le calcul du taux de cotisation En application de ces principes, le taux de cotisation est actualisé chaque année et déterminé pour chaque entreprise selon la nature de son activité et selon ses effectifs. Le taux net , qui est en fait le taux exigible, est la somme d'un taux brut et de trois majorations spécifiques. Le taux brut est le rapport, pour les trois dernières années de référence, entre les prestations servies en réparation d'accidents ou de maladies imputables à l'entreprise et les salaires. Selon la taille de l'entreprise, ce taux brut est : - celui calculé pour l'ensemble de l'activité dont relève l'établissement : c'est le taux collectif pour les entreprises de moins de 10 salariés ; - celui calculé à partir du report des dépenses au compte de l'employeur : c'est le taux réel pour les entreprises de 200 salariés et plus ; - pour les entreprises dont les effectifs sont situés entre 10 et 199 salariés, la tarification est dite mixte, le calcul se faisant en partie selon le taux collectif et en partie selon le taux réel, la part de ce dernier augmentant avec les effectifs. Au taux brut sont ajoutées trois majorations forfaitaires identiques pour toutes les entreprises et activités, pour tenir compte : - des accidents de trajet (M1) ; - des charges générales, des dépenses de prévention et de rééducation professionnelle (M2) ; - de la compensation entre régimes et des dépenses qu'il n'est pas possible d'affecter à un employeur, inscrites au compte spécial « maladies professionnelles » (M3). Le rôle de la branche La commission des AT-MP est chargée de fixer, avant le 31 janvier, les éléments de calcul des cotisations, conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale déterminées par les lois de financement. A défaut, ils sont déterminés par arrêté interministériel. Ce sont alors les caisses régionales d'assurance maladie qui, à partir des informations collectées régionalement et des éléments fixés par la commission, déterminent le taux de cotisation de chaque entreprise. Les caisses disposent en outre d'une possibilité d'appliquer soit des cotisations supplémentaires, soit des ristournes pour inciter les entreprises à mieux encadrer les risques professionnels. |
La mission souhaite conserver ce système mixte. Il n'est pas envisageable, en effet, d'individualiser totalement le financement de la branche AT-MP, sous peine de provoquer une véritable « catastrophe industrielle », beaucoup d'entreprises se trouvant dans une situation économique fragile. La mission a pu prendre la mesure de ce risque lors de sa visite de l'entreprise Constructions mécaniques de Normandie (CMN), à Cherbourg, dont la survie pourrait être menacée si un ou deux cas de mésothéliome apparaissaient au sein de son personnel.
Il lui semble cependant que le « curseur », entre mutualisation et responsabilisation des entreprises, pourrait être déplacé afin de renforcer la prévention. Elle partage la conviction du ministre de la santé et des solidarités, M. Xavier Bertrand, qui a indiqué à la mission que « la tarification des AT-MP ne sert pas suffisamment la prévention » .
S'appuyant sur des simulations, une mission de l'IGAS montre, dans un rapport de novembre 2004 69 ( * ) , que « la contribution du dispositif actuel de tarification à la réduction des risques ne peut être que limitée. En effet, même pour les entreprises de plus de 200 salariés tarifées individuellement, le système ne produit, pour les accidents courants, que des écarts de taux limités même dans le cas de situations de sinistralité très contrastées. Le dispositif ne différencie vraiment les taux que pour les accidents graves, alors même que ceux-ci sont, heureusement, relativement rares et ne peuvent donc de ce fait servir de support à une politique générale d'incitation. Bien évidemment, ce constat est amplifié dès lors que la tarification comporte une dimension collective ; or la tarification collective a une part prédominante dans le système actuel. La mission constate également que les performances en matière de prévention ne se répercutent pleinement qu'après un long délai dans les taux pratiqués » .
Les auteurs de ce rapport ajoutent qu' « il est probable que l'entreprise qui privilégie la prévention est aujourd'hui défavorisée au plan économique par rapport à celle qui la néglige » . Elle affirme également que « le dispositif de tarification n'est [...] pas piloté comme une composante d'une politique générale de prévention » .
Face à ce constat sévère, l'IGAS trace deux perspectives de réforme :
- elle suggère, en premier lieu, d'accroître significativement la part de la tarification individualisée, afin de responsabiliser davantage les entreprises, sans que cette mesure affecte cependant les entreprises de moins de cinquante salariés, seuil en deçà duquel les événements ne sont pas statistiquement significatifs ;
- elle propose, en second lieu, de fonder la tarification non plus sur les coûts d'indemnisation mais sur un indice de sinistralité : les coûts ne seraient pas une base pertinente dans la mesure où ils survalorisent des événements exceptionnels (accidents ou maladies graves) et minorent les événements courants, qui sont pourtant plus révélateurs d'un éventuel défaut de sécurité dans l'entreprise.
Mme Martine Aubry, ancienne ministre de l'emploi et de la solidarité, soulignant « qu'on ne peut pas traiter de la même manière une banque et une industrie sidérurgique », a également suggéré de différencier la tarification en fonction des risques propres à chaque secteur d'activité.
La mission juge ces préconisations intéressantes et souhaite que les partenaires sociaux s'en saisissent et approfondissent la réflexion, dans le cadre des négociations en cours. L'article 54 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit en effet que les partenaires sociaux formulent, dans le délai d'un an, des propositions de réforme de la branche AT-MP, notamment sur les questions de tarification. Ce délai ne sera pas respecté, les négociations n'ayant pas encore vraiment débuté, mais le Gouvernement a mis à la disposition des partenaires sociaux une mission d'appui de l'IGAS, présidée par M. Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales, afin d'en faciliter le déroulement.
2. La sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles
Les personnes auditionnées par la mission ont souvent attiré son attention sur les phénomènes de sous-déclaration et de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, qui rendent difficiles une appréhension exacte du nombre de malades et leur prise en charge effective par la branche AT-MP.
a) La sous-déclaration
Il appartient aux victimes de maladies professionnelles de déclarer leur maladie, mais elles s'abstiennent parfois de le faire. Les éléments d'explication suivants peuvent être avancés :
- le salarié et son médecin traitant ne font pas systématiquement le lien entre une maladie et son origine professionnelle ; les médecins de ville ou hospitaliers sont peu formés à la recherche de l'éventuelle origine professionnelle d'une pathologie et n'interrogent pas nécessairement les patients sur leur carrière professionnelle, surtout quand le délai de latence de la pathologie a été très long ;
- les salariés peuvent ensuite choisir de ne pas déclarer leur maladie professionnelle parce qu'ils craignent de perdre leur emploi, notamment lorsqu'ils souffrent de troubles musculo-squelettiques ou d'allergie. Mme Marianne Lévy-Rozenwald a donné l'exemple d'un jeune boulanger qui ferait une allergie à la farine ou d'une coiffeuse qui ferait une allergie aux produits de teinture.
b) La sous-reconnaissance
Une fois déclarée, la maladie doit être reconnue par la CPAM comme étant d'origine professionnelle.
C'est, en principe, le cas lorsque la maladie est inscrite dans un tableau et que le salarié a été exposé, de façon habituelle, à un risque dans l'exercice de ses fonctions. A défaut, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Une marge d'appréciation existe cependant, notamment parce que certaines maladies sont d'origine multifactorielle, ce qui explique que des différences notables en matière de taux de reconnaissance puissent apparaître entre les caisses.
Il est difficile d'évaluer précisément l'ampleur de ces phénomènes. L'InVS ou l'INSERM disposent cependant de données ponctuelles, qui suggèrent qu'elle serait significative, au moins pour certaines pathologies.
Lors de leur audition, le Pr Marcel Goldberg et le Dr Ellen Imbernon ont d'abord noté que, sur les 600 mésothéliomes pleuraux répertoriés chaque année par le régime général de sécurité sociale, seuls 400 font l'objet d'une réparation au titre des maladies professionnelles, alors que l'origine professionnelle de cette maladie est quasi-systématique. Evoquant ensuite le cancer de la vessie, ils ont indiqué que sur les 400 à 500 cas survenant annuellement qui pourraient très probablement être attribués à une exposition professionnelle, moins de 10 % font l'objet d'une prise en charge par la branche AT-MP. Ils ont enfin mentionné des études récentes montrant que plus de la moitié des personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques en relation avec leur activité professionnelle refusent de déclarer le mal dont elles souffrent de peur de perdre leur emploi.
Ils ont conclu leur intervention en estimant que « les statistiques qui sont régulièrement publiées par la Caisse nationale d'assurance maladie ne permettent donc nullement d'évaluer de manière satisfaisante l'impact du travail sur la santé des patients » .
Sensible à ces préoccupations, la mission demande qu'un important travail d'information soit mené auprès des médecins traitants, afin qu'ils s'interrogent plus souvent sur l'éventuelle origine professionnelle des maladies qu'ils diagnostiquent. Elle souhaite que les efforts notables menés par les caisses pour simplifier et accélérer les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles soient poursuivis et amplifiés, la complexité des démarches à accomplir étant souvent mise en avant par les victimes pour expliquer leur absence de déclaration. Plus fondamentalement, il conviendra de tirer les enseignements des expérimentations en cours en matière de suivi post-professionnel des travailleurs de l'amiante et de s'interroger sur l'opportunité de donner aux caisses un rôle plus actif dans la recherche des maladies professionnelles.
3. Le débat sur la réparation intégrale des risques professionnels
Plusieurs intervenants ont souligné, au cours des auditions auxquelles a procédé la mission, l'inégalité de traitement que la création du FIVA a instaurée entre les personnes malades de l'amiante et celles atteintes d'autres maladies professionnelles : alors que les premières ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice, les secondes doivent se contenter de la réparation forfaitaire servie par la branche AT-MP.
M. Franck Urbaniak, représentant la CGT-FO, a ainsi déclaré que le FIVA « génère des inégalités » et ne pas comprendre « comment on peut justifier de moins bien traiter des victimes des risques chimiques que des victimes de l'amiante » . Le secrétaire général de la FNATH a insisté sur les différences de traitement entre ayants droit : « les ayants droit d'un travailleur qui décède des suites d'un cancer professionnel, lié à l'utilisation du benzène ou des cires de bois, sont moins bien indemnisés, forfaitairement ou sans prise en compte de leurs préjudices personnels et complémentaires, que les ayants droit d'un travailleur qui décède d'un cancer de l'amiante. En effet, ces derniers seront indemnisés intégralement. Cette situation constitue donc une formidable injustice ! » . En conséquence, la FNATH demande la généralisation du principe de la réparation intégrale à l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
L'audition de Mme Martine Aubry, ancienne ministre de l'emploi et des solidarités, a d'ailleurs montré que cette possibilité avait été envisagée au moment de la création du FIVA. Mme Aubry a en effet déclaré qu'elle s'était « alors demandé s'il fallait un dispositif spécifique pour l'amiante ou s'il fallait attendre de mettre en place une réforme générale pour l'ensemble des maladies professionnelles ». « L'urgence du dossier », pour reprendre ses termes, l'a amenée à retenir la première solution, mais il s'agissait bien, dans son esprit, d'un « premier pas vers une réflexion plus globale ». Elle a défendu avec vigueur devant la mission l'idée du passage à une réparation intégrale des risques professionnels : « S'il y a bien un domaine dans lequel on devrait être réparé intégralement, c'est celui dans lequel le salarié est en position de subordination par rapport à la personne qui détient les pouvoirs dans le lieu où il se trouve. »
Pressentant sans doute que la création du FIVA ferait naître ce type de revendication, le Dr Pierre Thillaud, représentant la CGPME, a pour sa part regretté que les maladies de l'amiante fassent l'objet d'un traitement dérogatoire du droit commun et jugé qu'il n'y avait pas de justification à ce régime d'exception.
La mission estime que le passage à un régime de réparation intégrale pour certaines pathologies seulement crée des différences de traitement difficiles à justifier sur le plan médical ou en termes d'équité. La création du FCAATA puis du FIVA s'explique surtout par l'ampleur de la contamination par l'amiante, qui a suscité une émotion considérable appelant une réponse politique exceptionnelle. D'autres salariés également gravement malades, mais souffrant de pathologies plus rares, n'ont pas bénéficié de la même attention de la part des pouvoirs publics.
La mission note cependant que le principe de la réparation forfaitaire est la contrepartie d'une présomption d'imputabilité qui dispense le salarié d'apporter la preuve de la faute de l'employeur pour obtenir réparation. En bonne logique, le passage à la réparation intégrale devrait donc faire peser sur les salariés de nouvelles exigences de preuve, ce qui ne serait pas nécessairement à leur avantage. Il existe cependant des régimes légaux d'assurance, par exemple en matière d'assurance automobile, qui prévoient une indemnisation intégrale du préjudice de la victime sans que celle-ci ait à rechercher un responsable et un système analogue pourrait être instauré dans le domaine des accidents du travail.
Plus sûrement, cette mesure pourrait avoir, comme l'a noté M. Jacques Barrot, ancien ministre des affaires sociales, des conséquences négatives sur la qualité du dialogue social dans notre pays : en effet, « l'abandon de la réparation forfaitaire remet objectivement en cause le compromis passé entre employeurs et salariés au moment de la création du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, régime qui reste aujourd'hui un espace de gestion à forte participation des partenaires sociaux, dans un univers de sécurité sociale de plus en plus marqué par l'universalité des droits et l'impact de la solidarité nationale ». En d'autres termes, une telle mesure risque d'affaiblir le paritarisme dans la gestion de la branche AT-MP.
De plus, les travaux réalisés pour évaluer les conséquences du passage à la réparation intégrale ont mis en évidence le coût élevé d'une telle mesure 70 ( * ) . Elle occasionnerait une dépense supplémentaire de près de 3 milliards d'euros pour le seul régime général . Le surcoût serait évidemment minoré si le passage à la réparation intégrale était circonscrit à une partie seulement des accidents du travail et des maladies professionnelles :
- il serait ramené à 1,6 milliard d'euros si le passage à la réparation intégrale concernait les seuls accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente ;
- il serait ramené à 1,2 milliard d'euros si la réparation intégrale s'appliquait aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 % ;
- enfin, il serait de 0,7 milliard d'euros si la réparation intégrale concernait les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 20 %.
Comparaison de la réparation actuelle
et de
la réparation intégrale de tous les AT/MP
1
|
Types de préjudices |
Réparation AT-MP
|
Réparation AT-MP
|
Réparation intégrale
|
Réparation intégrale
|
Réparation
intégrale
|
|
Préjudice physiologique |
ACCIDENTS ET
|
62.000 |
4 % |
659 M€ |
|
|
Préjudice professionnel |
8.000 |
< 0,5 % |
1.418 M€ |
||
|
Pretium doloris |
1.400.000 |
89 % |
1.326 M€ |
||
|
Préjudice esthétique |
199.400 |
13 % |
194 M€ |
||
|
Préjudice d'agrément |
85.000 |
5 % |
144 M€ |
||
|
Total |
63.000 (4 %) |
813 M€ |
1.400.000 |
89 % |
3.741 M€ |
NB : chaque victime peut avoir subi plusieurs préjudices.
1 Le tableau représente la comparaison de deux types d'indemnisation, hors prestations en nature, indemnités journalières et indemnisation des ayants droit, étant entendu que l'indemnisation de l'incapacité permanente en AT/MP ne distingue pas les chefs de préjudice, contrairement au droit commun.
2 Données 2002.
Source : Rapport sur la rénovation de la
réparation des accidents du travail
et des maladies
professionnelles.
Compte tenu du déficit de la branche AT-MP, et de l'état dégradé de nos finances publiques de manière générale, il paraît difficile de financer, dans un avenir proche, ce surcroît de dépenses, sauf à augmenter dans des proportions importantes le niveau des cotisations sociales, ce qui serait peu cohérent avec la politique d'allégement des cotisations poursuivie depuis une dizaine d'années dans notre pays, dans le cadre de la politique de l'emploi.
TROISIÈME PARTIE - LE SOUCI DE PRÉVENIR DE NOUVELLES CONTAMINATIONS
« Au-delà des années 2030, ce qui surviendra dépend entièrement de ce que nous réalisons actuellement. Je répète (...) que toutes les estimations dont nous disposons ne concernent que les vingt à trente prochaines années. La qualité de la prévention que nous devrons mettre en oeuvre est donc particulièrement importante à partir de maintenant ». C'est ce qu'a déclaré le professeur Marcel Goldberg, conseiller scientifique à l'InVS, devant la mission.
Après six mois d'auditions et de déplacements, la mission considère également que le dossier de l'amiante est loin d'être clos .
Présent dans les bâtiments et dans plus de 3.000 produits et équipements divers mis sur le marché avant 1997, l'amiante est encore présent en France. La mission considère qu'il faut maintenir une vigilance constante, notamment sur les chantiers de désamiantage, et accorder une extrême attention à la situation des personnes ayant été exposées à l'amiante, dont le nombre va connaître une courbe ascendante dans les années à venir.
Au-delà de la gestion de l'amiante résiduel et des conséquences de l'exposition des salariés avant 1997, la mission estime qu'il convient de tirer les leçons de cette catastrophe sanitaire, pour qu'elle ne se reproduise pas sur un autre terrain.
Les « crises » successives de santé publique qu'a connues la France dans les années 1990 ont mis en relief l'importance des politiques de prévention et les carences du système de santé français, centré sur l'offre de soins.
Suite, notamment, au rapport remis en 2003 par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS), intitulé « Santé, pour une politique de prévention durable », les connaissances, les savoir-faire et les outils de la prévention mis en place entre 1998 et 2001 ont été renforcés. La mission estime qu'il faut aujourd'hui aller plus loin, et notamment redoubler de vigilance sur les produits chimiques, dont l'utilisation croissante en milieu professionnel est susceptible de mettre en danger la santé des salariés et de l'ensemble de la population
I. UN RISQUE AMIANTE ENCORE PRÉSENT
Un an avant l'interdiction définitive de l'usage de l'amiante en 1997 71 ( * ) , la France utilisait encore environ 35.000 tonnes d'amiante, majoritairement sous forme d'amiante-ciment destiné à la construction.
A titre de comparaison, entre 1973 et 1975, période pendant laquelle la consommation d'amiante en France était à son plus haut niveau, on utilisait environ 150.000 tonnes par an.
Avant 1997, la France continuait par conséquent à utiliser l'amiante dans le secteur du bâtiment, notamment sous forme de calorifugeage des parois, de dalles de sols et d'amiante-ciment, le flocage des structures métalliques ayant été progressivement interdit à partir de 1977.
D'après les résultats d'une étude réalisée conjointement en 1998 par le bureau d'étude SGTE, Spie-Batignolles, Lafarge, la société INERTAM et la société SOCOTEC, 4,7 % des bâtiments seraient concernés au niveau national par l'amiante, soit entre 4 et 6 millions de m 2 floqués et 500.000 m 2 calorifugés.
M. Philippe Dubuc, chargé d'une mission régionale d'appui juridique et technique aux services de l'inspection du travail en matière de prévention du risque amiante, a indiqué à la mission que ce chiffre était sous-estimé. Selon lui, il ne repose que sur les recensements existants, qui sont très insuffisants : « chiffrer entre 2 et 5 % le pourcentage de bâtiments amiantés apparaît en contradiction totale avec la réalité, dès lors que l'inspection du travail est en capacité de vérifier l'existence et la fiabilité du repérage ». Si l'ensemble du parc immobilier construit avant l'interdiction de l'amiante était convenablement diagnostiqué, il semble donc que le nombre des bâtiments amiantés en serait augmenté.
A. L'AMIANTE DIT « RÉSIDUEL », MAIS OMNIPRÉSENT
L'amiante résiduel soulève la question du risque induit par l'exposition « passive » à l'amiante, qui concerne potentiellement toute la population qui fréquente les bâtiments amiantés.
La plupart des interlocuteurs de la mission, scientifiques ou professionnels du secteur, ont reconnu que l'évaluation de ce risque était difficile, en raison des incertitudes concernant l'effet des faibles doses sur la santé.
Le professeur Marcel Goldberg a ainsi souligné qu'à l'heure actuelle « une des grandes questions qui pose de réels problèmes (...) concerne (...) la contamination survenant à la suite de la simple fréquentation de bâtiments pour y travailler » ajoutant que « s'il s'avérait qu'il existait un risque potentiel lié à cette éventualité, les conséquences en seraient très graves. Les données en seraient modifiées, notamment en termes de populations ayant été ou étant exposées ».
Les représentants de l'association de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) ont indiqué enregistrer à l'heure actuelle un nombre croissant de cas de contamination passive d'individus n'ayant jamais été en contact direct avec l'amiante, citant notamment « des salariés ayant travaillé dans les tours de la Défense, à l'époque de leur informatisation, [qui] développent aujourd'hui de graves maladies ».
Lors de son audition, M. François Malye a estimé qu'on pouvait chiffrer entre 15 et 20 % le nombre de victimes qui n'avaient jamais été en contact avec l'amiante au cours de leur vie professionnelle.
Au regard de ces chiffres, il apparaît que, comme le soulignait Maître Michel Ledoux, avocat de l'ANDEVA, devant la mission, l'accent doit être mis sur la prévention.
S'il convient de protéger particulièrement les personnes susceptibles d'être mises en contact avec l'amiante -les ouvriers des chantiers de désamiantage, les salariés de « second oeuvre » dans le bâtiment et les personnels d'entretien- le repérage et l'éradication des risques induits par l'amiante apparaissent comme des mesures de santé publique pour l'ensemble de la population.
1. Les diverses utilisations de l'amiante dans la construction
Dans le bâtiment, l'amiante a été utilisé pour l'ensemble de ses propriétés : résistance au feu, capacités d'isolation, résistance aux agressions chimiques et résistance mécanique élevée à la traction, notamment.
On peut ainsi distinguer trois types d'utilisation :
- les matériaux en amiante-ciment : dalles de revêtement de sols, cloisons..., dans lesquels les fibres d'amiante sont amalgamées en renfort dans d'autres substances ;
- le calorifugeage des chaudières, tuyaux et autres installations thermiques, destiné à isoler les sources de chaleur ;
- le flocage, visant à accroître la résistance au feu des structures métalliques ou améliorer l'isolation phonique ou acoustique.
Tous les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ne présentent pas les mêmes niveaux de danger. On les divise généralement en deux catégories, selon qu'ils contiennent de l'amiante lié ou non lié.
La première catégorie de produits, contenant de l'amiante lié, est considérée comme nettement moins dangereuse que la seconde, parce que les fibres d'amiante y sont présentes sous forme compacte et par conséquent difficilement libérées dans l'atmosphère.
La seconde catégorie fait l'objet d'une attention renforcée : l'amiante n'étant pas lié ou faiblement lié au matériau, elle s'effrite au fur et à mesure de la dégradation naturelle du produit, libérant les fibres dans l'atmosphère.
a) Le flocage : une protection contre l'incendie massivement utilisée
Le procédé dit de « flocage », massivement utilisé dans la construction à partir des années 60, consiste à projeter des fibres d'amiante, additionnées d'un liant, directement sur la structure métallique à protéger, afin d'assurer une protection incendie, d'isolation thermique ou acoustique.
M. Jean-Marie Schléret, président de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, a ainsi rappelé que, dans les années 60/70, pour faire face à la poussée démographique, un grand nombre de bâtiments - établissements scolaires et universitaires, équipements sportifs, préaux... - ont été construits en utilisant des structures métalliques, qui ont nécessité un flocage à base d'amiante pour leur protection contre l'incendie. Le campus de Jussieu, qui a été construit au cours des années 60, constitue sans doute le plus grand ensemble floqué à l'amiante de la décennie.
D'une manière générale, la plupart des bâtiments scolaires construits à cette époque sont concernés : M. Jean-Marie Schléret a regretté à cet égard qu'on ait assisté à certaines dérives, « à une époque où l'État construisait un collège par jour et utilisait, dans ce cadre, des constructions métalliques. »
Les professionnels du secteur entendus par la mission ont reconnu que les flocages réalisés au début des années 70 l'avaient été sans précaution particulière.
Les représentants de l'université Paris VII Denis Diderot, de l'Institut de physique du Globe de Paris et de l'établissement public du campus de Jussieu (EPCJ Jussieu) ont confirmé aux membres de la mission, lors du déplacement sur le site, qu'aucune protection spécifique n'avait entouré les opérations de flocage réalisées notamment dans les barres du Gril d'Albert et dans la tour centrale, ni en faveur des personnels qui ont effectué les travaux, ni en ce qui concerne la protection de l'environnement.
Par ailleurs, les flocages sont situés le plus souvent dans les plafonds et les faux plafonds et sont soumis à des interventions fréquentes, par exemple, à l'occasion de travaux de câblage.
Enseignant-chercheur à Jussieu dans les années 70, le professeur Pézerat a rapporté qu' « un jour, un de nos collègues est venu expliquer que la poussière que nous retrouvions sur nos paillasses trouvait son origine dans l'amiante qui se trouvait dans le flocage qui avait été fait au-dessus des faux plafonds ».
Il a ajouté que les chercheurs n'ont pas été les seuls concernés, citant l'exemple d'une cafétéria fréquentée par les étudiants, installée dans la tour centrale qui avait été floquée à l'amiante bleu : « Nous pouvions voir l'amiante tomber dans les cafés sous forme de poussières » .
D'autres constructions (centrales électriques, centres postaux, installations ferroviaires ou établissements pénitentiaires) ont également été massivement traitées par flocage.
Tout naturellement, les pouvoirs publics ont d'abord été sensibilisés aux risques résultant de l'utilisation massive de ce procédé : le flocage à l'amiante des locaux d'habitation a été interdit par arrêté du 29 juin 1977 .
Cette interdiction a été étendue à tous les bâtiments dès lors que la concentration de l'amiante dans les produits utilisés était supérieure à 1 % par le décret n° 78-394 du 20 mars 1978. Enfin, la projection d'amiante par flocage et les activités incorporant des matériaux isolants ou insonorisants de densité <1g/cm3 ont été interdites par le décret du 6 juillet 1992.
En 1989, le CPA lui-même, pourtant défenseur de l'usage contrôlé de l'amiante, s'est également inquiété de la détérioration des flocages existant ; dans une lettre adressée le 6 février 1989 au Premier ministre, Marcel Valtat, secrétaire du CPA, écrit : « En fonction de l'usage qui en est fait, des opérations d'entretien effectuées ou de la vétusté des locaux, il arrive que l'état de ces (...) (flocages) laisse fortement à désirer et nécessite un diagnostic sérieux avant toute intervention... Il ne paraît pas possible au CPA que les pouvoirs publics diffèrent davantage l'examen de cette question (alors même que) l'implication des enfants dans bon nombre de situations de ce type tend à lui conférer un potentiel émotionnel peu compatible avec le genre de décisions qu'il convient de prendre de sang froid » .
b) Le calorifugeage
En raison de sa résistance exceptionnelle à la chaleur, l'amiante a été utilisé comme isolant thermique, sous forme de calorifugeage, pour les canalisations et les chaudières notamment.
Comme on l'a dit, sur les 4,7 % de bâtiments concernés au niveau national, l'amiante serait présent sous forme de calorifugeage dans 500.000 m 2 .
c) Une utilisation massive de l'amiante-ciment
L'amiante utilisé dans les constructions l'a été le plus souvent sous forme d'amiante-ciment et ce jusqu'à une date récente puisque, comme le rappelait M. Philippe Huré devant la mission, 95 % de l'amiante importé en France avant 1997 l'ont été à travers ce matériau.
Les interlocuteurs de la mission ont reconnu la moindre dangerosité de l'amiante non friable, qui justifie que les précautions à respecter soient moindres qu'en présence d'amiante friable (notamment sur les chantiers de désamiantage ou en matière de gestion des déchets) ; certains professionnels du secteur, comme les responsables de la SOCOTEC, ont néanmoins insisté sur les dangers de l'amiante-ciment : « Même si celui-ci n'est pas censé libérer facilement des fibres, le découpage des plaques d'amiante-ciment peut engendrer une poussière très importante (...) De la même manière, un enduit qui contient de l'amiante est très résistant, mais peut produire des pollutions très importantes si on le perce ».
Le président du SYRTA, M. Bernard Peyrat, a également estimé que les risques de contamination par l'amiante-ciment étaient mal appréciés, notamment pour les toitures sur lesquelles il n'est pas rare que les particuliers interviennent dans le cadre de travaux d'entretien et de réparation.
M. Daniel Ferrand, de la SOCOTEC, a cependant estimé que le risque d'exposition était très faible pour ces matériaux, et notamment que, dans des conditions normales, la toiture ne se détériorait pas. Il reste qu'une action mécanique, comme un ponçage ou un percement, libère les fibres d'amiante, et nécessite par conséquent une protection particulière.
2. L'amiante dans les bâtiments publics
La plupart des bâtiments publics construits au cours de la décennie 1970 ont été floqués à l'amiante pour assurer leur protection contre l'incendie.
Les tentatives isolées de certains industriels, comme les frères Blandin, de remplacer l'amiante par des fibres de verre, notamment pour floquer une partie du RER parisien, ont rapidement été vouées à l'échec, notamment en raison de l'augmentation des prix du pétrole au début des années 80.
D'après les chiffres communiqués par la SOCOTEC, 15 % des bâtiments publics renfermeraient 70 % des surfaces amiantées, en particulier les structures sanitaires et les bâtiments industriels, les premiers ayant été massivement construits entre 1950 et 1980, les seconds comportant notamment des chaudières calorifugées.
A titre d'exemple, le diagnostic réalisé par le ministère de la défense, propriétaire de 30.000 immeubles et bâtiments, a révélé que sur 22.000 d'entre eux, 7.400 présentaient de l'amiante, sous forme friable dans plus de la moitié des cas.
Deux catégories de bâtiments publics ont fait l'objet d'une attention toute particulière : les établissements hospitaliers et les bâtiments scolaires et universitaires.
a) Les établissements hospitaliers
M. Jean-Marc Boulanger, secrétaire général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a indiqué à la mission que tous les établissements de l'AP-HP contenaient de l'amiante, à l'exception des hôpitaux Georges Pompidou, Bretonneau, Vaugirard et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux, ces derniers ayant été construits après 1997 ou entièrement rénovés.
Cela ne signifie évidemment pas que les patients et les personnels fréquentant les hôpitaux de l'AP-HP ont été ou sont encore exposés à des fibres d'amiante. Le diagnostic réalisé en 2001 dans les 56 établissements parisiens a permis de procéder à une classification, allant de 1 à 3, en fonction de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante, afin de faire procéder au retrait de ceux dont la dégradation rendait probable la diffusion des fibres dans l'atmosphère 72 ( * ) .
Il a fait apparaître que 10 % des locaux des établissements hospitaliers parisiens nécessitaient des travaux de désamiantage, dont la plupart étaient en cours en mars 2005 : d'après un bilan réalisé en juillet 2004, 33 établissements avaient terminé leur diagnostic et 17 étaient en voie de conclure leurs travaux de désamiantage.
Au plan national, la présence d'amiante dans les établissements de santé semble moins importante : une enquête réalisée par la SOFRES en mars 2005 sur 1986 établissements (sur les 4.000 existants) a révélé que 73 % d'entre eux ne présentaient plus d'amiante dans leurs locaux.
Devant la mission, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, a précisé que, pour les autres, 81 % déclaraient que l'amiante encore présent était en bon état de conservation, 79 % avaient réalisé un diagnostic technique amiante, tandis que des travaux de confinement étaient en cours dans 3 % d'entre eux.
La mission souhaite que les efforts engagés soient poursuivis.
b) Les bâtiments scolaires et universitaires
S'agissant des bâtiments scolaires et universitaires, il convient d'abord de regretter le retard pris par certaines collectivités pour constituer le dossier technique amiante (DTA) prévu par le décret du 13 septembre 2001.
Devant la mission, M. Jean-Marie Schléret a ainsi reconnu que « autant les obligations essentielles ont été remplies par les établissements, autant l'action en matière de dossier technique amiante est insuffisamment avancée » 73 ( * ) .
Ce retard ne doit pas occulter le fait que de nombreuses collectivités territoriales, responsables de la sécurité des établissements scolaires, ont pris des initiatives dès qu'elles ont été saisies du problème de l'amiante. C'est le cas en particulier du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais pour les lycées.
M. Jean-Marie Schléret a en effet indiqué, alors que les régions n'avaient, avant 2001, l'obligation d'engager des travaux qu'à partir de 25 fibres par litre d'air, que « majoritairement, les régions s'étaient positionnées pour des travaux de fond sans se contenter des solutions provisoires que sont l'encollement et l'encoffrement ».
Il ressort en effet des enquêtes réalisées par l'observatoire entre 1996 et 1998 que l'échelon régional est le plus concerné, puisque 13 % des lycées renferment des surfaces amiantées, floquées ou calorifugées, cette situation résultant du recours massif au mode de construction métallique.
S'agissant des lycées d'enseignement professionnel, notamment comportant des sections « automobile », M. Jean-Marie Schléret a reconnu que des dangers supplémentaires existaient, même s'il a regretté que les archives de ces établissements ne permettent pas de connaître précisément ce qu'ont pu être les conditions de travail des personnels et des élèves.
Concernant les compétences des départements et des communes, les sondages effectués par l'observatoire à la fin des années 1990 74 ( * ) montrent que les collèges sont plus concernés que les écoles, nombre de ces dernières ayant été construites au début du siècle, avant l'utilisation massive de l'amiante dans la construction et, les plus récentes, de faible hauteur, n'ayant pas utilisé ce matériau.
Ainsi, d'après le résultat d'enquêtes menées par l'Observatoire entre 1996 et 1998, le pourcentage de bâtiments contenant de l'amiante s'élevait à 5,3 % pour les collèges et 2 % pour les écoles primaires.
Enfin, s'agissant de l'enseignement supérieur, les chiffres de 1997 de l'observatoire de la sécurité indiquent que, sur les 13 millions de m 2 que représentent les 172 établissements concernés, 126.000 m 2 sont floqués ou calorifugés à l'amiante, hors les sites universitaires parisiens de Jussieu et de Censier.
3. Les populations principalement exposées
Si le risque d'exposition « passive » à l'amiante dans les bâtiments ne peut être sous-estimé, certaines professions doivent faire l'objet d'une attention particulière parce que leurs interventions les mettent en contact direct avec les flocages, les calorifugeages, les cloisons et les dalles amiantés dans les bâtiments construits avant 1997.
Trois catégories de salariés sont particulièrement concernées. Il s'agit tout d'abord des professions de « second oeuvre » dans le bâtiment, des personnels de maintenance et d'entretien des immeubles et enfin des ouvriers chargés du confinement et du retrait de l'amiante.
Si des mesures spécifiques d'information et de précaution ont été édictées en leur faveur en 1996 (décret n° 96-98 du 7 février 1996), nombre d'interlocuteurs de la mission ont déploré qu'elles soient globalement peu respectées, faute de procédures de contrôle et de sanction pour les contrevenants.
a) Les professions de « second oeuvre » dans le secteur du bâtiment : le rôle essentiel du DTA
Les personnes appelées à intervenir sur des matériaux comportant de l'amiante - c'est-à-dire des personnes qui percent, arrachent et découpent - appartiennent majoritairement à la catégorie du « second oeuvre » dans le bâtiment.
Électriciens, plombiers, couvreurs ou chauffagistes, leurs métiers les amènent à exercer des manipulations dans les parties floquées des bâtiments (plafonds, sous-plafonds, parties communes, gaines techniques) et sur les canalisations calorifugées à l'amiante.
M. Daniel Ferrand de la SOCOTEC indiquait ainsi qu'à Jussieu « des opérateurs passaient régulièrement dans les sous-plafonds pour tirer des câbles » , et « travaillaient en contact avec l'amiante » .
Mme Michèle Guimon, de l'INRS, a souligné qu' un à deux millions de salariés sont concernés par ce type d'activité, ce qui augmente considérablement le nombre de personnes susceptibles d'être contaminées par l'amiante.
Certaines des dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante concernent spécifiquement cette catégorie d'opérateurs du bâtiment 75 ( * ) . Son article 29 dispose ainsi que « l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié ».
Dans la réalité, la plupart des professionnels du secteur entendus par la mission ont reconnu que « les dispositions réglementaires en vigueur sont tout à fait satisfaisantes, [mais] que la difficulté persistante concerne leur application » .
Tant les conditions d'intervention de ces ouvriers - sollicités, le plus souvent, de manière occasionnelle -, que leur statut - travailleurs indépendants pour la plupart, ils sont soumis à des exigences de rentabilité qui tendent à occulter les impératifs de sécurité - rendent très difficiles, voire illusoires la mise en oeuvre et le contrôle de l'application effective des mesures de prévention.
En outre, le développement de la précarité et l'accélération du « turn-over » qui touchent les ouvriers de « second oeuvre » du bâtiment constituent un facteur de risque supplémentaire 76 ( * ) .
Il en résulte une sous-information sur les risques qu'ils encourent et une grande difficulté à reconstituer leurs parcours professionnels, ce qui rend difficile la mise en oeuvre de la surveillance médicale obligatoire. Mme Michèle Guimon a ainsi souligné que « le plus problématique reste que la plupart sous-estiment ou, pire, ignorent les risques que génère l'amiante ».
M. Philippe Huré, de l'INRS, a également confirmé devant la mission que « le principal problème qui reste à résoudre est la transmission d'informations ».
Dans ces conditions, il est aujourd'hui indispensable de disposer d'un document, conservé par le syndic de copropriété ou par le propriétaire, indiquant précisément l'emplacement des matériaux amiantés et décrivant les consignes de sécurité à respecter, qui serait mis à la disposition de tous les intervenants et les habitants des immeubles afin qu'ils puissent assurer leur sécurité.
Le dossier technique amiante (DTA), qui a été rendu obligatoire par le décret du 13 septembre 2001, poursuit ainsi le double objectif de recenser la présence de l'amiante et surtout de rendre les informations lisibles aux intervenants extérieurs, à partir d'une fiche récapitulative décrivant les éléments techniques du constat.
S'il est correctement mis à jour et effectivement utilisé comme un outil d'information systématiquement transmis aux entreprises intervenant sur les bâtiments, il pourra permettre d'éviter un certain nombre de situations dans lesquelles la mise en danger est prévisible.
Diminuer les risques auxquels sont exposés les ouvriers de « second oeuvre » revêt donc aujourd'hui un caractère d'urgence car, comme le rappelait M. Patrick Brochard, chef de service de médecine du travail et de pathologie professionnelle au CHU de Bordeaux, aujourd'hui (...) « 80 % des mésothéliomes observés le sont chez des personnes travaillant dans le secteur du bâtiment » .
b) Les personnels de maintenance et d'entretien
M. Jean-Marc Boulanger a indiqué à la mission que les personnels d'entretien de l'AP-HP chez qui avaient été décelées des plaques pleurales étaient tous intervenus sur des matériaux amiantés, en les perçant notamment. L'exemple le plus fréquemment évoqué est celui du revêtement ou des dalles de sol. Amalgamées dans la matière plastique ou dans le ciment, les fibres d'amiante ne sont pas dangereuses, mais une intervention de nettoyage ou de maintenance sur ce revêtement peut provoquer la diffusion de poussières d'amiante. Mme Michèle Guimon a reconnu à cet égard qu' « il y a encore probablement des machines de nettoyage qui dégagent des fibres d'amiante » 78 ( * ) .
L'activité des personnels de maintenance et d'entretien est donc susceptible de les exposer aux fibres d'amiante et également de provoquer la détérioration de matériaux contenant de l'amiante lié, engendrant une pollution environnementale dangereuse pour l'ensemble des occupants des bâtiments.
S'agissant de l'amiante friable, l'article 28 du décret du 7 février 1996 précité prévoit que « lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante : 1° Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ; 2° Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés. »
Concernant la mise en oeuvre effective de ces mesures, il convient de distinguer la situation des personnels dont le statut autorise le contrôle des conditions d'intervention et celle des intervenants ponctuels, notamment sous-traitants, pour lesquels la sécurité est beaucoup moins bien assurée.
Lors du déplacement de la mission sur le campus de Jussieu, les représentants de Paris VII, de l'IPG et de l'EPA de Jussieu ont reconnu que « s'il est possible de surveiller l'état de santé de la trentaine d'agents affectés au nettoyage et à l'entretien des locaux, il est plus difficile de connaître le devenir des salariés employés par des sociétés extérieures et qui interviennent sur le campus ».
La situation des personnels de maintenance des hôpitaux est, à cet égard, particulière : M. Xavier Bertrand, ministre de la santé, a indiqué que les personnels techniques bénéficiaient aujourd'hui d'un suivi systématique par la médecine du travail. Devant la mission, il a reconnu que 25 % de ceux chez qui avait été détectée une maladie professionnelle étaient atteints de mésothéliomes.
A l'AP-HP en particulier, l'entretien et la maintenance sont internalisés et assurés par des permanents. A l'hôpital Saint-Louis, où le diagnostic amiante a été achevé, le directeur d'établissement a décidé de soumettre le personnel d'entretien à un suivi médical renforcé. Soixante-cinq personnes identifiées par la médecine du travail ont pu bénéficier d'un scanner qui a révélé une infection à caractère professionnel chez dix-neuf membres du personnel, dix-huit d'entre eux présentant des plaques pleurales, le dernier souffrant d'une fibrose pulmonaire.
M. Jean-Marc Boulanger a souligné que « toutes les personnes chez qui l'on a décelé des plaques pleurales, font partie du personnel d'entretien » , confirmant le risque d'exposition accru de cette catégorie d'employés.
Le dispositif mis en place par la direction de l'AP-HP poursuit trois objectifs :
- prévenir, informer et, lorsque les personnels d'entretien interviennent dans une pièce ou sur une installation, faire en sorte qu'elles sachent, dans tous les cas, si les matériaux qu'elles manipulent contiennent ou non de l'amiante ;
- mettre à leur disposition, lorsqu'elles sont en contact avec un matériau contenant de l'amiante, des équipements de niveau professionnel dotés de dispositifs d'aspiration ou d'équipements de protection leur permettant de ne pas respirer de poussière d'amiante ;
- faire en sorte qu'elles balisent le secteur dans lequel elles interviennent de façon à ce que d'autres personnes ne viennent pas respirer des poussières d'amiante.
A cet effet, un référent global a été désigné sur chaque site, qui devra s'assurer que le diagnostic portant sur la présence d'amiante est effectué et que son résultat est communiqué aux différentes équipes et pris en compte par les équipes d'intervention. Puis un référent technique, responsable des équipes d'entretien, est chargé au sein de l'équipe d'intervention de vérifier que les personnels sont bien informés et respectent les règles de sécurité. Enfin, tous les membres du personnel d'entretien se verront proposer une formation spécifique au risque posé par l'amiante.
Ce dispositif n'a pu être mis en place que parce que les personnels sont dans une situation stable au sein de la structure dans laquelle ils interviennent.
|
Pour les personnels occasionnels ou sous-traitants , l'INRS a pris ces dernières années un certain nombre d'initiatives : en collaboration avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le ministère chargé du travail et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), l'Institut a participé au développement d'un réseau national de centres de ressources. Ces « centres de ressource amiante » visent à informer les salariés exposés lors des travaux d'entretien et de maintenance sur le risque amiante et sa prévention. Dans ce but, l'INRS a mis à disposition des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des comités régionaux de l'OPPBTP des stands d'information exposés dans toute la France entre 2000 et 2002 79 ( * ) . Par ailleurs, des fiches métiers ont récemment été mises en circulation pour sensibiliser les PME et les TPE (très petites entreprises) qui font de l'entretien et de la maintenance au problème posé par l'amiante et aux mesures de prévention à respecter. Un « guide de prévention », publié en 1997 et actualisé en juillet 2003, a également été rédigé à l'attention des professionnels de l'entretien et de la maintenance. |
S'il a reconnu que des efforts significatifs avaient été développés en matière d'information 80 ( * ) , M. Philippe Huré a souhaité, l'INRS ne pouvant diffuser des messages de prévention à la télévision à une heure de grande écoute, que l'information emprunte d'autres canaux, notamment pour toucher certaines catégories de travailleurs, tels les artisans, qui travaillent de manière isolée. C'est ce que devrait permettre la généralisation du dossier technique amiante, s'il est correctement actualisé et diffusé.
Encore faut-il que les dispositifs de protection soient adaptés aux conditions d'intervention de ce secteur. A cet égard, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi et à l'insertion des jeunes, a indiqué aux membres de la mission qu'un décret était en cours de préparation, afin de renforcer les règles encadrant les interventions des entreprises de maintenance dans les locaux amiantés.
c) Les ouvriers des chantiers de désamiantage
D'après les informations fournies à la mission, 76 % des chantiers de désamiantage sont en infraction par rapport aux mesures de protection prescrites par la réglementation : c'est ce qui ressort de la campagne de contrôle des chantiers de retrait de l'amiante friable menée conjointement du 15 au 29 mars 2004 par la direction des relations de travail (DRT), l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et destinée à dénoncer les manquements aux règles de sécurité régissant ces chantiers.
La campagne a révélé que sur 72 chantiers visités, 55 d'entre eux contrevenaient à la réglementation. Trois chantiers ont été arrêtés pour absence de certification des entreprises, défaut de plan de retrait, dysfonctionnement des sas de confinement du chantier et durée de travail excessive en zone de travail confinée.
(1) Une réglementation rigoureuse
Depuis 1996, les ouvriers chargés du désamiantage bénéficient d'une réglementation très protectrice, d'une part au titre des règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait (arrêté du 14 mai 1996) et d'autre part au regard des mesures de prévention prescrites par le décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
|
Les mesures protectrices à mettre en oeuvre 1. Restrictions d'emploi de certaines catégories de travailleurs Il est interdit d'affecter des salariés : - sous contrat à durée déterminée ; - d'entreprises de travail temporaire ; - âgés de moins de 18 ans ; aux travaux de retrait et de confinement de MCA, depuis les travaux préparatoires jusqu'à leur restitution du chantier. Compte tenu de ces restrictions, les stagiaires en formation professionnelle, les stagiaires conventionnés ainsi que les travailleurs mis à disposition par une association intermédiaire ne doivent pas être affectés, eux non plus, à ce type de travaux. 2. Notice d'information pour chaque poste ou situation de travail L'employeur est tenu d'établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant aux risques, une notice destinée à informer chaque travailleur concerné des risques auxquels ce travail peut l'exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. Cette notice générale est complétée pour chacun des chantiers par les parties du PRC qui doivent décrire les particularités des différents postes et situations de travail, définir les risques associés et les mesures correspondantes. L'employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais et avant chaque chantier, des risques ainsi évalués. 3. Information - Formation Avant toute affectation à ces travaux, les salariés doivent recevoir une formation spécifique aux risques encourus. Cette formation théorique et pratique comprend notamment : - une sensibilisation aux risques spécifiques à l'amiante ainsi qu'aux risques généraux ; - un apprentissage des techniques et modes opératoires utilisés ; - une description et un apprentissage des différentes procédures (conditions d'accès à la zone de travail, contrôles, décontamination, hygiène, élimination des déchets, etc.) ; - une utilisation des équipements de protection individuelle et en particulier de protection des voies respiratoires ; - les conduites à tenir en cas d'accident. Le médecin du travail est associé à cette démarche. Avant le début de chaque chantier ou en cours de chantier pour un nouvel arrivant, le responsable des travaux de l'entreprise qui traite les MCA lit et explique les documents nécessaires à l'exécution des travaux (dont le PRC) à tous les travailleurs concernés. 4. Suivi médical Les modalités obligatoires de la surveillance médicale des salariés exposés à l'amiante diffèrent selon le type d'exposition. Le médecin du travail est informé et consulté pour l'évaluation des risques, la définition des niveaux d'exposition et pour toutes les questions relatives à la prévention du risque d'amiante et notamment dans les domaines de l'information et de la formation des salariés chargés du traitement des MCA. Le médecin est également informé et consulté lorsque se superposent au risque amiante d'autres contraintes importantes au niveau physiologique : travaux en atmosphère chaude, voire très chaude, efforts intenses répétés, postures augmentant les contraintes physiques (couchée, accroupie, etc.), exposition à des rayonnements ionisants, à des produits chimiques dangereux, etc. 5. Surveillance médicale des salariés exposés Les salariés ne peuvent être affectés au retrait et au confinement de MCA qu'après une visite médicale préalable. Le médecin du travail détermine la fréquence des visites (au moins une fois par an) et se prononce sur l'absence de contre-indications pour ces activités. Les salariés affectés à ces travaux bénéficient ensuite d'une surveillance particulière qui se poursuivra même après la cessation d'activité. Lorsqu'ils quittent l'entreprise, l'employeur doit leur remettre une attestation d'exposition. 6. Durée du port d'équipements de protection individuelle (EPI) Le port permanent d'équipements de protection du corps et des voies respiratoires impose aux opérateurs des contraintes physiques et physiologiques parfois élevées dont il convient de tenir compte pour l'organisation des plages de travail et dans la mise en place du planning du chantier. L'employeur informe le médecin du travail de la pénibilité prévue des tâches à accomplir et du niveau de risque. En fonction de ces données, le médecin du travail pourra estimer la durée maximale du port ininterrompu des EPI. L'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la surveillance médicale des salariés réalisant des travaux de retrait ou de confinement de MCA précise qu'en tout état de cause, la durée du port ininterrompu de ces EPI ne devrait pas excéder 2 heures 30. 7. Liste des travailleurs exposés Le chef d'établissement établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité, ainsi que, s'ils sont connus, des niveaux d'exposition auxquels ils ont été soumis, de la durée de l'exposition, du choix des équipements de protection respiratoire et de la durée de leur port. Cette liste est transmise au médecin du travail. Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement. 8. Encadrement La présence permanente, sur le chantier, d'un représentant de l'encadrement de l'entreprise ou d'un responsable désigné par le chef d'établissement est nécessaire. 9. Mesures générales d'hygiène - Locaux d'accueil des salariés Des locaux propres, éclairés, aérés et chauffés en saison froide sont mis à disposition des salariés par le donneur d'ordre et à défaut par l'entreprise. Ces locaux sont équipés, en fonction de la nature du chantier : - d'armoires-vestiaires dans lesquels seront déposés les vêtements de ville et pris les vêtements pour se rendre à la zone d'équipement des EPI avant d'entrer en zone de travail ; - de sièges en nombre suffisant ; - de tables facilement lavables, d'un moyen de réchauffage des repas et d'un réfrigérateur si des salariés prennent leurs repas sur le site où se déroulent les travaux ; - de sanitaires et de douches d'hygiène corporelle. En fin de chaque période d'intervention à l'issue de laquelle des EPI sont retirés, les salariés doivent prendre une douche. Il est interdit de manger, boire, fumer dans les zones de travaux. Les temps de récupération et les repas doivent être pris dans un local mis à la disposition du personnel, aménagé à cet effet (sièges, etc.). |
Source : Documents de l'INRS
Devant la mission, le président du SYRTA a particulièrement insisté sur l'interdiction d'employer des salariés intérimaires pour les travaux de retrait d'amiante et sur l'obligation pour tous les salariés concernés de se soumettre à un contrôle d'empoussièrement à l'issue du chantier, organisé par l'entreprise, afin de s'assurer de leur non-exposition à l'amiante, soulignant en outre que les mesures de protection et de prévention différaient selon que le diagnostic préalable a révélé la présence d'amiante friable ou non friable.
En présence d'amiante non friable, l'obligation de confiner le chantier ou le port de l'équipement de protection notamment sont laissés à la discrétion de l'entreprise, « en fonction de l'évaluation des risques » (article 7 du décret du 14 mai 1996) . Or, dans ce cas, la certification de l'opérateur de chantier n'est pas obligatoire, et par conséquent, la fiabilité de l'opérateur de chantier ne présente pas les mêmes garanties.
D'après le SYRTA, il n'existe aujourd'hui quasiment pas de contrôle sur les entreprises traitant de l'amiante non friable : il en résulte qu'alors que la législation prévoit notamment l'obligation d'établir un plan de retrait, de rares plans sont en réalité déposés, faute de sanction pour les entreprises qui s'en dispensent.
La situation des ouvriers sur les chantiers traitant de l'amiante non friable doit, par conséquent, faire l'objet d'une attention accrue : paradoxalement, on peut considérer, comme la SOCOTEC, que « les risques sont certainement plus importants pour des chantiers menés sur des matériaux jugés initialement non dangereux ».
Les professionnels ont par ailleurs souligné la grande disparité des situations en fonction de l'ampleur et de la nature des chantiers.
Il est en effet nécessaire de distinguer les opérations d'une certaine ampleur, touchant des bâtiments publics en majorité, -pour lesquelles les chantiers sont déclarés, les entreprises certifiées et les ouvriers formés- et les petits chantiers, privés pour la plupart, voire les « déflocages sauvages », dont M. Gilles Evrard, directeur des risques professionnels à la CNAMTS, a souligné le développement depuis l'interdiction définitive de l'amiante.
Pour les premiers, la sécurité des ouvriers fait l'objet d'une vigilance particulière : M. Bernard Peyrat, a estimé devant la mission que la sécurité des 10.000 salariés des entreprises traitant de l'amiante friable était aujourd'hui assurée. Pour les seconds, la situation est plus préoccupante : comme le soulignait M. André Hoguet, représentant de la CFTC, lors de son audition, « la restauration d'une maison est un petit chantier ... (et) aucune précaution n'est prise alors que des milliers de personnes travaillent sur ces chantiers ».
D'une manière générale, la mission ne peut que regretter l'insuffisance des moyens de contrôle, dont le renforcement est aujourd'hui nécessaire pour inciter les entreprises à se soumettre aux consignes de sécurité, dont on a vu qu'elles n'étaient que partiellement respectées dans 76 % des chantiers visités par l'inspection du travail lors de l'« opération coup de poing » 81 ( * ) de mars 2004.
De nombreux interlocuteurs de la mission ont regretté à ce sujet que l'inspection du travail n'ait pas les moyens, ni en terme d'effectifs ni en terme de compétences techniques, pour assurer le suivi des travailleurs des entreprises spécialisées dans le désamiantage, M. Michel Parigot, président du comité antiamiante de Jussieu, déplorant en outre qu'un corps d'inspecteur du travail n'ait pas été dédié à l'amiante 82 ( * ) .
Par ailleurs, le nombre de chantiers de désamiantage rend illusoire la surveillance confiée aux organismes d'assurance-maladie : à titre d'exemple, 2.500 chantiers sont ouverts en Ile-de-France. M. Jacques Tonner, directeur général de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), a reconnu qu'avec 91 contrôleurs de sécurité permanents, « nous ne pouvons pas suivre 2.500 chantiers ».
Comme il sera vu plus loin, le plan santé travail (PST), dont deux des axes principaux visent à renforcer la capacité de contrôle de l'inspection du travail en santé au travail et à encourager les entreprises à être plus actives en matière de protection de la santé, constitue une première réponse à ce problème.
La mission s'est ainsi interrogée sur la nécessité de mettre aujourd'hui en place un recensement national des salariés qui traitent l'amiante, sur le modèle de ce qui existe dans d'autres secteurs présentant des risques particuliers, notamment dans le secteur du nucléaire.
Cette liste nationale, qui serait accessible sur Internet, permettrait en effet :
- aux propriétaires et aux donneurs d'ordre de s'assurer de la qualification des salariés qui interviennent sur leurs chantiers ;
- de mettre en place un suivi médical national spécifique, inexistant à l'heure actuelle (un tel suivi existe pour les salariés du secteur nucléaire).
(2) Des obligations de sécurité difficiles à appliquer en raison des conditions de travail sur les chantiers de désamiantage
Le document publié par l'INRS, suite à la campagne de contrôle des chantiers de retrait de l'amiante friable menée du 15 au 29 mars 2004 concluait que les entreprises sous-estiment le risque et la pénibilité des activités de désamiantage.
Le professeur Pézerat a indiqué à la mission que la plupart des entreprises de désamiantage faisaient travailler leurs salariés en moyenne trois fois 2,5 heures, « ce qui suppose six douches en une journée... en fin de journée, tous les ouvriers sont épuisés ». Il a noté que « même si nous ne sommes pas présents sur le chantier, je suis certain que les obligations sécuritaires ne sont pas systématiquement respectées : les ouvriers retirent l'équipement de sécurité qu'ils portent à ce moment, les conditions de travail étant trop éprouvantes ».
En 1992, l'INRS, qui avait publié une étude sur la protection des travailleurs chargés du désamiantage, avait préconisé de réduire la durée quotidienne de travail des ouvriers des chantiers et de définir un rythme adapté.
Pour leur permettre de respecter les obligations de sécurité, il serait souhaitable que les plages horaires journalières des salariés du désamiantage soient réduites afin de tenir compte de la pénibilité et des contraintes de leur travail, sans remettre en cause les droits et garanties des salariés.
(3) La nécessité de renforcer la qualification des salariés du désamiantage
Seules les entreprises certifiées doivent aujourd'hui transmettre la liste de leurs salariés et proposer à ces derniers une formation obligatoire spécifique (quatre jours pour les ouvriers, quinze jours pour les opérateurs, une semaine pour les personnes membres de l'encadrement), sanctionnée par un examen, dont le SYRTA a regretté le caractère théorique et insuffisant. A cet égard, les entreprises ne peuvent avoir recours aux contrats de professionnalisation pour compléter la formation des personnels.
Lors de son audition, le président du SYRTA a indiqué que la réglementation était aujourd'hui en cours d'évolution : le 25 avril 2005, le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a en effet publié un arrêté 83 ( * ) relatif à la formation de la prévention des risques liés à l'amiante qui, notamment, prévoit l'adaptation des formations des personnels sur les chantiers en fonction des évolutions techniques. Le SYRTA a estimé cette avancée nécessaire, à l'heure où de nouvelles méthodes et de nouveaux matériels sont mis en circulation, notamment pour permettre une meilleure aspiration des poussières d'amiante sur les chantiers.
(4) Les opérations de traitement de l'amiante-ciment ne sont aujourd'hui pas encadrées
Alors que l'article 11 modifié de la directive européenne n° 2003-18 du 27 mars 2003 84 ( * ) prévoit des mesures de protection pour les chantiers de désamiantage ou de démolition, seule la première partie, relative au désamiantage, a été introduite en droit français.
Interrogé à ce sujet lors de son audition, M. Gérard Larcher a indiqué avoir entamé des négociations avec les organisations syndicales concernées, dans la perspective de transposer par décret, avant la fin de l'année 2005, les règles encadrant le démontage des plaques d'amiante-ciment.
4. La prévention des risques d'exposition « passive » à l'amiante : une réglementation stricte mais mal appliquée
La prise de conscience progressive de la réalité des risques encourus par les occupants des immeubles 85 ( * ) - on parle « d'exposition passive intra-murale » - a conduit les pouvoirs publics à mettre en place une réglementation rigoureuse à la fin des années 1990, concernant l'amiante dans les bâtiments.
Cette réglementation fait obligation aux propriétaires d'effectuer le repérage des parties amiantées et, le cas échéant, de procéder à des travaux de confinement ou de retrait.
Progressivement renforcée, en dernier lieu par le décret du 13 septembre 2001 qui élargit l'obligation de repérage de trois à une vingtaine de matériaux dangereux, les obligations sont aujourd'hui très strictes et très détaillées.
La plupart des interlocuteurs de la mission ont déploré qu'elles soient néanmoins mal appliquées : la réalisation de diagnostics incomplets, des chantiers de désamiantage qui libèrent des fibres dans l'atmosphère, des entreprises certifiées à qui on retire l'agrément et qui réapparaissent sous un autre nom, des diagnostics de post-désamiantage qui mettent en évidence la présence d'amiante après la fin du chantier, ont notamment été évoqués.
a) L'obligation de repérer l'amiante dans les immeubles bâtis : du constat à la gestion.
L'obligation de repérer l'amiante dans les immeubles résulte du décret du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Modifié à deux reprises, respectivement en 1997 (par le décret du 12 septembre 1997) et en 2001 (par le décret du 13 septembre 2001), il fait obligation aux propriétaires des immeubles de rechercher la présence de flocages, calorifugeages et faux plafonds, notamment, contenant de l'amiante, et d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux de confinement ou de retrait sont nécessaires.
Historique des textes relatifs au repérage de l'amiante
|
Diagnostic Flocage calorifugeages |
||||||||
|
1996 |
||||||||
|
Diagnostic faux plafonds |
||||||||
|
1997 |
||||||||
|
Dossier technique amiante |
||||||||
|
2001 |
||||||||
|
Date ultime de réalisation des DTA = |
2005 |
|||||||
|
Source : SOCOTEC |
||||||||
Depuis 2001, les propriétaires publics et privés - à l'exception de ceux des maisons individuelles - doivent établir et conserver un dossier technique amiante (DTA) .
Avec le DTA, que la SOCOTEC a comparé à « une sorte de carnet de santé comme pour les personnes ou de carnet d'entretien, comme pour les voitures », on dépasse la logique du repérage de l'amiante en place pour instituer un outil de gestion.
L'article 10-1 du décret du 13 septembre 2001 modifiant le décret du 7 février 1996 précité dispose que « les propriétaires des immeubles (...) constituent et tiennent à jour un dossier technique amiante ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier ».
L'article 10-3 du même texte précise le contenu du DTA qui doit mentionner :
- la localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
- l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
- les travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
- les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention.
Une liste très détaillée, annexée au décret, précise les matériaux dont l'examen est obligatoire : les enduits, les dalles de sols, les joints et les canalisations sont notamment concernés.
Si les autres matériaux amiantés (réseaux d'eau, toitures en amiante, panneaux des portes coupe-feu...) ne font pas partie des informations devant obligatoirement figurer dans le DTA, ils peuvent néanmoins y figurer ; s'ils sont détectés par un professionnel, ce dernier a l'obligation de compléter le document en conséquence 86 ( * ) .
Une des innovations du décret de 2001 consiste dans l'obligation de tenir le document à jour : cette obligation, lourde pour le propriétaire, s'explique par la finalité assignée au document, à savoir rendre accessibles les informations techniques à toutes les personnes susceptibles d'être mises en contact avec l'amiante présent. A cet effet, le décret de 2001 (article 10-1) prévoit qu'une fiche récapitulative est rédigée et jointe au DTA.
Tenue à la disposition des occupants de l'immeuble ( article 10-5 du décret ) et obligatoirement transmise à toute personne physique ou morale appelée à y effectuer des travaux ( article 10-5, alinéa 22 ), la fiche récapitulative doit signaler les facteurs de risque et diffuser les consignes de sécurité.
M. Philippe Huré, de l'INRS, a souligné à cet égard l'importance du DTA en termes de prévention des risques professionnels. « La constitution d'un document technique amiante est absolument indispensable avant toute intervention d'une entreprise sur un bâtiment » a-t-il souligné parce qu'« elle leur permet notamment d'être informée de l'éventuelle présence d'amiante de manière à prendre les mesures de protection adéquates ».
(1) Les délais pour effectuer les repérages : le retard dans la mise en oeuvre de la réglementation
Les textes soumettant les propriétaires publics et privés à des obligations de repérage ont fixé des délais de réalisation variables.
• Le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds
La recherche initiale d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds des immeubles bâtis (à l'exception des maisons individuelles) devait être effectuée avant le 31 décembre 1999.
Il convient de rappeler qu'après ce premier repérage obligatoire, des diagnostics doivent encore être effectués dans le cadre du contrôle périodique de l'état de conservation qui s'effectue dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du dernier contrôle satisfaisant.
En cas de manquement à ces obligations, le propriétaire se voit appliquer des sanctions pénales. Pour une personne physique, l'amende est une contravention de la cinquième classe (1.500 euros au plus). Pour une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique.
• Les repérages étendus pour la constitution du DTA
Le dossier technique amiante, qui consigne la nouvelle obligation de repérage élargi à d'autres produits susceptibles de contenir de l'amiante que les flocages, calorifugeages et faux plafonds, et qui ne concerne ni les appartements ni les maisons individuelles, doit être établi :
- avant le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements recevant du public classés de la première à la quatrième catégories ;
- avant le 31 décembre 2005 pour les autres immeubles bâtis, c'est-à-dire les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
En cas de manquement à ces obligations, le propriétaire se voit appliquer les mêmes sanctions pénales que dans le premier cas cité : 1.500 euros d'amende maximum pour une personne physique, le quintuple au maximum pour une personne morale.
Le président du SYRTA, a indiqué à la mission que seulement 30 % des DTA étaient aujourd'hui réalisés . L'ensemble des professionnels a regretté le retard pris dans la mise en oeuvre de la réglementation.
La direction générale de l'administration de la fonction publique a adressé une note à tous les responsables des ministères le 19 novembre 2004, leur rappelant qu'ils avaient l'obligation de réaliser pour fin mars un recensement de leur patrimoine bâti amianté et un bilan des actions menées. Une synthèse devrait être publiée, après expertise des dossiers, par un comité scientifique, à la fin de l'été 2005.
De plus, un contrôle auprès des propriétaires des 160.000 bâtiments recevant le plus de public est envisagé pour le début 2006 87 ( * ) .
• La recherche d'amiante préalable à la démolition d'un immeuble
Le décret du 13 septembre 2001 introduit une nouvelle mesure de précaution dans le but de protéger les riverains des chantiers de démolition et l'environnement par une meilleure gestion des déchets : les propriétaires sont dorénavant tenus de procéder à une recherche plus complète d'amiante avant toute opération de démolition de leurs immeubles.
Il n'existe aucun délai pour cette recherche d'amiante concernant tout type de bâtiment qui doit être effectuée avant toute démolition.
• Le repérage établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti
Aucun délai non plus n'est prescrit pour ce type de repérage, le défaut de production de l'état relatif à l'amiante étant seulement sanctionné par l'impossibilité de s'exonérer de la garantie des vices cachés.
M. Michel Parigot, vice-président de l'ANDEVA, a déploré qu'en ce qui concerne les habitations privées, la réglementation « touche moins à la santé publique qu'au droit immobilier », puisque, selon lui, « elle se propose en définitive d'éviter un contentieux entre l'ancien propriétaire et l'acquéreur ».
En effet, en cas de diagnostic positif au moment de la vente, le repérage de l'amiante ne donne pas nécessairement lieu à un contrôle de l'empoussièrement ni à des opérations de confinement ou de retrait en cas de dégradation des parties amiantées, l'article 10-4 disposant seulement que les propriétaires sont « tenus (...) d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne (...) appelée à concevoir ou à réaliser les travaux ».
On soulignera également qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit l'information du locataire d'un propriétaire privé : comme le soulignait M. Christophe Zélas, porte-parole de la Confédération des associations du diagnostic immobilier dans un article paru le 19 juin 2005 dans « Le Monde », si le bailleur doit fournir certaines informations au locataire sur le plomb, les risques technologiques et la sécurité de l'installation au gaz, rien n'est prévu à propos de l'amiante 88 ( * ) .
(2) Le problème de la fiabilité des diagnostics
Interrogés sur la fiabilité des diagnostics réalisés, la plupart des professionnels auditionnés ont reconnu qu'on ne pouvait à l'heure actuelle garantir l'exactitude des repérages de l'amiante dans les bâtiments.
Le cas de la Tour Montparnasse, pour laquelle un rapport de diagnostic incomplet a été remis en juillet 2004 au syndic de copropriété, a conforté les inquiétudes de la mission.
D'après les différents interlocuteurs de la mission, cette situation peut trouver deux niveaux d'explication.
? L'opération de repérage de l'amiante est souvent délicate .
Selon le SYRTA, « une entreprise peut établir un excellent diagnostic sur un site et être dans l'erreur sur un autre site », en fonction de la complexité du bâtiment examiné.
A cet égard, M. Dubuc, de l'inspection du travail, a donné l'exemple de la réhabilitation du plus important groupe HLM de la ville de Saint-Raphaël. Après avoir rappelé que la mission de l'inspection du travail consistait à s'assurer, dès la connaissance de l'opération par la déclaration préalable, de la correcte évaluation des risques de présence d'amiante dans les matériaux touchés par les travaux, il a indiqué qu'il avait fallu réitérer à trois reprises l'opération de diagnostic avant que la mission de repérage soit correctement réalisée.
Les résultats sont édifiants : alors qu'un premier rapport concluait à la présence d'amiante dans certains enduits extérieurs en façade de trois des cinq bâtiments et dans les enduits intérieurs des parties communes, le dernier rapport établi après approfondissement des investigations montrait qu'un seul des cinq immeubles ne contenait pas d'amiante.
« Sans intervention de l'inspection du travail qui a dû faire compléter à deux reprises le rapport de repérage initial, une contamination importante des travailleurs et des occupants était inévitable » conclut M. Dubuc.
Il a imputé ce risque à la méthode utilisée en l'espèce par le professionnel du diagnostic, qu'un seul prélèvement négatif (démontrant l'absence d'amiante) sur l'une des façades de l'un des immeubles avait fait conclure à l'absence d'amiante sur toutes les façades de cet immeuble.
A cet égard, les professionnels du secteur ont insisté sur le fait qu'il n'existait pas de méthode de repérage unique, mais que chaque diagnostic devait être adapté à la date de construction et au type du bâtiment concerné.
Le président du SYRTA a cité le cas des locaux de vaccination de la compagnie Air France à Montparnasse ; les dalles en vinyle amiante s'étant dégradées sous l'effet d'un important passage, les dalles usées ont été remplacées par des dalles strictement identiques, mais ne contenant pas d'amiante : « Nous nous sommes retrouvés dans la situation où, sur plusieurs milliers de mètres carrés, nous ne pouvions pas déceler quelles étaient les dalles amiantées et quelles étaient celles qui ne l'étaient pas ». Comme les plans de travaux révélaient que 80 % des dalles contenaient de l'amiante, l'entreprise a considéré par principe qu'il y avait de l'amiante partout.
Le campus de Jussieu montre également la difficulté à définir une « zone homogène » de diagnostic. D'après les informations fournies par M. Henri Pézerat, certaines salles du rez-de-chaussée du campus contenaient de l'amiante, alors que les amphithéâtres situés au même niveau n'en contenaient pas. De même, la tour centrale de 24 étages a été floquée avec de l'amiante bleu, ce qui n'est pas le cas des autres bâtiments du campus. Il a souligné par conséquent que « d'un endroit à l'autre du campus, les situations n'étaient pas comparables » et indiqué que « les analyses d'amiante dans un couloir varient selon leur localisation » 89 ( * ) .
De manière plus générale, le président du SYRTA a souligné qu'il fallait prendre en compte certaines pratiques en vigueur dans le bâtiment. « Le bâtiment reste le bâtiment » a-t-il fait remarquer, « lorsque l'on procédait à un flocage, il y avait des fonds de sac qui traînaient. Lorsqu'il y a eu flocage dans dix appartements identiques, il n'est pas possible d'affirmer que l'un d'eux ne contient pas d'amiante ».
Il est donc impossible de faire l'économie d'un diagnostic individuel pour des unités d'un même ensemble immobilier, même si celles-ci ont été construites à la même époque et présentent, en apparence, les mêmes caractéristiques.
Mme Florence Molin, de la SOCOTEC, a ajouté que les techniques de repérage mises en oeuvre par les entreprises différaient en fonction de la mission définie par le propriétaire. Selon qu'elle recherche la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds, qu'elle réalise un DTA, ou qu'elle repère l'amiante avant travaux ou démolition, l'entreprise ne procède pas aux mêmes examens. Par conséquent, un diagnostic avant DTA n'est pas valable pour des travaux, qui nécessitent un nouveau diagnostic.
? Trop d'entreprises peu scrupuleuses restent encore sur le marché.
Selon M. Henri Pézerat, du CNRS, certaines entreprises « appartiennent à une catégorie de personnes qui profite de manière scandaleuse de l'émoi provoqué par « l'affaire de l'amiante » pour dresser hâtivement des diagnostics ».
Les interlocuteurs de la mission ont souligné que la précision du diagnostic était une condition de la protection des salariés et de la réussite du désamiantage. Par conséquent, le sérieux et la qualification des entreprises du secteur devraient être exemplaires, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas.
M. Claude Delpoux, de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), a déploré que « sous prétexte d'avoir suivi une formation de quelques semaines ou quelques mois, (certains contrôleurs techniques) s'estiment aptes à effectuer des diagnostics amiante ». C'est la raison pour laquelle certains assureurs refusent de contracter avec les professionnels du bâtiment qui s'instituent contrôleur technique sans disposer de qualification spécifique, alors que le décret du 13 septembre 2001 a renforcé les exigences requises des entreprises de diagnostic : « à compter du 1 er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction (qui réalise le DTA) doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions ».
Pour M. Dubuc, de l'inspection du travail, « la situation actuelle est paradoxale par le fait que cette attestation a accrédité officiellement une compétence des opérateurs de repérage et donné aux maîtres d'ouvrage et responsables d'entreprise un sentiment de sécurité illusoire ». Selon lui, l'efficacité de la certification est illusoire « lorsqu'on sait que cette attestation de compétence est le plus souvent obtenue sans difficulté par tous les participants, moyennant quelques centaines d'euros et deux à trois jours de formation au maximum sans compétence particulière dans le bâtiment... »
Dans le même sens, les représentants du SYRTA ont relevé que la formation ne comportait aucun enseignement sur les méthodes de construction, pourtant indispensables à l'activité de diagnostic.
Une réflexion est en cours pour faire évoluer la qualification obligatoire, notamment afin d'imposer l'actualisation des connaissances par le renouvellement de l'examen tous les trois ans et l'expérimentation de la formation aujourd'hui trop théorique.
(3) Le recensement des bâtiments amiantés et le problème du contrôle
Sept ans après la remise du rapport du professeur Claude Got à M. Bernard Kouchner et Mme Martine Aubry en 1998, où il était notamment proposé de rendre obligatoire la déclaration du diagnostic amiante sur un site internet accessible à tous, lequel aurait pris pour base le fichier du cadastre qui recense tous les logements et bâtiments, la mission a constaté qu'aucune avancée en ce sens n'avait été réalisée.
Comme il a été vu, le décret du 13 septembre 2001 prévoit cependant des sanctions pénales pour les propriétaires et les employeurs qui n'auraient pas réalisé le dossier technique amiante avant la fin de l'année 2005 90 ( * ) , mais reste muet sur le contrôle du respect de cette obligation ainsi que sur la transmission des DTA effectués.
La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction reconnaît qu' « aucun bilan n'a été réalisé » 91 ( * ) mais le ministère de l'équipement a indiqué que le ministère préparerait une circulaire rappelant aux propriétaires l'obligation de réaliser le diagnostic ; cependant « rien n'est prévu pour que nous puissions avoir communication du résultat » 92 ( * ) .
« Je crois que la législation qui a été élaborée pour effectuer le contrôle des bâtiments est salutaire. Je déplore qu'aucun moyen de contrôle de cette législation n'ait été prévu » a déclaré Henri Pézerat devant la mission.
Le constat établi par le professeur Claude Got dans son rapport de 1998 est par conséquent toujours d'actualité. On peut y lire que « le système actuel a bien organisé l'examen des immeubles bâtis (...). Il ne s'est pas donné les moyens de vérifier si le constat d'un matériau dégradé ou d'un empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux ».
La mission ne peut que partager ce constat en notant cependant que les collectivités territoriales ont l'obligation de transmettre les DTA au préfet pour les bâtiments dont elles ont la responsabilité.
Afin de remédier à cette situation, une des voies, suggérée par certains interlocuteurs de la mission, consisterait à reprendre la proposition du professeur Got de rendre obligatoire la transmission des observations de matériaux dégradés 93 ( * ) , afin de constituer une base informatique nationale.
Cette base pourrait être utilisée pour contrôler la réalisation des travaux et pour suivre l'application des décrets. Elle pourrait également être consultée par les responsables des entreprises pour mieux assurer la sécurité de leurs salariés intervenant sur des bâtiments contenant de l'amiante.
Pour le professeur Claude Got, ce système « permettrait de disposer en temps réel de l'historique et du suivi d'un bâtiment pour les occupants, pour les entreprises qui interviennent lors des travaux d'entretien ou de rénovation et pour les services de l'État, ainsi à même de veiller à la bonne application de la loi et de mener des contrôles aléatoires 94 ( * ) ».
Dans un article du « Monde » du 23 avril 2005, un représentant du ministère du logement souligne néanmoins la difficulté de la réalisation du recensement national : « L'inventaire sur l'amiante n'a pas été réalisé car on n'a pas les moyens de le faire ... On ne va pas mettre un gendarme derrière chaque propriétaire ».
Dans le même sens, les représentants de la SOCOTEC ont estimé que le dispositif était trop contraignant et peu réaliste. M. Daniel Ferrand a considéré qu'il fallait plutôt « trouver un dispositif permettant d'accompagner la bonne volonté des gens, sans pour autant leur imposer trop d'obligations ».
Afin de tenir compte du gigantisme du parc immobilier, la SOCOTEC a suggéré de procéder comme pour les normes européennes ISO 9000 : « O utre l'audit de qualité, nous vérifions, dans le temps, que les engagements sont tenus ». Un corps d'experts inscrits sur une liste homologuée pourrait donc être constitué afin d'exercer sur place le contrôle des obligations réglementaires.
On rappellera à cet égard l'initiative prise par le Conseil de Paris en mai 2005, visant à rendre public l'ensemble des diagnostics amiante des bâtiments publics parisiens.
(4) Un retrait d'amiante non systématique
Comme l'a rappelé la SOCOTEC, « d'après la réglementation, le retrait obligatoire d'amiante est limité aux trois matériaux dangereux, sous réserve que l'opérateur de diagnostic constate un certain niveau de dégradation ».
Il est en effet exclu pour des raisons techniques et économiques de procéder au retrait de tous les matériaux amiantés des immeubles : le SYRTA a souligné en outre que ce serait incohérent en termes de santé publique, seule la présence de fibres d'amiante dans l'atmosphère étant potentiellement dangereuse pour la santé humaine.
L'article 4 du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis indique en effet que, lorsque le diagnostic a conclu à la présence d'amiante, les propriétaires sont tenus de procéder :
- à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère ;
- si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.
A cet égard, M. Henri Pézerat s'est inquiété de la fiabilité des mesures réalisées 95 ( * ) : « combien y a-t-il eu de mesures de fibres d'amiante dans l'air réalisées la nuit ou pendant les vacances ? » , et a rappelé que « sans présence humaine, sans activité, sans courant d'air, il n'y a aucune fibre en suspension dans l'air » 96 ( * ) .
Si la réglementation prévoit une stricte séparation entre les entreprises chargées d'établir le diagnostic et celles qui sont en charge du retrait, « on ne peut être juge et partie » a souligné Bernard Peyrat, afin de garantir l'objectivité et l'impartialité de chacune des opérations, l'entreprise qui réalise les travaux de désamiantage est pourtant largement dépendante de celle qui a procédé au diagnostic.
b) Le désamiantage : une réglementation stricte et coûteuse
Compte tenu des risques sanitaires liés au désamiantage pour les travailleurs comme pour les occupants du bâtiment, les opérations de retrait de l'amiante sont encadrées par une réglementation très stricte qui a été renforcée en 1996 97 ( * ) : certification des entreprises, formation et surveillance médicale renforcées des salariés, notification des travaux à l'inspection du travail avant le début du chantier, mise en place de dispositifs techniques de protection.
Le décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques de l'inhalation de poussières d'amiante impose aux entreprises concernées la mise en oeuvre de mesures de protection à tous les stades du déroulement du chantier :
? Avant chaque chantier de retrait ou de confinement , l'entreprise doit établir un plan retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante (PRC).
Le PRC 98 ( * ) a pour objet de réduire au niveau le plus faible possible l'émission et la dispersion de fibres d'amiante pendant les travaux, d'éviter toute diffusion de ces fibres hors des zones de travaux, d'assurer les protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants pour l'ensemble des risques et de garantir l'absence de pollution résiduelle après travaux.
? Pendant les travaux , afin de s'assurer de la protection des ouvriers, des occupants et plus généralement de la population voisine, une vérification périodique doit être effectuée, portant sur l'étanchéité du confinement et des appareils de protection, sur les rejets en air et eau et sur l'atmosphère (maintien du niveau d'empoussièrement inférieur à 0,1 fibre/cm 3 sur une heure de travail).
? A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. L'article 7 du décret du 7 février 1996 précité précise que «s i les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux résiduels (...), dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage . »
Devant la mission, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, a indiqué que, par cette réglementation, la France avait anticipé les règles communautaires adoptées en 2003 99 ( * ) sur le modèle français.
Si la réglementation est très stricte, elle est pourtant inégalement appliquée : de nombreuses entreprises, attirées il y a quelques années par le marché florissant du désamiantage, ne présentaient pas les compétences techniques requises et étaient peu respectueuses des mesures de sécurité.
Si le secteur semble aujourd'hui quelque peu assaini concernant le retrait de l'amiante friable 100 ( * ) (matériaux le plus dangereux), les milliers de petits chantiers portant sur des habitations privées et sur des matériaux considérés comme moins dangereux (amiante non friable) échappent à tout contrôle.
(1) Le « marché » du désamiantage : un secteur en voie d'assainissement pour l'amiante friable
Le président du SYRTA, a rappelé qu'à partir de 1996 101 ( * ) , attirées par un marché en fort potentiel de développement, de nombreuses entreprises s'étaient improvisées des compétences dans les activités liées à l'amiante : « Quelque 400 entreprises sont arrivées sur le marché à cette époque. Elles provenaient d'horizons différents : les métiers du bâtiment, du nucléaire, du nettoyage industriel, etc.... » .
Comme il a été vu, une réglementation stricte a été mise en place depuis 1996 pour endiguer ce phénomène : les entreprises qui traitent des matériaux friables ont désormais l'obligation d'obtenir un certificat de qualification, délivré par deux organismes certifiés (Qualibat et AFAQ-Ascert) qui se basent sur un certain nombre de référentiels homologués 102 ( * ) .
Par ailleurs, les efforts de certains professionnels pour autoréguler la « filière amiante » ont abouti au regroupement de quelque 125 entreprises liées à l'amiante (secteur friable) au sein du Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA), dont l'objectif est d'élaborer des repères communs en terme d'exigence et d'encourager à plus de rigueur dans l'emploi des techniques de désamiantage.
Son président a indiqué à la mission que les entreprises qui ont obtenu la qualification sont majoritairement issues des filières du nucléaire, habituées à une grande rigueur, et que celles-ci sont désormais mieux réparties sur l'ensemble du territoire : alors que la plupart se sont créées en Ile-de-France, on compte en moyenne à l'heure actuelle une entreprise de désamiantage par département.
M. Daniel Ferrand, de la SOCOTEC, a estimé que des progrès avaient été réalisés concernant la sécurité. Entre 1996 et 1998, notamment sur les premiers chantiers des lycées de la région Nord-Pas-de-Calais, « nous n'avions pas d'outils adaptés », a-t-il reconnu .
Le développement du marché du désamiantage a conduit les industriels à s'intéresser à ce secteur et des matériels plus sophistiqués ont été mis en circulation : « Aujourd'hui, les technologies utilisées dans les chantiers de désamiantage sont connues » a indiqué la SOCOTEC précisant que « certains appareils, comme les scies ou les perceuses sont capables d'aspirer les poussières d'amiante » .
(2) Un chantier exemplaire sur le plan de la sécurité : le campus de Jussieu
« On critique beaucoup Jussieu aujourd'hui » , pourtant, « le cas de l'université de Jussieu est à maints égards un cas d'école » a déclaré le président du SYRTA, devant la mission.
Si la presse s'est faite l'écho du rapport de la mission interministérielle d'enquête sur la rénovation du campus de Jussieu, qui dresse un constat sévère de l'opération commencée en 1997 103 ( * ) , l'autorisation préfectorale de prolongement de travaux 104 ( * ) n'a été obtenue que parce que ceux-ci se déroulent dans des conditions de sécurité optimale.
Dressant un bref historique de l'opération de désamiantage débutée il y a presque dix ans, M. Peyrat a indiqué que le chantier avait été mis en place progressivement et dans le respect des obligations réglementaires de sécurité pour les intervenants et les occupants du campus : « Sur ce site, une prise de conscience collective est intervenue très tôt » . Dès 1975, les universités ont demandé un premier rapport qui a mis en évidence une présence d'amiante dans l'air très importante, en certains points du campus ; des mesures de confinement conservatoires ont pu être prises pour ce qui concerne l'amiante placé dans les faux plafonds.
Lors du déplacement de la mission sur le site, les représentants des trois établissements universitaires et de l'EPA Jussieu ont indiqué que, dès 1985, leurs responsables ont pris l'initiative, à titre de précaution, d'isoler certains locaux et de protéger les faux plafonds à l'aide d'un film plastique.
Suite aux deux décrets de février 1996, des travaux de confinement 105 ( * ) ont été réalisés sur le campus en 1996 et 1997, sous la responsabilité des universités de Paris VI et Paris VII, ainsi que de l'IPG, en attendant le retrait définitif de l'amiante. « Le risque amiante a pu être annihilé grâce à cette action préventive » , puis, « dès lors que les autorités universitaires ont pu s'assurer du relogement des personnes considérées, les travaux de désamiantage ont débuté », a précisé M. Bernard Peyrat en ajoutant que « le processus qui a été suivi à Jussieu est celui qui devrait être toujours mis en oeuvre, quel que soit le site : mesures conservatoires, prises de dispositions pour évacuer partiellement les locaux par barre ou groupe de barres ».
Lors de la projection d'un film présentant le chantier de désamiantage d'une des barres du campus, la délégation de la mission a pu constater, lors de son déplacement sur le site, la rigueur des mesures de sécurité mise en oeuvre à Jussieu dans quatre domaines :
• assurer la sécurité des ouvriers du chantier :
Les salariés, munis d'une tenue à usage unique et d'un masque de protection, pénètrent sur le chantier par l'intermédiaire d'un sas divisé en cinq compartiments. Ils sont soumis à un dépoussiérage après avoir quitté la zone contaminée, puis à une première douche, en tenue, suivie d'une seconde douche après déshabillage.
• éviter la dispersion des fibres d'amiante dans l'atmosphère :
Afin de limiter la dispersion de poussière d'amiante dans l'atmosphère, le flocage est humidifié puis l'amiante est retiré à l'aide d'une spatule. Les surfaces désamiantées sont brossées pour éliminer les dernières traces d'amiante La zone du chantier est isolée et maintenue en dépression pour éviter que des fibres d'amiante ne s'échappent vers l'extérieur. Des analyses sont régulièrement effectuées pour évaluer la concentration de fibres d'amiante dans l'air.
A l'heure actuelle, « dans les cours de Jussieu, il y a moins d'amiante qu'il n'y en avait il y a 20 ans, quand les plaquettes de freins étaient faites en amiante et qu'il existait une pollution environnementale mesurable non négligeable », a témoigné le professeur Claude Got.
• garantir l'innocuité des déchets :
Les déchets sont envoyés vers des centres d'enfouissement lorsque leur teneur en amiante est faible. Dans le cas contraire, ils sont traités par une entreprise spécialisée, qui les vitrifie pour les transformer en un matériau inerte. Les eaux usées contaminées par l'amiante sont filtrées avant d'être rejetées dans le système d'évacuation général.
Il a été rappelé à la mission que 40 tonnes d'amiante avaient été retirées de la barre 65-65 du campus, la première à avoir été désamiantée.
• sécuriser le site après la fin des travaux.
Les surfaces désamiantées sont brossées pour éliminer les dernières traces d'amiante. Les travaux sont considérés achevés lorsque la concentration d'amiante dans l'air est inférieure à cinq fibres par litre.
Si le chantier de Jussieu est exemplaire, il fait aussi figure d'exception, tant en raison de son coût que de sa médiatisation.
(3) Des chantiers de désamiantage clandestins
L'impossibilité de diligenter des contrôles sur tous les chantiers ouverts n'incite pas les maîtres d'ouvrage à respecter les obligations réglementaires.
M. Gilles Evrard, président de la CNAM, a, par ailleurs, souligné la recrudescence, depuis l'interdiction de l'amiante, de « déflocages sauvages » réalisés par des entreprises non qualifiées : « Malheureusement, de nombreuses entreprises, voire des artisans, effectuent des désamiantages sans déclaration de chantier, sans être certifiés ».
Il a indiqué qu'une campagne de contrôle avait été lancée en mars 2004 pour mesurer l'ampleur de ces désamiantages clandestins.
Devant la mission, M. Gérard Larcher s'est dit particulièrement sensibilisé par ce problème et a indiqué qu'une nouvelle campagne nationale de contrôle était en cours, menée conjointement avec les agents des CRAM et l'inspection du travail.
Deux catégories de chantiers sont particulièrement concernées :
• les chantiers qui traitent l'amiante non friable 106 ( * ) ;
« Très peu réglementé, le retrait de l'amiante non friable concerne des dizaines de milliers de petits chantiers qui échappent pour l'heure actuelle presque totalement au regard des pouvoirs publics », a déploré Michel Héry, chargé de mission à l'INRS. On rappellera que les entreprises de ce secteur n'ont pas à justifier d'une qualification certifiée, situation à laquelle il faudrait remédier, selon le président du SYRTA, parce qu'elle a conduit « un certain nombre d'entreprises de démolition, qui ne se posent pas trop de questions » à investir le secteur.
• les travaux à domicile, réalisés chez des particuliers, qui sont autant de « petits chantiers », ouverts, dans leur grande majorité sans précaution particulière, portant notamment sur la restauration de maisons individuelles.
Certains chantiers publics ne sont pas non plus exempts de critiques, comme le montre le cas de l'école primaire de la rue de Tlemcen, dans le XX e arrondissement de Paris, où, après le décès d'une enseignante, l'enquête a fait apparaître que « les bouches d'aération et les câbles électriques ont été laissés à l'air libre et la poussière qui s'est révélée être polluée par l'amiante, a continué de tomber à même le sol » 107 ( * ) .
Les professionnels du secteur ont imputé la multiplication des désamiantages « clandestins » au souci de certains chefs d'entreprises et de certains propriétaires de réduire le coût des opérations : les mesures réglementaires obligatoires de protection représentent en effet de 50 à 80 % du coût d'un désamiantage. La tentation est par conséquence grande de s'en affranchir, alors que les chantiers sont rarement contrôlés.
Pour remédier à cette situation, un des volets du plan santé travail, présenté en février 2005, vise à améliorer le contrôle de la réglementation, notamment par le renforcement du corps de l'inspection du travail, qui pourra s'appuyer sur des centres techniques régionaux.
Afin de réduire le nombre des chantiers sauvages, la mission considère que deux évolutions réglementaires sont aujourd'hui souhaitables :
• disposer d'une liste nationale de tous les chantiers ouverts en France, pour faciliter le contrôle des inspecteurs du travail et des agents de la CRAM ;
• rendre obligatoire la qualification des entreprises intervenant sur l'amiante non friable.
(4) Le désamiantage en milieu occupé : un moindre coût
Le président du SYRTA, a fait remarquer qu'il avait fallu près de 18 mois pour désamianter l'immeuble du Berlaymont, qui abrite la Commission européenne à Bruxelles. Il a ajouté que « les travaux ont coûté quelque 180 millions d'euros. Sur ces 180 millions, me croirez-vous si je vous dis que les opérations de déménagement ont coûté aussi cher que les travaux de désamiantage ? »
Sur les chantiers, en effet, deux méthodes peuvent être utilisées : soit le maintien partiel temporaire des populations sur place, avec location de « locaux-tampons », comme à Jussieu 108 ( * ) , soit le déménagement total des occupants pendant la durée des opérations, comme à Bruxelles.
Si cette deuxième solution permet une réalisation plus rapide des travaux, le coût du déménagement est très élevé.
« Le problème est, naturellement, d'ordre essentiellement financier » a reconnu M. Bernard Peyrat, qui a estimé que le désamiantage en milieu occupé constituait aujourd'hui la solution la plus raisonnable. Evoquant une actualité récente, il a considéré « qu'il est absolument irréaliste d'évacuer la Tour Montparnasse pour procéder aux travaux de désamiantage » , précisant que « même si vous faites des économies sur l'opération de désamiantage elle-même, ce déménagement impliquerait par ailleurs tant de contraintes que (...) les dérives (financières) seraient considérables » .
La présence des occupants et d'une population autour des zones d'intervention implique la mise en oeuvre de techniques spécifiques, visant à confiner de manière parfaitement étanche les locaux dans lesquels les entreprises interviennent. La mission a pu se rendre compte à Jussieu que ces techniques étaient maîtrisées par l'entreprise concernée, comme en témoigne le document ci-après :
Les étapes du désamiantage à Jussieu
|
Après le dépoussiérage et le déménagement, le désamiantage peut commencer. C'est une opération qui se déroule en plusieurs étapes, chacune nécessitant des techniques, du matériel et des mesures de sécurité spécifiques accompagnant tout chantier de désamiantage. |
|
|
1
re
étape :
|
Cette première étape comprend la dépose de tous les équipements des locaux (réseaux, fluides, portes, cloisons amovibles etc....) qui ne sont pas en contact direct avec l'amiante et qui ne sont pas contaminés par des fibres. |
|
2 e étape : confinement des locaux |
Le confinement consiste à protéger les murs et à rendre étanche la zone de chantier par rapport à l'extérieur. Les confinements statiques (pose de films plastiques) et dynamiques (mise en dépression du bâtiment) permettent de garantir qu'aucune fibre d'amiante ne sorte du chantier. Par ailleurs, des filets sont posés sur les façades afin d'éviter toute chute accidentelle d'objet ou d'élément de façade durant les travaux. |
|
3 e étape : démantèlement (ou curage) |
Le démantèlement consiste à déposer et évacuer l'ensemble des matériaux contaminés (dalles de faux plafonds, placards techniques et réseaux...) pour accéder au flocage. Ces éléments ont été soit en contact direct avec l'amiante, soit pollués par les fibres. |
|
4 e étape : arrachage de l'amiante |
Lors de l'enlèvement des flocages, les techniques doivent limiter le potentiel d'exposition des opérateurs de désamiantage aux poussières d'amiante et faciliter l'enlèvement des flocages. La méthode de l'enlèvement à l'humide est préconisée et privilégiée. Consistant à saturer totalement d'eau le matériau à base d'amiante avant de le retirer, elle se révèle la plus efficace pour limiter les émissions de poussières. Une fois l'amiante enlevé, la phase de nettoyage commence et les surfaces sont brossées et aspirées. |
|
Fin de désamiantage : mesures libératoires et mesures de restitution |
Une inspection visuelle est réalisée pour vérifier l'enlèvement de l'amiante. Après cette visite, s'il n'y a pas de réserve, l'entreprise de désamiantage est autorisée à déposer la première peau du confinement. Une période d'attente de 48 h est respectée avant de réaliser les mesures dites « libératoires », à charge du maître d'ouvrage, c'est-à-dire de l'EPA Jussieu. Lorsque ces mesures indiquent un niveau intérieur au seuil réglementaire de 5 fibres d'amiante par litre d'air, la phase de restitution peut commencer : l'entreprise dépose l'ensemble des installations de confinement et procède à un ultime nettoyage du chantier. Une nouvelle série de mesures, dites de restitution, a alors lieu : toutes les mesures doivent indiquer un taux inférieur à 5 fibres d'amiante par litre d'air pour que le chantier soit déclaré terminé. Les entreprises de désamiantage et la sécurité des opérateurs : Les entreprises de désamiantage sont agrées et doivent justifier d'un « certificat de qualification amiante ». Leurs opérateurs, eux-mêmes habilités, interviennent en zone amiantée équipés d'une tenue spécifique et d'un masque leur assurant une alimentation en air sain. Les relevés de présence des opérateurs en zone amiantée sont envoyés régulièrement aux services de médecine du travail. De plus, ils passent régulièrement des visites médicales. |
Source : EPA Jussieu
Le président du SYRTA a insisté sur le fait que « l'on ne peut pas faire autrement que d'accepter de désamianter des immeubles (en milieu occupé), mais à condition de ne pas confier ces travaux à des entreprises générales qui sous-traitent parfois à n'importe qui » , ajoutant que « c'est un travail de spécialistes, spécifiques (...), il faut donc faire appel à des entreprises qui ont des compétences réelles ». Il a rappelé que toutes les tours de la Défense, sauf la Tour Aurore, avaient été désamiantées alors qu'elles étaient occupées, et que les contrôles du niveau d'empoussièrement réalisés alors avaient montré l'absence de risque pour les occupants.
B. L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
L'exposition à l'amiante peut être aussi d'origine purement environnementale. C'est le cas, par exemple, en Nouvelle-Calédonie et surtout dans le département de la Haute-Corse. Le nord-est de l'île présente en effet des caractéristiques géologiques particulières du fait de la présence de schistes lustrés, souvent associés à la serpentinite, roche pouvant contenir de l'amiante.
1. L'amiante en Corse
Lors du déplacement de la mission dans l'île, M. Delga, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse, a rappelé que la Haute-Corse était confrontée à deux problèmes spécifiques liés à l'amiante :
- l'existence d'une friche industrielle à Canari, à l'emplacement de l'ancienne mine d'amiante ;
- la présence d'amiante à l'état naturel : des plaques pleurales ont été constatées chez des personnes qui n'avaient jamais été associées à l'exploitation de la mine.
La brochure publiée par la DDASS sur « l'amiante environnemental en Haute-Corse », indique que l'exposition passive de la population présente un certain caractère de permanence. Cette exposition vise particulièrement les professionnels du bâtiment et des travaux publics, qui peuvent être régulièrement exposés à des empoussièrements particulièrement élevés.
a) L'ex-mine de Canari
Dans son ouvrage « L'aventure industrielle de l'amiante en Corse », M. Guy Méria, inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales à la DDASS, indique que « la mine de Canari assurait la quasi-totalité de la production nationale et fournissait à elle seule 25 % des besoins industriels continentaux » . Son histoire peut être ainsi retracée.
En 1927, le géologue Henri Eggenberger, agissant pour le compte de la société française Eternit, demande l'autorisation d'extraire des roches sur les communes de Nonza et d'Olmeta, afin de « déterminer les emplacements possibles pour l'exploitation ».
Ce n'est qu'après de nombreuses analyses dans les laboratoires continentaux et après des études comparées avec les fibres de divers gisements mondiaux, dont ceux du Canada, que l'exploitation de la mine passera du stade artisanal à une échelle industrielle.
En 1938, le conseil municipal de Canari approuve le contrat portant concession des gisements amiantifères à la société Eternit. Dès 1939, les études sont lancées pour créer une usine de production de 2.000 tonnes, qui produira 6.000 tonnes après la guerre. L'exploitation est confiée à une filiale de la société Eternit, la société minière de l'amiante (SMA), qui décidera de construire une nouvelle usine, dite Canari I, en 1947.
La production, avec la mécanisation, va passer de 6.000 tonnes par an en 1950 à 11.500 tonnes en 1954 (date à laquelle est installée la seconde partie de l'usine), et jusqu'à 25.500 tonnes en 1962, trois ans avant la fermeture du site.
Un article de 1962 du Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la Corse, souligne que « la mine d'amiante de Canari est de loin l'entreprise industrielle la plus florissante de l'île ; sa production de l'ordre de 25.500 tonnes par an, représente une valeur marchande de 9.400.000 MF, ce qui en fait la troisième richesse de la Corse après les produits de l'exploitation forestière et les spéculations pastorales ».
En 1962, la production de Canari place la France au septième rang des pays producteurs d'amiante 109 ( * ) . La mine couvre alors le cinquième des besoins du marché intérieur, le reste étant importé du Canada, de l'URSS ou de l'Afrique du Sud (100.000 tonnes environ) ; 10.000 tonnes sont par ailleurs vendues à l'étranger, notamment à l'Allemagne.
Il ressort des entretiens que la mission a pu avoir en Corse avec ses interlocuteurs que seules des raisons économiques (l'amiante russe ou canadien arrivé au Havre revenait 10 % moins cher que l'amiante de Canari) ont été avancées à l'époque pour justifier la fermeture de la mine, alors que l'argument de la nocivité de l'amiante n'a jamais été évoqué. D'anciens mineurs rencontrés lors du déplacement ont même rapporté l'émotion de la population au moment de la fermeture de la mine, en rappelant la prospérité économique que l'exploitation de l'amiante, « qui faisait vivre directement 300 personnes, sans compter les emplois induits », avait apportée au village et à sa région.
D'après les informations fournies à la mission, 1.413 personnes auraient travaillé sur le site de Canari, dont des Marocains, des Turcs, des Italiens et même des prisonniers de guerre allemands dans les années d'après-guerre.
Il reste que les anciens mineurs comme tous les interlocuteurs de la mission ont souligné l'absence de mesure de prévention et d'information des personnels sur les dangers de l'amiante durant l'exploitation de la mine.
(1) Le devenir et le suivi des anciens mineurs de Canari
Les anciens mineurs ont témoigné que les masques de protection mis à leur disposition étaient peu utilisés, dans la mesure où leur port était difficilement supportable avec les conditions d'exploitation.
La délégation de la mission a pu examiner des documents photographiques des années 50, révélant l'ampleur du nuage de poussière qui était alors visible, et qui transformait les mineurs en autant de « Père Noël blancs ». En outre, à partir de 1954, date d'installation de la deuxième partie de l'usine, la capacité de production de la mine a été accrue sans que des précautions supplémentaires aient été prises en matière de sécurité au travail.
D'après les informations fournies à la mission par les anciens mineurs, il semble que les risques ont été largement sous-estimés durant toute la durée de l'exploitation, le directeur de la mine vivant même avec sa famille sur le site de Canari. Ils ont indiqué n'avoir pris connaissance des dangers de l'amiante qu'au milieu des années 1980, c'est-à-dire près de 15 ans après la fermeture du site.
Le docteur Mouries, pneumologue au centre hospitalier de Bastia, a indiqué à la délégation que la surmortalité des mineurs de Canari était aujourd'hui avérée, par asbestose ou cancer bronchique principalement. Le nombre de mésothéliomes est également en augmentation, a-t-il ajouté, en précisant néanmoins que les mineurs avaient été exposés au chrysotile, variété d'amiante réputée moins dangereuse.
Les anciens mineurs de Canari bénéficient d'un suivi médical approprié ; il est cependant difficile d'évaluer précisément le nombre de salariés décédés ou malades, nombre d'entre eux étant repartis dans leur pays d'origine ou sur le continent. M. Dubois, médecin du travail, a indiqué qu'un médecin du travail assurait le suivi de chacun des mineurs de Canari dont on avait retrouvé la trace, et que les radiographies des personnels étaient consultables dans les archives de la médecine du travail.
Les représentants de l'ARDEVA ont cependant regretté que l'utilisation du scanner ne soit pas encore systématique dans le protocole de suivi des anciens travailleurs de l'amiante 110 ( * ) , ceci en contradiction avec les recommandations de la conférence de consensus de 1999.
La présidente du tribunal des affaires sanitaires et sociales de Bastia a souligné que sa juridiction accordait aux victimes de l'amiante des indemnités supérieures à celles allouées par le FIVA. Lors d'une réunion avec les élus à la mairie de Canari, plusieurs victimes de l'amiante ont confirmé ces propos, en déclarant qu'après avoir accepté les indemnisations proposées par le FIVA, elles avaient constaté que certains tribunaux accordaient des indemnités supérieures, pour des pathologies parfois plus bénignes.
Elle a néanmoins admis que la reconnaissance de la maladie professionnelle était souvent refusée au motif que les demandeurs se trouvaient dans l'incapacité, du fait de l'ancienneté de leur contamination, de produire leur premier certificat de constatation médicale d'une pathologie liée à l'amiante, précisant que la reconnaissance en maladie professionnelle est facilitée lorsque la victime est titulaire d'une pension d'invalidité.
D'après les informations fournies par la représentante de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), 81 reconnaissances de maladies professionnelles ont été accordées depuis 2000, tandis que 19 ont été rejetées. Les victimes soutenues par les associations de défense contestent ces décisions : la présidente du TASS de Bastia a indiqué que sa juridiction avait été saisie de 17 recours dirigés contre des refus de reconnaissance de maladie professionnelle depuis novembre 2003.
A cet égard, M. Masotti, président de l'association « Corsica per Vivere » a indiqué gérer à l'heure actuelle 130 dossiers de victimes de l'amiante, dont les trois quart concernent des victimes de la mine de Canari.
S'agissant, enfin, du contentieux en responsabilité, la présidente du TASS de Bastia a relevé une augmentation des recours : 37 demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en relation avec l'exploitation de la mine de Canari, ont été déposées au TASS depuis novembre 2003.
Les représentants de l'ARDEVA PACA/Corse se sont félicités que, pour la première fois en 2004, le TASS ait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans une affaire concernant un ancien salarié de la mine, une décision similaire ayant été rendue en 2005.
Lors du déplacement en Corse, certains membres de la délégation se sont rendus au sommet de l'ancienne mine de Canari. Ils ont pu mesurer les difficiles conditions d'accès au site et l'ampleur des excavations formées dans la roche, qui forment d'immenses cratères.
(2) La sécurisation du site par l'ADEME
Comme l'indique M. Méria dans son ouvrage , « Plus qu'une plaie dans le magnifique Cap-corsin, les installations de l'ancienne usine, les bâtiments annexes, les galeries, les puits et les verses constituent un véritable danger » .
Si la commune de Canari possède aujourd'hui le site orphelin - en 1973, la commune a en effet acheté la mine à la société Eternit et l'utilise actuellement comme décharge d'ordures ménagères -, elle ne peut assurer le financement de la réhabilitation, qui a été confiée à l'ADEME.
A la fin de l'année 1998, un arrêté préfectoral a, en effet, chargé l'ADEME de piloter, pour le compte de l'État, les opérations de réhabilitation de la mine.
Plusieurs études, réalisées par le BRGM pour le compte de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), ont mis en évidence trois types de risques :
- un risque général de dangerosité du site qui comporte deux cratères et plusieurs galeries souterraines ;
- un risque amiante ;
- un risque d'instabilité des talus. Ce dernier est apparu au préfet comme le plus important et le plus immédiat. C'est pourquoi la phase actuelle des travaux est celle de la mise en sécurité du site.
M. Guy Méria a regretté devant la mission que les travaux aient été retardés. M. Milano, délégué régional de l'ADEME, a expliqué que l'arrêté préfectoral d'exécution des travaux ayant été publié en janvier 2004, le début de la première tranche des travaux, consacrée à la mise en sécurité du site contre le risque d'éboulement, était prévu pour le printemps 2006 et le début de la deuxième tranche, avec l'intervention des engins de chantier, pour octobre 2007.
La phase de sécurisation nécessite de prendre de grandes précautions, à la fois individuelles et collectives pour les intervenants : les travaux de « retalutage » et de reprofilage constituent une source de dangers et il sera nécessaire de limiter les dispersions de poussières en humidifiant le chantier et en menant ces travaux de stabilisation plutôt en période hivernale.
La diversité des intérêts en jeu rend par ailleurs l'opération complexe. Compte tenu de la spécificité du site, de l'utilisation qui en est faite par la commune, de l'attitude légitime des élus soucieux de l'activité touristique, de l'ampleur du projet de remodelage des pentes en respectant tous les impératifs de sécurité, de la responsabilité encourue par le maître d'ouvrage, la réhabilitation du site de la mine par l'ADEME apparaît particulièrement délicate.
Par ailleurs, le risque sanitaire au regard de l'amiante n'a pas été pris en compte par l'arrêté préfectoral précité de 1998, compte tenu des conclusions des études du BRGM et de l'INERIS.
C'est la raison pour laquelle un surcoût de 35 à 45 % résultant du caractère amiantifère du chantier a déjà été prévu pour la phase de stabilisation, évaluée initialement à 4,5 millions d'euros. M. Milano a indiqué que cette situation posait un problème budgétaire à l'ADEME, le cofinancement européen n'étant pas suffisant pour supporter ce surcoût. Il a souhaité en conséquence qu'une issue positive soit donnée à la procédure de recherche en responsabilité engagée à l'encontre de la société Eternit, ancienne propriétaire de la mine, afin que celle-ci participe au financement des travaux.
S'agissant des travaux en cours, il a indiqué que l'ADEME étudiait le problème de la stabilisation mécanique des dépôts sur le site et notamment de la mise en sécurité de la route départementale, très fréquentée pendant la période estivale.
Pour des raisons de sécurité, l'ADEME devrait clôturer la totalité du site pendant les travaux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle et poser des panneaux signalant les dangers.
A l'issue de ces travaux, le site devrait être revégétalisé.
(3) Les plages de stériles du Cap Corse
Outre les installations de l'ancienne usine, la conséquence la plus visible de l'exploitation de la mine de Canari est la formation de plages de stériles, depuis la baie d'Albo jusqu'à la falaise de Nonza, du fait du rejet des rebuts de l'exploitation à la mer, qui représentaient jusqu'à plus de 3.500 tonnes par jour.
Dans son ouvrage, M. Méria rappelle que cette solution peu respectueuse de l'environnement a été envisagée par les responsables de l'entreprise dès le début de l'exploitation : dans un rapport de 1941, concernant le projet de Canari 1, le géologue Eggenberger prévoit l'évacuation à la mer des stériles de fabrication. Des rapports de 1947 soulignent que « la proximité de la mer facilitant l'évacuation des stériles, constitue un avantage, car pour les autres mines d'amiante, cette opération est, en général, très coûteuse »... « Les déchets du travail seront jetés à la mer, comme vous l'avez si opportunément indiqué, et le transport sera exécuté avec l'eau de mer ».
D'après les informations fournies à la mission, les pouvoirs publics ne se sont véritablement préoccupés de cette situation qu'en 1960 : un arrêté préfectoral a en effet interdit le rejet des stériles à la mer, mais il est resté lettre-morte. Lorsqu'en 1962, M. Altani, président du comité de défense des intérêts du canton de Nonza écrit au Président de la République pour lui faire part de son inquiétude, concernant la pollution engendrée par l'exploitation de la mine de Canari, M. Raymond Barre, alors directeur de cabinet du ministre de l'industrie, lui transmet la réponse suivante : « Il s'agit là d'une question difficile, car on ne saurait envisager d'imposer à la société des charges trop lourdes sans risquer de remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation ».
Les intérêts économiques de l'époque ont donc prévalu sur les préoccupations environnementales.
Les rejets, brassés par la mer, seront progressivement transportés vers le Sud, « où ils ont transformé, en un désert de cailloux grisâtres, du plus déplorable effet, la baie d'Albo, son petit port et même celui que la société avait fait construire, en dédommagement, au pied de la vieille tour génoise » 111 ( * ) . Progressivement, c'est l'ensemble de la côte jusqu'à Nonza qui va recevoir ces stériles, comblant les petites criques et surtout la marine de Nonza.
Dans une étude de 1997 le BRGM estime à 11.250.000 tonnes et à 4,5 millions de m 3 les stériles rejetés en mer par la SMA, entre 1950 et 1965. En quelques décennies, les stériles ont créé une longue plage de colmatage, qui, en 1962, avait une longueur totale de près de 5 kilomètres, y compris sous la Punta Bianca, aujourd'hui battue à nouveau par la mer.
Lors de leur rencontre avec les élus à la mairie de Canari, la délégation a pu mesurer l'amertume des maires de Nonza et d'Ogliastro, qui ont expliqué que leurs communes n'avaient pas bénéficié des retombées économiques associées à la mine, alors que la plage de stériles s'étendait aujourd'hui sur leur territoire.
Le maire de Nonza a regretté n'avoir reçu aucune compensation de l'État et déploré que certains guides touristiques aient associé dans le passé le nom de son village à l'amiante, occasionnant un réel préjudice économique. Le maire d'Ogliastro a, pour sa part, regretté que l'État soit incapable d'informer précisément sur les risques encourus par les habitants.
(4) Les conséquences pour le tourisme
Lors de l'entretien avec le délégué régional de l'ADEME, celui-ci a reconnu que les autorités, notamment locales, étaient réticentes à évoquer le risque sanitaire en raison de la fréquentation touristique du Cap Corse, et de la présence de deux plages de stériles.
M. Guy Méria a rappelé à cet égard que la réaction de la population et des élus vis-à-vis de l'amiante avait toujours été ambivalente : si les dangers de l'amiante peuvent être évoqués, des craintes pour le tourisme ou le développement économique de la région sont également exprimées.
La rencontre avec les élus locaux à la mairie de Canari ont confirmé ce sentiment : M. Mortoni, conseiller général de Canari, a insisté sur l'importance de « ne pas inquiéter de manière déraisonnable les habitants et les touristes, ce qui ferait obstacle au développement du village » .
M. Bertoni, maire de Canari, a en effet indiqué à la délégation que le tourisme, stimulé par la présence de nombreux chemins de randonnée, était aujourd'hui la principale ressource économique du village, qui compte 300 habitants permanents et 1.500 l'été.
b) Les terrains amiantifères en Haute-Corse
Lors du déplacement de la mission, le docteur Mouriès, pneumologue au centre hospitalier de Bastia, a indiqué observer tous les deux ans, en moyenne, un cas de mésothéliome dont l'origine ne peut être attribuée à une exposition professionnelle à l'amiante, précisant que des études géologiques avaient démontré la corrélation entre la présence d'affleurements d'amiante dans les villages et la fréquence des plaques pleurales, qui affectent parfois 20 à 25 % de la population.
Il a ajouté qu'un lien statistique avait été observé entre la présence d'affleurements d'amiante et le risque de mésothéliome, en ajoutant qu'il était plus difficile d'établir une telle corrélation pour les cancers bronchiques qui peuvent avoir d'autres causes, notamment tabagiques.
Comme l'a rappelé M. Femenia, président de la chambre de commerce et d'industrie, aux membres de la mission, « les terrains amiantifères sont nombreux en Haute-Corse et même à Bastia : la préfecture elle-même est construite sur l'un d'eux ».
La cartographie réalisée par le bureau de recherche géologique et minière (BRGM) montre que 130 communes de Haute-Corse possèdent sur leur territoire au moins une zone d'affleurement de serpentinite.
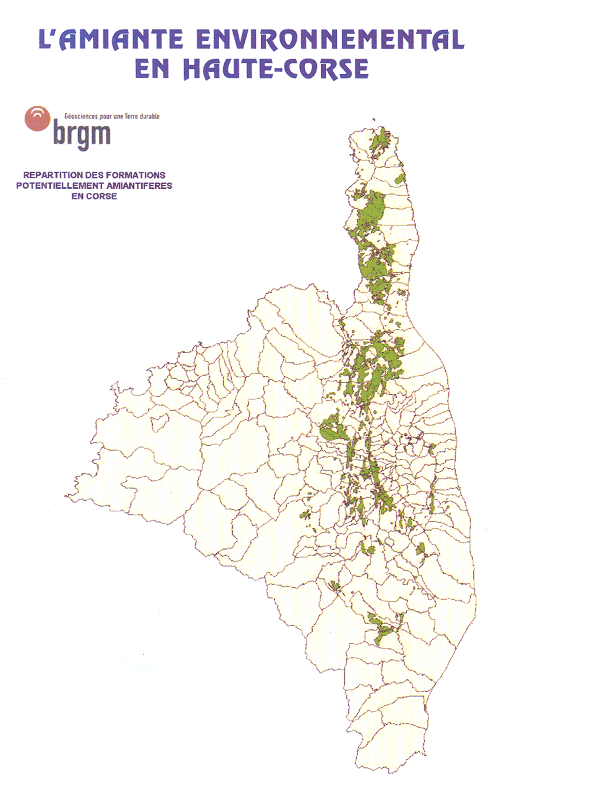
Plusieurs associations de protection de l'environnement avaient saisi, en 1996, le préfet Erignac du problème de l'amiante environnemental en Haute-Corse.
Cette question fait aujourd'hui l'objet d'une surveillance renforcée, sous l'égide de l'Institut de veille sanitaire, en relation avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Son directeur a indiqué que l'InVS avait engagé une étude en 1996. L'établissement d'une cartographie précise des roches potentiellement amiantifères a été confié au BRGM en 1997, en partenariat avec l'Office de l'environnement de la Corse.
De 2001 à 2004, le laboratoire des particules inhalées a procédé à des mesures qui ont révélé que les valeurs limites de la présence d'amiante avaient largement été dépassées à Bastia, ainsi que dans plusieurs villages. En outre, l'élaboration d'un modèle mathématique a permis d'étudier les incidences de la présence d'amiante sur les différents sites.
Le bilan partiel de l'étude fait apparaître en outre une évolution dans les causes d'exposition de la population : il s'agissait autrefois surtout de la circulation sur des voiries non recouvertes et du jardinage, alors qu'aujourd'hui, l'exposition est souvent liée à l'ouverture de chantiers dans des zones d'affleurements de roche amiantifères proches d'agglomérations, Bastia et Corte par exemple.
(1) Le BTP à Bastia
Les représentants de l'ARDEVA PACA/Corse ont signalé à la délégation, que les chantiers de BTP réalisés sur les terrains amiantifères diffusaient des poussières d'amiante alentour, menaçant tant les salariés des entreprises que les riverains.
Regrettant qu'il ait fallu attendre la réflexion engagée sur le chantier de Canari pour que la question de la contamination des salariés, mais aussi de la population, soit posée, M. Dubois, médecin du travail, a indiqué que les études révélaient des pics de pollution très importants sur les chantiers lors des opérations de creusement et de chargement des déblais.
Il s'est montré d'autant plus inquiet que les chantiers situés sur des terrains amiantifères, autrefois limités, ont tendance à se développer à l'occasion de grandes opérations immobilières, notamment à Bastia. M. Femenia, président de la CCI, a confirmé à cet égard que plusieurs projets importants étaient engagés, notamment la construction d'un centre d'affaires, près de Bastia.
Le docteur Dubois a exprimé la crainte que cette plus grande exposition des populations se traduise par une explosion des pathologies dans 20 ou 30 ans. Il a indiqué que des examens pratiqués par scanner auprès des salariés du BTP font d'ores et déjà découvrir des plaques pleurales, mais pas encore de pathologies plus graves, compte tenu du délai de latence .
Mme Burdy, inspectrice du travail, a alerté la mission sur le fait qu'aucune protection spécifique n'existait pour les ouvriers de ces chantiers.
Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bastia, M. Fagny, s'est interrogé sur la possibilité d'appliquer pour les chantiers à ciel ouvert, le décret du 7 février 1996 112 ( * ) , relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, afin d'amener les employeurs à prendre des mesures de précaution à l'égard de leurs salariés intervenant sur les chantiers. Il a fait état d'une procédure initiée, en 2003, à l'encontre d'un promoteur immobilier, maître d'ouvrage d'un chantier situé près de Bastia : l'inspection du travail avait constaté des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail et un défaut d'information des salariés sur la nature amiantifère du terrain.
Après que l'inspection du travail a dressé plusieurs procès-verbaux demandant l'arrêt du chantier, une enquête préliminaire, débouchant sur une citation directe par le parquet, devant le tribunal correctionnel, a été ouverte. L'avocat du maître d'oeuvre a contesté que le décret de 1996, conçu pour protéger les ouvriers des chantiers de déflocage, soit applicable à ce type de chantier à ciel ouvert. Le ministère du travail a cependant estimé que le décret trouvait bien à s'appliquer dans ce cas de figure, de même que les règles générales prévues pour la protection des salariés exposés à des matières cancérigènes. Lors du déplacement de la mission, le tribunal correctionnel n'avait pas encore rendu sa décision sur cette affaire.
En l'absence de texte spécifique, il apparaît en effet très difficile d'inciter les employeurs à mettre en place des mesures de protection : Mme Burdy, inspectrice du travail, a indiqué qu'elle avait élaboré une méthodologie d'intervention sur les chantiers amiantifères en 1997, rappelant que les entreprises avaient l'obligation d'évaluer les taux d'empoussièrement et de communiquer les informations à l'inspection du travail 113 ( * ) .
Depuis 1999, des campagnes d'information ont été engagées à l'intention des chefs d'entreprise, pour les sensibiliser au risque encouru par leurs salariés exposés aux poussières d'amiante. La cartographie du BRGM a notamment été diffusée. Par ailleurs, une convention a été signée, le 19 mai 2005, avec la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, aux termes de laquelle la CCI s'engage à mettre à la disposition des entreprises des personnels chargés de la prévention des risques liés au travail.
Le procureur de la République, la représentante de l'inspection du travail et le président de la CCI ont souligné la difficulté de stopper les chantiers manifestement trop dangereux.
Au titre de ses pouvoirs de police, le préfet peut en effet contraindre l'entrepreneur, au besoin sous astreinte, à faire cesser le chantier, si un risque mettant en danger la sécurité des ouvriers est avéré. L'interruption du chantier peut également être demandée en référé, si un danger imminent menace la sécurité des personnes.
Ces procédures semblent cependant peu suivies d'effets : selon le président de la CCI, « certaines entreprises préfèrent payer une amende pour pouvoir continuer les chantiers » .
Sur un plan général, il apparaît nécessaire à la mission de compléter la réglementation applicable à l'amiante par un volet environnemental, qui fait gravement défaut en Corse. Cette réglementation devrait notamment traiter la question des déblais amiantés, rebus des chantiers, qui est à l'heure actuelle un des sujets de préoccupation majeure des associations de défense de l'environnement.
(2) Le transfert et l'élimination des déchets des chantiers amiantifères
Comme l'a rapporté le procureur de la République de Bastia, à l'heure actuelle, pour certains chantiers, les déblais amiantifères sont transportés dans des camions non bâchés et déversés quelques kilomètres plus loin, sans aucune précaution.
Mme Burdy, inspectrice du travail, a également alerté la mission sur les conditions dans lesquelles s'opèrent actuellement le traitement, le transfert et l'élimination des déchets amiantés. Dans le même sens, l'association corse de protection de l'environnement, U Levante, dénonce « les poussières blanches envolées des camions » lors du transport des déblais.
D'après les interlocuteurs de la délégation, les mesures de précaution à mettre en oeuvre, devraient être les suivantes : sur les chantiers, en premier lieu, les déblais doivent être recouverts d'asphalte et les sites arrosés, afin d'éviter la dispersion des poussières. En l'absence de texte réglementaire, les entreprises n'effectuent pas ces opérations coûteuses.
Il semble enfin que des déblais sont aujourd'hui déversés dans des décharges sauvages ou vendus pour servir de remblais. Si la réglementation actuelle impose le stockage de l'amiante dans une des douze installations existant en France, autorisées à recevoir les déchets issus du traitement des résidus industriels spéciaux, la Corse, première région amiantifère, en est dépourvue.
Pour l'association U Levante, il serait irréaliste d'envoyer des déchets amiantifères sur le continent. Elle demande par conséquent qu'une installation de stockage soit ouverte à Canari. Le président de la CCI a indiqué aux membres de la mission que des gravières régulièrement inondées près de l'aéroport de Bastia, pourraient servir de lieux de dépôt.
Mme Burdy, inspectrice du travail a relevé qu'un des problèmes résidait dans la tentation, en dépit d'un décret de 1996 qui interdit une telle pratique, de réutiliser les déblais, ceux-ci ayant une véritable valeur marchande ; elle estime que la présence d'amiante sur les chantiers continuera d'être dissimulée tant qu'un dispositif de stockage des déblais n'aura pas été institué afin de prévenir leur réutilisation ou leur dépôt dans des décharges sauvages.
(3) Les préconisations de la mission
Pour la mission, deux points appellent des évolutions réglementaires :
- La sécurité des salariés intervenant sur les chantiers amiantifères
Les réticences des tribunaux à appliquer aux chantiers à ciel ouvert les dispositions du décret du 7 février 1996 visant à protéger les salariés au contact de l'amiante nécessitent que son champ d'application soit mieux défini, en visant explicitement les salariés intervenant sur les chantiers amiantifères.
- Le traitement et le stockage des déblais de chantiers
Si l'article 7 du décret précité vise spécifiquement le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante, il pourrait être complété de manière à prévoir la mise en oeuvre de mesures de précaution, nécessaires pour éviter la diffusion des fibres dans l'atmosphère.
Concernant le stockage des déblais de chantier, l'interdiction de les réutiliser sous forme de remblais ou de les déposer dans des décharges sauvages pourrait être expressément prescrite, afin de fournir une base juridique aux autorités chargées de contrôler le respect des dispositions réglementaires applicables aux déchets.
2. L'amiante en Nouvelle-Calédonie
Lors de son audition, le professeur Marcel Goldberg a indiqué avoir identifié en 1993 en Nouvelle-Calédonie un problème d'exposition environnementale à l'amiante.
« Il existe, au centre de la Nouvelle-Calédonie, une zone montagneuse. Il m'a été donné d'y relever des taux de mésothéliomes spectaculaires. Ils sont 500 fois supérieurs à ce que l'on constate habituellement » a-t-il indiqué.
Selon l'Institut Pasteur, 68 personnes, âgées de 31 à 81 ans sont mortes d'un mésothéliome en Nouvelle-Calédonie entre 1984 et 2002, soit un taux dix fois supérieur à celui de la métropole 114 ( * ) .
L'INSERM a diligenté une étude en 1994, selon laquelle l'origine de ces cancers est attribuée à une roche amiantifère, la trémolite, utilisée par les mélanésiens pour enduire leurs cases. Comme on le sait, la trémolite, dont l'enduit dérivé est appelé « Pö » en langage vernaculaire, est la forme la plus dangereuse d'amiante. Des taux de concentration de fibres d'amiante importants, parfois 400 fois supérieurs aux normes de santé publique, ont pu être observés dans les cases et sur les pistes.
En 2002, un plan d'éradication de la trémolite a été engagé 115 ( * ) , concernant plusieurs tribus mélanésiennes, 700 cases et environ un millier de personnes exposées.
En 2004, une nouvelle étude de l'Institut Pasteur, rédigée par Mme Francine Baumann, responsable du registre des cancers du sein de cet institut a contesté les conclusions de l'étude de l'INSERM.
« C'est à Houaïlou, un village de la côte est de 4 700 habitants, qu'on recense un tiers des victimes du mésothéliome, soit 20 morts entre 1984 et 2002. Un taux proportionnellement 250 fois supérieur à la moyenne mondiale alors qu'il n'y a qu'une soixantaine de cases enduites de Pö », souligne-t-elle.
André Fabre, ingénieur géologue, partage ces doutes et accuse notamment la serpentine 116 ( * ) , roche-mère du nickel, qui appartient à l'une des deux familles d'amiante à l'état naturel. En effet, une mine de nickel à proximité de Houaïlou est encore en activité. Néanmoins, d'après l'étude de l'INSERM, le personnel minier n'est pas, d'une manière générale, particulièrement touché par le mésothéliome.
Par ailleurs, d'autres roches trémolitiques sont présentes dans le nord de la Calédonie et le long de la chaîne centrale de montagnes.
Prenant en compte ces données controversées, le ministère de l'Outre-Mer vient d'affecter 15.000 euros au financement d'une expertise dans cette zone, confiée à des scientifiques de l'Institut Pasteur, de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et du BRGM.
3. Le problème du suivi et du traitement des déchets amiantés
Le président du SYRTA a affirmé à la mission : « Un trafic des déchets de l'amiante existe, c'est une évidence ».
|
Le porte-avions « Clemenceau » : désamiantage et combat juridique En décidant que la dernière phase du désamiantage de l'ancien porte-avions Clemenceau 117 ( * ) aura lieu en Inde, l'État français va en réalité exporter vers ce pays plus de 22 tonnes d'amiante, selon Annie Thiébaud-Mony de Ban Asbestos. C'est ce que dénonce cette association : le 10 mars 2005, le comité France de Ban Abestos et l'Andeva ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'interdire le départ vers l'Inde du porte-avions. Parallèlement, le Comité anti-amiante de Jussieu, également membre de l'Andeva, a déposé une demande dans le même sens devant le tribunal administratif de Paris, « au cas où la procédure devant le TGI échouerait ». Selon les demandeurs, le départ du bateau violerait le décret sur l'interdiction de l'amiante qui proscrit « la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant » , la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets, le Code français de l'environnement qui interdit l'exportation de déchets lorsque le destinataire n'a pas les compétences de les traiter sans porter atteinte à la santé humaine ainsi que la réglementation européenne. Ils estiment, en effet, que les chantiers indiens n'étant pas équipés et les personnes pas formées, le désamiantage ne pourra être réalisé dans de bonnes conditions de sécurité. Selon les avocats de l'État (propriétaire du Clemenceau) et de SDI, l'État a choisi en Inde « le meilleur sous-traitant et le meilleur chantier ». Le ministère de la défense a également indiqué que la France formait des cadres indiens qui dirigeront le chantier de démantèlement du Clemenceau à Alang, dans la province du Gujarat. Enfin, M. Brian Beilvert, le PDG de SDI, assure que cinq techniciens du chantier indien Shee Ram ont acquis une qualification d'opérateur de désamiantage en France. M. Henri Pézerat, membre du réseau Ban Asbestos, a estimé qu'il n'y avait aucun contrôle de l'amiante en Inde et que l'entreprise SDI n'avait pas les moyens de faire respecter la réglementation française sur place. |
Pourtant, une réglementation stricte a été édictée, qui varie en fonction de la nature des déchets. Le décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante fixent les dispositions générales relatives au traitement des déchets amiantés.
Des textes spécifiques viennent ensuite préciser le contenu des dispositions générales. Il s'agit :
- de la circulaire du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment ;
- de la circulaire du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks ;
- du décret modifié du 28 avril 1988 qui impose un étiquetage amiante, et s'applique aussi aux déchets ;
- de l'arrêté du 17 octobre 1977, qui fixe des consignes de sécurité pour le transport de l'amiante.
La réglementation actuelle distingue aussi deux catégories de déchets :
- les déchets de flocage et de calorifugeage, considérés comme des déchets industriels spéciaux et qui doivent être envoyés dans les centres d'enfouissement technique (CET) de classe 1 118 ( * ) ou bien vitrifiés ;
- les déchets d'amiante-ciment pouvant être stockés dans les CET de classe 2 voire 3.
a) Le traitement des déchets d'amiante friable
Concernant l'amiante friable, le président du SYRTA a rappelé que deux traitements étaient possibles :
- un enfouissement technique de classe 1 ;
- la destruction de l'amiante par torches à plasma. M. Bernard Peyrat a indiqué qu'il s'agissait d'un procédé unique en France, développé par EDF et exploité aujourd'hui par la société INERTAM, qui consiste à chauffer l'amiante à 1.500 degrés : « Vous savez que l'amiante est fait pour résister au feu. Il faut donc, pour le détruire par combustion, que les températures soient très élevées. Une fois fondue, l'amiante est transformé en matériaux vitrifiables ».
En application de la circulaire du 19 juillet 1996, précitée, les matériaux à haut risque de libération de fibres d'amiante doivent :
- être transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les installations d'élimination autorisées à les recevoir ;
- être conditionnés de manière totalement étanche 119 ( * ) ;
- être étiquetés « amiante », sur chaque emballage de conditionnement 120 ( * ) ;
- être transportés de manière à limiter l'envol de fibres. L'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux précise les modalités de chargement de l'amiante libre et d'acceptation en décharge de classe 1.
b) Le traitement des déchets d'amiante non friable
Concernant l'élimination des matériaux où l'amiante est fortement lié, la circulaire du 9 janvier 1997 précise :
- qu'ils peuvent être stockés temporairement sur le chantier, dans un site de stockage aménagé et surveillé ;
- qu'ils doivent être conditionnés de manière à permettre un contrôle lors de l'arrivée sur le site et porter l'étiquetage amiante : les plaques, ardoises et produits plans en amiante-ciment doivent être palettisés et filmés ; les tuyaux, gaines et canalisations en amiante-ciment doivent être conditionnés en racks et filmés.
S'agissant du choix de la filière de stockage des déchets d'amiante non friable, la possibilité de les stocker en installation de classe 3 reste un sujet de débat.
Le SYRTA a indiqué qu'une circulaire récente du ministère de l'environnement avait considéré que l'amiante non friable, tout en étant un déchet dangereux, pouvait être considéré comme un déchet inerte, donc susceptible d'être transporté vers des installations de classe 3. Son président a précisé que « cette circulaire aberrante a été retirée », mais que « le résultat est le même » : on continue aujourd'hui à déverser des déchets d'amiante non friable dans des installations de classe 3.
Or, les conséquences sont loin d'être anodines. D'une part, « cela représente des milliers de tonnes », comme l'a rappelé le SYRTA, d'autre part, le dispositif spécifique d'alvéoles (de type F) aménagé dans les installations de classe 2 pour recevoir l'amiante non friable n'existe pas dans les installations de classe 3, dans lesquelles « l'amiante est « benné » et la poussière se disperse un peu partout ».
Pour le SYRTA, il ne faut pas interdire purement et simplement le stockage en classe 3, mais « parvenir à effectuer du retraitement de classe 3 dans des conditions identiques à celles mises en oeuvre pour les systèmes de retraitement de classe 2 ».
D'une manière générale, qu'il s'agisse des déchets d'amiante friable ou non friable, les professionnels entendus par la mission ont indiqué que la réglementation n'était pas toujours respectée et que le risque de dissimulation d'une partie des déchets amiantés ne pouvait être écarté.
(1) La responsabilité du « producteur » sur le devenir des déchets amiantés.
Selon l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets, ..., est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».
Par conséquent, c'est le propriétaire des bâtiments ou le donneur d'ordre des travaux qui est responsable du choix de la filière d'élimination et des conditions dans lesquelles elle s'effectue : conditionnement, stockage intermédiaire, transport.
Le SYRTA, a souligné que ce choix obéissait le plus souvent à des considérations économiques, au détriment des enjeux environnementaux.
En tant que représentant des entreprises de désamiantage, son président a indiqué que « nous nous engageons forfaitairement concernant le déchet amianté en termes de quantité de déchets » estimant que « ce système de forfait c'est une véritable aberration ». Il a en effet expliqué que « faire s'engager une entreprise sur une quantité qu'elle ne peut par définition connaître qu'à l'issue des travaux de désamiantage peut avoir deux types de conséquences : soit l'entreprise a surestimé la quantité de déchets mais préfèrera se taire et fera une très belle opération ; soit, et c'est le cas le plus fréquent hélas, elle a sous-estimé la quantité de déchets. Elle peut par exemple avoir prévu 1.000 tonnes de déchets et elle en recueille finalement 2.000 ».
Le système de tarification forfaitaire semble donc être largement à l'origine de la dissimulation d'une partie des déchets.
(2) L'impossibilité pour l'INERTAM de valoriser les produits vitrifiés de l'amiante
Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ne reconnaît pas les produits vitrifiés comme étant des matériaux inertes, ce qui empêche leur valorisation. Parce que le produit vitrifié n'est pas considéré comme un produit inerte, l'INERTAM, seule entreprise à développer ce procédé en France, « continue de payer la TGAP et n'a toujours pas de filières de valorisation » , a déploré le président du SYRTA.
Cette situation entraîne un important préjudice économique pour l'entreprise. Située dans le département des Landes, alors que 60 % du marché se situe à Paris, elle est également handicapée par le coût du transport des déchets.
Le président du SYRTA a souligné que « pour beaucoup d'entreprises de désamiantage, c'est une solution onéreuse » , en précisant que « le prix de la tonne de déchets est d'environ de 2.000 euros, transport compris » . A titre de comparaison, il a indiqué que le coût du traitement de classe 1 est de l'ordre de 300 euros la tonne, transport compris. Il a ajouté : « nous estimons aujourd'hui qu'il existe un coefficient de 1 à 2 entre ce qui devrait arriver à l'INERTAM et ce qui y arrive réellement ».
La valorisation du vitrifiat permettrait d'améliorer la rentabilité économique du procédé, de le sécuriser et de le développer. Sur le site internet de l'INERTAM, il est aussi indiqué que « non dangereux, le vitrifiat peut être utilisé en sous-couche routière, sans aucun risque pour l'environnement ».
(3) L'absence de traçabilité des déchets d'amiante non friable
Dans la réalité, personne ne sait où sont stockés les déchets d'amiante non friables. M. Bernard Peyrat du SYRTA a indiqué que « des quantités d'amiante de la région parisienne sont transportées à des dizaines de kilomètres » , ajoutant : « aujourd'hui, j'ignore où vont exactement les déchets de l'amiante non friable, mais je sais qu'ils peuvent aller dans des installations de classe 3 » .
Il a estimé qu'il était urgent de mettre en oeuvre un code de traçabilité, indiquant que son principe avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, lui-même ayant travaillé pour le ministère de l'environnement à la rédaction de ce code. Il a indiqué que « le résultat des travaux auxquels il a participé devait faire l'objet d'un arrêté qui n'a jamais été publié » , compte tenu des pressions exercées par les professionnels du secteur.
La mission considère qu'un tel code serait aujourd'hui nécessaire. Il devrait notamment prévoir des certificats attestant du traitement et de l'acheminement des déchets dans un lieu de stockage adéquat. Les propos que M. Gérard Larcher a tenus devant elle sont encourageants, puisqu'il a déclaré que « la traçabilité des déchets devra être mise en oeuvre » .
4. Le risque d'importation en France de produits contenant de l'amiante
La mission considère que le risque de réintroduction de l'amiante en France par le biais des importations des pays émergents ou n'ayant pas interdit ce matériau, est aujourd'hui réel, même si le décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante prohibe, au même titre que la fabrication, « l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » 121 ( * ) .
Comme l'a souligné M. Philippe Huré de l'INRS, si des contrôles de douanes appropriés ne sont pas mis en place pour déceler la présence d'amiante dans les produits en provenance des pays tiers, les États de l'Union européenne continueront à importer des équipements susceptibles de contenir de l'amiante, « qu'il s'agisse notamment de machines à laver, de voitures ou de batteries ».
On rappellera qu'avant le 1 er janvier 2005, des produits contenant de l'amiante ont pu circuler par le biais des échanges intracommunautaires, l'interdiction de l'amiante dans les pays de l'Union européenne par une directive du 26 juillet 1999 122 ( * ) n'étant effective que depuis cette date.
En 2003-2004, quatre des quinze États membres de l'Union européenne continuaient à importer de l'amiante, parmi lesquels l'Allemagne, alors même que ce pays avait prononcé l'interdiction de ce matériau dès janvier 1995.
A l'heure actuelle, le risque majeur résulte des importations en provenance des pays extérieurs à l'Union européenne et en particulier des pays émergents : seuls 40 pays ont à l'heure actuelle interdit l'amiante et la production mondiale est à nouveau en hausse depuis quatre ans.
La mission soulignera, à cet égard, la position particulière du Canada : ce pays, à l'instar de la Russie et du Brésil, produit une variété d'amiante, le chrysotile, dont le caractère cancérigène fait encore l'objet de débats entre les autorités scientifiques.
Comme l'a indiqué M. Patrick Brochard, chef du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle au CHU de Bordeaux, le Canada profite de cette incertitude pour redémarrer fortement sa production (500.000 tonnes extraites chaque année, d'après les informations fournies par M. François Malye). Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Canada ne consomme pas l'amiante qu'il produit, 0,3 % de sa production seulement étant utilisée pour le marché intérieur.
Le professeur Pézerat a précisé que l'amiante canadien était majoritairement exporté vers les pays du tiers-monde. La mission ne peut donc que s'inquiéter de la présence d'amiante dans certains produits de consommation à destination du grand public, que la France importe du Canada 123 ( * ) , comme d'ailleurs de l'attitude de la Chine, exportatrice de produits de consommation vers les pays de l'Union européenne.
A cet égard, un représentant de la CGT a indiqué à la mission qu'au cours de l'Assemblée générale de l'association internationale des sécurités sociales (AISS) qui s'était tenue à Pékin au début de l'année 2005, la Chine avait mis en avant l'utilisation d'un million de tonnes d'amiante par an, rendant difficile la poursuite des discussions à ce sujet.
Au total, le risque d'importation de produits amiantés dépend de la rigueur des contrôles douaniers mis en place à ses frontières.
Les appréciations portées sur ce problème par les différents interlocuteurs de la mission divergent : M. Dominique Moyen a estimé que, depuis la fin de l'année 2002, les importations d'amiante étaient nulles en France alors que le professeur Got a reconnu qu'il était possible de trouver en France « des plaquettes de freins fabriquées dans un pays qui n'interdirait pas encore l'amiante et qui seraient importées frauduleusement ».
Enfin, devant la mission, M. Gérard Larcher a indiqué avoir participé en juin 2005 à une conférence de l'OIT, organisme dont il a rappelé la composition tripartite, au cours de laquelle l'institution a lancé une campagne mondiale de sensibilisation à l'amiante et a demandé à tous les gouvernements d'interdire l'utilisation de ce matériau.
II. LA PRÉVENTION DE NOUVELLES CONTAMINATIONS
« Si l'on veut éviter une nouvelle catastrophe de type amiante, il faudra aller plus vite et ne pas laisser passer à nouveau 15 ans entre l'identification du risque, et l'interdiction du produit . » C'est ce qu'a déclaré M. Jean-Louis Borloo, lors de la présentation du plan santé environnement en juin 2004.
Alors que, comme l'ont montré les dernières enquêtes, l'exposition des salariés aux produits chimiques tend à s'accroître 124 ( * ) et que le nombre de cancers liés à des pollutions environnementales est en augmentation 125 ( * ) , la veille et l'alerte sanitaires sont aujourd'hui indispensables.
Dans la continuité de la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, dont l'ambition était de poser les fondements d'une véritable politique de prévention, il convient aujourd'hui d'identifier et d'éradiquer les facteurs de mortalité évitables.
A. DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION RENFORCÉS
« La France a enregistré entre 20 et 30 ans de retard en matière de prévention par rapport à ce que les entreprises américaines ont initié dans le même temps » a déploré le professeur Marcel Goldberg devant la mission, avant de constater qu'aux Etats-Unis, le nombre de mésothéliomes pleuraux diminue aujourd'hui de manière significative, alors qu'il est en augmentation exponentielle en France.
Le docteur Ellen Imbernon, de l'InVS, a confirmé le désintérêt des pouvoirs publics jusqu'à une date récente pour les actions de prévention, en précisant que « l'alerte, en matière de santé publique [...] concernait exclusivement - et concerne encore quasi exclusivement - la prévention de la transmission des maladies infectieuses ».
Dans le même sens, M. Gilles Brücker, Directeur général de l'InVS, a indiqué que les maladies infectieuses avaient bénéficié des dispositions de la loi de santé publique de 1902, ajoutant que « les autres problèmes étaient peu surveillés ».
Comme l'a souligné le professeur Claude Got, le contexte est aujourd'hui fondamentalement différent : « Depuis, il y a eu le SIDA, l'hormone de croissance, l'amiante, le sang contaminé, les hémophiles », autant de drames qui ont fondamentalement bouleversé les comportements et réduit le niveau général d'acceptation du risque, aboutissant à un principe de précaution dans quasiment tous les domaines.
La création, à la fin des années 90, d'agences de sécurité sanitaire (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - AFSSAPS -, Institut de veille sanitaire - InVS -, Agence française de sécurité sanitaire des aliments - AFSSA -, Agence française de sécurité sanitaire environnementale - AFSSE -) a transformé en profondeur le paysage de la santé publique et les modes d'intervention de la puissance publique en ce domaine.
Par ailleurs, notre législation 126 ( * ) donne désormais une définition de la prévention, entendue comme ayant pour but « d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents, et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie ». Pourtant, le dispositif français de veille sanitaire souffre encore de graves lacunes.
La plupart des interlocuteurs de la mission ont notamment regretté :
• le manque de moyens dont dispose l'InVS, dont le département « santé-travail », seule structure formellement en charge de la veille de la santé en milieu professionnel, repose sur une trentaine de personnes ;
• la faible place accordée à la « santé au travail », parent pauvre du système de prévention mis en place en 1998 et 2001 ;
• l'absence d'une véritable politique de prévention couvrant les risques environnementaux.
1. L'Institut de veille sanitaire
« Avant la création, en 1998, de l'Institut de veille sanitaire (...) par la loi de sécurité sanitaire (...) aucun organisme n'était (formellement) chargé d'alerter les pouvoirs publics sur les risques pesant sur la santé publique », a déclaré le docteur Ellen Imbernon, responsable du département santé-travail de l'InVS, devant la mission.
Le professeur Claude Got et le professeur Marcel Goldberg ont confirmé l'absence de structure institutionnelle ayant vocation à exercer une veille épidémiologique sur la population avant la mise en place de l'InVS en 1998.
Ministre de l'emploi et de la solidarité lors de la création de l'InVS, Mme Martine Aubry a indiqué que M. Bernard Kouchner et elle-même avaient souhaité que les risques professionnels soient traités au même plan que les maladies infectieuses, les effets de l'environnement sur la santé, les maladies chroniques et les traumatismes. Rappelant que le ministère de la santé « anime et coordonne, en liaison avec la direction des relations du travail, la politique de gestion des risques professionnels en milieu de travail », elle a précisé : « Nous avons placé l'InVS auprès de la direction générale de la santé car c'est elle qui est au contact du terrain et, notamment, des caisses d'assurance maladie ».
Le professeur Claude Got a ajouté que la création de l'InVS s'était accompagnée d'une innovation institutionnelle, à savoir la création d'un département « santé et travail », en rupture par rapport à « la séparation [traditionnelle] très nette, en France, à l'échelon des pouvoirs publics et de l'État, (entre) ce qui relevait du monde du travail et ce qui relevait du monde de la santé ».
En vertu de la loi du 1 er juillet 1998 127 ( * ) , modifiée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l'InVS, qui a succédé au réseau national de santé publique, a pour mission :
- la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population ;
- la veille et la vigilance sanitaires. A ce titre, l'institut est chargé d'actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, de détecter de manière prospective les facteurs de risques susceptibles d'altérer la santé de la population, d'étudier et de répertorier les populations les plus fragiles ;
- l'alerte du ministre sans délai en cas de menace pour la santé.
La loi d'août 2004, tirant les leçons des dysfonctionnements relevés à l'occasion de la crise de la canicule de l'été 2003, a ajouté aux missions de l'institut la contribution à la gestion des situations de crise sanitaire, et élargit en conséquence ses sources d'information à tous les acteurs susceptibles de signaler des menaces pour la santé 128 ( * ) .
Les modifications les plus substantielles introduites par la loi d'août 2004 portent sur :
- la définition d'une priorité de santé publique accordée aux populations les plus fragiles. « Il est bien entendu impossible de ne pas voir là les conséquences de la canicule qui ont souligné la vulnérabilité des personnes âgées », ont souligné les rapporteurs du projet de loi au Sénat ;
- la prise en compte des déterminants sociaux ;
- la centralisation, par l'InVS, de toutes les données concernant les accidents du travail ;
- la participation active de l'InVS à la gestion des crises.
Établissement public, l'InVS est organisé en cinq départements, inégalement dotés en effectifs comme en moyens d'intervention 129 ( * ) . Pour mener à bien sa mission de surveillance, l'Institut dispose, outre ses moyens centraux, de cellules interrégionales d'épidémiologie de la santé (CIRES) 130 ( * ) qui ont pour mission l'épidémiologie d'intervention et l'évaluation quantifiée des risques, principalement dans les domaines des maladies transmissibles et des maladies liées à un environnement nocif.
Le plan santé-travail (PST) présenté en février 2004, qui vise un « changement d'échelle dans la connaissance des risques professionnels » renforce notamment le rôle et les missions de l'InVS.
Comme l'a indiqué M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, l'un des volets du plan, dont l'objectif est de systématiser la surveillance épidémiologique des travailleurs exposés sur le lieu de travail, va se traduire :
• au niveau financier, par l'allocation de nouveaux moyens au département santé au travail de l'InVS ;
• au niveau institutionnel, par la formalisation de la collaboration de l'InVS avec le ministère du travail, notamment par la cosignature des saisines, la coprésidence du comité de liaison DGS/BRT/InVS/DST, la prise en compte de l'avis de la DRT sur la partie santé travail du contrat d'objectifs et de moyens de l'institut ;
• au niveau opérationnel, par le développement de partenariats avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), le renforcement des compétences des structures régionales (CIRE) et l'accentuation du rapprochement déjà opéré sous forme de convention-cadre entre le département santé travail de l'InVS et le département épidémiologie en entreprise de l'INRS.
On rappellera, par ailleurs, que la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a permis une avancée importante dans la collecte des données relatives à la santé au travail par l'InVS : ne disposant auparavant que des informations transmises par les services de santé au travail, le département santé au travail de l'InVS aura désormais un accès direct aux informations statistiques en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles détenues par les entreprises.
M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, a souligné l'action du département santé et travail de l'InVS. Mme Catherine Procaccia, membre de la mission, a souligné à cet égard le rôle de l'InVS lors de l'apparition de quatre cas de cancers dans une école de Vincennes. Face à l'inquiétude de la population, qui établissait un lien entre les cancers touchant les enfants et l'ancienne activité industrielle du site, les investigations diligentées et les informations fournies par les services de l'InVS ont contribué à rassurer la population.
Depuis sa mise en place, l'InVS a développé de nouveaux outils et des méthodes qui ont fait progresser la veille sanitaire. Néanmoins, l'institut pâtit toujours d'une insuffisance de moyens financiers et humains.
« La surveillance sanitaire en milieu de travail, menée par l'InVS, n'est pas encore, faute de moyens, à la hauteur des enjeux ». C'est ce que l'on peut lire dans le plan santé travail et ce qu'ont déploré son directeur général, Gilles Brücker, la responsable du département santé travail, Mme Ellen Imbernon, le directeur de l'unité de santé publique et d'épidémiologie au sein de l'institut, le professeur Marcel Goldberg ainsi que le professeur Claude Got.
a) Le développement de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de surveillance sanitaire
Le directeur général de l'InVS, a estimé qu'un certain nombre d'avancées avaient été réalisées depuis l'installation de ses services en 1999. Le premier registre de surveillance d'une pathologie majoritairement liée au travail a été établi : il s'agit du programme national de dépistage du mésothéliome. Initié en 1998 au sein de 17 départements, puis étendu à 22 départements, il constitue la première base de données disponible permettant de mesurer l'incidence de cette maladie en France.
Ce programme de surveillance nationale vise en premier lieu à identifier les sources d'exposition. Après avoir analysé les conséquences des expositions à l'amiante, les données ont été modélisées, pour pouvoir suivre le développement de la pathologie.
Ce registre doit permettre de prolonger la surveillance des populations exposées dans le cadre de leur travail plusieurs années après leur exposition à l'amiante et favoriser le développement du processus d'indemnisation des victimes, à travers le FIVA.
Soulignant qu'il fallait aujourd'hui aller plus loin, et s'intéresser aux nouveaux facteurs de risque que constituent les fibres de substitution à l'amiante, M. Brücker a indiqué qu'un autre programme, dénommé « Evaluatil », était en cours pour mesurer les risques encourus par la population exposée professionnellement à des fibres autres que l'amiante .
Enfin, deux autres actions prioritaires sont en cours de réalisation :
- la finalisation d'un outil MAGENE (Matrice Emploi Exposition) permettant, en reconstituant les itinéraires professionnels des personnes, de mesurer leurs degrés d'exposition aux risques, ainsi que les risques qu'elles encourent ;
- le développement d'un réseau de médecins du travail .
« La situation de la médecine du travail en France, déconnectée de la santé publique et du ministère de la santé, car placée sous la tutelle des ministères du travail et de l'environnement, soulève un certain nombre d'interrogations » a précisé le directeur général de l'InVS.
Nombre d'interlocuteurs de la mission ont déploré pour leur part que les médecins du travail soient isolés et enfermés dans une logique d'aptitude à l'emploi, qui diffère d'une vraie logique de santé.
M. Gérard Larcher a confirmé devant la mission que cet objectif s'inscrivait pleinement dans le cadre des 23 actions du plan santé travail, dont un des objectifs est de mobiliser les acteurs de l'entreprise autour de leur action de prévention.
M. Gilles Brücker a indiqué que le département santé au travail de l'InVS s'était engagé dans la définition d'une organisation cohérente, en partenariat avec les branches et les secteurs d'activités. « Nous tâchons d'organiser ce réseau de manière à bénéficier de signalements ainsi que d'informations remontant les uns et les autres du terrain » a précisé le Dr Ellen Imbernon, responsable de ce département soulignant cependant que la constitution d'un véritable réseau serait un processus long et difficile. D'une part, parce qu'il suppose un véritable bouleversement des mentalités : en raison de leur statut, les médecins du travail travaillent de manière individuelle et indépendante. La réglementation, qui fixe notamment le nombre de visites médicales, et impose de consacrer un tiers de temps à des visites sur les lieux de travail, ne prévoit aucune obligation en ce qui concerne la collecte et le regroupement des données relatives à la santé des salariés. D'autre part, parce qu'il implique la mise en place de procédures d'animation des réseaux et de transmission des informations.
Le professeur Marcel Goldberg a ajouté qu'avec 25 salariés au sein du département santé travail, la tâche s'annonçait difficile. La mission ne peut donc que constater, elle aussi, que les moyens financiers et humains de l'InVS ne sont pas à la hauteur des objectifs poursuivis.
b) Des moyens insuffisants et inadaptés à la mission de veille
Le professeur Claude Got a estimé que le problème de l'InVS aujourd'hui était celui de ses moyens, et plus généralement qu' « on ne finance pas au niveau où il le faudrait les organismes de connaissance par rapport aux organismes opérationnels ».
Mme Martine Aubry est allé dans le même sens, déplorant qu'il n'y ait aujourd'hui « que 270 personnes à l'InVS au lieu de 670 à l'INRS, ce qui est évidemment insuffisant, d'autant plus que très peu s'occupent du travail ».
Le professeur Got a rappelé que, faute d'une évaluation des actions de l'institut, l'insuffisance de son budget n'a jamais été réellement prise en compte par les autorités budgétaires : « Il ne suffit donc pas de créer un organisme : il faut avoir la capacité de vérifier qu'il est bien entré dans une logique qui est la logique de la question posée ... Le texte législatif qui a présidé à sa création était pourtant de très bonne qualité et obligeait à dresser ce bilan ».
Selon lui, un véritable bilan aurait permis de révéler l'incapacité de l'InVS, en l'état de ses moyens, à répondre à ses missions. « Vous ne vous en êtes pas aperçus parce que vous n'avez pas eu les moyens, le temps ou l'inclinaison à ce type de démarches, mais si vous aviez demandé au directeur de l'InVS : Qu'avez-vous fait ? Est-ce bien en accord avec ce qu'a prescrit la loi ? Avez-vous assez de moyens ? », il aurait répondu non. Vous l'auriez entendu ou non et, éventuellement, dans un texte budgétaire, vous auriez dit : « Attention, l'InVS a des besoins » .
L'insuffisance de ses moyens budgétaires a en effet conduit l'InVS à concentrer son action sur certaines priorités, en contradiction avec sa mission de veille systématique.
En sa qualité de membre du comité scientifique, le professeur Claude Got a ajouté : « On n'a pas beaucoup de moyens. On va être les meilleurs sur les domaines qui nous paraissent prioritaires. On a identifié des risques : on va mettre les moyens là-dessus ... c'est l'inverse d'une veille ».
Le directeur général de l'institut a confirmé que, faute de moyens, les services avaient dû restreindre leur champ de compétences, en concentrant la veille sur les risques identifiés comme majeurs. C'est ainsi que le réchauffement climatique n'a pas été considéré comme un risque imminent, expliquant l'absence de l'InVS au moment de la crise de la canicule. Il a toutefois indiqué que, suite notamment à la crise de l'été 2003, l'institut a bénéficié d'un renforcement de ses moyens : au lieu de 150 personnes à temps plein en 2001, il dispose aujourd'hui de 280 personnes permanentes et 80 personnes à contrat à durée déterminée à temps plein.
L'évolution de la dotation de l'InVS depuis 2001 a été la suivante :
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
18,2 |
24,0 |
31,9 |
48,6 |
36,3 |
en millions d'euros
M. Gérard Larcher a indiqué, à cet égard, que les effectifs du département santé au travail allaient être renforcés, notamment dans la perspective de la constitution du réseau de médecins du travail.
Pour Mme Martine Aubry, ce département restera sous dotée eu égard à l'ampleur de ses missions. Elle a estimé devant la mission que « quand on voit que ce rapport sur la santé au travail prévoit (...) dix personnes en 2005 et seulement cinquante à l'horizon 2009, on comprend que c'est à l'évidence bien insuffisant ».
Les interlocuteurs de la mission ont souligné en outre le nombre insuffisant de toxicologues au sein de l'InVS . En effet, alors que les épidémiologistes analysent l'incidence sur les populations des expositions toxiques a posteriori , la toxicologie permet d'étudier la dangerosité des produits chimiques dans une optique préventive. Une veille systématique requiert par conséquent de disposer d'un nombre suffisant de toxicologues.
Le professeur Got, à qui a été confiée en 2003 une mission d'évaluation du fonctionnement des centres anti-poisons et des centres de pharmacovigilance, a témoigné que ces centres étaient «réellement à la dérive », soulignant que « la toxicologie n'a pas bénéficié d'un réel soutien sur le plan universitaire. Les jeunes s'y intéressent peu et les espoirs de carrière et de développement des structures sont faibles depuis une quinzaine d'années ».
L'InVS doit donc développer un système de toxico-vigilance. Le nombre de postes à créer dans ce domaine avait été estimé à 70 il y a deux ans, mais ils ne sont toujours pas pourvus aujourd'hui.
Le directeur général de l'InVS a enfin indiqué que la priorité pour 2005 consistait à « être aussi réactif que possible sur l'ensemble des risques » et, pour cela, mettre en place un schéma directeur des systèmes d'information.
2. Le Plan santé au travail (PST) 2005-2009
Le milieu professionnel a été le parent pauvre des dispositifs de sécurité sanitaire mis en place entre 1998 et 2001 : c'est ce que constate, notamment, l'IGAS dans son rapport annuel de 2003, intitulé : « Pour une politique de prévention durable » , et ce qu'ont confirmé M. Gérard Larcher et Mme Martine Aubry devant la mission.
Si on constate que la fréquence des accidents du travail est en constante diminution depuis 1995 131 ( * ) , en revanche, selon la dernière enquête SUMER 2002-2003, réalisée sur le terrain par 1.800 médecins du travail auprès d'environ 50.000 salariés, l'exposition des salariés aux risques tend à s'accroître depuis 1994, notamment aux produits chimiques.
Le plan santé au travail doit engager pour les cinq années à venir, une nouvelle dynamique afin d'améliorer durablement la prévention des risques professionnels. M. Gérard Larcher a indiqué que « son but est de faire reculer ces risques, sources de drames humains et de handicaps économiques, et d'encourager la diffusion d'une véritable culture de prévention dans les entreprises » .
On rappellera que le plan santé au travail, présenté le 23 février 2005, comprend vingt-trois actions organisées autour des quatre objectifs suivants :
• développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions en milieu professionnel ;
• renforcer l'effectivité du contrôle ;
• réformer les instances de pilotage et décloisonner les approches des administrations ;
• encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail.
Ces objectifs et ces actions sont rappelés dans le tableau suivant :
|
Les objectifs du plan santé au travail |
Les actions du plan santé au travail |
|
Ø Développer les connaissances des dangers, des risques et des expositions en milieu professionnel |
• Introduire la santé au travail dans le dispositif de sécurité sanitaire |
|
• Structurer et développer la recherche publique en santé et sécurité au travail |
|
|
• Organiser l'accès à la connaissance |
|
|
• Développer et coordonner les appels à projet de recherche en santé au travail |
|
|
• Développer la formation des professionnels de santé en matière de santé au travail |
|
|
Ø Renforcer l'effectivité du contrôle |
• Créer des cellules régionales pluridisciplinaires |
|
• Adapter les ressources du contrôle aux dominantes territoriales |
|
|
• Développer la connaissance des territoires et renforcer le système de contrôle |
|
|
• Renforcer la formation des corps de contrôle en santé et sécurité au travail |
|
|
Ø Reformer les instances de pilotage et décloisonner les approches des administrations |
• Structurer la coopération interministérielle sur la prévention des risques professionnels |
|
• Réformer le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels |
|
|
• Créer des instances régionales de concertation |
|
|
• Améliorer et harmoniser la réglementation technique |
|
Ø Encourager les entreprises à être acteur de la santé au travail |
• Moderniser et conforter l'action de prévention des services de santé au travail |
|
• Mobiliser les services de santé au travail pour mieux prévenir les risques psychosociaux |
|
|
• Repenser l'aptitude et le maintien dans l'emploi |
|
|
• Refaire de la tarification des cotisations AT/MP une incitation à la prévention |
|
|
• Encourager le développement de la recherche appliquée en entreprise |
|
|
• Aider les entreprises dans leur démarche d'évaluation a priori des risques |
|
|
• Promouvoir le rôle des CHSCT dans tous les établissements |
|
|
• Développer la prévention des accidents routiers au travail |
|
|
• Promouvoir le principe de substitution des substances chimiques les plus dangereuses (CMR) |
|
|
• Développer dans les écoles et par la formation continue, la sensibilisation des ingénieurs et des techniciens aux questions de santé au travail |
Lors de son audition devant la mission, le ministre délégué a particulièrement insisté sur le développement des connaissances concernant les risques professionnels et la mobilisation de l'ensemble des acteurs de terrain.
a) La création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et du travail (AFSSET)
Le constat commun dressé par les inspections 132 ( * ) est sans appel : le dispositif public d'évaluation scientifique des risques sanitaires ne prend pas en compte le milieu de travail et, plus particulièrement, l'analyse des risques induits par les substances chimiques. Par ailleurs, la surveillance sanitaire en milieu de travail menée par l'InVS n'est pas encore, faute de moyens, à la hauteur des enjeux.
Il en ressort que le dispositif d'expertise publique n'assure pleinement aucune des missions pourtant essentielles dans la prévention et la réduction des risques sanitaires en milieu de travail : l'expertise, la veille scientifique et technologique, la surveillance et l'alerte sanitaires, l'étude et l'évaluation des moyens de prévention en milieu de travail ainsi que leur promotion.
Comme l'a indiqué M. Gérard Larcher devant la mission, « le Gouvernement a décidé, dans le cadre du plan de santé au travail, adopté le 23 février dernier, d'intégrer la santé au travail dans le dispositif de sécurité sanitaire en étendant les missions de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale : elle deviendra à l'automne l'AFSSET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ».
Cette agence, qui sera placée sous la tutelle, notamment des ministères en charge du travail et de la santé :
- assurera une veille scientifique et technique sur les dangers (propriété intrinsèque d'un agent susceptible d'avoir un effet nuisible) et sur les risques (probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition) en milieu professionnel ;
- procèdera à une évaluation des risques pour l'homme en s'appuyant sur une expertise intégrée concernant la connaissance des dangers et des expositions ;
- organisera l'expertise (analyse critique des valeurs toxicologiques de référence, caractérisation des risques associés aux différents niveaux de valeurs limites d'exposition professionnelle - VLEP - en prenant en compte les aspects « effets sur la santé » et « métrologie ») nécessaire à la fixation des valeurs limites d'exposition aux substances dangereuses ;
- répondra à toute demande d'avis des ministères concernés sur les dangers et les risques en milieu professionnel.
Comme l'a indiqué le ministre délégué, l'agence disposera d'une expertise indépendante, compétente dans l'évaluation des risques professionnels : un collège « travail », un conseil d'orientation scientifique, un conseil des partenaires sociaux, une gestion de l'aspect travail directement par le ministère du travail et de l'emploi pour que la préoccupation santé au travail ne soit pas annexe ou collatérale de celle de l'environnement.
S'agissant des moyens de l'agence, le ministre délégué a indiqué que le Gouvernement avait, par anticipation, engagé le recrutement de dix ingénieurs afin de constituer un département spécifiquement dédié à la santé au travail, une demande identique ayant été formulée dans le cadre de la préparation du budget 2006 et que 5,7 millions d'euros seront consacrés dès 2005 au développement de l'expertise de santé au travail .
Lors de son audition, il a précisé l'état d'avancement du programme de travail de la nouvelle agence : « Outre le recrutement de spécialistes, le lancement d'un programme d'expertise prioritaire à l'AFSSE, des conventions d'études notamment sur le champ de la substitution des produits chimiques dangereux avec l'InVS et l'INRS et la contribution à la création de pôles scientifiques régionaux par le ministère de la recherche avec une enveloppe de 800.000 euros ont été décidés , ajoutant que les produits chimiques feront l'objet d'une attention particulière : « L'AFSSE a d'ores et déjà été saisie d'études concernant les fibres minérales artificielles, le formaldéhyde, les éthers de glycol et la nocivité des fibres courtes d'amiante ».
Outre la nouvelle agence, quatre pôles scientifiques pluridisciplinaires devraient permettre de décloisonner la recherche et de faire avancer les connaissances en matière de santé au travail.
b) La mobilisation des acteurs de terrain
(1) Le renforcement de l'inspection du travail
« Il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail », a déclaré Mme Martine Aubry devant la mission. Alors que l'inspection du travail du secteur général regroupe en France 1.366 contrôleurs et inspecteurs du travail en sections chargés de la surveillance de 1,5 million d'établissements employant 15 millions de salariés, elle a indiqué que « pour être seulement à la moyenne européenne, il nous manque 700 postes ». L'écart se creuse si on compare la situation de la France à celle de l'Allemagne ou des pays du Nord.
Outre ses effectifs réduits, l'inspection du travail, à qui incombe la charge de contrôler l'ensemble des domaines du droit du travail, manque également des compétences et des outils pour remplir correctement sa mission.
M. Gérard Larcher a indiqué que « la technicisation de l'inspection du travail, qui doit conserver son caractère généraliste, et sa présence accrue en situation de contrôle sur le terrain, constituent un des objectifs essentiels de ce plan » .
Pour renforcer l'action de l'inspection du travail, le plan santé travail prévoit :
- la mise en place de cellules d'appui territoriales de l'inspection du travail au sein des directions régionales du travail (DRT), essentiellement animées par des ingénieurs de prévention et des médecins-inspecteurs du travail : les contrôleurs et inspecteurs pourront faire appel à ces experts pour un soutien méthodologique, scientifique et technique ou pour un appui en mission dans le cadre de leurs interventions dans le domaine de la santé et sécurité. Huit cellules pilotes 133 ( * ) ont été installées à compter du second semestre 2005. D'ores et déjà, le ministre délégué a indiqué que le budget 2005 prévoyait la création de trente postes de directeurs adjoints du travail, d'ingénieurs de prévention, de médecins-inspecteurs du travail et d'inspecteurs du travail. Le plan prévoit la généralisation progressive de ces cellules d'appui avec l'objectif d'assurer la couverture complète du territoire en 2007 ;
- le renforcement de la formation initiale et continue des contrôleurs et inspecteurs : la formation initiale en santé-sécurité doit être renforcée et des modalités d'accès au concours adaptées mises en place à compter de 2006, afin de diversifier le profil des candidats à cette fonction et promouvoir ce métier dans les filières scientifiques et technologiques.
(2) Les médecins du travail et la prévention
« Tant que le financement des médecins dépendra de l'entreprise et que le choix du médecin, quand il est individuel, relèvera uniquement de l'entreprise, on n'y arrivera pas », a déclaré Mme Martine Aubry devant la mission.
On rappellera qu'avec près de 7.000 médecins du travail agissant dans 350 services interentreprises (qui couvrent 90 % de la population salariée suivie), et dans 750 services d'entreprise, les services de santé au travail constituent le premier réseau de terrain au service de la prévention et de la connaissance des risques professionnels.
En effet, les organismes de sécurité sociale, acteurs centraux de la prévention des risques professionnels depuis 1946, s'appuient sur les informations des prélèvements réalisés auprès des entreprises, qui se nourrissent notamment des déclarations des maladies professionnelles. Le médecin du travail constitue par conséquent le premier « donneur d'alerte » des risques professionnels.
Pour Mme Martine Aubry, « alors qu'aujourd'hui, chacun est encore plus attaché aux problèmes de la santé au travail, nous devons avoir un corps de médecins du travail totalement indépendant qui doit entrer dans l'entreprise en sachant qu'il ne doit rien au chef d'entreprise, ni son choix, ni sa rémunération ».
Le plan santé au travail ne va pas jusque là et confirme simplement le rôle des services de santé au travail, dont les compétences ont été élargies depuis la loi du 17 janvier 2002 avec l'appui de techniciens et d'ingénieurs intervenant aux côtés des praticiens pour mesurer les risques liés à la nature et aux conditions de travail. Il prévoit, de façon expérimentale dans un premier temps et parallèlement à une politique rénovée d'agrément, d'accompagner l'évolution de ces services au moyen de « contrats d'objectifs » conclus avec les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces contrats permettront de promouvoir des programmes de prévention des risques émergents en entreprise ou de contribuer à adapter l'organisation du travail pour viser la réduction de pathologies identifiées tels les troubles musculo-squelettiques ou psychologiques (stress, troubles dépressifs, maladies cardio-vasculaires...).
(3) Les entreprises et la prévention
L'évaluation des risques professionnels constitue une obligation à la charge de l'employeur 134 ( * ) . Le décret du 5 novembre 2001 crée un « document unique » : en vertu de l'article R. 230-1 du code du travail, l'employeur doit créer et conserver un document transcrivant les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé. Mme Martine Aubry a rappelé à cet égard que c'est « le chef d'entreprise, qui est le responsable permanent de la sécurité des travailleurs et qui doit protéger les salariés non seulement en fonction de ce qu'il sait, mais aussi de ce qu'il doit savoir ».
D'après les informations fournies à la mission, cette obligation est en réalité peu respectée.
M. Daniel Bouige, président du Laboratoire hygiène de contrôle des fibres (LHCF Environnement) a indiqué que « l'évaluation objective du risque fait souvent défaut », en prenant l'exemple des poussières de bois qui sont à l'origine de maladies professionnelles, tel que le cancer de l'ethmoïde , « alors que cette maladie est répertoriée au tableau des maladies professionnelles et fait l'objet de réparations » .
Afin de remédier à ces insuffisances, le PST propose :
- d'accompagner les entreprises , et notamment les TPE et les PME, dans leur démarche d'évaluation des risques.
Le document de présentation du PST souligne que « l'évaluation des risques consignés par l'entreprise dans le cadre du « document unique » institué par le décret du 5 novembre 2001 constitue un support indispensable pour assurer une action préventive et de surveillance ».
A cet égard, lors de la table ronde organisée par la mission avec les représentants des organisations patronales, M. Daniel Boguet, membre de l'Union professionnelle artisanale (UPA), a indiqué que son organisation portait un avis positif sur le PST, estimant qu'il tenait compte des contraintes et des difficultés propres aux petites entreprises, notamment artisanales.
- de créer des conseils régionaux de la prévention des risques professionnels.
Associant l'État et les partenaires sociaux avec la participation des organismes et acteurs de la prévention au plan territorial (ARACT, OPPBTP, médecins du travail, ingénieurs...), des « conseils régionaux de la prévention des risques professionnels » seront créés dans chaque région dès 2006. S'appuyant sur les Observatoires régionaux de la santé au travail (ORST), ils auront pour mission de mieux coordonner, au plan territorial, tous les intervenants publics et privés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail en partageant l'information, en dégageant les enjeux communs et en conduisant des actions partenariales. Cette instance de coordination, qui se substitue aux comités régionaux de coopération (État et partenaires sociaux) et aux commissions régionales de médecine du travail, définira, sur la base d'un diagnostic partagé, les priorités, les moyens et les actions à mettre en oeuvre dans le champ de compétence de chaque intervenant qui pourront prendre la forme d'un plan régional d'actions en santé au travail.
Pour Mme Martine Aubry, « le point faible de ce rapport sur la santé au travail, si tant est qu'il ait les moyens pour répondre à ses trois premiers objectifs, qui sont à l'évidence les bons, c'est bien la faiblesse de la partie concernant les entreprises ».
Notamment, elle a estimé qu'il fallait aller vers une individualisation plus grande des cotisations de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin d'inciter les entreprises à renforcer la prévention : « Il faut savoir que les entreprises qui font tous les efforts dépensent beaucoup plus que celles qui n'en font aucun, parce que l'écart de cotisation ne remplit pas cette différence ». Dans le plan santé travail, il a été demandé aux organisations patronales et syndicales de négocier sur ce sujet. « J'espère que cela ira jusqu'au bout » , a-t-elle ajouté.
M. Gérard Larcher a estimé que la réussite du PST était liée à son caractère interministériel et décentralisé ainsi qu'à la coordination des acteurs de l'entreprise. De nombreux interlocuteurs de la mission ont en effet considéré que le cloisonnement des administrations était largement responsable de l'inertie des pouvoirs publics dans l'affaire de l'amiante.
Pour le professeur Marcel Goldberg, « l'une des [raisons] les plus importantes [du retard qui a été accumulé dans la connaissance de la toxicité de l'amiante] est la séparation très nette, en France, à l'échelon des pouvoirs publics et de l'État, dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes, de ce qui relevait du monde du travail et de ce qui relevait du monde de la santé... Comme vous le savez, les risques professionnels étaient historiquement traités au sein du ministère chargé du travail alors que le ministère de la santé était chargé des problèmes de santé ».
Lors de son audition, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, a particulièrement insisté sur l'importance de la mise en place d'une commission interministérielle d'orientation stratégique de la protection contre les risques professionnels , placée auprès du Premier ministre.
Dans le document de présentation du PST, il est indiqué que cette commission « instance de liaison à caractère opérationnel » , se réunira au moins une fois par an, et sera chargée de définir des recommandations stratégiques et des directives d'actions concrètes.
Par ailleurs, elle suivra la mise en oeuvre du plan santé au travail pour les sujets relevant de l'État.
|
Composition : Cette commission associera tous les ministères membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture, ainsi que le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État (fonction publique d'État), le ministère de l'intérieur (fonction publique territoriale), le ministère en charge des hôpitaux (fonction publique hospitalière), le ministère de la recherche et le ministère des finances ; le recours à des experts sera possible. Des comités ad hoc pourront être constitués pour impulser et suivre ponctuellement la mise en oeuvre de recommandations et de directives émises par la commission. Saisine : Annuelle par les services du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du travail. La commission pourra en outre être réunie sur proposition de l'un des ministères y siégeant. Présentation de l'action de la commission : Présentation une fois par an, devant le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que devant la commission centrale d'hygiène et de sécurité de la fonction publique, des orientations stratégiques décidées. |
S'agissant du caractère décentralisé du dispositif, M. Gérard Larcher a mentionné en particulier la constitution de pôles scientifiques régionaux, en partenariat avec le ministère de la recherche, indiquant qu'il avait participé au lancement d'une des premières cellules, dans le Nord de la France. Il a également souligné l'importance des cellules régionales de soutien méthodologique, scientifique et technique de l'inspection du travail, dont l'implantation territoriale devrait être généralisée d'ici à 2009.
Enfin, comme le préconise de l'IGAS, « si l'État stratège doit arrêter les priorités, il doit s'appuyer sur des opérateurs très divers pour les mettre en oeuvre, médecins libéraux, hôpitaux, élus, entreprises, enseignants... ».
C'est sur ces opérateurs que s'appuient les actions du PST, dont un des quatre objectifs vise à encourager les entreprises à être acteurs de la santé au travail, notamment au travers des instances représentatives du personnel.
3. Le Plan national santé environnement (PNSE) de juin 2004
Devant la mission, le directeur général de l'InVS a estimé que « l'élargissement du champ environnemental des risques [était] une réalité depuis quelques années » . Citant notamment le cas des dioxines, « produits essentiellement dispersés dans l'environnement par les incinérateurs d'ordures ménagères » , de la légionellose, de la canicule et de la grippe aviaire, il a estimé que « la prise en compte du champ environnemental dans le cadre des maladies infectieuses a constitué, dans ce cadre, une grande avancée en matière de santé publique, l'anticipation en ce domaine nécessitant une attention quotidienne aux publications ».
A titre d'exemple, le professeur Dominique Belpomme, cancérologue et président fondateur de l'Association pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse (ARTAC) a notamment alerté les membres de la mission sur les effets nuisibles des phtalates, dont le sujet a été abordé lors de la conférence de Budapest 135 ( * ) , le 24 juin 2004.
Il a rappelé que « les phtalates étaient des molécules destinées à assouplir le plastique qui est utilisé pour la fabrication des poches de perfusion... Or, ces substances passent dans les perfusions et sont neurotoxiques. Elles sont donc responsables d'avortements prématurés, de naissances prématurées et de stérilité ».
Il a dénoncé l'inertie des pouvoirs publics français sur ce sujet alors que « la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Etats-Unis et le Japon en ont interdit l'usage » et que « quasiment tous les pays d'Europe ont suivi cette voie » , estimant que « l'utilisation de ces molécules va être à l'origine de multiples procès dans le futur. Elle risque de créer un nouveau scandale de l'ampleur de celui du sang contaminé. »
En présentant le Plan national santé environnement, le 21 juin 2004, le Premier ministre a reconnu que celui-ci résultait principalement du constat de la dégradation de notre environnement et de ses conséquences potentielles sur la santé, dont témoignent les observations suivantes :
- environ 30.000 décès anticipés par an sont liés à la pollution atmosphérique urbaine ;
- un doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires est enregistré depuis 20 ans ;
- seules 37 % des ressources en eau potable disposent aujourd'hui de périmètres de protection ;
- 14 % des couples consultent pour des difficultés à concevoir qui pourraient être liées en partie à des expositions à des substances toxiques pour la reproduction ;
- 7 à 20 % des cancers seraient imputables à des facteurs environnementaux ;
- près d'un million de travailleurs seraient exposés à des substances cancérogènes ;
- l'évaluation des risques liés aux substances chimiques est insuffisante, les capacités d'expertise française sont trop peu développées ;
- la recherche, l'expertise, la formation et l'information en matière de santé environnement sont très insuffisantes.
Devant la mission, le professeur Dominique Belpomme a complété ce constat alarmant :
« - la plupart des maladies actuelles sont liées à des problèmes environnementaux, comme la pollution chimique par exemple ;
« - l'enfant est en danger : le nombre d'enfants souffrant de cancers augmente chaque année de 1 % depuis 20 ans. De plus, un enfant sur sept est désormais asthmatique ;
« - la pollution de l'environnement risque de faire courir un risque à terme à l'espèce humaine : depuis 20 ans, les cas de cancer du sein chez la femme ont été multipliés par deux et les cas de cancer de prostate chez l'homme par trois ».
a) Les trois objectifs du PNSE
Le PNSE vise ainsi à répondre à trois objectifs majeurs :
• garantir un air et une eau de bonne qualité ;
• prévenir les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers ;
• mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants, femmes enceintes et personnes âgées).
|
Les objectifs et les indicateurs du PNSE Pathologies : |
|
Ø Réduire de 50 % l'incidence de la légionellose à l'horizon 2008 ; |
|
Ø Réduire de 30 % la mortalité par intoxication. Expositions : |
|
Ø Respecter les valeurs limites européennes de qualité de l'air, en 2008, dans toutes les villes ; |
|
Ø Réduire d'un facteur 5 le nombre total d'heures où la concentration en ozone dans l'air dépasse la valeur de seuil d'information (180ug/m3) ; |
|
Ø Diminuer par deux d'ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées en permanence pour les paramètres microbiologiques ou les pesticides. Emissions et protection des ressources : |
|
Ø Réduire les rejets atmosphériques toutes sources anthropique : - 40 % pour les composés organiques volatils et les oxydes d'azote entre 2000 et 2010 ; |
|
Ø Diminuer à l'horizon 2010 les émissions industrielles dans l'air de 85 % pour les dioxines, 50 % pour le cadmium, 65 % pour le plomb, 40 % pour le chlorure de vinyle monomère et de 35 % pour le benzène (années de référence 2000 ou 2002 selon les cas) ; |
|
Ø Assurer la protection de 80 % des captages d'eau potable en 2008 et 100 % en 2010 ; |
|
Ø Réduire de 30 % dans l'air les émissions de particules des véhicules diesel ; |
|
Ø Afficher les caractéristiques sanitaires et environnementales de 50 % des produits et matériaux de construction à horizon 2010. Indicateurs à construire |
|
Ø Exposition aux bruits (population générale/milieu professionnel) ; |
|
Ø Nombre de substances chimiques évaluées (en France et dans l'Union européenne) au regard des risques chroniques (toxicologie et ecotoxicologie) ; |
|
Ø Exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. |
b) Un premier bilan en 2005
En juillet 2005, un premier bilan de la mise en oeuvre du PNSE a été dressé.
S'agissant des expositions professionnelles , le travail réglementaire de fixation de valeurs limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour certains agents cancérogènes et toxiques pour la reproduction a été lancé, suite à l'actualisation des données scientifiques et dans le cadre de la transposition des directives européennes.
Dès 2005, dix nouvelles substances, dont la diméthylacétamide, toxique pour la reproduction, doivent être soumises à des valeurs limites d'exposition professionnelle. Il est précisé dans le document de travail que « les travaux d'expertise visant à abaisser les VLEP pour les fibres céramiques réfractaires seront terminés en 2005 » .
Par ailleurs, une circulaire sur les nouvelles règles de protection contre les risques chimiques est en préparation, et un guide méthodologique relatif à ces risques a été diffusé après des services déconcentrés. Deux guides de bonnes pratiques à destination des entreprises sont en cours de rédaction sur les poussières de bois et des actions de communication sur les guides relatifs au benzène et au plomb ont été entreprises.
Concernant l'évaluation et le contrôle des substances chimiques, deux études d'évaluation des risques sanitaires concernant les composés organiques volatils et le formaldéhyde ont été initiées au début de l'année 2005. Elles visent à mieux appréhender le danger et l'exposition des populations dans leur environnement courant et professionnel. Des résultats sont attendus fin 2005. Enfin, des campagnes ciblées de contrôle du respect de la réglementation pour les produits contenant certaines substances chimiques présents sur le marché sont en préparation.
Pour les produits phytosanitaires , il a été décidé en mai 2005, dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole, d'étendre les missions de l'AFSSA à l'évaluation des risques et bénéfices des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de la culture. Au sein de l'AFSSA, l'ANIV (Agence nationale des intrants des végétaux) sera chargée de cette tâche. Les moyens afférents seront renforcés par l'augmentation des taxes d'homologation payées par les producteurs. Le décret de création de l'ANIV sera publié au premier semestre 2006. En 2005, le ministère de l'agriculture a engagé une étude concernant l'exposition d'utilisateurs de produits phytosanitaires dans les serres et tunnels de production. Par ailleurs, en mars 2005, l'AFSSA et l'AFSSE ont rendu un avis sur l'évaluation des risques pour la santé humaine liés à une exposition au fipronil.
Dans le secteur agricole , le suivi sanitaire de 400.000 agriculteurs ou salariés exposés aux pesticides (viticulture, grandes cultures, arboriculture, fourrages et élevage) débutera dans onze départements en 2005 (surveillance épidémiologique des cancers : étude AGRICAN). De plus, le ministère de l'agriculture a chargé le CTBA de mener une action spécifique dans 36 scieries (campagne de mesure de l'empoussièrement). Enfin, une note de service précise les modalités de contrôle, par les services d'inspection du travail en agriculture, de la VLEP aux poussières de bois dans les entreprises agricoles.
Concernant la toxicologie , des travaux ont été engagés avec les agences de sécurité sanitaires (l'InVS en particulier) et les centres antipoison afin de renforcer et d'organiser le réseau de toxicovigilance. Un colloque sur les outils de la toxicovigilance a dressé en septembre 2004 un état des lieux des systèmes d'information et d'alerte existants et mis en présence l'ensemble des acteurs concernés. En 2004, le ministère de la santé a par ailleurs élaboré l'outil d'alerte « ToxAlert » mis en service début 2005, permettant notamment de réaliser des enquêtes de toxicovigilance.
B. S'ASSURER DE L'INNOCUITÉ DES PRODUITS DE SUBSTITUTION
Dans son rapport 136 ( * ) remis en 1998 aux ministres du travail et de la santé, le professeur Claude Got insistait sur la nécessité de définir « une politique de santé publique face au développement des (...) fibres de substitution à l'amiante...Les risques pour la santé induits par les fibres d'amiante ont provoqué progressivement leur remplacement par d'autres produits qui ont fréquemment une structure fibrillaire. Cette évolution a été accentuée par l'interdiction de tout usage de l'amiante depuis le 1 er janvier 1997. Ces fibres sont probablement capables d'induire des risques pour la santé ».
Selon lui, l'action des pouvoirs publics devait tendre à « ne pas prendre, avec les multiples substances fibrillaires qui sont produites industriellement, les risques que nous n'avons pas su maîtriser dans l'emploi de l'amiante »
Suite à la directive européenne n° 97/69 du 5 décembre 1997 qui a introduit les laines minérales, les fibres céramiques réfractaires (FCR) et les fibres à usage spécial dans la liste des substances dangereuses, un arrêté ministériel daté du 28 août 1998 a prévu la classification des FCR et des fibres à usage spécial en substance cancérogène de catégorie 2 et impose à l'employeur de mettre en place un certain nombre de précautions pour les salariés en contact avec ces matériaux : étiquetage T (toxique) ; obligation de rechercher des méthodes de remplacement quand cela est possible ; contrôle du niveau de l'empoussièrement et mise à disposition d'équipements de protection individuels.
Cependant, en dépit de la reconnaissance du caractère toxique de certains produits de substitution, aucune stratégie globale n'a été élaborée et aucune interdiction spécifique n'a été envisagée.
Pour M. Daniel Bouige (LHCF environnement), « il est impensable d'attendre 30 ans pour bénéficier d'un recul épidémiologique suffisant avant de mettre en question l'utilisation de ces fibres ».
1. Les diverses fibres de substitution
L'obligation de remplacer l'amiante par d'autres matériaux, basée sur le principe d'une directive européenne de 1992, de la recherche à chaque fois que cela est possible, pour les substances cancérogènes utilisées en milieu professionnel, de solutions de remplacement qui présentent les mêmes garanties techniques et un risque moindre pour la santé, est devenue effective à compter du 1 er janvier 1997, suite à l'interdiction totale de l'usage de ce produit en France.
Les premières tentatives pour remplacer l'amiante par d'autres produits moins dangereux sont pourtant très antérieures : comme l'a rappelé M. Philippe Huré de l'INRS, « dès 1957, l'INRS conseillait d'envisager une substitution de l'amiante dans une de ses notes (...) destinées aux entreprises » . Quant à la substitution effective, « elle a été initiée au cours de la seconde partie des années 1970 pour remplacer l'amiante dont la production commençait de chuter».
Le professeur Claude Got a, pour sa part, rappelé que certains industriels, conscients de la dangerosité du produit, avaient tenté de trouver des solutions de remplacement à l'amiante, citant l'exemple des frères Blandin, qui ont réalisé une partie du flocage du RER parisien avec des fibres de verre, matériaux plus coûteux que l'amiante.
Il semble pourtant qu'en France, contrairement à d'autres pays, la logique économique ait pris le pas sur la logique de santé publique : alors que « certains pays commençaient à mettre de la cellulose, des fibres synthétiques pour armer le ciment et remplacer les revêtements qui ont revêtu tous les hangars dans le monde agricole français, tous les poulaillers et tous les tubes collecteurs d'eaux usées », l'entreprise des frères Blandin était rachetée dans les années 1980 par des industriels de l'amiante.
Le professeur Marcel Goldberg a rappelé par ailleurs que « 80 % des importations d'amiante en France visaient des applications qui ne nécessitent en aucune manière de l'amiante », ajoutant que « la substitution de l'amiante ne pose aucune difficulté sur le plan technique ». Il a précisé que « depuis longtemps, nous savons de quelle manière il est possible de garantir la solidité du ciment grâce à une substitution du ciment par la cellulose », notant que « celle-ci n'apporte, à l'évidence, aucun risque» , même si ce procédé est beaucoup plus coûteux particulièrement avec les crises pétrolières. Les produits de substitution étant fabriqués en utilisant de l'énergie, leur coût varie en effet avec celui du pétrole.
La mission ne peut que constater que le poids des intérêts économiques explique en partie le retard pris par la France dans les années 1980 pour remplacer l'amiante par des substances moins dangereuses.
Le professeur Claude Got a ainsi regretté que « le comité permanent amiante n'ait, dans aucun de ses comptes rendus, posé la seule vraie question qui vaille, à savoir : « Peut-on se débarrasser de l'amiante ? Est-ce que les produits de substitution sont disponibles ? Quel est leur coût ? Quelle est leur sécurité ? »
Cependant, comme l'ont rappelé les interlocuteurs de la mission, il n'existe pas de matériau naturel ou artificiel unique présentant toutes les qualités de l'amiante.
On peut classer en deux principales catégories les matériaux de substitution à l'amiante, selon leur structure fibreuse ou non. S'agissant des matériaux fibreux, il faut distinguer les fibres naturelles (cellulose, coton...) et les fibres artificielles (métalliques, minérales et organiques ).
En fonction des techniques mises en oeuvre et de l'utilisation finale des matières fabriquées, les produits de substitutions varient. Le tableau ci-après retrace les principales utilisations de l'amiante et les matériaux de substitution correspondants.
Familles d'utilisation des matériaux amiantés et techniques de substitution
|
CLASSIFICATION DE L'AMIANTE |
FAMILLES D'UTILISATION |
TECHNIQUES/MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION |
|
1) Amiante brut en vrac |
Bourres, flocages, isolants, protections thermiques et acoustiques |
laines minérales (verre, roche, laitier) et fibres céramiques enduits, coquilles en plâtre chargé de vermiculite, mica... panneaux, coquilles de silicates divers cellulose |
|
2) Amiante dans des poudres, des produits minéraux (sauf amiante-ciment) |
Enduits, enduits de façade, enduits-plâtres de protection incendie, mortiers colle, mortiers de protection incendie, mortiers réfractaires, poudres à mouler |
Divers produits minéraux non fibreux : carbonates, silicates, perlite, vermiculite, mica... |
|
3) Amiante dans des liquides ou des pâtes |
Colles, enduits, mastics, mousses, pâte à joint, peintures |
charges silico-calcaires, argiles cellulose mica |
|
4) Amiante en feuilles ou en plaques |
cloisons, faux-plafonds, feuilles, feutres, filtres, papiers |
FMA (panneaux, matelas) Mousses d'argiles et de silicates, vermiculite agglomérée |
|
cartons, coquilles, panneaux, plaques |
Matériaux cités ci-dessus et FCR |
|
|
5) Amiante tissé ou tressé |
Bandes, bourrelets, cordons, couvertures, matelas, presse-étoupes, rideaux, rubans, tissus, tresses, vêtements anti-feu |
PE, PP, PA, PTFE (pour les basses températures)
fibres de carbone, d'aramides et d'acier
fibres de roche FCR |
|
6) Amiante dans une résine ou une matière plastique |
embrayages, freins, isolateurs électriques, joints |
FMA, aramides, fibres de carbone, PTFE, acier, cuivre, matériaux non fibreux |
|
matières plastiques |
idem II ou III |
|
|
revêtements muraux, revêtements de sols en dalles ou en rouleaux |
technologies alternatives |
|
|
7) Amiante-ciment |
Bacs, bardages, canalisations, cloisons, éléments de toiture, gaines, plaques, plaques de toiture, tablettes, tuyaux, vêtures |
fibres de cellulose, PP, polyvinylalcool aramides fibres de verre rarement parfois coton, sisal, jute dans certains pays |
|
8) Amiante dans des produits noirs |
Bardeaux bitumeux, bitumes, colles bitumeuses, enduits de protection anticorrosion, enduits de protection d'étanchéité, étanchéités de toiture, mastics, revêtements routiers |
charges silico-calcaires fibres et laines de verre et roche sauf dans les revêtements routiers |
FMA : fibres minérales artificielles ; PE : fibres de polyéthylène ; PP : fibres de polypropylène ; PA : fibres de polyamide ; PTFE : fibres de polytétrafluoroéthylène ; FCR : fibres céramiques réfractaires.
Comme l'a indiqué M. Philippe Huré, de l'INRS, l'amiante-ciment, soit plus de 90 % du marché de l'amiante dans les années 90, est aujourd'hui remplacé par un mélange de ciment et de fibres de cellulose, de polypropylène, d'alcool polyvinylique ou d'aramides.
Les produits de substitution sont utilisés en fonction des niveaux de températures atteintes dans les divers procédés industriels :
- jusqu'à 400° C : les fibres de verre dont certaines dites fibres de « verre aux oxydes » résistent jusqu'à 1.200°C ;
- jusqu'à 600° C : les fibres de roches
- au dessus de 1.200°C : les fibres céramiques réfractaires ;
- à 2.500°C : les fibres de carbone.
Les interlocuteurs de la mission ont indiqué que les fibres de verre étaient aujourd'hui les plus utilisées comme substitut à l'amiante. Néanmoins, M. Claude Imauven, a indiqué que Saint-Gobain utilisait du polypropylène, pour fabriquer des produits de toiture bas de gamme vendus sur le marché brésilien.
2. Le caractère nocif des produits de substitution
a) La toxicité des produits fibreux
Il est aujourd'hui avéré que les produits fibreux ont des effets nocifs pour la santé humaine. Comme le rappelait M. Claude Imauven, de Saint-Gobain, la toxicité des matériaux de substitution est en effet plus liée à leur caractéristique physique que chimique. Dans la note de l'INRS relative à la substitution, il est indiqué que « pour une substance de composition chimique identique, la structure fibreuse présente un potentiel toxique plus élevé que la structure granulaire » et que plus une particule est petite, plus elle peut pénétrer profondément dans l'appareil respiratoire. Des études expérimentales ont montré par ailleurs que plus les fibres sont longues et fines, plus l'organisme à des difficultés à les éliminer et plus elles sont dangereuses.
Si les effets sur la santé de tous les matériaux fibreux sont loin d'être totalement évalués, les fibres minérales artificielles ont fait l'objet de nombreuses études ces dernières années.
Dès 1995, à la demande de la direction générale de la santé et de la direction des relations du travail, un groupe d'experts, constitués notamment de biologistes, de toxicologues, d'épidémiologistes, a été réuni par l'INSERM pour examiner les effets sur la santé des fibres minérales artificielles (laine de verre, de roche et de laitier, filaments continus de verre, microfibres de verres et fibres céramiques) et des fibres organiques naturelles.
Estimant que les conclusions de ces experts, publiées en 1998, présentaient trop d'incertitudes, l'ALERT (Association pour l'étude des risques de travail) a confié à M. Henri Pézerat, toxicologue, la mission de rédiger un document de synthèse sur la toxicité des fibres de substitution à l'amiante et sur les mesures de prévention à engager.
Pour sa part, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a ensuite publié une évaluation en 2002.
Si l'ensemble des experts insistent sur l'absence de certitudes, en raison du manque de recul des observations (comme pour l'amiante, le temps de latence des pathologies est long), ils tirent les conclusions suivantes sur la base de données épidémiologiques :
- sur le plan dermatologique , au moins un ouvrier sur deux exposés à des fibres minérales artificielles présente une dermite irritative, au moins au début de son emploi ;
- s'agissant des pathologies respiratoires chroniques, bien que l'étude de l'INSERM soit extrêmement prudente, certains experts estiment que les fibres minérales artificielles peuvent être à l'origine d'irritations des voies respiratoires supérieures. Ces lésions ont été décrites surtout avec les laines de verre. Lors de son audition, Mme Françoise Mollin, de la SOCOTEC, a précisé que les fibres de verre et les fibres de roches pouvaient avoir des effets irritants ou des influences négatives sur l'asthme ;
- s'agissant du risque de cancer :
• chez les salariés de production de laine de verre, de roche et de laitier, les premières études épidémiologiques font apparaître un risque accru de cancer broncho-pulmonaire, mais une analyse plus détaillée n'a pas permis d'établir de lien entre le degré d'exposition aux fibres et les effets observés. Quelques cas de mésothéliomes ont été observés, mais dans la grande majorité des cas, une exposition ancienne à l'amiante a été retrouvée ;
• en ce qui concerne les fibres céramiques réfractaires, le risque de cancer a été démontré chez l'animal par inhalation (cancers pulmonaires et mésothéliomes) et des fibroses pulmonaires ont été observées.
Si le recul est actuellement insuffisant pour évaluer le risque de cancer chez l'homme, les radiographies ont montré des excès de plaques pleurales et des troubles ventilatoires obstructifs chez les fumeurs en relation avec l'exposition à ces fibres, dont la biopersistance élevée dans le poumon a été démontrée.
L'ensemble de ces données a conduit le ministère chargé du travail à fixer des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLE) sous la forme de valeurs moyennes d'exposition sur 8 heures (VME) pour les produits suivants :
|
PRODUIT DE SUBSTITUTION |
VALEURS MOYENNES D'EXPOSITION SUR 8 HEURES (VME) |
ETIQUETAGE/CLASSIFICATION 137 ( * ) |
|
Fibres ou laines de verre, de roche et de laitier |
1 fibre/cm 3 |
|
|
Fibres de verre en filament continu |
1 fibre/cm 3 |
- |
|
Fibres céramiques réfractaires |
0,6 fibre/cm 3 |
Cancérogène catégorie 2, R49 - R38 2 |
|
Fibres d'aramides |
1 fibre/cm 3 |
- |
|
Fibres végétales |
0,5 mg/m 3 (fraction thoracique) 140 ( * ) |
- |
|
Fibres de cellulose et poussières |
10 mg/m
3
(fraction inhalable)
4
|
- |
|
Fibres de chanvre, de coton, de lin |
0,2mg/m 3 (fraction thoracique) 4 |
- |
Pour Mme Martine Aubry, il faut aller plus loin et notamment, « de plus en plus intégrer l'aspect « non-poussières » dans la conception des machines à travers des réglementations ». Elle a en effet indiqué que « pour tous ces nouveaux produits qu'on ne connaît pas, si les machines sont capotées dès la conception et si on met les poussières en dépression pour qu'elles ne sortent pas dans l'air, on n'a plus à se demander si on est en dessous de tel ou tel seuil ».
b) La dangerosité des fibres céramiques réfractaires (FCR) : interdiction ou usage très contrôlé ?
Les fibres céramiques réfractaires ont été répertoriés en CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) par arrêté du 28 août 1998.
Les fibres céramiques réfractaires sont des fibres artificielles vitreuses, à orientation aléatoire, dont la composition chimique correspond à un contenu en oxydes alcalins et alcalino-terreux inférieur ou égal à 18 % 141 ( * ) .
C'est le caractère cancérigène avéré chez l'animal qui a conduit les pouvoirs publics à traiter spécifiquement les fibres céramiques réfractaires.
Comme l'affirme M. Henri Pézerat dans un document de synthèse de 1998, « en expérimentation animale (...), les données sont sans ambiguïté sur plusieurs espèces animales et par diverses voies d'exposition. Les fibres céramiques entraînent, à l'égal de l'amiante, des fibroses pulmonaires, des cancers du poumon et des mésothéliomes... On est donc en droit - dans le cadre d'une expertise et quelles que soient les questions que l'on se pose encore sur telle ou telle étude - d'affirmer sa conviction quasi absolue que les fibres céramiques réfractaires sont des matériaux à la fois cancérogènes et fibrosants chez l'homme, ce qui signifie qu'il y aura apparition de ces pathologies dans les populations les plus exposées en milieu de travail » .
La spécificité des FCR par rapport aux autres fibres tient à leur haute résistance aux chaleurs élevées. Les FCR sont des verres de silice-alumine, et non des silicates d'alcalins et d'alcalino-terreux. L'absence de ces derniers éléments (essentiellement sodium et calcium) confère à ces matériaux leur propriété réfractaire (tenue au delà de 1.000° C) et leur très faible solubilité en milieu aqueux. Certaines fibres céramiques contiennent également des oxydes de zirconium, de chrome et de fer.
En raison de ces caractéristiques, ces fibres ne sont utilisées que pour des applications à très haute température et ne sont incorporées que dans un nombre limité de produits.
Pour M. Daniel Bouige, président du laboratoire LHCF environnement, « les céramiques ont des caractéristiques importantes et intéressantes sur le plan technique, en particulier sur le critère de la température. Elles ne constituent cependant pas la panacée pour un certain nombre d'autres applications où la fibre joue un rôle de renfort plutôt que de protection thermique » .
Mme Michèle Guimon, de l'INRS, a rappelé que « ces fibres ont été utilisées depuis la décennie 1950 et ont longtemps coexisté avec l'amiante » . Elle a toutefois insisté sur le fait qu'elles avaient été exclusivement réservées à des applications à très haute température lorsque l'amiante ne pouvait pas être utilisé : « Les FCR ont été réservées à des utilisations industrielles, je pense à l'isolation des fours, des fonderies et hauts-fourneaux. Les FCR sont également utilisées dans l'industrie automobile pour les pots catalytiques ou les airbags. Elles le sont également dans le domaine aéronautique » . Elle a cependant indiqué qu' « en 1995-1996, période durant laquelle l'amiante a été interdit, des essais de substitution avaient été réalisés, notamment pour les plaquettes de frein » , précisant que « ces utilisations n'ont cependant pas duré longtemps » .
Il a été indiqué à la mission que 20.000 salariés seraient aujourd'hui en contact avec ces fibres dans le cadre de leur activité professionnelle, soit des effectifs sans rapport avec la population exposée à l'amiante. Il reste que « quelque 12.000 tonnes par an seraient consommées en France, soit le quart de ce que l'Europe consomme 142 ( * ) » .
La réglementation aujourd'hui applicable aux FCR reflète les incertitudes de la communauté scientifique sur le caractère cancérigène de ces fibres pour la santé humaine.
Pratiquement interdites dans la fabrication d'appareils destinés aux particuliers 143 ( * ) , les fibres céramiques réfractaires sont autorisées dans les produits à usage industriel, sachant que leur classement en produit cancérogène de catégorie 2 doit conduire les chefs d'entreprise à ne les utiliser qu'en dernier recours, là où il n'existe pas de solution de remplacement (c'est-à-dire au dessus de 1.200° C), et sous réserve du respect des précautions réglementaires notamment la valeur limite d'empoussièrement de 0,6 fibre par cm 3 sur 8 heures.
Cette réglementation apparaît cependant insuffisante à la mission.
M. Daniel Bouige (LHCF environnement) a en effet estimé qu' « il est tout à fait justifié, étant donné la biopersistance, les caractéristiques physiques et la capacité de rétention dans les poumons des céramiques, de mettre en oeuvre une démarche de prudence maximale » .
« J'estime qu'il faut interdire les fibres céramiques » a-t-il ajouté, précisant qu'une démarche d'interdiction doit être accompagnée de mesures plus ou moins restrictives, et prévoir des exceptions correspondants à des impératifs technologiques.
Mme Martine Aubry est allée dans le même sens, estimant que « si on pense qu'il y a un risque malgré les protections, on doit interdire ».
Une politique de précaution devrait se traduire par l'interdiction d'utiliser les FCR à des températures inférieures à 1.250 degrés. On rappellera que la recherche de solution de substitution est aujourd'hui facultative, et non obligatoire. Cette proposition formulée, notamment par Henri Pézerat, et par l'ARDEVA reflète l'opinion de nombreux membres de la communauté scientifique.
S'agissant de la valeur limite d'empoussièrement professionnelle, M. Michel Héry de l'INRS, et M. Henri Pézerat, considèrent qu' « il faut la diviser par six et en faire une contrainte réglementaire » 144 ( * ) , alors qu'elle n'est aujourd'hui qu'indicative.
Ce dernier estime que les CHSCT devraient mettre en oeuvre une politique de prévention concernant les FCR, « avec interpellation des employeurs et de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail, du service de prévention de la CRAM et de l'INRS, avec copie des constats effectués à la direction des relations du travail du ministère » 145 ( * ) .
Le directeur général de l'InVS, a indiqué à la mission qu'un système de surveillance sur les FCR, à partir d'une banque de données, fonctionnait à l'heure actuelle et que les programmes de surveillance et de prévention allaient être renforcés.
M. Gérard Larcher a, pour sa part, précisé que, dans le cadre du plan « santé-travail », un groupe d'experts avait été désigné au sein de la nouvelle agence pour la santé au travail pour approfondir la question du traitement des FCR. Ses conclusions devraient être rendues publiques avant la fin de l'année 2005.
La mission souhaiterait que ce calendrier soit tenu et qu'une réglementation très restrictive des FCR soit rapidement adoptée, qui poserait le principe de l'interdiction des fibres céramiques réfractaires sauf absence avérée de produits de substitution. La mise en place d'une procédure d'autorisation préalable par secteur utilisateur de ces fibres doit être envisagée. Dans les cas où l'autorisation serait accordée à titre dérogatoire, le contrôle de l'utilisation des FCR dans le processus de production devra être renforcé afin de s'assurer que les salariés en contact avec ces fibres bénéficient d'une protection adéquate.
C. UNE NÉCESSAIRE POLITIQUE DE PRÉVENTION À L'ÉGARD DES PRODUITS CHIMIQUES
D'après les informations fournies à la mission, plus de 100.000 molécules chimiques ont été mises sur le marché dans les 50 dernières années, en raison des innovations technologiques qui ont eu lieu dans l'industrie.
Parmi elles, 30.000 substances sont aujourd'hui commercialisées, représentant chacune plus d'une tonne par an ; on estime que leurs propriétés dangereuses sont ignorées pour 65 % d'entre elles.
Le dispositif actuel d'évaluation confié à l'Union européenne, n'a permis depuis 1994 d'engager que 140 études.
Depuis 1991 146 ( * ) , date de l'obligation pour les industriels d'évaluer et de déclarer les nouveaux produits mis sur le marché, 5.000 nouvelles substances ont été autorisées.
Le professeur Marcel Goldberg a rappelé à la mission qu' « il existe plusieurs douzaines de produits cancérigènes qui sont quotidiennement utilisés dans l'industrie » , citant, notamment, « l'arsenic, le nickel, le chrome, le benzène ou les ionisants » , tout en reconnaissant que « lorsque ces produits font l'objet d'une utilisation contrôlée et encadrée, notamment en termes de confinement et de limitation de l'exposition des populations, les risques qu'ils présentent diminuent » .
« Parce qu'il y a aujourd'hui des milliers de produits toxiques et des dizaines de produits cancérigènes dans les entreprises comme dans notre cuisine ou notre salle de bain », a rappelé Mme Martine Aubry, « tout le problème est de savoir si, à tout moment, nous faisons bien en sorte que l'usage tel qu'il en est réalisé met totalement à l'abri les consommateurs, les utilisateurs et les salariés des risques qu'ils peuvent entraîner ».
1. Les éthers de glycol
Parmi ces substances, les éthers de glycol apparaissent particulièrement dangereux.
Constituant une famille de plus de 80 produits dérivés 147 ( * ) , dont trente sont utilisés en milieu industriel, notamment pour la fabrication des peintures, les éthers de glycol sont d'excellents solvants.
Principalement utilisés pour la peinture aéronautique, la sérigraphie, la fabrication de circuits imprimés, le vernissage métallique et la fabrication de peinture, les éthers de glycol sont d'autant plus dangereux que les signes précurseurs d'intoxication susceptibles d'alerter l'utilisateur sont nuls ou n'apparaissent qu'en présence de fortes concentrations.
M. Philippe Huré, de l'INRS, a indiqué lors de son audition que « les éthers de glycol figurent parmi les produits solvants qui ont été les plus étudiés » . Ayant notamment fait l'objet d'une expertise collective de l'INSERM en 1999 et d'une évaluation au niveau européen, treize dérivés de l'éthylène glycol et neuf dérivés du propylène glycol ont fait l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés.
Lors de son audition, M. Gérard Larcher a indiqué que la nouvelle Agence chargée de la santé au travail (AFSEE) avait d'ores et déjà été saisie d'une étude concernant ces solvants.
2. La réglementation actuelle applicable aux produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)
Aujourd'hui, la réglementation générale qui s'applique à ces substances découle de la directive 67/548 des communautés européennes 148 ( * ) concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Par arrêté du 7 août 1997, modifié par celui du 13 octobre 1998, relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses, le ministre de la santé a interdit la mise sur le marché et l'importation à destination du public des produits « cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction » des catégories 1 et 2, dont font partie quatre des éthers de glycol déjà classés.
Cet arrêté ne s'applique pas à l'usage professionnel pour lequel la réglementation française prévoit l'évaluation à priori des risques à la charge de l'employeur et pour chaque poste de travail.
Le décret n° 2001-97 du 1 er février 2001 modifiant le code du travail, a étendu aux substances chimiques présentant des dangers de toxicité pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, les mêmes contraintes que celles appliquées depuis le 1 er janvier 1993 aux substances cancérogènes.
En vertu de l'article R. 231-56-12 du code du travail, l'employeur doit réduire l'utilisation de ces substances sur le lieu de travail notamment en limitant l'exposition respiratoire ou cutanée et en remplaçant, à chaque fois que cela est possible, un produit toxique par une substance, une préparation ou un procédé moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Les obligations de l'employeur, s'agissant de ces produits, sont retracées dans le tableau suivant :
|
Obligations prioritaires de l'employeur dans les
activités susceptibles
Evaluation des risques : nature, niveau et durée de l'exposition à l'agent cancérogène ou mutagène, afin de définir les mesures de prévention et des procédures et méthodes de travail appropriées ; Substitution obligatoire de la substance dangereuse pour un autre produit lorsque c'est techniquement possible ; Travail en système clos lorsque c'est techniquement possible et qu'une substitution n'a pu être mise en place ; Captage des polluants à la source lorsque la substitution et le travail en système clos ne sont pas applicables ; Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; Mise en place de mesures de détection précoces, d'hygiène et de dispositifs en cas d'urgence (en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos) ; Délimitation et balisage des zones à risques, étiquetage des récipients ; Formation et information des travailleurs ; Suivi médical : surveillance médicale régulière pendant toute la durée de l'activité professionnelle, constitution d'un dossier médical pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène ou mutagène, établissement d'une fiche d'aptitude par le médecin du travail (renouvelable au moins une fois par an), attestation de non contre-indication. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ni être maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction (catégories 1 et 2). |
Cette réglementation permet aujourd'hui aux industriels d'utiliser « plus de 250 matières figurant au classement des catégories 1 et 2 des produits CMR » , selon les informations fournies par M. Philippe Huré à la mission.
M. Claude Imauven, directeur général adjoint de la compagnie Saint-Gobain, a rappelé que « toute l'industrie, dans ses process, utilise des matières dont la plupart sont classées dangereuses à un titre ou à un autre - inflammabilité, caractère irritant, cancérogène » , ajoutant que « tout ceci est parfaitement réglementé » , soulignant néanmoins qu'il convenait de distinguer le « process » du produit final : « Ce n'est pas parce que, dans le process, on utilise un certain nombre de produits qu'on va les retrouver dans le produit final. Il faut bien faire la part des choses entre le caractère nuisible pour le consommateur et l'utilisateur et ce qui est nuisible dans le process ».
Selon l'enquête Sumer 149 ( * ) , 2.370.000 personnes, soit 13,5 % des salariés du champ étudié, seraient exposées à un ou plusieurs produits cancérogènes.
Le professeur Marcel Goldberg a estimé que si l'évaluation des risques et les mesures de précaution étaient correctement mises en oeuvre par les entreprises, les risques encourus par les salariés seraient diminués. Pour M. Claude Imauven, de Saint-Gobain, « il s'agit, à chaque étape de la chaîne de fabrication, de prendre toutes les mesures pour être certain qu'il n'y aura pas de danger » .
En fait ces mesures de précaution sont mal respectées . Comme l'a rappelé M. Henri Pézerat, « une loi oblige les employeurs qui font utiliser par leurs salariés des produits susceptibles de causer des maladies professionnelles à déclarer leur détention à la sécurité sociale. Un de vos confrères observait récemment que 10 % des employeurs la respectaient effectivement ».
M. Henri Pézerat a ainsi rapporté le cas d'une entreprise où le nombre de cancers du rein est en nette augmentation : « Cette entreprise appartenait précédemment à Rhône Poulenc. Elle fabrique, notamment sous forme de vitamines A et E, des compléments alimentaires pour les animaux. Le mode de production dédié à l'atelier de vitamine A a été modifié en 1982. Pour court-circuiter certains processus, la direction de l'usine introduit une nouvelle molécule. Plus de vingt ans après cette décision, le nombre des cas de cancers du rein s'élève approximativement à une vingtaine » .
Alerté par le CHSCT de l'usine, M. Pézerat a demandé en vain à la direction de l'entreprise de remplacer la molécule incriminée par une molécule moins nocive, conformément à la réglementation en vigueur : « Personne ne m'a appuyé, qu'il s'agisse du médecin, de l'inspecteur du travail ou de la direction de l'entreprise » , cette dernière ayant justifié sa décision « en évoquant le coût trop élevé d'une telle mesure » .
Alors que l'entreprise a été rachetée par des fonds de pension américains, qui « estiment prioritaire le rendement immédiat » , les salariés restent aujourd'hui exposés. « J'ai alerté mes collègues du Centre international de recherche sur le cancer de Lyon. L'Institut de veille sanitaire a également été alerté », a précisé M. Pézerat .
3. Un projet de réglementation européenne bloqué par le lobby des industries chimiques
La mission constate que le poids des intérêts industriels freine l'évolution de la réglementation concernant les produits chimiques. C'est le cas en particulier pour la proposition de règlement européen REACH qui semble bloquée à Bruxelles par le lobby des industries chimiques.
Lors de la table ronde organisée avec les représentants des organisations syndicales, M. Serge Dufour de la CGT a dénoncé la position des autorités françaises face à cette proposition : « Comment voulez-vous que, dans cette société, nous, travailleurs, avec l'insolence et l'impertinence dont nous sommes coutumiers, nous acceptions que le Président de la République joigne sa signature à celles du Premier ministre britannique et du Chancelier allemand pour écrire à la Commission de Bruxelles que la directive REACH pose des problèmes de paperasse pour nos entreprises de la chimie, que cela va les handicaper dans leur compétitivité économique et qu'il faudrait avoir le moins possible de réglementation contraignante par rapport à cela ? », estimant qu'il s'agissait pour ce texte « ni plus ni moins de la mise en oeuvre du principe de précaution » .
Devant la mission, Mme Martine Aubry a rappelé que le ministère de l'industrie représentait la France à Bruxelles s'agissant des autorisations de mise sur le marché, notant qu'« il s'agit d'un ministère qui est plus en contact direct avec les entreprises et qui peut être davantage soumis à des pressions, y compris lorsqu'on dit que cela risque d'entraîner la perte de centaines de milliers d'emplois ».
a) La proposition de règlement REACH
La mission rappellera que l'objectif de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2003, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) est d'instaurer un nouveau système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques afin de mieux protéger la santé humaine et l'environnement.
30.000 produits fabriqués ou importés dans l'UE, représentant chacun plus d'une tonne par an, seraient testés et répertoriés dans une base de données centrale, alors qu'on ne connaît pas actuellement leurs effets. Les substances les plus dangereuses (environ 1.500) seraient soumises à une procédure spéciale d'autorisation.
Cette réforme, proposée par Bruxelles, devrait être examinée à la mi-novembre en première lecture par le Parlement européen.
Une des novations essentielles par rapport au droit existant réside dans le renversement de la charge de la preuve de la sécurité des produits chimiques commercialisés, qui passe des autorités publiques à l'industrie.
|
Les principales mesures de la proposition de règlement concernent : L'enregistrement L'enregistrement constitue l'élément fondamental de REACH. Les substances chimiques fabriquées ou importées dans des quantités de plus d'une tonne par an 150 ( * ) doivent être obligatoirement enregistrées dans une base de données centrale. Faute d'enregistrement, la substance ne peut être ni manufacturée ni importée. L'industrie est ainsi tenue de se procurer des informations pertinentes sur les substances qu'elle produit et d'exploiter ces informations pour assurer une gestion sûre de ces substances. L'enregistrement comprendra les données relatives aux propriétés, aux utilisations et aux précautions d'emploi des produits chimiques. Les données requises seront proportionnées aux volumes de production et aux risques présentés par la substance. Une nouvelle agence européenne des produits chimiques sera chargée de gérer la base de données, de recevoir les dossiers d'enregistrement, ainsi que d'élaborer des orientations en vue d'assister les producteurs et les importateurs, ainsi que les autorités compétentes, dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Il est prévu que 80 % environ de toutes les substances enregistrées ne nécessiteraient aucune action plus poussée. La création d'une Agence européenne des produits chimiques Cette agence gère les aspects techniques, scientifiques et administratifs du système REACH, en veillant à la cohérence des décisions au niveau communautaire. L'agence gère également le processus d'enregistrement, joue un rôle fondamental en veillant à la cohérence de l'évaluation, établit des critères destinés à guider les Etats membres dans leur sélection des substances qui devront être évaluées et prend des décisions nécessitant des informations complémentaires sur les substances en cours d'évaluation. Elle formule également des avis et des recommandations dans le cadre des procédures d'autorisation et de restriction et a un devoir de confidentialité. L'inventaire des classifications et des étiquetages Ces dispositions garantissent que les classifications de toutes les substances dangereuses fabriquées ou importées dans l'UE soient à la disposition de tous les acteurs concernés. Les entreprises sont ainsi tenues d'inclure toutes les classifications dans l'inventaire. Toutes les divergences entre les classifications d'une même substance devraient être éliminées au fil du temps. Des classifications harmonisées au niveau de l'UE ne sont requises que pour les propriétés suivantes : substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour le système reproductif ou allergènes respiratoires. L'instauration d'une procédure d'autorisation pour les substances les plus dangereuses Les substances très préoccupantes sont soumises à l'autorisation de la commission en vue d'utilisations particulières. Ces substances comprennent : - les CMR (substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ; - les PBT (substances persistantes, bioaccumulables et toxiques) ; - le vPvB (substances très persistantes et très bioaccumulables) ; - les substances préoccupantes ayant des effets graves irréversibles sur l'être humain et l'environnement, telles que les perturbateurs endocriniens. Si les risques émanant de l'utilisation d'une telle substance peuvent être adéquatement gérés, l'autorisation est accordée. Dans le cas contraire, la commission considère le niveau de risque et l'éventuel intérêt socioéconomique de l'utilisation de la substance et si des substituts existent. Sur la base de ces facteurs, la commission décide de l'autorisation de la substance.
Rappelons, comme on l'a déjà indiqué, que
la charge de la preuve incombe au demandeur.
|
b) Trouver un équilibre entre protection environnementale et innovation industrielle
Le professeur Belpomme a estimé devant la mission que, si le règlement REACH était adopté, les pesticides, qui sont des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) 151 ( * ) feraient partie des produits interdits.
Devant la mission, M. Jacques Barrot, ancien ministre et commissaire européen, a néanmoins souligné qu'une réglementation trop rigoureuse aboutirait à interdire certains procédés industriels et à encourager les délocalisations vers les pays émergents.
Prenant l'exemple d'une entreprise qui produit des systèmes de purification d'eau à Saint-Etienne, il a indiqué qu'une des substances entrant dans le procédé de fabrication étant menacée d'interdiction par la réglementation REACH, le chef d'entreprise envisageait de délocaliser l'établissement en Chine.
Selon l'ancien ministre, il s'agit donc pour le commissaire européen à l'environnement, M. Stavros Dimas, qui examine attentivement le dossier, de trouver un équilibre satisfaisant entre protection environnementale et innovation industrielle.
Pour le directeur général de l'InVS, l'adoption du projet de règlement REACH constituerait une avancée majeure et permettrait :
- de développer la surveillance des populations : « Nous devons développer nos outils de surveillance pour déterminer les pathologies émergentes, les types d'expositions et les populations concernées. Aujourd'hui, il est fondamental de développer ces outils » ;
- d'évaluer la toxicité des produits au niveau européen : « Il convient de promouvoir les moyens nécessaires pour mener une expertise toxicologique des différents produits ... Il me semble que l'expertise doit se conduire à un niveau européen » . Pour lui, « la construction européenne est un formidable vecteur de mutualisation et de développement d'expertises communes. Il convient véritablement de mutualiser ce genre de démarche et d'y associer activement tous les pays européens » ;
- de faire l'inventaire des substances dangereuses. « Des milliers de produits chimiques sont utilisés sans que les risques qu'ils génèrent soient évalués. Il en va de même des conditions d'utilisation de ces produits ou des outils de surveillance à leur appliquer. La directive REACH, à travers un inventaire, tend à résoudre une partie de ces problème » .
Le professeur Belpomme a estimé pour sa part que la procédure d'autorisation préalable est essentielle, parce qu'elle permettrait d'interdire l'utilisation des substances dont la toxicité ne peut être convenablement gérée.
c) Les interrogations de la mission
La mission s'est interrogée sur la possibilité d'introduire une telle procédure d'autorisation dans notre législation, qui permettrait à la fois de dresser un inventaire des substances en circulation et, éventuellement de préconiser le remplacement d'une substance par une autre, moins dangereuse.
Mme Marie-Thérèse Hermange, notamment, a suggéré de s'inspirer de la procédure d'autorisation de mise sur le marché en vigueur dans l'industrie pharmaceutique.
M. Claude Imauven, de Saint-Gobain, a rappelé les contraintes du processus industriel, difficilement compatibles avec celles qu'occasionnerait la mise en place d'une telle procédure. Considérant en effet qu' « il faudrait avoir le recul nécessaire et faire des études épidémiologiques » , et qu' « il y a beaucoup d'effets retards que l'on ne connaît pas au moment où on utilise ces produits » , il a estimé que « cela tuerait pratiquement toute innovation industrielle » .
La mission proposera la mise en place d'une autorisation de mise sur le marché des produits chimiques, minéraux, organiques et biologiques inspirée de la procédure en vigueur pour les médicaments et s'inscrivant dans le cadre du futur règlement européen Reach.
LISTE DES PROPOSITIONS
28 propositions autour de 8 orientations
|
Le suivi médical post-professionnel 1) améliorer l'information des salariés susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière pour qu'ils soient plus nombreux à demander à bénéficier d'un suivi médical post-professionnel ; 2) sanctionner le refus de certains employeurs de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante à laquelle les salariés concernés ont légalement droit ; Le FCAATA 3) simplifier la gestion du dispositif en confiant aux caisses de sécurité sociale les attributions aujourd'hui dévolues à la Caisse des dépôts et consignations ; 4) officialiser une voie d'accès au FCAATA, sur une base individuelle, pour les salariés exposés à l'amiante dont l'entreprise ne figure pas sur une liste et s'appuyant sur des comités de site permanents, rassemblant toutes les parties concernées, afin de déterminer les droits de chacun ; 5) revaloriser le montant de l'ACAATA pour qu'elle atteigne pleinement son objectif ; 6) assurer à tous les personnels ayant été exposés à l'amiante au cours de leur carrière un traitement équitable au regard de la « préretraite amiante », indépendamment de leur statut (fonctionnaires, militaires...) ; Le FIVA 7) permettre au FIVA d'accorder aux victimes le bénéfice qui s'attache à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin que ces dernières ne soient plus incitées à emprunter la voie judiciaire ; 8)°accroître les moyens humains et matériels du service contentieux du FIVA pour faciliter les recours subrogatoires ; Les procédures contentieuses 9) mieux informer les tribunaux sur le barème d'indemnisation du FIVA afin d'harmoniser les indemnisations accordées par la justice ; si nécessaire, envisager la désignation d'une cour d'appel unique pour connaître de l'ensemble des recours ; Mesures financières 10) substituer à la taxe sur les tabacs une dotation budgétaire pour alimenter le FCAATA ; 11) déterminer les parts respectives de l'État et de la sécurité sociale au financement des fonds par l'application d'une clé de répartition stable dans le temps ; la contribution de l'État pourrait être fixée à 30 % ;
12) renforcer l'individualisation de la tarification des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Les entreprises de désamiantage 13) procéder à un recensement national des salariés de ces entreprises, à l'exemple du secteur nucléaire, et faire bénéficier ces derniers d'un suivi médical spécifique ; 14) réduire les plages horaires journalières des salariés du désamiantage afin de tenir compte de la pénibilité et des contraintes de leur travail, sans remettre en cause leurs droits et garanties ; 15) améliorer la qualification des agents chargés du diagnostic amiante, notamment au regard des techniques de construction ; 16) procéder à un recensement national des bâtiments amiantés, accessible sur Internet ; 17) établir une liste nationale de tous les chantiers de désamiantage ; 18) imposer une qualification aux intervenants sur l'amiante non friable ; La réglementation environnementale relative à l'amiante 19) compléter le décret du 7 février 1996 afin de mieux prendre en compte la protection des salariés travaillant sur des chantiers amiantifères ; 20) établir et publier un code de traçabilité des déchets amiantés ; 21) favoriser la valorisation des déchets vitrifiés de l'amiante ; La prévention de nouvelles contaminations 22) informer les clients des espaces commerciaux d'outillage et de bricolage des dangers de l'amiante ; 23) renforcer les effectifs de l'InVS, et notamment de son département santé-travail ; 24) engager une réflexion sur le statut des médecins du travail ; 25) privilégier dans la conception des machines la protection contre la dispersion des poussières des produits de substitution ; 26) interdire les fibres céramiques réfractaires, sauf absence avérée de produits de substitution et, après autorisation préalable, renforcer le contrôle de leur utilisation dans le processus de production ; 27) mettre en place une autorisation de mise sur le marché des produits chimiques, minéraux, organiques et biologiques inspirée de la procédure en vigueur pour les médicaments et s'inscrivant dans le cadre du futur règlement européen Reach ; 28) renforcer les moyens de contrôle sur l'importation des produits provenant de pays n'ayant pas interdit l'amiante. |
CONTRIBUTIONS
Contribution de Mme Michelle Demessine, de M. Roland
Muzeau
et du groupe communiste républicain et citoyen
Qu'il s'agisse de la discussion des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de nos interventions en soutien aux victimes de l'amiante, des actions des salariés, de leurs syndicats comme des associations et eu égard au nombre dramatique de victimes, notre groupe considère depuis des années - c f. les travaux menés par notre amie Marie-Claude Beaudeau - que la question de la prévention des risques professionnels et notamment celle relative au traitement de l'exposition à l'amiante méritait une réflexion approfondie et sans complaisance des parlementaires.
Face à ce drame sanitaire et humain, il nous apparaissait tout à fait justifié qu'une commission d'enquête parlementaire soit constituée. Regrettant le rejet d'une telle demande par la majorité gouvernementale de l'Assemblée nationale, le groupe CRC a porté au Sénat l'exigence de la création d'une mission d'information. Si, aujourd'hui, nous apprécions le travail accompli, nous tenons à souligner, comme le rapport d'ailleurs ne manque pas de le regretter, que les pouvoirs d'investigation réduits d'une mission d'information nous aient privés de l'audition de personnalités dont l'implication dans l'histoire de l'amiante est pourtant incontestable.
Par cette contribution, nous apprécierons le travail de la mission et son rapport au regard des objectifs qu'il nous semble indispensable de lui assigner :
une réelle lisibilité du drame ;
l'identification juste des causes et l'interprétation éclairée des conséquences ;
l'évaluation de la situation au regard de la réparation intégrale ;
une mise en perspective des actions de prévention des risques professionnels ;
des propositions dans le champ de la santé au travail susceptibles d'éviter la répétition de l'amiante.
L'ampleur du désastre, l'étendue de la littérature (scientifique, économique et sociale), la mobilisation constante et grandissante des salariés victimes de l'amiante face à l'absence de mesures en faveur d'une réelle politique de prévention de la part des entreprises comme de l'État, et face au déni de justice et aux obstacles pour obtenir réparation, nous autorisent à attendre de cette mission, non seulement un éclairage sans faille sur ce qu'il faut bien qualifier de crime sociétal, mais également des propositions fortes de transformation de notre système de santé au travail.
La première partie du rapport se devait de rendre lisible à tous le processus par lequel notre pays a pu en arriver à un tel constat : 3.000 décès chaque année, 100.000 annoncés d'ici vingt ans. Des territoires entiers sinistrés, des villes comme celle de Condé-sur-Noireau enregistrant en moyenne chaque semaine le décès d'une nouvelle victime de l'amiante. Nous saluerons ici la qualité des auditions, leur diversité et leur nombre. Par ces témoignages, l'ensemble des éléments de clarification nous a été donné. A ce titre, le rapport souligne opportunément que le drame de l'amiante aurait pu être évité et pose qu'il est impossible de se retrancher derrières des « incertitudes scientifiques » sur les effets de l'amiante sur la santé pour expliquer, comme d'aucuns persistent à le faire, l'absence de négligence des pouvoirs publics et des industriels sur ce dossier. Par ailleurs, le rapport réfute la thèse d'une responsabilité collective, nécessairement diluée, et acte de la collusion d'intérêt entre le CPA et les pouvoirs publics. Au fur et à mesure des chapitres, il éclaire la stratégie délibérée des entreprises et de l'État pour maintenir la production et l'exploitation de l'amiante le plus longtemps possible et promouvoir la politique de « l'usage contrôlé » sous caution scientifique. Pour autant, l'analyse du rapport, tirée de ces faits, sur la question générale de la responsabilité reste en deçà de la réalité. Il laisse à penser que chacun, à divers titres et degrés, aurait contribué au terrible bilan que nous connaissons. Il ne peut en être ainsi, car comment mettre sur le même plan de responsabilité l'État, redevable des lois permettant que les objectifs assignés à la sécurité sociale et à la branche accident du travail et maladie professionnelle remplissent leurs rôles de prévention et de réparation, et le corps scientifique dont on sait, depuis de nombreuses années, qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à l'élaboration des connaissances indispensables au traitement d'un risque tel que l'amiante. La participation de certains scientifiques au CPA ne saurait engager la responsabilité de tous ( cf. la correspondance de 1977 du professeur Jean Bignon au Premier ministre Raymond Barre). Ainsi, quand le rapport évoque « la passivité des donneurs d'alerte institutionnels », il s'agit plutôt de l'organisation volontaire de la passivité des donneurs d'alerte car, avec la somme de données scientifiques internationales, il était possible et nécessaire de mettre la priorité sur la santé au travail. Le rapport pointe également la passivité de la médecine et de l'inspection du travail, mais s'agissant de la première, il ne lie pas explicitement ces carences préventives au manque d'indépendance, ni à l'approche hygiéniste de la santé au travail dans l'entreprise enfermée dans une logique d'aptitude, préférant insister sur le manque de moyens. Concernant la seconde, il ne porte aucune exigence de renforcement de ses moyens, valide sa spécialisation et renvoie au plan santé au travail de M. Gérard Larcher (dont le Parlement n'a pas été saisi), qui n'a d'ambitions qu'à la hauteur des moyens qui lui sont attribués, c'est-à-dire dramatiquement faibles.
Quant à « l'anesthésie de l'État » par le lobby de l'amiante, interrogeons-nous : dirons-nous, dans 50 ans, que l'État fut anesthésié par le lobby de l'industrie chimique en réduisant, voire en évitant, l'application de la directive Reach ?
De la même façon, nous refusons l'idée d'un équilibre des responsabilités entre les entreprises et les salariés. En effet, tant dans leur rôle au sein de la branche AT/MP que dans leur stratégie de sous-déclaration des maladies professionnelles, les employeurs visent à surcharger la solidarité nationale des risques auxquels ils exposent leurs salariés. Depuis de nombreuses années, nous assistons ainsi à une véritable construction de l'invisibilité des conséquences du travail sur la santé publique. Cela nous est du reste brillamment démontré avec le cas emblématique de la société Arkema.
La prétendue responsabilité des travailleurs et de leurs représentants syndicaux se voit démentie par le simple fait de l'insuffisance de moyens en termes d'investigations et d'actions dont ils disposent face à ceux mobilisés par les employeurs. Et ce n'est pas leur participation sans voix décisives au CPA, organe qui a su donner l'illusion du dialogue social, qui pourrait illustrer cette responsabilité. Nous jugeons donc inacceptable l'assertion selon laquelle « les travailleurs de l'amiante n'auraient pas toujours eu un comportement irréprochable face au risque ». Comment, eu égard au chantage à l'emploi, à la pression de la production, à la méconnaissance de l'ampleur des risques, peut-on évoquer un seul instant la responsabilité individuelle des salariés, si ce n'est qu'en entretenant la dilution délibérée des responsabilités. A cet égard, il convient de rappeler que le droit du travail confère aux employeurs le droit exclusif « de l'organisation du travail », assorti de celui « disciplinaire », et organise la « subordination » des salariés. C'est à ce titre principal que l'employeur se trouve être « offreur » de risque. Enfin, et l'actualité de ces dernières années nous le rappelle utilement, c'est tout de même sous la pression des luttes syndicales et des associations de victimes que cette mission d'information a pu voir le jour.
Notre interprétation des causes fondatrices de la catastrophe de l'amiante diverge donc sensiblement de celle du rapport. Dès l'introduction, il débute par une citation tronquée du professeur Got, évoquant une « erreur de gestion » dans le cas du traitement de l'amiante. Or, si le professeur Got évoque effectivement la notion d'erreur de gestion, il nous semble évident qu'il faille tirer partie de l'ensemble de son analyse qui conduit, avec les éléments complémentaires du rapport, à statuer sur une faute de gestion du risque amiante. Ainsi, dans le cadre du bilan exposé, il est clair que la stratégie économique du patronat est bien à l'origine des dégâts humains et sociaux auxquels nous assistons, et cela avec l'accompagnement de l'État.
En deuxième partie, le rapport engage la réflexion sur l'amélioration de la réparation des victimes de l'amiante. Cette question, au coeur des préoccupations du monde du travail et des associations de victimes, mérite, à elle seule, que toutes les leçons du drame de l'amiante soient tirées afin que les moyens effectifs et efficaces soient engagés.
Or, le rapport nous laisse perplexe quant à l'analyse qu'il tire des enseignements et renseignements fournis par les auditions. La situation de la branche AT/MP en est l'illustration : Depuis des années, l'État présente une loi de Financement de la sécurité sociale qui organise illégalement (comme le remarque la Cour des comptes) la mise en déficit de la branche pour éviter la progression des cotisations des entreprises à la hauteur des dégâts qu'elles provoquent. Or, il est avéré aujourd'hui que les dissimulations, tricheries, négligences en tout genre conduisent à un détournement sur l'assurance maladie au bénéfice de la branche AT/MP, des coûts des dégâts provoqués par la gestion des employeurs sur la santé des travailleurs qui pourrait atteindre plus de 15 milliards d'euros par an, selon le croisement des données de plusieurs rapports officiels. Cette situation qui perdure depuis des décennies, et qui s'est aggravée depuis 5 ans, démontre objectivement le caractère organisé et structurel de la gestion des risques professionnels.
A partir de ce constat, nous ne suivrons pas le rapport qui, à plusieurs reprises, suggère que le coût de la réparation des maladies causées par l'amiante est de nature à fragiliser l'économie des entreprises. Il convient de rappeler ici que la cotisation AT/MP est une fraction du salaire des employés et que la règle de l'équilibre voudrait que cette cotisation recouvre l'ensemble des dépenses liées au traitement de la maladie et à sa réparation. Il n'est donc pas recevable d'évoquer la santé financière des entreprises alors que ces dernières n'ont pas hésité à sacrifier celle de leurs salariés. Il n'est pas plus recevable d'évoquer le déficit de la branche AT/MP et l'état de dégradation des finances publiques pour ne pas satisfaire les justes attentes de revalorisation de l'ACAATA et surtout clore le débat sur l'important sujet de la réparation intégrale de l'ensemble des risques professionnels. C'est bien parce qu'il n'y a pas assez de pression financière sur l'employeur que les entreprises n'attachent que peu de moyens à la prévention, phénomène tout à fait explicite dans le rapport.
Dès lors, et faute de cette analyse, le rapport tend à proposer l'ajustement budgétaire du FCAATA et du FIVA par une action conjuguée sur les variables « nombre de victimes » et financement étatique. Ce raisonnement à enveloppe fermée ne saurait résoudre la question du financement de la réparation et surtout n'apporte aucune garantie pour que ce drame ne se reproduise pas.
Il n'est donc pas surprenant que le rapport reste extrêmement prudent au sujet de la responsabilité pénale. En effet, bien que constatant « que le bilan judiciaire de l'affaire de l'amiante ne permet pas de tirer toutes les leçons de cette expérience tragique », n'excluant pas de fait à l'avenir le renouvellement de ce type de situation, les conclusions du rapport ne s'orientent pas vers des solutions de nature à permettre un procès pénal dont chacun s'accorde à reconnaître les vertus pédagogiques, ne serait-ce qu'en termes de prévention. Il ferme toutes les portes aux demandes des associations en considérant « que la loi du 10 juillet n'a pas besoin d'être modifiée pour permettre l'engagement de la responsabilité des chefs d'entreprises. » Si nous pouvons être d'accord avec une critique « relativisée » de la loi Fauchon qui n'empêche pas, mais complique sérieusement, l'instruction des affaires de santé publique, nous ne pouvons nous satisfaire de ce statu quo . L'importance des affaires dans ce domaine exige de lever les obstacles supplémentaires à la répression. Les critères retenus doivent être revus, le distinguo cause directe/indirecte reposé, la théorie de la causalité repensée. En outre, le rapport devrait être plus incisif sur l'absence de volonté politique de voir aboutir un examen réel des responsabilités et l'enchaînement des faits devant le pénal.
Concernant enfin les développements consacrés à la prévention, les préconisations sont peu exigeantes et aucunement structurelles. Nos interlocuteurs ont déploré l'état du dispositif français de veille sanitaire souffrant encore de graves lacunes en raison principalement d'un manque de moyens financiers et de personnels (les toxicologues notamment). Ils nous ont rappelé la nécessité de garantir l'indépendance de l'expertise. Si, pour éviter de nouvelles catastrophes, le rapport va jusqu'à dire qu'une présomption de risque est suffisante et fait siens les propos d'un ministre actuel invitant à aller plus vite entre l'identification d'un risque et l'interdiction du produit, il ne plaide pas en faveur de l'application du principe de précaution aux fibres de substitution ou aux éthers de glycol... Nous déplorons aussi qu'au sujet du projet de réglementation européenne sur les produits chimiques soient mises en balance la protection environnementale et l'innovation industrielle. L'affaire de l'amiante nous enseigne de ne plus accepter de laisser les intérêts économiques prendre le pas sur la logique de santé publique. Dans la gestion du risque chimique le principe devrait être « pas de données, pas de marché ».
Sous le bénéfice de ces observations les sénateurs communistes s'abstiendront sur le présent rapport.
*
* *
Liste des propositions formulées
par
M. Roland Muzeau, Mme Michelle Demessine
et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen
I - La prévention
De l'évaluation des risques sanitaires et de la surveillance épidémiologique
1. Renforcer les moyens financiers et humains de l'InVS, et notamment de son département santé au travail ;
2. créer d'au moins 70 postes de toxicologues ;
3. garantir l'indépendance et l'expertise de l'AFSSET dans ses missions de sécurité et prévention en santé au travail ;
4. revoir l'organisation de la médecine du travail en dotant les médecins d'un statut réellement indépendant ;
5. orienter la méthode de travail des médecins du travail vers une vraie logique de santé, en changeant de paradigme concernant l'aptitude (de la visite médicale à l'entretien médico-professionnel annuel) ;
6. Création sur 5 ans de 700 postes d'inspecteur du travail ;
Du suivi médical professionnel et post-professionnel
7. utilisation d'un volet de la carte vitale pour connaître les risques, permettre la traçabilité des expositions aux produits, assurer la surveillance professionnelle des salariés ;
8. définition d'un protocole rigoureux de suivi des salariés atteints de maladies professionnelles de l'amiante présentées comme « bénignes » ;
9. mise en place de systèmes formalisés d'information et de recherche active des salariés, retraités exposés professionnellement à l'amiante, afin qu'ils demandent à bénéficier du suivi post-professionnel ;
10. droit au scanner pour les anciens salariés de l'amiante selon les recommandations de la « conférence de consensus » de 1999 ;
11. sanctionner pénalement et ou par une sur cotisation AT/MP l'obligation pour l'employeur d'établir l'attestation d'exposition aux risques ;
Des mesures structurelles intéressant la branche AT/MP
12. donner à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles une dimension préventive en l'individualisant davantage et en raccourcissant la durée de répercussion des événements ;
13. augmenter la structure du budget de la branche AT/MP consacré à la prévention pour notamment dynamiser les contrats d'objectifs ;
14. sanctionner les employeurs contournant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles par une surcotisation AT/MP ;
II - La réparation des victimes
L'ACAATA
15. améliorer le fonctionnement du fonds pour que tous les travailleurs (du privé comme du public, intérimaires, sous-traitants) exposés à l'amiante bénéficient de l'ACAATA ;
16. rendre moins arbitraires les décisions de classement des établissements sur la liste ouvrant droit au versement de l'ACAATA, en confiant cette décision à une commission indépendante ;
17. fixer un plancher de l'ACAATA au moins égal au SMIC brut ;
18. relever à 75 % du salaire de référence le montant de l'ACAATA et calculer cette allocation sur la base des douze meilleurs mois de salaire de l'ensemble de la carrière professionnelle du demandeur ;
19. déplafonner la contribution des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante au FCAATA instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Le FIVA
20. autoriser les victimes de l'amiante à intenter des recours en reconnaissance de la faute inexcusable même lorsqu'elles ont accepté les offres d'indemnisation du FIVA ;
21. donner au FIVA les moyens humains et financiers pour engager des actions récursoires contre les employeurs ;
22. augmenter les barèmes d'indemnisation pour une réparation intégrale des préjudices ;
De l'ensemble des maladies professionnelles
23. réintégration des deux dispositifs spécifiques aux victimes de l'amiante dans la branche AT/MP et réforme d'ensemble du système de réparation basé sur la réparation intégrale du préjudice subi ;
III - La responsabilité pénale
24. Engager un processus de révision de la loi Fauchon par la constitution d'un groupe de travail élargi à l'ensemble des acteurs à l'appui de cette démarche ;
25. injonctions du garde des Sceaux aux parquets leur enjoignant d'engager des poursuites à l'encontre des responsables identifiés ;
IV - La protection contre l'amiante résiduel et les autres produits dangereux :
Recensement du risque amiante
26. organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de l'amiante dans les bâtiments et rendre, via internet ce recensement accessible au public ;
27. déterminer à quelle administration confier le contrôle du respect de l'obligation du DTA ;
28. soumettre les propriétaires privés à une obligation d'informer leur locataire sur l'amiante ;
29. garantir la qualification des entreprises chargées du diagnostic amiante ;
Protection des travailleurs
30. renforcer la réglementation concernant l'amiante non friable en imposant la certification de l'opérateur de chantier ;
31. élargir la possibilité pour l'inspection du travail d'arrêter des travaux présentant un risque pour les salariés aux cas de travaux entrepris sans recherche préalable d'amiante et de travaux d'entretien, de maintenance sans protection ;
32. limiter en temps et à deux le nombre de vacations en zone de désamiantage avec maintien intégral du salaire ;
Prévention des risques professionnels et environnementaux
33. sécuriser le transport et le suivi des déchets en rendant obligatoire la délivrance d'une attestation de réception remise au donneur d'ordre ;
34. interdire le stockage en installation de classe 3 des déchets d'amiante non friable ;
35. valoriser le vitrifiat ;
36. lutter contre la réintroduction des produits manufacturés contenant de l'amiante ;
37. interdire l'utilisation des fibres de substitution à l'amiante ;
38. application stricte du principe de précaution se traduisant par l'interdiction d'utilisation des éthers de glycol et autres produits chimiques toxiques ;
39. application du principe « pas de données, pas de marché » dans la gestion du risque chimique ;
40. exclure la santé au travail du champ des accords dérogatoires.
Contribution de Mme Marie-Christine
Blandin,
sénatrice verte du Nord, rattachée au groupe
socialiste
20 octobre 2005
Répondre aux demandes des victimes et à leurs interrogations est une priorité.
Cette mission sénatoriale s'est donc attachée à explorer tous les mécanismes de la connaissance et de la décision.
Les victimes demandent une juste réparation et s'attachent à obtenir des pouvoirs publics et de tous les partenaires concernés que ne puissent plus se reproduire de tels drames de santé environnementale.
Si l'on peut se satisfaire de la qualité et de la densité des auditions, ainsi que de l'essentiel des propositions de la mission, la révision de la loi Fauchon, dans le cadre d'un texte plus ambitieux sur les maladies et accidents du travail, qui serait accompagnée de moyens supplémentaires pour l'inspection et la médecine du travail, ainsi que de l'indépendance de ses acteurs, reste pour moi d'actualité.
En effet, si les arguments des juristes qui démontrent que des condamnations des responsables restent possibles dans le strict cadre du texte existant, sont audibles, force est de constater que ce texte est aussi utilisé pour débouter des victimes. Ceci est la raison de mon abstention, malgré la qualité de ce rapport.
La mission a laissé entrevoir le nombre considérable de victimes à venir : tant que le FIVA ne sera pas en mesure de requalifier sa réponse aux personnes contaminées, des moyens accrus et les ressources humaines adéquates doivent être attribués au pôle judiciaire de santé publique.
D'autre part, l'échéance décisive et très proche de la directive Reach doit nous conduire à ne pas renouveler les erreurs du passé : les ministères de la santé, du travail, de l'environnement sont davantage concernés que le ministère de l'Industrie : ils doivent être négociateurs, comme l'InVS, à part entière auprès de l'Union européenne. Les usagers, les organisations syndicales et associatives ont aussi un savoir indispensable sur ces questions. Cela leur donne une expertise d'usage et leur confère la légitimité d'être consultés.
Plus que jamais, dans l'entreprise, les instances chargées de la prévention et de la sécurité au travail doivent être garanties et redynamisées.
Enfin, une Haute autorité indépendante doit pouvoir juger, avec les expertises qu'elle souhaite rassembler, de la pertinence ou non de la production et de l'usage de substances susceptibles de porter atteinte à la santé des ouvriers comme des utilisateurs. Cela concerne les nouvelles substances dont on envisage la mise en circulation comme celles déjà répandues pour lesquelles de nouveaux soupçons se feraient jour.
COMPTES RENDUS DES DÉPLACEMENTS DE LA MISSION
Compte rendu du déplacement à
Dunkerque
31 mars 2005
Composition de la délégation
: M.
Jean-Marie Vanlerenberghe, président,
Mmes Michèle San
Vicente, vice-présidente, Sylvie Desmarescaux, secrétaire,
Michelle Demessine, Marie-Christine Blandin et M. Bernard Frimat
- Réunion avec des représentants de l'Association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA) et de l'Association régionale des victimes de l'amiante (ARDEVA) du Nord-Pas-de-Calais
1. Les activités de l'ARDEVA
M. Pierre Pluta, président de l'ARDEVA a d'abord rappelé que cette association avait été créée en 1996 et regroupait l'ensemble des victimes de l'amiante dans la région Nord-Pas-de-Calais, quels que soient leurs corps de métiers et leurs sensibilités syndicales ou politiques.
La création de l'ARDEVA est née du constat que la reconnaissance des pathologies liées à l'amiante comme maladies professionnelles apparaissait comme un véritable « parcours du combattant ». En effet, cette reconnaissance nécessite d'apporter un témoignage, ce qui se révèle difficile, les personnes ou entreprises concernées pouvant avoir disparu alors même que les délais de latence de la maladie sont extrêmement longs. Toutefois, l'ARDEVA s'est rendue compte qu'elle ne pouvait limiter sa mission à agir en faveur d'une telle reconnaissance. Elle joue également un rôle important en matière d'écoute des victimes qui s'expriment souvent pour la première fois sur leur maladie, qu'elles considèrent comme honteuse, auprès de membres de l'association.
Les représentants de l'ARDEVA réfutent la distinction entre les maladies bénignes, telles les plaques pleurales, et les maladies malignes, toutes les pathologies liées à l'amiante étant invalidantes (problèmes respiratoires, essoufflements). Les victimes viennent ainsi à l'association parler de leurs souffrances et de leurs angoisses, ainsi que des effets secondaires des traitements et aussi, parfois, de leurs espoirs. La capacité d'écoute des membres de l'association est donc un point important.
L'association doit également soutenir les familles, notamment après le décès de la victime, qui intervient souvent rapidement après l'apparition d'un cancer broncho-pulmonaire ou d'un mésothéliome. L'ARDEVA voudrait ainsi pouvoir donner aux victimes une « étincelle d'espoir », mais elle rencontre de grandes difficultés pour le faire, contrairement à des associations intervenant sur d'autres types de cancers pour lesquels l'espérance de vie est souvent bien plus importante. Selon l'association, les pouvoirs publics devraient accorder des moyens à la recherche médicale en direction des cancers liés à l'amiante, au moins pour pouvoir stopper l'évolution de la maladie. Elle a souligné l'absence du mésothéliome dans le « plan cancer » annoncé par le président de la République. Elle a également constaté un manque d'information flagrant du corps médical sur les pathologies liées à l'amiante. L'ARDEVA a même dû établir un guide relatif à la reconnaissance au titre des maladies professionnelles, qu'elle a adressé aux médecins de la région.
L'ARDEVA a souligné les limites du suivi médical post-professionnel mis en place par un arrêté du 28 février 1995 et qui apporte des informations sur l'attestation d'exposition à l'amiante devant être remise par l'entreprise aux salariés concernés. Plusieurs années après la mise en place du suivi médical post-professionnel, on constate qu'un tiers des effectifs des industries de la région ayant travaillé au contact de l'amiante est atteint par une pathologie liée à ce matériau. Pourtant, plus de 5.000 personnes ayant aujourd'hui quitté ces entreprises, l'entreprise Sollac en particulier, ne disposait d'aucune information sur leur état de santé. Par ailleurs, le suivi médical organisé à Dunkerque ne paraît guère opérationnel, faute de moyens. Ainsi, le centre hospitalier de Dunkerque a demandé la création d'un poste de pneumologue et l'Agence régionale de l'hospitalisation en a admis le principe, à condition que le centre hospitalier finance lui-même ce poste.
Les représentants de l'ARDEVA ont estimé que le drame de l'amiante n'avait pas servi de leçon car de nouveaux problèmes semblent apparaître avec certains des produits de substitution utilisés, telles les fibres céramiques réfractaires. L'association a d'ailleurs alerté le ministre du travail et des affaires sociales de l'époque ainsi que plusieurs parlementaires dont certains ont interrogé le gouvernement.
L'association a également insisté sur le problème du statut des médecins du travail dont la mission est rendue difficile par leur lien de subordination à l'employeur.
Selon l'ARDEVA, les salariés travaillant au contact de l'amiante n'étaient, à l'époque, absolument pas informés des dangers de ce matériau ; certains ignoraient même qu'ils travaillaient au contact de l'amiante, y compris dans des établissements publics comme le Port autonome, voire ignoraient jusqu'à l'existence de cette fibre. Certains médecins du travail expliquaient même que l'amiante était sans danger ou que le risque pris n'était pas plus grand que le fait de fumer.
Selon un représentant de l'ANDEVA, personne ne soutient plus aujourd'hui la thèse, y compris les employeurs, que les salariés étaient informés de la nocivité de l'amiante. La stratégie de défense des employeurs consiste à mettre en avant la sous-estimation générale des dangers de l'amiante et, relevant que tout le monde s'était trompé sur la nocivité de ce matériau, à en conclure qu'il n'y a aucune raison de faire porter les responsabilités de ce drame sanitaire sur les seuls employeurs.
2. Le témoignage de deux « veuves de l'amiante »
Les deux veuves qui se sont exprimées ont apporté un témoignage particulièrement poignant. Elles ont insisté sur l'âge relativement jeune de leurs maris à leur décès, respectivement 59 ans et 50 ans, et sur les souffrances qu'ils ont endurées. L'une des deux veuves a dû assurer seule l'éducation de ses cinq enfants à 46 ans.
Elles ont dénoncé les lenteurs de l'administration tant en ce qui concerne la reconnaissance au titre des maladies professionnelles (10 mois) qu'en matière d'indemnisation (dossier déposé il y a trois ans). Elles ont également noté les difficultés financières auxquelles elles sont confrontées, l'une d'entre elles indiquant ne percevoir que 1.600 euros par trimestre.
Elles ont exprimé le sentiment de gâchis familial et social engendré par l'amiante et qui n'aurait jamais dû survenir si leurs maris avaient travaillé ailleurs. Dénonçant le laxisme de l'ensemble des acteurs professionnels, elles ont souhaité un procès pénal de l'amiante qui permettrait de désigner les responsables, non par souci de vengeance, mais pour qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais.
3. Le volet juridique
Maître Michel Ledoux, avocat de l'ANDEVA, et M. Michel Parigot, membre de l'ANDEVA, ont rappelé que depuis une dizaine d'années, l'ANDEVA a engagé deux séries de procédures : d'une part, sur le plan civil, afin d'obtenir une indemnisation pour les victimes, et, d'autre part, sur le plan pénal, afin que les responsabilités soient clairement établies.
Procédure civile
La reconnaissance des maladies professionnelles a longtemps été assimilée à un véritable « chemin de croix ». Le risque professionnel, financé par les entreprises depuis l'institution du système assurantiel il y a plus de cent ans, apparaît aujourd'hui obsolète. L'ANDEVA souhaite que la tarification des accidents du travail par les entreprises soit réformée, ce qui est d'ailleurs prévu par le plan Larcher. Elle estime en effet que les entreprises dans lesquelles surviennent les accidents du travail devraient en assumer les conséquences financières. La prévention devrait être, à l'avenir, pour ces entreprises, économiquement plus rentable que la réparation.
L'ANDEVA a engagé des procédures sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur. Depuis un arrêt du 28 février 2002, la Cour de cassation a mis à la charge des entreprises une obligation de résultat en matière de sécurité au travail et a condamné à plusieurs reprises l'employeur pour faute inexcusable.
Il existe cependant de grandes disparités en matière d'indemnisation qui peuvent aller de 1 à 10 selon le ressort des tribunaux. Il s'agit pour l'ANDEVA d'un aléa judiciaire infondé et source d'une perte de crédibilité pour la justice. D'ailleurs, le rapport Lambert/Faivre, établi début 2004, à la demande du garde des Sceaux, avait proposé de prendre en compte des moyennes à partir des indemnisations décidées par les tribunaux en matière de réparation des dommages corporels.
Procédure pénale
L'ANDEVA a déposé plusieurs plaintes pour blessures ou homicides involontaires contre des employeurs, dans le domaine de la sidérurgie par exemple, dès 1996-1997. Ces dossiers n'ont guère évolué depuis.
Un non-lieu a été confirmé par la cour d'appel sur la base de la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000 relative aux délits non-intentionnels. L'association attend désormais la décision de la Cour de cassation.
Les représentants de l'ANDEVA ont estimé qu'en matière de santé publique, les dommages étaient forcément indirects et les responsables nombreux, voire très nombreux. Dans ces conditions, la « loi Fauchon » interdit toute poursuite, d'autant plus qu'elle exige une faute caractérisée pour engager la responsabilité. Or, une telle faute est précisément impossible à démontrer dans l'affaire de l'amiante, tant les acteurs étaient nombreux à s'être trompés. Dans un article de La Voix du Nord, le sénateur Fauchon avait suggéré aux victimes de recourir à la citation directe dans le cas de l'amiante. Or cette procédure sans instruction, utilisée pour les affaires les plus simples, suppose des responsables identifiés et apparaît pour l'ANDEVA tout à fait inadaptée.
L'ANDEVA a rappelé qu'elle avait, à l'époque de l'examen de ce texte, informé le gouvernement et l'ensemble des groupes parlementaires des risques que ne manquerait pas de faire courir la « loi Fauchon ». Certes, si, à l'origine, cette loi visait à limiter l'engagement de la responsabilité pénale des maires (même si seulement quatre élus locaux étaient en moyenne condamnés chaque année), elle a des conséquences sur la gestion des risques collectifs. Selon l'ANDEVA, le risque, dans une société aussi complexe que la nôtre, est beaucoup plus difficile à identifier qu'à l'époque de la rédaction du code pénal, les responsabilités étant souvent indirectes. Or la « loi Fauchon », qui a mis un terme à l'instruction des plaintes dans l'affaire de l'amiante, a envoyé un « message terrible » susceptible d'entraîner des conséquences négatives en termes de prévention. La « loi Fauchon » conduirait ainsi à punir davantage l'exécutant que le décideur dans un contexte où des catastrophes sanitaires pourraient se reproduire (éthers de glycol ou fibres céramiques réfractaires). En outre, les pôles de santé publique dans les parquets, à Paris et à Marseille, n'ont pas les moyens de conduire des instructions approfondies.
Les responsables de l'ANDEVA ont proposé de transmettre à la mission leurs suggestions pour modifier la « loi Fauchon » sur les problèmes qu'elle pose en matière de santé publique.
4. L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)
Les responsables de l'ARDEVA ont également dénoncé les difficultés de la reconnaissance des maladies professionnelles, l'exclusion des fonctionnaires du bénéfice de l'ACAATA et une méthode de calcul qui conduit à réduire de moitié l'indemnisation des dockers.
Comme le bénéfice de l'ACAATA est subordonné à la démission du salarié concerné de son poste de travail, le faible montant de l'allocation (85 % du salaire) prive nombre de ses bénéficiaires d'un niveau de vie décent, d'autant plus que les ouvriers de l'amiante percevaient un salaire peu élevé. L'ARDEVA a souhaité que le montant de l'ACAATA soit au moins égal au SMIC.
5. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
L'ARDEVA souhaiterait que la base du barème d'indemnisation du FIVA, qui est destinataire de l'ensemble des jugements pour faute inexcusable en matière d'amiante (1.400 en juin 2004), corresponde à l'indemnisation moyenne accordée par les tribunaux. Il existe en effet de grandes disparités entre l'indemnisation du FIVA et celle accordée par les tribunaux. Par exemple, pour les plaques pleurales (avec 5 % d'incapacité professionnelle), le FIVA propose une indemnisation de 14.300 euros, alors que la moyenne des indemnisations judiciaires s'élève à 25.800 euros. Pour un mésothéliome (100 % d'incapacité professionnelle), le FIVA propose 100.000 euros contre 160.000 euros pour les tribunaux.
Le FIVA qui, outre sa mission d'indemnisation, doit également engager des actions subrogatoires, ne remplit pas cette seconde mission. D'une part, il manque de moyens (son service juridique ne comptant que cinq collaborateurs alors qu'il reçoit 700 dossiers par mois), et, d'autre part, la tutelle, c'est-à-dire l'Etat, ne semble pas faire une priorité de cette mission.
*
A l'issue d'une conférence de presse tenue au siège de l'ARDEVA, la délégation de la mission a participé, à l'invitation de M. Alain Perret, sous-préfet de Dunkerque, à un déjeuner de travail à la sous-préfecture .
Participaient notamment à ce déjeuner de travail : MM. Jean-Pierre Decool, député de la 14ème circonscription du Nord, Jean-Philippe Joubert, procureur de la République, Naels, président de la Chambre de commerce et d'industrie, Léchevin, directeur des relations humaines du Port autonome, et Pierre Pluta, président de l'ARDEVA.
- Table ronde avec les syndicats
Participants :
- pour FO : MM. Jean-Jacques Fournier et Raymond Ryckebuch ;
- pour la CGT : MM. Jean-Pierre Thoor, Claude Tange, Gérard Oms, Bernard Benoît, Philippe Collet et Dany Wallyn ;
- pour la CFDT : MM. Fernand Donnet et Pierre Méquignion.
Les représentants de la CGT ont indiqué que les ouvriers de l'amiante, au cours de leur carrière, n'avaient jamais été avertis de la nocivité de ce matériau, ni par les organisations syndicales, ni au sein des CHSCT (des rapports du CHSCT de la fin des années 1980 indiqueraient que la direction de certaines entreprises affirmait qu'il n'existait pas d'études scientifiques sur les effets de l'amiante sur la santé alors que l'Association pour la prévention des risques professionnels (AINF) affirmait le contraire), ni par la médecine du travail, ni par l'inspection du travail. On conseillait même, après usage, aux ouvriers de la sidérurgie, de secouer leur protection ignifugée contenant de l'amiante, ce qui avait pour conséquence de disperser les fibres. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 1990 que l'on a commencé à parler des risques sanitaires de l'amiante. L'utilisation massive de l'amiante (« dans les établissements industriels de Dunkerque, il y avait de l'amiante partout, y compris dans les bureaux ») résultait des nombreuses qualités prêtées à cette fibre : moyen d'isolation efficace pour travailler à haute température, coût faible, grande malléabilité.
D'après les interlocuteurs de la mission, beaucoup d'amiante subsiste encore dans les bâtiments industriels en dépit des travaux de désamiantage effectués.
L'absence de coordination avec la médecine du travail a été dénoncée. Selon les syndicalistes entendus, celle-ci est toujours réticente à aborder le sujet : par exemple, son dernier rapport n'évoque ni le nombre de décès d'origine professionnelle, ni la cause des décès.
La direction d'Arcelor continuerait à cacher la vérité sur l'ampleur de la présence d'amiante.
Le système de cessation anticipée d'activité serait mal conçu, la loi étant interprétée de façon ambiguë en ce qui concerne l'obligation du préavis.
Les conditions du désamiantage ont également été critiquées. Il existe des situations dans lesquelles le caractère dangereux de l'amiante doit encore faire l'objet d'une vigilance particulière.
Les représentants de la CFDT ont indiqué, à partir des données fournies par 43 sections syndicales, que plus des trois-quarts des petites et moyennes entreprises et industries étaient touchées par l'amiante. Ils ont rappelé que, suite à des cas de cancer du poumon dans des cokeries, la CFDT avait demandé une protection collective et individuelle des salariés de l'amiante dès 1983 mais avait essuyé à l'époque de nombreuses critiques.
Dans certaines entreprises, où la direction réfute pourtant la présence d'amiante, on a relevé jusque 20,65 fibres par litre d'air. L'ensemble des organisations syndicales devraient participer aux enquêtes destinées à identifier les entreprises où l'amiante est présent, car l'administration du travail ne dispose pas de toutes les informations, dont certaines ont d'ailleurs été détruites dans les archives pour faire disparaître des dossiers compromettants.
Des inquiétudes sur les conséquences sur la santé des produits de substitution de l'amiante, telles que les fibres céramiques réfractaires, ont été exprimées.
Les moyens de protection des salariés devraient être accrus. Des entreprises non-spécialisées ont parfois été amenées à enlever de l'amiante sans protection particulière : on continue ainsi de contaminer de jeunes salariés. A été cité le cas d'un salarié d'une de ces entreprises qui n'avait travaillé que trois mois sur un chantier de désamiantage d'une agence de la Banque de France, mais qui est aujourd'hui atteint d'une pathologie liée à l'amiante.
Le statut de la médecine du travail devrait également être réformé afin de la rendre indépendante et de lui octroyer davantage de pouvoirs, les médecins du travail, salariés de l'entreprise, « n'ayant pas les mains libres ».
L'inspection du travail n'aurait également pas rempli sa mission dans le dossier de l'amiante, à commencer par la diffusion d'informations. Certains inspecteurs du travail affirmaient en effet que les plaques pleurales n'étaient pas une véritable maladie.
En Allemagne, un délai de seulement trois ans s'est écoulé entre l'alerte donnée sur les dangers de l'amiante et le désamiantage complet des sites sidérurgiques.
Les conditions d'établissement des certificats d'exposition à l'amiante ne seraient pas satisfaisantes.
Les représentants de FO ont insisté sur l'utilisation importante de l'amiante sur les navires. Ceux-ci en contiennent d'ailleurs encore d'importantes quantités, soit qu'ils aient été construits avant 1997 soit qu'ils proviennent de pays où l'amiante n'est pas interdit. La recherche d'amiante sur un navire de passage est rendue d'autant plus difficile que celui-ci a souvent quitté le port avant que les résultats du diagnostic ne soient connus.
L'utilisation des fibres céramiques réfractaires a été dénoncée et des interrogations émises sur leur caractère cancérogène.
Sept objectifs ont été évoqués afin de lutter efficacement contre les méfaits de l'amiante : briser la loi du silence ; saisir l'ampleur du problème et des conséquences sanitaires (données parcellaires mais impressionnantes) ; désamianter en uniformisant les législations des Etats ; renforcer la prévention ; élargir la liste des professions bénéficiant de départs anticipés ; améliorer l'indemnisation ; accroître la prévention des risques liés aux autres matériaux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
- Audition des représentants de l'entreprise Arcelor
Participants : MM. Denis Hugelmann, directeur de l'entreprise Sollac-Atlantique à Dunkerque, et Jean-Claude Muller, directeur santé-sécurité d'Arcelor.
M. Denis Hugelmann a indiqué que l'amiante avait été utilisé dans la sidérurgie pour deux types d'usage : comme coupe-feu pour éviter les incendies et comme équipements (vêtements de fondeur, nappes...) pour protéger les salariés de la chaleur et des projections de métal liquide.
Il a estimé que l'analyse des risques devait être replacée dans le contexte de l'époque, le principal risque alors perçu étant la brûlure et le feu.
L'entreprise Arcelor, dénommée Usinor jusqu'en 2002, qui emploie 100.000 salariés, dont 30.000 en France, avait diffusé une note en février 1977 sur les précautions à prendre pour enlever les coupe-feu (port d'un masque). Suite à la publication du décret de 1977, les vêtements de protection sont aujourd'hui recouverts d'aluminium.
Le problème de l'amiante n'a commencé à être évoqué au sein des CHSCT qu'au cours des années 1990. L'inspection du travail n'a envoyé à l'usine de Dunkerque aucun courrier relatif à l'amiante avant 1996.
Les fibres céramiques réfractaires suscitent en effet des interrogations quant à la dangerosité et l'entreprise tend à utiliser le béton réfractaire et la laine de roche.
Concernant le certificat d'exposition à l'amiante, l'entreprise de Dunkerque propose à tout salarié ayant été exposé éventuellement à l'amiante de bénéficier d'un suivi post-expositionnel. Les médecins du travail ne peuvent cependant certifier que ce qu'ils constatent physiquement sur un salarié et estiment ne pas pouvoir établir un diagnostic certain dans le cas où un salarié atteint par une pathologie liée à l'amiante a travaillé auparavant dans une autre entreprise où l'amiante était présent. L'entreprise Sollac de Dunkerque se refuse à délivrer un certificat d'exposition à l'amiante qui pourrait être utilisé ensuite contre elle par un salarié, au cours d'un éventuel procès.
M. Jean-Claude Muller, rappelant que l'usine de Dunkerque avait été construite en 1962, a expliqué que la sidérurgie était confrontée à l'époque à un grave problème de sécurité au travail lié aux brûlures. Son premier souci était alors de trouver une solution, la prise de conscience collective des risques de l'amiante ayant été beaucoup plus tardive.
La réglementation européenne concernant la protection contre l'amiante couvre 90 % des usines d'Arcelor. Au Brésil, où l'amiante continue d'être produit et utilisé, il n'est pas possible d'imposer dans les usines de l'entreprise les mêmes règles qu'en Europe, même si certaines bonnes pratiques ont été transposées dans ce pays.
*
- Table ronde avec des représentants de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) et des médecins du travail
Participants :
- CRAM : Mme Christine Dupont et M. Jean Chaudron ;
- Médecine du travail : Dr Joël Merle, médecin aux Chantiers de France, Dr Françoise Besme, ancien médecin du Port autonome, Dr Dérumeau, médecin de l'usine des Dunes, Dr Philippe Robinet, médecin du travail chez Eternit, Dr Daniel Furon, président du Centre de recherche en ergonomie, santé, travail (CERESTE).
Certains médecins du travail ont observé des mésothéliomes dès 1966. Ils se sont alors intéressés à l'amiante-ciment ou à l'isolation, mais ont reconnu n'avoir jamais songé aux autres risques d'exposition, pour les dockers par exemple. Leur connaissance des pathologies liées à l'amiante a donc été progressive. Certains médecins du travail, confrontés à des cas de cancer du poumon dans la réparation navale, pour des opérations de carénage, au milieu des années 1980, n'avaient pas même émis l'hypothèse que l'amiante pouvait être la cause de leur maladie.
Un système de surveillance post-professionnelle a été mis en place à partir de 1995, soit avant l'interdiction de l'amiante, avec l'aide du conseil régional. A l'époque, seul un pneumologue sur dix connaissait les risques de l'amiante.
Il était difficile, jusqu'au milieu des années 1980, de persuader les directions des entreprises et les CHSCT de prendre des précautions contre le risque amiante. Ainsi, à Usinor, à la fin des années 1970, la direction n'avait pas pris en considération l'alerte donnée par le médecin du travail. L'importance du risque s'en est donc trouvée sous-estimée.
Le dépistage demeure aujourd'hui difficile : 25 % des personnes ayant une radiographie normale des poumons présentent des plaques pleurales qui ne sont visibles qu'au scanner.
La législation est mal, voire pas appliquée, notamment pour l'établissement du certificat d'exposition à un produit chimique qui doit être délivré à un salarié quittant l'entreprise, et qui doit être co-signé par le directeur et le médecin du travail. Certains médecins ont dû établir un certificat de leur propre initiative en faveur d'un salarié. Ils ont parfois aussi été sollicités pour signer un certificat établi par le salarié lui-même, alors que c'est l'entreprise qui doit en prendre l'initiative.
Dans les entreprises, il existait souvent un seuil de dangerosité, en dessous duquel les salariés s'estimaient à l'abri. Ils ne prenaient donc aucune précaution particulière.
Le suivi des salariés anciennement exposés pose également problème.
Le dispositif de cessation anticipée d'activité ne bénéficie pas à certaines professions telles que les garagistes, les chauffagistes ou les plombiers, ni aux sous-traitants.
Il y a eu trop longtemps un manque de transparence dans la communication des informations aux médecins du travail et aux CHSCT.
S'agissant des dockers, le débat à l'époque portait sur la prime de risque : cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de débat sur l'existence d'un risque mais que celui-ci n'était pas abordé sous l'angle de la prévention mais sous celui de la réparation. De ce point de vue, on peut parler d'un échec de la prévention, voire d'un échec personnel pour les médecins du travail.
Les représentants de la CRAM ont estimé qu'il était difficile de faire comprendre aux entreprises qu'une faible exposition à l'amiante peut être dangereuse. La communication sur le risque lié à l'amiante a été en fait inexistante.
Il existe un problème de preuve de l'exposition à l'amiante pour les anciens salariés et plus encore pour ceux utilisés dans les entreprises de sous-traitance.
S'agissant de l'ACAATA, l'instruction du dossier administratif et les modalités de calcul sont particulièrement complexes (environ deux mois sont nécessaires pour instruire un dossier). Cette difficulté est telle qu'elle a des conséquences sur la qualité des réunions d'information organisées sur le sujet.
- Audition de l'Association pour la défense des victimes de l'amiante (APDA-CGT (dockers))
Participants : MM. Marcel Suszwalak, Christian Jonvel, et Jacques Dehorter, Mmes Baert et Heemeryck.
L'APDA-CGT a été créée en 1998. Elle visait au départ la filière transports des ports français, mais concerne désormais toutes les professions portuaires qui ont été exposées à l'amiante, de très nombreux dockers ayant été contaminés alors qu'ils n'ont jamais été informés des dangers de ce matériau avant 1992.
Le système de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas satisfaisant, le dernier employeur n'étant pas forcément celui qui est à l'origine de la contamination par l'amiante ; des collectivités territoriales ont par exemple employé des salariés des chantiers navals déjà contaminés.
Les modalités de calcul de l'indemnité des dockers ne sont pas adaptées. Elles aboutissent à une indemnisation à hauteur de 65 % du salaire brut, soit un niveau très faible. Il conviendrait de porter le montant minimum de l'indemnisation au niveau du SMIC.
En matière pénale, les représentants de l'APDA-CGT n'engageront de recours que lorsqu'ils auront la preuve irréfutable de la contamination. Pour eux, il ne s'agit pas de mettre en cause des personnes mais d'établir la responsabilité de différentes institutions qui n'ont pas accompli leur mission, en particulier la médecine du travail ou le ministère en charge d'accorder les licences d'importation de l'amiante.
Compte rendu du déplacement à
Cherbourg
14 avril 2005
Composition de la délégation : MM.
Jean-Marie Vanlerenberghe, président,
Roland Muzeau,
vice-président, Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy,
rapporteurs, et Mme Adeline Gousseau.
- Réunion avec les représentants de l'entreprise Constructions Mécaniques de Normandie (CMN)
Participants : MM. Pierre Balmer, président, Jean-Paul Rigault, directeur des ressources humaines, Thierry Dontenville, responsable du département production et président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et Léon Durel, responsable hygiène et sécurité au travail.
S'appuyant sur deux films de présentation de l'entreprise, les participants ont tout d'abord exposé les activités des Constructions Mécaniques de Normandie : la fabrication de navires de guerre, notamment de patrouilleurs rapides, a longtemps assuré leur prospérité ; la concurrence d'autres arsenaux aux coûts de production plus faibles, situés par exemple en Pologne, a cependant obligé l'entreprise à se restructurer et à diversifier sa production, en s'orientant vers la construction de navires de plaisance (yachts) et en développant les activités de service (logistique et maintenance). CMN emploie actuellement 350 salariés (contre 1.100 dans les années 1980), dont une cinquantaine dans son bureau d'études.
Après une visite des locaux de l'entreprise, les représentants des CMN ont abordé la question de l'exposition des salariés à l'amiante . Ils ont évalué à 2.200 le nombre de salariés, occupés au flocage des vedettes, ayant subi une forte exposition à l'amiante entre 1966 et 1978. D'autres salariés ont subi une exposition plus faible en utilisant, de 1978 à 1984, des tapis, gants ou coussins de protection en amiante. Jusqu'en 1996, des salariés ont enfin pu être soumis à des expositions sporadiques à l'amiante, contenu notamment dans des joints.
Ils ont estimé que l'utilisation importante de l'amiante dans l'entreprise résultait d'une insuffisante prise de conscience des risques qui y étaient associés, tant de la part des dirigeants de l'entreprise que du CHSCT ou des intervenants extérieurs, comme l'inspection du travail ou la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM). De plus, les vêtements de protection existant à l'époque, se présentant notamment sous forme de scaphandres, apparaissaient excessivement contraignants pour les salariés.
Ils ont souligné que le nombre de déclarations de maladies professionnelles causées par l'amiante était resté très faible jusqu'en 1992, avant de connaître une forte augmentation, puis de franchir un nouveau palier à partir de 1997. De multiples facteurs ont favorisé la déclaration des maladies professionnelles : la réalisation de bilans de santé au moment des départs en préretraite ; la mise en oeuvre, dès 1997, d'abord à l'initiative de l'entreprise, puis à l'initiative de la CRAM, d'un suivi médical post-professionnel ; l'arrivée du scanner, qui a permis d'affiner les diagnostics ; la simplification du tableau 30 des maladies professionnelles, qui recense les maladies professionnelles causées par l'amiante ; une meilleure information, tant du grand public que des médecins généralistes, sur les problèmes causés par l'exposition à cette fibre. Le temps de latence très long des maladies causées par l'amiante ne permet pas d'évaluer précisément, aujourd'hui, le nombre de personnes qui vont développer, à terme, des pathologies.
Les représentants des CMN ont ensuite indiqué que les taux d'incapacité permanente partielle (IPP) les plus couramment observés chez les salariés malades de l'amiante étaient de, respectivement, 5 % (dans 80 % des cas) et 100 % (dans 20 % des cas).
Un taux d'IPP de 100 % ouvre droit au bénéfice d'une rente égale à 100 % du salaire brut. En application des règles de tarification de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale, l'employeur se voit ensuite facturer une somme égale à 32 fois le salaire brut annuel du salarié, ce qui représente, en moyenne, entre 600.000 et 700.000 euros.
Les salariés peuvent également intenter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) un recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur , afin de bénéficier d'une majoration de leur rente. Pour une personne dont le taux d'IPP est de 100 %, les réparations complémentaires accordées par les TASS au titre du préjudice physique, moral et d'agrément s'échelonnent entre 110.000 et 300.000 euros. Il s'agit là de montants difficiles à prendre en charge pour une entreprise à la situation financière fragile comme les Constructions Mécaniques de Normandie.
A défaut d'engager un recours en justice, les victimes peuvent adresser une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Mais le FIVA peut ensuite engager une action subrogatoire pour récupérer, auprès de l'entreprise, les sommes versées.
Après un rappel de l'évolution de la réglementation, les participants ont souligné que la faute inexcusable était systématiquement reconnue à l'encontre des CMN et qu'aucune compagnie n'acceptait plus, de ce fait, d'assurer contre ce risque. L'entreprise a dû faire face, jusqu'ici, à 110 recours en justice, dont une partie est encore en attente de jugement. Pour éviter la condamnation, et faire supporter la charge financière de l'indemnisation par la branche AT-MP, elle tente de s'abriter derrière des moyens tirés du non-respect de certaines règles de procédure. Cette stratégie de défense est cependant de moins en moins efficace, dans la mesure où les caisses primaires d'assurance maladie en ont tiré les conséquences et revu leurs exigences en matière de formalisme. La charge de l'indemnisation pèse ainsi lourdement sur les entreprises, ce qui peut mettre en péril leur équilibre financier.
L'inscription, en 1999, des CMN sur la liste des entreprises dont les salariés ont droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a permis, à ce jour, à 173 d'entre eux de partir en préretraite. La création, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, d'une nouvelle taxe mise à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante devrait entraîner pour l'entreprise un surcoût de 300.000 euros.
*
- Réunion avec les représentants de l'entreprise DCN
Participants : MM. Daniel Cauchon, directeur, Gérard Feuardent, secrétaire général, Bernard Ract, chef du service de médecine du travail, Gilles Lecler, chef de la division méthodes, Yvan Pucelle, adjoint au directeur des ressources humaines, Denis Lerouvillois, service de l'infrastructure, Jean-Claude Feron, service des ressources humaines, et Patrick Dufour, chargé de prévention santé et sécurité au travail.
DCN dispose de huit sites industriels en France, dont celui de Cherbourg, spécialisé dans la fabrication des sous-marins. L'entreprise a changé de statut en 2003 pour devenir une société anonyme contrôlée par l'État. Les biens situés à Cherbourg ont été partagés entre DCN et la Marine nationale.
L'amiante était couramment utilisé à différentes étapes de la construction des sous marins :
- pour la protection des opérateurs en soudage et des équipements, en cas de travail de l'acier à très hautes températures ; l'amiante a depuis lors été remplacé par des matériaux en fibres minérales ;
- pour le calorifugeage : l'amiante a été remplacé, dans cet usage, par une variété de fibre céramique ; un groupe de travail réfléchit à un nouveau produit de substitution ;
- pour les peintures : les peintures bitumeuses, résistantes à l'eau de mer, contenaient de l'amiante ; elles ne sont plus utilisées à Cherbourg depuis la fin de l'année 1994 ;
- dans les joints et tresses d'étanchéité : soumis à des températures ou à des pressions élevées, ils ont souvent été fabriqués à partir de matériaux contenant de l'amiante, de sorte que leur retrait crée un risque d'exposition à la poussière d'amiante ; DCN travaille à leur remplacement par des produits de substitution.
Les opérations de maintenance sont confiées à des entreprises agréées afin de protéger les salariés contre le risque d'exposition à l'amiante.
L'amiante est également présent dans les immeubles bâtis , où il a été utilisé, notamment, pour des opérations de calorifugeage, dans des joints, des toitures en amiante ciment, des canalisations, des revêtements de sol, etc. En 1997, DCN a effectué, en application de la réglementation, un diagnostic complet des flocages, calorifugeages et faux plafonds, ce qui a conduit au désamiantage de deux bâtiments. Puis DCN a réalisé en 2004, conformément au décret du 13 septembre 2001, un diagnostic amiante étendu, qui a permis de repérer la présence d'amiante dans certains composants de construction (dalles de sol, bardages, toitures). Des opérations de retrait d'amiante sont en cours dans cinq bâtiments à la suite de ces contrôles. Des diagnostics sont également effectués avant chaque chantier de démolition. Le Centre d'Essais Techniques de DCN Cherbourg dispose de moyens d'analyse permettant de repérer la présence d'amiante dans les matériaux ou de mesurer la concentration de fibres d'amiante dans l'air. Depuis 1998, environ un millier d'échantillons ont ainsi été analysés et 130 campagnes de contrôle d'atmosphère ont été menées. Des opérations de nettoyage ont également été engagées lorsque les analyses de poussières ont mis en évidence la présence d'amiante dans celles ci. D'autres chantiers de dépoussiérage - nettoyage sont prévus jusqu'en 2008.
DCN s'est préoccupé de la prévention du risque amiante avant même l'adoption des premières mesures de réglementation, en 1977. Jusqu'en 1985, DCN, qui dépendait du ministère de la Défense, n'était pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, mais la direction adoptait des instructions qui reprenaient les règles techniques qu'il contenait. Un décret du 19 juillet 1985 a rendu applicables au personnel civil et militaire du ministère les règles techniques figurant dans le titre III du livre 2 du code du travail (hygiène, sécurité et conditions de travail). En 1996, une commission amiante, rattachée au CHSCT, a été créée pour analyser la réglementation, évaluer les risques et proposer des mesures de prévention et de protection.
Depuis 1977, 988 déclarations de maladies professionnelles causées par l'amiante, ayant occasionné 64 décès, ont été recensées. La plupart de ces pathologies sont bénignes (plaques pleurales). Les personnes malades, qu'elles soient en retraite ou encore en activité, bénéficient d'un examen de contrôle tous les deux ou trois ans. Toute personne quittant l'entreprise reçoit une attestation indiquant si elle a été exposée ou non à l'amiante. L'attestation d'exposition ouvre droit à un suivi post-professionnel après le départ en retraite. Conformément aux recommandations de la conférence de consensus de 1999, les personnes malades subissent un scanner tous les quatre ans. Ces examens ont mis en évidence l'existence de nodules pulmonaires dont l'origine reste indéterminée.
Les personnels de DCN bénéficient, selon leur statut, de mesures sociales différenciées. Les salariés de droit privé , relevant du régime général de la sécurité sociale, peuvent percevoir l'ACAATA. On estime que 50 à 60 salariés devraient en bénéficier en 2005, après le pic observé en 2004 (112 départs en préretraite). Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 a instauré un mécanisme analogue pour les ouvriers d'État du ministère de la Défense : les ouvriers relevant de certaines professions et ayant travaillé sur des ateliers déterminés du site de Cherbourg bénéficient ainsi d'un régime de préretraite. Les fonctionnaires et contractuels du ministère affectés à DCN devraient également pouvoir bénéficier, en vertu de l'article 96 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003, d'un mécanisme de départ anticipé, mais le décret d'application permettant sa mise en oeuvre n'a toujours pas été publié. Aucun dispositif n'est en revanche prévu pour les militaires . La coexistence, au sein de l'entreprise, de personnels relevant de statuts si divers pose de délicats problèmes d'articulation entre les règles applicables.
*
A l'invitation de M. Denis Dobo-Schoenenberg, sous-préfet de Cherbourg, la délégation a participé à un déjeuner de travail à la sous-préfecture .
Participaient à ce déjeuner de travail : MM. Pierre Le Roux, capitaine de vaisseau, représentant du préfet maritime, Bernard Cazeneuve, maire de Cherbourg-Octeville, Michel Garrandoux, procureur de la République, et Jean-Claude Camu, président de la Chambre de commerce et d'industrie.
- Réunion à la mairie de Cherbourg avec les représentants de l'ADEVA (Association de défense des victimes de l'amiante) et des syndicats
Participants :
- pour la CFDT : MM. Patrick Lerouge et Jean Penitot ;
- pour COGEMA Force ouvrière : M. Christian Aubin ;
- pour DCN Force ouvrière : MM. Norbert Lelaidier et Luc Bocquet ;
- pour UD Force ouvrière : M. Daniel Debourgeois ;
- pour la mairie d'Equeurdreville FO : M. Jean-François Michel ;
- pour l'UNSA Santé : Mme Véronique Lepiver ;
- pour l'UNSA Éducation : M. Philippe Lerévérend ;
- pour la CFE-CGC : MM. Jean-Marc Maubray et Daniel Legendre ;
- M. Patrick Delacour, représentant SMCTC - sous-traitant DCN ;
- M. Franck Pignot, délégué Normandie Caoutchouc ;
- pour l'ADEVA : MM. Didier Sayadera, président, Christian Rival, vice-président, et Hervé Estace, trésorier, Mme Jacqueline Bidard;
- pour DCN-ADEVA : M. Noël Buhot ;
- pour la CGT-CMN : MM. Michel Nee et Jean-Pierre Cosnefroy ;
- pour la CGT Construction : M. Michel Lejetté ;
- pour la DCN-CGT - élu CHSCT : M. Luc Vaultier ;
- pour la DCN - élu délégué personnel CGT : M. Stéphane Houlette ;
- pour la DCN, membre du collectif Amiante CGT : M. Pascal Canu ;
- M. Christian Catherine, secrétaire général de l'Union locale CGT de Cherbourg, et salarié des CMN ;
- pour le syndicat CGT de l'Arsenal de Cherbourg : MM. Jean-François Lecoffre, secrétaire général, Laurent Hébert et Joël Jullien, du collectif amiante.
Les représentants de la CFTC ont souligné que les syndicats avaient longtemps fait confiance au corps médical et que celui-ci n'avait pas correctement rempli sa mission d'alerte. Ils ont regretté que le décret d'application permettant la mise en oeuvre des mesures d'indemnisation prévues par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 n'ait pas encore été adopté.
Les représentants de la CGT-DCN ont estimé que la présence de la mission à Cherbourg portait témoignage de la justesse de leur combat, qui vise à obtenir réparation des dommages causés par leur employeur. Ils ont invité les membres de la délégation à porter un regard critique sur les propos rassurants tenus par les dirigeants de l'entreprise, qui affirment que la situation s'améliore. En réalité, des témoignages suggèrent que des dossiers en instance de traitement depuis des mois ont fort opportunément trouvé leur solution peu de temps avant la venue de la délégation. Ils ont considéré que les dirigeants de DCN connaissaient parfaitement la dangerosité de l'amiante, dénoncée par la CGT de l'Arsenal dès les années 1950, mais n'avaient pas pris les mesures de protection nécessaires. DCN continue d'ailleurs d'utiliser de l'amiante et d'en incorporer dans ses sous-marins destinés à l'exportation, par exemple dans le modèle Agosta vendu au Pakistan. Ils ont souhaité un désamiantage complet du site de Cherbourg, dans le plus strict respect des règles de sécurité, afin de ne pas exposer les salariés aux poussières d'amiante. Ils ont également plaidé pour une revalorisation de l'ACAATA, dont le montant, égal à 65 % du salaire brut, est jugé très insuffisant, et ont dénoncé son utilisation comme instrument d'accompagnement des restructurations, souhaitant que tous les départs en préretraite soient compensés par un nombre équivalent d'embauches. Ils ont proposé que des indicateurs fiables soient créés pour évaluer les conséquences humaines et industrielles de l'amiante.
Les représentants de l'UNSA éducation ont estimé qu'il y avait eu une carence de l'État dans sa mission de prévention, avant l'interdiction de l'amiante en 1997. Ils ont déploré l'insuffisance du suivi médical des enseignants et l'absence d'évaluation des conséquences des chantiers de désamiantage en milieu scolaire sur les élèves et les personnels.
Les représentants de l'UNSA santé ont insisté sur l'inquiétude des salariés face aux maladies causées par l'amiante, dont le temps de latence est très long.
Les représentants de la CGT-CMN ont mis en garde contre la présence d'amiante dans les charpentes des locaux des CMN et ont indiqué que 266 salariés avaient, à ce jour, déclaré être atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante. Ils ont évoqué le problème du suivi des salariés des nombreuses entreprises sous-traitantes des CMN.
Les représentants de l'ADEVA Cherbourg ont rappelé que la région était particulièrement touchée par l'amiante et ont évalué à plus de 1.000 le nombre de salariés contaminés à DCN et à 400 celui des salariés contaminés aux CMN. Au total, plus de 12.000 personnes auraient été exposées sur l'agglomération.
Rappelant les avancées obtenues par les associations de victimes, notamment la création du FIVA et du FCAATA, ils ont souligné l'insuffisante attention portée aux salariés des entreprises sous-traitantes et ont regretté la non-inscription sur les listes ouvrant droit à l'ACAATA de certains établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante. Ils ont vivement dénoncé les règles de cumul entre les indemnisations et les pensions de réversion, qui conduisent certaines veuves à devoir rembourser un trop-perçu. Ils se sont également interrogés sur le bien-fondé de la règle selon laquelle une personne reconnue atteinte d'une maladie professionnelle causée par l'amiante doit être âgée d'au moins 50 ans pour pouvoir bénéficier de l'ACAATA.
Citant les résultats d'une enquête menée par l'inspection du travail, la CRAM et l'INRS, qui avait mis en évidence un très grand nombre d'irrégularités sur les chantiers de désamiantage, ils ont souhaité que les contrôles soient renforcés, ce qui implique d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail et de la CRAM. Ils ont noté que les médecins du travail compétents en matière de suivi post-professionnel supportaient également une charge de travail excessive. Ils ont déploré la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de Dunkerque et estimé que la loi Fauchon devait être révisée pour mettre fin à cette impunité. Ils ont enfin regretté l'absence d'une véritable commission d'enquête parlementaire, que la gravité du dossier de l'amiante aurait pu justifier.
Les représentants de la CGT-FO ont affirmé que les maladies de l'amiante étaient six fois plus fréquentes en région Basse-Normandie que dans le reste de la France et se sont dits préoccupés par les risques d'exposition observés lors des opérations de désamiantage, parfois effectuées dans les établissements scolaires en présence des élèves. Ils ont critiqué les modalités de l'indemnisation, qui conduisent à ce que les universitaires de Jussieu soient mieux indemnisés que les ouvriers de l'arsenal, et considéré que l'on n'avait pas tiré les leçons de cette crise, comme en atteste la contamination par les éthers de glycol.
Les représentants de la CFDT-DCN ont estimé que la réglementation de 1977 avait été mal appliquée dans leur entreprise et ont demandé le désamiantage complet des locaux ainsi que l'inscription de l'ensemble du site du Cherbourg sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA. Ils ont indiqué que le faible montant de l'ACAATA conduisait parfois les salariés à renoncer à cette prestation pour continuer à percevoir leur salaire. Ils ont souhaité que des psychologues apportent un soutien aux victimes et demandé que les veuves et les enfants des salariés décédés soient embauchés par DCN. Ils ont évoqué les problèmes posés par les fibres céramiques réfractaires utilisées comme matériau de substitution à l'amiante.
Les représentants de l'Union locale de la CGT de Cherbourg ont regretté l'absence de commission d'enquête parlementaire, qui aurait permis de mieux établir les responsabilités, et indiqué que les employeurs devaient assumer les conséquences financières du suivi médical des victimes.
Le délégué du personnel de l'entreprise Normandie Caoutchouc a enfin fait part de son incompréhension devant le refus d'inscrire son entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA, alors qu'il est établi que Normandie Caoutchouc a livré des joints amiantés à de nombreux clients dans toute la France. Il a mis en garde contre le risque de catastrophe industrielle que pourrait entraîner le drame de la contamination par l'amiante.
*
Le déplacement de la délégation de la mission s'est achevé par une conférence de presse organisée à la mairie de Cherbourg .
Compte rendu du déplacement sur le site
universitaire de Jussieu
11 mai 2005
Composition de la délégation : MM. Roland
Muzeau, vice-président,
Gérard Dériot et Jean-Pierre
Godefroy, rapporteurs, Gilbert Barbier, secrétaire, Mmes Marie-Christine
Blandin et Catherine Procaccia, et M. Ambroise Dupont.
- Réunion avec les représentants de l'université Paris VII Denis Diderot, de l'Institut de physique du globe et de l'Etablissement public du campus de Jussieu (EPA Jussieu)
Participants : MM. Benoît Eurin, président, Robert Perret, directeur de cabinet du président, Sylvain Fourmond, chargé des affaires juridiques, de l'université Paris VII, Professeur Alain Bonneville, directeur adjoint de l'Institut de physique du globe de Paris, MM. Raphaël Franquinet, président, Michel Zulberty, directeur, Jean-François Texier, secrétaire général, Patrick Guyomard, chef du service technique et Alexandre Pernin, de la cellule désamiantage, de l'Etablissement public du campus de Jussieu (EPA Jussieu).
La délégation a tout d'abord assisté à la projection d'un film présentant le chantier de désamiantage d'une des barres du campus de Jussieu.
Construits entre 1964 et 1972, les locaux du site universitaire ont été floqués pour être protégés contre le risque incendie. La barre n° 65-66 est la première à avoir été désamiantée, au cours de l'année 1998-1999, les opérations de désamiantage proprement dites ayant été précédées de six mois de préparation technique destinée à assurer la sécurité du chantier.
Les salariés, munis d'une tenue à usage unique et d'un masque de protection, pénètrent sur le chantier par l'intermédiaire d'un sas divisé en cinq compartiments. Ils sont soumis à un dépoussiérage après avoir quitté la zone contaminée, puis à une première douche, en tenue, suivie d'une seconde douche après déshabillage. La zone du chantier est isolée et maintenue en dépression pour éviter que des fibres d'amiante ne s'échappent vers l'extérieur. Des analyses sont régulièrement effectuées pour évaluer la concentration de fibres d'amiante dans l'air.
Afin de limiter la dispersion de poussières d'amiante dans l'atmosphère, le flocage est humidifié puis l'amiante est retiré à l'aide d'une spatule. Les surfaces désamiantées sont brossées pour éliminer les dernières traces d'amiante. Quarante tonnes d'amiante ont été retirées de la barre 65-66. Les travaux sont considérés achevés lorsque la concentration d'amiante dans l'air est inférieure à cinq fibres par litre.
Les déchets sont envoyés vers des centres d'enfouissement lorsque leur teneur en amiante est faible. Dans le cas contraire, ils sont traités par une entreprise spécialisée, qui les vitrifie pour les transformer en un matériau inerte. Les eaux usées contaminées par l'amiante sont filtrées avant d'être rejetées dans le système d'évacuation général.
Après désamiantage, la protection de la barre contre le risque incendie est assurée par un revêtement à base de plâtre.
Après la projection du film, les représentants de l'Etablissement public du campus de Jussieu ont indiqué que huit barres étaient, à ce jour, désamiantées et que les deux tiers du site devraient être traités d'ici septembre 2005. Le désamiantage ne signifie cependant pas que le chantier soit achevé, puisqu'il est nécessaire, ensuite, de reconfigurer et de rénover les locaux en fonction de leur nouvelle affectation. La décision de désamianter le campus de Jussieu a été prise en 1996 et un établissement public a été créé l'année suivante pour piloter les travaux.
L'amiante a été utilisé dans les barres du Gril d'Albert et dans la Tour centrale pour protéger ces bâtiments contre le risque incendie, mais aussi à des fins d'isolation thermique et phonique, ce qui explique qu'il doive être remplacé par plusieurs matériaux de substitution.
A la fin des opérations de désamiantage, plusieurs contrôles sont effectués : un premier contrôle visuel permet de détecter d'éventuels résidus d'amiante ; puis des analyses mesurent la présence de fibres d'amiante dans l'air, qui doit être inférieure, de par la règlementation, à cinq fibres par litre ; il est alors possible de retirer les protections destinées à assurer le confinement du chantier ; on effectue ensuite un deuxième contrôle visuel, destiné à confirmer l'état d'achèvement du chantier, puis une dernière série d'analyses, avant de déclarer les locaux à nouveau utilisables.
La vitrification des déchets d'amiante permet de les transformer en un matériau inerte, qui a parfois été utilisé, sous forme concassée, à titre expérimental, pour la construction des routes.
Les représentants de l'université Paris VII et de l'Institut de physique du globe de Paris ont rappelé que des plaintes avaient été déposées et que des mises en examen avaient été prononcées à l'encontre de leurs établissements en tant que personnes morales, ainsi qu'à l'encontre de l'université Paris VI, dont le président a choisi de ne pas participer à la réunion et de n'envoyer aucun représentant.
Le campus rassemble environ 45.000 personnes, étudiants et personnels confondus. Une vingtaine de personnes employées sur le site ont développé des maladies professionnelles causées par l'amiante. Il est cependant difficile d'établir précisément la responsabilité de Jussieu dans leur contamination, dans la mesure où elles ont souvent été exposées à l'amiante antérieurement à leur arrivée sur le site. L'INSERM réalise actuellement une étude épidémiologique afin de mieux connaître l'état de santé des personnes employées sur le site. Les représentants universitaires ont indiqué ne pas avoir connaissance de cas de contamination dans le voisinage, causés par une pollution environnementale. Toutefois, les flocages ont été réalisés sans précaution particulière au début des années 1970, ce qui a certainement conduit à une exposition de la population environnante aux fibres d'amiante.
Depuis deux ans, un scanner est proposé aux personnes totalisant vingt années de présence sur le site et au moment du départ en retraite. Ces examens ont permis de détecter la présence de plaques pleurales. Si le suivi des personnels des universités Paris VI, Paris VII et de l'Institut de physique du globe de Paris est relativement aisé, il est plus difficile d'assurer celui des enseignants-chercheurs qui ont pu séjourner temporairement sur le campus, dans la mesure où ceux-ci n'ont jamais fait l'objet d'un recensement exhaustif. De même, s'il est possible de surveiller l'état de santé de la trentaine d'agents affectés au nettoyage et à l'entretien des locaux, il est plus difficile de connaître le devenir des salariés employés par des sociétés extérieures et qui interviennent sur le campus.
Si des précautions sont prises aujourd'hui à l'occasion des travaux de maintenance, il n'en a pas toujours été ainsi, dans la mesure où la prise de conscience des dangers de l'amiante a été progressive. En 1975, les universités ont commandé un premier rapport qui a mis en évidence une présence d'amiante dans l'air supérieure, en certains points du campus, au maximum règlementaire autorisé. Un second rapport, remis en 1983, indiquait que la concentration d'amiante dans l'air était désormais conforme aux normes en vigueur. Dès 1985, toutefois, les établissements présents à Jussieu ont pris l'initiative, à titre de précaution, d'isoler certains locaux et de protéger les faux-plafonds à l'aide d'un film plastique.
Les représentants de l'Etablissement public du campus de Jussieu ont indiqué que l'éventualité d'une évacuation du site, pour le désamianter et le rénover vide de ses occupants, avait été envisagée. Ils ont rappelé que l'université Paris VI avait vocation à quitter le campus pour s'installer dans de nouveaux locaux sur la ZAC Rive gauche.
L'hypothèse d'une démolition et d'une reconstruction du campus avait également été étudiée dans les années 1990, mais avait été écartée pour plusieurs raisons : le coût de l'opération, évalué à près de 200 millions d'euros (1,3 milliard de francs), auxquels il fallait ajouter les frais de déménagement et de location des locaux provisoires, avait été jugé trop élevé ; la valeur architecturale du site avait été mise en avant ; enfin, les enseignants-chercheurs craignaient que l'opération n'offre le prétexte d'une installation des universités en dehors de la capitale. Alors que les concepteurs du site lui avaient prédit une durée de vie de trente ans, une rénovation s'imposait cependant et il n'est pas impossible que le coût des travaux avoisine finalement le coût estimé d'une reconstruction du site.
- Réunion avec les représentants du comité anti-amiante de Jussieu et les représentants des syndicats
Participants : MM. Michel Parigot, président du comité anti-amiante de Jussieu, Paul Benalloul, membre du comité anti amiante de Jussieu, Guy Bastien, représentant du SNESUP-FSU de l'université Paris VI, Denis Limagne, représentant du SGEN-CFDT, membre du comité d'hygiène et de sécurité (CHS) de l'université Paris VII, Jean-Pierre Rubinstein, représentant de la CGT, membre du CHS de l'université Paris VI, et Mme Marie José Voisin, membre du comité anti-amiante, du SNESUP-FSU et du CHS de l'université Paris VII.
Les représentants du comité anti-amiante de Jussieu ont tout d'abord rappelé que le personnel présent sur le campus s'était mobilisé une première fois, en 1974 , contre les risques posés par la présence d'amiante dans les locaux. Si des travaux ont alors été effectués pour sécuriser les rez-de-chaussée du Gril, aucune mesure n'a en revanche été prise pour assurer la protection du personnel et des usagers présents dans les étages. Entre 1979 et 1994, le problème posé par l'amiante n'a plus retenu l'attention. Un programme de travaux a été annoncé en 1982, mais n'a jamais vu le jour.
Le personnel s'est à nouveau inquiété des dangers de l'amiante lorsqu'il est apparu, en 1994 , que neuf personnes employées sur le campus souffraient de maladies de l'amiante. Au cours de la décennie écoulée, environ 110 personnes ont été, selon les services de la médecine préventive, reconnues atteintes de maladie professionnelle causée par l'amiante. Il s'agit vraisemblablement d'une estimation basse, les maladies professionnelles étant notoirement sous-déclarées. En outre, les données recueillies par le service de médecine préventive de Jussieu ne sont pas exhaustives : le comité a eu connaissance, ces trois dernières années, de cinq cas de décès par mésothéliome, mais deux cas seulement sont reconnus par le service médical ; les autres concernent, en effet, des personnes aujourd'hui en retraite ou qui travaillent dans d'autres facultés, après avoir été en poste à Jussieu. Or, il n'existe pas de recensement systématique, au niveau national, des cas de maladies professionnelles dont l'origine réside dans une exposition à l'amiante contractée sur le campus.
Les premiers cas de mésothéliome constatés concernaient des personnels techniques, qui avaient été exposés à l'amiante dans d'autres fonctions, et pour lesquels il était donc difficile d'établir avec certitude un lien de causalité entre leur présence à Jussieu et l'apparition de la maladie. En revanche, les cinq cas de mésothéliome plus récents, qui viennent d'être évoqués, semblent résulter de la seule exposition des agents à l'amiante contenu dans les flocages du campus. Les pathologies bénignes, telles les plaques pleurales, affectent indifféremment toutes les catégories de personnel.
Les représentants du comité anti-amiante ont indiqué que leur structure était la seule à apporter soutien et assistance aux victimes de l'amiante. Les présidents des universités n'ont jamais ressenti le besoin d'organiser ne serait-ce qu'une réunion avec les victimes.
Ils ont, en outre, reproché au président de l'université Paris VI , en poste depuis quatre ans, de s'être opposé à la mise en place du suivi médical par scanner . Ce type d'examen permet pourtant de poser un diagnostic beaucoup plus précis sur l'état de santé des patients ; il permet notamment de mettre en évidence, dans certains cas, la présence de nodules pulmonaires, pour lesquels il serait nécessaire d'envisager l'élaboration d'un protocole de suivi particulier, afin d'éviter que des examens inutiles ou que des soins inappropriés ne soient pratiqués. Le rectorat et les médecins experts ont également demandé que les personnes malades travaillent désormais dans des locaux non amiantés, mais sans que leurs recommandations soient jusqu'à présent suivies d'effet.
Ils ont regretté l'absence de données exhaustives sur l'état de santé des anciens étudiants de Jussieu ; le comité peut simplement témoigner d'avoir été contacté par d'anciens étudiants qui ont déclaré souffrir de pathologies provoquées par l'amiante.
Ils ont également déploré la lenteur du chantier de désamiantage de Jussieu. La décision de désamianter le campus a été prise en 1996, le projet initial prévoyant de retirer l'amiante, dans un délai de trois ans, sans rien modifier dans l'organisation des locaux universitaires. Dès 1997, le nouveau ministre de l'enseignement supérieur a cependant décidé que le chantier de désamiantage s'inscrirait dans un projet plus vaste de rénovation du campus et de réorganisation des universités parisiennes. Cette décision a eu pour effet d'allonger considérablement le délai d'achèvement du chantier, qui devrait maintenant arriver à son terme entre 2012 et 2017.
Les représentants des syndicats comme du comité ont critiqué les conditions de déroulement des travaux : ils ont dénoncé un manque de réflexion d'ensemble sur l'avenir du site, l'absence de structure de pilotage efficace, la lenteur des travaux de rénovation et le coût élevé des locaux occupés à titre provisoire. Ils se sont interrogés sur les conséquences du déménagement de l'université Paris VII, qui va entraîner le dédoublement de nombreux équipements. Ils ont, de manière générale, estimé que les présidents des universités accordaient trop peu d'attention aux problèmes de santé et de sécurité au travail, citant, à titre d'exemple, la lenteur avec laquelle ils ont répondu aux demandes répétées des services de sécurité de la préfecture tendant à ce que soit installée sur le campus une alarme incendie.
Si le chantier de désamiantage fait l'objet de contrôles rigoureux, qui s'expliquent sans doute par l'attention soutenue des médias et des personnels, il n'en est pas de même des travaux d'entretien effectués par des intervenants extérieurs dans des bâtiments amiantés. Le caractère très contraignant des règles de sécurité conduit à douter de leur stricte application par ces salariés. Or, il est impossible de demander à l'inspection du travail ou à un huissier de vérifier le respect de la règlementation en raison du statut public du site universitaire.
Le représentant de la CGT a mis en garde contre la tentation consistant à tirer prétexte de la lenteur des travaux pour céder le site universitaire à des intérêts privés et a souligné que les opérations de déménagement et de dépoussiérage avaient été mal conduites.
Les représentants du SNESUP-FSU ont insisté sur les mauvaises conditions de travail découlant de l'éclatement des équipes universitaires sur de multiples sites, pendant le déroulement des travaux, et sur le découragement résultant des incertitudes entourant la date et les conditions du retour à Jussieu.
*
La délégation de la mission a achevé son déplacement sur le site universitaire de Jussieu par une visite du chantier de désamiantage et de locaux désamiantés d'une barre, en attente de sa nouvelle affectation .
Compte rendu du déplacement en
Corse
2 et 3 juin 2005
Composition de la délégation : MM.
Jean-Marie Vanlerenberghe, président,
Gérard Dériot,
rapporteur, Roland Muzeau, vice-président,
Mmes Sylvie Desmarescaux,
secrétaire, et Catherine Procaccia.
Jeudi 2 juin 2005
La délégation de la mission a d'abord été conviée par M. Jean-Luc Videlaine, préfet de la Haute-Corse, à un déjeuner à la préfecture. A l'issue de ce déjeuner, elle a procédé à une série d'auditions thématiques sur l'amiante en Corse.
- Réunions de travail à la préfecture
1. Histoire et actualité du risque amiante en Corse
Participants :
- M. Delga, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse ;
- M. Méria, inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales à la DDASS, auteur de L'aventure industrielle de l'amiante en Corse.
M. Delga a d'abord rappelé que la Haute-Corse était confrontée à deux problèmes spécifiques liés à l'amiante :
- l'existence d'une friche industrielle à Canari, à l'emplacement de l'ancienne mine d'amiante ; à cet égard, le projet, conçu dans les années 1980, de réutiliser des locaux de l'ancienne mine pour les sapeurs forestiers du conseil général a suscité de légitimes inquiétudes ;
- la présence d'amiante à l'état naturel : des plaques pleurales ont été ainsi constatées chez des personnes qui n'ont jamais été associées à l'exploitation de la mine.
Les mesures de l'empoussièrement de l'atmosphère réalisées jusqu'alors n'étant pas exploitables, plusieurs associations de protection de l'environnement ont décidé, en 1996, de saisir le préfet Erignac de la question des effets de l'amiante sur la santé de la population, posant ainsi le problème de l'amiante environnemental.
Il était initialement prévu d'effectuer une étude épidémiologique dans les villages de Haute-Corse les plus concernés par le risque amiante. Un cahier des charges avait été élaboré, en relation avec l'Institut de veille sanitaire (InVS), en 1998/99. Toutefois, la dispersion de la population concernée rendait une telle étude malaisée et le contexte particulièrement tendu en Corse à cette époque a conduit à l'abandon du projet.
L'analyse de l'amiante environnemental a été réalisée, de 2001 à 2004, au moyen d'études métrologiques consistant à effectuer des mesures dans les sites les plus amiantifères, en les comparant à un site-test de l'Ile Rousse dépourvu d'amiante, ces mesures ayant été confiées au laboratoire des particules inhalées. A Bastia, par exemple, il a été démontré que les valeurs limites de la présence d'amiante avaient largement été dépassées, ainsi que dans plusieurs petits villages.
L'élaboration d'un modèle mathématique a permis d'étudier les incidences de la présence d'amiante sur les différents sites. Sur la base des résultats de cette étude, il a été décidé de mettre en oeuvre le principe de précaution, en particulier dans deux directions :
- l'amélioration des connaissances environnementales sur les communes les plus touchées, en particulier Bastia et Corte, en relation avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
- le développement de l'information, par une information générale en direction de la population, l'élaboration de CD-ROM et une politique de formation destinée, notamment, aux chefs d'entreprise.
Des questions se posent en matière de réglementation du travail : peut-on arrêter un chantier dès lors que la sécurité au travail n'est pas assurée ? Dans quelle catégorie de décharges peut-on transporter et stocker des déblais amiantifères ? Quelle est la réglementation applicable en matière de droit de la construction dans les zones amiantifères ?
M. Méria a d'abord évoqué ses souvenirs d'enfance liés à la mine de Canari, où les mineurs apparaissaient comme autant de « Pères Noël blancs » et où les sacs d'amiante étaient transportés sans précautions particulières, y compris par les dockers du port de Bastia. Il a été sensibilisé très jeune au problème de l'amiante, notamment par son père syndicaliste qui connaissait des mineurs ou anciens mineurs présentant des pathologies liées à l'amiante, en particulier des asbestoses et des mésothéliomes.
Son travail d'historien sur la mémoire de la mine s'est appuyé sur des recherches documentaires, les archives paternelles et de nombreux témoignages. Il a indiqué que son ouvrage était volontairement technique et non polémique et que celui-ci a été récompensé par une distinction scientifique de la collectivité territoriale de Corse.
Il a ajouté que la mine avait permis de donner un travail à la population et avait contribué au développement économique de la région, dans le respect de la réglementation de la sécurité au travail, en particulier du décret de 1913 sur l'empoussièrement dans les ateliers. Illustrant ses propos par des photographies prises dans les années 1950, il a attiré l'attention de la mission sur l'ampleur du nuage de poussière qui était alors visible. Le comité d'hygiène de la mine, ainsi que des ingénieurs venus de Marseille, avaient évoqué le problème de l'empoussièrement dès 1950. De surcroît, la capacité de production de la mine avait été accrue à partir de 1954 après l'installation de la deuxième partie de l'usine, sans que des précautions supplémentaires aient été prises en matière de sécurité au travail.
Si 1.413 personnes ont travaillé sur le site de Canari, dont des Marocains, des Turcs, des Italiens, et même des prisonniers de guerre allemands dans les années d'après-guerre, il est difficile d'évaluer précisément le nombre de salariés décédés ou malades car on a perdu la trace de nombre d'entre eux, repartis dans leur pays d'origine ou sur le continent.
Présentant d'autres photographies du site et de la côte, il a évoqué la dégradation de l'environnement causée par le rejet de stériles provenant de la mine, alors que, dès 1960, un arrêté préfectoral, resté lettre-morte, prescrivait de réduire l'empoussièrement et interdisait le rejet des stériles à la mer.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a été chargée de la réhabilitation du site, mais les travaux, après avoir été à plusieurs reprises repoussés, n'ont toujours pas commencé. D'après des mesures effectuées, il y aurait désormais davantage de fibres d'amiante en suspension dans les villages environnants que sur le site de la mine.
La réaction de la population et des élus est ambivalente, car, si les dangers de l'amiante peuvent être évoqués, des craintes pour le tourisme ou le développement économique de la région sont également exprimées.
La mine de Canari, qui était la propriété de la société Eternit, a fermé en 1965, essentiellement pour des raisons économiques, au grand dam de la population. La mine, dont les bénéfices diminuaient, subissait la concurrence du Canada ou de l'Afrique du Sud, où l'amiante produit était moins cher. La commune de Canari a acheté ce site aujourd'hui orphelin dont elle ne peut évidemment assumer la réhabilitation.
2. La défense des victimes de l'amiante
Participants :
- Mme Nowak et M. Le Touzet, de l'ARDEVA PACA/Corse, et des anciens mineurs et salariés ;
- M. Masotti, président de l'association CORSICA PER VIVE.
Les anciens mineurs de Canari ont commencé par évoquer les difficiles conditions de travail qu'ils ont connues pendant toute la durée d'exploitation de la mine. Ils ont souligné l'absence de mesure de prévention et d'information sur les dangers de l'amiante, dont ils ont affirmé que leur employeur avait pourtant pleinement conscience à l'époque. Les masques de protection mis à leur disposition étaient peu utilisés dans la mesure où leur port était difficilement supportable à l'intérieur de la mine.
D'autres témoins ont cependant rappelé que le directeur de la mine vivait avec sa famille sur le site de Canari et qu'il était donc autant exposé à l'amiante que les autres salariés. Ils ont insisté sur la prospérité économique que l'exploitation de l'amiante, qui faisait vivre directement 300 personnes, sans compter les emplois induits, avait apportée au village et à sa région.
Outre les mineurs, des salariés affectés à des opérations de manutention ont également été contaminés par l'amiante. Un ancien docker, qui a travaillé douze ans dans le port de Bastia, a indiqué souffrir d'une maladie de l'amiante, dont les premiers symptômes se sont manifestés il y a une dizaine d'années.
La fille d'un ancien mineur a déploré que le diagnostic de l'asbestose de son père ait été très tardif, les médecins consultés ayant longtemps posé le diagnostic de simples bronchites, en dépit d'examens radiologiques réguliers.
Les représentants de l'ARDEVA PACA/Corse ont alors rappelé que la conférence de consensus, qui s'est tenue en 1999 à la Villette, avait recommandé le recours au scanner pour diagnostiquer les maladies de l'amiante. L'utilisation du scanner n'est pourtant pas encore systématique dans le protocole de suivi des anciens travailleurs de l'amiante et la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale est souvent réticente à prendre en charge ces examens coûteux.
D'autres témoins ont affirmé que la décision de fermer la mine s'expliquait par l'apparition des premiers problèmes de santé induits par l'amiante. Ils ont noté que des salariés venaient du continent pour travailler sur le site mais se gardaient bien de résider à proximité. D'anciens mineurs ont indiqué qu'ils avaient pris conscience des risques inhérents à l'exposition à l'amiante au milieu des années 1980.
Puis les représentants de l'ARDEVA ont évoqué les problèmes posés par la présence de terres amiantifères en Corse : tous les chantiers de BTP réalisés sur ces terrains diffusent de la poussière d'amiante alentour, ce qui menace tant les salariés que les riverains. Ils ont invité les membres de la délégation à réfléchir à une législation sur les terres amiantifères.
Ils ont ensuite fait part des difficultés que rencontrent les victimes de l'amiante pour obtenir la reconnaissance de leurs maladies professionnelles. Il arrive que les médecins retiennent une désignation des maladies dont ils sont atteints légèrement différente de celle figurant au tableau 30 des maladies professionnelles, ce qui fait obstacle à leur reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie. Il est également fréquent que des dossiers médicaux anciens, remontant à l'époque de la contamination, soient égarés et qu'il manque de ce fait des éléments pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Ils ont enfin indiqué que le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bastia avait, en 2004, reconnu pour la première fois la faute inexcusable de l'employeur dans une affaire concernant un ancien salarié de la mine et qu'une décision similaire avait été rendue en 2005.
La délégation de la mission a ensuite auditionné M. Masotti, président de l'association Corsica per vive , accompagné de sa collaboratrice.
M. Masotti a fait part de son expérience associative et de son engagement pour la défense des victimes. Membre du Comité national des chômeurs et précaires (MNCP), il a longtemps travaillé avec l'ANDEVA avant d'être sollicité pour fonder, en Corse, une association de défense des victimes de l'amiante. L'association Corsica per vive, dont la compétence apparaît très large, gère aujourd'hui 130 dossiers, dont les trois quarts concernent des victimes de la mine de Canari.
Il a également exposé son expérience professionnelle au contact de l'amiante : ancien chauffeur routier, il a fréquemment transporté de l'amiante, en particulier des plaques de couverture en amiante-ciment et a donc été exposé à d'importantes quantités de fibres.
3. Application de la législation HSCT par les entreprises
Participants :
- Mme Burdy, inspectrice du travail ;
- M. Dubois, médecin du travail.
Mme Burdy a indiqué être entrée en fonction en mai 1997. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle s'intéressait aux travaux d'élargissement de la route de Canari, subventionnés par le conseil général, elle a eu connaissance de la présence de terrains amiantifères en Haute-Corse.
Notant que les textes relatifs à la sécurité visaient essentiellement l'habitat, mais quasiment pas l'environnement, elle a été conduite à prendre en compte la protection des salariés amenés à travailler sur les chantiers exposés aux poussières d'amiante. A cette fin, elle a élaboré une méthodologie d'intervention sur les chantiers amiantifères, à la fin 1997.
Afin de permettre aux entreprises concernées d'avoir connaissance du risque, le préfet a autorisé, en 1999, la diffusion de la cartographie du BRGM.
S'agissant des déblais amiantés, les articles R. 231-54 et R. 231-56 du code du travail imposent aux employeurs des obligations en matière de prévention contre les risques d'exposition ; selon elle, la présence d'amiante sur les chantiers continuera d'être dissimulée tant qu'un dispositif de stockage des déblais n'aura pas été institué afin de prévenir leur réutilisation ou leur dépôt dans des décharges sauvages.
En effet, la tentation d'utiliser ces déblais est toujours grande, d'autant plus qu'ils ont une valeur marchande, même si un décret de 1996 a interdit une telle pratique. Le stockage de ces déblais relève d'une mission de service public car l'Etat doit prévenir les problèmes de santé publique, mais en convaincre le ministère du travail a demandé des années. Dans ce domaine, elle a estimé que l'intervention du secteur privé n'était pas souhaitable.
Par ailleurs, les entreprises ont l'obligation d'évaluer les taux d'empoussièrement et de communiquer ces informations à l'inspection du travail.
En 1999, des études expérimentales sur la dangerosité des travaux d'excavation ont été demandées à l'INRS, mais les premières mesures sérieuses n'ont été effectuées qu'en 2004.
Certaines mesures pratiques relativement simples, réclamées depuis des années, ne sont toujours pas mises en oeuvre par les entreprises, comme le recouvrement par asphalte des déblais de chantier, nécessaire pour éviter la dispersion des poussières par le vent. Les textes réglementaires existants devraient ainsi, selon elle, être complétés par un volet consacré à la protection de l'environnement.
L'étude épidémiologique sur l'amiante environnemental réalisée en septembre 2004 a conduit à demander à l'InVS d'inclure une étude épidémiologique spécifique sur le mésothéliome dans son programme de travail pour 2005.
M. Dubois a regretté qu'il ait fallu attendre la réflexion engagée sur le chantier de Canari pour que la question de la contamination des salariés mais aussi de la population soit posée.
Il a indiqué que les études révélaient des pics de pollution très importants sur les chantiers lors des opérations de creusement et de chargement, même à l'air libre, et a également insisté sur la nécessité de recouvrir les déblais amiantifères et de procéder à l'arrosage des sites concernés.
Il a cependant souligné la difficulté d'arrêter les chantiers en cours et de convaincre les chefs d'entreprise, ce qui pose le problème de l'autorisation de construire.
Il a noté que les chantiers situés sur des terrains amiantifères étaient autrefois limités, mais que ceux-ci avaient aujourd'hui tendance à se développer à l'occasion de grandes opérations immobilières, notamment à Bastia ; il en résulte une plus grande exposition des populations sur le plan environnemental, qui risque de se traduire par une explosion des pathologies dans 20 ou 30 ans.
Des examens pratiqués par scanner auprès des salariés du BTP font d'ores et déjà découvrir des plaques pleurales, mais pas encore de pathologies plus graves, compte tenu du délai de latence.
Enfin, il a rappelé que les mineurs de Canari bénéficiaient d'un suivi médical assuré par un médecin d'entreprise, les radiographies des personnels étant déposées dans les archives de la médecine du travail, et donc consultables.
4. Contentieux de l'indemnisation des victimes de l'amiante
Participants :
- Mme Lucciani, présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
- M. Fagny, procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bastia ;
- Mme Massoni, rédacteur juridique à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.
Le procureur de la République a indiqué que son tribunal n'avait été, à ce jour, saisi d'aucune plainte dans une affaire liée à la contamination par l'amiante. Il s'est ensuite interrogé sur les conditions d'application du décret n° 96-98 du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, pour les chantiers réalisés sur des terrains amiantifères.
Interrogé sur la loi Fauchon, il a estimé que ses dispositions rendaient plus difficiles la mise en cause des donneurs d'ordre, tout en admettant que, la jurisprudence n'étant pas encore fixée, des différences d'appréciations existaient selon les tribunaux.
La présidente du TASS de Bastia a souligné que sa juridiction avait été saisie, depuis novembre 2003, de 37 demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en relation avec l'exploitation de la mine de Canari, et de 17 recours dirigés contre des refus de reconnaissance de maladies professionnelles. Elle a noté que le TASS de Bastia accordait aux victimes de l'amiante des indemnités supérieures à celles allouées par le FIVA.
La représentante de la CPAM a observé que le FIVA avait été créé dans un souci d'équité, mais que cet objectif était contrarié par les différences d'indemnisation accordées par les tribunaux. Elle a indiqué que 81 reconnaissances de maladies professionnelles avaient été accordées depuis 2000, tandis que 19 demandes avaient été rejetées.
La présidente du TASS a expliqué que la reconnaissance de la maladie professionnelle était souvent refusée au motif que les demandeurs se trouvaient dans l'incapacité, du fait de l'ancienneté de leur contamination, de produire leur premier certificat de constatation médicale d'une pathologie liée à l'amiante. La reconnaissance en maladie professionnelle est facilitée lorsque la victime est titulaire d'une pension d'invalidité, le bénéfice de cette prestation étant en effet subordonné à certaines constatations médicales.
Le procureur de la République a fait état d'une procédure initiée, en 2003, à l'encontre d'un promoteur immobilier, maître d'ouvrage d'un chantier situé près de Bastia. L'inspection du travail a constaté des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail et un défaut d'information des salariés sur le caractère amiantifère du terrain. Les déblais étaient de surcroît transportés dans des camions non bâchés et déversés quelques kilomètres plus loin sans précaution aucune.
L'inspection du travail a d'abord demandé, en référé, l'interruption du chantier, qui lui a été refusée : le juge a ordonné, d'une part, que des expertises soient conduites, pour évaluer la présence d'amiante, d'autre part, que des mesures de protection des salariés soient appliquées, sous peine d'astreinte.
L'inspection du travail a cependant rapidement constaté que ces mesures de protection n'étaient pas mises en oeuvre par l'entrepreneur et a dressé un nouveau procès-verbal constatant ces infractions. Il s'en est suivi une enquête préliminaire, débouchant sur une citation directe, par le parquet, devant le tribunal correctionnel.
L'avocat du maître d'oeuvre a contesté que le décret de 1996, conçu surtout pour protéger les ouvriers des chantiers de déflocage, soit applicable à ce type de chantier à ciel ouvert. Interrogé, le ministère du travail a cependant indiqué que le décret trouvait bien à s'appliquer dans ce cas de figure, de même que les règles générales prévues pour la protection des salariés exposés à des matières cancérigènes. Le tribunal correctionnel n'a pas encore rendu sa décision sur cette affaire.
5. Prise en compte du risque amiante par les entreprises
Participant : M. Femenia, président de la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse.
M. Femenia a indiqué avoir créé son entreprise en Corse en 1964, soit avant la fermeture de la mine de Canari. Au moment de la fermeture, il a employé des chaudronniers qui avaient travaillé dans la mine, et a signalé le décès, dû à l'amiante, d'un de ses anciens salariés.
Une convention a été signée, le 19 mai 2005, avec la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, aux termes de laquelle la CCI s'engage, auprès des entreprises, à allouer des personnels à la prévention des risques liés au travail. Le champ d'application de ce dispositif de prévention n'est pas limité à l'amiante mais inclut naturellement ce matériau.
Les terrains amiantifères sont nombreux en Haute-Corse et même à Bastia : la préfecture elle-même est construite sur l'un d'entre eux. Certaines entreprises préfèrent payer une amende pour pouvoir continuer les chantiers.
Il existe plusieurs gros projets, dont la construction d'un centre d'affaires, qui imposent de prendre des mesures de précaution en urgence, en particulier le recours à des camions étanches qui chargeraient les déblais amiantifères préalablement mouillés afin d'éviter la dispersion des poussières et les transporteraient dans des lieux de stockage. Près de l'aéroport de Bastia, des gravières régulièrement inondées, aménagées à cet effet, pourraient servir de lieux de dépôt de ces matériaux.
M. Femenia a enfin rappelé que la mine de Canari a été fermée, en 1965, parce que l'amiante qui y était produit était devenu trop cher par rapport à celui du Canada, l'argument de la nocivité de l'amiante n'ayant en revanche jamais été évoqué.
6. Les pathologies liées à l'amiante
Participant : Dr Mouries, pneumologue au centre hospitalier de Bastia.
Le Dr Mouries a rappelé que le problème de l'amiante était connu de longue date ; la communauté médicale a d'abord constaté des pathologies particulières affectant les mineurs de Canari, avant d'observer une surmortalité par asbestose ou cancer bronchique au sein de cette population. Le nombre de mésothéliomes est également en augmentation, bien que les mineurs aient été exposés à la variété d'amiante chrysotile réputée moins nocive pour la santé humaine.
Des études géologiques ont, en outre, démontré une corrélation entre la présence d'affleurements d'amiante dans les villages et la fréquence des plaques pleurales, qui affectent parfois 20 % à 25 % de la population. Une corrélation statistique identique a ensuite été observée entre la présence d'affleurements d'amiante et le risque de mésothéliome. Il est plus difficile d'établir une telle corrélation pour les cancers bronchiques, en raison du biais introduit par la consommation de tabac, qu'il est difficile de neutraliser sur le plan statistique. Le Dr Mouries a indiqué observer tous les deux ans, en moyenne, un cas de mésothéliome dont l'origine ne peut être attribuée à une exposition professionnelle à l'amiante.
Interrogé sur le problème de la sous-déclaration des maladies professionnelles, le Dr Mouries a indiqué que les mineurs avaient été bien suivis sur le plan médical et que le phénomène était donc certainement limité. La médiatisation du dossier de l'amiante est un autre facteur qui incite à la déclaration des maladies professionnelles.
Il a souligné que des plaquettes d'information avaient été réalisées pour présenter à la population les dangers auxquels les exposent les terrains amiantifères et les précautions à respecter. Il a indiqué que la destruction de la végétation suite à un feu de forêt accentuait le ravinement des sols et favorisait la dispersion de l'amiante.
7. Le projet de réhabilitation du site de Canari
Participant : M. Milano, délégué régional de l'ADEME.
M. Milano a rappelé que l'ADEME avait été saisie du problème posé par le site de Canari, fin 1998, par un arrêté préfectoral et qu'elle était désormais maître d'ouvrage de la réhabilitation du site.
De nombreuses études ont été réalisées par le BRGM pour le compte de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), dont une étude de référence, globale, sur le site de Canari. Ces études ont mis en évidence trois types de risques : un risque de dangerosité général du site (qui comporte deux cratères et plusieurs galeries souterraines), un risque amiante, un risque d'instabilité des talus. Ce dernier est apparu au préfet comme le risque le plus important et le plus immédiat.
Les études du BRGM, et celles de l'INERIS, avaient conclu à l'absence de risque sanitaire au regard de l'amiante. L'arrêté préfectoral ne l'avait donc pas pris en compte. De surcroît, les autorités, notamment locales, répugnent à évoquer le risque sanitaire en raison de la fréquentation touristique du Cap Corse, et de la présence de deux plages de stériles.
S'agissant des étapes du calendrier de réhabilitation, l'arrêté préfectoral d'exécution des travaux a été publié en janvier 2004, le début de la première tranche des travaux, consacrée à la mise en sécurité du site contre le risque d'éboulement, est prévu pour le printemps 2006, et le début de la 2ème tranche, avec l'intervention des engins de chantier, pour octobre 2007.
L'ADEME est chargée d'étudier la stabilisation mécanique des dépôts sur le site. Le principal problème auquel elle est confrontée est celui de la mise en sécurité de la route départementale, très fréquentée pendant la période estivale.
La phase actuelle des travaux est celle de la mise en sécurité du site, qui nécessite de prendre de grandes précautions, à la fois individuelles et collectives, au regard du risque sanitaire pour ceux qui se rendent sur le site : les travaux de « retalutage » et de reprofilage constituent une source d'inquiétudes et il est impératif de limiter les envols de poussières en humidifiant le chantier et en menant ces travaux de stabilisation plutôt en hiver. Le coût de cette phase de stabilisation a été fixé à 4,5 millions d'euros, avec un surcoût de 35 % à 45 % résultant du caractère amiantifère du chantier, ce qui pose un problème budgétaire à l'ADEME, même si ces travaux bénéficient d'un cofinancement européen. Une procédure de recherche de responsabilité est engagée à l'encontre de la société Eternit, ancienne propriétaire de la mine, avec l'objectif de la faire participer au financement des travaux.
Les conditions de la revitalisation naturelle seront ensuite recréées, notamment grâce à une revégétalisation.
Le site n'est actuellement pas entièrement clos, ce qui pose un problème de sécurité du public. L'ADEME a toutefois l'intention de clôturer la totalité du site pendant les travaux et de poser des panneaux de signalisation du danger.
Au total, compte tenu de la spécificité du site de la mine de Canari, de l'utilisation qui en est faite par la commune, qui y dépose ses ordures ménagères par une route vertigineuse dans des conditions quelque peu acrobatiques, de l'attitude légitime des élus, soucieux de l'activité touristique, de l'ampleur du projet de remodelage des pentes en respectant tous les impératifs de sécurité, de la responsabilité encourue par le maître d'ouvrage, la réhabilitation du site de la mine par l'ADEME apparaît particulièrement délicate, en particulier en raison de l'imbroglio juridique dans lequel elle doit se réaliser.
Vendredi 3 juin 2005
- Table ronde avec les élus à la mairie de Canari
Participants : MM. Bertoni, maire de Canari, Motroni, conseiller général de Canari, Giorgetti, maire d'Olcani, Boncompagni, maire d'Olmeta du Cap, Mme Boncompagni, adjointe au maire d'Olmeta du Cap, MM. Klein-Orsini, responsable du « conservatoire du costume », Pedinielli, retraité, Santini, conseiller municipal de Canari, Granini, retraité, Santini, retraité, Caniffi, conseiller municipal de Canari, Collilieux, retraité, Burini, maire de Nonza, Meria, représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, Morganti, maire d'Ogliastro.
M. Bertoni, maire de Canari , a accueilli la mission de la délégation et a présenté sa commune : comptant 300 habitants permanents, et 1.500 l'été, le village de Canari se distingue par une présence encore significative des services publics et des commerces, qui peut s'interpréter comme un héritage de la période de prospérité assurée par la mine. Le tourisme, stimulé par la présence d'un musée du costume et de nombreux chemins de randonnée, est aujourd'hui la principale ressource économique du village, dont une partie de la population exerce cependant son activité professionnelle sur Bastia.
La commune a acheté la mine à la société Eternit en 1973 et utilise actuellement le site comme décharge d'ordures ménagères. L'ADEME pilote, pour le compte de l'Etat, les opérations de réhabilitation de la mine : il est indispensable, en particulier, de stabiliser les verses afin d'éviter des éboulements sur la route en contrebas. Les travaux devraient commencer en octobre 2006. La mine cesserait d'être utilisée pour le stockage des ordures ménagères, qui seraient envoyées vers un nouveau site de traitement.
M. Mortoni, conseiller général de Canari , a rappelé que la mine était exploitée à ciel ouvert, sans considération pour la santé des salariés ou des riverains, et l'a qualifiée, de manière imagée, d' « enfer blanc ». Pourtant, sa fermeture fut, à l'époque, accueillie avec regret : la mine a employé jusqu'à 300 ouvriers et était la principale source d'activité économique de la région ; les salariés n'avaient, en outre, pas conscience, alors, des dangers de l'amiante. Il a ajouté que les données scientifiques disponibles ne permettaient pas de déterminer si les riverains étaient aujourd'hui menacés du fait de la proximité du site et il a souhaité que des études complémentaires soient menées à ce sujet.
Il a noté que la réhabilitation du site impliquait qu'un important travail de déflocage et de dépoussiérage de l'usine soit réalisé et a demandé que le chantier soit mené jusqu'à son terme. Il a insisté sur le lourd fardeau que représente la mine pour la petite commune de Canari et a souhaité un soutien accru de l'Etat, qui tienne compte cependant de la nécessité de ne pas inquiéter de manière déraisonnable les habitants et les touristes, ce qui ferait obstacle au développement du village.
M. Burini, maire de Nonza , a indiqué que sa commune n'avait pas bénéficié des retombées économiques positives associées à la mine, mais que son exploitation avait abouti à la formation d'une plage constituée de stériles, c'est-à-dire de rejets de la mine, sur son territoire. Il s'est plaint de n'avoir perçu aucune compensation de l'Etat et a regretté que plusieurs guides touristiques aient associé le nom de son village à l'amiante, occasionnant ainsi un réel préjudice économique.
M. Morganti, maire d'Ogliastro , a expliqué que sa commune était également bordée par une plage de stériles et a regretté que l'Etat soit incapable d'informer précisément sur les risques encourus par les habitants.
M. Giorgetti, maire d'Olcani , a indiqué être lui même victime de l'amiante et s'est plaint de ne pas percevoir d'indemnité du FIVA, son dossier étant encore en instance d'instruction.
M. Boncompagni, maire d'Olmeta du Cap , a estimé que les indemnisations étaient très difficiles à obtenir : si les radios et scanners ne permettent pas de détecter de lésions, aucune indemnisation n'est attribuée, quand bien même l'exposition à l'amiante serait établie.
Plusieurs victimes de l'amiante ont ensuite déclaré qu'elles avaient accepté les indemnisations proposées par le FIVA, avant de constater que certains tribunaux accordaient des indemnités supérieures, pour des pathologies parfois plus bénignes. Elles ressentent un sentiment d'injustice face à cette différence de traitement peu justifiée.
Le maire de Canari a conclu la réunion en indiquant que ses administrés n'étaient pas excessivement inquiets de la présence d'amiante à proximité de la commune et qu'ils faisaient souvent preuve, sur ce sujet, d'un certain fatalisme.
Cette réunion a été suivie d'un déjeuner de travail avec les élus locaux , à la Marine d'Albo sur la commune d'Ogliastro.
Guidée par M. Filippi, ingénieur à la délégation régionale de l'ADEME, qui a mis à disposition les équipements de protection nécessaires, et avec le concours de M. Morganti, maire d'Ogliastro, qui a gracieusement prêté son véhicule personnel, la délégation de la mission a ensuite visité le site de la mine. Les sénateurs ont notamment pu apprécier les difficiles conditions d'accès au site et l'ampleur des excavations formées dans la roche par l'extraction de l'amiante. D'immenses cratères accueillent d'importantes quantités de déchets ménagers, qui sont parfois incendiés par des personnes malveillantes.
*
Le déplacement de la délégation de la mission s'est achevé par une conférence de presse organisée à la préfecture de Haute-Corse .
* 1 L'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir, par M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Henri Revol, sénateur, n° 329 AN (XIe législature) et n° 41, Sénat (1997-1998).
* 2 Une « réclame » publiée par l'Illustration du 30 mars 1929, titrée : « Tout en Eternit, à la maison, à la ferme, à l'usine », propose ainsi au service du client « ardoises, plaques ondulées, plaques planes, tuyaux, hourdis » et va même jusqu'à représenter un abri canin confectionné en amiante-ciment ondulé. Dès le début des années 30, la société anonyme française Eternit, sise à Prouvy-Thiant dans le département du Nord, au capital de 5 millions de francs, créée par l'industriel Georges Cuvelier en 1922, se présente comme « la plus ancienne et la plus importante marque du monde ». Elle a mis en exploitation la mine de Canari, au Cap corse, en 1927.
* 3 En dépit de la création de l'InVS en 1998, les autorités sanitaires sont passées à côté du drame de la canicule de l'été 2003.
* 4 D'après le rapport de la mission d'information de la commission des affaires culturelles du Sénat « Voyage au bout... de l'immobilier universitaire » (Président : M. Jacques Valade ; rapporteur : M. Jean-Léonce Dupont) n° 213 (2002-2003), le coût du programme de mise en sécurité et la réhabilitation de Jussieu devraient représenter environ le dixième du total des crédits du plan U3M, le tiers des crédits apportés par l'État pour l'université dans les contrats de plan 2000-2006, un coût supérieur aux crédits d'État du seul contrat de plan francilien, le double des crédits inscrits dans le CPER pour le programme universitaire d'aménagement de la ZAC Rive-Gauche et un coût très supérieur à celui de la restructuration de l'ensemble des universités parisiennes... étant rappelé que l'université de Paris VI, qui devrait être la seule à rester à Jussieu, avec l'Institut de physique du Globe, n'accueille que quelque 20.000 étudiants, soit environ 1 % de l'ensemble des étudiants accueillis dans notre système universitaire. Le jeu en valait-il la chandelle ?
* 5 Editions Le cherche midi, octobre 2004.
* 6 Le terme asbeste est un synonyme d'amiante et provient du latin asbestos, qui signifie incombustible.
* 7 Tétraèdres silicate.
* 8 Union des industries et métiers de la métallurgie.
* 9 On estime à 174 millions de tonnes l'amiante produit dans le monde au cours du XX e siècle.
* 10 Rappelons que le professeur Claude Got a estimé qu'au XX e siècle, la France avait importé l'équivalent de 80 kg d'amiante par habitant.
* 11 Sur ce point, on se reportera avec profit au supplément n° 1082 de la Semaine sociale Lamy, du 1 er juillet 2002, intitulé L'affaire de l'amiante, établi par M e Jean-Paul Teissonnière et Mme Sylvie Topaloff.
* 12 La loi du 12 juin 1893 porte sur les poussières industrielles : « Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors de l'atelier, au fur et à mesure de leur production. [...] L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ».
* 13 L'Association française de l'amiante.
* 14 Le texte de cette lettre est reproduit dans l'ouvrage de M. François Malye, Amiante : 100.000 morts à venir (annexe 5).
* 15 Les fibroses pleurales représentent plus de 50 % des dossiers reçus par le FIVA et 70 % des maladies prises en charge par le régime général en 2001.
* 16 Mme Martine Aubry, ancienne ministre de l'emploi et de la solidarité, a ainsi indiqué, devant la mission, que « nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre d'éléments, par exemple les plaques pleurales, peuvent entraîner et entraînent malheureusement dans la plupart des cas des maladies qui sont fatales ».
* 17 Au cours de son audition, M. François Martin, président de l'ALDEVA de Condé-sur-Noireau, a estimé que « le monde médical est aujourd'hui dans l'incapacité de prouver que ces plaques sont une cause de mortalité », ajoutant que « des personnes ayant développé d'importantes plaques pleurales sont décédées à Condé-sur-Noireau ». De même, M. Didier Payen, représentant de la CGT, a noté que « la mort prématurée de nos camarades a pratiquement toujours commencé par des plaques pleurales et des épaississements pleuraux ». Lors du déplacement d'une délégation de la mission à Dunkerque, les représentants de l'association régionale des victimes de l'amiante (ARDEVA) ont eux aussi réfuté la distinction entre les maladies bénignes et les maladies malignes, estimant qu'elles étaient toutes invalidantes.
* 18 Difficulté de la respiration.
* 19 Notamment des études publiées en anglais en 1998 et 2000.
* 20 On rappellera que l'asbestose est reconnue comme maladie professionnelle au Royaume-Uni depuis 1925.
* 21 Rappelons que 40 tonnes d'amiante ont été retirées de la barre 65-66 de Jussieu.
* 22 Sur cette question, on se reportera avec profit au rapport d'information n° 213 (2002-2003) de MM. Jacques Valade et Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, intitulé « Voyage au bout... de l'immobilier universitaire ».
* 23 Cette réunion a eu lieu le 20 décembre 1994.
* 24 Rapport d'information Assemblée nationale n° 329 (XI e législature) et Sénat n° 41 (1997-1998), intitulé L'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir.
* 25 D'autres témoins ont cependant rappelé que le directeur de la mine vivait avec sa famille sur le site de Canari et qu'il était donc autant exposé à l'amiante que les autres salariés.
* 26 Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
* 27 Ce document est reproduit dans l'ouvrage de M. François Malye, Amiante : 100.000 morts à venir (annexe 4).
* 28 Dans leur ouvrage précité, MM. Francis Chateauraynaud et Didier Torny notent que « le professeur Jean Bignon apparaît comme un des acteurs décisifs du dossier de l'amiante. Mais ce qui est frappant dans son cas, c'est le changement de position qu'il opère entre les deux périodes, changement qui est rapporté, selon les critiques, à sa participation au CPA au cours des années quatre-vingt. Car à la fin des années soixante-dix, il semble clairement relayer les inquiétudes en reprenant à son compte l'annonce d'une épidémie de mésothéliomes ». Avançant une tentative d'explication, ils indiquent que « les porte-parole, militants et défenseurs de cause ont autre chose à faire que de maintenir la pression en payant directement de leur personne. On retrouve ici le schéma classique dans lequel une mobilisation s'arrête après avoir imposé l'inscription sur l'agenda politique d'une cause collective ».
* 29 Question écrite n° 59710.
* 30 Lettre du 6 février 1989 de Marcel Valtat à M. Michel Rocard.
* 31 MM. Francis Chateauraynaud et Didier Torny, dans leur ouvrage précité, notent que, « pendant toute la période muette [1980-1994], le professeur Bignon occupe une place stratégique dans la production de l'expertise. [...] il est sollicité par la plupart des acteurs du domaine ». Le type de formulation qu'il emploie « vise à faire état des incertitudes qui traversent les milieux scientifiques et permet d'asseoir la nécessité d'un travail scientifique continu. Ce faisant, il rend quasiment impossible toute évolution vers l'alarme ».
* 32 Agence américaine de protection de l'environnement.
* 33 Dans une circulaire du 14 mai 1985 relative à la prévention des cancers d'origine professionnelle, adressée, notamment, aux inspecteurs du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indiquait une nouvelle fois que « le recul de ces pathologies passe aussi par une information efficace des travailleurs concernés et par une action concertée sous la responsabilité de l'employeur, de l'ensemble des partenaires sociaux et du médecin du travail » et qu' « il est souhaitable qu'un contrôle médical adapté, destiné à prévenir ou à détecter précocement les cancers, soit programmé par le médecin du travail ».
* 34 Editions Maspero.
* 35 Directives du 19 septembre 1983 et du 25 juin 1991.
* 36 La directive du 25 juin 1991, en revanche, a été transposée le 6 juillet 1992, soit avant le délai limite du 1 er janvier 1993.
* 37 Pierre Sargos, L'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité, La semaine juridique édition générale n° 4, 22 janvier 2003.
* 38 Selon l'expression de M e Arnaud Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Droit social n° 4, avril 2002.
* 39 Cet article dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
* 40 Ainsi, dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation, dans une affaire se rapportant à l'affection liée à l'exposition aux rayonnements ionisants contractée par une salariée recrutée en qualité de manipulatrice radiologique au sein d'un établissement de soins, relevant que ce dernier avait respecté la réglementation en vigueur quant à la surveillance médicale des personnels affectés à de telles tâches et qu'il avait suivi les avis du médecin du travail, a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont elle entendait obtenir réparation.
* 41 Arrêts Cts Thomas et Mme Bourdignon.
* 42 Arrêts Cts Botella et Cts Xuereff.
* 43 Il s'agit de l'arrêt M. D.
* 44 Notons toutefois que les associations ne sont pas unanimes sur ce point, l'Association des accidentés de la vie (FNATH) portant une appréciation plus nuancée sur la « loi Fauchon ». Elle a notamment considéré que la distinction entre responsabilité directe et responsabilité indirecte ne lui apparaissait pas poser problème.
* 45 Petites affiches n° 93, 11 mai 2005.
* 46 Dans leur manuel intitulé Le nouveau droit pénal, tome 1 Droit pénal général (éditions Economica), MM. Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec notent que les dispositions introduites par la loi du 10 juillet 2000 « devraient en pratique bénéficier aux décideurs publics, sans pour autant affaiblir la répression des infractions d'imprudence dans des domaines sensibles comme celui de la sécurité routière, ou celui du droit du travail ».
* 47 C'est d'ailleurs le sens de la circulaire du 11 octobre 2000 : « En tout état de cause, cette faute devra évidemment être appréciée in concreto conformément aux exigences résultant de la loi du 13 mai 1996 et que rappelle toujours le troisième alinéa de l'article 121-3 ».
* 48 Enquête pilote Espaces - Identification et suivi médical post-professionnel des salariés retraités ayant été exposés à l'amiante, avril 2001.
* 49 Rapport précité, p. 18.
* 50 Le conseil de surveillance veille au respect de la règlementation et examine les comptes du FCAATA. Il transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport retraçant l'activité du fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission AT-MP de la CNAMTS et du conseil d'administration central de la MSA ainsi que de personnalités qualifiées.
* 51 Cf. la déclaration de Mme Marianne Lévy-Rozenwald : « en tout état de cause, il ne faut pas que l'ACAATA soit au niveau du salaire de référence puisque, à ce moment-là, tout un chacun aurait intérêt à entrer dans le système ».
* 52 95 % des personnes indemnisées par le FIVA sont reconnues atteintes d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.
* 53 Cf. Rapport d'information n°301, « Amiante : quelle indemnisation pour les victimes ? », 2004-2005.
* 54 Article 6 - I° du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
* 55 Prévue par l'article 7 du décret du 23 octobre 2001, cette commission est composée de cinq personnes : un président, nommé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, de la justice et du budget, deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'amiante et deux médecins spécialistes ou compétents en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses (maladies pulmonaires causées par l'inhalation prolongée de poussières).
* 56 Cf. rapport précité, p. 45.
* 57 Cf. rapport précité, p. 19.
* 58 Cf. Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, n° 68 (2000-2001).
* 59 Hypothèse : progression de 3 à 5 % du nombre de cas chaque année.
* 60 Rapport précité, p. 22.
* 61 Rapport n°59, tome IV (2003-2004), de M. André Lardeux, fait au nom de la commission des affaires sociales.
* 62 Rapport précité de la Cour des comptes, p. 74.
* 63 La « consolidation » est le moment où la rente peut être fixée, la gravité de la pathologie dont souffre la victime étant considérée comme définitive.
* 64 Article 53-IV-2 de la loi du 23 décembre 2000.
* 65 Le FIVA considère qu'une offre est confirmée lorsque la majoration de l'indemnisation est inférieure à 15 % pour les préjudices extrapatrimoniaux et lorsque le principe de l'indemnisation en rente sur la base d'une valeur du point croissante est conforté.
* 66 Le groupe des député(e)s communistes et républicains de l'Assemblée nationale a déposé en juillet 2005 une proposition de loi, enregistrée sous le numéro 2489, tendant à ouvrir le droit à la cessation anticipée d'activité pour les fonctionnaires territoriaux victimes de l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions.
* 67 Rapport précité, p. 29.
* 68 Les désordres du travail : enquête sur le nouveau productivisme. Philippe Askenasy, éditions du Seuil, 2004.
* 69 Tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, rapport n° 2004-17 présenté par Pierre-Louis Bras et Valérie Delahaye-Guillocheau, novembre 2004.
* 70 Cf. La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rapport présenté par le comité technique de pilotage de la réforme des accidents du travail, présidé par Michel Laroque, mars 2004.
* 71 Le décret en date du 24 décembre 1996 fixe l'interdiction totale de l'importation et de la mise sur le marché français de tout produit contenant de l'amiante à compter du 1 er janvier 1997, assortie de quelques dérogations jusqu'à la fin de l'année 2001 pour les cas où il n'a pas été possible de trouver des substituts présentant moins de risques pour la santé.
* 72 Ainsi, sur les 3,5 millions de m 2 que représente au total l'AP-HP, 2.000 m 2 de locaux ont été classés en niveau 3, correspondant aux situations dans lesquelles les matériaux étaient en mauvais état et 30.000 m 2 en niveau 2, l'incertitude sur l'état des matériaux impliquant la mise en place de mesures permettant de détecter la présence d'amiante dans l'atmosphère. Pour ces derniers, bien que les mesures effectuées aient révélés la présence de moins de 5 fibres d'amiante par litre d'air, M. Jean-Marc Boulanger a indiqué que le conseil d'administration avait décidé de faire néanmoins procéder au retrait.
* 73 Alors que les textes réglementaires fixent au 31 décembre 2003 pour les établissements scolaires la date d'achèvement obligatoire de ce document, seuls 40 % des collèges et 50 % des lycées l'avaient établi en avril 2005.
* 74 M. Jean-Marie Schléret a insisté sur le caractère aléatoire du sondage réalisé et sur les difficultés rencontrées lors de la seconde étude sur les écoles, seules 1.000 écoles ayant fourni une réponse.
* 75 La section 3 du décret est consacrée aux « activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante ».
* 76 Les informations fournies par la DARES 77 indiquent qu'« un ouvrier non qualifié du second oeuvre sur cinq est un apprenti en 1998 », et confirment la rotation rapide des effectifs : « les salariés ne restent que cinq ans en moyenne dans leur entreprise ou administration, le taux d'entrée est près de trois fois plus élevé dans ce métier qu'ailleurs et le taux de sortie deux fois plus ».
* 78 Dans un article du 3 juin 2004 publié par « La Tribune » et intitulé : « Mieux informer les entreprises sur les dangers liés à l'amiante ».
* 79 On estime à 160.000 le nombre de visiteurs qui ont fréquenté ces centres de ressources.
* 80 Il a notamment indiqué que le site Internet de l'INRS était visité 17.000 fois par jour et que 75.000 exemplaires de la revue Santé et Hygiène au travail étaient diffusés.
* 81 C'est ainsi que M. Gilles Evrard, de la CNAMTS, a qualifié la campagne de contrôle menée conjointement avec la DRT et l'INRS.
* 82 Dans un article du Figaro du lundi 14 mars 2005, intitulé « l'ombre de la justice plane sur des centaines de bâtiments ».
* 83 L'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 dispose que « la formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs ».
* 84 Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail.
* 85 Dont l'activité habituelle n'est pas d'intervenir directement sur les matériaux contenant de l'amiante.
* 86 L'article 10-3, alinéa 6, précise que « en cas de repérage d'un matériaux ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou technicien de la construction est tenu de le mentionner ».
* 87 Voir « La Croix » du 11 mai 2005 : « Amiante. Le recensement des bâtiments amiantés n'est toujours pas fait ».
* 88 L'article 10-5 du décret prévoit que le DTA est transmis aux occupants de l'immeuble bâti, mais les propriétaires privés ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un DTA.
* 89 D'après les informations fournies par l'EPA Jussieu, la surface totale amiantée est égale à 190.000 m 2 pour le gril, 24.000 m 2 sous la dalle et 11.000 m 2 dans la tour centrale.
* 90 Avant la fin de l'année 2003 pour les IGH et les ERP.
* 91 « La Croix » du 11 mai 2005.
* 92 « Les Echos » du 15 mars 2005 : « Les propriétaires ont jusqu'à la fin de l'année pour diagnostiquer l'amiante ».
* 93 Les résultats déclarés devraient se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme d'un tableau simple à deux dimensions afin d'assurer une fusion facile dans une base informatique.
* 94 Extrait de l'article du Journal « La Croix » précité.
* 95 On rappellera que l'article 5 du décret du 7 février 1996 précise que « Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis ». L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
* 96 « La Croix » du 11 mai 2005.
* 97 Par le décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
* 98 Le plan doit être soumis à l'avis du médecin du travail, du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
* 99 Directive européenne n° 2003-18 du 27 mars 2003 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail.
* 100 D'après les professionnels auditionnés, une centaine d'entreprises spécialisées se partageraient aujourd'hui ce marché, évalué à environ 300 millions d'euros par an, en progression annuelle de 8 à 10 %.
* 101 Date de l'entrée en vigueur de la première réglementation concernant les risques liés à l'amiante dans les habitations.
* 102 L'arrêté du 26 décembre 1997 porte homologation des référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualifications.
* 103 Le rapport dénonce principalement les surcoûts (1,39 milliard d'euros contre une estimation initiale de 135 millions d'euros) et le retard (prévue pour l'année 2000, la fin des travaux devrait être reportée à 2013).
* 104 Un arrêté préfectoral du 22 juillet 2004 a autorisé la prorogation de 36 mois du délai initial fixé au 1 er janvier 2005 (conformément aux dispositions du décret du 12 septembre 2001). Il prend effet le 1 er janvier 2005 et est éventuellement renouvelable une fois.
* 105 Isolation des plafonds et des surfaces contaminées par la pose de films autocollants et condamnation des gaines en revêtant les portes des placards techniques.
* 106 Au sens de la réglementation (annexe de la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998), on entend par amiante non friable : les joints plats, l'amiante-ciment, le vinyl-amiante, les produits d'étanchéité, les matières plastiques, les colles, les mastics, les mousses chargées de fibres, les enduits et les mortiers de densité élevée, les revêtements routiers, les éléments de friction.
* 107 « Libération » du mardi 22 juin 2004 : « A Paris, école en grève pour cause d'amiante ».
* 108 Le coût de location des « locaux tampons » pendant le désamiantage du campus de Jussieu devrait cependant, représenter environ le tiers du coût total des opérations.
* 109 Les principaux pays producteurs étaient alors le Canada, l'Union Soviétique, l'Afrique du Sud et la Rhodésie.
* 110 La réticence de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale à prendre en charge ces examens coûteux peut expliquer, selon eux, pour une part, cette situation.
* 111 BSSHN de la Corse, troisième trimestre 1964, cité dans le livre de M. Guy Méria.
* 112 Il s'agit du décret n° 96-98 du 7 février 1996 qui impose au chef d'établissement de procéder notamment à une évaluation des risques, d'organiser une formation appropriée et de mettre à disposition des salariés des équipements de protection.
* 113 En application de l'article R. 231-54-2 du code du travail.
* 114 Sources : dépêche AFP du 25 mai 2005.
* 115 D'un montant de 17 millions d'euros, il prévoit la destruction des habitats à risque, la construction de nouveaux logements et une surveillance médicale.
* 116 La serpentine n'est présente que de manière occasionnelle sur les massifs de nickel et est cent fois moins nocive que la trémolite, d'après Bernard Robineau, géologue à l'IRD.
* 117 Les travaux de désamiantage de l'ancien porte-avions Clemenceau, entamés en novembre 2004 à Toulon, ont été confiés à la société SDI (Ship Decomissionning Industries Corporation).
* 118 On rappellera les trois types d'installation de stockage : installations de stockage des déchets industriels spéciaux ou centres de classe 1, installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ou centres de classe 2 et installations de stockage de déchets inertes ou centres de classe 3.
* 119 On les enferme dans des doubles sacs étanches et on les transporte dans un emballage supplémentaire conforme aux prescriptions du Règlement transport des matières dangereuses par route (RTMDR) de type GRV (Grands récipients en vrac), de façon à être immédiatement identifiés lors de l'arrivée sur l'installation de stockage.
* 120 Tout conditionnement devra être identifié et fermé au moyen d'un scellé numéroté. Le scellé mentionnera le numéro de SIRET de l'entreprise qui a conditionné l'amiante ainsi qu'un numéro d'ordre.
* 121 L'article 1 er du décret dispose que « Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites (...) la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs ».
* 122 Directive 99-77, 1999-07-26, portant sixième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76769 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États-membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
* 123 Notamment des chalets en kit. Les représentants de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, dont les compétences semblaient particulièrement circonscrites, ont déclaré à la mission ignorer ce type d'importations provenant du Canada.
* 124 Enquête SUMER 2002-2003.
* 125 C'est ce qui ressort d'un rapport de l'INSERM remis en juin 2005.
* 126 Article L. 1417-1 du code de la santé publique.
* 127 Relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
* 128 Ces dispositions sont codifiées dans le nouvel article L. 1413-15 du code de la santé publique.
* 129 Quatre départements par domaine (maladies chroniques et traumatismes ; maladies infectieuses ; santé/environnement ; santé au travail) et un département d'administration générale.
* 130 Par ailleurs, l'unité cancer dispose de relais locaux, notamment par le biais de registres du cancer, et plus récemment des centres de gestion départementaux des dépistages des cancers du sein. Le déplacement des maladies infectieuses peut s'appuyer, pour la surveillance de l'épidémie VIH, sur la procédure de déclarations obligatoires. Le département de la santé au travail doit quant à lui, rechercher ses propres sources de données ; c'est dans cet esprit qu'a été envisagée une collaboration avec les centres d'examen de santé de la sécurité sociale, en vue de les organiser en laboratoires de santé publique chargés de suivre le risque post-professionnel.
* 131 Données CNAMTS : bilan des conditions de travail, 2002 et 2003.
* 132 Rapport IGAS/IGF/IGE/COPERCI du 4 juin 2004 sur l'évaluation de l'application de la loi du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et du contrôle sanitaires.
* 133 En Aquitaine, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Île-de-France, Midi-Pyrénées, PACA.
* 134 Depuis la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques professionnels.
* 135 Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé, qui s'est tenue à Budapest du 23 au 28 juin 2004 sur le thème : « Un futur pour nos enfants ».
* 136 Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France, daté du 24 décembre 1997.
* 137 La classification européenne des substances cancérogènes :
Cancérogène de catégorie 2 : « Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme ».
Cancérogène de catégorie 3 : « Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles. Néanmoins les informations disponibles à leur sujet ne permettent pas une évaluation satisfaisante. Des études appropriées sur l'animal ont fourni des éléments, mais ils sont insuffisants pour classer ces substances dans la deuxième catégorie ».
Le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, a établi une autre classification des substances cancérogènes qui n'est pas réglementaire, consultable sur son site internet.
Les phrases de risque doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes des substances ou des préparations :
R49 : peut causer le cancer par inhalation
R40 : effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes
* 138 Sauf les fibres de diamètre supérieur à 6m, en référence à la note R de la directive 97/69/CE, étiquetées irritantes, R38.
* 139 Sauf les laines minérales exonérées de la classification cancérogène catégorie 3 en référence à la note Q de la directive 97/69/CE, étiquetées irritantes, R38.
* 140 Pour en savoir plus, consulter la note documentaire INRS ND 2098.
* 141 Définition donnée par la directive n° 97/69 de la communauté européenne.
* 142 L'Humanité du 19 janvier 2005 : « Un scandale gros comme l'amiante ».
* 143 Un décret interdit toute commercialisation en direction du grand public de produits ou préparations contenant plus de 0,1 % de FCR..
* 144 Voir « Libération » du 19 janvier 2005 : « Amiante, un scandale sans fin ».
* 145 Voir « L'Humanité » du 14 mai 2005.
* 146 Loi du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transcription de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, codifiée dans l'article L. 2326-2 du code du travail.
* 147 Fiche de l'INRS mise à jour le 7 juin 2004.
* 148 Directive du Conseil n° 67-548 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
* 149 Au cours de laquelle 1.800 médecins enquêteurs ont cherché à identifier les produits chimiques auxquels 50.000 salariés étaient exposés.
* 150 Quelques groupes de substances (énumérés dans la proposition de règlement) sont néanmoins exemptés de l'obligation d'enregistrement, tels que :
- certaines substances intermédiaires ;
- les polymères ;
- quelques produits chimiques gérés au titre d'une autre législation de l'Union européenne (UE).
* 151 Il a indiqué que 62 études attesteraient de leur effet sur la réduction du nombre de spermatozoïdes.







