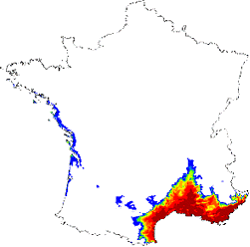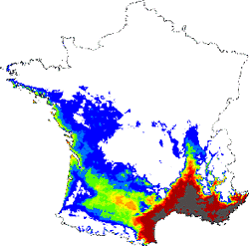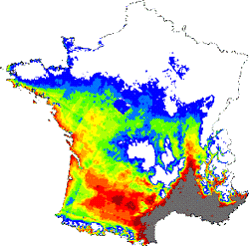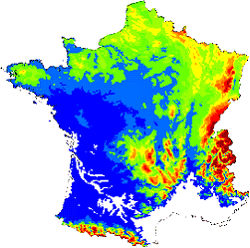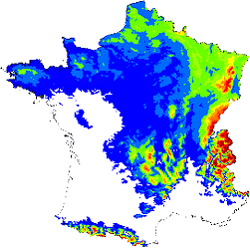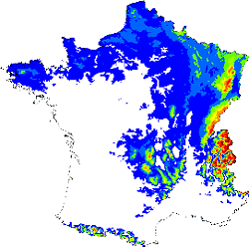2. Des menaces très préoccupantes
Compte-tenu de l'acquis déjà mesurable des modifications apportées à la biodiversité par le changement climatique acquis lors des dernières décennies, la perspective d'une poursuite, et plus probablement d'une accélération de ce phénomène est extrêmement préoccupante .
Pour cadrer l'échelle du problème, on rappellera ces deux évaluations du rapport Stern 39 ( * ) :
- 15 à 40 % des espèces sont menacées par le changement climatique,
- une hausse de 3°C de la température moyenne pourrait affecter le maintien de la forêt amazonienne.
Certes, comme on l'a souligné en première partie de ce rapport, beaucoup d'interrogations subsistent sur l'ampleur et sur la localisation de ces évolutions climatiques futures.
Mais les modélisations effectuées dont certaines bénéficiant déjà des confirmations des retours d'expériences montrent que la biodiversité des écosystèmes terrestres et marins pourrait être fortement perturbée par la poursuite du réchauffement climatique.
a) Les écosystèmes terrestres
Si on ne prend que le cas de la France - et sous réserve de la fiabilité des modèles prédictifs - le changement risque d'être très brutal d'ici la fin du siècle, qu'il s'agisse :
- des variations de précipitations :
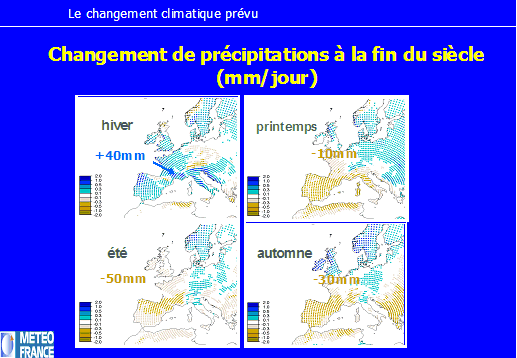
- de la teneur en eau dans le sol :
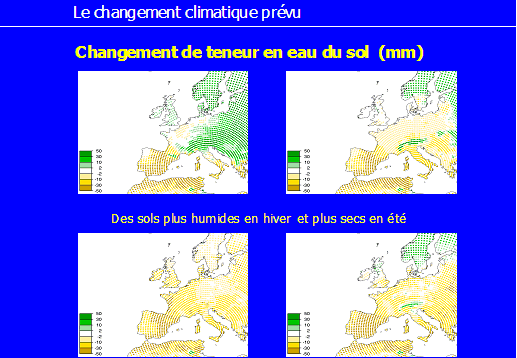
- ou de la fréquence des épisodes caniculaires :
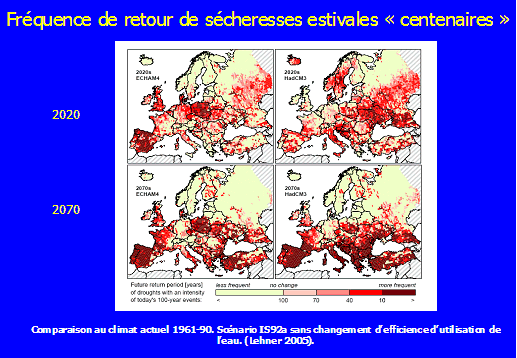
Quelles pourraient être les conséquences des phénomènes qui approcheront par leur ampleur la sortie de l'ère glaciaire il y a 10 000 ans ?
Les principales études dans ce domaine ont été effectuées sur les arbres et les plantes. Mais les modifications très importantes que l'on prévoit sur ces espèces affecteront l'ensemble des écosystèmes qui y sont associés.
En 2004, une équipe de l'INRA de Nancy 40 ( * ) a effectué une projection de l'implantation en 2050 et 2100 de près de 67 espèces éparses réparties en 13 grands groupes d'espèces en se référant au scénario moyen du GIEC.
Les résultats de ces projections montrent, en particulier pour le chêne-liège et le hêtre, des modifications de répartitions spectaculaires :
Cas du chêne vert
Répartition actuelle
|
Modélisée
|
Aire potentielle future
|
En 2050
|
En 2100
|
Cas du hêtre
Répartition actuelle
|
Modélisée
Le modèle retenu pour le hêtre fait intervenir les déficits pluviométriques des mois de juin et juillet et la température maximale du mois d'octobre |
Aire potentielle future
|
En 2050
|
En 2100
|
Les résultats de cette projection doivent être à la fois confirmés et tempérés par des constats faits sur les placettes d'observation de l'ONF :
- ces observations montrent que les essences seraient très sensibles aux épisodes de grande chaleur (les traces de stress hydriques consécutifs à la canicule de l'été 1976 sont encore observables 41 ( * ) ),
- il faut cependant relativiser le « mécanisme » de ces projections. En effet :
L'ONF a constaté que la qualité des sols constituait un facteur très important de résistance des espèces à la canicule.
Par ailleurs, la variété génétique intraspécifique des essences est comparable (elle peut atteindre 30 % pour deux fûts situés à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre) et laisse présager des possibilités d'adaptation que les projections ne peuvent pas mesurer. Pour en donner une illustration, il faut rappeler qu'il existe dans l'Orne un isolat de conifères qui a résisté aux changements climatiques consécutifs à la fin de la dernière glaciation .
Mais les essences menacées par le changement climatique auront-elles le temps de s'adapter ?
Une étude conduite par l'Union européenne permet d'en douter :
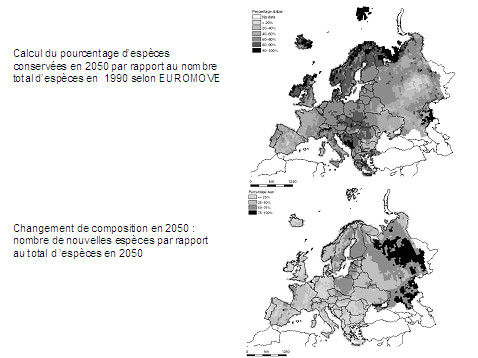
Cette étude met en évidence que le pourcentage d'espèces de plantes qui subsisteraient, en 2050, en cas de poursuite du changement climatique serait quelquefois inférieure à 60 %, la Péninsule Ibérique, le Sud de la France et l'Est de l'Europe étant les zones les plus menacées par cette déperdition.
Des modélisations effectuées sur cette base ont, en outre, montré que dans 19 % des cas, les espèces (et donc les biotopes associés) devraient se déplacer d'un kilomètre par an vers le Nord pour subsister .
Rappelons que cette vitesse a été celle de la recolonisation du chêne à la fin de l'ère glaciaire.
Mais notons que les infrastructures anthropiques (urbanisation routes, autoroutes, voies ferrées n'existaient pas à cette époque).
* 39 Une étude récente de la Royal Society anglaise fait un parallèle, qui peut être contesté, entre la hausse de température qui nous est promise en fin de siècle (6° C en hypothèse haute) et celle constatée lors de la crise du permien au cours de laquelle 95 % des espèces ont disparu.
* 40 Jean-Luc Dupouy et V. Badeau
* 41 S'agissant de la forêt méditerranéenne la canicule de 2003 s'est avérée catastrophique, puisqu'elle est intervenue après plusieurs années de sécheresse. Et le défaut pluviométrique qui a suivi a atteint plusieurs espèces dont le pin sylvestre et surtout le pin maritime.