d) Des concessions bilatérales inégales
Si le rabais britannique doit être considéré par la France comme le prix à payer pour l'acceptation de la politique agricole commune par la Grande-Bretagne, encore faudrait-il que les sacrifices consentis par les deux pays soient équivalents.
Ce n'est pas le cas.
Le chèque français est supérieur à ce que le Royaume-Uni paye à la France pour la PAC.
Concernant la participation de la France au chèque britannique, son montant s'est situé, de 2001 à 2009, entre 1,3 et 1,7 milliard d'euros, selon l'annexe au projet de loi de finances pour 2001 sur les relations financières avec l'Union européenne.
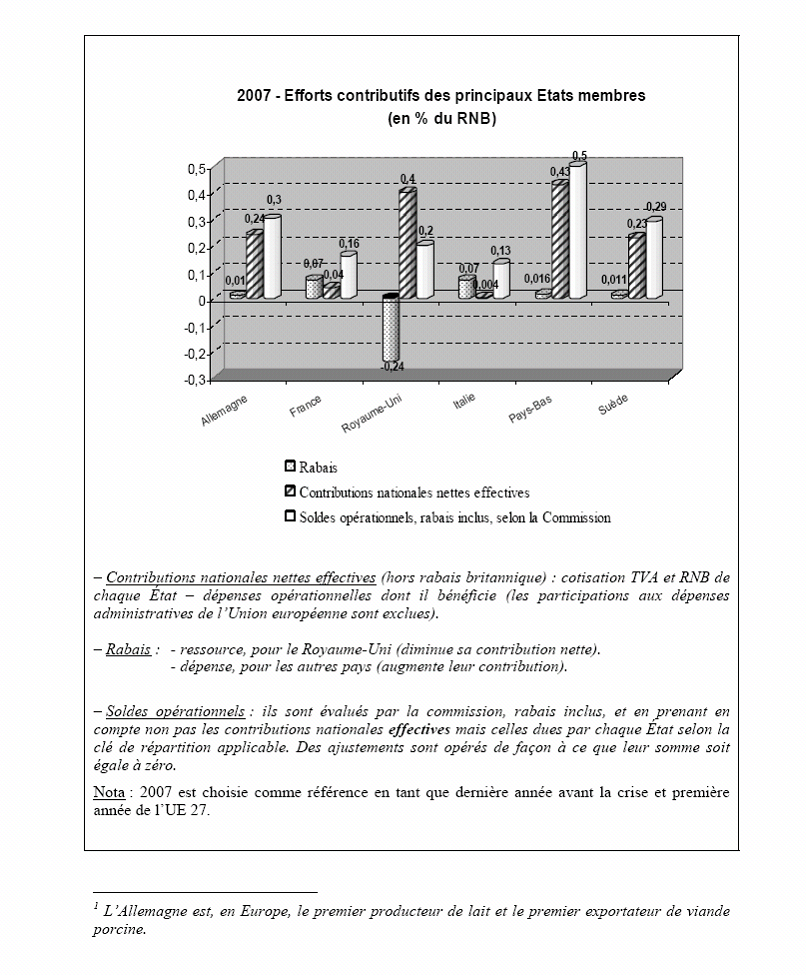
Ce que le Royaume-Uni a versé en contrepartie à la France au titre de la politique agricole commune peut être évalué de la façon suivante selon les données figurant dans ce même document et dans le rapport financier de la Commission.
|
1. Contribution nette effective du Royaume-Uni au budget de l'UE :
Contributions nationales (RPT+TVA) - dépenses
réparties (hors administration)
2. Part, dans ce déficit de retour, théoriquement affectée à la PAC :
6 729,7 x 49,6 % (proportion des dépenses
agricoles dans le budget de l'UE)
3. Part indirectement payée à la France au titre de la PAC :
3 338 x 19,2 % (pourcentage des dépenses
agricoles de l'UE bénéficiant à la France)
|
Ces sommes sont remboursées au Royaume-Uni grâce à la « correction » (rabais) qui lui est consentie.
Le calcul sommaire exposé ci-dessus peut probablement être affiné en fonction de certaines considérations. Il donne cependant un ordre de grandeur vraisemblable et, par là même, une idée du caractère particulièrement inéquitable pour la France du rabais britannique.
La France paye pour celui-ci, au Royaume-Uni, directement , deux fois plus que ce que ce pays lui verse, indirectement , au titre de la politique agricole commune.
En outre, les dépenses consacrées au rabais britannique n'ont aucun effet positif pour l'Union européenne, contrairement à celles de la PAC qui lui procurent des avantages substantiels (sécurité alimentaire, développement économique des nouveaux États membres, protection de l'environnement...).
e) Une propension à importer en dehors de l'Europe qui reste pourtant forte
Alors que la France finançait, en 2005, environ un tiers de la correction britannique, sa part dans les importations de produits alimentaires du Royaume-Uni n'était que de 12 %.
La propension de ce pays, dont le taux d'autosuffisance alimentaire avoisine 60 %, à importer des denrées agricoles en dehors de l'Union européenne reste forte si on en croit les statistiques de la Commission ; jusqu'en 2008, celles-ci précisaient la ventilation des RPT (ressources propres traditionnelles) en distinguant le montant des droits agricoles de celui des autres recettes concernées 75 ( * ) (cotisation sucre et droits de douane). Or, cette année-là, les droits en question payés par les Britanniques ont représenté, à eux seuls, 30 % du total encaissé par l'Union. (Cette proportion était de 40 % dans l'UE 15).
L'Union européenne continue, notamment, d'offrir des contingents tarifaires particuliers à de nombreux pays du Commonwealth comme l'Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande.
* 75 La DRP du 7 juin 2007 a décidé de supprimer cette distinction, estimant qu'à la suite de la transposition dans le droit européen des accords issus des négociations du cycle de l'Uruguay, il n'existe plus de différence sensible entre les droits agricoles et les droits de douane.







