V. LES CONSÉQUENCES À TIRER POUR NOTRE POLITIQUE DE DÉFENSE EN AFRIQUE
La première conséquence à tirer de l'intervention au Mali sur le plan de notre politique de défense est naturellement de maintenir un niveau de ressources budgétaires suffisant alloués à la défense. Le Président de la République a confirmé dans son intervention télévisée que le budget de la défense s'établirait en 2014 au même niveau qu'en 2013 (31,4 milliards d'euros). L'établissement d'un seuil minimal de 1,5 % du PIB consacré à la défense a reçu l'appui quasi unanime des forces politiques du Sénat. Il en va de l'intérêt supérieur de la Nation. Il s'agit de maintenir ce qui constitue les fondations de notre sécurité, de notre indépendance et donc de notre prospérité.
Sans cette décision, qui met fin au mouvement de dégradation d'un outil militaire, qui reste, selon les termes d'un récent rapport de notre commission, à un niveau « juste insuffisant », l'opération Serval aurait sans nul doute été le « chant du cygne » de l'armée française . Il faut maintenant la traduire dans les lois de finances et la loi de programmation militaire : votre commission sera pleinement mobilisée sur ces enjeux.
Quelles sont plus spécifiquement les conséquences à tirer de l'intervention au Mali en matière de politique de défense sur le continent africain ?
Depuis plusieurs années, notre posture de défense en Afrique a été reformulée et passe par l'appui à une prise en charge de leur propre sécurité par les Africains, et par une européanisation de notre action sur le continent. Parallèlement, en 2008, le livre blanc programmait une réduction de notre dispositif prépositionné en Afrique.
L'intervention au Mali n'a-t-elle pas quelque peu fragilisé les paradigmes sur lesquels s'appuie notre politique africaine ?
Serval n'a-t-il pas révélé l'échec des architectures africaines de sécurité, celui de l'européanisation, mais aussi, d'une certaine façon, l'échec de notre coopération militaire structurelle, en particulier avec le Mali ?
Plusieurs questions se posent : quelles conséquences en tirer, à la fois sur notre effort en faveur de coopération bilatérale, par opposition à notre coopération multilatérale et régionale, et sur le format de nos implantations, notre « empreinte au sol » sur le continent africain ? Les forces prépositionnées qui ont été si décisives, ont-elles vraiment vocation à évoluer, sous l'effet des restrictions budgétaires et de l'arrivée (enfin !) des capacités de transport stratégique, vers de simples plates-formes logistiques , plus légères ? Comment construire des relations bilatérales qui permettent d'éviter que nos forces ne soient un recours à chaque nouvelle crise ? Quel avenir pour la sécurité sur un continent dont on ne peut aujourd'hui que constater la faiblesse de ses armées ?
1. Faudra-t-il reformuler les paradigmes de notre politique africaine de sécurité ?
La doctrine militaire française en Afrique 42 ( * ) s'appuie sur un profond renouvellement des modalités d'intervention sur un continent qui a vu, depuis les indépendances, les forces françaises intervenir une trentaine de fois.
Refusant la position d'un gendarme obligé de l'Afrique, sans pour autant s'interdire d'intervenir lorsque les intérêts français sont en jeu, la France cherche à s'appuyer désormais systématiquement, dans le cadre de la légalité internationale exprimée par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, sur les organisations régionales africaines, et inscrit de plus en plus souvent son action dans un cadre multilatéral.
La reformulation de la politique de sécurité en Afrique, dans la foulée de la création de l'Union africaine et de la conceptualisation par les Africains d'une architecture de sécurité reposant sur des échelons régionaux (la CEDEAO en Afrique de l'Ouest), a donc avant tout consisté à africaniser et à européaniser notre mode d'action, pour le faire sortir d'un tête-à-tête politiquement et économiquement coûteux avec les pays devenus indépendants depuis 1960.
Dès 1997, le concept RECAMP (rétablissement des capacités africaines de maintien de la paix), transpose la vision française des enjeux de paix et de sécurité sur le continent africain. Articulé autour d'actions de formation, d'entraînement et de soutien à l'engagement opérationnel des contingents africains, il s'appuyait, à l'origine, sur la structure des organisations sous-régionales pour développer un dialogue adapté et des cycles d'exercices ayant pour ambition de rythmer la montée en puissance des capacités collectives africaines.
En 2004, le concept RECAMP est révisé en profondeur à la suite de la création de l'Union africaine (UA). Trois ans plus tard, l'Union européenne (UE) définit à Lisbonne un projet de partenariat stratégique avec l'UA, prenant en compte l'émergence d'un échelon continental africain de prévention et de gestion des crises. La France transfère alors la gestion de la dimension continentale du programme RECAMP à l'UE, interlocuteur naturel de l'UA en matière de paix et de sécurité, dans ce qui devient le programme EUROCAMP.
Cette nouvelle posture est réaffirmée dans le discours du Cap du 28 février 2008 dans lequel le Président de la République annonçait que les accords de défense seraient systématiquement renégociés avec les pays partenaires et feraient l'objet d'une transparence totale, ne comportant plus de clause secrète. Ce discours fixe aussi pour objectif prioritaire à la présence militaire française en Afrique l'aide apportée à bâtir un dispositif de sécurité collective, en particulier avec la mise en place des « forces en attente » de l'Union africaine. Au-delà de cet objectif il affirme que « la France n'a pas vocation à maintenir indéfiniment des forces armées en Afrique », ouvrant la voie au rétrécissement, programmé par le Livre blanc de 2008, des forces stationnées sur le continent africain.
Les quatre axes qui devaient être une constante étaient tracés : réduction de la présence militaire française permanente en Afrique, priorité au renforcement des capacités africaines, renégociation des accords de défense, appui sur un cadre multilatéral.
|
Aujourd'hui, la politique de défense française en Afrique repose sur 4 piliers : - Des accords de défense ou de coopération : ils ont été rénovés, expurgés de leurs éventuelles clauses « secrètes » ou d'assistance automatique. Aujourd'hui les accords avec le Togo, la République Centre Africaine et le Cameroun ont été ratifiés, ceux avec le Gabon, les Comores, Djibouti, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal sont en voie de l'être ; - Une politique de coopération structurelle ; - Un réseau d'attachés de défense : 29 permanents et 22 non-résidents, pour les 54 états africains ; - Des « points d'appui » ou forces prépositionées. |
Ce dispositif est-il bien dimensionné ? A-t-il été bien piloté ? A-t-il produit les résultats escomptés ?
Faut-il poursuivre dans la voie de l'européanisation et de l'africanisation ? Ces deux paradigmes sur lesquels devait s'appuyer notre nouvelle politique africaine ont tous deux révélé leurs faiblesses à l'occasion de la récente crise malienne.
Elle aurait pu pourtant à bien des égards représenter un cas d'école de leur mise en application, tant toutes les conditions étaient réunies pour leur mise en oeuvre. Ne s'agissait-il pas d'une région jugée prioritaire pour la politique extérieure de l'Union européenne (avec la stratégie intégrée sur le Sahel), dans laquelle l'Union avait d'ailleurs programmé, dès avant l'agression terroriste, une opération de formation des forces armées ? Ne s'agissait-il pas d'une intervention qui devait, aux termes de la résolution 2085 (votée quelques jours seulement avant que le scénario qu'elle avait prévu ne vole en éclats), être celle des forces africaines et de la CEDEAO en terre africaine ? N'avait-on pas affirmé plusieurs fois la volonté qu'aucun soldat français ne soit engagé sur le sol malien ?
Pourtant, la France s'est retrouvée presque seule en première ligne, dans un premier temps tout au moins, compte tenu du relais programmé aux forces africaines puis à celles sous mandat (et financement) de l'ONU.
On voit mal, pourtant, comment, aujourd'hui, dans les circonstances non seulement politiques mais aussi budgétaires qui sont celles de la France, on pourrait en changer radicalement.
Nul doute que le groupe de travail sur l'Afrique de notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, co-présidé par nos collègues Jeanny Lorgeoux et Jean-Marie Bockel, apportera prochainement des réponses plus détaillées à ces questions.
A ce stade, on peut toutefois constater que le soutien à la formation d'une architecture de sécurité collective africaine ne peut que rester une priorité de la politique de défense française.
Sans doute faut-il mieux en faciliter l'émergence, peut être en « adossant » mieux la présence militaire française aux organisations de sécurité africaine et en particulier à leur échelon régional ?
2. La coopération militaire structurelle a-t-elle eu les moyens de produire des résultats tangibles ?
La France met en oeuvre une coopération de défense et de sécurité, dite coopération « structurelle » (qui relève du ministère des Affaires étrangères), par opposition à la coopération « opérationnelle » qui relève du ministère de la défense, pour renforcer les capacités notamment africaines et prévenir les conflits.
En aidant les pays partenaires à structurer, dans le long terme, leurs élites militaires, cette coopération contribue au maintien de la paix et au renforcement des capacités à assumer des missions non seulement militaires mais aussi de protection civile, comme la lutte contre les catastrophes naturelles, le déminage, la dépollution...
Cette action a subi régulièrement des coupes budgétaires sévères au sein du budget du Quai d'Orsay, et le nombre total de coopérants a littéralement fondu en 20 ans (de 1 000 à 345 coopérants au total...), ce qui a entraîné un rétrécissement du champ d'action et un recentrage drastique sur quelques priorités géographiques ou sectorielles. De nouvelles coupes budgétaires sont programmées pour la période 2013-2015.
Les actions sont menées en partenariat avec 139 autres états ou organisations internationales, dans des régions particulièrement sensibles comme la zone Sahélienne. Ainsi, ce sont plus de 36 000 personnes qui ont bénéficié à un titre ou à un autre des actions de formation en 2011, dont 1 000 stagiaires accueillis en France et 2 400 dans les écoles africaines.
En particulier, 3 écoles nationales à vocation régionale (ENVR) ont été créées à l'initiative de la France : l'école de maintien de la paix (EMP) de Bamako, le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution (CPADD) de Ouidah au Bénin et l'école internationale des forces de sécurité (EIFORCES) d'Awaé au Cameroun. Dans le cas précis de l'école de maintien de la paix de Bamako, dont vos rapporteurs ont pu rencontrer des membres de l'encadrement, son fonctionnement a été interrompu pendant plus d'un an. Toutefois, la coopération militaire a repris mais s'est réorientée dans le cadre de l'intervention militaire française.
Vos rapporteurs ont été frappés lors des entretiens avec les plus hauts responsables du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur maliens de l'impact que peut avoir une politique d'accueil bien menée des officiers supérieurs dans nos écoles de formation. La plupart des jeunes officiers (de qualité) sur lesquels repose aujourd'hui la reconstruction de l'armée malienne a fréquenté des écoles supérieures de formation d'officiers en France, dans l'armée de terre et la gendarmerie.
Cette politique d'accueil des jeunes officiers permet de tisser les fils d'un dialogue unique, qui peut s'avérer essentiel ensuite en termes non seulement d'influence, mais aussi à l'heure où la restauration des capacités des armées et des forces de sécurité est un enjeu majeur de sécurité en Afrique de l'Ouest.
Au total, sans doute faudra-t-il réfléchir à l'efficacité de notre coopération structurelle militaire avec des pays comme le Mali.
Quelle a été l'efficacité réelle de cette action ? A-t-elle souffert d'un manque de moyens (ses moyens ont été laminés entre 2007 et 2010 et devraient subir à nouveau des coupes entre 2013 et 2015), d'un déficit de pilotage (les orientations ne semblent pas faire l'objet d'arbitrages politiques récents à haut niveau), ou s'est-elle trouvée limitée dans ses effets, par les capacités des pays partenaires ?
À cet égard on ne peut qu'être frappé par le fait que tous les responsables maliens sur place réclamaient, lors des entretiens conduits à Bamako, des « détachements d'assistance militaire et d'instruction » (DAMI) qui est une ancienne forme de coopération structurelle par détachement direct dans les structures du ministère de la défense, et non pas reposant sur l'effet de levier d'une formation de ses cadres dispensée à l'échelle régionale, comme c'est aujourd'hui le cas.
L'orientation prioritaire est de constituer des unités opérationnelles dans chaque pays de la CEDEAO.
3. Quelle doit être demain l'empreinte militaire française en Afrique ?
Vos rapporteurs estiment urgent de lancer, à la lumière de l'opération Serval, une réflexion complémentaire sur nos forces stationnées en Afrique, réflexion qui devrait être centrale dans le prochain Livre blanc de 2013.
Le Livre Blanc de 2008 programmait un rétrécissement qui n'a pas totalement été mis en oeuvre et qui n'aurait pas permis, s'il avait été mené à terme, d'intervenir au Mali dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.
En 2008, il était affirmé que « La France n'a pas vocation à être militairement présente en permanence sur les mêmes bases. (...) La France procédera donc à la conversion progressive de ses implantations anciennes en Afrique, en réorganisant ses moyens autour, à terme, de deux pôles à dominante logistique, de coopération et d'instruction, un pour chaque façade , atlantique et orientale, du continent, tout en préservant une capacité de prévention dans la zone sahélienne . ». Ne devaient donc être conservés que le Gabon et Djibouti, avec une allusion sans doute au Tchad via la mention de la zone sahélienne.
La création, en marge du Livre blanc, de la base des Émirats Arabes Unis, ainsi que le maintien, vu les circonstances, de dispositifs plus anciens n'ont pas empêché le mouvement de décrue significative de se poursuivre.
De fait, les forces stationnées en Afrique ont continûment diminué, sans doute plus sous l'effet de la contrainte budgétaire qui se resserrait que de choix politiques clairement formulés. Sur le continent africain, les effectifs des forces françaises s'élevaient à environ 30 000 hommes après les indépendances, à 20 000 dans les années 1970, à 15 000 dans les années 1980, à 10 000 dans les années 1990. Elles s'élèvent à environ 5 000 aujourd'hui.
La décrue a été effective depuis le Livre blanc de 2008, elle a notamment porté sur les éléments français au Sénégal, avec le repli des forces françaises au Cap Vert.
Tableau n° 14 : Effectifs des forces prépositionnées fin 2012
|
Terre |
Air |
Marine |
Autres |
Total fin 2012 |
Rappel au 30 juin 2010 |
|
|
Djibouti |
715 |
407 |
177 |
757 |
2 056 |
2 542 |
|
Sénégal |
114 |
25 |
48 |
178 |
365 |
988 |
|
Gabon |
575 |
50 |
0 |
302 |
927 |
725 |
|
Émirats arabes unis |
332 |
143 |
41 |
199 |
715 |
417 |
|
Total |
1 736 |
625 |
266 |
1 436 |
4 063 |
4 672 |
|
Source : Rapport de M Jean Launay, commission des finances de l'Assemblée nationale, loi de finances pour 2013 |
||||||
Outre les bases prépositionnées stricto sensu (Forces françaises stationnées à Djibouti (2 000 hommes environ) et forces françaises au Gabon (900 environ), découlant du Livre blanc de 2008, auxquelles s'ajoutent les forces françaises aux Émirats arabes unis (700 environ) et les Éléments français au Sénégal (300 environ), c'est en effet sur des opérations et dispositifs résultant essentiellement d'interventions « temporaires » ( Tchad -950 hommes- et Côte d'Ivoire -450 hommes- ) qu'a reposé la montée en puissance du dispositif Serval.
Ce dispositif en Afrique, qui comprend au total une douzaine de chasseurs, 7 avions de transport, 14 hélicoptères lourds, 4 hélicoptères légers et 3 bataillons interarmées, représente un coût total annuel d'environ 400 millions d'euros.
Tableau n° 15 : Effectifs des forces prépositionnées en février 2013
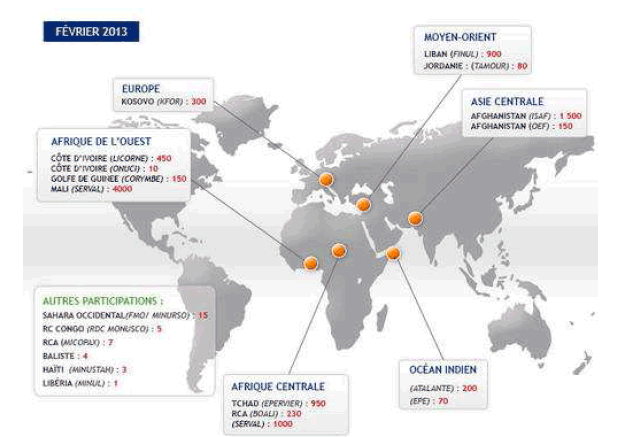

|
La force Licorne en Côte d'Ivoire La force Licorne est déployée en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002. Engagée pour assurer la sécurité des ressortissants français après une tentative de coup d'État, Licorne est rapidement chargée de contrôler le cessez-le-feu, puis de soutenir le déploiement d'une mission de la CEDEAO fin 2002, à laquelle succède rapidement une mission de l'ONU début 2003. Depuis 2007 et la signature de l'accord politique de Ouagadougou, la principale mission de la force Licorne est de soutenir la force de l'ONU en Côte d'Ivoire (ONUCI) pour veiller à la mise en oeuvre de cet accord. Depuis l'automne 2011, dans le cadre de la normalisation de la situation dans le pays et de la révision des accords de coopération qui lient la France à la Côte d'Ivoire, le dispositif militaire français évolue. En revanche ses missions restent identiques. A savoir : accompagner la réforme de l'armée ivoirienne et maintenir une présence militaire pour assurer la protection des ressortissants français si besoin est. Elle compte actuellement 450 militaires qui arment : - un état-major, - un élément de soutien ; - deux unités de combat. Un Transall C 160 et un hélicoptère Fennec de l'armée de l'air complètent ce dispositif. Licorne peut être ponctuellement soutenue par un bâtiment de la marine nationale déployé dans le golfe de Guinée dans le cadre de l'opération Corymbe et renforcée par des moyens des forces prépositionnées ou de métropole, comme cela fut le cas en janvier 2011. |
|
Les éléments français au Sénégal (EFS) Depuis le 1 er août 2011, les Forces Françaises du Cap-Vert (FFCV) sont devenues les Éléments français au Sénégal (EFS). En accord avec les autorités sénégalaises, la France conserve à Dakar un « pôle opérationnel de coopération à vocation régionale ». Les EFS disposent néanmoins de la capacité d'accueillir, de soutenir voire de commander une force projetée. S'inscrivant ainsi dans une posture de prévention, les EFS demeurent un point d'appui matérialisé par le maintien d'un noyau de poste de commandement interarmées (PCIA) et d'escales navale et aéronautique. Les éléments français au Sénégal sont essentiellement constitués de personnels en mission longue durée sur le territoire. Au total, ils représentent actuellement un effectif de 350 militaires, dont environ 250 permanents . Les EFS disposent d'un état-major interarmées ; d'une Unité de commandement et de coopération opérationnelle ; d'une unité de coopération régionale à laquelle sont rattachés pour emploi le détachement de fusiliers-marins et le détachement de fusiliers-commandos de l'air ; d'un détachement aéronautique , comprenant un détachement de patrouille maritime (avion de patrouille maritime Atlantique 2 ) et une unité d'escale aéronautique (1 Casa en détachement temporaire), à laquelle sont intégrés des pompiers de l'air ; et d'une station navale . Le nouveau dispositif EFS a pour mission : - de conduire des actions de coopération militaire opérationnelle bilatérale et régionale dans le cadre de l'appui à l' « Architecture africaine de paix et de sécurité » et de soutien aux missions de maintien de la paix dans la région ; - de contribuer à des actions de coopération civilo-militaires bilatérales ; - d'offrir une escale navale et/ou aérienne aux bâtiments et/ou aéronefs de passage ; - de participer aux opérations de search and rescue (SAR) conformément à l'accord de défense intergouvernemental en vigueur ; - de participer à la préparation opérationnelle des unités françaises et étrangères pour l'aguerrissement et le combat en zone semi-désertique ; - d'assurer une veille opérationnelle dans une partie de la zone de responsabilité permanente (ZRP) Ouest Afrique sous l'autorité du commandement des forces au Gabon (COMFOR Gabon). Le cas échéant, les EFS ont la capacité : - de soutenir les opérations particulières dans la durée ; - d'accueillir des moyens aériens, maritimes, terrestres ou spéciaux déployés dans le cadre d'une opération (ou d'un exercice majeur) ; - d'assurer initialement la protection des installations militaires françaises et de participer à la protection des ressortissants, en cas de crise inopinée au Sénégal ; - de contribuer aux missions de sécurité civile en appui à des autorités locales. |
|
Le dispositif Épervier au Tchad Le dispositif Épervier compte aujourd'hui près de 950 militaires . Il comprend : - un état-major interarmées, - un groupement Terre : environ 350 militaires et 70 véhicules (14 véhicules blindés légers ERC 90 Sagaie, 23 véhicules d'avant blindés et divers véhicules légers) répartis entre une compagnie motorisée et un escadron blindé à N'Djamena et une unité élémentaire de protection terrestre à Abéché, - un groupement Air : environ 150 militaires et 12 aéronefs stationnés sur la base de N'Djamena et assurant des missions de chasse et de reconnaissance (2 Mirage F1 CR, 6 Rafale), de transport tactique (1 Transall C160, 1 Hercules C130 et 4 Puma SA 330) et de ravitaillement en vol (3 C135 FR). |
On ne peut qu'être frappé du décalage entre les postures formulées dans les documents de réflexion stratégique et la réalité. La réalité, c'est que rien n'aurait été possible sans « Licorne » (450 personnes), sans « Épervier » (950 militaires), sans « Sabre » (forces spéciales). Aucun de ces dispositifs ne figure pourtant expressément au rang des bases prépositionnées du Livre blanc de 2008, qui ne prévoyait qu'une base par façade maritime africaine.
En particulier le Tchad, échelon aérien lourd dans notre dispositif militaire en Afrique, n'est-il pas un atout important et un point névralgique à l'heure où le sud Libyen se fragilise et où les connexions se densifient entre les terrorismes, du Nord Sahel à la Corne de l'Afrique, du Maghreb à l'Afrique sub-saharienne ? N'est-il pas un pivot central dans la lutte contre ce que certains appellent « l'arc djihadiste » ?
Quelle conséquence saura-t-on en tirer dans les arbitrages en préparation sur la loi de programmation militaire ?
Certains estiment qu'avec l'arrivée programmée de nouvelles capacités de transport stratégique (A400 M), des forces pourraient être facilement projetées depuis l'hexagone, et permettraient d'assurer la sécurité de nos intérêts sans nécessiter d'empreinte sur le sol africain aussi lourde que par le passé.
Il n'est pas avéré que l'on obtienne alors un même niveau d'efficacité.
Quatre exemples simples illustreront ce propos :
- Il aura fallu 5 heures à nos forces spéciales stationnées à Ouagadougou pour être sur le terrain malien, à Diabali et Konna, aux côtés des forces maliennes du colonel-major Dicko, qui se battaient d'ailleurs courageusement contre l'offensive terroriste, et pour stopper leur avancée, empêchant ainsi la prise de points stratégiques, comme l'aéroport de Sévaré ou le pont de Markala, qui auraient hypothéqué toute reprise ultérieure du terrain.
- Tout récemment, présence rassurante de patrouilles de soldats français dans Bangui quelques heures après le début des événements aura sans nul doute permis d'éviter un embrasement de violence plus généralisé encore.
- Nos forces à Libreville sont sous un régime d'alerte très exigeant qui les rend projetables en 12 heures seulement, nous permettant de « jeter un verre d'eau » pour éteindre un incendie dont la propagation ultérieure nécessiterait des moyens bien plus lourds.
- Enfin, le Général de Saint-Quentin, commandant l'opération Serval, disposait, grâce à son expérience de commandant des Éléments français au Sénégal, d'une connaissance des hommes et du terrain qui n'a pu qu'être un atout précieux pour la conduite de sa difficile mission.
Sans point d'appui sur le sol africain, disposerait-on de la même réactivité, de la même expertise, bref, de la même efficacité ?
Aujourd'hui, la France a su mobiliser, tant la communauté internationale, que les États africains, et nos partenaires européens. Cela montre la crédibilité dont elle dispose aujourd'hui pour ce qui concerne l'Afrique. En sera-t-il demain de même, sans forces présentes sur le sol africain ?
Pour autant, une réflexion approfondie doit être conduite notamment sur le centre de gravité (est-ouest) de nos points d'appuis : beaucoup d'effectifs sont aujourd'hui concentrés sur la Corne de l'Afrique et la péninsule arabe, alors que les communautés françaises vivent majoritairement en Afrique de l'Ouest, zone où la menace ne fait que s'aggraver. Faut-il déplacer le barycentre de nos implantations ?
La pertinence, à côté des bases à effectif important, de « points d'appui » plus légers, du type des Éléments français au Sénégal, semble démontrée. Faut-il aller, dans la région sahélienne, vers une politique de « nénuphars » s'appuyant notamment, outre le Tchad, sur le Niger, voire sur le Burkina Faso ?
Enfin, la véritable épopée logistique des troupes et des matériels français depuis Dakar où ils ont été débarqués par le BPC Dixmude a montré l'importance des ports, pendant que l'Afghanistan nous rappelait les coûts importants d'un désengagement logistique par voie aérienne. Faut-il rééquilibrer en conséquence nos effectifs, par exemple entre Libreville et Dakar ?
Enfin, pour appuyer la montée en puissance des forces africaines de sécurité, ne faut-il pas mieux articuler géographiquement, organiquement et politiquement la présence militaire française avec les architectures -certes naissantes- de sécurité africaines ?
Le Livre blanc, la loi de programmation militaire, devraient être l'occasion de débattre de ces questions.
* 42 Voir à cet égard les deux rapports d'information de la commission sur le sujet : « La politique africaine de la France », M Josselin de Rohan, n°324, 2010-2011 et « La France et la gestion des crises africaines : quels changements possibles ? » n° 450, juillet 2006, MM. Dulait, Hue, Pozzo Di Borgo et Boulaud







