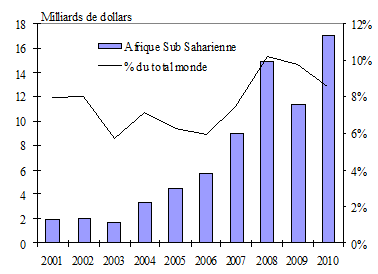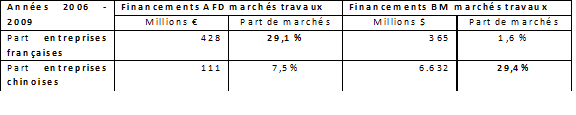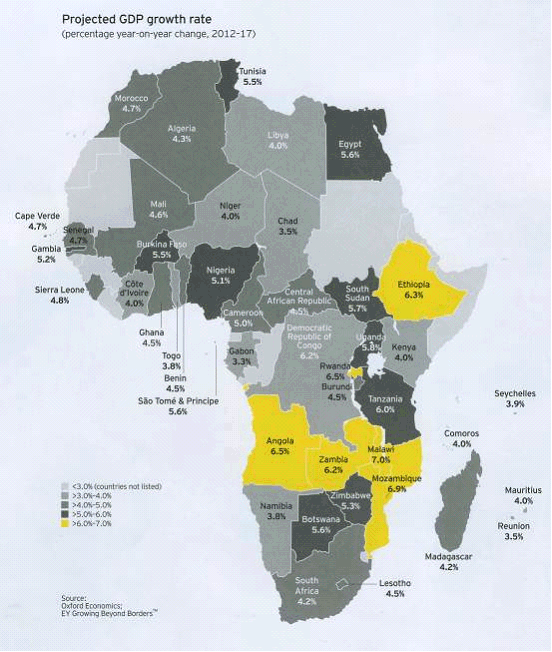Rapport d'information n° 104 (2013-2014) de MM. Jeanny LORGEOUX et Jean-Marie BOCKEL , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 29 octobre 2013
Disponible au format PDF (7 Moctets)
-
10 PRIORITÉS ET 70 MESURES
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE 1 : L'AFRIQUE EN MUTATION :
ENJEU MAJEUR POUR LA FRANCE ET L'EUROPE
-
I. VERS UN CONTINENT DE 2 MILLIARDS D'HABITANTS AUX
PORTES DE L'EUROPE
-
II. UNE TRANSFORMATION RAPIDE, DES
SOCIÉTÉS SOUS TENSION
-
III. ET POURTANT UNE PARTIE DE L'AFRIQUE EST BIEN
PARTIE
-
IV. D'IMMENSES DÉFIS RESTENT À
RELEVER
-
V. L'AFRIQUE À LA CROISÉE DES
CHEMINS
-
I. VERS UN CONTINENT DE 2 MILLIARDS D'HABITANTS AUX
PORTES DE L'EUROPE
-
CHAPITRE 2 : HIER IGNORÉE,
AUJOURD'HUI CONVOITÉE, L'AFRIQUE AU CENTRE DES RIVALITÉS
MONDIALES
-
I. UNE AFRIQUE DÉSORMAIS
INTÉGRÉE DANS LA MONDIALISATION
-
II. UN CONTINENT NAGUÈRE CONVOITÉ
PAR LES SEULES PUISSANCES OCCIDENTALES
-
III. DE NOUVEAUX PARTENAIRES DU SUD À
L'ASSAUT DU CONTINENT AFRICAIN
-
IV. L'AFRIQUE AU COEUR D'UNE REDISTRIBUTION DES
CARTES ENTRE ANCIENNES PUISSANCES COLONIALES ET NOUVELLES PUISSANCES
ÉMERGENTES
-
V. LE REVERS DE LA MONDIALISATION : TRAFICS
ILLICITES ET RÉSEAUX TERRORISTES
-
I. UNE AFRIQUE DÉSORMAIS
INTÉGRÉE DANS LA MONDIALISATION
-
CHAPITRE 3 : UNE PRÉSENCE
FRANÇAISE EN RECUL DANS UN CONTINENT EN ESSOR
-
I. LA FRANCE ET L'AFRIQUE : UNE RELATION SANS
ÉQUIVALENT
-
A. LA FRANCE EN AFRIQUE : UNE PRÉSENCE
FORTE LIÉE À L'HISTOIRE ET À LA LANGUE
-
1. Une présence continue depuis plus de 150
ans
-
2. Un tissu de relations interpersonnelles
intenses
-
3. 100 000 Français : des
communautés concentrées en Afrique de l'Ouest
-
4. Des intérêts économiques et
stratégiques circonscrits
-
5. Une coopération au développement
majeur
-
6. Le premier partenaire militaire de
l'Afrique
-
1. Une présence continue depuis plus de 150
ans
-
B. L'AFRIQUE EN FRANCE, UNE RÉALITÉ
SOUS-ESTIMÉE
-
A. LA FRANCE EN AFRIQUE : UNE PRÉSENCE
FORTE LIÉE À L'HISTOIRE ET À LA LANGUE
-
II. UNE PRÉSENCE EN RECUL, UNE IMAGE QUI
DEMEURE AMBIGUË
-
A. DES RISQUES DE DÉCLASSEMENT
RÉELS
-
B. UNE POLITIQUE TÉTANISÉE PAR LE
DÉBAT SUR LA « FRANÇAFRIQUE » ET LE MANQUE DE
MOYENS
-
1. Un discours sur l'Afrique obnubilé par
le passé
-
2. Une stratégie introuvable pour une
politique éclatée
-
3. Un réseau diplomatique en
réduction
-
4. Une aide au développement
écartelée entre ses ambitions et ses moyens
-
a) Une priorité africaine
problématique au regard des moyens en subventions
-
b) Une progression des activités de l'AFD
dans les pays anglophones bridée par l'insuffisance des fonds
propres.
-
c) Un déséquilibre croissant entre
aide multilatérale et aide bilatérale
-
d) La coopération technique en Afrique, un
instrument sacrifié
-
a) Une priorité africaine
problématique au regard des moyens en subventions
-
5. Un dispositif militaire inadapté
-
a) Une diminution de la présence militaire
française en Afrique continue
-
b) Une attrition des moyens de la
coopération militaire contradictoire avec la volonté de
promouvoir des solutions africaines aux crises du continent
-
c) Un dispositif encore trop coûteux et
rigide, politiquement peu lisible et militairement
déséquilibré par rapport aux intérêts
français
-
a) Une diminution de la présence militaire
française en Afrique continue
-
1. Un discours sur l'Afrique obnubilé par
le passé
-
C. UNE PRÉSENCE JUGÉE AMBIVALENTE
-
D. UNE EUROPE QUI NE PREND PAS ENCORE LE
RELAIS
-
A. DES RISQUES DE DÉCLASSEMENT
RÉELS
-
III. LA FRANCE EST-ELLE EN TRAIN DE RATER UN
TOURNANT STRATÉGIQUE ?
-
A. LA FRANCE PEUT APPARAÎTRE MOINS
MENACÉE QU'ON NE LE CROIT
-
B. SANS DOUTE LA LUNE DE MIEL AVEC LES NOUVEAUX
PARTENAIRES ÉMERGENTS EST-ELLE TEMPORAIRE
-
C. MAIS, DANS LE NOUVEAU CONTEXTE
STRATÉGIQUE, IL Y A POUR LA FRANCE UN IMPÉRATIF AFRICAIN
-
1. Avec la montée des
interdépendances, l'échec de l'Afrique serait un cauchemar
-
2. Nous jouons une partie de notre future
croissance en Afrique
-
3. Sécuriser nos approvisionnements face
à une nouvelle géopolitique de la pénurie
-
4. La France et l'Europe ont intérêt
à tirer l'Afrique vers un modèle de développement
équilibré
-
5. L'Afrique n'attendra pas
-
1. Avec la montée des
interdépendances, l'échec de l'Afrique serait un cauchemar
-
A. LA FRANCE PEUT APPARAÎTRE MOINS
MENACÉE QU'ON NE LE CROIT
-
I. LA FRANCE ET L'AFRIQUE : UNE RELATION SANS
ÉQUIVALENT
-
CHAPITRE 4 : 70 MESURES POUR UNE POLITIQUE
AFRICAINE RÉNOVÉE
-
I. DÉFINIR UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE
ET COHÉRENTE
-
II. FAIRE DE L'ÉCONOMIE UNE
PRIORITÉ
-
A. RÉINVESTIR L'AFRIQUE
-
B. INTÉGRER NOS INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES FRANÇAIS DANS LES MISSIONS DE NOTRE
COOPÉRATION
-
C. PROMOUVOIR UNE CONCURRENCE ÉQUITABLE
SUR LES MARCHÉS LIÉS À LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT
-
D. SÉCURISER NOS APPROVISIONNEMENTS
STRATÉGIQUES TOUT EN GARANTISSANT L'ÉQUITÉ ET LA
TRANSPARENCE DES CONTRATS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
-
E. PROMOUVOIR L'INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE DE LA ZONE FRANC
-
A. RÉINVESTIR L'AFRIQUE
-
III. DONNER UN SENS AFRICAIN À LA
PRÉSENCE MILITAIRE FRANÇAISE
-
IV. ACCOMPAGNER L'INTÉGRATION
RÉGIONALE ET LE PLURALISME
-
A. RENFORCER NOTRE COOPÉRATION AVEC L'UNION
AFRICAINE
-
B. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT EN FAVEUR DU
PLURALISME
-
C. DÉVELOPPER LE DIALOGUE ENTRE LES
SOCIÉTÉS CIVILES
-
A. POUR UN MINISTÈRE DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE DE PLEIN EXERCICE ET UN RÉSEAU
RESSERRÉ
-
B. RESTAURER NOS CAPACITÉS D'INTERVENTION
EN AFRIQUE
-
C. RENFORCER NOTRE POLITIQUE DE PROMOTION DE
L'EXPERTISE FRANÇAISE
-
D. APPROFONDIR NOTRE RÉFLEXION SUR NOS
INTERVENTIONS DANS LES PAYS FRAGILES
-
E. RELANCER LES DISPOSITIFS DE CAPITAL
INVESTISSEMENT DANS LES PME
-
F. CRÉER UNE ALLIANCE AVEC LES PAYS
AFRICAINS EN VUE DES PROCHAINES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
-
G. MISER SUR LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE EN
CAPITALISANT SUR NOTRE COMPÉTENCE PARTENARIALE AVEC LE SUD
-
A. RENFORCER NOTRE COOPÉRATION AVEC L'UNION
AFRICAINE
-
VI. DÉFENDRE CETTE AUTRE LANGUE AFRICAINE
QU'EST LE FRANÇAIS
-
VII. MIEUX ACCUEILLIR LES ÉLITES AFRICAINES
DE DEMAIN
-
VIII. PORTER NOTRE POLITIQUE AFRICAINE AU NIVEAU
EUROPÉEN ET MULTILATÉRAL.
-
I. DÉFINIR UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE
ET COHÉRENTE
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
-
LISTE DES ENTRETIENS AU COURS DES
DÉPLACEMENTS
N° 104
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2013 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) par le groupe de travail sur la présence de la France dans une Afrique convoitée ,
Par MM. Jeanny LORGEOUX et Jean-Marie BOCKEL, Co-présidents , Mme Kalliopi ANGO ELA, MM. René BEAUMONT, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Pierre DEMERLIAT, Jean-Paul FOURNIER, Jacques GILLOT, Robert HUE, Christian NAMY, Jean-Claude PEYRONNET, Bernard PIRAS, Gilbert ROGER.
Sénateurs.
|
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini . |
10 PRIORITÉS ET 70 MESURES
POUR RELANCER LES RELATIONS DE LA FRANCE AVEC LES PAYS AFRICAINS FONDÉES SUR DES INTÉRÊTS COMMUNS DANS UN PARTENARIAT RÉNOVÉ
Première priorité : Tenir un autre discours sur l'Afrique et définir une stratégie ambitieuse et cohérente : il s'agit de quitter le « vieux récit » sur une Afrique du passé, comprendre et mettre en valeur les mutations économiques en cours, développer un narratif plus juste des liens unissant la France à des pays africains qui ne sont pas seulement partie prenante de notre histoire, mais aussi des éléments clés de notre avenir.
1) Définir la relation de la France aux pays africains d'abord en fonction de nos intérêts partagés : des millions de Français qui sont d'origine africaine, ou vivent ou ont vécu en Afrique, des intérêts économiques et stratégiques, un enjeu pour la sécurité de la France comme de l'Afrique.
2) Se départir des préventions postcoloniales et assumer le fait que l'Afrique n'est pas seulement partie prenante de notre histoire, mais aussi un élément clé de notre avenir.
3) Établir une stratégie africaine de la France sous la forme d'un Livre blanc sur l'Afrique en associant des membres représentant le Parlement, les administrations, les opérateurs, les ONG intervenant en Afrique et des personnalités qualifiées françaises, étrangères et notamment africaines.
4) Créer un programme de soutien « pour une écriture franco-africaine d'une histoire partagée » afin de promouvoir le travail d'équipes mixtes franco-africaines sur l'étude de notre histoire commune.
5) Poursuivre l'ouverture des archives sur la période coloniale.
Deuxième priorité : Améliorer le pilotage de la politique africaine et la cohérence des actions menées sur le terrain.
Devant le constat d'une politique éclatée à tous les niveaux, le groupe de travail souhaite renforcer le pilotage de la politique africaine. En dehors du Livre blanc dont l'objectif est de fédérer toutes administrations sur des objectifs communs, il propose :
6) De créer un ministère de la coopération internationale et du développement de plein exercice rassemblant les services concernés du ministère des affaires étrangères et du ministère des finances.
7) D'instaurer une structuration régionale de notre dispositif diplomatique avec la nomination d'ambassades chefs de file régionaux et la mise à jour régulière de «stratégies-régions» validées au niveau interministériel.
8) D'étudier la possibilité dans certains pays de mutualiser notre dispositif diplomatique avec certains partenaires européens afin de constituer des ambassades communes.
9) De mettre en place une cellule de haut niveau en charge de la gestion civilo-militaire des situations de crise afin d'assurer une véritable coordination entre les responsables du développement et de la sécurité là où la France est présente. Cette cellule aura pour fonction de coordonner les actions de prévention des crises ou de gestion des situations post-crises afin de favoriser le rétablissement des services publics et privés essentiels au fonctionnement normal d'un pays.
Troisième priorité : Renforcer nos liens économiques avec l'Afrique qui décolle.
Le groupe de travail estime qu'il faut désormais accentuer notre regard sur les opportunités économiques qu'offre le décollage d'une partie du continent africain. Pour cela, il propose de :
10) Structurer une démarche internationale par géographies et par secteurs qui correspondent aux besoins des marchés africains, renforcer nos moyens de soutien aux entreprises dans les pays les plus dynamiques tels que l'Afrique du Sud, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, et le Kenya, mais également l'Éthiopie, le Ghana, le Botswana, la Tanzanie ou le Mozambique
11) Développer la pratique du portage des PME par les grands groupes présents sur le continent dans une démarche adaptée aux réalités africaines.
12) Développer des stratégies de conquête des marchés africains par le bas de la Pyramide et créer avec Proparco un fonds d'investissement en partenariat public privé sur ce type de stratégie « le bas de la Pyramides » impliquant des nouvelles technologies et des entreprises françaises.
13) Mettre fin à l'hémorragie des services économiques en Afrique, établir des stratégies régionales avec l'ensemble des services intervenant dans le domaine économique, renforcer les synergies entre Ubifrance, les Missions économiques, les Chambres de Commerce et d'Industries (CCI), en France et à l'étranger (Uccife), les conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF), Oséo, Coface, Pacte PME International, et les Opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI). Soutenir les postes dépourvus de service économique ou de soutien commercial.
14) Inscrire dans le COM de l'AFD un mandat dans le cadre de sa mission au service du développement de dialogue avec les entreprises privées et les bureaux d'études français et de promotion de l'économie française autour de l'expertise.
15) Fixer à PROPARCO des objectifs de co-investissement avec des entreprises françaises et soutenir son développement en renforçant ses fonds propres et lui garantissant une plus grande autonomie organique par rapport à l'AFD.
16) Plaider au sein de l'OCDE et du G20 pour une clause de réciprocité sur l'ouverture des marchés financés par l'APD afin de pousser les pays émergents à délier leurs financements ou, le cas échéant, à exclure leurs entreprises des appels d'offres financés par l'APD.
17) Renforcer les exigences environnementales et sociales dans les dossiers d'appel d'offres pour les marchés financés par la coopération française afin de permettre aux bénéficiaires de ces financements d'éliminer, au stade de la pré-qualification et de l'évaluation des offres, des entreprises ou des propositions qui ne seraient pas conformes techniquement sur le volet responsabilité sociale et environnementale et de sanctionner une entreprise qui ne respecterait pas ses engagements lors de l'exécution de son marché.
18) Faire établir par le Comité pour les métaux stratégiques (COMES) et le SGDSN une étude des intérêts de la France en Afrique en matière d'approvisionnement stratégique et prendre en compte les conclusions de cette étude dans la définition de notre stratégie africaine.
19) Engager le processus formel d'adhésion à l'initiative sur la transparence dans les industries extractives (ITIE).
20) Engager la transposition par la France des dispositions des directives comptables concernant certaines obligations pour les entreprises extractives européennes de publier pays par pays et projet par projet les revenus tirés de l'exploitation des ressources extractives versés à des Etats et définir une stratégie d'exemplarité des entreprises publiques françaises intervenant dans ce domaine en Afrique.
21) Soutenir les initiatives et les programmes des banques multilatérales de développement dans le domaine des industries extractives.
22) Renforcer notre coopération en faveur du renforcement de capacité au profit des programmes de l'UEMOA et notamment du Programme Économique Régional (PER).
23) Veiller à ce que la conclusion des Accords de partenariat économique (APE) ne nuise pas à l'intégration régionale, inviter la Commission européenne à faire preuve de plus de souplesse dans les négociations d'accords de partenariat économique régionaux afin de déboucher sur un aboutissement positif et un renforcement de la coopération européenne en faveur de l'intégration.
Quatrième priorité : Contribuer à la stabilité et la sécurité du continent.
Le groupe de travail demande le maintien, en accord avec les États concernés, des points d'appui existants en Afrique pour les forces déployées dans la bande sahélo?saharienne et sur les façades est et ouest africaines afin de contribuer activement à la sécurité de ce continent. Il souhaite que des actions de coopération structurelle et opérationnelle permettent la consolidation des capacités militaires et des architectures de sécurité sous-régionales africaines dans le cadre de l'Union africaine et, le cas échéant, la mise en oeuvre des résolutions des Nations unies et la protection des ressortissants français. Il propose que ces déploiements soient adaptés afin de disposer de capacités réactives et flexibles en fonction de l'évolution des besoins. Il préconise que soit dédiés de façon visible quatre pôles à la coopération avec les quatre organisations régionales, à Libreville avec la brigade centre de la CEEAC, à Dakar avec la brigade de l'ouest de la CEDEAO, à la Réunion avec la brigade sud de la SADC et à Djibouti face l'IGAD afin d'afficher aux yeux des opinions publiques africaine et française le sens africain de la présence militaire française sur ce continent. Cette priorité se traduit donc par 7 mesures :
24) Maintenir huit points d'appui militaire en Afrique : Abidjan, Dakar, la zone (Mali, Niger, Burkina-Faso), Libreville, Ndjamena, Bangui, Djibouti, et l'île de la Réunion.
25) Dédier quatre points d'appui militaire à la coopération avec les 4 organisations régionales, à Libreville avec la brigade centre de la CEEAC, Dakar avec la brigade de l'ouest de la CEDEAO, la Réunion avec la brigade sud de la SADC et Djibouti avec l'IGAD, afin d'afficher clairement la volonté française de participer à l'architecture de sécurité africaine.
26) Ouvrir les pôles de coopération français à des participations de partenaires européens et internationaux à l'instar de ce qui a été fait pour les écoles nationales à vocation régionale (ENVR).
27) Dépasser la distinction entre OPEX et forces prépositionnées au profit d'un dispositif global où les effectifs de chaque base évoluent en fonction des besoins avec un repositionnement autour du Sahel et dans les pays accueillant une forte présence de ressortissants français.
28) Doter chaque point d'appui de moyens de coopération structurelle et opérationnelle aussi bien en bilatéral qu'au niveau régional ainsi que la possibilité d'une projection en cas de crise.
29) Renforcer les crédits de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) et développer les ENVR avec des financements croisés de l'ensemble des ministères concernés et un recours croissant aux financements européens, multilatéraux, voire à des partenariats avec des pays qui partagent notre vision de l'Afrique, comme le Canada, ainsi qu'à des financements des pays africains qui en ont les moyens.
30) Renforcer les moyens de suivi et de coopération avec l'Union africaine en redéployant des effectifs vers l'ambassade d'Addis Abeba et en consacrant de l'assistance technique ou des projets bien ciblés de renforcement de capacité.
Cinquième priorité : Promouvoir le pluralisme politique.
Tout en conservant à l'esprit les exigences de stabilité du continent, le groupe de travail estime que, sur le long terme, la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, et l'éthique sont des facteurs d'épanouissement des populations et de cohésion sociale et politique. C'est pourquoi il propose dans le prolongement du discours de la Baule de renouveler le discours français sur la démocratie en centrant ce discours non sur la procédure formelle d'élections, mais sur la notion de pluralisme et de contre-pouvoirs. Il souhaite également tirer les leçons pour notre diplomatie des printemps arabes et d'un dialogue trop exclusivement centré sur l'Etat. Pour cela il propose de renforcer le dialogue avec les sociétés civiles, notamment à travers les ONG et les collectivités territoriales françaises. Ces deux derniers acteurs ont tissé des liens sans équivalent avec les populations et les territoires africains.
Cette priorité se traduit donc par 4 mesures :
31) Intégrer dans les discours français sur l'avenir de l'Afrique un discours renouvelé sur la notion de pluralisme et de contre-pouvoirs.
32) Aider à la constitution de fondations en faveur de la vigilance citoyenne, des contre-pouvoirs, des médias, des parlements, et de la « société civile ».
33) Renforcer le dialogue avec les sociétés civiles et poursuivre l'engagement de doublement du montant de l'aide qui transite par les ONG.
34) Soutenir les actions de coopération décentralisée en faveur de l'Afrique et étendre le dispositif de la loi Oudin-Santini aux ordures ménagères pour financer des actions de coopération dans ce domaine dans une Afrique en urbanisation rapide.
Sixième priorité : Moderniser notre coopération au développement.
Constatant que l'enjeu n'est pas de construire une coopération d'héritage, mais de construire une coopération dont la France et l'Afrique ont besoin, le groupe de travail propose à la fois une réallocation des moyens et une rationalisation du dispositif.
S'agissant des moyens : le groupe de travail estime qu'il faut redresser l'équilibre des contributions bilatérales et multilatérales de façon à retrouver un niveau d'intervention bilatérale sous forme de subventions supérieur à 500 millions à la fin du triennum budgétaire par redéploiement et développement des financements innovants. Il propose également un renforcement des fonds propres de l'AFD et la suppression du plafond des effectifs d'un établissement qui ne bénéficie d'aucune subvention de fonctionnement et finance son activité grâce à son résultat bancaire.
Sur le plan institutionnel, en dehors de la création d'un ministère de plein exercice, qui exercerait la responsabilité des programmes budgétaires, qui sont actuellement gérés, l'un par Bercy, l'autre par le Quai d'Orsay, le groupe de travail propose de simplifier l'organisation du réseau de coopération, de poursuivre la réforme de 1998 et de la mener à son terme, en poursuivant les transferts de compétence opérationnelle au profit de l'AFD et en mettant fin à la double compétence des SCAC et des agences de l'AFD, afin de renforcer la cohérence des actions à mener et de réduire le coût du réseau.
Cette priorité se traduit donc par 14 propositions :
35) Confier à un ministère de la coopération internationale et du développement la responsabilité des programmes 110 et 209 et les services qui les gèrent.
36) Simplifier l'organisation du réseau en mettant fin à la double compétence des Services de coopération et d'action culturelle (SCAC) et des agences de l'AFD et réduire ainsi son coût en s'appuyant principalement sur les agences de l'AFD sous l'autorité des ambassadeurs.
37) Poursuivre les transferts de compétence opérationnelle au profit de l'AFD de façon à ce que les Fonds de solidarité prioritaire (FSP) (hors domaine strictement régalien (police et justice)) soient gérés par l'AFD.
38) Mutualiser des fonctions support entre les représentations des instituts de recherche pour le développement dans un même pays des opérateurs du développement.
39) Resserrer le réseau des opérateurs de recherche pour le développement autour de représentants régionaux, responsables d'une agence.
40) Mieux intégrer les besoins opérationnels dans la programmation des organismes de recherche pour le développement.
41) Redresser l'équilibre des contributions bilatérales et multilatérales de façon à retrouver un niveau d'intervention sous forme de subventions supérieures à 500 millions à la fin du triennum budgétaire.
42) Accroître la part de la taxe sur les transactions financières (TTF) française affectée à la coopération.
43) Achever le processus d'adoption de la taxe sur les transactions financières européenne et s'assurer qu'une partie sera consacrée à la solidarité internationale.
44) Poursuivre le travail de conviction pour l'adoption d'une transactions financières au niveau mondial.
45) Consacrer le rééquilibrage de l'aide bilatérale en partie à de l'aide projet sous forme de dons destinés aux pays pauvres prioritaires et en partie aux financements d'expertises en amont des projets.
46) Procéder à un renforcement comptable des fonds propres de l'AFD.
47) Intégrer un nouvel accord sur une diminution de la distribution des dividendes dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens.
48) Supprimer la détermination en valeur absolue des effectifs de l'AFD.
Septième priorité : promouvoir l'expertise technique française.
L'Afrique bénéficie aujourd'hui d'un afflux de capitaux privés et publics, si bien que l'avantage comparatif de bailleurs de fonds relativement modestes comme la France est aujourd'hui la diffusion à travers ces financements d'une expertise pertinente, performante, compétitive et adaptée aux enjeux de développement de l'Afrique. Cette expertise est un enjeu de développement et d'influence. Elle permet de déployer dans ce continent des normes, des habitudes et des valeurs qui peuvent nous lier aux pays africains et favoriser les échanges à la fois intellectuels et commerciaux. Or, dans ce domaine, la France avance en ordre dispersé aussi bien en matière de financement que d'opérateurs.
Le Groupe de travail propose de :
49) Créer un fonds dédié à l'expertise internationale géré par l'AFD et destiné à des opérateurs privés ou publics français qui rassemblent l'ensemble des financements dédiés à l'expertise à l'international, mieux articuler les instruments d'aide liée et définir une stratégie géographique et sectorielle pour les assistants techniques.
50) Regrouper dans un groupement d'intérêt public tous les opérateurs d'expertise technique publics.
Par ailleurs, le groupe de travail propose en matière de coopération au développement :
51) D'établir un bilan de nos modes d'intervention dans les pays fragiles à faible maîtrise d'ouvrage et de définir une méthodologie adaptée.
52) De relancer les dispositifs de capital investissement dans les PME en redynamisant le Fonds d'investissement et de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA).
53) De créer une alliance avec les pays africains en vue des prochaines négociations sur le climat.
54) De développer des coopérations triangulaires en collaboration avec des partenaires sans passé colonial (Canada, Australie...), avec les émergents démocratiques (Afrique du Sud, Brésil, Inde), comme avec la Chine.
Huitième priorité : Renforcement de notre action en faveur de la francophonie.
Le groupe de travail constate qu'il n'y aura pas de dividendes démographiques automatiques si nous ne formons pas des maîtres d'école dans les pays francophones. C'est pourquoi il estime qu'il faut absolument établir un véritable diagnostic sur l'état de la Francophonie en Afrique et renforcer notre participation au partenariat mondial pour l'éducation, et promouvoir des partenariats public-privé en faveur du développement de systèmes de formation professionnelle francophone qui répondent directement aux besoins des pays africains. Cette priorité se traduit par 5 propositions :
55) Renforcer sa participation au Partenariat Mondial pour l'Education.
56) Promouvoir des partenariats public-privé en faveur du développement de système de formation professionnelle en Afrique.
57) Créer une université francophone pilote à l'image de l'université Paris-Sorbonne-Abou Dhabi.
58) Encourager le développement de thèses en cotutelle franco-africaine.
59) Développer des universités numériques en coordination avec les partenaires francophones.
Neuvième priorité : rétablir une cohérence entre notre politique d'influence et notre politique migratoire
Il y a eu ces dix dernières années une incohérence entre notre politique d'influence, qui visait à former et à tisser des liens forts avec les élites africaines, et notre politique migratoire qui a détourné de la France non seulement des étudiants, mais également des artistes et des hommes d'affaires.
Le groupe de travail propose d'assouplir le code de l'entrée et du séjour des étrangers de façon à instaurer des visas pluriannuels calqués sur la durée des études, à permettre l'exercice d'une première expérience professionnelle pour les étrangers juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français, et enfin d'accorder un visa illimité aux étudiants ayant obtenu un doctorat en France.
Ces réformes doivent être accompagnées notamment d'une redynamisation de la politique d'accueil des personnalités d'avenir, de la gestion du réseau des anciens élèves des lycées français à l'étranger.
S'agissant de l'immigration économique, ou de celle en provenance de zones désertées par le développement ou soumises à des régimes autoritaires comme l'Erythrée, le groupe de travail souligne que la solution de long terme réside dans le développement harmonieux de l'Afrique, mais qu'en attendant, il faut renouer le dialogue avec les pays d'origine sur les questions migratoires et adopter des positions et des politiques cohérentes au niveau européen.
60) Modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) visait à favoriser les conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle -expérience qualifiante- pour les étrangers tout juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français.
61) Instaurer des visas pluriannuels, calqués sur la durée des études.
62) Élaborer dans chaque ambassade un plan d'accueil des demandeurs de visas.
63) Redynamiser la politique d'accueil de personnalités d'avenir
64) Développer le dispositif « Quai d'Orsay/Entreprises »
65) Entreprendre une gestion dynamique du réseau des anciens élèves des Lycées français à l'étranger et des anciens boursiers etc.
66) Relancer le dialogue avec les pays d'origine sur les questions migratoires, avec la constitution de groupes de suivi paritaires et définir des positions et des politiques cohérentes au niveau européen.
67) Redéfinir une stratégie de promotion du développement solidaire.
Dixième priorité : Définir une stratégie africaine de la France dans les instances multilatérales et européennes.
Le groupe de travail estime qu'il faut convaincre nos partenaires européens qu'une Afrique de 2 milliards d'habitants à 14 km du sud de l'Europe avec autant d'opportunités et de risques devrait être une préoccupation centrale de l'Europe. Il souligne que la France n'a pas de stratégie globale dans les instances européennes et multilatérales, ce qui l'empêche évidemment d'avoir une stratégie concertée sur les questions africaines :
68) Définir une stratégie africaine de la France dans les instances européennes.
69) Définir une stratégie française en faveur de l'Afrique dans les instances multilatérales.
70) Promouvoir la voix de l'Afrique dans la gouvernance mondiale.
En conclusion, le groupe de travail a la conviction qu'une partie de l'avenir de la France est en Afrique. C'est pourquoi il a intitulé ce rapport : « L'Afrique est notre avenir ».
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport est né d'une interrogation : d'abord sur l'évolution de l'Afrique, hier présentée comme un continent perdu, aujourd'hui louée comme le prochain continent émergent, ensuite sur la présence de la France dans ce continent hier ignoré, aujourd'hui convoité et, enfin, sur l'adaptation de notre politique étrangère à la transformation de pays africains qui furent longtemps un axe majeur de notre diplomatie.
Ce rapport est né d'une préoccupation, celle d'enrayer le déclin de l'influence de notre pays dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il est animé par une priorité : favoriser la croissance et l'influence d'une France qui doute en dépit de ses nombreux atouts et notamment de cette connaissance, de cette intimité avec un continent africain en pleine transformation qui par ailleurs exprime souvent une « demande de France ».
Car la situation est paradoxale à plus d'un titre.
D'un côté le 50 e anniversaire de l'Union Africaine en 2013 a été l'occasion pour l'ensemble des chefs d'Etat africains d'affirmer collectivement leur conviction que le temps de l'Afrique était arrivé. Et force est de constater que, dans de nombreuses capitales africaines et occidentales, les responsables politiques et économiques mondiaux, notamment asiatiques, se bousculent pour annoncer le décollage d'une nouvelle Afrique, soulignant haut et fort des taux de croissance qui font pâlir l'Europe.
De l'autre, les innombrables défis posés par la croissance démographique, le niveau de la pauvreté qu'une croissance, même élevée, n'arrive pas à enrayer, l'état souvent médiocre des infrastructures, des systèmes sanitaires et éducatifs, en un mot la faiblesse des Etats, notamment au Sahel, comme en témoigne la crise malienne, laisse penser que ce continent présente tout autant, sinon plus, de risques que d'opportunités.
Nous avons voulu comprendre les deux faces de ce même visage.
A cinq ans d'intervalle, deux analyses témoignent du chemin parcouru : l'une, de Stephen Smith, en 2004, dans son livre « Négrologie », arborait comme sous-titre « Pourquoi l'Afrique meurt », l'autre, de MM. Jean Michel Severino et Olivier Ray dans « Le temps de l'Afrique », prenait à contre-pied la vision misérabiliste de l'Afrique pour souligner son émergence et se demandait si l'Europe et la France n'étaient pas en train de rater le tournant pris par ce continent.
Sont-ce les regards qui ont changé ou est-ce la réalité ?
Quelles sont les évolutions effectivement en oeuvre ? Cette nouvelle donne est-elle durable ? Quel sera le visage de cette Afrique émergente dans 20 ans ? Comment les Etats d'Afrique accompagnent-ils ces mutations ? Quels rôles y jouent les pays occidentaux ? Quels objectifs poursuivent les pays émergents qui investissent massivement sur le continent africain ? Quelle place la France y occupe-t-elle encore ? Voilà l'objet de ce groupe de travail sur « la place de la France dans une Afrique convoitée ».
Car l'autre paradoxe de la situation actuelle est que la France, après avoir été un des seuls pays à avoir poursuivi, après les indépendances, une vraie politique en Afrique, semble être dépourvue de stratégie à long terme. Les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Américains ont défini des stratégies africaines qu'ils mettent méthodiquement en oeuvre. La France, faute de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut sur ce continent qu'elle connaît pourtant bien, navigue à vue.
Ce choix n'exclut pas des actions fortes au profit de la sécurité du continent, comme en témoigne l'intervention au Mali ; mais il ne permet pas de définir un cap.
Regardons la dernière décennie, et cela indépendamment des clivages partisans. Ce qui domine dans l'opinion française et même dans une grande partie de la classe politique envers l'Afrique, c'est l'indifférence sauf en cas d'événement médiatisé. Même au Quai d'Orsay, l'Afrique est à la marge, loin de la grande politique, loin des organisations internationales et des enceintes qui font et défont les carrières diplomatiques.
Evidemment, il y a quelques entreprises, quelques hommes politiques, quelques médias, des hommes et des femmes de culture qui restent liés à l'Afrique et passionnés par elle. Mais ce sont des groupes très minoritaires ou spécialisés. Il y a bien des générations formées à l'Afrique par le service national de coopération. Mais celui-ci n'est plus et les jeunes générations séduites par d'autres horizons semblent avoir perdu le goût de l'aventure africaine.
La gauche, quand elle s'en préoccupe, est souvent partagée entre le paternalisme et la hantise de la compromission. La droite hésite entre retour illusoire au « pré carré », souci de protection migratoire et banalisation économique et libérale.
Nous avons voulu comprendre, au-delà des postures, quels étaient les intérêts partagés de la France et des pays africains dans les prochaines décennies.
Si l'opération Serval au Mali et la perspective d'un sommet Afrique-France semblent sonner le retour d'une politique africaine, les chiffres de notre présence sur le continent ne dessinent-ils pas un recul sur tous les plans de la présence française ? Non seulement les pays africains se lancent dans une diversification des partenariats qui, cinquante ans après les indépendances, semble mettre fin, sinon à cette relation particulière avec la France, du moins à ce « colloque singulier » qui faisait une partie de notre influence en Afrique et dans le monde, mais les entreprises françaises perdent des parts de marché et parfois quittent le continent au moment même où il décolle.
Face à la formidable progression de la présence des pays émergents, la Chine en tête, l'Inde ensuite, mais aussi le Brésil, la Turquie, les pays du Golfe, Israël ou même certains pays du Maghreb, la France se cherche et hésite : entre la tentation du retrait et la volonté de maintenir des liens privilégiés avec le continent ; entre la « normalisation » et le maintien de relations personnalisées ; entre des tendances à l'européanisation avec des partenaires au demeurant plus ou moins intéressés, et le souci de conserver une politique d'influence bilatérale ; entre la conservation d'un pré carré francophone et l'affermissement des liens avec de nouveaux partenaires politiques et commerciaux ; entre la modernisation de notre appareil de coopération militaire et le maintien de forces d'intervention rapide ; entre conditionnalités démocratiques et tolérance à l'égard des régimes autoritaires, entre aide-programme et aide-projet, etc.
La France semble tétanisée par des procès d'intention liés à son passé colonial, incapable de se projeter sur le long terme, avec un continent qui, quoiqu'il arrive, avec 2 milliards d'habitants en 2050, sera un partenaire majeur de la France et de l'Europe pour le meilleur ou pour le pire.
A cette hésitation correspond l'ambivalence des Africains francophones eux-mêmes à l'égard de la France, qui oscillent entre attirance et répulsion. A la politique française du « ni ingérence, ni indifférence » répond l'accusation africaine d'immixtion ou d'inaction suivant la posture adoptée.
L'opération Serval marque-t-elle un nouveau départ ? L'histoire jugera.
Mais il suffit de lire la presse, qui après avoir salué l'opération Serval, présente bien souvent le sommet France-Afrique comme une survivance du passé tandis que n'importe quel Sommet Afrique-Chine annonce l'avenir pour comprendre que le sens même de la politique africaine fait encore débat.
Nous avons essayé de saisir pourquoi, mais, surtout, comment sortir de cette situation : en prenant conscience des enjeux de la transformation en cours sur le continent, mais aussi en mesurant nos atouts et nos faiblesses dans une Afrique de plain-pied dans la mondialisation, qui multiplie les partenariats.
À un moment où le monde est en train de fermer la parenthèse de la domination européenne ouverte au XVI e siècle, nous avons tenté d'analyser en quoi une politique africaine rénovée portée au niveau national et européen pouvait constituer un élément structurant pour l'avenir de notre politique étrangère. Pour cela, la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées a constitué un groupe de travail composé de sénateurs de toutes tendances politiques qui ont en commun un intérêt pour l'Afrique.
Chacun a apporté son expérience.
En tant que vice-présidents et rapporteurs, nous avons mis à disposition du groupe notre expérience de l'Afrique, acquise pour Jeanny Lorgeoux (PS) au début de sa carrière professionnelle au Zaïre puis dans ses fonctions de député proche du Président de la République François Mitterrand et enfin au Sénat où il préside les groupes d'amitié interparlementaires avec le Congo-Brazzaville, la Mauritanie et le Sud-Soudan, pour Jean-Marie Bockel (UDI-UC) pendant de nombreuses années dans le cadre de la coopération décentralisée à la mairie de Mulhouse, en tant que secrétaire d'État chargé de la Coopération et de la Francophonie, puis à la Défense et aux Anciens combattants.
Les autres membres du groupe ont également largement contribué à la réflexion, Robert Hue (RDSE) grâce à une expérience approfondie de l'Afrique et notamment de l'Afrique du Sud dont il préside le groupe d'amitié interparlementaire, Jean Claude Peyronnet (PS) qui est notamment co-rapporteur du budget de l'aide au développement et membre du conseil d'administration de l'Agence française de développement, Kalliopi Ango Ela (EELV), sénatrice des Français de l'étranger qui a habité plus de 20 ans en Afrique, René Beaumont (UMP) qui est notamment Président du groupe d'amitié interparlementaire France-Djibouti ainsi que les autres membres du groupe d'amitié : Jean-Pierre Demerliat (PS), Bernard Piras (PS), Gilbert Roger (PS), Jacques Gillot (PS), Jean-Paul Fournier (UMP), Jean-Pierre Cantegrit (UMP), Christian Namy (UDI-UC).
Le groupe de travail a procédé, tous les jeudis matin, pendant huit mois, à des auditions d'acteurs de haut niveau : économistes, démographes, financiers, diplomates, universitaires, militaires. Pour ne pas être prisonnier d'une vision exclusivement française, le groupe de travail a auditionné aussi bien des personnalités françaises qu'étrangères susceptibles de les éclairer sur les attentes des responsables africains. Ces rendez-vous hebdomadaires, attendus par ses membres, ont été l'occasion de nombreux échanges particulièrement riches, grâce à l'engagement de chacun et à la qualité des personnes auditionnées qui doivent ici être remerciées.
Les membres du groupe de travail se sont également rendus sur le terrain : en Afrique du Sud, puissance continentale, en Éthiopie, acteur majeur de la Corne de l'Afrique et siège de l'Union Africaine, et en Côte d'Ivoire, pays influent s'il en est de l'Afrique de l'Ouest, de la Francophonie et de la CEDEAO. Nous n'avons pas pu multiplier autant que nous l'aurions souhaité les déplacements faute de moyens et de temps. Mais nous sommes conscients que parler de l'Afrique est une gageure et souvent un raccourci intellectuel tant les différences sont nombreuses entre l'Afrique de l'Ouest et la Corne de l'Afrique, l'Afrique australe et l'Afrique centrale, mais également entre pays voisins. Nous n'avons pas voulu ignorer la diversité ethnique et culturelle des pays africains, mais tenter une réflexion d'ensemble en s'appuyant sur la diversité des expériences nationales. Toutefois pour illustrer la diversité du continent, le groupe de travail a fait produire par l'Atelier de cartographie de l'Institut d'Études politiques de Paris de nombreuses cartes qui témoignent des différences entre pays africains, mais également des caractéristiques communes du continent. La qualité des cartes produites par l'équipe de l'Atelier de cartographie de l'IEP mérite d'être soulignée et ses membres remerciés.
Dans chaque pays visité, les membres du groupe de travail ont rencontré universitaires, ministres, diplomates, journalistes, officiers généraux. Ils ont eu l'occasion de confronter les points de vue en rassemblant, lors de déjeuners de travail, l'ensemble des ambassadeurs africains et européens en poste. Ces échanges informels et des visites de terrain nous ont permis de croiser les regards sur la politique africaine de la France. Le groupe de travail a également pu bénéficier de l'éclairage des membres qui se sont déplacés en Afrique dans différents cadres, en Mauritanie, à Madagascar ou au Mali. Le groupe de travail s'est également enrichi des travaux des deux autres groupes de travail créés par notre commission, sur le Mali, co-présidé MM. Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher, et sur la Méditerranée, co-présidé par Mme Josette Durrieu et M. Christian Cambon, ainsi que des nombreuses auditions organisées par la commission dans le cadre de la préparation du Livre blanc et de la loi de programmation militaire.
A quelques semaines du prochain Sommet de l'Elysée, ces travaux nous ont permis d'apporter notre contribution aux réflexions en cours sur l'avenir de la politique africaine de la France. Quelle place la France peut-elle jouer dans l'avenir de l'Afrique ? Quelle place l'Afrique doit-elle occuper dans l'avenir de la France ? Voilà, au fond, les questions que nous nous sommes posées en essayant d'observer le présent et d'anticiper l'avenir. Car il n'y a de stratégie que sur le long terme. Souvent empêtrée dans les querelles du passé, la réflexion sur l'Afrique doit aujourd'hui se tourner vers le futur d'un continent dont la population est composée pour moitié de femmes et d'hommes de moins de 25 ans qui n'ont connu ni la colonisation, ni la décolonisation, sont nés avec un portable et Internet et se préoccupent avant tout de l'avenir.
En résumé, il y a eu, dans l'histoire des relations entre la France et les pays africains, la période coloniale, la décolonisation, la période postcoloniale ou néocoloniale avec ce que certains ont appelé la Françafrique ; nous avons voulu dessiner les contours de ce que devrait être demain une relation adaptée à un continent en pleine transformation, une relation adulte, revisitée, renouvelée autour d'un partenariat fondé sur des intérêts respectifs assumés. Nous avons voulu dessiner le visage d'une nouvelle stratégie pour l'Afrique avec à la clef une réflexion d'ensemble mais aussi des propositions concrètes.
CHAPITRE 1 : L'AFRIQUE EN MUTATION : ENJEU MAJEUR POUR LA FRANCE ET L'EUROPE
Longtemps, l'Afrique a vécu en marge du monde européen. L'Europe y a certes fait des incursions durables. Sa présence y est ancienne. Et de nombreux Européens ont voué au continent noir une véritable passion. Mais, depuis 50 ans, l'aventure coloniale avait laissé place à la décolonisation, la décolonisation à la guerre froide, sans que les soubresauts de l'histoire africaine n'infléchissent le cours de l'histoire européenne.
Depuis les indépendances, l'évolution du Nord et du Sud de la planète semblait si disjointe que certains ont pu croire que la césure des deux hémisphères du Nord et du Sud constituait un nouvel ordre mondial. Succédant à la confrontation Est/Ouest, la séparation de l'empire et des nouveaux barbares, pour reprendre l'expression du livre de Jean-Christophe Rufin, passait par la Méditerranée.
Or voilà que deux décennies plus tard, avec la mondialisation et l'éclatement du Sud lié à l'essor des pays émergents, l'étendue des transformations en cours au sein du continent africain bouleverse la donne. Les phénomènes migratoires, la menace terroriste et le développement des épidémies à l'échelle planétaire ont mis en évidence l'interdépendance de l'Europe et l'Afrique. La guerre au Mali en témoigne.
Mais ces interdépendances ne concernent pas seulement les risques et les menaces, elles portent en elles des opportunités. L'explosion démographique et le décollage économique de l'Afrique sont une bonne nouvelle pour l'Europe comme pour les pays émergents qui y investissent massivement. Dans un monde dont le centre de gravité est en train de se déplacer vers l'Asie, l'Europe et la France peuvent-elles éventuellement trouver dans l'Afrique un moteur de leur croissance future ?
Le temps où nous pouvions rester indifférents à ce qui se passait à quatorze kilomètres au Sud de la France de l'autre côté de la Méditerranée est révolu. Dans ce monde globalisé et multipolaire, les transformations en cours sur le continent africain portent une partie de notre avenir pour le pire ou le meilleur.
I. VERS UN CONTINENT DE 2 MILLIARDS D'HABITANTS AUX PORTES DE L'EUROPE
« L'Afrique a l'avenir devant elle, parce qu'elle sera dans 50 ans le continent le plus peuplé du monde, composé pour moitié de jeunes en âge de travailler et de plus en plus formés » : voilà ce que nous a dit Madame Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l'Union africaine, dans son grand bureau d'Addis Abeba, au 18 e étage d'un impressionnant bâtiment de verre et d'acier flambant neuf offert par les autorités chinoises pour la modique somme de 200 millions de dollars.
Il est vrai qu'un continent de deux milliards d'habitants est en train de se constituer aux portes de l'Europe au-delà de cette Méditerranée qui n'a jamais été une frontière, mais un trait d'union entre nos deux continents.
A. UNE EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE INÉLUCTABLE
Entre les détroits de Gibraltar et de Sicile qui séparent les deux rives de la Méditerranée de quelques dizaines de kilomètres se font face deux continents aux évolutions démographiques opposées. D'un côté, une Europe vieillissante dont la population va diminuer, de l'autre une Afrique jeune qui lancée tel un éléphant en pleine vitesse double sa population tous les 26 ans.
Dans l'histoire, cela n'a pas toujours été ainsi. De 1500 à 1900, alors que la population européenne était multipliée par 5, la population africaine avait quant à elle diminué, notamment en raison du commerce triangulaire.
Pendant ces quatre siècles, la part de l'Afrique dans la population mondiale est passée de 17 % à 7 % avec une des plus faibles densités au km 2 de la planète, 15 fois moindre que l'Europe.
Depuis un siècle, nous avons vécu progressivement un grand rattrapage. Dans les 40 ans à venir nous assisterons à une explosion démographique.
1. Une Afrique à deux milliards d'habitants
Une explosion démographique d'une ampleur et d'une vitesse inégalées, un doublement de la population qui mettra inévitablement le continent sous une tension sans précédent.
En quarante ans, l'Afrique devra accueillir, nourrir, former, loger, employer un milliard de nouveaux habitants.
Revenons sur ce chiffre. La population africaine est passée de 100 millions en 1900 à 700 millions en 2000. Elle sera de 1,9 milliard en 2050 1 ( * ) selon les dernières projections de l'ONU, soit une croissance au rythme de 4,5 % par an. Autrement dit, au siècle dernier, la population du continent a été multipliée par sept ; elle va doubler d'ici 2050.
L'Afrique d'hier, le continent vide, cette Afrique-là est en train de disparaître. En 2050, la population africaine sera, d'après les prévisions, supérieure à celle de la Chine ou de l'Inde, trois fois supérieure à celle de l'Europe, comme l'illustre le graphique ci-dessous.
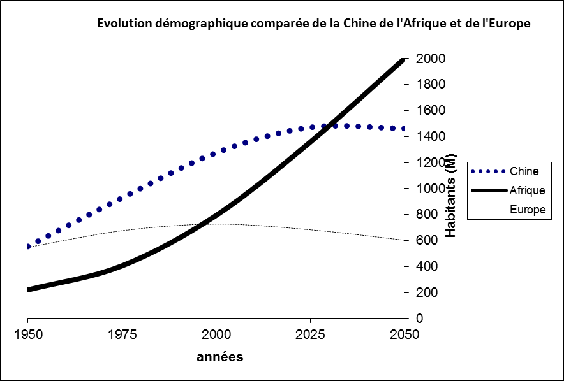 Source
: ONU
Source
: ONU
Ces chiffres sont impressionnants, mais faut-il être impressionné ? Quel crédit accorder à ces projections ? S'agit-il d'hypothèses pessimistes, de ces prévisions catastrophistes qui frappent les esprits, mais se trouvent vite démenties par l'avenir ?
Comme l'a souligné M. Carlos Lopez, Président de la commission économique de l'ONU, les projections de l'ensemble des centres de recherche de l'ONU, de l'OCDE, du FMI convergent. De plus, les estimations en matière de démographie sont en général considérées comme plus fiables que la majorité des autres types de prévisions, car elles mettent en oeuvre des mécanismes simples liés à la fécondité et à la mortalité et des dynamiques de long terme.
« Le chiffre de 1,9 milliard n'est en rien un scénario « haut » »
Il y a certes des scénarios variables en fonction de l'évolution de la fécondité et de la mortalité. Mais les tendances démographiques dégagées par l'ONU nous montrent que le chiffre de 1,9 milliard n'est en rien un scénario « haut », mais le bas de la fourchette des possibles.
2. Une transition démographique qui se fait attendre
L'Afrique n'a, en effet, que partiellement entamé la deuxième phase de sa transition démographique.
La baisse de la fécondité amorcée dans la quasi-totalité des pays africains, même si elle reste à un niveau élevé, résulte d'une multiplicité de facteurs dont l'urbanisation et le niveau de scolarisation. Comme en Europe au XX e siècle, les enquêtes montrent que les femmes africaines résidant en milieu urbain, ayant un niveau d'instruction secondaire ou plus et un revenu élevé, ont un taux de fécondité nettement inférieur à celles du monde rural. L'instruction du conjoint est également un facteur important de l'adhésion du couple à la pratique contraceptive. L'éducation intervient ainsi directement sur la fécondité par le biais de la transformation des systèmes de valeurs, par l'information et l'incitation à utiliser des méthodes contraceptives efficaces.
Tous ces indicateurs progressent en Afrique à grande vitesse. En 40 ans, l'indice de fécondité de l'Afrique subsaharienne a baissé de 1,3 enfant en moyenne. La situation est cependant variable selon les régions et à l'intérieur des régions selon les pays. La diminution du taux de fécondité a ainsi été de 3,4 enfants en Afrique australe, de 1,4 en Afrique de l'Est, mais il n'a été que de 1,2 enfant pour l'Afrique de l'Ouest.
En Afrique de l'Ouest même, la diminution de la fécondité est manifeste, elle demeure cependant très inégale selon les pays. Assez nette dans certains (Bénin, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Togo), elle est à peine amorcée dans d'autres (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Libéria).
Le Niger conserve, par exemple, avec un taux de fécondité de 7,2 enfants par femme, le taux le plus élevé du monde. Les conséquences, à terme, sont tout à fait frappantes. Le Niger, pays de 15 millions d'habitants, passera à 53 millions d'habitants en 2050. La population du Mali, 10 millions d'habitants en 2000, près de 15 millions aujourd'hui, passera à 50 millions en 2050.
Les hypothèses d'un doublement de la population se fondent sur une diminution du taux de fécondité à 2 enfants par femme contre 5,5 actuellement.
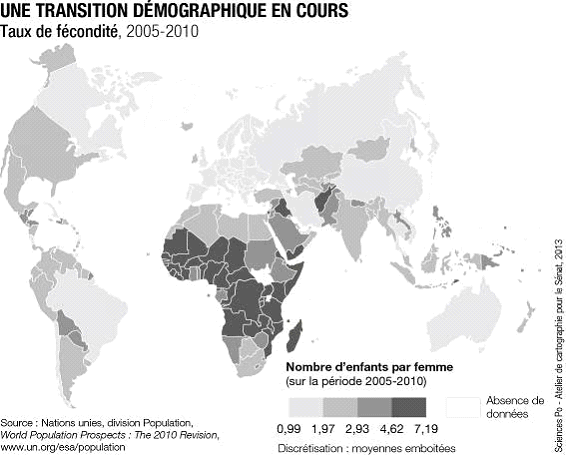
Avec cette hypothèse, la population aura été multipliée par plus de 10 en un siècle, de 170 millions en 1950 à 1,9 milliard en 2050. Mais, il s'agit bien de l'hypothèse la plus basse. Le scénario médian pour la même date est 2,4 milliards, si les tendances actuelles se poursuivaient, les projections s'élèveraient à plus de 2,9 milliards, soit un milliard de plus, la bagatelle !
Sur le fondement d'une hypothèse qu'on pourrait qualifier de mesurée, l'explosion démographique africaine prendra au cours de ces prochaines décennies une dimension dont on a du mal à prendre la mesure.
L'équivalent du sous-continent indien est en train de se constituer aux portes de l'Europe. Cela peut être un cauchemar ou une opportunité.
La première conséquence de cette explosion est de renverser le rapport entre le nombre d'actifs en âge de travailler et les personnes dépendantes à la charge de la société soit parce qu'ils sont trop jeunes soit parce qu'ils sont trop vieux.
Les trajectoires des pays émergents ont montré l'importance, dans l'accélération de la croissance économique, du rôle joué par la structure par âge, et en particulier de la diminution du rapport entre le nombre de personnes à charge de moins de 15 ans et de plus de 65 ans par rapport au nombre d'actifs. Ce rapport, que l'on appelle « taux de dépendance », est resté très élevé en Afrique du fait du poids des enfants. Dans cette phase de transition, il est amené pendant plusieurs décennies à diminuer.
Tous nos interlocuteurs, dans le cadre du groupe de travail, ont souligné que la transition démographique permettra à l'Afrique de bénéficier pendant une courte période de son histoire d'un dividende démographique.
3. Le dividende démographique : mythe ou réalité
Les plus optimistes sont les financiers et les investisseurs qui voient dans l'Afrique nouvelle une terre d'opportunité.
M. Jean-Michel Severino, ancien de la Banque mondiale, de l'AFD, aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement en Afrique nous a dit : « L'Afrique est une locomotive lancée à pleine vitesse qui va voir le nombre de ses actifs augmenter de façon phénoménale d'ici 2050 ».
M. Matthieu Pigasse, président de la Banque Lazard, a renchéri en indiquant que, dans les années 80, il y avait en Afrique une personne dépendante jeune ou vieille pour une personne en âge de travailler, cette proportion va tomber à 1 pour 2 en 2050 : « Cette nouvelle Afrique dont 2/3 des habitants ont moins de 25 ans est à la veille d'un grand chambardement. ».
M. Luc Rigouzzo, président d'Amethis Finance, société de conseil en financement et investissements pour l'Afrique, a quant à lui indiqué que « les investisseurs misent en Afrique sur tous les secteurs qui profitent de la croissance démographique qui tirent la consommation locale et la croissance en Afrique : banques de détail, biens de consommation, immobilier, infrastructures de base ».
Le temps de l'afro-pessimisme est révolu. La « Négrologie » de Stephen Smith a fait place à un vent d'optimisme. Pour beaucoup « le temps de l'Afrique » est arrivé. Ce discours sur l'« émergence » de l'Afrique est certes un discours des marchés financiers et des classes entrepreneuriales africaines, un discours d'auto-persuasion, notamment destiné à susciter la confiance. Mais ce renversement tient en grande partie à cette nouvelle perception de la démographie.
L'argument du dividende démographique pèse d'autant plus lourd qu'il s'agit d'un phénomène structurel et macroéconomique qui concerne plusieurs centaines de millions d'individus.
Si les investisseurs mettent en avant la démographie, c'est pour deux raisons : avec une telle population active, plus d'un milliard d'individus, l'Afrique va devenir le plus grand réservoir de main-d'oeuvre et de consommateurs du monde ; avec une telle population, même relativement pauvre, l'Afrique va devenir un des plus grands marchés du monde.
L'Afrique est devenue un vaste chantier, avec des échafaudages de fortune, des buildings immenses
Et comment ne pas être frappé, quand on parcourt les villes du continent, par ce vaste chantier qu'est devenue l'Afrique ? On y construit partout ! Avec des échafaudages de fortune, des buildings immenses. Car il faut loger chaque année des millions de nouveaux habitants.
Nous nous sommes rendus à Addis Abeba, à Pretoria, au Cap ou à Abidjan : on y construit çà et là, partout, des logements, des écoles, des universités, des dispensaires et des hôpitaux. Cela sera insuffisant pour loger tout le monde, mais il y a un tel effet de masse. Pas étonnant que le BTP africain constitue un moteur de la croissance. Dans beaucoup de pays, les nouveaux milliardaires africains sont des rois du béton, à l'image de M. Aliko Dangote du Nigéria, l'homme le plus riche d'Afrique, qui pèserait 16,1 milliards de dollars, à la tête d'un empire industriel fondé sur la cimenterie.
Le bâtiment n'est pas le seul secteur soutenu par la croissance démographique, car c'est l'ensemble des secteurs de la consommation qui bénéficie de cet élan. Là encore, il y a un effet de taille. Avec 2 milliards d'individus, si seulement 20 % de cette population accède à un pouvoir d'achat suffisant pour acheter des biens de consommation manufacturés, c'est un marché de plus de 400 millions de consommateurs. Avec le développement des classes moyennes, des secteurs comme la banque ou la grande distribution sont en plein essor et expliquent un afflux d'investissement direct étranger.
Demain, les Nigérians devraient être sensiblement moins nombreux que les Américains en 2050, et presque deux fois plus nombreux que les Brésiliens.
Plus que tout autre secteur, la téléphonie illustre les effets conjugués de la croissance démographique et économique. En 2000, il y avait 16 millions de mobiles actifs en circulation pour une population africaine de 800 millions d'habitants. Un téléphone pour 50 personnes.
A la fin 2011, selon une étude de Wireless Intelligence, le nombre d'abonnés africains au téléphone portable atteignait 620 millions (supérieure à celui de l'Europe et en passe de devenir le deuxième marché continental de la planète après l'Asie, et devant l'Amérique) pour une population totale ayant désormais franchi le cap du milliard d'individus. Un téléphone pour moins de deux personnes ! Avec une population de 2 milliards d'habitants, ce chiffre pourrait doubler.
De ce point de vue, l'Afrique est bien un nouveau géant. Ces dernières années, la Chine, l'Inde, le Brésil et de nombreuses autres économies émergentes ont été présentés comme les futurs poids lourds de l'économie mondiale. Le facteur démographique représente une des principales hypothèses de départ de ces prévisions. Dans cette perspective l'Afrique peut aussi se comparer à ces pays.
La population du continent est comparable en nombre à celles de la Chine et de l'Inde, et représente presque deux fois plus d'habitants qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et à la fin de ce siècle, la population africaine devrait être quatre à cinq fois plus nombreuse que celle d'Amérique du nord ou d'Europe.
La situation de certains pays mérite d'être soulignée. Ainsi aujourd'hui le Nigéria est le septième pays le plus peuplé au monde et sa population était estimée l'année dernière à 162 millions d'habitants, contre 196 millions pour le Brésil. On y recense plus d'habitants qu'en Russie. Demain, les Nigérians devraient être sensiblement moins nombreux que les Américains en 2050, et presque deux fois plus nombreux que les Brésiliens. Les projections pour la fin du siècle seraient de plus de 700 millions d'habitants. Les populations de Tanzanie et de RDC devraient toutes deux être plus nombreuses que celle du Brésil.
La vitalité démographique du continent est un atout. C'est aussi un défi, une course contre la montre.
En un siècle, entre 1950 et 2050, la population africaine aura décuplé. Cette évolution démographique, exceptionnelle par son ampleur et sa rapidité, représente un vrai défi pour le développement économique et social du continent, défi alimentaire, défi en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, défi en matière d'éducation et d'accès aux soins.
En matière d'infrastructures collectives, les décennies à venir s'apparentent à une course contre la montre.
Quant au dividende démographique, il ne produira ses effets que dans le temps et à condition qu'il y ait une maîtrise de la démographie et des politiques publiques adaptées.
Dans la phase de transition actuelle, la croissance de leur population inactive, jeune en très grande majorité, reste plus forte que celle de la population active, ce qui génère des coûts d'infrastructures croissants, ne serait-ce que dans le domaine scolaire.
C'est pourquoi les politiques publiques doivent réduire le rythme de la croissance démographique en favorisant une baisse de la fécondité.
Comme le souligne Jean-Pierre Guengant, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) : « le maintien d'une forte croissance démographique en Afrique subsaharienne pendant encore plusieurs décennies n'est pas soutenable et compromet leur ambition légitime de devenir à leur tour des pays émergents ».
Une diminution de la fécondité est une condition préalable à la possibilité pour l'Afrique de bénéficier du « dividende démographique.
La population jeune en Afrique ne sera le moteur de la prospérité économique que s'il existe non seulement des politiques nécessaires pour renforcer les opportunités qui s'offrent à cette jeunesse, mais aussi des incitations pour encourager des familles moins nombreuses.
Ces politiques de maîtrise de la démographie, de contrôle, d'espacement ou de régulation des naissances touchent les fondements même des sociétés, leurs structurations sociales, leurs traditions. Elles sont cependant au coeur de la modernisation du continent.
C'est pourquoi la planification familiale est aujourd'hui en Afrique intégrée dans une approche globale de la santé, fondée sur la promotion des femmes et le respect des droits sexuels.
De nombreux Etats ont mis en place des programmes de planification familiale avec un certain succès.
Ainsi le Rwanda, qui est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique, marqué par l'histoire tragique du génocide, a fait de la planification familiale une priorité nationale avec une politique contraceptive volontariste et une amélioration sensible des services de santé.
L'environnement politique positif en matière de planification familiale et le soutien de la communauté des donateurs ont contribué à une forte augmentation de l'utilisation des contraceptifs modernes chez les femmes mariées.
En 2004, 10 pour cent des femmes mariées utilisaient des contraceptifs. En 2010, 45 pour cent des femmes mariées utilisaient des contraceptifs modernes, l'une des augmentations les plus rapides dans l'utilisation de contraceptifs jamais enregistrée !
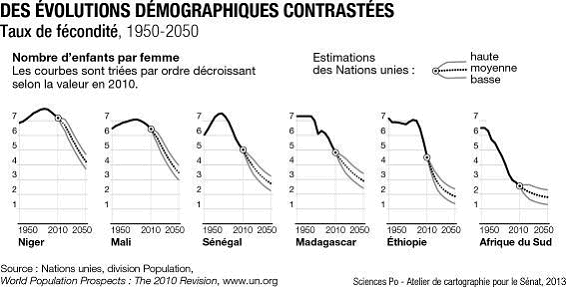
Pour l'ensemble des bailleurs de fonds qui interviennent aux côtés des Etats africains dans ces domaines, derrière les problématiques de santé et de droit des femmes, il y a cet objectif de maîtrise de la démographie.
Une partie de la maîtrise de la fécondité se joue en effet dans les inégalités de rapport entre les hommes et les femmes. Il est emblématique que la préservation des droits des femmes ait été au coeur des débats des Etats membres des Nations unies lors de la conférence internationale sur la population et de développement organisée au Caire en septembre 1994.
Fournir aux jeunes femmes des moyens de se prémunir contre des grossesses précoces permet à nombre d'entre elles d'avoir une scolarité plus longue, et, la fertilité chutant, d'accéder plus facilement au marché du travail.
La maîtrise de la fécondité se joue également dans la mise en place de politiques nationales de planning familial et leur décentralisation au niveau local, comme l'a souligné la conférence de Ouagadougou 2 ( * ) , « Population, développement et planification familiale en Afrique de l'Ouest : l'urgence d'agir » en février 2011, qui a rassemblé les représentants de huit pays francophones d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo).
Les pays d'Afrique subsaharienne ont adopté des programmes de ce genre, mais avec vingt ou trente ans de retard. Les résultats ont été décevants, pour diverses raisons : multiplicité des problèmes auxquels les pays sont confrontés (urgences obstétricales, forte mortalité maternelle et infantile, épidémie du sida), mais aussi faible mobilisation des autorités, des sociétés civiles.
C'est un enjeu qui mobilise les bailleurs de fonds publics et privés comment témoigne la tenue du Sommet pour la planification familiale organisé en 2012 par le Royaume-Uni et la Fondation Bill & Melinda Gates, avec le Fonds des Nations unies pour la Population auquel la France a participé. Ce sommet a rassemblé plus d'une centaine de pays et d'institutions du Sud et du Nord avec pour objectif de dégager les fonds et les méthodes pour permettre à 120 millions de femmes supplémentaires dans les pays les plus pauvres d'accéder à la contraception d'ici 2020 3 ( * ) .
La planification familiale constitue un axe fort de la stratégie française de réduction de la mortalité infantile et maternelle et de lutte contre le VIH-SIDA. Se situant parmi les premiers contributeurs mondiaux, la France a pris l'engagement de consacrer 100 millions d'euros supplémentaires entre 2011 et 2015 à la santé reproductive en Afrique de l'Ouest, qui doit faire face à de nombreux défis en matière de santé de la femme et de l'enfant.
Un exemple de projet est celui initié en 2002 par l'AFD en Mauritanie avec l'appui de la Coopération française et du ministère de la Santé, consistant à mettre en place un forfait obstétrical permettant à chaque femme enceinte qui paye une faible cotisation d'assurer l'ensemble des soins liés à la grossesse, l'accouchement et le suivi post-natal.
Les ONG, tout comme les bailleurs publics, adoptent une approche globale qui inclut les activités de planification familiale au sein de politiques plus larges ayant trait à la santé de la reproduction : santé maternelle et infantile, maladies sexuellement transmissibles, stérilité, inégalités hommes-femmes, etc. Ainsi, une organisation comme l' International Planned Parenthood Federation (IPPF), qui se limitait à l'origine à une fédération d'associations de Planning familial présentes dans plusieurs pays africains, s'occupe aujourd'hui de santé reproductive, de droits des femmes, de lutte contre le SIDA, de maîtrise de la fécondité ou encore d'éducation sexuelle des jeunes.
Au-delà de la maîtrise de la fécondité, cette exceptionnelle dynamique démographique sera, quel que soit son niveau, l'élément déterminant des politiques publiques des Etats africains.
Même si les États africains parviennent à maîtriser l'évolution de la fécondité, l'Afrique ne bénéficiera de ce fameux dividende démographique que si des politiques publiques adaptées assurent aux populations une sécurité alimentaire, un cadre de vie décent et, surtout, un investissement éducatif de qualité et une insertion économique des travailleurs en surnombre
Le doublement des populations de ces pays qui est déjà acquise, imposera ainsi aux Etats de prendre les mesures pour le développement d'agricultures plus productives, d'infrastructures accessibles et par la mise en place de services publics essentiels.
Mais, surtout, un enchaînement d'impacts positifs peut découler d'une population active plus vaste, mieux éduquée, avec moins d'enfants à charge, enfants qui seront à leur tour mieux éduqués et plus employables, à condition que les institutions en charge de la jeunesse soient renforcées et que des politiques économiques viables soient mises en place pour lutter contre le chômage des jeunes.
B. UNE URBANISATION VERTIGINEUSE ENTRE VILLE ET BIDONVILLE
Cette dynamique démographique s'accompagne de dynamiques spatiales, tant en termes de migration de population que d'urbanisation.
L'Afrique a longtemps été le continent le plus faiblement urbanisé de la planète, c'est encore aujourd'hui le cas avec 35 % de citadins contre 80 % en Amérique latine. En revanche, la dynamique d'urbanisation est en marche avec des taux de croissance allant jusqu'à 35 % par an, comme l'illustre la carte suivante.
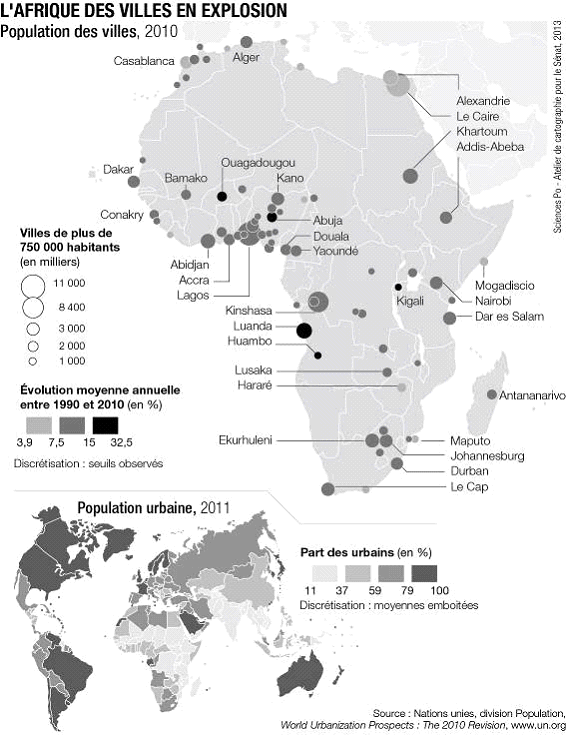
Le taux d'urbanisation de l'Afrique est cependant déjà supérieur à celui de l'Inde. Le continent compte aujourd'hui trois mégapoles, comme l'Inde, et presque autant que l'Amérique latine, qui en a quatre, alors que la Chine en héberge le double.
Quelque 400 millions d'Africains vivent en ville, soit près de 35 % de la population, contre 3 % il y a un siècle.
1. « L'exode rural est en marche »
L'Afrique rurale est en train de procéder à une vaste migration vers les villes. Des centaines de millions de ruraux sont concernés.
En 2030, le continent comptera environ 760 millions de citadins (soit plus que la population de l'ensemble de l'Europe), soit plus de la moitié de sa population.
En 1950, il n'y avait aucune ville de plus de 1 million d'habitants en Afrique subsaharienne. En 1960, seule Johannesburg atteignait ce seuil. Elles sont 53 actuellement; dans dix ans, elles seront plus de 70. A Kinshasa la population a été multipliée par dix depuis 25 ans. Lagos a vu sa population multipliée par 40.
Le défi est à la dimension de l'Afrique. Selon les dernières projections de l'ONU 4 ( * ) , en 2050, les villes africaines accueilleront plus d'un milliard d'habitants !
2. Les villes : locomotives du développement ou chaudron urbain
L'histoire des villes nous enseigne que le même processus s'est répété sur tous les continents: lors des révolutions industrielles et des phases de décollage économique, les villes ont été les locomotives du développement territorial. Ce phénomène est d'autant plus important dans une économie mondialisée. Shanghai ou Séoul en sont de belles illustrations.
Dans les grandes métropoles du littoral ouest-africain, comme Dakar, Abidjan ou Lagos, les capacités d'attraction et de rayonnement, héritées d'un positionnement géographique, géopolitique ou encore administratif particulièrement favorable, commencent cependant à être sérieusement remises en question par l'accumulation des dysfonctionnements résultant d'un urbanisme désarticulé, d'un étalement non régulé et d'un retard en matière d'équipements urbains, en particulier dans les infrastructures de transport.
Les grandes villes africaines sont encore loin d'être les moteurs économiques qu'elles devraient devenir.
20 % des urbains disposent d'eau potable et moins de 10 % ont accès à un réseau d'égouts.
C'est pourquoi, face à cette pression démographique, le développement équilibré des villes et des territoires devra être placé au coeur des politiques publiques.
Une population qui double en trente ans et qui s'urbanise à grande vitesse met nécessairement l'offre de services publics sous fortes tensions - des tensions qui pénètrent au plus profond des sociétés et des systèmes politiques.
Imaginez qu'aujourd'hui, on estime que seuls 20 % des urbains disposent d'eau potable et moins de 10 % ont accès à un réseau d'égouts.
Dans de nombreux pays, les autorités ont à faire face à de vastes « chaudrons » urbains où une jeunesse pléthorique et sans emploi est susceptible de poser des problèmes de sécurité d'une échelle inégalée.
Dans des villes riches comme le Cap, des quartiers entiers naissent et croissent de 5 % par an dans la pauvreté et la tôle ondulée pour accueillir en quelques décennies plusieurs centaines de milliers d'habitants.
A l'est du Cap, nous avons pu voir le long de la route vers la région de Stellenbosch et de Franshhoek, la terre de Huguenots français, le « Town ship » de Khayelitsha qui compterait plus d'un million d'habitants.
Ces milliers de cabanons juxtaposés, éclairés par de rares lumières alimentées par des branchements pirates aux quelques poteaux électriques qui surplombent une mer de tôles ondulées, sont devenus en quelques années des villes, l'urbanisme en moins. Ces favelas africaines héritées de l'apartheid ont grossi dans l'anarchie sans que les pouvoirs publics n'y puissent rien, sinon accepter un urbanisme de la nécessité, sans schéma, ni direction, sans infrastructure, ni réseau, sinon des rangées de toilettes préfabriquées : de monstrueux synoecismes que rien ne semble pouvoir arrêter.
Mais on aurait tort de penser que l'Afrique du Sud a le monopole des Township. A Kinshasa, la population a été multipliée par dix depuis 25 ans. Lagos a vu sa population multipliée par 40. Ces villes, à l'instar d'Abidjan, de Nairobi ou de Lagos, sont entourées de bidonvilles tentaculaires.
Comme l'a fait observer un responsable de la coopération française : « La démographie de ce continent ne sera un atout que si elle ne se traduit pas par des hordes de jeunes analphabètes campées dans des bidonvilles insalubres . » .
Dans les villes, la pauvreté s'accroît, même si, parfois, l'intense circulation des biens et des hommes en atténue la rigueur. La ville constitue un fantastique terreau pour une remise en cause et une réinterprétation de valeurs héritées, et pour l'émergence de nouvelles valeurs. Une culture urbaine se forge peu à peu. La ville favorise des processus d'individualisation propices à l'émergence de nouveaux rapports sociaux et, peut-être, à de nouveaux comportements économiques.
3. Urbanisme et aménagement du territoire : des politiques d'avenir
Comme l'a souligné un des ambassadeurs européens rencontrés à Addis Abeba, « la transformation du continent, des campagnes vers les villes, sera une véritable révolution culturelle pour l'Afrique dont on ne mesure pas encore les conséquences ».
L'Afrique de demain se dessine dans les villes et aujourd'hui trop souvent dans le chaos.
Face à cette pression démographique, le développement équilibré des villes et des territoires devra être placé au coeur des politiques publiques.
Il s'agit de répondre aux questions d'aménagement du territoire, entre milieu urbain et milieu rural, mais également en intra-urbain, aujourd'hui marquées par le dualisme entre la ville « structurée» et la ville « informelle», potentiellement déstabilisateur pour l'avenir. Cette expansion des villes s'accompagne de demandes croissantes en services, en infrastructures et en approvisionnement alimentaire. Apporter des réponses à ces demandes permettrait aux villes de constituer un atout majeur dans les dynamiques de développement, plutôt que de cristalliser les frustrations d'une pauvreté et d'inégalités croissantes.
Pour faire face à ces mutations, les États et les collectivités ont mis très longtemps à anticiper les besoins, mais aujourd'hui force est de constater que, malgré des efforts encore très inégaux, les politiques de la ville s'organisent et les plans d'aménagement et de développement urbain deviennent la règle.
Définition d'orientations stratégiques de la part des États et des autorités locales, élaboration de politiques foncières, de normes et de règles de constructions réalistes, mise en oeuvre de plans directeurs... Les gouvernements (et les collectivités locales lorsqu'elles y sont associées) font de l'aménagement et du développement urbain une priorité.
Les investissements, publics et privés, sont considérables, logements, infrastructures de base (pour l'approvisionnement en électricité et en eau, l'assainissement), équipements publics, routes, ponts, immeubles d'affaires, programmes résidentiels pour la diaspora, le tourisme, etc.
Ces politiques ne sont plus exclusivement centrées sur les capitales, mais élargies à leur agglomération et déclinées à l'échelle des villes plus petites. À l'instar du modèle sud-africain, l'idée de métropolisation fait en effet son chemin (après le Grand Casa ou le Grand Dakar s'ébauchent les plans du Grand Alger, du Grand Abidjan, du Grand Libreville...).
Enfin, longtemps oubliées dans les schémas globaux, les villes moyennes s'aménagent elles aussi, s'équipent et se relient les unes aux autres. Une tendance plutôt inspirée, sachant que la moitié des citadins du continent vit dans des villes de moins de 200 000 habitants et que c'est au sein de ces dernières, selon les projections de l'ONU-Habitat, qu'est attendue la majeure partie de la croissance urbaine en Afrique dans les dix prochaines années.
Ces politiques s'articulent dans le meilleur des cas autours de trois axes.
D'abord, réguler et maîtriser la croissance urbaine à la source, celle de l'exode rural, par des politiques d'aménagement du territoire renforçant les villes moyennes, afin de répartir l'expansion urbaine en différents points.
Ensuite, poursuivre et amplifier l'équipement et la modernisation des infrastructures de communication et de transport, des réseaux de fourniture d'énergie, et continuer également à sécuriser le cadre d'action des opérateurs, qu'il s'agisse de l'accès au foncier constructible, de la réglementation administrative et fiscale ou de la justice.
Enfin, reconnaître l'enjeu du développement économique urbain comme prioritaire au sein des politiques nationales, mobiliser les grands bailleurs de fonds sur des programmes de développement intégrés, associer davantage les acteurs économiques et démultiplier à l'échelle de chacune des grandes villes les cadres de concertation entre les autorités publiques et le secteur privé existant au niveau national.
La prise de conscience des enjeux au niveau des bailleurs de fonds est réelle. Le développement urbain occupe désormais une place centrale dans les politiques de développement des principaux bailleurs.
Les engagements de la Banque mondiale dans le secteur, en faveur des pays les plus pauvres par l'intermédiaire de l'Association internationale de développement (AID), ont ainsi considérablement augmenté ces dernières années. D'une moyenne de 0,6 milliard de dollars sur la période 2003-2007, ils ont presque triplé pour s'établir à 1,6 milliard de dollars sur la période 2008-2012. La Banque mondiale finance les services de base, le logement, les infrastructures, l'assainissement des lotissements précaires, la gouvernance municipale, l'amélioration et l'adaptation environnementale, le développement économique local.
Dans ce domaine, la France engage depuis longtemps des coopérations, forte de son expérience en matière d'urbanisme et de décentralisation. Ces projets sont soutenus au niveau national notamment par l'AFD et, au niveau local, par les très nombreuses initiatives de coopération décentralisée avec des collectivités locales ou des syndicats mixtes.
L'AFD finance des projets de politiques publiques d'accompagnement en faveur des populations les plus vulnérables des villes afin de leur offrir un accès aux services de base essentiels (eau, logement, électricité, transport, santé, éducation) et de soutien aux activités économiques (politique de l'habitat, marchés, gares, zones commerciales et industrielles, etc.).
En 2012, les projets liés aux infrastructures et au développement urbain représentaient un tiers des autorisations de financement accordées par l'AFD en Afrique subsaharienne, devant des secteurs comme l'agriculture, l'éducation ou la santé.
Ces projets se font en collaboration avec les Etats centraux, mais aussi les collectivités territoriales.
Au cours des vingt dernières années, le transfert de compétences au niveau local s'est accentué dans les pays en développement, dans le but de rapprocher pouvoirs politiques et populations. Les collectivités locales deviennent des interlocuteurs privilégiés en matière de politique de développement. Le rôle de l'AFD est alors d'accompagner ces collectivités dans la maîtrise de leurs territoires, en adoptant une approche globale qui prend en compte les principales fonctions de la ville : se loger, se déplacer, travailler, consommer. Un tel point de vue prend le pas sur une approche sectorielle plus traditionnelle qui ne permet pas d'adopter une vision d'ensemble du développement urbain.
L'AFD aide également les collectivités locales françaises en soutenant la coopération décentralisée. Le partenariat de l'Agence avec ces nouveaux acteurs de l'aide au développement se fait dans un souci de valorisation de l'expertise des collectivités françaises en matière d'urbanisme.
C. UNE JEUNESSE ENTRE ESPOIR ET RÉVOLTE
Avec près de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique possède déjà aujourd'hui la population la plus jeune du monde 5 ( * ) .
Une nouvelle Afrique qui n'aura connu ni la colonisation, ni la décolonisation est en train de naître. Ainsi au Niger, un habitant sur deux à moins de 15 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus n'y représentent que 4% de la population.
Cette Afrique-là qui est née avec la télévision, Internet et les mobiles ne regardera pas le monde de la même façon que les générations d'hier. Cette Afrique-là aura de ce fait un regard différent de nos continents en voie de vieillissement.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La part des jeunes de moins de 15 ans y représente 40 % de la population totale, contre 27 % dans l'ensemble de la population mondiale. La jeunesse africaine de moins de 25 ans constitue plus de 50 % de la population du continent, alors que, dans plusieurs pays d'Europe, ils ne représentent que 17% de la population.
1. 50 % des Africains ont moins de 25 ans
On pourrait ici multiplier les comparaisons. Toutes convergent pour souligner le poids et l'importance de cette jeunesse que l'on croise en masse dans les rues des capitales africaines.
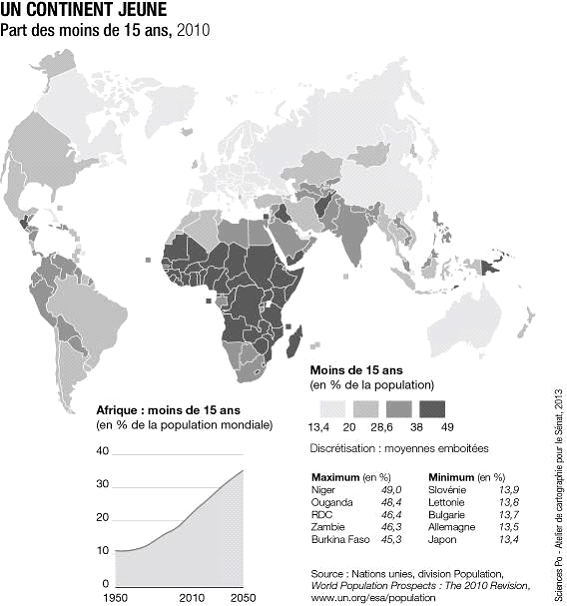
Cette jeunesse explique les besoins des pays africains en matière de formation, d'éducation et de santé. Elle détermine également les conditions d'exercice de la vie politique dans des pays où l'essentiel de l'opinion publique est composé de jeunes de moins de 25 ans.
Cette jeunesse-là, née dans les années 90, est nécessairement partagée entre tradition portée par leurs parents et la modernité véhiculée par la télévision et par Internet.
Comme dans beaucoup de pays en développement, la jeunesse africaine vit de plein fouet les mutations des sociétés traditionnelles où meurt le vieil ordre alors que le nouveau ne parvient pas à éclore. Dans cet interrègne, la jeunesse est ballottée entre les croyances traditionnelles et la foi dans la technologie occidentale, entre les rites et les cyberespaces, entre le village et la ville.
De nombreuses études soulignent une jeunesse en quête d'identité dans un « entre deux » qui explique des épisodes violents entre refondation identitaire et combats démocratiques.
Cette jeunesse est l'avenir de l'Afrique, non seulement parce qu'elle va accroître les effectifs des forces actives en âge de travailler et de consommer, et qui constituent le moteur de la croissance économique, mais également parce qu'elle est de plus en plus éduquée.
Partout, en effet, malgré les insuffisances des systèmes éducatifs, le niveau d'instruction progresse.
Depuis une dizaine d'années, des progrès considérables ont été faits en termes d'accès à l'école primaire. L'Afrique subsaharienne a enregistré les résultats les plus importants ces dix dernières années. Entre 1998 et 2009, l'effectif scolarisé a augmenté de 31% (soit 58 millions d'élèves supplémentaires). En dépit de ces résultats, 1/4 des enfants qui devraient être à l'école n'est toujours pas scolarisé. C'est désormais aux autres cycles d'enseignement qu'il faut améliorer l'accès, notamment le cycle secondaire. Seuls 34% des enfants y parviennent à l'heure actuelle malgré des progrès continus.
D'après les tendances actuelles, en 2030, 59 % des 20-24 ans auront reçu un enseignement secondaire, contre 42 % actuellement. On aura donc, pour cette tranche d'âge, 137 millions de jeunes diplômés du secondaire et 12 millions du tertiaire. Même si de graves problèmes de qualité demeurent, cette tendance créera des opportunités uniques pour le développement économique et social.
Cette jeunesse est une opportunité mais aussi un défi redoutable. Elle porte l'avenir, préfigure le futur, concentre les anciens espoirs et les nouveaux défis. Elle est, selon la formule de M. Ramtane Lamamra, Commissaire pour la Paix et la Sécurité de l'Union Africaine rencontré à Addis Abéba, « un atout et un talon d'Achille ».
2. Une opportunité mais aussi un défi redoutable
L'absorption par le marché du travail de cette jeunesse exigerait selon l'OCDE des taux de croissance de l'économie non pétrolière de l'ordre de 6 à 7 % pendant plus d'une décennie.
Le maintien des taux actuels de chômage chez les jeunes, qui s'élèvent dans certains pays à 40 %, fait courir des risques très importants. Si l'Afrique ne parvient pas à créer des opportunités économiques et d'emplois suffisantes pour offrir des conditions de vie décentes à ces centaines de millions de jeunes, la cohésion sociale et la stabilité politique s'en trouveront fragilisées.
La première conséquence de cette situation est aujourd'hui l'extrême pauvreté d'une partie de la jeunesse africaine. D'après le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 72 % des jeunes Africains vivent avec moins de 2 dollars (USD) par jour.
Le chômage, la pauvreté qui en découle mais aussi l'élévation du niveau de formation et l'effacement des valeurs traditionnelles conduisent nombres de jeunes à se révolter contre l'autorité de leurs aînés.
Comme l'a souligné devant le groupe de travail M. Maurice Enguéléguélé, Coordonnateur des Programmes IAG (Institut africain de la gouvernance), « on a vu ce processus à l'oeuvre dans le Maghreb : l'inversion des pyramides des âges, le fort taux de scolarisation couplé à celui de jeunes diplômés non ou sous-employés et un accroissement des inégalités génèrent des mouvements sociopolitiques, mais il n'est pas moins présent en Afrique subsaharienne même s'il n'a pas donné les même résultats ».
Au Sénégal, par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2012, la mobilisation des jeunes qui s'est multipliée à Dakar et dans les centres urbains a joué un rôle important dans la défaite d'Abdoulaye Wade, sur lequel les jeunes avaient fondé leurs espoirs en 2000.
Les jeunes urbains ont été les acteurs principaux de ces expressions protestataires, investissant d'une manière nouvelle l'espace public et la scène médiatique. Le collectif « Y'en a marre » (YEM) créé par un journaliste et plusieurs rappeurs, qui porte un projet de « conscientisation citoyenne » et de « remoralisation de l'espace politique », a connu un essor spectaculaire.
On a pu voir en Côte d'Ivoire, au cours de la dernière décennie, la face sombre de cette mobilisation et de son instrumentalisation possible à travers le mouvement des « Jeunes patriotes », relayant souvent des doctrines intolérantes et xénophobes. A contrario, le mouvement YEM a fait montre à plusieurs reprises d'une importante capacité de mobilisation pacifique, notamment dans ses appels à l'inscription sur les listes électorales et dans sa définition du « nouveau type de Sénégalais ».
En Afrique du sud on se souvient des «jeunes lions» héroïques qui furent les précurseurs de la démocratie et de la fin de l'apartheid.
Cette capacité de rébellion s'incarne cependant dans une réalité parfois plus cruelle. Cette jeunesse en colère instrumentalisée participe aux luttes armées et contribuent à l'instabilité du continent.
Rappelons-nous dans les années quatre-vingt des enfants-soldats du Mozambique et de la Sierra Leone, quintessence même de la désintégration civile. Et comment ne pas remarquer la jeunesse des mouvements rebelles qui sont illustrés ces dernières années en Centrafrique, au Mali ou en RDC. En témoigne la Seleka qui vient de renverser le Président Bozizé en Centrafrique composée pour une large part de jeunes. En témoigne, au Mali, Ansar Eddine, le Mujao et Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), qui ont recruté, entraîné et utilisé plusieurs centaines de jeunes et d'enfants au sein de leurs forces depuis le début de l'occupation du nord du Mali, mais aussi en République démocratique du Congo, dans le Nord-Kivu, où des milliers de garçons et filles déscolarisés ont rejoint, généralement contre leur gré, les rangs des groupes armés.
Il ne s'agit pas seulement d'exemples ponctuels, mais d'un vaste mouvement qui touche la majeure partie des États africains où l'absence d'emploi des jeunes constitue désormais un des principaux risques pour la stabilité des pays.
Ainsi la Banque mondiale, dans un rapport consacré au lien entre conflits, sécurité et développement sur l'ensemble du continent, souligne à l'issue de nombreuses études de terrain qu' « une cause majeure du ralliement des jeunes à un mouvement rebelle ou un gang urbain qui revient systématiquement dans les enquêtes d'opinion est le chômage. » 6 ( * ) . Parmi les jeunes qui rejoignent un mouvement d'insurgés, un sur deux déclare que le chômage constitue sa principale motivation.
L'enrôlement des jeunes dans des mouvements rebelles conduit inévitablement à l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Les images de ces jeunes nombreux, pauvres, désoeuvrés et donc dociles, du Libéria ou du Congo, condamnés par des chefs de guerre sans merci à se faire chair à canon le temps d'une campagne militaire, sont devenues des images récurrentes d'une Afrique en déshérence.
L'année 2012 marque le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Mettre un terme à l'utilisation d'enfants, tant par les forces armées gouvernementales que par les groupes armés non-étatiques, est malheureusement, encore aujourd'hui en Afrique, un défi.
3. L'emploi des jeunes au coeur de la stabilité du continent
De leur déplacement en Afrique, les membres du groupe de travail ont retiré la conviction largement partagée que s'ils ne modernisent pas rapidement leur économie, les pays africains risquent de gaspiller l'immense potentiel qu'offre leur population jeune.
Avec la forte croissance démographique de l'Afrique et la compression nécessaire du secteur public dans de nombreux pays, un secteur privé vigoureux constitue la principale source d'emplois pour les jeunes.
L'incapacité de la croissance forte de cette décennie en Afrique à créer des emplois en nombre suffisant constitue de loin le plus grand obstacle auquel sont confrontés les jeunes Africains aujourd'hui.
Pour maximiser l'impact sur l'emploi des jeunes d'une croissance plus vigoureuse du secteur privé et de l'économie, il faut mettre en oeuvre des mesures adaptées reposant sur une bonne compréhension des problèmes que rencontrent les jeunes qui veulent trouver un emploi décent et le conserver. L'éducation, la formation professionnelle, l'université et la recherche devront faire l'objet d'une priorité massive et déterminée. L'accès à la culture, l'élargissement des opportunités personnelles, le développement des capacités collectives et leur adaptation à l'économie en découleront.
Dans de nombreux Etats africains, la crise de l'Etat va de pair avec la perte de confiance dans le capital scolaire comme garantie d'un avenir meilleur. Certes, la plupart de ces jeunes rêvent de poursuivre des études mais une complainte revient fréquemment : « plus on a de diplômes, moins on trouve de travail ». L'inadéquation de plus en plus flagrante entre les systèmes d'enseignement et les besoins réels des économies africaines méritent d'être soulignée. L'abandon des secteurs sociaux par les bailleurs de fond dans les années 1990 fut de ce point de vue une regrettable erreur.
Sur ces sujets, la France a une expertise, notamment dans le domaine des formations professionnelle et universitaire, dans une langue qu'elle partage avec une grande partie de l'Afrique. Dans ce domaine, l'AFD, notamment, soutient la mise en place de centres de formation demandés par les pouvoirs publics africains et dédiés aux secteurs productifs moteurs des économies nationales impliquant directement les branches professionnelles concernées.
Il y a, à l'évidence, dans ces domaines, un intérêt partagé pour une coopération plus intense : les pays africains qui voudraient bénéficier du savoir-faire français, la France qui aimerait former des enseignants et des institutions plus enclines à regarder vers l'Hexagone.
La question de la jeunesse n'est, enfin, pas seulement une question sociale ou économique, mais également une question politique.
La sous-représentation des jeunes dans toutes les instances de décision économique ou politique est frappante dans un continent dont 50 % de la population a moins de 25 ans.
Dans tous les pays dans lesquels le groupe de travail s'est rendu, la jeunesse africaine aspire à prendre sa part de responsabilité dans la vie politique. Elle rejette le statut d'immaturité sociale dans lequel elle se sent enfermée. Elle revendique sa part de gestion des affaires publiques.
La Capacité de mobilisation de la jeunesse africaine crée un nouveau contexte politique
Paradoxalement, cette jeunesse africaine cherche moins à refaire le monde qu'à y trouver sa place. Elle se méfie des utopies sans lendemain dont elle paraît se lasser. Comme l'a souligné Richard Banégas devant le groupe de travail, « cette jeunesse aspire avant tout à être une consommatrice de la mondialisation et à se construire individuellement un parcours de réussite sociale. Bill Gates exerce sur elle plus de fascination que Che Guevara ».
Les jeunes Africains veulent gagner de l'argent, partir à l'étranger, revenir au pays, monter une entreprise, etc. Ils n'attendent pas grand-chose de l'Etat, juste qu'il leur donne les moyens d'une réussite qui sera d'abord une trajectoire de réussite individuelle.
La disqualification de l'action de l'Etat et des idéologies politiques a par ailleurs favorisé le foisonnement religieux auprès des jeunes. Au Sénégal où l'islam a été un élément essentiel de la stabilité politique et sociale reposant sur ce qu'on a nommé le « contrat social sénégalais », qui organise depuis la période coloniale des relations de type clientéliste entre l'Etat et les grandes confréries musulmanes, on constate l'investissement nouveau par une partie de la jeunesse urbaine des confréries religieuses de l'islam soufi comme nouveaux modèles de référence et espaces de réalisation de soi.
Au Mali qui est depuis l'indépendance une république laïque, l'islam malékite, traditionnellement modéré et tolérant, s'est vu concurrencé par des groupes « réformistes » wahhabites et salafistes, notamment sous l'influence de missionnaires venus du Pakistan et du Golfe. Un nombre croissant de jeunes en quête de repères et sensibles à leurs actions humanitaires et sociales, ont ainsi rejoint différents mouvements radicaux comme la secte fondamentaliste Dawa ou des organisations non gouvernementales comme le Croissant rouge qatari ou Qatar's charity.
Une même effervescence existe en Afrique dans l'orbite des « Eglises du Réveil » pentecôtistes, avec parfois une grande similarité dans les méthodes de prédication et dans la conception de la « réalisation de soi » avec les mouvements islamistes.
Au fond, la majorité des jeunes Africains des villes demande avant tout, comme leurs cousins du Maghreb, la liberté et la justice, le respect et la dignité.
L'ensemble de ces processus fait de la jeunesse un élément structurant de l'avenir de l'Afrique.
A l'heure où la France tente de redéfinir ses relations avec le continent, l'enjeu de demain réside précisément dans la capacité que l'on aura de renouer le dialogue avec les jeunesses africaines qui se tournent actuellement vers d'autres pays. La France doit savoir parler à cette jeunesse qui suit par ailleurs avec passion le championnat français de football.
Pour beaucoup, en particulier en Afrique francophone, la France reste une référence. D'abord parce que de nombreux concitoyens y habitent, ensuite parce qu'une partie d'entre eux souhaite y étudier ou commencer leur vie professionnelle, enfin parce que notre pays reste une référence d'émancipation, de culture et des droits de l'homme. Certains, cependant, dans la jeunesse francophone, ont le sentiment d'être délaissés, voire de ne pas être payés en retour de cette polarisation vers une France en repli, à la politique d'accueil des étudiants restrictive.
La France a pris le risque réel que les jeunes générations se détournent d'elle pour rejoindre de nouveaux partenaires. Notre diplomatie a depuis longtemps identifié cet enjeu. Chacun se souvient du 23 e sommet Afrique-France qui s'est tenu en 2005 à Bamako, consacré au thème de « la jeunesse africaine ». Plus que jamais ce thème reste d'actualité.
Cependant les jeunes savent bien que, depuis les indépendances, ils ont été constamment mobilisés par les pouvoirs en place à des fins de légitimation. Il faut faire très attention au message qui est délivré en réponse à ces attentes. S'en tenir aux promesses rituelles ne pourrait qu'accroître la colère qui monte et susciter des contre-feux qui auront des effets désastreux sur l'image de la France au sud du Sahara.
La meilleure réponse aux attentes de la jeunesse passe par l'éducation et l'emploi. Sur ce point la France a une longue expérience de coopération pour le développement des systèmes éducatifs africains.
Alors qu'à l'origine l'accent était mis exclusivement sur l'accès à l'éducation primaire, les bailleurs de fonds soulignent aujourd'hui la nécessité devant les progrès effectués de renforcer désormais le lien entre éducation post-primaire et emploi.
Dans un contexte international placé sous l'égide de programmes mis en place par l'ONU ( Éducation pour tous , Objectifs du millénaire pour le développement ), les bailleurs adoptent une approche intégrée et professionnalisante de l'éducation.
C'est le cas de la France dont la stratégie de coopération 2010-2015 « Éducation, Formation et Insertion » est basée sur la promotion de deux objectifs principaux : (i) contribuer de manière significative à la scolarisation primaire universelle et la parité filles/garçons dans l'accès à l'éducation ; (ii) adopter une vision globale de l'éducation, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur.
A travers l'AFD, la France a investi au cours des dix dernières années plus d'un milliard d'euros dans le secteur de l'éducation/formation, dont 2/3 sur le continent africain. Et dans les trois prochaines années, ses financements dans l'éducation devraient s'élever à plus de 500 millions d'euros, toujours majoritairement sur le continent africain. De même, l'AFD mène avec d'autres bailleurs de fonds de nombreuses actions en faveur de la formation professionnelle pour rapprocher les formations des besoins du marché de l'emploi. L'AFD a appuyé un peu plus de 60 projets dans une quinzaine de pays pour un montant d'environ 280 millions d'euros.
II. UNE TRANSFORMATION RAPIDE, DES SOCIÉTÉS SOUS TENSION
A l'horizon 2050, le doublement de la population africaine, avec un milliard d'habitants supplémentaire, aura des conséquences majeures sur un environnement jusqu'ici préservé et un marché du travail qui devra accueillir des dizaines de millions de nouveaux arrivants chaque année.
À eux seuls, ces deux facteurs auront à leur tour un impact sur les mouvements migratoires, d'abord en Afrique, puis en dehors du continent, notamment en Europe.
A. UNE PRESSION SUR L'ENVIRONNEMENT SANS PRÉCÉDENT
Longtemps, l'Afrique, continent vert par excellence, a préservé son équilibre écologique grâce à une des plus faibles densités humaines de la planète, des économies essentiellement rurales et une pauvreté endémique, ce qui a écarté l'Afrique des avantages, mais aussi des inconvénients des économies industrielles fondées sur la consommation et la production de masse.
1. Un modèle de croissance verte n'est pas un luxe pour l'Afrique
Comme l'écrit Nasser Zammit dans un ouvrage intitulé L'Afrique et la question environnementale 7 ( * ) : « L'Afrique est le continent de la pauvreté. Cela se traduit par le fait que sa consommation en ressources naturelles est de loin la plus faible du monde ».
Cette situation est en passe de changer.
L'empreinte écologique de l'Afrique a augmenté, selon la Banque Africaine de développement, de 240 % entre 1961 et 2008 8 ( * ) - résultat de l'accroissement des populations et de la progression de la consommation par habitant. Certaines des dégradations de l'environnement qui en résultent sont particulièrement visibles, comme l'assèchement du Lac Tchad dont la surface a diminué de 90 % depuis les années 60.
Qui a traversé les villes africaines et leurs alentours sait que, bien souvent, les sacs plastiques et les immondices jonchent le paysage. Nous avons parcouru la lagune d'Abidjan qui était autrefois la fierté des Ivoiriens et qui est aujourd'hui un cloaque qui a pollué jusqu'aux nappes phréatiques qui alimentaient hier la capitale.
À l'avenir, et en supposant que les contraintes de ressources ne limitent pas la croissance, l'empreinte écologique de l'Afrique devrait doubler à l'horizon 2040.
Les économies africaines sont en effet avant tout orientées vers l'exploitation de ce capital naturel, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la pêche ou de l'exploitation des ressources minérales et pétrolières.
Le dernier rapport de l'OCDE sur les perspectives économiques de l'Afrique en 2013 témoigne : « Toutes catégories confondues, les ressources naturelles (produits agricoles de base, bois d'oeuvre, métaux, minerais et hydrocarbures) contribuent à hauteur d'environ 35 % à la croissance de cette région depuis 2000. Les matières premières et produits semi-transformés ont constitué quelque 80 % des exportations de l'Afrique en 2011, contre 60 % au Brésil, 40 % en Inde et 14 % en Chine. De même, l'essentiel de l'investissement direct étranger (IDE) en Afrique a été consacré à des activités liées aux ressources naturelles. » 9 ( * )
Cette incroyable richesse de la nature africaine dans ses sols et ses sous-sols est un des atouts du continent qui est aujourd'hui exploité sans avoir toujours en tête sa durabilité.
Cette situation n'est pas près de changer tant la croissance démographique, l'exode rural, le développement économique vont inévitablement accentuer la pression sur les ressources naturelles des pays africains.
L'Afrique ne doublera pas sa population sans bouleverser son équilibre écologique. Il est d'ailleurs compréhensible qu'à l'instar de l'Europe le développement des activités économiques et des villes conduise à empiéter sur la nature. « On ne peut pas refuser à l'Afrique son décollage économique sous prétexte de préserver la nature ». L'enjeu est de faire en sorte que cette croissance économique ne s'effectue pas trop au détriment de la durabilité des ressources naturelles.
Cette situation est enfin en passe de changer parce que le développement de la demande de matières premières de la part des pays développés et des pays émergents est de nature à bouleverser la donne. Comme le disent Jean-Michel Severino et Olivier Ray : « L'Afrique entreprend son décollage à l'heure où l'humanité découvre la finitude de la planète » 10 ( * ) .
Dans de nombreux domaines, les marchés des matières premières commencent à montrer des signes de tension, signes d'un décalage croissant entre l'offre et la demande, voire d'une pénurie. L'Afrique constitue de ce fait une réserve déterminante, notamment pour de nombreux minerais rares. Les pays occidentaux et émergents ne s'y trompent pas et investissent massivement dans ces secteurs avec des méthodes d'extraction qui ne seraient souvent pas tolérées dans leur pays.
Dernier facteur : le changement climatique . Le continent africain apparaît, nous le verrons, comme l'un des plus vulnérables au changement et à la variabilité climatiques .
Ces quatre facteurs : concentration de la croissance sur le secteur primaire, décollage démographique et économique, croissance de la demande mondiale dans un contexte de pénurie et changement climatique vont exercer dans les 30 ans une pression considérable sur l'environnement.
Et nous n'en sommes qu'au début. Comme le souligne le dernier rapport de l'OCDE : « La comparaison avec d'autres régions montre qu'une grande partie du potentiel de ce continent reste inexploitée ».
La préservation de l'environnement est parfois présentée comme un luxe dans un continent qui doit avant tout se développer. Mais les périls climatiques, l'épuisement des sols, la pollution des villes et des sous-sols constituent autant d'hypothèques sur la croissance économique de l'Afrique.
Là où d'autres sociétés rencontrent la crise environnementale à un moment où elles disposent des ressources pour y faire face, l'Afrique y est confrontée sans avoir encore les moyens d'y faire face. Le continent africain, moins bien doté en moyens financiers, humains, techniques et institutionnels, devra payer un prix supérieur encore. La protection de l'environnement et l'adaptation à la crise environnementale globale ne sont donc pas un luxe de pays développés, mais une question essentielle pour l'avenir du continent.
2. Un capital en ressources naturelles érodé par la démographie
Une des principales ressources naturelles de l'Afrique est l'étendue de son couvert forestier et, notamment, les 220 millions d'hectares de forêt tropicale du bassin du Congo. La forêt africaine joue un rôle essentiel tant dans la préservation du climat que dans le maintien de la biodiversité.
Un couvert forestier menacé
Ces forêts constituent le deuxième massif forestier tropical du monde après l'Amazonie. Elles abritent la plus importante biodiversité d'Afrique : près de 10 000 espèces de plantes, 400 espèces de mammifères, dont les fameux grands singes, et 1 000 espèces d'oiseaux. Partagé entre six pays d'Afrique centrale, le bassin du Congo compte 80 millions d'habitants, pour lesquels il est une source d'énergie et d'alimentation essentielle.
Or ces forêts africaines font face à de multiples menaces : pressions démographiques, agriculture, activités minières, urbanisation, déforestation, autant de facteurs qui pèsent sur sa conservation et sur celle de toutes les espèces animales qu'elles abritent.
Entre 2000 et 2010, ce continent a déjà perdu 4 millions d'hectares de forêts par an, « ce qui représente près d'un tiers de la superficie déboisée dans le monde », selon la FAO 11 ( * ) . La conversion des zones forestières en zones d'agriculture permanente est la cause principale de ce déboisement.
Le taux annuel moyen de déforestation en Afrique était de plus du triple de la moyenne mondiale. La déforestation est très rapide en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, mais c'est également un phénomène réel en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, près de 80 % des forêts denses humides vierges ont été défrichées, et les poches de forêts restantes se sont sérieusement dégradées.
Aujourd'hui, l'Afrique ne représente plus que 16% de la superficie forestière mondiale. Un pourcentage qui pourrait encore baisser à l'avenir. « Les pertes de forêts devraient se poursuivre au rythme actuel. La demande croissante de denrées alimentaires et d'énergie ainsi que la hausse de leurs prix aggraveront la situation », prévoit la FAO.
Les défis environnementaux pèsent également sur le sort des forêts africaines. Sécheresses, inondations, diminution des ressources en eau... Le changement climatique devrait entraîner un besoin d'expansion des zones de pâturage. Et de plus en plus d'Africains vont avoir recours au bois de feu pour se chauffer.
Jusqu'au milieu des années 1980, les politiques forestières nationales permettant une exploitation à bas prix du capital forestier se sont accompagnées d'un gaspillage de la ressource et d'impacts importants sur l'environnement. Aux usages traditionnels de la forêt dense, se sont ajoutées l'agriculture d'exportation, les plantations de café, cacao et autres produits tropicaux qui ont largement entamé les forêts d'Afrique de l'Ouest.
Le bois de feu est la principale source d'énergie des populations des pays en développement. Le bois représente 80 % de la consommation énergétique totale dans les pays africains et l'Afrique est le seul continent où la consommation de bois énergie devrait continuer à s'accroître dans les prochaines décennies. Les forêts, et principalement les forêts périurbaines, jouent un rôle déterminant dans la fourniture de bois de feu et de charbon. De ce fait, la récolte de bois de feu a un impact majeur sur la déforestation et la dégradation dans les zones densément peuplées.
En raison de la limitation persistante de l'accès à des technologies agricoles améliorées, les paysans continuent à pratiquer une exploitation itinérante dans la grande majorité des communautés d'Afrique tropicale. Ce type d'agriculture s'est maintenu en symbiose avec l'écosystème pendant des siècles. Elle est devenue problématique à mesure que les périodes de jachère ont été réduites pour répondre aux besoins accrus de terres arables afin d'augmenter la production agricole, entraînant un déclin de la régénération des arbres, de la fertilité des sols et des rendements agricoles. C'est ainsi le cas dans certaines régions de Madagascar, où la déforestation affecte les écosystèmes de l'île, provoquant des glissements de terrain meurtriers et perturbant les régimes de précipitations.
En l'absence d'amélioration des systèmes de production alimentaire au profit de ces communautés, les menaces que ces systèmes font peser sur les forêts augmenteront immanquablement à l'avenir.
Or, dans un contexte de raréfaction des ressources pétrolières, l'utilisation et la valorisation économique des ressources renouvelables issues des forêts redeviennent un enjeu majeur. D'après la FAO, la forêt humide reculerait en moyenne d'environ 1 % par an, plus rapidement en Afrique occidentale qu'en Afrique centrale. Là encore, la situation est très contrastée selon les pays et selon les régions.
Le défi consiste donc à concilier préservation de cet espace naturel et développement économique, en privilégiant une gestion durable de ces forêts.
De nombreuses initiatives ont été prises aux niveaux national et international pour mieux encadrer les exploitations forestières. Toutefois la capacité des États à faire respecter les réglementations demeure très inégale, en particulier dans les États en crise comme en Côte d'Ivoire ou en RDC.
Le programme des Nations unies pour la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts, dit REDD+ devrait contribuer à aider ces États à promouvoir une exploitation des forêts compatible avec un développement durable.
Ce programme, auquel s'associe la Banque mondiale à travers son Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), prévoit de réduire de moitié la destruction des forêts des pays en développement à l'horizon 2020.
Le but est notamment de donner une valeur financière au carbone stocké dans les forêts, en incitant les pays en développement à réduire leurs émissions et investir dans des technologies à faibles émissions de carbone pour un développement durable. Au Sud-Est du Kenya, le projet du Couloir de Kasigau, lequel se situe entre deux parcs nationaux, protège 200 000 hectares de forêts sèches et préserve biodiversité et vie sauvage. Depuis 2009, la population locale bénéficie de la vente de crédits carbone par les partenaires privés du projet.
La France, là encore, est très présente, via l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Elle contribue notamment à la gestion durable des forêts du Bassin du Congo dans une démarche de coopération triangulaire entre l'Amazonie brésilienne, les partenaires africains et français sur ces sujets.
L'AFD a également démarré en 2000 en République Centrafricaine un projet d'accompagnement des autorités dans la mise en oeuvre de plans d'aménagement de permis forestiers. Outre l'aspect écologique, cette démarche a pour objectif de moderniser la filière bois dans le pays, en collaboration avec l'administration forestière, dans l'optique de permettre à cette dernière d'assurer contrôle et suivi.
Les ressources halieutiques surexploitées
L'Afrique dispose d'environ 37 500 km de côtes, avec un nombre varié de zones de pêche marines et d'écosystèmes, y compris des récifs coralliens, des mangroves marécageuses, des estuaires, des zones humides côtières et des rivages rocheux. Le continent dispose également de nombreuses zones de pêche intérieures. Il ressort des données disponibles que les zones de pêche à travers le monde, y compris en Afrique, s'épuisent à des taux pouvant faire penser à l'épuisement de toutes les zones de pêche marines d'ici à 2060.
Selon les estimations, au moins 70 % des réserves halieutiques sont soit pleinement exploitées, soit surexploitées, soit encore en cours de reconstitution après leur épuisement. En Afrique, la plus grave menace pour la durabilité a été la surexploitation des ressources halieutiques dans le cadre de la pêche artisanale, de la pêche à petite échelle et surtout de la pêche industrielle. Dans bon nombre de cas, les prises dépassent les niveaux viables de rendement. Dans la plupart des zones, la règlementation de la pêche s'est révélée difficile, et les ressources halieutiques locales se sont épuisées.
Les Etats africains manquent bien souvent de capacités techniques en vue de négocier sur un pied d'égalité avec leurs partenaires, notamment l'Union européenne. Par ailleurs, beaucoup de propriétaires de chalutiers étrangers n'ont pas conclu d'accords avec les pays côtiers africains et pêchent illégalement dans leurs eaux territoriales. Ces chalutiers, originaires surtout d'Europe de l'Est et de l'Ouest et d'Extrême-Orient, opèrent pour l'essentiel sans contrôle, étant donné que peu d'États côtiers disposent d'avions et de navires à même de lutter contre les intrusions.
Depuis le début des années 2000, la communauté internationale commence à prendre conscience de cette problématique.
En 2002, le Sommet de la Terre de Johannesburg s'engageait en faveur de la création d'aires marines protégées à l'horizon 2012. L'objectif de 10% d'aires marines protégées est aujourd'hui reporté à 2020. En 2005, la Banque mondiale crée PROFISH, un programme mondial sur les pêches durables. Au sein de ce programme, notons la création d'un fonds d'investissement pour des pêches durables dans les grands écosystèmes marins en Afrique Subsaharienne, un projet initié de manière conjointe avec le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). PROFISH reçoit aujourd'hui des dons de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, de la Banque mondiale, et de pays comme la Norvège, la Finlande, l'Islande, le Japon ou encore la France.
La France est en effet très impliquée dans la préservation des ressources halieutiques. C'est un enjeu de premier plan en Afrique de l'Ouest, où la pêche représente un secteur très important à l'exportation, notamment au Sénégal.
La France soutient le Réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, créé en 2002 par les Etats de la région avec le soutien des ONG. Depuis 2008, des subventions de 1,6 et 5 millions d'euros sont versées respectivement par le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) et l'AFD.
A l'est du continent, au Mozambique, l'AFD et le FFEM ont appuyé la création en 2002 du parc national des Quirimbas au Mozambique (5,2 millions d'euros à eux deux), un projet qui a également bénéficié de l'appui d'ONG (notamment du WWF). La France est également présente comme « voisin de l'Afrique » avec le parc naturel marin des Glorieuses à Mayotte, au milieu du canal du Mozambique, qui nécessite une surveillance d'autant plus forte qu'il est situé dans une zone particulièrement prisée par les pirates.
La gestion de l'eau : un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire
Une des menaces les plus préoccupantes est la pénurie prévisible d'eau dans de nombreuses zones.
L'Afrique est l'un des continents les plus secs. Elle abrite environ 22 % de toutes les terres du monde et environ 14 % de la population mondiale, contre 9 % seulement des ressources en eau renouvelables du monde. Environ 82 % des terres sont considérées comme arides ou semi arides. Un indicateur courant de rareté de l'eau est une disponibilité d'une source d'eau renouvelable de moins de 1 000 m 3 par habitant par an. Sur la base de cet indicateur, il y a une rareté d'eau physique dans la majeure partie de l'Afrique du Nord, ainsi que dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe.
Les pays nord africains comptent essentiellement sur les eaux souterraines, et beaucoup d'entre eux pompent les ressources en eaux souterraines à une cadence plus rapide que leur rechargement. La consommation d'eau augmentera pour chacune des principales utilisations : irrigation, besoins domestiques et besoins industriels.
En Afrique subsaharienne, les prélèvements d'eau moyens et la consommation totale d'eau augmenteront au moins jusqu'en 2025. Au regard des tendances actuelles de la croissance démographique et de l'utilisation de l'eau, les conclusions des recherches montrent qu'un certain nombre de pays dépasseront les limites de leurs capacités pour ce qui est des ressources en eau intérieures d'ici à 2025.
Les projections donnent à penser que le nombre de personnes vivant dans les zones où l'eau est rare en Afrique s'établira entre 350 et 403 millions d'ici à 2025, même sans changement climatique. Avec le changement climatique, le nombre de personnes pouvant être touchées par l'accentuation du stress hydrique devrait être de l'ordre de 350 à 600 millions. L'agriculture africaine, longtemps caractérisée par une très faible maîtrise de l'eau, a des besoins croissants. On observe, autour des points d'eau, des cultivateurs du Sahel empiétant sur les zones de pâturage.
Les tensions sur l'eau risquent d'avoir des conséquences géopolitiques importantes et d'être, à défaut de stratégies proactives, un des facteurs essentiels de conflits du XXI e siècle comme elle le sont ou l'ont été en Egypte et au Soudan, en Ethiopie et en Somalie, en Afrique du Sud et au Lesotho, dans les pays voisins du Nil ou du fleuve Niger.
L'eau était déjà, lors de la Conférence de Berlin, au centre des discussions sur la libre circulation des fleuves Congo et Niger. Les sociétés africaines, sauf rares exceptions, ne sont pas des civilisations hydrauliques. 4 % seulement des terres cultivées sont irriguées : en Afrique du Sud, dans la zone de l'Office du Niger au Mali, dans la moyenne vallée du Sénégal, dans le périmètre des barrages La Gézireh au Soudan. En revanche, les fleuves et les lacs (Niger, Congo, Zambèze, Orange) jouent un rôle central de délimitation des frontières et de dénomination des États.
L'eau est très inégalement répartie et conduit à opposer une Afrique en manque d'eau et une en excès d'eau. La plupart des pays souvent en aval des fleuves sont dépendants d'autres pays : Botswana, Gambie, Mauritanie, Niger, Soudan. On constate une raréfaction croissante, une baisse tendancielle de la pluviométrie et un assèchement des lacs (exemple du lac Tchad).
Les coopérations régionales entre les pays frontaliers des ressources hydrauliques seront ainsi déterminantes pour la prévention des conflits aussi bien pour le Bassin du Nil, que pour l'aménagement du fleuve Sénégal, ou le bassin du lac Tchad.
Nous avons pu constater en Éthiopie la détermination des autorités à achever la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, à la frontière soudanaise. Ce projet pharaonique (6000 MW soit deux fois Assouan, retenue de 240 km de long, plus de 5 milliards de dollars d'investissements hors connexions électriques), pour lequel chaque fonctionnaire éthiopien doit verser un mois de salaire, est pour les autorités une nécessité pour répondre à la demande d'électricité qui croit à rythme supérieur à 10 % par an. Mais il pourrait avoir des conséquences au niveau environnemental au Soudan et en Égypte. Ces pays craignent un impact sur la productivité agricole mais surtout sur la réduction de l'approvisionnement en eau douce.
Dans ce contexte, il faut toutefois noter que, pour les populations, la situation n'a pas empêché des progrès considérables ces dernières années en matière d'approvisionnement et d'assainissement d'eau.
L'Objectif du millénaire pour le développement (OMD) visant à réduire de moitié la part de la population n'ayant pas accès durablement à l'eau potable et à un assainissement de base d'ici à 2015 est en passe d'être atteint.
En 2012, le Programme commun OMS/UNICEF pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement a annoncé que la Banque mondiale avait atteint cet objectif dès 2010. Toutefois, 800 millions de personnes continuent de boire de l'eau non potable dont la qualité n'a pas été améliorée. En juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu, à travers la résolution 64/292, l'adduction d'eau et l'assainissement comme un droit fondamental.
La Banque mondiale reste très active dans ce domaine en finançant localement des projets avec les acteurs privés. Ce type de projet semble prendre le pas sur les interventions internationales massives.
La France est également pleinement impliquée dans la coopération en matière d'accès à l'eau et d'assainissement. Après avoir doublé le montant de l'aide consacrée à ce secteur entre 2003 et 2007, elle compte engager dans ce secteur, sur la période 2010-2015, par l'intermédiaire de l'AFD, 300 millions d'euros chaque année en Afrique subsaharienne.
Parmi les projets de grande ampleur, le Programme d'investissements régional Kandadji pour le développement de la vallée du Niger, auquel l'AFD participe à hauteur de 66 millions d'euros, prévoit la construction d'un barrage, d'une centrale hydroélectrique et l'aménagement de périmètres irrigués.
Des industries extractives polluantes en pleine croissance
L'Afrique dispose d'immenses ressources minières, représentant à peu près le tiers des ressources mondiales. La part de l'Afrique dans les réserves mondiales s'élève à 89 % pour le platine, 81 % pour le chrome, 61 % pour le manganèse et 60 % pour le cobalt. La strate souterraine du bassin du Congo contient d'importantes ressources en pétrole et en minerais, notamment en cuivre, manganèse et uranium, ainsi qu'en diamant et en or. Ces ressources fournissent déjà des revenus significatifs aux pays de la région.
Les industries extractives ont non seulement des impacts directs, comme la déforestation, la pollution et la dégradation des ressources naturelles, mais elles causent également des impacts indirects liés au développement des infrastructures. Sans amélioration des efforts de mitigation des impacts environnementaux et en absence de mesures compensatoires, le développement des industries extractives représentera une menace évidente pour l'environnement.
La prospection, l'exploitation des mines et l'évacuation des déchets ont parfois provoqué une dégradation importante des terres qui a porté atteinte à l'habitat local et imposé un usage différent de la terre. Les opérations de fusion du cuivre et d'autres métaux non ferreux, à l'origine d'une pollution par des poussières toxiques, d'émissions de dioxyde de soufre et de pluies acides, ont été les plus néfastes à la qualité de l'air. Dans certains cas, les forages, les drainages miniers acides, les écoulements chimiques, l'érosion des sols et les amas de déchets liés aux opérations d'extraction ont épuisé ou dégradé les eaux de surface, les eaux souterraines et les nappes aquifères locales.
Le site d'Ogoniland, au Nigeria, représente un cas particulièrement préoccupant de pollution de l'environnement due à l'extraction des ressources. Malgré l'arrêt de l'extraction de pétrole dans la région en 1993, la destruction de l'environnement et la contamination restent massives.
3. L'Afrique : une des premières victimes du réchauffement climatique ?
À la pression démographique s'ajoutent les effets du réchauffement climatique. Alors que l'Afrique produit moins de 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle mondiale, elle est considérée comme la région la plus vulnérable aux effets des changements climatiques du fait de la fragilité de ses économies.
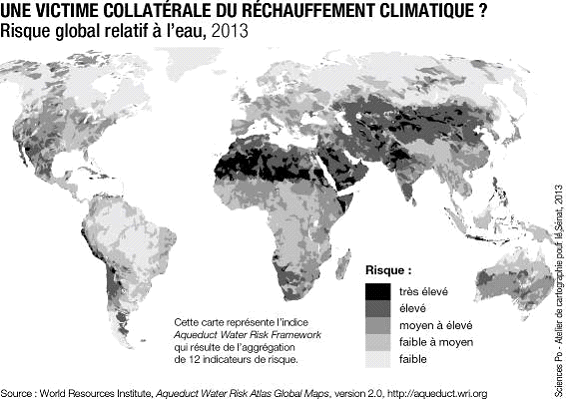
Ainsi constate-t-on des pertes de rendements agricoles particulièrement importantes dans les régions sahéliennes. Elles sont dues à la chute de fertilité des sols, mais aussi à une pluviométrie de plus en plus irrégulière, et en baisse globale en Afrique du Nord et dans certaines parties du Sahel. On en mesure déjà les impacts sur le taux de malnutrition dans un pays comme le Niger.
Le réchauffement climatique se traduit dans les zones semi-arides, où vit un tiers de la population africaine, par une irrégularité croissante des précipitations qui augmente le stress hydrique et diminue les terres arables. Ces zones risquent ainsi d'enregistrer une diminution de 26 % de leur productivité d'ici 2060 selon les estimations de la Banque mondiale.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) estime que, d'ici 2080, six cents millions de personnes supplémentaires pourraient être exposées à des risques de famine, dans leur plus grande part en Afrique subsaharienne.
D'après les experts en évolution climatique, l'Afrique sera le continent le plus affecté par les changements climatiques.
Ainsi, d'après le GIEC, sur la base des prédictions des experts, « vers l'an 2020, 75 à 250 millions de personnes seront exposées à un stress hydrique accru en raison des changements climatiques. Couplé à une demande en augmentation, le mal aura des incidences néfastes sur les moyens d'existence et aggravera les problèmes d'accès à l'eau.
Dans de nombreux pays et régions d'Afrique, on s'attend à ce que la production agricole et l'accès à la nourriture soient sérieusement compromis par la variabilité et l'évolution du climat. » 12 ( * )
Les prévisions alarmistes des changements climatiques n'épargnent pas la santé des populations. « Les expositions liées aux changements affecteront probablement la santé des millions de personnes et, en particulier, celles qui ont une faible capacité d'adaptation », prévoient les experts. Pis, « à l'horizon 2080, la population à risque par rapport au paludisme pourrait s'accroître de 80 millions. Á cela correspondront des risques plus élevés d'augmentation de la malnutrition, d'épidémies de méningites et de dengue . »
En Afrique, 250 millions d'Africains vivent le long de côtes exposées à l'élévation du niveau des mers. Ainsi, la conurbation quasi continue entre Abidjan et Lagos compte plus de 25 millions d'habitants vivant à un mètre en dessous du niveau de la mer, derrière une dune qui, vraisemblablement, ne résistera pas à une élévation du niveau de la mer.
C'est pourquoi une des préoccupations de la politique de coopération doit être de concilier développement et développement durable.
Comme l'a souligné le ministre délégué au développement lors de son audition devant la commission : « Prendre en compte le développement durable, c'est même une condition de réussite économique. Nos partenaires s'endettent aujourd'hui pour construire des barrages. Or, moins de pluies, plus de sécheresse, débouchent rapidement sur des infrastructures surdimensionnées qui tournent au ralenti. C'est déjà le cas de certains barrages au Kenya. L'impact du changement climatique modifie donc la rentabilité économique de ces ouvrages. Or, si ces infrastructures se révèlent impossibles à rentabiliser, au lieu d'être un vecteur de développement, elles se transforment en un poids supplémentaire pour les générations futures. » 13 ( * )
Comme le montre la Banque mondiale dans son récent rapport 14 ( * ) , en aggravant les sécheresses, le réchauffement climatique contribue déjà à accentuer l'insécurité alimentaire. Au final, c'est l'ensemble des progrès en termes de mortalité infantile qui pourrait être effacé du fait d'un réchauffement incontrôlé.
Autrement dit, un monde à plus 4 degrés, c'est aussi un monde où plus d'enfants mourront avant l'âge de 5 ans.
Avec 4°C de plus, 35 % des terres cultivées devraient devenir impropres à la culture. Une grande partie de la récolte et les pâturages de l'Afrique sub-saharienne peuvent s'attendre à éprouver d'importantes réductions dans la durée de la saison de croissance. Dans le cas d'un tel réchauffement, les rendements des cultures pour la production de maïs devraient être réduits de 13 à 23 % dans différentes régions africaines. Les pertes de récolte des haricots devraient être sensiblement plus élevées. La santé humaine en Afrique subsaharienne sera affectée par les températures élevées et la disponibilité réduite de l'eau, en particulier à la suite de modifications dans les modes de transmission des maladies.
Certaines régions de l'Afrique sub-saharienne pourraient faire face à une augmentation de 50 pour cent de la probabilité pour le paludisme.
Ces conditions devraient augmenter l'échelle de déplacements de population et la probabilité de conflits au fur et à mesure que les ressources deviendront plus rares.
B. UNE TENSION CONSIDÉRABLE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
De 2000 à 2008, la population en âge de travailler (15-64 ans) est passée de 443 millions à 550 millions, soit une hausse de 25 %.
En moins de 10 ans, l'Afrique s'est ainsi accrue de 100 millions d'actifs grâce à l'arrivée des jeunes générations sur le marché du travail.
Si cette tendance se poursuit, la main-d'oeuvre du continent sera d'un milliard de personnes en 2040. Ce sera la plus nombreuse population active au monde, dépassant celle de la Chine et de l'Inde
Cette période charnière qui correspond aux 20 à 30 prochaines années, pendant laquelle la population s'accroît encore rapidement alors que les emplois ne suivent pas, est celle de tous les dangers.
En moins de 10 ans, l'Afrique s'est ainsi accrue de 100 millions d'actifs.
Aujourd'hui déjà, malgré dix ans de croissance continue, les emplois créés ne sont pas suffisants pour répondre à la demande des jeunes en recherche d'emploi. Selon les estimations de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de 2000 à 2008, quelque 73 millions d'emplois ont été créés en Afrique pour plus de 100 millions de nouveaux entrants et seulement 16 millions d'emplois pour les 15-24 ans.
Les travailleurs pauvres et la précarité de l'emploi demeurent une réalité pour une majorité de jeunes Africains.
Le chômage des jeunes est aujourd'hui une des principales menaces pour la cohésion sociale au Nord comme au Sud du continent. Quelque 60 % des chômeurs africains sont des jeunes, soit 40 millions d'individus à la recherche d'un emploi. Dans la plupart des pays africains, le taux de chômage des jeunes est deux fois plus élevé que celui des adultes.
Le continent connaît désormais un nombre croissant de personnes sans emploi. Cette situation paraît d'autant plus inacceptable que l'Afrique dispose d'un potentiel impressionnant de jeunesse, de talents et de créativité.
L'Afrique de l'explosion démographique est en proie à une fracture générationnelle.
En Afrique du Sud, la mission du groupe de travail a pu constater que le chômage des jeunes s'établissait à 48 %. Le chômage des jeunes est 2,5 fois supérieur à celui des adultes. Quand ils travaillent, les jeunes sont nettement plus nombreux que les adultes à travailler dans le secteur informel, dans des conditions plus précaires, pour des salaires moins élevés.
Au total on constate que les situations de stagnation économique dans des contextes de forte démographie sont éminemment instables et dangereuses comme l'illustre le cas de la Côte d'Ivoire : la crise politique qu'a traversée ce pays depuis 1999 est largement liée au choc démographique et à l'échec économique qu'a connu ce pays depuis 1980.
Comme le souligne un récent rapport du bureau international du travail, la population croît particulièrement dans les régions où il existe peu d'opportunités de travail. La différence entre la situation de l'Afrique et de l'Asie mérite d'être soulignée.
De 2011 à 2015 le marché du travail africain devra accueillir en moyenne 2,1 millions de jeunes travailleurs supplémentaires par an alors que pendant la même période la moyenne annuelle en Asie du Sud sera de 465 000 nouveaux entrants.
C. UNE CROISSANCE IRRÉSISTIBLE DES MIGRATIONS
Si la croissance africaine n'est pas au rendez-vous, la constitution d'un continent de deux milliards d'habitants au sud de l'Europe sera à terme un risque majeur pour la stabilité de la zone méditerranéenne.
D'ici 2050, d'un côté, le nombre d'actifs européens va diminuer de 90 millions, de l'autre, l'Afrique subsaharienne va gagner 700 millions d'actifs .
Regardons les tendances à l'oeuvre à partir des hypothèses de la Banque mondiale : d'un côté de la Méditerranée, la population européenne diminuant de 57 millions d'habitants avec une population active en décroissance d'environ 90 millions de personnes en âge de travailler, mais conservant un des pouvoirs d'achat le plus élevé au monde ; de l'autre, une Afrique subsaharienne qui aura gagné 950 millions d'habitants dont 700 millions en âge de travailler avec un pouvoir d'achat qui risque de demeurer un des plus faibles du monde.
Changements prévus de la taille de la population en âge de travailler dans les régions mondiales sélectionnées, 2005-50 (en millions)
|
classe d'âge |
Afrique subsaharienne |
Moyen-Orient et Afrique du Nord |
Asie du Sud |
Asie de l'Est et Pacifique |
Europe de l'Est et Asie centrale |
Union européenne et autre Europe |
Amérique du Nord |
|
15-24 |
163 |
10 |
27 |
-78 |
-26 |
-18 |
-7 |
|
25-39 |
262 |
53 |
178 |
-63 |
-14 |
-37 |
- |
|
40M |
274 |
124 |
450 |
215 |
15 |
-33 |
1 |
|
Total en âge de travailler (l5-64) |
699 |
187 |
655 |
72 |
-26 |
-88 |
-12 |
|
Population totale |
951 |
270 |
863 |
321 |
i |
-57 |
22 |
Source: Optimisation du phénomène migratoire pour l'Afrique Envois de fonds, compétences et investissements Banque Mondiale 2011
La croissance des mouvements migratoires qui résultera de cette pression démographique sera sans précédent. Déjà, les drames frontaliers aux portes de l'Europe interpellent : à la fois problème politique complexe et délicat et tragédies qui en appellent à la morale la plus élémentaire.
Entre les deux rives de la Méditerranée se trouvent aujourd'hui les inégalités les plus fortes au monde. Les drames à Ceuta et Melilla dans le nord du Maroc ou au large de l'île de Lampedusa au sud de la Sicile illustrent l'attractivité de l'Europe, l'énergie et le désespoir qui animent les candidats à l'immigration.
Demain, cette pression migratoire est susceptible de redoubler d'intensité. Elle concernera cependant d'abord l'Afrique elle-même.
1. Une intensification des migrations régionales.
A l'aune des tendances actuelles et contrairement à la perception qu'en ont nombre de nos concitoyens, le continent noir n'immigre pas d'abord en Europe mais en Afrique.
Bertrand Badie, professeur des Universités à l'Institut d'études politiques de Paris nous l'a dit d'emblée dans son exposé liminaire : « En Afrique, la mobilité est la règle ». Les sociétés africaines sont accoutumées à la mobilité.
Le groupe de travail a pu constater sur place, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire à Abidjan, l'importance de cette immigration africaine qui se compte en millions d'individus venus chercher un travail dans des pays en forte croissance.
Promenez-vous au Cap ou à Pretoria dans les boutiques et les restaurants, on y parle français plus souvent qu'on pourrait s'y attendre tant les Camerounais et les Gabonais y sont présents.
Les migrations appartiennent à l'histoire et à la géographie africaine. Elles sont aussi anciennes que les transhumances saisonnières que l'on rencontre aux quatre coins du continent et notamment dans les zones sahéliennes au Niger et au Burkina Faso, mais aussi au Bénin, au Togo ou encore au Tchad.
Ces transhumances pastorales traversent les frontières nationales comme d'ailleurs nombre d'implantations ethniques qui se sont vu divisées par les frontières coloniales étroites créées ex-nihilo entre 1885 et 1910 et confirmées aux indépendances selon des tracés arbitraires.
Paradoxalement, le renforcement des constructions étatiques et des frontières, quand il a lieu, a revigoré des traditions migratoires précoloniales, celles des Luba en Afrique centrale, des Tchokwe entre le Zaïre et l'Angola, des Fang entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, alors que se réactivent les traditions nomadiques des Somali, dans la Corne de l'Afrique, des Masaï et des Turkana en Afrique orientale.
Aux migrations volontaires s'ajoutent les départs forcés, ceux des réfugiés dont les déplacements ont été provoqués par les conflits ou les catastrophes.
On estime à 11 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en Afrique à la fin de 2010, notamment au Soudan (4,5 à 5,2 millions), en République démocratique du Congo (1,7 million) et en Somalie (1,5 million). A ces déplacés s'ajoutent 2 à 3 millions de réfugiés autour du Mali, au Kenya, au Tchad, au Soudan 15 ( * ) .
Regardons les cartes de ces migrations. Sur 30 millions de migrants, 7 se dirigent vers l'Europe, 6 vers d'autres destinations extra-africaines, 15 au sein du continent.
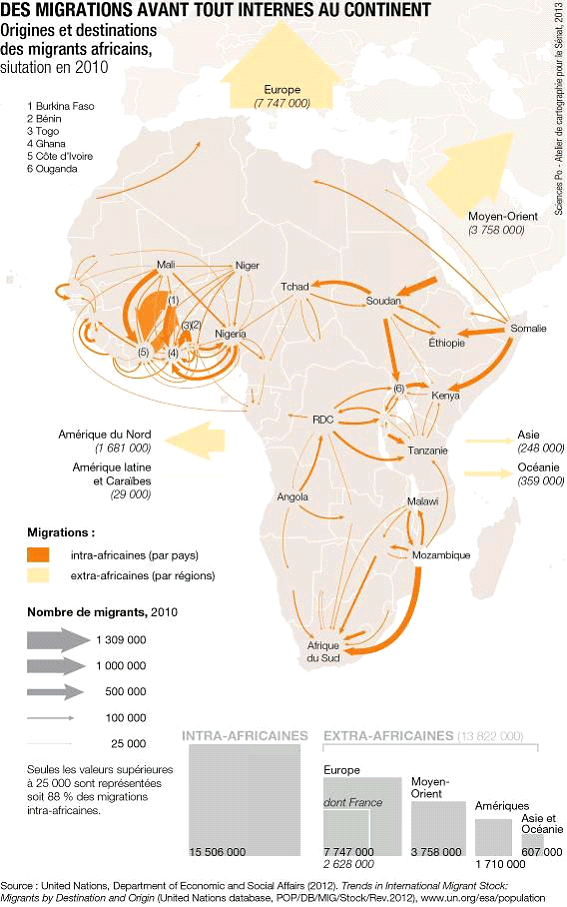
Pas étonnant dès lors que l'Afrique soit l'un des continents qui accueille le plus grand nombre de migrants. Sur ces 30 millions, plus de la moitié vivent en Afrique. Les migrations intra régionales en Afrique de l'Ouest subsaharienne représenteraient déjà actuellement près de dix fois les migrations de la zone vers l'Europe.
La majorité des migrants restent dans leurs sous-régions, avec des différences notables selon les différentes parties du continent. En Afrique de l'Ouest, par exemple, plus de 70 % de l'émigration intra-africaine se situaient dans la sous-région. À l'opposé, plus de 90 % des migrants provenant d'Afrique du Nord émigrent vers des pays en dehors de la région 16 ( * ) .
Sur 30 millions d'immigrés provenant de pays africains, plus de la moitié reste sur le continent
Ces migrations parfois massives suscitent des difficultés significatives pour les gouvernements. Des politiques répressives, voire des expulsions en masse, ne sont pas rares et suscitent en retour ressentiment et violence.
Ces mouvements sont d'autant plus difficiles à gérer que l'Afrique est un continent fragmenté composé de multiples petits pays. 51 % des habitants sont répartis dans 46 pays, le reste étant regroupé dans six États dont le Nigéria avec 433 millions d'habitants, l'Ethiopie (174), la Tanzanie (138), la RDC (149), l'Egypte (123) et l'Ouganda (106).
Avec une population supérieure, l'Inde connaît des mouvements migratoires de grande ampleur entre états, mais au sein d'un même pays, d'une même entité juridique. En Afrique, rien de comparable. Ces mouvements parfois très rapides constituent des défis politiques importants pour les gouvernements et des coûts plus élevés pour les migrants qui font face à des systèmes juridiques et réglementaires différents et parfois à l'hostilité des populations d'accueil.
De la capacité à organiser cette respiration naturelle du continent que sont les migrations régionales dépendra une bonne partie de la stabilité du continent.
Comme l'a souligné Jean Christophe Rufin devant le groupe de travail « Cette aptitude à la libre mobilité a toujours joué un rôle d'équilibre. Le drame aujourd'hui, responsable de la naissance de nouveaux archipels de la misère, ce n'est pas le mouvement mais son blocage. Le déracinement ne naît pas du déplacement mais du fait que ce déplacement soit dévié vers des destinations sans retour, sans avenir et sans liberté. » Deux grands obstacles ont été dressés en Afrique sur le libre chemin de la migration, la frontière et la ville.
Le niveau de la croissance, sa répartition dans l'espace, l'intensification ou la réduction des conflits armés, l'incidence du réchauffement climatique sur les zones arides, le niveau d'intégration du continent, la plus ou moins grande diffusion des théories xénophobes détermineront à leur tour la capacité du continent à faire face au doublement de sa population.
Dans ce contexte, les progrès de l'intégration régionale, la défragmentation du continent, mais aussi les coopérations transfrontalières joueront un rôle important.
L'augmentation de la population et la hausse rapide du taux d'équipement en moyens de communication et de transport vont conférer aux régions frontalières, des régions déjà peuplées, une fonction croissante d'interface. Il sera donc impératif d'encourager les coopérations transfrontalières d'initiative locale.
Les organisations régionales ont un rôle essentiel pour favoriser la libre circulation, pour réduire le temps d'attente à la frontière et équiper en services les agglomérations frontalières.
Comme l'a souligné Michel Foucher, géographe, ancien ambassadeur et directeur des études à l'IHEDN : « la « coopération » transfrontalière est déjà une pratique répandue sur le continent : le dispositif « SKBO » (Sikasso - Korhogo - Bobo Dioulasso - Banfora), les relations entre le sud du Niger et le nord du Nigéria, les initiatives prises dans le cadre de la Sénégambie méridionale, les coopérations pour faire fonctionner les grands corridors de transport (de Kampala à Mombassa, de Lusaka à Richards Bay, de Johannesburg à Maputo, de Ouagadougou à Tema, de Djibouti et Berbera à Addis Abeba, demain de Juba à Lamu) »
Il est notable de constater que les activités transfrontalières prospèrent le long des frontières déjà réglées, comme celles entre la Mauritanie et le Burkina Faso ou le Nigéria et le Niger. Les relations qui se sont établies entre riverains autour des rivières et des lacs (Sénégal, Niger, Congo, Oubangui, Okavango, Nil) vont dans le même sens.
A l'inverse les segments frontaliers qui sont sujets à des tensions bloquent les relations normales d'échelle locale (Tchad/Soudan, Tchad/RCA). La sécurité locale et régionale est cruciale non seulement dans les relations entre les États mais aussi au plan local (Ouganda, Kenya, RDC).
2. Des risques d'instabilité accrus
De la capacité à organiser cette respiration naturelle du continent que sont les migrations régionales dépendra une bonne partie de la stabilité du continent.
Le passé récent de la Côte d'Ivoire nous fournit cependant une illustration dramatique des bouleversements liés à cette évolution démographique.
Il y avait 11 habitants au km² en Côte d'Ivoire en 1960; il y en a 63 aujourd'hui, et il y en aura 110 en 2050 (soit l'équivalent de la densité en France). Si la France avait connu la même croissance que la Côte d'Ivoire entre 1960 et 2007, elle compterait aujourd'hui 240 millions d'habitants, dont 60 millions d'étrangers.
Les responsabilités des acteurs politiques de la tragédie qu'a vécue la Côte d'Ivoire au tournant du XXI e siècle peuvent être appréciées diversement. En tout état de cause, celle-ci s'est déroulée sur fond d'une équation à quatre facteurs : le délabrement économique dû à l'effondrement du prix du cacao ; une jeunesse nombreuse ; une population urbaine multipliée par vingt-cinq en l'espace de cinquante ans ; une forte immigration en provenance des pays voisins.
Or trois des quatre termes de cette équation s'amplifieront dans les décennies à venir. La Côte d'Ivoire devra gérer un nouveau quasi-doublement de sa population dans les 50 prochaines années. La ville d'Abidjan est passée de 100 000 à 4 millions d'habitants pendant la même période, et sa population devrait encore progresser vers 5-6 millions dans les décennies qui viennent.
Et ces changements concerneront tout autant la Côte d'Ivoire que le Ghana, le Tchad, la République démocratique du Congo (RDC) ou le Kenya. Comment ne pas faire le rapprochement entre les pogroms de jeunes patriotes ivoiriens contre les migrants burkinabés, les exactions des jeunes Kikuyus, Kalenjins ou Luos des bidonvilles nairobiens lors de l'explosion de violence de janvier 2008 et les violences urbaines anti migrants à Johannesburg en mai de la même année ?
Plusieurs frontières sont à la limite de la cassure ; un mouvement de sécessions en cascade, une transformation profonde du paysage géopolitique du continent et une remise en cause des frontières héritées de la colonisation ne sont pas à exclure. Frontières coloniales souvent mais pas toujours artificielles, qui ont garanti, bon an, mal an, une certaine stabilité de la carte de l'Afrique et une paix toute relative pendant plus d'un demi-siècle.
On relève depuis 1964 environ quarante-deux cas de tensions latentes et conflits ouverts autour de questions frontalières stricto sensu, à l'exclusion des problèmes internes.
Cette stabilité des configurations territoriales a semblé remise en cause en Afrique de l'Est avec le précédent érythréen, la quasi-indépendance du Somaliland et la sécession du Soudan méridional décidée par ses électeurs lors du référendum de janvier 2011, sans que des questions cruciales n'aient été résolues : citoyenneté, droit de circulation entre les deux pays, partage des revenus du pétrole dont le Sud possède 70 % des gisements, tracé exact de la frontière et sort de la zone litigieuse d'Abyeï qui doit être tranché par un référendum séparé.
Mais les parties en présence ont accepté les nouvelles réalités. S'agit-il d'un tournant dans la politique des États et des puissances extérieures encore influentes ? Il est trop tôt pour l'affirmer. La vigilance reste requise à l'égard d'autres situations de tensions, notamment en Afrique centrale, pour éviter que les deux cas cités ne fassent précédent.
Là encore l'intégration régionale, le recours aux négociations bilatérales ou à des procédures juridiques seront incontournables pour gérer les crises à venir.
3. L'Afrique à l'assaut de l'Europe ?
Le risque d'un chômage de masse pour les centaines de millions de jeunes Africains attendus d'ici à 2050 constitue une menace d'abord pour la stabilité d'une Afrique devenue plus urbaine et soumise aux pressions de migrations renforcées par la pression démographique, ensuite pour le Maghreb et l'Europe. Le changement d'échelle dans les prochaines décennies accentuera la mobilité de population qui sera d'autant plus forte qu'elle sera jeune.
Pour les candidats aux départs, la migration vers l'Europe paraît comme une fenêtre ouverte vers le monde, la liberté, l'accès à la modernité, vers une vie meilleure, et parfois vers la survie comme en témoigne le drame récent au large de Lampedusa.
Et il y a fort à parier que cela le restera, même si la croissance actuelle du continent africain pourrait limiter cette tendance voire, pour certaines catégories de la population, sonner l'heure du retour au pays natal.
Pour nombre de pays d'accueil, cela apparaît comme un facteur de flexibilité, de main-d'oeuvre bon marché, mais aussi de malaise face à une altérité rapidement considérée comme une menace. Le développement du populisme et de la xénophobie ces dernières années en Europe, alimenté par la crise économique et les effets de la mondialisation, s'est appuyé sur la question de l'émigration. Il est probable que cela restera un ressort d'autant plus puissant que la population européenne est en déclin et que l'économie européenne aura besoin, pour faire face à la diminution de sa population active, de faire appel à l'immigration.
Des deux côtés de la Méditerranée vont se faire face un continent européen dont la population va diminuer d'ici 2014 de 15 % et un continent africain dont la population va au moins doubler (+115 %).
Dans l'hypothèse où la pression migratoire rencontrerait de trop nombreux obstacles au sein du continent africain, il est probable que l'immigration intra-africaine s'orientera au-delà du continent. Dans quelle proportion ? Il est difficile de le savoir.
Un doublement des flux extra-africains ?
Le seul doublement de la population active, avec 900 millions de nouveaux entrants en 40 ans, est en soi un phénomène considérable. Le niveau de la migration venue d'Afrique vers l'Europe en 2050 est très difficile à définir tant les facteurs en jeu sont nombreux. Certains émettent l'hypothèse d'un doublement des flux extra-africains 17 ( * ) . Mais, en vérité, personne ne sait.
Les scénarios catastrophes ne manquent pas. En cas d'importantes modifications des écosystèmes dues au changement climatique, cette mobilité pourrait se grossir de réfugiés «environnementaux» : selon les estimations de l'ONU, le chiffre mondial des réfugiés climatiques pourrait ainsi, en fonction des scénarios du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), varier de 50 millions à 1 milliard en 2050 dont la majeure partie proviendrait d'Afrique.
Tous ces scénarios alimentent une peur d'un péril noir où une Afrique exsangue et proche alimentera le déferlement de hordes d'affamés et de demandeurs d'asile africains vers l'Europe. Une même crainte demeurée sans lendemain avait été suscitée en son temps par les Européens de l'Est après la chute du mur de Berlin.
Si on ne peut ignorer les tendances de fond qui travaillent le continent africain, il faut les apprécier à leur juste mesure.
Aujourd'hui, à peu près la moitié des immigrants africains réside en dehors de l'Afrique, principalement en Europe.
Si l'on considère les pays d'arrivée, les principales destinations extrarégionales des migrants africains comprennent la France (9 % du total des émigrants), l'Arabie Saoudite (5 %) ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni (4 % chacun).
Le continent africain est cependant loin d'être celui qui exporte le plus d'immigrés. En effet, seulement 8,5 % des immigrés dans les pays de l'OCDE proviennent de l'Afrique, tandis que 16,8 % sont originaires d'Asie, 13,5 % d'Europe et 25 % d'Amérique Latine.
Comme l'a souligné devant le groupe de travail M. Luc Derepas, secrétaire général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur, « les 30 années à venir seront sans doute marquées par une montée en puissance de l'immigration africaine ».
Mais les premiers concernés seront les pays du Maghreb.
L'immigration subsaharienne transite par le Maghreb et y reste souvent. On estime que seuls 20 à 40 % des migrants transsahariens parviennent en Europe. Le reste se fixe au Maroc, en Algérie ou en Libye.
A l'image des pays du sud de l'Europe, qui sont passés, dans la seconde moitié du XX e siècle, du statut de sociétés d'émigration à celui de sociétés d'immigration en provenance de la rive sud de la Méditerranée, le Maghreb est donc à son tour confronté à une immigration qui ne cesse d'augmenter. De ce point de vue, l'arrivée en masse de ressortissants africains dépendra largement de l'évolution économique des pays du pourtour sud de la Méditerranée.
Au-delà du Maghreb, la France est en première ligne. Le nombre des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne a été multiplié par 40 depuis 1950.C'est à la fois une forte croissance et en même temps une proportion marginale par rapport à l'ensemble des immigrés africains dans le monde : sur les 15 millions d'Africains subsahariens qui vivent hors de leur pays d'origine, seulement 3% vivent en France. Mais, demain, la France sera la destination naturelle de l'Afrique francophone. En effet, deux Africains sur trois en France proviennent d'anciennes colonies françaises.
Or la population des pays francophones fera plus que doubler, voire tripler dans le cas du Niger. Ce pays dont la population est encore modeste (16 millions en 2010) et dont les flux migratoires vers la France sont encore restreints, connaît une croissance rapide sans que la transition démographique n'y soit sensible encore. Un groupe de quatre pays, Tchad, Mali, Niger et Burkina Faso, est actuellement peuplé de 57 millions d'habitants. Ils devraient compter ensemble 160 millions d'habitants en 2040 compte tenu des évolutions démographiques mais aussi économiques. Le phénomène d'accélération des migrations, déjà sensible pour le Mali, peut donc s'étendre à ces quatre pays.
Dans un premier temps, la phase de décollage économique n'est pas de nature à stabiliser les populations. Au contraire, un certain décollage permettra à une classe moyenne d'émerger, suffisamment riche pour migrer. Le prolongement tendanciel de la baisse du coût des transports et la constitution d'une diaspora facilitant l'accueil en France ne feront que soutenir le processus.
Les géants africains, Nigeria, Égypte et RDC (Congo), connaîtront une croissance absolue spectaculaire. L'effet de masse devrait être perceptible : bien que faible en proportion de la population nigériane, la population migrante vers la France pourrait être importante. La probabilité d'un fort accroissement de la pression démographique est bien plus forte dans le cas de la RDC.
Enfin, en Afrique orientale, Madagascar, qui est une origine bien représentée en France, verra sa population atteindre 50 millions de personnes contre 21 millions en 2010.
Migration et développement : des relations complexes entre fuite des cerveaux et transfert de fonds des migrants
Pour bien comprendre les enjeux de cette immigration, en France comme en Europe, il faut bien mesurer son rôle paradoxal dans le processus de développement du continent africain.
D'un côté, elle prive le continent d'une main-d'oeuvre dont elle ne manque pas, lui soustrait des compétences qui parfois lui font cruellement défaut et, de l'autre, lui assure une source de financement substantielle.
En effet, les rentrées d'envois de fonds en Afrique ont quadruplé au cours des 20 dernières années depuis 1990, en atteignant environ 60 milliards de dollars soit 3 % du PIB africain en 2012. Dans certains pays, ces fonds atteignent près de 15 % du PIB.
Ces envois constituent pour l'Afrique subsaharienne la source la plus importante de recettes étrangères. La réception de ces envois de fonds présente des avantages importants pour les pays d'origine des émigrants.
Si le coût des transferts formels a diminué au cours de la décennie, il demeure encore un frein important (il peut atteindre 25 % du montant transféré) et varie fortement selon l'origine géographique de l'envoi. C'est pourquoi, la baisse des coûts d'envoi d'argent est une priorité des pouvoirs publics africains comme des bailleurs de fonds de la coopération pour pouvoir en augmenter massivement les volumes et rendre formelle la partie «souterraine».
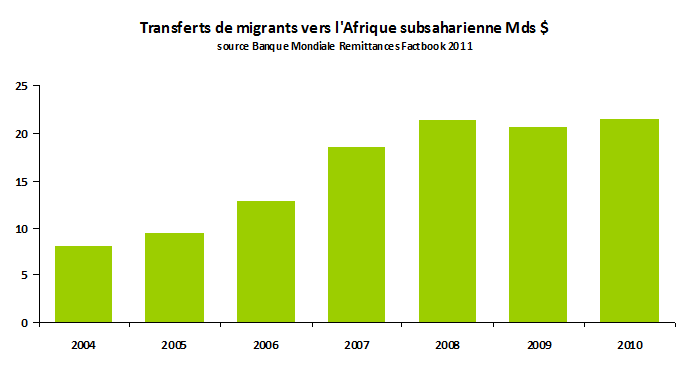
Les bailleurs de fonds et les pays partenaires de l'Afrique peuvent intervenir auprès des différents acteurs concernés : en contribuant à renforcer le rôle clé des intermédiaires bancaires et financiers et leur donner les moyens de répondre à cet enjeu, mais également en appuyant la définition et la mise en oeuvre de politiques publiques incitatives par les États d'origine des diasporas.
L'émigration de travailleurs qualifiés comporte pour les pays africains des avantages non seulement par le biais d'envois de fonds, mais aussi par les contacts avec les marchés étrangers, les transferts de technologie, et l'amélioration des connaissances des émigrants de retour au pays.
Cependant, l'émigration hautement qualifiée peut aussi nuire au développement en limitant la contribution de ces travailleurs au développement de leur pays.
La perte de travailleurs éduqués aux frais de l'État représente une perte substantielle, et de nombreux émigrants africains de niveau universitaire, qui ne peuvent pas obtenir d'emplois qualifiés dans leurs pays, représentent en Afrique comme ailleurs une perte d'investissement, « une fuite des cerveaux ».
Les taux de migration hautement qualifiée sont particulièrement élevés en Afrique. En 2000, un Africain sur huit avec un niveau universitaire vivait dans un pays de l'OCDE, le taux le plus élevé parmi les régions en développement hormis les Caraïbes, l'Amérique centrale et le Mexique. Dans une enquête sur les cinq meilleurs étudiants diplômés des 13 meilleurs lycées du Ghana entre 1976 et 2004, les trois quarts d'entre eux avaient émigré à un moment entre l'école secondaire et l'âge de 35 ans 18 ( * ) .
Le manque d'offres de travailleurs qualifiés dans les économies africaines révèle les limites des opportunités d'éducation et, dans de nombreux pays, les faibles retours de ceux qui ont poussé loin leurs études résultent de conditions de travail difficiles, d'un climat d'investissement défavorable ou d'une économie à petite échelle.
Les diasporas grandissantes dans les pays de destination offrent des opportunités pour l'amélioration du développement des pays d'origine en augmentant les investissements directs, en améliorant l'accès au marché des capitaux étrangers par le biais de fonds d'investissements, en fournissant des aides pour le développement, en établissant des contacts afin de promouvoir les échanges et les investissements, en augmentant la demande des exportations d'un pays et en transférant de la technologie .
Le groupe de travail l'a constaté en Éthiopie où l'ambassadeur américain a souligné le poids de la diaspora africaine aux USA, dont l'effectif dépasse le million. Ces ressortissants éthiopiens investissent en Éthiopie, parfois reviennent pour y lancer des affaires et suivent de près la politique américaine à l'égard du gouvernement éthiopien.
Le dialogue sur les questions migratoires entre les pays et l'Europe est un enjeu majeur des prochaines décennies
Pour l'ensemble des pays partenaires de l'Afrique, politique de coopération et régulation des flux migratoires ont partie liée puisque le but de la première est d'aider à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays en développement, contribuant par-là à réduire les migrations subies pour des raisons économiques, sociales, politiques ou écologiques.
Un des enjeux est de coordonner la politique de développement et la politique migratoire afin de profiter au développement des pays et des régions d'origine des migrations, en visant à maximiser et partager les effets bénéfiques des flux de personnes entre pays d'origine et de destination.
A cet égard, la France souscrit à l'approche globale adoptée en 2005 par l'Union européenne et organisée autour de trois axes : promotion de la mobilité et de la migration légale, prévention et lutte contre l'immigration clandestine et optimisation du lien entre migration et développement.
La mise en oeuvre de cette approche globale appelle une double cohérence qui fait parfois encore défaut : entre régulation migratoire et aide au développement dans le cadre de partenariats entre pays d'origine et pays d'accueil des migrants et en matière d'harmonisation entre pays de destination des migrations.
D'une part, l'Europe a encore dans la pratique des politiques très disparates. D'autre part, le dialogue avec les pays africains sur ce thème central des migrations est encore balbutiant.
D. DES RISQUES D'INSTABILITÉ ACCRUS
M. Lamamra, Commissaire pour la Paix et la Sécurité de l'Union africaine, diplomate algérien aguerri, qui nous a reçus à Addis-Abeba, nous a dressé un tableau de la situation sécuritaire de l'Afrique pour les prochaines décennies en insistant sur son espoir de voir le continent africain désormais se concentrer sur sa croissance économique.
« Même si la situation du Sahel nous rappelle que la situation politique est loin d'être stable partout, des progrès notables doivent être notés sur la dernière décennie, les conflits interétatiques ont presque disparu, les structures collectives de gestion de crise au niveau continental et régional sont en cours d'élaboration, des progrès considérables à l'échelle de l'histoire de l'Afrique indépendante ont été réalisés ».
Longtemps, l'Afrique a été le continent où le nombre de victimes du fait des conflits armés était le plus élevé du monde. Entre 1945 et 1995, plus d'un quart des conflits mondiaux ont été localisés en Afrique (48 sur 186). On estime que ces conflits ont fait plus de 6 millions de morts sur des populations de 160 millions de personnes (Soudan, Éthiopie, Mozambique, Angola, Ouganda, Somalie, Rwanda, Burundi, Sierra Leone). Depuis 1990, 19 conflits majeurs africains ont été localisés dans 17 pays avec un seul conflit interétatique (Éthiopie-Érythrée).
La baisse des conflits majeurs en Afrique entre 1990 et 1997 a fait place à une reprise entre 1998 et 2000 (11 conflits par an) avec une réduction au début du XXI e siècle (5 conflits par an).
Néanmoins, en 2011, une vingtaine de pays étaient dans une situation de crise d'intensité moyenne à haute. On pouvait différencier huit conflits ouverts : ceux de la RDC, du Soudan, et des pays voisins, Tchad, RCA et Ouganda, ceux de Somalie, celui entre l'Éthiopie et l'Érythrée et au Mali. Il faut y ajouter les crises nationales pouvant dégénérer en conflits ou tensions régionales (mouvements Touaregs et islamistes dans l'arc saharo-sahélien, MNED au Nigeria), les mouvements séparatistes (Polisario au Sahara occidental, Flec à Cabinda, en Casamance) ; les tensions ethnico-religieuses pouvant resurgir (Burundi, Kikuyu et nilotiques au Kenya, Liberia, Sierra Leone, Peuls et Malinké en Guinée, Akan, Bété et Dioula ou Senoufo en Côte d'Ivoire...).
Longtemps, l'Afrique a été le continent qui a monopolisé le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix.
Et il est vrai que le nombre de conflits, avec plus d'un millier de morts, a presque baissé de moitié (4,8 par an pour les années 1990 contre 2,6 pour les années 2000).
D'une part, les conflits interétatiques ont pratiquement disparu (à l'exception des conflits larvés entre les deux Soudan, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, entre Djibouti et l'Érythrée). On a plutôt observé la persistance ou l'apparition de conflits internes aux États dont les causes sont plurielles et qui peuvent avoir des incidences au-delà des frontières, voire régionales.
D'autre part, de nouvelles menaces et sources de conflictualité diffuses se sont imposées ou ont persisté, dont les acteurs entretiennent parfois des liens et qui s'alimentent (terrorisme islamique, intégrisme religieux, irrédentisme, trafics des ressources minières et environnementales, accaparement des terres et déplacements forcés des populations, piraterie maritime, narcotrafic, criminalité transfrontalière...).
Ces menaces dessinent une nouvelle géographie de la conflictualité qui traverse l'Afrique en largeur, de la zone sahélienne à l'Océan indien, et fragilise en longueur la situation sécuritaire dans plusieurs États du continent.
Des avancées en matière de prévention des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ont parallèlement été observées.
L'architecture africaine de sécurité -et son mécanisme d'alerte rapide- mise en place sous les auspices de l'Union africaine est entrée en activité.
L'Union africaine déploie désormais ses propres opérations de maintien de la paix (AMISOM, ...) et une force africaine de défense en attente est en cours de mise en place. Par ailleurs, toutes les communautés économiques régionales se sont dotées de dispositifs de prévention des conflits et de maintien de la paix. Les plus achevés sont ceux de la CEEAC, la CEDEAO, l'EAC, la SADC, qui intègrent des mécanismes de prévention et gestion des conflits de démocratie. La Conférence internationale des Pays des Grands Lacs a établi un mécanisme homologue pour ses pays membres.
Quelles sont les perspectives ? Sans doute les nouvelles formes de menaces mettront au défi la vulnérabilité structurelle des États africains. Nous y reviendrons. De nouvelles alliances entre la criminalité organisée, les rébellions politiques et le fondamentalisme terroriste mettent ainsi en évidence de nouveaux défis sécuritaires, le sous-équipement et la faiblesse opérationnelle des armées et des forces de sécurité du continent.
Mais plus que tout, ce sont le développement économique et la cohésion sociale du continent qui constitueront la clef de la stabilité du continent.
Dans ce contexte, les évolutions démographique et migratoire auront une importance majeure.
Le passé récent de la Côte d'Ivoire nous fournit une illustration des bouleversements liés à cette évolution démographique. Il y avait 11 habitants au km² en Côte d'Ivoire en 1960; il y en a 63 aujourd'hui, et il y en aura 110 en 2050 (soit l'équivalent de la densité en France). Si la France avait connu la même croissance que la Côte d'Ivoire entre 1960 et 2007, elle compterait aujourd'hui 240 millions d'habitants, dont 60 millions d'étrangers.
Les responsabilités des acteurs politiques de la tragédie qu'a vécue la Côte d'Ivoire au tournant du XXI e siècle peuvent être appréciées diversement. En tout état de cause, celle-ci s'est déroulée sur fond d'une équation à quatre facteurs : le délabrement économique dû à l'effondrement du prix du cacao ; une jeunesse nombreuse ; une population urbaine multipliée par vingt-cinq en l'espace de cinquante ans ; une forte immigration en provenance des pays voisins.
Or trois des quatre termes de cette équation s'amplifieront dans les décennies à venir. La Côte d'Ivoire devra gérer un nouveau quasi-doublement de sa population dans les 50 prochaines années. La ville d'Abidjan est passée de 100 000 à 4 millions d'habitants pendant la même période, et sa population devrait encore progresser vers 5-6 millions dans les décennies qui viennent.
Et ces changements concerneront tout autant la Côte d'Ivoire que le Ghana, le Tchad, la République démocratique du Congo (RDC) ou le Kenya. Comment ne pas faire le rapprochement entre les pogroms de jeunes patriotes ivoiriens contre les migrants burkinabés, les exactions des jeunes Kikuyus, Kalenjins ou Luos des bidonvilles nairobiens lors de l'explosion de violence de janvier 2008 et les violences urbaines anti migrants à Johannesburg en mai de la même année ?
Plusieurs frontières sont à la limite de la cassure ; un mouvement de sécessions en cascade, une transformation profonde du paysage géopolitique du continent et une remise en cause des frontières héritées de la colonisation ne sont pas à exclure. Frontières coloniales artificielles, qui ont garanti, bon an, mal an, une certaine stabilité de la carte de l'Afrique et une paix toute relative pendant plus d'un demi-siècle.
On relève depuis 1964 environ quarante-deux cas de tensions latentes et conflits ouverts autour de questions frontalières stricto sensu, à l'exclusion des problèmes internes.
Cette stabilité des configurations territoriales a semblé remise en cause en Afrique de l'Est avec le précédent érythréen, la quasi-indépendance du Somaliland et la sécession du Soudan méridional décidée par ses électeurs lors du référendum de janvier 2011, sans que des questions cruciales n'aient été résolues : citoyenneté, droit de circulation entre les deux pays, partage des revenus du pétrole dont le Sud possède 70 % des gisements, tracé exact de la frontière et sort de la zone litigieuse d'Abyeï qui doit être tranché par un référendum séparé. Mais les parties en présence ont accepté les nouvelles réalités. S'agit-il d'un tournant dans la politique des États et des puissances extérieures encore influentes ? Il est trop tôt pour l'affirmer. La vigilance reste requise à l'égard d'autres situations de tensions, notamment en Afrique centrale, pour éviter que les deux cas cités ne constituent un précédent.
Là encore l'intégration régionale, le recours aux négociations bilatérales ou à des procédures juridiques seront incontournables pour gérer les crises à venir.
E. UN CONTINENT TRAVAILLÉ PAR LES FANATISMES
Les transformations rapides du continent qui déstabilisent des pans entiers des sociétés traditionnelles africaines ont favorisé un regain des religions dans l'ensemble du continent.
L'Afrique était depuis longtemps l'un des continents où les différentes religions monothéistes et animistes étaient les plus présentes, avec 90 % de la population se définissant comme croyante, les deux religions les plus représentées étant l'islam et le christianisme.
Le développement d'un intégrisme religieux aussi bien musulman que chrétien s'est rendu visible de façon plus récente.
La crise que connaît actuellement le nord du Mali illustre la progression du fanatisme islamique dans la région du Sahel.
Comme la souligné le rapport de MM. Larcher et Chevènement sur le Mali, « on assiste actuellement à un « couplage », via la contagion du terrorisme et du radicalisme religieux, entre Maghreb, Machrek, Moyen-Orient et Afrique sub- saharienne ».
Au Nord-Mali, l'association entre le groupe touareg dissident Ansar Ed-Din et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et le Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao) illustre les liens grandissants entre le « djihadisme » armé de cellules terroristes vivant de l'enlèvement d'occidentaux et les trafiquants de drogue.
Ces organisations procèdent dans l'ensemble du Sahel et dans la Corne de l'Afrique de la même façon. Elles s'établissent dans un sanctuaire dans des Etats comportant de vastes « zones grises » mal contrôlées par les forces de police comme au Nord Mali en Libye ou en Somalie, par lesquelles transitent des hommes, des capitaux et du matériel. Dans le cas de la crise malienne, le Sahel a servi de sanctuaire à ces organisations pour développer leur action au Mali dans un premier temps, puis à l'échelle régionale.
Les enlèvements perpétrés par des organisations terroristes nigérianes viennent rappeler que la menace terroriste est aussi en expansion au sud du Sahel et, d'abord, au Nigéria, dans l'orbite de Boko Haram (littéralement, « la culture occidentale est illicite »), secte dont l'objectif est d'établir la « charia » dans les différents États du Nigéria et y mettre en place progressivement un émirat islamique.
La sphère d'influence de Boko Haram ne cesse de s'étendre en « tâche d'huile ». Partie de Maiduguri et de la région de Borno située à la lisière du lac Tchad, et initialement active dans seulement deux des trente-six États du Nigeria, --le Yobé et le Borno--, la secte est aujourd'hui présente dans toute la zone nord-est, jusqu'à Abuja la capitale, et dans le nord-ouest.
La société nigérienne est elle aussi traversée par un mouvement de réislamisation à l'oeuvre depuis plus d'une génération, qui semble avoir débouché sur un phénomène de « sunnification », au détriment d'un « islam noir » syncrétique. Alors que les institutions nigériennes s'appuient sur une constitution laïque, l'islam a envahi l'espace public depuis la libéralisation du système politique au début des années 1990. Quoiqu'encore marginale en termes de structures politiques, la religion musulmane constitue un réservoir moral et symbolique que les hommes politiques nigériens n'oublient pas de mobiliser. Cependant, le fait marquant, depuis le début des années 1990, est l'émergence, depuis le Nigeria, du mouvement Izala.
Tirant avantage du marasme socio-économique des milieux urbains, ce dernier revendique l'avènement d'une société islamique porteuse de plus grandes libertés sociales et économiques ; une umma empreinte de solidarité au-delà des rivalités ethniques ou tribales. Pour cela, Izala mène, au sein de l'islam nigérien, une lutte contre le syncrétisme impliquant des pratiques anté-islamiques, ou contre les pratiques confrériques.
Des connexions s'établissent avec les autres mouvements terroristes, en particulier les shebab somaliens. La Corne de l'Afrique est en effet l'un des foyers les plus anciens du terrorisme islamiste. Le démembrement de la Somalie en 1991 a fait de la Somalie ex-italienne un foyer d'insurrection et a également engendré la formation de deux « zones grises » : le Somaliland et le Puntland qui sont progressivement devenus des sanctuaires pour l'action du groupe islamiste Al-Qaïda dans la péninsule Arabique, qui est principalement dirigée vers le Yémen.
La sanctuarisation d'une partie de la Somalie étend également la menace terroriste à ses voisins africains, notamment au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Dans son rapport annuel daté de 2011, le groupe de contrôle des Nations Unies sur la Somalie et l'Erythrée avait souligné la montée en puissance des « réseaux kenyans étendus, reliés aux shebabs, qui non seulement recrutent et collectent des fonds, mais organisent des entrainements jusqu'à l'intérieur du Kenya ». Le groupe de contrôle avait alors insisté sur la menace que constituait une « nouvelle génération de jihadistes d'Afrique de l'Est ».
On voit donc que le développement récent d'organisations terroristes islamistes en Afrique de l'Ouest répond à la présence ancienne de ces mêmes groupes à l'extrême Est du continent. Dans ces deux régions le terrorisme islamiste dépasse le cadre de l'Etat-nation et a su conserver un aspect collectif fort qui permet aujourd'hui la formation d'un maillage islamiste à l'échelle du continent.
Même s'il n'a pas aujourd'hui la même dimension, le fanatisme religieux a son pendant chrétien.
Au Nigéria, les conflits inter-religieux entre musulmans et chrétiens auraient tué plus de 400 personnes par an entre 2006 et 2011 selon la base de données Nigeria Watch. En Ethiopie, depuis la chute du régime dictatorial de Mengistu Hailé Mariam en 1991, on observe une radicalisation de l'Eglise orthodoxe et la montée en puissance de l'Eglise pentecôtiste.
Cette confession concurrence l'Eglise éthiopienne täwahedo tant dans ses liturgies que dans ses préceptes. En effet, l'Eglise penté tend à protéger ses fidèles d'un monde dominé par le pêché et préconise un mode de vie quasi monastique. Cette église affiche une attitude sectaire vis-à-vis des autres cultes chrétiens qu'elle accuse d'être dans l'erreur, mais également des autres confessions, faisant parfois preuve de violence envers les musulmans. De plus, le développement de l'Eglise évangélique Mäkannä Iyyäsus, très présente en Oromie, dans une région où les revendications identitaires politico-religieuses sont nombreuses, engendrent des tensions.
L'importance de la religion en Afrique, qui structure la vie quotidienne et fédère les sociétés souvent beaucoup plus que le pouvoir politique central, fait du continent un théâtre d'expression de différents types de retour du religieux, mais aussi d'un fanatisme qui prend parfois des formes violentes.
Le fanatisme chrétien, tout comme l'islamisme radical, se veut défenseur d'un mode de vie pur et porteur d'une vérité. Ces modes d'expression religieux sont, de fait, vecteurs de conflits inter-confessionnels à l'échelle du continent. Mais ils ont surtout en commun d'être des forces de résistance à la globalisation libérale portée par l'occident. Leurs valeurs, primauté du groupe et de la famille patriarcale, hétéronomie absolue, confusion du public et du privé, du politique et du religieux, interdits sexuels, etc., les opposent trait pour trait aux sociétés libérales d'occident. Elles apparaissent, de fait, dans le monde d'aujourd'hui, porteuses par excellence de la tradition.
III. ET POURTANT UNE PARTIE DE L'AFRIQUE EST BIEN PARTIE
En 1991, Mme Axelle Kabou écrivait dans « Et si l'Afrique refusait le développement » : « L'Afrique est une sorte de cul-de-sac, de terminus, de voie de garage où aucun espoir de mobilité ascendante n'est permis. Tout paraît y être voué d'avance à la dégradation, à la détérioration, à l'inertie ».
20 ans après, l'ensemble des institutions économiques multilatérales et des analystes économiques souligne le décollage du continent.
L'Afrique se trouve à un moment crucial de son développement.
L'évolution démographique, la rapide urbanisation et une envolée prolongée des cours des produits de base ont aussi provoqué d'énormes changements.
Au niveau international, les mutations économiques et géopolitiques survenues au cours des deux dernières décennies ont modifié le rapport de forces traditionnel du monde et marqué l'émergence de nouvelles puissances issues du Sud qui investissent en Afrique.
Certes, il existe encore des zones désertée par le développement, marquée par la pauvreté comme au Sahel ou par des conflits à répétition comme en Centrafrique. Mais la période qui s'est ouverte avec le 21 è siècle semble offrir à une partie de l'Afrique des possibilités sans précédent de surmonter l'héritage du passé et d'entrer dans une phase accélérée de transformation.
A. UN REBOND ÉCONOMIQUE INCONTESTABLE
1. D'une terre de pessimisme à une terre d'opportunités.
Les chiffres sont là. Après plus d'une décennie perdue, l'Afrique subsaharienne connaît, depuis le milieu des années 1990, une période de croissance supérieure à celle du reste du monde.
Cette croissance moyenne a atteint ces dix dernières années 5,5 %, soit plus du double de ce qu'elle avait enregistré dans les années 80 (2,6 %) ou 90 (2,3 %) quand ces niveaux étaient inférieurs à la croissance démographique.
Ce niveau dépasse celui de l'ensemble de l'économie mondiale (3,7 %).
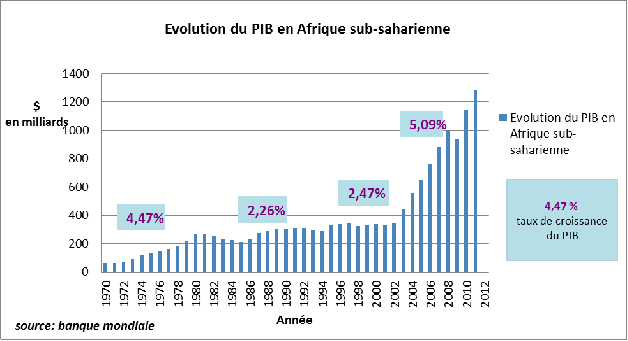
Au cours de la décennie écoulée, six des dix économies à la plus forte croissance dans le monde appartenaient à l'Afrique (Angola, Nigeria, Éthiopie, Tchad, Mozambique et Rwanda).
C'est la fin de l'image d'Épinal d'une Afrique perdante de la mondialisation : n'en déplaise à René Dumont, l'Afrique noire est enfin bien partie.
Le Docteur Carlos LOPES, Secrétaire exécutif de la Commission économique africaine de l'ONU, nous l'a confirmé : « En 2012, l'Afrique subsaharienne a affiché de solides résultats et devrait continuer de le faire. La croissance de la production a été en moyenne de 5,1 % en 2012 et, d'après les projections, devrait atteindre 5,4 % en 2013, puis 5,7 % en 2014 ».
« Les chiffres des statistiques africaines sont largement incomplets étant donné la faiblesse des outils statistiques et l'importance du secteur informel » a-t-il souligné, « mais le cas du Ghana a montré que l'actualisation des statistiques des comptes nationaux pouvait aboutir à une augmentation de 60 % de la taille estimative du PIB ! ».
Plusieurs économistes ont fait valoir que le calcul du PIB des pays africains ne permet pas de refléter la réalité d'un continent où la part de l'économie informelle est très importante et où les données officielles sont lacunaires. Pour Alwyn Young, professeur à la London School of Economics, auteur d'un ouvrage sur le miracle de la croissance africaine : « la croissance de l'Afrique subsaharienne au cours des vingt dernières années serait trois fois supérieure aux chiffres retenus par les organisations internationales. » 19 ( * )
Le discours a changé parce que la réalité a changé.
Cette année, d'après les prévisions du FMI, la moitié des 30 pays à la plus forte croissance seront situés en Afrique. Deux d'entre eux se placent même en tête de la liste. Certains experts prédisent qu'au cours des cinq années à venir, l'économie africaine croîtra plus vite que son homologue asiatique.
La Banque mondiale n'est pas en reste ; elle affirme que « l'Afrique «pourrait être au bord d'un décollage économique, tout comme la Chine il y a trente ans et l'Inde, il y a vingt ans .» 20 ( * ) .
Le pouls économique de l'Afrique s'est accéléré, impulsant au continent un nouveau dynamisme commercial. Les télécoms, la banque et le commerce de détail prospèrent.
Certes, l'Afrique a largement bénéficié de l'envolée du cours des matières premières dans la décennie écoulée. Ainsi, le cours du pétrole est passé de moins de 20 dollars le baril en 1990 à plus de 145 dollars en 2003. Les cours des minerais, des céréales et d'autres produits de base ont également grimpé en flèche dans le sillage de la demande mondiale.
Pourtant la manne des matières premières ne peut à elle seule expliquer la croissance de l'Afrique. Selon une étude de McKinsey Global Institute, « L'heure des Lions » : L'Afrique à l'aube d'une croissance pérenne, « à peine 24 % de la hausse du PIB entre 2000 et 2008 ont été générés par le secteur des ressources naturelles. Le reste provient de secteurs tels que le commerce de gros et de détail, les transports, les télécommunications et l'industrie manufacturière. »
Dans le domaine des transports, on constate ainsi une augmentation de 5,7 % d'augmentation par an du trafic passager annuel et des prévisions d'augmentation du nombre des avions de ligne de 600 à 1400 dans les vingt années à venir, ainsi qu'une croissance de 10 à 12 % d'augmentation des échanges commerciaux par voie maritime.
Le secteur des infrastructures terrestres est quant à lui soutenu par de nombreux projets : la construction du tronçon de 200 km manquant entre Assamaka (frontière avec l'Algérie) et Arlit au Niger, le projet d'autoroutes transafricaines entre Dakar et N'Djamena et entre N'Djamena et Djibouti tout comme la construction d'un tronçon ferroviaire entre Dakar, N'Djamena et Djibouti, la construction d'un gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie via le Niger (4300 km), la construction d'une autoroute entre le Sud Soudan et les bords du Nil, l'aménagement de la voie ferrée Abidjan-Ouaga à l'été 2013 (1300km), l'autoroute Abidjan-Lagos.
Dans le domaine des télécommunications, en l'espace de cinq ans, le marché de la téléphonie mobile en Afrique a crû à un rythme de 44 % par an, le continent recensant aujourd'hui environ 650 millions d'abonnements, chiffre qui le place devant l'Union européenne et les États-Unis. Le nombre de téléphones mobiles dépasse de très loin celui des lignes fixes.
Le rythme de cette croissance est époustouflant. Il suffit de comparer le nombre de téléphones cellulaires au Kenya en 2000,15 000, à celui d'aujourd'hui, 15 millions, pour s'en rendre compte.
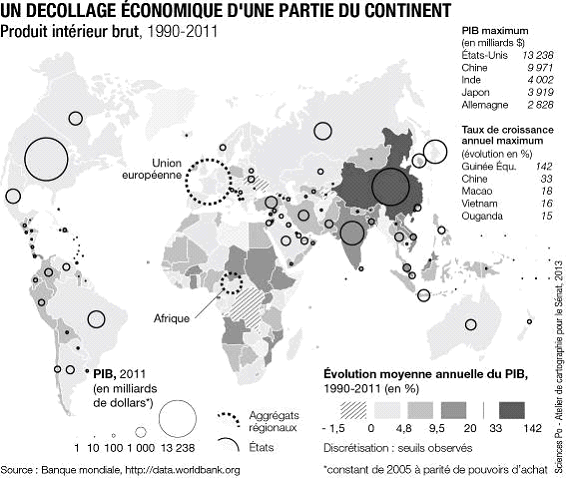
Le développement des services bancaires sur mobile est un exemple frappant des innovations en Afrique et de la manière dont une pratique adaptée au contexte local peut générer une vague de solutions innovantes et révolutionnaires. Au Kenya, plus de 30 % de la population dispose d'un compte virtuel. Les transferts d'argent entre individus atteignent 17 % du PIB, et la moitié de ces transactions ne dépasse pas 10 dollars. Les comptes virtuels sont utilisés pour transférer rapidement de l'argent à des proches dans le besoin ou effectuer des paiements en s'exonérant des coûts élevés des services bancaires traditionnels.
Au Ghana, les détenteurs d'un compte bancaire mobile sont plus nombreux que ceux qui disposent d'un compte ordinaire. Dans ce même pays, un opérateur téléphonique sud-africain s'est associé à une société d'assurances pour proposer le versement des cotisations d'assurance- vie par téléphone mobile. Les taux de croissance des banques de détail dans un pays comme le Kenya depuis sept ans se situent entre 30 et 35 %.
Pour Lionel Zinsou : « Le continent connaît la progression la plus rapide dans l'histoire des sociétés en matière de bancarisation . ». Une épargne significative apparaît dans les comptes bancaires et peut désormais être mise à disposition dans l'économie sur les marchés financiers. En passant désormais par des circuits professionnels, l'épargne devient active. L'Afrique anglophone est à cet égard plus rapide dans son évolution que l'Afrique francophone et a déjà mis en place des systèmes de fonds de pension et des mécanismes de financement long de l'économie. Plus de 400 milliards de dollars se retrouvent dans les comptes des fonds de pension en Afrique. Ces ressources d'épargne et d'assurance vie financent également les Etats qui vont alors sur les marchés. Ces derniers peuvent désormais émettre des obligations et se financer sur les marchés intérieurs, sans risque de change. On a donc une activation de l'épargne du continent sous forme moderne.
2. La confiance retrouvée des investisseurs
Compte tenu de la remarquable croissance qu'il enregistre depuis 2000, le continent est désormais regardé par beaucoup comme une « nouvelle frontière », un pôle mondial potentiel de croissance.
« Finie la famine, vive la croissance » semble dire le cortège d'études menées par des organisations internationales et des cabinets de conseil de premier plan qui pointent toutes vers un « moment africain ». Ce nouveau narratif a installé un début de confiance. Et la confiance, à son tour, les investisseurs.
Ainsi les banquiers, économistes et investisseurs entendus par le groupe de travail ont, à l'unanimité, souligné les opportunités d'un décollage durable du continent fondé sur des facteurs structurels.
De concert, chacun a souligné que les conflits politiques étaient en recul, la croissance économique vigoureuse et la gestion économique, la gouvernance et la stabilité politique améliorées.
Matthieu Pigasse, président de la Banque Lazard, a expliqué son choix d'ouvrir une branche africaine : « C'est le fruit de notre expérience. Depuis des décennies, Lazard conseille les gouvernements africains ..... Nous y avons acquis la conviction que l'Afrique subsaharienne dispose de potentialités extraordinaires. .... Aujourd'hui, le continent représente 4 % de la richesse mondiale ; en 2030, il en pèsera 7 %, et 12 % en 2050. Il sera alors plus riche que l'Europe et pèsera les deux tiers des États-Unis et de l'Europe réunis... » .Et de conclure : « le 21 è siècle sera africain ».
A Addis Abeba, à 15 jours du 50 e anniversaire de la création de l'Union Africaine, on nous a répété que toutes les mutations en cours ont contribué à modifier profondément la perception que l'Afrique a de son avenir, le pessimisme cédant la place à un espoir immense et les puissances économiques traditionnelles comme nouvelles se faisant entendre pour proposer leur partenariat.
Madame Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l'Union africaine, nous a même clairement affirmé que « L'Afrique n'a plus à attendre que l'initiative vienne de l'extérieur, elle n'a plus besoin d'aide, même si elle est la bienvenue, mais d'investissement ». Et force est de constater que le niveau des investissements directs étrangers fait aujourd'hui jeu égal avec les montants de l'aide au développement.
Abandonner l'aide au profit des investissements ? C'est sans doute aller vite en besogne. C'est ignorer nombre de fragilités, notamment dans ce qu'on appelle « l'environnement des affaires » et les infrastructures. C'est ignorer que dans les PMA, l'intervention des bailleurs de fonds internationaux reste une source essentielle de financements extérieurs. Reste que poser la question, c'est déjà changer d'époque et de regard.
Le parcours de deux des plus hauts responsables de l'aide publique française entendu par le groupe de travail est illustratif de cette évolution. M. Jean-Michel Severino, ancien vice-président de la Banque mondiale, ancien directeur général de l'AFD est aujourd'hui président d'« Investisseurs et Partenaires pour le développement », un fonds d'investissements dans les PME africaines. Luc Rigouzzo, ancien directeur de cabinet du ministre de la coopération, ancien directeur général de Proparco, filiale de l'AFD, est aujourd'hui président d'une société de conseil en financement et investissement pour l'Afrique.
Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'un changement de rythme, mais d'un changement de nature, fondé sur des éléments structurels tels que l'urbanisation, l'émergence d'une classe moyenne, l'éducation et les évolutions démographiques.
Point de doute pour Luc Rigouzzo : « une grande partie des économies du continent subsaharien est en passe de se transformer d'économies de comptoirs assises sur les exportations de ressources naturelles en économies endogènes diversifiées et nourries par un marché intérieur en croissance continue. »
Force est de reconnaître que les investissements sont là. Des investisseurs étrangers, qui n'auraient jamais pensé à l'Afrique il y a une décennie, affluent désormais en quête de nouvelles opportunités. Les échanges s'accroissent plus rapidement encore avec l'intégration croissante des entreprises aux marchés mondiaux.
D'après un rapport de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) sur les tendances en matière d'investissements, les IDE en Afrique ont été multipliés par 7 entre 2000 et 2008 pour atteindre un record de 62 milliards de dollars en 2008.
Ces investissements restent mal répartis, les dix principaux pays de destination (Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc, Libye, Soudan, Guinée Équatoriale, Algérie, Tunisie et Madagascar) en absorbant une très grande partie destinée aux secteurs du pétrole et des ressources minérales. Leur allocation à des secteurs porteurs d'une croissance pérenne et fortement créatrice d'emplois est un enjeu considérable.
Ces prédictions ont généré une certaine euphorie économique, qui est naturellement bienvenue, mais qui ne devrait néanmoins pas nous faire oublier l'autre réalité africaine, celle de la pauvreté, celle des défis complexes concernant la sécurité des populations.
3. Une amélioration de la situation sociale
Le continent africain n'est pas passé de l'ombre à la lumière. Comme nous le verrons, des poches de sous-développement et de conflits se perpétuent.
Si l'Afrique s'éveille pour une partie de la classe moyenne africaine occidentalisée, on ne peut oublier qu'une partie des populations restent plongées dans l'incertitude et la pauvreté.
Les taux de croissance affichés ne sont pas des illusions, ils sont en revanche à prendre à leur juste mesure.
Premièrement, l'Afrique part de loin. Il y a quinze ans, quand a débuté la phase actuelle, le PIB de l'Afrique équivalait à celui de la Belgique ; aujourd'hui il est comparable à celui de la France. « La vraie question qu'il faut avoir à l'esprit c'est que, sur la dynamique actuelle, il pourrait être au niveau de la Chine dans vingt ans » nous a dit Jean-Michel Severino.
Mais, actuellement, son poids dans le PIB mondial ne dépasse pas 4 %, contre 6 % pour l'Inde, 15 % pour la Chine ou 9 % pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
Deuxièmement, le rythme actuel de la croissance doit être comparé à celui de la population. Sur dix ans, le taux de croissance par habitant en Afrique subsaharienne n'est que de 2 % en raison du fort taux de croissance de la population. Ailleurs, en Chine, dont la population du continent est comparable en nombre sur la même période, ce taux de croissance moyen est de 10 %.
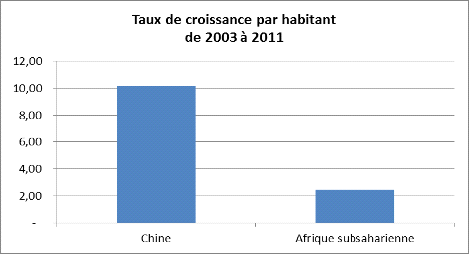
Il reste que le continent a pris le tournant de la croissance grâce à une évolution structurelle de ses économies. C'est là la nouveauté. Un retour dans le temps permet de mesurer les progrès que connaît la région, car les parcours des émergents montrent combien il est important de s'intéresser aux dynamiques au-delà des images figées.
Même à ce niveau, la croissance africaine et les politiques publiques mises en place ont permis d'améliorer la situation sociale de ces pays.
Les données indiquent que la pauvreté a reculé dans certains pays africains. Ainsi l'Éthiopie, qui a enregistré pendant les huit années allant de 2000 à 2010 une croissance très élevée a connu une réduction spectaculaire de la pauvreté ; la proportion de la population vivant avec moins de 1,25 dollar par jour a baissé, passant de 55,6 % en 2000 à 39 % en 2005 (Banque mondiale, 2010). Au Mozambique, la croissance a atteint 7,5 % par an pendant 15 ans, faisant plus que doubler le revenu réel moyen (même si le taux de pauvreté stagnait à 55 % en 2010, contre 69 % en 1997).
Au Mali, l'économie a progressé annuellement de 5,5 % depuis le milieu des années 90 : la pauvreté a diminué d'un tiers et le taux d'achèvement de l'école primaire a doublé. Au Cap-Vert, avec une croissance atteignant en moyenne 6 % par an pendant près de deux décennies, le taux de pauvreté est passé de 40 % à 20 %. Au Burkina Faso, le taux d'achèvement de l'école primaire est passé de 24% en 2001 à 54 % aujourd'hui, soit un processus de scolarisation plus rapide que celui que les États-Unis ont pu faire au XIX e siècle.
Le tableau suivant illustre les progrès effectués dans les pays en développement en général, y compris les émergents, et en Afrique subsaharienne de 1990 à 2010. Ils sont considérables. Mais, en même temps, il permet de mesurer le retard de l'Afrique subsaharienne sur de nombreux sujets.
Bilan des objectifs du millénaire pour le développement, Afrique subsaharienne.
|
Taux net de scolarisation dans le primaire |
Pays en développement |
Afrique subsaharienne |
|
Référence 1990 |
82% |
58% |
|
Situation 2011/2009 |
89% |
76% |
|
Objectifs 2015 |
100% |
100% |
|
Indice de parité des sexes pour le taux brut d'inscription dans l'enseignement primaire |
Pays en développement |
Afrique subsaharienne |
|
Référence 1990/1999 |
87 |
85 |
|
Situation 2011/2009 |
97 |
92 |
|
Objectifs 2015 |
100 |
100 |
|
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes |
Pays en développement |
Afrique subsaharienne |
|
Référence 1990 |
89 |
180 |
|
Situation 2011/2009 |
60 |
129 |
|
Objectif 2015 |
33 |
60 |
|
Taux de mortalité des mères pour 100 000 naissances |
Pays en développement |
Afrique subsaharienne |
|
Référence 1990 |
480 |
870 |
|
Situation 2011/2008 |
440 |
640 |
|
Objectif 2015 |
120 |
217 |
|
Taux d'incidence du VIH (nombre de nouvelles infections au VIH par an pour 100 personnes âgées de 15 à 49 ans) |
Pays en développement |
Afrique subsaharienne |
|
Référence 1990/2001 |
0.3% |
0.57% |
|
Situation 2009 |
0.8% |
0.49% |
|
Objectif 2015 |
Inverser la tendance |
Inverser la tendance |
|
Pourcentage de la population utilisant des infrastructures d'assainissement améliorées |
Pays en développement |
Afrique subsaharienne |
|
Référence 1990 |
42% |
28% |
|
Situation 2008/2010 |
53% |
31% |
|
Objectif 2015 |
71% |
64% |
B. DES TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES
1. Un environnement plus favorable à la croissance
Si la croissance a été plus forte, c'est aussi parce que la gestion économique a été meilleure et que les instabilités politiques ont été réduites.
a) Une stabilisation du cadre macro-économique
Ce dynamisme a été, en effet, d'abord permis par la nette amélioration des politiques macroéconomiques. L'inflation moyenne pendant la décennie 1990 était de 22 %, alors qu'elle est passée à 8 % dans la décennie suivante malgré la hausse des prix du pétrole.
De la même façon, sur la même période, l'endettement public extérieur a été divisé par trois (103 % du PIB pour la période 1995-2000 contre 34 % pour la période 2001-2013).
Cette amélioration des finances publiques est le fruit d'efforts mutuels : ceux des pays africains, qui ont réduit leur niveau de déficit de 60 % en une décennie et ceux des partenaires au développement, qui ont procédé à des allègements de dette considérables depuis le sommet du G7 de Lyon en 1996.
La dette extérieure totale de l'Afrique en proportion du PIB est ainsi passée de 53,6 % en 2004 à 34,2 % en 2013, un niveau très nettement inférieur au niveau européen.
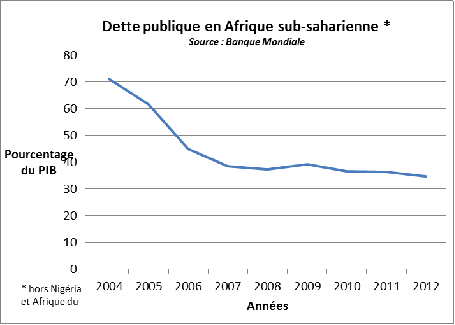
Ce mouvement de désendettement s'explique en particulier par les allègements de dette consentis au titre de l'Initiative PPTE, d'IADM et des efforts bilatéraux additionnels. La dette de 28 pays africains a ainsi baissé de 83 % après ces initiatives.
L'amélioration des fondamentaux économiques sur la décennie passée a permis aux pays africains d'accumuler des marges de manoeuvre qui, chose relativement inédite, leur ont permis d'apporter des réponses de politiques économiques appropriées, voire des plans de relance.
De plus, les dépenses sociales et les dépenses d'investissement, en général variables d'ajustement en temps de crise, n'ont pas été sacrifiées.
Le résultat des courses est que certains pays africains peuvent émettre aujourd'hui des obligations souveraines à des taux moins élevés que des pays européens. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a emprunté à moindre coût que la Grèce, le Sénégal a emprunté à moindre coût que le Portugal, la Zambie que l'Espagne, le Ghana que l'Irlande, le Nigeria que l'Italie, le Gabon que la Belgique et le Chili.
La perception des marchés financiers est en train de basculer.
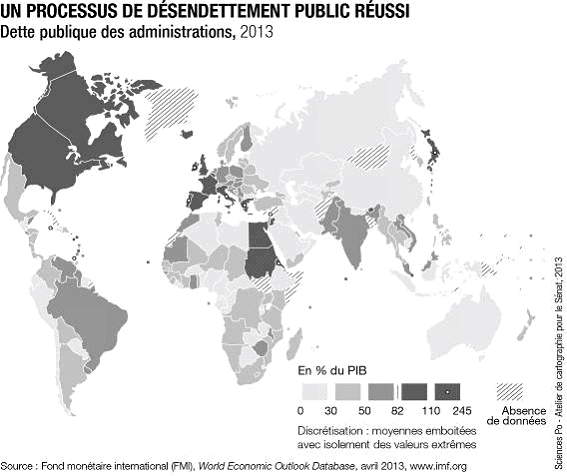
Cette amélioration de la situation des finances publiques largement due au processus d'annulation des dettes ne doit cependant pas conduire à un ré-endettement trop rapide des États et des entreprises publiques.
Alors que la région achève à peine le processus de désendettement auprès des bailleurs traditionnels (essentiellement ceux du Club de Paris) et multilatéraux dans le cadre du processus PPTE, plusieurs pays à revenu intermédiaire sont tentés de se ré-endetter à des conditions non concessionnelles auprès de certains partenaires émergents.
Ainsi M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor, a attiré notre attention sur ce point en soulignant que : « si l'endettement du secteur public dans son ensemble est passé de plus de 100 % du PIB en 2001 à 28 % en 2008, il connaît de nouveau une trajectoire ascendante et atteint 42 % du PIB en 2012. ».
b) Une amélioration de la gouvernance politique
Ensuite, même si la situation du Sahel nous rappelle que la situation politique est loin d'être stable partout, des progrès notables doivent être notés.
Le nombre de conflits, avec plus d'un millier de morts, a presque baissé de moitié (4,8 par an pour les années 1990 contre 2,6 pour les années 2000). Même si des progrès sont encore attendus pour les Africains, la démocratie s'étend et se renforce. En 1990, année du discours de La Baule, on comptait seulement trois présidents élus.
Depuis, 36 pays ont évolué de la dictature militaire ou de systèmes à parti unique vers des formes de multipartisme et de démocratie.
Les pays africains continuent de progresser dans la voie de l'ouverture politique et les taux de participation électorale ainsi que la participation de la société civile à la vie politique ont connu une constante évolution. La situation n'est toutefois pas idyllique. Il reste à institutionnaliser la culture de la démocratie - notamment par le développement de contre-pouvoirs - et à renforcer I'État de droit, étant donné que les vestiges de l'autoritarisme menacent les processus démocratiques, que la démocratie consensuelle n'est pas encore ancrée au sein de la classe politique et que des législations restreignant l'espace de participation politique de la société civile ont été adoptées dans plusieurs pays. De ce fait, les tensions, les conflits et les crises politiques y sont fréquents.
Des progrès remarquables dans la création et le renforcement d'institutions et de programmes régionaux de gouvernance politique.
Entre 2000 et 2011, l'Afrique a connu des progrès remarquables dans la création d'institutions et de programmes régionaux de gouvernance politique. On peut citer entre autres le Nouveau partenariat économique pour le développement (NEPAD/NPCA), le mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine (ECOSOCC), le Parlement panafricain (PAP), la Cour de Justice des Droits de I'Homme et des Peuples (CJDHP), la création et la montée en puissance de l'action de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA), le lancement de la conférence africaine des ministres de la décentralisation (CADDEL) en tant que structure permanente. On peut aussi noter la reconnaissance par l'Union africaine du rôle joué par les communautés économiques régionales (CEEAC, CEDEAO, EAC, SADC, COMESA, IGAD, CEN-SAD) de pilier de son action et de son développement.
Sur un autre plan, il y a désormais 32 pays africains qui participent de manière volontaire au processus du Mécanisme d'évaluation par les pairs (MAEP). Il s'agit d'un dispositif participatif unique dans le monde permettant aux pays africains et à leurs sociétés civiles d'auto-évaluer les progrès qu'ils réalisent.
Les changements réalisés vers la mise en place d'un environnement porteur pour le développement du secteur privé sont restés lents. Les privatisations des entreprises étatiques se sont progressivement ralenties, peut-être parce que la plupart des entreprises rentables ont été privatisées. Peu de pays disposent d'un régime anti-monopole bien développé. La réduction des pesanteurs administratives jouant contre les entreprises a été notable, mais le coût des transactions est resté élevé et les faiblesses dans l'exécution des contrats, la protection des droits de propriété et la gestion des entreprises ont été des difficultés récurrentes dans la plupart des pays.
De façon générale, le contexte institutionnel global s'est aussi largement amélioré : l'indice CPIA (Country Policy and Institutional Assessment) de la Banque mondiale à travers lequel elle mesure l'évolution de la qualité de la gouvernance est passé de 2,6 en 1995, en moyenne, à 3,4 en 2011, et, sur la même période, le nombre de pays considérés comme ayant des bonnes performances est passé de 5 en 1997 à 21 en 2011 (CPIA>3,5).
2. Cette croissance est tirée par les ressources naturelles
Ainsi, au-delà des discours triomphalistes sur l'émergence africaine, il convient de se rappeler que des périodes de croissance forte ont marqué l'histoire africaine sans pour autant constituer des tendances longues.
Si la dynamique de croissance à l'oeuvre suscite autant d'espoir, c'est qu'elle s'appuie sur deux leviers puissants : l'exploitation des ressources énergétiques et minérales et la croissance de la demande intérieure.
Les exportations de produits primaires sont le principal déterminant de la performance économique de l'Afrique depuis les indépendances - même si le secteur manufacturier, les finances, les télécommunications et le tourisme contribuent de plus en plus au PIB. Le profil d'exportation du continent n'a pas vraiment évolué, par rapport à l'époque coloniale, caractérisée par la dépendance à l'égard des produits de base. L'exploitation des matières premières est aujourd'hui, et de loin, la première source d'exportation de l'Afrique.
L'énergie et les mines représentent plus de 63% de l'ensemble des exportations africaines. Ainsi les combustibles minéraux (charbon, pétrole) représentent-ils plus de 90% des recettes d'exportation pour la Guinée équatoriale ou le Nigeria. Les minéraux comptent pour 80% dans celles du Botswana (diamant, cuivre, nickel, carbonate de soude, or), du Congo Brazzaville (pétrole), de la République Démocratique du Congo (diamant, pétrole, cobalt et cuivre), du Gabon (pétrole, manganèse), de la Guinée (bauxite, alumine, or et diamant), de la Sierra Leone (diamant) et du Soudan (pétrole et de l'or). Les minéraux et les combustibles minéraux représentaient plus de 50% des recettes d'exportation du Mali (or), de la Mauritanie (minerai de fer), du Mozambique (aluminium), de la Namibie (diamant, uranium, or et zinc) et de la Zambie (cuivre et cobalt).
Une part non négligeable de la croissance des économies africaines repose donc encore sur des facteurs extérieurs. Le poids dans cette croissance de la variation des prix des matières premières, de la croissance des émergents ou des industries extractives ne peut être ignoré. Étant donné que ces éléments constituent des formes de rentes, le développement africain dépendra de sa capacité à capitaliser sur les richesses du continent, notamment en développant sa capacité à transformer les matières premières sur place.
L'Afrique sub-saharienne est déjà la deuxième région exportatrice de pétrole au monde et elle représente 10 % des réserves hydrauliques mondiales économiquement exploitables. Elle concentre également près de 60% des nouvelles terres arables du monde et une part importante des stocks de certains minerais et métaux rares s'y trouve également.
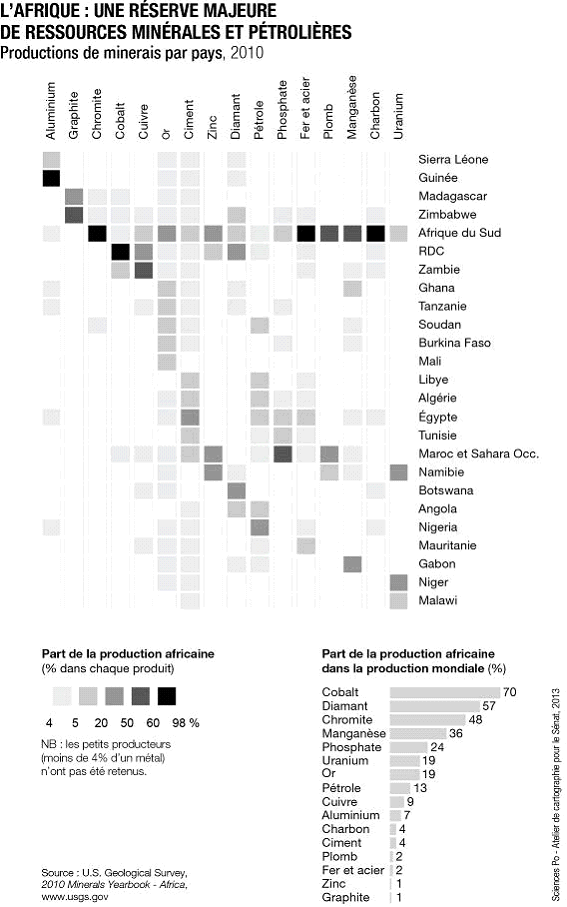
Si l'on se tourne vers l'avenir, une question essentielle consiste à déterminer si ce bond en avant restera un épisode exceptionnel ou s'il marquera un réel décollage économique de l'Afrique. La croissance du continent s'était également emballée pendant le boom pétrolier des années 70, mais avait ensuite brutalement ralenti lors de l'effondrement des cours du pétrole et des autres matières premières dans les deux décennies suivantes. Notre analyse tend à indiquer que les perspectives de croissance à long terme du continent sont cette fois solides, même si certaines économies africaines pourraient encore essuyer des revers. Ces perspectives positives se fondent en effet tout à la fois sur des tendances globales et sur des changements à l'oeuvre à l'échelle des sociétés et économies du continent.
Tout d'abord, l'Afrique va continuer à bénéficier de la hausse de la demande mondiale en pétrole, gaz naturel, minerais, denrées alimentaires, terres arables et autres ressources naturelles. La demande de matières premières est tirée principalement par les économies émergentes, qui représentent à présent la moitié du commerce africain.
Dans les années à venir, la place de l'Afrique dans l'industrie minière devrait augmenter. En effet, les réserves mondiales se trouvent, pour une part non négligeable, en Afrique dont le sous-sol a été beaucoup moins exploré qu'ailleurs. Selon la direction du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), les dépenses d'exploration par kilomètre carré sont encore cinq fois moins élevées qu'au Canada ou en Australie.
L'Afrique est ainsi considérée comme la « nouvelle frontière » de l'industrie minière et les pays les plus explorés sont bien sûr l'Afrique du Sud et la Zambie, mais aussi la Namibie, la Tanzanie, la RDC, le Ghana et, parmi les pays francophones, le Burkina et le Mali. Pour le moment, l'Afrique subsaharienne ne consomme qu'un faible pourcentage de sa production de minerais qui est donc essentiellement exportée.
|
Les exportations de minerais de l'Afrique subsaharienne Milliards de dollars et % du total mondial : 2000 2010 |
|
|
|
Source : à partir de Comtrade. |
De même, dans le domaine des hydrocarbures, l'Afrique, comme nous l'ont souligné les dirigeants de Total, offre des perspectives plus qu'intéressantes.
Sur les 2 600 milliards de barils de ressources pétrolières dans le monde, 242 milliards de barils soit 9% sont situées en Afrique. L'Afrique possède également environ 10 % des ressources de gaz du monde.
Les zones traditionnelles sont l'Afrique du Nord (Algérie, Libye, Egypte), le Golfe de Guinée (Nigeria, Angola, Guinée Équatoriale, Congo, Gabon). Les nouvelles zones d'exploitation sont situées en Mozambique, Tanzanie et Ouganda. Les prospections, quant à elles, se diversifient à l'ouest : Mauritanie, Côte d'Ivoire, Ghana, au sud Afrique du Sud et à l'est Kenya, Soudan du Sud.
Le secteur minier et pétrolier est au coeur de la croissance africaine mais également de certains systèmes politiques africains, qu'il les stabilise ou les déstabilise en fonction de l'évolution des cours et de mystérieux jeux de pouvoir qui se déroulent, au-delà du continent, dans des conseils d'administration.
Le secteur minier et pétrolier : une source de conflits locaux, nationaux et régionaux
Du fait des enjeux de pouvoir qu'il cristallise, ce secteur est aussi une source de conflits locaux, nationaux et régionaux comme le démontre la situation de la RDC ou du Darfour. Dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), l'exploitation artisanale des minerais bénéficie en partie aux groupes armés : cette capacité d'autofinancement explique leur effrayante durabilité et est à l'origine de leur pouvoir. En raison de l'importance des hautes technologies, l'approvisionnement en minerais critiques est en train de devenir aussi stratégique que l'approvisionnement en hydrocarbures.
Les conflits armés suscités par les revenus des gisements et des mines ont été tels depuis l'indépendance qu'on a pu parler de « malédiction des ressources », bien que cela soit moins ces dernières qui sont en cause que l'usage qui en est fait.
Malgré cela, ces activités seront un moteur du développement des pays africains qui peuvent en retirer une source de financement majeur de leurs infrastructures à condition que ces ressources naturelles soit exploitées de façon transparente, équitable et optimale.
On observe de ce point de vue, au début de notre siècle, un vaste changement de paradigme des politiques de développement minier et pétrolier qui vise à rééquilibrer les contrats, à assurer un meilleur partage de la rente, à renforcer la transparence et les exigences en matière de responsabilités sociale et environnementale.
La vague de renégociation des contrats qui a débuté en Amérique latine a fini par se répandre en Afrique, notamment sur les conseils de la Banque mondiale. Le mouvement de modification des règles qui lient les États aux firmes multinationales du secteur minier en est une illustration : projet de hausse de la fiscalité en Afrique du sud et en Tanzanie, volonté de révision des contrats miniers au Niger, au Sénégal et au Mozambique, adoption d'un nouveau code minier en Guinée en 2011, doublement des royalties en Zambie. Le Libéria avait ouvert la voie en 2006, puis la Zambie en 2007. Le Ghana entend réformer le secteur aurifère.
Hausse des impôts et taxes, prises de participations publiques, renégociation des contrats et investissements d'origine locale sont des voies suivies déjà par une douzaine d'États africains riches en minerais, et ils le sont probablement tous.
La renégociation tend à devenir la norme en cas de changement de régime. Le président nouvellement élu en Guinée-Conakry a lancé une révision des contrats miniers qui défraie la chronique et, sitôt son putsch commis en Centrafrique, Michel Djotodia a annoncé vouloir relire les contrats signés par le précédent régime avec la Chine et l'Afrique du Sud.
Vers un nouveau partage de la rente minière ?
Parallèlement les sociétés africaines réclament de plus en plus vigoureusement leur part de la rente et tentent de modifier le circuit de redistribution. En conséquence, par le haut et par le bas, l'Afrique semble vouloir exercer un meilleur contrôle sur des acteurs. Cette dynamique triangulaire, dans laquelle s'immiscent en outre des institutions internationales, connaît une évolution rapide.
Au-delà des aspects environnementaux, humains et sociaux, de la gestion et du partage des recettes minières, les réflexions en cours à la Banque mondiale, au FMI et à l'Union Africaine se focalisent sur les stratégies pour promouvoir des partenariats plus axés sur le développement en matière de production et de création de valeurs, d'infrastructures et de mise en place d'industries connexes.
L'idée notamment de la Vision africaine des mines, que les dirigeants du continent avaient adoptée en 2009, était d'augmenter la part de la valeur ajoutée produite en Afrique.
Ce secteur est ainsi au coeur de nombreuses problématiques essentielles au développement du continent : la mobilisation de ressources fiscales propres, l'industrialisation des économies par la captation de la valeur ajoutée et l'intégration au tissu économique local.
3. ..mais aussi par l'émergence d'une classe moyenne africaine
Nombreux sont ceux qui considèrent que, plus que sa richesse en ressources naturelles, le véritable pilote de la croissance africaine demeurera l'émergence de sa classe moyenne.
L'industrie extractive représente encore indéniablement une part importante de l'économie du continent, et les exportations de matières premières ont soutenu la croissance de manière considérable au cours de la dernière décennie. Une nouvelle tendance se fait néanmoins jour avec une croissance dans le domaine agricole, dans l'industrie légère, dans l'informatique et les services, qui est tirée par la consommation des ménages les plus aisés. Ce phénomène est d'autant plus important qu'il jette les bases d'une croissance endogène moins dépendante de la demande extérieure.
Une décomposition plus fine montre que des secteurs à forte croissance ont émergé en dehors du secteur extractif qui ne représente au total que 32 % du PIB africain.
Force est de constater que la croissance du secteur manufacturier est identique à celle du reste du secteur industriel. Il en va ainsi de la vente en gros et en détail (13 % du changement dans le PIB réel entre 2002 et 2007), de la construction et des services qui y sont associés (12 %), du transport et des télécommunications (10 %) ou de l'intermédiation financière (6 %). L'ensemble de ces secteurs sont responsables de plus d'un tiers de la croissance africaine et affichaient des taux de croissance de plus de 6% par an.
Ces secteurs sont portés par une demande interne croissante et par l'émergence de classes moyennes africaines : le PIB total de l'Afrique est aujourd'hui comparable à celui de la Russie ou du Brésil et le nombre de ménages avec des revenus de plus de 20 000 dollars par an est déjà supérieur à celui de l'Inde.
Une classe moyenne africaine comparable à celle de la Chine ou de l'Inde ?
D'après les calculs de la Banque africaine de développement (BAD), la classe moyenne africaine rassemble 326 millions de consommateurs qui dépensent entre 2 et 20 dollars par jour, dont plus de la moitié dans une « classe moyenne flottante » qui vit avec 2 à 4 dollars par jour.
Avec cette approche, la taille de la classe moyenne africaine serait comparable à celle de la Chine ou de l'Inde, bien qu'elle soit plus pauvre et moins homogène.
La définition de cette classe moyenne, selon l'intervalle de revenu retenu, varie considérablement. Mais ce qui est en jeu c'est l'apparition d'une part croissante de la population qui sort de l'urgence de la satisfaction des besoins primaires pour acquérir des biens durables, voire épargner, tout en restant exposée aux aléas économiques.
Une nouvelle tendance fondamentale apparaît dans les analyses publiées sur l'Afrique par les grands cabinets de consultants. Ils conseillent à leurs clients internationaux de réviser leurs stratégies. Ils prédisent que la production mondiale devra être réajustée pour satisfaire les besoins d'une classe moyenne africaine en croissance, en partie avec des revenus probablement limités, dans les pays en voie de développement.
Une stratégie industrielle gagnante : cibler le bas de la pyramide
D'après Ernst & Young, les futures stratégies d'entreprise devront absolument être ajustées à l'expansion de la demande des catégories moyennes en s'assurant que leur modèle économique est « adapté à une clientèle à faibles revenus ». De fait, la stratégie consistant à cibler le bas de la pyramide est désormais étudiée par de nombreuses multinationales notamment dans l'industrie pharmaceutique.
Le moteur de la croissance africaine repose désormais en partie sur la consommation. Nous avons été à Pretoria et au Cap. La dépendance de l'Afrique du Sud à l'égard des ressources naturelles, par exemple, est tout à fait marginale. Désormais, son secteur des TIC contribue à plus de 7 % du PIB, à comparer aux 6 % des industries minières. En Tunisie et en Tanzanie, les TIC atteignent respectivement 10 et 20 % du PIB.
Le développement de la consommation par les classes moyennes africaines va être soutenu par les deux processus de long terme que sont l'urbanisation et l'augmentation des actifs.
Ainsi pour McKinsey Global institute 21 ( * ) : « la croissance à long terme de l'Afrique va reposer davantage aussi sur des ressorts internes : des tendances sociales et démographiques interdépendantes qui vont entraîner de nouveaux moteurs de croissance domestique. Les principales sont l'urbanisation et l'ascension des consommateurs africains des classes moyennes. En 1980, à peine 28 % de la population africaine vivait en ville. »
Aujourd'hui, on compte 40 % de citadins, un pourcentage proche de celui de la Chine et supérieur à celui de l'Inde - et ce taux devrait continuer à progresser. Lorsque le nombre d'Africains délaissant les travaux agricoles pour des emplois urbains augmente, leurs revenus suivent la même tendance.
C. UNE CROISSANCE INÉGALEMENT RÉPARTIE
Ces évolutions et ces progrès ne sont évidemment pas uniformes et ne peuvent pas être considérés comme des acquis immuables. Certaines régions comme certains pays sont, de fait, restés à l'écart de ces dynamiques. En plus de connaître des croissances par habitant négatives, ils constituent parfois des foyers d'instabilité régionale dont les risques ne peuvent pas être sous-estimés. Les poches de mauvaise gouvernance sont autant d'endroits où les intérêts mafieux et idéologiques tentent de s'imposer.
1. Une dynamique qui n'emporte pas l'ensemble du continent
« L'Afrique est de nouveau considérée comme un continent des opportunités -- le dernier eldorado émergent de l'investissement. Nous remarquons cet optimisme dans le nombre et la diversité des entreprises et des pays qui affluent pour investir sur le continent. C'est un optimisme fondé sur une solide croissance économique que même la crise financière mondiale n'a pu inverser que brièvement. Et cette croissance est de plus en plus mise à profit pour diversifier les économies et investir dans les fondements essentiels des sociétés efficaces -- l'éducation, la santé et les infrastructures vitales » affirmait Kofi Annan, septième Secrétaire général des Nations unies, en 2011.
Cette renaissance africaine est cependant loin de toucher l'ensemble du continent. D'abord, les points de départ sont inégaux. Nous avons traversé l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Ce sont encore deux mondes qui ont peu de choses en commun. Prenez le revenu par habitant en 2010, il variait de 170 USD au Burundi à 14 500 USD en Guinée Équatoriale. Ensuite le rythme de croissance, les processus de développement et leurs conséquences sociales diffèrent très sensiblement d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre.
Un important groupe de pays africains n'a encore pas pu bénéficier des retombées de cette croissance. Pour des raisons différentes, le Burundi, la République Centrafricaine dont le PIB a chuté de 30 % depuis l'indépendance, le Tchad, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo dont le PIB a été divisé par 4 depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Somalie, le Soudan, le Togo et le Zimbabwe sont restés plus ou moins à l'écart de cette dynamique.
Inégalités entre pays, inégalités au sein des pays
On estime que plus de 200 millions d'Africains répartis dans 17 pays vivent dans des pays touchés par le conflit et l'instabilité. Autrement dit 20 % de la population d'Afrique subsaharienne ne participent pas à cette dynamique positive.
Ces pays fragiles font face à un nombre impressionnant de problèmes de développement et de pièges causés par la pauvreté. Peu d'entre eux sont sur la bonne voie pour atteindre ne serait-ce qu'un seul objectif du Millénaire pour le développement. Il existe une interdépendance complexe entre les conflits et la pauvreté. Des pays comme la RDC ou la Centrafrique peuvent être pris dans un cycle de conflits, dans lequel la mauvaise gouvernance et le sous-développement chronique sont à la fois une cause et une conséquence de la violence.
Là où le conflit est devenu un phénomène régional, comme dans la région des Grands Lacs, il peut s'avérer difficile pour les États pris individuellement d'échapper au cycle de violence sans une avancée à l'échelle régionale. Il existe également une étroite interdépendance entre la fragilité, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Ces États fragiles d'Afrique font face à un énorme déficit en infrastructures et en établissements sanitaires, à cause de nombreuses années d'inaction.
Sur ces 200 millions d'habitants d'États fragiles, jusqu'à 80 % de cette population vit de l'agriculture de subsistance et plus de 50 % a un revenu inférieur à 1,25 dollar par jour.
Les situations changent cependant rapidement. En l'Afrique de l'est, le Mozambique semble aujourd'hui sur la voie d'une croissance continue après des années d'une guerre civile particulièrement meurtrière. Nous avons vu en Côte d'Ivoire après dix années de crise une reprise de la croissance qui, d'après les estimations, s'établit à près de 10 % en 2012.
Inégalités entre pays, inégalités au sein des pays. La croissance africaine n'est ni suffisamment inclusive, ni suffisamment riche en emplois. A titre d'illustration, dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, 200 millions de jeunes Africains âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi : ils représentent 60 % des chômeurs du continent. 52 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Parmi les dix pays au monde où les inégalités sont les plus accentuées, six sont en Afrique (Namibie, Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Sierra Leone, République centrafricaine).
La croissance n'a pas encore endigué la pauvreté, qui reste, nous le verrons, un défi majeur pour l'Afrique.
2. Des performances, des profils et un degré de diversification variable
Structurellement, les pays disposant d'une rente pétrolière ou minière ont bénéficié, sauf exception, d'une croissance économique relativement plus vigoureuse en moyenne. C'est le cas de l'Angola, du Nigéria ou du Mozambique. Mais le Congo où 50 % de la population vit avec moins de 1 dollar, alors que les recettes du pétrole s'élèvent à 2,5 dollars par habitant et par jour, constitue un contre-exemple qui s'explique par la captation de la rente pétrolière et minière.
Si on regarde les quatre dernières années, les 11 pays d'Afrique les plus performants ont atteint le seuil de 7 %, considéré comme étant un préalable à la réalisation des OMD, l'Éthiopie et la Sierra Leone occupant les deux premières places.
Le résultat de l'Éthiopie est d'autant plus remarquable que le pays ne dispose pas de ressources du sol. La croissance en Éthiopie est due à l'augmentation des investissements publics et privés, à l'amélioration de la gestion macroéconomique et au rôle accru du secteur manufacturier et des services, notamment. La croissance en Sierra Leone reflète essentiellement la reprise après la guerre civile ainsi que la mise en exploitation des ressources naturelles.
La liste des pays les plus performants (Éthiopie, Sierra Leone, Libye, Ghana, Rwanda, Liberia, Malawi, Zimbabwe, Nigeria, Mozambique) n'en souligne que davantage l'importance centrale de la production et des exportations de produits de base. Ces pays sont, dans leur majorité, fortement tributaires du pétrole et/ou des minéraux.
A l'opposé, le Swaziland, le Soudan, Madagascar, les Comores et l'Afrique du Sud ont réalisé les performances les plus faibles durant la période 2008-2012.
L'économie du Swaziland a connu un ralentissement en raison notamment du déclin de l'industrie textile et du vêtement. Le faible taux de croissance du Soudan est largement dû à une contraction de 11 % en 2012, provoquée par l'environnement politique, la poursuite de la guerre civile, la sécession du Soudan du Sud et les tensions frontalières qui en ont découlé, autant de facteurs qui expliquent la faiblesse de ses taux de croissance moyens. Cependant, en raison de l'intensification des efforts de paix aux niveaux national et régional, la croissance dans ce pays devrait rebondir dans le moyen terme.
L'exposition de l'Afrique du Sud aux marchés financiers mondiaux a joué un rôle important dans sa faible performance de croissance durant les cinq dernières années. Nous avons cependant été frappés par la faiblesse des performances de ce géant de l'Afrique dont le PIB représente 30 % du PIB subsaharien. L'Afrique du Sud n'est pas la locomotive de la croissance africaine que l'on envisageait dans les années 90.
Une des façons de comprendre la spécificité, en termes d'opportunités et de défis, des pays africains est de les classer en fonction de leur niveau de diversification économique d'une part, et de leurs exportations rapportées au nombre d'habitants d'autre part.
Ceci permet d'évaluer deux dimensions connexes : la capacité à développer d'autres sources de croissance économique en plus des ressources naturelles et de l'agriculture, et la capacité à générer des revenus d'exportation pour financer l'importation de biens d'équipements nécessaires aux investissements. L'histoire économique montre que des progrès sur ces deux axes accompagnent généralement le développement des États.
Le modèle résultant de cette classification permet de distinguer quatre grands groupes de pays : ceux à économies diversifiées, les exportateurs de pétrole, ceux à économies en transition et ceux à économies en pré-transition.
Malgré des différences sensibles entre pays au sein d'un même groupe, les structures et les défis économiques sont relativement homogènes pour chaque catégorie. Notre modèle permet ainsi de mieux identifier les opportunités de croissance au-delà de la variété des situations nationales.
Parmi les économies diversifiées, qui constituent les moteurs de la croissance, certaines possèdent déjà une industrie manufacturière et un secteur des services bien développés, comme l'Afrique du Sud.
Au cours des 10 dernières années, le secteur tertiaire (ex. banque, télécoms et commerce de détail) a représenté plus de 50 % de la croissance de leur PIB national. Ces économies affichent les taux de croissance les plus stables d'Afrique et devraient largement bénéficier du renforcement de leurs liens avec l'économie mondiale.
Toutefois, les économies africaines diversifiées affichent encore des coûts unitaires de la main d'oeuvre supérieurs à ceux de la Chine ou de l'Inde, et doivent par conséquent chercher à se développer dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Elles devront également relever d'autres défis : accroître leurs exportations, tant sur les marchés régionaux que mondiaux, améliorer l'éducation afin de disposer de la main d'oeuvre qualifiée indispensable dans les secteurs de pointe, et développer les infrastructures nécessaires pour accompagner la croissance.
Pour les exportateurs de pétrole, la stratégie consiste à renforcer leur croissance en se diversifiant. Les pays africains exportateurs de pétrole et de gaz affichent le PIB par habitant le plus élevé, mais ont les économies les moins diversifiées. La hausse des cours de l'or noir a considérablement gonflé leurs recettes d'exportation : entre 2000 et 2008, les trois plus gros producteurs (l'Algérie, l'Angola et le Nigeria) ont engrangé 1000 milliards de dollars grâce aux exportations de pétrole, contre 300 milliards de dollars dans les années 90.
Toutefois, l'industrie manufacturière et les services restent relativement modestes, puisqu'ils ne représentent qu'un tiers du PIB en moyenne. Ces pays bénéficient de solides perspectives de croissance, pour autant que la manne pétrolière soit utilisée pour financer le développement de leur économie dans d'autres secteurs.
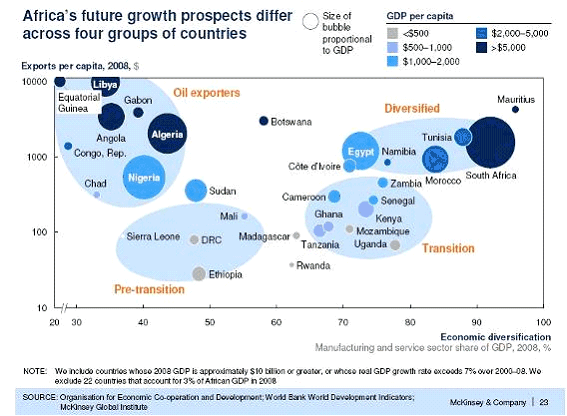
Les exportateurs de pétrole africains sont aussi confrontés à des défis partagés par nombre de pays en développement de par le monde, notamment celui de préserver la stabilité politique et de maintenir le rythme des réformes économiques ; de résister à la tentation de trop dépenser et de surinvestir, ce qui les rendrait vulnérables à un recul des cours des matières premières ; et d'établir un environnement économique permettant aux entreprises de tous les secteurs de prospérer.
Les économies africaines en transition, au nombre desquelles figurent le Ghana, le Kenya et le Sénégal, affichent un PIB par habitant inférieur à celui des pays des deux premiers groupes, mais leurs économies se développent rapidement. Les secteurs de l'agriculture et des ressources naturelles cumulés pèsent 33 % du PIB et deux tiers des exportations. Toutefois, ces pays exportent aussi de plus en plus de biens manufacturés, principalement vers d'autres parties du continent : des combustibles et produits alimentaires transformés, des produits chimiques, des vêtements et des cosmétiques par exemple. Développer le commerce intra-africain et élargir les marchés régionaux est l'une des sources de croissance future des économies en transition.
Ces pays pourraient également concurrencer des économies émergentes à bas coûts sur le marché mondial en améliorant leurs infrastructures et leurs régimes réglementaires. Par ailleurs, même si le secteur tertiaire connaît une expansion rapide, les taux de pénétration de certains services comme les télécoms, la banque ou le commerce de détail formel restent largement inférieurs à ceux des pays où l'économie est diversifiée, d'où une opportunité pour les entreprises de répondre à une demande insatisfaite. Enfin, plusieurs économies en transition vont probablement accroître leurs exportations de ressources naturelles dans les années à venir, ce qui pourrait stimuler leur croissance. Grâce aux nouveaux gisements pétroliers récemment découverts, le Ghana et l'Ouganda, par exemple, vont engranger des recettes supplémentaires qui, judicieusement investies, pourraient accélérer aussi leur diversification.
3. La croissance est-elle anglophone ?
Il est devenu coutumier de dire que les trajectoires de croissance entre pays anglophones et pays francophones divergent fortement depuis quelques années.
Les pays anglophones connaîtraient une forte croissance alors que les pays francophones marqueraient le pas.
Un examen des données disponibles sur longues périodes semble démontrer que ces trajectoires de croissance, si elles sont fortement différenciées, ne sont pas nécessairement associées à des zones géographiques particulières, même si globalement les pays d'Afrique francophone semblent parfois plus en retrait.
|
Pays anglophones |
Pays francophones |
||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Afrique du sud |
2,89 |
3,12 |
2,59 |
Benin |
2,55 |
3,53 |
3,47 |
|
Ghana |
8,01 |
14,39 |
8,18 |
Burkina Faso |
7,89 |
4,16 |
6,99 |
|
Kenya |
5,76 |
4,38 |
5,13 |
Burundi |
3,79 |
4,19 |
4,20 |
|
Liberia |
6,12 |
8,17 |
9,00 |
Cameroun |
2,93 |
4,20 |
4,70 |
|
Malawi |
6,53 |
4,35 |
4,31 |
Congo |
8,75 |
3,42 |
4,93 |
|
Maurice |
4,15 |
4,14 |
3,37 |
Côte d'Ivoire |
2,39 |
- 4,73 |
8,13 |
|
Namibie |
6,60 |
4,86 |
4,04 |
Gabon |
6,61 |
6,64 |
6,11 |
|
Nigeria |
7,98 |
7,36 |
7,07 |
Guinée |
1,94 |
3,91 |
4,79 |
|
Ouganda |
6,07 |
5,10 |
4,19 |
Madagascar |
0,42 |
1,81 |
1,90 |
|
Rwanda |
7,22 |
8,58 |
7,70 |
Mali 22 ( * ) |
5,82 |
2,73 |
- 1,50 |
|
Sierra Leone |
5,28 |
6,01 |
21,29 |
Niger |
7,96 |
2,29 |
11,30 |
|
Tanzanie |
7,04 |
6,45 |
6,51 |
RCA |
3,00 |
3,30 |
4,10 |
|
Zambie |
7,62 |
6,57 |
6,47 |
Sénégal |
4,13 |
2,62 |
3,69 |
|
Zimbabwe |
9,62 |
9,38 |
5,02 |
Tchad |
12,98 |
1,76 |
7,32 |
|
Togo |
4,00 |
4,87 |
5,03 |
||||
La problématique des effets des hausses de prix des matières premières est aussi un élément à prendre en compte. Un reclassement des pays selon les richesses naturelles dont ils disposent permet de constater que les trajectoires de croissance, notamment entre pays producteurs de matières premières, se rapprochent et de tempérer une conclusion intuitivement formulée.
Dans les pays anglophones, la croissance est essentiellement portée par les pays producteurs de pétrole ou riches en ressources minérales. C'est le cas, notamment, du Ghana, du Nigeria et du Sierra Leone. On constate une tendance identique pour les pays francophones (Niger, Tchad et Gabon).
En zone francophone, la croissance a été fortement ralentie en raison des deux crises politiques majeures de 2011 en Côte d'Ivoire (- 4,73%) et de 2012 au Mali (- 1,50 %). Les trajectoires de croissance semblent, en zone anglophone êtres plus stables et moins sujettes aux chocs internes comme externes qu'en zone francophone.
Les principaux pays porteurs d'activité et de croissance en zone anglophone restent, classiquement, l'Afrique du Sud et le Nigéria. Le Ghana et le Kenya connaissent une montée en puissance constante et régulière de leur PIB. Les moteurs de la croissance en zone francophone restent la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais dans une mesure beaucoup plus modeste que celle des pays de niveau comparable comme le Ghana ou le Kenya.
Les pays ne disposant pas de ressources naturelles abondantes connaissent, selon leur zone linguistique, des taux de croissance très différents mais généralement au détriment des pays francophones.
Si l'on prend les prévisions pour 2013, elles s'élèvent à 6 % pour l'Afrique de l'Ouest, 6,1 % pour l'Afrique de l'Est, 5,1 % pour l'Afrique centrale et 4 % pour l'Afrique australe.
Les pays africains les plus performants en 2013 sont répartis sur l'ensemble du continent : Mozambique (8,4 %), Côte d'Ivoire (8 %), Libéria (8 %), Rwanda (7,6 %), Ghana (6,9 %), Ethiopie (6,5 %), Niger (6,2 %), Angola (6,2 %).
De même que les pays qui enregistrent les taux de croissance les plus faibles : Comores (3,5 %), Guinée (3,4 %), Afrique du Sud (2,8 %), Madagascar (2,6 %), Guinée équatoriale (-2,1 %).
Cette segmentation des trajectoires de croissance est davantage liée aux caractéristiques même des pays qu'à leur appartenance à une zone géographique.
Un des principaux déterminants reste celui des richesses naturelles, notamment des hydrocarbures, pétrole et gaz. A l'inverse, les crises politiques à répétition restent un facteur discriminant. Chaque sous-région compte ainsi des « lions » africains qui connaissent un fort dynamisme économique, mais également des Etats « faillis » qui continuent de souffrir des guerres civiles et de défaillances institutionnelles et démocratiques.
L'idée qu'il existerait une Afrique anglophone prospère face à une Afrique francophone sinistrée est donc largement infondée.
Il faut toutefois noter que le poids de l'Afrique anglophone est supérieur à celui de l'Afrique francophone, avec un rapport démographique triple : l'Afrique anglophone a atteint un PIB de près de 898 Md$ pour une population de plus de 480 millions d'habitants face à une Afrique francophone qui a un PIB de près de 163 Md$ pour un peu plus de 170 millions d'habitants.
En revanche, les niveaux de l'indice de développement humain (IDH 2011) montrent que les pays francophones sont « à la traîne », ce qui pourrait dénoter un manque de redistribution « inclusive » des gains de croissance dans ces pays.
IV. D'IMMENSES DÉFIS RESTENT À RELEVER
Les performances du continent depuis une décennie expliquent que s'agissant de l'Afrique l'enthousiasme soit de rigueur.
En témoigne cette phrase de Lawrence Henry Summers, Secrétaire au Trésor des États-Unis de 1999 à 2001 dans l'administration Clinton, chef du Conseil économique national du président Obama, lors de la 2 e édition du New York Forum Africa au mois de juin 2013 : « Investir en Afrique est risqué, mais compte tenu des opportunités que présente ce continent, c'est encore plus risqué de ne pas y investir ».
Cet optimisme est devenu le credo des élites africaines. Il est le ciment commun de cette nouvelle élite entrepreneuriale que l'on croise dans les aéroports. Il est omniprésent dans la ligne éditoriale des nombreux magazines économiques qui sont sortis ces dernières années dont le fonds de commerce n'est autre que cette confiance retrouvée du continent.
C'est ce que veut entendre la nouvelle bourgeoisie africaine. Mais, c'est parfois loin de ce que vivent la majorité des africains en particulier ceux des bidonvilles ou des zones rurales délaissées par le développement.
Cet optimisme est à la hauteur du pessimisme qui régnait dans la décennie précédente. Ne nous y trompons pas cet optimisme, c'est le retour de la confiance, c'est la conviction que l'avenir sera meilleur. Cette conviction-là peut transporter des montagnes. On sait combien la confiance est au coeur de la croissance, à la base des anticipations des agents économiques.
Mais s'il faut prendre la mesure de la transformation en cours, qui entraînera sans doute un bouleversement des équilibres mondiaux, l'enthousiasme ne doit pas nous rendre aveugles aux défis considérables qui attendent le continent noir.
L'Afrique va mieux. Va-t-elle bien ?
Difficile d'y répondre. Difficile d'y apporter la même réponse pour les businessmen de Lagos ou d'Abidjan, formés dans les meilleures écoles françaises et de plus en plus souvent américaines, que nous avons croisés, et les paysans Nagadé que nous avons rencontrés autour du Lac Tana en Ethiopie.
Ces deux Afriques vivent sur une autre planète.
Des siècles les séparent. Parfois la mondialisation les rassemble sur l'un des nombreux projets d'agro-industriels qui se développent au Sud du Sahara à l'image des fermes de fleurs coupées du Kenya ou d'Ethiopie.
Aujourd'hui, le fossé qui les sépare rend toute réponse globale dérisoire.
Au fil des entretiens et des missions en Afrique, il nous a semblé que la réponse dépendra demain de plusieurs thèmes qui constituent des défis majeurs, dont le premier est la lutte contre la pauvreté.
A. TRANSFORMER LA CROISSANCE EN DÉVELOPPEMENT
1. Le défi de la pauvreté toujours d'actualité
Malgré ces dynamiques, les pays pauvres du globe restent majoritairement africains. Comme le dit Mo Ibrahim, Président de la Mo Ibrahim Foundation et fondateur de Celtel International : « L'Afrique est un continent très riche avec des habitants très pauvres » . Regardons la carte. Dans une grande partie des pays, la majorité de la population vit avec moins de 1,25 dollar par jour, qui est considéré comme le seuil de pauvreté
.
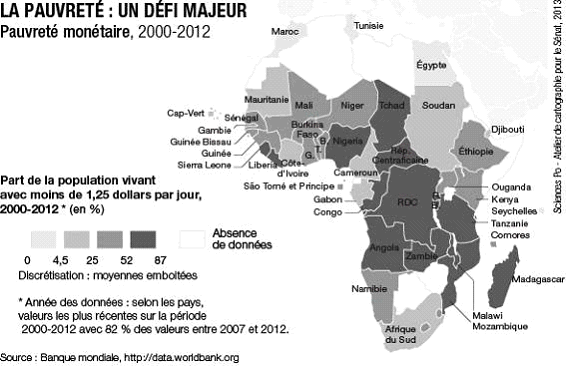
400 millions de personnes avec moins de 1,25 dollar par jour, la pauvreté diminue, le nombre de pauvres augmente
Sur l'ensemble du continent, cela représente près de 400 millions de personnes. Alors évidemment ces chiffres sont discutables. Les difficultés méthodologiques pour définir et mesurer le concept, ainsi que le manque de données et leur fiabilité limitée, doivent inciter à la plus grande prudence dans l'interprétation des tendances.
Il n'en demeure pas moins que les résultats en termes de réduction de la pauvreté sont relativement décevants et, en particulier dans les zones rurales, très lents. Et compte tenu de la croissance démographique, si la part relative des plus pauvres diminue légèrement, leurs effectifs augmentent.
En outre, la croissance démographique conduit à absorber beaucoup des progrès effectués ces dernières années. Car si la proportion de pauvres diminue, leur nombre augmente au rythme de la population. S'il y a de moins en moins de pauvreté, il y a de plus en plus de pauvres.
Comme nous l'a fait observer Lionel Zinsou : « Au Bénin par exemple, on avait à l'indépendance deux millions et demi de citoyens et plus d'un million d'exclus alors. Aujourd'hui, on a fait considérablement régresser la pauvreté (entre 25 % et 30 % en 2015). Or 25 % d'exclus sur une population de 10 millions d'habitants, cela fait deux fois plus d'exclus qu'au moment de l'indépendance. »
Entre l'Europe et l'Afrique, les différences de PIB par habitant peuvent atteindre un rapport de 1 à plus de 500.
De ce fait, l'écart avec l'Europe se creuse. Regarder le dynamisme de l'Afrique avec envie ne doit pas nous empêcher de voir les extraordinaires inégalités entre chacune des rives de la Méditerranée. En 2010, selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), le PIB par habitant atteignait un peu plus de 177 dollars au Burundi, alors qu'il dépassait 104 000 dollars au Luxembourg, un rapport de 1 à 587. Ces inégalités considérables sont relativement récentes au regard de l'Histoire. Il y a seulement 200 ans, l'Européen moyen n'était qu'environ trois fois plus riche que son homologue africain.
L'Afrique est encore le continent qui comprend 31 des 35 pays les plus pauvres de la planète.
L'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau et aux installations sanitaires reste toujours inégal, notamment pour les populations rurales.
Ces difficultés se traduisent par un retard du continent africain dans de nombreux domaines.
Une espérance de vie de 24 années inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE
L'espérance de vie à la naissance qui synthétise l'ensemble des progrès sanitaires nécessaires à l'allongement de la vie illustre les progrès effectués, mais aussi leurs limites. Elle progresse de 47,5 ans en 1980, à 52,7 ans en 1990 et 56 ans en 2010, mais cela reste 24 années de moins que la moyenne des pays de l'OCDE.
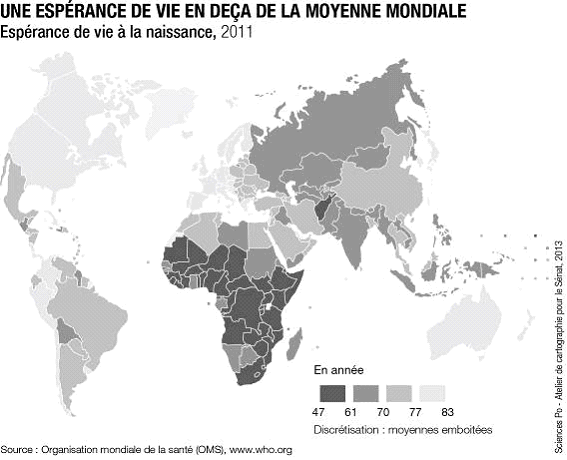
Au-delà de la pauvreté, ce sont les inégalités qui sont en train de devenir un enjeu important pour la stabilité des pays d'Afrique noire, comme cela a été le cas au Maghreb.
Alors que les niveaux de pauvreté en Afrique subsaharienne se sont réduits de près de 10 points de pourcentage dans les deux dernières décennies, l'écart entre le PIB national par habitant le plus faible et le PIB national par habitant le plus élevé est passé de 1 à 43 en 1990, à 1 à 88 en 2009.
Ces inégalités concernent tout autant les revenus que les conditions de vie et les aléas. Une couverture sociale couvrant l'ensemble des risques sociaux ne concerne qu'entre 5 et 10 % de la population en Afrique sub-saharienne contre 20 % en Asie, un tiers en Amérique Latine.
La plus grande inégalité est celle face à la mort.
Un enfant a 35 fois plus de risques de mourir avant l'âge de 5 ans en Afrique qu'en Europe.
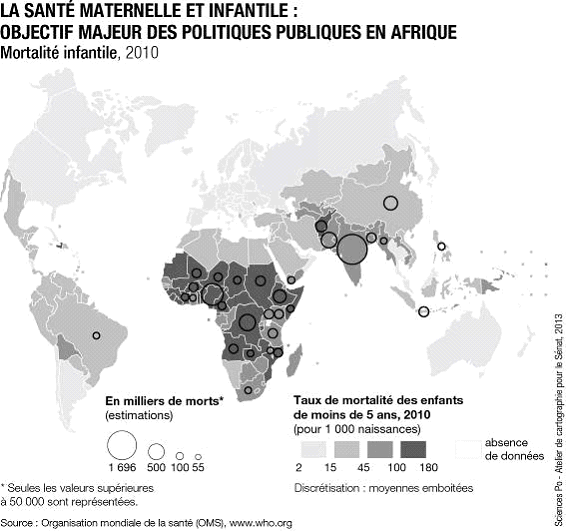
L'espoir est revenu. Il est vrai que l'Afrique au XXI e siècle est l'un des principaux réservoirs de croissance économique, la plus importante réserve de ressources naturelles, le plus grand marché en devenir. Il y a une Afrique qui décolle. Mais n'oublions pas que cette Afrique-là côtoie un continent de la misère et de l'inégalité, une Afrique sans eau courante, ni électricité, à l'agriculture soumise aux aléas du climat et des cours des matières premières, des territoires immenses qui, à l'image du Sahel, ont été désertés par des administrations impuissantes à en assurer le développement.
Le Mali, où nos militaires ont conduit de façon exemplaire une opération périlleuse, nous montre que le terrorisme prospère dans des pays que le développement a déserté, où les structures étatiques sont exsangues et la jeunesse désespérée, livrée au fanatisme et aux trafics de toutes sortes.
La lutte contre la pauvreté demeure donc une priorité africaine. Toutefois, celle-ci doit être considérée dans un nouveau contexte. Elle passe nécessairement par son pendant : le défi de la création d'emplois. Les Printemps arabes nous l'ont montré : la stabilité socioéconomique africaine dépendra de la capacité des États africains à créer un marché du travail capable d'accueillir les millions d'Africains supplémentaires qui devraient chercher un emploi au cours des quinze prochaines années. Il faut le répéter : il ne s'agit pas là de projections puisque ces personnes sont déjà nées. Dégager des emplois sera impossible sans parvenir à une diversification des structures productives et à une modernisation des secteurs de production existants.
La lutte contre la pauvreté passera en Afrique également par des politiques urbaines. L'urbanisation africaine, la plus rapide que le monde ait connu, rattrape les taux mondiaux : 35 % des Africains vivent aujourd'hui dans les villes, ils seront plus d'un sur deux en 2030. Or, les villes africaines comptent déjà aujourd'hui un nombre d'habitants vivant dans les bidonvilles très supérieur à celui des autres villes du monde (+ 40 %). Sans politiques volontaristes pour accompagner l'expansion des villes, en renforcer la gouvernance, la planifier, répondre au manque de logement, de réseaux d'assainissement et de transports publics, l'explosion urbaine ne sera pas sans porter de nouveaux risques sanitaires, sociaux comme politiques, et bien sûr environnementaux.
Lutter contre la pauvreté d'une façon qui ne mette pas en danger les écosystèmes locaux tout en participant, dans la mesure du possible, à l'effort global d'utilisation sobre des ressources représente à la fois la frontière et la condition d'un développement durable africain.
2. Une indispensable industrialisation
La croissance remarquable de cette dernière décennie en Afrique ne s'est pas traduite par la diversification économique, ni par la création d'emplois en nombre conséquent.
Ben Turok, figure éminente du « Congress of Democrats », militant syndicaliste et intellectuel, député de l'ANC, figure historique de la lutte contre l'apartheid et symbole de l'opposition blanche au système de l'apartheid, nous l'a dit avec véhémence : « La plupart des économies africaines restent encore largement tributaires de la production et de l'exportation des produits de base, avec très peu de création de valeur ajoutée et peu de liens en amont et en aval avec les autres secteurs de l'économie ».
En partance pour la sixième édition de la conférence commune des ministres africains des Finances, du Planning et du Développement économique consacrée à l'industrialisation du continent, il nous a dit : « L'heure du made in Africa a sonné, l'industrialisation doit être au service de l'émergence de l'Afrique, le besoin des entreprises africaines de « transfert de technologie » et de formation est immense, la France peut participer aux transformations du continent, rejoindre le nouveau monde en investissant en Afrique ».
Force est de constater que les sérieux déficits de capacité des États et des institutions, d'infrastructures physiques et politiques ainsi que l'incapacité d'amortir les incidences des chocs extérieurs ont contribué à ce qu'il est convenu d'appeler « le défi de la transformation » du continent.
Le défi majeur qui se pose aux pays africains est de savoir comment concevoir et mettre en application des politiques efficaces pour promouvoir l'industrialisation et la transformation économique.
En dépit de quelques progrès accomplis dans le secteur manufacturier au cours des dix ans passés, le continent n'est pas encore parvenu à inverser la tendance à la désindustrialisation qui a caractérisé son changement structurel : entre 1980 et 2010, la part du secteur manufacturier dans la production totale s'est rétrécie revenant de plus de 12 % à environ 11 %, alors qu'elle est demeurée à plus de 31 % en Asie de l'Est, où les industries à forte intensité de main-d'oeuvre ont induit une croissance forte et soutenue et permis de sortir des millions de citoyens de la pauvreté.
L'Afrique accuse également du retard par rapport à l'Asie de l'Est à d'autres égards. Cette région a affiché non seulement un revenu par habitant en hausse, mais également une part croissante des exportations mondiales et des revenus au cours des quatre dernières décennies. Les politiques industrielles ont particulièrement connu du succès en Asie de l'Est en raison de l'engagement et de la vision des dirigeants et des institutions politiques qui ont mis au point et appliqué des critères stricts de performance pour les industries. Ces dernières ont bénéficié de subventions et de mesures protectionnistes, avec l'appui d'une administration publique compétente en grande partie à l'abri des pressions politiques.
Forts de richesses aussi abondantes et de la demande mondiale croissante de matières premières, les gouvernements africains établissent actuellement de nouveaux partenariats, s'emploient à accroître les investissements dans les infrastructures et à acquérir du savoir-faire et de la technologie.
Mais la production et l'exportation des matières premières à l'état brut conduit à un abandon de recettes énormes en l'absence de valeur ajoutée.
« Il n'est pas normal que 60 % de la valeur ajoutée sur le cacao soit produite hors d'Afrique » nous a dit M. Gnamien Guillaume, directeur de cabinet du ministre de l'industrie de Côte d'Ivoire.
« Plutôt que de compter sur les exportations de matières premières, le continent devrait ajouter de la valeur à ses produits de base afin de promouvoir une croissance soutenue, la création d'emplois et la transformation économique ».
La création de valeur ajoutée aiderait les pays africains à réduire leur exposition au risque de fluctuations des cours de ces produits et, dans le même temps, à passer à des produits à plus forte valeur et plus diversifiés, à des marchés finaux sur lesquels les prix dépendent plus des fondamentaux du marché que de la spéculation.
Certains pays réussissent à réaliser des progrès substantiels au plan local à partir des secteurs des produits de base non renouvelables, énergétiques ou agricoles.
En Éthiopie, nous avons été surpris de constater l'implantation d'usines chinoise de chaussures fonctionnant avec de la main-d'oeuvre locale et du cuir local. En 2012, une fabrique de chaussures du groupe Huajian a vu le jour dans la ville de Dukem, à 30 kilomètres d'Addis-Abeba. L'entreprise, qui compte Calvin Klein parmi ses clients, emploie déjà près de 600 salariés, dont la moitié sont éthiopiens. En bonne marche, elle exporte 20 000 paires de chaussures par mois. Huajian ne cache pas ses ambitions puisqu'il prévoit d'investir 1,5 milliard d'euros dans son site africain. Et ce n'est que le début. Engagés dans un partenariat public-privé, le gouvernement éthiopien et des investisseurs chinois construisent une zone industrielle entière. A terme, 80 usines et 20 000 emplois pourraient être créés. Cette plate-forme de production et d'exportation sera prête à inonder le marché local d'ici à 2014.
Au Ghana, Cadbury a investi les capitaux de lancement d'un montant de 2 millions de dollars en 2008 afin dans de petites communautés agricoles au Ghana, qui fournit les fèves de cacao pour le chocolat à Cadbury Royaume-Uni, y compris Cadbury Dairy Milk, Wispa, Flake, Creme Egg et Buttons.
Mais la création de valeur ajoutée est encore limitée et la profondeur des liens varie d'un pays à l'autre, essentiellement en raison de contraintes propres à chaque pays ou industrie qui ne peuvent être surmontées par les forces du marché et nécessitent des politiques stratégiques et systématiques d'industrialisation. Même aujourd'hui, 90 % du revenu total tiré du café va aux pays consommateurs riches -- ce qui souligne les avantages dont les pays africains se privent actuellement.
3. Le défi agro-alimentaire à l'épreuve de l'accaparement des terres
Pour assurer son indépendance alimentaire, une Afrique à deux milliards d'habitants devra multiplier par cinq sa production.
Déjà aujourd'hui, une partie de la population souffre de malnutrition qui reste, à l'échelle de la planète, un mal essentiellement africain, comme l'illustre la carte ci-après. En 2011, la sécheresse qui a sévi dans la Corne de l'Afrique, menaçant près de 12 millions de personnes du Kenya à la Somalie, en passant par Djibouti et l'Éthiopie, a montré que l'Afrique pouvait encore être sujette aux famines.
Nous avons constaté sur place que l'Ethiopie s'est engagée, avec les pays voisins et avec le concours des bailleurs de fonds, dans une politique volontariste de prévention des crises alimentaires et de résilience à la sécheresse, avec notamment la construction de silos à grains et le soutien à l'économie pastorale en régions Afar et Somali.
La France participe à cet effort comme elle participe à « Alliance Globale pour résoudre la crise alimentaire », dont l'un des objectifs est de faire le meilleur usage de la terre en Afrique et donc d'améliorer les droits fonciers.
Toutefois, à long terme, la sécurité alimentaire du continent ne pourra venir que d'une transformation importante des méthodes agricoles. « L'Afrique a urgemment besoin d'une révolution verte » nous a dit Jean-Marc Châtaigner, directeur général adjoint de la mondialisation, du développement et des partenariats.
Paradoxalement, l'Afrique, où 70 % de la population vit encore de l'agriculture et qui dispose d'un potentiel agricole considérable, importe encore 20 milliards de dollars de denrée agricole par an.
Selon M. Serge Michailof, ancien directeur régional à la Banque mondiale : « Le modèle fondé sur l'alimentation des centres urbains par les importations va se gripper » , « les responsables africains ne peuvent plus faire confiance aux marchés mondiaux pour garantir durablement à l'avenir la sécurité alimentaire du continent » 23 ( * )
Seule une révolution verte permettra cela. Aujourd'hui les surfaces cultivées en Afrique ne représentent que 28 % des surfaces cultivables.
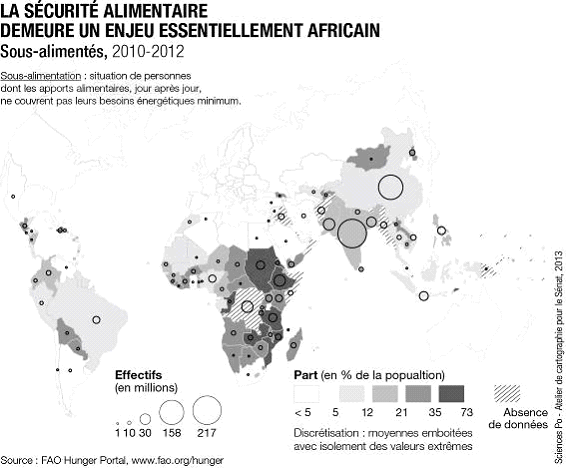
Aujourd'hui, les surfaces cultivées en Afrique ne représentent que 28 % des surfaces cultivables. L'avenir de l'agriculture africaine résidera donc dans l'extension, mais aussi et surtout dans l'augmentation de la productivité qui, aujourd'hui, est 200 fois inférieure à celle de l'Europe.
Selon M. Serge Tomasi, directeur-adjoint de la direction de la coopération pour le développement à l'OCDE : « l'augmentation de la production agricole proviendra pour 2/3 de gains de productivité et pour 1/3 de l'extension. C'est tout l'enjeu de la coopération en matière agricole, comment engager l'Afrique dans une révolution verte sur un modèle de développement durable ».
La marge de progression est élevée car les rendements agricoles africains restent inférieurs à ceux de la moyenne des pays en développement. Ainsi les rendements céréaliers demeurent à 1,2 tonne par hectare en Afrique contre 3 tonnes en moyenne dans les autres pays en développement.
L'enjeu est africain, mais pas seulement. Le monde devra doubler sa production agricole d'ici 2050 pour nourrir 9 milliards d'habitants. Avec 80 % des terres arables non cultivées du monde, l'Afrique peut devenir un des greniers de la planète. « C'est de l'or dans les mains de l'Afrique » nous a dit M. Carlos Lopes, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies.
Les pays émergents ne s'y trompent pas. Entre 2000 et 2010, 35 millions d'hectares ont été cédés à des entreprises des pays émergents. Le cas malgache est connu avec un contrat de 1,3 million d'hectares au Coréen Daweou.
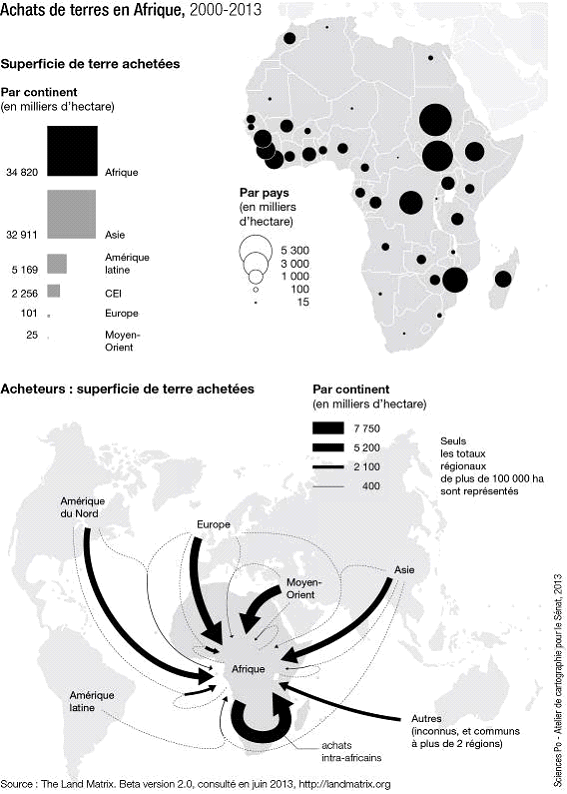
La pression croissante sur les terres agricoles risque de devenir un facteur de conflit croissant. On en a vu les résultats en Côte d'Ivoire où le nombre d'habitants par km 2 s'est accru de 500 % en 40 ans, au Rwanda ou au Kenya. Cette tension sur les terres s'accompagnera de tensions sur les ressources naturelles en eau, en bois, et en pâturages.
Ces risques seront d'autant plus élevés que l'agriculture africaine recèle un énorme potentiel pour les entreprises opérant à tous les maillons de la chaîne de valeur.
Les obstacles à une augmentation de la production agricole africaine sont bien connus et les surmonter ne sera pas chose aisée : manque de semences sophistiquées et d'autres intrants adaptés aux conditions écologiques du continent, infrastructures inadaptées pour commercialiser les récoltes, effets pervers des barrières douanières et des aides fiscales, manque d'assistance technique et de financements pour les agriculteurs.
Mais si le continent noir parvenait à lever ces entraves dans ce sens, le potentiel du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique pourrait se chiffrer à 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale. Comment ? En s'assurant que les acteurs concernés aient davantage accès aux capitaux, mais aussi à l'électricité, à de meilleures technologies et à l'irrigation, afin de permettre la culture de produits alimentaires nutritifs et à forte valeur ajoutée. Une telle progression tirerait la demande de produits en amont (engrais, semences) tout en stimulant la croissance des activités de transformation en aval (raffinage des céréales, biocarburants).
Une telle évolution exigera des politiques adaptées.
L'Afrique est le principal importateur et le plus gros consommateur de riz, avec 3,5 milliards de dollars d'importations. En augmentant sa production de riz, le Sénégal peut contribuer à répondre à la demande locale, ce qui nécessite toutefois davantage de capitaux, une hausse des investissements dans l'irrigation ainsi qu'un assouplissement de l'accès au foncier.
Madame Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l'Union africaine, dans son grand bureau d'Addis Abeba nous l'a prédit : « L'amélioration des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Afrique induira une augmentation des revenus et la création d'emplois. Elle permettra aussi à l'Afrique d'être compétitive sur les marchés mondiaux. Demain l'Afrique nourrira le monde ».
4. Pour une gestion des industries extractives au service de tous
Ces dix dernières années ont vu non seulement un essor des activités d'investissement étranger dans le domaine des industries extractives, mais aussi une prolifération des acteurs. La gamme d'entreprises opérant dans le secteur de l'extraction en Afrique va des multinationales qui dominent le pétrole et l'exploitation minière au niveau mondial aux acteurs régionaux plus petits et plus spécialisés. Les compagnies chinoises publiques et privées jouent un rôle de plus en plus important, tout comme les entreprises venant d'autres marchés émergents. Bon nombre des investisseurs étrangers présents en Afrique se plient aux meilleures pratiques internationales, souvent dans un contexte d'activité difficile.
Toutefois de nombreux rapports soulignent combien les bénéfices de ces industries sont inégalement répartis. Le dernier en date, du Africa Progress Panel (APP) présidé par M. Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies et prix Nobel de la paix, souligne les défis auxquels sont confrontés les pouvoirs publics pour mettre en place une gestion efficace et équitable des ressources naturelles de l'Afrique qui serait à même de transformer le continent.
Le premier concerne la structure de l'activité d'investissement. Les entreprises étrangères présentes en Afrique recourent massivement aux sociétés offshores et aux juridictions à faible taux d'imposition. Dans certains cas, à travers leurs activités d'investissement, les multinationales sont également liées à des réseaux complexes de sociétés fictives. Ces configurations s'accompagnent de divulgations publiques pour le moins sommaires et de vastes possibilités d'évasion fiscale.
La deuxième source d'inquiétude réside dans les interactions entre l'activité des investisseurs étrangers et les marchés locaux. Les industries extractives fonctionnent généralement comme des enclaves à faible valeur ajoutée, qui ont peu de liens avec les entreprises locales et les marchés de l'emploi. Sur plus d'une décennie de boom des matières premières, l'Afrique continue d'exporter majoritairement des matières premières brutes et d'importer des biens de consommation et des produits agricoles de base
L'Africa Progress Panel souligne ainsi qu'une mauvaise gouvernance des entreprises publiques et des actifs est associée à des pertes de revenus importantes. « En 2012, l'Angola a été incapable d'expliquer la présence de « résidus financiers » à hauteur de 4,2 milliards de dollars, essentiellement de l'argent manquant, dans les comptes de la compagnie pétrolière d'État. Le Nigéria aurait perdu quant à lui 6,8 milliards de dollars entre 2010 et 2012 ». Des pertes de revenus de cette ampleur peuvent nuire considérablement aux finances publiques et aux efforts des pays pour réduire la pauvreté.
Les accords de négoce de concessions sont souvent associés à une sous-évaluation des actifs. Aucun pays n'a perdu autant à cause de cette pratique que la République démocratique du Congo. Le rapport contient une analyse détaillée de cinq contrats de privatisation à travers la vente d'actifs publics à des investisseurs étrangers opérant par l'intermédiaire de sociétés offshore enregistrées aux Îles Vierges britanniques et dans d'autres juridictions. Il estime la totalité des pertes encourues dans ces contrats en raison d'une sous-évaluation des actifs à 1,3 milliard de dollars, soit plus du double du budget total dépensé pour la santé et l'éducation. Dans un pays où 7 millions d'enfants sont déscolarisés, avec le sixième taux de mortalité infantile le plus élevé au monde et une malnutrition endémique, des pertes de cet ordre ont un coût humain considérable
5. Des infrastructures nécessaires
Si la condition de la lutte contre la pauvreté est le niveau de croissance économique, ce dernier apparaît aujourd'hui bridé par le manque d'infrastructures. Certains rapports estiment que la médiocrité des infrastructures est la principale contrainte à l'activité économique et la responsable d'une perte de productivité d'environ 40%.
Pour la Banque africaine de développement le diagnostic est clair : « Les économies africaines sont peu compétitives, en raison du manque d'infrastructures, de compétences, d'institutions et de technologies. Le mauvais état des infrastructures conduit à des coupures de courant, à des problèmes de communication et à des retards sur le plan logistique qui entraînent une augmentation sensible des coûts supportés par les entreprises africaines. Dans certains pays, l'énergie représente 6 % du coût total des entreprises, chiffre six fois plus élevé que dans les économies émergentes telles que la Chine. ».
Le continent noir manque cruellement d'électricité. C'est le continent le moins électrifié au monde, avec une consommation qui s'élève à seulement 3% de la consommation mondiale et une capacité de production électrique équivalente à la production espagnole qui dessert 45 millions d'habitants.
Le quart de cette production est indisponible, en raison de la vétusté des centrales et du manque de maintenance du réseau. Répondre aux besoins électriques de l'Afrique exigerait, selon nos interlocuteurs, 40 milliards de dollars d'investissement tous les ans pendant 20 ans, soit quatre fois plus que la somme actuelle.
En moyenne, 20 % de la population dispose de l'électricité courante.
L'Afrique aborde sa phase de développement rapide avec une production électrique la plus chère et la plus polluante puisque composée à 80 % d'énergie fossile. « Il n'y a cependant pas de fatalité » nous a dit Jean-Marc Châtaigner, Directeur général adjoint de la Mondialisation, du développement et des partenariats auprès du ministère des Affaires étrangères, « la production d'électricité par personne était en Chine et en Inde inférieure à celle de l'Afrique subsaharienne à la fin des années 1960, ce qui n'a pas empêché le décollage de ces deux pays. »
L'Afrique ne mobilise que 10 % de son potentiel hydroélectrique. 90 % des sites sont à cheval sur plusieurs pays. Certains États sont pilotes comme le Ghana à 100 % hydraulique. Le potentiel géothermique de l'Afrique est lui aussi considérable dans la vallée du Rift.
Le coût du transport à l'intérieur des pays est au moins le double des coûts similaires en Asie et en Amérique latine. En conséquence, les entreprises africaines de moindre envergure sont incapables se soutenir la concurrence sur la scène internationale. La capacité des infrastructures portuaires souvent très en deçà des besoins (les ports de Bissau, San Pedro en Côte d'Ivoire ou de celui de Dakar au Sénégal, par exemple, reçoivent aujourd'hui environ 30 000 conteneurs par an alors qu'ils ont été initialement construits pour en recevoir 5 000).
L'insuffisance d'infrastructures prive chaque année l'Afrique subsaharienne de deux points de croissance.
Le manque de routes est patent. L'Afrique subsaharienne compte 204 km de routes par millier de kilomètres carrés, alors que la moyenne mondiale est de 944 km par millier de kilomètres carrés. Les voies de chemins de fer sont obsolètes. De ce fait les connexions sont difficiles entre les lieux de production et les marchés de consommation. Le mauvais état des infrastructures explique le coût élevé des échanges que l'Afrique, et en particulier les pays africains enclavés, subit par rapport aux autres régions. Le mauvais état des infrastructures représente 40 % des coûts de transport pour les pays côtiers et 60 % pour les pays enclavés. Cette situation explique que le commerce intra africain ne représente de fait qu'environ 10 % à 20 % des exportations totales des pays.
Au total, la Banque mondiale estime que l'insuffisance d'infrastructures, notamment de transports routiers, de télécommunications et d'électricité, prive chaque année l'Afrique subsaharienne de deux points de croissance. Mais comme l'a observé devant le groupe de travail Jean-Marc Châtaigner, Directeur général adjoint de la Mondialisation, du développement et des partenariats auprès du ministère des Affaires étrangères: « Il n'y a pas là de fatalité : la production d'électricité par personne était en Chine et en Inde inférieure à celle de l'Afrique Subsaharienne à la fin des années 1960, ce qui n'a pas empêché le décollage de ces deux pays. »
Actuellement, gouvernements africains et acteurs privés investissent au total 72 milliards de dollars par an dans de nouvelles infrastructures sur le continent.
Les besoins sont toutefois encore loin d'être intégralement couverts, en particulier en matière d'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que de transports, qui nécessiteront au moins 46 milliards de dollars de dépenses supplémentaires par an.
Un objectif atteignable à la faveur d'un accroissement des dépenses des gouvernements, des entreprises privées et des investisseurs, ainsi que de réformes réglementaires qui viseraient à accroître sensiblement l'efficience opérationnelle de ces infrastructures.
L'ensemble des bailleurs de fonds y participe au premier chef desquels la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne via le FED. La France y apporte sa contribution à travers sa participation aux financements de ces institutions, mais également directement à travers son aide bilatérale.
Dans le domaine énergétique, par exemple, la France concentre ses activités autour deux axes d'intervention : le renforcement de l'intégration énergétique régionale et la promotion des énergies renouvelables.
Plusieurs projets de lignes de transport et d'interconnexions électriques programmés dans le cadre du pool énergétique d'Afrique de l'Ouest (WAPP) et différents projets d'infrastructures d'énergies renouvelables ont été financés par l'AFD au cours de ces dernières années (plus de 200 millions d'euros pour le financement de l'interconnexion électrique entre le Ghana et le Burkina Faso).
Le Ministère des Affaires étrangères a par ailleurs apporté un important soutien au développement de politiques d'accès à l'énergie : financement d'un livre blanc sur une politique régionale relative à l'accès aux services énergétiques, et la mise en place du projet pour la promotion de l'accès à l'énergie dans les stratégies et programmes nationaux (MEPRED).
La France participe également au développement de l'énergie verte en Afrique de l'Est.
Principal bailleur du secteur énergétique au
Kenya, l'AFD apporte depuis plusieurs années un soutien important
à la valorisation de la géothermie avec plus de 230 millions
d'euros de financements apportés pour le développement du
potentiel géothermique du site d'Olkaria. D'autres projets de
développement de la géothermie sont à l'étude dans
la sous-région (Rwanda, Ouganda). La coopération française
travaille par ailleurs sur de nouveaux mécanismes de financement des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique, en partenariat avec des
banques commerciales.
B. CONFORTER LES CONDITIONS POLITIQUES DU DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE
1. Défragmenter le continent, renforcer l'intégration régionale
Barthélémy Boganda, père de l'indépendance centrafricaine, connu pour ses desseins panafricains, disait que « les poussières d'États ne peuvent rien contre les grands ensembles qui se construisent ». L'intégration africaine était, dans les années 1960, l'un des plus grands projets des pays africains.
Ce devait être la réponse de l'Afrique aux grands ensembles qui se construisaient. Ce qu'on appelle les pères de l'indépendance, les Senghor, les Houphouët, les Modibo Keita, les Kwame Nkrumah rêvaient, en fondant l'organisation africaine en mai 1963, d'un continent uni, d'une Afrique qui parle d'une même voix, d'une organisation qui devait à la fois assurer la paix et le respect des frontières héritées de la période coloniale, garantir la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures.
Des idées louables qui devaient obtenir l'adhésion de la trentaine de chefs d'État réunis à Addis-Abeba pour créer la charte de l'0rganisation de l'unité africaine (OUA). L'unité africaine, quelle belle idée ! Tout le continent en a été séduit, il l'est encore. 50 ans après, elle est encore dans tous les esprits, dans tous les discours.
Mais où en est l'intégration du continent africain, quel progrès dans l'unité du continent ? Malgré la transformation de l'Union africaine en 2004, le chantier avance lentement. Mais il avance. Il constitue un défi majeur d'abord pour traiter des sujets qui doivent recevoir une réponse au niveau régional ou continental, ensuite pour défendre les intérêts de l'Afrique face à ses partenaires, qu'il s'agisse des négociations climatiques ou commerciales, des enjeux de sécurité ou de sa représentation au sein des instances multilatérales.
D'un point de vue institutionnel, l'anniversaire des 50 ans de l`Union Africaine a permis de faire un bilan contrasté mais positif d'une organisation jeune et ambitieuse.
L'Union Africaine est en effet une organisation particulièrement jeune : si l'OUA/UA a fêté le 25 mai 2013 son cinquantenaire, l'UA en tant que telle n'a que 10 ans et ses institutions actuelles ont été mises en place en 2003 au Sommet de Maputo.
Quand on connaît l'extrême diversité culturelle et ethnique de l'Afrique, les très fortes inégalités qui parcourent un continent aussi vaste, on peut se demander si le panafricanisme n'est pas un projet démesuré.
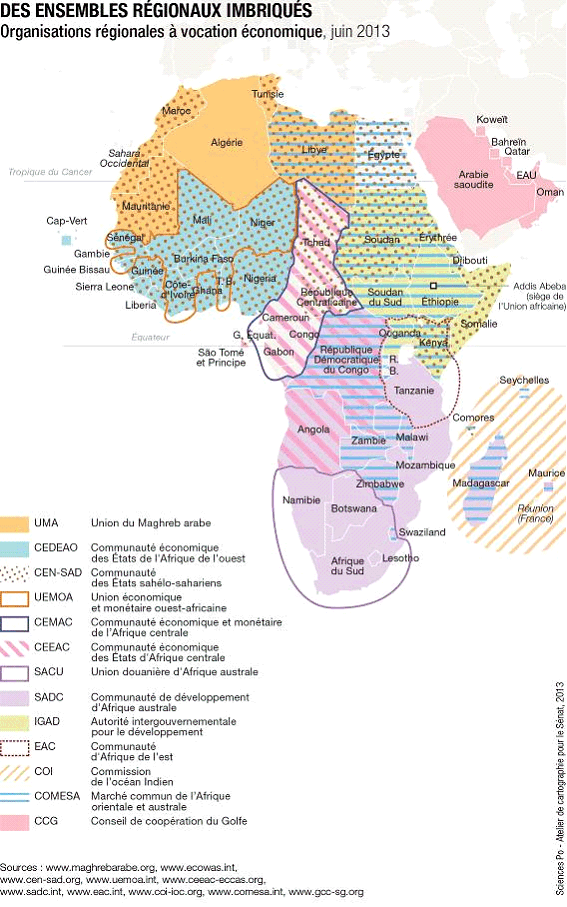
On peut se demander si les pères de l'indépendance n'avaient pas surévalué leur capacité à unir un continent aussi vaste, aussi divers, où les États si récents sont encore en construction.
L'institution compte 54 États-membres, soit deux fois plus que l'Union européenne, répartis sur 970 millions de km 2 , peuplés de près d'un milliard d'habitants et parcourus par une grande diversité régionale (huit Communautés économiques régionales (CER) reconnues, toutes préexistantes à l'UA, dont la doyenne, la CEDEAO, fondée en 1975. Et pourtant, l'Union africaine est parvenue à s'affirmer comme un partenaire incontournable sur les questions de paix et de sécurité en Afrique.
Son ambition est contrariée par son manque de moyens et son extrême dépendance financière à l'égard des partenaires, en particulier l'Union européenne. Son articulation avec les Nations unies et les communautés économiques régionales africaines, tout en s'améliorant, reste source de friction.
Parallèlement, depuis vingt ans, les progrès de la mondialisation, l'intégration des marchés des biens et services, et les télécommunications ont cependant beaucoup fait pour l'unité du continent. Cette intégration par le bas a sans doute fait plus de progrès que la construction politique du continent.
Aujourd'hui, cette unification du continent bute sur le cadre des États à un moment même où nombre de questions se posent à un niveau régional ou continental.
Nous l'avons vu dans le domaine militaire, mais c'est particulièrement frappant dans le domaine commercial.
D'emblée, Fatima Haram Acyl, commissaire tchadienne au Commerce et Industrie de l'Union africaine, nous a déclaré que « la croissance africaine est bridée par la fragmentation du continent. L'Afrique compte plus d'États que tout autre continent. Ses marchés étroits, fragmentés, n'offrent pas d'économies d'échelle. Les échanges intra-africains sont peu développés, avec seulement 12 % du commerce total du continent » .
Pour M. Patrick Guillaumont, président de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), responsable du rapport d'évaluation des gains attendus de l'intégration économique régionale dans les pays africains de la Zone franc, rendu par la Ferdi en octobre 2012 aux ministres de la Zone franc, les bénéfices que l'on peut attendre de l'intégration régionale en termes d'accroissement des échanges et de sécurité sont nombreux et pourraient se traduire par deux ou trois points de croissance supplémentaires.
Or aujourd'hui, cette fragmentation des marchés, qui tient tout autant à l'absence d'infrastructures qu'au maintien de barrières douanières et administratives, freine l'expansion du commerce et de l'investissement à l'échelle continentale.
Si le record de la traversée du continent du Nord au Sud, établi en 1963 par Eric Jackson et Ken Chambers en Ford Cortina, a tenu jusque dans les années 2000 c'est que les grands espaces coloniaux ont laissé place à un continent fragmenté où l'absence d'infrastructures et les tracasseries bureaucratiques aux frontières nuisent plus que jamais à la fluidité des échanges, à telle enseigne que les Africains regardent la construction européenne avec envie et souhaitent pouvoir bénéficier de notre savoir-faire dans la construction d'un espace commun.
Hors Zone franc, l'action des multiples organisations régionales couvrant le continent (Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (COMESA), Communauté du développement de l'Afrique australe (SADC)), est freinée par des chevauchements de compétences mal coordonnées. Ces initiatives ne disposent généralement que de peu de moyens juridiques et financiers, alors que la volonté d'intégration de leurs Etats-membres fait souvent défaut.
L'intégration fiscale et commerciale reste également à développer pour compenser les effets négatifs des barrières structurelles qui freinent l'investissement en Afrique (en particulier le coût élevé des facteurs, l'incertitude juridique et l'absence de protection des droits de propriété). En matière de cadre juridique des affaires, l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des affaires en Afrique (OHADA) regroupe pour le moment un nombre insuffisant de pays, avec seulement 17 pays membres, situés principalement en Zone Franc. Seule celle-ci et ses deux ensembles sous-régionaux que sont l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) offrent le cadre d'une certaine intégration économique régionale, incarnée par une monnaie unique - le franc CFA.
Un rapport de la Banque mondiale publié en avril 2012 s'intitulait : « La défragmentation de l'Afrique. Approfondissement de l'intégration du commerce régional et des services ». II pointe les obstacles au développement du commerce intra-régional et, notamment l'importance des coûts de transaction, des entraves non tarifaires.
Pour les autorités de la Banque mondiale, il n'est pas étonnant que le commerce avec des pays en dehors du continent soit plus développé que le commerce intra-régional.
Et en effet, la part dans les importations du commerce intra-régional est de 5 % pour la COMESA, de 10 % pour la CEDEAO et de 8 % pour l'UMEAO, contre 20 % pour I'ANASE, 35 % pour I'ALENA et 60 % pour l'UE.
La part du commerce international des pays africains qui s'effectue avec un autre pays africain n'est que de 12 %.
Selon le dernier rapport Doing Business, certaines interfaces sont de véritables goulets d'étranglement (Kinshasa-Brazzaville). Un des indicateurs de ces obstacles à l'échange est ce qu'il est convenu de qualifier de « temps d'attente à la frontière », qui se calcule sur la base du nombre de documents douaniers multiplié par le nombre de signatures requises et le temps de franchissement des postes frontières. Il est de 35 jours à l'export en Afrique sub-saharienne et de 41 jours à l'importation, contre 10 jours en moyenne dans les pays développés, avec un coût double de celui enregistré en Asie de l'Est et dans les pays de l'OCDE.
Ces contraintes pèsent particulièrement sur les pays enclavés qui dépendent du bon fonctionnement des grands corridors internationaux, qui assurent environ 70 % de leur commerce international. 40 % des Africains vivent dans des pays enclavés. Ces pays figurent parmi les économies les moins performantes au monde, et il existe entre eux et leurs voisins côtiers un retard de développement considérable.
Un quart des retards observés le long des grands corridors serait dû aux carences des infrastructures, le reste tenant aux obstacles non tarifaires et à l'insuffisance des mesures de facilitation du commerce.
Comme nous l'a dit l'ambassadeur Tebogo SEOKOLO, directeur Europe, du ministère des affaires étrangères en Afrique du Sud, « les frontières sont plus bureaucratiques que physiques, le problème tient plus aux douanes qu'aux routes ».
Voilà pourquoi la promotion de l'intégration économique de l'Afrique, en vue de créer des marchés plus vastes et plus attrayants, de relier les pays enclavés, notamment les États fragiles, aux marchés internationaux et d'appuyer le commerce intra-africain, doit être une priorité des années à venir.
2. Conforter le cadre politique des Etats et leur légitimité
Nombreux sont les pays africains qui ont réalisé des progrès remarquables au cours des deux dernières décennies. Toutefois, certains sont parvenus non seulement à augmenter de manière notable le revenu national, mais aussi à améliorer la situation sociale dans le domaine de la santé et l'éducation.
Dans la plupart de ces pays, le développement a été soutenu par un État proactif en matière de développement.
Comme l'a souligné M. Serge Tomasi, directeur adjoint de la direction de la coopération pour le développement à l'OCDE, « un État fort, dynamique et responsable qui élabore des politiques pour les secteurs public et privé, fondées sur une vision et un leadership à long terme, des normes et des valeurs partagées et des lois et des institutions qui favorisent la confiance et la cohésion » semble être une des clef de la réussite.
Pour parvenir à une transformation durable, les pays doivent adopter une approche du développement cohérente et équilibrée. Ceux qui ont réussi à stimuler et à soutenir leur croissance, en termes de revenu et de développement humain, n'ont pourtant pas suivi une recette unique. Quand on regarde l'évolution du Ghana, du Rwanda, du Botswana, qui se sont illustrés dans de nombreux domaines, on observe que, confrontés à différents défis, ils ont adopté des politiques diverses relatives à la réglementation du marché, la promotion des exportations, le développement industriel et les progrès technologiques.
Les gouvernements peuvent soutenir des industries qui, à cause de marchés incomplets, n'auraient aucune chance d'émerger autrement. Cette situation risque de favoriser la recherche de rentes et le « copinage », mais elle a néanmoins permis à plusieurs pays du Sud de transformer des industries inefficaces en premiers moteurs d'exportation, alors que leurs économies devenaient plus ouvertes.
Or, quand on regarde les pays africains en difficulté, on pense notamment au Mali ou à la Centrafrique, on ne peut être que frappé par la faiblesse des capacités institutionnelles et les difficultés à mener de véritables politiques publiques suivies dans le temps et coordonnées sur l'ensemble du territoire national.
M. Maurice Enguéléguélé, Coordonnateur des Programmes IAG (Institut africain de la gouvernance) nous a dressé un tableau de la gouvernance en Afrique qui témoigne des avancées mais aussi de nombreux défis qui attendent les pays africains dans la constitution d'États modernes.
Les problèmes ne sont pas seulement techniques, financiers et ne relèvent pas seulement d'un manque de formation des élites administratives, ils sont d'abord politiques. Comme la souligné M. Bertrand Badie, « c'est le contrat social entre les citoyens et l'Etat qui fait souvent défaut ».
Force est de constater que la volonté de vivre ensemble au-delà des différences ethniques, religieuses ou claniques fait souvent défaut, ce qui empêche la définition d'un intérêt général qui, à son tour, légitimerait un État impartial menant des politiques publiques au nom de cet intérêt général.
L'exemple ivoirien est frappant à cet égard. Fin 2010, les Ivoiriens s'apprêtaient à aller aux urnes pour élire leur président. Après une décennie de tensions sociales, de coups d'État et d'instabilité politique, ce pays d'Afrique de l'Ouest, autrefois considéré comme l'un des plus stables et prospères du continent, semblait sur le point de passer un cap. De l'avis quasi général, l'élection se déroula de façon démocratique. On connaît la suite. La crise électorale plongea le pays dans six mois de troubles qui firent environ mille morts et 1 million de sans-abri et forcèrent quelque 80 000 personnes à trouver refuge aux frontières du Ghana et du Libéria. En 2011, l'économie ivoirienne s'est contractée de plus de 7 %.
Les troubles survenus en Côte d'Ivoire sont un exemple extrême. Les conflits ne sont cependant qu'un aspect d'une question beaucoup plus vaste : la capacité d'un pays à se gouverner de façon respectueuse et transparente, tout en rendant compte de ses actes, la capacité à créer un espace public où tous les citoyens, quelle que soit leur origine, peuvent contribuer aux décisions qui détermineront l'avenir de leur pays.
De ce point de vue, M. Maurice Enguéléguélé a souligné que les progrès réalisés entre 2000 et 2011 en matière de résorption du déficit de gouvernance politique en Afrique sont mitigés.
Les pays africains continuent de progresser dans la voie de l'ouverture politique et les taux de participation électorale ainsi que la participation de la société civile à la vie politique ont connu une constante évolution. La situation n'est toutefois pas idyllique. Il reste à institutionnaliser la culture de la démocratie et à renforcer I'État de droit, étant donné que les vestiges de l'autoritarisme menacent les processus démocratiques, que la démocratie consensuelle n'est pas encore ancrée au sein de la classe politique et que des législations restreignant l'espace de participation politique de la société civile ont été adoptées dans plusieurs pays. De ce fait, les tensions, les conflits et les crises politiques sont constants dans plusieurs pays.
De manière générale :
- le multipartisme a fleuri dans les différents pays africains, mais sans véritable institutionnalisation ;
- les élections ont lieu plus régulièrement, mais elles restent entachées d'irrégularités dans certains pays.
Depuis 2000, plus d'une soixantaine de scrutins ont été organisés dans les pays d'Afrique. Pour la seule année 2011, six de ces scrutins se sont soldés par une alternance politique (Niger, Zambie, Guinée-Conakry, Cap-Vert, Côte-d'Ivoire, Tunisie). Le cycle électoral pour l'année 2012 prévoit 20 élections (présidentielles -y compris celle anticipée en Guinée-Bissau- législatives, locales) sur le continent.
La qualité des élections demeure toutefois suspecte dans de nombreux pays où elles sont bien souvent une source de tensions, violences et conflits, en raison de l'imprécision du cadre législatif électoral, de la faiblesse ou de la partialité des organes de gestion des élections ou des contestations des résultats - comme cela a été le cas au Kenya, au Zimbabwe, en Côte d'Ivoire ou au Liberia.
La question de la légitimité des pouvoirs face à leur légalité s'est posée de manière accrue. Les acteurs africains se sont interrogés de manière récurrente sur la façon dont les sociétés peuvent se reconnaître dans leurs élus plutôt que dans la seule légalité des modalités de leur accès au pouvoir dans des contextes généralisés de pluralisme juridique.
La liberté de presse a progressé mais reste encore précaire -y compris dans les pays qui sont réputés pour le dynamisme et la ténacité de leurs médias, comme l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya ou le Sénégal.
Bien que la décentralisation et le développement local aient connu de notables avancées institutionnelles dans la plupart des pays africains entre 2000 et 2011, la tendance générale reste celle d'une concentration des pouvoirs de décision et des ressources au niveau central. Les collectivités et autorités locales ne jouent pas encore pleinement leur rôle d'agents du changement participatif, légitimes et de proximité pour une gouvernance de développement effective dans la mesure où elles n'ont pas bénéficié de transferts réels des moyens financiers. Cette situation est paradoxale, car le niveau local reste le lieu essentiel pour refonder la démocratie et l'État en Afrique en raison de sa proximité du citoyen et de la confiance que ce dernier doit avoir dans ses représentants.
Le facteur ethnique est resté une donnée importante dans la vie politique de plusieurs pays africains. La gestion de la diversité et le renforcement des identités nationales sont des problèmes. L'accession pacifique du Sud-Soudan à l'indépendance, le 9 juillet 2011, a ouvert la voie à un type de solution inédit depuis les indépendances en redessinant les frontières du Soudan.
La formule peut toutefois difficilement être reproduite dans d'autres pays sujets à des irrédentismes (Cameroun, Nigéria, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal, Somalie, Libye) et le principe de l'intangibilité des frontières hérité de la colonisation reste largement partagé.
La question de la reconstruction des États dans les situations de post-conflit continue d'occuper une place importante (Centrafrique, Côte d'lvoire, Liberia, Sierra Leone, ....), d'autant qu'elle est liée avec celles des processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) et de la réforme du secteur de la sécurité (RSS).
Plus généralement, il faut souligner, pendant la décennie écoulée, la faiblesse généralisée des institutions démocratiques (parlements, justice, autorités de contrôle et/ou de régulation ainsi que de suivi/évaluation de la gestion des crédits publics et de la mise en oeuvre des politiques de développement), celle de la qualité du service public et des fonctions publiques, celle de l'apport de la décentralisation et la gouvernance locale dans la prestation effective de services aux populations.
La question de la corruption reste un problème central en Afrique subsaharienne même si ce continent est loin d'en avoir le monopole. L'indice de « Control of Corruption de la Banque mondiale » comme les enquêtes de l'association Transparency international ou la Fondation Mo Ibrahim souligne cependant l'ampleur du phénomène en Afrique.
La corruption demeure un frein au développement du continent.
La Banque mondiale estime que 40 milliards de dollars sont détournés chaque année dans les pays en développement -l'équivalent d'environ 20 à 40 % de l'aide publique au développement. Selon l'Union africaine, les ressources gaspillées du fait de la corruption en Afrique atteindraient 25 % du PIB total du continent. Pour la Banque africaine de développement (BAD), ce fléau conduit à la perte d'environ 50 % des recettes fiscales annuelles et engendre une augmentation des prix proche de 25 %.
La Banque mondiale estime ainsi que les pays qui mèneraient une lutte efficace contre la corruption pourraient s'attendre, dans le moyen terme, à une augmentation très significative de leur PIB. La corruption a, par exemple, pour conséquence, dans certains pays, l'augmentation jusqu'à 30 % du prix de raccordement d'une maison à un réseau d'eau. Du fait des sommes qui manquent dans les caisses de l'État et de l'affaiblissement des structures institutionnelles, certaines dépenses vitales ne peuvent être satisfaites. Ainsi la corruption engendre d'insidieux ravages sur les systèmes sociaux. Elle peut aussi conduire à biaiser les choix économiques au détriment des projets les plus justifiés socialement.
Alors certes, comme l'ont souligné nombre d'interlocuteurs une croissance économique vigoureuse est compatible avec un niveau élevé de corruption « bénigne » ou du moins « stable » et dont les produits sont largement redistribués ou réinvestis dans le pays lui-même. Toutefois une bonne partie du produit de la corruption est réinvesti en dehors du continent africain comme en témoignent les affaires liées aux biens mal acquis. Pour Mo Ibrahim dont la fondation s'est fixée pour objectif de favoriser la bonne gouvernance : l'évasion fiscale coûte chaque année de 70 à 120 milliards de dollars au continent africain.
Or pour atteindre leurs objectifs, les pays africains devront continuer de développer leurs propres sources de financement : d'une part, les sources privées, d'autre part, les sources publiques, dont les emprunts émis par l'État, qui peuvent notamment servir à financer des infrastructures telles que les routes et les écoles.
La fiscalité apparaît, à cet égard, de plus en plus comme une des pierres angulaires du développement ainsi que la principale option dont disposent les pays en développement pour mobiliser leurs ressources internes afin de bâtir leur avenir et réduire leur dépendance à l'égard de l'aide.
Ainsi Lionel Zinsou, président de PAIpartners, société d'investissement, nous a fait observer qu' au Bénin, il n'y avait au moment de l'indépendance qu'un seul hôpital public et seuls 400 000 enfants étaient scolarisés. Ils sont quatre millions aujourd'hui. Il a donc fallu construire les fonctions régaliennes. Or le pays est sous-équipé en moyens pour assurer les recettes publiques : l'Afrique souffre de la faiblesse de son système fiscal »
L'Afrique souffre de la faiblesse de son système fiscal.
C'est là un défi d'autant plus grand pour les pays africains que les recettes fiscales y sont proportionnellement beaucoup plus faibles que dans la zone OCDE : dans la moitié des pays d'Afrique subsaharienne, elles représentent moins de 15 % du PIB, contre 35 % environ dans les pays de l'OCDE. La fiscalité tend également à avoir une base plus étroite : dans une grande partie de l'Afrique, les recettes fiscales proviennent pour l'essentiel de l'exploitation des ressources naturelles, comme l'extraction minière et pétrolière, alors que la part de l'impôt sur le revenu et de l'impôt foncier y est beaucoup plus faible.
Politiquement parlant, ce type d'impôts est souvent plus facile à gérer que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'impôt sur le revenu ou la taxe sur les ventes. Mais cette base étroite a un prix : si, pour une raison ou une autre, les compagnies pétrolières décident soudain de réduire leur production, cela peut entraîner une chute des recettes fiscales. C'est pourquoi Lionel Zinsou considère que « ce système de fiscalité de porte est un signe d'archaïsme et de pathologie fiscale. La part des recettes douanières est un bon indicateur de développement : plus elle est basse, plus le pays est développé. »
Les pays africains doivent mettre en place des systèmes qui incitent le secteur informel à intégrer l'économie légale. Pour cela les entreprises doivent trouver un intérêt dans le passage au secteur formel. Si elles sont seules à opérer ce changement, elles seront accablées de charges. Cela suppose donc en échange de bâtir des politiques publiques susceptibles d'offrir un bouquet de services et de prestations qui répondent aux attentes des entreprises et des salariés.
Une analyse, même sommaire, révèle qu'en Afrique la fragilité des constructions politiques peut menacer les acquis économiques. Ces risques sont frappants dans des pays comme le Zimbabwe, mais aussi dans des pays autrefois très stables, comme la Côte d'Ivoire, le Kenya, sans parler de pays comme le Mali, le Tchad, le Congo, Madagascar, etc.
Contrairement à ce que l'on espérait sans doute un peu naïvement, il y a vingt ans, lorsque fut lancé le processus de démocratisation après la conférence franco-africaine de la Baule, la démocratie superficielle qui se pratique dans ces pays n'a guère réduit les tensions politiques.
La démocratie ne peut se limiter en effet à des élections périodiques où le vote exprime essentiellement un rapport de forces ethniques. Elle rend parfois même plus difficile les traditionnelles politiques de redistribution des rentes qui, aux yeux des tenants du pouvoir, risquent désormais de conforter leurs oppositions.
Et le Printemps arabe, marqué par des révolutions et des conflits civils en Tunisie, en Égypte et en Libye, a fait apparaître une nouvelle source de fragilité des États en Afrique.
Éclatant subitement dans des pays d'Afrique du Nord qui semblaient politiquement stables et relativement prospères, ces conflits ont montré que le développement lui-même peut être un facteur de conflit s'il n'offre pas des opportunités économiques à la majorité de la population.
L'exclusion économique des jeunes -- de mieux en mieux formés et en relation les uns avec les autres et avec le reste du monde à travers les médias sociaux -- constitue un risque politique évident. Les troubles qui s'ensuivirent ont mis en évidence l'importance du développement partagé en matière de lutte contre les causes de conflit et de fragilité.
Toutes ces raisons font du renforcement de la gouvernance et d'institutions administrées par « l'État capable » une priorité d'abord des États africains, ensuite de leurs partenaires.
En réponse aux demandes visant l'amélioration de la gouvernance et de la prestation de services de base en Afrique, la France, avec d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, finance de nombreux projets de renforcement des capacités des administrations, des parlements, des médias et des organisations de la société civile. Afin d'améliorer la gestion des finances publiques, elle contribue à soutenir la décentralisation financière et la mobilisation des ressources intérieures.
C. SÉCURISER LA CROISSANCE PAR LA PAIX
M. Lionel Zinsou, ancien de la Banque d'affaires Rothschild, aujourd'hui à la tête de PAIpartners, considéré comme le plus grand fonds d'investissement français en Afrique, nous a fait partager sa conviction que l'Afrique était sans doute à terme « la Chine de demain ». Il nous a dit « la croissance est là pour plusieurs décennies, à la guerre près ».
1. La guerre contre le développement
Malgré les progrès enregistrés ces dernières années notamment dans des pays comme l'Angola, la Sierra Leone et le Libéria, l'Afrique demeure l'une des régions les plus frappées par les conflits au monde, le nombre de conflits s'étant accru au cours des récentes années, bien qu'ils soient moins violents que dans le passé.
M. Ramtane Lamamra, Commissaire pour la Paix et la Sécurité de l'Union africaine, diplomate algérien aguerri qui nous a reçus à Addis-Abeba, nous a dressé un tableau de la situation sécuritaire de l'Afrique pour les prochaines décennies en insistant sur son espoir de voir le continent africain désormais se concentrer sur sa croissance économique.
« Même si la situation du Sahel nous rappelle que la situation politique est loin d'être stable partout, des progrès notables doivent être notés sur la dernière décennie, les conflits interétatiques ont presque disparu, les structures collectives de gestion de crise au niveau continental et régional sont en cours d'élaboration, des progrès considérables à l'échelle de l'histoire de l'Afrique indépendante ont été réalisés ».
Longtemps, l'Afrique a été le continent où le nombre de victimes du fait des conflits armés était le plus élevé du monde. Entre 1945 et 1995, plus d'un quart des conflits mondiaux ont été localisés en Afrique (48 sur 186). On estime que ces conflits ont fait plus de 6 millions de morts sur des populations de 160 millions de personnes (Soudan, Éthiopie, Mozambique, Angola, Ouganda, Somalie, Rwanda, Burundi, Sierra Leone). Depuis 1990, 19 conflits majeurs africains ont été localisés dans 17 pays avec un seul conflit interétatique (Éthiopie-Érythrée).
La baisse des conflits majeurs en Afrique entre 1990 et 1997 a fait place à une reprise entre 1998 et 2000 (11 conflits par an) avec une réduction au début du XXI e siècle (cinq conflits par an).
Néanmoins, en 2011, une vingtaine de pays étaient dans une situation de crise d'intensité moyenne à haute.
Trois foyers de conflits sont particulièrement actifs ces dernières années en Afrique : l'un s'étend du Nigéria à la Corne de l'Afrique en passant par le Tchad et le Soudan ; l'autre se situe dans la région des Grands Lacs, couvrant la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la République Centrafricaine. Au sein de ces zones, il est très difficile à un pays pris isolément de rompre ce cycle de violence sans une résolution plus large à l'échelle régionale. Enfin le Sahel est devenu la troisième zone de conflits aux confins de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb marqué par des révolutions et des conflits civils en Tunisie, en Égypte et en Libye.
Au sein de ces zones, on peut différencier huit conflits ouverts : ceux de la RDC, du Soudan, et des pays voisins, Tchad, RCA et Ouganda, ceux de Somalie, celui entre l'Éthiopie et l'Érythrée et au Mali. Il faut y ajouter les crises nationales pouvant dégénérer en conflits ou tensions régionales (mouvements Touaregs et islamistes dans l'arc saharo-sahélien, MNED au Nigeria), les mouvements séparatistes (Polisario au Sahara occidental, Flec à Cabinda, en Casamance) ; les tensions ethnico-religieuses pouvant resurgir (Burundi, Kikuyu et nilotiques au Kenya, Liberia, Sierra Leone, Peuls et Malinké en Guinée, Akan, Bété et Dioula ou Senoufo en Côte d'Ivoire...).
Longtemps, l'Afrique a été le continent qui a monopolisé le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix.
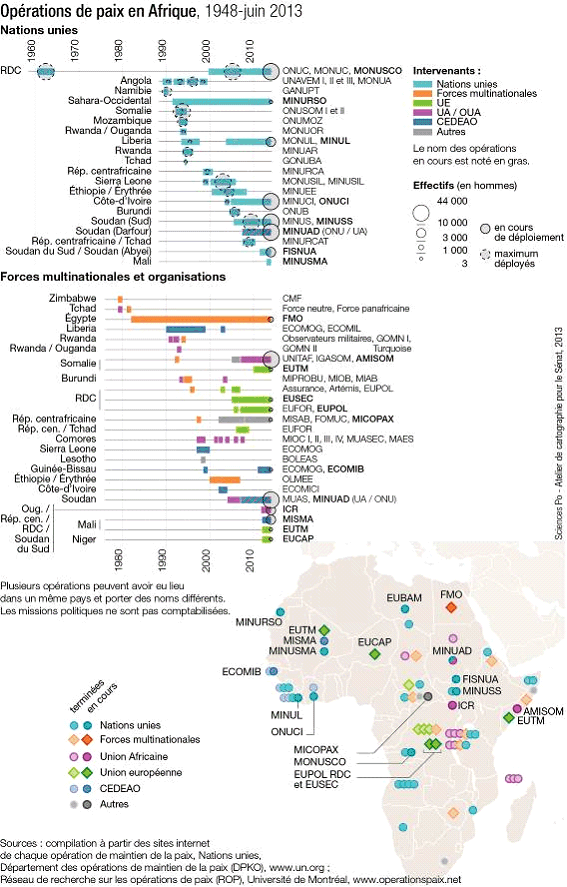
Et il est vrai que le nombre de conflits, avec plus d'un millier de morts, a presque baissé de moitié (4,8 par an pour les années 1990 contre 2,6 pour les années 2000).
D'une part, les conflits interétatiques ont pratiquement disparu (à l'exception des conflits larvés entre les deux Soudan, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, entre Djibouti et l'Érythrée). On a plutôt observé la persistance ou l'apparition de conflits internes aux États dont les causes sont plurielles et qui peuvent avoir des incidences au-delà des frontières, voire régionales.
D'autre part, de nouvelles menaces et sources de conflictualité diffuses se sont imposées ou ont persisté, dont les acteurs entretiennent parfois des liens et qui s'alimentent (terrorisme islamique, intégrisme religieux, irrédentisme, trafics des ressources minières et environnementales, accaparement des terres et déplacements forcés des populations, piraterie maritime, narcotrafic, criminalité transfrontalière...).
Ainsi à côté de ces quelques affrontements massifs entraînant la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, on a vu se multiplier un peu partout des «poches de colère», des conflits larvés, une violence issue des fissures de sociétés en pleine mutation. Prolifère une nouvelle forme de guerre, une « guerre fragmentée » où de multiples petits acteurs armés s'opposent aux États et créent une situation de désordre prolongé.
Ces menaces dessinent une nouvelle géographie de la conflictualité qui traverse l'Afrique en largeur, de la zone sahélienne à l'Océan indien, et fragilise en longueur la situation sécuritaire dans plusieurs États du continent.
La persistance des conflits a de graves conséquences sur les populations : des conséquences humanitaires avec des déplacements forcés à l'intérieur du pays mais aussi dans les pays voisins. C'est le cas par exemple en RCA où il y a des déplacements importants des populations vers le Cameroun, le Tchad et la RDC ; des conséquences économiques très fortes avec des retards de développement importants dans certains pays ; des conséquences en termes de stabilité régionale car la plupart des conflits ne sont plus confinés dans un seul pays. Prenez les conflits de la région des grands lacs qui affectent plusieurs pays de la région, mais aussi les conflits de la corne de l'Afrique, ou le conflit malien dans la région du Sahel.
La croissance est là pour plusieurs décennies, à la guerre près.
Les facteurs de conflit sont connus : l'accès au pouvoir central, les tensions entre centre et périphéries, le contrôle des ressources et les tentatives d'imposition d'idéologies religieuses.
Mais en vérité, ce qui frappe le plus dans la précédente décennie c'est que ce n'est plus la force des États qui incite au conflit extérieur mais leur faiblesse même, qui suscite des contestations internes de plus en plus violentes. Entre 2003 et 2012 on a dénombré douze coups d'Etat sur le continent dont le dernier en Centrafrique est un cas d'école.
D'horizontales, entre États-nations, les guerres africaines semblent redevenues largement verticales entre forces imbriquées dans un même espace. La majorité des hommes qui y portent les armes (organisations armées, milices d'autodéfense, polices, sociétés militaires privées) sont désormais civils et ceux qui en subissent les effets sont également civils, à 90 %.
Les guerres africaines en cours sont des guerres pour la survie des États contre les forces diverses et multiples qui les rongent de manière peu visible par en haut et, plus spectaculairement, par en bas, par ces fissures qui sont apparues dans toutes les fragilités de l'espace social comme ce fut le cas au Mali.
Au final, dans la cartographie mondiale des crises et conflits, le continent occupe encore une place trop importante. On y recense 27 % des conflits violents (dont 22% des conflits, 40% des guerres limitées et la moitié des guerres ouvertes), chiffre le plus important observé depuis 1945 en raison de la situation critique, en 2012, en Somalie, dans les deux Soudans, au Mali, au Nigéria et en RDC.
Un autre indicateur est fourni par la présence des forces d'interposition des Nations unies, sept sur dix-huit.
Les conflits sans issue ont des conséquences néfastes -- notamment des mouvements de réfugiés et la prolifération des armes légères -- qui s'étendent au-delà des frontières nationales, créant des zones de violence interconnectées.
Deux foyers de conflits sont particulièrement actifs ces dernières années en Afrique : l'un s'étend du Nigéria à la Corne de l'Afrique en passant par le Tchad et le Soudan ; l'autre se situe dans la région des Grands Lacs, couvrant la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la République Centrafricaine. Au sein de ces zones, il est très difficile à un pays pris isolément de rompre ce cycle de violence sans une résolution plus large à l'échelle régionale. Mais surtout, il n'y aura pas de développement en Afrique sans sécurité et inversement. Le sort de la Côte d'Ivoire ou du Mali montre combien les conflits sont ravageurs pour le développement des pays africains.
A bien des égards, du fait des risques de conflits, les progrès récents enregistrés par certains pays sont facilement réversibles. La Côte d'Ivoire, locomotive de l'Afrique de l'ouest, a ainsi perdu en une décennie beaucoup du chemin parcouru depuis l'indépendance. A l'inverse, on voit au Rwanda ou au Mozambique que la capacité de rebond des pays africains reste cependant forte. Toujours est-il que la croissance économique soutenue par le secteur privé ne peut s'épanouir que dans un environnement stable. Les acteurs africains, diplomatiques comme militaires, ont un rôle absolument clé. Sans un environnement stable assuré en partie par les Etats, l'économie demeure incontrôlée et incontrôlable. Les opérateurs privés n'investissent pas si la sécurité n'est pas suffisante.
C'est pourquoi la sécurisation du continent par une mobilisation collective des États est une priorité.
2. Une architecture de sécurité encore balbutiante.
Dès 2001, l'Acte constitutif de l'Union Africaine avait jeté les bases d'un changement de paradigme, le principe de « non-indifférence » se substituant à celui qui prévalait depuis 1963, dans un contexte de décolonisation, la « non-intervention ». En 2002, l'Union Africaine a adopté la création d'un Conseil de paix et de sécurité, ayant pour objectif la sécurité et la stabilité en Afrique, et mis en place les prémisses d'une architecture africaine de paix et de sécurité (APSA).
Le principe de « non-indifférence » s'est substitué au principe de « non-ingérence.
Cette architecture est conçue comme un ensemble d'outils fonctionnels qui s'articulent autour du Conseil de paix et de sécurité afin de répondre à des situations de crise. Elle est composée d'un Conseil des sages élu démocratiquement et d'un système d'alerte rapide à l'échelle du continent, mis en oeuvre par des analystes et des experts chargés de prévenir les autorités africaines lorsqu'un conflit se profile.
Par ailleurs, toutes les communautés économiques régionales se sont dotées de dispositifs de prévention des conflits et de maintien de la paix. Les plus achevés sont ceux de la CEEAC, la CEDEAO, l'EAC, la SADC, qui intègrent des mécanismes de prévention et gestion des conflits de démocratie.
La première réponse de l'Union Africaine face au conflit du continent a été une réponse normative et politique. Elle a adopté nombre de textes sur la gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme témoignant de la reconnaissance de la part des dirigeants africains qu'une part importante des conflits sont liés à des déficits de gouvernance. C'est pourquoi l'accent a été mis sur ces textes qui visent à encadrer l'action des Etats et à les inciter à prendre un certain nombre de mesures qui visent à prévenir les conflits. Des textes sur les droits des femmes, des enfants, des entreprises, des mesures qui concernent les élections car beaucoup de pays ont connu des crises électorales à l'image du Kenya, lors des élections de 2007 qui ont entrainé plus d'une centaine de morts. L'un des textes les plus emblématiques est sans doute la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance entrée en vigueur depuis 2007.
Ce corpus de normes est complété par un dispositif institutionnel avec un système continental d'alerte rapide qui vise à identifier les conflits potentiels avant qu'ils n'éclatent de manière à faciliter l'action de prévention et le groupe des sages composé de personnalités indépendantes qui ont la capacité de se prononcer de façon indépendante sur la situation d'un gouvernement sur le continent africain.
Comme nous l'a dit M. Ramtame Lamamra, Commissaire pour la Paix et la Sécurité de l'Union africaine : « la prévention est dans l'âme des Africains, elle correspond au symbole de l'arbre à palabre, mais il faut aussi du muscle ».
L'architecture africaine de paix et de sécurité est destinée à doter les Africains d'une capacité combinée de 15 000 à 20 000 militaires et ce grâce au projet ambitieux d'une Force africaine en attente (FAA), censée être opérationnelle en 2010 mais dont le déploiement a été repoussé à 2015. Cette force devait se décliner régionalement autour de cinq brigades en attente, prises en charge par les communautés économiques régionales.
La mutualisation par les États membres de l'UA de leurs moyens civils, militaires et policiers afin de participer à la résolution des conflits et au soutien de la paix à l'échelle régionale reste balbutiante comme en témoigne l'expérience du Mali.
Mais il faut toutefois considérer les progrès entrepris par une organisation particulièrement jeune. Comme nous l'a dit le Général Bruno Clément-Bollée, directeur de la coopération de sécurité et de défense : « il faut bien voir que les armées des pays membres de l'Union africaine ne se parlaient pas il y dix ans, aujourd'hui, certains organisent des exercices conjoints, d'autres interviennent ensemble avec succès comme en Somalie ».
Il est vrai que la difficulté à mettre en place les forces africaines en attente suscite une impatience à la hauteur des attentes.
L'annonce, lors du récent sommet d'Addis Abeba, de la création d'une Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC) constitue un constat d'échec pour la Capacité de déploiement rapide prévue dans le cadre de la Force africaine en attente, censée répondre aux objectifs aujourd'hui assignés à la CARIC.
Pour nombre d'observateurs, l'architecture africaine de paix et de sécurité a néanmoins montré une certaine efficacité au niveau de l'information : le travail fourni par les analystes du système d'alerte rapide a conduit le conseil à se réunir 365 fois depuis la mise en place du dispositif. Ce système de prévention est donc efficient et son poids politique est croissant. L'Union Africaine a ainsi pu intervenir dans cinq conflits (Burundi, Soudan et Soudan du Sud, Somalie, Comores) avec des succès notables.
Mais, l'architecture africaine de paix et de sécurité peine aujourd'hui à trouver des solutions efficaces aux types de conflits qui rongent le continent. De fait, les opérations de maintien de la paix sont encore largement prises en charge par l'ONU ou même menées par des puissances extracontinentales, comme en atteste l'exemple plus que cité de l'opération SERVAL.
Les FAA se font attendre et, malgré une formation militaire régionale croissante, l'Union Africaine a du mal à déployer des contingents militaires dans des délais pertinents, faute en partie de financements adaptés. La nécessité de réunir pour chaque crise des financements ad-hoc constitue notamment un frein majeur à la réactivité de l'Union Africaine.
Et lorsque des interventions militaires en réponse à des crises récentes ont pu avoir une base régionale (MICOPAX, MICECI, MISMA), elles n'en ont pas moins été conditionnées avant tout par les priorités nationales des Etats participants, et par les soutiens venus de l'extérieur de leurs régions respectives. La motivation première des Etats participant à une intervention militaire reste leur propre sécurité intérieure ou leur positionnement sur l'échiquier régional, plus qu'une réponse « automatique » à une crise.
Quand on relit les discours des années 2000, on ne peut que constater le décalage entre les scénarios d'intervention élaborés alors par l'Union Africaine et la réalité des moyens mis en oeuvre, mais aussi des types de conflits à laquelle l'Union Africaine a dû faire face : la corruption, les trafics en tous genres, la contrebande, la traite ou encore le terrorisme sont les principales menaces qui affectent aujourd'hui l'Afrique et qui sont autant de facteurs de déstabilisation non conventionnels des États.
Si les ambitions de l'Union africaine en matière de sécurité sont contrariées par son manque de moyens et son extrême dépendance financière à l'égard de ses partenaires en général et de l'Union européenne en particulier, elle a néanmoins réussi à s'imposer comme un partenaire incontournable.
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est en effet l'organe de l'Union Africaine qui fonctionne le mieux. Il joue depuis 2004 un rôle croissant « d'unification » de la voix de l'Afrique et de prescription à l'égard des États-membres, comme l'illustre son rôle dans la médiation sur le Soudan et le Soudan du Sud, notamment s'agissant d'Abyei.
« C'est un partenaire incontournable encore très dépourvu de moyens » nous a dit M. Michel Foucher, directeur de la formation, des études et de la recherche de l'IHEDN.
Il est vrai que l'Union Africaine ne peut pas pallier les déficiences des pays membres, notamment la faiblesse des budgets consacrés à la défense et aux armées.
Les initiatives multilatérales aux niveaux régional et continental sont en effet vouées à l'échec sans capacités nationales.
La carte suivante montre bien la faiblesse des budgets de la défense africains. En effet, dans un contexte économique dynamique mais où le développement n'en est qu'à ses prémices, l'effort financier investi par les pays africains dans le domaine militaire, bien que proportionnellement très conséquent par rapport au PIB, reste très limité.
Un des défis majeurs du continent reste la mise en place de forces de sécurité et de défense fiables à la hauteur des menaces.
Le défi est de taille : car actuellement la situation des appareils de défense et de sécurité est très contrastée mais présente des carences communes.
Globalement, ils ne permettent pas aux Etats d'assurer pleinement la sécurité élémentaire de leurs propres espaces nationaux ainsi que le contrôle de leurs frontières. Les dirigeants sont confrontés à des armées vieillissantes en sureffectif chronique.
Mais les dirigeants politiques africains ont pour une large part contribué à cette situation. Comme l'a souligné Bertrand Badie lors de son audition, la faiblesse des armées africaines tient aussi de la défiance des pouvoirs politiques à l'égard des militaires qui souvent leur ont pris le pouvoir.
Une double dynamique perverse semble s'être instaurée : les armées sont tentées de s'inscrire dans le jeu politique, entraînant les pouvoirs politiques à ne pas investir dans leurs forces armées qui trouvent dans la carence de l'appareil de défense un prétexte pour intervenir dans le champ politique.
Résultats : les déploiements des troupes africaines sur le terrain, comme au Mali, se heurtent aux problèmes de financement, d'équipements (soutien de l'homme, véhicules blindés, SIC...) et de transport, à des besoins opératifs et tactiques en matière de renseignements, de logistique, qui se traduisent par la difficulté à concevoir et commander au-delà du niveau bataillonnaire.
A l'origine de la faiblesse des armées africaines il y a la défiance des pouvoirs politiques à l'égard des militaires qui leur ont souvent pris le pouvoir.
Dans de nombreux pays africains en sortie de crise, la constitution d'une armée au service de la nation passe par un processus d'intégration de différentes factions armées.
Pour cela, les « Réformes du système de sécurité » (RSS) et les programmes Désarmement, Démobilisation, Réinsertion (DDR) en cours dans de nombreux pays sont particulièrement sensibles.
En Côte d'Ivoire, nous avons pu constater qu'entre novembre 2012 et mars 2013, 6 300 ex-combattants ont été désarmés et 5 900 armes récupérés tandis que 8 000 ex-combattants ont été réintégrés et réinsérés à travers une assistance financière.
Ce processus de réhabilitation, qui s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation au désarmement, à la paix et à la cohésion sociale, suite à la crise qui a secoué le pays en 2010-2011, est cependant loin d'être achevé.
Les processus RSS et DDR en Afrique constituent un passage obligé pour les pays africains qui doivent aujourd'hui moderniser leurs systèmes de sécurité pour ancrer leurs États dans le concret des nations démocratiques et concevoir des mécanismes de sortie de crise adaptés à leurs réalités.
Quant aux moyens propres des organisations régionales et de l'Union africaine, ils sont encore limités.
Des missions comme celles de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, est financièrement complètement dépendante de l'ONU et de l'Union européenne.
Au-delà de la question financière, la question de l'articulation entre l'Union Africaine, l'ONU et les organisations régionales sera un enjeu majeur des années à venir.
L'ONU est depuis 2002 le premier partenaire institutionnel de l'Union africaine pour le développement de ses capacités et la conduite de ses opérations. De ce fait, l'Union africaine occupe une place inégalée au sein de l'ONU : 70 % du travail du Conseil de sécurité concerne l'Afrique et 70 % des opérations de maintien de la paix y sont déployées.
Malgré une coopération politique très forte entre les deux organisations, certaines incompréhensions subsistent : l'Union africaine souhaite s'affranchir de la tutelle onusienne sans pour autant en avoir les moyens. De leur côté, les États membres de l'ONU, revenus d'un certain nombre d'expériences, sont de plus en plus réticents à soutenir financièrement les opérations déployées et commandées par l'Union africaine. La préparation des opérations au Mali a ainsi été révélatrice de ces tensions qui risquent de perdurer tant que les États africains ne se seront pas résolus à rechercher des financements internes et à mieux s'organiser pour gérer les différentes crises qu'ils ont en charge.
Car c'est bien la gestion autonome des crises et des conflits qui est désormais au coeur des enjeux de sécurité et de développement sur le continent. Si le partenariat stratégique qui lie l'ONU à l'Union africaine a été renforcé depuis 2007 avec la mise en place d'une batterie de réunions conjointes, il s'agit bien d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains.
C'est pourquoi la coopération entre l'Union africaine et les organisations régionales doit être améliorée. Il faut sortir du clivage entre le panafricanisme porté par l'Union africaine et le régionalisme prôné par les communautés économiques régionales (CER) afin de mettre en place des dispositifs de déploiement efficaces. En effet, tous les experts militaires africains le disent : l'appropriation de la réforme du système de sécurité (RSS) par les acteurs locaux est primordiale en Afrique.
3. Une prise de conscience croissante
Il faut donc que les autorités africaines, qui portent la responsabilité de leur appareil de défense, parviennent à mettre en place un système d'articulation effectif entre les décisions prises à Addis-Abeba par l'Union africaine et leur application au sein des CER. La communication est très importante dans le domaine de la sécurité : il faut informer les populations et leur expliquer les choix faits par les instances dirigeantes afin qu'elles s'approprient leurs décisions et participent à leur mise en oeuvre pérenne. Un tel effort permettrait également de redonner confiance aux populations dans l'action politique, encore trop souvent perçue comme l'oeuvre d'une oligarchie détachée des attentes de la société.
Le Commissaire à la paix et à la sécurité, M. Lamamra , l'a clairement exprimé lors de notre rencontre en soulignant que « nous avons, les uns et les autres, accueilli comme nécessaire, voire même salutaire, l'intervention française, qui a permis d'éviter la catastrophe qui se dessinait, mais, en nous-mêmes, nous avons clairement senti qu'une telle action aurait dû et aurait pu être le fait de troupes africaines », ajoutant que l'Afrique « ne peut tout simplement pas continuer à s'en remettre à des interventions étrangères, si bien intentionnées qu'elles puissent être » pour régler ses problèmes.
Pour beaucoup de responsables africains, l'intervention française au Mali a eu l'effet d'un électrochoc : elle a permis la prise de conscience de la nécessité pour les États africains d'améliorer leur capacité militaire de façon autonome et cohérente.
Si les partenaires de l'Afrique n'ont pas vocation à continuer à intervenir militairement dans des pays qui ont acquis leur indépendance, il y a plus de cinquante ans, ils peuvent contribuer aux côtés des États africains à mettre sur pied des forces militaires à même d'assurer la paix et la sécurité du continent.
C'est l'intérêt des États africains, c'est aussi le nôtre. Dans ce domaine, la France, qui conduit depuis les indépendances une politique de coopération militaire active, a un rôle de premier plan à jouer.
Déjà présente en matière de formation par le développement des écoles nationales à vocation régionale (ENVR), la France met en place une coopération bilatérale militaire efficace afin d'aider les pays du continent à forger leur autonomie en matière de sécurité. Il faut encourager le développement des capacités locales à former les cadres africains, civils comme militaires, et inciter nos partenaires à bâtir des outils moins ambitieux mais soutenables en promouvant, par exemple, la contractualisation dans les modèles d'armée.
Il nous faut adopter une stratégie militaire africaine afin d'aider le continent dans sa transition vers la mise en place d'une politique de sécurité efficace. L'autonomie de financement, la formation, la réhabilitation des militaires, le retour de la confiance dans l'armée et la mobilisation des populations locales sont les enjeux auxquels doit répondre l'architecture de paix et de sécurité africaine car, comme l'affirme Pascal Canfin, ministre délégué au développement : « Il n'y pas de développement possible sans sécurité, mais il n'y aura pas de sécurité durable sans développement ». 24 ( * )
V. L'AFRIQUE À LA CROISÉE DES CHEMINS
Les défis sont immenses, à la taille de ce continent.
Mais l'Afrique a pris le virage de la croissance. La question est de savoir comment elle va sortir de ce virage. Sans doute la trajectoire ne sera pas rectiligne, mais, comme nous l'a dit un de nos interlocuteurs, il faut à tout prix éviter la sortie de route.
A. L'AFRIQUE, UNE NOUVELLE FRONTIÈRE ENTRE RISQUE ET OPPORTUNITÉS
Dans les trente prochaines années, l'Afrique va construire les fondations d'un continent de deux milliards d'habitants.
Cette période comportera d'énormes opportunités. D'abord pour les Africains dont l'optimisme a aujourd'hui peu d'équivalent dans le monde. Ensuite, s'ils savent les saisir, pour les Européens et les Français. La croissance africaine peut être notre salut.
L'Afrique, c'est la Chine de demain et d'énormes opportunités.
L'Afrique est aujourd'hui dans une situation comparable à l'Asie dans les années soixante. A l'époque, des pays comme la Corée et le Ghana avaient à peu près le même niveau de développement économique et un PIB par habitant similaire. A l'époque, de nombreux ouvrages commentaient l'incompatibilité de la culture asiatique avec le capitalisme occidental.
Depuis, la Corée a connu le succès que l'on sait. Les Coréens ont une espérance de vie à la naissance de 80 ans, sont scolarisés à 98.5 %. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant dépasse 29 000 dollars. En 2011, la Corée se classait au 15 e rang mondial, selon l'Indice du développement humain (IDH) des Nations unies, qui repose sur des mesures de la santé, du niveau de vie et de l'éducation, et dont sont tirées ces données.
L'exemple de la Corée montre que le développement économique peut être très rapide. Et il est assez émouvant de voir la Corée à son tour adhérer au Comité d'aide au développement de l'OCDE. En quelques décennies, un pays dévasté et appauvri par la guerre est passé du statut de bénéficiaire de l'aide à celui de donneur, après avoir reçu 13 milliards de dollars d'aide. Elle est aujourd'hui un des plus fervents soutiens à la coopération Sud-Sud mais aussi à des coopérations triangulaires.
Ce passage du statut de bénéficiaire à celui de donneur, Oh Joon, vice-ministre coréen des Affaires étrangères en a lui-même témoigné lors de l'adhésion de son pays à l'OCDE : « Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'école élémentaire où nous buvions du lait et mangions du pain de maïs provenant de conteneurs qui portaient la marque « United Nations » ou « US Government ». Il y a quelques mois, je me suis rendu dans une école maternelle en Mongolie où les enfants étudient avec des livres sur lesquels il est indiqué qu'ils ont été offerts par la République de Corée. ».
Au Ghana, l'espérance de vie dépasse à peine 64 ans, le taux de scolarisation est d'environ 56 % et le PIB par habitant atteint seulement 1 533 dollars, environ 19 fois moins qu'en Corée. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, il a connu une croissance annuelle d'environ 5 %, les investissements et les exportations ont doublé, et ce n'est plus la moitié de la population environ qui vit sous le seuil de pauvreté absolue, mais un peu moins d'un tiers.
Ce retournement de l'Histoire, l'Afrique est en train de le vivre.
L'Afrique a devant elle la perspective de tirer des centaines de millions d'Africains de la pauvreté et de constituer des pôles de développement économique qui pourraient rivaliser avec l'Asie.
C'est pourquoi, nous considérons qu'une partie de notre avenir est en Afrique. Que ce continent poursuive sa trajectoire et la nôtre pourrait s'en trouver bouleverser.
« C 'est un changement de monde, un acteur majeur de la scène internationale, un moteur de la croissance mondiale qui est en train de naître à nos portes » nous a dit M. Jean Michel Severino, comme beaucoup de nos interlocuteurs.
Dans un monde dont le centre de gravité est en train de passer du Nord au Sud, un continent africain dynamique à 12 kilomètres au sud de l'Europe pourrait constituer, à l'instar des Etats-Unis avec l'Amérique du Sud, pour notre continent, non seulement une zone de prospérité partagée, mais aussi un gisement durable de croissance.
Pendant quelques décennies, la modernité en France, c'était de s'éloigner de l'ancien empire pour rejoindre l'Asie émergente. Demain, l'Afrique pourrait avoir un PIB équivalent à la Chine.
« C'est la Chine de demain » nous a affirmé Mathieu Pigasse de la Banque Lazard.
A l'instar du « pivot » des Etats-Unis vers la région Asie-Pacifique, nous estimons que la politique étrangère française devrait procéder à un pivot vers l'Afrique.
Non seulement, nous avons un intérêt majeur au développement de ce continent, mais, à l'inverse, nous serons en première ligne pour subir les conséquences d'une sortie de route de l'Afrique.
Dans un monde globalisé, les épidémies nées dans les maillons faibles des systèmes de santé africains, le terrorisme né dans les zones désertées par le développement concernent aussi bien l'Afrique noire que l'Europe. On l'a vu au Sahel, le terrorisme qui prospère dans des pays que le développement a déserté, où les structures étatiques sont exsangues et la jeunesse désespérée, livrée au fanatisme, menace nos sociétés.
Un pays comme la France, à quelques dizaines de kilomètres du continent africain, avec déjà plus de 800 000 ressortissants africains sur son territoire, est évidemment bien placé pour mesurer à quel point le sort de ce continent aura des conséquences majeures sur l'Europe.
L'Afrique au 21 e siècle est l'un des principaux réservoirs de croissance économique, la plus importante réserve de ressources naturelles, le plus grand marché en devenir. Le développement de ce continent de 1,8 milliard d'habitants est avant tout l'affaire des Africains, mais il risque, si la croissance n'est pas au rendez-vous, d'être aussi la nôtre du fait de l'ampleur des phénomènes migratoires.
B. LE CHOIX D'UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE : UN ENJEU MAJEUR POUR L'AFRIQUE ET POUR SES PARTENAIRES
Nous avons un intérêt majeur à participer à la transformation du continent africain, mais pas à n'importe quel modèle de développement.
Dans les trente prochaines années, l'Afrique va construire des dizaines de milliers kilomètre de routes, des aéroports, des ports, des centaines de centrales électriques et de barrages hydrauliques, des millions de logements.
La quantité importera autant que la manière.
Les choix de modèle de développement qu'adoptent aujourd'hui les pays africains structureront les cinquante ans à venir .
Ces choix sont loin d'être indifférents pour les Africains comme pour nous.
A Arusha, en juin 2012, à la quarante-septième assemblée de la Banque africaine de développement, devant une assemblée de banquiers et de ministres des finances, le président de la BAD, Donald Kaberuka, s'est livré à un délicat et inhabituel exercice : parler de croissance inclusive et d'une sobre utilisation des ressources naturelles, au moment où les prix élevés sur les marchés internationaux et des découvertes inattendues de nouveaux gisements de minerais et d'hydrocarbures ont redonné aux dirigeants la fièvre des matières premières et où l'industrialisation du continent apparaît comme une nécessité, même au prix d'un accroissement encore plus important des inégalités.
« Il faut que les Africains rejoignent cet objectif, pas simplement parce que c'est la volonté de leurs bailleurs, mais parce qu'il est de notre responsabilité de protéger nos écosystèmes », a-t-il exhorté.
Le Président de la BAD rejoint un sentiment partagé par les observateurs que nous avons rencontrés. L'Afrique a encore le choix. Entre un développement « à la chinoise » dont la facture environnementale et sanitaire, après trente ans de croissance rapide, est très lourde. Ou un développement qui n'hypothèque pas l'immensité de ses ressources naturelles et une croissance qui offre des emplois aux jeunes et préserve les équilibres sociaux.
L'apport de cette phase de décollage au développement des pays africains ne saurait se limiter à la seule augmentation du PIB : la qualité de la croissance, sa capacité à générer des emplois, son impact sur le bien-être et l'environnement et sa contribution au renforcement des Etats sont aussi importants que son rythme.
La croissance s'accompagne souvent d'un accroissement des inégalités qui, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent remettre en question ses bénéfices à long terme. L'efficacité de la croissance économique, sa robustesse et sa capacité à créer de l'emploi peuvent être sapées à la base par les inégalités. Les mécanismes de réduction des inégalités et de protection des plus vulnérables, doivent ainsi se généraliser au sein de chaque pays.
L'objectif premier et fondamental consiste donc, pour les gouvernements africains, à réaliser une croissance qui inclue le plus grand nombre.
Les responsables politiques africains rencontrés en sont bien conscients. Le rôle de l'Etat ne doit pas seulement se traduire par l'égalité de traitement et d'opportunités des citoyens, mais par des réductions profondes de la pauvreté et un accroissement massif et correspondant des emplois.
En permettant d'exploiter le vaste potentiel du continent -- et en améliorant ses chances de tirer parti du dividende démographique - la croissance inclusive induira la prospérité par un élargissement de la base économique qui transcende les obstacles liés à l'âge, au sexe et à la situation géographique.
Dans ce contexte, le rôle des partenaires de l'Afrique, des bailleurs de fonds et, au premier chef, de la France, est d'accompagner les pays africains dans cette démarche.
L'aide au développement ne peut pas tout. Mais elle peut faire évoluer favorablement la balance des risques et des opportunités. Il revient aux Africains de décider pour eux-mêmes. Les mieux intentionnés de leurs amis ne pourront se substituer à leurs choix d'investissements, à leur combat.
C'est aussi notre intérêt. Si demain l'Afrique s'industrialise, elle sera une terre de délocalisation.
C'est déjà le cas à faible échelle dans le domaine des services informatiques, de la télé-saisie et des centres d'appel. Assistance technique, saisie de données comptables, back office pour de grandes compagnies d'assurances, prise de rendez-vous médicaux, vente par téléphone : la délocalisation de services est de plus en plus poussée.
Après les pays à bas coût de l'OCDE, tels l'Irlande, puis les pays émergents comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, une troisième vague de pays africains fait surface, portée par le développement de la bande passante et l'accès Internet à haut débit.
Sur le continent africain, ils sont quelques-uns à vouloir surfer sur la vague : le Maroc, la Tunisie, le Kenya, l'Ouganda, mais aussi le Sénégal, le Mali, le Ghana ou le Nigeria.
Pressées de réduire leurs coûts, les entreprises françaises voient dans les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest une solution pratique à leurs besoins d'externalisation, avec des coûts moindres et une langue en partage.
Dans ce domaine, le Maghreb a montré la voie. A ce titre, le Maroc et la Tunisie sont largement en tête. A Casablanca, capitale économique du Royaume, le parc de CasaShore, avec ses 53 hectares et des coûts 30 à 50% inférieurs à l'Europe, fait le plein : Capgemini, Unilog, BNP Paribas, Axa, pour les filiales de grands groupes. Globalement, le secteur des call center au Maroc génère un chiffre d'affaires estimé à 2,6 milliards d'euros et quelque 25 000 emplois.
En Afrique de l'Ouest, le mouvement est perceptible, en particulier au Sénégal, mais il concerne des services de moindre valeur ajoutée, essentiellement le télémarketing et la télé-saisie. A Dakar, Premium Contact Center International (PCCI) est une success story. Ce centre ouvert en 2002 est aujourd'hui le plus important du Sénégal, avec près d'un millier de positions. Ses clients s'appellent Orange, Neuf Cegetel, Bayer, Poweo ou Canal +. Avec un coût de la bande passante à l'international très compétitif et des salaires attractifs - un employé à Dakar peut gagner trois fois le salaire moyen et rester huit fois moins cher que son équivalent français-, le Sénégal a des arguments à faire valoir.
En Afrique de l'est nous avons pu constater que l'Ethiopie se positionnait pour recevoir des délocalisations d'entreprises chinoises. Ainsi, le numéro deux mondial du prêt-à-porter, Hennes et Mauritz (H&M) en en train d'étendre son réseau de fournisseurs à l'Ethiopie, après avoir concentré 80 % de sa production sur le continent asiatique. En raison des augmentations des salaires en Chine, le coût de production d'un vêtement fabriqué actuellement en Ethiopie est moitié moins cher qu'un vêtement fabriqué en Chine en 2011, dernière année pour laquelle ces statistiques sont disponibles. En outre, les coûts de transport et les délais de livraison pourraient s'en trouver réduits, du fait de la plus grande proximité entre les côtes africaines et le marché européen, principale source de revenus du groupe.
L'Éthiopie dispose d'un savoir-faire historique dans le textile, le cuir et la chaussure depuis l'invasion italienne en 1935. L'enseigne britannique Tesco et le chinois Huajian, qui fournit les marques de chaussures Guess et Tommy Hilfiger, s'y fournissent déjà.
Imaginons à terme l'entrée progressive de pays africains dans la compétition internationale pour la délocalisation des services et des industries avec une population active de près de 1 milliard de personnes en 2050.
On a vécu cela ces dernières décennies avec le passage de 1,3 milliard d'actifs dans le monde, à la fin des années 1980, à 3 milliards d'actifs dans les années 2000.
Mis bout à bout, les phénomènes de croissance démographique et de la mise en marché du tiers-monde, puis des anciens pays communistes, ont provoqué la multiplication par deux de la population active sur le marché international du travail en une seule décennie.
La concurrence de la Chine et des autres émergents ont tiré les salaires et les systèmes sociaux vers le bas avec les résultats que l'on connaît.
Si nous voulons anticiper ces évolutions sur le continent africain, nous avons intérêts à promouvoir des modèles de croissance qui, tout en s'appuyant sur l'avantage comparatif des bas salaires, fait progressivement monter en puissance une régulation sociale au profit du plus grand nombre.
Entendons-nous bien, la délocalisation d'activités comprenant une forte part de main d'oeuvre peu qualifiée d'Europe vers l'Afrique n'est pas forcément en soi une mauvaise nouvelle. Comme l'a observé M. Jean-Michel Severino « quitte à délocaliser, il vaut mieux que cela se passe dans une zone de partenariat ».
Un des enjeux de demain sera la façon dont on peut accompagner l'Afrique dans la promotion simultanée de l'élévation des niveaux de vie et du respect de normes sociales minimales.
Le second objectif consiste à faire en sorte que la croissance soit durable, en aidant l'Afrique à faire la transition progressive vers la « croissance verte », qui protégera les moyens de subsistance, améliorera la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire, favorisera l'utilisation durable des ressources naturelles et stimulera l'innovation, la création d'emplois et le développement économique.
C'est l'intérêt de l'Afrique, mais c'est aussi l'intérêt de la communauté internationale et de la France.
Il y a un intérêt partagé des Européens et des Africains à mettre le continent sur les rails d'une croissance inclusive et durable.
Pour les pays africains, les problèmes écologiques restent avant tout des problèmes du Nord et la croissance verte est souvent perçue comme un moyen de mettre des freins à leur quête de prospérité.
L'Afrique doit comprendre que, pour son développement, « avoir de l'eau, des sols, préserver ses forêts, c'est aussi important que construire des routes ou des hôpitaux ».
La pression exercée sur les écosystèmes va doubler d'ici à 2040. L'agriculture et la destruction des forêts sont les principales causes de cette dégradation dans un continent encore en majorité rural et sous-équipé en matière énergétique.
Si l'objectif est d'avoir un continent d'ici cinquante ans pleinement électrifié, avec une élévation générale du niveau de vie des deux milliards d'habitants africains avec un accès à l'ensemble des modes de consommation occidentaux, alors les choix effectués aujourd'hui sont fondamentaux pour l'équilibre de l'Afrique mais également pour celui de la planète.
C'est pourquoi la France, qui accueillera la prochaine conférence sur le climat, doit appuyer des modes de développement qui atténuent la pression sur les ressources naturelles tout en gérant plus efficacement les risques environnementaux, sociaux et économiques.
C'est un des défis de notre coopération avec l'Afrique que d'intégrer davantage, dans les projets et les stratégies opérationnelles, les enjeux environnementaux et sociaux. Et c'est pourquoi, le groupe AFD s'est engagé, sur la période 2012-2016, à atteindre un niveau important d'activité « climat » : 50 % de l'activité dans les pays en développement et 30 % de l'activité de Proparco. L'Agence Française de développement viendra ainsi avec le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), l'Institut de recherche et développement (IRD), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et la branche internationale de l'Office national des forêts (ONF), conforter l'offre de la coopération française dans le domaine du développement durable.
La question se pose en Afrique, elle est aussi posée à l'échelle mondiale : dans les réflexions internationales, notamment aux Nations unies, ou en France lors des Assises du développement, l'enjeu est bien désormais de savoir comment faire se rejoindre les objectifs de développement post 2015 et ceux liés à l'environnement dans la suite de Rio+20.
Et c'est l'intérêt de la France de promouvoir simultanément l'élévation des niveaux de vie et le respect des normes sociales et environnementales. Le réchauffement de la planète ne connaît pas les frontières. L'internationalisation des marchés du travail met en concurrence les systèmes sociaux de la planète. Dans ce contexte-là, notre intérêt est de promouvoir toutes les formes de régulation de la mondialisation.
Pour cela, il faut prendre encore davantage en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans le dialogue avec les pays sur leurs politiques.
C. LES ÉTATS, LES ENTREPRISES PRIVÉES ET LES SOCIÉTÉS CIVILES : TROIS PORTES D'ENTRÉE DU DIALOGUE AVEC L'AFRIQUE
Ce dialogue avec les pays africains passe par les trois acteurs majeurs de la transformation du continent que sont les États, les entreprises privées et les sociétés civiles.
Après une décennie d'ajustements structurels qui ont mis à mal les capacités des administrations publiques, il faut aider les Etats africains à structurer des politiques de développement aussi bien au niveau régional dans la coopération interétatique qu'au niveau national et local.
L'émergence économique et l'insertion gagnante dans la mondialisation requièrent un Etat stratège, capable d'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie de croissance entretenant un consensus social, de concilier les multiples défis internes de son développement, d'arbitrer entre eux lorsque cela s'impose et de défendre ses intérêts sur la scène internationale, d'investir à long terme sur le capital physique et humain tout en préservant le patrimoine naturel et culturel.
C'est pourquoi nous estimons, nous le verrons, que la coopération qu'entretient la France avec les Etats africains doit se recentrer sur l'aide à la gouvernance et la coopération technique et administrative. La France doit renforcer son action en faveur de la modernisation de l'Etat, notamment par une coopération juridique, judiciaire, administrative et territoriale. Elle doit contribuer au renforcement de la gouvernance financière, à l'appui à la mobilisation des ressources nationales, au suivi de la qualité des finances publiques et au renforcement des institutions de contrôle.
Recentrer le dialogue sur l'aide à la gouvernance et la coopération technique et administrative
Le secteur privé a, quant à lui, contribué à près de 80 % du PIB du continent et créé environ 90 % de tous les emplois. Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, dont 65 % sont informelles, ont créé 70 à 80 % des emplois. Mais ces PME africaines manquent d'accès aux ressources financières de long terme. Ceci crée un vide, un «chaînon manquant» dans l'économie de ces pays. L'investissement privé ignore souvent ces entreprises de taille moyenne ou petite, dont les besoins en financement ne sont pas satisfaits, faute d'outils de financement adaptés. Les petites et moyennes entreprises sont certainement plus risquées, mais aussi plus rentables, financièrement et/ou socialement. Elles ont un impact environnemental très important et souvent sous-estimé en raison du caractère diffus du tissu de ces PME.
C'est pourquoi notre coopération doit avant tout promouvoir la création d'entreprises. Dans ce secteur, la France a pris une longueur d'avance grâce à l'action de l'Agence française de développement. Dans le cadre de l'initiative du Cap, la France oeuvre depuis 2008 à un soutien du secteur privé par la mobilisation de 2.5 milliards d'euros en 5 ans qui devraient générer un soutien à 1 900 entreprises, petites et moyennes principalement, avec à terme la création de plus de 300 000 emplois
Soutenir le micro-crédit, l'entreprenariat social et les différentes formes de soutien à l'initiative et aux entreprises du Sud
Il faudra sans doute renforcer encore notre action dans ce secteur et diversifier nos méthodes. L'appui à la croissance nécessite d'agir dans plusieurs directions complémentaires : stimuler un environnement des affaires propice à la mobilisation de l'investissement privé ; soutenir les évolutions du cadre institutionnel et règlementaire ainsi que les politiques du travail et de l'emploi ; mieux anticiper les chocs et leurs implications pour les entreprises, favoriser l'investissement de l'épargne nationale et les investissements directs étrangers, contribuer à une fiscalité structurante qui donne aux Etats les moyens d'agir et aux citoyens un sentiment d'équité.
Mais il faut également soutenir le micro-crédit, l'entreprenariat social et les différentes forme de soutien à l'initiative et aux entreprises du Sud, à travers la facilitation de l'accès au crédit sur les marchés locaux (grâce à des mécanismes de garantie en particulier), ou encore le renforcement de leurs fonds-propres (grâce à des fonds d'investissement adaptés).
Dans une économie informelle, de nombreux microprojets qui manifestent un réel potentiel peinent à se développer, voire échouent et cessent leur activité, faute de crédit, parce qu'ils parviennent à un niveau intermédiaire, dans lequel les institutions de micro-finance ne peuvent plus « suivre », tandis qu'ils ne répondent pas aux critères des banques classiques. Il y a sur ce segment un véritable potentiel à soutenir.
Les sociétés civiles, enfin, doivent être des partenaires stratégiques de notre coopération. Les printemps arabes ont montré combien ce dialogue avec les Etats partenaires n'était pas suffisant pour entretenir une relation de qualité. Les sociétés civiles africaines sont, en particulier, les garantes de la qualité de la gouvernance et de la vitalité de la vie démocratique.
L'efficacité des politiques et des actions de coopération est étroitement dépendante de l'adéquation des politiques suivies avec les besoins des populations.
Le dialogue entre Etats constitue, naturellement, le cadre premier dans lequel s'inscrit la politique publique de coopération pour le développement, mais il doit associer de façon croissante les populations. La participation des citoyens et de la société civile des pays partenaires doit donc être systématiquement recherchée dans les actions bilatérales mises en oeuvre par la France et promue aux niveaux européen ou multilatéral, qu'il s'agisse de leur association par l'Etat partenaire, en amont, à la définition des politiques publiques, au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions soutenues.
Les collectivités locales sont également l'un des lieux où s'opère le renforcement de la gouvernance à la faveur du processus de décentralisation et notamment le caractère participatif et démocratique du développement. La décentralisation rapproche le processus de décision et de gestion publique des citoyens, favorisant l'émergence d'une démocratie de proximité. Elle peut contribuer à un développement socio-économique adapté dans des domaines qui souffrent d'approches trop centralisées. Elle favorise la cohésion territoriale et l'enracinement de la démocratie. C'est pourquoi nous devons promouvoir le développement d'une coopération décentralisée française qui est déjà aujourd'hui un atout considérable dans notre relation à l'Afrique.
Dans ce dialogue, la France n'est cependant plus seule. L'époque où nous faisions l'histoire africaine est révolue. L'Afrique a multiplié les partenariats avec les nouveaux pays émergents.
Le type de coopération que nous proposons, le modèle de société que nous promouvons sont aujourd'hui concurrencés par des modèles complémentaires et parfois alternatifs.
C'est aujourd'hui à une Afrique pleinement intégrée à la mondialisation que nous devons nous adresser.
En 2050, le quart de l'humanité sera africain. Il faut désormais penser le monde en plaçant l'Afrique au coeur de nos analyses et donc aussi au coeur de nos choix et décisions.
Voilà le nouveau défi de la politique africaine de la France.
CHAPITRE 2 : HIER IGNORÉE, AUJOURD'HUI CONVOITÉE, L'AFRIQUE AU CENTRE DES RIVALITÉS MONDIALES
Dans les années quatre-vingt-dix, on pouvait lire dans un traité de relations internationales, sur lequel ont planché plusieurs générations d'étudiants en sciences politiques et futurs diplomates, la phrase suivante : « En cette fin de XX e siècle, dominée par la poursuite du formidable processus d'intégration mondiale, des régions demeurent en marge. ..... Ainsi en est-il de l'Afrique au sud du Sahara 25 ( * ) ».
On croyait l'Afrique isolée, déconnectée des transformations et des bouleversements en cours au sud de la planète.
Certes, l'Afrique a pris le train en retard, mais elle évolue désormais de plain-pied avec la mondialisation. Le décollage économique du continent n'aurait pas été possible autrement.
Non seulement les secteurs les plus évolués du continent sont directement branchés sur les réseaux financiers mondiaux, mais, même dans les zones les plus reculées, les nouvelles technologies ont fait entrer la modernité en Afrique pour le meilleur et pour le pire.
L'Afrique du siècle nouveau : c'est à la fois le Kenya qui concentre 50 % de l'activité mondiale du mobile banking , mais aussi les réseaux terroristes du Nord Mali qui se coordonnent par téléphone satellitaire.
Que l'on trouve des iPhones à Bamako est symbolique, mais finalement assez anecdotique. Ce qui a changé, c'est plus fondamentalement l'insertion de l'Afrique dans les échanges internationaux des biens, des capitaux et des idées.
I. UNE AFRIQUE DÉSORMAIS INTÉGRÉE DANS LA MONDIALISATION
Comme l'a déclaré le Président Barak Obama devant le Parlement du Ghana le 11 juillet 2009, « Le XXI e siècle sera influencé par ce qui se passera non seulement à Rome ou à Moscou ou à Washington, mais aussi en Afrique. C'est la simple vérité d'une époque où nos connexions font disparaître les frontières entre les peuples. ».
L'Afrique est entrée dans l'ère des économies intégrées et de l'instantanéité de l'information, dans une époque d'accélération des flux de capitaux et des échanges de biens et services, dans une période de montée en puissance des mouvements de population.
Il est vrai que longtemps l'Afrique est restée en marge des évolutions économiques et technologiques mondiales.
Symbole de cet isolement, l'Afrique subsaharienne représentait une part très limitée du commerce mondial et des investissements directs à l'étranger (IDE).
L'Afrique subsaharienne était la région du monde la plus confrontée aux difficultés d'accès aux marchés locaux, régionaux et mondiaux. Un manque d'infrastructures et la dépendance à l'exportation de matières premières constituaient des freins importants au développement du commerce au sein du continent et dans le monde.
Les pays d'Afrique subsaharienne faisaient aussi face à des barrières commerciales comme les taxes sur les importations ou les quotas, qui rendaient inopérante la mise en concurrence de leurs produits sur des marchés importants tels que les Etats-Unis, l'Europe et le Japon.
Au-delà des aspects économiques, l'Afrique était en butte à une fracture technologique avec un faible accès à Internet et à la télévision. En 2004, le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) titrait sur la fracture numérique et soulignait le fossé qui séparait l'Afrique du reste du monde.
Or depuis 10 ans, l'Afrique connaît une intégration dans les réseaux mondiaux à une vitesse et à un niveau sans précédent. Des difficultés demeurent, mais les dynamiques en cours illustrent l'intégration croissante du continent dans la mondialisation.
Les échanges dans les domaines du commerce, des voyages et des télécommunications se développent à un rythme soutenu dans la majeure partie de l'Afrique.
Le nombre de ressortissants africains qui se déplacent en dehors du continent n'a jamais été aussi élevé, notamment les professionnels des affaires, les touristes et les migrants.
A. LA FIN D'UN ISOLEMENT RELATIF
Premier témoin de cette interconnexion croissante de l'Afrique : le développement du trafic aérien qui a augmenté ces huit dernières années de 8,75 % en moyenne par an, soit le deuxième taux de croissance mondiale.
L'Europe reste la principale destination des vols intercontinentaux et concentre 56 % du trafic, mais les échanges avec la région Asie-Pacifique ne cessent de croître.
Le trafic global du pavillon africain sur les vols internationaux, avec notamment les trois premières compagnies africaines -South African Airways, Kenyan Airways et Ethiopian Airlines- a doublé au cours de la dernière décennie.
D'après les prévisions de l'association du transport aérien international en Afrique, le nombre d'avions de ligne devrait plus que doubler dans les vingt années à venir sur le continent. Et si les compagnies locales peinent à se regrouper pour atteindre des tailles critiques, les compagnies européennes ou du Moyen-Orient, mais aussi certaines compagnies africaines profitent déjà de l'augmentation du trafic.
Un nouvel eldorado pour les géants Boeing et Airbus et leurs concurrents
Ainsi pour John Leahy, le directeur commercial d'Airbus, « l'Afrique sera, d'ici une dizaine d'années, pour le transport aérien, « l'équivalent du Moyen-Orient», aujourd'hui. » 26 ( * ) .
Des taux de croissance du trafic maritime et aérien entre 8 et 12 % depuis une décennie
L'avion mais aussi le transport maritime profitent de l'ouverture du continent africain.
Les flux maritimes, tous modes confondus, affichent en Afrique des taux de 10 % à 12 % de croissance par an.
La croissance et les destinations du trafic maritime africain sont à l'image des exportations qui transitent à 95 % par voie maritime.
Les compagnies maritimes ne s'y trompent pas et réorganisent leurs flottes pour répondre au mieux aux évolutions de la demande africaine.
L'Afrique ne représente toujours que 3 % des volumes mondiaux, avec une quinzaine de millions d'EVP 27 ( * ) manutentionnés sur l'ensemble du continent en 2011.
Mais, au rythme actuel, le continent pourrait en traiter 38 millions dès 2020, selon les prévisions concordantes du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale, et devrait atteindre 176 millions d'EVP à l'horizon 2040.
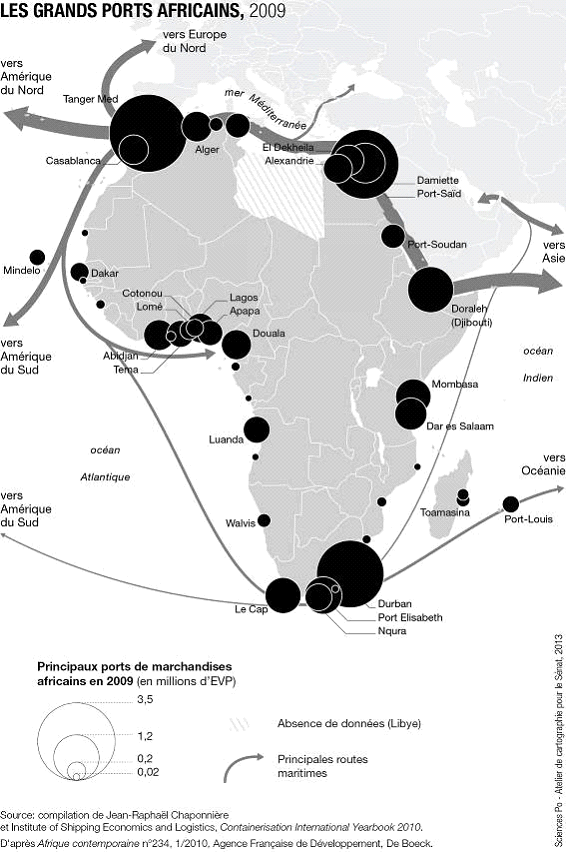
Cette augmentation est liée à la croissance du trafic enregistrée depuis 2000 sur l'axe Afrique-Asie, qui représente aujourd'hui un bon quart du commerce africain grâce à la Chine, pays avec lequel le continent échange le plus. 129 milliards de dollars ont été échangés par voie maritime entre la Chine et l'Afrique en 2010, soit 10 fois plus qu'il y a 10 ans.
Sur l'ensemble du continent, une hiérarchie portuaire sous-régionale s'orchestre autour de quelques grandes portes d'entrées adossées la plupart du temps à des marchés intérieurs régionaux importants : Abidjan, Tema et Dakar à l'Ouest, Luanda, Pointe Noire et Douala au Centre, Mombasa, Port Soudan et Dar es Salam à l'Est.
Une véritable révolution portuaire subsaharienne est en marche.
En moins d'une décennie, la part des intérêts privés dans l'exploitation des terminaux conteneurisés africains est passée de moins de 15 % à plus de 70 % : une véritable révolution portuaire subsaharienne est en marche avec des investissements colossaux à la clef.
Sur la façade ouest-africaine, le port marocain de Tanger a investi 7,5 milliards d'euros entre 2004 et 2012 qui ont permis la mise en service de Tanger Med et de ses infrastructures modernes, il y a cinq ans. Tanger Med n'est cependant pas un cas isolé.
Dans son sillage, les ports de toute la façade ouest-africaine ont clairement entrepris leur mue, à grand renfort de centaines de millions d'euros. Les installations obsolètes et les infrastructures sous-dimensionnées de la région entravaient le développement des pays côtiers comme de ceux de l'intérieur -en jouant le rôle de goulet d'étranglement à l'import comme à l'export. Mais la donne change. Entre Dakar et Cotonou, tous les grands ports généralistes ont, depuis le milieu des années 2000, lancé des projets de concession pour l'exploitation, la gestion et le développement des activités conteneurisées.
Sur la rangée Dakar-Douala, ce sont près de 2 milliards de dollars qui devraient être investis par les acteurs privés sur les terminaux à conteneurs.
« Nous investissons en moyenne 250 millions d'euros par an sur les ports africains », nous a indiqué Dominique Lafont, président de Bolloré Africa Logistics (BAL). Depuis que le groupe a remporté une première concession à Abidjan en 2003, les chantiers se succèdent, de la Guinée au Congo en passant par le Nigeria.
Longtemps la façade est-africaine a été caractérisée par sa pauvreté en infrastructures portuaires d'envergure. Seuls une quinzaine de ports disposent de quais, moins d'une dizaine de grues et de portiques. Déconnectés des grandes routes maritimes, installés historiquement sur des sites peu favorables à l'établissement de ports en eau profonde, les ports de la façade est ont également pris du retard en ne suivant pas le mouvement de passage au privé opéré sur la façade occidentale.
Mais la situation évolue à grande vitesse. DP World est arrivé en 2000 à Djibouti, où il a bâti le port à conteneurs de Doraleh, et en 2006 à Maputo, au Mozambique. Le gigantesque projet portuaire à Lamu, au Kenya, dont le budget s'élève à 19 milliards d'euros et celui - concurrent - de Bagamoyo, en Tanzanie, d'un montant de 7,6 milliards d'euros, ont été officiellement lancés en mars dernier. Ces projets succèdent aux investissements de l'Afrique du Sud dans les nouvelles infrastructures de Ngqura à quelque 20 km au nord-est de Port Elizabeth.
B. UNE INSERTION CROISSANTE DANS LES FLUX MONDIAUX DE MARCHANDISES ET DE CAPITAUX
Lors de la précédente décennie, les exportations africaines, elles, n'avaient que légèrement augmenté, passant de 126 milliards de dollars à 148 milliards de dollars, tandis que la part de l'Afrique dans le commerce mondial avait chuté de 2,9 % à 2,0 %.
Depuis, bien qu'encore faibles, les exportations africaines croissent à un rythme inégalé dans l'histoire du continent.
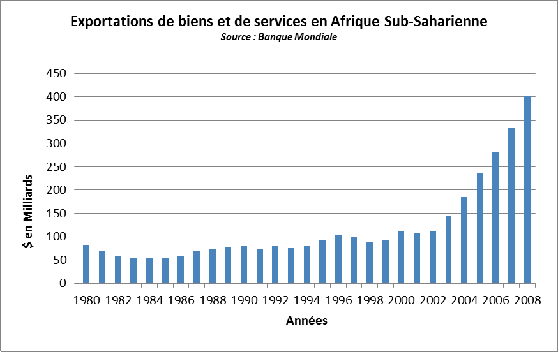
Selon des données de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement (CNUCED), ces exportations ont presque quadruplé en valeur entre 2000 et 2011 , passant de 148.6 à 581.8 milliards de dollars (USD).
Deux tendances se dessinent : la première porte sur le recul de l'Europe et des États-Unis dans les exportations africaines ; la seconde concerne l'intensification des relations commerciales avec les économies émergentes.
Bien que l'Europe demeure le principal partenaire commercial de l'Afrique, le commerce avec l'Asie - et la Chine en particulier - croît rapidement, en grande partie du fait des exportations de pétrole et de produits primaires.
En 2000, les économies émergentes absorbaient 8 % des exportations africaines - une proportion qui a bondi à 22 % en 2011.
L'Afrique s'ouvre et s'internationalise d'abord avec les pays émergents.
La Chine, l'Inde et le Brésil consomment toujours plus de produits africains : pétrole, matières premières et produits manufacturés. Les économies émergentes s'imposent sur les marchés d'exportation.
Malgré une nette augmentation de ses importations, l'Afrique conserve une balance commerciale excédentaire.
Alors que des progrès ont été observés en ce qui concerne les exportations de nouveaux produits, l'essentiel de cette croissance reste lié à l'explosion des prix du pétrole et des produits non manufacturés.
Faute d'une industrie performante, moins de 30 % des exportations de l'Afrique subsaharienne comprennent des produits manufacturés, par rapport à une moyenne de 70 % pour tous les pays en voie de développement.
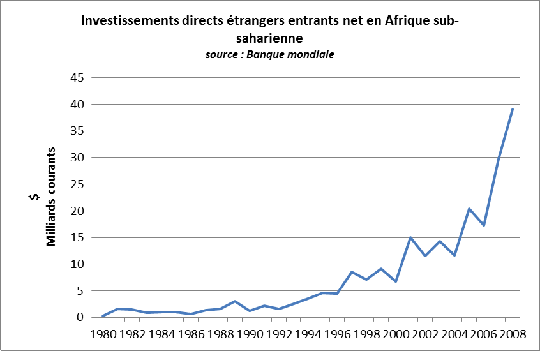
Sur le plan réglementaire et tarifaire, si de nombreuses difficultés persistent, l'Afrique a réalisé des progrès significatifs en matière de politique commerciale.
Les tarifs moyens africains sont désormais similaires à ceux des autres pays en développement et les restrictions quantitatives ont été largement limitées. Les taxes à l'exportation ont été largement supprimées. Des réformes ont été menées afin d'augmenter la compétitivité et d'investir dans des mesures de facilitation du commerce.
Au-delà du commerce, l'Afrique s'est très largement ouverte aux investissements directs.
Les investissements étrangers atteignent des niveaux sans précédent, même s'ils restent concentrés sur un nombre limité de secteurs (hydrocarbures, mines).
L'attractivité économique de l'Afrique subsaharienne s'est considérablement renforcée au cours des dix dernières années.
Elle a attiré l'attention des puissances émergentes, des puissances industrielles et des acteurs privés comme jamais, si bien que la part mondiale des Investissements Directs Etrangers (IDE) à destination de l'Afrique subsaharienne a doublé depuis 5 ans pour atteindre un peu moins de 6 % en 2012.
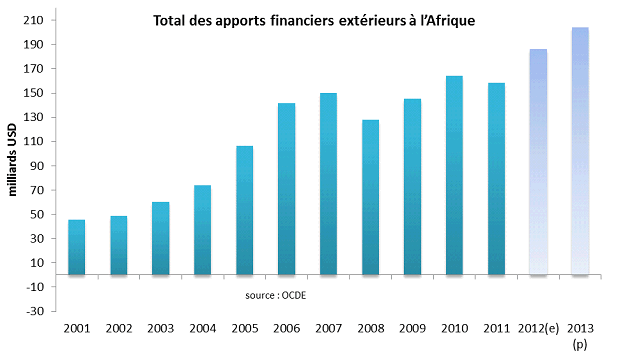
On a longtemps conservé l'image d'une Afrique assistée par l'aide au développement. Or, aujourd'hui, les investissements directs avoisinent les 50 milliards d'euros par an, auxquels s'ajoutent 20 milliards d'investissement de portefeuilles et près de 60 milliards de transferts de migrants.
L'apport des financements extérieurs privés aux économies africaines ont donc largement dépassé le poids de l'aide au développement qui culmine à 50 milliards de dollars. En 2003, l'APD représentait 45 % des apports financiers à l'Afrique, en 2013 elle ne devrait représenter que 28 %.
L'apport des financements extérieurs privés à l'Afrique est deux fois plus élevé que l'APD.
L'Afrique n'est plus un continent soutenu à bout de bras par des bailleurs de fonds. C'est un changement structurel que l'on ressent dans le discours de tous les responsables politiques que nous avons rencontrés.
Alors qu'en Afrique plusieurs ministres nous ont dit : « Nous n'avons pas besoin d'aide, mais d'investissements », à Paris, Mathieu Pigasse a insisté sur l'idée que « les Français doivent avant tout être présents en Afrique sous la forme d'investissements productifs (...) il faut oublier les schémas du passé, regarder les autres s'implanter dans ce qui deviendra demain un des plus gros marchés du monde ».
Le développement de la consommation, la richesse de ses sous-sols et de ses forêts et sa disponibilité en terres arables suscitent les convoitises, « boostent » sa croissance, et contribuent à multiplier le nombre des partenaires commerciaux qui viennent non seulement commercer avec l'Afrique, mais également s'implanter sur le continent dans les secteurs phares des services financiers, des infrastructures, de l'énergie, de l'agro-industrie, des télécoms et du BTP.
Dans ces secteurs, le capital-investissement international fait fureur tant les opportunités sont nombreuses.
La rentabilité des fonds de Private Equity en Afrique figure parmi la plus élevée au monde.
A titre d'exemple, en février 2012, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé une prise de participation de 50 millions de dollars au fonds du Groupe Carlyle basé aux États-Unis, lequel prévoit d'investir pas moins de 500 millions de dollars en Afrique subsaharienne. En mai, la Banque d'investissement brésilienne BTG Pactual a lancé un fonds de capital d'investissement d'un milliard de dollars axé sur l'Afrique. En 15 mois, de janvier 2011 à mars 2012, huit nouveaux fonds destinés à l'Afrique orientale et australe ont été lancés.
L'Afrique de l'Est compte à elle seule 16 fonds dédiés, sur 53 en activité dans la région. En mars, Deloitte, un cabinet de conseil international et Africa Assets, un cabinet de recherche et de conseil privé, ont publié une enquête menée auprès des délégués d'environ trois douzaines de fonds. Cette enquête a révélé que près des quatre cinquièmes d'entre eux prévoyaient d'accroître leurs dépenses l'an prochain.
Les chiffres globaux sont impressionnants, bien qu'un peu volatiles. Les opérations de capital-investissement en Afrique subsaharienne sont passées de 741 millions de dollars en 2003 à 1,3 milliard de dollars l'an dernier, avec des phases ascendantes et descendantes entre-temps, selon l'Emerging Markets Private Equity Association.
Autrement dit les fonds internationaux d'investissement se tournent vers l'Afrique qui commence à profiter à plein de la finance internationale.
La raison en est simple, nous a dit M. Luc Rigouzzo, qui dirige Amethis Finance (société de conseil en financement et investissements pour l'Afrique) avec un budget 200 à 300 millions d'euros en fonds propres et 200 à 300 millions en dette : « La rentabilité des investissements directs en Private Equity en Afrique figure parmi la plus élevée au monde».
C. UNE AFRIQUE CONNECTÉE.
Enfin, la dernière illustration de cette plongée dans la mondialisation est l'interconnexion croissante de l'Afrique à Internet.
L'Afrique affichait depuis deux décennies le plus faible taux de pénétration d'Internet dans le monde, les tarifs d'accès les plus coûteux au monde ainsi que l'absence de réseaux internationaux haute capacité.
Pourtant, l'utilisation des TIC a véritablement connu un boom ces dernières années sur le continent. Ainsi, selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), le taux de pénétration des téléphones portables sur le continent serait supérieur à 45 % et celui de l'Internet dépasserait les 10 % avec une croissance du nombre de lignes mobiles de 44 % par an, soit la plus forte croissance au monde !
L'internet se diffuse en Afrique grâce à l'Internet mobile.
En Afrique subsaharienne l'Internet mobile est désormais beaucoup plus développé que l'internet fixe.
Malgré le retard de l'Afrique en matière d'accès à haut débit, l'accès à Internet est en plein développement avec 25 millions de connections (Internet) et 57 réseaux 3G déjà déployés. Environ 3 milliards de dollars d'investissements cumulés sur la période 2010-2013. Le flux sur la bande passante internationale en Afrique est passé de 100 Giga bps en 2008 à 1 Tera bps (10 fois plus) en 2012. La multiplication de ces investissements va favoriser l'abaissement des prix. Une baisse des prix de bande passante de 20 % d'ici 18 mois est déjà estimée par les experts pour les grands pays africains.
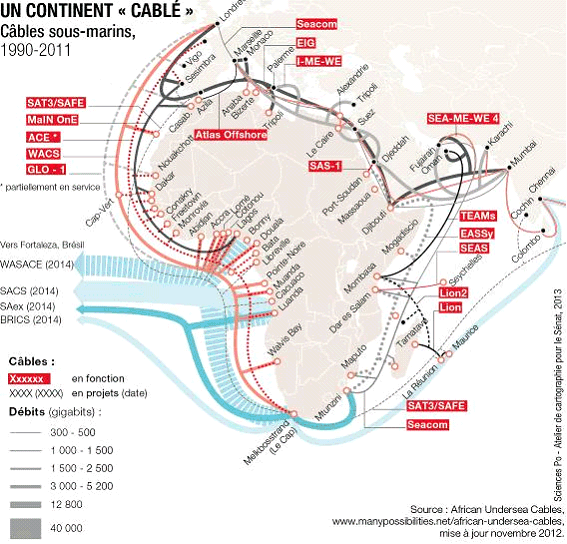
II. UN CONTINENT NAGUÈRE CONVOITÉ PAR LES SEULES PUISSANCES OCCIDENTALES
Non seulement l'Afrique est de plus en plus connectée aux mouvements économiques, technologiques, politiques et culturels mondiaux, mais elle est en train de devenir le lieu d'une confrontation pacifique où se joue un nouveau rapport de force entre les anciennes puissances coloniales et les nouvelles puissances émergentes.
« Les centaines de milliers de Chinois qui s'y précipitent ont une longueur d'avance. Ils séduisent les dictateurs, parce qu'ils investissent et ne parlent pas de démocratie, et les peuples, parce qu'ils construisent des routes ou des barrages. Les Occidentaux, la France surtout, se laisseront-ils évincer ? », pouvait-on lire dans « La Chinafrique : Pékin à la conquête du continent noir » paru en 2008.
Avec l'accélération des investissements chinois, nombre de Français ont eu le sentiment que la France n'est plus seule en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest. Mais, en vérité, elle ne l'a jamais été.
L'intérêt des puissances extra-africaines pour le continent africain n'est pas nouveau, comme en témoigne l'histoire coloniale qui, par bien des aspects, pèse encore en Afrique.
A. D'ANCIENNES PUISSANCES COLONIALES ENCORE TRÈS PRÉSENTES, CINQUANTE ANS APRÈS LES INDÉPENDANCES
Depuis toujours, l'Afrique et les grands empires africains qui ont précédé la colonisation ont attiré les convoitises.
On ne saurait comprendre la portée de l'émergence de ces nouveaux partenaires sans mesurer le poids de cette présence passée qui structure encore la sphère d'influence des pays européens en Afrique.
Lorsque l'intérieur du continent noir commence à être exploré, les tensions entre les principales puissances, notamment autour du bassin du Congo, rendent nécessaire l'organisation de la conférence de Berlin (novembre 1884-février 1885).
C'est sur cette base que l'Afrique fut divisée au cours des trente années suivantes entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal, mais aussi d'autres puissances européennes dont le passé colonial est moins prégnant : l'Allemagne (Tanganyika, Sud-Ouest africain, Togoland, Kamerun), l'Italie (Somalie, Tripolitaine, Erythrée), l'Espagne (Sahara espagnol, Guinée équatoriale).
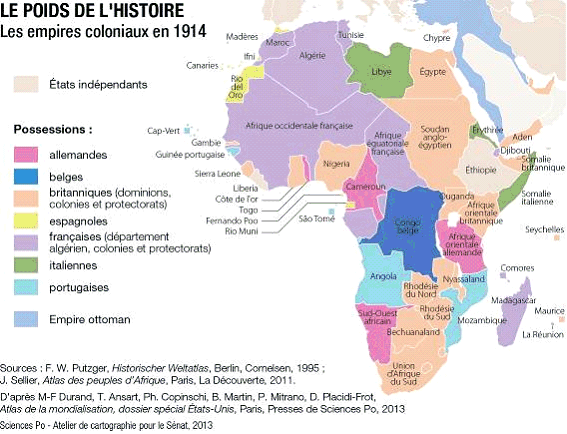
Néo colonialismes et impérialismes
Croire que la relation particulière entre la France et l'Afrique concerne tout le continent est une erreur que l'usage trop fréquent du terme générique « l'Afrique » laisse accréditer.
La relation franco-africaine varie considérablement selon qu'on se situe dans d'anciennes colonies, françaises ou pas. Cela ne signifie pas pour autant que la sphère d'influence française soit limitée aux seules colonies françaises.
Elle s'étend, en fait, peu ou prou, à l'ensemble de l'Afrique francophone. Ce qui inclut les colonies allemandes qui lui ont été confiées par la Société des Nations au lendemain de la Première Guerre mondiale (Togo, Cameroun) dont la relation aujourd'hui avec la France ne se distingue quasiment pas de celle qu'entretiennent les anciennes colonies françaises et les colonies belges (Zaïre, Rwanda, Burundi) sur lesquelles la France a exercé, depuis les années 1970, une influence importante.
Dépassant les limites des États francophones, l'influence de la France peut s'étendre à d'anciennes colonies espagnoles (la Guinée équatoriale) et portugaises (la Guinée-Bissao, le Cap-Vert, Sao-Tomé et Principe) : certaines utilisent le franc CFA (la Guinée équatoriale depuis 1985, la Guinée-Bissao depuis 1997), toutes ont adhéré à la Francophonie (la Guinée équatoriale depuis 1989, la Guinée Bissau depuis 1979, le Cap-Vert depuis 1996, Sao Tomé depuis 1999).
Mais, dans ces quatre pays-là, comme d'ailleurs dans les trois anciennes colonies belges, la place de la France n'est pas aussi importante que dans ses anciennes colonies. Sans évoquer le cas particulier du Rwanda, la Guinée Bissau, pour ne citer qu'elle, est un exemple de pays africain situé aux marges du « pré carré » : entourée de pays francophones, le Sénégal au nord, la Guinée à l'ouest, le pays a intégré l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ; mais la Guinée-Bissao, membre depuis sa fondation en 1996 de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), conserve des liens étroits avec le Portugal, son deuxième fournisseur (derrière le Sénégal).
La fracture africaine la plus évidente est celle qui sépare les États francophones et anglophones en Afrique. Il est étonnant de constater combien ces États diffèrent de leurs voisins francophones. La France est presque totalement absente de la Gambie, du Ghana, de la Sierra Leone ou du Liberia. Elle est encore peu présente en Afrique du Sud, au Nigeria ou en Angola sinon dans le secteur des hydrocarbures.
En effectifs, la coopération française semble être restée concentrée sur les anciens pays « du champ ». La présence diplomatique dans les anciennes colonies britanniques est encore embryonnaire : l'ambassade de France à Abuja (Nigeria) est moins importante que celle de Niamey (Niger).
Si on restreint l'analyse au seul « pré carré », la France fut sans doute longtemps en situation de quasi-monopole.
Même si, pendant la Guerre froide, l'Afrique fut l'un des terrains d'affrontement des grandes puissances, la France veilla jalousement à empêcher toute infiltration communiste dans son domaine africain. Mais ces jeux d'ombre n'eurent finalement guère d'impact sur la réalité quotidienne de l'Afrique où ni les Américains ni les Soviétiques, ni même les Chinois, ne s'implantèrent durablement : que le Bénin, le Congo ou Madagascar aient flirté quelques années avec le marxisme-léninisme n'a en définitive pas changé grand-chose à leur relation avec Paris.
C'est au regard de cette histoire que l'irruption de la Chine puis de l'ensemble des pays émergents a été perçue à Paris comme une intrusion dans ce qui apparaissait, dans l'esprit de certains, comme des dépendances de la France, dans le sens originel de la Françafrique telle que l'envisageait Félix Houphouët Boigny.
Il est clair aujourd'hui que ce discours, qui transparaît parfois dans les propos de certains responsables politiques français, est, cinquante ans après les indépendances, décalé.
Le souvenir, la nostalgie d'une époque où la France « faisait l'histoire » de l'Afrique, peut expliquer ces dérapages. Comme nous l'a dit un ambassadeur d'Afrique de l'Ouest : « Vous ne devriez pas céder du terrain, vous restez un allié incontournable, mais il est temps de changer de discours, vous n'êtes pas nos grands frères, nous sommes majeurs, vaccinés, maîtres de nos destins, responsables devant nos opinions publiques, libres de choisir nos amis, nos partenaires, nos financements ».
Le pragmatisme anglais
Autre ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne est également l'héritière d'une longue tradition africaine. Elle n'a cependant pas, ni avant, ni après les indépendances, investi de la même façon que la France sa politique africaine. Sa diaspora, moins nombreuse que la française, est surtout concentrée en Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, au Kenya, au Zimbabwe et au Nigéria.
L'arrivée de Tony Blair à la tête du gouvernement a cependant marqué un renouveau de la politique africaine britannique, en particulier dans le domaine de la coopération au développement, avec la création du Department for International Development (DfID) en mai 1997, la loi sur le développement international de 2002 (International Development Act 2002), renforcée par une loi de 2006 qui fixe clairement pour objectif de faire reculer la pauvreté, en particulier par l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En quelques années seulement, grâce à une volonté politique affirmée des plus hauts dirigeants notamment inspirés par des valeurs d'inspiration chrétienne, les Britanniques sont devenus les leaders de la pensée sur l'aide au développement.
Depuis 2010, le gouvernement de coalition s'est inscrit dans la continuité du Labour, affirmant en particulier sa volonté « d'honorer notre (leur) engagement de consacrer 0,7 % du PIB à l'aide au développement à partir de 2013 et d'inscrire cet engagement dans la loi » (point 18 du contrat de coalition de mai 2010). La dotation du DfID (avec celle accordée à la Santé) fait ainsi figure d'« exception budgétaire ». Sur la période 2010-2015, dans un contexte de restrictions budgétaires sans précédent, les ressources du DFID devraient augmenter de 35 % en termes réels, avec une hausse des dépenses en capital de 20 %.
Or cet effort qui, on le verra, contraste avec celui de la France, tant du point de vue des montants que de la composition de l'aide entre prêts et dons, bénéficie d'abord à l'Afrique. Le continent noir percevra environ 58 % des dotations sur la même période, notamment via une dotation régionale de 813 M£ sur cinq ans. On retrouve, parmi les 27 pays qui bénéficient de la coopération britannique, 16 pays africains, avec d'abord l'Afrique du Sud, la RDC, le Nigeria, l'Ethiopie, mais aussi le Ghana, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.
Parallèlement, l'Initiative de la Commission pour l'Afrique, l'International Finance Facility , prévoit un accroissement de 25 milliards de dollars d'aide sous forme de prêts remboursés par le G7 et l'appui au NEPAD.
L'Afrique est également vue comme un marché en devenir pour les entreprises britanniques qui y ont investi 30,5 milliards de dollars dans des opérations de fusions-acquisitions entre 2000 et 2010.
Si on a à l'esprit les anciennes puissances coloniales que sont la France et la Grande-Bretagne, on a tendance à oublier le Portugal.
Un Portugal, encore influent
Le Portugal a su tirer profit de son héritage historique et a fait de ses anciennes colonies des alliés stratégiques dans sa politique africaine.
La proximité politique et économique qui lie Lisbonne au continent s'illustre d'abord au sein de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP). Les membres africains de la CPLP sont le Cap Vert, la Guinée Bissau, le Mozambique, l'Angola, Sao Tomé et Principe. La CPLP regroupe 240 millions d'habitants et s'étend sur une superficie comparable à celle des Etats-Unis ou du Canada. Basée à Lisbonne et présidée depuis 2012 par le mozambicain Murade Isaac Murargy (diplômé de la faculté de Lettres de Lisbonne), la CPLP est le principal outil de la diplomatie d'influence portugaise en Afrique.
Ainsi, les membres africains de la CPLP sont les premiers partenaires commerciaux du Portugal. La société d'exploitation d'hydrocarbures portugaise Galp Energia est ainsi implantée dans l'ensemble de ces pays et sa présence remonte à 1957, au Mozambique. Leader sur le marché de la Guinée-Bissau et très implantée en Angola, Galp Energia se développe de plus en plus en Afrique. De la même façon l'entreprise portugaise Mota Engil, leader national de la construction et du génie civil est très présente en Afrique : en 2012, elle a réalisé 35 % de son chiffre d'affaires, d'un total de 2,1 milliards d'euros, sur le continent.
Sur le plan diplomatique, le Portugal a fait de ces pays des alliés de choix sur la scène internationale. C'est notamment grâce au soutien des pays africains que Lisbonne a pu obtenir un siège de membre non-permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU pour l'année 2011-2012. Fort de sa présence au sein de l'organe exécutif des Nations Unies et désireux de jouer un rôle actif dans la crise la crise politique qui a touché la Guinée Bissau, le Portugal a permis l'adoption, le 18 mai 2012, de la résolution 2048 qui met en place un régime de sanctions à l'encontre des principaux auteurs du coup d'Etat et appelle à la « restauration d'un processus électoral ».
Deuxième investisseur au Mozambique et premier partenaire en termes de coopération et de développement pour la Guinée Bissau, le Portugal est résolument tourné vers ses anciennes colonies. Luanda est ainsi le principal client de Lisbonne hors UE et son 4 e partenaire commercial mondial.
Ironie de l'histoire et signe des temps, suite à la crise financière portugaise et au décollage économique angolais, c'est au tour de l'Angola d'investir au Portugal. Les investissements angolais dans le marché portugais sont passés de 1,6 à 116 millions d'euros de 2002 à 2009. La situation est telle que le directeur général du géant angolais Sonagol, peut déclarer « Notre pari sur le Portugal est réel et durable » . Une banque d'investissement a été créée par la caisse des dépôts du Portugal et Sonagol afin de faciliter le développement d'infrastructures et d'industries lourdes avec son siège en Angola. Face à la cure d'austérité à laquelle est soumis le pays, les flux de migrations du Portugal vers l'Angola sont plus importants que ceux de l'Angola vers le Portugal, l'ancienne colonie fait ainsi figure d'eldorado pour les salariés portugais.
Enfin, face à l'influence croissante des grands émergents sur le continent, le Portugal bénéficie d'un avantage sur les anciennes puissances coloniales : sa relation privilégiée avec le Brésil. Leur appartenance à la CPLP en fait des partenaires de longue date du continent africain, pour des raisons différentes. C'est dans ce cadre que se posent les prémices d'une politique de coopération en matière de développement durable : le Portugal, le Brésil et l'Angola ont ainsi signé un protocole d'entente en juin 2012 qui prévoit une coopération en matière de traitement des résidus de production industrielle afin de préserver l'environnement.
Sans doute l'arrivée de nouveaux partenaires du Sud modifie la relation aux anciennes puissances coloniales. Mais il est frappant de constater que leur influence, notamment à travers la langue, reste considérable.
B. LES DEUX SUPERPUISSANCES DE LA GUERRE FROIDE TOUJOURS LÀ VINGT ANS APRÈS LA CHUTE DU MUR.
Seuls parmi les nations occidentales à être des partenaires traditionnels de l'Afrique sans être d'ex-puissances coloniales, les Etats-Unis et la Russie conservent en Afrique une influence stratégique et financière incontournable.
On a coutume de dire que la fin de la Guerre froide, ayant fait perdre sa valeur stratégique à l'Afrique, a provoqué le désintérêt des grandes puissances pour le continent.
Il est vrai qu'un temps, tout s'est passé comme si les institutions multilatérales remplaçaient les chancelleries diplomatiques au chevet de l'Afrique. Elles ont notamment été de puissants véhicules d'une conception ultralibérale de l'économie de l'Etat. La décennie des ajustements structurels a imposé le « consensus de Washington » sur l'ensemble du continent, contribuant à l'assainissement des finances publiques, à un recentrage de l'Etat sur les fonctions régaliennes conforme à la vision anglo-saxonne de la puissance publique.
Ces ajustements structurels, synonymes d'un désengagement brutal de l'Etat de secteurs clés de l'économie nationale, se sont malheureusement accompagnés d'une diminution de l'aide publique au développement de toute façon incapable d'en atténuer les conséquences sociales. Cette « décennie perdue » a justifié une nouvelle mobilisation de la communauté internationale avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement et l'annulation de la dette.
USA : Trade and order
Les États-Unis de Bill Clinton manifestaient déjà à l'égard de l'Afrique un intérêt jamais enregistré. L' African Growth and Opportunity Act, adopté en mai 2000 par le Sénat, prévoyait de favoriser les échanges commerciaux entre l'Afrique et les Etats-Unis, les parties signataires s'engageant à respecter les principes du libéralisme économique ; cet accord se concentrait surtout sur le pétrole.
Treize ans plus tard, la structure des relations commerciales africano-américaines n'a guère évolué. La moitié des IDE américains envoyés en Afrique sont destinés aux pays extracteurs d'hydrocarbures et de minerais et, malgré l'appétit chinois, les Etats-Unis restent le premier importateur du pétrole africain (30 % des exportations du continent). Ces ressources africaines aimantent ainsi les majors pétrolières américaines indépendantes, telles qu'Exxon Mobil ou Conoco Philipps, très présentes en Afrique.
Le golfe de Guinée est désormais considéré comme une alternative cruciale à la dépendance américaine aux importations d'hydrocarbures venus des pays arabes. Les entreprises américaines, qui ont investi plus de 40 milliards de dollars dans cette zone entre 1995 et 2005, ont effectué 30 milliards de dollars d'investissements supplémentaires entre 2005 et 2010. Cette stratégie économique est facilitée au Nigeria, en Guinée équatoriale et à São Tomé car ces Etats autorisent les sociétés étrangères à être majoritaires dans les consortiums pétroliers.
Le secteur minier africain attire également les firmes d'outre-Atlantique afin d'extraire des diamants, du cobalt, de l'uranium ou encore du platine des pays possédant des sous-sols riches. L'activité de Newmont Mining, numéro 2 mondial de l'extraction d'or, est particulièrement représentative de cet appétit américain : 20 % de ses actifs mondiaux se trouvent au seul Ghana.
Au-delà des matières premières, les entreprises de la Silicon Valley s'intéressent également à l'Afrique subsaharienne. Si Google ou Intel ne cessent de développer leurs implantations sur le continent, c'est Microsoft qui est le partenaire américain le plus ancien de l'Afrique dans ce domaine. Présent depuis 1992, l'entreprise de Bill Gates a lancé cette année le projet « Initiative Microsoft 4Afrika » qui vise à aider les projets d'entreprenariat africain innovant en matière de technologie. On note que le budget de la Fondation Gates consacré à l'Afrique s'élevait à 2 milliards de dollars en 2012, contre un somme prévue de 1,09 milliard pour l'OMS sur l'année 2012-2013. Enfin, le géant américain de la distribution Wal-Mart a accédé aux marchés africains en 2011, en rachetant le sud-africain, Massmart, numéro 3 de la distribution en Afrique.
Mais cette diversification des investisseurs américains reste cependant anecdotique face à la prédominance de l'exploitation de matières premières. Alors que l'AGOA expire en 2015, son prolongement est aujourd'hui capital pour la stratégie économique américaine : il convient désormais de parvenir à un réel transfert de technologies et de savoirs afin de permettre l'essor économique et politique du continent.
Alors que l'élection d'un président d'origine kényane en 2008 a renforcé les attentes africaines envers les États-Unis, la politique africaine d'Obama s'est inscrite dans la continuité de celle des administrations précédentes d'objectifs généraux tels que la lutte contre le terrorisme, le renforcement des institutions démocratiques, le développement de la croissance économique ou encore l'établissement de la paix et de la sécurité.
Sa visite d'Etat en juin et juillet 2013 a été l'occasion de réaffirmer les positions diplomatiques américaines de Washington. Le président Obama a achevé son tour en Tanzanie, où il s'est recueilli sur le mémorial dédié aux victimes de l'attentat terroriste perpétré contre l'ambassade des Etats-Unis en 1998, en compagnie de G.W Bush. Image forte de ce séjour, cette visite des deux présidents réaffirme l'engagement des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.
C'est dans ce cadre qu'a été créée en 2007 l' Africa Command (AFRICOM), unité militaire américaine responsable des relations avec les nations africaines, et chargée de combattre les menaces transnationales, d'assurer un environnement sécurisé propice à la bonne gouvernance et au développement et de protéger les intérêts américains.
Cette unité militaire oeuvre en faveur d'une Afrique sûre et stable, définie comme un intérêt national pour les Etats-Unis. Forte de 2000 personnes et d'un budget de 276 millions de dollars en 2012, l'AFRICOM déploie ses opérations depuis son quartier général basé à Stuttgart, en Allemagne, faute d'avoir trouvé un pays d'accueil adéquat en Afrique.
L'armée américaine possède néanmoins des bases sur le continent. L'essentiel des moyens est déployé à Djibouti sur la base de Camp Lemonnier, qui est également la principale base de drones américains dans le monde. Mais le continent africain est également parsemé de « mini-bases » que l'on retrouve dans un grand nombre d'Etats africains, en particulier dans la zone qui va du Golfe de Guinée à la Corne de l'Afrique, notamment en Éthiopie, au Kenya et au Niger, qui permettent de surveiller, entre autres, l'évolution du mouvement Al Shabab, les actions de Boko Haram au Nigéria ainsi que l'organisation des groupes terroristes au Sahel. La présence militaire américaine en Afrique sert également la formation des militaires locaux à travers le contingent d'assistance et d'entraînement de l'AFRICOM, l'ACOTA, avec des résultats assez inégaux selon les pays.
Les Américains revendiquent notamment la formation des armées du Burundi, de Djibouti, du Kenya, de la Sierra Leone et de l'Ouganda qui participent désormais à la mission de l'Union Africaine en Somalie (AMISOM). L'armée américaine a également massivement investi dans la formation des militaires maliens durant plusieurs années ; jusqu'en 2012. 600 millions de dollars ont été déboursés par le Pentagone avec le résultat que l'on sait : certains militaires maliens d'origine touarègue ont rejoint la rébellion, apportant ainsi leur savoir aux jihadistes, tandis que le capitaine Sanogo, formé par l'US Army, a organisé le putsch contre le gouvernement malien en mars 2012.
Si cet investissement et ses résultats reflètent la difficulté de ce type d'exercice et sans doute une connaissance encore lacunaire des réalités africaines de la part des militaires américains, il met aussi en évidence l'importance de la sécurisation du continent pour Washington.
Enfin, les Etats-Unis s'illustrent par un effort conséquent en matière de coopération au développement de l'Afrique.
Développement économique, bonne gouvernance et démocratie allant de pair avec la paix et la sécurité, les administrations successives ont beaucoup investi dans l'APD, d'une valeur nette de 30,75 milliards USD en 2011, faisant de la Maison-Blanche le premier fournisseur de coopération pour le développement en Afrique.
Le Président Obama souhaite en effet recentrer l'approche américaine de l'Afrique sur d'autres aspects que le volet sécuritaire. L'importance des institutions démocratiques a été soulignée à maintes reprises dans les discours officiels ainsi que dans le choix des pays africains visités par l'administration Obama : le Ghana, le Sénégal, le Togo, le Bénin ou encore le Cap vert ont été choisis après la tenue d'élections transparentes.
Promouvant une politique de partenariat plus que de parrainage, les États-Unis ont également valorisé l'importance de la jeunesse sur le continent, perçue comme un ensemble de dirigeants en devenir qui sont la clé de l'autonomie politique et économique du continent. Lors de sa visite en Afrique du Sud à l'été 2013, le Président Obama a ainsi rencontré des étudiants, symboles du futur faste et démocratique de l'Afrique.
La mise en place de programmes de partenariats économique, militaire et d'aide au développement montrent que les Américains ont pris conscience de l'enjeu africain, tant sur le plan de leur approvisionnement énergétique que sur le plan diplomatique. L'Afrique est, pour Washington, l'une des clés de la sécurité mondiale.
Russie : Le dividende de l'anti-colonialisme
De son côté, la Russie a progressivement renoué avec l'Afrique.
On se souvient de son omniprésence sur le continent durant la Guerre froide, avec près de 40 000 « conseillers » répartis sur 40 pays. L'Union soviétique soutenait les indépendances africaines dans les années 1960 et apportait son aide à la lutte contre l'apartheid (Namibie), au gouvernement socialiste (Mozambique) ainsi qu'au régime révolutionnaire (Somalie).
L'URSS fournissait alors du matériel civil et militaire en Afrique et collaborait avec les Cubains présents sur le territoire afin de défendre les intérêts communistes. Mais cette omniprésence avait un prix : à la veille de l'effondrement de l'URSS, les échanges avec l'Afrique s'élevaient à 3 milliards de dollars par an. Il s'agissait en fait de livraisons d'Etat à crédit, l'Union soviétique envoyant des marchandises en Afrique sans qu'il y ait un véritable mouvement de retour. La dette commerciale africaine atteignit ainsi la somme considérable de 25 milliards de dollars, dont 14,3 pour l'Afrique noire, déstabilisant profondément l'économie soviétique qui ne pouvait assurer les ambitions géostratégiques planétaires de ses dirigeants.
Durant la décennie 1990, la Russie fédérale dut faire face aux problèmes de restructuration interne hérités de l'URSS et fut pratiquement absente du continent : la part de l'Afrique dans les importations russes passa de 2,5 % en 1986 à 0,4 % en 2001.
C'est dans ce contexte que s'est opérée la « renaissance africaine » de la Russie (Mikhaïl Lebedev), marquée par l'accueil à Moscou des présidents de l'Algérie, de l'Egypte, du Nigeria, de la Guinée et du Gabon, en 2001. Le président Poutine a entrepris sa première tournée africaine en Afrique du Sud et au Maroc en 2006, deux partenaires stratégiques de la Russie, afin de développer la nouvelle diplomatie « multipolaire » souhaitée par le Kremlin, visant à rétablir l'image de superpuissance du pays. Il s'agit pour la Russie de « trouver un nouveau champ de travail » (Vladimir Poutine) sur ce continent afin de développer des liens bien différents de ceux conservés par les anciennes puissances coloniales.
M. Poutine promettait ainsi « des milliards de dollars d'investissements » en Afrique du Sud, un pays avec lequel les liens historiques sont très forts, Moscou ayant soutenu le Congrès national africain sous l'apartheid, ce qui n'a pas été oublié par les dirigeants sud-africains. Les perspectives de coopérations bilatérales concernent le domaine minier, la société russe Renova et la société sud-africaine Harmony gold Mining ayant signé un accord-cadre concernant l'exploitation des minerais dans les deux pays. Des accords de coopérations ont également été conclus concernant l'extraction du diamant entre le géant russe Alrosa et le groupe De Beers. La Russie est enfin le premier fournisseur d'uranium enrichi de la centrale nucléaire de Koeberg, la seule sur le continent africain.
En 2009, le président Medvedev a effectué une vaste tournée africaine, axée sur quatre pays stratégiques que sont l'Angola, la Namibie, l'Egypte et le Nigeria, afin de mettre en place une « diplomatie des matières premières ». Ce voyage a été l'occasion pour les entreprises gazières et pétrolières russes de mettre en place des projets de coopération avec les entreprises nationales, négociant ainsi des contrats colossaux tels que la création de la filiale russo-nigériane Nigaz, qui permettrait à Gazprom d'aider le Nigeria dans l'exploitation de ses ressources de gaz naturel et de pétrole brut, qui font de lui le dixième producteur mondial d'hydrocarbures.
Enfin sur le plan politique, la Russie bénéficie d'un capital sympathie auprès des Etats africains en raison de son opposition au colonialisme et de l'important soutien qu'elle a fourni aux mouvements révolutionnaires sur le continent durant la Guerre froide. Elle bénéficie toujours aussi du réseau des anciens étudiants formés en URSS qui exercent des responsabilités dans les administrations de nombreux pays africains.
Finalement, les liens politiques qui existaient entre la Russie et l'Afrique ont résisté à l'épreuve du temps, ce qui permet à Moscou de pouvoir développer rapidement sa nouvelle stratégie diplomatique sur le continent. Cependant, les dix années d'absence ont entraîné un retard russe sur le plan économique : le Kremlin doit faire face à l'expansion chinoise sur les marchés africains alors même qu'elle ne possède pas la puissance industrielle de l'Empire du Milieu. C'est donc grâce à la « diplomatie des matières premières » que la Russie entend rétablir son statut de grande puissance sur le continent, vingt-cinq ans après l'effondrement de l'URSS.
Les puissances économiques occidentales s'intéressent donc de près à l'Afrique, qui n'est plus perçue comme un continent à la marge, nécessitant un important soutien humanitaire, politique et économique, mais comme un partenaire fort de potentialités économiques dynamiques.
Mais le plus intéressant est cependant ailleurs. L'Afrique n'est plus seulement l'affaire des « vieilles » puissances du G7/G8. Elle suscite l'intérêt croissant des États émergents : Chine, Inde, Brésil, Turquie... La nouveauté est double : d'une part, des puissances moyennes développent une politique globale dans une région du monde exotique et marginale avec laquelle elles avaient jusqu'alors peu de liens ; d'autre part, l'Afrique, longtemps exclue des affaires du monde, semble au coeur d'une rivalité planétaire comme elle n'en avait plus connue depuis la fin du XIX e siècle.
III. DE NOUVEAUX PARTENAIRES DU SUD À L'ASSAUT DU CONTINENT AFRICAIN
« Regardez, les avions à destination de l'Afrique sont aujourd'hui peuplés de Chinois, d'Indiens et de Brésiliens, écoutez les annonces d'Air France vers l'Afrique, certaines sont en chinois », nous a dit un homme d'affaires français.
L'Afrique est-elle en train de devenir la Chine de demain au sens figuré comme au sens propre ?
Les estimations diffèrent, mais il y aurait aujourd'hui environ 1 million de Chinois sur le continent. Beaucoup sont ingénieurs, d'autres travaillent sous le soleil africain en tant qu'ouvriers, on trouve également des professionnels de la santé, des directeurs d'entreprises d'import-export, des marchands installés sur le bord des routes, des cuisiniers, etc.
L'engagement de la Chine en Afrique n'est pas exempt de controverses. « La Chine remplace l'Occident : ils prennent nos matières premières et vendent des produits finis à travers le monde », nous a-t-on dit en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire.
Si certains intellectuels africains ironisent en constatant qu'après « le bâton occidental, les Africains courent après la carotte chinoise », les autorités, elles, accueillent à bras ouverts ces nouveaux partenaires qui apportent à l'Afrique « ce dont elle a besoin : des investissements ».
Mais on aurait tort de se focaliser sur la Chine. Le mouvement concerne tous les pays émergents du Sud et les puissances moyennes du Maghreb, d'orient et d'extrême orient.
Il faut voir la progression des intérêts marocains, turcs et coréens pour y croire.
L'appétit suscité par les ressources minérales et les marchés africains conduit vers l'Afrique des responsables politiques et des hommes d'affaires de tous les continents. Elle attire les investisseurs marocains, turcs, indiens, brésiliens, coréens ou japonais pour n'en citer que quelques-uns, qui multiplient les salons pour profiter du décollage africain.
Hier ignoré, aux lendemains de la Guerre froide le renouveau africain en a fait un continent convoité. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Comment se traduit-il ? En flux commerciaux, en investissements ? Dans quels secteurs ? Dans quels pays ? Avec quelles retombées politiques ?
A. LES PARTENAIRES TRADITIONNELS CÈDENT DE LA PLACE
Alors que le commerce extérieur africain était quasiment exclusivement orienté vers l'Europe et l'Amérique du Nord, la Chine, l'Inde, le Brésil font depuis quelques années une apparition fracassante dans la liste des principaux partenaires commerciaux des pays africains.
En effet, le montant des échanges commerciaux avec l'Inde a été multiplié par 30 entre 2000 et par 20 avec la Chine.
En 2009, la Chine a dépassé les États-Unis et est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique loin devant la France. Elle est aussi en train de devenir le premier bailleur de fonds du continent.
L'ancien Président chinois Hu Jintao a annoncé en 2012 que la Chine doublerait ses crédits au continent africain pour atteindre un montant annuel de 20 milliards de dollars de prêts non concessionnels, soit pratiquement dix fois plus que l'APD déclarée de la France en 2010 !
De façon générale, les relations économiques avec les nouveaux partenaires ne se limitent plus aux échanges commerciaux, mais concernent également deux autres importants vecteurs de changement en Afrique : les investissements directs étrangers et l'aide au développement.
Et ce phénomène ne concerne pas seulement la Chine, mais l'ensemble des pays émergents.
Entre 2000 et 2009, la totalité des échanges de l'Afrique avec les pays émergents (les importations et les exportations) a plus que doublé, passant de 247 à 629 milliards de dollars.
Au début de la décennie 2000, les partenaires « traditionnels » de l'Afrique, principalement l'Amérique du Nord et l'Europe, représentaient 77 % de ces échanges ; en 2009, leur part était tombée à 61,5 %.
Au cours de la même période, celle des partenaires « émergents » est passée de 23 % à 38,5 %.
La progression est particulièrement marquée pour la Chine - sa part a presque triplé, de 4,7 % à 13,9 % -, et l'Inde n'est guère en reste - sa part a plus que doublé, de 2,3 % à 5,1 %.
Depuis vingt ans ces deux courbes progressent au même rythme, l'une décline, l'autre augmente. Elles vont bientôt se croiser.
Après des siècles d'hégémonie sur le commerce africain, les pays occidentaux au premier chef desquels les anciennes puissances coloniales auront cédé leur place aux pays du Sud, aux anciens pays en développement, devenus émergents.
Déjà en 2011, pour la première fois, la contribution des pays du Sud à la croissance mondiale avait supplanté celle du Nord.
L'inversion des pôles de croissance entre le Nord et Sud est en route, l'Afrique risque d'en être un acteur pivot.
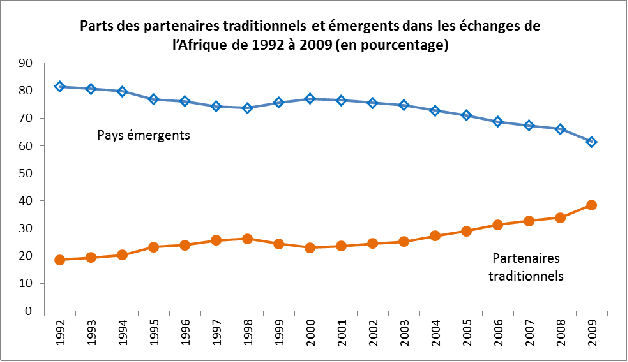
Le changement est moins spectaculaire s'agissant de l'investissement : les partenaires traditionnels de l'Afrique semblent encore détenir la part du lion grâce à un stock d'investissement accumulé depuis la colonisation.
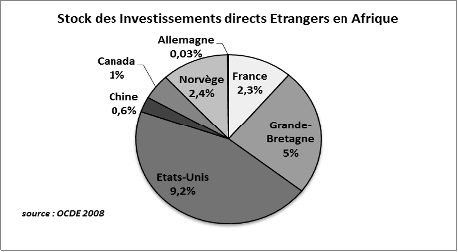
Cependant, les estimations d'une étude portant sur 11 pays africains laissent penser que, là aussi, les économies émergentes jouent un rôle de plus en plus important : leur part dans le flux annuel de l'investissement direct étranger (IDE) a presque doublé entre la première et la deuxième moitié des années 2000, passant de 5,6 % à 10,2 %, avec un quadruplement de la part de l'Inde de 0,4 % à 1,7 %.
Les études de l'OCDE attestent également des efforts croissants que déploient les économies émergentes en matière de coopération pour le développement, un phénomène qui attire de plus en plus l'attention.
Contrairement aux bailleurs de fonds traditionnels, la plupart des économies émergentes ne notifient pas de données sur l'aide à l'OCDE. Et lorsqu'elles le font, l'aide publique au développement (APD) ne correspond pas toujours à la même définition, d'où la difficulté de comparer précisément donneurs traditionnels et nouveaux donneurs. La prudence est donc de mise lorsqu'on analyse toute estimation.
Néanmoins, il est clair, depuis quelques années, que l'ampleur de ces efforts va en augmentant et que des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Venezuela jouent un rôle toujours plus significatif en matière d'aide.
Selon une série d'estimations, la part de ces nouveaux partenaires du développement dans l'APD mondiale est passée de 1,7 % en 1995 à 12 % en 2008, et elle devrait atteindre 20 % en 2015.
Si l'ampleur de ces activités de coopération sud-sud est révélatrice, la façon dont les économies émergentes s'impliquent avec leurs partenaires de développement est peut-être plus frappante encore.
Toute généralisation est risquée, mais les nouveaux bailleurs de fonds se caractérisent souvent par une approche différente de la coopération en mettant l'accent sur les avantages réciproques, la fourniture d'infrastructures, les projets plutôt que le soutien budgétaire général. Leur aide est souvent liée à des contrats avec des entreprises de leur pays.
Les coopérations occidentales légitiment leurs actions au nom d'objectifs généraux, d'avantages collectifs à plus long terme, comme l'amélioration de la sécurité mondiale et la création de nouveaux marchés ou encore la réduction des inégalités et la protection des biens publics mondiaux.
Les nouveaux partenaires sont plus susceptibles de chercher des résultats immédiats, la coopération étant souvent présentée comme une relation « gagnant-gagnant » globale dans laquelle investissement économique et initiative classique de développement se confondent.
« Moins de sermons, plus d'aide concrète », la coopération des économies émergentes est aussi assortie de moins de conditions, notamment en termes de responsabilité sociale et environnementale.
Alors que les coopérations émergentes sont très fortement influencées par des considérations liées à la politique étrangère et à l'économie, elles bénéficient d'un avantage comparatif lié à l'histoire en revendiquant une communauté de destin face aux anciennes puissances coloniales et une meilleure « compréhension » des problématiques de terrain.
Au-delà de ces caractéristiques communes, chaque pays entend renforcer à sa façon ses relations avec l'Afrique.
B. LES GRANDS ÉMERGENTS À MARCHE FORCÉE
Nous avons assisté au dernier sommet des BRICS à Durban en 2013. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui rassemblent 43 % de la population et produisent le quart du produit intérieur brut (PIB) de la planète ont affirmé leur volonté de participer à la transformation du continent africain en se dotant notamment d'institutions et mécanismes communs leur permettant de contourner un système mondial actuellement dominé par l'Occident, du FMI à la Banque mondiale en passant par les agences de notation. Qu'elle ait abouti ou pas, cette initiative symbolise cette volonté conjointe des pays africains et des pays émergents de créer un axe Sud-Sud.
1. La Chine-Afrique, entre prédation et partenariat.
Les relations sino-africaines se développent sur fond de prédominance croissante de la Chine dans l'économie mondiale, dont les poids lourds traditionnels - les États-Unis et l'Europe - ont été durement ébranlés par les crises financières.
L'essor spectaculaire des échanges sino-africains ces dernières années ne fait donc que refléter la tendance générale à la croissance du commerce et des investissements chinois dans le monde.
L'Afrique ne représente d'ailleurs qu'une part très limitée de cette expansion chinoise dans le monde, comme l'atteste le graphique suivant.
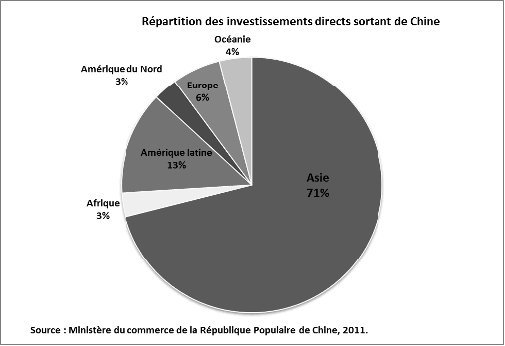
La présence chinoise reste spectaculaire à plus d'un titre.
Un dispositif conquérant
Elle est d'abord visible. Il faut voir le nouveau siège de l'Union africaine, « Le don de la Chine à l'Afrique », un imposant immeuble de 20 étages à Addis-Abeba dont la Chine a pris en charge les frais de construction pour 250 millions de dollars pour mesurer l'ampleur de cette diplomatie du bâtiment public. Ce complexe ultramoderne, le plus haut bâtiment d'Éthiopie, achevé en décembre 2011, à temps pour un sommet de l'UA organisé le mois suivant, comprend une salle de conférence de 2 500 places qui rivalise avec celle de l'ONU à New York.
La largesse de la Chine envers l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Auparavant, la Chine avait soit fait don, soit participé à la construction de nombreux palais, bâtiments publics, parlements, stades ou ponts à Bamako, Abidjan, Libreville, Luanda, en Sierra Leone et au Bénin pour ne citer que quelques exemples.
À la cinquième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, qui s'est tenue à Beijing en juillet 2012, le Président chinois Hu Jin tao a mentionné d'autres projets, notamment : 100 écoles, 30 hôpitaux, 30 centres de lutte contre le paludisme et 20 centres pilotes agricoles.
Cette diplomatie des bâtiments publics s'accompagne d'une mise en récit des relations avec l'Afrique qui renvoie à une histoire millénaire. Au commencement était l'histoire ! Tel semble être le credo de la Chine pour célébrer son retour sur le continent africain. Pour cette puissance émergente sans passé colonial en Afrique, il s'agit de sceller les retrouvailles autour de principes fondateurs qui tirent leur légitimité de l'histoire commune partagée.
Comme le rappelle volontiers le Président chinois Hu Jintao, « l'amitié sino-africaine plonge ses racines dans la profondeur des âges et ne cesse de s'approfondir au fil des ans 28 ( * ) ». Cette légitimité historique constitue le tremplin idéal pour asseoir la légitimité idéologique, fruit de la présence indéfectible de la Chine à côté de l'Afrique, comme porte-drapeau du non-alignement, pendant les luttes d'influence de la Guerre froide.
Ce combat mené au coude à coude place la Chine et l'Afrique sur un pied d'égalité et justifie un respect mutuel dont l'expression achevée demeure la non-ingérence et la neutralité, troisième principe fondateur de la diplomatie chinoise en Afrique.
La politique africaine chinoise peut désormais se décliner dans plusieurs domaines. Fidèle à sa tradition des « petits pas », la diplomatie chinoise s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs en instituant, avant tout, des structures politiques sino-africaines, instances d'expression et de rationalisation de son offensive.
Cette étape franchie, elle peut valablement mettre en oeuvre sa diplomatie économique et commerciale, centrée sur les ressources pétrolières, objectif majeur de son retour en Afrique.
Enfin, pour compléter le dispositif, la présence économique balise la voie aux autres formes de coopération, visant à renforcer l'empreinte chinoise sur le continent, notamment sur le plan culturel.
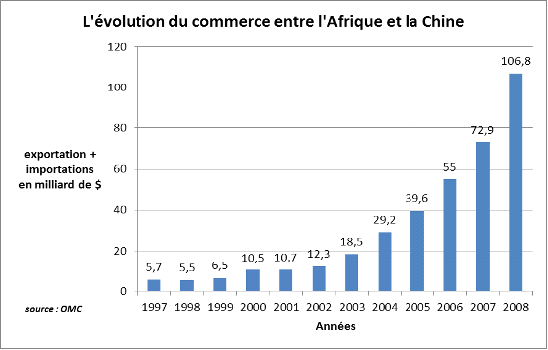
Mutatis mutandis , la politique extérieure, et pas seulement la rhétorique chinoise, progresse à travers la contestation de l'ordre occidental établi, à travers le dialogue et la coopération mutuelle avec l'Asie, puis avec l'Afrique.
Pour M. Dominique Perreau, ancien ambassadeur, ancien directeur de l'AFD, co-auteur d'un rapport sur l'Afrique et les grands émergents, l'essor chinois en Afrique relève de la conjonction d'un mouvement micro-économique désordonné et d'une ambition politique globale : « Cette ambition a pour objet de sécuriser les approvisionnements énergétiques et miniers chinois (pétrole et gaz en Angola, Nigeria et Soudan ; uranium au Niger, fer en Mauritanie) ».
Un bilatéralisme efficace
Le dialogue s'instaure sur des bases bilatérales, approche préférée des autorités chinoises, car mieux adossée aux intérêts stratégiques nationaux, mais également sur une base multilatérale, instrument de communication et de coordination sur les efforts consentis pour l'ensemble du continent.
Les échanges multilatéraux sont, de ce point de vue, assez comparables au dialogue institutionnalisé entre la France et l'Afrique dont la première édition remonte à novembre 1973. La coopération sino-africaine se concrétise d'abord par la tenue de forums. Le premier du genre a été organisé en 2000. Il a été l'occasion de réunir de nombreuses délégations africaines au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le deuxième forum, organisé en Ethiopie, a été beaucoup plus important dans ses implications. C'est en effet à l'occasion de ces échanges que s'est dessiné le plan d'action d'Addis-Abeba qui échafaude les principes généraux de la coopération la plus large.
D'un discours tissé dans la contestation coloniale, subsiste d'abord, comme pour le Brésil, un message légitimateur ancré dans l'absence de passé colonial. De ce fait, la Chine peut partager les frustrations des peuples ayant connu l'oppression et adopter une rhétorique offensive en la matière.
Subsiste également le parti pris de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. La doctrine du Président Hu Jintao est inscrite dans la continuité de celle de ses prédécesseurs. La phraséologie est dans la tonalité du discours d'Accra de Zhou Enlai. En visite au Ghana, en 1964, le Premier ministre de Mao Tsé-Toung s'était alors posé en promoteur d'une coopération équilibrée, respectueuse de la souveraineté des peuples et de la coopération mutuelle.
Ainsi lors du déplacement du Président HU Jintao au Mali en 2009, le Président malien a salué la présence chinoise en ces termes : « Nous avons partagé les valeurs pour la libération des peuples et des pays. Le Mali a toujours été très proche de la Chine avant et après la rentrée de la Chine au niveau des Nations unies... les premières installations industrielles après l'indépendance du Mali ont été réalisées par la Chine.... La Chine nous a accompagnés à l'époque pour nous permettre d'avoir des écoles, des infirmeries et des industries. »
Qualifiant de « blague » les théories de la « menace de la Chine » et du « néo-colonialisme chinois », le Président Touré a estimé que la coopération avec la Chine était « directe, franche et concrète ». « Ce que nous avons pu réaliser avec la Chine, nous ne pouvons le faire avec les autres. La Chine n'est jamais intervenue dans nos problèmes internes. La Chine nous respecte, avec nos points forts et faibles. La Chine n'est pas un faiseur de leçons », a-t-il martelé.
On mesure ici les avantages de cette prise de distance envers la notion de « bonne gouvernance » libérale aux implications à la fois économiques et politiques, distance également envers un système de valeurs démocratiques universelles entendues comme une référence philosophique internationale commune.
La distanciation avec ce système de valeurs a des propriétés évidemment immunisantes. Par la nature des relations bilatérales qu'elle souhaite établir, en creux, la Chine signale au reste du monde que, par symétrie, elle n'entend accepter aucune immixtion dans la gestion de ses affaires intérieures.
La critique de la « bonne gouvernance démocratique » s'est ouvertement invitée au sommet Chine-Afrique de novembre 2006. Une cinquantaine de délégations africaines ont pour l'occasion fait le voyage à Pékin, représentées, pour la plupart d'entre elles, au plus haut niveau de l'Etat. Le même esprit a prévalu en Egypte, lors du sommet de Sharm el-Sheikh, en novembre 2009. Par ses valeurs, la Chine entend être un contrepoint aux idéaux du « consensus de Washington ».
La Chine fait la promotion de son paradigme alternatif, que les observateurs qualifient parfois de « Consensus de Pékin ». Ce paradigme est dominé par la non-ingérence, par le principe d'autodétermination des choix économiques des Etats. Mais il est aussi et peut-être surtout commandé par la volonté de satisfaire les propres intérêts de l'Empire du Milieu.
La Chine est donc très éloignée d'une conditionnalité financière et économique de caractère libéral telle que celle mise en oeuvre par les organismes internationaux dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, elle est opposée à la conditionnalité d'une aide qui serait octroyée selon les mérites démocratiques des Etats et subordonnée à la qualité de leur gouvernance.
Dans la volonté de non-ingérence, il y a, par extension naturelle, la volonté de penser les relations internationales en fonction des intérêts supérieurs de la nation chinoise et du libre arbitre de ses dirigeants.
L'avantage que cette stratégie procure pour l'Afrique, notamment pour la politique d'allocation de l'aide bilatérale, a été maintes fois souligné, notamment par l'ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade. Il a eu l'occasion de rappeler que la signature d'un contrat avec la Banque mondiale ou l'Union européenne prenait plusieurs années, quand quelques mois suffisaient pour conclure avec les autorités chinoises. De là à soutenir que le temps de négociation d'un concours financier n'est qu'un coût de transaction, il n'y a qu'un pas, que l'exposition aux risques de corruption ou de « mauvaise » gouvernance publique n'invite pas à franchir.
Le principe de non-ingérence a largement facilité la pénétration de la Chine, en particulier dans les pays mis au ban de la communauté internationale. C'est ainsi que Pékin a continué à entretenir des relations commerciales avec l'Afrique du Sud quand les Nations Unies privilégiaient le boycott du régime de l'apartheid. La Chine a également investi des pays souvent délaissés en raison de processus de décolonisation difficiles (Angola). La façon dont les autorités chinoises ont géré la relation avec le Soudan, le Zimbabwe ou encore avec la Libye a été symptomatique de l'affirmation d'une stratégie diplomatique que Pékin souhaite déterminer de manière totalement indépendante.
Cette stratégie s'appuie sur des organismes d'Etat coordonnés par le ministère du Commerce (MOFCOM), qui, en association avec le ministère des Affaires étrangères, est en charge de l'élaboration des stratégies et des politiques de développement du commerce et de la coopération économique internationale, qu'il met en oeuvre avec l'Export-Import Bank. Tous ces acteurs sont en concertation avec les opérateurs économiques chinois, à commencer par les groupes publics. Ils disposent de moyens financiers considérables.
L'aide chinoise est articulée avec l'avancée de ses grandes et moyennes entreprises, et la présence de ses migrants en terres africaines, deux dimensions à l'égard desquelles le dynamisme des vingt dernières années a été impressionnant.
La combinaison de cette ambition d'Etat et des mouvements spontanés des migrants et commerçants chinois a fait la force de la progression chinoise sur le continent africain ces 20 dernières années.
Une diaspora active
En 2011, l'évacuation de plus 30 000 ressortissants chinois de Libye nous a rappelé l'importance de la présence de la diaspora chinoise en Afrique. Environ 750 000 à 1 million de Chinois sont expatriés en Afrique, soit 7 fois plus que d'expatriés français.
Le rythme de croissance est comparable à celui des échanges commerciaux, qui ont été multipliés par dix depuis 2000.
De là à penser, comme Axelle Kabou, essayiste de renom, qu'en 2050 « la plupart des Africains seront des Afro-Asiatiques aux yeux bridés qui parleront un créole fait de langues africaines et de langues asiatiques », il y a un pas difficile à franchir. Mais le seul fait qu'on puisse en émettre l'idée est hautement significatif.
Quels sont les pays de concentration de cette communauté ? Une fois encore, l'évaluation est gouvernée par les approximations.
En 2005, la plus grosse communauté était fixée en Afrique du Sud, où la fourchette variait de 100 000 à 300 000 personnes. D'une manière générale, la présence chinoise est significative sur Madagascar (60 000), sur l'île Maurice (40 000), en Zambie où leur nombre dépasserait les 40 000, en Tanzanie et en Afrique centrale. Le gouvernement angolais reconnaît une population de 70 000 Chinois, chiffre revu à la hausse dans les statistiques officieuses.
Les mouvements internationaux de populations chinoises ne sont qu'en partie la conséquence d'incitations politiques. Mais il est vrai que les entreprises chinoises plus que celles d'autres pays préfèrent exporter leur main-d'oeuvre plutôt que d'embaucher sur place.
Avec des tarifs en moyenne 30 % moins chers, les Chinois défient toute concurrence, aussi bien africaine qu'étrangère. Ainsi, des charters entiers acheminent jusqu'au dernier ouvrier du fond de la Chine. Cette répugnance des Chinois à engager des travailleurs locaux n'est pas sans provoquer la colère des Africains et toutes sortes de tensions. Mais, dans le cadre de financements avantageux, les partenaires africains sont souvent prompts à accepter cette situation.
L'existence d'un maillage de commerçants chinois en Afrique, qui sont généralement issus de migrations spontanées a, par ailleurs, largement favorisé la pénétration des produits chinois en créant des réseaux d'importateurs qui ont inondé les marchés africains de produits bon marché.
Ces migrations ne sont pas réductibles à une stratégie publique centralisée. En effet, le développement de la Chine et de son rapport au monde suscite des implantations qui, sans être nécessairement spontanées, sont aussi le résultat de construits sociaux où les diasporas locales sont amenées à jouer un rôle souvent décisif.
L'Afrique de l'Ouest entre dans ce cas de figure où la présence commerciale chinoise est liée, pour une part significative, à des petites activités commerciales, parfois très anciennes, dont les animateurs ne sont pas forcément les mieux considérés des ambassades de Chine.
Le pouvoir central n'est cependant pas indifférent à des implantations de population dans les pays où sa politique est dictée par la sécurisation des approvisionnements en matières premières, par la construction d'infrastructures dont la réalisation est adossée à des flux financiers au titre de dons ou de prêts.
Pour M. Dominique Perreau, ancien ambassadeur, ancien directeur de l'AFD, l'essor chinois en Afrique est la conséquence d'une stratégie globale, comme l'illustrent l'organisation de sommets des chefs d'Etat africains à Pékin ou la convocation des ministres et ambassadeurs africains en août 2010 par Hu Jintao, dit « l'Africain ».
Cette ambition a pour objet de sécuriser les approvisionnements énergétiques et miniers chinois, mais elle porte également ses fruits dans l'enceinte de l'ONU car elle permet à la Chine de recueillir les suffrages africains sur les dossiers qu'elle entend faire avancer, comme l'illustrent les votes sur le dossier de Taiwan ou encore la nomination d'une Chinoise à la tête de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Politique, cette stratégie est avant tout économique. La Chine est en tête du développement en matière d'infrastructures en Afrique. Elle remporte 90 % des marchés de BTP grâce à une offre attractive tant sur le plan de la conception des projets, des délais de réalisation que de leur financement. L'approche multisectorielle des entreprises chinoises, (la « chasse en meute ») afin de répondre aux besoins du pays, apparaît à cet égard particulièrement performante. « Imaginez que Total se déplace avec Bouygues sur un projet », a relevé M. Dominique Perreau.
Que représentent les entreprises chinoises dans le paysage économique africain ? C'est difficile à dire précisément. Il n'existe pas d'annuaire permettant d'en identifier le nombre avec une marge d'erreur raisonnable. Les données courantes font état de 1 000 entreprises formelles sur l'ensemble du continent, mais l'incertitude est grande, compte tenu des entreprises de la diaspora, très liée à la « mère patrie ». Ces chiffres impressionnent ; ils sont pourtant à relativiser.
Par comparaison, s'agissant des entreprises françaises, on en dénombre tout autant sur un seul pays à revenu intermédiaire comme le Maroc. Il est vrai, cependant, que toutes les entreprises ne se valent pas. La Chine n'est pas en reste, avec ses géants dont une trentaine figure dans le classement des plus grandes entreprises mondiales.
C'est le cas des majors du pétrole que sont China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) et China National Petroleum Corporation (CNPC), c'est également le cas du mastodonte de l'extraction minière (CNFMIC), détenu à 100 % par l'Etat, ou de State Grid, géant de l'électricité, des entreprises du domaine de la construction (CRBC) ou de la finance (CITIC). Beaucoup de ces entreprises ont vu leur pénétration en Afrique facilitée par le succès dans des appels d'offres internationaux, notamment ceux de la Banque mondiale, ou, plus encore, par les marchés afférents aux prêts de l'Export Import Bank of China (Ex-Im Bank).
Au total, le stock des IDE chinois en Afrique s'élevait à 9 milliards de dollars en 2009, soit 3 % du total des IDE en Afrique. Il croît toutefois de 10 % par an.
Les éléments d'une politique d'influence chinoise en Afrique ne se réduisent pas à ces aspects économiques.
Sur le continent, la présence chinoise suscite parfois des critiques, voire du rejet. Pékin veut maintenant rectifier le tir en améliorant son image de marque auprès des Africains. Premier instrument de cette politique : l'aide au développement. Lors du dernier forum de coopération Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin en juillet dernier, le Président chinois Hu Jintao annonçait qu'il doublerait ses crédits alloués à l'Afrique pour les trois années à venir, ce qui équivaut à 20 milliards de dollars.
La Chine a également entrepris de favoriser les échanges culturels et scientifiques. Lors du dernier forum Chine-Afrique, le chef de l'Etat chinois s'est engagé à envoyer 1 500 personnels médicaux sur le continent et à attribuer des bourses à 18 000 étudiants - un partenariat que le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, a qualifié comme étant « l'un des meilleurs exemples de réussite de la coopération Sud-Sud ».
La Chine, de plus en plus soucieuse de préserver son image sur le plan international, a conscience que la durabilité de sa présence en Afrique ne pourra être assurée que par l'amélioration des conditions de ses implantations. Les entreprises chinoises font désormais l'objet d'accusations qui pourraient nuire de façon considérable à leurs objectifs dans la région - et dans le monde - si elles s'obstinent à ne pas modifier rapidement leur comportement en matière de responsabilité sociale et environnementale. Elles sont donc désormais incitées, par les autorités, à s'engager en matière de responsabilité sociale, et ce pour éviter les manifestations antichinoises et dissuader les enlèvements de Chinois en Afrique.
D'autres actes de l'Etat chinois vont dans le même sens, comme la participation à la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe d'Aden ou les pressions exercées par la Chine sur le régime d'Omar el-Béchir au Soudan.
Par ailleurs, les entreprises chinoises s'associent de plus en plus à un partenaire occidental. La tendance actuelle est, pour ces entreprises -d'Etat ou privées- de découvrir les vertus du management moderne « normal » en s'appuyant sur des entreprises occidentales solides.
Mais le « soft power » transparaît également dans la dynamique de création des instituts Confucius qui sont des lieux d'imprégnation de la culture et de la langue chinoise. L'objectif de dialogue des cultures est aussi un point d'ancrage pour des relations d'affaires et le développement de flux commerciaux. Le premier de ces instituts a ouvert à Nairobi, en novembre 2005. En août 2010, on n'en dénombrait pas moins de 27 dans 19 pays de l'ensemble du continent africain.
« Comprendre la Chine », c'est le titre sans ambiguïté d'un programme mis en place par le gouvernement chinois. Objectif : proposer à des diplomates, des journalistes et des hommes d'affaires du monde entier un cursus d`un mois à Pékin, sur le campus de l'université des études internationales. Politique, économie, défense et diplomatie sont au menu. Un programme qui s'ajoute à ceux que la Chine a mis en place depuis 2008 pour promouvoir son image à l'étranger : au total, 5 milliards d'euros ont été investis, dont une grande partie a été consacrée aux médias et à l'éducation. C'est ainsi que Pékin accorde de plus en plus de bourses aux Africains.
Élément de cette politique, la Chine diffuse à travers sa chaîne de télévision CCTV Afrique, sur tout le continent, en chinois, mais également en français, en anglais et en langue vernaculaire. La Télévision centrale de Chine dispose ainsi d'un centre de production d'informations basé au Kenya. Cette nouvelle chaîne, créée le 11 janvier 2012, est la première du genre pour la télévision chinoise. Elle se concentre sur les nouvelles perspectives africaines ainsi que sur toute l'actualité internationale. Le journal quotidien en français informe des derniers développements sur le continent et notamment des échanges entre la Chine et les pays africains.
Mais plus que tout, les Chinois préparent l'étape de l'introduction de la TNT en Afrique. Grâce à StarTimes Media, ils s'imposent comme des partenaires incontournables du paysage audiovisuel africain. StarTimes est à la fois un équipementier et un opérateur de télévision numérique. En RDC il sera diffusé sur Digital Video Broadcast-Terrestrial 2 (DVB-T2) qui est une norme de diffusion de télévision numérique, avec le signal fourni par Pan African Groupe Network. Elle a également fait des percées significatives dans plusieurs pays (Rwanda, Tanzanie, Nigéria, République centrafricaine, Kenya, Guinée....).
Pour les responsables de RFI, TV5 et Canal 24 que nous avons auditionnés, la stratégie chinoise associant les équipements et le contenu est particulièrement performante au moment où l'on va basculer dans toute les capitales africaines sur la TNT.
Cette montée en puissance de la présence chinoise en Afrique a autant suscité d'analyses qu'elle a éveillé de fantasmes dans les pays du Nord. Leur percée inquiète les chancelleries occidentales. La politique chinoise de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains saperait leurs efforts pour promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l'homme et la démocratie, mais, plus encore, elle concurrence les intérêts économiques et stratégiques occidentaux sur le continent.
C'est le cas en France où la présence chinoise en Afrique est devenue une véritable obsession, mais c'est aussi une préoccupation aux Etats-Unis où les discours anti-chinois fleurissent oubliant que les chinois ne font parfois pas autre chose que ce que les entreprises occidentales ont toujours fait en Afrique.
« Les investissements chinois en Afrique ne visent qu'à profiter des ressources naturelles et les entreprises chinoises négligent la protection de l'environnement et le développement local », a ainsi déclaré Hillary Clinton, secrétaire d'Etat américaine, dans un discours au Sénégal à l'occasion de sa tournée diplomatique africaine en 2013, ajoutant que les USA préfèrent un partenariat qui « ajoute de la valeur plutôt qu'un partenariat qui la soustrait ».
L'un des facteurs de l'avancée chinoise en Afrique est précisément le retrait des Occidentaux. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les entreprises, note Jean-Raphaël Chaponnière, chercheur associé à Asia Centre. « Bon nombre d'entrepreneurs européens se sont tournés, depuis la chute du Rideau de fer à la fin des années 1980, vers l'Europe orientale, délaissant le continent africain. ».
Par leurs achats des matières premières africaines, les Chinois ont permis aux cours de ne pas s'effondrer mais également un renouveau économique dont les Chinois ont été les premiers à profiter en raison de leur présence.
Il reste que ces critiques, on le verra, ont un écho en Afrique même, comme l'illustre la déclaration du Président sud-africain, Jacob Zuma, qui a jugé que le déséquilibre des échanges commerciaux à travers lesquels l'Afrique exportait ses matières premières vers la Chine et importait de grandes quantités de produits manufacturés bon marché n'était pas soutenable.
Nombreux sont les dirigeants qui souhaitent ainsi voir le continent noir se doter d'une stratégie pour gérer ses relations avec le géant économique chinois. L'inde pourtant très présente suscite moins de commentaires et de réticences.
2. L'Inde, histoire partagée, avenir commun ?
Nous avons été reçus par l'ambassadeur d'Inde en Éthiopie, M. Baghwant Bishnoi, dans sa résidence d'Addis Abeba. Il a d'emblée souligné que « La présence indienne en Afrique ne date pas d'hier. Depuis des siècles, des marchands indiens font du commerce sur la côte est du continent. Ces mouvements se sont accélérés avec la colonisation britannique de l'Inde et avec l'importation de main d'oeuvre indienne pour la construction du chemin de fer, notamment en Ouganda et au Kenya. La majorité de ces travailleurs est restée sur place et leurs descendants, souvent dans le secteur du textile et du commerce de proximité, occupent encore aujourd'hui une place importante dans les économies de ces pays. ».
Les voiliers traversaient alors la mer d'Oman pour approvisionner en épices et en bijouteries le royaume d'Aksoum, actuellement le nord de l'Ethiopie, Djibouti et l'Erythrée. Les échanges entre les deux régions se sont ensuite intensifiés, avec l'arrivée en Afrique de manoeuvres et boutiquiers indiens qui essaimèrent du Kenya à l'Afrique du Sud en passant par la Tanzanie. Ces échanges sont dans l'explication de l'importance d'une diaspora ayant fait souche en Afrique du sud et de l'est, actuellement évaluée à plus de 2 millions d'individus.
L'Inde et l'Afrique ont en partage des solidarités formées dans les mouvements de décolonisation et du non-alignement.
En 1961, Nehru effectue la première visite d'un chef d'Etat indien en Afrique. Elle devance de trois ans celle de son homologue chinois, Zhou Enlai. La seconde visite, en octobre 2007, soit 46 ans plus tard, intervient à l'occasion du voyage du Premier ministre Manmohan Singh au Nigéria, second partenaire africain de New Delhi après l'Afrique du Sud. Cette visite inaugure une intensification de l'activité diplomatique avec l'organisation de sommets multilatéraux qui se succèdent à fréquence rapprochée. Dès 2008, le premier sommet indo-africain se tient à New Dehli, réunissant quatorze chefs d'Etat ou de gouvernement. En mars 2009, un forum Afrique centrale - Inde est organisé à Brazzaville, suivi, en mai 2011, du deuxième sommet Inde-Afrique au siège de l'Union africaine, en Ethiopie.
En présence de seize chefs d'Etat, le discours du Premier ministre indien continue de reposer sur les idéaux du non-alignement, une toile de fond assez comparable à celle de la Chine. New Delhi plaide en faveur d'un partenariat fondé sur l' « égalité », sur la « confiance mutuelle » et sur une approche « transparente de la concertation », critique à peine voilée du comportement de certains partenaires...
Dans son rapport aux pays africains, l'Inde est incontestablement moins crispée sur le principe de non-ingérence. La manière dont elle a traité le sujet de la crise à Madagascar, en 2009, est révélatrice non seulement d'une défense des intérêts des grands commerçants indiens de l'île, dont les monopoles économiques avaient été ébranlés par Ravalomanana, mais également de la volonté de s'aligner sur les critères de bonne gouvernance reconnus au niveau international.
Historiquement, la « grande île » fait partie des partenaires privilégiés, mais l'Inde n'a pas hésité à se rallier aux positions de l'Union Africaine, prenant l'engagement de suspendre son aide. Le principe de non-ingérence et de non-alignement sur les idéaux occidentaux n'a donc pas prévalu, l'Inde démocratique se rangeant finalement à la logique de sanction du régime malgache.
Une Compagnie des Indes à rebours...
Il reste que les ambitions indiennes tiennent d'abord d'une volonté de sécuriser ses approvisionnements en énergie et en ressources minérales qui conditionnent la soutenabilité de son industrialisation. Avec une croissance économique autour de 8 % de rythme annuel, les besoins en énergie du pays augmentent rapidement. Le taux de dépendance sur les produits pétroliers avoisine 80 % et la sécurisation des accès appelle une diversification géographique des achats vis-à-vis d'un Moyen-Orient qui fournit plus de 60 % des besoins. Les autorités de New Delhi se sont donc naturellement tournées vers l'Afrique.
L'Inde est ainsi engagée dans un processus de rattrapage qui fait d'elle un des principaux partenaires commerciaux du continent africain avec une part de marché qui contracte les positions de l'Europe et des Etats-Unis, mais aussi de certains pays asiatiques comme le Japon.
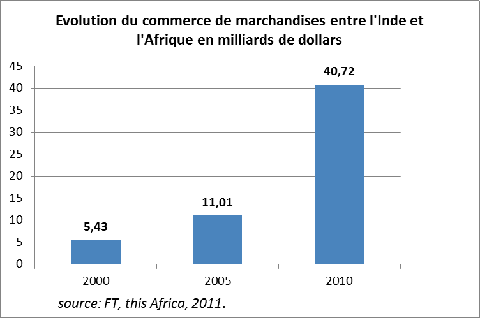
En témoigne la mission qui a amené des hommes d'affaires indiens en visite au Ghana en juillet 2012. Composée de 200 chefs d'entreprises qui souhaitaient lancer ou développer leurs activités en Afrique de l'Ouest, il s'agissait de la plus importante mission indienne à s'être rendue dans un pays africain. Cet événement a montré un signal clair : l'Inde demeure déterminée à étendre son influence en Afrique, et ce processus est même en phase d'accélération, après une décennie de forte croissance.
Depuis 2000, l'Inde s'est imposée comme l'une des principales sources d'investissement direct étranger en Afrique, et les échanges commerciaux entre ce pays et le continent ont explosé. D'un modeste volume de 3 milliards de dollars en valeur en 2000, les échanges ont augmenté jusqu'à 46 milliards en 2010 et 60 milliards en 2011. Une croissance si rapide que même le gouvernement indien a été pris par surprise. Un an à peine après avoir prédit que le commerce avec l'Afrique atteindrait 70 milliards en 2015, Delhi a dû revoir son estimation pour la porter à 90 milliards de dollars.
Entre autres productions, car en s'étoffant le commerce s'est diversifié, l'Inde exporte des automobiles, souvent de marques occidentales, fabriquées dans ses usines de montage, mais également des machines-outils et matériels informatiques, des produits pharmaceutiques, qui élargissent la gamme des biens de consommation courante plus traditionnels. L'Afrique exporte quant à elle ses matières premières, en particulier le charbon et le pétrole, mais aussi l'or, le diamant, ainsi que tout l'éventail de minerais dont les industries indiennes ont besoin.
Un certain nombre d'entreprises indiennes sont déjà très en vue, à commencer par la plus célèbre d'entre elles, le groupe Tata, au 11 e rang mondial des entreprises les plus influentes selon Forbes 2009. Ce conglomérat, présent en Afrique depuis les années 1960, est aujourd'hui implanté dans une dizaine de pays. Il est représentatif de l'attaque du marché africain, notamment avec une stratégie centrée sur la recherche de solvabilité de la demande d'automobiles à bas prix. Le groupe Tata est investi dans une très large gamme d'activités, allant de la sidérurgie aux télécommunications et à l'hôtellerie. Mais de nombreuses autres firmes indiennes ont également pris position dans des secteurs très variés. Le groupe congloméral Birla a notamment investi dans plusieurs pays africains. Il est présent sur son territoire national dans 19 secteurs (travail des métaux, engrais, télécommunication, fibres acryliques...) et à l'extérieur de l'Inde dans 36 pays.
Progressivement, l'ensemble du continent est entré dans la sphère d'attraction de ces sociétés, pas seulement les partenaires traditionnels de New Delhi, soit les pays d'Afrique de l'Est et les Etats riverains de l'océan Indien. La société Kalinda Rail a été impliquée dans la rénovation des chemins de fer au Ghana, Infosys vend des solutions informatiques aux banques nigérianes et les produits de Ciplan sont distribués dans toute l'Afrique. Les pays francophones n'échappent pas à ces influences industrielles. Le géant de l'agroalimentaire Iffco est entré dans le capital des industries chimiques du Sénégal (ICS). Taurian Resources explore l'uranium au Niger ; Tata Steel a créé une filiale en Côte d'Ivoire pour exploiter le fer du Mont Nimba, quand Arcelor#172;Mittal a signé un protocole d'accord avec la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie.
A l'instar de ce que fait le géant chinois, l'Inde entend également se positionner davantage sur des grands travaux. Le pays est désormais plus porté à la réalisation de projets d'infrastructures dont il s'est longtemps tenu à l'écart. Ces initiatives, qui ne sont pas en dehors des objectifs de sécurisation des approvisionnements de ses industries, ont été à l'origine de la création d'un fonds souverain dédié aux acquisitions à l'étranger de la société publique Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). Dans leur gestion stratégique de l'Afrique, les deux géants asiatiques dessinent des méthodes comparables qui sont moins l'expression de convergences d'intérêts que des rivalités commerciales qui devraient aller crescendo.
Le gouvernement indien a créé et financé le Pan-African e-Network, pour permettre aux hôpitaux et aux universités de quarante pays africains, d'avoir accès à l'expertise indienne dans leurs domaines. Une opération caractéristique de la diplomatie "soft" déployée par l'Inde en direction du continent africain. Elle veut combiner le meilleur du savoir-faire indien (compétences scientifiques et médicales, télécoms) avec les besoins réels des pays africains, à des prix extrêmement bas.
Cette diplomatie économique est souvent relayée par les entreprises privées, ce qui la différencie de l'approche chinoise. Ainsi, en 2010, le leader indien des télécoms, Bharti Airtel, a signé l'une des plus grosses acquisitions Sud-Sud jamais réalisées, en payant 7,8 milliards d'euros pour les actifs de l'opérateur télécoms Zaïn, dans 16 pays africains. L'objectif est clair : passer en deux ans de 40 à 100 millions de clients africains en appliquant les recettes du groupe en Inde : tarifs bas et gros volumes.
Entre 2000 et 2010, le volume des échanges Inde-Afrique a été multiplié par quinze pour atteindre près de 50 milliards de dollars, un montant encore inférieur de moitié à celui du commerce Chine-Afrique. On parle même depuis 2007 d'« Indafrique ». C'est à ce sujet que le magazine indien The Caravan a consacré la une de son numéro de février 2013 sous le titre « L'Inde en Afrique: les Indiens peuvent-ils concurrencer la Chine sur le continent qui connaît la plus forte croissance du monde ? »
Dans ces pages, le journaliste Anjan Sundaram, longtemps envoyé spécial du New York Times en RDC, explique : « L'Afrique sera très probablement le prochain terrain de la rivalité géopolitique entre l'Inde et la Chine ».
2. Le Brésil au-delà de l'espace lusophone
Si le Brésil présente de modestes performances en comparaison des deux autres puissances émergentes, il dispose d'une base solide dans la sphère lusophone. Près de la moitié de la population brésilienne a une origine africaine. Il faut entendre le président Lula devant l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2006 dire que « Nous nous sentons reliés au continent africain par des attaches historiques et culturelles. En tant que deuxième plus importante population noire du monde, nous nous sommes engagés à partager les défis et la destinée de l'Afrique », pour mesurer à quel point cette dimension ethnoculturelle est présente.
Le Brésil intensifie alors ses rapports avec les pays africains. Dix-sept nouvelles ambassades sont implantées sur le continent et accompagnent le quintuplement du commerce entre 2002 et 2012.
Le Président Lula a effectué dix voyages sur ce continent, visitant vingt-trois pays et certains d'entre eux plusieurs fois avec la concrétisation d'une coopération technique qui devient un instrument de projection externe. A l'occasion de ces voyages, le président n'a cessé de resserrer les liens naturels avec ces pays lusophones réunis, en 1996, sous le Président Cardoso, en une Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Cette politique a été poursuivie par Dilma Rousseff qui, pour la seule année 2012, a effectué deux voyages en Afrique pour le sommet Afrique-Amérique du Sud (ASA), pour le 5 e sommet des BRICS à Durban et pour le 5 e anniversaire de l'Union Africaine.
Un des objectifs du Brésil en Afrique est d'acquérir une assise qui lui permettrait de devenir un acteur clé d'un système international multipolaire ; réformer les Nations unies avec, comme l'Inde et l'Afrique du Sud, l'ambition d'obtenir un siège permanent au Conseil de Sécurité ; modifier le contenu et le fonctionnement des institutions financières internationales et de l'OMC. Aujourd'hui, la Présidente Dilma Roussef poursuit la même politique africaine que son prédécesseur.
La communauté lusophone, forte de plus de 250 millions d'habitants, est incontestablement l'un des leviers de la politique africaine du Brésil. Parti d'un espace linguistique et de son extension aux pays du proche voisinage, notamment l'Afrique du Sud, la volonté d'influence régionale s'étend bientôt à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale.
Les points d'application de cette stratégie sont d'abord sur les matières premières avec la présence de grands groupes multinationaux, très impliqués dans les explorations de pays africains ; c'est le cas de Vale, seconde entreprise mondiale pour l'extraction de minerais de fer et de cuivre, mais également de Petrobras, dans les hydrocarbures, qui réalise 24 % de sa production en Afrique avec des investissements très importants prévus en Angola (900 millions de dollars entre 2009-2012) et au Nigéria (environ 2 milliards de dollars sur la même période). Les activités brésiliennes en Afrique sont de plus en plus diversifiées. Elles se déploient dans la construction avec Odebrecht, mais aussi dans les produits agroalimentaires et les aéronefs avec Embraer, qui a percé sur le marché des avions de moins de 100 places.
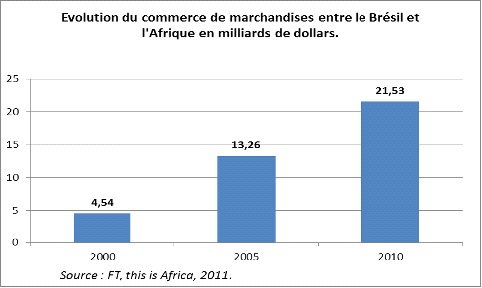
Devenu une puissance non plus émergente mais émergée, le Brésil veut offrir de nouveaux débouchés à ses exportations. Le commerce bilatéral Brésil-Afrique, passé de 4 à 26 milliards de dollars entre 1999 et 2012, témoigne de son dynamisme.
La progression des IDE brésiliens en Afrique illustre cette présence économique croissante, même si le Brésil reste un acteur secondaire par rapport à l'Inde et à la Chine.
3. L'Afrique du Sud, moteur du continent ?
Au 5 e sommet des BRICS à Durban en juin dernier, beaucoup de commentateurs ont décrit l'Afrique du Sud comme l'ambassadeur du continent, lors de ce rendez-vous entre grands émergents qui portait précisément sur le développement de l'Afrique.
Si l'Afrique du Sud fait partie du continent, elle y a vécu longtemps en marge en raison de l'apartheid. Le lien entre la destinée du continent et celle de la République d'Afrique du Sud (RSA) est intimement corrélé à la fin d'un régime qui a été perçu comme le dernier épisode de l'histoire de l'émancipation africaine. Symboliquement, il remonte au sommet de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) à Tunis en 1994, durant lequel Mandela évoqua la « renaissance africaine », concept devenu, depuis lors, le fer de lance de la politique extérieure de la nation arc-en-ciel.
Cette « renaissance africaine » de la nation « arc-en-ciel » s'illustre d'abord, sur le plan diplomatique, par la promotion de l'idée d'un continent uni et de la création du Nouveau partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD). Promouvant les initiatives pour la paix, la bonne gouvernance et la libéralisation des échanges, le NEPAD reflète les ambitions de la politique africaine de la République sud-africaine.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la relance de l'Union Africaine en juillet 2002, dont la première présidence est confiée à Pretoria, laissant ainsi à J. Zuma le soin de résumer le besoin politique africain en ces termes: « la nécessité de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits et de faire face aux défis socio-économiques est devenue urgente, spécialement à la lumière de la mondialisation ».
L'Afrique du Sud se veut le leader de la « renaissance africaine » tant à l'échelle régionale, avec les efforts de médiation, notamment celle de M. Mbeki dans la crise en Côte d'Ivoire en 2005, qu'à l'échelle internationale avec la présidence du Conseil de Sécurité de l'ONU en janvier 2012. Cette volonté ne manque pas de susciter la crainte d'un développement hégémonique de la République sud-africaine, à l'échelle continentale, auprès de ses pairs. L'élection de Mme Dlamini-Zuma, Ministre de l'Intérieur, au poste de Présidente de la Commission de l'Union Africaine, le 14 juillet dernier, a constitué un incontestable succès.
Pour autant, sur le plan économique, l'Afrique du Sud n'est pas devenue la locomotive du continent noir qu'on espérait dans les années 1990, en ce sens qu'elle est restée une exception. Près de vingt ans après la fin de l'apartheid, elle reste elle-même confrontée à de multiples défis. Défi économique : elle a été affectée par la récession de 2009, et peine à renouer avec une croissance forte. Défis sociaux : avec la persistance du chômage massif et des inégalités, les tensions sociales s'aggravent. Défi politique : fort de sa légitimité historique, l'ANC exerce une hégémonie excluant encore toute alternance, et les changements au pouvoir relèvent davantage du jeu d'appareil que d'une compétition pluraliste.
L'Afrique du Sud reste néanmoins, de loin, la première économie du continent, un pays industriel, et un Etat de droit attractif pour les investisseurs. Elle constitue le premier partenaire commercial de la France en Afrique sub-saharienne (20 % de nos exportations). Membre des BRICS et du G20, l'Afrique du Sud est un acteur diplomatique au rôle croissant en Afrique, et dont la voix compte sur la scène internationale. L'Afrique du Sud espère ainsi obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Cette démarche répond à une double logique. D'abord celle d'un pays émergent élu pour contrebalancer le poids des pays du Nord ; le Brésil et l'Inde y sont associés. Ensuite celle d'un pays africain élu pour représenter le continent dans cette instance ; l'Afrique du Sud y est en concurrence avec le Nigeria.
La puissance économique de l'Afrique du Sud contribue fortement à son leadership en Afrique. Elle demeure le poids lourd de l'Afrique subsaharienne avec 25 % du PIB de l'Afrique, 33 % de celui de l'Afrique sub-saharienne et 75 % du PIB de l'Afrique australe, qui constitue, à bien des égards, son «pré carré ». Elle représente, de fait, 90 % du Revenu National Brut de la Southern African Customs Union, qui regroupe le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swatziland afin d'abolir les droits de douane entre ces Etats.
Parmi les 500 premières entreprises africaines, 127 sont sud-africaines ; elles réalisent à elles seules plus de 60 % du chiffre d'affaires de ces 500 entreprises. Le second pays dans ce classement est l'Algérie, loin derrière. La domination de l'Afrique du Sud sur le continent se vérifie dans tous les secteurs : agro-industrie, textile, industrie du bois et du papier, travaux publics, production électrique, mines, chimie, téléphonie, transport, assurance, banque. Or, les grandes entreprises sud-africaines, parapubliques ou privées, ont profité de la fin de l'apartheid pour se développer sur le continent africain, comme on le voit à travers les exemples d'Eskom, de Shoprite, de Sasol et de Vodacom/MTN.
Dans tous les cas, on distingue une première aire d'influence, ancienne, en Afrique australe : de nombreux pays de la région, malgré leurs politiques officiellement hostiles à Pretoria, en sont toujours restés dépendants (Namibie, Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Zimbabwe) ou le sont redevenus, à l'instar du Mozambique. Cette aire d'influence correspond à l'Union douanière d'Afrique australe (Southern African Custom Union, SACU) élargie à une partie de la Communauté de développement d'Afrique australe (South African Development Community, SADC).
Au-delà, l'expansion est récente. La compagnie parapublique Eskom, premier producteur d'électricité du continent, illustre ce nouvel essor. Sa domination est complète en Afrique australe et, depuis 1994, elle se développe au-delà : en République démocratique du Congo (barrage d'Inga), au Nigeria, en Afrique du Nord. C'est à l'échelle continentale qu'elle s'efforce de connecter ses réseaux. La chaîne de distribution Shoprite, groupe privé, suit la même stratégie : elle est implantée dans quinze pays d'Afrique et ses supermarchés diffusent des produits sud-africains du Ghana à l'Ouganda. Vodacom (contrôlée à 35 % par l'État sud-africain) et MTN, groupes leaders sur le marché sud-africain de la téléphonie mobile, se disputent le marché africain depuis seulement quelques années. Sasol, enfin, est une société parapublique, créée sous l'apartheid pour assurer l'approvisionnement énergétique du pays mais aussi la capacité de production industrielle dans le domaine chimique ; c'est aujourd'hui le premier groupe chimique du continent. Il est d'autant plus présent dans l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures que ceux-ci manquent à l'Afrique du Sud.
La République d'Afrique du Sud couvre ainsi 40 % de la production industrielle du continent et exporte principalement des produits finis à forte valeur ajoutée vers les autres pays africains, renforçant ainsi la dépendance du continent à ses exportations.
L'économie de l'Afrique du Sud reste caractérisée par l'existence de cinq grands conglomérats financiers qui, à eux seuls, représentent près de 80 % des capitaux boursiers sud-africains. Ces groupes naguère régionaux sont devenus des acteurs globaux à l'image de l'Anglo American plc. Ce groupe est né en 1917 de l'exploitation aurifère, puis a pris le contrôle de la société De Beers, premier producteur mondial de diamants, pour devenir 80 ans plus tard le premier producteur d'or, de platine, de charbon (privé) et de diamants du monde. Cette internationalisation s'appuie sur un des éléments clés de l'émergence économique de l'Afrique du Sud : le Johannesburg Stock Exchange (JSE), la bourse de Johannesburg.
La politique africaine de l`Afrique du Sud oscille entre aspiration diplomatique internationale liée à une politique économique libérale et revendication culturelle africaine forte. Critiquée par ses homologues continentaux, l'Afrique du Sud est également remise en cause dans son statut d'émergent, souvent qualifiée de « puissance secondaire », étant la dernière économie du sous-ensemble BRICS. Sa présence en Afrique est complexe et sa diplomatie est elle-même en proie à des contradictions : alors qu'elle prône le respect des droits de l'Homme et la paix, Pretoria a conservé d'excellentes relations avec le Zimbabwe, partenaire économique stratégique du pays de Mandela et intervient dans des conditions controversées en Centrafrique.
L'Afrique du Sud est enfin l'une des grandes armées d'Afrique. Composée de 50 000 militaires relativement bien équipés, elle dispose de quatre frégates, dont 3 sous-marins. C'est le premier budget africain en matière de défense, même si cela représente un dixième du budget de la défense de la France et une capacité d'intervention terrestre très limitée.
De l'avis de la Defence Review Committee, dont six de ses membres se sont déplacés à l'ambassade pour rencontrer longuement notre délégation, l'Afrique du Sud n'a pas encore les moyens de devenir, seul, un gendarme du continent, malgré ses ambitions, car le format des armées requis nécessiterait un accroissement de l'effort de défense considérable pour ce pays, jusqu'à 2 % du PIB contre 1,1 % actuellement, soit environ 4 milliards d'euros. Mais l'ambition est là, ce qui suscite parfois la réticence de ses voisins.
Moins puissante que les autres BRICS, confrontée à des difficultés économiques et sociales, l'Afrique du Sud reste une puissance incontournable du continent.
C. L'ORIENT À LA CONQUÊTE DU CONTINENT NOIR
Que les nouvelles puissances économiques mondiales aient des stratégies à l'échelle planétaire n'étonne pas, qu'elles cherchent à s'implanter sur un contient grand pourvoyeur de matières premières et marché de consommation en pleine croissance non plus. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir à la périphérie du continent, au Nord avec le Maroc, en Orient avec la Turquie et les pays du Golfe, en Extrême-Orient Orient avec la Corée du Sud et le Japon, des puissances intermédiaires ou très éloignées développer des stratégies volontaristes de pénétration des marchés africains et d'influence culturelle, notamment à travers le facteur religieux.
1. Le Maroc prend le sud.
Il faut avoir participé au 6 e Sommet Africités, qui s'est tenu à Dakar, du 4 au 8 décembre 2012, sur le thème « Construire l'Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? », aux côtés de près de 5000 personnes issues d'une cinquantaine de pays, dont la moitié d'élus, pour mesurer l'ambition marocaine en Afrique. Les Marocains, qui ont largement financé l'événement, avaient là le plus grand stand de tous les pays, affirmant ainsi la disponibilité des pouvoirs publics et des collectivités marocaines à mettre sur pied des coopérations dans tous les domaines.
Alors que le Maroc a été l'un des pionniers de l'unité africaine, accueillant dès janvier 1961 la conférence de Casablanca, qui accoucha d'une charte revendiquant l'objectif de « faire triompher la liberté dans toute l'Afrique et de réaliser son unité », il a cessé d'en être membre, le 12 novembre 1984, au 20 e sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) pour protester contre la présence du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Abdelaziz.
Un demi-siècle après la création de l'OUA et un peu moins de trente ans après s'en être retiré, le Maroc n'a pourtant jamais été aussi présent au sud du Sahara.
Tout en entretenant des relations personnelles excellentes avec nombre de chefs d'État (Félix Houphouët-Boigny, Mobutu, Omar Bongo Ondimba), Hassan II n'avait pas véritablement fait de l'Afrique une priorité diplomatique. Par contraste, son fils et successeur Mohammed VI a, depuis le début de son règne, surtout voyagé au sud du Sahara.
À l'occasion de grandes tournées ou de visites d'État, il s'est rendu dans de nombreux pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal. Avec ces pays, le Maroc partage une proximité liée à l'Histoire et à la langue française et, pour les nombreux musulmans d'Afrique, à la religion, mais aussi des intérêts économiques qu'illustre la vitalité des entreprises marocaines qui s'y implantent.
Plusieurs pays africains bénéficient aussi d'une assistance financière destinée à la réalisation de microprojets à caractère économique et social dans des secteurs vitaux comme l'éducation, la santé et la petite hydraulique rurale (forage de puits et adductions d'eau).
En effet, le Maroc fonde sa politique africaine sur une diplomatie d'influence dont l'un des principaux outils est l'Agence marocaine de Coopération Internationale (AMCI). Son fonctionnement est comparable à celui de l'Agence française de Développement (AFD) mais ses moyens sont beaucoup plus limités. L'AMCI est un projet ambitieux quand on sait que le Maroc est lui-même demandeur d'aides internationales. L'AMCI est chargée de « développer » et de « renforcer » la coopération avec les pays amis du Maroc, les principaux bénéficiaires de ces programmes de coopération étant le Sénégal, la Guinée, le Niger, la République Démocratique du Congo, mais également les Comores.
L'Afrique subsaharienne a toujours été perçue comme un outil de « désenclavement » stratégique pour le Royaume du Maroc, pris en étau entre l'Espagne et l'Algérie, avec lesquelles il entretient des relations diplomatiques complexes.
De fait, le Maroc assouvit son désir de puissance au sud du Sahara grâce à la mise en place d'un soft power qui se base sur des programmes globaux de coopération à long terme et la mise en place de partenariat plus stratégique, à l'instar du Sénégal.
La présence de la religion musulmane en Afrique subsaharienne permet la mise en place d'un « Axe privilégié » entre le Maroc et le Mali, mais surtout entre le Maroc et le Sénégal. La politique marocaine à l'égard du Sénégal est basée sur l'utilisation de symboles culturels et religieux qui connotent la grandeur du Royaume dans l'histoire des deux pays, comme en atteste la ville de Saint-Louis au Sénégal, ancienne limite du « Grand Maroc ».
L'importance de la confrérie Tidjanyia au Sénégal, originaire du Maroc, est ainsi l'un des points d'ancrage de la relation privilégiée entre ces deux Etats et assure la stabilité de ce lien diplomatique. Le Ministre des Affaires islamiques marocain suit d'ailleurs directement le Ministre des Affaires étrangères sur le plan protocolaire : c'est dire l'importance de la religion musulmane dans la diplomatie marocaine, notamment en direction des pays africains.
Au-delà du religieux, Rabat a mis en place une politique de coopération en matière d'éducation afin d'étendre son influence en Afrique. Ainsi, depuis les années 1970, il existe des programmes d'échanges estudiantins permettant à de jeunes Africains de bénéficier de l'enseignement supérieur marocain.
Cette politique a particulièrement été relancée durant la dernière décennie, les étudiants étrangers au Maroc étant cinq fois plus nombreux durant l'année 2007-2008 que ceux recensés durant l'année 1994-1995.
Près de la moitié de ces étudiants sont originaires des huit pays francophones d'Afrique de l'Ouest : on voit donc l'importance du français dans les relations diplomatiques africaines. Ces échanges sont gérés par le Ministère des Affaires étrangères marocain et chaque étudiant sélectionné se voit attribuer une bourse de 750 dirhams afin de poursuivre ses études dans le Royaume. Une fois leurs études achevées, ces étudiants deviennent des employés et partenaires idéals pour les entreprises marocaines investissant sur le continent. Cette politique de coopération universitaire est un moyen de rayonnement économique et culturel en Afrique pour Rabat.
2. La Turquie lorgne sur l'Afrique.
Engagées depuis 1998 avec «la stratégie d'ouverture vers l'Afrique», les relations de la Turquie avec le continent noir ne cessent de se développer. Business, diplomatie et, plus inattendue, influence culturelle, servent de socle à sa quête stratégique de nouveaux marchés et d'alliés potentiels.
La dernière tournée diplomatique effectuée par le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, entre le 6 et le 11 janvier 2013, a été consacrée à l'Afrique de l'Ouest, avec trois pays visités : le Gabon, le Niger et le Sénégal, tous trois francophones.
A cette occasion, le Premier ministre turc a annoncé vouloir plus que doubler les échanges de son pays avec l'Afrique d'ici 2015, en les portant de près de dix-huit milliards de dollars fin 2012 à quelque cinquante milliards dans trois ans. Une accélération exponentielle des échanges commerciaux avec les partenaires africains entamée en 2002, époque où ils ne représentaient que deux 2 milliards de dollars.
A l'instar de la Chine, de l'Inde et du Brésil, la Turquie, qui a rapidement mais plus discrètement développé ses liens avec l'Afrique, poursuit allègrement son implantation et devient désormais un acteur incontournable.
C'est sous l'impulsion du Premier ministre Erdogan et de son Parti de la justice et du développement (AKP) qu'a été organisé, en 2008, le premier sommet de la Coopération Turquie-Afrique à Istanbul, auquel ont participé 50 pays. Dans le cadre de la rénovation de la politique étrangère turque, l'Afrique semble désormais être un allié fondamental pour aider la Turquie à s'affirmer sur la scène internationale.
Dans un tel processus, la dimension religieuse est particulièrement mise en valeur, la Turquie se positionnant en tant qu'héritière de l'Empire Ottoman pour utiliser son prestige auprès des musulmans d'Afrique. D'ailleurs, c'est dans cet élan que le bureau de coordination du programme en Afrique de l'Agence turque pour la coopération et le développement internationaux (TIKA) a d'abord été inauguré à Addis-Abeba en 2005 et, plus tard, à Khartoum et à Dakar en 2006 et 2007 respectivement.
Parallèlement, la Turquie multiplie le nombre de ses représentations diplomatiques. La dernière ambassade vient d'être inaugurée au Gabon, à l'occasion de la visite de M. Erdogan, début janvier 2013. Elle fait partie des 19 ambassades et consulats turcs mis en place en Afrique depuis 2009. La Turquie doit encore ouvrir trois nouvelles ambassades en Afrique dans les prochains mois, ce qui portera le total sur le continent à 34.
Signe de cette volonté d'ouverture sur l'Afrique, la compagnie aérienne Turkish Airlines, détenue à 49 % par l'Etat, a rapidement étendu son réseau africain au cours des dernières années. Avec l'ouverture récente de nouvelles lignes à Nouakchott, à Abidjan et les liaisons vers le Burkina Faso, le Cameroun et le Niger en décembre 2013, cette compagnie dessert désormais 18 pays africains avec 33 destinations au total.
Par ailleurs, de 20 à 30 % moins coûteux que les produits européens, le made in Turkey (matériaux de construction, agroalimentaire, ingénierie, machinerie, textile, prêt-à-porter, équipement médical, technologies de l'information, produits d'hygiène personnelle et de nettoyage, ou encore bijouterie) jouit auprès du consommateur africain d'une meilleure réputation que son concurrent chinois.
3. Les pays du Golfe et la carte religieuse
Comme au Proche et au Moyen Moyen-Orient, la diplomatie saoudienne se fonde sur les pétrodollars et une influence religieuse croissante.
Partant de l'Erythrée et suivant l'axe Karthoum-Ndjamena, traversant les provinces nord du Nigeria où s'applique la Charia, le Niger, le Nord Mali pour atteindre finalement le Sénégal, siège régional de la Ligue islamique mondiale, principal outil d'influence de l'Arabie Saoudite, un projet d'influence wahhabite semble se dessiner en Afrique.
La stratégie diplomatique saoudienne consiste à contourner les acteurs classiques afin d'établir un lien direct avec les populations locales. L'aide financière directe et les réseaux humanitaires facilitent le développement de son influence idéologique.
Cette volonté d'influence religieuse n'est pas nouvelle : afin de contenir l'expansion socialiste et progressiste voulue par Nasser et incarnée par la création de l'université Al-Azhar, Riyad créa l'université de Médine en 1961, point de diffusion de l'idéologie wahhabite dans le monde. Cette université est au centre du système de propagande de l'Arabie Saoudite et, selon les voeux de Riyad, « les musulmans de tous les pays islamiques sont conviés à Médine pour y étudier l'Islam (...) pour, plus tard, retourner chez eux et y enseigner et y guider ». Riyad est également à l'origine de la création du Conseil africain de coordination islamique.
Dakar accueille à la fois le siège régional de la Ligue islamique mondiale et le siège du Conseil africain de coordination islamique car le Sénégal est un des premiers pays musulman d'Afrique noire. De la même façon, la position géographique du Tchad le prédestinait à accueillir le centre de formation pédagogique de l'ISECO, équivalent de l'UNESCO pour les pays musulmans. Une annexe de l'Université de Médine a enfin été ouverte au Soudan, afin de former les prédicateurs.
L'Arabie saoudite finance des organisations islamiques locales qui agissent dans les domaines de l'humanitaire et de l'éducation afin de faire passer leur message. Les structures et les modes d'actions se multiplient, alors que l'objectif reste le même. Ainsi, après la création de la Ligue islamique mondiale, c'est la World Assembly of Muslim Youth (WAMY) qui est créée afin de rendre la politique prédicative de Riyad plus efficace et toujours plus visible. L'Arabie saoudite s'appuie également sur un réseau de personnalités religieuses influentes à l'échelle locale, allant même jusqu'à soutenir de façon assez paradoxale des entités soufies.
L'Afrique noire constitue une priorité pour la diplomatie d'influence de Riyad car elle est souvent considérée comme un maillon faible de l'Ummah, qu'il faudrait sauver et dont il faudrait garantir « l'identité musulmane ». C'est pourquoi l'Arabie saoudite soutient financièrement les associations humanitaires islamiques ainsi que les projets locaux, veillant au développement d'une éducation religieuse plutôt qu'à l'expansion de l'enseignement laïc. Les pétrodollars ainsi injectés dans les économies subsahariennes ont, durant les décennies précédentes, remodelé le paysage religieux d'une Afrique noire secouée par les crises financières. La contestation des modèles religieux sur le continent semble désormais passer par la manipulation des symboles religieux, notamment islamiques.
Le Qatar marque également un intérêt croissant pour l'Afrique depuis 2008. Il mène des actions sur plusieurs fronts. Il a lancé depuis septembre 2008 de multiples médiations pour relancer le processus politique au Darfour. Une nouvelle conférence des donateurs sur la reconstruction du Darfour a ainsi été organisée les 7 et 8 avril 2013 à Doha. En outre, l'émirat mène depuis juin 2010, à la demande de l'Erythrée et de Djibouti, une médiation dans le conflit frontalier opposant les deux pays. Le Qatar a par ailleurs signé avec le Kenya un accord pour le fermage de 40 000 hectares. Au Gabon, des discussions sont en cours à propos du gisement de fer géant de Belinga, un temps promis aux Chinois. Enfin, en décembre, le président soudanais Omar el-Béchir a conclu à Doha des accords dans les domaines minier et agricole.
Il existe une lutte d'influence sur le continent africain entre Doha et Riyad, les deux pétromonarchies cherchant à être le référent religieux pour l'ensemble de la communauté musulmane.
Les événements des « printemps arabes » ont conduit le Qatar et l'Arabie Saoudite à repenser leurs alliances stratégiques au Maghreb et au Moyen-Orient. L'influence d'Al Jazeera dans ces révolutions n'est plus à démontrer. La chaîne s'est fait le relais des intérêts qataris, soutenant les Frères musulmans lors des élections égyptiennes. A l'inverse, l'Arabie Saoudite est restée fidèle à Moubarak jusqu'à son éviction du pouvoir et accueille aujourd'hui Ben Ali. Elle cherche à limiter l'influence des Frères musulmans qu'elle considère comme un courant modéré voire mou de l'islam et a affiché son soutien aux salafistes. On retrouve cette lutte d'influence au Sahel, notamment au nord du Mali, où les deux Etats du Golfe ont apporté à différentes populations et groupes djihadistes des soutiens indirects.
4. Le Japon, entre approvisionnement et coopération.
La cinquième Conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad), qui s'est terminée en juin 2013 sur l'adoption de la Déclaration de Yokohama, illustre l'ambition africaine du Japon. Ce texte, qui énumère les engagements pris par le Japon d'ici à la prochaine Ticad, programmée en 2018 pour « la croissance, le développement durable et la réduction de la pauvreté », vient rappeler que l'archipel est engagé en Afrique depuis longtemps.
Le Japon prévoit d'appuyer le déploiement de sa présence en Afrique sur son aide publique au développement. Il y ajoute une priorité aux partenariats public-privé et au soutien au secteur privé, décidé à se positionner en Afrique. En janvier, la principale fédération patronale nippone a émis plusieurs propositions à l'intention du gouvernement en vue de développer des activités sur ce continent.
Selon ces nouvelles orientations, l'Etat a déjà annoncé 754 millions d'euros d'aide aux groupes désireux d'investir dans l'exploitation des matières premières. Ainsi la maison de commerce Mitsui &Co va se positionner au Mozambique pour un projet gazier. La Jogmec, compagnie japonaise du pétrole, du gaz et des métaux, va participer à l'exploitation de gisements de terres rares en Afrique du Sud.
Le Japon a également annoncé le doublement, à 10, du nombre de bureaux africains de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro), l'investissement de 20 milliards de dollars pour garantir les opérations engagées par les entreprises nippones, et la multiplication des partenariats public-privé.
Il a promis 32 milliards de dollars d'aide pour les cinq prochaines années, dont 14 milliards de dollars d'aide publique au développement. En plus de l'enveloppe évoquée, le Japon devrait investir 6,5 milliards de dollars dans les projets d'infrastructure. Le Japon financera des formations de techniciens locaux, qui devraient être recrutés par des entreprises nippones implantées en Afrique. Ces compagnies emploient déjà 200 000 personnes. Ce chiffre devrait doubler en cinq ans. Le Japon s'est par ailleurs engagé à soutenir le secteur agricole pour qu'il atteigne 6 % de croissance et que la production de riz soit doublée d'ici à 2018.
Il va aussi octroyer 428 millions d'euros pour la stabilisation du Sahel, ainsi qu'une enveloppe qui ira à l'éducation, à la santé, à l'aide alimentaire mais également à la formation de 2 000 Africains dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. « La prise d'otages en Algérie fut un choc pour les Japonais », a souligné, le 2 juin, Shinzo Abe, faisant référence au drame de janvier sur le site gazier d'In Amenas, au cours duquel dix techniciens nippons sont morts.
Les échanges avec l'Afrique, environ 30 milliards de dollars fin 2011, ne représentent que 2 % du commerce nippon. Ce continent n'attire que 1 % des investissements de l'Archipel, mais l'intérêt des groupes nippons ne cesse de croître, comme en témoigne le rachat, en décembre 2012, de la maison de commerce CFAO (Compagnie française d'Afrique de l'Ouest) par son homologue nippone Toyota Tsusho, soucieuse de développer sa présence en Afrique de l'Ouest. Les investissements industriels se multiplient. Honda a construit une usine de production de deux-roues au Nigeria et prévoit de faire de même au Kenya. Le Japon cherche à s'implanter en Afrique à travers des coopérations avec ses voisins sud-coréens et chinois. Ainsi, le japonais Sumitomo travaille avec le sud-coréen Kores dans le projet Ambatovy d'extraction du nickel de Madagascar et Toyota Tsusho conduit avec Hyundai Engineering un projet de production d'électricité d'origine géothermique au Kenya.
5. Le « pays du matin calme » en Afrique.
A l'instar de la Chine ou de la Russie, la présence sud-coréenne en Afrique est peu connue mais ancienne.
Suite à la guerre de Corée, le continent devient le théâtre de la concurrence diplomatique qui oppose Séoul à Pyongyang. Désireuse de circonscrire l'influence de sa rivale sur le continent, la Corée du Sud envoie donc des missions de bonne volonté au Libéria, en Libye, en Tunisie, au Ghana et au Soudan à partir de janvier 1960.
Mais c'est véritablement au tournant des années 2000 que la Corée du Sud s'intègre à ce que certains commentateurs appellent « la ruée africaine ». En effet, en 2006, le Président Roh Moh-hyun annonce l'« initiative pour le développement en Afrique », point de départ du renouveau diplomatique sud-coréen en direction de l'Afrique.
Trois raisons expliquent l'importance du continent pour Séoul. D'abord, l'ouverture commerciale à l'Afrique permettra à la Corée du sud de doubler son PIB par habitant de 20 000 à 40 000 dollars. Ensuite, Le soutien apporté aux pays en développement aidera la Corée du Sud à asseoir son statut au sein de la communauté internationale et facilitera à long terme les relations avec les partenaires africains. Enfin, Le potentiel de croissance du continent et le rôle de marché alternatif qu'il présente sont des facteurs clés en cas de stagnation économique de la Chine.
Afin de mettre en place cette stratégie, le gouvernement coréen a entrepris une série d'actions multilatérales. Six mois avant le Sommet sino-africain de Pékin, Séoul a accueilli, en avril 2006, la première Conférence ministérielle de coopération économique entre la Corée du Sud et les pays africains (KOAFEC) co-organisée par le gouvernement sud-coréen et la Banque africaine de développement (BAD). En 2008, à l'occasion de la deuxième KOAFEC, le ministre des finances sud-coréen a affirmé la volonté de son pays de s'engager dans une « coopération gagnant-gagnant pour promouvoir le développement durable » et « contribuer au développement de l'Afrique ». La 4 e rencontre qui s'est tenue en octobre 2012 a mis l'accent sur la thématique de la « croissance inclusive ».
Une percée sélective
La Corée du Sud met également en place des relations diplomatiques bilatérales de façon sélective. Ainsi quatre représentants ont été choisis pour chaque sous-région : l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe, le Ghana en Afrique occidentale, le Kenya en Afrique orientale et la RDC en Afrique centrale. C'est autour de ces pays que Séoul souhaite concentrer son effort diplomatique afin de s'implanter durablement sur le continent.
Cette diplomatie bilatérale menée au plus haut niveau de l'Etat vise à préserver en priorité la coopération dans le domaine énergétique. La Corée du sud est en effet très dépendante à l'importation de telles ressources : en 2010 elle était le 7 e consommateur mondial de pétrole et dépend actuellement du Moyen-Orient pour 82 % de sa consommation. Elle est également le deuxième plus grand importateur de gaz naturel liquéfié, après le Japon.
Cette vulnérabilité, conjuguée aux instabilités régionales qui menacent le Moyen-Orient, a conduit Séoul à réfléchir à la sécurisation et à la diversification de ses importations. Plusieurs compagnies sud-coréennes ont ainsi obtenu des contrats d'exploitations dans des pays africains : Samsung a conclu un accord avec le Gabon pour construire une raffinerie à Port Gentil, dont le coût est estimé à un milliard de dollars, opérationnelle en 2016. SK group a signé un accord de d'investissement de 5,5 milliards de dollars avec une firme nigériane dans les secteurs pétrolier, gazier et logistique.
Le groupe sud-coréen a également des intérêts pétroliers en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Guinée équatoriale. Enfin la compagnie Korea National Oil Corporation est présente sur le continent depuis les années 1990. Après avoir mené des opérations en Libye (bloc Elephant NC174), elle exploite plusieurs blocs dans l'offshore nigérian et vient de signer un accord de partenariat avec la compagnie nationale sud-africaine PetroSA qui concerne les secteurs du pétrole et du gaz en Afrique du Sud et dans d'autres pays du continent.
Les projets se multiplient également dans le domaine minier : Daewoo International a accéléré ses efforts pour se développer sur le continent : présente au Nigéria depuis 1975 elle a ouvert de nouvelles filiales en 2011 au Cameroun et en RDC. Elle exploite la mine Ambatovy à Madagascar qui abrite l'une des plus grandes réserves de nickel latéritique au monde. Des projets miniers en Ethiopie et en RDC sont également en cours et concernent l'extraction de cuivre. Le géant mondial de l'acier Posco a conclu des accords avec des firmes australiennes et suisses afin d'exploiter des mines au Cameroun et au Zimbabwe.
La décennie 2000 se caractérise ensuite par une intensification des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Corée du Sud : d'un montant global de 6,4 milliards de dollars en 2000 contre 11,5 en 2005, ils s'élèvent à 22,2 milliards en 2011 grâce aux efforts de Séoul. L'objectif sud-coréen est désormais clair : atteindre le chiffre de 80 milliards de dollars en 2020.
La structure de ces échanges est des plus classiques : Séoul exporte principalement des machines, des équipements de transports, des produits manufacturés et des produits chimiques tandis qu'elle importe majoritairement des matières premières. On retrouve ici une dynamique commerciale tout à fait comparable à celle qui lie l'Afrique à ses partenaires traditionnels.
Concernant l'aide au développement, le gouvernement sud-coréen a affirmé en novembre 2012 sa volonté d'élargir significativement son soutien aux pays africains. L'aide au développement est octroyée par la Korea International Cooperation Agency (KOICA) qui possède des bureaux régionaux en Ethiopie, au Nigéria, au Ghana, au Rwanda, au Mozambique, en Ouganda, au Cameroun, en RDC, au Kenya, en Egypte, au Maroc, au Sénégal, en Tanzanie, en Algérie et en Tunisie. Selon les chiffres de la KOICA, en 2009, 19 % du budget dédié à la coopération était destiné à l'Afrique.
L'Afrique semble donc être un atout, voire un outil de cette stratégie, pour Séoul qui bénéficie d'une image globale très positive auprès des populations africaines. Cependant, l'implantation croissante du « pays du matin calme » en Afrique n'est pas exempte de troubles : c'est l'activité d'une des compagnies sud-coréennes qui a été à l'origine de la crise politique qui secoue Madagascar.
IV. L'AFRIQUE AU COEUR D'UNE REDISTRIBUTION DES CARTES ENTRE ANCIENNES PUISSANCES COLONIALES ET NOUVELLES PUISSANCES ÉMERGENTES
La percée des émergents et des nouvelles puissances intermédiaires en Afrique illustre la place que ces pays ont acquise dans la première décennie du XXI e siècle au sein de l'économie mondiale.
Quand on évoque le basculement de la richesse vers le Sud, on en voit précisément les résultats en Afrique où les entreprises indiennes et chinoises, comme leurs États respectifs, ont des capacités de financement qui aujourd'hui font défaut aux pays occidentaux et à leurs entreprises.
Comme nous l'a dit Lionel Zinsou, président de PAI partners, société d'investissement, « la pénétration des marchés africains exige aujourd'hui des stratégies panafricaines avec des investissements que les entreprises françaises n'ont pas en ce moment les moyens de se payer ».
A l'origine de ce processus, on trouve un différentiel de croissance qui perdure. Les chiffres en témoignent : alors que les pays de l'OCDE représentaient 62 % de l'économie mondiale en 1990, on prévoit que leur part tombera à 43 % d'ici à 2030, les 57 % restants revenant aux pays émergents et en développement.
Il n'est toutefois pas nécessaire de regarder l'avenir pour prendre la mesure de ce basculement.
En 2008, alors même que la crise économique frappait, le PIB augmentait de 5,6 % dans les pays en développement, mais de seulement 0,5 % dans les pays développés de l'OCDE.
Dans un avenir prévisible, les pays émergents devraient continuer à connaître une croissance bien plus forte que leurs homologues occidentaux.
Forts de cette dynamique économique, les pays émergents s'imposent en Afrique comme ailleurs dans le monde. Pour des pays comme la Chine, il s'agit en outre de trouver des relais de croissance au cas où la croissance chinoise s'essoufflerait.
Des liens se tissent entre les pays du « Sud » en contournant les puissances économiques traditionnelles d'Europe et d'Amérique du Nord. Cela offre de nouvelles opportunités aux pays africains. Et c'est indéniablement un nouveau défi pour les pays occidentaux, en général, et pour l'Europe et la France, en particulier.
Se jouent là, sur le continent africain, non seulement, à l'évidence, des opportunités économiques dont les pays occidentaux en panne de croissance ont besoin, mais également une partie de leur influence dans le choix des Africains sur les modèles d'organisation politique et de développement économique.
Regardons de plus près les motivations communes de cette ruée sur le continent noir pour en mesurer la dimension politique. Que vont chercher ces nouveaux acteurs en Afrique ?
A. APPROVISIONNEMENT CONTRE INFRASTRUCTURES : DES MOTIVATIONS D'ABORD ÉCONOMIQUES
Les nouveaux partenaires des Etats africains importent comme par le passé des produits agricoles : café, cacao, coton, bois, noix de cajou, arachide, banane, et des minerais et métaux rares ou précieux dont les puissances industrialisées ont besoin : platine, chrome, manganèse, cobalt, vanadium, cassitérite et uranium.
Mais c'est au premier chef le pétrole africain qui attise les plus grandes convoitises.
L'Afrique subsaharienne assure respectivement 27 % et 21 % des importations chinoises et indiennes de pétrole et 70 % des importations brésiliennes.
Dans le même temps, entre 2000 et 2007, la part du continent africain dans les importations pétrolières des États-Unis est passée de 14,6 % à 19,4 % alors que celle du Moyen-Orient se réduisait de 22,6 % à 16,1 %.
Qu'ils soient nouveaux ou traditionnels les partenaires des pays africains viennent en premier lieu s'assurer une source d'approvisionnement en hydrocarbure alternative au Moyen-Orient.
Cet approvisionnement est vital pour les économies en croissance des pays émergents, et en particulier pour la Chine et l'Inde qui n'ont, contrairement aux États-Unis, pas de ressources propres.
Importations de pétrole africain par les puissances émergentes
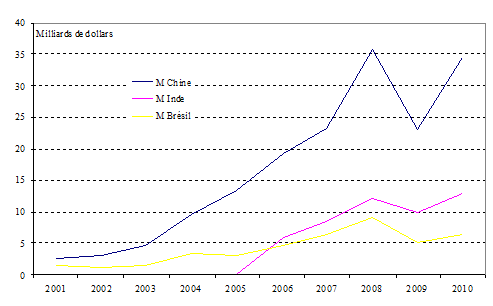
S'agissant des minerais, le décollage économique des émergents a accru leurs besoins et, de ce fait, leurs importations.
Ainsi entre 2001 et 2010, la part des puissances émergentes dans les importations mondiales de minerais est passée de 18 % à plus de 52 %.
Cette situation s'explique par la faiblesse de leur production nationale qui les rend particulièrement dépendants de leurs importations de minerais. Ainsi les pays africains assurent 98 % de la consommation chinoise de cobalt, 97 % de chrome, 94 % de platine, 84 % de cuivre, 78 % de manganèse.
Cette dépendance est particulièrement forte pour la Chine qui assure ainsi en Afrique un approvisionnement vital pour son industrie.
Selon les données Chelem (CEPII), la part de la Chine dans les exportations africaines de produits miniers a par ailleurs augmenté de 7 % à 39 % entre 2000 et 2009, celle de l'Inde de 2 % à 5 %. Au cours de la même période, la part de l'Union européenne a été ramenée de 47 % à 26 %.
L'intérêt des puissances étrangères pour les ressources pétrolières et minières explique ainsi la géographie de leurs investissements : l'Afrique du Sud, l'Angola et le Soudan sont les trois principaux partenaires de la Chine en Afrique, tandis que le Nigeria est le premier partenaire commercial de l'Inde sur le continent.
Les partenaires émergents et les pays occidentaux se disputent l'accès aux ressources naturelles, mais un examen plus détaillé des flux commerciaux et d'investissement dans d'autres secteurs met en lumière des complémentarités géographiques.
Les partenaires traditionnels sont plus présents dans l'Afrique du Nord et de l'Ouest, alors que les nouvelles puissances sont plus visibles en Afrique centrale, orientale et australe.
B. UN IMMENSE MARCHÉ INTÉRIEUR
Les perspectives du marché africain, qui compte aujourd'hui environ un milliard de consommateurs et pourrait en représenter près de deux en 2050, sont la deuxième motivation des investissements massifs effectués ces dernières années.
Les pays industrialisés s'y livrent une concurrence féroce dans le domaine de la distribution d'énergie ou d'eau, du transport maritime, des infrastructures portuaires, de la téléphonie mobile.
Le continent africain est un marché prometteur pour les produits made in China (habillement, chaussures, petit électroménager, deux-roues, etc.) dont la modicité du coût est bien adaptée à des populations au pouvoir d'achat limité.
Grâce à une main-d'oeuvre bon marché et à une expertise éprouvée, le BTP chinois est très actif sur le continent, poursuivant une tradition qui remonte à la construction du chemin de fer Tazara entre la Zambie et la Rhodésie dans les années 1970 : des routes, des aéroports et des voies ferrées sont construites par la coopération chinoise en Angola, au Soudan ou au Gabon.
Dans cette concurrence, la Chine et les pays émergents ont gagné la première manche. En 2009, la Chine a dépassé les États-Unis et est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique. La part des échanges de l'Afrique avec les pays émergents est elle-même passée de 23 % à 39 %. Les cinq pays émergents partenaires de l'Afrique les plus importants sont dorénavant la Chine (38 %), l'Inde (14 %), la Corée du Sud (7,2 %), le Brésil (7,1 %) et la Turquie (6,5 %).
Dans le BTP, les entreprises occidentales ont perdu des parts de marché considérables, comme l'illustre ce recensement des contrats BTP de la banque mondiale et de la Banque africaine de développement.
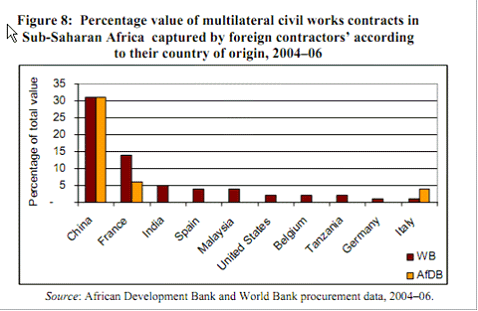
Source : Banque Mondiale
Plus que jamais, l'Afrique constitue, en ce début du XXI e siècle, un enjeu majeur qui est au coeur d'un jeu d'influence.
C. DERRIÈRE LES AFFAIRES : UN NOUVEAU BANDUNG ?
Longtemps, ils ne furent que « des taches de couleur sur les cartes symbolisant les empires coloniaux ». C'est à Bandung, en Indonésie, en avril 1955, que cette moitié de la planète devint le « tiers-monde ». C'est ainsi que Jean Lacouture commentait cette conférence qui marqua le début d'une prise de position commune des pays du Sud de la planète.
La conférence s'acheva par un discours mémorable de Jawaharlal Nehru 1 er Premier ministre de l'Inde « Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que l'immense tragédie qu'a vécue l'Afrique depuis quelques siècles [...], depuis l'époque où des millions d'Africains ont été expédiés comme esclaves en Amérique ou ailleurs, la moitié d'entre eux mourant dans les galères. Malheureusement, même aujourd'hui, le drame de l'Afrique est plus grand que celui d'aucun autre continent, tant au point de vue racial que politique. Il appartient à l'Asie d'aider l'Afrique au mieux de ses possibilités, car nous sommes des continents frères. [...] ».
Retrouve-t-on derrière cette ruée économique vers l'Afrique la renaissance d'un nouvel axe politique des pays du Sud au détriment des pays occidentaux ?
Pour Bertrand Badie, cela ne fait guère de doute : « L'Afrique est devenue, à une vitesse effrayante, un champ de manoeuvre politique pour les puissances émergentes . »
Car la percée économique des pays émergents en Afrique s'accompagne d'ambitions politiques souvent concurrentes, comme en témoignent de nombreuses visites de haut niveau. Et on ne compte plus les tournées africaines de grands responsables chinois, indiens, brésiliens ou autres.
L'amitié revendiquée entre ces nouveaux acteurs et les États africains est célébrée à l'occasion de grandes rencontres internationales. En novembre 2006, le troisième forum sur la coopération Chine-Afrique (Focca) s'est tenu à Pékin. La publicité qui a été faite autour de ce sommet, au cours duquel la Chine a promis de doubler son aide aux pays africains et de leur accorder des prêts importants à des taux préférentiels, a largement nourri le soudain intérêt pour la « nouvelle question sino-africaine ».
Le Japon organise depuis 1993 des sommets similaires, les TICAD (Tokyo International Conference on African Development) dont la quatrième édition a eu lieu en mai 2008.
Le Brésil, dont la sphère d'influence naturelle en Afrique, on l'a vu, est constituée par les pays lusophones membres de la CPLP, a organisé, en novembre 2006, un premier sommet Afrique-Amérique du Sud.
L'Inde a accueilli à New Delhi, en avril 2008, un sommet Inde-Afrique.
Il n'est pas jusqu'à la Turquie qui n'ait organisé son sommet africain avec une quarantaine de pays invités à Istanbul en août 2008.
C'est avec la France, en 1973, qu'avaient été lancés les sommets Afrique-France qui se tenaient chaque année, alternativement en France et en Afrique, et qui se tiennent désormais tous les trois ans pour tenir compte des sommets UE-Afrique et des sommets de la Francophonie.
Alors que la formule des sommets Afrique-France a toujours fait l'objet de critiques en France, d'aucuns voyant en ces grand-messes les symboles d'une époque révolue, les pays émergents, qui ont moins d'états d'âme, multiplient les sommets et les tournées africaines.
Les voix convoitées des 53 États africains à l'ONU
Comme la France, les pays émergents, on l'a vu, cherchent, en maximisant leur influence en Afrique, à obtenir le vote africain dans les multiples instances internationales, où les 53 voix des pays africains sont convoitées.
Le Japon, par exemple, a fait de la conquête d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU un de ses objectifs principaux de politique étrangère, qu'il ne pourra pas atteindre si les 53 voix africaines à l'ONU lui sont hostiles. L'Inde espère, elle aussi, un siège permanent au Conseil de sécurité et elle escompte de sa participation aux opérations de maintien de la paix (OMP) de l'ONU en Afrique, notamment au Soudan, au Liberia et en République démocratique du Congo, pour donner l'image d'une puissance respectable.
Le Brésil ambitionne également de devenir un acteur clé d'un système international multipolaire. Le Brésil s'est associé à l'Allemagne, au Japon et à l'Inde afin de présenter en mai 2005 une réforme du Conseil de sécurité visant à élargir le nombre de membres, en ajoutant 6 permanents (G4 + 2 Etats africains) et 4 non-permanents renouvelables tous les deux ans. Le soutien africain est donc essentiel à la stratégie d'influence brésilienne sur la scène mondiale.
La Chine entend évincer du continent Taiwan, qui entretenait pourtant des relations diplomatiques avec un grand nombre d'États africains (le Sénégal, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine...), mais qui a vu ses alliés faire défection les uns après les autres au point de se réduire aujourd'hui à quelques confettis (Burkina Faso, Gambie, Sao-Tomé et Swaziland).
Ces différentes stratégies diplomatiques ne s'arrêtent pas là. L'Afrique est désormais un enjeu politique entre les puissances émergentes.
Regardons la carte de l'Afrique : à l'est l'océan Indien, avec une Inde prise dans une concurrence effrénée avec la Chine pour le leadership des pays émergents.
Une Afrique entre océan Indien et Amazonie bleue
La Chine développe manifestement une stratégie qui vise à contenir les avancées que l'Inde a pu opérer en tant que puissance régionale. Pékin a mis en place une coopération militaire avec le Pakistan, ennemi traditionnel de Delhi, et accroît sa présence militaire dans les pays du pourtour de l'océan Indien, tendant ainsi à encercler l'Inde. Géographiquement, la Chine peut s'appuyer sur le flanc oriental de l'Afrique pour soutenir cet effort. Une présence indienne active dans cette région présente donc un intérêt de premier plan pour la sécurité nationale.
La course au développement des activités d'affaires indiennes en Afrique et l'influence économique et diplomatique qui en découle aident non seulement Delhi à contrer la montée en puissance de la Chine en Afrique et dans l'océan Indien, notamment à Madagascar et Maurice, mais jouent également en faveur de l'Inde sur un plan plus général, comme dans sa tentative de décrocher un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU réformé et élargi.
L'investissement de l'Inde en Afrique permet au pays de se positionner non comme une puissance asiatique, mais comme une superpuissance mondiale. Le changement de statut de bénéficiaire de l'aide à donateur, le lancement de plans comme l'Initiative indienne pour le développement, l'appel de l'Inde à une réforme de la gouvernance mondiale et son aspiration à un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, tous ces éléments font de l'Afrique un facteur essentiel de la politique étrangère indienne.
A l'Ouest, au-delà de l'Atlantique, le Brésil cherche à se positionner comme point de jonction entre les deux rives de cet océan. C'est notamment vrai pour ce qui est des questions sécuritaires. Brasilia considère l'Atlantique Sud comme une zone de grande importance stratégique ; en effet, ces dernières années, de gigantesques gisements pétrolifères ont été découverts à quelques centaines de kilomètres de ses côtes. Il s'agit pour le Brésil d'oeuvrer collectivement pour sécuriser cet espace, qu'il qualifie d'« Amazonie bleue », contrôler le commerce des armes, lutter contre la piraterie maritime et les trafics de tout genre. Pour ce faire, Brasilia a récemment ravivé la ZOPACAS et encouragé une coopération navale dans l'Atlantique Sud entre l'Afrique du Sud et certains pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay).
Un anticolonialisme en partage
L'arrivée en force d'Etats eux-mêmes autrefois victimes de la colonisation est accueillie comme une sorte d'étape nouvelle.
Comme nous l'a déclaré un interlocuteur indien : « Nous avons avec l'Afrique une communauté de souffrance liée à la colonisation. Vous, vous avez une dette historique. Nous, nous faisons des investissements. Vous, vous financez l'aide au développement. Chacun oeuvre selon son passé et ses compétences ».
Le président Lula ne manquait jamais de répéter que son pays compte la deuxième population noire du monde après la Nigéria. Soulignant cette dette historique à l'égard de l'Afrique, il n'hésitait jamais à souligner ce passé commun au Brésil et à l'Afrique que sont la traite, l'esclavage et la colonisation.
Ces pays ont des atouts qui rendent leur offensive d'autant plus sérieuse : dispensés de gérer le passé colonial, ils se plaisent aussi à s'afficher moins sourcilleux en matière de droits de l'homme ou quant à la nature même des régimes et des dictatures, avec des différences selon les régimes politiques de chacun.
Mais surtout, au-delà de leurs différences, qui sont, on ne le soulignera jamais assez, très importantes, les pays émergents ont en commun avec l'Afrique un regard critique vis-à-vis de l'occident, de ses valeurs et d'un système international qui semble encore trop centré sur l'occident.
Participer à une émancipation du Sud, à un renversement du rapport de force avec l'occident
Comme nous l'a dit un interlocuteur en Afrique du Sud, « finalement, le plus petit dénominateur commun entre les pays africains et les autres pays du Sud, c'est d'avoir été agressés par l'Occident d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que, 50 ans après, le discours anticolonial fonctionne toujours ». Un des atouts des pays émergents réside dans ce substrat anticolonial et tiers-mondiste. Quels que soient leurs intérêts particuliers, les pays émergents jouent la carte de l'anticolonialisme, de l'émancipation, voire d'un renversement des valeurs.
Nous étions en Afrique du Sud lors du dernier sommet des BRICS. Dans l'euphorie d'un sommet qui promettait aux pays africains des financements pour des infrastructures, une industrialisation du continent et la mise sur pied d'une banque du développement qui permettrait de se passer du FMI et de la Banque mondiale, on a senti qu'il y avait là, en filigrane, comme une invitation pour les pays africains à participer à un renversement de l'ordre établi. Il y avait jadis, l'Occident et le reste du monde. Ce que proposent les pays émergents comme rêve aux pays africains, c'est de renverser le rapport de force, de procéder, sinon à une passation de pouvoir, du moins à une redistribution des cartes.
L'histoire ne dit pas si in fine les pays africains y gagneront, mais leurs nouveaux partenaires, qu'ils se comportent ou non comme les anciennes puissances coloniales, ont une certaine légitimité pour proposer aux pays africains un programme d'émancipation du Sud.
Ces tentatives de coaliser le Sud gagnent tous les forums sans exception. Quand le Brésil choisit de mettre en place une stratégie de concertation avec les autorités africaines, à travers l'organisation de rencontres diplomatiques telles que le sommet Afrique-Amérique du Sud, il se fixe pour objectif de définir des positions communes vis-à-vis de l'OMC et de l'ONU.
Comme nous l'a dit Bertrand Badie : « Tout se passe comme si les puissances émergentes avaient pour principal souci d'entretenir sous leur direction un bloc uni du Sud qui aurait en outre l'avantage de leur donner des atouts que les Etats développés du Nord n'ont plus. Il n'y a qu'à voir comment le Brésil a une diplomatie active en direction de l'Afrique, à coup de sommets multilatéraux ou de rencontres bilatérales. Il n'y a qu'à prendre la mesure de l'essor du réseau diplomatique indien, de la présence chinoise en Afrique et des efforts consentis par l'Afrique du Sud pour apparaître aux Nations unies comme le champion d'un néo-afro-asiatisme. »
De façon générale, s'il faut insister sur les points communs entre ces nouvelles puissances qui investissent l'Afrique, on ne saurait négliger leurs différences et la concurrence qu'elles se livrent. Comme hier les pays colonisateurs, les pays émergents arrivent en Afrique en ordre dispersé et dans une concurrence parfois exacerbée, comme c'est le cas entre la Chine et l'Inde.
Le sommet des BRICS qui s'est tenu à Durban en mars 2013, s'il semblait porteur d'opportunités pour le continent africain, s'est cependant achevé sur un bilan en demi-teinte : les dirigeants n'ont pas annoncé la création pourtant attendue d'une « South-south bank » visant à contrebalancer la direction occidentale du FMI et de la Banque mondiale.
L'absence d'accord sur ce point souligne la complexité des rapports d'influence qui se jouent en Afrique et l'hétérogénéité de ce groupe d'émergents. Il semble que les intérêts diplomatiques nationaux président à la mise en place d'une politique extérieure commune à travers la présence des BRICS en Afrique. Force est de constater que les intérêts brésiliens et chinois divergent parfois à cette échelle, du fait des alliances tissées par chaque nation.
Cela ne les empêche pas de jouer la carte du Sud contre le Nord.
On a vu, lors de la guerre en Libye, la capacité de mobilisation d'un discours critique à l'égard de l'intervention occidentale qui a rassemblé une grande partie des pays africains et des pays émergents. On se souvient du discours ovationné du Président Lula en 2011 à Malabo : « Il faut que les Nations unies représentent la force pour faire face aux menaces qui entravent la paix mondiale. Il est inacceptable que le continent africain, avec 53 pays, n'ait aucun représentant au Conseil de sécurité. De même, il est inacceptable que l'Amérique Latine, avec 440 millions de personnes, n'ait pas non plus de représentant. Il est inacceptable qu'à peine 5 pays soient responsables des décisions, des actions... Il faut que les Nations unies soient capables d'avoir le courage pour demander le cessez-le-feu en Libye et de constituer une table de négociation. ».
La coopération Sud-Sud : la réussite des émergents comme modèle
La coopération Sud-Sud ne repose pas uniquement sur des fondements idéologiques. Elle se nourrit d'une expérience concrète et récente du développement des pays émergents. Mais elle n'est pas exempte de ce terreau-là. En témoigne cet entretien avec l'ambassadeur Tebogo SEOKOLO, directeur Europe au Ministère des Affaires étrangères (DIRCO) d'Afrique du Sud, qui nous a dit : « l'Occident nous a apporté les 3 c : commerce, civilisation et colonisation, les BRICS viennent avec les trois i : intégration, infrastructure et industrialisation ».
Mais, naturellement, la croissance de la Chine, de l'Inde ou du Brésil, qui ont tiré de la pauvreté des centaines de millions de personnes en une génération, constitue pour les pays africains un modèle de réussite.
Les performances de ces pays ont de quoi susciter l'admiration. Entre 1981 et 2008, la Chine a réduit de 663 millions de personnes le nombre de Chinois vivant dans l'extrême pauvreté. En Inde, où la pauvreté est davantage répandue qu'en Chine, le taux de pauvreté devrait chuter de 51 % en 1990 à 22 % en 2015 contre 5 % en Chine à la même date.
Par comparaison, l'Europe, avec une croissance atone, une population vieillissante et une crise des finances publiques sans précédent, apparaît à la fois moins dynamique et moins transposable.
Les responsables africains ne s'en cachent pas. Pour beaucoup, la création en Chine, à la fin des années 70, d'un « projet national » visant à faire passer la Chine de la pauvreté à un statut de pays à revenu intermédiaire en une génération constitue un modèle. La capacité de l'État à s'engager dans une ligne de conduite claire ouvrant la voie à des initiatives « du haut vers le bas » à tous les niveaux, de la province au village, est pour beaucoup un modèle de stratégie de développement associant dirigisme et pragmatisme.
Le modèle chinois n'est cependant pas le seul. En matière de gouvernance, il apparaît à beaucoup comme peu transposable au contexte africain. En outre, le modèle démocratique reste, au moins dans les esprits, la référence. De ce point de vue, les expériences de l'Inde et du Brésil plus démocratiques suscitent également un intérêt.
Du côté de l'occident, la politique de coopération fait depuis toujours partie d'une diplomatie qui vise à changer la situation socio-économique et politique des pays bénéficiaires pour les conduire vers des valeurs partagées par les pays occidentaux, et notamment par les membres du comité d'aide au développement de l'OCDE, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie et le libéralisme économique et politique. De ce point de vue, le soi-disant « alignement des politiques de coopération sur les priorités du bénéficiaire » s'est toujours fait au sein d'un champ des possibles largement prédéterminé.
Sur le long terme, l'enjeu dépasse donc très largement une vision mercantiliste de la coopération. Il s'agit plus fondamentalement de promouvoir à travers des actions de coopération un modèle de développement.
L'enjeu n'est en effet pas de savoir si l'Afrique va se développer, mais comment elle se développe, avec quel impact sur les équilibres régionaux et mondiaux, et avec quels partenaires. Est-ce d'une manière qui favorise la paix et la sécurité ou en cristallisant les sources de tensions qui menacent la sécurité régionale et mondiale ? En favorisant une élévation des conditions de vie et de travail des populations ou en laissant s'approfondir les risques de dumping social et environnemental ? En inventant des chemins de croissance compatibles avec la survie de la planète ou en cédant à la tentation du « rattrapage économique à tout prix » sans considération des dangers sociaux et environnementaux afférents ?
L'Afrique devient ainsi un espace multiplicateur de puissance. Cet intérêt croissant pour le continent nous éclaire aussi sur une réalité nouvelle des relations internationales. L'arrivée des pays émergents ces dernières années en Afrique et leur expansion de plus en plus importante sur ce continent contribue indéniablement au décentrage économique mais aussi politique du pouvoir mondial vers le Sud.
V. LE REVERS DE LA MONDIALISATION : TRAFICS ILLICITES ET RÉSEAUX TERRORISTES
Si l'intégration de l'Afrique dans les réseaux mondiaux d'échanges est un facteur de croissance économique et de découverte scientifique, il s'accompagne également d'une croissance des trafics illicites en provenance ou au départ de l'Afrique, de l'insertion de mouvements rebelles dans des réseaux plus vastes inspirés par le djihadisme armé et d'un développement sans précédents de la piraterie.
La plongée de l'Afrique dans la mondialisation a sa face sombre.
Ces nouvelles menaces se déploient de façon privilégiée dans les déserts du Sahel et dans les océans qui bordent les côtes africaines, deux éléments qui ont en commun de former des espaces creux, mal contrôlés, peu contrôlables, des zones grises qui échappent aux pouvoirs publics des Etats.
Sur les mers ou dans le sable africain, les trafics illicites se développent dans les zones désertées par les puissances publiques.
Sur mer, la criminalité favorisée par des zones de non-droit, le long des côtes africaines à l'ouest dans le golfe de Guinée, à l'est au large de la Somalie, et dont une des conséquences est l'émergence d'une véritable « industrie » de la piraterie maritime, le pillage des ressources halieutiques, des différends territoriaux et, enfin, une privatisation de l'emploi de la force armée en mer aussi qui pourrait devenir préoccupante si on ne canalise pas ce phénomène.
Sur terre, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont incontestablement devenus une plaque tournante pour le trafic international de drogues dures telles que l'héroïne et la cocaïne en provenance d'Amérique latine et d'Afghanistan.
Parfois en liaison avec ces trafics, l'Afrique est devenue un terrain de manoeuvre de groupes terroristes islamistes plus ou moins reliés à des réseaux internationaux.
A. « L'AFRICAN CONNEXION »
Zone traditionnelle de contrebande en raison de ses multiples voies de circulation entre Afrique subsaharienne et Maghreb, la région du Sahel fut longtemps essentiellement concernée par le trafic et la contrebande de cannabis, principalement cultivé au Maroc. Cependant, depuis le début du XXI e siècle, la partie nord-ouest de l'Afrique est devenue un carrefour de trafic de drogues de toutes sortes, entraînant la formation de groupes criminels mieux structurés et disposant de moyens financiers et « militaires » accrus.
L'une des explications est que la région est moins risquée que les routes plus directes entre les pays producteurs d'Amérique du sud et le continent européen qui s'avère être aussi le premier marché de consommation mondiale.
L'industrie de la drogue du continent sud-américain utilise les routes le long du 10 e parallèle pour pénétrer par l'Afrique de l'Ouest. Ce trafic est en outre aggravé par la présence d'héroïne et cocaïne provenant d'Afghanistan et transitant aussi par cette zone ainsi que par la côte est du continent africain. La drogue est ensuite acheminée à travers le Tchad, le Mali, le Niger, le Maroc et l'Algérie, dont la porosité des frontières facilite les déplacements, pour être vendue et consommée en Europe.
Selon l'Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) 29 ( * ) , en 2012, il était estimé que 50 tonnes de cocaïne d'un montant de 2 milliards de dollars et équivalant au PNB de la Guinée et de la Sierra Leone réunies ont transité par l'Afrique de l'ouest.
Le montant des transactions de drogue en Afrique de l'Ouest dépasse le budget de nombreux Etats sahéliens
L'essentiel de la cocaïne passe par la Guinée-Bissau, le Ghana, la Guinée Conakry, et le Cap-Vert qui forment des plaques tournantes depuis lesquelles des mules voyageant à bord de vols commerciaux transportent la drogue jusqu'à leur destination finale.
Le nouveau rapport de l'ONUDC souligne toutefois que la cocaïne n'est pas la seule drogue à transiter par la région. Ses auteurs s'inquiètent de l'émergence de la production de méthamphétamine au Nigeria, où deux laboratoires ont été repérés en 2011 et 2012, ainsi que du nombre de mules qui auraient transporté l'équivalent de 360 millions de dollars de ce stupéfiant en vogue vers l'Afrique de l'Est en 2010.
Les zones de départ sont en évolution constante. La baisse de la Colombie a permis la hausse du Venezuela, de la Bolivie et du Pérou. Le Brésil se développe également depuis quelques années comme zone de transit et plaque tournante. Les zones d'arrivée se diversifient et se déplacent vers l'Est du golfe de Guinée, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Nigeria.
De même, les modes de transport et les quantités transportées sont en évolution rapide. Les anciennes grosses cargaisons transportées par voies maritimes commerciales laissent la place à de petites quantités à bord de vecteurs multiples, aussi bien maritimes qu'aériens. Ces évolutions permanentes montrent la capacité de réaction et les moyens financiers considérables à disposition des trafiquants.
Le Nigéria, le Ghana, le Togo et le Bénin représentent une zone d'arrivée et de transit sous le contrôle de groupes nigérians. La drogue arrive soit directement dans les grands ports, soit est redistribuée en mer sur des petits navires qui la diffusent sur le littoral.
Dans ces pays, la corruption est solidement installée. Plus au nord, la Sierra Leone, la Guinée, le Sénégal, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau sont également des points d'entrée de la drogue, par voie maritime ou aérienne. Les quatre premiers pays cités sont touchés essentiellement du fait de la corruption mais il y persiste une volonté de contrer le trafic. En revanche, la Guinée-Bissau est déjà considérée comme un narco-Etat où tous les pans de la société sont impliqués, rendant de fait impossible toute lutte ou coopération avec ce pays.
25 % de la cocaïne à destination de l'Europe transitent par l'Afrique de l'Ouest
Avec la hausse de la production et de la consommation de drogues, la piraterie et l'instabilité politique, l'Afrique de l'Ouest pose un défi important tant elle ne constitue plus simplement une voie de transit, mais aussi une destination finale pour la revente de stupéfiants.
Ce trafic de drogue est par ailleurs aggravé par les liens tissés entre les narcotrafiquants, les gouvernants et les appareils sécuritaires de la région ainsi que certains groupes terroristes présents au Sahel tel que le Mouvement d'Unité pour le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).
En sus du trafic de drogue et d'armes, l'importante contrebande de cigarettes à travers le Sahel est aussi très rémunératrice pour les trafiquants de la région.
Les cigarettes qui proviennent d'usines de contrefaçon, principalement du Nigeria, sont distribuées dans la région, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Europe. Ce trafic est une source secondaire de financement pour les groupes terroristes, qui, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans ce genre de contrebande, s'enrichissent toutefois en imposant un impôt contre une « garde rapprochée » aux contrebandiers.
Dans ce mélange des genres, les groupes terroristes tel qu'AQMI ont très rapidement compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer en établissant un gentlemen's agreement avec certains groupes criminels, par exemple s'agissant de la capture d'otages. En effet, alors que les actions violentes d'AQMI sont présentées sous des idéaux religieux, le groupe est néanmoins intéressé par l'appât du gain à travers ses demandes de rançons.
Par ailleurs, la chute de Kadhafi en Libye et l'instabilité géopolitique régnante qui s'ensuit, ainsi que la perméabilité des frontières qui facilite le passage d'armes d'un pays à un autre ont procuré aux terroristes et narcotrafiquants une opportunité supplémentaire de renforcer leur position dans la région, aggravant de ce fait la situation au Sahel.
Une corruption solidement installée
C'est dans ce contexte que la prolifération d'armes, de drogues, de trafics de cigarettes et autres produits illicites s'enracine au Sahel. Mais ce dévolu sur la région est aussi principalement dû à la faiblesse des Etats qui composent cette zone géographique, au manque flagrant de surveillance, à la porosité des frontières ainsi qu'à la corruption qui gangrène les institutions de ces mêmes Etats, telles que l'armée, la douane ou la police.
Afin de combattre ce fléau, la coopération entre les Etats, mais aussi entre les différentes organisations et autres institutions internationales, est une condition sine qua non pour obtenir des résultats probants.
La source de ce problème se trouve évidemment aussi dans la faiblesse des systèmes éducatifs et l'étroitesse du marché de l'emploi. Aussi, c'est en améliorant les conditions de vie des populations locales, en conduisant des programmes d'éducation et de développement économique et en renforçant l'Etat de droit que les trafics en tous genres, en Afrique de l'Ouest et au Sahel, pourront être, sinon éradiqués, tout au moins combattus.
L'augmentation des activités criminelles dans la région souligne le besoin urgent d'actions afin de renforcer la souveraineté des Etats concernés. Car il est incontestable que ce trafic en Afrique de l'Ouest est en train de se propager comme une traînée de poudre à travers tout le continent africain.
La mauvaise passe dans laquelle se trouve actuellement le Mali est sans nul doute préoccupante. Mais les origines de cette crise sont présentes dans d'autres Etats de la région, et la complaisance de certains gouvernants envers les trafics en fait partie.
B. LE CONTINENT NOIR DE LA PIRATERIE
Comme le constatait un document préparatoire à l'actualisation du Livre blanc préparé par le SGDSN en 2012 : « La piraterie et le brigandage maritimes ont connu un développement inédit depuis 2008, en particulier au large des côtes africaines. La Corne de l'Afrique est la région la plus dangereuse (Somalie et Golfe d'Aden, avec une extension à l'Est jusqu'aux côtes indiennes). Le Golfe de Guinée, zone importante dans le domaine des hydrocarbures, connaît une multiplication des attaques depuis le début de l'année 2011.
L'absence de moyens de surveillance du trafic maritime et de marine hauturière, la faiblesse des Etats et l'absence de véritable répression à terre sont propices à la pérennité du phénomène. La piraterie pose de manière croissante le problème de la protection des navires. La réponse européenne (opération Atalante et internationale au large de la Corne de l'Afrique) est efficace mais insuffisante pour enrayer le phénomène. ».
Si l'on focalise souvent sur la situation qui prévaut en Somalie, où le phénomène est en nette diminution, il est en plein développement dans le golfe de Guinée. En dépit des nombreuses différences liées aux situations locales, on constate partout la création de véritables entreprises de piraterie.
Si autrefois il fallait avoir bac+5 pour pouvoir naviguer à cinq jours de distance des terres, aujourd'hui, avec les moyens modernes, des pirates analphabètes s'engagent bien plus loin des côtes de l'océan Indien avec des moyens de communication et des armements relativement sophistiqués. De fait avec un GPS portable, un moteur Yamaha et une Kalachnikov, les pirates vont, avec une barque au milieu du Golfe de Guinée, mettre en danger des porte-conteneurs ou des tankers.
La situation sur le continent africain est cependant plus complexe en raison du délitement des structures étatiques le long de la Corne de l'Afrique et en particulier en Somalie.
C'est la raison pour laquelle l'Europe, à travers l'opération Atalante déployée depuis décembre 2008, veille et souhaite prévenir et réprimer les actes de piraterie dans les eaux internationales ainsi que dans les zones territoriales somaliennes.
Avec dix pays de l'Union participant à l'opération, Atalante est l'une des premières opérations conjointes intégrées de l'Union européenne. Cette action est complétée par les forces de l'OTAN avec l'opération Ocean Shield, mais aussi par la présence sur mer de bâtiments russes, iraniens, indiens, japonais, coréens et chinois.
L'une des raisons de la mobilisation croissante des Etats est non seulement les prises d'otages, mais également la progression de l'impact économique de la piraterie.
Le montant annuel des rançons versées aux pirates somaliens n'aurait cessé de s'accroître. Il était estimé à 131 millions de dollars en 2011, contre 80 millions de dollars en 2010.
Le coût global de la piraterie serait cependant bien supérieur, puisqu'il faut tenir compte des primes d'assurance pour les armateurs, les dépenses afférentes aux équipes de protection embarquées ou encore le coût du recours à des sociétés de sécurité privées de protection des navires.
Concernant les primes d'assurance, le surcoût lié à une traversée de l'océan Indien est généralement de l'ordre de 0,5 % de la valeur du navire, soit souvent proche de 20 000 à 30 000 dollars supplémentaires par jour de traversée. Le contournement des zones dangereuses, par exemple par le Cap de Bonne Espérance, induit un allongement des délais et une consommation plus élevée de fioul.
Selon le rapport de MM. Jean-Claude Peyronnet (Soc, Haute-Vienne) et François Trucy (UMP, Var) sur l'application de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer «au total, le « chiffre d'affaires » généré par la piraterie dans l'océan Indien est estimé entre 7 et 8 milliards de dollars ».
La piraterie dans l'océan Indien est donc naturellement devenue une préoccupation majeure des pays dont les bâtiments croisent les côtes somaliennes, mais également une occasion pour s'implanter dans la région. C'est dans cette perspective que le Japon a, par exemple, installé, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une base navale en dehors de son territoire à Djibouti. C'est également au titre de la lutte contre la piraterie que la Chine assure dans cette zone une présence quasi permanente.
La piraterie dans le Golfe de Guinée est différente de celle en océan Indien. Il s'agit d'un phénomène endémique avec lequel les compagnies opérant dans le secteur avaient appris à vivre. Toutefois, les événements en Somalie ont provoqué une prise de conscience.
Il faut sécuriser le golfe de Guinée.
Depuis avril 2008, un contrôle naval volontaire a été mis en place par la Marine nationale dans le golfe de Guinée. S'il est difficile de mesurer scientifiquement le phénomène, dans la mesure où toutes les attaques ne sont pas reportées, on estime qu'il y aurait treize attaques par mois, toutes catégories confondues.
Les pirates y pratiquent le « siphonage » qui consiste à prendre par la force des pétroliers dans le but de leur dérober une partie des produits raffinés, en haute mer. Ces actes sont observés de la Côte d'Ivoire et au Gabon. Généralement pris dans les zones d'attente des grands ports (Abidjan, Lomé, etc.), les navires et les équipages sont ensuite relâchés à proximité du nord du Nigeria entre Lagos et Escravos. Le vol se pratique partout mais est davantage signalé dans le sud et le sud-ouest du Nigeria. La prise d'otages se pratique uniquement dans le sud et le sud-ouest du Nigeria ; les otages sont soit conservés à bord d'un bâtiment-mère, soit ramenés à terre, jusqu'à l'obtention d'une rançon. Ces enlèvements ont concerné au moins 195 personnes en 2012.
L'augmentation du phénomène a été à l'origine des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies n° 2018 du 31 octobre 2011 et n° 2039 du 29 février 2012, qui appellent la communauté internationale à créer un mécanisme multinational et transrégional de sécurité maritime couvrant toute la région du golfe de Guinée.
Ce dispositif est, malgré la coopération avec les Britanniques sur ce sujet, trop « juste » face à l'immensité de la zone, à l'ampleur des sujets et à la lenteur de la montée en puissance des moyens de surveillance maritime des États riverains, malgré une prise de conscience de certains d'entre eux. Il est ensuite partiellement « aveugle » : malgré le partage d'informations satellitaires (notamment avec les États-Unis) et la construction d'une chaîne sémaphorique, de nombreuses zones restent à l'ombre des systèmes de surveillance.
Il sera, enfin, il faut le redouter, affecté par les réductions d'activité qui seront imposées aux bâtiments de la Marine nationale dans le cadre de la future loi de programmation militaire.
C'est pourquoi la question de son européanisation mérite d'être posée, s'agissant d'une des principales routes d'approvisionnement stratégique de l'ensemble de l'économie européenne.
Il faut enfin prendre conscience que la sécurisation des côtes africaines est une préoccupation africaine mais aussi européenne.
Comme le souligne une étude de la Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique sur la « Vulnérabilité de la France face aux flux maritimes », la sécurité au large des côtes africaines a un effet direct sur notre souveraineté énergétique.
Certes, grâce à sa situation géographique, la France dispose de deux façades maritimes métropolitaines, la façade atlantique vers l'Afrique de l'Ouest où est localisée une part significative de nos approvisionnements en pétrole et en Uranium, la façade méditerranéenne vers Suez et, de là, vers l'océan Indien en passant par les détroits de Bâb el Mandeb ou d'Ormuz.
Au regard des approvisionnements en hydrocarbures, la France, qui dispose heureusement d'un bouquet énergétique et de sources d'approvisionnement diversifiées, présente une vulnérabilité limitée en termes de sécurité énergétique.
En outre, à l'avenir, la mise en exploitation de nouvelles ressources en Arctique, au Brésil, et la diversification de nos approvisionnements, en s'adressant au Venezuela ou à la Guyane par exemple, devraient avoir un impact sur les flux énergétiques français, en renforçant l'importance stratégique de l'océan Atlantique. Cette évolution devrait contribuer, grâce à la diversification des fournisseurs, à une diminution quantitative de la vulnérabilité de la France face aux flux énergétiques.
Mais l'économie française reste très dépendante en ce qui concerne le trafic de conteneurs et les approvisionnements en métaux stratégiques (aluminium, cuivre, minerai de fer, mais aussi terres rares, niobium, tantale, cobalt, nickel...) de l'une des voies maritimes les plus sensibles au monde. La route stratégique majeure pour les conteneurs transite par la Méditerranée avant de parcourir l'océan Indien, de franchir le détroit de Malacca et de traverser la mer de Chine du sud. En conséquence, toute crise située sur cette trajectoire pourrait avoir un impact majeur pour la santé économique de la France.
Ainsi, la France est fortement vulnérable à l'égard des flux de minerais et des composants électroniques. Cette vulnérabilité devrait s'accroître en raison de la concurrence entre puissances pour l'accès aux ressources, notamment en métaux stratégiques pour les industries de hautes technologies (défense, aérospatial, électronique...) et pour les industries « vertes ».
La montée en puissance de l'implantation militaire française aux Emirats Arabes Unis (EAU), inaugurée en mai 2009, la confirmation de notre accord de défense avec Djibouti, en décembre 2011, comme la participation aux opérations Atalante doit se comprendre par la volonté des pouvoirs publics d'être présents sur les routes d'approvisionnement maritime de la France.
Nos deux implantations sur cet axe entre la Méditerranée et l'océan Indien ont notamment pour mission d'affirmer une présence interarmées, dissuasive vis-à-vis d'un agresseur et permettant, le cas échéant, de faciliter la mise en oeuvre rapide de premières mesures de réaction face à une action hostile, notamment dans le cadre de nos accords de défense.
La proximité géographique, les liens historiques, démographiques et commerciaux, l'impact sur les questions de politique intérieure et de défense, les possibles répercussions en matière d'approvisionnement énergétique ou de flux migratoires font des évolutions de l'Afrique un enjeu stratégique majeur pour la France et pour l'Europe.
Ces nouvelles menaces, comme la ruée des pays émergents et des nations périphériques vers l'Afrique doivent nous faire réfléchir à notre investissement dans la relation de la France au continent africain.
Les enjeux de l'Afrique d'aujourd'hui sont très éloignés des questions qui ont occupé le devant de la scène sur notre responsabilité historique, sur notre dette morale ou sur la France-Afrique et ses dérives. Ils doivent nous faire reconsidérer le sens de notre politique africaine, les intérêts que nous avons à y défendre et les projets que nous voulons y promouvoir.
CHAPITRE 3 : UNE PRÉSENCE FRANÇAISE EN RECUL DANS UN CONTINENT EN ESSOR
Face à cette « ruée » vers l'Afrique, que fait la France ? Quelle place la France occupe-t-elle encore sur ce continent décidément convoité ? Nous avons posé ces questions aux quatre coins de l'Afrique. Quelle place ? Quel rang, quelle influence, mais aussi quelle contribution aux changements en cours, quel soutien à nos partenaires africains dans cette formidable mutation du continent ? En résumé : quelle est la valeur ajoutée de la présence française dans cette Afrique en transformation ? Des questions obsédantes et finalement très françaises.
Notre spécificité ? À l'évidence cette dernière n'est plus la quantité. Nous ne sommes plus le principal partenaire économique de l'Afrique, ni même de l'Afrique francophone. La France est le cinquième exportateur vers l'Afrique subsaharienne derrière la Chine, l'Inde, les États-Unis et même l'Allemagne. Les Français ne sont plus la principale communauté étrangère, même dans les anciennes colonies françaises.
Nous avons interrogé nos interlocuteurs en Afrique et à Paris. La réponse la plus fréquente est banale, elle se répète jusqu'à l'absurde dans les déclarations d'amitié que les dirigeants français et africains échangent dans les salons feutrés des ambassades : une histoire commune et une langue partagée.
On peut discuter de savoir si c'est un avantage ou un inconvénient. Mais force est de constater que ces liens-là - ils ne sont pas les seuls - conditionnent notre relation avec les pays africains et nous différencient des nouveaux partenaires.
I. LA FRANCE ET L'AFRIQUE : UNE RELATION SANS ÉQUIVALENT
A. LA FRANCE EN AFRIQUE : UNE PRÉSENCE FORTE LIÉE À L'HISTOIRE ET À LA LANGUE
La parenthèse coloniale a été brève au regard de l'histoire longue, un siècle au Sénégal, soixante ans à peine au Tchad. Elle ne concerne qu'une petite partie de l'Afrique.
Mais les traces sont encore très présentes et l'empreinte française vivante.
1. Une présence continue depuis plus de 150 ans
Il y a le legs du passé bien sûr. On pense aux frontières, à l'organisation des villes, à l'orientation des économies rentières tournées vers l'exportation de matières premières, à l'organisation administrative et juridique qui a été copiée sur les systèmes français, mais surtout à l'usage d'une langue commune, le français.
La réalité du français en Afrique est aujourd'hui sans doute moins assurée qu'il n'y paraît devant l'essor de l'anglais et des langues vernaculaires comme le yoruba, le swahili, la bambara ou le wolof.
Mais cette proximité linguistique reste un atout majeur, une carte maîtresse. À travers la langue, c'est toute une culture, toute une vision du monde que nous partageons avec plus de 50 millions de locuteurs francophones en Afrique.
Si pour les grands groupes, les barrières linguistiques ne sont pas des problèmes dans la mesure où ils disposent de cadres qui parlent plusieurs langues dont l'anglais, c'est beaucoup moins le cas des PME. Dès lors la francophonie est un atout majeur pour les PME françaises qui trouvent en Afrique francophone des interlocuteurs avec lesquels il n'y a aucune barrière linguistique.
Comme l'a dit Mathieu Pigasse devant notre groupe de travail : « Il n'y a que les Européens pour ignorer que les Africains pensent le monde à travers des concepts européens, des langues européennes et au premier chef la langue française ».
Le français est aujourd'hui une langue africaine. Elle est non seulement une langue officielle dans une vingtaine de pays 30 ( * ) , une langue enseignée, dans les écoles primaires, secondaires, et universitaires, mais aussi une langue pensée et vécue comme la langue d'accès au savoir, comme celle qui crée le lien : lien au sein de la communauté nationale divisée en différentes ethnies et langues vernaculaires, lien entre différents pays de la communauté francophone.

Cette langue en partage, les pays africains se la sont appropriée au point d'être les plus fervents défenseurs de la francophonie dans les instances internationales.
Il faut entendre les ambassadeurs des pays francophones nous tancer à Addis Abeba parce que nous ne soutenons pas avec assez de fermeté le français à l'Union africaine pour comprendre que nous ne sommes pas seuls à porter haut les couleurs de la langue de Molière. Ils défendent ici leur identité autant que notre langue. Il leur arrive même de penser que nous pourrions parfois être plus francophiles !
Il faut voir les gouvernements africains défendre les institutions internationales de la Francophonie fondées par Léopold Sédar Senghor et aujourd'hui dirigées par l'ancien Président sénégalais Abdou Diouf.
Il ne s'agit pas de se gargariser de cette francophonie. On peut dire que « l'Afrique est l'avenir de la Francophonie ». Il est vrai que demain, en 2050, si la planète compte 600 millions de francophones, ce sera grâce au continent noir. Mais il faut aussi regarder les choses en face. Chacun sait que dans certains bastions, le français recule. C'est le cas au Sénégal comme à Madagascar.
Il reste cependant un formidable atout et le signe le plus évident de la spécificité de la présence française en Afrique.
Le français : cette autre langue africaine
Cette langue en partage n'est plus seulement la France, elle a pris racine en Afrique et cet enracinement est le signe le plus profond qu'elle ne quittera pas le continent demain si facilement.
50 ans après les indépendances, il eût été surprenant que le français d'Afrique ne s'acculture pas. Il faut entendre dans les rues d'Abidjan, le long des « maquis », l'argot local, le « Nouchi », pour comprendre que la langue de Rabelais se métisse, s'imagine et se métamorphose.
Il faut parcourir l'Afrique, explorer, vêtu d'une « culotte grande manche » 31 ( * ) , ses « sans confiance » aux pieds, traverser le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, en passant par le Niger, le Cameroun, le Congo, partout où les dialectes locaux se mélangent avec fantaisie à la langue française.
Vous passerez sur des « tablettes de chocolat » (routes mal entretenues), vous vous arrêterez à « l'essencerie » (station essence) ou chez le tablier (vendeur de cigarettes) pour y rencontrer des « mamans Benz » (commerçantes qui se déplacent en Mercedez-Benz) ou des « femmes bien développées » (femmes instruites).
« Le français, cette autre langue africaine » disent les Alliances françaises. C'est un « magnifique butin de guerre » disait Kateb Yacine.
Il faut lire les romans de Henri Lopes : « Sans tam-tam » ou « Le pleurer-rire », une oeuvre qui se veut une véritable entreprise de décolonisation des mentalités, mais aussi un éloge de la langue française et de ce que l'auteur appelle « un Bantou mâtiné de Français » pour savourer ces morceaux de France au coeur de la culture africaine.
La langue française dont l'écrivain et cinéaste ivoirien Jean-Marie Adiaffi disait « un mariage forcé devenu un mariage d'amour », est notre porte d'entrée dans le continent.
C'est également un visa pour l'ensemble des pays qui veulent s'implanter en Afrique francophone, si bien qu'en Chine, en Afrique du Sud et en Inde, on apprend d'abord le français pour aller en Afrique et ensuite, éventuellement, pour venir en France.
Il faut regarder les affiches des sommets Afrique-Chine en français pour prendre conscience que même les pays émergents s'implantent en Afrique en français.
La langue a laissé des traces dans les esprits, l'histoire, dans les paysages urbains et dans les institutions.
Ces traces font partie du décor.
Descendre d'avion en Afrique francophone, c'est fouler une terre éminemment exotique, mais aussi familière.
Traverser Dakar ou Abidjan, c'est parcourir un monde familier par la langue, par la forme des panneaux, l'aménagement urbain. Entrer dans une administration en Afrique de l'Ouest peut réserver des surprises, mais reste un monde connu, une organisation et des procédures inspirées du modèle français jusqu'à la caricature.
Cette familiarité-là, cette intimité-là nous sont enviées par nos concurrents.
Cette histoire partagée est à double tranchant : elle nous vaut d'être à la fois admirés et haïs. Si le temps a passé depuis les indépendances, la présence française en Afrique peut toujours être rapportée à cette origine, soit pour dénoncer un comportement qui serait irrespectueux, humiliant ou exagérément interventionniste, soit pour rappeler la dette morale et le devoir d'assistance de l'ex-puissance coloniale dont le rôle dans les maux qui affligent l'Afrique peut à tout moment être évoqué.
Il est tellement fréquent d'entendre encore aujourd'hui des ministres africains citer l'héritage colonial pour justifier la situation de tel ou tel secteur, qu'il serait injuste de n'en citer qu'un seul. « Le conflit en Casamance en 2013 ? Ses racines sont avant tout coloniales ». 50 ans après l'indépendance, « la sous-industrialisation de tel ou tel pays : un legs de la préférence coloniale ». Ces paroles entendues sur RFI illustrent combien le passif colonial reste une figure imposée du débat politique africain.
S'il est vrai que plus de 80 % de la population, voire plus, n'ont pas connu le système colonial, si bien sûr la jeunesse est aujourd'hui essentiellement tournée vers l'avenir, un avenir qu'elle entrevoit souvent avec optimisme, il faut cesser de penser que ce passé colonial n'intéresse que les Français.
La parole de la France et de ses représentants porte le poids de l'histoire.
Elle est vivante dans les esprits et présente dans le débat politique africain. Ce passé est un élément incontournable de la relation entre la France et l'Afrique pour le meilleur et pour le pire. La question est de savoir ce qu'on en fait : le mettre sur le devant de la scène ? Lui donner sa juste place, construire ensemble un discours partagé, une histoire écrite à deux mains ? Ou se lancer des anathèmes au nom d'un passé reconstruit ou fantasmé ?
Cette histoire explique que la parole de la France en Afrique a un retentissement qui va bien au-delà de son poids économique et même politique.
Les réactions au discours de Dakar du Président Sarkozy en sont l'illustration. Voilà un discours maladroit et mal inspiré qui a provoqué des dizaines d'ouvrages et d'articles et des prises de position sans nombre. Y-a-t-il encore un pays dont le Président pourrait susciter autant de succès en librairie ?
Une histoire complexe, passionnée et passionnante, qui explique que la parole de la France en Afrique ait un retentissement qui va bien au-delà de son poids économique.
Cette longue connivence linguistique, culturelle, politique et financière est un avantage comparatif que ne peut revendiquer aucun des pays émergents qui aujourd'hui convoitent nos positions en Afrique.
Comme nous l'a dit un interlocuteur anglais, « en Afrique francophone, quand une feuille de palmier se détache du tronc, les Français le savent avant qu'elle tombe par terre ».
Et ce n'est pas le moindre paradoxe que de voir aujourd'hui des entreprises françaises faire commerce de cette connaissance de l'Afrique pour ouvrir aux entreprises chinoises les marchés africains. De nombreux Français se font les guides des arcanes africaines, les interprètes des habitudes et des coutumes africaines, vendent cette connaissance de l'Afrique accumulée au fil du 20 e siècle.
Car cette histoire partagée est dans les esprits, elle est aussi dans la myriade d'institutions françaises et franco-africaines qui sont autant de ponts entre nos deux continents.
Nous aurions voulu avoir le temps de cartographier l'ensemble de ces institutions. Cette carte aurait illustré la densité du maillage des relations entre la France et ses ex-colonies. La carte ci-dessous ne concerne que les Alliances françaises et les instituts français ; elle décrit déjà la géographie de la présence française et sa densité à l'échelle d'un continent.
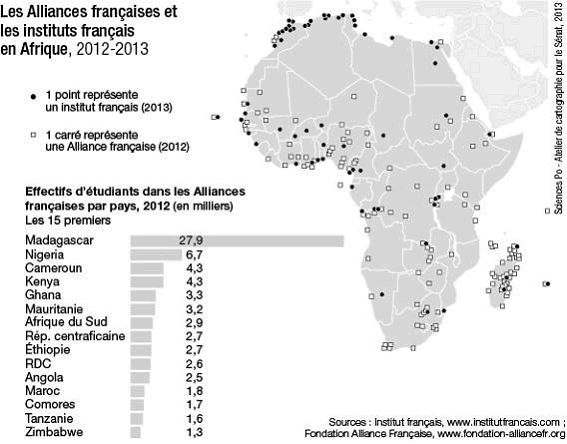
Les institutions françaises en Afrique sont en effet le fruit d'une histoire longue, d'une sédimentation d'expériences parfois individuelles, souvent collectives, qui prend racine dans la colonisation et a trouvé après les indépendances un nouveau sens.
Il y a les destins individuels , ces lignées de Français d'Afrique qui ont traversé le siècle en faisant vivre par-delà les secousses de l'histoire des entreprises familiales. Nous avons rencontré en Côte d'ivoire des familles françaises ou franco-africaines implantées à Abidjan depuis plusieurs générations et qui sont restées en dépit de tout, à travers la crise de la dernière décennie, quand des Français par milliers ont quitté le territoire. Ils sont restés là « chez eux ». Ils ne sont plus tout à fait la France et pas non plus l'Afrique. On en trouve encore dans toutes les anciennes colonies.
Il y a les institutions et les organismes qui ont traversé l'histoire des indépendances jusqu'à aujourd'hui.
On pense évidemment à la dizaine de centres de recherche en Afrique subsaharienne de l'IRD qui a pris la succession de l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM), créé en 1944.
Une présence imposante à travers un maillage multisectoriel d'une densité rare
Plus de huit mois d'auditions et de déplacements nous ont permis de comprendre que, si la coopération française civile, militaire, culturelle, monétaire ou scientifique mise en place au lendemain des indépendances a perdu de sa superbe, elle reste un maillage sectoriel remarquable, une présence sans équivalent, éclatée dans différents domaines, mais finalement assez dense tant elle couvre de secteurs variés.
Tentons une photographie, un kaléidoscope de ce legs de l'histoire, une liste qui sonnera un peu comme un inventaire à la Prévert, mais qui donnera une idée de la présence française dans toute sa diversité.
La France en Afrique : c'est d'abord une présence humaine de plus de 100 000 français, des communautés hétérogènes de plus en plus franco-africaines concentrées pour l'essentiel dans les anciennes colonies. Nous y reviendrons.
C'est dans le domaine économique , selon le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), «1.000 établissements et 80.000 collaborateurs sur place» pour un chiffre d'affaires de «40 milliards d'euros». Des chiffres qu'il faut majorer puisque les sociétés adhérentes au CIAN représenteraient environ 75% de la présence économique française sur place.
C'est également 17% de nos exportations (28 milliards d'euros en 2011 et 26 milliards pour les importations pour l'ensemble du continent), 7% des investissements français à l'étranger en 2011, soit plus de 4 milliards d'euros en Afrique.
Des investissements qui dans la durée ont permis de constituer une présence entrepreneuriale importante à l'échelle de l'Afrique.
Dans les pays d'Afrique de l'Ouest , les investissements français représentent souvent plus de plus 50% du stock d'investissements étrangers et, dans certains pays comme le Sénégal, les entreprises françaises sont encore les principaux employeurs étrangers du secteur formel.
La composition du Conseil d'administration du CIAN donne une image fidèle de ce que sont les grandes entreprises françaises qui possèdent des intérêts en Afrique. On y trouve logiquement des sociétés comme EDF, la CFAO, des banques (BNP, Société Générale), Bolloré, Total, Lafarge ou la Compagnie Fruitière.
Ces entreprises peuvent compter sur un réseau institutionnel dense, une dizaine de représentations d' Ubifrance , des dizaines de chambres de commerce et d'industrie franco-africaines, un réseau de services économiques dans les ambassades de France regroupés en cinq services économiques régionaux à Dakar, Abuja, Yaoundé, Nairobi et Pretoria.
Sur le plan de la coopération économique , si la France a perdu de son aura, elle demeure très présente et un des principaux bailleurs de fonds. On compte une trentaine de bureaux de l'Agence française pour le développement avec plus de 2 milliards d'engagements annuels, une trentaine d'organismes d'expertise publique qui interviennent sur le terrain, une coopération financière et monétaire intense avec la zone franc et les banques centrales de cette zone qui comprend pas moins de 14 pays, des centaines d'assistants techniques et de conseillers placés jusqu'à la présidence de certains États.
Sur le plan culturel , la France en Afrique, c'est un réseau de lycées et de collèges français aux noms prestigieux : le Lycée Jules-Verne de Johannesburg, le Lycée franco-éthiopien Guébré-Mariam d'Addis-Abeba, le cours Lamartine d'Abidjan, pour ne citer que ceux que nous avons visités.
L'ensemble se compose de 87 établissements accueillant un peu moins de 50 000 élèves qui forment génération après génération des étudiants francophones.
« Ces lycées accueillent les enfants des Français expatriés, mais on oublie souvent que la majorité des élèves sont des enfants du pays qui conserveront toute leur vie cette formation française », nous a dit le très dynamique directeur du lycée français d'Addis-Abeba dont 70% des élèves sont éthiopiens.
En comptant l'ensemble des établissements conventionnés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), plus de 100 000 élèves seraient formés en Français en Afrique subsaharienne.
Mais, la France en Afrique : c'est aussi un réseau de 200 Alliances françaises et Instituts français en 2012.
Les alliances forment en Afrique, parfois dans des zones particulièrement reculées, chaque année, plus de 80 000 étudiants . Comme les instituts, elles diffusent non seulement la culture française, mais tissent au quotidien des ponts entre la culture française et les cultures africaines et constituent des tremplins à destination des artistes africains.
Comme l'a souligné Delphine Borione, ancienne directrice de la politique culturelle et du Français, à la direction de la mondialisation du ministère des affaires étrangères : « Si la France a longtemps été et reste une vitrine et un débouché pour de nombreux artistes africains, c'est grâce à son réseau dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne».
Grâce à des programmes comme « Afrique et Caraïbes en créations » qui financent des initiatives franco-africaines telles que « les Rencontres de Bamako » pour la photographie, le Concours « l'Afrique est à la mode », « Regard Bénin » pour les arts visuels ou la saison croisée France - Afrique du Sud, la diplomatie culturelle française soutient activement la création africaine, comme elle soutient le Cinéma africain, avec le Fonds Sud Cinéma qui a financé près de 110 films d'Afrique subsaharienne depuis sa création.
Il n'y a pas un secteur de la vie sociale, économique et culturelle où la France n'a pas un réseau d'institutions ou d'associations présentes sur le continent africain.
Dans le domaine de la coopération administrative, de nombreux organismes d'expertise technique française interviennent ponctuellement en coordination avec les SCAC dans l'ensemble de la sphère des politiques publiques africaines.
La tradition française de l'assistance technique résidentielle a permis à notre pays de développer en Afrique une expertise administrative dont la qualité est internationalement reconnue, notamment dans les domaines des politiques de renforcement institutionnel et de gouvernance ou concernés par les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Cette expertise est mise en oeuvre par un nombre croissant d'organismes publics et privés. Dans le secteur public, trois entités se partagent l'essentiel des missions : l'opérateur France Expertise Internationale (FEI) du ministère des affaires étrangères, ADETEF , l'opérateur de coopération technique internationale des ministères français de l'économie, du budget, et, plus récemment, de l'écologie et de la réforme de l'Etat, CIVIPOL , la société de conseil et de service du ministère de l'Intérieur français, qui ont des moyens et une légitimité qui leur permettent de mener un développement très autonome. 32 ( * )
Dans le domaine de la recherche et de la diplomatie scientifique , l'ancienne tradition française d'exploration a trouvé en Afrique un terrain de recherche privilégié.
À travers les différentes implantations de l'Institut de recherche pour le développement ( IRD ), du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ( CIRAD ), du Centre national de la recherche scientifique ( CNRS ), des établissements de l'Institut Pasteur à l'instar du Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon, du Centre de recherche médicale et sanitaire au Niger, ou du Centre Muraz au Burkina-Faso , la France dispose de ressources précieuses pour la connaissance du milieu local et les besoins particuliers de nos partenaires.
Dans le domaine des sciences humaines, les sociétés et les civilisations d'Afrique subsaharienne sont encore aujourd'hui au coeur de nos programmes d'archéologie et d'ethnologie comme en attestent cinq Instituts français de recherches à l'étranger (IFRE) en Afrique (Soudan, Éthiopie, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud).
Ces centres de recherches assurent la mise en place d'une coopération bilatérale entre les universités françaises et locales à l'image de la Sfdas - Section française de la Direction des antiquités du Soudan, qui a ainsi établi un partenariat avec l'Université de Shendi et la National Corporation for Museums and Antiquities.
La recherche universitaire française est également tournée vers l'Afrique subsaharienne. Il existe en effet plusieurs centres de recherche consacrés à cette région au sein d'universités françaises de renom: c'est notamment le cas du Centre d'études des mondes africains pour l'université Paris 1 (la Sorbonne), du Centre d'études africaines de l'EHESS et de l'IRD ou encore de l'unité mixte de recherche Les Afriques dans le monde fondé par le CNRS et Sciences Po-Bordeaux.
Ce réseau des Instituts français de recherches à l'étranger ainsi que la mise en oeuvre de programmes universitaires ont favorisé, malgré la diminution des budgets, une omniprésence de la recherche française sur le continent.
Ainsi dans le domaine archéologique, en 2013, le ministère des affaires étrangères soutient 31 programmes de fouilles pour la section Afrique-Arabie. Ces programmes de recherches archéologiques sont aujourd'hui associés à des études sur les sociétés contemporaines. Le CFEE poursuit ainsi des fouilles dans la Vallée d'Omo, lieu de la découverte de Lucy en 1974, et propose une section de recherches sur « la politique régionale et le développement urbain » en Éthiopie.
Ces programmes reflètent à la fois l'intérêt historique des Français pour le continent mais également leur capacité à exporter nos méthodes universitaires en Afrique, vecteur d'un mode de pensée français.
Sur le plan militaire, c'est une présence inégalée avec 10 000 hommes sur le terrain en 2013, 8 accords de défense, 16 accords de coopérations militaires, 9 bases ou points d'appui notamment en Côte -d'Ivoire, à Djibouti, au Tchad, au Sénégal et au Gabon et plus récemment au Mali ainsi qu'un dispositif de formation militaire sur le continent et en France qui permet de former 50 000 militaires africains par an.
Ce tour d'horizon ne serait complet si on ne prenait pas en compte environ 2 500 projets annuels de coopération décentralisée avec plus de 700 collectivités françaises et structures intercommunales.
En 2010, les collectivités françaises par exemple ont alloué près de 41 millions d'euros à ce continent, soit 60% de l'aide, principalement dans cinq pays : le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin et le Niger 33 ( * ). Plus que des fonds, cette coopération tisse des liens entre des collectivités, des élus, des responsables administratifs et des populations qui apprennent ainsi à se connaître.
A ces projets, il faudrait ajouter les centaines de jumelages institutionnels entre différents organismes, hôpitaux, écoles, universités, centres de recherche de part et d'autre de la Méditerranée.
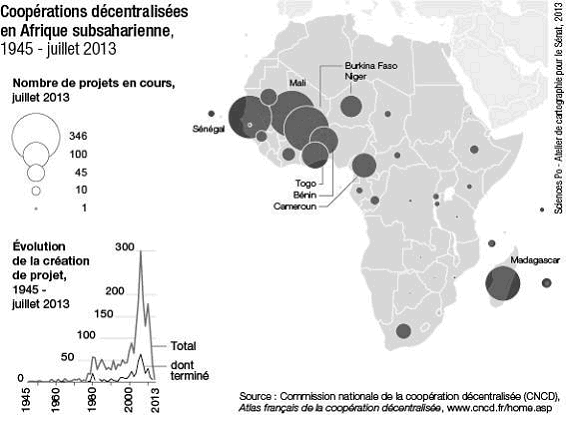
Les va-et-vient entre la France et l'Afrique sont enfin nourris de l'action des milliers d'ONG humanitaires ou de coopération dans l'ensemble de l'Hexagone qui conduisent des dizaines de milliers de projets sur tout le continent noir . L'essentiel des activités des associations comme Médecins sans frontières, Vétérinaires sans frontières, Pharmaciens sans frontières, etc., se situe en Afrique subsaharienne.
Au-delà de cette présence physique sur le terrain, la France est présente à travers les ondes.
Sur le plan des médias , RFI reste la radio la plus écoutée du monde francophone sur un contient où la radio reste le média le plus répandu. Qui ne connaît pas le jingle « RFI, il est huit heures à Paris, six heures en temps universel, sept heures à Yaoundé » ? Avec un budget de près de 400 millions d'euros, elle diffuse des émissions en français grâce à l'implantation de 114 émetteurs dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne.
Comme la souligné Alain Foka, journaliste de RFI qui anime sur tout le continent des émissions publiques dans le cadre d'une émission hebdomadaire « Le débat africain » : « Nous restons une radio de référence, les émissions enregistrées en public sont encore des événements qui drainent parfois plusieurs milliers d'auditeurs qui viennent assister en direct à l'enregistrement ».
Les chaînes de télévisions françaises dont TV5, France 24, malgré une concurrence croissante, sont parmi les plus regardées du continent.
Dans le secteur privé, l'offre française est très dynamique, à travers Canal Horizons, mais elle est en concurrence croissante avec des offres de programmes anglophones, lusophones et en langue régionale.
Il y a en revanche un potentiel considérable si se multiplient les partenariats avec l'audiovisuel public africain et le soutien aux productions africaines, auxquelles manquent encore des moyens de diffusion, de formation et de financement.
Le ministère des Affaires étrangères s'efforce de développer des coopérations dans ce sens avec Canal France international (CFI), filiale du groupe France Télévisions (75%) et d'Arte France (25%), qui s'est donné pour mission le transfert d'expertise, notamment à destination des pays d'Afrique. Opérateur de la coopération audiovisuelle publique française chargé de mettre en place, essentiellement sur financements publics, des actions d'appui aux télévisions des pays en développement principalement africaines, CFI est notamment appelé à fournir quotidiennement, à un réseau de 77 télévisions partenaires africaines , des programmes produits en France.
Après plus d'un siècle d'intenses relations avec le continent noir, il n'y a pas un secteur de la vie sociale, économique et culturelle où la France n'a pas un réseau d'institutions ou d'associations présentes sur le continent africain, tant il apparaît comme la destination naturelle de toute coopération vers le Sud.
Quels que soient les secteurs, cette présence française est très inégalement répartie : elle reste hypertrophiée dans certains pays, mais très faible dans d'autres pays stratégiques comme la RDC, le Nigeria et les nouveaux États pétroliers d'Afrique de l'Est.
Notre présence reste concentrée sur l'Afrique francophone : 86% des Français d'Afrique subsaharienne y habitent, les populations françaises, les moyens humains et financiers y sont plus importants, voire sans proportion avec ceux déployés en Afrique anglophone et lusophone.
Si on prend l'exemple de Madagascar, la France est son premier partenaire économique, son premier fournisseur et son premier client. Les échanges franco-malgaches représentent environ 30% des échanges commerciaux de Madagascar. Cinq cents entreprises à capitaux français sont présentes dans tous les secteurs de l'économie. Madagascar est aussi le pays où la communauté française est la plus importante au sud du Sahara, avec 25 000 citoyens, dont 60% sont franco-malgaches.
De l'autre côté du continent, au Cameroun , la présence française est importante tant par le nombre de filiales d'entreprises françaises (250) que par le nombre de PME/PMI fondées par des franco-camerounais ou par sa coopération. La France soutient des institutions et des programmes régionaux (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et Commission en charge des forêts d'Afrique centrale) basés à Yaoundé.
Une présence hypertrophiée dans certains pays d'Afrique francophone, mais très faible dans d'autres
La France sait aussi parfois sortir de ce qu'on appelait jadis son « pré carré ».
Regardons la précédente carte des Alliances françaises : on les trouve en Afrique du Sud, au Botswana, au Swaziland et au Lesotho, en Angola, à Luanda, Cabinda et Lubango ou au Ghana, pour ne citer que ces exemples.
Les Alliances françaises dans ces pays travaillent le plus souvent avec les moyens du bord, dans des régions parfois très isolées. Une armée d'enseignants, de professeurs, et des légions d'élèves et d'étudiants français et étrangers, portent ainsi le flambeau de la vitalité francophone, de la culture française, d'une certaine vision du monde dans des régions reculées d'Afrique.
Regardons l'AFD qui en quelques années a déployé son activité au-delà de la sphère francophone puisque, sur les trois dernières années, 47% de ses engagements concernent des pays anglophones, au premier chef desquels l'Afrique du Sud.
C'est également le cas des entreprises françaises dans le domaine de l'énergie, où la majorité des investissements français se sont dirigés vers des pays anglophones comme l'Angola ou le Nigeria.
L'ensemble des institutions, des femmes et des hommes mobilisés dans une relation avec l'Afrique subsaharienne forme un maillage complet de la société et des secteurs d'activités qui n'a pas d'équivalent chez les autres partenaires de l'Afrique. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas pour d'autres pays, ici une diaspora importante, notamment chinoise et indienne dans l'ensemble de l'est africain, britannique en Afrique du Sud et au Kenya, là une langue commune comme le portugais, ailleurs des relations institutionnelles séculaires comme avec les Britanniques ou les Belges, mais aucun de ces pays ne bénéficie d'une implantation aussi dense, associant une présence continue depuis des décennies et une langue commune.
2. Un tissu de relations interpersonnelles intenses
Densité, mais aussi continuité, la France n'a, en fait, jamais quitté le continent. C'est ce que lui reprochent ses détracteurs. C'est aussi le signe d'une certaine fidélité et d'une permanence qui ont permis de tisser des liens d'amitié et de travail entre les élites françaises et africaines, qui constituent encore aujourd'hui le socle des relations franco-africaines.
Contrairement aux Anglais, la décolonisation n'a pas provoqué au Sud du Sahara un départ massif des Français.
La quasi-totalité des colonies françaises d'Afrique subsaharienne ont accédé à l'indépendance en 1960. La Guinée de Sékou Touré avait franchi le pas deux ans plus tôt suite à son refus d'adhérer à la Communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle. En Afrique orientale, les Comores n'ont accédé à l'indépendance qu'en 1975 et Djibouti en 1977.
Les indépendances africaines se sont dans l'ensemble, à l'exception notable de Madagascar et du Cameroun, déroulées sans violence. Elles ont été pour l'essentiel le résultat d'une négociation. Et c'est une différence significative avec la situation qui a prévalu en Indochine ou au Maghreb. Cette décolonisation pacifique est pour beaucoup dans le fait que les liens noués avec ces pays n'ont pas été brutalement rompus comme ils l'ont été en Asie du Sud-est ou en Afrique du Nord.
Sur le terrain, les choses se sont modifiées très progressivement. Les administrateurs coloniaux, pour certains, sont restés en poste après les indépendances, souvent dans le même pays, à des fonctions identiques, parfois dans le même bureau.
L'histoire de la décolonisation explique encore aujourd'hui cette proximité des élites politiques, économiques, administratives et militaires africaines et françaises
Nombreux sont ceux qui ont trouvé leur place dans le nouveau dispositif de coopération mis en place par la France : les ambassadeurs en Afrique comme les tout premiers chefs des missions d'aide et de coopération (MAC) ont été d'anciens administrateurs de la France d'outre-mer.
Des conseillers français, souvent choisis parmi les anciens administrateurs coloniaux, ont été mis à la disposition des Présidents africains et de leurs ministres au titre de l'assistance technique.
Leurs armées se sont constituées avec des matériels et des formateurs fournis par la France. La France a mis à la disposition des jeunes États des contingents d'expatriés dont le nombre a dépassé paradoxalement celui des Français en Afrique au temps des colonies.
Les nouveaux dirigeants ont entretenu des liens forts avec la France. Parmi les premiers chefs d'État de l'Afrique indépendante, deux auront au préalable été ministres de la République française : Félix Houphouët Boigny (Côte-d'Ivoire), Léopold Sédar Senghor (Sénégal) et deux autres vice-présidents de l'Assemblée nationale, Modibo Keita (Mali) et Hubert Maga (Bénin, ex Dahomey).
Sans doute est-il aujourd'hui difficile de saisir la singularité et la complexité des rapports qui se sont noués entre la plupart des hommes d'États africains et français sur les bancs du Palais-Bourbon, du palais du Luxembourg ou du château de Versailles.
Leur proximité est au fondement de cette intimité entre les sphères dirigeantes de part et d'autre de la Méditerranée.
Ces dirigeants des premières années des indépendances ont envoyé à leur tour des générations de fonctionnaires et de militaires africains se former dans les universités françaises, à Science po, à l'ENA ou à Saint Cyr.
Ces derniers ont eux aussi noué des relations avec des camarades français. Des promotions entières de professeurs, de sergents, de médecins, de fonctionnaires français et africains ont donc fréquenté les mêmes bancs. Plusieurs dizaines de milliers de militaires africains ont été accueillis comme stagiaires en France, partageant les mêmes conditions de vie et de formation que leurs homologues français, tandis que pratiquement chaque officier français a fait dans sa carrière une, sinon plusieurs, périodes en Afrique.
Si la réalité est éloignée de l'image de « barbouzerie » généralisée véhiculée plus tard par les pourfendeurs de la « Françafrique », cette proximité des élites politiques, économiques administratives et militaires africaines francophones et françaises a eu sa face sombre.
Cette proximité a rendu possible les dérives de la Françafrique
Au Gabon ou au Congo-Brazzaville, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, ou encore en Centrafrique, une nébuleuse d'acteurs disposant de réseaux de connaissances personnelles où se côtoyaient dirigeants politiques, hommes d'affaires, agents de renseignement, militaires ou mercenaires, a trouvé dans les réseaux de la Françafrique de quoi dévoyer la politique africaine de la France, parfois au nom de la raison d'État, souvent dans la défense d'intérêts particuliers privés ou partisans, avec son lot de scandales dont le plus connu est l'affaire Elf.
Ce clientélisme d'État, ces valises de billets, qui ont alimenté aussi bien les partis politiques français que des patrimoines français et africains, ces émissaires occultes souvent mandatés par nul autre qu'eux-mêmes, tout cela a existé et pour l'essentiel vécu.
Beaucoup de facteurs y ont contribué au premier chef desquels la lassitude d'une grande partie de la classe politique africaine pour laquelle ce mode de relations relève d'une autre époque.
Ce changement de génération, la réglementation du financement des partis politiques en France, le développement de la transparence de l'information des médias et des ONG via Internet, les différents scandales mis à jour par la justice qui est devenue en deux décennies un acteur majeur des relations franco-africaines ont contribué à marginaliser ce mélange des genres.
La Françafrique dont on a annoncé régulièrement la renaissance, notamment pendant le précédent quinquennat, a pour l'essentiel disparu avec le décès d'une génération dont Félix Houphouët Boigny, Léopold Sédar Senghor et Omar Bongo furent les symboles.
Comme l'a affirmé l'un des auteurs de ce rapport alors Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie, le 15 janvier 2008, il fallait « signer l'acte de décès de la « Françafrique », « car il s'agissait de pratiques d'un autre temps, d'un mode de relations dont certains, ici comme là-bas, ont tiré avantage, au détriment de l'intérêt général et du développement ».
Mais ces tissus de relations interpersonnelles ont également, tel Janus, une face plus lumineuse qui a trop souvent été ignorée.
Des relations interpersonnelles qui sont un facteur de compréhension mutuelle
Les solides liens d'amitié tissés sur les bancs des écoles et des universités ou encore ceux existant entre les militaires blancs et leurs homologues noirs ont été à l'origine de la relation privilégiée qui se maintient entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne.
Dans toutes les professions, les cadres africains qui ont effectué plusieurs séjours de formation en France tout au long de leur carrière ont aujourd'hui des relations professionnelles et amicales fortes avec leur alter ego français, une connaissance de la France et des produits français.
« Notre connaissance de l'Afrique vient de ces échanges, presque tous les militaires français, et notamment les Marsouins, ont été à un moment de leur carrière affectés une ou plusieurs fois en Afrique à Djibouti, Libreville, Dakar ou Abidjan, beaucoup d'officiers généraux africains ont été formés en France, cela crée des liens », nous a dit le Général Bruno Clément-Bollée, directeur de la coopération de sécurité et de défense.
« Je connais un général tchadien avec lequel j'ai étudié à Saint-Cyr. Je l'ai retrouvé à l'école d'application, à l'école de guerre et puis une première fois au Tchad comme capitaine d'unité combattante avec les forces françaises et enfin une seconde fois comme chef d'état-major des armées alors je commandais l'opération Épervier. Je connais tout son parcours, toute sa famille. Ces liens-là sont uniques. »
Ces liens constituent une chance, chacun des protagonistes de cette relation franco-africaine en tirant bénéfice : la France, qui trouve dans sa politique d'influence sur le continent une occasion de conserver son rang ; les pouvoirs africains, qui firent longtemps de la rente découlant des politiques bilatérales d'aide publique au développement la base d'un compromis postcolonial générateur de stabilité.
La France a envoyé de plus des dizaines de milliers de coopérants en Afrique pour lesquels cette expérience fut souvent fondatrice. Selon Yves Gounin, auteur de La France en Afrique : « Alors que le nombre des administrateurs coloniaux en Afrique subsaharienne était inférieur à 7 000 en 1956, il y avait en 1963, 8 749 coopérants civils dans les États africains nouvellement indépendants, 9 364 en 1973 et 10 292 en 1980 ».
Ces coopérants, assistants techniques ou autres, sont venus gonfler les effectifs importants des Français restés en Afrique bien longtemps après les indépendances.
Aux coopérants recrutés par le gouvernement français en accord avec les autorités locales, mais qui peuvent dépendre de plusieurs ministères (Coopération, Éducation nationale, Enseignement et Recherche...), se sont ajoutés des intervenants envoyés par d'autres institutions, en particulier les institutions religieuses.
Dans ce cadre, les Églises ont joué un rôle actif, que ce soit la Délégation catholique pour la coopération (DCC), le Service protestant de mission (Défap) ainsi que d'autres instances, telles les multiples associations oeuvrant en Afrique (ONG. Ingénieurs sans Frontières, Groupement des Retraités Éducateurs sans frontières ...) qui sont actifs dans différents pays d'Afrique.
C'est aussi le cas des VSN (Volontaires du Service national), qui effectuaient deux années de service civil de coopération en Afrique qui resteront pour beaucoup un souvenir inoubliable.
Au plus fort de la coopération, ils seront plus de 10 000 par an à passer deux années puis 18 mois sur ce continent.
Des générations de jeunes diplômés français ont ainsi acquis le goût de l'Afrique. Marquée par cette expérience, une proportion importante d'entre eux maintiendra un lien avec le continent. Certains de ces coopérants sont même restés en Afrique et ont augmenté les effectifs des Français d'Afrique subsaharienne.
Si la France a réussi, pendant plus de trente ans, à conserver un lien fort avec le continent, ce n'est pas seulement grâce aux alliances politiques et aux réseaux d'individus qui s'étaient établis au plus haut niveau de l'État.
C'est aussi et surtout par la vertu des relations sociales qui, à tous les niveaux, établissaient des ponts de communication entre Français et Africains. Ce qui faisait le ciment de cette relation, c'est moins le clientélisme d'État que les réseaux d'interconnaissance et de sociabilité communs.
Comme nous l'a dit M. Richard Banégas, professeur au CERI-Sciences Po, « Pour le meilleur et pour le pire, ce sont ces réseaux d'amitié ou de simple connaissance, tissés sur les bancs de l'université, de l'école de guerre ou du militantisme syndical des années 1960-70, qui ont nourri la croyance en un destin commun et des valeurs communes. Et c'est ainsi, par capillarité, que s'exerce notre influence française en Afrique. »
3. 100 000 Français : des communautés concentrées en Afrique de l'Ouest
Lors d'un déjeuner organisé pendant un déplacement, un Français installé en Afrique depuis des décennies nous a demandé : « Vu de Paris, la France en Afrique, c'est quoi ? ».
Si l`on essaie d'être le plus factuel possible, on serait tenté de dire dans un premier temps : c'est d'abord plus de 100 000 Français au Sud du Sahara, des milliers d'entreprises dont le fleuron de l'industrie française comme AREVA, TOTAL, BOLLORÉ, VINCI, BOUYGUES mais aussi des ressources stratégiques uniques telles que l'uranium du Niger, qui couvre 30% de nos besoins civils et 100% de nos besoins militaires, ou encore un pétrole qui assure 30% de nos approvisionnements et une zone franc qui comporte pour la France autant d'avantages que d'obligations.
Si notre relation aux pays africains se résumait à sa dimension économique, on pourrait être tenté de résumer « l'Afrique utile » à cela.
Nous verrons que ce n'est pas le cas. Si on parle d'une politique africaine et non d'une politique asiatique ou américaine, c'est précisément en raison des caractères indissociables des enjeux diplomatiques, militaires, culturels, économiques et migratoires. Il n'existe pas de continent où nous ayons une palette aussi large d'interactions et où les enjeux soient aussi indissociables.
Cela étant dit, commençons par la protection de nos ressortissants, elle reste notamment un des motifs du déploiement militaire français
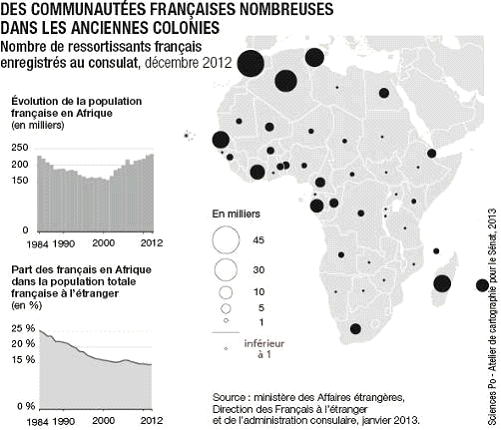
On dénombre près de 200 000 expatriés sur l'ensemble du continent africain, soit 15% des Français établis hors de France ; 98 000 d'entre eux vivent en Afrique du Nord, plus de 100 000 au sud du Sahara.
Répartition des Français établis en Afrique
|
inscrits 2012 |
Variation 1984/2012 |
|
|
Afrique du Nord |
98 090 |
+ 39% |
|
Afrique francophone |
117 378 |
- 20% |
|
Afrique non francophone |
18 796 |
+ 49% |
|
Total Afrique |
234 264 |
+ 2% |
Plus de 86% des Français installés en Afrique subsaharienne vivent dans des pays francophones, soit quelque 117 378 en 2012, principalement au Sénégal, à Madagascar ou en Côte d'Ivoire.
Les Français d'Afrique francophone représentent 86% des Français d'Afrique subsaharienne
C'est là la marque de notre héritage historique : la proximité linguistique et la tradition d'expatriation dans ces anciennes colonies expliquent encore aujourd'hui notre présence sur le continent, même si notre nombre est en diminution.
Pour les Français expatriés, l'Afrique reste encore l'Afrique francophone, l'Afrique du pré carré, l'Afrique des colonies.
L'installation dans les pays anglophones est limitée à 18 000 inscrits, soit 13% des inscrits d'Afrique subsaharienne et 8% du total sur l'ensemble du continent, mais elle ne cesse d'augmenter depuis les années 1980, notamment en Afrique du sud.
Cet intérêt pour l'Afrique australe reflète l'attractivité économique de cette sous-région, des pays comme le Nigeria étant de grands producteurs d'hydrocarbures.
Qui sont ces Français d'Afrique ?
Ils ont des profils extrêmement diversifiés allant du retraité de Cap Skirring au travailleur humanitaire, en passant par les cadres expatriés des grands groupes français, les agents français des ambassades et de leurs démembrements.
Au fil des décennies qui ont suivi les indépendances, les communautés françaises se sont profondément transformées. À la période faste des « années coopérants » a succédé, à partir de la fin des années 1980, celle du reflux.
Le nombre des Français d'Afrique a désormais rejoint le niveau de 1985.
Les cadres expatriés du privé comme les agents publics forment encore les bataillons les plus visibles de la France d'Afrique qui vivent confortablement. Comme le dit joliment un article de «Jeune Afrique 34 ( * ) »: « Ils ont leur figure de proue -l'ambassadeur-, leur rituel -le 14 Juillet dans les jardins de la chancellerie-, ils remplissent les avions d'Air France en période de départs en vacances, n'intéressent les médias que lorsque l'armée les évacue, et les politiciens quand une élection présidentielle pointe à l'horizon ».
Ces Français expatriés en Afrique côtoient des Français dont la situation est moins confortable et plus précaire. Beaucoup de contrats d'expatriation ont fait place à des contrats dits locaux nettement moins avantageux. Certains concitoyens arrivent en Afrique sans emploi et parfois sans billet retour, d'autres, en délicatesse avec la République, cherchent ici l'occasion de refaire leur vie. « On voit arriver de tout », nous a dit le Consul général à Abidjan, « des aventuriers, des retraités attirés par la possibilité d'un pouvoir d'achat plus confortable, des couples mixtes qui se font et se défont, des hommes âgés attirés par les perspectives plus ou moins fondées d'une nouvelle vie sentimentale... l'aventure laisse parfois place à la misère et à la désillusion ».
Certains, présents depuis des décennies, se sont pleinement intégrés à la vie africaine au point de ne plus vouloir revenir en France. Ces Français « boucanés » que l'on croise dans les maquis n'ont plus de famille, plus de maison, plus de lien avec la France, ce qui rend leur rapatriement en cas de crise particulièrement douloureux, à cette différence près que plus de la moitié d'entre eux sont désormais des binationaux.
Des profils extrêmement diversifiés
Comme nous avons pu le constater en Côte d'Ivoire où les résidents français d'Abidjan ou de Bouaké sont désormais en majorité des doubles nationaux, l'évolution majeure de ces dernières décennies est l'augmentation de la proportion de binationaux qui sont désormais, dans l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, majoritaire.
Certains, naturalisés français à l'occasion d'un long séjour dans l'Hexagone, ont finalement choisi de revenir, en famille en Afrique. D'autres, à partir d'un mariage mixte, ont pu satisfaire aux formalités de naturalisation simplifiées mises en place en 1973. Il n'est guère que l'Afrique non francophone où les doubles nationaux français ne sont pas majoritaires, par déficit, sans doute, d'un passé commun avec la « métropole ».
Pour la première fois, les Français d'Afrique ne sont plus majoritairement des expatriés, mais des citoyens du pays où ils vivent, des métis franco-africains. Ce métissage en Afrique comme en France est un des éléments structurants qui font que pour les générations à venir, pour les descendants de ces franco-africains, le lien avec l'Afrique perdurer. Comme nous l'a dit le père d'une descendance franco-camerounaise : « l'Afrique ne nous quittera plus ».
Comme le souligne l'article précité de Jeune Afrique « À condition que la France officielle sache la saisir, c'est une vraie chance pour refonder sa relation avec le continent. ».
Chacune à leur façon, ces différentes communautés participent à ce lien particulier de la France avec l'Afrique.
L'ensemble de ces concitoyens est aujourd'hui exposé aux troubles politiques et sociaux qui secouent le continent.
La protection et le rapatriement des ressortissants français et européens : une contrainte forte de la politique africaine
Une des préoccupations majeures de la politique africaine est de protéger ces ressortissants et d'assurer le cas échéant leur rapatriement en cas de crise si l'État qui les abrite n'est plus en mesure d'assurer leur sécurité.
On se souvient notamment de l'évacuation des Français de Côte d'Ivoire au printemps 2011 : la crise postélectorale avait engendré un climat d'insécurité pour les ressortissants français, victimes de pillages et d'agressions. Les autorités diplomatiques françaises ont donc décidé l'évacuation des expatriés, mise en oeuvre avec la coopération du personnel de l'opération Licorne.
L'efficacité de notre système de rapatriement a permis à cette occasion l'évacuation de 8 000 personnes. La France a joué le rôle de pays-pilote pour l'évacuation des étrangers de Côte d'Ivoire et a garanti, à ce titre, la protection des ressortissants européens et libanais. Elle a également procédé au sauvetage de l'ambassadeur du Japon, assiégé dans sa résidence à Abidjan.
Ce savoir-faire ainsi que notre présence militaire dans ces pays font de la France le pays-pilote pour l'ensemble des ressortissants des pays-membres de l'Union Européenne au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, aux Comores, à Djibouti, en Guinée-Bissau (conjointement avec le Sénégal), à Madagascar, au Maroc (conjointement avec l'Espagne), au Sénégal et au Togo.
La sécurité de nos ressortissants ainsi que celle de nos partenaires européens est donc l'un des éléments structurants de notre diplomatie africaine et l'une des justifications des implantations militaires françaises qui permettent notamment de sécuriser, voire de prendre le contrôle, le cas échéant, d'un aéroport pour assurer l'évacuation vers la métropole.
Cet objectif de protection est d'autant plus important dans le contexte actuel de recrudescence du terrorisme en Afrique occidentale.
La France en Afrique : une des cibles privilégiées des attaques terroristes et des tentatives d'enlèvement
Notre pays détient un triste palmarès en matière de prises d'otages : depuis 1997, 94 Français ont été pris en otage en Afrique, contre 48 pour les autres nationalités. Le développement de ce mode d'action s'explique par l'intérêt financier évident que représente la demande de rançon pour ces réseaux.
Depuis les années 2000, des dizaines de millions d'euros ont été versés pour la libération de ressortissants occidentaux en Afrique. Le procédé a enrichi considérablement les organisations terroristes et par effet de ricochet a contribué à accroître leurs moyens.
C'est pourquoi l'État français a décidé de ne plus verser ces rançons. Ce choix politique inévitable rend la situation des otages plus que délicate au moment où la France devient l'une des cibles privilégiées des attaques terroristes en Afrique comme les djihadistes l'ont montré, suite à l'intervention française au Mali, quand AQMI a appelé en mai 2013 à attaquer les intérêts français « partout dans le monde » en réponse à l'opération Serval.
La multiplication des tentatives d'attentat contre nos ambassades, comme ce fut le cas à Nouakchott en février 2011, illustre par ailleurs l'exposition accrue de notre pays à de telles attaques.
Les Français d'Afrique subsaharienne ne constituent que 8% des Français de l'étranger, mais ces 8% sont sans doute les Français les plus exposés aux risques d'enlèvement comme en témoignent les cartes du Quai d'Orsay des zones « rouges », fortement déconseillées, dans les fiches « Conseils aux voyageurs » du ministère des affaires étrangères.
La France en Afrique de l'Ouest est aujourd'hui particulièrement exposée.
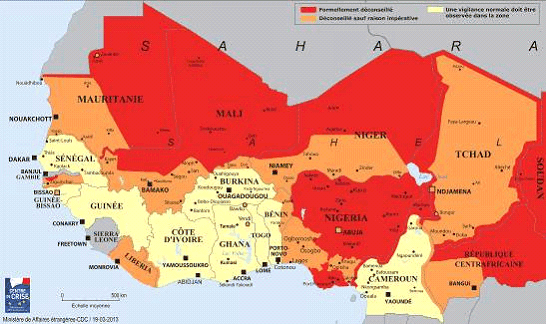
Cette recrudescence des risques pose la question du maintien de la présence de ces Français, notamment des coopérants. Elle pose aussi le problème du maintien des activités touristiques à destination des français dans certains endroits : ces activités sont vitales pour l'économie, mais la montée des menaces doit être prise en compte. Enfin, elle pose la question de la permanence d'une expertise scientifique dans ces régions, si le séjour y reste durablement déconseillé.
Afin de protéger au mieux nos ressortissants et notre présence en Afrique, le Quai d'Orsay a mis en place un dispositif de sécurité accru dans les zones à risques et a adapté nos dispositifs à l'évolution rapide de ce type de menaces.
Un triste palmarès : les Français : le plus grand nombre d'otages occidentaux
La formation et le recrutement des gardes de sécurité des ambassades françaises en Afrique est de ce fait en pleine restructuration. Des programmes de formation des ressortissants aux réflexes de sûreté se développent. Les entreprises implantées dans les zones africaines particulièrement exposées à ce type d'attaque ont également pris des mesures en lien avec le centre de crise du Ministère des affaires étrangères.
La montée du terrorisme sur le continent concerne particulièrement l'Afrique de l'Ouest, où se trouve la majorité de nos expatriés à l'échelle régionale, mais également l'Afrique de l'est comme l'illustre la récente prise d'otage à Naïrobi.
La multiplication des attentats et des prises d'otages rend cependant difficile la protection de plus de 100 000 ressortissants qui sont libres de leurs mouvements.
Les relations entre la France et l'Afrique sont aujourd'hui en partie conditionnées par cet impératif sécuritaire qui rend illusoire tout désengagement de la France dans cette zone.
4. Des intérêts économiques et stratégiques circonscrits
En 2010, la France a dégagé un excédent commercial de quelque 3,2 milliards d'euros (selon l'INSEE) et était encore le deuxième fournisseur du continent en 2010.
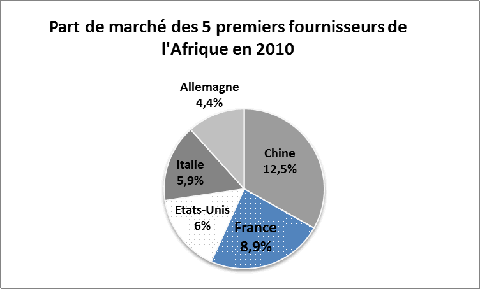
En 2011, le continent africain représentait 17% des exportations françaises et 13% de nos importations.
Nous importons principalement des hydrocarbures et des combustibles nucléaires depuis l'Afrique.
Les importations en pétrole brut et en gaz naturel représentent en effet près de 55% de l'ensemble des importations en provenance de l'Afrique pour l'année 2011.
Nos principaux fournisseurs dans ce domaine en Afrique subsaharienne sont l'Angola et le Nigeria. Nous importons également des fruits tropicaux et du cacao depuis les pays d'Afrique de l'Ouest.
La France exporte principalement des produits de haute technologie (aéronautique, pharmacie) qui lui permettent de rester compétitive sur le continent.
Ainsi, malgré la concurrence de la Chine, la part de marché de l'aéronautique français en Afrique a progressé de 21.7 points entre 2000 et 2010, notamment grâce à la vente d'Airbus en direction de l'Afrique du Sud. Le solde positif avec ce dernier de plus de 1,3 milliard d'euros, est le 4 e excédent avec un pays émergent ou proto émergent après l'Australie, l'Arabie Saoudite et Singapour
Nous sommes également les premiers fournisseurs de l'Afrique en céréales.
La grande similitude que l'on constate entre les cartes des exportations et des importations françaises s'explique par le fait que nous exportons également beaucoup de matériel permettant l'exploration de puits pétroliers ou de gaz naturel afin de pouvoir ensuite importer ces hydrocarbures. Ces exportations sont faites en direction des filiales des firmes françaises sur le continent.
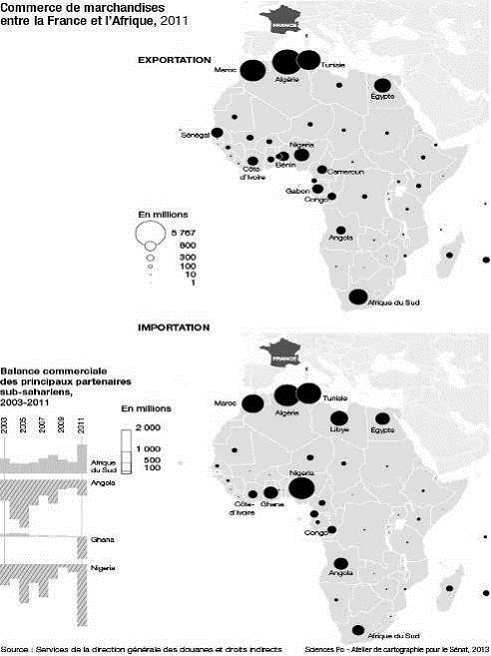
Les marchés africains semblent donc porteurs pour les firmes françaises qui, comme leurs homologues étrangères, essaient de profiter de la croissance africaine et notamment des investissements massifs effectués ces dernières années en matière d'infrastructures ainsi que de l'augmentation de la consommation des ménages, comme en témoigne la signature récente entre Carrefour et CFAO d'un protocole d'accord visant à constituer une société commune pour développer différents formats de magasins dans huit pays d'Afrique : le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal.
Si ces firmes bénéficiaient de certains appuis directs de l'État, comme l'aide liée qui leur a permis d'accéder à certains contrats africains dans les domaines du bâtiment et des travaux publics (Bouygues, Dumez), mais aussi dans les secteurs de l'eau et de l'électricité (Électricité de France, Lyonnaise des eaux, Vivendi) jusqu'à la fin des années 1990, ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la mesure où la France a délié la quasi intégralité de sa coopération dans le cadre de l'OCDE .
Les entreprises françaises bénéficient cependant des avantages de la monnaie unique dans la zone Franc, de la politique de coopération monétaire ainsi que du soutien de la Compagnie française d'assurance du commerce extérieur (Coface) qui garantit les risques des exportateurs français, et des réseaux français. A titre d'exemple, la Banque nationale de Paris, la Société générale et le Crédit Lyonnais représentent à elles seules 70% du chiffre d'affaires des banques de la zone franc. Cette zone concentre également 731 filiales d'entreprises françaises.
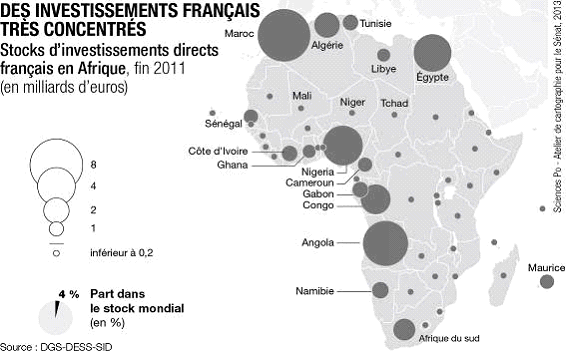
En termes de flux d'investissement, l'Afrique subsaharienne représente un peu moins de 5 milliards par an, majoritairement au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Nigeria et en Angola.
L'analyse sectorielle de ces investissements montre que c'est l'exploitation d'hydrocarbures qui concentre la majorité de nos intérêts économiques en Afrique aussi bien en matière d'investissement direct -c'est ainsi que s'explique le niveau de ces investissements en Angola et au Nigeria- qu'en termes d'échanges puisque 25% de nos importations en pétrole brut provenaient du continent africain en 2011.
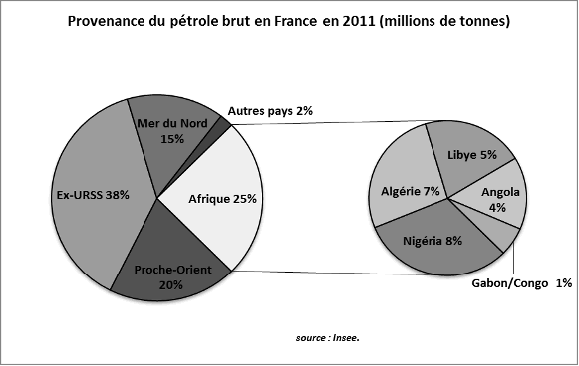
Total est ainsi présent dans 50 pays africains par le biais de ses filiales de distribution et d'exploration. Le groupe a investi massivement sur le continent, notamment en Angola et au Nigeria.
« L'Afrique représente pour le groupe 31% de sa production, 28% de ses réserves et la moitié du potentiel d'exploration du Groupe » nous a dit Jacques Marraud des Grottes, Directeur Afrique TOTAL Exploration-Production. Ainsi 45 000 personnes travaillent chaque jour sur les installations du groupe en Afrique, en incluant le personnel des sociétés de services : un poids qui est amené à croître avec la découverte de nouveaux bassins de gisement au Soudan, au Ghana, en Ouganda, et en Mozambique. Si 50% du potentiel d'exploration conventionnel est situé dans le Golfe de Guinée, Total diversifie ses implantations passant de 11 pays à 18 en 2 ans, comme l'illustre la carte ci-après.
Mais la concurrence est de plus en plus vive, notamment avec des entreprises occidentales ENI, Exxon, Chevron, Shell, BP, Statoil, mais aussi de façon croissante avec de nouveaux acteurs dont les entreprises chinoises telles que China National Petroleum Corporation, Chinese National Off-shore Company et PetroChina.
Le renouveau de la carte pétrolière de
Total
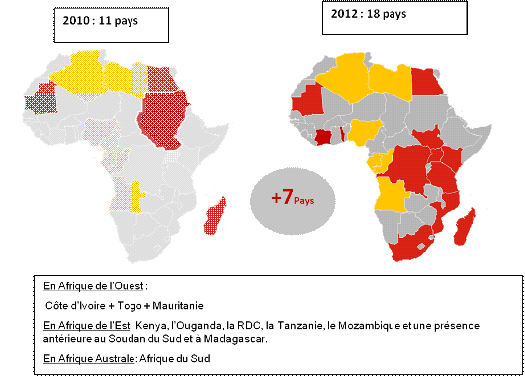
La France est également présente dans l'exploitation d'uranium en Afrique, bien qu'elle possède d'importantes réserves pour son usage civil. Elle est en particulier dépendante des seules mines du Niger pour son approvisionnement en uranium à usage stratégique militaire.
L'enjeu de la politique économique de la France en Afrique est donc, entre autres, d'assurer un accès sécurisé aux ressources énergétiques et minières dont elle a besoin.
La création du Comité pour les Métaux Stratégiques (COMES) en 2011, qui avait notamment pour objet de réfléchir à la sécurisation de l'accès des industries françaises aux ressources en métaux, illustre la volonté des pouvoirs publics de mieux coordonner la politique minière en Afrique.
Dans ce secteur la France est présente en Afrique à travers le groupe français ERAMET, leader mondial de l'exploitation des métaux d'alliage. Afin de maximiser sa présence et son exploitation des ressources africaines, ERAMET a pris part à 46% dans le groupe gabonais COMILOG (spécialiste de ferromanganèse) en 1995. Sa filiale, TIZIR, issue de l'association d'ERAMET et de l'australien Mineral Deposits Limited est également devenue l'opérateur principal du projet Grande Côte au Sénégal. Ces alliances avec des entreprises locales ou potentiellement concurrentes a permis à ERAMET de sécuriser son approvisionnement en minerai de titane et de conserver son rang de leader international.
La présence française en Afrique est importante mais finalement circonscrite à la fois sur les plans géographique et sectoriel. Elle est encore massive et diversifiée en Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Ailleurs, elle est encore très concentrée autour des importations pétrolières et de l'exploitation d'uranium et de minerais.
5. Une coopération au développement majeur
La tradition de la coopération française en faveur du développement est née pendant la colonisation et a pris son essor lors de la décolonisation. L'Afrique en constitue le coeur à tel point que longtemps la « Coop », le ministère de la coopération, était de facto le ministère des affaires africaines et malgaches.
50 ans après les indépendances, la « Coop » a disparu ; le ministère de la rue Monsieur a vécu, notre coopération au développement s'est émancipée des « pays du champ » pour embrasser l'ensemble des pays en développement y compris les pays émergents. Son action s'est diversifiée pour englober l'ensemble des enjeux de la mondialisation, y compris le réchauffement climatique ; une partie de son budget a été déléguée à des organismes européens ou multilatéraux dont le champ géographique d'intervention ne se réduit pas au continent noir.
Et pourtant l'Afrique en demeure la priorité. Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement du 31 juillet 2013 l'a redit : « Les pays d'Afrique subsaharienne demeurent la priorité de la France »
Pilotée conjointement par le ministère des affaires étrangères et celui des finances, la coopération française mobilise la très grande majorité de ses moyens bilatéraux en faveur du continent africain et encourage la programmation des institutions communautaires et multilatérales à se concentrer sur ce continent.
Répartition par donateurs de l'APD à destination de l'Afrique
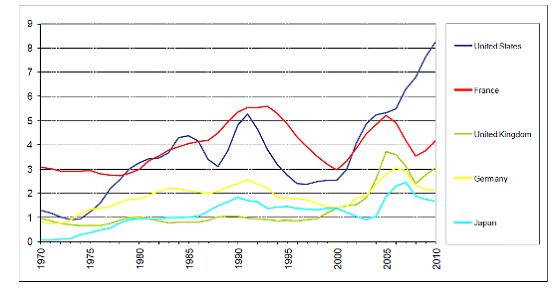
« Notre coopération a changé de visage, découvert de nouveaux horizons, mais elle reste encore essentiellement africaine » nous a dit Jean-Marc Châtaigner, Directeur général adjoint de la Mondialisation, du développement et des partenariats auprès du ministère des Affaires étrangères.
Quatrième contributrice mondiale de l'aide au développement, représentant à elle seule 10% de l'aide mondiale, la France mobilise toute une gamme d'instruments - dons, aides budgétaires, prêts bonifiés ou non, souverains et non souverains, prises de participation, garanties et autres financements innovants sur le continent africain.
Elle est le deuxième contributeur d'aide au développement de l'Afrique après les États-Unis, avec un montant moyen de 4 milliards de dollars d'aide à l'Afrique subsaharienne de 2009 à 2011.
Sur la période 1998-2010, l'Afrique subsaharienne a été ainsi à la fois le premier bénéficiaire de l'Aide Publique au Développement française, en volume ou en proportion du total, et le premier destinataire de l'accroissement de cette aide observé depuis le début des années 2000.
Évolution de la part relative de l'aide publique
au développement française
en Afrique
subsaharienne
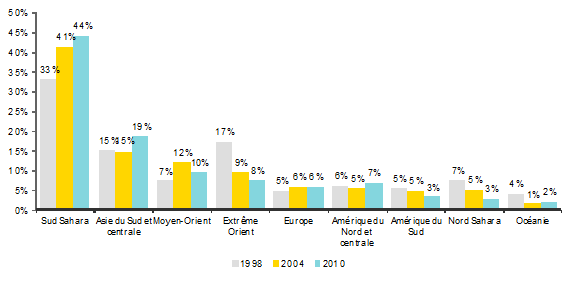
Si on ne considère que l'effort financier de l'aide bilatérale française, c'est-à-dire les subventions et les bonifications de prêts, environ 60% de cet effort ont ainsi été consacrés ces dernières années à cette région.
En outre, les États subsahariens définis comme des pays pauvres prioritaires (PPP), ont reçu plus de 50% des subventions. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, des Comores, de Djibouti, du Ghana, de la Guinée Conakry, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et du Togo.
Pour Anne Paugam, directrice général de l'AFD, « Les pays d'Afrique subsaharienne bénéficient ainsi d'un accès privilégié aux instruments les plus concessionnels de l'AFD (subventions et prêts très concessionnels), ce qui se traduit par une part relative plus importante de ces pays dans l'effort budgétaire. Nous sommes presque à 70% des ressources financières allouées par l'Etat en 2010 à l'agence. »
Afin de renforcer cette concentration, le dernier Comité Interministériel de la Coopération internationale et du Développement (CICID) de juillet 2013, en présence de 15 ministres, a décidé qu'à partir de 2014, la France consacrera la moitié de ses dons et les deux tiers de ceux de l'AFD vers les pays pauvres prioritaires (PPP). 85% de l'effort financier en faveur du développement seront dirigés vers les pays de l'Afrique subsaharienne et les pays voisins du sud et de l'est de la Méditerranée.
La coopération française en Afrique se développe à la fois sous la forme de soutien de projets par des prêts, des dons ou des garanties, -essentiellement gérés par l'AFD qui est en charge de 80% des crédits, le reste étant géré par les Conseillers de Coopération et d'Action Culturelle-, de coopération technique, mais également de soutien macro-économique qui comprend le processus d'annulation de dettes ainsi que la mise en place d'une aide budgétaire.
Par rapport aux autres pays, la France dispose d'une palette particulièrement variée d'instruments d'intervention.
Sur la plan macro-économique, comme l'a fait observer M. Ramon Fernandez, Directeur général du Trésor : « La France a joué un rôle central dans l'initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), mise en place par le club de Paris dont elle est le premier contributeur. Nous avons joué un rôle tout à fait positif dans le rétablissement de la situation macro-économique des pays africains ».
Une large palette d'instruments financiers : de l'annulation de dette au microprojet
Ce procédé a permis à de nombreux États africains de bénéficier d'un allègement de dettes considérable afin d'obtenir une marge de manoeuvre budgétaire dans le but de lutter contre la pauvreté. Ce procédé a conduit à la réduction des ratios de dettes de près de 90%. Parmi les 39 pays éligibles, 32 sont africains, ce qui confirme l'importance du continent dans nos programmes de coopération.
La France a également mis en oeuvre une procédure spécifique d'annulation à 100% de ses créances APD, connu sous le nom de Contrat de désendettement et de développement (C2D). Par ce biais, la France annule la dette APD contre l'engagement de l'État bénéficiaire d'orienter ses dépenses vers des secteurs prioritaires.
Le C2D est un outil de gouvernance budgétaire pour notre pays, qui a conclu ce type de contrat avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, la Guinée, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, le Rwanda, le Burundi, le Congo, le Malawi et la Tanzanie. Nous avons pu constater en Côte d'Ivoire, qui a commencé à recevoir les fruits d'un C2D de plus de 2,8 milliards d'euros, le caractère structurant de ce processus qui constituera pour les dix années à venir notre principal outil de coopération avec ce pays dont le rôle économique est essentiel pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest.
Au total, la France a contribué à hauteur de 21 milliards d'euros à cette initiative PPTE, dont environ 9 milliards d'euros dans le cadre du Club de Paris et 12 milliards d'euros dans le cadre de son effort bilatéral additionnel.
Principaux bénéficiaires du traitement de
la dette par la France
pour la période 1998-2010 (en millions de
dollars US)
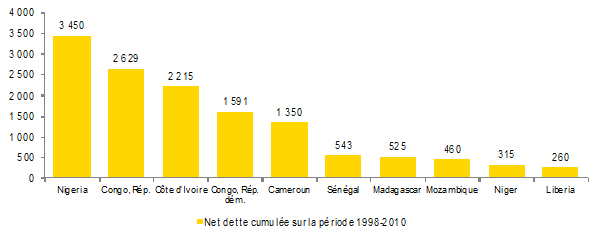
De plus, la France apporte des aides budgétaires globales ou sectorielles aux pays africains sous forme de prêts ou de dons selon leurs capacités économiques.
En 2013, le montant des dons s'est chiffré à 80 millions d'euros. Ces dons correspondent soit à l'accompagnement d'un État ayant une difficulté passagère comme les 15 millions d'euros alloués au Mali en mai 2013 ou les 300 millions d'euros en Côte d'Ivoire à la sortie de la crise, soit au soutien de la stratégie de développement d'un pays à plus long terme comme avec le Burkina Faso.
La France a largement contribué au désendettement du continent africain.
Financement de projets, annulation de dettes, la France intervient également en Afrique en soutien de la zone Franc 35 ( * ) qui est la plus ancienne zone monétaire existante au monde (1939), mais dont les mécanismes ont été régulièrement actualisés pour répondre aux besoins réciproques de chacun de ses membres.
Cette coopération monétaire, unique par sa longévité, est fondée sur quatre principes fondamentaux : la garantie de convertibilité illimitée apportée par la France, la parité fixe entre ces monnaies (francs CFA et francs comoriens) et l'euro, la libre transférabilité des fonds au sein de chaque sous-région et la centralisation des réserves de change.
La finalité première de cette coopération monétaire est de garantir des unions monétaires, autrement dit les monnaies uniques africaines que sont le franc de la Communauté financière africaine, le franc de la Coopération financière en Afrique centrale et le franc comorien.
Par ailleurs, les mécanismes de la Zone franc fournissent un certain nombre de protections et de garde-fous aux partenaires africains de la France.
Ces dispositifs ont été très appréciables lors de la récente crise financière mondiale, qui a moins touché la Zone franc que le reste de l'Afrique subsaharienne. En garantissant la fixité du taux de change, les accords de coopération monétaire renforcent la crédibilité de la politique de stabilité monétaire, et par là même, son efficacité. L'inflation moyenne des pays de la Zone franc a été contenue en-deçà de 3% ces dernières années, sauf en 2011 en UEMOA (notamment sous l'impact de la crise ivoirienne) et en 2012 en CEMAC alors que l'inflation nigériane ou ghanéenne est par exemple supérieure à 10%.
L'expression de cette solidarité contribue à atténuer les effets des crises, économiques ou politiques, comme à faciliter les rebonds en sortie de crise. Les exemples ivoirien et malien nous le montrent. La mise en commun des réserves de change a permis de résorber le déficit des balances des paiements. La définition au niveau régional de la politique monétaire garantie par la France a permis de contenir les tensions inflationnistes et d'éviter d'ajouter le fléau de la perte de valeur à celui de la guerre. Au total, la récession ivoirienne en 2011 a été limitée à un recul de 4,5% du PIB pour un taux d'inflation de 4,9%. Au Mali en 2012, la récession a été limitée à un recul de 1,2% du PIB et l'inflation contenue à 5,8%.
La zone Franc décriée politiquement a, d'un point de vue économique, contribué à la lutte contre l'inflation et favorisé l'intégration régionale.
La Zone franc a permis aux pays membres de l'UEMOA et de la CEMAC de jeter les bases de l'intégration et de la solidarité régionales, indispensables pour accroître leur potentiel de croissance et améliorer leur résilience aux chocs extérieurs.
Dans ce cadre, la France soutient financièrement les banques de développement de ces deux sous-régions que sont la BOAD (banque ouest-africaine de développement) et la BDEAC (banque de développement des États de l'Afrique centrale) et apporte chaque année une aide budgétaire globale pour financer des projets d'intégration régionale.
La Zone Franc constitue enfin une enceinte privilégiée de dialogue avec la tenue semestrielle d'une réunion des ministres des finances des pays membres.
Au-delà des aspects financiers, l'essentiel de la coopération française en Afrique passe par la réalisation de projets via l'Agence française de développement (AFD) et sa filiale dédiée au développement du secteur privé, PROPARCO.
A l'issue des réformes de 1998 et de 2004 qui ont entraîné l'intégration de la coopération au sein du quai d'Orsay et le transfert de compétences de ce dernier vers l'AFD, l'Agence est devenue l'acteur central de la coopération française en Afrique.
Comme l'a souligné la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat dans un rapport intitulé : « L'AFD, fer de lance de la coopération française » 36 ( * ) , l'agence n'est plus seulement le banquier du développement africain, elle est devenue l'acteur pivot de notre coopération contribuant à la mise en oeuvre de cette politique mais aussi à sa conception. ».
Le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD de 2010, pour une durée de trois ans, impose à l'AFD de consacrer 60% de l'effort financier de l'État (subventions, coût-État des prêts, C2D, ABG) à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, 50% des dons (subventions et ABG) aux pays pauvres prioritaires et au sein des dons aux pays pauvres prioritaires, 50 % aux pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad).
Dans la pratique, en 2012, le résultat est supérieur puisque que 68%, soit 1,6 milliard d'euros d'autorisations de financement, ont été consacrés à l'Afrique subsaharienne.
Le groupe AFD intervient à la fois en faveur des États, mais aussi des secteurs privé et parapublic et illustre ainsi une conception française de la coopération visant la responsabilisation économique et financière des pays partenaires et l'accompagnement progressif de l'État dans le processus de développement.
En 2012, l'AFD a autorisé 1,6 milliard de financement en Afrique subsaharienne.
L'AFD gère également un fonds FISEA, destiné spécifiquement à l'Afrique. Créé en 2009, FISEA a pour objectif de financer 50 millions d'euros de projets par an pendant cinq ans, en intervenant directement en prises de participation auprès de PME africaines, ou par l'intermédiaire de fonds d'investissement en Afrique, illustrant en cela la conviction que c'est par la promotion de la croissance et par le secteur privé que l'Afrique pourra sortir de la pauvreté.
Lors du discours du Cap en février 2008, le Chef de l'État français, alors M. Nicolas Sarkozy, a indiqué que le total des engagements financiers français bilatéraux pour l'Afrique subsaharienne s'élèverait à 10 milliards d'euros sur les cinq prochaines années.
L'engagement dépasse le seul cadre de l'APD pour inclure les 2,5 milliards annoncés dans le cadre du soutien à l'initiative privée, dont des garanties et participations.
Un pari gagné qui mérite d'être souligné dans une période où on n'est plus enclin à dénoncer les engagements sans lendemain.
L'activité du Groupe AFD en Afrique subsaharienne a effet connu une forte croissance, pour atteindre plus de 2 milliards d'euros d'engagements en 2012, soit 29 % de l'activité du Groupe dans les États étrangers.
L'AFD a multiplié par trois ses engagements en Afrique subsaharienne depuis 2005.
PROPARCO a participé activement, aux côtés de l'AFD, à la mise en oeuvre de l'initiative du Cap dans sa composante de soutien au secteur privé qui a mobilisé sur la période 2,5 milliards d'euros au bénéfice de 2 000 entreprises, avec à terme la création de plus de 300 000 emplois et une mobilisation de financements complémentaires auprès des investisseurs de plus de 8 milliards.
Ainsi sur la période 2008-2012, sur la base de prévisions pour 2011 et 2012, l'activité cumulée du groupe AFD devrait permettre de dépasser l'objectif fixé de 10 milliards d'euros avec une très nette progression des engagements en Afrique anglophone.
Prévisions d'activité du Groupe AFD sur
l'Afrique subsaharienne 2008 - 2012
(en milliards d'euros)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Cumul |
|
1,3 |
2,1 |
2,4 |
2,6 |
2,9 |
11,3 |
Source : OCDE
Fer de lance de la coopération française en Afrique, l'AFD a également été le moteur de la présence française dans les pays anglophones.
Comme le dit Jean-Michel Severino, ancien DG de l'AFD, « la visibilité de la France dans des pays comme le Kenya a été considérablement renforcée par l'AFD ». Avec des prêts peu bonifiés, l'AFD apporte un savoir-faire qui assure à la France un partenariat durable avec les pays de l'est de l'Afrique où nous étions peu présents.
Ainsi, en Afrique du Sud, nous avons pu constater qu'historiquement peu présente dans la région, la France y apparaît aujourd'hui comme l'un des premiers bailleurs étrangers grâce à la croissance des engagements de l'Agence Française de Développement (AFD) depuis 2009.
Le Document cadre de Partenariat (DCP) signé en mars 2011, prévoyait un milliard d'euros d'engagements français pour 2011-2013, orienté en priorité vers les infrastructures de base (notamment eau, transports, énergie), afin de réduire les inégalités structurelles résultant d'un demi-siècle de développement séparé.
Les interventions de l'AFD selon les zones linguistiques
|
Engagements en millions d'euros |
2010 |
2011 |
2012 |
Total |
en pourcentage |
|
Pays anglophones |
1 085 |
825 |
560 |
2 471 |
47% |
|
Pays francophones |
456 |
1 330 |
918 |
2 705 |
51% |
|
Pays lusophones |
15 |
65 |
50 |
130 |
2% |
|
Total |
1 557 |
2 221 |
1 529 |
5 307 |
100% |
En matière de coopération multilatérale, la France s'est également fixé une priorité africaine en essayant, grâce au poids de ses contributions, d'orienter les moyens des bailleurs multilatéraux vers l'Afrique.
Deuxième contributeur de l'aide au développement européen, 5 e actionnaire de la Banque mondiale et 4 e de la Banque Africaine de Développement, la France possède un pouvoir d'influence notable dans les négociations multi-bailleurs.
Cette position stratégique au coeur de la coopération multilatérale lui permet de promouvoir notre priorité africaine.
Le niveau élevé de financement du FED (Fonds européen de Développement) et les interventions de la BEI (Banque européenne d'Investissement) apportent une contribution majeure à la coopération avec l'Afrique, notamment sur les aspects d'ouverture aux échanges ou d'appui au secteur productif.
La France travaille avec ses partenaires à l'adaptation des instruments financiers européens. Elle soutient le développement des activités de la BEI dans la région, en collaboration avec les banques africaines et les agences bilatérales européennes.
La France soutient également la Banque africaine de développement, dont les interventions sont recentrées sur un éventail de priorités sectorielles ciblées : infrastructures, secteur privé, gouvernance, États fragiles et intégration régionale, permettant un effet de levier sur ces priorités ; sur le plan géographique, les interventions du groupe rejoignent la volonté de concentration de la France, les quatorze pays pauvres prioritaires étant éligibles à son guichet concessionnel, le fonds africain de développement.
En tant que cinquième contributeur de la Banque mondiale, premier fonds concessionnel mondial, la France veille également à ce qu'une part majoritaire des ressources subventionnées soit affectée à l'Afrique subsaharienne.
La France pèse de tout son poids dans les instances des banques multilatérales pour orienter les financements vers l'Afrique.
Globalement d'après les chiffres communiqués au Parlement, plus de 55% des ressources subventionnées des banques multilatérales de développement et des fonds multilatéraux auxquels la France contribue, sont affectés à l'Afrique subsaharienne et 54% sur les PMA.
Ces chiffres relativement positifs laissent à penser que la stratégie française d'investissement dans les fonds multilatéraux afin d'orienter leur programmation vers l'Afrique porte ses fruits, même si le niveau de développement de nombre de pays africains en fait naturellement des cibles de la solidarité internationale.
Or la priorité française pour l'Afrique francophone n'est pas partagée par l'ensemble des actionnaires de la Banque mondiale. D'une part, certains actionnaires comme les États-Unis n'ont pas cette proximité géographique avec l'Afrique et s'orientent plus volontiers vers l'Amérique du Sud. D'autre part, même des actionnaires européens comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne peuvent avoir des préférences pour d'autres régions comme les Balkans ou l'Afrique anglophone.
Le tropisme africain de la France joue donc son rôle.
Part des ressources subventionnées des banques multilatérales de développement et des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires en %
|
Unité |
2009
|
2010
|
2011
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
|
Afrique subsaharienne |
% |
57,1 |
56,6 |
53 |
53 |
54 |
55 |
|
PMA |
% |
52,3 |
58,4 |
52 |
52 |
54 |
54 |
Malgré une diversification de centres d'intérêt de la coopération française avec la suppression d'un ministère de plein exercice qui lui était dédié, l'Afrique subsaharienne demeure dans les discours, comme dans les faits, la priorité de l'aide au développement française avec une palette très large d'instruments qui interviennent aussi bien au niveau macro-économique que dans le financement de micro-projets.
6. Le premier partenaire militaire de l'Afrique
Sur le plan militaire, l'opération SERVAL est venue rappeler avec force à l'opinion publique française et internationale que la France disposait d'une présence sans équivalent en Afrique.
« Vous étiez la seule nation occidentale à être capable d'intervenir sur le terrain malien comme vous l'avez fait » nous a dit M. Michael Battle, ambassadeur des États Unis auprès de l'Union africaine, « non seulement vous avez des bases qui vous permettent d'intervenir en premier sans délai à la demande d'assistance d'un pays ami, mais vous avez des soldats aguerris à la réalité africaine. »
Dans la décennie précédente, les deux guerres d'Irak et le conflit afghan avaient conduit à considérer, sous l'influence intellectuelle de la guerre contre le terrorisme de l'administration Bush, que l'effort de défense français devait se positionner sur un « arc de crise » allant du Golfe de Guinée jusqu'à l'Afghanistan.
Le conflit malien est venu rappeler que les intérêts français étaient d'abord en Afrique, là où sont nos ressortissants, là où est notre histoire, là où sont nos intérêts. Il a permis à chacun de prendre conscience que l'Afrique est le continent où la France joue encore un rôle militaire majeur qui lui vaut la réputation de «gendarme du continent ».
Si la France s'interroge depuis 15 ans sur le sens de sa relation avec les pays africains et sur ses modalités, elle y maintient une présence sans équivalent parmi les pays occidentaux avec plus de la moitié de ses forces militaires hors hexagone et un coût budgétaire qui avoisine le milliard d'euros annuel.
Cet investissement a pour contrepartie une influence politique sans équivalent. Comme nous l'ont dit la plupart de nos interlocuteurs rencontrés sur le continent : « Les Africains savent maintenant, s'ils en doutaient, que lorsqu'il y a des problèmes, la France ne se défausse pas et sait venir à leur secours »
Pour le Général Didier Castres, sous-chef d'état-major « opérations » au ministère de la défense, « l'Afrique est probablement la seule zone dans laquelle nous pouvons peser sur une crise dans ses différents volets (politique, militaire, développement, gouvernance), mais également susciter un effet d'entraînement diplomatique et militaire sur des partenaires européens. Des exemples récents en témoignent, de la RCI au Mali en passant par la RCA et le Tchad. Tous nos alliés nous reconnaissent comme étant parmi les seuls à comprendre et à connaître l'Afrique ».
Une présence permanente depuis les indépendances
Cette présence armée a un passé et un passif.
L'armée française a endossé bien des uniformes, jouant tour à tour les rôles d'explorateur, de colonisateur, de pacificateur, de bâtisseur et de gendarme pour le meilleur et pour le pire. Elle a ses héros, de Gallieni à Lyautey, son corps d'élite avec les Troupes de marine, ses moments de gloire et ses drames.
Les indépendances sont loin d'avoir mis fin à ce rôle de gendarme de l'Afrique qu'on assigne volontiers à la France.
Au lendemain de la décolonisation, la France a en effet signé une vingtaine d'accords de défense et de coopération avec ses anciennes colonies africaines. En vertu de ces accords, ou afin de venir en aide à ses ressortissants, l'armée française est intervenue à près de quarante reprises sur le sol africain en l'espace d'un demi-siècle. Certaines opérations françaises n'ont duré que quelques jours, d'autres ont donné lieu à des déploiements de plusieurs décennies.
Comme le disait avec ironie un général de l'armée ivoirienne : « beaucoup de nos concitoyens n'ont jamais vu un soldat blanc qui ne soit français ».
|
Une trentaine d'interventions militaires françaises en Afrique depuis 1960 1961 : Opération «Bouledogue» (transformée en opération «Charrue longue») pour le maintien de la base militaire navale de Bizerte en Tunisie. 1964 : Rétablissement du président Léon M'ba dans ses fonctions après le putsch d'une partie de l'armée au Gabon. 1968-1972 : Opérations «Limousin» et «Bison» contre la rébellion du Tibesti au Tchad. L'armée française enregistre des pertes importantes. 39 tués dans les rangs français durant l'opération «Limousin» ainsi qu'une centaine de blessés. 1977 : Opération «Verveine» en soutien au maréchal Mobutu contre la rébellion du Shaba. 1977 : Opération «Lamentin» de l'armée de l'air contre le Front Polisario en Mauritanie, dans le secteur du train minéralier Zouérat-Nouadhibou». 19 mai 1978 : Opération «Léopard» ou «Bonite». Les paras du 2 e REP sautent sur Kolwezi au Zaïre et délivrent les 3 000 civils de Kolwezi, en quelques heures, des rebelles katangais du FLNC (Front de libération national du Congo) qui faisaient régner la terreur dans la ville minière. Opération «Tacaud» au Tchad pour contrer l'avancée du Frolinat (Front national de libération du Tchad) de Goukouni Oueddei (Weddeye). 1979-1981 : Opération «Barracuda» en Centrafrique qui destitue l'empereur/président Bokassa et replace David Dacko au pouvoir. 1983 : Opération «Manta» au Tchad : 4 000 soldats français mobilisés en soutien au président Hissène Habré face aux rebelles de Goukouni Oueddei. Février 1985 : les Jaguar bombardent la base aérienne libyenne de Ouadi-Doum. 1986 : 150 parachutistes français débarquent en renfort au Togo suite à une tentative de coup d'État contre le président Gnassingbé Eyadéma. 1989 : Opération «Oside» aux Comores après l'assassinat du président Ahmed Abdallah et la prise de contrôle du pays par les mercenaires de Bob Denard. 1990-1993 : Mission «Noroit» au Rwanda pour protéger le régime du président Juvénal Habyarimana contre une attaque des rebelles du Front patriotique rwandais. 1992-1993 : Opération «Oryx» en Somalie. L'opération sera placée ensuite sous le commandement américain de la mission «Restore Hope». 1993 : Opération «Bajoyer» au Zaïre. Évacuation des ressortissants français. Kinshasa connaît des émeutes initiées par les militaires. 1993 : Opération «Chimère et Volcan», formation de l'armée rwandaise. 1994 : Opération «Amaryllis». Evacuation des ressortissants européens alors que le président Habyarimana vient d'être assassiné et que débute le génocide. 1995 : Opération «Azalée» aux Comores. Bob Denard et ses mercenaires ont renversé le président Saïd Mohamed Djohar. L'armée française neutralise Bob Denard, le ramène en France où il est emprisonné. 1996-2007 : Opération «Aramis» au Cameroun, soutien de l'armée camerounaise en lutte contre le Nigeria pour le contrôle de la presqu'île pétrolière de Bakassi. 1997 : Opération «Pélican» au Congo-Brazzaville pour évacuer les ressortissants étrangers durant la guerre civile. 1998 : Opération «Malachite», évacuation des ressortissants français de Kinshasa. 2002 : Début de l'opération «Licorne», force de maintien de la paix, en Côte d'Ivoire suite à une rébellion qui menace le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Cette intervention précède les accords de Marcoussis entre les forces politiques ivoiriennes, en janvier 2003. 2003 : Opération européenne «Artemis» dans l'est de la RDC. 2004 : Destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne après le bombardement de Bouaké dans lequel 9 soldats de la force Licorne vont trouver la mort et 35 autres sont blessés. Evacuation des ressortissants français. 2006 : Soutien à l'armée tchadienne face aux rebelles (dispositif Épervier). L'aviation française effectue un tir de semonce devant une colonne rebelle à 250 km de Ndjamena. 2008 : Protection de l'aéroport de Ndjamena et évacuation des ressortissants français au Tchad. 2008 : opération européenne Eufor Tchad-RCA, dissoute en 2009 2008 : Soutien logistique à l'armée djiboutienne à la frontière érythréenne. 2008 : Début de l'opération européenne de lutte contre la piraterie «Atalante» dans le golfe d'Aden. 2011 : en Libye les avions français sont les premiers à bombarder les forces de Mouammar Kadhafi en mars, après le vote de l'Organisation des Nations unies qui autorise l'intervention en Libye pour protéger les civils pris au piège dans une rébellion contre Kadhafi. L'OTAN a pris le commandement de la mission globale le 31 mars, qui a permis aux rebelles libyens de vaincre les forces du gouvernement et de prendre le pouvoir. 2011 : Côte-d'Ivoire, les forces françaises font pencher la balance aux côtés des forces de l'ONU lors de la guerre civile qui a éclaté après le refus de Laurent Gbagbo de démissionner et d'accepter la victoire électorale d'Alassane Ouattara comme président. |
Certaines de ces interventions ont été fortement contestées dans leurs objectifs, leurs modalités ou leurs conséquences.
Des opérations relevaient assurément de la protection de nos concitoyens, d'autres se sont soldées par des coups de forces soit pour défendre les pouvoirs en place, soit pour en changer les titulaires. La France a longtemps fait l'histoire, fait et défait des chefs d'État, pour le bonheur et parfois pour le malheur des populations. Cette histoire écrite en collaboration par des historiens français et africains devra progressivement en donner une vision objective, sa part de lumière et d'ombre.
Cette présence militaire a un passé et un passif
Quoi qu'il en soit, ce passé explique à la fois la connaissance remarquable des militaires français des théâtres africains et la dimension et le retentissement politique de toute intervention militaire française sur le continent qui lui est le plus proche.
Une des singularités de la France est non seulement la fréquence de ses interventions, mais également la permanence de sa présence physique sur le sol africain.
Cette présence distingue la France des autres pays qui eurent ou ont encore une politique militaire en Afrique sans pour autant y déployer des troupes.
L'autre grand colonisateur européen du continent, le Royaume-Uni, après une intervention militaire en Tanzanie, en 1961, en appui du président Nyerere, n'est pas intervenu sur le continent pendant près de quarante ans. Sa coopération militaire se limita à des actions ponctuelles de formation dispensées par les BMATTs (British Military Advisory and Training Teams).
Les Soviétiques n'eurent jamais de forces permanentes en Afrique et, lorsqu'ils y sont intervenus, ont préféré souvent le faire par le biais d'intermédiaires tels que les Cubains en Angola. Quant aux Américains, qui comme les Soviétiques, ne s'installèrent jamais durablement en Afrique durant la Guerre froide, ils ont, on l'a vu, créé un commandement régional pour l'Afrique, Africom qui dispose d'un certain nombre de bases, mais ils peinent à lui trouver un point de chute à tel point que son état-major se trouve en Allemagne !
Aujourd'hui, ce dispositif militaire français est organisé autour de 4 pôles qui interagissent :
- des accords de défense ou de coopération (8 accords de défense et 16 accords de coopération),
- un réseau des attachés de défense ,
- un dispositif de formation et de coopération dans ses deux dimensions, coopération opérationnelle et coopération structurelle, qui permet de former chaque année de l'ordre de 50 000 hommes,
- des bases de départ, d'accueil ou d'entraînement en cas de crise : notamment les forces prépositionnées au Gabon, à Djibouti, au Sénégal avec environ 5 000 hommes, Opérations extérieures au Tchad, en Côte d'Ivoire, en RCA, et au Mali avec environ 5 700 hommes.
L'armée française en Afrique en 2013 : 10 000 hommes, 8 bases ou points d'appui, 52 attachés de défense, 24 accords de défense ou de coopération pour un coût de plus d'un milliard d'euros par an
Ce maillage africain permet à la France d'avoir - autant que faire se peut - des moyens de renseignement, d'anticipation, de prévention, de protection et d'intervention sur l'ensemble du continent africain.
La politique de sécurité et de défense vis-à-vis de l'Afrique a connu une période charnière dans les années 90.
En effet, avant 1990, l'Afrique a été le champ clos des affrontements Est-Ouest. La France bénéficiait alors d'une grande marge de manoeuvre de la part de ses alliés pour contrer les initiatives soviétiques sur le continent.
La fin de cette période, l'horreur du génocide au Rwanda en 1994, qui a mis en évidence les risques d'instrumentalisation d'un engagement strictement bilatéral, la professionnalisation des armées françaises, un nouveau Livre blanc, ont marqué la décennie 1990-2000.
De cette prise de recul est né le tournant multilatéral de la politique de sécurité de la France en Afrique. Sortir des engagements unilatéraux signifiait dès lors repenser les objectifs et les modalités de notre présence militaire en l'arrimant au projet d'une architecture de sécurité africaine.
C'est en 1998 que, pour la première fois, sont définies de nouvelles orientations de notre coopération militaire en Afrique qui renouvellent la doctrine en s'appuyant sur cinq grands principes :
- le refus de l'unilatéralisme .
- des interventions militaires bilatérales en lien avec la sécurité des ressortissants français ,
- une présence permanente mais réduite ,
- une multilatéralisation des opérations avec les forces africaines, l'Europe et l'ONU,
- l'appui aux forces africaines de sécurité avec le programme de Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix (RECAMP) et le développement de la régionalisation qui s'appuie sur les écoles nationales à vocation régionale (ENVR).
Au-delà des alternances politiques et des interventions militaires sur le terrain, ces principes restent encore très largement d'actualité même si dans leurs modalités ils connaissent des adaptations au grès des crises.
Ces principes tirent une double leçon des trente années d'intervention.
La première est que le refus systématique d'intervenir n'est pas tenable. Les intérêts de la France en Afrique ne sont pas négligeables au point qu'elle puisse rester l'arme au pied lorsque des troubles y éclatent. Les forces de sécurité africaines ne sont pas encore assez aguerries face aux nouveaux types de menaces et aux conséquences humanitaires de crises peu soutenables par les opinions publiques. Du fait de ses moyens, la France a de facto une responsabilité dont elle peut difficilement se défausser compte tenu de sa volonté d'exercer des responsabilités internationales et de son statut de membre permanent du conseil de sécurité.
La seconde est que les modalités de son intervention doivent changer. La France doit marquer la fin du tête-à-tête avec ses anciennes colonies dont elle ne veut ni ne peut plus assumer le coût politique et financier. La crise des finances publiques françaises lui impose à terme de partager le coût de sa contribution à la sécurité du continent. Le drame rwandais a montré les risques politiques d'une présence uniquement bilatérale que l'ancienne puissance coloniale ne supporte plus de porter seule.
Ce parti pris a lui-même deux conséquences.
La première est d'encourager l'africanisation des solutions. La présence militaire française en Afrique doit servir en priorité à aider l'Afrique à bâtir son propre dispositif de sécurité collective. C'est le slogan « des solutions africaines à des problèmes africains » Du principe à la réalité, il y a cependant un long processus politique et militaire qui est loin d'avoir abouti. Mais la France entend faire une priorité du soutien aux efforts des États africains pour résoudre eux-mêmes les conflits armés notamment par le biais de ses organisations régionales. Pour ce faire, elle a engagé dès les années 90 un programme de renforcement des capacités africaines avec des moyens, il est vrai, de plus en plus limités.
La seconde, en attendant que les organisations régionales soient capables d'apporter des réponses efficientes, parallèlement à l'africanisation, c'est que la France n'entend plus intervenir que dans un cadre multilatéral avec l'onction juridique de l'ONU ou des organisations panafricaines et avec, sur le terrain, la collaboration plus ou moins significative d'autres armées, européennes ou africaines.
En multilatéralisant ses interventions, la France entend s'entourer d'une légitimité plus solide. L'exigence préalable d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, cohérente avec le rôle central que la diplomatie française entend faire jouer à l'instance onusienne, doit désamorcer l'accusation d'arbitraire qui pourrait être adressée à une opération décidée sans mandat international.
Dans ce contexte, l'ONU comme l'Union Africaine constitue une source de légitimité indispensable. Une des conséquences de cette stratégie est un intense travail diplomatique à New-York pour rallier nos partenaires à nos positions.
Comme nous l'a fait observer M. Gérard Araud, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations unies, « L'Afrique représente 70% de l'activité du Conseil de sécurité des Nations unies, signe des crises qu'elle traverse. Dans la mesure où les résolutions sont présentées par les États-membres, cela amène la France à être à l'origine de 60% des textes, concernant par exemple le Mali, la Côte d'Ivoire, la RDC ou la RCA. ».
Cette volonté d'obtenir une légitimité multilatérale est cependant régulièrement confrontée à la tentation de s'en affranchir pour maintenir notre autonomie d'action, par exemple en n'acceptant pas de placer nos troupes en Côte d'Ivoire sous commandement africain ou onusien.
Les opérations menées au Tchad ou en RDC conduisent parfois à s'interroger sur le décalage qui demeure entre les nouvelles tendances vers l'européanisation de la gestion des crises et la réalité des pratiques d'intervention qui restent encore très « bilatérales » du fait des réticences de nos alliés et, au premier chef, des Allemands, à s'impliquer davantage sur le continent.
Quoi qu'il en soit, ces nouvelles orientations trouvent notamment leur traduction dans la renégociation des accords de défense.
Les accords bilatéraux de défense signés, au lendemain des indépendances, entre la France, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, le Koweït, le Sénégal et le Togo garantissaient l'intervention de la France en cas d'agression extérieure.
Ces accords ont été redéfinis entre 2008 et 2012 afin de s'adapter aux demandes des parties et à la situation sur le terrain. Les clauses de confidentialité et d'automaticité ont notamment été supprimées. Certains d'entre eux contenaient des clauses secrètes prévoyant l''intervention des forces armées françaises en vue du maintien de l'ordre intérieur.
L'exposé des motifs des projets d'accord instituant un partenariat de défense entre la France et divers pays africains montre que l'objectif principal de la coopération est désormais, à côté de la fonction traditionnelle de formation des cadres des armées nationales, d'aider l'Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective.
De plus, ces accords comportent une dimension multilatérale prévoyant l'association au partenariat de défense d'autres pays africains ou européens, ainsi que les institutions de l'Union européenne et de l'Union africaine et les ensembles sous régionaux de cette dernière.
Les systèmes de sécurité collective de l'ONU et de l'Union africaine sont pris en compte ainsi que le partenariat stratégique Afrique-Union européenne défini à Lisbonne en 2007. Enfin, la référence au respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale des partenaires, vient manifester la volonté de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés.
De nouveaux accords de défense en cours de ratification.
Trois accords renégociés sont d'ores et déjà entrés en vigueur avec le Togo, le Cameroun et la République centrafricaine, tandis que les cinq autres sont encore en attente de ratification parlementaire. Ils concernent respectivement notre partenariat avec : les Comores, Djibouti, le Sénégal, le Gabon et la République de Côte d'Ivoire.
Ces accords de défense sont complétés par 16 accords de coopération militaire.
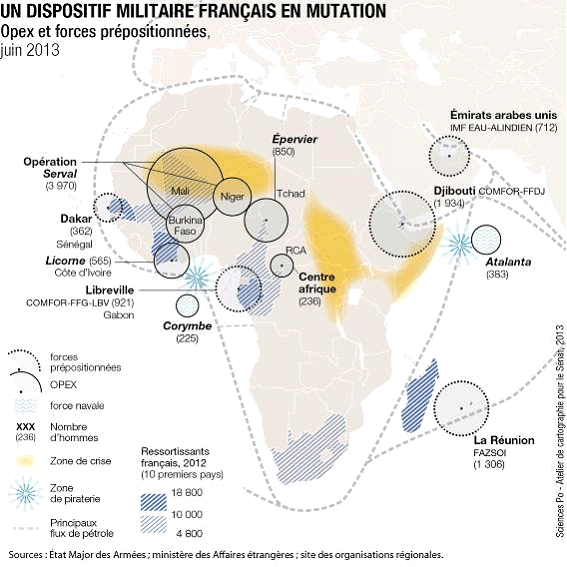
Ces accords ainsi que des opérations extérieures (OPEX) qui, à l'origine temporaires, se sont installées dans la durée, ont permis à la France de bénéficier de plusieurs points d'appui militaires sur le continent, notamment à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, en République centrafricaine, au Tchad avec l'opération Epervier et plus récemment et de façon temporaire au Mali.
Au total, sur les 10 000 hommes en poste en Afrique, 5 050 militaires français sont pré-positionnés dans le cadre d'accords bilatéraux et près de 5 300 hommes sont mobilisés au titre des OPEX.
Des équipements militaires viennent compléter ces effectifs. Ces hommes disposent en temps normal des capacités suivantes : 11 chasseurs, 7 avions de transport tactique, 14 hélicoptères de manoeuvre, 4 hélicoptères légers, 4 chalands de transport de matériel et 3 bataillons interarmes.
Émargeant sur des lignes budgétaires différentes, les forces prépositionnées et les OPEX ont dans la réalité peu de différences opérationnelles.
S'ajoutent à cela des forces sous mandat international, notamment dans le cadre des opérations contre la piraterie au large de la Somalie et du Golfe de Guinée, et les forces de souveraineté présentes dans l'océan Indien, à la Réunion et à Mayotte.
L'Afrique c'est 50 % des effectifs et 70% des crédits militaires liés à une présence ou à des opérations hors du territoire national
Sur le plan budgétaire, le coût annuel des forces prépositionnées est en 2013 de l'ordre de 400 millions d'euros, celui des OPEX en Afrique de l'ordre de 900 millions (65 millions en Côte d'Ivoire, 107 au Tchad, 26 millions pour l'océan Indien, 22 en Centrafrique, 700 millions pour le Mali) sur un budget d'OPEX variant, suivant les années, entre 800 millions et un milliard d'euros (comme ce fut le cas en 2011 et comme cela sera vraisemblablement le cas en 2013 compte tenu de Serval, dont le coût annuel devrait s'élever à 700 millions d'euros).
L'Afrique représente en 2013 ainsi environ 70% du budget militaire finançant une présence ou des opérations hors du territoire national et 50 % des effectifs hors du territoire national.
|
État des forces françaises en Afrique en 2013 En Afrique, notre dispositif militaire, de 10 000 hommes environ sans la Réunion et Mayotte, combine en effet aujourd'hui : - des forces de présence permanente (3 000 environ) qui ont deux statuts distincts : les Forces françaises au Gabon, environ 900 militaires à Libreville, dont 450 permanents, et les Forces françaises stationnées à Djibouti, contingent français numériquement le plus important en Afrique, avec 1 900 militaires, dont 1 400 permanents, qui sont les deux bases prépositionnées prévues par le Livre blanc de 2008 ; et les Éléments français au Sénégal , à Dakar, autour d'un « pôle opérationnel de coopération à vocation régional » de 350 militaires, dont environ 260 permanents ;- et des opérations extérieures (OPEX), résultant d'opérations « temporaires », pour un total de 6 000 hommes environ (4 200 pour le Mali et la zone sahélienne, 1 000 au Tchad (Épervier) et 1 000 autres entre la Côte d'Ivoire (Licorne et Onuci), la République Centre Africaine 240 hommes (BOALI), et les dispositifs de lutte contre la piraterie Atalante et Corymbe, 225 hommes dans le Golfe de Guinée (Bâtiment CORYMBE), 383 hommes dans le Golfe d'Aden (ATALANTA). - des forces de souveraineté (La Réunion-Mayotte : les forces armées en zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) représentent environ 1 900 militaires des trois armées ; Il faut y ajouter les Forces françaises aux Émirats Arabes Unis, sur la péninsule arabe (700 hommes environ), dans le cadre d'un accord intergouvernemental avec ce pays créant une implantation militaire française permanente. |
D'un point de vue opérationnel , les bases permanentes françaises en Afrique offrent :
- des points d'appui du soutien français à l'architecture africaine de paix et de sécurité,
- des capacités prépositionnées à proximité des zones d'intérêt et des forces projetées en complément depuis la métropole,
- des facilités logistiques comme à Djibouti pour l'opération Atalanta qui donnent souplesse et réactivité aux forces françaises et qui contribuent à l'autonomie stratégique de notre pays,
- des bases d'entraînement pour les forces françaises.
Des forces aguerries et acclimatées, immédiatement déployables, à proximité des foyers de crise
Comme l'a montré l'opération SERVAL au Mali, ces points d'appui donnent à la France :
- une position unique et enviée en Afrique, qui lui confère une influence et une crédibilité incontestable sur nos partenaires dans nos relations diplomatiques, que ce soit avec les organisations africaines régionales ou continentales, mais également avec nos partenaires bilatéraux, (États-Unis, Canada, Royaume-Uni) et au sein des organisations internationales.
- une liberté d'action politique avec des forces aguerries et acclimatées, immédiatement déployables, à proximité des foyers de crise.
D'un point de vue géographique, le dispositif français comprend une présence sur la façade atlantique du continent africain, une sur sa façade orientale, deux points d'appui dans le golfe Arabo-Persique et un dans l'océan Indien.
Ainsi sur la côte ouest, la France dispose des bases d'Abidjan, de Dakar, et de Libreville.
Sur la côte est, Mayotte et la Réunion regroupent des forces souveraines et assurent ainsi notre présence au sud-est du continent tandis que la base de Djibouti couvre le nord-est du continent et la base des Émirats, le Golfe Persique et la corne de l'Afrique.
Un dispositif qui se veut équilibré entre la façade atlantique du continent africain, sa façade orientale et l'océan Indien.
On voit alors se dessiner en creux la carte des intérêts français en Afrique : les trois bases postées sur la côte occidentale encadrent à la fois la zone où se concentre la majorité de nos expatriés (l'Afrique francophone) et le Golfe de Guinée, haut lieu de piraterie maritime, par lequel transite la majorité de nos approvisionnements en hydrocarbures et minerais africains.
De la même façon, les troupes postées à Djibouti, aux Émirats arabes unis et à la Réunion sont autant de moyens de contrôle des routes maritimes et pétrolières qui longent l'Est de l'Afrique en provenance des pays du Golfe et de l'Asie.
Ce dispositif est complété par un volet de coopération structurelle assurée par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), organe dépendant du ministère des Affaires étrangères, chargée de garantir la stabilité des pays partenaires tout en soutenant l'extension de l'influence française dans le monde.
70% de notre coopération militaire est destiné à l'Afrique.
Là encore, l'essentiel de l'activité de la France est en Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2012, 69% de nos crédits de coopération militaire structurelle, qui avoisinent les 90 millions d'euros, sont consacrés à l'Afrique subsaharienne, contre 14% à la zone Afrique du Nord - Moyen-Orient et seulement 9% à l'Asie.
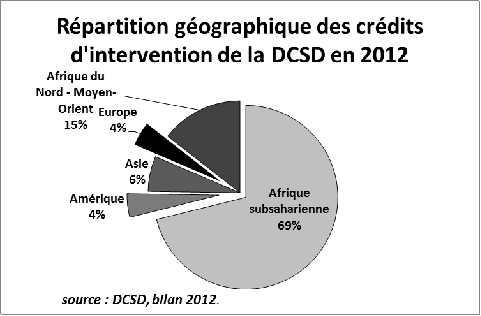
La répartition des crédits alloués par le fonds de solidarité prioritaire (FSP) consacré à la sécurité est encore plus frappante : 87% étaient destinés à l'Afrique subsaharienne pour cette même année.
La coopération structurelle française inscrit son action en Afrique dans la lutte contre les grands enjeux de sécurité, l'aide à la lutte contre le terrorisme, la piraterie, le crime organisé.
Elle apporte des conseils de haut niveau aux ministres et aux chefs d'état-major des armées, une expertise et un audit, des formations, un enseignement du français, un accompagnement des contrats en équipements, un soutien logistique et parfois une aide directe.
Enfin, la direction de la coopération de sécurité et de défense prend aussi une part importante dans l'application des réformes du système de sécurité africain en collaboration avec la Direction générale de la mondialisation (DGM) notamment dans les contextes de post crise où les questions de désarmement sont stratégiques pour stabiliser le retour à la Paix.
Les écoles nationales à vocation régionale : un dispositif unique
En 2012, la Direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères a financé la formation de 1 000 stagiaires en France, 2 500 stagiaires dans l'une des Ecoles nationales à vocation régionale (ENVR) implantées en Afrique, 11 000 stagiaires en langue française. Au total, 65 000 personnes ont ainsi bénéficié en 2012 de l'action de coopération de la DCSD.
Parallèlement, 17 000 soldats ont été formés en 2012 dans le cadre la coopération opérationnelle dans les pays africains.
La coopération militaire française privilégie autant que possible une approche régionale en Afrique via des écoles et des centres de formation.
La plupart de ces structures sont des écoles nationales à vocation régionale (ENVR), fruit d'une collaboration étroite entre militaires français et africains.
Les ENVR s'ancrent dans un souci de rayonnement régional du pays hôte. On en compte 17 -et sans doute 20 dans les prochaines années- sur le continent africain proposant 60 formations différentes et recevant 2 500 stagiaires par an. 45 coopérants français sont en poste au sein de ces écoles.
Il s'agit à la fois de former les futurs cadres des armées africaines afin de permettre aux États du continent d'être capables d'assurer leur propre sécurité, et de pérenniser le rayonnement de l'influence française.
De fait, ces centres de formation sont l'un des principaux vecteurs de l'apprentissage du français et ne cessent de se développer sur le sous-continent. Ainsi en 2012 une nouvelle école nationale à vocation régionale -l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou- a été ouverte au Burkina Faso, tandis que l'École internationale des forces de sécurité a poursuivi sa montée en puissance au Cameroun. Une école de ce type va prochainement ouvrir en Tunisie autour du thème de la protection civile, à la suite de celle du Burkina Faso. Une nouvelle structure ouvrira en Côte d'Ivoire avec un cursus de formation des officiers.
Enfin, notre coopération militaire en Afrique s'inscrit de plus en plus dans un cadre international. En effet, la France entend défendre sur le continent des intérêts sécuritaires et géopolitiques qui sont aussi ceux de l'Union européenne.
Ainsi, le concept RECAMP (renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) créé en 1996-1997 à l'initiative de la France constitue une véritable percée conceptuelle. Il s'agit d'un programme comprenant des cycles de formation et d'entrainement à tous les niveaux (stratégique, tactique et opérationnel) dont la pertinence a été reconnue par nos interlocuteurs africains et qui se poursuit malgré une diminution sensible des moyens budgétaires disponibles pour l'impulser.
Ce projet est clairement à l'origine du cycle EURORECAMP AMANI AFRICA qui a repris au niveau européen le concept en le recentrant sur les aspects stratégiques avec un succès plus mitigé.
L'implication croissante de l'Union européenne et de la France dans la formation militaire en Afrique tend à soutenir la mise en place par l'Union africaine (UA) du projet d'architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) et du projet de forces africaines en attente.
Des bases militaires qui ont vocation à soutenir les brigades régionales de l'Union africaine.
La présence militaire française en Afrique est aujourd'hui sans doute un des aspects les plus visibles de notre présence sur ce continent et constitue une spécificité française. C'est une présence qui présente une forte charge symbolique et des implications politiques majeures. C'est un élément structurant de notre influence, une contribution importante à la sécurité du continent en même temps qu'une responsabilité lourde tant sur le plan politique qu'humain et financier.
50 ans après les indépendances, cette présence est naturellement amenée à évoluer dans sa forme et ses modalités. Mais l'intervention au Mali a montré son utilité et lui a redonné une légitimité.
La vocation des forces armées françaises en Afrique n'est cependant pas de continuer à se substituer aux forces africaines. Un des enjeux de la décennie est sans doute d'assurer une transition compatible avec le maintien d'une sécurité vitale au développement d'un continent plus que jamais soumis à des forces déstabilisatrices.
Le prochain Sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique avec l'ensemble des chefs d'État africains doit être l'occasion de réfléchir aux moyens de renforcer l'utilité de cette présence pour la constitution de forces de sécurité régionale africaines.
B. L'AFRIQUE EN FRANCE, UNE RÉALITÉ SOUS-ESTIMÉE
Après deux jours d'opération Serval, le Président de la République François Hollande a reçu les représentants des associations de la communauté malienne installée en France, notamment le Haut Conseil des Maliens de France qui fédère 360 associations d'une communauté qui compte environ 100 000 Maliens de France.
Quelques mois plus tard, alors qu'une soixantaine de soldats maliens défilent le 14-Juillet sur l'avenue des Champs-Elysées aux côtés de militaires français dont les unités ont été engagées au Mali rappelant le souvenir des tirailleurs sénégalais et des héros de Monte Cassino « morts pour la France », la 67e édition du Festival d'Avignon s'ouvre autour de représentants majeurs de la scène théâtrale africaine réunis par le Congolais Dieudonné Niangouna.
Ces gestes symboliques illustrent une autre dimension de la relation au continent africain, la présence d'une communauté africaine forte de plus de 800 000 immigrés auxquels il faut ajouter près de 200 000 descendants de plus de 18 ans.
C'est pourquoi la France en Afrique ne saurait se comprendre sans mesurer le poids, l'importance du continent noir dans l'Hexagone.
L'Afrique, la France la vit aussi de l'intérieur, à cause de cette communauté africaine nombreuse qui fait que jamais la relation au continent noir ne sera la même qu'avec un autre continent, mais aussi en raison de la présence au sein des réseaux culturels français d'un tropisme africain qui existait bien avant la décolonisation et qui perdure au-delà, dans un compagnonnage fertile.
1. 1 million d'Africains en France : un enjeu politique et diplomatique
Même s'il ne s'agit que de 13 % de la population immigrée de France, avec plus d'un million de personnes, l'existence d'une communauté africaine de France pèse et influence de différentes façons l'évolution des relations avec les partenaires africains.
La présence d'une Afrique de l'Hexagone ne dicte pas la conduite du pays à l'égard du continent africain, loin s'en faut. Elle n'a pas le poids que peut avoir par exemple la communauté juive ou éthiopienne aux États-Unis, mais elle constitue l'un des éléments structurants de la politique africaine.
La politique migratoire et sa fermeture progressive, mais aussi la politique d'accueil et de promotion des artistes africains au sein des institutions culturelles de l'Hexagone ont façonné le profil d'une présence africaine en France. L'attitude des pouvoirs publics à l'égard de cette communauté a été, selon les moments et les sujets, une source de rapprochements avec différents pays ou au contraire un facteur d'irritation.
L'immigration africaine en France, une dimension négligée de la politique africaine.
Cette présence a une histoire. La montée en puissance de l'immigration d'Afrique subsaharienne et de son enracinement en France s'est renforcée depuis les années soixante-dix, mais tire évidemment son origine dans l'histoire de la colonisation.
Au cours du 20 e siècle, la filière scolaire par laquelle certains éléments brillants des colonies sont venus en France est la raison la plus ancienne et, sans doute, la plus constante. Elle a permis de former les leaders de mouvements politiques, culturels et indépendantistes ou assimilationnistes dès la fin de la Première Guerre mondiale. Une grande partie de l'élite africaine des indépendances est passée par la France.
Une filière militaire s'est également mise en place dès la Première Guerre mondiale (1914-1918) avec la mobilisation des colonies par la France. Les bataillons de tirailleurs sénégalais et d'Africains noirs participant aux combats en 1914-1918 comptaient environ 134 000 hommes. Ils étaient 64 000 à se battre au printemps 1940. Si la plupart des survivants sont rentrés à la fin de la guerre, certains sont restés et se sont installés en France.
Même s'il a fallu attendre longtemps pour qu'il leur soit rendu hommage, le souvenir de leur sacrifice est encore présent dans les mémoires. On se souvient des polémiques et de l'injustice faite aux anciens combattants dont les retraites ont été gelées avant que le Conseil constitutionnel impose aux pouvoirs publics de changer de position.
Cette dette de sang est un des épisodes marquants de la relation à l'Afrique francophone.
A l'occasion du cinquantenaire des indépendances africaines, certains anciens soldats d'Afrique subsaharienne avaient été invités en France, témoignant ainsi de la reconnaissance de la France à l'égard de ce qui est présenté comme une dette de sang. C'est d'ailleurs précisément à eux que François Hollande a rendu hommage en recevant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, au lendemain de l'intervention au Mali : « C'est une dette que mon pays avait à acquitter à l'égard de l'Afrique. Parce que la France ne pouvait pas oublier la participation des soldats d'Afrique à nos côtés lors des deux dernières guerres mondiales. Non, la France ne pouvait pas oublier les dizaines de milliers d'Africains qui ont laissé leurs vies sur les champs de bataille pour la liberté de la France, pour les libertés de l'Europe. ».
C'est cependant la migration de travail qui a été la principale cause de l'augmentation de la communauté africaine en France.
Après la première guerre, militaires démobilisés, navigateurs, travailleurs manuels originaires du continent sont recensés dans les villes portuaires (Marseille, Bordeaux, Le Havre, etc.) mais aussi à Paris. Les ressortissants de la vallée du fleuve Sénégal (Soninké et Toucouleur du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie) sont arrivés à partir des années 60 en plus grand nombre dans le cadre des accords de main-d'oeuvre bilatéraux.
L'immigration africaine: un enjeu majeur du débat politique français.
Les migrations des épouses, amorcées au début des années 70 au titre du regroupement familial, a pris très vite la forme de migrations de travail. La population africaine de France s'est diversifiée ensuite avec le développement des flux de citadins venant principalement d'Afrique centrale (Cameroun, Zaïre) mais comportant aussi des ressortissants des capitales et villes de l'Afrique occidentale, notamment sahélienne.
Les migrations d'étudiants africaines, à l'origine tournantes et provisoires, deviennent, à partir de cette époque, plus souvent définitives, avec la crise des États africains et les migrations de travail.
A partir de 1974, la fermeture des frontières à l'immigration de travail extra-européenne va modifier la donne et faire de l'immigration un élément important de la relation de la France à l'Afrique subsaharienne.
Après avoir encouragé l'immigration à une époque où les besoins de main-d'oeuvre étaient importants, les différents gouvernements ont alternativement ouvert et fermé les possibilités d'obtenir des visas avec, globalement, une restriction des entrées.
Dans un contexte de chômage structurel élevé et de tensions sociales croissantes se traduisant par la multiplication des phénomènes d'exclusion sociale, l'immigration est devenue un enjeu majeur du débat politique.
La crispation de l'opinion publique, le contexte économique et social dégradé, les difficultés rencontrées par les politiques d'intégration, ont conduit la France à adopter une politique migratoire plus ou moins restrictive -pour ne pas dire répressive- selon les gouvernements en place et à renforcer les moyens de lutte contre l'immigration irrégulière.
Il s'en est suivi des politiques de visas restrictives et d'encouragement au retour des ressortissants étrangers travaillant dans les secteurs où traditionnellement le nombre d'emplois à pourvoir était important et dont le profil ne correspondait plus aux besoins de l'économie française.
Ces politiques de retour ont été concrétisées par des mesures d'expulsion des immigrés clandestins, accompagnées d'un volet d'incitation et d'accompagnement se traduisant par l'octroi de pécules qui pouvaient être injectés dans l'économie du pays d'origine. Par ailleurs, les retours volontaires et spontanés ont également ramené au pays d'origine des ressortissants porteurs de capacités d'investissement et de création d'entreprises.
Pour l'opinion publique africaine, ce revirement s'est essentiellement traduit par une restriction de la politique des visas et a été illustré par les fameux charters de Maliens en 1986 qui concernent un nombre assez limité d'immigrés, mais dont la médiatisation a eu pour effet de cliver le débat politique sur les sans-papiers, d'envoyer volontairement un signal négatif aux candidats à l'immigration.
Politique des visas, expulsions et charters : trois figures du ressentiment africain
La politique des visas comme ces expulsions médiatisées ont été très mal perçues en Afrique, l'opinion publique jugeant l'attitude de la France à la fois ingrate et attentatoire à la dignité des Africains.
Pour autant, sur une longue période, cette politique migratoire française, au-delà des clivages politiques, n'a pas arrêté l'immigration africaine mais en a enrayé le rythme. Elle a, en effet, continué à prendre en compte les besoins en main-d'oeuvre des différents secteurs de l'économie ainsi que les flux liés au regroupement familial.
En 2012, les autorités françaises ont délivré 1,8 million de visas de court séjour et plus de 170 000 titres de long séjour. Elles ont procédé également à plus de 100 000 naturalisations.
Le flux d'étudiants africains reste important avec plus de 50 000 étudiants africains (hors Maghreb), ce qui constitue près du quart des étudiants étrangers en France.
La politique migratoire restrictive menée ces dernières années a eu un impact direct, on le verra, sur la politique d'accueil des artistes et des élites africaines et des étudiants.
Elle n'a cependant pas empêché la constitution en France d'une communauté africaine importante même si elle est très minoritaire parmi les immigrés.
Les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne n'étaient que 20 000 en France au moment du recensement de 1962, contre 800 000 en 2012, soit une multiplication par 40 en un peu plus de 40 ans. L'augmentation est certes importante, si bien qu'en 2012 les Subsahariens ne représentent qu'un peu plus d'un dixième de l'ensemble des immigrés en France (13%).
Cette communauté africaine de France que l'on retrouve parfois concentrée à Montreuil, « la deuxième grande ville du Mali », à Paris notamment à Belleville ou à la Goutte-d'Or, en région parisienne, notamment à Corbeil, à Mantes-la-Jolie, à la Courneuve, à Saint-Denis ou Sarcelles, est très jeune. La moitié n'est en France que depuis 10 ans, 50 % sont âgés de 25 à 44 ans. Elle accueille aujourd'hui une deuxième génération d'Africains de France qui possèdent la nationalité française.
Cette communauté est pour l'essentiel issue de l'Afrique francophone, deux Africains sur trois en France provenant d'anciennes colonies françaises.
Comme l'a souligné M. Luc Derepas, secrétaire général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur : « on observe cependant des différences notables entre les immigrés venus d'Afrique guinéenne ou centrale et ceux qui proviennent de l'Afrique sahélienne. »
Les immigrés venus d'Afrique guinéenne ou centrale sont par exemple 66 % à avoir parlé le français durant l'enfance, alors que pour l'Afrique sahélienne, la part n'est que de 34 %. Ces écarts et similitudes s'observent aussi pour les descendants, mais à des niveaux beaucoup plus élevés : 84 % des descendants originaires d'Afrique sahélienne, 98 % pour ceux originaires d'Afrique guinéenne ou centrale parlaient le français durant l'enfance.
Ces différences s'observent également quant à la répartition par niveau de diplôme atteint. Les immigrés originaires d'Afrique sahélienne sont 32 % à être sans diplôme mais aussi 30 % à être diplômés du supérieur. Dans le premier cas, c'est une proportion élevée, mais aussi dans le second. Pour les femmes, 52 % sont sans diplôme et 10 % à être diplômées du supérieur. Les hommes immigrés d'Afrique guinéenne ou centrale sont 42 % à être diplômés du supérieur et seulement 9 % à n'être pas diplômés.
Il s'agit donc, contrairement à l'image que l'on s'en fait, d'une population relativement éduquée et diplômée.
Les Africains de France appartiennent aux catégories sociales les plus diverses et comptent dans leurs rangs des figures d'excellence telles que : dans le domaine économique, Lionel Zinsou ou Tidjane Thiam, polytechnicien, ingénieur civil des Mines, originaire de la Côte-d'Ivoire, premier PDG d'origine africaine du Footsie (équivalent britannique du CAC 40) ; dans la sphère politique, Rama Yade, née à Dakar, administratrice du Sénat puis Secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme, ou Kofi Yamgnane, né à Bassar au Togo, maire d'une commune du Finistère et Secrétaire d'État aux Affaires Sociales et à l'Intégration dans les gouvernements socialistes d'Edith Cresson et de Pierre Bérégovoy ; dans le domaine du sport, Yannick Noah ; ou dans le cinéma Omar Sy, acteur français né d'une mère mauritanienne et d'un père sénégalais.
Comme le souligne régulièrement La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, cette Afrique de France est confrontée, à l'instar des minorités qu'on appelle désormais visibles, à des discriminations liées à leur nationalité autant qu'à la couleur de leur peau.
Le racisme sous toutes ses formes reste une réalité telle que décrite par le roman de Calixthe Beyala ou de Sami Tchak, qui touche aussi bien « les petits princes de Belleville » que des parcours prestigieux comme celui de Tidjane Thiam qui, après avoir à la sortie de Polytechnique paradé sur les Champs-Élysées à la grande fierté de sa mère sénégalaise sans instruction, a fini par quitter la France lassé de ce plafond de verre qui empêche trop souvent les cadres d'origine africaine de décrocher des postes à responsabilité là où l'Angleterre s'avère plus ouverte.
« Quand les banlieues françaises flambent, la jeunesse d'Afrique se sent maltraitée ».
Cette Afrique de France est regardée, observée par le continent noir.
Avec le développement d'Internet et de la télévision, la réalité de vie des communautés africaines en France est aujourd'hui mieux connue en Afrique et très commentée. Le développement du racisme comme le sort des sans-papiers est suivi avec attention et réprobation. Si les difficultés de l'intégration ne dissuadent pas les candidats à l'immigration, toujours très nombreux, comme nous l'a dit un interlocuteur à Abidjan, « Quand les banlieues françaises flambent, la jeunesse d'Afrique se sent maltraitée ». Et il est significatif de voir que lorsque TF1 nomme Harry Roselmack comme présentateur du journal télévisé de TF1, la presse africaine titre : « Un 20h présenté par un Noir sur la première chaîne française, une sacrée avancée ».
Cette présence africaine dans l'Hexagone influe sur la politique africaine de la France de différentes façons.
Au niveau politique, elle ne constitue pas en soi un enjeu électoral majeur, même si localement, à Montreuil ou ailleurs, la concentration des communautés africaines a une influence sur les positions des responsables locaux. Elle pèse néanmoins à travers un réseau dense d'associations dont les capacités de mobilisation avec les ONG nationales ne sont pas négligeables, comme l'a illustré le combat pour les sans-papiers.
Des communautés africaines de France mobilisées sur tous les dossiers qui touchent le continent noir
Ces réseaux sont particulièrement présents dans les débats sur l'immigration, la gestion concertée des flux migratoires et le codéveloppement. Leur mobilisation lors de l'opération Serval ou sur des dossiers pendants relatifs aux droits de l'homme, à la démocratie, à la corruption, sur des dossiers comme les biens mal acquis, montre que la politique africaine du gouvernement est aujourd'hui suivie de près par les communautés africaines de France.
Au niveau diplomatique, dès les années 2000, le fait migratoire devient un élément incontournable des relations avec les pays africains.
D'un côté, les pouvoirs publics, toutes majorités confondues, ont cherché à optimiser le lien entre migration et développement en essayant de promouvoir des actions de codéveloppement menées par des migrants dans leurs pays d'origine.
S'appuyant sur des pratiques sociales anciennes, les gouvernements successifs ont cherché à abonder les projets soutenus par les migrants dans une perspective de développement mais aussi de retour au pays d'origine.
Contestées par les uns, louées par les autres, ces actions ont eu du mal à s'imposer comme une politique publique autre qu'expérimentale.
La faiblesse des moyens mis en oeuvre au sein d'un programme budgétaire 301, son arrimage à la politique de restriction de l'immigration et la difficulté à transformer une pratique sociale en une politique publique d'envergure ont contribué à en limiter les résultats.
Parallèlement, la France a cherché à établir une contractualisation, avec les pays d'origine des migrants, des règles en matière de circulation et séjour des personnes, de lutte contre l'immigration clandestine et de retour des immigrés clandestins.
En 2011, treize accords avaient été signés notamment avec le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, la République de Maurice, le Gabon, le Sénégal, la Tunisie.
Le principe des accords de gestion « concertée » des flux migratoires était d'articuler un assouplissement des règles de circulation pour certaines catégories de personnes originaires des pays partenaires, comme les étudiants ou les travailleurs migrants, avec un renforcement de la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et un soutien aux initiatives dans le domaine du codéveloppement.
Les accords de gestion concertée des flux : une tentative de créer un cadre de dialogue sur la question des migrations.
Le but principal de ces accords était et reste de former un cadre de dialogue avec les pays africains sur la question des migrations. En l'absence d'échanges institutionnels, le sujet était encore très empreint d'approximations et de préjugés que la mise en oeuvre des accords doit permettre d'affronter plus sereinement avec un suivi régulier au sein de commissions mixtes qui constituent autant d'instances de dialogue.
En revanche, l'équilibre des accords, qui dépend largement de leurs conditions d'application et, en premier lieu, de la concrétisation de leur volet « développement », a été jugé par beaucoup défavorable aux pays africains. Non seulement les budgets n'ont pas suivi, mais le droit commun de plus en plus restrictif est venu remettre en cause les maigres avancées prévues par les conventions en matière de visas.
La multiplication des régimes spécifiques a conduit à une gestion singulièrement complexe par les préfectures et les consulats. Ces derniers, déjà confrontés à des dispositifs multiples, ont limité la portée des mesures visant à faciliter les migrations circulatoires à l'image de la carte « compétences et talents », dont le passage « en régime de croisière » s'est finalement traduit par des délivrances « au compte-gouttes », soit 300 cartes par an pour l'ensemble de la planète !
Cette politique de visas circulatoires a, en outre, été progressivement vidée de son sens par la pratique des consulats et les circulaires d'interprétation de plus en plus restrictives à l'image de la circulaire du ministère de l'Intérieur français du 31 mai 2011, surnommée « circulaire Guéant » abrogée en 2013.
Le volet développement des accords a été considérablement réduit par les contraintes budgétaires à une trentaine de millions d'euros et par la difficulté à définir la spécificité des projets de codéveloppement qui dans un premier temps étaient conduits par le ministère de l'immigration.
Enfin, la mise en oeuvre de ces accords, qui étaient censés ouvrir la voie à une politique ambitieuse de codéveloppement, a fini par être perçue comme une forme de « chantage migratoire » aux termes duquel les pays contractants, en échange de la reprise de leurs ressortissants en situation irrégulière, bénéficiaient selon les cas d'un surcroît de coopération ou simplement du maintien de leur aide au développement.
Cette situation a conduit des pays comme le Mali, dont plus de 4 % du PIB provient de fonds transférés par les migrants, à refuser de signer, les autorités jugeant un accord trop impopulaire auprès de la population malienne qui craignait qu'un tel accord limite encore les possibilités de visas.
Parallèlement, la nouvelle majorité issue des élections de 2012 s'est engagée à supprimer ce lien entre les accords de gestion concertée et le financement du codéveloppement dont les crédits ont été rapatriés au ministère des Affaires étrangères, sans remettre en cause les accords signés.
Dans le même temps, la majeure partie des pays européens concernés et l'Union européenne se sont engagés dans des politiques similaires.
Le « Pacte européen sur l'immigration et l'asile », adopté par le Conseil européen en 2008, vise ainsi à encourager des partenariats entre les pays de destination, d'origine et de transit, favorisant les synergies entre migrations et développement.
En outre avec la mise en place de l'espace Schengen, la politique migratoire française à l'égard de l'Afrique a pris une dimension européenne sans qu'une harmonisation des pratiques ne se soit véritablement mise en place.
Compte tenu du défi démographique auquel devra faire face l'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier, cette question de l'immigration est sans doute un aspect névralgique des relations de la France à l'Afrique dans les décennies à venir.
2. La France : une vitrine de la culture africaine dans le monde
La présence physique d'une « Afrique de France » s'accompagne d'une présence culturelle intense comme en témoigne, en 2013, la multiplication des expositions et événements célébrant l'Afrique, de la présence de l'Afrique au festival d'Avignon à la saison Afrique du Sud-France en passant par les expositions organisées dans le cadre du « Tandem Dakar-Paris ».
Il est vrai que le passé colonial a conduit la France à valoriser les trésors de la culture africaine.
Peu de continents extra-européens sont aussi présents dans les grandes institutions culturelles françaises.
Longtemps cette présence a été cantonnée au registre colonial et néocolonial à l'image du Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie de la Porte Dorée construit dans les années 30. La France y a découvert l'art nègre, selon l'expression de l'époque, un art qui va faire la fortune de nombreux marchands d'art et de collectionneurs du Quartier Latin à l'issue de ce qu'il faut bien considérer comme un pillage du continent noir.
Cet art africain, qui a irrigué la création picturale française du 20 ème siècle, de Picasso à Dubuffet, est aujourd'hui particulièrement bien mis en valeur au sein du musée du Quai Branly. Ce musée réunit les collections de l'ancien Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie, devenu maintenant la Cité de l'Immigration, et les collections du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme, soit à peu près 300 000 oeuvres.
A travers des expositions comme celle consacrée au Fleuve Congo, le Musée des Arts Premiers et, à travers lui la France, fête le génie africain avec un certain succès puisque le musée reçoit 1,5 million de visiteurs par an, ce qui en fait le quatrième musée parisien.
La France ne se contente cependant pas de célébrer le patrimoine africain, elle met en valeur depuis des décennies la création culturelle africaine.
D'autres expositions marquantes comme celle du centre George Pompidou consacrée aux « Magiciens de la terre » en 1989 ou l'exposition itinérante Africa Remix en 2005, ont ainsi contribué à faire connaître des artistes africains de premier plan comme Chéri Samba ou Ousmane Sow.
Mais c'est dès les années 1950 que les actuels classiques de la littérature africaine, tels que Léopold Sédar Senghor, Camara Laye, Ferdinand Oyono ou Ousmane Sembène, commencent à se faire connaître grâce à des éditeurs français.
Une décennie plus tard, apparaît une littérature marquée par la vague d'indépendance que connaît l'Afrique francophone entre 1956 et 1962 avec des auteurs comme Yambo Ouologuem qui reçoit le Prix Renaudot de 1968.
Les éditeurs français ont ainsi très largement contribué à faire connaître une Afrique qui s'est imposée comme la principale pourvoyeuse de fiction francophone avec des auteurs comme des Kourouma, Mabanckou, Waberi ou Mukasonga, aujourd'hui célèbres.
De même les scènes et les impresarios français, grâce au repérage du réseau des centres culturels français sur le continent noir, ont mis en avant des musiciens africains qui sont aujourd'hui des références internationales comme Toumani Diabaté, Salif Keita, Youssou N'Dour, Manu Dibango.
Enfin le cinéma africain, si mal traité dans un continent qui n'a ni industrie cinématographique, ni réseau d'exploitation, a trouvé en France un refuge notamment à travers les festivals et l'action de l'Institut français. C'est au festival de Cannes que le Malien Souleymane Cissé, le Burkinabé Idrissa Ouedraogo ou le Tchadien Mahamat Saleh Haroun obtiendront les prix qui leur permettront de poursuivre leur oeuvre dans des conditions matérielles certes précaires, mais renforcés par la visibilité que leur a conférée la Croisette.
Cet accueil, cette écoute, cet élan vers la création africaine dans tous les domaines sont assez uniques pour que la France soit encore considérée comme une vitrine de la culture africaine.
Comme l'a souligné M. Xavier Darcos, Président de l'Institut français : « Cette vision française de l'Afrique est certes, le produit de l'histoire et de parcours individuels à l'image de celui de Jacques Kerkache, père du musée du quai Branly, mais aussi le fruit d'une politique d'Etat ».
L'Afrique occupe une place privilégiée dans la politique de l'Institut français comme c'était le cas avec Cultures-France et l'Association française d'action artistique (AFAA).
A travers des programmes comme « Afrique en création » devenu « Afrique et Caraïbes en création » qui ont plus de 20 ans, la France a longtemps été un agent particulièrement entreprenant de la création africaine dans l'Hexagone et dans le monde.
3. La France hexagonale et ultramarine en voisin de l'Afrique
12 kilomètres seulement séparent l'Afrique de l'Europe et c'est une raison suffisante pour que les destins de nos deux continents soient liés. C'est sans doute une évidence pour les États membres ayant une façade méditerranéenne comme la France, plus que pour d'autres.
Car la France est voisine de l'Afrique à plus d'un titre.
D'abord par sa façade atlantique, par laquelle le commerce entre la France et l'Afrique transite depuis la découverte du continent pour le meilleur et pour le pire. C'est encore par cette voie que transitent une grande partie des approvisionnements de la France en hydrocarbures via le Golfe de Guinée, ainsi que les exportations françaises vers l'Afrique. C'est également par l'océan Atlantique que transite aussi une partie des trafics illicites de drogue et de personnes.
Ensuite par sa façade méditerranéenne, c'est à travers le Maghreb et la Méditerranée que l'essentiel des trafics illicites passe d'Afrique vers l'Europe.
La France considère ainsi l'Afrique en voisine et il est significatif que lors du déclenchement de l'opération SERVAL, les autorités françaises aient justifié cette intervention en affirmant qu'elle était née « du refus de la France de se voir constituer à ses frontières un État terroriste », comme s'il était naturel de penser que le Mali et la France partageaient une frontière commune !
La France est voisine de l'Afrique enfin, par ses possessions ultramarines dans l'océan Indien.
Lorsque nous nous sommes rendus en Afrique du Sud, nous avons reçu des membres du Defence Review Committee, équivalent du Livre blanc de la défense nationale, qui ont spontanément évoqué les possibilités de coopération en matière de surveillance maritime du fait de ses possessions françaises dans le sud de l'océan Indien.
L'île de La Réunion , celle de Mayotte, les îles de Crozet, les îles Kerguelen ou îles de la Désolation au sud de l'océan Indien qui forment l'un des cinq districts des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), Saint-Paul et Amsterdam, les îles Éparses : Europa, l'île Bassa-da-India, l'île Juan-da-Nova, la Grande Glorieuse ou île du Lys, Tromelin, située à 450 km à l'est de Madagascar et à 535 km au nord de La Réunion sont autant de territoires frontaliers de l'Afrique qui font de la France un pays voisin.
C'est à ce titre que la France est membre de la Commission de l'océan Indien (COI), organisation intergouvernementale créée en 1982 à Port-Louis de l'île Maurice et institutionnalisée en 1984 par l'Accord de Victoria (Seychelles) qui réunit cinq pays de la région océan Indien : Union des Comores, France/Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles.
A travers la Commission de l'océan Indien, la France est également un partenaire régional de l'Union Africaine.
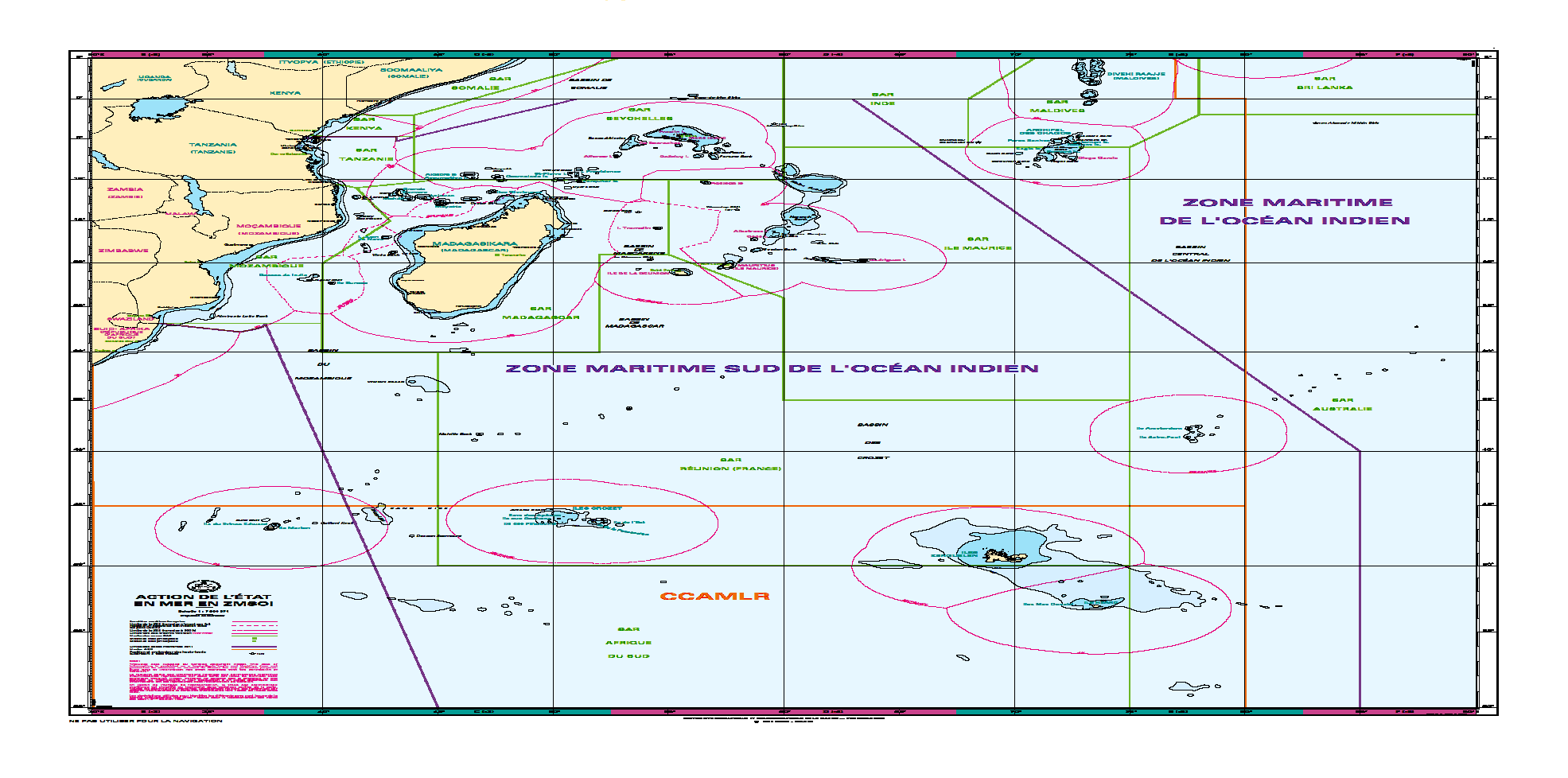
Comme l'a souligné un récent rapport de la commission des affaires étrangères du Sénat sur « La maritimisation : la France face à une nouvelle géopolitique des océans » 37 ( * ) : « Dans un contexte international marqué par le début d'une concurrence pour les richesses des sous-sols marins, certaines ZEE françaises autour de l'est africain ne font pas encore l'objet de délimitations physiques et juridiques incontestées »
La délimitation de l'île de La Réunion est faite avec Madagascar et Maurice. Tromelin a fait l'objet d'un accord de cogestion avec Maurice ; la ZEE existe, même si la délimitation n'est pas établie. Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) vient seulement de produire des cartes qui doivent être déposées aux Nations unies.
À Mayotte, le changement de statut a conduit à revoir la délimitation de la zone, en tenant compte du parc naturel marin à proximité des îles comoriennes.
Pour les îles Éparses, des accords sont en cours de négociation avec Madagascar et le Mozambique. Pour les Glorieuses, il reste à conclure un accord avec Madagascar et les Comores, ce qui supposerait de surmonter sur ce point des divergences politiques importantes.
C'est pourquoi les forces navales françaises disposent, par ailleurs, en permanence sur ces territoires, des moyens de surveillance et de contrôle des approches qui peuvent être renforcés par le déploiement de moyens complémentaires ou mieux armés, comme des frégates, des chasseurs de mines et des avions de patrouille maritime Atlantique.
Ces missions de surveillance permettent notamment de défendre les zones de pêche des habitants de Mayotte et de la Réunion, mais aussi de protéger les ressources sous-marines. Il est ainsi fréquent que les frégates de surveillance, basées à La Réunion, en mission de souveraineté et de police des pêches, appréhendent des bâtiments de recherche pétrolière en train de mener des activités illégales de recherches scientifiques dans notre ZEE dans le canal du Mozambique.
La situation géographique de ces territoires constitue un atout considérable pour participer à la sécurisation des voies de communication qui entourent le continent africain.
Que ce soit aux abords du canal du Mozambique, dans les Caraïbes, à la sortie du canal de Panama ou aux avant-postes de la traversée de l'Atlantique, cette capacité de sécurisation des voies maritimes africaines fait de la France un partenaire incontournable des États africains riverains de l'océan Atlantique comme de l'océan Indien.
II. UNE PRÉSENCE EN RECUL, UNE IMAGE QUI DEMEURE AMBIGUË
Fort de ce tableau d'une présence française importante en Afrique, voire sans équivalent, nous avons parcouru ce continent.
A chaque étape, nous avons été frappés par l'idée d'une présence en recul que nous ont renvoyée nos interlocuteurs.
Vous ne pouvez pas croiser un ministre sans qu'il vous dise « C'est dommage que la France ne soit pas plus présente ».
Quand on vous dit cela au Kenya, à la suite de la visite du président kényan Uhuru Kenyatta en Chine après que les deux pays ont signé des contrats d'une valeur de 5 milliards de dollars pour la construction d'une ligne ferroviaire et de plusieurs projets énergétiques, le propos interroge.
Mais qu'on vous répète cela à tout bout de champ dans l'Afrique francophone après l'intervention SERVAL nous a fait réfléchir.
A Paris, même son de cloche. Les entrepreneurs présents en Afrique dénoncent sans relâche la timidité des autres entreprises françaises sur les marchés africains.
M. Jean-Michel Severino nous a dit : « C'est comme si la France avait décidé de tourner le dos à l'Afrique, aussi bien la sphère publique que privée s'est détournée du continent africain ».
Si vous arpentez les couloirs des ministères concernés par l'Afrique, vous entendrez les mêmes arguments revenir comme une rengaine : 1) on n'a plus d'argent pour investir dans la coopération bilatérale avec les pays africains, il nous faut réviser à la baisse nos ambitions. 2) En matière de marchés extérieurs, il faut concentrer nos efforts vers l'Asie et les pays émergents.
En matière de coopération, les ONG et les coopérants ne cessent depuis des années de critiquer une stabilisation en trompe-l'oeil de nos budgets. « Le budget de la coopération a été réduit comme peau de chagrin, il permet d'intervenir dans les pays pauvres prioritaires à hauteur de 10 millions d'euros par an, le reste part dans les contributions multilatérales », nous a-t-on dit. « Notre aide bilatérale n'est plus crédible » entend-t-on. « On a supprimé le ministère de la coopération en 1998, aujourd'hui on nous supprime le ministre de la coopération pour un titre de ministre du développement, on nous dit sanctuariser le budget mais en réalité, il ne cesse de diminuer », nous a-t-on répété.
En résumé, à entendre les Cassandre de tous bords, les entreprises françaises sont en train d'être évincées d'Afrique, la francophonie est en régression, notre présence militaire aujourd'hui auréolée de son succès au Mali ne durera qu'un temps, notre coopération s'efface devant l'Europe et la Chine : bref la place de la France dans cette Afrique convoitée est en déclin.
Cette France qui entre dans la mondialisation le coeur serré par la nostalgie de sa grandeur serait en train de perdre son dernier bastion.
A faire le constat, comme nous venons de le faire, de l'étendue et de la densité de notre présence sur le continent, on a du mal à croire à ces discours.
Et si les « déclinologues » avaient pour une fois raison ? Et si malgré la francophonie, malgré cette présence militaire sans équivalent, les risques d'un déclassement progressif de la France en Afrique n'étaient finalement pas si négligeables ?
« Les Africains diversifient leurs partenariats, il est normal que nos positions relatives s'érodent car nous étions parfois en situation de monopole ».
Est-on si sûr que ce déclin soit seulement relatif ?
Pour le savoir, nous avons tenté de dégager les dynamiques en cours.
A. DES RISQUES DE DÉCLASSEMENT RÉELS
1. Un partenariat commercial en perte de vitesse
Sur le plan commercial, on constate, depuis dix ans, la dégradation de la part de marché des entreprises françaises sur le continent, comme l'illustre ce graphique établi sur la base des chiffres communiqués à notre demande par le service des douanes.
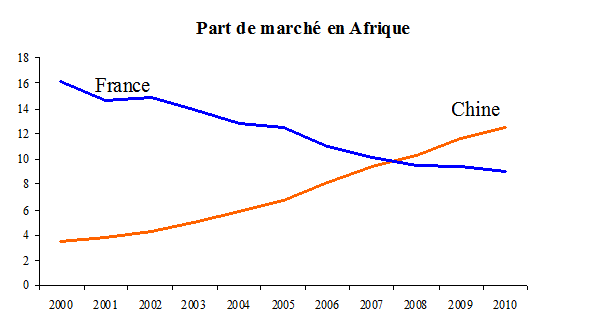
Sources : douanes
Cette diminution est concomitante avec la croissance des parts de marché des entreprises chinoises qui suit une trajectoire inverse. Même s'il n'y a pas de lien de causalité avéré, le parallèle est frappant.
La part de marché des entreprises françaises en Afrique subsaharienne est passée de plus de 16% en 2000 à moins de 10% en 2010, des chiffres qui se recoupent assez bien avec la réalité que l'on est amené à constater, pays par pays.
L'érosion de la part de marché de la France est observable partout en zone franc, son ampleur a été systématiquement supérieure à celle de l'ensemble des pays de l'OCDE. Aucun pays africain ne fait exception, même si les mouvements de long terme ne sont pas à l'identique.
En se concentrant sur les trois plus grands pays de la zone franc - plus de 40% du produit intérieur brut de cet espace économique - il apparaît qu'entre 1985-95 et 2005-09, le poids de la France est passé de 43,5% à 23,2% au Cameroun, de 40,4% à 18,3% en Côte d'Ivoire, et de 42,2% à 20,7% au Sénégal.
Dans ces pays francophones, les parts de marché de la France ont été divisées par deux.
Le Bénin est emblématique de ces violents mouvements de redistribution avec des importations françaises qui ne représentent plus que 7,6% contre 26,3% sur les deux périodes précitées (1985-95 ; 2005-09).
Le jeu de vases communicants a été évident ; la place de la Chine, initialement de 5,1%, est passée à plus de 40,4%, ce qui en fait le principal fournisseur de biens de ce pays devant l'ensemble des pays de l'OCDE (31%).
Le Togo est dans un cas de figure très comparable. La Chine lui fournit désormais 33,3% des importations, presque autant que l'OCDE (36%), quand la part de la France a glissé de 26,4% de moyenne (1985-95) à 7,9% dans les dernières années, une part de marché qui se rapproche de celle de l'Inde (5%).
Si on prend l'ensemble des pays émergents, on observe également une augmentation considérable de leur présence commerciale dans les pays de la zone franc, du moins dans les pays comportant des industries extractives signi?catives.
Ainsi, la part des exportations dans le PIB de la CEMAC à destination des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a été multipliée par deux entre 2000 et 2010. Le stock d'investissements directs chinois a quintuplé depuis 2003.
Le CAC 40 a fui l'Afrique
Le recul des entreprises françaises, historiquement très présentes en Afrique, illustre cet essoufflement de relations commerciales autrefois dynamiques : les investissements directs vers l'Afrique subsaharienne, qui représentent depuis dix ans entre 1 et 6% des flux d'investissements directs à l'étranger de la France, stagnent ou reculent d'une année sur l'autre, alors même que ceux des autres acteurs de l'économie mondiale sur ce continent ont été multipliés par 7 entre 2000 et 2008.
Alors que les investisseurs chinois et indiens se ruent pour investir en Afrique, certaines entreprises françaises vendent leurs participations dans des groupes de télécommunication africains ou dans des banques de détail.
La vente la plus symbolique a sans doute été la vente par le groupe PPR (Pinault-Printemps-Redoute) de CFAO, géant de la distribution automobile et pharmaceutique en Afrique, qui a réalisé 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2011.
À un moment où le marché de la consommation africain décolle, tiré par l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, le groupe français cède ses parts au Japonais Toyota Tsuho Corporation.
Pour Dominique Lafont, directeur de Bolloré Africa Logistic, « le CAC 40 a fui l'Afrique ».
Dans le domaine du BTP, les entreprises françaises sont en train d'être évincées des marchés d'Afrique francophone et restent peu présentes dans l'Afrique anglophone.
Quand on regarde les appels d'offre internationaux, notamment de la Banque mondiale mais également de l'Agence française de développement, les entreprises françaises ont perdu des parts de marché significatives.
Une comparaison des parts de marchés des constructeurs français et chinois en Afrique subsaharienne sur financement AFD et BM (2006-2009) montre que les entreprises françaises n'ont obtenu pendant cette période que 1,6% des marchés de la Banque mondiale contre près de 30% pour les entreprises chinoises.
Plus récemment, un appel d'offre pour l'aéroport de Nairobi, financé par des fonds de l'AFD et dont les études avaient été réalisées par Aéroport de Paris, a été attribué à des entreprises chinoises dont les offres, qui ont fait l'objet d'un examen attentif, étaient non seulement 30% moins chères mais en tous points conformes aux normes environnementales et sociales exigées.
Parts de marché respectives des entreprises françaises et chinoises dans le BTP
|
|
Nombreuses sont les entreprises qui attribuent ces contre-performances à la concurrence déloyale d'entreprises chinoises qui pratiqueraient du dumping grâce au soutien des autorités chinoises.
Bouygues Bâtiment nous a dit : « Quand on se positionne sur les appels d'offres avec financement extérieur de bailleurs multilatéraux, la présence d'entreprises chinoises fausse la concurrence. Ces dernières sont considérées comme des entreprises locales car elles ouvrent des établissements stables dans les pays pour pouvoir être acceptées. Ces entreprises font du dumping sur les marchés avec financement extérieur et des marges sur les projets financés par l'aide chinoise. Quand les Chinois financent directement les projets, il n'y a pas de compétition car leurs aides sont liées. Nous sommes donc dans un jeu ou les règles sont biaisées. ».
La concurrence dans ce secteur vient également des entreprises du Maroc et de Tunisie pour l'Afrique francophone et d'Afrique du Sud pour l'Afrique anglophone.
Les grandes entreprises égyptiennes telles Orascom ou Arab Contractor sont également des compétiteurs en Afrique.
Mais force est de constater que, sur de nombreux projets, les offres françaises étaient nettement moins compétitives et pas toujours seulement en termes de prix.
L'analyse des offres sur des projets tel le barrage de Lom Pangar au Cameroun cofinancés avec la Banque mondiale et la BEI montre que les différences de prix entre l'offre française et celle de ses concurrents chinois étaient de 60%, de près de 30% avec celle du concurrent brésilien, pour le coup totalement privé.
Dans le domaine de la banque, alors même que ce secteur connaît sur le continent une progression importante qui atteint dans certains pays 30%, les acteurs historiques que sont BNP Paribas, Société générale et Crédit Agricole, se désengagent peu à peu.
Les établissements français qui ont longtemps dominé le financement du commerce des matières premières et des produits de base entre l'Afrique et l'Europe réduisent la voilure en Afrique.
Dans les états-majors des groupes, on préfère parler de réorganisation stratégique. Celle-ci consiste notamment à se renforcer sur les principaux marchés - Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun - et à concentrer les efforts sur les activités les plus rentables.
Ainsi, Société générale a gelé ses acquisitions en Afrique francophone, mais a annoncé en juin 2010 un plan stratégique visant à ouvrir 90 agences d'ici à 2015, principalement au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où elle se lance aussi dans le mobile banking.
BNP Paribas s'est retirée de la Mauritanie et de Madagascar. Crédit Agricole s'est quant à lui recentré depuis deux ans sur la banque de détail en Europe et dans le Bassin méditerranéen.
Il a ainsi cédé à Attijariwafa Bank, en 2010, six de ses filiales subsahariennes (Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Sénégal, Afrique du Sud).
La participation des grandes banques françaises dans le système bancaire ouest-africain est passée de 80% à 33% au cours de la décennie. Alors que les indicateurs économiques ouest-africains virent au vert, elles poursuivent aujourd'hui leur stratégie de repli au profit des banques nigérianes, marocaines ou chinoises.
Ainsi l'Industrial and Commercial Bank of China, la plus grande banque du monde, a profité de la baisse des prix pour accroître ses investissements sur le continent : elle a acquis une participation de 20 % dans le capital de la Standard Bank of South Africa, l'une des plus grandes banques du continent, pour quelque 4,85 milliards de dollars.
Dans certains secteurs, les mines par exemple, la France est de plus en plus absente à l'exception d'Eramet. Dans d'autres, comme le pétrole, où Total avait une expertise particulière sur l'Afrique, nos positions reculent alors même que le secteur connaît une expansion sans précédent dans de nombreux pays, en Afrique anglophone ou lusophone, en Angola, au Mozambique, au Ghana, en Ouganda, en Tanzanie mais aussi dans l'Afrique francophone, au Niger ou en Mauritanie.
Comment expliquer cette passivité par rapport au dynamisme des pays émergents ?
Pour Mathieu Pigasse de la banque Lazard, le premier problème est la perception qu'ont les entreprises françaises de l'Afrique : « Elles n'ont pas compris ce qui est en train de se passer, le modèle européen est en panne, le modèle exportateur chinois est en train de faire du surplace, le continent africain décolle ; c'est un changement de monde, très bien perçu par les Chinois et que nous sommes peut-être en train de rater ».
Les entreprises françaises surévalueraient les risques et minimiseraient les opportunités.
L'Afrique fait encore peur aux investisseurs français
Pour Luc Rigouzzo, président d'Amethis Finance (société de conseil en financement et investissements pour l'Afrique) : « L'expérience et les données financières disponibles démontrent un couple rendement/risque bien meilleur que celui mesuré par les marchés financiers, les risques sont réels, mais sont inférieurs aux risques mesurés: le système de notation international qui intègre des plafonds par pays atteint ses limites en Afrique, où le risque du secteur privé est meilleur que le risque souverain. ».
Il est vrai que nombre d'entreprises asiatiques, chinoises, coréennes ou indiennes ont parié très tôt en effet sur la dynamique de la population africaine et la montée d'une classe moyenne africaine.
« Les entreprises des pays émergents ont été plus promptes que les entreprises occidentales à apprécier le redressement des économies africaines» nous a dit Lionel Zinsou racontant comment un opérateur de télécommunication français avait préféré, dans les années 2000, investir en Norvège plutôt que de racheter un opérateur sud-africain. Dix ans après, se réveillant trop tard, la même entreprise découvre que son homologue africain, qui était à l'époque à sa portée, est désormais estimé à 1,3 fois sa valorisation boursière, autrement dit un montant inaccessible.
Les marchés africains n'attendront pas. Les places sont de plus en plus chères
Certains sont déjà arrivés à maturité. Pour Luc Rigouzzo, « il y a de nombreuses opportunités mais les places sont de plus en plus chères au fil du temps».
En comparaison avec les investisseurs occidentaux, souvent confrontés à des baisses de taux de marge et sous le contrôle d'un actionnariat exigeant, avec des obligations de rendement immédiat et de distribution de dividendes, les grandes entreprises des puissances émergentes sont généralement moins tributaires des contraintes de court terme. Leur dimension et les objectifs de leurs actionnaires, le niveau des bénéfices qu'elles dégagent en interne et les financements publics d'appui sont autant de facteurs qui concourent naturellement à cette stratégie de long terme en Afrique.
L'Inde et la Chine manifestent ainsi une moindre préférence pour le présent. Comme nous l'a indiqué M. Dominique PERREAU, ancien ambassadeur, ancien directeur de l'AFD : « La logique qui sous-tend la démarche de ces grands émergents consiste à prendre date, à créer les conditions tendancielles d'une sécurisation de leurs importations et d'une élévation de leurs parts de marché à l'exportation.».
Répondant à un observateur qui l'interrogeait sur le rôle du risque politique dans les investissements en Afrique, le Premier ministre indien, Manmohan Singh, a traduit l'état d'esprit national, celui du gouvernement comme celui des entrepreneurs : « L'investissement est un « acte de foi » et les difficultés temporaires de l'Afrique n'empêcheront pas le peuple indien de se tenir aux côtés du « continent frère ».
A contrario, la situation financière des entreprises françaises limite leurs capacités d'investissement. « Le marché africain exige de plus en plus des stratégies panafricaines et donc des investissements importants dont les entreprises françaises n'ont pas en ce moment les moyens financiers » nous a dit Jean- Michel Severino.
« On a perdu CFAO, c'est un drame, on pourrait perdre demain Castel et, au rythme où cela va, peut-être qu'un jour verrons-nous Bolloré Africa Logistics, avec ses activités portuaires aux quatre coins de l'Afrique, vendre ses activités à Dubaï port » nous a dit un entrepreneur français, président d'une chambre de commerce franco-africaine.
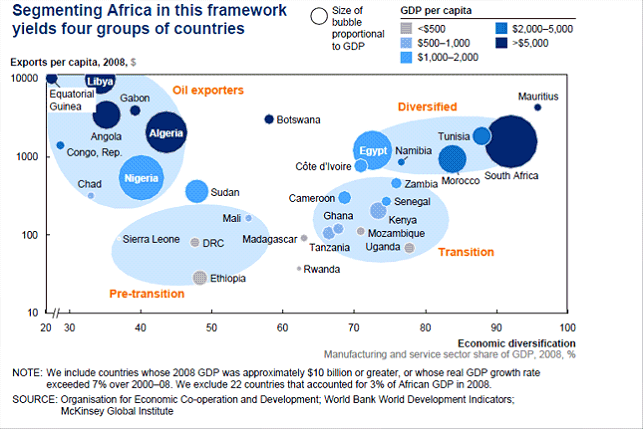
Le décollage économique de l'Afrique et la diversification des économies semblent concerner avant tout l'Afrique anglophone plutôt que l'Afrique francophone comme l'illustre le schéma précédent.
L'Afrique des classes moyennes, celle du décollage économique, que cela soit l'Afrique du Sud, le Ghana, le Bostwana, le Mozambique, le Kenya ou l'Ouganda, toutes se situent dans un monde anglophone où la France n'est pas attendue, voire mal accueillie.
Cela n'empêche cependant pas les entreprises françaises d'y investir. Le stock d'investissements français au Nigeria, en Angola et au Congo ne doit pas faire illusion. Il s'agit avant tout d'investissements pétroliers.
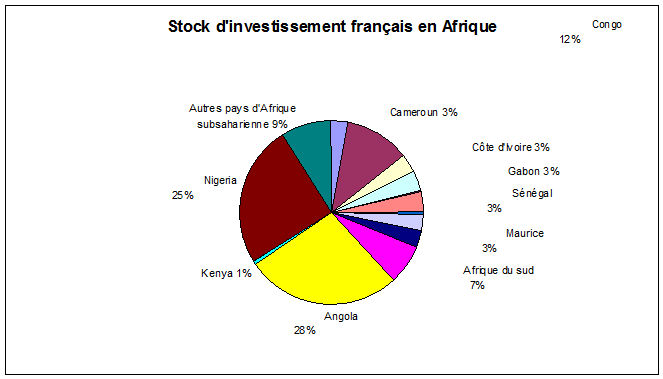
Tout n'est pas noir, certaines entreprises françaises ont pris conscience des opportunités.
D'après Nicolas de Roquefeuil, directeur commercial géographique pour le Maghreb, l'Afrique francophone et lusophone de Bouygues et directeur général SETAO, « Bouygues est en train de reconquérir des positions qu'elle avait laissées de côté au Nigeria, en Côte d'Ivoire et en Guinée Equatoriale et vise désormais de nouveaux marchés dans des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Mozambique et l'Angola.».
Mais pour M. Alexandre Vilgrain, président du Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) et directeur général de SOMDIAA depuis 1995, « la France a perdu beaucoup de temps à un moment crucial du développement de l'Afrique, on doit aujourd'hui soutenir les entrepreneurs qui s'investissent sur ce continent. Le premier pas est de changer le regard sur l'Afrique, mais aussi sur les entrepreneurs qui font des affaires en Afrique. Quand une entreprise gagne un important marché en Asie on le félicite pour son dynamisme, quand c'est en Afrique, on soupçonne de la magouille. La France ne peut pas être le seul pays qui pense que faire des affaires en Afrique c'est forcément sale, ce n'est pas vrai et les Africains ne supporteront pas longtemps ce discours, ils nous attendront pas, tant les pays émergents se bousculent à leurs portes».
2. Une communauté d'expatriés français en diminution
La chute du nombre d'expatriés français confirme ce recul économique : près de 130 000 Français vivent en Afrique francophone, contre près de 160 000 en 1984. La part relative des Français en Afrique par rapport à l'ensemble des expatriés a été divisée par deux, passant de 18% à moins de 9%.
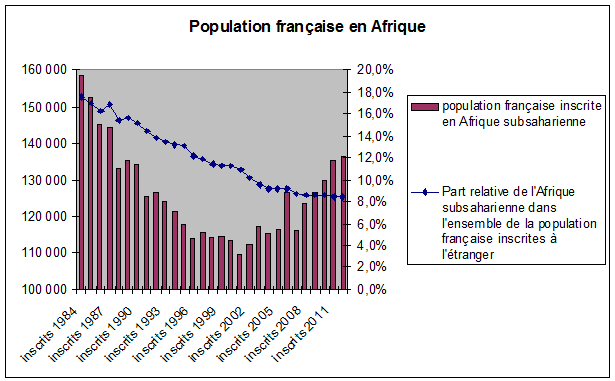
3. Une politique d'influence contrariée par une politique migratoire dissuasive
En Afrique du Sud, nous avons rencontré Paul-Simon Handy qui dirige la division chargée de la prévention et de l'analyse des risques de conflit à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria, un Think Tank panafricain connu pour ses analyses sur les questions de sécurité dans l'ensemble du continent. Il nous a raconté son parcours. Né au Cameroun, étudiant à Yaoundé en sciences politiques, il avait voulu poursuivre ses études en France. Après deux refus de visa, il s'est décidé pour Berlin puis Leipzig où il a obtenu son doctorat. Il est aujourd'hui une référence dans son domaine.
Combien y a-t-il de cas comparables ? Difficile à dire. Pratiquement tous les interlocuteurs africains que nous avons rencontrés nous ont raconté des histoires similaires de cadres africains aujourd'hui reconnus par leurs pairs qui, faute de visa français, ont poursuivi leurs études ailleurs.
Combien d'occasions avons-nous ratées de transmettre notre vision du monde, de susciter un goût, un appétit pour la France, pour ses idées ou pour ses produits ?
Le phénomène a de quoi inquiéter. Certes en 2010 la France était encore le premier pays d'accueil des étudiants africains en mobilité, concentrant à elle seule près de 30% de cette population tout niveau confondu.
Mais la tendance est au repli. La proportion des étudiants africains qui font leurs études en France parmi l'ensemble des étudiants qui effectuent leurs études à l'étranger a diminué de 7% en l'espace de 4 ans, chutant de 36 à 29%.
Dans les enquêtes réalisées par CampusFrance, les étudiants interrogés expliquent avant tout le choix de la France par les qualités académiques qu'offre le pays : la qualité de la formation, la valeur des diplômes, la réputation de l'établissement choisi.
Mais la langue française est un critère essentiel dans leur choix puisque plus de la moitié des étudiants africains qui poursuivent des études en France sont de langue maternelle française et plus de 80% sont originaires de l'Afrique francophone.
La France a ainsi avec l'Afrique francophone une opportunité de former des générations d'élites francophiles qu'elle est en train de gâcher en les invitant à aller ailleurs.
.
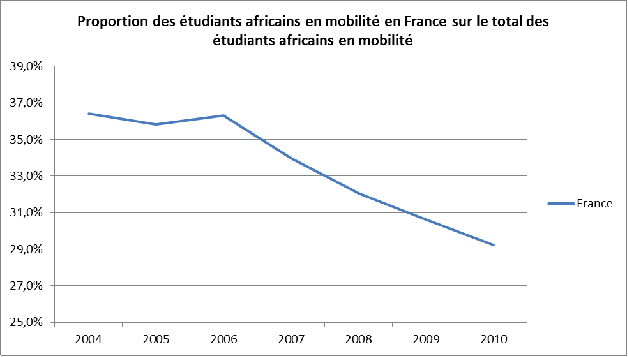
Sources : Campus France Unesco
Dans le même temps, l'Afrique du Sud enregistre une hausse de 28,8%, le Royaume-Uni de 19,3% et, plus surprenant encore, la Malaisie de 400% du nombre d'étudiants africains. On observe ces dernières années des taux de croissance très élevés du nombre des étudiants allant en Italie (+ 54 % entre 2005 et 2008), au Canada (+ 42 %) et au Maroc (+ 50 %).
Les causes de cette désaffection sont nombreuses : le coût des études en France, l'attrait de la langue anglaise, la faible compétitivité des universités françaises, mais la première est une politique des visas dissuasive.
Alors même que notre pays se targue d'être le partenaire privilégié du sous-continent africain, la politique des visas mise en place à partir de 2002 a d'abord découragé plus d'un étudiant africain de suivre son cursus universitaire en France.
Tous les interlocuteurs africains vous le diront : il faut s'armer de courage et de patience pour faire une demande de visa auprès d'une ambassade française sur le continent.
Malgré la bonne volonté du personnel des consulats, souvent en sous-effectifs, les demandes de visa sont vécues comme un parcours du combattant.
Nos entretiens ont été pleins de ces récits de personnes de talent qui se sont senties humiliées lors de ces démarches, tant par l'accueil qui leur a été réservé que par le mode de sélection.
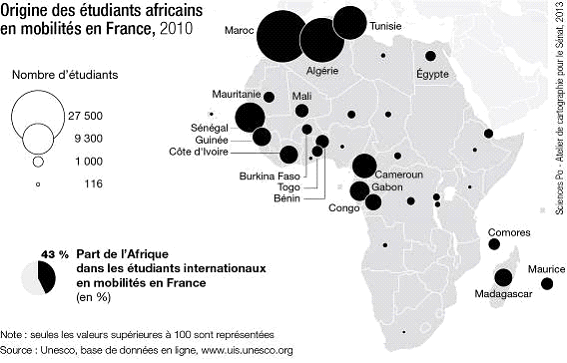
La lenteur des démarches administratives, notamment à l'approche de la rentrée scolaire, complique l'installation des étudiants. « Quand on demande un visa pour la rentrée scolaire, il arrive qu'on vous accorde un premier rendez-vous après le premier jour de la rentrée, autrement dit vous êtes assuré de la rater. » nous a dit une étudiante ivoirienne .
Le visa accordé avec retard oblige les étudiants africains à rattraper les cours qu'ils n'ont pu suivre tandis que les bourses ne sont presque jamais délivrées en temps voulu. Il devient donc difficile de trouver un logement, de pouvoir subvenir à ses besoins et de réussir son année universitaire. Le nombre de bourses lui-même a tendance à diminuer sous le coup des restrictions budgétaires.
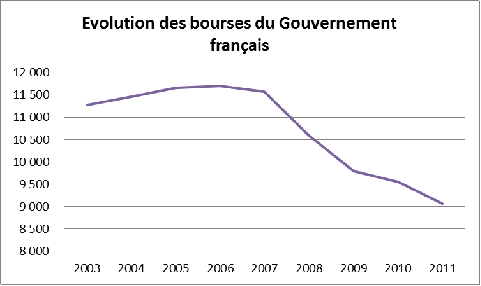
Source : Campus France
Dans certains cas, l'avis négatif de Campus France, qui se prononce sur la pertinence du projet d'études à la vue du cursus envisagé et des études déjà effectuées, est communiqué après coup. « Pendant ce temps, les candidats ont dû présenter au consulat un billet d'avion et réunir les sommes exigées pour obtenir le visa. Non seulement, leur projet tombe à l'eau, mais ils ont perdu de l'argent » nous a-t-on raconté.
Ces cas ne sont pas isolés, loin s'en faut. L'articulation actuelle d'une double procédure, celle de Campus France et celle du Consulat, a sa logique, mais elle ne prend pas assez en compte les contraintes des demandeurs.
La réalité d'une telle complexité administrative contraste avec l'image véhiculée par une longue tradition de formation des élites africaines au sein des prestigieuses universités françaises.
Elles nourrissent un ressentiment réel parmi la jeunesse africaine.
Cette situation résulte à la fois de notre politique prohibitive d'immigration mise en place à partir de 2002, de son interprétation dans un sens restrictif par les administrations sous l'impulsion du pouvoir politique d'alors, et du sous-effectif des consulats qui doivent par ailleurs faire face à une multiplication de la fraude documentaire. Plus la législation est restrictive, plus l'imagination des fraudeurs se développe, plus la méfiance des services consulaires s'accroît, plus les exigences et les délais pour obtenir un visa augmentent.
Ce cercle vicieux a nui à l'image de la France dans des proportions que nous avons trop longtemps ignorées.
Une fois en France, beaucoup d'étudiants africains disent avoir l'impression d'être considérés différemment des autres étudiants étrangers notamment issus du programme ERASMUS : ils ressentent de la méfiance à leur égard et se sentent souvent perçus, non pas comme des dirigeants et des entrepreneurs en devenir, mais plutôt comme des migrants potentiels.
Ce climat alors peu accueillant les a conduits à aller se former ailleurs.
Autrefois, si les chefs d'État d'Afrique francophones n'avaient pas fait leurs études en France, ce qui était rare, on pouvait être sûr que c'était le cas de leurs principaux conseillers.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il reste un grand nombre de cadres qui ont été formés dans les universités françaises, dans les Instituts des sciences politiques, voire à l'ENA. Mais la France a perdu le monopole de la formation des élites africaines.
Les élites africaines ne se contentent plus du Quartier Latin, elles parcourent le monde, choisissent entre Paris, Londres, San Francisco, Le Cap ou ailleurs, l'ENA, la London School of Economics, Harvard, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Berkeley, Oxford Cambridge ou ailleurs, selon les opportunités. L'Afrique s'ouvre à de nouveaux partenaires, s'engage dans la mondialisation et il naturel et même souhaitable qu'elle diversifie le parcours scolaire de ses futures élites.
Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à préférer les États-Unis à la France, à l'instar de Thierry Tanoh, actuel vice-président de la Société Financière Internationale, l'une des filières de la Banque mondiale. Cet Ivoirien a effectué ses études à l'École supérieure de commerce d'Abidjan puis a complété sa formation en suivant un cursus en deux ans au sein de l'université d'Harvard, grâce au programme Fulbright. Il est aujourd'hui l'une des personnalités africaines influentes.
La réduction des visas de moyen séjour et la chute des bourses universitaires ont conduit à une contradiction majeure : comment peut-on espérer restaurer notre image et mener une politique d'influence sur le continent tout en fermant nos frontières derrière les grilles de la forteresse européenne.
L'enjeu est beaucoup plus large et doit être pensé en des termes politico-diplomatiques et non plus seulement sécuritaires ou migratoires. C'est dans cette voie que s'oriente le nouveau gouvernement. Car ce qui arrivait aux étudiants, arrivait aux chercheurs, aux artistes et aux entrepreneurs.
Les anecdotes sont nombreuses : des colloques franco-africains qui ne peuvent se monter ; des collaborateurs africains d'entreprises françaises qui ne peuvent pas honorer des rendez-vous à Paris ; des artistes qui décommandent des spectacles faute de visa dans les temps.
Le cas des étudiants du supérieur est d'autant plus frappant qu'il engage des générations entières qui feront ou pas l'avenir des relations franco-africaines.
Comme l'a souligné M. Xavier Darcos, Président de l'Institut français : « Nous avons réduit nos programmes de bourses, notre politique de délivrance de visa reste frileuse du fait du risque migratoire, quand les Américains ou les Chinois multiplient les appels à destination des étudiants, ciblant, pour les premiers, les meilleurs à qui ils offrent des possibilités de carrière. Nous sommes en contradiction flagrante avec notre action de soutien à l'émergence artistique qui nécessite de faciliter la mobilité des talents. »
Et la concurrence universitaire de la France ne se résume pas aux facultés américaines ou chinoises : on constate un essor de la mobilité étudiante intra régionale en Afrique.
Il ne suffira pas demain de rétablir une politique de visa circulatoire plus ouverte pour attirer les futures élites africaines, car la concurrence pour « capter » les étudiants africains est de plus en plus rude. La formation universitaire est devenue un marché concurrentiel et les étudiants africains, un marché d'avenir compte tenu de leur croissance démographique et de l'élévation continue de leur niveau.
Ainsi l'Afrique du Sud déploie une stratégie ambitieuse de captation des étudiants africains. Elle se classe déjà au deuxième rang des pays d'accueil en 2010, juste après la France, attirant à elle seule 15% des étudiants africains en mobilité.
Le niveau de vie y est moins élevé qu'en Europe mais le pays présente une stabilité politique, une dynamique économique et un niveau de développement qui offrent des perspectives d'emplois à ces étudiants. Si ce pays accueille principalement des étudiants venus d'Afrique australe, il attire également de plus en plus d'étudiants originaires d'Afrique de l'Ouest.
La majorité des étudiants africains francophones en mobilité sur le continent se dirige toutefois aujourd'hui vers le Maroc, qui se classe au 10ème rang mondial des pays d'accueil des étudiants africains en mobilité pour l'année 2010, selon une étude Campus France. La proximité géographique et culturelle du royaume chérifien conjuguée à la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, souvent dans des écoles privées, sont autant d'atouts aux yeux des étudiants venus du Sénégal ou de la Côte d'ivoire pour ne citer qu'eux.
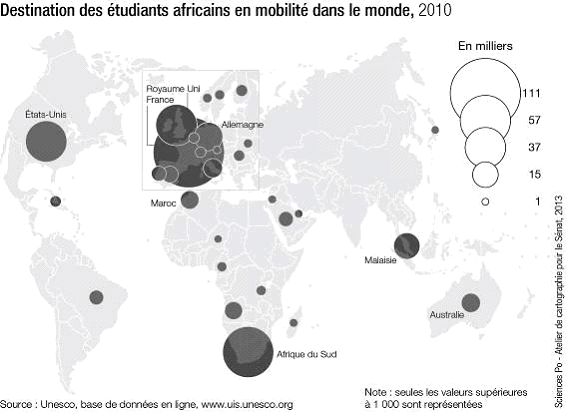
La demande des étudiants africains en enseignements universitaires de qualité à des coûts raisonnables a conduit certains États extracontinentaux à mettre en place des stratégies d'influence dans ce domaine.
C'est le cas du Royaume-Uni qui a développé un programme de promotion de la science et de l'innovation en Afrique, l'Africa Knowledge Transfer Partnerships. Il s'agit d'un partenariat de transfert de connaissances vers le continent, orchestré par le réseau des British Councils présents en Afrique.
La Chine a quant à elle établi une stratégie de diplomatie d'influence offensive, à travers le développement des désormais célèbres instituts Confucius dont certains établissements sont accueillis au sein des universités africaines.
En 2000, le gouvernement chinois a décidé de doubler les bourses accordées aux étudiants africains dans les domaines de l'agriculture, de la médecine, des langues, de l'éducation, de l'économie ou encore de la gestion.
Pari tenu : le plan d'action de Pékin (2013-2015) dévoilé lors du forum de coopération sino-africaine en juillet 2012 prévoit 18 000 bourses pour les étudiants du continent contre quelque 5 500 attribuées entre 2010 et 2012.
La Chine n'offre pas seulement des formations et des bourses, avec la croissance de son économie, elle offre également des débouchés d'emploi.
Face à cette concurrence renforcée, la France souffre de faiblesses structurelles comme l'indiquent les enquêtes réalisées par Campus France.
Les étudiants interrogés rencontrent des difficultés pour se loger et s'insérer et sont déçus par le manque de débouchés professionnels à l'issue de leur formation en France. Ainsi seuls 64% des étudiants originaires d'Afrique interrogés estiment que leur séjour en France a favorisé leur insertion professionnelle.
La situation actuelle est d'autant plus préoccupante qu'on ne perçoit sur le terrain que le début d'un processus dont les effets se feront sentir dans dix à quinze ans quand les nouvelles générations, qui se seront éloignées de la France, occuperont des postes de responsabilité.
Sans verser dans le catastrophisme, il y a une génération de leaders africains qui auront dans leur jeunesse été confrontés à une politique migratoire française dissuasive et parfois humiliante.
Comme nous l'a dit un ambassadeur africain, « Il est temps de resserrer les liens et de restaurer la confiance, si vous voulez qu'on vous confie encore la formation de nos enfants. Chez les francophones les plus modérés, une impression d'être délaissés, voire de ne pas être payés en retour par une France en repli domine, avec pour corollaire le risque réel que les jeunes générations se détournent de la France pour rejoindre de nouveaux partenaires».
Restaurer la confiance passe par une mise en cohérence de notre politique migratoire, en relation avec la redéfinition de notre politique d'influence sur le continent. Pour restaurer notre influence, il est capital de retisser des liens humains dans les deux sens et de faciliter la circulation des hommes et pas seulement des marchandises.
On peine à comprendre comment sur place au sein d'une même ambassade et à Paris au sein d'un même Gouvernement, on peut d'un côté monter des programmes pour attirer les talents africains et de l'autre tout faire pour ne pas leur accorder des visas.
Il nous faut parvenir à attirer les futures élites nationales par une politique de bourses universitaires beaucoup plus dynamique. Au-delà de la période de formation initiale, il convient de structurer des dispositifs d'échanges qui permettent à des universitaires et des professionnels établis dans leurs pays d'exercer leur métier une partie de l'année en France sous la forme de « doubles-chaires ».
4. Une francophonie en difficulté malgré la dynamique démographique
Cette perte de vitesse dans le domaine de la formation et de l'éducation se reflète dans le déclin de la francophonie sur le continent.
Si les prévisions à l'horizon 2050 assurent que 80% des francophones vivront en Afrique, c'est plutôt en raison de la dynamique démographique du continent que d'une véritable politique francophone et francophile.
Au contraire, les États africains semblent de plus en plus résolus à se détacher de cet héritage linguistique, en atteste la position du Gabon qui, quelques jours avant le sommet de la Francophonie en 2013, a annoncé l'introduction de l'anglais obligatoire à l'école primaire.
Le Rwanda a montré comment un pays au régime autoritaire pouvait en peu de temps tourner le dos au français.
Dans les pays francophones où les systèmes éducatifs sont dégradés, le dividende démographique de la francophonie ne sera pas automatique. Au contraire, tandis que le nombre de locuteurs potentiels de français augmente de manière mécanique grâce au dynamisme démographique avec un effectif scolarisé en augmentation de 31 % en dix ans, la qualité de l'enseignement du français régresse et la maîtrise de la langue diminue.
Dans les pays non-francophones, la langue française progresse : elle réussit à se positionner comme une langue internationale capable d'offrir un avenir professionnel à ses locuteurs ; les autorités éducatives ont souvent décidé d'accorder une place plus importante au français dans l'enseignement des langues étrangères, nous l'avons constaté aussi bien en Afrique du Sud qu'en Éthiopie. Mais les objectifs fixés en matière d'apprentissage du français s'avèrent le plus souvent irréalisables tant le déficit de professeurs de français est important.
Ce déficit d'enseignants en français est d'autant plus alarmant qu'il se double d'un vieillissement accru du corps enseignant, de recrutements de personnels peu ou pas qualifiés, ainsi que du manque d'attractivité du métier d'enseignant de français, en particulier en dehors des grandes zones urbaines.
En Éthiopie, alors que le Gouvernement a souhaité réintroduire le français dans le secondaire, nous avons découvert que depuis plusieurs années, pour des raisons administratives complexes, il n'y avait plus d'étudiants inscrits en français à l'université. Autrement dit, dans cinq ans, aucun professeur de français ne sortira de la faculté d'Addis Abeba.
La baisse d'attractivité du français est à la fois due au déficit d'image dont pâtit actuellement notre pays en matière d'accueil des étudiants mais aussi à un problème de formation d'enseignants et de linguistes compétents.
Le dividende démographie de la francophonie est une illusion si une nouvelle génération de professeurs de français n'est pas formée
Au Sénégal, le wolof se développe au détriment du français qui est pourtant considéré comme la seule langue officielle du pays, car les méthodes d'apprentissage ne permettent plus aux jeunes populations d'être à l'aise avec cette langue.
Beaucoup de professeurs préfèrent d'ailleurs s'exprimer en wolof pendant les cours, ce qui pose des problèmes lors de l'arrivée des élèves à l'université. Chaque année le niveau baisse toujours un peu plus, et le français employé s'apparente de plus en plus à une langue morte. Même les élites s'expriment de plus en plus en wolof, et cet idiome gagne du terrain dans les médias : les débats politiques et les journaux sont majoritairement diffusés en wolof.
Le noyau dur de la relation avec l'Afrique qu'est la francophonie est en difficulté au Sénégal comme à Madagascar
Un constat d'autant plus étonnant que le Sénégal s'est longtemps enorgueilli d'être le berceau de la francophonie africaine. On se rappelle de Senghor se définissant comme « le père de la francophonie » hier tandis qu'aujourd'hui l'Organisation Internationale de la Francophonie est dirigée par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf.
Nous avons entendu les responsables de RFI et de TV5. Ils nous ont dit qu'ils perdaient des parts de marché à cause du français ! Quoi de plus symptomatique. Ce qui était notre atout est aujourd'hui une faiblesse que les responsables de l'audiovisuel tentent de compenser intelligemment par le développement de radio et télévision en langues régionales comme le Swahili et le Bambara.
Dans certains pays francophones, pour diffuser l'image et les valeurs de la France à travers RFI et France 24, on en est venu à devoir ne plus utiliser le français
Ce désintérêt pour le français dénote la perte d'influence de Paris et reflète le « pivot » américain qui s'opère au sein de la population.
Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sénégalais font le choix d'étudier aux États-Unis et teintent leur français d'expressions américaines. Assez naturellement les élites voient l'Afrique s'insérer dans une mondialisation dominée par la culture anglo-saxonne et souhaitent, avec l'anglais, avoir tous les atouts pour y réussir.
Madagascar connaît un tiraillement encore plus fort entre l'anglais et le français, du fait de son passé colonial. La grande île devait ainsi accueillir le sommet de l'OIF en 2010 mais la crise politique survenue cette même année a contraint l'organisation à suspendre le pays et à organiser le sommet en Suisse. Aujourd'hui les deux seules langues officielles établies dans la Constitution de 2010 sont le malgache et le français. Mais la présidence de Marc Ravalomanana a favorisé l'anglais au détriment du français. Elle a rendu l'enseignement de l'anglais obligatoire et dans le même temps l'apprentissage du français s'est dégradé.
Ce désintérêt pour le français dénote tout autant la perte d'influence de Paris que le « pivot » anglo-saxon qui s'opère au sein des populations africaines.
Aujourd'hui, le français a atteint un niveau médiocre sur l'île, même les instituteurs ne sont pas assez bien formés pour enseigner cette langue. En effet, le français n'est plus pratiqué quotidiennement : 4 enfants sur 5 maîtrisent mal le français à l'école primaire et ces difficultés se ressentent jusqu'au cursus universitaire. Plus inquiétant encore, c'est la position du gouvernement : aucune mesure n'a été mise en place afin de pallier cette faiblesse. Les autorités encouragent ainsi passivement le déclin du français.
Le désintérêt croissant pour la francophonie au sein des populations africaines est aussi le résultat d'une politique de coopération culturelle française qui a du mal à capter les attentions et les désirs africains et dont les moyens sont en constante régression.
Si dans certains milieux africains, on est d'une certaine façon fatigué de notre aide et si on aspire à des liens plus clairement fondés sur des relations économiques réciproques, la vraie légitimité qui nous est reconnue est fondée sur la francophonie ; cette dernière constitue bien le noyau dur de la spécificité de notre relation avec l'Afrique et notre défaillance est regrettée.
Sur un continent qui a une demande de formation aussi forte dans tous les domaines, la francophonie devrait nous permettre de mettre en place des stratégies ambitieuses de formation des cadres africains.
Les difficultés de la Francophonie linguistique fragilisent, par ailleurs, le projet de la diplomatie française de transformer la Francophonie institutionnelle, d'un espace de gestion d'un patrimoine linguistique et culturel commun, vers une organisation politique à part entière sur la scène internationale.
Le déclin du français ne peut que limiter l'influence d'une organisation au demeurant très jeune qui connaît par ailleurs des difficultés importantes à s'imposer comme un acteur politique.
Le sommet de Cotonou en 1995 avait en effet consacré le renforcement des institutions avec la création d'un poste de secrétaire général de la Francophonie, auquel fut nommé l'ancien secrétaire général des Nations unies M. Boutros Boutros-Ghali.
Les difficultés de la Francophonie linguistique fragilisent le projet de transformer la Francophonie vers une organisation politique
À la culture et à l'éducation, domaines de prédilection de la coopération francophone, se sont alors ajoutés au fil des sommets les sujets politiques (paix, démocratie et droits de l'homme), le développement durable, l'économie et les technologies numériques. La Francophonie s'était dotée d'une Charte lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Hanoï en 1997, Charte révisée en 2005 par la conférence ministérielle réunie à Antananarivo.
Il s'agissait de structurer les relations entre pays membres de l'OIF par l'adhésion à des valeurs communes et de créer un dialogue avec d'autres organisations internationales.
La Francophonie s'est ainsi progressivement dotée de règles internes fondées sur le respect des droits de l'homme, des valeurs de la démocratie, de la paix et de la bonne gouvernance qu'elle promeut. Tout État qui enfreint ses propres règles constitutionnelles en est désormais suspendu, et ce en vertu de la déclaration de Bamako de 2000. L'application de cette règle a déjà conduit à la mise à l'écart de quatre États, Madagascar (2009), la Guinée-Bissau (2012), le Mali (2012) et la République centrafricaine (2013).
En 2006, l'adoption de la déclaration dite de Saint-Boniface relative à la prévention des conflits et à la sécurité humaine est venue compléter ce dispositif en mettant en avant la responsabilité des États membres dans la protection des populations civiles sur leurs territoires.
Presque vingt ans après le bilan semble maigre.
L'augmentation régulière du nombre des États membres de cette institution a accru certes son audience mais elle n'a pas aidé à la définition d'une ligne diplomatique claire et a contribué à diluer la présence de l'Afrique.
Les adhésions les plus récentes, à partir de 1997, ont été surtout le fait de pays dans lesquels la langue française a une diffusion limitée au cercle des élites lettrées et qui ont des visions du monde très différentes, qu'il s'agisse de la Pologne, de la Lituanie, de la République tchèque ou de l'Autriche, qui ont acquis la qualité d'observateurs, ou du Qatar qui est devenu membre associé.
Alors que l'Union européenne, pourtant adossée à la puissance de ses États membres et à une intégration économique croissante, peine à définir une politique étrangère commune, on conçoit les difficultés que la Francophonie aura à dépasser les différences fortes entre ses membres.
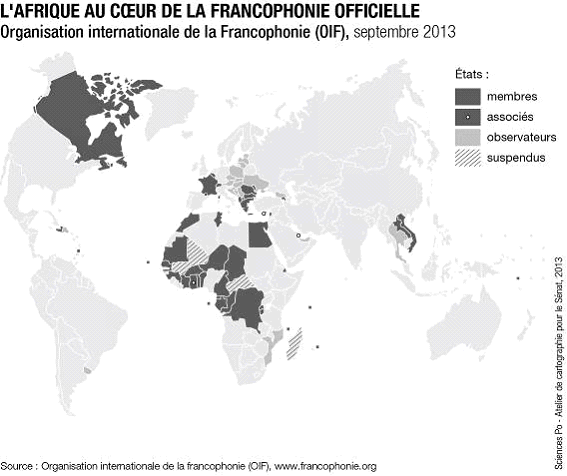
Une des conséquences de cette situation est la faiblesse du budget de l'OIF qui, avec des crédits nettement inférieurs à 100 millions d'euros, n'a pas vraiment les moyens d'une politique internationale ambitieuse. En prenant en charge près de 76% de son budget, la France est de loin le principal contributeur financier de l'organisation.
Vu de Paris, l'ambition initiale était de faire de cette organisation un acteur à part entière de la scène internationale en général et africaine en particulier, dans laquelle la France jouerait un rôle prépondérant.
C'était sans doute un dessein qui n'était pas partagé par les autres membres de l'organisation et notamment par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou par le Québec dont les motivations sont très indépendantes des intérêts français. Toujours est-il que la réalité est très en deçà des ambitions.
La crise malienne de 2012-2013 montre qu'en cas de crise grave, l'influence de la Francophonie institutionnelle devient très secondaire au regard de celle d'autres acteurs multilatéraux.
B. UNE POLITIQUE TÉTANISÉE PAR LE DÉBAT SUR LA « FRANÇAFRIQUE » ET LE MANQUE DE MOYENS
Si les entreprises perdent des parts de marchés, si les Français s'installent moins qu'auparavant en Afrique, si les étudiants africains sont plus attirés par le monde anglo-saxon, des mesures sont-elles prises du côté des pouvoirs publics pour limiter ce recul, resserrer les liens avec l'Afrique et affronter ensemble les défis des décennies à venir ?
Non seulement la réponse nous paraît négative, mais il nous semble que le discours officiel de la France et l'absence de stratégie collective des administrations françaises ont participé à ce recul de la présence française.
1. Un discours sur l'Afrique obnubilé par le passé
Lors de nos déplacements en Afrique, les ambassadeurs de France ont, à notre demande, systématiquement organisé des déjeuners avec une quinzaine de leurs homologues africains souvent francophones.
Dans ces vieux bâtiments qui témoignent de l'ancienneté de la présence française sur le continent, ces représentants de l'Afrique nouvelle nous ont souvent tenu le même langage : « Que fait la France ? », « Pourquoi après être resté si longtemps, partir au moment où tout le monde arrive ? »
Tous étaient unanimes pour saluer le courage de l'intervention française au Mali, mais, une fois les remerciements passés, chacun s'est interrogé à demi-mot sur les raisons pour lesquelles la France cédait tellement de terrain face aux nouveaux partenaires.
Nous n'excluons pas que la courtoisie ait conduit nos hôtes à nous dire ce que nous voulions entendre, c'est-à-dire qu'il y avait encore en Afrique un désir de France.
Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est cette perplexité devant l'attitude de la France, devant sa difficulté à dépasser les querelles du passé et à comprendre les transformations du continent.
« Quand la France parle de l'Afrique, elle parle plus du passé que de l'avenir » nous a dit un interlocuteur africain, « il faut changer de lunettes » .
a) Rompre avec la Françafrique comme seule stratégie
Quand on regarde les 20 dernières années, la parole sur l'Afrique au sommet de l'État aura été dominée par la rupture avec le passé en général et avec la Françafrique en particulier.
Longtemps, l'Afrique a constitué pour les chefs d'État successifs, « un », sinon « le » coeur de l'influence française dans le monde, le théâtre privilégié dans lequel les autorités françaises ont pu prouver l'utilité et le poids de la France dans le concert des nations. Longtemps, l'Afrique aura été le lieu de la manifestation de la «grandeur» et du «rang» de la France, à tel point qu'on a pu dire que « La France sans l'Afrique, c'est le Luxembourg » .
Les différents Présidents de la République ne s'y sont pas trompés, De Gaulle le premier évidemment. L'Afrique a longtemps fait partie intégrante de la posture présidentielle française, la cellule africaine de l'Élysée assurant la continuité par-delà des styles différents.
On est subrepticement passé de la célébration de la spécificité de notre relation à l'Afrique à sa négation, de l'exceptionnalité africaine à sa banalisation.
Et puis imperceptiblement, de réforme en réforme, la France a semblé, du moins dans le discours, s'en désintéresser, comme si la France sans l'Afrique, c'était peut-être, après tout, un fardeau en moins.
Dans l'intervalle, entre la dévaluation du franc CFA, la suppression du ministère de la coopération, la disparition d'Omar Bongo en 2009 et les décès d'Houphouët-Boigny puis de Foccart, on est subtilement passé de la célébration de la spécificité de notre relation à l'Afrique à sa négation, de l'exceptionnalité africaine à sa banalisation.
Relisons les débats sur la politique africaine depuis 15 ans : le maître mot est la rupture avec le passé.
La « rupture », tant annoncée en 1974 et en 1981, est repensée à l'aube des années 2000. Avec le second mandat de Jacques Chirac, et surtout avec l'élection de Nicolas Sarkozy, l'intégration de la cellule Afrique au sein de la cellule diplomatique entendait signifier institutionnellement ce changement d'époque et de moeurs.
La relecture des professions de foi sur l'Afrique de tous les candidats aux deux dernières élections présidentielles en témoigne : l'Afrique y est quasiment absente et quand la question est abordée, le thème central est encore et toujours la rupture avec le passé.
A-t-on vraiment rompu ? Comment rompre ? Rompre avec quoi au juste ?
Chacun a sa version. Pour les uns, c'est d'abord rompre avec un discours et une vision de l'Afrique, rompre avec une vision paternaliste et ethnocentrique de ce continent, rompre avec une posture de donneur de leçons pour établir des partenariats d'intérêts mutuels.
Pour les autres, c'est rompre avec de sombres pratiques et des réseaux d'émissaires officieux qui n'ont d'autre mandat que celui qu'ils s'inventent, avec des interventions militaires improvisées au profit de régimes politiques les plus contestables du continent.
Pour beaucoup, c'est enfin rompre avec des circuits financiers opaques qui ont trop longtemps fait le jeu de la corruption, les financements occultes de partis politiques africains et français et des biens mal acquis.
Les discours du Cap de Nicolas Sarkozy (2008) et de Dakar (2012) de François Hollande ont convergé pour annoncer que la rupture, c'était une plus grande transparence et la nécessité de confier la sécurité du continent aux Africains eux-mêmes, aux instances régionales et, éventuellement, aux instances multilatérales et européennes.
Cette évolution progressive a conduit à des changements profonds tels que la réforme de la coopération, le redéploiement de notre dispositif militaire en Afrique ou la révision des accords de défense.
Mais quid de la France, de sa politique, de ses intérêts ? Rien ou peu, sinon renoncer avec force non pas encore à l'Afrique, mais à la « Françafrique », terme péjoratif s'il en est à force de désigner une relation si spéciale. Quid de l'avenir ?
On a souvent considéré in fine notre relation à l'Afrique comme un encombrant héritage que le temps finira par dilapider.
C'est en cela que chacun s'est accordé à dire que la France n'avait pas vocation à maintenir sa présence militaire sur le continent, comme elle n'a pas vocation à toujours alimenter une aide au développement dont la réussite et le succès seront précisément sa disparition.
Ainsi l'avenir semblait voué à un retrait, que la diminution de nos moyens budgétaires nous imposerait de toute façon.
Rompre avec la Françafrique, ce n'est pas rompre avec l'Afrique
Seule, la convoitise des émergents aura suscité un doute sur la démarche à suivre. « C'est la Chine qui a fait changer le regard des Français sur l'Afrique » a souligné Dominique Lafont, directeur de Bolloré Africa Logistic. « Nous avons multiplié par 3 notre chiffre d'affaires en Afrique durant une décennie où les Français regardaient le continent avec indifférence ou nostalgie ».
Nous abandonnons progressivement nos débats franco-français parce que l'Afrique est en train de devenir un lieu de rivalités dont les enjeux s'imposent à tous.
Alors que nous nous désengagions, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Royaume-Uni, Israël et les pays du Golfe se bousculaient à sa porte.
Durant cette période, les mutations en profondeur qui animaient l'Afrique échappaient en grande partie aux responsables de la défense du «pré carré».
Même dans les cercles les plus renseignés, au lendemain de la chute de la menace communiste, les penseurs de la politique africaine de la France ont de moins en moins maîtrisé les événements sur le continent, et semblent avoir éprouvé de plus en plus de peine à offrir une ligne claire et continue à l'action française.
La mondialisation et ses conséquences géopolitiques ont de ce fait finalement été plus subies qu'anticipées. L'effondrement de la menace soviétique a fait perdre à la France l'argument fondateur de sa mission sur le continent - fût-elle bien plus complexe dans ses intentions comme dans ses réalisations-, sans qu'on prenne la peine de repenser une stratégie africaine adaptée au 21 ème siècle.
b) À regarder dans le rétroviseur, l'Afrique est restée dans l'angle mort.
Comme nous l'a excellemment décrit Yves Gounin, « ce sont deux décennies pendant lesquelles la politique africaine de la France voit s'affronter deux clans. D'un côté les Anciens. De l'autre les Modernes. Les Anciens, autour de Jacques Foccart, voulaient que soient préservés les liens spécifiques qui unissaient la France et l'Afrique. De l'autre, Les Modernes appelaient de leurs voeux la réforme de la relation franco-africaine et sa banalisation. Une querelle qui voit s'affronter en définitive les tenants d'une politique normalisée et ceux qui refusent que soit signé l'acte de décès de la Françafrique. »
Deux décennies pendant lesquelles on a rouvert les débats sur le passé de la relation à l'Afrique.
D'un côté, on a redécouvert le passé esclavagiste de la France. Les historiens et les journalistes se sont emparés d'un sujet qui touche d'autant plus la France qu'elle dispose, avec les Antilles et La Réunion, de territoires peuplés en grande partie par les descendants des esclaves déportés d'Afrique. Le continent noir a été dépossédé d'une partie de sa population alors qu'il était encore sous-peuplé, au terme d'un commerce triangulaire dont la France a été l'un des acteurs majeurs.
De l'autre, l'histoire du passé colonial fait resurgir des mémoires divergentes sur la colonisation, son impact sur l'histoire africaine et sur les épisodes dramatiques d'une décolonisation qui fut sans doute plus pacifique que celle de l'Algérie, mais qui a été cependant émaillée d'épisodes sanglants.
Le premier débat aboutira à la loi Taubira sur la mémoire de l'esclavage, le second sur la loi Mekachera du 23 février 2005 dont l'article 4 faisait obligation aux programmes scolaires de reconnaître le rôle « positif » de la présence française en Afrique du Nord. Débattue pendant un an, la loi sera finalement abrogée en 2006.
Enfin, dans le débat public, les différentes publications sur la Françafrique issues de travaux de François-Xavier Verschave et de l'association Survie ont occupé la décennie en dénonçant dans la veine de « La Françafrique, le plus long scandale de la République », l'histoire des relations franco-africaines comme le produit d'une diplomatie occulte et d'intermédiaires officieux, mêlant soutien aux dictatures et coups d'État, détournements de fonds et financement illégal de partis politiques : une littérature d'autant plus médiatique qu'elle sera régulièrement alimentée par l'actualité judiciaire avec l'Affaire Elf, l'Angolagate, et plus récemment l'affaire Borrel.
S'est imposée aux yeux de l'opinion publique l'image d'une politique africaine forcément corrompue et illégitime. L'expression « Françafrique », créée par Houphouët-Boigny pour souligner de façon positive l'intimité qui associe ce continent à l'Hexagone, s'est ainsi imposée à l'inverse, de façon particulièrement dévalorisante, avec pour symbole les 3 E (Elysée, Elf, État-major), pour héros le Secrétaire général aux affaires africaines et malgaches, Jacques Foccart et pour principe, la raison d'État.
À lire certains ouvrages, la politique africaine n'est alors que « le lieu d'un double langage, du dualisme de l'officiel et du réel, de l'émergé et de l'immergé, du légal et de l'illégal, où se mêlent des intérêts privés et publics, le financement des partis politiques, le soutien des régimes en place par crainte du chaos. »
Cette image sulfureuse s'est étendue aussi bien à la sphère publique qu'à la sphère privée.
Pour M. Alexandre Vilgrain, président du CIAN, «L'opprobre qui a entouré une certaine sphère publique a gagné le privé. Une des difficultés des entreprises françaises en Afrique, c'est qu'elles sont mal vues en France même. Quand vous travaillez en Afrique, c'est forcément louche. Si vous faites la même chose, le même chiffre d'affaires en Chine, c'est formidable, en Afrique c'est mal vu. Il faut en finir avec le passé et assumer qu'on s'intéresse à l'Afrique, comme un des axes stratégiques de développement des entreprises françaises ».
Parallèlement quelques maigres efforts ont été effectués pour dépassionner ces débats et les poursuivre sur le terrain de la recherche historique, afin notamment de favoriser une nécessaire écriture partagée entre la France et l'Afrique de certains épisodes dramatiques de la décolonisation.
Ces efforts ont reçu un soutien encore très minimal des pouvoirs publics alors qu'ils permettraient d'apaiser la mémoire, notamment à Madagascar et au Cameroun où coexistent encore des visions extrêmement divergentes de faits qui remontent à plus de cinquante ans, sans parler du Rwanda où, plus de vingt après, le souvenir du génocide reste une blessure non cicatrisée, qui continue d'envenimer les relations franco-rwandaises.
Ces contentieux non réglés, qui empoisonnent la relation, méritent qu'on essaie de solder le passé par une mise en récit commune d'une histoire partagée.
À débattre du passé, la France a regardé l'Afrique dans le rétroviseur
Pendant que le passé occupait le terrain, la compassion qui va de pair avec la dénonciation de la Françafrique est restée le cadre de pensée privilégié de la relation à l'Afrique.
L'image du continent est restée trop longtemps figée dans celle de la pauvreté et du conflit. « Les Français ont trop longtemps conservé l'image d'une Éthiopie de la famine sans voir la naissance d'une puissance régionale » nous a dit M. Michel Foucher, géographe, ancien ambassadeur et Directeur de la formation, des études et de la recherche de l'IHEDN.
La difficulté de penser le continent tel qu'il est et tel qu'il évolue ne permettra pas de définir la raison d'être d'une politique africaine et encore moins la spécificité d'une relation qu'il faudrait avant tout banaliser.
Pendant des années, à regarder dans le rétroviseur, l'Afrique est restée dans l'angle mort.
Cela ne signifie pas que personne n'ait perçu les évolutions en cours, ni qu'aucune réforme n'ait été menée : celle de la coopération entreprise en 1998, poursuivie en 2004, celle du dispositif militaire français en Afrique, ont marqué leur époque sans qu'elles soient poussées à leur terme et sans qu'une cohérence d'ensemble ne s'en dégage sinon celle de la rigueur budgétaire.
Pour Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l'AFD qui a été l'un de ceux qui ont éveillé l'opinion publique et la classe politique aux transformations du continent avec son livre Le temps de l'Afrique : « Pendant trop longtemps, les Français ont tourné le dos à l'Afrique ... ils n'ont longtemps vu dans l'Afrique que les menaces et les risques sans voir les opportunités ».
Comme l'a observé le Général Didier Castres, sous-chef d'état-major « opérations » au ministère de la défense « notre perception de la relation à l'Afrique est toujours teintée de `'trop'' de paternalisme, teintée de `'trop'' de romantisme, teintée de `'trop'' d'idéologies et de `'trop'' de complexes de l'ancien colonisateur. ».
Les discours présidentiels y ont contribué. Il suffit de se rappeler le Président Jacques Chirac dire à Cannes : « nous sommes réunis parce que la France aime l'Afrique et se sent liée à elle par les engagements de la fraternité, de l'histoire et du coeur », ou le Président Nicolas Sarkozy à Dakar : « le problème de l'Afrique et, permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est d'entrer dans l'histoire », pour comprendre combien sont prégnants non seulement la présence du passé, mais surtout le registre du sentiment.
Coincées entre nostalgie d'une grandeur passée et mauvaise conscience, les autorités françaises n'ont pas su jusqu'à présent dégager une nouvelle vision claire et objective de ce que devrait être une relation apaisée au continent africain.
Même dans les cercles initiés, il est difficile de regarder notre relation à l'Afrique telle qu'elle est objectivement. On y trouve une vision partagée entre :
- une Afrique « continent en marge » des affaires du monde entendues comme la mondialisation, la grande politique, la grande stratégie : elle est alors quasiment ignorée ;
- une Afrique « exutoire » discrète aux affrontements indirects qui commencent avec la colonne Marchand et l'épisode de Fachoda pour finir aujourd'hui avec une rivalité avec la Chine ;
- une Afrique « arrière-cour », considérée comme une simple réserve à matières premières rares et chères ;
- une Afrique « menace » vis-à-vis de laquelle il fallait se barricader
Et quand on évoque la relation de la France à l'Afrique, on parle plus volontiers de ce qu'elle devrait être que de ce qu'elle est.
2. Une stratégie introuvable pour une politique éclatée
Si la thématique de la Françafrique s'est aussi facilement imposée au coeur du débat politique, c'est aussi qu'il n'y a pas eu, au sein des pouvoirs publics, une mise en récit éprouvée des relations avec l'Afrique susceptible de nourrir une véritable stratégie africaine, avec une vision froide de nos intérêts mutuels susceptible de fédérer l'action des différentes administrations.
Ce vide a laissé la place dans le débat aux détracteurs de la politique africaine de bonne et de mauvaise foi.
Sans vision partagée de la présence de la France en Afrique, il a été difficile d'invoquer un cap ou de convaincre nos interlocuteurs qu'il s'agissait pour la France d'un partenariat stratégique.
De même sur le terrain, l'absence de cap commun a laissé aux différentes administrations jalouses de leurs prérogatives le soin de mener des actions mal coordonnées, voire contradictoires, comme l'illustre la question de visas.
Quelle est la politique africaine de la France ? On serait bien en peine de répondre à la question. Aucun ou peu de document stratégique sur le sujet, aucune ou peu de réflexion commune aux acteurs de la politique africaine.
Comme l'a souligné Hubert Védrine devant la commission des affaires étrangères du Sénat, il serait paradoxal que la France soit le seul pays à ne pas avoir de politique africaine ! : « Toutes les puissances ont une politique africaine aujourd'hui. Et la France ne devrait plus en avoir à cause de son passé colonial ? » 38 ( * )
Dans le même temps, les pays émergents à l'instar des autorités chinoises, définissaient des documents de stratégies africaines.
Mais il n'y a pas eu que les émergents.
L'Allemagne a publié en 2011 une « stratégie du gouvernement fédéral pour l'Afrique » qui, selon les termes du ministre des Affaires étrangères Guido Westerwelle, « coïncide avec une époque de bouleversements et de renouveau de l'Afrique qui est la manifestation peut-être la plus fascinante du monde en mutation dans lequel nous vivons ».
Les Américains, les Chinois, les Allemands ont défini une stratégie africaine, la France, elle, peine à définir un cap
Pour l'Allemagne, cela signifie qu'il faut « entretenir et approfondir les vieilles amitiés mais aussi s'appliquer à en tisser de nouvelles ». Telle est précisément la vocation de la stratégie pour l'Afrique: « Nous souhaitons ouvrir un nouveau chapitre des relations avec notre continent voisin », a affirmé le ministre fédéral des Affaires étrangères. L'objectif est de prendre en compte l'importance grandissante de l'Afrique et du principe de l'appropriation africaine.
La même année, aux États-Unis, le président Barak Obama dévoile la « U.S. Strategy for Sub-Saharan Africa » qui englobe l'ensemble des dimensions économiques, militaires, diplomatiques et de coopération au développement.
En France un tel document est encore impossible tant les différents secteurs ministériels ont du mal à élaborer des stratégies conjointes. Aucun document, aucune structure ne rassemble les différents acteurs de la politique africaine de la France.
Longtemps l'Élysée a été le lieu d'une synthèse. L'unité du pilotage de la politique africaine a été conduite pendant de nombreuses années par le secrétariat général des affaires africaines et malgaches, qui couvrait l'ensemble des secteurs au service d'une politique africaine unifiée tant dans ses objectifs que dans ses moyens.
Cette organisation très assimilée aux dérives de la Françafrique, notamment en raison de sa proximité avec les services spéciaux, a progressivement été vidée de sa substance et a laissé place à une fragmentation des centres de décision.
Certes, l'Afrique conserve une place centrale dans les prérogatives présidentielles : coeur du domaine réservé, elle est, par excellence, le théâtre des initiatives élyséennes, l'épisode malien en témoigne.
Alors qu'officiellement, depuis la fin des années 1990, la rupture devait se traduire par la mise sous tutelle diplomatique de la cellule africaine, le caractère «privé» ou exceptionnel des liens entre les chefs d'État français et africains n'a pas été renié par les différents successeurs de Charles de Gaulle.
La politique africaine reste incarnée par l'Elysée et l'Afrique reste un élément du prestige international de la fonction présidentielle dans la République héritée du général de Gaulle. En ce sens, le « pré carré » initial comme le modèle foccartien de la cellule se sont certes épuisés, mais pas les ambitions élyséennes qui continuent de trouver en Afrique une scène de théâtre privilégiée.
« Tout le monde se parle, mais aucune structure de travail ne coordonne l'action des militaires, des diplomates et des coopérants. »
La phrase du Président Hollande à Bamako sortant du registre diplomatique pour dire : « Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. A un moment, une décision doit être prise, elle est grave. Je l'ai prise au nom de la France, elle honore la France, et à travers le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand honneur. » en est l'illustration.
En revanche, la structure élyséenne, aujourd'hui réduite à deux conseillers au sein de la cellule diplomatique, n'a plus pour ambition de piloter des administrations très autonomes les unes des autres sur le champ africain.
Tout le monde se parle et se réunit, notamment le jeudi rue de l'Elysée, mais aucune structure de travail ne coordonne l'action des militaires, des diplomates et des coopérants, à part le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) sur certains aspects. Au sein de chaque entité ministérielle, il y a d'ailleurs peu de documents stratégiques.
La défense, on le verra plus loin, a modifié son dispositif en suivant la contrainte budgétaire plus que toute autre considération. Les conseils de défense de 2004 avaient essayé d'élaborer une organisation calquée sur les forces africaines en attente et défini une stratégie en matière de coopération structurelle, une belle architecture qui a volé en éclats au gré des crises et des coupes budgétaires.
En matière de coopération militaire, le création de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) au sein du ministère des affaires étrangères a permis de mieux harmoniser les positions des deux ministères. En revanche l'intégration de la sécurité civile dans le périmètre de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) n'empêche pas le ministère de l'intérieur de prendre des initiatives sans coordination avec cette direction qui en assure pourtant l'exécution. Les mêmes tensions existent entre la coopération menée par le ministère de la Justice et les actions pilotées par le ministère des affaires étrangères.
En matière de coopération civile, la situation est encore plus complexe. Deux récentes évaluations soulignent que l'action publique reste confrontée, malgré la succession des réformes, à un pilotage politique incertain et à un partage des rôles inachevé entre les différents acteurs. Le rapport de la Cour des comptes souligne ainsi que « datant de la fin des années 1990, le modèle français d'organisation de l'aide est confronté depuis des années à une évolution qui lui fait atteindre aujourd'hui ses limites : il est fragmenté et déséquilibré. Contrastant avec la plupart des modèles étrangers, ce modèle est privé d'un centre de gravité. »
On a d'un côté de la Seine, le Quai d'Orsay qui gère les crédits de subventions de l'aide bilatérale, les contributions aux fonds multilatéraux hors banque de développement et aux fonds communautaires et assure la cotutelle de l'AFD et, de l'autre, la Direction Générale du Trésor qui gère les crédits de bonification des prêts, les annulations de dettes, les contributions aux banques de développement, la zone franc et la cotutelle de l'AFD. Au milieu, ou presque, l'AFD bénéficie d'une relative autonomie que l'absence de coordination entre les deux tutelles favorise.
La coopération civile manque elle-même d'un pilotage politique
L'éclatement du dispositif suscite une concurrence entre services et ministères qui entraîne d'inévitables différences d'appréciation entre administrations et, par conséquent, des demandes récurrentes d'arbitrage à Matignon, voire à l'Élysée. Cette situation conduit à des délais et des incohérences incompatibles avec le rythme et la nature des enjeux à traiter. Le seul organe de coordination, le CICID ne s'est pas réuni pendant 4 ans.
Au-delà de la personnalité du titulaire du portefeuille, l'absence de pilotage politique de la politique de coopération en Afrique s'explique par le fait que le ministre du développement ne dispose pas des moyens de porter une politique d'ensemble qui reste marquée par la concurrence entre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances.
L'organisation actuelle ne lui permet pas non plus d'arbitrer les priorités budgétaires de la mission budgétaire « Aide publique au développement », notamment entre instruments bilatéraux et multilatéraux. De fait, la mission APD constitue une variable d'ajustement des budgets respectifs des ministères concernés, autrement dit le ministère des finances d'un côté, celui des affaires étrangères de l'autre.
L'ensemble de la coopération civile travaille peu avec les militaires. La culture des coopérants, sous la surveillance attentive des ONG, les y incite peu. Aucune structure, même dans les États en crise, ne les y contraint. On a beau dire qu'il n'y pas de sécurité sans développement et pas de développement sans sécurité, comme le rappelle à l'envi le ministre du développement, l'administration française peine à concrétiser à Paris et sur le terrain une approche globale de l'Afrique.
Quant aux aspects économiques, mis à part les entreprises participant aux approvisionnements en hydrocarbures et minéraux stratégiques, ils étaient en Afrique peu pris en considération.
Le déficit du commerce extérieur français et le décollage économique de l'Afrique semblent contribuer à un rapprochement entre les considérations diplomatiques, commerciales et de développement. Le Quai d'Orsay, avec la nouvelle sous-direction des entreprises, semble décidé, sous l'impulsion du ministre des affaires étrangères Laurent Fabius, à faire de la diplomatie économique une priorité, tandis que l'AFD a pour mandat de mieux prendre en considération les intérêts français dans les projets qu'elle finance.
Sur le terrain toutefois, en Côte d'ivoire ou au Mali, on peinerait à voir une coordination concrète entre les militaires, les développeurs et les représentants des entreprises françaises, comme c'est le cas chez les Américains ou les Britanniques. Et les agents publics chargés de promouvoir les échanges commerciaux restent, au sein des ambassades, liés hiérarchiquement au ministère des finances.
Reste que personne, ni aucune structure, n'assure la cohérence du tout. Difficile dans ces conditions d'établir une stratégie africaine de la France. Difficile de dire s'il y a une cohérence entre les priorités militaires, économiques, culturelles de la France en Afrique.
On observe plutôt un découplage entre les enjeux économiques qui se situent pour une large part dans l'Afrique de l'Est anglophone et les enjeux géopolitiques, dans l'Afrique francophone, dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique.
Difficile en fin de compte de dire ce qu'est la cohérence de la politique africaine de la France.
De fait, le fil conducteur de ces dix dernières années en matière de politique africaine a été avant tout budgétaire : réduire la voilure.
Car, pendant que le discours de la banalisation s'imposait, celui de la rigueur budgétaire a dicté dans la pratique une reconfiguration de nos outils diplomatiques et de coopération civils et militaires qui ressemble fort à une réduction de nos ambitions.
3. Un réseau diplomatique en réduction
« Nous devons faire attention à ne pas provoquer la fin de la politique d'influence et de rayonnement de notre pays en Afrique. Chaque poste, chaque programme supprimé n'est pas important en soi, mais mis bout à bout, l'impact est grave. On finira par ne plus être grand-chose sur ce continent dans quelques années », nous a dit un diplomate en poste en Afrique, qui préférait ne pas être cité.
Chacun connaît la contribution du Quai d'Orsay à la réduction des dépenses publiques : une baisse de 20% du budget et du personnel en 25 ans, comme le rappelaient en juillet 2010 les anciens ministres des affaires étrangères MM. Hubert Védrine et Alain Juppé dans une tribune du journal Le Monde.
Tous les ministères doivent évidemment contribuer à la réduction des dépenses publiques, mais aucune administration n'a été réduite dans ces proportions.
Ce que l'on sait moins, c'est que notre présence en Afrique a supporté la grande partie de cet effort, au prix d'une réduction brutale des postes et des initiatives.
La Cour des comptes relève ainsi que sur la période 2007-2011 39 ( * ) « Les postes d'Afrique subsaharienne ont absorbé les deux-tiers des réductions. », observant que « les postes de Madagascar et du Sénégal ont ainsi diminué leurs effectifs de plus de 20%. » .
Pour l'ensemble des réseaux du ministère, l'ajustement des effectifs et des formats s'est inscrit dans une évolution visant au rééquilibrage de la présence française en Asie au détriment de l'Afrique.
Un redéploiement a été effectué, avec sur cette même période -14% de postes en Afrique et océan Indien dont -8% en Afrique du Sud et - 10% en Europe contre -1% dans la zone Asie mais +11% en Chine et +14% en Inde.
Dans un environnement budgétaire contraint, le choix de l'Asie s'est effectué au détriment de la couverture du continent africain tant sur le plan culturel que commercial.
L'Afrique a contribué pour deux tiers des réductions des effectifs du quai d'Orsay
Ce choix avait sa pertinence.
La question est aujourd'hui de savoir si nous ne sommes pas allés trop loin et si l'allocation des ressources est pertinente par rapport aux intérêts français.
La France a en tout cas donné à l'Afrique le sentiment d'avoir choisi l'Europe comme nouveau multiplicateur de rayonnement et l'Asie comme perspective d'avenir.
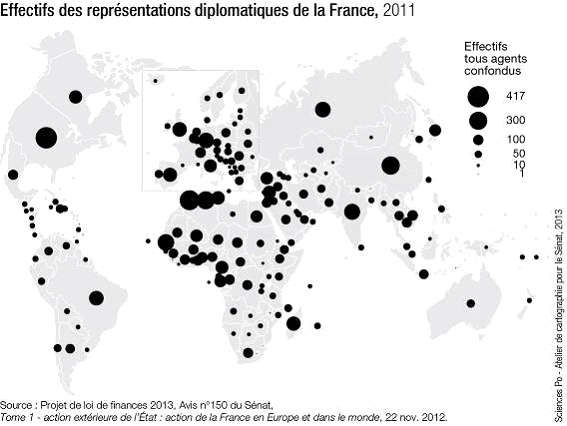
Après la réforme du dispositif militaire français en Afrique et la disparition du ministère de la Coopération dans les années 1990, cette attrition des moyens diplomatiques participe à une lente déconstruction de la relation entre la France et l'Afrique.
Et ce à l'heure où, dans un mouvement exactement contraire, la Grande-Bretagne s'implique sur le continent avec la création du DFID ou l'intervention militaire en Sierra Leone. Et le mouvement se poursuit.
En 2013, il est prévu la suppression de 56 postes sur les 845 agents que compte la zone Afrique - océan Indien.
Si le chiffre paraît peu important au regard du nombre de personnel présent sur le continent, le choix des secteurs supprimés est frappant : l'assistance technique est le domaine le plus touché, notamment au Sénégal et au Gabon où les postes d'enseignants sous statut ETI (25 postes sur la période 2012-2013) sont en cours de suppression.
En Éthiopie, nous avons constaté que la France ne disposait que d'un seul diplomate pour suivre les travaux de l'Union Africaine, là ou d'autres pays y consacrent une ambassade entière ! Quelle contradiction entre un discours qui ne cesse de promouvoir l'intégration du continent et le peu de considération que traduit ce manque de moyens qui ne permet pas de peser pleinement sur une institution dont on ne cesse par ailleurs de promouvoir le rôle.
En Éthiopie, la France ne consacre qu'un seul diplomate pour suivre l'ensemble des travaux de l'Union Africaine, là où les Etas-Unis ont une ambassade.
A la dernière Conférence des ambassadeurs, on annonçait la suppression de 600 postes dans l'ensemble du réseau de 2013 à 2015. L'Afrique sera là encore au premier rang.
D'un point de vue sectoriel, la baisse des effectifs au ministère des affaires étrangères a été de 9%, de 2007 à 2011, mais les programmes budgétaires ayant été les plus touchés concernent au premier chef l'Afrique : c'est la « diplomatie culturelle et d'influence » (-15%) et la « solidarité en faveur du développement » (-17%).
Il en va de même pour les budgets d'intervention. Depuis 2009, les enveloppes de coopération hors fonds de solidarité prioritaire (FSP) ont connu une baisse de 20%, pour une baisse moyenne de 15% à l'échelle de l'ensemble du réseau de notre coopération culturelle.
A cela s'ajoute une baisse notable du FSP : les crédits de paiement de ce fonds ont diminué de 42% entre 2009 et 2012. Pour les seuls Pays pauvres prioritaires, cette baisse atteint même 50% en contradiction avec la typologie des Pays Pauvres Prioritaires, qui devraient, selon les termes du CICID, bénéficier d'un soutien budgétaire élevé.
L'écart entre les besoins des postes et le montant de crédits de paiement disponibles rend très difficile le respect de nos engagements, notamment dans les postes où l'outil FSP constitue, depuis de nombreuses années, le pilier de notre action dans les domaines de la gouvernance et de la francophonie.
Cette diminution des crédits impose notamment aux établissements culturels dépendant de l'Institut français d'assurer toujours plus avant un autofinancement. Heureusement, les établissements du réseau, d'implantation souvent ancienne, sont très actifs et bénéficient en Afrique d'un important capital de reconnaissance en étant très présents dans le paysage local, où ils sont souvent les seuls établissements culturels de taille critique à avoir une activité continue. On ne peut cependant ignorer que leurs taux d'autofinancement seront en Afrique toujours nécessairement inférieur à celui des instituts situés dans des zones plus développées.
A titre d'exemple, des pays comme le Nigeria ou la Guinée Conakry affichaient, en 2012, un taux d'autofinancement de respectivement 75% et 70%, alors que d'autres étaient très largement tributaires de la subvention de l'État comme le Tchad (taux d'autofinancement de 8%), la Mauritanie (12%) ou Djibouti (25%).
Pour certains Instituts français, souvent en territoire francophone, le développement des recettes liées aux cours ou aux examens de langue et la recherche de partenariats ne sont pas pleinement intégrés dans la culture de travail et souvent mal perçus par les usagers, en particulier parce qu'ils sont synonymes de hausse des tarifs des cours.
Ce désengagement, sans doute inévitable dans un contexte de réduction budgétaire brutale, n'est pas perdu pour tout le monde, notamment pour les nouveaux acteurs qui s'installent dans le vide ainsi créé. La Chine, au premier rang, investit massivement dans un réseau d'instituts Confucius qui rencontrent un grand succès.
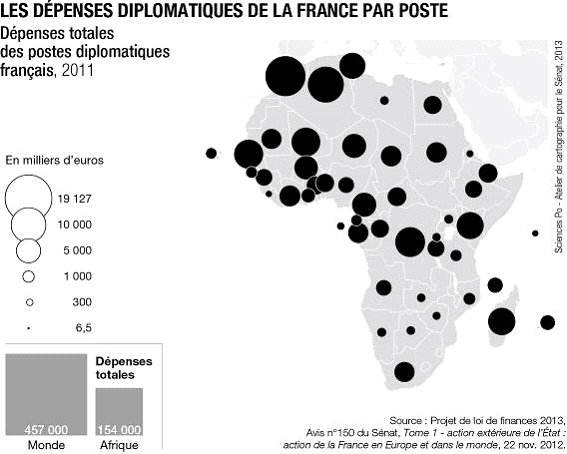
L'Allemagne est devenue une destination d'études privilégiée là où elle était largement absente il y a dix ou quinze ans, avec un impact économique à long terme évident.
Dans le domaine économique, la fusion de la Direction des Relations Économiques Extérieures et de de la Direction du Trésor a conduit l'État à réduire son soutien aux entreprises françaises en Afrique ; elles ne peuvent compter que sur quelques services économiques régionaux et quelques antennes de UBIFRANCE là où chaque ambassade avait un PEE clairement identifié.
La suppression des services économiques en Mozambique, une illustration de la mauvaise prise en compte de l'évolution de l'Afrique
Dans des zones en pleine expansion, on ferme des bureaux en application de programmations anciennes qui n'ont pas vu venir le décollage économique de l'Afrique subsaharienne, au point que dans certains pays comme le Mozambique, en l'absence de toute représentation économique, c'est finalement l'AFD qui représente le soutien économique aux entreprises dans un pays un plein essor qui vient de passer une commande de 30 bateaux d'une valeur de 200 millions d'euros aux Constructions mécaniques de Normandie (CMN) et dont on prédit un taux de croissance pour 2012-2017 de 7% !
Le repli régional de la DGPTE et la diminution du réseau des missions économiques en effectifs ou en nombre de postes paraissent être, pour tous, en déphasage avec le dynamisme africain.
Dans le domaine consulaire, les consulats manquent cruellement de moyens humains pour gérer convenablement les demandes de visas. « Les moyens sont faibles même pour mener une politique de refus », nous a déclaré un interlocuteur. L'accueil souvent déplorable au sein des consulats français nuit gravement à l'image de notre pays, notamment vis-à-vis des élites intellectuelles et économiques.
La politique d'influence est également sinistrée. Quand les ambassades américaines, même de taille modeste, animent année après année le réseau de leurs anciens boursiers et invités, leurs homologues françaises en sont généralement dans l'incapacité, faute de personnel.
Au final, la France dispose toujours d'un maillage exceptionnel en Afrique, mais de moins en moins de moyens pour le faire vivre, pour mener une politique d'influence ou pour soutenir nos entreprises.
Un maillage exceptionnel, mais de moins en moins de moyens pour le faire vivre
Cette pénurie de moyens qui concerne l'ensemble de la diplomatie française rend encore plus difficiles les arbitrages géographiques y compris au sein du continent entre l'Afrique de l'Ouest où la France a des obligations et des responsabilités et l'Afrique de l'Est en croissance vers laquelle les pouvoirs souhaitent s'ouvrir.
Difficile en effet, dans le contexte actuel, de renforcer nos moyens en Afrique du Sud, au Nigéria, en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda ou au Mozambique. C'est pourtant dans ces pays « pré-émergents » que la France devrait renforcer sa présence économique. Par leur taille, leur dynamisme, ces pays doivent constituer des priorités notamment pour notre diplomatie économique. La France ne peut pas plus longtemps être absente de l'Afrique qui bouge.
Comme l'a souligné Jean-Christophe Belliard, directeur d'Afrique et de l'Océan Indien au ministère des affaires étrangères : « Ce n'est pas fromage ou dessert, il faut concilier la fidélité à l'Afrique de l'Ouest et l'ouverture à l'est . »
Un défi : concilier la fidélité à l'Afrique de l'Ouest et l'ouverture à l'Est
La perte d'influence française qui résulte de la réduction de nos moyens diplomatiques risque de ne pas être seulement conjoncturelle. Elle est bien sûr liée à la redistribution des cartes dans le monde, mais elle est aussi la conséquence de choix politiques qui sacrifient un outil évidemment perfectible mais bien réel, pour des raisons comptables à court terme, aux dépens d'une vision stratégique à long terme.
4. Une aide au développement écartelée entre ses ambitions et ses moyens
Au sein du réseau diplomatique et souvent à sa marge, longtemps en Afrique la coopération au développement a été l'instrument de solidarité et d'influence qui a assuré à la France un rayonnement et une présence sans équivalent.
Toutefois la suppression d'un ministère de la coopération, presque entièrement dédié à l'Afrique, et la multilatéralisation progressive de l'Aide Publique au développement française dans un contexte de réduction importante de son budget, ont semblé banaliser l'Afrique au sein de la coopération autant qu'elles ont banalisé la France parmi les bailleurs de fonds. Qu'en est-il ?
Tout au long des années 90, on observe une forte baisse de l'APD qui est divisée par deux de 1994 à 2000 passant de 0,63% du Revenu National Brut (RNB) à 0,31% suivie d'une stabilisation puis d'une augmentation en trompe-l'oeil durant les années 2000.
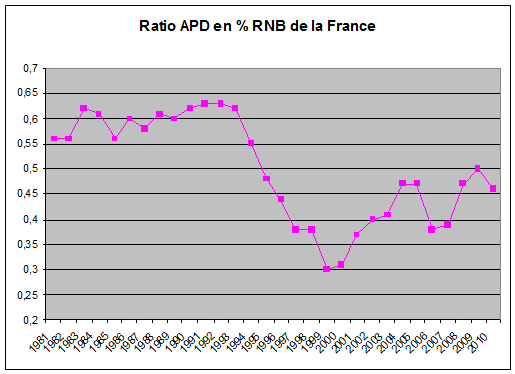
Optiquement, l'effort de la France en faveur de l'aide au développement s'est maintenu grâce à une augmentation continue des prêts en parallèle avec une diminution des dons et en particulier des prêts à des conditions proches du marché, notamment dans les pays émergents et à des flux comptables qui ne correspondent pas à des projets de développement comme les écolages.
La France est devenue l'un des pays où la part relative de l'aide réellement programmable pour des projets sur le terrain par rapport à l'ensemble de l'aide est la plus faible.
En effet, pour la moyenne des pays du CAD, l'aide programmable représente 63% de l'APD. En France, elle ne représente que 37% de l'aide déclarée en 2010.
« La France a fini par devoir reconnaître qu'elle n'atteindra pas l'objectif d'allouer 0,7% du RNB à l'aide »
Longtemps la France a ainsi maintenu les apparences, affichant un taux d'effort en faveur du développement conforme à son image de fer de lance de la coopération internationale en faveur des pays pauvres en général et des pays africains en particulier. Cette politique s'est notamment traduite par l'engagement solennel et répété d'atteindre en 2015 un taux d'effort de 0,7% du RNB conformément aux engagements de Monterrey de 2002.
Or dix ans après, comme le souligne le dernier rapport de l'OCDE sur l'aide française : « La France reconnaît qu'elle n'atteindra pas l'objectif d'allouer 0,7% du revenu national brut (RNB) à l'aide publique au développement (APD) d'ici 2015 » 40 ( * ) faute d'avoir défini une trajectoire budgétaire crédible à l'instar de la Grande-Bretagne, qui semble pouvoir atteindre cet objectif avec une aide composée à plus de 90% de dons.
Cette diminution de fait de l'aide au développement n'a pas empêché la France, quelle que soit la majorité au pouvoir, de multiplier les engagements financiers à l'égard de l'Afrique sans toujours se soucier de leur cohérence et de leur soutenabilité pour des finances publiques de plus en plus en difficulté.
pour l'
|
eau et assainissement en Méditerranée |
|
|
Scolariser 8 millions d'enfants en Afrique d'ici 2010, et tous les enfants d'ici 201545 ( * ) |
pour l'initiative de
|
200 M€ / an consacrés à la biodiversité à partir de 2012, puis 500 M € /an à partir de 201450 ( * ) |
Certains de ces engagements font l'objet d'un suivi méthodique, d'autres non. Certains ont été honorés, d'autres non.
La diminution des moyens de la coopération n'a pas empêché une surenchère d'engagements à l'égard de l'Afrique qui a nui à la crédibilité de la parole de la France
Lors de l'adoption du Consensus européen sur le développement en 2005, la France a promis qu'un accroissement de 50% de l'aide de l'Union européenne d'ici 2010 devait aller à l'Afrique et s'est engagée à un doublement de son APD vers ce continent.
A l'occasion du sommet France-Royaume-Uni en mars 2008, l'engagement a été pris de construire un nouveau partenariat pour scolariser dans le primaire 16 millions d'enfants africains d'ici 2010 (la moitié pour la France, soit 8 millions d'enfants, et l'autre pour la Grande-Bretagne) et tous les enfants d'ici 2015. Les deux États se sont aussi engagés à travailler -avec d'autres pays- pour recruter et former 3,8 millions d'enseignants supplémentaires nécessaires pour atteindre l'objectif de l'éducation primaire universelle en Afrique subsaharienne en 2015.
D'après les informations communiquées à la commission des affaires étrangères du Sénat en 2012, si l'on estime à environ 100 dollars le coût de scolarisation d'un élève dans les pays en développement, on peut affirmer que la France, par son effort d'APD depuis l'accord Brown-Sarkozy pour les années 2008/2009, contribue, dans le monde, à la scolarisation d'un peu plus de 5 millions d'enfants sur les huit millions envisagés.
En revanche, l'engagement pris lors du discours du Cap en février 2008, que le total des engagements financiers français bilatéraux pour l'Afrique subsaharienne s'élèverait à 10 milliards d'euros sur les cinq prochaines années serait en passe d'être honoré. Avec 2,27 Mds € en faveur du secteur privé en Afrique subsaharienne à fin 2012, le Groupe AFD a atteint près de 90% de la cible qui lui a été fixée. Sur la période 2008-2012, l'activité cumulée du groupe AFD devrait permettre de dépasser l'objectif fixé de 10 milliards d'euros.
A l'occasion du sommet d'Heiligendamm (2007), puis du sommet de Toyako (2008), les pays du G8 se sont engagés à consacrer 60 milliards de dollars, au cours des cinq prochaines années, à la santé en Afrique. Le Président Sarkozy y a alors précisé que la France y consacrerait pour sa part un milliard de dollars par an. Le total s'élevait ainsi, en 2009, à plus de 1 110 millions de dollars. L'objectif serait donc atteint.
Dans certains cas, on peinerait à mesurer, après quelques mois, la traduction concrète de ces engagements, qui ne font en général l'objet d'aucune affectation financière véritablement nouvelle. Toute nouvelle « annonce » internationale s'appuie sur le recyclage d'une aide limitée, non extensible, et déjà promise plusieurs fois.
Les décisions d'aide aux pays en crise se traduisent régulièrement par une simple réallocation des subventions en principe destinées aux pays les plus pauvres d'Afrique pourtant eux-mêmes déclarés « prioritaires », voire par l'annonce en grande pompe des sommes prévues avant les crises auxquelles ces promesses, comprises à tort comme additionnelles, sont censées remédier.
Ces effets d'annonce ont nui à la crédibilité de la parole de la France en Afrique et à la cohérence de l'action menée.
Dans un contexte où les subventions bilatérales pour l'Afrique avaient déjà atteint un étiage jamais constaté depuis plus de 30 ans, on conçoit bien la difficulté de conduire une politique dans la durée dans ces pays pourtant annoncée comme prioritaires quand les mêmes priorités changent en fonction des dernières annonces.
A privilégier la visibilité sur la cohérence, la politique de coopération française a perdu en Afrique une partie de son crédit.
a) Une priorité africaine problématique au regard des moyens en subventions
Au terme de la dernière décennie, comme le souligne le Bilan évaluatif de la politique française de coopération au développement entre 1998 et 2010 effectué par le cabinet Ernst and Young à la demande du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de l'Economie et des Finances et de l'Agence française de Développement : « Le respect de la priorité africaine apparaît problématique ».
Le Bilan évaluatif estime que « le respect de la priorité africaine pose la question en termes d'adéquation entre les instruments mobilisés et la recherche de concentration vers les pays pauvres prioritaires. L'effet conjugué du maintien de la priorité à l'Afrique subsaharienne et de la baisse importante de l'enveloppe de crédits de subvention alloués à l'AFD oblige à un recours croissant à l'instrument de prêts dans cette zone ».
Pendant que le total des prêts comptabilisés dans la déclaration d'APD de la France à l'OCDE a été multiplié par près de trois, entre 2005 et 2009, passant de 14 % des engagements bilatéraux annuels en 2005 à 40 %, les subventions aux pays prioritaires ont diminué de presque 30% comme l'illustre ce tableau issu du DPT pour 2013.
Subventions aux pays prioritaires
|
Pays pauvres prioritaires |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Subventions |
271 |
246 |
243 |
205 |
182 |
2010 |
220 |
Or, à l'exception du Ghana anglophone pour lequel la plupart des engagements sont opérés sous forme de prêts, les autres pays pauvres prioritaires de la coopération française sortent d'un processus de désendettement et sont inéligibles aux prêts, conduisant à réorienter l'aide française, accordée sous forme de prêts, vers des pays africains « non prioritaires », tels que l'Afrique du Sud ou le Kenya.
Pour l'OCDE qui vient de procéder à une revue de la coopération française souligne : « La baisse des dons, en valeur absolue et relative, menace sérieusement la capacité d'intervention de la France dans les pays pauvres ».
L'Afrique dans sa globalité reste en part relative la priorité de la coopération française. Mais sa capacité d'agir dans ce qu'elle a défini comme son coeur de cible, c'est-à-dire l'Afrique pauvre francophone, est mis à mal.
Ainsi, la part de l'effort financier de l'État consacrée à l'Afrique subsaharienne s'est élevée à 60% en 2010 et 77% en 2011, en nette hausse par rapport à 2009 (57%) et 2008 (54%). La France a donc largement atteint l'objectif de 60% cité dans le Document-cadre. De même, la part des subventions allouées aux 14 pays prioritaires d'Afrique subsaharienne a atteint 47% en 2011, légèrement en deçà de l'objectif cible de 50%.
La France n'a pas par ailleurs, même en part relative, atteint l'objectif d'allouer les deux tiers de son aide à l'Afrique qu'elle s'était fixé il y a plus de dix ans et si elle est présente dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, seuls 7 pays africains comptent parmi les 20 premiers récipiendaires de l'APD bilatérale française.
Mais surtout la part de l'APD bilatérale nette destinée aux pays pauvres prioritaires est faible et en diminution : 15% de l'APD nette en 2008, 11,5% en 2009, 11% en 2010 et moins de 10% en 2011 (hors allègement de dettes).
La France ne consacre que 10% de son aide aux pays pauvres prioritaires d'Afrique francophone
Le sentiment de décalage entre nos ambitions et nos moyens vient sans doute de ce chiffre : 200 millions de subventions pour 17 pays prioritaires revient à consacrer en moyenne un peu plus de 10 millions d'euros de subvention par an à chaque pays et ce, alors même que nous affichons une aide au développement d'un montant supérieur à 10 milliards d'euros.
Comme le soulignait la revue à mi-parcours de l'aide au développement française par le CAD, il y a une contradiction entre les objectifs de la coopération française et l'évolution des dons de plus en plus préoccupante : « Les cinq secteurs sur lesquels la France veut se concentrer, d'après la décision du CICID, sont des secteurs dont la plupart sont susceptibles d'être appuyés par des dons, et ne se prêtent pas facilement aux prêts, puisqu'ils ne sont pas des secteurs productifs. Pourtant, la France a réduit ses dons. Ceci pose un défi pour la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la France et le ciblage sur les PMA en Afrique qu'elle a proposé. »
M. Serge Michailof, consultant international, enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien directeur régional à la Banque mondiale, a estimé devant la commission que « nous sommes sans moyens d'action effectifs pour répondre à nos préoccupations propres, qu'il s'agisse d'intervenir dans des pays pauvres où nous avons des enjeux géopolitiques, comme ceux du Sahel, ou sur des thématiques importantes, comme le développement rural pour lequel nous avons une expertise ancienne avérée ».
Il s'agit moins d'interroger le volume global du budget de l'aide au développement qui est relativement stable, que de s'inquiéter de voir que sur une mission de 3,5 milliards d'euros, l'allocation des ressources soit à ce point en contradiction avec les priorités.
Ce constat a été confirmé par les travaux du bilan évaluatif de la politique de coopération française au développement entre 1998 et 2010 « au-delà des objectifs en termes de moyens, le respect de la priorité africaine pose questions en termes d'adéquation entre les instruments mobilisés et la recherche de concentration vers les pays pauvres prioritaires retenus dans le document-cadre (DCCD). »
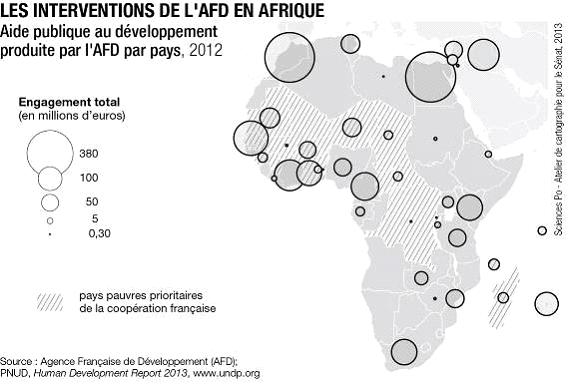
On le constate sur cette carte, les interventions les plus limitées sont celles qui concernent les pays prioritaires où l'AFD ne peut intervenir que sous forme de subventions. Or les subventions dont bénéficie l'AFD de la part du ministère des affaires étrangères ont diminué de plus de 30 % depuis 2006.
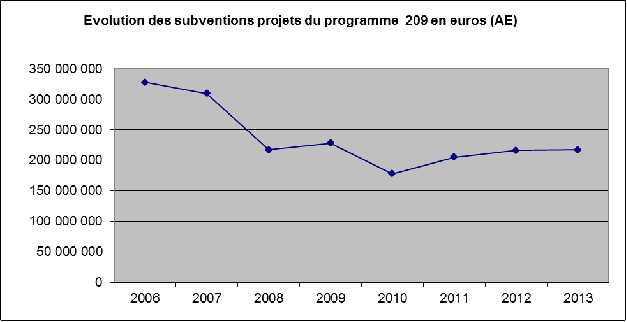
La faiblesse des subventions limite les interventions sur les thématiques prioritaires reliées aux OMD, telles que la santé, l'éducation ou le développement rural, qui, même si ces pays étaient en mesure de contracter des emprunts souverains, se prêtent mal aux prêts, même concessionnels.
Comme ont pu le constater les rapporteurs du budget de l'aide au développement de la commission des affaires étrangères du Sénat lors de leur mission au Mali et à Madagascar, le visage de la coopération française dans l'Afrique francophone s'en trouve considérablement modifié 52 ( * ) « La France conserve une forte intimité avec ces pays et possède encore une expertise et une capacité reconnues d'entraîner les autres bailleurs de fonds, mais elle n'est plus, loin s'en faut, ni le seul, ni le premier bailleur de fonds d'une Afrique francophone courtisée aussi bien par les autres membres de l'OCDE que par les pays émergents. ».
Pour limiter les effets de ce qui a été perçu comme une banalisation de la place de l'Afrique dans la coopération française, les responsables politiques n'ont cessé de renforcer les objectifs de concentration sur l'Afrique des subventions et de l'effort budgétaire de l'Etat.
Dès 2004, le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement (CICID) a indiqué que « la France souhaite maintenir la part prépondérante de l'Afrique (deux tiers environ de notre aide bilatérale) et augmenter la part consacrée aux PMA, en vue d'atteindre en 2012 l'objectif des Nations unies de 0,15% du PIB ». En 2009, le même CICID a décidé que « l'Afrique subsaharienne se verra allouer 60% des ressources budgétaires de l'aide. En 2011, le Document cadre prévoit 60% des ressources budgétaires de l'aide pour l'Afrique et 20% pour la Méditerranée et 50% des subventions aux pays prioritaires ». En juillet 2013, le dernier CICID décide de consacrer la « Priorité à l'Afrique et à la Méditerranée : Le Gouvernement décide de consacrer au moins 85% de l'effort financier de l'État en faveur du développement en Afrique subsaharienne et dans les pays voisins du Sud et de l'Est de la Méditerranée. »
Jusqu'à présent, l'augmentation du taux de concentration n'a pas pu empêcher la diminution des moyens en valeur absolue.
La coopération bilatérale française dans les pays prioritaires représente aujourd'hui environ dix millions d'euros par an et par pays.
Sur une aide publique au développement déclarée, estimée à près de dix milliards d'euros par an, dix millions d'euros par an pour un pays prioritaire, c'est un millième par pays, autrement dit, pour le moins, une priorité relative.
Ce n'est pas vrai que la France continue en matière de coopération d'avoir les ambitions des Etats-Unis avec le budget du Danemark, mais il faut reconnaître que la coopération française manque de moyens pour maintenir sa place dans l'Afrique francophone.
b) Une progression des activités de l'AFD dans les pays anglophones bridée par l'insuffisance des fonds propres.
Dans les pays anglophones comme l'Afrique du Sud ou le Kenya, la présence française est en grande partie assurée par l'AFD qui mène des actions de coopération à travers des prêts faiblement bonifiés. La progression des activités de l'AFD dans cette partie de l'Afrique a permis à la France d'être présente dans cette partie dynamique de l'Afrique. Cette progression risque toutefois d'être contrainte par les problèmes de fonds propres que rencontre l'AFD. Nous avons constaté en Afrique du Sud que l'agence ne pouvait plus développer de nouveaux projets en raison du ratio grand risque qu'elle avait atteint sur ce pays. Sans un renforcement de ses fonds propres, l'activité de prêts de l'AFD va se trouver assez rapidement saturée dans certains pays stratégiques.
Une aide bilatérale dont les moyens financiers ne sont plus crédibles dans les pays francophones les moins avancés.
c) Un déséquilibre croissant entre aide multilatérale et aide bilatérale
Les contributions françaises aux organisations multilatérales (le FED, la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement) améliorent la donne en matière de montants affectés et permettent d'avoir une vision plus positive de notre contribution à la coopération avec l'Afrique.
La part de l'aide au développement française programmable qui transite par les instances multilatérales et européennes est en effet passée de moins de 30% en 1990 à plus de 50% à partir des années 2000. De fait la majorité des dons français à l'Afrique transite aujourd'hui par les instances multilatérales et communautaires.
La France a ainsi accompagné la montée en puissance des grandes banques multilatérales et régionales, telle que la Banque mondiale qu'elle finance à hauteur de plus de 400 millions d'euros par an, afin d'orienter leur programmation vers les zones prioritaires de la France et en particulier vers l'Afrique subsaharienne.
Elle a également promu le développement d'une politique de coopération européenne à travers le FED, auquel la France contribue pour plus de 800 millions d'euros par an. Elle a enfin été à l'initiative de la mise en place de nouveaux instruments comme le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, auquel elle contribue désormais à hauteur de 360 millions d'euros par an, soit, depuis sa création, une contribution de près de 3 milliards d'euros.
La montée en puissance du multilatéralisme a sa légitimité mais pose un problème de visibilité.
La montée en puissance du multilatéralisme a sa cohérence en termes de développement du continent africain. Elle contribue sur le long terme à la mise en place de politiques globales à l'échelle continentale grâce à des institutions qui ont une légitimité, une relative neutralité politique, des compétences et des capacités financières sans commune mesure avec les institutions nationales.
Elle correspond au niveau européen à la tentative de faire émerger une politique européenne de développement qui puisse être le cadre d'une complémentarité et d'une synergie des politiques de coopération des États membres et de la Commission.
Encore faut-il que l'augmentation de nos concours à ces organisations se traduise par une vision claire de leur rôle, et un investissement dans leur pilotage proportionné aux moyens qui y sont investis. C'est loin d'être toujours le cas.
Cette évolution, pour souhaitable qu'elle soit, a pour contrepartie une moindre visibilité de la France en Afrique.
L'engagement de la France dans l'aide européenne et multilatérale a pour contrepartie une moindre visibilité de la France en Afrique
Le sentiment de décalage entre les ambitions affichées par la France pour l'Afrique et les moyens constatés sur le terrain s'explique-t-il en partie par la faible visibilité de ces contributions aux institutions multilatérales ?
On l'a vu à Abidjan, au Mali et à Madagascar, les crédits que la France attribue aux organisations multilatérales, que cela soit la Banque mondiale, le Fonds européen de développement ou à la Banque africaine de développement, ne sont pas perçus par nos partenaires comme étant aussi une contribution française.
Rarement, voire jamais, lors de l'inauguration de projets financés par la Banque mondiale ou par un opérateur communautaire, il n'est rappelé que ces institutions sont financées par des contributions nationales et que la contribution de la France est parmi les plus importantes.
Le choix du multilatéral qui a été fait pendant de nombreuses années s'est donc mécaniquement traduit par une moindre lisibilité de la France dans les projets de coopération.
Le graphique suivant illustre aisément, dans un pays comme le Mali qui peut être considéré comme un pays emblématique de l'Afrique subsaharienne, la diminution, au cours des dix dernières années, de l'APD bilatérale française et l'augmentation parallèle des crédits multilatéraux que l'on peut imputer à la France au regard de ses contributions aux différentes institutions multilatérales.
On constate alors que l'effort global de la France au Mali augmente de 2002 à 2009. Malgré cela, la perception que les acteurs locaux peuvent avoir de cette aide est en diminution, car la seule aide visible, c'est-à-dire l'aide bilatérale, est elle-même en diminution.
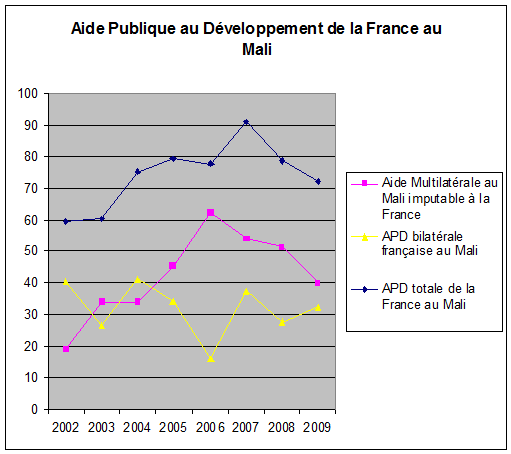
Source OCDE chiffre hors allégement de dette en millions de dollars US
Le cas du Mali est à l'image des 14 pays prioritaires.
Dans l'ensemble des pays prioritaires, l'aide multilatérale imputable à la France est égale à l'aide bilatérale et trois fois supérieure aux subventions.
Répartition des instruments d'APD par zones d'intervention (DPT 2013)
|
APD nette, en millions d'euros dans les 14 pays prioritaires. |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Aide multilatérale imputée |
418 |
352 |
425 |
556 |
619 |
|
APD bilatérale totale nette |
814 |
787 |
710 |
592 |
643 |
|
Subventions. |
271 |
246 |
243 |
205 |
199 |
Ces contributions multilatérales pourraient être efficaces et visibles pour la France à condition d'avoir un certain leadership sur le terrain, ce que la réduction des moyens bilatéraux permet de moins en moins.
d) La coopération technique en Afrique, un instrument sacrifié
Si, dès les indépendances, l'aide française s'est donnée une priorité de renforcement des capacités de ses partenaires du Sud avec les assistants techniques et la politique de formation des élites, les réformes successives de l'appareil français de coopération ont entraîné un déclin du déploiement des assistants techniques sans que la politique de coopération technique n'ait fait l'objet d'un nouveau cadrage stratégique, en réponse aux évolutions des besoins des zones d'intervention et des modes opératoires de l'aide.
Non seulement, la présence de nos coopérants, qui a été une des marques de fabrique de la France, est en constante diminution, mais la gestion de l'expertise et de la coopération technique française en Afrique est éclatée entre de nombreux organismes, avec des moyens en diminution et sans stratégie commune.
De fait, la France qui possédait une forte tradition et une forte expérience en matière de renforcement des capacités, institutionnelles et humaines, est de moins en moins présente dans ce domaine pourtant essentiel par rapport à des pays comme l'Allemagne qui en a fait une véritable priorité.
En 1979, les effectifs des assistants techniques s'élevaient à environ 10 976 pour n'atteindre plus que 967 en 2011, soit une division par plus de 10 des effectifs.
Évolution des effectifs d'assistance technique de 1990 à 2011
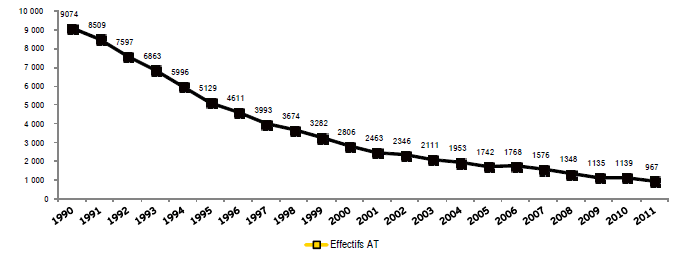
Dans les années 2000, la France a réduit son dispositif public à l'étranger.
Le recours à l'expertise technique française en Afrique a pris des formes variées avec cependant deux grandes catégories :
- l'assistance technique à moyen-long terme, aussi connue comme « résidentielle », avec la mise à disposition d'agents d'État ou de contractuels par l'État français pour de l'appui aux administrations et le renforcement des capacités locales,
- l'expertise technique de courte durée mise en oeuvre par une multiplicité d'opérateurs privés ou publics sur des marchés ouverts à la concurrence.
L'assistance technique « résidentielle » qui a longtemps été considérée comme une force de la politique de coopération française, tant pour le développement que pour sa visibilité et son influence, a aujourd'hui considérablement diminué.
L'assistant technique français en Afrique : une catégorie en voie de disparition
Sur l'ensemble de la période de 1990 à nos jours, la diminution des effectifs s'explique principalement par l'abandon progressif de la coopération de substitution mise en place dans les années 1960 avec la mise à disposition permanente d'experts techniques, dont une grande partie d'enseignants, auprès de gouvernements ou d'institutions étrangères dans le monde.
Cette évolution correspond à la fois à la volonté politique de mettre fin à un système d'assistance permanente trente ans après les indépendances et à la prise en compte de contraintes budgétaires.
Il s'agissait de rompre avec un système hérité de la période coloniale et de réduire le coût lié au financement d'un personnel permanent, installé auprès des autorités de pays partenaires qui ont eu le temps de se constituer des élites administratives.
Une fois les gros bataillons d'experts techniques supprimés, les suppressions ont eu pour cause la contribution aux contraintes imposées par la Révision générale des politiques publiques (RGPP) ainsi qu'à l'abandon de projets dont les financements n'étaient plus assurés.
Parallèlement, la responsabilité d'une partie des assistants techniques qui relevaient du ministère des affaires étrangères, dans les secteurs de l'éducation et de la santé notamment, a été transférée à l'Agence française de développement. Le ministère a, quant à lui, conservé la gestion des assistants liés à la gouvernance.
Le recours à l'expertise technique est cependant désormais majoritairement conçu comme des missions temporaires d'experts à haute valeur ajoutée, placés en position de conseillers auprès de décideurs locaux ou affectés à des fonctions d'animation dans le cadre de projets de développement.
La quasi-disparition des assistants techniques dans certains pays et secteurs a fait perdre à la France un atout précieux pour la coopération au développement aussi bien en matière d'efficacité que d'influence. Elle est regrettée par l'ensemble des acteurs sur le terrain.
La récente évaluation de la Cour des comptes sur l'aide au développement 53 ( * ) cite de nombreux témoignages allant dans ce sens.
L'ambassade au Sénégal estimait ainsi que « le dispositif d'assistance technique géré par le Département est très apprécié tant par les administrations sénégalaises que par les partenaires techniques et financiers, en particulier multilatéraux ».
Leur présence se révèle même de nature à renforcer les actions multilatérales, comme au Togo, où, selon l'ambassade, « de nombreux projets européens seraient incapables d'atteindre les objectifs fixés s'ils n'étaient pas appuyés, voire directement mis en oeuvre par l'assistance technique française ».
De même, l'Inspection générale des affaires étrangères pouvait-elle constater, en mai 2009, dans un des pays pauvres prioritaires du Sahel : « La baisse continue des crédits de coopération conjuguée à la fermeture des postes d'assistance technique qui sont comptabilisés dans les équivalents temps plein (ETP) sous plafond dont il convient de réduire le nombre, alors même que leur présence dans ce pays est une action de coopération en soi, finira par rendre notre pays inaudible dans ce pays » 54 ( * ) .
Avec moins de 400 assistants techniques en Afrique subsaharienne, la France y dispose aujourd'hui de moins d'agents que l'Allemagne, dont l'opérateur technique GIZ déploie 1 350 experts expatriés et 11 240 experts nationaux.
C'est pourquoi la commission des affaires étrangères du Sénat considère, depuis plusieurs années, que la France a été trop loin et a sacrifié un instrument de coopération précieux dont l'influence et l'intérêt économique sont pourtant reconnus 55 ( * ) .
Il est vrai que d'autres acteurs ou d'autres modalités de renforcement des capacités des pays africains ont pris le relais.
De très nombreuses collectivités locales ont développé une coopération internationale, parfois à base de projets classiques, mais principalement en mobilisant leurs compétences internes pour appuyer leurs homologues. Des lois autorisent même de prélever jusqu'à 1% du budget des services d'eau, d'assainissement pour mener des actions de coopération avec les collectivités étrangères.
Par ailleurs, l'action des opérateurs de coopération inclut pour sa part des actions de renforcement des capacités, soit dans les modalités de mise en oeuvre, soit en accompagnement de celle-ci. Les financements de l'AFD sont entièrement mis en oeuvre par les bénéficiaires, mais l'Agence assure un dialogue régulier avec les maîtrises d'ouvrage locales et leur apporte une expertise pour leur permettre de faire face aux difficultés pratiques qu'elles rencontrent. Des appuis budgétaires sont généralement accompagnés de mesures de renforcement des capacités
La France est fortement impliquée dans le renforcement des capacités commerciales, pour lequel elle a élaboré un plan spécifique qui associe des contributions multilatérales et un programme bilatéral spécifique, le Programme de renforcement des capacités commerciales (PRCC). L'appui porte à la fois sur la capacité des pays à mieux assimiler les règles qui régissent les échanges internationaux et sur l'amélioration effective de leurs performances à l'exportation. Cela se traduit par des prestations d'assistance technique, de formation et de sensibilisation ; des études sectorielles ou de faisabilité ; voire par le financement de petits matériels ou d'équipements pédagogiques.
Globalement, les moyens pour financer des études ou des prestations d'expertises sont très limités faute de ligne budgétaire bien identifiée, d'acteurs suffisamment légitimes et de stratégies. Pour l'Afrique, l'AFD dispose, avec les ressources du Programme 209 du ministère des affaires étrangères, de crédits d'intervention permettant de financer ce type d'activités. Mais le niveau des subventions allouées par l'Etat à l'AFD et Ia compétition sur son usage entre financement d'investissement et d'accompagnement, notamment dans les pays où I'AFD n'est pas autorisée à prêter, ne permettent pas de répondre à l'ensemble des besoins dans les pays prioritaires d'Afrique Subsaharienne.
La politique de promotion de l'expertise technique passe enfin également aujourd'hui par les opérateurs français publics et privés sur les marchés internationaux d'expertise financés par l'aide multilatérale à laquelle la France contribue largement.
La présence croissante des bailleurs de fonds multilatéraux sur les « marchés » de l'expertise entraîne une demande fondée sur des appels d'offres internationaux, notamment de la Banque mondiale et des fonds communautaires.
Dans ce contexte, la promotion des opérateurs français sur les marchés internationaux constitue une manière de chercher des financements pour pallier la faiblesse des crédits bilatéraux et un retour sur investissement de la part des organisations multilatérales financées par la France.
Or ces opérateurs sont en France nombreux et divisé. Chaque ministère ou presque a, en effet, mis en place un opérateur « métier », pour promouvoir à l'international ses expertises propres, auquel s'ajoute, selon les secteurs, des opérateurs privés.
Comme l'a constaté notre collègue Jacques Berthou dans un récent rapport d'information : « Pour une « équipe France » de l'expertise à l'international » 56 ( * ) la France ne s'est pas dotée d'instruments suffisants pour fédérer ses opérateurs publics afin de faire face à la concurrence internationale en matière d'expertise.
La multiplicité des opérateurs, leur faible taille critique, l'hétérogénéité des modèles économiques pour des métiers pourtant proches, l'hétérogénéité des résultats et des performances, l'absence d'une véritable stratégie commune et les conflits de rôles potentiels ou avérés, semblent conduire à une concurrence stérile et à des réflexes corporatistes nuisibles au rayonnement de l'expertise française en Afrique.
Il existe, en effet, une trentaine d'opérateurs publics d'expertise à l'international, des « opérateurs métiers » (proches des viviers d'expertise) et un opérateur généraliste (FEI). Le volume d'activité cumulé annuel s'élève à environ 80 millions d'euros dont 60 millions d'euros proviennent des 3 plus grosses structures (FEI, ADETEF et CIVIPOL).
Cette situation résulte, d'une part, d'un choix politique, au moment de la réforme de 1998, de ne pas se doter d'un opérateur public dominant qui aurait pu permettre de développer les synergies entre aide bilatérale et expertise technique internationale et, d'autre part, de l'existence d'« expertises métiers » découlant d'une succession de décisions « individuelles » des administrations à s'investir à l'international.
L'État ne semble jouer, ni le rôle d'arbitre, ni le rôle de pilote. Il laisse chaque administration défendre son pré carré, sans d'ailleurs toujours en définir les limites, sans feuille de route commune, sans indicateur cohérent, sans économie d'échelle et avec ce qui peut apparaître, de plus en plus, comme un saupoudrage des moyens publics.
Cette organisation entraîne de véritables difficultés à se positionner sur les appels d'offres internationaux en l'absence de taille critique qui permette une maîtrise des procédures et une capacité de veille suffisante.
À cela s'ajoutent des difficultés à mobiliser le potentiel humain : malgré la proximité affichée des « viviers d'expertise », les opérateurs publics dans leur majorité sont confrontés à la réticence accrue des administrations à mettre à disposition leurs experts, du fait des restrictions en personnel, à des viviers au périmètre restreint à la fonction publique d'État et à l'absence d'une valorisation de l'expérience internationale dans le déroulé de carrière des experts.
Elle contraste avec celle rencontrée en Grande-Bretagne ou en Allemagne où cette compétence revient à un opérateur dominant, le Dfid ou la GIZ, bénéficiant d'un budget conséquent et d'effectifs beaucoup plus importants.
Alors que la France était une référence en matière d'expertise technique, ce recul pénalise notre influence sur les choix politiques d'États africains en pleine transformation.
5. Un dispositif militaire inadapté
Depuis une vingtaine d'années, la multilatéralisation, la régionalisation et l'« africanisation » des dispositifs de sécurité français avaient vocation à répondre aux enjeux futurs du continent africain.
Le bilan est aujourd'hui mitigé.
La crise malienne comme la situation dramatique en RCA montrent la faiblesse des capacités africaines ou internationale à agir en premier pour éviter le pire.
La France se voit contrainte d'agir et ce faisant de maintenir une présence militaire forte.
La sédimentation de nos interventions qui de temporaires deviennent souvent permanentes conduit malgré la réduction continue des effectifs à un dispositif lourd, coûteux et pas toujours bien articulé ni avec la défense de nos intérêts, ni avec notre stratégie d'africanisation.
a) Une diminution de la présence militaire française en Afrique continue
Le désengagement de la France en Afrique a été assumé et organisé. Il devait être progressivement compensé par la montée en puissance des armées africaines.
La décrue des effectifs des militaires prépositionnés de 70% depuis 1990 et sa division par dix depuis 1960 répondaient à cette logique en même temps qu'à la réforme des armées française, avec la professionnalisation puis la réduction de leur format en cours.
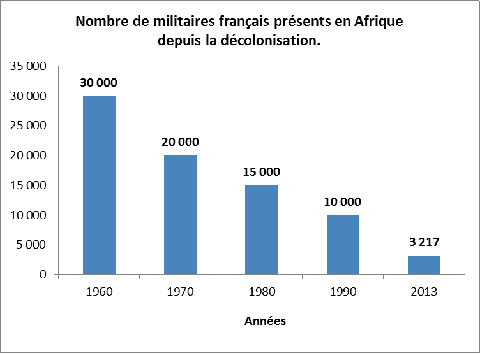
Le nombre de militaires français prépositionnés en Afrique est ainsi passé de 30 000 hommes dans les années 1960 à seulement 3 200 à la fin des années 2000 sur le sol africain avec une remontée temporaire pour l'opération SERVAL.
Le Livre blanc de 2008 entendait accentuer le rythme de cette réduction et prévoyait une diminution des effectifs prépositionnés de 28% des effectifs français sur le continent dans un souci d'économie, mais aussi avec la volonté affichée de laisser aux Africains la gestion de leurs problèmes.
Une attrition de la présence militaire en Afrique, qui n'a pas totalement été mise en oeuvre et qui n'aurait d'ailleurs sans doute pas permis, si elle avait été menée à terme, d'intervenir au Mali dans les mêmes conditions.
En 2008, le Livre blanc sur la défense nationale indiquait clairement : « La France n'a pas vocation à être militairement présente en permanence sur les mêmes bases. (...) La France procédera donc à la conversion progressive de ses implantations anciennes en Afrique, en réorganisant ses moyens autour, à terme, de deux pôles à dominante logistique, de coopération et d'instruction, un pour chaque façade, atlantique et orientale, du continent, tout en préservant une capacité de prévention dans la zone sahélienne. ».
Ne devaient donc être conservés que le Gabon et Djibouti, avec une allusion sans doute au Tchad via la mention de la zone sahélienne.
La création, en marge du Livre blanc, de la base des Émirats Arabes Unis, ainsi que le maintien, vu les circonstances, d'opérations plus anciennes n'ont pourtant pas empêché le mouvement de décrue significative de se poursuivre.
Cette stratégie était relayée au plus haut niveau de l'État. Au Cap, il y a cinq ans, le Président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, affirmait ainsi : « Je propose que la présence militaire française en Afrique serve en priorité à aider l'Afrique à bâtir, comme elle en a l'ambition, son propre dispositif de sécurité collective. L'Union africaine souhaite disposer de forces en attente à l'horizon 2010 - 2012 ? Que cet objectif soit aussi celui de la France ! La France n'a pas vocation à maintenir indéfiniment des forces armées en Afrique. Il ne s'agit pas d'un désengagement de la France en Afrique. Je souhaite au contraire que la France s'engage davantage aux côtés de l'Union africaine pour construire le système de sécurité collective dont l'Afrique a besoin car la sécurité de l'Afrique c'est d'abord naturellement l'affaire des Africains. ».
« Poursuivre la décrue pour responsabiliser les systèmes de sécurité collectif africains ? »
Son successeur, François Hollande, ne dit pas autre chose, même si l'opération SERVAL a conduit à infléchir le discours.
Le Livre blanc 2013 poursuit donc naturellement la même logique. Il insiste sur l'importance de l'Afrique d'un point de vue économique et sécuritaire, mais n'annonce aucun infléchissement quant à la décrue.
Au contraire, il indique, dans des termes choisis, la poursuite de la réduction : « S'agissant de l'Afrique, une conversion de ces implantations sera réalisée afin de disposer de capacités réactives et flexibles, à même de s'adapter aux réalités et besoins à venir du continent. Cette évolution devra notamment privilégier une meilleure contribution de nos forces, à l'assistance à nos alliés, à la capacité des Africains à gérer eux-mêmes les crises que le continent traverse, au renseignement et à la lutte contre les trafics et le terrorisme. ».
Le document n'avance aucun chiffre précis, non plus qu'il ne précise en quoi consistera la « ré articulation » des points d'appui en Afrique.
Le chef d'état-major des armées, l'Amiral GUILLAUD, commentait récemment en termes positifs cet état de fait : « Le Livre blanc prend acte de cette nécessité de conserver plusieurs points d'appui en Afrique, sans indiquer combien, de façon à laisser assez de souplesse pour que nous puissions nous déployer aux endroits nécessaires. ».
La loi de programmation en cours de discussion indique quant à elle indique quant à elle aucune indication stratégique sinon une réduction des forces prépositionnées et de souveraineté de 1 100 postes.
Le retrait progressif des troupes françaises correspond en réalité avant tout aux contraintes budgétaires et à ce qui apparaît alors comme une possibilité opérationnelle de minimiser l'empreinte et l'exposition au sol des soldats français en cas de crise.
D'un point de vue budgétaire, la diminution de la présence française en Afrique est une déclinaison homothétique de la réduction du format des armées qui est elle-même la conséquence de la réduction de l'effort de défense de la France sur une longue période comme l'illustre le graphique suivant.
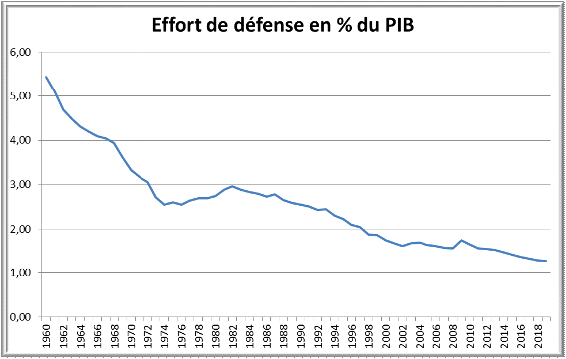
Si on prend en compte les hypothèses de la prochaine loi de programmation, l'armée française verra ses effectifs diminuer de 82 000 militaires de 2008 à 2019.
Il est dès lors naturel que les forces prépositionnées participent à cette réduction du format.
D'un point de vue opérationnel, la réduction de l'empreinte au sol correspond, par ailleurs, à l'espoir que les crises à venir ne nécessiteront que des interventions exclusivement aériennes, à l'image de l'opération HARMATTAN en Libye, qui minimise l'exposition au sol et le risque de pertes difficilement supportables pour des opinions publiques « fatiguées » des interventions extérieures. S'ajoute à cela l'idée qu'une fois rétablies nos capacités de transport de troupes et de matériel avec le futur A400M, les bases prépositionnées puissent être reconfigurées de façon à n'être plus que des points d'accueil avec éventuellement des dépôts de matériel lourd.
La crise malienne et l'opération SERVAL, sans remettre en cause l'évolution historique à terme vers un retrait de la présence militaire française en Afrique, ni la possibilité d'avoir une présence plus légère et plus flexible, en modifient selon nous le calendrier pour plusieurs raisons.
Au regard de l'européanisation et de l'africanisation de la présence militaire française, la crise malienne aura servi de révélateur.
Voilà une crise douloureuse et dévastatrice pour un pays et une population qui souffraient déjà d'un sous-développement chronique, un conflit qui a conduit le Mali, jadis présenté comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest et une vitrine de la coopération civile et militaire française, au bord du gouffre, une expérience qui doit nous faire réfléchir sur l'efficacité de notre coopération et la pertinence des choix stratégiques effectués ces dernières années.
Car comme l'a fait observer le rapport d'information présenté par Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher consacré au Sahel, le succès des forces armées et de la diplomatie française dans la gestion de la crise malienne ne doit pas faire oublier la nécessité d'en tirer des enseignements et de comprendre les causes profondes d'un conflit qu'on n'a pas vu venir et pas su empêcher.
Malgré des millions d'euros et de dollars investis par la France et les États-Unis dans la formation des militaires maliens, les colonnes de pick-up des mouvements djihadistes ont trouvé devant eux une armée sans unité organique, ni chaîne de commandement : « 62 généraux pour un effectif théorique de 12 000 hommes, dont pas plus de 3 000 n'auraient réellement pu être alignés sur le terrain, avec une capacité opérationnelle variable. » 57 ( * )
Toutes les armées africaines ne sont pas à cette image. Elles sont dans des situations très contrastées, avec des carences nombreuses et communes, et parfois des performances tout à fait édifiantes comme en témoigne notamment l'engagement des forces tchadiennes. Les difficultés des forces de sécurité africaines sont cependant réelles.
Le scénario selon lequel la sécurité de la région sahélienne pourrait être assurée avec une présence française minimale qui s'appuierait sur la coopération opérationnelle avec des forces africaines désormais aguerries n'est pas encore d'actualité.
A court terme, le Mali a montré que la relève africaine en matière de sécurité collective n'était pas encore assurée
Autrement dit : croire qu'on pourra « faire faire » pour compenser la réduction de format d'une armée en effectifs réduits qui risque d'être, demain, inférieure en effectifs à la RATP est pour nous une illusion, du moins à court terme. L'horizon reste inévitablement celui de la montée en puissance de forces régionales, par la formation, la coopération structurelle. Mais c'est un objectif de long terme.
La faible réactivité de la CEDEAO puis la difficile montée en puissance de la MISMA montrent les limites des capacités opérationnelles des forces régionales.
Au plan institutionnel, les efforts africains de maintien de la paix sont confrontés à la fragilité des organisations régionales et au déficit de coordination.
Certaines de ces structures restent des coquilles vides du fait d'un manque d'engagement à la fois financier, technique et politique des États membres, reflet d'un manque d'intérêt réel pour l'intégration régionale. Par ailleurs, la coordination est déficiente entre organisations régionales, tant avec l'organisation mère qu'entre les structures régionales. Les relations de travail de la CEEAC avec l'UA sont de qualité moyenne en raison des difficultés culturelles et linguistiques, l'essentiel du travail de l'UA se faisant en anglais et les concepts servant de soubassement à ses politiques venant du monde anglo-saxon. Une très faible communication entre la CEEAC à Libreville et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) à Bangui est également à déplorer.
Derrière ces difficultés, il y a une réalité politique difficilement contournable : le fait que les conflits et problèmes africains font rarement consensus à l'UA et dans les organisations régionales.
A titre d'illustration, la SADC a été très divisée sur la position à adopter vis-à-vis du régime autoritaire de Robert Mugabe; au sein de l'Initiative pour le bassin du Nil, le clivage entre les pays de l'aval (Égypte et Soudan) et tous les pays de l'amont réactivant l'hypothèse d'une future et probable guerre de l'eau , les contentieux et rivalités au sein des pays d'Afrique du Nord rendent, pour le moment, impossible la mise en place de la brigade régionale prévue dans l'architecture de paix et de sécurité ainsi qu'une solution régionale pour la sécurité du Sahel.
Pour l'instant, seule la France dispose d'une capacité d'entrée en premier sur ce type d'opération.
Les performances des armées françaises et ses points d'appui à Abidjan, Dakar, Ouagadougou et Niamey lui en donnent les moyens. Comme l'a souligné, M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie au ministère des affaires étrangères : « la France a de fait des responsabilités parce qu'elle a des moyens sur place. C'est l'existence de ces moyens qui crée la responsabilité et les demandes d'empire ».
Chacun reconnaît que si l'état-major de la CEDEAO a pu constituer un premier échelon de planification opérationnelle pour l'intervention militaire au Mali, ses capacités restent très légères et, en tout état de cause, inadaptées à la virulence de la menace.
Ce sont dans la plupart des cas des moyens français et occidentaux qui ont permis le déploiement des 6 000 soldats de la MISMA sur le sol malien. Ces troupes africaines ont pris progressivement le relais de nos forces pour assurer le contrôle des zones du nord, comme les contingents nigérien, sénégalais ou burkinabé à Ménaka, Gao ou Tombouctou.
Un des enjeux du transfert actuel de responsabilité de la France qui maintien au Mali 1 000 hommes et la MINUSMA est de savoir si nous pourrons bien réduire à terme notre présence.
Quant à l'Europe, l'absence de réaction commune lors de cette crise montre le chemin à parcourir pour mettre sur pieds une Europe de la défense qui soit le pendant d'une politique étrangère commune alors même que le Sahel est identifié depuis 2011 comme une zone prioritaire pour l'Union européenne.
Ce fut une occasion ratée pour l'Union européenne, même si le soutien des Britanniques, des Espagnols, des Allemands, des Néerlandais, et tout particulièrement des Belges et des Danois a été précieux d'un point de vue logistique. L'européanisation de la politique africaine de la France a encore de l'avenir devant elle !
L'Europe n'est pas restée inerte face à la crise malienne, puisque les autres États membres ont apporté : un soutien politique, une action de formation de l'armée malienne, une accélération de l'aide au développement.
Mais la génération de forces des 500 formateurs d'EUTM-Mali est éloquente : la France a fourni l'ensemble de l'analyse des besoins, presque la moitié du contingent et, faute d'obtenir de nos partenaires qu'ils assurent la tâche de protéger le camp de Koulikoro, il nous a encore fallu servir de « variable d'ajustement ». Sans une capacité d'intervention autonome de la France, l'Europe ne serait pas intervenue au Mali.
Quant aux considérations opérationnelles, il nous apparaîtrait, en outre, dangereux de céder à ce que MM. Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher appellent dans leur rapport sur la situation au Sahel la « tentation du hors-sol », qui consisterait à considérer que des capacités de transport stratégiques rendraient désormais caduque la nécessité de disposer d'une empreinte au sol à proximité des zones de crise, et particulièrement au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
D'abord, plus la réponse militaire est rapide, plus elle est efficace et surtout proportionnée. Plus l'intervention tarde, plus son niveau de violence et son coût sont élevés. Ce qu'on peut arrêter en jetant un verre d'eau, si l'on est à côté, exige de lourds moyens si on laisse le feu s'étendre.
Ensuite, seule la présence sur zone dans la durée permet la connaissance fine des hommes et du terrain propre à garantir le succès de l'action et, là encore, sa juste proportionnalité dans les moyens engagés.
Toute guerre commence et se termine au sol, même si le risque de l'enlisement doit toujours être pesé et circonscrit. C'est pourquoi avec des moyens de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus limités, la France doit laisser les stratégies contre-insurrectionnelles sur le terrain être menées par des forces autochtones de nos partenaires africains autant que possible.
La réalité, c'est que rien n'aurait été possible au Mali sans « Licorne » (450 personnes), sans « Épervier » (950 militaires), sans « Sabre » (forces spéciales).
Or aucun de ces dispositifs ne figure pourtant expressément au rang des bases prépositionnées du Livre blanc de 2008, qui ne prévoyait qu'une base par façade maritime africaine.
Pour réussir, Serval a eu besoin de points d'appui en Afrique, besoin d'une empreinte au sol.
Un des enseignements de SERVAL à court terme est que la diminution de notre présence militaire en Afrique n'a pas encore été compensée ni par la montée en puissance des armées africaines dont on aurait cependant tort de négliger les efforts, ni par l'implication croissante de nos alliés.
Nous estimons dans ces conditions qu'une présence prépositionnée en Afrique de l'Ouest, avec l'accord des États concernés, reste indispensable pour contribuer avec nos partenaires africains à la sécurité de la zone.
Même si c'est toujours dans le cadre de la légalité internationale, et le plus souvent possible avec nos alliés, (internationaux, dans le cadre de l'ONU, européens, ou régionaux), la France semble devoir maintenir une capacité d'agir, au Sahel, seule, en relative autonomie. L'opération SERVAL a montré que c'était encore possible, même si, du point de vue de la logistique et du renseignement opérationnel, l'aide de nos partenaires occidentaux a été indispensable.
C'est pourquoi la décrue de nos moyens prépositionnés doit être échelonnée. La montée des menaces, en particulier au Sahel, ne doit pas nous faire baisser la garde trop vite.
Si la France reste, à bien des égards, seule en Afrique devant les responsabilités que lui donnent ses moyens militaires sur place, elle prend en même temps le risque d'être fréquemment appelée à jouer le rôle de gendarme sans pouvoir toujours choisir ses combats.
C'est pourquoi il importe de persévérer dans l'effort de formation des armées africaines et de marquer en certaines occasions notre refus de nous substituer à elles.
Car la volonté de maintenir nos effectifs ne doit pas nous faire perdre de vue que la stabilisation de la situation au Sahel ou en Centrafrique comme au Kivu dépend avant tout des Etats de la région face à des menaces qui les concernent tous.
Le sommet de l'Élysée devra rechercher un nouveau partage des tâches et un renforcement de la coopération régionale
Les autorités politiques africaines portent la responsabilité de leur appareil de défense. La majorité des crises ont aujourd'hui une dimension régionale et doivent recevoir des solutions régionales. Car ce qui frappe dans les crises africaine récentes, au Mali, en Centrafrique comme au Congo, c'est le caractère transnational des crises avec de fortes implications régionales et une virulence de menaces transversales (drogues, armes, trafics humains) qui touchent aussi bien l'Afrique que l'Europe.
De ce point de vue, l'initiative du Président de la République de proposer une réunion des chefs d'État africains à Paris, les 6 et 7 décembre prochain, sur le thème de la sécurité du continent africain est la bienvenue.
Il est essentiel de trouver un format qui permette aux discussions régionales d'avancer de façon réellement constructive pour déboucher sur la mise en place de solutions effectives. Il importe, en particulier au Sahel, que les pays de la zone améliorent leur coopération pour renforcer la lutte contre le terrorisme.
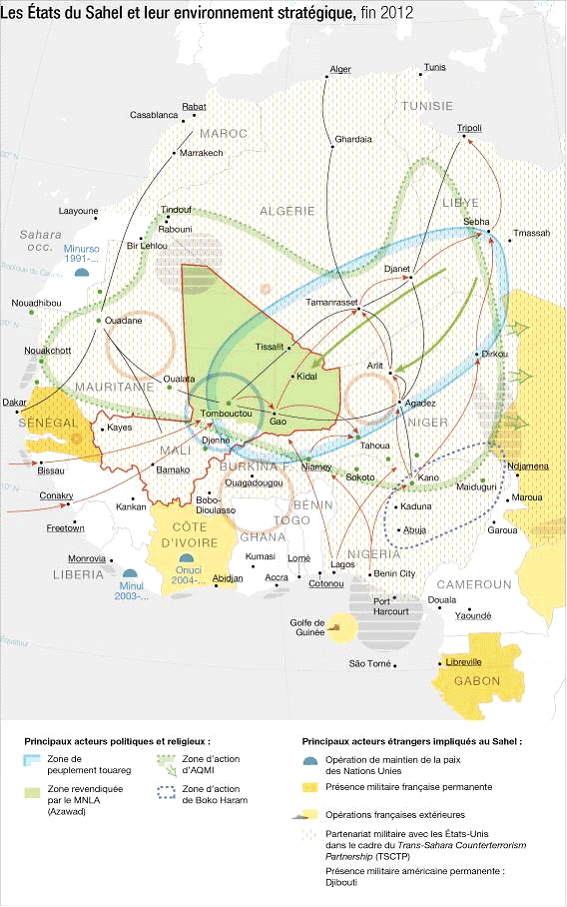
En revanche, le positionnement français semble contradictoire en matière de coopération structurelle.
b) Une attrition des moyens de la coopération militaire contradictoire avec la volonté de promouvoir des solutions africaines aux crises du continent
La diminution constante des crédits consacrés à la formation et à la coopération militaire française en Afrique crée un hiatus de moins en moins tenable entre notre volonté politique affichée de faire émerger des capacités africaines de sécurité et la réalité de notre action.
Depuis 2006, le budget d'intervention de la Direction de la coopération de sécurité et de défense a diminué de moitié.
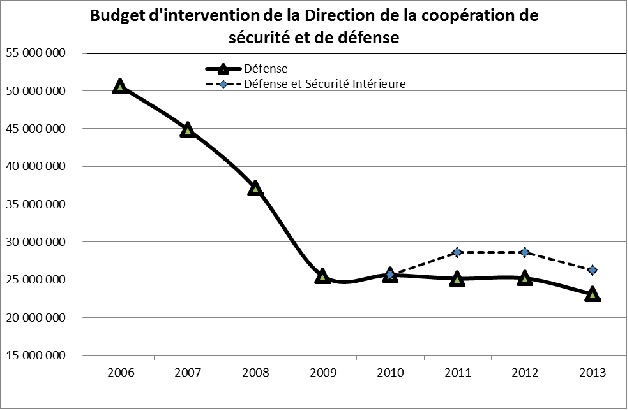
La diminution des moyens de coopération militaire au cours des huit dernières années, en termes de budget comme de coopérants, nuit à la crédibilité de notre posture comme aux résultats obtenus.
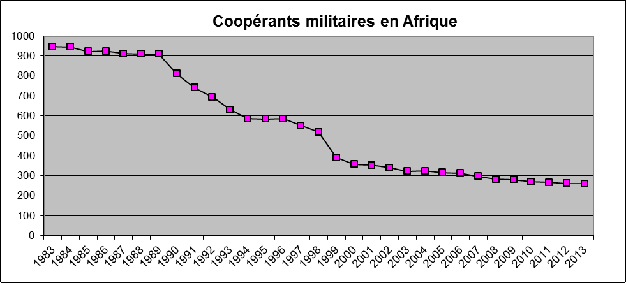
Le constat lors de la montée en puissance de la MISMA a été unanime, la caractéristique la plus partagée et la plus handicapante pour les armées africaines est un besoin de formation des cadres auquel nous ne répondons plus, faute de budget et de places offertes dans nos écoles en France.
Nous avons, en matière de formation, une expertise unique reconnue de tous, en particulier des Africains, et enviée par les Américains et les Britanniques.
La dualité de notre coopération qui assure un continuum indispensable entre projets fondamentaux de long terme (coopération structurelle) et actions d'entrainement en vue de l'emploi tactique immédiat (coopération opérationnelle) a montré son efficacité.
Nos partenaires africains reconnaissent que notre coopération est pragmatique, pratique, adaptée, flexible et qu'elle fait l'objet d'un véritable dialogue à la différence des autres partenaires : programme américain ACOTA régulièrement décrié pour sa rigidité, son côté théorique.
Alors, certes, tous nos points d'appui participent d'une façon ou d'une autre à la formation des armées africaines. Pendant l'opération SERVAL, Le commandement des éléments français au Sénégal (COMELEF), pôle opérationnel de coopération à vocation régionale ainsi que les forces de l'opération Licorne que nous avons visitées ont contribué à former des bataillons africains qui ont ensuite rejoint la MISAMA puis la MINUSMA.
Par ailleurs, la décrue des moyens de coopération a été en partie compensée par des financements européens et étrangers des écoles nationales à vocation régionale (ENVR) qui, tout en conservant un encadrement français, sont aujourd'hui éligibles à des financements européens.
Il reste que la Direction de la coopération de sécurité et de défense ne dispose plus que de 345 coopérants pour 149 pays partenaires et 86 millions d'euros dont 80% est à destination de l'Afrique.
Le nombre de coopérations a été diminué par dix ces vingt-cinq dernières années.
Quant aux stagiaires, la formation dans les écoles nationales à vocation régionale (ENVR) a pris le pas sur la formation en France. En 2000, quelque 661 militaires en devenir étaient formés en France et 663 dans les ENVR ; en 2013 ils étaient 2 426 dans les ENVR contre seulement 376 dans les centres français.
Il y a une disproportion entre les moyens mis en oeuvre dans les opérations et celui mis dans la coopération qui est en contradiction avec l'exhortation répétée faite aux responsables africains de mettre sur pieds des armées opérationnelles.
Difficile dans ces conditions de définir une stratégie de coopération structurelle. La volonté de développer la formation dans le domaine crucial pour les populations de la sécurité civile ou de promouvoir en Afrique des formes de services civils au développement pour accompagner les opérations de désarmement se heurtent au manque de moyens.
Ce n'est en effet pas les idées qui manquent. L'organisation en juin dernier du 14ème Forum de l'IHEDN sur le continent africain en a témoigné.
De nombreux intervenants ont évoqué des initiatives à prendre, par exemple pour accompagner des réflexions type « Livre blanc africain», pour inciter à la mise en oeuvre de mesures de confiance entre civils et militaires, pour renforcer la formation des élites militaires, mais aussi civiles, pour faire un effort sur la formation des jeunes officiers, pour développer les capacités locales à former les cadres africains, inciter les institutions africaines à investir dans des écoles africaines, pour développer la coopération avec des partenaires qui partagent notre vision de l'Afrique, comme le Canada, pour promouvoir les initiatives régionales et développer davantage les liens avec nos forces déployées en Afrique à travers des exercices régionaux et des exercices franco-africains au sein de la CEDEAO ou de la CEEAC.
En revanche, notre pays manque cruellement de moyens.
C'est une question de moyens mais aussi de priorités.
Les quelques dizaines de millions d'euros de la coopération structurelle militaire en Afrique émargent aujourd'hui sur le budget du ministère des affaires étrangères dont ce n'est guère la priorité.
Et il y aurait pourtant une cohérence à investir plus généreusement dans cette coopération si nous voulons à terme ne pas avoir à financer des interventions directes comme au Mali dont le coût s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros.
c) Un dispositif encore trop coûteux et rigide, politiquement peu lisible et militairement déséquilibré par rapport aux intérêts français
La loi de programmation militaire pour 2014-2019 qui prévoit une réduction des effectifs prépositionnés en Afrique à laquelle s'ajoutera une décrue des effectifs en OPEX conduit à une réduction numérique des effectifs français en Afrique dont le coût s'avère aujourd'hui difficilement soutenable au regard des contraintes budgétaires.
La loi de programmation militaire prend acte du fait que la France ne peut plus financer un effort budgétaire supérieur à un milliard par an pour renforcer la sécurité du continent africain.
L'Afrique représente plus de la moitié des crédits consacrés aux forces ou opérations hors du territoire national. Le coût annuel des forces prépositionnées est en 2013 de l'ordre de 400 millions d'euros (entre Djibouti, Libreville et Dakar), celui des OPEX en Afrique de l'ordre de 900 millions (65 millions en Côte d'Ivoire, 107 au Tchad, 26 millions pour l'océan Indien, 22 en Centrafrique, 700 millions pour le Mali) sur un budget d'OPEX variant, suivant les années, entre 800 millions et un milliard d'euros (comme ce fut le cas en 2011 et comme cela sera vraisemblablement le cas en 2013 compte tenu de Serval, dont le coût annuel devrait s'élever à 700 millions d'euros).
La conjonction des diminutions d'effectifs des forces prépositionnées, programmées à 1 200 hommes, et des OPEX dont le niveau, stabilisé à 450 millions d'euros contre 528 millions d'euros en moyenne sur les dix dernières années et plus de 900 ces trois dernières années supposera une diminution d'au moins un millier d'hommes supplémentaires, va nécessairement réduire la présence militaire en Afrique.
Le chiffre de 450 millions d'euros pour solde de tout compte des opérations extérieures signifie, en effet, vraisemblablement, que la France ne s'engagera plus dans plus de deux opérations concomitantes en Afrique. La diminution des effectifs des OPEX impliquera une diminution des effectifs, vraisemblablement à Djibouti et à Libreville, et une transformation de certaines OPEX en opérations permanentes financées au titre des forces prépositionnées. Cette distinction avant tout budgétaire n'a d'ailleurs pas vraiment de sens avec des OPEX comme les opérations LICORNE et EPERVIER qui durent depuis des années.
Surcoût des opérations extérieures en 2011 et 2012
|
Exécuté 2011 (1) |
Exécuté 2012 |
Prévu 2013 |
|
|
KOSOVO |
47 |
40 |
36 |
|
COTE D'IVOIRE |
64 |
63 |
65 |
|
AFGHANISTAN |
518 |
485 |
259 |
|
TCHAD |
97 |
115 |
107 |
|
LIBAN |
79 |
76 |
62 |
|
LIBYE |
368 |
||
|
MALI |
ND |
||
|
DJIBOUTI (Atalante) |
29 |
30 |
26 |
|
CENTRAFRIQUE |
22 |
||
|
Autres |
43 |
63 |
36 |
|
Total |
1 247 |
873 |
611 (hors Mali) |
Tout en constatant que les menaces, en particulier dans cette région du monde, sont loin de diminuer, le ministère de la défense s'ajuste à la réalité budgétaire d'une France qui ne peut plus financer une présence militaire en Afrique aussi massive.
Le pari et le défi du ministère de la défense sont d'arriver à produire un dispositif aussi efficace mais moins coûteux.
Cette contrainte doit notamment conduire à repenser la cohérence de l'ensemble de notre dispositif vers un dispositif plus souple où les effectifs s'ajustent en temps réel aux besoins opérationnels.
Avec 300 hommes, notre point d'appui à Dakar a apporté une contribution essentielle à l'opération SERVAL et à des actions de formation des troupes africaines qui ont nourri la MISMA puis la MINUSMA.
Au vu de cette expérience, un meilleur ratio pourrait être trouvé ailleurs entre forces d'action et unités de coopération et de formation. Les points d'appui français doivent plus que jamais assurer une polyvalence entre ses deux missions en coordination avec les écoles nationales à vocation régionale et les forces africaines.
La diminution des moyens budgétaires comme les enseignements de l'opération SERVAL milite ainsi pour le maintien de nos points d'appui en Afrique, mais pour une plus grande flexibilité des effectifs qui doivent pouvoir être modulés rapidement en fonction des besoins opérationnels.
Les effectifs des bases actuels sont, en outre, en déphasage avec les besoins opérationnels pour assurer la sécurité de nos intérêts, notamment pour la protection de nos ressortissants.
Des effectifs nombreux sont aujourd'hui concentrés sur la Corne de l'Afrique et la péninsule arabe, alors que les communautés françaises vivent majoritairement en Afrique de l'Ouest, zone où la menace ne fait que s'aggraver ; de la même façon, le centre de gravité nord-sud paraît trop bas sur la façade ouest africaine.
Le centre de gravité de nos implantations militaires en Afrique mériterait d'être repositionné : aujourd'hui trop concentré au fond du Golfe de Guinée où se trouve la majorité de nos forces (Gabon), il gagnerait à être remonté au Nord.
Déséquilibré entre la façade Ouest et la façade Est de l'Afrique (où nous avons 12 avions, 2 groupements tactiques interarmées et 8 hélicoptères, en incluant nos capacités aux Émirats Arabes Unis), il gagnerait aussi à être rebasculé vers l'Afrique de l'Ouest, où sont nos intérêts les plus anciens, et d'abord nos ressortissants.
Enfin, plus que jamais, dans la décennie à venir, la condition de l'acceptation par les Africains de la présence militaire française en Afrique, et donc de sa légitimité, est naturellement qu'elle contribue réellement à la montée en puissance des architectures de sécurité africaines.
Lors du cinquantième anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba le 25 mai dernier, dont il était le seul invité occidental, le Président de la République François Hollande affirmait : « Je considère que ce sont les Africains qui doivent assurer eux-mêmes la sécurité de l'Afrique. Mais la France est prête à travailler avec les Africains, pour renforcer les capacités d'action, pour doter les armées africaines des moyens de répondre à toutes les agressions. (...) Nous définirons ensemble les formes de la meilleure coopération pour prévenir et traiter les conflits, et pour lutter partout contre le terrorisme. »
Adosser notre présence militaire à la montée en puissance des capacités africaines est une condition décisive pour une bonne acceptation par les Africains de notre présence militaire en Afrique, la première étant évidemment l'expression de la volonté des États concernés.
De ce point de vue, la vocation du dispositif français apparaît encore trop peu lisible pour les opinions publiques africaines.
C. UNE PRÉSENCE JUGÉE AMBIVALENTE
Conséquence de l'absence de stratégie africaine autre qu'un repli budgétaire, la politique africaine s'adapte de façon pragmatique aux événements. Mais la difficulté à dégager une ligne de conduite claire a contribué à brouiller notre image.
1. Une politique hésitante
Pendant des années, la France a affiché, à la suite de Lionel Jospin, une doctrine du « ni-ni » -« ni ingérence, ni indifférence »- qui devait poser les bases d'une nouvelle relation de la France avec ses partenaires africains, débarrassée des oripeaux de l'ingérence postcoloniale.
Cette devise, censée résumer toute sa politique à l'égard du continent noir avait ainsi déçu les caciques des pouvoirs africains à l'ancienne, qui souffraient d'un complexe d'abandon ; elle avait aussi désespéré les oppositions qui misaient sur une improbable « ingérence démocratique ».
Au nom de la mise au placard des clientélismes et de l'arrêt de la connivence avec des régimes contestables, la France avait souhaité faire oublier qu'elle était naguère aussi « faiseuse de rois ». Le respect des peuples, des institutions et de la souveraineté des États imposait une ligne de conduite prudente en rupture avec l'ancienne « politique de la canonnière » qui l'avait conduite à 51 opérations militaires sur le continent en 30 ans.
Pourtant, à partir des années 2000 et singulièrement après 2002, la lisibilité de la doctrine du ni-ni apparaît problématique.
L'implication directe de notre armée dans la crise ivoirienne, au Tchad et en RCA semble avoir entériné de facto un nouveau changement de doctrine, sans que celle-ci ne soit jamais vraiment explicitée.
En 2011, cette politique a franchi un nouveau cap avec les guerres menées en Libye et en Côte d'Ivoire. En 2012, malgré l'alternance, l'engagement du Président de la République de rompre avec les interventions du passé, la France s'engage dans la crise malienne après s'être jurée pendant des mois de ne pas intervenir.
Cette « politique du Yoyo », selon l'expression utilisée par M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie au ministère des affaires étrangères, qui a conduit les différents gouvernements à alterner abstention et intervention n'a pas favorisé une image très claire de la politique africaine de la France.
Cette politique pragmatique du cas par cas laisse ouvertes des questions dont la presse africaine se fait l'écho : comment comprendre que la France monte en première ligne pour faire respecter le verdict des urnes en Côte d'Ivoire alors qu'elle s'abstient dans d'autres contextes comparables ?
Comment départager les situations où l'on doit se résoudre en propre à une intervention armée de celles où s'impose la prise de responsabilité de l'Union Africaine et de ses organisations régionales ? La « communauté internationale » s'abrite bien souvent derrière le paravent des « solutions africaines aux problèmes africains » quand cela l'arrange, tandis que certains Etats africains se livrent à une instrumentalisation opportuniste de l'« agenda occidental », par exemple en matière d'anti-terrorisme.
Dans les situations d'urgence, l'européanisation comme l'africanisation de la politique africaine de la France montrent leurs limites, comme au Mali et en Côte d'Ivoire. Cette situation conduit la France à afficher des principes dont elle doit s'affranchir dès que la situation impose une action rapide.
Jusqu'où la responsabilité de protéger, héritière du « droit d'ingérence », nous permet-elle d'intervenir ? Après s'être réclamé des grands principes de la légalité internationale, comment fixer les limites sans avoir l'air de choisir au cas par cas en fonction des intérêts français ?
Nous intervenons au Mali, mais pas en Centrafrique où la dégradation de la situation sécuritaire et les exactions perpétrées contre la population civile sont avérées et l'incapacité de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) à l'enrayer, manifeste. Dans ce cas, la France se contente de « saluer les initiatives des États de la Communauté économique d'Afrique centrale et de l'Union africaine pour parvenir à une sortie de crise durable en RCA 58 ( * ). » .
Sur le plan de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie où les attentes de nombreux Africains à l'égard de la France restent importantes, la réponse française a été également perçue ces dernières années comme erratique.
Après l'espoir suscité par le discours de La Baule (juin 1990), qui laissait penser que la France s'engageait résolument en faveur de la démocratie au Sud du Sahara, le soutien y compris militaire apporté à des gouvernants bafouant les libertés publiques a brouillé le message. De même, ces deux dernières années, l'engagement militaire en Côte d'Ivoire et en Libye a fait ressortir, par contraste, l'immobilisme adopté vis-à-vis d'autres situations (fraude électorale massive au Tchad, en RDC, en RCA, au Togo...).
Il est vrai que, depuis septembre 2001, on a eu tendance à voir le continent avant tout comme une menace.
Certains gouvernants africains ont saisi le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de ce prisme sécuritaire et de la rente qui pouvait en découler. Leurs peuples ont de leur côté compris que le discours des Occidentaux sur la démocratie perdait en effectivité dès lors que leurs dirigeants, même s'ils exerçaient une dictature, ne seraient pratiquement jamais sanctionnés tant qu'ils luttaient contre Al-Qaida. Une attitude dont on a vu les limites au Maghreb sans qu'on en tire pleinement les conséquences en Afrique, sans voir que le développement de l'islam politique dans de nombreux pays, bien plus massif que celui de l'islamisme, peut apparaître de ce point de vue avant tout comme un symptôme de cette déception à l'égard du discours démocratique rabâché depuis les indépendances, dont les fruits sont jugés décevants.
Cette ambivalence se retrouve dans de nombreux domaines où la politique africaine de la France se cherche, hésitant entre diverses options.
Entre le maintien d'une politique d'influence et d'accueil des élites africaines et une politique migratoire dissuasive, entre la tentation du retrait et la volonté de maintenir des liens privilégiés avec le continent ; entre la normalisation et la personnalisation des relations ; entre des tendances à la multilatéralisation et le souci de conserver une politique d'influence bilatérale ; entre la conservation d'un pré carré francophone et l'affermissement des liens avec de nouveaux partenaires politiques et commerciaux ; entre la modernisation de notre appareil de coopération militaire et la perpétuation d'une vieille « politique de la canonnière » ; entre conditionnalités démocratiques et soutien à des régimes autoritaires, entre aide-programme et aide-projet, etc.
2. Une image entre attirance et répulsion
Cette ambivalence nourrit celle des Africains eux-mêmes à l'égard de la France qui oscillent entre attirance et répulsion. A la politique du « ni-ni » correspond l'accusation d'ingérence ou d'inaction suivant la posture adoptée avec à la clef un dilemme dont le Gouvernement Français ne semblait plus pouvoir sortir : intervenir en étant taxée d'ingérence ou laisser faire, signe d'indifférence voire d'acceptation et de participation, au pire comme au Rwanda.
La difficulté à dégager une ligne de conduite claire a contribué à brouiller notre image.
Moins négative qu'on pourrait le croire en Afrique anglophone où notre compétence africaine en matière d'aide au développement et notre défense de l'Afrique dans les enceintes internationales sont reconnues, l'image de la France dans nos anciennes colonies oscille, selon l'expression de M. Richard Banégas, professeur au CERI-Sciences Po, « entre attirance, sentiment d'abandon et répulsion, au gré du soutien politique ou des interventions militaires. »
La présence militaire est reconnue, sauf exception, comme positive, sous quelque forme qu'elle soit déclinée (aéroterrestre ou navale), pourvu qu'elle ne vienne pas en appui à des régimes peu recommandables et qu'elle soit limitée dans la durée.
Chez les francophones, une impression d'être délaissés, voire de ne pas être payés en retour par une France en repli (immigration, visas, réduction de l'aide, traitement des anciens combattants), domine, avec pour corollaire le risque réel que les jeunes générations se détournent de la France pour rejoindre de nouveaux partenaires.
Une étude du Quai d'Orsay en 2007 sur l'image de la France en Afrique indiquait : « Un fossé s'est ainsi creusé entre Français et Africains. Les premiers voient les seconds comme "des gens pauvres parce que corrompus, à qui la France doit dire ce qu'ils doivent faire". En miroir, domine en Afrique la vision d'"une France frileuse, doutant de ses intérêts, méfiante à l'égard de la jeunesse africaine" » .
On souhaiterait de manière générale que les Français fassent mieux justice aux progrès accomplis par l'Afrique (règlement des conflits, élections, croissance économique). De ce point de vue un certain dépit africain se nourrit du rejet d'une France « donneuse de leçons » dont les performances économiques, l'art de vivre jugée excessivement individualiste et peu solidaire, le comportement de certains de ses membres, notamment dans le cadre de l'affaire de L'Arche de Zoé, n'apparaissent pas si exemplaires.
En matière de coopération, nombre de responsables africains se disent fatigués de recevoir des leçons de morale, de bonne gouvernance et de gestion « mêlant arrogance et charité », de tous les contributeurs à l'exception des Chinois. Ils ne se retrouvent plus dans des modèles politiques et de développement où la pensée unique règne et souhaiteraient que l'on réponde enfin à leurs demandes « d'égal à égal ». Cette critique ne s'applique pas seulement à la France mais à l'ensemble des institutions financières internationales, aussi bien à l'ONU qu'à l'aide européenne ou bilatérale, corsetées de « conditionnalités », qui varient trop rapidement au gré des modes.
D'un point de vue sécuritaire, l'exemple du Mali ou de la Centrafrique laisse penser que, si la France ne détient plus la solution, elle est encore perçue comme un recours avec le risque de rentrer dans un engrenage d'interventions répondant à des appels récurrents ressuscitant l'image flatteuse de « gendarme de l'Afrique ».
Le risque existe que l'image de la France ne se réduise à son versant militaire et martial. Quoi de plus significatif que cette phrase du Président sénégalais Macky SALL où se mêlent à la fois une demande et un refus : « Le moment est venu que les États-Unis soient à nos côtés, comme la France l'est, pour que l'Afrique se donne les moyens de réagir de façon autonome quand le besoin s'en fait sentir (...). Il n`est pas acceptable que nous appelions des soldats européens pour venir régler des problèmes sur notre territoire »
3. Le Mali un nouveau départ ?
L'intervention au Mali marque-t-elle une nouvelle étape ?
L'opération Serval, déclenchée le 11 janvier 2013, est ainsi née du refus de la France de voir une partition de l'État malien ou la constitution d'un État terroriste. Déclenchée dans l'urgence avec le soutien de la MISMA, cette force a aujourd'hui achevé sa mission principale. Cette intervention a sans doute évité une profonde déstabilisation que la chute de la capitale malienne aurait provoquée dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Le territoire est repassé dans sa plus grande partie sous le contrôle de l'État malien. Plus de 200 tonnes d'armes ont été confisquées, l'administration a pu retourner dans le Nord et les éléments terroristes résiduels continuent à y être traqués. La transformation de la MISMA dans une force sous mandat onusien, la MINUSMA, forte de 12 600 casques bleus, s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. La France maintient au Mali des capacités de lutte contre les terroristes et continue à participer à l'opération EUTM de formation de l'armée malienne. L'accompagnement politique de l'intervention a permis la tenue des élections à la présidence du Mali dont Ibrahim Boubacar Keita est sorti vainqueur avec 77,62% des voix. Le calendrier électoral devrait permettre des élections législatives en octobre et novembre 2013. L'accord de Ouagadougou ("Accord préliminaire à l'élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix") devrait permettre un difficile processus de réconciliation entre le Sud et le Nord. Au final la France est intervenue militairement sans s'immiscer trop avant dans les affaires maliennes sauf pour organiser des élections.
Un sans faute ? Disons une intervention en cohérence avec le discours où, tout en assumant le leadership, la France est intervenue dans le cadre de la légalité internationale et du chapitre 7 de la Charte des Nations unies, à la demande des autorités maliennes, pour préserver l'intégrité territoriale du pays au sein d'une coalition européenne et africaine.
Un succès ? Cela dépendra de la suite. Comme l'ont souligné les sénateurs Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher 59 ( * ) , « le plus difficile sera de gagner la Paix ».
Le succès ne sera véritable que quand la réconciliation entre le Nord et le Sud sera effective, que la vie politique et institutionnelle aura repris un cours normal et que le pays sortira du sous-développement qui nourrit les extrémismes et les trafics en tous genres.
Le plus difficile : gagner la paix
50 ans de coopération ont montré que ces objectifs étaient difficiles à atteindre et doivent nous inciter à réfléchir sur nos méthodes de coopération.
Si la situation ne s'améliorait pas malgré les engagements financiers substantiels de 3,2 milliards promis à Bruxelles le 15 mai dernier, par la France et l'Europe, le consensus qui s'est dégagé dans la communauté africaine pour saluer l'intervention française deviendrait sans doute moins unanime et la présence militaire française plus discutée.
En outre, en cas d'enlisement ou de bavures, le retournement de l'opinion publique africaine pourrait être rapide. La France, en prenant la responsabilité de cette intervention, s'est engagée durablement au Mali.
L'insistance avec laquelle les autorités françaises ont souligné que les forces françaises n'ont pas vocation à rester sur son sol cache en réalité la crainte de devoir y laisser encore longtemps plusieurs centaines de soldats. Il est d'ores et déjà acquis que la France maintiendra 1000 hommes début 2014 sur le sol Malien.
La « reconstruction » des structures étatiques prendra du temps, qu'il s'agisse de l'armée, de l'administration ou des services à la population.
Des doutes sérieux existent sur notre faculté à accélérer des processus politiques et économiques nécessairement lents et toujours endogènes. L'ampleur des difficultés rencontrées à dépasser, de part et d'autre, les rancoeurs entretenues depuis des décennies entre les Touaregs et les populations du sud du Mali laissent présager un processus politique long et laborieux pour reconstituer le contrat politique qui doit être au fondement de l'Etat Malien. La responsabilité de faire vivre ce contrat incombe aux élites maliennes du Nord comme du Sud.
Pour notre part, l'absence de réflexion approfondie sur l'évaluation des échecs passés en matière de coopération, la faible capacité d'absorption de l'aide par les administrations maliennes, l'absence de coordination autre qu'« informelle » des différents bailleurs de fonds militent pour une certaine prudence.
Quant aux aspects sécuritaires, chacun sait que les groupes terroristes implantés au Sahel depuis la fin des années 90 restent mobiles et circulent librement dans ces vastes espaces sahariens aux immenses frontières si difficiles à contrôler, le long d'une route qui reliait leur forteresse dans l'Adrar des Ifoghas, au Nord Niger, à la Libye et jusqu'à la Tunisie. Avec Serval, une partie importante de leurs capacités a été détruite, mais ils ont cherché à se constituer un nouvel abri, dans le sud-ouest libyen, avec peut être une prolongation dans le massif de l'Aïr au Niger.
On compterait jusqu'à 300 000 miliciens en armes en Libye entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine tandis que le Fezzan, au sud, avec ses Toubous et ses Touaregs jugés « pro-kadhafistes », est déjà considéré comme un sanctuaire pour les « djihadistes ».
Sans solution politique, les résultats des interventions militaires sont fragiles
Cette intervention militairement réussie, contenue dans le temps, débouchant sur une solution politique accompagnée par des forces régionales, conforte le poids politique de la France sur le continent.
Si nous avions un doute, nous voilà rassurés : si la France ne fait plus l'Afrique, elle compte encore. L'approbation de l'Union Africaine, celle de l'Afrique du Sud ou de l'Algérie, les drapeaux français à Bamako et Tombouctou n'auront peut-être qu'un temps, mais ils confortent l'idée que la France peut ici retrouver son rang et légitimer son rôle de puissance régionale.
La France sait et peut intervenir en premier, l'avenir dira si elle sait aussi transférer la gestion de la situation post-crise à des forces légitimes africaines ou onusiennes. Avec la réduction du format des armées, il est à craindre que nous ne puissions plus longtemps financer le maintien de plusieurs centaines d'hommes dans chaque pays où nous intervenons.
La France a néanmoins pris le risque que, sur le long terme, un fossé ne se creuse pas avec la partie de l'opinion publique africaine prompte à dénoncer « l'impérialisme occidental » et le néocolonialisme français. La facilité avec laquelle M. Laurent Gbagbo a instrumentalisé le sentiment anti-français montre que le ressentiment anticolonial est encore très présent et ne demande qu'à être ravivé.
C'est bien ce risque qui retient la France d'intervenir unilatéralement en Centrafrique malgré les massacres.
Au moment où, dans les relations avec l'Afrique, notamment avec l'Afrique du Sud, reviennent en force les thématiques du legs colonial, de l'anti-impérialisme et de la souveraineté aliénée, une approche uniquement sécuritaire peut contribuer à nourrir des tensions et des résistances croissantes pendant que, dans le même temps, les pays émergents approfondissent une coopération économique et politique avec, à la clef, de nouveaux marchés.
C'est précisément pour échapper à ce risque que la France doit continuer en dépit de tout à mettre en avant la voie de la multilatéralisation, de la régionalisation et de l'« africanisation » des dispositifs de sécurité. C'est pour cela qu'elle doit accompagner son effort militaire d'une plus grande implication en matière de coopération économique et institutionnelle.
Dans ce contexte de lutte internationale contre le terrorisme, en effet, la tentation est grande de ne voir le continent africain qu'à travers le seul spectre de l'insécurité.
Pour éviter que le fossé ne se creuse avec des opinions publiques africaines qui refuseront de plus en plus les ingérences extérieures, il convient que la France se départisse de cette tentation sécuritaire et martiale dans ses rapports avec le continent en veillant à un bon équilibre entre la coopération militaire et une politique africaine tournée vers la coopération politique, culturelle et économique.
De ce point de vue, la prévention des conflits doit figurer parmi les objectifs prioritaires de notre politique dans l'accompagnement des sociétés africaines en mutation.
La prévention des conflits : un axe stratégique à concrétiser
Elle est identifiée comme l'une des cinq fonctions stratégiques dans le Livre blanc de 2013 sur la défense et la sécurité nationale : « l'une des meilleures façons de garantir notre sécurité face aux risques de conflit ou de crise est de prévenir leur avènement, en agissant au plus tôt sur leurs causes. La sécurité nationale doit donc s'appuyer sur une stratégie de prévention qui repose sur des moyens diplomatiques, économiques, financiers, militaires, juridiques et culturels. ».
Or la prévention semble demeurer le parent pauvre de la réflexion sur les liens entre sécurité et développement. Elle fait encore l'objet de peu d'investissements intellectuels et opérationnels.
C'est avant tout le sous-développement qui fait le terreau du djihadisme et des trafics en tout genre, c'est le désoeuvrement et l'absence de perspectives qui ont jeté la jeunesse touarègue dans les bras des salafistes, c'est le non-développement qui a fait du Nord Mali, une zone de non-droit.
C'est pourquoi notre effort doit aussi porter massivement sur le développement et le renforcement des capacités des Etats à assurer les services publics essentiels.
Face à ces défis, l'aide au développement et le renforcement de nos partenariats économiques en Afrique ne peuvent pas tout, mais ils peuvent créer des opportunités, favoriser des processus vertueux et participer à la création d'emploi et à la reconstruction de services publics essentiels au fonctionnement normal du pays.
Le succès de l'opération du Mali ne doit pas donc nous donner l'illusion de l'efficacité de la solution militaire. La guerre reste un échec et l'intervention de militaires français en Afrique une exception.
Au-delà des atrocités de la guerre, les coûts financiers des opérations de stabilisation, de maintien de la paix et des interventions de reconstruction post-conflit sont extrêmement élevés, pour des résultats qui restent fragiles.
C'est pourquoi l'intérêt mutuel de la France et des pays africains est avant tout de créer les conditions d'un développement économique durable.
D. UNE EUROPE QUI NE PREND PAS ENCORE LE RELAIS
La diminution de nos moyens budgétaires et la volonté de sortir du face à face avec nos ex-colonies a conduit la France à essayer de porter sa politique africaine au niveau communautaire.
Sans se priver d'une politique bilatérale autonome, la France pouvait espérer démultiplier son influence en prenant la direction d'une politique africaine au niveau continental tout en mutualisant le coût d'une politique africaine qu'elle a de plus en plus de mal à financer.
Le pari est osé quand on voit la composition de la nouvelle Europe, mais il n'est pas sans légitimité.
Car l'ensemble du continent est concerné par l'évolution des pays africains. L'Europe comme la France ne peuvent pas, même si elles le voulaient, se désintéresser de l'Afrique. D'une certaine façon, l'affaire malienne en a fait la démonstration. Nos partenaires européens ont bien perçu qu'ils ne pouvaient se permettre d'avoir un État terroriste à quelques centaines de kilomètre de la rive sud de la Méditerranée, comme ils ne peuvent tolérer la progression d'une piraterie qui met en danger les voies maritimes d'approvisionnement énergétique au large de la Corne de l'Afrique ou dans le Golfe de Guinée.
De même, si l'Afrique présente de réelles opportunités de croissance pour l'ensemble de l'Union européenne, elle présente des risques communs notamment liés au choc démographique des décennies à venir. On l'a vu, l'Europe, et pas seulement la France, sera en première ligne pour en subir les conséquences. Les pays riverains de la Méditerranée en sont conscients, les autres moins.
Malgré des avancées réelles, cette tentative de fédérer une politique africaine de l'Europe n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements aussi bien en matière d'affaires étrangères que de défense. Pour les Européens, nous a dit un ambassadeur de l'Union, « c'est encore le deuxième cercle des priorités, le deuxième voisinage ».
En revanche, l'Union européenne s'est imposée comme un bailleur de fonds de la coopération au développement sans que la coordination avec l'aide bilatérale française soit toujours satisfaisante.
1. Une politique africaine commune encore improbable ?
La France n'a pas attendu des difficultés budgétaires pour faire de l'Europe un élément de sa politique africaine.
Dès les fondations de la construction européenne, la France a cherché à faire entendre son tropisme africain au sein des instances communautaires. Les accords de Yaoundé de 1963 ont été en grande partie négociés sous influence française durant la présidence de de Gaulle.
Mais très vite, l'importance que la France accorde à son voisin méditerranéen est apparue comme étant loin d'être partagée par l'ensemble des États membres de l'UE. L'élargissement à l'est a nettement accentué le phénomène. A partir des années quatre-vingt-dix, Paris a eu de plus en plus de difficultés à faire entendre sa voix au sein d'une communauté d'États toujours plus tournée vers l'est que vers le sud de ses frontières.
Le résultat, d'un point de vue financier, est là, les fonds structurels versés aux dix nouveaux pays entrants représentent par habitant et par an plus de 500 euros contre moins de 15 euros d'APD versés aux pays africains.
De plus, le passé colonial des nations qui valorisent l'importance stratégique de l'Afrique pour l'Europe en affecte le message. La difficulté de gérer cet héritage historique a ainsi conduit l'Allemagne à redéfinir sa politique africaine, hors de tout intérêt géostratégique et en focalisant son action sur l'aide au développement. Quant aux autres nations ayant un passé colonial, elles ont un intérêt marqué pour l'Afrique mais aussi une rivalité commune sur ce continent.
En outre, l'Union a eu des difficultés à assurer la cohérence de sa politique en raison de ces points de vue différents, mais également des contradictions des États membres qui, tout en étant un soutien fort à la coopération agricole avec l'Afrique, ont toujours soutenu la protection de la production agricole européenne en général, et française en particulier, parfois à l'encontre du développement agricole africain. La comparaison entre le montant annuel des fonds consacrés à la PAC de 55 milliards euros par rapport à l'appui européen à l'agriculture africaine de 500 millions d'euros illustre le poids relatif de chacune des préoccupations.
L'absence d'un leadership politique au niveau de l'Union européenne et les balbutiements de la politique étrangère commune ont freiné d'autant plus la mise en place d'une véritable stratégie en direction de l'Afrique qu'aucun consensus ne s'est dégagé pour définir ce que l'Europe pouvait y faire, sinon de la coopération dans les domaines incontestables du développement humain.
Le traité de Lisbonne et la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune n'ont pas fondamentalement changé la donne. Sans volonté politique de ses États membres de s'investir sur le continent noir, il n'y a pas eu jusqu'à présent de politique africaine européenne.
Dans ce contexte, la France a souvent été soupçonnée par ses partenaires de vouloir faire financer l'agenda caché d'une politique africaine contestable, sans en dévoiler les tenants et les aboutissants. Il est vrai que certaines opérations, comme l'opération au Tchad en 2008 où l'intervention des soldats d'Épervier mise au profit d'Idriss Déby, ont donné quelques crédits à cette thèse.
Toute la difficulté ces dernières années des diplomates français a été de vaincre ces réticences, notamment à propos du Sahel.
Incapable de définir seule un plan d'action efficient, l'Union européenne s'est cependant souvent finalement rangée derrière l'action de la France lors de ses interventions sur le continent.
Ce fut le cas lors des événements de 2010 en Côte d'Ivoire et surtout lors de la crise malienne. Si l'on ne peut que déplorer l'absence de mobilisation proprement européenne, on peut cependant se réjouir de la confiance accordée à la France en termes d'action en Afrique.
La France jouit en définitive d'un statut d'expert par défaut des questions africaines au sein de l'Europe. La multiplication des crises sur le continent ainsi que la volonté européenne de lutter contre le terrorisme et d'oeuvrer pour l'instauration de la démocratie renforcent le rôle de la France comme l'importance l'Afrique pour la diplomatie européenne.
En Afrique : un partage des rôles entre la France et l'Europe est encore à trouver
Il est ainsi significatif que le président Hollande a été le seul chef de gouvernement européen présent à Addis-Abeba cette année pour célébrer les 50 ans de l'Union africaine.
Forte de sa relation privilégiée avec le continent, la France entend bien pour l'avenir mettre l'Afrique au coeur des préoccupations européennes, tant pour la défense des intérêts nationaux que pour ceux régionaux.
La préparation du sommet de l'Élysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique, qui se tiendra les 7 et 8 décembre 2013, doit être un moment d'échanges entre les États africains et un pays ami, la France, mais également comme un point de départ d'une politique de coopération entre l'Europe et l'Afrique autour de thèmes de sécurité communs tels que la lutte contre le trafic de drogue.
De ce point de vue, un meilleur partage des rôles entre les capacités françaises d'intervention militaires rapides et les moyens européens et africains en matière d'opérations civilo-militaires doit être envisagé.
Avec une armée au format réduit, la France n'a pas les moyens de mener seule des opérations de maintien de la paix. En revanche, l'Europe, qui a acquis un savoir-faire en matière civilo-militaire, et l'ONU ont des moyens et une légitimité dans la durée qui leur permettent de mieux assumer ces opérations de long terme.
2. L'Union européenne, premier bailleur de fonds de l'Afrique
S'il y a un domaine où l'Europe s'est en revanche pleinement investie, c'est l'aide au développement. La construction de l'Europe a été élaborée au moment de la décolonisation. Elle s'est d'emblée caractérisée par une politique originale d'aide au développement.
Pour les fondateurs de l'Europe, la solidarité avec le Sud était au coeur de l'identité européenne. Les principes initiaux étaient ceux des 4 P (partenariat, parité politique, participation, préférences commerciales).
Il s'agissait prioritairement de mettre en place un droit du développement prenant en compte les asymétries, des mécanismes stabilisateurs et compensateurs des instabilités des marchés.
Si cette spécificité s'est cependant estompée avec le temps, le multilatéralisme commercial, la mondialisation et l'élargissement de l'Europe, l'aide au développement reste cependant l'un des principaux engagements extérieurs de l'Europe. Cette aide se tourne naturellement en premier lieu vers la plus proche voisin du continent européen qu'est l'Afrique.
L'Europe investit à hauteur de 5 milliards d'euros par an, principalement dans les domaines de la coopération au développement et de l'humanitaire. L'Afrique est ainsi le premier bénéficiaire de l'aide communautaire. Le continent noir a reçu 43% de l'APD nette européenne en 2010 et près de 77% des crédits alloués par le fonds européen pour le développement (FED) la même année. L'Union européenne est enfin le premier bailleur de fonds de l'Union africaine dont elle assure 60% de son budget annuel.
Grâce à ces financements, la Commission européenne s'est affirmée comme un acteur multilatéral majeur de la coopération au développement en Afrique et dans le monde. Sur la base de son seul programme de dons, qui s'est chiffré à 12,7 milliards de dollars US en 2010, l'Union Européenne se classe au 2 e rang des bailleurs de fonds dans le monde.
Les prêts consentis par l'Union Européenne aux pays partenaires et ses prises de participations au capital d'entreprises de ces pays ont totalisé 8,3 milliards USD en termes bruts, ce qui constitue une contribution majeure au développement.
Ce soutien financier de l'Union au développement de l'Afrique a été réaffirmé lors de l'approbation du plan de coopération au développement 2014-2020 pour les pays ACP qui prévoit une aide de 31,5 milliards de dollars en direction de ces pays, au premier rang desquels on retrouve les pays d'Afrique subsaharienne. L'objectif de consacrer 0,7% du PNB de l'Union européenne à l'aide au développement en 2015 a ainsi été maintenu en dépit des difficultés économiques que connaissent les pays européens.
La hauteur des montants engagés par l'Union européenne en fait un interlocuteur de taille par rapport à la France, en particulier en matière de financement sous forme de subventions.
Du côté français, parce que les gouvernements successifs, depuis dix ans, ont été convaincus de l'opportunité et de la valeur ajoutée d'une action européenne en matière de développement, la France a fait le choix d'inscrire sa politique d'aide au développement dans un cadre européen et a toujours oeuvré pour l'affirmation de cette compétence de l'Union.
Ainsi, le quart de son aide publique au développement transite par le canal européen et la Commission européenne met aujourd'hui en oeuvre près de la moitié de ses dons programmables.
Les dernières années ont connu une forte augmentation des contributions de la France à l'Union européenne en volume : progression de 30% entre 2006 (1 544 millions d'euros) et 2010 (2 009 millions d'euros).
Ainsi, les instruments européens sont les premiers bénéficiaires de l'aide française transitant par des canaux multilatéraux, devant les fonds verticaux comme le Fonds Sida ou les banques de développement comme la Banque mondiale. L'aide européenne représente pour la France entre 14 et 23% de l'APD totale sur la période 1998-2010
Les contributions de la France aux instruments européens sur la période 2006-2010 (en millions d'euros )
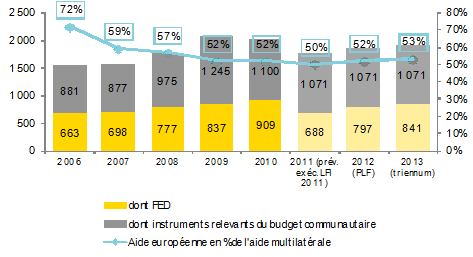
Source : OECD.Stat
Ce choix est lourd de conséquences. En déléguant une partie significative de sa coopération à l'Union, la France fait le pari de l'avenir, mais se lie à des partenaires européens qui n'ont ni le même tropisme pour l'Afrique subsaharienne, ni la même expérience de la coopération.
Ce choix suppose une participation permanente de la France à la construction et à la mise en oeuvre de la politique de développement de l'Union Européenne, tant par le biais du FED que par le biais du budget général.
En raison de son poids financier, mais aussi de l'élaboration récente par elle d'une stratégie européenne, la France a pesé auprès de la Commission dans la définition de la nouvelle stratégie européenne de développement.
Cette nouvelle stratégie reprend en effet certaines propositions françaises, telles que notamment une priorité forte pour l'Afrique subsaharienne, la notion des partenariats différenciés, le recours aux solutions de mixage entre prêts et dons.
Ce travail de conviction et d'influence reste une priorité.
Comme le souligne le Bilan évaluatif de la politique française de coopération au développement entre 1998 et 2010 : « la France se trouve encore relativement isolée dans son intérêt pour les pays africains francophones qui intéressent moins la plupart des bailleurs européens, davantage investis dans les pays anglophones (c'est notamment le cas des pays nordiques, ainsi que des nouveaux pays bailleurs de l'Europe de l'Est). Par conséquent, le choix des pays bénéficiaires pilotes pour de nombreuses initiatives innovantes de la Commission européenne se porte souvent sur les pays anglophones, comme par exemple le choix des 12 pays pilotes retenus pour la programmation européenne conjointe. ».
On constate ainsi que les 17 pays pauvres prioritaires de la coopération française (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Ghana, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo) n'ont bénéficié que de 30% des décaissements du FED en 2010, soit 13% de l'aide au développement totale de l'Union.
On observe, par ailleurs, sur le terrain que, malgré les initiatives en faveur d'une meilleure coordination et de programmation conjointe, les représentations de l'Union agissent encore très largement comme un bailleur de fonds additionnel qui est d'une certaine manière étranger aux États qui pourtant les financent.
De ce point de vue, nos pays partenaires africains ont bien du mal à comprendre que l'action financée par l'Union européenne est en partie imputable à la France.
Au-delà du problème de visibilité, les acteurs sur le terrain soulignent la lourdeur des procédures communautaires et le manque de réactivité d'une coopération communautaire engagée dans des programmations de long terme souvent dénoncées comme trop rigides.
De fait, en choisissant de faire passer un quart de son aide par l'Europe, la coopération française a perdu en réactivité, même si elle a gagné en volume.
Réorienter l'action de l'Europe vers l'Afrique et oeuvrer pour que la politique européenne de développement devienne un instrument de coordination et de complémentarité entre l'ensemble des politiques de coopération des États membres constituent encore deux défis majeurs.
Pour cela, deux pistes semblent devoir être approfondies : définir une stratégie française pour promouvoir l'Afrique au sein des instances européennes, approfondir encore les initiatives en cours en faveur des stratégies communes et une répartition du travail en fonction des avantages comparatifs de chacun entre la Commission européenne et les agences des différents États membres.
3. Les accords de partenariats économiques dans l'impasse ?
Sur le plan commercial et du développement, les accords de Yaoundé de 1963 puis de Lomé de 1975, entre la Communauté européenne et les pays ACP, se situaient dans une perspective régionaliste de préférence et de non-réciprocité prenant en compte les asymétries internationales.
Ils visaient à insérer les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans des accords préférentiels avec leurs anciennes métropoles s'intégrant à l'espace européen.
Les accords de Cotonou (Bénin) signés en 2000 entre l'Union européenne et les pays ACP ont cependant transformé le partenariat économique qui liait l'Europe à l'Afrique.
A partir de cette date, les accords APC ont perdu beaucoup de force avec l'élargissement de l'Europe à des pays sans passé colonial et avec la réorientation des intérêts vers l'Europe de l'Est depuis la chute du mur de Berlin.
L'ajustement a conduit à fortement rapprocher les doctrines des bailleurs de fonds sous le leadership des institutions de Bretton Woods.
La Commission, seule compétente en matière de politique commerciale extérieure et représentante de l'Union à l'OMC, a mis ses accords en conformité avec les règles de l'OMC qui n'intègrent pas les asymétries internationales. Or, le Système de préférence généralisée prenait précisément en compte les asymétries internationales afin de permettre aux États africains, et en particulier aux pays les moins avancés (PMA), de jouir de l'accès aux marchés européens sans craindre la concurrence des produits venus d'Europe sur leur marché intérieur.
L'accord de Cotonou prévoit la conclusion d'accords de partenariat économique (APE) entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne et ses États membres à compter du 1 er janvier 2008.
Cependant, plusieurs pays n'ont ni pris les mesures nécessaires en vue de la ratification d'un APE, ni conclu de négociations régionales globales. La Commission européenne a proposé donc, qu'à compter du 1 er janvier 2014, les pays qui n'ont pas signé ou ratifié leurs accords soient rayés de la liste des bénéficiaires de cette disposition.
Les 17 pays qui n'ont pas mené à bien jusqu'à présent leur processus de ratification se répartissent en différentes catégories et les conséquences pratiques de cette proposition, dans les circonstances actuelles, dépendraient de leur statut et de l'accord final obtenu lors de la révision du système de préférences généralisées (SPG) :
- le Burundi, les Comores, Haïti, le Lesotho, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie font partie des pays les moins avancés (PMA), qui continueraient à bénéficier de l'accès en franchise de droits et hors contingents, en vertu de l'initiative « Tout sauf les armes » (TSA), et ne seraient donc pas touchés ;
- le Cameroun, les Fidji, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Swaziland retomberaient dans le système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, qui prévoit des droits de douane réduits par rapport au taux applicable à la nation la plus favorisée (NPF), mais pas aussi favorables qu'un accès en franchise de droits et hors contingents, ce qui entraînerait une hausse des droits de douane sur la plupart des exportations essentielles ;
- le Botswana et la Namibie, qui sont rangés dans la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire, reviendraient, selon la proposition relative au SPG, au taux NPF, tel qu'il est appliqué à la plupart des pays (y compris par exemple les États-Unis et le Japon).
Cette évolution a conduit aux renégociations en cours des Accords de Partenariats économiques qui devaient initialement conjuguer les deux composantes, commerce et développement, avec les flexibilités nécessaires pour répondre aux spécificités des pays partenaires.
Ces accords avaient été conçus pour être appliqués uniformément à de grandes régions afin de favoriser l'intégration régionale : la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la CEEAC pour l'Afrique Centrale, la SADC pour l'Afrique australe et l'EAC pour l'Afrique de l'Est.
La coexistence de plusieurs régimes d'accès au marché de l'Union Européenne, comme c'est le cas aujourd'hui, constituait un frein à la solidarité régionale. Un des objectifs de la négociation des APE est d'harmoniser les régimes applicables à nos relations commerciales avec les pays ACP et de favoriser l'intégration régionale dont on a vu qu'elle constituait un enjeu économique majeur.
Or, en l'état des négociations, l'effet inverse est en train de se produire, chaque pays négociant seul des accords différents dans le cadre d'un ultimatum qui laisse peu de choix aux pays africains et notamment à ceux qui risquent de se voir imposer un système de préférences généralisées (SPG) de l'Union qui entraînerait une hausse des droits de douane : une situation qui inquiète les partenaires africains de la France.
Les bénéfices commerciaux que l'Union Européenne accorde aux pays ACP sont en effet aujourd'hui appliqués de façon unilatérale dans l'attente de la conclusion des APE intérimaires ou régionaux. La date limite de ratification des APE intérimaires, repoussée au 1 er octobre 2014 grâce notamment à l'action de la France, se rapproche.
A défaut d'accord, et à l'exclusion des PMA qui continueraient à bénéficier du régime « Tout sauf les armes » de l'Union européenne, les pays concernés perdraient leur accès préférentiel au marché de l'Union européenne (le Kenya, le Swaziland, la Cote d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et les iles Fidji, le Botswana et la Namibie seraient ainsi concernés).
Ainsi, à titre d'illustration, sans perspective d'un accord régional au 1er octobre 2014, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore le Cameroun, pourraient avoir à choisir entre ratifier leur accord de partenariat économique, conclu en 2007, et le mettre en oeuvre de façon bilatérale (mettant ainsi en danger les unions douanières négociées ou en négociations dans leurs régions), ou, de façon alternative, renoncer, au nom de l'intégration régionale, à un APE et donc à certaines préférences de I'UE.
Un certain manque de souplesse de la Commission européenne et les hésitations des pays africains ne permettent pas d'avancer de manière décisive dans des négociations où les demandes africaines sont peu prises en compte.
Comme le Président de la République l'a mentionné dans son discours à Dakar, le 12 octobre 2012, le partenariat entre l'Europe et les pays africains suppose d'établir des relations commerciales plus équitables entre l'Afrique et l'Europe : « La position des pays africains dans la négociation des APE n'a pas été assez prise en compte ».
Il convient de relancer les discussions sur de nouvelles bases, avec des conditions de calendrier et de contenu plus favorables pour les pays africains.
4. Une politique de sécurité encore balbutiante
Historiquement fondée sur les relations avec les pays ACP, les relations entre l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne ont pris un réel tournant en 2000 au premier sommet UE-Afrique au Caire.
À partir de 2007, l'Union européenne est devenue un gros contributeur financier en matière de paix et de sécurité en Afrique. Dès 2005, l'Union a développé un volet stratégique africain de la PESD. En 2006, le Conseil du 13 novembre a adopté des conclusions pour le « renforcement des capacités dans la prévention, la gestion et la résolution des crises . ». Depuis 2007 l'Union européenne et l'Union africaine ont une stratégie conjointe autour de huit partenariats dont le premier concerne la paix et la sécurité.
Le sommet UE-Afrique de Lisbonne (8-9 décembre 2007) a établi un nouveau partenariat politique stratégique pour l'avenir qui a pour ambition de dépasser les relations établies sur le mode bailleur de fonds/bénéficiaires en s'appuyant sur des valeurs et des objectifs communs dans la recherche de la paix et de la stabilité, de la démocratie et de l'État de droit, du progrès et du développement.
Le partenariat stratégique pour la paix et la sécurité vise à :
- renforcer le dialogue sur les défis à relever en matière de paix et de sécurité, notamment dans les enceintes internationales, afin de dégager des positions communes et de mettre en oeuvre des approches conjointes en ce qui concerne les défis en matière de paix et de sécurité en Afrique, en Europe et au niveau mondial ;
- rendre pleinement opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), afin d'en assurer le bon fonctionnement et de lui permettre de relever les défis en matière de paix et de sécurité en Afrique, notamment en ce qui concerne la prévention et la reconstruction au lendemain des conflits ;
- assurer le financement prévisible des opérations de soutien de la paix conduites par l'Afrique, notamment en oeuvrant ensemble à l'élaboration, dans le cadre du chapitre VIII de la Charte des Nations unies, d'un mécanisme de l'ONU visant à financer de manière durable, souple et prévisible les opérations de maintien de la paix menées par l'UA ou sous son autorité et approuvées par le Conseil de sécurité de l'ONU.
L'Union européenne a apporté un soutien au renforcement des capacités africaines de gestion des crises et à la Force africaine en attente, notamment à travers la pérennisation d'un nouvel instrument financier : la Facilité européenne pour la paix en Afrique, créée en 2003. Les 9 e et 10 e FED ont créé une facilité de paix dotée de 300 millions d'euros, montée à 450 millions depuis.
Cette facilité finance des actions au profit de la paix de manière à pourvoir aux opérations de paix des Africains sur le continent. En effet, si l'Union africaine prononce des sanctions, elle ne dispose pas encore de moyens pour les mettre en application. Sur l'ensemble de son budget de 250 millions de dollars, seuls 45 millions proviennent des cotisations des Etats membres. Au sein de cet ensemble, seuls quelques pays contribuent de manière significative.
Le sommet UE-Afrique de Syrte, en Libye, en novembre 2010, a poursuivi cette démarche en soulignant notamment que « Nous sommes fermement décidés à rendre l'architecture africaine de paix et de sécurité pleinement opérationnelle, en étroite coopération avec les organisations régionales. Pour ce qui est des opérations de maintien de la paix dirigées par l'UA, il a été convenu d'oeuvrer à l'obtention de financements souples, prévisibles et durables. »
Les initiatives de l'Europe dans les domaines de la défense et de la sécurité touchent aujourd'hui un large périmètre lié aux opérations et missions de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ainsi qu'à l'entraînement et à la formation.
Sur les 16 missions civiles et opérations militaires actuelles de la PSDC, 8 ont lieu sur le territoire africain et concernent plus particulièrement la bande sahélienne, à savoir Mali, Niger, Soudan jusqu'à la Corne de l'Afrique, et la République démocratique du Congo. La proportion devrait augmenter car, sur la seule année 2012, les 4 dernières missions lancées l'ont été sur le territoire africain, a fortiori dans la bande sahélienne.
Pour le Sahel, une stratégie pour la sécurité et le développement a été adoptée en octobre 2010 avec comme objectifs le retour à la sécurité, une réduction de la pauvreté et une relance de l'économie. La dernière mission (EUTM Mali), décidée par le Conseil le 17 janvier 2013, vise à appuyer la formation et la réorganisation des forces armées maliennes.
Un autre champ d'action privilégié de l'Europe est la Corne de l'Afrique, qui comprend Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Somalie et Ouganda. Un cadre stratégique a été approuvé et un Représentant spécial a été nommé, avec mission de coordonner les moyens de l'Union européenne déployés sur place en se focalisant plus particulièrement sur la Somalie et la lutte contre la piraterie.
L'opération anti-piraterie EUNAVFOR Atalante a permis de protéger les navires du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et d'éradiquer progressivement la piraterie. En parallèle, l'Union européenne continue à former et entraîner les soldats somaliens qui participent maintenant à la reconquête de leur pays aux côtés de l'AMISOM, mission de l'Union africaine financée par l'Europe.
Une troisième mission, EUCAP Nestor, est en cours de montée en puissance. Elle a pour objectif de renforcer les capacités maritimes de cinq pays de la Corne de l'Afrique et de l'océan Indien occidental. Elle constitue en soi un élément important de l'approche globale de l'Union européenne en matière de lutte contre la piraterie. Dans le cadre de cette mission, l'Union européenne a développé des partenariats stratégiques avec l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
Une des particularités de ces interventions est la complémentarité avec les autres projets de coopération au développement financés par l'Union européenne Pour la Somalie, un programme complet de la Commission européenne couvre les secteurs de la gouvernance (institutions, État de droit, droits de l'homme), de l'éducation, du domaine social et du développement économique (ressources en eau, élevage, agriculture).
Depuis 2011, l'Union européenne alloue, en marge du Programme alimentaire mondial, une aide humanitaire supplémentaire pour venir en aide aux victimes de sécheresses, d'inondations, de famines, de conflits et de déplacements. On peut estimer que pour la seule Somalie, l'enveloppe financière engagée par l'Union européenne en 2012 s'est élevée à plus de 500 millions d'euros.
Dans ces opérations, la France est souvent restée une nation-cadre, notamment en Afrique francophone, tout en bénéficiant d'un soutien européen important.
La France trouve, quand elle arrive à convaincre ses partenaires à Bruxelles, une légitimité et des moyens qui lui font défaut ; en contrepartie, l'Europe a pu trouver de nouveaux « terrains d'expérimentation » pour sa politique de défense commune.
Le recours à des forces « européennes » est nécessaire car, dans certains pays, une intervention bilatérale s'avère impossible tant l'opinion publique serait réticente à voir l'ancienne puissance coloniale intervenir militairement. C'est typiquement le cas de la RDC.
L'affaire du Mali montre cependant le chemin à parcourir pour que l'européanisation de notre politique de sécurité en Afrique ait un sens. Pour l'instant l'Europe n'a pas de capacité politique à entrer en premier dans un théâtre d'opérations en Afrique comme ailleurs. Les délais de discussion pour obtenir une décision unanime sont incompatibles avec les nécessités d'une action militaire, comme l'a illustré le cas du Mali.
De même, le bilan de l'européanisation de RECAMP apparaît aux yeux de nombreux interlocuteurs encore assez décevant. Le programme EUROCAMP s'est concrétisé par un premier cycle d'exercices dit « Amani Africa », conduit de 2008 à 2010, pour lequel la France a accepté de demeurer nation-cadre.
L'appropriation de ce dialogue stratégique par l'Union Européenne semble s'être traduite par un essoufflement de la dynamique et une diminution de la coopération.
Les réticences des Allemands, voire des Anglais, à exercer un rôle actif dans la sécurité régionale africaine ont des raisons historiques, mais tiennent également au comportement de la France.
A titre d'illustration, lors de l'opération au Tchad en février 2008, l'intervention des soldats d'Épervier au profit d'Idriss Déby a donné aux partenaires européens de la France l'impression d'être instrumentalisés par Paris pour maintenir au pouvoir l'un de ses alliés africains. Certains des États de PUE ont alors envisagé le retrait de leurs soldats déjà déployés ; quant à l'Allemagne et au Royaume-Uni, l'intervention française les a confortés a posteriori dans leur décision de ne pas envoyer de troupes pour l'opération européenne.
C'est donc en impliquant en amont ses partenaires sur des objectifs partagés que la France peut espérer partager avec ses partenaires européens des responsabilités dans la stabilité du continent.
La politique de l'Union européenne en Afrique dans les domaines de la sécurité et de la défense concerne enfin des perspectives à plus long terme.
L'interlocuteur privilégié reste l'Union africaine (UA), dont le rôle est d'assurer la concertation à moyen terme et, si nécessaire, d'intervenir pour la stabilité du continent. En particulier, l'Union africaine développe une architecture africaine de paix et de sécurité destinée à lui permettre de garantir la paix et la stabilité sur le continent.
Afin de participer à cet objectif, l'Union européenne a signé avec l'Union africaine une stratégie commune en 2007, traduite dans un plan d'action financé par l'Union européenne à hauteur d'1 milliard d'euros.
Aujourd'hui, vue la situation de l'Europe de la défense et de la politique étrangère commune, à européaniser sa politique africaine, la France gagne en légitimité et en moyens et perd en autonomie et en réactivité.
La situation actuelle se caractérise par un entre-deux où la France cherche à jouer sur les deux tableaux en cherchant un équilibre entre l'invention d'une politique africaine de l'Europe aujourd'hui embryonnaire et le maintien d'une spécificité française en Afrique.
III. LA FRANCE EST-ELLE EN TRAIN DE RATER UN TOURNANT STRATÉGIQUE ?
Les entreprises françaises perdent des parts de marchés dans une Afrique qui s'impose comme une des zones de croissance les plus dynamiques, nos moyens diplomatiques s'amenuisent. La Francophonie, qui a toujours été et qui reste notre atout, est en régression. Notre coopération au développement, qui reste une des coopérations les plus impliquées en Afrique, manque de plus en plus de moyens pour peser notamment dans les pays pauvres francophones.
Les domaines où notre présence reste marquante, les aspects militaires et l'aide au développement, restent à la charge de l'État pendant que d'autres pays développent avant tout des relations commerciales. Comme le disait un ambassadeur chinois en Afrique qui ne manquait pas de malice, « c'est très bien, vous assurez la sécurité, nous faisons des affaires ». Alors faut-il s'en inquiéter ? Nous avons posé la question à de nombreux interlocuteurs et les réponses varient considérablement de l'un à l'autre.
A. LA FRANCE PEUT APPARAÎTRE MOINS MENACÉE QU'ON NE LE CROIT
D'un côté, celui des administrations, tous ministères confondus, la tentation est de nuancer la tendance en minimisant l'enjeu et le recul.
Tous les responsables politiques ne sont pas sur cette ligne loin s'en faut. Dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, fin septembre 2012, le ministre français de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici, a rappelé que la France est encore le deuxième exportateur vers l'Afrique subsaharienne, derrière la Chine mais devant les États-Unis et l'Allemagne. « Ce n'est pas si mal. En même temps, il ne faut pas s'en contenter » fait observer le ministre de l'Economie et des Finances qui veut réorienter le partenariat entre la France et l'Afrique « en aidant les entreprises françaises à mieux appréhender le risque qu'elles tendent à surévaluer et à aller de l'avant ». « Nous n'avons pas à avoir peur des Chinois » a-t-il ajouté.
Mais beaucoup de responsables administratifs restent dubitatif quant à la nécessité de réinvestir l'Afrique.
On nous dit que l'époque où la France faisait de l'Afrique sa « chasse gardée » est révolue. Ce fut le cas en un temps où sa puissance dépendait de la domination qu'elle exerçait sur ses colonies d'Afrique. Mais, aujourd'hui, sa puissance dans un monde globalisé ne dépend plus de l'Afrique. Elle se joue en Europe, d'abord, puis sur l'ensemble des marchés internationaux de plus en plus intégrés. La France milite pour que la paix et la sécurité y soient désormais garanties dans un cadre européanisé, car être l'exclusif gendarme de l'Afrique n'est pour elle que de peu de bénéfice. Car, avant d'être un atout, son rôle en matière de sécurité est une lourde responsabilité, coûteuse, que l'on doit aujourd'hui mieux partager pour demain s'en défaire devant la constitution, à terme, d'une architecture de sécurité exclusivement africaine.
Que notre coopération se dilue dans l'aide européenne, ce n'est que le sens de l'histoire. Qu'elle soit déliée et ne profite que marginalement aux entreprises françaises, c'est naturel, car ce n'est pas son objectif premier. Il existe, de plus, des instruments dédiés au commerce extérieur. Plusieurs études montrent enfin que le déliement de l'aide profitant in fine aux entreprises françaises qui ont ainsi accès à l'ensemble des marchés financés par l'ensemble des bailleurs de fonds, alors qu'elles y perdraient à rester concentrées sur une aide qui ne représente que 8% de l'aide programmable mondiale.
Qu'en est-il des approvisionnements en matières premières et des parts de marché des entreprises françaises ? Le poids de la zone franc dans le commerce extérieur français est tombé à seulement 1%, c'est négligeable. Dans ces conditions, la perte de quelques marchés africains, si elle émeut les quelques groupes français qui détiennent encore des marchés importants en Afrique (Bolloré, Bouygues, Total, Accor ...), ne menacerait nullement les équilibres macroéconomiques de la France.
Minorer l'enjeu, mais aussi le recul de notre présence. La menace d'un déclassement serait exagérée.
Sans doute l'Afrique s'ouvre à de nouveaux partenaires. Ce faisant, elle entre à son tour de plain-pied dans une mondialisation caractérisée par la multiplication des échanges et la diversification des partenaires.
L'Afrique ne constitue plus pour la France une « chasse gardée » que la pénétration commerciale de nouveaux acteurs menace. Les pays africains se développent, multiplient les partenariats et font jouer la concurrence. Sans doute les nouveaux acteurs du continent africain enregistrent-ils une croissance très rapide de leurs parts de marché. Mais on oublie trop souvent qu'ils partaient de très bas. Le marché africain s'accroît et s'ouvre à l'international, il est naturel que notre part de marché connaisse une dilution sur un marché plus vaste avec des acteurs plus nombreux. « Est-ce si grave ? » s'est demandé devant le groupe de travail M. Yves Gounin, conseiller d'Etat, conseiller à l'ambassade de France au Kenya, puis à la Présidence du Sénégal et auteur d'un livre intitulé « La France en Afrique », « La France n'a plus besoin économiquement de l'Afrique » disait le Président Sarkozy. Il n'avait pas complètement tort » a-t-il ajouté.
De plus, la perte de parts de marché relative devrait être à terme compensée par l'augmentation de la taille du marché.
Sur le plan politique, il est vrai que l'Afrique subsaharienne n'est plus ce continent où, selon la formule souvent répétée : « la France pouvait faire l'Histoire - c'est-à-dire abattre ou rétablir un régime avec 200 hommes et quelques avions ». Mais peut-on vraiment souhaiter le contraire plus de 50 ans après les indépendances ?
Dire que la France est aujourd'hui supplantée par la Chine serait cependant commettre une erreur de jugement. C'est pourquoi l'on aurait tort de céder à la tentation de la formule facile de la « Chinafrique ». La relation franco-africaine et la relation sino-africaine ne sont en rien comparables. Si la France et l'Afrique ont, après la colonisation, maintenu une relation symbiotique étroite, rien de tel dans la relation sino-africaine.
Comme le souligne Yves Gounin : « Dans un cas, on est face à une relation consubstantielle, fruit de l'histoire et de la géographie, mais surtout d'une longue connivence linguistique, culturelle, politique, financière et d'une diaspora nombreuse de part et d'autre ; dans l'autre cas, ce qui frappe, c'est, au contraire, la diversité des acteurs et des stratégies » 60 ( * ) .
Il faut se méfier d'une lecture de la percée chinoise qui croit deviner, derrière la présence économique et humaine croissante des Chinois sur le continent, l'exécution soigneusement planifiée d'une politique expansionniste. Des travaux de terrain, menés par des géographes, des sociologues ou des anthropologues dévoilent la variété sinon l'impréparation des parcours des immigrants chinois. Pour nombre d'observateurs, la diaspora chinoise essaime un peu partout dans l'ensemble régional africain sans programmation arrêtée de ses parcours migratoires, sans stratégie élaborée.
La percée de ces nouveaux acteurs s'effectue de plus principalement dans des pays extérieurs au « pré carré ».
Les principaux partenaires de la Chine sont, on l'a dit, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Soudan. L'Inde entretient les relations les plus actives avec les pays d'importantes communautés indiennes et ismaéliennes. Le Brésil s'appuie en priorité sur les pays lusophones.
Dans les pays francophones, la France n'est plus seule ; mais elle est encore prédominante. Ainsi, la Chine est devenue le deuxième investisseur en CEMAC et en UEMOA en 2010, le stock d'investissement direct de ce pays représentant respectivement 4% et 13% du total. Mais il convient toutefois de relativiser cette progression spectaculaire au regard des positions acquises par des pays de la zone euro, et en premier lieu la France dont le stock d'investissement représentait en 2010, respectivement 56% et 70% du total du stock d'IDE en CEMAC et en UEMOA 61 ( * ) .
Les Français y sont la communauté expatriée la plus nombreuse aussi bien au Sénégal, qu'en Côte d'Ivoire ou à Madagascar.
L'ambassadeur de France à Abidjan, Dakar ou Tananarive est la personnalité la plus importante du corps diplomatique, celle vers laquelle ses collègues se tournent pour obtenir de l'information, celle qui a le privilège d'être reçue fréquemment par le Chef de l'Etat - alors que la plupart des ambassadeurs ne le rencontrent en tête-à-tête que pour lui remettre leurs lettres de créances et à l'occasion de leur visite de départ.
De même, il est frappant de constater la place qu'occupe encore la France dans l'économie locale, où les entreprises françaises réalisent un quart du PIB et des entrées fiscales, dans la vie diplomatique et, plus que tout, dans les mentalités.
Comme nous l'a fait observer Lionel Zinsou : « Une grande partie des actifs africains appartiennent aux Européens et en Afrique francophone aux Français sans qu'ils le savent » Dans la zone franc, le stock d'investissements directs français est tel que les entreprises françaises sont dans certains pays les premiers employeurs du secteur formel.
Il est de même frappant de constater la persistance de la zone Franc qui a survécu à la période coloniale à la différence de toutes les autres zones monétaires. Bien que présentant des avantages en termes de convertibilité, de monnaie régionale et d'absorption des chocs extérieurs, la zone Franc est régulièrement critiquée en raison du risque de surévaluation et de l'absence de maniement du taux de change. Souvent perçue comme une atteinte à la souveraineté monétaire, elle n'a néanmoins pas été remise en cause par les gouvernements africains et continue de participer de l'influence de la France.
Enfin, la présence militaire de la France en Afrique demandée par les État africains lui assure un statut à part.
Aucune autre puissance européenne n'assure une telle présence sur ce continent. Aucune autre puissance n'est en mesure de déclencher en urgence une opération militaire d'envergure. Ces derniers mois en ont fait la démonstration. Voilà ce qu'on peut entendre à Paris : « L'épisode malien en témoigne, la France joue encore un rôle central en Afrique ». Circulez, il n'y a rien à voir !
B. SANS DOUTE LA LUNE DE MIEL AVEC LES NOUVEAUX PARTENAIRES ÉMERGENTS EST-ELLE TEMPORAIRE
Une autre figure du déni est la dénonciation des nouveaux compétiteurs qui viendraient sournoisement nuire à nos intérêts et par la même occasion à ceux de l'Afrique tant les deux se conjuguent naturellement.
Il y a une dizaine d'années, c'était contre les États-Unis qu'il fallait se prémunir. À l'époque, on voyait la main de l'oncle Sam partout : dans l'éviction de la France des Grands Lacs, dans la défaite de Abdou Diouf au Sénégal, dans la victoire du peu francophile Marc Ravalomanana à Madagascar. Aujourd'hui, qui parle encore de la menace américaine ?
Une menace chassant l'autre, Pékin a remplacé Washington dans le rôle du grand méchant. Dans les descriptions qu'on entend de la « Chinafrique », on lit en filigrane le projet expansionniste d'une puissance hostile, décidée à conquérir le monde en commençant par ses marges les plus fragiles avec des pratiques forcément douteuses.
Il faudrait souhaiter à l'Afrique des partenaires plus loyaux, plus respectueux de ses intérêts à l'instar de Hillary Clinton qui, dès son arrivée à Dakar le 1 er août 2012, avait affirmé que Washington souhaitait des « partenariats qui ajoutent des valeurs et non qui se contentent de les extraire ».
Ce discours, qui puise parfois dans une hostilité systématique vis-à-vis de la Chine, voire un ethnocentrisme au relent de racisme antichinois, doit être examiné avec vigilance. Il y a là une facilité qui évite à chacun de se regarder en face. Il ne faut ni pêcher par naïveté, ni considérer que, parce les puissances émergentes s'imposent aujourd'hui là on nous étions seuls, leur attitude est naturellement discutable.
Il faut regarder en face les opportunités qui se présentent aux pays africains aujourd'hui avec la multiplication des partenariats, mais ne pas ignorer les dangers des processus en cours.
Sans doute, la lune de miel actuelle entre les pays émergents et l'Afrique aura une fin car on sent poindre en Afrique une certaine exaspération devant une forme de néocolonialisme en particulier Chinois. Mais il ne sert à rien de tabler sur le rejet de nos concurrents pour nous rassurer et espérer regagner le terrain perdu.
1. Les nouveaux pays émergents : une contribution essentielle à la croissance africaine ?
Du point de vue du développement strictement économique, un examen impartial de la contribution des pays émergents à la croissance africaine ne peut que relever certains aspects particulièrement positifs.
Sur le moyen terme, la concurrence comme les importateurs les plus « gourmands en matières premières » ont eu un effet positif significatif sur le prix et les volumes des matières premières exportées depuis l'Afrique subsaharienne.
La concurrence autour des appels d'offres sur les projets de grande envergure a favorisé une baisse des prix des offres et constitue un atout pour les autorités africaines, même si parfois certains contrats en apparence avantageux se sont révélés plus coûteux qu'il n'y paraissait.
L'ensemble a stimulé l'offre et la demande intérieures en Afrique. Et la décennie 2000 a montré que la présence des pays émergents sur le continent a accru la capacité du continent à résister à des crises conjoncturelles.
En effet, la crise de 2008 n'a fait qu'accélérer le commerce sud-sud, renforçant le lien entre l'Afrique et la croissance économique forte des puissances émergentes, tandis que la faible intégration financière africaine aux marchés internationaux a considérablement limité la propagation de la crise au continent. L'intensification des échanges avec les émergents a atténué la dépendance économique de l'Afrique aux partenaires traditionnels qu'étaient les pays occidentaux.
Les puissances émergentes ont contribué également à l'exploration et l'exploitation des réserves par leurs investissements et aident à la construction d'infrastructures et de moyens de transport par le truchement de leur coopération au développement. En outre, elles étendent l'échantillon des ressources exploitables du continent au-delà de ce que les puissances traditionnelles pouvaient explorer et importer à elles seules.
Dans de nombreux pays, même si l'essentiel des investissements des partenaires émergents vise à s'approvisionner en ressources, ils permettent de lever des prêts garantis par les ressources pour réaliser des projets d'infrastructures d'importance cruciale dans les domaines de l'éducation, de l'énergie et des services publics.
Les interventions des pays émergents en matière de coopération ont été, en outre, à bien des égards, complémentaires de celles des bailleurs de fonds traditionnels.
Ces dernières décennies, les partenaires traditionnels ont concentré leurs efforts de coopération sur la réduction de la pauvreté, les secteurs sociaux et la gouvernance. Les émergents, pas seulement la Chine, semblent se concentrer davantage sur les goulots d'étranglement dans les infrastructures et autres secteurs structurels.
Enfin, les importations de biens de consommation courante à prix abordable venus d'Asie participent à l'accroissement du pouvoir d'achat des Africains et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les équipements meilleurs marché et plus adaptés permettent aux entreprises d'augmenter leur productivité et de progresser dans l'échelle de valeurs mondiale.
La stimulation économique entreprise par les puissances émergentes soutient l'accroissement potentiel du niveau de vie africain moyen et augmente le bien-être des actifs. Preuves du dynamisme africain, les importations du continent ont été multipliées par 4 entre 1990 et 2000, surpassant les importations des émergents et des pays de l'OCDE grâce à une hausse de la demande africaine.
2. Un partenariat gagnant perdant ?
La face sombre de cette ruée vers l'Afrique est liée à sa dépendance accrue vis-à-vis des exportations en matières premières qui limite la diversification de son économie et renforce sa place défavorable dans la division internationale du travail.
L'arrivée des émergents sur le continent ne peut que renforcer la spécialisation de l'Afrique dans l'exportation de matières premières (hydrocarbures, minerais, bois). Le Brésil, l'Inde et la Chine concentrent leurs achats sur les produits pétroliers, qui représentent 80 à 90% de leurs importations.
Les importations africaines sont, à l'inverse, assez diversifiées : les États se tournent vers la Chine pour les télécommunications et le textile, ils s'adressent à l'Inde pour les produits pharmaceutiques et pétroliers et achètent des denrées alimentaires auprès du Brésil.
L'intensification des échanges commerciaux entre les puissances émergentes et l'Afrique restreint le continent dans un statut d'exportateur de matières premières tandis qu'elle accroît sa dépendance aux produits manufacturés et à des secteurs spécifiques de chacune des économies émergentes.
Les investissements chinois dans l'agriculture (en particulier dans la production d'agrocarburants) ont tendance à favoriser le développement des monocultures d'exportation. L'importation massive de produits chinois provoque le déclin du secteur industriel local, notamment textile, dans les rares pays où il a pu se développer, notamment en Zambie, Afrique du Sud, Cameroun, Gabon, Nigeria et cela malgré les tarifs préférentiels accordés par la Chine.
Enfin, si les recettes budgétaires des gouvernements peuvent se trouver augmentées grâce aux exportations vers la Chine, se pose la question de la répartition de ces recettes (pour quelle usage/redistribution étant donné la dégradation de la gouvernance ?) et de la durée (combien de temps cela va durer étant donné que les ressources exportées sont pour une bonne part non renouvelables ?). Mais l'Europe fait-elle mieux à ce niveau ?
En important des matières premières et en exportant des produits finis, la Chine reproduit en effet un schéma d'exploitation coloniale. Elle accentue la mono-spécialisation comme le faisaient jadis les métropoles coloniales qui n'avaient pas encouragé la transformation sur place des matières premières qui y étaient produites.
Sans doute l'exportation du pétrole et des richesses minières gonfle-t-elle les caisses de l'État ; mais ces rentes font courir aux États qui les perçoivent le risque d'être frappés par le « syndrome hollandais » : captation des bénéfices par les élites, désaffection des autres secteurs de l'économie nationale, fragilité accrue face aux fluctuations des cours mondiaux, appréciation de la monnaie, risque de multiplication des conflits pour s'approprier les richesses naturelles.
En outre, cette situation met les pays africains dans une situation de très forte dépendance à l'égard de la Chine. La Chine absorbe aujourd'hui 30 à 40% du fer ou du cuivre vendu sur le marché international, et jusqu'à 60% du soja, pour ses élevages. Le fait que Pékin se mette à stocker d'énormes quantités a des effets massifs sur les cours mondiaux et sur les économies africaines.
On l'a bien vu en 2012 et en 2013 avec les incertitudes politiques, autour de la réunion du 18 e congrès du parti communiste chinois, et économiques avec une diminution de la croissance chinoise. Des incertitudes qui se sont traduites sur un certain nombre de marchés de matières premières industrielles notamment les minerais de fer, le cuivre et le caoutchouc.
Dans un continent où les institutions étatiques sont encore faibles, il est difficile de gérer efficacement la rente liée à l'exportation des matières premières. Les gains engendrés conduisent à une surévaluation de la monnaie qui entraîne un problème de compétitivité pour les secteurs soumis à la concurrence internationale, notamment l'industrie manufacturière qui ne peut rivaliser avec l'offre des émergents sur la scène mondiale.
Cela étant dit, certains comportements des émergents, en particulier des entreprises chinoises, sont en train de susciter des réticences croissantes dans de nombreux pays où l'on découvre que les relations ne sont pas aussi « gagnant-gagnant » qu'on le dit.
3. Tabler sur l'échec des pays émergents : une stratégie perdante
De nos séjours en Afrique, nous avons vu prospérer dans l'opinion publique un rejet croissant de certains aspects de la présence essentiellement chinoise.
De nombreux médias africains dénoncent régulièrement une politique commerciale fondée sur une sous-évaluation du Yen qui permet une compétitivité des prix qui serait à l'origine de l'effondrement des industries locales naissantes. Comatex et Batexci, deux grandes entreprises textiles du Mali, auraient ainsi été durement touchées par l'importation de tissus bon marché d'Asie. Au Nigeria, le secteur textile serait aujourd'hui en grande difficulté face à la concurrence de la Chine, tandis que le gouvernement tanzanien a interdit l'accès de certains produits chinois pour protéger les producteurs locaux.
Par ailleurs, la non-convertibilité de la monnaie chinoise et ses capacités financières lui permettent de mener des politiques commerciales agressives qui fausseraient la concurrence aussi bien avec les entreprises locales qu'occidentales. Dans le secteurs du BTP, on dénonce pêle-mêle les subventions cachées des entreprises semi publiques et les financements liés qui permettent aux entreprises chinoises de faire des marges suffisantes pour pouvoir vendre à perte sur les appels d'offre internationaux.
Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que les pratiques de ces nouveaux acteurs ne s'embarrasseraient guère du respect des règles de bonne conduite.
Certains n'hésiteraient pas à recourir à la corruption, ce qui encourage les « kleptocraties africaines ». D'autres s'exonéraient du paiement des impôts et des taxes au risque de décrédibiliser l'État.
Mais ce serait principalement sur les plans social, politique et environnemental que l'intrusion de la Chine en Afrique poserait le plus problème. En effet, les droits sociaux des travailleurs africains employés par les entreprises chinoises seraient régulièrement bafoués (sous-payés, non reconnaissance des syndicats, etc.). Et les entreprises chinoises ne font preuve que de très peu de responsabilité sociale.
Quand elles recourent à la main-d'oeuvre locale, les entreprises chinoises leur imposeraient des méthodes de travail très dures, parfois en violation du droit national. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'on assiste actuellement à une multiplication de réactions d'opposition à la présence chinoise de la part des populations d'Afrique : Au Sénégal où les petits commerçants se sont ligués pour interdire aux marchands chinois de leur faire concurrence, en Zambie où une cinquantaine d'ouvriers africains d'une usine de dynamite de la Copperbelt sont morts dans un accident provoqué par la violation des règles de sécurité par l'employeur chinois.
Le meurtre du directeur chinois d'une mine de cuivre, dans ce même pays, le 4 août dernier, illustre cruellement les risques qui accompagnent la croissance spectaculaire de l'investissement chinois en Afrique. Un an auparavant, dans cette même mine de Collum, les cadres chinois avaient réagi aux revendications des mineurs en leur tirant dessus à balles réelles, blessant douze d'entre eux. Au Nigeria, on a assisté à un enlèvement d'ingénieurs chinois, ce qui signifie désormais que la Chine n'est plus à l'abri des attaques jusque-là réservées au Nord.
Si la préoccupation des Chinois pour les normes sociales semble faible, il en va de même pour les normes environnementales qui sont souvent négligées dans la quête des ressources naturelles et la mise en oeuvre des projets d'infrastructure (routes, ponts, voies ferrées, barrages, etc.).
Sur ces deux plans, il faut bien admettre que les pratiques des investisseurs européens, bien qu'inégales, sont en voie d'amélioration (montée en force des principes de responsabilité sociale et environnementale, codes de bonne conduite, etc.), notamment du fait qu'elles sont l'objet de contrôles et de pressions de la part des sociétés civiles européennes (campagnes internationales à l'exemple de celle contre IKEA).
La dernière préoccupation enfin concerne le renforcement de la démocratie et de la Gouvernance.
Comme l'a souligné Bertrand Badie « L'Afrique, épuisée par les plans d'ajustement structurel et exaspérée par les conditionnalités politiques qui accompagnent l'aide occidentale qui lui est chichement distribuée, est évidemment séduite par le nouveau « consensus de Pékin », moins regardant sur les droits de l'homme et les droits sociaux ».
Certains régimes africains, mis au ban de la communauté internationale, trouvent avec ces nouveaux partenaires le moyen de rompre leur isolement diplomatique. Le Soudan, qui vend les deux tiers de son pétrole à la Chine, a pu longtemps compter sur son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer l'adoption de résolutions trop contraignantes sur le Darfour ; alors qu'il venait d'être mis en cause par la Cour pénale internationale, le Président soudanais a ainsi pu narguer la communauté internationale en participant à Istanbul au sommet Turquie-Afrique en août 2008. Le Zimbabwe de Robert Mugabe, en réaction aux sanctions dont il fait l'objet, a développé une « Look east policy » visant à remplacer les investisseurs occidentaux par des investisseurs asiatiques.
De là à penser comme Bertrand Badie que « la force des émergents est de se plaire à contourner les voeux de la communauté internationale et à offrir des portes de sortie dans lesquelles les vieux dictateurs, de Khartoum à Harare, aiment à se précipiter. Risquons l'hypothèse que l'Afrique peut être la grande victime de tout ce remue-ménage », il y a un pas que franchissent de nombreuses ONG africaines relayées par une opinion publique de plus en plus hostile à la présence chinoise.
Il en va jusqu'à la coopération chinoise en matière d'infrastructure dont la qualité est critiquée. Une partie des routes construites dans les années 70 et 80 par la Chine en Afrique se seraient effondrées, certains bâtiments publics se seraient fissurés, etc. Les infrastructures sanitaires et scolaires suivraient le même chemin.
Certains gouvernements commencent à réagir. Le gouvernement tchadien a annoncé cette année avoir suspendu « toutes les activités » de la filiale tchadienne de la compagnie pétrolière publique chinoise (CNPCIC) pour « violation flagrante des normes environnementales » dans ses forages d'exploration de brut dans le sud du pays, à Koudalwa, à environ 200 km au sud de N'Djamena.
Dans une tribune parue le 11 mars 2013 dans les colonnes du Financial Times, le gouverneur de la banque centrale du Nigeria, Lamido Sanusi s'insurge contre le pouvoir qu'a réussi à prendre la Chine vis-à-vis des pays africains. Il dénonce des méthodes dignes du colonialisme et espère une réaction de la part des décideurs politiques et économiques africains pour mettre un terme à cette dépendance.
M. Lamido Sanusi écrit : " il est temps pour nous d'ôter les lunettes teintées de rose à travers lesquelles nous voyons la Chine ". Une façon pour lui de taper du poing sur la table et de tenter de provoquer un sursaut des acteurs économiques de son pays face à ce qu'il considère comme de l'impérialisme de la part de l'Empire du Milieu.
Il dénonce des relations commerciales qu'il considère inégales entre la puissance commerciale mondiale qu'est devenue la Chine et les pays d'Afrique, prêts à concéder l'exploitation de leurs ressources naturelles contre des devises fraîches et des prêts, et contre des biens manufacturés de faible qualité mais très peu onéreux. " La Chine nous prend des matières premières et nous fournit des biens manufacturés. C'était aussi l'essence du colonialisme " s'insurge-t-il dans les colonnes du journal britannique.
La structure du commerce bilatéral " n'est pas viable sur le long terme ", a également mis en garde le président sud-africain Jacob Zuma lors du Forum Chine-Afrique tenu à Pékin en juillet 2012.
Ces critiques rejoignent des observations que d'autres bailleurs de fonds ont formulées depuis longtemps notamment sur les aspects financiers. « Les Chinois accordent à des économies déjà lourdement endettées des prêts « insoutenables » ». La Chine en particulier apporterait à l'Afrique des ressources financières, généralement non concessionnelles, d'un montant massif, pouvant contribuer au ré-endettement non soutenable des pays.
En Zambie, en 2011, la présence chinoise a été au coeur des débats de l'élection présidentielle qui s'est soldée par l'élection de Michael Sata dont les discours ont dénoncé pendant toute la campagne la mainmise des intérêts chinois sur le pays.
L'ensemble de ces critiques, qui méritent une évaluation plus approfondie, illustre l'émergence d'un regard distancié à l'égard de ces nouveaux partenaires. La France peut y contribuer en engageant ces nouveaux partenaires à respecter des normes minimales en matière de financement soutenable à destination des pays à faible revenu, en matière de soutenabilité sociale, financière et environnementale de leurs industries extractives. De nombreuses initiatives collectives vont dans ce sens.
Elles commencent à produire des effets. Ainsi la Banque d'investissement chinoise en Afrique, l'Exim Bank, se montre actuellement de plus en plus soucieuse par rapport aux remboursements, sur les questions de transparence et à la notion de risque pays. Elles doivent être soutenues.
Mais en revanche, il apparaît vain d'espérer que ces critiques s'amplifient au point d'entraîner un recul de la présence des émergents en Afrique
L'impact du commerce avec les émergents dépendra du facteur temps.
A court terme, il présente un avantage incontestable pour l'économie africaine. Sur le long terme, si l'on considère que le développement est fonction de l'installation de structures productives plus que de l'évolution des besoins mondiaux en matières premières, alors le défi du changement structurel de l'économie sera plus difficile à relever pour l'Afrique subsaharienne.
Or, la construction sur le temps long est, par essence, politique ; ce sont donc les politiques publiques, les structures étatiques et les négociations bilatérales qui détermineront le développement du continent africain.
Les sommets liant les émergents à l'Afrique sont autant d'opportunités pour les dirigeants du continent de protéger leurs intérêts économiques face à des partenaires toujours plus dépendants des ressources africaines.
En attendant, à la France de jouer sa partition en accompagnant les pays africains dans un développement qui puisse nous être mutuellement bénéfique. Dans cette perspective, la France pourrait tirer avantage à développer plus qu'aujourd'hui des partenariats triangulaires avec les pays émergents. Certaines entreprises françaises l'ont bien compris qui développent en Afrique des partenariats avec des investisseurs indiens ou chinois. Dans le domaine de la coopération au développement, c'est également une voie à creuser pour amener les partenaires émergents à un dialogue sur les modèles de développements africains.
C. MAIS, DANS LE NOUVEAU CONTEXTE STRATÉGIQUE, IL Y A POUR LA FRANCE UN IMPÉRATIF AFRICAIN
A l'inverse des thèses visant à minorer l'importance de l'Afrique dans les intérêts stratégiques de la France, nous estimons à l'issue de ce travail de réflexion qu'il y a un impératif que nous voudrions ici résumer.
Si, en Afrique, le tournant du siècle marque une rupture avec la période précédente, c'est en raison de trois facteurs décisifs qui s'imposent à ce continent comme à d'autres : la montée des interdépendances, l'inversion des pôles de croissance entre le Nord et le Sud et, enfin, la perspective d'une tension, voire d'une pénurie de ressources naturelles au niveau mondial.
Ces trois ruptures sont de nature à nous faire reconsidérer la place de l'Afrique dans notre conception des intérêts stratégiques français et européens.
1. Avec la montée des interdépendances, l'échec de l'Afrique serait un cauchemar
La montée des interdépendances est le phénomène le plus frappant. Hier, les troubles au Zaïre, les dérapages d'un chef d'Etat en Centrafrique, les guerres de la RDC pouvaient menacer les intérêts français, leurs conséquences restaient loin du territoire national et n'impliquaient qu'indirectement la sécurité de l'Hexagone.
Aujourd'hui, la menace terroriste, les cyberattaques, les implications de la piraterie, le développement des trafics illicites et l'immigration, l'éclatement de la Somalie ou du Mali, la révolution dans les pays arabes ont, à des degrés divers, un impact immédiat sur la collectivité nationale.
Cette montée des interdépendances qui touchent aussi bien les questions de sécurité que les questions sanitaires avec le développement des épidémies, fait de l'Afrique, à 12 kilomètres du Sud de l'Europe, une préoccupation centrale pour la sécurité de notre continent.
Comme le souligne le Livre blanc de 2008, « qu'il s'agisse de l'immigration clandestine, de la radicalisation religieuse, de l'implantation des groupes terroristes, des réseaux criminels, les trafics divers, des réseaux de prolifération, ou du blanchiment, la bande sahélienne, de l'Atlantique à la Somalie, apparaît comme le lieu géométrique de ces menaces imbriquées et, à ce titre, appelle une vigilance et un investissement spécifique de la durée. ».
Et, depuis, la situation n'a fait que se dégrader, à tel point que le Livre blanc de 2013 réévalue la place de l'Afrique dans la stratégie nationale de défense et de sécurité française : « Si l'Afrique subsaharienne confirme dans les prochaines décennies un décollage économique qui a été marqué, dans les cinq dernières années par une croissance annuelle de 5%, le continent peut devenir un des moteurs de la croissance du monde et contribuer fortement à la prospérité européenne. Cependant, l'Afrique subsaharienne est également une zone de grandes fragilités. De 2003 à 2012, une dizaine de pays ont été secoués par des crises politiques ou des guerres civiles, et la majorité des casques bleus des Nations unies y sont déployés, parfois depuis plus de dix ans. Selon que les espaces non gouvernés ou à faible gouvernance reculeront ou au contraire s'étendront, ce sont deux avenirs bien différents qui se profileront à l'horizon des vingt prochaines années. Nulle part, sans doute, l'éventail des possibles n'est aussi ouvert que sur le continent africain ».
S'il convient de ne pas regarder l'Afrique sous le seul angle de la menace, il faut avoir conscience que la France et l'Europe ne peuvent pas, même si elles le voulaient, se désintéresser de l'Afrique. Cela d'autant plus que l'évolution stratégique des États-Unis les conduit à être plus sélectifs dans leurs engagements extérieurs. Si les États-Unis continuent de s'intéresser à l'Afrique, comme en témoigne la création d'un commandement spécialisé AFRICOM, ils considèrent désormais que les Européens, plus directement concernés par sa stabilité et disposant des moyens d'en assumer la charge, doivent prendre une plus grande part à la sécurité du continent africain.
Comme il a été dit à propos de l'éventualité de l'instauration d'un régime djihadiste à Bamako, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir l'Afghanistan sur la rive sud de la Méditerranée. L'Afrique présente de réelles opportunités de croissance, mais elle devra également faire face à de nombreux défis dont le moindre n'est pas le doublement de sa population d'ici 2050. L'Afrique est au milieu du gué, si par malheur ce choc démographique déstabilisait le continent, l'Europe serait en première ligne pour en subir les conséquences. La France le voudrait qu'elle ne pourrait se désintéresser du continent, la crise malienne en témoigne.
2. Nous jouons une partie de notre future croissance en Afrique
La deuxième rupture a trait à la crise financière, au déclin économique de l'Europe, à ses implications politiques et, par contraste, au décollage économique d'une partie de l'Afrique et à la consolidation de la situation des pays émergents.
Alors que les conséquences économiques et sociales se font sentir depuis de nombreuses années, la France et l'Europe commencent seulement à ressentir les conséquences politiques et stratégiques du déclin de leur croissance économique depuis plusieurs décennies.
La crise des dettes souveraines entraîne aujourd'hui les pays européens dans des politiques d'ajustement structurel bien connues des pays africains. Le redressement des finances publiques en Europe se traduit par une réduction de la taille des outils diplomatiques et militaires alors que, dans le même temps, les pays émergents ne cessent d'accroître les leurs.
L'Afrique est, à cet égard, un terrain privilégié pour observer le chassé-croisé entre les anciennes puissances coloniales et les nouvelles puissances nées de la mondialisation des années 2000. A la fermeture des centres culturels français en Afrique correspond la création ces dernières années de plus de 25 instituts Confucius dans 18 pays, à la diminution du budget de la coopération française correspond un doublement de l'aide Chinoise etc.
Pour retrouver des marges de manoeuvre, la France doit impérativement retrouver le chemin de la croissance. C'est le sens de la priorité donnée par le ministère des affaires étrangères à la diplomatie économique qui doit favoriser la conquête de marchés extérieurs et réduire le déficit de notre balance commerciale.
Or l'Afrique qui connaît une croissance de plus de 5% depuis dix ans n'offre-t-elle pas aujourd'hui des opportunités qui n'existaient pas hier ? Longtemps, face au continent africain, la compassion était de rigueur.
Aujourd'hui une grande partie des économies du continent subsaharien est en passe de se transformer, d'économies de comptoirs assises sur les exportations de ressources naturelles en économies endogènes, diversifiées et nourries par un marché intérieur en croissance continue.
Demain, les entreprises qui se seront implantées dans cette Afrique qui bouge seront à la tête d'un marché considérable et particulièrement dynamique à l'image du Cimentier nigérian Dangote qui prépare une introduction en Bourse comprise entre 35 et 40 milliards de dollars environ, sans augmentation de capital. Un niveau qui valoriserait le groupe cimentier numéro un au Nigeria - et en plein développement panafricain - à un niveau très nettement supérieur à celui atteint par ses concurrents internationaux ; la capitalisation du français Lafarge tourne en effet autour de 11 milliards de dollars, celle du suisse Holcim tutoie les 20 milliards tandis que celles du mexicain Cemex et de l'allemand Heidelberg sont en-dessous des 10 milliards.
Lionel Zinsou nous a dit « alors que la croissance africaine décolle, la modernité de la France, c'est de sortir de l'Afrique et d'investir en Asie ». Bien sûr, il faut être en Asie, mais il faut aussi penser à plus long terme et voire l'Afrique comme une opportunité à 10 ans.
Ce qui se passe sur ce continent n'est pas seulement un changement de rythme, mais un changement de nature, fondé sur des éléments structurels tels que l'urbanisation et les évolutions démographiques.
Il demeure des défis considérables, économiques, politiques, sanitaires, urbains, énergétiques et alimentaires qui sont loin d'être maîtrisés. Il reste que, pour les 30 ans à venir, il semble que la France et l'Europe ont à leur porte un gisement de croissance que certains n'hésitent pas à comparer à la Chine.
Dès lors, comment ne pas voir que notre proximité géographique, notre affinité culturelle liée à la langue comme à l'histoire sont des atouts majeurs par rapport aux pays émergents ?
Comme l'a dit Mathieu Pigasse de la Banque Lazard devant le groupe de travail : « Il faut faire avec l'Afrique ce qu'a fait l'Espagne avec l'Amérique Latine, le secteur bancaire et les télécoms espagnols ont survécu à la crise grâce à leurs implantations en Amérique latine ».
« La France est en retard d'une guerre, le continent est en train d'émerger, et nous regardons encore l'Afrique à travers le prisme de l'APD et des forces prépositionnées » a-t-il ajouté.
Notre devoir est d'être là-bas.
Il ne s'agit pas de regarder l'Afrique avec autant de convoitise, voire de cupidité, qu'hier nous avions de condescendance et de compassion.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui avec ces pays un intérêt commun à un développement durable et harmonieux de l'Afrique. Si nous arrivons à promouvoir un regard croisé sur une insertion maîtrisée de l'Afrique dans la mondialisation, un développement économique et agricole durable et harmonieux, la mise sur place progressive de services publics de base, de régimes institutionnels protecteurs des minorités et décentralisés, la France peut porter une vision de l'Afrique qui rencontrerait les aspirations africaines.
Or dans un monde dont le centre de gravité est en train de passer du Nord au Sud, un continent africain au sud de l'Europe pourrait constituer, à l'instar des États-Unis avec l'Amérique du Sud, pour notre continent, non seulement une arrière-cour mais également un gisement durable de croissance.
Le développement d'un nouveau tissu de PME, l'émergence d'une classe moyenne de plusieurs centaines de millions de personnes sur le 1,8 milliard d'habitants que connaîtra l'Afrique en 2050 méritent alors que les pouvoirs publics se donnent les moyens de favoriser les intérêts français sur ce continent sur des marchés comme la téléphonie mobile en Afrique en croissance de 44% par an, les banques de détail dont les taux de croissance dans un pays comme le Kenya depuis 7 ans se situent entre 30 et 35%, mais également le traitement des eaux, autant de secteur où la France possède des entreprises compétitives.
Il est vrai que l'Afrique dynamique, cette Afrique qui a enjambé l'étape du téléphone fixe pour bénéficier de l'essor du portable et d'Internet, n'est pas, à première vue, majoritairement l'Afrique francophone qui nous est proche.
Mais rien ne nous condamne à l'Afrique qui ne marche pas. Des pays comme la Côte d'Ivoire sont en train de rattraper le retard lié à la crise politique. Rien n'interdit aux entreprises françaises d'explorer les opportunités de l'Afrique de l'Est et du Sud, de la Mozambique ou du Nigeria. Il en va ainsi des groupes comme le groupe Bolloré, présent dans 47 pays africains qui a multiplié par trois son chiffre d'affaires en moins de dix ans, passant de 900 millions d'euros à 2,7 milliards de 2005 à 2013, avec pas moins de 25 000 collaborateurs en Afrique subsaharienne.
Sur aucun autre continent, en Asie ou en Amérique Latine, la France ne part, par rapport à ses concurrents, avec cet avantage comparatif que lui confèrent sa langue, sa connaissance et son intimité avec les acteurs économiques africains.
Nous ne sommes plus des partenaires obligés, mais nous restons des partenaires désirés. « On préfère le diable que l'on connaît » nous a dit un ministre ivoirien. « Vous devez faire la preuve que vous êtes compétitifs. Mais à valeur égale, nous vous préférons, parce que nous vous connaissons ».
3. Sécuriser nos approvisionnements face à une nouvelle géopolitique de la pénurie
La troisième rupture est l'entrée de la planète dans ce que l'on pourrait appeler une nouvelle géopolitique de la pénurie.
La croissance de la population mondiale, qui pourrait atteindre 9 milliards en 2050, et l'essor économique de l'Asie et de l'Amérique Latine susciteront de fortes tensions sur les ressources naturelles. Dans ce contexte, la sécurisation des approvisionnements, notamment en hydrocarbures et en métaux, sera l'un des enjeux majeurs des prochaines décennies. Les pays d'Asie l'ont d'autant mieux intégré dans leur politique étrangère qu'ils seront à l'origine de ces tensions en rattrapant le niveau de vie des pays occidentaux. Plus de 60% de l'augmentation de la consommation d'hydrocarbures dans les 20 ans à venir proviendra ainsi de l'Asie.
Or l'économie mondiale est entrée, du fait de la diminution des réserves naturelles, pour plusieurs décennies, dans une ère d'énergie coûteuse.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production de pétrole conventionnel devrait avoir atteint un «pic» en 2006, sommet à partir duquel, en raison de l'épuisement progressif des ressources exploitables à faible coût, la production devra s'orienter vers d'autres sources d'énergies non conventionnelles, notamment le pétrole et le gaz de schiste. Mais le coût et le rendement de la production d'hydrocarbures ne feront que croître. Un constituant crucial d'une croissance élevée disparaîtra ainsi du paysage.
Le problème ne se pose pas seulement pour l'énergie, mais aussi pour un grand nombre de métaux et de minéraux qui entrent dans la composition de nombreux produits industriels, et dont la consommation s'est énormément accrue depuis un siècle et, plus encore, depuis une vingtaine d'années, avec le développement de l'électronique et l'expansion des pays émergents.
Depuis le premier choc pétrolier, on mesure, en effet, l'importance des matières premières énergétiques, charbon, hydrocarbures et gaz, et on a, depuis 1973, pris des mesures pour mieux gérer les stocks et diversifier les approvisionnements. Mais on mesure encore mal combien nous sommes devenus dépendants des matières premières stratégiques minérales que sont le cuivre, le titane ou le diamant et ce que l'on appelle les terres rares ainsi que des matières premières stratégiques végétales comme les céréales et les terres arables.
Ce n'est qu'avec l'expansion économique très rapide de nouveaux acteurs comme la Chine, l'Inde et le Brésil, que les pays du Nord ont réalisé que leur propre accès aux matières stratégiques pouvait devenir problématique, du fait de l'accès des pays émergents aux technologies de transformation primaire des matières premières, mais aussi parce que les nouvelles technologies, particulièrement dans le domaine des télécommunications, dépendent de ces matériaux rares.
De nombreux métaux et minéraux ont en commun des goulots dans la chaine d'approvisionnement, une production par un nombre restreint d'entreprises ou de pays, des usages de haute technologie, d'être peu ou pas substituables dans leur utilisation, d'être difficilement collectés en vue de leur recyclage et enfin de provenir de pays pouvant représenter des risques.
Ce contexte, à un moment donné et pour un marché donné, en fait des métaux dits « stratégiques » pour le pays, sur lesquels il est nécessaire de porter une attention particulière afin de sécuriser les approvisionnements de l'économie nationale
Se profilent à l'horizon d'une ou deux décennies de fortes tensions sur la production de métaux tels que le cuivre, l'antimoine, le dysprosium, le platine, etc. Ces éléments sont tout à fait cruciaux dans certains domaines de pointe : les aimants de précision, tout comme les éoliennes, requièrent l'utilisation de néodyme. Le galium entre dans la fabrication des billets de banque, pour en prévenir la falsification, comme dans celle des lasers utilisés par les avions de chasse de dernière génération. Le germanium est indispensable à la réalisation de systèmes de visée nocturne etc.
Or l'Afrique constitue un réservoir de ressources naturelles considérable. Elle détient notamment dans le Golfe de Guinée avec le Nigeria et l'Angola, des réserves importantes de pétrole. À elle seule, elle concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome (au Zimbabwe et en Afrique du Sud), 90% des réserves de platine (en Afrique du Sud) et 50% des réserves mondiales de cobalt (en République démocratique du Congo et en Zambie). Le continent recèle également d'importantes réserves en or, diamant, manganèse, cuivre, fer, uranium ou charbon. A titre d'exemples, pour n'en citer que quelques-uns, l'Angola possède entre autres ressources naturelles du diamant, du minerai de fer et du pétrole; le Botswana est riche en ressources minières, notamment le diamant, le charbon, le cuivre, le nickel, l'or, le carbonate de sodium et le sel ; la République Démocratique du Congo (RDC) possède les plus grands gisements de cuivre, de cobalt, et de colombo-tantalite d'Afrique, mais aussi d'importantes réserves de diamants, d'or et d'autres minerais ainsi que des ressources forestières. Au Ghana, l'or est le troisième secteur d'exportation du pays, après le cacao et le bois et on y retrouve également les autres ressources naturelles comme les diamants industriels, le manganèse et la bauxite.
L'Afrique figure ainsi dans les premiers rangs mondiaux pour la production de minerais, notamment pour le cobalt, le platine, le titane, la bauxite, la chromite et autre vanadium.
« L'Afrique est au coeur de l'un des secteurs les plus dynamiques du commerce mondial. »
Même si l'offre de certains produits est imprévisible, les marchés devraient rester serrés au cours des prochaines années, les prix réels restant bien au-dessus du niveau moyen des années 1990. Fin 2011, les prix moyens de l'énergie et des métaux communs étaient trois fois supérieurs à ce qu'ils étaient dix ans plus tôt, et approchaient voire surpassaient les niveaux records des 40 dernières années. Reflétant les conditions sous-jacentes du marché, les investissements miniers ont plus que quadruplé entre 2000 et 2010, atteignant près de 80 milliards de dollars US par an, et la valeur de la production mondiale de métaux a augmenté deux fois plus vite que le PIB mondial : un contraste saisissant par rapport à la stagnation de valeur durant la décennie précédente. Résultat : l'Afrique est au coeur de l'un des secteurs les plus dynamiques du commerce mondial.
Pour l'Europe, qui y importe plus de 50% de ses approvisionnements d'argent, de chrome, de manganèse, de nickel, de zirconium et la totalité de son uranium, l'Afrique est un enjeu majeur pour ses approvisionnements stratégiques. Et les investissements massifs des pays émergents dans ces secteurs constituent, de ce point de vue, une menace sérieuse.
L'Europe a, en effet, quasiment disparu de la scène internationale de la production minière proprement dite. Les entreprises des grandes puissances émergentes rivalisent désormais avec les majors américano-australo-canadiens dans les travaux d'exploration minière et d'acquisition de nouveaux gisements en Afrique.
L'Afrique subsaharienne représente déjà une source d'approvisionnement majeure pour la Chine qui importe notamment plus de 40% de son minerai de fer et 80% de son bauxite. Le quintuplement de la demande chinoise de minerais d'ici 2050 ne fera qu'accroître la compétition et le risque d'éviction de l'Europe et de la France. Si la diversification de nature et de provenance géographique des énergies consommées en Europe a contribué à sécuriser ses approvisionnements énergétiques, l'effort qui doit impérativement être accompli au profit de l'approvisionnement en métaux passe par l'Afrique.
La course aux ressources naturelles, les perspectives offertes par le marché africain replacent donc l'Afrique au coeur de nouveaux enjeux stratégiques dont il convient de prendre la mesure pour, selon les secteurs et les pays, les souligner ou les relativiser.
4. La France et l'Europe ont intérêt à tirer l'Afrique vers un modèle de développement équilibré
Alors que notre vision de l'action de la France en Afrique reste encore très marquée par une histoire qui pèse sur nos relations mais nous rassure quant à notre influence, il faudrait essayer de penser l'avenir de la France dans une Afrique convoitée qui, selon les prévisions en cours, pèsera dans le PIB mondial en 2030, c'est-à-dire sans doute plus que l'Europe.
La France a enfin, plus que jamais, besoin des pays africains, non seulement comme débouchés économiques et sources d'approvisionnement stratégique, mais également comme partenaires politiques.
Dans un contexte où le statut de la France au sein des instances internationales, et notamment la place de la France au sein du Conseil de sécurité, pourrait être remis en cause, au regard de critères qui mesureraient exclusivement son poids économique, l'aide publique au développement de la France en Afrique, comme notre effort de défense en faveur de la paix et de la sécurité de ce continent, contribuent à maintenir le rang de la France sur la scène internationale.
L'Afrique offre à la France une profondeur géopolitique qu'aucun autre continent ne pourrait lui apporter.
Comme le souligne Jean-Louis Guigou, président de l'IPEMED, l'Europe, les pays du Maghreb et l'Afrique subsaharienne, singulièrement l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale qui partagent des relations économiques, mais aussi culturelles séculaires et travaillent dans le même fuseau horaire et donc dans un même espace-temps, ont vocation à constituer des ensembles plus cohérents s'ils veulent demain peser dans la mondialisation.
L'Amérique du Nord a constitué, avec ses deux voisins, le Canada et le Mexique, l'ALENA. Les pays sud-américains ont eux aussi constitué leur grand marché commun, le Mercosur. Ces deux ensembles coopèrent de plus en plus étroitement pour dessiner une grande région continentale, qui prend la forme d'un « quartier d'orange » nord-sud.
De son côté, la Chine a constitué avec tous ses voisins un immense marché commun, l'ASEAN+5 de 2,5 Mds d'habitants, avec ses propres régulations. L'Europe qui avait pris de l'avance en 1957 en créant le Communauté économique européenne a bien réagi en intégrant dans les années 1990 l'Europe centrale et orientale.
Au sud de l'Europe, en Méditerranée et en Afrique, la constitution d'une grande région réunissant les pays développés vieillissants à des pays jeunes et émergents est nécessaire. Une Europe à la démographie vieillissante, dont seul un cinquième de la population a moins de vingt ans et dont le marché intérieur s'essouffle, a besoin des atouts d'une Afrique jeune et dynamique.
Il y a un espace euro-africain dont l'extrême hétérogénéité dissimule l'existence. Il faut, à cet égard, se comparer à la Chine : pour des raisons historiques et culturelles fortes, cette dernière est spontanément considérée comme un unique ensemble, au contraire de l'espace euro-africain qui est vécu comme cloisonné. Or il y a autant de distance physique, comme économique, de Shanghai à la Chine de l'Ouest, qu'entre Bruxelles et Bamako.
L'Afrique constitue un atout pour la France et l'Europe.
Il faut avoir à l'esprit que la zone Afrique-Moyen-Orient est la seule zone au monde où la balance commerciale française est encore excédentaire. La France reste attractive et compétitive en Afrique et l'Europe détient une part importante du stock de capital en Afrique.
Plus l'Afrique se développera, plus l'Europe trouvera dans le continent un partenaire économique sérieux.
La complémentarité des économies des deux zones doit être mise au centre d'une stratégie de coprospérité.
La France est particulièrement bien placée pour porter ce message et convaincre ses partenaires européens d'y participer.
Il s'agit de défendre nos intérêts, mais aussi de partager une vision du monde. La France, « puissance moyenne à vocation planétaire » qui revendique au niveau international une vocation universelle héritée de la Révolution, trouve en Afrique un terrain où elle peut démontrer qu'elle a une vision du monde au-delà de ses frontières et de ses intérêts propres.
Nous avons en Afrique à partager une réflexion sur la démocratie, les droits de l'homme et le modèle de développement social et économique. Il ne s'agit plus d'exporter nos modèles clefs en main comme des solutions intangibles, mais de réfléchir ensemble aux solutions les plus adaptées à des enjeux communs.
La France s'est conçue comme gardienne d'une certaine idée de la justice et de la paix, protectrice des petits face aux Empires. Les valeurs de la France en font donc le héraut naturel des peuples du Sud, sur les grandes questions auxquelles l'opinion planétaire est sensibilisée : droits humains, réchauffement climatique, développement durable, sécurité alimentaire mondiale, sécurité civile... On peut se désoler du fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme votée à l'ONU en 1948 ne pourrait plus l'être aujourd'hui.
C'est pourtant un fait. Le monde connaît de profondes mutations stratégiques. Un bouleversement planétaire s'accomplit sous nos yeux, qui risque fort de laisser l'Europe, partenaire du passé, sur le banc de touche. La France doit en prendre conscience, porter sa voix, défendre ses valeurs tout en prenant acte de la configuration actuelle des relations internationales.
L'Europe peut soutenir avec l'Afrique des positions communes, à la fois justes et généreuses.
Dans une période historique où l'influence internationale de la France est en déclin, l'Afrique reste le lieu où elle peut démontrer qu'elle agit encore sur le monde, « le dernier endroit où on compte encore ».
C'est pourquoi un déclassement de la France en Afrique serait un recul autrement plus grave qu'il n'y paraît.
5. L'Afrique n'attendra pas
Un continent de deux milliards d'habitants est en train de se constituer au sud de l'Europe avec un formidable potentiel de croissance et de nombreux défis. L'ensemble des pays émergents y investissent chaque jour de plus en plus.
Avec des taux de croissance de plus de 6%, une partie de l'Afrique est en train de changer à une vitesse sans précédent. La géographie même du continent est en train de changer avec le dynamisme de la côte est comme l'illustre la carte suivante issue de travaux de EY Oxford Economics qui figure les prévisions des taux de croissance des différents pays de 2012 à 2017.
Avec la diversification de ses partenaires et l'afflux de capitaux, l'Afrique n'attendra pas que la France se repositionne en Afrique.
CHAPITRE 4 : 70 MESURES POUR UNE POLITIQUE AFRICAINE RÉNOVÉE
Une politique : c'est un discours et des actes. Le bilan de la présence française en Afrique nous invite à réagir pour chercher les moyens d'inverser une tendance qui, si elle se poursuivait, signifierait notre déclin sur un continent où nous conservons une influence déterminante.
La réalité c'est que la politique africaine de la France a évolué moins vite que l'Afrique elle-même. Il demeure un décalage entre le discours sur l'enjeu que représente l'Afrique pour la France et la manière dont les politiques publiques à l'égard de ce continent sont menées.
Nous n'avons cependant pas la prétention d'avoir la solution. De nombreuses femmes et hommes oeuvrent aux liens entre la France et les pays d'Afrique subsaharienne. Ils y donnent le meilleur d'eux-mêmes, bien plus souvent par conviction que par intérêt. Nous ne leur ferons pas l'affront de penser que quelques solutions simples, quelques gadgets administratifs tout droit sortis d'un rapport vont infléchir la trajectoire de relations si riches et complexes.
Comme l'a souligné Justin Vaïsse, directeur du Centre d'Analyse, de Prévision et de Stratégie au Ministère des Affaires étrangères : « il n'y a pas de formule magique », de « clef d'entrée facile dans le continent ». Cela est d'autant plus vrai que les trajectoires des différents pays semblent se différencier de plus en plus.
Parler du continent dans son ensemble, il y 30 ans, n'avait pas beaucoup de sens. En parler aujourd'hui en a encore moins. Nous l'avons fait ici trop souvent par facilité de langage, mais, en vérité, de politique africaine, il y en a presque autant que de pays africains. Cette vérité-là ne doit cependant pas nous faire renoncer à un exercice de synthèse et à la définition d'une stratégie ou d'un cap à suivre.
Les problématiques de l'Afrique subsaharienne sont aussi liées à celles du Maghreb, la question du Sahel en est un exemple. Nos travaux sont à mettre en regard de ceux de nos collègues Josette Durrieu et Christian Cambon, chargés du groupe de travail sur les pays de la rive sud de la Méditerranée, et de ceux de Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher sur le Sahel 62 ( * ) .
S'il n'y a pas de baguette magique, il doit y avoir des inflexions. Si nous avons nécessairement cherché l'idée nouvelle, nous avions aussi à l'esprit que la nouveauté n'est pas toujours la garantie de la pertinence.
Nous nous sommes évertués à penser aux moyens de maximiser l'efficacité de notre politique et de nos dispositifs de coopération civils et militaires par rapport aux priorités fixées, sans ignorer que, dans l'hypothèse la plus favorable, il nous faudrait réfléchir dans le cadre des moyens budgétaires actuels d'un État impécunieux qui doit redresser ses finances publiques .
Les pistes que nous avons dégagées sont, à ce stade, encore incomplètes, souvent mal formulées, elles nous ont cependant paru les plus ajustées à la réalité que nous avons observées et au diagnostic que nous venons de formuler.
I. DÉFINIR UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE ET COHÉRENTE
Se donner des objectifs pour une politique publique, comme dans la vie, c'est d'abord distinguer, comme les stoïciens le faisaient en leurs temps, ce qui dépend de nous et ce que l'on ne maîtrise pas.
A. CE QUI DÉPEND DE LA FRANCE ET CE QU'ELLE NE MAÎTRISE PAS
Les facteurs qui ne peuvent pas être maîtrisés par la France sont nombreux.
L'ouverture des pays africains aux nouveaux pays émergents et l'implication croissante de ces derniers sur le continent : ces pays sont des voisins et des partenaires politiques de l'Afrique. Leur investissement dans le développement du continent est une bonne nouvelle, s'il ne se traduit pas par un nouvel impérialisme. Nous pouvons plaider pour une harmonisation des pratiques de coopération, une concurrence loyale dans le domaine économique ; nous pouvons chercher à tirer les modèles de développement économique et politique des pays africains vers un modèle plus compatible avec le nôtre, mais nous ne pouvons pas fixer comme objectif de limiter la présence et l'influence des pays émergents en Afrique, qui s'inscrit dans un renversement beaucoup plus large des dynamiques entre le Nord et Sud de la planète.
L'appétence des Africains pour le monde anglophone : l'insertion croissante de l'Afrique dans la mondialisation, dans les flux de biens, de capitaux et d'idées conduit nécessairement un nombre croissant d'Africains à se tourner vers la langue de la mondialisation qu'est l'anglais. Il nous faut promouvoir la francophonie, mais cette évolution est inévitable et d'ailleurs pas exclusive d'une progression du français comme d'un renouveau des langues régionales.
La défiance à l'égard de tout ce qui pourrait s'apparenter à une forme de néocolonialisme : 50 ans après les indépendances, les pays africains et leurs opinions publiques aspirent naturellement à assumer pleinement leur destinée en toute autonomie. C'est en cela que l'intervention française au Mali a été vécue à la fois comme un soulagement et une honte. Les pays africains ne tolèrent la persistance de dispositifs hérités de la période coloniale que faute de mieux. Le sens de l'histoire que véhicule la notion de « renaissance africaine » est l'émancipation vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. La France peut donner un sens nouveau à ce partenariat, mais elle ne peut effacer les conséquences de cette perspective historique dans laquelle elle doit s'inscrire, faute de quoi elle risque d'être identifiée au passé.
Les risques d'instabilité politique et sécuritaire : les bouleversements démographiques et économiques que nous avons décrits mettront sous tensions l'ensemble du continent. Alors que les zones les moins développées connaissent les affres des pays où la déliquescence de l'Etat ne lui permet pas d'assurer ni l'ordre public, ni les services publics minima nécessaires au développement, dans les zones plus développées, la croissance économique, l'élévation de vie et d'éducation pourraient entraîner une instabilité politique croissante dans des pays où l'espace public est encore très réduit.
L'histoire des siècles anciens comme celle des printemps arabes ont montré que les phases de décollage économique étaient porteuses d'instabilité et de frustration. Cette instabilité a donc des racines politiques, économiques et sociales profondes qui traversent l'ensemble du continent. Il revient aux Africains d'en limiter les conséquences en favorisant le développement, la sécurité et une vie politique pluraliste.
La France et ses partenaires européens peuvent les y aider, mais les mieux intentionnés de leurs amis ne pourront se substituer à leurs choix.
En revanche, certains facteurs peuvent être mieux maîtrisés par les pouvoirs publics français :
Un renforcement de la cohérence de sa politique africaine et des synergies entre les différents acteurs est possible. Il existe des marges de progression substantielles pour accroître la synergie entre les politiques de coopération militaire et civile, économique, migratoire et culturelle. De ce point de vue, la réalisation d'une stratégie globale à l'égard du continent africain permettrait de faire travailler ensemble des départements ministériels dont les actions sont au mieux parallèles et au pire contradictoires. Sur le terrain, des marges de progression existent dans la mise en cohérence du maillage des différentes institutions et réseaux français en Afrique.
La promotion d'une image rénovée de l'Afrique qui, sans masquer la réalité, mette aussi en valeur les nombreuses opportunités de ce continent devrait pouvoir faire l'objet d'une réflexions aussi bien en matière de promotion du commerce extérieur avec des opérateurs comme UBIFRANCE, la COFACE, que dans le domaine culturel où les saisons franco-africaines font déjà beaucoup pour mieux faire connaître l'Afrique ou encore dans le domaine de la recherche où de nombreux laboratoires français ont une expertise reconnue sur l'Afrique.
Le renforcement de la présence des entreprises françaises dans les zones d'Afrique anglophones particulièrement dynamiques devrait pouvoir faire l'objet d'une action concertée de la part du ministère des finances et des organisations professionnelles.
Le déséquilibre des moyens publics mis en oeuvre entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone nécessiterait également une stratégie plus globale visant à adapter les effectifs du réseau diplomatique et des différents opérateurs de l'action extérieure de l'Etat aux priorités d'une politique africaine réaffirmée.
Les difficultés d'accueil des élites africaines aussi bien dans le domaine universitaire que dans les domaines du commerce et des arts relèvent également d'un champ d'action dans lequel la France a la possibilité d'inverser la tendance en simplifiant l'accueil des demandeurs de visa, qui est aujourd'hui un véritable parcours du combattant, et en encourageant la dématérialisation et la simplification des procédures d'inscription et de délivrance de visas circulaires, mais aussi soutenant la promotion des formations d'excellence françaises sur ce qui, aujourd'hui, est devenu un marché de la formation des élites.
Le soutien à la Francophonie fait également partie des domaines dans lesquels la France peut mener une politique plus ambitieuse dans l'appui à la formation initiale et continue des professeurs, au réseau français à l'étranger, aussi bien les établissements, Instituts et les Alliances françaises, mais aussi à travers le soutien à l'audiovisuel et aux médias francophones. Cela exige de mieux jouer sur les complémentarités des canaux bilatéraux et multilatéraux.
B. TENIR UN AUTRE DISCOURS SUR L'AFRIQUE
Formuler un nouveau discours sur la politique africaine de la France n'est pas chose aisée. Nicolas Sarkozy comme François Hollande s'y sont essayé. Beaucoup de choses ont été dites. A relire les discours du Cap, de Dakar, voire très récemment de Tombouctou, on se rend compte que les divergences sont d'ailleurs moindres que les points communs.
La première étape d'un renouveau de notre politique africaine consiste à vouloir en formuler une, à juger qu'il est utile, au-delà de l'évolution des relations bilatérales, des fluctuations diplomatiques au gré des événements, en réaction aux crises ou à la suite de visites ministérielles, de formuler une politique africaine de la France.
Formuler une stratégie, c'est d'abord définir un objectif et sa justification. L'objectif c'est le renforcement de notre lien avec le continent africain. La justification c'est établir la démonstration que se joue sur ce continent une partie de notre avenir.
Nous l'avons ici suffisamment étayé pour ne pas avoir à le répéter.
Notre proximité avec l'Afrique peut être une menace comme une opportunité, dans les deux cas nous avons intérêt à une politique africaine plus ambitieuse et plus cohérente.
Un document stratégique, à l'instar de ce qu'ont établi les Américains, les Allemands ou les Chinois, présenterait l'avantage, au-delà de ce modeste rapport parlementaire, d'essayer de convaincre les responsables administratifs et les entrepreneurs privés des opportunités que représente le décollage de l'Afrique dans le contexte géopolitique du début du XXI è siècle.
Il s'agit de quitter le « vieux récit » sur une Afrique du passé et de susciter, selon l'expression plusieurs fois évoquée, un « besoin d'Afrique » qui soit le pendant d'une « demande de France », de prendre la mesure des atouts français sur ce continent, mais aussi des défis auxquels il nous faut faire face dans un continent sous une tension liée à une transformation accélérée des sociétés.
Plusieurs mois de travail nous ont convaincus que la France, ses entreprises, ses talents, peut profiter de la croissance africaine et qu'inversement nous pouvons contribuer à atténuer les risques auxquels devront faire face les responsables politiques africains en termes de démographie, d'urbanisme, d'environnement et de sécurité.
L'amélioration de l'image et de la connaissance de l'Afrique doit s'inscrire dans le long terme et s'appuyer sur une recherche universitaire de qualité sur l'Afrique. Longtemps la France a été pionnière dans ce domaine. L'intérêt pour les pays émergents a conduit à réduire les budgets consacrés à l'Afrique. Il conviendrait de réfléchir à la nécessité ou non d'un rééquilibrage : si l'Afrique est un continent en émergence, dont la France est proche à divers égards, alors il est cohérent de lui consacrer plus de moyens.
Administrer la preuve que la France a besoin de l'Afrique comme cette dernière a besoin de la France : la deuxième étape, comme la deuxième partie de la phrase, est, dans les faits, plus difficile à démontrer au-delà de l'actualité immédiate du Mali.
L'Afrique a-t-elle besoin de la France ? Il nous faut en faire tous les jours la démonstration, faire en sorte que les responsables africains considèrent la présence d'experts français, d'entreprises, d'écoles française comme utiles à leur développement, à leur sécurité ou à l'équilibre de leur relation avec les émergents.
Pour cela, la France doit continuer à faire la démonstration qu'elle a une expertise, une connaissance de l'Afrique et des valeurs qui lui permettent d'être un partenaire utile, fiable et loyal, prêt à partager, avec les responsables politiques africains comme avec les organisations des sociétés civiles africaines, une vision d'un développement du continent harmonieux, respectueux des équilibres sociaux et environnementaux.
Sur le long terme, les pays émergents nous rattraperons dans la formation d'experts, notamment dans les domaines techniques. Les universités indiennes rivalisent déjà dans certains domaines avec nos meilleures grandes écoles. Les effectifs des ingénieurs que produisent les systèmes de formation supérieure indiens ou chinois auront, par ailleurs, un effet de masse. Les deux processus combinés nous feront sans aucun doute perdre le monopole de l'expertise dans des pays d'Afrique. Pour rester compétitif, il nous faudra en conséquence nous battre sur le maintien de la qualité d'excellence de notre expertise et sur notre connaissance et notre familiarité avec la culture africaine.
Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique.
Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Certes, le Mali a marqué les esprits. L'intervention n'a pas fait taire ceux qui ont dénoncé en leur temps les interventions en Côte d'Ivoire, au Tchad ou encore l'épisode dramatique du Rwanda.
Le nouveau discours sur l'Afrique doit trouver son équilibre entre le rappel de la permanence des liens entre la France et l'Afrique depuis deux siècles, qui explique la spécificité des relations franco-africaines, et la nécessité de se départir de la posture postcoloniale qui consiste à considérer que notre pays a une « vocation » africaine et/ou une responsabilité particulière vis-à-vis de l'Afrique.
Cette posture, teintée parfois de culturalisme, a souvent conduit la France à vouloir parler « au nom des Africains » et à se substituer à eux pour régler leurs problèmes.
Un nouveau discours sur l'Afrique devrait donc insister sur le fait que ce temps-là, que cette posture-là est révolue, mais que la spécificité de notre relation avec chacun des pays du continent n'appartient pas au passé, mais à l'avenir.
Le choix du Président de la République de placer l'opération Serval sur le plan symbolique de la dette de sang a eu l'avantage de rappeler ces liens spécifiques liés à une histoire partagée, mais aussi de placer le Mali et la France dans une relation d'égal à égal. L'étape suivante aurait pu consister à déclarer que cette intervention avait aussi à voir avec la défense des intérêts français, dans l'Hexagone comme sur le continent.
Fini la « Grande famille » des chefs d'Etat africains, le village franco-africain, le conseil de famille, le rôle de grand frère, l'évocation de modes de relations considérées comme acquises, pour privilégier dans le discours comme dans les actes des relations d'égal à égal.
Au-delà du contexte spécifique de l'opération malienne, l'évocation du passé ou de la dette de sang ne pourra éternellement servir de viatique dans une Afrique qui entre de plein fouet dans la mondialisation, les yeux rivés sur un avenir qu'elle pressent comme meilleur.
Il nous faut reconnaître que la France n'est qu'un partenaire parmi d'autres qui, comme les autres, a des intérêts et agit en conséquence.
Comme nous l'a dit un ambassadeur lors de nos déplacements « Les Africains sont lassés des grands discours moralisateurs et de l'« empathie » française envers le continent ; ils préfèrent que la France, comme les autres puissances, affiche clairement ses intérêts et traite avec eux comme avec n'importe quel autre interlocuteur dans le monde ».
Parfois habités par le paternalisme, les acteurs français sous-estiment généralement l'instrumentalisation dont ils peuvent faire l'objet de la part d'interlocuteurs africains les connaissant mieux qu'ils ne le croient. Sans doute faut-il clairement renoncer à la tentation de se substituer à des décisions qui ne nous appartiennent pas, renoncer à vouloir par trop influencer des trajectoires qui ne sont pas les nôtres.
C'est-à-dire abandonner toute ingérence ancienne manière avec la « politique du béret rouge », mais également nouvelle manière, avec son lot de conditionnalités démocratiques, financières et, plus récemment, environnementales .
Il reste que nos moyens nous obligent. On l'a vu au Mali, où la France a pesé de tout son poids pour imposer le calendrier des élections et les bases d'un accord avec les Touaregs. On le voit en Centrafrique où renoncer à intervenir, c'est accepter des exactions qui mettent en danger de nombreuses vies dont celle des expatriés français, mais aussi mettre les pays riverains et les organisations régionales devant leurs responsabilités.
Renoncer à l'ingérence mais pas à nos valeurs : c'est l'équilibre à trouver. La France ne peut pas dépenser plusieurs milliards dans sa coopération civile et militaire sans par ailleurs avoir quelque espoir d'influencer nos partenaires dans le sens de la démocratie, des droits de l'homme ou de l'adoption de modes de développement durable et inclusif.
L'idée est d'abord de tirer les enseignements des printemps arabes pour entretenir un lien fort non seulement avec les Etats mais également avec les sociétés elles-mêmes.
Elle est ensuite de signifier que les pays africains ne sont pas pour la France seulement des réservoirs de matières premières et un marché pour nos entreprises, mais également des partenaires dont le développement harmonieux constitue un objectif partagé.
Autrement dit, prendre appui sur notre tradition républicaine et notre engagement en faveur de l'aide au développement et des biens publics mondiaux pour promouvoir une vision du développement de l'Afrique conforme à nos valeurs comme à nos intérêts et qui nous distinguerait de certains pays émergents.
Renoncer à l'ingérence mais pas à notre expertise, qu'il convient de valoriser et même de rentabiliser.
Il y a des domaines et des pays en Afrique qui ont suffisamment de ressources pour que nous puissions « vendre » notre expertise, faire valoir notre savoir-faire. De ce point de vue, il faut en finir avec une posture dominée par l'obligation d'assistance et ajuster notre positionnement à chaque contexte.
Il y a en Afrique un marché de l'expertise sur lequel la France doit mieux se positionner en mettant en ordre de bataille ses opérateurs publics.
Le point commun de ces approches est d'essayer de développer un narratif plus juste des liens unissant la France à l'Afrique.
Plutôt que de définir la relation d'abord comme un héritage du passé colonial, il faut la caractériser autant que possible en fonction des paramètres qui la façonnent aujourd'hui en insistant sur le fait que la France est liée à l'Afrique :
- parce que des millions de Français sont d'origine africaine, ou vivent ou ont vécu en Afrique ;
- parce que la France a des intérêts économiques et stratégiques en Afrique et qu'elle regarde ce continent en essor comme un réservoir de croissance ;
- parce que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, représente un enjeu pour la sécurité nationale de la France (trafic de personnes, trafic de drogue, terrorisme...) ;
- parce que la France est garante de la stabilité monétaire des quinze Etats africains appartenant à la zone franc ;
- parce que nous avons un intérêt partagé à un développement durable et harmonieux de l'Afrique.
Dans le domaine de la sécurité, plutôt que des discours vertueux sur la responsabilité française vis-à-vis de l'Afrique, mieux vaudrait dire haut et fort que la France, comme toute puissance, a des intérêts sur le continent et qu'elle est prête à les défendre quand ils sont menacés.
Dans le même temps, il convient de rééquilibrer un discours dominé par la peur du terrorisme ou de l'immigration.
Si le regard sur l'Afrique tend à évoluer positivement, on continue néanmoins, dans certains cercles, à voir le continent avant tout comme une menace plus qu'une opportunité.
L'Afrique n'est pas pour la France qu'une question de sécurité.
La politique africaine ne saurait se réduire à la coopération militaire ou à la prévention de l'immigration illégale.
Notre discours sur l'Afrique doit faire sa part à l'Afrique qui décolle. Nous en avons décrit ici les nombreux enjeux politiques, économiques, commerciaux, environnementaux et culturels.
La France doit y défendre ses atouts et ses intérêts sans complexe.
C'est d'ailleurs ce qu'attendent nos interlocuteurs africains.
La démarche des pays émergents proposant un partenariat gagnant/gagnant devrait nous inspirer.
C'est un gage de modernité, conforme aux nouvelles relations que le continent entretient désormais avec le reste du monde. Il faut s'émanciper le plus possible du passé pour parler de l'avenir d'un continent jeune avec lequel nous voulons compter, notamment du point de vue économique.
Au regard des enjeux, il est temps de se départir des préventions postcoloniales et d'assumer le fait que l'Afrique n'est pas seulement partie prenante de notre histoire, mais aussi un élément clé de notre avenir.
Assumer nos intérêts, s'orienter vers l'avenir, miser sur notre expertise de l'Afrique : voilà les orientations que nous proposons pour structurer un nouveau récit sur notre relation à l'Afrique.
|
1) Définir la relation de la France aux pays africains d'abord en fonction de nos intérêts partagés : des millions de Français qui sont d'origine africaine, ou vivent ou ont vécu en Afrique; des intérêts économiques et stratégiques, un enjeu pour la sécurité de la France comme de l'Afrique 2) Se départir des préventions postcoloniales et assumer le fait que l'Afrique n'est pas seulement partie prenante de notre histoire, mais aussi un élément clé de notre avenir. |
C. DÉFINIR UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE ET COHÉRENTE
L'intérêt de définir une stratégie africaine de la France est dans le résultat autant que dans la méthode.
Faire travailler ensemble les différents départements ministériels, le Quai d'Orsay, sa direction politique en charge de l'Afrique, mais aussi la DGM et la nouvelle direction en charge des entreprises, la défense, la coopération, les finances, les opérateurs de l'Etat, l'AFD, l'Institut français, l'AEFE, l'Alliance française, France expertise internationale, ADETEF, le CIAN, le Medef international, les entreprises présentes en Afrique, les ONG sur la présence de la France en Afrique et notre politique africaine : voilà qui permettrait de dépasser les clivages administratifs, les frontières idéologiques pour analyser comment la France peut orienter sa politique dans cette Afrique en mouvement.
Plusieurs formules étaient envisageables pour créer cette synergie.
L'unité du pilotage de la politique africaine, longtemps représentée par le Secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, qui couvrait l'ensemble des secteurs au service d'une politique africaine unifiée tant dans ses objectifs que dans ses moyens, a laissé place à une fragmentation des centres de décision dont on mesure les inconvénients en termes de cohérence.
Cette formule est d'un autre temps, elle avait elle aussi ses inconvénients et notamment l'existence d'une politique parallèle à celle définie par chaque ministère qui faisait de l'Afrique un domaine réservé pour le meilleur et pour le pire. Elle a sans doute favorisé les dérives que l'on a dénoncées. Il reste que sa disparition a laissé une faille dans le dispositif. En dehors de réunions techniques, il n'y a plus véritablement de lieu où les différents acteurs réfléchissent à leurs intérêts communs et aux synergies qu'ils peuvent dégager.
Pour ce qui est de formuler une stratégie définie en commun par l'ensemble des acteurs : la formule du Livre blanc à la manière du Livre blanc sur la défense et la sécurité semblerait la plus adaptée. Il n'est pas nécessaire de créer une structure pérenne. En revanche, il faut pouvoir associer des responsables de haut niveau représentant l'ensemble du spectre des institutions intervenant en Afrique.
La Commission du Livre blanc sur la politique africaine pourrait comporter une quarantaine de membres représentant le Parlement, les administrations, les opérateurs, les ONG et des personnalités qualifiées françaises et étrangères et notamment africaines.
Présidée par une personnalité incontestée dotée d'une lettre de mission du Président de la République, cette commission du Livre blanc sur l'Afrique pourrait bénéficier des réflexions des groupes de travail thématiques qu'elle aurait constitués pour démultiplier son action et étendre le champ des personnalités entendues.
Elle permettrait à chacun des acteurs de s'approprier une stratégie collective et de procéder à des choix autres que sur le seul critère budgétaire.
L'exercice devrait également permettre à chacun de comprendre les préoccupations des autres intervenants et de s'approprier des objectifs communs au-delà des différences légitimes entre, par exemple, militaires et ONG, coopérants et industriels, universitaires et diplomates.
Il devrait pouvoir déboucher sur un débat large qui puisse avoir un retentissement médiatique et politique avec un débat au Parlement.
Sur le fond, il ne s'agit pas de définir une ligne politique unique pour l'ensemble du continent, mais une stratégie adaptée à un objet lui-même complexe : l'Afrique est plurielle et notre politique doit l'être aussi. Il ne peut plus y avoir une politique africaine de la France, mais des politiques de la France en Afrique.
Notre stratégie doit être modulée en fonction de nos avantages comparatifs et des enjeux spécifiques à chaque région, voire à chaque Etat partenaire. Certains Etats sont de meilleurs partenaires en bilatéral qu'en tant que membres d'une organisation régionale ; certaines organisations régionales fonctionnent, d'autres ne sont pas mûres ; l'Union Africaine est performante sur certains sujets, moins sur d'autres.
Il semble évident que l'Afrique de l'Ouest va continuer de constituer, dans les années à venir, une zone d'attention cruciale pour notre diplomatie, notre appareil de défense et nos entreprises. Parce que le centre de gravité des crises, hier plus proche de l'équateur, s'en est rapproché, mais aussi en raison des liens interpersonnels forts reliant nombre de nos concitoyens à cette région.
Il faut en prendre acte et placer la sous-région Afrique de l'Ouest au coeur d'une stratégie assumée et énoncée à l'égard du continent.
Cette priorité à l'Afrique de l'Ouest devrait s'accompagner d'un investissement résolu, centré sur l'économie, en direction des pays dynamiques des régions non francophones (Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Botswana, Ethiopie, Angola, Mozambique).
Une stratégie africaine devrait pouvoir articuler cette fidélité à l'Afrique francophone et cette ouverture à l'Afrique anglophone.
Elle devrait également penser les évolutions de l'Afrique de l'Ouest avec celles de l'Afrique du Nord.
De ce point de vue, il faudra penser notre relation à l'Afrique au-delà du clivage entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. La question du Sahel a montré les limites de cette démarche. Les dynamiques politique, économique, voire religieuse vont dans le sens d'une interpénétration grandissante du Nord et du Sud du continent.
|
3) Etablir une stratégie africaine de la France sous la forme d'un Livre Blanc sur l'Afrique en associant des membres représentant le Parlement, les administrations, les opérateurs, les ONG intervenant en Afrique et des personnalités qualifiées françaises, étrangères et notamment africaines. |
D. S'EMANCIPER DU PASSÉ
La relation franco-africaine reste lestée du poids d'un passé mal assumé.
Le rejet dont la France est parfois l'objet, notamment dans les couches les plus jeunes de la population africaine, tire argument de sa responsabilité dans les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique : l'esclavage qui l'a saignée de ses forces vives alors qu'elle constituait encore un continent sous-peuplé, la colonisation qui marqua son entrée traumatisante dans la modernité tout en l'enserrant dans des frontières qu'elle n'avait pas choisies, la décolonisation dont on néglige qu'elle fut, en Afrique subsaharienne, émaillée de massacres aujourd'hui «oubliés» (Madagascar 1947, Cameroun 1955, Algérie...).
Dans notre pays même, le passé colonial et post-colonial a du mal à passer.
Le thème resurgit régulièrement dans l'espace public, provoquant scandales et controverses, signe de la profondeur du malaise attaché à la relation à l'Afrique dans notre pays. Celui-ci tire sa source d'une difficulté à regarder en face l'histoire coloniale et des relations qui se sont tissées dans la décolonisation avec les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne et du Maghreb.
Cette histoire est peu et mal connue dans la société française. Certains événements douloureux, dans lesquels notre pays n'a pas eu le beau rôle, font encore débat et ne sont pas entrés dans l'histoire « officielle », si tant est que ce terme ait un sens.
Ce passé alimente à la fois une certaine culpabilité, notamment chez les progressistes, et quantité de fantasmes et de caricatures. Il a forgé, dans les représentations collectives, des images extrêmement fortes et réductrices, qui ont tendance à symboliser pour nos compatriotes la réalité africaine, comme celle du monarque africain, autocrate corrompu et richissime, celle des affaires politico-financières (Elf, « angolagate »), ou celle du l'aide détournée (« Carrefour du développement », « éléphants blancs »).
Face à cette histoire refoulée et à ces images médiatiques, le système politique français peine à énoncer, vis-à-vis de l'ancien espace colonial, un discours et des pratiques permettant de concilier les valeurs universelles que nous portons, la défense de nos intérêts et l'héritage de cette histoire.
La coopération est devenue depuis longtemps, aux yeux de l'opinion et d'une grande partie des élites, un des principaux symboles de cette histoire. Une partie de ses dysfonctionnements trouvent d'ailleurs leur origine dans ce malaise africain, porté par les décideurs ou les acteurs de la coopération eux-mêmes : la préférence pour le multilatéral supposé neutre et légitime, face à un bilatéral « corrupteur» ; l'obsession de notre aide à l'Afrique, érigée en vache sacrée, sans savoir bien souvent de quelle Afrique on veut parler.
Une telle assimilation coopération-« Françafrique » était sans doute excessive il y a vingt ans. Elle est, à présent, largement anachronique, tant les pratiques ont évolué.
Pourtant elle reste très présente. Et elle viendra immanquablement s'inscrire en toile de fond d'une relance de la politique africaine que nous souhaitons.
C'est pourquoi il convient de régler ces contentieux, qui empoisonnent la relation et solder le passé par une mise en récit commune de cette histoire partagée.
Pour cela, toutes les initiatives qui peuvent déboucher sur des regards croisés sur l'esclavage, la colonisation et la période post-coloniale sont à promouvoir : livre d'histoire franco-africain écrit à deux mains, initiatives collectives franco-africaines, etc.
Pour ce faire, nous proposons de créer un programme de soutien aux travaux de recherche franco-africains abondés par des crédits de l'ensemble des ministères concernés (affaires étrangères, éducation nationale, recherche, défense).
Il s'agirait de promouvoir le travail d'équipes mixtes franco-africaines sur l'histoire commune.
Ce programme « pour une écriture franco-africaine d'une histoire partagée » devrait être complété par une plus large ouverture des archives sur la période coloniale. La remise récente des archives sur le massacre de Thiaroye va dans ce sens 63 ( * ) . Ce geste doit être renouvelé pour l'ensemble des épisodes suscitant encore des débats et où des travaux scientifiques sont susceptibles d'apaiser les mémoires.
Ce fonds pourrait également être ouvert à des ouvrages sur la période contemporaine mettant l'accent sur les relations franco-africaines.
|
4) Créer un programme « pour une écriture franco-africaine d'une histoire partagée » pour promouvoir le travail d'équipes mixtes franco-africaines sur l'étude de notre histoire commune. 5) Poursuivre l'ouverture des archives sur la période coloniale. |
E. RESTRUCTURER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE AFRICAINE
La définition d'une stratégie africaine à travers un Livre blanc ne suffira pas à impulser dans la gestion quotidienne une meilleure coordination des différents acteurs de la politique africaine.
Dans le même temps, loin de nous l'idée de créer un ministère de l'Afrique. Cela n'aurait pas de sens : la mondialisation conduit l'Afrique a être un des acteurs de problématiques plus larges, aussi bien en matière de changement climatique que de commerce international ou de culture.
De ce point de vue, l'intégration de l'ancien ministère de la coopération, presque exclusivement consacré à l'Afrique, au sein du ministère des affaires étrangères, a anticipé sur la montée en puissance des problématiques liées à la mondialisation qui concernent aussi bien les pays d'Afrique que les émergents d'Asie. L'implication croissante de ces derniers en Afrique renforce encore l'idée que les questions de développement international doivent être traitées de façon globale.
En revanche, il est souhaitable qu'il y ait plus de cohésion, notamment dans certains domaines comme la conduite de notre coopération au développement et la gestion de notre coopération dans les Etats fragiles ou en sortie de crise, où sont intimement associées des problématiques de développement et de sécurité.
1. Pour un ministère de la coopération international de plein exercice
Le groupe de travail a fait le constat qu'en dépit des efforts déployés depuis 1998, le pilotage de la coopération dans son ensemble doit encore être amélioré, ainsi que de nombreux observateurs l'ont relevé 64 ( * ) .
Si la réforme de 1998 a conduit à la rationalisation administrative de l'aide autour de deux grands pôles, l'un diplomatique, issu de l'absorption du secrétariat d'Etat à la coopération par le ministère des affaires étrangères (MAE), et l'autre, financier, centré sur le ministère de l'économie et des finances (MEF), elle a surtout conforté le rôle de l'AFD qui est devenue l'« opérateur pivot » de l'aide française.
Depuis lors, les transferts successifs de compétences ont conduit l'AFD à prendre en charge la gestion de plus de 80 % des moyens de l'aide programmable mise en oeuvre par les canaux bilatéraux.
Or en dépit des réformes, le dispositif institutionnel est encore composé de nombreuses structures qui créent des doublons et appellent nécessairement de multiples mécanismes de coordination.
D'une part, les coûts de transaction résultant de la nécessaire coordination entre les deux ministères pilotes sont élevés ; et, d'autre part, le système demeure complexe et fragmenté : outre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances, neuf autres ministères interviennent dans la coopération, certains pour des montants très significatifs (notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche), ainsi que huit opérateurs spécialisés - peu d'entre eux étant dédiés exclusivement à cette mission.
Au ministère de l'économie et des finances, la direction générale du Trésor est responsable de la gestion des contributions françaises auprès de la Banque mondiale, du FMI et des banques régionales de développement (BAD, BAsD, BID) et est en relation directe avec les administrateurs représentant la France auprès de ces institutions.
Les contributions françaises auprès des institutions de l'Union européenne et du système des Nations unies sont gérées par les services du ministère des affaires étrangères.
Cette division dans la gestion des crédits français d'aide multilatérale contribue dans les faits à la concurrence entre organisations de Bretton Woods et organisations onusiennes alors que la France, actionnaire des deux, pourrait peser en faveur d'une plus grande cohérence de leurs actions.
Le ministère de l'économie et des finances gère également les financements d'appuis budgétaires (leur instruction est toutefois menée de manière conjointe par la direction générale du Trésor, la direction général de la mondialisation du Ministère des affaires étrangères et avec l'appui de l'AFD), les remises et allègements de dettes (Club de Paris) ainsi que l'instruction et la mise en oeuvre des Contrats de de désendettement et de développement (C2D).
Sur ces différents points, au sein de la direction générale du Trésor, les conseillers financiers régionaux entretiennent des relations très suivies avec les Services de coopération et d'action culturelle (SCAC) et les agences de l'AFD.
D'un point de vue budgétaire, l'éclatement de l'action de l'Etat en matière de coopération se traduit par une multiplication des programmes et des lignes budgétaires dont l'architecture répond plus à une logique historique et bureaucratique qu'à une logique de gestion.
D'un point de vue opérationnel, la complexité du pilotage de la politique de coopération française implique des délais de concertation qui peuvent être importants. Cette concertation ne permet pas toujours de surmonter les divergences et impose donc le recours fréquent à des arbitrages du Premier ministre, voire du Président de la République.
Chaque réforme, même minime, donne lieu à des négociations complexes au sein du ministère des affaires étrangères puis entre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances.
Ainsi, malgré des réformes successives, le dispositif institutionnel reste marqué par certains héritages de l'histoire : le rôle hypertrophié de la Présidence de la République et surtout une concurrence nocive entre les deux ministères les plus concernés par cette politique, ceux de l'économie et des affaires étrangères.
Le dispositif institutionnel ne permet pas de porter cette politique de manière globale et cohérente : le secrétaire d'Etat ou ministre délégué chargé du développement, placé auprès du ministre des affaires étrangères, a bien du mal, par construction, à jouer le rôle d'animation et de coordination interministérielle qui lui est en théorie assigné, coincé entre un ministre de plein exercice qui exerce les arbitrages internes au Quai d'Orsay, et le ministre de l'économie qui tient les cordons de la bourse.
Deux ministres puissants qui, de par leur mission, répondent à des fonctions d'objectifs différentes de celles de la Coopération : un prisme essentiellement monétaire et financier ou commercial à Bercy, un prisme avant tout diplomatique et d'influence au Quai d'Orsay.
Quelles que soient la majorité et la bonne volonté du ministre en charge du dossier, la priorité gouvernementale semble ailleurs. Cela se traduit concrètement aussi bien dans les agendas des ministres, souvent accaparés par d'autres missions, que dans les arbitrages budgétaires.
Depuis que la Coopération lui a été rattachée en 1998, le ministère des affaires étrangères a ainsi globalement démontré une grande difficulté à défendre les moyens de l'APD, en particulier dans le contexte d'arbitrages avec d'autres moyens du Quai, de son réseau ou de ses politiques.
Pour sa part, le ministère de l'économie est, par construction, plus mobilisé par les moyens nécessaires pour les activités dont il a la charge directe en faveur des banques de développement et, au plan bilatéral, par les activités de prêt qui figurent à son budget que par les dons pour les projets dans les pays les plus pauvres ou pour l'assistance technique qui figurent au budget du ministère des affaires étrangères. Le choix des instruments n'est, dès lors, plus guidé par les objectifs visés ou les besoins de nos partenaires, mais par le poids respectif de chaque ministre de part et d'autre de la Seine.
Ce déséquilibre institutionnel conduit à une absence de vision globale et réduit la cohérence des choix et des arbitrages.
C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne le partage des moyens entre les canaux bi et multilatéraux et, au sein de l'aide multilatérale, entre banques multilatérales, organismes des Nations unies et instruments communautaires. Mais cela l'est également pour des dossiers comme la promotion de l'expertise technique française : en dépit de très nombreux rapports parlementaires et administratifs dénonçant la faible performance de la situation actuelle, la situation n'évolue pas.
Comme le souligne l'OCDE en 2013 dans la revue par les pairs de la coopération française, après la Cour des comptes en 2011 et le Cabinet Ernst and young en 2012 : « Le dispositif institutionnel demeure complexe et génère des coûts de transaction élevés. Les efforts en termes de pilotage et de rationalisation devront donc être poursuivis ».
Ce constat amène le groupe de travail à proposer de mener à terme la rationalisation du dispositif institutionnel engagé en 1998, dans une logique de cohérence et d'efficacité, de créer un ministère de la coopération internationale de plein exercice, doté d'une administration propre rassemblant les services aujourd'hui chargés du développement, comme c'est le cas en Grande-Bretagne ou en Allemagne.
Cette proposition sera détaillée dans la partie consacrée à la coopération au développement.
|
6) Créer un ministère de la coopération internationale de plein exercice rassemblant le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances. |
2. Pour une meilleure prise en compte de la dimension régionale
Nous avons fait le constat dans le premier chapitre que les problématiques de sécurité et de croissance de la majorité des pays africains se posaient à une échelle régionale.
C'est le cas des zones de conflits au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, c'est le cas en matière d'infrastructures de transports, d'énergie, c'est le cas en matière de commerce avec la création d'espaces économiques communs.
L'approche régionale, aujourd'hui notoirement négligée par nos partenaires africains, aiderait à réduire les failles de la gouvernance économique.
C'est également vrai dans la lutte contre les trafics qui se jouent des frontières dans l'espace ouest-africain et sahélo-saharien et dans l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, agricoles et minières, qui exige notamment la réalisation d'infrastructures de transports et d'énergie communes.
Or l'organisation de la relation avec l'Afrique est, en France, encore presque exclusivement bilatérale, comme en témoignent les difficultées à produire collectivement une stratégie pour le Sahel ou pour le Lac Tchad.
D'une part, nous investissons très peu les organisations continentales ou régionales en dehors des financements qui transitent par l'Union européenne.
D'autre part, nous ne structurons pas notre action par région, ni en matière de sécurité, où les bases prépositionnées ou les point d'appui des OPEX ne sont pas pas véritablement organisés par niveau régional, ni dans le réseau diplomatique où il n'y a pas de struturation regionale des ambassades, ni au niveau de la coopération, même si l'AFD pratique depuis longtemps des projets à l'échelle régionale.
Les deux aspects sont en partie liés dans la mesure où la France ne consacre que peu de moyens aux institutions régionales. Ces questions sont suivies par les services de l'ambassade du pays de résidence de l'organisation régionale sans qu'ils bénéficient de moyens supplémentaires. C'est le cas à Addis Abbeba où l'ambassade de France en Ethiopie ne peut consacrer qu'un agent au suivi de l'Union Africaine.
La question n'est pas seulement l'investissement mis dans le suivi et la coopération dans les instances régionales, au demeurant trop faible, mais la prise en compte de la dimension régionale dans la gestion quotidienne de nos relations avec les pays africains.
C'est pourquoi, nous proposons de désigner dans chaque région une ambassade chef de file pour coordonner les réflexions et les actions qui ont des implications régionales.
Ces ambassades devraient être désignées en fonction du caractère central du pays de résidence et du siège de l'organisation régionale dominante.
De même, concernant les points d'appui et les bases militaires françaises, dans chacune des zones, une base devrait être désignée comme chef de file, notamment dans la coopération avec les organisations régionales qui participent à la formation des forces africaines en attente. Dans le domaine militaire, cette structuration aurait le mérite de prendre en considération le projet d'architecture de sécurité africaine et de légitimer notre présence par cet arrimage.
Une structuration régionale de notre dispositif civil et militaire permettrait, sans remettre en cause les relations bilatérales dont le rôle reste essentiel, de mieux identifier les sujets qui méritent un traitement plus régional.
Cet effort de réorganisation devrait se fonder sur une analyse des risques et des opportunités entre les ambassades et des services centraux concernés et devrait se traduire par la mise à jour régulière de «stratégies-régions» validées au niveau interministériel.
Actuellement, ambassadeurs et services d'une même région se parlent. Il y a une réunion annuelle des ambassadeurs sous-région par sous-région, chaque année dans un pays différent. Mais l'institutionalisation de ce dialogue et la possibilité de faire des choix en définissant des priorités et des moyens à l'échelle régionale permettrait, dans un contexte de contrainte budgétaire forte, d'allier une plus grande adéquation aux évolutions locales avec une rationalisation des moyens qui s'imposera de toute façon.
En ce qui concerne l'universalité du réseau, il faut par ailleurs ne s'interdire aucune hypothèse, notamment étudier celle de mutualiser des moyens avec certains partenaires européens - dont l'Allemagne, voire de déléguer notre représentation à l'Union européenne. Le principe d'ambassades communes pourrait être testé dans certains pays d'Afrique comme la Namibie ou le Botswana. Ca ne voudrait pas dire réduire nos moyens, mais au contraire les accroitre en les mutualisant. Cela mènerait logiquement à une politique commune d'aide au commerce extérieur, et donc à des joint-ventures franco-allemandes - ce dont nous avons besoin pour être à la hauteur des enjeux d'un point de vue volumétrique.
|
7) Instaurer une structuration régionale de notre dispositif diplomatique avec la nomination d'ambassades chefs de file régionaux et la mise à jour régulière de «stratégies-régions» validées au niveau interministériel. 8) Etudier la possibilité dans certains pays de mutualiser notre dispositif diplomatique avec certains partenaires européens ou avec l'Union européenne avec la constitution d'ambassades communes. |
3. Pour une approche globale dans la gestion des Etats fragiles
Le troisième point sur lequel le pilotage de la politique africaine mérite d'être amélioré est la gestion de notre coopération dans les Etats fragiles, en crise comme la Somalie, en sortie de crise comme le Mali, peut-être un jour la RCA, ou en difficulté comme le Tchad ou Madagascar. Ces pays se distinguent à de nombreux égards du groupe des pays de l' « Afrique qui gagne ».
Dans un certain nombre d'entre eux, notre présence se traduit par de multiples coopérations civiles et militaires qui devraient être complémentaires et cohérentes. Dans certains pays nous avons été présents avant le surgissement d'une crise sans arriver à l'anticiper et à la prévenir.
Sans se faire d'illusion sur notre capacité à maîtriser des évolutions qui nous échappent très largement, les guerre du Rwanda, de Côte d'Ivoire ou du Mali mènent à penser que la France a un intérêt manifeste à contribuer à prévenir l'escalade de la violence armée.
Sans même considérer le coût humain, les dommages physiques et psychologiques de long terme, le retard pris termes de développement pour les pays concernés, les coûts financiers des opérations de stabilisation, de maintien de la paix et des interventions de reconstruction post-conflit pour les pays partenaires que nous sommes, sont extrêmement élevés, pour des résultats qui restent fragiles. Car il est toujours plus long et difficile de panser les plaies après que le sang a coulé. Les difficultées rencontrées par les processus de réconcilation et de désarmement montrent combien la spirale de la violence est difficile à éteindre.
Une intense production intellectuelle existe sur la coopération militaire et civile dans des situations de fragilité en France et dans le monde, notamment dans les organisations internationales, aussi bien à l'ONU, à l'OTAN qu'à la Banque Mondiale, mais d'un point de vue opérationnel, la France, elle, n'a pas tiré beaucoup d'enseignements de cette réflexion.
Certes, la France participe activement aux forums internationaux portant sur les situations de fragilité, dont le Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité et le Dialogue international sur la construction de la paix et le renforcement de l'État. Elle pilote l'initiative en République centrafricaine. Sur un plan interne, elle a publié en 2007 une stratégie sur les États fragiles, qui est en cours d'actualisation, de même qu'une stratégie sur la réduction de la violence armée sur la base d'un travail interministériel associant le monde de la recherche. Il serait utile qu'elle traduise ces stratégies en plans d'action et outils concrets et réalistes.
Mais, comme le souligne la dernière évaluation de la coopération française par l'OCDE, « la France n'a pas encore adopté d'approche cohérente pour les situations de sortie de crise. Jusqu'à présent, elle n'a pas non plus mis en place de mécanisme efficace de coordination pour faire le lien entre les programmes humanitaires et les programmes de développement. ». Un problème qui se pose, d'ailleurs, en France comme au sein de l'Union européenne.
La nature du dispositif français, qui est éclaté entre diverses institutions, rend plus difficile cette coordination. Cette situation se retrouve dans l'absence de lien entre l'action militaire, humanitaire, la prévention des crises et la réduction des risques, même si des initiatives ont été prises dans le domaine de la sécurité alimentaire, et plus récemment pour favoriser la résilience dans les pays du Sahel
Contrairement à la Grande-Bretagne pour laquelle le lien entre les questions de développement et de sécurité est au coeur de sa stratégie, en France l'approche globale de ces questions est restée encore très conceptuelle. La Grande-Bretagne a mis en place des task forces interministérielle associant le ministère de la défense et l'armée (''the MoD and the armed forces''), le ministère des affaires étrangères (''Foreign and Commonwealth office - FCO'') et le département pour le développement international (Department for international development -DFID).
Aujourd'hui, une coordination accrue est nécessaire dans le cadre d'une approche globale interministérielle et multilatérale, afin d'optimiser l'emploi de moyens comptés que nous utilisons dans les pays fragiles d'Afrique.
Le Livre blanc de 2008 avait déjà fait ce constat et, en 2009, a été élaborée une stratégie interministérielle de gestion civilo-militaire des crises extérieures, dont le pilotage relève du ministère des affaires étrangères.
Une structure en charge de la mise en place de réponses globales aux crises a été constituée avec un comité de pilotage qui se réunit à un haut niveau trois fois par an et une Task Force, qui est sa cheville ouvrière, placée sous une double tutelle, celle de la direction politique et celle du centre de crise du ministère des affaires étrangères.
N'ayant bénéficié que de peu de moyens, elle peine à jouer un rôle d'animation interministérielle ainsi qu'un rôle de planification stratégique, pourtant nécessaires à la cohérence des interventions en amont, durant et en aval des crises.
Or une capacité crédible de prévention et de gestion civilo-militaire des crises s'impose.
Le dispositif français doit être revu à partir d'un bilan de ses forces et faiblesses et d'une analyse des dispositifs existants chez certains de nos partenaires et auprès d'autres structures comme le SGDSN. Celle-ci pourrait être menée conjointement par les ministères concernés, dans le cadre d'une mission de Modernisation de l'Action Publique.
L'expérience des crises récentes a montré que nos capacités civiles, dans les actions de prévention comme dans la reconstruction/stabilisation après un conflit, sont encore insuffisantes, faute, notamment, d'avoir pu créer les conditions permettant la mobilisation efficace et coordonnée des ministères compétents.
Il convient par conséquent de relancer la stratégie interministérielle. La politique de prévention de la France a pour objectif d'éviter l'apparition de foyers de crise, notamment dans notre environnement proche. La coopération de défense et de sécurité, l'assistance opérationnelle à des armées étrangères ainsi que notre dispositif prépositionné constituent autant d'outils qui doivent contribuer à la cohérence de notre politique en matière de prévention et de coopération au développement.
Si, malgré ces efforts de prévention, la France est appelée à participer à une opération de gestion de crise, les forces d'intervention doivent être, au plus tôt, complétées par le déploiement de capacités civiles spécialisées.
Une structure de haut niveau associant étroitement les différents départements ministériels compétents doit pouvoir être mobilisée pour gérer de façon coordonnée des situations d'après conflit comme la Côte d'ivoire, la Libye ou le Mali.
Les modalités de la mise en oeuvre de cette approche globale dans la gestion des crises devraient être anticipées et planifiées au plus tôt et, si possible, en amont de toute intervention.
Il convient par ailleurs de faire travailler ensemble tous les acteurs concernés en remettant en place le « cycle des acteurs français du post-crise » qui avait un temps existé, financé par la DAS, le MAE et l'AFD. Ce cycle a été très important pour rapprocher les cultures professionnelles et disposer d'une compréhension commune des enjeux et besoins.
La définition préalable des stratégies post-crise et la mobilisation des ressources humaines et matérielles correspondantes demandent une coordination rigoureuse aux niveaux interministériel et multilatéral, qui doit pouvoir s'appuyer sur une organisation et des procédures éprouvées.
C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'une procédure de mobilisation de structures de réponse rapide aux crises composées de personnels mis à disposition représentant les différents départements ministériels compétents.
Ces structures légères et réactives resteront en activité tout au long de la période critique. Cette approche globale interministérielle doit se traduire, sur le théâtre de la crise, par une délégation et un partage clair des responsabilités afin d'assurer la cohérence de l'action au contact des réalités du terrain.
Le renforcement de l'action civile sur le terrain passe surtout par une mobilisation rapide des expertises civiles, notamment dans les spécialités critiques (sécurité publique, douanes, administration publique, magistrature, génie civil, etc.).
Une démarche volontariste valorisant dans la fonction publique les parcours internationaux devrait permettre de disposer des capacités civiles à la hauteur de nos ambitions. Le vivier d'experts volontaires pouvant être sollicités doit ainsi être consolidé, élargi et régulièrement actualisé en coordination avec les administrations et les opérateurs spécialisés (France-Expertise Internationale, CIVIPOL, etc.).
|
9) De mettre en place une cellule de haut niveau en charge de la gestion civilo-militaire des situations de crise afin d'assurer une véritable coordination entre les responsables du développement et de la sécurité là où la France est présente. Cette cellule aura pour fonction de coordonner les actions de prévention des crises ou de gestion des situations post-crises afin de favoriser le rétablissement des services publics et privés essentiels au fonctionnement normal d'un pays. |
4. Une politique qui doit s'adapter à l'ère du multimédia
En matière d'influence et de promotion culturelle comme dans d'autres domaines, il faut s'interroger en Afrique comme ailleurs sur le lien automatique entre la présence physique et l'influence. Outre qu'il est contestable sur le plan de la méthode, il n'est plus financièrement tenable. Pour repenser ce lien entre présence et influence, au moins trois voies peuvent être explorées.
La première consiste à rationaliser le dispositif en Afrique, dans une démarche classique d'ajustement, à la recherche d'une meilleure efficacité et d'une plus grande cohérence entre les objectifs et les moyens. C'est dans ce cadre qu'il faut voir s'il n'est pas plus pertinent d'allouer des moyens supplémentaires dans l'Afrique anglophone pour profiter des opportunités que présentent ces pays en prélevant sur les effectifs des pays francophones. C'est le sens des dernières mesures adoptées tout récemment par le ministère des affaires étrangères, qui va renforcer sa présence au Rwanda, en Angola et en Afrique du Sud
La deuxième consiste à mettre en oeuvre une présence internationale européenne et non plus seulement nationale, ce qui suppose une répartition des rôles voire la création de représentations communes. C'est le sens de la construction d'une politique étrangère commune, nous y reviendrons.
La troisième, enfin, consiste à agir non plus sur la présence mais sur le contenu, c'est-à-dire sur le sens, sur le type d'influence souhaité.
Souhaite-t-on plutôt opérer en réseau, avec des partenaires, dans le domaine du soft power et de l'action normative et sur un certain nombre de thèmes prioritaires préalablement définis ? Cette démarche n'est pas nécessairement moins coûteuse : elle nécessite de se doter de tous les instruments nécessaires à une politique d'influence moderne. Elle pose donc, là encore, la question de la mutualisation des moyens et de la définition d'objectifs éventuellement communs.
La politique française en matière d'audiovisuel extérieur, ambitieuse, avec, entre autres, la chaîne de Radio France International, les chaînes de télévision TV5 Monde et France 24 constituent de ce point de vue des outils précieux qu'il convient de soutenir, notamment dans la phase d'implémentation de la TNT en Afrique, quitte à l'ouvrir plus largement à des partenaires francophones ou européens.
De même, en matière d'éducation, l'accès à des plateformes multimédia apparaît comme un enjeu essentiel. Les cours en ligne ouverts et massifs ("MOOC" en anglais ou "CLOM" en français), dispensés gratuitement sur Internet par les meilleurs établissements et mis à la disposition de toute personne, vont révolutionner la transmission des savoirs, notamment dans les pays d'Afrique qui sont de plus en plus connectés mais qui n`ont pas encore un système d'enseignement supérieur performant. Il y a là un enjeu majeur pour la Francophonie.
II. FAIRE DE L'ÉCONOMIE UNE PRIORITÉ
On a trop longtemps regardé l'Afrique comme un sujet avant tout politique. Le décollage du continent nous impose de regarder les pays africains autrement en mettant la priorité sur la dimension économique.
A. RÉINVESTIR L'AFRIQUE
Longtemps en marge, le continent africain s'impose chaque jour davantage comme un acteur de la croissance mondiale. Le formidable dynamisme démographique de l'Afrique, l'essor de ses entreprises, ses ressources considérables en font une des principales réserves de croissance de l'économie mondiale pour les décennies à venir. C'est pourquoi, il convient de réinvestir l'Afrique et mettre fin au recul de la présence économique française.
1. Définir une stratégie de conquête des marchés africains par filières.
L'élaboration d'un Livre blanc sur l'Afrique devrait comporter une partie centrale dédiée à la promotion de nos intérêts économiques, fruit d'un travail commun des principaux acteurs, aussi bien la direction générale du Trésor, qu'UBIFRANCE, la COFACE, la BPI et les syndicats professionnels, le réseau des chambres consulaires.
Les récents travaux menés par le ministère du commerce extérieur pour identifier les couples pays/secteurs gagnants à l'international vont dans le bon sens mais n'accordent pas assez d'importance à l'Afrique.
Ils ne mentionnent que quatre pays cibles : l'Afrique du Sud, le Nigéria, la Côte d'Ivoire, et le Kenya, sans prendre en compte le potentiel de pays comme l'Éthiopie, le Ghana, le Botswana ou la Mozambique, sans identifier les logiques régionales dans lesquelles évoluent désormais les groupes africains.
Certes, on constate une prise de conscience des responsables gouvernementaux. Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, s'est rendue en Afrique du Sud les 14 et 15 octobre, dans le cadre de la visite d'Etat du Président de la République. Il s'agissait du 3 ème déplacement de la ministre en Afrique subsaharienne, après le Kenya et le Nigeria mi-septembre et avant la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Éthiopie d'ici fin 2013.
Il ne faut cependant pas oublier que la France conserve des parts de marché importantes, souvent comprises entre 15% et 20%, chez ses partenaires historiques d'Afrique de l'Ouest, qui ont cependant reculé depuis 2000, appelant une action ciblée sur ces pays afin de restaurer ses positions.
Pour y parvenir, cela passe, avec plusieurs de ces pays, par la mise en place d'un pacte de co-production, permettant d'accroître nos exportations, en répondant à leurs exigences en matière de création de valeur ajoutée sur leur territoire et d'affronter ensemble les marchés tiers.
Il faut, de ce point de vue, ne pas seulement se focaliser sur les exportations et la fourniture de biens, mais aussi sur des co-investissements.
Les entreprises françaises ont tout intérêt à s'implanter dans une zone qui sera une des plus dynamiques des prochaines décennies.
Le dispositif français est, par ailleurs, encore trop orienté par les grands contrats (aéronautique, matériel de transport, énergie...) décrochés par nos grandes entreprises.
Ceux-ci, qui sont importants, ne suffisent cependant pas à faire progresser fortement notre part de marché, dans la mesure où ils ne permettent pas d'assurer un flux d'exportations pérenne.
Pour y parvenir, il conviendra aussi de se déployer dans des zones de croissance où les entreprises sont trop peu présentes et où l'Etat n'a pas eu d'action suffisamment structurée, s'agissant de pays d'Afrique anglophones ne se situant pas dans notre aire d'influence traditionnelle.
Un travail de mobilisation est nécessaire pour structurer une démarche internationale de filières qui correspondent aux besoins des marchés africains en réduisant la perception du risque qui est souvent surévalué quand il s'agit de l'Afrique.
Par ailleurs, la pratique du portage, qui a connu une nouvelle impulsion avec la signature, en mai 2011, par 20 grands groupes français de la « Charte Pacte Export », doit être amplifiée et adaptée aux réalités africaines.
Nombre de nos concurrents « chassent naturellement en meutes ». En France, nous n'avons pas cette tradition. Les pouvoirs publics ont la responsabilité de favoriser cette pratique en rassemblant les grandes entreprises présentes en Afrique telles que Bolloré, Total, Vinci, Bouygues, ou de plus petites entreprises, et de voir comment, selon les secteurs et les géographies, le succès des uns peut tirer les autres.
|
10) Structurer une démarche internationale par géographies et par secteurs qui correspondent aux besoins des marchés africains, renforcer nos moyens de soutien aux entreprises dans les pays les plus dynamiques tels que l'Afrique du Sud, le Nigéria, la Côte d'Ivoire et le Kenya, mais également l'Éthiopie, le Ghana, le Botswana ou le Mozambique. 11) Développer la pratique du portage des PME par les grands groupes présents sur le continent dans une démarche adaptée aux réalités africaines. |
2. Promouvoir des stratégies d'innovation pour des produits et des services destinés au « bas de la Pyramide »
La répartition des revenus en Afrique est fortement inégalitaire. Ce fait connu se reflète dans une pyramide dont le sommet est constitué par une faible proportion de personnes à revenus élevés et dont la base est constituée de la majorité de la population à faibles revenus
Pendant de nombreuses années les stratégies internationales des grandes entreprises se sont concentrées essentiellement sur les consommateurs à hauts revenus. Lorsque ces marchés ont été saturés ces entreprises ont porté leur attention sur les marchés des pays émergents en Asie mais également en Afrique. Les populations les plus pauvres situées au bas de la pyramide représentaient un potentiel de marché considérable Leur pouvoir d'achat individuel est faible mais leur grand nombre offre des opportunités de marché considérables. Les grandes entreprises multinationales telles qu'Unilever, Nestlé, Danone et Procter & Gamble se sont déjà lancées dans la conquête des marchés du bas de la pyramide. Par exemple, Nestlé a déclaré que ce segment de marché mondial représentait un domaine stratégique de croissance de l'entreprise
Les stratégies de marketing doivent être complètement révisées et adaptées à ces nouveaux segments de marché Les produits doivent être conçus spécialement pour des consommateurs à faible budget et pour des usages spécifiques Les produits sont dès lors adaptés, notamment en termes de format. En effet, les emballages sont de plus petite taille afin de permettre aux consommateurs pauvres d'acheter des produits à l'unité ou en très faible quantité étant donné qu'ils n'ont pas les moyens d'acquérir de grands volumes à la fois.
Les canaux de distribution doivent également être modulés en fonction des spécificités de ces marchés. Le modèle des circuits de vente traditionnels, petits magasins, stands de rue, etc, se substitue à celui des grands centres de distribution. Les «microdistributeurs» sont au coeur des stratégies de vente des entreprises multinationales sur les marchés des pays pauvres.
Au-delà des aspects marketing, c'est le processus même de fabrication qui est concerné. De nombreux succès entrepreneuriaux reposent en Afrique sur le concept d' « Innovation Frugale » où s'opère une rupture des processus d'ingénierie complexes pour construire un produit ou service de manière plus économique adapté au marché africain. Dans de nombreux secteurs, l'innovation au bas de la pyramide n'est pas une option, mais une obligation.
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) offrent, en particulier, de formidables opportunités en termes d'accès durable des populations de la base de la pyramide à des services essentiels comme l'éducation, la santé, les services agricoles ou les services financiers. Ainsi la société M-PESA au Kenya a créé un système innovant qui permet de transférer de l'argent tant aux utilisateurs de -PESA qu'aux non-utilisateurs, sans avoir besoin de compte bancaire, via une interface mobile simple. Le service a été lancé début 2007 et compte plus de 13 millions de clients trois ans après sa création. mPedigree est une entreprise privée basée en Afrique qui est née d'une ONG fondée par un entrepreneur social ghanéen. Lancé en 2007, mPedigree travaille avec des opérateurs mobiles et des fabricants de médicaments pour fournir un système efficace de vérification dans la lutte contre la contrefaçon et les faux médicaments, que l'on trouve trop souvent dans les pharmacies et les échoppes en Afrique. Le service est aujourd'hui accessible au Ghana, au Kenya, et au Nigeria.
Pour encourager ces initiatives, le groupe de travail propose la création, en partenariat avec Proparco, la filiale privée de l'AFD et des investisseurs privés soit d'un fonds d'investissement soit d'un guichet de l'AFD spécialisé dans des services d'innovation technologique et sociale.
Cet instrument de cofinancement financerait des projets RSE/bottom of the pyramid portés par des entreprises françaises. L'AFD cofinancerait des initiatives, répondant à des cahiers des charges précis avec une plus-value développementale avérée. Etant donné que les conditions locales diffèrent et que les services doivent être adaptés aux spécificités locales, un tel instrument pourrait être partenaire de fonds locaux, plus au courant des conditions de succès dans un endroit donné, afin de réunir une expertise mondiale sectorielle et une connaissance du terrain. Enfin, cet instrument pourrait coupler ses outils financiers avec de l'assistance technique, éventuellement fournie par un groupe de volontaires mis à disposition par des entreprises de technologie de l'information. Le fonds n'investirait que dans des projets ayant une part significative d'investisseurs privés afin de s'assurer de la bonne viabilité des projets et une part d'investisseurs français pour promouvoir l'investissement français en Afrique.
|
12) Favoriser des stratégies de conquête des marchés africains par le bas de la Pyramides et créer avec Proparco un fonds d'investissement en partenariat public privé sur ce type de stratégie « le bas de la Pyramides » impliquant des nouvelles technologies et des entreprises françaises. |
3. Renforcer la coordination des acteurs du soutien à l'exportation
En France, au niveau local, nous devons mieux repérer, sélectionner et préparer les entreprises capables d'aller vers des pays africains en plein développement.
L'Etat doit diffuser une meilleure information sur les marchés africains au niveau des Régions, notamment à travers le dispositif d'appui au développement international des PME et des ETI, les pôles de compétitivité, les CCI et les centres régionaux de la BPI. Les équipes des services économiques sur place doivent favoriser l'intervention collective sur les marchés locaux et susciter un meilleur portage entre les grands groupes et les PME.
Une telle stratégie suppose que l'on mette fin à l'hémorragie des services économiques en Afrique et que l'on identifie la répartition des tâches respectives, notamment dans les postes en sous-effectifs d'UBIFRANCE, des services économiques et de l'Agence française de développement.
Le transfert à l'Agence française pour le développement international des entreprises - UBIFRANCE -, des missions d'appui commercial étant réalisées jusqu'alors par les services économiques (SE) de la direction générale du Trésor, a été achevé en 2012.
L'objectif était de mettre en place deux réseaux économiques distincts aux compétences clairement établies : le réseau des services économiques chargé des missions régaliennes (suivi de la situation économique et financière des pays, relations avec les autorités locales, appui aux grands contrats, négociations multilatérales...), et le réseau d'UBIFRANCE, proposant une large gamme de produits et de prestations aux PME et ETI françaises souhaitant se développer sur les marchés extérieurs.
Il se traduit dans certains cas en Afrique par des suppressions de services économiques et par un transfert des compétences des services économiques vers l'AFD dans le domaine de l'analyse macro-économique sans que la place de celle-ci dans la promotion des intérêts économiques ne soit véritablement clarifiée.
Certes, la mobilisation du réseau diplomatique qui reste «universel» en faveur de la diplomatie économique apporte un soutien local aux entreprises, notamment dans ce qu'on appelle les «postes orphelins», c'est-à-dire privés de la présence du réseau économique.
La création au quai d'Orsay de la direction des entreprises qui coordonne le «back-office» de l'action économique de nos ambassades vient renforcer cette mobilisation.
De même, la création dans les représentations diplomatiques les plus importantes de conseils économiques autour de nos ambassadeurs, qui rassemblent à parité autorités publiques et entreprises privées afin d'améliorer le partage d'informations, la réactivité et les besoins des entreprises, devrait permettre de mobiliser l'ensemble d'acteurs qui jusqu'ici avaient peu l'habitude de travailler ensemble.
Le devoir des pouvoirs publics est de créer autour des ambassades un écosystème propice au développement des entreprises françaises à l'exportation.
|
13) Mettre fin à l'hémorragie des services économiques en Afrique et établir des stratégies régionales avec l'ensemble des services intervenant dans le domaine économique et des stratégies régionales avec l'ensemble des services intervenant dans le domaine économique, renforcer les synergies entre Ubifrance, les Missions économiques, les Chambres de Commerce et d'Industries (CCI), en France et à l'étranger (Uccife), les conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF), Oséo, Coface, Pacte PME International, et les Opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI). Soutenir les postes dépourvus de service économique ou de soutien commercial. |
4. Améliorer le financement de l'export.
Nos entreprises ne disposent pas, aujourd'hui, des mêmes conditions de garantie à l'export que celles pratiquées dans d'autres pays. C'est un désavantage important. Par ailleurs, à l'heure actuelle, la multiplicité des acteurs de l'offre publique (OSEO, BPI, COFACE, CCI) et le manque de coordination entre eux hypothèque l'efficacité de leur action.
A la différence de la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, les Etats-Unis, la Chine et la Corée du Sud ont des instruments de crédits exports sous forme de prêts directs.
La loi de finances rectificative adoptée en fin d'année 2012 a prévu la création d'une garantie rehaussée de refinancement qui permet le refinancement de crédits exports par les investisseurs, par laquelle l'Etat se porte indirectement garant à 100% du montant que les investisseurs accepteraient de prêter aux banques pour refinancer les crédits exports.
Par ailleurs, le Gouvernement a lancé un programme de simplification de l'accès des PME et des entreprises de taille intermédiaire aux financements exports et notamment l'élimination des doublons qui existent entre les produits de prêts proposés par les acteurs de l'offre publique, comme la COFACE et OSÉO par exemple, la mise en place d'un produit de prêt unique, appelé « prêt de développement export » pour les prêts destinés à financer le développement des entreprises exportatrices, qui viendra fusionner et remplacer le millefeuille d'offres actuel, la standardisation de la documentation liée aux demandes de financement, en particulier les crédits acheteurs de petits montants.
Ce plan prévoit la création d'un catalogue commun de produits -prêts, assurances, cautions- offerts par les trois principaux acteurs de l'offre publique (bpifrance, UBIFRANCE et la COFACE) sous un même label, « bpifrance export » et la distribution par les directions régionales de bpifrance des soutiens financiers à l'export.
Pour assurer cette distribution globale des soutiens financiers, des chargés d'affaires internationaux UBIFRANCE intègreront les directions régionales de bpifrance. Ils seront rejoints prochainement par des développeurs COFACE.
S'agissant de l'amélioration des produits de financement eux-mêmes, l'accès aux crédits fournisseurs pour les PME et ETI dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 M€ devrait être amélioré en leur donnant la possibilité d'escompter auprès des banques les créances de leurs fournisseurs qui seraient garanties à 100% par la Coface.
Ces mesures issues des évaluations effectuées par la Cour des comptes et l'inspection des finances en 2011 et 2012 sont trop récentes pour avoir encore porté leurs fruits. Une évaluation devra être effectuée pour en mesurer l'impact.
Il conviendrait de même de mettre à plat les performances respectives du FASEP et de la RPE pour voir s'il ne conviendrait pas de réformer ces deux outils dont les performances ont été mises en cause par plusieurs évaluations.
B. INTÉGRER NOS INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES FRANÇAIS DANS LES MISSIONS DE NOTRE COOPÉRATION
Le groupe de travail, en cohérence avec ses propositions sur le renforcement du soutien à nos entreprises en Afrique, souhaite mieux articuler la politique bilatérale de développement avec les intérêts économiques français de long terme, en contribuant à une meilleure veille sur nos intérêts stratégiques et à la promotion de nos savoir-faire.
1. Relier l'aide : une fausse bonne idée
Si les outils de soutien à l'export précités n'ont pas une dimension propre à l'Afrique, l'intervention des pouvoirs publics dans cette partie du monde est marquée par la présence de la coopération au développement sous l'aspect « financement de projet et expertise technique ».
Nous nous sommes interrogés sur le rôle de ces deux outils dans la promotion et le soutien de nos entreprises.
Bien que l'aide au développement française soit une des plus déliée au monde avec plus 90 % de l'aide déliée 64 ( * ) , le taux de retour pour nos entreprises en Afrique est de l'ordre de 50 %. Ce taux est comparable à celui de nos partenaires bailleurs de fonds. Ainsi, bien que l'AFD n'affiche pas explicitement la promotion des intérêts économiques parmi ses objectifs, de fait, la présence de financements français, les liens avec les réseaux économiques, les performances des entreprises elles-mêmes conduisent à privilégier les entreprises françaises aux côtés des entreprises locales.
Faut-il relier l'aide pour mieux défendre nos entreprises ? Si l'idée paraît séduisante face à la concurrence des pays émergents et notamment de la Chine dont l'aide est quasiment intégralement liée à la défense de ses intérêts stratégiques, dans la pratique, un reliement de l'aide aux projets ne semble pas devoir atteindre les objectifs poursuivis sur le long terme.
D'une part, un certain nombre de pays dont l'Afrique du Sud refuse la pratique de l'aide au développement lié. Autrement dit, l'AFD ne peut poursuivre ses activités que si elle continue à pratiquer des financements déliés. C'est le cas dans de nombreux pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure qui souhaitent avoir le choix des contractants et se méfient des procédures de gré à gré.
C'est d'ailleurs une des clauses de l'engagement pris par la France en 1978 au sein de l'OCDE sur les crédits exports qui a été étendue aux pays les moins avancés et aux pays pauvres très endettés.
La France pourrait dénoncer ces accords. Jusqu'à présent la stratégie suivie a été, au contraire, d'amener les pays émergents à adhérer à ces accords, sinon à leur lettre du moins à leur esprit. Sans doute la France y perdrait en crédibilité dans la communauté des bailleurs de fonds, notamment parce que les montants de l'aide déclarée de la France chuteraient drastiquement, l'aide liée ne pouvant être déclarée que si elle comporte un degré de concessionnalité aujourd'hui hors de portée des finances publiques, mais aussi parce qu'elle opérerait un revirement majeur dans une stratégie qui vise à augmenter globalement les exigences des appels d'offre financés par l'aide, aussi bien en matière de transparence que de responsabilité sociale et environnementale.
Un tel revirement rendrait difficile, par ailleurs, les financements croisés qui sont aujourd'hui un axe majeur pour coordonner l'action des bailleurs de fonds. Gagnerait-elle d'un point de vue commercial ?
Les évaluations effectuées sur les protocoles du Trésor avant le déliement font état de surmarges de l'ordre de 30 % quand la concurrence est restreinte aux seules entreprises françaises avec des cas d'entente aussi bien entre entreprises qu'avec les administrations partenaires. Il y a dès lors un risque de financer des projets qui ne correspondent pas à des besoins avérés et de soutenir des entreprises dont les prestations sans cette aide seraient peu compétitives. Et cela sur des montants qui ne peuvent pas avoir des effets massifs puisque la France ne représente que 10 % de l'aide programmable globale.
C'est d'ailleurs pourquoi ni le MEDEF ni les autres syndicats professionnels ne réclament un reliement de l'aide, contraire au principe de libre concurrence. Ces syndicats constatent par ailleurs que le déliement de l'aide d'autres pays a profité aux entreprises françaises dans les pays où elles étaient bien placées. Ils réclament, en revanche, une meilleure prise en compte des intérêts économiques en amont des financements des projets, notamment en matière d'expertise technique, et la promotion d'une concurrence équitable avec les entreprises des pays émergents sur les marchés africains.
2. Prendre pleinement en compte la promotion des intérêts économiques dans notre politique de coopération
Un examen attentif des politiques de coopération de nos partenaires occidentaux montre que de nombreux pays affichent explicitement ou implicitement un objectif de promotion de leur économie nationale dans les objectifs de leur coopération.
C'est le cas au Japon, en Allemagne, aux Etats-Unis.
A chaque fois avec des modalités différentes, dans la majorité des cas, les outils de promotion du commerce extérieur et d'aide au développement sont distincts, mais parfois gérés par le même organisme.
Le soutien des efforts de développement des entreprises japonaises constitue un des deux axes stratégiques de l'agence de coopération japonaise. Aux États-Unis, USTDA ne finance que des projets de coopération technique pour lesquels il existe une offre américaine ; l'agence MCC, dont l'aide est officiellement déliée, a exclu en 2010 de ses appels d'offres les entreprises publiques, ce qui exclut de facto une grande partie des entreprises chinoises.
En Allemagne, la coordination des intervenants de l'APD bilatérale allemande se réalise au travers de cadres stratégiques, par pays définis par le ministère de la coopération, qui intègrent les questions de la défense des intérêts allemands. Ces cadre établissent un état des lieux de la situation du pays au regard du développement, fixent les secteurs d'interventions au regard des besoins du pays et des positions sectorielles de l'industrie allemande et définissent dans les grandes lignes les instruments à privilégier.
Dans la majorité des cas, la coopération technique liée apparaît comme le levier pour diffuser des normes techniques nationales et favoriser par la suite l'attribution des marchés aux entreprises du pays bailleur.
L'Allemagne et le Japon consacrent près du tiers de leur effort d'APD à une offre d'assistance technique largement liée qui permet d'assurer la diffusion de leurs standards nationaux et de favoriser la mise en place de projets sur des secteurs où il existe une offre des entreprises allemandes et japonaises.
De même la coopération technique américaine vise explicitement à mettre en place des marchés hautement susceptibles d'être remportés par une entreprise américaine.
Par comparaison, les intérêts économiques français ne sont pas suffisamment pris en compte dans le cadre de l'aide bilatérale.
A l'AFD, le mandat de promotion des intérêts économiques comme objectif secondaire après le développement n'est pas explicite et ne fait pas consensus. De ce fait, le cadrage stratégique des outils de financement de projets et de la coopération technique française n'intègre pas cette dimension. Dans les documents de stratégie-pays des différents acteurs, la réflexion ne s'avère ni systématique ni précise sur un positionnement sectoriel optimal en amont, faute de connaissance suffisante des segments où l'offre française est déjà compétitive et surtout susceptible de l'être
Pour la même raison, la coordination entre les acteurs publics et privés de l'aide-projet française, tant au niveau national que dans les pays bénéficiaires, est insuffisante.
A Paris, la coordination sur ces questions entre le ministère des affaires étrangères, celui des finances, bpifrance, UBIFRANCE, la COFACE, les représentants des entreprises, et les représentant des bureaux d'étude est quasiment inexistante, sauf à travers des réseaux informels ou sur des sujets ponctuels et parfois conflictuels comme le champ de compétences des opérateurs d'expertise technique.
Sur le terrain, la coordination entre les bureaux de l'AFD, les services économiques, l'agence Ubifrance, les entreprises et les bureaux d'études dépendent fortement des relations et des parcours personnels. Nous avons constaté en Afrique du Sud, une forte cohésion avec l'établissement en commun entre l'AFD et les services économiques d'un catalogue de l'aide française présente en Afrique du Sud.
Ce n'est pas le cas partout, la répartition des compétences sur les secteurs où la France est compétitive et l'identification des entreprises étant variable selon les pays
Enfin, par comparaison, force est de constater la faiblesse de l'expertise technique accordée par la France en accompagnement du financement de ses projets, notamment en comparaison des principaux bailleurs bilatéraux.
Aujourd'hui, les moyens budgétaires pour financer des études et des expertises en Afrique à l'initiative de l'AFD sont pris sur les mêmes crédits que les subventions projets dont les montants ont diminué de 30 % depuis 2006.
Or l'expérience de nos partenaires montre que c'est en amont des projets, dans le dialogue sur des normes techniques, sur des politiques publiques, qu'un politique d'influence peut avoir une incidence de long terme sur les relations économiques avec des entreprises françaises.
Le développement de cadres normatifs et de régulation similaires aux nôtres au sein des administrations africaines ne peut que favoriser les échanges économiques des entreprises françaises.
Mettre en place les normes ferroviaires en s'appuyant sur des normes françaises ou allemandes maximise les chances des entreprises françaises ou allemandes, participer à la refonte du droit civil malgache, selon que cette refonte s'inspire du système juridique français ou de la « Common Law » britannique, favorise les cabinets d'avocats anglo-saxons ou francophones.
Les cadres politiques, normatifs, économiques et administratifs futurs de nos partenaires africains dépendent, dans une large mesure, de l'expertise apportée pour les concevoir. Les prestations d'expertise et de conseil auprès des gouvernements étrangers et des organisations internationales constituent ainsi un vecteur essentiel pour la diffusion des normes et standards français, tant sociaux que juridiques, sanitaires ou environnementaux. L'expertise internationale française permet aussi le rayonnement de notre modèle d'organisation de la société et de nos valeurs.
L'expertise participe notamment de la promotion d'une vision sociale de la mondialisation et de valeurs portées par notre diplomatie multilatérale (« socle de protection sociale », égalité dans l'accès à la santé, un droit du travail protecteur...).
L'expertise française dans ces domaines constitue potentiellement un puissant relais d'influence pour la France à l'heure où la santé, l'emploi et les inégalités sociales deviennent des facteurs de déséquilibres géopolitiques importants (chômage des jeunes, inégalités hommes femmes, sida et autres maladies infectieuses, concurrence favorisant le moins-disant social).
L'ensemble de ce diagnostic conduit à proposer que l 'AFD se voie confier officiellement en plus de son mandat au service d'un développement durable et au sein de son mandat de politique d'influence, un mandat de dialogue avec les entreprises privés et les bureaux d'études et de promotion de l'économie française autour de l'expertise.
Pour ce faire, le groupe de travail propose que cet objectif soit inscrit dans le contrat d'objectif de l'agence, qui devra travailler en étroite collaboration avec les services compétents du ministère des finances et du ministère des affaires étrangères, en France comme dans le réseau. Cet objectif imposera un mécanisme permanent de dialogue et de concertation avec le secteur privé français.
Il ne s'agit donc ni de relier le financement des projets, ni d'influencer le résultat des appels d'offre qui ne sont pas d'ailleurs du ressort de l'AFD, mais bien de développer un dialogue sectoriel de façon à mieux se faire rencontrer les préoccupations de développement et celles de commerce extérieur en amont de la définition de stratégies sectorielles et géographiques.
Cette concertation aura pour objectif : une identification, avec l'aide des services de l'Etat, des filières fortes par pays, susceptibles de voir de l'expertise ou des entreprises françaises se positionner et répondre de manière compétitive à la demande.
Cette proposition s'articule avec le souhait explicité ci-après de doter l'AFD de moyens renforcés pour financer de l'expertise technique.
La gestion d'un fonds dédié à l'expertise, permettrait à l'AFD de mieux prendre en compte encore les secteurs force de l'économie française d'agir en amont des projets pour promouvoir des politiques publiques et des normes en cohérences avec ses points forts.
Par ailleurs, PROPARCO, filiale de l'AFD pour le secteur privé constitue un instrument particulièrement intéressant en matière de promotion du secteur privé et de l'investissement en Afrique. Elle est aujourd'hui encore limitée dans son développement par la définition d'un plafond d'emploi au sein du groupe AFD et une surface financière insuffisante. Il conviendrait d'étudier la manière dont elle pourrait développer son activité avec une plus grande autonomie organique par rapport à l'AFD et renforcer ses objectifs de co-investissement avec des entreprises françaises.
|
14) Inscrire dans le COM de l'AFD un mandat de dialogue avec les entreprises privées et les bureaux d'études et de promotion de l'économie française autour de l'expertise. 15) Favoriser le développement de PROPARCO en renforçant ses fonds propres et garantissant une plus grande autonomie organique, et en lui fixant des objectifs de co-investissement avec des entreprises françaises. |
C. PROMOUVOIR UNE CONCURRENCE ÉQUITABLE SUR LES MARCHÉS LIÉS À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
La convergence de la politique d'aide des pays émergents vers les principes d'efficacité et de transparence de l'aide constitue aujourd'hui une priorité.
Le volume considérable et croissant de l'aide des pays émergents en fait aujourd'hui un enjeu majeur de la politique internationale d'amélioration de l'efficacité de l'aide.
Le poids déterminant des entreprises des pays émergents en général et de la Chine en particulier dans le tissu économique des pays en développement en fait des concurrents de premier plan pour les entreprises étrangères, notamment dans les marchés d'APD.
La présence croissante d'entreprises chinoises dans le secteur des infrastructures, mais aussi des biens et services, associée à une compétitivité des prix très forte, renforce la pression concurrentielle exercée tant sur les entreprises locales que sur les entreprises étrangères, dont françaises, implantées dans les pays concernés.
Dans l'intérêt économique des pays en développement comme des entreprises françaises, il convient d'accorder une attention accrue aux conditions de concurrence sur les marchés d'aide et de coopération.
L'existence de financements à l'exportation émanant des banques publiques chinoises et dérogeant aux règles auxquelles s'astreignent les membres de l'OCDE, le faible respect des normes sociales et environnementales et de lutte contre la corruption justifient l'adoption de mesures visant à restaurer la réciprocité des conditions commerciales sur les marchés des pays en développement, notamment les marchés d'aide.
Il est souhaitable que les pouvoirs publics utilisent toutes les mesures nécessaires pour favoriser la convergence des pratiques d'aide de la Chine avec celles de bailleurs du CAD en intensifiant le dialogue sur l'efficacité avec les pays émergents, dont la Chine, dans les différentes enceintes internationales existantes (Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, Nations Unies, G20) en encourageant les initiatives multilatérales de transparence de l'aide, telles que l'initiative IATI; en engageant ces pays dans des coopérations trilatérales afin d'établir un dialogue concret sur la politique d'aide.
Le groupe de travail estime que les occidentaux doivent accroître leurs pressions sur les pays émergents afin d'obtenir une clause de réciprocité sur l'ouverture des marchés financés par l'APD, de pousser les pays émergents à délier leurs financements ou, le cas échéant, à exclure leurs entreprises des appels d'offres financés par les APD qui répondent aux critères de l'OCDE.
Par ailleurs, le groupe de travail souhaite, s'agissant des contrats financés par la France, que l'AFD renforce les exigences retenues dans les appels d'offres en matière de responsabilité sociale et environnementale afin de pouvoir, le cas échéant, écarter de la compétition toute concurrence déloyale.
Certes, les marchés financés par l'AFD sont attribués, signés et exécutés sous la responsabilité exclusive des maîtrises d'ouvrage locales, bénéficiaires de ses concours, en application de la réglementation nationale, mais l'AFD en s'assurant de la bonne utilisation de ses fonds peut et doit contrôler le respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la convention de financement, qui peut comporter des obligations de se conformer aux bonnes pratiques internationales régissant la commande publique : ouverture, équité, transparence et économie, mais aussi des engagement spécifiques des soumissionnaires quant à leur responsabilité sociale et environnementale.
En 2013, des propositions ont été élaborées pour renforcer les exigences environnementales et sociales dans les dossiers d'appels d'offres pour les marchés à fort impact afin de permettre aux bénéficiaires de ses financements d'éliminer, au stade de la pré-qualification et de l'évaluation des offres, des entreprises ou des propositions qui ne seraient pas conformes techniquement sur le volet responsabilité sociale et environnementale et de sanctionner une entreprise qui ne respecterait pas ses engagements lors de l'exécution de son marché.
Le groupe de travail souhaite que ces propositions puissent être reprises, non seulement par l'AFD mais également par le plus grand nombre de bailleurs de fonds et de pays récipiendaires. Car seule une action concertée de l'ensemble des acteurs bailleurs de fonds et pays partenaires permettra de limiter la pratique du dumping social et environnemental sur les fonds d'aide au développement.
|
16) Plaider pour une clause de réciprocité sur l'ouverture des marchés financés par l'APD afin de pousser les pays émergents à délier leurs financements où le cas échéant à exclure leurs entreprises des appels d'offres financés par l'APD. 17) Renforcer les exigences environnementales et sociales dans les dossiers d'appel d'offres pour les marchés financés par la coopération française afin de permettre aux bénéficiaires de ces financements d'éliminer, au stade de la pré-qualification et de l'évaluation des offres, des entreprises ou des propositions qui ne seraient pas conformes techniquement sur le volet responsabilité sociale et environnementale et de sanctionner une entreprise qui ne respecterait pas ses engagements lors de l'exécution de son marché. |
D. SÉCURISER NOS APPROVISIONNEMENTS STRATÉGIQUES TOUT EN GARANTISSANT L'ÉQUITÉ ET LA TRANSPARENCE DES CONTRATS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
La croissance économique des nouvelles puissances, qui va de pair avec celle de la consommation d'énergie ainsi qu'un besoin accru en ressources naturelles et en matières premières stratégiques, va créer des tensions accrues sur les approvisionnements stratégiques en Afrique. Par ailleurs, la surexploitation des ressources naturelles africaines est susceptible de relancer des tensions, inconnues jusqu'à présent à ce degré, pour satisfaire les besoins en énergie, en eau, en nourriture et en matières premières.
Actuellement, faute de production minière sur le territoire métropolitain, les entreprises consommatrices doivent s'approvisionner sur les marchés mondiaux. La croissance rapide et forte de la demande (nouvelles technologies, tendances démographiques, économies émergentes, etc.) fait de l'accès aux matières premières et du contrôle des ressources un enjeu majeur.
Depuis 10 ans, les marchés ont profondément évolué : les pays producteurs ont pris conscience de la richesse que représentaient leurs ressources et cherchent à mieux les gérer, voire à les protéger. Quant aux pays consommateurs, ils ont pris conscience des aléas liés aux approvisionnements en métaux.
C'est aujourd'hui une problématique pour l'Union européenne et la Commission a identifié 14 substances « critiques ». Différents États membres, telle l'Allemagne, ont également engagé une stratégie visant à rendre plus pérennes les approvisionnements de leurs entreprises.
Conscients des difficultés que pouvaient rencontrer les entreprises, les pouvoirs publics, par décret du 24 janvier 2011, ont créé le Comité pour les métaux stratégiques (COMES), qui organise une concertation entre tous les acteurs français : ministères, organismes publics et Fédérations professionnelles représentant l'industrie.
Aujourd'hui, c'est dans le domaine de notre approvisionnement en métaux qu'un effort analogue à celui qui a été effectué en matière énergétique en réponse à la crise de 1973 doit impérativement être réalisé.
Pour cela il importe que le COMES et le SGDSN procèdent à une analyse des intérêts de la France en Afrique en matière d'approvisionnement et des évolutions en cours.
La fin du monopole français sur l'uranium du Niger et la percée remarquable de la Chine dans ce pays doivent-ils être perçus comme un avertissement ? AREVA a dû fortement hausser ses prix d'enlèvement, pour relever le défi chinois. L'amont de la filière nucléaire française est fragilisé et l'arrivée de concurrents émergents vient s'ajouter aux troubles politiques de la zone sahélienne.
A l'inverse, les découvertes récentes dans l'océan Indien et notamment dans le canal du Mozambique sont à suivre avec d'autant plus d'attention que nos Zones économiques exclusives se trouvent aux bordures de zones côtières concernées. L'Institut d'études géologiques des États-Unis (US Geological Survey) estime que les zones côtières de l'océan Indien pourraient renfermer plus de 7,1 billions de m 3 (250 billions de pieds cubes) de gaz et 14,5 milliards de barils de pétrole. Pour remettre ce chiffre dans son contexte, l'estimation dépasse les réserves connues des Émirats Arabes Unis et du Venezuela.
Il s'agit d'un bouleversement considérable dont il convient de mesurer les conséquences.
La France doit faire face aux enjeux et aux risques de perturbations de ses approvisionnements en matières premières sur l'ensemble du continent pour anticiper les tensions et les opportunités à venir.
Mais, dans le même temps, la France doit se montrer exemplaire en garantissant l'équité et la transparence des contrats miniers et énergétiques. Comme nous l'avons souligné dans le chapitre premier de ce rapport, une mauvaise gouvernance des contrats miniers et énergétiques a contribué à des pertes de revenus considérables au détriment des populations.
De nombreux gouvernements africains montrent l'exemple. Des dirigeants politiques réformateurs, soutenus par la société civile, ont utilisé l'Initiative de transparence des industries extractives (ITIE) pour renforcer les normes de divulgation. La Sierra Leone publie désormais les contrats et les concessions en ligne. En février 2012, la Guinée a publié sur le site Internet du gouvernement plus de 60 documents contractuels concernant 18 projets d'exploitation minière, avec un résumé interactif des termes des contrats permettant aux non-initiés de retrouver les sections les plus importantes et de comprendre les obligations des entreprises et du gouvernement. La loi ghanéenne de 2011 sur la gestion des revenus pétroliers surpasse les normes de l'ITIE en matière de déclaration des comptes. Toutes ces initiatives sont le reflet de l'élan politique en faveur d'une transparence et d'une responsabilité accrues en Afrique.
La France doit soutenir les efforts de l'Afrique dans ce sens.
Aux États-Unis, en vertu de la loi Dodd-Frank, la Securities and Exchange Commission exigera des sociétés impliquées dans les industries extractives qu'elles divulguent publiquement tous les paiements effectués pour chaque projet. Malheureusement, de nombreuses entreprises ont engagé des poursuites devant la justice dans le but de contrer les dispositions de la loi Dodd-Frank. D'autres se sont lancées dans une guerre d'usure visant à diluer les exigences de déclaration obligatoire. Les opposants ne sont pas tous issus de l'industrie. Le gouvernement canadien s'est opposé à la mise en place de normes de divulgation obligatoires. Ce refus a son importance, car les sociétés cotées à la Bourse de Toronto contrôlent pour plus de 109 milliards de dollars US d'actifs miniers internationaux et étaient, en 2011, impliquées dans plus de 330 projets en Afrique.
Plusieurs gouvernements africains sont en train de mettre en place des régimes fiscaux plus efficaces et plus équilibrés. Les taux de redevance ont été augmentés, afin de refléter l'escalade des cours mondiaux. La Banque africaine de développement a proposé d'indexer les redevances sur les cours internationaux, ce qui permettrait d'améliorer la stabilité et la prévisibilité au sein de l'administration fiscale. Le FMI a demandé aux gouvernements d'éviter de négocier des contrats d'imposition au cas par cas pour chaque investisseur, et plusieurs pays ont renégocié avec succès des accords qui étaient déséquilibrés.
L'évasion fiscale est un problème mondial facilité par un mélange entre les pratiques commerciales internes aux entreprises, le recours massif des investisseurs étrangers aux centres offshore, aux sociétés fictives et aux paradis fiscaux, et les normes de divulgation laxistes d'un certain nombre de centres financiers et de négoce de matières premières, notamment la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
En dépit des mouvements encourageants vers davantage de dialogue international sur la fiscalité, ce qui fait défaut, c'est une action internationale décisive: Dans ce domaine, le G8 et le G20 peuvent faire la différence.
La France, dans le cadre de ses engagements en faveur de la gouvernance démocratique et financière, compte parmi les contributeurs les plus importants de l'Initiative, au fonds fiduciaire de l'ITIE.
Le ministère des affaires étrangères s'est particulièrement engagé au Niger en 2009 et soutient plusieurs projets locaux au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, en République de Centrafrique, en Guinée, en Mauritanie, au Niger et au Tchad depuis 2010. Ces projets sont portés essentiellement par des organisations de la société civile locale et destinés à sensibiliser les citoyens sur l'importance d'une bonne utilisation des revenus issus de l'extraction.
La France y joue un rôle particulier puisque 14 pays sont francophones et 17 sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). L'ITIE compte aujourd'hui 33 pays membres, dont 21 pays africains.
La France poursuit dans cette voie en favorisant l'adoption par l'Union européenne d'une législation imposant aux entreprises du secteur extractif de publier ce qu'elles paient aux pays où elles sont installées.
La Commission européenne a décidé de saisir le renouvellement des directives comptables (78/660/CEE et 83/349/CEE) pour introduire une législation comparable à la loi dite Dodd-Frank adoptée aux Etats-Unis.
La proposition de la Commission inclut toute entreprise pétrolière, gazière et minière cotée à une bourse de l'Union européenne. Allant au-delà de la loi Dodd-Frank, la Commission inclut également les entreprises forestières, ce qui est très important pour nombre de pays africains. Les forêts représentent en moyenne 6 % du PIB de l'Afrique subsaharienne, soit trois fois plus que la moyenne mondiale. L'économie de dix-huit pays africains dépend à 10 % ou plus de la ressource forestière. De plus, la proposition inclut également les grandes entreprises non cotées.
En février 2013, la loi bancaire française, puis la loi bancaire européenne (dite directive CRD4) obligeaient les banques à rendre publics à partir de 2014 leurs chiffres d'affaires, leurs bénéfices, et les impôts qu'elles paient dans chacun des pays où elles sont présentes.
Début avril de la même année, le Parlement européen et les Etats membres s'accordaient sur une nouvelle directive de transparence qui oblige les entreprises minières, pétrolières et gazières, ainsi que celles qui exploitent les forêts, à rendre public l'ensemble de leurs flux financiers avec les Etats. Cette disposition qui lutte à la fois contre l'évasion fiscale et contre la corruption entrera en vigueur au plus tard en 2015. Enfin, le Conseil européen a soutenu la proposition française d'étendre la transparence à peine votée pour les banques, à l'ensemble des secteurs de l'économie.
La France doit poursuivre son effort de conviction pour que ces dispositifs soient pleinement adoptés et renforcer sa coopération pour que soient Intégrées les dispositions renforcées de l'ITIE dans les législations nationales et les directives régionales des pays africains.
Le groupe de travail encourage la France à :
- engager le processus formel d'adhésion à l'initiative sur la transparence dans les industries extractives (ITIE), conformément à l'annonce du Président de la République lors du sommet du G8 de Lough Erne, avec pour objectif d'adhérer à l'occasion de la prochaine conférence internationale de l'ITIE ;
- engager la transposition par la France des dispositions des directives comptables concernant certaines obligation pour les entreprises extractives européennes de publier pays par pays et projet par projet les revenus tirés de l'exploitation des ressources extractives versés à des Etats ;
- soutenir les initiatives des banques multilatérales de développement dans le domaine des industries extractives.
- faire en sorte que les entreprises françaises du secteur, notamment celles dans lesquelles l'État français a une participation -telles que AREVA ou TOTAL- soient exemplaires en matière de transparence et de responsabilité environnementale et sociale. Des efforts dans ce domaine ont été effectués, comme en témoigne la mobilisation du CIAN sur la rédaction d'un guide pratique : « responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises en Afrique ». Mais il faut aller plus loin afin de faire la démonstration que les entreprises françaises sont des partenaires fiables et respectueux des intérêts de long terme des pays africains.
L'effort doit être poursuivi au niveau mondial pour créer un régime multilatéral pour la transparence fiscale : le G8 doit établir la structure requise pour qu'un régime multilatéral mette un terme à l'évasion fiscale. Les sociétés enregistrées dans les pays du G8 devraient être obligées de publier la liste complète de leurs filiales et les informations concernant leurs revenus à l'échelle internationale, leurs profits et les impôts payés dans les différentes juridictions. Les autorités fiscales, y compris les autorités fiscales africaines, doivent échanger plus systématiquement leurs informations.
|
18) Faire établir par le COMES et le SGDSN une étude des intérêts de la France en Afrique en matière d'approvisionnement stratégique et prendre en compte les conclusions de cette étude dans la définition de notre stratégie africaine. 19) Engager le processus formel d'adhésion à l'initiative sur la transparence dans les industries extractives (ITIE). 20) Engager la transposition par la France des dispositions des directives comptables concernant certaines obligations pour les entreprises extractives européennes de publier pays par pays et projet par projet les revenus tirés de l'exploitation des ressources extractives versés à des Etats. 21) Soutenir les initiatives et les programmes des banques multilatérales de développement dans le domaine des industries extractives. |
E. PROMOUVOIR L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE LA ZONE FRANC
Les performances économiques des pays africains de la Zone franc, en moyenne autrefois plutôt meilleures que celles des autres pays africains, ne le sont plus.
Notre analyse nous conduit à penser qu'au moment où l'Afrique subsaharienne semble avoir trouvé le chemin d'une croissance rapide, l'avantage que donne l'intégration régionale aux pays des deux Unions de la Zone doit être mieux exploité.
Aujourd'hui, le ralentissement de l'activité économique dans les pays développés, notamment en Europe, souligne l'urgence du développement des échanges interafricains et le besoin de solidarité entre Etats africains. La croissance démographique sans précédent rend crucial le développement de la production agricole en Zone franc, ainsi que la création d'emplois ruraux et urbains pour les jeunes.
Un renforcement de l'intégration régionale peut être un moyen essentiel de répondre à ces défis.
Dans ce contexte, les pays africains de la Zone franc disposent de l'atout considérable que constitue une longue expérience de coopération régionale mise en oeuvre au travers d'unions dont l'originalité historique est d'avoir été des unions monétaires avant d'être des unions économiques.
Dans le domaine monétaire et financier, de nombreux instruments de l'intégration sont déjà en place, mais des progrès semblent souhaitables en matière d'intégration financière et de supervision macroéconomiques. Mais l'intégration commerciale en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale repose pour l'essentiel sur le bon fonctionnement des unions douanières existantes et sur l'harmonisation fiscale qui lui est associée, autant de domaines dans lesquels les Etats comme les organisations régionales manquent de compétences comme de soutien politique.
Comme l'a souligné M. Patrick Guillaumont, président de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), responsable d'un récent rapport d'évaluation des gains attendus de l'intégration économique régionale dans les pays africains de la Zone franc : l'approfondissement du marché commun et les politiques sectorielles sont enfin des domaines où des progrès importants pourraient être réalisés. Il s'agit, d'une part, de mettre en place des instruments régionaux dans les domaines où les économies d'échelle sont les plus fortes (politiques agricoles, sécurité alimentaire, connexions des réseaux électriques, corridors routiers, câblage fibre optique, centres d'excellence régionaux d'enseignement et de recherche, collaboration pour les approvisionnements en médicaments) et, d'autre part, d'appliquer les décisions existantes (libre circulation des personnes, droit d'établissement, non-utilisation des interdictions d'exportations intracommunautaires sur les produits agricoles).
La France a, à l'égard de cette zone, une responsabilité particulière et des intérêts nombreux.
Or les évaluations de la coopération française dans ces différents domaines et, notamment, l'évaluation pilotée conjointement par la DG Trésor et la DGM (ministère des affaires étrangères) en 2012, sur les appuis français à l'intégration régionale au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ( UEMOA ) sur la période 2002-2009, soulignent la faiblesse des moyens de financement pour soutenir les politiques et les programmes de l'UEMOA compte tenu des besoins considérables du Programme Économique Régional (PER).
Il faut aujourd'hui renforcer les appuis français aux objectifs d'intégration régionale et assurer une meilleure articulation de l'aide française au niveau régional avec celle déployée au niveau des pays membres. La France ne peut pas tout mais, notamment en matière d'expertise technique, elle doit renforcer son soutien.
En matière de financement, il convient de rechercher un effet de levier plus élevé en mobilisant davantage la Banque Ouest Africaine de Développement et une meilleure coordination avec les autres bailleurs intervenant au niveau régional, notamment l'Union européenne, dans le cadre des négociations sur les APE et la Banque africaine de développement.
L'Union européenne de par son expérience en matière d'intégration économique et monétaire doit consacrer un effort supplémentaire à la question de l'intégration de la Zone Franc en veillant à renforcer les administrations en charge de ces questions et à promouvoir la levée de ressources propres aux organisations régionales.
Il est enfin paradoxal que les négociations actuelles sur les APE conduisent à mettre en péril certains accords douaniers. En effet, comme il a été souligné au chapitre 3, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore le Cameroun pourraient avoir à choisir entre ratifier leur accord de partenariat économique, conclu en 2007, et le mettre en oeuvre de façon bilatérale (mettant ainsi en danger les unions douanières négociées ou en négociation dans leurs régions), ou, de façon alternative, renoncer, au nom de l'intégration régionale, à un APE et donc à certaines préférences de I'UE.
La France doit pousser la Commission européenne à faire preuve de plus de souplesse pour avancer dans des négociations où les demandes africaines sont peu prises en compte.
|
22) Renforcer notre coopération en faveur du renforcement de capacité au profit des programmes de l'UEMOA et notamment du Programme Économique Régional (PER). 23) Veiller à ce que la conclusion des Accord de partenariat économique (APE) ne nuise pas à l'intégration régionale, inviter la Commission européenne à faire preuve de plus de souplesse dans les négociations d'APE régionaux afin de déboucher sur un aboutissement positif et un renforcement de la coopération européenne en faveur de l'intégration. |
III. DONNER UN SENS AFRICAIN À LA PRÉSENCE MILITAIRE FRANÇAISE
La certitude que la France jouera le rôle de pourvoyeur de sécurité en dernier ressort reste ancrée dans l'esprit des gouvernants africains, notamment francophones. Cela déresponsabilise certains et donne lieu à une lecture conspirationniste et « anti-impérialiste » chez d'autres (Afrique du Sud, Angola, Rwanda...).
La réponse à ces soupçons doit être pour la France l'occasion de clarifier les motifs de sa présence militaire et d'énoncer les critères présidant à ses interventions armées sur le sol africain. C'est une condition nécessaire pour sortir de l'engrenage des « appels d'empire », parfois satisfaits, parfois rejetés, sans que les déterminants du choix soient toujours lisibles.
Il convient de rappeler solennellement que cette présence correspond à un intérêt commun à la France et aux pays africains pour la stabilité et la sécurité du continent. La France y assume ses responsabilité de membre permanent du Conseil de sécurité et y défend ses intérêts et notamment la protection de ses ressortissants. Elle se fixe pour objectif l'appui aux forces africaines de sécurité et le développement de la régionalisation qui repose sur les écoles nationales à vocation régionale (ENVR) et sur les forces française en présence et n'intervient que dans le cadre de la légalité internationale, en coordination avec les organisations régionales, continentales et avec l'ONU.
Dans la perspective du sommet de l'Elysée, l'analyse du groupe de travail conduit à préconiser, en cohérence avec ces objectifs, le maintien des points d'appui militaires français en Afrique et une réforme d'ampleur de ses modalités.
A. S'INSCRIRE DANS LE SENS DE LA CONSTRUCTION D'UNE ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ AFRICAINE OPÉRATIONNELLE
Le constat du groupe de travail est que le dispositif actuel avec ses huit points d'appui Abidjan, Dakar, la zone (Mali, Niger, Burkina Faso) Libreville, N'Djamena, Bangui, Djibouti, et l'île de la Réunion permet un maillage et une réactivité au service de nos intérêts et de la sécurité du continent.
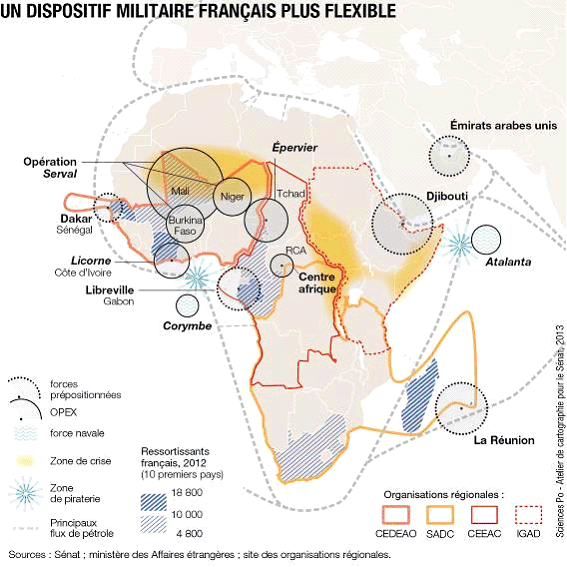
Contrairement à l'analyse du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, compte tenu des menaces et des demandes des pays partenaires, ces points d'appui doivent être conservés sauf avis contraire des pays hôtes.
Huit points d'appui : Abidjan, Dakar, la zone (Mali, Niger, Burkina Faso) Libreville, Ndjamena, Bangui, Djibouti, et l'île de la Réunion
Ces bases doivent procéder d'un accord officiel discuté au Parlement. Les orientations prises depuis 2008 sur les accords de défense : transparence, absence de clauses secrètes, publication et approbation par les parlements de chaque État partie doivent bien entendu être poursuivies. Le Parlement a été saisi des accords avec Djibouti et la Côte d'Ivoire. Il conviendra également de définir les bases légales de notre présence au Mali, au Niger et au Burkina Faso si nous maintenons dans ces pays des troupes dans la durée.
L'ensemble des accords de défense doit être adopté par le Parlement
Par ailleurs, si depuis 2007, notre dispositif est censé s'adosser à l'architecture de sécurité, la portée politique de cet adossement pour les opinions publiques françaises et africaines doit être mieux mise en valeur.
Pour cela l'ensemble du dispositif devrait être articulé autour de quatre pôles régionaux de coopération au Sénégal, au Gabon, à Djibouti et à la Réunion. Ces pôles de coopération en lien avec les écoles nationales à vocation régionale doivent avoir comme objectif principal la formation des cadres des armées nationales, et la mise sur pied de systèmes de sécurité collective.
Leur nom, leur mission et leur effectif doivent être ajustés à cette mission qu'ils rempliront parallèlement aux missions de coopération bilatérale.
À l'occasion du sommet de l'Elysée, la France doit donc mettre en valeur les avancées enregistrées en matière de sécurité collective et s'engager à continuer à les soutenir à travers des implantations qui doivent être entendues comme une contribution à la sécurité collective du continent.
La « honte » qu'a représentée pour beaucoup de responsables l'incapacité ouest-africaine à réagir adéquatement à l'offensive islamiste au Mali a constitué un électrochoc qu'il conviendra d'exploiter positivement, en vue d'une prise de conscience de la nécessité pour les Etats africains d'améliorer leurs capacités militaires de façon autonome mais cohérente.
Le sommet de l'Elysée pourrait être l'occasion, pour l'Union africaine et ses partenaires, de se focaliser sur des objectifs intermédiaires moins ambitieux que les Forces Africaines en Attente et le développement des capacités nationales dans un cadre coordonné régionalement.
Européaniser pour mieux rester
Dans ce cadre, les pôles de coopération français devraient être ouverts à des participations de partenaires européens à l'instar de ce qui a été fait pour les ENVR.
Nous avons intérêt à européaniser notre dispositif aussi bien pour des raisons de coûts que pour des raisons politiques. Cette ouverture doit avoir pour contrepartie une participation effective aux efforts de coopération et à la possibilité d'une intervention et ne pas se réduire à des cellules de veille des activités françaises.
Les pôles régionaux de coopérations avec les organisations régionales
|
Le Pôle régional de coopération avec la CEDEAO basé au Sénégal |
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo |
|
Le Pôle régional de coopération avec la CEEAC basé au Gabon |
Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) : Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Equatoriale, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Angola |
|
Le Pôle régional de coopération avec l'IGAD basé à Djibouti |
Intergovernmental authority for development IGAD - EASBRIG : Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda |
|
Forces armées de la zone sud de l'océan Indien, pôle régional de coopération avec la SADC |
Southern African Development Community (SADC) : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe |
Ces pôles de coopération devraient être complétés par un pôle opérationnel consacré au Sahel avec des points d'appui au Mali, au Tchad, à Abidjan, au Niger et au Burkina Faso.
La situation décrite au Sahel justifie que la France maintienne, au service de la sécurité de ses partenaires africains de la région et en liaison avec l'effort de coopération civil français et européen, un collier de perles de points d'appui pour lutter contre les forces djihadistes et les groupes armées qui se cachent dans la région et notamment au sud de la Libye.
Ce dispositif doit, en liaison avec l'opération EUTM et les forces de la MINUSMA sous commandement de l'ONU, pouvoir participer à des actions de formation et, le cas échéant, à la constitution souhaitée d'un dispositif régional de sécurité qui associerait les pays du Sahel.
Un collier de perles en soutien d'un dispositif régional au Sahel est nécessaire pour faire face à la situation
La France doit mettre tout son poids pour qu'un tel dispositif essentiel à la sécurisation de la région sur le long terme voie le jour.
Enfin, la situation en Centrafrique justifie que la France puisse contribuer à appuyer plus largement les forces d'une Misca (Mission internationale de soutien à la Centrafrique) renforcée et éventuellement mise sous l'autorité de l'ONU pour asseoir son financement et augmenter ses effectifs qui sont aujourd'hui nettement insuffisants pour rétablir l'ordre.
La montée en puissance d'un dispositif en RCA sous contrainte budgétaire pourrait être prélevée dans les deux réservoirs de forces existants que sont Djibouti et Libreville. Mais la répartition actuelle des points d'appui français ne permet pas de comprendre en quoi notre dispositif est aujourd'hui arrimé à l'architecture de défense africaine.
Les quatre pôles de présence militaire française qui pourraient être dédiés à la coopération avec les organisations régionales, Libreville avec la brigade centre de la CEEAC, Dakar avec la brigade de l'ouest de la CEDEAO, la Réunion avec la brigade sud de la SADC et Djibouti face l'IGAD, ont peu de visibilité politique et ne permettent pas d'afficher clairement la volonté française de participer à l'architecture de sécurité africaine.
B. RE STRUCTURER UN DISPOSITIF RÉNOVÉ, SOUPLE ET ADAPTÉ AUX NOUVELLES MENACES
Si nos points d'appui doivent être maintenus, en revanche, le format et la définition de ces points d'appui doivent évoluer.
La distinction entre les OPEX et les forces prépositionnées n'a pas de sens
La distinction entre les OPEX et les forces prépositionnées doit être revue. Les opérations Epervier et Licorne ont un caractère permanent qui rend inadaptées l'appellation et les modalités de financement par la dotation OPEX. Cette distinction introduit des rigidités dans les modalités de financement des troupes qui passent d'un statut à un autre et n'a aucune pertinence opérationnelle.
Les points d'appui doivent désormais avoir en commun pour missions, la coopération structurelle et opérationnelle aussi bien en bilatéral qu'au niveau régional ainsi que la possibilité d'une projection en cas de crise.
La dualité de notre coopération, qui assure un continuum indispensable entre projets fondamentaux de long terme (coopération structurelle) et actions d'entrainement en vue de l'emploi tactique immédiat (coopération opérationnelle), doit être renforcée.
Toutefois, la diminution du coût du dispositif doit passer par une diminution des effectifs des bases dont la vocation principale est la formation des cadres des armées nationales et la mise sur pied d'un système de sécurité collective.
L'expérience de Dakar montre que le service rendu en matière de coopération avec 300 hommes peut être équivalent à celui fourni avec des effectifs précédents qui étaient trois fois plus nombreux.
L'application de la loi de programmation qui prévoit une diminution de 1200 hommes des forces prépositionnées et un volume d'opérations extérieures de 450 millions d'euros suppose des choix.
S'il convient de conserver des réservoirs de forces en cas de crise, la diminution des effectifs des bases de Djibouti et de Libreville est envisageable à partir du moment où l'ensemble des bases fonctionnent en réseau.
C'est dans cette perspective que la préconisation du Livre blanc d'un dispositif souple et modulable prend tout son sens.
« Cette logique de réduction des coûts et d'économie des moyens nous oblige à concentrer nos efforts en termes géographique et thématique »
Cette logique de réduction des coûts et d'économie des moyens nous oblige à concentrer nos efforts en termes géographique et thématique. En 2014, tout en continuant d'appuyer une vision continentale de la sécurité en Afrique, notre effort doit porter sur l'Afrique occidentale et centrale (CEDEAO, CEEAC) et sur les pays francophones.
Avec ces pays notre coopération doit permettre de renforcer les capacités de commandement des états-majors régionaux et de développer davantage les liens avec nos forces déployées en Afrique dans ce domaine. De ce point de vue, il apparaît utile de reprogrammer épisodiquement des exercices franco-africains au sein de la CEDEAO ou de la CEEAC.
Cette priorités sur l'Afrique de l'Ouest impose d'assumer un certain partage des tâches avec nos partenaires occidentaux et notamment anglo-saxons qui sont les partenaires naturels de l'Afrique de l'Est.
|
24) Maintenir huit points d'appui militaire en Afrique : Abidjan, Dakar, la zone (Mali, Niger, Burkina Faso), Libreville, Ndjamena, Bangui, Djibouti, et l'île de la Réunion. 25) Dédier quatre points d'appui militaire à la coopération avec les quatre organisations régionales, à Libreville avec la brigade centre de la CEEAC, Dakar avec la brigade de l'ouest de la CEDEAO, la Réunion avec la brigade sud de la SADC et Djibouti avec l'IGAD, afin d'afficher clairement la volonté française de participer à l'architecture de sécurité africaine. 26) Ouvrir les pôles de coopération français à des participations de partenaires européens et internationaux à l'instar de ce qui a été fait pour les ENVR. 27) Dépasser la distinction entre OPEX et forces prépositionnées au profit d'un dispositif global où les effectifs de chaque base évoluent en fonction des besoins avec un repositionnement autour du Sahel et dans les pays accueillant une forte présence de ressortissants français. 28) Doter chaque point d'appui de moyens de coopération structurelle et opérationnelle aussi bien en bilatéral qu'au niveau régional ainsi que la possibilité d'une projection en cas de crise. |
C. REDRESSER LES MOYENS DE LA COOPÉRATION STRUCTURELLE AU SERVICE DES FORCES AFRICAINES DE DEMAIN
L'analyse du groupe de travail le conduit à préconiser un redressement du budget de la coopération structurelle. Aujourd'hui imputés sur le seul budget du ministère des affaires étrangères, ces crédits à budget constant doivent faire l'objet d'une priorisation et pourraient bénéficier d'une réallocation des moyens de la part du ministère de la défense afin de rétablir la cohérence de notre action.
De même, les actions menées en direction de la sécurité civile sur le modèle de l'ENVR de Ouagadougou doivent pouvoir bénéficier d'un soutien financier accru de la part du ministère de l'intérieur.
Notre coopération en matière de sécurité sera d'autant plus pertinente qu'elle répondra aux préoccupations des responsables africains en matière de maîtrise du territoire et des frontières, de lutte contre le terrorisme ou de réponse aux catastrophes naturelles. Cela suppose une approche globale et une implication plus forte du ministère de l'intérieur avec la gendarmerie, la sécurité civile et la police et du ministère des finances avec les douanes.
Enfin, la voie d'un recours croissant aux financements européens et multilatéraux voire à des partenariats avec des pays qui partagent notre vision de l'Afrique, comme le Canada, doit être poursuivie.
Le bilan de notre coopération passée conduit en outre à renforcer nos exigences à l'égard de nos partenaires africains et, quand c'est possible, à subordonner notre aide à des progrès tangibles et mesurables.
Il serait souhaitable d'inciter nos partenaires africains à bâtir des outils moins ambitieux et plus soutenables et de promouvoir la réduction des forces et la contractualisation dans les modèles d'armée.
Pour cela, il convient de promouvoir l'accompagnement de réflexions type « Livre blanc » afin de définir des modèles d'armée adaptés aux besoins de chaque pays.
Plus que jamais il convient de développer les capacités locales à former les cadres africains, inciter les gouvernements africains à investir dans des écoles africaines de formation et soutenir les pays africains dans leur volonté de participer aux Opérations de maintien de la Paix qui sont l'occasion de mettre aux standards les troupes africaines et de financer une partie de leur équipements.
|
29) Renforcer les crédits de la DCSD et développer les ENVR avec des financements croisés de l'ensemble des ministères concernés et un recours croissant aux financements européens, multilatéraux, voire à des partenariats avec des pays qui partagent notre vision de l'Afrique comme le Canada, ainsi qu'à des financements des pays africains. |
IV. ACCOMPAGNER L'INTÉGRATION RÉGIONALE ET LE PLURALISME
A. RENFORCER NOTRE COOPÉRATION AVEC L'UNION AFRICAINE
Si la France est l'un des 47 Etats ou organisations bénéficiant du statut d'observateur auprès de l'Union africaine, nous sommes perçus par l'organisation comme un partenaire privilégié et influent, dont les avis sont écoutés et le soutien politique recherché. En raison de notre qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, notre présence et notre coopération avec cette institution demeurent très en deçà des attentes de nos partenaires africains et très limitées par rapport aux autres nations occidentales.
Le contexte actuel, marqué par la densité du dialogue politique de haut niveau et le soutien unanime à notre action au Mali, est favorable au renforcement de notre partenariat avec l'Union africaine. Nous devons y répondre au mieux, notamment en mettant en place des moyens de coopération.
La France ne mène actuellement aucun projet spécifiquement dédié à l'UA à l'exception d'un soutien au renforcement de la francophonie dans l'organisation via l'OIF et d'un poste de coopérant de la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) pour le soutien à l'opérationnalisation de la Force africaine en attente.
Cette situation s'explique en partie par le bilan mitigé tiré de notre coopération antérieure avec l'Union Africaine. Notre pays souffre d'une absence de visibilité dans les domaines hors « paix et sécurité » de l'Union africaine alors que le développement de ces activités constitue une priorité de l'institution. L'écart est par ailleurs croissant avec nos principaux partenaires qui ont accru ces dernières années leur coopération avec l'Union Africaine.
A titre d'exemple, les Etats-Unis ont signé en 2010 un accord d'assistance pluriannuel (2010-2012) d'un montant de 5,8 millions de dollars. Le Royaume-Uni consacre un budget annuel de 3,3 millions de livres à sa coopération avec l'Union africaine. L'Allemagne fournit également un effort conséquent, le budget de la coopération de la GIZ avec l'Union Africaine s'élevant à environ 14 millions d'euros en 2012 (35 employés internationaux. auxquels s'ajoutent 55 employés locaux). Ce budget n'inclut pas les actions de coopération menées par Banque de développement allemande, la KFW, ni le budget consacré à la construction du nouveau bâtiment paix et sécurité de la Commission de l'UA (environ 26 millions d'euros entre 2008 et 2013).
|
30) Renforcer les moyens de suivi et de coopération avec l'Union africaine en redéployant des effectifs vers l'ambassade d'Addis Abeba et en consacrant de l'assistance technique ou des projets bien ciblés de renforcement de capacité. |
B. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT EN FAVEUR DU PLURALISME
La multiplication des élections jugées « crédibles » en Afrique ne doit pas faire illusion : des scrutins pacifiques ne signifient pas l'ancrage de la démocratie, s'ils ne sont précédés et suivis d'une véritable vie démocratique, ce qui passe par l'existence de contre-pouvoirs. Le cas du Mali est emblématique : ce pays longtemps présenté comme un modèle était en fait miné par les prébendes, les trafics et des scrutins discutables. D'autres Etats ouest-africains basés sur le même prototype de « démocratie sans démocrates » ou de « démocratie sans alternance » risquent le même effondrement.
Le discours de La Baule (juin 1990) a suscité en son temps de grands espoirs sur le continent. Il a indéniablement marqué les esprits en laissant penser que la France, patrie des droits de l'Homme, s'engageait résolument en faveur du pluralisme et de la démocratie au Sud du Sahara.
Mais, 23 ans après La Baule, le constat est cruel. Non seulement la France n'a pas réussi à promouvoir les processus de démocratisation en Afrique, mais, à tort ou à raison, elle est associée, dans les opinions publiques francophones et anglophones, au maintien des régimes autoritaires corrompus. Le non-respect de nos propres conditionnalités, le soutien apporté à des gouvernements bafouant les libertés publiques, les interventions militaires destinées à sauver de la banqueroute un régime ami, l'accréditation des successions familiales, la diplomatie du « double standard » ont terni notre image sur le continent et affecté notre crédibilité auprès des jeunes générations qui aspirent au changement.
Il est vrai que la promotion d'un modèle institutionnel démocratique uniforme a souvent été menée de façon inadaptée, privilégiant le formalisme, trop institutionnel et stato-centré et ignorant les spécificités des sociétés africaines.
Dans la réalité, en Afrique, les régimes et les instruments du jeu démocratique adoptés par les Constitutions n'ont pas fait disparaître les structures intermédiaires et les systèmes d'allégeance traditionnels entre l'État et les individus.
Le pervertissement de l'élection et du modèle de démocratie fondé sur l'opposition majorité/minorité en constitue une preuve éclatante. Dans de nombreux pays, la règle démocratique a entraîné la domination de la communauté ethnique majoritaire au détriment des autres. Le mimétisme et la survivance des pratiques et liens sociaux traditionnels ont généré la coexistence de systèmes différenciés, s'hybridant, s'instrumentalisant, se concurrençant ou entrant en conflit, mais que ni la domination ni la coercition étatique ne réussirent à unir dans une norme partagée et acceptée par tous.
Sans doute l'Afrique doit-elle, selon l'expression d'Ousman Sy, ancien ministre malien et promoteur du Centre d'expertises politiques et institutionnelles en Afrique (CEPIA), « tisser la démocratie sur sa propre natte », inventer sa façon de faire vivre la démocratie aussi bien au niveau local que national et régional.
Mais notre analyse conduit à considérer la question du respect du pluralisme comme essentielle à la constitution d'une vie politique pacifique dans des sociétés très hétérogènes, dont la formation en tant qu'entité nationale est encore souvent en gestation.
L'affirmation du pluralisme comme norme juridique et politique est au coeur de la constitution des sociétés politiques africaines modernes et du mode de représentation des populations. Elle suppose la défense des droits de l'homme et des minorités, mais elle autorise également de penser la cohabitation de formes de légitimité diverses qui associe des modes de représentations traditionnelles, par exemple dans des secondes chambres ou au niveau des villages, avec des modes plus démocratiques de désignation.
Dans ce contexte, le groupe de travail s'est interrogé sur la façon dont la France dialogue avec les différents régimes politiques, et accompagne les changements vers l'émergence de régimes ayant l'appui de la majorité de leur population, sans opprimer les minorités.
Il lui semble que la France gagnerait à défendre de façon plus ostensible la notion de pluralisme, à faire toute sa place à la question pourtant centrale du renforcement des contrepouvoirs et à renforcer les crédits qu'elle consacre à la gouvernance démocratique, qui n'ont cessé de diminuer pour devenir presque dérisoires.
Il ne peut évidemment pas y avoir de « bonne gouvernance démocratique » sans des mécanismes politiques et sociaux de mise en question des pouvoirs établis, sans une opposition politique crédible, des citoyens mobilisés et des organisations sociales robustes.
C'est ainsi et non par le biais des conditionnalités de l'aide internationale que la responsabilité politique peut progresser. Depuis une vingtaine d'années, en dépit de l'échec des transitions, cette culture politique de la responsabilité citoyenne a considérablement avancé dans les représentations populaires du pouvoir.
Le nouveau contexte des « printemps arabes » repose avec une grande acuité la question démocratique au Sud du Sahara.
La plupart des conflits que traverse le continent sont des crises de la citoyenneté, portées par de nouvelles générations qui réclament une reconnaissance de leur place dans l'espace public. La plupart des mobilisations sociales, parfois violentes, qui secouent les pays ont à voir avec cette question centrale de la revendication des droits. C'est ainsi que peut s'interpréter la percée de l'islam radical dans certains pays du Sahel. Et c'est donc ainsi qu'il faut y répondre.
La France doit reprendre la tête d'un nouveau discours sur la citoyenneté et le pluralisme en Afrique en plaçant au centre de ses programmes d'aide à la gouvernance la question centrale de la citoyenneté, du pluralisme, de la dignité et de la reconnaissance des droits.
Il faut encourager le processus d'affirmation de la vigilance citoyenne en soutenant plus fermement et directement le renforcement des contre-pouvoirs. La France, comme les autres bailleurs, a depuis longtemps des programmes d'appui aux médias, aux parlements, aux organisations paysannes et autres structures dites de la « société civile ».
Mais, d'une part, les financements destinés à ces programmes sont ridiculement faibles au regard des sommes engagées pour soutenir les institutions de l'Etat ; d'autre part, ces aides restent prisonnières d'un véritable tabou : à savoir que l'on ne soutient pas les oppositions politiques en tant que telles, notamment les partis politiques ou les syndicats et les organisations de droits de l'homme qui, dans certains pays, tiennent lieu d'opposition.
Il convient de lever ce tabou politique en aidant par le biais de fondations ad hoc, sur le modèle allemand ou américain, par exemple, à la structuration de véritables systèmes partisans qui sont, qu'on le veuille ou non, des conditions nécessaires à la consolidation du pluralisme.
|
31) Intégrer dans les discours français sur l'avenir de l'Afrique, un discours renouvelé sur la notion de pluralisme et de contre-pouvoirs. 32) Aider à la constitution de fondations en faveur de la vigilance citoyenne, des contre-pouvoirs, des médias, des parlements, et de la « société civile ». |
C. DÉVELOPPER LE DIALOGUE ENTRE LES SOCIÉTÉS CIVILES
Si la France a longtemps peiné à concevoir sa politique de coopération autrement qu'au niveau interétatique, la reconnaissance de la contribution des ONG à l'efficacité de l'aide et au dialogue entre les peuples progresse.
Aujourd'hui la France reste cependant le dernier des Etats membres du CAD en part d'APD transitant par les ONG, avec 1,5 %, alors que la moyenne OCDE est de 13 %.
Le Président de la République François Hollande s'était engagé à doubler le montant de l'aide qui transite par les ONG sur cinq ans.
Les ONG sont en effet des acteurs assurant une véritable complémentarité par rapport aux actions mises en oeuvre dans le cadre de la coopération publique.
Une particularité essentielle des ONG est de s'appuyer sur des démarches participatives et partenariales dans leurs actions de renforcement des sociétés civiles du Sud. Les ONG agissent, en effet, le plus souvent, avec des partenaires locaux (ONG des pays du Sud, organisations sociales locales).
Les premiers critères de qualité de l'action des ONG sont ainsi la qualité et la pérennité du partenariat et leur capacité à contribuer au renforcement de la responsabilité et de l'efficacité de leurs partenaires. Leurs atouts résident également dans la mise en oeuvre d'une coopération de proximité, dans leur rapidité d'intervention, et dans leur capacité d'innovation qui leur permet de faire évoluer rapidement leurs interventions et de les adapter aux contextes changeants.
Nous souhaitons en conséquence que les engagements pris à l'égard des ONG soient tenus, car il importe, pour l'efficacité même de notre politique, de renforcer les opérateurs associatifs français qui mènent sur le terrain des actions souvent remarquables.
Sans doute cela exige-t-il que les ONG françaises renforcent leurs capacités d'action collective. Cette contrepartie aurait, me semble-t-il, dû être davantage formulée. Nos ONG de développement, contrairement aux ONG humanitaires qui sont de grands groupes multinationaux, sont globalement bien plus faibles et fragmentées que les ONG anglo-saxonnes.
Les printemps arabes ont montré qu'il convenait de renforcer les liens des services de coopération avec les sociétés civiles pour ne pas rester dans un dialogue exclusif avec les autorités gouvernementales. Dans ce cadre, les ONG peuvent être des vecteurs essentiels de ce dialogue avec la société civile de nos partenaires en Méditerranée mais également en Afrique.
La France a en effet tout à gagner à un renforcement de la capacité des ONG à mener des actions en concertation avec les ONG locales.
Or les ONG françaises ont, dans l'ensemble, des capacités financières limitées par rapport à leurs homologues anglo-saxonnes, comme l'illustrent les tableaux suivants :
Autre acteur infra-étatique, les collectivités territoriales sont en passe de devenir des acteurs majeurs de la coopération.
La coopération décentralisée est souvent le premier contact des citoyens avec L'Afrique. Elle concerne plus des milliers de collectivités françaises.
Un des membres du groupe de travail, M Jean-Claude Peyronnet a essayé dans le cadre des travaux de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation d'obtenir une évaluation plus juste de l'effort des collectivités dans ce domaine. Une estimation de l'ordre de 115 millions d'euros, soit près du double du montant déclaré, est souvent donnée pour cette aide publique au développement des collectivités territoriales.
Dans le contexte actuel de crise économique et de stagnation des ressources des collectivités territoriales les collectivités françaises sont sollicitées par leurs administrés qui peuvent avoir du mal à comprendre les justifications d'une action internationale dans ces conditions.
C'est pourquoi, il convient de recourir aux financements innovants et d'inciter les collectivités territoriales et leurs groupements à utiliser 1% des ressources affectées aux budgets des services de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et du gaz pour financer des actions de coopération décentralisée comme la possibilité en est ouverte par la loi Oudin-Santini. Une application totale et généralisée de cette loi permettrait de mobiliser 67 millions d'euros par an, contre près de 20 millions d'euros aujourd'hui.
Le dispositif de la loi Oudin-Santini pourrait être élargi à d'autres domaines de la coopération décentralisée. En effet, ce mécanisme permet de mobiliser des sommes importantes pour une contribution annuelle moyenne par habitant modique. C'est pourquoi le groupe de travail propose de l'étendre au traitement des ordures ménagères pour financer des projets dans ce domaine essentiel sur un continent dont la population urbaine va doubler d'ici 2040.
|
33) Renforcer le dialogue avec les sociétés civiles et poursuivre l'engagement de doublement du montant de l'aide qui transite par les ONG. 34) Soutenir les actions de coopération décentralisée en faveur de l'Afrique et étendre le dispositif de la loi Oudin-Santini aux ordures ménagères pour financer des actions de coopération dans ce domaine dans une Afrique en urbanisation rapide. |
V. FAIRE ÉVOLUER NOTRE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Le constat établi par le groupe de travail sur les défis auxquels seront confrontés les pays d'Afrique subsaharienne dans les 10 ans à venir conduit d'abord à valider les priorités actuelles de notre coopération dans les cinq domaines clefs :
- l'accompagnement de la dynamique du secteur privé, principal pourvoyeur d'emplois, permettra de favoriser les investissements de productivité, de faciliter l'accès aux financements de long terme, et de renforcer les capacités commerciales des économies de la région ;
- l'accès aux infrastructures essentielles pour désenclaver les économies et les hommes, notamment l'énergie, en particulier à travers le financement du développement des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité et la biomasse, les transports et l'amélioration de la capacité d'accueil des mégapoles et des villes secondaires ;
- les secteurs sociaux de la santé et de l'éducation afin de participer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, de l'éducation de base et de la formation professionnelle ;
- la sécurité alimentaire et la productivité agricole ;
- les questions du genre, de l'égalité hommes-femmes et de la santé maternelle et infantile qui sont autant de thèmes qui permettent de rentrer dans celui délicat de la démographie, si central dans l'évolution du continent.
Le groupe de travail a, en revanche, formulé des propositions visant à pallier les carences observées en matière de pilotage de cette politique, de répartition des moyens financiers, de promotion de l'expertise et du renforcement de capacité. Il a enfin souhaité souligner les enjeux liés à la construction d'une coalition la plus large possible avec les pays africains en matière de climat.
A. POUR UN MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE PLEIN EXERCICE ET UN RÉSEAU RESSERRÉ
1. Un ministère de la coopération internationale de plein exercice
Le Premier ministre a réuni, le 31 juillet 2013, le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), en présence de 15 ministres concourant à la politique française de développement.
Ce Comité, chargé de définir les principes et les priorités de l'effort de solidarité internationale de la France, n'avait pas été réuni depuis quatre ans. Après les Assises du développement et de la solidarité internationale, clôturées le 1 er mars 2013 par le Président de la République, cette réunion du CICID témoigne de la volonté du Gouvernement de donner de nouvelles orientations à la politique de développement de la France.
L'enjeu est d'adapter les instruments et les priorités de notre aide aux défis du XXI è siècle : différenciation des pays en développement accentuée par la mondialisation, généralisation des aspirations démocratiques, dégradation progressive de l'environnement.
Prenant en compte les résultats des Assises et conformément à un certain nombre de recommandations formulées, notamment par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), par la Cour des Comptes et par le Parlement, le Gouvernement présentera un projet de loi d'orientation et de programmation sur la politique de développement et de solidarité internationale en conseil des ministres au plus tard en novembre prochain ; il sera examiné par le Parlement au début de l'année 2014.
Le constat opéré sur le pilotage de la politique de coopération a conduit le groupe de travail à proposer d'aller plus loin en rassemblant les différentes administrations qui concourent à cette politique, en Afrique comme ailleurs, au sein d'un ministère de la coopération internationale de plein exercice.
De quoi s'agit-il précisement ?
Il ne s'agit pas de refaire un ministère de la coopération, mais de prendre acte de la montée en puissance avec l'approfondissement de la mondialisation de la politique de coopération sur des enjeux globaux tels que la santé et ou le climat et de prendre acte des dysfonctionnements actuels.
Cette mesure renforcerait les pouvoirs budgétaires du ministre du développement en lui confiant la responsabilité des programmes 110 et 209.
Elle consacrerait le rôle de ce ministre dans la tutelle de l'AFD et l'animation interministérielle de la politique d'aide au développement :
- en lui rattachant, outre la DGM (dont le personnel titulaire resterait rattaché au Quai d'Orsay), les services du Trésor actuellement en charge du programme 110 (dont le personnel resterait rattaché au Trésor), les services en charge du pilotage stratégique de l'AFD (dont le personnel resterait rattaché à l'AFD), ainsi que des agents des ministères techniques concernés (environnement, agriculture, éducation nationale, santé, etc.) ;
- en lui confiant une présidence du Conseil d'administration de l'AFD, rendue compatible avec les exigences de la loi bancaire.
Elle renforcerait le rôle d'opérateur de l'AFD en achevant le transfert de compétences initié en 2008.
Cette mesure aurait plusieurs avantages :
- l'autorité du ministre de la coopération sur les programmes 110 et 209 permettrait de les restructurer en deux programmes (un bilatéral et un multiltéral), et autoriserait ainsi des arbitrages cohérents sur l'ensemble des instruments de la politique de coopération bi et multi, des agences de Bretton Woods, du système onusien, et européen, ainsi que sur les opérateurs de promotion de l'expertise technique ;
- ce ministère donnerait une visibilité politique aux tentatives de régulation de la mondialisation et de mise en place de politiques publiques globales à l'échelle planétaire. Il s'agirait d'un ministère de la coopération internationale qui serait chargé des biens publics mondiaux, de la coopération internationale, du développement et de la gouvernance mondiale ;
- l'intégration des services de la DGM et du Trésor mettrait fin aux redondances administratives et aux conflits liés à leur appartenance à des ministères concurrents, tout en conservant leurs cultures professionnelles complémentaires dans un ministère qui ne serait ni celui des finances, ni celui des affaires étrangères.
|
35) Confier à un ministère de la coopération internationale et du développement la responsabilité des programmes 110 et 209 et les services qui les gèrent. |
2. Unifier le réseau de la coopération au développement en achevant la réforme de 1998
Si la réforme de 1998 a conduit à la rationalisation administrative de l'aide autour de deux grands pôles, l'un diplomatique, issu de l'absorption du secrétariat d'Etat à la coopération par le ministère des affaires étrangères et européennes, et l'autre, financier, centré sur le ministère des finances, elle a surtout conforté le rôle de l'AFD qui est devenue l'« opérateur pivot » de l'aide française.
Depuis lors, les transferts successifs de compétences ont conduit l'AFD à prendre en charge la gestion de plus de 80 % des moyens de l'aide programmable mise en oeuvre par les canaux bilatéraux.
En dépit des réformes, sur le terrain, le dispositif est encore composé de deux structures, les agences de l'AFD et les SCAC, qui coexistent pour un coût élevé, des risques avérés de redondances et une faible lisibilité.
Les Services de coopération et d'action culturelle (SCAC), dirigés par un conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), à la fois conseiller de l'ambassadeur sur le pilotage du dispositif de l'aide française au plan local et chef de service, sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction générale de la mondialisation, mais ne gèrent plus que 20 % des crédits de financement de projets.
La compétence des SCAC en matière de gouvernance, de suivi du fonds mondial contre le Sida ou d'aide alimentaire, leur permet d'intervenir dans presque tous les domaines de compétences des agences avec cependant des moyens d'intervention très limités et pour un nombre d'agents parfois identique ou supérieur aux agences de l'AFD. Ainsi à Madagascar, le développement rural relevait de l'AFD, mais le cadastre rural d'un FSP, la santé de l'AFD, et le soutien à une maternité ou à l'institut Pasteur du SCAC.
Ce constat rejoint l'évaluation de la Cour des comptes en 2011 sur l'aide au développement qui préconise la poursuite des transferts des compétences opérationnelles du ministère des affaires étrangères à l'AFD sur le fondement de trois arguments, la compétence de l'AFD en matière de gestion et de suivi des projets, le recentrage de la DGM sur les missions de pilotage stratégique de l'aide bilatérale et multilatérale, et enfin la rationalisation du réseau.
La Cour des comptes estime que « le réseau public de mise en oeuvre de l'aide française est d'un coût relativement élevé. Il demeure hétérogène et insuffisamment articulé. »
Elle a évalué ce coût de gestion de la politique d'aide, qui n'est pas présenté de manière synthétique dans les documents budgétaires, à 700 millions d'euros en 2010, soit près de 9 % de la somme des dépenses budgétaires de l'Etat et des engagements de l'Agence.
La dernière revue par les pairs de l'OCDE va dans le même sens : « Sur le terrain, dans un contexte où les crédits de coopération gérés par les SCAC diminuent fortement, la question se pose d'une rationalisation du réseau afin de diminuer les frais de structure, ainsi que le recommande la Cour des comptes. Il sera par ailleurs utile d'examiner l'impact sur les frais de fonctionnement de la création des instituts français. »
Le groupe de travail propose d'achever le transfert vers l'AFD de toutes les responsabilités opérationnelles, afin d'assurer une meilleure cohérence de l'action bilatérale en faveur du développement et de faire bénéficier l'ensemble des secteurs du savoir-faire de l'AFD en matière de mise en oeuvre et de suivi de projet, de simplifier l'organisation du réseau en mettant fin à la double compétence des SCAC et des agences de l'AFD et de réduire ainsi son coût en s'appuyant principalement sur les agences de l'AFD, sous l'autorité des ambassadeurs.
Il observe que l'intégration prochaine des SCAC dans l'Institut Français posera de toute façon la question de l'avenir des compétences développement des SCAC et la question pendante du transfert des compétences à l'AFD des secteurs de la Gouvernance et de l'éducation supérieure, la culture ayant vocation à rester à l'Institut Français.
Dans le même temps, la Cour des compte juge que « la gestion des FSP par le ministère chargé des affaires étrangères s'est révélée insuffisamment rigoureuse. », aussi bien au niveau central qu'au niveau des ambassades. Comme le soulignent les travaux du bilan évaluatif de la coopération française qui rejoignent l'analyse de la Cour des comptes, le partage des rôles reste inachevé entre les différents acteurs, malgré l'existence d'un opérateur dominant (l'AFD).
Les réformes poursuivies n'ont pas permis de dissocier complètement la fonction stratégique et la fonction opérationnelle et de remédier à sa fragmentation. Les interventions françaises sont ainsi menées principalement par l'AFD, mais les services de coopération et d'action culturelle (SCAC) et les services économiques du MINEFI ont conservé la gestion de certains instruments sous l'autorité des ambassadeurs, ce qui engendre encore, ponctuellement, certaines frictions dans des secteurs spécifiques comme la gouvernance financière.
L'ensemble de ces observations conduit à la proposition de poursuivre les transferts de compétence opérationnelle au profit de l'AFD de façon à ce que les FSP hors domaine strictement régalien (police et justice) soient gérés par l'AFD.
Ces transferts devraient concerner également les services économiques du MINEFI qui conservent la gestion de quelques instruments spécifiques (FASEP et RPE), parallèlement à leur mission générale d'analyse macro-économique. Le groupe de travail propose, en effet, de confier à l'AFD la gestion d'un fonds d'expertise lié qui serait en partie financé par l'intégration la refonte du FASEP et de la RPE.
Si, à terme, l'AFD a donc vocation à intégrer l'ensemble des activités opérationnelles de coopération au développement, la poursuite des transferts de compétences à l'AFD doit s'accompagner de transferts de moyens adaptés et d'un déplafonnement des ETP de l'Agence, dès lors que toute croissance d'ETP est adossée à une croissance de l'activité. Par ailleurs, cela suppose une évolution de positionnement des directeurs d'agence qui devront assumer en plus de leur mission de banquier de développement celle de conseiller de l'ambassadeur pour les questions de développement. Si c'est déjà le cas dans de nombreux pays où les directeurs d'agence de l'AFD ont pleinement intégré leur rôle vis-à-vis des missions diplomatiques, le repositionnement des agences supposera une évolution des mentalités dans une entité très marquée par la culture bancaire.
|
36) Simplifier l'organisation du réseau en mettant fin à la double compétence des SCAC et des agences de l'AFD et réduire ainsi son coût en s'appuyant principalement sur les agences de l'AFD sous l'autorité des ambassadeurs. 37) Poursuivre les transferts de compétence opérationnelle au profit de l'AFD de façon à ce que les FSP (hors domaine strictement régalien (police et justice)) soient gérés par l'AFD. |
3. Rationaliser le réseau des opérateurs de recherche pour le développement français
Comme l'a souligné la mission commune d'information sur l'action extérieure de la France en matière de recherche pour le développement du Sénat dont Mme Kalliopi Ango Ela était la rapporteure 65 ( * ) : « Le déploiement international de nos acteurs de la recherche pour le développement est difficilement lisible pour nos partenaires du Sud »
Conformément à la mission qui lui avait été assignée, l'AIRD a entrepris de rationaliser le réseau des représentations à l'étranger de ses membres fondateurs. Cette rationalisation, effectuée sur une base volontaire, n'a visiblement pas été poussée assez loin : seules deux implantations de l'IRD et du CNRS sont mutualisées.
La mission d'inspection sur l'IRD a elle-même suggéré une mutualisation des fonctions support entre les représentations dans un même pays des opérateurs du développement. Les coûts de fonctionnement en seraient réduits, puisque les frais d'immobilier ou de recrutement local seraient partagés.
Cette mutualisation renforcée pourrait s'envisager aussi bien entre instituts de recherche qu'avec les postes diplomatiques et même avec les agences de l'AFD, ce qui permettrait d'avoir une plus grande cohérence dans l'action française au service du développement, d'améliorer sa visibilité sur le terrain et, finalement, son efficacité auprès des interlocuteurs locaux comme des partenaires internationaux.
Une deuxième piste pour rationaliser le réseau consiste à le penser en termes d'action régionale plutôt que strictement nationale. L'AERES, dans son rapport d'évaluation de l'IRD daté de 2010, relevait que l'expérience des représentations les plus efficaces montrait la pertinence d'une action au niveau régional plutôt que national : la régionalisation permettrait d'agréger les demandes émanant de la part de plusieurs pays partenaires.
Au plan institutionnel, elle encouragerait aussi un décloisonnement entre les opérateurs français de recherche pour s'entendre avec les pays d'une région donnée sur des projets communs. Même si elle n'ignore pas la difficulté que peut représenter la fermeture d'une représentation dans un pays, que ce soit pour l'organisme concerné, pour le pays hôte ou même pour la diplomatie française, votre mission préconise de resserrer le réseau des opérateurs de recherche pour le développement autour de représentants régionaux, responsables d'une agence.
Les alliances de recherche constituent un troisième levier de rationalisation de la présence en Afrique des opérateurs français de la recherche pour le développement. En effet, les alliances de recherche s'organisent de plus en plus pour mieux se projeter en Afrique de manière unie. Elles peuvent jouer un rôle important en facilitant en amont les échanges thématiques entre les différents instituts de recherche et en utilisant comme têtes de pont sur le terrain les opérateurs dédiés à la recherche pour le développement qui sont bien connus des partenaires du Sud et sont les mieux placés pour nouer des partenariats.
Le dernier CICID a souligné que « L'offre française de recherche au service du développement doit toutefois être rendue plus accessible pour les partenaires du sud. Il convient d'en renforcer la visibilité et la cohérence entre acteurs. Le Gouvernement décide d'élaborer d'ici la fin de l'année, avec l'aide de l'ensemble des acteurs français de la recherche, une charte sur la recherche au service du développement, qui débouchera sur des recommandations opérationnelles, qui s'appuieront notamment sur le travail de coordination des alliances thématiques . »
Le groupe de travail pense qu'il faut aller plus loin et encourage donc un dialogue approfondi entre opérateurs de recherche, au sein des alliances, pour identifier les moyens de rendre plus lisible l'offre française en matière de partenariats.
Outre la mutualisation du réseau à l'étranger, les opérateurs de la recherche pour le développement peuvent en effet s'entendre, par voie d'accords bilatéraux, pour se répartir des prestations de service comme la gestion de bourses de thèse, mettre en commun des moyens dédiés à l'information et à la culture scientifique ou développer ensemble des activités de transfert et de valorisation.
|
38) Mutualiser des fonctions support entre les représentations des instituts de recherche pour le développement dans un même pays des opérateurs du développement. 39) Resserrer le réseau des opérateurs de recherche pour le développement autour de représentants régionaux, responsables d'une agence. 40) Mieux intégrer les besoins opérationnels dans la programmation des organismes de recherche pour le développement. |
B. RESTAURER NOS CAPACITÉS D'INTERVENTION EN AFRIQUE
Le constat du groupe de travail est que les moyens de notre coopération à destination de l'Afrique, malgré la stabilisation de la mission budgétaire « aide au développement », restent très limités pour avoir une influence significative, car la stabilisation s'est effectuée à un niveau historiquement bas, en particulier en matière de subventions aux projets.
Le dernier CICID de juillet 2013 souligne que « Les pays d'Afrique subsaharienne demeurent la priorité de la France. La France interviendra dans tous les secteurs opportuns et mobilisera toute la gamme des instruments dont elle dispose -dons, aides budgétaires, prêts bonifiés ou non, souverains et non souverains, prises de participations, garanties et autres financements innovants-pour répondre de manière adaptée aux besoins de ces pays ». Mais les moyens de cette ambition au niveau bilatéral font défaut.
Dans ce contexte, à court terme, tout élément permettant non seulement de préserver mais d'accroître, même modestement, nos moyens d'intervention, mérite d'être poursuivi : rééquilibrage entre les contributions bilatérales et multilatérales, délégation de fonds européens ou tiers (fonds verticaux sida, vert...), financements innovants, affectation de la taxe sur les transactions financières qui peut participer au rééquilibrage bi-multi en matière de dons.
Au-delà, les perspectives de remontée significative de l'enveloppe de dons, si elles sont repoussées en raison de la situation économique, restent extrêmement souhaitables dès que la situation le permettra.
Partant de l'idée que si la coopération française veut avoir une action significative dans ces zones prioritaires d'Afrique subsaharienne et renforcer en matière d'expertise technique, il faut trouver, selon les ambitions que l'on se fixe, 200 à 500 millions d'euros, le groupe de travail a approfondi, parmi les pistes évoquées, deux pistes pour trouver ces financements par redéploiement de crédits afin de ne pas aggraver les déficits publics.
1. Trouver un nouvel équilibre entre nos contributions bilatérales
La première solution consisterait à réduire nos contributions multilatérales. Dans le droit-fil du rééquilibrage entre les contributions bilatérales et multilatérales, il s'agirait de trouver plusieurs centaines de millions d'euros dans les actions multilatérales des programmes 110 et 209.
Or, l'examen de ces contributions nous a montré que les marges de manoeuvre étaient étroites.
En effet, sur le programme 110, la majeure partie des fonds multilatéraux ont déjà fait l'objet de reconstitutions, de sorte que nos engagements courent jusqu'en 2013, voire au-delà. Ainsi, la France a participé à la 16 e reconstitution de la Banque mondiale qui nous engage jusqu'en 2014. De même la France a participé à la 12 e reconstitution du Fonds africain de développement qui nous engage jusqu'en 2013. Elle vient de s'engager de nouveau sur la reconstitution du Fond mondial de lutte contre le Sida à hauteur de 360 millions par an.
Le groupe de travail est d'avis qu'un prélèvement sur les différents fonds multilatéraux du programme 110 et 209 permettrait, année après année, de dégager des marges de manoeuvre.
Une analyse de nos contributions aux fonds multilatéraux, particulièrement les fonds spécialisés tels que le Fonds du sarcophage de Tchernobyl et le Compte pour la sûreté nucléaire, le FIAS, le Fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), la facilité pour le Partenariat oriental, ou le Fonds Doha, au regard notamment du taux de consommation de ces crédits, mais aussi des contributions plus importantes comme celles que nous versons à la Banque mondiale et au Fonds mondial de lutte contre le Sida et au FED, devrait permettre de dégager à terme une centaine de millions d'euros.
S'il convient de veiller à ce qu'une réduction de nos contributions aux fonds multilatéraux ne fragilise pas trop la participation de la France aux instances de programmation, voire aux conseils d'administration, comme c'est déjà le cas dans certaines institutions de l'ONU, il faut aujourd'hui rééquilibrer l'effort budgétaire en faveur de l'aide bilatérale.
|
41) Redresser l'équilibre des contributions bilatérales et multilatérales de façon à retrouver un niveau d'intervention sous forme de subventions supérieures à 500 millions à la fin du triennum budgétaire. |
2. Poursuivre le combat en faveur des financements innovants
La seconde voie à explorer pour redresser nos capacités d'intervention en Afrique sous forme de dons est l'essor des financements innovants du développement, c'est-à-dire de nouveaux flux financiers plus stables, plus prévisibles et moins dépendants des arbitrages de la loi de finances.
Ces financements complètent cette dernière par une fiscalité assise sur les activités économiques internationales peu ou non taxées à l'échelon mondial, à l'instar de la taxe sur les billets d'avion ou de la taxe sur les transactions financières internationales.
La TTF française a permis de lever 415 millions d'euros entre août 2012 et avril 2013. Celle-ci s'applique aux transactions d'actions d'entreprises françaises cotées en bourse et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros (0,2%) ainsi qu'aux opérations de trading à haute fréquence et aux contrats d'assurance contre le risque de défaut des Etats (0,02%).
La France s'est engagée à affecter un total de 480 M€ (autorisations d'engagements) sur la période 2013-2015 à des actions à l'international dans les domaines de l'adaptation au changement climatique et de la santé, soit 10% en moyenne par an des recettes totales attendues.
Une augmentation de ce taux conformément à l'engagement du Président de la République de consacrer à la coopération « la majeure partie » des recettes de la TTF constitue une deuxième voie pour restaurer nos capacités d'intervention en Afrique.
La mise en place de cette taxe est une première étape visant à prouver la faisabilité d'un instrument voué à être transposé à plus large échelle : l'introduction d'une TTF européenne via une coopération renforcée est une priorité de la France. Grâce à la mobilisation d'un groupe de 11 Etats pionniers, ce projet, validé par le Conseil Ecofin, fait actuellement l'objet de négociations.
Le groupe de travail reste fermement attaché à la mise en place d'une contribution juste et morale du secteur de la finance à la réduction du déficit public et au financement du développement.
L'adoption par l'Europe de la TTF est en effet une des conditions pour sa généralisation au-delà de l'Europe à l'ensemble de la planète.
Compte tenu des besoins de l'Afrique en matière de développement humain, les besoins de financements, notamment en matière d'éducation et de santé, excèdent très largement non seulement les capacités de la France, mais également celles des budgets des donateurs du CAD. Ils sont, compte tenu de la démographie, importants et durables. Ils requièrent des réponses structurelles.
La crise financière des pays occidentaux et les mesures de consolidation budgétaire qui s'en sont suivies, sont venues aggraver les problèmes de financement et compromettre gravement la capacité des gouvernements à s'acquitter de leurs engagements en faveur de l'Afrique.
C'est pourquoi l'essor des financements innovants est un combat essentiel pour les PMA africains. C'est la garantie de nouveaux flux moins dépendants des budgets annuels des pays membres du CAD et des nouveaux pays donateurs que l'aide traditionnelle.
Ces financements complètent cette dernière par une fiscalité assise sur les activités économiques internationales peu ou non taxées à l'échelon mondial, à l'instar de la taxe sur les billets d'avion ou du projet de taxe sur les transactions financières internationales.
L'étude de certains modèles révèle que même une faible imposition de dix points de base sur les capitaux propres et de deux points de base sur les obligations pourrait générer environ 48 milliards de dollars sur l'ensemble des pays du G20 ou 9 milliards de dollars si l'on se limite aux principaux pays d'Europe. D'autres propositions de taxes sur les transactions financières offrent des perspectives sensiblement plus avantageuses, allant de 100 à 250 milliards de dollars, notamment en incluant les produits dérivés.
Aujourd'hui, la faisabilité technique de la mise en place d'un financement innovant ne semble plus contestée, comme l'illustrent les récents documents de travail du FMI et du G20.
Le groupe de travail souhaite souligner la portée politique de ce projet.
Asseoir le financement des politiques d'aide au développement en faveur des pays les plus pauvres d'Afrique sur une ressource fiscale mondialisée permettrait de jeter les bases de politiques publiques de redistribution à l'échelle mondiale.
Leur mise en place est d'autant plus justifiée qu'elles constituent une forme moderne de redistribution internationale basée pour l'essentiel sur la taxation d'activités qui bénéficient de la mondialisation vers ceux qui n'en profitent pas ou peu.
|
42) Accroître la part de la TTF française affectée à la coopération. 43) Achever le processus d'adoption de la TTF européenne et s'assurer qu'une partie sera consacrée à la solidarité internationale. 44) Poursuivre le travail de conviction pour l'adoption d'une TTF au niveau mondial. |
3. Conforter le modèle économique de l'AFD
L'AFD est l'outil bilatéral pivot pour soutenir les priorités françaises en Afrique, qu'elles soient fondées sur des motifs historiques, géostratégiques, ou des réponses aux défis du continent (démographie, urbanisme, emploi, protection de l'environnement), à l'écoute des besoins de nos partenaires, mais aussi, à travers une projection de nos valeurs et de nos normes (démocratiques, environnementales et sociales), de notre expertise et de notre savoir-faire.
Elle doit pour cela pouvoir mobiliser l'ensemble de la gamme de ressources financières et non financières adaptées à la variété des besoins, y compris mobiliser les détenteurs d'expertise et d'expérience (bureaux d'études, collectivités territoriales, centre de recherche, administrations...).
Le dernier CICID a souligné que « Le Gouvernement s'accorde sur la nécessité de donner à l'AFD, acteur pivot de la politique de développement, les capacités financières d'exercer pleinement ses missions dans le cadre de ces nouvelles priorités, afin qu'elles soient déclinées dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour la période 2014 - 2016. »
Or le groupe de travail a constaté que l'agence ne dispose pas des moyens budgétaires nécessaires en subvention pour intervenir de façon significative en Afrique francophone. Il observe que la conjonction des restrictions des frais de fonctionnement et de personnel, en valeur absolue, dans le dernier contrat d'objectifs et de moyens, et de la diversification géographique de ses activités fait craindre à terme à une diminution des moyens des agences sur ce continent.
Il constate enfin qu'au regard du niveau de ses fonds propres, le respect des limites prudentielles contraint les capacités d'action de l'AFD dans certains pays du Maghreb et d'Afrique anglophone, notamment en Afrique du Sud.
Comme le souligne la dernière revue par les pairs de l'OCDE en 2013 : « Le maintien et la crédibilité du modèle financier de l'AFD à moyen terme est donc un enjeu majeur, face auquel différents scénarios doivent être élaborés et étroitement surveillés ».
Cette contrainte va s'accroitre et s'étendre à d'autres pays dans les années à venir. Il est donc nécessaire de réfléchir à des solutions de renforcement des fonds propres.
L'AFD a versé en dividende à l'Etat depuis 2004 un montant cumulé d'1,1 milliard d'euros qui font aujourd'hui cruellement défaut. Enfin l'AFD ne dispose pas de crédits suffisamment identifiés pour financer à plus grande échelle des expertises et des études.
|
45) Consacrer le rééquilibrage de l'aide bilatérale en partie à de l'aide projet sous forme de dons destinés aux pays pauvres prioritaires et en partie aux financements d'expertises en amont des projets. 46) Procéder à un renforcement comptable des fonds propres de l'AFD. 47) Intégrer un nouvel accord sur une diminution de la distribution des dividendes actée dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens. 48) Supprimer la détermination en valeur absolue des effectifs de l'AFD. |
L'agence ne bénéficie pas de subvention de fonctionnement, mais finance son activité grâce à son résultat bancaire. Dès lors un plafonnement de ses effectifs constitue un véritable frein à son déploiement aussi bien en Afrique que dans d'autres zones plus « rentables ».
C. RENFORCER NOTRE POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EXPERTISE FRANÇAISE
1. Créer un fonds dédié au financement de l'expertise et fusionner les opérateurs publics dédiés à la promotion de l'expertise française
Le groupe de travail a constaté dans les chapitres précédents, d'une part, que le renforcement des compétences, notamment en matière de politiques publiques est, nous l'avons vu, un besoin essentiel de l'Afrique. C'est notamment un levier majeur permettant de favoriser l'émergence d'institutions plus légitimes et plus efficaces et donc mieux à même de piloter les processus de développement. Il a observé, d'autre part, que les moyens de la coopération technique française étaient en très net déclin et sa gestion éclatée entre de nombreux organismes sans stratégie commune.
Dans ses pays d'intervention traditionnelle, I'AFD dispose, avec les ressources du Programme 209 du ministère des affaires étrangères, de crédits d'intervention limités lui permettant de financer ce type d'activités, dans des projets dédiés ou à travers des composantes de projets plus larges. Ces activités visent essentiellement à renforcer les capacités à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des politiques, programmes et projets de développement des pays les plus pauvres d'Afrique. Dans les nouveaux pays d'intervention, pays à revenu intermédiaire, l'AFD fait face à une forte demande d'expertise et d'expérience française, s'inscrivant dans une optique de coopération bilatérale et d'échanges avec des experts et des opérateurs techniques français ayant des compétences et des métiers comparables. Cette demande de mise en relation avec les savoir-faire français, qui vise à bénéficier d'approches nouvelles et innovantes, émane de nombreux acteurs (ministères et entreprises publiques, secteur privé et organisations professionnelles, collectivités locales...) et peut prendre des formes très variées.
L'AFD peine à répondre à cette demande dans les nouveaux pays d'intervention, faute d'outil financier spécifique sur dons. Elle a choisi, il y a quelques années, de prendre en charge ce type d'activités dans son budget de fonctionnement. Cette solution présente plusieurs inconvénients. Elle implique, en particulier, un niveau d'engagement modeste, compte tenu des contraintes liées au modèle financier et à la maîtrise des charges de fonctionnement de l'AFD. Elle génère une difficulté à mobiliser certaines compétences françaises, le volume d'affaires représenté par l'AFD n'étant pas suffisant pour inciter des opérateurs potentiels à développer leurs activités correspondant aux besoins identifiés.
C'est pour répondre à ce diagnostic qu'il a été proposé, depuis plus d'un an, la création d'un instrument spécifique complétant l'éventail des outils à la disposition de I'AFD : le Fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences. Ce fonds, annoncé par le dernier CICID, serait pour l'instant doté d'un financement provisoire de 20 millions d'euros et destiné aux pays à revenu intermédiaire 66 ( * ) .
Le groupe de travail se félicite de cette initiative, mais estime qu'il faut aller plus loin en pérennisant le financement de ce fonds par des abondement des programme 110 et 209 et en rassemblant les financements dédiés aux différentes modalités de l'assistance technique, du renforcement de capacité et des études et, notamment, le Fonds d'appui au secteur privé - Etudes (FASEP-Etudes) et, le cas échéant, la Reserve Pays émergents. Ces deux instruments d'aide liée mériteraient en effet d'être revus. Leur concentration géographique et sectorielle et la lourdeur de leurs procédures affaiblissent leur pertinence et, dans l'ensemble, le dispositif français gagnerait à une meilleure articulation entre les instruments liés et déliés, comme c'est le cas notamment aux Etats-Unis. De ce point de vue, confier la gestion des deux types d'instruments à l'AFD avec des guichets distincts présenterait l'avantage d'une meilleure articulation.
La finalité d'un fonds élargi dédié à l'expertise serait de répondre aux demandes et besoins d'expertise et d'expérience françaises émanant des pays à revenu intermédiaire, de nourrir le dialogue sur les politiques publiques tout en valorisant les savoir-faire français.
Son périmètre géographique cible en priorité les pays émergents dont l'Afrique du Sud et les pays à revenu intermédiaire au sens du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE tels que, notamment, l'Angola, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Nigéria, le Botswana, ou le Gabon. Son champ sectoriel devrait être en cohérence avec le mandat de l'AFD dans les domaines présentant un intérêt particulier pour des opérateurs français. Le fonds n'interviendra pas exclusivement en Afrique, mais devra en faire une de ses priorités.
Ce Fonds permettra d'intervenir en amont de la réalisation de projets ou programmes, notamment d'équipements ou d'infrastructures, ou en accompagnement de ceux-ci, sans avoir vocation, en général, à financer des études de faisabilité. Grâce aux activités financées, le Fonds répondra à une demande des partenaires et permettra de les familiariser avec les solutions techniques et financières.
Ce fonds devra être géré par un guichet de l'AFD au même titre que le guichet ONG, que ces financements soient réservés à des opérateurs publics ou privés français.
Par ailleurs, le groupe de travail juge que la France ne devrait pas s'interdire de développer une offre d'expertise payante ou remboursable, comme en dispose la Banque mondiale. Selon le type d'opération et le pays, l'expertise mise à disposition serait gratuite (financée par le 110 ou le 209) ou payante, avec une grille tarifaire adaptée.
S'agissant de l'organisation institutionnelle et de la gestion de cette politique, le groupe de travail préconise que le pilotage stratégique en soit toujours confié au ministère de la coopération de plein exercice qu'il appelle de ses voeux, mais que l'AFD gère l'ensemble des crédits destinés aux assistants techniques résidents en cohérence avec la poursuite de la réforme de 1998 et des transferts de compétence. Il propose que cette politique de placement fasse l'objet d'une cartographie géographique et sectorielle et d'une stratégie élaborée conjointement entre le ministère des affaires étrangères, l'AFD et le ministère des finances pour les aspects de gouvernance financière.
|
49) Créer un fonds dédié à l'expertise internationale géré par l'AFD et destiné à des opérateurs privés ou publics français qui rassemble l'ensemble des financements dédiés à l'expertise à l'international. Mieux articuler les instruments d'aide liée et déliée et définir une stratégie géographique et sectorielle pour les assistants techniques. |
2. Mutualiser les opérateurs publics dédiés à la promotion de l'expertise française
S'agissant des opérateurs publics, le groupe de travail, s'appuyant sur les travaux de leur collègue Jacques Berthou, préconise la constitution d'un groupement d'intérêt public de tous les opérateurs afin de mutualiser :
- le travail de veille sur appels d'offres internationaux, et d'aide à la structuration de consortiums d'acteurs pour y répondre ;
- l'entretien du lien avec le réseau des ambassades, des agences de l'AFD et des organisations multilatérales ou européennes ;
- l'intermédiation financière entre les financements en provenance des bailleurs et les structures mettant à disposition l'expertise ;
- le travail de communication sur l'équipe France tout en préservant l'identité des opérateurs existants qui ont acquis une visibilité et une crédibilité au gré de leurs interventions passées.
Ce GIP aurait pour mission l'animation du vivier d'experts français et sa mobilisation en accompagnement de projets d'aide au développement.
|
50) Regrouper dans un groupement d'intérêt public tous les opérateurs d'expertise technique publics. |
D. APPROFONDIR NOTRE RÉFLEXION SUR NOS INTERVENTIONS DANS LES PAYS FRAGILES
La coopération française, à travers l'AFD, a largement professionnalisé et standardisé ses méthodes de travail en cohérence avec les réflexions internationales sur les principes de l'efficacité de l'aide et les procédures liées à son statut d'établissement de crédit.
Or les méthodes de travail et les résultats obtenus varient considérablement selon les catégories de pays. Des pays fragiles comme le Mali, Madagascar ou le Tchad se distinguent à de nombreux égards du groupe des pays de « l'Afrique qui gagne ». Leur situation économique et surtout sociale est médiocre, avec une pauvreté massive et un accroissement vertigineux des inégalités, faisant le lit des idéologies extrémistes. Leur situation de gouvernance politique, économique et financière est très mauvaise, certes avec des oscillations, mais la profondeur de leurs problèmes culturels, institutionnels et sociaux et la faiblesse de leurs capacités humaines et institutionnelles ne permettent pas d'imaginer une évolution rapide de leur situation.
Les programmes de l'AFD dans ces pays soulèvent des interrogations en termes de méthodes et de durabilité. Au Mali, de nombreux observateurs se sont interrogés sur les résultats de plus de cinquante ans de coopération. Des interrogations partagées par les membres du groupe de travail. Qu'a-t-on fait de nos actions en faveur de l'éducation et de la santé, en faveur des infrastructures de transport et d'assainissement ? Que sont devenues nos contributions aux différents plans en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le nord du Mali ? A ces questions nous n'avons reçu presqu'aucune réponse. Or il nous faut dresser une évaluation de nos actions pour en améliorer l'efficacité. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux acteurs de cette coopération, qui ne ménagent pas leurs efforts, mais de tirer des enseignements.
Il y a un problème d'allocation de nos moyens d'intervention. Sur les dix dernières années, le Mali représente 4 % de notre aide au développement. C'est peu, pour un pays prioritaire de la coopération française dont les besoins sont immenses, et dont nous accueillons sur notre territoire une partie de la population.
Mais, il y a aussi un problème de méthode qui concerne l'ensemble des pays fragiles.
Ces pays appellent une grande souplesse dans le choix des instruments et dans l'exécution, du temps, des agents expérimentés dotés de fortes compétences techniques, diplomatiques et intellectuelles ainsi qu'une forte capacité d'adaptation.
Certes, la France a développé plusieurs outils pour guider son action dans les contextes de fragilité ou de sortie de crise ; des positions ont été élaborées et adoptées en interministériel sur : la gouvernance démocratique (2006) ; les Etats fragiles et les situations de fragilité (2008) ; la lutte contre la corruption (2008) ; la réforme des systèmes de sécurité (2008) ; le DDR (2009) ; la réduction de la violence armée (2012). La stratégie pour les Etats fragiles développée en 2007 est, par ailleurs, en cours de renouvellement. Pour autant, il ne semble pas que les méthodes utilisées soient toujours bien adaptées aux situations particulières.
Gagner la paix au Mali, ou plutôt gagner le développement, est une toute autre affaire que gagner la guerre, une affaire dont la durée s'étend au minimum sur une génération. La construction d'un discours qui porte une vision d'avenir de notre action, de nos partenariats et de nos financements dans ces pays devrait prendre en compte le bilan de notre action passée.
La France occupe dans ces pays presque tous francophones une position délicate car la relation particulière évidente qu'elle entretient avec eux génère deux attitudes contradictoires de la part de ses partenaires : une forme de rejet de l'influence française et une grande attente d'appui ! Ce discours est à bâtir avec les partenaires des pays mais aussi avec les tutelles, les parlementaires, les ONG et les collectivités locales. Il est également à bâtir avec d'autres pays européens qui ne peuvent pas laisser la France dans un tête-à-tête trop étroit. Il doit intégrer les financements des pays émergents qui font partie des problèmes et des solutions.
Il s'agit notamment de partir d'une analyse approfondie du contexte, de privilégier une entrée par les acteurs plutôt qu'une entrée par les secteurs, de viser la préparation de l'avenir plutôt que des résultats importants à court terme, donc d'accorder une véritable priorité au renforcement des capacités et à la promotion du dialogue sur les politiques publiques, de privilégier les projets innovants, pilotes, et les actions d'étude/plaidoyer/débats vectrices d'une influence constructive.
En agissant ainsi, au plus près des acteurs et des enjeux, ce que peu de bailleurs de fonds savent faire, l'AFD répondra à des besoins essentiels avec des budgets limités et un effet de levier maximum. La sélection des partenaires sera cruciale, en fonction de leur engagement et de leurs capacités. Il s'agira de cibler des acteurs d'avenir, dans le privé, la société civile, les collectivités locales ou les administrations de façon très sélective, quitte parfois à contourner l'Etat.
Dans certains cas, il convient de sélectionner les modes d'action et procédures les plus adaptées et les plus simples, notamment en matière de sélection et de passation des marchés, en respectant l'esprit des principes clefs plutôt que la lettre. Confier des maîtrises d'ouvrage déléguées à des opérateurs privés ou non souverains peut constituer une des solutions.
Dans d'autres cas, un partage des tâches entre, d'un côté, la France (AFD et ONG, en partenariat) sur des petits projets pilotes de qualité, c'est-à-dire coûteux en termes d'instruction et de suivi, et, de l'autre, des grands bailleurs de fonds comme l'Union européenne ou la Banque mondiale qui ont vocation à financer leur réplication ou le passage à l'échelle supérieure.
|
51) Etablir un bilan de nos modes d'intervention dans les pays fragiles à faible maîtrise d'ouvrage et de définir une méthodologie adaptée. |
E. RELANCER LES DISPOSITIFS DE CAPITAL INVESTISSEMENT DANS LES PME
En Afrique, l'essor considérable du capital investissement n'a pas pleinement bénéficié aux PME. Les fonds internationaux ou continentaux se sont centrés pour l'essentiel sur les secteurs des télécommunications, des grandes infrastructures et, pour l'essentiel, dans l'énergie et se sont dirigés vers les pays les plus mûrs, au nord du continent et en Afrique du Sud.
Le phénomène est encore plus marqué pour les PME de petite taille employant moins de 100 salariés. Il est démultiplié dès qu'il s'agit des start up, ou des jeunes entreprises de moins de cinq ans dont le rôle dans le dynamisme économique est pourtant fondamental.
Comme l'a souligné devant le groupe de travail Jean-Michel Severino « Ce sont sur ces PME que le développement va se concentrer : elles sont l'avenir du moteur de croissance africain, son dispositif d'allumage central. Pourtant, elles sont totalement délaissées. »
Trop d'institutions financières publiques soutenant le secteur privé continuent à avoir des exigences financières excessives vis-à-vis de ces petites entreprises.
À l'image de la création du Fonds d'investissement et de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA) par l'Agence française de développement, il est important que les institutions bilatérales ou multilatérales de financement du secteur privé structurent des compartiments « d'investissements patients », qui puissent bénéficier au social business en général et aux PME en particulier.
C'est pourquoi le Groupe de travail propose de redynamiser cet instrument qui a été sous-utilisé.
|
52) Relancer les dispositifs de capital investissement dans les pme, notamment en redynamisant le Fonds d'investissement et de soutien aux entreprises en Afrique (FISEA). |
F. CRÉER UNE ALLIANCE AVEC LES PAYS AFRICAINS EN VUE DES PROCHAINES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
L'accès à l'énergie durable est un levier essentiel de la croissance verte en Afrique qui dispose de ressources en énergies locales et renouvelables considérables (hydroélectricité, géothermie, énergie solaire ou éolienne, biomasse) qui pourraient lui permettre d'assurer les moyens de son développement. Les sujets liés à l'adaptation au changement climatique sont, par ailleurs, au coeur des préoccupations africaines, notamment liées à l'agriculture, la désertification et les forêts.
De son côté, l'action de la France dans le domaine énergie-développement s'inscrit dans le cadre de stratégies globales de lutte contre la pauvreté, de promotion de la croissance verte et de protection des biens publics mondiaux.
Comme la souligné le dernier CICID : « La politique de développement de la France s'inscrit dans un nouveau cadre, qui associe lutte contre la pauvreté et développement durable dans ses trois composantes : économique, sociale et environnementale »
Cette aide est étroitement liée à notre action contre le changement climatique et ses effets. Depuis 2007, sur les 8,8 milliards d'euros mobilisés par le groupe AFD (AFD + Proparco) sur la thématique énergie, l'énergie durable (énergies renouvelables et efficacité énergétique) est le volet qui a connu la plus forte croissance, avec au total plus de 4,4 milliards d'euros engagés.
Plus spécifiquement sur l'énergie renouvelable, les projets financés par l'AFD portent sur les différentes filières : hydroélectricité, éolien, géothermie, bioénergie, et, depuis 2011, solaire. Le total des engagements du groupe sur les six dernières années dans le domaine des énergies renouvelables est de 2,8 milliards d'euros.
Le Fonds Français pour l'Environnement Mondial a également fait de l'énergie durable en Afrique une priorité pour 2013-2014 et consacrera 5 M€ de subvention en cofinancement au développement de projets innovants, notamment d'accès à l'énergie.
Pour renforcer notre participation à l'Initiative « Accès à l'énergie durable pour tous », SE4All, du Secrétaire général des Nations unies, la France, via le ministère des affaires étrangères et l'AFD, a également mobilisé pour l'année 2013 une contribution spécifique d'assistance technique spécifiquement orientée vers l'Afrique subsaharienne.
L'aide au développement française en faveur des énergies renouvelables et de la croissance verte en Afrique se développe également à travers l'Union européenne qui est aujourd'hui l'un des principaux bailleurs du secteur de l'énergie. L'AFD participe au financement de nombreux projets nationaux et régionaux en Afrique en partenariat avec l'Union européenne. Elle apporte ainsi un soutien important au développement d'interconnexions et de lignes de transports de l'électricité dans le cadre du pool énergétique régional d'Afrique de l'Ouest, a développé des projets de lignes de crédits « efficacité énergétique » et « énergies renouvelables » destinées aux banques locales en Afrique de l'Est, etc.
Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Les pays africains, représentant plus du quart des pays dans le monde, n'ont, comparativement à d'autres Parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), pas une implication très forte dans les négociations. Sous l'impulsion de l'Union africaine, notamment, les pays africains ont récemment tenté d'apparaître unis en adoptant des positions africaines communes.
Les positions de l'UE et de l'Afrique sont assez proches (niveau d'ambition élevé, accord juridiquement contraignant applicable à tous, importance de l'adaptation au changement climatique, soutien aux financements innovants etc.), ce qui s'est traduit par un rapprochement à Copenhague en 2009 ou à Durban en 2011.
Parmi les pays les plus actifs du continent figurent l'Algérie, le Congo, l'Éthiopie, l'Egypte, le Kenya, le Mali, Maurice, le Mozambique, le Nigeria et l'Ouganda. L'Afrique du Sud parvient également à faire entendre sa voix lors des négociations, à la fois en tant que pays du Groupe Afrique et en tant que pays émergent membre du BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine).
La Francophonie est un vecteur intéressant pour mobiliser les Parties africaines francophones, via l'Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD). Le programme NECTAR (Négociations climat pour toute l'Afrique réussies) permet notamment la publication de documents clefs tels que des guides des négociations, des résumés à l'intention des décideurs ou encore des notes de décryptage.
Dans ce contexte, la France hébergera la conférence de 2015. L'objectif est de parvenir à l'adoption d'un nouvel accord ambitieux et applicable à tous. Il permettra ainsi de soumettre tous les émetteurs de gaz à effet de serre à des objectifs de réduction de leurs émissions à partir de 2020 et de limiter à 2°C l'augmentation des températures mondiales d'ici 2100, évitant ainsi de graves dérèglements.
La France partage avec le Groupe Afrique la même volonté de relever le niveau d'ambition de la communauté internationale pour lutter plus efficacement contre le changement climatique. L'alliance qui s'est nouée en 2011 lors de la conférence de Durban entre l'Union européenne, le Groupe Afrique, les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires a été déterminante pour parvenir à un accord visant à l'élaboration d'un nouveau régime international sur le climat. Il apparaît désormais nécessaire de réactiver cette alliance et de continuer à entretenir des relations approfondies avec nos partenaires africains, afin de faire de la COP21 un succès.
D'ici 2015, diverses occasions pourraient être mises à profit pour contribuer à l'obtention d'un accord ambitieux à Paris.
Le Sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique sera une échéance clef. Une partie de l'ordre du jour de ce sommet sera en effet consacrée au changement climatique.
|
53) Créer une alliance avec les pays africains en vue des prochaines négociations sur le climat. |
G. MISER SUR LA COOPÉRATION TRIANGULAIRE EN CAPITALISANT SUR NOTRE COMPÉTENCE PARTENARIALE AVEC LE SUD
Bien qu'elles soient difficiles à mettre en oeuvre, des coopérations triangulaires devraient être favorisées en collaboration avec des partenaires sans passé colonial (Canada, Australie...), avec les émergents démocratiques (Afrique du Sud, Brésil, Inde), comme avec la Chine.
La présence accrue des pays émergents en Afrique constitue une opportunité pour développer des coopérations triangulaires.
Il est nécessaire que les pays émergents augmentent progressivement le pourcentage du revenu national qu'ils consacrent à l'aide au développement, à l'image de la Corée du Sud qui s'est distinguée en s'engageant à tripler le pourcentage du RNB réservé à l'aide publique au développement d'ici 2015.
Outre ces aides financières toujours plus importantes, ces pays peuvent apporter une précieuse contribution, grâce à leur expérience et à leurs compétences pour résoudre les problèmes les plus complexes liés à la pauvreté. Ayant suivi le processus de développement avec succès, ces pays ont une connaissance approfondie des besoins des pays pauvres et les capacités techniques d'innovation pour répondre à ces besoins.
L'adhésion de la Corée au Comité d'aide au développement de l'OCDE est, à cet égard, un événement significatif. En quelques décennies, un pays dévasté et appauvri par la guerre est passé du statut de bénéficiaire de l'aide à celui de donneur après avoir reçu 13 milliards de dollars d'aide. Elle est aujourd'hui un des plus fervents soutiens à la coopération Sud-Sud mais aussi à des coopérations triangulaires.
Les coopérations triangulaires peuvent être une occasion de dialogue, notamment avec les autorités chinoises pour les amener vers les standards de coopération du CAD.
Le rapport de M. Bill Gates aux membres du G20 en 2011 cite à cet égard de nombreux exemples de coopération triangulaire réussie : « le Serum Institute of India a récemment mis au point un vaccin pour la méningite A, le tout premier vaccin créé spécialement pour les pays pauvres. Pour le fabriquer au prix cible de 50 cents la dose, l'institut s'est procuré les matières premières auprès d'une société biotechnologique néerlandaise et a organisé un transfert de technologie à partir de la Food and Drug Administration des États-Unis. Ce processus a commencé lorsque des responsables africains ont demandé un moyen plus efficace pour lutter contre les épidémies de méningite. Les secteurs privé et public dans les pays industrialisés et à croissance rapide ont négocié une solution mutuellement avantageuse pour faire face à ce défi ».
Ces partenariats peuvent tout à fait produire des effets en Afrique comme dans les pays émergents.
Ainsi, la Fondation Total finance au Cambodge une fondation sur le suivi thérapeutique des enfants et des jeunes porteurs du VIH et de la tuberculose qui utilise une expertise africaine sur l'observance des médicaments chez les adolescents mieux connue en Afrique qu'en Asie.
De même, en Inde, certains chercheurs de de l'IRD, affectés en Inde à la CEFIRSE, travaillent avec des collègues chercheurs en Afrique, notamment au Bénin, pour adapter les modèles développés à la CEFIRSE à la mousson africaine.
Le poids des pays émergents dans l'économie mondiale, dans les stocks alimentaires et dans la diffusion des pandémies planétaires va croissant. Leurs communautés scientifiques compteront beaucoup demain et il importe donc de lier aussi des partenariats avec ces pays, qui investissent massivement en Afrique, dans notre zone d'action prioritaire.
|
54) Développer des coopérations triangulaires en collaboration avec des partenaires sans passé colonial (Canada, Australie...), avec les émergents démocratiques (Afrique du Sud, Brésil, Inde), comme avec la Chine. |
VI. DÉFENDRE CETTE AUTRE LANGUE AFRICAINE QU'EST LE FRANÇAIS
A. L'ENJEU DE LA FORMATION AU CoeUR DE LA FRANCOPHONIE
Le constat du groupe de travail est qu'en dépit d'une dynamique démographique positive, la Francophonie en Afrique est en difficulté en raison principalement de la fragilité des systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne.
En Afrique francophone, toute les actions qui permettent de consolider l'accès de tous les enfants à une scolarisation de base de qualité, à l'enseignement moyen, ou à la formation professionnelle concourent à la francophonie et contribuent également à l'acquisition de compétences répondant aux besoins réels de l'économie.
Compte tenu des moyens nécessaires pour faire face au défi démographique, les moyens budgétaires de la France doivent se concentrer sur le renforcement de capacité et les réformes qui permettent l'amélioration de la qualité des enseignements et de la gestion des systèmes éducatifs.
Même dans ce domaine, les moyens bilatéraux sont dérisoires par rapport aux besoins. En 2010 et 2011, l'AFD a apporté un appui technique et financier direct pour l'éducation à hauteur de 54,5 millions dans le domaine de l'éducation dans différents pays (Mali, Burkina, Mauritanie, Burundi, Tanzanie et République centrafricaine), ou à travers des programmes régionaux (soutenus par l'Agence universitaire de la Francophonie - AUF - et l'Organisation internationale de la Francophonie - OIF).
Des efforts importants dans une enveloppe contrainte ont été effectués ces dernières années sous l'impulsion du contrat d'objectif et de moyen (2009-2013) qui tendait à redresser l'effort de l'AFD dans un secteur qu'elle avait quelque peu délaissé. Ainsi la part des dons de l'AFD affectés à l'éducation et la formation professionnelle en Afrique subsaharienne doit passer de 12 % atteints en 2009 à plus de 30 % en 2013, et celle des dons affectés à l'éducation de base en Afrique subsaharienne de 8 % atteints en 2009 à plus de 20 % en 2013.
Il reste que le principal instrument en matière d'éducation reste le Partenariat mondial pour l'éducation (PME). Le PME n'est pas seulement un fonds mondial pour l'éducation, mais c'est aussi une initiative internationale innovante qui permet une articulation forte de l'aide bilatérale, multilatérale et des financements nationaux, en appui à des stratégies nationales solides. Chacun des 46 pays membres a développé une stratégie éducative avec ses propres objectifs en collaboration avec les partenaires locaux qui apportent un soutien financier et technique. Ceci assure une appropriation forte du programme par les partenaires et évite les redondances entre les interventions.
Les pays ayant bénéficié des fonds du PME contribuent activement au financement de leur plan d'éducation : en 2011, ils ont alloué 32,5 Mds$ (soit 19% de leurs dépenses) à l'éducation. En terme de résultats, le taux d'achèvement des études primaires est passé de 56% en 2000 à 68% en 2009 dans les pays ayant bénéficié du soutien du PME, correspondant à une croissance supérieure à celle des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire dans leur ensemble. Quatorze pays pauvres prioritaires de la stratégie française bénéficient de 43% des financements du PME (949 M$ à ce jour).
Depuis 2002, le PME a permis d'engager plus de 3,5 milliards de dollars et d'obtenir des résultats très positifs : entre 2002 et 2011, le PME a contribué à scolariser 23 millions d'enfants supplémentaires. Le nombre d'enfants scolarisés dans les pays africains soutenus par le PME a progressé de 64 %, soit le double du rythme d'accroissement enregistré dans les autres pays. Dans les pays partenaires du PME, le taux d'alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans est passé de 77 % entre 2000 et 2003, à 81 % entre 2007 et 2010, le taux d'achèvement des études primaires est passé de 56 % en 2002 à 71% en 2011. Les filles représentent 62 % des nouvelles inscriptions dans les pays partenaires du PME et 68 % des filles achèvent désormais le cycle primaire, comparé à 56% en 2002. Le PME a contribué à construire 37 000 salles de classe, à fournir 220 millions de manuels scolaires, à former 413 000 enseignants.
Si le nombre d'enfants scolarisés a effectivement augmenté depuis 2000, des obstacles continuent de se poser pour maintenir la qualité de l'éducation et mobiliser les ressources nécessaires au financement de l'éducation de tous les enfants de la planète. En 2012, 57 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont toujours pas scolarisés, le déficit externe de financement de la scolarisation universelle dans le primaire et le secondaire s'élève à 26 milliards USD par année. Il subsiste des groupes importants d'enfants non scolarisés, notamment chez les plus déshérités et les filles. La piètre qualité des apprentissages dans les pays à faible revenu est inquiétante. Les ressources nécessaires pour financer l'éducation sont insuffisantes. Les pays en développement ne cessent d'accroître le montant des ressources qu'ils consacrent à l'éducation, et les bailleurs de fonds du PME ont renforcé leur appui extérieur à ces pays ; mais les financements restent insuffisants, surtout si l'on considère la pénurie d'enseignants et la nécessité d'élargir l'accès à l'éducation secondaire.
Sur le plan multilatéral, la France a joué un rôle moteur dans la conception et la mise en oeuvre du Partenariat. Elle a notamment mis en place une expertise technique rénovée et reconnue destinée à apporter un soutien au montage et à la réalisation des stratégies sectorielles.
Elle fait aujourd'hui partie de la trentaine de donateurs du fonds fiduciaire du PME ; elle y a contribué à hauteur de 20 millions d'euros entre 2005 et 2008 et a signé un engagement de 50 millions d'euros pour les années 2011 à 2013. De plus, deux experts français sont mis à disposition du secrétariat de l'institution placé auprès de la Banque mondiale à Washington.
La France a bénéficié d'une capacité d'influence importante, aujourd'hui amoindrie par l'omniprésence des Britanniques et des Australiens, premiers bailleurs de l'organisation. Elle a ainsi pu peser sur la géographie d'intervention du PME : 80 % des crédits sont aujourd'hui attribués aux pays de notre zone de solidarité prioritaire.
C'est pourquoi le groupe de travail insiste pour que la France renforce sa participation au partenariat mondial pour l'éducation.
|
55) Renforcer sa participation au Partenariat Mondial pour l'Education. |
B. ASSOCIER DES FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AU DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
La politique de formation en Afrique subsaharienne devra combler le décalage entre l'offre et la demande d'emploi et, au-delà, l'inadéquation entre les compétences actuellement enseignées et les besoins des entreprises.
Nombreux, aujourd'hui, sont les pays africains qui s'accordent dans leurs politiques sectorielles pour lier «formation professionnelle», «emploi» et «croissance». Dans les pays en transition qui ont réussi la scolarisation de base, l'enjeu porte sur l'adaptation permanente de la capacité nationale de formation à l'élévation régulière des besoins en compétences des entreprises. Dans les pays les moins avancés qui restent tributaires de nombreuses contraintes structurelles, l'enjeu porte sur la création ou la rénovation de systèmes souples et multiformes de formation pour développer l'employabilité de la population active.
Dans tous les cas, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, une majorité de jeunes africains sont victimes d'une politique de formation inadaptée, entre les compétences enseignées et la demande des employeurs. S'ils ont pu bénéficier d'une scolarité dans le secondaire ou, pour certains, ont eu accès à l'Université, ils n'ont pas acquis les compétences recherchées par les entreprises. Les offres d'emplois se concentrent sur des qualifications techniques, de la supervision des processus de fabrication et de la qualité dans les secteurs exportateurs.
Alors même que l'Afrique est la région du monde qui compte la plus forte proportion d'étudiants dans les filières littéraires et des sciences sociales, ce décalage entraîne inéluctablement une inadéquation de la formation aux besoins des entreprises et, par la suite, un chômage massif.
De nombreux pays sont en train de structurer des fonds de financements de la formation professionnelle. Les finalités et modalités d'intervention des fonds se différencient selon le niveau économique des pays. Ainsi dans beaucoup de pays d'Afrique sub-saharienne où l'emploi dit «informel» représente entre 80 % et 90 % des emplois et où le niveau scolaire est faible, les formations d'artisans sont prédominantes tandis que dans des pays semi-industrialisés comme l'Afrique du sud, où le secteur industriel représente 30 % des emplois avec un important secteur tertiaire moderne, les demandes adressées aux fonds proviennent davantage des secteurs dits «modernes». Les fonds interviennent comme appui de la structuration des systèmes de formation professionnelle qui sont en plein développement.
La France a un système de formation professionnelle très développé. L'Agence française de développement et les syndicats professionnels doivent s'associer aux pouvoirs publics locaux, écoles, universités et entreprises pour répondre à une demande croissante d'expertise dans un domaine particulièrement stratégique en matière d'influence économique.
Le modèle de l'Institut des métiers de l'aéronautique de Nouaceur (Casablanca- Maroc) fournit un exemple particulièrement réussi de ce que la coopération française dans ce domaine peut faire de mieux.
Cet institut a pour objectif de former des opérateurs, des techniciens et des cadres intermédiaires en langue française. Cet institut, fonctionnant sur le principe du partenariat public (Ministère de l'Emploi, de la formation professionnelles, de l'Industrie, de l'Économie et des Finances, AFD) et privé (groupement des industries aéronautiques et de l'IUMM français) assure également la formation professionnelle tant sur les coeurs de métiers que sur les activités support et annexes (qualité, marketing).
Le groupe de travail estime que ce modèle de formation, mixte et concret, permet une politique de formation et d'emploi, lisible et efficace.
Il pourrait aisément s'adapter aux secteurs de l'automobile, de la téléphonie, du textile, de l'habillement, dans le cadre d'un rayonnement économique régional voire international. Il pourrait s'enrichir d'une politique d'échanges et de mobilité avec les partenaires français et européens francophones.
|
56) Promouvoir des partenariats public-privé en faveur du développement de système de formation professionnelle en Afrique. |
C. DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS FRANCOPHONES
Or on observe actuellement deux phénomènes s'agissant de l'accueil des étudiants africains en France : d'une part, les familles n'ont souvent plus les moyens financiers d'envoyer leurs enfants en France et privilégient des universités francophones du continent africain, comme les universités marocaines ; d'autre part, pour les familles dont les revenus sont plus élevés, les premiers cycles de l'université française sont peu attractifs et subissent pleinement la concurrence universitaire internationale, les étudiants se tournant vers les structures de pays qui ne sont pas forcément francophones. Dans les deux cas, c'est la qualité d'accueil de ces publics dans les universités françaises qui est en question.
En dehors des propositions relatives à l'accueil des étudiants, le Groupe de travail estime que les partenariats entre les universités françaises et africaines peuvent être une solution d'avenir. A une époque où la France soutient l'université Paris-Sorbonne-Abou Dhabi, créée par un accord de coopération internationale entre l'université Paris-Sorbonne et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'émirat d'Abou Dhabi, (Émirats arabes unis), il estime qu'un projet comparable, par exemple à Dakar avec la création d'une grande université francophone en lien avec une université française et les instances de la Francophonie, permettrait d'attirer les étudiants francophones d'Afrique de l'Ouest vers un enseignement en français délivré par des professeurs francophones originaires d'Afrique ou de pays francophones dont la France.
Un autre moyen de garder dans l'orbite francophone les meilleurs étudiants pourrait consister à encourager, par exemple par des bourses, la cotutelle de thèse (disposition permettant à un étudiant d'effectuer son travail de recherche sous la responsabilité de deux directeurs de thèse : l'un en France et le second dans son pays).
|
57) Créer une université francophone pilote à l'image de la Paris-Sorbonne-Abou Dhabi. 58) Encourager le développement de thèses en cotutelle franco-africaine. |
D. PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE EN LIGNE
Troisième révolution après l'invention de l'écriture et celle de l'imprimerie, la révolution numérique apparaît comme une opportunité pour diffuser la langue française et le savoir-faire français et un défi.
Une opportunité, celle de repenser l'élaboration et la transmission des savoirs, de manière interactive, en mettant les étudiants en France comme en Afrique au coeur du projet pédagogique de l'enseignement supérieur. Un défi, celui de construire une université performante, innovante et ouverte sur le monde.
Le développement des cours en ligne (Massive Open Online Course) dans les dix prochaines années redéfinira la carte universitaire internationale.
Les cours en ligne se multiplient; ces cours ouverts et massifs, désignés sous l'acronyme MOOCs (massive open online courses), sont nés il y a quelques années aux États-Unis. Ces cours en ligne sont non seulement gratuits et accessibles à distance, mais ils peuvent déboucher sur une certification. Ces cours, auxquels sont associés un accompagnement pédagogique et la possibilité d'interagir avec les enseignants et les autres participants, permettent de former des étudiants de tous les continents.
La France a un rôle à y jouer, à la hauteur de la qualité de son enseignement et de sa recherche, en termes de coopération avec les pays en développement et les pays francophones. La diffusion de cours en ligne, en français, demeure une expression forte de sa politique en faveur de la francophonie.
Aux Etats-Unis, des plateformes numériques privées ou publiques présentent aux étudiants du monde entier des cours dans toutes les disciplines. Sur certaines plateformes on peut compter jusqu'à 4 à 5 millions d'inscrits sur les quelques 500 cours en ligne. Un des premiers MOOCs a été suivi par 160 000 inscrits dans le monde, faisant dire à son créateur qu'il lui aurait fallu dispenser 250 ans de cours en amphithéâtre pour toucher un tel public.
Il s'agit là d'une rupture fondamentale car jamais auparavant une mise à disposition des connaissances sous une forme aussi élaborée que celle-ci n'avait été possible.
Le Gouvernement a annoncé la création d'une fondation chargée de susciter et de coordonner une offre de formation d'enseignement numérique innovante et d'offrir une meilleure visibilité nationale et internationale à l'offre française, de proposer une première plateforme comme outil d'intérêt commun pour héberger les formations numériques des établissements, qu'il s'agisse de MOOCs certifiant, de formations en ligne diplômant es ou qualifiantes.
Le C.N.R.S., Sorbonne Paris Cité, l'Ecole Centrale Paris, Paris 10 et l'E.H.E.S.S., le CNAM, l'Ecole Polytechnique, Sciences-Po, H.E.C., l'Institut Mines Telecom ont déjà mis en place des dispositifs d'enseignement à distance.
Des partenariats européens se sont également noués, entre Paris 5, l'université de Berlin et l'INRIA, France Université Numérique étant ouverte à l'ensemble de nos partenaires.
L'Institut de la Banque mondiale s'est investi dans des programmes de formation à distance, de même que le CEFEB, organe de formation de l'AFD, qui vise à devenir une Université virtuelle. L'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (CI2E) basé à Ouagadougou a ouvert la voie dans les pays francophones. L'Agence universitaire de la francophonie (AUF) peut également dans ce domaine jouer un rôle essentiel pour rendre accessible au Sud l'enseignement supérieur et promouvoir en même temps la francophonie. Association d'universités fondée en 1961 à Montréal, l'AUF elle-même a très tôt contribué à la création de campus numériques. L'AUF dispose aujourd'hui d'une soixantaine de lieux sécurisés et équipés pour permettre la formation à distance.
Le groupe de travail invite le Gouvernement à poursuivre son effort en faveur des universités numériques en coordination avec les partenaires francophones.
|
59) Développer des universités numériques en coordination avec les partenaires francophones. |
VII. MIEUX ACCUEILLIR LES ÉLITES AFRICAINES DE DEMAIN
A. REMETTRE DE LA COHÉRENCE ENTRE NOTRE POLITIQUE D'INFLUENCE ET NOTRE POLITIQUE DES VISAS
Le groupe de travail a constaté que la possibilité pour les élites africaines de venir en France pour étudier ou faire des affaires s'est réduite drastiquement avec la politique de restriction migratoire, la réduction des visas de moyen séjour et la chute des bourses universitaires.
Il estime que nous devons transformer notre politique des visas pour en faire un véritable outil au service de l'attractivité des élites africaines. Une approche trop étroite a probablement prévalu dans le passé en privilégiant excessivement une politique migratoire restrictive au détriment de notre politique d'influence.
Depuis 2011, l'abrogation de la circulaire Guéant et les instructions adressées aux consulats afin de faciliter la délivrance des visas de circulation à destination des hommes d'affaires, des chercheurs, des universitaires, des artistes, des intellectuels et des touristes ont globalement amélioré la situation. Des partenariats avec les entreprises visant à faciliter la circulation de leurs employés et de leurs clients sont également proposés.
Ces visas à entrées multiples permettent à leurs titulaires d'entrer et de sortir à plusieurs reprises de l'espace Schengen sans être contraints de demander un nouveau visa à chaque déplacement. Leur durée de validité, comprise entre 6 mois et 5 ans, permet de séjourner en France et dans l'espace Schengen 90 jours par période de 6 mois.
Il a également été demandé aux postes de multiplier les listes d'attention positive et de développer les partenariats avec les entreprises, chambres de commerce, universités ou organisations professionnelles pour mettre en place au bénéfice de leurs employés ou membres des procédures simplifiées.
Au lieu d'envoyer un message généralisé de renfermement, la France commence de nouveau à adresser un message de bienvenue à tous ceux qui, par leur activité ou leur visite, contribuent à notre croissance.
De nombreux efforts restent à faire pour simplifier la chaîne d'accueil et encourager la dématérialisation et la simplification des procédures d'inscription et de délivrance des visas et, en particulier, des titres de séjour valables pour toute la scolarité.
Aujourd'hui, la législation française impose à des hommes d'affaires en lien permanents avec la France ou à chercheurs de haut niveau de renouveler, parfois tous les trois mois ou chaque année, des visas au prix d'une longue procédure, d'une journée d'attente à la préfecture, avec un résultat toujours incertain.
Actuellement, par exemple, pour entrer sur le territoire français, les étudiants inscrits en doctorat et les scientifiques-chercheurs titulaires d'une convention d'accueil visée par le préfet doivent être bénéficiaires d'un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) valable un an, portant la mention « étudiant » ou « scientifique chercheur ».
Les étudiants doctorants et les scientifiques chercheurs peuvent se voir délivrer à l'issue de leur VLS-TS ou de leur carte de séjour, pour ceux déjà présents sur le territoire français, une carte de séjour pluriannuelle (L. 313-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
La durée de cette carte doit correspondre, pour les doctorants, à la durée prévisible du doctorat, dans la limite de quatre ans et, pour les scientifiques chercheurs, à la durée prévisible de leurs travaux prévue par la convention d'accueil. Cette possibilité a cependant été très peu utilisée puisque 3 000 ont été délivrées en 2011 pour 280 000 étudiants.
L'impact de toutes ces contraintes est considérable. Les hommes d'affaires comme les chercheurs doivent en effet pouvoir se projeter dans l'avenir, à moyen ou long terme. Le fait, pour eux, de ne pas être assurés de leur avenir et de ne pas savoir si leur titre de séjour sera renouvelé les place dans une insécurité qui n'est guère propice à des relations de travail confiantes.
Le groupe de travail est en conséquence favorable à une modification au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) visant à favoriser les conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle -expérience qualifiante- pour les étrangers tout juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français, mais aussi à sécuriser la situation des étudiants étrangers en France et limiter les démarches administratives, souvent vexatoires, qui les épuisent et les précarisent tout en encombrant inutilement les services préfectoraux.
Le groupe de travail préconise des visas pluriannuels, calqués sur la durée des études et intégrant, comme pour les bourses, une année supplémentaire Ainsi, l'étudiant étranger qui aurait accompli une année d'études en France obtiendrait un titre de séjour pluriannuel : d'une durée de trois ans s'il prépare un diplôme équivalent à la licence ; de deux ans pour le master ; d'une durée de quatre ans pour un diplôme de doctorat.
Il propose un droit illimité au séjour en France pour tout diplômé d'un doctorat obtenu en France auquel la carte « compétences et talents » serait délivrée sur demande. En effet, qu'ils choisissent de retourner dans leur pays d'origine ou de mener une carrière internationale, ces experts garderont toute leur vie un lien très étroit avec la France et seront ses meilleurs ambassadeurs.
Ces dispositions permettront de restaurer notre influence, il est capital de retisser des liens humains dans les deux sens et de faciliter la circulation des hommes et pas seulement des marchandises.
Elles devront être complétées par des mesures de nature à améliorer l'accueil des personnes dans les consulats.
Le groupe de travail estime qu'il faut améliorer les conditions d'accueil dans les consulats.
Avec 821 personnels dédiés, dont seulement 237 agents titulaires pour traiter 2,4 millions de demandes, la France est en difficulté là où la demande est exponentielle, ce qui n'est pas encore le cas de l'Afrique. Le rapport Fitoussi-Barry de Longchamp a fait apparaître un retard par rapport à nos partenaires Schengen qui sont pourtant, sauf exception comme l'Allemagne, moins vigilants que nous pour la délivrance des visas Schengen. Nous avons la productivité agent la plus élevée. L'externalisation est une solution, appliquée avec beaucoup de prudence en Afrique (Lagos, Dakar bientôt, Afrique du Sud).
Le groupe de travail estime que chaque ambassade devrait élaborer un plan sur l`accueil à partir d'un diagnostic. Des mesures d'accompagnement sont prévues, notamment pour revaloriser la fonction consulaire et les carrières qui s'y déroulent.
Des mesures destinées à attirer les futures élites nationales par une politique de bourses universitaires beaucoup plus dynamique permettraient aux universités françaises de mieux faire face à la concurrence des universités anglo-saxonnes.
Au-delà de la période de formation initiale, il convient de structurer des dispositifs d'échanges qui permettent à des universitaires et des professionnels établis dans leurs pays d'exercer leur métier une partie de l'année en France sous la forme de « doubles-chaires ». Ces dispositifs permettraient de lutter également contre la fuite des cerveaux.
|
60) Modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) visant à favoriser les conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle -expérience qualifiante- pour les étrangers tout juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français. 61) Instaurer des visas pluriannuels, calqués sur la durée des études. 62) Élaborer dans chaque ambassade un plan d'accueil des demandeurs de visas. |
B. ACCUEILLIR LES TALENTS
La France mène depuis des années une politique d'accueil de personnalités d'avenir, soit à travers le quai d'Orsay et son Programme d'invitation des personnalités d'avenir (PIPA), l'ENA, les grandes écoles militaires, mais également à travers des politiques de partenariats et d'échanges universitaires, notamment dans le domaine de la médecine.
Ces programmes ont fortement souffert ces dernières années de la diminution des crédits. Le programme PIPA, à titre d'illustration, est à la croisée des chemins. Apprécié tant par les postes diplomatiques que par les intéressés eux-mêmes, il doit faire face depuis 2011 à une réduction de 30% de ses moyens budgétaires.
Ces restrictions conduisent à sélectionner des profils de candidature sur la base de priorités géographiques ou sectorielles parmi lesquelles l'Afrique conserve une place de choix. Mais beaucoup plus pourrait être fait pour démultiplier l'effet de ces invitations, souvent judicieusement ciblées : réunions d'alumni en France ou sur le continent, animation de réseaux d'anciens invités et étudiants à leur retour dans leur pays.
De même, le dispositif « Quai d'Orsay/Entreprises », cofinance des bourses avec des entreprises françaises auxquelles leurs succès industriels et économiques, notamment dans les technologies de pointe, assurent une présence reconnue sur la scène internationale, à destination d'étudiant(e)s étrangers issus des meilleurs établissements d'études de leur pays d'origine.
Pour ouvrir à ces étudiant(e)s l'accès, dans les meilleures conditions possibles, à un cursus d'études supérieures dans un établissement d'enseignement supérieur français de renom, en lien direct avec le monde professionnel, le dispositif « Quai d'Orsay/Entreprises » propose aux entreprises des conventions de partenariat permettant d'associer les moyens du ministère des affaires étrangères à ceux du secteur privé, de Grandes écoles et universités françaises renommées.
Le ministère des affaires étrangères assure la coordination de ces partenariats, s'engage à l'étranger dans l'information en direction des meilleurs étudiants des établissements locaux sur chacun des programmes de bourses, apporte l'expertise de son réseau de coopération culturelle et scientifique, et attribue aux lauréat(e)s le statut de Boursier du Gouvernement français à travers la couverture sociale et les avantages qui s'y attachent (facilités de demande de visa, activités culturelles, etc.) ; il propose également aux boursiers des cours de français intensifs avant leur départ, dispensés dans leur pays d'origine au sein des Alliances françaises.
Ces initiatives en partenariat entre le dispositif public et les entreprises privées doivent être encouragées.
|
63) Redynamiser la politique d'accueil de personnalités d'avenir. 64) Développer le dispositif « Quai d'Orsay/Entreprises ». 65) Entreprendre une gestion dynamique du réseau des anciens élèves des Lycée français à l'étranger et des anciens boursiers etc. |
C. DÉVELOPPER LE DIALOGUE SUR LA QUESTION MIGRATOIRE
Le dernier CICID de juillet 2013 souligne que : « Le Gouvernement relève que politique de développement et politique migratoire doivent être en cohérence. Il reconnaît le rôle des migrations pour le développement des pays partenaires. Les migrants sont des acteurs du développement. Ils y contribuent par leurs apports financiers, techniques et culturels. L'articulation entre politique migratoire et politique de développement s'inscrit dans l'approche globale des migrations adoptée par le Conseil européen en 2005 et mise en oeuvre par l'Union européenne. Cette méthodologie a vocation à s'appliquer à tous les pays concernés. »
Le groupe de travail constate, quant à lui, que cette question migratoire est, du fait des déséquilibres démographiques entre l'Afrique et l'Europe, une question tout à fait essentielle pour les décennies à venir.
Il observe que le Gouvernement a souhaité rompre le lien établi par la majorité précédente entre les questions migratoires et le financement des actions de développement solidaire en estimant qu'il ne pouvait proposer à nos partenaires africains ce qui pouvait s'apparenter à une forme de chantage.
Il reste que la contractualisation et le dialogue sur les questions des migrations entre l'Europe et les pays africains restent une question essentielle.
Certes, les accords de gestion concertée des flux migratoires étaient très déséquilibrés. La forme des accords, très solennelle, « la France s'engage », contrastait avec le fond qui reprenait, pour l'essentiel, tout en les aménageant, des dispositifs existants. Sur certains points, comme l'admission au séjour pour une première expérience professionnelle, les régimes accordés apparaissaient parfois moins favorable que le droit commun. Quant aux crédits destinés au développement solidaire, ils étaient particulièrement limités.
Ces quelques accords passés avec le Sénégal le Burkina Faso et le Cameroun, comme avec la Tunisie, avaient pour ambition de construire une approche globale, combinant entrées régulières d'étudiants et de salariés, coopération sur la surveillance des frontières et pour la réadmission des irréguliers. Le volet modeste de « développement solidaire » n'avait pas vocation à « acheter » cette coopération (avec 30 millions par an pour tous les accords, c'eût été prétentieux) mais à amorcer une discussion sur les actions susceptibles d'aider à fixer les populations candidates au départ.
Ils avaient l'avantage d'institutionnaliser ce dialogue qui doit se poursuivre tant au niveau bilatéral qu'européen. La France soutient l'« approche globale sur la question des migrations », dont l'UE s'est dotée en 2006. Les principaux outils de mise en oeuvre de cette approche sont la conclusion de « partenariats pour la mobilité » visant à faciliter et mieux encadrer la migration légale avec les pays du voisinage immédiat, et la mise en place de « programmes pour la mobilité et les migrations » pour les pays tiers. Un dialogue se tisse notamment entre l'Europe et l'Afrique sur le lien entre migration et développement, tant au niveau bilatéral que régional, avec le processus euro-africain sur la migration et le développement («processus de Rabat ») et le dialogue ACP-UE sur les migrations.
La majorité des Etats africains sont demandeurs d'une régulation de flux légaux, de l'organisation de migrations circulaires, avec retour au pays des cadres formés en France, d'une meilleure utilisation du potentiel que représentent les diasporas. Cela peut s'accompagner d'une stratégie d'attractivité des talents étudiants qui pourraient rester en France aussi bien qu'aider leur pays, l'essentiel étant que notre rayonnement, la conquête de marchés exports, les prises de participation soient facilités par tous ces « ambassadeurs » que seront les étudiants formés en France.
A l'inverse, renoncer à passer des accords sur les flux migratoires revient à s'exposer à une dégradation des relations bilatérales avec les pays sources, en raison de l'augmentation des clandestins et des mesures de réadmission.
Il faut en effet avoir à l'esprit les chiffres évoqués au chapitre 1, la population africaine estimée à 1 milliard en 2010, les prévisions de l'ONU tablent sur 2,2 milliards en 2040, à moins d'une génération ! Le nombre des 20 à 39 ans va passer de 350 à 620 millions. Les marchés du travail locaux auront, malgré le décollage économique, des difficultés à absorber de telles demandes d'emploi et l`Europe sera plus que jamais un Eldorado. Surtout si les appareils universitaires se développent et, comme en Tunisie, mettent au chômage des milliers de diplômés.
Ce sont les pays actuellement les plus pauvres, avec une population modeste aujourd'hui, qui vont connaître les hausses les plus fortes : Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso passeront ensemble de 57 à 160 millions d'habitants. Ils sont en partie francophones, avec une diaspora qui peut augmenter si les couches moyennes enrichies cherchent à s'installer en France et accueillir ses compatriotes.
Les géants que sont le Nigéria, l'Egypte et la RDC connaîtront une croissance spectaculaire en volume : 360 millions au Nigéria !! Et plus qu'un doublement en RDC (de 62 à 148 millions). Madagascar passera de 21 à 50 millions.
La pression migratoire va donc augmenter. La croissance des flux peut être progressive mais aussi marquer des accélérations d'opportunité, comme lors du printemps arabe qui a mis sur les routes de l`immigration, en plus des Africains travaillant en Libye, des ressortissants d'Afrique subsaharienne et de la corne orientale (Soudan, Somalie, Ethiopie). Toute déstabilisation d'un des « Etats tampons » du Maghreb pourrait entrainer des mouvements très importants.
Par ailleurs, le contexte de récession et de crise économique qui s'annonce pour notre pays, tout comme pour la majeure partie des Etats européens, fait peser une lourde hypothèque sur notre capacité à accueillir les migrants issus d'une relance de la migration de travail dans de bonnes conditions. Les capacités d'emploi et de logement que peut offrir notre pays se trouveront nécessairement affectées.
Un dialogue sur ce sujet avec les pays riverains de la Méditerranée et les pays africains est donc plus que jamais nécessaire. Le drame de Lampedusa ne fait qu'en souligner la nécessité.
C'est pourquoi le Groupe de travail se prononce en faveur d'une relance du dialogue avec les pays d'origine sur les questions migratoires, avec la constitution de groupes de suivi paritaires qui permettent d'échanger les points de vue et les données sur les migrants, la réadmission des personnes en situation irrégulière, la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et la fraude documentaire.
En termes de politique publique, l'articulation entre migrations et développement doit également être repensée.
Toutes les études soulignent le rôle important des migrants dans les dynamiques de développement des pays africains aussi bien en matière de transfert de fonds, qui sont plus importants que l'APD, que de formation. Quel dialogue engager avec les pays partenaires et comment prendre en compte, de manière transversale, ce sujet dans les politiques de développement ? Comment réduire plus efficacement les écarts de richesse, causes majeures des migrations, notamment en incitant les migrants à être des acteurs du développement ?
La France prend en compte le lien entre migrations et développement depuis plusieurs années à travers les projets de codéveloppement menés en partenariat avec les associations et le soutien aux transferts de fonds des migrants.
Convaincue de l'importance des transferts d'argent des migrants pour le développement, la France a oeuvré en faveur de l'adoption au G20 à Cannes, en 2011, d'un engagement de réduction d'ici 2014 des frais moyens d'envoi de fonds de 10 à 5% du montant transféré.
Le groupe de travail estime que le Gouvernement devrait lancer une évaluation des projets de développement solidaire menés ces dernières années et reformuler des propositions sur la base de ces évaluations.
|
66) Relancer le dialogue avec les pays d'origine sur les questions migratoires, avec la constitution de groupes de suivi paritaires. 67) Redéfinir une stratégie de promotion du développement solidaire. |
VIII. PORTER NOTRE POLITIQUE AFRICAINE AU NIVEAU EUROPÉEN ET MULTILATÉRAL.
La France entretient avec les pays africains des relations bilatérales intenses, mais elle est également fortement engagée dans des instances communautaires et multilatérales qui ont une importance majeure sur le continent.
A. PARTAGER L'ENJEU AFRICAIN AVEC NOS PARTENAIRES EUROPÉENS
Le Groupe de travail a fait le constat que l'Europe peine à formuler et à mettre en oeuvre une politique africaine ambitieuse. Cela tient en partie aux instruments, la politique étrangère commune et encore plus la défense européenne n'en sont qu'à leurs débuts. Cela tient également à l'absence d'une volonté politique partagée.
L'union est engagée dans un double processus d'élargissement et de voisinage à l'est avec les Balkans occidentaux et les six pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine).
Dans le premier cas, des pays pour lesquels l'adhésion à l'UE n'est qu'une question de temps, depuis le Conseil de Thessalonique en 2003, et dans le second groupe, des pays pour lesquels la question de l'adhésion est encore du « non-dit », comme en suspens. Les pays des deux groupes sont pourtant incontestablement des « voisins européens », pas des voisins de l'Europe », qui en appellent à notre responsabilité historique.
L'Europe est ensuite particulièrement sensible à l'évolution des voisins immédiats de la Méditerranée à la suite des printemps arabes. C'est là un sujet essentiel qui est intimement lié à la problématique africaine.
Il reste donc à convaincre nos partenaires de l'importance stratégique de l'Afrique. Pour cela, il faut faire admettre qu'il y a pour l'Europe une différence de nature entre les enjeux du développement mondial et celui de l'espace euro-méditerranéo-africain.
Le premier pose la question du poids de l'Europe dans les questions globales. C'est la question de la capacité collective de l'Europe d'être à la place que lui confère son poids économique dans les négociations mondiales et dans le monde des grands bailleurs de fond multilatéraux et régionaux.
Le second pose la question multiforme de la gestion d'une proximité, avec toutes les conséquences économiques, politiques et humaines qui en découlent, et qui appellent une politique articulant tous les acteurs des sociétés européennes et africaines.
Il faut distinguer la définition de l'espace européen, d'une part, et celle de l'espace au sein duquel l'Europe pourra relever les défis qui se posent à elle, d'autre part.
Il n'y a en effet pas de puissance économique sans capacité d'aménagement de son espace, certes organisé en centres et périphéries mais en vue d'une prospérité commune. Il s'agit ni plus ni moins d'augmenter la croissance potentielle de l'Europe en l'arrimant à l'un des moteurs de la croissance économique mondiale de ces prochaines années.
Comme nous l'a dit Jean-Michel Debrat, directeur de l'Agence de l'AFD en Afrique du Sud : « il faut penser l'espace Europe-Afrique comme un marché intérieur, un bassin d'emploi, un unique espace de sécurité, comme un espace territorial de développement économique et financier ».
Il faut penser cet espace comme un Marché Intérieur en construction appelé à tirer la croissance. L'Europe n'a pas plus intérêt à laisser l'Afrique en situation de sous-développement que la Chine l'ensemble de son territoire national.
Il faut penser l'Eurafrique comme un bassin d'emplois dont les différentiels de coût de main-d'oeuvre doivent être « utilisés » de manière positive. La problématique du Maghreb n'est pas très différente de celle de l'Europe centrale et les mouvements de population doivent être envisagés de facto à l'intérieur de ce grand ensemble.
Pour l'Europe aussi la stratégie de population ne peut être que globale et va avoir pour enjeu la maîtrise des coûts et la maîtrise des migrations, la faible compétitivité de sa main-d'oeuvre et les difficultés de contrôle des mouvements migratoires.
On ne pourra pas longtemps repousser la définition des solidarités internes à l'espace européen et, parallèlement, la définition de la solidarité de l'Europe vis-à-vis des pays du sud, tant ces deux questions sont liées.
Il faut penser cet espace comme un unique espace de sécurité ; cette idée est ancienne mais elle a connu une évolution très rapide. Avant les années 80, le contexte de la guerre froide l'emportait, puis ce fut le souci d'exporter la démocratie et de créer les conditions d'une bonne gouvernance, enfin, depuis le 11 septembre 2001, la préoccupation de sécurité a pris le pas. L'Afrique est trop proche, tant au sens géographique qu'en termes de population, de l'Europe pour que l'on puisse y voir se multiplier des « Etats fragiles » sans que l'Europe ne soit directement concernée : cette problématique a remplacé aujourd'hui celle de la guerre froide.
En toute hypothèse, l'Union européenne doit contribuer à améliorer la capacité des Etats à prévenir les conflits.
Elle a commencé à le faire avec la facilité « Paix pour l'Afrique » qui permet de financer des interventions militaires. Mais il faut bien sûr se placer plus en amont : les problèmes dits « de sécurité » (migrations anarchiques, violences civiles, terrorisme, etc.) résultent pour une large part des dysfonctionnements de l'aménagement de l'espace et de défaillances institutionnelles.
Cette conviction-là, la France doit la porter chez nos partenaires européens.
|
68) Définir une stratégie africaine de la France dans les instances européennes. |
B. DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE AFRICAINE AU NIVEAU MULTILATÉRAL
Au cours des années 2000, une série de crises (sanitaire, alimentaire, environnementale, financière, sociale) a révélé des déséquilibres profonds du système économique, qui mettent au défi l'action collective internationale.
La communauté internationale prend conscience du besoin de réguler davantage les interdépendances liées à la mondialisation. Certains progrès ont ainsi été permis par les décisions prises au moment de la crise financière : meilleure représentativité des structures (création du G20, réforme des institutions financières internationales), développement d'une gouvernance mondiale des marchés financiers (création du Conseil de stabilité financière).
Parce qu'elles associent pays développés, pays émergents et pays en voie de développement, et parce qu'il est rapidement devenu clair qu'une réponse efficace à ces défis impliquerait des transferts importants de ressources et de savoir-faire entre ces acteurs du Nord et du Sud, les institutions d'aide publique au développement (APD) se sont retrouvées au coeur de ce double effort de solidarité et de régulation.
Après une longue décennie d'interrogations sur son sens et son efficacité, l'APD a renoué avec la dimension stratégique qui était la sienne au cours de la guerre froide. Rehaussée au niveau de la diplomatie et de la défense dans la stratégie de sécurité américaine dite des « 3D » (diplomatie, défense, développement), l'aide au développement a dépassé l'approche essentiellement caritative qui avait marqué les années 1990 et 2000 pour constituer un instrument de gestion des interdépendances dont l'Afrique est le premier champ d'application.
De fait, un ensemble de politiques publiques multilatérales se sont mises en place en Afrique (santé publique, sécurité alimentaire, stabilité financière, éducation et culture, promotion des énergies renouvelables, etc.), ce qui se traduit par la densification du tissu institutionnel (OMS, PAM et FAO, FMI, UNESCO, IRENA...).
Ces organisations participent aux processus d'édiction de normes internationales (négociations climat, comité de Bâle, etc.), au suivi statistique, au financement de projets et/ou à l'assistance technique aux Etats ne disposant pas de capacités suffisantes pour traiter des vulnérabilités susceptibles d'avoir des effets au-delà de leurs frontières.
La France accompagne depuis une décennie la montée en puissance des grandes banques multilatérales et régionales, telle que la Banque mondiale qu'elle finance à hauteur de plus de 460 millions d'euros par an, afin d'orienter leur programmation vers les zones prioritaires de la France et en particulier vers l'Afrique subsaharienne.
Elle a également promu le développement d'une politique de coopération européenne à travers le FED, auquel la France contribue pour près de 800 millions d'euros par an.
Elle a enfin été à l'initiative de la mise en place de nouveaux instruments comme le Fonds mondial de lutte contre Le sida, la tuberculose et le paludisme auquel elle contribue désormais à hauteur de 360 millions d'euros par an, soit, depuis sa création, une contribution de près de 3 milliards d'euros.
Principales contributions nettes de la France aux organisations multilatérales, comptabilisées en APD
|
en millions d'euros |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
|
(LFI) |
PLF |
||||||||
|
Union européenne |
FED |
698 |
777 |
837 |
909 |
686 |
576 |
694 |
|
|
Budget communautaire |
877 |
975 |
1 245 |
1 100 |
1 056 |
978 |
968 |
||
|
Total |
1 575 |
1 753 |
2 083 |
2 009 |
1 742 |
1 554 |
1 662 |
||
|
Banque mondiale (BM) |
395 |
379 |
454 |
658 |
493 |
462 |
468 |
||
|
Banque Africaine de Développement (BAfD) |
126 |
137 |
129 |
132 |
141 |
141 |
141 |
||
|
Banque Asiatique de Développement (BAsD) |
30 |
30 |
24 |
24 |
36 |
24 |
23 |
||
|
Banque interaméricaine de développement |
8 |
7 |
7 |
||||||
|
Fonds Monétaire International (FMI) |
-23 |
28 |
587 |
247 |
-5 |
196 |
198 |
||
|
Organisations des Nations unies (ONU) |
172 |
190 |
188 |
192 |
153 |
163 |
169 |
||
|
Fond Mondial pour la Lutte contre le Sida, la Tuberculose, et le Paludisme (FMLSTP) |
286 |
300 |
300 |
300 |
360 |
360 |
360 |
||
|
Facilité Internationale pour le Financement de la vaccination (IFFIm) |
20 |
41 |
43 |
45 |
48 |
51 |
54 |
||
|
Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) |
34 |
34 |
35 |
34 |
64 |
64 |
34 |
||
Sources : Versements déclarés au titre de l'APD brute au CAD de l'OCDE pour les années 2006-2011 (versements nets pour le FMI). Montants inscrits en loi de finances pour 2012 et en prévision du PLF 2013.
La France poursuit cet effort important sans définir une stratégie concertée de ses contributions multilatérales, ni a fortiori de stratégie africaine.
Le groupe de travail ne peut qu'insister sur la nécessité de se fixer des objectifs de partenariats entre nos actions bilatérales et les actions multilatérales en Afrique des organismes auxquels la France contribue.
Sur le terrain, de nombreux interlocuteurs ont souligné la faible articulation entre les agences bilatérales et les agences multilatérales.
Lorsque la commission des affaires étrangères a organisé une table ronde sur le document-cadre d'aide au développement, certains intervenants ont souligné combien il était difficile de combiner les efforts des agences bilatérales et des instances internationales. M. Jean-Michel Severino ancien directeur général de l'AFD, vice-président de la Banque mondiale a observé ainsi que cela était « plus difficile encore au niveau européen qu'au niveau international » jugeant « opportun de définir un objectif d'influence en la matière » et de « prévoir une stratégie plus offensive à l'égard de l'aide publique au développement assurée par le canal multilatéral et européen ».
Ces propos rejoignent les évaluations faites par la direction générale du Trésor du ministère des finances sur l'efficacité de l'interaction des organisations multilatérales dans les pays africains 67 ( * ) . Ces dernières soulignent la faible corrélation entre la programmation de la Banque mondiale et les priorités de la France.
Des progrès ont été faits, notamment au niveau européen, à travers des expériences de programmation conjointe. La programmation conjointe est, en effet, un sujet clé de l'actualité européenne de l'aide. Elle s'inscrit dans la réflexion générale que mène la Commission sur l'avenir de la politique européenne de développement et participe à l'objectif de renforcement de l'efficacité de l'aide.
En revanche, comme le souligne la dernière revue par les pairs de l'OCDE : « En dépit de cet engagement, la France ne dispose pas de stratégie d'ensemble de l'aide multilatérale......une approche stratégique d'ensemble, couvrant également les agences des Nations Unies et les principaux fonds verticaux auxquels la France contribue fortement, faciliterait les arbitrages entre l'aide bilatérale, l'aide communautaire et l'aide multilatérale en tenant compte des différents objectifs poursuivis, et favoriserait l'articulation entre l'aide bilatérale et l'aide multilatérale ».
Le groupe de travail propose qu'une telle stratégie soit établie avec en son sein une stratégie pour l'Afrique. Ce document devrait prendre en compte les évaluations en cours des contributions à la Banque mondiale et au FED.
|
69) Définir une stratégie française en faveur de l'Afrique dans les instances multilatérales. |
C. PROMOUVOIR LA VOIX DE L'AFRIQUE DANS LA GOUVERNANCE MONDIALE
L'Afrique sera en 2050 plus peuplée que l'Inde et la Chine, trois fois plus que l'Europe, elle représentera un cinquième de l'humanité. Ce rattrapage la rend incontournable, comme le sont aujourd'hui la Chine avec 1,3 Md d'habitants et l'Inde avec 1,2 Md. Un tel poids devra être représenté au niveau de la gouvernance mondiale.
Cet objectif peut à ce jour être recherché par trois canaux : renforcer le dialogue entre le G8, le G20 et les pays africains, garantir le rôle pivot des Nations unies au sein du système de gouvernance collective, système où l'Afrique est largement représentée, et plaider en faveur d'une réforme de la gouvernance politique favorable à l'Afrique.
Le G8 et le G20 ont une responsabilité importante pour contribuer à mieux insérer l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Seule l'Afrique du Sud est aujourd'hui présente au G20, une situation qui ne pourra être maintenue dans le temps. Les intérêts de 14% de la population mondiale, la plus pauvre qui plus est, sont portés par un seul pays, alors que 2 pays sud-américains représentent 8,6%, trois nord-américains, 5%.
C'est sans doute un des thèmes que la France peut porter comme elle l'a déjà fait au Sommet d'Evian sous présidence française.
|
70) Promouvoir la voix de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. |
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous la présidence de M. Daniel Reiner, vice-président, a examiné le présent rapport le 29 octobre 2013.
M. Jean-Marie Bockel, co-rapporteur . - Je voudrais remercier en préalable les participants au groupe de travail, Kalliopi Ango Ela, Jean-Claude Peyronnet, René Beaumont et Robert Hue : durant huit mois, nous avons auditionné une centaine de personnes, à Paris ou lors de nos déplacements en Afrique du Sud, en Ethiopie, et en Côte d'Ivoire - et je crois exprimer le sentiment général en disant que ces rencontres très riches nous ont beaucoup apporté, en témoigne l'imposant rapport qui en résulte.
Parmi les défis auxquels l'Afrique fait face, le plus flagrant est démographique : d'ici quarante ans, le continent devrait compter deux milliards voire trois d'habitants, ce qui signifie qu'il devra nourrir, loger et former au moins un milliard d'êtres humains supplémentaires. Cette transformation est une opportunité : l'Afrique est l'un des plus grands marchés de la planète, avec 326 millions de consommateurs, presque autant que l'Europe - et sa croissance est exponentielle. Cette explosion démographique s'accompagne de dynamiques spatiales : ce seront les villes africaines qui accueilleront le milliard d'habitants supplémentaire ; une nouvelle Afrique est en train de naître puisque la moitié de la population a moins de 25 ans, et l'emploi des jeunes sera au coeur de la stabilité du continent.
L'explosion démographique met les sociétés africaines sous tensions. La pression est d'abord écologique. L'empreinte écologique de l'Afrique a augmenté de 240 % entre 1961 et 2008 et elle devrait doubler à l'horizon 2040. Le capital naturel de l'Afrique a été largement exploité, voire surexploité et pillé, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la pêche ou de l'exploitation des ressources minérales et pétrolières. A cela s'ajoute le réchauffement climatique. Alors que l'Afrique produit moins de 4 % des émissions de gaz à effet de serre, elle est considérée comme la région la plus vulnérable aux effets des changements climatiques.
La pression, ensuite, est migratoire : en moins de dix ans, l'Afrique s'est accrue de 100 millions d'actifs et le continent devrait compter un milliard d'actifs supplémentaires en 2040 - ce qui en fera la plus nombreuse population active au monde. D'ici 2050, le nombre d'actifs européens va diminuer de 90 millions, alors que l'Afrique subsaharienne va au minimum gagner 700 millions d'actifs.
Malgré ces défis, une partie de l'Afrique semble bien partie, et nous sommes loin du temps où, avec Louis Dumont, on pensait que l'Afrique était bien mal partie... Une partie de l'Afrique connaît un véritable décollage économique, avec 5% de croissance annuelle depuis dix ans, taux moyen qui recouvre des réalités cependant très contrastées sur le continent. Voyes l'essor de la téléphonie mobile : le marché a crû de 244% par an sur cinq ans et plus d'un Africain sur deux possède un téléphone portable.
La situation est certes très difficile dans des pays comme la Centrafrique, la République démocratique du Congo, ou encore au Sahel - mais en dehors de ces « trous noirs », il y a une Afrique dynamique, une Afrique courtisée par les pays émergents, une Afrique qui peut être pour nous un formidable réservoir de croissance. Ce dynamisme économique a permis une réduction de la dette publique pour des pays comme le Ghana, le Bostwana, le Rwanda, qui connaissent des progrès sociaux et économiques. Il y a dix ans, la mode était à l'afro-pessimisme - est aujourd'hui à l'optimisme, car l'Afrique décolle. Pour notre part, nous n'avons pas souhaité être pessimistes ou optimistes, mais vigilants et résolument afro réalistes.
D'immenses défis restent néanmoins à relever. Celui de la pauvreté, tout d'abord : en Afrique, 400 millions de personnes vivent avec moins d'1,25 dollar par jour et avec une espérance de vie de 24 années inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE, le continent n'a pas encore transformé une décennie de croissance en développement. Les inégalités de niveaux de vie se creusent sur le continent entre les pays et à l'intérieur des pays. Par ailleurs, l'économie africaine reste encore peu diversifiée. L'industrialisation est balbutiante et ne représente que 11% de la production contre 31% en Asie du Sud Est. Les économies africaines sont encore bridées par la fragmentation du continent et le manque infrastructures. 20 % de la population a accès à l'électricité courante, moyens de transport à l'intérieur du continent peu développés... Le délitement de certains Etats, le terrorisme, les conflits entravent encore l'émergence économique et politique de l'Afrique sur la scène mondiale. Or, il n'y pas de développement possible sans sécurité, mais il n'y aura pas de sécurité durable sans développement.
L'Afrique est donc à la croisée des chemins, où se pose la question suivante : comment va-t-elle se développer ? L'Afrique a encore le choix : entre un développement « à la chinoise », ou un développement qui préserve les équilibres sociaux et environnementaux. C'est un des défis de notre coopération avec l'Afrique que d'intégrer davantage ces enjeux dans les projets.
En 2050, le quart de l'humanité sera africain. Il faut donc dès à présent penser le monde en plaçant l'Afrique au coeur de nos analyses. C'est ce que font la plupart des pays émergents qui investissent aujourd'hui ce continent. Hier ignorée, aujourd'hui convoitée, l'Afrique est devenue un lieu de rivalités : c'est devenu le nouvel eldorado des pays émergents.
Connectée à la mondialisation, l'Afrique est, en effet, au coeur d'une redistribution des cartes entre anciennes puissances coloniales et puissances émergentes. La part des échanges de l'Afrique avec les pays émergents a presque doublé en dix ans. En 2009, la Chine est ainsi devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. On pense à la Chine, à l'Inde, au Brésil, mais les ressources minérales et les marchés africains suscitent aussi l'appétit des investisseurs, marocains, turcs, indiens, brésiliens, coréens ou japonais... La Chine développe une stratégie dite « des petits pas » qui va de la construction d'écoles à l'extraction minière ; le commerce bilatéral avec le continent se chiffrait à plus de 100 milliards de dollars en 2008, cent fois plus qu'en 2000 ! L'Inde s'appuie sur une diaspora ancienne pour développer son influence en Afrique, ses échanges commerciaux avec le continent ont bondi de 3 à 60 milliards de dollars entre 2000 et 2011. L'Afrique du Sud, qui représente 25 % du PIB de l'Afrique subsaharienne, s'affirme comme le moteur du développement du continent et s'en fait le porte-parole sur la scène mondiale.
La coopération Sud-Sud se nourrit d'une expérience concrète et récente du développement des pays émergents. On nous a dit en Afrique du Sud : « l'Occident nous a apporté les 3 c : commerce, civilisation et colonisation, les BRICS viennent avec les trois i : intégration, infrastructure et industrialisation ».
Partenaire économique, l'Afrique est également un soutien politique primordial pour les émergents qui veulent acquérir une envergure diplomatique nouvelle. Les 53 voix des États africains à l'ONU font l'objet de toutes les convoitises, sur fond de renversement du rapport de force avec l'occident.
Il y a enfin des aspects stratégiques. Regardons la carte de l'Afrique : à l'Est l'océan Indien, avec une Inde prise dans une concurrence effrénée avec la Chine. A l'Ouest, au-delà de l'Atlantique, le Brésil cherche à se positionner comme point de jonction entre les deux rives de cet océan.
La France est-elle en perte de vitesse en Afrique ? Nous avons le sentiment d'une relation sans équivalent, mais d'une présence en recul dans ce continent en essor. La relation entre la France et l'Afrique, c'est tout d'abord une histoire commune et une langue partagée, avec la francophonie. La présence française en Afrique se caractérise également par sa continuité depuis les indépendances, à travers les quelque 1000 entreprises françaises implantées sur le continent, le réseau des 200 Alliances françaises et Instituts français qui forment 80 000 étudiants africains chaque année, ou encore notre communauté d'expatriés forte de 100 000 Français.
La France et l'Afrique, c'est ensuite l'Afrique en France, avec quelque 800 000 immigrés, qui participent à la présence en France de la culture africaine.
La France est enfin un des premiers bailleurs de fonds et le premier partenaire militaire de l'Afrique, avec 10 000 militaires déployés sur le continent.
Pourquoi, dans ces conditions, avoir le sentiment d'un déclin ? Premier facteur : nos parts de marché diminuent en Afrique, à mesure qu'y augmentent celles des entreprises chinoises. Ainsi le poids de la France dans le PIB de la zone franc est passé de 40 % sur la période 1985-1995 à 20 % sur la période 2005-2009 tandis que celui de la Chine a été multiplié par huit. Alors que le secteur bancaire est en plein décollage, les géants français de la banque ont vu leur participation chuter drastiquement. Comme nous l'a dit Dominique Lafont, directeur de Bolloré Africa Logitics « Le CAC 40 a fui l'Afrique ».
Deuxième facteur : la France n'a pas de stratégie bien établie en Afrique. Depuis dix ans, tout se passe comme si notre politique africaine était tétanisée par le débat sur la « Françafrique ». Alors qu'une grande partie du continent se modernise, le discours français est resté obnubilé par le passé sans voir que le continent changeait. De là, une politique hésitante, qui oscille entre l'ingérence et l'indifférence. A ces hésitations correspond en Afrique un sentiment ambivalent à l'égard de la France, fait d'attirance et de répulsion. Le succès de l'opération Serval ne doit pas nous donner l'illusion de l'efficacité des solutions militaires. L'intérêt mutuel de la France et des pays africains est avant tout de créer les conditions d'un développement durable.
Troisième facteur : faute de stratégie politique, le critère budgétaire est devenu le seul fil conducteur de l'intervention française et la réduction de la voilure a été notre seul cap, aussi bien dans la coopération civile que militaire. L'Europe aurait pu prendre le relais, ce n'est pas encore le cas. En matière d'aide au développement, l'UE est en revanche devenue le premier bailleur de fonds de l'Afrique, nous y prenons une part active. L'enjeu est là comme ailleurs de trouver la meilleure articulation possible entre le niveau bilatéral et le niveau européen.
Dans ces conditions, la France est-elle en train de rater un tournant stratégique ? Notre présence reste marquante dans certains aspects militaires et dans l'aide au développement qui sont à la charge de l'Etat, pendant que d'autres pays développent des relations commerciales. Comme nous l'a dit un ambassadeur chinois : « Vous assurez la sécurité, nous faisons des affaires ». La France peut apparaître moins menacée qu'on ne le croit. Après tout, l'Afrique ne fait que s'ouvrir à de nouveaux partenaires. De plus, la lune de miel avec les nouveaux partenaires émergents est sans doute temporaire. Apparaît çà et là une prise de conscience d'un partenariat qui n'est pas si « gagnant-gagnant » et qui serait en matière d'approvisionnement en hydrocarbures et en minerais plutôt « gagnant-perdant ».
Pour autant, tabler sur l'échec des pays émergents serait une stratégie perdante. Il faut surtout être compétitif et montrer à nos partenaires africains que nous avons un intérêt partagé pour un développement durable et harmonieux.
Il y a pour la France un impératif africain, avec la montée des interdépendances, l'échec de l'Afrique serait un cauchemar. Avec l'explosion démographique de l'Afrique, notre intérêt premier est la sécurité et le développement de ce continent. Nous jouons là-bas une partie de notre croissance. Comme le dit Larry Summer, l'ancien secrétaire d'Etat américain, il est aujourd'hui plus risqué de ne pas investir en Afrique que d'y investir. De ce point de vue, comme nous l'a dit Mathieu Pigasse de la Banque Lazard, « la France est en retard d'une guerre. Le continent est en train d'émerger, et nous regardons encore l'Afrique avec le prisme de l'APD et des forces prépositionnées . »
Ce « pivot Africain » qui englobe aussi le Maghreb est d'autant plus nécessaire que nous entrons dans une nouvelle géopolitique de la pénurie où la sécurisation des approvisionnements en hydrocarbures et en métaux sera l'un des enjeux majeurs. Les pays émergents ne s'y sont pas trompés.
Notre intérêt bien compris est donc de favoriser un co-développement de l'Europe et de l'ensemble du continent africain -Maghreb compris - et de tirer l'Afrique vers un modèle de développement équilibré. Mais une chose est sûre : l'Afrique ne nous attendra pas.
M. Jeanny Lorgeoux, co-rapporteur . - La politique africaine de la France a évolué moins vite que l'Afrique elle-même. C'est pourquoi nous proposons 70 mesures regroupées en dix priorités pour relancer une politique africaine rénovée. Pour ce faire, nous avons commencé par distinguer, comme les stoïciens le faisaient en leur temps, ce qui dépend de nous et ce que l'on ne maîtrise pas.
Les facteurs qui ne peuvent pas être maîtrisés par la France sont nombreux. J'en citerai quatre : l'ouverture des pays africains aux nouveaux pays émergents et l'implication croissante de ces derniers sur le continent ; l'appétence des Africains pour le monde anglophone ; la défiance à l'égard de tout ce qui pourrait s'apparenter à une forme de néocolonialisme ; enfin, les risques d'instabilité politique et sécuritaire : les bouleversements démographiques et économiques que nous avons décrits mettront sous tensions l'ensemble du continent. Alors que les zones les moins développées connaissent les affres des pays où la déliquescence de l'Etat ne lui permet pas d'assurer ni l'ordre public, ni les services publics minima nécessaires au développement, dans les zones plus développées, la croissance économique, l'élévation de vie et d'éducation pourraient entraîner une instabilité politique croissante dans des pays où l'espace public est encore très réduit.
En revanche, certains facteurs peuvent être mieux maîtrisés par les pouvoirs publics français : nous pouvons renforcer la cohérence de notre politique africaine et les synergies entre les différents acteurs est possible ; nous pouvons promouvoir une image rénovée de l'Afrique qui, sans masquer la réalité, mette aussi en valeur les nombreuses opportunités est envisageable ; nous pouvons renforcer la présence des entreprises françaises dans les zones d'Afrique anglophones particulièrement dynamiques est souhaitable ; enfin, les conditions d'accueil des élites africaines aussi bien dans le domaine universitaire que dans les domaines du commerce et des arts, dépendent de la partie française.
Nous avons dégagé dix priorités :
• Première priorité : tenir un autre
discours sur l'Afrique : il s'agit de quitter le « vieux récit
» sur une Afrique du passé et de susciter un « besoin
d'Afrique » qui soit le pendant d'une « demande de France ». Il
faut se départir des préventions postcoloniales et assumer le
fait que l'Afrique n'est pas seulement partie prenante de notre histoire, mais
aussi un élément clé de notre avenir.
Il faut fonder nos relations sur nos intérêts partagés : des millions de Français qui sont d'origine africaine, ou vivent ou ont vécu en Afrique ; des intérêts économiques et stratégiques, un enjeu pour la sécurité de la France comme de l'Afrique. Pour cela nous proposons que soit établie une stratégie africaine de la France sous la forme d'un Livre Blanc sur l'Afrique en associant des membres représentant le Parlement, les administrations, les opérateurs, les ONG intervenant en Afrique et des personnalités qualifiées, françaises, étrangères et notamment africaines. Nous proposons de créer un programme « pour une écriture franco-africaine d'une histoire partagée » afin promouvoir le travail d'équipes mixtes franco-africaines sur l'étude de notre histoire commune.
Deuxième priorité : le pilotage de cette politique africaine. Le constat c'est une politique éclatée à tous les niveaux. Au niveau central, la cellule africaine, comme le secrétariat général aux affaires africaines et malgaches n'est plus. C'est en théorie une bonne chose. Dans la pratique, chacun va de son côté, les diplomates, les militaires, les services économiques, l'AFD. Au sein de chaque secteur, c'est la même chose.
Le soutien aux entreprises françaises, ce sont des services économiques de moins en moins nombreux, Ubifrance, les chambres de commerce, des opérateurs de promotions de l'expertise française en nombre. Dans le domaine de la coopération vous avez deux pilotes, Bercy et le quai d'Orsay et un opérateur, l'AFD, qui jouit d'une autonomie renforcée.
Chez les militaires c'est plus simple comme toujours. En revanche, le pilotage d'une synergie entre civils et militaires est encore balbutiante : ce qui est un problème dans des pays en crise comme le Mali.
Nous n'avons pas voulu proposer de révolution institutionnelle mais il nous semble quand même que les choses pourraient être améliorées tant au niveau central que sur le terrain.
Au niveau central, nous proposons, dans le droit fil des recommandations de nos collègues Christian Cambon et Jean-Claude Peyronnet et du dernier bilan décennal de l'aide au développement française, de créer un ministère de la coopération internationale de plein exercice qui mettrait fin à la concurrence entre les services de Bercy et du Quai d'Orsay sur ce sujet. Ce ministère, qui ne serait pas réservé à l'Afrique, permettrait enfin au ministre de la coopération ou du développement d'avoir une capacité de pilotage des fonds bilatéraux et multilatéraux comme c'est le cas en Angleterre ou en Allemagne.
Nous proposons également de mettre en place une gouvernance de haut niveau en charge de la gestion civilo-militaire des crises au niveau du secrétariat général de la séfense et de la sécurité nationale (SGDSN).
Sur le terrain, nous proposons d'instaurer une structuration régionale de notre dispositif diplomatique avec la nomination d'ambassades chefs de file régionaux et l'établissement régulier de stratégies région validées au niveau interministériel. La plupart des problèmes de sécurité et de développement en Afrique, du fait de l'extrême fragmentation du continent, se posent au niveau régional. C'est vrai au Sahel, c'est vrai autour du lac Tchad, c'est vrai dans la Corne de l'Afrique. Il ne s'agit pas de déshabiller des ambassades, mais de permettre au dispositif de définir des priorités régionales.
Troisième priorité : l'économie. Nous avons intitulé ce chapitre « L'économie d'abord » parce qu'il faut regarder désormais ce continent avant tout à travers le prisme de l'économie.
Nous proposons de structurer une stratégie sur les plans sectoriel et géographique qui corresponde aux marchés africains. Le plan export de Nicole Bricq nous semble sous-estimer les perspectives des marchés africains. Il n'y a que quatre pays cités. Elle est en train de redresser la barre avec une tournée africaine. Mais il y a une réflexion à développer sur l'adaptation de notre stratégie aux réalités africaines, l'adaptation de nos produits à ce qu'on appelle « le bas de la pyramide », et enfin sur la façon dont les grands groupes présents en Afrique -je pense à Bolloré, à Bouygues, à Total- pourraient renforcer le portage des PME. Les Chinois, les Allemands, pour ne parler que d'eux, chassent en meute. Il faut s'en inspirer.
En ce qui concerne le dispositif public, il faut mettre fin à l'hémorragie de nos services économiques en Afrique. La suppression du seul poste qu'il y avait au Mozambique à un moment où ce pays a découvert des réserves de gaz et de pétrole supérieures à celles du Qatar est une illustration de la sous-estimation des potentiels de cette Afrique qui bouge.
Nous proposons également d'inscrire dans le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD un mandat de dialogue avec les entreprises privées et les bureaux d'études et de promotion de l'économie française autour de l'expertise. Il ne s'agit pas de relier l'aide mais de faire en sorte que, notamment en matière d'expertise, l'AFD puisse travailler avec les entreprises pour définir les secteurs et les géographies où elles ont un avantage compétitif dans des domaines qui, par ailleurs, contribuent au développement.
Nous pensons, par ailleurs, qu'il faut renforcer les exigences environnementales et sociales dans les appels d'offres financés par la coopération française afin de pouvoir éliminer, au stade de la pré-qualification et de l'évaluation, celles qui ne seraient pas conformes à ces exigences, je pense évidemment aux entreprises chinoises.
Nous pensons également qu'il faut poser au niveau international la question de la réciprocité avec les pays émergents. La majorité d'entre eux pratiquent en Afrique de l'aide liée qui est réservée à leurs entreprises. Les pays occidentaux ont fait un choix différent. C'est une longue discussion dans laquelle je ne vais pas rentrer. En revanche, je pense que nous devrions collectivement, au sein de l'OCDE, obtenir des Chinois qu'ils ouvrent leurs appels d'offres et faire valoir que, s'ils continuent, nous n'avons pas de raison d'accepter leurs entreprises sur des appels d'offres financés par notre aide. Notre mot d'ordre est donc clair : défendons nos intérêts !
En matière d'approvisionnement stratégique, nous demandons à ce qu'un bilan des intérêts français en Afrique en matière d'hydrocarbures et de minéraux soit actualisé par le COMES et le SGDSN. Dans le même temps, la France doit se montrer exemplaire en matière de transparence des industries extractives, en adhérant à l'initiative du même nom et en exigeant de ces entreprises le respect de normes sociales, environnementales et financières de nature à convaincre nos partenaires africains que, contrairement à nos concurrents, la France est partisane d'un partenariat durable, respectueux des intérêts de long terme des pays africains.
Quatrième priorité : la stabilité et la sécurité du continent. Notre diagnostic nous conduit à être favorables au maintien de huit points d'appui militaire en Afrique : Abidjan, Dakar, la zone sahélienne (Mali, Niger, Burkina Faso), Libreville, Ndjamena, Bangui, Djibouti, et l'île de la Réunion.
Je crois que la volonté de ne plus figer les effectifs mais d'avoir un dispositif souple et réactif est pertinente. Nous pensons qu'il faut dédier de façon visible quatre pôles à la coopération avec les quatre organisations régionales, à Libreville avec la brigade centre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), à Dakar avec la brigade de l'ouest de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à la Réunion avec la brigade sud de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et à Djibouti. Il faut afficher clairement la volonté française de participer à l'architecture de sécurité africaine. C'est ce que nous appelons donner un sens africain à la présence militaire française.
Nous pensons qu'il ne faut pas exclure la possibilité d'ouvrir les pôles de coopération français à des participations de partenaires européens et internationaux à l'instar de ce qui a été fait pour les écoles navales à vocation régionale (ENVR).
Nous estimons qu'il faut renforcer les crédits de la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) et développer les ENVR avec des financements croisés de l'ensemble des ministères concernés et un recours croissant aux financements européens, multilatéraux, voire à des partenariats avec des pays qui partagent notre vision de l'Afrique comme le Canada.
Cinquième priorité : les aspects plus politiques. Il nous semble que tout en conservant à l'esprit les exigences de stabilité du continent, il faut regarder sur le long terme et maintenir un discours français sur la démocratie. Mais nous proposons que ce discours soit centré non pas sur la procédure formelle d'élections - qui peut s'accompagner de dérives - pour privilégie la notion de pluralisme et de contre-pouvoirs, tout en tenant compte de relations d'Etat à Etat.
Pour ce faire nous proposons notamment la constitution de fondations en faveur de la vigilance citoyenne, des contre-pouvoirs, des médias, des parlements, et de la « société civile ». Il nous faut tirer les leçons des printemps arabes et d'un dialogue trop exclusivement centré sur l'Etat. Pour cela il nous faut entretenir un dialogue avec la société civile, ne pas oublier les ONG et les collectivités territoriales françaises.
Sixième priorité : la coopération au développement. En dehors de la création d'un ministère de plein exercice, qui exerce la responsabilité des programmes 110 et 209, qui sont actuellement gérés, l'un par Bercy, l'autre par le Quai d'Orsay, nous proposons de simplifier l'organisation du réseau de coopération. Il faut poursuivre la réforme de 1998 et la mener à son terme, mettre fin à la double compétence des SCAC et des agences de l'AFD et réduire ainsi le coût du réseau en s'appuyant principalement sur les agences de l'AFD sous l'autorité des ambassadeurs. Cela signifie poursuivre les transferts de compétence opérationnelle au profit de l'AFD de façon à ce que les fonds de solidarité prioritaire (FSP) soient gérés par l'AFD.
Il nous faut également mutualiser des fonctions support entre les représentations des instituts de recherche pour le développement dans un même pays et les opérateurs du développement.
Voilà pour ce qui est de l'organisation institutionnelle.
S'agissant des financements, nous estimons qu'il faut redresser l'équilibre des contributions bilatérales et multilatérales de façon à retrouver un niveau d'intervention sous forme de subventions supérieur à 500 millions à la fin du triennum budgétaire.
Il y a des redéploiements possibles. Ils sont nécessaires pour retrouver une capacité d'intervention significative dans les pays pauvres prioritaires.
Parallèlement, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à accroître la part de la taxe sur les transactions financières françaises affectée à la coopération, à achever le processus d'adoption de la TTF européenne et de poursuivre le travail de conviction pour l'adoption d'une TTF au niveau mondial.
Voilà pour ce qui est des moyens d'interventions sous forme de subventions.
Pour ce qui est des prêts, qui représentent 80 % de l'activité de l'AFD, nous plaidons fermement pour une augmentation de ses fonds propres et la suppression du plafond de ses effectifs.
La septième priorité concerne la promotion de l'expertise française. Nous pensons, dans le droit fil du rapport de notre collègue Jacques Berthou, qu'il faut regrouper l'ensemble des financements consacrés aux études et à l'expertise auprès d'un guichet unique géré par l'AFD.
La huitième priorité concerne le renforcement de la francophonie. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de dividendes démographiques automatiques si nous ne formons pas des maîtres d'école dans les pays francophones. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut absolument renforcer notre participation au partenariat mondial pour l'éducation, qu'il faut promouvoir des partenariats public-privé en faveur du développement de système de formation professionnelle en Afrique.
Il y a une formidable demande en matière de formation professionnelle en Afrique. Nous avons un savoir-faire. Nous avons les entreprises susceptibles d'être intéressées par des investissements dans des unités de production en Afrique, des projets particulièrement intéressants ont été implantés, notamment au Maroc et en Tunisie.
Nous pensons également que la promotion de la francophonie passe par la création d'une université francophone pilote à Dakar, à l'image de l'université Paris-Sorbonne-Abou Dhabi. Pour les étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller à Paris, une université parrainée par le système universitaire français et francophone des formations de qualité constituerait un progrès important pour les étudiants africains et un symbole politique fort pour la francophonie.
La neuvième priorité concerne l'immigration. Comme nous l'avons souligné, il y a eu ces dix dernières années une incohérence entre notre politique d'influence, qui visait à former et à tisser des liens forts avec les élites africaines, et notre politique migratoire qui a détourné de la France non seulement des étudiants, mais également des artistes et des hommes d'affaires.
Nous proposons d'assouplir le code de l'entrée et du séjour des étrangers de façon à instaurer des visas pluriannuels calqués sur la durée des études, à permettre l'exercice d'une première expérience professionnelle pour les étrangers juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français, et enfin d'accorder un visa illimité aux étudiants ayant obtenu un doctorat en France.
Ces réformes doivent être accompagnées d'une redynamisation de la politique d'accueil des personnalités d'avenir, de la gestion du réseau des anciens élèves des lycées français à l'étranger. Voilà pour ce qui est de l'accueil des élites africaines en France dont une majeure partie retournera dans une Afrique qui offre aujourd'hui de nombreuses opportunités pour les plus qualifiées d'entre elles.
S'agissant de l'immigration économique, ou de celle en provenance de zones désertées par le développement ou soumises à des régimes autoritaires comme l'Erythrée, chacun est bien conscient qu'il n'y a pas de solution de court terme. La Méditerranée n'a jamais été une frontière, et ne le sera pas plus demain qu'hier. La solution, c'est évidemment le développement de l'Afrique.
En attendant, nous estimons qu'il faut entretenir le dialogue avec les pays d'origine sur les questions migratoires, sans tabou. Il faut pouvoir parler aux autorités maliennes des besoins réciproques de chaque pays, de la question des filières clandestines, de celle de la fraude documentaire. Ce n'est pas en ignorant ces questions que nous allons les résoudre. Il convient, par ailleurs, de relancer la politique de développement solidaire qui prenait appui sur les diasporas présentes en France. Cette politique a été quelque peu discréditée par le lien qui avait été fait avec l'immigration clandestine, mais il y a pourtant une piste à creuser. Vous savez qu'aujourd'hui les transferts financiers des diasporas de l'Europe vers l'Afrique sont supérieurs à l'aide publique au développement.
La dixième priorité, c'est de définir une stratégie africaine de la France dans les instances multilatérales et européennes. Il nous faut convaincre nos partenaires européens qu'il y a là un axe stratégique majeur pour les décennies à venir. Les transferts économiques que nous avons opérés vers les pays de l'est sont aujourd'hui sans commune mesure avec ceux que nous consacrons à la rive sud de la Méditerranée. Il y a là un rééquilibrage à opérer qui exigera un travail de conviction. L'opération Serval y a contribué, il faut néanmoins poursuivre. De même, nous n'avons pas de stratégie française globale dans les instances multilatérales, ce qui nous empêche évidemment d'avoir une stratégie concertée sur les questions africaines. Là encore il y a un travail de coordination à renforcer si nous voulons que nos contributions financières dans ces organismes poursuivent bien des objectifs cohérents avec nos priorités.
Nous ne prônons pas la révolution, nous avons bien conscience que l'Afrique n'est qu'une partie du monde, qu'il y a l'Asie du sud-est, l'Amérique latine, mais une Afrique de 2 milliards d'habitants à 14 km du sud de l'Europe avec autant d'opportunités et de risques devrait être une préoccupation centrale de l'Europe.
Voilà, mes chers collègues, un résumé de notre rapport. Vous trouverez dans le document écrit une déclinaison des dix priorités en 70 mesures concrètes. Ce que nous voulions vous faire partager aujourd'hui c'est la conviction qu'une partie de l'avenir de la France est en Afrique. C'est pourquoi nous avons intitulé ce rapport : « L'Afrique est notre avenir ».
M. Daniel Reiner, président . - Un grand merci pour cette analyse fournie et ces propositions hardies - et place au débat.
M. Christian Cambon . - Je commencerai par rendre hommage aux rédacteurs de ce rapport qui, par la qualité de son diagnostic et de ses préconisations, honore notre commission et le Sénat tout entier. Je note avec plaisir que ses conclusions convergent grandement avec celles que nous présenterons demain sur le Maghreb, en particulier l'idée qu'il faut donner le primat à l'économique - comme me l'a fait remarquer André Vallini, je serais devenu marxiste - et qu'une grande voie s'ouvre à la France si elle sait, par ce primat, se repositionner en Afrique.
Lors de notre déplacement aux Nations Unies, nous avons largement constaté l'importance de la relation entre la France et les pays africains, l'attente que ces pays nourrissent envers le nôtre - ce qui rend d'autant plus difficile à accepter le peu d'appétence de grandes entreprises françaises envers l'Afrique, la fermeture de postes diplomatiques, la dispersion de notre coopération, son manque de résultats, ou encore l'incapacité de l'Union européenne à s'organiser sur le continent africain, alors que c'est bien par lui que l'Europe, qui est en manque d'espérance, pourra se revivifier ! Je crois que l'Afrique doit reprendre son destin en mains : pourquoi son développement devrait-il passer par de grandes entreprises internationales, et pas, d'abord, par de grandes entreprises africaines ? Je l'ai dit devant le secrétaire général des Nations Unies, en prenant l'exemple de la Corée, qui était aidée jusque dans les années 1960 et qui nous dame le pion depuis vingt ans sur les téléviseurs et aujourd'hui sur l'automobile. Le développement économique de l'Afrique sera le fait des Africains, il faut le répéter sans cesse, y compris à certains Africains qui peuvent avoir tendance à en attendre trop de la France.
Je suis parfaitement d'accord avec nos rapporteurs sur le caractère primordial de la formation professionnelle, sur l'utilité qu'aurait une grande université francophone en Afrique ou encore sur la nécessité de revoir notre politique de visas - même si je crains que l'accueil permanent de docteurs africains formés en France ne renforce la fuite des cerveaux, alors que ces élites sont très attendues et nécessaires en Afrique. Sur la formation dans l'ensemble, je crois également que la France a beaucoup à faire en Afrique et qu'elle dispose d'une expertise hors pair, que nous devons promouvoir.
Sans dévoiler ce que nous dirons demain, je crois également que nous avons à renouveler nos relations avec et envers le Maghreb, qui est notre voisin méditerranéen, mais qui est également une porte d'entrée sur le continent africain dans son ensemble, ce qui doit nous inciter à y investir bien davantage, sur le plan économique aussi bien que social et culturel.
Ce qui est certain, enfin, c'est que notre commission élabore une doctrine sur l'Afrique et sur le Maghreb : j'espère que nous serons entendus !
M. Jacques Berthou . - Je suis, comme mes collègues, impressionné par ce rapport. Nous y constatons que la présence française décline en Afrique, comme dans le reste du monde - une situation dont nous sommes tous redevables. Ne doit-on pas craindre une Afrique à deux vitesses, où les progrès d'une partie du continent, n'entrainent pas ceux d'une autre partie qui reste aux prises avec les conflits, le terrorisme et une pauvreté toujours plus importante ?
Leila Aichi, enfin, m'a chargé de vous poser cette question : que pensez-vous d'une ambassade française placée exclusivement auprès de l'Union africaine ?
M. André Vallini . - A mon tour, je salue la qualité de ce rapport. Je me reconnais parfaitement dans le propos de Christian Cambon sur l'attente et « l'envie de France » en Afrique : c'est ce que nous en ont dit les ambassadeurs africains que nous avons rencontrés à New York, j'ai bien ressenti leur désir d'un certain retour de la France en Afrique, mais aussi le fait que les Chinois n'y étaient pas toujours très bien vus - en particulier parce qu'ils y travaillent quasiment en autarcie, sans recourir aux travailleurs africains et en leur livrant plutôt une concurrence directe : je crois, à ce titre, que la présence chinoise en Afrique n'a rien d'inéluctable.
Mme Josette Durrieu . - Je partage ces impressions. Je connais très peu l'Afrique subsaharienne, mais beaucoup mieux l'Afrique du Nord ; à ce titre, je ne sais pas si le Maghreb fait partie de l'Afrique, au-delà de la géographie, mais je crois très fortement que nous devons le repositionner politiquement, sur son socle africain : nous devons promouvoir une vision longitudinale, celle d'un axe vertical qui va de l'Europe à Afrique du Sud, en passant par le Maghreb ! Dans ce fuseau se dessine une grande région du monde, aussi importante que l'Amérique ou que l'ensemble Asie-Pacifique, mais nous ne le savons pas assez : nous devons le dire davantage, en France comme en Europe.
Ensuite, comme André Vallini, j'ai été surprise par la vigueur de « la demande de France » en Afrique : je l'ai constatée lors d'un déplacement en Angola et en Namibie, nos interlocuteurs étaient si enthousiastes qu'ils nous ont transmis des messages pour le gouvernement. Je n'y ai du reste ressenti aucune amertume envers le passé, ni aucun soupçon de visées néocolonialistes. Je crois donc qu'il faut aller en Afrique : il faut, même, y aller vite ! Lors de l'assemblée interparlementaire qui s'est tenue à Quito, j'ai constaté que le terrain politique envers les Africains était occupé, ou tentait de l'être, par un bloc de pays réunis autour de Cuba, avec des pays comme la Corée du Nord ou le Venezuela : ne nous obnubilons pas sur la présence chinoise en Afrique, il y a aussi la concurrence politique d'autres pays qui se félicitent de notre absence relative. C'est aussi ce qui me fait dire que la reconquête économique passe par l'instauration d'un nouveau mode de partenariat, qui soit enfin d'égal à égal.
M. Daniel Reiner, président . - J'ajouterai quelques questions, non sans avoir félicité à mon tour les auteurs de ce rapport qui honore effectivement notre commission.
Les « BRICS » sont des partenaires particulièrement dynamiques en Afrique, mais ils traversent une période difficile : ressentez-vous que leurs difficultés actuelles amoindrissent leur influence ?
Où en sont, ensuite, les institutions africaines, qu'il s'agisse de l'Union africaine ou des organisations régionales, comme la CDAO : sont-elles solides, représentatives, quelle est leur réalité sur le plan économique, social, culturel ?
Vous suggérez que la France participe davantage à l'architecture de la sécurité africaine, aux côtés de l'Union européenne, déjà engagée dans la mise en place d'états-majors ou encore d'écoles militaires : où en est-on ? Comment renforcer notre présence sans s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats africains ?
Vous proposez la création d'un ministère de la coopération internationale qui soit à égale distance de Bercy et du Quai d'Orsay : y croyez-vous vraiment ?
Vous concluez en déplorant une absence de stratégie concertée de notre pays en Afrique : le constat est-il véritablement si sévère ? Si c'est le cas, quelle voie suivre pour conforter notre stratégie ? L'institutionnalisation d'une stratégie particulière à l'Afrique n'encoure-t-elle pas le risque d'une forme de néocolonialisme ?
M. Jeanny Lorgeoux, co-rapporteur . - Je vous remercie pour votre propos, Monsieur Cambon, que je partage très largement. Cependant, un visa permanent pour les docteurs formés en France ne signifie pas une résidence dans notre pays, mais bien une possibilité d'aller et de venir librement dans le pays où l'on a obtenu son doctorat - et aussi une marque de respect envers les docteurs que nous avons formés ; c'est très important, car les Africains ressentent trop souvent que la France leur manque de respect : c'est particulièrement vrai avec la procédure de délivrance des visas. Quatre Africains diplômés de Harvard sur cinq reviennent travailler en Afrique : la fuite des cerveaux n'est pas inéluctable. La facilité d'aller et venir, en fait, facilitera les affaires, l'esprit d'entreprise entre l'Afrique et la France - n'oubliez pas que la première fortune africaine, celle de la famille nigériane Dougote, s'élève à quelque 113 milliards de dollars...
M. Jean-Marie Bockel, co-rapporteur . - Je rejoins tout à fait Christian Cambon : notre commission élabore une doctrine sur l'Afrique - et je suis convaincu que nous faisons oeuvre utile, parce qu'il est toujours utile de dire les choses qui doivent être dites parce qu'elles sont vraies.
Jacques Berthou s'en inquiète et nous nous sommes penchés sur le sujet : oui, les pays d'Afrique ne progressent pas au même rythme, il y a bien une Afrique à deux vitesses - et la partie francophone est singulièrement celle où les difficultés sont les plus importantes. Nous n'avons pas trouvé d'explication unique, mais nous devons tenir compte de ce contexte.
Faut-il qu'une ambassade se consacre spécifiquement à l'Union africaine ? Les moyens actuels de notre ambassade en Ethiopie, qui suit l'UA, ne sont pas suffisants : un seul fonctionnaire auprès de l'ambassadrice pour l'organisation panafricaine ! Cependant, je ne crois pas très pertinent de consacrer une ambassade à l'UA et je pencherais pour plus de pragmatisme. Les organisations africaines se professionnalisent, nous sommes loin de la caricature d'hier dans les relations Nord/Sud ; cependant, Nkosazana Dlamini-Zuma, la présidente de l'UA, est à la croisée des chemins - et nous pouvons, avec l'Union européenne, l'aider à prendre la meilleure voie, celle qui fera que les Africains s'organiseront par eux-mêmes dans le concert des nations.
Je crois également, avec André Vallini, que « l'attente de France » en Afrique nous ouvre une fenêtre d'opportunité et que le temps est bien à l'action, en Afrique même. Je crois encore à la vision longitudinale euro-africaine que Josette Durrieu nous propose, au nécessaire repositionnement politique que nous devons prendre envers le continent africain dans son ensemble, pour pouvoir y compter bien davantage : nous devons renouveler notre présence, sans être enchaînés au passé, sans angélisme cependant, tout en prenant en compte les émergents, qui vont rester en Afrique. Cela vaut également pour la perspective sécuritaire : nous devons réinventer les voies de notre présence, sans tout remettre en cause comme cela avait été envisagé un temps, lorsque j'étais au gouvernement.
Enfin, un ministère de la coopération internationale est-il envisageable ? L'idée n'est pas dans l'air du temps et il est vrai que les Britanniques ont institué un tel ministère dans une période plus faste - le combat, cependant, mérite d'être mené.
M. Jeanny Lorgeoux, co-rapporteur . - Je crois que nous assistons, globalement, à une bascule géostratégique du monde, qu'un nouveau « Bandung » se prépare - et que notre rôle, dans ces conditions, est bien d'identifier les facteurs décisifs qui nous aiderons à bâtir une France « non alignée » : c'est bien le sens du Livre blanc sur l'Afrique que nous appelons de nos voeux et qui devra nous aider à prendre la mesure des changements en cours.
Sur l'architecture de la sécurité, notre idée est assez pragmatique : aujourd'hui, les Etats africains, sauf exceptions, n'ont pas les moyens d'assurer leur sécurité ; notre rôle, dès lors, est peut-être d'aider à sortir des crises civilo-militaires en nous appuyant sur les institutions africaines et européennes, d'où l'idée de nous caler sur les quatre pôles institutionnels africains. Enfin, je crois que l'heure n'est pas de nous focaliser sur les seuls problèmes liés à notre propre gouvernance, mais bien de tenir compte de la profondeur stratégique des changements en cours.
M. René Beaumont . - Je crois très utile d'insister sur la politique des visas : nous devons aller bien plus loin qu'on ne le dit ici ou là, l'enjeu est bien de définir une véritable politique d'accueil des étudiants étrangers ; car au-delà du baccalauréat, la France n'est quasiment plus présente, c'est déplorable quand on sait la qualité des élites et des classes moyennes africaines - qui sont, on le constate de plus en plus, formées ailleurs qu'en France.
M. Jeanny Lorgeoux, co-rapporteur . - Parfaitement d'accord.
M. Jean-Claude Peyronnet . - Tirons-nous complètement les bénéfices, en termes d'influence, de notre présence militaire sur le continent ? Nous devons bien poser la question sous cet angle, car nous avons des concurrents sur le terrain, qui veulent prendre notre place - je pense en particulier à l'Afrique du Sud. C'est aussi à cette aune, je crois, que nous devons mesurer les moyens dont nous avons besoin en Afrique, même s'il est toujours difficile d'expliciter nos objectifs en matière d'influence...
M. Jean-Marie Bockel, co-rapporteur . - Je crois que c'est précisément notre travail, de politique.
La commission adopte le rapport.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
|
Jeudi 17 janvier |
M. Jean-Michel Severino , ancien vice-président de la Banque mondiale, ancien directeur général de l'AFD, président de « Investisseur et Partenaire pour le Développement » |
|
M. Jean Christophe Belliard , directeur Afrique et Océan Indien au ministère des affaires étrangères |
|
|
Jeudi 24 janvier |
M. Luc Rigouzzo , ancien directeur de cabinet du ministre de la coopération, ancien directeur général de Proparco, président d'Amethis Finance |
|
Jeudi 31 janvier |
M. Jean-Marc Châtaigner , directeur général adjoint de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats auprès du ministère des affaires étrangères, ancien ambassadeur de France à Madagascar, ancien directeur de cabinet du ministre de la coopération |
|
Jeudi 7 février |
M. Matthieu Pigasse , président de la Banque Lazard |
|
M. Lionel Zinsou , président de PAIpartners, société d'investissement |
|
|
Jeudi 14 février |
M. Richard Banegas , maître de conférences des universités, directeur du Centre d'études juridiques et politiques du monde africain (CEJPMA) |
|
M. Yves Gounin , conseiller d'Etat, auteur de « La France en Afrique » |
|
|
Jeudi 21 février |
Général Bruno Clément-Bollée , directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère des affaires étrangères |
|
M. Jean-François Leguil-Bayart , Enseignant chercheur expert en politique africaine |
|
|
Jeudi 28 février |
M. Dominique Perreau, ancien ambassadeur, ancien directeur de l'AFD, co-auteur d'un rapport sur l'Afrique et les grands émergents |
|
Jeudi 14 mars |
M. Dov Zerah, directeur général de l'AFD |
|
Jeudi 21 mars |
M. Maurice Enguéléguélé , Coordonnateur des Programmes IAG (Institut africain de la gouvernance) |
|
M. Jean-Christophe Rufin, écrivain, ancien ambassadeur de France au Sénégal, ancien vice-président de MSF |
|
|
Jeudi 4 avril |
Général Didier Castres , sous-chef d'état-major « opérations » au ministère de la défense |
|
M. Bertrand Badie, professeur de Science politique et relations internationales à Sciences-Po Paris |
|
|
Jeudi 11 avril |
Mme Hélène Le Gall, conseiller diplomatique pour les affaires africaines auprès du Président de la République |
|
M. Xavier Darcos , ancien ministre, président de l'Institut français |
|
|
Jeudi 25 avril |
M. Dominique Lafont , directeur de Bolloré Africa Logistic |
|
M. Jacques Marraud des Grottes , directeur Afrique exploration-production et M. Momar Nguer, directeur Afrique / Moyen-Orient de la branche Supply & Marketing de TOTAL |
|
|
Jeudi 23 mai |
M. Michel Foucher , géographe, ancien ambassadeur, directeur de la formation, des études et de la recherche de l'IHEDN |
|
M. Patrick Guillaumont , président de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international |
|
|
Jeudi 30 mai |
Mme Delphine Borione , ancienne directrice de la coopération culturelle et du français, secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée (UpM) |
|
M. Antoine Grassin , directeur général de Campus France |
|
|
Mercredi 12 juin |
M. Gérard Araud, ambassadeur, représentant permanent de la France à l'ONU |
|
Jeudi 13 juin |
M. Serge Tomasi, ancien directeur de l'économie globale et des stratégies du développement au ministère des affaires étrangères, directeur adjoint de la direction de la coopération pour le développement à l'OCDE |
|
M. Yves Bigot , directeur général de TV5 Monde et Mme Denise Epoté , directrice régionale marketing Afrique Mme Michèle Jacobs , directrice de la Francophonie, promotion du Français et des relations institutionnelles |
|
|
Jeudi 20 juin |
M. Alexandre Vilgrain, président du conseil des investisseurs en Afrique (Cian) |
|
Jeudi 27 juin |
M. Luc Derepas, secrétaire général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur |
|
Jeudi 4 juillet |
M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor |
|
Pour Mme Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de l'audiovisuel extérieur : M. Victor Rocaries , directeur général délégué M. Jean-Marc Belchi , directeur du développement Afrique M. Yves Rocle , adjoint à la directrice en charge de l'information Afrique |
|
|
Mardi 9 juillet |
Mme Anne Paugam, directrice générale de l'agence française de développement |
|
M. Justin Vaïsse , directeur du centre d'analyse, de prospective et de stratégie du ministère des affaires étrangères |
|
|
Mardi 17 septembre |
M. Pascal Canfin , ministre délégué chargé du développement |
|
Mercredi 16 octobre |
Pour l'ONG Coordination Sud : M. Laurent Chabert d'Hieres , directeur de l'ONG Eau vive et M. Philippe Mayol , chef du service Afrique au CCFD |
|
Mercredi 23 octobre |
Pour Mme Nicole Bricq
,
ministre du
commerce extérieur
:
|
|
Jeudi 24 octobre |
M. Philippe Errera , délégué aux affaires stratégiques |
Ont également été entendus par les co-présidents :
M. Yannick Morillon , directeur général du groupe Advens, opérateur français dans le domaine agro-industriel
M. Yves Boudot , directeur Afrique de l'AFD
SE. M. Charles Gomis , ambassadeur de Côte d'Ivoire
M. Vincent Hugueux , journaliste à l'Express
M. Alain Foka , journaliste à RFI
LISTE DES ENTRETIENS AU COURS DES DÉPLACEMENTS
AFRIQUE DU SUD
à Pretoria et Johannesburg
• Mme Elisabeth BARBIER , ambassadrice
• M. Olivier BROCHENIN, premier conseiller
Lundi 25 mars
• SE. M. Tebogo SEOKOLO , ambassadeur, directeur Europe, ministère des affaires étrangères (DIRCO)
• M. Jean-Claude BARRERE , attaché de défense
• M. Pierre LEMONDE , conseiller culturel a.i.
• M. Dominique LEBASTARD , chef du service économique régional
Mardi 26 mars
• S.E. M. Antonio RICOCA FREIRE , ambassadeur du Portugal
• Think tank ISS (Institute for Security Studies ), spécialisé dans les relations internationales - « action française, vue de l'Afrique du Sud »
• M. Jean-Michel DEBRAT , directeur régional de l'AFD
Mercredi 27 mars
• Lycée français (Mme Marie-Hélène Despin-Hirlimann, proviseur , et M. Patrick Parrot, attaché de coopération pour le français )
• Alliance française de Johannesburg
au Cap
• M. Benjamin Turock , membre du Parlement (ANC) : Co Chairperson Joint Committee on Ethics & members interests
• M. Ian Davidson , membre du Parlement ( DA) Shadow Minister - International Relations and cooperation
• Dr Adekeye Adebajo , Executive Director of the Centre for Conflict Resolution (CCR)
• Professeur Renfrew Christie , Universitaire - Bizerca
Hommes d'affaires français :
• M. Christophe Viarnaud - Directeur Methys
• M. Pascal Asin - Directeur Export Moet &Chandon
• M. Agustin Llorens - Directeur EDF au Cap
• M. Philippe Gomez - Directeur General - Agrana
• M. Philippe Jarry - Directeur Necotrans
• M. Gregory Massanet - Directeur Laser
ETHIOPIE
• Mme Brigitte Collet , ambassadrice
• M. Olivier Brochet , premier conseiller
• Lundi 13 mai
• SE. M. Michael Battle , ambassadeur des Etats Unis auprès de l'Union africaine , et Mme Molly Phee , vice-ambassadrice des Etats Unis auprès de l'Ethiopie
• M. Ahmed Shide, secrétaire d'Etat du ministère des finances et du développement économique (MOFED).
• M. Hailemariam Dessalegn , Premier ministre
• SE. Mme Isabel Heyvaert , ambassadrice du Brésil
• Lycée Guebre Mariam (M. Jean-Pierre Pasquiou, proviseur )
• Alliance française
• Groupe d'ambassadeurs africains (Tchad, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Togo, Rwanda, Liberia), et MM. Libère Bararunyetse , représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie et Wane El Ghassim , directeur Paix et sécurité de l'Union africaine
Mardi 14 mai
• M. Baghwant Bishnoi , ambassadeur d'Inde
• M. Adamu Ayana , secrétaire d'Etat à la Fonction publique
• Section éthiopienne des Conseillers du Commerce extérieur
• M. Berhane Guebrechristos , secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
• Mme Dlamini-Zuma , présidente de la Commission de l'Union africaine
Mercredi 15 mai
• Général Kinfe , directeur général de METEC
• M. Ramtame Lamamra , commissaire Paix et Sécurité de l'Union africaine
• M. Carlos Lopes , secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (à l'UNECA)
• Mme Fatima Haram ACYL , commissaire chargée du Commerce et de l'Industrie (à l'Union africaine).
• - Ambassadeurs de l'Union européenne
• Centre français des études éthiopiennes (MM. Jean-François Breton, directeur , M. Thomas Osmond (l'Islam en Ethiopie et les questions sociales), Jean Gabriel Leturcq (la question du Nil)).
• Représentants de la communauté française
CÔTE D'IVOIRE
• M. Georges Serre, ambassadeur
• M. Laurent Souquière , premier conseiller
Mardi 4 juin
• Rencontre avec les hommes de la force Licorne au Camp de Port-Bouët
• M. Daniel Kablan Duncan , Premier ministre, ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire
• M. Jean-Louis Billon , ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME
Mercredi 5 juin
• M. Pierre Magne , représentant du président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI)
• M. Marc Alberola , directeur général de Finagestion (et entretien avec les conseillers du commerce extérieur)
• M. Patrick Achi , ministre des infrastructures économiques
Jeudi 6 juin
• M. Oulatta Gaho , président de la commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale
• M. Jean-Louis Giacometti, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire
• SE. M. Thierry de Saint Maurice , ambassadeur de l'UE
• Déjeuner avec les ambassadeurs :
Son Exc. M. Karl Prinz, Ambassadeur d'Allemagne
Son Exc. M. Peter Huyghebaert, Ambassadeur de Belgique
Son Exc. M. Simon David Tonge, Ambassadeur de Grande Bretagne
Son Exc. M. Alfonso Di Rizo, Ambassadeur d'Italie
Son Exc. M. Zhang Guoqing, Ambassadeur de Chine
Son Exc. M. Phillip Carter III, Ambassadeur des Etats Unis
Son Exc. Mme Chantal de Varennes, Ambassadeur du Canada
Son Exc. M. Thierry de Saint Maurice, Chef de Délégation Union Européenne
M. Arnauld Akodjenou, Représentant Spécial adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies
• M. Bieffo, directeur du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI)
• M. Venance Konan , directeur général de Fraternité Matin
Vendredi 7 juin
• M. Alain Sterbik, consul général
• M. Jean-Claude Brou , ministre de l'Industrie
• M. Ally Coulibaly , ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur
• Représentants élus des Français et des associations de Français .
• M. Ibrahima Cissé Bacongo , ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
• M. Julien Lefilleur , représentant régional de l'Afrique de l'Ouest de Proparco
* 1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision, Highlights and Advance Tables. ESA/P/WP.220. http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Highlights.pdf
* 2 La conférence « Population, développement et planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone : l'urgence d'agir » relève d'une initiative conjointe de la France et des Etats-Unis visant à repositionner la planification familiale dans l'agenda des Etats de l'Afrique de l'Ouest francophone.
* 3 Le Sommet pour la planification familiale du 11 juillet 2012 : http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/about.php
https://www.gov.uk/government/news/family-planning-london-summit-11-july-2012
* 4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. Final Report with Annex Tables. New York, 2012, http://esa.un.org/unpd/wup/Documentation/final-report.htm
* 5 L'emploi des jeunes - Perspectives économiques en Afrique, OCDE, 2012, http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/in-depth/Emploi_des_Jeunes/
* 6 Rapport sur le développement dans le monde, Conflits, sécurité et développement, Rapport sur le développement dans le monde 2011. Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale. : wdronline.worldbank.org/worldbank/a/langtrans/3
* 7 L'Afrique et la question environnementale, Nasser Zammit, Editions Connaissance et savoirs, 2012.
* 8 Stratégie de la BAD pour la période 2013-2022
* 9 Les perspectives économiques de l'Afrique, OCDE, 2013
* 10 Le temps de l'Afrique, Jean Michel Severino, Olivier Ray
* 11 Evaluation des ressources forestières mondiales 2010, FAO
* 12 Contribution du Groupe de travail II au quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm-fr.pdf
* 13 Audition de M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé du développement, du 24 juillet 2012 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20120723/etr.html
* 14 Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, word Bank 2012
* 15 The State of the World's Refugees: In Search of Solidarity Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
* 16 Optimisation du phénomène migratoire pour l'Afrique, Banque Mondiale, 2012
* 17 Ces arrivées sont estimées à 14 millions de personnes au début des années 2000 et à 27 millions au début des années 2030. Benoît FERRY (dir.), L'Afrique face à ses défis démographiques : un avenir incertain, Karthala, CEPED, AFD, Paris, 2007.
* 18 Optimisation du phénomène migratoire pour l'Afrique, Rapport de la Banque Mondiale
* 19 A. Young, The African Growth Miracle, London School of Economics, 2009.
* 20 Africa's Future and the World Bank's Role in it
* 21 « L'heure des Lions » : L'Afrique à l'aube d'une croissance pérenne
* 22 Croissance 2012 reprise des analyses du Fond Monétaire International. Ce chiffre pourrait être révisé défavorablement pour la croissance malienne.
* 23 Révolution verte et équilibres géopolitiques au Sahel, Serge Michailof
* 24 Discours lors de la conférence de Bruxelles le 15 mai 2013 intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali ».
* 25 Philippe Moreau Defarges, relations internationales, point seuil, page 177.
* 26 69 e édition de l'assemblée générale de l'IATA Association du transport aérien international en Afrique.
* 27 L'équivalent vingt pieds ou EVP (en anglais, twenty-foot equivalent unit : TEU) est une unité approximative de mesure de conteneur qui regroupe à la fois les conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds. On l'utilise pour simplifier le calcul du volume de conteneurs dans un terminal ou dans un navire. Un conteneur de 20 pieds vaut 1 EVP et un conteneur de 40 pieds en vaut 2.
* 28 Dès la fin du VIIème siècle , on trouve des monnaies chinoises à Zanzibar; entre le XI et le XVème siècle, des produits chinois sont diffusés en Ethiopie, Tanzanie, Zimbabwe ; au début du XVème siècle, les jonques de la flotte de Zheng HE descendent le long des côtes orientales de l'Afrique jusqu'à l'actuel Mozambique
* 29 Source : ONUDC : Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest, février 2013
* 30 États africains reconnaissant le français comme langue officielle unique : Bénin, Burkina Faso, Congo, Congo RD, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo. États africains reconnaissant le français comme langue co-officielle : Burundi (+ kirundi), Cameroun (+ anglais), Centrafrique (+ sango), Comores (+ shikomor et arabe), Djibouti (+ arabe), Guinée équatoriale(+ espagnol) Haïti (+ créole), Madagascar (+ malgache et anglais), Rwanda (+ anglais et kinyarwanda), Seychelles (+ créole et anglais), Tchad (+ arabe)
* 31 Les expressions suivantes sont empruntées au dossier « Expressions et images d'Afrique-francophone » de TV5 monde. http://www.tv5.org
* 32 À côté de ces trois opérateurs, on trouve également une vingtaine d'autres intervenants de plus petite taille dont le GIP ADECIA qui intervient dans les secteurs de l'agriculture, l'alimentation, la pêche et la forêt, le GIP France Vétérinaire International, l'ADECRI, qui est l'opérateur de coopération technique réunissant l'ensemble des organismes nationaux de sécurité sociale français ou le GIP international travail, emploi, formation professionnelle, qui développe l'assistance technique internationale dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, des migrations et du co-développement.
* 33 La solidarité internationale à l'échelle des territoires : état des lieux et perspectives
Rapport d'information de M. Jean-Claude PEYRONNET, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales n° 123 (2012-2013) - 13 novembre 2012
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-123-notice.html
* 34 « Les nouveaux Français d'Afrique » Par François Soudan et Jacques Bertoin
* 35 La zone franc qui regroupe trois ensembles distincts dotés chacun d'une monnaie propre : les huit États d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) membres de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest (UEMOA), les six États d'Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad) appartenant à la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC) et les Comores.
* 36 Rapport d'information de MM. Christian CAMBON et André VANTOMME, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, n° 497 (2010-2011) - 6 mai 2011 http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-497-notice.html
* 37 Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans. Rapport d'information de MM. Jeanny LORGEOUX et André TRILLARD, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées n° 674 (2011-2012) - 17 juillet 2012
* 38 Audition de M. Hubert Védrine, sur la place de la France dans l'OTAN et les perspectives de l'Europe de la défense. Mardi 27 novembre 2012 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20121126/etr.html
* 39 Référé du 2 mai 2013 sur l'évolution du réseau diplomatique depuis 2007 http://www.ccomptes.fr/%20fr/Publications/Publications/L-evolution-du-reseau-diplomatique-depuis-2007
* 40 Examen par les pairs de l'OCDE sur la coopération au développement FRANCE 2013
* 41 Discours du Président de la République à la FAO le 3 juin 2008
* 42 Engagement du G8 de l'Aquila (juillet 2009)
* 43 Sommet de Copenhague décembre 2009
* 44 Sommet de Paris pour la Méditerranée, 13 juillet 2008
* 45 Déclaration du sommet franco-britannique, 27 mars 2008
* 46 Discours du Cap, 28 février 2008
* 47 Annonce française aux sommets d'Heiligendamm (2007) et de Toyako (2008)
* 48 Allocation supplémentaire au Fonds mondial annoncée par le Président de la République en septembre 2010.
* 49 Relevé de décisions du CICID du 5 juin 2009
* 50 Déclaration de la secrétaire d'Etat à l'écologie, Chantal Jouanno, le 28 octobre 2010 lors du Sommet international sur la biodiversité à Nagoya
* 51 Conférence de presse du Président de la République lors du Sommet du G8 / G20 de Muskoka le 27 juin 2010. L'engagement du G8 est de consacrer 5 Mds USD de financements additionnels dans les 5 prochaines années à la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans
* 52 Avis n° 150 (2012-2013) de MM. Jean-Claude PEYRONNET et Christian CAMBON, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 22 novembre 2012 http://www.senat.fr/rap/a12-150-4/a12-150-4.html
* 53 La politique française d'aide au développement, rapport rendu public mardi 26 juin 2012 : http://www.ccomptes.fr/content/download/44455/770878/version/1/file/rapport_public_politique_francaise_aide_publique_au_developpement.pdf
* 54 idem
* 55 Voir l'avis n° 150 (2011-2012) - tome 4 (Aide publique au développement) sur le projet de loi de finances de MM. Jean-Claude PEYRONNET et Christian CAMBON, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées http://www.senat.fr/rap/a12-150-4/a12-150-4.html
* 56 Rapport d'information de M. Jacques BERTHOU, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées n° 131 (2012-2013) - 14 novembre 2012 http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-131-notice.html
* 57 « Sahel : pour une approche globale » recommandations pour relever le défi de la sécurité Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat Rapport d'information n° 720 (2012-2013) de MM. Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher, co-présidents du groupe de travail sur le Sahel, MM. Jacques Berthou, Alain Gournac, Joël Guerriau et Rachel Mazuir, sénateurs
* 58 Situation en République centrafricaine (Q&R - Extrait du point de presse - 28 août 2013) http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/la-france-et-la-republique-1216/evenements-19300/article/situation-en-republique-108081
* 59 Mali : comment gagner la paix ? Rapport d'information de MM. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et Gérard LARCHER, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées n° 513 (2012-2013) - 16 avril 2013
* 60 La France en Afrique, Yves Gounin, édition de boeck. 2009.
* 61 L'impact de la crise de la zone euro sur la zone franc : analyse des canaux de transmission Hélène EHRHART et Luc JACOLIN Direction des Études et des Relations internationales et européennes Service de la Zone franc et du Financement du développement
* 62 Rapport d'information n° 720 (2012-2013) « Sahel : pour une approche globale » de MM. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et Gérard LARCHER.
* 63 Le massacre de Thiaroye, ou tragédie de Thiaroye, s'est déroulé dans la périphérie de Dakar au Sénégal le 1er décembre 1944 quand des gendarmes français renforcés de troupes coloniales ont tiré sur des tirailleurs sénégalais, récemment démobilisés et pour la plupart anciens prisonniers de guerre et qui manifestaient pour le paiement de ce qui leur était dû et promis depuis des mois. Le bilan officiel rappelé par François Hollande lors de son discours à Dakar le 12 octobre 2012 est de 35 morts.
* 64 Ce taux est sensiblement inférieur de l'ordre de 75 % si on prend en compte les écolages comme étant liés ce qui met la France dans la moyenne de l'OCDE.
* 65 Au coeur du développement : la recherche en partenariat avec les pays du sud. Mission commune d'information sur l'action extérieure de la France en matière de recherche pour le développement, présidé par M. Henri de RAINCOURT (UMP- Yonne), ancien ministre.
* 66 Pays à revenu intermédiaire: Angola, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Lesotho, Maroc, Nigéria, São Tomé-et-Principe, Soudan, Tunisie et Swaziland. Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Gabon, Guinée équatoriale, Libye, Maurice, Namibie et Seychelles.
* 67 Mars 2010 - Efficacité de l'interaction des organisations multilatérales dans les pays africains DGTPE