ANNEXE 5 -
REPARTITION DE LA
FACILITÉ FINANCIÈRE
AU 4 OCTOBRE
2016
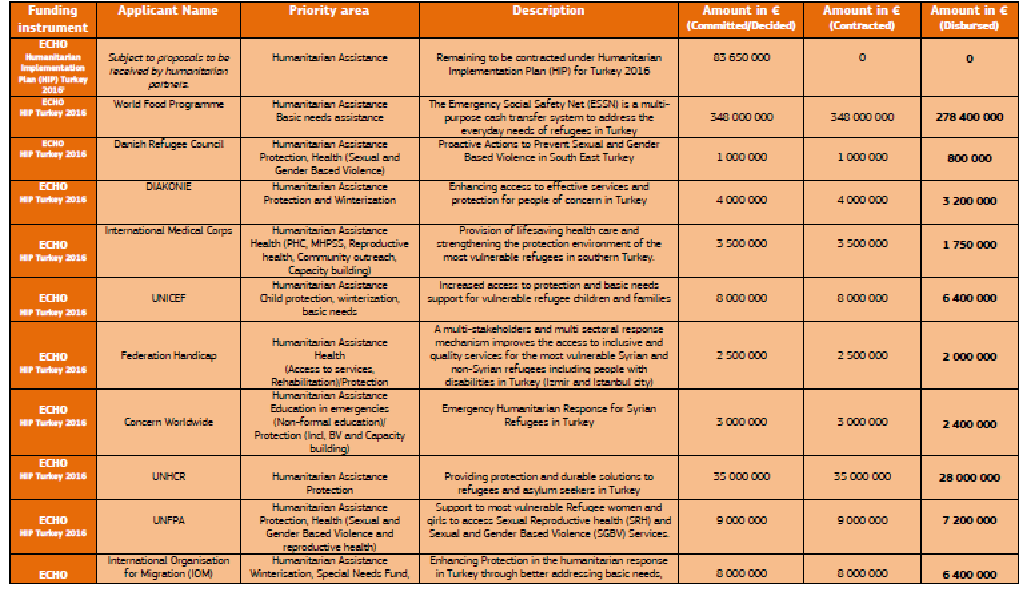
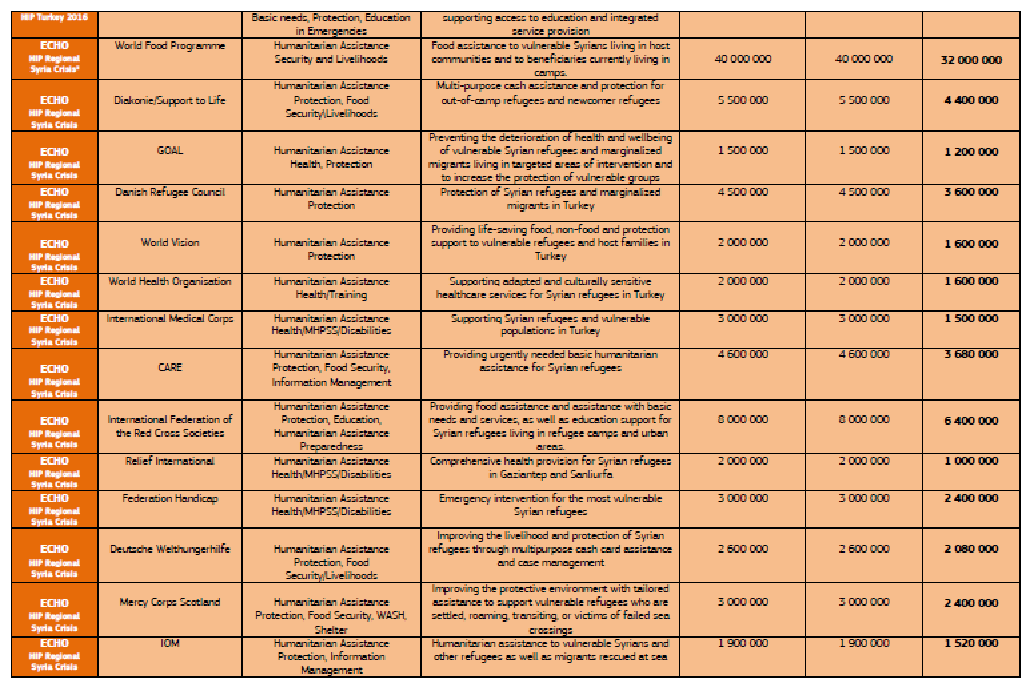
Source : Commission européenne
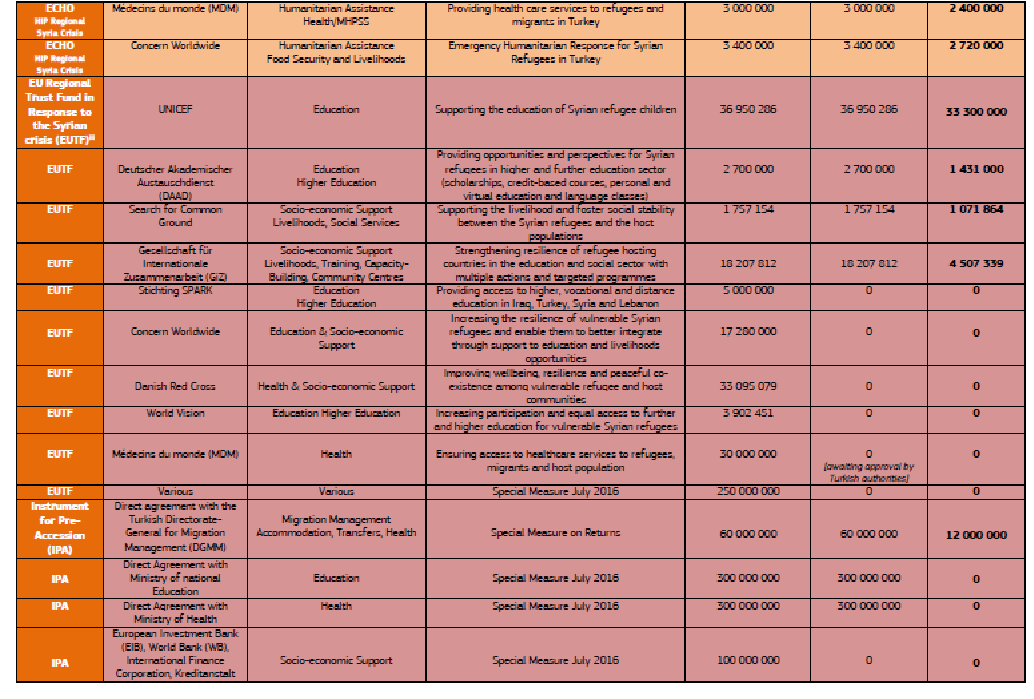
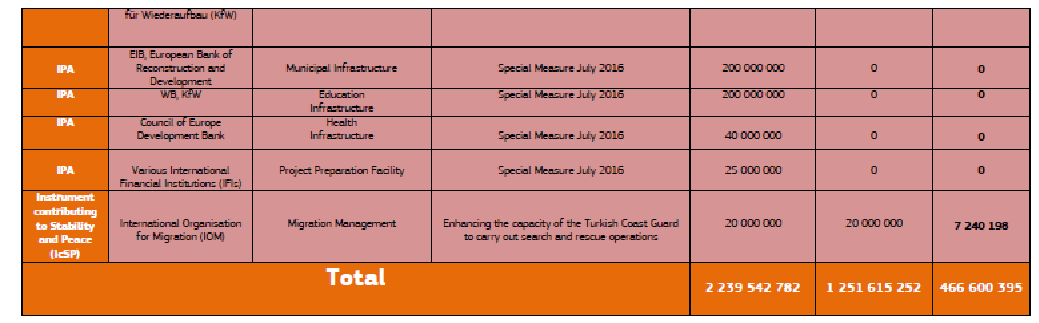
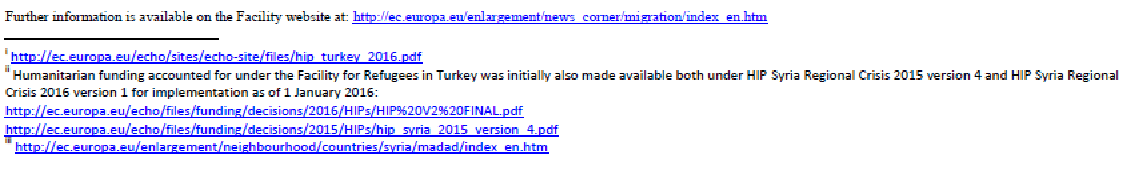
Source : Commission européenne
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Audition de M. Pierre-Antoine Molina,
directeur général des
étrangers en France au Ministère de l'intérieur
Mercredi 11 mai 2016
M. Jacques Legendre, président. - Nous sommes heureux de vous accueillir pour inaugurer les travaux de notre mission commune d'information sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur la crise des réfugiés, accord qui, en réalité, est plutôt un arrangement politique, une « déclaration », selon les termes utilisés par le Conseil européen. Vous êtes le directeur général des Étrangers en France et, en cette qualité, supervisez la direction de l'immigration, la direction de l'asile et la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Vous êtes venu avec MM. Raphaël Sodini, directeur de l'asile, Frédéric Joram, sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière, et Philippe Conduché, chef de la mission européenne de votre direction générale.
Quels volets de l'accord vous incombent plus particulièrement ? Vous pilotez le groupe opérationnel chargé de sa mise en oeuvre. Quel est précisément le rôle de ce groupe et quels acteurs réunit-il ? Où en est la mise en oeuvre de l'accord ? Quel a été le nombre d'arrivées en Grèce en provenance de Turquie depuis le 20 mars ? Combien de demandes d'asile ont été déposées en Grèce ? Quelles réponses ont-elles reçu ? Où en sont les relocalisations et les réinstallations prévues dans le cadre du « programme un pour un » ? Quels sont les problèmes rencontrés ? Quels sont les moyens humains et matériels mis à disposition par la France pour l'application de cet accord ?
M. Pierre-Antoine Molina, directeur général des étrangers en France au Ministère de l'intérieur. - La Turquie est le premier pays d'accueil - après la Syrie elle-même, bien sûr - des déplacés du conflit syrien, et le premier pays de transit vers l'Union européenne. Elle héberge environ 3 millions de réfugiés, dont 2,7 millions de Syriens. En 2015, Frontex a détecté 885 000 passages irréguliers de la Turquie vers la Grèce, soit dix-sept fois plus qu'en 2014, alors que le flux migratoire entre la Libye et l'Italie est resté à peu près stable. La France souhaite assurer de bonnes conditions d'accueil aux personnes ayant besoin de protection et faire diminuer les flux irréguliers, à la fois pour préserver les capacités d'accueil et pour protéger les migrants des réseaux criminels de passeurs. Pour atteindre ces objectifs, la coopération avec les pays de transit est sans doute l'un des outils les plus efficaces à court terme, surtout lorsque ceux-ci disposent de capacités d'action réelles. C'est pourquoi la coopération avec la Turquie est une priorité.
Les relations de l'Union européenne et de ses membres avec la Turquie étaient déjà particulièrement intenses avant cette crise migratoire : entre les instruments de pré-adhésion, de voisinage ou de paix et de stabilité, une enveloppe de 4 milliards d'euros était déjà prévue. Les accords conclus depuis ne sont pas des instruments conventionnels, en effet, mais des accords politiques. Depuis octobre 2015, trois réunions au sommet ont eu lieu, et la déclaration commune du 29 novembre 2015 a marqué un premier accord. Les discussions ont porté sur cinq volets. Les deux premiers - le processus d'adhésion et le renforcement du dialogue à haut niveau structuré entre l'Union et la Turquie - ne sont pas de mon ressort. Deux autres concernent plus directement ma direction générale : la libéralisation des visas et la mise en oeuvre des accords de réadmission, d'une part, et la lutte contre l'immigration irrégulière et la mise en place de voies légales d'accès à l'Union européenne, d'autre part. Quant au cinquième volet - le soutien financier de l'Union européenne et de ses États-membres à l'accueil des réfugiés en Turquie - il ne représente pas une aide à la Turquie elle-même mais à l'accueil des réfugiés en Turquie ; en novembre 2015, une facilité de 3 milliards d'euros a été mise en place à cet effet, et il a été prévu le 18 mars dernier que ce montant pourrait être dépassé, sans que le montant final soit précisé. Pour l'heure, 1 milliard d'euros est prélevé sur le budget de l'Union, et 2 milliards d'euros doivent être versés par les États-membres.
L'accord du 18 mars 2016 prévoit de rendre opérationnels les accords de réadmission. La Turquie et la Grèce ont signé il y a une quinzaine d'années un accord bilatéral de réadmission portant aussi sur les ressortissants de pays tiers, mais sa mise en oeuvre a rencontré des difficultés. Un accord de réadmission existe également entre la Turquie et l'Union européenne. Il est entré en vigueur en octobre 2014, mais la clause concernant les ressortissants de pays tiers ne doit entrer en vigueur qu'en octobre 2017 ; il est envisagé d'anticiper cette date. L'accord du 18 mars 2016 rappelle certaines garanties, notamment sur les modalités opérationnelles de la réadmission.
Il approfondit également les contreparties. Le processus de libéralisation des visas sera accéléré, sans que cela dispense la Turquie de se conformer aux 72 critères prévus dans la feuille de route initiale. Alors que le troisième rapport sur leur respect devait initialement être rendu par la Commission européenne à l'automne 2016, il a été présenté la semaine dernière. Et l'échéance de la libéralisation des visas a été fixée à la fin juin de cette année.
Le programme dit « un pour un » prévoit que pour chaque Syrien réadmis, un autre serait accueilli à titre définitif dans un État-membre de l'Union. Cela établira une voie légale d'accès à l'Union européenne, fondée sur la vulnérabilité des personnes et non leur propension à tenter un passage irrégulier. Les engagements pris par chaque État-membre au titre de la réinstallation sont déductibles de ceux pris au titre de la relocalisation.
L'accord est assorti d'un mécanisme de suivi qui a déjà donné lieu à un rapport de la Commission européenne publié le 4 mai 2016. Les flux irréguliers entre la Turquie et la Grèce, qui concernaient jusqu'à 10 000 personnes par jour à l'automne, puis 2 000 pendant l'hiver, ont considérablement diminué pour s'établir à quelques dizaines de personnes par jour aujourd'hui. Entre 600 et 700 personnes ont été réadmises en Turquie depuis la Grèce depuis le 18 mars dernier. Des échanges d'agents de liaison sont en cours entre la Grèce, la Turquie, Frontex et Europol. Une plateforme d'échange d'informations est mise en place.
Plusieurs dizaines de projets ont été approuvés par le comité de pilotage du fonds fiduciaire et 187 millions d'euros ont déjà été engagés, notamment dans des projets d'aide alimentaire, d'accompagnement social, de scolarisation ou de construction de centres communautaires.
La Commission européenne a publié en même temps que ce rapport une proposition législative tendant à l'exemption de visas pour les ressortissants turcs. Le troisième rapport de la Commission montre toutefois que plusieurs critères ne sont pas respectés, malgré des efforts importants faits par les autorités turques. La France considère que le respect effectif de tous les critères est un préalable incontournable à une exemption de visas et demande donc un quatrième rapport de progrès. Elle estime aussi que des modalités de suspension éventuelle de la libéralisation des visas doivent être définies.
D'après la Commission, 135 personnes ont été réinstallées depuis la Turquie vers les pays de l'Union européenne. La France a donné son accord à 81 dossiers dès le 1 er avril, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a depuis examiné sur place 227 dossiers. Mais comme il s'agit d'un processus volontaire, les personnes concernées arrivent quand elles le souhaitent, ce qui rend plus difficile leur comptabilisation.
Le bon fonctionnement de cet accord nécessite des efforts importants de la Grèce, avec un fort soutien de l'Union européenne. Pour faire réadmettre en Turquie des demandeurs d'asile, il faut en effet que la demande d'asile ait été examinée et qu'un recours suspensif ait pu être déposé. Il a donc fallu modifier la législation grecque, ce qui a été fait le 3 avril dernier, et la Turquie a dû apporter des garanties sur la protection dont bénéficieraient les personnes réadmises. En pratique, il faut que la Grèce dispose de moyens suffisants pour appliquer l'accord. C'est pourquoi les agences ont lancé des appels à la mise à disposition d'experts : 1 500 pour Frontex, surtout pour des escortes, et plusieurs centaines pour le Bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asylum Support Office, EASO). Certes, le système d'asile grec, déficient depuis longtemps, n'allait pas devenir performant du jour au lendemain. Trois mille demandes d'asiles ont été enregistrées et plusieurs centaines de décisions rendues, dont la moitié environ est défavorable. Les recours, toutefois, n'ont pas encore été jugés.
La France s'est pleinement mobilisée pour la mise en oeuvre de cet accord. Le Président de la République a pris le 18 mars 2016 un engagement, avec la Chancelière allemande, consigné dans une lettre cosignée par MM. Cazeneuve et de Maizière, les deux ministres de l'intérieur. Il s'agissait pour chaque pays de mettre à disposition 200 experts pour effectuer les escortes. La France s'est exécutée fin mars en déployant en 48 heures dans les îles grecques 122 escorteurs français - le premier contingent, et de loin. Les cent experts promis à EASO seront des officiers de l'Ofpra, des interprètes, des personnes susceptibles d'enregistrer des demandes d'asile ainsi que des spécialistes qui aideront à bâtir un système juridictionnel d'appel.
Les officiers de protection de l'Ofpra ont accéléré les opérations de relocalisation. Déjà, 900 personnes ont été relocalisées vers d'autres États-membres, dont 40 % en France. Si l'on ajoute à ces 360 personnes arrivées en France un nombre équivalent dont les dossiers ont été acceptés, notre pays est nettement le plus engagé. Sur les 50 000 personnes arrivées en Grèce avant le 20 mars 2016, la moitié environ est éligible à une relocalisation.
Le groupe opérationnel a organisé la montée en puissance de la contribution française à l'application de l'accord. La France soutient aussi le service de soutien à la réforme structurelle en Grèce, qui coordonne ces opérations. Envers la Grèce comme envers la Turquie, la France se mobilise pour tenir ses engagements.
M. Michel Billout, rapporteur. - Merci pour ces précisions. La nécessité d'une coopération active avec les pays de transit n'est contestée par personne, mais la nature de l'accord passé en mars soulève des interrogations, d'autant que c'est le premier de cette ampleur dans ce domaine. Il est un peu tôt pour évaluer son application, sans doute, mais notre mission dispose de plusieurs mois. L'actualité turque, avec le départ du Premier Ministre et les déclarations fracassantes du Président Erdogan, laisse perplexe sur la perspective d'une libéralisation des visas. Certes, cet accord vient conforter des conventions bilatérales antérieures. Dès lors, pourquoi fallait-il un étage supplémentaire ? Comment cet accord s'articulera-t-il avec le précédent ? Qu'apportera-t-il ? Le Parlement grec a dû accorder à la Turquie le statut de pays tiers sûr, ce qui ne va pas forcément de soi...
M. Pierre-Antoine Molina. - Cet accord est politique, il ne s'agit pas d'un instrument conventionnel. Il fournit un cadre à plusieurs processus antérieurs parallèles. La question de l'adhésion est ancienne ; celle de la libéralisation des visas était liée à la réadmission. Celle-ci ne fonctionnait pas car l'accord de la Turquie avec l'Union européenne n'était entré en vigueur, à ce stade, que pour les ressortissants turcs ; celui qui la lie à la Grèce n'était guère sollicité, les deux pays se renvoyant la responsabilité de cette situation. La complexité des relations entre la Grèce et la Turquie ne permettait pas d'atteindre le niveau de coopération nécessaire, en pratique, au fonctionnement d'une procédure de réadmission. Nous voyons bien, avec l'Italie, combien les échanges entre services doivent être fournis, alors même qu'il s'agit d'une frontière terrestre.
M. Claude Malhuret. - Merci de ces précisions éclairantes sur cet accord parfois troublant. Chacun comprend qu'il faut discuter avec la Turquie mais cet accord comporte des précisions qui risquent de le rendre inapplicable, ce qui posera un problème politique. Sur les visas, la Commission européenne a fixé 72 critères. Beaucoup ne sont pas respectés, même si la Commission a déclaré qu'il n'en manquait que cinq. Pis, la Turquie s'est parfois contentée, pour s'y conformer, d'adopter des textes qui ne seront pas appliqués.
Le non-respect des droits fondamentaux s'aggrave chaque jour : deux journalistes viennent d'être condamnés à cinq ans de prison, les équipes de Zaman ont été remplacées par des journalistes affidés au régime, d'autres médias ont été supprimés, la magistrature est au pas et Reporters sans frontières classe la Turquie au 151ème rang en matière de liberté de la presse, entre le Tadjikistan et le Congo ! Les universitaires ayant signé une pétition contre la répression au Kurdistan sont révoqués, et 2 000 citoyens turcs ont été inculpés d'outrage au président depuis l'élection de M. Erdogan à la présidence de la République turque. Il serait donc provocateur d'affirmer que le critère de respect des droits fondamentaux est respecté.
Le président Erdogan a expliqué qu'il ne modifierait pas la loi antiterroriste. On peut le comprendre, étant donné la situation au Kurdistan, mais cela nous pose un problème. Quant à la lutte contre la corruption, vu le niveau auquel se situent les principaux problèmes de corruption en Turquie, il est peu probable qu'elle progresse d'ici le prochain Conseil européen. La France exigera le respect effectif des critères, demandera un quatrième rapport... Mais dans le troisième rapport, la Commission s'est discréditée en ne mentionnant pas le respect des droits fondamentaux !
Bref, nous nous sommes engagés dans un processus sans issue, ce qui ne manquera pas d'entraîner des problèmes majeurs entre pays européens - déjà, le premier accord a été pratiquement imposé par Mme Merkel - et entre l'Union européenne et la Turquie. Voyez-vous, à votre niveau, une solution à ce problème inextricable ?
M. Jean-Yves Leconte. - Merci pour ces informations. Qui sélectionne les personnes réinstallées ? D'où arrivent les candidatures ? Quelle est l'articulation de la réinstallation avec la procédure de demande d'asile ? Combien avons-nous enregistré de demandes d'asile au premier trimestre de 2016 ? En février dernier, j'ai constaté que le système grec d'asile avait beaucoup progressé, mais comme tous ceux qui veulent rester en Grèce doivent déposer une demande d'asile, puis faire appel en cas de rejet, le système s'est embolisé en deux mois. N'avons-nous pas le même problème, d'ailleurs ? Du coup, les escorteurs de Frontex chôment, pour l'instant.
Les passeports biométriques turcs seront-ils lisibles par les polices aux frontières des membres de l'espace Schengen ? La Moldavie, la Géorgie ou l'Ukraine demandent aussi la suppression des visas. Une fois que les conditions fixées sont réunies, nous leur imposons une période probatoire, dont nous allons dispenser la Turquie. Est-ce bien raisonnable ? Cela n'aura-t-il pas des conséquences sur les négociations avec d'autres pays ?
M. Jean-François Rapin. - Comment la charge des 2 milliards d'euros sera-t-elle répartie entre les États-membres? Quelles sommes supplémentaires sont prévues, et à quelles conditions ?
M. Jean-Pierre Vial. - En Italie, comment se passe la réadmission ? Qui sélectionne les personnes bénéficiant du programme « un pour un » ? Il ne faudrait pas que ceux qui sont entrés dans une procédure d'asile régulière, qui peut être longue, s'en trouvent exclus.
M. Michel Billout, rapporteur. - Cet accord a été vivement critiqué par les organisations humanitaires. La France est très volontariste dans sa mise en oeuvre. Le ministère de l'Intérieur avait-il analysé ses effets juridiques, notamment au regard du principe de non-refoulement ? Sa solidité a été renforcée, mais les critiques demeurent, y compris de la part du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). Les ONG évoquent des expulsions collectives, contestent le statut de pays tiers sûr accordé à la Turquie et dénoncent la rétention de migrants dans des conditions incontrôlées. Comment répondez-vous à ces critiques ? Pensez-vous que cet accord soit incontestable sur le plan juridique ?
M. Pierre-Antoine Molina. - Le premier point de l'accord du 18 mars 2016 prévoit que le renvoi en Turquie des migrants en situation irrégulière se fera en totale conformité avec le droit de l'Union européenne et le droit international, ce qui exclut toute forme d'expulsion collective. Le principe de non-refoulement sera respecté. Toute demande d'asile sera traitée individuellement par les autorités grecques, en coopération avec le HCR. Reste à rendre effectives ces garanties. La Commission européenne a écrit le 16 mars dernier que les législations grecque et turque présentaient des insuffisances. Une loi a donc été adoptée par la Grèce, qui met en place des comités d'appel et reconnaît la Turquie comme pays tiers sûr. En effet, la directive « Procédures » prévoit qu'une demande d'asile peut être rejetée comme irrecevable si le pays de renvoi peut être considéré comme premier pays d'asile ou comme pays tiers sûr - notions définies par les articles 35 et 38 de cette directive.
Il fallait aussi que la Turquie prenne certaines mesures. Saluons au passage son effort d'accueil et de protection des 2,7 millions de Syriens qui sont sur son territoire, dont 300 000 environ sont hébergés dans des camps. Le statut de protection temporaire qui leur est accordé leur offre l'accès à certains droits sociaux. Le 12 avril dernier, la Turquie a renforcé ces garanties, notamment en abrogeant une disposition faisant perdre le bénéfice du statut de protection temporaire aux personnes qui quittaient son territoire : comment pourraient-elles y être réadmises sinon ? Les 6 et 24 avril 2016, elle a donné des précisions par échange de lettres en faveur des ressortissants d'autres pays que la Syrie, notamment les Afghans et les Irakiens.
Cela dit, le caractère de pays tiers sûr de la Turquie ne peut être déclaré qu'au cas par cas, en fonction de chaque situation individuelle. Des entretiens approfondis sont donc nécessaires. En moyenne, la moitié des dossiers est aujourd'hui considérée comme recevables. Pour les autres, le recours est suspensif si la décision est fondée sur la notion de pays tiers sûr.
Il n'y a aucune substitution entre la réinstallation et nos programmes de visa pour asile ou nos engagements à l'égard du HCR pour le Liban et la Jordanie. En revanche, sur les 30 500 personnes que nous devions relocaliser, certaines seront réinstallées. En effet, la Hongrie n'a pas souhaité bénéficier du programme de relocalisation. Par conséquent, 54 000 places n'étaient plus attribuées, dont 10 000 pour la France. C'est pourquoi il a été décidé que le nombre de Syriens réinstallés depuis la Turquie pourra être déduit de ce volant de relocalisés non utilisé. Pour l'heure, il y a eu 135 arrivées effectives dans l'ensemble de l'Union européenne.
La réinstallation se fait de plusieurs manières. La France ne prend que des dossiers du HCR, qui font l'objet d'un double examen sur place : l'Ofpra statue sur le besoin de protection et la DGSI effectue des vérifications de sécurité. Un visa est ensuite délivré et la personne entre sur le territoire sans avoir à demander l'asile. Plusieurs organismes l'aident à trouver un logement et l'accompagnent socialement. La mobilisation du logement fait l'objet d'une mission, conduite par un préfet.
Un jugement de la CEDH de 2011 constatait que le règlement Dublin ne pouvait être mis en oeuvre en Grèce faute de garanties sur son système de l'asile. Nous étions dans une situation anormale en Grèce avec un nombre élevé d'arrivées irrégulières pour une demande d'asile quasiment inexistante. Cette situation traduisait une déficience du système grec très importante, d'où la nécessité d'efforts rapides pour y remédier.
La France est attachée à ce que les critères de la feuille de route soient durablement respectés et plaide donc pour un contrôle régulier de leur application. Chaque processus en cours de libéralisation des visas doit être examiné indépendamment des autres.
Sur les droits fondamentaux, la Commission estime que plusieurs critères ne sont pas respectés, notamment le critère n° 65 ou celui relatif à la lutte contre la corruption. La libéralisation des visas ne bénéficiera qu'aux personnes munies d'un passeport biométrique. Or la distribution de ces passeports n'a pas débuté... La Commission européenne demande qu'ils soient lisibles par les polices des États-membres. Vu le retard pris par la Turquie, une solution transitoire pourrait être adoptée jusqu'en octobre 2016.
Environ 70 % des personnes interpellées dans les Alpes-Maritimes sont réadmises. Si ce taux était atteint entre la Grèce et la Turquie, ce serait un net progrès !
Sur les 3 milliards d'euros évoqués, la contribution de la France devrait être de l'ordre de 300 millions d'euros. Oui, 3 milliards d'euros supplémentaires ont été envisagés, mais cela ne figure pas dans l'accord du 18 mars dernier.
M. Raphaël Sodini, directeur de l'asile. - Le nombre de demandes d'asile en France a augmenté de 23 % en 2015. Au second semestre, ce chiffre a même atteint 45 %. Au premier trimestre 2016, la hausse est de 20 % et concerne davantage des personnes isolées, surtout originaires d'Afghanistan, de Syrie et du Soudan. Les Balkans ne figurent plus parmi les premières zones d'origine. Sur douze mois glissants, la hausse est de 20 %.
M. Jacques Legendre, président. - Nous vous remercions pour ces éclaircissements.
Audition de M. Christophe
Léonzi,
directeur-adjoint de l'Union européenne au
ministère des affaires étrangères et du
développement international
Mercredi 11 mai 2016
M. Jacques Legendre, président. - Nous accueillons M. Christophe Léonzi, directeur adjoint en charge de l'Union européenne au Quai d'Orsay, accompagné de Mme Florence Lévy, responsable adjointe du service des politiques internes et des questions institutionnelles dans cette direction et de M. Bertrand Buchwalter, sous-directeur en charge de l'Europe méditerranéenne au Quai d'Orsay et, à ce titre, en charge du suivi de la Turquie.
L'audition portera sur l'accord - qui n'en est pas vraiment un - entre l'Union européenne et la Turquie sur la crise des réfugiés. Je vous propose, après une brève évocation du contexte de crise migratoire et du premier accord passé en novembre, de nous présenter les différents volets de cet arrangement : renvoi des migrants en Turquie, asile en Grèce, réinstallations, facilité financière, libéralisation des visas pour la Turquie, relance du processus d'adhésion, etc. Cet accord, qui a donné lieu à des débats virulents, reste très critiqué, car il pourrait nous conduire à renoncer aux principes défendus par l'Europe, tant vis-à-vis des réfugiés que dans notre position à l'égard de la Turquie. Cette dernière se montre manifestement réticente à accomplir les progrès qui sont encore attendus pour la libéralisation des visas, en témoignent les récentes déclarations du président Erdogan.
M. Christophe Léonzi, directeur-adjoint de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères et du développement international. - En ce qui concerne le contexte de cet accord, la situation syrienne est l'une des causes de cette crise qui s'est développée en 2015-2016 et s'est traduite par un flux de 850 000 personnes en 2015 à travers la Turquie et la Grèce, et encore 135 000 de janvier à mars 2016, avec des pics de 10 000 entrées par jour à l'automne.
L'impact a été considérable dans les trois principales destinations : Allemagne, Suède et Autriche. La Suède a accueilli 130 000 réfugiés, soit le total le plus élevé par habitant. Ses capacités d'accueil sont saturées.
La fermeture progressive de la route des Balkans à l'initiative de l'Autriche et de la Hongrie a placé la Grèce dans une situation explosive : en quelques semaines, le pays a dû faire face à la venue de 50 000 migrants, flux difficile à gérer pour un pays dont les capacités administratives sont déjà limitées par la crise.
Quatrième élément, les conditions déplorables dans lesquelles ces mouvements de population se déroulent. L'estimation est incertaine, mais en 2015, 500 à 800 personnes se seraient noyées dans la mer Égée ; 150 à 200 début 2016. Une économie criminelle de trafic d'êtres humains s'est développée, avec un chiffre d'affaires évalué à 3 milliards d'euros pour 2015.
Enfin, le risque sécuritaire lié au terrorisme est réel, puisque certains des auteurs des attentats de 2015 et 2016 ont emprunté cette voie.
Un plan d'action a été conclu avec la Turquie le 29 novembre, prévoyant un effort accru en matière de contrôle des frontières, une lutte renforcée contre les trafics migratoires et le soutien budgétaire de l'Union européenne. Ensuite, le sommet Union européenne-Turquie du 7 mars a eu plusieurs résultats importants : la déclaration du 18 mars prévoyant la réadmission en Turquie de tous les migrants irréguliers, commencée le 4 avril selon le principe du « un pour un » : un Syrien réinstallé de Turquie dans l'Union européenne pour un Syrien renvoyé de Grèce en Turquie, afin de dissuader les réseaux criminels et de substituer des flux migratoires légaux aux flux migratoires illégaux ; une accélération du déboursement des 3 milliards d'euros d'aide européenne prévus le 29 novembre ; une accélération des négociations d'adhésion, notamment sur le chapitre 33 ; et une libéralisation des visas avant la fin juin, sur la base du respect des 72 critères. Enfin, la déclaration souligne la nécessité d'une amélioration des conditions humanitaires en Syrie.
S'agissant des priorités qui ont été les nôtres dans cette négociation, le premier objectif était de sauver des vies en substituant les voies légales au trafic d'êtres humains ; ensuite, une coopération efficace avec Ankara reposant sur une lutte accrue de la Turquie contre les trafics et une coopération policière dans le respect du droit international et européen, côté grec comme côté turc ; enfin, un engagement de la Turquie sur la protection des réfugiés syriens et non-syriens. Par l'accord du 18 mars, les autorités turques s'engagent au respect du droit d'asile européen. S'agissant du programme « un pour un », nous avons demandé que la réinstallation des migrants s'effectue dans le cadre des engagements existants pris par chaque État membre en matière de relocalisation- soit 30 000 personnes pour la France, à raison de 400 par mois à terme.
Concernant la libéralisation des visas, nous avons demandé le plein respect des procédures de l'Union européenne (les 72 critères) ; concernant les négociations d'adhésion et l'ouverture du chapitre 33, qui définit la contribution financière du futur Etat membre consacrée aux questions budgétaires et ne prend vraiment son sens qu'à la fin de la négociation, nous souhaitions une progression sur la seule base du mérite et des réformes concrètes. Les financements visés sont destinés aux réfugiés syriens ou non syriens et portent sur la santé, l'éducation, l'alimentaire, sur la base de besoins concrets. La définition des projets doit s'effectuer dans un dialogue direct entre la Commission européenne et l'ONG, sans intervention des autorités turques. Nous avons enfin insisté sur nos attentes en matière de respect des droits de l'homme et de liberté d'expression.
Vis-à-vis de la Grèce, qui se trouve dans une situation très difficile, l'Union européenne doit marquer sa solidarité. Nous le faisons au niveau français : 362 personnes ont d'ores et déjà été relocalisées et nous allons poursuivre sur un rythme de 400 par mois. De même, nous prêtons notre concours aux Grecs à travers la mise à disposition de deux cents agents français (juges, interprètes, spécialistes du droit d'asile, etc.) destinés au renforcement des équipes dans les hotspots et à la conduite des opérations de criblage. Depuis l'accord, la situation s'est détendue en Grèce. Nous avons aussi contribué au programme d'aide Euro Echo de 700 millions d'euros sur trois ans, auxquels s'ajoutent 200 millions versés en 2015, mis sur pied dans un délai record de quelques semaines.
Nous y insistons depuis le début : l'accord Union européenne-Turquie doit s'inscrire dans une approche globale, ce qui implique que l'UE renforce le contrôle des frontières extérieures, notamment avec la création d'un corps de garde-frontières, mais aussi qu'elle soit attentive aux autres voies d'accès.
C'est ainsi que nous nous sommes montrés particulièrement attentifs au volet africain. L'engagement de l'Union européenne sur le dossier syrien est important.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'accord, je peux indiquer, sur la base du récent rapport de la Commission, que plus d'un mois après l'accord, nous sommes passés de 2 000 à 3 000 entrées par jour début 2016 à 50 à 60 en mai. Dans les trois semaines précédant l'accord, 26 800 entrées ont été enregistrées, et 5 800 dans les trois semaines suivantes, ce qui démontre l'effet dissuasif de ce dispositif.
La Turquie a également décidé d'accorder une protection temporaire renouvelable aux Syriens admis sur son territoire ainsi qu'un accès au marché légal du travail, une scolarisation pour les enfants et une protection internationale. A minima, les non Syriens - principalement Pakistanais et Afghans - ne seront pas refoulés du territoire turc, aux termes d'un engagement pris auprès de l'Union européenne.
L'Union européenne a renforcé sa délégation à Ankara pour surveiller la mise en oeuvre des accords. Un programme de visites des centres d'accueil des migrants a été établi.
Les financements européens sont conditionnés au respect des engagements de l'accord ; de plus, ils vont directement aux ONG, ce qui nous donne un aperçu des développements sur le terrain.
La Grèce a accéléré le traitement des demandes d'asile, réduisant le délai à deux semaines. Une centaine de demandes de recours sont en cours d'examen. Les hotspots sont en train d'être renforcés. Le pré-enregistrement accéléré de 21 000 réfugiés a été entamé avant l'enregistrement proprement dit, auquel nous participerons.
Pas moins de 22 000 réinstallations de la Turquie vers l'Union européenne sont prévues ; 16 000 offres n'ont pas encore été honorées à ce jour. En France, l'objectif est de 6 000 sur deux ans.
La Commission n'a pas constaté de report massif des flux de réfugiés de la mer Égée vers la Méditerranée centrale, même si cette dernière route connait à nouveau une hausse de fréquentation comparable à celle de l'année passée pour la même période. .
Enfin, dans le cadre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, des contrats d'un montant de 77 millions d'euros ont été signés et les premiers paiements effectués fin mars ; une évaluation conjointe a été présentée au comité de pilotage le 12 mai. Une enveloppe de 165 millions a été débloquée. Six nouveaux projets en faveur des réfugiés seront financés par le fonds d'affectation spéciale de l'Union européenne pour l'aide d'urgence (dit fonds « Madad ») à hauteur de 76 millions d'euros.
En dépit des nombreuses difficultés quotidiennes, il y a du positif. Les flux illégaux ont été jugulés au profit des circuits légaux. Face à l'urgence, cet accord était la seule option viable.
M. Michel Billout, rapporteur. - Vos collègues du ministère de l'intérieur, que nous avons interrogés, ont mis en avant la réactivité de la France dans la mise en oeuvre de l'accord politique. Nous sommes plus interrogatifs quant à sa place dans la négociation avec la Turquie, dont l'Allemagne semble avoir pris le leadership exclusif. Qu'en est-il ? Les États membres semblent répondre en ordre dispersé à une crise sans précédent.
Sur le plan juridique, la limitation géographique que la Turquie continue à appliquer au statut de réfugié, réservé aux seuls ressortissants européens, semble constituer une entorse aux critères de définition d'un « pays tiers sûr » qui autoriserait le renvoi des réfugiés vers ce pays.
Au vu des récentes déclarations du président turc dénonçant les critères restant à remplir, en particulier la modification de la loi antiterroriste, un échec de l'accord est envisageable. Dans cette hypothèse, un plan B est-il prévu ou se satisfera-t-on d'avoir ralenti le rythme des arrivées ?
La libéralisation des visas ne constituerait-elle pas une inégalité de traitement au détriment des autres pays en négociations avec l'Union européenne, comme l'Ukraine ou plusieurs États des Balkans ?
En cas de contestation de l'accord devant un juge, qui serait condamné ? La Grèce ?
Vous mettez en avant la préservation des vies humaines ; ne craignez-vous pas le développement d'autres routes, en Méditerranée centrale mais aussi vers l'Albanie par l'Adriatique ?
Enfin, comment les migrants renvoyés sont-ils orientés et pris en charge ? Dans quels centres sont-ils logés, et l'accord laisse-t-il la possibilité à des représentants de l'Union européenne d'y accéder ? Nous préparons un déplacement sur le terrain en juin.
M. Christophe Léonzi. - La base de départ des négociations est l'accord du 29 novembre, jugé insuffisant puisque les flux se sont poursuivis dans les mêmes proportions. L'Allemagne ayant accueilli 80 à 90 % des migrants, sa motivation politique était forte, ce qui explique l'activité importante déployée par la chancelière Merkel - mais d'autres aussi - lors du sommet du 7 mars.
Nous avons agi en accord étroit avec notre partenaire allemand, avec des discussions à toutes les étapes. La France a porté l'exigence de respect du droit international, de relocalisations dans le cadre des engagements déjà pris par les États membres, du respect des critères définis en matière de visa et de processus d'adhésion. Le dialogue franco-allemand a été constant à tous les niveaux.
Notre priorité a aussi été de revenir à une approche européenne cohérente et unifiée, dans cette crise où des initiatives se prenaient de manière désordonnée. C'est pourquoi nous avons poussé à la création d'un corps européen de garde-côtes et de garde-frontières et à la conclusion d'un accord rendant sa cohérence à l'action de l'Union.
M. Bertrand Buchwalter, sous-directeur en charge de l'Europe méditerranéenne au ministère des affaires étrangères et du développement international. - La question de la limitation géographique à l'application de la Convention de Genève fait l'objet du point numéro 24 de la feuille de route vers la libéralisation des visas. Il est demandé à la Turquie d'adopter des mesures d'effet équivalent à la protection assurée aux réfugiés par le protocole de Genève. Celle-ci a d'abord accordé une protection temporaire aux réfugiés syriens avant de l'étendre aux réfugiés venus d'autres pays. Ils ont enfin pu bénéficier d'un accès au marché du travail.
Les déclarations turques sur la législation antiterroriste ne modifieront pas notre position sur le respect de la totalité des critères. La Turquie doit s'aligner sur la définition européenne du terrorisme mais aussi mettre les pratiques de ses forces de sécurité et de son appareil judiciaire en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous serons très attentifs au respect de ce critère, dans un contexte de forte exposition du pays à la menace terroriste de Daech mais aussi du PKK et du DHKP-C.
Les flux de migrants en Méditerranée centrale n'ont pas augmenté significativement depuis 2015 malgré plusieurs tragédies. On a dénombré 27 000 arrivées sur les côtes italiennes en 2016, ce qui est conforme au rythme de 2015. Les personnes concernées, qui ne sont pas éligibles à la protection internationale, proviennent pour plus de moitié d'Afrique subsaharienne.
Mme Florence Lévy, responsable adjointe du service des politiques internes et des questions institutionnelles à la direction de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères et du développement international. - Déjà, 386 réfugiés ont été renvoyés de la Grèce vers la Turquie, dont quatorze Syriens et une majorité d'Irakiens et d'Afghans. Ils sont dirigés vers deux types de camps : ceux qui accueillent les réfugiés éligibles au droit d'asile au titre du « un pour un » et un camp regroupant les migrants considérés comme économiques près de la frontière turco-bulgare, où ils font l'objet d'une procédure de retour vers leur pays de transit ou d'origine. L'Union européenne est très présente dans cette procédure et soutient les autorités grecques dans l'organisation des retours sur le plan technique, à travers la mise à disposition d'experts, de bateaux, de spécialistes de l'asile, ainsi que sur le plan financier.
M. Christophe Léonzi. - Difficile de répondre sur un éventuel contentieux contre l'accord : tout dépend du point sur lequel porterait la contestation. Il est probable qu'une procédure en justice serait engagée par une voie nationale.
M. Claude Malhuret. - Votre collègue de l'Intérieur m'a donné une réponse très partielle sur la libéralisation des visas qui, il est vrai, intéresse davantage le Quai d'Orsay. C'est un sujet politique épineux et certains pays - sans compter les opinions publiques d'autres États plus ouverts sur la question - sont très réservés. L'accord doit par conséquent être inattaquable au plan technique et juridique. Or ce n'est pas le cas.
D'après la Commission européenne, cinq des 72 critères ne sont pas satisfaits - à mon avis, le chiffre est plus élevé, mais passons. Sur la loi antiterroriste, vous avez répondu. Le deuxième critère, la lutte contre la corruption, recouvre une situation qui ne sera certainement pas réglée avant longtemps. Enfin, les droits fondamentaux, qui font partie du bloc 4 de la feuille de route, n'ont pas été évoqués par la Commission ; or personne ne peut prétendre qu'ils sont respectés, ils le sont même de moins en moins. Des journalistes ont été condamnés à des peines de cinq ans de prison ; ceux du quotidien d'opposition Zaman ont été licenciés ; une agence de presse a été fermée ; deux mille procédures pour outrage au Président ont été engagées.
La Commission n'a pas inclus les droits fondamentaux dans la liste des critères non respectés. C'est indéfendable ! M. Molina n'a évoqué que les critères de la protection des données personnelles. On fait également valoir les mécanismes de sauvegarde qui, en cas de non-respect des critères, permettent une suspension temporaire du régime de libéralisation. Reste qu'on s'assoit sur les principes !
Les protocoles additionnels nos 4 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatifs à la libre circulation et à la protection des étrangers, n'ont pas été ratifiés par la Turquie. C'est un problème majeur, qui au demeurant ne disparaîtra pas avec la ratification.
Côté turc comme côté européen, la question du plan B reste posée. Nous resterons vigilants sur ce point.
M. Jean-Yves Leconte. - Si aucun transfert significatif de la voie turque vers la voie italienne n'est relevé - si ce n'est une connexion limitée via l'Égypte - on enregistre une augmentation importante côté italien. Les murs entre les pays des Balkans n'étant pas hermétiques, certains réfugiés parviennent de Grèce vers l'Europe du Nord par cette voie. Tout n'est pas réglé. Il faut prendre en compte les dynamiques.
Les 250 000 euros d'amende par personne pour les pays qui refusent la répartition automatique des demandeurs d'asile ne me gênent pas sur le principe, mais c'est une provocation vis-à-vis des pays déjà réticents. Ce n'est pas le meilleur moyen de reconstruire de la solidarité. Quelle est la position française ?
Comment peut-on envisager la suppression des visas pour les citoyens turcs sans avoir vérifié la réalisation effective des engagements ? Pourquoi ces exigences réduites ? Alors que la Turquie est plus loin que jamais de l'Union européenne sur les droits fondamentaux, la liberté de la presse ou le fonctionnement de la justice, nous accélérons le processus d'adhésion ! Les autres pays engagés dans la procédure, comme la Serbie ou la Macédoine, en concluront que moins l'on progresse, plus l'on obtient de concessions...
M. Didier Marie. - Cet accord nécessaire ne doit pas masquer les difficultés. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe vient de rendre un rapport alarmant sur la situation en Grèce, notamment dans les îles où le déploiement des hotspots rencontre des obstacles. Les réfugiés installés à Athènes et au Nord, à Idomeni, vivent dans des conditions sanitaires et de sécurité difficiles. Quid des enfants isolés ? Que compte faire l'Union pour améliorer l'accueil sur le territoire grec et rendre opérationnels tous les hotspots ? Comment aider la justice et l'administration grecques à s'organiser ? Les tribunaux grecs sont embolisés.
Les dernières positions du président Erdogan n'incitent guère à la confiance. Qui plus est, le prochain congrès de l'AKP devrait entériner la mise à l'écart du Premier ministre, Ahmet Davutoglu, avec lequel les relations se sont dégradées. Que se passera-t-il si M. Erdogan, comme on peut le craindre, fait monter les enchères ? De quels leviers dispose l'Union européenne pour s'assurer que les autorités turques respectent leurs engagements ? Comment seront-ils évalués et à quel rythme ?
Enfin, il faut évoquer les réticences turques à engager la coopération policière avec d'autres États membres : avec Chypre en particulier, les relations sont pour le moins complexes.
M. Philippe Kaltenbach. - Les accords ont tari le flux migratoire sur la mer Égée. Les décès ont pratiquement cessé et le risque de nouvel afflux est minime.
En Turquie, beaucoup d'enfants syriens mendient dans les rues ou travaillent dans des usines ; très peu sont scolarisés. Très attendu, l'argent promis par l'Europe aura des effets positifs. Cependant, le chantage aux visas du président ne laisse pas d'inquiéter. La libéralisation ou, pour mieux dire, la suppression des visas est un point fort du discours politique. L'atterrissage en juin sur la question semble difficilement envisageable. On ne voit pas d'évolution sur les droits fondamentaux, l'emprisonnement des journalistes ou la loi antiterroriste. En juin, on constatera que la Turquie ne veut pas respecter les critères sur les droits fondamentaux et la loi antiterrorisme, et la suppression des visas sera bloquée. Pourrons-nous alors poursuivre les discussions sans remettre en cause les résultats positifs déjà obtenus ?
M. Pascal Allizard. - Je prépare, dans le cadre de la commission des affaires européennes, un rapport sur le partenariat oriental. Avec la Géorgie, les discussions évoluent positivement ; or je n'ai pas l'impression que la Turquie fasse les mêmes efforts. Y a-t-il des États plus égaux que d'autres ? L'urgence et le réalisme politique justifient-ils que l'on s'assoie sur les valeurs et principes qui ont présidé à la construction de l'Union européenne ?
M. Christophe Léonzi. - J'essaierai de répondre de la façon la plus détaillée à vos questions d'une précision remarquable. Soyez assurés que la France, très impliquée sur ce sujet, jouera pleinement son rôle, en particulier sur la question de l'Etat de droit.
Nous comptons sur le dialogue pour faire progresser la situation des droits de l'homme en Turquie, même si la situation n'est pas simple. Droits de l'homme, État de droit, séparation des pouvoirs sont des éléments fondamentaux. Dans les négociations d'adhésion, ils sont traités dans le cadre des chapitres 23 et 24, qui sont à la fois le point de départ et le terme de ces négociations. La France considère avec attention et préoccupation certains développements récents, comme les intimidations contre les journalistes et les universitaires. Notre ambassade et notre consul général, avec plusieurs de leurs collègues de l'Union européenne, suivent les procès en cours. Nous sommes alertés des menaces physiques à l'encontre de certains journalistes. Nous faisons passer nos messages sur les droits de l'homme et les droits fondamentaux dans nos entretiens bilatéraux.
La position de la France est claire : les 72 critères doivent être remplis pour la libéralisation des visas. Dans son dernier rapport, la Commission a soulevé sept critères non satisfaits, dont deux techniques, dont les passeports biométriques, et cinq de fond, dont le respect des droits fondamentaux.
Je crois savoir que la Turquie a tout récemment (le 02 mai) ratifié la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, et signé en 1992 les protocoles additionnels nos 4 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qui doivent encore être ratifiés. Nous nous efforçons de pousser la Commission à se montrer précise sur la question des droits fondamentaux. La liberté de la presse, la loi antiterroriste et la question de la protection des données sont intimement liées. Nous sommes attachés au respect de l'ensemble des critères.
La corruption est un problème systémique et, en effet, elle ne se résorbera pas à court terme. Nous avons besoin d'instruments forts à cet égard.
M. Bertrand Buchwalter. - Les droits fondamentaux constituent un bloc de neuf critères dont la majorité est satisfaite. Nous attendons une révision de la législation antiterroriste en conformité avec la jurisprudence de la CEDH, dans le respect de la liberté d'expression et d'association.
La Commission européenne ne fait pas bon marché des cinq critères qui restent à remplir. Le Président s'est exprimé clairement sur ce point lors du dernier conseil européen, au lendemain de la descente de police dans les locaux du journal Zaman. Notre représentation diplomatique assiste au procès et nous avons fait entendre notre voix face aux intimidations contre les universitaires, les journalistes et les avocats.
M. Christophe Léonzi. - Les flux en Méditerranée centrale n'ont pas augmenté de manière significative. On dénombre 150 000 passages sur l'année 2015 et 25 000 pour les premiers mois de 2016. Pour l'instant, nous n'avons pas de stratégie efficace pour endiguer ces flux. Des hotspots ont été mis en place en Italie ; il y a aussi des points de contrôle à la frontière franco-italienne - la coopération, encadrée par les accords de Chambéry, se déroule bien - et à la frontière italo-autrichienne où les relations sont plus difficiles. Mais il n'y a pas eu de report massif vers cette route.
Nous ne négligerons aucun des 72 critères pour la libéralisation des visas. La Turquie ne bénéficiera d'aucun passe-droit : une clause transversale prévoit une suspension de l'accord d'exemption en cas de pression asymétrique
Nous restons vigilants à l'égard des négociations d'adhésion, mais il ne s'agit pas de les bloquer. Les avancées sont limitées en raison de la faiblesse des progrès réalisés par la Turquie sur le fond. Seuls deux chapitres ont été ouverts au cours des cinq dernières années. Le fil rouge de la position européenne est la priorité donnée, dans la procédure d'élargissement, à l'indépendance des pouvoirs, à l'état de droit et aux libertés fondamentales.
En Grèce, la situation globale reste tendue bien que l'accord ait donné de l'air aux autorités. Grâce à l'aide financière européenne, des moyens supplémentaires vont arriver.
Mme Florence Lévy. - La mise en oeuvre de l'accord a en effet soulagé la Grèce. On compte 8 000 réfugiés dans les îles et 54 000 sur l'ensemble du territoire. La solidarité européenne se mobilise. L'organisation des hotspots monte en puissance : les autorités grecques, d'abord hésitantes à reconsidérer leur approche de l'asile, ont finalement mené à bien ce changement. Cinq des six hotspots prévus sont pleinement opérationnels, 26 000 places d'hébergement supplémentaires seront mises à disposition par les autorités grecques dans les prochaines semaines.
À Idomeni circulent de fausses rumeurs faisant état d'une prochaine réouverture de la frontière avec la frontière de l'ancienne république de Macédoine. C'est pourquoi les 10 000 à 12 000 réfugiés qui y sont installés ne souhaitent pas quitter le camp, et les autorités ont des difficultés à les faire entrer dans le processus d'enregistrement et de sécurisation. Parallèlement, une expertise européenne de traitement des demandes d'asile se déploie grâce au Bureau européen d'appui en matière d'asile.
Les autorités grecques espèrent mettre en place avant juin un processus accéléré d'enregistrement pour désengorger les îles et assurer un hébergement dans des conditions plus dignes. En plus du soutien de l'Union européenne qui a d'ores et déjà débloqué 300 millions d'euros, le HCR a lancé, avec le PNUD, et l'OIM le 25 janvier 2016, un plan régional conjoint pour les migrants et les réfugiés en Europe d'un montant initial de 550 millions de dollars. Ce plan vise à financer les opérations d'assistance et de protection des arrivants (y compris identification des personnes, enregistrement, hébergement,...) et à renforcer les capacités de réponse des pays concernés (Turquie, Grèce, Macédoine, Serbie, Croatie et la Slovénie) pour l'amélioration des conditions sanitaires, d'hébergement, de scolarisation temporaire et de vaccination. Après une mise en place assez lente, la mobilisation atteint son rythme de croisière.
Nous le rappelons sans cesse : le soutien à la Grèce est une priorité. Nous appelons également nos partenaires européens à monter en puissance dans leurs prévisions d'accueil et de réinstallation. La France a d'ores et déjà engagé cet effort. Les équipes de l'Ofpra et des services concernés tournent à plein régime grâce à un système de rotation des agents pour la conduite des entretiens, des screenings (opérations de contrôle) sécuritaires et la préparation des dossiers sollicités par les autorités grecques.
Sur la question des enfants isolés, nous constatons une prise de conscience des États membres. La Finlande, en pointe sur le sujet, accueille le gros du contingent d'enfants mineurs non accompagnés.
M. Christophe Léonzi. - Les autorités grecques expriment une véritable reconnaissance. Il faut reconnaitre la célérité remarquable dont la Commission européenne a fait preuve dans la mobilisation des moyens en faveur d'Athènes.
La France a joué un rôle important au début de la crise migratoire pour éviter que l'on ne perde de vue les intérêts stratégiques de l'Union. Nous avons aussi veillé à ce que le processus de paix chypriote ne soit pas bousculé par ces événements.
M. Bertrand Buchwalter. - Éviter l'isolement d'un État membre est une préoccupation constante du Président Hollande et du président du Conseil européen, Donald Tusk. Plusieurs critères de la feuille de route concernent Chypre. La Turquie a d'ores et déjà levé l'obligation de visa pour les citoyens chypriotes.
M. Didier Marie. - Tout en soulignant que cela ne valait pas reconnaissance de la République de Chypre...
M. Christophe Léonzi. -Le prochain congrès de l'AKP, le 22 mai, débouchera probablement sur un changement de Premier ministre. Nous resterons attentifs à la réalisation effective des réformes annoncées, que le gouvernement change ou non.
M. Jacques Legendre, président. - Merci. Nous serons peut-être amenés à vous solliciter pour un nouveau point en septembre.
Audition de M. Pascal
Brice,
directeur général de l'OFPRA (Office français de
protection des réfugiés et apatrides)
Mercredi 18 mai 2016
M. Jacques Legendre, président. - Nous souhaitons recueillir votre point de vue sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie et sur le rôle de l'OFPRA dans sa mise en oeuvre. L'OFPRA intervient dans la relocalisation et la réinstallation de Syriens au titre du programme dit « un pour un ». Notre rapporteur, Michel Billout, ne manquera pas de vous interroger après votre exposé liminaire. MM. Leconte et Reichardt vous poseront également des questions dans le cadre de leur travail à la commission des affaires européennes sur les relations entre l'Union européenne et la Turquie.
Pour ma part, je vous soumettrai quelques questions dans le cadre de la réflexion que je mène avec mon collègue Gaëtan Gorce sur la crise des migrants au sein de la commission des affaires étrangères.
M. Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA. - Je vous remercie de votre invitation. Nous faisons face à une crise de l'asile au niveau européen mais pas, je tiens à le préciser, au niveau français. Notre système est néanmoins soumis à de fortes tensions, en particulier l'OFPRA, qui a profondément réformé son fonctionnement depuis trois ans et bénéficié d'un renforcement régulier de ses moyens.
Je rappelle, en tant que directeur général de l'OFPRA, qu'il ne peut y avoir de limite au nombre de demandes d'asile examinées en France : toute demande d'asile déposée en France, dès lors qu'elle ne relève pas d'un autre État membre en vertu des dispositions de Dublin, doit être examinée. C'est du point de vue plus général des politiques publiques que l'on peut adopter une approche différente.
C'est à ce titre que l'accord avec la Turquie était à mes yeux indispensable pour reprendre le contrôle de la situation. Nous avons constaté la difficulté d'apporter une réponse européenne coordonnée et maîtrisée à cette crise, qui est davantage une crise de l'asile qu'une crise migratoire. Si les décideurs publics doivent traiter de ces deux aspects, seul le premier relève des missions de l'OFPRA.
A l'OFPRA, nous mettons en oeuvre l'accord selon deux modalités : la relocalisation de demandeurs d'asile en besoin manifeste de protection depuis la Grèce, et un programme de réinstallation de réfugiés syriens de la Turquie vers la France. L'OFPRA ne participe pas aux examens de recevabilité conduits par les autorités grecques dans les hotspots auprès des personnes arrivées après le 20 mars - à la suite desquels des personnes considérées comme relevant du droit d'asile seront renvoyées vers la Turquie.
En revanche, nous sommes donc pleinement mobilisés sur les deux missions que j'ai citées. Concernant la relocalisation, en vertu des décisions de juillet et d'octobre 2015 du Conseil européen, l'OFPRA doit mener à bien l'admission de personnes arrivées en Grèce et en Italie en provenance de pays dont le taux d'accord, dans les pays de l'Union européenne, est supérieur à 75 % : principalement des Syriens, Irakiens et Érythréens. Ces derniers bénéficient, dans les hotspots, d'une sorte de présomption de droit d'asile ; cependant, en vertu notamment de la loi relative à la réforme du droit d'asile du 29 juillet 2015 votée par le Parlement, l'OFPRA est tenu de vérifier la réalité de leur besoin de protection dans le cadre d'un entretien classique.
Les réfugiés arrivent sur le territoire national après enregistrement par les autorités grecques ou italiennes, souvent avec l'appui de Frontex. La procédure est la suivante : ils manifestent leur souhait de relocalisation, enregistré par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asylum Support Office, EASO), puis les autorités grecques ou italiennes proposent leur relocalisation aux autorités françaises, qui procèdent ensuite à des vérifications sécuritaires. Une fois arrivés en France, les réfugiés ont un entretien avec un officier de protection de l'OFPRA délocalisé en région. Nous multiplions les missions de ce type : en novembre dernier, des officiers de l'OFPRA se sont rendus à Nantes pour l'accueil de réfugiés érythréens venus d'Italie. Nous nous assurons avant tout de la provenance du réfugié, qui fonde le besoin de protection manifeste. Nous vérifions également que la personne ne relève pas d'une clause d'exclusion de la convention de Genève - crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de génocide - ce qui peut être le cas de collaborateurs du régime syrien ou de djihadistes. Enfin, nous faisons usage de la disposition de la loi du 29 juillet 2015 qui écarte les personnes représentant une menace pour la sûreté de l'État ou une menace grave pour la société. Le ministère de l'intérieur effectue ses propres vérifications de manière étanche par rapport aux entretiens de l'OFPRA.
Les personnes qui arrivent dans les hotspots italiens sont principalement érythréennes.
La relocalisation depuis la Grèce concerne exclusivement les personnes arrivées dans ce pays avant le 20 mars - qu'elles aient été conduites des îles vers le continent ou y soient déjà présentes, en particulier près de la frontière macédonienne, à Idomeni. L'OFPRA depuis janvier conduit dans une antenne à Athènes les entretiens avec les candidats proposés par les autorités grecques à la relocalisation en France. Chaque mois, l'OFPRA envoie une équipe : en avril, 400 personnes ont été entendues en deux semaines et nous nous apprêtons à en entendre autant la semaine prochaine. À l'issue de l'entretien avec les candidats à la relocalisation, je soumets la décision finale au ministère de l'intérieur, qui de son côté, effectue ses propres contrôles sécuritaires. Le ministre décide par conséquent en considération de ces deux procédures. Il s'agit d'un dispositif dérogatoire : sur le territoire national, la décision de l'OFPRA relative à l'octroi de l'asile est souveraine. Dans le cas de l'autorisation d'accès au territoire, la décision souveraine appartient in fine au Gouvernement.
Le programme de relocalisation monte en puissance. La fermeture des frontières, et surtout de la frontière macédonienne, a avivé l'intérêt des migrants pour ce programme : le chemin de l'Allemagne étant coupé, 57 000 personnes dont 20 à 30 000 Syriens, Irakiens et Érythréens se sont retrouvées bloquées en Grèce, dans des conditions souvent dramatiques. Le dispositif OFPRA repose sur des missions d'instructions envoyées sur place depuis janvier mais aussi, dans le cadre de l'accord avec la Turquie, sur la mise à disposition de quinze officiers de protection à Athènes, Thessalonique et Alexandroupoli, qui aident les autorités grecques à doubler leurs capacités d'enregistrement des candidats en Grèce continentale. Pour la relocalisation vers l'ensemble de l'Union européenne, les officiers de protection de l'OFPRA agissent sous l'égide de l'EASO. Les relocalisations s'effectuent en proportion des dispositions d'accueil notifiées chaque mois par l'Intérieur aux autorités grecques.
Le second volet de notre participation à la mise en oeuvre de l'accord est la réinstallation depuis la Turquie vers l'Union européenne. Le ministre de l'intérieur a fixé un objectif de 6 000 réinstallations de réfugiés syriens en deux ans. Il s'agit pour l'OFPRA de l'amplification d'un dispositif mis en place depuis deux ans en Égypte, en Jordanie et au Liban, répondant aux instructions du Président de la République fin 2013 pour accueillir 500 réfugiés syriens supplémentaires. Nos agents se sont ainsi rendus à Alexandrie, au Caire, à Amman et à Beyrouth à huit reprises depuis 2014. Au total, 1 500 personnes en grande vulnérabilité ont été accueillies dans ce cadre, grâce au travail d'identification mené par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).
Nous avons mené une première mission en avril dernier à Ankara au cours de laquelle 400 personnes ont été entendues ; 300 autres le seront à partir du 23 mai. L'OFPRA se rendra régulièrement en Turquie pour évaluer le besoin de protection des candidats et une éventuelle exclusion au titre des clauses de protection ou de sûreté de l'Etat - toujours dans le cadre d'entretiens doubles et étanches menés par l'OFPRA et par le ministre de l'intérieur.
M. Michel Billout, rapporteur. - Je vous remercie. Selon la presse, en mars dernier, l'OFPRA s'est opposé à l'esprit même de l'accord et a refusé de participer à sa mise en place. Qu'est-ce qui a motivé cette communication qui, au cours d'une séance de questions d'actualité dans notre assemblée, a fait apparaître des différences entre les positions du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'État aux affaires européennes ?
Pouvez-vous nous préciser les différences de traitement entre les migrants arrivés avant et après le 20 mars 2016 ? Dans le dispositif de relocalisation, ont-ils le choix du pays de destination ? Côtoyez-vous des collègues européens qui font le même travail que vous ?
Hormis l'intervention sur site, le « un pour un » diffère-t-il des autres procédures de réinstallation ?
L'accord a entraîné une baisse significative des flux ; cependant, les retours vers la Turquie restent limités. La relocalisation des candidats à l'asile l'est encore plus. Risquons-nous de voir arriver davantage de migrants en Turquie, ce qui ne manquerait pas de produire une situation délicate ?
Enfin, quelle appréciation portez-vous sur la récente législation grecque de l'asile ? Le dispositif est-il efficace ? Des moyens suffisants sont-ils prévus ?
M. Pascal Brice. - Ma position, précisée à la presse, est claire : ma responsabilité consiste à mener les missions de l'Office. Il ne m'appartient pas de commenter l'accord mais de définir ce qui relève de la compétence de l'OFPRA : la relocalisation et la réinstallation, dans lesquelles nous nous engageons pleinement. En revanche, j'ai estimé que le volet de l'accord prévoyant la reconduite de personnes éligibles au droit d'asile en Europe vers la Turquie ne relevait pas de l'OFPRA, dont la mission est de protéger en Europe. La France ne considère pas la Turquie comme un pays d'origine sûr ou un pays tiers sûr. Ils n'ont pas à participer à l'examen de recevabilité conduit dans les hotspots auprès des réfugiés arrivés après le 20 mars.
L'OFPRA se voit confier par la loi une mission complexe mais binaire : si la personne relève du droit d'asile, elle doit être protégée quoi qu'il arrive ; avec la même rigueur, si elle n'en relève pas, l'OFPRA doit lui opposer un rejet. C'est la cohérence de la loi, qui relève de la convention de Genève et des textes européens sur la protection subsidiaire. Dans ce cadre, il est difficile d'inventer une troisième option du point de vue de la cohérence de l'OFPRA : un entretien de demande d'asile en Grèce conduisant à la reconduite en Turquie - hors Union européenne - de personnes relevant pourtant du droit d'asile... L'OFPRA protège d'ailleurs 20 % des ressortissants turcs qui demandent l'asile en France. Or le retour de Grèce en Turquie relève de l'appréciation par les Grecs de la capacité des autorités turques à accueillir et protéger ces personnes.
Je me permettrai en plus un avis personnel : l'Europe doit reprendre le contrôle de la situation. C'est le sens de l'action menée par le Président de la République et le gouvernement depuis plusieurs mois. Le ministre de l'intérieur s'est rendu dans les capitales européennes dès l'été 2014 afin de plaider pour la mise en place des hotspots. Ce « plan Cazeneuve » a abouti, en juillet 2015, aux décisions du Conseil européen. Malheureusement, celles-ci, que j'estime adaptées, ont été imparfaitement mises en oeuvre : les hotspots n'ont pas fonctionné. Il fallait y associer la Turquie, sans laquelle la situation n'est pas gérable - je suis conscient des implications de ces propos qui dépassent la compétence de l'OFPRA. Une aide financière pour aider les organisations internationales à stabiliser les migrants était à mes yeux indispensable. La principale difficulté réside dans la reconduite vers un pays tiers de personnes relevant du droit d'asile.
En Italie, la proposition de relocalisation est formulée par les autorités italiennes et EASO. J'ai dépêché deux officiers de protection de l'OFPRA en Sicile et un dans le Sud de l'Italie. Nous conduisions le même travail dans les îles grecques jusqu'à la mise en oeuvre de l'accord. Depuis, les officiers de protection ont rejoint la Grèce continentale pour informer les personnes arrivées avant le 20 mars de la possibilité de bénéficier du programme de relocalisation. Je compte renforcer l'équipe, actuellement de vingt personnes, dans la perspective de missions dans les camps décidées par les autorités grecques avec notre soutien.
Les candidats ne choisissent pas leur destination. Après un premier enregistrement des Syriens, Irakiens et Érythréens, l'Agence européenne de l'asile procède à un second enregistrement où ceux-ci dressent une liste de quatre ou cinq pays de préférence. Leur choix peut être guidé par la présence de membres de leur famille, une maîtrise linguistique ou parfois même des effets de mode. La France figure presque toujours dans la liste. Le choix final du pays d'accueil proposé appartient aux autorités grecques ou italiennes.
Du dispositif « un pour un », l'OFPRA n'a à connaître que du « un » de la réinstallation, dans les conditions et selon les procédures que j'ai décrites.
J'admire le courage de mon homologue grecque face à la situation extrêmement difficile de son pays. Nous assistons les Grecs dans la mesure de nos possibilités. Je n'ai pas de vision claire de l'évolution de la législation grecque en matière d'asile depuis l'accord : la mise en oeuvre s'invente au fur et à mesure. Avant le 20 mars, soit les réfugiés relevaient de la relocalisation - c'est le cas des Syriens, Irakiens et Érythréens ne relevant pas des clauses d'exclusion et ne présentant pas de menace pour la sécurité de l'État -, soit ils avaient vocation à demander l'asile en Grèce. C'est d'ailleurs problématique, notamment pour les nombreux Afghans, au vu de la faiblesse des moyens grecs pour l'examen des demandes prioritaires de relocalisation. Les personnes arrivées après le 20 mars sont détenues dans les hotspots. Les premiers examens ont eu lieu, les premières reconduites aussi, mais à ce jour aucune reconduite de réfugiés syriens éligibles à l'asile vers la Turquie n'a été effectuée.
M. Jacques Legendre, président. - Comment l'OFPRA appréhende-t-il la proposition d'installer des hotspots gérés par les États membres dans les pays de départ ou de transit ?
M. Pascal Brice. - Avec beaucoup de circonspection : ce serait une extra-territorialisation de la gestion de l'asile. Il existe des moyens éprouvés de traiter ces situations, au premier chef la réinstallation menée par l'OFPRA depuis 2014 conformément aux voeux du Président de la République. Nous travaillons en bonne intelligence avec le HCR ; ce dispositif a permis de protéger des malades, des personnes handicapées, des femmes seules, des Kurdes de Syrie apatrides ; et ce, en toute sécurité grâce à la double enquête conduite, de manière étanche, par nos services et ceux du ministère de l'intérieur. Ce dispositif est, à mes yeux, supérieur à tout autre de ce type - toujours dans l'objectif d'éviter les traversées dramatiques. En tant que directeur général de l'OFPRA, je suis profondément attaché au principe selon lequel une personne mettant le pied en Europe et relevant du droit d'asile doit être protégée en Europe.
M. Jean-Yves Leconte. - Je crois comprendre que pour les réinstallations à partir de la Turquie, vous travaillez hors du cadre du « un pour un » mais dans celui des engagements pris sur un nombre global de réfugiés accueillis. Les autorités turques considèrent-elles que cette méthode s'inscrit dans l'accord ? Le chiffre fixé dépend-il des capacités d'hébergement ?
Le taux de 20 % de citoyens turcs dont la demande d'asile est acceptée par l'OFPRA est considérable ; comment évolue-t-il ? La Turquie n'est pas signataire de la convention de Genève dans son entier ; de plus, les pratiques ne correspondent pas toujours aux lois. Comment les faire évoluer ? La France ne considère pas la Turquie comme un pays tiers sûr, mais pour que l'accord fonctionne, il faut qu'elle le devienne.
Pourquoi ne pas faire converger la procédure de visa pour demande d'asile et celle de réinstallation, et surtout les normer ? En l'état, chaque consulat a ses propres modes de fonctionnement, avec des délais de réponse très longs du ministère de l'intérieur. Il convient de répondre dans des délais raisonnables à ceux qui s'adressent à la France sans le filtre du HCR et en vertu de critères proches de ceux de l'OFPRA.
À leur arrivée en France, les moins de 25 ans à qui vous accordez une protection ne sont pas éligibles aux prestations sociales. Que faire dans ce cas ?
M. Pascal Brice. - Le gouvernement nous assigne un objectif de 6 000 réinstallations de Syriens depuis la Turquie en deux ans. Cet objectif, je le suppose, est fixé dans le cadre de l'équilibre général de l'accord, c'est-à-dire 30 à 32 000 réfugiés accueillis au niveau européen.
L'accord a vocation à mettre fin aux traversées ; le « un pour un » deviendrait alors zéro pour zéro. En revanche, le besoin de réinstallations à partir de la Turquie persistera, même si l'accord est bien mis en oeuvre.
Le nombre de personnes accueillies relève de la compétence du ministère de l'intérieur. Pour chaque mission sur place, en Turquie, en Jordanie, au Liban ou en Égypte, nous partons avec un chiffre de personnes à protéger, à entendre potentiellement. Je n'ai pas à me prononcer sur les considérations qui président à sa fixation, même si l'on peut supposer que les capacités d'hébergement entrent dans le calcul. L'OFPRA a simplement besoin de prévisibilité, sachant qu'il traite par ailleurs 80 000 demandes par an.
M. Jean-Yves Leconte. - Les réfugiés de Grèce peuvent-ils se mettre en route pour l'Europe immédiatement après avoir été entendus par l'OFPRA ?
M. Pascal Brice. - Il y a un délai d'acheminement logistique. Après avoir entendu les personnes, nous rendons un avis au ministre de l'intérieur qui valide la liste des personnes retenues. Ces dernières sont ensuite acheminées en quelques semaines par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). Ce délai est réduit pour les cas humanitaires lourds, comme récemment celui d'un garçon de douze ans électrocuté à Idomeni sur un chemin de fer ou encore celui d'un jeune Syrien souffrant d'un cancer de l'oesophage.
Les réinstallations sont conduites par l'Office international des migrations pour le compte de l'Ofii dans des délais qui nous semblent collectivement toujours trop longs, les situations étant parfois dramatiques.
Le taux de protection accordée par l'OFPRA aux ressortissants turcs a baissé au cours des dernières années, mais la tendance pourrait s'inverser au vu de la situation des Kurdes et des opposants politiques. Je vous communiquerai des indications plus précises à ce sujet. Le nombre de demandes d'asile turques en France a baissé depuis dix à quinze ans, même s'il reste significatif.
La question de l'asile en Turquie est juridiquement complexe ; ne sous-estimons pas l'effort des autorités turques, qui ont accueilli 2,7 millions de réfugiés depuis le début de la crise. Cet accord qui aidera les Turcs à accueillir les réfugiés est une évolution très positive. Je me cale habituellement sur le HCR, qui parle en l'occurrence d'un accueil différencié selon l'origine des réfugiés : autant le sort des Syriens s'améliore, autant pour les autres, le taux de protection est faible et les refoulements existent.
Je partage votre intérêt pour le visa au titre de l'asile, qui ne relève toutefois pas de la compétence de l'OFPRA. Les moyens qui y sont consacrés mériteraient d'être renforcés. Des agents de l'OFPRA forment parfois les agents consulaires aux entretiens ; ces entretiens, différents de ceux de l'OFPRA, aboutissent à une décision souveraine du ministre de l'intérieur, même s'il y a des recoupements. Une procédure spécifique concerne les minorités religieuses d'Irak où des agents de l'OFPRA ont formé les personnels des consulats d'Erbil et de Bagdad. Ceux qui obtiennent un tel visa se voient attribuer le statut de réfugié sur dossier par l'OFPRA, sans devoir se rendre dans ses locaux : le besoin de protection est en effet plus que manifeste.
Je me suis ouvert du problème des personnes de moins de 25 ans auprès des ministères concernés, notamment après que le Président de la République nous eut envoyés en Allemagne en novembre 2015 pour protéger des jeunes démunis. Dans certains départements, des solutions ont été trouvées.
M. Jean-Pierre Vial. - Merci de confirmer que les procédures de visa au titre de l'asile et celles menées par l'OFPRA sont étanches, sauf lorsque ce dernier est sollicité par les ministères des affaires étrangères ou de l'intérieur pour fournir une ingénierie, si je puis dire.
Quant aux engagements chiffrés du Président de la République, ils ne semblent pas avoir été respectés. En 2014, moins de 500 réfugiés ont été accueillis - le chiffre n'a donc pas été atteint - 650 en 2015. Si on cumule les engagements, on arrive à 10 300. Les demandes que vous traitez s'imputeront-elles sur ce contingent ?
Vous dites que les instructions que vous menez en Grèce valent pour l'ensemble des pays membres de Schengen. D'autres opérateurs se trouvent-ils en Grèce ? La France pourrait-elle à son tour bénéficier réciproquement d'instructions menées par d'autres pays ?
M. Pascal Brice. - En effet, il s'agit de procédures différentes, même si nous offrons une ingénierie. Je confirme vos chiffres. L'OFPRA a entendu et protégé 500 personnes en 2014, 1 500 autres en 2015. L'engagement du Président de la République a été pleinement tenu. Nous poursuivons ces missions qui seront imputées sur le contingent de 9 000 à 10 000 personnes à réinstaller depuis la Turquie, le Liban, la Jordanie et probablement l'Égypte en deux ans. En Grèce, les agents de l'OFPRA mènent deux types de missions : ils enregistrent pour le compte de la Grèce en vue de la relocalisation vers les autres pays européens des personnes arrivées avant le 20 mars, ou bien se rendent tous les mois dans nos locaux athéniens pour instruire les demandes d'asile enregistrées en Grèce et proposées à la relocalisation en France - donc uniquement pour le compte de celle-ci.
M. Didier Marie. - Le rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des migrants s'inquiétait hier des conditions de détention - pour reprendre ses mots - de rétention, plutôt, des migrants dans les hotspots, en particulier des femmes et des mineurs isolés. Que préconiseriez-vous pour protéger ces personnes particulièrement vulnérables ? Quelles dispositions sont prises pour les regroupements familiaux ?
La Commission européenne a jugé qu'il faudrait 4 000 agents pour l'enregistrement des migrants. Les moyens de l'État grec sont insuffisants. La France a fait le nécessaire, puisque l'OFPRA a envoyé ses agents. Mais Frontex a du mal à mobiliser et les 27 États membres ne participent pas de la même manière. Que faire pour atteindre ce seuil optimal d'agents ? Quand serons-nous opérationnels pour absorber les flux ?
La Commission a fait des propositions sur la politique d'asile. Quel est votre sentiment ? Vers quoi faut-il aller pour améliorer la situation en Europe ?
M. Pascal Brice. - Les personnes retenues en Grèce ne relèvent pas de ma compétence, mais l'OFPRA n'est pas étranger à l'objectif de durabilité de l'accueil de ces personnes en Europe. Le Conseil européen, largement à l'initiative de la France, avec ce que j'ai appelé le « plan Cazeneuve », a pris les bonnes décisions en 2015. Il faut des outils juridiques et des moyens pour stabiliser la situation des migrants, le temps du contrôle aux frontières extérieures, de l'instruction des demandes d'asile et du retour de ceux qui n'en relèvent pas.
L'actuelle façon de faire n'est pas la meilleure pour conforter ce qui est indispensable dans les centres de rétention ou les zones de transit. Dans l'esprit de Bernard Cazeneuve, c'était la vocation des hotspots. Ils doivent répondre aux normes universelles - les mineurs n'y ont pas leur place - et l'instruction de la demande doit être la plus rapide possible, comme ce que nous faisons à la frontière, à Roissy. Je ne condamne pas les Grecs, qui ont mis en place des outils de stabilisation des migrants et font tout leur possible dans une situation très difficile, mais la situation n'est pas des plus claires au regard du droit d'asile. Je sais que les Grecs sont les premiers à y être attentifs.
Le regroupement familial est un droit en France. Nous y sommes également très attentifs pour les personnes que nous réinstallons ou relocalisons.
M. Didier Marie. - Sans délai ?
M. Pascal Brice. - Avec des délais trop longs pour la délivrance des actes d'état-civil. L'OFPRA est la mairie des réfugiés. Le Parlement nous a autorisés à recruter des officiers de protection supplémentaires, mais il a été plus difficile de convaincre pour augmenter le nombre des personnels administratifs. Le retard est maintenant en passe d'être résorbé.
Concernant le nombre d'agents nécessaires pour l'enregistrement, je crois la Commission européenne sur parole. Le besoin est criant. La France est l'un des premiers pays à participer aux contrôles extérieurs via Frontex et à la relocalisation avec l'OFPRA. Les Italiens et les Grecs n'ont pas réagi tout de suite. L'appui des autres pays européens a tardé, il est nécessaire et les autorités françaises sont dans cette démarche.
Je ne m'exprimerai pas sur Dublin : l'OFPRA est frustrée par ce régime qui nous empêche d'entendre des personnes que nous voudrions entendre. Les dernières propositions européennes de réforme du système d'asile ressemblent à une extension à d'autres pays de ce qui se fait avec la Turquie. Il faut regarder cela de plus près ; ne cédons pas à la tentation de l'extra-territorialisation de l'asile.
Ce sont les autorités françaises qui détermineront la position française, non l'OFPRA. À titre personnel, et même si la Commission européenne est réservée, je suis favorable à un OFPRA européen. En réalité, il n'y a pas de disparité majeure entre les grands pays de l'asile (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suède) pour l'exercice de la protection. Les taux d'accueil y sont tous de 97 % pour les Syriens, de 30 à 40 % pour les Soudanais, de 70 à 80 % pour les Afghans et de 100 % pour les - « vrais » - Erythréens. Avec ce masochisme qui nous prend parfois, nous entendons parfois que la France serait moins protectrice. Le taux global de 42 % en Allemagne pour 35 % en France s'explique par la proportion très supérieure de Syriens outre-Rhin, et par les demandes d'asile en France de Haïtiens, par exemple, notamment en Guyane et en Guadeloupe, avec un taux d'accueil de 3 à 4 %. La disparité tient moins aux méthodes, unifiées au demeurant par les directives européennes, qu'aux aspects connexes : hébergement, aides, dispositifs sociaux. Je suis donc favorable à un OFPRA européen - à condition qu'il soit aussi indépendant des exécutifs nationaux et l'exécutif européen que l'est l'OFPRA en France.
M. Jean-Yves Leconte. - Une Cour nationale du droit d'asile (CNDA) unique ne serait-elle pas une étape intermédiaire qui garantirait des procédures unifiées, même si nous gardons 28 agences différentes ?
M. Pascal Brice. - C'est une option, mais je ne vous surprendrai pas en préférant que la première instance fasse le travail.
M. Jacques Legendre, président. - Merci de nous avoir donné votre sentiment très franchement.
Audition de M. Philippe
Léglise-Costa,
secrétaire général des affaires
européennes
Mercredi 18 mai 2016
M. Jacques Legendre, président. - Nous recevons M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes. Quelles ont été les conditions de la négociation de la déclaration commune de l'Union Européenne et de la Turquie, dans laquelle l'Allemagne semble avoir pris une grande part ? Quel rôle y a joué la France ? Comment les autres États membres ont-ils réagi ? Cette solution était-elle envisagée dès le sommet Union européenne-Turquie de novembre 2015 ? Force est de constater son efficacité en termes de limitation des flux ; est-elle transposable ? Ses implications ne sont pas anodines ; quels sont les « points de vigilance » de la France, ses priorités et ses attentes pour le prochain Conseil européen ?
M. Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires européennes. - L'Allemagne a, en effet, été très active dans ces négociations. La chancelière s'y est sentie tenue au vu de la situation de son pays, qui n'avait rien à voir avec celle de la France, mais elle a systématiquement respecté le cadre convenu au niveau européen et recherché une compréhension commune avec le Président de la République à chaque étape.
Venue à Paris le 4 mars dernier pour préparer le Conseil européen du 7 mars, elle a recherché un accord préalable avec la France, qu'elle porterait au dîner prévu avec le Premier ministre turc le 6 mars et indiqué que l'appui de la France était indispensable pour parvenir à un résultat équilibré. Cet appui lui a été confirmé par le Président de la République selon des termes convenus avec la Chancelière, y compris sur les points importants pour la France. Lors de ce long dîner, auquel assistait aussi le Premier ministre néerlandais au titre de la présidence tournante, M. Davutoglu a fait la proposition inattendue de réadmettre en Turquie les Syriens arrivés en Grèce. Dès le lendemain matin, les collègues allemands nous ont prévenus, la Chancelière souhaitant se mettre d'accord avec le Président de la République avant le début du Conseil européen.
Il est donc juste de dire que la chancelière a été très active dans l'obtention de cet accord, mais il ne serait pas exact d'affirmer qu'elle l'a fait de façon solitaire.
Pour la France, plusieurs exigences accompagnaient notre soutien à cet accord :
Premier point de point de vigilance : la vérification de la légalité du dispositif. Le doute était légitime, car la proposition turque était très générale. Cette question nous a occupés du 7 au 18 mars et au Conseil européen même : il fallait que l'accord, qui concernait la Grèce et la Turquie de manière différente, garantisse qu'il n'y aurait ni expulsion collective, ni refoulement, mais des examens individuels selon des procédures conformes au droit européen et international. Dans ce contexte, la Turquie s'est engagée à assurer la protection requise aux personnes réadmises sur son territoire. Vous savez en effet que la Turquie a ratifié la convention de Genève avec une réserve importante : il fallait donc des garanties supplémentaires.
Deuxième exigence : l'accord avec la Turquie était nécessaire car c'est de son territoire que provenaient les flux exceptionnels de réfugiés. Mais il ne devait pas amener l'Union européenne à renoncer aux conditions qu'elle a posées dans les différents cadres composant sa relation avec ce pays :
- Ainsi, s'agissant de la facilité de 3 milliards d'euros, mise en place par l'Union européenne et destinée aux Syriens présents en Turquie - qui sont près de 2,7 millions -, la Turquie a demandé que l'Europe s'engage à poursuivre son effort si la situation en Syrie ne s'améliorait pas. La France l'a accepté à condition que nous puissions nous assurer que ces fonds seraient bien destinés à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés syriens sur le territoire turc et que les décisions de déboursements supplémentaires seraient prises au vu de la consommation de la première facilité de 3 milliards.
- S'agissant de la demande de libération des visas, il pouvait y avoir un risque d'accélération sans conditions. Issu de négociations débutées dans les années 2000, l'accord de réadmission avait pour contrepartie une feuille de route vers une exemption de visas pour les ressortissants turcs, à condition que la Turquie remplisse 72 critères précis. La France a insisté pour que le strict respect de ces critères soit intégralement vérifié. M. Davutoglu, lorsqu'il était Premier ministre, avait engagé plusieurs réformes dans ce sens, mais il reste encore des critères à vérifier, de l'aveu même de la Commission.
- S'agissant des demandes relatives aux négociations d'adhésion, la France a demandé que le processus reste dans le cadre fixé par l'Union européenne, là aussi dans les années 2000. Depuis onze ans, plusieurs chapitres de négociation ont été ouverts, mais on note un ralentissement ces dernières années, que les blocages viennent de la Turquie - chapitres liés aux marchés publics, à la concurrence, aux droits sociaux - ou de l'Union européenne et de Chypre. Ainsi, deux chapitres ont été ouverts en quatre ans. Dans l'accord, il a été convenu d'ouvrir le chapitre 33 relatif aux dispositions financières et budgétaires toujours selon les conditions générales arrêtées pour ce processus.
- Enfin, la situation des droits fondamentaux en Turquie s'est dégradée et la France, avec d'autres, a tenu à ce que l'Europe marque sa préoccupation. Il faut d'ailleurs noter que les critères liés à la feuille de route sur les visas, comme bien sûr le processus d'adhésion, comportent des exigences précises dans ce domaine.
Troisième exigence sur laquelle la France a également insisté : l'aide à la Grèce, qui s'est trouvée isolée lors de la fermeture de la frontière macédonienne et a été proche d'une tragédie humanitaire, afin d'assurer des conditions dignes pour les personnes arrivées et retenues en Grèce et des examens individuels de leur situation. L'instrument européen créé pour l'occasion - EURO ECHO - a été doté de 300 millions d'euros dès cette année et les premiers soutiens ont été apportés en Grèce. La France et l'Allemagne ont également pris des engagements équivalents afin de fournir des moyens en personnel destinés à soutenir l'administration grecque.
Enfin, quatrième exigence : nous avons demandé que les relocalisations (de Grèce) et les réinstallations (de Turquie, dans le contexte du « un pour un ») s'inscrivent, pour ce qui concerne la France, dans le cadre de l'engagement qu'elle avait pris en septembre dernier d'un accueil de 30 000 demandeurs d'asile. La France tient cet engagement. Par ailleurs, nous nous sommes assurés que les relocalisations comme les réinstallations s'effectuent dans le respect de nos exigences de sécurité, par la présence des services français compétents.
Les autres États membres se sont retrouvés dans des situations diverses. Certains ont été exposés à l'arrivée des migrants sur la route des Balkans. S'ils ont réagi différemment, chacun avait besoin d'une solution. D'autres, comme l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande, ont accompagné le mouvement. D'autres encore, comme le Royaume-Uni, se sont tenus en retrait, apparaissant comme étant moins concernés par la situation. Les pays d'Europe centrale et orientale n'ont pas tous eu la même posture, mais le même objectif : ne pas prendre d'engagement supplémentaire, assurer la fermeture de la frontière nord de la Grèce et éviter l'apparition de voies alternatives, contribuer au corps européen de garde-frontières et garde-côtes ; bref, se protéger sans nécessairement nuire à la recherche d'un accord.
Le plan d'action arrêté le 29 novembre 2015 n'avait pas été suffisamment mis en oeuvre : tout l'hiver, les flux se sont maintenus à des niveaux bien trop élevés, jusqu'à plusieurs milliers de personnes par jour.
Depuis, les travaux ont permis de préciser les engagements : l'OTAN, grâce à une opération déjà présente en Méditerranée, contribue à la surveillance des routes en mer Égée ; la règle du « un pour un » a amené la Turquie à accepter les réadmissions, comme l'assurance que les 3 milliards seraient déboursés au profit des réfugiés syriens en Turquie ; l'objectif de calendrier pour l'exemption de visas - sur lequel le président Erdogan reviendra peut-être est passé d'octobre à juin, mais cela ne sera néanmoins possible que si le respect de tous les critères est accéléré. Nous verrons si cela est réalisé.
Est-ce efficace ? Des moyens techniques importants ont été dégagés pour aider la Grèce. La France a envoyé des experts, elle a accompagné l'aide humanitaire de l'Union par une aide spécifique. Il reste qu'en matière d'asile, le système grec souffre de difficultés matérielles et politiques. À la frontière, la France a mis un navire à disposition de l'opération de l'OTAN.
Des leçons peuvent être tirées de la situation grecque, qui montre qu'un État chargé d'une frontière extérieure peut se retrouver dans l'incapacité de faire face à ses responsabilités en cas d'afflux exceptionnel. Des moyens permanents, comme le futur corps européen de garde-frontières et garde-côtes, sont dès lors justifiés. Ce dispositif a fait l'objet d'un accord au Conseil des Ministres et nous attendons le feu vert du Parlement européen en juin. Les premiers contingents devraient être déployés à l'automne, ce qui pourra aussi faciliter la levée des contrôles aux frontières sur la route des Balkans. Nous avions inscrit ce sujet à l'agenda européen dès 2014, ce qui avait amené à un compromis sur une étude de faisabilité. Chacun reconnaît désormais que c'est une nécessité si nous voulons préserver Schengen.
Il faut aussi aider les pays qui accueillent les réfugiés. En cas de crise ou de guerre, la majorité des réfugiés préfère rester dans leur région, même si la réinstallation vers l'Europe ou d'autres pays est justifiée dans certains cas de vulnérabilité spécifique. Le soutien à la Turquie ne nous dispense bien sûr pas de soutenir le Liban et la Jordanie, au contraire. Si la situation se reproduit, certains des instruments actuels pourront être mobilisés. C'est vrai par exemple pour les Erythréens dans les pays de la Corne de l'Afrique.
Il y a aussi un besoin de moyens militaires. En mer Égée, nous avons fait appel à l'OTAN, ce qui a permis un accord avec la Turquie sur la surveillance de la frontière. Mais l'Europe doit être prête à s'équiper elle-même. En Méditerranée centrale, il y a ainsi déjà un « continuum » entre la mission civile de Frontex (« Triton ») et l'opération militaire européenne (« Sophia »).
Ceci devrait plus largement amener à une réflexion autour d'un renforcement des institutions européennes d'action extérieure, de défense et de développement.
Cet afflux exceptionnel de personnes arrivées de Grèce repose la question des règles européennes d'asile. Le règlement de Dublin prévoit que, si les premiers critères ne s'appliquent pas (existence de lien familiaux dans un autre Etat membre, délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa par un autre Etat membre...), le pays de première entrée dans l'Union doit instruire la demande d'asile, ce qui peut créer de fortes difficultés en cas d'afflux exceptionnel. En dépit de l'adoption du « paquet asile », récemment transposé en France, les conditions de traitement des demandes restent hétérogènes et les procédures manquent d'efficacité. La Commission européenne vient de proposer de rénover l'ensemble des instruments de Dublin pour tirer les leçons de cette période dans un objectif d'efficacité et de convergence des procédures. S'agissant de situations exceptionnelles, elle propose une répartition des demandes d'asile au-delà d'un seuil, sans remettre en cause les principes de base. Elle propose aussi un renforcement de certains outils comme le fichier des empreintes digitales (Eurodac) et l'EASO, qui pourrait être transformé en agence.
À court terme, l'accord ne peut être transposé dans toutes les situations, en particulier en Libye, pays avec lequel il n'est pas, à ce jour, possible de mettre en place une coopération analogue à celle décidée avec la Turquie. Si les flux augmentent fortement, il faudra cependant trouver d'autres solutions en amont ou en aval.
L'ordre du jour du prochain Conseil européen de juin comporte un point sur la situation. Nous devrons revenir sur la mise en oeuvre des décisions prises et de l'accord, avec la Turquie, en tenant aussi compte des évolutions internes dans ce pays (le 22 mai se tiendra un congrès exceptionnel de l'AKP pour désigner son nouveau dirigeant et probablement son Premier ministre).
M. Michel Billout, rapporteur. - Aucun d'entre nous ne remet en cause l'utilité de développer des relations durables avec la Turquie, mais nous sommes perplexes sur la faisabilité d'un accord durable, au vu des conditions exigées. Le président Erdogan a refusé de revoir la loi sur le terrorisme en Turquie ; en cas de blocage durable sur la question des visas, la Turquie aura-t-elle intérêt à mettre en oeuvre l'accord ? Jusqu'où sommes-nous prêts à ne pas transiger ? M. Erdogan semble vouloir négocier en permanence. Les conditions de mise en oeuvre de la libéralisation des visas sont-elles suffisantes ? Quels seraient les potentiels effets négatifs ? La loi turque sur les personnes réadmises répond-elle aux demandes de la Commission européenne ? De quels moyens d'application dispose-t-elle ?
Le Gouvernement français a-t-il réfléchi à un ou plusieurs plans B si l'application de l'accord du 18 mars était suspendue à la suite du congrès de l'AKP ? Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et les migrants, M. François Crépeau, demande la fin du placement en détention durant 25 jours des migrants arrivés sur le sol grec et est plus critique que vous sur la légalité de l'accord, qu'il qualifie d'« accord politique sans caractère juridique contraignant ».
M. Philippe Léglise-Costa. - La position française sur les visas est claire. Les 72 critères doivent être tous satisfaits : ils ont été dûment pesés et sont nécessaires pour libéraliser les visas de court séjour. Les garanties sont nécessaires pour assurer que l'exemption de visa ne crée aucun risque, par exemple sur la sécurité des documents ou l'organisation des administrations compétentes en Turquie. En théorie, on pouvait craindre que d'autres membres de l'Union européenne ne soient tentés d'être indulgents pour favoriser l'application de l'accord sur le terrain. L'Allemagne a toutefois la même appréciation que nous et exige également le respect de ces critères. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'un engagement de la Turquie elle-même.
La Commission européenne reconnait que certains critères ne sont pas encore remplis, ce que ne contestent pas les autorités turques, qui paraissent néanmoins contester le critère 65 relatif à la législation turque sur le terrorisme. Il ne s'agit bien sûr pas de limiter l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais d'assurer le respect, par la Turquie et l'Union européenne, des droits fondamentaux reconnus par le Conseil de l'Europe, dont la Turquie est membre. Si ce critère n'est pas respecté, il n'y aura pas d'accord sur l'exemption de visas et nous devrons en tirer les conséquences. Avec l'Allemagne, nous avons demandé un dispositif horizontal de sauvegarde, bien plus puissant que le précédent, qui permettra à l'Union européenne de suspendre l'exemption de visas en cas de difficulté. La négociation au Conseil et au Parlement européen est en cours. La Commission a explicitement prévu dans sa proposition législative de libéralisation des visas que si la Turquie cesse de remplir ses engagements de novembre 2015 et de mars 2016, cette suspension sera justifiée. La Turquie a donné des garanties pour la protection des personnes revenant de Grèce. Les personnes ayant acquis un statut de réfugié en Turquie puis partis en Grèce auront accès à cette protection. Les autres seront soumis à une procédure individuelle respectant les standards internationaux. Nous veillerons au maintien de ces garanties, avec l'Union européenne, le HCR et les autres organisations sur le terrain.
Nous avons mis du temps à trouver un accord efficace avec la Turquie. Nous partons du principe que ce grand pays continuera à respecter ses engagements. La France reste bien sûr vigilante et continuera par ailleurs à apporter son soutien à la Grèce.
Parlons plutôt de placement en rétention que de détention. Selon la France, l'Allemagne et l'Union européenne, si les hotspots doivent être utiles, ils doivent avoir une certaine capacité de rétention et ne pas être seulement un lieu d'identification et d'enregistrement, immédiatement quitté sans attendre la vérification du statut. Cela ne permettrait pas de vérifier le statut dans de bonnes conditions, ni de procéder à la relocalisation en cas de demande d'asile. C'est la situation qui avait prévalu au départ : d'un côté, nous demandions à la Grèce et à l'Italie, pour pouvoir procéder à des relocalisations, qu'elles mettent en place un cadre de rétention, bien sûr dans des conditions de dignité pour les personnes ; de leur côté, ces pays hésitaient à mettre en place ces hotspots complets tant que les garanties de relocalisation ou de retour n'étaient pas assurées. Nous avons engagé un processus qui fonctionne désormais de manière régulière. La rétention n'est pas une entorse aux règles de droit ; il est possible de retenir une personne jusqu'à la vérification de son statut.
Toutes les critiques formulées après la signature de l'accord avec la Turquie devaient être entendues. Comme la Commission, nous avons dialogué avec les organisations sur le terrain et le HCR pour lever les incompréhensions et pouvoir appliquer l'accord dans des conditions de légalité. Le HCR a ainsi repris sa coopération.
M. Didier Marie. - Dans le cadre de l'accord avec la Turquie sont prévus 3 milliards d'euros pour un accueil digne des réfugiés, dont 2 milliards de la part des États membres. Début mai, seuls seize États auraient adressé un certificat de contribution. Il manque 400 millions d'euros. Quelles difficultés particulières certains pays avancent-ils pour ne pas assumer leur part ? Sont-ce les mêmes qui refusent de participer à l'effort d'accueil des réfugiés ?
La situation en Syrie ne s'améliore pas. Si beaucoup sont déjà partis, des familles continuent de fuir le pays, notamment Alep à la suite des bombardements. Sait-on combien de réfugiés arrivent désormais en Turquie ? On citait le chiffre de 3 millions...
Une nouvelle voie de passage se crée-t-elle en Méditerranée via la Libye, en raison du contrôle de la voie turco-grecque et de la fermeture de la voie des Balkans ? D'autres mobilités humaines s'y ajoutent, comme celles venant d'Érythrée. Si l'Europe répond dans l'urgence, elle devra continuer à réfléchir à la question des réfugiés, en lien avec les conflits et le changement climatique. Quelle est la position de la France vis-à-vis de la politique migratoire européenne ?
M. Jean-Yves Leconte. - Il est important que le nombre des personnes en rétention reste proportionné. En février, nous avions été choqués de voir que les personnes repartaient avant même la vérification de leur statut. Laissons le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile et à un éventuel recours.
D'où viennent les 3 milliards d'euros ? Une partie de la politique de voisinage, l'autre de la politique d'élargissement ? Que pourra-t-on faire avec cette facilité ? Est-ce l'Union européenne qui choisit les projets ?
La Commission européenne propose une amende de 250 000 euros par réfugié refusé, soit le contraire de ce qu'il faut faire pour convaincre les pays réticents. Mettons un terme à cette attitude suicidaire car on incite ces pays à durcir leur position ! Comment crédibiliser le principe d'une unification de l'asile, quel que soit le lieu de relocalisation ? Quels moyens sont pris pour unifier les chances de disposer d'une protection ? Alors qu'on renforce le dialogue politique, comment faire pour que le rapport de force ne devienne pas la règle de tous les débats relatifs à l'élargissement ?
M. Philippe Léglise-Costa. - Les départs de Syrie ou d'autres pays ne sont pas de ma compétence dans mes fonctions actuelles. En Europe, cela n'a pas, à ma connaissance, induit récemment d'arrivées supplémentaires. Nous vous transmettrons des indications plus précises en relation avec le ministère des Affaires étrangères.
Nous n'avons pas encore détecté de voies alternatives pour les Syriens. Il existait un risque de passage par l'Albanie en raison de la fermeture de la frontière entre la Grèce et l'ARYM, mais il ne s'est pas matérialisé à ce jour. Nous n'observons pas non plus de passages significatifs de la Turquie vers la Bulgarie et la mer Noire. Certains réfugiés, peu nombreux, ont transité par la Russie vers la Finlande et la Norvège.
Les arrivées significatives en provenance de Libye ne proviennent pas de Syrie, mais de pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, avec ensuite d'autres routes de répartition des flux en Europe. Quelques arrivées ont été détectées à Vintimille, mais elles sont à ce jour plus limitées que l'année dernière.
Effectivement, les Erythréens peuvent apparaître comme une population oubliée alors que, depuis des années, le régime amène les Erythréens à quitter leur pays. La situation dans les camps est très mauvaise. Nous avons débloqué des moyens plus importants pour améliorer les conditions de vie. Vous vous rappelez qu'avec les ressortissants irakiens et syriens, les Erythréens peuvent faire l'objet de relocalisations.
En raison des crises, du changement climatique ou des écarts de développement, l'enjeu migratoire perdurera. Selon certains analystes, la crise en Syrie serait d'ailleurs, en partie, due à une sécheresse prolongée. Il faut prendre en charge l'ensemble du sujet, par l'aide humanitaire, l'aide au développement, la politique d'adaptation au changement climatique, la politique de défense et, bien sûr, la diplomatie pour résoudre les crises. Une initiative européenne aidera aussi à structurer l'aide à la sécurité dans ces pays.
L'accueil des réfugiés est le devoir et l'honneur de l'Europe. Nous travaillons à réformer le système d'asile pour qu'il soit plus efficace, afin de ne pas créer de désordres internes, tout en respectant nos engagements européens et internationaux. Oui, la rétention doit être proportionnée et correspondre à une durée strictement nécessaire. Nous devons continuer à aider la Grèce, soumise à de fortes pressions, l'inciter à améliorer ses propres procédures et augmenter les moyens pour soutenir ses efforts. Nous serons vigilants sur la proportionnalité et l'efficacité.
Les 3 milliards d'euros doivent améliorer les conditions de vie des Syriens en Turquie et sont plutôt destinés à ceux, majoritaires, qui résident dans les villes, en dehors des camps donc, qui étaient sans permis de travail - et sont souvent les plus vulnérables. Nous vérifions la destination de cette aide : elle a d'abord pris la forme d'une aide humanitaire, et s'élargit à des projets d'infrastructures sanitaires, éducatives ou pour le logement. Nous avons instauré un suivi sur place et un comité, associant les États membres à Bruxelles, qui vérifie la destination des fonds. La proposition de la Commission visant à infliger une amende de 250 000 euros pour chaque réfugié refusé n'est pas claire, et s'apparente en effet à une sanction davantage qu'à une incitation. En plus des questions morales qu'elle pose, elle sera nécessairement rejetée par un nombre important d'État membres.
Il ne peut s'agir de renoncer aux conditions sur les visas et sur les négociations d'adhésion, dans le cadre des engagements pris il y a des années. Notre exigence initiale a été de trouver un équilibre efficace, acceptable et qui respecte ces conditions.
M. Jean-Yves Leconte . - Oui, mais rien n'avait été fait jusqu'ici. Pourquoi le décider maintenant ?
M. Philippe Léglise-Costa. - Sur les négociations d'adhésion, plusieurs chapitres, faciles à ouvrir, ont été ouverts à partir de 2005 et par la suite, avant un ralentissement ces dernières années. Sur les visas, la feuille de route prévoyait un lien entre l'accord de réadmission et l'exemption de visa. Ce n'est pas un rapport de force qui peut changer la donne, mais le respect ou non des critères par la Turquie.
M. Jacques Legendre, président. - Merci beaucoup d'être venu nous éclairer.
M. Philippe Léglise-Costa. - Je reste à votre disposition autant de fois que vous le jugerez utile.
Audition de M. Ralf
Gruenert,
représentant ad interim
et Mme Céline
Schmitt,
porte-parole et responsable de l'information du Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR) en France
Mercredi 25 mai 2016
M. Jacques Legendre, président. - L'audition de M. Ralf Gruenert et Mme Celine Schmitt portera sur la déclaration Union européenne-Turquie du 18 mars dernier relative à la crise des réfugiés, qui constitue l'objet de notre mission d'information.
Nous souhaitons recueillir votre point de vue sur cet accord et, notamment, sur le volet des réinstallations. Le HCR a émis, nous le savons, de fortes réserves sur le programme dit « 1 pour 1 », qui prévoit la réinstallation de réfugiés syriens en Europe depuis la Turquie en contrepartie de la réadmission par celle-ci des Syriens ayant gagné la Grèce par la mer. Pouvez-vous nous livrer votre analyse sur la validité juridique de ce dispositif ?
Nous attendons aussi que vous nous exposiez comment le HCR intervient dans la mise en oeuvre de cet accord, en Turquie mais aussi en Grèce.
Quelle appréciation portez-vous sur les voies légales disponibles - y compris celles offertes par l'accord avec la Turquie - pour répondre à la présente crise des réfugiés ? Sont-elles désormais suffisantes ? Sinon, combien de réinstallations supplémentaires faudrait-il proposer pour répondre aux besoins ?
Enfin, l'action du HCR a été pénalisée, ces dernières années, par le niveau insuffisant des contributions volontaires. Qu'en est-il pour 2016 ? Les annonces de contributions en augmentation suffiront-elles à couvrir les besoins ?
M. Ralf Gruenert, représentant ad interim du HCR en France. - Merci pour votre invitation qui nous permet d'expliquer notre position sur cet accord au sujet duquel le HCR a émis des réserves. Nous n'approuvons pas les retours de réfugiés en masse sans possibilité de déposer une demande d'asile en Grèce ; nous nous opposons également aux centres d'hébergement fermés, voire aux centres de détention sur les îles. Enfin, le principe du 1 pour 1 - une forme de troc - ne nous paraît pas acceptable.
En revanche, cet accord met fin au chaos qui régnait avant sa signature : plus d'un million de personnes ont traversé l'Europe sans contrôle. Il introduit une notion de responsabilité partagée à travers le transfert annoncé de 6 milliards d'euros à la Turquie pour financer l'installation des camps. Le HCR est toujours favorable aux voies légales, c'est pourquoi nous soutenons la réinstallation en provenance de Turquie, du Liban et de Jordanie.
Mme Céline Schmitt, porte-parole et responsable de l'information du HCR en France. - Au moins 10 % parmi les 4,8 millions de réfugiés syriens se trouvant dans les pays voisins de la Syrie, soit 480 000 personnes, auront besoin d'une réinstallation ou d'une aide humanitaire pour leur transfert vers un autre lieu sûr avant la fin 2018. Les engagements pris par les États le 30 mars dernier à la conférence de Genève s'élèvent à 185 000 places comprenant réinstallations, visas humanitaires (France), bourses d'études et programmes de parrainage privé (Canada, Allemagne). Nous encourageons les États à explorer ces voies.
Le montant de l'aide humanitaire a augmenté, mais les besoins aussi. Le nombre de personnes déplacées dans le monde, qui était de 60 millions en 2014, sera supérieur en 2015. Seuls 50 % de notre budget qui s'élève à sept milliards d'euros ayant été financés (en 2015), 50 % de nos programmes ont pu être mis en oeuvre. Les personnes les plus vulnérables sont ciblées en priorité. Dans les crises oubliées, comme en Centrafrique ou au Burundi, les programmes n'ont été financés qu'à hauteur de 20 à 30 %.
M. Ralf Gruenert. - Donner une protection aux réfugiés est une responsabilité globale, c'est pourquoi le HCR a demandé une augmentation globale des réinstallations, et un quota de 10 % pour la réinstallation des réfugiés Syriens.
M. Michel Billout, rapporteur. - Estimez-vous que les personnes nécessitant une protection internationale la trouveront en Turquie, considérée aux termes de l'accord comme un pays sûr ? Un tribunal d'appel grec vient de statuer en sens contraire.
La limitation géographique prévue par la Turquie dans l'application de la convention de Genève a-t-elle eu des conséquences sur votre action dans ce pays ? Les mesures récemment prises par cette dernière pour renforcer la protection des réfugiés font-elles évoluer votre rôle là-bas ? La protection temporaire accordée aux réfugiés syriens l'est-elle au terme d'un examen individuel et d'un enregistrement, ou automatiquement et collectivement ? 90 % des réfugiés syriens sont répartis dans les villes, et non dans les camps. Les arrivées en Turquie se poursuivent-elles ?
L'accord a redéfini le rôle des hotspots qui, de centres d'enregistrement, sont devenus des camps de rétention pour les réfugiés. Quel est votre témoignage sur la situation dans ces centres ?
M. Ralf Gruenert. - La décision que vous évoquez a été prise par un tribunal d'appel à Lesbos.
La Turquie a donné refuge à près de deux millions de Syriens, et voté de nouvelles lois pour leur accorder une protection temporaire. La protection vise d'abord à les protéger d'un refoulement vers la Syrie ou d'autres pays ; elle permet aussi, pour les réfugiés qui restent dans le pays, d'accéder au marché du travail, aux soins, ou à un logement.
Le HCR encourage la localisation des réfugiés dans les villes, car nous ne sommes pas favorables aux camps. L'accès au travail est pour le moment difficile, mais nous attendons une amélioration. Avec l'assistance du HCR et de l'Europe, la Turquie est en train de mettre sur pied un organisme chargé d'améliorer l'accès aux soins.
Nous vérifions les informations selon lesquelles des retours vers la Syrie auraient eu lieu.
Enfin, le HCR n'a pas quitté les îles grecques, mais il ne facilite pas le transport vers les hotspots et ne participe pas à leur gestion.
Nous nous félicitons de la décision prise de démanteler le camp d'Idomeni, où les conditions étaient déplorables, et du transfert de ses occupants vers d'autres centres plus sûrs.
Le nombre d'arrivées en Grèce a beaucoup baissé et environ 300 retours vers la Turquie ont été enregistrés.
M. Michel Billout, rapporteur. - Les arrivées en Grèce ont globalement été stoppées, mais nous ne savons pas si les migrations continuent vers la Turquie, la Jordanie ou le Liban.
M. Ralf Gruenert. - Les arrivées continuent mais ont diminué ; on relève également quelques retours, notamment de la Jordanie vers la Syrie, liés au cessez-le-feu. Mais des arrivées ont aussi été enregistrées à la frontière turque et libanaise, à cause de la situation à Alep.
Mme Céline Schmitt. - Nous vous remettrons les dernières statistiques. La dégradation de la situation à Alep a provoqué de nouveaux déplacements à l'intérieur du pays et vers la Turquie. Nous continuons le dialogue avec les autorités turques et nous encourageons les autorités à permettre aux civils dans le besoin d'une protection internationale à rechercher la sécurité.
Dans certaines zones de Syrie, il peut y avoir des retours, mais la situation est très volatile. L'une de nos équipes qui est récemment allée à Homs, ville entièrement détruite, nous a signalé des retours, mais les défis de reconstruction sont énormes. Dans d'autres zones, certaines familles ne se sont déplacées que de quelques centaines de mètres pour fuir les combats et rester près de chez eux.
M. Jean-Pierre Vial. - En Turquie et en Jordanie, seuls 20 à 30 % des réfugiés vivent dans les camps. À travers l'accompagnement et la gestion administrative, êtes-vous en mesure d'intervenir de façon équivalente dans et en dehors des camps ?
Les conditions de l'accueil sont liées au nombre de personnes accueillies : si cela se passe mal, le pays concerné réduira ses engagements. Un peu plus de 10 000 réfugiés syriens ont été accueillis en France. D'après nos informations, vous avez une quasi-délégation pour choisir, sur le terrain, les familles qui bénéficieront des réinstallations en Europe. Comment procédez-vous ? Notre gouvernement, les organismes que nous avons interrogés désignent le HCR comme le seul opérateur, sans possibilité pour l'État d'agir sur le choix des personnes qu'il accueillera.
M. Ralf Gruenert. - Vous avez parlé de gestion ; c'est bien de cela dont il s'agit. Nous devons gérer le défi posé par un grand nombre d'arrivées. En 2015, nous avons pâti des conséquences d'une absence de gestion des flux migratoires. L'afflux croissant de réfugiés en milieu urbain nous a conduit à mettre au point des méthodes innovantes et de nouveaux moyens d'assistance auprès d'eux, comme les cash cards permettant de retirer l'argent sur un compte et de reprendre une vie plus normale.
Le HCR a de l'expérience dans le traitement des retours volontaires, qui s'effectuent principalement de Jordanie vers la zone d'origine. Nous informons les réfugiés et leur apportons une assistance au transport et à l'intégration.
Pour la réinstallation, nous nous appuyons sur notre système d'enregistrement reconnu, qui utilise des méthodes biométriques. Les données sont partagées avec les États. Voici un an, nos procédures étaient critiquées parce que trop longues... Le HCR ne fait que proposer les réinstallations aux États, dont la décision reste souveraine. C'est un défi pour le HCR que d'interagir avec 28 systèmes d'accueil différents, avec des exigences d'information variables. Notre expérience dans la gestion et le partage de l'information est reconnue.
En Turquie, l'enregistrement est assuré par le gouvernement turc et partagé avec le HCR qui y applique ses critères de vulnérabilité avant de soumettre la réinstallation à l'État choisi ; ce dernier conserve là aussi la décision finale.
Mme Céline Schmitt. - La majorité des réfugiés vivant hors des camps, le HCR agit aussi en zone urbaine à travers différents programmes destinés aux personnes les plus vulnérables. En 2009, nous avons adopté une stratégie de protection et d'assistance aux réfugiés dans les zones urbaines puis, en 2014, une stratégie d'alternative aux camps. Je vous ferai parvenir les deux stratégies. Le principal critère de réinstallation est la vulnérabilité.
M. Didier Marie. - Le HCR a indiqué que les capacités d'accueil en Grèce étaient notoirement insuffisantes pour accueillir tous les migrants. La situation dans les hotspots, notamment pour les enfants isolés et les femmes, s'est-elle améliorée sur le plan sécuritaire et sanitaire ? Vous dénoncez la transformation des hotspots en camps de rétention, voire de détention, mais quelle est l'alternative ?
Je n'ai pas saisi votre réponse sur l'octroi à la Turquie du statut de pays de premier asile ou de pays tiers sûr. Le HCR a-t-il accès aux camps installés sur le territoire turc et, le cas échéant, comment fonctionnent-ils ? Les populations y sont-elles bien accueillies ?
Il nous a été signalé que certains migrants renvoyés en Turquie ne bénéficiant pas d'une protection internationale avaient été presque immédiatement reconduits aux frontières extérieures, notamment des Afghans.
1 500 relocalisations avaient été effectuées à la fin mai, pour un objectif de 20 000. Quels sont les principaux blocages ? Que pensez-vous de la proposition de la Commission européenne, du 4 mai dernier, d'imposer des amendes pour contraindre les pays du groupe de Visegrad à remplir leurs obligations en la matière ?
M. Ralf Gruenert. - La situation d'Idomeni était inacceptable, mais il existe des camps où une assistance adéquate est fournie. Nous avons accès aux hotspots. Ceux-ci étant situés sur des îles, les personnes accueillies ne peuvent pas en sortir sans permission. Nous ne sommes pas favorables aux centres d'accueil fermés. Nous ne nous opposons pas aux retours, dans la mesure où la personne a pu déposer une demande d'asile et en a été déboutée à l'issue d'une procédure équitable. C'est valable pour la Grèce comme pour la France et pour toutes les nationalités. Des Bangladeshis ont été retournés de Grèce vers la Turquie. Il est indispensable de distinguer le migrant du réfugié.
Le HCR a également mis en place un programme de recherche de logements en Grèce. La situation s'est améliorée mais pourrait se dégrader si les arrivées augmentaient à nouveau, notamment à la frontière macédonienne, près d'Idomeni.
Les relocalisations ont fait l'objet d'une réponse tardive. Les blocages se situent plutôt en Grèce et en Italie et sont de nature bureaucratique. La France occupe le premier rang pour les relocalisations ; j'espère qu'elle servira d'exemple et que les blocages seront résorbés.
La Commission européenne a développé un plan de répartition des responsabilités entre États européens. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés stipule que la responsabilité de protection est partagée. Le système actuel ne fonctionne plus ; il faut en trouver un autre à l'échelle de l'Europe. Naturellement, le HCR ne peut se substituer à la Commission européenne.
Nous sommes favorables à la répartition, qui est une expression de cette responsabilité partagée. En Slovénie, des réfugiés sont récemment arrivés et la Croatie s'est déclarée prête à en accueillir. Au départ, l'objectif des réfugiés était l'Allemagne mais la situation a changé. Il faut accompagner la répartition et s'assurer qu'il n'y aura pas de mouvements secondaires. Les chiffres proposés aux pays d'Europe de l'Est sont modestes ; avec l'accompagnement adéquat, nous pouvons les convaincre sans les contraindre. Cela passe aussi par un discours d'explication auprès de la population : ces arrivées ne sont pas une menace pour la culture du pays. Cet effort doit être intensifié.
Nous avons accès aux camps installés en Turquie, qui sont de très bon niveau. Le défi est plutôt la situation des réfugiés hors de ces camps. Le transfert de six milliards d'euros devrait stabiliser leur situation.
M. Michel Billout, rapporteur. - Manifestement, vous ne souhaitez pas répondre à la question du pays de premier asile ou de pays tiers sûr... Dans votre communiqué du 18 mars intitulé « Position du HCR sur l'accord », vous demandiez une amélioration de la situation en Turquie et en Grèce ; un accès juste et équitable à la demande d'asile avant le renvoi éventuel en Turquie, des garanties contre le refoulement et un certain nombre de dispositions à prendre en Turquie même avant le renvoi depuis la Grèce. Le 1er avril dernier, vous appeliez de nouveau à la mise en oeuvre des garanties prévues dans l'accord avant le retour des migrants. Ces progrès ont-ils eu lieu ? Qu'en est-il de l'exigence que la Turquie revoie sa position limitant l'application de la convention de Genève aux ressortissants de certains pays ? Ce qui s'y passe actuellement dans le pays ne nous rassure pas sur l'avenir de l'accord.
M. Ralf Gruenert. - La directive européenne « Procédures d'asile » définit une série de conditions au renvoi des personnes vers un pays sûr : l'absence de risque de persécution ou de refoulement, l'application de la convention de Genève par ce pays, la possibilité d'obtenir un titre de séjour, l'assistance délivrée aux personnes ayant des besoins spécifiques, l'accès à des solutions durables. Commençons par appliquer ces critères.
Il faut également tenir compte du fait que les conditions de vie des Syriens qui ont trouvé refuge en Turquie devraient s'améliorer grâce à l'assistance financière et à l'accès au marché du travail. En matière d'accès à l'école, des progrès restent à faire. Sous certains aspects, cet accord est une opportunité.
C'est pourquoi ma réponse à votre question est hésitante ; nous sommes moins critiques que d'autres organismes. N'oublions pas que la Turquie a accordé une protection à plusieurs millions de réfugiés, alors que l'Europe a laissé plus d'un million de personnes traverser ses frontières sans gestion administrative avant de réagir. Sans gestion des flux mixtes de réfugiés et de migrants, les populations demanderont que cesse l'accueil des réfugiés et leurs gouvernements auront des difficultés à défendre l'assistance apportée.
Mme Céline Schmitt. - Nous avons demandé que des garanties soient mises en place et notamment que chaque personne souhaitant demander l'asile en Grèce puisse le faire, avec une possibilité d'appel. La Grèce a récemment adopté une loi sur l'asile mais des améliorations restent à faire, notamment le développement de structures d'accueil et d'enregistrement et d'examen des demandes. Lorsque les hotspots ont été transformés en centres de détention, le HCR y a suspendu certaines de ses activités en conservant néanmoins une présence sur place pour le « monitoring de protection », c'est-à-dire une surveillance relative au respect des droits de l'homme et à l'accès à l'information. D'autres activités ont depuis été rétablies suite à la recherche d'alternatives à la détention par les autorités grecques. Une partie des enfants non accompagnés ont été transférés vers d'autres centres. Nous appelons les États membres à aider la Grèce à répondre à la situation.
En Turquie, une protection temporaire est accordée (par décret) aux réfugiés syriens. La demande d'asile y est aussi accessible aux non-Syriens. Nous cherchons à obtenir davantage de garanties contre le refoulement. Nous avons enfin demandé un accès aux centres de retour. Le dialogue se poursuit.
M. Ralf Gruenert. - L'accord a aidé à limiter l'activité des passeurs, une industrie dirigée par des réseaux criminels qui génère entre trois et six milliards d'euros par an, très bien implantée en Turquie. Plus de 3 700 personnes ont perdu la vie en mer.
M. Michel Billout, rapporteur. - L'accord a-t-il découragé les passeurs ou incité les autorités turques à prendre des mesures plus fermes à leur égard ? Un officier français, commandant en second de l'opération Sophia, nous a déclaré hier qu'il s'attendait à la mise en place d'autres routes par les passeurs. L'une d'entre elles passe par l'Égypte. L'activité des passeurs est-elle arrêtée, ou simplement suspendue le temps d'une réorganisation ?
M. Ralf Gruenert. - Un business de six milliards d'euros ne s'arrête pas du jour au lendemain. Des réseaux pourraient se reconstituer en Égypte. À l'avenir, moins de familles prendront la route très dangereuse de la mer Égée mais les flux ne se tariront pas. En France, en Italie aussi, des réseaux sont actifs, bien que souvent sous-estimés.
Mme Céline Schmitt. - Nous suivons l'évolution de la situation des arrivées en Italie. En mars, le nombre de personnes arrivées en Italie a augmenté d'un peu plus de 20 % ; la répartition des nationalités d'origine, cependant, n'a pas évolué : il s'agit toujours de réfugiés d'Afrique subsaharienne (Nigérians, Gambiens, Soudanais, Erythréens, Somaliens et Ethiopiens), principalement de jeunes hommes, avec quelques familles syriennes et irakiennes. Au total en 2016, 46 714 personnes ont effectué la traversée vers l'Italie cette année. C'est quasiment le même nombre que le total enregistré durant les cinq premiers mois de 2015 (47 463).
M. Jacques Legendre, président. - Merci d'avoir répondu à nos questions.
Audition de M.
Jean-François Dubost,
responsable du programme de protection des
populations à Amnesty International France,
et de Mme Sylvie
Houedenou,
responsable de la commission des personnes
déracinées à Amnesty International France
Mercredi 25 mai 2016
M. Jacques Legendre, président. - L'audition de M. Jean-François Dubost et Mme Sylvie Houedenou portera sur la déclaration Union européenne-Turquie du 18 mars dernier relative à la crise des réfugiés, objet de notre mission d'information.
Amnesty International s'est montrée, dès le stade de la négociation, très critique à l'égard de cet accord et de sa principale disposition qui consiste à renvoyer en Turquie tous les migrants arrivés en Grèce depuis le 20 mars dernier, y compris les demandeurs d'asile.
Quelle est votre analyse sur la validité juridique de ce dispositif ? L'Union européenne méconnaît-elle, à travers lui, ses obligations légales et morales au regard du droit d'asile ? Quid de sa mise en oeuvre ?
Cette audition fait l'objet d'une retransmission en direct, sur le site Internet du Sénat, et d'un enregistrement qui sera consultable à la demande sur ce site.
M. Jean-François Dubost, responsable du programme de protection des populations à Amnesty International France. - Merci de nous avoir permis de nous exprimer sur cet accord et sur ses conséquences concrètes. Nous avons d'autant plus à coeur que la représentation nationale se saisisse de cette question que celle-ci a été peu consultée au moment de la prise de décision. Nous aurions voulu un véritable débat.
L'accord, ou plutôt la déclaration Union européenne-Turquie est destinée à trouver à l'extérieur de l'Union européenne des solutions à un problème auquel celle-ci n'a pas su répondre. Les causes profondes de la crise ne tiennent pas tant au nombre de personnes déplacées qu'à la qualité de la réponse collective apportée par les États membres. La déclaration foule aux pieds certains principes cardinaux édictés par le droit international - la Convention relative aux réfugiés de 1951, mais aussi la directive européenne « procédures d'asile » qui définit les pays tiers sûrs. D'un point de vue moral, nous condamnons le marchandage qu'est le principe du « 1 pour 1 » : les États membres n'accueillent que sur une base volontaire la réinstallation depuis la Turquie de personnes qui ont risqué leur vie pour y parvenir.
À plus long terme, la déclaration pourrait être une première étape vers la mise en place d'un système équivalent négocié avec d'autres États, la proposition de refonte du règlement de Dublin présenté par la Commission européenne semblant le permettre.
Des représentants des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères ont justifié devant vous la déclaration par la nécessité de réduire les flux irréguliers, de préserver les capacités d'accueil des Etats membres et de protéger les migrants des réseaux de passeurs. Cela a été dit dès le début des négociations.
Certes, ceux qui transitent par la mer Égée sont formellement en situation irrégulière car ils n'ont pas de documents. Mais ce sont très clairement des réfugiés : 90 % d'entre eux sont issus des dix principaux pays d'origine des réfugiés dans le monde. Ils relèvent bien de l'article 31 de la Convention de 1951 qui confère une immunité aux réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil. De plus, réduire ces flux entre en contradiction avec le principe de protection des personnes qui fuient les persécutions.
Quant aux capacités d'accueil, là encore les États, sauf à couper les routes empruntées, ont des obligations vis-à-vis des personnes en recherche de protection. L'Union européenne est le premier espace économique mondial ; ses États membres avaient les moyens d'ajuster ces capacités.
La déclaration a été présentée comme indispensable pour mettre un terme aux trafics ; mais il ne suffit pas d'empêcher la traversée. L'outil le plus efficace contre les réseaux illégaux est le développement de voies légales d'accès pour les réfugiés. Ajouter des obstacles et des contrôles aux frontières ne fera qu'alimenter le trafic de ceux qui recherchent une protection. Les barrières n'arrêtent pas le mouvement de fuite.
On a mis en avant la logique du contrôle des migrations et des frontières et proposé en guise d'alternative un système volontaire d'accueil portant sur 54 000 à 72 000 personnes, un total hors de proportion avec les besoins. C'est une véritable défaillance.
Les fonctionnaires que vous avez entendus ont reconnu que le système d'asile grec - réformé en quatre jours alors que la France a mis un an et demi à le faire - n'atteindrait pas immédiatement sa pleine efficacité ; il en va de même pour le système de protection des réfugiés mis en place en Turquie. Par conséquent, il aurait fallu prendre ces dispositions beaucoup plus en amont. Les grands perdants sont les réfugiés qui, en attendant, ne bénéficient ni des garanties minimales de la législation, ni de la protection contre le refoulement prévue par la Convention de 1951.
L'accord considère la Turquie comme un pays de premier asile ou un pays tiers sûr selon les cas. Or les critères pour ce faire ne sont pas réunis. Pour commencer, la limitation géographique opérée par ce pays dans l'application de la Convention de 1951 exclut les non Européens. Nous sommes opposés par principe à l'usage de la notion de pays tiers sûr, qui rapporte des cas individuels à une notion générale. Rien dans les conventions internationales n'oblige une personne à déposer une demande dans un État plutôt que dans un autre ; à cet égard, la conformité de la législation européenne à la Convention de 1951 n'a jamais été contrôlée.
Enfin, le nombre de places offertes à la réinstallation est très faible au regard de la situation en Turquie et à l'échelle régionale et mondiale. Les mécanismes de contrôle et de renvoi font appel à des instruments contraignants, alors que la protection est soumise à la bonne volonté des États. Depuis l'accord, le nombre de personnes ayant bénéficié de la réinstallation est très faible. La France a néanmoins prévu d'accueillir 6 000 réfugiés en deux ans.
Tout ceci est d'autant plus inquiétant que les tentatives de relocalisation intra-européennes ont toutes échoué depuis un an alors que 22 000 personnes devaient être réinstallées selon la décision prise en 2015. Mais les États ont eu du mal à s'engager.
La Commission européenne a précisé les conditions juridiques de cet accord avec la Turquie pour le rendre compatible avec la législation européenne, mais il ne s'agit que d'un verni de protection, le but de cet accord étant avant tout de dissuader l'arrivée de réfugiés.
Bien en amont de la signature de cet accord, nous avons adressé des notes au Président de la République et au ministère de l'intérieur pour les alerter sur ces points.
Nous publierons le 3 juin un état des lieux d'une vingtaine de pages à la suite d'une mission de recherche qui a récemment pris fin en Turquie et qui démontre l'ineffectivité de la protection offerte aux réfugiés ainsi que les risques de refoulement depuis ce pays.
Mme Sylvie Houedenou, responsable de la commission des personnes déracinées à Amnesty International France. - L'accord entre l'Union européenne et la Turquie a un impact direct sur la situation des réfugiés, qu'ils soient en Grèce ou en Turquie.
Depuis l'entrée en vigueur de cet accord, tous les migrants et réfugiés qui arrivent sur les îles grecques sont mis systématiquement en détention et sont privés de leur liberté de circulation, ce qui est inacceptable. Sur les îles de Lesbos et de Chios, les centres d'accueil prévus ont été transformés en centres de détention : 4 200 réfugiés se trouvent ainsi dans une situation inacceptable. Ces camps sont surpeuplés et on y trouve des enfants en bas âge, des nourrissons, des femmes enceintes et des personnes malades ou blessées. Des chercheurs ont constaté que les conditions de vie y étaient déplorables : pas de savon, pas de toilettes, trop peu de médecins. Ainsi, dans le camp de Moria à Lesbos, il n'y a que trois médecins pour 3 150 personnes. Les installations sont dégradées et la vulnérabilité des réfugiés n'est pas prise en compte, à l'exception des mineurs isolés.
J'en viens à la procédure d'asile en Grèce : depuis l'entrée en vigueur de cet accord, deux procédures sont en place. Les personnes arrivées avant le 20 mars sur ces iles bénéficient de la procédure traditionnelle, tandis que celles arrivées après cette date sont soumises à une procédure « accélérée » de 15 jours, le temps pour les autorités grecques d'évaluer si la Turquie est un pays sûr pour ces personnes. Si tel est le cas, elles sont renvoyées en Turquie sans que les conditions de fond aient été étudiées. Nous nous sommes, en autre, rendu compte que des personnes arrivées avant le 20 mars, mais qui n'avaient pas été enregistrées, sont soumises, elles aussi, à la procédure « accélérée ».
L'information des réfugiés n'est pas assurée : ils ne savent pas qu'ils vont être mis en détention pendant toute la procédure et ils ne bénéficient pas d'assistance juridique gratuite en première instance.
Nous sommes donc assez préoccupés par leur situation sur ces îles.
J'en viens aux réfugiés en Turquie : certaines données sont très alarmantes, notamment l'augmentation des violations de leurs droits. Nous avions déjà publié un rapport en décembre 2015 à ce sujet. Après l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, la situation s'est encore aggravée. Plusieurs réfugiés ont été renvoyés dans leur pays d'origine : quelques heures après la signature de l'accord, une vingtaine d'Afghans ont ainsi été renvoyés dans leur pays sans avoir pu présenter leur demande d'asile. Les autorités turques ont prétendu qu'il s'agissait de retours volontaires, mais tel ne semble pas avoir été le cas : la contrainte physique a été utilisée. Des enfants mineurs et des femmes enceintes ont été renvoyés en Syrie. En l'espace de trois jours, il y a eu des renvois collectifs de réfugiés qui se trouvaient dans le sud de la Turquie. La plupart de ces personnes n'avaient pas été enregistrées comme demandeurs d'asile. Beaucoup de réfugiés nous ont dit qu'ils ne se faisaient pas enregistrer de peur d'être renvoyés. Nous avons eu le témoignage de personnes qui ont été refoulées et d'autres qui ont essuyé des tirs.
En Turquie, ces personnes ne bénéficient pas du statut de réfugié au sens de la convention de Genève de 1951, puisque la Turquie a signé cette convention mais y a mis des réserves géographiques : cette convention ne s'applique donc pas aux non-européens. Les réfugiés ne disposent donc que d'une protection temporaire.
Nous assistons à la mise en place d'une « forteresse » Turquie, comme ce fut le cas pour l'Europe : tout est fait pour que les réfugiés ne puissent entrer sur le territoire. La frontière terrestre entre la Turquie et la Syrie a été fermée, sauf pour les personnes qui ont un besoin urgent de soins. Ces derniers mois, la Turquie a imposé une obligation de visa pour les réfugiés syriens qui arrivent en avion de pays tiers. Ce pays s'inspire de la législation européenne pour faire en sorte que ces personnes ne puissent arriver sur son territoire. Trois députés européens se sont rendus, il y a quelques semaines, en Turquie et ont fait le même constat.
Nous faisons plusieurs recommandations : la Turquie ne peut être considérée comme un pays tiers sûr. Nous souhaitons la mise en place d'un plan de réinstallation à grande échelle pour les réfugiés se trouvant en Turquie, afin qu'ils atteignent un pays où ils puissent demeurer de façon pérenne. L'Union européenne doit favoriser la réunification familiale de ces réfugiés : ainsi un fils réfugié en Turquie n'a pu rejoindre son père installé en Grande-Bretagne. C'est inquiétant.
Pour l'Union européenne, nous recommandons de favoriser la relocalisation des réfugiés en Grèce vers d'autres pays de l'Union et nous demandons que soit mis un terme à la détention de tous les réfugiés. En outre, les réfugiés doivent être informés de la procédure d'asile et être avertis qu'ils vont être mis en détention pendant plusieurs mois. Ils doivent pouvoir avoir accès à un conseil juridique pendant toute la procédure.
M. Jean-François Dubost. - Il a souvent été dit que les autorités turques avaient ouvert aux réfugiés l'accès à leur marché du travail : s'agissant de la protection internationale prévue par la législation turque, les conditions d'accès au travail sont, en réalité, très restrictives. De fait, il est quasiment impossible de bénéficier de ce droit et les réfugiés, y compris les enfants, travaillent de façon irrégulière avec les conséquences que cela emporte. Certaines personnes n'ont eu d'autre choix que de retourner en Syrie du fait de leurs conditions de vie : c'est une situation de refoulement de fait.
De même, l'ouverture du marché du travail aux réfugiés syriens qui bénéficient d'une protection ad hoc ne permet pas à tous de travailler. En effet, des textes ont précisé les conditions dans lesquelles les réfugiés syriens pouvaient solliciter ce droit à travailler. Nous sommes loin d'une ouverture large permettant à ces personnes de subvenir à leurs besoins. En outre, il n'existe qu'une centaine de places d'accueil pour les réfugiés ; les autres sont livrés à leur sort et ne disposent pas de ressources leur permettant de se loger convenablement. Ces personnes se retrouvent à la rue, dans des maisons délabrées, dans des campements informels ou dans des chambres surpeuplées louées fort cher.
Selon l'ONG Human Rights Watch, 400 000 enfants réfugiés n'auraient pas accès à l'éducation en Turquie. Certes, les trois millions de réfugiés dans ce pays pèsent sur ses capacités d'accueil mais l'Union européenne apporte une contribution financière. En outre, nous préconisons d'arrêter tout renvoi de réfugiés en Turquie et demandons que l'Union européenne offre davantage de réinstallations.
M. Michel Billout, rapporteur. - Merci pour votre propos introductif très complet. Pour ma première question, je vais me faire l'« apôtre » de cet accord. Vous avez décrit la détresse des réfugiés en Grèce mais ce problème a précédé l'accord. Face à la fermeture de la route des Balkans et à l'arrivée massive de réfugiés en Grèce, il était urgent de stopper le flux dans la mesure où ce pays ne pouvait accueillir tout le monde. Cet accord n'a-t-il pas eu la vertu de mettre un terme à ce phénomène et de donner du temps pour régler la situation ?
Quelle autre solution aurait été préférable à cet accord pour endiguer ces arrivées ? Cet accord, s'il réussissait, pourrait servir de modèle dans le futur. Il est important de savoir en quoi il est utile, efficace, et s'il pose des problèmes.
Vous nous avez dit que plutôt que de renvoyer les migrants vers la Turquie, il aurait été préférable de les réinstaller dans des pays de l'Union européenne mais, quid des réactions dans ces pays ? Voyez l'Autriche !
M. Jean-François Dubost. - Nous sommes confrontés à dix années de défaillance du système grec qui a misé sur un contrôle de ses frontières au détriment de la structuration de son système d'accueil. Ce pays a donc une part de responsabilité en tant que porte d'entrée de l'Union. Nous avons voulu régler le problème de l'accueil défaillant en Grèce en concluant un accord avec un État pour y bloquer les réfugiés. Or, nous savons que ce pays détient ces personnes dans des conditions quasi-carcérales - les ONG n'ont pas accès à ces centres - et qu'il les renvoie vers le danger. En outre, la protection qu'il leur offre n'est ni durable ni effective : or, le droit international prévoit la protection juridique et la possibilité d'intégration par le travail, par l'éducation et par la formation. C'est la règle du jeu fixée depuis 1951.
Nous ne pouvons nous satisfaire de voir les réfugiés bloqués en Turquie plutôt qu'en Grèce.
Nous aurions pu venir en aide à la Grèce il y a quelques mois ; nous aurions pu proposer des niveaux de relocalisation beaucoup plus importants : il est presque scandaleux de voir des chiffres aussi faibles : la France s'en sort plutôt bien, au 13 mai, avec 362 personnes relocalisées tandis que d'autres États n'en ont accueilli aucune. Bien sûr, il aurait fallu développer des voies légales à partir de la Turquie : si ce pays a du mal à faire face aux trois millions de réfugiés, la communauté mondiale aurait pu proposer une réinstallation de ces personnes, comme cela se pratique depuis le Liban ou la Jordanie. Une aide humanitaire et technique aurait également pu être proposée à ce pays pour l'aider à élever son niveau de protection. Ces alternatives nécessitent des politiques à moyen et long terme ; or nous assistons à des réactions de court terme.
Mme Sylvie Houedenou. - Le flux des réfugiés correspond à 0,2 % de la population européenne alors qu'au Liban, il s'agit de 10 %. Certes, le flux est important, mais acceptable à l'échelelle de l'Union.
M. Michel Billout, rapporteur. - Les contreparties proposées à la Turquie - l'aide financière de 3 milliards qui pourrait être doublée, la libéralisation des visas, la poursuite du processus de candidature de la Turquie à l'Union européenne - ne sont-elles pas suffisantes pour inciter le gouvernement turc à améliorer l'accueil des migrants ?
M. Jean-François Dubost. - Nous nous limitons à la question des réfugiés : le système d'accueil turc ne peut convenir. Il y avait deux prérequis à prendre en compte : la certitude absolue qu'il n'y aurait pas de refoulement de réfugiés ni de traitement contraire aux normes internationales. Or, tel n'est pas le cas. Jusqu'à quel degré l'Union européenne est-elle prête à coopérer avec des États tiers qui ne respectent pas les principes que nous défendons ?
Les engagements de l'Union européenne en matière de réinstallation sont extrêmement faibles : ni contrainte, ni clé de répartition, ni réelle volonté d'accueillir. Certains États posent des critères de religion et de qualification des réfugiés en Grèce pour accepter de les relocaliser. Les contreparties proposées par l'Union européenne ne sont pas à la hauteur de l'enjeu ni de ses capacités.
M. Didier Marie. - Vous dressez un tableau sombre de la situation. Mais cet accord est récent et les moyens promis permettront peut-être d'améliorer l'accueil des réfugiés en Grèce. Pour la Turquie, les retours doivent se passer dans les meilleures conditions et l'accueil doit s'améliorer. Pensez-vous, en définitive, que cet accord soit fondamentalement mauvais ou qu'il puisse s'améliorer et être efficace ?
M. Jean-François Dubost. - Cet accord est une « enveloppe politique » qui comprend un certain nombre d'instruments, comme le plan d'action conjoint négocié entre l'Union et la Turquie et formalisé en novembre 2015. L'accord a précisé certains aspects mais a confirmé des instruments qui fonctionnaient déjà.
Pour la Grèce, il en va de même : les dispositifs existent depuis longtemps. Peut-être cet accord montre-t-il qu'il est urgent d'agir, mais la situation en Grèce reste défaillante et la relocalisation ne fonctionne pas.
Les premiers signaux donnés par les autorités turques sur la protection des réfugiés ne sont pas bons et s'inscrivent en violation des principes internationaux. Peut-être la situation s'améliorera-t-elle dans les prochains mois, mais devait-on signer cet accord avant de tenter d'améliorer la situation ? Pour nous, c'était l'inverse qu'il fallait faire. L'accord aurait dû être conforme à nos principes et aux règles internationales. Enfin, les États de l'Union ne se sont pas précipités pour offrir des places de réinstallation pour les réfugiés en Turquie, ce qui aurait pu constituer un signe de bonne volonté. Cet accord pourrait être bloqué, comme le laisse présager la décision de justice grecque qui a conclu que la Turquie n'était pas un pays tiers sûr. Il y aura sans doute des saisines des deux cours européennes de justice et des droits de l'homme : tout cela prendra du temps. En attendant, que se passe-t-il pour ces femmes, ces enfants et ces hommes qui n'ont pour seul défaut que d'avoir fui leur pays ?
Mme Gisèle Jourda. - Selon les dernières informations, la Grèce ne pourrait actuellement examiner qu'une dizaine de demandes d'asile par jour. En outre, on nous dit que 90 réfugiés arrivent quotidiennement dans ce pays. Comment endiguer cette situation et avec quels moyens ?
Sur la centaine de réfugiés qui ont bénéficié de l'asile en Grèce, un seul l'aurait été en raison du fait que la Turquie n'était pas un pays sûr. Cette décision de justice pourrait-elle bloquer l'accord ?
M. Jean-François Dubost. - Aujourd'hui, 50 000 personnes sont bloquées en Grèce. Il y a eu un appel à la solidarité européenne avec des demandes précises d'interprètes et d'officiers d'asile. Au 12 mai, 15 % des besoins en interprètes étaient couverts, 14 % des besoins en officiers d'instruction de demande d'asile l'étaient mais aucun en matière de juges dédiés à la procédure d'appel. En revanche, 42 % des besoins étaient couverts pour les personnes en lien avec Frontex. Ce qui montre que l'on choisit de miser sur les dispositifs de contrôle et de renvoi plutôt que sur l'accueil.
La décision de justice que vous avez évoquée devrait être confirmée par toutes les décisions en appel et validée par la justice grecque. Nous avons salué cette décision qui confirme notre analyse. Reste à savoir quelles en seront les conséquences : les réinstallations à partir de la Turquie vont-elles cesser ? Ce serait une erreur. Des négociations vont-elles se poursuivre avec la Grèce qui a modifié sa législation en quatre jours ? Quatre jours ! Il est inconcevable de reconstruire un système d'asile en si peu de temps. Pour l'heure, cette décision pourrait bloquer une partie de l'accord.
M. Jacques Legendre, président. - Considérez-vous que les trois millions et demi de réfugiés en Turquie se trouvent dans un pays qui n'est pas sûr pour eux ? Faudrait-il les faire partir pour les accueillir dans un pays sûr ? Et où trouver un pays sûr au Proche-Orient ? Il faudrait tous les recevoir en Europe. Est-ce envisageable ?
M. Jean-François Dubost. - Nous ne demandons pas que l'Union européenne accueille tous les réfugiés : tous les pays du monde doivent prendre leur part, à commencer par les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande... Les pays du Golfe pourraient également en accueillir.
M. Jacques Legendre, président. - Sont-ils vraiment sûrs ?
M. Jean-François Dubost. - Certes...
La Corée du Sud, le Japon pourraient également en recevoir.
La Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte et le Kenya auraient besoin du soutien de la communauté internationale pour leur venir en aide : il existe des critères et des procédures comme la réinstallation, les admissions humanitaires, le recours à des « visas-asile », le regroupement familial... Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fixé des critères pour les personnes les plus vulnérables. Cette année, il y aurait un million de personnes vulnérables à réinstaller dans le monde. Ce qui manque, c'est une coordination internationale et l'Union européenne pourrait jouer un rôle lors des négociations qui vont s'ouvrir en prévision de l'assemblée générale des Nation Unies en septembre. Le Secrétaire général tentera de mettre en place un système de répartition à l'échelle mondiale pour prendre en charge les réfugiés. Il faut sortir d'une vision à court terme pour traiter de cette question qui va malheureusement perdurer pendant de nombreuses années.
M. Jacques Legendre, président. - Pensez-vous que l'on peut contraindre un État à recevoir sur son territoire des réfugiés contre l'avis de sa population ? Dans nos pays européens, cela va devenir de plus en plus difficile. Parfois, les migrants se retrouvent concentrés sur une partie du territoire : élu du Nord, je vois la situation à Calais qui est vécue par la population comme insupportable.
Mme Sylvie Houedenou. - Vous parlez de rejet de la population européenne. Nous avons récemment publié une enquête qui démontre le contraire : en France, 82 % de la population est prête à accueillir plus de réfugiés et ces données se retrouvent dans chaque pays européen. Il ne manque plus que la volonté politique.
M. Claude Kern. - Comment avez-vous posé la question ? S'agissait-il de l'accueil dans le pays, en général, ou dans la commune de résidence ?
M. Jean-François Dubost. - L'étude a été menée dans 27 États, dont la France : 83 % des personnes sont favorables à la protection et à l'accueil des réfugiés et 63 % souhaitent que leur Gouvernement fasse plus. Lorsqu'on précise les questions, 9 % des sondés sont prêts à accueillir des réfugiés chez eux, 19 % dans leur quartier et le reste des personnes interrogées dans la commune ou le pays. On peut interpréter ce sondage comme démontrant une hostilité grandissante à mesure que la proximité s'affirme, mais aussi comme le fait que les sondés ne voient pas où, dans leur quartier, ces réfugiés pourraient aller, ce qui peut révéler une méconnaissance des conditions réelles dans lesquelles des demandeurs d'asile sont déjà accueillis.
Nous nous sommes engagés dans un travail de terrain auprès des communes de France : nos militants ont essayé de sensibiliser l'opinion publique et les retours sont loin d'être négatifs. Il faut expliquer et repositionner le débat auprès des conseils municipaux pour obtenir des ouvertures de places. À notre échelle, les résultats sont plutôt satisfaisants et les autres associations ne constatent pas un rejet massif. La minorité hostile à l'accueil de réfugiés se fait parfois virulente et est souvent reprise par des médias et des hommes politiques. En outre, la politique d'accueil n'est pas assumée par les Gouvernements, dont celui de la France, alors que des initiatives tout à fait intéressantes sont prises par des communes. Les retours positifs et les valorisations sont très rares et c'est bien dommage. La réinstallation fonctionne très bien en France mais elle reste confidentielle. Le ministère de l'intérieur a refusé les accueils au sein des familles alors que la demande était forte : six mois après, nous notons des velléités pour l'organiser. Nous devrions à la fois accueillir les réfugiés et prendre en compte le ressenti de nos concitoyens.
M. Michel Billout, rapporteur. - Votre enquête portait-elle sur l'accueil des réfugiés ou celle des migrants ?
M. Jean-François Dubost. - Elle portait sur l'accueil des réfugiés. L'usage des termes est extrêmement important et l'on a pu faire des confusions dans des débats qui ont dérouté nos concitoyens.
M. Michel Billout, rapporteur. - Une distinction très forte a été faite entre les réfugiés fuyant la guerre et les migrants qui fuient la misère et la famine. Maire d'une commune de 8 500 habitants, mon conseil municipal s'est porté volontaire pour accueillir des réfugiés et la réaction de la population a été très positive. A l'inverse, l'électorat du Front national, très présent, est des plus réticents à accueillir des migrants économiques même si parfois la distinction avec les réfugiés ne me semble pas, quant à moi, très évidente.
M. Jacques Legendre, président. - Merci pour cet échange fructueux. Nous allons continuer à réfléchir sur notre capacité à mettre en place un système qui permette d'accueillir les réfugiés dans des conditions raisonnables et humaines.
Audition conjointe d'Organisations Non Gouvernementales (ONG)
Mercredi 1 er juin 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de certains de nos collègues, retenus par le congrès des maires.
Nous accueillons aujourd'hui les représentants de plusieurs organisations non gouvernementales qui vont donner leur appréciation sur l'accord UE-Turquie, en partageant avec nous leur expérience du terrain et les témoignages qu'ils ont recueillis.
Je remercie donc vivement pour leur participation à cette table ronde l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), le Service jésuite des réfugiés (JRS), Médecins du monde, Human Rights Watch (HRW), ainsi que EuroMed Rights.
Je vous propose, mesdames, messieurs, de vous présenter brièvement, ainsi que votre organisation, puis je vous redonnerai la parole, selon vos souhaits, au fur et à mesure du déroulement des débats, structurés, si vous le voulez bien, en trois grandes parties : la situation en Grèce, la situation en Turquie et, enfin, la « philosophie » de l'accord et la gestion par l'UE de la crise actuelle.
M. Gérard Sadik, coordinateur national asile à la Cimade. - La Cimade est une association qui existe depuis 1939. D'origine protestante, elle s'occupe en France et ailleurs de la situation des personnes étrangères, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile, de réfugiés ou de migrants.
Mme Violaine Carrère, chargée d'étude au GISTI. - Le GISTI existe depuis 1972. Il a pour objet la défense des droits des étrangers, en particulier par la publication d'informations et une aide en matière contentieuse.
Mme Mathilde Mase, responsable du programme asile à l'ACAT. - L'ACAT est une association de défense des droits de l'homme qui existe depuis 1974. Nous luttons contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la peine de mort ; nous portons assistance aux victimes de ces crimes pour le dépôt de plaintes devant les juridictions pénales ou les instances internationales ; enfin, nous protégeons ces victimes, notamment en les aidant à invoquer le droit d'asile. Nos activités principales incluent analyses, enquêtes, plaidoyers et sensibilisations ; nous offrons également une permanence juridique aux réfugiés demandeurs d'asile.
Mme Irinda Riquelme, responsable du « plaidoyer » au JRS. - Le service jésuite des réfugiés a été créé dans les années 1980 à la suite de la crise des « Boat people ». Cette association est présente sur le terrain dans 18 pays d'Europe, y compris la Grèce. Nous entendons protéger les réfugiés et travailler pour leur intégration.
Mme Bénédicte Jeannerod, directrice « France » de HRW. - Notre organisation de défense des droits de l'homme a été créée en 1983. Nous sommes présents dans 90 pays. Notre rôle est d'enquêter sur les violations des droits humains, de les documenter et de plaider auprès des gouvernements pour tenter d'infléchir leurs politiques. Nous travaillons à toutes les étapes de la crise actuelle des réfugiés, tant dans les pays d'origine des personnes qui fuient la guerre que dans les pays de premier accueil et en Europe même. Nous travaillons aussi auprès des institutions internationales, qu'il s'agisse de l'Union européenne, des agences des Nations unies ou de l'Union africaine.
M. Loïc Blanchard, responsable du service juridique de Médecins du monde. - Médecins du monde est une association de médecins qui existe depuis le début des années 1980. Nous agissons principalement sur le terrain pour mettre en sécurité les populations les plus précaires et garantir leur accès aux soins. Nos statuts nous imposent également de témoigner des situations que nous rencontrons et de plaider en faveur des victimes. Médecins du monde est présent sur l'ensemble du parcours migratoire de la Syrie jusqu'à Calais en passant par la Grèce, la Macédoine et la Serbie.
Mme Marie Martin, administrateur du programme « migration et asile » à EuroMed Rights. - Notre réseau, connu auparavant sous le nom de Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, a été constitué en 1997 dans le cadre du processus régional de Barcelone. Il rassemble des associations de différents pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord - la région dite « MENA - et d'Europe méridionale. Nous avons différents programmes thématiques et des programmes de soutien aux défenseurs des droits en Algérie, en Syrie et en Égypte. S'y ajoutent les programmes régionaux « migration et asile », « liberté d'association » et « défense des droits des femmes ». Nous suivons la situation à la frontière gréco-turque de très près.
M. Jacques Legendre, président. - Permettez-moi de nous présenter à notre tour. Notre mission commune d'information a été créée à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat. Elle est composée de sénateurs de tous les groupes politiques. Le rapporteur, M. Michel Billout, appartient au groupe à l'initiative de la mission ; la présidence est revenue à un représentant de la tendance politique opposée. Outre nos auditions, nous devrions nous rendre en Grèce et en Turquie prochainement. Notre rapport devrait être publié en octobre prochain.
J'en viens à notre premier point : la situation en Grèce. Quelle est la situation dans les centres de rétention dans les îles et sur le continent ? Quel jugement portez-vous sur le fonctionnement du système d'asile en Grèce ?
Mme Violaine Carrère. - Le GISTI a récemment envoyé une mission de trois personnes en Grèce durant une semaine. Ils ont pu se rendre à Athènes, Chios et Lesbos, et rencontrer des interlocuteurs institutionnels, des avocats et des migrants.
Les centres fermés - le terme « centre de rétention » me paraît discutable - servent de lieux de tri entre les migrants autorisés à formuler une demande d'asile en Grèce, ceux qui devront le faire en Turquie et ceux qui peuvent faire l'objet d'une relocalisation ou d'une réinstallation.
Les problèmes rencontrés dans ces centres sont multiples. On peut citer en premier lieu l'enfermement lui-même, qui consiste à retirer la liberté d'aller et venir à des personnes qui sont dans leur très grande majorité des demandeurs d'asile. La Grèce n'est pas le seul pays à enfermer ainsi des demandeurs d'asile, mais la France ne le fait pas, par exemple. Cet enfermement est particulièrement choquant quand il est imposé à des personnes vulnérables et malades, ou encore à des mineurs en famille ou isolés.
Les migrants retenus dans ces centres se plaignent de nombreux autres problèmes. Ils ne savent pas, si vous me permettez l'expression, « à quelle sauce ils vont être mangés ». Ils n'ont que très peu d'informations quant à la procédure à suivre. Ils craignent aussi de manquer de nourriture, notamment au camp de Suda, à Chios, où aucune distribution de nourriture n'est organisée, de n'avoir aucun accès à du personnel médical et à des soins, sans parler des problèmes de vêtements et d'hygiène, ou encore de la promiscuité qui règne dans ces lieux. Une mission de députés français a pu témoigner de ces conditions matérielles dramatiques ; selon elle, on est à l'aube d'une « catastrophe humanitaire » et il y aura des morts avant la fin de l'été. Que va-t-il se passer après un tel constat ?
Le problème qui intéresse plus particulièrement le GISTI est l'accès effectif au droit. La première étape de la procédure de tri est un entretien, dont l'objet est de savoir si ces personnes sont susceptibles ou non d'être renvoyées vers la Turquie. Le problème est qu'elles ne connaissent pas l'objet réel de cet entretien et pensent, souvent, qu'il s'agit d'un entretien préalable à l'octroi de l'asile : elles expriment leurs craintes ou narrent leur expérience de persécution dans la perspective d'une demande de protection ; en revanche, elles ne pensent pas en général à mentionner la Turquie et les risques qu'elles sont susceptibles d'y encourir. Elles peuvent en outre être renvoyées par la Turquie dans leur pays d'origine ; de tels retours ont eu lieu, en tout cas vers l'Afghanistan, postérieurement à la conclusion de l'accord UE-Turquie.
Durant l'entretien, ces personnes ne sont pas assistées par un conseil ou un avocat ; il est par ailleurs difficile de juger de la qualité des interprètes employés par les autorités grecques. La plupart des documents remis aux réfugiés sont en grec ; une minorité d'entre eux est traduite en anglais. J'ai ici le compte rendu d'un entretien, qui montre que la personne n'a pas été interrogée quant aux risques potentiels de son renvoi en Turquie. Il lui est simplement notifié par un agent, par le biais d'un interprète, que sa demande est non-admissible parce que la Turquie est considérée comme un pays tiers sûr.
Le problème essentiel qui se pose dans tous les camps grecs est l'absence d'aide juridictionnelle effective. Une réforme de la législation grecque sur ce sujet a été adoptée voici quelques semaines. Il est désormais prévu un système d'aide juridictionnelle mais celui-ci n'a pas encore été mis en place et aucun budget n'y a été alloué. Les avocats qui voudraient engager des contentieux en faveur de migrants ou, tout au moins, les assister lors des entretiens, le font sans aucune indemnité compensatoire, difficile à envisager dans un pays qui connaît l'austérité que vous connaissez.
Ces circonstances produisent les effets prévisibles. Les réfugiés se voient déclarés « non recevables » à l'asile et risquent le renvoi vers la Turquie. Cela concerne non seulement les Syriens mais aussi des représentants de nombreuses autres nationalités. En admettant que la Turquie, aujourd'hui, ne renvoie personne vers la Syrie, il est à craindre qu'elle ne renvoie, en revanche, vers leur pays d'origine des personnes qui auraient à y craindre des persécutions.
Les conditions qui règnent dans les camps engendrent du désespoir. Un membre du GISTI a assisté au suicide d'un mineur par pendaison, qui a donné lieu à une grève de la faim d'autres jeunes occupants du camp. Nous sommes bien à l'aube d'une « catastrophe humanitaire » ; la catastrophe juridique, quant à elle, est déjà en cours. Les droits humains les plus fondamentaux, reconnus par l'Union européenne et ses membres, sont bafoués. Le manque de contrôle démocratique de l'accord UE-Turquie me choque lui aussi.
Mme Izza Leghtas, chercheuse « migrants et Europe » à HRW. - Nous contestons tout d'abord le principe de « fermeture » de ces camps. Enfermer des migrants et des demandeurs d'asile dans de tels centres sans démonstration qu'il s'agit du dernier recours possible constitue une détention arbitraire qui affecte des personnes vulnérables ou handicapées, des familles et des enfants.
Cette détention s'effectue dans des conditions déplorables, comme en témoignent nos collègues qui ont effectué une mission le mois dernier à Chios, Samos et Lesbos. Ces camps connaissent beaucoup de violence ; la frustration est grande et la pénurie de nourriture entraîne elle aussi des conflits. Cette violence, qui a conduit à l'hospitalisation de plusieurs personnes, ne suscite pas d'intervention de la police grecque : personne n'assure la sécurité des occupants des camps. Des femmes témoignent aussi de leurs craintes de harcèlement sexuel.
Nous demandons donc à l'Union européenne et à la France de critiquer le principe de « fermeture » de ces centres.
Je me suis moi-même rendue à Athènes au mois de mars. Des milliers de personnes vivaient au port du Pirée et dans un centre ouvert dans des conditions catastrophiques. Le système d'asile grec, par lequel ces personnes ont l'obligation de passer, est complètement saturé. J'ai rencontré des personnes qui se rendaient tous les jours, parfois avec des enfants en bas âge ou handicapés, faire la queue devant l'administration grecque de l'asile ; ils repartaient « bredouille » tous les jours, sans même avoir pu obtenir un rendez-vous.
La France, au 31 mai 2016, n'a relocalisé que 362 personnes depuis la Grèce et 137 depuis l'Italie, alors que 17 000 places auraient été mises à disposition. Nous voulons bien croire qu'une grande part de ce retard est due au système grec. En revanche, il nous semble que la France pourrait en faire plus et, notamment, apporter un soutien aux autorités grecques pour s'assurer que ces places soient pourvues.
M. Loïc Blanchard. - Notre prisme de lecture est de ne pas remettre en cause l'activité des États, qui font face à une pression très importante et ont essayé d'organiser des camps qui, malgré des problèmes indéniables, sont structurés et permettent du moins un accès à l'eau et à des infrastructures sanitaires ; les conditions y sont, somme toute, meilleures qu'à Calais.
Sur l'aspect sanitaire, force est de constater que les pathologies principales sont, très largement, des problèmes de santé mentale consécutifs aux traumatismes vécus par ces personnes. On peut également relever beaucoup de pathologies respiratoires ou d'hypertension, souvent dues à la rupture de soins reçus dans le pays d'origine mais auxquels elles n'ont plus accès.
Pour autant, du fait de la dissémination des camps en Grèce et de l'existence d'un système de santé fonctionnel dans ce pays, qui ne connaît pas de pénurie de médecins à la différence de la Turquie, la couverture primaire des urgences médicales est aujourd'hui acceptable. On peut constater une volonté de l'État et de la population grecs de garantir un niveau sanitaire correct dans ces camps. En revanche, nous dénonçons nous aussi le principe des camps « fermés », dont le but est clairement de maintenir captives ces personnes.
On peut par ailleurs constater certaines violences policières dans ces camps ; elles ne sont toutefois pas « institutionnalisées » et l'État grec tente de les sanctionner.
Nous relevons aujourd'hui deux problèmes principaux pour l'accès aux soins et au droit dans ces camps. En premier lieu, l'accord UE-Turquie fait peser sur les migrants une peur d'être fichés, ce qui entraîne une réticence à aller voir les médecins ou les avocats présents dans le camp. En second lieu, la barrière de la langue demeure très forte : aucune structure organisée n'existe pour assurer des capacités de traduction. L'accès à l'information légale sur le statut de réfugié et la capacité à le demander reste indisponible dans les langues des migrants, en dépit des exigences de la loi grecque. La barrière de la langue affecte aussi le système de santé, qui s'avère certes capable de prendre en charge des urgences mais non pas la vie courante de ces personnes.
Mme Irinda Riquelme. - Nous vous avons fait parvenir un document de synthèse sur les conditions d'accueil des migrants en Grèce et en Turquie. Je ne reviendrai donc pas dessus en détail. Je voudrais juste souligner qu'on ne voit pas de solution à moyen ou à long terme. Pour améliorer cette situation catastrophique, on comptait sur l'aide européenne, qui tarde à venir, mais surtout sur un retour rapide des demandeurs d'asile en Turquie. La justice grecque a néanmoins rendu une décision, le 17 mai dernier, qui change complètement la donne : elle a considéré que la Turquie n'était pas un pays d'origine sûr.
Je passe la parole à M. Nour Allazkani, réfugié syrien qui travaille dans notre organisation et souhaitait vous faire part d'un témoignage.
M. Nour Allazkani, chargé de mission au JRS. - Je suis arrivé en France voici presque deux ans. Je voudrais vous transmettre le témoignage d'un ami d'enfance avec qui je suis en contact. Il a décidé de venir demander l'asile en Europe après avoir été torturé en Syrie. Il est allé de Syrie en Turquie en empruntant un véhicule militaire officiel puis une voiture du Front Al-Nosra, ce qui lui a permis de passer les checkpoints de Daech : tout se passe bien quand on paye un passeur. Il est arrivé à Chios le 9 mars dernier, juste avant la conclusion de l'accord UE-Turquie, ce qui lui a permis de rejoindre Idomeni, où des milliers de personnes attendaient dans des conditions inhumaines l'ouverture éventuelle des frontières balkaniques. Il est retourné à Athènes le 11 mars et s'y est pré-enregistré pour bénéficier de la relocalisation. On lui a assuré qu'après quinze jours, les conditions matérielles d'accueil seraient réunies. Il a attendu plus d'un mois sans être recontacté et sans parvenir à joindre quiconque. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps de payer l'hôtel et la nourriture ; il a donc décidé de retourner en Turquie, où se trouvaient certaines de ses connaissances. Pour ce faire, il devait payer un autre passeur. Il se trouve maintenant à Istanbul, illégalement. Il a peur de contacter les autorités et de ne pas avoir les moyens de payer un titre de séjour. Avoir déposé une demande de protection auprès du HCR ne lui apporte aucun avantage, que ce soit une allocation financière, un hébergement ou des cours de langue turque. Il ne peut travailler qu'au « noir » et poursuivre ses études d'informatique lui est impossible. Il vit dans des conditions très précaires : 18 personnes partagent un petit trois-pièces pour 60 euros par mois.
M. Michel Billout, rapporteur. -Tout d'abord, constatez-vous des différences de traitement entre les migrants arrivés avant la signature de l'accord et ceux arrivés après ?
Que pensez-vous du rôle de l'armée dans la gestion de la crise migratoire en Grèce ? Avez-vous eu l'occasion d'observer un tel rôle de l'armée dans d'autres pays ?
De nouvelles routes s'ouvrent-elles pour contourner la route des Balkans, aujourd'hui presque complètement fermée ?
Quelle est votre appréciation du dispositif de relocalisation et des blocages qui s'y opposent ? Que pensez-vous de la proposition de la Commission européenne du 4 mai dernier tendant à imposer des amendes aux États ne remplissant pas leurs obligations en la matière ?
Mme Violaine Carrère. - La différence de traitement entre migrants arrivés avant et après le 20 mars pose la question de l'articulation entre l'accord UE-Turquie et l'accord bilatéral préexistant entre la Grèce et la Turquie. On observe que les personnes arrivées avant le 20 mars, qui relèvent a priori de l'accord bilatéral, recevaient un document selon lequel leur demande d'asile ne pourrait pas être examinée en Grèce mais serait transmise à la Turquie. Munies de ce document, elles étaient laissées libres de se déplacer en Grèce ou de tenter d'emprunter la route des Balkans. En revanche, les personnes arrivées depuis le 20 mars subissent l'enfermement : la différence cruciale est là.
M. Gérard Sadik. - Les chiffres de relocalisation sont en effet très en-deçà des objectifs fixés par la décision européenne de septembre 2015, qui devait d'ailleurs, juridiquement, s'appliquer aux personnes enregistrant une demande jusqu'en septembre 2017, et non pas jusqu'au 20 mars 2016. Or les personnes arrivées après cette date, quand bien même elles ont les nationalités déclarées éligibles, n'ont pas accès à la relocalisation.
La France est le pays qui fait le plus gros effort mais le nombre de migrants relocalisés dans notre pays reste inférieur aux objectifs fixés à l'origine. Le ministère de l'intérieur nous annonçait l'arrivée de 1 200 personnes chaque mois ; on espère désormais faire venir 800 personnes par mois. On crée en ce moment 5 000 places dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), spécifiquement réservées aux relocalisations.
M. Loïc Blanchard. - La gestion de camps par l'armée grecque est ambivalente. D'une part, elle revêt un caractère anxiogène pour les occupants de ces camps. D'autre part, l'armée a travaillé de manière rapide et efficace : les camps ont été montés rapidement, l'accès à l'eau y est à peu près garanti.
Quant à l'existence d'autres routes de transit vers l'Europe, à notre connaissance, aucune ne s'est encore vraiment mise en place mais il ne faut pas se bercer d'illusions : les choses se feront et les parcours migratoires s'adapteront aux blocages. Les routes passant par l'Ukraine ou la Libye seront à n'en pas douter employées à nouveau.
Mme Irinda Riquelme. - Sur le même sujet, selon Interpol, 800 000 personnes attendraient le beau temps sur les côtes libyennes pour traverser la Méditerranée. Mais il en est qui n'attendent pas : le HCR a recensé au moins 700 morts en mer la semaine dernière.
M. Jean-Yves Leconte. - Certaines personnes arrivées en Grèce avant le 20 mars y sont toujours bloquées. La route des Balkans, sans avoir été rouverte, semble avoir été à nouveau percée : on a constaté ces derniers jours de nouvelles arrivées en Hongrie. Cette percée a-t-elle des conséquences sur la situation en Grèce ? Des personnes nouvellement arrivées parviennent-elles par ailleurs à échapper aux centres fermés ?
Comment la situation évolue-t-elle dans les centres fermés compte tenu des dernières décisions de la justice grecque, qui bloquent de fait les renvois vers la Turquie ? J'imagine que malgré des arrivées moins nombreuses, ces camps se trouvent toujours plus peuplés et que l'attente des réfugiés est toujours plus longue. Quels efforts sont faits pour améliorer la situation ?
M. Didier Marie. - Selon un rapport de l'UNICEF, près de 10 000 enfants ont disparu depuis le début de la crise. J'aimerais en savoir plus sur la protection de ces enfants. Avez-vous une idée du nombre d'enfants isolés présents aujourd'hui dans les camps ? Avez-vous connaissance de mesures spécifiques prises à leur égard ? Si ce n'est pas le cas, que conviendrait-il de faire en urgence pour répondre à la situation de ces jeunes ? Par ailleurs, pour élargir la question aux femmes isolées, avez-vous connaissance d'éventuels trafics d'êtres humains ?
M. Jean-François Rapin. - On sent bien, à l'écoute de vos témoignages, l'existence d'une convergence entre vos associations. L'organisez-vous afin de mieux porter votre message ?
Par ailleurs, quelle est votre relation sur le terrain ou dans les capitales avec le HCR ?
Mme Violaine Carrère. - Sur la question des mineurs disparus, plutôt que de craindre un éventuel trafic, le GISTI fait une hypothèse bien différente.
Selon nous, d'abord, des mineurs disparaissent lorsqu'on décide de ne plus voir qu'ils le sont. En France, les personnes se présentant dans les structures censées les accueillir - la Permanence d'Accueil et d'Orientation des Mineurs Isolés Etrangers (PAOMIE), par exemple, à Paris - subissent une procédure dont les principes ont complètement changé ces dernières années. Auparavant, un document d'état civil suffisait à un jeune à prouver qu'il était mineur ; on n'exigeait pas une expertise médico-légale, sauf à avoir démontré que les papiers étaient faux ou détournés ; la jurisprudence était constante sur ce point, sur le fondement de l'article 47 du code civil. La jurisprudence est désormais complètement « retournée » : les tribunaux, jusqu'au niveau des cours d'appel, jugent légitime de mettre en doute la minorité d'un jeune en dépit des documents qu'il détient. Ainsi, des mineurs deviennent majeurs et disparaissent ainsi des statistiques !
Les mineurs qui sont mal pris en charge disparaissent eux aussi. Plutôt que de leur apporter une réelle prise en charge, avec un hébergement et des éducateurs ou une famille d'accueil, on en héberge certains à l'hôtel avec la seule visite hebdomadaire d'une assistante sociale. Un jeune placé dans une telle situation fugue parce qu'il a bien compris qu'on n'allait pas s'occuper de lui. Ces mineurs aussi disparaissent !
Mme Izza Leghtas. - J'étais en Hongrie voici quelques semaines. Effectivement, de nouvelles arrivées avaient eu lieu ; néanmoins, plutôt que la route des Balkans, il semblerait que ces personnes aient emprunté un itinéraire passant par la Turquie et la Bulgarie. Elles avaient réussi à quitter les centres de rétention bulgares. En Hongrie, beaucoup de demandeurs d'asile sont privés de liberté dans des conditions absolument déplorables.
Quant aux mineurs disparus, j'ai été frappée en Hongrie par le témoignage de nombreux jeunes présents dans les centres de rétention : selon eux, ils avaient 16 ou 17 ans mais n'avaient pas été crus par les policiers des zones de transit, qui les avaient enregistrés comme ayant 18 ou 19 ans, sans même recourir à des tests osseux ou une autre technique.
Mme Irinda Riquelme. - On compterait 38 % de mineurs parmi les personnes arrivées en Grèce cette année. Fait préoccupant : plus de la moitié des occupants du camp d'Idomeni ont disparu lors de son évacuation, parmi lesquels de nombreux enfants.
Pour ce qui est de notre action avec d'autres associations, JRS Europe mène actuellement une campagne contre l'accord UE-Turquie auprès du Parlement européen.
M. Gérard Sadik. - Il existe une longue tradition grecque d'enfermement des mineurs. Je m'étais rendu en 2008 à Lesbos, dans le camp de Pagani : des mineurs de 13 ou 14 ans y étaient enfermés dans une cellule spéciale depuis plusieurs semaines.
La directive européenne du 26 juin 2013 prévoit que les mineurs non accompagnés ne doivent être placés en rétention qu'en dernier ressort ; des dispositions prévoient même leur libération assez rapide. Malheureusement, ces règles ne sont pas appliquées dans les camps fermés. Une avocate grecque a dû saisir la Cour européenne des droits de l'homme en urgence pour que son client, mineur, puisse être libéré.
Mme Violaine Carrère. - Dans le camp de Moria, à Lesbos, les mineurs non accompagnés ont été placés dans un lieu qui était auparavant une prison à l'intérieur du centre fermé, destinée aux personnes posant des problèmes de sécurité. On a justifié cette décision par le souci d'éviter une promiscuité entre mineurs et adultes : cette solution déborde d'imagination !
Mme Marie Martin. - Une association membre de notre réseau, le Conseil grec des réfugiés, est partenaire du HCR dans la mise en oeuvre de ses programmes. Le HCR, en effet, est moins présent en Europe qu'ailleurs pour l'application pratique de ses programmes. Au centre d'accueil d'Ellinikon, où 4 000 personnes étaient massées lors de ma visite, le HCR disposait d'une permanence : y travaillaient deux membres du Conseil grec des réfugiés, financés par le HCR dans le cadre de leur programme d'accompagnement à la demande d'asile. La collaboration entre le HCR et des ONG, en nombre limité, se fait généralement dans un tel cadre. Par ailleurs, la possibilité pour le HCR d'infléchir des politiques est, en tout cas en Europe, extrêmement faible.
Je m'interroge par ailleurs quant à l'action du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), qui est complètement opaque. Nos partenaires en Grèce lui ont fait parvenir de très nombreuses demandes d'information ; aucune réponse ne leur est parvenue. Les personnes « déployées » par cette agence en Grèce sont fréquemment renouvelées, ce qui entraîne une faible effectivité de leur action.
M. Jacques Legendre, président. - Je vous propose d'aborder maintenant notre deuxième séquence, consacrée à la situation en Turquie : quel est votre avis sur les garanties offertes par la Turquie en matière de protection internationale, au vu des dernières mesures adoptées ? Comment sont traités les migrants non protégés ?
Mme Marie Martin. - Deux associations turques sont membres de notre réseau : le comité citoyen Helsinki et l'Association des droits humains, qui reçoit un très fort soutien de la communauté kurde. Nous suivons les atteintes aux droits de l'homme commises en Turquie envers les Turcs comme les non-Turcs.
L'accord du 18 mars dernier s'appuie sur le présupposé selon lequel la garantie procédurale des libertés offerte par le droit turc est suffisante pour y déposer une demande d'asile. À tout le moins, les droits économiques et sociaux et le droit à la protection des réfugiés devraient y être respectés. Or tel n'est toujours pas le cas, en dépit des nombreuses réformes entreprises par la Turquie dans la perspective de sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne.
À l'heure actuelle, la Turquie accueille environ 2,8 millions de réfugiés depuis la Syrie, y compris des Palestiniens et des apatrides. Par ailleurs, le HCR a recensé 400 000 personnes en besoin de protection internationale en provenance d'autres pays, tels l'Afghanistan ou l'Irak. Le HCR a cessé voici trois ans d'enregistrer les demandes d'asile des personnes non-syriennes car les quotas de réinstallation sont insuffisants, ce qui aggrave la vulnérabilité de ces personnes.
La loi turque sur les étrangers et la protection internationale a été adoptée en 2014 ; en revanche, ses décrets d'application n'ont été adoptés que le 17 mars dernier, à la veille de la signature de l'accord avec l'Union européenne... Cette loi prévoit certaines garanties procédurales compatibles avec le droit de l'Union européenne ; elle limite la privation de liberté au motif du renvoi dans un autre pays à six mois renouvelables une fois ; elle ouvre le droit à un conseil juridique ; elle précise aussi, à son article 4, l'obligation de non-refoulement.
Ce dernier point est très important. En effet, la Turquie avait émis des réserves à son adhésion à la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et au protocole de 1968 qui en élargit l'application : seules les personnes revenant d'un pays européen pourraient obtenir le statut de réfugié, ce qui en limitait considérablement l'utilité. Une personne provenant de Syrie peut en revanche bénéficier d'un statut de protection temporaire en vertu d'une directive de 2014. Les autres nationalités ne sont pas concernées par cette directive ; toutefois, le gouvernement turc a fait quelques efforts, notamment pour ce qui est de l'obtention d'un permis de travail.
Cette différence entre les réfugiés Syriens et les réfugiés d'autres nationalités est cruciale dans plusieurs domaines.
En pratique, les Syriens ont une obligation de visa depuis le 8 janvier 2016 pour entrer en Turquie et ce, pour essayer de limiter le flux de personnes arrivant de Jordanie et du Liban. Ils n'ont pas d'accès effectif à un permis de travail.
La société civile, les journalistes et les avocats n'ont aucun accès aux camps de réfugiés qui, quoique de bonne qualité - on a pu parler de camps « cinq étoiles » -, limitent très largement la liberté d'aller et venir de leurs occupants, quand elle n'est pas tout simplement interdite. Ces camps sont gérés d'une main de fer par le Croissant rouge, organisation qui n'est pas pleinement non-gouvernementale. La plupart des réfugiés vivant en zone urbaine, en dehors de ces camps, n'ont pas accès à de nombreux services.
Nous avons aussi relevé, avant la signature de l'accord UE-Turquie, des cas d'expulsions maquillées en opérations de retour volontaire, ainsi que des privations de liberté motivées, soit par le séjour irrégulier, soit par d'éventuelles menaces à la sécurité nationale. Le conflit syrien et la lutte entre l'État turc et le Parti des travailleurs du Kurdistan - le PKK - pèsent dans ces décisions : une loi antiterroriste très forte a été adoptée et est régulièrement utilisée. Des tirs de l'armée turque contre des populations civiles ont eu lieu à la frontière syro-turque, qui reste fermée aux personnes ayant fui Alep qui s'y massent. Relevons néanmoins que bien des réfugiés de Syrie ont pu bénéficier d'une certaine protection en Turquie. Cela se joue souvent au cas par cas : certaines personnes peuvent bénéficier de faveurs de l'administration mais le respect des droits et des garanties procédurales n'est pas systématique.
En ce qui concerne les réfugiés des autres nationalités, on constate un durcissement des conditions d'obtention de visas pour les Irakiens, qui constituent un tiers des entrées irrégulières dans l'Union européenne via la Turquie. Les décisions turques sont très liées aux pressions effectuées par l'Union européenne. Les Irakiens n'ont pas d'accès effectif à la procédure d'asile, y compris dans les lieux de privation de liberté. La Turquie a par ailleurs systématiquement refusé la protection temporaire aux personnes arrivant du Liban et de la Jordanie. La Commission européenne note, dans son rapport d'évaluation des réformes en vue de l'adhésion de la Turquie à l'UE de mai 2016, que des refus systématiques ont eu lieu, mais elle ne les condamne pas. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection internationale de 2014, aucun Afghan dont la demande a été examinée en procédure accélérée n'a vu sa demande d'asile acceptée.
Quelles différences peut-on relever depuis le 20 mars dernier ? L'accord UE-Turquie a tout d'abord eu très peu d'effets sur le nombre de personnes mortes en mer, ce qui représentait pourtant l'une des motivations de son adoption urgente. Les renvois se font sans respect des garanties procédurales. Toutefois, depuis le 29 avril 2016, les autorités turques donnent au HCR accès à tous leurs centres de rétention ; il n'avait jusqu'alors qu'un accès partiel aux centres d'Istanbul et d'Izmir. Toutefois, nous avions constaté en 2013 et 2014 que le HCR se contentait en général d'un simple appel téléphonique aux centres auxquels il avait théoriquement accès : si leur interlocuteur niait la présence de demandeurs d'asile privés de liberté, le HCR ne vérifiait pas sur place.
L'accord UE-Turquie a permis au gouvernement turc d' « empocher » une enveloppe budgétaire considérable. Selon le rapport de la Commission européenne de mai 2016, sur les 3 milliards d'euros prévus, 77 millions d'euros lui ont d'ores et déjà été accordés : un premier versement a eu lieu le 18 mars dernier. L'aide aux réfugiés doit se voir consacrer 165 millions d'euros ; un fonds spécial de soutien à l'accueil des migrants renvoyés depuis la Turquie devrait, quant à lui, gérer 60 millions d'euros. Beaucoup d'argent est en jeu dans cet accord mais nous ne sommes pas certains qu'il va réellement servir les personnes concernées.
Il est intéressant de constater que cet argent va être versé non pas à la direction générale en charge des questions migratoires créée par la loi turque de 2014, mais à l'agence qui en était chargée auparavant, l'Autorité de gestion des désastres et des urgences, qui relève du ministère de l'intérieur, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour le respect des droits et la transparence financière. En outre, cette organisation témoigne d'une gestion de crise plutôt que d'une vision durable.
Depuis la signature de l'accord, un officier de l'agence Frontex est en poste à Ankara ; réciproquement, un officier turc est posté au siège de l'agence, à Varsovie, et un autre au siège d'Europol. On assiste donc à une coopération accrue dans la gestion des contrôles migratoires d'un point de vue sécuritaire. Les entretiens avec les migrants mentionnés par Mme Carrère alimentent cet échange d'informations sans que les personnes en soient informées. Aucun droit personnel à la protection des données n'existe en Turquie ce qui est problématique. Que ce droit ne soit pas offert non plus lors des entretiens réalisés en Grèce l'est encore plus.
Les réfugiés syriens renvoyés depuis la Grèce sont répartis dans des centres de réfugiés, qui se situent le plus souvent dans le sud du pays et dans les villes frontalières avec la Syrie, où la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée.
L'ouverture de la protection temporaire et l'accès à l'enregistrement pour en bénéficier avaient été suspendus en janvier et février dernier. Cette procédure est réouverte depuis mars. En revanche, le nombre de bureaux accessibles pour effectuer une telle demande a été diminué : à Izmir, par exemple, de 5 bureaux, nous sommes passés à 2, ce qui est trop peu. Le principe de la protection temporaire est similaire au statut de réfugié : si vous quittez la Turquie, vous perdez cette protection. Qu'en est-il des personnes parties en Grèce ? La Turquie a amendé la loi en vigueur pour permettre à celles-ci de maintenir ce droit une fois renvoyées en Turquie. Ce maintien ne s'applique néanmoins qu'aux ressortissants syriens : les Palestiniens et les apatrides, tels les membres de la communauté Ajanib, n'y ont pas droit. Ils peuvent donc être privés de liberté et renvoyés en Syrie.
Les ressortissants d'autres nationalités sont quant à eux transférés directement dans des centres de rétention ; certains sont expulsés. Les associations turques et européennes ont énormément de mal à connaître leur sort : aucun accès n'est accordé. Il est certain que la Turquie multiplie actuellement les tractations pour signer des accords de réadmission ; un tel accord a été signé le 7 avril dernier avec le Pakistan. Des accords avec l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, l'Algérie, le Bangladesh, le Cameroun, l'Érythrée, le Maroc, le Ghana, le Myanmar, le Congo, la Somalie, le Soudan et la Tunisie devraient prochainement conclus. Se pose la question du coût élevé de ces expulsions : il est à craindre que l'argent versé par l'UE dans le cadre de l'accord serve à expulser ces personnes vers des pays où elles peuvent subir des traitements inhumains et dégradants.
Le mandat de l'agence censée remplacer Frontex, s'il est adopté dans les termes proposés par la Commission, permettra à celle-ci d'effectuer des vols retour depuis un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est le cas de la Turquie. Cette clause, si elle est maintenue, pourrait permettre de financer ces expulsions.
En tout état de cause, les personnes non réfugiées de Syrie n'ont aucun accès aux droits économiques et sociaux en Turquie. Lorsqu'elles se trouvent en situation irrégulière, elles sont privées de liberté.
Mme Izza Leghtas. - Human Rights Watch a été très présente à la frontière syro-turque. Nous avons pu documenter des abus de la part des garde-frontières turcs. Des demandeurs d'asile syriens ont été blessés, certains ont été tués. Des dizaines de milliers de Syriens essayent de fuir les violences de Daech mais se trouvent bloqués à la frontière sans nulle part où aller. Alors que l'on parle beaucoup de combattre Daech, que fait-on pour aider ceux qui en fuient le risque réel ?
L'accord UE-Turquie se fonde sur la notion de pays tiers sûr : la Turquie, selon lui, est un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Deux conditions principales, en droit européen, sont nécessaires pour considérer un pays comme étant sûr. En premier lieu, il doit respecter le principe de non-refoulement. Or la Turquie empêche l'entrée sur son territoire depuis la zone de guerre qu'est la Syrie. S'y ajoutent des cas de renvoi de Syriens dans leur pays d'origine : selon des témoignages que j'ai recueillis, des retours prétendument volontaires s'effectuaient sous la contrainte. La Turquie ne remplit donc pas cette condition. En second lieu, un pays doit respecter les droits dont jouissent les réfugiés en vertu de la Convention de Genève. Tel n'est pas le cas en Turquie, notamment pour les non-Syriens, comme Mme Martin nous l'a expliqué.
Près de 3 millions de Syriens vivent en Turquie, principalement hors des camps de réfugiés ; la plupart d'entre eux sont extrêmement démunis. J'ai pu rencontrer en particulier des mères élevant seules leurs enfants ; elles travaillent durant un nombre d'heures incroyable parce qu'elles n'ont pas d'autres choix pour payer un logement complètement inadapté très cher. On voit également des enfants syriens mendier dans les villes turques ou être exploités dans des usines textiles. Les difficultés d'accès au système de santé sont elles aussi réelles : un réfugié syrien m'a affirmé que certains hôpitaux refusaient de soigner les Syriens.
Il faut réfléchir à la manière dont les réfugiés arrivent en Europe. Nous avons connaissance du système français de visa pour asile, destiné aux personnes présentant des vulnérabilités particulières ou ayant des liens particuliers avec la France. Nous demandons depuis longtemps une voie d'accès légale et sûre au système d'asile européen. Il faudrait que ce système soit davantage mis en oeuvre, en Turquie notamment au-delà d'Ankara. La France devrait également inciter d'autres pays européens à adopter un système comparable au sien.
Mme Mathilde Mase. - L'ACAT n'est pas directement présente en Grèce et en Turquie ; nous n'avons donc sans doute pas d'éléments factuels à ajouter aux interventions des représentants des organisations qui y travaillent. Notre analyse va en tout cas dans le même sens.
Je voudrais revenir sur la notion de pays tiers sûr et sur la stratégie de la Commission européenne vis-à-vis de la Turquie. La Commission, dans son rapport d'étape publié en mai, se félicite des progrès effectués par la Turquie. Pour autant, à qui incombe la charge de la preuve ? Appartient-il au demandeur d'asile de prouver, lors de son entretien individuel avec les autorités grecques, que la Turquie n'est pas pour lui un pays sûr, ou bien appartient-il aux autorités grecques de prouver qu'il s'agit d'un pays sûr pour ce demandeur d'asile ?
Je veux par ailleurs rappeler les déclarations de M. Pierre-Antoine Molina, directeur général des étrangers en France, lors de son audition devant votre mission d'information. Selon lui, la Turquie aurait adressé deux lettres, les 6 et 24 avril derniers, à la Commission européenne dans lesquelles elle aurait présenté des assurances tendant à établir qu'elle constitue un pays tiers sûr. Ces lettres n'ont pourtant pas été rendues publiques : personne ne peut connaître aujourd'hui la teneur des garanties offertes par la Turquie et présentées par la Commission comme des critères devant être pris en compte par les autorités grecques quand elles apprécient le caractère de pays tiers sûr de la Turquie. Cette opacité nous pose problème.
Je voudrais enfin comparer la notion de « pays tiers sûr » à celle de « pays d'origine sûr ». La Commission, le 9 septembre 2015, avait présenté une proposition de liste européenne commune de pays d'origine sûrs, où l'État de droit, la démocratie et les droits de l'homme seraient respectés. Dans cette liste figurait la Turquie. Toutefois, 23,1 % des demandes d'asile présentées par des citoyens turcs au sein de l'UE reçoivent une réponse positive, contre, par exemple, 1,8 % pour la Serbie, 0,9 % pour la Macédoine, etc. Un seul État membre de l'UE, à savoir la Bulgarie, reconnaît d'ailleurs la Turquie comme pays d'origine sûr. Quelle est donc la stratégie de la Commission à cet égard ?
M. Jean-Yves Leconte. - Je m'étonne, madame Martin, de vos déclarations relatives à l'emploi des 3 milliards d'euros promis par l'Union européenne. J'ai rencontré la semaine dernière la personne chargée de la gestion de cette somme à la Commission européenne ; selon elle, il ne s'agissait en rien d'une aide budgétaire à la Turquie. Cet argent est destiné à des organisations et des associations qui développent des projets humanitaires. Il est possible que, au vu de l'urgence, les organisations partenaires classiques de la Commission soient privilégiées pour assurer l'accès aux soins, à l'éducation et aux besoins quotidiens des réfugiés syriens en Turquie. Peut-être même que les associations membres de votre réseau en Turquie seraient-elles éligibles, à ce qu'on nous a dit.
Quant à la notion de « pays tiers sûr », la décision de la justice grecque apporte une réponse. De fait, quelle que soit la volonté politique, quand la justice fonctionne, on a la réponse ! En revanche, j'aurais souhaité savoir si l'on commençait à ressentir une évolution de la demande d'asile en provenance de Turquie compte tenu de la situation problématique dans le Sud-Est de ce pays ?
M. Didier Marie. - Personne n'a évoqué, à mon étonnement, la situation des Syriens kurdes. Avez-vous des informations relatives au traitement qui leur est réservé par les autorités turques ?
Mme Izza Leghtas. - Sur ce dernier point, je n'ai pas d'éléments concernant leur traitement en Turquie mais j'ai pu interroger plusieurs demandeurs d'asile en Grèce à ce sujet. Les Kurdes faisaient montre d'une grande crainte à l'idée de devoir retourner en Turquie.
M. Didier Marie. - Y a-t-il des Kurdes parmi les quelque 3 millions de Syriens présents en Turquie ?
Mme Marie Martin. - Oui, ils sont présents en tant que citoyens syriens.
M. Loïc Blanchard. - Nous sommes inquiets à leur sujet mais notre accès aux camps est extrêmement limité ; il nous est donc compliqué d'avoir une perception précise de la situation des Kurdes syriens en Turquie.
L'accord UE-Turquie a été fondé sur la lutte contre les passeurs et la qualification de « pays tiers sûr » donnée à la Turquie. Or, pour ce qui est des passeurs, force est de constater qu'ils se portent toujours aussi bien ; l'accord ne semble pas avoir changé grand-chose au rythme des arrivées. Quant à la notion de « pays tiers sûr », je rejoins tout ce que mes collègues ont dit à ce sujet. Pour autant, la décision de justice grecque a été immédiatement remise en cause par les autorités de ce pays, qui ont déclaré qu'il s'agissait d'une décision isolée concernant un seul individu et ne reflétant en rien leur perception de la Turquie. À ce jour, ni l'UE, ni le gouvernement grec, n'ont commenté le fait que cette décision a été pour le moins bafouée et remise en cause ; ils ne semblent pas vouloir en tirer de conséquences globales.
Or, à l'heure actuelle, la Turquie négocie des accords de réadmission avec le Pakistan, le Yémen et d'autres pays dont la « sûreté » est aussi sujette à caution. Nous pouvons également constater sur le terrain des violences policières caractérisées à la frontière syrienne et le refoulement presque systématique de Syriens désirant entrer en Turquie. Les condamnations de ce pays par la Cour européenne des droits de l'homme sont monnaie courante.
Je voudrais enfin revenir sur les conditions de vie dans les camps turcs, qualifiés de « cinq étoiles ». On constate que l'État turc y a beaucoup travaillé et que les conditions, là encore, sont meilleures qu'à Calais, ce qui interroge sur nos capacités d'accueil. Le chiffre de 2,8 millions de réfugiés syriens en Turquie correspond aux personnes enregistrées seulement ; j'ai, pour ma part, entendu évoquer la présence de 3 à 4 millions de réfugiés. Si les camps sont plutôt de bonne facture et que certains critères fixés par le HCR, comme l'accès à l'eau, sont bien respectés, pour autant l'accès aux soins pose véritablement question aujourd'hui. La Turquie connaît déjà un déficit de médecins sur son territoire ; le problème se pose évidemment avec beaucoup plus de prégnance dans ces camps de réfugiés. Les problématiques de santé mentale n'y sont quant à elles, semble-t-il, pas du tout traitées.
M. Michel Billout, rapporteur. - J'insiste sur la problématique de l'utilisation des 3 milliards d'euros annoncés par l'Union européenne. Je confirme ce que disait Jean-Yves Leconte quant aux informations qui nous ont été communiquées à ce sujet : ces moyens ne seraient pas versés directement au gouvernement turc. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette question ? Vos organisations peuvent-elles répondre à des appels à projet ?
Il nous a été dit par ailleurs que cet argent serait destiné en priorité aux réfugiés qui ne sont pas dans les camps. À ce propos, les représentants du HCR en France nous ont dit ne pas avoir accès à tous les camps en Turquie. En tout état de cause, puisque seuls 10 % environ des réfugiés enregistrés en Turquie sont dans les camps, l'urgence va plutôt à ceux qui sont dispersés en dehors, on ne sait trop où. Vos organisations ont-elle la possibilité de travailler efficacement en dehors des camps ?
Enfin, considérez-vous que le dispositif de réinstallation prévu dans le cadre du programme dit « un pour un » constitue une voie légale sûre pour permettre l'installation de réfugiés dans l'Union européenne ?
M. Loïc Blanchard. - Oui, nous avons la capacité de travailler sur le territoire turc, mais de manière extrêmement compliquée. En effet, les ONG internationales ne sont pas toujours les bienvenues en Turquie. La législation turque pose beaucoup d'obstacles à l'emploi salarié de Syriens pour notre compte en Syrie même. Nous avons dû assumer plusieurs amendes fiscales dernièrement pour cette raison.
Par ailleurs, notre autorisation d'exercice sur le territoire expire demain matin et n'a toujours pas été prolongée, alors même que nous en avons fait la demande il y a plus de trois mois. Nous avons dû créer une structure juridique associative en Turquie, qui n'est pas encore opérationnelle, pour contourner ce problème ; pour ce faire, il nous a fallu, outre de nombreuses autorisations, recueillir plus de 50 personnes de nationalité turque comme créateurs de l'association. Vous comprendrez la difficulté que de tels obstacles peuvent poser à des organisations internationales.
Mme Violaine Carrère. - Une seule décision a été rendue par la justice grecque. Nous ne pouvons pas du tout être certains que la jurisprudence soit établie et durable. L'administration grecque continue quant à elle à qualifier la Turquie de « pays tiers sûr » quotidiennement.
J'ajouterai que de telles décisions ne peuvent être rendues que pour autant que les personnes intéressées aillent devant la justice. Or bien peu de réfugiés ont, de fait, accès à la justice du fait du manque d'aide juridictionnelle. Il faudra donc attendre quelque peu pour connaître la décision finale de la justice grecque.
Si nous faisons tous le même constat quant aux manques et aux illégalités constatés, il n'est pas sûr que nous ayons la même convergence quant aux solutions à apporter. Le GISTI plaide pour la liberté de circulation et considère qu'il n'y a pas lieu d'exiger qu'une personne qui a besoin d'une protection se résigne au choix qui a été fait pour elle en matière d'obligation de demander l'asile dans le pays d'entrée dans l'Union.
Le système de relocalisation ou de réinstallation est régi par la même philosophie, qui nous semble contraire aux droits de l'homme en ce qu'elle prive le demandeur d'asile de sa liberté de choix et d'initiative. En outre, cette philosophie ne fonctionne pas. Chaque État, y compris la France, s'est empressé d'expliquer pourquoi il n'avait pas les moyens d'accueillir grand-monde. À lire le compte rendu de l'audition de M. Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, j'ai peine à comprendre sa position. M. Brice accepte d'aller en Grèce et de s'occuper du programme de relocalisation mais il n'est pas question selon lui de s'occuper de l'identification des personnes renvoyées vers la Turquie. Il distingue ensuite les personnes en fonction de leur date d'arrivée sur le territoire grec, ce qui est tout de même problématique. On ne comprend en outre pas très bien quelle aide à l'enregistrement l'OFPRA entend offrir à la Grèce. Ce qui est clair, c'est que rien n'est transparent pour les migrants : ils ne peuvent guère savoir de quel dispositif ils sont susceptibles de faire l'objet. Les citoyens français comme les migrants mériteraient d'en savoir plus.
Tout le monde s'accordera à penser qu'il est grotesque de n'accueillir que 362 personnes. Certes, me dira-t-on, il est compliqué d'identifier et d'acheminer les personnes, de trouver des lieux où les installer, etc. Néanmoins, j'ai visité plusieurs villes en France, cette année, qui s'étaient portées volontaires pour accueillir des réfugiés, avaient organisé leur accueil avec la préfecture, les associations locales et les bailleurs ; or ces villes attendent encore « leurs » réfugiés ! Il faudrait réfléchir aux capacités d'accueil de la France : il n'est pas sûr qu'elles soient aussi maigres qu'on ne le pense. Le programme de relocalisation pourrait sans doute être très grandement accéléré ; on pourrait du moins atteindre sans problème l'objectif de 30 000 réfugiés accueillis en deux ans.
M. Jacques Legendre, président. - Nous avons commencé à aborder des thèmes relevant de la troisième partie de cette audition.
M. Philippe Kaltenbach. - J'ai eu l'occasion d'aller en Grèce, à Lesbos et Athènes, en février dernier. Nous y avons constaté qu'il y avait très peu de demandes de relocalisation en France. En effet, outre des raisons de délai de traitement des dossiers, les passeurs promettaient alors de conduire leurs passagers à Berlin en vingt-quatre heures, pour des sommes qui restaient acceptables. La relocalisation s'effectuera désormais, pour une grande part, depuis la Turquie. Le système actuellement mis en place là-bas est-il selon vous efficace pour atteindre l'objectif d'accueil de 30 000 réfugiés supplémentaires venant du Moyen-Orient ? Les ratés observés en Grèce ne risquent-ils pas de se reproduire ?
M. Gérard Sadik. - Quant à la réinstallation, j'estime que l'accord « un pour un » est un simple baume au coeur. Il est très discriminatoire dans la mesure où il ne concerne que les réfugiés syriens. Sur deux ans, 6 000 personnes seraient réinstallées en France dans le cadre de cet accord, en plus des réfugiés accueillis dans le cadre de l'accord signé le 20 juillet 2015. On commence à avoir des données statistiques sur l'application de ce dernier : il s'avère que c'est le Royaume-Uni qui a réinstallé le plus de réfugiés dans ce cadre - 1 835 personnes au 30 mai 2016 -, alors que ce pays ne voulait pas à l'origine participer à la mise en oeuvre de cet accord. L'accord « un pour un », c'est « cacahuète » ! Très peu de réinstallations ont eu lieu dans ce cadre : 54 personnes en Allemagne, quelques-unes aux Pays-Bas seulement. Le plus grave est la discrimination introduite entre réfugiés éligibles et non-éligibles, qui bafoue les décisions de septembre 2015. L'accord UE-Turquie n'existe pas en droit !
Les décisions de relocalisation ne concernaient déjà que les nationalités les plus manifestement en besoin de protection, à savoir, principalement, la Syrie, l'Irak, l'Érythrée, la Centrafrique et le Burundi, mais non pas l'Afghanistan ou le Soudan. Cela pose déjà question.
Pour répondre à la question de M. Leconte sur les demandes d'asile en provenance de Turquie, les données de l'OFPRA montrent de fait une relative stabilité, sinon une baisse des demandes. En revanche, on observe une hausse importante des réexamens, ce qui est logique au vu du durcissement de la situation au Kurdistan.
Mme Mathilde Mase. - Sur le principe, le programme « un pour un », ou plutôt « un réfugié pour un réfugié », est éthiquement inacceptable : on troque une personne qui a besoin de protection contre une autre. Par ailleurs, on sanctionne des personnes entrées irrégulièrement dans l'Union européenne en les renvoyant en Turquie et en leur retirant la priorité dans les programmes de réinstallation, sanction pourtant interdite par la Convention de 1951.
Quant à la réinstallation elle-même, on estime qu'entre 54 000 et 72 000 places sont offertes dans toute l'Union européenne. Comparé aux quelque 3 millions de réfugiés présents en Turquie, il s'agit vraiment d'une approche a minima, dont je doute qu'elle pourra résoudre la situation actuelle en Turquie. Par ailleurs, seuls les 300 000 réfugiés syriens présents dans des camps turcs officiels peuvent bénéficier de la réinstallation ; les autres, déjà livrés à eux-mêmes, sont une fois de plus laissés de côté par ces programmes de réinstallation.
En outre, comme l'a souligné Gérard Sadik, ces programmes sont discriminatoires. Ils excluent des personnes dont l'OFPRA même reconnaît le « besoin de protection manifeste ». En effet, dans le cadre des accords de relocalisation à partir de la Grèce, les Érythréens et Irakiens sont considérés comme prioritaires : pourquoi sont-ils ignorés par les programmes de réinstallation ? Comment justifie-t-on cet écart de traitement entre les deux dispositifs ?
Énormément de réfugiés, quand bien même ils ne proviennent pas de ces pays « prioritaires », sont exposés à des risques de persécutions. Ils sont de vrais réfugiés qui craignent personnellement pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour dans leur pays. Or cet accord les laisse de côté. Plus pratiquement, alors que le système d'asile turc est déjà saturé, les réfugiés non-syriens se trouvent face à une absence totale de perspective de réinstallation : ces personnes se sentent à coup sûr encouragées à s'en remettre plutôt aux passeurs et à employer des routes toujours plus dangereuses pour rejoindre l'Europe de manière irrégulière.
Mme Marie Martin. - Nous constatons, au vu des enveloppes budgétaires disponibles, que l'argument selon lequel l'Europe n'a pas les moyens d'accueillir les personnes en besoin de protection internationale ne tient pas. L'argent est visiblement disponible ; il s'agit donc de priorités politiques.
Concernant les financements à destination de la Turquie, nos informations nous ont été fournies par le Comité citoyen Helsinki, association membre de notre réseau. Je leur demanderai des précisions, que je vous ferai parvenir.
En tout état de cause, il faut se demander quelles associations vont profiter de ces financements, si ce n'est le gouvernement turc. Les organisations internationales, comme vous l'a expliqué Loïc Blanchard, rencontrent déjà des obstacles ; une nouvelle loi sur les associations pourrait encore compliquer les financements depuis l'étranger. Les gages donnés verbalement par le gouvernement turc lors de la conclusion de l'accord ne sont pas effectifs à nos yeux. Nous venons de publier un rapport sur la situation dans le Sud du pays, où nous suivons de très près les atteintes aux violations des droits des populations, en particulier des minorités kurdes. Au vu de cette situation, on peut se poser la question de l'efficacité de l'action associative dans un tel pays.
Par ailleurs, des financements de l'Union européenne ont servi à financer les centres de rétention utilisés depuis novembre 2015 pour priver de liberté les personnes renvoyées de Grèce.
Il serait intéressant de proposer la mise en place d'un mécanisme de contrôle indépendant pour s'assurer précisément de la destination des 3 milliards d'euros promis. Cela permettrait à la société civile de bénéficier d'une forme de transparence sur ces questions.
Quant à la réinstallation, elle se fait normalement par le biais d'une recommandation par le HCR. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une tractation avec le pays d'accueil. Le gouvernement turc a ainsi déclaré qu'il pouvait refuser la réinstallation dans un autre pays d'une personne utile à l'économie turque par ses qualifications. L'indépendance du système de réinstallation est en cause.
L'accord de réadmission conclu entre l'UE et la Turquie contient une clause applicable aux ressortissants tiers non-turcs, dont l'application devait à l'origine être effective en octobre 2017 mais semble avoir été avancée à ce jour, le 1er juin 2016. C'est très préoccupant : qu'en sera-t-il des personnes dont on considérera que la demande d'asile est inadmissible, qui arriveront en Turquie sans papiers mais seront réadmises ? On assistera là à une expulsion « en chaîne ».
Enfin, s'il y a peu de demandeurs d'asile turcs en Europe, c'est aussi parce que les Turcs, comme beaucoup d'autres nationalités, ont besoin d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen. Se rendre dans une ambassade européenne pour demander un visa Schengen peut s'avérer problématique pour une victime, même potentielle, de persécutions dans la Turquie actuelle, véritable État policier où les droits humains sont moins respectés que jamais durant les dix dernières années.
Par ailleurs, je rappellerai que la France impose des visas de transit aéroportuaires aux ressortissants syriens, ce qui constitue une atteinte au droit de demande d'asile ; en dépit de la validation par le Conseil d'État de ce dispositif, nous nous y opposons très fortement. Une audition a eu lieu à ce sujet à l'automne dernier à l'Assemblée nationale.
Mme Irinda Riquelme. - Le programme « un pour un » représente pour nous aussi une vaste opération de communication. Les chiffres montrent bien que la proportion entre Syriens renvoyés en Turquie et Syriens réinstallés en Europe est loin d'être de « un pour un » : 383 demandeurs d'asile ont été réinstallés en Europe et 14 ont été renvoyés en Turquie.
L'idée même de substitution de flux migratoires légaux aux flux illégaux est aussi fausse. Ce programme n'ouvre pas de nouvelle voie légale : on ne fait que reprendre les réinstallations promises depuis juillet 2015 par les différents gouvernements européens au HCR. En revanche, les conséquences de ce programme sont très préoccupantes : on donne aux autorités turques le pouvoir de choisir ceux qui iront en Europe. Der Spiegel a récemment révélé que si, officiellement, c'est le HCR qui prend la décision en coopération avec les autorités turques, ces dernières ont de fait la main sur la décision sans droit de regard du HCR. Il s'avère que les personnes retenues pour la réinstallation depuis la Turquie sont de faible niveau éducatif ou présentent de sérieuses pathologies médicales.
Enfin, s'il permet de tarir aujourd'hui certains flux illégaux, combien de temps y parviendra-t-il ? Cet accord est très précaire ; ainsi, les autorités turques menacent régulièrement de le dénoncer. Pas plus tard qu'avant-hier, le ministre turc des affaires étrangères déclarait qu'il leur était impossible de modifier la loi antiterroriste, ce qui était pourtant l'un des points essentiels de l'accord ; il demandait en outre la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs.
En somme, il s'agit d'un accord très fragile dont les conséquences sont préoccupantes.
Mme Izza Leghtas. - Je me demandais aussi pourquoi si peu de relocalisations avaient eu lieu en France. En effet, la plupart des réfugiés à qui je demandais où ils voulaient aller mentionnaient l'Allemagne, parfois la Suède. Pour l'Allemagne, le rôle personnel d'Angela Merkel n'est pas à négliger, de même que le bouche-à-oreille. Il est vrai aussi que beaucoup de familles ont été séparées. J'ai parlé à beaucoup de femmes seules, à Athènes, qui voyageaient avec leurs enfants pour retrouver leur mari déjà arrivé en Allemagne. Ces femmes avaient peur de s'inscrire au programme de relocalisation et préféraient risquer le chemin par elles-mêmes. Cela dit, j'ai aussi rencontré des personnes désireuses de s'installer en France : beaucoup d'efforts restent à faire à mon sens pour l'information des réfugiés et le traitement de leurs demandes.
Mme Bénédicte Jeannerod. - Pour nous, la crise des réfugiés n'est pas une crise de capacités : c'est bien une crise de volonté politique. Il y va de même pour la France : elle aurait pu prendre une position plus forte sur la question, sans limiter cette crise à un problème de politique intérieure et craindre l'effet de cette crise sur le vote Front national. Nous appelons vraiment la France à renforcer ses efforts. Certains dispositifs, comme les visas pour asile, sont intéressants et la France pourrait se montrer beaucoup plus volontariste sur cette proposition.
Nous avons aussi une grande inquiétude vis-à-vis de la Libye et des discussions qui se tiennent actuellement à l'échelon européen à son sujet. Elles pourraient aboutir sinon à un accord identique à celui conclu avec la Turquie, du moins à des discussions quant aux moyens d'endiguer les flux provenant de Libye. La situation des droits humains dans ce pays est extrêmement préoccupante ; le refoulement de réfugiés vers la Libye serait donc une véritable catastrophe. L'accord UE-Turquie ouvre ainsi des perspectives pour nous très menaçantes dans d'autres ensembles géographiques.
M. Gérard Sadik. - Je voudrais aborder la façon dont l'Europe réagit à la question des réfugiés. Un certain nombre d'initiatives ont été prises par la Commission européenne, notamment en matière de relocalisation, mais aussi la révision annoncée le mois dernier du règlement Dublin. Il s'agit là d'une proposition radicale car elle pose comme principe l'application de la notion de pays tiers sûr par tous les États. Cela pose en France un problème de constitutionnalité.
Cette proposition inclut aussi l'examen très rapide des demandes issues de pays d'origine sûrs, avant même la détermination de l'État responsable et ce, ad vitam aeternam. La particularité du système actuel, qui explique peut-être l'absence d'explosion en Italie ou en Grèce, est que, après un délai de transfert pouvant aller de six à dix-huit mois, la responsabilité relevant à l'origine de la Grèce ou de la Hongrie disparaît parce que l'intéressé n'a pu être transféré depuis, par exemple, la France.
Or dans ce projet de « Dublin IV », la responsabilité resterait pour toujours à l'État initialement responsable. Les critères fixés dans ce projet restent sensiblement les mêmes. Certes, un système d'allocation serait mis en oeuvre lorsque les capacités d'un pays sont dépassées de plus de 150 %, suivant une distribution complexe.
On entrerait ainsi dans un système qui risque de provoquer des situations dramatiques dans les pays « frontières » de l'Union européenne, la Grèce au premier chef. Certes, depuis 2011, les États européens ne transfèrent plus personne vers la Grèce, à la suite d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Au-delà de la Grèce, on peut penser à la Hongrie, premier pays saisi par la France en 2015. Si les transferts restent peu nombreux, la situation en Hongrie est néanmoins catastrophique. Même si l'on peut relocaliser des Syriens, s'ils prennent la route des Balkans, ils seront transférés vers la Hongrie, où on les enfermera. L'audience de grande chambre de la CEDH du 17 décembre 2015 pourrait peut-être conduire à un moratoire similaire à celui en vigueur pour la Grèce.
Quant aux femmes qui se trouvent en Grèce alors que leur mari est en France ou en Allemagne, le règlement Dublin devrait normalement s'appliquer de façon positive : la Grèce pourrait le saisir pour les transférer. Or cela reste statistiquement marginal, sauf pour l'Allemagne.
En 2015, 1 200 000 demandeurs d'asile sont arrivés en Europe. Cela ne représente que 0,23 % de la population européenne : ce n'est donc pas totalement ingérable ou massif au sens du HCR. La zizanie et les décisions unilatérales de chacun des États ont provoqué cette crise.
Deux systèmes sont possibles. Soit on maintient un système obsidional, ultra-sécuritaire, qui externalise les procédures d'asile - cette logique, développée depuis quelques années, commence à être mise en oeuvre avec l'accord UE-Turquie et va encore provoquer des drames -, soit on choisit une approche plus fédérale. Une des idées possibles serait de développer une sorte d'OPFRA européen, dont les critères de détermination seraient du plus haut niveau de protection. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Si l'on s'en tient à une logique nationale, le système explosera quoi qu'il arrive et quelque mur qu'on construise. Il faudrait plutôt aller vers une plus grande intégration des politiques européennes.
M. Jacques Legendre, président. - Nous avons pris note de vos remarques, qui nous seront utiles. Nous essaierons de creuser les points que vous nous avez indiqués.
Audition de Mme Ayça
Saritekin,
Conseillère à l'Ambassade de Turquie en France
Mercredi 8 juin 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Mme Saritekin, Conseillère à l'Ambassade de Turquie en France. Chère Madame, nous vous remercions de représenter Son Excellence M. Hakki Akil, dont l'audition était prévue mais qui a eu un empêchement. Peut-être aurons-nous l'occasion de reprogrammer ultérieurement son audition, avant la présentation de notre rapport. Notre mission d'information a pour objet l'accord passé le 18 mars dernier entre l'Union européenne et la Turquie. Nous voudrions, en préambule, que vous nous fournissiez quelques repères sur les réfugiés présents en Turquie. Quel est actuellement leur nombre, qu'ils soient syriens ou non sur le sol turc ? Quelle a été l'évolution de leur effectif au cours des cinq dernières années ? Comment se répartissent-ils sur le territoire ? Enfin, continuent-ils d'arriver en Turquie et l'accord a-t-il eu aussi un effet positif sur ce plan ? Si ce mouvement se poursuit, d'où proviennent-ils ? En ce qui concerne l'accord, il ne vise, pour l'essentiel qu'à accélérer la mise en oeuvre d'outils juridiques et de procédures existantes. Sa principale « innovation », la possibilité de réadmettre en Turquie des demandeurs d'asile est, semble-t-il, une proposition turque au départ. Cet accord fonctionne, puisque les flux vers la Grèce ont diminué de plus de 90 % depuis son entrée en vigueur. Or aujourd'hui, la crainte est que le Parlement turc ne ratifie pas l'accord, si aucun progrès n'est fait en matière de libéralisation des visas. Progrès qui, soulignons-le, dépendent de la Turquie. Mais l'intérêt de la Turquie dans cet accord se limite-t-il au volet des visas ?
Mme Ayça Saritekin, Conseillère à l'Ambassade de Turquie. - Je voudrais vous remercier de me recevoir et vous prie à nouveau d'excuser M. l'Ambassadeur, dont l'emploi du temps ne lui a pas permis de venir devant votre mission. J'aborderai, à titre liminaire, la politique conduite par la Turquie vis-à-vis des réfugiés syriens. Depuis le début de novembre 2011, la Turquie a ouvert ses portes aux Syriens qui fuient la guerre et la persécution dans leur pays. Une aide humanitaire a également été fournie sans aucune distinction ethnique ou religieuse et le principe de non-refoulement a été respecté. Les Syriens se sont vus reconnaître un statut de protection temporaire, conformément aux obligations de la Turquie en matière internationale. La création de ce statut repose sur une base légale : le règlement de protection temporaire qui est entré en vigueur en octobre 2014.
Le nombre de réfugiés en Turquie s'élevait, au 6 juin 2016, à 2 744 915 personnes d'origine syrienne, soit quelque 2,7 millions de personnes auxquelles s'ajoutent 300 000 réfugiés de différentes nationalités, dont 200 000 Irakiens. Au total, le nombre de réfugiés en Turquie s'élève donc à 3 millions de personnes. Parmi les réfugiés syriens, 259 896 vivent dans les vingt-six centres de protection provisoires, et le reste dans les diverses provinces turques notamment frontalières avec la Syrie telles que Þanlýurfa, Hatay, Gaziantep et Kilis et aussi dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara ou Izmir. Le nombre des nouveau-nés dans les camps s'élève aujourd'hui à 152 000. Tous les réfugiés syriens sont enregistrés bio-métriquement et disposent d'une carte d'identité qui contient également leurs empreintes digitales. Leur enregistrement précède une procédure de contrôle de santé.
Nous assurons gratuitement aux réfugiés bénéficiaires d'un statut temporaire l'alimentation, les soins de santé, l'éducation ainsi que des activités sociales. Les réfugiés syriens, qui se trouvent en dehors des camps sont également sous le contrôle de notre régime de protection et ont également accès aux soins de santé et à l'éducation.
Depuis cinq années, la Turquie a assumé ses responsabilités en accueillant tous ces Syriens, mais avec l'intensification de la crise migratoire et ses images tragiques comme le décès du petit Aylan Kurdi, l'Europe a pris la mesure de l'ampleur du phénomène. La Turquie et l'Union européenne ont alors franchi une nouvelle étape. Celle-ci s'est traduite par la « normalisation » de nos relations.
En novembre dernier, l'Union européenne s'est associée à la Turquie dans le cadre d'un « plan d'action commun », dont la mise en oeuvre a amélioré les conditions de vie des Syriens en Turquie, tout en limitant l'immigration irrégulière en Mer Egée. La Turquie a appliqué avec détermination ce « plan d'action » qui a permis d'atteindre de très bons résultats.
Dans ce cadre, avant la réintroduction des visas pour les Syriens venant des pays tiers, le 9 janvier dernier, 40 000 personnes passaient la frontière turque chaque semaine. Une fois les visas réintroduits pour les Syriens venant des pays tiers, ce nombre a baissé pour atteindre environ 1 000 entrées. Depuis le 15 janvier, les Syriens peuvent se voir délivrer un permis de travail, ce qui apporte une amélioration réelle à leurs conditions de vie.
En outre, les mesures policières que la Turquie a appliquées avec vigilance depuis le début de la crise ont elles aussi produit de bons résultats. Pour preuve, près de 7 000 personnes passaient la frontière chaque jour en novembre 2015, alors qu'en février 2016, ce chiffre baissait à 2 000. Ces mesures n'étaient cependant pas suffisantes pour endiguer les flux migratoires irréguliers. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, lors du Sommet du 7 mars, la Turquie a fait une proposition qui fut acceptée par l'Union européenne le 18 mars dernier. Cette résolution dite de « un pour un » visait d'une part à mettre un terme aux pertes en vies humaines dans la Mer Egée, d'autre part à démanteler les réseaux de passeurs et enfin à organiser une forme « régulière » d'immigration. La Turquie était animée par des motivations humanitaires et cet accord a permis d'enregistrer des résultats tout à fait tangibles.
La Turquie a souhaité créer un effet dissuasif destiné à frapper les esprits. Cette démarche a fonctionné. En effet, depuis l'application de l'accord, certains jours ne connaissent aucun passage et aucun décès à déplorer en Mer Egée. Certaines allégations, relatives au retour des flux en raison de l'amélioration des conditions météorologiques, se sont avérées fausses. Aujourd'hui, la route centrale méditerranéenne a certes été réactivée, mais ce n'est plus le cas pour la Mer Egée.
Je souhaiterais préciser un point. L'accord contient des éléments importants concernant les relations entre la Turquie et l'Union européenne. La crise migratoire, comme je l'ai rappelé à titre liminaire, a donné lieu à la normalisation, au sens strict du terme, des relations entre la Turquie et l'Union européenne. L'accord comporte la libéralisation des visas qui n'est nullement un engagement nouveau de l'Union européenne puisque le dialogue de libéralisation a été lancé en parallèle de la signature de l'accord de réadmission signé en 2013. On a juste « anticipé » l'exécution de ce paquet dont les deux volets sont inséparables. L'ouverture des chapitres constitue, me semble-t-il, un sujet anodin par rapport à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais cette démarche ne permet nullement d'en présager l'accélération. J'ajouterai que l'accord de mars dernier fonctionne très bien, mais que certaines hésitations se font jour quant à la pérennisation des résultats qui viennent d'être obtenus. Ainsi, la désorganisation des Autorités grecques empêche l'échange de migrants avec la Turquie et un tel obstacle peut nuire à l'effet psychologique et dissuasif de cet accord. En effet, si les réseaux clandestins et les migrants comprennent que cet accord est inopérant, les flux peuvent « redémarrer ». Nous pensons en conséquence qu'il importe de soutenir la Grèce dans ses efforts pour traiter la question migratoire. Je vous remercie de votre attention.
M. Jacques Legendre, président. - Je vous remercie, Madame, pour cette première série de réponses et vais tout de suite donner la parole à notre rapporteur, M. Michel Billout.
M. Michel Billout, rapporteur. - Madame la Conseillère, je voudrais assurer, par votre intermédiaire, la Turquie de la solidarité du Sénat français après les nouveaux attentats qui viennent de frapper votre pays. Je commencerai par vous adresser une première série de questions qui concerne la façon dont la Turquie s'efforce de respecter le droit des réfugiés dans cette période un peu difficile. Suite à vos propos évoquant l'accueil massif assuré par votre pays d'un très grand nombre de réfugiés syriens et l'application du principe de non-refoulement notamment sur la frontière turco-syrienne, un grand nombre d'observateurs nous indiquent que ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'après leurs témoignages, la Turquie serait actuellement « fermée », ce qui pourrait conduire à s'interroger sur le statut de « pays tiers sûr » qui vous a été reconnu notamment par la législation grecque. Qu'en est-il donc aujourd'hui de la politique turque à l'égard des nouveaux réfugiés syriens qui se présentent à la frontière, compte tenu notamment des nouvelles opérations militaires conduites en Syrie ? Comment envisagez-vous la présence des réfugiés syriens à long terme sur le territoire turc, car la question syrienne ne saurait être réglée à brève échéance ? La Turquie prévoit-elle leur « retour au pays » ou prend-elle le parti de les intégrer ?
Je formulerai une autre question. L'« arrangement » entre l'Union européenne et la Turquie prévoit des adaptations législatives ou réglementaires en Turquie afin que des garanties supplémentaires soient apportées aux personnes ayant besoin d'une protection internationale, qu'elles soient ou non syriennes. Nous savons que des mesures ont été prises en ce sens, avec des garanties écrites. Ces mesures sont-elles bien mises en oeuvre ? La pratique de l'asile, dans votre pays, évolue-t-elle dans le même sens ?
En outre, la Turquie envisage-t-elle de tirer les conséquences de ce renforcement de la protection internationale, en levant formellement la restriction géographique qu'elle oppose à l'application de la Convention de Genève qui lui est tout à fait spécifique ?
Mme Ayça Saritekin. - Je vous remercie de vos questions. Je répondrai tout d'abord à celle concernant la législation turque concernant les étrangers et leur protection internationale. Cette loi est entrée en vigueur en 2014 et avait reçu l'aval du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR). Mais cette première loi ne concernait que les individus et il nous a fallu gérer l'arrivée « en masse » de migrants. Nous avons dû promulguer une réglementation spécifique destinée à ces masses de personnes arrivant en Turquie. D'ailleurs, avant que ne survienne cette crise migratoire envers l'Europe, personne ne questionnait la politique migratoire conduite par Ankara ni ne remettait en cause la qualité des infrastructures destinées à l'accueil des réfugiés. Après le commencement de la crise, la Turquie a essuyé des accusations sans fondement de la part des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt. Certes, nous avons des restrictions géographiques à l'application de la convention de Genève, mais nous disposons de notre propre législation qui fournit assez de protections aux réfugiés en Turquie. Cette législation nationale s'avère totalement conforme aux critères internationaux. Aucune lacune juridique n'est par conséquent à déplorer s'agissant de la protection que nous accordons aux Syriens. En outre, la Convention de Genève prévoit également le partage du fardeau et des responsabilités, mais cet aspect est toujours passé sous silence. On nous oppose souvent ces restrictions géographiques mais, depuis longtemps, la Turquie a dépassé ce seuil grâce à sa législation nationale. Les polémiques qui entourent ces restrictions géographiques sont purement « politiques ».
Depuis cinq ans, la Turquie a assumé totalement ses responsabilités envers les Syriens. Elle a ainsi dépensé pour eux plus de 10 milliards de dollars, la crise syrienne a un impact de près de 30 milliards de dollars pour l'ensemble de l'économie turque. Nous accueillons tout de même trois millions de réfugiés ! De ce fait, la Turquie agit toujours pour répondre à la fois d'un point de vue juridique et politique aux besoins des Syriens. Nous avons ainsi accordé le droit de travailler en janvier dernier, ce qui permet d'intégrer ces personnes dans notre économie. De fait, notre pays a une vision à long terme de l'intégration de ces populations. Ainsi, les enfants d'origine syrienne en âge d'être scolarisés peuvent bénéficier, l'après-midi, d'une parité de cours avec des enseignants eux-aussi d'origine syrienne. Cet aménagement du temps scolaire souligne notre préoccupation d'éviter que ces enfants ne deviennent pas une « génération perdue ».
Contrairement aux allégations qui ont pu être faites ici ou là, la Turquie ne contraint nullement les Syriens à retourner en Syrie. Tous les retours volontaires s'effectuent sous l'égide du HCR. En outre, par exemple si le conflit à Alep s'intensifie, ce qui induirait un nouvel exode de réfugiés, il faudrait sans doute revoir les dispositifs actuellement mis en oeuvre. Pour que cette crise connaisse un terme, il faut une solution politique en Syrie. Mais c'est un autre sujet qui mérite une discussion séparée. Le risque demeure quant à une arrivée en masse de réfugiés à nos frontières.
M. Jacques Legendre, président. - Monsieur le Rapporteur, avez-vous d'autres questions ?
M. Michel Billout, rapporteur. -Tout à fait, Monsieur le Président. Cependant, je tenais à clarifier un point. Nous ne sommes pas ici pour nous faire l'écho d'allégations ou pour donner des leçons à la Turquie sur la problématique des réfugiés. Nous sommes ici pour comprendre comment l'accord du 18 mars fonctionne et peut susciter des questions au regard du respect du droit international. Nous souhaitons également obtenir des informations plus générales sur le traitement de cette question migratoire, qui ne va pas s'arrêter demain, entre la Turquie et l'Europe. Je comprends bien l'inquiétude de la Turquie sur le fait qu'elle accueille aujourd'hui près de trois millions de réfugiés, sans présager de la suite de cette immigration. D'ailleurs, la Turquie considère-t-elle avoir atteint une limite quant au nombre de ressortissants syriens accueillis ou, au contraire, s'estime-t-elle capable de reculer les « limites » du « possible » en la matière ?
Mme Ayça Saritekin. - Notre pays n'a nullement fixé de limite quant à l'accueil des réfugiés syriens. Il y a quelques mois, leur nombre s'élevait déjà à deux millions et sa hausse s'est effectuée contre toute attente. La Turquie continue à fournir sans hésitation une aide humanitaire à tous les Syriens et aux Irakiens qui la lui demandent, que ce soit sur son sol mais aussi au-delà de ses frontières. L'évolution de cet accueil dépend de celle de la guerre, mais la volonté de la Turquie demeure constante. Nous avons eu quatre élections en une année et aucun parti politique n'a utilisé les Syriens ou les réfugiés comme une question politique. Ce sujet n'a jamais politisé, à l'inverse de ce qui s'est produit dans certains États européens. Cette question a toujours fait l'objet d'un traitement humanitaire, sans doute pour des motifs culturels. Pour répondre encore à de fausses allégations, la Turquie est un pays aussi sûr que la France et son inclusion dans une liste de pays sûrs n'a pas à être débattue. Considérer la Turquie comme un pays « non sûr » est pour nous une démarche irrecevable, comme si notre pays était considéré comme sûr pour les trois millions de réfugiés et « dangereux » pour les ressortissants turcs. C'est un paradoxe et il incombe aux autorités européennes de le résoudre.
M. Michel Billout, rapporteur. - J'aurais également une autre série de trois questions. À la suite de l'accord de mars dernier, il est apparu que la Turquie était tout à fait en mesure de contrôler ses côtes et ses frontières maritimes, de lutter efficacement contre les réseaux de passeurs et, en conséquence, de juguler dans une très large mesure le départ massif de réfugiés des côtes turques vers l'Union européenne. Or, avant la conclusion de l'accord, la Turquie laissait entendre que lutter contre les passeurs et les flux migratoires relevait quasiment d'une mission impossible. Qu'est-ce qui a permis une telle évolution ? Quelles dispositions très pratiques la Turquie a-t-elle été amenée à mettre en oeuvre ? Vous avez par ailleurs évoqué le montant de l'effort budgétaire consenti par la Turquie à l'accueil des réfugiés syriens. Cet accord a permis de renouveler le principe d'une aide de trois milliards d'euros de l'Union européenne à la Turquie qui pourrait être complétée par une aide supplémentaire de trois autres milliards. J'avoue cependant que nous n'avons toujours pas bien compris ici, dans le cadre de la mission, comment cette aide parviendrait aux intéressés. Celle-ci, nous a-t-on dit, ne sera pas directement versée à l'Etat turc et devrait contribuer au financement d'actions conduites par des organismes indépendants. Quels sont ces organismes ? Je vous pose cette question car les principales ONG que nous avons auditionnées nous ont fait part de leurs difficultés à agir comme elles le souhaiteraient sur le territoire turc. Pourriez-vous nous donner votre vision quant à la possibilité d'utiliser ces fonds, afin qu'ils soient effectivement versés et qu'ils puissent être utiles ? Enfin, s'agissant de la problématique de l'accès au travail pour ces millions de réfugiés, vous nous avez indiqué que le droit de travailler avait été formellement accordé en janvier dernier aux réfugiés syriens. Bien que cette mesure soit récente, ce droit se traduit-il déjà dans la pratique et êtes-vous en mesure de nous donner des informations quant à l'accès des réfugiés syriens au travail et qu'en est-il des autres réfugiés auxquels une protection est également reconnue ?
En outre, comme vous l'avez indiqué, la Turquie accueille 2,7 millions de réfugiés syriens, dont 300 000 dans les camps et je dois dire que les personnes que nous avons auditionnées ont salué la qualité de l'accueil dont ont bénéficié ces réfugiés ; je pense notamment aux camps placés sous l'égide du Croissant rouge. La Turquie fournit des efforts importants pour l'accueil de ces migrants, même si la problématique du « phénomène de masse » demeure. En effet, ces personnes sont accueillies autour des villes turques et leur situation demeure délicate. D'ailleurs, au cours de nos auditions, il nous a été indiqué que l'aide des trois milliards d'euros serait plutôt destinée à ces réfugiés qu'à ceux qui sont déjà accueillis dans les camps et dont l'accès au droit est déjà satisfaisant.
Mme Ayça Saritekin. - Je commencerai par répondre à votre question portant sur les passeurs. On a reproché à la Turquie de ne pas avoir pris assez de mesures sécuritaires avant la signature de l'accord. Cette réflexion est sans fondement. En effet, la Turquie a arrêté 4 471 passeurs en 2015. Durant cette même année, près de 91 000 réfugiés illégaux ont été arrêtés le long des 3 000 kms des côtes égéennes. De tels chiffres démontrent le travail effectué par les garde-côtes et les policiers. La Turquie a manifestement pris l'ensemble des mesures policières nécessaires avant et après la crise. Or, j'insiste sur le fait que l'accord que nous avons conclu a eu un indéniable effet psychologique et c'est là une réussite de la démarche conjointe à l'Union européenne et à la Turquie que d'avoir fait passer un message dissuasif aux passeurs et aux immigrés irréguliers. Pourquoi payer des milliers d'euros pour partir en Grèce avant d'être renvoyé en Turquie ? En revanche, si toutes les mesures policières, sécuritaires et frontalières ont bien été prises jusqu'au début de la crise, elles demeurent en elles-mêmes insuffisantes, comme nous l'a démontré la continuation des flux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes parvenus à un accord. Les passeurs, quant à eux, génèrent un chiffre d'affaire colossal de près de quatre milliards de dollars et leurs réseaux se structurent en cellules : pour preuve, si les chauffeurs de bus connaissent les passeurs, ils ne connaissent pas les conducteurs de bateaux. Nous avons fait de notre mieux pour les combattre. Ainsi, en 2016 ainsi, 1 887 passeurs ont été arrêtés et 400 parmi eux ont été emprisonnés. En outre, 73 751 migrants irréguliers ont également été renvoyés. Nous poursuivons ainsi nos efforts depuis le début de la crise. Encore une fois, nous ne pouvons que nous féliciter de l'effet psychologique suscité par cet accord.
S'agissant des trois milliards d'euros destinés aux besoins des Syriens, je vous rappelle que la Turquie a déjà dépensé quelque dix milliards de dollars depuis le début de cette crise. Cependant, dans le cadre du partage du fardeau et des responsabilités, nous attendons que l'Union européenne assure sa part. Notre accord mentionne également une somme de trois milliards d'euros. A quelles populations celle-ci est-elle destinée ? Vous avez évoqué son éventuelle destination vers les camps de réfugiés situés aux abords des villes. Cet argent est destiné à répondre aux besoins de tous les Syriens quelle que soit leur localisation. L'aide de la Turquie n'est pas limitée à sa seule assistance dans les camps, puisque les Syriens en dehors des camps ont accès aux services offerts par la Turquie. Les besoins sont encore importants. Pour preuve, sur les 830 000 enfants syriens en âge d'être scolarisés, seuls 300 000 le sont effectivement. La Turquie a ainsi partagé avec l'Union européenne la liste des projets qu'elle comptait conduire dans ce cadre. Le dialogue à ce sujet avec l'Union européenne est très fructueux. Nous attendons que le versement de ces montants soit effectif et rapide, conformément aux engagements souscrits par l'Union européenne qui doit maintenant les honorer. La Turquie a ainsi assumé son rôle.
Enfin, la plupart des réfugiés se trouve en dehors des 26 centres provisoires qui sont situés dans dix villes. On ne peut sans cesse installer de nouveaux camps. Alors que l'Europe de 500 millions de personnes n'a pas pu accueillir un million de personnes, notre pays a su en accueillir 3 millions ! Ainsi, à Kilis, la population turque est devenue minoritaire. D'ailleurs, le taux de criminalité des Syriens y est très bas, ce qui témoigne de la qualité de l'accueil que nous leur offrons.
M. Michel Billout, rapporteur. -- Sur l'accès au droit de travailler ?
Mme Ayça Saritekin. - Pour être autorisés à travailler, les Syriens doivent se trouver en Turquie depuis six mois. Notre règlement mentionne des seuils, afin d'assurer l'intégration de ces populations dans l'économie turque. Certes, le travail clandestin existe, mais cette réglementation vise également à le diminuer. Tout est ainsi fait pour donner une base légale, sous le contrôle des autorités, au travail des Syriens.
M. Jean-Yves Leconte. - Nous voyons bien combien la Turquie reçoit de réfugiés par rapport à l'Union européenne. Nous mesurons également l'évolution de notre propre législation, dans les domaines comme la sécurité ou la lutte contre le terrorisme. Nous comprenons ce que la Turquie vit, par rapport à notre propre expérience. Il ne s'agit nullement de donner des leçons mais de s'interroger sur ce qui est fait. Vous avez évoqué le fait que la Turquie n'a pas ratifié l'ensemble de la Convention de Genève et que la conformité de votre législation interne avec celle-ci évinçait tout problème. Il me semble toutefois que subsiste un décalage, car la Turquie n'est responsable que vis-à-vis d'elle-même, sans obligation conventionnelle. Compte tenu de cela, il est difficile pour les autres pays, dont la Grèce, de considérer que votre engagement puisse être bilatéral, faute d'une base multilatérale. Le fait de ne pas avoir ratifié la totalité de la convention de Genève demeure même si, dans les textes, on peut considérer que votre loi est conforme aux exigences de la Convention de Genève.
Ma deuxième question concerne toujours le droit au travail. À quelle situation la notion de « réfugié » renvoie-t-elle ? S'agit-il de toute personne arrivant sur le territoire turc ou obtenant la protection sur le territoire turc ? Dans ce cas-là, celle-ci a certes le droit au travail, mais son accès à la demande d'asile demeure problématique. Nous rencontrons d'ailleurs ce même problème en Ile-de-France.
Par ailleurs, lorsque vous parlez d'effet psychologique, si les sorties sont bloquées depuis la Turquie qui reste « ouverte », les personnes qui ont besoin de protection viendront inéluctablement vers vous. N'allez-vous pas nécessairement vous retourner à terme vers l'Europe pour lui signaler votre difficulté d'accueillir une masse continue de réfugiés ?
J'en viens à ma quatrième question. Vous nous dites qu'il n'y a pas de situation difficile en Turquie aujourd'hui. Or, même l'Ordre des architectes fait l'objet de mesures répressives et lorsqu'on voit l'évolution de la situation depuis un an, un certain nombre de problèmes semble se poser !
Enfin, voyez-vous une possibilité d'obtenir une circulation sans visa, compte tenu du blocage sur la loi anti-terroriste. J'ai compris que le Président Erdogan proposait une commission germano-turque pour travailler sur cette question. Une porte de sortie existe-t-elle ou allons-nous demeurer « bloqués » sur cette question ?
Mme Ayça Saritekin. - Je vous remercie de toutes vos questions. S'agissant tout d'abord de la libéralisation des visas, la Turquie, pour remplir les 72 critères énoncés par la feuille de route de libéralisation des visas, a fourni un travail énorme de ratification et d'élaboration. Nous pensions avoir rempli tous ces critères, mais la Commission européenne a considéré que cinq critères demeuraient ignorés. L'un d'eux concerne la définition du terrorisme en Turquie. Je ne suis pas certaine qu'existe un critère unique de définition du terrorisme parmi les différents pays de l'Union européenne. Certes, chaque pays dispose de ses propres outils pour lutter contre le terrorisme. Attendre de la Turquie qu'elle change sa législation, alors qu'elle combat en même temps Daesh, le PKK et le DHKPC, est injuste. Demander à la Turquie, qui lutte contre le terrorisme depuis une quarantaine d'années, de satisfaire à un tel critère est incompréhensible ! Notre combat continue, comme vous le savez, et nous avons perdu hier onze personnes à Istanbul et aujourd'hui un camion vient encore d'exploser, et le premier bilan, dont je viens d'avoir connaissance, fait état d'un mort et d'un blessé. Dans un tel contexte, la Turquie n'est pas en mesure de changer les outils qui sont les siens pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes néanmoins ouverts aux négociations techniques. D'ailleurs, la Turquie et l'Union européenne continuent de discuter le contenu de ces cinq critères. En France, vous n'avez connu qu'une seule attaque certes de grande ampleur, alors qu'en Turquie, celles-ci sont plus fréquentes. La France a pourtant déclaré l'état d'urgence et modifié sa législation pénale en ce sens. Chaque pays prend les mesures qui lui sont propres en matière de lutte contre le terrorisme. Soyez juste envers la Turquie sur ce point.
Il ne faut pas sous-estimer l'effet psychologique de l'accord dont je parlais sur les migrants irréguliers et les passeurs. Ses résultats sont d'ailleurs très concrets. Si la Turquie lève sa réserve concernant la Convention de Genève, quelle en sera la conséquence ? Que va apporter un tel renoncement à la totalité des efforts déjà consacrés par la Turquie à cette question ? La question n'est pas ici celle des demandes d'asile individuelles, susceptibles d'être traitées en mobilisant au cas par cas des bases juridiques, mais d'une arrivée « en masse ». Comment est-il possible alors de procéder au cas par cas ? Enlever notre « veto » sur cette restriction géographique est un acte juridique, mais dont l'effet sur la situation actuelle nous paraît contestable. En Grèce, quelques tribunaux déclarent que la Turquie n'est pas un pays sûr et hésitent ainsi à y renvoyer les migrants. C'est le problème de la Grèce et non celui de la Turquie qui est suffisamment « sûre » depuis cinq ans pour trois millions de réfugiés ! Avant la crise, personne ne remettait en cause l'approche géographique de la Turquie. Ce grief a été formulé par les ONG et au lieu d'insister sur cette clause géographique, mieux vaudrait augmenter les capacités des autorités grecques, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'accord. C'est là une question primordiale. Notre législation nationale a d'ailleurs reçu l'aval du HCR, l'autorité internationale la plus compétente en matière d'asile et l'accueil de réfugiés.
Mme Gisèle Jourda. - Je souhaiterais vous poser une question au sujet des événements de l'année dernière puisque nous connaissons tous le rôle joué par l'Allemagne dans la mise en oeuvre de l'accord UE-Turquie pourtant sur les migrants qui nous réunit aujourd'hui. Or, la reconnaissance du génocide arménien par l'Allemagne a suscité une réaction forte du Président Erdogan. Celui-ci a indiqué qu'il s'agissait d'une affaire entre lui et l'Allemagne qui ne remettait nullement en cause les relations avec l'Union européenne. Qu'en est-il des effets possibles sur l'accord lui-même ?
Mme Ayça Saritekin. - Si la crise des migrants a affecté certains pays de l'Union européenne, comme la Grèce, l'Allemagne, et d'autres pays d'Europe centrale, l'Allemagne était la plus intéressée par cette question. C'est d'ailleurs ce qui explique l'importance de son rôle dans la négociation de cet accord qui n'a pas été conclu avec l'Allemagne, mais avec les 28 pays européens représentés par la Commission européenne. L'affaire à laquelle vous faîtes référence demeure bilatérale et ne présente aucun lien avec l'application de l'accord proprement dit, puisqu'il concerne tous les pays de l'Union européenne.
Mme Gisèle Jourda. - Je comprends tout à fait votre réponse. Quand bien même l'attachement de la Turquie à l'Union européenne est réel, comme en témoigne sa candidature à l'entrée, on peut toutefois s'interroger sur la position du Bundestag et ses éventuels effets sur l'accord. C'était là le sens de ma question.
Mme Ayça Saritekin. - Ces scénarii relèvent, à ce stade, de l'hypothèse. La Turquie est au contraire inquiète du « bon fonctionnement » de l'accord. Nous sommes toujours attachés à nos engagements et à notre candidature, depuis des années, pour l'adhésion à l'Union européenne. Nous sommes destinés à y entrer et cet objectif est stratégique à nos yeux. Bien sûr, à la fin du processus, il faudra consulter les peuples concernés. La Turquie se considère comme un membre de la famille européenne. Cet accord fournit une illustration de la bienveillance de la Turquie envers l'Union européenne, ce qui démontre l'inanité des allégations selon lesquelles notre pays s'en éloigne. Les deux parties à cet accord se sont épaulées mutuellement et j'espère que cette coopération ne sera pas de court terme.
M. Jacques Legendre, président. - En l'absence de nouvelles questions, il me reste, en votre nom, à remercier Mme la Conseillère Ayça Saritekin d'être venue nous expliquer la position de la Turquie et répondre à nos questions. Bien évidemment, Madame, si vous estimez disposer de documents complémentaires destinés à nous éclairer dans la rédaction de notre rapport, nous serons intéressés à les recevoir. En outre, une délégation de notre mission se rendra en Turquie pour rencontrer nos partenaires turcs et faire le point sur la situation.
Je vous remercie.
Audition de M. Jean-Dominique
Giuliani,
président de la Fondation Robert Schuman
Mercredi 8 juin 2016
M. François-Noël Buffet, président. - Monsieur le président Legendre étant obligé de participer à la séance publique, il m'a demandé de présider la réunion à sa place.
Monsieur Giuliani, vous êtes depuis de nombreuses années un ardent défenseur de la cause européenne et de l'idéal qui est poursuivi. C'est en cette qualité que nous souhaitons connaître votre point de vue sur l'accord intervenu le 19 mars dernier entre l'Union européenne et la Turquie dans le cadre de la crise migratoire et, singulièrement, des drames constatés en mer Égée, entre la Grèce et la Turquie.
L'Union européenne a-t-elle été à la hauteur de ses valeurs et de ses ambitions en concluant cet accord ? De nombreux observateurs estiment au contraire que l'Union européenne a sous-traité cette question à un pays tiers sur lequel il y aurait beaucoup à dire, alors qu'elle aurait pu s'en charger elle-même avec tous les moyens dont elle dispose. Quel est votre point de vue ?
D'une façon plus générale, quelle réponse l'Union européenne devrait-elle selon vous apporter à cette vaste problématique des migrations ? Il y a quelques semaines a eu lieu une réunion de l'ensemble des présidents des Parlements européens à Luxembourg, à laquelle le président Larcher participait d'ailleurs.
Enfin, en tant que citoyen européen, quel est votre point de vue sur la possibilité de voir un jour la Turquie rejoindre l'Union européenne ? L'audition précédente a témoigné que la Turquie conservait cet objectif stratégique. Quel est votre sentiment par rapport aux événements récents ? Les évolutions politiques constatées au cours des derniers mois dans ce pays ont-elles fait évoluer les points de vue ?
Cette audition ne fait pas l'objet d'un enregistrement filmé, mais donnera lieu à un compte rendu écrit, qui vous sera préalablement soumis avant publication, afin de s'assurer que nous n'aurons pas trahi les propos que vous allez tenir.
Vous avez la parole.
M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. - Merci infiniment de me faire l'honneur de m'écouter pour former votre opinion, dans une maison qui, vous le savez, me tient beaucoup à coeur, à laquelle je suis très attaché, dans laquelle j'ai servi très longtemps et dont je connais la qualité des travaux et de la réflexion. Je ne doute donc pas que votre rapport servira à former une opinion sur un accord qui a été conclu dans des conditions peu transparentes, et qui suscite beaucoup de réactions.
Vous avez dit que j'étais un Européen convaincu. J'essaie aussi, à la tête de la Fondation Robert Schuman, d'être un Européen lucide, et je vais tenter, malgré mon enthousiasme, d'être le plus objectif possible. Vous saurez de toute façon corriger les choses mieux que moi.
L'idée même de conclure un accord avec ses voisins immédiats - et surtout un grand voisin comme la Turquie, particulièrement concerné par la crise migratoire et les conséquences de la guerre civile en Syrie - afin d'essayer de maîtriser ce flux d'immigration est une idée juste qui, vraisemblablement, devrait être « dupliquée » avec d'autres grands pays parmi ceux qui nous entourent. Je sais que les travaux du Sénat évoquent aussi les relations avec la Russie.
Ce principe de diplomatie est un principe conforme aux valeurs de l'Union européenne, qui consiste à discuter avec ses adversaires, ses rivaux, voire ses ennemis - si tant est qu'elle en ait - pour essayer de régler en commun une question aussi complexe en matière d'immigration. Ceci est d'autant plus vrai que la protection de nos frontières ne saurait s'opérer derrière des barbelés et des murs qui seront toujours franchis et débordés.
Pour répondre précisément à votre question et ouvrir la discussion, je voudrais faire trois séries de réflexions que j'ai préparées pour vous sur le sujet de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, sur lequel la Fondation Robert Schuman a beaucoup travaillé et fait travailler.
La première série de réflexions concerne le contenu de l'accord. Je dirais que c'est un accord qui a été conclu par défaut, que c'est un accord à la légalité douteuse ou, en tout cas, « questionnée », et que c'est un accord à l'efficacité incertaine.
Il s'agit tout d'abord d'un accord par défaut, parce qu'il faut bien reconnaître, quel que soit l'enthousiasme européen, que c'est faute d'un consensus européen sur la manière de faire face à la crise migratoire, faute d'une politique européenne d'immigration ou des réfugiés coordonnée qu'il a été conclu. L'Allemagne seule, pour des raisons qui lui appartiennent, et notamment la composition de sa population et la forte immigration dont elle fait l'objet depuis déjà plusieurs années, est apparue comme l'artisan de cet accord.
La semaine dernière, nous recevions à Paris le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, à qui j'ai posé la question. Il m'a dit être sous la pression de l'Allemagne pour donner des réponses qui, au demeurant, concernent tous les pays de l'Union.
Cet accord pose aussi la question de la relation franco-allemande, puisqu'on a vu la Chancelière faire non seulement le voyage elle-même jusqu'à Ankara, mais aussi peser sur les institutions européennes pour la conclusion dudit accord.
On peut dire aussi, plus positivement que, face à la crise des réfugiés, l'Allemagne - à tort ou à raison - est la seule à s'être vraiment engagée pour essayer de trouver des solutions, certes conformes à ses intérêts, à ce qu'elle est et à ses valeurs, mais que l'Union européenne s'est trouvée déchirée, avec une division Nord-Sud qui existait auparavant face à l'immigration et, désormais, une division Est-Ouest sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir.
Cet accord par défaut, je le regrette, à titre personnel, énormément, car je constate une fois de plus, alors que notre environnement est très instable et qu'il s'agit de défendre nos intérêts dans le monde, que l'Union européenne a agi sous la pression, et comme à chaque fois dans pareil cas, qu'elle l'a fait plutôt mal et dans la division.
En second lieu, il s'agit d'un accord à la légalité douteuse, qui a notamment été mis en cause par le Défenseur des droits. Il existe en effet un problème avec la Turquie, qui n'est pas un pays sûr au sens juridique et qui a toujours, dans son droit positif, des réserves sur la convention de Genève de 1951 restreignant le droit d'asile aux citoyens européens.
À ce jour, d'après mes informations, seules 38 593 personnes ont bénéficié de l'asile en Turquie, ce qui démontre, compte tenu des 2,7 millions de réfugiés syriens présents sur son territoire - si tant est que ce chiffre soit exact - que l'acquisition du statut de réfugié, la protection de la convention de Genève ou des autres textes des Nations unies pose un problème en Turquie, problème qui, lorsqu'on interroge les autorités turques, se résout selon elles plus facilement qu'il n'en a l'air. Quoi qu'il en soit, ce n'est juridiquement pas conforme à la manière dont nous agissons généralement en Europe.
Par ailleurs, il existe un problème, pour les réfugiés présents en Turquie, en matière d'accès au marché du travail.
Cela a fait dire au Défenseur des droits que le fait de traiter avec un pays qui n'est pas sûr présente un problème juridique. La Commission européenne, que nous avons interrogée, affirme dans tous ses communiqués qu'elle a pris toutes précautions pour s'assurer que l'instruction des demandes d'asile serait accélérée, que l'accès au marché du travail des réfugiés en Turquie serait amélioré, et qu'elle a obtenu des engagements du Premier ministre qui n'est désormais plus en fonction.
Troisièmement, c'est un accord à l'efficacité incertaine, car on s'interroge pour savoir si tous les irréguliers ou tous les illégaux entrés en Turquie et ceux qui sont aujourd'hui sur le sol grec auront accès aux dispositions de l'accord. Tous les irréguliers présents en Grèce auront-ils droit à un accord de type « un pour un » ? Seront-ils renvoyés en Turquie, même s'ils ne le veulent pas ? Toutes les demandes d'asile seront-elles traitées, soit en Grèce, soit en Turquie ? Les réponses ne sont pas claires.
En outre, s'il faut aider les Turcs à faire face à cette situation, on peut cependant s'interroger sur la volonté réelle des autorités turques qui, dans l'accord qui a été conclu, s'engagent à honorer les accords de réadmission conclus avec la Grèce et l'Union européenne, ceux-ci n'étant toujours pas entrés en application.
Enfin, si l'immigration illégale en provenance de Turquie vers la Grèce a beaucoup diminué - on parle de 2 700 arrivées par mois au lieu de 2 700 par jour - on peut se demander si on n'a pas transféré le problème vers la Méditerranée occidentale, notamment avec la recrudescence de migrants arrivés de Libye.
Ma seconde série de réflexions porte sur les conditions dans lesquelles cet accord a été négocié. Pour moi, il s'agit d'un accord négocié sous la contrainte. C'est un accord qui mêle des sujets qui ne sont pas directement liés au problème migratoire, et qui traduit un rapport de force qui s'est inversé entre l'Union européenne et la Turquie.
Le fait que cet accord ait été négocié sous la contrainte est évident. La Turquie, c'est vrai, est débordée par l'afflux de réfugiés provenant de Syrie, mais il arrive aussi en Grèce des ressortissants des pays d'Afrique noire ou du Maghreb, voire du Pakistan, d'Érythrée ou d'Afghanistan. Il y a une forte présomption dans notre esprit - sans qu'on en ait évidemment la preuve - que si la Turquie est débordée, elle est aussi extrêmement cynique dans le traitement de ce problème. Quand on sait la proximité géographique de la Grèce et de la Turquie et la manière dont l'État turc fonctionne, on s'aperçoit que la baisse spectaculaire du nombre d'arrivées tient aussi au fait que les services de l'État turc ont commencé à réaliser un travail qu'ils ne menaient pas jusqu'alors.
La question se pose donc de savoir si c'était volontaire et s'il s'agissait d'une sorte de pression exercée sur l'Union européenne, l'État turc ayant les moyens de contrôler les départs. On a à ce sujet un exemple très précis, que je tiens de la direction des migrations de la Commission européenne, celui des « cargos fantômes ». L'année dernière, les services de la Commission et Frontex ont identifié leur port de départ. On pouvait y acheter un cargo pour 300 000 euros. À force de faire pression sur les autorités turques, tous les « cargos fantômes » ont disparu du jour au lendemain.
Les services de la Commission européenne pourront en attester. C'est le fruit de leur travail.
En deuxième lieu, cet accord mêle des sujets qui ne sont pas liés. C'est ce qui figure dans l'accord, que la Turquie a exigé : relance du processus d'adhésion, ouverture du chapitre 33 sur l'Union européenne économique et monétaire, qui laisse entrevoir que, pour les Turcs, la stratégie de rapprochement avec l'Union européenne est toujours officiellement en vigueur, question des visas. Je comprends très bien l'intérêt politique d'un accord sur la libéralisation des visas mais, s'agissant d'un pays qui n'est pas sûr, c'est selon moi extrêmement dangereux. Cet accord sous la contrainte montre en tout cas qu'on a cédé à d'autres revendications traditionnelles de la diplomatie turque.
Ceci me conduit à ma troisième réflexion : en fait, le rapport de force entre la Turquie et l'Union européenne s'est largement inversé au profit de la Turquie. Pour reprendre la critique de plusieurs commentateurs, nous nous sommes placés dans un état de dépendance qui pose des questions plus générales sur la Turquie elle-même.
C'est l'objet de mes trois réflexions suivantes, qui porteront sur la question turque, l'instrumentalisation de l'Union européenne par la Turquie à des fins de politique intérieure, et les relations entre la Turquie et l'Union européenne.
La question turque, nous l'avons tous à l'esprit. Le projet du président Erdogan est manifestement de prendre la place de Mustafa Kemal Atatürk, mais pas exactement avec les mêmes principes. Il souhaite en tout cas retrouver une puissance conforme à ce qu'est la Turquie, mais pas sur les mêmes bases qui étaient, à l'époque d'Atatürk, une rupture avec le passé islamique du pays. Au contraire, il s'agit d'assumer le passé islamique, de le revendiquer même, et d'en faire un moyen de politique régionale. On aurait pu estimer logique que les pays entourant la Turquie acceptent cette formule, mais les conséquences ne sont pas au rendez-vous.
La diplomatie officielle de M. Davutoðlu, quand il était ministre des affaires étrangères, consistait à n'avoir aucun problème avec les voisins de la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie a des problèmes avec pratiquement chacun d'entre eux.
On sait les difficultés qui existent au sein de l'Union européenne, dont les opinions publiques s'écartent de la perspective d'une adhésion de la Turquie. C'est une position qui a progressé et qui est désormais majoritaire au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Il existe toutefois des exceptions, comme l'Italie ou l'Espagne, qui n'ont pas les mêmes problèmes.
J'ajoute que se pose, outre la question d'Erdogan, celles des Frères musulmans et des confréries, sur lesquelles nous avons selon moi insuffisamment travaillé pour comprendre ce qui se passe en Turquie.
La question turque elle-même pose des problèmes à nos alliés américains au sein de l'OTAN, mais aussi à la France et ailleurs dans la région. On voit bien que la Turquie a eu une responsabilité dans la guerre civile syrienne, qu'on le veuille ou non. Elle a changé de position pour nous rejoindre dans le combat contre le terrorisme, mais cela n'a pas toujours été le cas.
J'ajoute, pour répondre à votre question sur les valeurs, que le Parlement européen est de plus en plus remonté contre la Turquie pour des questions de respect de la liberté la presse et de droit d'expression. Pour l'instant, les politiques européennes, y compris sur le plan financier - puisqu'il existe des transferts financiers du budget européen vers la Turquie au titre de la pré-adhésion - ont été maintenues mais, sur le plan diplomatique, l'affaire est devenue de plus en plus compliquée à comprendre.
En réalité, pour nous, observateurs certes un peu partisans, l'Union européenne est instrumentalisée à des fins de politique intérieure. Autant on a pu longtemps faire confiance aux autorités turques pour mener de front la modernisation de la Turquie en profitant de la perspective européenne - c'était d'ailleurs ainsi que le voyaient les dirigeants européens - autant on peut aujourd'hui se poser la question.
L'accord sur lequel vous travaillez est particulièrement efficace sur le plan de la politique intérieure, puisqu'il satisfait à la fois les pro-européens et les antieuropéens. On peut dire aux premiers qu'on est toujours dans la perspective européenne, et aux seconds que l'on a fait plier l'Europe : nous sommes redevenus une grande puissance.
Enfin, on peut s'interroger sur la politique européenne en matière de visas et d'ouverture. Je trouverais personnellement plus intelligent d'ouvrir davantage notre politique de visas à l'égard de la Russie plutôt qu'à l'égard de la Turquie, avec laquelle nous partageons déjà une union douanière, et où les choses sont relativement avancées. La question est donc posée.
Cette inversion du rapport de force et cette situation de dépendance me conduisent à un raccourci : incapable de protéger ses frontières extérieures ou d'avoir une politique d'immigration commune à l'égard des réfugiés, l'Union européenne n'a finalement pu se mettre d'accord pour assurer la sécurité de ses frontières qu'en la confiant à la Turquie. C'est pourquoi je pense que les choses sont incertaines, car soumises à des aléas que nous ne maîtrisons pas.
Quand on interroge nos amis allemands de la Commission européenne, ils nous répondent qu'ils ont déjà des résultats. Il y a moins d'immigration, c'est vrai, mais j'ai peur qu'il s'agisse d'un résultat à court terme, soumis à des aléas et à du chantage.
Il ne suffit pas de critiquer : il faut aussi essayer de se demander quelles auraient été les meilleures solutions. C'est la question que vous me posez. Je pense que les grands pays de l'Union européenne - mais les autres aussi - auraient dû venir à l'aide de la Grèce, au nom du principe de solidarité, pour traiter l'afflux des réfugiés. Cela n'a pas été fait. J'ai interrogé le ministre de l'intérieur qui, je crois, partage ce point de vue. Il a fait le maximum, a envoyé des équipes techniques, mais tout cela n'est pas à la mesure de l'enjeu, et certainement pas coordonné. On aurait pu, par exemple, se coordonner avec les Allemands, les Autrichiens, voire les Britanniques, pour essayer d'aider la Grèce, qui en a besoin sur le plan financier. C'est un premier point.
Je suis tout à fait à l'aise avec l'idée d'aider la Turquie à faire face au poids de la prise en charge des réfugiés, y compris sur le plan financier. Cela ne me choque pas du tout, puisque l'Union européenne est déjà un des premiers donateurs du HCR au Liban, en Jordanie, et qu'il faudra vraisemblablement faire davantage encore. Il faut aussi mettre la Turquie devant ses responsabilités et essayer de tirer une contrepartie réelle qui ne soit pas sans rapport avec la question des réfugiés.
Enfin, je pense qu'on a fait preuve - à cause de nos divisions, mais aussi peut-être du fait que l'Allemagne s'est mise en première ligne dans cette affaire - d'une faiblesse à l'égard de la Turquie, qui pratique d'abord le rapport de force dans les relations internationales.
Selon une étude menée par Pew Research Center, les Britanniques, les Israéliens, les Américains, les Russes et les Turcs considèrent que la diplomatie doit avant tout s'appuyer sur la force plutôt que sur le dialogue. Ce sont là des tendances profondes de l'opinion qui démontrent bien, selon moi, que les valeurs entre la Turquie et l'Union européenne sont loin d'être partagées.
D'après moi, la Turquie n'est pas un pays sûr, mais ce n'est pas non plus un allié sûr pour l'Union européenne. Je pense que nous avons devant nous une question turque, d'autant qu'on s'est placé dans cette situation de dépendance.
Personnellement, je crois que nous avons commis une grave erreur collective à l'époque où nous avons ouvert des négociations avec la Turquie de manière un peu trop rapide, en fonction du principe selon lequel l'Union européenne, forte de ses valeurs et de sa richesse, pouvait exporter son modèle. En réalité, l'Union européenne ne doit pas se concevoir comme un modèle, mais comme un exemple.
La différence est pour moi importante : on pouvait exporter notre modèle tant que nous étions riches, prospères et que nous n'avions pas en face de nous une puissance comme la Russie ou un dirigeant comme le président Erdogan. Les relations internationales n'ont rien d'idyllique !
Je pense que nous aurions intérêt, même si cela passe par une crise, à revoir nos relations avec la Turquie pour en faire un grand partenaire privilégié, avec des accords signés, y compris sur les plans militaire et diplomatique, en essayant de partager quelques visions communes, plutôt que d'essayer de poursuivre dans cette voie qui risque de nous apporter beaucoup de déconvenues.
Voici, monsieur le président, l'état de nos modestes réflexions mais qui, je pense, répondent à vos questions.
M. François-Noël Buffet, président. - Merci pour la clarté de vos propos.
La parole est au rapporteur.
M. Michel Billout, rapporteur. - Le président Giuliani a déjà répondu à beaucoup des questions que je souhaitais lui poser, mais on peut essayer d'en approfondir d'autres, tout d'abord en prenant un peu des distances par rapport à l'accord spécifique entre l'Union Européenne et la Turquie - pour en revenir au problème migratoire d'un point de vue plus général.
Quelle est l'analyse de la Fondation Robert Schuman sur ce que beaucoup considèrent comme une crise migratoire ? Est-on vraiment face à une telle crise, qui aurait un début et une fin, ou sommes-nous plutôt face à un mouvement de longue durée - pour ne pas dire perpétuel, dans un environnement bien plus mondialisé que ce qu'il était auparavant ? On doit en effet tirer de l'analyse de cette question une politique en rapport avec le problème qui est posé.
S'il s'agit d'une crise migratoire provoquée par des conditions exceptionnelles liées à la situation de déstabilisation dans certains pays du Moyen-Orient, on peut décider de mesures transitoires, à caractère exceptionnel et limitées dans la durée, mais ce que nous cherchons à savoir, c'est si l'Union européenne n'est pas à la recherche d'un modèle d'accord qui pourrait se transposer à d'autres pays, avec d'autres problématiques qui consisteraient à essayer de faire traiter la question des migrations à destination de l'Europe par les pays voisins. On a là un premier essai avec la Turquie.
Une réflexion est en cours avec la Libye, qui se heurte à d'autres types de problème, notamment celui d'avoir un État qui n'est pas encore réellement constitué. On voit bien, dans les nouveaux mouvements migratoires, que la route de la Méditerranée, au départ de l'Égypte, s'ouvre à nouveau. Ne faudra-t-il pas, demain, avoir ce type d'accord avec l'Égypte, ce qui posera à chaque fois la question des contreparties et de savoir dans quel type de rapport de force on est amené à négocier, sous la contrainte d'un effet migratoire que l'Europe ne souhaite pas affronter ?
Par ailleurs, le droit d'asile est-il remis en cause en Europe ? À partir du moment où on traite du problème avec des pays que l'on peut qualifier de peu sûrs, je pense que le droit d'asile subit, en Europe, une perversion assez importante.
Ceux qui défendent cet accord - et c'était le cas de la conseillère de l'ambassadeur de Turquie que nous avons auditionnée avant vous - mettent en avant le fait que c'est un moyen d'augmenter les voies légales d'accès à l'asile et à la migration vers l'Europe, notamment à travers l'application du principe « un pour un », qu'on ne voit pour le moment pas se concrétiser. Quelle a été l'évolution des voies légales d'accès à l'asile et à la migration en Europe depuis une vingtaine d'années ? Peut-on affirmer, comme on l'entend parfois, que l'Europe s'est refermée ?
Enfin, quelle analyse faites-vous de la montée du populisme en Europe face à la crise des réfugiés, qui peut justifier que les vingt-huit États de l'Union européenne aient beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur une politique migratoire commune ? Peut-on parler d'un rejet des opinions publiques vis-à-vis du phénomène migratoire ?
J'ajoute que la question a été posée par la conseillère de l'ambassade de Turquie, qui a précisé qu'il n'existait pas en Turquie de problématique politique quant à l'accueil des réfugiés, à l'inverse de ce qui se passe en Europe.
M. François-Noël Buffet, président. - La parole est aux commissaires.
M. Jean-Pierre Vial. - Je voudrais prolonger la dernière question du rapporteur concernant le droit d'asile. On sait que la Turquie a régularisé environ 30 000 demandes d'asile, tout en campant sur la position qui consiste à considérer que, lorsqu'on accueille des gens comme les Syriens chez soi, on peut les mettre à la porte lorsqu'ils deviennent indésirables.
Dans votre présentation, vous avez évoqué l'interrogation des pays européens au regard de l'asile. L'Europe est-elle en mesure d'arrêter une position commune à ce sujet, ainsi qu'au sujet des frontières et de la migration, après la quasi-disparition de Schengen ?
Mme Gisèle Jourda. - On enregistre beaucoup de flux migratoires en provenance de l'Afrique subsaharienne. Du fait de l'accord passé entre l'Union Européenne et la Turquie, les routes vers l'Europe ont été fermées. Or, on a enregistré la semaine dernière 880 décès en Méditerranée. S'agit-il d'une conséquence liée à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie ? Ce type d'événements dramatiques sur le plan humain ne peut-il constituer un accélérateur de la mise en place d'unités de garde-côtes européens ?
M. Jean-Dominique Giuliani. - Vous avez raison, monsieur le rapporteur, on ne peut parler de crise migratoire. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une pression migratoire durable. Les chiffres les plus fantasques sont annoncés. Le ministre de la défense a affirmé que 800 000 personnes étaient prêtes à quitter la Libye pour venir chez nous. Certaines personnalités publiques parlent de 10 millions de personnes. Je n'ai pas réussi à trouver de chiffres fiables, mais vous êtes tout à fait dans le vrai - et je mets cela en relation avec la question de Mme Jourda : on n'a pas fermé la route de l'Afrique, on l'a détournée.
M. Leggeri, directeur de Frontex, a vu à Lesbos des ressortissants Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, arriver sur les côtes turques. Peut-être cet accord va-t-il limiter les choses, mais on retrouve en tout cas sur les îles grecques des ressortissants d'Afrique noire parlant le français, qui ont des problèmes avec les garde-côtes grecs qui, eux, ne parlent pas français, ou allemands, qui parlent anglais.
Je pense comme vous qu'il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une pression de longue durée. Quand on essaye d'étudier pourquoi, on s'aperçoit que la politique de développement de l'Union européenne et de ses États membres, qui est aujourd'hui la plus généreuse - Sénégal, université du Burkina Faso, où la France met beaucoup d'argent - ne suffit pas à fixer les populations. Souvent, les élites des États africains sont les premières à s'expatrier après avoir été formées.
Cela me paraît extrêmement inquiétant, car nous pensions que l'immigration touchait des personnes en difficulté, chassées pour des raisons ethniques ou parce qu'elles étaient les plus pauvres. C'est parfois le cas, mais pas uniquement. L'Europe attire. C'est peut-être le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre : elle est devenue le premier continent d'immigration du monde.
De mémoire, selon Eurostat, le nombre d'entrées sur le territoire européen représente chaque année 32 ou 36 millions de personnes. Selon l'ONU, plus de 72 millions de personnes résident plus de quinze jours sur le territoire de l'Union européenne chaque année - étudiants, hommes d'affaire, touristes, etc.
Entre 900 millions et un milliard de personnes passent par l'espace Schengen chaque année. Nous avions découvert ce chiffre quand j'étais à la Commission européenne auprès de Jacques Barrot, alors vice-président de la commission chargée de cet aspect des choses. C'est beaucoup, et l'Union européenne n'est pas prête à les gérer, les États membres n'ayant pas voulu d'une politique migratoire commune, estimant que ceci relève de leur souveraineté. Surtout, il n'existe pas d'accord sur une politique migratoire quelle qu'elle soit.
Les besoins différents des États membres, qui dépendent largement de la démographie, mais aussi du marché de l'emploi ou de la situation économique, voire peut-être de problème d'intégration, constituent aujourd'hui des facteurs de division en Europe, alors qu'ils pourraient être des facteurs de complémentarité. On sait que l'Allemagne a besoin, d'après son patronat, d'un million de travailleurs importés d'ici 2020. C'est un besoin identifié qui peut justifier une politique d'immigration plus ouverte. Ce n'est pas le cas de la France, qui a une démographie beaucoup plus active, et qui connaît une autre immigration venue d'Afrique noire traditionnelle et du Maghreb.
Il n'y a donc aucun consensus sur le contenu d'une politique migratoire. Les institutions européennes y incitent, mais cela ne prend pas du tout, du fait du refus de toutes les capitales et de tous les gouvernements qui, au-delà des déclarations, conduisent une politique conforme à leurs intérêts du moment - même le gouvernement allemand.
Vous avez raison de dire que l'idée de faire traiter la question migratoire par les autres découle de cette incapacité. Selon moi, elle n'a aucune chance de succès. Seule une politique offensive et imaginative peut le permettre.
Quelques exemples nous autorisent à ne pas désespérer. L'Espagne, il y a quelques années, était soumise à une pression migratoire très importante venue de Mauritanie, du Sénégal et du Maroc. Elle a engagé une politique double en s'ouvrant à une immigration légale nouvelle - avec des quotas, dont des quotas par profession, en exigeant un certain nombre de diplômes pour s'installer en Espagne en contrepartie d'une carte de séjour - et en recourant à une politique financière extrêmement généreuse à l'égard de ces États, assortie de l'obligation de reprendre les illégaux. Il faudrait interroger des autorités espagnoles plus qualifiées que moi, mais la chose est pour moi possible.
Les cas du Moyen-Orient et du Maghreb sont devant nous et apparaissent très préoccupants pour la France : imaginez une déstabilisation de l'Algérie ! On a vu ce que cela pouvait donner avec le « printemps arabe » en Tunisie. Il faudrait y réfléchir. Ceci va nous coûter extrêmement cher politiquement. Il va falloir accepter une immigration légale - et je ne vois pas, sur l'échiquier politique, de personnalités politiques capables de l'assumer devant l'opinion des différents pays. Sur le plan financier, nous allons par ailleurs devoir être bien plus généreux que nous ne le sommes.
Il ne s'agit pas de créer des camps de travail ou de réfugiés en Libye, au Mali, au Niger ou au Sénégal : il faut aussi donner un avenir aux personnes qu'on dissuade de choisir l'immigration. Tous les exemples mondiaux que nous avons en tête - Australie, États-Unis - ne sont pas positifs. L'Australie pratique en effet une politique de retour des réfugiés clandestins ou des immigrés irréguliers dans des conditions assez brutales que je n'imagine pas en Europe. Aux États-Unis, le thème du mur a repris du « poil de la bête » dans la campagne présidentielle.
Pour éviter les autres routes, comme l'Égypte, je pense qu'un partenariat avec ce pays, tel que le Gouvernement et le Président de la République l'ont engagé, est extrêmement intelligent, mais il faut aller beaucoup plus loin, quelle que soit la situation en termes de valeurs, de droits de l'homme, etc.
Je pense qu'une stabilisation de la situation en Libye serait extrêmement utile. Aujourd'hui, nous attendons, pour passer à la phase 3 de l'opération Sofia, une demande des autorités libyennes que nous n'arrivons pas à obtenir, pas plus qu'un mandat de l'ONU, du fait du blocage de nos partenaires russes, notamment. Ils sont « échaudés » par la guerre en Libye.
C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut essayer de travailler, en mettant beaucoup plus d'argent à la disposition de ces pays. Nous avons les structures, les ONG, le savoir-faire pour être présents dans ces pays si nous le voulons.
Oui, Monsieur le rapporteur, le droit d'asile, tel qu'il est dans les textes, qui est issu des années 1920, est remis en cause en Europe ! Le juriste que je suis considère que nous ne respectons pas les principes du droit d'asile qui, en France, figurent dans le préambule de la Constitution de 1946, et fait donc partie du bloc de constitutionnalité, sous réserve de vérifications.
Les voies légales d'accès à l'immigration sont doubles - ouvrir des possibilités d'immigration, les restreindre. Toutes les formules sont envisageables, comme les quotas, la restriction par profession ou provenance géographique, même s'il est choquant de parler ainsi. Il s'agit d'ouvrir des voies légales d'immigration en contrepartie d'une coopération des États qui nous envoient les immigrés.
Cela pose des problèmes avec l'Afghanistan, l'Érythrée, le Soudan. J'avoue que je n'ai pas de solution immédiate.
Quant au populisme, je ne dirais pas qu'il est la cause de l'euroscepticisme, ou que l'immigration est la cause du populisme. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Les populismes, en Europe, sont nés dans le courant des années 2000, avec l'apparition du parti de Pim Fortuyn aux Pays-Bas en 2002, lors du référendum français sur le traité établissant une Constitution sur l'Europe en 2005, ou après l'alliance des socio-démocrates autrichiens avec l'Alliance pour l'avenir de l'Autriche (BZÖ) en 2006.
C'est un problème général de démocratie représentative, qui trouve ses origines dans la manière de faire de la politique, la communication instantanée - Twitter, Facebook, etc. - face à la complexité des problèmes et à une mondialisation qui bouleverse toutes les idées reçues, ainsi que la façon de travailler.
En revanche, la question de l'immigration et des réfugiés est un accélérateur des populismes, vous avez raison. On le voit bien dans la campagne référendaire au Royaume-Uni, où les Britanniques, d'après les sondages, s'apprêtaient après un débat assez violent et vigoureux, comme ils les adorent, à être raisonnables et à ne pas voter contre leurs intérêts. Cependant, la question migratoire, on vient de le voir ces tout derniers jours avec les chiffres qui sont parus, a obscurci les raisonnements rationnels et risque de faire basculer l'opinion. Personnellement, je ne le pense pas, mais s'il existe un risque, il est bien là !
Les opinions rejettent donc l'immigration et, dans notre pays comme dans d'autres, on peut l'attribuer bien sûr à une immigration quantitative importante, mais aussi à des défauts d'intégration.
J'ai grandi à Marseille, au milieu des Arméniens, des jeunes Algériens, dont les mères n'avaient qu'un rêve : faire de leur fils des petits Français à part entière. Quand je retourne à Marseille, je ne reconnais plus ma ville. Bien sûr, l'immigration a augmenté mais, surtout, j'ai l'impression que l'on s'est trompé dans la manière d'appréhender l'immigration et l'intégration. C'est quelque chose qui nécessite plus d'autorité. Nous devons être plus fiers de ce que nous sommes et aider les populations à s'intégrer à ce que nous sommes. C'est en tout cas comme cela que le voyaient les familles algériennes. J'ai beaucoup travaillé dans les associations d'immigrés, avec mon père, qui était très engagé dans ce domaine. Ils rêvaient qu'on les aide à avoir des bourses, à faire des études, à devenir de bons petits Français, tout en gardant d'ailleurs leur religion.
Sur ce point, les parents ne mettaient jamais l'islam en avant. C'est peut-être ce qui explique que les enfants s'identifient de temps en temps à une certaine expression de leur religion, en rébellion contre leurs parents. C'est plutôt ce problème d'intégration, qu'on rencontre dans tous les pays d'Europe, qui contribue à accélérer un rejet de l'opinion et à accroître les réflexes populistes.
À l'Est de l'Europe, c'est différent. On le voit en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, en Hongrie. C'est un problème qui est compliqué par la question de la souveraineté, qui a été niée pendant très longtemps. Ils n'ont retrouvé que la moitié de celle-ci en entrant dans l'Union européenne. On ne peut les obliger à avoir une population immigrée, alors qu'ils n'y étaient pas intellectuellement préparés. On voit aussi ce que donnent les effets du totalitarisme sur les opinions publiques.
L'accord avec la Turquie est-il un exemple ? J'espère que non : vous avez compris que j'étais assez réticent et, en tout cas, assez sceptique. J'ai malheureusement peur que l'on agisse toujours un peu de la même manière et qu'on essaye de le reproduire si d'autres poussés migratoires venaient à se produire.
Je pense plutôt à l'exemple espagnol, avec une double politique : on ne ferme pas tout à fait la porte, et on s'engage en même temps sur le terrain ou dans la région de manière plus efficace.
La question des garde-côtes européens suscite chez moi beaucoup de scepticisme. Peut-être cela vient-il du fait que je suis officier de marine de réserve. Je sais que celui qui garde la côte est armé. En France, un garde-côte peut ouvrir le feu sur un trafiquant de drogue. Je n'imagine pas Frontex faire la même chose. Je qualifierais donc plus les garde-côtes européens de société européenne de sauvetage en mer, en l'état actuel du projet, que de véritables garde-côtes, capables d'exercer une activité souveraine à nos frontières - même si c'est une activité commune.
Je crois qu'on aurait mieux fait d'envoyer la marine française aider la marine grecque, les douaniers français, la PAF, les Allemands. Après tout, on peut leur prêter deux mille ordinateurs pour enregistrer les réfugiés. On ne l'a pas fait et on a eu bien tort !
M. François-Noël Buffet, président. - Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ?
M. Jean-Dominique Giuliani. - Parce que les gouvernements n'en ont pas eu l'idée !
M. François-Noël Buffet, président. - C'est inquiétant.
M. Jean-Dominique Giuliani. - En effet. J'ai eu ce débat à la télévision avec M. Cazeneuve. Je lui ai demandé ce qu'on faisait concrètement après avoir sauvé la Grèce pour la maintenir dans la zone euro. Il m'a dit qu'il avait envoyé des policiers, mais je pense qu'on aurait dû faire bien plus et que la France, l'Allemagne et quelques autres auraient dû passer une sorte d'accord avec le gouvernement grec et envoyer cinq mille policiers à leurs frontières pour qu'ils traitent correctement les demandes d'asile.
Enfin, sauver le projet européen nécessite une intégration par l'exemple. Je préférerais que ce soit la France et l'Allemagne qui le fassent et entraînent les autres. On a besoin de faire redémarrer le moteur. Cela résoudrait beaucoup de problèmes. Même les Hongrois ou les Polonais ne veulent pas sortir de l'Europe, pas plus que les Grecs, au plus fort de la crise. Ils ont l'impression qu'on n'avance pas et que, dans l'esprit de nos grands dirigeants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique, la question européenne passe après la question nationale, alors qu'elle en fait désormais partie, compte tenu de toutes les compétences que l'on a déjà déléguées.
Nous devons montrer l'exemple. Même s'il n'est pas conforme au droit communautaire, cela m'est personnellement égal - même si je suis partisan de la méthode communautaire. Plutôt que créer un corps comme Frontex, qui est tout à fait généreux, mais qui n'est pas un vrai corps de garde-côtes, on ferait mieux d'envoyer la marine allemande ou la marine française, les policiers britanniques, etc., aider nos amis grecs. Ceci aurait valeur d'exemple. Chaque fois qu'on a vraiment avancé en matière européenne, c'est lorsqu'on a su montrer la voie. Je constate que, pour des raisons politiques intérieures, aucun pays ne le fait, ce qui m'inquiète.
M. François-Noël Buffet, président . - L'intégration de la Turquie au sein de l'Europe, qui est une volonté forte de la Turquie, la remise en cause des négociations ouvertes il y a plusieurs années, dont les engagements allemands d'aujourd'hui, relèvent-ils d'une procédure particulière ? La décision peut-elle être prise sans formalisme particulier ?
M. Jean-Dominique Giuliani. - C'est une décision du Conseil européen, qui a entraîné des actes ayant une portée juridique. Ils appartiennent au droit positif, et créent des droits à l'égard de la Turquie, comme par exemple le droit au crédit de pré-adhésion, à l'accès à certains règlements ou à l'union douanière.
On ne peut s'en abstraire seul, mais rien n'interdit de réaliser une grande mise à jour, même si c'est délicat, dangereux et difficile, car je pense que l'on va à la catastrophe - et je le pense depuis très longtemps !
M. François-Noël Buffet, président. - J'ai cru comprendre que les visas biométriques étaient autorisés à partir du mois de juin...
M. Jean-Dominique Giuliani. - Les Turcs n'ont pas de visas biométriques. Il existe dans l'accord une période transitoire. La Turquie devait émettre des passeports provisoires sur lesquels figurent les empreintes et la photographie, comme sur nos anciens passeports. La Turquie doit s'engager en décembre à fournir des passeports biométriques conformes à ce que font Safran et Morpho.
Mme Gisèle Jourda. - J'en reviens à l'une de vos conclusions à propos de la politique européenne et du fait de « vouloir sauver » ce modèle en servant d'exemple.
La commission des affaires européennes du Sénat a travaillé sur la politique de sécurité et de défense. Vous dites qu'il conviendrait d'envoyer certaines de nos forces plutôt que Frontex. Placez-vous quelque espoir dans le futur plan de sécurité que va présenter Mme Mogherini ?
M. Jean-Dominique Giuliani. - Je vous enverrai l'étude que je viens de publier, qui est une remise en cause de tout ce que l'on dit et de tout ce que l'on entend. J'estime que la défense européenne n'existe pas, et que l'urgence est la défense de l'Europe !
Mme Gisèle Jourda. - Nous sommes d'accord !
M. Jean-Dominique Giuliani. - On a un peu tout mélangé, y compris dans le traité de Lisbonne, qui était un traité communautaire, dans lequel toutes les dispositions relatives à la défense sont intergouvernementales. Cela ne fonctionne pas. On a fait des battle groups de 1 500 personnes dont on ne s'est jamais servi.
Mme Mogherini va s'acharner à essayer de faire fonctionner ce dispositif avec l'aide de notre brillant compatriote Michel Barnier. Personnellement, je ne lui accorde aucune chance de succès. Il n'y a pas consensus, il existe trop de différences. Là encore, on touche au coeur de la souveraineté, d'autant qu'on est frappé par le terrorisme et que la France est en guerre, avec 20 000 militaires à l'étranger. Je pense qu'il faut faire preuve d'un immense pragmatisme, à la manière de Schuman et de Monet, comme je me suis permis de l'écrire, sans nier la réalité : la France et le Royaume-Uni sont à peu près les deux seuls pays à avoir une armée qui fonctionne. Il faut que l'on fasse en sorte que, lorsqu'ils agissent, ils le fassent de manière moins unilatérale, et qu'en contrepartie, ils aient un soutien effectif de leurs partenaires pour créer une solidarité de fait.
Je verrais bien, à long terme, l'Allemagne se réengager sur le terrain. La ministre allemande a annoncé une augmentation du budget de la défense et des effectifs pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale.
Le travail concret sur le terrain est le seul moyen de démontrer qu'il y a de l'« utilité » à cette solidarité pour rendre ensuite les choses possibles. Si vous interrogez nos militaires, ils vous diront qu'ils ont l'habitude de travailler avec leurs collègues européens, mais en tenant compte des inégalités de formation, etc. J'ai participé à la mission « Jeanne d'Arc » destinée à former les jeunes officiers, en essayant de débattre de l'Europe avec eux. Il y avait là beaucoup de ressortissants allemands, britanniques, etc. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ce qu'il faut, c'est ne pas se payer de mots et essayer de résoudre les problèmes.
J'entends mes amis pro-européens dire qu'il faut un « FBI européen » : commençons donc par travailler ensemble !
C'est pourquoi je parle d'intégration par l'exemple : donnons nous-mêmes l'exemple en intégrant la plus-value européenne pour répondre aux défis que nos dirigeants ont à résoudre, qui sont considérables, j'en suis conscient. À nous, ensuite, de le rendre public ou non, d'en faire une leçon ou non, d'ouvrir la porte aux autres. C'est ainsi que Schengen est né, à cinq. C'était tellement formidable qu'on l'a agrandi sans regarder les obligations que cela impliquait. Même la Norvège et la Suisse sont aujourd'hui dans Schengen.
Nous nous sommes laissé emporter par notre enthousiasme et notre confort en matière de défense, par notre richesse aussi. Nous en subissons maintenons les revers. La pression migratoire sera de plus à plus forte : à l'heure du téléphone portable, quand Mme Merkel se fait photographier sur Twitter avec un réfugié irakien, des masses se mettent aussitôt en route.
M. François-Noël Buffet, président. - Merci beaucoup.
Audition de Mme Catherine
Teitgen-Colly,
membre de la commission nationale consultative des droits de
l'homme
Mercredi 15 juin 2016
M. Jacques Legendre, président. - Je suis heureux d'accueillir Mme Catherine Teitgen-Colly, professeure de droit public à l'Université Panthéon Sorbonne-Paris 1 et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont elle a été vice-présidente de 2012 à 2015.
Nous conduisons une réflexion sur l'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie le 18 mars 2016, qui est plutôt une déclaration politique visant à formaliser des engagements réciproques entre les deux parties.
Nous souhaitons recueillir votre avis sur cet accord, qui a beaucoup heurté un certain nombre d'observateurs et d'acteurs, notamment humanitaires et de défense des droits de l'homme, dans la mesure où l'Union européenne paraît vouloir se soustraire, à travers le dispositif de renvoi, à ses obligations en matière d'asile.
En même temps, force est de reconnaître l'efficacité de l'accord, les flux entre la Turquie et la Grèce ayant été quasiment stoppés, ce qui constitue aussi une amélioration sur le plan humanitaire.
Pour lancer le débat, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la solidité juridique des dispositifs prévus par l'accord, en particulier le renvoi des demandeurs d'asile en Turquie ? Peut-on affirmer, au moins en théorie, que les régimes d'asile et de protection de la Grèce et de la Turquie sont, compte tenu des réformes et des aménagements qui leur ont été apportés récemment, désormais conformes aux standards européens ? Le régime de protection temporaire accordé par la Turquie en fait-il un pays d'origine sûr ou un pays tiers sûr ? Pourrez-vous, à cet égard, nous rappeler comment sont appréciés les critères de la directive « Procédures » qui permettent de déduire cela ?
Mme Catherine Teitgen-Colly, membre de la commission nationale consultative des droits de l'homme. - Je suis ici comme membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) qui, depuis longtemps, porte la plus grande attention aux travaux sur l'asile, tant en France qu'en Europe. Nous avons rendu de nombreux avis : sur des projets de loi - en novembre 2004 pour celui relatif à la réforme du droit d'asile ; en mai 2015, sur celui relatif au droit des étrangers en France - mais aussi sur des thématiques spécifiques - en juin 2011, sur les mouvements migratoires liés aux printemps arabes ; en juillet 2015, sur la situation des migrants à Calais ; sur la situation à Grande-Synthe, le mois dernier. Et nous allons rendre à nouveau un avis sur Calais, en juillet. Notre attention est donc constante. Afin de nourrir notre réflexion et de forger notre conviction, nous procédons à des auditions de parlementaires, de membres du Gouvernement, de représentants de l'Union européenne, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), etc., qui alimentent notre information, et nous nous rendons parfois sur place ; entre l'année dernière et cette année, nous nous sommes ainsi rendus à Calais, à deux reprises, et une fois à Grande-Synthe.
Notre vigilance ne date pas du début de la crise migratoire. Dès les années 1990, nous avons mis en garde contre une politique de repli, de fermeture aux migrations et au droit d'asile. La situation que nous connaissons est particulièrement grave, mais elle ne date pas d'hier. Migreurop, qui est un réseau européen et africain d'associations, a été créé au milieu des années 1990, et on estime à 30 000 le nombre de personnes mortes pour avoir entrepris la traversée de la Méditerranée depuis 2000. Un chiffre qui ne cesse de croître.
J'ai été entendue par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la mission d'information visant à évaluer l'efficacité des politiques d'asile en Europe, le 15 mars dernier, soit l'avant-veille de la signature de l'accord européen. J'ai tenu à attirer l'attention sur le geste exceptionnel d'Angela Merkel ; son « Wir shaffen das », qui marquait sa décision, en septembre 2015, d'accueillir 800 000 personnes, nous était apparu comme un sursaut essentiel pour une Union européenne reposant sur de vraies valeurs. Il signait pour moi un vrai réveil de l'Europe, au rebours de l'indifférence des autres Etats, dont la France, qui n'a pas pris la mesure de ce qui se passait.
Le lendemain de cette audition, la Commission consultative, réunie en assemblée plénière, a rédigé une déclaration à l'attention du Gouvernement, pour alerter sur l'accord en train d'être passé entre l'Union européenne et la Turquie. Cette déclaration, publiée le 17 mars 2016, reprenait les quatre points principaux de l'accord et dénonçait un certain nombre d'éléments.
J'ai dit que notre vigilance ne datait pas d'hier. Initialement, notre attention avait été attirée par les printemps arabes, susceptibles de provoquer, selon nous, des flux migratoires importants. Mais cette prévision s'est démentie, tandis qu'en revanche, les guerres civiles autour de la Méditerranée, en Syrie, en Irak, ont conduit au résultat que l'on sait : en 2015, selon le chiffre de l'office international des migrations (OIM), un million de migrants arrivés par mer en Europe, et 35 000 par voie terrestre, et 3 770 morts en route.
Sur 4 700 000 Syriens qui ont quitté leur pays, 2 700 000 sont en Turquie, 1 800 000 au Liban - ce qui représente 40 % de la population libanaise -, 650 000 en Jordanie, 250 000 en Irak et 150 000 en Egypte. Ce sont, pour la plupart, des demandeurs d'asile, et l'Union européenne a été sollicitée par 1 200 000 demandeurs en 2015, soit près du double des 625 000 demandes enregistrées en 2014. Comment ces demandes se sont-elles réparties au sein de l'Union ? En Allemagne, pour 442 000, soit un accroissement de 155 % ; en Hongrie, pour 175 000, soit un accroissement de 323 % ; en Suède, pour 156 000 ; en Autriche, pour 85 000, soit un accroissement de 233 % ; en France, pour quelque 75 000, soit un accroissement de 26 % ; en Belgique, pour 39 000 ; au Royaume-Uni, pour 38 000 ; en Finlande, enfin, pour 32 000. Mais plus significatif que ces chiffres bruts est le ratio de ces arrivées à la population des pays concernés. Un ratio qui se laisse corréler, bien que tous les pays ne réagissent pas de la même manière, aux réactions que l'on a pu voir naître dans la population. La Hongrie accueille 18 demandeurs d'asile pour 1 000 ressortissants, la Suède 17 pour 1 000, l'Allemagne 6 pour 1 000, la France 1,2 pour 1 000, le Royaume-Uni, 0,6 pour 1 000. Il n'est pas anodin de rappeler ces chiffres, alors que l'on entend dire depuis des années que l'Allemagne, la France et l'Angleterre sont les trois principaux pays d'accueil des demandeurs d'asile. Nous nous battons, à la CNCDH, pour que ces ratios soient mis en exergue.
En 2015, la France a donc reçu 75 000 demandes - 80 000 si l'on compte les demandes de réexamen -, au premier rang desquelles 5 000 en provenance du Soudan et 3 400 de Syrie. Au cours des cinq premiers mois de 2016, la Syrie est passée en tête, avec 2 967 demandes, tandis que les demandes en provenance d'Afghanistan, à la dixième place en 2015, remontent également. Sachant que 363 000 Syriens sont demandeurs d'asile, on voit que la France a accueilli, en 2015, moins de 1 % de la demande d'asile en provenance de ce pays.
Relevons également un taux moyen d'admission important en 2015, à 36 %, pour beaucoup au niveau de l'Ofpra, avec pour corollaire moins de recours devant la commission nationale du droit d'asile. Ce taux d'admission varie selon les pays d'origine. Les ressortissants les mieux protégés au titre de l'asile en France sont les Irakiens, avec 98 % d'acceptation, suivis par les Syriens, à 97 %, les Centrafricains, à 88 %, les Yéménites, à 82 %, les Afghans, à 80 %. On sait la situation catastrophique que connaît le Soudan, touché par une famine qui n'est que le fruit des événements politiques ; or 33 % des Soudanais seulement obtiennent l'asile en France. Quant à la demande, forte, du Kosovo, elle n'est admise qu'à 8,7 %.
Au total, le taux d'admission en France est devenu important, mais il reste inférieur au taux global en Europe. Sont concernées, en 2015, selon les chiffres du dernier rapport de l'Ofpra, 206 000 personnes. La CNDCH insiste : on est loin du problème « majeur » dont on entend parler, et du sentiment qui s'impose à l'opinion publique.
Etant entendu que l'on qualifie de réfugié ceux qui ont obtenu l'asile ou bénéficient de la protection subsidiaire, ce sont donc 206 000 réfugiés qui sont sous la protection de l'Ofpra. Or, depuis les années 1950, lorsqu'on a créé le système de l'asile en France, on a toujours été autour de 180 000 à 190 000 réfugiés reconnus. Le chiffre de 206 000 n'a donc pas lieu d'effrayer. Nous mettons en garde contre une tendance que l'on voit se déchainer depuis les printemps arabes, qui fait de la « crise migratoire » l'argument justifiant la frilosité de l'Europe et la remise en cause du droit d'asile.
L'Europe, pourtant, s'est engagée il y a près de vingt ans dans l'harmonisation des politiques d'asile. Elle s'est dotée, à travers plusieurs directives, d'un régime d'asile européen commun, mais le problème, c'est que personne ne veut le mettre en oeuvre. Partout il manque une volonté politique. Quand, en 1998, avec le traité d'Amsterdam, on intègre au droit de l'Union européenne les normes de l'espace Schengen, on a en mémoire la guerre en ex-Yougoslavie et le règlement anarchique, fait d'une multitude d'initiatives généreuses mais dispersées, de la question des réfugiés en provenance de la région. C'est ainsi que l'on prend le premier texte d'harmonisation de la politique d'asile dans l'Union, avec la directive « protection temporaire » en cas d'afflux massif, qui met en place un mécanisme pour accueillir des populations arrivant en masse de manière impromptue. On prévoit un accueil provisoire pour ces personnes, qui ont parallèlement la possibilité de demander l'asile en vertu des directives qui ont suivi : après cette directive ont été adoptées les directives « protection des demandeurs d'asile », « statut des bénéficiaires de l'asile » et, enfin, la directive « procédures ». Et l'on met en place, parallèlement, le règlement de Dublin, qui n'est que la traduction de la première convention signée à Dublin.
Alors que le mécanisme européen existe, avec la directive « protection temporaire », jamais les États n'ont fait pression auprès du Conseil pour qu'il soit mis en place, ce qui pose un vrai problème. On a, en lieu et place, une multitude de politiques d'asile nationales, chaque pays étant plus ou moins sollicité, puisque les demandeurs d'asile se tournent de préférence, comme cela est naturel, vers ceux où existe une vraie procédure de demande d'asile, une protection des demandeurs et un taux d'admission correct. Mais le problème, c'est qu'avec le règlement de Dublin, qui impose au premier pays par lequel le demandeur est arrivé de traiter la demande ainsi que le renvoi vers ce pays des demandeurs qui l'auraient quitté, il n'y a plus de choix possible du pays d'accueil. C'est un recul du droit d'asile, même si certaines dispositions du règlement de Dublin prévoient que les renvois entre pays doivent s'équilibrer - car ces dispositions extrêmement lourdes, et qui ne concernent au reste guère que 500 à 600 personnes par an, n'ont jamais fonctionné.
On aboutit ainsi, avant même ce que l'on appelle la crise migratoire, à des politiques très différentes d'un Etat à l'autre. On s'est mis d'accord beaucoup plus vite, au sein de l'Union, sur les procédures que sur le fond. Et ce désaccord sur le fond a cette conséquence que l'on n'apprécie pas de la même manière les critères de Genève tels qu'intégrés au traité de Lisbonne. Si bien que dans certains pays, le taux d'admission est quasiment nul, tandis qu'il est beaucoup plus important dans d'autres.
J'en arrive, de là, aux événements récents, à savoir les arrivées massives de septembre 2015, le cadavre du petit Aylan sur la plage de Bodrum, enfin la déclaration d'Angela Merkel sur la politique d'accueil de l'Allemagne. Le président Juncker fait alors appel aux Etats membres, il propose des quotas d'accueil par pays, en fonction de leur population et de leur richesse. Mais il se heurte à une fracture des pays d'Europe centrale et orientale, au premier rang desquels la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, regroupés dans le groupe de Visegrad. La France, quant à elle, se déclare prête à admettre 30 000 personnes par an sur deux ans - un chiffre loin d'être démesuré. Parallèlement, des hotspots sont mis en place en Grèce et en Italie - la Hongrie, qui devait en accueillir, les a refusés. L'idée est de disposer de lieux où, le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) étant présent, on aide les Etats à identifier les migrants, à enregistrer leurs empreintes dans le système Eurodac, à les informer sur leurs droits avant de les orienter vers un pays d'accueil. L'Europe tombe d'accord pour relocaliser 120 000 migrants, sélectionnés dans ces hotspots.
Cette sélection pose un premier problème : on fait un tri, dans les hotspots, entre les migrants, ce qui revient à rompre avec le principe d'universalité du droit d'asile, qui veut que l'on ne discrimine pas selon la nationalité : c'est écrit en toutes lettres dans la Convention de Genève. Et c'est pourtant ce que l'on fait : on considère que sont relocalisables les demandeurs en provenance de pays dont 75 % des demandeurs sont admis à l'asile. Si bien que les ressortissants de pays dont les demandes d'asile ne sont pas agréées à ce taux sont considérés comme ne méritant pas l'asile. Et cela, prima facie, puisqu'il n'y a pas d'examen individuel, hormis la recherche de nationalité.
L'Europe crée, parallèlement, en 2015, un corps européen de gardes-frontières, pouvant intervenir sans le consentement des Etats. Et l'on renforce Frontex, qui doit passer de 600 à 1 000 agents. Enfin, on institue un contrôle systématique des ressortissants de l'Union à l'entrée sur le territoire européen.
Ce mécanisme d'ensemble, mis en place entre septembre et décembre 2015, va se révéler difficile à mettre en oeuvre. Si bien que la Grèce, en prise aux difficultés économiques que l'on sait et saturée de demandeurs d'asile, passe un accord bilatéral avec la Turquie pour demander assistance aux forces de l'Otan en vue de la surveillance de l'espace maritime entre les deux pays. L'objectif est double : d'une part, soulager le pays en empêchant l'entrée sur son territoire et, d'autre part, poursuivre les passeurs. Moyennant quoi les bateaux de l'Otan peuvent intercepter en mer des bateaux de migrants qui se dirigeraient vers la Grèce, et les renvoyer vers la Turquie.
Face à cela, le HCR, au début de l'hiver, pousse un cri d'alarme : une crise humanitaire sévit dans les Balkans, une crise sanitaire se profile et il faut à tout prix mettre en place des structures de mise à l'abri. Dans le même temps, les pays se raidissent - les chiffres que j'ai mentionnés pour la Hongrie ne sont pas anodins. On voit se fermer des frontières, se mettre en place des contrôles filtrants entre la Slovénie et la Croatie, entre l'Autriche et la Slovénie, entre le Danemark et la Suède, tandis que l'Allemagne en vient à rétablir sa frontière.
J'en arrive à vos questions sur l'accord avec la Turquie. Vous savez que la Convention de Genève de 1951 ouvrait la possibilité de réserves géographiques et temporelles. On pouvait limiter la Convention aux ressortissants européens, et à des événements survenus en Europe avant 1951. La Turquie est signataire de la Convention, mais a retenu la réserve spatiale, si bien qu'elle n'applique pas la Convention aux ressortissants non-européens. Ce qui signifie que nous renvoyons des demandeurs d'asile vers un pays pour lesquels la Convention de Genève ne s'applique pas.
Et c'est bien pourquoi les réfugiés qui arrivent en Turquie, en l'absence de mécanisme leur permettant de demander l'asile, font tout pour passer en Grèce, au péril de leur vie. Sur un million de migrants, 820 000 y sont passés, dont 49 % de Syriens, 21 % d'Afghans, 9 % d'Irakiens, 4 % d'Erythréens. C'est dans cette situation qu'Angela Merkel, constatant, après ses déclarations de septembre 2015, que l'Europe ne faisait rien, s'organise seule. On a beaucoup entendu critiquer la position qui était la sienne, on a argué que l'Allemagne avait des intérêts propres, liés à son déclin démographique ou à des intérêts économiques, que sa chancelière cherchait à imposer son image dans l'Histoire, et j'en passe. Peut-être, mais de telles considérations ne poussent pas tout le monde à réagir comme elle l'a fait, et c'est pourquoi la CNCDH a salué cette initiative. Le problème, c'est qu'elle se traduit par cet accord du 18 mars 2016 avec la Turquie.
On m'objectera que l'idée n'est pas nouvelle. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une externalisation non pas des procédures, mais bien de l'asile même, dans un pays qui n'applique pas totalement la Convention de Genève. L'idée, il est vrai, a été d'abord été portée par le Royaume-Uni. En 2003, les Anglais veulent externaliser le traitement de la demande d'asile dans les pays d'origine - comme si cela était simple - ou à défaut, sur la route migratoire, via des centres de rétention destinés à trier les demandeurs d'asile prima facie, avec réinstallation de ceux qui peuvent demander l'asile sur le sol européen, et renvoi des autres dans leur pays d'origine. Et les Britanniques sont si pugnaces que la Commission européenne décide, en 2005, de programmes régionaux expérimentaux. L'idée n'est donc pas nouvelle, mais c'est bel et bien une rupture avec les engagements de Genève. Aucun pays n'ose dire qu'il ne veut plus de la Convention de Genève, parce que c'est politiquement impossible, mais on retire tout caractère concret au droit s'asile. Dès lors que l'on sélectionne les demandeurs d'asile sur leur nationalité, en donnant priorité aux Syriens et en laissant de côté les Soudanais ou les Pakistanais, alors que l'on sait que des problèmes dramatiques se posent dans ces pays, on rompt avec l'universalité du droit d'asile. Puis on en vient à externaliser l'asile vers la Turquie, avec l'idée, pour l'Union européenne, de soulager la Grèce et de lutter contre les passeurs tandis que, pour la Turquie d'Erdogan, c'est le moyen de redorer une image ternie non seulement en Europe mais jusque dans son pays - même s'il a gagné les dernières élections.
Côté Grèce, on ferme complètement l'entrée, avec un contrôle de Frontex et de l'Otan - c'est un des aspects de l'accord - et l'on reconduit, à partir du 20 mars, tous les nouveaux arrivants vers la Turquie, en prévoyant une réinstallation sélective, sous la forme d'un troc honteux du un pour un : un Syrien accueilli dans l'Union européenne contre la réadmission d'un migrant en Turquie. Un tel marchandage n'est pas supportable.
Cet accord a donné lieu à des réactions très fermes, non seulement des ONG mais de responsables politiques européens et internationaux. Le Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a fait part au Parlement européen de ses plus vives inquiétudes. M. Peter Sutherland, conseiller spécial des Nations Unies sur l'immigration, a émis des réserves sur un accord qu'il qualifie de « potentiellement illégal ». Pour le service juridique du Parlement européen, il s'agit d'un accord politique. Ce qui m'amène, avant d'en venir aux critiques juridiques que l'on peut opposer aux modalités de cet accord, aux problèmes juridiques que pose l'accord lui-même.
Premier problème, la perte du droit de demander asile. Or la Convention de Genève ne mentionne même pas le terme, tant, en 1951, il allait de soi. En France, ce n'est qu'à partir de 1985 que l'on commence à voir apparaître la notion de « demandeur d'asile » et que l'on inscrit dans les textes un droit de demander asile. Ce droit est également inscrit à l'article 18 de la Charte européenne des droits fondamentaux, et les quatre directives européennes que j'ai citées le protègent. Le droit d'entrée sur un territoire pour y demander asile reste implicite dans la Convention de Genève, mais constitue bien un principe juridique puisque le droit d'asile, droit fondamental, implique le droit de demander asile. Le Conseil constitutionnel l'a également rappelé en 1993.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme met en oeuvre un principe de non-refoulement, non pas au titre de l'article 33 de la Convention de Genève mais de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, disposant que nul ne puisse être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdit de renvoyer dans son pays un ressortissant qui pourrait y être exposé. Il existe aussi, depuis 2010, une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet. Le fait est que les Etats européens ont adhéré à ce principe de non-refoulement, puisqu'ils ont pris, en rédigeant leurs instruments, la Convention de Genève comme modèle.
Ajoutons que les expulsions collectives sont interdites aussi bien par le protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 19-1 de la Charte des droits fondamentaux. La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de sanctionner de telles expulsions.
Un mot, enfin, sur la notion de vulnérabilité. On renvoie, depuis le 20 mars 2016, en Turquie les nouveaux arrivants, mais en préservant les plus vulnérables. Pour moi, et c'est une idée que je défends becs et ongles devant la CNDH, la vulnérabilité est la discrimination dans les droits de l'homme. Il s'y mêle certes de la générosité, et il est vrai que les dernières arrivées offrent un tableau effrayant, où se mêlent des vieillards en fauteuil et des nourrissons. Mais est-il admissible d'avancer ce critère comme un argument de tri, alors que nous sommes loin d'être dans une situation où le bateau européen menacerait de sombrer - car qu'est-ce qu'un million de réfugiés au regard de la population et de la richesse économique de l'Europe ? Mais cela, personne n'ose plus le dire, car on brandit si haut le spectre de la « crise migratoire » que l'on ne sait plus raison garder. Nous avons cette capacité d'accueil, mais seule Angela Merkel l'a dit, et personne ne l'a relayée.
Quoi qu'il en soit, la violation de nos engagements internationaux est patente. On a certes pris la précaution d'introduire la notion de « pays tiers sûr » à côté de celle de « pays d'origine sûr ». Mais qu'est-ce qu'un pays « sûr » ? J'ai eu l'occasion de m'y pencher, en travaillant sur la directive « procédures ». Il faut adhérer aux conventions internationales sur les droits de l'homme ? Mais tout le monde y adhère ! - sauf peut-être les Etats-Unis... Tout pays, sur la base de ses engagements internationaux, pourrait se prétendre sûr. Et aucun, pourtant, ne peut se prévaloir de l'être : il n'est pas un pays européen qui n'ait été condamné pour violation plus ou moins grave de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En particulier la Russie et la Turquie. S'il y a un pays qui est dans le collimateur, depuis des années, de la Cour de Strasbourg, c'est bien la Turquie. Un pays qui ne progresse pas, et que l'on a pourtant failli inscrire, en France, dans la liste des pays d'origine sûrs, du temps que M. Éric Besson était ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. On s'apprêtait à faire entrer dans la liste des pays d'origine sûrs le premier pourvoyeur, depuis dix ans, de demandeurs d'asile ! Heureusement, cela n'a pas été fait. Mais, implicitement, on considère la Turquie comme un pays tiers sûr. L'article 33 de la Convention de Genève interdit le refoulement vers des pays où il existe des risques pour la vie ou la liberté ? Soit ! Qu'il suffise de déclarer que tel pays est sûr pour n'être plus en infraction ! Mais où est la sûreté en Turquie, tant au regard des condamnations qui y sont prononcées que des procédures d'asile ? Des procédures qui ont, paraît-il, été réaménagées, mais qui étaient en tout cas il y a peu encore complètement défaillantes. Bref, l'expédient est habile, mais c'est un expédient. Que reste-t-il du droit d'asile, dans tout cela ? Quand je pense au discours que l'on nous a servi sur la fin de l'Europe forteresse ! Jamais les frontières ne sont réapparues avec une telle force !
J'ajoute que l'on est aussi en infraction avec le règlement de Dublin : on ne respecte pas l'obligation pour tout pays d'accueil de traiter la demande, puisque la Grèce renvoie. On peut également s'interroger sur la licéité des interventions de l'Otan.
On accorde trois milliards d'euros, suivis de trois autres milliards d'euros, soit six milliards d'euros au total, à la Turquie pour assurer ce rôle. L'accord prévoit une dispense de visas à l'entrée dans l'Union européenne pour les ressortissants turcs. Mais on sait bien que la Turquie ne remplira jamais toutes les conditions pour bénéficier de cette exemption.
M. Michel Billout, rapporteur. - Merci de cette présentation très complète, qui répond largement à la question que je souhaitais vous poser sur l'adéquation de la déclaration du 18 mars avec les droits fondamentaux reconnus par la Charte européenne des droits de l'homme, les valeurs de l'Union européenne et, plus largement, le droit international.
Vous avez rappelé que l'idée de traiter le phénomène migratoire hors des frontières n'était pas inédite, puisque la Grande-Bretagne l'avait déjà avancée en 2003. Le renvoi de demandeurs d'asile potentiels s'est-il déjà rencontré ailleurs, par exemple en Australie ? Préfigure-t-il une évolution des accords de réadmission avec d'autres pays ? Je pense à la Libye, quand un Etat y sera effectivement constitué, ou à l'Egypte.
Vous avez rappelé que la Turquie était certes signataire de la Convention de Genève, mais lui appliquait une restriction géographique forte. La représentante de l'ambassade de Turquie, que nous avons entendue la semaine dernière, nous a indiqué que, certes, une restriction s'appliquait, mais qu'il existait des dispositions législatives en Turquie qui offraient un niveau de protection au moins équivalent, et que lever cette restriction n'apporterait rien de plus. Qu'en pensez-vous ?
Les hotspots, en Grèce, se transforment en des centres de rétention très fermés. Est-ce bien conforme au droit européen ? Comment la vulnérabilité des personnes retenues est-elle appréciée ? Selon l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, cette appréciation serait lacunaire ou, à tout le moins, ne serait pas systématique.
Mme Catherine Teitgen-Colly. - Y a-t-il déjà eu renvoi de demandeurs d'asile vers des pays tiers par des pays signataires de la Convention de Genève ? Oui, par l'Australie, pays à l'encontre duquel des plaintes ont d'ailleurs été déposées devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a rendu des constatations. Le système australien consistait à empêcher les demandeurs d'asile d'arriver jusqu'en Australie, en les renvoyant dans les petites îles alentour, où ils y étaient laissés dans des conditions déplorables.
On a aussi l'exemple des États-Unis, avec l'affaire du Haitian Council, qui a trait au renvoi, par les Etats-Unis, des demandeurs d'asile haïtiens arrivant en bateau. S'y est jouée une question d'interprétation de la Convention de Genève. Faut-il se diriger vers la terre ferme ou y avoir mis le pied pour que la Convention s'applique ? La Cour suprême des Etats-Unis a répondu par une interprétation extrêmement restrictive, qui a donné lieu à de nombreuses critiques. Seul un juge de la Cour a manifesté une opinion dissidente, fort intéressante, qui a d'ailleurs été reprise par un juge de la Cour européenne des droits de l'homme, manifestant clairement qu'à aucun moment, lors de l'élaboration, en 1951, de la convention, on n'a envisagé qu'il faille avoir franchi la frontière du territoire d'accueil pour demander l'asile. Au reste, dans le cas des aéroports, la France, qui a essayé de plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme que les zones d'attentes étaient des zones internationales qui n'étaient pas soumises au droit français, n'a pas eu gain de cause.
Il y a donc eu des précédents de renvoi, mais en contradiction flagrante avec les instruments internationaux. Une fois encore, la Convention de Genève, qui protège les personnes quittant leur pays parce qu'elles ont des craintes de persécution, pour l'un des cinq motifs qu'elle prévoit, comporte, pour les pays signataires, une obligation de ne pas refouler les intéressés avant de s'être assuré s'ils répondent ou non à ses critères.
L'accord avec la Turquie préfigure-t-il une évolution des accords de réadmission ? N'oubliez pas qu'il a existé un accord de ce type entre l'Italie de Berlusconi et la Libye de Khadafi, au prix d'un soutien économique et sans doute politique au régime libyen. Puis les événements ont pris le dessus et l'Etat libyen ayant disparu, il n'y a plus d'accord possible.
S'agissant des arguments de la représentante de l'ambassade de Turquie en France, n'oublions pas qu'elle s'exprime au nom de la Turquie. Il n'est pas étonnant qu'elle fasse valoir que la législation turque est largement protectrice. Je ne saurais le confirmer, mais si tel est le cas, si la Turquie a effectivement mis en place des instruments de protection relatifs à l'asile, pourquoi diable ne lève-t-elle pas sa réserve géographique à la Convention de Genève ? Car pour l'heure, la Turquie applique, certes, la Convention, mais aux seuls ressortissants européens - qui ne sont évidemment pas les premiers demandeurs d'asile en Turquie.
Vous vous interrogez sur les mesures de rétention à l'oeuvre dans les hotspots en Grèce. En France, on réserve pudiquement ce terme de rétention à l'aval. En amont, à l'arrivée des demandeurs d'asile, on les place en « zone d'attente », avant l'examen de la demande d'asile par l'Ofpra. Si ces zones d'attente sont loin d'être des zones de liberté, puisque la seule liberté qu'on y conserve, c'est de rebrousser chemin, en aval, se trouve les centres de rétention administrative, où sont placés les migrants, dont les demandeurs d'asile déboutés, en attente de renvoi.
Qu'en est-il en Grèce ? Les hotspots confirment l'idée que les demandeurs d'asile ne sont pas protégés. Les photos dont la presse nous a abreuvés sont proprement effrayantes. On y voit des gens, parmi lesquels des enfants, parqués comme des moutons derrière des grillages. Je ne vois pas ce qui justifie de mettre en rétention dans un espace fermé des personnes qui n'ont commis aucune infraction et qui ne sont pas en situation irrégulière. Or les enfermer, c'est les considérer comme telles, alors que la Convention de Genève retient deux grands principes cardinaux : le non-refoulement vers un pays à risque (article 33) et l'immunité pénale (article 31).
Comment est appréciée la vulnérabilité ? L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'en est inquiétée, ainsi que vous le rappelez. Nous avons eu, à la CNCDH, la même crainte, car la réforme de l'asile en France introduit ce critère de vulnérabilité. Nous avons travaillé avec France Terre d'asile et avons fait des recommandations, visant à mettre en garde sur les modalités d'appréciation de ce critère.
À mon sens, le principe même d'un critère de vulnérabilité est contraire à la Convention de Genève et à la Charte européenne des droits fondamentaux, et est d'autant plus difficile à mettre en pratique que l'on manque, sur place, de moyens humains.
Sur la procédure juridique qui a présidé à l'accord, un recours a récemment été formé par deux Pakistanais et un Afghan devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui met en cause sa validité et partant, celle de l'accord lui-même. De fait, indépendamment de tout le mal que l'on peut penser de cet accord en termes politiques - qui ne permet pas d'assurer notre devoir d'asile - et juridiques - en ce qu'il viole la Convention de Genève et la Charte européenne des droits fondamentaux - se pose un vrai problème de violation des compétences au sein de l'Union européenne. On a qualifié cet accord de « déclaration », et le service juridique du Parlement européen y voit un « accord politique ». Mais en vérité, c'est beaucoup plus que cela.
La Cour de justice de l'Union européenne devra d'abord se prononcer sur la recevabilité de ce recours. Les recours en annulation sont très encadrés. Ils peuvent être portés par un Etat membre, la Commission, le Conseil européen, le Parlement européen ou des personnes physiques ou morales, à condition qu'elles soient directement et personnellement concernées. Si ce cap de la recevabilité est passé, l'irrégularité de l'accord me paraît patente. Les accords de l'Union européenne avec un pays tiers sont très précisément réglés par le droit de l'Union européenne : ils sont, sur proposition de la Commission, soumis au Conseil qui doit les adopter à la majorité qualifiée, puis doivent être examinés et adoptés par le Parlement. Or, il n'y a pas eu proposition de la Commission européenne, le Conseil n'a produit qu'un simple communiqué et le Parlement européen n'a même pas été consulté. L'article 218 du traité n'a donc pas été respecté. Au fond, l'Union européenne est engagée par un accord en réalité bilatéral entre l'Allemagne et la Turquie.
S'agit-il véritablement d'un accord, objectera-t-on ? Qu'on l'appelle déclaration ou communiqué, ce qui compte, c'est son contenu ou son but. Il comporte des éléments juridiques, sous forme d'engagements réciproques, qui répondent aux canons posés par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 23 mars 2004 France contre Commission. On ne voit donc pas comment, si ce recours passe le cap de la recevabilité, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait ne pas invalider l'accord.
M. Jean-Pierre Vial. - Je reviens sur le critère de vulnérabilité. L'Allemagne fait son tri, nous ne le faisons pas, puisque nous nous en remettons à la déclaration de vulnérabilité du HCR. Depuis deux ans, je suis deux familles qui se trouvent au Liban et doivent être entendues par le HCR, mais dans un village chiite, alors qu'elles sont d'un village sunnite. Elles m'ont appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il n'était pas possible que les hommes s'y rendent. Je leur ai suggéré de faire descendre les femmes, et de préciser qu'elles procèdent ainsi sur ma recommandation. Cet exemple témoigne que les questions touchant à la vulnérabilité ne sont pas simples.
Vous avez évoqué la position de la Turquie à l'égard de la Convention de Genève. Il est vrai que la représentante de l'ambassade de Turquie nous a affirmé, lors de son audition, que la Turquie était un pays aussi sûr que la France, mais quand on interroge les responsables sur place, on se rend compte qu'ils ne considèrent pas les Syriens qui se trouvent chez eux comme des réfugiés : ils estiment qu'ils ne font que les accueillir. C'est une façon de se placer hors de la Convention de Genève.
Mme Catherine Teitgen-Colly. - Le cas que vous évoquez témoigne bien que les hommes de ces deux familles ont des craintes. Preuve que la vulnérabilité n'est pas facile à apprécier, et que ce critère est difficile à mettre en oeuvre : pour passer le test de vulnérabilité, les hommes ne peuvent pas descendre.
Pour moi, ce critère est ambivalent. Il va de pair avec la conception anglo-saxonne des droits de l'homme qui, plutôt que de s'énoncer en termes de droits, se fonde sur l'idée que les plus vulnérables méritent générosité ; une générosité qu'on leur octroie. Or, si droit d'asile il y a, c'est un droit qui vaut pour tout le monde. La CNCDH est farouchement attachée à ce principe d'universalité et d'indivisibilité des droits.
Les Turcs disent qu'ils ne font qu'accueillir les Syriens ? Ils considèrent en effet qu'en vertu de leur réserve territoriale à la Convention de Genève, c'est à eux à décider du traitement à réserver à ces personnes, dans le cadre de leur législation nationale. Le problème, c'est que l'Union européenne a mis en place un régime de droit d'asile très protecteur des demandeurs d'asile. Pour un demandeur d'asile, ce n'est pas tant le traitement de sa demande qui soulève difficulté. En France, l'arrivée de Pascal Brice à la tête de l'Ofpra a marqué une grande ouverture, et la CNDA est à l'écoute. Mais encore faut-il arriver à cette étape. Or, l'Europe n'a cessé, depuis vingt ans, de multiplier les obstacles à l'entrée, parce qu'elle a bien conscience que le droit d'asile, fondamental, emporte des obligations concrètes, et que l'on ne peut se contenter de laisser les intéressés avec un papier vert ou rose en main, mais dénués de toute protection. Il existe une importante jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le sujet, de nombreux arrêts du Conseil d'Etat, et une jurisprudence européenne, qui considèrent que le droit d'asile implique des obligations très concrètes : informer, donner accès à la procédure, doter éventuellement d'un conseil, héberger, etc.
Comment peut-on imaginer de renvoyer en Turquie les demandeurs d'asile qui se trouvent en Grèce, alors que le représentant du HCR nous disait en mars dernier que ceux qui s'y trouvaient déjà n'étaient pas même localisables ? Mais où sont nos obligations ? On ne peut pas penser l'asile comme l'immigration. J'ai été pendant quinze ans juge du HCR à la commission de recours des réfugiés, j'ai fait partie de la commission permanente chargée de mettre en place la réflexion juridique sur l'asile, et ces expériences ont forgé en moi une certitude : il faut cesser d'envisager cette politique de l'asile isolément. Tant que notre politique étrangère ne prendra pas cela en compte, on s'interdira de comprendre pourquoi on se retrouve avec des demandeurs d'asile en provenance de certains pays d'Afrique. Demandons-nous d'où cela vient. On ne vient pas de Bangui spontanément ! Et voyez la Turquie : c'est un pays prospère, qui attire beaucoup de migrants, mais son solde migratoire est négatif !
M. François-Noël Buffet. - Je comprends ce que vous dites sur l'application du droit d'asile, et les difficultés qui se posent dans les hotspots, mais compte tenu du volume de la crise migratoire, quelle solution préconisez-vous pour organiser le premier accueil sur le terrain, afin de déterminer ceux qui relèvent de l'asile de ceux qui n'en relèvent pas ?
Mme Catherine Teitgen-Colly. - L'un des objectifs est de mettre un terme à la prospérité des passeurs, mais s'il y a des passeurs, c'est parce que les frontières sont bloquées. Il ne faut pas attendre de voir apparaître des noeuds, comme en Grèce, pour s'interroger. Une Europe aussi riche, aussi prospère, ne peut se désintéresser du reste du monde. On va avoir des réfugiés climatiques, on le sait. Cela suppose une politique environnementale à la hauteur. Vous me direz que je remonte au général, mais il est très important de s'en préoccuper. Car c'est aux sources qu'il faut s'attaquer. Et il faut prévoir des voies d'immigration légales, sans lesquelles des goulots d'étranglement apparaissent inévitablement.
Vous évoquez l'ampleur de la crise mais encore une fois, un million de réfugiés, ce n'est pas énorme. Il est juste cependant de souligner, comme l'a fait Angela Merkel, que la crise migratoire n'est pas finie.
M. François-Noël Buffet. - On le verra en 2016 !
Mme Catherine Teitgen-Colly. - Elle a raison : tant que l'on n'aura pas réglé les problèmes politiques énormes qui secouent les pays concernés, on n'en viendra pas à bout.
M. François-Noël Buffet. - Au-delà de la Syrie, le reste représente des volumes énormes.
Mme Catherine Teitgen-Colly. - On règlerait déjà le problème de la Syrie, celui de l'Irak, celui de quelques pays africains, comme le Soudan, par une politique étrangère cohérente, sans faire passer les intérêts économiques de la France par-dessus certaines règles internationales... Certains pays vivent une telle terreur et une telle confiscation du pouvoir que cela provoque inévitablement des demandes d'asile. Nous avons reconnu à toute personne le droit de quitter son pays, cela suppose d'organiser aussi le droit d'arrivée.
Les réfugiés sont aujourd'hui en Grèce. Alors que l'Europe a mis en place depuis vingt ans un régime d'harmonisation, le Conseil européen juge qu'il est hors de question de le mettre en oeuvre ! Moyennant quoi, on ferme nos frontières et l'on décide d'une procédure sélective a priori alors que chaque pays serait en mesure de distinguer entre ceux qui sont éligibles à l'asile et les autres, en les faisant passer devant les instances compétentes. Une personne qui fuit ne peut produire aucune preuve - et c'est d'ailleurs pour cela que quelques terroristes ont pu s'infiltrer dans le lot. Ce n'est pas quand on sort d'une barque avec un enfant dans les bras et un grand-père à ses côtés que l'on peut prouver quoi que ce soit.
M. François-Noël Buffet. - Je vais être un peu vigoureux, mais la Grèce a vu passer 820 000 migrants, dont plus de 500 000 par la seule île de Lesbos. On ne peut pas laisser entrer les gens sans entreprendre, à un moment donné, de s'organiser - et l'Europe l'a malheureusement entrepris avec retard. Dans les hotspots, tous les services sont là, et le travail est fait par des gens compétents. Il faut le dire. Il y a des gens de l'Ofpra, des gens de Frontex venus de tous les pays d'Europe.
Vous nous dites qu'il faudrait laisser entrer tout le monde, charge à chaque pays de traiter les demandes. Une telle façon de faire poserait un vrai problème. Les hotspots ne sont peut-être pas parfaits, mais ils ont le mérite d'exister. Ceux qui ont franchi la première étape n'y restent que deux à trois mois, et les autres repartent librement, munis d'un laisser-passer.
Mme Catherine Teitgen-Colly. - Je ne fais pas d'angélisme, car nous sommes en effet face à un problème, mais je m'interroge sur les raisons pour lesquelles on a laissé ce problème arriver. En Europe, la politique de l'asile et des migrations a été laissée pour compte, et l'on se retrouve aujourd'hui face au noeud. Je ne remets nullement en cause le travail admirable de l'Ofpra, du HCR, de Frontex sur place, ni la gravité de la situation à Lesbos. Mais je me demande comment il se fait que l'on n'ait pas fait, pour la Syrie, ce que l'on a fait, naguère, dans le Sud-Est asiatique, pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, où loin d'attendre que les gens arrivent chez nous par leurs propres moyens, à leurs risques et périls, on est allé les chercher, en nombre, et on leur a accordé le statut de réfugiés. Pour les Syriens, on n'a rien fait de tel. Et personne n'a rien dit, en vertu d'une sorte de préjugé à leur encontre. La première chose à faire, au lieu de laisser les gens tomber dans l'esclavage en Libye pour se procurer des passeports, aurait été de mener une opération politico-humanitaire, d'aller les chercher, et de les répartir en Europe. C'est la proposition Juncker, qui, toute modeste qu'elle fut, puisqu'il ne s'agissait que de répartir 120 000 personnes, a été rejetée. Résultat, on se retrouve avec 750 000 personnes en Grèce, Etat dont l'économie est déjà gravement menacée. Moyennant quoi, on passe un deal avec la Turquie, qui va coûter six milliards d'euros, qui prévoit d'assouplir la politique des visas pour ce pays, ce qui ne marchera jamais, et qui relance le processus d'adhésion. Cette question de l'adhésion a toujours divisé, certains s'y montrant radicalement hostiles, quand d'autres y voyaient une bonne idée - peut-être aurait-il fallu le faire lorsque c'était le moment : je rappelle que la Turquie est un des premiers pays membres du Conseil de l'Europe. On ne l'a pas fait, pour des raisons qui sont avant tout de politique interne. Et à présent, le problème est là.
M. Jacques Legendre, président. - Nous vous remercions pour toutes ces précisions.
Audition de M. David
Skuli,
directeur central de la police aux frontières du
ministère de l'intérieur
Mercredi 15 juin 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir M. David Skuli, directeur central de la police aux frontières du ministère de l'intérieur ainsi que M. Serge Galloni, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté.
Monsieur le directeur, nous souhaitons recueillir votre point de vue sur l'accord passé le 18 mars dernier entre l'Union européenne et la Turquie, qui incontestablement a permis d'enrayer les flux entre la Grèce et la Turquie.
À quoi tient principalement son efficacité, selon vous ? Pensez-vous qu'il puisse tenir ou reste-t-il une solution temporaire ? Êtes-vous confiant dans la volonté de la Turquie de coopérer avec l'Union européenne pour la gestion des flux migratoires ?
Un certain nombre d'agents de votre direction sont déployés en Grèce. Quelle est précisément leur contribution et quelles informations vous parviennent par leur intermédiaire ? Leur cadre d'intervention est-il lié à celui de l'agence Frontex ?
Coopérez-vous également avec la Turquie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord ? Si oui, de quelle manière ?
Enfin, de manière plus large, comment votre direction participe-t-elle à la coopération avec les pays tiers, qui constitue aujourd'hui un volet stratégique car, on le sait, il convient aussi de traiter à la source la question de l'immigration irrégulière ?
Monsieur Skuli, je vous cède la parole pour une dizaine de minutes. Je passerai ensuite la parole au rapporteur de la mission sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, M. Michel Billout.
M. David Skuli, directeur central de la police aux frontières du ministère de l'intérieur. - Merci de me recevoir. Je suis accompagné de M. Serge Galloni, qui me représente au sein de l'agence Frontex, avec laquelle nous sommes impliqués dans la crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés.
Vous avez listé une série de questions. J'essaierai d'y apporter des réponses du point de vue de la direction centrale de la police des frontières, qui regroupe onze mille fonctionnaires placés sous mon autorité, en métropole et dans les territoires ultramarins.
Une des missions essentielles de la police aux frontières, dans le moment où nous sommes, consiste à gérer le rétablissement du contrôle aux frontières et les problématiques de passage frontalier, mais surtout à traiter de la lutte contre l'immigration irrégulière et le démantèlement des filières. À cela s'ajoutent d'autres missions liées à la sûreté aérienne ou, le cas échéant, à la police des transports.
L'accord entre l'Union européenne et la Turquie a été signé le 18 mars et mis en application le 20 mars. Ses premiers effets, pour ce qui est de la police aux frontières et de nos collaborateurs envoyés en Grèce, se sont fait sentir à partir du 4 avril. Force est de constater que cet accord a eu un effet immédiat significatif.
Les précédents orateurs vous l'ont indiqué : il existe plusieurs voies d'entrée dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen, parmi lesquelles la voie de la Méditerranée orientale. Les chiffres du 9 juin recensent 160 314 migrants, soit plus de 140 % par rapport à la même période l'année dernière. En Méditerranée centrale, on en est à environ 50 533 à la même date, chiffre en perpétuelle évolution. On constate un léger tassement par rapport aux mêmes périodes de l'an dernier. L'intensité est différente en Méditerranée centrale lorsqu'on examine les chiffres au fil des mois, puisqu'on enregistre une légère baisse de 2 %.
La route des Balkans reste importante : 116 000 y ont été recensés entre le 1er janvier et le 9 juin, soit plus 131 % par rapport à la même période de référence en 2015. La Méditerranée occidentale, qui comprend les enclaves de Ceuta et de Melilla et le détroit, enregistre quant à elle une baisse de 87 % en comparaison des 5 premiers mois de l'année 2015. Les flux migratoires, sur cette voie, ne sont donc pas importants.
À ce jour, la Méditerranée orientale, si on compte les données chiffrées, restent la première voie d'entrée sur le territoire de l'Union européenne.
À partir de l'accord signé le 18 mars et appliqué le 4 avril, on a relevé une décrue extrêmement forte, presque un tarissement. On était à un chiffre compris entre huit cents et neuf cents arrivées par jour durant l'hiver, de la fin 2015 au début de 2016. Nous sommes aujourd'hui en Grèce entre cinquante et quatre-vingt-dix arrivées par jour dans les hotspots implantés sur les principales îles grecques.
Sur un plan typiquement policier et purement opérationnel, on peut dire que l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie a eu un effet immédiat sur les filières, puisque des retours « systématiques » vers la Turquie ont été annoncés, même si l'on peut considérer à ce jour que ceux-ci sont assez faibles - quatre cent quarante-neuf migrants. La majorité n'étant d'ailleurs pas syriens.
Cet effet s'est fait sentir, les réseaux d'immigration irrégulière ayant réorienté les filières, bien que l'on ne puisse pas encore affirmer qu'il existe un transfert de la route de la Méditerranée orientale vers la Méditerranée centrale. Les hotspots, en Grèce, qui génèrent quelques difficultés, sont devenus des sortes de centres de rétention administrative, alors qu'ils étaient auparavant des centres de passage. On a contribué à aider les Grecs sur ce point. Je rappelle que deux des terroristes qui se sont fait exploser au Stade de France étaient probablement passés par ces hotspots pour rejoindre ensuite le lieu de leur méfait.
La France a bien sûr mobilisé des moyens très importants pour participer, avec l'Allemagne, en vue de la bonne application de cet accord. Ces moyens se sont traduits par l'envoi d'officiers de la police (dont une vingtaine de la DCPAF) et de la gendarmerie nationales (une soixantaine par mois), notamment dans les hotspots, en Grèce et en Italie (la Grèce compte cinq hotspots, l'Italie en compte six). Ainsi, nous sommes présents dans les deux pays. Frontex nous a demandé depuis peu de nous réorienter vers l'Italie, la route de la Méditerranée centrale enregistrant des augmentations significatives, qui se répercutent ensuite sur notre frontière Sud, celle des Alpes-Maritimes. Nous y avons des screeners, des debriefers, et des personnels que nous encadrons pour l'assistance à la prise des empreintes digitales dans les bornes Eurodac.
À cela s'ajoute une contribution française tout à fait significative d'escorteurs. Le Président de la République avait annoncé une contribution française de deux cents escorteurs. Finalement, les besoins de Frontex ont été moins importants. On en a d'abord projeté cent vingt-deux. Un total de soixante-et-onze escorteurs, composés de policiers, de gendarmes et de personnels de la préfecture de police est susceptible d'être projeté en Grèce pour servir à des escortes vers la Turquie, en fonction du besoin, sous soixante-douze heures.
Selon les personnels sur place, les problèmes que nous rencontrons dans l'application de cet accord concernent le système de l'asile. Nombre de migrants qui arrivent sur les îles grecques - et même ceux qui sont déjà sur place - déposent systématiquement une demande d'asile, dès lors qu'ils savent qu'ils peuvent être renvoyés vers la Turquie, poussés en cela par les différentes associations qui demeurent. Certaines, en raison des conditions sanitaires qui sévissent dans les hotspots, ont quitté les îles grecques.
La législation grecque en matière d'asile a été modifiée en avril dernier. Il fallait auparavant plus de dix mois pour traiter une demande. Le délai théorique est maintenant de quatorze jours. C'est fort impressionnant, je pense que l'administration grecque n'est pas en mesure de traiter toutes les demandes d'asile, malgré l'aide de l'agence European Asylum Support Office (EASO).
Il y a dans la capacité à traiter ces demandes un véritable enjeu. Un des piliers de l'accord veut que l'on renvoie un Syrien en Turquie et que, en contrepartie, on réinstalle dans un pays de l'Union européenne, un autre ressortissant syrien afin de favoriser les conditions d'entrée légale dans celle-ci. La problématique de l'asile risque donc de handicaper l'accord.
Par ailleurs, se pose le problème des relocalisations qui, à ce jour, n'est pas complètement réglé. Force est de constater que cet accord a mis un coup d'arrêt très net aux flux sur la route de la Méditerranée orientale. Il ne faudrait toutefois pas, à la faveur de ratés, que le mouvement migratoire reparte. Les Turcs ont, à l'occasion de cet accord, renforcé la surveillance de leurs côtes, et nous coopérons beaucoup.
Je reviens d'Ankara, où j'ai eu l'occasion de dialoguer à plusieurs reprises avec eux et le chef de l'OCRIEST s'est également rendu en Turquie dans le cadre de la mise en place d'un service turc similaire à l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST). Izmir et Bodrum sont en effet des lieux classiques d'embarquement vers les îles grecques. Les Turcs, à l'occasion de ratés ou de difficultés, ont relâché la surveillance de leurs côtes et ont permis à la « pompe » de se réamorcer, laissant le flux migratoire repartir vers les îles grecques.
Nous constatons une réactivation des flux en Méditerranée centrale. Même si on est toujours, en volume, sur une baisse de 2 %, je pense que l'on aura un chiffre positif d'ici peu de temps. On constate en effet que les arrivées en Italie sont importantes : on est passé d'environ cinquante à soixante interpellations à la frontière franco-italienne à Menton de migrants par jour à des niveaux compris entre cent et cent cinquante.
Les migrants arrivent par l'Italie, puis les mouvements s'amorcent vers notre territoire et prennent la direction du Nord pour s'agglutiner à Calais ou monter encore plus haut, vers les pays d'Europe du Nord.
Tous les services de renseignement le disent : trente-cinq mille migrants sont potentiellement en instance de départ, principalement de Libye, car tous les départs de Méditerranée centrale s'opèrent à 90 % de ce pays, et un peu d'Égypte et de Tunisie. Il y a fort à parier que les filières actives en Méditerranée centrale vont essayer de faire passer beaucoup de migrants, avec un risque supplémentaire venant de Libye, l'introduction de personnes pouvant peu ou prou être liées aux organisations terroristes comme Daech.
Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Selon ce que je viens d'apprendre, le process de libéralisation des visas, qui devait trouver son terme en juin 2016, va se poursuivre jusqu'en octobre, voire novembre, les soixante-douze critères auxquels la Turquie doit répondre n'étant pas complètement atteints. Le ministre turc compétent a bien compris que, concernant la libéralisation des visas, l'accord connaîtrait un peu de retard.
M. Jacques Legendre, président. - Vous avez parlé de trente-cinq mille migrants en attente en Libye. Nous avons reçu récemment un autre responsable qui nous a parlé de chiffres plus importants, de l'ordre de cinq cent mille personnes. Pouvez-vous nous préciser ce point ?
M. David Skuli. - J'aurais pu annoncer un chiffre de huit cent mille, mais celui-ci est basé sur des estimations peu précises. Le chiffre de trente-cinq mille correspond à des estimations assez fines de personnes ayant été repérées et qui sont prêtes et pourraient donc débarquer dans les jours à venir sur les côtes italiennes, sachant que les migrants venant par la voie de la Méditerranée centrale sont issus d'Afrique de l'Ouest - Nigérians, Gambiens, Sénégalais l'Afrique de l'Est venant bien entendu grossir ce flot.
M. Jacques Legendre, président. - La parole est au rapporteur.
M. Michel Billout, rapporteur. - Les membres de la mission s'interrogent beaucoup sur les raisons d'une efficacité aussi foudroyante de l'application d'un accord entré en vigueur le 20 mars, avec des effets enregistrés dès le 4 avril. En quinze jours, c'est quasiment miraculeux !
Nous interrogeons régulièrement les personnes que nous auditionnons. Nous avons reçu trois types de réponse. Celle de la représentante de l'ambassade de Turquie en France était assez intéressante : elle nous a indiqué qu'il s'agissait d'un effet psychologique. La frontière étant dorénavant fermée, on sait qu'en partant en Grèce, on sera immédiatement refoulé vers la Turquie. On ne vient donc plus...
D'autres, dont vous faites partie, nous indiquent qu'il y a eu un regain d'efficacité des forces de police et des forces militaires turques, qui ont mieux contrôlé leurs frontières.
Un universitaire turc que la commission des affaires étrangères a auditionné ce matin, qui est vice-président de la Sorbonne, nous disait que ceci était sans doute lié à la communication faite autour de cette mesure et à une plus grande fermeté.
Quelle est votre analyse ? Faut-il craindre un retournement d'attitude de la part des forces de sécurité turques si la négociation sur l'application des contreparties avec l'Union européenne devait traîner en longueur ? Vous avez fait référence à la négociation sur les visas, dont la date butoir est fixée à la fin du mois de juin. On a parlé d'octobre, et l'on comprend bien que c'est encore compliqué. En cas de réticences, le président Erdoðan évoque le fait que la Turquie pourrait ouvrir à nouveau les vannes. Faut-il le craindre ou constatez-vous un véritable travail de démantèlement des réseaux de la part de vos partenaires turcs ?
Quant aux autres routes, l'universitaire que nous avons auditionné ce matin considère que la majorité des 2,5 millions de réfugiés syriens et irakiens actuellement en Turquie est destinée à y rester. Il pense toutefois que, quoi qu'il arrive, un million d'entre eux désirera toujours gagner l'Europe, et plus particulièrement l'Allemagne, l'Autriche et la Suède, et estime que, tôt ou tard, d'autres routes seront empruntées.
Les informations que nous avons aujourd'hui et que vous confirmez démontrent que ces nouvelles routes ne sont pas encore significativement repérées. On a parlé de l'Albanie ou de l'Égypte : y en a-t-il d'autres ?
Concernant les flux illégaux de migrations constatés, détectés ou évalués aux frontières françaises, constatez-vous une différence depuis la fermeture de la route des Balkans et la mise en oeuvre de l'accord du 18 mars entre l'Union européenne et la Turquie en fonction des origines ? J'ai cru comprendre que oui.
Qu'en est-il enfin des flux en provenance d'Italie ? L'augmentation récente de ceux en provenance de Méditerranée centrale se traduit-elle par une augmentation des flux secondaires vers la France ? Enfin, quelle procédure la police aux frontières applique-t-elle en ce qui concerne les mineurs isolés étrangers ou supposés tels quand ils arrivent aux frontières de notre pays ?
M. David Skuli. - S'agissant de l'efficacité de l'accord, on dénombrait en janvier dernier 67 400 arrivées sur les îles grecques, 57 000 en février, 26 000 en mars, avant une rupture en avril avec 3 650 personnes, puis 1 400 en mai et encore moins en juin.
On enregistre chaque mois des fluctuations, mais les chiffres baissent.
Par ailleurs, la frontière gréco-macédonienne a été fermée le 9 mars. On apprécie d'ailleurs la solidarité des pays européens, puisqu'on veut laisser en Grèce les cinquante mille migrants qui s'y trouvent ! On ferme la frontière, on envoie du monde sur les îles pour que les hotspots deviennent de gros centres de rétention administrative, et cela crée des difficultés, avec des troubles à l'ordre public assez significatifs, à tel point que de nouvelles filières se sont recréées entre les hotspots et le territoire continental grec. Il existe donc une tension du fait de la présence de migrants dans ces îles, comme à Lesbos.
Même si la population grecque est sympathique, les conditions de vie offertes aux migrants ne sont pas toujours faciles. On l'a vu lors de l'évacuation du camp d'Idoméni.
Cette fermeture de la frontière gréco-macédonienne a constitué un signal. Certains pays européens, notamment la Pologne, sont venus aider les garde-frontières macédoniens. Plusieurs pays ont renforcé leurs procédures de contrôle.
Il faut noter la très forte pression exercée sur les autorités turques. J'ai accompagné notre ministre de l'intérieur en Grèce et en Turquie. Il a été très clair en indiquant qu'il existait réellement des failles. On voyait à Bodrum une inaction quasi totale des garde-côtes turcs. Les Turcs l'ont finalement compris, sans compter qu'il existait également un accord de réadmission entre la Grèce et la Turquie. Cet accord de réadmission s'est jusqu'à présent traduit par un nombre insignifiant de réadmissions. Il ne fonctionnait donc pas.
L'accord officiel a été assorti de facilités - nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion, possibilité d'accorder aux Turcs la libéralisation des visas. Financièrement, ce n'est pas non plus un accord neutre. Les garde-côtes que j'ai rencontrés en Turquie avaient reçu des instructions très fermes pour mettre un terme à la situation. Il y a même eu un cas significatif où des migrants arrêtés à la limite des eaux territoriales ont été récupérés par les Turcs, qui les ont ramenés en Turquie, ce qui était inédit.
Grâce à l'ensemble de ces facteurs, on peut dire qu'on a aujourd'hui une forme de tarissement des flux.
Va-t-il durer ? J'en arrive à ce stade à la question de la réversibilité. Je ne suis pas dans les négociations entre l'Union européenne et la Turquie. Je pense que le thème des visas est extrêmement important pour les Turcs, mais l'Union européenne est également ferme sur les soixante-douze critères, qui semblent un peu compliqués, on le voit avec la levée de l'immunité de certains parlementaires. On pourrait imaginer, si les négociations n'aboutissent pas, que les Turcs, qui ont déjà reçu beaucoup d'argent pour accueillir les réfugiés, relâchent un peu leur vigilance et que des migrants arrivent régulièrement sur les côtes grecques.
Le partenaire turc a fait quelques efforts, puisque deux services de lutte contre l'immigration régulière ont été créés, l'un dans la police, l'autre dans la gendarmerie. Nous nous sommes déplacés entre le 2 et le 4 mai dans le cadre d'une mission, après la création d'une structure turque, à l'instar de la structure française en charge de toute problématique du démantèlement des filières.
À la suite d'opérations menées à Istanbul, où près de mille passeports français avaient été retrouvés chez des trafiquants, les Turcs nous ont communiqué l'ensemble des informations relatives à cette affaire, ce qui était quasiment impossible il y a plusieurs mois.
Nous avons donc reçu des gages qui démontrent que la Turquie fait des efforts sur ses côtes et essaie d'avoir une relation de coopération normale avec les services européens, notamment le nôtre. La Turquie a aussi accepté de coopérer avec Frontex. Depuis peu, un officier de liaison de l'agence est installé en Turquie et a pour mission d'analyser les flux par voie maritime ainsi que d'apporter une forme de coopération à la Turquie.
Par ailleurs, on peut dire aujourd'hui que la Turquie est un partenaire avec lequel nous avons, depuis mai, une coopération en termes d'informations. J'ai reçu dans mon service des officiers turcs de cette structure de démantèlement des filières, et j'ai eu l'occasion d'envoyer des officiers français sur place à deux reprises. Nos demandes de renseignements sont absolument prises en compte.
Nous avons également travaillé avec les Turcs sur un programme lié à la lutte contre la fraude documentaire. Nous allons le développer.
S'agissant des autres routes migratoires, on peut dire aujourd'hui que celle de la Méditerranée orientale est fortement freinée - ce qui ne veut pas dire que cela durera tout le temps. On ne constate pas de report systématique entre le frein que nous observons dans les flux en provenance de Turquie et les arrivés par la Méditerranée centrale. Il n'empêche qu'il existe une légère progression dans cette zone. Les conditions météo se sont tout d'abord améliorées. Les trafiquants ne font le plein d'essence des bateaux que pour arriver à la limite des eaux territoriales, où les migrants sont immédiatement récupérés. La thématique du sauvetage est donc assez prégnante.
Je rappelle que la Libye est toujours un État déstabilisé et qu'il n'existe aucun contrôle au départ de ses côtes. Nous avons également un effort à faire vis-à-vis de l'Égypte, puisque 12 % des départs se font à partir de ses côtes. C'est un pays avec lequel nous devons développer notre coopération.
Comment la police aux frontières participe-elle au travail avec les pays de transit et les pays sources ? Nous y menons d'abord des actions de coopération technique. Nous disposons d'un réseau de la direction de la coopération internationale. D'ici la fin de l'année, sept cents experts seront mobilisés dans le cadre de différentes missions. Ils seront à la fois impliqués dans les hotspots et dans les missions à l'étranger que nous effectuons.
Par ailleurs, nous allons installer une équipe au Niger dans le cadre d'un projet opérationnel franco-espagnol financé par la Commission européenne. Le Niger est un pays extrêmement important pour les différentes filières africaines.
La semaine passée, nous étions au Niger, où nous avons rencontré le ministre de l'intérieur et le directeur général de la police pour étudier les principes de cette coopération. Celle-ci sera opérationnelle. Elle permettra d'aider les Nigériens à identifier les filières, à mieux contrôler leurs frontières - ce qui constitue un vaste défi quand on considère l'importance de ce pays et à fournir des informations aux différents services occidentaux qui participent au suivi et à la gestion desdites filières.
Cette équipe commune doit bénéficier d'un financement européen de plusieurs millions d'euros sur trois ans. Le déploiement devrait s'opérer au deuxième semestre pour arriver à Niamey. Et il s'agira d'actions de coopération opérationnelle et en matière de formation avec les Nigériens.
C'est une expérience que les Espagnols avaient mené en Mauritanie, où ils avaient, dans le cadre d'un projet appelé « Seahorse Atlantico », développé une équipe commune.
C'est là notre second axe de coopération.
Par ailleurs, nous disposons d'une quarantaine d'officiers d'immigration dans le monde et notamment en Afrique. Ces officiers sont en lien avec nos partenaires africains dans le domaine des flux migratoires. Nous démantelons chaque année près de deux cent cinquante à deux cent soixante filières, ce qui est considérable. Près de 50 % des filières démantelées le sont à partir d'informations ou de renseignements provenant de ces officiers de liaison.
Le troisième volet de notre action regroupe toutes les consultations diverses que nous avons avec la direction générale des étrangers en France (DGEF), qui n'est pas une direction opérationnelle mais administrative, avec qui nous coopérons sur les aspects opérationnels de la mise en oeuvre des accords de réadmission ou de la politique des visas.
Voici les différentes coopérations que nous partageons avec les pays tiers.
Quant à la pression migratoire, elle est forte dans les Alpes-Maritimes. Nous avons des unités de forces mobiles dans ce département et un gros dispositif de la police aux frontières. La majeure partie des entrées sur le territoire français s'opère par deux voies, dont la voie ferroviaire Vintimille-Menton, où nous partageons quelques patrouilles avec les Italiens. Nous avons interpellé, depuis le début de l'année, neuf mille deux cents migrants utilisant cette voie. La seconde voie qu'empruntent les migrants passe par l'autoroute A8 et le péage de La Turbie, ainsi que par la vallée de la Roya, qui constitue un axe de passage assez important.
Il ne s'agit pas, comme dans le cas des filières chinoises, d'un organisateur unique, mais de filières multiples. C'est ce qui complique les choses. Une multitude de passeurs se charge de conduire les migrants de l'Italie vers la France, avant que de petites filières ne les aident à atteindre Paris ou le Calaisis, notamment pour ce qui est des ressortissants soudanais.
Les ressortissants qui empruntent la filière du Sud sont Soudanais, Tunisiens, Érythréens, Pakistanais. On compte peu d'Afghans ou d'Irakiens, qui utilisent plutôt des voies en provenance d'Allemagne ou de Belgique pour arriver sur notre territoire.
Nous avons actuellement une population stabilisée d'environ huit cents personnes sur le Dunkerquois et quatre mille cinq cents sur le Calaisis, soit un total d'environ cinq mille personnes, de sociologie assez différente. Nous sommes confrontés à des Soudanais, des Érythréens, des Afghans, des Irakiens, des Syriens. Pour ces trois dernières nationalités, force est de constater que les éloignements sont aujourd'hui assez difficiles.
Les filières, en France, sont de deux types. Il s'agit de filières de transit, dont je viens de parler, et de filières d'installation, qui sont particulièrement liées à l'Algérie, à la Tunisie ou au Maroc, où de faux documents permettent l'installation de ces ressortissants.
La thématique des mineurs isolés est importante et coûte très cher, les conseils départementaux ne sachant plus comment faire. Ce sont des personnes que l'on ne peut renvoyer et qu'il faut placer en foyer. Il y a d'abord un problème d'identification. Quelle est aujourd'hui la différence entre un mineur et un jeune majeur ? C'est assez compliqué, et nous y sommes quotidiennement confrontés à Calais, la marge d'erreur étant de plus de dix-huit mois selon les standards de la médecine légale.
On compte aujourd'hui trois cents mineurs isolés dans le Calaisis, dont le placement comporte des difficultés pour le conseil départemental. Il n'y a en effet pas de places pour tout le monde, et le conseil départemental doit également assurer le placement d'autres mineurs du département. Ces mineurs sont parfois placés dans des foyers mais, après deux ou trois jours, reviennent dans le camp de Lande, à Calais.
Les procédures de placement sont donc d'une efficacité toute relative, sans compter que les conseils départementaux n'ont plus assez d'argent. C'est ce qu'ils affirmaient lors d'une réunion sur ce thème à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister avec le ministre de la justice.
Quant à la problématique des mineurs isolés venant d'Italie, elle est faible, puisque les ressortissants sont plutôt majeurs. Scientifiquement, je le répète, il est toutefois difficile de déterminer si une personne est mineure entre quatorze ans et demi et dix-huit ans. Nous estimons que la population de mineurs isolés est de l'ordre de trois cents personnes dans le Calaisis.
M. Jacques Legendre, président. - La parole est aux membres de la mission.
M. Didier Marie. - On parle peu - voire pas du tout - des arrivées de migrants sur les îles, parfois non habitées, en lisière des eaux territoriales turques. Est-on sûr que le chiffre de cent soixante mille intègre la totalité des migrants ou existe-t-il une certaine porosité ?
J'ai appris que des migrants arrivés sur une toute petite île au Sud de Lesbos étaient directement repartis sur le continent avec des pêcheurs grecs qui, moyennant finances, les ont emmenés. J'ai le sentiment - peut-être entièrement faux - que le phénomène n'est pas totalement marginal. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Deuxièmement, vous nous avez indiqué qu'on avait dénombré un peu plus de cent seize mille migrants sur la route des Balkans. Or, celle-ci est considérée comme obstruée depuis que la Macédoine a fermé ses frontières. Est-ce à dire qu'il y a encore un flux significatif vers cette destination et que certains pays ont des frontières qui peuvent permettre le passage, ou éventuellement des pays qui laissent encore passer des migrants ?
Troisièmement, il semble qu'il existe un certain nombre de réfugiés, voire un nombre conséquent, disséminés en Grèce continentale et qui ne sont pas enregistrés, ayant pu passer préalablement à l'accord. A-t-on une estimation du nombre de ces personnes ? Quel est leur cheminement et leur destination ?
Enfin, concernant les moyens du service, vous avez aujourd'hui un surcroît d'activité du fait du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Vous travaillez en outre avec Frontex. Vous avez indiqué que onze mille agents étaient sous votre responsabilité. Ces moyens sont-ils suffisants ? Doivent-ils être consolidés ? Cela peut être utile pour la suite de nos discussions dans d'autres domaines, en matière financière notamment.
M. Jean-Pierre Vial. - Pouvez-vous nous donner des chiffres concernant les hotspots ? On parle souvent du nombre de réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie ou au Liban. Ce qu'on évoque moins souvent, c'est que seuls 15 % environ de ces réfugiés vivent dans des camps, les autres étant dans la nature.
Combien y a-t-il de personnes dans les hotspots que l'on peut considérer sous maîtrise comptable, et à combien s'élève le nombre de ceux qui se trouvent en dehors et qu'on peut imaginer prendre la route qui a été utilisée jusqu'à présent ?
En second lieu, les élus du Calaisis que l'on rencontre disent tous que ceux qui sont là, tôt ou tard, passeront de l'autre côté. On en a eu une illustration lorsque le ministre de l'intérieur a voulu dégager Calais : des cars sont venus les emmener dans différents départements ! Dans le mien, ils sont arrivés à quarante-cinq personnes. Cinq jours après, il n'en restait qu'un ! On voit donc bien qu'ils n'étaient pas enclins à rester dans nos départements.
Enfin, vous avez parlé d'un flux en provenance de Méditerranée centrale qui reprendrait le dessus et viendrait grossir les chiffres aux frontières. Vous avez évoqué la situation de la région au Sud de Vintimille. Je connais plus modestement celle de la Savoie, et je vois comment les choses s'y passent. Je suis sincèrement admiratif du professionnalisme et de l'humanité des personnels qui exercent leur activité dans de telles conditions, mais on doit bien constater que la comptabilisation se fait selon le bon vouloir des Italiens. Aujourd'hui, que se passe-t-il pour les populations en situation irrégulière aux frontières, notamment au regard de nos amis italiens ?
M. David Skuli. - Tout d'abord, une réponse globale : depuis le rétablissement des contrôles aux frontières, juste après le 13 novembre, on a prononcé plus de vingt-deux mille mesures de non-admission sur notre territoire. Vingt-deux mille personnes auraient pu avoir le statut d'étranger en situation irrégulière. C'est considérable, puisqu'on compte près de cinq mille gardes-frontières sur les frontières terrestres, maritimes, aériennes. Près de quarante millions de personnes, dans les flux entrants et sortants, ont fait l'objet d'un passage contrôlé. Les fichiers de police ont été interrogés plus de vingt millions de fois afin de détecter les entrées ou les sorties qui pourraient faire l'objet de fiches particulières, et vingt-huit mille fiches ont été détectées. Ce rétablissement des contrôles aux frontières est d'ailleurs une barrière, certes temporaire, mais qui participe au ralentissement des flux illégaux pouvant pénétrer sur notre territoire.
Je ne connais aucune frontière hermétique. La Grèce a seize mille kilomètres de côtes, et quatre mille îles, dont quatre cents habitées. J'en ai parcouru lors de la précédente présidence grecque de l'Union européenne. Les chiffres que je vous donne sont répertoriés sur les principales îles : Lesbos, Leros, Chios, Kos, Samos. C'est principalement là que les flux arrivent, mais on enregistre parfois un petit nombre d'arrivées de trente ou quarante migrants sur le chapelet d'îles qui existent. Aujourd'hui, il est vrai qu'il existe un véritable tarissement de cette route, puisque le travail est également fait par les Turcs. C'est de leurs côtes que partent les migrants. Les Turcs jouent donc actuellement le jeu. Les arrivées, même dans les petites îles, restent très accessoires par rapport aux cinq îles que je viens de citer.
Huit mille quatre cents personnes sont aujourd'hui répertoriées dans les cinq hotspots grecs, ce qui crée d'ailleurs des tensions. La majeure partie d'entre eux demandent l'asile, et les Grecs traitent l'asile avec lenteur, malgré l'assistance de l'agence européenne EASO, qui apporte son soutien, et malgré la modification de la législation. Cela crée des troubles parmi les migrants, qui refusent de se laisser signaliser. Ceux qui sont là n'ont qu'un seul objectif, celui de quitter l'île et de reformer des flux vers le continent, puisqu'à l'issue de leur période de rétention de vingt-cinq jours, ils sont en principe dispersés et placés sous une forme d'assignation à résidence. C'est ce qui est prévu dans l'attente du résultat sur l'asile.
C'est d'ailleurs un des enjeux, car plus on met de temps pour rendre une décision en la matière, moins on peut les renvoyer, et plus on fragilise l'accord.
Le nombre de migrants actuellement présents en Grèce, qu'elle soit continentale ou qu'il s'agisse des îles, s'élève à cinquante-trois mille ou cinquante-quatre mille. Je tiens ces chiffres de notre attaché de sécurité intérieure en poste à Athènes, qui suit cela régulièrement, avec toutes les marges d'incertitude qui peuvent exister mais, compte tenu de la fermeture de la frontière gréco-macédonienne, on pense que ces chiffres sont assez fiables, même s'il existe un flux assez important de migrants irréguliers séjournant de manière permanente en Grèce.
Le chiffre de 116 806 qui auraient emprunté la route des Balkans remonte au début de l'année. Cela ne veut pas dire que cette route est toujours active, mais les arrivées de janvier, février et mars ont été extrêmement nombreuses.
Je rappelle que la frontière macédonienne a commencé à se fermer le 9 mars et que l'efficacité de cette fermeture a commencé à faire effet vers fin mars, lorsque deux cents garde-frontières polonais sont venus aider les Macédoniens. J'en parlais la semaine dernière avec Fabrice Leggeri à Varsovie, qui me disait qu'il n'avait pas bien compris l'action qu'avait menée la Macédoine, sans aucune concertation globale, créant des problèmes en perturbant la réaction d'ensemble.
Aujourd'hui, plusieurs pays européens, comme la Slovénie ou l'Autriche, ont rétabli leurs frontières, rendant les passages plus difficiles, mais celles-ci ne sont pas encore complètement hermétiques. Certains passages s'opèrent donc encore par la frontière italienne, le tunnel du Mont-Blanc et celui du Fréjus, ou par la Savoie. Nous les prenons en compte.
Les effectifs de la police aux frontières sont de onze mille, en y intégrant les territoires ultramarins, et d'environ huit mille sur le territoire national. Le rétablissement des contrôles aux frontières pose de nouveaux défis. Le contrôle aux frontières peut s'opérer de deux façons : soit vous y mettez des hommes, soit vous recourez aussi à la technologie. Je pense qu'il faut aussi s'orienter vers cette deuxième solution, car certaines frontières sont extrêmement importantes, comme les frontières aériennes. Peut-être avez-vous entendu parler des dispositifs automatiques de passage aux frontières que nous expérimentons. Il s'agit de dispositifs de reconnaissance faciale, notamment à Saint-Pancras pour l'Eurostar, et à Roissy, pour l'aéroport. Nous réalisons un effort de développement de ces moyens automatiques de contrôle, qui s'inscrivent dans le projet smart border de la Commission européenne, qui va trouver son application en 2019-2020. Il convient de contrôler toutes les personnes qui entrent et sortent de l'espace Schengen. L'association des hommes et des technologies est de nature à nous permettre d'absorber certains flux, notamment en matière de trafic aérien.
Reste la question de l'augmentation. Il faudra, je pense, réfléchir au nombre d'« équivalents temps plein » dévolu à la police aux frontières - car, aujourd'hui, la frontière de la France est gréco-turque - si l'on veut s'inscrire dans ce système qu'est le nouveau mandat de l'agence Frontex, c'est-à-dire projeter des effectifs interopérables. Un garde-frontière français peut fort bien servir à la frontière avec la Pologne ou la Grèce. Frontex crée d'ailleurs un module de formation qui fait que nous avons des garde-frontières interopérables. Je reçois, dans le cadre de l'Euro, vingt-huit garde-frontières tout à fait interopérables. On se rend donc bien compte que tout le débat autour des frontières va être celui de la souveraineté.
Dans un espace commun dans lequel on veut garantir une libre circulation, cela ne va-t-il pas supposer un accord global des vingt-huit pour surveiller nos frontières extérieures et pallier les carences d'un État membre ? On ne pourra plus arguer de la souveraineté en prétendant contrôler seul sa frontière : cela n'aura aucun sens - ou bien l'on démantèle le bel espace qui est le nôtre. La vraie problématique est de savoir si nous devons projeter de plus en plus d'experts. Lorsqu'on réadmet une personne, on ne fait pas que lui payer un billet d'avion : on l'escorte. À titre d'exemple, aujourd'hui, quatre Russes qui ont commis des troubles à Marseille sont partis avec des policiers français jusqu'à Moscou. Si Frontex, dans son nouveau mandat, doit organiser des vols de retour, il va nous falloir un vivier d'escorteurs. Frontex l'estime à mille cinq cent pour toute l'Europe.
Par ailleurs, il faut une force de projection rapide, afin que chaque État membre soit en mesure d'envoyer des garde-frontières sur une frontière. À ce titre, il faut de la ressource. Nous devrons donc réfléchir, dans un futur proche, à une nouvelle modélisation de la police aux frontières, le nombre d'experts à projeter étant de plus en plus important. Nous les perdrons d'ailleurs lorsque le contrôle intégré des frontières extérieures fonctionnera. C'est Frontex qui décidera alors, à partir d'une action de l'Union européenne. C'est l'avenir auquel nous allons être confrontés.
Pour ce qui est des réfugiés, la Turquie en héberge environ trois millions. Je n'ai pas trop de visibilité sur cette thématique. Je suis sur les flux et les passages de migrants. Je n'ai donc pas véritablement de réponse à vous apporter.
S'agissant du Calaisis, le passage vers l'Angleterre à partir de cette région est extrêmement difficile, voire nul pour ce qui est du vecteur maritime et du vecteur ferroviaire. C'est un dispositif extrêmement : nous disposons de huit unités de forces mobiles sur Calais. Quant à la PAF, je projette des effectifs chaque semaine de l'OCRIEST en complément des effectifs locaux. Notre rôle concernant le démantèlement des filières est considérable
Les dispositifs d'Eurotunnel et du port de Calais, financés par les Britanniques, sont très importants, les Britanniques ayant investi plusieurs millions d'euros dans les dispositifs de sécurité, les clôtures, les caméras, les obstacles, les inondations de certains espaces. C'est si vrai que l'on constate une augmentation de la pression sur Dieppe, Ouistreham et Cherbourg. Nous devons donc prendre des mesures, les migrants qui s'aperçoivent qu'il n'est plus possible de passer par Calais tentant de passer ailleurs.
Certains mouvements s'opèrent également depuis Zeebrugge. On a à présent des migrants qui remontent vers la Belgique pour essayer de passer par les ports belges - mais les Belges s'organisent aussi. Les filières s'adaptent donc à chaque fois, mais les intrusions dans le tunnel du Calaisis sont devenues quasiment impossibles : il faut franchir six clôtures et compter avec les forces mobiles.
Tout se passe actuellement sur la rocade de Calais, où les migrants prennent d'assaut les poids lourds pour y pénétrer. Les réseaux prennent également les migrants sur la rocade, les emmènent parfois jusque dans la Marne, sur des parkings que nous surveillons, pour les réintroduire dans des camions et les faire revenir à Calais pour les plus riches.
Les migrants les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens d'utiliser des camions avec la complicité de chauffeurs, notamment polonais ou étrangers, agressent chaque soir les poids lourds sur la rocade en essayant d'y pénétrer de force, ce qui entraîne d'autres problèmes, puisqu'on découvre dans les poids lourds un nombre de migrants considérable.
On se rend aujourd'hui compte qu'un véritable étau s'est créé. Notre problématique, à Calais, est de faire diminuer les chiffres. C'est ce qui crée cette noria vers les ports du Nord, avant qu'elle ne se déplace ensuite vers Calais et la Manche.
Cela représente entre cinq mille et cinq mille cinq cents personnes, qu'il n'est pas aisé de gérer. Il est assez difficile de renvoyer ces personnes en Érythrée ou au Soudan. On trouve dans cette population très particulière des Syriens et des Afghans. On pourrait techniquement envisager des éloignements, mais il faut clairement définir la stratégie politique que notre pays veut mettre en oeuvre vis-à-vis de ces pays.
M. Jacques Legendre, président. - Le camp de Grande-Synthe est-il intégralement kurde ?
M. David Skuli. - Il est irako-kurde. Il s'agit du camp de la Linière. Il comporte, au dernier recensement qui date d'hier, huit cent vingt personnes. Il a atteint des chiffres bien plus importants. Il est situé entre une autoroute et une voie de chemin de fer. Je suis du Nord de la France. Je vais souvent visiter cette partie des deux départements. Dans le Calaisis, nous comptons quatre mille cinq cents migrants. La population y est différente, avec moins de Syriens et d'Irako-Kurdes à Calais qu'à Dunkerque.
M. Jean-Yves Leconte. - Je vous trouve très optimiste dans votre description du corps européen de garde-frontières, car le plus dur dans cette affaire est d'accepter qu'il existe une gouvernance commune. Or, on se rend compte que même des pays qui auraient aujourd'hui besoin de faire évoluer le règlement Dublin par solidarité préfèrent encore garder ce système, qui les accable, pour éviter qu'on puisse leur envoyer une surveillance aux frontières sans que ce soit eux qui pilotent. On envoie des experts, mais en Grèce, les choses restent sous supervision grecque.
Quant au Nord de la France, le problème vient également de la demande d'asile en Île-de-France : si on veut obtenir rapidement l'asile, il faut aller à Calais, ce qui aggrave la pression sur cette partie du territoire.
Vous avez évoqué les conditions sanitaires dans les hotspots en Grèce. Avez-vous vu la situation des centres de rétention en Turquie de ce point de vue ?
Par ailleurs, à partir du moment où la Turquie et l'Union européenne coopèrent plus efficacement pour stopper le flux en direction de la Grèce, comment le reste de notre coopération se passe-t-il concernant les aspects sécuritaires, qui n'étaient pas si mauvais que cela depuis deux ou trois ans ? Existe-t-il une liaison entre les deux ou les choses continuent-elles à bien se dérouler de ce côté-là ?
Enfin, vous avez évoqué l'Italie. Les personnes en provenance de ce pays qui se rendent dans les Alpes-Maritimes ont-elles été enregistrées en Italie, ou n'est-ce pas toujours le cas ?
Mme Gisèle Jourda. - Ma question porte sur les relations entre l'Italie et l'Autriche et sur le projet de construire un mur à la frontière, au col du Brenner, que M. Juncker a qualifié de catastrophe politique.
L'affaire remonte au début du mois de mai, et a d'ailleurs donné lieu à des manifestations. Le nouvel afflux de réfugiés qui arrivent par la voie italienne peut-il rendre plausible une fermeture ? A-t-on des échos par rapport aux dispositions que compte prendre l'Autriche ?
M. David Skuli. - En ce qui concerne l'Italie, nous avons des officiers dans les hotspots. Je puis vous dire qu'en Italie, le niveau d'enregistrement des empreintes dans Eurodac dépasse les 95 %.
L'Italie est une grande nation, un pays très organisé, dont les forces de police et de gendarmerie fonctionnent bien et disposent de bornes Eurodac. Leur utilisation est donc satisfaisante et la procédure bien conduite.
S'agissant des relations entre l'Italie et l'Autriche, le dispositif de fermeture de la frontière au col du Brenner peut varier en fonction des flux de migrants. Les Italiens sont fort marris de l'attitude autrichienne, surtout conditionnée par la situation politique que le pays a connue récemment, et dont l'issue a été plus favorable que prévu. En tout état de cause, la situation en Autriche était très particulière. Ce pays a tout de même accueilli plusieurs centaines de milliers de migrants en 2015. D'autres diraient que les ordres de grandeur ne sont pas du tout comparables avec Calais. Des patrouilles tripartites existent entre l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Je pense que l'Autriche est politiquement extrêmement sensible à la migration. On ne peut pas exclure une réaction inattendue de sa part, indépendamment de la position du président Juncker.
Mon homologue italien, Giovanni Pinto, est assez attentif à cette situation. Les Italiens font des efforts pour contrôler les trains et le col du Brenner, mais on n'est pas à l'abri d'une réaction autrichienne assez ferme pour éviter que la situation politique, qui est sensible, ne dérape.
Si les flux remontent en Italie, l'Autriche sera aussi une voie de passage, puisqu'elle l'a déjà été, ce qui constituera un facteur de tensions.
Vous m'avez interrogé sur la coopération avec la Turquie en matière de sécurité. Je puis vous dire qu'elle est très bonne pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme et du suivi des djihadistes. Une procédure a été bâtie concernant les Français qui sont allés s'entraîner sur les terres du djihad. Les informations sont mises à la disposition des services français lorsque ces personnes rentrent de Turquie. Quelques errements avaient eu lieu au départ, mais ceux-ci ont été corrigés et la Turquie coopère largement sur cette question.
Quant à la situation des centres de rétention turcs, je n'ai pas eu l'occasion de les visiter. Je ne me manquerais pas de m'y rendre lors de mon prochain déplacement en Turquie, mais je n'ai pas d'indication spécifique.
Enfin, s'agissant de la thématique relative au droit d'asile, il faut évoquer ce sujet avec le directeur de l'asile de la DGEF. Je n'ai pas de visibilité sur ce point. Je sais que la France fait beaucoup d'efforts pour multiplier les réponses aux demandeurs d'asile. Elle s'est inscrite parmi les premiers pays en matière de relocalisations et d'accueil des migrants se trouvant en Grèce - mais je n'ai pas plus d'éléments sur ce point. Ce n'est pas mon principal champ d'action.
M. Jacques Legendre, président. - Monsieur le directeur, nous vous remercions pour la qualité et la franchise de vos réponses. Vous nous avez éclairés. Nous avons l'intention de rendre notre rapport courant septembre. Si, d'ici là, tel ou tel aspect des problèmes méritait selon vous d'être porté à la connaissance de la mission, n'hésitez pas à nous faire parvenir tous les documents qui vous sembleraient utiles.
Audition de M. Marc
Pierini,
ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie,
chercheur visiteur à Carnegie Europe
Mercredi 6 juillet 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, nous allons d'abord entendre M. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie et chercheur visiteur à Carnegie Europe ; nous nous entretiendrons ensuite avec M. Jacques Toubon, Défenseur des droits.
Monsieur l'ambassadeur, votre expérience nous intéresse pour apprécier l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie le 18 mars dernier.
Si cet accord, ou plutôt cette déclaration politique, a incontestablement permis d'enrayer les flux de réfugiés entre la Grèce et la Turquie, pensez-vous qu'elle puisse représenter une solution durable, éventuellement transposable à d'autres conflits ? Êtes-vous confiant dans la volonté de la Turquie de coopérer avec l'Union européenne pour la gestion des flux migratoires, compte tenu des dernières déclarations du président Erdogan ?
Plus globalement, que pensez-vous de la gestion de la crise des réfugiés par les institutions européennes ? Reflète-t-elle une crise de ces institutions face à un afflux de réfugiés de grande ampleur ?
Par ailleurs, plusieurs personnes que nous avons auditionnées avant vous ont regretté que cet accord entre en contradiction avec les principes de notre droit européen, mais aussi de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Partagez-vous cette analyse ?
Telles sont, Monsieur l'ambassadeur, les questions générales que je souhaitais vous poser en préambule. Après votre exposé liminaire, vous serez interrogé par notre rapporteur, M. Michel Billout, puis par nos autres collègues.
M. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. - Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, ayant quitté le service de l'Union européenne voilà quatre ans, c'est avec une entière liberté de parole que je m'adresse à vous.
Mon exposé introductif s'ordonnera en trois temps : je traiterai d'abord des principes, puis des aspects concrets et, enfin, de la dimension stratégique.
Sur le plan des principes, l'arrangement conclu entre l'Union européenne et la Turquie est non conforme aussi bien à la Convention des Nations unies de 1951 sur les réfugiés et à ses versions suivantes qu'à la directive de l'Union européenne de 2013 qui en est le dernier document d'application, s'agissant notamment du principe de non-refoulement et du retour dans les pays considérés comme non sûrs.
Un problème juridique évident se pose donc, que le Conseil européen a décidé d'ignorer.
Il faut rappeler que la Commission européenne avait annoncé une vague migratoire d'ampleur dès février 2015, mais que la proposition sur la migration et l'asile du mois de mai avait été balayée du revers de la main par le Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est ainsi qu'une véritable crise, et même une panique politique, ont éclaté au mois d'août, devant l'ampleur prise par des flux que maîtrisaient des mafias internationales parfaitement organisées - qui les maîtrisent d'ailleurs toujours, mais dans une moindre mesure.
Dans ma carrière, j'ai eu affaire à de telles mafias au Maroc, voilà bien longtemps, puis en Syrie, en Tunisie, en Libye et enfin en Turquie. Si les schémas, notamment saisonniers, sont toujours les mêmes, les modes opératoires sont aujourd'hui beaucoup plus sophistiqués, parce que les technologies sont plus performantes : sur la mer Égée, on se sert de téléphones mobiles et de cartes prépayées !
Un véritable fonds de commerce a vu le jour pendant l'été 2015, qui a rapporté aux trafiquants, selon l'estimation la plus basse, 2 milliards d'euros l'année dernière pour la seule côte turque. Pour l'ensemble de la filière qui va de la Syrie et d'autres pays jusqu'au nord de l'Europe, le bénéfice financier se monte probablement entre 5 et 7 milliards d'euros.
A la base de cet accord assez bizarre, il y a donc une faillite européenne, qui tient à l'incapacité des États à s'entendre sur une politique, à l'absence de garde-côtes et de gardes-frontières et au désaccord complet sur la politique d'asile.
Globalement, l'Allemagne, qui était la cible principale des trafiquants, s'est retrouvée isolée par rapport à deux catégories d'États membres : d'une part, l'Europe centrale, qui considère que le problème ne la concerne pas, et les pays dits « opt-out », c'est-à-dire la Grande-Bretagne et le Danemark, qui se dissocient de toute affaire migratoire ; d'autre part, le reste de l'Europe occidentale, qui voudrait bien aider, mais ne le peut pas, pour diverses raisons.
Désavouée à la fois par l'Europe centrale, qui ne voulait rien savoir, et par ses partenaires d'Europe occidentale, qui ne proposaient qu'une aide infime par rapport à l'ampleur du problème, la chancelière allemande a déclenché une manoeuvre européenne. J'insiste : celle-ci n'est pas partie des institutions européennes, mais de Berlin. Je reviendrai plus loin sur le dysfonctionnement des institutions européennes, qui n'est pas vraiment lié à la Turquie.
Je passe aux aspects concrets. Cet accord illégal et immoral n'en sera pas moins source de bénéfices dans ses aspects concrets, notamment en termes d'alimentation, de santé, d'éducation et de formation professionnelle.
Les 3 milliards d'euros prévus sont en train d'être dépensés, même si c'est bien trop lentement au goût des autorités turques. Ces fonds sont consommés en trois phases : allocation, contractualisation et versement effectif. À l'heure actuelle, environ 750 millions d'euros ont été alloués, 150 millions d'euros contractés et 105 millions d'euros versés. La Commission européenne considère que, d'ici à la fin du mois de septembre, 2 milliards d'euros auront été alloués.
L'accord aura des bénéfices tangibles pour les familles les plus défavorisées, étant entendu que tous les réfugiés en Turquie ne sont pas accessibles de la même façon : 280 000 d'entre eux environ vivent dans des camps gérés par l'État ou les municipalités, de manière parfaitement organisée, mais tous les autres, c'est-à-dire 90 % du nombre total, se débrouillent à leur compte dans les villes et les villages, avec leur épargne et les fonds envoyés par l'oncle des Émirats arabes unis ou du Canada.
Tous, en revanche, sont unanimes à reconnaître qu'ils ont reçu de la Turquie deux choses : une carte d'invité temporaire qu'ils peuvent présenter à la police et un accès gratuit à tous les soins de santé. Ces deux bénéfices sont pour eux tout à fait considérables. J'ai d'ailleurs pu constater que les réfugiés sont au plus haut point reconnaissants envers la Turquie et M. Erdogan, lequel a imaginé de leur accorder la nationalité turque, ce qui servirait ses intérêts politiques.
La mise en oeuvre de l'accord comporte néanmoins deux dangers.
D'une part, l'agence de gestion des catastrophes et des urgences, ou AFAD, le Croissant rouge et d'autres ONG soulignent qu'ils pourraient faire beaucoup plus vite que l'Union européenne. Qu'ils le puissent, cela n'est pas douteux, l'État turc, centralisé, étant très efficace ; mais le prix en serait la politisation de l'aide, qui irait là où le pouvoir y trouverait intérêt.
D'autre part, depuis trois mois environ, les autorités turques demandent à l'Union européenne de pouvoir dépenser une partie des fonds en Syrie, dans la zone où sont massées entre 100 000 et 150 000 personnes fuyant les combats dans la région d'Alep et les avancées de l'État islamique. La chancelière allemande s'y est dite favorable dans une de ses déclarations publiques.
Voilà des années que la Turquie cherche à instaurer ce qu'elle appelle une zone de sécurité et d'interdiction de vol dans cette région comprise entre l'Euphrate et le district kurde d'Afrin, mais aucun pays occidental n'a jamais été disposé à engager des troupes ni à assurer une couverture aérienne pour protéger les réfugiés. Cette situation est une invitation à de nouveaux Srebrenica - encore serait-ce à la puissance dix. Au demeurant, des camps gérés par des ONG turques en Syrie ont déjà été attaqués par l'aviation du régime de Bachar al-Assad.
Il peut sembler tentant de retenir les réfugiés chez eux, comme la Turquie le suggère, mais, en l'absence d'accord militaire, le danger serait très grand dans cette zone, dont le ciel est tenu sans partage par l'aviation russe.
Sur le plan stratégique, la volonté turque de contenir les réfugiés du côté syrien à l'aide de financements européens procède aussi du souci de séparer les deux districts kurdes, celui de Kobané et Jazira et celui d'Afrin. En effet, la hantise politique de la Turquie est de voir se constituer un ensemble kurde syrien unifié d'un bout à l'autre de la frontière. Elle essaie de s'y opposer, en impliquant l'Europe, par le biais de l'aide humanitaire, mais cette politique n'est pas celle des autorités européennes, non plus d'ailleurs que des américaines.
Au total, l'accord du 18 mars 2016 est bancal et pas très glorieux ; dans l'un de mes articles, j'ai employé l'expression « diplomatie de bazar »...
Vous m'avez demandé, monsieur le président, si l'on pouvait faire confiance à la Turquie. Je réponds : oui, dans une large mesure, étant entendu qu'elle essaiera toujours d'atteindre ses objectifs politiques au passage.
Dans cet accord, l'Europe a cru bon d'inclure des concessions ou des promesses de concessions touchant au processus d'adhésion et aux visas. Or, ces concessions, elle ne peut pas les accorder, les contreparties exigées de la Turquie n'étant pas remplies. De fait, la Turquie est plus éloignée que jamais de satisfaire aux critères politiques, et même à nombre de critères techniques, de l'adhésion à l'Union européenne. Au demeurant, M. Erdogan n'a aucun intérêt à cette adhésion, qui serait contraire à sa marche vers le pouvoir absolu. Sans compter que, côté européen, l'enthousiasme pour l'adhésion turque est singulièrement retombé depuis un certain temps...
En ce qui concerne les visas, une condition fondamentale reste non remplie : la révision de la législation antiterroriste, qui fait partie du « paquet » de l'accord sur les réfugiés. Or le gouvernement turc a fait savoir très clairement qu'il ne changerait pas cette législation. Sur le plan de la stricte menace terroriste, ils ont raison ; mais le fait est qu'une partie de cette législation n'est tout simplement pas acceptable par les Européens, vu qu'elle permet d'envoyer en prison n'importe qui pour n'importe quel motif.
Vous m'avez également demandé, monsieur le président, si l'accord du 18 mars 2016 reflétait une crise. Selon moi, oui, très largement.
En effet, nous voyons bien que les institutions centrales de l'Union européenne, c'est-à-dire la Commission européenne et le Service européen d'action extérieure, sont politiquement faibles et ne sont plus écoutées lorsqu'elles lancent des avertissements ou avancent des propositions - souvenons-nous de ce qui s'est passé au printemps de l'année dernière.
Ce n'est pas seulement une affaire de confiance envers les institutions. Il faut voir aussi que le traité de Lisbonne a connu une dérive dans son application : la politique étrangère est faite intégralement au niveau du Conseil européen, dont les ministres des affaires étrangères ont été exclus, de sorte que les décisions se prennent en l'absence de toute expertise, sur le mode d'une gestion de crise par les chefs d'État et de gouvernement, ce qui ne permet pas de prendre en compte tous les paramètres des situations.
Telle est la politique européenne aujourd'hui : elle s'occupe de crises, qu'il s'agisse des réfugiés, de la sortie du Royaume-Uni ou de l'euro. C'est regrettable, mais c'est ainsi.
Cet accord est-il réplicable dans d'autres pays, à commencer par la Libye ?
Je ne crois pas que le pouvoir central libyen soit aujourd'hui suffisamment stabilisé pour qu'un tel accord puisse être conclu avec lui. Il faut mesurer que l'État libyen, après avoir subi une destruction de ses structures pendant les quatre décennies de règne de Khadafi, est encore très faible. Si donc un accord devait être passé avec la Libye, il devrait s'accompagner d'une forte surveillance et d'une d'implication poussée, s'agissant notamment de l'assistance technique.
En ce qui concerne la Tunisie, elle n'est pas aujourd'hui un pays de départ, mais elle pourrait le devenir, si les hostilités en Libye devaient se poursuivre. En effet, il y a en Libye un réservoir permanent de 1 million, peut-être 2 millions, de migrants africains, essentiellement économiques, qui attendent l'occasion de passer vers l'Italie.
Ce phénomène a toujours existé et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les problèmes de sécurité n'y changent rien. En effet, ceux qui investissent la fortune d'une tribu ou d'un village dans un voyage vers l'Europe ne craignent pas les dangers : ils peuvent mourir dix fois dans le Sahara, sur la côte libyenne ou en mer, mais l'alternative est tout aussi dangereuse... Sans compter que ces personnes, et celles dont elles portent l'espoir, sont manoeuvrées par des trafiquants, qui leur mentent sur la situation de l'emploi en Europe.
Le risque est grand que ces migrants, s'ils ne peuvent pas partir de Libye, essaient un jour de le faire en passant par la Tunisie. Nous devons être extrêmement vigilants à cet égard.
M. Jacques Legendre, président. - Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour votre exposé.
M. Michel Billout, rapporteur de la mission d'information. - Du déplacement que j'ai fait en Turquie et en Grèce avec notre président et deux autres membres de la mission d'information, je reviens avec deux sentiments désagréables, outre celui que des êtres humains se trouvent dans des situations extrêmement dramatiques.
Le premier vient de la comparaison entre la manière dont la Turquie a fait face à une arrivée massive de réfugiés sur son territoire - 2,7 millions de Syriens et un peu plus de 300 000 réfugiés d'autres nationalités - et la grande difficulté qu'a eue l'Europe à faire face de façon solidaire à l'arrivée de 1 million de personnes. Dans ces conditions, il est difficile de parler d'égal à égal avec la Turquie.
Le second tient au rapport de force politique défavorable et hypocrite dans lequel nous nous trouvons engagés. Le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, personne aujourd'hui ne croit réellement qu'il ira à son terme ; d'ailleurs, le président Erdogan ne le souhaite très certainement pas. Quant à la libéralisation des visas, elle sert surtout un intérêt de politique intérieure, puisque seulement 15 % des Turcs possèdent un passeport et que cette proportion serait encore moindre avec un passeport biométrique. Avec ces dés un peu pipés, la Turquie parvient à organiser un rapport de forces avec l'Union européenne, ce qui rend la situation extrêmement désagréable.
L'application de l'accord me paraît très fragile : il peut être mis par terre chaque jour, si la Turquie le décide, puisque son efficacité dépend principalement du contrôle des réseaux par ce pays.
Comme vous l'avez expliqué, Monsieur l'ambassadeur, les migrants d'aujourd'hui sont tous équipés de smartphones. Les réseaux de passeurs se servent de sites internet et des réseaux sociaux pour les avertir de passer par telle voie ou par telle autre. Aujourd'hui, les réseaux considèrent que la Grèce est fermée ; ils recommandent de passer plutôt par l'Égypte, voire par l'Ukraine, d'après des ONG turques que nous avons rencontrées. Si, demain, ils considèrent que la voie de la Grèce peut être à nouveau ouverte, nous risquons de nous trouver dans une situation extrêmement inconfortable car, même si des gardes-frontières et des garde-côtes européens sont mobilisés, la complexité géographique de la Grèce empêchera une action réellement efficace.
Monsieur l'ambassadeur, alors qu'un rendez-vous important aura lieu en septembre ou en octobre, un accord durable vous paraît-il possible ?
M. Marc Pierini . - Il faut distinguer le discours politique de M. Erdogan et ses intérêts matériels.
Dans la crise politique à laquelle il doit faire face, liée aux élections de l'année dernière et à la véritable guerre qu'il mène dans le sud-est du pays, M. Erdogan tire profit d'un discours musclé envers l'Europe, qui lui assure les voix nationalistes sur lesquelles il compte pour atteindre un jour la majorité des deux tiers et réformer la Constitution en vue d'instaurer un régime de présidence exécutive. Ce contexte est bien connu, mais la panique a fait qu'on a décidé de l'ignorer.
Le point faible de l'accord sur le plan politique est que, dans tous les documents conjoints, l'Union européenne s'est délibérément interdit d'entrer sur le terrain de l'État de droit et des libertés en Turquie, pour ne pas froisser M. Erdogan et obtenir un accord. Il fallait que les chiffres baissent, comme l'on dit à Berlin. Ils ont d'ailleurs baissé, tout simplement parce que, un jour, M. Erdogan ayant appuyé sur un bouton, la police et la gendarmerie turques se sont mises au travail.
Des réfugiés ayant obtenu l'asile en Belgique m'ont expliqué avoir pris un avion pour Antalya, puis un autre pour Izmir. Je leur ai demandé : à l'arrivée, comment fait-on ? Ils m'ont répondu : on va prendre le thé sur une place publique et, au bout de cinq minutes, un réfugié de la vague précédente engagé par un mafieux vous demande s'il peut vous aider. Ensuite vient la négociation : si l'on peut payer 2 500 euros pour passer la mer Égée, on empruntera un chalutier qui prendra une trajectoire oblique, moins surveillée ; si l'on ne peut payer que 1 000 euros, on aura un canot pneumatique ; si l'on a encore moins, on prendra le canot pneumatique un jour de tempête, parce que ces jours-là il y a des rabais... C'est cela, l'horreur de la migration ! Le pouvoir turc, bien entendu, est parfaitement au courant de tout cela.
Ces passages représentent les 2 milliards d'euros dont j'ai parlé précédemment, mais il y a aussi toutes les industries annexes, comme celle des faux gilets de sauvetage et, bien sûr, celle du faux passeport syrien puisque, pour arriver en Grèce, il vaut mieux être Syrien que Pakistanais ou Érythréen.
Une fois en Grèce, où, jusqu'à présent, la politique consistait à faire passer les réfugiés le plus vite possible vers le reste de l'Union européenne, mes interlocuteurs ont pris contact avec un fournisseur de faux passeports, espagnols en l'occurrence. Deux sur trois ont réussi à passer ; quant au troisième, n'ayant pas pu quitter la Grèce par avion, il a pris la route des Balkans en version luxe, c'est-à-dire en taxi, en bus et en train, étant un peu mieux loti que la moyenne.
Il faut donc bien mesurer que nous sommes confrontés à un système mafieux très organisé, même si l'accord que la Turquie, pour des raisons très largement politiques, a conclu avec l'Europe leur rend la vie plus compliquée.
Est-ce réversible ? Bien sûr car, avec M. Erdogan, on peut virer à 180° à tout moment, comme cela vient de se passer avec la Russie et Israël ; la prochaine étape, c'est l'Égypte. Il n'y a ni théorie, ni principe, ni moralité politique : tout dépend des intérêts du moment.
Le problème qui se pose à l'Europe tient à la décision qu'a prise le Conseil européen, sans même que M. Erdogan l'ait demandé, de mettre dans le plateau d'argent confié à M. Tusk, outre les 3 milliards d'euros, les visas et les chapitres de négociation, son silence sur la liberté d'expression et l'État de droit en Turquie. Quel intérêt l'Europe a-t-elle à ignorer ses propres principes devant un régime qui devient ouvertement autoritaire et autocratique ? Il n'y en a aucun, du moins à moyen terme.
Selon moi, la prolongation de l'accord n'aurait de sens que si l'on revenait à un minimum de décence en ce qui concerne les principes qui guident l'Union européenne, c'est-à-dire l'État de droit et la liberté d'expression. Non que je m'illusionne sur l'influence que nous aurions aujourd'hui sur M. Erdogan, qui est en marche vers l'absolutisme et ne rencontre aucune opposition qui puisse l'arrêter, puisque la seule opposition qu'avait son parti, l'AKP, était le parti kurde HDP, qui a été diabolisé ; mais tenons bon au moins sur les principes.
Je ne crois pas du tout à la menace exprimée par M. Erdogan en octobre dernier, une menace restée confidentielle avant d'être révélée au début de l'année : si vous ne me donnez pas tout ce dont j'ai besoin, je lâcherai des convois d'autobus vers la frontière bulgare. Et puis quoi ? Si cela se produit, la Bulgarie mettra deux blindés en travers de la route et M. Erdogan se retrouvera avec une crise humanitaire sur son territoire.
De surcroît, la Turquie n'a pas manqué de mettre en avant sa compassion et sa générosité envers les réfugiés, les opposant à l'attitude de l'Europe, de sorte que M. Erdogan peut difficilement faire demi-tour sur ce plan moral et religieux, qui est très important pour lui.
M. Jacques Legendre, président. - Nous allons maintenant passer aux questions de nos collègues.
M. Jean-Yves Leconte. - Puisque votre parole est libre et votre connaissance de la région précise, Monsieur l'ambassadeur, je commencerai par vous interroger sur certains échos qui me sont parvenus : des pays bénéficiant de la liberté d'accès à l'espace Schengen sans visa commercialiseraient des passeports en Jordanie ou en Égypte de manière quasi publique. La République dominicaine, en particulier, se livrerait assez ouvertement à cette pratique. Voyez-vous là un véritable problème ou seulement des faits ponctuels ?
Par ailleurs, la force politique d'Erdogan tient au soutien populaire qui découle de sa relative réussite économique, laquelle doit beaucoup à l'Europe. Dès lors, et même si l'on peut comprendre ce qui se passe en Turquie en matière d'antiterrorisme compte tenu du nombre d'attentats qui frappent le pays, M. Erdogan ne pourra pas faire n'importe quoi si l'Europe se montre plus précise sur un certain nombre de sujets.
En particulier, on ne peut pas accepter que l'État turc mette sur le même plan l'État islamique, qui est une menace globale, et le PKK, quelles que soient les horreurs commises par ce parti ou des éléments dissidents de celui-ci. N'y a-t-il pas un moyen de l'obliger à reconnaître qu'il y a une différence ?
Enfin, s'agissant de l'évolution des droits en Turquie et de l'échange permis par l'accord du 18 mars avec un régime de plus en plus autoritaire, pensez-vous que l'on puisse établir une comparaison avec l'Ostpolitik et le processus d'Helsinki ? Parler de démocratie avec Brejnev semblait un peu étrange, mais il en est quand même mort !
M. Marc Pierini. - Le trafic de passeports existe bien, mais je suis incapable de vous renseigner sur l'ampleur de ce phénomène. Il y a aussi des ambassades européennes qui vendent des visas Schengen... Je ne crois pas que ces pratiques aient une ampleur considérable par rapport au problème des réfugiés.
Le succès économique est, en effet, le fondement de la réussite politique de M. Erdogan. Ne serait-ce qu'au cours des cinq ans et deux mois que j'ai passés en Turquie, j'ai vu la classe moyenne se transformer. Il est sûr qu'un jeune couple d'une trentaine d'années avec deux enfants a aujourd'hui une vie sensiblement différente de celle qu'il aurait eue lorsque l'AKP est arrivée au pouvoir, voilà bientôt quatorze ans.
Le problème vient de ce que cette prospérité a été acquise à crédit. La continuation de cette politique repose sur des taux d'intérêt très bas. Or il est difficile de maintenir une telle politique si le tourisme décline, les exportations baissent et la monnaie se dévalue.
M. Jean-Yves Leconte. - Il s'agit d'un contexte européen.
M. Marc Pierini. - Le succès cache donc une fragilité. Celle-ci explique en partie que M. Erdogan n'ait jamais dit, sauf dans des propos d'estrade, vouloir tourner le dos à l'Europe. Il sait bien que c'est d'Europe que viennent l'investissement et la technologie et que c'est en Europe que vont plus de la moitié des exportations turques.
Sa politique à l'égard de la Russie et son revirement vis-à-vis d'Israël, très largement lié au gaz, s'expliquent par les mêmes raisons économiques.
Par ailleurs, la fameuse politique « zéro problème avec les voisins » ne s'est pas révélée un grand succès. Quand on se retrouve tout seul dans un trou, on cesse de creuser et on fait autre chose...
En ce qui concerne l'antiterrorisme, la Turquie ayant fini par admettre, après des années, qu'elle est dans le même panier que nous du point de la vue de la menace que représente l'État islamique, on ne peut pas lui dire qu'elle ne doit pas s'en occuper. Voilà des années qu'on lui demande de le faire, notamment pour ce qui est du transit des djihadistes et du pétrole de contrebande.
Il faut discuter de la législation antiterroriste, mais le faire dans le détail, en comparant précisément les règles turques et les nôtres. C'est alors que, évidemment, les différences apparaîtront. En France, en Belgique et ailleurs, nous nous efforçons de combattre le terrorisme en respectant l'État de droit. Ce n'est pas ce que fait la Turquie, où une dérive autoritaire est à l'oeuvre sous couvert de la lutte antiterroriste.
Je n'ai pas d'espoir que la situation change à très court terme. Au prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra dans quelques jours à Varsovie, le discours turc sera inchangé. La Turquie prétend même qu'elle peut faire changer d'avis les pays occidentaux...
S'agissant du long terme, s'il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de cesser de parler avec M. Erdogan, même si celui-ci a une vision de la démocratie très caricaturale à nos yeux. De fait, il considère que, ayant recueilli 52 % des voix à l'élection présidentielle, il peut faire tout ce qu'il veut en ignorant toute forme de contre-pouvoir. Ainsi, le problème de Gezi est venu de ce qu'il n'a aucun égard pour les pouvoirs locaux, non plus d'ailleurs que pour la presse ni pour la société civile.
Cette volonté de n'agir qu'à sa guise explique son obsession actuelle d'établir un régime présidentiel exécutif, ce qu'il souhaiterait faire non pas par la pratique quotidienne, comme aujourd'hui, mais en révisant la Constitution, ce qui suppose une majorité des deux tiers si l'on veut procéder rapidement.
Je ne vois pas quel intérêt aurait l'Europe à favoriser, ne serait-ce qu'indirectement, l'arrivée de M. Erdogan à l'absolutisme. Même si la Turquie n'adhère pas à l'Union européenne, ce qui est probable, elle sera toujours un pays de 76 millions d'habitants situé à nos portes. Si les choses vont mal dans ce pays, c'est un problème pour nous. Au demeurant, une prochaine vague de réfugiés pourrait être constituée de Kurdes de Turquie.
M. Didier Marie. - Monsieur l'ambassadeur, votre propos est assez noir : il donne le sentiment que la dérive vers l'absolutisme en Turquie sera difficile à arrêter. Quelles sont les forces internes susceptibles de contrecarrer cette évolution et, à terme, de nouer un véritable partenariat avec l'Europe ? Comment pouvons-nous les aider ?
M. Marc Pierini. - Ce n'est pas moi, non élu, qui vous apprendrai que la politique est toujours locale.
M. Erdogan est élu confortablement et son parti détient une majorité nette. Surtout, il n'a pas face à lui d'opposition, même si, à l'intérieur de son parti, un certain nombre de personnes, comme l'ancien président Gül, ont manifesté un désaccord avec ses options et, en auraient-elles le pouvoir, se rapprocheraient beaucoup plus de l'Union européenne. Seulement voilà : ce n'est pas nous qui décidons ; nous ne pouvons que composer avec les réalités.
Nous aurions disposé, si la négociation d'adhésion avait progressé normalement, d'un levier qui, dans la situation présente, n'est plus très efficace. En effet, le contexte politique intérieur fait que les critères d'adhésion à l'Union européenne sont devenus pour M. Erdogan des obstacles à sa gestion politique. Ainsi, il a muselé la presse, maîtrisé la justice et la société civile, toutes choses parfaitement contraires aux critères de Copenhague.
Je prendrai un autre exemple, plus technique : celui du chapitre de négociation qui se rapporte à la gestion des marchés publics. Nos principes en la matière, M. Erdogan n'en veut pas, parce que, comme il l'a expliqué, ce sont des sacrifices pour son parti ! Souvenez-vous des circonstances dans lesquelles Aéroports de Paris, allié à TAV, a perdu l'appel d'offres de mai 2013 sur le troisième aéroport d'Istanbul : le gouvernement turc a changé les règles trois jours avant l'attribution du marché. Résultat : des sociétés proches de M. Erdogan ont gagné, sans avoir les moyens de l'offre qu'elles avaient mise sur la table. Elles ont donc été renflouées, après des mois de discussions, par une banque publique...
Le projet de contre-révolution anti-kémaliste inclut la constitution d'une classe d'entrepreneurs islamistes acquis à M. Erdogan. Ceux qui ont remporté l'appel d'offres en font partie. Les « gulénistes » en faisaient partie aussi, mais ils font aujourd'hui l'objet d'une chasse aux sorcières.
En somme, là où il y avait un avantage économique pour l'économie turque à s'aligner sur les principes économiques européens, il y a aujourd'hui un inconvénient politique pour M. Erdogan.
La véritable discussion qu'il faudrait avoir avec les autorités turques, une discussion dont j'aimerais qu'elle soit européenne et pas seulement allemande, commencerait par un retour aux fondamentaux : l'économie turque est liée à l'Europe et, de ce point de vue, la Turquie ne peut pas trouver un autre ancrage que l'Europe.
En ce qui concerne l'antiterrorisme, la Turquie a cru pouvoir gérer une relation avec Daech, sur la base d'un mélange de conservatisme religieux et de business.
Comme toute frontière avec une zone de guerre, la frontière entre la Turquie et la Syrie est évidemment un casino permanent : si l'on gagne, on gagne vraiment beaucoup !
Les djihadistes y font du trafic. Dans ce domaine, la France a fait des efforts - d'autres États membres n'en ont pas fait autant. Elle a renforcé ses moyens policiers en Turquie et obtenu des résultats. C'est du cousu-main, c'est très compliqué, d'autant plus que la Turquie n'a pas vraiment été coopérative. Il y a deux ans, M. Davutoglu, alors ministre des affaires étrangères, disait : « Comment voulez-vous que je contrôle tous ces touristes qui viennent dans le sud-est de la Turquie ? » La police turque peut très bien faire la distinction entre un touriste et un candidat au djihad.
La contrebande de pétrole exporté par Daech a fait l'objet d'une polémique majeure entre M. Poutine et M. Erdogan, laquelle est parfaitement documentée par le Trésor américain.
Enfin, les approvisionnements de l'État islamique en munitions et autres passent par cette frontière.
La réunification des deux districts orientaux des Kurdes syriens a permis de fermer l'un des points de passage (Tell Abyad), l'un des poumons de l'État islamique, mais il en subsiste un, Jaraboulous, situé le long de l'Euphrate, lequel constitue un véritable test aujourd'hui.
Le dialogue avec la Turquie porte sur des aspects techniques - la relation avec l'Europe, le commerce, la révision de l'union douanière, l'extension aux services, etc. -, sur la question des réfugiés, notamment la mise en oeuvre des 3 milliards d'euros, voire davantage plus tard, mais aussi sur celle de l'antiterrorisme. Sous la pression des attentats - celui d'Ankara a fait 102 morts, celui d'Istanbul en a fait 45 -, peut-être sera-t-il possible d'amener la Turquie à un peu plus de raison ? On ne changera pas son style, mais peut-être pouvons-nous compter sur son réalisme politique.
M. Jean-Yves Leconte. - Selon vous, y a-t-il une contradiction entre l'enrichissement de la classe moyenne, qui aura des appétences - on l'a déjà vu avec le mouvement du parc Gezi - et les objectifs politiques de M. Erdogan ?
Indépendamment de la fuite en avant dans le sud-est du pays, cette contradiction ne serait-elle pas la deuxième fragilité de M. Erdogan ? Sa réussite va-t-elle entrer en contradiction avec son projet politique ?
M. Marc Pierini. - C'est en théorie vrai, si ce n'est que la société turque, au-delà de la moitié des voix qui vont à l'AKP, reste éminemment conservatrice. Ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ce sur quoi je ne veux pas spéculer, c'est l'effet qu'aura cette prospérité nouvelle. Quels seront les effets sur la mentalité d'une génération le fait de faire des études à l'étranger ? Il s'agit là de tendances lourdes. C'est dans ces domaines que l'Union européenne a peut-être le plus d'influence. La Turquie compte une importante classe urbaine. À terme, près de 70 % des habitants vivront dans des villes. La transformation sociale et démographique y est la même que celle qui a été constatée dans nombre de pays autour de la Méditerranée et, bien avant, dans nos propres pays. Nous avons grand intérêt à rester impliqué dans ces domaines.
Pour ma part, j'ai été frappé au cours des années que j'ai passées en Turquie par l'appétit des étudiants pour le programme Erasmus, par celui des administrations turques pour des jumelages avec les administrations européennes de divers États membres, pour des sujets allant de la qualité de l'air - Paris était impliquée - au respect des droits de l'homme dans les procédures de la gendarmerie. Tous ces éléments, qui ne sont pas très visibles, sont extrêmement importants, nous ne devons pas y renoncer.
De nombreux sujets sont irritants pour M. Erdogan, et tel sera toujours le cas, car il a besoin de ce langage conflictuel. Toutefois, profondément enfoui en lui, il y a aussi un certain réalisme, qu'il nous faut à mon avis cultiver.
M. Michel Billout, rapporteur. - Quand M. Erdogan parle de lutte contre le terrorisme, on le sait, il évoque plus le PKK et la problématique kurde que Daech, même s'il va certainement devoir modifier sa position après les récents attentats.
Le HDP, qui est une force kurde, explique que des réseaux sont actifs dans les camps de réfugiés en Turquie, près de la frontière syrienne, que ces camps servent de base arrière aux Syriens membres d'al-Nosra, lesquels combattent les forces de Bachar Al-Assad, mais également les forces kurdes, qu'on peut s'y approvisionner en armes et en uniformes. Ces informations corroborent-elles celles dont vous disposez ? Les fonds de l'Union européenne accordés à ces camps alimenteraient-ils une forme de terrorisme ?
M. Marc Pierini. - Tous ces risques existent, mais ils sont évidemment difficiles à chiffrer.
Dans cette zone, les allégeances sont réversibles du jour au lendemain. Elles dépendent de nombreux éléments, dont le facteur financier. Pour les Turcs, les Kurdes syriens, c'est le PKK. La résurgence du Kurdistan est pour eux une obsession. Il ne faut pas oublier que le gouvernement régional du Kurdistan irakien bénéficie depuis deux ans d'un soutien occidental, de la part de plusieurs États membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais également des États-Unis bien sûr, qu'il a déclaré il y a quelques mois son intention d'accéder à l'indépendance et qu'il est d'une très grande efficacité contre l'État islamique.
Il n'y a pas d'entité autonome en Syrie, comme chacun le sait, mais les milices des Kurdes syriens ont malgré tout été reconnues par les États-Unis et par la Russie comme les meilleurs combattants contre l'État islamique.
Certaines situations ont confiné à l'absurde. Je pense à la bataille de Kobané. Les États-Unis ont dû avoir recours à des bombardiers stratégiques et à des parachutages d'armes pour défendre 2 kilomètres carrés, car la Turquie ne permettait pas aux Kurdes irakiens de transiter par sa frontière. Tout cela continuera.
Au dernier trimestre 2011, l'Union européenne a proposé une aide humanitaire pour les réfugiés à M. Davutoglu, alors ministre des affaires étrangères. Les circonstances étaient alors évidemment très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui : le nombre de réfugiés syriens s'élevait à 8 000, sachant que le scénario catastrophique en prévoyait 100 000. Il nous a alors répondu : « Non, merci, on se débrouille. » C'était d'abord une question de fierté pour les Turcs, qui disposaient par ailleurs de très bons équipements grâce à l'Agence des situations d'urgence. Dans le fond, les Turcs redoutaient les ONG, sachant qu'elles ont une connaissance politique du terrain et qu'elles entraînent des journalistes dans leur sillage. Ils craignaient donc qu'elles ne mettent leur nez partout, y compris dans les camps d'entraînement où, à cette époque, des rebelles syriens étaient formés. Les Turcs tiennent encore ce discours aujourd'hui. Ils veulent qu'on leur donne l'argent et qu'on leur laisse ensuite gérer la situation.
Nous devons rester très vigilants. La situation en Syrie est éminemment complexe et réversible à tout moment, mais le point crucial, c'est la suprématie de la Russie dans les opérations militaires dans l'ouest syrien et dans la négociation politique sur une éventuelle transition.
Les États-Unis se sont alignés, l'Europe, par définition, doit s'aligner, et la Turquie est en partie en train de s'aligner dans le cadre de sa normalisation avec la Russie. Il était peut-être le dernier, ou l'avant-dernier - il y a encore les Saoudiens - à souhaiter le départ de M. al-Assad. Plus grand-monde aujourd'hui ne souhaite son départ. Un revirement ayant eu lieu, un dialogue politique entre l'Europe et la Turquie est nécessaire. Cela va au-delà, bien sûr, de la seule problématique des réfugiés.
Mme Gisèle Jourda. - Monsieur l'ambassadeur, les sommes que les ONG prélèvent au titre de leurs frais de fonctionnement sur les fonds débloqués en faveur des réfugiés soulèvent des questions.
M. Marc Pierini. - Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame la sénatrice. Les ONG, mais également les agences des Nations unies, lorsqu'elles interviennent dans ce type d'opérations, qu'il s'agisse de la gestion d'un camp, d'une action de formation ou dans le domaine de la santé, souhaitent financer leurs frais généraux. Ces frais, qui sont habituellement de l'ordre de 6 % à 7 %, sont alors de 15 % à 20 %. Ce n'est pas acceptable, sachant en outre que l'aide à la Turquie s'élève à 3 milliards d'euros, soit une somme considérable dans cette zone, compte tenu du niveau de vie et des besoins des gens.
M. Jacques Legendre, président. - On nous a parlé de 20 % à 30 % lors de nos auditions.
M. Marc Pierini. - Oui, c'est possible. Ce qui est plus choquant, c'est que les agences des Nations unies font la même chose. Elles essaient de facturer à l'Union européenne leurs services comme si elles étaient des consultants. C'est un réel problème, qui nécessite une surveillance.
M. Jacques Legendre, président. - Lors de notre déplacement, j'ai eu l'impression qu'une économie s'était mise en place autour des migrants, du fait d'entreprises mafieuses, mais également des organisations humanitaires, qui se financent grâce à eux d'une certaine manière. C'est assez choquant.
M. Marc Pierini. - Bien sûr. Les chiffres sont considérables eu égard à la richesse du pays. Ainsi, les autorités locales ne comprennent pas pourquoi les soins de santé des réfugiés sont financés à un tel niveau alors que leurs propres hôpitaux sont débordés et leurs écoles surchargées. La même chose se passe au Liban et en Jordanie. Les communautés d'accueil éprouvent un sentiment d'injustice.
M. René Danesi. - Vous êtes arrivé à la conclusion que l'évolution de la politique intérieure de la Turquie ne permettait pas d'envisager son adhésion à l'Union européenne. On peut raisonnablement penser que les instances de l'Union européenne sont elles aussi arrivées à cette même conclusion.
Pourtant, on continue, presque par habitude, d'ouvrir de nouveaux chapitres dans la discussion. On en a ainsi ouvert un nouveau après le Brexit. Ce n'était sans doute pas le moment de le faire, et les populistes ne manqueront d'en faire leurs choux gras.
L'adhésion de la Turquie à l'Europe n'étant pas possible, la bonne solution, en termes d'efficacité, ne serait-elle pas d'ouvrir des négociations sur les seules relations économiques ? L'économie turque a besoin de l'Europe et l'Europe ne peut négliger un marché de 76 millions de consommateurs.
M. Marc Pierini. - En ouvrant des chapitres tout à fait insignifiants, comme la coopération régionale ou les affaires monétaires, on procède à un échange de faux-semblants. On sait qu'ils ne mèneront nulle part, mais personne n'a envie d'y mettre fin, surtout pas les Turcs, attentifs à la notation des agences financières.
Cela étant dit, la négociation économique a commencé, il s'agit de la révision de l'union douanière. Je rappelle que la Turquie est le seul pays au monde ayant une union douanière avec l'Union européenne. Cette union douanière rapporte beaucoup à la Turquie, à qui elle a permis de transformer son industrie. Elle rapporte également beaucoup à l'Europe. Concrètement, lorsque Renault fabrique des Clio dans son usine de Bursa, c'est comme si elle les fabriquait à Flins. Cette union douanière profite à Renault comme à Fiat, à Ford, à Mercedes, à Airbus et à d'autres dans d'autres secteurs. Cette union douanière est évidemment beaucoup moins spectaculaire du point de vue politique qu'une ambition d'adhésion, mais elle a le mérite d'exister, et elle va probablement être approfondie.
Personne n'aura le courage de mettre fin aux négociations sur l'adhésion. Peut-être le Brexit fournira-t-il une piste, encore que je ne fasse pas partie de ceux qui considèrent qu'il est acquis. Ayant assisté à de très nombreuses renégociations britanniques au cours de mes trente-cinq ans de carrière, je m'attends à une autre solution. Si le Royaume-Uni devait toutefois effectivement sortir de l'Union européenne et trouver avec elle un arrangement privilégié, cette formule conviendrait peut-être aussi à la Turquie.
M. Philippe Bonnecarrère. - Vous avez évoqué les situations de double langage, qu'il s'agisse de l'approche du président Erdogan, centrée sur des logiques de politique intérieure, ou des hypocrisies de l'Union européenne, qui ouvre de nouveaux chapitres.
Dès lors, comment analysez-vous, à l'aune de ce double langage généralisé, les négociations à Chypre entre la partie turque et la partie grecque, négociations encore inimaginables il y a quelques années ?
Par ailleurs, que pensez-vous du vote de la coalition CDU-SPD au Bundestag sur la question arménienne ?
Si j'évoque ces sujets, c'est parce qu'il me semble que tout n'est pas que realpolitik. J'avoue ne pas comprendre la position du président Erdogan sur la reprise des négociations chypriote et le vote du Bundestag sur le génocide arménien.
M. Marc Pierini. - Comme vous le savez, plusieurs députés d'origine turque ont voté au Bundestag la reconnaissance du génocide arménien. C'était de leur part une réaction politique, un vote de protestation contre la précipitation avec laquelle la chancelière fédérale a conclu un accord avec la Turquie, au mépris d'un certain nombre de principes de l'État de droit.
M. Erdogan a eu la mauvaise idée de protester violemment et dans des termes inouïs. Je rappelle qu'il a suggéré de faire des analyses de sang des Kurdes allemands siégeant au Bundestag afin de vérifier s'ils étaient turcs ou pas.
L'Allemagne a réagi avec force : la moitié du Bundestag était en session [lors de la lecture de la réaction de son Président], mais également la totalité du Gouvernement, y compris Mme Merkel, qui est rarement présente à toutes les sessions.
Je pense que c'est une manière très saine d'envoyer des messages à M. Erdogan et de lui dire que tout n'est pas si simple dans nos sociétés.
J'ajoute que le fait que M. Erdogan ait déposé plainte en Allemagne contre un journal, contre une chaîne de télévision et un acteur, et ce personnellement, suscite une irritation considérable dans ce pays. De même, 1 800 de ces plaintes ont été déposées en Turquie. Le même problème se pose aux Pays-Bas.
Concernant l'affaire chypriote, le leader chypriote grec et le leader chypriote turc - le tandem Anastasiades-Akinci - s'entendent authentiquement et ont donc toutes les chances d'aboutir à un accord. Cet accord aura un aspect pénible pour la Turquie, car il signifie l'évacuation de 35 000 soldats, ce qui n'est pas simple en termes d'image et pour l'honneur turc, quelle que soit l'idée que nous en avons. En même temps, c'est ce qui a déclenché le blocage en décembre 2006 de huit chapitres de la négociation d'adhésion et le blocage par Chypre d'un certain nombre d'autres chapitres.
Curieusement, l'effet induit sur la négociation d'adhésion est une motivation pour M. Erdogan. Le paradoxe, c'est que la négociation d'adhésion pourrait être ainsi débloquée à un moment où les critères politiques ne sont plus du tout remplis, en tout cas beaucoup moins qu'il y a neuf ans et demi. J'ignore donc ce que nous ferons si nous en arrivons là. Reste à savoir quelle sera la position de la République de Chypre.
M. Jacques Legendre, président. - Nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur, d'être venu nous faire part de vos réflexions sur ce pays que vous connaissez bien, où vous avez servi, et auquel vous restez très attentif.
Notre rapport devrait paraître à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, à un moment un peu crucial, nous semble-t-il, de la relation avec la Turquie.
M. Marc Pierini. - Je vous remercie de votre invitation.
Audition de M. Jacques
Toubon,
Défenseur des droits
Mercredi 6 juillet 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir M. Jacques Toubon, ancien garde des sceaux et aujourd'hui Défenseur des droits.
Monsieur le Défenseur des droits, vous avez à plusieurs reprises abordé la question des réfugiés dans le cadre de vos travaux. En octobre dernier, vous avez publié un rapport consacré à la situation des migrants à Calais dans lequel vous dénoncez notamment les nombreux abus à l'intégrité physique des personnes vulnérables.
Plus récemment, vous avez lancé un cri d'alarme sur la discrimination subie par les étrangers en France, en relevant les nombreux obstacles qui entravent leur accès à leurs droits fondamentaux, liés en partie aux idées préconçues et à la méfiance qu'ils suscitent.
Ces récents travaux nous permettent ainsi d'aborder la mise en oeuvre, en France, de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, le 18 mars dernier, afin de tarir le flux de réfugiés, syriens principalement, qui traversaient la Grèce. Ces événements sont à l'origine de la création au Sénat de notre mission d'information sur la position de la France à l'égard de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie.
Nous souhaitons recueillir les éléments qui ont été portés à votre connaissance sur la situation des réfugiés arrivés en France et sur les dispositifs mis en oeuvre pour leur insertion. Quel en est le premier bilan selon vous ?
Par ailleurs, disposez-vous de données qui permettent de comparer la situation des réfugiés en France à celle d'autres pays européens ?
Telles sont les questions générales que je souhaitais vous poser en préambule. M. le rapporteur ne manquera pas de vous poser à son tour de nombreuses questions.
M. Jacques Toubon, Défenseur des droits. - Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous sur ce sujet, car nous avons affaire à un exemple des plus symptomatiques des effets négatifs sur les droits fondamentaux, dont j'ai partiellement la charge, de ce que l'on appelle en français administratif, la « maîtrise des flux migratoires », mais que l'on devrait appeler, en français courant, la fermeture des frontières.
Vous avez rappelé, monsieur le président, le rapport que j'ai publié le 6 octobre dernier sur la situation des migrants à Calais. J'en ai publié un autre le 20 avril sur les mineurs non accompagnés à Calais. J'en publierai un autre, à la suite de la visite que j'ai effectuée jeudi dernier dans cette même ville. Il s'agira d'un compte rendu de cette visite, accompagné de recommandations.
La situation à Calais, qui est la conséquence des accords du Touquet de 2003, des accords de Dublin et désormais de ce qu'on appelle, à tort, l'accord - car il n'existe pas d'accord- entre l'Union européenne et la Turquie, est emblématique. La fermeture des frontières a des effets négatifs sur la situation des personnes et sur certains territoires de l'Union européenne, qu'il s'agisse de Calais ou de certaines régions de Grèce par exemple.
L'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie en novembre 2015 à l'issue d'une rencontre entre la Chancelière fédérale, Mme Angela Merkel, et le Président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan - système de négociation un peu particulier -, prévoit que les candidats à l'asile arrivant vers l'Europe puissent être, soit arrêtés, soit renvoyés en Turquie. Je rappelle que ce pays accueille sur son territoire aujourd'hui, pour l'essentiel dans des camps, entre 2,5 et 3 millions de réfugiés ou de personnes prétendant à ce statut en Europe.
Un accord de ce type est un accord de réadmission. Il prévoit de rapatrier vers le pays d'origine des migrants ceux d'entre eux qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire et à demander l'asile. Il permet aussi de renvoyer les ressortissants de pays tiers qui ont seulement transité par les pays signataires, par exemple par la Turquie ou par un pays de l'Union européenne. Autrement dit, vingt-huit États membres de l'Union européenne peuvent faire réadmettre sur le territoire turc non seulement des ressortissants turcs, ce qui est la base des accords de réadmission, mais également tous les ressortissants syriens, afghans, irakiens ou autres ayant transité par l'État turc lors de leur tentative d'atteindre l'Union européenne. Ce sont bien entendu eux qui sont visés, beaucoup plus que les Turcs eux-mêmes.
Cet accord comporte naturellement un certain nombre de contreparties, dont je ne parlerai pas, car elles n'entrent pas dans le cadre de notre réunion aujourd'hui. Il s'agit de visas pour les Turcs, d'aides financières considérables, etc.
En dehors de cet effet « repoussoir », cet accord vise à établir un schéma « un Syrien pour un Syrien » : chaque Syrien réadmis par la Turquie peut donner lieu à la réinstallation sur le territoire européen d'un autre Syrien en provenance de Turquie. On n'augmente en rien les obligations des États en matière de protection des réfugiés, on se contente d'utiliser les 18 000 places de réinstallation prévues par le plan européen de juillet 2015. À cet égard, notons que, en avril dernier, seuls 4 555 réfugiés avaient fait l'objet de ce système d'échange, dont 15 en France.
Après avoir parlé de la portée de la déclaration conjointe Union européenne-Turquie de novembre 2015 et de tout ce qui a été réitéré depuis lors, notamment dans la nouvelle déclaration du mois de mars, j'évoquerai maintenant les conséquences juridiques de cet accord avant d'essayer de voir comment on peut en sortir.
Je traiterai successivement des implications juridiques - la notion de pays sûr et celle de pays tiers - et des conséquences factuelles de cet accord.
Renvoyer ces personnes en Turquie suppose que cet État serait devenu, à la suite de l'accord passé avec lui, un pays sûr, au sens des conventions internationales. Bien entendu, vous le savez, tel n'est pas le cas.
La Commission elle-même a émis les plus expresses réserves à cet égard. Dans sa communication du 17 mars 2016, dans laquelle elle fait un premier bilan de l'accord avec la Turquie, elle a souligné que ce dernier requérait la modification préalable de la législation grecque - la Grèce doit reconnaître la Turquie comme pays sûr, ce qu'elle a fait en votant une loi en ce sens - et de la législation turque, laquelle doit garantir l'accès effectif à des procédures d'asile.
Tant que cela n'est pas le cas - pour la Turquie, ce ne l'est toujours pas -, ces dispositions sont contraires à la directive « Procédures » selon laquelle un État peut refuser d'examiner une demande d'asile si le demandeur est illégalement entré sur son territoire à condition que l'État de renvoi soit un pays sûr. Or, selon cette même directive, pour pouvoir être considéré comme sûr, un État doit avoir ratifié la Convention de Genève sans aucune limitation géographique. Tel n'est pas le cas de la Turquie, qui applique cette convention aux seuls pays européens. La Turquie a modifié sa législation le 4 avril dernier et délivre désormais un statut de « réfugié conditionnel » permettant aux demandeurs d'asile non européens de séjourner en Turquie jusqu'à leur installation dans un pays d'accueil.
Cette protection, loin d'être comparable au droit d'asile appliquée par la plupart des pays européens, sera en outre difficile à mettre en oeuvre : dans son second rapport sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie du mois de mai, la Commission a pointé l'immense retard pris dans l'instruction des dossiers d'asile en Turquie. Pour résorber le stock, une réduction substantielle de l'arriéré des demandes de 11 000 à 13 000 par mois serait nécessaire afin de permettre l'instruction des nouvelles demandes.
Autrement dit, non seulement le système adopté par la Turquie le 4 avril 2016 est restrictif - il n'offre pas vraiment la protection du droit d'asile -, mais il est en outre totalement embolisé par le stock des demandes restant à instruire en Turquie.
D'autre part, le renvoi vers la Turquie, ce peut être aussi le renvoi vers d'autres pays tiers. Cela pose problème du point de vue des droits fondamentaux et du respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux, en particulier son article 3.
La Turquie, qui ne veut évidemment pas que se maintiennent durablement sur son territoire les migrants réadmis par les États européens, entreprend de signer à son tour un certain nombre d'accords bilatéraux de réadmission avec les États sources d'immigration, tels que le Pakistan, la Russie, le Nigeria, la Syrie. Elle envisagerait de le faire avec quatorze autres pays, dont l'Irak, l'Iran, le Soudan et l'Égypte. Ces accords, en permettant le « refoulement en chaîne » de personnes qui fuient souvent les guerres et les persécutions, nient l'existence du droit fondamental de quitter son pays, notamment pour demander l'asile, quand on est opprimé, poursuivi ou emprisonné.
L'interdiction de renvoyer une personne dans un pays, y compris dans un pays considéré comme sûr, s'il y a un risque que ce dernier renvoie lui-même cette personne dans un autre pays risqué pour elle, celui de sa nationalité ou de sa résidence, est pourtant contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Or ce risque n'est aujourd'hui pas hypothétique : on sait que des ressortissants afghans ont été expulsés de Turquie sans réel examen individualisé de leur situation. De même, Amnesty International indique avoir été témoin du renvoi de Syriens depuis la Turquie, ce qui illustre le caractère dangereux de cet accord.
Cet accord a également des conséquences factuelles, à commencer par la nécessaire rétention des exilés dans les centres de tri et de rétention avant même leur renvoi.
Au cours des discussions dans le cadre de l'accord, il a été prévu que 45 000 à 60 000 personnes devaient être réadmises par mois. Quels que soient les moyens mis à disposition - 4 000 experts européens, 30 juges nationaux, 280 millions d'euros -, la Grèce n'a pas pu enregistrer et « trier » en temps réel les exilés en fonction du besoin qu'ils ont de protection internationale. Dans l'impossibilité de trier, d'orienter et, éventuellement, de réadmettre les migrants de l'autre côté de la Méditerranée orientale, ces hotspots sont devenus en réalité des centres de rétention. Le tri, opération théoriquement et conceptuellement intelligente, se traduit dans la réalité par la mise en oeuvre d'une rétention administrative sous contrainte sur le territoire européen. Le plus bel exemple en est le camp grec de Moria où la situation est infâme.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le Haut-Commissariat pour les réfugiés a décidé de ne plus acheminer les exilés depuis les plages où ils débarquent jusqu'aux centres d'enregistrement, les demandeurs d'asile n'ayant pas, selon lui, à être retenus dans des centres.
Les 18 et 20 avril dernier, des députés français ont visité plusieurs camps grecs. À leur retour, ils ont indiqué que les conditions de vie dans ces centres y étaient physiquement et humainement intenables. Elles sont contraires à tous les droits, qu'il s'agisse du droit à un abri, à un hébergement, à la santé ou à l'intégrité physique.
Autre conséquence de fait : la volonté clairement exprimée de « fermer la route des Balkans », après avoir rendu impraticable celle de la mer Méditerranée du côté italien, entraînera l'ouverture d'une autre voie, sans doute plus dangereuse, avec l'aide forcément intéressée d'un certain nombre de personnes. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le redémarrage des routes libyenne et italienne. Les migrants recourent désormais à d'autres routes que la route turco-hélleno-balkanique.
L'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie, en coupant une route d'immigration, visait à lutter contre les trafics humains. Il s'agissait de « démanteler le modèle économique des passeurs et d'offrir aux migrants une perspective autre que celle de risquer leur vie ».
En réalité, cet accord vise avant tout à ce que la Turquie coupe la route aux migrants via les Balkans, à destination principalement de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Suède et de la Slovaquie, furieux de cette situation. Le seul effet a été l'interruption des flux dans un premier temps, puis leur détournement dans un second temps.
Dans son rapport de mai dernier sur la mise en oeuvre de l'accord, la Commission européenne a indiqué que dans le mois précédant son application, 1 740 migrants avaient traversé la mer Égée pour les îles grecques. Depuis le 1er mai, le nombre moyen d'arrivées quotidiennes est tombé à 47. Le nombre de morts en mer Égée serait passé de 89 au mois de janvier à 7 à la fin du mois de mars.
Bien entendu, ces chiffres sont fallacieux et ne traduisent pas du tout un réel progrès. D'une part, ils signifient que des milliers de personnes justifiant une application de la convention de Genève ne sont pas venues demander l'asile en Europe. C'est une manière de ne pas mettre en oeuvre les conventions internationales qui nous lient tous. D'autre part, ils signifient que le nombre de décès des exilés en mer est loin, au total, d'avoir faibli. Le 28 juin 2016, Frontex s'inquiétait dans la presse allemande du nombre grandissant de migrants tentant de rejoindre l'Europe au départ de l'Égypte en effectuant « une traversée très dangereuse ». Je rappelle que le 4 juin 2016, 700 migrants ont fait naufrage au large de la Libye et que le 9, 2 000 y ont été secourus et, heureusement, sauvés.
J'ai réuni le 28 juin dernier à Paris tous les Défenseurs des enfants européens, avec la Commission européenne et le Conseil de l'Europe, sur le thème du sort des mineurs errant en Europe. En 1947, on les aurait appelés des « chiens perdus sans collier », à l'instar du livre et du film du même nom. Le rapport de l'ENOC, le réseau européen des ombudsmans s'occupant des enfants, rédigé en février par les ombudsmans suédois et hollandais, a servi de base à nos travaux.
Ce rapport indiquait qu'un tiers des migrants qui se sont noyés en 2015 étaient mineurs. J'insiste parce qu'il faut analyser ce genre de situation à la lumière du drame auquel on est en train d'assister.
On voit donc les incidences juridiques instables, incertaines et, en toute hypothèse, contraires aux conventions internationales de cet accord, de même que ses conséquences concrètes très dangereuses. La question qui se pose désormais, et que je me pose moi-même, porte sur les recours possibles contre cet accord.
Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) a formé un recours « mesures provisoires » devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), visant à bloquer la réadmission de 50 migrants syriens, irakiens et afghans dont les demandes d'asile avaient été rejetées. Le jour même de la saisine, la Cour a rejeté la requête, mais le recours est maintenu au fond et sera examiné dans quelques mois.
Par ailleurs, le 18 juin dernier, trois exilés pakistanais et afghans ont demandé au Tribunal de l'Union européenne d'annuler l'accord passé. Cette décision conduira donc le Tribunal à clarifier la nature juridique de cet accord, qui, s'il a été récemment considéré comme une simple déclaration d'intentions par le Parlement européen, n'en produit pas moins des effets, en fait comme en droit.
De ce point de vue, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) comme celle de beaucoup d'autres juridictions, y compris notre juridiction administrative - le Conseil d'État -, ne retient pas seulement l'aspect formel de l'acte, mais apprécie également et admet de pouvoir juger l'intention des parties et les actions concrètes mises en oeuvre pour parvenir aux objectifs assignés par, par exemple, une déclaration d'intentions. Au regard de cette jurisprudence, l'« accord » UE-Turquie semble être doté d'une véritable valeur contraignante.
Si cet accord a une force obligatoire, il relève alors de l'article 218 du traité du fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cet article traite des règles de négociation et de conclusion des accords, quelle que soit leur forme, entre l'Union européenne et les pays tiers. Pour ce qui concerne l'asile, c'est la procédure législative ordinaire - adoption à la majorité qualifiée par la Commission, après approbation du Parlement européen, d'une décision portant conclusion de l'accord - qui s'appliquerait. Or, en l'occurrence, cette procédure n'a pas été respectée, et il est de jurisprudence constante que le défaut de respect de cette procédure affecte la légalité de la mesure.
Toutefois, on pourrait très bien considérer aussi que l'accord est constitué des communiqués de presse, des différentes déclarations exposant le dispositif de l'accord par un État membre - l'Allemagne notamment - ou par le Parlement européen. On pourrait également attaquer cet accord par l'intermédiaire d'une question préjudicielle posée par une juridiction nationale en vertu de l'article 267 du TFUE.
Ainsi apparaît le paradoxe insoutenable où nous nous trouvons et dont les conséquences sont dramatiques. Il n'y a formellement pas d'accord ; Mme Merkel a fait une visite, des déclarations ont été faites, et la Commission a décidé d'adresser des propositions à la Turquie en échange de la réadmission des exilés rejetés d'Europe. Comme je viens de le démontrer, cette absence d'accord n'a pas empêché que celui-ci ait des effets juridiques et matériels.
Aussi, si cet accord, ou ce qui en tient lieu, était annulé, c'est-à-dire si son inexistence juridique, liée à sa non-conformité aux règles internationales ou communautaires, était démontrée - ce qui arrivera probablement un jour -, cela n'emporterait pour autant aucun effet matériel. En effet, les situations d'urgence auxquelles nous sommes confrontés auront été de toute façon traitées, probablement très mal, même si l'accord UE-Turquie est rétrospectivement annulé.
Voilà ce que j'appellerais un « coup parfait » de la politique européenne de la forteresse, qui se donne pour seul objectif de dresser des murs aussi infranchissables que possible. Ainsi en va-t-il à Calais, par exemple, où l'on en est arrivé à transformer une frontière de Schengen, normalement destinée à contrôler les entrées, en une frontière vouée à empêcher les sorties ; une invention de la coopération franco-britannique d'une remarquable créativité...
Ce « coup parfait » peut bénéficier à court terme d'une certaine réussite ou, en tout cas, avoir un certain effet, mais il est clair que la seule façon de traiter à long terme ces questions est naturellement de revenir au droit primaire de l'Union européenne, qui va à l'encontre de ce pseudo-accord.
En effet, l'article 10 A du traité de Lisbonne - ce n'est pas de la protohistoire -, énonce que « l'action de l'Union sur la scène internationale [...] vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international ». L'externalisation de la gestion des flux migratoires engagée par l'Union - tant au travers de l'externalisation des demandes d'asile que de la pénalisation croissante de l'immigration - entre naturellement en pleine contradiction avec les objectifs énoncés à cet article.
Je pense que la force de la réalité finira par mettre en échec ce type de politique. J'ai récemment échangé avec Mme Natacha Bouchart, maire de Calais. La politique menée dans son agglomération, consistant en gros à dégager le centre-ville pour installer de fait ou de droit toutes les personnes qui viennent se heurter à la frontière britannique située en France sur des terrains vagues calaisiens, est naturellement en train de trouver ses limites. Un accord sera prochainement signé entre l'État et le département du Pas-de-Calais pour installer un nouveau centre d'accueil provisoire de mineurs non accompagnés ; cela représentera un progrès temporaire, mais ne réglera en rien le problème de fond, car ces mineurs relèvent probablement pour partie de la réunification familiale, en vertu de l'article 8 du règlement dit de Dublin III.
En discutant avec Mme Natacha Bouchart, qui est responsable de la population vivant à Calais - tant les Calaisiens que les migrants, qui sont devenus des habitants de fait de Calais -, on réalise que la politique européenne met en cause véritablement les droits fondamentaux au mépris des textes qui la régissent, et que l'on ferait mieux d'organiser l'accueil plutôt que la chasse.
Pour respecter les droits fondamentaux, les conventions internationales, les textes européens et, tout simplement, la dignité de ces personnes, il faut non pas fermer les frontières, mais ouvrir de manière organisée, c'est-à-dire communautaire, les voies légales d'immigration. De ce point de vue, l'Allemagne constitue un exemple intéressant puisqu'elle mène une double politique : d'une part, elle ouvre les voies légales d'immigration et l'accueil des réfugiés et, d'autre part, elle a été le principal protagoniste de l'accord UE-Turquie, c'est-à-dire de la volonté d'externaliser la barrière à la migration vers l'Europe.
En tant que Défenseur des droits, mais aussi en tant que citoyen, je suis assez effaré - pour employer un mot simple et générique -, par la cécité ou par le « court-termisme » de la politique actuelle en la matière. Non seulement on tourne le dos à l'histoire européenne depuis deux cents ans mais, pour demain, on est en train d'insulter l'avenir du continent.
Je me permets par ailleurs, pour ce qui concerne l'accueil des réfugiés et les chiffres y afférents, de vous renvoyer à un dossier d'Eurostat extrêmement bien renseigné. Je vous en communiquerai une synthèse.
M. Michel Billout, rapporteur. - Je n'ai plus beaucoup de questions à vous poser. Vous avez en effet abordé les problématiques que pose cet « accord », cet « arrangement », cette « déclaration » - on a toujours un peu de mal à qualifier cet acte - et son rapport aux droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le droit international, notamment la convention de Genève sur le statut des réfugiés.
Nous assistons à quelque chose de paradoxal. Nous revenons d'un déplacement en Turquie où nous avons échangé avec les autorités de ce pays. Trois millions de réfugiés sont accueillis dans ce pays de 80 millions d'habitants, alors que l'Union européenne, qui compte 500 millions d'habitants, a du mal à en accueillir un million. Aussi, quand la communauté de 500 millions de personnes demande à la communauté de 80 millions d'habitants de retenir les réfugiés, la situation est délicate...
M. Jacques Toubon. - L'Union européenne compte en effet 510 millions d'habitants, a le plus haut niveau de vie dans le monde, atteint les sommets en matière de recherche et de culture et représente un territoire très étendu. Pourtant, ces 510 millions de personnes ne semblent pas être capables d'accueillir chaque année entre 100 000 et 300 000 personnes réfugiées... C'est effectivement de cet ordre de grandeur qu'il s'agit, dans le plan de la Commission. Pour un pays de 66 millions d'habitants comme la France, cela représente environ 60 000 personnes. On en a accepté 30 000 dans le cadre de la relocalisation ; je ne pense pas qu'avec 60 000 personnes, on serait, comme le disent certaines personnes, « submergé »...
M. Michel Billout, rapporteur. - Cela dit, la Grèce avait réellement besoin d'une pause, me semble-t-il. À force de ne pas anticiper les choses, de laisser le phénomène se développer sur un territoire qui n'avait ni les structures ni les moyens nécessaires pour gérer ce flux, on a créé un drame humanitaire sur le territoire grec, où l'on ne voit guère de progrès.
M. Jacques Toubon. - Le problème de la Grèce, c'est Dublin III ! On doit lancer les négociations d'un Dublin IV qui renverse la logique de Dublin III ; alors, le problème de la Grèce sera réglé !
M. Jacques Legendre, président. - Pour ma part, je suis un peu plus perplexe. Il faut avoir une approche juridique et une approche politique. On peut débattre des chiffres et l'on peut regretter que la sensibilité des Européens soit exacerbée dès que l'on parle de migrants, mais les flux qui arrivent constituent une menace pour une communauté comme l'espace Schengen, dont les frontières sont mal tenues et sont remises en cause.
M. Jacques Toubon. - Il est vrai qu'il y a un lien entre migration et libre circulation.
M. Jacques Legendre, président. - La libre circulation et les acquis de Schengen en général sont menacés par les migrations. Or c'est l'un des seuls éléments qui nous restent actuellement, surtout après le Brexit. Les politiques doivent donc se saisir de cette question.
Se pose aussi le problème du pays sûr. On entend des opinions contradictoires à ce sujet. Au sein même du Conseil de l'Europe, les avis divergent. Ainsi, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Nils Muiznieks, nous a tenu des propos très proches des vôtres, tandis que le secrétaire général de cette institution, M. Thorbjørn Jagland, affirmait que si l'examen des cas restait individuel, il ne voyait pas de problème dans l'accord UE-Turquie.
La Turquie est-elle un État sûr ? Difficile de répondre. S'il s'agit de renvoyer des Kurdes en Turquie, on peut se poser la question. Cela étant dit, selon un certain nombre d'interlocuteurs que nous avons rencontrés, les migrants sont mieux traités en Turquie qu'en France ou dans bien des pays européens.
En revanche, le cas de Syriens renvoyés en Syrie que vous soulignez serait contraire à tout ce que nous pouvons accepter, mais c'est la première fois que nous entendons cela. Nous n'avons rien entendu de tel lors de notre déplacement en Turquie, donc cela mériterait un examen plus approfondi, car la Syrie ne peut en aucun cas être considérée comme un État sûr.
M. Jacques Toubon. - C'est même un État plus que risqué.
M. Jacques Legendre, président. - Oui, cela ne prête pas à discussion, mais nous n'avions pas entendu cela.
On nous a également parlé des 3 millions de personnes réfugiées en Turquie, dont 2,7 millions sont dans la nature et 300 000 dans des camps, organisés selon des standards corrects, voire supérieurs à ce que l'on peut trouver ailleurs. Nous avons pu visiter, en Grèce, un camp d'une grande tristesse situé dans une zone industrielle au centre d'Athènes, et avons vu aussi de pauvres gens installés aux abords du port du Pirée. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons en revanche pas pu aller à Lesbos.
Cela étant dit, un argument fort mis en avant par les défenseurs de l'accord consiste à dire qu'il fallait remplacer une situation d'illégalité par des moyens légaux de gagner l'Europe, de sorte à faire passer le message suivant : « il n'est pas nécessaire de se lancer sur la mer Égée, au péril de sa vie, alors que l'on peut arriver par des moyens légaux en Union européenne ». D'où cette procédure étonnante du « un pour un », qui permet de remplacer une présence illégale par une présence légale. C'est donc le pragmatisme qui a prédominé plutôt que le caractère juridiquement satisfaisant.
M. Jacques Toubon. - Sans doute, mais on obtient le résultat contraire. En effet, d'un côté, il y a un blocage - les voies légales ne sont pas du tout ouvertes, car tout le monde se terre dans son trou, y compris sous les bombes à Alep - et, d'un autre côté, on prend beaucoup de risques et l'on paie très cher pour passer par la voie libyo-italienne. C'est le contraire de l'objectif affiché.
La politique que nous menons - à Calais, en Turquie ou en Grèce - consistant à dresser des barrières ne permet pas d'orienter les migrations vers des voies légales. Là est toute la question : souhaitons-nous afficher que, sauf pour ceux que l'on qualifie de « réfugiés de guerre », nous ne voulons accueillir personne ou bien au contraire que nous mettons en oeuvre des politiques communautaires rationnelles d'immigration, conformes, pour l'asile comme pour les autres types d'immigration, à nos principes et - disons-le clairement - à nos intérêts ?
Mon rapport du 6 octobre 2015 sur la situation à Calais précisait que, à ne jamais vouloir afficher un seul élément positif dans le sens de l'accueil et de l'hospitalité, à tenir un discours de fermeture et de rejet, on déclenche les problèmes. La maîtrise des flux migratoires n'est pas la solution à nos problèmes, c'est au contraire ce qui crée des difficultés.
On objecte souvent à cela : « si je dis ce que je fais et si ce que je fais est bien, j'entraîne un appel d'air considérable donc je ne peux pas le dire » ; mais, dans la réalité, c'est complètement faux. La justification qui a été donnée à cet accord ne me semble pas s'être traduite concrètement par le résultat recherché. Il y a certes eu une baisse momentanée des arrivées à Calais, mais, depuis un mois et demi, on voit augmenter de nouveau le nombre de personnes qui s'installent dans le camp de la lande - la « jungle » - ; il y a ainsi entre 5 000 et 6 000 réfugiés dans ce camp aujourd'hui.
M. René Danesi. - Je voudrais faire deux remarques et poser une question.
Premièrement, les traités que je qualifierais d'« humanitaires » ont été rédigés dans les années 1950, et ont été constamment améliorés depuis lors, parce que l'on avait observé de grands mouvements de population à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui interpellait les consciences. Néanmoins, ces textes ont été écrits après ces grands mouvements, mais avant ceux qui ont suivi, c'est-à-dire dans une période où ce droit ne s'appliquait qu'à peu de personnes - quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers, mais certainement pas plusieurs centaines de milliers. Il y a donc un divorce entre ce droit et la réalité que nous vivons depuis deux ou trois ans.
Deuxièmement, on parle des migrants de façon générale, sans réellement distinguer deux sortes de migrants.
Il y a, d'une part, les migrants économiques, la grande masse des personnes cherchant à franchir la Méditerranée au risque de mourir, mais qui ne viennent pas de pays où ils risquent tous les jours leur vie. L'Europe a besoin de ces migrants économiques en raison de sa démographie déclinante, mais elle n'a pas besoin de tous ceux qui viennent. Même l'Allemagne, qui fait venir de la main d'oeuvre de toute l'Europe, n'a pas besoin d'une telle immigration économique. Il faut donc avoir le courage de poser cette question ; oui, l'Europe a besoin de migrants économiques, mais dans une certaine limite et dans des secteurs bien précis.
D'autre part, il y a les réfugiés de guerre, qui viennent de régions du monde où on risque sa vie - Syrie, Irak, Soudan... - malheureusement très nombreuses. On n'a pas assez travaillé aux conditions d'accueil de ces réfugiés de guerre, qui ont vocation, à mon sens, à rentrer chez eux à la fin de la guerre pour reconstruire leur pays. Quand 10 % ou 15 % de la population d'un État en guerre, et pas nécessairement parmi les plus pauvres, quittent leur pays, qui va le reconstruire ? On peut d'ailleurs faire la même remarque avec la migration économique : comment ces pays vont-ils se développer si l'Europe les écrème en leur prenant leurs médecins ou leurs ingénieurs ?
Aussi, au-delà des sentiments humanitaires, qui sont importants dans la culture européenne, il faudrait faire preuve d'un peu plus de réalisme et distinguer entre les migrants économiques, dont la plupart, mais pas forcément tous, resteront chez nous, et les réfugiés de guerre, qui ont vocation à rentrer chez eux pour reconstruire leur pays.
À la suite de ces deux remarques, je voudrais poser une question. On constate les réactions que ces arrivées de migrants provoquent dans la population européenne, on le voit à chaque élection. On l'a ainsi vu en Autriche et au Royaume-Uni. Or, dans ce contexte, la Hongrie va organiser un référendum portant sur une question posée à peu près en ces termes : « Êtes-vous d'accord pour que l'on accueille le nombre de migrants que l'Union européenne veut nous imposer ? » Vu la façon dont la question est posée, on peut imaginer ce que sera la réponse...
Cela étant dit, chaque peuple a le droit de répondre aux questions qui lui sont posées. On peut regretter la réponse, mais c'est cela aussi la démocratie ; s'en prendre au référendum, c'est nier le principe de la démocratie, cela signifie que le peuple n'a plus rien à dire et que les élites décident pour lui.
Ma question est donc simple : la Hongrie a-t-elle le droit de décider elle-même du nombre de réfugiés qu'elle accueille ?
M. Jacques Toubon. - Il faut distinguer deux sujets, comme je l'ai fait dans mon étude publiée le 9 mai dernier sur les droits fondamentaux des étrangers et leur insuffisante mise en oeuvre en France. Un domaine relève de la souveraineté d'un pays, c'est la police des étrangers - entrée, séjour, éloignement. Cette compétence est reconnue aux États, mais elle n'est pas du tout absolue, puisqu'elle est encadrée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est d'application directe - la CJUE en fait d'ailleurs couramment application.
En revanche, quand il s'agit des droits fondamentaux, dans la vie quotidienne, on se trouve enserré dans des dispositions s'imposant aux États. Ainsi, la personne qui s'installe dans un pays bénéficie de droits universels. C'est pourquoi j'ai mis en évidence le hiatus existant au pays des Droits de l'Homme entre la proclamation des droits et leur mise en oeuvre, dans le domaine de la santé, du logement ou encore de l'éducation.
La Hongrie peut donc décider si elle mettra ou non en oeuvre les prescriptions de l'Union européenne, mais cela signifierait simultanément qu'elle considère que toutes les autres règles de l'Union européenne, dont elle fait partie en tant qu'État membre, peuvent ne pas s'appliquer. L'Union européenne est effectivement à la fois un système d'accords intergouvernementaux et de règles supranationales donnant lieu à des contreparties.
Au Parlement européen, peut-être quelqu'un déposera-t-il un projet de résolution affirmant que les États n'appliquant pas la relocalisation ne pourront plus bénéficier des crédits de la politique de l'aide régionale ? La Commission européenne pourrait tout à fait le décider et le Parlement européen le voter. Donc, là aussi, la souveraineté est indirectement contrôlée.
Il y a une certaine incompréhension dans l'opinion publique : la plupart des gens confondent le régime juridique des droits fondamentaux s'appliquant à toutes les personnes, qu'elles soient ou non étrangères - en gros, les Droits de l'Homme -, et celui de certains pouvoirs de police qui appartiennent à la souveraineté de chaque État.
Pour ce qui concerne votre deuxième remarque, il n'est pas de ma compétence de dire ce qu'il faut faire des réfugiés de guerre ou des migrants économiques. Néanmoins, sachez qu'il est très difficile de distinguer entre les réfugiés en général, les réfugiés de guerre en particulier et les migrants économiques ou environnementaux. Un bon exemple est constitué par l'Érythrée - il y a beaucoup d'Érythréens à Calais -, où toutes les causes sont mélangées : une dictature féroce, la misère, les inondations, les séquelles d'un conflit armé.
Quant à votre proposition de faire évoluer le droit international selon les périodes historiques et que ce qui a été fait à la lumière de la Seconde Guerre mondiale, de la barbarie nazie et des mouvements de population qui les ont suivies devrait être désormais modifié, je serais plus réservé.
Si l'on mesure l'intensité des droits en fonction du nombre de personnes concernées, on met en cause le caractère absolu des Droits de l'Homme. Or il s'agit de droits visant à établir et garantir l'égalité entre toutes les personnes qui vivent à la surface de la Terre, sans se poser la question de leur nombre. On peut sans doute étudier de nouvelles conventions, mais pas à partir du principe selon lequel, en caricaturant votre pensée : s'il y a trop de migrants, il faut leur accorder moins de droits.
M. Jacques Legendre, président. - Il existe un groupe de travail sur les migrants, que je copréside avec M. Gaëtan Gorce, sur le phénomène global des migrations et qui distingue, d'une part, les réfugiés de guerre - un problème tragique mais limité -, qu'il ne faut pas renvoyer dans un pays en proie aux flammes et, d'autre part, l'explosion démographique de l'Afrique, avec laquelle nous avons des liens étroits et qui va conduire à d'importantes demandes d'immigration en Europe.
M. Jacques Toubon. - On pourrait parler dans ce cas de catastrophe naturelle, car il y a également une raréfaction des ressources. Prenons l'exemple du Niger, que vous connaissez bien, monsieur le président, ce pays comptera en 2030 50 millions d'habitants ; comment feront-ils pour vivre, manger, boire ?
M. Jacques Legendre, président. - En tant que président du groupe d'amitié d'Afrique de l'Ouest, je me rends régulièrement là-bas. Or, quand je vois la poussée démographique de ces pays, je me demande comment nous gérerons la confrontation entre des hommes jeunes voulant avoir ailleurs une vie meilleure et des pays comme les nôtres, où l'on peut se battre avec 12 % à 14 % de chômage, comme dans ma région. L'accueil sera délicat...
M. Jacques Toubon. - Il y a aussi des catastrophes naturelles au sens propre. En 2015, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés, il y a eu deux fois plus de mouvements de population en raison de catastrophes naturelles qu'en raison des causes classiques des mouvements de population - guerre, répression, dictature, pauvreté. Les mouvements de population pour des raisons environnementales ont concerné 18 millions de personnes, et cela ne diminuera pas avec le réchauffement climatique...
M. Jacques Legendre, président. - Il y a, au Niger, 7 enfants par femme, Boko Haram sur une partie du territoire,...
M. Jacques Toubon. - Sans parler d'AQMI, de l'autre côté.
M. Jacques Legendre, président. - ... la zone sahélienne, la sécheresse, l'extension des zones sahariennes ; bref, tout cela produit une accumulation de problèmes et un mélange redoutable qui nous inquiètent tous.
M. Jacques Toubon. - En effet, et je ne crois pas que nos murs, quel que soit leur matériau, puissent résister à cela. L'attitude intelligente et, me semble-t-il, conforme au progrès humain, consiste à trouver les voies pour prendre légalement en considération ces phénomènes à l'échelon international. Cela passe peut-être par un aggiornamento des règles internationales.
M. Jacques Legendre, président. - La politique menée à l'égard des migrants m'a d'ailleurs rappelé la situation des Shadoks et des Gibis. D'un côté, les ONG se mobilisent et défendent une vision humanitaire et, de l'autre, on demande à Frontex et aux services de police d'être aussi efficaces que possible dans l'érection de barrages. On appuie donc à la fois sur l'accélérateur et sur le frein ; il ne faudra donc pas s'étonner quand on fera une sortie de route...
M. Jacques Toubon. - En guise de référence littéraire, on pourrait aussi évoquer le roi Ubu... !
Cela dit, vous avez, dans votre assemblée, tous les moyens de mener une réflexion à ce sujet, et je suis à votre disposition pour vous assister dans cette tâche.
Audition de Mme Dorothée
Schmid,
directrice du programme « Turquie contemporaine » à
l'IFRI
Mercredi 21 septembre 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir Mme Dorothée Schmid, directrice du programme « Turquie contemporaine » à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI.
Si nos travaux touchent à leur fin, il semblait utile que nous bénéficiions, avant de les conclure, d'une analyse géostratégique de la situation en Turquie après les événements qui se sont produits cet été - la tentative de coup d'État et les purges massives qui ont suivi, l'opération « Bouclier de l'Euphrate » engagée par la Turquie en Syrie - et d'apprécier ses éventuelles conséquences sur l'accord passé entre l'Union européenne et la Turquie au sujet des réfugiés et des migrants.
Madame Schmid, vous avez la parole pour une dizaine de minutes, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions-réponses.
Mme Dorothée Schmid, directrice du programme « Turquie contemporaine » à l'Institut français des relations internationales. - Je suis assez réticente à intervenir sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, car ce sujet n'est pas ma spécialité. Je comprends bien néanmoins qu'une analyse du contexte actuel soit nécessaire. Il faut en effet aujourd'hui prendre en compte la nouvelle psychologie des dirigeants turcs.
J'évoquerai trois points : le coup d'État, ses conséquences sur la politique intérieure turque, ses conséquences pour l'extérieur.
Le coup d'État manqué donne lieu à des interprétations complotistes. Mais il a bien eu lieu, fomenté par une faction minoritaire et mal préparée de l'armée, et son échec ne tient peut-être pas à grand-chose. On ne saura pas avant longtemps ce qui s'est réellement passé. Le discours officiel impute le coup d'État aux gülénistes qui représentent un danger grave pour la Turquie. Pour ma part, je pensais que la lutte contre les gülénistes avait été menée à son terme en Turquie, puisqu'elle a commencé fin 2013.
En fait, ce coup d'Etat démontre que la Turquie est un État instable. Auparavant, il existait deux menaces pour le pays : Daech - malgré le flou qui caractérise les activités de Daech en Turquie - et la question kurde, réactivée depuis un an, avec la reprise des attaques du PKK contre les forces de sécurité. On se pose désormais des questions sur la stratégie d'action du PKK, qui commence à s'en prendre à des hommes politiques turcs (AKP, CHP), au-delà des forces de sécurité. Un cap est en train d'être franchi dans les rapports entre les communautés turque et kurde et, à mon sens, le risque de guerre civile devient réel. Gülen fait désormais figure de troisième menace, le président turc mettant ces trois dangers, pourtant de nature fort différente, sur un même plan. La conséquence en est que la situation des libertés publiques s'aggrave rapidement. La propagande officielle célèbre les victimes du coup d'Etat et met en scène leur martyre. Quiconque aujourd'hui a un lien, même très ténu, avec les gülénistes, peut avoir des problèmes. De façon plus large, tous les fonctionnaires de l'Etat sont désormais sous surveillance, et c'est également valable pour les universitaires, qui ont été interdits de sortie du territoire cet été. Des pressions fortes s'exercent à l'égard des voix dissidentes. Les gülénistes demandent eux aussi discrètement de l'aide. Je suis pessimiste sur l'évolution de la situation intérieure, entre la dégradation sécuritaire et le verrouillage complet de l'opinion : c'est l'état de droit qui est en cause.
Sur le plan diplomatique, la réconciliation avec Israël et la Russie avait déjà été scellée avant le coup d'État, dans l'optique de réparer les erreurs imputées à la politique extérieure menée par Ahmet Davutoglu. Depuis le coup d'Etat, les relations avec les pays occidentaux -et en particulier, les Etats-Unis- se caractérisent par un extrême malaise, la Turquie leur reprochant d'avoir manifesté trop tard leur solidarité avec le régime. Du point de vue européen, la démarche de Martin Schultz a permis un certain apaisement. Il faut souligner, à cet égard, que l'Allemagne compte un nombre important de migrants d'origine turque et que la situation en Turquie a des implications précises pour elle en termes de politique intérieure. Il faudra être attentif aux demandes d'extradition par les autorités turques de personnes qui seraient considérées comme liées à la tentative de coup d'État. Cette problématique concernera par exemple directement la Grèce, puisque des mutins y ont trouvé refuge. Or, il n'y a pas eu de concertation au sein de l'Union européenne sur ces questions. On peut s'attendre à de nouvelles crises diplomatiques à ce sujet dans les mois à venir.
Ce qui me frappe à propos de la mise en oeuvre de l'accord, c'est que la Turquie ne cesse de changer de discours. Par ailleurs, la question de la loi anti-terroriste reste plus que jamais un point de blocage, dans un contexte de resserrement sécuritaire en Turquie.
Concernant l'intervention turque en Syrie, on peut se demander si elle a vraiment été concertée avec les autres acteurs de cette crise. C'est un sujet d'inquiétude. Vladimir Poutine manifeste, à cet égard, une certaine impatience à l'égard de la présence turque en Syrie.
J'ai récemment entendu une universitaire turque plaider pour une solidarité militaire française à l'égard de l'intervention turque en Syrie, pour compenser le fait que la France n'avait pas soutenu suffisamment le gouvernement dans la période post-coup d'État. Une certaine grogne s'exprime aussi vis-à-vis des réformes demandées par l'Union européenne dans le cadre du processus d'adhésion.
Une période de crispation était inévitable après les événements du 15 juillet. Le président Erdogan se montre depuis 2015 prêt à tout pour conserver un pouvoir absolu en Turquie. Dans un sens, la campagne anti-Gülen offre un dérivatif à une violence qui aurait pu se déchaîner d'une autre manière en Turquie. Nous sommes actuellement dans une période de « réglage » de la répression. Cela étant dit, il va être difficile de continuer à traiter avec la Turquie comme avant.
M. Michel Billout, rapporteur. - Peut-on s'attendre à une nouvelle politique turque à l'égard des réfugiés ? Par ailleurs, on constate que la répression va bien au-delà des gülenistes et touche aussi le mouvement pro-kurde comme le montre la destitution récente de 29 maires dont 26 maires kurdes, issus, pour une grande part, des régions du sud-est de la Turquie. Quelle est la situation des Kurdes dans le sud-est de la Turquie ?
Mme Dorothée Schmid. - Dans le dossier des réfugiés, le Gouvernement turc n'a pas de stratégie, il a juste laissé faire. Il s'agissait au départ d'un accueil bienveillant. Lorsqu'on discute du cas des Syriens, les autorités turques mettent surtout en avant la gestion remarquable des camps, mais qui ne concernent qu'une minorité des réfugiés. Il semble en revanche qu'elles aient peu de prise sur les autres, ceux qui sont dans les villes et qui se déplacent sur le territoire, malgré les tentatives de les fixer. Depuis le début de l'année, on commence à parler de la nécessité d'une politique d'intégration, il y a comme une volonté de trouver une issue par le haut à cette question. L'idée de leur octroyer la nationalité turque fait partie de cette tactique. Mais elle a été plutôt mal reçue par l'opinion publique. En tous cas, la prise de conscience des enjeux de ce dossier est tardive.
En ce qui concerne leur intégration économique, très peu de permis de travail ont été délivrés jusqu'ici (quelques milliers). Leur délivrance implique des contraintes fortes pour les entreprises turques. Elles sont donc réticentes, car il est plus intéressant pour elles de ne pas légaliser les travailleurs syriens. L'apport de la main d'oeuvre syrienne à l'économie turque dans le secteur informel est très important (le secteur textile compte par exemple deux tiers d'emplois clandestins, incluant une part importante d'enfants réfugiés).
La normalisation du dossier des réfugiés implique de la part de la Turquie qu'elle gère sa frontière avec la Syrie. C'est aussi pour s'assurer le contrôle d'une zone où elle pourra maintenir voire renvoyer des réfugiés syriens qu'elle est intervenue dans ce pays.
Jusqu'à présent, la population a fait preuve d'une grande tolérance à l'égard des réfugiés, mais à terme, il n'est pas certain que cette question ne finisse pas par lasser l'électorat de Tayyip Erdogan.
Concernant les Kurdes, la situation est catastrophique. On glisse très facilement de l'accusation de terrorisme à la neutralisation de toute voix dissidente. Le durcissement est très net depuis 2015, après ces élections législatives du mois de juin où le parti pro-kurde avait obtenu 13 % des voix. L'antagonisme turco-kurde devient très dur et produit un racisme réciproque. Le risque est que les Kurdes non politisés dérivent. La marginalisation du HDP, de plus en plus présenté par le régime comme une vitrine légale du PKK, me semble aller en ce sens.
M. Jean-Yves Leconte. - Je relève un décalage entre l'image moderne que renvoie ce parti et sa base qui est celle du PKK. Pour quelles raisons l'ambassade de France a-t-elle fermé juste avant le coup d'État ?
Mme Dorothée Schmid. - Il ne faut pas verser dans la théorie du complot. La France, comme d'autres pays, avait fermé son ambassade en raison des menaces de Daech. Quant au HDP, il est vrai qu'il est constitué pour une bonne partie de militants pro-autonomie, dans la mouvance large du PKK. Mais son positionnement politique est assez compliqué pour susciter l'intérêt. Ce parti évolue plus rapidement que les autres en Turquie : c'est le seul parti à tenir un discours audible et structuré sur les questions d'Etat de droit et des libertés publiques.
M. Jean-Yves Leconte. - Il semblerait que la Russie et l'Iran aient fourni à la Turquie des informations sur ce qui se tramait dans l'armée alors que les services occidentaux ne l'ont pas fait. Y-a-t-il un vrai changement d'orientation et un rapprochement de la Turquie avec ces pays ? Beaucoup estiment que la Turquie tire profit de l'accord passé avec l'UE sur le plan intérieur, en se donnant le beau rôle.
Mme Dorothée Schmid. - Certes, le coup d'Etat a contribué à renforcer les liens de la Turquie avec la Russie et l'Iran. Néanmoins, la relation russo-turque n'est pas sans aspérités. L'intervention turque en Syrie embarrasse l'OTAN et aurait nécessité un peu de concertation en amont. Concernant les réfugiés, il faut admettre que depuis 2011, l'UE néglige les efforts réalisés par la Turquie en faveur des réfugiés. Leur présence sur le sol turc n'est pas forcément un atout car, pour l'heure, la situation économique turque n'est pas florissante. En outre, de même qu'il y a une fragmentation de la population syrienne, il y a une fragmentation de la population des réfugiés. La Turquie a fini par fermer sa frontière avec la Syrie, ne pouvant accueillir davantage de réfugiés. Je persiste à croire que les autorités turques connaissent très mal cette population. Cela pose un problème aussi en termes de sécurité, car parmi les Syriens se trouvent aussi des Kurdes et des radicaux islamistes.
M. Michel Billout, rapporteur. - On peut parler d'une réussite de l'accord en termes de flux. Quel peut être l'intérêt de la Turquie à le maintenir si l'UE, compte tenu des critères, ne peut lui donner satisfaction sur le plan des visas et de l'adhésion ?
Mme Dorothée Schmid. - On assiste à un retour en force de la rhétorique turque sur sa volonté d'adhésion et le traitement discriminatoire que l'UE lui infligerait ; mais en fait, la Turquie est soucieuse de ne pas infliger trop de dommage à sa relation avec l'UE. Concernant le tarissement des flux, je suis persuadée qu'a joué l'effet d'annonce de la fermeture de la route des Balkans, y compris sur les réfugiés se trouvant au Liban et en Jordanie. Si la Turquie concède en outre la nationalité turque aux réfugiés, les Syriens qui le peuvent resteront probablement en Turquie si les portes de l'Europe restent fermées.
M. Jacques Legendre. - Les réseaux de passeurs ont-ils vraiment été démantelés ou bénéficient-ils d'une certaine tolérance ?
Mme Dorothée Schmid. - Sur toute la frontière turco-syrienne, on sait que se développent des trafics divers, y compris humains. Il est évident que les réseaux de passeurs ont pu corrompre des officiels et bénéficier de complicités locales. Entre la Turquie et la Grèce, les mêmes opérateurs peuvent s'organiser : les passeurs sont syriens, mais aussi turcs pour la plupart.
M. Philippe Kaltenbach. - Les réfugiés forment une main-d'oeuvre pas chère pour la Turquie, y compris les enfants, mais constituent-ils également une réserve de voix pour Tayyip Erdogan ? Peut-on parler d'une démarche électoraliste ? Par ailleurs, la menace du président Erdogan de « rouvrir les vannes » vous semble-t-elle crédible ?
Mme Dorothée Schmid. - D'un point de vue économique, vous avez raison. On commence à peine à mesurer la contribution des réfugiés à l'économie turque. Ce pays a en effet, malgré un contexte difficile, marqué notamment par la guerre, une croissance supérieure aux prévisions. La présence des Syriens a des effets positifs dans la mesure où ils travaillent, y compris les enfants, avec des salaires inférieurs aux salaires turcs. Il y a aussi des Syriens qui ont délocalisé leur activité en Turquie dans le secteur informel. La volonté de compenser un manque de croissance peut effectivement induire de la tolérance vis-à-vis des réfugiés. Mais cette concurrence pourrait aussi alimenter une grogne anti-réfugiés, alors que jusqu'à présent, l'électorat de l'AKP -c'est-à-dire la classe moyenne des petits entrepreneurs- soutenait le discours d'accueil de Tayyip Erdogan. La présence de Daech est aussi liée à celle des réfugiés, notamment dans le sud-est. Sur le terrain, on relève des incidents de plus en plus fréquents liés à leur présence. On atteint désormais les limites de l'invisibilité des réfugiés syriens. Je suis inquiète de la manière dont leur intégration peut se faire, dans un pays où cohabitent déjà difficilement différents groupes de population. Certains soupçonnent en effet les autorités turques de tenter « d'arabiser » le sud-est du territoire, pour effectuer une sorte de rééquilibrage au détriment de la population kurde.
Audition M. Didier
Billion,
directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et
stratégiques
Mercredi 21 septembre 2016
M. Jacques Legendre, président. - Mes chers collègues, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir M. Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Comme je l'indiquais à notre précédent intervenant, notre mission rendra bientôt ses conclusions sur l'accord UE Turquie, sujet sur lequel nous travaillons depuis le mois de mai dernier, et nous souhaiterions, avant cette échéance, recueillir votre analyse sur l'évolution récente de la Turquie - putsch manqué et reprise en main qui a suivi ou encore intervention turque en Syrie - et sur ses éventuelles conséquences pour l'accord migratoire passé entre l'Union européenne et la Turquie.
M. Didier Billion, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques. - Je vais vous exposer les différents aspects de la question très brièvement et peut-être, je vous prie de m'en excuser, un peu schématiquement. La situation induite par le coup d'État de juillet dernier a entraîné des réactions en chaîne dont nous ne maîtrisons pas encore l'ampleur. À mon sens, les conséquences politiques de ce coup d'État, heureusement avorté, s'apprécieront sur plusieurs années.
Avant toute chose, il faut souligner qu'il y a eu une véritable tentative de coup d'État. On peut considérer qu'il était mal préparé, que ceux qui en étaient à l'origine étaient des amateurs et qu'il a été réalisé par une coalition hétéroclite, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une véritable tentative de coup d'État, dont l'expression la plus symbolique - je suppose que l'on y est forcément sensible dans une institution comme la vôtre - a été le bombardement du Parlement.
Cette tentative de coup d'État a démontré une nouvelle fois l'extraordinaire réactivité du président Recep Tayyip Erdogan, pour le meilleur et pour le pire, car, après une période très courte de flottement - on peut le comprendre, des avions militaires survolaient la capitale et Istanbul -, les mesures nécessaires ont été prises très rapidement. Cela s'est traduit par la sauvegarde de l'appareil d'État et par ce que l'on pourrait appeler un contre-coup d'État civil.
Je ne ferai pas un parallèle entre le coup d'État et ce contre-coup d'État civil ; toutefois, dans les mesures répressives qu'il a prises, le pouvoir en place a ratissé large. Les réseaux gülenistes étaient certes implantés dans l'appareil d'État, y compris au sein de l'institution militaire, mais parmi les personnes radiées de la fonction publique, arrêtées ou expulsées de leur entreprise, on peut considérer, si l'on admet que les réseaux gülenistes ne possèdent pas une structure centralisée, qu'il y a des personnes qui ont été, à un moment donné, en lien avec Hizmet, mais qui ne sont pour rien dans la tentative de coup d'État. Il y a donc en ce sens une pente dangereuse, cela est incontestable.
Toutefois, je ne pense pas que notre réaction ait été des plus appropriées. De mémoire, dans son premier communiqué après l'évènement, le ministre français des affaires étrangères condamnait la tentative de coup d'État, mais indiquait, dans le même temps, qu'il faudrait veiller à ce que les autorités turques n'en profitent pas pour restreindre trop les libertés publiques. Il ne s'agit pas de critiquer le ministre des affaires étrangères, mais d'avoir en tête les possibles réactions de la Turquie.
Voici donc la difficulté : nous ne pouvons rester indifférents aux mesures prises par le pouvoir turc, qui ont un caractère incontestablement liberticide, mais nous devons aussi nous centrer sur la question principale : avons-nous - en Union européenne, en France - les mêmes intérêts géopolitiques que la Turquie ? Avoir les mêmes intérêts géopolitiques fondamentaux n'implique pas d'être forcément toujours d'accord sur tout, mais la critique, que nous avons le droit voire parfois le devoir de formuler, ne doit pas aboutir à une condamnation permanente de la Turquie.
Par ailleurs, il faut saisir la période de tensions que traverse la Turquie, le thème de la guerre civile apparaît fréquemment dans la presse turque. Si c'est sans doute exagéré, il y a tout de même eu des moments de micro-guerres civiles, notamment au Sud-Est il y a environ un an.
Nous pouvons émettre des critiques sur la situation des droits de l'homme et de l'État de droit en Turquie, mais nous devons faire l'effort de replacer ces critiques dans le contexte turc, et de les mesurer en raison de la situation politique régionale - conflit syrien, question kurde.
En second lieu se posent les questions de l'application de l'accord du 18 mars dernier et donc celle des visas, les deux étant indissolublement liées. Nous avons signé cet accord, donc, il nous engage. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'est peut-être pas très bon, mais il n'y en avait sans doute pas de meilleur.
Cela touche à la question antiterroriste, sur laquelle l'Union européenne demeure un peu floue. Sans doute avons-nous le droit d'émettre des critiques sur la conception large des autorités turques de la lutte contre le terrorisme, conduisant par exemple à l'arrestation de journalistes traitant trop complaisamment les revendications kurdes, mais il est très difficile de les faire comprendre aux autorités turques, ainsi qu'à une portion très large de la population qui subit des attentats depuis des années. On risque dans ce cas d'être inaudibles, il faut en tenir compte.
Il convient également d'avoir à l'esprit que la Turquie a trois ennemis publics numéro 1 : Daech, le PKK et les gülenistes. En avoir un, c'est fréquent, il peut arriver que l'on en ait deux, mais en avoir trois paraît excessif. Donc, même si c'est difficile à dire, on ne peut pas considérer sur le même plan, en les qualifiant de terroristes, les combattants de l'État islamique, les membres du PKK et les gülenistes. La genèse de ces mouvements et leur histoire diffèrent.
Pourtant, aujourd'hui, le gouvernement et le président turcs dénomment le mouvement Gülen « FETÖ », acronyme turc de « organisation terroriste Fethullah». Des gülenistes ont sans doute participé au coup d'État, mais de là à les qualifier de terroristes, il y a un pas que je ne franchirais pas. Cela dit, demander aux autorités turques de préciser leur définition du terrorisme, ou plutôt la nature de leur lutte antiterroriste est difficile, il ne faut pas faire de faux pas. On est donc piégé, mais il faut toujours sortir des pièges, c'est-à-dire trouver des pistes.
En ce qui concerne les réfugiés, on lit ou on entend qu'ils seraient maltraités ; peut-être ne sont-ils pas très bien gérés à leur arrivée, mais rappelons qu'ils sont trois millions et qu'il n'est pas facile d'en accueillir un tel nombre. Chacun s'accorde à constater que d'importants efforts ont été réalisés pour ce qui concerne les camps d'accueil. En outre, l'Union européenne doit aussi remplir sa part de l'accord en honorant ses engagements sur le plan financier ; or on est loin du compte.
Le 24 août dernier, date de l'intervention turque sur le sol syrien, a toutefois marqué un tournant dans le conflit en Syrie. La critique adressée à la Turquie à propos de sa complaisance à l'égard de l'État islamique est désormais derrière nous. Soulignons toutefois que si l'Etat islamique est visé c'est plus fondamentalement la lutte de l'État turc contre le PYD qui est l'essentiel - je parle bien du PYD et non des Kurdes.
Je termine mon propos liminaire en demandant si nous, Français, Européens, avons intérêt à nous renforcer nos liens avec la Turquie. Oui, de mon point de vue. Nous avons souvent en France cette tendance à considérer que les Kurdes constituent une réalité politique en tant que telle, ce qui est erroné. En réalité, nous avons plus d'intérêts communs que de divergences avec la Turquie concernant la Syrie. Dès le printemps dernier, fin mai, Tayyip Erdogan a déclaré qu'il était nécessaire de dialoguer avec la Syrie, ce qui désignait clairement le pouvoir de Damas. La Turquie a donc fortement évolué puisque, je le rappelle, Tayyip Erdogan et Ahmet Davutoglu avaient pour objectif la chute de Bachar al-Assad. Il y a ainsi un rapprochement avec les positions de la France - je ne dis pas « avec les positions européennes » car j'ai du mal à saisir quelle est la position européenne ; ce que je crois avoir compris, c'est qu'il y a plutôt de multiples positions européennes.
Je reviens à la question des valeurs, de la démocratie, de l'État de droit. On ne peut pas se poser en donneur de leçons à ce sujet vis-à-vis de la Turquie, ne serait-ce que parce que les Turcs sont susceptibles ; c'est une réalité dont il faut tenir compte. Il faut se placer dans une perspective positive. À cet égard, le rapport de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat me paraît avoir la bonne tonalité, adopter le bon angle. La tendance facile serait en effet de condamner, mais la condamnation ne vaut pas grand-chose : elle n'ouvre pas de perspective et elle froisse.
C'est une erreur tactique que nous avons commise lorsque nous avons condamné le coup d'État tout en demandant aux autorités de ne pas en profiter pour prendre des mesures liberticides. C'est très mal perçu en Turquie et c'est même instrumentalisé : Tayyip Erdogan s'en prend aux puissances occidentales, présentées comme donneuses de leçons. Cela dit, il fait cela parce qu'il a besoin d'un dialogue avec les puissances occidentales. Il est faux de considérer que la Turquie et Tayyip Erdogan sont en rupture avec les puissances occidentales, au contraire. Cela n'exclut pas une réconciliation avec la Russie ; ce n'est pas parce que l'on fait plus de Russie ou d'Asie que l'on fait moins d'Europe ou d'États-Unis...
M. Michel Billout, rapporteur. - Je voudrais réagir en recentrant la discussion sur notre sujet, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie destiné à faire cesser le flux de migrants vers la Grèce. Voici notre constat : que ce soit un effet de l'accord ou lié à un autre facteur, le flux de migrants a chuté alors que toutes les autres dimensions de l'accord ne fonctionnent pas.
Du côté européen, tout le monde souhaiterait en rester là, mais il y avait des contreparties à l'accord, concernant notamment la politique de visas et la reprise du processus d'adhésion. Que faire maintenant ? Sans parler du processus d'adhésion, purement cosmétique, les Européens doivent-ils être plus souples pour les visas ?
Seconde question : de son côté, Tayyip Erdogan a-t-il intérêt à continuer d'agiter la menace selon laquelle, si l'on n'applique pas l'accord, il arrêtera tout et les migrants retraverseront la mer Égée ?
M. Didier Billion. - Faire cesser le flux de migrants vers la Grèce demeure bien entendu l'objectif majeur, mais le flux continuera tant que se poursuivra la guerre en Syrie. Avant l'accord du 18 mars dernier, en février me semble-t-il, il y a eu un afflux massif de migrants d'Alep vers la frontière turque, fermée par les autorités. Mme Federica Mogherini avait alors intimé à celles-ci d'ouvrir leurs frontières, tout en maintenant fermées celles de l'Union européenne. On ne peut pas exiger cela, nous devons être logiques.
Nous touchons effectivement là au coeur du sujet. Ne peut-on accepter que cette question des visas soit totalement et radicalement indépendante de la question de la définition de la lutte contre le terrorisme ? Je réalise que cela est plus facile à dire qu'à faire, mais il n'y a pas d'autre solution si l'on veut gérer la question du flux. Tayyip Erdogan l'a d'ailleurs bien compris et il fait de la surenchère.
En outre, sur cette question de la lutte antiterroriste, sommes-nous audibles lorsque nous disons que la Turquie doit restreindre la définition du terrorisme et de la lutte anti-terroriste alors qu'elle a subi plusieurs attentats au cours des derniers mois ? Que dirions-nous, en France, si une organisation internationale ou un État étranger nous demandaient de suspendre l'état d'urgence alors que nous avons été victimes de plusieurs attentats ? Or la Turquie est confrontée à un défi semblable au nôtre, mais dans un contexte encore plus chaotique.
Ne peut-on donc faire un pas en ce sens ? On pourrait tout à fait imaginer un compromis acceptable, d'autant que la polarisation s'est accentuée en Turquie, avant même le coup d'État de juillet dernier.
Seconde question : jusqu'où Tayyip Erdogan peut-il aller ? Pour ma part, je crois qu'il peut mettre ses menaces à exécution, je pense qu'il peut tout à fait, ponctuellement, pendant quelques semaines, ouvrir les vannes. C'est condamnable, sans doute, c'est du chantage, mais c'est pour cela qu'il faut négocier et il faut le faire sans se renier. Si l'on n'est pas capable de prendre cela en compte, on ne fait plus de politique. Nous faisons d'ailleurs la preuve que, dans notre propre pays, où pourtant l'État de droit est respecté, il existe, indépendamment des surenchères politiques, des débats sur la lutte antiterroriste. Cela signifie donc bien que cette question est difficile.
Par ailleurs, je n'ai pas réussi à avoir des éléments tangibles à ce sujet, on m'a dit que les flux vers la Grèce ont augmenté récemment, est-ce le cas ?
M. Jacques Legendre, président. - C'est vrai, mais dans des proportions limitées.
M. Didier Billion. - En outre, avant de dire que les Turcs ont leur pleine place dans l'Union européenne - ce à quoi personne ne croit vraiment, en tout cas dans le court terme -, il serait tout de même utile d'ouvrir les chapitres 23 et 24 des négociations. Ouvrons-les ! Je ne suis d'ailleurs pas sûr que cela plairait à nos amis turcs, car il s'agit des droits fondamentaux et des libertés publiques, mais discutons-en, nous sommes partenaires. Le processus d'adhésion n'a pas été théoriquement arrêté. Cela aiderait en outre les démocrates turcs, qui en ont besoin.
J'ai conscience que cela est plus facile à dire qu'à faire, parce que Tayyip Erdoðan a parfaitement compris qu'il a des atouts dans sa manche, mais on ne peut pas lui couper le bras, donc il faut en tenir compte. Peut-être suis-je trop empreint de realpolitik, mais il n'y que cette méthode qui puisse donner des résultats.
M. Michel Billout, rapporteur. - Vous pensez que Tayyip Erdogan pourrait ouvrir les vannes, mais nous nous sommes demandé s'il les avait réellement fermées. Plusieurs intervenants turcs ont affirmé que ce n'était pas le cas. Selon eux, il s'agirait d'un phénomène psychologique, la fermeture des Balkans aurait tari le flux. Le représentant de la Turquie auprès de l'Union européenne nous a ainsi indiqué que la Turquie ne reprendrait plus les réfugiés de Grèce, mais il n'y a pas eu de reprise des flux antérieurs. Les Turcs disent plutôt qu'ils n'ont pas de prise sur ce phénomène - il y a d'ailleurs une certaine incohérence à prétendre que l'on ne maîtrise pas les flux et à menacer d'ouvrir les vannes...
M. Didier Billion. - Pour ma part, sur le fondement des informations dont je dispose, cela n'est pas vrai. Les Turcs ont resserré le dispositif de contrôle. Ce n'est sans doute pas le seul facteur, il existe aussi un facteur psychologique et un tarissement des flux par ces voies, mais tout cela se conjugue. Ils se donnent le bon rôle, mais ce n'est que très partiellement vrai. J'ai même entendu dire lors, d'un échange avec un parlementaire turc, que c'étaient les gülenistes qui étaient responsables des flux transfrontaliers...
D'après ce que nous pouvons savoir, un système de surveillance et de contrôle renforcé a été mis en place pour bloquer les passages. Néanmoins, cela n'est pas contradictoire avec le fait que les réfugiés passent par d'autres voies.
Bref, les autorités turques ont fermé les vannes et ont donc joué le jeu, c'est pourquoi je crois le Président Erdogan quand il dit qu'il peut les rouvrir ; il est allé jusqu'à affirmer dans un discours que les cars et les avions turcs pourraient être utilisés pour aller en Europe... Puisque ce responsable politique ne comprend que le langage du rapport de force, il peut ouvrir les vannes de façon temporaire pour faire pression sur l'Union européenne. Il y a donc là un jeu dialectique compliqué.
M. Michel Billout, rapporteur. - Que pouvez-vous nous dire sur la question des réfugiés en Turquie, notamment sur l'intérêt que le Président Erdogan pourrait avoir à les y maintenir ? En effet, ces réfugiés constituent une main-d'oeuvre bon marché et l'on pourrait aussi en faire des électeurs. En outre, pour pouvoir retourner facilement en Syrie, ils restent dans la région sud-est, donc cela pourrait favoriser une nouvelle forme de peuplement de la région kurde.
M. Didier Billion. - Oui, la main-d'oeuvre bon marché que constituent les réfugiés est une réalité. Cela étant dit, attention, cela peut facilement entraîner un profond mécontentement social et du chômage. Il y a de fortes contradictions sociales en la matière. Le gouvernement turc a d'ailleurs parfaitement conscience de cette difficulté. Une loi permettant aux réfugiés de trouver du travail a été adoptée. On ne peut contester le principe qui la sous-tend. Cela représente un véritable effort et il y a des aspects positifs dans le fait de donner un cadre légal, un statut, à ces réfugiés. Toutefois, c'est un fait qu'une fraction des entrepreneurs peut en profiter et la presse turque a souligné les tensions extrêmement fortes que cela pouvait entraîner sur le marché du travail.
Cela ne concerne d'ailleurs pas que le marché du travail mais aussi l'immobilier. Une partie des réfugiés syriens, disons autour de 10 % d'entre eux, ne sont pas de pauvres gens, ils ont de l'argent et ils l'investissent, y compris dans le marché immobilier.
Enfin, en 2015, la majorité des entreprises ont été créées par des réfugiés syriens et irakiens - il s'agit bien entendu de petites entreprises. Pour les petits et moyens entrepreneurs turcs, cela représente une concurrence directe. Or ces petits et moyens entrepreneurs constituent la base sociale de l'AKP. En tout état de cause, les autorités ont conscience de toutes ces réalités.
Tayyip Erdogan a aussi fait des déclarations annonçant la naturalisation des réfugiés. On dit que cela pourrait accroître sa base électorale ; certes, mais il a été élu président au premier tour en 2014 et son parti a remporté 49 % des voix aux secondes élections législatives de 2015. Il a donc d'ores et déjà une base électorale solide.
M. Jacques Legendre, président. - Mais pas aux premières élections de 2015...
M. Didier Billion. - C'est vrai, mais l'AKP avait tout de même remporté 41 % des suffrages. Après 12 ans au pouvoir, ce n'est pas rien. Beaucoup de partis en France aimeraient remporter autant de suffrages après une telle durée. Toutefois, il est vrai que son objectif n'était pas atteint puisqu'il voulait la majorité qualifiée requise pour pouvoir modifier la Constitution.
Par ailleurs, Tayyip Erdogan a effectivement évoqué le droit de vote pour les réfugiés mais, de mémoire, seulement dans des discours et à deux reprises, la dernière fois étant en juin dernier.
La question de l'avenir des réfugiés en Turquie pose le problème de la région sud-est. Y aurait-il une tentation de modifier la composition ethnique et confessionnelle dans cette région ? C'est peut-être un objectif mais, dans ce cas, il faudrait beaucoup plus de réfugiés que trois millions.
Il y a aussi la question des alévis de Turquie. Les alévis voient l'installation des réfugiés d'un très mauvais oeil. S'il existe un danger d'être submergé par les réfugiés, cela concerne plutôt les alévis, qui sont très inquiets d'un possible remplacement ethno-confessionnel. Je pense toutefois que Tayyip Erdogan est suffisamment fin politique pour ne pas prendre ce risque et qu'il n'y aura pas de naturalisations massives. En revanche, je pense qu'une partie importante des réfugiés restera en Turquie pendant plusieurs décennies, voire ad vitam æternam.
M. Jacques Legendre, président. - Que pouvez-vous nous dire sur la position politique des partis de l'opposition non güleniste ? La représentante du parti kémaliste nous a fait un discours plutôt embarrassé au Conseil de l'Europe. Elle a insisté sur le risque de réduction du droit des femmes et sur celui de guerre civile.
M. Didier Billion. - Je ne crois pas que l'on puisse poser la question du droit des femmes en ces termes...
Pour ce qui concerne la situation des partis d'opposition, concentrons-nous sur le parti kémaliste. En effet, le parti d'extrême droite, le Parti d'action nationaliste, traverse une crise très profonde ; je pense qu'il subira une scission et, en tout cas, il est en perte de vitesse. Quant au Parti démocratique des peuples, il est en difficulté puisque le souhait de lever l'immunité parlementaire est dirigé contre lui.
À ce sujet, la France et l'Union européenne doivent être très fermes, c'est une question de principe. Il s'agit d'un parti parlementaire, qui a des élus. Même s'il entretient des liens avec le PKK, on ne peut pas considérer ses membres comme terroristes. On a connu en Europe des situations comparables - en Irlande du Nord ou dans le Pays basque espagnol - et ce parti, quoi qu'on en pense, fait partie de la solution. Si la procédure judiciaire va à son terme et si une partie des députés concernés perd effectivement son immunité, ce sera une catastrophe, l'État de droit n'existera plus.
Revenons au parti kémaliste. Celui-ci est piégé. Avait-il une autre solution ? J'en doute, car qui peut critiquer l'exécutif de prendre des dispositions au lendemain d'un coup d'État ? Pourtant, la première manifestation, qui a eu lieu un dimanche, deux semaines après le coup d'État, a été organisée de manière très subtile, me semble-t-il, par le parti républicain. Il s'agissait d'une manifestation à la fois contre le coup d'État et en défense des droits civils.
Ensuite, il y a eu cette manifestation colossale du 7 août dernier, organisée par l'AKP. Deux dirigeants kémalistes ont été invités et sont intervenus. Pouvaient-ils faire autrement ? Je ne le sais pas, mais le piège est maintenant refermé. En acceptant cela sans critique, ils y participent. Il y a eu un débat à ce sujet au sein du parti républicain, qui s'est finalement aligné sur Tayyip Erdogan. D'ailleurs, j'ai vu début août pendant deux heures et demie trois parlementaires turcs de passage à Paris - un membre du parti républicain et deux membres de l'AKP - et le député républicain était plus virulent, contre les auteurs du coup d'État, que les deux autres.
La marge de manoeuvre des membres du parti républicain est donc très faible, alors que leur devoir doit être, en s'inscrivant dans la logique de la répression contre le putsch, de défendre l'État de droit.
Il y a une autre difficulté pour le parti républicain : il est devenu le parti des alévis, qui ne représentent que 15 % de la population mais 80 % de sa direction. L'AKP en profite, car lui défend le sunnisme, la tradition. La marge de manoeuvre est ainsi très réduite, le parti kémaliste s'étant mis en porte-à-faux vis-à-vis de la société. Pourtant, il faut trouver des voix pour lutter contre cette tendance.
Sur la question des droits des femmes, que voulait dire la députée que vous avez entendue ? Considère-t-elle que, s'ils étaient encore réduits, cela entraînerait une guerre civile ? Il me semble que c'est exagéré.
M. Jacques Legendre, président. - Elle semblait surtout très inquiète du risque de recul des droits des femmes en Turquie.
M. Didier Billion. - Oui, cette députée est, à juste titre, très attachée aux droits des femmes.
M. Jacques Legendre, président. - Nous vous remercions de votre éclairage sur la situation en Turquie depuis le putsch et sur les conséquences de cet évènement sur cet arrangement.
M. Didier Billion. - Un « arrangement », c'est le bon terme...







