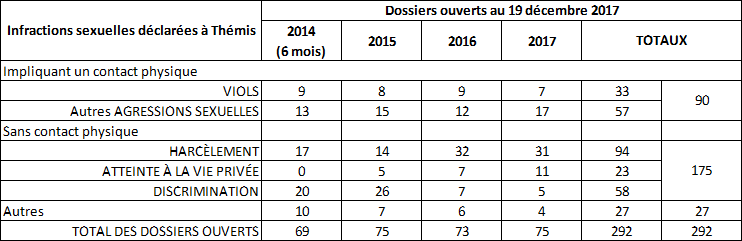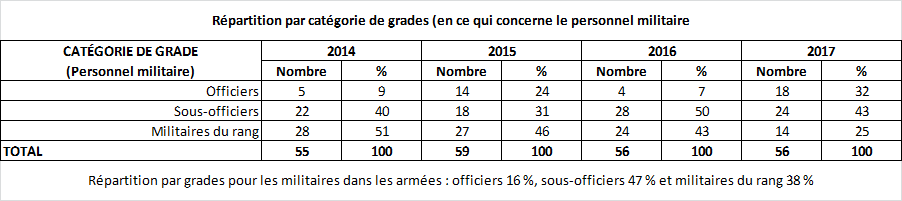COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION
I. AUDITIONS ET RÉUNIONS DE TRAVAIL
Audition d'Édouard Durand, magistrat, et d'Ernestine
Ronai, co-présidents de la commission « Violences de
genre » du Haut conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes
(16 novembre 2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Édouard Durand, magistrat, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, et Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, co-présidents de la commission « Violences de genre » du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE).
La délégation a en effet souhaité vous entendre une nouvelle fois, pour commencer avec vous ses travaux sur les violences faites aux femmes. Notre réflexion s'inscrit dans une actualité très chargée : harcèlement et libération de la parole des victimes ; « affaire de Pontoise » qui fait écho aux travaux de la mission Flament-Calmettes ; publication du livre de Sandrine Rousseau sur l'affaire Baupin...
Dans ce contexte, des propositions de loi, dont les auteurs sont de toutes tendances politiques, ont été déposées tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat depuis le début de la session parlementaire. Le Haut conseil à l'égalité, dont vous êtes tous les deux membres, a d'ailleurs largement contribué à l'information sur les violences, en publiant un rapport sur le viol et en travaillant sur le harcèlement en ligne. Vous voudrez certainement nous en dire quelques mots.
La délégation souhaite réagir à tous ces événements et apporter sa pierre au débat.
Comme nous l'avons décidé jeudi dernier, elle se penchera d'abord sur la question du harcèlement sexuel dans toutes ses dimensions. Nous avons souhaité aussi faire porter notre réflexion sur les violences faites aux femmes handicapées, sujet très peu traité jusqu'à présent, comme d'ailleurs le handicap en général.
Dans la perspective de l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement, nous travaillerons aussi sur les autres formes de violences faites aux femmes - agressions sexuelles et viols, violences conjugales... -, avec une attention particulière pour la dimension ultramarine de ce problème. Je crois donc que nous aurons d'autres occasions d'échanger avec vous, madame Ronai, pour vous entendre nous présenter le travail que vous avez effectué au Conseil économique social et environnemental (CESE) sur les violences dans les Outre-mer !
Cette préoccupation particulière pour les violences, qui caractérise ce début de session, s'inscrit toutefois dans la continuité des précédents travaux de notre délégation : je rappellerai à cet égard nos rapports d'information sur les femmes victimes de la traite et sur le bilan de dix ans de lutte contre les violences conjugales, tous les deux publiés en mars 2016.
Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voudrais aussi signaler qu'Édouard Durand et Ernestine Ronai viennent de publier un travail collectif qu'ils ont coordonné, intitulé Violences conjugales, le droit d'être protégée . Vous nous en parlerez probablement. Je suis certaine que cet ouvrage sera une lecture intéressante pour nos travaux !
Peut-être Monsieur Durand pourrait-il plus particulièrement aborder le thème de la coparentalité et réagir à la récente proposition de loi relative au principe de garde alternée des enfants, sur laquelle nous a alertés la semaine dernière Laurence Rossignol, et qui sera examinée en commission à l'Assemblée nationale le 22 novembre, puis le 30 novembre en séance publique ?
Madame Ronai pourrait ensuite nous présenter les points de vigilance actuels de la lutte contre les violences sexuelles et contre les violences conjugales, en évoquant les mesures législatives susceptibles d'améliorer notre arsenal juridique et en rappelant les principales conclusions de l'avis du HCE sur le viol. Nous souhaiterions également que vous puissiez nous présenter l'étude relative au viol menée dans votre département, indispensable pour notre information.
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation qui le souhaitent feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions. Je vous remercie d'être venus jusqu'à nous et je vous laisse sans plus tarder la parole.
Édouard Durand, magistrat, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, co-président de la commission « Violences de genre » du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes . - Merci de votre invitation et de votre accueil, madame la présidente. Cette délégation m'a déjà fait l'honneur de m'inviter à présenter mon travail, et je vous sais gré de l'attention que vous voulez bien accorder à l'expérience d'un juge des enfants. Madame Rossignol, je suis très heureux de vous retrouver et très admiratif du travail que vous avez effectué en tant que ministre. Nous pouvons continuer le sillon que vous avez tracé durant tout ce temps, car la cohérence de la législation de ces dernières années est un guide très important. Merci de votre engagement.
Vous m'avez demandé de parler plus particulièrement de droit de la famille et de coparentalité, en évoquant les violences faites dans ce cadre aux femmes et aux enfants. Ernestine Ronai et moi-même avons l'habitude de travailler ensemble sur ces questions : ce qu'elle m'a appris sur ce sujet m'aide à penser mon travail de juge.
Au fond, l'enjeu est la question du rapport entre les libertés individuelles fondamentales appliquées à la famille et l'ordre public. Nous voyons bien aujourd'hui que nous sommes toujours sur une sorte de ligne de crête : nous craignons toujours de tomber, d'un côté, dans l'immixtion excessive de la société et de l'État dans le champ privé de la famille, et, de l'autre, ce qui paradoxalement nous effraie moins, dans le risque de laisser dans le huis clos des familles une totale marge de manoeuvre aux agresseurs sur leurs proches.
À ce propos, permettez-moi de vous citer une phrase de l'oeuvre de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan : « Pour beaucoup de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire, puisqu'elle met à leur disposition, et comme à portée de la main, un petit nombre d'êtres faibles que le plus lâche peut effrayer. Car l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. » D'une certaine manière, comme juge, je peux être spectateur de ces violences, ou alors essayer d'en protéger les victimes.
La coparentalité est, de façon étonnante, quasiment le seul paradigme avec lequel nous pensons les rapports entre les hommes et les femmes, les pères, les mères et les enfants dans la famille aujourd'hui, dans un contexte où les séparations conjugales sont extrêmement nombreuses. Ce principe, qui a émergé sous l'impulsion de la Convention internationale des droits de l'enfant, a été traduit dans notre droit de façon plus explicite par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qui définit précisément dans notre code civil les implications du principe de coparentalité 343 ( * ) .
En lien avec cette loi, nous pensons la coparentalité comme l'affirmation de la nécessité de préserver la place des pères, qui serait perçue comme fragile. Or c'est une illusion d'optique, car ce qui est nouveau dans notre droit, et fragile par sa nouveauté, c'est plutôt la reconnaissance de la place des femmes, épouses et mères, et des enfants dans la famille. Nous devons encore penser la coparentalité comme la préservation de la reconnaissance de la femme, épouse et mère, comme sujet de droit.
En réalité, le grand basculement, ce n'est pas la loi du 4 mars 2002 344 ( * ) , c'est la loi du 4 juin 1970 345 ( * ) relative à l'autorité parentale qui nous a fait passer d'un régime de puissance paternelle à un régime d'autorité parentale. Ce fut une nouveauté radicale ! L'autorité se distingue en effet de la puissance par deux éléments : d'une part, l'autorité, contrairement à la puissance, exclut le recours à la violence, et, d'autre part, l'autorité parentale est juridiquement un pouvoir subordonné à une finalité. Or la finalité de l'autorité parentale, en vertu de l'article 371-1 du code civil, c'est la protection de l'enfant, pour reprendre les termes du législateur en 1970, ou l'intérêt de l'enfant, pour citer la loi du 4 mars 2002.
Nous avons donc deux impératifs à préserver. Le premier est la prise en compte de la place de la femme comme sujet de droit dans la famille, et le second est l'appréhension de ce que nous appelons l'intérêt de l'enfant.
Or il n'est pas excessif de penser que le souci quasiment exclusif actuellement semble être de préserver la place du père, ce qui est paradoxal. Pour le comprendre, il faut partir de nos représentations de la place des hommes, des femmes et des enfants dans la famille, de nos représentations personnelles et collectives.
La proposition de loi sur la résidence alternée 346 ( * ) fait référence à l'intérêt de l'enfant. Mais qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant dans notre droit ? C'est une notion quasiment exclusivement subjective. L'intérêt de l'enfant, c'est la décision que j'estime, en tant que juge, devoir prendre. Mais mon collègue magistrat dira, pour une situation strictement identique, que l'intérêt de l'enfant est de prendre une décision contraire.
Il faut donc avoir une appréhension un peu plus objective de l'intérêt de l'enfant, en référence à ses besoins fondamentaux, tels qu'ils ont été introduits dans notre droit par la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfant 347 ( * ) . Vous avez initié, Madame Rossignol, une démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants, qui a réuni beaucoup d'experts, notamment pour centrer la protection de l'enfant sur son besoin de sécurité et de stabilité. Ce besoin passe par la nécessité de lui donner des repères éducatifs constants.
Mais tout l'enjeu pour vous, parlementaires, est de garantir la cohérence de la législation. Car si les mesures de protection de l'enfant, d'assistance éducative prises dans les conseils départementaux ou au sein des services d'aide sociale à l'enfance, visent à garantir son besoin de sécurité, il faut aussi avoir cette priorité en tête quand on détermine les modalités d'organisation de la vie de l'enfant en cas de séparation des parents. Car le besoin de sécurité de l'enfant devrait être identique devant n'importe quel juge ou professionnel de la protection de l'enfance.
J'en viens à la coparentalité et aux violences conjugales.
Lors de la séparation des parents, il convient de distinguer quatre grands types de modèles correspondant à la situation nouvelle : l'entente, le conflit, la violence et l'absence.
Le premier modèle est l'entente. Il arrive que les parents s'entendent sur la séparation, sur l'organisation de la séparation et divorcent par consentement mutuel. Parfois, ils restent très bons amis après la séparation. Mais cela est rare et prend beaucoup de temps. La loi ou le juge ne peuvent faire croire que les parents peuvent s'entendre. C'est leur rendre un très mauvais service et c'est courir le risque que les besoins fondamentaux de l'enfant ne soient pas pris en compte.
Le deuxième modèle est le conflit. Il y a alors désaccord entre deux sujets, mais deux sujets qui respectent mutuellement la parole de l'autre.
Le troisième modèle est la violence conjugale. Ce n'est pas un désaccord entre deux sujets à égalité mais un rapport de domination entre un sujet et un objet, acquise par les passages à l'acte violents.
Le dernier modèle est l'absence ou la présence aléatoire de l'un des parents, le plus souvent le père. Paradoxalement, on en fait grief à la mère et on la suspecte d'avoir écarté le père de la vie de l'enfant, voire de procéder à ce que l'on appelle « l'aliénation parentale » 348 ( * ) .
Madame la présidente, vous avez parlé de la proposition de loi récente sur la résidence alternée. Permettez-moi de vous signaler que vos prédécesseurs ont voté en une nuit une proposition de loi similaire sur la résidence alternée, en référence à un prétendu syndrome d'aliénation parentale. Il y a derrière ce type d'initiative des lobbies qui peuvent être assez puissants.
Avant d'élaborer une loi sur les violences faites aux femmes, les parlementaires procèdent à des auditions, examinent des recommandations d'experts, puis débattent pendant plusieurs mois avant d'aboutir au vote du texte. Il faut aussi un long délai pour évaluer la mise en oeuvre de cette loi et préparer la loi suivante. Il y a donc un contraste entre les délais nécessaires à l'adoption de semblables lois et la précipitation dans laquelle a été voté l'amendement dont je parlais à l'instant 349 ( * ) .
La proposition de loi sur la résidence alternée, qui sera débattue prochainement à l'Assemblée nationale, me glace le sang. Il est proposé que le code civil soit ainsi rédigé : « La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention, d'un commun accord entre les parents, ou à défaut, par le juge. Si la résidence de l'enfant ne peut être fixée pour une raison sérieuse au domicile de chacun de ses parents du fait de l'un d'eux, elle est fixée au domicile de l'autre . »
Il s'agit là d'une rédaction subtile. Ses auteurs ont tiré les conséquences du fait que les controverses sur le concept d'aliénation parentale avaient précédemment empêché la mobilisation du gouvernement et du législateur. Donc, il n'est plus fait référence au syndrome d'aliénation parentale, mais, d'une façon tout aussi fallacieuse, au concept d'intérêt de l'enfant. Or cette notion est mal articulée aux besoins fondamentaux de celui-ci. De plus, est introduite une sorte de distinction, très pernicieuse à mon avis, entre, d'une part, un principe de résidence, et, d'autre part, les modalités réelles de vie de la famille après la séparation, comme si, pour apaiser le divorce, il fallait dire systématiquement que l'enfant a en principe sa résidence chez ses deux parents, mais qu'il faudra traiter ensuite l'organisation concrète de la vie de l'enfant. Or les parents qui se séparent n'ont pas forcément envie que le jugement mentionne simplement la fixation de la résidence chez les deux. Ils veulent que la vie de la famille soit organisée de façon sérieuse et responsable, car le jugement rendu par le juge aux affaires familiales est la loi qui s'applique à la famille, et donc qui garantit la sécurité des relations entre les personnes.
En tant que juge aux affaires familiales, j'ai souvent vu des emplois du temps d'enfants dignes de ministres ou de sénateurs, avec un calendrier hebdomadaire ou mensuel qui comprenait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour représenter les périodes où ils étaient chez leur père, leur mère ou leurs grands-parents. Comment un enfant peut-il se retrouver dans un tel système ? L'enfant a besoin de repères fondamentaux qui le sécurisent. Ses repères quotidiens doivent donc être préservés par les adultes qui s'occupent de lui. Rappelons-nous la citation de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit. »
Vous devez garantir que la loi protège les besoins fondamentaux de l'enfant et les mères victimes de violences conjugales. Cette proposition de loi viendrait à mon sens fragiliser considérablement tous les efforts qui ont été faits pour la protection des femmes victimes de violences conjugales. Il n'y a pas de compromis possible ! On ne peut pas introduire dans le code civil des mesures destinées à protéger les victimes de violences, et par cette proposition de loi, affirmer un principe qui balaie les quatre modèles dont je vous ai parlé il y a un instant.
En effet, quand il y a entente entre les parents, je ne suis pas opposé à la garde alternée à partir de sept ans. Quand il y a conflit léger, on peut le discuter ; quand il y a conflit sévère, absence ou violence, on ne peut pas protéger les victimes en les laissant sous l'emprise de l'agresseur, même quinze ans après la séparation.
Malgré le principe de l'autorité parentale, qui a pour finalité la protection et l'intérêt de l'enfant, nous avons encore une conception de l'autorité parentale servant principalement à reconnaître le parent dans son statut de parent. C'est pourquoi, en dépit de la loi du 4 août 2014 350 ( * ) et de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, très peu de décisions de justice retirent l'autorité parentale à un parent agresseur. Et trop peu accordent à un parent protecteur l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Or l'autorité parentale peut être un moyen d'exercer une emprise sur les membres de la famille, même à distance, car le juge et le législateur reconnaîtront toujours cette prérogative au parent violent.
De la même façon, en voulant coûte que coûte maintenir un droit de visite et d'hébergement, voire une résidence alternée, au profit du parent agresseur, nous laissons celui-ci continuer à exercer sa domination sur l'enfant. Pourtant, des études ont montré que l'exposition de l'enfant aux violences conjugales a un impact traumatique plus sévère que l'exposition à la guerre ou au terrorisme. Nous savons aussi qu'un enfant sur deux exposé aux violences conjugales est directement victime de violences physiques exercées contre lui par le violent conjugal. De plus, la fille d'un parent violent court 6,5 fois plus de risques qu'une autre d'être victime d'agressions sexuelles ou de viols par le violent conjugal. L'enjeu, pour le parent violent, c'est le pouvoir, qui passe aussi par le sexuel. Il faut donc prendre en compte la dangerosité des violents conjugaux.
J'en viens à mon second sujet. Il existe quatre grands registres de la parenté qu'il ne faut pas confondre : la filiation, l'autorité parentale, le lien, la rencontre.
Commençons par la filiation. Vous connaissez ces situations où, bien que le parent soit incarcéré pour violences conjugales ou sexuelles sur l'enfant, les visites en prison sont maintenues entre eux, car c'est son père. Peut-être, mais la filiation n'emporte pas nécessairement l'autorité parentale ou son exercice. On peut maintenir la filiation sans l'autorité parentale.
Il faut également distinguer entre le lien et la rencontre. Le lien est psychique, la rencontre est physique. Dans le développement de l'enfant, un processus psychique est le détachement par lequel l'enfant s'autorise à ne plus vouloir être en lien avec un parent maltraitant. Or les violences conjugales sont l'une des plus graves maltraitances qui puissent être infligées à l'enfant. Il faut respecter l'enfant dans ce processus de détachement.
C'est pourquoi il faut combattre par tous les moyens les tentatives pour imposer le « syndrome d'aliénation parentale », caution du déni de la maltraitance faite aux enfants. Un parent protecteur qui alerte sur les troubles manifestés par l'enfant est effectivement instantanément suspecté d'aliénation parentale.
J'en viens aux deux propositions envisageables pour protéger à la fois l'enfant victime de violences conjugales et la mère, c'est-à-dire le parent protecteur.
La première piste est le cumul idéal de qualification.
Nous nous accordons aujourd'hui sur le fait que l'enfant est victime ou co-victime des violences conjugales, tant l'impact sur lui de ces violences est sévère. Il n'est pas pour autant reconnu en tant que tel sur le plan pénal, car l'infraction poursuivie est celle qui est commise contre sa mère, la seule victime sur le plan pénal. Mais il est possible que notre droit reconnaisse à l'enfant sa qualité de victime au sens pénal, et ce de deux façons.
On pourrait prévoir que la présence d'enfants dans le couple constitue une circonstance aggravante des violences conjugales. Mais cela ne suffit pas pour reconnaître pleinement la place de l'enfant comme victime. En outre, on suggèrerait ainsi que les violences conjugales seraient moins graves en l'absence d'enfants.
Pourrait ensuite s'appliquer, dans l'idéal, le cumul de qualification : un même fait est poursuivi en même temps sous deux incriminations pénales, par exemple les violences contre la conjointe et celles contre l'enfant. Les conditions exigées sont la pluralité d'objectifs visés par la société et la pluralité de victimes. C'est bien le cas, précisément, des violences conjugales...
La seconde piste relève à mon sens du fantasme juridictionnel.
Puisque nous sommes à la charnière entre les libertés fondamentales, les libertés privées et l'ordre public, il faudrait renforcer la place du procureur de la République dans le procès familial. Le procureur est déjà très présent au civil, en matière d'assistance éducative. C'est lui qui, le plus souvent, saisit le juge des enfants. Mais il est présent de façon rarissime dans la séparation des parents. Pourtant, l'article 373-2-8 du code civil prévoit déjà que « le procureur de la République peut saisir le juge aux affaires familiales ». C'est assez rare dans les faits. Peut-être le législateur pourrait-il ajouter que le procureur puisse intervenir comme partie dans le procès civil aux affaires familiales.
Souvent, les mères victimes savent que la convention par consentement mutuel est totalement inégalitaire, mais elles défendent le père violent. Cette attitude est compréhensible et la position des juges, ainsi que celle des notaires, est difficile dans ces affaires. Le juge doit-il laisser faire s'il n'est pas d'accord avec la convention ? La société doit, par la voix du procureur, prendre une autre décision pour protéger la mère et l'enfant.
Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, co-présidente de la commission « Violences de genre » du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes . - Merci de nous recevoir, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs. Ce moment est important, car si de nombreuses actions ont été menées ces dernières années en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, beaucoup reste à faire. Au moment où la parole se libère, le nombre de plaintes pour violences sexuelles - agressions et viols - a augmenté de 26 %. Comment vont-elles être traitées ?
Je suis inquiète, car si les forces de gendarmerie et de police ne prennent pas sérieusement en compte les plaintes et ne conduisent pas correctement les auditions, plus par manque de temps et de formation que dans un esprit malveillant, on risque l'échec. La Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), dont j'étais coordonnatrice nationale jusqu'à la fin de 2016, a publié à l'intention des professionnels concernés un guide d'aide à l'audition en matière de violences sexuelles et conjugales.
Une enquête réalisée à Angers dans les unités médico-judiciaires (UMJ) a montré qu'une seule audition y avait été réalisée avec ce guide. Or il est important d'interroger correctement une victime, de la laisser parler en confiance, sinon elle s'interrompra et ne donnera plus d'éléments pour l'enquête. Logiquement, le procureur classera la plainte sans suite, faute de preuve.
La formation des magistrats aux violences sexuelles et aux violences conjugales est également très importante, tant en formation initiale qu'en formation continue.
Édouard Durand et moi-même intervenons à l'École nationale de la magistrature (ENM) en formation initiale. Nous intervenons aussi en formation continue, lorsque les élèves ont choisi ce thème. Tous les outils nécessaires ont été créés par la MIPROF. Si 400 000 professionnels ont été formés, il faudrait peut-être envisager de rendre obligatoires ces formations pour tous les acteurs mentionnés par l'article 51 de la loi du 4 août 2014 351 ( * ) . Aujourd'hui, seuls les cursus des médecins et des sages-femmes comprennent cette formation pour tous, sans l'asseoir sur le volontariat. Actuellement, les travailleurs sociaux et les enseignants n'y sont pas tenus, ce qui ne semble pas approprié. Or la formation de tous les intervenants garantit un bon accueil des victimes.
Prenons appui sur ce qui existe pour continuer à progresser face à la situation nouvelle que nous vivons aujourd'hui. La libération de la parole à laquelle nous assistons est passionnante, mais elle exige notre vigilance. C'est pour une meilleure condamnation sociétale des agressions sexuelles et des viols que nous avons formulé, sous l'égide du Haut conseil à l'égalité, en octobre 2016, un avis, assorti de douze recommandations, que nous avons adressé à Laurence Rossignol, alors ministre, que je salue.
Les violences sexuelles ont été intégrées au 5 ème plan gouvernemental de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, et nous souhaitons qu'elles restent une priorité.
Deux questions cependant doivent être traitées. En premier lieu, Édouard Durand et moi-même avons beaucoup travaillé sur les mots : nous ne parlons plus de consentement, mais de contrainte. Le procureur adjoint à Bobigny, avec lequel je travaille, a comparé notre point de vue sur le viol à l'image du braqueur qui utilise un pistolet pour arriver à ses fins. C'est la même chose pour le viol : si l'on ne regarde que la victime, on ne verra pas nécessairement les moyens - menace, surprise ou violence - que l'agresseur a utilisés pour la forcer.
Il est donc extrêmement important de resituer précisément la définition du viol. C'est en 1980, après le procès d'Aix-en-Provence, que le regard a complètement changé sur le viol en se portant sur l'agresseur. On a alors commencé à comprendre que la victime peut ne pas être capable de manifester son non-consentement. C'est précisément le cas de la petite fille de Seine-et-Marne ou de celle de Pontoise... On sait que cette dernière avait montré à l'agresseur son carnet scolaire sur lequel figurait son âge (onze ans), lui suggérant ainsi qu'elle ne pouvait pas être d'accord. Elle pensait qu'il allait comprendre... Elle l'a suivi par peur ! Soyons vigilants pour ne pas nous concentrer exclusivement sur le consentement de la victime, mais également sur les moyens de l'agresseur.
En second lieu, il faut fixer un âge en-dessous duquel la contrainte entre un majeur et un mineur serait automatiquement constituée. Personnellement, je pense que l'âge se discute. Au HCE, nous avons choisi treize ans et moins, car nous voulions que l'écart d'âge entre le jeune majeur et la victime soit suffisant pour que la législation soit inattaquable et que son application ne suscite aucune difficulté. Nous avons choisi un écart suffisamment important - entre treize et dix-huit ans -, mais la discussion reste ouverte. Il faut en tout cas par la loi fixer un interdit suffisamment fort. Cela servira à la fois à la pénalisation et à la prévention du viol.
Par ailleurs, certains envisagent un allongement des délais de prescription. Depuis 2017, la loi fixe un délai de prescription de six ans pour un délit et de vingt ans pour un crime 352 ( * ) . Pour les mineurs, ce délai ne court qu'à partir de l'âge de dix-huit ans car ils ne peuvent pas ester en justice avant leur majorité. Lors des débats, certains souhaitaient mettre à égalité tout le monde - vingt ans pour tous - mais les enfants ne peuvent pas porter plainte avant leurs dix-huit ans : il ne s'agit donc pas de leur donner une dérogation, mais d'appliquer la justice. Si l'adulte n'entend pas ou ne veut pas entendre un enfant révélant des violences sexuelles, la souffrance de l'enfant va perdurer et cela provoquera un stress post-traumatique important. Nous avons tous entendu parler de la mémoire traumatique. Cela peut prendre du temps pour retrouver le souvenir du viol.
L'agression sexuelle d'un enfant provoque des conséquences tellement graves sur son développement affectif, cognitif et physique qu'il faut maintenir l'écart de prescription entre un majeur et un mineur. La Mission de consensus , sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur-e-s, proposée par Laurence Rossignol et co-présidée par Flavie Flament et Jacques Calmettes, proposait un délai de trente ans. Les conséquences du viol d'un mineur sont telles que le droit à l'oubli n'a pas de sens dans ce cas. La victime, elle, n'est pas dans l'oubli. Pourquoi l'agresseur ne subirait-il pas de conséquences, quand bien même s'il s'agit d'un homme devenu âgé qui a autrefois violé sa petite fille ?
Depuis 2016, l'inceste est entré dans le code pénal avec une définition précise ; il était temps ! Mais toutes les conséquences n'en ont pas été tirées. Dans le code pénal, un crime commis par une personne ayant autorité est une circonstance aggravante, mais l'inceste n'est pas plus pénalisé qu'une agression commise par un moniteur sportif. C'est aberrant ! La relation affective dans le cadre familial devrait être un socle de sécurité, et donc une circonstance aggravante en cas d'agression.
Le Haut conseil à l'égalité propose un accompagnement et une prise en compte des violences sexuelles par deux mesures incluses dans le 5 ème plan gouvernemental de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, mais qui doivent être mieux appliquées : d'une part, l'intégralité des soins somatiques et psycho-traumatiques des victimes doit être prise en charge à 100 %, à l'instar de ce qui existe pour les victimes du terrorisme. Les victimes du « terrorisme familial » ne doivent pas être traitées différemment. Je co-anime actuellement au ministère de la Santé un groupe de travail sur cette piste, certes coûteuse, mais très importante. Au moment où vous débattez du budget, soyez vigilants !
D'autre part, préservons les preuves d'un viol, même si la victime n'a pas préalablement porté plainte. Actuellement, pour pouvoir se rendre dans une unité médico-judiciaire (UMJ), il faut porter plainte et avoir une réquisition du procureur.
En cas de viol, une femme a le réflexe d'aller voir un médecin pour savoir si elle est enceinte ou atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. La Sécurité Sociale paie les analyses et les soins correspondants. Un simple geste supplémentaire permettrait de garder l'ADN de l'agresseur, afin de vérifier dans le fichier national qu'il n'a pas déjà été condamné. Pour la victime, c'est aussi un élément de réalité. Dans les UMJ, le fait de prélever l'ADN pour le ressortir en cas de plainte montre que vous êtes cru. Or les victimes de violences sexuelles portent rarement plainte, de peur qu'on ne les croie pas, car l'agresseur les prétendra consentantes. À Bordeaux, où est expérimenté ce dispositif, une étude sur dix ans a montré que pour les personnes qui se sont rendues aux UMJ indépendamment d'une plainte, le taux de plaintes passait de 10 à 30 %. Cela suppose d'avoir quelques moyens techniques, un lieu de recueil et un répertoire ; mais si la volonté politique existe, cela se fera !
La loi de juillet 2010 353 ( * ) prévoit dans le code de l'éducation nationale des mesures de prévention sur les violences faites aux femmes par le biais de l'éducation à la sexualité et de la sensibilisation à l'égalité. Sept ans après, nous n'y sommes pas du tout. Cela se fait plus ou moins dans les établissements scolaires. Toutefois, en cas d'agression grave, il arrive que l'on nous sollicite en urgence pour intervenir... Cette prévention relève aussi d'une éducation à la sexualité qui ne soit pas uniquement « technique », mais qui évoque des relations humaines respectueuses...
Je voudrais dire un mot des viols jugés aux assises, c'est-à-dire les viols les plus graves. Dans une enquête menée en Seine-Saint-Denis sur les viols jugés aux assises, on constate que dans 33 % des cas seulement, l'ADN est mobilisé comme moyen de preuve. Cela montre que lorsque l'enquête est bien faite, les policiers bien formés, il y a mille autres façons de trouver des preuves. Ceci vaut également pour la prescription. Souvent, il n'y a pas de témoins de l'agression et, fréquemment, la victime ne se souvient de rien dès le lendemain... C'est l'enquête qui déterminera les choses, d'où l'importance de la prise en charge psycho-traumatique, d'un bon accompagnement par les UMJ ou les médecins, d'une enquête de voisinage... À mon avis, il n'y a pas plus d'éléments le lendemain que trente ans après... Souvent, il est rare que le violeur n'ait agressé qu'une seule personne, même s'il est difficile de détecter les réitérants, c'est-à-dire ceux qui recommencent mais ne se font pas arrêter. Faire des enquêtes de qualité suppose du personnel formé en nombre suffisant : là est le principal défi.
Annick Billon, présidente . - Merci de vos interventions. Vous disiez, Édouard Durand, que la proposition de loi relative à la garde alternée vous « glaçait le sang ». En effet, imaginer qu'on règlera d'un seul coup les problèmes de séparation en décidant que la résidence de l'enfant doit être alternée relève d'un certain amateurisme pour le législateur. Nous devrons tous nous mobiliser au moment de son examen par notre assemblée. Je vous ai entendu. Vous avez bien défini les différents cas de séparation ; chacun doit être traité différemment. Vos propos me rassurent dans mes convictions.
Madame Ronai, une prise en charge à 100 % des soins post-traumatiques au profit des victimes de violences sexuelles est une excellente proposition. Toutes les études scientifiques montrent l'importance et la durée du traumatisme des violences conjugales sur les victimes ainsi que sur les enfants, victimes collatérales.
Laurence Rossignol, en tant que ministre, a fait énormément progresser les choses et il est heureux qu'elle fasse partie de notre délégation. Parmi les arguments contre le passage à une prescription de trente ans, la crainte que les preuves aient disparu est très fréquemment objectée. Vous avez montré les limites de cet argument et avez souligné l'importance de la formation de tous les acteurs, cruciale pour recueillir les témoignages et autres preuves. J'en prends note en vue de l'examen du projet de loi annoncé.
Monsieur Durand, pourriez-vous nous éclairer sur la pratique, qui semble devenue assez fréquente, de la correctionnalisation des affaires de viol : existe-t-il des statistiques démontrant un recours plus fréquent au tribunal correctionnel qu'aux assises pour juger ces affaires ? Quels sont selon vous les facteurs expliquant cette pratique ? Quelles peuvent en être les conséquences pour les agresseurs et les victimes ? Cela vous paraît-il une bonne ou une mauvaise évolution ? Si vous pensez que c'est une mauvaise chose, comment selon vous remédier à cette « dérive » ?
Pourriez-vous nous rappeler les différences entre médiation familiale et médiation pénale, et nous expliquer si ces médiations sont pertinentes ou, au contraire, totalement contre-indiquées, dans les cas de violences conjugales ?
Quel regard portez-vous sur la prise en charge des auteurs de violences ou des agresseurs sexuels, notamment s'agissant des stages de responsabilisation ? Quelles seraient selon vous les marges de progression en ce domaine ?
Madame Ronai, pourriez-vous nous dresser un bilan de la formation des professionnels susceptibles d'être en contact avec des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles ? Que reste-t-il à faire en matière de formation des professionnels de justice et de sécurité ? Peut-on, selon vous, aller au-delà de la formation et de la sensibilisation des acteurs pour améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes de violences ?
Après la mesure d'accompagnement protégée (MAP), le département de Seine-Saint-Denis met en place une nouvelle mesure, celle de l'espace de rencontre protégé. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste cette mesure et quelles sont les conditions actuelles de sa mise en oeuvre ?
Enfin, pourriez-vous nous faire un point sur la mesure d'accompagnement protégé (MAP) mise en place en Seine-Saint-Denis : ce dispositif s'est-il révélé efficace ? A-t-il été généralisé à d'autres départements ou bien existe-t-il uniquement en Seine-Saint-Denis ? Quelles sont les perspectives d'évolution de cet outil ?
Françoise Laborde, co-rapporteure. - Vos interventions s'inscrivent dans l'ensemble des travaux consacrés aux violences par notre délégation. En 2016, nous vous avions entendu sur les traumatismes enfouis dont le souvenir revient grâce aux soins psycho-traumatiques. Vous nous aviez expliqué que la prise en charge devrait être similaire à celle des victimes du terrorisme : voir un psychologue trois mois, six mois ou un an ne suffit pas. Il faut un travail au long cours pour un possible réveil des souvenirs.
Vous avez raison de le souligner une nouvelle fois : l'emprise du parent agresseur peut perdurer par le biais de l'enfant ; la coparentalité ne se limite pas à l'accompagnement à l'école ou à recevoir les papiers...
Parfois, la victime peut de nouveau rencontrer son agresseur, non encore jugé ou dans le cas d'un aménagement de peine. J'aimerais travailler sur cette question de l'aménagement des peines dans le cadre d'un véhicule législatif adapté.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il était indispensable que notre délégation vous entende. Je n'aurais pas fait le quart de ce que j'ai pu réaliser en tant que ministre sans M. Durand et Mme Ronai. Je cite souvent Édouard Durand : « L'enfant témoin est un enfant victime », ce qui est une révolution dans la prise en compte des violences conjugales. La MIPROF a contribué à changer cet angle de vue.
Je vous suggère un déplacement à l'UMJ de Saint-Malo, hôpital dans lequel est réalisé un remarquable travail de décloisonnement sur l'écoute des enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes... Ils ont même réussi à faire réduire le nombre de réitérations, grâce au travail conjoint de la police, de la gendarmerie, du parquet, du siège et des médecins.
Je suis très perplexe sur la « correctionnalisation » du viol. Certains parquetiers engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes considèrent que le tribunal correctionnel assure une plus grande certitude de condamnation. On peut en douter au vu des récentes affaires de Pontoise et de Seine-et-Marne. Dans le premier cas, c'est la qualification d'atteinte sexuelle et non celle de viol qui a été retenue, et le prévenu a été condamné, sous ce motif, à des peines moins sévères. Dans l'affaire de Seine-et-Marne, le jury a acquitté l'auteur des faits, inculpé pour viol. Certes, il peut être difficile de convaincre les jurés...
M. Durand, bravo pour votre raisonnement sur la résidence alternée. Merci également pour vos remarques sur l'autorité parentale. En effet, il convient de dissocier l'autorité parentale du maintien du lien. Comment expliquer que le père meurtrier de la petite Marina ait conservé, après sa condamnation aux assises, l'autorité parentale sur ses frères et soeurs, placés à l'Aide sociale à l'enfance ? Ces enfants doivent solliciter l'accord d'un criminel tortionnaire pour des actes anodins de la vie quotidienne... En 2016, nous avons fait en sorte que le juge ait à justifier les raisons pour lesquelles il maintient l'autorité parentale d'une personne condamnée.
J'avais obtenu une circulaire du ministère de la Justice sur le syndrome d'aliénation parentale, mais elle doit être appliquée. Le processus est lent. Ne relâchons pas la pression, sous peine de revenir en arrière.
Dans la proposition de loi dont j'ai pris l'initiative, mes collègues et moi avons proposé l'âge de quinze ans en deçà duquel l'absence de consentement est présumée, par cohérence avec les atteintes sexuelles. Le HCE a défini un seuil de treize ans en se référant aux autres pays européens, qui depuis ont augmenté cet âge. Ce débat reste ouvert.
Les députés sont sous la pression des « masculinistes » pour la garde alternée. Pour les trouver, prenez la liste des signataires des appels au soutien aux pères sur les grues... Nous avons raison d'être vigilants !
Françoise Cartron. - C'était un grand moment d'entendre vos présentations si claires. Dans les écoles, le retard de prévention est probablement dû au défaut de formation des enseignants, qui considèrent que ce n'est pas leur mission première. Avez-vous des contacts avec les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) pour mettre en place des modules de formation obligatoire de prévention et de vigilance à destination des enseignants ?
Je m'interroge, moi aussi, sur les bénéfices de la résidence alternée. Nous le savons, les enfants ont un besoin fondamental de repères et de stabilité. On peut l'observer, même en cas d'entente entre les parents, faire sa valise chaque semaine ne répond peut-être pas aux besoins de l'enfant...
Laurence Cohen, co-rapporteure. - Merci pour cette riche présentation. C'est extrêmement important d'avoir, quelle que soit notre sensibilité politique, un travail sur la protection des mineurs en cas de viol. J'ai déposé avec le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) une proposition de loi fixant l'âge minimal du consentement à quinze ans. Même si je suis membre du HCE, j'ai évolué après plusieurs auditions quant à la maturité des enfants et aux traumatismes engendrés. Le HCE avait aussi choisi l'âge de treize ans pour harmoniser sa position avec celle d'autres pays, qui l'ont changée depuis - comme le rappelait Laurence Rossignol. Soyons également cohérents avec l'âge de la majorité sexuelle. La priorité, c'est de protéger les enfants. Si un consensus se dessine pour treize ans, je ne le refuserai pas. Actuellement, le seuil est à cinq ans ! C'est terrible...
Je suis troublée car des magistrats que j'ai rencontrés ne semblent pas estimer si grave le glissement vers la « correctionnalisation » du viol. En cela, je rejoins Laurence Rossignol. Selon ces magistrates - toutes des femmes - le tribunal correctionnel juge plus vite et le verdict est moins aléatoire, tandis que la cour d'assises rassemble magistrats et jury, avec des risques possibles. Certes, le viol est un crime et relève de la cour d'assises, mais en même temps il n'est pas concevable que les victimes y soient moins bien défendues. Je souhaiterais avoir votre éclairage sur ce point.
Enfin, soyons cohérents : il ne saurait y avoir de véritable politique contre les violences faites aux femmes sans moyens financiers. Oui, prenons en charge 100 % des soins aux victimes de violences. Mais nous ne pouvons pas, dans le même temps, voter un projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) indigent...
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - ... ni un projet de loi de finances !
Marta de Cidrac . - Merci pour cet exposé passionnant. Monsieur Durand, j'ai beaucoup aimé votre expression de « femme, sujet de droit ». Nos analyses sur les droits des femmes gagnent à s'appuyer sur des outils juridiques pointus. Cette remarque vaut pour les droits de l'enfant.
Nous nous interrogeons sur l'âge à partir duquel il y a contrainte. Il me semble étonnant qu'il faille légiférer sur ce sujet. Dès lors qu'il y a une agression, la contrainte ne devrait faire aucun doute... De même, par définition, l'inceste est commis dans le cadre familial : comment définir les circonstances aggravantes en matière d'inceste ?
Nicole Duranton, co-rapporteure . - Merci pour ces interventions passionnantes et enrichissantes. Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il manque une meilleure synergie entre les forces de sécurité et les professionnels de la santé et de la justice. C'est un enjeu majeur. Dans le bilan du HCE de novembre 2016 sur la mise en oeuvre du 4 ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes, vous préconisez l'instauration de commissions départementales. Où en sont-elles ?
Par ailleurs, le viol conjugal est souvent passé sous silence au sein du couple, la frontière avec ce que l'on appelait « le devoir conjugal » étant ténue. Seules 2 % des femmes portent plainte. Comment faire changer les mentalités et inverser la tendance ?
Christine Prunaud . - J'ai été passionnée par vos interventions, plus particulièrement sur la garde alternée. Récemment, elle était considérée comme la « moins pire » des solutions pour les enfants, or vous remettez en cause ce présupposé... Nous avons également besoin de travailler ensemble sur l'âge du consentement. Merci de votre engagement.
Édouard Durand . - Merci de vos questions, qui recouvrent bien les enjeux des violences sexuelles, conjugales et familiales...
Ernestine Ronai citait tout à l'heure l'interdit moral. En tant que citoyens, nous assumons de porter un regard moral sur la famille, avec l'interdiction de la violence en son sein. Deux logiques peuvent être adoptées à cet égard. Selon la logique du droit du principe, la famille n'est pas un groupe si spécifique que les principes d'organisation de la société ne peuvent s'appliquer à elle, comme la liberté et l'égalité - être ou non un sujet. Selon la logique du droit du modèle, la famille est un regroupement humain si particulier que l'organisation des rapports en son sein doit se conformer à un modèle spécifique.
Nous pensons pour notre part que le rapport homme-femme, père-mère, mari-épouse doit suivre le droit du principe pour penser l'altérité sexuelle et aussi l'égalité entre les époux. Mais nous pensons aussi que la place des enfants et leur protection doivent suivre la logique du droit du modèle : ils ont des besoins qui sont universels, comme la sécurité, ainsi que le montrait la Mission de consensus demandée par Laurence Rossignol. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons au sein de la famille. Pour survivre, un enfant doit faire appel à une figure d'attachement - comme lorsqu'on appelle à l'aide en cas de besoin -, souvent la mère. Si l'on ne prend pas cela en compte, on désorganise son développement.
Je reviens sur la remarque de Laurence Rossignol : peut-on faire confiance au juge ? J'en suis persuadé. Mais il y a un risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionalité d'une loi qui systématiserait le retrait de l'autorité parentale en cas de viol ou d'agression sexuelle. Actuellement, la loi oblige le juge à se poser la question, mais il ne s'en saisit pas assez et ne justifie que rarement l'absence de retrait d'autorité parentale.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Cela se passe ainsi ?
Édouard Durand . - Il y a trop peu de traitement de l'autorité parentale sur le plan pénal. Souvent, la question n'est pas réglée...
Ernestine Ronai . - ... même en cas de « féminicide » !
Édouard Durand . - Oui. Les magistrats raisonnent au cas par cas, et c'est leur fonction : individualiser la réponse civile ou pénale aux enjeux d'une situation particulière. Mais ils ne peuvent pas faire l'économie des grands modèles, au risque de devenir arbitraires. Souvent, toutefois, au cas par cas, le juge aux affaires familiales fait la même chose, et décide systématiquement l'exercice conjoint de l'autorité parentale dans le cadre de la garde alternée ou du droit de visite et d'hébergement classique, parce qu'il ne se réfère pas à ces grands modèles devant guider le travail des juges...
Selon certains, dans une optique féministe, la résidence alternée permettrait aux mères de dégager davantage de temps pour leur vie personnelle ; c'est illusoire ! Ce qu'elle ferait une semaine comme mère, elle le ferait la semaine suivante comme belle-mère. En tant que législateurs, faites attention à l'espace que vous pensez créer pour ces femmes ; ce n'est pas la bonne solution.
Avec les lois de 2010 et de 2014, le législateur a exclu le recours à la médiation pénale dans le cas de violences conjugales. On ne peut pas avoir d'alternative aux poursuites pénales ni poursuivre son agresseur sous réserve de sa participation à la médiation pénale - cela mettrait les deux personnes sur un même plan. Mais le législateur a, parallèlement, ouvert la possibilité de la médiation familiale, donc civile, ordonnée par le juge aux affaires familiales et non par le procureur de la République, dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle 354 ( * ) . Or cette justice a plutôt comme modèle l'industrie du XIX e siècle : il faut aller toujours plus vite et tendre à des modèles de traitement « tout faits »... Il faut, j'en suis convaincu, que la loi prévoie une exception très claire à la médiation familiale, notamment en cas de violences conjugales, en l'excluant dès lors que les violences sont alléguées, et pas seulement commises. Pour éviter la médiation, il suffirait alors de dire qu'on a été victime de violences pour que le juge se saisisse ensuite du fond du dossier.
Nous sommes souvent victimes d'une illusion d'optique : depuis longtemps, les agresseurs sexuels bénéficient d'une attention sociale, et notamment de soins, éventuellement sous contrainte. Je suis favorable au contrôle par la société des soins aux sujets violents, à ce retrait de liberté nécessaire pour préserver de la violence tant l'espace public que l'espace privé. Mais nous devons avancer au rythme des victimes et non à celui des agresseurs, même si le parcours de soins de l'agresseur est très important, long et patient, et qu'il lui permet de ne plus être violent. Le psycho-traumatisme de la victime peut être très grave. La psychologue Linda Tromeleue nous met en garde : « nous ne devons pas nous laisser infiltrer par la pensée de l'agresseur, car il s'agit de grande criminalité ».
Il existe déjà un interdit - et une infraction - d'atteinte sexuelle pour une relation sexuelle avec un enfant de quatorze ans au plus, et cette qualification a été utilisée à Pontoise pour poursuivre l'agresseur devant le tribunal correctionnel. La loi ne dit pas qu'on est majeur sexuellement à partir de quinze ans - l'idée de majorité sexuelle est perverse - car un enfant est mineur jusqu'à dix-huit ans, et ses parents sont responsables de sa protection, y compris sur le plan de la découverte de sa sexualité. Mais un majeur ne commet pas d'infraction si le mineur de quinze ans ou plus est consentant.
À Pontoise, la société est parvenue à voir la scène, ce qu'il y avait de choquant à se représenter une pensée égalitaire entre cet adulte et cette enfant de onze ans et les conséquences de cet acte sur le développement mental, affectif, corporel et sexuel de l'enfant. Mais nous avons des injonctions sociales très contradictoires : voyez l'hypersexualisation des enfants, sur laquelle Chantal Jouanno a publié un rapport 355 ( * ) . Le pédopsychiatre Maurice Berger a écrit un article : « Que reste-t-il du rôle civilisateur du complexe d'OEdipe ? », dans un environnement affecté d'un côté par l'hypersexualisation de l'enfance, et l'accès précoce à la sexualité, et de l'autre, par une volonté de perfectionner la protection de l'enfance...
Ce qui est moral, c'est de protéger le développement de l'enfant, car il est vulnérable et garant de la continuité du monde. Il faut fixer un seuil d'âge en dessous duquel l'agression est systématiquement qualifiée d'agression sexuelle ou de viol. Un acte sexuel reste possible entre adultes et avec un mineur de quinze ans ou plus, si cet âge est retenu, s'il n'y a ni menace, ni contrainte et ni surprise. En deçà de ce seuil, l'agression est systématiquement constituée.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - En conséquence, vous choisiriez quinze ou treize ans ?
Édouard Durand . - Le « mineur » est celui qui a moins de dix-huit ans, un « mineur de treize ans » a douze ans ou moins, un « mineur de quinze ans » a quatorze ans ou moins - quinze ans exclus. Dans la moyenne des pays européens, le seuil est de treize à quinze ans. Si le seuil de treize ans préconisé par le HCE est choisi, il restera la qualification d'atteinte sexuelle, donc au total trois régimes de qualification. Un seuil de treize ans ? donc jusqu'à douze ans inclus - me semble trop faible. Un seuil à quatorze ans serait une bonne moyenne - c'est une façon de ne pas répondre...
Mme Ronai a prononcé une phrase remarquable sur les tribunaux en parlant des viols jugés aux assises, « c'est-à-dire des viols les plus graves »... Cela dit beaucoup : normalement, chaque viol est un crime, et doit être jugé par la cour d'assises, tandis que le délit est une infraction jugée par le tribunal correctionnel. C'est la juridiction qui détermine la qualité de l'infraction, et non la gravité de l'acte. Or notre système établit une sorte de graduation entre les crimes plus ou moins graves... C'est un problème de principe.
Certains font davantage confiance au magistrat qu'au citoyen, il faudrait peut-être concilier les deux... D'autres experts seraient plus compétents que moi sur ce sujet. Je suis juge des enfants, donc aussi juge pénal des enfants délinquants. Les enfants criminels de moins de seize ans sont jugés par le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ; ceux de seize et dix-sept ans par la cour d'assises des mineurs ; les adultes criminels par la cour d'assises. Or la correctionnalisation ne se produit que pour les cours d'assises des mineurs. On ne correctionnalise pas pour les enfants de moins de seize ans car ils sont quand même jugés par le juge pour enfants. C'est quelque chose de purement opportuniste à mon avis. Le système garde les conséquences de la qualification criminelle des actes des enfants de moins de seize ans : le fichier sur les infractions sexuelles, le casier criminel... Nous sommes beaucoup plus complaisants avec les enfants de plus de seize ans et les adultes qu'avec ceux qui ont moins de seize ans. Inspirons-nous du tribunal pour enfants jugeant en matière criminelle.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Que va dire la Chancellerie!
Ernestine Ronai . - Je voudrais revenir sur la correctionnalisation.
Dans l'enquête que nous avons réalisée en Seine-Saint-Denis, 46 % des agressions sexuelles jugées devant le tribunal correctionnel étaient en réalité des viols. C'est énorme ! Quel est l'intérêt de la cour d'assises ? Certes, elle coûte cher, mais elle présente le grand avantage de juger selon une procédure orale, ce qui signifie que la victime et l'agresseur entendent les éléments du dossier lors de l'audience, les experts, la famille.
La valeur pédagogique de ce principe est très forte, car la victime peut se reconstruire et l'agresseur peut reconnaître les faits, même s'il était dans le déni au départ. Or la compréhension est essentielle pour la prévention de la récidive. Tout le monde sait aussi que les avocats de la défense peuvent être durs avec la victime, et donc extrêmement déstabilisants pour elle. C'est pourquoi la personne qui vient en cour d'assises ne doit pas être seule ; elle doit être accompagnée par une association et préparée à la cour d'assises.
Il est inexact d'affirmer que les affaires jugées en cour d'assises ne donnent pas lieu à condamnation. En Seine-Saint-Denis, selon l'enquête que nous avons réalisée, la décision de poursuivre par le procureur a donné lieu à 92 % de condamnations en cour d'assises et à 82 % en correctionnelle, soit une bonne moyenne de condamnation dans les deux cas. En réalité, quand l'enquête est bien menée, les faits peuvent être reconnus. Il ne faut pas sous-estimer la qualité de l'enquête, capitale pour la suite de la procédure. Or tous les magistrats ne sont pas sensibilisés à son importance.
J'ai indiqué que l'ADN était pris en compte dans 33 % des cas en cour d'assises, et beaucoup moins en correctionnelle. Cela dit, l'ADN n'est pas le seul élément déterminant de preuve.
Autre élément en faveur du maintien des cours d'assises, peut-être en les améliorant : selon le procureur adjoint de Bobigny, les jurés de la société civile ne jugent pas plus mal que les juges de métier, qui peuvent ne pas être très favorables aux victimes. Il faut impérativement dire le droit aux jurés. Personnellement, je reste assez attachée à la cour d'assises et aux moyens qui lui sont accordés.
Sur la question du viol conjugal, le nombre de plaintes est en augmentation, de même que celui des condamnations, si les plaintes sont correctement traitées. La notion de « devoir conjugal » commence à s'estomper ! Grâce aux médias, les Français prennent conscience qu'un viol conjugal, cela existe. Sans doute avons-nous encore besoin d'une campagne de grande ampleur, après celle de mars 2016 sur les agressions sexuelles et les viols. La société est prête, agissons en accord avec elle : télévisions, affiches, flyers ...
Vous avez un rôle à jouer pour nous aider. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai l'histoire du budget ridiculement petit du secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Nous devons engager un vrai travail dans ce domaine, en ayant le souci de rétablir l'expression « droits des femmes » dans l'intitulé de ce département ministériel. C'est à mes yeux très important de parler de violences faites aux femmes plutôt que de violences sexuelles et sexistes, car dans la société actuelle, ce sont les femmes qui sont majoritairement victimes de violences, notamment dans l'espace privé et par une personne connue dans 90 % des cas. Le profil des hommes victimes est différent : les hommes subissent plutôt des violences physiques dans l'espace public, et par des inconnus. Poursuivons donc les efforts consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes.
J'en viens aux circonstances aggravantes.
L'inceste est défini depuis 2016 par le code pénal, mais celui-ci n'a pas prévu une peine spécifique à la hauteur de la gravité de l'inceste. Le fait que l'auteur exerce sur le mineur une autorité est une chose, mais il faudrait ajouter une autre mention différenciant l'inceste du viol ou de l'agression sexuelle. Une agression au sein de la famille ne peut être traitée comme les autres cas.
Je vous rappelle que dans notre avis sur le viol, nous proposions que, jusqu'à dix-huit ans, une relation entre un majeur détenteur de l'autorité parentale et un mineur de dix-huit ans sur lequel s'exerce cette autorité soit considérée ipso facto comme un viol ou une agression sexuelle. Cette idée me paraît très importante et pourrait être intégrée dans une future loi.
Je vous remercie sincèrement de votre attention et de vos questions, car grâce à vous, des évolutions sont possibles. Je connais déjà l'engagement de certains d'entre vous sur ces sujets. Ce combat est long et difficile. Pour le mener à bien, nous avons besoin de vous ! (Applaudissements.)
Annick Billon , présidente . - Nous avons été très heureux de vous recevoir aujourd'hui : nos collègues ont été passionnés par vos interventions et par les pistes de réflexion que vous nous avez livrées. La délégation aux droits des femmes a la ferme volonté de défendre les femmes victimes de violence, forte de son expérience dans ce domaine et avec une dynamique nouvelle due au renouvellement des membres de la délégation. Monsieur Durand, vous êtes un homme de consensus...
Laurence Rossignol, co-rapporteure. - De compromis !
Annick Billon , présidente . - ...en proposant l'âge de quatorze ans ! Pour ma part, je ne m'étais pas aventurée à cosigner les propositions des lois qui ont été déposées depuis quelques semaines sur ce sujet. Je ne voulais pas, en tant que présidente de la délégation, me positionner avant que le débat ne soit ouvert et tranché entre nous.
Vos propos sur la « correctionnalisation » du viol sont très éclairants. Beaucoup reste encore à faire en matière de lutte contre les violeurs mais il faut poursuivre les efforts entrepris en matière de formation et promouvoir une campagne d'information, comme vous le suggérez. Nous devons tous être vigilants car bien souvent, les organismes qui protègent les victimes de violence sont à la merci des budgets et des subventions qui leur sont alloués, sans garantie de pérennité suffisante dans le temps pour agir efficacement sur le long terme. Nous aurons d'autres occasions d'échanger sur tous ces sujets. Merci à tous !
Ernestine Ronai. Nous vous invitons en Seine-Saint-Denis !
Annick Billon, présidente . - Nous acceptons cette invitation avec grand plaisir. Je remercie M. Durand et Mme Ronai, ainsi que tous ceux de nos collègues qui sont intervenus ce matin.
Audition de Laurence Rossignol, ancienne ministre des
Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, membre de la
délégation,
sur les 4ème et 5ème plans
de mobilisation et de lutte
contre toutes les violences faites aux
femmes
(23 novembre 2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, ainsi que vous en avez été avisés hier, l'audition de Maudy Piot a été annulée. Nous espérons que la santé de la présidente de Femmes pour le dire, femmes pour agir lui permettra de participer d'ici quelques semaines à une nouvelle audition, conformément à son souhait. Je forme des voeux, en notre nom à tous, pour son rétablissement.
Avant d'entendre notre collègue Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, je propose que nous procédions à la désignation des membres du groupe de travail sur les femmes handicapées victimes de violences.
J'ai reçu les candidatures de :
- Chantal Deseyne (LR) ;
- Martin Lévrier (LaREM).
Quels sont les autres membres proposés par les autres groupes à raison d'un sénateur par groupe politique ?
Je prends note de la candidature de Roland Courteau (SOCR).
Nous attendons le retour des autres groupes pour poursuivre la désignation des membres de ce groupe de travail.
Par ailleurs, je rappelle que notre collègue Loïc Hervé est membre pour l'Union centriste de notre groupe de travail sur le harcèlement. Si vous en êtes d'accord, je souhaiterais également participer aux travaux de ce groupe en tant que présidente de la délégation, dans la perspective de l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement. Je vous en remercie.
J'en viens à notre première séquence.
Cette matinée s'inscrit dans les travaux que nous avons décidé d'entreprendre, non seulement sur le harcèlement et plus globalement sur toutes les agressions sexuelles, mais aussi sur les mutilations sexuelles et sur les violences faites aux femmes handicapées, sujet que Laurence Rossignol a qualifié, lors de notre réunion du 9 novembre, d'« angle mort » des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes.
Je vous remercie, madame la ministre, chère collègue, d'avoir accepté d'intervenir devant la délégation deux jours avant la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour faire le bilan du 4 ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016) et pour nous éclairer sur la mise en oeuvre du 5 ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019).
Nous connaissons toutes et tous votre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes qui se trouvent depuis plusieurs semaines dans l'actualité quotidienne, nationale et internationale.
Comme l'ont rappelé nos interlocuteurs de la semaine dernière, vous avez largement contribué à faire progresser la lutte contre les violences faites aux femmes à travers une action ministérielle particulièrement dynamique.
Je vous laisse sans plus tarder la parole, puis nous vous poserons des questions.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Merci, madame la présidente, de m'avoir proposé de partager avec toute la délégation mon expérience sur le sujet des violences faites aux femmes.
Je vais donc exposer l'articulation entre les 4 ème et 5 ème plans de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Rappelons que le premier plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes a été élaboré en 2004 pour la période 2005-2007 et partait du constat qu'il ne suffisait pas d'aggraver les sanctions pénales pour faire diminuer le nombre des violences faites aux femmes. En effet, ces violences s'inscrivent dans un long continuum qui nécessite à la fois des actions de prévention, d'éducation et d'accompagnement.
Les statistiques indiquent, invariablement, qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Je suis cependant quasiment certaine que ces chiffres sont en deçà de la réalité car ils n'intègrent pas les données relatives aux suicides consécutifs aux violences psychiques et psychologiques, ni toutes les maladies engendrées par la consommation de psychotropes, tabac et alcool qui vont généralement de pair avec un état psychologique dégradé.
Pour brosser un tableau schématique :
- les meurtres interviennent dans un nombre non négligeable de cas lors des procédures de séparation, les hommes tuant leur compagne ou ex-compagne au nom de ce qu'ils considèrent comme une « extension du droit de propriété ». Les affaires de meurtres commis par des femmes au sein d'un couple, si elles existent aussi, sont de nature très différente ;
- les violences quotidiennes perpétrées contre des femmes, à leur stade ultime, mènent aussi à leur lot de meurtres ; elles sont donc toutes susceptibles de déboucher sur la mort de la victime de ces violences.
Le premier plan a donc été fondé sur l'idée qu'il fallait une politique globale et concertée autour des violences faites aux femmes. Il faut saluer la continuité de l'action des différents gouvernements, par-delà les alternances politiques, entre le premier plan débuté en 2005 et le 5 ème plan initié en 2016 : il n'y a pas eu d'interruption dans la succession de ces plans pour continuer à améliorer la politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
Le 4 ème plan a été évalué en 2016 par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Cette évaluation a été effectuée dans le cadre de l'élaboration du plan interministériel suivant. Le HCE a dressé un bilan positif et encourageant de la mise en oeuvre du 4 ème plan, considérant qu'un cap qualitatif et quantitatif avait été franchi.
Parallèlement au 4 ème plan, des avancées législatives majeures ont permis de renforcer l'arsenal à la disposition des pouvoirs publics et des victimes :
- la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR 356 ( * ) a renforcé les obligations des acteurs et actrices départementaux afin de favoriser l'accès au logement social pour les femmes victimes de violences, notamment conjugales. Cette loi réduit en particulier le délai de préavis pour la sortie du logement social partagé avec un conjoint violent ; elle contient par ailleurs de nombreuses dispositions qui permettent de lever les obstacles se dressant devant les femmes qui veulent sortir des situations de violences ;
- la loi du 4 août 2014 357 ( * ) pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a intégré la dimension des violences faites aux femmes handicapées à la politique de prévention du handicap même si, à mon sens, des travaux restent à mener sur ce sujet. Elle prévoit aussi un renforcement du dispositif des ordonnances de protection, une formation des professionnels à la prise en charge des femmes victimes de violences sur laquelle je reviendrai, le développement des obligations des chaînes de télévision et de radio afin d'assurer le respect des droits des femmes et de lutter contre les images dégradantes. Comme je l'évoquais tout à l'heure, l'une des spécificités des violences faites aux femmes est ce continuum menant des violences sexistes quotidiennes au meurtre : c'est bien un ensemble de représentations dans lesquelles les violences sexuelles ou psychiques sont banalisées ou qui mettent en scène des femmes dans des situations dégradantes, qui permettent à la « culture du viol » de prospérer ;
- la loi du 17 août 2015 358 ( * ) relative au dialogue social et à l'emploi a introduit dans le code du travail la notion d'agissement sexiste, à l'initiative, je le rappelle, de plusieurs membres de la délégation ;
- la loi du 13 avril 2016 359 ( * ) visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées pose comme postulat que l'achat, la vente ou le trafic de services sexuels sont des violences à l'encontre des personnes prostituées, majoritairement des femmes.
En parallèle, des campagnes de communication ont permis d'améliorer l'accès aux droits pour les victimes, d'interpeller les auteurs de violences et de faire connaître les sanctions pénales qu'ils encourent : je vous rappelle notamment la campagne portant sur le harcèlement dans les transports.
Les outils visant à répondre à l'urgence et à prévenir la réitération des violences se sont étoffés avec la mise en oeuvre du 3919 , devenu un numéro de référence, que l'on essaye d'imposer dans le paysage médiatique afin qu'il devienne aussi connu que le 15 . De plus, des actions de formation ont été menées au sein des commissariats, gendarmeries et services d'urgence, avec notamment une mesure importante consistant dans la désignation d'un référent-e dans les services d'urgence des hôpitaux. Il s'agit en général d'un médecin ou d'un membre du personnel infirmier, spécialisé et capable d'identifier parmi les femmes qui se présentent aux urgences celles qui n'osent indiquer spontanément que leurs blessures résultent de faits de violences et en dissimulent l'origine sous couvert de douleurs abdominales ou de chutes.
La formation a concerné aussi les personnels éducatifs, la police municipale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs mais aussi ceux de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), dans un souci d'accompagner les victimes de violences commises contre les femmes réfugiées. À cet égard, j'ai posé pour principe que toute femme réfugiée était présumée avoir été victime de viol pendant son parcours. Ces femmes peuvent par exemple subir des relations sexuelles forcées pour prix de leur acheminement par des passeurs. Les femmes réfugiées seraient donc éligibles à l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place pour l'accompagnement psychologique et physique des victimes de violences ; malheureusement, les résultats à cet égard n'ont pas été à la hauteur de mes espérances.
J'en viens maintenant au 5 ème plan. Il s'inscrit dans la continuité du 4 ème tout en en renforçant les mesures.
Le chiffre de 400 000 personnes formées annoncé par la MIPROF 360 ( * ) a été confirmé lors de son audition du 16 novembre dernier par Ernestine Ronai ; connaissant sa rigueur, ce chiffre m'apparaît représentatif du volume horaire de formation, même si d'aucuns le contestent. Rappelons toutefois que les formations délivrées font beaucoup appel à des outils tels que les MOOC, sans toujours nécessiter la participation physique de l'auditeur aux réunions, lesquelles se déroulent d'ailleurs le plus souvent au plan local dans les services et les structures de terrain, de préférence à des formations organisées à Paris. De même, dans les hôpitaux, le référent forme à son tour les autres personnels hospitaliers.
Le 5 ème plan définit plusieurs priorités : assurer l'accès aux droits et sécuriser les dispositifs qui ont fait leur preuve pour améliorer le parcours des victimes, faciliter la libération de la parole, la révélation des violences, mieux mettre à l'abri les victimes et répondre à l'urgence en déterminant qui doit rester au domicile de la famille. À cet égard, diverses réponses sont possibles selon les situations, notamment en présence d'enfants, car il faut alors gérer les changements d'établissements scolaires, trouver des centres d'hébergement accueillant femmes et enfants parfois nombreux, auquel cas leur maintien au domicile est préférable, pour autant que les mesures d'éloignement du conjoint violent soient respectées. En ce qui concerne les ordonnances de protection et le téléphone grave danger (TGD), je m'étais attachée à ce que les procureurs qui disposent de TGD les attribuent en totalité, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Le 5 ème plan entend également alourdir les condamnations des auteurs de violences, non pas en prononçant des peines plus sévères, mais en augmentant le nombre de poursuites diligentées et de condamnations contre ces auteurs. Enfin, nous avons souhaité prendre en compte les violences dans toute leur étendue, élargir la formation à d'autres professionnels, tels que les pompiers, réfléchir à une extension des délais de prescription et améliorer le dépôt de plaintes.
Par ailleurs, l'une des spécificités du 5 ème plan est la connexion entre femmes et enfants. Je rappelle que le fait d'inclure dans le champ des violences faites aux femmes les violences faites aux enfants a fait l'objet de réticences dans le passé, tant était prégnante la crainte qu'une plus grande sensibilité aux violences faites aux enfants ne focalise l'attention sur celles-ci, en dissimulant la compréhension des violences faites aux femmes. Par conséquent, l'appréhension des violences faites aux femmes a infiniment mieux progressé que celle des violences faites aux enfants, qui demeurent un véritable tabou. Certes, les enfants maltraités émeuvent tout le monde mais pas au point de désigner la famille comme étant le premier lieu de la violence qui leur est faite et mettre en oeuvre une vraie politique de lutte contre ces violences, tant nous nous heurtons encore aux représentations protectrices et bienveillantes de la famille. Il faut donc déconstruire ces représentations au préalable.
Mon mérite est limité car c'est Édouard Durand, comme toujours lumineux et limpide, qui est l'inspirateur de l'articulation entre la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le cadre des violences intrafamiliales, à travers la formule : « les enfants témoins de violences sont des enfants victimes ».
Le 5 ème plan souligne la nécessité d'assurer la protection des mères et des enfants pendant la séparation, et intègre les violences économiques aux violences faites aux femmes, au nombre desquelles le non-paiement des pensions alimentaires.
L'intitulé de mon ministère, à ma nomination comme ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a suscité de nombreux commentaires désobligeants. Leurs auteurs y voyaient le signe d'une régression digne du pétainisme ! Pourtant, ce regroupement a bel et bien permis de mieux articuler l'ensemble des violences intrafamiliales pour mobiliser de concert les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes et celles faites aux enfants ; ainsi, l'inclusion dans mon ministère du champ de la famille m'a permis de créer l'Agence de recouvrement des pensions alimentaires (Aripa) qui réduit les violences économiques résultant du non-paiement de celles-ci.
Le 5 ème plan s'intéresse aussi à un « angle mort » des politiques publiques antérieures, celui des jeunes femmes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, installées ou non en couple, et qui, majeures soumises à des violences, ne relèvent plus du traitement des violences faites aux enfants mais ne se reconnaissent pas toujours dans les politiques de lutte contre les violences conjugales, parce qu'elles ne considèrent pas être sous statut conjugal.
Existent ainsi des violences, qui n'en sont pas moins dramatiques, exercées par des garçons au sein de couples non-cohabitants, instables et éphémères. Ces jeunes femmes peuvent aussi souffrir de violences parentales qui perdurent au-delà de leur majorité. Entre 2014 et 2017, nous avons créé 1 500 nouvelles places d'hébergement, mais pas toujours au sein des seuls centres dédiés aux femmes, comme l'auraient souhaité les associations.
Le 5 ème plan prévoit la création de 100 solutions d'hébergement spécialisées pour les dix-huit/vingt-cinq ans. Vous connaissez peut être à Paris l'association FIT, Une femme, un toit , spécialisée dans l'accueil des jeunes femmes victimes de violences et dirigée par Marie Cervetti, aux positions très affirmées, et extrêmement efficace dans son travail.
Des femmes vivant en milieu rural nous ont aussi alertés sur le fait que le monde rural ne bénéficie pas et ne bénéficiera jamais du tissu associatif spécialisé qui existe dans les villes ; aussi, en matière de formation, nous nous sommes appuyés sur l'existant pour mettre en place la formation des intervenants sociaux présents en milieu rural, en convention avec la Mutualité sociale agricole (MSA) et les réseaux associatifs : centres sociaux ruraux, familles rurales, missions locales. Nous avons également prévu la création de permanences d'écoute dans des missions de service public.
Enfin, les violences faites aux femmes ont aussi été incluses dans la campagne « Sexisme, pas notre genre ».
Trois mois après le lancement du 5 ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes, a été présenté le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour 2017-2019, qui formalise l'analyse selon laquelle les enfants sont des co-victimes des violences faites aux femmes.
Constater l'absence de plan interministériel contre les violences faites aux enfants, alors que les plans de lutte contre les violences faites aux femmes en sont déjà à leur 5 ème édition, témoigne du retard pris sur ce sujet. Nous l'avons traité sous l'angle des violences sexuelles, de la mémoire traumatique, de l'amnésie post-traumatique et de ses conséquences sur la santé des enfants. Nous avons aussi mené une campagne de sensibilisation « Le signalement n'est pas une délation ». En effet, il est important de dénoncer les faits, dont nous sommes témoins, de violences à l'encontre d'enfants et de battre en brèche le vieil adage invitant à ne pas se mêler des affaires privées qui se déroulent au sein d'une famille, au motif que les parents sont libres de l'éducation de leurs enfants. L'ouvrage paru dans les années 1970 Crie moins fort, les voisins vont t'entendre est parfaitement révélateur de cet état d'esprit auquel nous devons mettre fin. Les marches blanches en mémoire des victimes ne suffisent pas, il faut éviter que l'irréparable ne soit commis !
J'ai mené campagne pour faire adopter une loi contre les violences éducatives ordinaires, moquée sous la dénomination très réductrice de « loi fessée », à connotation vaguement sexuelle. Or il faut promouvoir l'éducation non violente des enfants. Cette campagne a suscité des incompréhensions de certains parents quant à l'interdiction qui peut leur être imposée de ne pas frapper leur enfant, notamment de la part d'une frange de la France traditionnelle, comme si l'exercice de violences à portée « éducative » était une des composantes de notre identité ! Cette disposition a été introduite dans le projet de loi « Égalité et citoyenneté » (PLEC), mais a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, qui l'a annulée pour des raisons de procédure, en tant que cavalier législatif. Il faudrait donc que cette mesure puisse être de nouveau examinée et adoptée par le biais d'un autre vecteur législatif.
Le droit des femmes doit passer de sujet sectoriel à transversal ; en effet, au-delà des discours, qu'il s'agisse de celui que prononcera le 25 novembre le Président de la République ou de ceux qui le seront à l'occasion de la journée du 8 mars, force est de constater que l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes demeurent des sujets sectoriels qui n'ont pas encore imprégné l'ensemble des politiques publiques. Or une implication interministérielle est nécessaire pour mobiliser toute la société et les acteurs publics contre les violences faites aux femmes. La question des moyens qui y sont affectés est aussi essentielle : au-delà des déléguées départementales aux droits des femmes, les « véritables » services extérieurs du ministère des Droits des femmes ou du secrétariat d'État à l'Égalité femmes-hommes sont les associations. C'est grâce aux associations que se mettent en place les politiques publiques de l'égalité entre femmes et hommes. Or les subventions qui leur sont attribuées ne représentent qu'une part infime des moyens qui sont affectés à un service extérieur de l'État. C'est pourquoi je demande le maintien et la création des contrats aidés dans tout le milieu associatif dédié aux droits des femmes, d'autant plus que ces associations sont actuellement encore plus sollicitées pour assister des femmes depuis que leur parole s'est récemment libérée.
Annick Billon, présidente . - Merci, chère collègue, pour ce témoignage qui souligne votre force de conviction.
Parmi les aspects que vous avez évoqués, je relève la continuité dans la mise en oeuvre des politiques publiques de lutte contre les violences, même si certains aspects portant sur la question des enfants ou la ruralité doivent être précisés. À cet égard, la délégation, au cours de ses travaux sur le thème des agricultrices, a souligné l'importance de la désignation d'associations de référence pour accueillir les femmes victimes de violences en milieu rural, ces associations étant formées par des structures spécialisées, inégalement présentes dans nos territoires.
Vous avez justement indiqué que les moyens sont fluctuants, notamment les subventions attribuées aux associations dans le cadre départemental, qui peuvent se voir fortement réduites, voire disparaître à la suite d'un changement à la tête de cet exécutif local. Comme le soutien aux femmes victimes de violence n'est assuré que par les associations, il peut en résulter de fortes inégalités territoriales, et c'est très regrettable.
Le magistrat que nous avons auditionné la semaine dernière a été limpide dans son propos quant au lien entre les violences faites aux femmes et celles faites aux enfants, en rappelant, comme vous venez de le mentionner, qu'un enfant témoin est un enfant victime, ce dont on n'a sans doute pas assez conscience. Je suis d'accord avec vous, il y a une réticence à se mêler de ce qui se passe dans l'intimité des familles...
Françoise Cartron . - Merci de nous avoir rappelé les progrès accomplis et le chemin restant à parcourir.
Une formation au signalement doit être menée auprès de différents acteurs ; lors de ma carrière d'enseignante, alors que j'avais constaté que l'un de mes élèves présentait des marques de violences physiques, on m'a fortement dissuadée de le signaler en instillant le doute quant à la réalité des faits, voire en faisant apparaître ma démarche comme irréfléchie ! Il faut être conscient de cette difficulté à laquelle sont confrontés les enseignants.
Par ailleurs, je m'interroge sur les critères de nomination des déléguées départementales aux droits des femmes. Je n'ai pas été convaincue, par exemple, par le travail d'une déléguée, qui d'ailleurs est restée en poste fort longtemps, qui n'abordait que des sujets tels que les femmes cheffes d'entreprises, sans se soucier des violences...
Nassimah Dindar . - Je vous remercie, madame la ministre, pour votre exposé. Nous vous avons reçue à La Réunion. Vous connaissez bien l'acuité du problème des violences exercées contre les femmes dans les départements d'Outre-mer (DOM) et vous avez bien décrit l'ensemble des violences intrafamiliales. Je voudrais saluer le fait que les dispositions du 5 ème plan incluent au sein des violences faites aux femmes l'ensemble des violences intrafamiliales comme un sujet indissociable ; lors des rencontres avec des élus locaux, l'aide sociale à l'enfance ne peut être mentionnée sans y associer toute la place donnée aux familles, aux pères parfois absents et à la dégradation des conditions de vie de la mère de famille qui constituent chez nous en Outre-mer autant de problèmes cruciaux. Je rappelle à cet égard un chiffre édifiant publié il y a deux semaines : à La Réunion, 80 % des interventions en urgence de la gendarmerie ont pour cause des violences intrafamiliales.
Dans mon territoire, un cofinancement État-département a permis de créer au sein de cinq gendarmeries des postes d'assistants sociaux qui y effectuent un travail remarquable, ce qui démontre la nécessité de disposer de moyens financiers pour assurer une présence physique de l'autorité.
Je vous rejoins sur la politique du logement : elle doit être définie au niveau interministériel et intégrer les problématiques des violences faites aux femmes et aux violences intrafamiliales, afin qu'une convention conclue avec les bailleurs sociaux permette de disposer d'un intervenant dédié dans chaque groupe d'immeubles. Une association a démontré l'efficacité d'un tel référent de proximité au sein d'une barre d'immeubles.
De plus, le sexisme qui accompagne l'image de la femme dans les médias n'est pas le fait de la seule publicité mais vient aussi du parti pris de les valoriser ou de les dévaloriser ; ainsi les femmes et les hommes politiques ne bénéficient pas d'un égal traitement dans les médias.
Sur la question des moyens, bien que les déléguées aux droits des femmes ne disposent que de budgets dérisoires, celle de La Réunion effectue un travail remarquable avec une dotation infime de 50 000 euros ! Il me semble qu'un travail de ventilation budgétaire devrait définir dans chaque département et région les budgets à allouer au vu des actions à y mener. Plus généralement, les associations ne peuvent disposer d'une visibilité sur leurs actions en l'absence de convention de financement pluriannuelle. Il faudrait à cet égard identifier des référent-e-s au niveau national.
Enfin, comme vous l'avez souligné, le problème de société que sont les violences intrafamiliales doit être traité à un niveau interministériel.
Pour conclure, il me semble qu'un travail reste à mener sur la femme et l'islam de France pour éduquer ces jeunes françaises qui deviendront les parents des futurs musulmans de France.
Victoire Jasmin . - La situation en Guadeloupe est similaire à ce qu'a décrit ma collègue de La Réunion.
En Guadeloupe, les hommes ont longtemps considéré qu'ils étaient propriétaires de leur femme, comme en témoigne l'anecdote suivante : je n'ai appris le prénom de l'une de mes tantes que le jour de ses obsèques car, au cours de sa vie, elle n'était connue que sous la dénomination de « tante Serge », la coutume voulant que la femme prenne le prénom de son époux : Mme Auguste, Mme Gaston... Je pense que c'est une tradition que n'accepteraient plus les jeunes générations.
À cette époque, beaucoup de femmes confrontées à la violence de leur conjoint ne trouvaient nul réconfort auprès de leurs parents et notamment de leur mère, qui les renvoyaient à leur foyer violent.
Même si cela a aussi changé, beaucoup de femmes meurent encore sous les coups en Guadeloupe et en Martinique ; cette violence à l'encontre des femmes existe aussi en France métropolitaine : un policier guadeloupéen y a récemment tué sa femme et plusieurs de ses enfants. Quand les femmes se rebellent contre le joug imposé par leurs hommes, ceux-ci ne l'acceptent pas et peuvent basculer dans une violence extrême.
Par ailleurs, un récent article du Quotidien du médecin mentionne que les femmes en situation précaire négligent souvent leur santé pour s'occuper de leur famille. Il y a là un vrai sujet pour la délégation.
En Guadeloupe, la lutte contre les violences faites aux femmes résiste aux alternances politiques. La déléguée départementale aux droits des femmes est ainsi restée en poste pendant vingt ans et a su décliner sur le terrain les politiques publiques de l'État, avec le concours des associations. Des dispositifs innovants ont été mis en place pour permettre l'expression des femmes dans le cadre de groupes de parole, au sein desquels hommes et femmes conversent pour exprimer leurs non-dits, poser clairement les problèmes sous-jacents à une communication insuffisante entre les sexes et aboutir à un apaisement de relations qui débouchaient auparavant trop souvent sur des violences dont les enfants étaient aussi généralement victimes.
J'ai demandé à la présidente d'une de nos associations locales d'adresser à la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat une synthèse des actions qui ont été menées en Guadeloupe.
Les personnes handicapées éprouvent notamment des difficultés à accéder aux dispositifs de prévention du cancer du sein et à un suivi gynécologique, car selon leur handicap, elles ne sont pas toujours en capacité de réagir et de signaler leurs maux par elles-mêmes, demeurant alors tributaires de la bonne volonté des personnes qui les assistent.
Nous menons des actions de prévention avec le concours d'associations ou, dans un cadre intercommunal, des CISPD 361 ( * ) , au sein desquels certains bailleurs sociaux s'impliquent en nommant des référents dans les immeubles qui peuvent procéder à des signalements de familles rencontrant des difficultés ; néanmoins, des freins subsistent, des femmes restant hésitantes à faire remonter l'ensemble des informations dont elles peuvent disposer.
Souhaitons que les récentes campagnes de libération de la parole des femmes permettent à terme de surmonter ces réticences afin de nous donner les moyens d'agir.
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Même si j'ai éprouvé des réticences à la création de votre ministère, je reconnais cependant que votre action y a été positive.
Notre rapport sur les violences au sein des couples 362 ( * ) pointait déjà la problématique de l'ensemble des violences intrafamiliales, qu'elles s'exercent sur les femmes ou sur les enfants.
Ancienne enseignante en maternelle, je corrobore les propos de Françoise Cartron sur la pusillanimité de l'éducation nationale à procéder à des signalements, les enseignants étant fortement dissuadés de s'y risquer par des intervenants de l'ensemble de sa structure, notamment la médecine scolaire. Une formation au signalement est donc nécessaire, mais il est difficile de faire évoluer les mentalités sur ce point.
J'en suis bien consciente, heureux sont les départements qui disposent d'une déléguée départementale, surtout lorsque celle-ci est efficace, comme c'est le cas en Haute-Garonne !
Comme beaucoup d'autres collègues autour de cette table, j'ai versé une partie de ma dotation parlementaire à des associations ; or, celles qui désormais ne bénéficient plus ni de contrats aidés ni des versements issus de la réserve parlementaire, et doivent se contenter des subsides alloués par l'État ou le département, se trouvent confrontées à de graves difficultés financières.
Certains préfets ont fait le choix de conserver les contrats aidés dans les secteurs de l'éducation, de l'accompagnement ou du social ; cependant, si on leur enjoint de procéder à des mesures d'économie plus drastiques, en réduisant encore le volume global des contrats aidés, rien n'assure que ces secteurs préservés le resteront.
Roland Courteau . - Les propos de Laurence Rossignol confirment que la lutte contre les violences au sein des couples est désormais considérée comme une politique publique à part entière, ce qui n'était pas encore le cas en 2005 lorsque la première proposition de loi destinée à lutter contre ce fléau a été présentée.
« Protéger la mère, c'est protéger l'enfant » nous précise Édouard Durand dans son ouvrage ; à cette fin, il me semble nécessaire de recourir plus fréquemment aux mesures d'accompagnement protégé (MAP) qui permettent d'éviter le contact direct entre le père auteur de violences et la mère.
Puisque la reconstruction de la victime passe par la mise à sa disposition d'un logement, subir des violences conjugales devait constituer un motif prioritaire d'attribution d'un logement social selon les dispositions de la loi de 2010 363 ( * ) ; à ce titre des conventions devaient être signées entre l'État et les bailleurs sociaux : qu'en est-il ?
Le suivi des victimes de violences conjugales, femmes et enfants, notamment dans ses composantes psycho-traumatiques est insuffisant, le nombre d'établissements de soins spécialisés ne pouvant aujourd'hui répondre à une demande de soins souvent lourds, et qui doivent être prodigués pendant des années, voire une vie entière.
L'incrimination des violences psychologiques, non retenue dans la loi de 2006 364 ( * ) , a été reprise dans celle de 2010. Mais qu'en est-il des condamnations prononcées à ce titre ? Elles semblent rarissimes, alors même que la violence psychologique exercée par un agresseur habile détruit lentement un être sans laisser de traces visibles, cette absence de preuves tangibles permettant difficilement de sanctionner leur auteur. Faudrait-il sensibiliser les magistrats à ces violences psychologiques ou en adopter une définition plus large ?
Si notre arsenal législatif est suffisant pour permettre de lutter contre le fléau des violences conjugales, il faudra cependant traiter au plus vite les stéréotypes sexistes dont l'influence est forte dès la prime enfance. Ces stéréotypes sont un ferment des inégalités et ont une responsabilité dans les violences ultérieures envers les femmes.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Monsieur Courteau, l'articulation entre les violences faites aux femmes et les stéréotypes a bien été prise en compte dans le 5 ème plan, qui s'intitule « le sexisme tue aussi », et qui inscrit la mobilisation contre les violences faites aux femmes au sein d'une mobilisation globale contre le sexisme. Plusieurs études s'intéressent au respect du consentement dans le secteur cinématographique : de nombreux films mettent en scène un homme qui passe outre le consentement d'une femme. Pourquoi s'en priverait-il ? Pour autant qu'il soit suffisamment insistant, la femme se laisse convaincre et finalement elle a l'air très contente ! Je vous invite à revoir les films de James Bond, typiques de cette approche...
Céline Boulay-Espéronnier . - Cela évoque aussi l'affaire Weinstein !
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - En matière de signalement des violences, ce n'est pas l'éducation nationale qui est la plus à blâmer, mais plutôt les médecins généralistes, dont le taux de signalement est le plus bas parmi l'ensemble des acteurs qui rencontrent des enfants victimes de violences. Pourtant, ils ne sont pas passibles de poursuites pour dénonciation calomnieuse. En effet, des dispositions législatives les protègent : une proposition de loi déposée il y a dix-huit mois et adoptée au Sénat exonère les médecins de toute poursuite en matière de diffamation en cas de signalement de violences. Bien qu'elle soit redondante avec les textes existants, je l'ai soutenue pour rassurer les médecins sur ce point en leur rappelant la règle.
La culture interne de l'éducation nationale a aussi évolué positivement sur la question du signalement, si l'on veut bien se rappeler qu'il y a encore quelques années, les enseignants pédophiles étaient simplement déplacés d'une académie à une autre !
Les enseignants, inquiets pour leurs élèves, procèdent plus fréquemment à des signalements les veilles de week-end et de vacances scolaires, périodes pendant lesquelles l'enfant sera seul avec ses parents. Les enseignants souffrent cependant de l'absence de retour sur le traitement de leur signalement. Il leur semble que celui-ci est vain : cela les dissuade de faire cette démarche. Les Cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) devraient être associées à des travaux pour que les services d'inspection des rectorats informent l'équipe éducative qui a procédé au signalement ; dans le cas contraire, le découragement guette les enseignants.
À l'issue de chaque intervention sur les droits de l'enfant dans une classe, on constate qu'au moins un enfant se présente à l'intervenant pour décrire ce qu'il vit dans sa famille ; promouvoir les droits de l'enfant à l'école est donc fondamental ! Cela permet de révéler et de faire comprendre aux enfants que des situations qu'ils pensaient jusqu'ici normales, car sous l'autorité de leurs parents, ne le sont aucunement.
Je suis bien d'accord avec nos collègues ultramarines, l'ampleur des violences dans les DOM justifierait que des moyens supplémentaires y soient affectés, notamment pour former l'ensemble des acteurs.
Les déléguées départementales sont choisies par une commission départementale aux droits des femmes sur proposition des préfets, après audition des fonctionnaires qui demandent une mutation sur ce poste ou de contractuels. Les déléguées départementales sont très diverses, comme d'ailleurs tous les personnels de la fonction publique. Elles effectuent leur travail plutôt en solitaire, même si elles rendent compte aux délégations régionales aux droits des femmes.
J'en suis bien consciente, les budgets attribués à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes sont dérisoires au regard des besoins, et la retenue dans l'expression des personnes oeuvrant en ce domaine, qui préfèrent la discussion calme aux débordements et autres blocages routiers, à l'inverse de ce que peuvent faire certains groupes catégoriels, n'est pas de nature à faire pression sur le Gouvernement. On peut espérer que la récente libération de la parole des femmes inversera ce rapport de force et soulignera l'ampleur des besoins.
Françoise Laborde est dans le vrai, la suppression de la réserve parlementaire représente une baisse discrète mais réelle des ressources des associations.
Le nombre insuffisant de praticiens formés pour traiter les épisodes psycho-traumatiques est apparu patent après les récents attentats de masse. Un groupe de travail du ministère de la Santé travaille sur cette question et doit faire des propositions à l'assurance maladie pour examiner l'extension de la prise en charge à 100 % à vie au profit de l'ensemble des adultes victimes de violences sexuelles, comme cela existe pour les enfants victimes de violences sexuelles, pris en charge dans le cadre d'ALD (Affection de longue durée) pour les pathologies relevant du traitement des violences sexuelles qu'ils ont subies.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Je reconnais l'ensemble du travail accompli par Laurence Rossignol, féministe convaincue de longue date, même si je suis restée critique sur la dénomination qui avait été retenue pour son ministère et les budgets qui lui avaient été affectés.
Quel que soit le gouvernement, les moyens financiers consacrés aux droits des femmes sont indigents alors même que les violences faites aux femmes non prises en charge induisent des dépenses très importantes pour la société, comme l'a indiqué un rapport du HCE.
Que pourrait-on faire de plus pour alerter et parvenir à débloquer des crédits supplémentaires ? Je salue à cet égard l'amendement adopté par la commission des affaires sociales visant à augmenter les crédits de la lutte contre la prostitution.
Pourrait-on disposer d'une cartographie de la répartition territoriale des déléguées aux droits des femmes, les postes n'étant pas pourvus dans certains départements ?
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - C'est une demande qu'il faudrait formuler auprès de Mme Schiappa.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Si l'ensemble de la délégation partage le constat que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes constituent une violence économique, je constate cependant que cette unanimité n'est plus de mise quand il s'agit de faire adopter des dispositions visant à pénaliser davantage les entreprises...
La prise en charge des psycho-traumas des femmes victimes de violences devrait être de 100 %, comme c'est le cas pour les victimes des attentats. La psychiatre Muriel Salmona demande qu'un centre de santé spécialisé dans la prise en charge de ces pathologies soit créé dans chaque bassin de vie pour assurer un suivi des victimes dans le cadre du tiers payant.
Soyons d'autre part attentifs à toujours associer le mot femmes aux expressions « violences intrafamiliales », « sexistes » ou « sexuelles » car ce sont bien les femmes qui en sont principalement victimes !
Christine Prunaud . - Madame la ministre, je salue votre engagement pour les droits des femmes. Élue des Côtes-d'Armor, je suis originaire d'une ville en milieu rural et je déplore que depuis plus d'un an, le poste de chargée de mission aux droits des femmes y soit vacant, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'organisation de la coordination de la prévention des violences faites aux femmes. Chaque préfecture doit disposer d'un référent dédié aux droits des femmes, c'est une question d'égalité territoriale ! Je déplore que des courriers adressés à Mme Schiappa sur ce sujet soient restés sans réponse.
Notre délégation est unanime pour demander que lui soit adressé un état des lieux de la répartition territoriale de ces chargées de mission aux droits des femmes.
Le rapport de force doit évoluer et des négociations plus fermes s'engager avec les ministères et les préfets pour exiger des moyens pérennes de financement de la prévention des violences faites aux femmes qui ne repose actuellement que sur des associations, lesquelles se trouvent dans une situation financière extrêmement précaire.
Céline Boulay-Espéronnier . - Dispose-t-on de statistiques sur les signalements des violences faites aux enfants selon que l'on se trouve en zone d'habitat urbain ou périurbain ?
Des cas dramatiques de violences sur enfants exercées au sein du foyer familial ont mis en exergue le rôle joué par les mères qui en sont témoins, sans que l'on sache précisément si elles étaient simplement passives, victimes elles-mêmes de violences ou bien consentantes ; l'arsenal juridique est-il suffisant pour prendre en compte ces situations ?
La dénonciation des violences verbales et psychologiques, qui mènent souvent à des violences physiques doit par ailleurs, selon moi, être encouragée.
Martin Lévrier . - Vice-président d'un organisme de logements sociaux, j'ai eu à traiter des cas dramatiques d'anciennes épouses de militaires qui se trouvaient du jour au lendemain sans domicile du fait d'une séparation.
En effet, au prononcé du divorce entre un militaire et un civil, le conjoint civil doit immédiatement quitter le logement de fonction attribué par l'autorité militaire, faute de quoi il est expulsé ! Cette pratique est d'une incroyable violence ! Ces faits se sont déroulés à Versailles et à Satory au sein de la gendarmerie.
Je propose de mener des actions de prévention systématiques sous couvert d'une formation à la famille, par exemple à l'occasion des entretiens précédant les mariages, en y exposant le respect entre conjoints et en informant sur les moyens d'alerte existants, dont le numéro national 3919 .
Noëlle Rauscent, co-rapporteure . - Beaucoup de femmes ne reçoivent pas la pension alimentaire qui leur est due, pourtant nécessaire à l'équilibre de leur budget et à l'éducation des enfants dont elles ont la charge, sans oser en réclamer le versement par crainte des violences que pourraient exercer leur ex-conjoint à leur encontre. Comment peut-on y remédier ?
En milieu rural, le signalement des violences sur enfants serait accru en améliorant la communication, encore inégale, entre les établissements scolaires et les municipalités ; en tant que maire, j'ai ainsi pu faire avancer le traitement d'un dossier de violences en réunissant les informations issues de l'école et des services de la mairie.
Certes, le parti LaREM dont je suis représentante est favorable à la suppression de la réserve parlementaire ; cependant, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, a indiqué lors de son audition d'hier qu'une enveloppe de 200 millions d'euros était disponible pour des quartiers urbains en difficultés, ainsi qu'en milieu rural ; les demandes de crédits peuvent donc s'inscrire dans ce cadre.
Chantal Deseyne . - Madame la ministre, je salue votre engagement et votre combat pour la cause des femmes.
Nos modèles éducatifs ne sont pas adaptés à la nécessaire prévention des violences faites aux femmes et aux enfants ; aussi, comment faudrait-il associer l'éducation nationale, le corps médical ainsi que les élus au sein d'une instance qui affirmerait avec force que femmes et petites filles ne sont pas soumises à leur père ou à leur compagnon ?
Comment accompagner les femmes dépendantes économiquement après une séparation et faciliter le recouvrement d'une pension alimentaire impayée ou sous-évaluée ?
Claudine Lepage . - Des femmes françaises avec enfants vivant en Italie, mariées à des conjoints violents, divorcées, ou ayant engagé une procédure de divorce, m'ont indiqué que celles dont le jugement de divorce a été prononcé par un juge italien sont contraintes de rester dans ce pays à proximité du conjoint violent ; la situation devient dramatique lorsque (c'est le cas pour l'une de ces femmes) l'ex-conjoint violent appartient à la mafia. Qu'adviendra-t-il lorsqu'elle reviendra dans sa famille en France ? Comment la protéger ?
Annick Billon, présidente . - Je remercie Martin Lévrier d'avoir souligné le drame que vivent les femmes de militaires divorcées qui doivent immédiatement quitter l'ex-domicile conjugal, parfois avec leurs enfants.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Sur cette question du logement des militaires, je suggère de nous rapprocher du haut fonctionnaire chargé de l'égalité femmes-hommes qui existe au sein du ministère de la Défense comme dans chaque administration centrale, pour mettre en place des dispositifs transitoires, d'autant que ce ministère a montré qu'il est plutôt réceptif sur les questions relatives à l'égalité femmes-hommes.
Un ministère des droits des femmes, même de plein exercice, demeure de facto un « ghetto » dans la mesure où les moyens et les outils dépendent des autres ministères ; j'avais en charge la famille au sein de mon ministère et donc la tutelle de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), ce qui m'a permis de disposer de l'outil de la politique familiale au service des droits des femmes, sans avoir besoin de solliciter d'autres ministères pour disposer des leviers nécessaires.
Pour faire évoluer le monde judiciaire sur les droits des femmes, un grand ministère en charge des Droits des femmes et de la Justice serait une bonne formule à mon avis.
Concernant les violences sur les enfants, le ministère de la Justice ne peut fournir que peu d'éléments, et encore ceux-ci diffèrent-ils des chiffres du ministère de l'Intérieur...
L'Observatoire national de la protection de l'Enfance (ONPE), assisté par les Observatoires départementaux de protection de l'enfance (ODPE), réalise les enquêtes statistiques sur les violences exercées à l'encontre des enfants. Nous ne disposons cependant que de rares données, notamment sur la répartition territoriale de ces violences, et des outils sont en cours de construction. Là encore, des moyens financiers suffisants sont nécessaires.
On note une recrudescence des violences faites aux enfants par les beaux-pères, les femmes étant probablement sous emprise, je veux bien l'admettre dans certains cas. Cependant, ce concept d'emprise, encore récent en droit français, ne doit pas permettre d'exonérer les mères elles-mêmes auteurs, complices ou témoins ! L'incrimination pénale de non-dénonciation de maltraitance sur enfant est applicable à ces mères témoins et j'ai proposé dans une proposition de loi de faire débuter le délai de prescription de cette infraction aux dix-huit ans de l'enfant au lieu de six ans après la commission des faits, ce qui est le cas actuellement.
La question du décloisonnement des politiques sociales, même si cela s'avèrerait coûteux sur le plan humain et budgétaire, est centrale. Elle constitue à mon avis un véritable enjeu de modernisation de l'État.
Concernant la question de Noëlle Rauscent, le mariage est protecteur pour les femmes car son dénouement donne lieu à une procédure judiciaire qui fixe les modalités de calcul et de versement de la pension alimentaire, ce qui n'est pas le cas pour les autres couples qui se séparent. Par ailleurs, je constate que les femmes qui gagnent bien leur vie n'en font pas un sujet. Nous avons mis en place la garantie de pension alimentaire relayée par l'Agence de recouvrement des pensions alimentaires (Aripa) qui permet aux femmes victimes de violences d'utiliser l'écran de cette agence pour faire procéder aux versements de pension. Cette agence fait aussi une avance pour tous les enfants, sans critères de ressources. C'est important pour les mères.
Réserver une enveloppe de 200 millions pour les quartiers urbains et ruraux fragiles, c'est une bonne chose ! Encore faut-il préserver la capacité d'agir des associations têtes de réseaux. En effet, si ces dernières sont exsangues, le tissu associatif présent sur le terrain en sera affecté.
L'affaire dont nous fait part Claudine Lepage relève à mon sens des dispositifs de protection des témoins, comme cela existe dans les affaires judiciaires pour protéger les prostituées qui dénoncent des réseaux ; il existe aussi des mécanismes de mise à l'abri pour les femmes qui subissent des violences. Le cas complexe qui nous est exposé relève toutefois de conventions bilatérales, et il reste à déterminer quel sera l'interlocuteur qui prendra en charge ce dossier : Affaires étrangères, Intérieur, Justice...
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie de votre intervention et d'avoir défendu la cause des femmes pendant ces années à la tête du ministère des Droits des femmes.
Chers collègues, je vous remercie de votre participation active à nos travaux. J'observe qu'une belle dynamique se créée au sein de notre délégation.
Audition de Marie-France Hirigoyen, psychiatre,
sur le
harcèlement
(30 novembre 2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Marie-France Hirigoyen, psychiatre, pour nous parler du harcèlement, un phénomène de violence qui affecte les femmes au travail, en ligne, dans les transports et plus généralement dans l'espace public. Un phénomène qui touche aussi les plus jeunes, dès l'école.
Notre réflexion s'inscrit dans une actualité très chargée, que nous avons tous présente à l'esprit.
Comme nous l'avons acté dans notre programme de travail, le harcèlement sera notre principal sujet d'étude, avec les violences sexuelles, jusqu'au dépôt du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
Docteur, nous avons besoin de votre expertise sur le phénomène général du harcèlement, moral ou sexuel, qu'il ait lieu au travail, à l'école ou dans les transports, plus particulièrement sous l'angle de ses conséquences pour les victimes.
De surcroît, comment expliquer la prise de parole si tardive des victimes ? Qu'est-ce qui empêche l'émergence de la parole ? Pourquoi l'affaire Weinstein a-t-elle déclenché la libération de la parole à laquelle nous assistons aujourd'hui, à tel point que le nombre de plaintes a augmenté de 30 % pendant le seul mois d'octobre, et pas l'« affaire Baupin » ?
Par ailleurs, pouvez-vous nous parler plus en détail de votre travail de psychiatre avec les victimes ?
Comment travailler avec les hommes pour lutter contre les violences ?
Avant toute chose, peut-être pourriez-vous commencer par nous donner quelques éléments de définition du harcèlement, notamment sexuel. À cet égard, je dois dire que je m'interroge sur la pertinence du terme de « harcèlement » de rue, car ces comportements me semblent relever de l'agissement sexiste, voire d'agressions sexuelles, plutôt que du harcèlement...
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions.
Je vous remercie d'être venue jusqu'à nous et je vous laisse sans plus tarder la parole.
Marie-France Hirigoyen, psychiatre . - Je travaille sur les violences faites aux femmes depuis les années 1970 : ce phénomène n'est donc pas nouveau par-delà notre actualité. Quand on parle de violences, tous les spécialistes ne s'entendent pas sur les limites de la notion. Où commencent les violences ? Leur définition varie selon qu'on se situe sur le plan légal, social ou culturel. Des comportements qui étaient naguère permis ne le sont plus. Aujourd'hui, nous sommes dans une société non violente : nous tolérons donc beaucoup moins la violence. De surcroît, le monde est devenu plus égalitaire, mais les hommes et les femmes n'ont pas évolué de la même façon.
Les violences faites aux femmes sont comme un iceberg : il y a eu un temps où l'on ne parlait que des violences physiques, des femmes qui étaient tuées par leur compagnon. Mais si l'on veut prévenir les violences, il faut se situer en amont et être en mesure de repérer les situations préalables à l'émergence de violences physiques, les situations qui peuvent dégénérer. Certaines femmes n'avaient jamais été frappées avant d'être tuées par leur compagnon, elles n'avaient pas pu repérer sa dangerosité.
La partie émergée de l'iceberg est donc constituée par les homicides et les violences physiques : c'est ce qui se voit. Les violences psychologiques ne sont pas toujours identifiées car elles sont limitées à un espace déterminé (le travail, par exemple, ou la famille) et elles répondent à une définition floue. Je peux citer le cas d'une patiente réellement terrorisée par son conjoint : elle a déposé des mains courantes mais au commissariat, ses interlocuteurs pensent qu'elle « fait des histoires ». Il faut comprendre que la victime est perdue et qu'elle donne l'impression, vue de l'extérieur, que c'est elle qui pose problème. À l'écouter, on peut avoir l'impression qu'elle s'est « mal débrouillée ».
Dans la partie immergée de l'iceberg, il y a le sexisme et les inégalités, qui ne sont pas qualifiables de violences à proprement parler et qui ne sont pas pris au sérieux par les auteurs : « je voulais plaisanter », disent-ils. À la base de la violence, il y a la capacité de la désigner comme telle, de la nommer. Or le sexisme crée un climat qui amène à accepter un geste déplacé et à le considérer comme normal. Mais il faut en avoir conscience : le sexisme prépare le terrain à d'autres violences.
Je vais vous montrer un petit film intitulé The monkey business illusion . Vous allez voir deux groupes jouant au ballon, l'un habillé de noir, l'autre de blanc. Le test consiste à compter le nombre de passes entre les jeunes filles habillées de blanc.
[Le film est projeté à l'écran.]
Vous avez vu que la bonne réponse est seize. Qui n'est pas arrivé à ce résultat ? (Certains répondent dix, d'autres quinze.)
Qui a vu le gorille traverser la scène ?
Je constate que cette image a échappé à beaucoup d'entre vous.
Qui a vu que le rideau changeait de couleur ?
Même remarque : vos réponses confirment que lorsque l'on est concentré sur un objectif, il se produit une sorte de cécité à voir autre chose, même des événements importants.
Cette cécité permet de comprendre pourquoi des femmes victimes de harcèlement peuvent mettre beaucoup de temps avant de dénoncer les comportements dont elles ont souffert. En témoigne par exemple le cas de ces militantes de l'UNEF, rapporté par Le Monde il y a quelques jours. Accaparées par leur mission de militante, elles ne voyaient pas les violences sexistes liées à un environnement demeuré très masculin. Je peux faire la même remarque sur la situation dans le milieu médical : quand j'étais étudiante en médecine, beaucoup de choses aujourd'hui inacceptables, qui relevaient du harcèlement sexuel le plus grave, semblaient habituelles. Il fallait « faire avec », les femmes ne remarquaient même pas les remarques sexistes dont elles faisaient l'objet. Les progrès de l'égalité entre femmes et hommes et l'accès de femmes à des positions de pouvoir favorisent aujourd'hui la prise de conscience et l'esprit critique.
Revenons sur l' « affaire Baupin ». À l'époque des faits, les victimes n'avaient pas réagi. Ce n'est que par la suite qu'elles ont osé parler. Il est difficile, quand on est jeune, et que l'on n'est pas sûre de soi, de dénoncer ce genre d'agissements. Le soutien d'autres femmes est décisif pour oser en faire état.
Il y a quelques jours, je suis intervenue dans le cadre de l' Association Française des Femmes Médecins ( AFFM ) sur les violences faites aux femmes. Des hommes médecins ont fait valoir le nombre d'hommes tués par leur conjointe : « vous voyez, les femmes aussi sont capables de violence ! ». Ils méconnaissaient le fait que ces situations d'homicides s'inscrivent généralement dans la légitime défense de femmes agressées par un conjoint violent. Mais beaucoup d'hommes ont du mal à l'entendre.
Dans le même esprit, j'ai récemment reçu un message d'un groupe d'études sur le sexisme dont les membres considèrent que l'engagement du chef de l'État dans la lutte contre les violences conjugales relève d'un positionnement sexiste, et qu'il est inspiré par un lobby « misandre ». Ce rappel me conduit à souligner qu'il faut travailler avec les hommes à la lutte contre les violences conjugales.
L'actualité, avec cette accumulation de témoignages de faits de harcèlement et de violence, peut déstabiliser beaucoup d'hommes. Pour moi, il est essentiel de faire attention à éviter d'encourager un amalgame et de favoriser une sorte de guerre des femmes contre les hommes, et inversement. Ce genre de situation ne marche jamais.
Initialement, dans les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, il n'y avait vraiment que des femmes, des bénévoles d'ailleurs. Les hommes sont trop peu présents dans ce combat et peut-être insuffisamment sollicités. Pour beaucoup, un homme qui défend les femmes court le risque de ne pas être considéré comme un « vrai mec ». Un jour, j'ai assisté à une réunion sur les violences faites aux femmes, à laquelle a participé un boxeur. On ne pouvait vraiment voir en lui qu'un « vrai mec ». Il a expliqué que dans la boxe, on ne fait pas n'importe quoi et il a montré pourquoi un homme ne devait pas accepter la violence. Ce témoignage illustre l'importance cruciale de la participation des hommes à la lutte et à la prévention des violences faites aux femmes.
Une autre remarque sur la situation des hommes : les évolutions de la société rendent les choses moins faciles pour certains d'entre eux. Le modèle de l'homme « chef de famille » n'est plus valide. Certains hommes, que l'on peut considérer comme fragiles, ont du mal à accepter l'autonomie, par exemple financière ou sexuelle, des femmes d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes sont à la recherche d'un couple fusionnel : or les femmes sont nombreuses à souhaiter un espace d'indépendance. Tous les hommes ne le supportent pas.
De même, avec les enfants, les hommes ne peuvent plus avoir la posture d'autorité qui était de mise autrefois. De manière très concrète, par exemple, les nouvelles technologies soulignent leur perte relative de pouvoir : c'est souvent vers les enfants qu'ils se tournent pour obtenir des explications !
Pour ceux qui sont « mûrs », il n'y a pas de problèmes et ils s'adaptent. Les choses sont plus compliquées pour ceux qui vivent un malaise intérieur. Ces derniers réagissent par un excès de contrôle sur leur compagne, souvent motivé par la jalousie. Des expériences réalisées aux États-Unis ont montré que les hommes se sentant rabaissés ont tendance à sur-réagir avec une attitude « viriliste ». Le nouveau modèle de couple égalitaire fonctionne bien avec les jeunes gens ayant atteint un certain niveau d'instruction et d'éducation. Pour d'autres, on constate un durcissement certain de leur attitude, parfois encouragé par des influences religieuses extrémistes - cela concerne tous les cultes - qui favorisent un modèle ancien de contrôle de la femme par l'homme.
Je vais maintenant évoquer plus particulièrement la violence dans le couple, en lien avec l'emprise. C'est le sujet d'un enseignement que je délivre, à l'attention des futurs magistrats, dans le cadre de l'École nationale de la magistrature (ENM). Quand on parle de violence dans le couple, il faut distinguer conflit et violence, deux notions qui inspirent une certaine confusion. Un conflit est symétrique : même s'il s'exprime violemment, par des disputes et des portes qui claquent, les deux parties sont conscientes qu'elles sont en désaccord et sont capables d'échanger. En revanche, dans la situation de violence, il ne se passe parfois rien, ni bruit, ni porte qui claque. Ce sont des situations souvent très difficiles à détecter.
J'ai un exemple : l'une de mes patientes, dont le mari occupe une situation de notable, m'a décrit une ambiance à la maison où domine d'un côté la peur et de l'autre la colère. Un système d'alarme permet au conjoint de surveiller tout ce qui se passe à la maison. Cette femme n'a jamais été frappée, mais elle vit dans la peur. Quand elle a fait part à ses enfants de son désir de partir, ils ont exprimé la crainte d'être tous tués en même temps qu'elle. Nous sommes pourtant dans une situation où, si cette patiente se rend au commissariat, la police ne fera rien. Or elle est en danger. On le sait bien, c'est quand une femme décide de partir que se déclarent les violences les plus graves. Le moment de la rupture est un moment critique.
Il faut insister sur le lien entre harcèlement sexuel et violences dans le couple : tout cela procède en fait du même phénomène. Le harcèlement existe aussi dans le couple. Physiques, sexuelles, psychologiques : toutes les violences sont liées, à l'extérieur ou à l'intérieur du foyer.
En 2000, j'ai participé au rapport Henrion 365 ( * ) , pour attirer l'attention des professionnels de santé sur l'importance des violences dans le couple. À l'époque, on ne parlait pas du viol conjugal, maintenant il est reconnu par la loi. Là encore, il est très difficile de situer la limite. Quand une femme se soumet, qu'il s'agisse du harcèlement dans le couple ou du harcèlement sexuel au travail, est-ce parce qu'elle a peur ? Est-ce pour ne pas « faire d'histoires » ? Elle ne s'oppose pas, certes, mais cela signifie-t-il qu'elle consent ? Elle peut aussi ne pas avoir décodé la violence qui lui est faite. On l'a vu avec cette affaire concernant des agents de nettoyage travaillant pour un sous-traitant de la SNCF à la gare du Nord. Elles n'ont pas protesté car elles pensaient que ce qu'on leur faisait n'était pas sanctionnable. Or il s'agissait véritablement de harcèlement sexuel.
J'en viens maintenant au processus d'emprise : il s'agit d'une manipulation qui s'installe dans la durée, qui va conduire une femme à perdre son esprit critique. Quand on est agressé dans la rue, on sait que c'est de la violence. Mais quand c'est quelqu'un que l'on aime qui vous frappe, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Combien de fois l'ai-je entendu : « mon mari ne me bat pas, mais il m'a déjà donné des claques. » Ou alors : « je suis tombée, mais ce n'est pas de sa faute ». En général, on pense que si la violence n'est pas intentionnelle, ce n'est pas de la violence.
Pour le harcèlement sexuel, la violence se prépare par des micro-violences qui ne sont pas non plus reconnues comme telles. Elle commence par de petites attaques, des réflexions de dénigrement... La victime s'y habitue et elle finit par considérer tout cela comme normal, par estimer que ce n'est pas grave.
Dans la démarche de l'auteur de l'emprise, il y a une étape de séduction pendant laquelle il va solliciter les instincts protecteurs de la femme en se posant en victime afin d'attirer sa bienveillance. C'est une façon d'ôter à la femme toute résistance.
Puis surviennent les propos méprisants et dévalorisants, destinés à casser la confiance en soi de la victime. Parallèlement, celle-ci subit un isolement croissant (elle quitte son travail, ne voit plus ses amis ni sa famille et sa vie sociale disparaît...). Elle se trouve ainsi dans un état de dépendance économique et, coupée de ses relations, n'a plus de recours, plus personne vers qui se tourner. Le contrôle est également très important dans l'emprise. Il est d'ailleurs rendu plus facile par les nouvelles technologies. Il est présenté comme justifié par la jalousie du harceleur. Ces étapes successives de l'emprise conduisent la femme à considérer que ce qu'elle vit est normal. De plus, ses repères sont brouillés par une communication que je qualifie de perverse, qui consiste par exemple à dire une chose puis son contraire, à commencer une phrase sans la finir, en conférant une tonalité inquiétante à des propos anodins, simplement par des notes d'ambiance. La femme a peur, et elle a raison, mais la menace qu'elle subit n'est pas apparente. Si elle en parle, peu de gens peuvent la comprendre. Il faut bien voir que dans toutes les situations violentes, il y a une inversion de la culpabilité, toujours assumée par la victime.
Certaines situations d'emprise ne sont pas loin du fonctionnement sectaire. Je pense notamment à l'isolement de la victime, au contrôle exercé sur elle et à sa culpabilisation permanente. Il faut aussi parler du comportement de pseudo-thérapeutes qui exercent un véritable pouvoir sur des femmes qu'ils amènent à accepter des relations sexuelles.
Je l'ai souvent observé dans mon activité : quand les femmes dénoncent auprès de leurs supérieurs hiérarchiques le harcèlement dont elles sont l'objet ou quand elles vont porter plainte au commissariat pour une violence, ce sont souvent elles qui se sentent coupables : « si je le dénonce, il va être viré ». Dans le cas des violences au sein des couples, les hommes jouent de cette culpabilité quand la femme menace de partir. Il faut savoir que plus la situation de violence a duré, moins les femmes ont de moyens d'en sortir. Il s'agit d'une « impuissance apprise ». C'est encore plus difficile pour la victime de savoir comment réagir quand les agressions sont aléatoires, avec une alternance de phases de séduction et de moments de violence. Les femmes le savent bien au fond d'elles-mêmes : une opposition frontale de leur part est de nature à aggraver la violence, quelle qu'elle soit, même le harcèlement au travail. C'est pour cela que la stratégie déployée par les femmes consiste bien souvent à biaiser, à essayer de trouver les moyens de faire comprendre qu'elles ne sont pas d'accord, sans exprimer frontalement leur refus. Mais ce faisant, elles deviennent en quelque sorte complices. Pourquoi, en effet, réagir aujourd'hui alors qu'hier j'ai laissé faire, se disent-elles ?
On ne le sait pas assez, les situations de violence ont des conséquences dramatiques sur la santé des victimes. Ces femmes développent des troubles psychosomatiques, beaucoup souffrent de dépression. Les conséquences du harcèlement peuvent aller jusqu'au stress post-traumatique. En général, elles perdent confiance en elles, ce qui les prive d'autant plus de moyens de s'en sortir et de se défendre. Perte ou prise de poids, perte de cheveux, troubles dermatologiques graves sont fréquemment la conséquence du harcèlement qu'elles subissent. Souvent d'ailleurs, ces symptômes les aident à sortir du déni. Des patientes me l'ont fait observer : le corps rend visible la violence qu'elles subissent sans toujours s'en rendre compte. Pour moi, ces femmes sont cassées dans leur développement personnel. Le dénigrement et les humiliations qu'elles subissent restent ancrés dans leur mémoire. Ces femmes finissent par penser qu'elles méritent d'être traitées ainsi. Je considère l'ensemble de ces troubles comme une véritable « perte de chances » pour les victimes.
Quant aux conséquences professionnelles du harcèlement pour les victimes, elles sont catastrophiques. Les femmes, en général, perdent leur travail. Leur état de fragilité les empêche souvent d'ailleurs d'en retrouver un. Je connais des cas, en revanche, où le harceleur a été promu : un moyen comme un autre de s'en débarrasser...
J'en viens à la législation sur le harcèlement sexuel. La loi actuelle, adoptée en 2012 366 ( * ) , est parfaitement adaptée aux deux aspects du phénomène, à la fois à ce que l'on peut qualifier d'abus de pouvoir et au harcèlement lié à un environnement humiliant et offensant.
Reste le problème crucial de la prévention par l'éducation, qui à mon avis ne devrait pas être si compliqué à régler. Il s'agit là de la responsabilité des employeurs. Le comportement sexiste peut s'éduquer, même si les choses sont plus compliquées dans la fonction publique que dans le privé, selon moi.
Par exemple, si l'on se réfère à la situation de milieux professionnels qui ont longtemps fonctionné dans un cadre exclusivement masculin, il me semble que l'arrivée des femmes a permis une certaine pacification de l'ambiance qui a soulagé certains hommes, malheureux d'évoluer dans une ambiance sexiste qu'ils ressentaient comme très négative. Il faut le savoir, l'environnement sexiste est souvent mal vécu par les hommes eux-mêmes. C'est à la hiérarchie que revient la responsabilité d'accompagner ces changements. À cet égard, je regrette des pratiques telles que des week-ends professionnels où sont encouragées des ambiances alcoolisées propices à certains débordements. Les femmes qui ne s'y prêtent pas sont stigmatisées ; les hommes qui ne jouent pas le jeu sont mis en cause dans leur virilité même. Or ces réunions sont le plus souvent réservées à des cadres destinés à exercer des responsabilités.
Le harcèlement par abus de pouvoir est, à mon avis, beaucoup plus compliqué à déjouer et à dénoncer. Celui qui a le pouvoir peut en quelque sorte tout se permettre. C'est pour cela que les actrices ont mis si longtemps à prendre la parole.
Par ailleurs, on constate souvent une confusion entre des comportements de séduction (ou prétendus tels), et des propositions sexuelles non désirées.
Dans le second cas, des hommes ne se rendent pas compte que « non, c'est non ». Il faut aussi reconnaître que les femmes devraient savoir opposer un refus clair au lieu d'esquiver pour essayer de trouver un compromis. Or, dans ce domaine, le compromis est par définition difficile ! Il y a une éducation à faire, non seulement des garçons mais aussi des filles, car il est évident que le problème doit être traité dès le plus jeune âge.
Dans certains milieux professionnels, très masculins, des femmes subissent des gestes déplacés non désirés. J'ai entendu un témoignage de ce type, venant d'une policière. Ses collègues masculins trouvaient ça très drôle...
La difficulté pour qualifier le harcèlement sexuel est qu'il résulte d'un mélange de tous ces comportements et agissements et qu'il se met en place progressivement. Les collègues de la victime, d'ailleurs, ont tendance à la considérer comme la favorite du chef. Non seulement ils ne la défendent pas, mais en outre, cela crée un climat malsain pour tout le monde. Il faut travailler avec les hommes pour qu'ils prennent conscience de la différence entre la drague et des propositions sexuelles non désirées, et pour qu'ils arrêtent de faire peser sur les femmes la responsabilité de leur attitude. C'est trop facile d'alléguer des jupes trop courtes !
Une prise de conscience est nécessaire et nous avons des progrès à faire dans le domaine de la sensibilisation au harcèlement. L'une de mes patientes a été traitée de manière différente par la branche américaine de sa société et par la branche française. La branche américaine reconnaissait les faits de harcèlement, au contraire de la branche française. On voit à quel point il nous reste du chemin à parcourir pour reconnaître le harcèlement au travail.
Abordons maintenant la question de la preuve. Toute la difficulté, en matière de harcèlement sexuel, est de réussir à le prouver. Certes, on peut produire des échanges de SMS ou de courriels, le cas échéant avec un constat d'huissier. L' Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) fait un travail considérable pour accompagner les victimes. L'un des obstacles au dépôt de plainte est que beaucoup de femmes répugnent à rendre publique leur humiliation et à se positionner en victime, ce qui est un risque dans le cadre des suites judiciaires du harcèlement. Il arrive que les cellules de lutte contre le harcèlement mises en place dans les lieux de travail portent plainte en lieu et place des victimes ; dans certains cas, le harceleur porte plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse et l'affaire peut se retourner contre celui qui a pris cette initiative. Certaines de mes patientes, que j'oriente vers l'AVFT, décident d'elles-mêmes de ne pas franchir cette étape. Je dois dire que toutes les victimes n'ont pas les ressources nécessaires pour supporter l'épreuve que constitue la procédure judiciaire. Il arrive que le harceleur profère des mensonges extrêmement violents et humiliants dont il est très difficile de se remettre.
En ce qui concerne la loi de 2012 sur le harcèlement sexuel, il s'agit à mon avis d'un texte parfaitement satisfaisant, qui répond bien à la nature complexe du harcèlement. Il reste toutefois à l'appliquer : on se heurte en la matière, comme je l'ai dit à l'instant, au problème de la preuve. Il me semble que les enregistrements de conversations devraient être reconnus comme des preuves, quand bien même ils seraient effectués à l'insu du harceleur. Je pense aussi que la formation des magistrats reste perfectible, notamment pour établir une différence entre harcèlement moral et harcèlement sexuel. La formation au harcèlement devrait être obligatoire pour eux, en formation continue plus particulièrement.
J'ai été sollicitée pour intervenir au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, deux institutions qui ont mis en place un système dont on gagnerait à s'inspirer dans notre pays. Il s'agit des « personnes de confiance » ou ombudsmen . Ces personnes, spécialement formées, sont placées en dehors de toute hiérarchie et ont pour mission d'accompagner et d'orienter les victimes. En France, il semble que cette organisation soit peu répandue, ce qui est dommage. Les victimes, se sentant humiliées, ont honte de s'exprimer et sont réticentes à s'adresser à quelqu'un qui relève de leur environnement professionnel. Les DRH ne sauraient être un recours, à mon avis. Il convient plutôt de désigner un intermédiaire neutre, sans lien ni avec la hiérarchie ni avec les collègues de proximité.
Les obligations de prévention des risques psychosociaux, qui reposent sur les employeurs, comprennent la prévention du harcèlement. La législation à cet égard est contraignante, or elle est insuffisamment appliquée. Si l'on se réfère à l'ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, il y a d'excellentes suggestions pour la prévention du harcèlement. Mais on ne peut s'empêcher de voir dans ce texte un recueil de belles paroles sans conséquences concrètes...
Comment perfectionner la lutte contre les violences dans le couple ? À mon avis, les campagnes d'information visent à l'excès la violence physique. Beaucoup d'hommes et de femmes ne s'y reconnaissent pas. Dans leur esprit, tant qu'il n'y a pas de coup, il n'y a pas de violence. Pour moi, l'éducation à la non-violence doit être plus globale.
S'agissant des difficultés relatives aux plaintes, l'idée d'une pré-plainte en ligne, annoncée par la garde des Sceaux, me semble très prometteuse. Elle est de nature à aider les victimes à franchir le pas, à condition toutefois que cette démarche se traduise par un suivi immédiat des autorités compétentes.
Les stéréotypes sexistes doivent être combattus car ils encouragent des comportements de dénigrement, d'humiliation et de violence. Il faut porter une attention particulière aux images dégradantes de la femme véhiculées par les médias et à la conception du rôle des femmes qui se dégage des émissions de téléréalité. Certaines émissions que je désapprouve vigoureusement sont porteuses de violences potentielles à l'encontre des femmes. Or, les jeunes les regardent assidûment. C'est inquiétant pour l'avenir des relations entre femmes et hommes. Cela me conforte dans la conviction qu'il faut absolument investir dans la prévention pour travailler sur le temps long.
J'ai assisté au Québec à des interventions d'un conseiller en prévention de la violence dans les écoles. Il s'adressait à des élèves de toutes les classes, de la maternelle à la terminale. Grâce à des jeux des rôles mettant les jeunes en situation, il leur expliquait la portée sexuelle de la plupart des insultes dont ils sont familiers. Or les jeunes ne se rendent pas compte de cette dimension, car la plupart du temps, ils ne connaissent pas vraiment le sens de ces expressions. Il faut aussi travailler avec les jeunes pour leur faire prendre conscience de ce que l'autre ressent quand ils l'insultent et l'agressent. Il y a un travail considérable à faire dans ce registre.
J'en viens à l'éducation à la sexualité, à mon avis trop orientée dans notre pays sur les aspects médicaux (prévention du Sida et des maladies sexuellement transmissibles notamment), aux dépens de la notion de respect. Cela nous renvoie à l'échec des ABCD de l'égalité.
Il y a un exemple dont nous pourrions nous inspirer, il s'agit du Nudge 367 ( * ) expérimenté aux États-Unis à l'initiative de Michelle Obama dans le domaine de la lutte contre l'obésité. Peut-être cette méthode serait-elle transposable à l'éducation aux comportements non sexistes ? Il s'agit à mon avis d'une piste à explorer.
Je vous remercie, mesdames et messieurs les sénateurs, de m'avoir écoutée et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Annick Billon, présidente . - Merci pour cette intervention très riche. Avant de passer la parole à mes collègues pour la discussion, je voudrais dire que je suis surprise de n'avoir pas entendu dans votre exposé la référence aux « pervers narcissiques » que l'on associe généralement au harcèlement. J'ai assisté récemment dans mon département à une réunion sur le harcèlement au cours de laquelle il a été question de ces pervers comme auteurs. Pourriez-vous développer la question du lien entre harcèlement sexuel et pervers narcissiques ?
Ensuite, je retiens de vos propos que le harcèlement revêt différents visages et que la difficulté principale, face à ce phénomène, reste la question de la preuve.
À cet égard, la réticence ou la difficulté des victimes à dénoncer les faits ne vient-elle pas aussi de leur crainte que leur procédure n'aboutisse pas, en raison de l'absence de preuve ?
Vous avez souligné le rôle des personnes de confiance pour épauler et soutenir les victimes de harcèlement. Ce sont effectivement des jalons essentiels qui peuvent aider la victime à parler.
Je retiens aussi que vous estimez que le dispositif législatif actuel en matière de harcèlement est suffisant, mais qu'il n'est pas encore correctement appliqué, notamment dans les entreprises.
Maryvonne Blondin . - Vous avez cité le problème lié au manque de preuve du harcèlement. S'agissant des agressions sexuelles sur mineurs, la question de la prescription est actuellement présente dans le débat. J'ai évoqué ce sujet avec une magistrate qui a souligné, comme vous, les grandes difficultés de pouvoir apporter une preuve matérielle au bout de vingt ou trente ans. Or notre système juridique est fondé sur la présomption d'innocence et les droits de la défense. Quand on arrive au « parole contre parole », les magistrats peuvent difficilement condamner. On en a une illustration concrète avec la plainte contre un député de la majorité qui vient d'être classée sans suite, faute de preuve.
En ce qui concerne le harcèlement exercé par la hiérarchie, je voudrais citer un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe auquel j'ai contribué et qui porte sur le harcèlement dans les armées. En France, le ministère de la Défense a mis en place dès 2014 un protocole fondé sur le principe de tolérance zéro pour traiter ce phénomène.
Roland Courteau . - La prévention du harcèlement, qui est en effet fondamentale, passe par la lutte contre les stéréotypes, et ce dès le plus jeune âge. Cela concerne notamment les jouets des enfants (je renvoie à un rapport de la délégation, publié en décembre 2014, sur ce sujet 368 ( * ) ) et cela nécessite une meilleure information des jeunes dans les collèges et les lycées. Nous avions fait en sorte que cette information soit inscrite dans le code de l'éducation, lors du débat sur la loi de 2010 369 ( * ) . Pour information, j'ai rencontré en dix ans environ 14 000 élèves de collège et lycée, à qui j'ai beaucoup parlé de la notion de respect, de la lutte contre les préjugés sexistes et contre les violences, et de l'égalité entre les filles et les garçons.
S'agissant du viol conjugal, il est peu dénoncé car les femmes ont peur. Certains témoignages m'ont d'ailleurs surpris, la victime évoquant son « devoir conjugal », tout en disant que son mari la battait. Voilà qui est stupéfiant de la part des victimes elles-mêmes !
En outre, je m'interroge sur les raisons pouvant expliquer le faible nombre de condamnations au titre des violences psychologiques. S'agit-il d'un problème de définition, de preuve, de témoignage, de formation des magistrats ?
Vous avez dit qu'il faut associer les hommes à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je voudrais rappeler que, lorsque j'ai déposé en 2005 une proposition de loi qui a abouti à la loi de 2006 sur les violences 370 ( * ) , j'ai été l'objet de critiques et de moqueries de la part de plusieurs collègues, et cela peut encore arriver. En outre, certaines femmes m'ont demandé à l'époque de quoi je me mêlais...
Annick Billon, présidente . - Cher collègue, merci pour votre engagement que nous connaissons tous.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - On voit très bien dans votre exposé que les violences faites aux femmes sont un continuum et s'inscrivent dans un système patriarcal au sein duquel les femmes sont assignées à un rôle mineur depuis la nuit des temps...
N'oublions pas non plus les violences économiques. J'estime pour ma part que les inégalités professionnelles et salariales, qui existent encore en 2017, relèvent de la violence.
Selon un rapport du Défenseur des Droits de 2014, 40 % des femmes qui ont porté plainte pour harcèlement ont perdu leur emploi. Vous avez évoqué les femmes de ménages qui étaient harcelées dans une entreprise sous-traitante de la SNCF. Il semble que les choses commencent à bouger dans le monde syndical, mais il arrive encore que des délégués syndicaux subissent des sanctions pour avoir défendu de telles victimes. Comment mieux les protéger ? Ne devrait-on pas envisager de créer un statut protecteur, un peu à l'image de ce qui existe pour les lanceurs d'alerte ?
Enfin, je voudrais attirer votre attention sur un point de langage. Ernestine Ronai nous a appelés il y a quinze jours à ne pas gommer la référence aux « violences faites aux femmes » dans le langage. Or c'est ce qui se passe quand on se réfère aux violences sexistes et sexuelles. Quand on parle de harcèlement sexuel, on invisibilise en quelque sorte le fait que cette violence affecte très majoritairement des femmes. Soyons vigilants sur ce point.
Pour conclure, je voudrais excuser publiquement notre collègue Victoire Jasmin qui aurait vivement souhaité assister à notre réunion, mais qui a dû repartir en urgence en Guadeloupe à la suite d'un violent incendie au CHU de Point-à-Pitre. Elle m'a demandé de vous le dire ce matin.
Marie-France Hirigoyen . - Bien sûr, il existe un continuum des violences qui s'inscrit dans un système. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Des violences sexistes aux violences dans le couple et au travail, le processus est le même. Ce continuum facilite insidieusement l'acceptation des femmes qui n'osent pas réagir, mais aussi celle de la société tout entière qui, finalement, considère que ce n'est pas si grave.
Je souscris également à vos propos sur la question du langage et sur la nécessité de conserver la référence à des violences faites aux femmes.
J'en profite pour signaler que le terme « harcèlement de rue » ne me paraît pas du tout approprié. Il faut trouver une autre expression. Le harcèlement s'inscrit dans la répétition. Il y a des définitions juridiques du harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel. Ce terme me paraît dangereux car il mène à la confusion et à la banalisation.
Les syndicats sont en train d'évoluer positivement sur la question du harcèlement. Je précise que le syndicaliste qui avait défendu les femmes de ménage que j'ai évoquées a lui-même été licencié. Dans certains syndicats, il a existé une ambiance machiste dont ils n'avaient pas conscience. Peut-être est-ce en train de changer. Il y a toutefois encore beaucoup à faire à ce niveau. On constate notamment une différence entre les prises de conscience individuelles et la direction des syndicats, qui devrait donner des consignes beaucoup plus claires pour cadrer certaines dérives auxquelles on peut assister, aussi bien du point de vue du harcèlement sexuel que moral.
La prévention dans les écoles est essentielle et devrait être faite partout, et pas seulement ponctuellement. Néanmoins, il ne faut pas minimiser les difficultés des enseignants, qui sont eux-mêmes gênés par des jeunes qui recourent à un langage sexuel qui les heurtent.
Roland Courteau . - La loi oblige les établissements scolaires à mettre en place ce type d'information. À ce titre, elle autorise les chefs d'établissement à inviter des associations ou des personnes qualifiées. Je regrette que le ministère de l'Éducation nationale n'ait pas fait passer d'instruction en ce sens, par exemple à l'occasion de la journée du 25 novembre, sept ans après le vote de la loi...
Marie-France Hirigoyen . - Quand il y a des interventions d'associations bénévoles dans les établissements, elles portent généralement sur les aspects médicaux (Sida, MST...). Il y a une sorte de terrain glissant quand il s'agit de parler de respect et de consentement, il est difficile de ne pas tomber dans la leçon de morale.
La semaine dernière, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai réalisé plusieurs interventions, dont une à Strasbourg avec Ernestine Ronai. Des classes entières sont venues nous écouter et une mère m'a confié qu'elle regrettait de ne pas être venue avec ses enfants. Il manque en effet quelque chose. Comment mettre en place cette information de façon régulière dans les établissements ?
Ce que vous avez dit sur le devoir conjugal, je l'entends très souvent. Dans certains cas, le mari empêche la femme de sortir et lui dit qu'elle lui « appartient ». Dans d'autres cas plus graves encore, les hommes imposent des pratiques sexuelles à leurs partenaires qui les désapprouvent (échangisme, sadomasochisme). Ces femmes acceptent de se prêter à ces pratiques malgré leur répugnance, en pensant que cela aidera leur couple et que leur conjoint en sera moins violent. Or elles peuvent se faire piéger si elles sont filmées et que le mari menace ensuite de donner la vidéo au juge en cas de séparation. Elles craignent dans ce cas de perdre la garde des enfants.
Je veux redire l'importance d'associer les hommes à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut qu'ils soient les plus nombreux possibles. Par ailleurs, il ne faut pas tomber dans la caricature et la stigmatisation auxquelles nous incitent certains médias - notamment américains - qui font leurs choux gras des scandales sexuels actuels : la grande majorité des hommes sont respectueux des femmes et non-violents.
J'en profite ici pour faire une incise sur la proposition de loi relative à la résidence alternée, en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Ce texte me paraît particulièrement dangereux dans le contexte actuel, comme s'il voulait donner l'opportunité à certains de régler leurs comptes avec des femmes. On ne peut pas fonctionner comme ça, cela ne va rien régler. On a au contraire besoin de travailler ensemble sur ce sujet.
Concernant la prescription, le problème de preuve est réel. Il est vrai qu'on voit des personnes pour qui cela ne remonte qu'aujourd'hui, longtemps après les faits. Mais cela remonte en ce moment aussi, parce qu'on en parle. Il y a une zone grise entre ce qui est humainement acceptable et ce qui est juridiquement démontrable. La justice ne peut agir qu'avec des preuves.
Vous avez parlé de l'armée : il y aurait probablement encore beaucoup à faire. Je pense aussi aux casernes de pompiers et aux policiers...
En ce qui concerne le faible nombre de condamnations au titre des violences psychologiques, il me semble que les magistrats craignent de se faire manipuler, notamment en cas de séparation et de divorce. Toutefois, on ne peut pas simuler la peur. Sur la violence psychologique, la loi précise qu'on peut recueillir tous les éléments de preuve suffisants. En particulier, les praticiens médicaux qui accueillent régulièrement une personne et ont suivi son évolution peuvent rédiger des certificats pour attester de la réalité de ces violences. Le problème est qu'il y a parfois des personnes qui viennent nous voir une fois, se déclarant victimes de violences et demandant un tel certificat. Or il est évident qu'il ne m'est pas possible de rédiger ce type de document pour une personne que je n'aurais vu qu'une ou deux fois. Je précise d'ailleurs que le Conseil national de l'Ordre des médecins nous déconseille de faire le moindre papier dans ces situations.
Je suis très concernée par la violence faite aux enfants en cas de violences conjugales, et cela commence dès la grossesse. On sait qu'un enfant dont la mère enceinte a été victime de violences en sera fortement impacté. Cela donne des enfants de petit poids, voire des enfants qui présentent un stress post-traumatique à la naissance. Plus ils sont jeunes et plus les conséquences seront graves pour leur développement. Enfin, ils risquent eux-mêmes, une fois adultes, de reproduire la violence dans leur couple. C'est pourquoi, lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi faire oeuvre de prévention pour les générations suivantes.
Céline Boulay-Espéronnier . - Je voudrais pour ma part revenir sur une question qui me paraît importante mais quasiment taboue et très peu abordée dans le déferlement médiatique actuel : qu'en est-il des femmes qui sont harcelées et qui finissent par céder à l'auteur des faits, sous son emprise ? Dans ce cas, comment se passent les procédures lorsqu'elles décident finalement de porter plainte ? Cela ne complique-t-il pas leur situation ?
Marc Laménie . - Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. J'ai pris conscience de l'ampleur du sujet. Vous avez évoqué la question cruciale de la formation des magistrats. Cela concerne aussi les gendarmes et les policiers, mais ils manquent parfois de temps pour participer à ces formations. Il faudrait également élargir ces dernières à toutes les forces de l'ordre, aux travailleurs sociaux et aux personnels de l'Éducation nationale, car il y a encore des vides à combler en ce domaine.
Laure Darcos . - Je voulais revenir sur l'AVFT dont vous avez parlé. Il se trouve que, la semaine dernière, dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai eu l'occasion de me rendre à l'université Paris-Sud où la présidente avait invité une troupe de théâtre pour une séance de jeux de rôle sur le thème du harcèlement. Dans ce cadre, nous pouvions passer du rôle du harceleur à celui de la victime ou des témoins, et j'ai réalisé que lorsqu'on se trouve dans la position de la victime, on se sent beaucoup plus démuni que lorsqu'on est spectateur.
L'un des jeux de rôle m'a plus particulièrement marquée. Il s'agissait de se mettre à la place du conjoint d'une personne subissant du harcèlement. J'ai pris conscience que dans la plupart des cas, le conjoint peut avoir une tendance à minimiser le harcèlement moral, à s'inquiéter avant tout de la « vertu » de sa femme en cas de harcèlement sexuel, bref, à culpabiliser la victime. Il y a donc un réel travail de sensibilisation à mener.
Comme Annick Billon, j'aurais souhaité aborder la question des troubles psychiques des auteurs de harcèlement. Par exemple, existe-t-il une corrélation entre les harceleurs et la bipolarité ? Cette pathologie présente-t-elle un terrain favorable au harcèlement ?
Annick Billon, présidente . - À ce stade de notre réunion, je veux insister sur trois éléments décisifs lorsque l'on évoque les questions de harcèlement. Premièrement, la définition du harcèlement et la question des limites qui varient en fonction des époques et des personnes. Deuxièmement, le rôle essentiel de l'éducation des jeunes et de la formation de tous les acteurs en contact avec les victimes. Troisièmement, l'importance de l'écoute, et notamment celle de l'entourage des personnes harcelées et des policiers qui prennent la plainte, pour mettre en confiance les victimes et leur permettre de parler, sans bloquer la parole.
Céline Boulay-Espéronnier . - Au bout du compte, quel peut être l'intérêt d'une femme victime de harcèlement à déposer plainte quand on connaît le parcours semé d'embûches qui l'attend ?
Marie-France Hirigoyen . - J'ai eu l'occasion de faire avec l'Unicef, en 2015, des séances de prévention sur le harcèlement scolaire. Dans ce cadre, nous avions demandé à des jeunes de jouer différents rôles : celui du proviseur, du harceleur et du harcelé notamment. Cet exercice a donné des résultats très probants. Il était malheureusement limité aux seules classes de seconde, et ponctuel. Nous devrions développer ce type d'initiatives et les étendre à toutes les classes.
Sur la réaction des conjoints harcelés, je vous invite à regarder le film Trois huit de Philippe Le Guay, qui met en scène un travailleur victime de harcèlement moral chez Saint-Gobain. Le fils ne supporte pas que son père soit victime et le critique comme quelqu'un de faible. Je souligne à cet égard que les compagnes ont encore plus de mal à comprendre que leur mari ou conjoint soit victime de harcèlement moral, car cela va à l'encontre de leur représentation de la virilité.
S'agissant du harcèlement sexuel, il faut savoir que certaines femmes ne parlent pas car elles craignent la réaction de leur conjoint. Je pense notamment à des victimes de harcèlement sexuel à l'AP-HP qui refusaient de parler, redoutant le déshonneur qui pourrait en rejaillir sur leur famille. Cela explique le silence de beaucoup de femmes.
En ce qui concerne l'accueil des victimes, il faut admettre qu'il y a eu beaucoup de progrès. Dans la plupart des grandes villes, on trouve des référents dédiés pour suivre ce type de plaintes. Ils sont en général bien formés et sensibilisés. Il faudrait accentuer la formation de ces professionnels qui ont une mission complexe et qui peuvent être déroutés par l'ambivalence des victimes.
Il faut le savoir, beaucoup de victimes de harcèlement sexuel que je vois, et qui d'ailleurs ne s'en remettent pas, ont fini par céder. L'exemple classique est celui du déplacement professionnel, au cours duquel le harceleur se retrouve dans la chambre voisine de sa victime et ira frapper à sa porte. La femme ouvrira pour éviter un scandale à l'hôtel. Ou encore une réunion tardive qui aboutit à ce que le harceleur ramène sa victime chez elle en voiture, en l'absence de métro.
Ces femmes ont cédé par lassitude, pour avoir la paix. Ce faisant, elles deviennent complices malgré elles. Mais consentir n'est pas souscrire ! Ces femmes sont épuisées psychologiquement. Malheureusement, elles sont bien souvent, après avoir cédé, rongées par la culpabilité, craignant que leur comportement ne soit ébruité. Injustice suprême, ces victimes perdent souvent leur travail, quand les harceleurs sont rarement sanctionnés.
Céline Boulay-Espéronnier . - Il me semble que cette injustice n'est pas assez mise en avant.
Marie-France Hirigoyen . - Je pense aussi à une jeune femme étrangère qui n'était pas encore régularisée, et qui a préféré céder à son harceleur, craignant de ne pas obtenir ses papiers en cas de refus.
Ce n'est pas parce que ces femmes ont cédé qu'elles ne pourront pas déposer plainte, mais cela complique leur situation.
En ce qui concerne le profil psychique des harceleurs, je dirais que la bipolarité n'est pas une excuse. Par ailleurs, faisons attention à ne pas galvauder la notion de « pervers narcissique » (que j'ai moi-même contribué à faire connaître). Il faut faire une différence entre les hommes immatures et machistes en raison de leur éducation, qui peuvent évoluer si on les sensibilise au problème, et ceux qui sont atteints de troubles de la personnalité. Notre société valorise dangereusement les comportements limite de ces hommes autoritaires et manipulateurs. Ils arrivent souvent à monter dans l'échelle sociale et développent des stratégies de pouvoir en toute impunité. Notre société ne cadre pas assez ce type de comportements. Je dirais que les psychologues rencontrent aujourd'hui beaucoup moins de personnes névrosées que de personnes atteintes de troubles de la personnalité, qui sont dans une recherche effrénée de pouvoir au détriment des autres. C'est une raison de plus pour poser des limites.
Annick Billon, présidente . - Nous vous remercions pour cette audition passionnante. Certes, tout ne peut pas être réglé par la loi, il y a un travail à mener dans un esprit de prévention, sur l'éducation et la formation, et l'on peut à cet égard se réjouir des annonces du ministre de l'Éducation nationale, qui souhaite mettre en place des mesures de sensibilisation à destination des jeunes.
Audition de Brigitte Grésy, secrétaire
générale du Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP),
sur le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail
(7
décembre 2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Dans la continuité de l'audition de Marie-France Hirigoyen la semaine dernière sur le harcèlement, nous entendons ce matin Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP), pour évoquer les agissements sexistes au travail, qui sont encore bien présents, si l'on se réfère aux chiffres existants.
Je remercie Brigitte Grésy d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Je rappelle que nous l'avions auditionnée en 2016, avant l'examen de la « El Khomri 371 ( * ) ».
Le CSEP, sous son égide, a publié en mars 2015 un important rapport intitulé Le sexisme dans le monde du travail, entre déni et réalité , qui dresse un panorama complet du sexisme dans le monde du travail, de sa prise en compte dans le droit et des instruments de régulation et de sensibilisation mis en oeuvre au sein des entreprises.
En 2016, madame la secrétaire générale, vous avez publié un ouvrage intitulé Le sexisme au travail, fin de la loi du silence , dont je recommande vivement la lecture. Comment définiriez-vous le sexisme et comment situez-vous l'agissement sexiste et le harcèlement ?
Qu'en est-il de la prévention de l'agissement sexiste depuis son introduction dans le code du travail par l'article 20 de la loi du 17 août 2015 372 ( * ) , à l'initiative de plusieurs membres de notre délégation ? Cette disposition est-elle mobilisée par les plaignantes et leurs avocats ? Quelle est la portée effective de cette interdiction ?
Pouvez-vous faire état de politiques d'entreprises prenant en compte les violences sexistes et sexuelles ? Quels leviers juridiques proposez-vous dans ce domaine ?
Nous nous interrogeons également sur les conséquences éventuelles de la disparition des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués du personnel prévue par les ordonnances, pour ce qui concerne la prévention du sexisme dans l'entreprise. Ne peut-on craindre, en effet, que le CHSCT, qui peut interpeller les employeurs et demander des enquêtes en matière de sexisme et de harcèlement sexuel, ne soit affaibli dans cette prérogative par la fusion des instances représentatives du personnel ?
À cet égard, la CGT vient de recommander la mise en place de « référent-e-s violences » dans les entreprises pour accompagner les victimes, diligenter des enquêtes et suivre la mise en oeuvre de mesures de prévention. Qu'en pensez-vous ? Ces référent-e-s ont-ils leur place dans le code du travail modifié par les ordonnances ?
Le CSEP a-t-il constaté, dans le cadre de la libération de la parole, une hausse du nombre de plaintes et une plus grande mobilisation des entreprises et des syndicats en matière de prévention du harcèlement et du sexisme ?
Par exemple, le kit élaboré par le CSEP pour agir contre le sexisme dans le cadre de la campagne « Sexisme, pas notre genre » est-il largement diffusé dans les entreprises ?
Qu'en est-il plus particulièrement du MEDEF ? A-t-il, à votre connaissance, favorisé la mise en place d'outils pour aider les employeurs à s'approprier leur devoir de prévention ?
Nous comptons sur vous pour nous apporter des éléments de réponse sur ces nombreuses interrogations, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres points que je n'aurais pas soulevés et qui vous paraîtraient importants.
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions.
Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . - Je suis très heureuse de revenir devant vous, alors que la situation au regard du harcèlement a profondément changé. Je suis les questions d'égalité depuis 1999, à des postes différents - cheffe de service des Droits des femmes, directrice de cabinet de la ministre chargée des Droits des femmes, Inspectrice générale des affaires sociales - mais toujours sous l'angle des politiques publiques. Aujourd'hui, je constate un changement de posture. Un quart des agressions sexuelles se fait au travail et une salariée sur cinq est victime de harcèlement sexuel. Il existe un décalage entre la réalité du phénomène et sa prise en compte dans les structures collectives. Je précise que je n'évoque que la situation sur le marché du travail, qui est le champ d'action du CSEP, et non dans la fonction publique, qui relève du Conseil commun de la fonction publique. J'ajoute aussi que j'interviens aujourd'hui à titre personnel, et que les opinions que je vais exprimer devant vous ne reflètent pas la position officielle du CSEP.
On peut distinguer trois étapes.
Jusqu'en 2010 environ, l'égalité professionnelle était traitée comme un bloc : la situation respective des hommes et des femmes était évaluée à l'aune de différents critères : embauche, formation, qualifications... Les violences et le harcèlement sexuel étaient traités à part. Ainsi, généralement, le 8 mars on parle de l'égalité professionnelle, et le 25 novembre - Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes - on évoque le harcèlement sexuel et les autres violences sexuelles au travail.
Grâce à différents mouvements, français et anglo-saxons, on a assisté à un changement à partir des années 2010, et surtout à partir de 2013. On a pris conscience de la « tragédie des 20 % ». Alors que les femmes représentent plus de la moitié de l'humanité, il y a toujours un « gap » entre elles et les hommes. Les chiffres sont parlants : alors que 83 % des femmes âgées de vingt-cinq à quarante-neuf ans travaillent, l'écart de rémunération avec les hommes en moyenne brute annuelle s'élève à 27 % ; 25 % des experts des médias sont des femmes ; 20 % des salariés à temps partiel sont des hommes ; les hommes ne prennent en charge que 20 % du temps domestique. S'agissant de la mise en oeuvre de la loi Copé-Zimmermann 373 ( * ) , si l'on prend en compte l'entièreté de son champ d'application, on a seulement 30 % de femmes dans les conseils d'administration des entreprises visées par la loi de 2011, alors que l'objectif était d'atteindre 40 %.
L'arsenal juridique de l'égalité est très complet, même si on peut toujours l'améliorer. Le discours politique sur l'égalité est tout à fait à la hauteur. Pourtant, tout se passe comme si les politiques publiques en faveur de l'égalité réelle, pourtant menées avec conviction, ne produisaient pas tous leurs effets. Cela s'explique par les résistances archaïques fondées sur la persistance des stéréotypes de sexe entre les femmes et les hommes, si bien mis en valeur par Françoise Héritier. Ces stéréotypes sont fondés sur la binarité des compétences et des aptitudes - masculin contre féminin, dur contre mou, rigueur contre intuition, actif contre passif -, et sur la stigmatisation et l'infériorisation de tout ce qui relève du féminin. Dans la vie comme dans la grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin !
Les stéréotypes de sexe ne créent pas en eux-mêmes les inégalités, mais ils les légitiment en les rendant invisibles et naturelles. Ils peuvent aboutir à un traitement différencié des hommes et des femmes, c'est-à-dire à un système discriminatoire appelé le sexisme. Le sexisme au travail, c'est à la fois une idéologie qui érige la supériorité d'un sexe sur l'autre, et des actes, comportements, propos et attitudes qui infériorisent les femmes dans le monde du travail, ce qu'on peut appeler le sexisme ordinaire, et peuvent aussi porter atteinte à leur intégrité physique (harcèlement sexuel, agressions sexuelles, viol) et, in fine , créent une souffrance telle qu'elle produit des impacts forts, y compris sur la performance au travail.
Le CSEP a fait une enquête en 2013 auprès de 20 000 cadres, hommes et femmes, et en 2015 auprès de 16 000 non cadres sur la question du sexisme ordinaire : 80 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de sexisme au travail. Pour 90 % de ces personnes, le sexisme avait eu des conséquences négatives sur leur sentiment d'efficacité au travail et sur leur confiance en elles.
Il s'agit donc d'un phénomène massif et insuffisamment appréhendé. Le sexisme au travail couvre un champ qui va du sexisme ordinaire jusqu'au harcèlement sexuel, à l'agression sexuelle, au viol, en passant par la discrimination. Selon moi, il ne faut pas dire qu'il y a un continuum strict des violences : celui qui fait une blague sexiste à la machine à café n'est pas forcément celui qui va agresser sexuellement. Du moins, ce sujet n'est pas documenté. Simplement, le sexisme ordinaire crée un terreau favorable aux dérives en tous genres.
En 2015, nous avons abouti, grâce à votre délégation, à l'introduction de l'agissement sexiste dans le code du travail, grâce à la loi Rebsamen : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Sont visés tous les petits mots ou comportements qui, l'air de rien, de façon sournoise, délégitiment, infantilisent, décrédibilisent les femmes dans le monde du travail.
Aux côtés de l'agissement sexiste, on trouve le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle.
Il faut se demander si la discrimination à raison du sexe est une discrimination comme les autres. Doit-on s'en tenir à un principe d'équivalence des discriminations ? Les femmes sont non pas une minorité visible, mais une majorité invisible. Majoritairement, les femmes et les hommes travaillent et vivent ensemble tout au long du jour et de la nuit : il existe une interdépendance entre eux pour les besoins de la reproduction et du désir, ce qui crée une porosité entre la sphère du travail et la sphère privée. Sont ainsi importées dans la sphère du travail des représentations de la femme imprégnées de l'image privée. La femme a une double image, positive et négative : elle est celle qui protège, la mère, et celle qui pervertit, la putain. Et cette irruption de l'intime dans le monde du travail brouille les relations interpersonnelles et participe de l'invisibilité du phénomène.
À cela s'ajoute l'utilisation du temps, c'est-à-dire la charge, notamment mentale : les femmes assurent encore 80 % du travail domestique et les deux tiers du temps parental.
De ce fait, on ne peut pas utiliser pour les femmes les mêmes leviers d'action que ceux applicables aux autres groupes discriminés. Si les lois ne fonctionnent pas à l'égard des discriminations à l'encontre des femmes, c'est parce que le sexisme au travail repose sur des systèmes de pensée archaïques très ancrés. Il faut donc prendre en charge ce problème culturellement. Quelques illustrations de cet ancrage profond des inégalités : les métiers majoritairement féminins sont sous-valorisés par rapport à ceux qui sont majoritairement masculins. Je le dis souvent, il est aussi difficile de porter une personne âgée dépendante - le quotidien de celles qui travaillent dans les métiers du Care - que de porter un sac de ciment, ce que l'on retrouve dans les métiers industriels, mais ce n'est pas valorisé comme tel dans la classification des métiers. Toutes les compétences discrètes des femmes - gestion des conflits, anticipation... - sont moins valorisées que les compétences requises dans les secteurs comme la chimie ou la sidérurgie, qui se réfèrent à une conception classique de la pénibilité. On nous dit que les big datas, fondés sur les algorithmes savants, vont faire disparaître les discriminations entre les sexes, alors que les données fournies pour construire les algorithmes intègrent les stéréotypes sexistes.
Entre 2013 et 2015, donc, a émergé l'idée que le sexisme faisait déraper les choses. C'était une première évolution.
Puis est arrivée l'affaire Weinstein, et l'explosion de la parole et de l'écoute. Dès lors, les questions de politique d'égalité professionnelle ne peuvent qu'intégrer les atteintes à l'intégrité du corps des femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout à coup, le 8 mars s'invite le 25 novembre, et les questions relatives aux violences s'inscrivent dans la réflexion sur l'égalité professionnelle ! L'égalité professionnelle doit aujourd'hui être traitée par des politiques structurelles sur l'embauche et la formation, mais aussi en agissant sur la culture symbolique du sexisme.
Pour répondre à votre question, madame la présidente, il n'y a eu jusqu'à présent aucun contentieux sur le fondement de l'agissement sexiste, car on ne se l'est pas encore approprié. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de mettre sur la table la question des violences sexistes et sexuelles. Auparavant, je considérais le sexisme non pas comme de la violence, mais comme des actes qui infériorisaient les femmes. Certains partenaires sociaux travaillent depuis longtemps sur cette question, comme la CGT ou la CFDT, FO également. Aujourd'hui, il me semble qu'il est plus facile de traiter tout en bloc : le sexisme ordinaire, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, le viol.
Alors que peut-on faire ? Je vais vous exposer ma position personnelle sur la question et non la position officielle du CSEP, comme je le disais tout à l'heure.
On peut agir sur un certain nombre de leviers. Le premier est celui de la négociation. L'obligation de négocier un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est une disposition d'ordre public. Cette obligation de conclure un accord - à défaut, l'entreprise doit produire un plan unilatéral - doit être respectée par toutes les entreprises de plus de 50 salariés, sous peine d'une sanction qui peut aller jusqu'à 1 % de la masse salariale. Cette obligation porte sur neuf domaines d'action - le neuvième a été ajouté en 2014 et concerne « la santé et la sécurité au travail ». Les entreprises de plus de 300 salariés doivent décliner au moins quatre domaines sur neuf ; celles de moins de 300 salariés, trois domaines sur neuf. Un domaine est obligatoire : l'égalité des rémunérations.
Il est temps d'ajouter à la formule « santé et sécurité au travail » les mots « dont les violences sexistes et sexuelles ». Dans la partie réglementaire du code du travail, il faudrait prévoir un indicateur sur les violences sexistes et sexuelles.
Le deuxième levier est celui de la prévention. On prend désormais en considération les risques psychosociaux. Dans l'Accord national interprofessionnel de 2010 sur le harcèlement et la violence au travail et dans celui du 19 juin 2013, il était indiqué que la question de la violence et des stéréotypes devait être prise en compte.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, les employeurs doivent mettre en oeuvre des actions de prévention fondées sur neuf principes généraux. Parmi ceux-ci figuraient déjà les risques liés au harcèlement moral et sexuel. Ont été intégrés en 2016 ceux liés aux agissements sexistes.
Nous avons donc les moyens législatifs pour agir. Mais 80 % des entreprises (source CGT) ne prévoient pas de plan de prévention. La CGT a proposé une disposition nouvelle prévoyant une sanction.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'évaluation des risques doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe. Cela traduit l'idée que les risques n'atteignent pas de la même façon les hommes et les femmes. Peu de choses sont faites dans ce domaine. Il faudrait mettre en place un groupe de travail pour élaborer un outil prévoyant une méthode d'évaluation des risques pour la santé liés aux violences sexistes et sexuelles, et des mesures de prévention à intégrer dans le document unique d'évaluation des risques et le plan de prévention. Nous avons là dans la loi une pépite que l'on n'exploite pas !
Avec l'intégration du CHSCT dans le Comité social et économique (CSE) a émergé la crainte d'une dilution des sujets. Aujourd'hui, un seul délégué peut saisir le CSE sur un sujet donné ; mais il faudra être vigilant. Cette peur a été exprimée lors de la dernière réunion plénière du CSEP, qui portait sur la prise en compte des violences sexistes et sexuelles au travail.
Une déléguée syndicale nous a indiqué avoir participé à une réunion où le nombre de présents et de sujets évoqués était tel que des cas de harcèlement n'avaient pu être évoqués. Quelle portée donnons-nous à la parole et à ces sujets sensibles ?
Au-delà de la prévention, il faut recourir davantage à des instruments de régulation dans l'entreprise, et notamment le règlement intérieur, qui est sous-utilisé. C'est un acte réglementaire de droit privé, obligatoire dans les entreprises et les établissements de plus de vingt salariés, et établi de manière unilatérale par l'employeur. Il y a des clauses obligatoires en matière d'hygiène, de sécurité et de règles générales de discipline. La loi du 8 août 2016 374 ( * ) a obligé, via l'article L. 1321-2 du code du travail, à citer dans le règlement intérieur les agissements sexistes à côté des harcèlements moral et sexuel. Le CSEP a analysé plusieurs règlements intérieurs ; la plupart du temps, la formulation des dispositions est insensible au genre ; le contenu de la loi de 2012 375 ( * ) - le harcèlement est caractérisé par la répétition ou une pression grave - n'est pas inscrit dans les règlements intérieurs, et la technicité et la généralité de ses dispositions sont telles qu'elles sont incompréhensibles si elles ne sont pas expliquées et commentées.
Il faudrait recommander aux entreprises de libeller une clause générale, afin que l'ensemble du personnel ait des comportements respectueux envers les hommes et les femmes. Une circulaire de la Direction générale du travail pourrait ainsi obliger les règlements intérieurs à comporter l'intégralité des dispositions de la loi de 2012 sur les harcèlements moral et sexuel, ainsi que sur les agissements sexistes, exemples à l'appui.
En Belgique, toute nouvelle personne recrutée doit signer le règlement intérieur. On pourrait ainsi compléter l'article R. 1331-1 du code du travail par un deuxième alinéa prévoyant que le règlement intérieur est remis en mains propres à tout nouvel employé et signé à nouveau en cas d'avenant au règlement intérieur contre une décharge affirmant sur l'honneur qu'il a pris connaissance du règlement intérieur.
Autre instrument, les codes d'éthique, qui nous viennent des États-Unis, et qui sont une base d'autorégulation. Nous en avons examiné plusieurs, américains ou français. Généralement, ils sont insensibles au genre - sauf un code d'éthique français. Il faudrait obliger l'employeur à intégrer dans ce document le sexisme au sens large, et à définir ses différentes manifestations, en rappelant l'interdiction des agissements liés au sexe. Il en est de même dans le label Égalité, qui prévoit des dispositions très complètes dans son cahier des charges, mais mentionne le sexisme sans autre précision. Le sexisme ordinaire, l'humour sexiste devant la machine à café doivent être prohibés, mais pas l'humour...
Troisième pilier, la formation doit être renforcée. Je vous ai apporté des guides qui fleurissent dans des organisations comme FO, la CFDT ou certaines entreprises. Ces outils de sensibilisation sont essentiels. J'ai moi-même fait du sexisme sans le savoir. Ce sexisme exclut les femmes et les auto-exclut. Nous sommes tous tombés dans la marmite des stéréotypes depuis que nous sommes petits, et avons intégré leurs prédictions auto-réalisatrices.
La formation et la sensibilisation sont essentielles. Il faut rendre obligatoire, par la loi, une formation aux violences sexistes et sexuelles. Le CSEP a réalisé un guide et interrogé les entreprises. Les formations à la négociation collective étaient nombreuses, surtout depuis la loi Génisson (encore une sénatrice !) de 2001 376 ( * ) qui rendait obligatoire la négociation sur l'égalité professionnelle. Et ces formations se sont renforcées lors de la loi de 2010 qui prévoit des sanctions. Mais il existe aussi le mythe de « l'égalité déjà là » et les entreprises se sont tournées depuis quelques années davantage vers les formations sur les stéréotypes de sexe mais sans en tirer toutes les conséquences sur les effets du sexisme. Dès lors, il faudrait rendre obligatoire une formation aux violences sexistes et sexuelles, pour tous les salariés, et en particulier pour les membres des Comités sociaux et économiques (CSE, futures instances représentatives du personnel), les partenaires sociaux, les managers et les responsables des ressources humaines. Ces formations doivent permettre de réfléchir, de montrer comment certains comportements peuvent déboucher sur du sexisme, et lutter contre certains travers : la femme qui se sent coupable, dont on booste la confiance, ou bien l'absence d'interrogation sur la responsabilité collective du sexisme... Aujourd'hui, il faut des formations liant les violences sexistes et sexuelles à l'égalité professionnelle, et intégrer une obligation de former. La loi du 27 janvier 2017 377 ( * ) a modifié l'article L. 1131-2 du code du travail pour faire en sorte que dans « toute entreprise employant au moins trois cents salariés et toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans. » Prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, la formation à la sécurité est également obligatoire. Rajoutons donc dans les formations obligatoires une formation sur les violences sexuelles et sexistes à destination de tous les salariés, sinon au moins aux managers, partenaires sociaux, responsables des ressources humaines et responsables de la santé et de la sécurité au travail.
Quatrième point, au-delà de la prévention et de la sensibilisation, il faut s'attaquer au traitement des victimes du sexisme. Les délégués du personnel ont un droit d'alerte, prévu à l'article L. 2313-2 du code du travail. L'employeur peut alors diligenter une enquête avec le délégué. C'est une organisation juridique intéressante. Parallèlement, certaines entreprises ont mis en place un dispositif d'alerte professionnelle comme des cellules d'écoute ou le traitement des plaintes et réclamations. Ainsi, chez Areva, « tout salarié doit pouvoir faire état et porter à la connaissance de l'entreprise des événements discriminatoires - discriminations, agissements ou harcèlements discriminatoires. » Les parties rappellent que de telles situations peuvent remonter par les voies normales et habituelles que sont les lignes hiérarchique, fonctionnelle, les ressources humaines, les représentants du personnel, les déontologues, voire les voies judiciaires. Ces réclamations peuvent également être portées à la connaissance du responsable en charge de la lutte contre les discriminations au sein de la Direction de la diversité et de l'égalité des chances. Cette possibilité est aussi ouverte à des tiers témoins. Le traitement des réclamations et alertes est interne au groupe, centralisé et complémentaire aux voies de recours précitées, soumises à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Ces cellules d'alerte existent seulement dans certaines entreprises. Il faut aussi faire attention à certains points : le choix ou non du principe d'anonymat ou de la confidentialité, pour éviter les dénonciations calomnieuses ; la légitimité des instances ou des personnes saisies de l'alerte ; le périmètre de l'alerte ; la traçabilité des données recueillies. On pourrait imaginer un lieu d'écoute et de libération de la parole, soit interne, soit externe à l'entreprise, comme évoqué dans l'accord national interprofessionnel de 2002.
L'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 378 ( * ) relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée le dispositif du lanceur d'alerte, d'abord pour la lutte contre la corruption économique. Mais le lanceur d'alerte y est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit ». Un décret précise qu'il faut un référent légitime, stable, une pratique de signalement, et prévoit comment pratiquer les signalements.
Un travail reste à mener sur le lanceur d'alerte et le droit d'alerte pour savoir s'il faut construire quelque chose, éventuellement obligatoire - mais en mutualisant pour les petites entreprises - afin de permettre le recueil de la parole, qui doit être bienveillant sans être complaisant. Le conflit est consubstantiel à toute vie collective, et donc à la vie dans l'entreprise, il peut être riche sauf s'il est lié à un motif de discrimination et notamment en raison du sexe : dans ce cas, il détruit la personne. Le sexisme est différent de la compétition entre les individus. On vit huit à douze heures ensemble chaque jour en entreprise... Il faut faire la part des choses : sensibiliser, prévenir et traiter.
Les effectifs de l'Inspection du travail ont diminué de 20 % depuis 2010. D'après la circulaire de novembre 2012 du directeur général du travail, consécutive à la loi sur le harcèlement, elle a comme mission d'informer sur les nouvelles dispositions, donc sur celles concernant les agissements sexistes. Mais la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles ne fait pas l'objet d'une évaluation par l'Inspection du travail. Autre mission, elle contrôle et peut réaliser des enquêtes. Mais le traitement des violences sexistes et sexuelles n'est pas identique dans toutes les régions ; il faudrait se pencher sur ce sujet.
Cinquième pilier, les sanctions et les réparations doivent être renforcées. L'entrepreneur se doit d'être réactif. Il a différents moyens, comme son pouvoir disciplinaire, insuffisamment utilisé. Il doit insister sur le caractère inacceptable de ces violences. Il faut aussi permettre la réparation, soit en nature sur le contrat de travail ou la rémunération, soit en dommages et intérêts ou indemnités.
Le CSEP a rédigé un Kit pour agir contre le sexisme ; trois outils pour le monde du travail , sous le logo « Sexisme, pas notre genre ! » dont Mme Rossignol est responsable...
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - ...et même coupable !
Brigitte Grésy . - Nous avons travaillé sur dix leviers de lutte contre le sexisme ordinaire - ou les violences sexistes et sexuelles, c'est la même chose... Ce guide est un must dans les entreprises : souvent, on nous en demande 40, 50 ou 100 exemplaires. Il est téléchargeable sur le site du CSEP. Plusieurs entreprises s'inspirent de ce kit pour réaliser leurs guides, complétés avec leurs propres exemples. Elles se l'approprient donc totalement, ce qui est une très bonne chose. Les leviers de lutte contre le sexisme valorisés par le kit sont : construire un programme d'action contre le sexisme, porté au plus haut niveau de l'entreprise ; définir clairement les actes prohibés ; mettre en place une politique de prévention du sexisme ; intégrer la lutte contre le sexisme dans le dialogue social ; sensibiliser à la question du sexisme l'ensemble des personnes appartenant à l'entreprise ; prendre en charge les victimes et traiter les situations de sexisme ; instaurer une vigilance sur les stéréotypes de sexe dans les procédures du ressort des ressources humaines ; construire une communication interne et externe dépourvue de caractère sexiste - au contraire de la dernière campagne de communication du Salon de l'étudiant , par exemple, qui cantonnait les femmes aux métiers du Care et à la communication ; assurer une promotion active du programme d'action contre le sexisme ; établir un baromètre de confiance au sein de l'entreprise et procéder à des évaluations régulières...
Annick Billon, présidente . - Merci de votre intervention. Pourquoi, à votre avis, n'y-a-t-il pas de contentieux à ce stade sur le fondement de l'agissement sexiste ? Est-ce parce que ce type de contentieux a peu de chances de prospérer ?
On peut observer, il me semble, des différences de traitement dans l'accueil des femmes victimes de violence selon les entreprises et la taille des entreprises. Souvent, les obligations sont plus importantes dans les grandes entreprises que dans les PME, instaurant de facto une inégalité de traitement des femmes. Les grandes entreprises ont établi des guides, qu'en est-il des PME ?
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Merci de votre intervention. Vous nous aidez à avancer. De nombreuses choses existent déjà, même si les dispositifs peuvent toujours être améliorés. Il faut de la formation, de la prévention et appliquer les sanctions, vous avez raison de le souligner.
Je réagis positivement à vos propositions sur le règlement intérieur des entreprises ; j'avais fait adopter certaines dispositions dans le code du travail lors de la discussion de la loi « El Khomri » 379 ( * ) , notamment à la suite de l'affaire Baby Loup. Le règlement intérieur est un outil qu'il faut absolument mobiliser. Si l'on arrive à responsabiliser l'encadrement supérieur, les directeurs des ressources humaines et l'ensemble des salariés, ce sera une grande avancée. Inspirons-nous de l'exemple belge que vous nous avez commenté pour responsabiliser les salariés. Une fois le règlement intérieur signé, la personne est censée l'avoir lu. Cela doit accompagner la signature du contrat de travail. Renforçons la loi et insistons aussi sur tout ce qui existe déjà.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Merci pour cet exposé complet. La loi est extrêmement riche, mais tout le problème réside dans son application. Creusons cette piste : faut-il augmenter les sanctions, notamment financières ? Actuellement, certaines entreprises peuvent se défausser. Tenons compte des entreprises vertueuses sur l'égalité salariale et professionnelle, qui jouent le jeu et appliquent la loi.
Rappelons-nous que faire évoluer la condition des femmes, c'est faire progresser toute la société. En 2017, je suis horrifiée par l'absence d'égalité salariale : c'est une perte pour le budget de l'État et pour la protection sociale. Le patriarcat est un système puissant.
Vous rappelez votre manque de moyens pour diffuser le guide sur le sexisme. Dès qu'il s'agit de droit des femmes, c'est le bénévolat qui domine. Vous êtes bien placée pour le savoir, madame la secrétaire générale. Les budgets ne sont pas à la hauteur des enjeux ; c'est scandaleux !
Marta de Cidrac . - La discrimination sexiste et sexuelle est-elle un facteur aggravant d'autres discriminations ? J'ai moi-même entendu une jeune femme d'origine indienne se plaindre de discrimination pour raisons sexistes et sexuelles, et on lui a répondu que c'était plutôt du racisme de base... J'ai l'impression que les deux discriminations se cumulaient. Comment faire la part des choses dans le code du travail ?
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Je vous recommande la lecture du livre de Brigitte Grésy, La Vie en rose , excellent ouvrage pour comprendre les stéréotypes de sexe. Après le discours de l'Élysée du 25 novembre du Président de la République, la ministre du Travail a été chargée d'organiser une table ronde et un groupe de travail. Où en est-on ? Le CSEP a-t-il été sollicité ?
Par ailleurs, je m'adresse tant à l'agrégée de grammaire qu'à la spécialiste des stéréotypes. Quel est votre avis sur l'écriture inclusive et la féminisation de la langue ?
Laure Darcos . - Après toutes ces années d'observation du monde du travail, avez-vous détecté une corrélation entre le sexisme au travail et la parité ? Dans le secteur de l'édition dans lequel je travaille, les femmes sont majoritaires, et la question du sexisme se pose moins. Dans le monde politique, il a fallu instaurer des quotas et la parité... Lors des élections locales, le sexisme est moins présent qu'auparavant. Les hommes reconnaissent que les femmes travaillent différemment et nous montrent plus de respect. Mais ce n'est pas encore le cas au Parlement, vous l'avez souligné...
Dans ma société, la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) est une question souvent saisie par les femmes. Lorsque les femmes sont à parité, voire majoritaires, le regard est différent. Qu'en est-il aussi de l'égalité salariale ? Malgré la loi Copé-Zimmermann, il est très difficile pour des femmes d'accéder à des postes d'administrateurs, a fortiori de membres de comités exécutifs et ce même si, comme moi, elles ont suivi une formation spécifique...
Roland Courteau . - Plus nous creusons ce sujet, plus je suis choqué. Stendhal, en 1840, affirmait : « L'admission des femmes à l'égalité parfaite sera la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublera les forces intellectuelles du genre humain ». Les choses ont changé, mais les inégalités salariales n'ont été réduites que de 3 % en vingt ans. À ce rythme, nous atteindrons l'égalité parfaite en 2186... Il est nécessaire de s'attaquer aux stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge !
Annick Billon, présidente . - Merci, cher collègue, pour cet éclairage littéraire et historique.
Brigitte Grésy . - Il n'y a pas de contentieux spécifique sur les agissements sexistes, mais parfois des entreprises concluent de magnifiques accords qui ne les empêchent pas de tolérer des agissements sexistes. Nous avons écrit ce guide pour montrer que les leviers d'action ne sont pas forcément les mêmes. On joue sur la culture, mais les stéréotypes perdurent. Ce sont souvent les grandes entreprises qui se saisissent du sujet. Dans les accords sur l'égalité, il y a eu environ 2 000 mises en demeure depuis 2003 et 100 pénalités. Plus de 80 % d'entre elles concernent des PME. Lorsqu'il n'y a pas de service de ressources humaines ou de structuration suffisante, les responsables font comme ils peuvent, à flux tendu. Dans les PME, il y a aussi une telle proximité avec les individus qu'il peut y avoir des ajustements de l'ordre de l'interrelationnel - sauf présence de déviants notoires. Mais cela repose sur la bonne volonté, à la différence des grandes entreprises qui mettent en place des politiques structurées.
Il existe une énorme différence dans la prise en compte de l'égalité professionnelle selon la taille des entreprises. Seules les entreprises de plus de 50 salariés doivent signer un accord, alors que celles de moins de 50 salariés n'ont à prendre en considération qu'un objectif d'égalité professionnelle. Il faudrait un véritable site Internet sur l'égalité professionnelle porté par le ministère du Travail et celui des Droits des femmes, facile d'accès, et comprenant de nombreux exemples : comment faire un accord, qu'est-ce que le sexisme, comment le traiter...
Nous avons aussi besoin de régulation et d'outils d'encadrement pour faciliter le travail des PME. À l'heure du numérique, il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles sur Internet.
Il faut responsabiliser les entreprises. Faut-il augmenter les sanctions - c'est une piste possible - augmenter le nombre de domaines concernés, renforcer certains d'entre eux ? Certaines dispositions, actuellement uniquement supplétives, pourraient être déclarées d'ordre public.
Il y a un véritable problème d'appropriation des outils relatifs à l'égalité. Faut-il aller jusqu'au name and shame ou privilégier le name and honour ?
Peut-être faut-il aussi prendre en compte la recommandation européenne sur la transparence des rémunérations. Les lois anglaises et finlandaises vont plus loin. Il y a un mouvement vers la transparence des rémunérations. En France, les entreprises sont obligées d'en faire une synthèse portée à la connaissance des salariés et disponible sur le site Internet, mais il n'existe qu'un seul indicateur sur les rémunérations moyennes ou médianes. Il faudra travailler sur la transparence dans ce domaine et, éventuellement, prendre des sanctions.
Nous avons une obligation de progrès. On pourrait établir des classements, comme le baromètre Ethics and board , sur la place des femmes dans le top 100 des entreprises - mais, rappelons-le, ce baromètre ne traite pas des rémunérations. Il manque une réflexion plus globale sur l'impact de l'égalité professionnelle et de l'égalité de rémunération. Il faut avoir conscience du fait que lorsqu'on améliore les conditions de travail des femmes sur les chaînes de montage, en créant des outils de portabilité par exemple, on améliore aussi l'ergonomie pour les hommes moins costauds ou qui prennent de l'âge !
Il faut faire le même raisonnement à propos des temps de vie. Pour moi, il y a un droit individuel de chacun à la parentalité. La performance au travail est liée au réseau d'interdépendances, souvent prises en charge par les femmes. Si l'on prend en compte l'équilibre du temps de vie, on laisse du temps non seulement pour la vie familiale, mais aussi pour le mandat syndical, le sport, la récupération...
Laure Darcos . - Pour les femmes politiques aussi !
Brigitte Grésy . - Lorsque les femmes sont arrivées en nombre dans le secteur médical, certains craignaient une dévaluation de l'exercice de la médecine. Certes, les femmes avec de jeunes enfants ont fait en sorte de ne pas avoir à se réveiller trois fois par nuit pour des urgences, et ont préféré se regrouper dans un cabinet où une personne par nuit gérait les urgences. Et d'ailleurs, avoir trois regards sur un même patient plutôt qu'un n'est pas forcément plus mal. Ce sont les conditions de l'exercice de la médecine qui changent, pas forcément sa qualité qui se déprécie...
À chaque fois qu'on met de l'égalité, on transforme les processus d'organisation et les modèles culturels. C'est valable dans tous les domaines. Cette problématique est insuffisamment traitée. On considère l'égalité comme un business case : mettez de l'égalité, votre chiffre d'affaires va augmenter. Et, en conséquence, les femmes sont recrutées pour leur valeur ajoutée. Elles ont été exclues du contrat social ( cf. Rousseau) sous prétexte qu'elles étaient différentes et incapables de faire. Voilà qu'elles sont incluses précisément au motif qu'elles devraient être différentes, et donc complémentaires des hommes. Le talent des femmes est tellement repéré que des analystes mettent en évidence l'augmentation du PIB qui résulterait d'un taux d'activité des femmes équivalent à celui des hommes et de l'égalité de rémunération. Les inégalités de rémunération sont donc responsables d'un manque à gagner en cotisations sociales et en fiscalité, en talents, en absence d'équilibrage des compétences et en gâchis des capacités extrêmement pénalisant. Mais ne les traitons pas seulement par le prisme de la performance. Il s'agit aussi d'un modèle social à transformer. On ne peut faire la révolution numérique et la transition énergétique si l'on ne pose pas la question du salarié au travail. L'arrivée des femmes aux postes de gouvernance est un fait et les hommes auront moins accès à des postes de gouvernance. Mais est-ce une catastrophe ? Qu'est-ce qu'une belle carrière ? Là aussi, il y a une réflexion à mener. On pourrait avoir des postes de management, puis d'audit, avant de manager de nouveau, et différemment... Une carrière ne serait pas linéaire mais irait dans plusieurs directions. Il faut imaginer des conditions de travail et des carrières différentes.
Vous évoquiez le manque de moyens, sachez que je suis bénévole depuis cinq ans à mon poste...
Quant au cumul des discriminations, à la question de l'intersectionnalité, ils ne sont pas suffisamment étudiés - on parle de discrimination systémique, avec par exemple le cumul sexe, origine et âge. On a progressé sur la discrimination directe, mais la discrimination à raison du sexe est une discrimination indirecte. La discrimination systémique a un effet multiplicateur. Mais notez que le fait d'être une femme d'origine indienne travaillant dans l'informatique par exemple peut être un avantage, voyez à Bangalore...
Une table ronde, multilatérale, sur les violences sexistes et sexuelles se tiendra en janvier, et le CSEP est mobilisé. Tous les partenaires sociaux doivent envoyer leurs remarques à Muriel Pénicaud avant le 15 décembre. Je n'en sais pas plus.
La féminisation des titres de fonction est le B-A BA. Au Moyen Âge, on féminisait de manière assez systématique. Vaugelas et Malherbe sont responsables de l'idéologie ayant imposé le masculin, le mâle étant considéré comme plus noble que la femelle. Au XIX e siècle, on disait encore la médecine et la médicineuse. L'introduction de l'école publique obligatoire à la fin XIX e siècle a abouti à simplifier les règles - et à les appauvrir. Contrairement à ce que prétendent les tenants du masculin, il n'y a pas de neutre dans la langue française.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Et il y a eu l'Académie française...
Brigitte Grésy . - Oui, au XX e siècle, elle a noyauté le sujet. Mais une femme fait bouger les choses de l'intérieur... Je suis partisane de l'écriture inclusive car elle donne de la visibilité aux femmes. Ajouter « .e » ou « .e.s » est certes long, mais au prix d'une contrainte légère, à laquelle on s'habitue car ce « point milieu » devient un réflexe ; on obtient des textes riches de toutes les différences, comme un tableau de Brueghel, qui font apparaître la multiplicité de la population, au lieu de la neutralité qui noyait la diversité. La règle de la proximité - on ne peut faire plus simple ! - a été utilisée par Ronsard. Elle s'imposera, je ne suis pas inquiète. Auparavant, l'absence de féminisation des fonctions représentait une inégalité de traitement entre madame la directrice d'école et madame le directeur d'une grande banque.
La montée en puissance de la parité réduit le sexisme. L'appropriation et la familiarisation avec des visages féminins réduit le sexisme, même si cela n'empêche pas des poches de résistance, des montées de la masculinisation et des poussées de peurs identitaires qui ressurgissent, comme la peur inspirée il y a quelques années par les ABCD de l'égalité. Non, ce n'est pas parce que l'on agit comme le font majoritairement les hommes à certains postes que l'on deviendra un homme... Faisons la différence entre l'identité et l'orientation sexuelle et l'identité sexuée. Les femmes et les hommes ne sont pas faits pareil mais peuvent faire pareil dans le monde du travail, quasiment à tous les postes. Cela ne doit pas créer de peurs identitaires.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie.
Audition de Marie Pezé, docteure en psychologie,
spécialiste de psychopathologie du travail, sur les conséquences
pour les victimes du harcèlement et des agressions sexuelles au
travail
(7 décembre 2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, nous poursuivons notre matinée sur les violences sexuelles et sexistes au travail par l'audition de Marie Pezé, docteure en psychologie, ancienne experte judiciaire, responsable du réseau de consultation « Souffrance au travail ».
Madame Pezé, vous êtes à l'origine de la création de la première consultation « Souffrance au travail » à l'hôpital de Nanterre. Nous aimerions que vous nous parliez des conséquences du harcèlement et du sexisme sur la santé physique et mentale des personnes concernées.
Bien sûr, la souffrance au travail dépasse le sujet du harcèlement ; elle trouve souvent son origine dans certaines formes de management qui induisent beaucoup de pression chez les salariés. À cet égard, quelle est la spécificité du sexisme ordinaire et du harcèlement sexuel par rapport aux autres formes de souffrance au travail ?
Dans son ouvrage Le sexisme au travail, fin de la loi du silence , Brigitte Grésy, que nous venons d'entendre, souligne que les liens entre souffrance psychique et travail ne font pas encore l'objet d'analyses très précises, et qu'ils sont souvent déniés, encore plus lorsqu'ils concernent le sexisme ordinaire. Qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous développer ce point ?
Dans le cadre de votre consultation, quelle proportion représentaient les personnes victimes de sexisme et/ou de harcèlement sexuel ? S'agissait-il majoritairement de femmes ?
Enfin, pourquoi les victimes de violences sexuelles et sexistes au travail parlent-elles tardivement ? Qu'est-ce qui rend l'émergence de la parole si difficile ?
Madame Pezé, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Nous comptons sur vous pour nous apporter des éléments de réponse sur ces questions, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres points que je n'aurais pas soulevés et qui vous paraîtraient importants !
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions. Je vous laisse sans plus tarder la parole.
Marie Pezé, docteur en psychologie, spécialiste de psychopathologie du travail . - Je vous remercie de me recevoir. Je pense qu'il est important de préciser que la consultation que j'ai créée en 1996 a d'emblée été axée sur ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, véritable terreau du sexisme ordinaire dans ce pays. C'est bien cette discrimination de système que je vais vous présenter ce matin. Car au-delà de la partie apparente, qui émerge actuellement sur les réseaux sociaux, cela fait trente ans, en réalité, que l'on étudie les conséquences de cette division sexuelle du travail sur la santé des femmes.
Je vous renvoie à cet égard à l'enquête Sumer réalisée par la DARES et la Direction générale du travail (DGT) tous les six ans. Il s'agit d'une enquête épidémiologique prédictive qui porte sur 23 millions de salariés, illustrée par des chiffres très précis sur les tableaux cliniques des femmes et des hommes, faisant apparaître une spécificité des pathologies féminines dans le monde du travail. C'est une donnée encore méconnue, en raison d'une forme de « construction de l'ignorance » sur toutes ces questions de souffrance au travail.
Je précise qu'il y a aujourd'hui 130 consultations dédiées à la souffrance au travail et que nous essayons de développer dans ce domaine un bon maillage territorial. J'ai également été à l'origine, avec Christophe Dejours, de la création du certificat de psychopathologie du travail, le seul délivrant un enseignement sur cette division sexuelle du travail et formant des cliniciens à même de prendre en charge ces spécificités.
La question de la différence de traitement au travail des hommes et des femmes et des conséquences qui en résultent sur leur santé a été présente dès l'origine de ma consultation. J'ai en effet travaillé pendant trente ans dans un service de chirurgie de la main, pionnier dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les femmes, au sein duquel j'ai pu constater la prévalence de ces troubles et du syndrome du canal carpien chez les femmes. Les chirurgiens de l'époque l'expliquaient par des causes hormonales, se référant à la grossesse ou à la ménopause. On peut le dire, le sexisme ordinaire imprégnait les théories scientifiques de l'époque, qui n'étaient donc pas très crédibles... Il a fallu attendre longtemps pour que le lien entre l'apparition préférentielle et tendancielle de ces TMS chez les femmes et les postes déqualifiés qu'elles occupaient dans la hiérarchie des métiers, soit établi.
C'était une importante avancée. Il me paraissait en effet très difficile d'expliquer à l'ouvrière qui vissait 27 bouchons par minute que les pathologies dont elle souffrait étaient imputables à son OEdipe, alors que c'est à ce poste que l'assignait l'organisation du travail. De même, comment aurais-je pu dire aux jeunes femmes cadres travaillant dans le quartier de la Défense que le masochisme féminin était responsable de leur moindre rémunération, à hauteur de 30 % ? De la même manière, il me paraissait incongru de demander aux jeunes femmes harcelées pourquoi elles n'étaient pas parties plus tôt - c'est ce que leur disaient les psychiatres -, alors que démissionner fait perdre ses droits sociaux, ce qu'une femme en situation de monoparentalité - cas hélas très répandu dans notre pays - ne peut absolument pas se permettre...
Je voudrais vous faire comprendre ce qui me paraît être le terreau de tout le reste. On peut lutter contre le sexisme ordinaire, contre le harcèlement sexuel au travail, mais quand le premier message qu'on envoie à une jeune femme qui se présente sur le marché du travail, c'est qu'il va falloir qu'elle accepte d'être payée entre 20 et 30 % de moins qu'un homme, quand on lui indique lors de son entretien d'embauche qu'elle est jeune et aura des enfants, et que de ce fait elle n'évoluera pas dans sa carrière, on lui fait intérioriser sa prétendue infériorité. Les femmes intègrent ainsi dans leur inconscient ce que Danièle Kergoat appelle la « position féminine fautive » (c'est-à-dire que tout ce qui peut arriver est la faute des femmes) et la nécessité d'adopter des comportements de soumission pour pouvoir « se faufiler et passer entre les gouttes ».
Nous ne voulons pas de cette règle sociale implicite pour nos filles, nos soeurs et nos enfants : il est donc temps de leur envoyer un message de véritable égalité.
Pour bien comprendre les implications de la division sexuelle du travail, il est important de se référer aux travaux de Danièle Kergoat et Héléna Hirata, toutes deux directrices de recherche au CNRS, spécialistes de ce sujet depuis de nombreuses années. Des recherches existent dans ce domaine, mais elles n'ont pas encore « infusé » dans l'ensemble de la société.
La division sexuelle du travail s'inscrit dans une conception de la société fondée sur deux caractéristiques : d'une part, l'assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et celle des femmes à la sphère reproductive ; d'autre part, la captation par les hommes des fonctions à très forte valeur politique, religieuse et militaire. Il en résulte deux principes organisateurs du marché du travail : on distingue des travaux d'hommes et des travaux de femmes, les premiers valant plus que les seconds. Et encore aujourd'hui, c'est une réalité quotidienne !
Les hommes ont construit une hiérarchie des métiers reflétant le paradigme de l'assignation des hommes au dehors, à l'espace public, et des femmes au-dedans, à l'espace privé, ainsi que le fonctionnement physique, psychologique, social, des hommes et leurs ambitions. Or ils n'ont pu mettre au point une telle organisation que parce que les femmes les libéraient de la prise en charge des enfants et de la sphère domestique.
Dans notre pays, on constate la permanence d'une organisation « au masculin neutre ». Aux hommes, l'attribution des métiers de conception et de direction, aux femmes celle des métiers de subordination, d'exécution et de prise en charge des autres (ce que l'on appelle le Care ).
Je vous rappelle, mesdames, que nous sommes naturellement assignées à la prise en charge des enfants, des vieillards, de l'aspirateur, de la cuisine ! Autant de savoir-faire prétendument naturels qui induisent sur le marché du travail des embauches avec de faibles qualifications, peu de formation et encore moins de reconnaissance.
Les femmes se trouvent ainsi confrontées à ce que j'appellerais une double peine : une embauche discriminatoire accompagnée de la mise en invisibilité, dans une organisation du travail « au masculin neutre », de la seconde journée qu'elles doivent encore assumer de manière tendancielle même si, fort heureusement, les jeunes hommes s'occupent désormais un peu plus des enfants. Mais, vous le savez, toutes les études mettent en avant la persistance de la prise en charge des tâches domestiques par les femmes, ce qui s'accompagne d'une lourde charge mentale. C'est une réalité.
Nous sommes le seul pays, en Europe et parmi les États anglo-saxons, à maintenir cette organisation du travail au masculin neutre. Certains de mes proches sont partis à l'étranger. Par exemple aux Pays-Bas, où tout le monde prend son mercredi et quitte le travail à 17h30. Ou encore au Canada, où, alors qu'ils travaillaient comme cadres supérieurs jusqu'à 21h00 en France, ils se sont retrouvés seuls dans leur open-space , le premier jour, à 17h30, car tous leurs collègues étaient partis chercher leurs enfants à l'école. À Tübingen, enfin, ville universitaire allemande où il est exclu de travailler le week-end. À ma connaissance, ces trois pays ne sont pas en voie de développement et leur économie se porte bien !
Comment expliquer que dans notre pays, les entreprises persistent à organiser les réunions tard le soir, à donner les rapports à taper aux secrétaires en fin de journée, si ce n'est parce que perdure une organisation du travail pour des hommes débarrassés de la prise en charge de la vie familiale par les femmes ? L'idéologie managériale à la française repose sur le « présentéisme », alors qu'ailleurs il est considéré comme de l'incompétence. Dans notre pays, si vous n'êtes pas encore au bureau à vingt heures, on considère que vous n'êtes pas « corporate », ni engagé dans la vie de l'entreprise. En conséquence, la femme qui quitte le bureau à dix-huit heures subit des remarques du type « tu prends ton après-midi ? ». Ce travers me préoccupe d'autant plus que je suis convaincue que si nous parvenions à faire bouger cette idéologie managériale, nous pourrions résoudre la question des épuisements professionnels qui détruisent actuellement les intelligences françaises, mais aussi les foyers. Je rappelle que le taux de divorce dans les cas de burn-out est de 80 %.
Il est donc extrêmement important de s'attaquer aux fondements de cette idéologie, car cela permettrait de faire progresser la santé au travail, qu'il s'agisse de celle des hommes ou de celle des femmes.
Pour en revenir à la division sexuelle du travail, l'enquête Sumer est très précise sur le fait que les comportements humiliants et hostiles tels que le harcèlement sexuel ou le sexisme ordinaire affectent majoritairement les femmes, et déclenchent chez elles des syndromes anxio-dépressifs et des pathologies spécifiques. Chez les hommes, le mal-être au travail provient plutôt de l'absence de reconnaissance ou de l'inadéquation de certains postes par rapport à leurs ambitions sociales.
Je vais maintenant vous parler plus en détail des dégâts de la division sexuelle du travail sur le corps des femmes.
En premier lieu, les femmes qui évoluent dans une organisation du travail « au masculin neutre » et qui y occupent un poste important ont tendance à « neutraliser » leur corps féminin. Ainsi, comme Michèle Alliot-Marie l'a fait à l'époque où elle était ministre et où on ne l'a plus jamais vue en robe, la plupart des femmes cadres adoptent « l'uniforme » de mise - noir ou bleu marine -, plutôt des tailleurs pantalons, des coupes de cheveux sportives, des bijoux de bon aloi et un maquillage discret - car il faut tout de même se maquiller. Il s'agit pour ces femmes d'être coquettes sans être sexy, de montrer qu'elles sont des femmes, mais sans risquer d'attirer les éventuelles réflexions des hommes.
Ceci n'est pas sans conséquence, surtout quand on sait que les femmes entrent généralement dans le monde du travail avec une grosse différence de salaire et se heurtent à une progression ralentie de leur carrière, à travers des grossesses qu'on leur reproche : combien de femmes ne retrouvent pas leur poste au retour de congé maternité ? Combien sont placées dans une voie de garage pour finalement bénéficier d'une retraite au montant dérisoire ?
La neutralisation du corps féminin et le sentiment d'être en faute parce qu'on est une femme - la position féminine fautive dont je parlais à l'instant - induisent des pathologies spécifiques. Dans nos 130 consultations « souffrance et travail », nous accueillons des milliers de patients et de patientes chaque année. Cela représente une belle cohorte clinique, mais, faute de moyens - car c'est moi finalement qui finance le réseau par les formations que je peux dispenser - on ne peut pas analyser ce magnifique matériau clinique issu de nos consultations, qui pourrait certainement vous servir dans vos travaux.
30 % de femmes en situation de discrimination au travail, avec toute la panoplie des comportements dont Brigitte Grésy vous a parlé, présentent des pathologies de la sphère gynécologique. C'est un chiffre colossal. L'identité et la construction identitaire partent du corps réel. La construction du deuxième corps, celui que j'appelle le corps érotique, imaginaire, sexué ou genré, s'appuie sur ce corps physique, mais c'est aussi là qu'il vient s'éteindre quand cette identité sexuelle est mise à mal. Ainsi, les femmes victimes de la division sexuelle du travail présentent très rapidement des métrorragies (règles abondantes) ou des aménorrhées (disparition des règles) - dont elles ne s'étonnent d'ailleurs même plus -, mais aussi des kystes des ovaires et du sein, des cancers de l'ovaire, du sein et de l'utérus. La sphère corporelle étant soumise au stress aigu dans le cadre de la souffrance au travail, cela provoque une hyper-sécrétion de cortisol qui va entraîner l'atteinte des différentes fonctions sollicitées au travail.
À cet égard, j'ai du mal à comprendre pourquoi notre pays continue à rattacher la santé au travail au ministère du Travail, plutôt qu'au ministère de la Santé, ce qui fait que la santé au travail n'est pas incluse dans les études de médecine. Cela ne facilite pas l'identification des atteintes à la santé au travail. A l'inverse, dans d'autres pays où il n'y a pas plus de médecine du travail qu'en France - je pense au Japon et aux États-Unis par exemple - les cardiologues ont fait des études remarquables montrant des liens entre des risques cardio-vasculaires et les conditions de travail des femmes. Je pense notamment à une enquête américaine sur les femmes cadres qui montre que ces femmes présentent des taux d'infarctus de 45 %, corrélés avec la double journée, des postes à très haute responsabilité et très peu de congés ou d'arrêts maladie. Nous savons que les trois principaux critères des infarctus féminins sont des durées de travail supérieures à 60 heures par semaine, des changements de tâches constants et un vécu d'impasse, c'est-à-dire la sensation que rien ne change malgré l'expression de ce qui ne va pas dans l'organisation de leur travail.
Peut-être certaines d'entre vous se reconnaissent-elles dans ces situations, car c'est comme ça que le travail des femmes se passe sur le terrain. Nous savons aussi que le taux d'infarctus féminin explose en France mais on entend encore que cela est dû au fait que les femmes boivent et fument comme des hommes ! Jamais, en France, vous n'entendez un cardiologue parler du présentéisme exigé au travail, de la double journée qui est demandée aux femmes et de la charge mentale, pour expliquer ces statistiques affolantes.
Laissez-moi vous dire à quel point cette charge mentale est préoccupante du côté des hommes comme des femmes. Le clivage est un mécanisme de défense inscrit dans le psychisme. On ne le contrôle pas. Une femme au travail ne peut donc pas s'empêcher de penser à tout ce qu'elle doit faire à la maison : préparer le dîner du soir, récupérer les chemises au pressing, faire le repassage, penser à appeler le pédiatre parce que le petit dernier démarre une rhino, et comme il n'est pas question de le garder à la maison, il va donc falloir prescrire, voire « sur-prescrire », des antibiotiques...
La surconsommation française de médicaments n'y est pas étrangère. Ma fille vit à Amsterdam et l'on n'y prescrit jamais d'antibiotiques quand les petits sont malades : les employeurs renvoient chacun des deux parents à leur domicile pour qu'ils puissent s'occuper de leur enfant malade. Et cela va de soi. Une autre culture de santé est possible ; les rapports sociaux de sexe et la construction de la division sexuelle du travail représentent donc un enjeu crucial de santé publique, qui dépasse le problème du sexisme ordinaire et du harcèlement sexuel au travail. Il s'agit de préserver notre société du chaos social dans tous les aspects de la vie des travailleurs (vie privée et vie sociale).
Pour conclure, je souhaiterais vous présenter trois cas concrets, ce que j'appelle des « vignettes », pour vous aider à prendre la mesure de ce qui se passe sur le terrain.
Le premier cas est celui d'une jeune femme, secrétaire depuis six ans dans une entreprise de cordistes. Ce type d'entreprise emploie principalement des hommes ancrés dans leur virilité, mais cette jeune femme a néanmoins su y faire sa place. Les ressources humaines lui ont attribué des toilettes séparées. Un jour, le patron de l'entreprise la convoque pour lui annoncer qu'il vient d'embaucher un nouveau cordiste et qu'il anticipe des relations compliquées avec cette personne. Effectivement, la première chose que le nouveau recruté va faire sera de souiller les toilettes de la jeune femme pour « marquer son territoire ». À longueur de journée, il va l'humilier, faire des gestes déplacés. Cette jeune femme va alors se plaindre à son patron et au service des ressources humaines, lequel, tout en lui disant qu'elle a mauvais caractère, va prendre la décision de poser un verrou sur ses toilettes. Or cette décision est une erreur : il aurait fallu convoquer le salarié et le recadrer, dans la logique de l'obligation légale de sécurité des salariés à la charge de l'employeur. Ce cadenas témoignait d'une faiblesse disciplinaire vis-à-vis du salarié. La situation n'a donc fait qu'empirer jusqu'à ce que la victime fasse une crise de nerfs sur son lieu de travail. Elle n'a pas été soutenue par sa hiérarchie. Elle a été arrêtée pour maladie. Elle présentait les symptômes d'un stress post-traumatique. Trois jours après le début de son arrêt maladie, son employeur l'a appelée pour lui proposer une rupture conventionnelle, synonyme de perte d'emploi. Le médecin du travail, mal formé, a seulement reproché à l'employeur l'absence d'effectif féminin au sein de l'entreprise, ce qui n'était pas le problème en l'espèce. C'est dire l'importance de la formation !
Le deuxième cas est celui d'une jeune femme qui travaille dans une boutique de manucure et d'esthétique. Elle subit un attouchement sexuel de la part de son patron. Celui-ci lui demande par ailleurs de faire de fausses attestations afin de licencier deux employées qui ne lui plaisent pas. La jeune femme refuse. Les choses s'enveniment. Elle va voir le médecin du travail qui l'arrête dans le cadre d'un accident du travail. La Sécurité sociale refuse et diligente un enquêteur qui se rend sur place pour entendre le patron. Ce dernier lui raconte que son employée se prostitue dans l'hôtel voisin du salon entre douze heures et quatorze heures. L'enquêteur de la Sécurité sociale, mandaté pour s'assurer que l'incident déclaré par la salariée a bien eu lieu sur le lieu de travail, va alors se rendre à l'hôtel pour vérifier si cette jeune femme loue une chambre entre midi et deux.
Comme en témoigne cette réaction hallucinante de l'enquêteur, qui excède ses prérogatives, il est consternant de réaliser que le sexisme ordinaire imprègne les comportements et les raisonnements intellectuels de tout un chacun. Nous avons pris en charge cette jeune femme et déposé un recours devant la Sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance de son arrêt en accident du travail. Notre réseau compte des inspecteurs du travail, des juristes et des avocats. La jeune femme a déposé plainte pour harcèlement sexuel contre son patron et sera défendue par l'une des avocates avec laquelle nous travaillons.
Le troisième cas que je vais vous décrire me paraît encore plus grave. Il concerne une jeune femme, commerciale dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom, embauchée par un responsable qui apprécie ses compétences et souhaite qu'elle « fasse carrière ». Six mois après son embauche, au cours d'une soirée de fin d'année, le responsable qui l'a recrutée, dans l'impunité d'une atmosphère alcoolisée, l'humilie en public par un geste sans ambiguïté et une proposition d'ordre sexuel. La jeune fille en sort bouleversée et honteuse, contrairement à son agresseur dont la conscience morale est émoussée par l'alcool. Certains de ses collègues la plaignent et proposent de témoigner, quand d'autres disent : « que veux-tu, c'est comme ça ». On voit l'enjeu de la prévention et de la sensibilisation, car ces personnes n'ont pas réalisé qu'il s'agissait d'une agression sexuelle.
Après cet incident, la jeune femme passe toute l'année suivante à essayer d'éviter cet homme qui lui fait régulièrement des propositions ou lui impose des gestes déplacés. Au cours de la soirée festive de l'année suivante, le même homme récidive et lui fait de nouveau subir en public des attouchements sexuels. La jeune femme est tétanisée et c'est un autre responsable qui les sépare de force. La victime se retrouve en état de stress post-traumatique et tombe dans ce que l'on appelle la dissociation. Anesthésiée, elle parvient juste à dire qu'elle veut rentrer chez elle. Son responsable la ramène donc à l'hôtel, il monte dans l'ascenseur et au moment d'appuyer sur le bouton de son étage, il lui rappelle que dans cette entreprise, « quand on veut y arriver, il faut coucher ». Elle finit par le suivre et passe la nuit avec lui. Il faut bien avoir à l'esprit que l'état de dissociation pose la question du consentement. À partir de là, il devient impossible à la jeune femme d'avoir des rapports sexuels avec son mari. Elle grossit de quarante kilos. Elle est de plus en plus mal et leur couple s'en ressent. Son mari finit par l'inviter à parler ce qui lui est arrivé au travail en lui expliquant qu'il en va de la survie de leur couple - il faut souligner un réel changement d'attitude, positif, chez les jeunes compagnons d'aujourd'hui. En effet, cette parole de bienveillance et d'écoute de la part de son mari lève la dissociation, et la jeune femme parvient à lui raconter ce qui s'est passé. Son mari va l'accompagner au commissariat pour porter plainte. C'est à ce moment-là que je l'ai reçue pour faire l'expertise nécessaire et montrer l'impact d'une dissociation, qui peut durer des années avant de permettre au refoulement de remonter à la surface. La jeune femme a perdu son travail. Vous pensez bien qu'entre le bon commercial agressif et la petite jeune récemment embauchée, le choix a été vite fait. Je tiens à souligner que certaines entreprises autorisent de tels comportements, qui permettent à leurs employés d'être agressifs et de conquérir des marchés. Vous avez même des réunions de travail le lundi matin dans certaines entreprises dédiées aux prouesses érotiques du week-end des employés... Cela « booste » leur combativité dans les affaires, dit-on...
Enfin, le dernier cas est celui d'une jeune femme cadre de très haut niveau qui subit depuis plusieurs mois, sur les écrans de veille de ses collègues de l' open-space , la présence d'images pornographiques, chose banale dans certaines entreprises. La jeune femme se plaint à sa hiérarchie qui refuse d'intervenir en considérant que « ce n'est pas méchant ». Un jour, excédée, elle décide elle aussi d'afficher sur son écran d'ordinateur une image pornographique. Que croyez-vous qu'il arriva : elle fut convoquée immédiatement et mise à pied pendant huit jours par sa hiérarchie...
Voilà le genre de situations que nous affrontons au quotidien. La balle est désormais dans votre camp, car c'est vous qui avez la possibilité de faire changer les choses.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie de cet exposé qu'illustrent des situations de violences vécues dans le monde du travail.
Je considère que les violences sexistes et sexuelles s'exercent non seulement à l'encontre des collaborateurs d'une entreprise mais aussi dès leur recrutement, notamment lors des entretiens collectifs pendant lesquels les candidates féminines sont dévalorisées. J'ai été surprise quand j'en ai fait l'expérience pendant mon propre parcours.
La formation et la prévention sont essentielles dans le traitement de ces violences, tout autant que la nécessité que les femmes qui en sont victimes bénéficient d'un accompagnement bienveillant et d'une écoute attentive, en particulier de la part de personnels formés pour recueillir leurs témoignages.
Marta de Cidrac . - J'avoue que la gravité des situations que vous exposez me laisse pantoise ! Comment votre association est-elle amenée à connaître les cas de ces femmes et à les prendre en charge ? Quels sont les moyens dont vous disposez, non seulement pour exercer votre expertise, mais aussi pour assurer l'intervention de conseils ?
Marie Pezé . - Une forte implication est indispensable pour déconstruire la peur qui habite ces femmes terrorisées.
Bien que les voies d'entrée du réseau « Souffrance et travail » soient multiples, on constate que ces femmes nous sont majoritairement adressées dans le cadre d'examens complémentaires par des médecins généralistes, des psychiatres ou encore des médecins du travail, soumis au secret médical et qui doivent impérativement noter dans le dossier médical du travail les faits dénoncés dont la chronologie est fondamentale pour l'expert judiciaire.
Notre site « Souffrance et travail » propose les adresses des consultations en accès direct ; je regrette que ni le ministère de la Santé ni celui du Travail ne mentionnent sur leur propre site la liste de ces dernières et des lieux dédiés à l'écoute de ces femmes, alors même que notre réseau dispose pourtant de toutes les compétences cliniques et juridiques.
La prise en charge de ces femmes par notre réseau est coordonnée entre différents intervenants :
- le médecin du travail pour déterminer les leviers à exercer au sein de l'entreprise ;
- un psychiatre de notre réseau spécialiste dans le traitement de leurs pathologies ;
- le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), pour requalifier en accident du travail leur état de stress aigu ou post-traumatique, afin d'en imputer la cause à l'entreprise et de permettre aux patientes de bénéficier d'une meilleure prise en charge par l'assurance maladie ;
- nos avocats spécialisés qui assurent le suivi de la procédure judiciaire.
Toutefois, outre cette coordination médico-administrative, notre réseau mène un travail essentiel pour sortir ces femmes de la solitude, car elles souffrent bien d'une « pathologie de la solitude » et éprouvent une grande honte à exprimer ces faits, qui les affectent dans leur intimité.
Ces femmes doivent comprendre qu'elles ne sont désormais plus seules et seront accompagnées et assistées lors des auditions et expertises ; le cas échéant, une demande de protection peut être formulée auprès des forces de l'ordre.
Christine Prunaud . - Dans d'autres pays que la France, pourtant aussi développés économiquement, la valeur que l'on attribue au travail et le partage des charges familiales au sein des couples diffère de celles qui prévalent dans l'hexagone.
Tout travail n'est pas émancipateur, surtout pour les femmes !
Je suis admirative du travail que vous menez avec des moyens dont nous avons bien compris l'insuffisance.
Françoise Cartron . - Je salue votre bienveillance à l'égard de toutes ces femmes que vous accompagnez.
Les sénateurs sont aussi des employeurs d'assistants parlementaires, dont la gestion administrative est confiée à une association que j'ai présidée pendant les trois dernières années. Face à certaines situations, il a été décidé de mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement, afin de permettre aux assistants, dans le respect de l'anonymat, de confier leurs souffrances à un médecin du travail qui déterminera les suites à y donner.
Marie Pezé . - Les médecins du travail ne sont pas formés à la prise en charge de ces pathologies et sont souvent mal à l'aise lorsque des patients en font état !
Le réseau « Souffrance au travail » possède un site Internet classé d'intérêt général, visité mensuellement par 80 000 personnes, et dont le financement est assuré par le produit des formations que j'anime ; il propose un accès à 130 consultations, dont 50 en région parisienne, ainsi que des guides pratiques dont celui des violences sexistes et sexuelles au travail , élaboré par Marylin Baldeck, délégué générale de l' Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) , qui intervient dans le certificat de spécialisation en psychopathologie du travail. Je vous invite donc à diriger ces salarié-es vers l'une de nos consultations spécialisées dans le traitement de ces violences.
Françoise Cartron . - C'est bien la démarche que nous préconisons lorsque le médecin du travail nous alerte, mais il est essentiel que les collaborateurs puissent bénéficier en premier recours du concours d'un intervenant de proximité, en l'occurrence le médecin du travail, pour libérer la parole. Un guide sera bientôt diffusé au sein de l'institution pour faire connaître l'ensemble de ces démarches.
Les enseignants devraient aussi être sensibilisés pour ne pas appeler systématiquement la mère d'un enfant au moindre souci bénin de santé, en la culpabilisant par des propos alarmistes. Ils devraient être formés pour juger si l'état de l'enfant nécessite vraiment des soins immédiats, pour éviter de soumettre la mère à l'injonction de venir chercher immédiatement son enfant.
Marie Pezé . - Les vieux réflexes perdurent, d'autant que le manque d'infirmières et de médecins scolaires se fait cruellement sentir !
Roland Courteau . - Peut-on considérer que les atteintes dont vous parlez sont psychologiques et neurologiques ? Quelles sont les conditions pour espérer guérir d'un traumatisme ?
Enfin, dispose-t-on de statistiques fiables sur les victimes qui osent déposer une plainte ?
Marie Pezé . - Les atteintes sont incontestablement tant psychologiques que neurologiques, notamment dans les cas de burn out qui affectent principalement les postes d'encadrement supérieur et dirigeant, le diagnostic de surmenage étant alors établi par nos neuropsychologues à l'issue de batteries de tests systématiquement proposés.
Les bilans neuropsychologiques des femmes en état d'épuisement professionnel attestent de capacités intellectuelles définitivement altérées, le fonctionnement cérébral de femmes brillantes issues des plus grandes écoles étant définitivement amoindri, certaines n'arrivant même plus à renseigner des formulaires de Sécurité sociale, non pas en raison d'une dépression, mais parce que leurs capacités de concentration et de logique sont définitivement entamées : elles ne pourront vraisemblablement jamais retrouver du travail.
L'une d'elle n'a que quarante-cinq ans et son coeur bat encore à 140 battements par minute après six mois d'arrêt maladie car elle se sent toujours oppressée par un état de stress aigu qui nécessite de lui prescrire des béta bloquants.
C'est une part du génie français qui ainsi s'abîme irrémédiablement !
Dans ce genre de situation, il convient de consulter au plus vite, mais aussi de pouvoir bénéficier du soutien de son compagnon dans l'épreuve ; je constate d'ailleurs que les jeunes hommes sont aujourd'hui plus attentifs et solidaires de leur femme que ne l'étaient encore il y a quelques années ces hommes qui opposaient généralement la suspicion aux propos relatés par leur compagne. Récemment, le compagnon d'une jeune femme en contrat aidé, harcelée par des photographies et des messages graveleux adressés par son employeur, a parfaitement réagi en conservant ces preuves et en lui conseillant d'enregistrer les propos qui lui étaient tenus par son harceleur. Il faudrait que les enregistrements soient acceptés comme preuve aux prudhommes comme c'est le cas au pénal. Dans cette affaire, la DRH de l'entreprise alertée par la directrice de la mission locale a immédiatement fait un signalement à l'inspection du travail, signe que les mentalités évoluent. Rappeler les règles légales et indiquer les démarches à effectuer, notamment pour recueillir des preuves, permettra aux femmes et aux hommes qui les soutiennent d'agir à bon escient.
Marylin Baldeck, déléguée générale de l' AVFT , que vous recevrez bientôt, pourra vous préciser les données statistiques sur les dépôts de plaintes par des victimes de violences sexuelles au travail.
Beaucoup de victimes négocient leur départ avec le concours d'un juriste, estimant qu'une indemnisation vaut réparation, seules déposent plainte celles qui disposent d'éléments probants suffisamment solides.
Noëlle Rauscent, co-rapporteure . - Les comportements que vous rapportez existent aussi en milieu rural où ils peuvent parfois être encore plus graves, mais les femmes qui y sont confrontées, notamment au sein des TPE, ne savent à qui se confier, sinon à leur médecin généraliste.
Marie Pezé . - Les comportements excessifs existent dans tous les milieux professionnels, comme l'illustre le cas de cette vendeuse qui doit se soumettre à un viol quotidien de la part de son chef pour conserver son poste ; 6 % des viols sont commis dans le cadre professionnel.
Le choix des futurs auditeurs du certificat de spécialisation en psychopathologie, effectué par notre association, vise un maillage territorial de cette compétence. Il faut éviter que des territoires soient démunis. Le concours des associations dans les territoires, notamment avec la Mutualité sociale agricole (MSA), est nécessaire pour progresser, tout autant que l'implication des hommes, tant les poncifs qui accablent les femmes les desservent quand elles veulent se faire entendre.
La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), qui effectue déjà un extraordinaire travail d'information sur l'épuisement professionnel et son suivi, en imposant désormais une visite de pré-reprise par le médecin du travail, pourrait étendre ces dispositifs à la prise en charge des agressions sexuelles dans le milieu professionnel, pour autant que les médecins conseils soient formés.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie, madame, pour la richesse de votre exposé.
Chers collègues, je vous remercie de votre participation active à nos travaux.
Échange de vues avec Carmelina de Pablo,
présidente,
Françoise Bey et Nora Husson,
vice-présidentes de l'association
Élues contre les violences
faites aux femmes (ECVF)
(12 décembre 2017)
Participantes : Annick Billon, présidente,
et
Françoise Laborde, vice-présidente
Annick Billon, présidente . - Merci d'être venues jusqu'à nous pour nous parler de l'action d' Élues contre les violences faites aux femmes . Je vous remercie de me faire connaître les axes d'intervention de votre association contre les violences faites aux femmes.
Comme vous l'imaginez, notre délégation a décidé de centrer ses réflexions, depuis la reprise de ses travaux en novembre dernier, sur le thème des violences faites aux femmes, dans la perspective du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
Nous souhaitons ne pas limiter notre travail aux aspects législatifs de la lutte contre les violences et contre le sexisme. Nous aimerions aussi pouvoir relayer, à travers les recommandations qui concluront notre rapport sur les violences, des bonnes pratiques susceptibles de servir d'exemples dans d'autres territoires et d'autres collectivités, par exemple en matière d'accueil et d'écoute des victimes, de prévention des violences et du sexisme, de formation et de sensibilisation des acteurs.
Enfin, je suis persuadée que les collectivités qui ont mis en place de bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre les violences sont tout simplement des collectivités sensibles à l'égalité entre femmes et hommes, qui méritent d'être connues et mises en valeur par notre délégation.
Carmelina de Pablo . - L'association, créée en 2003 par Geneviève Fraisse et Francine Bavay, est composée d'élus ou d'anciens élus, de tout parti politique démocratique et de tout niveau territorial. À l'époque, on ne parlait pas volontiers de la lutte contre les violences faites aux femmes. En dépit de la visibilité que l'on donne aujourd'hui à cette problématique, il reste encore beaucoup à faire.
Nous organisons un colloque chaque année. Le thème du dernier événement portait précisément sur « les bonnes pratiques » ; nous voulions démontrer aux élus-es que l'on peut faire des choses et que cela fonctionne.
La lutte contre les violences faites aux femmes doit être transversale et doit être conduite partout. Le dernier contre-exemple que l'on pourrait citer, en matière de sexisme, est celui d'une publicité destinée à soutenir la création d'une ligne TGV à Béziers, montrant une femme ligotée sur des rails, attendant le train qui va la percuter !
Nous pensons qu'il est inadmissible que l'on puisse encore actuellement subir ce genre d'images ; il faut que les politiques prennent conscience des violences faites aux femmes et de ce qu'implique ce genre de représentation.
Nora Husson . - Le « fil rouge » de notre association est la sensibilisation des personnes. Les élus-es sont confrontés-es chaque jour à des femmes victimes de violence-s qui viennent chercher de l'aide. L'enjeu consiste à ce que les élus-es soient bien informés-ées des dispositifs qui existent localement afin d'orienter ces femmes au mieux. Il faut aussi faire prendre conscience aux élu-e-s que, à chaque échelon territorial, on peut agir. Le colloque que nous avons organisé en 2016 a été intéressant dans ce sens, car il a montré qu'avec peu de moyens, on peut tout de même faire avancer les choses.
Carmelina de Pablo . - Notre objectif est également de faire baisser la tolérance de la société envers les violeurs. La presse présente généralement ces hommes comme étant de bons pères de famille, avec un métier respectable. Il n'empêche qu'un viol est un crime !
Annick Billon, présidente . - Quelles relations entretenez-vous avec les associations d'élus-es ? Avec l'Association des Maires de France ? Je vois que vous avez un volet très important sur la formation. Toutes les associations de maires proposent des formations sur les finances, l'urbanisme, les espaces verts, les cantines. En tant qu'adjointe à l'urbanisme, aucune formation sur les violences faites aux femmes ne m'a jamais été proposée. Pourquoi ne vous connaît-on pas mieux ?
Carmelina de Pablo . - Les sollicitations de rencontres que nous faisons auprès des associations d'élu-e-s restent sans réponse. Les hommes élus considèrent que les violences faites aux femmes ne constituent pas un sujet. Un exemple : le conseil régional d'Ile-de-France a souhaité, il y a un an, proposer une formation obligatoire pour les élus. Seuls cinq élus de la région Ile-de-France y ont participé. Je ne doute pas une seconde que le travail d'information auprès des élus a été fait ; on ne peut que constater une réticence de leur part à considérer qu'ils doivent se former afin de changer leur appréhension de ce sujet. Le thème de cette formation portait notamment sur les violences faites aux femmes et sur le sexisme en politique.
Annick Billon, présidente . - Il y a une obligation de parité dans toutes les instances, même si les regroupements de communes l'ont rendue moins visible. Je suis persuadée qu'il y aurait une possibilité de mieux faire connaître le sujet des violences. Ces formations sont, à mon sens, perçues à tort comme « militantes » alors qu'elles visent essentiellement à éduquer pour lutter contre un fléau épouvantable, ce qui est bien différent.
Nora Husson . - De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de violences ? De défense des droits des femmes, évidemment. Nous travaillons avec deux expertes, Ernestine Ronai et Muriel Salmona, qui ont rédigé des travaux reconnus. Nos formations sont conçues et encadrées par des personnes qui savent de quoi elles parlent, elles permettent aux élus de comprendre l'impact sur les victimes, sur leur famille, leurs enfants, leur travail, des violences qu'elles subissent. Nous essayons surtout d'aider les élus à appréhender les actions qu'ils peuvent mener sur leurs territoires.
Carmelina de Pablo . - Les élus locaux sont tous confrontés à des situations de violences envers les femmes.
Annick Billon, présidente . - Qu'en est-il des petites communes ? Les femmes ne sont-elles pas réticentes à faire état de ces violences, au risque de voir leur situation familiale connue de tous ? N'est-ce pas plus facile dans les grandes villes ou les grandes agglomérations, où il y a plus d'anonymat ?
Françoise Bey . - C'est le cas dans l'agglomération strasbourgeoise. Les accueils des femmes victimes de violences sont concentrés en centre-ville, notamment parce qu'il est nécessaire d'avoir des structures, et les financements pour les accompagner. Nous essayons de faire participer financièrement le département, mais les subventions restent minimes.
Cette question de la proximité entre habitants des petites communes est un frein à la libération de la parole des femmes et les empêche de sortir de leur situation. Les violences existent partout, dans les milieux ruraux comme dans les villes.
Annick Billon, présidente . - D'où l'importance de former les élus-es dans les territoires moins denses. Une personne qui vient demander un logement social par exemple, alors qu'elle en habite déjà un, lance peut-être un appel au secours...
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Dans les communes ou collectivités de communes, les femmes élues qui assistent à ces formations peuvent éventuellement participer à la transmission de leur contenu : qu'en pensez-vous ? L'association Élues locales , qui travaille énormément sur le sujet de la formation des élue-e-s, est-elle intéressée par les formations que vous proposez ? J'ai contribué à l'implantation d' Élues locales 31 dans mon département de la Haute-Garonne. L'association fonctionne très bien et commence à acquérir une visibilité certaine.
Carmelina de Pablo . - Nous ne sommes malheureusement pas assez nombreuses, et de plus, nous sommes implantées dans des territoires trop éloignés les uns des autres, ce qui nous empêche de solliciter efficacement les diverses associations nationales. Mais nous avons prévu de nous y atteler dès le début de l'année prochaine. Nous avons des petits moyens, pas beaucoup de subventions, mais nous sommes obstinées !
Annick Billon, présidente . - Il serait intéressant d'associer les parlementaires des départements afin d'attirer l'attention des associations de référence.
Carmelina de Pablo . - Nous travaillons également, par le biais d'échanges d'informations, avec les déléguées départementales aux droits des femmes et à l'égalité, auxquelles les préfectures n'accordent pas, il faut le dire, beaucoup de moyens.
Annick Billon, présidente . - Que pensez-vous du discours prononcé par le Président de la République, le 25 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et du lancement de la grande cause du quinquennat ?
Françoise Bey . - Ce sont pour moi de belles annonces, mais la question des moyens que le Gouvernement va consacrer à cette grande cause reste posée. La révision de la loi pénale sur le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs est à mon sens une bonne chose, de récents faits d'actualité ont démontré qu'il fallait intervenir dans ce domaine. En ce qui concerne l'âge du consentement sexuel, je pense qu'il faut entendre l'avis des pédopsychiatres.
Nous nous battons depuis longtemps pour que, dès la maternelle, les enfants soient éduqués et sensibilisés aux stéréotypes. À Strasbourg, chaque année, ont lieu « les semaines de l'égalité et de lutte contre les discriminations » qui comprennent un volet sur l'égalité filles-garçons à l'école, et qui sont destinées aux élèves de maternelle jusqu'aux collégiens.
Nora Husson . - Un élan plus fort devrait être donné à la lutte contre les préjugés sexistes, à l'éducation au respect de l'égalité filles-garçons, de l'égalité femmes-hommes, au respect des droits des femmes, dès le plus jeune âge. Les ABCD de l'égalité nous semblaient aller dans le bon sens ; ils ont été, à notre avis, mal interprétés. C'est dommage.
Il faut trouver des moyens humains, financiers pour que la formation des enseignants, des personnels de l'éducation, des personnels socio-éducatifs, soit développée.
Il nous semble également, au regard des récentes affaires judiciaires - de Pontoise et de Meaux - que les magistrats devraient être mieux sensibilisés et formés à cette problématique des violences faites aux femmes.
Les annonces faites par le Président de la République n'ont rien de spectaculaire ; nous attendons de connaître les moyens qui permettront de les financer. Les lignes budgétaires existent. Le Président s'est engagé à ce que les crédits votés soient versés. Nous allons être vigilantes sur les moyens donnés aux déléguées départementales qui, du fait de leur changement de statut - autrefois rattachées aux préfectures de régions, elles sont désormais rattachées aux Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) - ne bénéficient plus aujourd'hui de la même visibilité.
Annick Billon, présidente . - En ce qui concerne la question de la formation des magistrats, il semble qu'il y ait une disparité selon les territoires. Au tribunal de grande instance de Bobigny, huit magistrats sont formés et spécialisés dans les affaires de violences sexuelles envers les mineurs.
Carmelina de Pablo . - La formation des magistrats ne suffit pas. Celle des personnels de gendarmerie ou de police nous semble également essentielle, car les femmes victimes de violences n'y sont pas toujours très bien accueillies.
Cécile Werey . - Il n'y a pas d'harmonisation en France sur l'accueil des victimes car il n'y a aucune obligation en matière de formation, du moins en ce qui concerne la formation continue.
Carmelina de Pablo . - S'agissant des délais de prescription, il faut tenir compte du temps qu'il faut à certaines femmes pour porter plainte. Le délai de prescription ne devrait pas s'appliquer dans ce type de situation. Mais c'est un avis personnel, pas celui de l' ECVF .
La majorité sexuelle est aujourd'hui fixée à l'âge de quinze ans pour les filles comme pour les garçons. Pour quelle raison devrait-on fixer un seuil de non-consentement différent de cet âge ?
Je souhaiterais également souligner l'hypersexualisation des femmes imposée par notre société depuis quelques années. Nous avons l'injonction d'être à la fois de bonnes épouses, de bonnes mères, et de ressembler aux femmes dont les photographies, souvent très suggestives, font la une des magazines. Cette publicité, qui « chosifie » les femmes, est en contradiction avec tout l'arsenal développé par les politiques publiques destinées à lutter contre ces phénomènes. C'est souvent cette image là des femmes - l'image suggestive - qui l'emporte !
Françoise Bey . - À Strasbourg, depuis 2010, sous l'impulsion de la conseillère déléguée aux droits des femmes, le maire, Roland Ries a créé une « Mission des droits des femmes ». La ville a signé la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Un plan d'action interne, destiné à promouvoir l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, a été mis en place. Grâce à l'administration conjointe de la ville de Strasbourg et de la communauté de communes, nous avons pu développer cette thématique dans les petites communes. Nous organisons chaque année un colloque avec les associations qui oeuvrent dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. De 500 personnes à ses débuts, le colloque accueille aujourd'hui plus de 3 000 personnes et suscite désormais l'intérêt des médias.
Annick Billon, présidente . - Comment travaillent entre eux les élus en charge de ces questions au sein de leurs collectivités respectives ?
Françoise Bey . - Nous avons encouragé une méthode de travail transversale intéressant toutes les directions, au sein de la mairie. Le regard par le biais du genre permet de s'intéresser à tout le monde. Nous avons, par exemple, mis en place des marches exploratoires au sein de certains quartiers afin de recueillir la parole des habitants - femmes et hommes - concernés par le réaménagement de ces quartiers.
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Les élus masculins ont du mal à comprendre la nécessité de la mise en place de marches exploratoires.
Françoise Bey . - En dépit des campagnes d'information que nous menons, notamment contre le sexisme, certains élus prétendent ne pas savoir comment accueillir la parole des personnels victimes d'actes ou de paroles inappropriés, ni comment les orienter. Nous avons aujourd'hui dans la collectivité une personne dédiée à l'accueil, à l'écoute et à l'orientation de ces personnels. Nous avons remarqué une libération de la parole des femmes au sein de la collectivité.
Carmelina de Pablo . - Les maires des villes de plus de 20 000 habitants ont également l'obligation de fournir un rapport de situation comparée (RSC). Ils peuvent refuser de voter le budget en l'absence de ce rapport, qui précise les situations respectives des hommes et des femmes agents des collectivités territoriales (accès aux postes à responsabilités, mixité des filières et des métiers, écarts de rémunération, etc.).
Françoise Bey . - À Strasbourg, le RSC est présenté en comité technique paritaire auquel assistent les syndicats, ce qui nous permet d'envisager ensemble les points à améliorer.
Carmelina de Pablo . - Le rapport de situation comparé est certes contraignant, mais il oblige à établir un état de la situation et peut permettre une évolution positive de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail.
Les élus peuvent adhérer individuellement à notre association, les communes, les conseils régionaux le peuvent également. L'adhésion d'une collectivité nous permet d'avoir une plus grande visibilité, car lors du débat qui a lieu, au sein de la collectivité, sur l'adhésion à l'association, les élus, hommes et femmes, prennent conscience de la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes au travail.
Audition du Docteur Ghada Hatem,
gynécologue-obstétricienne, fondatrice de La Maison des femmes de
Saint-Denis, sur La Maison des femmes de Saint-Denis et les soins aux femmes
victimes de violences
(14 décembre 2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Chers collègues, nous accueillons ce matin le Docteur Ghada Hatem, gynécologue.
Le Docteur Hatem a pris l'initiative de créer La Maison des femmes de Saint-Denis, qui assure une prise en charge globale des femmes victimes de violences, qu'il s'agisse des violences conjugales, des viols, y compris incestueux, et des mutilations sexuelles, pour lesquelles est proposée une prise en charge globale, médicale et psychologique, mais aussi sociale.
La Maison des femmes de Saint-Denis a récemment fêté son premier anniversaire : nous vous remercions, Docteur, de nous présenter le bilan de ce lieu de soins et d'accueil unique, dont la création n'allait pas de soi et pour lequel vous avez déployé une énergie hors du commun.
Docteur, vous incarnez à vous seule les deux préoccupations majeures de notre délégation. Nous avons en effet souhaité cette année travailler sur les violences faites aux femmes pour préparer l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement. Nos questionnements concernent plus particulièrement le drame des victimes de violences sexuelles, notamment des victimes les plus jeunes, et les obstacles qui jalonnent leur parcours judiciaire. Nous nous intéressons, bien sûr, à l'accompagnement médical et psychologique de ces victimes, jeunes et moins jeunes.
Nous préparons aussi un travail sur les mutilations sexuelles en vue de la semaine du 6 février : vous avez bien voulu accepter de participer à la table ronde que nous organiserons le jeudi 8 et nous vous en remercions chaleureusement.
Notre deuxième sujet de travail, à plus long terme quant à lui, concerne l'avenir de la gynécologie : c'est dire, Docteur, si nous avons vocation à vous revoir souvent, ce dont je me réjouis.
Ghada Hatem, médecin chef de La Maison des femmes de Saint-Denis . - Je vous remercie de me recevoir et de me donner ainsi l'occasion de vous exposer une initiative qui me tient à coeur. La Maison des femmes est un lieu atypique et innovant que nous avons conceptualisé progressivement, au gré des constats qui ressortaient de mes consultations, au cours desquelles j'ai notamment appris que la violence peut se nicher dans tous les secteurs de la vie sociale. J'exerce à Saint-Denis depuis sept ans. Vous le savez, c'est l'un des départements les plus pauvres de France. J'ai été frappée par le fait que la pauvreté et l'immigration aggravent les inégalités en matière de violence, rendant les choses encore plus difficiles pour les femmes concernées.
À l'hôpital Delafontaine, la population que nous recevons est très diverse : on y compte plus d'une centaine de nationalités et de dialectes parlés. En tant que responsable de la maternité pendant cinq ans, j'ai observé que les femmes qui y sont accueillies sont fréquemment victimes de violences, liées notamment, pour celles qui sont d'origine subsaharienne, à leur parcours migratoire. De plus, pas moins de 14 % des femmes qui accouchent dans notre maternité ont été victimes de mutilations sexuelles. D'où mon idée d'ouvrir un lieu hospitalier et de vie à la fois, pour accueillir indifféremment toutes les femmes vulnérables. Nous nous adressons à celles qui sont en demande d'IVG, car cet acte, contrairement à ce que l'on entend parfois dire, n'est jamais simple à décider pour les femmes, qui se posent beaucoup de questions. Nous nous adressons aussi à celles qui sont victimes de violences conjugales, intrafamiliales ou sexuelles, ce qui inclut le viol conjugal. Cette notion reste mal appréhendée par les médecins. On a encore tendance à considérer que les femmes ont un « devoir conjugal ». Heureusement, la loi a changé pour réprimer les relations sexuelles non consenties entre époux.
Nous avons également mis en place une consultation spécifique pour les victimes d'inceste. Il s'agit pour nous d'un énorme problème de santé publique. Enfin, l'une de nos unités s'intéresse spécifiquement à la prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles.
J'ai souhaité accueillir toutes ces femmes dans un lieu situé dans l'enceinte de l'hôpital, sans être toutefois l'hôpital. La Maison des femmes est dotée d'un accès direct par la rue, les femmes qui ont besoin de nous n'ont pas à passer par l'accueil de l'hôpital. Je peux témoigner que cela change tout. Les femmes qui viennent nous voir comprennent très vite que cela va changer leur parcours, en leur évitant un passage administratif souvent long et laborieux. Cela rassure ces femmes particulièrement vulnérables, qu'elles soient sans papier ou privées de toute estime d'elles-mêmes après toutes les humiliations qu'elles ont subies.
Ainsi, le simple fait de pousser le portillon et d'entrer directement dans La Maison des femmes simplifie grandement leur venue. Du reste, cette idée de simplification a guidé la conception globale de la prise en charge que nous leur offrons. En effet, toutes les études, y compris la dernière commanditée par Marisol Touraine en 2014, s'accordent sur le fait que le parcours de prise en charge des victimes de violences doit être simple et coordonné, pour leur éviter d'avoir à ressasser à de multiples intervenants un récit douloureux, dont la répétition a pour conséquence de réactiver leur traumatisme, ou bien d'avoir à organiser elles-mêmes cette prise en charge, ce dont elles sont incapables.
Très conscients de cet impératif, nous avons souhaité offrir aux femmes toute la palette des outils dont elles pourraient avoir besoin, en commençant par le soin. Il s'agit là d'une porte d'entrée essentielle, car elle permet à la femme de parler le plus simplement possible de ce qu'elle vit. Cela inclut le recueil des preuves physiques, notamment si les violences sont récentes, même dans le cas où les victimes ne souhaitent pas porter plainte. Nous leur expliquons que ces preuves sont pour elles une sécurité, car le certificat ou les photos que nous réalisons pourront attester l'ancienneté des faits, par exemple en cas de répétition de l'agression, au cas où elles se sentiraient prêtes à déposer plainte dans le futur. Cela permettra alors de conforter leur parole.
Une fois que nous avons accueilli ces femmes et recueilli leur parole, en leur ayant montré - chose essentielle - que nous les croyons et que nous allons tout mettre en oeuvre pour les accompagner, nous évaluons ensuite les urgences et les besoins : si le mari d'une victime est derrière la porte avec un fusil, ce n'est évidemment pas nous qui pouvons régler le problème, et il faut appeler d'urgence les services de police. Cependant, les femmes viennent rarement nous voir dans ce contexte d'urgence immédiate.
Si nous percevons la détresse d'une victime et un syndrome de stress post-traumatique, nous la confions immédiatement à une équipe de psychologues pour la prendre en charge, ce qui est fondamental.
S'il y a besoin de procédures, nous sollicitons les juristes, les avocats et les policiers qui travaillent bénévolement à nos côtés. Par exemple, un ancien policier, délégué police-population, a choisi d'exercer cette fonction au sein de La Maison des femmes et vient une fois par semaine à ce titre. Nous avons également recours à une policière de la brigade criminelle qui vient également quelques heures par semaine. Sa présence contribue à rétablir le lien de confiance, parfois abîmé, entre les victimes et la police. Dans ce cadre, les femmes - notamment les plus vulnérables d'entre elles - entendent qu'elles ont des droits même si elles sont en situation irrégulière, ce qu'elles ne savent pas. La continuité des actions mises en oeuvre garantit l'efficacité de la prise en charge « holistique », c'est-à-dire globale, que nous pouvons offrir et qui nous a permis de tirer d'affaire plusieurs jeunes filles.
Après dix-huit mois d'exercice, nous sommes débordés par notre succès : fréquentation des femmes, intérêt des médias, acteurs du secteur médico-social ou étudiants qui souhaitent s'impliquer. De nombreux bénévoles nous ont rejoints, dont beaucoup de jeunes femmes d'un excellent niveau de diplôme, qui sont heureuses de trouver un cadre concret où s'investir sur le terrain. C'est cela qui les attire chez nous. Leur aide nous est très précieuse. La solidarité qui se déploie est une belle chose à observer.
Nous avons également suscité de l'intérêt dans d'autres régions ou départements. Le CHU Saint-Pierre nous a contactés car il souhaitait reproduire notre concept à Bruxelles. Leur centre vient d'ouvrir au 320, rue Haute et nous célébrerons la création, demain, de notre première « petite soeur ». De même, nous avons reçu hier des représentants du Centre d'accueil, information, sexualité (CACIS) de Bordeaux, très actif et engagé, avec qui nous avons partagé savoir-faire et expérience. Nous avons aussi été reçus par le service d'urbanisation de Nantes et abordés par la région PACA. Tous ces échanges nous ont incités à publier un kit pratique expliquant comment ouvrir une Maison des femmes . Plus généralement, notre structure suscite beaucoup d'intérêt et me semble répondre à un besoin qui n'était pas pris en compte jusque-là.
Par ailleurs, les European family justice centers mènent une action similaire à la nôtre, au niveau européen, à la différence près qu'ils n'incluent pas les soins. Ils ont pris contact avec nous par le biais de la fondation Kering qui est notre meilleur soutien et ils nous ont « adoubés », faisant de notre structure le premier dispositif français à avoir rejoint ce mouvement. J'avoue que je ne comprends pas que la France ne soit pas intégrée dans ce dispositif qui intègre aussi bien des Ukrainiens, des Belges, des Berlinois, que des Anglais ou des Ecossais. Nous devrions réfléchir pour associer notre pays à ce mouvement. Tout comme nous, ces centres proposent une prise en charge psycho-juridico-sociale, et notre volet santé les intéresse beaucoup. Nous essayons de construire un socle commun.
C'est une grande satisfaction pour moi de constater que notre exemple peut inspirer des réalisations comparables.
Le président Macron a rappelé, le 25 novembre dernier, l'importance pour la France de s'investir dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, y compris en ce qui concerne les mutilations sexuelles. Il a évoqué la création de dix lieux de soin innovants, sans en préciser les contours : nous sommes restés un peu « sur notre faim » et nous aimerions avoir davantage de précision. Nous aimerions aussi être sollicités pour mettre en place ces expérimentations, car nous avons suffisamment bataillé pour que La Maison des femmes existe ! Nous souhaitons contribuer à l'ouverture de nouveaux lieux d'accueil, à Bordeaux notamment.
Annick Billon, présidente . - La Maison des femmes est le résultat d'une conception intelligente, qui a su rassembler en un lieu unique écoute attentive des victimes et démarches administratives. La simplification de leur parcours et un accueil centré sur les soins, tels sont, si j'ai bien compris, les deux piliers de votre projet, dont le maître mot est la bienveillance. À quelle forme de structure administrative vous rattachez-vous ? Quels sont vos liens avec l'hôpital ? Parmi les personnes que vous accueillez, combien vont jusqu'à déposer une plainte ? Enfin, quel est votre avis à l'égard de la question des viols de mineurs, sur l'âge du consentement, sujet fort évoqué dans les médias ?
Ghada Hatem . - Initialement, la direction de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis avait accepté de nous donner un terrain. Nous avons travaillé dur pendant trois ans pour trouver les financements nécessaires à la réalisation de notre projet. Ils proviennent pour un tiers de la région, qui subventionne La Maison des femmes au titre de lieu de planning familial aux missions élargies ; pour un tiers, du département, car Stéphane Roussel qui préside le Conseil général de Seine-Saint-Denis nous a beaucoup soutenus ; et pour un tiers, de dons en provenance de quinze fondations privées, parmi lesquelles la fondation Kering - j'en ai parlé à l'instant -, dont la présidente a joué un rôle essentiel pour développer notre mécénat auprès de fondations comme Elle , L'Oréal , Sanofi , Aéroports de Paris , etc.
Marisol Touraine, alors ministre, nous a accordé 160 000 euros en 2017 et autant en 2018. Elle a missionné des inspecteurs de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour évaluer l'intérêt de reproduire notre dispositif. Le rapport, qui date de mai 2017, est public depuis une semaine. Il conclut à notre légitimité en mettant en avant le socle incompressible qui doit être financé par l'État : soins médicaux, soins psychologiques, accompagnement social. Nous travaillons à mettre en place ce financement avec l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France.
Le rapport de l'IGAS conclut à la nécessité d'ouvrir des lieux d'accueil de ce type partout sur le territoire, même si l'offre de soins peut être modulable selon les besoins des régions. Il sollicite la Haute autorité de santé (HAS) sur la définition de ce que doit être la prise en charge des violences faites aux femmes. Un groupe de travail devrait voir le jour à ce sujet, qui réservera une place particulière aux enfants, car ceux-ci portent toute leur vie les répercussions douloureuses de l'agression qu'ils ont vécue, lorsqu'ils ont été victimes directes de violences.
De plus, l'IGAS nous a demandé de clarifier notre position par rapport à l'hôpital. Nous sommes une unité de l'hôpital, avec un personnel rémunéré par l'hôpital. Parmi ceux qui exercent à nos côtés, il y a deux sages-femmes, un sexologue, un psychologue, et une secrétaire dont la Fondation Sanofi financera le salaire pendant trois ans. François-Henri Pinault, président de la Fondation Kering, s'est engagé à nous financer pendant deux années supplémentaires. Nous avons créé une association de la Maison des femmes par l'intermédiaire de laquelle nous menons des campagnes de crowdfunding . L'association est très active sur les réseaux sociaux et a gagné en notoriété grâce à la campagne « Pied dans la porte ». Nous renforçons notre projet, brique après brique.
Quant à l'âge du consentement, c'est une question sur laquelle je reste embarrassée en tant que gynécologue. La notion de consentement absolu avant la majorité est délicate. J'ai reçu dans mon cabinet des jeunes filles de quatorze ans qui vivaient une sexualité parfaitement épanouie avec leur ami de dix-sept ans. On peut toujours déplorer la précocité des premiers rapports sexuels... Il n'en reste pas moins que certaines jeunes filles sont très matures et ne sont pas forcément des victimes. C'est pourquoi, retenir comme limite l'âge de treize ans me semble plus adapté à la réalité des pratiques ; mais, à mon avis, les situations doivent être traitées au cas par cas.
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Toulouse pourrait avoir besoin d'un lieu comme La Maison des femmes , au même titre que Bordeaux. Votre kit d'ouverture m'intéresse et je souhaiterais beaucoup visiter votre établissement.
Notre délégation a travaillé pendant plusieurs mois, en 2015-2016, sur le thème des femmes et des religions dans le cadre d'un rapport paru il y a un peu plus d'un an.
En travaillant à l'élaboration de ce document, nous nous sommes plus particulièrement préoccupées du lien entre les soins gynécologiques et le poids des injonctions religieuses qui pèsent spécifiquement sur les femmes, dans la logique d'une morale qui fait reposer sur le corps des femmes l'honneur des pères, des frères et des maris.
Selon les informations qui nous ont été communiquées il y a un an environ par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), il semblerait que les demandes de certificats de virginité sont moins fréquentes aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, quand le CNGOF a publié un communiqué intitulé « Les gynécologues-obstétriciens défendent les femmes contre l'intégrisme musulman » 380 ( * ) .
Partagez-vous ce point de vue, selon lequel les demandes de certificats de virginité se font plus rares, ou êtes-vous toujours sollicitée pour cela, particulièrement de la part de très jeunes patientes ?
Pouvez-vous nous parler des réfections d'hymen, qui sont parfois pour certaines jeunes femmes une question de survie ?
D'après les femmes que vous traitez et accompagnez, êtes-vous en mesure de nous parler du fléau des mariages forcés ?
Ghada Hatem . - Vous êtes les bienvenues à La Maison des femmes . Nous ferions avec plaisir à Toulouse ce que nous avons fait à Bordeaux.
Je suis très sensible aux liens entre femmes et religions. Étant libanaise, je viens d'un pays où la religion est inscrite sur les cartes d'identité. L'irruption du communautarisme en France m'a beaucoup surprise. Dans ma pratique, j'ai constaté une augmentation du nombre des demandes de certificats de virginité. Ce constat est sans doute lié au fait que je travaille dans un département qui se caractérise par une très grande diversité.
Toutes les religions, à mon avis, sont liberticides pour les femmes.
Sur le terrain, je reçois des jeunes filles qui ont eu une vie amoureuse pendant quatre ou cinq ans, sans l'accord de leur famille. Elles sont contraintes d'épouser un homme du village dont leur famille est originaire, et pour cela il faut qu'elles soient vierges. J'ai beau leur expliquer qu'elles démarreront leur vie conjugale sur un énorme mensonge, rien n'y fait. Elles ont pourtant un niveau de formation important, travaillant comme infirmières ou juristes, et elles ont bénéficié de la « respiration laïque », pour reprendre les mots de la philosophe Catherine Kintzler. Mais elles refusent, sur ce sujet spécifique, de s'opposer à leur communauté.
Je délivre quelques certificats de virginité, soit quand la jeune fille qui me le demande est manifestement en danger, soit quand elle me paraît extraordinairement angoissée. Les jeunes filles idéalisent souvent celui qu'on leur impose comme mari avant de découvrir la triste réalité. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. J'ai rencontré une femme d'un haut niveau de diplôme, fonctionnaire de catégorie A qui, victime de tromperie, s'est mariée à presque quarante ans avec un homme qu'elle avait rencontré sur Internet, qui l'a frappée, volée, et compromis sa carrière. Ce type de situation constitue l'humiliation suprême pour ces jeunes femmes qui n'osent parfois plus retourner dans leur pays d'origine.
Roland Courteau . - Merci pour votre action. Si ce type de structure n'existait pas, il faudrait l'inventer ! Le rapport que nous avons produit en 2016 sur le bilan de l'application des lois entre 2006 381 ( * ) et 2016 382 ( * ) en ce qui concerne les violences faites aux femmes ne disait pas autre chose 383 ( * ) .
Les enfants sont exposés aux violences et sont aussi des victimes collatérales des violences conjugales. Accueillez-vous des enfants dans votre établissement ? Comment reconnaître qu'un enfant est victime en cas de violences conjugales ? Comment parler aux enfants de ce type de violence ?
Les prises en charge des victimes de mutilations sexuelles sont-elles en augmentation ? Est-ce parce que les mutilations se multiplient ? Ou parce que les femmes parlent davantage ?
Ghada Hatem . - S'agissant des enfants, nous accueillons de jeunes adolescentes dans le cadre de notre consultation IVG et contraception. En cas de demande d'IVG par de très jeunes femmes, nous posons toujours la question du viol ou de l'inceste et nous faisons intervenir des psychologues. En effet, lorsqu'on n'est pas formé à recueillir cette parole, il arrive que l'on pratique des IVG en occultant le fait que cette grossesse est issue d'un viol. La prise en charge de ces très jeunes filles à La Maison des femmes nous permet de leur faire rencontrer des psychologues, des assistantes sociales, des conseillères conjugales, et de mieux les accompagner.
Nous réalisons également - et ce sujet me tient à coeur - des IVG tardives pour motif médico-psycho-social. La loi française offre cette opportunité. Vous savez qu'on peut interrompre une grossesse quand la vie de l'enfant à venir est gravement compromise. La loi française, très ouverte à ce sujet, permet d'intervenir à un stade avancé de la grossesse. Pour les femmes victimes de maltraitance ou souffrant de difficultés médico-psycho-sociales, nous pouvons interrompre les grossesses pour viol assez tardivement. Par exemple, nous intervenons fréquemment sur des jeunes filles de douze ou treize ans qui ont fait des dénis de grossesse après un viol. C'est toutefois une prise en charge douloureuse et complexe.
Pour ce qui concerne les violences conjugales, nous n'avons pas de consultations dédiées aux enfants, mais nous les accueillons avec les mères et nous sommes formés à reconnaître et analyser les comportements inhabituels des enfants. Je remercie la ministre Laurence Rossignol ici présente, et que je salue, qui a oeuvré pour que les enfants soient reconnus comme co-victimes des violences conjugales.
Dans certains cas, les enfants peuvent aussi être victimes de comportements incestueux. Je pense par exemple à deux jeunes garçons qui accompagnaient leur mère en consultation et qui avaient des comportements très étranges. Nous avons sollicité le psychologue et, en les interrogeant, nous nous sommes aperçus que le couple était séparé mais que le père les accueillait hélas régulièrement et avait avec eux des comportements incestueux. Nous avons fait signalement sur signalement, mais la mère étant jugée fragile, vulnérable et incapable de s'occuper de ses enfants, leur père continue à les recevoir. C'est terrifiant ! Il faut donc développer les lieux d'accueil et sensibiliser les personnels à l'interprétation des indices tels que ceux qui nous ont alertés.
S'agissant des mutilations sexuelles, du fait des travaux initiés en Seine-Saint-Denis il y a trente ans à la suite du décès d'une petite fille qui avait subi une excision, elles ont pratiquement cessé sur le sol français. Mais nous n'avons pas de certitude. Il n'y a quasiment plus d'excisions sur le territoire Français, même si certaines familles continuent à se cotiser pour faire venir des exciseuses de l'étranger. En revanche, beaucoup de jeunes filles sont excisées lorsqu'elles retournent en vacances dans leur pays d'origine, parfois même contre l'avis de leurs parents. Il suffit que ces derniers manquent de vigilance pour qu'une grand-mère ou une tante prenne l'initiative d'une mutilation sexuelle. C'est un vrai sujet de préoccupation. Un travail important de prévention et d'assistance est réalisé par les PMI, les médecins étant formés pour examiner les petites filles avant et après leur voyage dans leur pays d'origine. Cependant, la PMI ne prend plus en charge les enfants après six ans. Certaines petites filles sont excisées à six ans et ne reçoivent aucun soutien. J'entends à cet égard des histoires édifiantes : une enfant enjouée, qui était première de la classe, excisée pendant les vacances, pourra changer totalement de comportement et voir ses résultats scolaires chuter, sans que personne ne se préoccupe de lui en demander la cause. Il est donc important de former et de faire des campagnes d'information et de prévention, comme par exemple la campagne « Alerte excision » lancée au printemps 2017 par l'association Excision, parlons-en ! pour prévenir et protéger les adolescentes. Cette campagne devrait être renouvelée en 2018. Il faut aussi mentionner la campagne « Protégeons la jeune génération » de l'association Équipop (Équilibre et population).
Il faut aussi être très actif sur le terrain scolaire. Pour notre part, nous menons une action de formation sur l'éducation à la sexualité dans les lycées et les collèges de l'académie de Créteil, à l'initiative du Fonds sur la santé des femmes (FSF). Alors que la loi prévoit cette éducation à la sexualité, de la maternelle à la terminale, à raison de trois séances par année scolaire, elle n'est que très peu dispensée en pratique.
Martine Filleul . - Je constate une grande différence entre les régions en ce qui concerne les financements accordés aux droits des femmes. Dans les Hauts-de-France, dont je suis élue, la question des femmes et du Planning familial est l'objet de toutes les économies. Les financements dédiés aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes subissent de fortes restrictions budgétaires. Comment contribuer à instaurer une égalité de traitement sur tout le territoire français en ce domaine ?
Ghada Hatem . - Le Planning familial est un outil puissant, qu'il faut pérenniser et développer. Les Américains nous l'envient. C'est en tant que Centre de planning familial que nous avons commencé notre action.
Victoire Jasmin . - L'action que vous menez est exemplaire. Vous n'avez pas mentionné les maladies sexuellement transmissibles (MST) dans les soins que vous dispensez aux femmes qui s'adressent à vous. Or les femmes peuvent en contracter lors des agressions dont elles sont victimes.
Ghada Hatem . - Il s'agit là d'une mission traditionnelle, que nous assurons en délivrant aux victimes un traitement préventif. Nous bénéficions par l'hôpital d'un centre de dépistage anonyme du Sida. Le sujet des MST est traditionnel. La prévention est, sur ce terrain, à mon avis, bien implantée.
Marie-Thérèse Bruguière . - Votre exposé m'a beaucoup touchée et a éveillé en moi des souvenirs. J'ai travaillé pendant vingt-trois ans dans une maternité qui accueillait des femmes accouchant sous X, souvent à la suite d'un viol. C'était à Montpellier. Les viols qui donnent lieu à des naissances ont des conséquences terribles, car les enfants sont souvent abandonnés. En quarante-deux ans de travail à l'hôpital, la seule amélioration efficace que j'ai constatée était liée à l'action du Planning familial . Les violences faites aux femmes sont fréquentes, et pas seulement dans les populations subsahariennes. La population gitane est aussi largement touchée. D'après votre expérience, les femmes qui décident de garder leur enfant né d'un viol se posent-elles la question du devenir de cet enfant ?
Ghada Hatem . - Il n'est qu'à lire Les noces barbares de Yann Quéffelec : la vie des enfants nés d'un viol est terrible ! Certaines femmes africaines font le choix de garder leur enfant, même s'il est issu d'un viol. Je me souviens de l'une d'elles, qui avait tout perdu, son mari, ses enfants, et qui se disait : « Cet enfant, c'est tout ce qui me reste », ou bien encore : « Plus seul au monde et plus mal aimé que moi, il y a lui. »
Ce qui importe, c'est de continuer à lutter pour l'éducation sexuelle, en impliquant les parents. Dans certains milieux, les jeunes filles n'ont aucune possibilité de dialoguer avec leurs parents en matière de comportement sexuel. Elles ne prennent pas la pilule et font comme si de rien n'était lorsqu'elles n'ont plus leurs règles, avant que nous les récupérions, malheureusement.
Annick Billon, présidente . - Recevez-vous beaucoup de jeunes filles qui subissent des violences sexuelles ? Le sujet des violences au sein des couples que l'on appelle « non-cohabitants » intéresse particulièrement Laurence Rossignol.
Ghada Hatem . - Je remercie Laurence Rossignol, qui nous a beaucoup aidés. Oui, nous recevons beaucoup de ces jeunes filles, victimes parfois d'un partenaire beaucoup plus âgé, dans ce qui peut nous apparaître comme une forme de prostitution. Cependant, elles sont en couple ; il est difficile d'intervenir. Le cyber-harcèlement est un autre phénomène dangereux.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Les policiers et gendarmes auditionnés dans le cadre du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, auquel la délégation est associée, ont attiré notre attention sur une forte augmentation de la prostitution de jeunes mineures. Cette prostitution est relativement consentie : c'est le « syndrome Zahia », du nom de cette jeune femme qui sortait avec un footballeur célèbre. Toutes ces jeunes filles ont un souteneur derrière elles. Il faudrait leur proposer une prise en charge globale. Voilà un autre chantier à venir.
Ghada Hatem . - Effectivement, on ne peut pas porter plainte et ces situations sont très compliquées à traiter. On constate aussi la prostitution chez les jeunes filles Roms, parfois juste pour manger. Certaines sont mariées à douze ans, déscolarisées, et nous ne faisons même plus de signalements aux CRIP 384 ( * ) . Certaines de mes patientes sont de jeunes Roms de quinze ans qui viennent consulter pour stérilité, car elles sont mariées depuis trois ans et n'ont pas encore d'enfants !
Annick Billon, présidente . - La volonté politique doit accompagner notre mouvement pour éviter les inégalités liées à des différences de traitement selon les territoires. Formation, prévention, éducation à la sexualité et à l'égalité : voilà ce qui aidera les jeunes à être conscients de ce qui est acceptable ou pas.
Je suis heureuse de vous remettre notre rapport d'information sur la place des femmes dans les religions. C'est le fruit de l'important travail mené sous la présidence de Chantal Jouanno en 2015 et 2016. Nous vous remercions.
Audition de Carine
Durrieu-Diebolt, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la
défense des victimes de violences sexuelles
(14 décembre
2017)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, nous poursuivons notre série de réunions sur le thème des violences par l'audition de Maître Carine Durrieu-Diebolt, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans la défense des victimes de violences, pour évoquer plus précisément le parcours des victimes de violences sexuelles.
Ce parcours est souvent long et difficile, depuis l'épreuve de la prise de parole et du dépôt de plainte jusqu'au procès et au verdict - à supposer qu'il n'y ait pas eu de classement sans suite. Il nécessite un accompagnement spécifique, en particulier pour les plus jeunes victimes.
Je vous remercie de nous faire partager votre expérience et de nous aider à avancer sur le sujet des violences sexuelles, dans la perspective de l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
Concernant l'accueil et l'accompagnement des victimes, quel est le profil des personnes que vous recevez ? Quel est leur âge, leur milieu social, le type d'atteintes qu'elles ont subies - harcèlement, agressions ou viols, dans l'espace public ou sur Internet ? Avez-vous constaté une hausse des sollicitations auprès de votre cabinet depuis l'affaire Weinstein ? Quelles sont selon vous les principales difficultés auxquelles se heurtent les victimes de violences sexuelles dans le cadre de leur parcours judiciaire ? Comment remédier à ces obstacles ? Comment accompagnez-vous les victimes ? Quels conseils leur donnez-vous ?
Par ailleurs, que pensez-vous des annonces du Président de la République destinées à garantir un meilleur accompagnement, mais aussi un meilleur repérage des victimes - procédure de signalement en ligne, mise en oeuvre d'un questionnaire systématique des femmes par tous les professionnels de santé, présence de référents de la police et de la gendarmerie dans les lieux d'accueil pour faciliter le dépôt de plainte, recueil et préservation des preuves dans les Unités médico-judiciaires (UMJ) indépendamment du dépôt de plainte, création d'une dizaine d'unités spécialisées dans la prise en charge du psycho-trauma ? Toutes ces mesures nécessiteront des financements...
Sur la réponse judiciaire, que pensez-vous de la correctionnalisation de certaines affaires de viols ? Avez-vous déjà conseillé à une victime de choisir la correctionnalisation plutôt qu'un procès aux assises, et le cas échéant, pour quelles raisons ?
L'arsenal législatif actuel sur les viols et agressions sexuelles sur mineurs vous paraît-il adapté ? Nous pensons notamment à la question du consentement qui fait la une de l'actualité, mais aussi à celle des délais de prescription des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. À cet égard, les mesures législatives évoquées par le Président de la République (instauration d'un seuil de quinze ans pour la présomption de non-consentement des mineurs à un acte sexuel, et allongement des délais de prescription de vingt à trente ans à partir de la majorité de la victime) vous semblent-elles pertinentes ?
Merci, Maître, de nous apporter des éléments de réponse sur ces diverses questions, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres points que je n'aurais pas soulevés et qui vous sembleraient importants.
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions.
Je vous remercie et je vous laisse sans plus tarder la parole.
Carine Durrieu-Diebolt, avocate au barreau de Paris . - Je suis avocate à Paris depuis 1995, spécialisée dans la réparation des dommages corporels. J'ai d'abord travaillé sur le droit de la santé, notamment sur la responsabilité médicale. Depuis cinq ans, je me suis spécialisée dans les violences faites aux femmes. Je suis titulaire du diplôme universitaire « Violences faites aux femmes » de l'université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, dirigé par Ernestine Ronai. Dans ce cadre, j'ai notamment suivi des formations sur le psycho-traumatisme, et des enseignements de sociologie - autant de matières qui ne sont pas proposées dans les cursus de droit. J'ai aussi suivi la formation concernant les violences sexuelles organisée par l'École nationale de la magistrature (ENM) dans le cadre de la formation continue. Actuellement, une formation initiale est obligatoire sur ce sujet à l'ENM, mais la formation continue des magistrats relève du volontariat. De façon générale, il y a un problème de formation des professionnels rencontrés tout au long de son parcours par la victime. J'y reviendrai.
Je reçois des victimes de toutes origines, de tous âges et de toutes catégories professionnelles. Mon cabinet traite plus souvent de viols et d'agressions sexuelles, rarement de harcèlement sexuel. Les seuls cas que j'aie eus à traiter ont été des cas de harcèlement sexuel au travail, avec une action souvent double, devant le Conseil des prud'hommes et au pénal. Les procédures aux prud'hommes ont plus de chance d'aboutir, alors que 80 % des plaintes au pénal sont classées sans suite. J'ai aussi traité des cas de harcèlement sexuel émanant d'anciens conjoints, accompagnant des violences physiques.
Vous le savez, le viol est un crime renvoyé aux assises, tandis que l'agression sexuelle relève du tribunal correctionnel. L'atteinte sexuelle est la qualification juridique retenue par le parquet dans l'affaire de Pontoise - je suis l'avocate de la victime -, ce qui a suscité une grande émotion médiatique...
Je centrerai mon intervention sur quatre points, en commençant par le temps judiciaire dans le parcours des victimes, sous deux problématiques : les délais de prescription et les délais de procédure. Dans un deuxième temps, j'évoquerai le droit mal compris par les victimes, puis les victimes mal entendues par la justice avec la question de la formation des professionnels, et enfin, la sous-estimation des préjudices subis par les victimes à travers la réparation du dommage corporel, pour vous montrer le long parcours judiciaire jusqu'à la reconnaissance.
Le délai de prescription a fait l'objet de nombreux débats, au regard du temps nécessaire à la reconstruction psychologique et de l'amnésie traumatique dont peuvent être victimes les mineurs agressés sexuellement. Souvent, cette amnésie est levée vers 35-40, ans lorsque la victime construit sa propre vie familiale. Il faut un temps de prise en charge psychologique, indispensable pour que la victime puisse être capable de porter plainte et de supporter la procédure. Cela demande du temps. C'est pourquoi je suis très favorable à l'allongement des délais de prescription. Récemment, j'ai défendu deux soeurs agressées par un cousin. L'aînée voulait porter plainte, mais les faits étaient prescrits. Elle les a évoqués dans sa famille. Elle a alors appris que sa jeune soeur en avait aussi été victime. Cette dernière a déposé plainte, et l'aînée a ainsi pu témoigner. Il n'y a pas eu de déperdition de preuves. Cet exemple démontre bien que, parfois, au-delà de la prescription actuelle, des procédures peuvent aboutir. En revanche, l'imprescriptibilité relève d'une autre dimension, car elle concerne les crimes contre l'humanité, les crimes de masse. Je ne suis donc pas favorable à l'imprescriptibilité des infractions sexuelles commises contre les mineurs.
Autre élément, la durée de la procédure est rarement évoquée, alors qu'elle est très éprouvante pour les victimes. Certes, le fait que les délais de procédure soient de six à huit ans pour une procédure pénale peut décourager certaines victimes de porter plainte. L'enquête est plus ou moins rapide, l'instruction dure plusieurs années, sauf si l'agresseur est en détention provisoire - cas très rare -, et peut être ralentie par des recours de la défense, avant un renvoi en cours d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Les procédures, au total, peuvent durer de huit à dix ans au pénal, auxquels s'ajoutent environ deux ans de procès civil en réparation de la victime !
Je ne suis pas favorable à la correctionnalisation des viols, qui sont des crimes et relèvent en tant que tels de la cour d'assises. Récemment, après huit ans d'instruction, j'ai défendu une victime devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour un viol conjugal. C'est éprouvant : la victime doit bénéficier d'un double accompagnement, à la fois psychologique pour se confronter à ses traumatismes, et de la part de l'avocat pour la préparer au procès. J'essaie de le mettre en place systématiquement pour une bonne reconstruction psychologique. Dans cette affaire de viol conjugal avec violences - ce qui est une circonstance aggravante -, le tribunal a condamné le conjoint à trois ans de prison dont un an avec sursis, et sans mandat de dépôt. L'auteur des faits a donc pu bénéficier d'un aménagement de peine et porter un bracelet électronique, alors que la peine encourue aux assises pour les faits commis est de vingt ans de réclusion ! Ce qui montre que les peines pour viol correctionnalisées ne sont pas nécessairement sévères. Le président du tribunal m'a demandé de déposer en juin la demande de dommages et intérêts pour la présentation d'expertises, alors qu'il aurait pu l'ordonner immédiatement. Il faudra donc que je revienne devant le tribunal pour statuer sur des intérêts civils, que nous échangions nos conclusions avec la partie adverse, et la procédure durera encore deux ans à deux ans et demi ; soit un total de dix ans de procédure.
La justice manque de moyens. C'est une chose d'inciter à déposer plainte, mais les services de gendarmerie et de police sont saturés, et il faut parfois cinq ans pour étudier un dossier - d'autant que parfois il est laissé de côté... Les juges d'instruction sont aussi débordés, de même que les juridictions. La question des moyens est cruciale.
Une deuxième difficulté est le droit tel qu'il est compris et entendu par les victimes. Souvent, elles ne comprennent pas qu'une fellation ou qu'une pénétration digitale est un viol, ou que l'absence de violences physiques n'exclut pas le viol. Il y a une carence d'information par rapport aux définitions. Se pose aussi la question du consentement : les victimes croient qu'il faut démontrer qu'elles n'étaient pas consentantes. Or en droit, la preuve négative est impossible. Il faut prouver la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Le procès est celui de l'agresseur au vu de ses agissements et non un procès pour la victime. Pourtant, dans l'affaire de Pontoise, la presse a davantage évoqué la victime à travers le défaut de consentement, que la contrainte morale et la surprise exercées par l'agresseur, axes sur lesquels j'ai plaidé. Cela a introduit de la confusion. Il faut faire un travail de pédagogie en amont sur les définitions et vulgariser le droit auprès des médias. Lors du procès pénal, le procureur qui requiert pour la société plaide la peine, ce n'est pas le rôle de la victime. En raison de ces confusions, les victimes peuvent ainsi souvent être déçues.
La qualification pénale est claire : un viol est un crime, une agression sexuelle est un délit, mais de nombreux viols sont correctionnalisés pour de multiples motifs. On me propose souvent de correctionnaliser en cours d'instruction, mais parfois aussi ab initio, c'est-à-dire dès le début de la procédure. Nous en débattons avec le juge d'instruction : la victime n'est parfois pas suffisamment forte pour supporter un procès d'assises durant plusieurs jours ; les délais de procédure sont plus rapides devant le tribunal correctionnel que devant les assises ; les jurés aux assises seraient moins sévères qu'un tribunal correctionnel composé de magistrats et de juristes. Mais ce dernier argument en particulier est faux : souvent, les peines sont plus légères devant le tribunal correctionnel, en témoigne le cas du viol conjugal jugé au tribunal de Bobigny que j'ai évoqué. Selon la loi Perben 2 385 ( * ) , le magistrat doit demander son accord à la victime avant de correctionnaliser : nous expliquons donc la situation à la victime. Dans les faits, la victime est souvent contrainte à une décision qui la satisfait rarement. Elle a l'impression que le crime est sous-estimé, ce qu'elle ressent comme une injustice, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle a été victime d'un viol. Pour autant, certaines victimes peuvent l'accepter d'emblée, notamment lorsqu'elles sont dans l'incapacité totale de parler ; cela peut concerner de jeunes adolescentes. Ce sont les seuls cas dans lesquels j'accepte la correctionnalisation. Il est en effet très difficile de mener un procès d'assises dans cette situation.
Il existe aussi de « bonnes » et de « mauvaises » victimes : une prostituée victime de viol durant son sommeil, alors qu'elle dormait dans un squat - et par ailleurs se droguait - a déposé plainte. L'agresseur a reconnu plusieurs viols devant le juge : il n'y avait donc pas de problème d'établissement de la preuve. Pourtant le juge a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que les éléments de l'infraction étaient a priori constitués mais ne pouvaient pas être requalifiés en agression sexuelle car les délais étaient en l'occurrence prescrits, et a refusé de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises. J'ai fait appel devant la chambre de l'instruction. La victime était alors suivie par un avocat recevant l'aide juridictionnelle - 480 euros pour toute la procédure d'instruction, quel que soit le travail réalisé. Un cabinet ne peut pas vivre avec l'aide juridictionnelle, et l'avocat a été réticent à interjeter appel devant la chambre d'instruction, car cela lui aurait donné du travail supplémentaire, qui n'aurait pas été rémunéré. On remarque encore une fois un problème de moyens. Comme la victime le pressentait, je lui ai répondu que le non-lieu signifiait effectivement, en quelque sorte, qu'une prostituée ne pouvait être victime de viol. Ce n'est pas acceptable. Je souhaite aller au bout de la procédure, mais j'ai aussi besoin des magistrats pour un renvoi devant les assises - qui est rare, dans ce type de cas. Je suis hostile à la correctionnalisation mais parfois, il y a un « bras de fer » avec les magistrats. Certains vont jusqu'à nous menacer de rendre une ordonnance de non-lieu si nous refusons d'aller devant le tribunal correctionnel, ce qui suppose deux ans de procédure supplémentaire devant la chambre de l'instruction. Dans la pratique, il est parfois difficile de s'opposer à cette décision.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Quelles sont les motivations des magistrats ?
Carine Durrieu-Diebolt . - Le manque de budget, et des assises saturées. Ils nous promettent que si nous acceptons le tribunal correctionnel, notre dossier sera examiné en trois à quatre mois, contre deux ans aux assises. Il faut néanmoins nuancer ce constat. En province, il y a moins de correctionnalisation car les assises sont moins surchargées ; cette pratique est propre aux grandes villes. Nous avons un des budgets de la Justice les plus faibles d'Europe, la moitié du budget allemand par habitant. Le montant de l'aide juridictionnelle est aussi l'un des plus faibles d'Europe. On en revient toujours à la question des moyens.
Troisième difficulté, l'audition des victimes de violences sexuelles n'est pas satisfaisante. Il faudrait former les professionnels pour garantir partout un bon accueil des victimes lors du dépôt de plainte : or la situation peut varier sensiblement d'un commissariat à l'autre ou d'un commissariat à la gendarmerie. C'est une loterie : certains professionnels traitent très bien les victimes, d'autres non. Lorsque certaines victimes viennent me voir avant de déposer plainte, je peux les orienter en fonction de ce que je connais de l'accueil dans tel ou tel commissariat. Je leur conseille également de téléphoner pour prendre rendez-vous et de demander à déposer plainte avec une femme ou un référent policier formé aux violences faites aux femmes. Sinon, les victimes sont parfois soumises à des questions déstabilisantes, voire mises en accusation. Les protocoles d'audition ne sont pas toujours respectés. Ainsi, dans l'affaire de Pontoise, la victime a d'abord été entendue à l'hôpital de Gonesse durant deux heures - une durée très longue à onze ans - sans application des protocoles pour mineurs qui prévoient une mise en confiance de la personne et un test de mémoire préalable à l'entretien. Durant la première heure, elle a répondu seule, sans ses parents, à trente-et-une questions portant exclusivement sur sa fréquentation des réseaux sociaux. Elle s'est sentie mise en accusation, les policiers croyant qu'elle avait déjà une relation, qui aurait mal tourné, avec son agresseur. On ne lui avait pas dit qu'elle pouvait demander des explications sur des mots qu'elle ne comprenait pas, et parfois on lui posait trois questions en une. À laquelle répondait-elle ? Elle a été auditionnée deux fois, dont une avec confrontation, moins que son agresseur.
À l'inverse, à Bourges, j'ai défendu deux soeurs mineures victimes d'un homme âgé. L'enquête policière a appliqué le protocole, les soeurs ont été mises en confiance. La juge d'instruction était bienveillante, expliquant que ce n'était pas parce qu'elles n'avaient pas dit non qu'elles avaient consenti, qu'elles pouvaient demander des explications et que l'audition pouvait s'arrêter si elles ne se sentaient pas bien. Dans ce contexte, la victime a le sentiment d'être crue et elle va parler ; sinon elle reste sur sa réserve et ne parle pas.
La formation des professionnels est indispensable et devrait être obligatoire pour les violences sexuelles car le traumatisme subi par les victimes peut aboutir à des mécanismes de sidération et de dissociation, comme l'a montré la psychiatre Muriel Salmona : dans ces cas, une personne non avertie peut avoir l'impression que la victime ne se sent pas concernée par ce qui lui est arrivé, ce qui peut perturber et déstabiliser le professionnel qui passe ainsi à côté du dossier s'il n'est pas formé.
À Paris, nous disposons d'une antenne des mineurs qui prévoit un parcours de justice spécialisé pour les mineurs agresseurs, avec des magistrats spécialisés et une cour d'assises des mineurs. Pourquoi n'y aurait-il pas de parcours judiciaire spécialisé sur les violences sexuelles avec des professionnels formés ? Avant de m'intéresser de très près à ces question et de suivre des formations spécialisées, je ne comprenais pas que les victimes n'aient pas crié, fui, ou même que parfois elles soient revenues auprès de leur agresseur. Cela peut être culpabilisant pour la victime. La formation est indispensable, elle devrait être obligatoire pour tous les professionnels susceptibles d'être en contact avec ces victimes.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Le parcours judiciaire dédié que vous proposez inclut-il des chambres spécialisées ?
Carine Durrieu-Diebolt . - J'y suis effectivement favorable. Cela résoudrait le problème des assises saturées ; mais il y a, là encore, un problème de moyens. C'est une solution qui éviterait de modifier les qualifications juridiques. Des chambres spécialisées avec des magistrats spécialisés traiteraient le viol comme un crime, sur une durée par exemple d'environ une journée, sans aller jusqu'aux deux jours minimum d'un procès aux assises, ce qui est extrêmement éprouvant. Selon une étude de l' Observatoire des violences faites aux femmes réalisée en Seine-Saint-Denis, dans 86 % des cas, l'agresseur nie les faits. Il a trois stratégie de déni : il peut nier le rapport sexuel, affirmer que la victime était consentante, ou encore qu'il s'agit d'un malentendu parce qu'il n'avait pas vu que la victime n'était pas consentante - or il faut prouver l'intention de l'agresseur. Des audiences longues et le formalisme de la cour d'assises peuvent parfois amener l'auteur présumé à reconnaître les faits, même si c'est très rare. Cette dimension n'existe pas en correctionnelle.
Pour ma part, je serais favorable à la création de chambres spécialisées en matière de violences sexuelles, avec des magistrats spécialisés. Je peux en effet témoigner qu'il est très dur de défendre un dossier devant des magistrats non formés. L'avocat de la victime tient une place dérisoire lors du jugement : les trois parties entendues en phase de jugement sont l'agresseur au nom des droits de la défense et de la présomption d'innocence, le parquet qui représente la société, requiert sur l'infraction pénale et propose une peine, et la victime, partie selon moi « accessoire ». Lorsque l'avocat de la victime plaide devant le tribunal correctionnel, les juges - c'est du vécu - ne cachent pas leur ennui. Et normalement il ne doit pas empiéter sur le discours du parquet - je le fais cependant. Parfois, l'audience commence à 13h30 et l'avocat plaide à 21 heures... Les affaires d'agressions sexuelles sont quelquefois prévues délibérément en fin de journée. Elles ne bénéficient pas de l'attention méritée. Je serais plus à l'aise devant une chambre spécialisée avec des magistrats formés, connaissant le B-A-BA des mécanismes du psycho-trauma.
Quatrième préoccupation, la réparation des victimes est essentielle. La réparation du dommage corporel est indispensable en droit des victimes. Celles-ci vont se porter partie civile dans la procédure pénale. L'avocat évoque l'infraction et le traumatisme psychologique, qui a un retentissement par la suite, et peut donner lieu à des dommages et intérêts. La demande au forfait est théoriquement interdite, même si certains avocats en requièrent avec des sommes dérisoires. Une étude de la Gazette du Palais , fondée sur les résultats des jugements, citait le cas d'une mineure de huit ans violée par un voisin, qui a obtenu une indemnité de 15 000 euros, montant dérisoire par rapport aux conséquences de cette agression sur la vie de la petite victime. Souvent, si les victimes n'envisagent pas initialement de réclamer des dommages et intérêts, elles demandent ensuite une évaluation des préjudices. Mais le contentieux est complexe et de nombreux magistrats sont incompétents en ce domaine. Je vais régulièrement devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) - possibilité offerte pour les victimes au pénal - qui peut ordonner une expertise psychologique et psychiatrique. Cela intéresse les victimes non pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance de leur traumatisme à travers une exposition détaillée des préjudices subis devant le tribunal. Ainsi, hier, j'ai plaidé le cas d'une femme qui avait arrêté de travailler depuis son agression en 2008. Cette étape ne devrait pas être minimisée. Souvent, les indemnités sont dérisoires, sous-évaluées, même si cela progresse. Par ailleurs, il n'y a pas assez de psychiatres formés. Lorsque j'ai demandé pour cette affaire une psychiatre femme, le président de la CIVI m'a répondu qu'il ferait le maximum mais que rien n'était sûr : les psychiatres experts à la CIVI sont sous-payés, beaucoup se désistent et celui qui reste n'est pas forcément spécialisé dans ce type de contentieux... Il y a toujours et encore un problème de moyens. C'est une difficulté de fond.
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Vous évoquez plusieurs dysfonctionnements de la justice...
Carine Durrieu-Diebolt . - Le parcours des victimes est vraiment très éprouvant. Si vous receviez ces victimes, vous verriez que tout ce que je vous dis n'est que le reflet de leur ressenti. Dans le cas que j'évoquais à l'instant, la victime avait été très bien accueillie par les policiers, mais le juge d'instruction a passé une heure, durant les quatre qu'a duré l'audition, à lui montrer les photos de toutes les victimes que son conjoint, qui l'agressait durant son sommeil - parfois à la limite de la barbarie - postait sur Internet. C'était très éprouvant pour elle. Finalement, j'essaye de relayer la parole des victimes. Le point de vue des avocats est intéressant en ce qu'ils sont les interlocuteurs privilégiés des victimes, car ils nouent une relation avec elles sur des années.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie. Les moyens de la justice sont un sujet majeur, qui va de pair avec la formation des acteurs accompagnant les victimes, du recueil de preuves jusqu'au jugement, en passant par les soins. Depuis le début de nos auditions, nous avons vu que la prévention et la formation sont essentielles. J'observe que votre position est assez différente de celle de la magistrature, qui est plutôt opposée à l'allongement du délai de prescription...
Carine Durrieu-Diebolt . - Il y aurait un risque de déperdition des preuves, mais je vous ai montré que dans certains dossiers, la question ne se pose pas. Souvent, la principale raison est la surcharge de travail : l'instruction est longue puisqu'il faut remonter loin dans le temps.
Marie-Pierre Monier . - J'ai été maire d'une commune de 1 200 habitants dans la Drôme, département rural. Dès lors que j'ai dit que j'appartenais à la Délégation aux droits des femmes et que nous travaillions sur les violences faites aux femmes, trois victimes se sont spontanément manifestées. Pour l'une d'entre elles, les faits étaient prescrits, mais elle rencontre encore son violeur dans la rue... Une autre a été sauvée par un gendarme qui l'a bien prise en charge. Je suis intervenue pour la dernière, car elle n'arrivait pas à se faire entendre. Ces trois cas soulignent que la formation des policiers et des gendarmes est indispensable. Nous avons organisé des ateliers de concertation avec eux, et j'ai évoqué la question de l'accueil des femmes victimes de violences. Un responsable départemental de la police m'a indiqué que bien sûr, ce sujet était pris en compte, tandis que le responsable de la gendarmerie m'a avoué n'avoir qu'une seule référente pour viol sur le département ; il sollicitait mon appui pour demander un deuxième poste. Le traitement est donc inégal selon les brigades. Il y a des dispositifs, des lois, mais il faut que tout cela soit efficace, appliqué sur le terrain. C'est difficile.
Roland Courteau . - Vous l'avez dit, la sidération et l'emprise expliquent des attitudes parfois déroutantes devant les gendarmes ou les policiers ; des victimes continuent de voir leur agresseur et parfois renoncent à porter plainte. Des magistrats et des policiers ont souligné l'importance d'une formation obligatoire mais il me semblait que la loi de 2010 386 ( * ) le prévoyait ?
Le certificat médical, qui mentionne l'incapacité de travail des victimes de violences sexuelles, a-t-il une importance majeure pour une action en justice ? Si c'est le cas, il me semble que la formation des professionnels de santé à la rédaction de ces certificats est incomplète. L'incapacité totale de travail (ITT) est une notion juridique parfois mal connue des médecins. Ainsi, les ITT prescrites sont, semble-t-il, plus longues dans le Nord que dans le Sud de la France. Cela ne nécessiterait-il pas une harmonisation ?
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Merci de votre expertise sur ces sujets. Nous allons nous efforcer de proposer des pistes pour améliorer la législation. Rassurez-vous, nous ne sommes pas plus entendus que vous dans nos instances lorsque nous plaidons cette cause : un brouhaha se fait, chacun baisse la tête...
La presse a mentionné que la petite Sarah que vous défendez serait d'origine africaine ou antillaise. Pouvez-vous commenter ce point ?
Carine Durrieu-Diebolt . - J'ai lu cet article, qui a été repris ensuite par le reste de la presse, et je suis intervenue auprès de son rédacteur car cette affirmation m'a paru très contestable. Il se trouve que cette jeune fille est d'origine guadeloupéenne. Rien ne permet de supposer qu'il ait pu y avoir une quelconque tromperie sur son âge. Un article diffusé à l'étranger serait à l'origine de ces allégations. J'ai demandé au journaliste de me le fournir, je l'attends toujours.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il me paraît effectivement contestable de préciser l'origine de cette jeune fille. Mais lorsqu'on étudie certaines affaires qui ont défrayé la chronique, on ne peut s'empêcher de se demander si, dans l'esprit de certains, certaines jeunes filles non occidentales auraient un rapport plus libre avec le sexe et une maturité sexuelle plus précoce.
Carine Durrieu-Diebolt . - C'est possible. Dans le dossier de Pontoise, ma cliente habitait une cité et son agresseur sortait de prison. Il y a donc un contexte social spécifique. Pour le coup, la justice a été rapide, les faits se sont produits en avril, l'instruction était terminée en juin ! Que se serait-il produit si l'affaire avait concerné un milieu moins défavorisé ?
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il faut également avoir conscience du fait que le traitement d'une affaire dépend pour beaucoup du profil des magistrats : formés ou non, sensibilisés ou non...
Carine Durrieu-Diebolt . - Et du profil des victimes...
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Je souhaiterais attirer votre attention sur ce qui me semble être une lacune de notre code pénal, qui définit le viol par la pénétration. Je me permets de vous soumettre un cas qui me laisse perplexe : un jeune garçon mineur est victime d'une fellation imposée par un majeur... Selon le code pénal, c'est une agression sexuelle, alors même que la victime est mineure et l'auteur majeur.
Carine Durrieu-Diebolt . - Légalement, ce n'est pas un viol : il faut qu'il y ait pénétration de la victime.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Pour moi les conséquences d'un tel acte sur la jeune victime sont comparables à celles d'un viol.
Carine Durrieu-Diebolt . - Vous avez raison, le traumatisme est le même. J'ai effectivement rencontré ce cas. Le droit des violences sexuelles n'est pas abouti.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Faut-il modifier le code pénal sur ce point ?
Carine Durrieu - Diebolt . - Je vais y réfléchir. Il faudrait intervenir sur la notion de pénétration...
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Ou bien l'expliciter très clairement.
Joëlle Garriaud-Maylam . - La formation des professionnels est indispensable, nous devons être très fermes. Il faut une formation obligatoire, en formation continue également, avec une obligation de mise à niveau régulière. Faut-il instaurer un contrôle et une évaluation, éventuellement par les victimes, de l'accueil par les gendarmes et les policiers ? Le réseau de la Réserve citoyenne pourrait-il être sollicité en renfort ? Des personnes qui seraient formées à cet effet pourraient venir soutenir la gendarmerie.
Peut-être s'agit-il là d'une piste à envisager ?
Pour en revenir aux chambres spécialisées, cette formule serait, selon moi, idéale, mais c'est un voeu pieux à l'heure actuelle. Allons de l'avant, et rapidement.
Carine Durrieu-Diebolt . - Votre suggestion de faire appel à des réservistes pourrait peut-être permettre une évolution rapide. Je suis tout à fait d'accord sur la formation des policiers et des médecins. Une formation est obligatoire pour les policiers entrants - avec des quanta d'heures variant selon le grade - mais pas pour les policiers en poste depuis longtemps. J'ai assisté une victime de viol à Toulouse : le policier qui recevait sa plainte avait une photo de femme nue affichée derrière lui ; c'est perturbant et ne met pas en confiance...
En ce qui concerne les certificats médicaux, il faut savoir que lorsque la victime dépose plainte, une réquisition est faite pour l'envoyer dans une unité médico-judiciaire (UMJ), la plupart du temps. L'évaluation de la victime est donc faite dans un premier temps par l'UMJ qui rédige un certificat détaillé. En ce qui concerne les violences conjugales, ce certificat est remis aux victimes pour qu'elles puissent présenter une demande d'ordonnance de protection. En revanche, en cas de violences sexuelles, on ne leur remet pas ce certificat qui est souvent renvoyé par fax au commissariat. En conséquence, nous n'avons pas dans un premier temps le détail du certificat médical des UMJ. Oui, monsieur le sénateur, la notion d'ITT pose problème. Dans l'affaire de Pontoise, le certificat médical était favorable à la victime, puisqu'il mentionnait bien l'état de sidération et de dissociation, mais il ne comportait malheureusement aucune indication en termes d'ITT.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Était-elle trop jeune ?
Carine Durrieu-Diebolt . - Je n'ai pas d'explication. Le médecin aurait pu écrire « sous réserve d'un nouvel examen ultérieur ». L'avocat de la défense ne manque pas de remarquer cette lacune, cela lui donne un argument. Les psychologues ou psychiatres peuvent trouver des modèles sur Internet. Les médecins commencent à être formés à la rédaction des certificats, mais cette formation devrait être systématique et non pas aléatoire. Avoir à la fois un policier qui accueille bien, des juges d'instruction bienveillants, une formation de jugement également, un avocat suivant partout la victime et l'accompagnant du début jusqu'à la fin, cela relève du miracle...
Françoise Cartron . - Aujourd'hui, la formation est intégrée au cursus de l'ENM.
Carine Durrieu-Diebolt . - Uniquement pour la formation initiale. Elle est réalisée notamment par la psychiatre Muriel Salmona...
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - ... et Ernestine Ronai, que nous connaissons bien !
Carine Durrieu-Diebolt . - La formation pour les magistrats en poste relève de la formation continue, facultative. Or les magistrats changent de poste durant leur carrière. Un magistrat peut être juge civil durant dix ans, avant de devenir juge d'instruction. Au bout de ce délai, il a pu oublier sa formation initiale. C'est pourquoi il faudrait à mon avis que tout juge d'instruction suive cette formation, qui ne dure que deux jours, ou bien instaurer un parcours spécialisé, avec des juges d'instruction spécialisés dans ce type de violences. La juge d'instruction de Bourges que j'ai citée tout à l'heure était ainsi reconnue comme ayant une compétence particulière. On lui renvoyait souvent les violences sexuelles dans sa juridiction.
Annick Billon, présidente . - Merci de cette audition très riche. Nous espérons pouvoir contribuer à améliorer la prise en charge des victimes que vous accompagnez au quotidien, car c'est d'elles que nous nous préoccupons en premier lieu.
Réunion de travail avec
Érik Dal, contrôleur général des
armées,
médecin des armées, chef de la cellule
Thémis
(19 décembre 2017)
Participantes : Annick Billon présidente, Maryvonne
Blondin,
Nassimah Dindar
Annick Billon, présidente . - La délégation aux droits des femmes du Sénat travaille depuis le début de cette session sur les violences faites aux femmes, dans la perspective de l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement. En lien avec l'actualité, la question du harcèlement sexuel au travail et de sa prévention est un aspect important de nos réflexions.
La délégation aux droits des femmes du Sénat s'est intéressée à la cellule Thémis dès la mise en place de celle-ci à l'initiative de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense. Elle a donc auditionné, dès le 22 mai 2014 (je n'étais pas encore sénatrice à l'époque), le Général Bolelli et la contrôleure générale Brigitte Debernardy, dont la mission d'enquête avait préfiguré les contours de cette cellule, qui a alors été jugée exemplaire au Sénat.
J'observe qu'il y a un an, lorsque les députés Pascale Crozon et Guy Geoffroy ont publié un rapport d'information sur l'application de la loi de 2012 sur le harcèlement sexuel, ils ont présenté en termes très positifs le travail de la cellule Thémis . L'exemplarité de celle-ci a été soulignée par mon ancienne homologue de l'Assemblée nationale, Catherine Coutelle, lors du débat en commission des lois sur ce rapport qui, parmi ses recommandations, comporte une proposition consistant à « développer dans la fonction publique des dispositifs tels que celui mis en place par le ministère de la Défense avec la mise en place de la cellule Thémis 387 ( * ) ».
Vous comprendrez que notre délégation ait besoin d'actualiser ses connaissances sur le fonctionnement de la Cellule Thémis !
Nous aimerions que vous nous fournissiez tous les éléments nécessaires pour comprendre comment fonctionne cette cellule d'accueil des signalements et d'enquête administrative, qui est installée au sein du Contrôle général des armées.
Nous avons besoin aussi de statistiques, notamment :
- le nombre de saisines ;
- pour quels faits ;
- les suites données ;
- les sanctions éventuelles ;
- le nombre d'enquêtes diligentées.
Nous aimerions savoir comment vous orientez les victimes (vers les psychologues, médecins, assistantes sociales, etc.) et comment ont été choisis ces professionnels.
Il semblerait aussi que vous mettiez en place des formations à l'attention des différentes catégories de personnels concernés. Pouvez-vous nous en parler ? À quels moments du parcours professionnel des personnels de la Défense se situent ces formations ?
Même question pour les formations dispensées aux militaires partant en OPEX : comment sont-elles conçues ?
Quel bilan tirez-vous de ces formations ? Comment sont-elles perçues par ceux et celles qui les suivent ?
Il me semble en effet que, lorsque l'on parle de harcèlement ou, a fortiori , de violences sexuelles, peu de gens, finalement, ont une connaissance précise du contenu juridique de ces notions. On perçoit parfois de l'ironie, ou alors certains ont le sentiment qu'ils ne sont pas concernés. Or beaucoup ignorent que les blagues sexistes peuvent entrer dans le champ du harcèlement sexuel, et que l'agression sexuelle commence avec un geste inapproprié qu'il est fréquent de considérer comme anodin.
Peu de gens, par ailleurs, ont conscience, faute d'être sensibilisés à la question, du fait que certaines blagues ou certaines ambiances « viriles » peuvent être très mal vécues par les femmes. Or l'armée est un univers par construction viril...
Comment traitez-vous ces difficultés ?
Maryvonne Blondin . - J'ai travaillé, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur la place des femmes dans les forces armées. Notre propos était de promouvoir l'égalité et de mettre fin aux violences fondées sur le genre. Avec l'ambassadrice de l'OTAN de l'époque, en charge de ces questions au Parlement européen, nous avons réalisé une étude au moyen d'un questionnaire que nous avons adressé aux 47 états membres. 36 nous ont répondu. Nous avons également procédé à de nombreuses auditions en France et nous avons ainsi pu faire des propositions et des recommandations.
Je vous remercie, madame la présidente, d'avoir organisé cette rencontre pour nous éclairer sur le suivi du principe de « tolérance zéro », initié dans l'armée française par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense.
Érick Dal, contrôleur général des armées . - J'ai une formation de médecin généraliste et j'ai exercé au sein du service de santé des armées. J'ai été inspecteur de santé pour la marine et la gendarmerie. Le fait d'avoir travaillé au cabinet militaire d'Alain Richard puis de Michèle Alliot-Marie m'a donné une connaissance transverse de divers sujets qui ne sont pas sans lien avec mes responsabilités actuelles de responsable de la cellule Thémis au sein du Contrôle général des armées. Je suis accompagné de mon adjoint, le lieutenant-colonel Benoît Luneau.
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - J'ai découvert l'armée lors de mon service militaire, et j'y suis resté. J'y suis entré à la fin de mes études de droits et j'y exerce des fonctions de juriste depuis une vingtaine d'année. J'ai été affecté à la cellule Thémis le 1 er septembre 2015.
Érick Dal, contrôleur général des armées . - Dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes, et bien que des procédures de remontée de l'information aient existé auparavant, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, a lancé le 15 avril 2014 un plan de lutte contre le harcèlement, les violences et discriminations sexuelles.
Une des mesures de ce plan a été la création, le 21 juillet 2014, d'une structure spécialisée, la cellule Thémis , chargée d'étudier les cas de cette nature commis au sein du ministère et de ses établissements publics.
Cette cellule complète le dispositif hiérarchique existant, qui comprend la procédure dite « EVENGRAVE ». Celle-ci permet d'une part, l'information du cabinet du ministre et, d'autre part, la réalisation d'enquêtes de commandement.
Je précise qu'au sein des « événements graves » auxquels est dédiée cette procédure, les cas de harcèlement, de violences et de discriminations sexuelles ou HDV-S relèvent d'une classification particulière.
La cellule Thémis , constituée d'un contrôleur général, de trois officiers et d'un personnel civil, a été mise en place au sein du Contrôle général des armées. Il est apparu qu'il fallait adjoindre des juristes à la cellule.
Dans une première partie, je présenterai le dispositif Thémis , ses procédures et ses résultats et, dans une deuxième partie, j'expliquerai comment l'expérience que nous avons acquise nous a permis de mettre en place un plan de sensibilisation de l'ensemble des agents du ministère des Armées, souhaité par l'ancien ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, et poursuivi par sa successeure, Mme Florence Parly.
La cellule Thémis , accessible hors hiérarchie, est un dispositif de vigilance et d'accompagnement. Le mot « écoute » nous semble réducteur, car si nous avons vocation, bien évidemment, à permettre à chacun de parler, cette parole ne doit pas rester sans suite.
La grande majorité des signalements (près de 90 %) est réalisée par des femmes. Les signalements proviennent également d'hommes et de femmes homosexuels et de personnes transgenre.
La cellule Thémis doit permettre à tout personnel ressortissant du ministère des armées, victime ou témoin, de signaler des faits de HDV-S. Elle doit veiller à ce que les victimes soient protégées et les auteurs fermement sanctionnés. La cellule respecte la présomption d'innocence, le devoir de discrétion - le commandement n'est informé qu'avec l'accord des victimes - et l'obligation de protection de la victime.
Je citerai ici l'exemple d'une femme, victime d'agression sexuelle il y a une dizaine d'années, reconnue aujourd'hui invalide à 45 % par notre service des pensions. On voit bien que des faits, qui ont peut-être été considérés comme peu signifiants à l'époque, peuvent avoir des conséquences très graves. Au-delà de l'écoute, la cellule assure aux femmes et aux hommes qui l'ont saisie un accompagnement dans la durée.
Entre sa création, le 15 avril 2014, et aujourd'hui, 19 décembre 2017, la cellule Thémis a été saisie ou s'est saisie près de 300 fois pour des motifs relevant de sa compétence.
Le portail intranet du ministère des Armées présente en page de garde le logo de Thémis STOP harcèlement sexuel , qui ouvre sur le dispositif de lutte mis en place en 2014 et indique comment signaler une agression, une discrimination ou un harcèlement sexuel.
Le site offre également une documentation, dont un vadémécum sur le harcèlement sexuel : identifier une situation, réagir en situation de commandement à un signalement, faire face au harcèlement, quelle attitude adopter en tant que témoin.
Ces procédures visent à ne laisser aucune victime sans solution, tout en harmonisant les pratiques disciplinaires selon le principe de tolérance zéro. Notre action, précisée par une note du chef du Contrôle général des armées du 16 janvier 2015, est orientée selon deux axes : les victimes présumées et la hiérarchie.
- S'agissant tout d'abord des victimes présumées, l'action de Thémis s'exerce :
• en les écoutant puis en les conseillant, par Internet, par téléphone ou en les recevant au cours d'un entretien ;
• en les accompagnant de façon pluridisciplinaire - juridique, social et statutaire. Faut-il porter plainte ? Quelles conséquences en cas d'arrêt maladie prolongé ?
• en les orientant vers les services compétents, en particulier Écoute Défense , dispositif initialement créé pour traiter les conséquences post-traumatiques. Le choix de s'adresser à Écoute Défense doit être volontaire et, j'en profite pour l'indiquer ici, il est ouvert aux militaires, aux anciens militaires et civils des armées, ainsi qu'à leur famille ;
• en veillant à ce que leurs droits soient respectés : ne pas faire d'emblée l'objet d'une mutation sous prétexte que l'on se déclare victime ; la mutation ne doit intervenir que si la victime le demande expressément.
Maryvonne Blondin . - Le plus souvent, on constate que ce sont les victimes qui sont obligées de demander à partir, sans que les auteurs y soient contraints !
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - Il y a des cas de figure où ce sont les victimes qui souhaitent changer d'affectation. J'ai un précédent à citer. Il s'agissait d'une personne qui avait eu des relations sexuelles avec plusieurs militaires du rang au sein d'une unité. Une plainte pour viol avait par la suite été déposée. L'autorité judiciaire, à l'issue de la procédure, n'a retenu aucune infraction. Les personnes mises en cause ont cependant vu leurs contrats dénoncés en raison d'un comportement jugé contraire à la discipline militaire, alors que leur partenaire d'un soir, également fautive, n'avait été sanctionnée que de façon symbolique. Il lui était dès lors devenu très difficile de rester au sein de l'unité car son environnement professionnel vivait mal la mansuétude dont elle avait , selon eux , bénéficié. Elle a donc été mutée, à sa demande, pour lui permettre de redémarrer sa carrière militaire, et la poursuivre dans de bonnes conditions.
Il est vrai qu'il peut aussi arriver qu'un service envisage de muter une victime contre son gré. Dans ce cas de figure, la cellule Thémis intervient auprès de la direction des ressources humaines de l'armée concernée pour rappeler que ce n'est pas à la victime de partir mais bien à son agresseur.
Érick Dal, contrôleur général des armées . - Dans le respect du droit des victimes, Thémis les aide dans leur demande de prise en charge financière des honoraires de leur avocat.
S'agissant maintenant du second axe de notre action, qui s'oriente vers la hiérarchie, il nous est apparu qu'il valait mieux laisser au commandement le soin d'enquêter. Certes, Thémis pourrait se charger des enquêtes (mes collaborateurs et moi-même en ont d'ailleurs le pouvoir), mais cela nécessiterait une réorientation complète de la cellule. Il nous revient donc de fournir au commandement, pour le bon déroulement de son enquête, les éléments recueillis par nous auprès des victimes, avec leur accord.
Dans la majorité des cas, les victimes s'adressent à Thémis parce qu'elles ne veulent pas parler à une hiérarchie proche. Il peut également s'agir de personnes ayant été victimes d'agression au cours d'opérations extérieures (OPEX) ou lors d'une affectation hors métropole, et qui préfèrent attendre d'être rentrées pour en parler. La victime peut également refuser de parler car son agresseur fait partie de sa chaîne hiérarchique.
Il faut aussi garder à l'esprit qu'aujourd'hui, un tiers de l'armée française vit sous le régime interarmées, les auteurs et leurs victimes pouvant être de statuts différents et dépendre de plusieurs unités. Une femme harcelée par un homme ne dépendant pas de sa chaîne hiérarchique, dans des locaux extérieurs aux hiérarchies respectives, peut parfois être un peu perdue et fait alors appel à la cellule Thémis pour être orientée.
Nassimah Dindar . - Le rapport à l'autorité hiérarchique, particulièrement présent dans l'armée, a un impact, de mon point de vue, sur la difficulté pour la victime de s'adresser à elle en cas d'agression. Cette hiérarchie verticale freine la libération de la parole.
Érick Dal, contrôleur général des armées . - On observe aussi, au sein de l'armée, des cas de harcèlement entre pairs, notamment parmi les personnels installés dans le cadre de leurs logements.
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - La nature même des infractions, presqu'autant que le lien hiérarchique, empêche parfois la parole. Qu'on soit, ou non, dans une relation hiérarchique, il est toujours difficile de parler de l'intime à quelqu'un que l'on connaît. Il est plus aisé de le faire anonymement auprès de la cellule Thémis , qui ne dépend d'aucune hiérarchie.
Annick Billon, présidente. - Combien de personnes travaillent au sein de la cellule ?
Érick Dal . - Nous sommes actuellement trois, nous devrions être cinq. Nous nous employons actuellement à compléter la cellule, en essayant autant que faire se peut de respecter la parité. L'approche féminine est différente et complémentaire de l'approche masculine. Les deux sont nécessaires dans cette mission.
Après la période d'instruction du dossier, nous n'informons le commandement qu'après avoir reçu l'accord écrit des victimes présumées. Car elles nous confient des photos, des textos, des captations d'images, des témoignages, tous très intimes. Les descriptions des agressions sont, parfois, particulièrement crues.
Derrière la parole des victimes - les associations de femmes s'en font l'écho - figure très souvent la honte.
Nous parlons de manière très libre avec nos interlocutrices : nous sommes là pour les aider à parler. Un exemple me revient : celui d'une liaison amoureuse qui s'est créée de manière virtuelle entre un homme et une femme, allant jusqu'à l'échange de photographies très intimes. La femme était en situation de fragilité professionnelle. Cette femme, isolée et seule, avait été repérée par cet homme dont elle pensait qu'il pouvait, par ses fonctions, l'aider. Lorsqu'elle s'est rendu compte que ce n'était pas son but, elle a tenté de faire marche arrière. Mais il a cherché à profiter de ses fonctions pour obtenir des faveurs sexuelles en échange d'une intervention pour empêcher une mutation dans un service où l'intéressé ne souhaitait pas aller. Les services de police ont pris connaissance des 700 SMS échangés entre eux deux, mais ont refusé tant de prendre la plainte de la femme victime que de lui permettre de déposer une simple main courante. Elle a donc informé sa hiérarchie, qui a saisi le procureur de la République. Il s'agissait de faits de harcèlement sexuel caractérisé. La teneur même des SMS reçus par la victime ne permettait aucun doute. L'affaire a pourtant été classée sans suite, au motif que l'auteur avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire (il avait été déplacé).
Nous avons expliqué à cette femme les recours dont elle pouvait user à la suite de cette décision mais, s'étant vu refuser le dépôt de plainte et l'affaire ayant été classée, elle a baissé les bras. Comment pouvait-elle se faire entendre ?
Annick Billon, présidente . - Colonel, comment avez-vous rejoint la cellule Thémis ?
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - J'ai demandé à rejoindre la cellule car j'ai une formation de pénaliste et qu'il me semblait intéressant de traiter ces questions de violence par une approche juridique. Je peux confirmer que certains militaires ont une connaissance approximative du droit pénal et notamment de la définition du harcèlement sexuel, telle qu'elle résulte de la réforme de 2012. Si la prohibition du « chantage sexuel », défini à l'article 222-33 II du code pénal, est plutôt bien connue, nombreux sont ceux qui n'imaginent pas que l'exposition d'autrui à des comportements à connotation sexuelle peut aussi constituer une infraction pénale, conformément à l'article 222-33 I du code pénal.
À chaque fois qu'il se passe quelque chose de répréhensible dans les armées, notamment une infraction sexuelle, un compte rendu doit être rédigé dans les trois heures. Ce qui compte, c'est que les faits soient qualifiés et que les affaires puissent remonter à la hiérarchie pour être traitées. Le gros travail que nous faisons au travers de nos formations est d'expliquer ce qu'est un délit de harcèlement sexuel, de faire prendre conscience qu'il recouvre des comportements variés qui ne se résument pas au fait de faire pression sur une personne pour obtenir des faveurs sexuelles.
Érick Dal . - Une fois que le commandement a été informé des faits, nous allons nous assurer :
- de la mise en oeuvre de mesures conservatoires ;
- que les enquêtes disciplinaires ou administratives sont bien menées (selon le cas, Thémis peut mener ses propres enquêtes) ;
- que les sanctions disciplinaires sont adaptées, dans le respect des droits de la défense.
J'ai demandé qu'il soit fait en sorte que ces sanctions reflètent mieux la gravité et la nature des faits qui les motivent. J'y ai été conduit par le cas d'un officier qui, auteur d'une situation de harcèlement, n'a reçu qu'un rappel à l'ordre par une lettre simple de sa hiérarchie, alors que ces faits valent habituellement vingt à trente jours d'arrêt ! Nous travaillons actuellement à harmoniser les procédures et les sanctions.
Maryvonne Blondin . - Vous inspirez-vous de ce qui existe au sein de l'OTAN, notamment en ce qui concerne la procédure de dépôt de plainte ?
Érick Dal . - Nous connaissons bien cette procédure, mise en place par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS).
Nous veillons également à ce que les signalements soient faits aux autorités judiciaires. Nous avons aussi une action de conseil aux victimes ainsi qu'au commandement, en cas de doute sur les procédures à mettre en oeuvre : l'un des outils susceptibles d'être mobilisés à cet effet est un guide, disponible sur notre site intranet, qui permet aux officiers chargés de rédiger les comptes rendus d'utiliser le vocabulaire approprié pour la description des faits. Ce guide est d'ailleurs accessible à tous les personnels.
En résumé, le processus de traitement des appels comprend quatre étapes :
- l'instruction du dossier, au sein de la cellule, sur déclaration de la victime présumée ;
- l'action du commandement, une fois obtenu l'accord de la victime présumée ;
- le suivi de la victime, tant en interne-Défense (pour le retour dans l'unité par exemple) que dans le cadre des procédures judiciaires (demande de dommages et intérêts) ;
- la clôture du dossier, qui peut s'avérer difficile à expliquer à une victime, quand la cellule n'est pas parvenue à corroborer sa plainte, faute de faits suffisants.
La cellule Thémis est, par ailleurs, chargée de recenser l'ensemble des signalements de cette nature et devrait disposer d'un logiciel adapté en 2018. Le prototype va être livré très prochainement et fera l'objet d'une expertise par la Direction des affaires juridiques, afin de vérifier sa conformité aux dispositions de l'arrêté CNIL du 12 juillet 2015.
La cellule Thémis n'a donc pas vocation à se substituer au commandement qui, sauf exception, quand il a connaissance des faits, protège les victimes et punit les auteurs. Elle peut toutefois l'assister, si besoin, dans le traitement des faits constitutifs de violences sexuelles et, surtout, donne la possibilité aux victimes de se faire entendre hors hiérarchie.
Thémis est compétente pour les actes de HDV-S commis au sein du ministère des Armées et de ses établissements publics. La note du 16 janvier 2015 dont j'ai déjà parlé, précise à l'attention du commandement que toute personne qui se dit victime ou témoin de faits de HDV-S peut saisir Thémis , à la condition que ces faits soient commis à l'occasion du service ou de l'exécution du service, ou dans des lieux soumis à l'autorité du ministre.
En conséquence, les faits commis en opérations extérieures (OPEX) comme ceux commis en opérations intérieures (OPINT) entrent dans le champ de l'action de Thémis . Dans le cadre des responsabilités de l'État employeur, les personnes civiles n'appartenant pas au ministère peuvent faire appel à Thémis .
Quelques données chiffrées au 19 décembre 2017 : le flux des nouveaux dossiers ouverts est, en moyenne, de six à sept par mois ; actuellement onze dossiers sont en phase « instruction », vingt-deux en « action du commandement », et 79 dossiers en « suivi ».
Le suivi statistique de l'activité de la cellule est annuel, du 1 er janvier au 31 décembre (les chiffres 2017 sont ceux arrêtés au 19 décembre). Le tableau ci-après recense les faits tels qu'ils sont décrits par les victimes présumées.
Annick Billon, présidente . - Parmi les ressortissants de la cellule Thémis , y a-t-il des corps plus concernés que d'autres ?
Érick Dal . - Je ne fais pas ce calcul. Nous ne pouvons pas mettre en avant un corps plus qu'un autre. D'ailleurs la féminisation des corps n'est pas homogène.
Plusieurs constatations, sous réserve de prendre en compte le faible volume de séries statistiques disponibles :
- 90 % des signalements sont faits par les femmes ;
- le ratio civil/militaire (21 %/79 %) correspond sensiblement au rapport des deux populations au sein du ministère (en revanche la répartition des infractions semble différente : plus de harcèlement pour les civils et plus d'agressions pour les militaires) ;
- le nombre des infractions, comme leur répartition, restent stables au fil du temps ;
- le « harcèlement sexuel » reste l'infraction la plus déclarée (les victimes présumées peuvent plus facilement identifier les critères de harcèlement), avec une diminution proportionnelle des cas décrits en 2015 comme relevant de la discrimination. À mon avis cette évolution tient davantage à la compréhension des définitions juridiques qu'à un changement de comportement.
Trois points particuliers sont, je pense, à souligner :
- les « atteintes à la vie privée » correspondent essentiellement aux captations et diffusions d'images sans consentement ; elles sont en augmentation ;
- nous n'avons pas remarqué d'« effet Weinstein » : au dernier trimestre 2016, vingt-deux nouveaux appels pour dix-sept en 2017 sur la même période : on ne peut pas parler d'augmentation réellement significative ;
- en ce qui concerne l'évolution de la répartition des grades des plaignantes et plaignants militaires, sous réserve de confirmation par des travaux de recherche, les officiers féminins sont surreprésentés en 2017, comme le montre le tableau suivant :
Par ailleurs, je voudrais insister sur le fait que la cellule Thémis , forte de son expérience, participe aux groupes de travail institués afin de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes : en particulier, elle est partie prenante à la rédaction d'un guide d'aide à la prise en charge des dossiers de changement d'identité de genre, en cours actuellement.
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - Ce groupe de travail est né à la suite de la saisine d'un officier de l'armée de terre qui qui s'était engagé dans un parcours de changement d'identité sexuelle. Les difficultés ne venaient pas tant de son environnement professionnel immédiat que de personnes qui vivaient mal ses revendications : porter des cheveux longs, du maquillage et des bijoux, revêtir l'uniforme féminin et, plus particulièrement, accéder aux sanitaires du personnel féminin. Le commandement se trouvait donc confronté à des menaces de plaintes pour discrimination s'il ne cédait pas aux demandes de la personne transgenre et à l'opposition d'un certain nombre de ses collègues féminines qui n'appréciaient pas qu'une personne ayant conservé ses attributs masculins puisse utiliser leurs sanitaires. Face à cette situation difficile, le commandement a pris le parti de s'en remettre à la mention du sexe figurant sur la carte d'identité de l'intéressé, tout en lui assurant que dès qu'il aurait obtenu la modification de son état civil, il en tirerait toutes les conséquences qui s'imposent. Pendant que le groupe de travail menait ses travaux, la loi a changé 388 ( * ) . La question a été « démédicalisée », ce qui a permis de raccourcir sensiblement la durée de la période de transition puisqu'une modification irréversible de l'apparence n'est plus requise avant un changement d'état civil. La modification du seul prénom est même de la compétence de l'officier d'état civil, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, nous avons aujourd'hui au sein de l'armée une personne qui a obtenu le changement de son prénom, mais pas encore celui de la mention du sexe sur ses papiers d'identité. Nous avons donc un militaire de sexe masculin ayant un prénom féminin. La loi ne l'oblige d'ailleurs pas à mettre les deux en concordance.
Dans notre vadémécum , le groupe de travail a considéré qu'une personne portant un prénom masculin devait être appelée par la civilité correspondant à ce prénom.
Nous nous sommes efforcés d'identifier ce qui était à l'origine des crispations, pour donner des pistes au commandement et lui laisser une marge de manoeuvre. Nous formalisons ces procédures et nous espérons que cela permettra de dépassionner les réactions face à ce type de situation.
La question de l'aptitude à servir fait également partie de nos travaux. Le médecin appartenant à ce groupe de travail s'est interrogé sur la compatibilité d'un parcours de changement d'identité de genre avec un engagement militaire : le traitement hormonal se prenant tout au long de la vie, il peut sembler difficile d'envoyer ces personnes dans les territoires d'Outre-mer ou sur des OPEX, une rupture dans la fourniture des médicaments étant toujours possible, avec des risques évidents pour leur santé. La conclusion de ce groupe de travail a toutefois été qu'il n'existait pas d'inaptitude « d'emblée » et que les personnes effectuant un parcours de changement d'identité de genre verraient leur situation évaluée au cas par cas.
Ce vadémécum devrait être diffusé au sein des armées dans les semaines qui viennent.
Érick Dal . - La cellule Thémis s'inscrit également dans la réalisation de la sensibilisation aux violences sexuelles de tous les agents du ministère des armées, civils et militaires, dans le cadre de leur parcours professionnel. Ce point a été décidé dès avril 2016 par le ministre. Cette formation est pilotée par la Haute fonctionnaire à l'égalité du ministère. Un plan de formation contre les HDV-S concernant tous les personnels a donc été mis en place dans cette logique.
À cet effet, la Commission d'adaptation de la formation (CAF) « Formation pour la prévention des HDV-S » a réalisé un plan de formation articulé autour de trois axes : les personnels à former, les formateurs, les supports. Ce plan, co-piloté par l'État-Major des armées (EMA) et la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD), a été validé par le Comité de coordination de la formation (CCF) le 12 juin 2017. Il prévoit que tout personnel militaire ou civil (en école ou centres de formation ou en emploi) reçoive au moins une fois dans sa carrière une sensibilisation à cette question.
Sans attendre la mise en oeuvre de ce plan, la cellule Thémis a mis en place depuis 2016 un cycle de conférences semestriel au profit, d'une part, des instructeurs des militaires du rang (CFIM, CSMV), priorité du ministre et, d'autre part, de l'ensemble des agents civils et militaires du ministère de la Défense, tant en centres de formation (CFMD, CFD, écoles d'officiers ou de sous-officiers) qu'au profit de populations cibles (commandants d'unités, cadres et référents mixités, conseillers techniques sociaux, aumôniers, etc.)
La sensibilisation comporte une partie relative à la définition des infractions sexuelles, avec une attention particulière aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, et précise :
- que les infractions sexuelles sont des crimes ou des délits ;
- que les sanctions disciplinaires sont indépendantes des sanctions pénales ;
- que le ministre des armées applique une politique de « tolérance zéro » dans ce domaine.
La cellule Thémis dispose pour cette formation de supports didactiques, dédiés et harmonisés :
- savoir se comporter, sous forme d'un « kit de prévention » comprenant trois films d'animation et un livret d'accompagnement pédagogique réalisé en liaison avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ;
- savoir anticiper, réagir, intervenir, sous forme de conférence-type à orientation juridique, de cas concrets et de quizz adaptés aux grades et aux fonctions des auditeurs.
Thémis a organisé, les 11 et 15 décembre 2017, deux journées d'enseignement pour 120 formateurs-relais, au sein des organismes des armées, et participe à la réalisation d'un enseignement par e-learning pour le personnel ne passant pas en centre de formation.
La cellule est également chargée de la mise à jour et de la validation des supports existants ainsi que de la création d'un module e-learning . La mise en place du plan s'effectuera sur le rythme de l'année scolaire 2017-2018. La commission d'adaptation de la formation (CAF) « Formation pour la prévention des HDV-S » suivra la mise en place du plan de formation par les armées, directions et services et fera avec eux un point de situation en janvier 2018.
Le nombre de dossiers devenant significatif, Thémis mène par ailleurs les actions suivantes :
- la poursuite des enquêtes auprès des armées et services pour établir une corrélation entre les faits déclarés par la victime, les faits constatés par le commandement et sa réaction, ainsi que la réponse judiciaire ;
- le développement d'un logiciel (GESSIT avec accord CNIL) dans le but d'exploiter une base de données unique à partir des informations obtenues par Thémis ;
- la réalisation des travaux de recherche avec des étudiants en droit ou en médecine.
Plusieurs sujets sont retenus dont :
• les circonstances de survenues des cas de HDV-S ;
• le lien entre les déclarations des victimes présumées, la réponse disciplinaire et la réponse pénale ;
• les conséquences sur les victimes en termes de santé - congés pour raison de santé, invalidité, réforme - et de carrière (mutation, sanction, carrière dans la réserve, démission).
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - En ce qui concerne les opérations extérieures (OPEX), la formation intervient à différents niveaux.
Tous les militaires qui partent en OPEX suivent ce que l'on appelle une « préparation à l'engagement opérationnel ». Pendant une quinzaine de jours, ils sont spécialement formés au théâtre d'opérations sur lequel ils vont être projetés. Les conseillers juridiques opérationnels, qui sont déployés sur tous les théâtres d'opération, suivent différents stages, parmi lesquels figure le stage « LEGAD 389 ( * ) niveau II ». Au cours de ce stage, une formation spécifique sur les violences sexuelles dans les conflits armés est dispensée par un représentant du comité international de la croix rouge.
Il existe aussi des formations ouvertes à tous mais qui ne constituent pas forcément un préalable à une projection à l'étranger, parce qu'elles sont plus techniques, plus juridiques. Elles s'adressent à un public qui sera chargé, du fait de ses fonctions, de diffuser les bonnes pratiques au sein des unités.
Il s'agit, par exemple, des formations que nous dispensons aux formateurs-relais. La question des violences sexuelles en OPEX s'intègre dans la sensibilisation plus générale des personnels au thème des violences sexuelles.
De même, une journée entièrement consacrée à la « prévention de l'exploitation et des abus sexuels dans le cadre des opérations extérieures » a été organisée au mois de juin dernier par la direction des affaires juridiques du ministère.
Au cours de ces journées, des thèmes plus techniques peuvent être abordés, comme la question de savoir si toute relation sexuelle d'un militaire avec une personne civile, même majeure et même consentante, ne doit pas être questionnée sur le terrain de l'inaptitude à consentir. Tout dépend des théâtres d'opérations, de l'intensité des conflits, du fait de savoir si la relation entre ces personnes n'est pas faussée par une contrainte morale liée à l'autorité de fait qu'exercerait le militaire... Nos personnels doivent être conscients de tout cela.
Enfin, je voudrais juste faire partager mon expérience de conseiller juridique en opérations pour souligner le fait que la lutte contre les violences sexuelles en OPEX constitue une préoccupation ancienne du commandement. Lorsque j'étais conseiller juridique en Côte d'Ivoire en 2005, j'avais été sollicité pour intervenir sur ce sujet auprès des troupes. Je devais rappeler les règles d'engagement, autrement dit, les conditions d'ouverture du feu, mais aussi informer tout le monde que le fait qu'avoir des relations sexuelles pouvait constituer une infraction, même lorsque le partenaire était consentant, dès lors qu'il était mineur.
Annick Billon, présidente . - Cette cellule de cinq personnes est-elle suffisamment étoffée pour prendre en charge tous les dossiers ?
Érick Dal . - La cellule fonctionne actuellement avec seulement trois personnes. Je tiens ici à remercier l'ensemble de mes officiers qui ont fourni cette année un travail colossal : le suivi des dossiers des victimes, le travail sur des outils performants, l'harmonisation des dossiers informatiques et « papiers » et la rédaction du guide de procédures. Nous avons travaillé parallèlement à la préparation des conférences de sensibilisation et d'information que j'ai évoquées tout à l'heure.
Lieutenant-colonel Benoît Luneau . - Le ministère des armées est avant-gardiste. Nous avons eu un cas de harcèlement sexuel par un subalterne sur sa supérieure féminine. Le ministre avait pris la sanction la plus sévère : la radiation des cadres. L'intéressé a estimé que cette sanction était trop sévère, il a saisi le tribunal administratif qui lui a donné raison, en considérant qu'il y avait eu une erreur d'appréciation. Le ministre a alors saisi la cour administrative d'appel qui a infirmé le jugement du tribunal administratif et confirmé la sanction prononcée. Les sanctions disciplinaires sont de plus en plus sévères et lorsqu'elles sont contestées, elles sont généralement confirmées par la juridiction administrative.
Nous citons des exemples concrets dans nos formations : aujourd'hui, des peines d'emprisonnement ferme peuvent être prononcées à l'encontre d'auteurs de faits de harcèlement sexuel alors que c'était tout à fait exceptionnel il y a une dizaine d'années. La tendance est à un accroissement de la sévérité des sanctions prononcées, sur les plans administratif et pénal : c'est le message que nous nous efforçons de transmettre au cours de nos formations et il est relativement bien entendu. Nous avons pris le parti de nous situer sur le plan de la morale, mais de nous fonder uniquement sur le droit, en rappelant les textes et la jurisprudence.
M. Érick Dal . - Des comités de suivi de Thémis , présidés par le ministre, se sont tenus en juin 2015 et juin 2016 ; la tenue d'un comité de suivi est programmée pour juin 2018 390 ( * ) . Thémis aura alors quatre ans d'existence et ses modalités d'intervention pourront être le cas échéant revues à l'aune de l'expérience acquise.
Annick Billon, présidente . - Nous vous remercions pour cet éclairage intéressant.
Audition de Sandrine Rousseau,
ancienne secrétaire nationale adjointe
du parti Europe
Écologie Les Verts (EELV), maître de conférences en
sciences économiques à l'université de Lille,
présidente de l'association Parler
(17 janvier 2018)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, pour cette première réunion de 2018, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à tous vos proches et à vos équipes, une excellente année 2018.
Une chose est sûre : cette année sera, comme 2017, très occupée à la délégation aux droits des femmes, si j'en juge par notre programme !
Je salue chaleureusement notre collègue Marie Mercier, présidente du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs, et je la remercie de sa présence à notre réunion.
Nous accueillons aujourd'hui Sandrine Rousseau ; je précise à son intention que nous avons décidé, dès la reconstitution de la délégation à l'issue du dernier renouvellement sénatorial, de centrer notre agenda sur les violences faites aux femmes, en lien avec une actualité chargée et avec la préparation du projet de loi annoncé par le Gouvernement. Toutes les auditions auxquelles nous avons procédé depuis le début de cette session concernent donc le thème des violences.
Deux auditions porteront plus particulièrement, en mars, sur les violences dans les Outre-mer, conformément au souhait exprimé dès notre première réunion par nos trois collègues ultramarines. En février et mars, nous travaillerons sur les mutilations sexuelles féminines. Quant au rapport d'information sur les violences faites aux femmes handicapées, inscrit à notre programme, nous sommes conduits à en décaler la réalisation en raison du récent décès de Maudy Piot, présidente universellement regrettée de la principale association référente en la matière : Femmes pour le dire, femmes pour agir . Il convient en effet que cette association se soit adaptée au contexte issu de la disparition de sa fondatrice.
Notre audition d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de réunions dédiées au sujet des violences sexuelles, qu'il s'agisse du harcèlement, y compris dans ses dimensions « cyber », des agressions sexuelles ou du viol.
Sandrine Rousseau, vous avez été au coeur de ce qui est devenu l'« affaire Baupin » et vous faites partie des femmes qui ont contribué à « libérer la parole » face à des violences dont il est très difficile de parler.
Parler , c'est justement le titre du livre de témoignage que vous avez écrit, et c'est aussi le nom de l'association que vous avez tout récemment créée pour aider les femmes victimes de violences.
Je pense qu'il n'est pas utile de revenir sur les circonstances précises de l' « affaire Baupin », qui sont rappelées dans votre livre. Toutefois :
- pouvez-vous nous dire pourquoi les conséquences de cette affaire ne relèvent pas de la même échelle que celles de l'« affaire Weinstein » ? Les femmes en France se seraient-elles senties moins concernées par ce qui arrivait dans le milieu politique que par les agressions vécues par des actrices américaines ?
- S'agissant de votre parcours judiciaire, pourriez-vous aussi revenir sur la manière dont vous avez été accueillie par les services de police lors du dépôt de plainte ? Avez-vous des suggestions dans ce domaine pour améliorer l'accueil des victimes ? La pré-plainte en ligne envisagée par la garde des Sceaux est-elle à votre avis une solution ?
Nous aimerions aussi que vous nous présentiez votre association, qui a pour objectif d'aider à la prise de parole et d'accompagner les victimes, comme le précise votre site Internet, « jusqu'au dépôt de plainte et au-delà ». Quel est le bilan de ses premières semaines d'existence ? Les témoignages reçus par les femmes qui se sont adressées à vous confirment-ils votre propre vécu ?
Vous évoquez dans votre livre le soutien de l' Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ( AVFT ) et de sa déléguée générale, Marilyn Baldeck, que nous entendrons le 31 janvier. Confirmez-vous que sans ce type de soutien, votre démarche aurait été beaucoup plus difficile ?
C'est avec plaisir que je vous laisse la parole, puis mes collègues vous poseront des questions et nous aurons un temps d'échanges.
Sandrine Rousseau . - Je vous remercie de me recevoir. Mon propos introductif sera volontairement court, afin de favoriser le dialogue avec les membres de la délégation.
Pour répondre à votre question sur les réactions moins nombreuses à la suite de l' « affaire Baupin » que dans le sillage de l'« affaire Weinstein », je pense effectivement qu'il est plus difficile de parler après que les affaires sont sorties du milieu politique que du milieu du spectacle, qui a quelque chose de beaucoup plus consensuel. C'est une explication parmi d'autres. En France, je pense qu'il est assez difficile de faire émerger des affaires dans des sphères autres que la politique. On a entendu quelques dénonciations issues du militantisme politique, quelques-unes aussi dans le milieu journalistique, mais cela reste encore assez limité.
Pourquoi ai-je décidé de fonder l'association Parler et d'écrire l'ouvrage que j'ai intitulé de la même manière ? Pour répondre à cette question, il faut que je revienne un peu en arrière. Quand on a été confronté comme moi à une violence sexuelle, on vit souvent une période durant laquelle on essaie de faire avec, en se disant que ce n'est pas si grave, qu'on a fait face. Pendant cette période, on peut avoir des moments de bonheur et de joie, on ne pense pas forcément en permanence à l'agression, qui n'est pas nécessairement obsessionnelle. Malgré tout, ce souvenir reste toujours présent dans un coin de notre tête. Donc, on en parle quand même, pour essayer de faire évoluer les choses. En ce qui me concerne, j'en ai parlé au sein du parti dans les minutes qui ont suivi mon agression, je n'ai même jamais cessé d'en parler, mais je me suis heurtée à la surdité du monde politique. Personne n'a vraiment voulu entendre !
À partir du moment où l'on parle officiellement, que ce soit dans les journaux ou en allant déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat, on traverse une sorte de révolution personnelle, qui nous assaille pour le meilleur et pour le pire. Cela bouleverse totalement notre monde personnel. Aujourd'hui, en France, parler est vraiment un parcours extrêmement compliqué et douloureux. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature sur ce sujet, dans un moment où cela m'aurait beaucoup aidée. Il existe des livres sur le traumatisme du viol, mais très peu sur les violences sexuelles en général et sur le parcours d'une victime après la libération de sa parole. On peut avoir l'impression de devenir folle. Dans ces situations, seules les autres victimes, les femmes qui sont passées par là, peuvent constituer un soutien, alors que même vos proches ne vous comprennent plus.
J'ai donc voulu créer l'association Parler , une association de victimes, pour leur permettre de parler ensemble et leur offrir un espace de complète liberté de parole, pour échanger et leur montrer qu'elles ne sont pas seules. À la suite de la publication de mon livre, du lancement de l'association et de mon passage à l'émission On n'est pas couchés qui a suscité une polémique, j'ai reçu des milliers de témoignages de femmes. Toutes, elles disent la même chose. Il est vraiment frappant de voir à quel point leurs discours se ressemblent et à quel point leurs parcours sont communs, alors même qu'elles se sentent si seules et isolées.
Forte de mon vécu, je voudrais vous soumettre plusieurs propositions pour améliorer le parcours des femmes victimes de violences sexuelles.
Annick Billon, présidente . - Nous vous écoutons avec intérêt, puis les membres de la délégation pourront vous faire part de leurs réactions.
Sandrine Rousseau . - Une préoccupation récurrente dans les témoignages que j'ai reçus est celle de la formation de tous les personnels susceptibles d'être en contact avec les victimes, du dépôt de plainte jusqu'au terme de la procédure : les policiers qui sont chargés de l'accueil dans les commissariats, les juges, mais aussi les médecins. L'accueil dans les commissariats peut encore être défaillant. Je sais qu'il y a eu des avancées notables, mais beaucoup reste encore à faire. Un policier ou une policière par commissariat formé-e à l'accueil des femmes victimes de violences, cela ne suffit pas. Il faut qu'ils le soient quasiment toutes et tous.
De la même façon, il est particulièrement éprouvant pour une victime d'agression sexuelle ou de viol de venir raconter les faits dans le hall d'un commissariat plein de monde, sans aucune confidentialité. C'est pourquoi je suggère l'instauration d'un code, par exemple 3919, en référence au numéro d'urgence, ou d'autres mots, peu importe, pour savoir que la femme devant eux est victime de violences sexuelles. Ce code serait compris par les policiers chargés de l'accueil, qui orienteraient alors la personne dans un lieu adapté à la situation, pour lui éviter d'avoir à prononcer les mots de viol ou d'agression sexuelle devant tout le monde.
En outre, j'insiste sur la formation des psychologues et des médecins, notamment dans le cadre des expertises psychologiques, autre moment très éprouvant pour les femmes qui viennent déposer plainte. Selon la loi, les victimes de violences sexuelles font l'objet d'une expertise psychologique pour évaluer l'ampleur du traumatisme subi. Or, souvent ces expertises outrepassent cet objectif et se révèlent à charge contre les femmes qui déposent plainte pour des violences sexuelles, en les présentant parfois comme des menteuses ou des manipulatrices. Ce n'est pas ce que l'on demande à l'expert, en l'occurrence. Il me paraît donc nécessaire de mieux encadrer ces expertises, d'autant plus qu'elles représentent un élément important du dossier pour la suite de la procédure. Cette tendance problématique à présenter les femmes comme des manipulatrices en dit long, à mon avis, sur la vision que porte notre société sur les femmes et leur sexualité...
J'ai également des recommandations relatives au corps médical. Beaucoup des femmes qui ont témoigné dans le cadre de mon association ont fait part de leur mal-être lié à l'examen qu'elles ont subi en médecine légale pour constater le viol après le dépôt de plainte. En effet, bien souvent, ces prélèvements ADN sont réalisés par des hommes, ce qui est insupportable pour des femmes qui viennent de subir un viol. Il me semble qu'il serait pertinent d'élargir le champ des personnes susceptibles de procéder à ces examens, aujourd'hui réalisés par un personnel très restreint, aux infirmières ou aux médecins du travail, sous réserve de formation. À tout le moins faudrait-il encadrer ces prélèvements sensibles par un protocole, car il est vraiment très violent de faire examiner par un homme une femme qui vient tout juste d'être violée.
Toujours dans le champ médical, il faut savoir que les victimes d'un viol sont soumises à des traitements préventifs contre le VIH ou les hépatites, qui sont des protocoles assez lourds. Or, même quand l'auteur du viol a été arrêté, on ne lui fait pas d'examen pour s'assurer que ces traitements sont nécessaires : on continue à donner à la victime des trithérapies et autres traitements très contraignants alors que l'auteur du viol est connu et qu'il peut ne pas être lui-même contaminé. Cela fait partie des choses que les victimes supportent très mal dans leur parcours. Il en va de même quand on effectue les prélèvements gynécologiques ou ADN : les victimes ne sont pas tenues informées de leur dossier médical. Tout cela fait aussi partie des violences supplémentaires qu'on inflige aux femmes.
En outre, se pose la question du manque de lieux adaptés pour l'accueil des victimes de violences sexuelles dans les commissariats et les hôpitaux. Il est en effet difficile de parler de son intimité dans des lieux très froids et impersonnels, peu adaptés à l'émotion qui imprègne les propos des victimes quand elles racontent les faits, et cela peut aussi les déstabiliser. Cela m'a marquée, alors que j'ai fait ma déposition longtemps après mon agression. Or le moment du dépôt de plainte est un moment important dans le parcours d'une victime, car sa déposition servira ensuite tout au long de l'instruction. Une victime a besoin de se sentir en confiance pour parler.
Un autre problème concerne la protection des victimes. Beaucoup de femmes qui déposent plainte reçoivent des menaces contre elles-mêmes ou leurs enfants, surtout quand elles connaissent leur agresseur. Je pense que tant que la justice n'a pas statué, il faut organiser la protection de ces femmes. Les juges peuvent demander une protection dans ces situations, mais ce n'est pas systématique et cela se fait rarement en pratique, et de façon assez légère. Certaines victimes ressentent une profonde détresse face à ces menaces : les gérer en plus de leur traumatisme leur est tout simplement impossible.
En outre, j'estime qu'il faudrait permettre aux femmes qui déposent plainte de se faire rembourser 100 % des soins, notamment psychologiques, liés à leur agression, au moins jusqu'à ce que la justice ait statué. Il ne faut pas oublier les conséquences d'une agression sexuelle, du harcèlement ou d'un viol sur une victime, notamment dans le domaine professionnel. Je parle de remboursement à 100 %, pas d'enrichissement personnel ! L'objectif est juste de pouvoir aller chez le médecin, ce qui est parfois difficile pour des femmes qui ont perdu leur travail. Sans le remboursement intégral des soins, elles sont bien souvent dans l'incapacité de se faire suivre et se retrouvent alors de plus en plus isolées.
En ce qui concerne l'indemnisation des victimes, je note que, dans le contexte de l'affaire Weinstein, le Canada vient de rouvrir toutes les plaintes pour violences sexuelles classées sans suite depuis deux ans. Je trouve que c'est une décision intéressante, qui s'adapte au changement de contexte.
Enfin, il me paraît indispensable de lutter absolument contre la correctionnalisation des viols. C'est une pratique scandaleuse. Le viol est un crime et doit être jugé comme tel.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie pour ces pistes d'amélioration sur lesquelles réagiront sans doute mes collègues.
Laure Darcos . - Je vous remercie pour ce témoignage. En tant que membre de la commission de la culture, j'ai été très fière que cette dernière vous exprime tout de suite et spontanément sa solidarité, par une saisine du CSA, après ce que vous avez subi durant votre passage dans l'émission On n'est pas couchés , en dénonçant des agissements inadmissibles. Cette polémique illustre d'ailleurs à mon sens la collusion qui peut exister entre le monde politique et le monde médiatique.
Il est vrai que le milieu politique est un monde particulier, qui est resté pendant très longtemps l'apanage des hommes. Jusqu'à la loi sur la parité, les femmes arrivaient péniblement à entrer dans ce milieu-là et au fond - je vais peut-être choquer plusieurs d'entre vous - certaines femmes se sont peut-être prêtées dans une certaine mesure à une sorte de jeu de séduction dans ce contexte. Je ne dis pas que c'était bien ou que c'était une pratique courante. C'est juste une hypothèse.
En tout état de cause, il est très compliqué pour une femme de parler dans une situation comme celle que vous avez vécue, parce qu'elle peut avoir peur, quand elle appartient à un parti politique, à une fédération ou autre, des répercussions qui en résulteraient sur sa vie politique.
Il me paraît donc important de responsabiliser l'entourage, notamment politique, des victimes de violences sexuelles. Bien souvent, dans ce genre d'affaires, beaucoup de gens savaient, mais n'ont pas parlé pour les raisons que j'ai évoquées. Il faudrait les inciter à témoigner, en s'inspirant de ce qui existe en matière d'obligation de signalement concernant la maltraitance aux enfants.
J'ai récemment organisé une table ronde dans le sud de mon département avec d'autres élues. Je sais que la délégation a déjà évoqué la question des femmes victimes de violences en milieu rural, dans le cadre de son rapport sur les agricultrices 391 ( * ) , mais je dois dire que j'ai réalisé à l'occasion de ces échanges qu'il est particulièrement difficile pour ces femmes de porter plainte contre leur mari ou leur conjoint violent. Elles ont très peu d'interlocuteurs vers qui se tourner, notamment le maire, mais ce dernier peut être un proche de l'agresseur... Cela rend la libération de la parole encore plus compliquée que dans les grandes villes. Le milieu rural est encore très isolé pour ce qui concerne la prise en charge et la protection des victimes.
Christine Bonfanti-Dossat . - Je vais faire une digression mais vous comprendrez in fine le rapport entre mes propos et notre sujet. Je fais partie d'une association qui lutte contre la maltraitance des enfants et des adolescents - et aujourd'hui cela concerne 80 % des violences sexuelles. Nous nous constituons partie civile dans les procédures et nous n'obtenons bien souvent qu'un euro symbolique. Or, j'ai constaté depuis deux ou trois ans que dans les affaires de cyber-harcèlement, nous avons pu obtenir des dommages et intérêts.
Nous avons comme vous observé que les locaux des commissariats et gendarmeries sont des endroits peu propices à la confession des victimes, et notamment des enfants. Notre association a donc contribué au financement de salles dédiées aux enfants, dites « salles Mélanie ». Ces endroits à la fois apaisants et rassurants, équipés de jouets, gérés par des professionnels formés, sont beaucoup plus adaptés au recueil de la parole des enfants et cela donne des résultats fabuleux. On compte actuellement 25 « salles Mélanie » en France - la dernière en date sera prochainement inaugurée à Toulouse. Pourquoi ne pas imaginer ce type de salle au profit des femmes victimes de violences sexuelles ? Je serais très intéressée de pouvoir discuter d'un tel projet avec vous.
Claudine Lepage . - Je vous remercie pour votre témoignage. Vous avez distingué le monde politique du monde du cinéma et du reste de la société. Pour ma part, je ne suis pas persuadée qu'il faille opposer ces différents mondes. Je pense qu'il s'agit davantage d'une question culturelle qui tient à notre société. Ainsi, j'opposerais plutôt cette dernière à un monde plus puritain, anglo-saxon. On a connu au cours des dernières années des scandales dans le milieu politique en Grande-Bretagne, aux États-Unis, deux pays qui n'ont pas la même appréhension que nous des relations entre les femmes et les hommes. Les rapports entre les deux sexes y sont beaucoup plus tranchés. Dans notre pays, et plus généralement dans l'Europe du Sud, nous avons longtemps brandi l'idée de la séduction et de rapports plus apaisés entre les hommes et les femmes, ce qui occultait totalement la question des agressions sexuelles. Aujourd'hui, on en parle enfin ; notre société est en train de changer, d'évoluer et j'y suis pour ma part très favorable.
Pour conclure, je veux vous assurer que nous soutenons pleinement votre combat.
Céline Boulay-Espéronnier . - Nous partageons avec vous le fait d'être des femmes politiques et vos propos sur la difficulté à parler de ces agressions renvoient à la perception de la parole de la victime, notamment dans le monde politique qui, comme le rappelait Laure Darcos, est un univers basé sur la séduction.
Il existe bien des modalités de séduction et il est navrant de constater l'amalgame qui peut exister entre elles ; la femme ou l'homme politique désire plaire à l'électorat mais aussi à ses collègues des deux sexes, c'est un monde de complaisance.
Je désirerais que vous développiez la difficulté à témoigner dans la sphère politique où règne l'omerta.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Je constate avec satisfaction que la parole se libère à l'échelle mondiale, cependant il est de notre responsabilité et de tous ceux qui sont conscients de cette problématique que cette parole libérée soit non seulement entendue mais aussi que des mesures réelles soient prises.
Vous nous avez indiqué avoir été soutenue par l' Association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail ( AVFT ) qui effectue une considérable prise en charge des victimes de violences dans le cadre du travail. Je suis tout particulièrement consternée que les femmes ayant témoigné de harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles au travail perdent leur emploi dans la majorité des cas, subissant donc une double peine : le traumatisme qu'elles vivent auquel s'ajoute la violence résultant des conséquences de cette perte d'emploi.
Les dispositifs permettant à ces femmes d'être accompagnées doivent être maintenus, renforcés ou remplacés si des mesures plus efficaces peuvent être mises en oeuvre. À cet égard, je m'inquiète des récentes dispositions limitant les champs d'investigation de l'Inspection du travail et de la Médecine du travail, mais aussi de celles relatives à la fusion des instances représentatives du personnel, en application des ordonnances Pénicaud 392 ( * ) et de la loi « El Khomri » 393 ( * ) . Je m'inquiète aussi de la suppression du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), alors même qu'il est déjà difficile d'entendre la parole des femmes victimes et de mettre en oeuvre des mesures appropriées. Dès lors, le risque existe que les violences sexuelles, qui peuvent aller jusqu'au viol, ne soient plus vraiment prises en compte dans le monde du travail.
Je souligne le parallélisme entre le sort réservé aux femmes agressées dans le cadre de leur travail et celui des femmes politiques qui dénoncent des faits d'agressions sexuelles : il est paradoxal qu'elles soient toutes mises au ban de leur famille politique ou de leur entreprise, alors que c'est à l'agresseur d'en être écarté.
Roland Courteau . - Je vous remercie d'avoir insisté sur la nécessité de former tous les intervenants (policiers, gendarmes, médecins...) appelés à recevoir les femmes victimes d'agressions sexuelles. L'accueil et l'accompagnement d'une victime traumatisée sont essentiels, mais demeurent encore à améliorer tant sur le volet de la formation initiale que sur celui de la formation continue de ces intervenants. Malgré les dispositifs légaux qui disposent que ces formations sont obligatoires, de nombreux témoignages me laissent à penser que l'accueil d'une femme venant déposer plainte pour des faits d'agressions sexuelles laisse encore beaucoup à désirer dans certains commissariats ou unités de gendarmerie.
Il me semble qu'il faut aussi étoffer le nombre d'intervenants sociaux, en charge de l'accompagnement des femmes traumatisées et désemparées, au sein des commissariats. Qu'en pensez-vous ?
Marie Mercier . - Un parallélisme certain apparaît entre votre agression sexuelle et les faits qui ont été rapportés lors des différentes auditions du groupe de travail de la commission des lois consacré aux infractions sexuelles commises sur les mineurs.
Si la transposition du concept des « salles Mélanie » dédiées au recueil de la parole des enfants constituerait un apport considérable pour assurer un accueil apaisant des femmes victimes d'agressions, il est cependant essentiel, quelle que soit l'architecture retenue, que des moyens humains y soient associés pour la faire fonctionner. Nous avons visité l'UMJ de Saint-Malo et sa « salle Mélanie », bel exemple de partenariat entre les différentes institutions. En revanche, nous avons pu constater qu'une autre « salle Mélanie », pourtant magnifique, implantée dans un CHU, ne fonctionnait pas, faute d'un environnement humain vraiment adapté à l'écoute des enfants. Les locaux, c'est certes important, mais l'humain est lui aussi primordial.
Libérer la parole est indispensable, mais les formations pour en assurer le recueil sont au moins aussi nécessaires.
J'ai été frappée par vos propos sur les hommes médecins chargés des prélèvements ADN : l'empathie des professionnels de santé n'est pas liée à mon avis à leur sexe. Peut-être vouliez-vous exprimer que cet examen médico-légal doit être pratiqué avec suffisamment de tact, de professionnalisme et de gentillesse, dans le respect de la victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, de sa parole et de son humanité fracturée ? J'ai pu observer au cours de mes études de médecine que ces qualités humaines ne sont pas l'apanage d'un seul sexe...
Sandrine Rousseau . - Je conviens que certaines professionnelles (de la police ou de la magistrature, par exemple) que l'on peut être amené à rencontrer dans le cadre d'une agression sexuelle peuvent effectivement être très désagréables. Ce serait trop simple s'il suffisait d'avoir affaire à des femmes ! Mais il y a néanmoins quelque chose de symbolique, de l'ordre d'une insurmontable réticence, à se faire examiner avec une pénétration digitale par un homme juste après un viol !
Marie Mercier . - Lorsqu'un médecin pratique un toucher vaginal ou rectal, cela relève d'un examen professionnel, il faut le déconnecter de l'agression.
Sandrine Rousseau. - La victime d'une agression est dans un état d'esprit qui ne permet pas un tel détachement.
Annick Billon, présidente . - Il y a le regard du médecin, mais il faut tenir compte du regard de la patiente. Imaginez ce que peut ressentir une adolescente consultant pour la première fois un gynécologue ! C'est souvent le premier homme devant lequel elle doit se dévêtir si elle n'a pas encore eu de rapports sexuels...
Sandrine Rousseau . - Autre sujet : l'inversion de la charge de la preuve du consentement. Les femmes sont supposées consentantes et doivent faire la preuve qu'elles ne l'étaient pas. C'est une question très grave. Cet a priori du consentement me pose problème. En outre, le rassemblement des différentes plaintes concernant un agresseur n'est pas systématique alors qu'il suffirait d'une circulaire du garde des Sceaux aux juges d'instruction pour progresser dans la connaissance de l'étendue des violences.
L'émission On n'est pas couchés a révélé le traitement qui est réservé à celles qui dénoncent des violences sexuelles : la polémique qui en a résulté portait sur l'attitude de Christine Angot mais selon moi, celle des deux autres animateurs était tout aussi problématique. Je vous remercie pour votre soutien.
Par ailleurs, impliquer l'entourage de façon à ce qu'il se sente concerné et l'amener à agir est un vrai sujet.
Vous l'avez dit, le recueil de la parole des femmes victimes de violences dans les territoires ruraux et ultramarins est délicat : les interlocuteurs auxquels elles pourraient s'adresser sont en nombre limité. De plus, en milieu rural, peut se poser un problème de confidentialité. Quand tout le monde se connaît... Une solution serait de permettre à ces victimes de s'adresser à des structures éloignées de leur domicile ; la plainte en ligne est aussi une possibilité.
Si le monde politique est un monde de séduction, c'est aussi un monde de pouvoir, y compris d'abus de pouvoir... Les violences sexuelles relèvent non pas de la séduction mais bel et bien du pouvoir : ce que j'ai ressenti n'a rien à voir avec la séduction ! Mon agression s'est déroulée dans le cadre d'une réunion que j'animais. La situation était totalement étrangère à la séduction.
Je n'ai cessé de parler de mon agression depuis les minutes qui l'ont suivie, mais personne n'a jamais réellement entendu ; selon moi, cette surdité est à mettre au compte de l'extrême influence de mon agresseur au sein du parti, nul n'ayant voulu l'affronter sur les dénonciations dont il était l'objet. Or nous étions une quinzaine à le dénoncer. Donc si le parti avait sérieusement enquêté après mes prises de parole, il serait apparu qu'il y avait bien un problème qui ne relevait pas de la seule séduction.
De cette quinzaine de femmes qui ont été agressées ou harcelées, peu demeurent au sein du parti ! Si notre parole n'a pas été contestée car nous étions trop nombreuses, s'est cependant tissé un climat parfois délétère autour de nous et à certains moments, nous avons été marginalisées au sein du parti, considérées comme des femmes dont il fallait se méfier.
Au regard de mon expérience, je suis convaincue que l'un des combats des femmes agressées sera de reprendre le chemin de la politique pour faire évoluer la société et ne pas les laisser cantonner au rang de victimes, mais montrer qu'elles sont des femmes qui peuvent assumer des responsabilités.
L' Association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail ( AVFT ) nous a éclairées, pas lors du dépôt de plainte, mais pendant l'enquête journalistique et sur le parcours judiciaire que l'on allait devoir affronter ; les membres de l'association sont des femmes aux rares compétences juridiques, malheureusement confrontées à un afflux de demandes difficile à gérer.
Mais quels vont pouvoir être les recours des femmes qui subissent des violences sexuelles au sein de leur entreprise, avec la suppression du CHSCT et la révision des prérogatives de la Médecine et de l'Inspection du travail ?
Je propose que soient créés des référents dédiés, hors hiérarchie, désignés pour recevoir les témoignages et alerter la hiérarchie.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie de votre témoignage, d'autant que si vous avez pu vous exprimer dans votre livre, cela doit toujours vous être difficile de vous exprimer sur ces faits.
Il faut libérer la parole et la faire suivre d'actions en justice, mais aussi donner une chance aux victimes de passer à autre chose en dépassant ce statut.
J'ai trouvé originale et excellente votre proposition d'indiquer discrètement par un code que l'on souhaite déposer plainte pour agression sexuelle dans un commissariat, sans être contrainte de préciser les faits devant tout le monde, comme cela a pu nous être rapporté.
Le dépôt de plainte en ligne pourrait aussi permettre d'orienter ces victimes vers la personne compétente et formée pour les accueillir et les entendre.
J'ai aussi été sensible à vos remarques portant sur le corps médical et je comprends tout à fait que l'état d'esprit d'une personne diffère selon qu'elle est examinée par un médecin en tant que patient, ou que victime, a fortiori après une agression sexuelle.
Je vous remercie de votre engagement ; il est bien la preuve que vous n'êtes plus une victime mais vous rend au contraire actrice de votre parcours et vous permet de rebondir vers d'autres horizons.
Sandrine Rousseau . - Merci à vous. Je suivrai vos débats avec attention au moment de l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
Audition du Docteur Emmanuelle
Piet,
présidente du Collectif féministe contre le
viol
(18 janvier 2018)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, nous poursuivons ce matin nos auditions sur les violences faites aux femmes. Notre matinée sera particulièrement riche puisque nous aurons trois réunions successives. Je rappelle que notre délégation a souhaité travailler cette année - actualité oblige -, sur les violences faites aux femmes, afin de préparer l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
Nos questionnements concernent plus particulièrement le drame des victimes de violences sexuelles, notamment des victimes les plus jeunes, et les obstacles qui jalonnent leur parcours judiciaire. Nous nous intéressons, bien sûr, à l'accompagnement et à la prise en charge médicale et psychologique de ces victimes, jeunes et moins jeunes.
Pour commencer notre matinée de travail, nous avons le plaisir d'accueillir le Docteur Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe contre le Viol ( CFCV ). Créé en 1985, le Collectif a mis en place dès 1986, grâce au soutien financier du ministère des Droits des femmes d'Yvette Roudy, la permanence téléphonique nationale gratuite Viol Femmes Informations .
Docteur Piet, votre engagement en faveur des droits des femmes ne date pas d'aujourd'hui. En tant que médecin de Protection maternelle et infantile (PMI) vous avez très tôt fait de la protection de la santé des femmes votre vocation. Il en va de même pour la protection des petites filles contre l'excision, thème sur lequel nous préparons un autre rapport d'information. Nous y reviendrons au moment des questions. Pourriez-vous commencer par nous parler de votre parcours ?
Dans un second temps, pourriez-vous nous présenter l'action du CFCV : quels sont ses objectifs, ses outils, ses activités ? Quel bilan dressez-vous de l'action menée depuis 1985 ? Que reste-t-il à faire selon vous pour améliorer la protection et la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles ?
Enfin, nous souhaiterions que vous réagissiez aux principales annonces du Gouvernement sur le contenu du futur projet de loi - présomption de contrainte en-dessous de treize ou quinze ans en cas d'acte sexuel entre un mineur et un majeur, allongement des délais de prescription des infractions sexuelles commises contre des mineur et création d'un délit d'outrage sexiste pour réprimer le « harcèlement de rue » - en nous faisant part, le cas échéant, de vos propositions.
Je vous remercie chaleureusement d'être venue jusqu'à nous et je vous laisse sans plus tarder la parole.
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et vous poseront des questions.
Emmanuelle Piet . - Je suis médecin départemental de PMI. Aujourd'hui à la retraite, je continue néanmoins les consultations. J'ai commencé à exercer en 1975 à la PMI : j'ai donc un certain recul sur ces sujets. Je me suis occupée de planification familiale et de protection maternelle et infantile. J'ai piloté la campagne de prévention des agressions sexuelles à l'encontre des enfants à partir de 1985. Enfin, j'ai travaillé dans le domaine de la prévention des mariages forcés, des mutilations sexuelles et des violences faites aux femmes en général.
Je suis présidente du CFCV depuis 1992. Ce collectif s'est créé en 1985 après plusieurs viols commis sur la voie publique devant de nombreux témoins, sans qu'aucun n'intervienne. À cette occasion, les féministes s'étaient rassemblées (le Mouvement Français pour le Planning Familial , Solidarité Femmes , La Maison des Femmes ...) pour créer un collectif d'associations. Nous nous sommes constituées en association à proprement parler à partir de 1989, afin de pouvoir ester en justice aux côtés des victimes.
Nous avons animé la permanence téléphonique Viol Femmes Information depuis 1986. Actuellement, la permanence est ouverte de 10 heures à 19 heures tous les jours en semaine. Nous entendons quotidiennement entre trois et quinze nouvelles victimes venant témoigner d'un viol, et ce depuis trente-trois ans. Au total, 54 200 victimes ont téléphoné au moins une fois. Pour chacune d'entre elles, nous rédigeons une fiche et procédons à une analyse. Les victimes téléphonent de façon anonyme, mais dans la mesure où elles rappellent pour avoir un complément d'information, nous leur demandons de communiquer un prénom et un département pour pouvoir les retrouver, et suivre leur histoire.
Ces 54 200 témoignages et les analyses que nous en avons tirées nous ont inspiré des propositions de réformes législatives. Nous sommes véritablement portés par la parole des victimes. Lorsqu'on les écoute en continu, il est très impressionnant de voir à quel point ce qui ressort, c'est une stratégie de l'agresseur. Pour nous, ce premier constat a été très important. À ceux qui prétendent que le violeur est uniquement guidé par des pulsions et que l'agresseur n'avait pas perçu l'absence de consentement de la victime, nous pouvons répondre que cela n'est pas vrai. Au vu du déroulé des agressions sexuelles et des viols, nous constatons qu'il y a toujours une préméditation. Rien n'est soudain. Ces agressions font l'objet d'une vraie stratégie, que je vais tenter de résumer.
Tout d'abord, il faut savoir qu'un agresseur sexuel choisit sa victime. C'est très important. Dans mon travail, j'ai soigné de jeunes violeurs à la prison de Villepinte et ensuite, en réparation pénale. Trois gamins avaient violé et torturé une très vieille dame de quatre-vingt ans qu'ils ne connaissaient pas. La vieille dame, comme toutes les victimes, se demandait « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? ». En consultant le dossier d'aide sociale à l'enfance du meneur de quatorze ans et demi, on a constaté que celui-ci avait subi des attouchements sexuels de la part de sa grand-mère, dix années auparavant. Or ces faits n'avaient été ni traités, ni soignés et il en résultait que le jeune en question détestait les vieilles dames. Il y a toujours quelque chose de cet ordre. La victime se pose la question « Pourquoi moi ? », alors que cette question n'a pas lieu d'être puisque l'explication du viol est étroitement liée au scénario de l'agresseur.
Un autre choix de scénario peut être lié à la facilité ou au lieu de l'agression. Après le viol, l'agresseur isolera la victime. Il pourra s'agir d'un isolement ponctuel dans un coin, mais également à long terme, pour l'empêcher de parler. Puis il essaiera d'inverser la culpabilité. C'est extrêmement important, car les victimes ne comprennent pas bien ce point. Je me souviens d'avoir reçu en consultation une jeune femme qui me racontait comment elle avait été violée, en s'excusant constamment, comme si c'était de sa faute... Elle sortait d'une rupture amoureuse, elle était triste. Ses amies lui avaient proposé de sortir dans un bar pour lui remonter le moral. Il est vrai qu'elles avaient bu un peu. Puis elles étaient rentrées tardivement en métro. Ses amies l'ont laissée car elles habitaient plus près. Elle était donc seule quand elle est descendue à son arrêt. Dans la rue, un homme l'a abordée pour lui dire qu'elle avait l'air triste dans le métro. À ce moment, elle m'a dit qu'elle a tout de suite senti le danger. Elle a essayé de répondre de façon neutre, puis a continué à marcher. Elle s'est soudain retrouvée plaquée contre un mur avec un couteau sous la gorge. Il lui a dit : « Demande-moi d'enlever mon pantalon. » Alors elle a dit : « Enlève ton pantalon. »
Le lendemain, dans mon cabinet médical, la seule chose dont elle se souvenait, c'était : « Vous vous rendez compte ? C'est moi qui lui ai demandé d'enlever son pantalon ! ». C'est une stratégie d'agresseur. Si l'on cherche, on trouvera toujours quelque chose comme cela. Il pourrait aussi avoir dit : « Tu aimes ça ? ». Elle aurait répondu « Oui », pour que cela finisse plus vite. Le risque c'est que ce soit la seule chose qu'on retienne : « Enlève ton pantalon » ! Ce genre de scénario se retrouve dans toutes les histoires.
Par ailleurs, les violeurs - c'est une évidence - ont toujours envie de rester en liberté. C'est pourquoi ils donnent des consignes de silence en terrorisant leurs victimes : « Si tu parles, je te tue ». « Si tu parles, ta mère se suicidera et ta famille sera brisée ». « Si tu parles, tu te retrouveras nue sur Facebook ». Toutes ces menaces sont terrorisantes, et expliquent que les victimes aient du mal à parler.
Dans toutes les situations exposées au téléphone, nous constatons une volonté de nuire, d'anéantir le libre-arbitre et de nier la personne. Je n'ai encore jamais rencontré de victime de viol qui n'ait pas eu, à un moment donné, le sentiment qu'elle allait mourir. Aujourd'hui, nous savons qu'un syndrome post-traumatique apparaît très fréquemment après un viol. En effet, 80 % des victimes de viols présentent de tels syndromes, alors que le taux est de 40 % après un attentat. Pourtant, beaucoup de victimes se disent, dans un premier temps, que cela n'était rien. Elles se rendent donc à leur travail et essaient de vivre comme si de rien n'était. Deux mois ou deux ans après, tout à coup, elles se retrouvent dans une situation de paralysie générale. Elles ont l'impression de devenir folles. En réalité, c'est exactement comme après un attentat. Certaines victimes en sortent soulagées d'être encore vivantes et sans blessure physique. Six mois plus tard, elles sont hantées par des images de bombe et de membres sanglants. Dès lors, elles ne peuvent plus avancer ni travailler.
En étudiant le devenir de ces femmes victimes de viol à partir des appels qu'elles nous adressent, nous avons constaté que 10 à 15 % d'entre elles finissaient par souffrir d'un handicap les empêchant de travailler. Il faut donc mesurer le coût humain et social très important des violences sexuelles.
Pour l'ensemble de ces raisons, j'estime que la justice va devoir faire mieux. Certes, la loi actuelle est satisfaisante, mais depuis 1987, le CFCV défend l'imprescriptibilité des crimes sur les personnes. Nous avons été responsables de la première modification de la loi en 1989 394 ( * ) sur le report de la prescription à dix ans après la majorité. Nous savons que nous avançons à petits pas. Nous avons donc accepté ce délai de dix ans, comme nous avons entériné celui de vingt. Nous accepterons un délai de prescription de trente ans.
Nous savons par ailleurs que les violeurs ne commettent jamais des actes uniques, et qu'ils ont des carrières épouvantablement longues. Par exemple, la victime d'un célèbre sexologue témoignait avoir été violée par lui lorsqu'il était médecin généraliste et qu'elle venait d'accoucher. Son bébé était malade et elle l'avait appelé. Il est venu et l'a violée alors que le bébé se trouvait dans la chambre voisine. Bien des années plus tard, à soixante-douze ans, il trahissait encore son contrôle judiciaire en violant une femme. En d'autres termes, les violeurs le sont à vie. Ils n'envisagent leurs rapports sexuels que sous l'angle de la domination.
Pourtant, moins de 0,5 % des violeurs sont condamnés. Ce qui signifie, a contrario , que 99,5 % des violeurs continuent. Finalement, on peut dire que les récidivistes sont des « idiots » qui se sont fait arrêter deux fois, mais la plupart passent au travers ! Nous avons fait en sorte de rappeler ce point dans le dernier dossier de viol conjugal pour lequel nous nous sommes constitués partie civile. La policière avait fait un travail remarquable. La victime avait porté plainte pour torture et viols de la part de son compagnon. La policière a fait en sorte d'interroger toutes les précédentes compagnes du suspect, au nombre de six. Toutes avaient vécu la même chose. Un violeur n'agit rarement qu'une seule fois. C'est pourquoi nous nous constituons partie civile dans des procès où nous pensons faire avancer un certain nombre d'idées.
Les violeurs se conduisent toujours de la même façon. Un violeur d'enfants qui agit sur sa fille, violera sa petite-fille s'il n'est pas arrêté. Pour cette raison essentielle, la prescription n'a pas de sens. Nous allons être partie civile dans le procès d'un grand-père qui a violé sa fille et sa petite-fille, mais qui bénéficiera de la prescription pour le premier crime. Ce n'est pas juste. Dans le procès pour viol conjugal que je viens d'évoquer, la « carrière » du mari violeur était de vingt-sept ans. La première épouse, lorsqu'elle est venue témoigner à la barre, bien qu'elle n'ait aucune chance d'être reconnue comme victime, n'a même pas voulu donner son adresse. Elle était encore paralysée par la peur.
Pour toutes ces raisons, nous accepterons bien entendu, comme je le disais, une prescription de trente ans, mais préfèrerions dans l'idéal une durée plus longue.
Il en est de même pour ce qui concerne l'âge du consentement d'un mineur à un rapport sexuel avec un adulte. J'aimerais mieux que cet âge soit fixé à quinze ans plutôt que treize ans, mais il faut absolument affirmer qu'avant treize ou quinze ans, un mineur ne peut consentir à un rapport sexuel avec un majeur. Je peux témoigner avoir entendu lors d'un procès, y compris de la part d'un expert-psychiatre, que les viols d'un beau-père sur une petite fille de sept ans relevaient d'une histoire d'amour ! En conséquence, la relaxe a été prononcée. C'est insupportable, mais c'est pourtant comme cela que ça se passe actuellement. Dans le droit actuel, pour obtenir la condamnation d'un rapport sexuel avec un enfant, il faut prouver la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Cela n'est pas juste.
Sur l'inceste, nous avons approuvé la modification législative de 2011 intégrant l'inceste dans la définition du viol. Malheureusement, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, avant d'être réintroduite sous la forme de circonstances aggravantes. Mais cela ne suffit pas, car il faut toujours prouver la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Or comment imaginer qu'un enfant mineur puisse consentir à un acte sexuel avec son papa ou son oncle ? Cela n'est pas concevable !
Dans la grande majorité des cas, les viols surviennent dans l'enfance, à des âges parfois très tendres. Le record français concerne une petite fille de deux jours, violée et tuée dans une maternité par son père. Pour autant, il n'y a pas d'âge pour les victimes de viol lorsqu'elles sont enfants. Actuellement, les enfants ne sont pas protégés. En 1985, lorsque j'ai initié la campagne de prévention contre les agressions sexuelles sur enfants, je me suis heurtée à une ambiance de déni. Il était même prétendu que toutes les petites filles avaient pour fantasme d'avoir des rapports sexuels avec leur père ! Pour lutter contre ce déni, nous avons dû mener une bataille. Puis, nous avons entendu que les mères ne jouaient pas leur rôle de protection. Mais aujourd'hui, alors que les mères tentent de mener à bien cette protection, elles se heurtent aux accusations de manipulation de leurs enfants. Par conséquent, nous ne parvenons pas à protéger les enfants.
En ce moment, je suis le cas de deux soeurs de sept et dix ans, qui se trouvent en résidence alternée. En 2014, une ordonnance de protection avait déjà été prononcée à l'encontre du père pour violences sur la mère. Pourtant, une garde alternée a été décidée. Ces deux petites filles viennent me raconter tous les quinze jours les bleus, les coups avec les ceintures, le fait que le père leur demande de mettre des robes courtes et de se maquiller... Elles racontent aussi qu'elles se retrouvent la nuit dans le lit de leur père sans comprendre pourquoi. Qu'il leur fait du mal. La première fois que je les ai rencontrées, elles m'ont dit : « On ne va pas te parler, sinon on verra papa encore plus. » En effet, à chaque fois que des signalements ont eu lieu, la juge a reproché à la mère de manipuler ses filles. La mère risque même de se voir retirer ses enfants pour qu'elles soient confiées au père. J'ai fait un signalement. J'avais honte. La petite fille m'a dit : « Tu vas voir, cela ne servira à rien. Il est grand, papa. » Je les vois tous les quinze jours, mais je n'arrive pas à les protéger malgré quatre signalements. Je pense qu'il faut repenser toute la protection de l'enfance, en matière de viols d'enfants. Il y a une tolérance infernale de notre société. De surcroît, dans le cadre de notre étude sur Viol et grossesse , nous avons vu un nombre effroyable d'hommes qui reconnaissent l'enfant né du viol, et qui continuent à persécuter la femme par le biais de cet enfant. Elles en prennent pour dix-huit ans !
Nous avons d'ailleurs des témoignages d'enfants nés du viol, qui racontent des choses comme celles-ci. Parfois, nous entendons ces enfants devenues grandes, raconter « J'ai été violée parce que mon père voulait faire du mal à ma mère. » Nous en avons beaucoup. Dans cette tentative de destruction des femmes, ils iront jusque-là.
Dans un tel contexte de violence, la garde alternée doit être exclue. Il faut que vous y pensiez. Je trouve cette situation vraiment dangereuse.
Je souhaite également m'exprimer sur la correctionnalisation des viols. Lorsque le Collectif a ouvert en 1985, environ 2 500 plaintes pour viol étaient dénombrées par an. Ce chiffre a varié régulièrement, pour passer aujourd'hui à environ 12 500 ou 13 000. La réalité est sans doute de 300 000 personnes au minimum. En effet, le viol concerne 86 000 femmes adultes, sachant que les petites filles sont violées deux ou trois fois plus. De plus, 40 % des mineurs violés sont des garçons. Le nombre de victimes de viols est donc probablement de 300 000 en France chaque année. Les victimes âgées n'apparaissent dans aucune enquête, de même que les hommes adultes violés. Le viol des hommes adultes ne se dit pas, ne se déclare pas, de sorte que les chiffres ne sont pas connus. Nous avions travaillé avec la ligne téléphonique de Sida Info Service , qui recevait un grand nombre d'appels d'hommes violés. Les associations ont des difficultés à traiter ce type de viols. Je pense qu'il faudrait se pencher spécifiquement sur ce sujet du viol des hommes, qui est complexe. Pour notre part, 7 % des appels que nous recevons concernent des garçons violés.
Au total, 12 000 plaintes seulement sont déposées chaque année, ce qui est une proportion très faible au vu du nombre réel de viols. Les chiffres sont encore plus préoccupants si l'on considère que depuis quinze ans, seules 1 300 condamnations en cour d'assises sont recensées, correspondant au nombre de places disponibles pour les procès d'assises. C'est-à-dire que sur 2 600 places par an en cour d'assises, 1 300 sont réservées aux procès pour viol, ce qui est présenté comme déjà très significatif. De ce fait, l'ensemble des affaires de viols sont correctionnalisées.
Au cours d'une audience correctionnelle à laquelle j'ai assisté à Bobigny, j'accompagnais un garçon qui avait violé son petit frère. L'audience a commencé à 13h30 par une demi-heure incompréhensible de demandes de renvois. Puis est arrivé un homme qui avait violé ses deux filles. Son cas a été traité en seulement vingt-cinq minutes. Ensuite a été évoqué le dossier d'un homme qui avait enlevé son fils de dix-neuf ans, puis a été traité celui d'un père ayant enlevé et drogué son fils pour l'emmener de force en Égypte. Ensuite seulement le garçon que j'accompagnais a été entendu, en vingt-cinq minutes aussi. Enfin, l'affaire de trois loubards qui avaient volé 254 euros dans une cave a été évoquée. C'étaient les seuls à comparaître incarcérés. Mon « client » a été condamné à deux ans avec sursis, avec obligation de suivi socio-médical pendant deux ans. À la sortie, il n'avait même pas compris la peine à laquelle il avait été condamné !
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Que faisaient tous ces cas de viol en correctionnelle ?
Emmanuelle Piet . - Cette façon de correctionnaliser les viols n'est pas pédagogique et n'a aucun sens. Cela n'est pas possible. À l'inverse, dans une audience d'assises, le temps nécessaire est laissé pour traiter les dossiers. L'audition des témoins permet d'éclairer les choses et de comprendre le contexte. L'accusé comprend en outre la peine à laquelle il est condamné et peut prendre conscience de ce qu'il a fait. Loin de cela, la correctionnalisation est une justice de misère. Il n'est même pas possible de parler de pénétration, puisqu'on ne juge pas un viol, donc on ne parle de rien. Cela n'a pas de sens. Nous sommes très opposés à la correctionnalisation, qui ne permet pas de gagner de temps, contrairement ce que prétendent les avocats et les magistrats. En réalité, la prescription des délits étant beaucoup plus courte, un plus grand nombre de dossiers sont classés. Finalement, même si c'est incontestable, les procès d'assises sont longs - et ce d'autant plus que l'appel est désormais possible - à tout le moins les dossiers y sont traités en profondeur.
S'agissant des prises de plaintes, si je me réfère à mon expérience locale et à l'écoute téléphonique - même si nous n'entendons que les retours faisant état de dysfonctionnements - les femmes qui appellent le Collectif ont porté plainte dans 30 % des cas. C'est beaucoup plus que dans la population générale. Je ne sais pas si ce score s'explique parce que nous sommes efficaces, ou parce que ces victimes ont été héroïques. Je ne sais pas si c'est lié à ce que nous leur disons pour les orienter et les accompagner. Tout de même, les trois derniers refus de plainte qui nous ont été signalés sont particulièrement choquants. La mère d'une jeune fille de quatorze ans enceinte après un viol est allée porter plainte au commissariat, en compagnie de sa fille. Or les policiers ont proféré des propos orduriers à la mère et à la jeune victime, comme si ce viol avait été une partie de plaisir pour cette jeune fille ! La plainte a malgré tout été prise, mais dans des termes ne permettant pas les poursuites.
De façon générale, selon plusieurs adolescentes que j'ai reçues, la Brigade des Familles essaie de dissuader le dépôt de plainte. Il s'agit selon moi d'une forme de maltraitance. D'ailleurs, le fait même que l'agresseur soit présumé innocent implique, en bonne logique, que la victime soit présumée menteuse. La victime le ressent très fortement. De plus, lorsque les victimes portent plainte dans un commissariat, la première chose qu'elles voient, en général, est une affiche rappelant les condamnations en cas de dénonciation calomnieuse, qui est dissuasive en elle-même. Un tel rappel n'étant nullement une obligation légale, c'est donc véritablement un choix.
Récemment, j'ai suivi le cas d'une jeune femme vulnérable, prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et amenée par une éducatrice. Cette jeune fille ayant été violée, elle en a immédiatement informé son éducatrice. Le garçon l'a poursuivie jusqu'à l'entrée de l'ASE, de sorte que l'éducatrice a dû appeler la police. La victime et son agresseur ont été entendus par les policiers. La jeune fille m'a affirmé que la policière lui avait laissé croire qu'elle irait en prison pour deux ans si elle maintenait sa plainte. Par conséquent, la jeune fille a retiré sa plainte. J'imagine que la policière n'a pas exactement dit cela mais tout de même, c'est ce que la jeune fille a compris. De ce fait, la plainte n'a pas été prise, malgré l'appel réitéré de l'éducatrice.
Sur le viol conjugal, nous avons encore des témoignages selon lesquels la police a dit « C'est votre mari, vous n'allez pas faire d'histoires ». Nous entendons encore ce genre de propos tenus par la police, en France ! On nous assène encore le « devoir conjugal ».
En définitive, je ne sais pas si la pré-plainte en ligne annoncée par le Gouvernement pourrait modifier ces situations. Tout d'abord, il faut savoir écrire et manier Internet. Je travaille en Seine-Saint-Denis, où un grand nombre de personnes ont des difficultés en la matière. Il existe une vraie fracture dans notre pays. De façon générale, les victimes ont besoin d'un contact humain empathique. Je ne prétends pas qu'il faut tout croire. Je dis seulement qu'au moment où la victime est entendue, il ne faut pas lui donner l'impression d'être prise pour une menteuse. Les professionnels compétents doivent tout entendre, puis mener leur enquête sans exposer leurs doutes de prime abord. Les victimes, confrontées à une attitude suspicieuse, sont totalement paralysées. Il est vrai que des guides ont été réalisés pour la conduite de ce type d'audition, mais ils ne sont pas toujours appliqués dans la pratique quotidienne.
En tout état de cause, il faut signaler que les prévenus comparaissent tous libres devant le tribunal, et qu'ils sont encore libres pendant les suspensions d'audience. C'est pour cette raison que nous accompagnons les femmes aux procès : il faut leur éviter cette confrontation avec leur agresseur. Nous ne pouvons cependant pas assister à toutes les audiences. Or il est impossible pour la victime de se déplacer dans le tribunal, au risque d'être contrainte d'y côtoyer son agresseur. La protection des victimes dans les salles de justice n'est pas assurée à l'heure actuelle. Dans le cabinet du juge, les choses sont souvent mieux faites, ce qui n'est pas le cas dans les salles d'attente qui réunissent les témoins, les victimes, les agresseurs et leurs amis. C'est effrayant. Il faudrait réfléchir à organiser les choses différemment.
Sur la prise en charge, il y a un vrai progrès à faire pour les professionnels du soin. En ce qui me concerne, je pose deux questions aux psychiatres avant de leur adresser des enfants. Dans le cas d'enfants effectuant une révélation de viol, procèdent-ils automatiquement à un signalement ? Dans le cas d'un enfant qui leur est adressé après un signalement, acceptent-ils de commencer leur prise en charge en disant à l'enfant : « Je sais ce qui s'est passé. L'agresseur n'avait pas le droit et tu n'y es pour rien. » ? Si le psychiatre ne répond pas positivement à ces deux questions, je ne lui confie pas l'enfant. Or beaucoup de professionnels du soin ne correspondent pas à ces critères.
Sur la prise en charge des psycho-traumas, des progrès commencent à être constatés. Toutefois, actuellement, la prise en charge à 100 % de ces soins n'est possible que pour les consultations de psychiatres, et non pour celles des psychologues. C'est dommage.
Enfin, il faut améliorer la recherche sur le psycho-trauma, pour mieux prendre en compte les conséquences des violences sexuelles pour la société dans son ensemble.
Annick Billon, présidente . - Merci Docteur, pour votre intervention. Nous avons apprécié la qualité de vos propos, ainsi que la franchise avec laquelle vous vous êtes exprimée. Vous vous êtes prononcée clairement sur le délai de prescription, l'âge du consentement et la résidence alternée. Sur ce dernier point, nous savons que si la résidence alternée était instaurée de manière automatique, cela ne permettrait pas de prendre en compte de manière rigoureuse les problèmes de violence et d'emprise au sein du couple.
Roland Courteau . - J'ai particulièrement apprécié votre exposé. J'ai été choqué par certains passages, s'agissant des viols perpétrés par le conjoint, concubin et partenaire pacsé ; ces faits démontrent que pour une femme, le foyer n'est pas toujours un refuge. J'ai reçu la semaine dernière une femme victime de violences conjugales, qui a commencé son récit puis s'est interrompue. Je lui ai demandé pourquoi elle s'était arrêtée. Elle m'a répondu qu'elle allait dire une bêtise. Je l'ai engagée à continuer, et elle m'a déclaré : « Il me roue de coups, il me prend de force mais j'allais vous dire une bêtise. Cela n'est pas du viol puisque je suis mariée et qu'il y a le devoir conjugal. » Par conséquent, en 2018, la notion de « devoir conjugal » n'est pas encore tombée en désuétude, comme vous le disiez.
Par ailleurs, dans la loi du 4 avril 2006 395 ( * ) , j'avais proposé que le mariage, le concubinage ou le PACS puissent constituer une circonstance aggravante en cas de violences conjugales. Aujourd'hui, le viol, lorsqu'il est commis au sein du couple, peut faire l'objet d'une condamnation de vingt ans pour circonstance aggravante. En revanche, si le viol est commis sur une inconnue, la peine est de quinze ans. Cela nous a été reproché. Je souhaiterais savoir ce que vous en pensez, puisque certains considèrent que le viol d'une inconnue, par la surprise, l'angoisse de la mort et l'effroi qu'il suscite, devrait être plus sévèrement puni que le viol conjugal. Quelle est votre position sur ce point ?
Enfin, vous avez dit qu'un violeur restait un violeur et que trop peu (0,5 %) étaient condamnés. Ceux qui le sont reçoivent-ils une obligation de soin ? Un violeur soigné peut-il ne plus être récidiviste ?
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Les propos d'Emmanuelle Piet sont effrayants, car ils proviennent d'une experte de terrain, après l'accumulation d'années d'expérience et de travail. Cette connaissance percute toutes nos représentations et toutes les satisfactions que nous pouvons éprouver du fait de quelques améliorations réalisées. Il faut en même temps avoir en tête que les progrès existent, mais que la situation reste terrifiante.
J'aurai deux mots sur la tolérance de notre société aux viols commis sur les enfants. En refaisant l'histoire, nous constatons qu'en matière de viols sur les femmes, le mouvement féministe a permis de lever le voile sur ces sujets. Aujourd'hui, nous sommes bien plus avancés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que celles commises sur les enfants sont toujours un sujet totalement tabou.
Pour ma part, je ne dirai pas qu'il y a une sorte de tolérance sur les violences faites aux enfants, mais qu'il s'agit plutôt d'une représentation collective de la famille, incompatible avec la compréhension des violences intrafamiliales. En d'autres termes, la famille passe pour un lieu de protection des enfants. Il s'agit quasiment d'un sujet politique et institutionnel. Affirmer l'existence de violences intrafamiliales aboutirait à changer le regard sur l'institution familiale, qui est l'une des institutions centrales de notre organisation collective et sociale. Cette institution est extrêmement résistante à l'idée d'être remise en cause, et décrite dans la diversité de ses réalités. Dans les propos du Docteur Piet, j'ai été frappée de la difficulté, dans les jugements de divorce, à faire entendre par le juge les violences faites aux enfants.
Lors des débats sur la disposition interdisant la fessée, que j'avais introduite dans le cadre de l'examen du projet de loi égalité et citoyenneté - elle a été censurée par le Conseil constitutionnel -, nous étions bien conscients que de temps à autre, un parent peut avoir un moment d'agacement. Or il existe une différence entre un moment d'agacement, et le fait de faire des punitions corporelles une méthode éducative. Nous voulions marquer dans la loi l'affirmation que les punitions corporelles n'étaient pas une méthode éducative. De plus, lorsque des violences physiques sont pratiquées à titre éducatif, la frontière est encore plus mince avec les abus sexuels. Souvent, il y a un continuum , comme pour les femmes. Les parents qui frappent sont peu respectueux du corps de leurs enfants. Dans cette délégation, nous devons avoir en tête ce continuum et la cohérence de cette approche.
J'évoquerai également le syndrome d'aliénation parentale (SAP), qui décrit les enfants victimes de mères manipulatrices. Ce syndrome, qui a toutes les apparences d'un syndrome médicalement constaté et reconnu, est en fait une mystification totale. Il n'y a aucune réalité scientifique du SAP, qui est pourtant devenu l'alibi scientifique et médical à la disqualification de la parole des mères, et au maintien du droit de visite et d'hébergement de pères maltraitants. Encore aujourd'hui, sur certains sites, y compris sur celui du ministère des Affaires étrangères, le terme « syndrome d'aliénation parentale » est employé. J'avais alerté les autorités à ce sujet. Les juges l'utilisent. Je conclurai sur ce point, en partageant les propos du Docteur Piet. Nous sommes bien sûr conscients du risque de manipulation, qui existe. Mais pour avoir interrogé les juges en matière de dénonciation de viols par des femmes adultes, il est rare d'avoir affaire à de fausses allégations. En matière de justice familiale, c'est un peu plus fréquent. Pour autant, cela ne justifie pas la disqualification globale de la parole des mères en matière de protection des enfants. C'est pourquoi il est nécessaire que les juges changent de culture.
En matière de justice pénale, je ne sais pas s'il faut allonger la durée des peines. Je pense nécessaire, dans un premier temps, d'appliquer celles qui existent, d'accompagner les victimes et de sanctionner les violeurs. Ce serait déjà énorme. En outre, un travail très conséquent doit être accompli en matière de justice civile, qui est insuffisamment présente dans la modification des comportements et la défense des victimes. Je souhaite savoir si le Docteur Piet partage ce point de vue.
Annick Billon, présidente . - Vos témoignages, Docteur Piet, ont beaucoup ému l'assistance. Je vous laisse répondre aux deux premières questions avant de recueillir les suivantes.
Emmanuelle Piet . - Le viol conjugal n'est reconnu en France que depuis 1992. Pourtant, plusieurs articles du code civil mentionnent la « communauté de vie » et les « obligations et devoirs » des époux, qui interrogent nos représentations du devoir conjugal... Peut-être faudrait-il songer à toiletter le code civil...
Dans les violences conjugales, je pense qu'il y a 100 % de viols. Je n'ai jamais vu de femme victime de violences conjugales à qui des rapports sexuels n'avaient pas été imposés. En tant que médecin, je rédige depuis quarante ans des certificats médicaux de contre-indication aux rapports sexuels, qui ont le mérite de faire prendre conscience aux femmes la situation de violence qu'elles subissent. Ce ne sont pas des faux, puisque j'estime contre-indiqué, sur le plan médical, d'avoir des rapports sexuels quand on n'en a pas envie. J'ai rédigé le premier certificat de cette nature pour une patiente souffrant de graves séquelles médicales après une épisiotomie. J'ai simplement mentionné que les rapports sexuels devaient être évités. Sur la table d'examen, la patiente m'a rétorqué : « Si vous croyez que c'est moi qui décide... ». Je lui ai répondu : « Si ce n'est pas vous, ce sera moi » et j'ai rédigé mon premier certificat médical pour quinze jours. La patiente m'a alors demandé d'une petite voix : « Vous ne pourriez pas mettre plus ? ». Je lui ai répondu que j'allais de toute façon devoir la revoir très vite, afin de vérifier l'évolution de son épisiotomie. Finalement, ces certificats sont entrés dans ma pratique quotidienne. Parfois, les femmes reviennent en disant que le certificat a eu des résultats positifs, car elles ont pu se reposer et même, communiquer avec leur conjoint. Dans d'autres cas, elles disent que le mari « a fait quand même, car il se fiche de ma santé. » À travers ce type de constats, elles prennent conscience peu à peu qu'elles sont prisonnières de la notion de devoir conjugal.
Mon autre « arme » est de rédiger des ordonnances de lubrifiants remboursés par la Sécurité sociale. Un rapport non consenti étant très douloureux, il est moins pénible si l'on utilise du lubrifiant. Après une ordonnance que je rédige pour quinze jours, les femmes reviennent me voir. Certaines d'entre elles m'indiquent que leurs rapports sexuels sont en nette amélioration. D'autres, en revanche, me disent : « Il n'aime pas quand je n'ai pas mal » : dans ce cas, nous avons bien affaire à des violeurs, mais une femme qui prononce ces paroles commence déjà à cheminer vers la prise de conscience de sa situation.
Une étude menée sur des femmes violées et battues hébergées par SOS Femmes avait comptabilisé quarante-et-une grossesses ayant abouti à un enfant, vingt fausses couches et trois fois plus d'enfants prématurés qu'en population générale. De même, le nombre d'accouchements à domicile était cent fois plus élevé que dans la population générale. En outre, 100 % de ces femmes avaient été battues pendant la grossesse, y compris sur le ventre. 82 % avaient subi des agressions sexuelles pendant la grossesse. Le viol est présent en permanence. Dans une histoire collective, vingt ans est une période courte pour transformer les mentalités.
Concernant les violeurs, il est vrai que certains auront des obligations de soins. Sur ce point, je trouve dommage que l'obligation de soins ne commence qu'à la sortie de prison, ou puisse être un palliatif à la prison. Pourtant, les soins pourraient plus utilement commencer pendant que les violeurs sont incarcérés. À la prison de Villepinte, de 1997 à 2000, j'ai organisé des groupes de parole pour les enfants agresseurs sexuels, violeurs et criminels de sang. J'ai rencontré 119 enfants. J'ai cessé volontairement ces consultations en 2000 car le poste de la psychologue du quartier des mineurs avait été supprimé. Ces enfants avaient tous pour point commun, dans leur histoire, d'avoir été gravement maltraités et agressés sexuellement, de venir d'un pays dans lequel ils avaient assisté ou participé à des évènements violents. Ils avaient aussi été affectés par un abandon grave autour d'eux ou par une mort violente et injuste. J'ai repris les groupes de parole dans le cadre de la réparation pénale. Le tribunal nous envoyait des enfants agresseurs sexuels dits « légers ».
En 2011, lors de l'étude menée sur ces enfants, nous avons trouvé parmi eux 90 % d'enfants maltraités, 30 % d'enfants agressés sexuellement, 65 % d'enfants abandonnés par le père, la mère ou les deux parents et 60 % d'enfants ayant vu leur père battre leur mère. La violence s'apprend avant tout à la maison, dans son corps, sa chair et sa vie. Ce n'est qu'ensuite qu'on se trouve conforté par les images violentes vues à la télévision ou sur Internet, mais de telles images ne sont pas nécessairement le point de départ de la violence.
Lorsque j'aide les jeunes violeurs à faire le lien avec ce qu'ils ont vécu, et que je les entends parler de ce qu'ils ont vécu, ce que personne ne fait jamais, je pense que c'est utile. Ces enfants ont vécu des horreurs que jamais personne n'a écoutées ou entendues.
Je pense à ce gamin de dix-sept ans, au quartier des mineurs, qui m'a demandé à comprendre pourquoi il avait été violeur. Il faisait du football dans un club et avait été agressé sexuellement à l'âge de onze ans par l'entraîneur. En réalité, il avait été vendu par son père à l'entraîneur de football, qui tenait également un réseau de prostitution de petits garçons. Il avait alors fugué pendant six ans, sans que le collège ou l'assistante sociale ne s'en inquiètent ! Nous l'avons retrouvé à dix-sept ans, violeur d'un petit garçon de onze ans. Lorsque les jeunes visionnent le film que nous leur projetons, dans lequel un petit joueur de football entre seul dans le vestiaire avec l'entraîneur pendant que la porte se referme, je demande : « Que s'est-il passé, à votre avis dans ce vestiaire ? ». Les élèves de quatrième répondent, en général, qu'il a été victime d'une agression. Les jeunes en prison répondent en termes beaucoup plus crus. Je demande ensuite : « Que croyez-vous qu'il a pensé, ressenti ? ». D'habitude, on me dit : « Il a eu peur, il a eu mal ». Pourtant ce garçon m'a dit : « Sûrement qu'il a kiffé ». Je lui dis : « Tu crois qu'on peut kiffer ça ? ». Il répond : « Oui. ». Lorsque j'ai poursuivi mon questionnement, il a changé de position et a fini par dire : « Non. On ne peut pas ». À partir de ce moment, il a fait un bon travail avec la psychologue. C'était en 1997. Avec la psychologue, nous avons fait un signalement au procureur. Bien entendu, l'affaire a été classée. Personnellement, je ne sais pas soigner cet enfant.
Ces gamins agressés sexuellement, qui deviennent à leur tour agresseurs subissent à chaque fois une fouille à corps lorsqu'ils arrivent en prison. Personnellement, j'estime qu'il s'agit d'une agression sexuelle caractérisée. Une agression par l'État ! Pratiquée sur des enfants, cela peut aggraver leur état. Et je ne parle pas des adultes... Nous pouvons faire quelque chose pour les agresseurs, mais c'est un vrai travail.
Pour les enfants, il faut se souvenir que la protection de l'enfance n'a été confiée aux PMI et aux missions scolaires que depuis 1983, date des deux circulaires Ralite. Il s'agissait d'une réelle progression mais, manifestement, nous avons beaucoup reculé ces vingt dernières années. Les meurtres d'enfants sont bien plus fréquents que les meurtres de femmes, mais je trouve qu'il existe une tolérance sidérante à ces crimes. Madame Courjault a accompli à peine trois ans de prison et élève aujourd'hui ses enfants alors qu'elle en a mis quatre dans un congélateur ! On pense qu'une mère est nécessairement gentille alors qu'il y a des tueuses. Ce n'est pas comme si l'on affirmait que toutes les mères sont tueuses. Il y a des tueuses, et puis il y a des mères. Il faut arriver à le penser pour parvenir à protéger les enfants.
J'ai mené la campagne de prévention des agressions sexuelles à l'encontre des enfants. La première fois que je suis allée dans une classe, c'était en 1985 dans un CM2 tranquille. J'étais naïve à l'époque. Il y avait vingt-sept enfants de dix ans et c'était une première pour nous. Lorsque j'ai innocemment demandé quelles étaient les punitions à la maison, j'ai entendu « claques », « fessées », « martinet »... Et puis un enfant m'a répondu : « la casserole d'eau bouillante ». Je le revois encore... Finalement, il s'est avéré qu'un seul enfant n'était pas battu, dans ce quartier pavillonnaire de classes moyennes. Je leur ai dit que si c'était trop, les services de protection de l'enfance pouvaient les protéger. Pourtant, si vous ne faites pas une loi en ce sens, on ne peut pas protéger les enfants. J'exprime le besoin de cette loi depuis trente-cinq ans, peut-être cela viendra-t-il. Mais tout de même, je ne peux pas dire cela aux enfants : « Je peux te protéger si c'est trop ». Qui apprécie ce « trop » ? C'est un alibi formidable pour la maltraitance. Bien évidemment, nous avons besoin de cette loi.
Annick Billon, présidente . - Vous êtes passionnée et passionnante. Ce que vous nous racontez est terrible.
Christine Prunaud . - Alors que nous avons quelques connaissances sur les violences faites aux femmes, sujet auquel nous sommes sensibles, vos interventions nous ont bousculées. Des violences faites aux femmes, vous en êtes venue à la protection de l'enfance, ce que j'ai apprécié. J'ignorais qu'il existait un tel manque en la matière. Je pense que nous travaillerons sur le fait que la famille n'est pas toujours un lieu de sécurité. Merci de nous avoir rappelé cette urgence.
Maryvonne Blondin . - J'ai récemment rencontré dans mon département des juges, avocats, procureurs et policiers. Je peux témoigner que la priorité est donnée aux violences et que la répression est avérée. La formation à l'accueil des femmes qui déposent plainte est également assurée. De réels progrès ont été accomplis.
Vous avez parlé du cercle familial ; je parlerais plutôt du cercle de confiance, qui permet à toutes les personnes gravitant autour de l'enfant de perpétrer des violences. Quelles sont vos propositions en matière d'accompagnement et de réparation psychologique ?
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Je souhaiterais insister sur au moins trois points. Pour nous, il est important que la loi intègre bien la protection des victimes, notamment des enfants et des femmes. Je pense qu'on ne peut pas être un bon père lorsqu'on est un homme violent. Il faut le réaffirmer et le revendiquer. Lorsqu'on parle de protection, je suis frappée par le fait que les professionnels sont assez démunis face aux témoignages de violences recueillis de la part des enfants. Plus on donne des éléments qui, normalement, devraient permettre de mettre fin au droit de visite du père violent, et plus souvent la mère est accusée de manipulation. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour empêcher ce type de situation totalement injuste.
En outre, il faut réfléchir à ne pas réunir dans les commissariats et les tribunaux les victimes et leurs familles, ainsi que les agresseurs. J'ai été convoquée dans un commissariat en tant que témoin pour une comparution face à un agresseur. Je peux vous dire que c'est très impressionnant ; pourtant je n'avais pas les mêmes raisons qu'une victime d'avoir peur de cette confrontation : il faut impérativement protéger les victimes et les témoins.
En troisième lieu, en termes de formation, des policiers m'ont indiqué que les formations qui leur sont destinées sont facultatives. Il y a certainement un élément à améliorer.
Maryse Carrère . - Dans le cadre du groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, nous avons auditionné beaucoup de magistrats, de policiers et de gendarmes. Les personnels de justice, dans leur majorité, ne souhaitent pas voir modifier le délai de prescription, car ils invoquent la problématique de la preuve. On nous dit que le remède sera pire que le mal. Vingt ou trente après, il est difficile de faire la preuve d'un viol, et les victimes sont effondrées de n'avoir pu le faire.
Joëlle Garriaud-Maylam . - Pour nuancer les propos de Laurence Rossignol, je dirais qu'en règle générale, la famille est aussi un socle protecteur. Il y a des choses à faire pour aider les parents, dans certains cas. Il y a sept ans, j'avais proposé la création au Sénat d'une délégation aux droits des enfants, mais ma proposition n'avait pas été retenue. Je pense que c'est aujourd'hui devenu une exigence.
Emmanuelle Piet . - Sur l'intérêt de la protection des enfants, je me suis occupée de ce sujet pendant toute ma carrière, en PMI. En France, une femme sur dix est victime de son compagnon. Le chiffre est multiplié par trois lorsqu'elle a été battue dans l'enfance, et par cinq lorsqu'elle a été agressée. Il serait donc intéressant de soigner les enfants victimes, pour leur éviter d'être à nouveau victimes à l'âge adulte, et de passer éventuellement dans le camp des agresseurs. D'une façon plus générale, la prévention de toute violence passe par la protection des enfants.
En tout état de cause, il faut faire la différence entre l'erreur éducative et la maltraitance grave. La mode actuelle du placement à domicile est une erreur totale. 90 % des violeurs de femmes et d'enfants sont des proches, et beaucoup plus rarement des inconnus. Pour moi, c'est la priorité : si on veut arrêter la violence, il faut prévoir des moyens pour garantir une vraie prise en charge de ces enfants, notamment psychologique.
En matière de preuve, il faut dire qu'il y en a rarement dans les viols. C'est souvent l'accumulation qui fait la preuve. Un gynécologue a pu violer des femmes pendant trente ans, et seuls les derniers témoignages ont permis de l'établir.
Enfin, je regrette de ne pas avoir eu le temps de m'exprimer sur les mutilations génitales féminines, mais je reste à votre disposition pour évoquer ce sujet.
Annick Billon, présidente . - Merci beaucoup pour votre témoignage précieux et pour la franchise avec laquelle vous vous êtes exprimée. Cette franchise a mis en exergue la difficulté que nous avons à avancer sur ces sujets. Notre délégation va continuer à travailler sur ces sujets très complexes et sensibles.
Audition d'Élisabeth
Moiron-Braud, secrétaire générale de la Mission
interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences
et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) et de Flavie
Flament, co-présidente de la Mission de consensus sur le délai de
prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur.e.s
(18
janvier 2018)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, nous poursuivons notre matinée par l'audition de Mmes Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la MIPROF, et Flavie Flament, pour évoquer les conclusions de la Mission de consensus sur le délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineur-e-s.
Je rappelle que ce travail, co-présidé par Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes, a été mandaté par Laurence Rossignol, alors ministre des Familles, de l'enfance et des droits des femmes, que je salue, et que le rapport de la commission a été publié en avril 2017. Ses conclusions sont aujourd'hui au coeur de l'actualité, puisque le Gouvernement a annoncé un projet de loi sur les violences faites aux femmes, qui pourrait prévoir un allongement des délais de prescription applicables aux infractions sexuelles commises contre les mineurs, comme l'a recommandé la Mission de consensus .
Mesdames, nous vous recevons pour vous écouter sur toutes ces propositions. Nous souhaiterions tout d'abord que vous nous dressiez le bilan de la Mission de consensus , à travers une présentation de ses méthodes de travail et de ses principales recommandations. Dans quel esprit avez-vous travaillé ? Quelles personnes avez-vous entendues pour préparer ce rapport ? Comment s'est formé le « consensus » sur cette question ?
Dans un second temps, nous souhaiterions que vous puissiez commenter les principales orientations du projet de loi annoncé par le Gouvernement, à la lumière des conclusions de la mission de consensus : problématique de la prescription d'une part, question de la présomption de contrainte avec l'instauration d'un seuil d'âge en dessous duquel on présumerait l'absence de consentement du mineur ayant une relation sexuelle avec un majeur, d'autre part.
Nous accueillons nos deux collègues représentants de la commission des lois qui a constitué un groupe de travail sur ces questions. Je salue donc Maryse Carrère et Marie Mercier et leur souhaite la bienvenue à la délégation aux droits des femmes.
Je vous remercie chaleureusement d'être venues jusqu'à nous et je vous laisse sans plus tarder la parole, en vous laissant vous organiser entre vous pour la présentation des différents thèmes.
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et vous poseront des questions.
Flavie Flament . - Merci à vous toutes et tous de nous accueillir. Je suis très satisfaite et particulièrement émue de constater que tout le travail que nous avons entrepris suite à la parution de mon livre, La Consolation , et à travers la mission que nous avons menée avec Jacques Calmettes et Élisabeth Moiron-Braud, continue à porter ses fruits. La première à s'être emparée de ce sujet est Laurence Rossignol qui, trois semaines après la parution de mon livre, a souhaité me rencontrer. Nous nous sommes vues à plusieurs reprises. Je lui ai expliqué ce qui avait motivé l'écriture de mon ouvrage, question qui nous réunit aussi, c'est-à-dire les délais de prescription en matière de crimes sexuels sur mineurs. Laurence Rossignol m'a indiqué qu'elle souhaitait initier cette mission de consensus consacrée à une réflexion autour des délais de prescription, afin de donner à son successeur les éléments d'information nécessaires pour s'emparer de la question au plus vite. J'ai trouvé extraordinaire cette idée de transmission, car il restait quelques mois de travail avant les élections et la formation du nouveau gouvernement. Nous avons donc bénéficié d'un vrai tremplin pour que le rapport puisse être remis à Marlène Schiappa, qui a succédé à Laurence Rossignol au ministère chargé des droits des femmes. Cette mission de consensus était très importante car pour la première fois, elle permettait de placer les victimes au coeur du débat.
En tant que victime, je n'aurais jamais écrit La Consolation si j'avais eu le sentiment d'avoir été entendue, considérée, écoutée. J'avais au contraire celui qu'on me privait de mon libre arbitre et de ma capacité à analyser une situation, de ma possibilité de désigner mon violeur et de poser des actes pour faire en sorte que justice soit rendue. J'ai souhaité prendre une parole dont on me privait. Je m'en suis emparée, avec tous les risques que cela comportait. Souvent, on parle de ces questions sans écouter les victimes, dont on estime qu'elles ne sont pas en mesure d'avoir un point de vue tout à fait construit sur le sujet. C'est une erreur. Les victimes sont des expertes de ce qui leur arrive. En étant écoutées, elles peuvent aider à faire avancer les choses. La mission de consensus a été créée de manière assez inédite, accueillant les victimes autour de la table à titre d'experts. Il nous a semblé important qu'elles puissent s'exprimer, mais aussi communiquer avec des personnes ouvertes - magistrats, psychiatres, spécialistes de la loi.... Toutes ces personnes se trouvaient enfin réunies pour échanger leurs points de vue et exprimer leurs ressentis. De semaine en semaine, nous nous sommes rendu compte que les esprits s'ouvraient et que les victimes avaient enfin le sentiment d'être entendues.
Au fur et à mesure de ces auditions, nous avons convenu tous ensemble de recommandations qui vont dans le sens de chacun. Nous avons trouvé une sorte de modus vivendi , qui conduit aujourd'hui les associations à saluer ce rapport de mission. Les recommandations ne sont pas inapplicables. Nous avons fait en sorte que les choses avancent de façon concrète, et pas uniquement de façon théorique ou philosophique.
Finalement, on se trompe souvent de regard sur les victimes. On a tendance à penser qu'une victime est diminuée par ce qu'elle a vécu. À titre personnel, je peux vous dire qu'il n'est pas facile de libérer sa parole. Notre mission s'intéresse d'ailleurs à tout ce qui peut entraver leur parole lorsqu'elles sont mineures. S'attaquer à un enfant est un crime spécifique : ils ne sont pas construits de la même façon qu'un adulte et se trouvent submergés par une forme de honte et partagés entre des conflits de loyautés concurrentes. L'amnésie traumatique est également un phénomène important. Le fait qu'une victime puisse enfin libérer sa parole et sentir une écoute en face d'elle, une attention particulière portée à son vécu, est essentiel à sa reconstruction. En cela, l'allongement des délais de prescription est une occasion supplémentaire donnée à des enfants traumatisés de pouvoir s'en sortir. La petite fille violée demeure en moi. En n'écoutant pas de façon bienveillante les victimes et en ne leur apportant pas un accompagnement psychologique, on construit une société malade, car les enfants victimes sont le monde de demain. Mon documentaire, « Viols sur mineurs, mon combat contre l'oubli », diffusé en novembre sur France 5 , démontre de façon inédite les conséquences physiques des traumatismes sur le cerveau, telles que la maladie d'Alzheimer. Les hippocampes atrophiés de mon cerveau, visualisés par IRM, témoignent de mon traumatisme.
Depuis la parution de La Consolation , j'ai le sentiment que nous assistons à une prise de conscience générale, qui va dans le bon sens. J'espère que nous pourrons rapidement trouver une solution législative aux recommandations contenues dans le rapport.
Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) . - Je vous remercie de nous avoir invitées à nous exprimer sur ce sujet. Effectivement comme l'a dit Flavie, nous avons auditionné des experts - magistrats, avocats, psychiatres, psychologues, chercheurs - et des victimes, ce qui nous a amenés à prendre en compte tous les aspects du sujet. À titre personnel, les travaux que nous avons menés m'ont permis de mieux appréhender les spécificités et les lourdes conséquences qu'entrainent les violences sexuelles subies durant l'enfance.
En tant que magistrate et secrétaire générale de la MIPROF, j'aborderai le point de vue juridique et judiciaire. Lorsque Laurence Rossignol nous a demandé de mettre en place la Mission de consensus , elle nous a indiqué avoir entendu les demandes d'allongement du délai de prescription, mais également les magistrats qui soulevaient les problèmes de la déperdition de la preuve. Elle avait donc beaucoup d'interrogations et souhaitait qu'un rapport soit élaboré pour contribuer à la réflexion. J'espère que celui-ci aidera le Parlement lorsque le projet de loi sera examiné.
En premier lieu, le sujet de l'allongement des délais de prescription est débattu depuis de nombreuses années. Les crimes sexuels sur mineurs présentent des spécificités. Ces crimes sont commis sur des enfants, particulièrement vulnérables, souvent dans un contexte familial ou dans l'environnement proche de la victime (école, centre sportif, communauté religieuse...), ce qui crée des situations d'emprise et des conflits de loyauté. Surtout, on constate fréquemment chez ces victimes un sentiment de honte et de culpabilité, ainsi que la peur de ne pas être entendues. Les conséquences sur leur psychisme sont telles qu'une amnésie traumatique peut intervenir. Cela a été le cas de Flavie et nous avons également entendu les témoignages concordants de nombreuses autres victimes lors de la mission de consensus. Le législateur a souhaité prendre en compte dès 2004 ces spécificités, notamment en termes de délai de prescription. La loi Perben du 9 mars 2004 396 ( * ) a donc instauré un délai dérogatoire de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs de vingt ans commençant à courir à compter de la majorité de la victime. Après 2004, au moins cinq propositions de lois ont porté sur un nouvel allongement du délai de prescription, voire sur l'imprescriptibilité. Dans certaines affaires emblématiques en effet, un grand nombre de victimes se sont vu opposer ce délai de prescription de vingt ans.
Plus près de nous, la loi du 17 février 2017 397 ( * ) est très importante dans l'évolution du droit de la prescription. Elle porte à vingt ans le délai de prescription pour tous les crimes. Son article 7 définit un certain nombre d'exceptions concernant les crimes les plus graves pour lesquels un délai dérogatoire de trente ans est retenu.
Le législateur a pris en compte l'allongement de la durée de vie et les progrès de la science qui permettent de recueillir les preuves, des années après les faits. Les débats lors de l'examen de cette loi ont révélé un changement de regard sur la société, qualifiée désormais de « société de la mémoire ». Cette conception récuse le droit à l'oubli, qui était le fondement de la prescription de l'action publique. L'oubli n'apparaît plus pertinent à l'heure où la parole de la victime est de plus en plus entendue. J'ai connu l'époque où la victime était entendue en qualité de partie civile et recevable à demander des dommages et intérêts. Aujourd'hui, la victime est véritablement partie au procès pénal.
Au cours des débats devant le Parlement, de nombreux amendements ont été déposés, mais non adoptés, soit pour voir déclarer imprescriptibles les crimes sexuels sur mineur, soit pour porter le délai de prescription à trente ans. Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineur s'aligne aujourd'hui sur celui des autres crimes, soit vingt ans. Il ne diffère que sur le point de départ des délais, soit à compter de la majorité de la victime. Si le législateur qualifie ce crime de « particulièrement grave », il n'en a pas tiré toutes les conséquences puisque le caractère dérogatoire du délai est très atténué.
Au cours de la mission de consensus, nous avons auditionné un grand nombre d'experts. Aucun argument déterminant ne nous a permis de considérer que la prescription de vingt ans devait être maintenue en l'état. À la suite des auditions, nous sommes parvenus à la conclusion de la nécessité d'un allongement du délai de prescription. Nous avons aussi été sensibles aux arguments sur l'imprescriptibilité, hypothèse évoquée dans le rapport mais mise de côté. Il est vrai qu'en France, l'imprescriptibilité est une exception suprême, applicable uniquement aux crimes contre l'Humanité, même si la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental ni d'un principe de valeur constitutionnelle 398 ( * ) . Cela étant, nous avons considéré qu'une telle réforme devait s'inscrire dans une réflexion plus large portant sur les crimes les plus graves, à l'image de ce qui est appliqué en Grande-Bretagne, en Suisse et dans l'État de Californie.
Considérant que les crimes sexuels sur mineurs présentent des spécificités et un caractère de particulière gravité incontestée, un délai dérogatoire de prescription devait pouvoir s'appliquer alors même que l'article 7 de la loi de 2017 a prévu un délai dérogatoire de trente ans pour les crimes de guerre et le trafic de stupéfiants ou les infractions terroristes. De surcroît, le rapport de la mission a considéré que la fixation du point de départ du délai à dix-huit ans - l'âge de la majorité - ne constitue pas une réelle dérogation. En effet, il paraît naturel que le délai parte de la majorité, âge auquel la victime pourra ester en justice.
C'est ainsi que la recommandation n° 1 du rapport préconise que le délai de prescription applicable aux crimes sexuels sur mineurs bénéficie du régime dérogatoire prévu par l'article 7 de la loi, et soit donc porté à trente ans.
Il est souvent opposé à l'allongement du délai de prescription le problème du dépérissement des preuves et que plus le temps passe, plus il sera difficile de juger de tels faits. Cependant, les procédures d'enquête se fondent sur la recherche de faisceaux d'indices graves et concordants, des témoignages, des enregistrements... Or nous sommes entrés dans l'ère numérique et les progrès scientifiques permettent une amélioration du recueil des preuves telles que les traces ADN, les caméras de surveillance, les messages.
Enfin, la preuve en matière de violences sexuelles pose toujours des difficultés, quel que soit le délai de prescription retenu. L'argument souvent invoqué du traumatisme que représenterait pour les victimes une affaire classée ou un acquittement paraît inopérant. En effet, ce n'est pas à nous de décider à la place des victimes ce qui est bon ou mauvais pour elles. L'important est que la parole des victimes soit entendue. Si ces dernières ont décidé d'engager une action en justice, elles doivent être accompagnées et soutenues psychologiquement pendant toute la procédure par des associations qui jouent un rôle essentiel.
Enfin, la troisième partie du rapport préconise un meilleur repérage des victimes par la formation des professionnels, et un accompagnement renforcé des victimes.
Annick Billon, présidente . - Merci, Mesdames, pour la clarté de vos propos. Chère Flavie Flament, merci en particulier pour votre témoignage. Nous savons qu'il n'est pas facile d'évoquer de tels faits, même avec la libération de la parole. Nous avons reçu, hier après-midi, Sandrine Rousseau. Même si la parole se libère, elle se paie aujourd'hui très cher. Sandrine Rousseau nous disait que sur la quinzaine de victimes qui avaient osé parler en 2016, une seule faisait encore partie du groupe politique auquel elles appartenaient. Comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas, et on ne doit pas, se mettre à la place des victimes. Nous devons juste essayer de les comprendre et de les aider dans le chemin qu'elles ont à parcourir.
Flavie Flament . - Je pense qu'effectivement, il faut entendre les victimes et les accompagner, mais aussi s'enrichir de leur expérience et de leur capacité à analyser ce qu'elles ont vécu. Une victime entend l'injonction de sortir de ce statut de victime, et de se débrouiller avec ce vécu. Bien sûr, mais pas seule ! Nous ne pouvons pas nous en sortir sans aide. En revanche, lorsque nous sommes reçues, accompagnées et écoutées, nous pouvons enrichir le débat. Nous sommes une parole qui n'a pas été assez entendue ni considérée. Qui sont ceux qui peuvent parler à la place des victimes, en prétendant savoir mieux qu'elles comment agir ? Pour ma part, je pense que la parole de la victime est enrichissante.
Marc Laménie . - Merci, Mesdames, pour vos témoignages, et pour le travail important que vous avez accompli. Vous avez beaucoup évoqué l'écoute des victimes. Le document très dense que vous avez produit fait état de la complexité juridique des questions de prescription. Sur le délai de prescription, que conviendrait-il de faire ? Les intervenants sont nombreux, la justice est complexe. Je représente un département rural, dans lequel les professionnels de terrain ne sont pas suffisamment formés. Comment faire en sorte d'aboutir à un travail, et à un résultat ?
Roland Courteau . - J'étais déjà convaincu de la nécessité de porter le délai de prescription à trente ans, puisque j'avais déposé le texte d'une proposition de loi en ce sens il y a un an. En vous entendant, je pense que je pencherais aujourd'hui vers l'imprescriptibilité.
Céline Boulay-Espéronnier . - L'imprescriptibilité est-elle la meilleure arme anti-récidive ?
Marie Mercier . - À la commission des lois, nous avons eu un changement de regard. Dans ces questions, le prêt à penser est à bannir. Nous continuons à travailler sur un allongement du délai de prescription. Trente ans ? Imprescriptibilité ? Tout doit être fait dans l'intérêt de la victime. Il faut donner des lieux de parole, mais également des formations à ceux qui vont la recueillir. Nous travaillons sur la prise en charge, capitale, des plaignants et des victimes. Qu'est-ce que les victimes attendent d'un procès, une justice restaurative ?
Laurence Cohen, co-rapporteure . - J'ai lu attentivement les recommandations de votre rapport. Lors de l'audition du Docteur Piet, il a été mis en évidence que lorsque des enfants témoignent contre le père, la mère est parfois accusée de manipulation pour en avoir la garde. Finalement, la situation se retournera dans certains cas contre l'enfant, sa garde étant confiée au père violent. Le fait de recueillir la parole n'est pas toujours un gage de protection. La recommandation n° 5 de la Mission de consensus devrait beaucoup plus insister sur la nécessité de croire en la parole de l'enfant et de protéger celui-ci. Lorsqu'un enfant se confie à un adulte et qu'il n'est pas entendu, il en ressent un douloureux constat d'impuissance.
Annick Billon, présidente . - Comment libérer la parole des enfants, après celle des adultes ? Nous savons qu'il y a beaucoup de violences faites aux enfants.
Flavie Flament . - Je ressens que vous insistez sur l'accompagnement des victimes. Aujourd'hui, la parole des adultes s'est libérée, mais on se sent toujours seul au monde, comme je l'ai ressenti il y a dix-huit mois en témoignant pour la première fois. Il est donc extrêmement important d'accompagner les victimes pour consolider leur confiance en leur propre parole. Il n'y a rien de pire pour un enfant que de s'exprimer « dans le vent » et de constater que ce qu'il dit est vain. L'accompagnement doit intervenir dès la libération de la parole. C'est pourquoi les médecins doivent avant tout être aptes à recevoir cette parole. Il y a une façon de poser les questions, une délicatesse à acquérir lorsqu'on parle avec des victimes. De même, les équipes d'enseignants doivent pouvoir repérer des victimes dont la parole ne se libère pas.
Au commissariat, lorsqu'une victime porte plainte, les policiers ne sont pas nécessairement formés. C'est pourquoi il semble difficile pour une victime d'aller dans un commissariat raconter ce qu'elle a vécu, pour retourner ensuite dans son cadre habituel où elle se retrouvera confrontée à son prédateur. Il faut donc que la parole ne soit pas fragilisée et contredite. Pour moi, il a été fondamental, pour ma reconstruction, de sentir que l'on me croyait. Lorsque les adultes peuvent venir désigner leur violeur, il est important de leur donner une marche à suivre, de les orienter vers des associations et de leur donner l'assurance qu'ils (ou elles) seront accompagnés jusqu'au procès.
Je pense qu'il faut expliquer aux victimes les risques qu'elles peuvent courir en portant plainte. Si la victime choisit en connaissance de cause d'aller au procès, le traumatisme ne sera pas celui du non-lieu. Le procès est une occasion, pour la victime, de « remettre le monde à l'endroit ». J'aurais voulu voir David Hamilton dans un prétoire, et lui faire sentir que j'étais du côté de la parole entendue. Sur le banc des accusés, j'aurais aimé que la honte change de camp. C'est l'occasion pour la victime de se dire qu'elle est du bon côté de la société. Je n'ai pas eu cette chance, et j'ai donc dû prendre la parole dans un procès en quelque sorte privé, grâce à mon livre. David Hamilton s'est suicidé juste après avoir appris qu'une de ses victimes se trouvait encore dans les délais de prescription pour déposer plainte.
Nous n'attendons pas de la justice qu'elle nous répare intégralement, mais qu'elle remette le monde à l'endroit.
Élisabeth Moiron-Braud . - Sur le sujet du repérage, il convient de souligner qu'une victime entendue dans un commissariat, par des policiers formés à l'écoute, bénéficiera d'une prise en charge bien plus satisfaisante. Il faut donc former les professionnels en créant des outils pour les formateurs, ainsi que le prévoit la loi du 4 août 2014 399 ( * ) . C'est d'ailleurs une des principales actions de la MIPROF. Par ailleurs, il est nécessaire de lancer des campagnes d'information régulières en direction de la société, sur les violences. Aujourd'hui, les non-dits dans les familles et dans les communautés sont encore trop nombreux. La loi ne fait pas tout ; il faut que la société tout entière change de regard sur les violences sexuelles.
Une fois la procédure judiciaire enclenchée, il est indispensable que les associations accompagnent les victimes tout au long de ce parcours. En cas de non-lieu, la victime doit pouvoir être informée par le magistrat en présence d'une association d'aide aux victimes.
Annick Billon, présidente . - Si j'avais une phrase à retenir de cette audition, Mesdames, ce serait « Remettre le monde à l'endroit » : ces mots résument l'essentiel de ce qui nous a été dit sur le vécu des victimes. Nous avons également souvent entendu la volonté que la honte change de camp. Comme vous l'avez souligné, il importe de mettre l'accent sur le coût qu'aura, pour la société, la parole non entendue d'un enfant. Celui-ci se construira alors sur de très mauvaises bases, avec des conséquences dont nous n'avons pas conscience aujourd'hui.
Jacqueline Eustache-Brinio . - Dans notre pays, les inégalités territoriales sont nombreuses. Dans la région Ile-de-France dont je suis élue, des initiatives ont été prises pour l'accueil des victimes dans les commissariats. Tel n'est pas le cas dans d'autres régions. Il s'agit un vrai problème en termes d'égalité de traitement de la victime.
Par ailleurs, il faut aussi que la parole se libère dans les établissements scolaires. Je suis très inquiète de la situation qui empire dans les collèges : les rapports filles-garçons, l'éducation à la sexualité qui ne peut être abordée... C'est un combat qu'il faut mener.
Flavie Flament . - Avant tout, je pense qu'il faut envoyer un signal aux victimes en leur demandant de parler. En Angleterre, lors du scandale dans le monde du football, un message a été diffusé à l'intention des victimes pour les inciter à venir parler. Cette invitation à la parole doit être lancée aux adultes et aux enfants. Dans les lycées et les collèges, je travaille avec des associations qui expliquent aux jeunes comment réagir et prendre la parole, avec le concours d'un ancien négociateur du Raid !
Élisabeth Moiron-Braud . - S'agissant de la présomption de contrainte, j'ai co-présidé la commission « Violence » du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) qui a élaboré un rapport sur le viol 400 ( * ) . Nous avons rendu un avis au terme duquel nous recommandons que soit instauré un seuil d'âge de treize ans en-dessous duquel un enfant est présumé ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur. Il s'agit d'une présomption irréfragable. L'âge de treize ans en-dessous duquel un mineur est présumé contraint paraît raisonnable. Entre treize et quinze ans, le texte sur l'atteinte sexuelle s'appliquerait.
Je voudrais également souligner qu'instaurer une telle présomption assurerait une meilleure sécurité juridique ; la contrainte morale, prévue par le code pénal, est en effet difficile à apprécier et les décisions de justice varient selon les territoires.
Annick Billon, présidente . - Ce sujet fera également l'objet de débats.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Lorsque le HCE s'est prononcé sur l'âge de treize ans, le moment était différent, notamment lorsque les pays européens avaient eux-mêmes adopté cet âge. Aujourd'hui, l'âge de quinze ans est plutôt retenu.
Élisabeth Moiron-Braud . - Nous avons préconisé treize ans, car il s'agit d'une présomption irréfragable. Il faut faire attention à l'âge de quinze ans, en particulier dans le cas d'un acte sexuel entre un mineur de quinze ans et un jeune majeur de dix-neuf ans.
Annick Billon, présidente . - Merci à tous pour votre participation. Il est ici question de la place des femmes et des hommes dans la société, du respect entre les femmes et les hommes et du respect des corps. Les solutions seront difficiles à trancher.
Audition de la
Fédération nationale solidarité femmes (FNSF)
(18
janvier 2018)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de ce matin avec les représentantes de la Fédération Nationale Solidarité Femmes : Françoise Brié, sa directrice générale, que j'ai rencontrée au Haut conseil à l'égalité (HCE), est accompagnée de Dominique Guillen-Isenmann, présidente, de Josette Gonzales, avocate et de Priscilla Fert, chargée de mission « Justice ».
Je rappelle à l'attention des représentantes de la FNSF que notre délégation a souhaité travailler cette année - actualité oblige - sur les violences faites aux femmes, afin de préparer l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
Nos questionnements concernent tout le spectre des violences faites aux femmes, y compris évidemment les violences conjugales, mais le rapport d'information que nous préparons portera plus particulièrement sur le drame des violences sexuelles et les obstacles qui jalonnent le parcours judiciaire des victimes. Nous nous intéressons, bien sûr, à l'accompagnement et à la prise en charge médicale et psychologique de ces victimes, jeunes et moins jeunes.
La Fédération nationale Solidarité femmes ( FNSF ), réseau de 67 associations, gère le 3919 , devenu en 2014 le numéro national de référence pour l'accueil et l'orientation téléphoniques des femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient, et pas spécifiquement les victimes de violences conjugales.
Pouvez-vous nous présenter le réseau que vous animez ? Comment s'explique, selon vous, l'évolution du volume d'appels reçus sur le 3919 dans la durée ? Il semblerait qu'en 2016 une baisse des appels sur le 3919 ait été enregistrée par rapport à 2015. Comment l'expliquez-vous ?
Nous aimerions avoir des éléments statistiques sur la répartition des appels en fonction des violences concernées : violences au sein des couples, y compris viol conjugal, harcèlement sexuel au travail, harcèlement sexuel en ligne, agressions sexuelles, viol...
On sait en revanche que le 3919 , en lien avec l'actualité, a connu durant le dernier trimestre 2017 une hausse significative d'appels. Cette augmentation pose évidemment la question des moyens dont dispose votre association pour mener à bien sa mission. Nous vous invitons à nous en parler.
À ce sujet, le président de la République a annoncé, le 25 novembre 2017, la création d'une application numérique pour aider les victimes de cyber-violences, que la FNSF est chargée de développer. Qu'en est-il des moyens dont vous disposez pour mener à bien cette nouvelle mission ? La délégation s'intéressant de près à la question des cyber-violences faites aux femmes, pouvez-vous nous en dire plus sur cette application ?
De manière générale, le 3919 ayant vocation à écouter des femmes victimes de violences très diverses, ce qui suppose des aptitudes d'ordre psychologique et des connaissances assez pointues pour les conseiller et les orienter au mieux, nous aimerions savoir comment vous formez vos accueillantes.
Je donne la parole à nos interlocutrices, qui s'organiseront à leur guise pour présenter l'action de la FNSF en se répartissant ces diverses thématiques dans le temps de parole qui leur est proposé.
Dominique Guillen-Isenmann, présidente de la Fédération Nationale Solidarité femmes . - Je suis présidente de la FNSF et administratrice de SOS Femmes Solidarité Strasbourg , puisque notre fédération a la particularité d'avoir, au sein de son conseil d'administration, des représentants des différents territoires. Les mouvements Solidarité Femmes ont pris naissance dans les années 1970-1975 autour du militantisme féministe et des combats d'alors, au travers de quelques associations ayant rapidement repéré qu'un grand nombre de femmes étaient victimes de violences dans leur couple. Partant de ce constat, quelques associations se sont créées en France. Puis elles ont souhaité entrer dans une démarche de coordination, dans un souci d'efficacité et dans le but d'échanger autour de la question des violences conjugales et intrafamiliales (mariages forcés souvent suivis de violences conjugales par exemple).
La FNSF est née dans un premier temps « de bric et de broc », avec une déclaration officielle en 1987. Sa taille est relativement petite, car elle comporte aujourd'hui 67 associations membres faisant partie de huit territoires, aussi bien en métropole qu'en Outre-mer (Guadeloupe, Martinique). Nous avons également des demandes concernant La Réunion, et souhaiterions pouvoir toucher aussi la Guyane. Les associations sont réparties sur le territoire de manière assez égale, sauf peut-être dans certains territoires isolés du centre de la France. Nous ne désespérons pas, toutefois, de pouvoir couvrir ces territoires dans le cadre de notre réseau.
Nos missions générales sont diversifiées. Elles concernent la prévention des violences à l'encontre des femmes et la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes. Depuis plusieurs années, nous incluons dans le volet « prévention » les jeunes femmes, voire les très jeunes et les mineures.
En ce qui concerne la prise en charge et l'hébergement des femmes victimes de violences avec ou sans enfants, nous avons mis en place des actions spécifiques car les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles sont des violences de genre, nécessitant aussi un accompagnement long et soutenu. Nous avons également été parmi les premières à nous intéresser aux enfants vivant dans un climat de violence, ce qui fait d'eux inévitablement des victimes.
Le troisième volet concerne la formation et la sensibilisation de tous les professionnels qui interviennent, c'est-à-dire notamment les gendarmes et policiers, le corps médical et paramédical, les travailleurs sociaux.
Dans le domaine juridique, nous nous efforçons également d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics, d'une manière générale dans tout ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons ainsi été sollicitées par le gouvernement actuel, mais également par les précédents autour des différentes lois et plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes. De la même manière, nous espérons être force de proposition sur le texte annoncé par le Gouvernement.
En termes de chiffres, la Fédération reçoit 50 000 appels pris en charge au 3919 . 30 000 femmes victimes sont suivies au sein de services d'accueil (lieux d'écoute et d'accueil ou accueils de jour départementaux), mis en place en 2012 sur le territoire français par le précédent gouvernement. 6 500 femmes et enfants sont hébergés dans nos associations. Nous sommes spécialisés dans la mise en sécurité des femmes en très grand danger, qui peuvent, dans un délai de huit à quinze jours au maximum, être transférées dans un autre de nos établissements pour fuir un danger de mort. L'an dernier, 123 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint. Plus de 2 000 femmes et enfants ont été relogés depuis 2009, notamment en région Ile-de-France, par les quatorze associations Solidarité Femmes, dans le circuit habitation « normal » avec le soutien des bailleurs sociaux.
Un observatoire national des violences conjugales permet à la fédération nationale d'analyser les statistiques avec du recul.
Enfin, les campagnes de sensibilisation des professionnels et du grand public dépendent de nos finances qui, comme vous en doutez, sont limitées. De telles campagnes, variables selon les années, influent notamment sur la masse des appels reçus aux 3919 .
Françoise Brié, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes . - En matière de violences faites aux femmes, il est important de soutenir les structures spécialisées. En effet, les dispositifs généralistes peuvent permettre le repérage des victimes mais ne sont pas toujours adaptés à leur prise en charge, compte tenu de la spécificité des situations et des formes des violences. Nous plaidons en conséquence pour un accompagnement dédié.
Sur le plan politique, notre analyse porte sur le fait que ces violences sont des violences de genre, se déroulant dans un contexte d'inégalités femmes-hommes. C'est pourquoi notre travail aux côté des femmes vise à déconstruire les stéréotypes qui sont à la base des inégalités. Par conséquent, notre accompagnement n'est pas uniquement technique ; il s'efforce aussi de faire prendre conscience aux femmes des violences machistes et du contexte de domination dans lequel elles vivent.
Le 3919 a été créé en 1992 à l'initiative de la FNSF par une ligne d'écoute, la première à destination des femmes victimes de violences conjugales. Le soutien financier de l'État a abouti à la création de ce numéro. En 2007, le 3919 a vu le jour, dans un premier temps accessible du lundi au samedi de 9 heures à 22 heures. Depuis 2014, le numéro est totalement gratuit, y compris depuis les téléphones mobiles, et ouvert sept jours sur sept.
La typologie des appelantes au 3919 réunit les victimes, les tiers et les professionnels. Quelques hommes victimes appellent également, mais le pourcentage est infime, de même que celui des auteurs de violences qui nous contactent.
L'équipe du 3919 compte vingt-cinq écoutantes et trois chargées de pré-accueil en CDI à temps plein ou à temps partiel, soit environ seize équivalents temps plein (ETP). Sur la plateforme, nous avons cinq à sept personnes en permanence, écoutantes et chargées de pré-accueil. La plateforme est divisée en deux parties : un pré-accueil qui reçoit les appels et, en fonction de leur typologie, les oriente vers les écoutantes qui interviennent à un deuxième niveau ou vers les associations partenaires. L'équipe pluridisciplinaire compte des professionnelles issues du travail social (assistantes sociales, éducatrices...) mais également des psychologues, des juristes, des conseillères conjugales... Elles reçoivent une formation en double écoute pendant un mois minimum, puis sont formés en interne en continu. Cette formation de base est dispensée à toutes les équipes du réseau, tandis qu'une juriste les accompagne dans leurs questionnements. D'autres formations sont ensuite dispensées régulièrement.
Il est important de souligner que l'écoute est réellement un métier. Il faut pouvoir écouter les victimes à travers l'information qu'elles apportent, mais aussi les soutenir et les encourager dans leurs décisions et démarches. En outre, le 3919 comporte une base de données de plusieurs milliers d'adresses, pour orienter les femmes au plus près de leur lieu de résidence.
S'agissant des typologies des violences, les motifs d'appels concernent dans leur très grande majorité des violences conjugales. Ainsi, le 3919 reçoit environ 5 000 appels par mois. En 2017 (données non consolidées), plus de 90 % des appels relevaient des violences conjugales (femme victime et homme auteur). De façon générale, nous souhaiterions que le projet de loi annoncé par le Gouvernement couvre aussi le champ des violences conjugales - y compris dans leur dimension sexuelle -, d'une part parce qu'il s'agit de violences sexistes, et d'autre part, parce que les enfants en sont également victimes. En effet, les viols et agressions sexuelles sur les enfants sont fréquents dans un contexte de violences conjugales. En 2016, 4,3 % des appels pris en charge (979) concernaient des violences sexuelles ou du harcèlement sexuel au travail. Nous avons une convention avec d'autres associations ( CFCV 401 ( * ) , AVFT 402 ( * ) , CIDFF 403 ( * ) , FDFA 404 ( * ) , ADN 405 ( * ) ) afin d'orienter vers elles les appels ne portant pas sur les violences conjugales, y compris la prostitution. Nous avons également une convention avec le 119 .
En 2017, 1 493 appels (6,8 %) concernaient les violences sexuelles ou du harcèlement sexuel au travail, dont 50 % recensés au dernier trimestre, en lien avec la libération de la parole dans le contexte que nous connaissons.
Par ailleurs, la plateforme du 3919 est organisée pour recevoir des appels en continu. Nous avions mené en 2014 une grande campagne de communication qui a eu des effets sur le flux d'appels reçus en 2015. La baisse des appels en 2016 s'explique en partie par le non-renouvellement de cette campagne.
En tout état de cause, il est important que les campagnes de communication permettent de repérer le numéro d'appel en continu, avec des diffusions locales toute l'année. Si nous n'anticipons pas les pics d'appel, nous pouvons difficilement y faire face, sachant que la plateforme a déjà du mal à répondre à tous les appels en temps normal. Des moyens supplémentaires seraient nécessaires sur la plateforme à hauteur de trois équivalents temps plein (ETP) sur toute l'année.
Josette Gonzales, avocate . - J'ai été longtemps avocate, et je suis actuellement présidente de l'association de Marseille, qui est de taille importante. Nous sommes en effet la seule association des Bouches-du-Rhône à travailler spécifiquement sur les violences conjugales. Toutefois, nous recevons des appels de victimes de toutes les formes de violences.
En premier lieu, le projet de loi annoncé par le Gouvernement doit évoquer le sujet du délai de prescription en cas de crimes sexuels sur mineurs. Nos associations connaissent les difficultés des victimes à déposer plainte, encore accrues lorsqu'il s'agit de violences commises au sein du couple ou de la famille. Il faut parfois des décennies pour parvenir à dénoncer ces faits.
Je rappelle que les viols sur mineurs peuvent actuellement être poursuivis pendant vingt ans après la majorité de la victime, donc jusqu'aux trente-huit ans de celle-ci. Or dans la pratique nous constatons que, passé ce délai, nombre de femmes ne parviennent pas encore à dénoncer les viols dont elles ont été victimes enfants. Les autres agressions sexuelles et viols sur mineurs sont prescrits sur dix ans, sauf pour les moins de quinze ans. Nous estimons que ce délai devrait être prolongé, tant pour les victimes mineures que majeures. Il est très important que les personnes puissent déposer plainte, même si sur le plan juridique elles n'obtiennent pas satisfaction. C'est pourquoi nous sommes favorables à un allongement conséquent du délai de prescription.
Par ailleurs, le projet de loi devrait porter sur l'instauration d'un âge minimum au-dessous duquel un enfant ou un adolescent serait présumé comme non-consentant à l'acte sexuel. Actuellement, aucun âge n'est fixé, ce qui est fort préjudiciable, comme nous avons pu le constater dans l'actualité. La fédération considère qu'au-dessous d'un certain âge, il faut absolument protéger les enfants de leurs agresseurs. Ainsi, nous sommes favorables à ce que les actes sexuels entre majeurs et jeunes de moins de quinze ans constituent une agression sexuelle ou un viol, selon les cas. C'est cohérent avec la notion actuelle de majorité sexuelle. Concrètement, il nous semble important que soit interdit tout acte sexuel entre une personne majeure et un ou une mineure, avec une présomption irréfragable de non-consentement, de façon à ce que la victime mineure n'ait pas à apporter la preuve de son absence de consentement.
S'agissant des relations entre adolescents, et entre adolescents et jeunes majeurs, qui ne relèvent pas tout à fait de notre domaine, nous pourrions sans doute nous inspirer du droit canadien. Dans ce pays en effet, il est prévu de ne pas pénaliser les relations consenties entre adolescents de treize à quinze ans, ou entre adolescents de treize à quinze ans avec des jeunes de quinze à dix-huit ans.
Françoise Brié . - L'an dernier, treize mineures ont appelé le 3919 . Nous recevons de très jeunes femmes, dont 11 % de moins de vingt-cinq ans. Nos structures reçoivent en outre entre 11 et 14 % de femmes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans.
Nous notons également que dans le cadre des actions de prévention menées dans les établissements scolaires, nos associations sont sollicitées par des jeunes femmes mineures à propos de leurs relations amoureuses. Les démarches sont compliquées par le fait que ces dernières résident chez leurs parents, de sorte qu'un accompagnement particulier doit être mis en place. Par ailleurs, nous constatons que les femmes de dix-huit à vingt-cinq ans victimes de violences dans le couple font les mêmes demandes que les autres femmes, c'est-à-dire conseil, accompagnement et hébergement. Enfin, 18 % des femmes en très grand danger qui sollicitent l'éloignement géographique ont entre dix-huit et vingt-cinq ans.
Josette Gonzales . - Sur le harcèlement dit de rue, l'article 222-33 du code pénal n'est pas spécifique au travail et peut être appliqué. Nous ne sommes cependant pas opposées à ce qu'un texte dédié condamne le harcèlement de rue et les violences sexistes. Une prévention et une communication forte pourraient également être prévues pour faire en sorte que ce harcèlement diminue.
Concernant le viol conjugal, la France a ratifié la Convention d'Istanbul 406 ( * ) . De ce fait, il importerait que notre droit en reprenne les dispositions. Le problème du consentement est un problème majeur car, actuellement, la victime doit prouver qu'elle n'a pas consenti. Nous souhaiterions, pour ce domaine spécifique du viol, que la charge de la preuve soit inversée, et que ce soit à l'auteur de prouver qu'il a obtenu le consentement de la victime. Par ailleurs, les viols conjugaux se déroulent toujours dans un cadre privé.
Françoise Brié . - La Convention d'Istanbul a une définition claire sur le sujet. Je vous suggère également de lire le rapport explicatif, qui en commente les différents alinéas.
Josette Gonzales . - La convention détaille les notions de viol et de consentement. Il nous semble important de mieux définir ces situations, car trop peu de femmes déposent plainte pour viol, a fortiori pour viol conjugal. Pour elles, parler de viol est encore inconcevable. Dans un certain nombre de commissariats ou de services de gendarmerie, il leur est encore affirmé que le viol entre époux n'existe pas. Le « devoir conjugal » est encore mentionné, y compris dans certains tribunaux ! Par conséquent, un travail important de formation des acteurs et partenaires reste à accomplir. Nous déplorons également que les crimes sexistes et viols conjugaux soient requalifiés presque systématiquement en agressions sexuelles. Nous sommes contre la correctionnalisation de faits criminels.
Françoise Brié . - En 2016, au 3919 , sur 9 480 femmes victimes de violences conjugales perpétrées par un homme auteur, pour lesquelles l'indicateur violences sexuelles a été renseigné, 713 ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, soit 7,7 %, ce qui est infime par rapport à la réalité. Pour ces déclarantes, les violences subies sont les suivantes : le viol conjugal (53 %), les pratiques sexuelles imposées (18,5 %), un partenaire sexuel imposé par l'agresseur (pour 23 femmes déclarantes), la prostitution forcée (14 femmes déclarantes). De plus, 25 % des victimes dénoncent du harcèlement sexuel. Nous avons noté que, parmi ces victimes, 44 % avaient déjà effectué une démarche auprès des services de police et de gendarmerie, avec des réponses plutôt positives dans notre échantillon. En effet lorsqu'il y a révélation de viol conjugal ou de tentative, 69,2 % et 61,4 % respectivement avaient déposé plainte. Par la suite, le processus de réponse judiciaire est réellement compliqué pour les victimes.
Annick Billon, présidente . - Merci pour tous ces éléments de réponse très clairs sur les chiffres du 3919 , mais également sur le délai de prescription des crimes sexuels commis contre les mineurs. Vous vous prononcez en effet pour l'imprescriptibilité ou, au minimum, pour l'allongement de ce délai. Il me semble que l'allongement du délai de prescription à trente ans fait son chemin en ce moment.
Concernant l'âge du consentement, vous avez également une position tout à fait claire, dont nous vous remercions.
Dans votre présentation, j'ai noté le point relatif à la formation des écoutantes au 3919 . Quelles sont les qualités que vous demandez à ces personnes, qui vont peut-être faire en sorte que la victime poursuive dans sa démarche ou s'arrête totalement ?
S'agissant du dépôt de plainte en ligne, qui me paraît être une bonne idée, un argument majeur a été soulevé par le Docteur Emmanuelle Piet : la maîtrise de la langue et de l'informatique. Que pouvez-vous nous dire sur cette pré-plainte en ligne, étant observé que finalement, le téléphone semble plus simple à utiliser ?
Sur la pénalisation du harcèlement, vous apportez aussi des réponses intéressantes.
Françoise Brié . - Les écoutantes sont en général issues du travail social : assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, conseillères conjugales, juristes, psychologues... Lorsqu'elles arrivent au niveau de l'écoute téléphonique, elles ont déjà plus d'un mois de double écoute avec une écoutante en place depuis quelques années, afin d'acquérir cette écoute empathique qui amène l'appelante à raconter son histoire. Elles reçoivent également une formation de base organisée par la FNSF avec les associations du réseau, axée sur les violences conjugales et sur la déconstruction des stéréotypes sexistes. Cette formation est assurée par une formatrice diplômée. Par ailleurs, il est important d'indiquer que les écoutantes sont en lien avec notre réseau. Nous avons aussi des formations sur les femmes étrangères, sur la santé...
Certaines écoutantes sont salariées au 3919 depuis la création de la ligne, soit vingt-cinq ans, et ont donc acquis une expertise autour de l'écoute empathique. Les méthodes d'écoute sont professionnelles. Au sein du service, sont également menées des analyses de pratique. En effet, les écoutantes qui reçoivent des appels pendant quelques heures sur des cas de violences parfois extrêmement lourds, doivent avoir la possibilité de débriefer et de travailler en équipe, pour être soutenues dans leur pratique. Ces écoutantes expliquent très bien que lors des appels, qui durent en général vingt à trente minutes, elles sont dans une posture de concentration vers la victime, pour des conversations particulièrement éprouvantes. Il n'est pas possible d'imaginer une telle écoute sans professionnalisme au niveau de la plateforme. Il faut mettre de la distance.
Victoire Jasmin . - Merci pour tout ce que vous nous apportez. Je suis sénatrice de la Guadeloupe et fais également partie de l'association FORCES , avec l'Observatoire féminin de la Guadeloupe. Ma question portera sur les différents échanges de ce matin. S'agissant des réseaux, vous avez précisé que des efforts restaient encore accomplir dans certaines régions.
Au-delà des espaces de paroles pour les victimes et des formations destinées aux professionnels qui font partie de votre association, formez-vous des acteurs de terrain ? En effet, bien souvent, nous constatons que les problèmes les plus récurrents concernent d'autres acteurs, tels que les policiers et les gendarmes qui reçoivent les victimes. Un certain nombre d'entre elles ne sont pas toujours très bien accueillies, alors même qu'elles sont déjà choquées et ont hésité à faire la démarche consistant à déposer plainte.
Françoise Brié . - La FNSF a un service agréé de formation, qui peut être utilisé par les autres structures. Notre réseau compte également des services de formation agréés. Les associations sont très impliquées dans la formation des professionnels, qu'il faut avant tout penser en termes de parcours des femmes. En d'autres termes, il est nécessaire que des personnes soient formées au repérage et à la culture commune sur les violences sexistes. Il ne suffit pas d'apprendre la technique. C'est pourquoi, lorsque nous organisons des formations, nous travaillons avec les personnels sur la déconstruction de leurs propres préjugés sexistes, ce qui demande du temps. Généralement, nos formations se déroulent en deux ou trois jours, avec un retour sur expérience des personnes formées, ainsi qu'un travail en réseau. Il importe en effet que les femmes, une fois repérées, puissent être orientées vers les services adéquats dans les différents départements.
En tout état de cause, il est essentiel d'acquérir une culture commune pour parler le même langage aux femmes, et éviter ainsi les injonctions contradictoires.
Annick Billon, présidente . - Cette question me rappelle notre audition d'hier avec Sandrine Rousseau sur la libéralisation de la parole, qui faisait état de la nécessité pour les femmes d'être accompagnées par un médecin femme juste après un viol.
Françoise Brié . - Dans notre réseau, les premières écoutantes sont uniquement des femmes. En revanche, les associations de notre réseau comptent des hommes assistants sociaux, psychologues et juristes.
Victoire Jasmin . - Dans les échanges d'hier, il a été question de femmes entendues par des personnes n'ayant pas bénéficié de ce travail de déconstruction. De ce fait, ces personnes pouvaient porter des jugements de valeur sur les victimes. C'est pourquoi la déconstruction des stéréotypes me paraît également essentielle, de même que le travail en réseau.
Françoise Brié . - J'ai été directrice d'un centre d'accueil et d'hébergement pendant quelques années. L'accompagnement sur le terrain consiste aussi en cette mise en réseau. S'agissant de l'accueil et du parcours des femmes, il faut garder à l'esprit que dans les commissariats, en particulier en Ile-de-France, plusieurs personnes peuvent être mutées en une seule fois. Dans les parquets, les substituts spécialisés avec lesquels nous avons commencé à établir des liens, changent également. Par conséquent, le travail doit être mené en continu pour garantir un bon accueil des victimes de violences sexuelles par les policiers et les magistrats. Il est en outre essentiel que nous soyons associés aux formations de ces acteurs. En 2006, une convention a été signée avec le ministère de l'Intérieur, mais n'est que peu appliquée aujourd'hui.
Sur la prise en charge psychologique et l'accompagnement des femmes, il faut aussi souligner que la femme est motrice dans son parcours. Au 3919 , nous accompagnons sa décision. Je vous renvoie au travail de Patricia Romito et à ses études réalisées en Angleterre et aux États-Unis. Cette professeure de psychologie sociale se félicite de ce que la question du stress post-traumatique ait fait reconnaître les femmes comme victimes, à la fois sur le plan politique et sur le plan des souffrances. Toutefois, après un certain nombre d'années, les questions politiques de fond sur l'agresseur et les violences machistes font encore considérer la femme comme une personne malade en quelque sorte. Patricia Romito estime par conséquent qu'il est nécessaire de trouver un équilibre sur ce sujet, et d'impliquer encore davantage les associations féministes dans l'accompagnement et sur le plan politique. Nos structures, qui comptent des psychologues, peuvent contribuer à apporter cet éclairage.
En termes de reconstruction des femmes victimes de viols ou de violences sexuelles, il ne faut pas négliger le fait que ces dernières ont de nombreuses problématiques à gérer : ressources, hébergement, logement, emploi... Ces éléments doivent par conséquent être inclus dans le suivi que nous leur proposons en réseau. À défaut, les femmes ne seront pas en mesure de redevenir autonomes sur du long terme. Ainsi que le démontrent toutes les études, les femmes se reconstruisent plus efficacement, et se trouvent moins dans la souffrance quand elles ont par exemple retrouvé un emploi. Dans certains départements, dont les Hauts-de-Seine (92), il existe des conventions entre nos associations et les services de santé, qui nous adressent les femmes après un repérage. Nous sommes également présents dans des permanences tenues au sein des hôpitaux. Dans les situations de grave danger, les femmes peuvent être hébergées sur demande des services de santé à partir de notre analyse.
En définitive, le travail en réseau est essentiel. La prise en charge du stress post-traumatique ne peut être déconnectée du reste.
Dominique Guillen-Isenmann . - Comme l'a déjà souligné Françoise Brié, s'agissant des personnels de police et de gendarmerie, non seulement les formations sont très courtes, mais ces personnels bougent beaucoup. J'ai pu le constater lors de mon expérience personnelle à Strasbourg. C'est pourquoi la formation doit être un effort permanent, ce qui implique des effectifs et de l'argent. Ce qui est fait une fois ne suffit pas.
Un important travail de formation doit être aussi mené dans les parquets et chez les juges aux affaires familiales (JAF). Pour les médecins, en particulier les médecins de famille, il faut améliorer le repérage ainsi que la formation sur les conséquences physiques et psychiques des violences. Pourtant, le Conseil de l'ordre estime qu'un médecin ne doit pas poser de questions précises sur les violences. Ce dogme ne pourrait-il pas être questionné ?
Enfin, les travailleurs sociaux de nos établissements ont accès à une formation de base, fortement conseillée lorsqu'une association adhère à la fédération. Tous les nouveaux entrants dans une association sont invités à cette formation.
Annick Billon, présidente . - Parallèlement à notre travail général sur les violences faites aux femmes, nous allons faire un rapport plus spécifique sur les mutilations sexuelles féminines. Quel est le pourcentage d'appels que vous recevez sur ce point précis ?
Françoise Brié . - Nous avons reçu 26 appels en 2017, ce qui est infime par rapport à la masse des appels traités par la fédération.
Annick Billon, présidente . - Merci, mesdames, pour votre intervention.
Françoise Brié . - Pour conclure, je tenais à préciser que notre application sur téléphone mobile est en cours d'élaboration. Nous avons une réunion prochainement avec le Secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et attendons les financements afférents. Par ailleurs, nous sommes favorables à la mise en place d'un chat sur le 3919 , afin de travailler avec les jeunes femmes et en lien avec les associations du réseau Solidarité Femmes . D'ailleurs, concernant plus spécifiquement cette génération, nous avons des centres maternels spécialisés, ainsi que des places d'hébergement réservées.
Annick Billon, présidente . - Merci pour ces précisions. Nous resterons bien évidemment en contact avec vous sur toutes ces questions.
Audition de Jacques Toubon,
Défenseur des Droits,
sur le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes au travail
(25 janvier 2018)
Présidence d'Annick Billon présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, dans le cadre de notre travail sur les violences sexuelles, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Toubon, Défenseur des Droits. L'objet de cette réunion porte plus précisément sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail, sujet que vous connaissez bien, monsieur le Défenseur des Droits, puisque vous avez publié en 2014 une enquête très approfondie sur ce thème.
Notre travail s'inscrit dans une actualité évidente : l'examen du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes annoncé par le Gouvernement.
Depuis le mois de novembre, la délégation a entendu de nombreux experts et représentants d'associations, aussi bien sur la question des violences dans leur globalité que sur celle du harcèlement sexuel. Ces personnes nous ont parlé des conséquences de ces différentes formes de violences sur la vie des victimes - leur santé et leurs carrières notamment - et ont formulé des propositions pour améliorer leur prise en charge médicale et psychologique, mais aussi leur accompagnement dans un parcours judiciaire souvent compliqué.
Je rappelle que le Défenseur des Droits est, d'après l'article 2 de la loi organique du 29 mars 2011 407 ( * ) , une « autorité constitutionnelle indépendante », chargée de lutter contre les discriminations, défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits.
Monsieur le Défenseur des Droits, pouvez-vous nous rappeler les principaux constats et enseignements de votre enquête de 2014 ? Pensez-vous que les choses aient évolué positivement depuis cette date pour favoriser la parole et la reconnaissance des victimes de ce phénomène insidieux et multiforme ? On peut évoquer à cet égard l'introduction dans le code du travail de l'agissement sexiste.
Quels sont, selon vous, les « angles morts » de la législation sur le harcèlement sexuel ? Enfin, quelle part représentent les saisines au titre du harcèlement sexuel dans le volume global des saisines du Défenseur des Droits ? Avez-vous constaté une hausse de ces saisines après l'affaire Baupin ou l'affaire Weinstein ?
Je vous remercie chaleureusement d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Nous avions déjà eu le plaisir de vous entendre dans le cadre d'un rapport sur les droits des personnes dites « intersexes », et nous avions gardé un souvenir très fort de cette audition.
Jacques Toubon, Défenseur des Droits . - Je vous remercie de votre présence à cette heure matinale ! Je précise également que je vous remettrai un avis écrit détaillé 408 ( * ) , auquel pourra se référer par la suite la délégation aux droits des femmes.
Il me semble judicieux de votre part d'avoir travaillé ce sujet très en amont - dès novembre - pour vous forger une opinion sur des sujets complexes, qui feront sans nul doute l'objet d'un projet de loi et qui ont déjà inspiré des propositions de lois.
Je vous indique également que j'ai été entendu au mois de novembre par le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, qui travaille plus spécifiquement sur la question du non-consentement pour les mineurs. Dans ce cadre, j'ai présenté un avis très circonstancié sur ce thème, auquel pour pouvez également vous référer, même si cela ne concerne qu'une partie de votre sujet.
Lors de notre enquête de 2014, une femme active sur cinq - soit plusieurs milliers - disait avoir été confrontée à un acte de harcèlement sexuel au cours de sa carrière. Dans le secteur privé, 23 % des femmes de dix-huit à soixante-quatre ans rapportaient avoir subi un acte de harcèlement sexuel, contre 19 % dans le secteur public. Les ordres de grandeur sont donc comparables, qu'il s'agisse du privé ou du public.
L'enquête a également mis en avant une amplification des expériences rapportées depuis les années 2000, dans un contexte d'objectivation scientifique, de reconnaissance sociale des victimes et de mobilisation des pouvoirs publics et de la société civile. Cette plus grande propension à la déclaration explique la hausse du nombre des faits déclarés, et ce phénomène devrait s'amplifier avec le mouvement actuel de libération de la parole.
Ces évolutions modifient le seuil de rejet de ces agissements et favoriseront certainement une augmentation des déclarations et des recours.
À partir de ces constats, j'en viens à ma première recommandation : il faut poursuivre l'objectivation des situations de harcèlement sexuel (fréquence, circonstances, recours entamés et raisons de l'éventuelle absence de démarche), par le biais de la réalisation d'une nouvelle enquête, l'enquête Violences et rapports de genre , dite Virage , ayant été réalisée en 2015, avant l'affaire Weinstein et les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc .
L'adoption de la loi du 6 août 2012 409 ( * ) ne s'est pas traduite par une augmentation du nombre de plaintes et de condamnations : sur 1 048 plaintes déposées pour des faits de harcèlement sexuel, seulement 65 condamnations ont été prononcées en 2014 et 50 % des poursuites ont donné lieu à des procédures alternatives (rappel à la loi, composition pénale...). Selon un rapport d'information de l'Assemblée nationale publié en 2016 sur l'application de cette loi 410 ( * ) , son bilan est très faible par rapport à l'attente suscitée.
Qu'en est-il de l'action du Défenseur des Droits ? Compétent pour traiter les réclamations des victimes de harcèlement sexuel au titre de sa mission de lutte contre les discriminations dans l'emploi et dans l'accès aux biens et services, il l'est aussi dans le cadre de sa mission de défense des droits et libertés des usagers dans leurs relations avec le service public et, lorsque les victimes interagissent avec des acteurs de la chaîne pénale (forces de sécurité et magistrats), de contrôleur de la déontologie de la sécurité.
Il dispose de techniques d'enquête rigoureuses, qui prennent en compte la particulière vulnérabilité des victimes en respectant le principe du contradictoire. Dans ce cadre, j'y reviendrai, il faut encore progresser sur la prise en charge des plaintes par la police et la justice.
Pour autant, les saisines du Défenseur des Droits pour des cas de harcèlement sexuel demeurent peu nombreuses : une dizaine de cas, chaque année, depuis la loi du 6 août 2012. Dans la fonction publique, nous avons comptabilisé dix-sept saisines depuis 2012, émanant pour l'essentiel d'agents de la fonction publique territoriale ou de fonctionnaires de l'État exerçant dans la Police nationale.
Le plus souvent, ces démarches sont menées par les associations, notamment l 'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail , l'AVFT. Cela s'explique par le fait que la plupart des personnes ne savent pas que le harcèlement sexuel constitue une discrimination en droit et que le Défenseur des Droits est compétent pour en traiter.
Si faible qu'elle soit quantitativement, notre action a permis de faire évoluer très favorablement la jurisprudence, grâce à la reconnaissance du harcèlement sexuel « d'ambiance » 411 ( * ) - arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 février 2017 412 ( * ) - ou du harcèlement sexuel généralisé, qui prospère sur le terreau de la précarité sociale, dans une entreprise de nettoyage intervenant à la gare du Nord.
Dans la discussion finale sur les ordonnances réformant le code du travail, nous avons fait en sorte que la procédure de la prise d'acte en raison de harcèlement sexuel soit exclue du plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, au même titre que les autres licenciements pour motif discriminatoire.
Nous avons aussi contribué à la réintégration, en 2016, dans la loi dite « El Khomri » 413 ( * ) , d'une disposition prévue dans la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 414 ( * ) et annulée par le Conseil constitutionnel pour vice de procédure : le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à une personne licenciée à la suite d'un traitement discriminatoire ou d'un acte de harcèlement. S'y ajoute le versement d'une indemnité « plancher », que la loi du 8 août 2016 fixe à six mois et que je préconise de porter à douze mois pour tout salarié licencié en raison d'un motif discriminatoire ou à la suite d'un harcèlement dont il avait été victime.
J'en viens au cadre juridique du harcèlement sexuel.
La loi du 6 août 2012 a marqué un changement radical dans la conception du harcèlement sexuel. Celui-ci se définit, non plus seulement par l'intention de l'auteur - obtenir des faveurs sexuelles -, mais par les conséquences de son comportement sur la victime. Cette définition modifiée, beaucoup plus large, figure à l'identique dans le code pénal, le code du travail et le statut des fonctionnaires.
Ces textes en donnent une double définition : le harcèlement sexuel qui repose sur la répétition d'actes ou qui se caractérise par une pression grave sur la victime dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Mais la loi du 27 mai 2008 415 ( * ) , transposant les directives européennes sur les discriminations, en donne une définition qui va au-delà : dans son article 1 er , elle assimile le harcèlement à une discrimination liée au sexe, permettant d'inclure les actes uniques de harcèlement sexuel, et sans se référer à la notion de « pression grave ».
J'en viens ainsi à ma deuxième recommandation : il faut harmoniser les différentes définitions du harcèlement sexuel : celle figurant dans le code du travail, le code pénal et le statut de la fonction publique, et celle de la directive 2006/54 416 ( * ) , de la loi du 27 mai 2008 et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'acte unique. À l'issue de cette harmonisation, un fait unique suffirait à caractériser le harcèlement sexuel, s'il porte atteinte à la dignité de la personne ou crée à son encontre une situation humiliante et offensante. C'est ma principale recommandation. Elle permettrait d'aboutir à une prise en considération plus large du phénomène de harcèlement.
Par ailleurs, depuis la loi Rebsamen de 2015 417 ( * ) et la loi « El Khomri » de 2016, les agissements sexistes ont été intégrés dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique.
Une ambiance de travail marquée par des comportements sexistes récurrents, tolérés par l'employeur, représente un terreau propice au harcèlement sexuel. Il est donc indispensable que les entreprises, qui sont encore trop souvent dans une logique de réparation et non de prévention, prennent conscience de leurs responsabilités en termes d'anticipation des risques, de formation et de sanction des auteurs.
Enfin, la loi sur la prescription du 27 février 2017 418 ( * ) a porté de trois à six ans le délai de prescription du harcèlement sexuel, ce qui aura indiscutablement des effets.
La question de la prescription se pose également, comme vous le savez, concernant les infractions sexuelles commises contre les mineurs, certains proposant d'allonger le délai de prescription, voire de rendre imprescriptibles certains faits. Mais cela relève d'un autre débat.
À partir de ce cadre juridique, comment la France peut-elle mieux prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel ?
Il est tout d'abord nécessaire de développer l'information. L'étude de 2014 montre que 57 % des actifs s'estiment plutôt mal informés sur le harcèlement sexuel au travail, que près de neuf actifs sur dix pensent qu'il n'est pas suffisamment reconnu dans les situations de travail et que plus de sept actifs sur dix considèrent qu'il est difficile à identifier.
Je vais donc lancer le 6 février prochain une campagne de sensibilisation fondée sur trois outils - un dépliant, une affiche et une vidéo issue d'un concours - afin de rappeler que le harcèlement sexuel, trop souvent banalisé, est interdit par la loi et d'inviter les victimes à faire valoir leurs droits.
J'aborde ma troisième recommandation : des campagnes nationales régulières d'information doivent être organisées sur la définition du harcèlement sexuel et les voies de recours possibles, de manière notamment à informer le public sur l'aménagement de la charge de la preuve en matière civile et administrative.
Il s'agit d'expliquer aux gens qu'ils peuvent obtenir satisfaction. J'y reviendrai plus tard.
Un changement de mentalité est indispensable. C'est l'objet de ma quatrième recommandation : il faut absolument lutter contre les stéréotypes de genre, dès le plus jeune âge. Les séances d'éducation à la sexualité en milieu scolaire prévues dans la loi du 4 juillet 2001 419 ( * ) et dans une circulaire de 2003 420 ( * ) doivent obligatoirement être mises en oeuvre dans tous les établissements, dans le cadre d'une approche globale d'éducation à la sexualité. Cette approche doit comporter non seulement des données physiques et sanitaires, mais également les dimensions sociales, affectives, la prévention et les soins, ainsi que la lutte contre les violences et pour l'égalité des sexes et des sexualités. Il faut expliquer qu'il n'y a pas de domination d'un sexe sur l'autre, d'une sexualité sur l'autre. Je vous renvoie sur ce point à mon rapport d'activité de novembre 2017 sur les droits des enfants.
Cinquième recommandation : il faut évaluer la mise en oeuvre de l'obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les mécanismes d'emprise psychologique, prévue par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 421 ( * ) pour les médecins, les travailleurs sociaux, les agents de l'état civil, les personnels de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), les enseignants, les personnels des services de police et de gendarmerie, les magistrats, etc., et en développer des modalités de contrôle et de sanction. Nous n'avons pas vraiment le sentiment que ce chantier a été pris à bras le corps. Cette évaluation pourrait par exemple être menée par l'Inspection des affaires sociales (IGAS).
Sixième recommandation : il faut sensibiliser les magistrats, en particulier ceux de l'ordre administratif. Les juges administratifs ont des difficultés à qualifier des comportements comme relevant expressément de faits de harcèlement sexuel. Ils préfèrent évoquer des « comportements inappropriés » ou des « comportements de nature à justifier une sanction disciplinaire ».
Autre exigence : les magistrats et les forces de sécurité doivent être mieux formés, en particulier en matière d'accueil des victimes. Les policiers et les gendarmes doivent donc bénéficier d'une formation spécifique sur le harcèlement sexuel lors de leur formation initiale, mais aussi en formation continue, afin qu'ils ne refusent plus d'enregistrer une plainte. La loi du 6 août 2012 prévoit en effet de réprimer un ensemble de comportements pour lesquels certaines victimes se voient encore aujourd'hui refuser l'enregistrement de leur plainte.
Il faut également améliorer la prévention et les sanctions dans les entreprises et dans la fonction publique. Malgré les obligations prévues dans la loi du 6 août 2012, peu d'organisations ont mis en place des actions d'information et de prévention. L'enquête de 2014 indique que seuls 18 % des actifs interrogés affirment que leur employeur a mis en place de telles actions. Il s'agit essentiellement des entreprises de grande taille, 91 % des entreprises de moins de dix salariés n'ayant mis en oeuvre aucune action.
Tout employeur public ou privé a pourtant une obligation de sécurité envers ses salariés, notamment via une procédure de recueil des signalements, obligatoire dans les organisations de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés. La loi du 6 août 2012 prévoit également un affichage obligatoire.
Dans la fonction publique, la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la protection des agents victimes de harcèlement sexuel ou moral ou de discrimination, n'est pas suffisamment mise en oeuvre, quand elle n'est pas refusée. Souvent, les premiers témoignages ne sont pas pris au sérieux, aucune enquête n'est diligentée.
En outre, lorsqu'une femme harcelée décide d'agir, l'autorité tend encore trop souvent à la déplacer pour la protéger, ce qui l'isole et lui donne l'impression d'être sanctionnée, quand l'auteur des faits reste en place et n'est nullement sanctionné. Dans ces situations, la « protection » accentue en fait la dépréciation de la victime. Il convient donc de rappeler aux organisations publiques ou privées leurs obligations légales et de les aider à mettre en place une politique de prévention. Les partenaires sociaux ont naturellement un rôle majeur à jouer, qu'ils n'assurent encore qu'insuffisamment.
Il faut aussi rappeler aux victimes et aux employeurs que les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes les unes des autres. L'employeur peut, sans attendre l'issue d'une procédure pénale, sanctionner un salarié ; il peut également le faire si l'intéressé a été relaxé. La relaxe signifie, non qu'il n'y a pas de preuves, mais que celles-ci sont insuffisantes au regard de la mise en oeuvre du droit pénal. Une sanction disciplinaire est possible si les comportements en cause sont prohibés par le code du travail et la loi de 1983 422 ( * ) sur la fonction publique.
Ces constats m'amènent à formuler ma septième recommandation : les « fiches réflexes » sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel dans la fonction publique, actuellement en cours d'élaboration par le Service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, doivent être étendues aux services des ressources humaines des entreprises privées, ainsi qu'aux organisations syndicales.
Ma huitième recommandation concerne l'administration : dans la fonction publique, rappeler aux chefs de service qu'une enquête administrative doit être diligentée dès que des faits de harcèlement sexuel sont signalés, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il faut aussi s'assurer que l'autorité hiérarchique ayant recueilli le signalement en informe systématiquement le chef de service. Des comportements n'étant pas susceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel pourraient par ailleurs néanmoins être sanctionnés, car contraires au principe déontologique résultant de l'article 25 du statut de la fonction publique.
Le nombre de décisions accordant la protection fonctionnelle aux agents ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel est faible. Or la mise en oeuvre de cette protection dépend de l'accord de l'autorité hiérarchique ; et celle-ci pourra considérer que l'agent n'a pas apporté d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement et de faire naître ainsi son obligation. Là réside l'ambiguïté de cette mesure.
Ma neuvième recommandation consiste donc à faire évoluer le droit de la protection fonctionnelle afin de permettre à l'agent de passer outre l'autorité hiérarchique et de s'adresser à une autorité indépendante - au Centre de gestion de la fonction publique territoriale ou à la Direction générale de la fonction publique - pour obtenir cette protection.
Il est par ailleurs indispensable de procéder à une réforme de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, lorsqu'un agent harcelé est en congé maladie et dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, par exemple parce qu'il est atteint de troubles psychiques. L'avis de la commission de réforme consultée n'étant que consultatif, l'employeur est généralement réticent à suivre son avis favorable, lorsque la demande est en lien avec des faits de harcèlement.
C'est l'objet de ma dixième recommandation : la décision de l'employeur doit obligatoirement être conforme à l'avis de la commission de réforme lorsque la maladie résulte de faits de harcèlement reconnus.
Onzième recommandation : les condamnations étant rares - 6 % des cas seulement - les ministères de la Justice et de l'Intérieur doivent réaliser des enquêtes statistiques fines sur le traitement des affaires de harcèlement par la justice et établir notamment des statistiques sur les motifs de clôture des dossiers.
La difficulté pour les victimes de porter plainte est une caractéristique de l'ensemble des infractions sexuelles. Une enquête nationale de 2006 avait montré que seules 10 % des femmes victimes d'un viol ou d'une tentative de rapport forcé au cours des douze derniers mois avaient déposé plainte en 2005, cette proportion n'ayant pas varié depuis.
La difficulté à témoigner est particulièrement grande dans un environnement professionnel, car elle se conjugue avec la peur de perdre son emploi, d'autant plus que, dans trois cas sur dix, les victimes occupent un emploi précaire. En outre, les victimes disposent rarement de preuves, s'agissant de comportements insidieux et cachés. Même en présence de témoins, les éléments matériels manquent, et les faits sont alors insuffisamment caractérisés pour permettre une poursuite pénale. Dans sa mission de contrôle de la déontologie des forces de sécurité, le Défenseur des Droits reçoit des plaintes sur ce point en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Mais on peut imaginer que des griefs similaires nous soient rapportés en matière de harcèlement.
Ma douzième recommandation préconise donc de mener une réflexion approfondie sur l'accueil des victimes dans les commissariats et les gendarmeries et leur prise en charge tout au long du traitement de leur plainte.
De surcroît, les victimes de harcèlement sexuel bénéficient d'un aménagement de la charge de la preuve devant les juridictions civiles et administratives, ce qui facilite les choses. La loi « El Khomri » a en effet aligné le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui des discriminations en général. Cela signifie que le salarié victime ne doit plus établir des faits mais seulement « présenter des éléments de faits ».
S'agissant du caractère probatoire des faits allégués, le Conseil d'État a admis que l'aménagement de la charge de la preuve au profit de la personne qui s'estime victime de discrimination était applicable aux litiges portant sur des faits de harcèlement, dans un arrêt de 2009 423 ( * ) . Il incombe donc à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement 424 ( * ) .
Je rappelle que le Défenseur des Droits est compétent pour traiter les réclamations des victimes dans l'accès à l'emploi, mais aussi aux biens et aux services. Ma treizième recommandation prend en compte cette triple compétence : il faut informer les victimes de harcèlement sexuel que l'aménagement de la charge de la preuve vaut également pour les faits commis lors de l'accès aux biens et aux services - par exemple un logement ou une demande de crédit - car ce point n'est pas suffisamment connu.
Ma quatorzième recommandation porte sur les enregistrements effectués à l'insu des personnes écoutées. Ils sont admis comme mode de preuve par la jurisprudence en matière pénale. Leur recevabilité par les juridictions civiles doit être envisagée dans des cas d'agressions sexuelles et de harcèlement où ils sont parfois le seul moyen pour la victime d'établir la réalité des faits.
La quinzième concerne, plus largement, le lancement d'une réflexion sur les moyens de recueillir et de conserver, en amont d'une procédure judiciaire, les éléments susceptibles de constituer des preuves dans ce type d'affaires.
Comment, enfin, les parquets peuvent-ils engager ou non des poursuites ? Lors des débats qui ont présidé à l'adoption de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, il avait été mis en exergue le fait que, par le passé, trop d'infractions sexuelles, pouvant aller jusqu'au viol, avaient été poursuivies sous la seule qualification de harcèlement sexuel.
Or, selon l 'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), cette dérive regrettable perdurerait, alors qu'elle va à l'encontre de la volonté du législateur de pénaliser en tant que tels des faits de harcèlement sexuel. Ainsi, dans une décision du 31 juillet 2017, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné l'État pour faute lourde en raison de la mauvaise qualification juridique d'un délit sexuel et de longueurs dans les délais d'enquête, à la suite d'un recours de cette association. Il convient donc d'améliorer l'effectivité de la réponse pénale.
Si la législation actuelle énonce clairement les infractions susceptibles de poursuites, demeure toutefois la difficulté précitée relative à la recevabilité des preuves. Une meilleure formation des magistrats est, à cet égard, nécessaire. Le fait de privilégier le traitement en temps réel de la majorité des plaintes pour harcèlement sexuel s'accorde en outre assez mal avec la complexité des procédures qui s'y appliquent. Peut-être faudrait-il envisager une spécialisation de certaines juridictions ? Cela permettrait de disposer de magistrats experts : il est, en effet, indispensable de prendre le temps d'écouter les victimes.
Annick Billon, présidente . - Merci, monsieur le Défenseur des Droits, pour votre exposé très exhaustif.
La définition du harcèlement sexuel demeure le point d'ancrage pour ester en justice. Dès lors, les différents instruments - législation en matière de preuves et sanctions, mais également campagnes d'information et de prévention - doivent tous tendre à mieux définir ces comportements, pour mieux les prévenir et les sanctionner.
Roland Courteau . - Je suis très surpris par le faible nombre de saisines dont vous faites l'objet en matière de harcèlement sexuel, ce qui me convainc de l'utilité de lancer une ambitieuse campagne de sensibilisation sur ce sujet.
Les chiffres rendus publics aujourd'hui font état d'une augmentation des plaintes pour viol et agression sexuelle d'environ 12 % en 2017. Si la parole se libère, ce dont il convient évidemment de se réjouir, est-ce, selon vous, une conséquence de l'affaire dite Weinstein, qui secoue depuis plusieurs semaines les États-Unis, d'un recul des tabous dans notre société ou le résultat des politiques mises en oeuvre ?
En tout état de cause, ce mouvement ne doit pas s'étioler. Dans ces domaines, en effet, les résultats restent fragiles. À titre d'illustration, après dix ans de lutte contre les violences conjugales, seules 14 % des femmes qui en ont victimes osent porter plainte. C'est dire combien la tâche à accomplir est encore immense !
Il convient par ailleurs, je vous rejoins totalement sur ce point, de renforcer la lutte contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, dans les jouets comme en milieu scolaire, et d'améliorer l'éducation sexuelle à l'école. Notre délégation l'a mis en exergue dans plusieurs rapports : les inégalités entre les hommes et les femmes, qui peuvent conduire, dans les cas les plus graves, à des situations de menace physique, psychologique ou sexuelle, s'imposent dès le plus jeune âge. Dans ce cadre, une meilleure formation initiale et contenue des enseignants sur ces sujets est indispensable. Or, bien que prévue par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, elle est encore trop souvent basée sur le volontariat, tandis que son niveau laisse à désirer.
Laure Darcos . - Les stéréotypes de genre, s'ils se construisent effectivement dès l'enfance, dépendent aussi dans une large mesure de l'éducation dispensée au sein des familles. À elles donc, avant tout, d'oeuvrer au changement des mentalités !
Les plaintes pour agressions sexuelles ont considérablement augmenté au cours de l'année 2017, cela a été mentionné. Surtout, elles ont enregistré une croissance de 31 % au quatrième semestre, ce qui tend à montrer le lien avec l'actualité.
Je m'interroge sur les responsabilités qui, d'un point de vue juridique, peuvent être imputées à l'entourage d'une victime, notamment, dans le cadre professionnel, aux représentants du personnel, lorsqu'ils ont connaissance d'un cas de harcèlement ou d'agression. J'ai pu assister à un jeu de rôle organisé par l' AVFT à l'université Paris-sud, qui mettait en scène une telle situation : lorsque la victime avait fait état de ses difficultés à son syndicat, celui-ci avait refusé d'intervenir, ce qui avait choqué les participants. Les organisations représentatives du personnel ont évidemment un rôle à jouer en matière de prévention et de défense des salariés victimes de ce type de comportements. On peut dresser un parallèle avec la récente décision du ministre de l'Éducation nationale de radier plusieurs fonctionnaires et contractuels concernés par des affaires de pédophilie.
De manière générale, s'agissant des violences faites aux femmes, les problématiques sont très spécifiques en milieu rural. En Essonne, j'ai assisté aux travaux d'un groupe de parole rassemblant des femmes d'agriculteurs ou de maires ruraux sur le sujet des délits sexuels. Ces femmes ignorent souvent vers quelle structure se tourner car, dans ces territoires, en raison du faible nombre d'habitants, la pression sociale est extrêmement forte. Ne serait-il pas envisageable de leur permettre de déposer plainte dans des lieux leur garantissant l'anonymat ?
Marc Laménie . - S'agissant du maillage du territoire par votre institution, disposez-vous de relais dans chaque département ?
Au-delà du harcèlement, j'aimerais également connaître votre sentiment sur l'état, en France, du mal-être au travail. Le phénomène a fait l'objet de nombreux travaux, dont il est difficile de tirer une conclusion générale.
Céline Boulay-Espéronnier . - L'actualité nous offre, depuis quelques semaines, l'occasion de multiples témoignages et statistiques sur le harcèlement sexuel. Il apparaît notamment que 70 % des actifs estiment malaisé d'identifier avec certitude un cas de harcèlement. C'est dire, comme vous le releviez, l'importance de l'information sur ces sujets !
Parmi les différentes définitions que vous avez données du harcèlement, je n'ai nullement entendu de référence à la domination que le harceleur exerce, dans le milieu professionnel par exemple, sur la victime. J'aimerais que vous m'éclairiez sur ce point.
Comme ma collègue Laure Darcos, je m'interroge sur la responsabilité juridique de l'entourage professionnel d'une victime, qui n'aurait pas dénoncé des faits de harcèlement ou d'agression dont il aurait été témoin.
Christine Prunaud . - Je suis convaincue de l'utilité de lutter contre les stéréotypes de genre en milieu scolaire. À cet effet, de nombreuses associations oeuvrent dans les établissements, dans le cadre de partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale. Il demeure cependant difficile d'en évaluer les résultats. Vous avez parlé de la nécessité de l'éducation à la sexualité prévue par le code de l'éducation. Cette exigence rejoint les principes sur lesquels étaient fondés les ABCD de l'égalité. Comment peut-on procéder pour rendre ces séances effectives ?
La prévention du harcèlement est essentielle dans les entreprises également, y compris dans celles de taille modeste. Or, dans mon département, il me semble que rien ne soit réellement réalisé dans ce domaine. L'information des employeurs sur leurs obligations en matière de harcèlement sexuel devrait pourtant constituer une priorité.
Annick Billon, présidente . - La fusion des instances représentatives du personnel prévue par les ordonnances ne peut-elle faire craindre que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), compétent pour interpeller les employeurs et demander des enquêtes en matière de sexisme et de harcèlement sexuel, ne soit affaibli dans cette prérogative ?
Victoire Jasmin . - Il est incohérent que les ordonnances relatives au code du travail aient contraint le champ d'action des syndicats alors que, dans le même temps, nous leur enjoignons de signaler plus systématiquement les cas de harcèlement et de renforcer l'accompagnement des victimes.
Dans les départements d'Outre-mer, les femmes subissent un taux de chômage élevé ; lorsqu'elles sont victimes de harcèlement, elles sont donc hésitantes à déposer plainte. Des enquêtes approfondies sur le taux de plaintes sont donc indispensables.
Enfin, pour améliorer la prévention réalisée auprès des élèves par l'Éducation nationale, il conviendrait d'évaluer l'efficacité des actions d'ores et déjà mises en oeuvre et de faire en sorte que toutes les personnes qui contribuent à cette éducation soit formées.
Jacques Toubon. - S'agissant de la définition du harcèlement sexuel qui figure au code pénal, elle comporte à la fois le verbe « imposer » et le mot « pouvoir », ce qui montre que la « supériorité » du harceleur sur la victime - qui n'implique d'ailleurs pas de lien hiérarchique - est une composante de la définition du harcèlement sexuel.
Monsieur Laménie, le Défenseur des Droits dispose de 500 délégués territoriaux dans les départements métropolitains et ultramarins. Ils traitent directement 80 % des 90 000 dossiers annuels et transmettent les plus délicats au siège parisien de l'institution.
Nous avons effectivement constaté, en 2017, une augmentation des plaintes pour motif sexuel, dont les causes sont multiples. J'espère qu'il ne s'agira pas que d'un « feu de paille » médiatique ; trop souvent une actualité chasse l'autre. Aux pouvoirs publics de s'emparer du sujet et de le maintenir à l'ordre du jour pour le faire progresser.
La loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité n'est pas correctement appliquée et les problèmes systémiques ne sont pas traités. Nous devons travailler plus étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale sur ce point : vous l'avez tous rappelé, la lutte en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et contre le harcèlement doit débuter dès le plus jeune âge, au moment où se construisent les représentations sociétales et sociales des enfants.
Il est encore trop tôt, madame la présidente, pour juger des conséquences de la mise en oeuvre de la réforme du CHSCT en matière de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Pour ma part, je ne suis pas certain qu'il faille s'en inquiéter : elle pourrait conduire, et cela est positif, l'ensemble des membres du nouvel organe à se saisir du dossier de manière efficace, en ne traitant pas la question uniquement sous l'angle de la santé au travail.
Pour conclure, sauf en ce qui concerne l'éventuelle harmonisation de la définition actuelle du harcèlement sexuel avec celle de la loi sur la discrimination, je pense que la législation française en matière de lutte contre les délits sexuels est satisfaisante. Elle mériterait toutefois d'être plus systématiquement appliquée. À cet égard, souhaitons que l'actualité de ces derniers mois conduise à de profondes et durables évolutions des comportements et des rapports sociaux.
Annick Billon, présidente . - Ce débat nous renvoie plus largement à la place des femmes dans notre société et aux outils qu'il convient de développer pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à tous pour ces fructueux échanges.
Audition de Marylin Baldeck,
déléguée générale de l'Association
européenne contre les violences faites aux femmes au travail
(31
janvier 2018)
Présidence d'Annick Billon, présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, dans le cadre de nos travaux sur les violences sexuelles, nous recevons ce matin Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail ( AVFT ). Mme Baldeck est accompagnée de Mme Léa Scarpel.
Cette audition s'inscrit dans le cadre de nos travaux sur les violences sexuelles, en lien avec la préparation du projet de loi annoncé par le Gouvernement.
L' AVFT est l'association de référence en ce qui concerne la prise en charge des victimes de harcèlement sexuel, mais aussi, plus généralement, de toutes les violences sexuelles dont les femmes peuvent être victimes au travail.
Ses statuts précisent ainsi que cette association « a pour champ d'action et de réflexion la lutte contre toutes les formes de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles au travail 425 ( * ) ».
Marilyn Baldeck, Sandrine Rousseau, que nous avons entendue le 17 janvier, vous présente dans son livre, Parler , comme « une actrice incontournable sur le sujet, excellente juriste, fine connaisseuse des questions de violence, celle qui fait discrètement avancer la jurisprudence en matière de violences faites aux femmes ».
Pourriez-vous nous présenter votre association : quels sont ses missions, ses outils, ses moyens ? Quel bilan dressez-vous de l'action menée depuis la création de l' AVFT en 1985 ?
L'association a connu une hausse sensible des sollicitations à la suite de l'affaire Baupin en 2016. Vous écrivez, dans la postface du livre de Sandrine Rousseau, qu'un an après l'affaire Baupin il était difficile de trouver une place dans vos locaux pour poser son manteau, et encore plus difficile d'y trouver « un interstice sur une étagère pour y ranger un nouveau dossier ».
Je ne doute pas que la libération de la parole, dans le sillage de l'affaire Weinstein, a eu des conséquences comparables. Pouvez-vous nous donner des ordres de grandeur de cette hausse du nombre de sollicitations que vous avez reçues depuis l'automne ?
Quelles ont été les principales difficultés auxquelles votre équipe s'est heurtée pour faire face à l'augmentation de la charge de travail qui en est résulté pour vous ? Avez-vous pu proposer des solutions aux femmes que vous n'avez pas été en mesure d'accompagner ?
-Autre question : avez-vous constaté une plus grande mobilisation des entreprises et des syndicats sur la prévention du harcèlement et du sexisme au travail ?
Que convient-il de faire selon vous pour améliorer :
- la protection et la prise en charge des femmes victimes de harcèlement sexuel ?
- la réponse pénale aux faits de harcèlement sexuel ?
- la prévention du harcèlement sexuel ?
Plus généralement, au regard de votre expérience, quels sont selon vous les « angles morts » de la législation sur le harcèlement : estimez-vous que l'arsenal actuel est complet et adapté, notamment depuis la réforme de la définition du harcèlement sexuel dans la loi de 2012 426 ( * ) ?
Le Haut conseil à l'égalité est d'avis d'adapter la définition légale du harcèlement pour permettre la sanction des « raids » qui sont pratiqués par les « cyber-harceleurs ». Qu'en pensez-vous ?
Qu'en est-il aussi de l'agissement sexiste depuis son introduction dans le code du travail par l'article 20 de la loi du 17 août 2015 427 ( * ) (à l'initiative, je le rappelle, de plusieurs membres de notre délégation) ? Avez-vous déjà eu l'occasion de mobiliser cette disposition législative pour traiter certaines affaires ? Quelle est sa portée effective 428 ( * ) ? On constate que beaucoup de juristes ne l'ont pas vraiment intégrée. Nous avons d'ailleurs fait une recommandation dans un de nos rapports pour que cette notion soit mieux connue des juristes 429 ( * ) .
En outre, nous nous interrogeons sur les conséquences éventuelles de la disparition des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des délégués du personnel prévue par les ordonnances, pour ce qui concerne la prévention du sexisme dans l'entreprise. Ne peut-on craindre, en effet, que le CHSCT, qui peut interpeller les employeurs et demander des enquêtes en matière de sexisme et de harcèlement sexuel 430 ( * ) , ne soit affaibli dans cette prérogative à travers la fusion des instances représentatives du personnel ?
Nous comptons sur vous pour nous apporter des éléments de réponse sur ces nombreuses interrogations, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres points que je n'aurais pas évoqués et qui vous sembleraient très importants.
À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions.
Je vous remercie pour votre présence et je vous laisse sans plus tarder la parole.
Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail . - Je vous remercie pour votre invitation et pour vos propos positifs sur notre action. Je voudrais associer à ces compliments mes collègues de l'association, sans qui nous ne pourrions pas fonctionner, dont certaines sont présentes aujourd'hui : Léa Scarpel, Clémence Joz et Margaux Dalstein-Jidkoff.
Vous m'avez effectivement interrogée sur un grand nombre de sujets et je m'efforcerai de répondre au maximum d'entre eux. J'ai structuré mon intervention en trois parties, en laissant délibérément de côté les questions qui sont plus périphériques à l'objet social de l' AVFT (cyber-harcèlement et outrage sexiste), mais nous pourrons y revenir pendant les questions.
Dans la première partie de mon intervention, je répondrai à la problématique de l'adaptation de notre association à l'augmentation de sa charge de travail. C'est une question d'actualité. Vous me recevez dans un moment particulier de la vie de l' AVFT , puisque nous avons décidé lundi de fermer notre accueil téléphonique jusqu'à nouvel ordre, car nous ne pouvons plus faire face à l'afflux des nouvelles demandes. Nous avons publié un communiqué en ce sens ce matin pour nous en expliquer.
Depuis de nombreuses années, l' AVFT fait face à des demandes toujours plus nombreuses, qu'elle se trouve malheureusement de moins en moins en mesure de satisfaire. Nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme en 2014, en évoquant un véritable « tonneau des Danaïdes », mais nous n'avions pas été entendues. Nous manquons de moyens, mais l'association n'est pas seule dans cette situation. C'est le cas de l'ensemble des structures et institutions publiques qui accompagnent, soutiennent, orientent, conseillent et défendent les femmes victimes de violences dans leur parcours judiciaire.
En 2014, nous avions communiqué sur la réalité de notre travail. Nous devons en effet sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage pour faire comprendre que l' AVFT n'est pas une permanence téléphonique, mais une association de défense des victimes, et que l'essentiel du travail commence à partir du moment où nous avons raccroché le téléphone, même si ce premier contact téléphonique est déjà très important et demande des compétences bien précises. Nous savons d'ailleurs que la fermeture de notre accueil téléphonique ce matin ne sera pas synonyme de recul de la charge de travail, en tout cas pas dans l'immédiat. À l' AVFT , derrière un « entretien téléphonique », il y a un processus qui consiste à transformer la parole de la victime, elle n'a souvent que cela quand elle nous appelle, en procédure judiciaire. C'est cela qui prend beaucoup de temps et implique de nombreuses démarches, qui vont du recueil précis des agissements dénoncés et de la reconstitution de leur chronologie au rassemblement des éléments de preuve, en passant par la mise en contact avec d'autres professionnels, des recherches juridiques, une réflexion sur une stratégie judiciaire, la sécurisation de la rupture du contrat de travail (quasi inévitable dans nos dossiers), la rédaction de lettres à l'employeur, au parquet, la constitution le cas échéant d'un dossier d'aide juridictionnelle pour celles qui ne sont pas en mesure de le faire ou que leur traumatisme empêche de le faire et bien d'autres choses encore qui sont énumérées dans notre communiqué de presse de mars 2014.
Le Défenseur des Droits, qui est un acteur de la lutte contre le harcèlement sexuel, va prochainement lancer une campagne d'information à destination des victimes et va les inciter à le saisir, ce qui est une très bonne chose. Mais par exemple, pour l' AVFT , orienter une victime vers le Défenseur des Droits présuppose la constitution d'un dossier, souvent composé d'une dizaine de pièces, Ainsi, pour nous, même l'orientation des victimes vers d'autres acteurs représente un gros travail.
En 2014, nous avions« crié dans le désert », notre alerte ne suscitant pas la moindre réaction des pouvoirs publics. Nous avions décidé de ne plus ouvrir de nouveaux dossiers pendant sept mois afin de pouvoir travailler sur les dossiers en cours.
Jusqu'en août 2015, notre situation s'est plus ou moins stabilisée. Mais à cette époque nous avons renoncé à remplacer une salariée ayant quitté l'association pour retrouver notre équilibre budgétaire. Le nombre de juristes salariées de l'association est passé de cinq à quatre.
Quelques mois plus tard a éclaté l'affaire Baupin, qui a mis la question du harcèlement sexuel au travail à l'agenda médiatique. Dans la foulée, nous avons dû faire face à une multiplication par trois du nombre de saisines entre mai 2016 et fin 2016. En janvier 2017, après un documentaire sur le harcèlement sexuel à la télévision qui a connu une très bonne audience, et dans lequel était présentée l'action de notre association, nous avons de nouveau constaté une forte hausse des appels. Enfin, avec l'affaire Weinstein, le mouvement #Metoo et la diffusion d'un nouveau documentaire sur le service public qui met également en lumière l' AVFT et a lui aussi réalisé une très bonne audience, nous avons connu une nouvelle « flambée » des appels.
Alors que le nombre de dossiers qui nous parviennent a été multiplié par deux entre 2015 et 2017, nos effectifs et les subventions publiques dont nous bénéficions sont restés stables depuis treize ans. La subvention étatique dont nous bénéficions, dans le cadre de « Conventions Pluriannuelles d'Objectifs », a même baissé, puisqu'elle était de 245 000 euros annuels jusqu'en 2011, année où elle est passée à 230 000 euros, pour être rehaussée à 235 000 euros en mai 2012.
Dès lors, quelle alternative proposer à ces victimes que nous ne pouvons plus accueillir ? Il n'est pas aisé de les réorienter vers d'autres associations, car ces dernières sont tout aussi débordées que nous, et pas forcément spécialisées dans l'accès à la justice et la défense des victimes de violences sexuelles au travail.
Sur le plan institutionnel, notre expérience est que cela ne fonctionne pas ou alors beaucoup moins bien si notre réorientation n'est pas précédée d'un travail de l'association de mise en récit de la parole de la victime et de constitution d'un premier dossier, que les victimes soient réorientées vers la police ou la gendarmerie, le Défenseur des Droits ou l'Inspection du travail.
Il est par exemple très difficile pour l'Inspection du travail, dont les effectifs n'ont cessé de baisser ces dernières années et qui n'est pas ou plus formée à agir en matière de harcèlement sexuel au travail, de traiter un dossier face à une victime dissociée, dont l'état psychologique sera peu compatible avec la rigueur nécessaire à l'engagement de procédures, même non judiciaires. Le travail de « facilitation » de l' AVFT est souvent indispensable.
Au bout du compte, les victimes que nous tentons de réorienter rappellent bien souvent l'association...
Qu'en est-il des avocats ? Il faut savoir que la grande majorité du public qui nous contacte relève de l'aide juridictionnelle (AJ). Ce qui est souvent ignoré, c'est que l'essentiel du travail d'un avocat dans une procédure judiciaire, plus particulièrement une procédure prud'homale ou administrative, n'est pas couvert par l'AJ, dont le montant est déjà dérisoire : la constitution du récit, la rédaction de la plainte, les courriers à l'employeur, la collecte des éléments de preuve, les rendez-vous, parfois nombreux, avec les clientes - précisément ce que fait l' AVFT . Or les politiques publiques visant à favoriser l'accès des femmes victimes de violences à la justice ne peuvent reposer à ce point sur le bénévolat des avocats, qui, dans ces dossiers, sont bien souvent des avocates. Il est exact qu'il est difficile de trouver des cabinets compétents qui acceptent de prendre ces dossiers complexes et chronophages à l'AJ, mais je ne jetterai surtout pas la pierre à ces petits cabinets militants qui ne refusent l'AJ que parce que leur équilibre économique serait en danger
En conclusion, nous nous heurtons à l'éternelle question des moyens et de la volonté politique.
Le deuxième point de mon intervention concerne l'adaptation du droit pénal à la lutte effective contre le harcèlement sexuel au travail.
Si l'arsenal législatif actuel est grosso modo satisfaisant, la réponse pénale est loin de l'être. Le rapport des députés Pascale Crozon et Guy Geoffroy sur l'application de la loi du 6 août 2012 431 ( * ) , publié en novembre 2016 432 ( * ) , mentionne un taux de 93,7 % de plaintes classées sans suite.
Ce taux est souvent justifié par l'argument selon lequel, dans ces affaires, on manquerait de preuves et qu'on serait dans une situation du type « la parole de l'un contre la parole de l'autre », qui rendrait toute condamnation impossible. Or dans un grand nombre de dossiers dans lesquels on nous oppose que c'est « parole contre parole », l'enquête pénale a été bâclée. Il n'est en effet pas étonnant de manquer de preuves lorsqu'une enquête a démarré six mois après la plainte, a duré deux ans, et au cours de laquelle seule une partie des actes d'enquête pertinents est réalisée. Les preuves - ce fameux faisceau d'indices graves et concordants - ne sont pas impossibles à trouver. Mais il faut se donner les moyens de les chercher.
Par ailleurs, la preuve par « faisceau d'indices graves et concordants » en matière pénale, qui est théoriquement la règle, est diversement appliquée. Il peut en effet être bon de se demander ce que doit être une preuve pénale en matière de violences sexuelles : un ou plusieurs témoignages directs ? La présence d'ADN ? Si c'est cela que la justice recherche, c'est perdu d'avance pour les victimes. Dans nos dossiers, par exemple, il est déjà arrivé que des juges écartent l'existence d'autres victimes dénonçant des agissements similaires dans des circonstances comparables comme élément de preuve.
Par ailleurs, je peux vous assurer qu'il existe des dossiers dans lesquels nous disposons de nombreuses preuves consistantes, comme des centaines de SMS, de mails, de mots manuscrits glissés dans une boîte à lettre (impliquant que le harceleur s'est rendu jusque chez sa victime) - de messages avec des menaces de viol... qui font quand même l'objet de classements sans suites du parquet, au nom du principe d'opportunité des poursuites, qui permet de moduler la politique pénale de l'État.
Ceci pose en effet la question des priorités de politique pénale. Les parquets font le tri des affaires parce qu'il y a là encore trop de dossiers à traiter et pas assez de temps ni de moyens. Malheureusement, cet arbitrage ne se fait pas en faveur des victimes de harcèlement sexuel.
J'en viens à la question de la qualification des violences sexuelles dans le contentieux pénal, en écartant la question de la correctionnalisation des viols, que vous ne connaissez que trop bien ; c'est un problème récurrent. Laure Ignace, une de mes collègues, a mené une étude portant sur trente-quatre dossiers et a constaté que six de ces affaires relevaient en réalité, non pas de harcèlement sexuel, mais d'agressions sexuelles caractérisées, voire de tentatives de viol.
Je rappelle que la définition du harcèlement sexuel prévue par l'article 222-33 du code pénal depuis l'adoption de la loi du 6 août 2012 contient deux volets : le premier caractérise le harcèlement sexuel par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le second volet assimile le harcèlement sexuel au fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Au moment de l'adoption de la loi du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel, nous avions beaucoup critiqué ce second volet en soulignant qu'il risquerait d'accentuer la tendance des parquets à requalifier des agressions sexuelles en actes de harcèlement sexuel, avec des peines moins lourdes à la clé.
Et comme nous l'avions anticipé, c'est l'alinéa II de l'article 222-33 du code pénal qui est utilisé par les magistrats pour déqualifier des agressions sexuelles en harcèlement sexuel.
Alertée par l' AVFT , la Chancellerie avait, par voie de circulaire pénale du 7 août 2012, rappelé aux magistrats qu'ils ont non seulement le pouvoir mais également l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, en vertu du principe de la saisine in rem des juridictions.
Dans un dossier où le parquet avait mal qualifié les faits et refusait de les requalifier en agressions sexuelles 433 ( * ) - tout comme le tribunal correctionnel -, nous avons décidé, aux termes d'une procédure judiciaire particulièrement longue, de lancer une action en responsabilité contre l'État pour dysfonctionnements des services de police et de justice, afin de demander l'indemnisation du préjudice de notre victime. Le TGI de Paris a condamné l'État pour faute lourde, dans un arrêt du 31 juillet 2017, tant du fait de la mauvaise qualification juridique que des délais d'enquête anormalement longs. L'État n'a pas relevé appel de ce jugement. C'est une décision importante.
Sur la question de la définition du harcèlement dans le code pénal, nous pensons qu'il y a des pistes d'amélioration à envisager. Vous pourriez par exemple vous intéresser à la définition du « consentement » en matière sexuelle, véritable « angle mort » de notre législation actuelle, à la différence de plusieurs autres pays. Sur ce point, je rappelle qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 36 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul, « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».
La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a par ailleurs condamné la Bulgarie en 2003 par une décision dans laquelle elle indique qu'en aucun cas le défaut de consentement ne doit se déduire d'une résistance physique de la victime.
Nous pensons donc que la France ne répond pas aux exigences européennes à cet égard.
Dernier point, la question du droit du travail, qui est très important en matière de harcèlement sexuel. Compte tenu du taux de classements sans suite déjà cité au pénal, c'est plutôt devant les conseils de prud'hommes que les victimes de harcèlement sexuel au travail peuvent faire valoir leurs droits de manière effective. Il est donc important que les procédures sociales fonctionnent bien, sans que cela signifie qu'il faut abandonner la voie pénale, car il faut agir sur tous les fronts et que les troubles à l'ordre public soient sanctionnés.
Ce sont donc bien les conseils de prud'hommes qui pour l'essentiel établissent les faits de harcèlement sexuel et ordonnent la réparation par l'employeur des préjudices des victimes. C'est la raison pour laquelle l' AVFT porte une attention toute particulière aux évolutions du droit du travail. À cet égard, nous avons accueilli avec circonspection - c'est un euphémisme - certaines des modifications apportées par les récentes réformes du code du travail.
C'est d'autant plus regrettable que depuis quelques années, l' AVFT , le Défenseur des Droits et quelques cabinets d'avocats spécialisés accomplissent un travail considérable pour faire évoluer favorablement la jurisprudence en faveur des victimes de harcèlement sexuel, et que, dans une certaine mesure, ces efforts ont été couronnés de succès.
Je citerai à cet égard un arrêt de février 2017 qui consacre en droit du travail la notion de harcèlement sexuel dit « environnemental ». Cela signifie que le harcèlement sexuel est reconnu lorsqu'une salariée est confrontée à un environnement de travail empreint de commentaires sexuels, d'images à caractère pornographique ou encore de commentaires dégradants sur les femmes, sans pour autant qu'une salariée ne soit explicitement visée. Nous menions ce combat depuis plusieurs années.
Dans ce dossier, le conseil des prud'hommes - juridiction paritaire composée de salariés et d'employeurs - nous avait donné raison dès la première instance. Mais pour optimiser les chances que cette décision soit confirmée par la cour d'appel d'Orléans, nous avons saisi le Défenseur des Droits pour lui demander s'il partageait notre point de vue.
Ainsi, c'est forte de l'avis du Défenseur des Droits confirmant la notion de harcèlement sexuel environnemental que la cour d'appel d'Orléans a rendu un arrêt de principe en reconnaissant que le harcèlement sexuel ne se limite pas à des pressions sexuelles sur une personne, mais peut recouvrir un champ beaucoup plus vaste.
Nous avons également obtenu un arrêt du 17 mai 2017 - l'année 2017 s'est avérée fructueuse sur le plan de l'élargissement du spectre de la définition du harcèlement sexuel en droit du travail - établissant qu'un acte unique suffit à caractériser le harcèlement sexuel - la répétition n'est donc pas nécessairement exigée -, y compris lorsqu'il n'y a pas d'exercice de pressions graves et lorsqu'il n'y a pas l'intention de la part de l'auteur d'obtenir un acte de nature sexuelle.
La Cour de cassation considère donc que le harcèlement sexuel peut être caractérisé par un acte unique et laisse à la libre appréciation des juges du fond le point de savoir dans quelles circonstances un acte unique est suffisant pour prononcer la condamnation civile d'un employeur pour harcèlement sexuel. Cet arrêt a fait grand bruit et a été commenté à de multiples reprises dans les revues juridiques, ce qui permet aussi que notre travail profite à d'autres. En effet, ce sont autant d'avocats qui peuvent se fonder sur cet arrêt pour défendre leurs clientes.
Nous avons aussi obtenu une décision de justice, première dans les annales judiciaires, condamnant solidairement pour harcèlement sexuel deux employeurs, le donneur d'ordre, un palace parisien et une entreprise sous-traitante en charge du nettoyage de l'hôtel, dans le cadre d'une agression sexuelle d'une femme de chambre par un client ; sa fuite vers le Qatar avait été facilitée et organisée avant que la police ne puisse procéder à son interpellation, ainsi que l'a prouvé l'enquête pénale.
Rodée aux procédures concernant les salariés de droit privé, l'équipe de l' AVFT s'est plus récemment formée à la mise en cause de la responsabilité de l'employeur public devant les tribunaux administratifs, ce qui nous permet désormais de mieux répondre aux agentes de droit public victimes de violences sexuelles. La qualité d'employeur public, y compris quand il s'agit de l'État, aurait permis d'en attendre une grande exemplarité mais force est de constater que ceux-ci ne sont pas irréprochables et nous allons de surprise en surprise !
Je ne résiste pas à la lecture de l'extrait d'un mémoire produit en défense devant le tribunal administratif dans un dossier de harcèlement sexuel en octobre 2017 par un ministère : « Les plaisanteries graveleuses, aussi regrettables soient-elles, interviennent dans un contexte particulier, celui d'une unité de terrain dont les missions sont particulièrement difficiles, dont le mode de fonctionnement favorise la promiscuité, et composée jusqu'alors exclusivement d'effectifs masculins. Les profondes mutations intervenues ces dernières années ont modifié les codes et les comportements des agents qui, pour certains, n'ont pas encore totalement assimilé ces évolutions sans pour autant que la maladresse dont ils peuvent parfois faire montre suffise à caractériser le harcèlement ».
Il s'agit d'un mémoire en défense du ministère de l'Intérieur concernant le dossier d'une policière, produit en octobre 2017 alors que le battage médiatique autour de l'affaire Weinstein faisait grand bruit.
Or l'État doit faire montre d'une plus grande exemplarité, d'autant que cette policière, membre d'une Compagnie républicaine de sécurité (CRS), ajoutait qu'elle craignait bien plus les pauses à la caserne que les opérations parfois dangereuses auxquelles elle pouvait participer.
Les travaux législatifs portant sur la réforme du droit du travail ont été engagés depuis des années et l' AVFT aurait souhaité que le Parlement fasse preuve de davantage de pugnacité lors de l'examen des dispositions concernant spécifiquement le harcèlement sexuel au travail. Nous avons en effet regretté que certains correctifs n'aient pas été apportés, par exemple sur la question de la prescription.
En effet, si le délai de prescription est passé de trois à six ans pour les délits, considérant qu'il faut du temps aux victimes de harcèlement sexuel pour porter plainte, en parallèle, le délai pour attaquer l'employeur en cas de rupture du contrat de travail s'est effondré. La volonté de réduire le délai de prescription pour contester un licenciement ne date pas des ordonnances travail. Ce délai a en effet été réduit de manière vertigineuse ces dix dernières années. Jusqu'en juin 2008, les salarié-es avaient trente ans pour contester leur licenciement. La loi du 17 juin 2008 a divisé ce délai par six pour le ramener à cinq ans. Puis la loi du 14 juin 2013 a encore divisé ce délai, ramené à deux ans. Depuis le 22 septembre 2017, date d'entrée en vigueur des ordonnances, ce délai est à nouveau divisé par deux. L'article 1471-1 (alinéa 2) du Code du travail dispose désormais : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
L'article précité ne prévoit aucune dérogation, même en cas de harcèlement sexuel ou de discrimination.
Or l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que le délai est de cinq ans en cas de contestation d'un acte discriminatoire. De notre point de vue, le licenciement intervenu à l'encontre d'un-e salarié-e ayant subi, refusé de subir, relaté ou témoigné de faits de harcèlement sexuel est un acte discriminatoire qui devrait pouvoir être contesté pendant cinq ans. C'est également la position du Défenseur des Droits.
Faute d'une dérogation explicite dans le code du travail, le délai de prescription applicable fera l'objet de débats âpres et insécurisants pour les victimes devant les conseils de prud'hommes.
Votre assemblée aurait pu proposer une clarification.
De surcroît, l' AVFT milite depuis 2013 pour que le montant de l'indemnisation des victimes de discrimination au travail soit au moins égale à douze mois de salaire. Cette revendication est née d'une étude que nous avons réalisée sur les montants des indemnisations versées aux victimes de harcèlement sexuel licenciées après avoir dénoncé les faits dont elles avaient été l'objet : nous nous sommes alors aperçues que les victimes conseillées et aidées par l' AVFT étaient beaucoup mieux indemnisées par les conseils de prud'hommes que celles qui ne l'étaient pas.
Selon nous, ces disparités s'expliquent par la qualité du dossier constitué en amont par l' AVFT , par l'orientation des salariées vers des cabinets d'avocats compétents, mais également par l'intervention de l'association dans les procédures, qui présente des observations orales et écrites auprès des juridictions, en soutien des demandes des salariées. Ce travail continu depuis des années porte ses fruits : nous dépassons souvent très largement le minimum d'indemnisation, de six mois de salaire, et obtenons régulièrement la condamnation de l'employeur à verser l'équivalent de douze mois de salaire, voire beaucoup plus pour des salariées ayant une ancienneté significative au sein de l'entreprise.
Ce niveau d'indemnisation qui assure aux victimes une meilleure prise en charge des préjudices, mais encourage aussi les employeurs à respecter leurs obligations de prévention, doit, selon l'AVFT, bénéficier à toutes les victimes dans une démarche d'harmonisation.
Cette proposition a fait l'objet d'un amendement lors de l'examen du projet de loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en 2014 434 ( * ) , qui a été adopté et voté, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel au motif d'un dépôt trop tardif, sans que le fond de l'amendement ne soit cependant contesté.
Par la suite, cette disposition intégrée dans un autre véhicule législatif lors de l'examen de la loi « El Khomri » 435 ( * ) a de nouveau été abrogée par ordonnance, puis proposée sous la forme d'un nouvel amendement, avant d'être finalement rejetée par le Sénat sur avis défavorable du Gouvernement.
L'indemnisation constitue un point crucial pour l' AVFT , d'autant plus que six mois de salaire ne correspondent somme toute qu'à 14 000 euros pour une employée licenciée payée au SMIC, autant dire pas grand-chose !
Nous continuerons à défendre cette revendication d'autant plus que le harcèlement sexuel demeure la seule violence sexuelle dans le code du travail qui ne peut pas être indemnisée par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Il est donc primordial pour les victimes d'être indemnisées lorsqu'elles s'engagent dans une procédure sociale.
En outre, les ordonnances « travail » comportent une disposition relative à la pluralité des motifs du licenciement dont nous ne comprenons pas l'intérêt, même du seul point de vue patronal, aux fins de diminuer l'indemnisation.
En effet, la Cour de cassation martèle depuis plusieurs années que le licenciement d'une salariée pour dénonciation de faits de harcèlement sexuel est nul de plein droit, sauf à ce que l'employeur puisse démontrer la fausseté de ces allégations, et ce, quand bien même d'autres motifs de licenciement auraient été mentionnés dans la lettre de licenciement. Ces motifs complémentaires n'ont alors même pas à être examinés par le juge au regard de la gravité des faits de harcèlement.
Cette disposition contestée des ordonnances revient sur cette jurisprudence, juste et constante, de la chambre sociale de la Cour de cassation, alors que les licenciements intervenus pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel sont assez rares, les employeurs usant d'autres motifs pour licencier ces salariées ; aussi l'intérêt patronal de cette disposition est minime et nous ne comprenons donc pas ce qui la motive réellement.
Cette évolution législative nous désole d'autant plus que c'est la première fois depuis quinze ans que l' AVFT n'a été consultée ni par le Gouvernement, ni par les commissions des deux assemblées, alors qu'elle l'était systématiquement dès qu'un projet de loi touchait de près ou de loin à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
Devoir clore mon exposé sur cette remarque me désole !
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie de la précision de vos propos. Le tableau que vous nous avez dressé n'est guère réjouissant compte tenu de l'augmentation des affaires que vous devez traiter au regard des insuffisants moyens financiers et humains qui vous sont alloués.
Si le Président de la République a porté au rang de « grande cause nationale » du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, votre intervention démontre qu'il faudrait affecter des moyens plus importants pour obtenir des avancées sur ces sujets.
Les chiffres relatifs à la réponse pénale que vous citez corroborent ceux que nous a indiqués le Défenseur des Droits, Jacques Toubon, lors de son audition par la délégation la semaine dernière.
Je retiens cependant l'évolution positive que constitue l'élargissement de la jurisprudence à la notion de harcèlement environnemental, et ce, grâce à l' AVFT ; je déplore que vous remplissiez ce que je qualifierais de « mission de service public » sans disposer de moyens suffisants au regard du nombre toujours plus important des victimes qui sollicitent votre assistance.
Roland Courteau . - J'aimerais revenir sur la fusion du CHSCT avec le comité d'entreprise et le collège des délégués du personnel et sur ses conséquences possibles sur le traitement des questions de harcèlement au travail, à travers la réduction des attributions du CHSCT au sein de la nouvelle instance représentative du personnel.
Je me joins à la présidente pour saluer la « mission de service public » que vous menez ; pourriez-vous nous indiquer quelle est l'évolution du montant des subventions versées à l' AVFT ?
Vous nous avez indiqué que 93,7 % des plaintes sont classées sans suite. Qu'en est-il cependant de la propension des collègues de travail de la victime à témoigner ?
A l'instar des campagnes de sensibilisation aux violences faites aux femmes, même si elles sont trop peu fréquentes, existe-t-il des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement sexuel au travail ? Dans le cas contraire, faut-il en réaliser ?
Marilyn Baldeck . - Je salue tout d'abord votre engagement de longue date dans la lutte contre les violences faites aux femmes et votre présence aujourd'hui.
La fusion des instances représentatives du personnel (IRP) - dont le CHSCT - au sein d'une nouvelle instance, le Comité Social et Économique (CSE), peut s'analyser à la fois positivement, puisque celle-ci récupère des compétences en matière de traitement du harcèlement sexuel, mais aussi fort négativement, en diluant la spécificité du CHSCT, instance dédiée exclusivement aux questions de sécurité et de santé au travail.
Plusieurs dispositions des ordonnances permettent de conclure des accords directement au niveau de l'entreprise, en dépossédant les branches de certaines de leurs prérogatives ; aussi nous étonnons-nous que n'ait pas été laissée la possibilité aux entreprises qui le désiraient de conserver leur CHSCT lorsqu'il fonctionnait bien. Cette voie n'a d'ailleurs même pas été envisagée !
Sur la question des subventions publiques de l' AVFT :
- la dernière augmentation de subventions en provenance de l'État dont l' AVFT a bénéficié a été décidée par Nicole Ameline, alors ministre de plein exercice à la Parité et à l'égalité professionnelle, en 2005. Cette augmentation substantielle, + 20 %, dont d'autres associations ont également bénéficié, a porté notre subvention annuelle à 245 000 euros. En 2018, soit treize ans plus tard, le soutien financier de l'État à l' AVFT est de 235 000 euros par an, il est donc en baisse. La Ville de Paris apporte un soutien financier régulier mais modéré à l' AVFT (15 000 euros par an). En 2017, les ressources financières de l' AVFT s'élevaient à 370 000 euros annuels : 250 000 euros de fonds publics et 120 000 euros de fonds propres, dont 80 000 euros de produits de formations.
Le financement de la défense des victimes par notre activité de formation (qui répond par ailleurs à un besoin et à notre objet social) a cependant atteint ses limites ; l' AVFT doit rester une association de défense des victimes, qui par ailleurs fait de la formation, et non un organisme de formation qui par ailleurs défend des victimes !
Vous m'interrogez sur les témoignages des salariés ; ceux-ci ne constituent pas une part significative du faisceau d'indices dans les affaires de harcèlement sexuel. Une enquête est obligatoirement diligentée, aussi bien dans le secteur public que privé, dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur envers ses salariés et il est indifférent que la victime ait préalablement déposé plainte.
Le volume des témoignages de collègues est bien plus important si l'enquête est réalisée non pas en interne, mais confiée par le CHSCT à un cabinet de conseil qui recueille anonymement les témoignages et de manière sérieuse et impartiale, comme l'exige la jurisprudence sociale.
La réalisation d'une enquête externalisée par un cabinet agréé par le CHSCT, jouant le rôle de tiers de confiance, a d'ailleurs été déterminante dans le succès de la procédure déjà évoquée qui a entériné la notion de harcèlement sexuel environnemental, alors que l'employeur soutenait depuis des mois que la salariée n'avait simplement pas d'humour et que tout cela n'était qu'à mettre au registre des gamineries...
Il n'y a jamais eu de campagne publique de sensibilisation au harcèlement sexuel, si ce n'est une très brève campagne en septembre 2012, après l'adoption de la loi, pour laquelle des affiches au format pdf avaient été envoyées par mail aux délégations régionales aux droits des femmes, à charge pour elles de trouver les moyens de les imprimer et les diffuser ! Autant dire que nous ne les avons pas beaucoup vues. C'est principalement l'agenda médiatique qui est le vecteur de cette sensibilisation.
Annick Billon, présidente . - Vous avez pointé du doigt l'absence de réactions des assemblées face aux ordonnances « travail », mais on peut regretter la rapidité avec laquelle on désire désormais légiférer sans laisser un temps suffisant aux parlementaires pour être force de proposition, et pas simplement pour s'opposer.
Je vous remercie de la précision de votre témoignage. Je salue l'équipe qui vous accompagne, dont vous mettez en avant le travail collectif au sein de votre association.
Audition de M. Dominique
Rivière et d'Ernestine Ronai, co-rapporteurs, au nom du Conseil
économique social et environnemental (CESE), du rapport Combattre les
violences faites aux femmes dans les Outre-mer,
et de Raphaëlle
Manière, vice-présidente de la délégation aux
droits des femmes du CESE
(15 février 2018)
Présidence d'Annick Billon présidente de la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes,
et de
Michel Magras, président de la délégation
sénatoriale aux Outre-mer
Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Mes chers collègues, je vous remercie de votre présence et je souhaite la bienvenue à notre collègue Dominique Vérien, qui siège désormais au sein de notre délégation en remplacement d'Élisabeth Doineau.
Nous souhaitions depuis longtemps travailler avec nos collègues de la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur des sujets d'intérêt commun. L'actualité a décidé pour nous du thème de cette audition conjointe, qui s'inscrit dans le cadre de nos travaux sur les violences faites aux femmes - qu'il s'agisse de violences sexuelles, de harcèlement ou de violences conjugales. Elle a été inspirée par nos trois collègues ultramarines Nassimah Dindar, Victoire Jasmin et Viviane Malet, qui ont rejoint la délégation aux droits des femmes depuis le dernier renouvellement, tout en étant membres de droit de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Nous connaissons leur implication dans ces sujets et, dès sa première réunion, notre délégation a décidé à l'unanimité d'accéder à leur souhait de consacrer une séquence de notre programme à la thématique des violences faites aux femmes dans les Outre-mer.
Nous recevons donc ce matin les co-rapporteurs de Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer , avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui est incontestablement le document de référence sur ce sujet. Publié en mars 2017, ce travail a fait date, en raison de l'exhaustivité du constat qu'il dresse comme de la qualité de ses quarante préconisations. Aussi, je remercie chaleureusement pour leur présence Mme Raphaëlle Manière, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du CESE, M. Dominique Rivière, co-rapporteur et vice-président de la délégation à l'Outre-mer du CESE et Mme Ernestine Ronai, co-rapporteure, responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes et co-présidente de la commission « Violences de genre » du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Ernestine est pour la délégation une interlocutrice précieuse et nous la connaissons bien. Nous l'entendons d'ailleurs pour la troisième fois depuis le mois d'octobre dernier. Je tiens également à adresser tous nos voeux de prompt rétablissement à Pascale Vion, présidente de la délégation aux droits des femmes du CESE, empêchée d'être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé.
Enfin, je rappelle que notre délégation poursuivra ses travaux sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer le 15 mars, avec l'audition des responsables scientifiques de l'enquête Virage Outre-mer .
Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer . - Je vous remercie, madame la présidente, d'avoir pris l'initiative d'associer notre délégation à la présente audition. Nous avions imaginé, au cours de l'année dernière, organiser un événement commun pour donner de la visibilité au rôle et à la place des femmes dans la vie économique et associative de nos Outre-mer, mais le temps nous a manqué tant il est difficile de dégager des créneaux communs à nos deux instances. Notre réunion atteste d'une volonté d'amorcer un mouvement qui est de bon augure ! Et je sais que nos collègues qui siègent au sein des deux délégations resteront vigilantes et épauleront, par leur dynamisme et leur engagement, de futures actions conjointes.
Je salue à mon tour nos trois invités et tiens à rendre hommage à la qualité du travail qu'ils ont accompli au CESE. Leur étude, sans concession sur un sujet éminemment douloureux, fait état d'une situation particulièrement préoccupante dans les Outre-mer, même s'il existe une grande disparité entre les territoires, en lien avec les niveaux de vie, les différences culturelles et la confrontation entre modernité et sociétés traditionnelles.
Comme sur de nombreux sujets concernant les Outre-mer, le constat est fait du caractère lacunaire des connaissances en matière de violences faites aux femmes et le remarquable rapport établi par Mme Ernestine Ronai et M. Dominique Rivière a le mérite de procéder à un état des lieux débouchant sur des préconisations concrètes. Je ne doute pas que ce travail considérable serve d'appui à un tissu associatif très prégnant dans nos Outre-mer et contribue à lutter contre le fléau de la violence.
Raphaëlle Manière, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du CESE. - Je suis heureuse de pouvoir évoquer nos travaux devant vos délégations. Si le CESE est une instance ancienne, sa délégation aux droits des femmes est beaucoup plus jeune puisqu'elle fêtera ses vingt ans en 2019. Elle poursuit une double mission : une veille transversale sur les travaux du CESE et, depuis quelques années, la production de ses propres avis.
À l'occasion d'un travail mené en 2014 sur les violences faites aux femmes par notre présidente Pascal Vion est apparue la nécessité de réaliser un focus sur les Outre-mer ; nous nous sommes donc réjouis de la saisine du CESE par le Gouvernement en 2017 sur ce thème.
Ce travail a été mené par les deux délégations aux droits des femmes et à l'Outre-mer du CESE.
Je voudrais maintenant vous dire un mot de nos travaux en cours et à venir.
Nous travaillons actuellement sur une étude, dont je suis rapporteure, sur les temps de vie des femmes. Nous sommes partis de l'ouvrage de la sociologue Dominique Méda, paru en 2001 436 ( * ) , dans lequel elle estimait que les leviers de transformation à l'oeuvre (loi sur la parité, développement des politiques d'égalité, réduction du temps de travail, etc.) allaient sensiblement modifier la vie des femmes. Mais nous avons fait le constat qu'il n'en avait finalement rien été. Nous réfléchissons donc aux moyens de remobiliser ces leviers pour transformer enfin l'organisation des temps de vie. Les femmes travaillent à l'extérieur du foyer tout en continuant à assumer 70 % des charges parentales et domestiques : elles sont fatiguées ! Il convient de réfléchir au partage des tâches, à la coparentalité, à l'organisation du travail et à la reconnaissance des métiers dans lesquels les femmes sont majoritaires, de repenser la dimension des congés parentaux - paternité et maternité - et, plus généralement, de lutter contre les stéréotypes.
Prochainement, nous engagerons aussi un travail sur la question des droits sexuels et reproductifs dans le cadre européen. Sans accès à la planification de leur maternité, à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception, il ne peut y avoir d'égalité possible pour les femmes. Or, les résistances en la matière sont nombreuses en Europe. Nous allons les identifier et réfléchir aux moyens de les lever.
Dominique Rivière, co-rapporteur de Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer , CESE. - Nous devons à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU) et au travail des militants des droits et de la cause des femmes le fait que la lutte contre les violences faites aux femmes soit devenue un enjeu historique et civilisationnel mondial. Les violences dépassent les clivages politiques, religieux, sociaux ou culturels ; le combat pour les éradiquer est celui de « la famille humaine », selon les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
En Outre-mer comme ailleurs, et sans même parfois que nous en soyons conscients, des stéréotypes sur le masculin et le féminin se sont installés dans nos esprits. Il était néanmoins apparu, lors des travaux menés par le CESE en 2014, que les violences faites aux femmes étaient plus nombreuses en Outre-mer. Le combat contre ces violences, loin de toute vision désincarnée, est mené par des acteurs de terrain, même si l'État, en application de la convention d'Istanbul contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 437 ( * ) , se doit également de mettre en oeuvre des actions et d'en rendre compte régulièrement. Nous avons donc pris soin de co-construire notre avis avec les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser), les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE), les conseils économiques, sociaux et culturels (CESC) et les associations, afin de disposer d'un état des lieux des violences et des initiatives existantes. La collaboration avec les Ceser est d'ailleurs une méthode de travail qui se développe au sein du CESE. En Nouvelle-Calédonie, le Ceser a réalisé à notre demande une étude sur le sujet, car la saisine prévoyait un focus particulier sur les territoires du Pacifique.
Pourquoi les violences faites aux femmes sont-elles plus fréquentes et plus graves en Outre-mer, même s'il existe des différences d'un territoire à l'autre ? Je parle de meurtres, voire de mains coupées - oui, cela existe ! Il convient de rappeler la toile de fond que constituent l'histoire coloniale et le passé esclavagiste. Cela explique en partie que le seuil de tolérance à la violence soit plus élevé en Outre-mer et qu'il y soit parfois moins aisé d'exprimer ses sentiments. Parce que la sidération face au maître fait que l'on a du mal à exprimer ses sentiments, pour les hommes comme pour les femmes. Et quand on n'a pas exprimé les choses, la violence surgit, notamment dans le contexte familial. Même si l'ensemble des classes sociales sont concernées par les phénomènes de violence, la situation économique et sociale dégradée de certains territoires, source de chômage, d'exclusion, de promiscuité dans les logements, voire d'alcoolisme et d'addiction, explique également ce constat. Enfin, l'apprentissage de la masculinité et de la féminité, à l'origine de stéréotypes ancrés dans les représentations de chacun, est influencé par les traditions et les religions. À cet égard, le Pacifique n'est pas si pacifique ! Les Églises y sont puissantes ; elles protègent certes les victimes, mais peuvent également contribuer à la propagation de certains stéréotypes. Elles se sont ainsi opposées à la signature de la convention d'Istanbul pour l'élimination des violences faites aux femmes, au motif qu'il y était question d'avortement et, en filigrane, de mariage entre personnes de même sexe. En conséquence, certains États de la zone Pacifique ne l'ont pas signée. Reste que la situation n'est guère plus brillante à La Réunion, où l'on enregistre de nombreux féminicides.
Plus globalement, les femmes souffrent, dans les territoires d'Outre-mer, d'une difficulté d'accès aux droits et à la protection publique (gendarmes, services publics, etc.). La lutte contre les violences faites aux femmes comprend des actions très concrètes : la mise à l'abri et la prise en charge des victimes, la formation des professionnels, l'information des populations. Nous les avons examinées dans le rapport. Elles nécessitent des financements spécifiques, que l'État devrait flécher vers les territoires qui en ont le plus besoin.
Les violences faites aux femmes représentent, évidemment, un gâchis humain pour les victimes, leurs enfants et les auteurs ; elles ont également un coût économique, du fait notamment des pertes d'emplois et du versement de réparations, que plusieurs études ont tenté de mesurer. Voici un argument supplémentaire pour lutter contre ce phénomène, si son caractère humainement inacceptable ne suffisait pas... Lutter contre les violences faites aux femmes aura des conséquences favorables sur l'économie, comme, monsieur Magras, les investissements au profit de l'activité économique sur les dépenses sociales. Le dossier est motivant, car les résultats en sont visibles. Populations et acteurs de terrain doivent se mobiliser pour faire de cette « grande cause nationale », selon l'expression de notre Président de la République, une grande cause locale.
Ernestine Renai, co-rapporteure de Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer , CESE . - La présentation de notre travail devant vous représente un moment important, auquel je souhaite associer les secrétariats de nos délégations : espérons que cette rencontre permettra à nos propositions, que nous avons souhaitées concrètes et précises, d'aboutir. Et je salue comme un gage de réussite la présence de nombreux sénateurs et sénatrices, de métropole comme des Outre-mer, à cette réunion.
Lorsque je me suis rendue en Martinique en décembre dernier pour présenter notre rapport à Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Leïla Laviolette, jeune enseignante, venait, avec ses enfants, de mourir sous les coups de son ex-compagnon. C'est dire l'urgence et l'importance de ce sujet ! En 2015 et en 2016, pas moins de dix femmes ultramarines ont été tuées par leur compagnon dans les Outre-mer ; elles étaient onze en 2014. On voit que le chiffre ne baisse pas. Cela représente un douzième des décès similaires enregistrés en métropole. Et encore, votre collègue Thani Mohamed Soilihi m'indiquait qu'à Mayotte, ces crimes n'étaient pas même répertoriés ! La proportion des femmes se déclarant, au cours d'une enquête, victimes de violences conjugales - sexuelles ou physiques - était, par rapport à l'hexagone, sept à neuf fois supérieure en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et très supérieure également en Guyane. Les violences au sein des couples sont deux fois plus nombreuses en Guadeloupe et en Martinique qu'en métropole. Cet écart est identique s'agissant des violences sexuelles à La Réunion.
Les stéréotypes sexistes expliquent en partie cet état de fait. En Nouvelle-Calédonie, où nous nous sommes rendus dans le cadre de ce rapport, leur prégnance est particulièrement impressionnante. J'ai relu à cette occasion Françoise Héritier, qui écrivait que « dans l'histoire des sociétés, les hommes se sont rendu compte que c'était les femmes qui mettaient les enfants au monde ». Selon son analyse, les hommes se sont appropriés le corps des femmes pour avoir la certitude de leur paternité. Cette appropriation, qui concerne particulièrement la sexualité et la reproduction, a pris dans le temps et dans l'espace des formes différentes : la ceinture de chasteté dans l'Occident médiéval, l'infibulation dans certaines ethnies et, partout, l'enfermement, qui prive la femme de sa liberté sexuelle, de sa liberté de circulation et l'exclut du savoir, du pouvoir économique et politique. Les femmes sortent progressivement de cet état - nous l'avons constaté en Nouvelle-Calédonie -, ce qui crée, selon les termes de M. Magras, une confrontation entre modernité et tradition. Cela ne veut pas dire bien sûr que les hommes soient tous des agresseurs. Il faut aussi souligner que protéger une femme ne signifie pas que l'on en fasse une victime pour toujours, mais qu'on lui permette de reprendre sa vie en main.
Nous avons, dans ce document, souhaité dresser un bilan complet de la situation dans les Outre-mer, aidés par les populations, les services des ministères compétents, notamment celui de la Justice, et les associations. Les quarante préconisations qui en découlent s'organisent autour de six axes.
Le premier axe vise à renforcer les connaissances sur les violences faites aux femmes. Les éléments statistiques manquent pour certains territoires ; ils sont, par exemple, inexistants en Guyane et à Mayotte. À cet effet, nous proposons que l'enquête Virage sur les violences, menée en Hexagone et, prochainement, en Guadeloupe, à La Réunion et probablement en Nouvelle-Calédonie, soit reproduite dans l'ensemble des territoires ultramarins. Si cette extension était difficile dans l'immédiat, l'enquête « Migrations, famille et vieillissement » de l'Institut national d'études démographiques (INED), déjà effectuée en Outre-mer, pourrait utilement se voir adjoindre des questions supplémentaires relatives aux violences faites aux femmes. Déjà, l'enquête annuelle « Cadre de vie et sécurité » sera étendue à Mayotte d'ici 2020 et renouvelée à La Réunion, mais il conviendrait d'en élargir le champ. Plus généralement, il serait également utile de soutenir les travaux de recherche universitaires, à l'instar des thèses de médecine menées sur ce sujet à Mayotte.
Le deuxième axe porte sur le développement de la coopération et de la coordination entre les acteurs, afin de disposer d'un diagnostic partagé et de mettre en oeuvre des actions conjointes. La loi de programmation du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle des Outre-mer 438 ( * ) préconisait à cet égard la généralisation des observatoires territoriaux. Des partenariats existent déjà entre administrations et associations dans le cadre d'observatoires en Guadeloupe, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, avec un quadruple objectif : diagnostiquer les cas de violences, enrichir les connaissances en la matière, promouvoir l'innovation et, surtout, évaluer les dispositifs existants. Les déléguées départementales et régionales aux droits des femmes et à l'égalité jouent également un rôle majeur, notamment en matière de subventions aux associations. Toutefois, elles ne sont pas partout installées : c'est le cas en Guadeloupe. Ce sera aussi le cas prochainement en Martinique, avec le départ en retraite de l'actuelle déléguée, prévu au mois de juin.
Le troisième axe a pour objectif de conforter la formation des professionnels (associatifs, médecins, forces de l'ordre, etc.). Nous recevions hier la responsable des droits des femmes de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, qui rappelait ce besoin. L'accent doit particulièrement être mis sur la formation : celle des forces de sécurité, concernant la prise en charge des psycho-trauma, celle des magistrats - une réflexion est d'ailleurs en cours avec l'École nationale de la magistrature (ENM) pour renforcer la formation préalable à une prise de poste dans ces territoires - sans oublier la formation des professionnels de santé dans les unités médico-judiciaires (UMJ), les centres médico-sociaux et les services de protection maternelle et infantile (PMI). En Nouvelle-Calédonie, nous avons ainsi pu constater le rôle majeur joué par les nombreux centres médico-sociaux installés en province Nord pour l'accueil des victimes.
Le quatrième axe concerne l'amélioration de la prévention et de l'information auprès des populations, et notamment des jeunes. En Outre-mer, les grossesses précoces non désirées sont plus fréquentes qu'en métropole, sur fond d'accès insuffisant à la contraception et à l'IVG, de précarité, de difficulté, voire d'échec scolaire, et de violences sexuelles. Dans ces conditions, il est indispensable de renforcer les moyens des antennes locales du Mouvement français pour le Planning familial , en particulier en Guyane, où ces situations sont nombreuses, et d'en ouvrir une à Mayotte. Ces antennes, fréquemment gérées par des bénévoles, réalisent un travail extraordinairement important, en distribuant gratuitement des moyens de contraception, en permettant de réaliser des IVG médicamenteuses et en dispensant un suivi gynécologique. Il convient également de travailler sur les stéréotypes sexistes dans les écoles et les universités. Des actions de lutte contre les violences faites aux femmes et contre le sexisme sont menées via la mobilisation du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, créé en 2014 et doté d'un million d'euros : elles doivent être évaluées, de manière à inscrire dans la durée des dispositions jugées efficaces. Il est enfin nécessaire de sensibiliser les populations à la gravité des comportements violents et sexistes. Déjà, des campagnes d'information sont conduites dans les territoires ultramarins, avec des effets positifs, comme en témoigne l'augmentation du nombre de plaintes déposées par des femmes victimes de violences. Mais ces campagnes doivent être amplifiées ! Les premiers États généraux contre les violences faites aux femmes, qui se sont ouverts en novembre 2016 à La Réunion, ont réuni plus d'un millier de personnes : c'est extraordinaire ! Les campagnes #Metoo et #Balancetonporc ont également conduit à une croissance de 30 % des dépôts de plaintes, et c'est extrêmement positif. Nous avons également été séduits par l'initiative mahoraise consistant à transmettre des messages de sensibilisation via les telenovelas populaires. Il serait utile de traduire ces séries en créole pour en étendre la diffusion à La Réunion et, plus globalement, de diffuser aussi les supports d'information dans les langues usuelles des territoires d'Outre-mer.
Le cinquième axe porte sur la consolidation des procédures de soutien aux victimes, sur le modèle des actions menées en métropole : mieux les repérer et les orienter en développant les lieux d'écoute et d'orientation ainsi que les référents dans les commissariats ; d'un point de vue sanitaire, former les services d'urgence à l'accueil et au repérage ; créer des unités médico-judiciaires (UMJ) sur chaque territoire ; prévoir la gratuité des soins pour les psycho-trauma, comme pour les victimes du terrorisme ; en matière pénale, étendre le « téléphone grave danger » (TGD), malgré, parfois la faiblesse du réseau téléphonique ; établir des antennes des bureaux d'aide aux victimes là où le tribunal de grande instance n'est pas facilement accessible ; prévoir des traducteurs professionnels à tous les stades de la procédure ; renforcer les solutions de mise à l'abri, car il est particulièrement difficile pour une victime de se protéger des représailles sur une île ; sensibiliser les entreprises et améliorer l'accès à l'emploi et à la formation pour assurer, autant que possible, une autonomie financière aux victimes ; enfin, améliorer l'accompagnement des populations les plus fragilisées (femmes handicapées, migrantes, prostituées, etc.).
Le sixième axe de nos travaux porte enfin sur les moyens attribués à ces politiques publiques. Le ministère des Outre-mer doit, nous semble-t-il, dédier des financements spécifiques à ces actions et les faire figurer dans un document transversal. Les dispositifs doivent faire l'objet d'une évaluation préalable à leur montée en puissance. Comme l'indiquait mon collègue Dominique Rivière, je vous rappelle que le coût des violences faites aux femmes, estimé à 3,6 milliards d'euros, est bien supérieur aux 30 millions d'euros de budget annuel du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes !
Nous comptons sur votre soutien pour porter nos préconisations, qui s'inscrivent dans le cinquième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes pour la période 2017-2019. Je conclurai par une phrase d'Aimé Césaire, qui illustre à la fois notre état d'esprit et notre combat : « Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté ».
Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Vous terminez sur une note pleine d'espoir. Les propos de M. Rivière sur le seuil d'acceptabilité de la violence m'ont interpellée. Cela me faisait penser au débat sur l'interdiction de la fessée sur les enfants : on ne peut définir un seuil à partir duquel la violence serait acceptable ! Pourtant, vous l'avez indiqué, les violences faites aux femmes sont plus fréquentes et plus graves dans les Outre-mer. L'évocation des mains coupées glace le sang !
Ce combat est essentiel, et je remercie nos collègues sénatrices des Outre-mer d'avoir pris l'initiative de l'intégrer à nos travaux. Il apparaît que de nombreuses actions sont menées dans ces territoires par des associations qui, sans guère de moyens, accomplissent des missions qui relèvent du service public. Je comprends mieux - et je salue - l'engagement de notre collègue Victoire Jasmin auprès des associations guadeloupéennes ! Ces associations méritent d'être soutenues. Les campagnes récentes sur les réseaux sociaux ont libéré la parole des femmes, c'est heureux, mais comment les associations, avec leurs moyens techniques et humains limités, vont-elles pouvoir absorber ce flux de plaintes nouvelles et d'appels au secours ?
Victoire Jasmin . - J'approuve vos interventions. J'appartiens à la Fédération féminine d'organisation et de revalorisation culturelle, économique et sociale ( Forces ) présidée par Christiane Gaspard-Méride, et à l'Observatoire féminin de Guadeloupe. Il y a un très fort taux de violences familiales, avec des conséquences évidentes pour les femmes, dans mon département. Il y a quinze jours, notre collègue Catherine Conconne a mentionné, lors des questions d'actualité au Sénat, un meurtre qui s'est déroulé en Martinique. C'est un problème récurrent, lié à la situation économique et sociale, et qui a des conséquences importantes sur les enfants : les enfants risquent de reproduire ces comportements une fois adultes ; c'est très grave.
De nombreuses associations tentent d'accompagner les femmes, avec la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la Guadeloupe (DRDFE). Une Maison des femmes a été créée dans une ville - mais elle n'est pas aussi développée qu'en Seine-Saint-Denis, si j'en juge par l'audition de sa fondatrice, le Docteur Ghada Hatem, par la délégation aux droits des femmes, le 14 décembre 2017 439 ( * ) . De nombreuses initiatives émanent des bénévoles et parfois, des contrats aidés, mais les moyens manquent.
Interrogeons-nous aussi sur la transmission et l'éducation des garçons. Nous avons des partenariats avec l'éducation nationale et les fédérations de parents d'élèves pour sensibiliser chacun à l'égalité femmes-hommes. Un référent de l'éducation nationale intervient sur ce sujet sur le territoire du rectorat.
Certaines initiatives ne portent pas encore tous leurs fruits car les personnes qui sont les plus touchées ne viennent pas forcément. Je prends un exemple : depuis deux ans, l'association Forces a mis en place des groupes de parole pour répondre à la demande des femmes. En créole, on dit « façader » : se parler face à face. Il faut aussi interroger notre façon d'éduquer les garçons. Auparavant, l'éducation était focalisée sur le matriarcat : ce sont les femmes qui transmettaient les valeurs, mais qui prodiguaient également une éducation différenciée entre filles et garçons. Les hommes n'étaient pas là pour transmettre certaines valeurs. Tout reposait sur les femmes. Elles autorisaient davantage de choses aux garçons, tandis que les filles restaient dans l'ignorance. Désormais, les choses ont évolué et dans ces « façades », ces groupes de parole, on réalise que les hommes sont frustrés car les femmes ont pris une certaine indépendance. Auparavant, lors d'une situation critique, la famille voulait apaiser la situation, éviter que d'autres personnes soient informées, et la femme obéissait. Il y a quelques années, aux urgences, une femme des Abymes déclarait ainsi, un couteau dans le ventre, aux côtés de son conjoint, qu'elle était « tombée dessus ». Comment peut-on tomber sur un couteau ? Elle est décédée sans avoir dénoncé son mari. Désormais, la famille est souvent moins soudée.
Le paradoxe est que malgré ces violences, les femmes sont très fortes dans les Antilles. On peut dire que, dans une certaine mesure, elles ont pris le pouvoir, comme le suggère l'exemple de Gerty Archimède, députée, avocate et conseillère générale, et de Lucette Michaux-Chevry, qui est devenue ministre. Beaucoup ont été maires ou conseillères générales avant même l'adoption de lois sur la parité.
Des femmes meurent sous les coups de leur compagnon, pour n'avoir rien dit. Il faut former les personnels des urgences pour accueillir la parole de ces victimes. De nombreuses femmes portent plainte puis la retirent, sous la pression de leur environnement. Certaines acceptent la violence de leur compagnon car elles sont dépendantes, affectivement ou financièrement. Toutes les violences ne sont donc pas forcément répertoriées. Les violences faites aux femmes posent aussi un problème d'absentéisme au travail, et créent des déséquilibres dans l'entreprise. Elles ont donc des conséquences économiques très négatives.
Les enfants sont également touchés : tout le monde se connaît dans l'archipel, les femmes ne peuvent fuir loin, et il faut scolariser les enfants. Cela les empêche de quitter leur compagnon violent. Le rapport du CESE doit nous faire réagir. Cette violence familiale se retrouve dans l'école, dans la rue ou même au carnaval ! Il n'y a pas suffisamment de dialogue au sein des familles, ce qui provoque des frustrations, engendrant de la violence et celle-ci se propage.
Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Merci de votre intervention passionnée, et de votre engagement de longue date pour cette cause.
Viviane Malet . - Je salue l'excellente étude du CESE. J'ai été vice-présidente d'un Centre communal d'action sociale (CCAS) et d'un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Il y avait aussi un centre d'hébergement d'urgence et un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : le territoire de Saint-Pierre est un modèle à cet égard, bien mieux pourvu que d'autres en métropole ! Le CCAS est un lieu de proximité où la femme en difficulté se réfugie avant de voir un médecin ou d'aller au commissariat de police. La seule solution, c'est la mise à l'abri immédiate. Le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) émet des préconisations, mais la femme est souvent conduite immédiatement dans une chambre d'hôtel. Il faut des solutions plus pérennes car il y a trop peu de maisons-relais. Construisons dans nos territoires ces structures pérennes et laissons-en la gestion à des associations. Il faut se battre pour trouver un logement adapté à la famille et faire des baux glissants, car il est difficile de déloger une famille une fois qu'elle a trouvé un hébergement temporaire, sans compter la scolarisation des enfants. Les élus ont des difficultés de gestion et de coordination. Le 25 novembre dernier, se sont réunies dix-sept associations de La Réunion qui ont signé une motion dénonçant le manque de moyens ; nous le savons, les dotations des collectivités diminuent. Il y a des difficultés de sources de financement, d'activation de ces moyens, et des délais trop longs : souvent, les subventions ne sont versées qu'en année N+1.
Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer . - Merci infiniment pour la qualité de votre exposé et la consistance du rapport. La présence de nombreux collègues masculins témoigne de l'importance que nous accordons à ce sujet. La délégation aux Outre-mer est très diverse, rassemblant au-delà des obédiences politiques, hommes et femmes, métropolitains et ultramarins, ce qui fait toute sa richesse.
Comment transformer l'essai, et passer des préconisations aux applications concrètes ? Nos délégations n'ont pas de pouvoir législatif propre mais les sénateurs ont, à titre individuel, un pouvoir d'initiative législative. Pour les mesures qui ne sont pas d'ordre législatif, c'est aux collectivités et territoires d'agir.
De par leur histoire et les aléas qui les touchent, les ultramarins ont l'habitude de la violence, et du mal à extérioriser leurs sentiments. Ils sont malheureusement souvent résignés face à leur destin. Je suis fier que nous prenions conscience que le destin n'est pas une fatalité, qu'il se construit. Les choses changent, et la voix des Outre-mer commence à se faire entendre.
Selon vous, l'État seul ne peut pas tout. C'est effectivement aux ultramarins de se prendre en main. L'État est là pour accompagner, donner des moyens, aider notre volonté à se concrétiser. C'est le fil conducteur pour notre délégation, sur tous les sujets que nous traitons. Nos propositions sont du grain à moudre ; à l'État, au Parlement, aux collectivités de les transformer en réalisations concrètes.
Madame Ronai, vous voulez flécher la part de financement dédiée à ces actions au sein du budget des Outre-mer. Je suis rapporteur pour avis, pour la commission des affaires économiques, de ce budget, qui comporte les programmes Emploi et Conditions de vie. Cependant, les crédits budgétaires bénéficiant aux Outre-mer sont dispersés dans de nombreuses missions du budget de l'État et difficilement identifiables.
Roland Courteau . - Merci pour vos remarquables exposés et vos recommandations pertinentes sur les violences faites aux femmes, véritable fléau en métropole et en Outre-mer. Comment traduire en actes ces recommandations ? Cela devrait devenir l'un de nos prochains chantiers !
Monsieur Magras, vous avez insisté sur le manque de connaissance des violences faites aux femmes en Outre-mer. Il en était de même dans les années 2000 en métropole : le sujet était minimisé. En 2005, on connaissait le nombre des téléphones portables volés, mais pas celui des femmes mourant sous les coups de leur conjoint !
Vous avez mis le doigt sur l'essentiel : les stéréotypes sexistes, première cause des violences faites aux femmes. Pour certains hommes, la masculinité suppose des droits sur les femmes ou une domination sur les femmes. Lutter contre ces stéréotypes dans les écoles, les manuels scolaires, et même dans les jouets, est une priorité. Notre délégation a consacré à ces questions deux rapports d'information 440 ( * ) .
Quel est le coût économique et social des violences faites aux femmes en Outre-mer ? Il est de 3,6 milliards d'euros en métropole. Quelles sont les perspectives s'agissant des centres de soins sur le psycho-trauma ? Le Gouvernement nous a toujours répondu que multiplier les centres de soins pour les victimes ou les auteurs des violences coûtait très cher. Mais avec 3,6 milliards d'euros, on pourrait en créer un certain nombre, pour les femmes et les enfants !
Qu'en est-il de l'ordonnance de protection en Outre-mer, alors qu'il existe des difficultés d'application en métropole, à l'exception de la Seine-Saint-Denis ? Combien compte-t-on de Téléphone grave danger (TGD) dans les Outre-mer ? Les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences se mettent difficilement en place en métropole, quelle est la situation dans les Outre-mer ? Qu'en est-il des intervenants sociaux, indispensables ? Le relogement des victimes laisse aussi à désirer en métropole, alors qu'il devrait être prioritaire. Les violences physiques sont-elles plus nombreuses que les violences sexuelles en Outre-mer ? Et que sait-on des violences psychologiques ?
Gérard Poadja . - Ce sujet est très important pour moi. Les violences faites aux femmes ne doivent pas être vues comme particulières à chaque territoire : il faut une approche globale car c'est l'affaire de tous, même si la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier, avec une cohabitation du droit commun et du droit coutumier. Il faut poursuivre le travail d'amélioration de l'organisation de la justice. Désormais, des officiers peuvent réaliser des actes coutumiers, des tribunaux sont décentralisés et tiennent des permanences dans les villages. Il faut du personnel formé pour nous faire sortir de ces traditions. Dans les îles, nous n'osons jamais nous exprimer ouvertement.
Faute de moyens, il y a très peu de maisons d'accueil pour les femmes maltraitées, très peu de personnel formé pour l'accueil et surtout l'accompagnement de ces personnes. L'important n'est pas seulement un lieu où déposer plainte, mais un accueil.
Le statut coutumier est difficile à gérer, hormis pour ceux qui, comme moi, le connaissent très bien et qui travaillent pour une meilleure cohésion entre les deux droits. 80 à 85 % des femmes de Nouvelle-Calédonie sont sous statut coutumier. De nombreuses femmes ne dénoncent pas, en raison de la chape de plomb des traditions et de la crainte des représailles.
Les Outre-mer sont dans une situation délicate. En Nouvelle-Calédonie, nous avons pris les choses en main. Mais au-delà de la volonté, il faut agir. Ne laissons pas un trop grand délai entre le dépôt de plainte et l'intervention du juge car, dans l'intervalle, la femme peut subir encore plus de violences. Il faut de la solidarité et de l'accompagnement.
Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer . - Merci de parler avec autant de liberté.
Guillaume Arnell . - Nous sommes dans une position inconfortable car les violences faites aux femmes sont commises par des hommes... Je remercie les rapporteurs pour la clarté et la justesse de leur analyse, et pour avoir tenu compte de l'ensemble des territoires, dont Saint-Martin. Ce territoire, en partie autonome, connaît des phénomènes de violence anormalement importants par rapport à sa taille et à la faiblesse de la population - 30 000 habitants.
L'absence de statistiques ne doit pas occulter l'existence de ces phénomènes de violences anormalement élevés.
Qu'ont fait ces femmes pour mériter un tel traitement ? Notre collègue Victoire Jasmin a apporté un élément d'explication, avec l'éducation. Il faut dénoncer la première violence car il ne saurait y avoir de seuil d'acceptabilité. Lors du dépôt de plainte, les gendarmes se rendent souvent compte que ce n'était pas la première fois. Incitons les victimes à s'exprimer immédiatement.
Les femmes ont souvent honte de porter plainte, d'autant que leurs plaintes ne sont pas toujours reçues avec sérieux et que les gendarmes tardent parfois à se déplacer - il n'y a pas de police nationale, et la police territoriale refuse de prendre part à ces sujets.
La réponse judiciaire est lente, quelle que soit la nature des affaires. Les hommes sont absents du dispositif de prise de conscience ou des initiatives contre la violence. Serait-il envisageable de créer une structure où les hommes pourraient parler et participer activement à la solution ?
Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer . - Les sociétés antillaises sont en pleine contradiction : la femme est au centre de l'organisation familiale, elle est le potomitan , mais elle est aussi la plus maltraitée.
Dominique Théophile . - Je tenais à être présent aujourd'hui, pour cette grande cause nationale. Comme pour la santé, attachons-nous aux deux aspects, préventif et curatif. Ce n'est pas une course de vitesse mais un changement de mentalité est nécessaire. Le curatif doit peut-être différer selon les territoires, leur histoire, mais la prévention doit être générale. Tous les moyens doivent être axés sur la prévention. L'éducation nationale s'est emparée du sujet de la sécurité routière, ce qui a permis de faire baisser la mortalité routière. De la même manière, l'éducation nationale doit centrer ses actions sur les violences faites aux femmes, avec un volet masculin.
Oui, il y a une contradiction entre la place de la mère choyée qui tient le foyer et les violences qui la touchent. Une proportion de cas reste cachée, du fait de l'attitude des victimes. Dans certaines entreprises, des femmes déclaraient avoir eu des accidents, alors qu'elles étaient battues. Certaines victimes refusent de l'admettre, pour elles, pour leurs enfants ou pour éviter le regard des autres. Mais les gestes se reproduisent. L'éducation nationale doit s'emparer de ce sujet. Malgré le poids de l'histoire, les jeunes font bouger les lignes.
La loi doit fixer un cadre général avec une échelle de peines adaptée aux différents actes.
Vivette Lopez . - Les violences faites aux femmes sont un problème global, qui existe aussi dans l'hexagone. Dans une île, tout le monde se connaît. Pourquoi cette loi du silence ? Pourquoi les voisins ne donnent-ils pas l'alerte, pourquoi les gendarmes ne prennent-ils pas en compte le signalement ? Le temps est trop long entre la connaissance des faits et l'intervention de la justice et favorise l'escalade de la violence. Se préoccuper du choix des jouets ne sert à rien car garçons et filles mélangés jouent aux mêmes jeux. Les femmes sont les piliers de la maison, et elles sont en charge de l'éducation. Souvent les garçons supportent mal que leur mère soit maltraitée et s'en prennent, adultes, à leur père ou à d'autres, ce qui ne les empêche pas, à leur tour, de reproduire ce qu'ils ont vécu.
Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Depuis le renouvellement de septembre 2017, la délégation aux droits des femmes a choisi de travailler sur le thème des violences faites aux femmes dans sa globalité, notamment sur l'ensemble des violences sexuelles. Nous travaillons aussi sur les mutilations sexuelles féminines. Cette table ronde répond à la demande des sénatrices des Outre-mer membres de la délégation aux droits des femmes, qui nous ont fait remarquer des particularités prégnantes de leurs territoires : la gravité et le nombre des violences faites aux femmes, dans des îles où la promiscuité rend le signalement plus difficile et fausse les statistiques.
L'éducation à la sexualité et la sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes figurent dans le code de l'éducation depuis 2001. Encore faut-il disposer des moyens correspondants...
Dominique Rivière . - Nous réalisons ici une acculturation. Les ultramarins doivent porter ce sujet et l'État, assumer ses responsabilités régaliennes et coordonner les moyens en lien avec le plan national. Nous avons l'habitude de faire plus avec moins...
L'idée de fatalité en Outre-mer évolue. Une course de fond est engagée. L'éducation nationale et les collectivités territoriales peuvent, par une propagande massive, « ringardiser » les auteurs de violences et l'idée du mâle dominateur. Améliorons la communication publique sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'initiative mahoraise sur les telenovelas , histoires fondées sur le quotidien des populations, invite celles-ci à se regarder en face et encourage les changements de comportement. Les pouvoirs publics font de la propagande pour la sécurité routière ou contre l'alcoolisme, plus difficilement contre les violences faites aux femmes. Réalisons des campagnes de prévention pour libérer la parole. Cela éduquerait les plus jeunes et modifierait le comportement des parents. La transmission des stéréotypes sexistes se fait aussi par la mère !
Parfois les gendarmes refusent de prendre une plainte, sachant qu'elle sera retirée sous pression de la famille. Il faut une réponse pénale et un traitement psychologique des auteurs, mais les moyens manquent. La récidive est décourageante ; souvent, la violence est apprise dès l'enfance. Cela nécessite une prise en charge individualisée. À nous de dialoguer dans les territoires, et de nous faire entendre à l'échelle nationale.
Roland Courteau . - Je comprends parfaitement pourquoi la femme retire sa plainte ou ne la dépose pas : elle craint les représailles. Dans notre esprit, l'ordonnance de protection devrait répondre à ce problème. Or souvent, elle n'est délivrée qu'avec parcimonie, et tardivement.
Dominique Rivière . - De plus, c'est la femme qui doit partir alors que l'auteur des violences reste au domicile conjugal !
Ernestine Ronai . - J'ai apporté un tableau récapitulant les progrès accomplis depuis l'adoption de nos quarante recommandations : réalisées, en cours, à faire, non-réalisées, administration non concernée... Nous rencontrons tous les ministères pour les informer et faire l'état des lieux des recommandations qui les concernent, ainsi que l'ENM. En novembre prochain, nous ferons le point. Le suivi de ce travail est aussi important que les constats qu'il établit et les recommandations qui l'accompagnent.
Comment faire appliquer ces préconisations ? La gendarmerie, la police et la justice manquent de moyens. Il faut des magistrats et des policiers en nombre suffisant en Outre-mer. Mesdames et Messieurs les parlementaires, vous votez la loi de finances. Nous comptons sur vous pour mettre en avant cette exigence au moment du vote du budget.
Nos recommandations ont été très bien accueillies par les deux ministères de l'Outre-mer et de l'Égalité femmes-hommes, qui ont endossé cette « feuille de route ». Les deux ministres y sont très attentives.
Gardez un oeil sur le fléchage des crédits relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer. Je vous remercie pour vos remarques qui nous aident à réfléchir.
S'agissant de la prévention, il faut être conscient que le premier lieu d'apprentissage de la violence est la maison. Les référents de l'éducation nationale existent aussi dans les Outre-mer. L'éducation nationale fait un effort, mais ne peut pas tout : toute la société doit bouger. Oui, les enfants peuvent reproduire la violence dont ils sont témoins. Le pédopsychiatre Maurice Berger racontait sa surprise de constater que les enfants les plus violents n'étaient pas ceux qui avaient eux-mêmes subi des coups, mais ceux qui avaient été exposés au spectacle des violences conjugales. Et les plus petits pouvaient être touchés, avec des gestes, des regards, des sensations susceptibles de faire ressurgir l'image du parent violent à l'occasion d'un événement qui leur faisait de nouveau éprouver leur peur. Alors l'enfant ne distingue plus le passé du présent et risque de devenir dangereux. Le psycho-trauma marque le cerveau, on le sait maintenant !
Vous le savez bien, nous éduquons nos enfants avec la société ; la famille n'est pas isolée. Il y a donc tout un travail à mener en tant qu'individu, mais aussi en tant que société et collectivité nationale.
N'inversons pas la culpabilité en parlant du déni des femmes. Le seul responsable de la violence, c'est l'agresseur. Le mécanisme de déni a un rapport avec celui de la violence. La femme est souvent sous emprise et reçoit des injonctions contradictoires : l'homme à la fois la dévalorise et lui dit qu'il l'aime. L'emprise explique que la femme puisse retirer sa plainte. Lorsque l'homme, craignant son départ, redevient « gentil », elle retire sa plainte en espérant qu'« il a changé ». Personne ne veut voir dans son compagnon un « sale type » ! Nous enseignons aux policiers et aux magistrats à gérer ces phénomènes d'emprise et de psycho-trauma.
Le 25 novembre dernier, le Président de la République a annoncé la création de dix unités de psycho-trauma en France. Je veillerai à ce qu'il y en ait au moins une en Outre-mer. Nous avons besoin de nous acculturer sur ce sujet.
L'hébergement est un problème majeur. Il y a quatre CHRS pour mille habitants en Guadeloupe, quatre en Guyane, huit à La Réunion, quatre en Martinique, mais 855 en métropole... Voyez le décalage ! Certains territoires n'ont même pas de foyers mère-enfant. Il y a vraiment besoin de travailler ce sujet.
Les hommes de Nouvelle-Calédonie ont participé à la campagne du ruban blanc 441 ( * ) . Impliquer les hommes dans la lutte contre les violences est important. La répression fait aussi partie de la prévention. Les hommes violents ne sont pas malades - sinon ils ne seraient pas condamnés. Depuis la loi de 2014 442 ( * ) , on parle de « groupes de responsabilisation » pour les hommes, et de « groupes de parole » pour les femmes qui sont victimes. Parce que les hommes font un choix : on a toujours le choix de ne pas être violent. Et ils sont pénalisés justement parce que c'est un choix.
Monsieur Poadja, j'ai été très sensible à votre discours sur le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie et sur la volonté de sortir d'une situation où la femme est très infériorisée. Un autre statut est nécessaire. Notre rapport émet par exemple des préconisations pour simplifier et accélérer les procédures judiciaires, afin qu'un seul juge (au lieu de trois) traite les dossiers pénaux des violences faites aux femmes.
Je tiens à saluer l'action de Roland Courteau sur les dispositifs de protection. Le mécanisme des ordonnances de protection monte en puissance. Il dépend des moyens de la justice et de la formation des magistrats. Nous intervenons sur ce thème lors de la formation initiale de tous les magistrats et lors des formations continues. La loi prévoyait que l'ordonnance de protection serait délivrée avant le dépôt de plainte mais la réalité est tout autre : elle est délivrée dans les faits au moment du dépôt de plainte. Vous devez rappeler la volonté du législateur d'organiser la protection avant le dépôt de plainte.
Soyez attentifs aux Téléphones grave danger (TGD) : le troisième appel d'offres risque d'être infructueux dans certains territoires, par manque de couverture réseau. Je l'ai signalé hier à Nicole Robineau, membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie connue pour son engagement en faveur des droits des femmes. Installons au moins des TGD dans les endroits couverts par le réseau - par exemple à Nouméa.
Je suis d'accord avec vous, le rôle des intervenants sociaux est très important. Je pense qu'il y aura des annonces en ce sens le 8 mars.
Enfin, il serait judicieux de demander une étude sur le coût des violences faites aux femmes en Outre-mer.
Pour conclure, je reprendrai une de mes citations favorites : Simone de Beauvoir disait que « La fatalité ne triomphe que si l'on y croit ». Dans vos deux délégations, vous ne croyez pas à la fatalité, donc les violences faites aux femmes vont reculer !
Guillaume Arnell . - Ne vous méprenez pas. Lorsque je demandais : « Qu'ont-elles fait pour mériter un tel traitement ? », je m'interrogeais sur les raisons de la violence des hommes.
Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Nous l'avions bien compris ainsi.
Françoise Laborde . - La délégation aux droits des femmes travaille depuis longtemps sur les violences faites aux femmes, les violences conjugales et leurs incidences sur les enfants. Alertons tous nos collègues ! Lorsque nous proposons des mesures de prévention, nos amendements sont souvent retoqués au titre de l'article 40 de la Constitution. L'habitude est de les gager sur le tabac... Ne pourrait-on pas inventer un gage sur les dépenses publiques liées aux violences ? Le curatif coûte plus cher que la prévention. Nous pourrions changer cette façon de gager...
Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer . - Merci de soulever ce problème dont nous avons tous été victimes... mais l'article 40 ne peut être modifié que par une révision constitutionnelle !
Françoise Laborde, co-rapporteure . - C'est le moment !
Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer . - Merci pour cette réunion pertinente et de qualité. Si les Outre-mer connaissent les mêmes problèmes que la France entière, nous avons aussi des spécificités. Certaines solutions particulières sont peut-être à trouver en sus des solutions nationales. J'ai été très heureux de travailler avec la délégation aux droits des femmes. La nôtre sera toujours à l'écoute, et prête à mettre en commun ses énergies et ses compétences.
Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes . - Merci à nos collègues ultramarins de nous avoir fait part de leur expérience de terrain. La question des violences faites aux femmes est un problème global, qui pose une question de société : quelle place voulons-nous y faire pour les femmes, et avec quelles conséquences - notamment sur les enfants ? Travaillons ensemble pour que la société donne aux femmes la place qu'elles méritent !
Audition de François
Molins,
procureur de la République de
Paris
(22 février 2018)
Présidence d'Annick Billon, présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions sur les violences sexuelles. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin François Molins, procureur de la République de Paris, dont nous connaissons tous l'implication dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Je précise à l'attention de François Molins que notre délégation a souhaité travailler cette année sur les violences faites aux femmes, afin de préparer l'examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement, mais aussi pour réagir à une actualité extrêmement chargée.
Depuis le mois de novembre, nous avons ainsi entendu de nombreux experts et représentants d'associations, aussi bien sur la question des violences sexuelles que sur le thème du harcèlement. Ces personnes nous ont parlé des conséquences de ces différentes formes de violences sur la vie des victimes - sur leur santé et sur leurs carrières notamment - et ont formulé des propositions pour améliorer non seulement leur prise en charge médicale et psychologique, mais aussi leur accompagnement dans un parcours judiciaire souvent compliqué.
S'agissant justement du parcours judiciaire des victimes, le parquet de Paris est souvent cité comme modèle. Nous souhaiterions donc que vous nous présentiez la politique de votre parquet en matière d'infractions sexuelles : comment sont traitées les affaires de violences sexuelles au parquet de Paris ? Qu'en est-il de la correctionnalisation des viols ? Que pouvez-vous nous dire des alternatives aux poursuites en matière d'agressions sexuelles ? Dans quelles circonstances sont-elles adaptées ? Quelles sont selon vous les bonnes pratiques des magistrats à généraliser pour améliorer le traitement judiciaire des violences sexuelles ? Que pensez-vous de l'idée de chambres spécialisées parfois présentée comme une piste d'évolution possible pour assurer le traitement de ces dossiers très complexes ?
Plus généralement, quels sont selon vous les « angles morts » de la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et de la réponse pénale qui y est faite ? En ce qui concerne la loi pénale, y a-t-il des évolutions législatives souhaitables selon vous (prescription, consentement...) ?
S'agissant plus spécifiquement du harcèlement, pourriez-vous nous donner quelques éléments statistiques relatifs à la répression pénale du harcèlement sexuel (au travail, en ligne, dans le couple...) ? La définition du harcèlement sexuel faite par le code pénal vous semble-t-elle adaptée aux différentes formes de harcèlement en ligne mises en lumière par le récent rapport du Haut conseil à l'égalité (HCE) ? Plus généralement, quel bilan dressez-vous de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ? Des évolutions législatives vous paraissent-elles souhaitables en ce domaine ?
Monsieur le Procureur, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation.
Nous sommes certains que vous pourrez nous apporter des éléments de réponse à ces nombreuses questions, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres points que je n'aurais pas soulevés et qui vous paraîtraient importants.
À l'issue de votre intervention, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions.
Je vous laisse sans plus tarder la parole.
François Molins, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris . - Merci, madame la présidente. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de me permettre de m'exprimer sur ce sujet, qui constitue un volet important de l'action menée au quotidien par le parquet de Paris. Je voudrais tout d'abord vous donner quelques informations pour vous permettre de comprendre comment nous travaillons.
Paris est un lieu particulier par le volume des affaires tout d'abord : nous traitons entre 350 000 et 400 000 procédures par an. Dans cet ensemble, les violences sexuelles représentent quelques milliers d'infractions.
Face à ce volume très important, nous avons mis en place un protocole de répartition des saisines, qui répartit les affaires entre les services de police judiciaire et les services de sécurité publique, la police judiciaire traitant des affaires les plus complexes et les plus graves, la sécurité publique prenant en charge les moins complexes et les plus faciles à traiter. Cette orientation des affaires vers un service plutôt qu'un autre peut être un facteur de complexité du traitement de la procédure et du parcours des victimes. C'est un point sur lequel nous essayons de travailler.
La politique pénale diffère selon que les infractions sexuelles interviennent au sein ou en dehors du couple. Au sein du couple, ces infractions peuvent venir d'une plainte pour viol ou agression sexuelle, mais aussi d'une plainte pour violence qui, lorsque nous approfondissons les choses, va déboucher sur une affaire d'agression sexuelle ou de viol commis entre conjoints. Notre travail consiste alors à déterminer très rapidement s'il faut traiter l'affaire dans sa globalité, réunissant dans un même dossier l'affaire de viol et celle de coups et violences volontaires ou, s'il faut, au contraire, dans un objectif d'efficacité, les séparer entre les services de sécurité publique pour l'affaire de coups volontaires, et la police judiciaire pour l'affaire de viol.
Nous n'avons pas de doctrine bien arrêtée sur le sujet. Nous traitons le dossier dans sa globalité, notamment lorsque nous observons que les violences constatées peuvent constituer un élément important pour caractériser la contrainte physique qui aura pu être déployée pour arriver au viol ou lorsque des éléments du dossier démontrent à l'évidence que la globalité du traitement facilitera la prise en charge de la victime. À l'inverse, nous pouvons parfois être conduits à dissocier les affaires, lorsque l'affaire de viol va nécessiter des investigations longues et complexes, alors que l'affaire de coups est parfaitement établie. Dans ce cas, nous poursuivrons l'affaire de violences volontaires en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, le viol donnant lieu à l'intervention du juge d'instruction dans une procédure qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
A Paris, nous avons la chance de disposer de services spécialisés dans chaque commissariat. Il s'agit des Brigades de lutte contre les violences familiales (BLPF), formées de personnels policiers compétents pour traiter ce genre d'affaires.
Nous n'opérons jamais de correctionnalisation des faits de viol au sein du couple ab initio . Nous choisirons toujours la qualification la plus haute et si nous saisissons un juge d'instruction, nous le ferons pour viol, à charge pour le juge d'instruction, en accord avec les victimes et avec nous, de procéder le cas échéant à la correctionnalisation des faits à l'issue de l'information. Dans le cadre des violences sexuelles au sein du couple, ce phénomène de correctionnalisation se produit souvent à l'issue de la procédure d'instruction, car de très nombreuses victimes préfèrent éviter la cour d'assises pour des raisons multiples, que nous pouvons entendre, notamment pour préserver les enfants, mais aussi pour des raisons de pudeur, autant pour la victime que pour l'accusé qui ne souhaitent pas évoquer, dans un débat public parfois très long, des relations de couple qu'ils ont envie de garder pour eux. Ainsi, de nombreux dossiers sont correctionnalisés, avec l'accord des parties civiles, à l'issue des procédures diligentées par les juges d'instruction.
Sur le traitement des violences sexuelles en dehors du couple, je vous ai apporté quelques statistiques, sachant qu'il y a toujours une marge d'erreur dans ce domaine. En 2017, nous avons enregistré 711 procédures de viol sur majeur. Je pourrai approfondir ces statistiques si vous le souhaitez. Nous recensons entre 600 et 800 procédures chaque année. Rapportés aux centaines de milliers de procédures que nous traitons, ces chiffres vous donnent une idée de la portée du phénomène.
Le protocole de répartition des saisines consiste à confier tous les viols aux services de police judiciaire à l'exception des faits commis dans le métro. Nous disposons en effet, au niveau du réseau RATP-SNCF, d'un service de police spécialisé, la Brigade des réseaux ferrés, qui dépend de la sous-direction régionale de la police des transports. Ce service est composé de fonctionnaires de police compétents, qui ont l'habitude de travailler avec la RATP, qui peuvent intervenir très rapidement et qui sont formés au décryptage des images vidéo. Cette brigade peut être amenée à traiter des viols lorsqu'ils se produisent dans le métro.
En dehors de cette spécificité, les districts de police judiciaire possèdent une compétence exclusive pour les viols, quels que soient le contexte, le type de faits et la personnalité de l'auteur. Nous disposons dans ce domaine de moyens d'investigation très classiques : recherche vidéo, déplacement sur les lieux, constatations, prélèvements, etc. Nous accompagnons systématiquement nos enquêtes d'un examen médical et d'une évaluation du retentissement psychologique du viol sur la victime. Chaque fois qu'une victime vient déposer plainte, que ce soit pour des faits qui viennent d'être commis ou dont elle a été victime parfois plusieurs années auparavant, cette expertise est réalisée. Elle permettra de valider ou non les déclarations de la victime. Ces faits sont traités en flagrance par la permanence criminelle du parquet. Au niveau de la section P12 du parquet de Paris, qui traite toutes les infractions en flagrance, une permanence est assurée du lundi au vendredi, puis du vendredi au lundi. Un collègue est en charge de toutes les affaires criminelles commises sur la ville de Paris, ce qui garantit la cohérence de traitement par un même magistrat.
Les agressions sexuelles relèvent en principe des services de sécurité publique (SAIP), mais elles peuvent être traitées également par les services de police judiciaire lorsque nous faisons face à des faits particulièrement graves ou complexes, ou qui renvoient à des affaires de violeur ou d'agresseur en série. En termes de réponse pénale, les viols sont confiés assez rapidement à des juges d'instruction, comme le prévoit la loi. Pour les agressions sexuelles, nous privilégions des réponses rapides pour éviter tout risque de réitération, en particulier les poursuites par voie de comparution immédiate. À Paris, nous considérons que les agressions sexuelles constituent des infractions graves, qui nécessitent des réponses rapides et efficaces. S'il existe des alternatives aux poursuites, ce n'est qu'à la marge, pour des faits dont la gravité se situerait vraiment dans le bas du spectre.
Nous opérons là encore très peu de correctionnalisations ab initio . Nous saisissons presque systématiquement le juge d'instruction sous la qualification la plus haute. À Paris, de nombreux viols et agressions sont commis sur la voie publique ou dans des domiciles privés, par des individus qui repèrent leurs victimes, les suivent dans la rue et arrivent à s'introduire dans les halls d'immeuble ou les domiciles par violence, surprise ou contrainte, et qui vont commettre leurs méfaits dans ces lieux. Nous ne correctionnalisons jamais les viols commis sur la voie publique ou au domicile des victimes, sous la menace d'une arme, ou accompagnés de violences graves. Nous estimons que ces faits sont trop graves et, quelle que soit l'approche des victimes, la nôtre est celle de violences criminelles.
Dans la phase de jugement, nous avons de fait, même si elle n'est pas officialisée, une spécialisation de chambre correctionnelle. À Paris, tous ces dossiers sont en effet jugés par une même chambre du tribunal correctionnel qui comporte deux sections, la 10-1 et la 10-2, ce qui nous assure une unité de jurisprudence intéressante et des peines qui, en cas de correctionnalisation, restent sérieuses puisqu'elles se situent entre trois et cinq ans d'emprisonnement. Cela assure une réponse pénale qui a un certain sens.
Vous m'interrogez, madame la présidente, sur d'éventuelles modifications de la législation. À cet égard, les trois problèmes que nous rencontrons aujourd'hui renvoient directement aux réflexions conduites depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre du groupe de travail de la commission des lois du Sénat devant lequel j'avais été entendu voilà quelques semaines 443 ( * ) .
La première problématique, qui concerne les mineurs, renvoie à la question de la présomption de consentement ou de la définition d'un âge en deçà duquel il n'y a pas de discernement, et donc pas de consentement, dès lors que le viol a été commis par un majeur.
Nous avions été amenés à indiquer à la commission des lois, avec ma collègue qui dirige la section des mineurs, que nous étions favorables non pas à l'idée d'une présomption de consentement, mais à l'introduction dans le code pénal d'une disposition indiquant clairement qu'il n'existe pas de consentement pour un viol commis par un majeur sur un mineur, dès lors que l'âge de ce mineur est inférieur à treize ans.
Cette position nous permettait de conserver une certaine cohérence avec l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui définit l'âge de treize ans comme une séparation entre sanction éducative et sanction pénale. Cette approche présente aussi l'avantage d'éviter devant la juridiction saisie de ces affaires le débat que pourrait faire naître la notion de présomption.
Nous le savons, le droit positif et le Conseil constitutionnel n'aiment pas les présomptions irréfragables. Si l'on introduit dans le code pénal la notion de présomption, il ne s'agirait donc que d'une présomption simple. Or celle-ci pourrait être contestée, ce qui donnerait lieu à des débats sans fin devant les juridictions.
L'âge de treize ans que je préconise s'appliquerait uniquement aux viols commis par les majeurs, il faut le préciser. Pour les viols commis par les mineurs, la situation est totalement différente, car de nombreux viols peuvent s'apparenter à des « jeux sexuels » qui tournent mal. Cette problématique différente devrait donc, selon moi, rester en dehors du champ des débats actuels. Certes, on pourrait choisir l'âge de quinze ans, mais l'âge de treize ans nous semble présenter plus de cohérence avec le volet « auteur » de l'ordonnance de 1945.
Le second sujet a trait au renforcement de certaines sanctions. Nous imaginions l'introduction dans le code pénal d'une aggravation de peine au travers d'une circonstance aggravante pour les viols et agressions sexuelles ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours. Aujourd'hui, cette circonstance n'est pas prévue dans le code et il s'agit là d'une lacune.
Enfin, la troisième problématique sur laquelle porte le débat actuel concerne la prescription. Sur le sujet, nous avions indiqué que nous n'étions pas favorables à l'imprescriptibilité des crimes sexuels, cette dernière nous paraissant devoir être réservée aux crimes contre l'humanité et aux génocides, et ne pas devoir être étendue à d'autres formes de criminalité, aussi graves soient-elles. Se posait alors la question de l'extension de la prescription. Certes, on peut toujours étendre ce délai de prescription, mais cela posera le problème des exigences probatoires, dans la mesure où nous devrons juger devant des juridictions criminelles des faits vieux de vingt ou trente ans, voire davantage si l'on considère que la majorité est le point de départ du délai de prescription. Dans ces dossiers, il n'existerait plus de preuves physiques, biologiques, et parfois plus de témoins.
Je crois que la vraie marge de progression sur ces sujets réside plus dans la recherche des « angles morts » de la politique pénale et des politiques publiques pour essayer de les corriger. Je suis convaincu que l'arsenal législatif est relativement complet aujourd'hui, sous la réserve que j'exposais tout à l'heure s'agissant de l'ITT supérieure à huit jours. La loi nous donne les moyens de travailler. La problématique renvoie peut-être davantage à des questions de moyens, d'organisation et de procédures.
À Paris, nous nous sommes penchés depuis plusieurs années sur ces questions et nous avons été amenés à accélérer cette réflexion en lien avec l'actualité, depuis septembre 2017. Nous avions d'ailleurs travaillé dans ce domaine depuis quatre à cinq ans. Nous avons bâti, en lien étroit avec la Mairie de Paris, un schéma départemental d'aide aux victimes tout à fait unique en France qui comporte un travail avec le réseau spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes notamment. Ce schéma, fruit d'un diagnostic de huit mois, contient quatre-vingt recommandations en cours de mise en oeuvre. Les trois quarts de ces recommandations sont appliqués aujourd'hui et il vit à travers un chargé de mission qui travaille à temps plein, sous la double tutelle du secrétaire général de la ville de Paris et du procureur de Paris. Ce poste est financé par des fonds de la Mairie de Paris, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et des programmes d'accès au droit du ministère de la Justice.
Nous avons essayé de lancer un certain nombre d'actions et nous avons été amenés à reprendre cette réflexion pour franchir une dimension supplémentaire à compter de septembre dernier, avec les affaires de harcèlement venues des États-Unis, la campagne #Balance ton porc et toutes les dénonciations qui alimentent les médias depuis plusieurs mois et se traduisent par des évolutions statistiques significatives. Nous avons étudié la question avec les services de police il y a quelques jours. Nous n'avons pas enregistré plus de viols. En revanche, les signalements de harcèlement et d'agression sexuelle se révèlent beaucoup plus nombreux.
Entre janvier et août 2017, nous avions recensé chaque mois 87, 98, 103, 90, 126, 123, 98, 100 signalements. À partir de septembre, le nombre est passé à 120 signalements, puis 154 en octobre, 137 en novembre, 120 en décembre et 115 en janvier 2018. L'augmentation des signalements se situe ainsi entre 20 et 30 %. On peut clairement la relier aux débats et aux articles qui se sont répandus dans les médias et les réseaux sociaux depuis la rentrée de 2017.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Avez-vous pu vérifier si l'augmentation des faits déclarés concerne des faits anciens ?
François Molins . - Les statistiques ne permettent pas de l'affirmer, mais je pense que c'est le cas.
Dans le travail que nous effectuons sur les points à améliorer, nous nous efforçons de porter un regard critique sur nos pratiques, en particulier en ce qui concerne le parcours des victimes, en partant du schéma de répartition des saisines.
La victime d'un viol ou d'une agression sexuelle se présente dans un commissariat : les choses commencent à se compliquer. La situation diffère selon qu'elle se présente le jour ou la nuit, en semaine ou le week-end. Le protocole consiste à déterminer le service le mieux « armé » pour traiter un tel dossier. Cela implique de recueillir un certain nombre de renseignements. Il est donc important que la victime ait en face d'elle un fonctionnaire déjà formé et compétent pour collecter les renseignements qui seront portés à la connaissance du parquet et qui permettront de déterminer si le dossier reste du ressort du SAIP du commissariat d'arrondissement ou doit être envoyé à la police judiciaire, en fonction de la gravité des faits. Or tous les fonctionnaires ne possèdent pas le même niveau de compétence et l'organisation n'est pas toujours identique d'un commissariat à l'autre. Certaines victimes peuvent ainsi être amenées à rester plusieurs heures dans un commissariat, être entendues plusieurs fois sur les mêmes faits par le même service ou des services différents. Cette situation peut être assez pénible.
Nous avons donc travaillé à améliorer la prise en charge de la victime. Nous avions lancé début 2017 le dispositif de l'évaluation personnalisée des victimes, issu de la loi du 17 août 2015 444 ( * ) . Selon l'article 10-5 du code de procédure pénale, ce dispositif consiste à déterminer si la victime a besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale, parce que les faits dont elle a été victime sont très graves ou qu'elle est susceptible de mesures de représailles ou d'intimidation de la part de l'auteur des faits. Nous avions demandé aux services de police de mettre en oeuvre cette mesure : il s'agissait, chaque fois qu'ils allaient voir une victime de faits relativement graves, de nous dire si, d'après eux, elle devait entrer dans ce dispositif. Le cas échéant, nous devions saisir une association d'aide aux victimes pour obtenir cette évaluation personnalisée. Une première évaluation statistique des résultats du dispositif, à la fin de 2017, a fait apparaître entre trente et quarante retours positifs de la part des services de police parisiens. Je ne les incrimine pas, bien au contraire ! Je pense que le dispositif est passé à côté de la cible et que les policiers ont tant à faire sur des contentieux de masse qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer cette détection.
Nous avons donc rectifié le tir et inversé le dispositif. Nous avons constaté que celui-ci « doublonnait » en quelque sorte un dispositif permettant au parquet de saisir directement les associations d'aide aux victimes face à des victimes gravement traumatisées. Nous avons donc fusionné les deux dispositifs. Désormais, les sections de permanence du parquet de Paris saisissent systématiquement le Centre d'information sur les droits des femmes (CIDF) afin d'obtenir une évaluation personnalisée pour toutes les victimes d'infractions criminelles, dès lors que les faits ont été commis au sein du couple. C'est Paris Aide aux victimes qui est saisie en revanche si les faits ont été commis en dehors du couple. Nous avons instauré le même dispositif à l'égard des victimes d'infractions délictuelles particulièrement traumatisées ou exposées à des risques de représailles ou d'intimidation. J'ai adopté ces directives le 20 décembre 2017. Lors de la première évaluation de ce système, fin janvier 2018, près de soixante-dix signalements avaient été adressés au CIDF ou à Paris Aide aux victimes . Aujourd'hui, ce dispositif présente une réelle efficacité et fait « exploser les compteurs » des associations d'aide aux victimes.
Nous avons également oeuvré à une accélération et à une meilleure répartition des saisines afin d'éviter une attente trop longue de la part de la victime. Nous nous sommes donc attachés à identifier les failles dans leur parcours. Dans les commissariats parisiens, les Brigades locales de protection de la famille (BLPF) ne travaillent pas le week-end. Les points de fragilité sont la nuit, le samedi et le dimanche. Nous avons travaillé en premier lieu sur la primo-audition : nous avons donné des instructions pour éviter les auditions multiples et renouvelées. Ces directives ne sont pas encore formalisées, mais nous avons réuni tous les services de police parisiens pour en parler ; le message est en train de passer. Nous insistons sur le fait que la primo-audition n'est pas nécessaire si aucun fonctionnaire présent n'est compétent et n'a pas été formé à cette fin. Elle n'est utile que si elle permet de recueillir suffisamment d'éléments pour appeler le parquet et lui permettre de saisir le service compétent. En tout état de cause, mieux vaut réserver la première audition au service de police qui sera saisi de l'enquête et des investigations plutôt que de procéder à une primo-audition qui ne sera pas concluante.
Il est également impératif que le service de police accueille la victime qui se présente au commissariat. Nous avons en effet constaté des situations dans lesquelles la victime se présentait à un service et, parce que tous les agents étaient occupés, elle était renvoyée chez elle et invitée à revenir plus tard. Nous avons souligné que cette pratique était à proscrire et que les victimes devaient être traitées immédiatement.
Nous avons par ailleurs observé que, chaque année, à Paris, entre soixante-dix et quatre-vingt victimes de viol ne portent pas plainte dans un commissariat, mais se présentent directement aux Unités médico-judiciaires (UMJ) ou à l'AP-HP pour un examen médical et pour la réalisation de prélèvements. Or lorsqu'aucune procédure n'est en cours, cet examen n'est pas pris en charge au titre des frais de justice. Certaines victimes peuvent même être renvoyées chez elles, les services de santé ayant refusé d'effectuer les prélèvements au motif qu'ils ne seront pas payés pour cela. Nous travaillons pour que les examens médicaux et les prélèvements soient réalisés même en l'absence de procédure et, si la victime l'accepte, que le service de police en soit avisé. Nous nous engagerons alors à prendre en charge financièrement, au titre des frais de justice, les examens médicaux et prélèvements dès lors que la plainte aura permis d'ouvrir une procédure pénale.
Un travail est mené depuis plusieurs mois sur les classements sans suite. De nombreux dossiers se traduisent par un classement, par exemple lorsque l'auteur n'a pas été identifié (viol sur la voie publique notamment). Autre cas de figure : dans le cadre de dossiers complexes, pour lesquels l'enquête n'a pas permis de recueillir suffisamment d'éléments permettant le renvoi devant la chambre criminelle ou correctionnelle aux fins de condamnation de l'auteur. Dans ces cas, la Chaîne applicative supportant le système d'information orienté procédure pénale et enfants ( Cassiopée ) édite des imprimés de classement sans suite, extrêmement lapidaires, qui peuvent laisser à la personne le sentiment qu'elle n'a été victime de rien du tout. La notion d'infraction insuffisamment caractérisée, par exemple, donne l'impression que le viol n'est pas certain. Nous avons été amenés à adapter ces imprimés au niveau du parquet de Paris.
Désormais, pour les viols, nous n'utilisons plus ces imprimés ; nous établissons un courrier expliquant à la victime qu'après sa plainte, une enquête a eu lieu, mais qu'elle n'a pas permis d'établir suffisamment d'éléments pour renvoyer l'auteur devant la juridiction. Pour autant, ce courrier précise que cela ne signifie pas que la victime n'a pas subi les faits dénoncés. Nous lui indiquons également la possibilité d'être reçue par une association d'aide aux victimes ou un délégué du procureur, voire par un magistrat pour obtenir des précisions sur les motifs du classement.
Un travail sera engagé avec les associations d'aide aux victimes, les assistants sociaux des commissariats et les bureaux d'aide aux victimes du futur Palais de justice de Paris. À compter de notre déménagement dans le nouveau palais, mi-avril 2018, nous disposerons d'un bureau d'aide aux victimes particulier. Paris Aide aux victimes a obtenu des crédits pour embaucher 0,5 équivalent temps plein (ETP) d'assistant social et 0,5 ETP de psychologue. Ce bureau d'aide aux victimes pourra donc amorcer une prise en charge immédiate des victimes les plus gravement traumatisées. Cela permettra aussi d'initier un travail en réseau avec les victimes qui auraient déjà pu être en contact avec des psychologues et assistants sociaux des commissariats.
Enfin, la Section des mineurs travaille sur la problématique des infractions prescrites. Cette section se trouve en effet confrontée à de nombreuses plaintes de personnes qui ont été victimes dans leur enfance de faits particulièrement graves, qu'elles viennent dénoncer alors que l'action publique est éteinte par le fait de la prescription. À Paris, la Section des mineurs et la Brigade des mineurs ont mis en place une pratique spécifique. Dans les cas de prescription, une enquête est menée et peut se poursuivre jusqu'à l'audition du mis en cause, non pas dans le cadre d'une garde à vue (puisque les faits sont prescrits), mais d'une audition libre. L'expérience démontre que les victimes ont besoin de cette parole posée. Il est même possible parfois de parvenir à des confrontations. Il arrive que des aveux surviennent alors que les auteurs savaient que les faits étaient prescrits, et que des lettres d'excuses soient adressées aux victimes. Cela peut contribuer à des phénomènes de restauration des victimes.
Par ailleurs, nous sommes confrontés depuis vingt ans - et la situation ne s'améliore pas - à une pénurie d'experts pédopsychiatres, pour les victimes, et d'experts psychiatres, pour les auteurs.
Quant aux faits de harcèlement, au parquet de Paris, ils peuvent être traités par deux sections différentes selon qu'ils sont commis au travail ou en dehors du travail. Le harcèlement sexuel en dehors du travail est traité par la section chargée de la délinquance sur la voie publique, qui avait notamment traité l'affaire Baupin.
Nous rencontrons les mêmes difficultés pour le harcèlement au travail et le harcèlement en dehors du travail. Elles sont plus grandes dans ce second cas. Souvent, les faits dénoncés sont relativement anciens. Cette difficulté est moins forte dans le cadre du harcèlement au travail, car le cadre professionnel est souvent plus restreint, plus stable, et les personnes se connaissent. Ceci rend plus facile la caractérisation de propos et de comportements qui, par nature, sont étrangers à l'activité professionnelle. Dans le cadre professionnel, on arrive aussi à faire peur. Le parquet de Paris, lorsqu'il envoie la plainte au commissariat, rappelle systématiquement qu'il faut notifier aux témoins les dispositions des articles 225-1-1 et 225-2 du code pénal qui prévoient une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende à l'égard de toute personne qui prononcerait une sanction professionnelle contre une personne qui témoignerait de faits de harcèlement. Je pense que cela peut faciliter la libération de la parole dans un cadre professionnel. Nous recueillons quand même relativement peu de plaintes pour harcèlement sexuel.
Annick Billon, présidente . - Merci, monsieur le procureur. Nous l'avons vu, le parquet de Paris est assez exemplaire sur la façon d'accueillir et de traiter les affaires de violence. Nous avons noté dans votre propos l'attention portée aux victimes et l'importance du premier accueil de ces dernières. Il est important que les victimes puissent être accueillies dans de bonnes conditions, et ce, à tout moment. Vous avez évoqué le travail que vous effectuez avec des associations. Or celles-ci sont de plus en plus sollicitées : mes collègues poseront sans doute des questions sur les moyens qui leur sont attribués. Ressentez-vous un affaiblissement de la capacité des associations à accompagner les victimes ? Par ailleurs, que pensez-vous des inégalités de traitement des victimes selon les territoires ?
François Molins . - Le harcèlement représente une centaine de procédures par an. Les deux tiers ne peuvent donner lieu à poursuites, en raison de problèmes de prescription ou parce que l'infraction n'est pas caractérisée. Un tiers de ces dossiers seulement est susceptible de poursuites devant le tribunal correctionnel.
Annick Billon, présidente . - Merci pour cette précision. Je vais passer la parole à mes collègues.
Roland Courteau . - Dans le cadre des violences au sein des couples, la garde à vue peut représenter un moyen d'assurer la décohabitation entre l'auteur et sa victime. Elle permet aussi à cette dernière d'organiser sa constitution de plainte en sécurité. Mais il y a aussi l'ordonnance de protection (OP), procédure qui a fait ses preuves. Pourtant, cette ordonnance est délivrée parfois tardivement, quand elle l'est... Quelle est selon vous la voie la plus efficace ?
La politique de conventionnement que vous avez initiée permet d'assurer la coordination des services et de garantir la protection des victimes. Existe-t-il ailleurs en France des conseils de juridiction dans lesquels les magistrats du siège, les parquets, les services de police et la mairie agissent de concert ?
Françoise Laborde, co-rapporteure . - Merci, monsieur le procureur, pour cet exposé très intéressant. J'ai bien retenu dans vos propos que le parquet de Paris a mis en place des pratiques dont d'autres juridictions pourraient s'inspirer. En tant que sénateurs et sénatrices, nous serions intéressés de savoir qui pourrait décider que ces bonnes pratiques se diffusent dans tous les territoires ?
Sur le classement sans suite, Paris fait, là encore, mieux qu'ailleurs. Les lettres issues de Cassiopée , dont vous avez parlé tout à l'heure, sont effectivement de nature à décourager les victimes. Elles ne donnent certainement pas envie de s'engager dans ce « parcours du combattant » des victimes.
Je m'interroge surtout sur le problème des infractions prescrites. Souvent, les personnes ne portent pas plainte parce qu'elles ont une famille, des enfants. Dans ce cas précis, l'enquête peut-elle être conduite de façon plus discrète, de façon à ménager les proches de la victime ?
Maryvonne Blondin . - Vous avez utilisé un terme qui m'a un peu interpellée. Vous avez parlé, s'agissant des victimes, d'expertise de retentissement psychologique, ce qui peut sembler étonnant vis-à-vis de quelqu'un qui a subi un traumatisme.
Vous n'avez pas mentionné les Téléphones grave danger (TGD) qui constituent aussi un moyen efficace au service de la lutte contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, ces outils sont encore trop peu nombreux dans nos départements. Françoise Laborde évoquait la comparaison entre Paris et les départements. J'insisterai aussi sur la différence entre commissariats, en ce qui concerne l'accueil des victimes. Nous avons bien vu combien le premier accueil est décisif. Or certains commissariats, dans mon département, ont mis à profit l'enveloppe dédiée aux travaux d'accessibilité pour organiser un espace d'accueil fermé, ce qui facilitera justement l'enregistrement des plaintes. J'ai vu récemment dans Libération un dossier sur l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et les plaintes pour viol : une victime déclare être passée, à Paris, d'un commissariat à un autre avant de pouvoir déposer plainte. Elle a persévéré, mais ces renvois multiples peuvent déstabiliser et faire reculer certaines victimes.
François Molins . - Le « retentissement psychologique » renvoie, j'en conviens, à un langage un peu technocratique.
La question des moyens demeure une question compliquée. À Paris, je pense que nous avons la chance de disposer de plus de moyens qu'ailleurs. Par exemple, je dispose d'un cabinet pour m'épauler, avec un magistrat chargé de la prévention de la délinquance et de l'aide aux victimes. Il est certain qu'avec 136 magistrats et 360 fonctionnaires, nous bénéficions à Paris de plus de ressources que partout ailleurs. Pour autant, il ne suffit pas d'avoir des moyens : encore faut-il les utiliser. Je pense que ce que nous avons réalisé à Paris pourrait l'être dans d'autres territoires.
Des comités locaux d'aide aux victimes ont été institués au niveau départemental. Dans ce cadre, en principe, tous les dispositifs d'aide aux victimes ont été mis en cohérence. Ce modèle d'organisation est parti de l'expérience parisienne. Aujourd'hui, il est prévu qu'au niveau de chaque comité local d'aide aux victimes soit établi un schéma départemental. Ce travail exige du temps et des moyens, car il ne peut être fondé que sur un diagnostic précis de la situation. Sans ce constat, on ne peut pas corriger les dysfonctionnements et améliorer ce qui doit l'être. Lorsque tous les départements auront mis en place ce type de schéma, je pense que l'on observera des résultats intéressants.
Il existe, à mon sens, une deuxième condition à la réussite des politiques publiques, c'est la pérennité. Une action qui s'arrête deux ans après avoir été engagée ne sert à rien. Les politiques publiques doivent survivre aux acteurs administratifs qui les mettent en place et qui les portent. Or dans un certain nombre de départements, des actions intéressantes sont engagées, puis elles s'interrompent parce que le préfet ou le procureur a changé. Cela me paraît tout à fait anormal. Une politique publique qui n'est pas pérenne ne sert à rien. Elle se traduit par un gâchis de moyens. Je soutiens mes collègues procureurs, car on attend beaucoup de nous. Je pense toutefois qu'ils agissent aussi en fonction des moyens dont ils disposent. S'ils bénéficiaient de l'aide de chargés de missions spécialisés dans la politique de la ville et l'aide aux victimes, ils en feraient probablement davantage.
Le garde des Sceaux reste le principal acteur de la politique pénale. La ministre a pris, en novembre 2017, une circulaire de politique pénale engageant l'ensemble des parquets à travailler la réponse pénale pour renforcer son efficacité. C'est dans ce cadre que j'ai inscrit le travail que je mène depuis plusieurs mois, mais cela ne suffit pas. Il faut, en parallèle, engager un travail de réseau qui renvoie directement aux comités locaux d'aide aux victimes, maintenant placés sous l'égide de la déléguée interministérielle aux victimes, Élisabeth Pelsez, qui travaille beaucoup sur le sujet. Il faut progresser dans ce domaine. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur l'impératif de pérennité des politiques publiques.
Roland Courteau . - Dans les départements, ce n'est pas toujours une question de moyens. Il peut s'agir aussi d'un certain manque de volonté.
François Molins . - Je suis d'accord avec vous. Lorsque je suis arrivé à Paris, en novembre 2011, il n'existait pas de Téléphone grave danger (TGD). Au mois de juillet, une convention était signée avec la mairie. Pour avoir exercé les fonctions de procureur en Seine-Saint-Denis, j'avais observé l'efficacité de ce dispositif et je souhaitais vivement en obtenir à Paris. Je les ai obtenus en six mois.
Pour répondre à la question de Monsieur Courteau, je pense que les dispositifs de l'ordonnance de protection (OP) et la garde à vue sont complémentaires. Ils obéissent toutefois à des tempos différents. L'éviction du conjoint violent peut intervenir très vite dans le cadre de la flagrance. C'est la politique que nous menons à Paris. Nous essayons de proposer la réponse pénale la plus effective possible, fondée sur la mise en garde à vue du conjoint violent, ce qui permet d'organiser la décohabitation dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures. L'OP permettra aussi d'éloigner le conjoint violent, mais cela suppose un délai compris entre quinze jours et plusieurs semaines, selon les juridictions.
Ces démarches ne répondent pas aux mêmes situations. Elles sont néanmoins complémentaires, notamment dans le cadre de l'instauration du TGD. A Paris, nous disposons de vingt-cinq téléphones : quinze sont utilisés ; vingt sont réservés. Ces téléphones seront renouvelés dans les prochaines semaines dans le cadre du nouveau marché national mis en oeuvre au niveau du ministère. Nous avons d'ailleurs demandé cinq téléphones supplémentaires pour porter la dotation parisienne totale à trente. Ce dispositif fonctionne très bien et constitue un pan important de la politique pénale du parquet, mais aussi de l'ensemble du réseau. Nous travaillons sur le sujet en bonne entente avec le CIDF, l'association qui effectue les évaluations à notre demande.
À Paris, le conseil de juridiction permet à la juridiction de s'ouvrir sur l'extérieur sur des thèmes choisis : l'aide aux victimes, l'amélioration du suivi des sortants de prison, le harcèlement scolaire, le schéma départemental de l'aide aux victimes, le déménagement du Palais de justice, etc. Ce dispositif fonctionne bien. Il n'est pas ciblé sur la thématique des violences sexuelles ou des violences faites aux femmes, mais il pourrait l'être.
Enfin, sur la prescription, je suis persuadé que, même si l'infraction est prescrite, il est tout à fait possible d'aménager un parcours « allégé » présentant un intérêt évident, non seulement en termes de prise en charge et de réponse à la victime qu'en termes de pédagogie à l'égard de l'auteur. Là encore, cette démarche participe d'une forme de volontarisme. Il me paraît difficile de l'inscrire dans un schéma normatif, car elle renvoie essentiellement à des pratiques professionnelles. À Paris, nous avons la chance de disposer d'un service spécialisé, la Brigade des mineurs, où travaillent des policiers spécialement formés pour traiter ces questions. Nous ne pourrions peut-être pas le faire aussi bien sans eux. Tous les autres parquets ne possèdent pas un tel outil.
Roland Courteau . - Je suis étonné d'entendre que l'OP est délivrée dans un délai de trois à quatre semaines, alors que la loi précise qu'elle doit être délivrée quand la personne ou ses enfants sont en danger, dans les meilleurs délais.
François Molins . - La notion du temps renvoie à une appréciation différente selon les procédures. En procédure pénale, le temps peut être extrêmement rapide : vingt-quatre à quarante-huit heures pour la flagrance. Dans une procédure civile, un délai de quinze jours peut apparaître rapide.
Annick Billon, présidente . - Il l'est beaucoup moins pour la victime...
François Molins . - Cela renvoie aussi au travail de formation et de spécialisation des avocats. Lorsque la victime se présente devant un avocat, celui-ci doit être en mesure de lui indiquer qu'elle peut solliciter une ordonnance de protection en précisant bien qu'elle ne l'obtiendra que dans quinze jours. L'avocat doit aussi lui conseiller de porter plainte, si elle est battue, pour qu'une procédure en flagrance soit engagée. À Paris et dans les grandes villes, les barreaux ont mis en place des antennes spécialisées, avec des avocats dédiés aux affaires de violences faites aux femmes ou de mineurs, qui interviennent régulièrement devant les Juges aux affaires familiales (JAF). Ces avocats devraient donc pouvoir bien orienter les victimes. Je reconnais qu'un délai de quinze jours peut être extrêmement long pour la victime.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Merci pour l'expertise que vous avez bien voulu partager avec nous. L'absence de pérennité des dispositifs qui se mettent en place dans les départements constitue effectivement un vrai sujet de préoccupation pour les élus locaux que nous sommes. Conclure une convention consomme beaucoup d'énergie. Or il suffit qu'un acteur change pour que cette convention dépérisse.
Je citerai un exemple sur la diversité des réponses pénales des parquets. La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 445 ( * ) est très diversement appliquée sur le territoire. Certains parquets s'en sont saisis et en font un excellent usage. Dans d'autres endroits, personne ne mobilise ce texte, alors que cette loi pourrait être utilisée dans des circonstances telles que le harcèlement de rue, par exemple. Certaines gendarmeries y ont d'ailleurs recours dans la lutte contre la prostitution des mineurs.
Je voulais vous faire partager une préoccupation. Actuellement, on ne cesse de chercher le hiatus entre le nombre de faits extrapolé des enquêtes sur les violences sexuelles, le nombre de plaintes et le nombre de condamnations. Face à ces chiffres, il est difficile de dire aux victimes que la justice doit rester leur premier recours. Comment pouvons-nous inciter les victimes à s'adresser à la justice alors que les chiffres eux-mêmes n'entretiennent pas la confiance en la justice ? Comment pouvons-nous lever cette contradiction, d'autant qu'en matière de violences sexuelles, on ne peut pas se contenter de considérer que seuls les faits poursuivis sont vrais ? Nous savons tous en effet que certains faits, bien que vrais, ne sont pas poursuivis. À cet égard, quel est, selon vous, le pourcentage de dénonciations calomnieuses et d'affabulations en matière de violences sexuelles ? On en parle beaucoup. Dans cette société de la délation qui s'instaure, toutes celles qui n'ont pas pu faire reconnaître par la justice les faits qu'elles dénonçaient seraient finalement considérées comme des manipulatrices ou des affabulatrices. Or je suis certaine que tel n'est pas le cas.
Enfin, l'articulation entre la justice pénale et la justice civile en matière de violences conjugales me pose problème. Autant je crois qu'il existe une bonne compréhension des faits en matière pénale, autant la justice civile continue de ne pas prendre en compte la parole de la femme. Je vous conseille d'aller voir le film Jusqu'à la garde . On y voit un personnage de juge aux affaires familiales qui n'entend pas la parole de la femme victime. Comment mieux articuler la connaissance que vous possédez au niveau pénal avec la justice familiale ?
Quant aux commissariats et gendarmeries, il s'agit de mon point de vue d'un problème de volonté politique des ministres. Je n'ai jamais entendu un ministre de l'Intérieur demander aux préfets de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la priorité de l'action des forces de l'ordre, au même titre que les cambriolages ! J'entends toujours que l'on ne va pas solliciter les policiers, qui ont déjà beaucoup de travail avec la sécurité publique, pour traiter des questions de violences faites aux femmes. Je suis convaincue qu'il s'agit d'abord d'un problème de volonté politique.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Monsieur le procureur, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous nous éclairez énormément. J'ai besoin néanmoins de certaines précisions. J'ai moi-même déposé une proposition de loi sur l'âge du consentement. Je proposais de fixer à quinze ans l'âge limite en matière de consentement. Il me semble important de légiférer, que l'âge retenu soit de treize ou quinze ans. J'ai toutefois été interpellée par des magistrats et magistrates que j'ai auditionnés qui m'ont opposé la notion d'irréfragabilité. La notion même d'atteinte sexuelle me semble pourtant liée à l'irréfragabilité. Je ne comprends pas pourquoi cette question se pose sur l'âge.
Toujours sur cette problématique, on a évoqué, contre la question des seuils d'âge, l'argument tiré d'une histoire d'amour qui pourrait survenir entre une jeune fille de quatorze-quinze ans et un jeune homme de dix-huit ans passés de quelques mois. La définition d'un seuil d'âge pourrait entraîner un dépôt de plainte pour viol, notamment par les parents de la jeune fille. Or cela me semble relever d'un paradoxe : si l'on pense qu'une jeune fille de treize ans est en capacité de discerner ce qu'impliquent des rapports sexuels, on lui confère donc une certaine maturité physique et psychologique. Pour autant, on ne considère pas que son discernement lui permette de porter plainte. Ne faudrait-il pas redéfinir la majorité pour porter plainte ? Aujourd'hui, le mineur est dessaisi de ce droit, au motif qu'il n'est pas majeur au sens de la loi. Mais on peut néanmoins considérer qu'il a le discernement nécessaire pour avoir des relations sexuelles. Je n'arrive pas à dépasser ce paradoxe !
François Molins . - Vous avez abordé le problème de la pérennité des politiques pénales. Je pense qu'il manque aujourd'hui dans ces politiques une dimension d'évaluation. Nous le soulignons depuis près de vingt ans au ministère de la Justice, sans que l'on puisse constater d'évolution notable dans ce domaine. Qui pourrait procéder à ces évaluations ? Aujourd'hui, en principe, ce sont les procureurs généraux qui devraient évaluer ces politiques publiques, mais ils ne le font presque jamais. J'ai connu dans ma carrière quelques procureurs généraux, très minoritaires, qui, avant le départ d'un procureur, effectuaient une inspection du parquet et adressaient au nouveau procureur une lettre de mission pour récapituler la situation du parquet et les axes de politique pénale à conserver, voire à développer. Cette inspection n'est presque jamais réalisée, alors qu'elle entre dans la mission du Procureur général. Ce dernier est en effet en charge de l'animation, de l'évaluation et de la mise en cohérence des politiques pénales de sa cour d'appel. Si cette mission était développée, et accompagnée des moyens nécessaires, je pense que l'efficacité et la pérennité des politiques publiques s'en trouveraient améliorées.
Nous avons recueilli sans doute plus de signalements en matière de violences sexuelles depuis quelques mois. Dans le domaine de la flagrance, nous sommes régulièrement confrontés à des cas d'affabulation concernant des viols dont sont victimes des femmes et de plus en plus d'hommes. Des personnes se présentent dans les commissariats en inventant des agressions. L'objectif est parfois de justifier d'une absence vis-à-vis d'amis, de parents ou de petits amis. D'autres personnes vivent dans ce genre de fantasme. Le phénomène existe, mais il reste marginal.
Je ne veux pas botter en touche, mais la réponse à la question de Mme Rossignol s'avère compliquée. Le parcours judiciaire de la victime ne sera jamais facile. On peut s'attacher à le faciliter, mais il ne sera jamais facile pour autant. La victime, quelle que soit sa crédibilité, va se trouver enfermée dans un schéma procédural dans lequel elle n'aura pas plus de droits que la personne soupçonnée. Cette dernière doit, elle aussi, disposer de certains droits. La victime sera enfermée dans un cadre qui doit satisfaire à une exigence probatoire. Le procureur aussi, même s'il a une vigilance particulière à l'égard des victimes, se trouvera enfermé dans une exigence d'impartialité qui l'amènera à développer toutes les investigations, à charge et à décharge. Je pense que nous ne pourrons jamais garantir aux victimes un parcours facile. Toute parole, dans le cadre d'une procédure, a vocation à être contestée par la personne accusée. On peut néanmoins s'attacher à faire disparaître un certain nombre d'embuches ou d'anomalies qui n'ont pas lieu d'être dans le parcours des victimes. C'est le travail que nous avons essayé de lancer depuis quelques années au parquet de Paris. Nous ne sommes pas encore parvenus au terme de ce processus, qui exige des efforts permanents.
S'agissant de l'âge du consentement, il existe de vraies difficultés. Il existe quand même un précédent en droit français. En effet, l'article 227-25 réprime l'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans. Il fixe donc un cap. Il faudrait pouvoir en parler de façon plus détaillée, éventuellement avec ma collègue de la Section des mineurs qui vit cette situation au quotidien. Nous distinguons bien les viols sur mineurs selon qu'ils sont commis par des majeurs ou par des mineurs ou de très jeunes majeurs. Il faut garder à l'esprit que le viol renvoie toujours à la nécessité - si l'on se réfère à la définition du code pénal - de déterminer une dimension de violence, contrainte ou surprise. En l'absence de ces critères, il peut y avoir des difficultés. C'est la raison pour laquelle je pense que la fixation d'un âge constituerait la seule façon de sortir de ce débat.
Par rapport au schéma de maturité sexuelle de certains jeunes, l'âge de quinze ans me paraît poser problème. Bien sûr, la loi ne peut pas tout régler et il faut, à l'évidence, faire preuve d'un certain discernement. Vous preniez l'exemple d'une histoire amoureuse entre une jeune fille de quatorze ans et un jeune homme de dix-huit ans et quelques mois. Quelle que soit la loi, ces dossiers excluent une approche trop rigide, sauf à risquer des erreurs. Pour autant, je pense qu'il n'existe pas d'autre solution aujourd'hui que de légiférer dans ce domaine, que ce soit en fixant un âge ou une présomption.
Annick Billon, présidente . - Merci beaucoup, monsieur le procureur. Nous l'avons vu, ce sujet qui nous occupe est particulièrement complexe. Je vous remercie pour vos réponses sur l'âge du consentement et le délai de prescription, qui nous éclairent beaucoup. Il importe que les victimes soient écoutées et entendues.
Je retiendrai aussi de votre intervention qu'au parquet de Paris, vous disposez de moyens, mais que la volonté des acteurs en place est un paramètre décisif de l'efficacité du travail de la justice. On se plaint souvent de l'inégalité des territoires, mais certains territoires disposent peut-être de moyens qu'ils n'utilisent pas.
Je relèverai aussi l'enjeu de pérennité des politiques publiques par-delà la mobilité des acteurs qui les mettent en place. Dans le domaine des violences faites aux femmes, beaucoup de choses dépendent des associations et il est difficile d'imaginer des politiques pérennes. Le parquet de Paris s'appuie sur un certain nombre d'acteurs et partenaires, dont des associations. Il est nécessaire pour le législateur de se poser la question du financement de ces associations qui travaillent à vos côtés et qui sont incontestablement des partenaires très importants de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Je vous remercie pour la précision de vos réponses. Nous vous réinviterons très certainement pour évoquer d'autres sujets plus longuement. Merci à vous.
Audition de Christelle Hamel,
chercheure à l'Institut national des études démographiques
(INED), sur l'enquête Violences et rapports de genre (Virage)
(22
février 2018)
Présidence d'Annick Billon, présidente
Annick Billon, présidente . - Mes chers collègues, après l'audition du procureur de la République de Paris, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Hamel, sociologue, chercheure à l'Institut national d'études démographiques (INED), pour évoquer une question cruciale quand on travaille sur les violences sexuelles : celle de l'évaluation du nombre de victimes.
On parle en effet souvent du « chiffre noir » des violences faites aux femmes pour évoquer la sous-évaluation des statistiques disponibles en ce domaine. C'est un point qui a été souligné à plusieurs reprises au cours de nos auditions.
Je précise à l'attention de Christelle Hamel que nous avons décidé, dès la reconstitution de la délégation à l'issue du dernier renouvellement sénatorial, de centrer notre agenda sur les violences faites aux femmes - qu'il s'agisse de violences sexuelles, de harcèlement ou de violences conjugales - en lien avec une actualité chargée et avec la préparation du projet de loi annoncé par le Gouvernement sur la lutte contre les violences.
Des études précises sont indispensables pour être en mesure de connaître la fréquence des viols et autres agressions sexuelles en France, les contextes dans lesquels ils se produisent, ainsi que l'âge et le sexe des victimes, mais aussi des auteurs.
C'est l'un des objectifs de l'enquête Violences et rapports de genre ( Virage ) réalisée par l'INED, à laquelle vous participez. Je rappelle que cette étude vise à mesurer statistiquement les violences subies par les femmes et les hommes - mais nous savons que les violences, quelles qu'elles soient, affectent majoritairement les femmes, même si le procureur de la République vient de nous dire que le parquet de Paris reçoit de plus en plus de signalements concernant des viols commis sur des hommes.
Christelle Hamel, nous comptons donc sur vous pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet.
Pouvez-vous nous donner une analyse dans la durée des études statistiques appréhendant les violences faites aux femmes (Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), Cadres de vie et sécurité (CVS), Virage ...) ? À cet égard, pouvez-vous nous présenter plus particulièrement les premières conclusions de l'enquête Virage menée en 2015, qui a interrogé un vaste échantillon représentatif de la population âgée de 20 à 69 ans ?
Quelles sont les spécificités de l'enquête Virage par rapport aux autres enquêtes, notamment du point de vue de la méthodologie ? Les ordres de grandeur des différentes études sont-ils comparables ? Que pouvez-vous nous dire sur la sous-évaluation statistique des victimes de violences ?
Enfin, pensez-vous que la libération de la parole à l'oeuvre depuis quelques mois se reflètera dans les futures enquêtes ?
Madame Hamel, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes certains que vous pourrez nous apporter des éléments de réponse à ces nombreuses questions, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres points que je n'aurais pas soulevés et qui vous paraîtraient importants. À l'issue de votre présentation, les membres de la délégation feront part de leurs réactions et ne manqueront pas de vous poser des questions.
Je vous laisse sans plus tarder la parole.
Christelle Hamel, chercheure à l'INED, sur les statistiques de violences faites aux femmes . - Merci beaucoup, madame la présidente. Je vais vous présenter brièvement les premiers résultats de l'enquête Virage en me focalisant sur les violences sexuelles, car ce sont celles qu'en tant qu'équipe nous avons décidé d'analyser en priorité. Les résultats sur les violences conjugales paraîtront ultérieurement. J'évoquerai successivement les objectifs généraux de l'enquête, les résultats sur les violences sexuelles au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, c'est-à-dire pendant l'année 2015, les violences sexuelles déclarées au cours de la vie par les enquêté-e-s. Je préciserai ensuite les âges, les contextes ainsi que les modes d'extorsion du consentement des personnes victimes interrogées par les enquêteurs et enquêtrices de Virage .
Quelles étaient les connaissances statistiques sur les violences lorsque nous avons décidé de lancer le projet ? La première enquête nationale réalisée sur les violences faites aux femmes, l'ENVEFF, a été conduite par l'Institut de démographie de l'université de Paris-I en 2000 auprès de 7 000 femmes. Cette enquête avait été demandée à la suite de la Conférence de Pékin en 1995, lors de laquelle il avait été constaté que la France ne disposait pas d'outils statistiques pour mesurer les violences faites aux femmes. Depuis lors, plusieurs enquêtes ont permis de mesurer les violences, notamment les violences sexuelles. C'est le cas en particulier de l'enquête sur la sexualité en France de 2008, réalisée dans un contexte d'études des comportements face aux maladies sexuellement transmissibles 446 ( * ) , mais aussi de l'enquête Événement de vie et santé, réalisée en 2006, par la DRESS 447 ( * ) .
Les violences sexuelles sont assez bien documentées en France, car elles ont été prises en compte dans les grandes enquêtes sur la sexualité et la santé, depuis le début de l'épidémie de Sida. La création de l'Agence nationale de recherche sur le Sida au début des années 1990 a ainsi permis de financer de nombreuses enquêtes statistiques sur ce sujet et d'aborder les violences sexuelles. En revanche, toutes les autres formes de violences qui se produisent dans le contexte conjugal, dans le contexte du travail ou dans l'espace public restent très mal connues. L'enquête Cadre de vie et sécurité (CVS), qui a fait suite à l'enquête Événement de vie et santé, est réalisée tous les ans depuis 2007 par l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ORDP) et l'Insee. Elle apporte certains éléments sur les violences constatées dans et en dehors du cadre conjugal. Cette enquête est réalisée chaque année auprès d'un échantillon de 13 000 à 19 000 personnes - femmes et hommes -, selon les financements. Elle recueille des données sur les violences conjugales, mais elle a pour défaut de ne pas correspondre, dans son questionnement, aux standards internationaux de mesure des violences fondées sur les rapports de genre ( Gender-based Violence dans la convention d'Istanbul). En effet, il existe aujourd'hui des protocoles très approfondis pour aider les pays qui souhaitent s'engager dans l'élaboration de données statistiques. Ces standards internationaux sont édictés par l'ONU.
Eurostat est également en train de mettre en place une enquête européenne sur la base de ces standards internationaux pour les pays membres de l'Union européenne et ce sont les offices nationaux de statistiques (équivalent de l'Insee) qui seront en charge de réaliser cette enquête. Ses résultats sont attendus à l'horizon 2021-2022 et induiront une transformation de l'actuelle enquête Cadre de vie et sécurité (CVS). L'enquête CVS sera donc amenée à évoluer très profondément dans son contenu. Cette enquête CVS a été instaurée dans le cadre de la Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI 448 ( * ) ), afin d'estimer le « chiffre noir » de la délinquance, des délits et de la criminalité. Elle pose donc des questions sur les violences conjugales et les violences sexuelles, mais de manière très succincte, au milieu de nombreuses questions sur les cambriolages, les vols de voiture, les vols de téléphone portable, etc. Ce cadre n'est pas très propice à la déclaration de violences commises dans un cadre intime. Surtout, l'enquête présente une mesure un peu différente de la nôtre.
Dans le cadre de l'enquête Virage , nous avons interrogé 27 000 personnes, hommes et femmes, âgées de 20 à 69 ans. Il s'agit d'un échantillon représentatif de la population résidant « en ménage ordinaire », c'est-à-dire qui vit dans une maison ou un appartement. En revanche, toutes les personnes vivant dans une institution (centre d'hébergement, hôpital de jour, prison, etc.) ne sont pas questionnées, ce qui a pour effet une sous-estimation de l'effectif des victimes de violences. Ces établissements accueillent en effet des personnes en situation de vulnérabilité, notamment parce qu'elles ont subi des violences ou d'autres situations difficiles. Pour obtenir une estimation juste du nombre de victimes, il faudrait interroger dans le même temps les personnes qui vivent en institution, mais ce travail ne peut se faire sans la collaboration du SAMU Social et de l'Insee. Il nécessite en outre de mettre en place un dispositif de collecte des données assez complexe. L'entrée dans ces institutions est soumise à autorisation administrative, et à des autorisations des administrations concernées, mais aussi de la CNIL. Ainsi, toutes les femmes accueillies dans des foyers d'hébergement d'urgence à cause de violences conjugales ne sont pas enquêtées, ni dans Virage ni dans aucune des enquêtes qui l'ont précédée.
Le questionnaire de l'enquête Virage dure une heure. Il a été mené par téléphone par 67 enquêtrices et 43 enquêteurs de l'institut de sondages MV2. La collecte a duré neuf mois, de février à novembre 2015. À la fin du questionnaire, une information systématique a été donnée aux personnes enquêtées, qu'elles aient ou non déclaré des violences, sur les dispositifs d'aide aux victimes, notamment le 3919 449 ( * ) et le 08Victimes 450 ( * ) .
Comment mesurons-nous les violences sexuelles ? Nous utilisons une terminologie différente du vocabulaire courant. Nous n'employons jamais les termes de « viol » ou d'« agression sexuelle », car ils sont associés à des représentations trop hétérogènes d'une personne à l'autre pour permettre une mesure fiable du phénomène. Les questionnaires demandent plutôt si les personnes ont subi des « rapports sexuels imposés par la contrainte » ou des « rapports sexuels forcés » (ou une tentative) ou des « attouchements forcés ». Lorsque la réponse est positive, les personnes doivent s'auto-classer dans l'une ou l'autre de ces catégories prédéfinies : attouchements forcés, tentatives de rapports forcés ou rapports sexuels forcés. Ce procédé est moins subjectif que le recours aux termes de « viol » ou « agression », en raison de la très grande variabilité des représentations de ces notions selon les individus. Néanmoins, il ne fait pas complètement disparaître le problème et reste assez éloigné des définitions légales. Nous ne reprenons pas non plus les définitions juridiques mot à mot dans les enquêtes, car elles peuvent apparaître un peu ésotériques pour les enquêté-e-s, comme la définition du viol prévue par l'article 222-23 du code pénal (« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise »).
L'enquête Virage a fait le choix de reprendre la méthodologie des enquêtes précédentes tout en essayant de se rapprocher des catégories juridiques, et de décrire plus précisément les actes subis par les personnes, afin de mieux inclure les violences subies par les hommes. Nous avions pour hypothèse que, pour les hommes, les violences sexuelles peuvent correspondre à des faits commis lors de bizutage (par exemple, intromission dans l'anus d'une bouteille ou d'un objet). Mais ces faits ne sont pas forcément perçus comme un « rapport sexuel forcé » qui induit une situation mettant en présence deux personnes et peut laisser de côté d'autres situation comme le bizutage. Nous avons donc légèrement modifié le dispositif de questionnement.
Trois questions sont posées à tous nos enquêtés. La première question est, pour les femmes : « Au cours des douze derniers mois, quelqu'un a-t-il, contre votre gré, touché vos seins ou vos fesses, vous a coincé pour vous embrasser, s'est frotté ou collé contre vous ? » et la réponse prévoit d'indiquer le nombre de fois. Il s'agit là d'agressions sexuelles relevant du délit. Pour les hommes, la question est : « Quelqu'un s'est-il, contre votre gré, frotté ou collé contre vous ? » Nous avons retiré, à la suite de l'enquête pilote, les mots « a touché vos fesses, vous a coincé pour vous embrasser, », car elle faisait souvent rire des hommes et certains ont pu en profiter pour se mettre à « draguer » les enquêtrices.
Comme nous craignions à l'époque d'être soupçonnés de sous-estimer les violences subies par les hommes, nous avons conservé cette seconde formulation, mais cela ne renvoie évidemment pas au même type de violences pour les hommes et les femmes. C'est la seule question de notre questionnaire qui soit différente pour les femmes et pour les hommes. Toutes les autres sont strictement identiques.
La deuxième question était : « Vous a-t-on forcé-e à faire ou à subir des attouchements du sexe, a-t-on essayé ou est-on parvenu à avoir un rapport sexuel avec vous contre votre gré ? ». Ensuite, les enquêtés devaient dire, à partir d'une liste d'actes qui leur était lue, desquels ils avaient été victimes, en précisant le nombre de fois. La troisième question était : « Vous a-t-on forcé-e à d'autres actes ou pratiques sexuelles ? » Nous n'utilisons plus dans cette dernière question la notion de « rapport sexuel forcé », pour englober les faits commis lors de bizutages ou d'actes sexuels collectifs. C'est en listant la nature des agressions ou gestes que les personnes ont subis que nous nous rapprochons des catégories juridiques.
Je dois souligner ici qu'avec ces trois questions, nous n'avons pas de mesure du harcèlement sexuel ni de l'exhibitionnisme. Le harcèlement sexuel recouvre des propos de nature verbale incitant à des relations sexuelles contre le gré de la personne, mais aussi des attouchements sur des parties du corps qui ne sont pas forcément des parties sexuelles : l'épaule, la nuque, la taille... Ces questions figurent seulement dans le module « travail » de notre enquête que je n'aborderai pas aujourd'hui.
Les données que je vais présenter concernent un nombre de victimes et non un nombre de faits. Celui-ci se révèle beaucoup plus important que le nombre de victimes, car souvent les actes sont répétés, en particulier pour les femmes.
À partir de la liste des actes, nous avons reconstitué les catégories juridiques. Dans la catégorie du viol, nous avons classé les individus répondant positivement aux agissements suivants :
- pour les femmes, « une pénétration du sexe ou de l'anus par le sexe » ;
- pour les hommes, « une pénétration de l'anus par le sexe (que vous avez subie) » ;
- pour les femmes, « une pénétration du sexe ou de l'anus par les doigts ou un objet ». C'est une situation mal identifiée par les individus comme caractérisant un viol ;
- pour les hommes, « une pénétration de l'anus par les doigts ou un objet (que vous avez subie) ».
Nous avons également mentionné « une pénétration de la bouche par le sexe (fellation forcée) », que les individus identifient là encore très mal comme un viol, et « un autre rapport sexuel avec un tiers ». Légalement, tous ces actes relèvent du viol, mais les enquêtés ne les considèrent pas forcément comme tels. En décrivant très précisément les actes, nous avons pu échapper au biais lié aux représentations des individus.
Laurence Cohen, co-rapporteure . - Pourquoi avez-vous précisé, pour les hommes, « que vous avez subie » et pas pour les femmes ?
Christelle Hamel . - Nous avions eu des interrogations de la part des enquêtés. Les hommes ont beaucoup de mal à s'identifier comme des personnes victimes de viol ou de violence. Lors de l'enquête pilote, nous avons dû apporter cette précision pour indiquer qu'il s'agissait des actes subis et non commis.
Nous avons fait le même exercice pour les tentatives. Tous les autres actes représentent les autres agressions sexuelles qui relèvent du délit : « les attouchements du sexe que vous avez subis (y compris avec la langue) », « les attouchements du sexe que vous deviez faire », avec la précision « y compris avec la langue » pour les hommes, « être forcé à montrer vos seins, votre sexe, vous dénuder », pour les hommes : « une pénétration que vous deviez faire ». Nous avons classé ces derniers faits (la pénétration que l'homme devait faire) dans les agressions sexuelles autres que le viol, parce que dans ces cas, la personne ne subit pas une pénétration ; elle est contrainte de pénétrer quelqu'un d'autre. Nous avons cependant constaté que la législation et la jurisprudence ne sont pas, à notre connaissance, très précises sur ce type de situation.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Ne s'agit-il pas d'un viol en réunion ?
Christelle Hamel . - Cela correspond plutôt à une situation dans laquelle une personne est contrainte de commettre un viol sur une autre. Ce n'est pas forcément un viol en réunion.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Il me semble qu'il y a un angle mort concernant le fait, pour un jeune homme, de subir une fellation contre son gré. Cette situation est-elle prise en compte par votre enquête ?
Christelle Hamel . - Dans le viol, nous avons listé le cas d'une pénétration de la bouche par le sexe, pour les femmes comme pour les hommes.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Certes, mais qu'en est-il d'un jeune homme qui subit une fellation qu'il n'a pas souhaitée ?
Christelle Hamel . - Cette situation de pénétration de la bouche est prise en compte et classée comme un viol. Dans les autres agressions sexuelles figurent « les attouchements du sexe que vous avez subis (y compris avec la langue) ».
Annick Billon, présidente . - Laissons Christelle Hamel poursuivre sa présentation avant de lui poser des questions.
Christelle Hamel . - Pour les autres agissements, nous avons mentionné le fait d'être forcé à « visionner des films pornographiques », « être filmé pendant un rapport sexuel », « des pratiques sadomasochistes », « des pratiques échangistes », « la prostitution ». La catégorie juridique correspondante dépend très largement du contexte. Ces autres actes sexuels se sont révélés très minoritaires.
S'agissant des résultats, 0,3 % des femmes enquêtées ont déclaré avoir subi un viol ou une tentative de viol sur les douze derniers mois, dont 0,26 % un viol et 0,18 % une tentative. Le nombre total de victimes de viol ou tentative de viol atteint 62 000 personnes, dont certaines ont subi un viol et une tentative de viol au cours de l'année. Pour les hommes, la proportion est bien inférieure. Elle s'élève à 0,01 %, soit 2 700 hommes ayant subi un viol ou une tentative. Nous retrouvons le même phénomène de concomitance de viol et de tentative pour certains hommes.
Pour les autres agressions sexuelles (hors harcèlement sexuel et exhibitionnisme), le pourcentage de femmes atteint 2,7 %, soit 553 000 femmes. Il s'agit essentiellement d'attouchement des fesses, des seins et de baisers forcés. 58 000 femmes sont victimes d'attouchements du sexe. Pour les hommes, le nombre de victimes est estimé à 185 000. Il s'agit essentiellement de situations où quelqu'un s'est « collé-frotté » contre eux. Les attouchements génitaux ne concernent que 12 000 hommes. Le nombre de victimes peut apparaître important pour les hommes, mais il faut surtout s'intéresser aux agissements les plus graves. Les autres actes ou pratiques sexuelles concernent 9 000 femmes et 15 000 hommes. Pour les hommes, ce nombre renvoie peut-être à des contextes de bizutage et situations d'actes sexuels forcés dans des cadres collectifs, que nous ne savons pas bien identifier dans les enquêtes.
Il faut retenir le chiffre de 580 000 femmes victimes d'agressions sexuelles (hors harcèlement et exhibitionnisme). Ce chiffre se révèle extrêmement important, d'autant qu'il se répète chaque année. Pour les hommes, il faut plutôt retenir les 12 000 attouchements du sexe, car les situations où quelqu'un se frotte contre eux contre leur gré ont peu d'incidence et leur classement dans les agressions sexuelles peut être discuté.
Françoise Cartron . - L'enquête a interrogé 27 000 personnes. Comment parvenez-vous à ces chiffres ?
Christelle Hamel . - La population enquêtée est représentative. Nous appliquons une pondération à cet échantillon. Une personne enquêtée représente ainsi entre 1 000 et 10 000 individus. Toutes les enquêtes fonctionnent de la sorte. Même à l'Insee, les enquêtes sont réalisées sur 20 000 personnes et les résultats sont fournis pour la population entière. Nous aboutissons par exemple à ces 62 000 victimes de viol ou tentative de viol en multipliant 0,3 % par les 30 millions de femmes que compte la France.
Nous avons comparé ces résultats avec ceux des autres enquêtes. L'enquête ENVEFF estimait l'effectif de victimes de viols et tentatives de viol à 80 000, 0,5 % des personnes ayant subi ces actes au cours des douze derniers mois. L'enquête CVS menée en 2015 concluait à un effectif à peu près similaire pour les femmes. L'enquête Virage donne un chiffre moins important. La différence tient au fait que nous classons nous-mêmes les personnes dans les catégories au lieu de les laisser s'auto-classer. Le chiffre se révèle un peu plus bas pour les viols et les tentatives de viol, mais il est beaucoup plus élevé que dans l'enquête CVS pour les autres agressions sexuelles (attouchements du sexe, des seins, baisers forcés), qui n'étaient pas aussi clairement distinguées des pénétrations de la bouche, du sexe et de l'anus dans l'enquête ENVEFF.
Pour les femmes, toutes agressions sexuelles confondues, nous retrouvons les mêmes ordres de grandeur que dans l'enquête CVS, mais la répartition entre viol et tentative de viol (les crimes) et les autres agressions sexuelles (les délits) est différente. Les chiffres sont donc cohérents entre les deux enquêtes s'agissant des violences sexuelles. En revanche, chez les hommes, les résultats se révèlent très différents. Ils n'étaient pas interrogés dans l'enquête ENVEFF. L'auto-classement dans les catégories « tentative de rapport forcé » ou « rapport forcé » de l'enquête CVS aboutit à un effectif de 10 000 hommes victimes de viol ou de tentative au cours des douze derniers mois. Avec notre mode de classification par les actes finement décrits, le nombre d'hommes classé dans la catégorie « viol et tentative de viol » est dix fois moins important, de l'ordre de 2 200 personnes. Pour les autres agressions sexuelles, en revanche, le nombre est plus important. Cela démontre que lorsque l'on demande aux individus de s'auto-classer, la subjectivité est plus grande ; ainsi, les hommes qui subissent des attouchements du sexe ont plus facilement tendance à déclarer avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé que les femmes. L'étude Virage se rapproche donc davantage des catégories juridiques.
L'enquête nous fournit également des éléments d'information sur la répétition et la gravité des faits. Pour les attouchements des seins ou des fesses, les baisers forcés et le « pelotage », quatre à cinq femmes sur dix et cinq à six hommes sur dix déclarent que ces faits sont répétés au cours des douze derniers mois. Lorsque nous observons la gravité des faits, 33 % des femmes indiquent que ces faits sont « tous très graves » et 70 % estiment qu'ils sont « assez graves ou très graves ». À l'inverse, 84 % des hommes considèrent ces faits « sans gravité ».
Par ailleurs, les résultats sur les violences sexuelles au cours de la vie permettent d'appréhender les contextes et les âges. La proportion de femmes qui déclarent un viol ou une tentative de viol s'élève à 3 % pour les viols et 2,5 % pour les tentatives. Pour les hommes, la proportion atteint 0,5 % dans les deux cas. Les autres agressions sexuelles (hors harcèlement et exhibitionnisme) touchent 13 % des femmes et 3 % des hommes. Sur l'ensemble des agressions sexuelles identifiées dans l'enquête, le pourcentage atteint 14 % pour les femmes et près de 4 % pour les hommes. Nous constatons donc une nette différence de proportion selon le sexe.
S'agissant des lieux dans lesquels ces faits se produisent, pour les femmes, les violences au cours de la vie surviennent essentiellement dans la famille durant l'enfance (inceste) et dans le cadre du couple pour les viols et tentatives de viol. Pour les hommes, les viols et tentatives de viol ont lieu essentiellement dans la famille, quand ils sont jeunes (inceste).
Pour les autres agressions sexuelles relevant du délit, le panorama se révèle légèrement différent. Elles sont très présentes dans le cadre de la famille pour les femmes, mais aussi avec une forte fréquence dans les espaces publics et c'est aussi le cas pour les hommes. Les crimes se produisent dans l'enfance et dans le couple pour les femmes, dans l'enfance pour les hommes. Les autres agressions sexuelles surviennent dans ces espaces, mais aussi dans les espaces publics. Elles se produisent moins dans le cadre du travail ou des études.
Nous avons par ailleurs identifié, pour chaque contexte, les âges auxquels le premier fait (viol, tentative ou attouchement du sexe) s'est produit. Dans le contexte familial, la première agression sexuelle se produit, dans plus de 80 % des cas, avant quatorze ans. Ce premier acte correspond essentiellement à un attouchement du sexe. Les tentatives de viol et les viols surviennent à des âges un peu plus avancés. Nous avons quand même été frappés de constater que les agressions sexuelles dans le cadre familial commencent très tôt, chez les femmes comme chez les hommes. Dans le cadre de la scolarité, les faits se répartissent entre les plus jeunes, les adolescents et les jeunes majeurs. Dans l'espace public, les jeunes filles, mais aussi les jeunes femmes adultes sont concernées dans des proportions quasiment identiques. C'est moins vrai pour les hommes qui sont davantage victimes dans l'espace public lorsqu'ils sont plus jeunes.
Pour les viols et les tentatives de viol, notre enquête comportait une question permettant d'identifier les modes de contrainte exercés sur la victime, les enquêtés pouvant cocher plusieurs des modes proposés. La liste était la suivante : « en profitant de votre jeune âge », « en profitant de votre confiance », « par le chantage affectif ou la culpabilisation », « par le chantage économique », « par la menace ou l'intimidation », « par la force physique », « en vous menaçant avec une arme », « il/elle vous a fait boire de l'alcool ou drogué », « vous étiez sous l'emprise de l'alcool, d'une drogue, de médicaments » et « vous étiez endormi-e ».
Dans le cadre de la famille, le fait d'avoir profité du jeune âge de la victime constitue le mode de contrainte le plus souvent avancé (81 %). Avoir profité de la confiance représente également un motif évoqué par 64 % des victimes. Près de 60 % des personnes ont évoqué le chantage affectif et la culpabilisation et 66 % le chantage économique. La menace ou l'intimidation ne concerne qu'une victime sur deux, la force physique moins d'une victime sur deux (42 %). La menace d'une arme et les phénomènes d'alcoolisation ont été signalés dans 5 à 6 % des cas. Enfin, 13 % des victimes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol alors qu'elles étaient endormies. Nous pouvons donc observer que la définition du viol pourrait prendre en compte, s'agissant de la notion de contrainte, des situations telles que l'abus de confiance, le chantage affectif et la culpabilisation, le chantage économique, l'intimidation, le fait de profiter du jeune âge, d'autant que nous avons constaté des écarts d'âge énormes entre l'auteur et la victime.
Dans le couple, les modes de contrainte les plus présents vis-à-vis des femmes sont l'abus de confiance et le chantage affectif, puisqu'ils concernent respectivement une victime sur trois et une victime sur deux. La menace et l'intimidation recouvrent la moitié des victimes. La force physique est avancée dans 65 % des cas. Dans des relations entre adultes, nous voyons bien que la force physique intervient davantage. L'utilisation de l'alcool est aussi plus présente, même si elle reste minoritaire dans les modes de contrainte (10-11 %). 15 % des victimes déclarent avoir subi un viol ou une tentative alors qu'elles étaient endormies. Le fait d'être endormi-e pourrait peut-être figurer explicitement dans la législation.
Dans les espaces publics, toujours s'agissant des femmes, dans la majorité des cas, l'auteur est connu de la victime. La contrainte liée à l'abus de confiance et au jeune âge peut donc intervenir, mais c'est plutôt l'usage de la force physique qui est évoqué par une victime sur deux. L'alcoolémie est aussi plus souvent avancée que dans le cadre familial. 20 % des victimes déclarent en effet qu'elles étaient sous l'emprise de l'alcool, d'une drogue ou de médicaments lors des faits. Ces éléments de l'enquête sur les modes de contrainte me semblent particulièrement éclairants, car ils précisent la façon dont le consentement des victimes a été extorqué.
Nous avons fait le même exercice pour les hommes, en nous centrant sur le cadre familial. Les viols et tentatives se révèlent trop peu nombreux dans les autres cadres pour obtenir des résultats significatifs. Comme pour les femmes, le mode de contrainte le plus fréquent dans le cadre intrafamilial consiste à profiter du jeune âge et de la confiance. La force physique n'intervient que dans 24 % des cas. On notera que le fait d'user de la violence physique ou d'utiliser une arme est beaucoup moins fréquent que pour les femmes (0 % contre 6 % pour les femmes, s'agissant de la menace d'une arme). La raison vient du fait que les victimes sont souvent de très jeunes hommes alors qu'il peut s'agir aussi, chez les femmes, d'adolescentes ou de très jeunes adultes.
Dans l'espace de la famille et des relations avec les proches, 85 % des violences débutent avant l'âge de quinze ans. Il existe un ou plusieurs hommes agresseurs pour 94 % des femmes victimes et 75 % des hommes victimes. Les femmes restent minoritaires parmi les auteurs de ces abus. Ce sont des violences répétées pour les deux tiers des personnes victimes.
Concernant les relations conjugales, 73 % des femmes victimes dans le couple déclarent au moins un viol ou une tentative. Là encore, ce sont des actes répétés. Ces violences existent même dans le cadre des relations de couples adolescents. Trois quarts des femmes victimes subissent des viols ou tentatives de viol répétés. La force physique est mentionnée par deux femmes victimes sur trois et la menace par une femme victime sur deux.
Dans les espaces publics, enfin, les situations sont diverses. Ces faits peuvent être commis dans la rue, les transports, le voisinage, mais aussi, plus rarement, dans les contacts avec des professionnels (professionnels de santé, police, etc.). Ces violences se produisent tout au long de la vie, surtout pour les femmes. Les viols, les tentatives de viol et les attouchements du sexe sont plutôt le fait de personnes connues, alors que les autres attouchements et baisers forcés sont commis par des personnes inconnues dans la plupart des cas.
En conclusion, il faut retenir que cette enquête fournit une mesure plus proche des catégories juridiques et des définitions de la violence sexuelle que la plupart des sondages et des autres enquêtes existantes. Elle montre aussi que les violences sexuelles n'ont pas baissé depuis quinze ans. Elle souligne qu'au cours de sa vie, une femme sur sept et un homme sur vingt-cinq sont victimes d'agression sexuelle (hors harcèlement et exhibitionnisme). Le chiffre d'une femme sur deux a été avancé récemment dans le débat public : il est erroné. Néanmoins, les résultats de l'étude Virage montrent que ces violences sont un phénomène massif, qui concerne bien une proportion importante de la population et que les auteurs sont des personnes connues, et non des marginaux. Cela nécessite évidemment de mettre en place des plans de prévention de ces violences, d'accompagnement des victimes et de sanction des auteurs nettement plus ambitieux que ce qui existe aujourd'hui. L'enquête fait enfin ressortir que les femmes sont six fois plus souvent victimes de viols et de tentatives de viol que les hommes, et que ces derniers sont victimes pendant leur jeunesse, alors que les femmes le sont tout au long de la vie et dans tous les espaces de vie.
Je vous remercie de votre attention.
Annick Billon, présidente . - Je vous remercie pour cette présentation exhaustive. Nous prendrons connaissance de ces données de manière approfondie. Je retiendrai que les statistiques s'avèrent assez effrayantes, d'autant qu'elles ne prennent pas en compte les personnes qui vivent dans des institutions (prisons, Ehpad, établissements d'accueil des personnes en situation de handicap, foyers d'hébergement pour victimes de violences, etc.). Nous imaginons donc, comme vous l'avez dit, que ces chiffres sont finalement sous-estimés.
J'ai également été surprise par le parti pris de ne pas utiliser la terminologie de viol ou d'agression, mais je comprends qu'il soit lié à la difficulté d'appréhender la notion de crime ou de délit. En effet, les personnes ne relient pas forcément un viol ou une agression à une condamnation pénale. Par ailleurs, je relève que de nombreuses agressions se déroulent dans le milieu familial, un milieu souvent protégé dans lequel il est compliqué pour des personnes extérieures de s'immiscer et qu'il est difficile pour les victimes de dénoncer. Vos statistiques concernant les modes de contrainte montrent que l'abus de confiance, la contrainte et la surprise font partie des notions principales, et soulignent la nécessité de se prononcer sur la question de l'âge du consentement.
Maryvonne Blondin . - Je reviendrai sur la notion de cercle de confiance. Je rappelle que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a réalisé une étude et lancé une campagne de formation et d'information des professionnels « 1/5 », pour communiquer sur le fait qu'un enfant sur cinq, dans les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, est victime de violences dans le cercle de confiance.
Vous avez évoqué les standards internationaux. De nombreuses études ont effectivement été réalisées au niveau de l'Europe et du Conseil de l'Europe. En 2016, l'Union interparlementaire (UIP) a publié une étude sur le sexisme, le harcèlement et les violences à l'égard des femmes parlementaires qui a eu un impact international tout à fait considérable. Elle a fait ressortir des problèmes sérieux qui faisaient obstacle à l'égalité de genre et fragilisaient la fondation de la démocratie. Une étude similaire va être menée conjointement entre l'APCE et l'UIP et sera consacrée en partie au personnel parlementaire féminin. Elle a débuté en janvier dernier et consistera en une interrogation d'une heure par téléphone. Ces résultats sont attendus pour novembre 2018. J'ai proposé un amendement pour inclure aussi les collaborateurs parlementaires dans le champ de cette enquête. Il importe de trouver des appellations identiques ou homogènes à l'international pour favoriser les comparaisons et aboutir ainsi à une connaissance véritablement approfondie de ces phénomènes.
Céline Boulay-Espéronnier . - Pourquoi l'étude Virage ne prend-elle pas en compte l'exhibitionnisme ? Est-ce à dire qu'il n'est pas considéré comme une agression sexuelle ?
Christelle Hamel . - Nous l'avons bien pris en compte dans notre questionnaire, mais uniquement dans l'espace public et dans le cadre du travail. À ce stade des résultats de l'enquête, nous avons souhaité comparer les mêmes catégories d'actes par espace et nous ne l'avons donc pas inclus. Il s'agissait aussi de faciliter la comparaison avec les autres enquêtes qui ne le prennent pas forcément en compte. Nous publierons ultérieurement de nouvelles statistiques par contexte. Dans l'espace public, nous avons également ajouté la question : « vous est-il arrivé, dans les douze derniers mois, d'être interpellée ou importunée sous prétexte de drague ? », qui prend en compte ce que l'on désigne de manière sans doute inappropriée juridiquement par le « harcèlement de rue ». 20 % des femmes répondent positivement et la majorité trouve que ces faits sont graves ou assez graves.
Nous avons présenté les mesures pour les faits pour lesquels les enquêté-e-s étaient interrogé-e-s dans tous les contextes de vie, mais nous allons également publier des données par contexte de vie, qui incluront donc selon les contextes l'exhibitionnisme et le harcèlement.
Sur les violences physiques intrafamiliales, par exemple, nos données vont certainement surprendre. Nous avons ainsi relevé près de 1 % de tentatives de meurtre envers les enfants. Nous avons récolté des informations sur l'orientation sexuelle des personnes et, lorsque nous comparons les personnes qui déclarent avoir subi des violences, de quelque nature qu'elles soient, dans le cadre de la famille, celles qui se déclarent aujourd'hui comme homosexuelles ou bisexuelles affichent des taux quatre à cinq fois supérieurs à ceux des personnes hétérosexuelles. Certains éléments font clairement apparaître des problèmes de sexisme et d'homophobie dans le milieu familial.
Dans nos représentations, il y a l'image de la violence intrafamiliale liée aux familles pauvres, où elle peut s'accompagner de problèmes d'alcoolisme. Or il apparaît que d'autres indicateurs pourraient relativiser ces préjugés. Pour l'instant, nous prenons notre temps pour analyser les données, car nous souhaitons publier des résultats qui apportent vraiment quelque chose de nouveau et qui soient éclairants pour les politiques publiques.
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Je tiens à saluer votre travail. Nous n'avons rien d'autre que vos chiffres pour mesurer les violences sexuelles faites aux femmes. Ni les statistiques du ministère de la Justice ni celles du ministère de l'Intérieur ne nous permettent d'appréhender, comme le font vos travaux, l'ampleur et la réalité de ces violences. C'est grâce à vous que nous savons rapporter le taux de plainte par rapport au taux de violences subies, un résultat déterminant pour identifier les dysfonctionnements de la justice. Bravo pour tout ce que vous faites.
Christelle Hamel . - Merci beaucoup, au nom de toute l'équipe Virage . Je voudrais ajouter, concernant les personnes en institution, que le SAMU Social a réalisé une enquête sur l'état de santé des femmes avec enfants hébergées dans ses centres d'accueil. Il s'agit de l'enquête « Enfants et Familles sans logement » (ENFAMS). Elle comporte des questions sur les violences subies dans la famille. Elle fait ressortir que souvent, les femmes entrent dans ces centres d'hébergement après avoir perdu leur domicile, par exemple pour des raisons de toxicomanie ou d'autres causes. Toutefois, il faut être conscient que les violences conjugales sont très souvent au démarrage de tous leurs problèmes. De ce fait, l'enquête ENFAMS vient en complément de l'enquête Virage .
Laurence Rossignol, co-rapporteure . - Un tiers des enfants entrent dans l'Aide sociale à l'enfance (ASE) pour des faits de violences intrafamiliales, mais à l'issue de premières investigations, on constate que le pourcentage d'enfants ayant subi des violences familiales est deux fois plus important, même si ce n'est pas pour ce motif qu'ils ont été placés.
Christelle Hamel . - Je souhaiterais conclure en soulignant que mettre en place le financement de l'enquête Virage s'est révélé extrêmement compliqué. Une enquête de ce type coûte trois millions d'euros pour le paiement de l'institut de sondage. Plus d'une centaine de personnes a travaillé pendant neuf mois. La seule phase de questionnement par téléphone a représenté 27 000 heures de travail, le questionnaire durant une heure, cela sans compter le temps passé à appeler les ménages qui ont refusé de participer à l'étude, le temps de formation des enquêteurs et leur accompagnement. Recevoir des récits de violence à longueur de journée est difficile ! Le dispositif a mobilisé un grand nombre de personnes sur ce laps de temps.
À mon sens, il serait utile de créer une agence nationale de recherche sur les violences faites aux femmes comme nous avons créé, lors de l'épidémie de Sida, une agence nationale de recherche sur le Sida. Ces statistiques de violences faites aux femmes présentent l'ampleur des épidémies. Nous avons donc besoin d'une agence dotée de moyens, bénéficiant d'un financement interministériel, annualisé. De nombreux domaines sont touchés par ces violences : le travail, la famille, les études, la santé, la police, la justice, etc. Tous les ministères sont concernés. Le travail de préparation de l'enquête Virage s'est avéré compliqué et chronophage en raison de la recherche de financement, et l'enquête aurait pu ne pas voir le jour. Nous voulions interroger 35 000 personnes à l'origine, notamment pour obtenir des résultats plus précis sur les femmes migrantes. Les effectifs dans l'enquête restent trop faibles pour répondre à toutes nos questions à leur sujet.
La création d'une telle agence est une recommandation qui, en tant que chercheuse, me semble indispensable. Je crois que l'enquête ENVEFF a permis de sortir de l'ignorance et de la volonté de ne pas savoir. Elle a eu pour effet de contribuer à libérer la parole des victimes. Les résultats de Virage vont continuer d'aider les victimes. Avec ces statistiques, elles pourront constater qu'elles ne sont pas seules et leur peur de ne pas être crues diminuera. Outre l'enquête Virage , nous pourrions réaliser de nombreuses enquêtes, notamment sur la population qui arrive dans les services d'urgence des hôpitaux, les femmes qui font une IVG, etc. Ces enquêtes sont réalisées dans d'autres pays, mais ne sont pas menées en France ; c'est dommage.
Annick Billon, présidente . - Merci beaucoup pour votre témoignage et ces données très importantes. Nous vous remercions d'être venue devant la délégation aux droits des femmes. Nous attendons vos résultats complets avec impatience, car c'est une enquête inédite et très éclairante, dont les résultats permettront de mieux combattre les violences faites aux femmes.
DÉPLACEMENT DE LA DÉLÉGATION
AU
PÔLE JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE À
PONTOISE
(22 janvier 2018)
Un déplacement au Pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale implanté à Pontoise a eu lieu le lundi 22 janvier 2018 .
À cette visite ont participé Annick Billon , présidente, Laurence Cohen , sénatrice du Val-de-Marne, Marta de Cidrac , sénatrice des Yvelines, Nassimah Dindar et Viviane Malet , sénatrices de La Réunion.
La délégation a été accueillie par :
- le général de brigade François Daoust , commandant le Pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale (PJGN) ;
- le colonel Patrick Touron , directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ;
- le lieutenant-colonel Grégory Briche , adjoint au chef de la division Physique Chimie de l'IRCGN ;
- le colonel Nicolas Duvinage , chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) du Service central de renseignement criminel (SCRC) ;
- le colonel Laurent Collorig , chef de la Division du renseignement du SCRC ;
- le colonel Jérôme Servettaz , chef du Service central de renseignement criminel ;
- Jessica Gourmelen, analyste de la Division du renseignement du SCRC ;
- les capitaines Flavie Vampouille et Clara Bader , de la Division du renseignement.
I. - L'accueil et la prise en charge des victimes de violences sexuelles
Un premier échange s'est instauré sur l' accueil et la prise en charge des victimes de violences sexuelles .
• En ce qui concerne l' accueil des victimes qui viennent déposer plainte , les interlocuteurs de la délégation ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la formation et la sensibilisation des personnels de gendarmerie afin de créer un climat de confiance propice à la libération de la parole des victimes. Les gendarmes s'efforcent par exemple d' enregistrer les auditions pour éviter à la victime d'avoir à subir à plusieurs reprises le moment éprouvant de la prise de parole. En outre, ils ont souligné l'importance du travail en coopération avec les services sociaux et de la circulation de l'information, dans le cadre d'une prise en charge et d'un accompagnement globaux des victimes.
• Interrogés sur la pertinence de la pré-plainte en ligne annoncée par le Gouvernement en ce qui concerne les violences sexuelles, les gendarmes ont estimé qu'un tel système pourrait permettre de mieux orienter les victimes, mais il leur paraît important de conserver un contact humain entre la victime et la gendarmerie 451 ( * ) .
• Les interlocuteurs de la délégation estiment également qu'il conviendrait de mieux informer les victimes sur les enjeux du procès pénal , parce que celles-ci croient bien souvent que leur bonne foi suffit et peuvent être très déstabilisées quand leurs plaintes sont classées sans suite, faute de preuve. Dans ces situations, elles ont l'impression, qui peut être désastreuse pour elles, de ne pas être crues.
• De plus, a été souligné l' enjeu crucial que représente le recueil des preuves , le plus tôt possible, et dans les meilleures conditions, pour garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire, fondée sur un dossier crédible au regard des exigences du droit pénal. C'est notamment la tâche de l'IRCGN, qui exploite les indices techniques recueillis par les enquêteurs. Les gendarmes ont rappelé à cet égard que la finalité du dépôt de plainte reste le procès pénal , dans lequel seuls comptent les faits et les éléments de preuve. En effet, la dénonciation des faits et « la parole de l'un contre celle de l'autre » ne sont pas suffisants pour condamner un auteur présumé, dans notre système judiciaire fondé sur la présomption d'innocence et le respect des droits de la défense.
• Les gendarmes ont aussi évoqué la piste des prélèvements et de la conservation des preuves, indépendamment du dépôt de plainte . Dans cette hypothèse, pourrait être envisagé le principe d'un relevé d'indices pérenne dans le temps, en prévoyant de ne pas détruire les scellés avant le classement d'une affaire. Mais une telle évolution pose des questions de responsabilité légale et de financement et soulève des interrogations sur la durée de conservation de ces prélèvements hors dépôt de plainte.
• De surcroît, les gendarmes ont regretté les inégalités territoriales dans la répartition des unités médico-judiciaires (UMJ). Actuellement, on compte environ 50 UMJ pour 100 départements. Dans les départements qui en sont dépourvus, il est compliqué de procéder à des prélèvements rapidement après une agression sexuelle ou un viol. Cette absence de structure dédiée est d'autant plus problématique qu'elle peut dissuader les victimes de porter plainte. C'est pourquoi la gendarmerie réfléchit à la mise en place d'une mallette d'aide à l'accompagnement et à l'examen des victimes de violences sexuelles (MAEVAS).
|
LA MALLETTE D'AIDE À L'ACCOMPAGNEMENT
Consciente des inégalités relatives à l'offre d'unités médico-judiciaires sur l'ensemble du territoire français, la Gendarmerie nationale souhaiterait que toutes les victimes, quel que soit le lieu où survient l'agression sexuelle, bénéficient d'un accompagnement technique permettant d'effectuer et de recueillir avec diligence des preuves matérielles des agressions . Ce projet est intitulé MAEVAS et s'inspire notamment du set d'agression sexuelle (SAS) mis en place en Belgique dès 1999. Le kit, destiné aux enquêteurs, permettrait de réaliser des prélèvements (ADN, toxicologie, traces de transfert, saisine numérique) de façon systématique en cas d'agression sexuelle. L'objectif affiché est aussi de dissuader les agresseurs potentiels , qui courront alors toujours le risque d'être identifiés dans le cas, par exemple, de relevés de traces ADN. La Mallette MAEVAS est en cours de finalisation , mais sa mise en oeuvre se heurte à quelques difficultés . Outre qu'il nécessite des financements conséquents , qui devraient être imputés sur le budget de la gendarmerie, pour la partie équipement et sur le budget de la justice, pour la partie enquête (réquisitions, besoins d'analyses dans les territoires...), il implique de définir la liste des laboratoires susceptibles de traiter les prélèvements et de déterminer les personnes habilitées à réaliser ces derniers (médecins locaux agréés ou centres de santé), dans le cadre d'un processus encadré par un protocole. Par ailleurs, une réflexion est en cours quant à la conservation des prélèvements (durée, cadre légal...). La dépense principale associée à la mallette serait liée au traitement et à l'analyse des prélèvements , sachant que la mallette elle-même aurait un coût de revient de 50 à 100 euros . |
• En ce qui concerne l'accompagnement des victimes, ont été évoqués :
- les enjeux liés à la suite donnée aux plaintes , alors qu'on constate une forte augmentation des plaintes pour violences sexuelles au quatrième trimestre 2017 ;
- ainsi que la nécessité de mener une réflexion sur la protection des victimes qui déposent plainte , à travers des structures d'hébergement adaptées.
Les gendarmes ont par ailleurs relevé que les enquêteurs doivent rester vigilants dans la mesure où certaines plaintes sont en réalité de fausses dénonciations , qui interviennent parfois dans un contexte de séparation. Pour autant, ce phénomène reste marginal .
• En outre, les interlocuteurs de la délégation ont souligné la nécessité de prévoir aussi des mesures de prévention et de détection des profils à risque , sur lesquels les enquêteurs pourraient ouvrir une enquête préliminaire. À cet égard, les gendarmes estiment qu'il faut favoriser le partage d'information entre les forces de l'ordre et les services sociaux , qui disposent souvent d'éléments sur le quotidien des familles. De même, les gendarmes ont souligné les difficultés liées au cloisonnement entre informations judiciaires et non judiciaires , imposé par la CNIL, qui peuvent se révéler pénalisantes pour l'efficacité des enquêtes.
• Enfin, les gendarmes ont annoncé la création d'une brigade numérique 452 ( * ) , plateforme Internet ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 conçue comme un nouveau vecteur de contact entre la population et la Gendarmerie nationale. Cette dernière en attend des résultats positifs, notamment pour ce qui concerne la prise en charge des femmes victimes de violences, car la brigade numérique permettra de limiter l'épreuve que constitue tout déplacement à la gendarmerie pour les victimes, tout en leur prodiguant les premiers conseils. 30 militaires ont été recrutés spécialement à cet effet. Les locaux de cette brigade sont situés à Rennes.
En ce qui concerne la création , dans le code pénal, d'un « outrage sexiste » envisagée par le Gouvernement, les gendarmes estiment que, s'il s'agit d'un délit, il ne faudrait pas que la masse de contentieux qui en résulterait gêne la répression de faits plus graves. En outre, ils ont pointé la question de l'applicabilité d'une telle disposition.
II. - La lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains
Dans un second temps, les sénatrices ont pu échanger avec leurs interlocuteurs sur la problématique de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains .
Les gendarmes ont relevé des différences d'application de la loi du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel 453 ( * ) en fonction des territoires, en ce qui concerne la lutte contre proxénétisme et contre la traite des êtres humains.
On constate par ailleurs selon eux un renouvellement des modes opératoires , en lien avec le contexte migratoire. Les personnes victimes d'exploitation sexuelle et de traite des êtres humains représentent une population extrêmement vulnérable , qui est la proie naturelle de la criminalité organisée.
1) L'infraction de TEH encore peu mobilisée par les magistrats : un enjeu de sensibilisation et de formation
Selon les interlocuteurs de la délégation, l'infraction de traite des humains n'est aujourd'hui que peu mobilisée par les magistrats . Il y a là un enjeu de sensibilisation et de formation. Cela peut s'expliquer par les différentes dimensions que revêt la traite : travail forcé, exploitation sexuelle, et par la frontière assez fine qui peut exister, parfois, entre prostitution, proxénétisme et traite. Cette situation est d'autant plus regrettable que l'infraction de traite donne des droits spécifiques aux victimes au regard du séjour en France, alors que certaines sont candidates à l'immigration.
Ces constats rejoignent les analyses effectuées par la délégation dans son rapport sur les femmes, victimes de la traite des êtres humains 454 ( * ) . Une recommandation portait d'ailleurs sur la nécessité de renforcer la formation des professionnels - notamment les magistrats, les policiers et les gendarmes - aux différents aspects de la traite des êtres humains, dans le cadre de la formation initiale et continue.
2) Les nouveaux visages de la prostitution, notamment nigériane
En outre, les gendarmes ont évoqué une augmentation substantielle de la prostitution nigériane , dans le contexte des flux migratoires actuels. Les Nigérianes sont réputées « casser » la concurrence avec des prix particulièrement bas. Si ces affaires sont peu traitées en zone gendarmerie, les enquêteurs sont sensibilisés au fait que ces personnes sont victimes d'une mafia qui s'adonne non seulement au proxénétisme, mais aussi à la criminalité organisée (traite des êtres humains, blanchiment d'argent...).
Par ailleurs, les gendarmes ont relevé que ces réseaux criminels sont aujourd'hui mondialisés et beaucoup plus organisés que par le passé, difficilement identifiables et particulièrement violents. En outre, les victimes sont de plus en plus jeunes , certaines associations ayant porté secours à des adolescentes âgées de 1deux ans seulement.
3) Un phénomène émergent : le proxénétisme de cité, qui implique des mineur-e-s
Un autre phénomène qui suscite la préoccupation des gendarmes est l'émergence d'un proxénétisme de cité , particulièrement inquiétant selon eux. Les souteneurs, de jeunes mineurs, sont issus du trafic de stupéfiants et peuvent se montrer très violents (enlèvement et séquestration de mineures de quatorze ou quinze ans). Ils ciblent en général des jeunes femmes ou des adolescentes particulièrement vulnérables, dans les foyers ou les écoles.
4) Un bilan mitigé de la loi de 2016 sur la lutte contre le système prostitutionnel
Enfin, les interlocuteurs de la délégation ont fourni quelques éléments relatifs à l'application de la loi sur la lutte contre le système prostitutionnel 455 ( * ) .
Selon les statistiques du service central de renseignement criminel (SCRC), l'accroissement de l'activité des services est incontestable puisque, en zone gendarmerie nationale (ZGN), 553 faits de recours à la prostitution étaient relevés dans l'année qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi (juin 2016-juin 2017), contre 55 faits de racolage en 2015 et 44 faits jusqu'à mi-avril 2016.
Pour autant, les gendarmes ont souligné que la suppression du délit de racolage a rendu plus difficile , dans certains cas, le suivi des personnes prostituées et de leur parcours . Par ailleurs, selon les gendarmes, la pénalisation de l'infraction est difficile à constater .
À cet égard, le colonel Duvinage a rappelé que, du point de vue criminel, les enquêteurs ne s'intéressent pas au client mais au souteneur . Selon lui, la pénalisation des clients des prostituées constitue malgré tout une « porte d'entrée » judiciaire pour ouvrir une enquête.
Par ailleurs, les actes de violences commis à l'encontre des prostituées demeurent importants .
III. - Démonstration au Centre de lutte contre les criminalités numériques ( C3N )
Enfin, les sénatrices ont eu l'opportunité d'assister à une démonstration dans les locaux du C3N , sous l'égide du colonel Nicolas Duvinage.
1) Présentation du C3N
Le C3N est un service précurseur qui peut mener des enquêtes sous pseudonymes, notamment en matière de pédopornographie. Unité à compétence nationale , le C3N ne traite que les enquêtes les plus sensibles et les plus complexes, la plupart de celles-ci étant menées par les unités régionales ou territoriales de gendarmerie.
On distingue trois modes de saisine pour initier une enquête :
- une saisine à partir d'une enquête locale au cours de laquelle apparaît une dimension complexe de cyber-criminalité ;
- une saisine proactive à l'initiative du C3N , à partir de ses propres recherches sur Internet ;
- une saisine sur plainte , par exemple à l'initiative d'une association.
2) Les différents aspects des violences sexuelles sur Internet
Le colonel Duvinage a rappelé la typologie très riche et variée des violences faites aux femmes en ligne :
- revenge porn 456 ( * ) : cette infraction est juridiquement bien définie et donc aisément poursuivable (art. 226-2-1 du code pénal), d'autant plus depuis l'ajout du 2 ème alinéa de l'article précité par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ; la difficulté est davantage pratique (victimes n'osant pas porter plainte par honte) ;
- sextorsion 457 ( * ) (qui touche autant les hommes que les femmes) : cette infraction est juridiquement bien définie (extorsion) ; les difficultés principales résident dans le dépôt de plainte, les victimes n'osant pas porter plainte par honte, et dans la coopération policière et judiciaire internationale (délinquance majoritairement en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest) ;
- installation de logiciels espions 458 ( * ) , que l'on constate par exemple dans les couples en instance de séparation - l'homme surveille sa femme sur son téléphone portable, avant ou après la rupture - ou bien de la part de pères souhaitant contrôler leurs filles adolescentes, voire majeures (le C3N rencontre quelques cas de ce type par mois, mais cela demeure assez marginal au niveau statistique). Cette infraction est juridiquement bien définie (atteinte à un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances).
Qu'en est-il de la typologie des victimes de cyber-violences ? S'agissant du revenge porn , le colonel Duvinage a confirmé que les victimes sont très majoritairement des femmes, généralement âgées de 15 à 35 ans. Selon lui, il s'agit d'un phénomène générationnel et le spectre d'âge devrait donc s'étendre avec celui des victimes.
Pour ce qui concerne les logiciels espions en cas de ruptures conjugales , les victimes ont entre 25 et 55 ans. Quand il s'agit d'un contrôle parental, l'âge peut aller jusqu'à 25 ans.
Le harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux concerne pour l'essentiel le milieu scolaire et étudiant - de la 6 ème au master, avec des victimes de 12 à 25 ans -, périscolaire, sportif ou encore associatif. Mais il peut aussi intervenir dans le milieu professionnel (en entreprise) ou encore dans le cas de séparation de couple.
Plus généralement, le cyber-harcèlement devient un nouvel enjeu de lutte contre les violences faites aux femmes , notamment aux adolescentes. Par ailleurs, Internet est un vecteur croissant de recrutement des prostituées , en particulier s'agissant de jeunes filles mineures.
3) Exemples de délits en ligne et enjeux de la poursuite des auteurs
Le colonel Duvinage a ensuite présenté aux sénatrices des exemples de délits en ligne , dont certains posent des défis aux gendarmes du C3N pour réprimer les infractions constatées sur Internet car elles ne sont pas toujours aisées à caractériser.
Selon le colonel Duvinage, pour lutter efficacement contre les cyber-violences, il importe de bien différencier les sujets et d'identifier les modes opératoires .
a) Les attaques groupées contre une victime unique
Lorsque l'on assiste à des attaques multiples sur une victime unique en ligne - on parle de « raid » -, la difficulté est de savoir qui poursuivre . Cette question est cruciale du point de vue de la stratégie d'enquête à adopter. Pour identifier l'auteur de la menace, les gendarmes doivent demander une réquisition aux réseaux sociaux concernés. Pour autant, ces entités n'acceptent pas toujours de collaborer aux enquêtes et de répondre aux gendarmes, car elles ne sont pas nécessairement soumises à la loi française. Ainsi, elles ne s'estiment pas tenues de répondre si elles considèrent que les propos incriminés ne violent pas leurs conditions générales d'utilisation. Dans ces conditions, obtenir une adresse IP peut déjà prendre de quelques jours à plusieurs semaines .
Ensuite, les gendarmes doivent adresser une réquisition auprès du fournisseur d'accès à Internet (FAI) pour identifier l'adresse IP, processus qui coûte 18 euros par adresse IP. L'une des difficultés tient au fait que l'auteur des propos n'est pas forcément le titulaire de l'adresse IP. Il faut donc mener un « travail d'environnement » (réquisitions auprès des impôts et de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) pour connaître la composition du foyer du titulaire de l'adresse IP, recherches d'antécédents judiciaires, etc.). Cette phase peut aller jusqu'à l'audition, voire la garde à vue, du titulaire de l'abonnement.
Selon le colonel Duvinage, les enquêteurs se heurtent, pour traiter ces dossiers, à des difficultés qui ne tiennent pas tant à des questions de procédure juridique qu'à des questions de temps et de moyens . En effet, pour adresser une réquisition, les enquêteurs doivent recueillir l'accord systématique du Parquet, car c'est lui qui finance les réquisitions. Or la multiplication des réquisitions pour identifier les titulaires des adresses IP peut aboutir à une augmentation problématique des frais judiciaires , a fortiori quand le résultat de l'enquête peut être aléatoire.
C'est pourquoi, en cas de « raid » sur les réseaux sociaux, les gendarmes se concentreront sur les auteurs des propos les plus virulents et approfondiront la piste qu'ils auront sélectionnée.
b) La vente de substance illégales sur Internet : l'exemple de la drogue du violeur (GHB)
Un deuxième exemple de cyber-criminalité liée aux violences sexuelles concerne la vente de GHB ou GBL (précurseur chimique du GHB) sur Internet. Le GHB est un produit anesthésiant qui provoque des troubles de la mémoire. Il est interdit en France. En revanche, le GBL est beaucoup moins réglementé et on le trouve en vente quasiment libre (il peut s'utiliser pour nettoyer les jantes des voitures). Par ailleurs, le GHB et le GBL à des fins de viol peuvent se procurer sur le dark web 459 ( * ) .
Selon le colonel Duvinage, les criminels exploitent les failles de notre législation . Ainsi, vendre la recette de fabrication du GHB n'est pas illégal, cette action étant assimilée à un « cours de chimie ». Néanmoins, le code de procédure pénale autorise les enquêteurs à se faire passer pour des acheteurs, ce qui permet parfois de remonter jusqu'aux criminels.
c) La vente de logiciels espions
Les enquêteurs du C3N ont pu constater que l'on peut acheter sur Internet des logiciels espions pour une somme de 30 euros par mois . En France, la mise à disposition de ce type de logiciels est réglementée par un agrément du Secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale (SGSDN). Or le colonel Duvinage a observé que la grande majorité des sociétés qui font de la publicité sur Internet pour ce type de produit ne sont pas agréées.
Selon le colonel Duvinage, dans ces dossiers, les enquêteurs ne se heurtent pas à un problème de définition juridique des infractions, puisqu'ils peuvent mobiliser la loi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. La difficulté tient une fois encore à une question de temps et de moyens.
d) Les défis qui mettent en danger la vie d'autrui
Certains sites ciblant les adolescents et jeunes majeurs leur proposent de réaliser des défis susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui ; ils peuvent donc être réprimés sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal.
|
ARTICLE 227-24 DU CODE PÉNAL Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
e) L'offre de prostitution en ligne
Il existe de très nombreux sites d'offres de prostitution en ligne , plus ou moins explicites.
Des associations comme Le Nid font régulièrement des signalements de ces sites sur Pharos 460 ( * ) .
Le C3N constate que la frontière entre un site officiellement présenté comme un site de petites annonces de rencontres et un site de petites annonces d'offres de prostitution est parfois ténue et difficile à qualifier pénalement a priori . L'infraction de proxénétisme peut, notamment, être qualifiée via les éléments techniques de connexion (par exemple, cas d'une adresse IP unique servant à créer plusieurs petites annonces distinctes), lesquels ne peuvent être obtenus que sur réquisition judiciaire dans le cadre d'une enquête déjà ouverte, mais cette dernière ne peut l'être que si l'infraction est matérialisée...
Cela pose la question de la responsabilité pénale des plateformes , lesquelles disposent de ces éléments techniques de connexion . Le code des postes et des communications électroniques prévoit un statut favorable pour les hébergeurs . En effet, ils ne sont pas responsables pénalement et civilement des contenus qu'ils abritent et ne sont passibles de sanctions que s'ils n'ont pas retiré des contenus litigieux avec diligence alors qu'ils en ont été dûment informés .
Ainsi, l'article L. 32-3-4 du code des postes et des communications électroniques n'impose pas de police proactive pour les annonceurs et hébergeurs , mais uniquement une obligation de réaction .
|
ARTICLE L. 32-3-4 DU CODE DES POSTES
Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants : 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ; 2° elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance , soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. |
Selon le colonel Duvinage, il pourrait être intéressant d'envisager une rédaction plus contraignante du code des postes et des communications électroniques au regard des obligations imposées aux hébergeurs, s'ils abritent des sites ou des annonces liés à de la prostitution (obligation de « profilage » des données techniques de connexion).
4) Des outils de prévention à mieux faire connaître et à renforcer : le permis Internet, le site e-enfance et le portail cybermalveillance.gouv.fr
Le permis Internet est une initiative partenariale entre la Gendarmerie nationale, le groupe Axa prévention et l'éducation nationale, dispositif clé de prévention et de sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de la cyber-criminalité.
Il s'agit d'un kit pédagogique dont le contenu est présenté par le corps enseignant à des classes de CM2, âge auquel les enfants commencent à avoir une activité régulière sur Internet et doivent donc être sensibilisés aux dangers liés à son utilisation, en tant que victime et en tant qu'auteur éventuel de violences en ligne.
Depuis la création de ce dispositif, il y a une dizaine d'années, plus d'un million d'enfants ont été sensibilisés .
S'il s'est avéré compliqué de mettre en place le dispositif, il rencontre aujourd'hui un vrai succès . La Gendarmerie nationale est déjà très engagée sur ce dispositif, qui est désormais également déployé en police nationale.
Les membres de la délégation s'interrogent sur l'opportunité d'étendre ce dispositif de prévention aux adolescents et jeunes adultes , avec le concours des associations étudiantes par exemple.
De la même manière, le colonel Duvinage a salué la qualité du travail mené par l'association E-enfance à travers son site Internet (www.e-enfance.org).
Il a également mentionné le portail gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr (www.cybermalveillance.gouv.fr), qui contient des informations pour comprendre la cyber-malveillance et se protéger. On y trouve notamment un onglet destiné aux victimes pour les accompagner dans leur parcours.
* 343 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
* 344 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
* 345 Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale.
* 346 Proposition de loi de M. Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues relative au principe de garde alternée des enfants, enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2017, n° 307, 15 ème législature.
* 347 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
* 348 Le syndrome d'aliénation parentale a été créé par le psychiatre Richard Gardner dans les années 1980 pour expliquer l'attachement unilatéral d'un enfant à un parent (le plus souvent la mère) quand il s'accompagne d'une attitude de rejet à l'égard de l'autre parent (le plus souvent le père). Le syndrome d'aliénation parentale n'est pas reconnu en tant que trouble par la communauté médicale et judiciaire. (Note du secrétariat).
* 349 Il s'agit d'un amendement portant article additionnel après l'article 17 du projet de loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, adopté au Sénat le 17 septembre 2013.
* 350 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 351 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 352 Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
* 353 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
* 354 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.
* 355 Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité, rapport parlementaire de Mme Chantal Jouanno, sénatrice de Paris, du 5 mars 2012.
* 356 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
* 357 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
* 358 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
* 359 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016.
* 360 Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
* 361 Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
* 362 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales , rapport de Corinne Bouchoux, Laurence Cohen, Roland Couteau, Chantal Jouanno, Christiane Kammermann et Françoise Laborde fait au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 425, 2015-2016.
* 363 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
* 364 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
* 365 Roger Henrion, Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé : rapport au ministre chargé de la Santé, Documentation française, février 2001.
* 366 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
* 367 La théorie du Nudge (terme parfois traduit par « paternalisme libéral ») consiste à faire valoir que des suggestions indirectes peuvent influencer la motivation, l'incitation et les prises de décision des individus, au moins aussi efficacement que l'instruction directe ou la législation.
* 368 Jouets : la première initiation à l'égalité , rapport d'information n° 183 (2014-2015) du 11 décembre 2014, par Chantal Jouanno et Roland Courteau.
* 369 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
* 370 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
* 371 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 372 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen).
* 373 Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.
* 374 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 375 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
* 376 Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
* 377 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
* 378 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
* 379 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 380 Communiqué du 17/10/2006.
* 381 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein des couples ou commises contre les mineurs.
* 382 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
* 383 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales , rapport n° 425 (2015-2016) de la délégation aux droits des femmes du Sénat.
* 384 Cellules de recueil des informations préoccupantes.
* 385 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 386 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
* 387 Proposition n° 12.
* 388 La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.
* 389 LEGAD pour Legal Advisor .
* 390 Le comité de pilotage Thémis a été réuni le 7 mars 2018 par la ministre des Armées, conjointement avec l'Observatoire de la parité femmes-hommes.
* 391 Femmes et agriculture : pour l'égalité dans les territoires , rapport n° 615 (2016-2017) de la délégation aux droits des femmes du Sénat.
* 392 5 Ordonnances du 22 septembre 2017 : 2017-1385 à 2017-1389.
* 393 Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 394 Loi 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance.
* 395 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
* 396 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 397 Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
* 398 Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au traité portant statut de la Cour pénale internationale ; Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt n° 596 du 20 mai 2011 ; Conseil d'État, Avis sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale du 01 octobre 2015.
* 399 Loi n° 2014-173 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
* 400 Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles du 5 octobre 2016.
* 401 Collectif féministe contre le viol .
* 402 Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail .
* 403 Centres d'information sur les droits des femmes et des familles .
* 404 Femmes pour le dire, femmes pour agir .
* 405 Amicale du Nid .
* 406 Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.
* 407 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits.
* 408 Avis 18-03 du Défenseur des Droits au Parlement.
* 409 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
* 410 Harcèlement sexuel : une loi adaptée, une mise en oeuvre à consolider : rapport d'information n° 4233 de Pascale Crozon et Guy Geoffroy au nom de la commission des Lois.
* 411 Ou harcèlement personnel « environnemental ».
* 412 Cour d'appel d'Orléans, chambre sociale, 7 février 2017 ; 15/02566
* 413 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 414 Loi n° 2014- 873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 415 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
* 416 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
* 417 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
* 418 Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
* 419 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
* 420 Circulaire 2003-027 du 17 février 2003 relative à l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées.
* 421 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 422 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
* 423 CE Perreux, 30 octobre 2009, n° 298348.
* 424 CE 11 juillet 2011, n° 321225.
* 425 Source : interview de Mme Baldeck sur le site de l'AVFT, en date du 8 juillet 2010.
* 426 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
* 427 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
* 428 Pour mémoire, plusieurs mesures destinées à renforcer la lutte contre les agissements sexistes dans les entreprises ont été adoptées dans le cadre de la loi « El Khomri ».
* 429 Il s'agit du rapport laïcité.
* 430 Pour mémoire : aux termes des dispositions de l'article L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT peut « proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé ». Pour leur part, les délégués du personnel, en vertu de l'article L. 2313-2 du code du travail peuvent mettre en oeuvre le droit d'alerte au titre « de faits de harcèlement sexuel ou moral ».
* 431 Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
* 432 Harcèlement sexuel : une loi adaptée, une mise en oeuvre à consolider, rapport d'information n° 4233 de Pascale Crozon et Guy Geoffroy fait au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, novembre 2016.
* 433 La victime avait porté plainte contre son supérieur hiérarchique pour des agissements relevant du harcèlement sexuel mais également de l'agression sexuelle.
* 434 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 435 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 436 Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles . Flammarion, 2001. Ed. revue, 2008.
* 437 Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, 11-05-2011.
* 438 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
* 439 Audition de Mme Ghada Hatem, fondatrice de La Maison des femmes de Saint-Denis sur La Maison des femmes de Saint-Denis et les soins aux femmes victimes de violences
( http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171211/femmes.html#toc2 ).
* 440 Lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires : faire de l'école un creuset de l'égalité - Rapport n° 645 (2013-2014) de M. Roland Courteau, fait au nom de la délégation aux droits des femmes ; Jouets : la première initiation à l'égalité - Rapport n° 183 (2014-2015) de Chantal Jouanno et Roland Courteau, fait au nom de la délégation aux droits des femmes.
* 441 Le propos de cette campagne est d'alerter sur les conséquences, souvent irréversibles, des violences domestiques sur les plus faibles ( https://www.province-sud.nc/ruban-blanc ).
* 442 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
* 443 Ce groupe de travail était composé de Mme Marie Mercier, rapporteur ; Mmes Esther Benbassa, Maryse Carrère, Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, MM. Arnaud de Belenet, François-Noël Buffet, Dany Wattebled ( http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-289-notice.html ).
* 444 Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
* 445 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
* 446 La sexualité en France : pratiques, genre et santé , Nathalie Bajos et Michel Bozon, 2008.
* 447 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé.
* 448 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
* 449 Numéro vert national d'écoute pour les violences faites aux femmes.
* 450 Numéro vert national du ministère de la Justice pour les victimes.
* 451 Le ministre de l'Intérieur a annoncé le 8 février 2018 l'ouverture, au printemps, d'une plateforme de signalement des faits de violences sexuelles et sexistes, dans la continuité de la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes/hommes. L'extension des pré-plaintes en ligne aux faits de discrimination est prévue dans le courant de l'année, de même qu'un projet de dépôt de plainte en ligne pour les escroqueries sur Internet (source : Bulletin Quotidien du 9 février 2018).
* 452 Le ministre de l'Intérieur a annoncé le 8 février 2018 le lancement de la « Brigade numérique », une plateforme d'accès aux forces de police et de gendarmerie ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, qui permettra d'orienter et de renseigner les usagers (source : Bulletin Quotidien du 9 février 2018).
* 453 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
* 454 Traite des êtres humains, esclavage moderne : femmes et mineur-e-s, premières victimes , rapport d'information de Corinne Bouchoux, Hélène Conway-Mouret, Joëlle Garriaud-Maylam, Brigitte Gonthier-Maurin, Chantal Jouanno et Mireille Jouve fait au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 448 (2015-2016).
* 455 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
* 456 Vengeance pornographique en français. Il s'agit de photographies ou vidéo à caractère explicitement sexuel publiées ou partagées sur Internet, sans le consentement de la personne concernée. Publié par un ou une ex-partenaire, ce contenu a pour vocation première d'humilier la personne concernée, à des fins de vengeance, souvent après une rupture (source : rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pour une République numérique, par Catherine Coutelle, députée, n° 3348, XIVème législature, 15 décembre 2015).
* 457 Le délit de sextorsion consiste en l'extorsion via Internet de faveurs sexuelles ou monétaires. Il se double le plus souvent de celui de chantage à la webcam (source : Wikipédia).
* 458 Un logiciel espion (aussi appelé mouchard ou espiogiciel, en anglais spyware ) est un logiciel malveillant qui s'installe dans un ordinateur ou autre appareil mobile, dans le but de collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il s'est installé, très souvent sans que l'utilisateur en ait connaissance (source : Wikipédia).
* 459 La législation sur les médicaments est beaucoup plus permissive dans certains pays, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qu'en France. Dans ces pays, la plupart des médicaments se vendent sur Internet, sans ordonnance.
* 460 La plateforme PHAROS (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements), mise à la disposition des internautes par l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication (OCLCTIC), permet de signaler en ligne les contenus et comportements illicites de l'Internet.