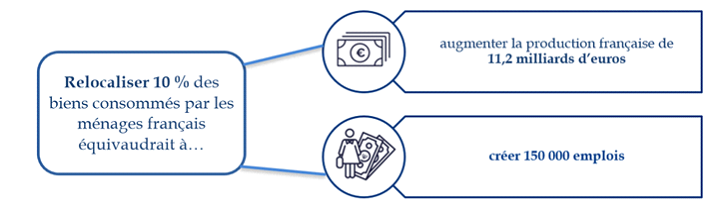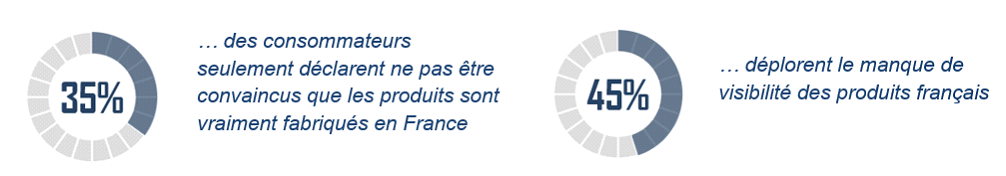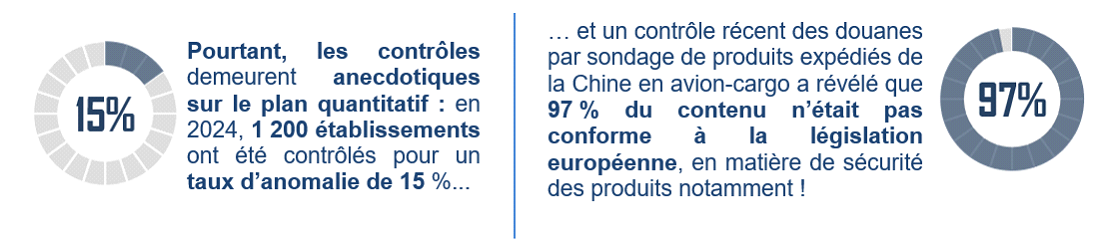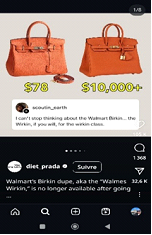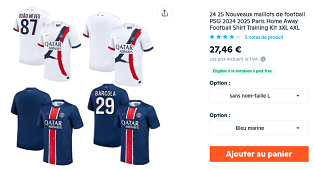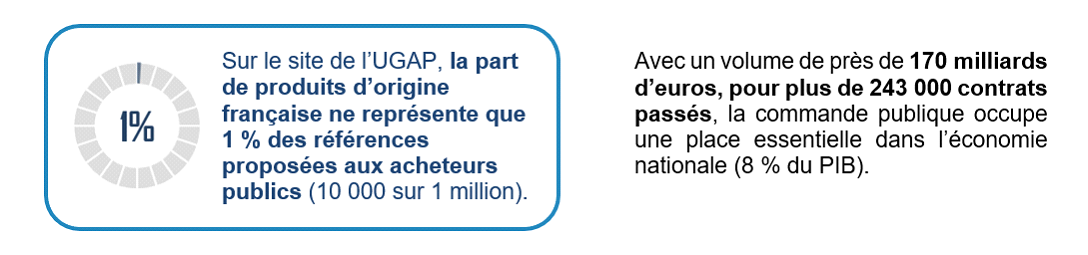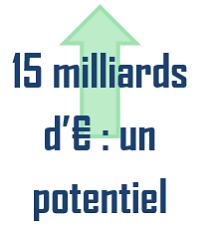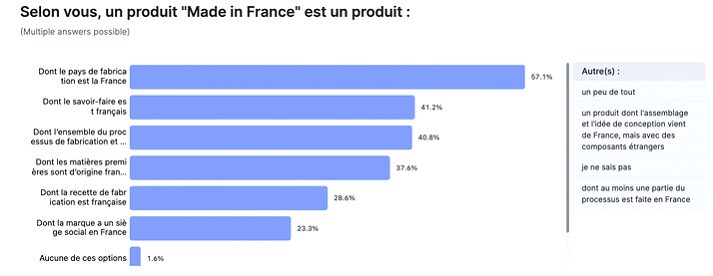- L'ESSENTIEL
- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE RESSOURCE
À MIEUX EXPLOITER
- II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES
CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
- III. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS
HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
- IV. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS
SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
- V. CINQ AXES D'ACTIONS POUR VALORISER L'ATOUT DU
FABRIQUÉ EN FRANCE
- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE RESSOURCE
À MIEUX EXPLOITER
- AVANT PROPOS
- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : LA
COMPÉTITIVITÉ PATRIOTIQUE
- II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES
CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES
- A. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE NOTION
COMPLEXE À DÉFINIR
- B. UNE FORTE SUSPICION SUR LE FABRIQUÉ EN
FRANCE
- C. DE TROP NOMBREUX LABELS ET CERTIFICATIONS
PUBLICS ET PRIVÉS QUI DÉSORIENTENT LE CONSOMMATEUR
- D. LE DRAPEAU TRICOLORE EST UTILISÉ POUR
RENFORCER, DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR, L'ORIGINE ALLÉGUÉE DU
PRODUIT.
- A. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE NOTION
COMPLEXE À DÉFINIR
- III. DES CONTRÔLES ENCORE LARGEMENT
INSUFFISANTS
- IV. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS
HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
- A. UNE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE QUI
ANALYSE L'INDICATION DE L'ORIGINE COMME UNE « MESURE D'EFFET
ÉQUIVALENT » À UNE « RESTRICTION
QUANTITATIVE À L'IMPORTATION »
- B. UNE DÉSINDUSTRIALISATION MASSIVE QUI
EMPÊCHE UNE OFFRE ADÉQUATE
- C. DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS DE
CONSOMMATION
- D. UNE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON À
MODERNISER ET À RENFORCER EN MOYENS
- A. UNE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE QUI
ANALYSE L'INDICATION DE L'ORIGINE COMME UNE « MESURE D'EFFET
ÉQUIVALENT » À UNE « RESTRICTION
QUANTITATIVE À L'IMPORTATION »
- V. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS
SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
- VI. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : CINQ AXES
D'ACTIONS POUR VALORISER UN ATOUT
- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : LA
COMPÉTITIVITÉ PATRIOTIQUE
- LES PROPOSITIONS POUR VALORISER
L'ATOUT DU FABRIQUÉ EN FRANCE
- EXAMEN EN DÉLÉGATION
- AUDITION DU 15 MAI 2025 :
« FABRIQUER EN FRANCE : EST-CE ENCORE POSSIBLE ? »
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- COMPTE-RENDU DU DÉPLACEMENT EN
ITALIE
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
N° 754
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation aux entreprises (1) portant sur le thème « Le fabriqué en France »,
Par Mme Anne-Marie NÉDÉLEC et M. Franck MENONVILLE,
Sénatrice et Sénateur
(1) Cette délégation est composée de : M. Olivier Rietmann, président ; MM. Pierre Cuypers, Christian Klinger, Michel Canévet, Patrick Chauvet, Mme Marion Canalès, MM. Simon Uzenat, Martin Lévrier, Ian Brossat, Michel Masset, Guillaume Gontard, Emmanuel Capus, vice-présidents ; M. Michel Bonnus, Mmes Else Joseph, Brigitte Devésa, M. Jérôme Darras, secrétaires ; MM. Yves Bleunven, Denis Bouad, Jean-Luc Brault, Mmes Catherine Conconne, Mireille Conte Jaubert, MM. Gilbert Favreau, Stéphane Fouassin, Mme Laurence Garnier, M. Fabien Gay, Mmes Antoinette Guhl, Brigitte Hybert, M. Olivier Jacquin, Mme Lauriane Josende, MM. Daniel Laurent, Pierre-Antoine Levi, Mme Pauline Martin, MM. Franck Menonville, Serge Mérillou, Damien Michallet, Mme Anne-Marie Nédélec, MM. Cyril Pellevat, Clément Pernot, Sebastien Pla, Mme Anne-Sophie Romagny, M. Dominique Théophile, Mme Sylvie Valente Le Hir.
L'ESSENTIEL
Alors que l'immense majorité des consommateurs français déclarent vouloir acheter des produits fabriqués en France, ils les considèrent trop chers, de qualité insuffisante et jugent l'offre « France » illisible.
Pour autant, la délégation aux Entreprises n'est pas actuellement favorable au marquage obligatoire de l'origine, qui ferait supporter aux entreprises une charge supplémentaire. Cette perspective pourrait être reconsidérée après la mise en place du passeport numérique des produits et une étude d'impact à l'échelle européenne démontrant son coût quasi-nul pour les entreprises. La délégation considère en revanche prioritaire de lutter contre la contrefaçon et le dumping des importations de produits à bas coût qui menacent les savoir-faire traditionnels et tout produit fabriqué en France.
I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE RESSOURCE À MIEUX EXPLOITER
Une forte demande des consommateurs
Avec 23 %, ce motif d'achat arrive loin derrière le prix (80 %), la qualité (73 %) et la durée de vie (41 %). Par ailleurs, 75 % des Français attendent des entreprises qu'elles s'engagent en matière de patriotisme économique.
Le fabriqué en France est aujourd'hui perçu comme une réponse concrète pour préserver les emplois locaux, soutenir l'économie nationale, répondre aux enjeux de souveraineté nationale, garantir des produits de meilleure qualité et mieux tracés. Les préoccupations environnementales expliquent l'intérêt grandissant pour le fabriqué en France. Cependant, la crise du pouvoir d'achat freine la demande de « fabriqué en France ».
Le « fabriqué en France », un concept célébré
Symbolisant la qualité et le savoir-faire artisanal à l'origine, le fabriqué en France est devenu un symbole d'authenticité et de tradition et incarne, dans la mondialisation, la qualité, la durabilité et le maintien d'un savoir-faire français.
Initiatives privées et publiques valorisent l'origine française des produits. Ainsi la dernière édition (novembre 2024) du salon du « Made in France », créé en 2012, a regroupé 1 000 exposants et attiré 110 000 visiteurs. Un « parcours des savoir-faire français » a été organisé par l'État à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en octobre 2024. Le Palais de l'Élysée a accueilli la 4e édition de la « grande exposition du fabriqué en France » avec 112 produits français, sélectionnés parmi 2 452 produits candidats.
Acheter français pour favoriser l'emploi
II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Le fabriqué en France, une notion complexe à appréhender
Un produit importé peut être qualifié de « fabriqué en France ». Comme le reconnaît la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) : « le recours aux règles douanières, basées sur la notion de dernière transformation substantielle, est effectivement parfois critiqué pour son manque de clarté ou d'ambition à l'égard du « Fabriqué en France » car le respect de ces règles ne signifie pas que le produit est 100 % français (c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en France uniquement avec des matières françaises) ». Il peut donc y avoir confusion pour le consommateur qui, en lisant « Fabriqué en France » ou « origine France », peut croire que le produit est 100 % français. En matière non alimentaire, l'utilisation des couleurs du drapeau français n'est pas interdite. Son utilisation peut être en revanche considérée comme une pratique commerciale trompeuse si les produits ou services ne sont pas français.
Comme le reconnaît la DGDDI : « La réglementation sur l'origine non préférentielle peut effectivement sembler complexe à un opérateur économique », en particulier pour les PME et TPE. Les règles européennes couvrent 900 pages du Journal officiel de l'Union européenne. En fin de compte, l'appréciation est effectuée au cas par cas par 6 agents du Service de l'Origine et du Made In France (SOMIF). Seulement 850 « informations », qui ne constituent pas une certification officielle, ont été délivrées en 2024.
Une forte suspicion sur le fabriqué en France
De trop nombreux labels publics et privés qui désorientent le consommateur
L'imagination marketing est sans limite pour utiliser des allégations connexes faisant croire qu'un produit est français : « Conçu en France », « Création Française », « Collection Française », « Savoir-faire français », « Design français », « Conditionné en France », « Imprimé en France », « Inventé en France », quand il ne s'agit pas de l'utilisation abusive du drapeau français.
La tromperie sur le « fabriqué en France » pénalise les entreprises françaises à hauteur de 5 milliards d'euros, faisant perdre des dizaines de milliers d'emplois.
Les 92 labels et certifications publics et privés entretiennent une grande confusion chez les consommateurs.
Des contrôles trop peu nombreux
Si 22 millions de produits contrefaits ont été saisis en 2024 en France, l'Italie déclare en avoir bloqué 800 millions. Les contrôleurs de la Garde des finances italienne sont quatre fois plus nombreux que les effectifs des douanes françaises (68 000 contre 16 500) et dotés d'outils juridiques plus efficaces. L'OCDE a estimé la valeur des importations de contrefaçons dans l'Union européenne en 2021 à environ 100 milliards d'euros, soit 4,7 % des importations de l'UE.
Selon, une étude de la Fédération européenne des industries du jouet, 95 % des articles achetés sur Temu et testés étaient dangereux pour les enfants. Plus récemment, la Fédération finlandaise du commerce a analysé 14 produits vendus sur cette plateforme et aucun d'entre eux ne respectait les normes européennes de sécurité et de conformité.
III. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
Une réglementation européenne qui considère l'indication de l'origine comme une « mesure d'effet équivalent » à une « restriction quantitative à l'importation ». Pourtant, l'information sur la provenance d'un produit n'est pas un obstacle mais une condition de la concurrence pour le consommateur.
Une désindustrialisation massive qui empêche une offre adéquate. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est de 11 % au plus. L'offre de produits français s'est donc rétrécie à proportion de la désindustrialisation et des délocalisations.
De nouveaux comportements de consommation. Les jeunes générations sont moins attachées à l'origine des produits qu'ils achètent. En matière de luxe, le « dupe » est même une contrefaçon recherchée, très populaire chez les jeunes, dont le pouvoir d'achat est plus faible.
La révolution du e-commerce (8,4 milliards d'euros en 2005 de chiffre d'affaires mais 175 milliards en 2025) a élargi la brèche du « francolavage » avec un flux ininterrompu de contrefaçons proposées sur les réseaux sociaux et places de marchés. Ce « tsunami » de produits à bas coûts se traduit par 1,5 milliard de colis livrés en France, dont 800 millions sont des articles de moins de 150 euros, exemptés de droit de douane et bénéficiant d'un tarif postal préférentiel. En effet, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, est toujours considérée comme un pays en développement par l'Union postale universelle...
La lutte contre la contrefaçon doit être modernisée et renforcée. La France est le pays dont les entreprises sont les plus touchées par la contrefaçon, après les États-Unis, et devant l'Italie. En 2024, 21,5 millions de produits contrefaits ont été saisis, soit quatre fois plus en cinq ans. Réseaux sociaux et places de marché proposent un flux ininterrompu de contrefaçons. Les contrefaçons chinoises représentent 85 % des saisies mondiales en ligne et 51 % des saisies de ventes mondiales hors ligne. La contrefaçon s'est globalisée, industrialisée et criminalisée à grande échelle. Notre droit peine à s'adapter à des acteurs plus agiles et plus puissants...
IV. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
Le fabriqué en France est le « trou noir » de la commande publique. Le potentiel supplémentaire des achats de produits fabriqués en France est estimé à 15 milliards d'euros, soit près d'un cinquième du déficit commercial de 2024. Si 25 % des marchés publics étaient réservés aux produits français, cela représenterait 50 milliards d'euros par an d'achats français.
L'achat local est toutefois indirectement favorisé grâce à la prise en considération des caractéristiques environnementales des offres et la promotion des achats auprès des PME.
Les handicaps de l'achat français dans la commande publique sont nombreux :
· La préférence locale n'est pas admise par l'Union européenne ;
· La mesure de la part importée dans notre commande publique est totalement déficiente ;
· La commande publique est éclatée entre 60 centrales d'achats publics (dont la plus importante est l'UGAP avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros) et 135 000 pouvoirs adjudicateurs (30 000 en Allemagne, 3 500 en Italie) ;
· La France pénalise le délit de favoritisme applicable à l'ensemble de la commande publique, conduisant les acheteurs publics à une lecture excessivement prudente des règles ;
· La moitié des marchés publics en volume est passée sous le seuil de mise en concurrence de 40 000 euros HT. Dans ce cas, l'acheteur public est libre : il peut se fournir sur les plateformes du e-commerce sans se préoccuper d'acheter français ;
· Le point faible de la commande publique est l'inexistence des contrôles des engagements des attributaires de marchés publics, notamment en matière environnementale et sociale au niveau national.
V. CINQ AXES D'ACTIONS POUR VALORISER L'ATOUT DU FABRIQUÉ EN FRANCE
Axe 1 - Mieux identifier le fabriqué en France
1. Définir le fabriqué en France comme un produit dont la majorité de la valeur ajoutée a été créée sur le territoire national et non plus comme la dernière transformation substantielle
2. Maintenir le caractère facultatif du marquage de l'origine de fabrication des produits non alimentaires
3. Regrouper progressivement les labels publics et privés sous un label unique « fabriqué en France »
4. Réserver aux produits dont la majorité de la valeur est ajoutée en France, l'exclusivité de l'apposition du drapeau français, et considérer que le fait d'apposer ou de faire apparaître un drapeau français sur un produit vendu en France qui n'est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse
5. Créer une plateforme en ligne unique exclusivement réservée aux produits « fabriqués en France »
6. Rendre obligatoire au niveau européen le marquage de l'origine de production des produits importés et commercialisés dans l'Union européenne
7. Confier aux comités stratégiques de filières l'élaboration d'une stratégie industrielle de relocalisation, en donnant la priorité aux produits identifiés comme en situation de vulnérabilité d'approvisionnement, avec la création de zones franches ayant une fiscalité allégée
Axe 2 - Rétablir une concurrence libre et non faussée
8. Étendre aux produits industriels le principe des clauses miroirs afin d'appliquer aux produits importés les mêmes règles environnementales et sociales
9. Saisir l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 461-2 du code de commerce, du sujet des reventes à perte de la part des plateformes de commerce en ligne, notamment chinoises
10. Demander à l'Union européenne de lancer une procédure antidumping contre les plateformes de commerce en ligne chinoises et d'enquêter sur des subventions octroyées par des pays non membres de l'UE à des entreprises actives sur son territoire, afin de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union européenne
11. Refonder la politique concurrentielle européenne afin d'intégrer la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne de réduction de la dépendance dans des domaines stratégiques
12. Mettre en oeuvre rapidement l'amendement du Sénat qui soumet à un minimum de droits de douanes tout colis extra-communautaire de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos
13. Étendre la taxe carbone (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières) aux produits de consommation courante
Axe 3 - Renforcer les contrôles sur le fabriqué en France
14. Réorienter les contrôles de la DGCCRF et des Douanes vers le commerce en ligne extra-communautaire, en priorisant le contrôle de la sécurité des consommateurs
15. Sensibiliser les places de marché (marketplaces) à la mise en avant du « fabriqué en France », notamment à l'occasion du « Black Friday », et au déréférencement des entreprises qui fraudent sur l'origine des produits (« francolavage »)
16. Assimiler la contrefaçon à une non-conformité du produit, dans le cadre de l'application du règlement relatif à un marché unique des services numériques (DSA) et du règlement sur les marchés numériques (DMA)
17. Créer une amende délictuelle forfaitaire en cas de fraude sur une allégation de produit fabriqué en France, pour les vendeurs comme pour les acheteurs
18. Autoriser le blocage des sites « miroirs » afin de lutter contre la multiplication des pages du web proposant des contrefaçons
19. Augmenter les moyens de la DGCCRF et des Douanes en étendant leur compétence en matière de police judiciaire afin de mieux lutter contre le « francolavage »
20. Faire de la contrefaçon une priorité de l'Office européen de lutte anti-fraude, rendre compétent le Parquet européen, renforcer la coopération douanière notamment avec la Belgique et les Pays-Bas
Axe 4 - Mobiliser la commande publique au service du fabriqué en France
21. Diviser par dix le nombre de pouvoirs adjudicateurs (actuellement 135 000), en les mutualisant
22. Mesurer la part importée de la commande publique
23. Imposer les appels d'offre hors taxe pour les marchés dans lesquels peuvent se présenter des entreprises extra-communautaires
24. Assurer un contrôle des engagements sociaux et environnementaux pris par les entreprises ayant remporté un marché public
25. Faire du critère bas-carbone un levier en faveur des circuits d'approvisionnements territoriaux courts
26. Transférer la tutelle de l'UGAP au ministère de l'Industrie
Axe 5 - Informer et davantage responsabiliser le consommateur
27. Informer, par des campagnes régulières de sensibilisation, le consommateur des conséquences sur leur santé et leur sécurité, sur l'impact social et environnemental (conditions sociales de production inacceptables, bilan carbone désastreux) des produits importés
28. Stigmatiser et dénoncer les entreprises qui pratiquent le « francolavage »
AVANT PROPOS
Alors que l'immense majorité des consommateurs français déclarent vouloir acheter des produits fabriqués en France, ils les considèrent trop chers, de qualité insuffisante et jugent l'offre « France » illisible. La question de la compétitivité des produits fabriqués en France convoque des enjeux structurels : la soutenabilité du financement par les entreprises d'un modèle social toujours plus coûteux, une fiscalité pénalisante avec des impôts de production handicapant les entreprises, la durée du temps de travail et son coût, la qualité de fabrication des produits, la réindustrialisation et la relocalisation de la production.
L'irruption du commerce en ligne et, plus récemment, de plateformes chinoises proposant des produits à très bas coûts, rend les efforts de mise en avant des produits français plus difficiles. Le foisonnement des labels déconcerte le consommateur. L'information sur la provenance d'un produit n'est pas un obstacle mais une condition de la concurrence. Les contrôles du « francolavage »1(*) sont cependant théoriques face au « tsunami » des colis du e-commerce. La commande publique ne joue pas son rôle. Pourtant, le fabriqué en France permet, sur le marché national, de préserver un savoir-faire de qualité, ancré dans les territoires, à forte valeur ajoutée, et qui peut être valorisé à l'international.
La délégation aux Entreprises n'est pas actuellement favorable au marquage obligatoire de l'origine, qui ferait supporter sur les entreprises une charge supplémentaire.
Cette perspective pourrait être reconsidérée après la mise en place du passeport numérique des produits et une étude d'impact à l'échelle européenne démontrant son coût quasi-nul pour les entreprises. La délégation considère en revanche prioritaire de lutter contre la contrefaçon et le dumping des importations de produits à bas coût qui menacent les savoir-faire traditionnels et tout produit fabriqué en France.
Le rapport d'Yves Jégo sur le fabriqué en France vient d'être rendu public (28 mai 2025). Il était l'auteur en 2010 d'un précédent rapport « En finir avec la mondialisation anonyme, la traçabilité au service des consommateurs et de l'emploi », qui proposait déjà de « rendre obligatoire le marquage de l'origine nationale des produits sur le marché communautaire ». Aujourd'hui, avec un rapport intitulé « Simplifier l'appréhension de l'origine des produits pour valoriser les filières françaises et européennes », il suggère d'imposer dans un premier temps un marquage obligatoire de l'origine des produits importés dans l'Union Européenne et ensuite de mettre en place un marquage de l'origine obligatoire pour accompagner l'usage des allégations à la France. Il préconise également de faire de la préférence européenne le principe directeur de nos achats publics ; de créer une fédération des marques territoriales ; d'instaurer un « Mois de l'achat français » ; et enfin de modifier le décret relatif au label Entreprises du Patrimoine Vivant afin de valoriser la production en France des entreprises labellisées.
I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : LA COMPÉTITIVITÉ PATRIOTIQUE
A. UNE FORTE DEMANDE DES CONSOMMATEURS
1. Les consommateurs français aimeraient acheter français, mais le prix est un obstacle
Selon une enquête réalisée en octobre 2023 pour CCI France, le pays de fabrication n'occupe que la 4e place dans l'acte d'achat d'un produit. Avec 23 %, ce motif arrive loin derrière le prix (80 %), la qualité (73 %) et la durée de vie (41 %). Les principales motivations à l'achat français sont le soutien des producteurs locaux (63 %), à l'économie française (56 %), et la qualité du produit (47 %).
Neuf Français sur dix qui achètent des produits français aimeraient en consommer davantage mais le prix freine ces achats pour 70 % des Français. Cependant, les consommateurs français sont prêts à faire un effort : si, en 2005, seuls 43 % des consommateurs étaient prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France, plus des deux tiers de la population (65 %) y étaient favorables en 2020. L'attrait pour les produits nationaux reste toutefois plus marqué parmi les catégories les plus aisées et les plus diplômées.
Ces résultats varient en fonction des générations. La Génération X (personnes nées entre 1964 et 1979) semble être celle qui accorde le plus d'importance à l'origine du produit avec 23,6 % des répondants plaçant ce critère au coeur de leur décision d'achat. Les Boomers (1946-1964), avec 19,8 %, sont suivis de près par les Millénials (1980-1996) qui représentent 18,2 % des personnes interrogées. La Génération Z (1997-2012) s'avère être celle qui se préoccupe le moins de l'origine du produit (8 %).
Selon une étude récente2(*), 75 % des Français attendent des entreprises qu'elles s'engagent en matière de patriotisme économique.
2. Une prise de conscience des enjeux du fabriqué en France par les « consomm'acteurs »
Le fabriqué en France est aujourd'hui perçu comme une réponse concrète pour préserver les emplois locaux, soutenir l'économie nationale, répondre aux enjeux de souveraineté nationale, garantir des produits de meilleure qualité et mieux tracés. Les préoccupations environnementales expliquent l'intérêt grandissant pour le fabriqué en France. En effet, en privilégiant les produits fabriqués en France, l'empreinte carbone liée aux flux internationaux est considérablement réduite. Les acheteurs participent ainsi, dans une certaine mesure, à la préservation de l'environnement. De consommateurs passifs, ils deviennent des « consomm'acteurs » engagés.
Selon le CREDOC3(*), en 2020, l'argument écologique est ainsi devenu central dans les décisions d'achat. En 2005, la moitié des personnes qui se disaient préoccupées par l'environnement (50 %) étaient d'accord pour payer plus cher un produit fait en France contre 42 % de celles non préoccupées par cet enjeu. Quinze ans plus tard, 76 % des consommateurs soucieux de la dégradation de l'environnement (contre 39 % de ceux ne l'étant pas) se disent prêts à payer un surcoût. Grâce à cet argument écologique, ce qui était autrefois l'apanage d'une population âgée touche aujourd'hui également les jeunes générations4(*).
Or, dans un contexte d'inflation et de crise du pouvoir d'achat, le moteur « environnementaliste » de l'acte d'achat français ralentit : si en 2020, 87 % des Français étaient incités à consommer un produit en raison de sa fabrication française, et 77 % en raison de ses garanties écologiques, ils ne sont plus en 2024 que 73 % pour les garanties nationales et 54 % pour les garanties écologiques. Lors du dernier salon « Made in France », Guillaume Gibault, fondateur du Slip Français, a ainsi lancé une pétition pour « la mise en place d'un cadre économique en faveur des entreprises fabriquant en France », tenant compte du fait que « tout le monde ne peut pas encore se permettre » d'acheter des produits français.
L'importance accordée au fabriqué en France varie cependant selon la catégorie de produits. Elle est particulièrement forte en ce qui concerne l'alimentation, élément important/déterminant pour les trois quarts des Français (74 %), devant les produits d'hygiène et cosmétiques (63 %) et l'automobile (54 %).
Pour les entreprises, l'achat français reste également trop coûteux. Ce critère d'attribution d'une commande par les directions des achats est passé de 61 % en 2022 et 65% en 2023 à 47 % pour 2024, tombé au même niveau qu'en 2021. Pour 22 % des répondants, le coût est trop important (17 % en 2023).
B. LE « FABRIQUÉ EN FRANCE », UN CONCEPT CÉLÉBRÉ
Comme l'a indiqué lors de l'audition du 15 mai Anaïs Voy-Gillis, économiste, « la question du soutien à la production nationale porte celle de la fierté collective, du sens que l'on donne à l'action, et de la capacité à se projeter dans un projet de société partagé ».
Symbolisant la qualité et le savoir-faire artisanal à l'origine, le fabriqué en France est devenu un symbole d'authenticité et de tradition et incarne, dans la mondialisation, la qualité, la durabilité et le maintien d'un savoir-faire français. Il influence ainsi grandement les achats des consommateurs.
Les acteurs économiques se sont investis depuis longtemps à des campagnes de communication. Ainsi, dès 1993, les CCI s'engageaient dans la responsabilisation des consommateurs avec la campagne « nos emplettes sont nos emplois ».
Initiatives privées et publiques valorisent l'origine française des produits. Ainsi la dernière édition (novembre 2024) du salon du « Made in France », créé en 2012, a regroupé 1 000 exposants et attiré 110 000 visiteurs. Un « parcours des savoir-faire français » a été organisé par l'État à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et les 26 et 27 octobre 2024, le Palais de l'Élysée a accueilli la 4e édition de la « grande exposition du fabriqué en France » avec 112 produits français, sélectionnés parmi 2 452 items candidats.
C. ACHETER FRANÇAIS POUR FAVORISER L'EMPLOI
Comme l'a souligné une étude de 2018 du Conseil d'orientation pour l'emploi, « la relocalisation de 10 % des biens consommés par les ménages français qui sont actuellement importés et qui seraient alors demain produits sur le territoire équivaudrait, toutes choses égales par ailleurs, à augmenter dans un premier temps la production française de 11,2 milliards d'euros », permettant de créer 150 000 emplois.
II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES
A. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE NOTION COMPLEXE À DÉFINIR
En matière alimentaire, depuis le 1er avril 2020, lorsque l'étiquetage fait apparaître l'origine d'une denrée alimentaire et que celle-ci diffère de celle de son ingrédient primaire5(*), l'indication de l'origine de l'ingrédient en question est obligatoire. Elle l'est également pour les fruits, les légumes et les viandes, et depuis 2025 pour de nouveaux produits6(*).
En matière non alimentaire, le marquage de l'origine est facultatif. Il est laissé à l'initiative du professionnel, qui doit toutefois être en mesure de justifier son allégation. La commercialisation de marchandises comportant un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'elles ont été fabriquées en France ou qu'elles sont d'origine française alors qu'elles ne le sont pas, est prohibée. La douane contrôle les importations et la DGCCRF la commercialisation sur le territoire national.
Les règles de l'origine non préférentielle selon les douanes
L'origine préférentielle sert à appliquer un taux de droits de douane réduit (dans le cadre des relations préférentielles de l'UE avec certains pays) ou nul.
L'origine non préférentielle, qui correspond à la nationalité économique d'une marchandise, doit être distinguée de la provenance, notion géographique, qui renvoie au flux physique de la marchandise.
L'origine non préférentielle permet d'appliquer le tarif extérieur commun (le taux de droits de douane) à une marchandise pour l'entrée sur le territoire douanier de l'UE et de procéder au marquage de l'origine d'une marchandise dans l'UE. L'origine non préférentielle est applicable si une entreprise souhaite apposer un marquage d'origine sur ses produits. L'origine non préférentielle d'un produit est le dernier pays où a lieu une transformation.
Deux cas de figure peuvent se présenter lors de la détermination de l'origine d'une marchandise :
1/ Si le produit est élaboré dans un seul pays : on parle de produit « entièrement obtenu » (en pratique, des produits agricoles ou minéraux).
2/ Si le produit élaboré à partir de matières premières originaires de plusieurs pays ou dont le processus de fabrication fait intervenir plusieurs pays, c'est la nature de l'opération réalisée dans le dernier pays de transformation qui va déterminer l'origine non préférentielle du produit. Le produit doit ainsi subir, dans le dernier pays, une « transformation substantielle », c'est-à-dire une transformation donnant naissance à un produit nouveau ou correspondant à un stade important de fabrication.
Cette dernière transformation substantielle est définie par des critères spécifiques permettant de déterminer le degré substantiel d'une ouvraison ou d'une transformation conférant l'origine aux produits. Ces critères sont définis par des règles d'origine spécifiques applicables à chaque catégorie de produits. Pour déterminer si une transformation substantielle a lieu, il convient d'identifier les matières non originaires du pays où a lieu cette transformation, puis de leur appliquer la règle d'origine correspondante.
Lorsqu'un marquage de provenance est apposé sur un produit en France, il doit être conforme aux règles de l'origine non préférentielle du code des douanes de l'Union.
Un produit importé peut être qualifié de « fabriqué en France ». Comme le reconnaît la DGDDI : « le recours aux règles douanières, basées sur la notion de dernière transformation substantielle, est effectivement parfois critiqué pour son manque de clarté ou d'ambition à l'égard du « fabriqué en France » car le respect de ces règles ne signifie pas que le produit est 100 % français (c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en France uniquement avec des matières françaises) ». Il peut donc y avoir confusion pour le consommateur qui en lisant « fabriqué en France » ou « origine France » croirait que le produit est 100 % français. En outre, ces règles permettant de déterminer l'origine varient d'un produit à l'autre. Les services de l'État utilisent trois types de critères :
1. le changement de position tarifaire (code différent pour le produit fini et les matières utilisées pour sa fabrication) ;
2. le critère de la valeur ajoutée (un certain pourcentage de valeur ajoutée doit avoir été réalisé en France lors de la fabrication du produit fini) ;
3. le critère de l'ouvraison spécifique (une opération bien définie doit avoir été réalisée lors de la fabrication du produit fini).
Les règles nationales doivent s'articuler avec les règles sur l'origine non préférentielle du code des douanes de l'Union européenne, lequel renvoie à l'annexe 22-01 du règlement d'exécution et, pour les produits non repris à l'annexe, dans un tableau publié sur le site Europa7(*). Ces normes européennes couvrent 900 pages du Journal officiel de l'Union européenne. Comme le reconnaît la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) : « La réglementation sur l'origine non préférentielle peut effectivement sembler complexe à un opérateur économique », en particulier pour les PME et TPE. Une circulaire du 13 mai 2016 est censée rendre le dispositif plus lisible, mais elle est elle-même absconse pour des acteurs économiques comme en témoigne cet extrait :
« Une marchandise a donc toujours une origine non préférentielle et possède de surcroît une origine préférentielle si l'échange commercial intervient dans le cadre d'une relation préférentielle (ALE, APE ou concession unilatérale) et que la marchandise répond aux règles spécifiques d'octroi de cette origine ».
La DGDDI accompagne les acteurs économiques de façon personnalisée, par les cellules conseil aux entreprises (CCE). Lorsqu'une entreprise souhaite s'assurer que son produit peut porter un marquage « fabriqué en France », elle a la possibilité, depuis 2016, de déposer auprès du Service de l'Origine et du Made In France (SOMIF) une demande, facultative et gratuite, afin d'obtenir un avis réglementaire qui lui permet de savoir si son produit respecte les règles de l'origine préférentielle. Cette « information sur le Made in France » (IMF) repose sur une base déclarative, sans vérification préalable, et ne constitue ni une certification officielle ni une preuve d'origine juridiquement opposable. Seulement 850 IMF ont été délivrées en 2024 (en hausse de 20 % sur un an). Six fonctionnaires sont chargés de répondre, au cas par cas, à la question de savoir si un produit peut être qualifié de « fabriqué en France ». La réponse est complexe en raison de l'enchevêtrement des normes juridiques nationales et européennes, de la difficulté à déterminer économiquement l'origine française d'un produit en raison de l'insertion de la France dans les chaînes de valeur mondiales.
B. UNE FORTE SUSPICION SUR LE FABRIQUÉ EN FRANCE
En dehors du prix, l'information sur l'origine des produits est également citée comme un obstacle par les personnes qui aimeraient consommer davantage de produits français. Précisément, 35 % de ces personnes déclarent ne pas être convaincues que les produits sont vraiment fabriqués en France. Le manque de lisibilité et d'identification des produits français est d'ailleurs largement reconnu : 45 % des répondants estiment qu'ils ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente ; 52 % jugent même que les acteurs de la distribution ne les mettent pas suffisamment en avant et 59 % des personnes qui n'achètent pas de produits fabriqués en France déclarent que ces produits ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente.
Selon une étude de marché réalisée en avril 20248(*), 41 % des Français pensent qu'un produit fabriqué en France est issu d'un processus de fabrication réalisé en France. Or, cette mention ne signifie pas que l'entièreté du processus de fabrication se situe en France, mais qu'une partie significative, ainsi que sa dernière étape, le sont. En revanche, pour 41 %, cette définition met le lieu de fabrication de côté et concerne davantage un produit dont le savoir-faire est français.
C'est ainsi que la voiture française produite en plus grand nombre sur notre territoire est la Yaris de Toyota (avec 206 679 unités en 2024)...
C. DE TROP NOMBREUX LABELS ET CERTIFICATIONS PUBLICS ET PRIVÉS QUI DÉSORIENTENT LE CONSOMMATEUR
Les Français sont globalement sensibles aux labels. Cependant, 19 % ne seraient pas prêts à payer plus cher pour un label. Cette réticence peut découler soit d'une question de pouvoir d'achat, soit d'une incompréhension des critères de certification, conduisant certains à remettre en question la valeur ajoutée « française » de ces labels.
« Alerte rouge au francolavage » : selon la Fédération indépendante du Made in France, le « francolavage » pénaliserait les entreprises françaises à hauteur de 5 milliards d'euros, faisant perdre des dizaines de milliers d'emplois.
« Alors que la mention prône l'authenticité et le savoir-faire, une méfiance est née en raison du manque de traçabilité des produits, une lacune perçue comme cruciale par les consommateurs attentifs à l'origine et à la qualité des articles qu'ils achètent. En l'absence de transparence dans la chaîne d'approvisionnement, les consommateurs ressentent une incertitude quant à la qualité des produits présentant le fabriqué en France. L'opacité entourant l'origine des matières premières ainsi que les cycles de fabrication, érode progressivement la confiance des consommateurs. Ils se tournent ainsi vers des alternatives, soit avec une meilleure visibilité quant à la provenance, soit vers un produit sans label, moins cher. Pour de nombreux consommateurs, le fabriqué en France ne représente plus la qualité, ni l'authenticité d'un savoir-faire, mais s'apparente davantage à une stratégie commerciale. En effet, si une courte majorité des Français (55 %) estiment que le Made in France représente un vrai engagement de la part des marques, 45 % considèrent que c'est surtout un argument marketing pour mieux vendre ».
Enquête LSA, précitée.
Le « francolavage » désigne tout procédé visant à faire croire au consommateur qu'un produit est fabriqué en France alors qu'il ne l'est pas. Il recouvre une large zone grise se situant entre la méprise et la véritable tromperie. En effet, le fabriqué en France n'est pas un label ni une certification. Aucun bureau officiel ne tamponne cette mention, pas même les pouvoirs publics. Il est laissé libre d'utilisation par quiconque souhaitant déclarer que son produit l'est. Pourtant, la DGDDI et la DGCCRF effectuent des contrôles, assortis de sanctions sur la base des règles décrites ci-après. La ligne rouge résidant dans la confusion du consommateur.
92 labels ou certifications privées9(*) : la grande hétérogénéité des sigles et des mentions, la multiplication des labels publics et privés, entretient une grande confusion chez les consommateurs. Le rapport Jégo en recense 92.
En matière non alimentaire, le professionnel est libre de valoriser l'origine du produit sous la forme qu'il estime pertinente, dès lors qu'il est en mesure de justifier son allégation.
Concernant l'origine française des produits, outre le « Made in France » ou « Fabriqué en France », on peut trouver les allégations suivantes : « 100 % Made in France », « Fabrication Française », « Fabricant français », « Nous fabriquons en France », « Chez nous, tout est fait en France ! ». Dès lors que le professionnel utilise de telles allégations, son produit doit être d'origine française au sens des règles douanières.
Tant que les produits ne pourront pas bénéficier d'un marquage de type « fabriqué en France », des entreprises chercheront à valoriser l'une des étapes de fabrication du produit situé en France en utilisant des allégations connexes : « Conçu en France », « Création Française », « Collection Française », « Savoir-faire français », « Design français », « Conditionné en France », « Imprimé en France », « Inventé en France ». L'imagination marketing est sans limite.
Les allégations locales échappent pour leur part aux règles de l'origine non préférentielle et sont autorisées : Made in Provence / Made in Ardèche / Made in the Alps / Made in Royan / Made in Nouvelle-Aquitaine / Made in Bassin d'Arcachon / Made in Grand Est / Made in Dijon / Made in Berry ; « Fait main par nos soins à Marseille », « Origine Provence », « Fattu manu in Corsica », « Atelier du Val de Loire », « Producteurs creusois », « 100 % breton », « Fleurs de Beauce », « Cosmétiques du Sud-Ouest », « Savoir-faire des Hauts de France »....
Un label regroupe un ensemble d'exigences auxquelles les produits labellisés doivent répondre.
Les critères d'attribution des labels régionaux sont variables. Certains sont plus stricts que d'autres. Cette situation entraîne une forte hétérogénéité des cahiers des charges et des exigences applicables. De même, tandis que certains labels font appel à des organismes externes pour attester de la conformité des entreprises adhérentes et assurer un contrôle, d'autres privilégient des approches encore internalisées ou manquent de contrôle, ce qui nuit à la qualité de l'information fournie au consommateur.
Le professionnel peut également opter pour l'adhésion à un « label » privé, qui recouvre juridiquement les marques collectives simples et de garantie au sens du code de la propriété intellectuelle. La grande majorité de ces labels concernent une origine locale et sont d'initiative privée. Ils sont généralement conçus et gérés par des associations régies par la loi de 1901, regroupant plusieurs professionnels adhérents.
Un label apporte moins de garanties qu'une certification puisqu'il peut provenir d'un organisme public ou privé.
S'il n'existe pas de contrôle a priori de ces labels privés, les services de l'État appliquent les textes du code de la consommation10(*) prohibant les pratiques commerciales trompeuses, les tromperies et autres infractions sur l'origine du produit et sont donc naturellement amenés à contrôler a posteriori les labels et l'usage qui en est fait. Ainsi, lorsqu'un label ou l'utilisation d'une marque sont constatés dans le cadre d'un contrôle, il convient de vérifier que le professionnel a effectivement effectué les démarches de reconnaissance auprès du gestionnaire de la marque ou du label. Dès lors qu'un professionnel allègue un « fabriqué en France » ou toute mention équivalente, il doit respecter les règles de l'origine non préférentielle du produit. À défaut, il commet une pratique commerciale trompeuse, constitutive d'un délit pénal, nécessitant l'établissement d'un élément intentionnel, lequel ne se présume pas. Il appartient aux services de contrôle de caractériser l'infraction dans le cadre d'un procès-verbal. Le professionnel doit fournir des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles. À défaut de telles preuves, il est réputé avoir commis un délit.
La certification, plus exigeante, est une procédure qui permet de certifier la qualité et la conformité des produits et des services, par un organisme accrédité. En France, la certification est encadrée par le code de la consommation. La certification est un acte volontaire. La démarche n'est donc pas obligatoire mais, parce qu'elle s'accompagne d'un logo, elle offre le plus souvent une meilleure visibilité aux bonnes pratiques, et établit un lien de confiance avec le client.
En matière de qualité, la certification de produits NF est donc une démarche précise, encadrée par la loi et par le code de la consommation. Chaque année les entreprises certifiées NF sont auditées par un organisme certificateur, qui lui-même est audité par le COFRAC (comité français d'accréditation) selon la norme ISO17065, norme internationale qui spécifie les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification de produits, de processus et de services. Elle garantit que les organismes de certification opèrent de manière compétente, cohérente et impartiale, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance dans le processus de certification.
La certification Origine France Garantie va au-delà des règles de l'origine non préférentielle et suppose, d'une part, qu'au moins 50 % du prix de revient unitaire du produit soit acquis en France, et d'autre part que les caractéristiques essentielles du produit soient acquises en France. Ces critères sont vérifiés produit par produit, par un organisme tiers.
Code de la consommation :
Certification de conformité pour les services et produits
autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L. 433-3
Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.
L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
Article L. 433-4
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
Article L. 433-5
Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
Article L. 433-6
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées.
La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.
Article L. 433-7
Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.
Article L. 433-8
Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :
1° À la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;
2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Ve partie du code de la santé publique ;
3° À la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques de garantie ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
4° À la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Article L. 433-9
Il est interdit :
1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.
Article L. 433-11
Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.
En matière alimentaire, le système de qualité liée à l'origine des produits alimentaires est encadré par la réglementation européenne (indications géographiques) et repose sur le principe d'un lien entre le produit et son origine géographique. Les appellations d'origine contrôlées (AOC), développées depuis longtemps dans le domaine des vins et des produits agroalimentaires, ont été intégrées au droit communautaire à partir de 1992. L'Appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C'est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d'origine. L'Indication géographique protégée (IGP) quant à elle identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité', la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
L'État a créé le logo Origin'info, dispositif d'affichage volontaire de l'origine de la matière première agricole, des ingrédients des denrées alimentaires transformées, complémentaire des règles européennes d'indication de l'origine de l'ingrédient primaire.
D. LE DRAPEAU TRICOLORE EST UTILISÉ POUR RENFORCER, DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR, L'ORIGINE ALLÉGUÉE DU PRODUIT.
En matière alimentaire, le code de la consommation11(*) interdit de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires ne sont pas d'origine française. L'affichage obligatoire du pays d'origine a été tenté, à l'initiative du Sénat, à deux reprises, dans la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, puis dans la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, mais sans succès.
En matière non alimentaire, l'utilisation des couleurs du drapeau français n'est pas interdite dans le cadre de la publicité commerciale mais son utilisation pourrait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse si les produits ou services qui font l'objet de la publicité commerciale ne sont pas français. Si le code de la consommation12(*) prohibe de tromper le consommateur sur « l'origine » d'une marchandise, aucune protection particulière du drapeau français n'existe. Un importateur indélicat peut utiliser librement le drapeau national pour un produit qui n'est pas fabriqué en France. S'il n'est pas saisi par les douanes, il sera ensuite impossible en pratique aux services de l'État d'engager des poursuites à l'étranger pour cette tromperie, malheureusement courante, et de plus en plus sur les plateformes de commerce en ligne.
La Suisse exige, depuis 2017, que le drapeau ne soit présent que sur les produits fabriqués en Suisse. Elle impose la même contrainte pour l'utilisation de tous les symboles helvétiques. La tablette de chocolat Toblerone a ainsi dû gommer le mont Cervin, de son emballage à la suite de la délocalisation de sa production en Slovaquie.
III. DES CONTRÔLES ENCORE LARGEMENT INSUFFISANTS
A. DEUX ADMINISTRATIONS CONTRÔLENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle la loyauté du marquage Made in France au sens des règles de l'origine non préférentielle, mais également les allégations connexes, éventuellement accompagnées par l'usage de symboles de la France (drapeau, carte de France, Tour Eiffel, coq), les allégations « régionales », les labels...
Comme de nombreux parquets ne disposent pas de section dédiée au droit de la consommation et que les infractions sur la provenance sont relativement méconnues, les transactions pénales sont incitées « au maximum pour éviter des audiencements plus chronophages et coûteux ».
La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ne dispose pas de moyens spécifiquement affectés au contrôle du marquage de l'origine défini par l'article 39 du code des douanes.
Lors d'un contrôle, les agents des douanes vérifient tous les marquages, qu'ils soient apposés sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes. Le terme de marquage est large : il comprend du texte, des couleurs, des dessins. Un produit non fini peut porter par avance au moment de l'importation un marquage « fabriqué en France », s'il est destiné à subir ultérieurement en France, avant commercialisation, une transformation substantielle. Dans ce cas, l'importateur devra prouver que la transformation à réaliser en France est bien de nature à conférer une origine française au produit.
La présence d'une mention litigieuse entraîne soit l'apposition d'un correctif, soit la suppression des indications délictueuses, en vue d'obtenir la mainlevée des marchandises. Si l'importateur n'est pas en mesure d'apporter ce correctif, la marchandise doit être détruite ou réexportée.
B. QUELQUES MILLIERS DE CONTRÔLES POUR DES CENTAINES DE MILLIONS DE PRODUITS
Suite à l'annonce de « 10 000 contrôles en 2024 », par la DGCCRF, de l'origine française des produits alimentaires en 2024, 8 398 établissements ont été concernés et ont fait l'objet de 9 620 visites. Un taux d'anomalie de 34 % a été constaté dans 2 857 établissements. 1 802 établissements ont fait l'objet d'avertissements pour leur rappeler les règles applicables, 588 d'une injonction pour se mettre en conformité et 562 établissements ont fait l'objet de procès-verbaux pénaux ou administratifs.
Les contrôles en matière non alimentaire sont anecdotiques sur le plan quantitatif : en 2024, 1 200 établissements ont été contrôlés pour un taux d'anomalie de 15 %. Les anomalies portaient principalement sur une origine fausse ou confusionnelle, et ont fait l'objet de 98 avertissements, 72 d'injonctions de cessation de pratique illicite et 27 PV pénaux dont 5 transmis au Parquet.
Si 22 millions de produits contrefaits ont été saisis en 2024 en France, les autorités italiennes indiquent en avoir bloqué 800 millions. Les contrôleurs de la Garde des finances italienne sont quatre fois plus nombreux que les effectifs des douanes françaises (63 000 contre 16 500) et dotés d'outils juridiques plus efficaces.
À l'égard des plateformes de commerce, la DGCCRF dispose depuis 2020 d'un pouvoir de réquisition numérique13(*), exercé notamment en août 2020, à l'égard de Wish, qui proposait 95 % d'appareils électriques, jouets, bijoux non conformes, et 45 à 90 % dangereux.
Cette possibilité de déréférencement que confie l'article L. 521-3-1 du code de la consommation confie à la DGCCRF, à fait suite à une enquête de son service national d'enquête (SNE) ouverte en septembre 2020 et concernant la sécurité des produits vendus sur cette plateforme. Parmi les 140 produits retenus dans l'échantillonnage, pour la plupart importés, les agents de la DGCCRF ont relevé que 95 % des jouets étaient non conformes, dont 45 % dangereux, que 95 % des appareils électriques étaient non conformes, dont 90 % dangereux et que 62 % des bijoux fantaisie étaient dangereux. Par ailleurs, les procédures de retraits et de rappels de produits ne répondaient pas aux exigences applicables en la matière.
Au mois de juillet 2021, la DGCCRF a donc enjoint à la plateforme Wish de se conformer à ses obligations en cessant de tromper les consommateurs sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués, dans le délai de deux mois qui lui avait été octroyé. La plateforme ne s'étant pas conformée à ses obligations, la DGCCRF a demandé au mois de novembre 2021 le déréférencement du site et de son application. D'autres sites de commerce électronique ont fait l'objet de mesures similaires pour pratiques commerciales trompeuses, tandis que 16 000 contrôles de site internet ont été réalisés.
Il convient enfin de souligner que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la société ContextLogic Inc - société exploitant Wish - a jugé que le dispositif d'injonction prévu à l'article L. 521-3-1 du code de la consommation était conforme à la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi DDADUE du 3 décembre 2020.
Rapport n° 614 (2022-2023), déposé le 17 mai 2023 de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.
Par ailleurs, un contrôle récent des douanes par sondage de l'entier contenu de produits expédiés par avion-cargo par un opérateur chinois a révélé que 97 % des produits n'étaient pas conformes à la législation européenne, en matière de sécurité des produits notamment...
C'est ainsi que la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a saisi en février 2024 le ministère de l'Économie car les acteurs français du commerce en ligne « ont aujourd'hui le sentiment de ne pas se battre à armes égales face à ces nouveaux acteurs dont les pratiques interpellent au regard de leur conformité à nos règles, notamment en matière protection des consommateurs, de lutte anti-contrefaçon et de respect des normes environnementales ». La FEVAD a demandé « à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de contrôler l'activité de ces acteurs internationaux opérant de l'étranger, avec la même rigueur et la même diligence que celles exercées, et c'est bien légitime, dans le contrôle des entreprises opérant sur le territoire national » et que « les manquements qui pourraient être constatés lors de ces contrôles soient sanctionnés avec la même fermeté que celle appliquée aux acteurs nationaux afin d'assurer une concurrence équitable pour l'ensemble des commerçants opérant en France. Au-delà du simple respect du principe d'équité envers nos entreprises nationales, il en va de la sécurité et santé publique, de la protection des consommateurs, de celle des titulaires d'autres droits ainsi que de la sauvegarde de nos emplois dans le commerce ».
Les contrôles les plus massifs sont le fait des consommateurs eux-mêmes : la plateforme publique SignalConso, recueille ainsi chaque année 300 000 signalements de consommateurs. Accessible sur internet ainsi que sur smartphone, elle n'est cependant pas exclusivement dédiée au contrôle de l'origine des produits mais accueille également les cas de litiges de consommation.
IV. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
A. UNE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE QUI ANALYSE L'INDICATION DE L'ORIGINE COMME UNE « MESURE D'EFFET ÉQUIVALENT » À UNE « RESTRICTION QUANTITATIVE À L'IMPORTATION »
Le marquage systématique de l'origine des produits commercialisés dans l'espace national par un État est actuellement considéré comme contraire au traité de fonctionnement sur l'Union Européenne (TFUE) qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation et toutes les mesures d'effet équivalent.
Or, il existe un double paradoxe :
· Alors que les règles douanières européennes permettent de déterminer l'origine nationale de chaque produit importé, cette indication est prohibée pour les produits des États-membres de l'Union au nom de la libre concurrence, ce qui bénéficie aux produits des autres pays européens comme aux pays non européens. Cette règle européenne a donc une portée mondiale alors que la concurrence libre et non faussée est loin d'être la règle hors d'Europe, tant sont nombreux les pays qui subventionnent massivement leurs exportations ;
· L'indication de l'origine est en revanche obligatoire dans le secteur alimentaire, pour un certain nombre de denrées alimentaires d'origine agricole ou de règles sectorielles.
L'information sur la provenance d'un produit devrait être considérée par l'Union européenne non comme un obstacle mais comme une condition de la concurrence libre et non faussée. Les règles du secteur alimentaire pourraient être généralisées au secteur non-alimentaire.
B. UNE DÉSINDUSTRIALISATION MASSIVE QUI EMPÊCHE UNE OFFRE ADÉQUATE
L'offre de produits français s'est rétrécie à proportion de la désindustrialisation et des délocalisations, ou de l'internationalisation de multinationales d'origine française qui visent désormais le marché mondial. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est de 11 % au plus. La part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB place la France en 2023 en 24e position sur 27 pays de l'Union européenne avec 13,4 %, devant Malte (8,5 %) Chypre (7,4 %) et le Luxembourg (5,2 %).
Selon l'INSEE14(*), le fabriqué en France, défini comme le contenu en valeur ajoutée française de la demande intérieure finale française, a baissé de 11 points entre 1965 et 2019, passant de 89 % à 78 %. Si elle est commune aux pays européens, elle est particulièrement prononcée en France pour les produits manufacturiers, pour lesquels il est passé, pour la même période, de 82 % à 38 %.
La France a pris conscience, lors de la crise sanitaire de 2019, de ses vulnérabilités liées à un long et profond déclin industriel. Cette situation est documentée par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale15(*) de janvier 2022, un rapport de la Cour des comptes consacrée aux politiques industrielles16(*), de novembre 2024, ou de nombreuses notes de thinks tanks.
La détérioration de la situation est telle que la mention du pays de fabrication peut révéler l'ampleur des délocalisations et porter préjudice aux entreprises qui se prévalent de l'image de marque d'un savoir-faire « national » alors que leurs produits sont fabriqués à l'étranger. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais en autarcie. Vouloir la promotion du fabriqué en France ne vise pas une autonomie illusoire mais une meilleure information du consommateur ainsi que la promotion de stratégies industrielles pertinentes de relocalisation de certains produits.
La difficulté de relocaliser : l'exemple de l'industrie pharmaceutique
L'augmentation des coûts de production dus à l'innovation, conjuguée à la pression de l'État pour baisser les prix des médicaments, a fragilisé la production nationale. La France est passée du 1er au 6e rang européen pour sa production. La crise du COVID a révélé cette fragilité, avec le paracétamol qui n'est plus produit sur le territoire national depuis 2008. Pourtant, la dimension de relocalisation, condition de la restauration de la souveraineté sanitaire, n'est toujours pas prise en considération. Si la loi de financement de la sécurité sociale a ajouté en 2022 aux critères légaux de fixation du prix, un nouveau critère permettant la prise en compte de la sécurité d'approvisionnement apportée par la localisation des sites de production, ce point n'est toujours pas opérationnel. Comme l'a constaté la Cour des comptes17(*) en juin 2024, la doctrine de l'État « sur la conciliation des intérêts financiers de l'assurance maladie et de la souveraineté industrielle et d'approvisionnement de la France en produits de santé stratégiques » n'est toujours pas précisée.
C. DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION
1. Les jeunes générations sont moins attachées à l'origine des produits qu'ils achètent.
En matière de luxe, le « dupe » est même une contrefaçon recherchée. Ce nouveau mode de consommation, qui se focalise sur les produits de luxe, est très populaire chez les jeunes : plus de 4 consommateurs sur 10 issus de la Génération Z18(*) réalisent des achats sur l'une des plus grandes plateformes de e-commerce chinois au monde.
Un « dupe »19(*) n'est pas une reproduction, ni même une imitation ou une copie mais une « inspiration ». Le fabricant de dupes s'inspire des produits de marques et y appose la sienne. Il ne cherche pas à faire passer ses produits pour ceux dont il s'est inspiré mais à attirer des consommateurs en se plaçant dans le sillage du titulaire de la marque, sans toutefois produire les éléments à l'identique. Sur TikTok, le hashtag #dupe aurait généré à lui seul environ 6 milliards de vues. Il existe même un #dupechallenge destiné à ceux qui souhaitent dénicher les meilleurs dupes, lequel totalisait en 2023 près de 60 millions de vues. Une vidéo promouvant le « Wirkin », imitation plastique coûtant 73 euros, du sac en cuir Birkin vendu chez Hermès entre 5 000 et 300 000 euros, a été visionnée 9 millions de fois. Il était vendu aux États-Unis par Walmart, chaîne populaire de grande distribution.
Le « dupe » permet aux consommateurs leur maîtrise des codes de la consommation tout en les détournant et en accédant à des alternatives abordables financièrement. À la différence de la contrefaçon, le dupe s'affiche et s'étale sur les réseaux sociaux. Il est indifférent à la provenance du produit, massivement importé d'Asie quand bien même il s'inspire de créations françaises.
Générant une activité très polluante, ce phénomène pénalise en outre les marques qui voient ainsi leur image ternie et subissent un manque à gagner. L'UNIFAB20(*) a chiffré ces pertes en France à 6,7 milliards d'euros par an et plus de 38 000 emplois supprimés. Le « dupe », qui représente 2,5 % du commerce mondial, s'étend à tous les États européens, lesquels perdent 15 milliards d'euros de recettes publiques chaque année.
2. La révolution du e-commerce a élargi la brèche du francolavage
En vingt ans, le commerce en ligne est passé de 8,4 milliards en 2005 à 175 milliards d'euros en 2025, dont 67 milliards de produits vendus au cours de 2,6 milliards de transactions. Chaque cyberacheteur procède à un achat en ligne par semaine en moyenne, pour un total annuel de 4 216 euros.
La confiance des consommateurs a été altérée par de nombreuses arnaques en ligne, facilitées notamment par le modèle commercial du dropshipping qui permet aux entrepreneurs de créer des boutiques en ligne sans avoir à gérer de stocks, en acquérant des produits uniquement lorsque les commandes sont passées. Cette approche a ouvert la voie à de nombreux nouveaux acteurs du e-commerce, créant ainsi une concurrence accumulée sur le marché, mais certains vendeurs peu scrupuleux ont saisi ce marché afin de revendre beaucoup plus cher des produits de faible qualité et fraudant sur leur provenance.
62 % des Français ont déclaré en 2024 que le commerce en ligne avait facilité l'accès à des produits et services « fabriqués en France ». La France est aujourd'hui le seul pays d'Europe où les acteurs nationaux restent très largement majoritaires sur leur propre marché et celui qui compte le plus grand nombre d'entreprises nationales implantées sur les autres marchés européens.
Cependant, ce succès du commerce français est aujourd'hui fragilisé par l'arrivée de nouveaux acteurs basés en dehors de l'Union européenne, principalement en provenance d'Asie. Selon la FEVAD21(*) : « en quelques mois, ces acteurs, filiales de géants mondiaux du e-commerce, disposant de moyens financiers exceptionnels, se sont hissés parmi les sites les plus fréquentés, en France comme dans d'autres pays de l'Union européenne, au prix de pratiques commerciales particulièrement agressives. Aujourd'hui, ces acteurs exercent une concurrence directe sur l'ensemble du commerce français, sur internet comme en magasin, au moment même où nos entreprises sont confrontées à un ralentissement important de l'activité du fait de l'inflation ».
Shein est désormais leader des sites de e-commerce dans la mode féminine, tandis que Temu, arrivé en France il y a seulement deux ans, se hisse déjà à la troisième place dans la décoration, dépassant les acteurs nationaux installés de longue date.
Le tsunami des colis chinois en Europe risque de s'amplifier avec la guerre commerciale. Alors que le e-commerce a progressé en 2024 (+9,6 %), les 500 plus grandes entreprises européennes d'e-commerce ont connu une baisse de 18 % de leurs ventes transfrontalières en 2023, en grande partie en raison de la concurrence de ces plateformes chinoises. Les deux plus grandes plateformes de e-commerce chinoises figurent parmi les dix sites e-commerce les plus visités en France, avec plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois au dernier trimestre 2024.
En 2024, 4,6 milliards de colis de moins de 150 euros ont été livrés en Europe, quatre fois plus qu'en 2020. Sur les 1,5 milliard de colis livrés en France, 800 millions concernaient des articles de moins de 150 euros.
Ces colis proviennent, à 91 %, de Chine, particulièrement dans le secteur textile. La plateforme Shein est devenue le premier vendeur de France en ayant triplé sa part de marché (3 %). Son chiffre d'affaires a progressé de 900 % en trois ans. Elle met en ligne 7 000 nouvelles références en ligne chaque jour (avec des pointes à 10 000). Elle n'exploite aucun magasin en France mais les trois premières plateformes chinoises transportent 10 000 tonnes de vêtements par jour par voie aérienne. Le e-commerce chinois représente désormais 25 % du total des ventes de détail mondiales dont 10 % de part de marché en France et 20 à 25 % du chiffre d'affaires de la Poste contre 5 % en 2019.
Ces colis sont exemptés de droits de douane et bénéficient d'un tarif postal préférentiel. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, est encore considérée comme un pays en développement par l'Union postale universelle... Une commission du Congrès américain22(*) a ainsi relevé que : « les niveaux actuels des droits de douane et des tarifs douaniers profitent de manière disproportionnée aux entreprises chinoises de commerce électronique ». La suppression de cette exemption a été proposée par la Commission européenne le 8 décembre 2022 dans le cadre du paquet de propositions visant à moderniser le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et a récemment été à nouveau évoquée, mais elle n'est toujours pas effective.
Par ailleurs, Temu pratiquerait un dumping massif. Une analyse des coûts de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise par le magazine Wired, a calculé en mai 2023 que Temu perd une moyenne de 30 dollars par commande.
La guerre commerciale mondiale déclenchée par les États-Unis intervient dans un contexte d'offre croissante de ces produits de consommation, grâce à la montée en puissance des plateformes en ligne, qui séduisent de plus en plus les consommateurs européens.
Plus de quinze mois après cette alerte de la FEVAD, un plan d'action sur la régulation et la sécurité du e-commerce a été présenté par le ministère de l'Économie le 29 avril 2025 pour tripler les contrôles en 4 ans et informer davantage le consommateur sur le retrait des produits non conformes. En 2023, sur 680 contrôles de jouets, 130 ont été jugés dangereux et 225 000 produits détruits. Cependant, ce plan d'action ne s'accompagne d'aucune augmentation des moyens de l'administration, censée contrôlée des centaines de millions de produits dont des millions suggèrent une provenance frauduleuse...
D. UNE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON À MODERNISER ET À RENFORCER EN MOYENS
Selon l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, la France est le pays dont les entreprises sont les plus touchées par la contrefaçon, après les États-Unis, et devant l'Italie. Certaines plateformes numériques sont passives dans la lutte contre les contrefaçons. Suite au rapport de l'Assemblée nationale sur l'évaluation de la lutte contre la contrefaçon23(*), du 9 décembre 2020, s'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes24(*) et au rapport de suivi du 9 novembre 202325(*), un renforcement de la répression pénale a été votée par l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi26(*) n'a toutefois pas été examinée par le Sénat.
Au niveau européen, le règlement sur les services numériques du 4 octobre 2022 (« DSA ») responsabilise les grandes plateformes numériques, afin de lutter contre les contenus illicites (dont les produits contrefaits) et soumet les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche27(*) à des obligations renforcées. Le règlement sur les marchés numériques 14 septembre 2022 (« DMA »), qui concerne six plateformes28(*), confère à la Commission européenne un pouvoir de sanction renforcé lui permettant d'infliger aux entreprises auteures d'infractions des amendes et des astreintes importantes. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, désigne la DGCCRF comme l'autorité chargée de contrôler le respect de l'ensemble des obligations des fournisseurs de places de marché en ligne. Elle pourra ordonner aux opérateurs de plateforme en ligne ou aux hébergeurs de contenus, pour les infractions les plus graves passibles d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement, le déréférencement ou la limitation de l'accès aux adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, ou le blocage d'un nom de domaine.
Cependant, comme l'avait souligné le rapport de la commission spéciale du Sénat, « les nouveaux pouvoirs des administrations et des régulateurs doivent être accompagnés d'une mise à niveau de leurs moyens, sans quoi les dispositions ambitieuses du projet de loi resteront largement lettre morte », notamment l'utilisation de l'IA et de la chaîne de blocs. La lutte contre la contrefaçon suppose également un renforcement de la coopération douanière européenne.
Par ailleurs, certaines des propositions de l'Assemblée nationale de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, comme la suspension groupée de nombreux noms de domaine ou l'amende forfaitaire à l'encontre d'une personne condamnée pour contrefaçon, pourraient être reprises et, pour cette dernière, étendues aux consommateurs de produits contrefaits.
V. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE
A. UN FABRIQUÉ EN FRANCE MARGINAL DANS L'ACHAT PUBLIC
Avec un volume de près de 170 milliards d'euros, pour plus de 243 000 contrats passés, la commande publique occupe une place essentielle dans l'économie nationale (8 % du PIB). Elle bénéficie à 45 % à des PME, à 27 % à des ETI et à 16 % à des microentreprises. L'origine du bien acheté n'est pas une donnée essentielle des marchés publics recensée par l'Observatoire économique de la commande publique. Le fabriqué en France est le « trou noir » de la commande publique. Le potentiel supplémentaire des achats de produits fabriqués en France est estimé à 15 milliards d'euros, soit près d'un cinquième du déficit commercial de 2024. Si 25 % des marchés publics étant réservés aux produits français, cela représenterait 50 milliards d'euros par an d'achats français.
Selon l'Observatoire économique de la commande publique, moins de 2 % des marchés publics passés par des acheteurs français seraient attribués à des entreprises européennes ou étrangères contre une moyenne sur l'ensemble des pays de l'Union européenne de 5 %. Le Conseil d'analyse économique (CAE) estimait en 2021 que la part des importations dans la commande publique de biens et services en 2014 était de 9 % pour la zone euro et de 8 % pour la France. Cela signifie qu'une part substantielle des entreprises françaises adjudicatrices de marchés publics proposent dans leurs offres des produits importés. Un opérateur privé attributaire d'une procédure de mise en concurrence peut en principe s'approvisionner dans le pays de son choix.
Sur le site de l'UGAP, la part de produits l'origine française ne représente que 1 % des références proposées aux acheteurs publics (soit 10 000 sur 1 million). Il s'agit de deux labels privés : Made In France ou, plus rarement Origine France Garantie, avec seulement 467 références.
B. LES HANDICAPS DE L'ACHAT FRANÇAIS DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
La préférence locale n'est pas admise par l'Union européenne et les réponses aux appels d'offres doivent être traitées sans prendre en compte l'origine de l'entreprise candidate. Si fixer un critère de nationalité ou d'origine de l'entreprise est impossible, il est en revanche tout à fait possible pour un acheteur public de fixer d'autres critères permettant de favoriser les achats locaux. La prise en compte de considérations sociales et environnementales dans le cadre des marchés publics et le rejet des offres violant la législation applicable en matière sociale et environnementale ou des offres anormalement basses permet de valoriser les opérateurs vertueux.
Cependant, plusieurs facteurs affaiblissent le réflexe national dans l'achat public en France.
La commande publique est éclatée entre 60 centrales d'achats publics (dont la plus importante est l'UGAP avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros) et 135 000 pouvoirs adjudicateurs (30 000 en Allemagne, 3 500 en Italie).
La France est un des rares États en Europe qui pénalise le délit de favoritisme applicable à l'ensemble de la commande publique. Si ce délit constitue, par application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, une infraction intentionnelle, il demeure en pratique un délit quasi matériel. La jurisprudence présume en effet l'élément intentionnel, un adjudicateur ayant nécessairement connaissance de la loi. Cette forte pression pénale « conduit les acheteurs publics à une lecture excessivement prudente des règles », comme l'a souligné Arnaud Montebourg, lors de son audition par la délégation aux Entreprises le 15 mai 2025. Par ailleurs, 90 % des acheteurs publics sont des juristes. Ils ne sont pas assez sensibilisés aux aspects économiques et ne connaissent pas suffisamment les entreprises locales qui pourraient concourir.
La moitié des marchés publics en volume est passée sous le seuil de mise en concurrence de 40 000 euros HT. Dans ce cas, l'acheteur public est libre : il peut se fournir sur les plateformes du e-commerce sans se préoccuper d'acheter français. L'incitation à acheter du fabriqué en France se heurte d'une part à la liberté de l'entreprise qui remporte un appel d'offre29(*) de s'approvisionner où elle veut, et, d'autre part, à son incapacité à donner la provenance du produit.
Le point faible de la commande publique est l'inexistence des contrôles au niveau national des engagements des attributaires de marchés publics notamment en matière environnementale et sociale. En revanche, les contrôles européens peuvent être plus stricts30(*).
Malgré l'existence de l'Observatoire économique de la commande publique, « la mesure de la part importée dans notre commande publique est totalement déficiente (...) Comme si mesurer le « Made in France » devenait une faute par intention ou même une faute par possible intention face au droit européen (...) Le chantier de l'achat public de proximité « Made in France » se trouve actuellement enlisé dans l'incantation politique et n'est pas opérationnalisé. L'achat public souverain reste le passage clandestin d'une commande publique ne réussissant pas à se libérer des contraintes mais aussi des interprétations des textes qui la commandent ».
Source : Conseil national des achats : « Le « Made in France », passager clandestin de la commande publique »
Une meilleure connaissance de l'achat français permettrait de mesurer son impact en surplus de recettes fiscales nationales et locales, en quelque sorte d'évaluer son « retour sur investissement » malgré le surcoût des produits français.
C. UN ACHAT LOCAL INDIRECTEMENT FAVORISÉ PAR LES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
Le fabriqué en France est indirectement favorisé par la part croissante des considérations environnementales dans l'achat public et, moins fortement, par la volonté de réduire la dépendance de l'Europe envers l'approvisionnement extra-communautaire.
Sur le plan communautaire, outre les outils existants31(*), la prise en compte de considérations sociales et environnementales dans le cadre des marchés publics et le rejet des offres violant les législations ou des offres anormalement basses, permettent de valoriser les opérateurs vertueux. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement nationaux.
En particulier, le règlement 2024/1735/UE pour une industrie « zéro net » comporte des dispositions novatrices prend en compte, pour la première fois, la dépendance de l'UE à l'approvisionnement auprès de pays tiers pour certaines technologies (panneaux photovoltaïques, batteries, pompes à chaleur). L'acheteur ou l'autorité concédante devra faire figurer dans son contrat des clauses d'exécution imposant au titulaire de ne pas utiliser, dans le cadre du marché, plus de 50 % de produits issus d'États tiers. L'entrée en vigueur de ce texte reste subordonnée à l'intervention d'actes d'exécution de la Commission européenne, et a un impact marginal sur le sujet global du fabriqué en France.
Sur le plan national, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui prévoit qu'au plus tard le 21 août 2026, tous les acheteurs et autorités concédantes devront intégrer une clause sous forme de condition d'exécution environnementale, une autre relative au domaine social et à l'emploi32(*) et un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Le Plan national pour des achats durables (PNAD) pose l'objectif de 100 % des contrats comportant une considération environnementale et 30 % intégrant une considération sociale d'ici fin 2025. L'Observatoire économique de la commande publique (OECP) doit proposer prochainement des clauses, des critères de sélection et des recommandations pour certains secteurs d'activité, parmi lesquels en priorité le textile et les véhicules. Par définition, les produits fabriqués en France disposent d'une empreinte environnementale plus faible qu'un produit importé et pourraient être davantage favorisés à ce titre.
La réglementation des marchés publics, qui impose que les spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, permet de valoriser la qualité technique des offres et leurs performances en matière sociale et environnementale. En accordant à ces critères une pondération supérieure à celle du prix, les acheteurs peuvent lutter contre la concurrence déloyale des entreprises étrangères et défendre le savoir-faire de nos entreprises, sans pour autant tenir compte de leur implantation géographique ou de l'origine des produits, ce qui constituerait une méconnaissance des principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. Pour les aider à s'inscrire pleinement dans cette démarche, le gouvernement propose des outils pédagogiques et opérationnels, tels que le guide de l'achat responsable de la direction des achats de l'État33(*) ou le guide sur les aspects sociaux de la commande publique34(*) de l'Observatoire économique de la commande publique.
Réponse ministérielle à la question n° 10419, 19 décembre 2023
L'approche allemande constitue une autre piste. Si 50 % des appels d'offres ne se jugent que sur le prix, contre 15 % en France, l'achat de produits allemands s'effectue grâce à une sélection en amont se fondant sur les critères techniques.
VI. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : CINQ AXES D'ACTIONS POUR VALORISER UN ATOUT
A. MIEUX IDENTIFIER LE FABRIQUÉ EN FRANCE
Il s'agit en premier lieu de mieux définir le fabriqué en France tant la zone grise est importante et permet toutes les allégations connexes qui déroutent le consommateur, le font douter et le détourne d'un marquage de l'origine non fiable. Une approche économique plus robuste est nécessaire, en retenant le critère de la majorité de la valeur ajoutée créée sur le territoire national et non plus la dernière transformation substantielle en application des règles de l'origine non préférentielle du code des douanes de l'Union.
On pourrait, à cet égard, s'inspirer de l'approche de l'INSEE, précisée dans l'encadré ci-après.
Pour un vendeur, étiqueter son produit fabriqué en France est soumis à une réglementation précise. Un produit prend l'origine du pays où il a subi sa dernière transformation substantielle. Ces transformations peuvent se traduire par un changement de position tarifaire douanière du produit (au sein de la nomenclature douanière internationale) ou par un critère de pourcentage de valeur ajoutée attribuée à cette dernière transformation (45 % pour la Commission européenne).
Pour s'affranchir de cet effet de seuil à 45 % et avoir une mesure continue, et non binaire, du fabriqué en France, l'approche statistique évalue le contenu en valeur ajoutée (CVA) intérieure pour chaque produit consommé. Si une chemise est produite en France et composée à 44 % de valeur ajoutée française, elle n'est pas considérée comme fabriqué en France du point de vue juridique, donc 0 % fabriqué en France. Du point de vue statistique, 44 % de la chemise sont considérés fabriqués en France.
L'indicateur fabriqué en France, peut être calculé à partir du tableau des entrées-sorties national, mais cela ne permet pas de tenir compte du fait qu'une partie des importations peut aussi avoir un contenu d'origine française (par exemple, une voiture importée qui contient un volant construit en France sera considérée comme entièrement importée). L'utilisation des tableaux internationaux des entrées-sorties permet de quantifier cet indicateur de manière complète.
Le fabriqué en France est défini comme la part de la valeur ajoutée française incorporée à la demande intérieure finale rapportée à la demande intérieure finale.
Formellement, le made in du pays j s'écrit :
Made inj = ?k CVA(j,k),j / DF j.
La matrice CVA correspond au contenu en valeur ajoutée de la demande intérieure finale : elle mesure l'origine géographique des produits utilisés pour satisfaire la demande finale dans un pays donné.
CVA = diag(VA) × diag(P-1) × L × DF
L'indicateur de liens « amont » mesure l'intensité de la dépendance directe et indirecte d'une branche à ses intrants en amont.
BL j,l = ?k Lj,k),(j,l)
BL j,l mesure la hausse de la production (intérieure et/ou étrangère) consécutive à une augmentation d'un euro de demande finale adressée à la production de produit l du pays j. L'indicateur BL mesure donc l'intensité des liens amont direct et indirect entre la hausse de la demande finale en un produit donné, et la production supplémentaire que cela engendre nationalement et à l'étranger afin de servir cette demande supplémentaire.
Source : « Produire en France plutôt qu'à l'étranger, quelles conséquences ? », Alexandre Bourgeois (Insee), Jérémi Montornes (Banque de France), INSEE Analyses n° 89, 30 octobre 2023.
Il s'agit en second lieu d'imposer le marquage de l'origine de fabrication des produits importés dans l'Union européenne (comme nos principaux partenaires commerciaux le font, ce qui mettra les États membres de l'Union européenne sur un pied d'égalité). Comme l'a souligné le rapport Jégo, ce principe est conforme aux règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) que l'Union européenne n'applique pas, et qui pose le principe de marquage des biens importés : « chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les parties contractantes devront permettre l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine ». Il est paradoxal de constater que, sur ce point, les États-Unis respectent scrupuleusement les règles de l'OMC contrairement à l'Union européenne ! Cette évolution répond aux attentes des consommateurs européens, de plus en plus sensibles aux impératifs de transparence des méthodes de production des biens de consommation.
En revanche, il est proposé de maintenir le marquage de l'origine de production des produits fabriqués et commercialisés dans l'Union européenne facultatif, contrairement au rapport Jégo qui préconise de le rendre obligatoire. Une telle évolution doit émaner d'une demande des entreprises, ce qui n'est pas le cas. Elles redoutent en effet, à juste titre, des coûts bureaucratiques supplémentaires, surtout pour les PME, le marquage des produits étant à leur charge. Ce marquage n'est pas nécessaire pour tous les produits ; pour certains, le fabriqué en France n'apporte pas de valeur ajoutée ; pour d'autres, elles peuvent déjà effectuer une démarche de regroupement des entreprises concernées afin de faire reconnaître la qualité, la réputation ou une autre caractéristique essentiellement attribuable à une origine géographique.
Le règlement (UE) 2023-2411, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2025, a étendu la protection des indications géographiques aux produits artisanaux et industriels35(*). Il pourrait « dynamiser » les dispositions de la loi relative à la consommation n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a élargi les indications géographiques aux produits manufacturés et ressources naturelles mais qui n'ont été appliquées que pour 23 produits.
Cette démarche, ascendante et volontaire, est à privilégier, puisque chaque nouvelle indication géographique doit être portée par un collectif d'entreprises appelés Organismes de Défense et de Gestion (ODG).
Enfin, un marquage obligatoire nécessite de réunir une majorité au Conseil européen afin de modifier les règles du jeu de l'Union européenne, qui est aujourd'hui hors de portée.
En revanche, lorsque le passeport numérique des produits sera pleinement opérationnel, et après une étude d'impact approfondie, cette option pourrait être ultérieurement étudiée.
Le Digital Passeport Product ou passeport numérique des produits est prévu par le règlement (UE) 2024/1781 sur l'éco-conception de produits commercialisés sur le marché intérieur, dont l'entrée en vigueur est prévue de façon progressive à compter de 2027. Accessible de façon électronique via un QR code36(*), du NFC37(*), ou du RFID38(*), il accompagnera le produit au cours de son existence et apportant aux consommateurs des informations sur sa conception et ses performances. La liste exacte des informations à fournir, qui sera déterminée par la Commission européenne, agissant par délégation du Parlement et du Conseil, pourrait techniquement contenir l'origine du produit si la décision politique était prise en ce sens. Comme l'a constaté en effet le rapport Jégo du 28 mai 2025 : « étant donné que chaque produit dispose d'une origine, il serait techniquement possible d'imposer un marquage systématique des produits commercialisés au sein de l'Union européenne ».
Il s'agit en quatrième lieu de réserver aux produits réalisés à plus de 50 % en France l'exclusivité de l'apposition du drapeau français, et considérer que le fait d'apposer ou de faire apparaître un drapeau français sur un produit vendu en France qui n'est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse.
Il s'agit en cinquième lieu de mettre fin à la tour de Babel des labels en regroupant progressivement les labels et certifications publics et privés sous un label unique « fabriqué en France », une fois le marquage d'origine nationale autorisé, et de favoriser la création d'une plateforme en ligne unique exclusivement réservée aux produits « fabriqués en France ».
Pour consolider l'offre de produits français, il faut une politique de réindustrialisation et de relocalisation, en confiant aux comités stratégiques de filières le ciblage des produits à relocaliser39(*), en priorisant sur les produits identifiés comme en situation de vulnérabilité d'approvisionnement, avec la création de zones franches ayant une fiscalité allégée.
B. RÉTABLIR UNE CONCURRENCE LIBRE ET NON FAUSSÉE
Le pouvoir d'achat est actuellement maintenu par l'importation de produits à bas coût. Cette politique économique est mortifère pour les entreprises européennes. L'Europe doit choisir entre « être un continent de producteurs ou simplement des pays consommant des produits venant de l'étranger » comme l'a indiqué M. Amir Reza-Tofighi, président de la CPME lors de la table-ronde organisée par la délégation aux Entreprises le 29 avril sur « les entreprises françaises dans la guerre commerciale »40(*).
Il faut donc « des décisions rapides et impactantes » sans lesquelles, nous courrons à la catastrophe, de nombreux producteurs français et européens risquant de disparaître. Il serait alors vain de vouloir défendre et promouvoir le « fabriqué en France » ! Les États-Unis imposent des frais radicalement dissuasifs. La stratégie de dumping des plateformes chinoises leur a permis une conquête ultra-rapide, en 18 mois, de 11 % du marché en ligne et d'aspirer les données numériques des consommateurs, sans doute leur principal objectif. De nombreuses entreprises françaises et européennes sont menacées de faillite à très court terme. Imposer un minimum de droits de douane pour chaque colis extra-communautaire constitue une mesure d'urgence vitale économique. Le Sénat a adopté, le 2 juin 2025, un amendement à la proposition de loi sur l'impact environnemental de l'industrie textile qui soumet les colis de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos à une taxe comprise entre 2 et 4 euros. L'Union européenne doit reprendre rapidement cette disposition. À moyen terme, il sera nécessaire d'étendre la taxe carbone (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières) aux produits de consommation courante.
Le renforcement du contrôle des plateformes étrangères proposant des produits à bas coût est urgent. C'est la raison pour laquelle votre délégation aux Entreprises propose, d'une part, de saisir l'Autorité de la concurrence du sujet des reventes à perte de la part des plateformes de commerce en ligne, notamment chinoises. Par ailleurs, elle souhaite qu'il soit demandé à l'Union européenne de lancer une procédure antidumping41(*) contre les plateformes de commerce en ligne chinoises et d'enquêter42(*) sur des subventions octroyées par des pays non membres de l'UE à des entreprises actives sur son territoire et de lutter contre leurs effets négatifs, afin de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union européenne.
À terme, la politique concurrentielle européenne doit être refondée afin d'intégrer la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne de réduction de la dépendance dans des domaines stratégiques43(*), et de permettre de développer la notion d'empreinte territoriale, c'est-à-dire l'impact d'un achat local en termes d'emplois ou de recettes fiscales supplémentaires.
Le principe des clauses miroirs, désormais acquis en matière agricole, devrait être étendu en matière industrielle, afin de garantir le respect, par les produits importés, des mêmes règles que les produits fabriqués en Europe. Certes, ce principe existe juridiquement. Les produits importés doivent prendre en compte les normes et standards en vigueur dans le pays d'origine, mais aussi les exigences légales françaises et européennes. Applicable également aux places de marché, la directive 2019/771 relative à certains aspects des contrats de vente de biens, impose une garantie légale minimale de 2 ans pour tous les biens de consommation, y compris ceux importés de pays tiers. Cependant, son applicabilité concrète demeure virtuelle, tant les obstacles (identification du responsable, délais de recours) sont nombreux. L'existence du dropshipping (vente d'un produit d'un fournisseur tiers) affaiblit la portée de la protection du consommateur, même si, en théorie, le vendeur est responsable de tout défaut de qualité et de livraison, même si c'est le fournisseur qui se charge de l'expédition du produit. La création d'une véritable garantie légale européenne unifiée, qui s'appliquerait de manière identique dans tous les pays de l'Union européenne, et l'amélioration de l'information sur les places de marché avec l'indication obligatoire de la garantie légale de conformité, contribueraient à améliorer considérablement la protection des consommateurs dans le cadre des achats transfrontaliers, y compris pour les produits importés de pays tiers.
C. RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LE « FABRIQUÉ EN FRANCE »
La priorité doit se porter sur la lutte contre le « le flux ininterrompu de contrefaçons proposées sur les réseaux sociaux et les places de marché », relevé par les représentants des marques44(*). Cette action défensive est indispensable à la protection du fabriqué en France.
La France semble particulièrement exposée. Si les saisies ont augmenté de 31 % en Europe, concernant 86 millions d'articles en 2021, elles ont quadruplé en France entre 2020 et 2024, avec 22 millions d'articles contrefaits saisis l'an dernier. Les contrefaçons chinoises représentent 85 % des saisies mondiales en ligne et 51 % des saisies de ventes mondiales hors ligne.
Les contrôles de la DGCCRF semblent aller au plus simple : vers les entreprises françaises, et pour des infractions mineures. En revanche, elles sont particulièrement lentes ou peu efficaces à l'égard du commerce en ligne. La plateforme américaine Wish (déréférencée fin 2021 par les principaux moteurs de recherche, à la demande de la DGCCRF car ses jouets et produits électriques étaient non conformes à 95 %) a retrouvé sa place sur la Toile tricolore en mars 2023. La contrefaçon a réapparu aussitôt.
Les enquêtes sur Temu et Shein sont enlisées depuis trois ans car à chaque remarque, les plateformes corrigent leur offre ce qui étend la période du contradictoire. La lutte contre le « francolavage » se heurte à un obstacle procédural insurmontable. Alors qu'une seule procédure pourrait être engagée contre le contenu d'un seul containeur, chaque colis doit faire l'objet d'une procédure judiciaire distincte, ce qui paralyse toute répression efficace.
Il faut donc réorienter les contrôles de la DGCCRF et des Douanes vers le commerce en ligne extra-communautaire, en priorisant le contrôle de la sécurité des consommateurs et en autorisant des listes noires d'importateurs qui fraudent massivement soit en termes de contrefaçon soit en termes de « francolavage », et faire de la lutte contre la contrefaçon une priorité de l'Office européen de lutte anti-fraude afin d'approfondir la coopération douanière européenne.
La coopération avec les places de marché pour favoriser la protection du « fabriqué en France » sera nécessaire pour déréférencer les entreprises qui fraudent sur l'origine des produits, notamment à l'occasion du « Black Friday ».
Il faut également massifier la répression de la contrefaçon et :
· Adapter les contrôles à l'industrialisation de la fraude en matière de commerce en ligne et à l'individualisation des rapports commerciaux par la livraison de milliards de colis avec une utilisation de l'IA ;
· Rendre possible le blocage des sites connexes (ou sites miroirs, qui tentent de contourner une décision judiciaire via un nouveau site).
Cette possibilité existe depuis la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, en matière de streaming et de piratage audiovisuel. Elle permet la suspension groupée de noms de domaine et de dispenser le plaignant de démontrer le lien de connexité entre différents sites dont il demande le blocage lorsqu'ils reprennent le contenu de sites visés par une décision de justice, sans qu'il soit besoin de solliciter de nouveau la justice. Il est proposé de s'inspirer de cette loi, qui a renforcé la protection du droit d'auteur en matière de piratage audiovisuel, et de transposer ses principes à la protection de la propriété industrielle, donc du « fabriqué en France ».
· Réformer les procédures de contrôle des douanes en étendant ses compétences en matière de police judiciaire, afin de lutter plus efficacement contre la fraude,
Cette réforme pourrait s'inspirer de la compétence horizontale de la « Garde des finances » italienne, corps militaire comprenant 68 000 agents disposent de vastes prérogatives judiciaires d'enquête en matière de police économique générale.
· Assimiler systémiquement la contrefaçon à une non-conformité du produit, dans le cadre de l'application des règlements DSA et DMA,
· Créer une amende délictuelle forfaitaire en cas de fraude sur une allégation de produit fabriqué en France pour le vendeur comme pour l'acheteur (sur le modèle de l'infraction créée en 2019 pour l'achat de cigarettes vendues à la sauvette),
· Augmenter les moyens matériels et humains de la DGCCRF et des Douanes.
Le contrat d'objectifs et de moyens de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pour la période 2022-2025 comprend ainsi des mesures liées à la maîtrise de la frontière numérique (axe n° 2). Tenir cette frontière, « c'est faire en sorte que les produits achetés en ligne et acheminés depuis l'étranger [...] n'échappent pas à l'impôt et au respect des normes [...]. C'est aussi empêcher que ces colis servent à introduire des marchandises illicites comme les stupéfiants ou les contrefaçons ».
Ses moyens juridiques ont été renforcés par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner aux services des douanes les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Les saisies pour contrefaçon ont doublé depuis cette loi récente.
Ses moyens financiers ont également été accrus, essentiellement afin de renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants45(*).
Les moyens humains de la douane ont diminué d'un quart depuis les années 1990, de 22 000 au début des années 1980 à moins de 17 000 en 2023, alors que ses missions se sont intensifiées et diversifiées.
· Faire de la contrefaçon une priorité de l'Office européen de lutte anti-fraude, rendre compétent le Parquet européen46(*), renforcer la coopération douanière notamment avec la Belgique et les Pays-Bas
L'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) constitue la base légale de la lutte contre la fraude de l'Union européenne, en précisant qu'elle relève de la responsabilité conjointe des États membres et de l'Union européenne. Les États membres doivent ainsi prendre « les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers ».
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a été créé en 1999 sur décision de la Commission. Sa mission est de détecter les cas de fraude relatifs à toutes les dépenses du budget de l'Union européenne, et certains domaines de recettes de l'Union européenne, principalement le recouvrement des droits de douane. Cette décision fait référence, de manière assez générale, aux « enquêtes administratives internes destinées à lutter contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ».
Il conviendrait donc de faire de la lutte contre la contrefaçon une priorité de la politique européenne de lutte contre la fraude afin de mobiliser la direction générale « Fiscalité et Union douanière » (DG TAXUD), placée sous la responsabilité du commissaire européen au commerce et à la sécurité économique, Maro efèoviè et du Comité du Code des douanes.
D. MOBILISER LA COMMANDE PUBLIQUE AU SERVICE DU FABRIQUÉ EN FRANCE
Les outils statistiques manquent pour mesurer la part importée de la commande publique.
Le lieu de fabrication des produits ne figure pas parmi les données à collecter auprès des acheteurs au titre des données essentielles (arrêtés modifiés du 22 décembre 2022). Sur leur fondement, environ 45 données peuvent être collectées pour un marché public et parmi celles-ci l'origine France ou Union européenne est prévue pour les catégories prioritaires de produits suivants : denrées alimentaires, véhicules, produits de santé et habillement. L'origine du produit est intrinsèquement liée au lieu de fabrication au titre du code des douanes, il est donc indirectement pris en considération dans les données essentielles.
La mesure de la part importée de la commande publique est un préalable indispensable du pilotage d'une politique d'achat valorisant l'offre nationale.
Il existe par ailleurs un trop grand nombre de pouvoirs adjudicateurs (actuellement 135 000), qu'il faut rationnaliser en les mutualisant autour d'agences de la commande publique opérant au profit de plusieurs pouvoirs adjudicateurs d'un même territoire.
L'achat public doit être exemplaire. Une commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française47(*) proposera des recommandations.
Une volonté d'achat français et local doit exister. L'État doit pouvoir :
· Imposer les appels d'offre hors taxes pour les marchés dans lesquels peuvent se présenter des entreprises extra-communautaires,
Les difficultés liées à la détermination du taux de TVA applicable à une opération ne sont pas nouvelles mais bien récurrentes. La directive européenne (UE) n° 2022/542 du 5 avril 2022 ayant vocation à simplifier et uniformiser les taux réduits de TVA applicables au sein des États-membres en a certes conduit la Direction des Affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances (DAJ) à inviter ses utilisateurs à renseigner des montants « TTC », dans son guide publié en mars 2024 sur les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics. Cependant, une erreur sur le taux de TVA peut pénaliser l'entreprise remportant le marché48(*).
Par ailleurs, la prise en compte de la TVA peut pénaliser les entreprises françaises au détriment de concurrents européens.
· Assurer un contrôle des engagements sociaux et environnementaux pris par les entreprises ayant remporté un marché public
Que ce soit pour les considérations sociales ou environnementales, les acheteurs peuvent prévoir dans les documents contractuels des obligations à la charge des opérateurs économiques en leur rappelant le cadre législatif et réglementaire, en exigeant la mise en place de mesures spécifiques respectueuses de l'environnement ou de l'insertion sociale, en prévoyant la communication de données d'exécution sur ces aspects, voire en prévoyant des pénalités et le cas échéant une résiliation du marché pour faute.
Afin d'aider les acheteurs dans cette démarche, la DAJ, après concertation des différents partenaires de l'Observatoire économique de la commande publique, a publié début 2025 des recommandations générales49(*) afin que les acheteurs intègrent de telles clauses dans leur marché.
Assurer ce suivi doit permettre de renforcer l'impact des clauses environnementales et sociales qui contribuent indirectement à favoriser le « fabriqué en France ».
· Faire du critère bas-carbone un levier en faveur des circuits d'approvisionnements territoriaux courts, lequel constitue le levier le plus efficace pour favoriser le « fabriqué en France ».
· Transférer la tutelle de l'UGAP au ministère de l'Industrie, afin de garantir une politique volontariste en faveur de la commande locale en matière d'achats publics.
E. INFORMER ET DAVANTAGE RESPONSABILISER LE CONSOMMATEUR
La communication sur le fabriqué en France demeure essentielle. Comme dans d'autres pays européens, comme en Italie, des campagnes régulières de sensibilisation en direction des consommateurs doivent être organisées. L'accent doit être mis sur les conséquences sur leur santé et sécurité, sur l'impact social et environnemental (conditions sociales de production inacceptables, bilan carbone désastreux) des produits importés, et devrait permettre de valoriser les effets sociaux et environnementaux du fabriqué en France. Le slogan « nos emplettes sont nos emplois » a été particulièrement marquant.
La promotion des cartes cadeaux distribuées par les comités sociaux d'entreprises valables sur des plateformes en ligne proposant uniquement des produits français, comme La carte française, qui regroupe 700 enseignes et propose 500 000 produits, pourrait être encouragée.
Enfin, stigmatiser et dénoncer50(*) (« name and shame ») les entreprises qui pratiquent le « francolavage » est une action de communication qui a fait ses preuves pour d'autres objectifs (les délais de paiement), les entreprises étant extrêmement sensibles à leur réputation.
LES PROPOSITIONS POUR VALORISER
L'ATOUT DU
FABRIQUÉ EN FRANCE
Axe 1 - Mieux identifier le fabriqué en France
1 Définir le fabriqué en France comme un produit dont la majorité de la valeur ajoutée a été créée sur le territoire national et non plus comme la dernière transformation substantielle
2 Maintenir le caractère facultatif du marquage de l'origine de fabrication des produits non alimentaires
3 Regrouper progressivement les labels publics et privés sous un label unique « fabriqué en France »
4 Réserver aux produits dont la majorité de la valeur est ajoutée en France, l'exclusivité de l'apposition du drapeau français, et considérer que le fait d'apposer ou de faire apparaitre un drapeau français sur un produit vendu en France qui n'est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse
5 Créer une plateforme en ligne unique exclusivement réservée aux produits « fabriqués en France »
6 Rendre obligatoire au niveau européen le marquage de l'origine de production des produits importés et commercialisés dans l'Union européenne
7 Confier aux comités stratégiques de filières l'élaboration d'une stratégie industrielle de relocalisation, en priorisant sur les produits identifiés comme en situation de vulnérabilité d'approvisionnement, avec la création de zones franches ayant une fiscalité allégée
Axe 2 - Rétablir une concurrence libre et non faussée
8 Étendre aux produits industriels le principe des clauses miroirs afin d'appliquer aux produits importés les mêmes règles environnementales et sociales
9 Saisir l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 461-2 du code de commerce, du sujet des reventes à perte de la part des plateformes de commerce en ligne, notamment chinoises
10 Demander à l'Union européenne de lancer une procédure antidumping contre les plateformes de commerce en ligne chinoises et d'enquêter sur des subventions octroyées par des pays non membres de l'UE à des entreprises actives sur son territoire, afin de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union européenne
11 Refonder la politique concurrentielle européenne afin d'intégrer la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne de réduction de la dépendance dans des domaines stratégiques
12 Mettre en oeuvre rapidement l'amendement du Sénat qui soumet à un minimum de droits de douanes tout colis extra-communautaire de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos
13 Étendre la taxe carbone (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières) aux produits de consommation courante
Axe 3 - Renforcer les contrôles sur le fabriqué en France
14 Réorienter les contrôles de la DGCCRF et des Douanes vers le commerce en ligne extra-communautaire, en priorisant le contrôle de la sécurité des consommateurs
15 Sensibiliser les places de marché (marketplaces) à la mise en avant du « fabriqué en France », notamment à l'occasion du « Black Friday », et au déréférencement des entreprises qui fraudent sur l'origine des produits (« francolavage »)
16 Assimiler la contrefaçon à une non-conformité du produit, dans le cadre de l'application du règlement relatif à un marché unique des services numériques (DSA) et du règlement sur les marchés numériques (DMA)
17 Créer une amende délictuelle forfaitaire en cas de fraude sur une allégation de produit fabriqué en France, pour les vendeurs comme pour les acheteurs
18 Autoriser le blocage des sites « miroirs » afin de lutter contre la multiplication des pages du web proposant des contrefaçons
19 Augmenter les moyens de la DGCCRF et des Douanes en étendant leur compétence en matière de police judiciaire afin de mieux lutter contre le « francolavage »
20 Faire de la contrefaçon une priorité de l'Office européen de lutte anti-fraude, rendre compétent le Parquet européen, renforcer la coopération douanière notamment avec la Belgique et les Pays-Bas
Axe 4 - Mobiliser la commande publique au service du fabriqué en France
21 Diviser par dix le nombre de pouvoirs adjudicateurs (actuellement 135 000), en les mutualisant
22 Mesurer la part importée de la commande publique
23 Interdire les appels d'offre hors taxe pour les marchés dans lesquels peuvent se présenter des entreprises extra-communautaires
24 Assurer un contrôle des engagements sociaux et environnementaux pris par les entreprises ayant remporté un marché public
25 Faire du critère bas-carbone un levier en faveur des circuits d'approvisionnements territoriaux courts
26 Transférer la tutelle de l'UGAP au ministère de l'Industrie
Axe 5 - Informer et davantage responsabiliser le consommateur
27 Informer, par des campagnes régulières de sensibilisation, le consommateur des conséquences sur leur santé et sécurité, sur l'impact social et environnemental (conditions sociales de production inacceptables, bilan carbone désastreux) des produits importés
28 Stigmatiser et dénoncer les entreprises qui pratiquent le « francolavage »
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Réunie le 18 juin 2025, la délégation sénatoriale aux Entreprises a examiné le rapport de Anne-Marie Nédélec et Franck Menonville sur « Le fabriqué en France ».
M. Olivier Rietmann, président. - Mes Chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le rapport d'Anne-Marie Nédélec et Franck Menonville qui ont mené une mission d'information sur le « Fabriqué en France ». Je donne tout de suite la parole à nos rapporteurs et les remercie pour le travail de fond qu'ils ont mené. Je mettrai ensuite le rapport au vote, après les questions diverses. Je vous rappelle que si ce rapport n'était pas voté, il ne pourrait pas être publié.
Mme Anne-Marie Nédélec, co-rapporteure. - Je voudrais tout d'abord remercier le Président de m'avoir associée à cette mission très intéressante. Mes chers collègues, en cette date hautement symbolique du 18 juin, nous évoquons l'achat patriotique de produits français, donc un nouvel appel à la résistance, en quelque sorte.
Tout le monde, apparemment, exprime une volonté d'acheter français, mais pourtant, le pays de fabrication n'occupe que le quatrième rang dans les critères guidant l'acte d'achat (avec 23 %), loin derrière le prix (80 %), puis la qualité et la durée de vie. Pourtant, acheter local, bien au-delà du prix, c'est soutenir nos entreprises, préserver nos emplois, réduire considérablement notre empreinte carbone, préserver notre indépendance économique et affirmer notre souveraineté.
Certes, la réalité tempère un petit peu ce constat, puisque l'inflation, la crise du pouvoir d'achat, ont ralenti l'acte d'achat français, alors même que la valorisation du fabriqué France, elle, progresse. Les salons professionnels, comme le Made in France ou la grande exposition du fabriqué en France à l'Élysée, témoignent de cette attractivité. La première édition de cette exposition avait d'ailleurs accueilli les robots Nao et Pepper, mais hélas, l'entreprise Aldebaran, qui les fabriquait, symbole de l'innovation française dans la robotique humanoïde, vient d'être placée en liquidation judiciaire. Donc, vous le constatez, loin de devenir une start-up nation, la désindustrialisation a repris. Les pouvoirs publics sont dans le déni, sans aucune action pour tenter de redresser la situation.
Pourtant, selon une étude du Conseil d'orientation pour l'emploi en date de 2018, si seulement 10 % des biens consommés par les ménages français actuellement importés étaient produits sur le territoire, la production française serait augmentée de 11,2 milliards d'euros, permettant de créer 150 000 emplois. À cela, il faudrait bien sûr ajouter les retombées en cotisations sociales, les retombées sur la balance commerciale, les impôts, la baisse des allocations chômage, etc.
Notre premier sujet est celui de la définition du fabriqué France. Nous ne disposons pas des matières premières qui nous assurent l'autosuffisance. Par voie de conséquence, un produit manufacturé intégralement français est extrêmement rare. Or, un produit importé peut être qualifié de « fabriqué en France » dès lors qu'il subit sa dernière transformation substantielle sur notre sol. Évidemment, tout est dans le « substantiel ». Donc, qualifier un produit français ne signifie pas que le produit est 100 % français et qu'il a été fabriqué en France uniquement avec des composants français. Il peut ainsi y avoir confusion pour le consommateur qui, en lisant « fabriqué en France », peut croire que le produit est 100 % français.
À cette complexité, il faut ajouter les près de 900 pages de règles d'origine dans le Journal Officiel de l'Union européenne. Six fonctionnaires seulement du service de l'origine et du Made in France, le SOMIF, sont habilités à fournir des attestations aux entreprises. Cependant, il n'y en a que 850 par an. Ces attestations peuvent, malgré cette présomption, être remises en question par les contrôles de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Vous comprendrez bien que ça ne motive pas les entreprises à demander cette certification. Les consommateurs sont donc dubitatifs. 35 % déclarent ne pas être convaincus que les produits sont vraiment fabriqués en France, bien qu'ils soient étiquetés comme tels. Ils jugent qu'ils ne sont pas vraiment identifiables dans les points de vente.
S'ajoute à ce scepticisme une prolifération de 92 labels et certifications, privés ou publics, nationaux ou locaux, et la multiplication de pratiques trompeuses qu'on appelle « francolavage », qui désigne tout procédé visant à faire croire aux consommateurs qu'un produit est fabriqué en France, alors qu'il ne l'est pas. Cela peut être l'utilisation des trois couleurs, l'utilisation du drapeau, le petit dessin de l'hexagone etc... Vous voyez par exemple cette écharpe du Paris Saint-Germain (PSG), qui est fabriquée en Italie, ou ces capsules lave-vaisselle dont le lieu de fabrication n'est pas précisé alors que l'emballage comporte les trois couleurs nationales. /(La rapporteure montre les produits apportés)
Dans le domaine alimentaire, l'indication de l'origine est obligatoire, mais en matière non alimentaire, le marquage de l'origine est facultatif. Il est laissé à l'initiative du professionnel, qui doit toutefois être en mesure de justifier son allégation. La commercialisation de marchandises comportant un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'elles ont été fabriquées en France ou qu'elles sont d'origine française, alors qu'elles ne le sont pas, est prohibée.
Lorsque le drapeau bleu-blanc-rouge est apposé, il s'agit de « francolavage », mais comme le pays d'origine est indiqué en petits caractères, on ne considère pas que ce produit tombe sous le coup de la loi. Par contre, l'apposition du drapeau bleu-blanc-rouge sans indication du pays d'origine, peut être effectivement répréhensible.
Du fait de l'imprécision de la notion, les allégations sont multiples : « conçu en France », « créations françaises », « collections françaises », « savoir-faire français », « conditionné en France », « imprimé en France », etc. L'imagination n'a pas de limites. Il faut savoir également - c'est aussi un point faible - que l'utilisation du drapeau français n'est pas protégée en tant que telle. Un importateur indélicat peut donc tout à fait s'approprier le drapeau national pour un produit qui n'est pas fabriqué en France.
J'en arrive au deuxième sujet, celui des contrôles. En France, la douane contrôle les importations et la DGCCRF la commercialisation sur le territoire français.
En matière alimentaire, 8 398 établissements ont été concernés et ont fait l'objet de 9 620 visites en 2024, avec un taux d'anomalie de 34 %, qui ne concernait pas seulement une tromperie sur l'origine. Mais en matière non alimentaire, 1 200 établissements ont été contrôlés pour un taux d'anomalie de 15 %. En 2024, plus de 22 millions de contrefaçons importées ont été saisies. C'est quatre fois plus en cinq ans, mais c'est nettement moins que chez nos voisins italiens. La contrefaçon est aujourd'hui une activité criminelle organisée et industrialisée qui submerge nos douanes et nos systèmes pénaux. C'est d'ailleurs l'objectif de cette massification. Ces contrôles sont particulièrement difficiles pour les plateformes de commerce. Le commerce en ligne explose. En 20 ans, il est passé de 8,4 milliards en 2005 à 175 milliards d'euros en 2025, dont 67 milliards de produits. Comment contrôler 2,6 milliards de transactions annuelles ?
Certes, le commerce en ligne facilite l'accès à des produits et services fabriqués en France, puisque la France est aujourd'hui le seul pays d'Europe où les acteurs nationaux restent très largement majoritaires sur leur propre marché et celui qui compte le plus grand nombre d'entreprises nationales implantées sur les autres marchés européens. Mais le problème, c'est le « tsunami » des colis chinois en Europe qui risque de s'amplifier avec la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis. En 2024, 4,6 milliards de colis de moins de 150 euros ont été livrés en Europe, c'est quatre fois plus en quatre ans. Sur les 1,5 milliard de colis livrés en France, plus de la moitié, 800 millions, concernaient des articles de moins de 150 euros qui proviennent à 91 % de Chine, particulièrement dans le secteur textile. Par ailleurs, les contrefaçons chinoises représentent 85 % des saisies mondiales en ligne et 51 % des saisies de vente mondiale hors ligne.
Or, ces colis de moins de 150 euros sont exemptés de droits de douane et bénéficient d'un tarif postal préférentiel car la Chine est encore considérée par l'Union postale universelle comme un pays en développement, alors qu'elle est devenue la deuxième puissance économique du monde. Donc, nous marchons un peu sur la tête, d'autant plus que la France est devenue elle-même, malheureusement sur certains segments, un pays en voie de développement, comme Arnaud Montebourg nous l'a rappelé dans son audition. Nous vendons des produits bruts, par exemple du bois, et nous achetons et importons des produits finis, par exemple des meubles à plus haute valeur ajoutée.
Par ailleurs, et cela a été une révélation lors de nos investigations, Temu pratiquerait un dumping massif en perdant en moyenne 30 dollars par commande alors que le panier d'achat moyen est de 6 euros. Cela signifie qu'en fait, le coût réel est de 36 euros. Dès janvier 2024, la Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD) a alerté les pouvoirs publics au sujet de ce dumping.
Un plan d'action pour la régulation et la sécurité du e-commerce a été présenté par le ministère de l'Économie le 29 avril 2025. Il a donc fallu 15 mois pour réagir, et encore très faiblement, puisque ce plan ne s'accompagne d'aucune augmentation des moyens de l'administration, censée contrôler des centaines de millions de produits, dont des millions ont une provenance frauduleuse. Vous voyez que l'État et l'Union européenne ont très probablement un temps de réaction mortifère et ne sont pas capables de produire une réponse efficace.
M. Franck Menonville, co-rapporteur - La commande publique doit absolument devenir patriote dans notre pays. Avec un volume de plus de 170 milliards d'euros et plus de 243 000 contrats passés, la commande publique occupe une place essentielle dans l'économie nationale, soit 8 % du produit intérieur brut (PIB). C'est un levier essentiel de notre politique économique. Si la France appliquait tout simplement le taux de produits nationaux de notre voisin allemand, les entreprises françaises pourraient bénéficier de 15 milliards d'euros supplémentaires.
Si seulement 25 % des marchés publics étaient réservés aux produits français, cela représenterait 50 milliards d'euros par an d'achats supplémentaires des Français. Or, le fabriqué en France aujourd'hui est le « trou noir » de la commande publique. L'achat de produits fabriqués en France n'est pas mesuré par l'observatoire économique de la commande publique. Une meilleure connaissance de l'achat français permettrait de mesurer son impact sur le surplus de recettes fiscales nationales et locales.
En effet, aujourd'hui, nous raisonnons uniquement en matière de coût d'achat, alors que bien évidemment, en face de ce coût, il y a aussi un bénéfice économique et social au profit de notre pays et de nos territoires. On sait toutefois qu'une part substantielle des entreprises françaises adjudicatrices de marchés publics proposent des produits importés dans leur offre. Un opérateur privé, attributaire d'une procédure de mise en concurrence peut en effet s'approvisionner dans le pays de son choix. Sur le site de l'Union de groupements publics, (UGAP), la part de produits « Origine France » ne représente que 1 % des références proposées aux acheteurs publics, soit 10 000 références sur 1 million. Il s'agit principalement du label Made in France et plus rarement de la certification Origine France garantie, avec seulement 467 références.
L'achat français dans la commande publique souffre de nombreux handicaps. La préférence locale n'est pas admise par l'Union européenne, mais elle n'est pas plus dans les autres pays. Donc, les réponses aux appels d'offres doivent être traitées sans prendre en compte l'origine des entreprises candidates. Si réserver l'achat public aux entreprises françaises est impossible, il est en revanche tout à fait possible d'énoncer, de bâtir et d'utiliser un certain nombre de critères permettant de favoriser les achats locaux, comme la proximité géographique des candidats afin de faciliter les contrôles de l'acheteur public. Il faut bien évidemment avoir de l'imagination et de l'inventivité, et surtout une stratégie et une volonté.
Cependant, plusieurs facteurs affaiblissent le réflexe national dans l'achat public en France. La commande publique est éclatée, beaucoup trop éclatée, entre 60 centrales d'achat public (dont la plus importante a été précédemment citée, l'UGAP) avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros, et surtout 135 000 acheteurs, les pouvoirs adjudicateurs, contre 30 000 en Allemagne et 3 500 en Italie.
Par ailleurs, la France est l'un des rares pays d'Europe qui pénalise le délit de favoritisme, applicable à l'ensemble de la commande publique, ce qui opère une pression pénale très importante sur les acheteurs, et les rend excessivement prudents. Elle les conduit à une lecture restrictive des règles, comme l'a très bien souligné Arnaud Montebourg lors de son audition du 15 mai 2025.
En outre, 90 % des acheteurs publics sont des juristes. Ils ne sont pas assez sensibilisés aux aspects économiques et ne connaissent pas suffisamment les entreprises locales qui pourraient concourir et fournir cette commande publique. Par ailleurs, la moitié des marchés publics en volume est passée sous le seuil de la mise en concurrence de 40 000 euros. Dans ce cas, l'acheteur public est libre. Il peut se fournir sur les plateformes du e-commerce chinois sans se préoccuper de l'achat français.
Le point faible de la commande publique est l'inexistence des contrôles des engagements des attributaires du marché public, notamment en matière environnementale et sociale au niveau national. En revanche, les contrôles européens peuvent être de plus en plus stricts. Les rares leviers actuels sont environnementaux. La loi du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ces effets prévoit qu'au plus tard, le 21 août 2026, tous les acheteurs et autorités concédantes devront intégrer une clause sous forme de conditions d'exécution environnementale et d'autres dans le domaine social ou ayant des références à l'emploi et un critère prenant compte des caractéristiques environnementales de l'offre.
Le plan national pour l'achat durable, le PNAD 2022-2025, pose l'objectif de 100 % des contrats comportant une considération environnementale. Par définition, les produits fabriqués en France disposent d'une empreinte environnementale plus faible qu'un produit importé et pourraient donc davantage être favorisés à ce titre.
Une réponse ministérielle du 19 décembre 2023 indique, je cite : « En accordant à ces critères une pondération supérieure à celle du prix, les acheteurs peuvent lutter contre la concurrence déloyale des entreprises étrangères et défendre le savoir-faire de nos entreprises sans pour autant tenir compte de leur implantation géographique ». À ce titre, pour aider à s'inscrire pleinement dans cette démarche, le gouvernement propose des outils pédagogiques et opérationnels.
Je voudrais revenir sur l'approche allemande qui constitue une autre piste et qui devrait être étudiée. Si 50 % des appels d'offres ne s'y jugent que sur le prix, contre 15 % en France, l'achat de produits allemands s'effectue grâce à une sélection en amont en se fondant sur des critères techniques. La stratégie allemande consiste à être assez fin dans l'approche du cahier des charges technique pour favoriser ce qui répond à ces critères techniques en phase avec la fabrication allemande.
Mme Anne-Marie Nédélec, co-rapporteure. - Nous vous avons formulé un certain nombre de constats. Maintenant, nous allons vous indiquer quelles sont nos recommandations.
Le premier axe, c'est d'abord de mieux identifier et définir le fabriqué en France, tant la zone grise est importante. Toutes les allégations connexes, vous l'avez compris, déroutent complètement le consommateur, le font douter et le détournent d'un marquage d'origine. Une approche économique plus solide est nécessaire en retenant, comme l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) l'a fait, le critère de la majorité de la valeur ajoutée créée sur le territoire national et non plus la dernière transformation substantielle en application des règles des douanes de l'Union.
En second lieu, il s'agit d'imposer le marquage de l'origine de fabrication des produits importés dans l'Union européenne, comme nos principaux partenaires commerciaux le font, ce qui mettra les États membres de l'Union sur un pied d'égalité. Comme l'a souligné aussi le rapport Jégo, ce principe est conforme aux règles du GATT (l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), que l'Union européenne n'applique pas et qui pose le principe de marquage des biens importés. Il est paradoxal de constater que les États-Unis respectent, ici, scrupuleusement les règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce), contrairement à l'Union européenne. L'outil technologique de cette révolution économique existera bientôt, théoriquement, avec le passeport numérique des produits. En revanche, nous proposons de maintenir le caractère facultatif du marquage de l'origine de production des produits fabriqués et commercialisés dans l'Union européenne, à l'inverse des préconisations du rapport Jégo.
Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce marquage obligatoire ferait supporter sur les entreprises une charge supplémentaire, et que nous considérons que la priorité, c'est aujourd'hui de lutter contre la contrefaçon et le dumping des importations de produits à bas coût. Si nos entreprises disparaissent, du fait de cette concurrence déloyale, le problème du fabriqué en France ne sera même plus d'actualité. Cependant, cette perspective pourrait être reconsidérée avec la mise en place du passeport numérique des produits, qui devrait entrer en vigueur progressivement à partir de 2027 et permettrait de tracer un produit de A à Z jusqu'à son recyclage ou son réemploi. Techniquement, nous pourrions aussi y imposer la traçabilité, donc son origine.
Il faudra en tout état de cause une étude d'impact à l'échelle européenne, démontrant son coût quasi-nul pour les entreprises. Il faudra aussi dégager une majorité au Conseil européen. Les deux précédentes tentatives en 2003 et 2014 ont échoué, mais il faut savoir que l'Allemagne, par exemple, ne tient pas à afficher que les voitures allemandes sont fabriquées en Europe centrale ou même au-delà, même si je pense maintenant que c'est un « secret de Polichinelle ».
En quatrième lieu, nous proposons de réserver aux produits réalisés à plus de 50 % en France l'exclusivité de l'apposition du drapeau français, mais actuellement, je vous l'ai dit, l'utilisation du drapeau n'est pas protégée en tant que telle, donc il faudra forcément y remédier. Nous souhaitons également mettre fin à ce qu'on a appelé la « tour de Babel des labels », en regroupant progressivement les labels publics et privés et les certifications sous un label unique du Fabriqué France. Nous recommandons aussi aux pouvoirs publics d'encourager les acteurs économiques à créer une plateforme en ligne unique, exclusivement réservée aux produits fabriqués en France.
Enfin, pour consolider l'offre de produits français, il faut absolument une vraie politique de réindustrialisation et de relocalisation, en confiant au comité stratégique de filière le ciblage des produits à relocaliser, en priorisant sur les produits identifiés comme en situation de vulnérabilité, avec la création de zones franches ayant une fiscalité allégée au sein des zones de développement prioritaire qui existent actuellement.
Le deuxième axe vise à rétablir une concurrence libre et non faussée. Notre sujet majeur, c'est de savoir si l'Europe veut être un continent de producteurs ou simplement de pays consommant des produits venant de l'étranger. C'est ce qu'a indiqué le président de la Confédération des PME lors de son audition par la délégation aux entreprises lors de la table ronde du 29 avril sur les entreprises françaises dans la guerre commerciale. Il faut donc des décisions rapides et impactantes, et c'est là que réside la difficulté, puisque nous manquons de réactivité par rapport à nos concurrents chinois qui, eux, réagissent et s'adaptent très rapidement. Donc, il nous faudrait des décisions rapides et déterminantes sans lesquelles nous courons à la catastrophe, puisque de nombreux producteurs français, mais aussi européens, risquent de disparaître.
Les États-Unis imposent des frais radicalement dissuasifs. La stratégie de dumping des plateformes chinoises leur a permis une conquête ultra rapide des marchés européens. En 18 mois, ils se sont approprié 11 % du marché en ligne et ils aspirent les données numériques des consommateurs, ce qui est sans doute l'un de leurs principaux objectifs. De nombreuses entreprises françaises et européennes sont menacées de faillite à très court terme. Proposée par la Commission européenne le 8 décembre 2022, la mesure visant à imposer un minimum de droits de douane pour chaque colis extracommunautaire de moins de 150 euros constitue une mesure d'urgence vitale. Mais nous sommes en 2025 et elle n'est toujours pas appliquée.
Le Sénat a voté le 2 juin, lors de l'examen de la proposition de loi sur la fast-fashion, une taxation comprise entre 2 et 4 euros des colis de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos. Il faudrait que cette taxe soit reprise par l'Union européenne et entre en vigueur très rapidement. Les États-Unis ont adopté une taxe sensiblement plus élevée, 100 dollars pour les colis de moins de 800 dollars. Si l'Europe n'agit pas vite, elle sera submergée, car les flux chinois cherchent des débouchés, puisque le marché américain se ferme drastiquement. Donc, à moyen terme, il sera aussi nécessaire que l'Union européenne étende sa taxe carbone aux produits de consommation courante.
Le renforcement du contrôle des plateformes étrangères à bas coût est urgent. C'est la raison pour laquelle nous proposons à la délégation de saisir l'autorité de la concurrence au sujet des reventes à perte de la part des plateformes de commerce en ligne, notamment chinoises. Nous demandons aussi à l'Union européenne d'aller au-delà en lançant une procédure antidumping et en enquêtant sur les subventions octroyées par des pays non membres de l'Union européenne à des entreprises actives sur son territoire. L'Europe se doit de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union. Elle joue sa survie en quelque sorte.
À terme, la politique concurrentielle européenne doit être refondée afin d'intégrer la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne de réduction de la dépendance dans les domaines stratégiques. Elle doit permettre de développer la notion d'empreinte territoriale afin de prendre en considération l'impact d'un achat local en termes d'emploi ou de recettes fiscales supplémentaires.
M. Franck Menonville, co-rapporteur. - Nous proposons pour notre troisième axe de renforcer le contrôle sur le fabriqué en France. En effet, les contrôles de la DGCCRF semblent aller au plus simple, principalement axés sur les entreprises françaises et concernent parfois des broutilles ou des sujets minimes et secondaires. Certes, à l'égard des plateformes de commerce, la DGCCRF dispose depuis 2020 d'un pouvoir d'obtenir des référencements. Il a été exercé d'ailleurs en 2020 à l'égard de la plateforme américaine Wish, qui proposait 95 % d'appareils électriques, jouets, bijoux non conformes à la réglementation et dont 45 à 90 % étaient dangereux. Mais la plateforme américaine est à nouveau aujourd'hui accessible depuis la France et continue à proposer de la contrefaçon. Les enquêtes sur Temu et Shein sont enlisées depuis trois ans, car à chaque remarque, les plateformes corrigent leur offre, ce qui étend la période de la procédure contradictoire.
La lutte contre le « francolavage » se heurte à des obstacles procéduraux insurmontables. Alors qu'une seule procédure pourrait être engagée contre le contenu d'un conteneur, chaque colis doit faire l'objet d'une procédure judiciaire distincte, ce qui paralyse toute répression efficace. Il faut donc réorienter les contrôles de la DGCCRF et des douanes vers le commerce en ligne extracommunautaire. C'est une priorité absolue, en se focalisant sur le contrôle de la sécurité des consommateurs et en autorisant des listes noires d'importateurs qui fraudent massivement, soit en matière de contrefaçon, soit en matière de « francolavage ». Il existe tellement de contrôles sur les entreprises françaises qu'on pourrait envisager leur regroupement afin de réaffecter des contrôleurs à la vérification de ces importations, en les formant bien évidemment. Ce redéploiement doit s'opérer à coût constant, compte tenu de la situation budgétaire.
En Italie, la Garde des finances, qui est militaire, dispose de 65 000 agents contre, en France, 17 000 douaniers. En France, leur nombre a d'ailleurs été diminué d'un quart en 30 ans. En Italie, c'est, même s'il faut être prudent sur le chiffre qui nous a été indiqué, près de 800 millions de produits contrefaits qui ont été saisis en 15 mois, contre seulement 22 millions en France.
Sans un accroissement des moyens, et une réorganisation des moyens matériels et humains, le renforcement des procédures juridiques de lutte contre la contrefaçon sera inefficace et vain. Il faut en effet adapter les contrôles douaniers à la massification du commerce en ligne et à l'industrialisation des rapports commerciaux par la livraison de milliards de colis. Il faut intensifier l'utilisation de l'IA pour lutter contre la contrefaçon en réponse à son industrialisation croissante.
Il faut étendre les compétences judiciaires des douanes sur le modèle de la Garde des finances italienne, qui a des compétences horizontales. En France, nous avons une approche beaucoup trop segmentée, trop séparée et, finalement, une organisation en silo qui ne rend pas suffisamment efficace le dispositif. On gère d'un côté le narcotrafic, on contrôle d'une autre manière la contrefaçon, d'une troisième manière d'autres délits, alors qu'ils sont gérés par une même organisation et les mêmes réseaux.
Il faut également rendre possible le blocage des sites miroirs qui tendent de contourner une décision judiciaire en créant un nouveau site et avec une réactivité absolument remarquable. En matière de droits d'auteur, cette possibilité existe depuis la loi du 25 octobre 2021, relative à la régulation et la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique pour lutter contre le streaming et le piratage audiovisuel. Elle permet la suspension groupée de nombre de domaines et de démontrer le lien de connexion entre différents sites, dont ils demandent le blocage lorsque ces sites reprennent le contenu de sites visés par une décision de justice sans avoir à en solliciter une nouvelle. Il est donc proposé de s'inspirer de cette loi et de cette procédure, qui a renforcé la protection des droits d'auteur en matière de piratage audiovisuel et de transposer ces principes à la protection de la propriété industrielle, donc au fabriqué en France.
Nous proposons également d'assimiler systématiquement la contrefaçon à la non-conformité du produit, dans le cadre de l'application du règlement européen de 2022 sur les services numériques qui s'attaquent aux produits illicites, contrefaits ou dangereux, proposés en ligne ou au règlement sur le marché numérique qui vise à mieux encadrer les activités économiques des plus grandes plateformes. Il devrait également être créé une amende délictuelle forfaitaire en cas de fraude sur une allégation de produits fabriqués en France par le vendeur. Mais nous souhaitons aussi responsabiliser et sanctionner l'acheteur, sur le modèle de l'infraction créée en 2019 pour l'achat de cigarettes vendues à la sauvette.
La dernière recommandation sera sans doute la plus difficile à mettre en oeuvre. L'Europe doit mieux se protéger. Or, la coopération douanière est insuffisante. L'Office européen de lutte anti-fraude doit faire de la contrefaçon une nouvelle priorité. Le Parquet européen doit élargir sa compétence. La coopération douanière doit se renforcer, notamment avec nos voisins, la Belgique et les Pays-Bas, qui sont aujourd'hui, par la dynamique et la taille de leur port, un lieu d'entrée massive de la contrefaçon.
Le quatrième axe de nos propositions vise à mobiliser la commande publique au service du fabriqué France. La mesure de la part importée dans la commande publique est un préalable indispensable du pilotage stratégique d'une politique d'achat, valorisant l'offre nationale. Sans elle, pas de pilotage efficace. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment de stratégie en la matière.
Il existe par ailleurs un trop gros nombre de pouvoirs adjudicateurs d'acheteurs, je le disais tout à l'heure, 135 000 acheteurs. Il faut rationaliser en les mutualisant autour d'agences de commande publique, opérant au profit de plusieurs pouvoirs adjudicataires d'un même territoire. L'achat public doit être exemplaire. Une volonté d'achat français et local doit exister. L'État doit faire du critère bas carbone un levier en faveur des circuits d'approvisionnement territoriaux courts, interdire les appels d'offres hors taxe pour les marchés dans lesquels peuvent se présenter des entreprises extracommunautaires, assurer un contrôle des engagements sociaux et environnementaux pris par les entreprises ayant remporté des marchés publics et enfin garantir le rôle de l'UGAP afin de garantir une politique plus volontariste en matière d'achat public. Nous proposons de transférer la tutelle de l'UGAP qui est aujourd'hui au ministère des Comptes publics, au profit du ministère de l'Industrie. Nous devons passer d'une stratégie trop souvent financière à une stratégie économique et de souveraineté.
Le cinquième et dernier axe vise à informer et responsabiliser davantage le consommateur. En effet, la communication sur le fabriqué France demeure essentielle. Comme dans d'autres pays européens, en Italie par exemple, des campagnes régulières de sensibilisation en direction des consommateurs doivent être organisées, et notamment sur les retombées territoriales, économiques et sociales de l'acte de consommation. Il faut transformer le consommateur en « consom'acteur ».
L'accent doit être mis sur les conséquences sur leur santé et leur sécurité, sur l'impact essentiel et environnemental des produits importés, afin de valoriser les effets sociaux et environnementaux du fabriqué en France. Le slogan « Nos emplettes sont nos emplois » a été particulièrement efficace il y a quelques années. Nous ne préconisons pas d'organiser un mois ou une semaine annuelle de la promotion des produits fabriqués France, car elles doivent l'être toute l'année, et la grande distribution met suffisamment et en permanence en avant ces produits, dans les linéaires. On pourrait en revanche mieux promouvoir les cartes cadeaux distribuées par les comités sociaux d'entreprise, valables sur les plateformes en ligne, proposant uniquement des produits français, comme la Carte Française, qui regroupe 700 enseignes et propose 500 000 produits.
Enfin, stigmatiser et dénoncer les entreprises qui pratiquent le « francolavage » est une action de communication qui a fait ses preuves pour d'autres objectifs, les entreprises étant extrêmement sensibles à leur image et à leur représentation.
L'ensemble des mesures que nous proposons doit pouvoir marquer une nouvelle ère dans la défense et la valorisation du fabriqué France, du savoir-faire français. Si vous les adoptez, nous nous engagerons à assurer son suivi au-delà de cette publication. Mes mots de conclusion iront pour Monsieur le Président qui nous a fait confiance et nous a confié cette très belle mission avec Anne-Marie Nédélec, avec qui nous avons formé un très beau tandem sur ce sujet et cet enjeu primordial pour notre réindustrialisation et notre économie.
M. Olivier Rietmann, président. - Merci à tous les deux pour ce formidable travail de fond. Mes chers collègues vous avez la possibilité de poser des questions à nos rapporteurs.
M. Simon Uzenat. - Je tiens à remercier les deux co-rapporteurs pour le travail accompli. Je serai très concis concernant la partie relative à la commande publique, car la commission d'enquête rendra dans les prochains jours, début juillet, les conclusions de ses travaux. Je ne peux préjuger des décisions que nous prendrons avec mes collègues. Je souhaite néanmoins réagir sur les propositions 21 à 26 et établir le lien avec les témoignages recueillis lors de nos auditions, qui font écho au travail que vous avez réalisé.
Concernant les chiffres de la commande publique, les 170 milliards d'euros sont issus des données de la commande publique, mais prennent uniquement en compte les marchés supérieurs à 90 000 euros. En se fiant aux données de la Cour des comptes de l'Union européenne, qui a rendu un rapport estimant le poids de la commande publique à environ 15 % du PIB, nous pourrions évaluer le montant de la commande publique dans notre pays entre 300 et 400 milliards d'euros.
Concernant le nombre de pouvoirs adjudicateurs, nous avons plutôt constaté la nécessité de professionnaliser les acheteurs, ce qui rejoint votre préconisation. Nos structures sont souvent de taille trop réduite et il convient d'accompagner cette montée en compétences.
Sur la part importée de la commande publique, il est essentiel d'assurer la traçabilité de la création de valeur. Nous avons auditionné le ministre Éric Lombard, qui affirme que 97 % de nos marchés sont attribués à des entreprises ayant leur siège en France, mais cela n'implique aucunement qu'elles créent de la valeur sur notre territoire. Elles peuvent, par exemple, s'approvisionner en Asie. Nous rencontrons une véritable difficulté pour identifier cette création de valeur. Nous avons repéré cette problématique et j'en informerai le rapporteur afin que nous puissions faire écho aux travaux de ce rapport d'information.
Concernant les appels d'offres hors taxe, nos entreprises communautaires peuvent être concurrentes, avec des taux de TVA différents, ce qui désavantage les entreprises françaises. Nous partageons vos recommandations au profit des appels d'offre hors taxe.
Les recommandations 24 et 25 correspondent largement aux témoignages recueillis lors de nos auditions. Du point de vue des acheteurs et des opérateurs économiques, les considérations sociales et environnementales, qui sont parfois perçues comme des contraintes, représentent en réalité des leviers pour soutenir les entreprises françaises.
Quant à l'UGAP, vous évoquez un transfert de tutelle. Nous verrons quelles recommandations nous formulerons, mais le pilotage par l'État et le pouvoir politique au niveau national s'avère absolument indispensable. Un dirigeant d'entreprise que nous avons reçu donnait l'impression que l'UGAP agit de manière relativement autonome. Pour assurer une cohérence avec nos objectifs, il est nécessaire de réaligner la gouvernance de l'UGAP. Dans le rapport que nous rendrons début juillet, je souhaiterais mentionner les travaux de la délégation aux entreprises et de nos deux co-rapporteurs.
M. Pierre Cuypers. - Vous avez judicieusement choisi ces deux rapporteurs qui ont réalisé un travail considérable, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion.
Concernant la commande publique, il convient de s'interroger sur les raisons qui nous amènent à commander des produits à l'extérieur, lesquels ne respectent pas les mêmes règles que les nôtres. Nous devons nous interroger sur la possibilité de supprimer les surtranspositions de normes que nous nous imposons dans tous les domaines, et questionner l'existence de taxes spécifiques à notre pays. Notre manque de compétitivité dépasse le cadre de l'Union européenne.
Mme Antoinette Guhl. - Je remercie les deux rapporteurs pour le travail accompli. Je lirai attentivement ce rapport, qui traite d'un sujet essentiel pour nous tous qui oeuvrons auprès des entreprises de nos régions. Les États-Unis ont réussi à interdire de nombreux produits chinois en posant comme principe qu'aucun pays recourant à l'esclavage moderne n'est autorisé à commercer sur leur territoire. En conséquence, un nombre important de produits et d'entreprises sont frappés d'interdiction d'importation, au motif qu'ils proviennent de régions où le travail forcé des Ouïghours est pratiqué.
Cette approche me semble constituer un levier d'action significatif pour empêcher l'arrivée en France de produits de qualité médiocre et dangereux pour la santé et l'environnement. Il s'agit d'une main-d'oeuvre détenue contre son gré et non rémunérée. En vertu du respect des droits humains, nous pourrions interdire ces importations à nos entreprises.
M. Olivier Rietmann, président. - Je rebondis sur les nouveaux certificats de protection environnementale chinois. Des chefs d'entreprise m'ont récemment indiqué que les panneaux photovoltaïques chinois sont désormais plus efficaces que ceux fabriqués en Europe. La Chine prétend produire son électricité grâce à l'hydroélectricité, mais celle-ci provient de 192 mégabarrages construits au Tibet sur les grands fleuves d'Asie. Ces fleuves sont les sources d'eau de nombreux pays comme le Pakistan et l'Inde. La Chine contrôlera ainsi demain le robinet d'eau d'une grande partie de ces pays, ce qui n'est pas suffisamment dénoncé.
Mme Laurence Garnier. - Merci de vous être attaqués au sujet du Fabriqué en France, qui revient dans nos débats publics depuis longtemps et d'avoir, au travers du rapport et des recommandations que vous formulez, eu le mérite de clarifier ce paysage confus et d'avancer des propositions particulièrement concrètes.
Durant mes trois mois en tant que secrétaire d'État à la consommation sous Michel Barnier, j'ai découvert que la consommation constituait le moteur de la croissance française, expliquant les deux tiers de notre croissance. Il s'agit d'un levier potentiel, mais ne serait-ce pas davantage un problème ? Une croissance française dynamique, associée à notre balance commerciale systématiquement déficitaire, signifie que la progression de la consommation française alimente les importations. Cette question mérite d'être posée, car elle représente l'un des noeuds du problème.
Nous avons l'objectif de favoriser le « fabriquer, consommer et acheter français » par rapport aux règles que nous nous imposons au sein de l'Union européenne. Pour autant, je préfère acheter une écharpe du PSG fabriquée en Italie, plutôt qu'en Inde ou en Chine. L'acte d'achat peut revêtir une dimension patriotique, qui se joue parfois à l'échelle européenne. Nous avons toutefois une problématique bien plus grave par rapport à tout ce que vous avez décrit avec les plateformes comme Shein, Temu et beaucoup d'autres, qui affichent des croissances exponentielles de leurs ventes en ligne ces trois dernières années.
Pour remédier à cette situation tout en tenant compte des impératifs de pouvoir d'achat - le produit français étant souvent perçu comme plus onéreux par nos concitoyens - un travail de pédagogie s'impose. Les Français possèdent en moyenne 19 appareils électroniques à batterie, et les jeunes 26. Ces produits, rarement fabriqués dans notre pays, ont un coût. Quand on possède autant d'appareils, on préfère acheter une voiture chinoise ou du poulet ukrainien que des produits locaux. Nous devons donc expliquer que l'achat français est une nécessité pour préserver les emplois, mais aussi vis-à-vis des enjeux de qualité, notamment sur le plan sanitaire.
Je crois à l'échelle de l'hyperlocal, c'est-à-dire privilégier les fraises du maraîcher nantais plutôt que celles du Maroc, même à un prix légèrement supérieur. Le citoyen perçoit concrètement qu'il s'agit de l'exploitation maraîchère d'un proche ou d'une entreprise locale. En favorisant l'achat local, nous encourageons implicitement l'achat français. Cette piste mérite d'être explorée.
M. Michel Canévet. - Je remercie les rapporteurs pour leur travail. Il existe également des labels régionaux comme « Produit en Bretagne ». Comment situez-vous ces signes distinctifs, qui favorisent davantage l'économie circulaire locale ?
Par ailleurs, que recouvre votre concept de « zone franche » ? Au sein de la Commission des finances du Sénat, nous sommes plutôt réservés sur ce type de dispositif.
Mme Pauline Martin. - J'attire votre attention sur le point numéro 4 concernant le poids de la commande publique, qui continue de s'alourdir ces dernières années. Nous avons tendance à ajouter des normes sans jamais simplifier. Une vigilance particulière s'impose concernant le code des marchés publics.
M. Franck Menonville, co-rapporteur. - Je répondrai d'abord sur la commande publique : nos investigations dans nos deux missions sont concordantes et complémentaires. L'absence de pilotage stratégique constitue un enjeu majeur - il n'existe pas de stratégie définie pour l'achat public favorisant le fabriqué en France ou localement.
Nos conclusions sont parfaitement complémentaires : les initiatives régionales présentent un potentiel intéressant et doivent apporter une valeur ajoutée au fabriqué en France. Cependant, la commande publique souffre d'acheteurs trop nombreux et dispersés, davantage juristes qu'acheteurs professionnels, sans véritable stratégie gouvernementale. En commission des affaires économiques, j'ai interrogé le ministre Éric Lombard, qui a indiqué que la situation s'améliorait, mais sa réponse manquait de conviction. Nous avons besoin de définir une stratégie claire.
Nous avons identifié la nécessité de transférer la tutelle de l'UGAP pour lui conférer une dimension économique et industrielle, porteuse d'une conviction et d'une volonté politique nationale, ce qui ne nous a pas semblé être le cas actuellement, l'organisation étant guidée par des habitudes structurelles et des considérations financières.
Concernant les normes, je citerai les propos d'Arnaud Montebourg : « Une bonne norme est une norme qui s'applique à tous ». La réciprocité des normes est essentielle ; nous ne pouvons les limiter au cadre franco-français sans perdre en compétitivité. Inversement, nous devons exercer une vigilance accrue sur nos importations. L'effort de contrôle doit s'appliquer au périmètre européen comme vis-à-vis des produits provenant de l'autre bout du monde, qui ne respectent aucunement nos normes environnementales et sociales. Le constat est édifiant : un panier moyen chez Temu coûte 6 euros pour un coût réel de 36 euros, soit 30 euros de dumping. Ce montant nous a paru si extraordinaire que nous l'avons fait vérifier.
Mme Anne-Marie Nédélec, co-rapporteure. - L'approche publique française manque de cohérence et de stratégie véritable. Contrairement à d'autres pays comme l'Italie, nous ne manifestons pas la volonté d'imposer des règles claires. Lorsque la détermination de l'origine d'un produit est claire, il est toujours possible de trouver des règles relatives aux conditions de production, conditions de travail, contraintes environnementales, contraintes techniques, etc.
La réactivité est également indispensable ; les plateformes de commerce électronique se reconstituent en à peine 48 heures et changent de nom. En comparaison, lorsque nous identifions un problème en janvier et que nous examinons quinze mois plus tard les mesures envisageables et notre réponse manque totalement d'efficacité.
Initialement, nous souhaitions imposer le marquage « Produit en France », qui nous paraissait absolument nécessaire. Nous nous sommes heurtés d'abord à la réglementation européenne, qui interdit d'imposer un tel marquage. Nous avons également rencontré un obstacle typiquement français : la lourdeur administrative, qui ne rend pas service à nos producteurs en leur imposant des contraintes supplémentaires. Un fabricant qui estime avantageux d'obtenir une certification s'y conformera, mais d'autres s'en abstiendront.
Dans le domaine de la commande publique, nous voulions imposer un minimum de 50 % de produits fabriqués en France, mais cette ambition s'est révélée irréalisable en raison de notre incapacité à les produire. Nous avons atteint un niveau de désindustrialisation alarmant. Pour promouvoir efficacement le Made in France, nous devons être en mesure de fabriquer en France - c'est la problématique fondamentale.
M. Olivier Rietmann, président. - Merci à tous les deux, encore félicitations pour le travail de fond que vous avez mené.
Mes chers collègues, il est temps de conclure et de mettre aux voix l'adoption de ce rapport.
Peut-on considérer qu'il est adopté par la délégation ? Les membres de la délégation adoptent le rapport à l'unanimité.
M. Olivier Rietmann, président. - Autorisez-vous sa publication ?
M. Olivier Rietmann, président. - Le rapport est donc adopté et sera mis en ligne d'ici peu, je vous remercie.
La délégation sénatoriale aux Entreprises adopte le rapport à l'unanimité et en autorise la publication.
AUDITION DU 15 MAI
2025 :
« FABRIQUER EN
FRANCE : EST-CE ENCORE POSSIBLE ? »
M. Olivier Rietmann, président. - Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous remercie pour votre présence. Notre thème porte aujourd'hui sur « le fabriqué en France », avec une interrogation croissante : est-ce encore possible ? Cette table ronde s'inscrit dans le cadre des travaux de la mission d'information confiée à nos collègues Anne-Marie Nédélec et Franck Menonville.
Les Français affirment volontiers leur attachement aux produits issus du territoire national. Pourtant, d'après une enquête réalisée en octobre 2023 pour CCI France, le pays de fabrication n'arrive qu'en quatrième position parmi les critères guidant l'acte d'achat, derrière le prix, la qualité et la durabilité. De surcroît, la définition même d'un produit fabriqué en France demeure complexe. La prolifération des labels et certifications n'a pas dissipé le scepticisme des consommateurs : 35 % d'entre eux doutent que les produits ainsi présentés soient effectivement d'origine française. En réalité, aucun organisme officiel ne valide cette appellation, qui reste librement utilisable par tout producteur qui souhaite la revendiquer. Toutefois, les services des douanes et de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) exercent un contrôle a posteriori et disposent du pouvoir de sanctionner les abus en la matière.
Cette question a pris une dimension critique depuis la guerre commerciale initiée par l'administration Trump. Elle engage désormais un enjeu stratégique majeur pour l'Europe, appelant une réponse à très court terme. Nos entreprises résisteront-elles à la reconfiguration des flux commerciaux induite par le commerce en ligne, alors que les colis d'une valeur inférieure à 150 euros échappent à toute taxe douanière, et qu'un envoi vers la Chine coûte aujourd'hui plus cher qu'une expédition depuis ce pays ? La plateforme chinoise Shein représente désormais le premier acteur du commerce en France en volume, sans générer un seul emploi dans notre pays. Or, la dénomination « Fabriqué en France » implique des usines, des emplois, et la vitalité de nos territoires.
Pour éclairer ces enjeux, nous écouterons Arnaud Montebourg, ancien ministre, aujourd'hui entrepreneur. Monsieur le Ministre, vous avez récemment participé au Salon du « Made in France » pour y promouvoir du miel issu de votre territoire, et chacun se souvient de la une du Parisien, lorsque vous posiez en marinière avec un appareil électroménager français entre les mains.
Quels enseignements tirez-vous de votre expérience ministérielle en matière de relance de la production nationale ? Quelle lecture portez-vous aujourd'hui sur ce sujet à la lumière de votre parcours entrepreneurial ?
Nous devions également accueillir Yves Jégo, empêché ce matin. Nous écouterons Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie, chercheuse associée à l'Institut des administrations des entreprises (IAE) de Poitiers.
Madame, vous avez contribué aux travaux de la délégation sur le commerce extérieur et développé une expertise reconnue sur la réindustrialisation, à laquelle vous avez récemment consacré un ouvrage appelant à une véritable révolution industrielle. À vos yeux, quelles conditions économiques convient-il de réunir pour permettre un ancrage solide de la production en France ? Quels leviers concrets peuvent favoriser le développement du Fabriqué en France ?
Je vous laisserai à chacun la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, avant d'ouvrir les échanges avec mes collègues de la délégation. Cette table ronde est ouverte à la presse, retransmise en direct sur le site Internet du Sénat, et sera accessible en vidéo à la demande.
M. Arnaud Montebourg, ancien ministre et entrepreneur. - Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à un sujet complexe, devant lequel bien des gouvernements ont éprouvé des difficultés. Un pays qui ne produit pas renonce à sa liberté et compromet l'équilibre de ses comptes publics. La France se trouve précisément dans une situation de dépendance à la fois coupable, fautive et dangereuse. C'est pourquoi, durant mon mandat ministériel, j'ai pris l'initiative d'interpeller la conscience de nos compatriotes par des prises de position parfois non conventionnelles, mais qui s'inscrivaient dans une orientation politique claire.
Qu'entend-on par Made in France ? Il s'agit d'abord de préserver notre outil productif lorsqu'il se trouve menacé, en organisant un véritable « système de soins » pour les entreprises. La doctrine du « laissez-faire », qui prévalait dans les discours des libéraux de l'époque, envisageait la chute d'une entreprise comme le dénouement inexorable d'une mauvaise gestion. Ce raisonnement reviendrait à refuser l'admission d'un malade à l'hôpital, au prétexte de ses faibles chances de guérison. Or, nous avons élaboré des mécanismes permettant de préserver un nombre significatif d'instruments de production menacés. La période actuelle enregistre près de 67 000 procédures collectives, contre 61 000 en 2012-2013, tandis que le seuil considéré comme soutenable s'établit à 45 000. Nous avons systématisé la préservation des outils de travail en péril, en reposant sur le partage des charges : les banques acceptent de prendre leur part de perte, les actionnaires voient leur participation réduite, les salariés consentent à des départs, et l'État renonce à certaines créances. Ce dispositif a été institutionnalisé grâce aux commissaires au redressement productif, qui ont accompagné de nombreuses entreprises, marquant profondément les territoires.
Cette politique s'est maintenue, avec quelques variations, préservant ainsi un certain savoir-faire. Face au manque de financement bancaire, j'avais créé le Fonds de résistance économique, permettant à l'État de jouer le rôle de banque pour les entreprises en difficulté. Ce fonds de développement économique et social (FDES) ou « Fonds de résistance », constituant à l'origine une ligne budgétaire dédiée à la reconstruction du pays, a permis de mobiliser des fonds prêtés aux grandes entreprises en difficulté. Cette ligne demeure active aujourd'hui : le ministère de l'Industrie publie régulièrement ses statistiques, tandis que chaque année, la loi de finances prévoit des autorisations parlementaires pour l'abonder. Ce dispositif pallie les carences du secteur bancaire, particulièrement absent du domaine des restructurations. Bien que les statuts de la Banque publique d'investissement (Bpifrance) ne prévoient pas explicitement le financement de restructurations, celle-ci peut également participer à des fonds destinés à soutenir les entreprises en difficulté par des apports en fonds propres. Ce premier axe de politique industrielle visait ainsi à sauver ce qui pouvait l'être.
Le deuxième axe concernait la reconquête de pans entiers de l'industrie nationale, à travers les plans industriels. Certains y ont vu une résurgence du Gosplan soviétique. Pourtant, les plans industriels des périodes Pompidou ou de Gaulle ont donné naissance à des succès reconnus : aéronautique, nucléaire, spatial... Pourquoi se priver d'outils qui ont fait leurs preuves ?
De surcroît, contrairement à ce que prétendaient certains tenants de l'école libérale, ces plans n'émanaient pas des administrations, mais des filières industrielles elles-mêmes, construites et pilotées par les acteurs économiques. En 2013, nous avons ainsi lancé, avec Renault et Stellantis, un plan pour développer un véhicule thermique à 2 litres aux 100 kilomètres. Les constructeurs automobiles français, en manque de moyens pour financer leur R&D, ont trouvé en l'État un partenaire pour soutenir cette innovation, et le véhicule aurait dû être prêt pour 2020. Cependant, le projet a été abandonné par mon successeur, Emmanuel Macron, alors même qu'il aurait pu profondément modifier l'équilibre mondial du secteur. Les 34 plans industriels identifiés à cette époque restent publiquement accessibles, notamment sur le site « Les Équipes du Made In France.
Lorsqu'un nouveau besoin technologique ou sociétal émerge, il convient de créer les entreprises capables d'y répondre. Cette dynamique suppose des ressources financières, humaines et techniques, que seule une politique industrielle cohérente peut mobiliser. Parmi ces projets figurait également la création d'un cloud souverain, en réunissant OVH et Atos, deux acteurs aux profils très différents. Ce chantier, lui aussi, n'a pas été mené à terme, alors qu'il aurait permis de garantir notre indépendance numérique. En effet, la planification industrielle permet de donner un cap et de structurer une vision de long terme.
Par ailleurs, ce contexte préfigurait ce que d'autres ont ultérieurement qualifié de « start-up nation », qui ne peut fonctionner sans financements adaptés aux différentes phases de croissance. Si le capital-risque est bien couvert en France, le financement du développement de l'économie reste défaillant. Il s'agit d'un enjeu stratégique.
S'agissant du label et de l'information du consommateur, la Commission européenne considère que mentionner l'origine des produits constitue une entrave à la libre concurrence. Nous avons toutefois obtenu, sur certains produits, l'affichage obligatoire des origines. Ce fut le cas du miel, en raison de son rôle stratégique dans la pollinisation agricole. Grâce à l'action conjointe des syndicats et du Parlement, l'origine des miels mélangés est désormais mentionnée sur les pots. Cette avancée, bien que modeste, constitue un précédent. Toutefois, ces dispositifs restent exceptionnels, souvent justifiés par des considérations sanitaires. L'introduction d'un étiquetage généralisé à tous les produits susciterait immédiatement une plainte devant la Commission européenne.
À cet égard, j'estime qu'il faut composer avec les condamnations européennes. Une politique économique impose parfois de braver les interdits afin d'instaurer l'ordre dans le désordre. La DGCCRF et les douanes effectuent des contrôles portant sur l'application du droit européen, lequel autorise l'apposition de la mention Made in France dès lors que la dernière transformation, y compris un simple emballage marginal et accessoire, a été réalisée sur le territoire national. Or, je suis las de voir le drapeau tricolore utilisé de manière abusive. Nous sommes nombreux à lutter fermement contre le « francolavage » des produits fabriqués à l'étranger, indûment habillés de bleu-blanc-rouge.
Je demande au Sénat, comme je l'ai fait auprès de l'Assemblée nationale, d'adopter une législation imposant la mention de l'origine sur l'ensemble des produits. Nombre d'entrepreneurs seraient favorables à cette mesure. Si vous sollicitez l'autorisation de la Commission européenne, elle vous sera refusée. Agissez d'abord, nous plaiderons ensuite. Finalement, de nombreuses décisions passent ainsi, portées par le simple bon sens.
Pour obtenir le label Origine France Garantie, nous sommes contraints de financer nous-mêmes les contrôles attestant que plus de 50 % de la valeur ajoutée du produit provient de France. Autrement dit, nous payons pour avoir le droit de déclarer notre origine. Il semblerait pourtant plus logique de faire supporter ces coûts à ceux qui dissimulent l'origine réelle de leurs produits, plutôt qu'à ceux qui s'engagent dans la transparence. Nous évoluons dans un système inversé, dans lequel, comme l'ont dénoncé certains agriculteurs, nous marchons sur la tête.
M. Olivier Rietmann, président. - Cette situation fait écho aux propos de Stéphane Manigold lors d'une audition sur le « fait maison » : nous marchons sur la tête.
Mme Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie, chercheuse associée à l'IAE Poitiers. - Oui, nous marchons sur la tête. Ce constat semble faire consensus parmi les Français depuis plusieurs années. Les rapports se multiplient, tandis que l'action publique ne suit pas. Comment transformer les discours en actes concrets ?
On observe parfois la tentation de considérer le Fabriqué en France comme un simple outil marketing ou un marqueur identitaire, alors qu'il constitue un instrument essentiel au service de notre souveraineté, à savoir la liberté de choisir notre avenir en tant que société. Or, avec l'internationalisation des chaînes de valeur et le détricotage de notre tissu industriel, nous avons perdu des marges de manoeuvre que nous payons chèrement à chaque crise. La pandémie a révélé des images frappantes pour un pays comme la France qui se perçoit comme une puissance mondiale : absence de masques, batailles sur les tarmacs d'aéroport, principes actifs non produits en France, manque de respirateurs, médecins en surblouse avec des sacs poubelle, constituant autant de symboles d'un État qui n'a plus les moyens de son ambition. L'heure des arbitrages stratégiques a sonné. Où convient-il d'allouer nos ressources ?
La reconfiguration des chaînes de valeur s'articule désormais autour de la Chine, qui conduit une politique industrielle claire, structurée autour d'objectifs précis, identifiant les secteurs dans lesquels elle entend rompre toute dépendance extérieure. La guerre économique avec les États-Unis, notamment sur les semi-conducteurs, explique également les tensions autour de Taïwan. La Chine a aussi pris le contrôle de l'approvisionnement en matières premières critiques via les nouvelles routes de la soie. Les récentes manoeuvres de Donald Trump - sur l'Ukraine et le Groenland - s'inscrivent dans cette même logique de sécurisation des ressources. On pourrait croire que Donald Trump ne se soucie guère d'environnement, mais il a parfaitement compris que l'avenir appartiendra à ceux qui maîtriseront l'accès aux ressources naturelles dans un monde aux réserves finies.
L'Europe affiche une politique moins ambitieuse. Sans pour autant adopter une logique prédatrice, elle devrait pourtant prendre conscience de ses dépendances et mettre en place des dispositifs explicites. En France, le déclin de l'industrie entraîne une perte de valeur et de cohésion, en raison du lien direct entre tissu industriel, emploi, consommation et recettes publiques.
La réindustrialisation, intimement liée au Fabriqué en France, se heurte aujourd'hui à deux entraves : une demande intérieure atone, et un pouvoir d'achat artificiellement maintenu par l'importation de produits à bas coût. Il conviendrait d'intégrer des facteurs structurels comme le poids du logement dans le budget des ménages. Réduire cette part, sans toucher à la fiscalité, permettrait de dégager des marges pour consommer des produits mieux-disants, y compris fabriqués en France. Les États-Unis ferment progressivement leur marché aux exportateurs chinois, poussant ces derniers à chercher de nouveaux débouchés, notamment en Europe, dont les marchés restent ouverts. Dans le même temps, toutes les grandes puissances - États-Unis, Corée, Japon, ou d'autres pays européens - mènent des stratégies actives de réindustrialisation. La Chine dispose de surcapacités industrielles dans des domaines stratégiques comme l'acier, les panneaux solaires ou les batteries.
Toute politique de réindustrialisation restera inefficace si elle ignore les déséquilibres intra-européens, en particulier avec l'Allemagne, ainsi que la concurrence mondiale. Des industriels, y compris ceux implantés en Chine, constatent aujourd'hui l'arrivée sur le marché européen de produits chinois vendus à des prix inférieurs à leurs propres coûts de production, constituant un signe manifeste de dumping. Face à cette situation, la réponse européenne demeure insuffisante. L'instauration de droits additionnels sur les véhicules électriques, ou encore le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, constituent des débuts de réponse, mais ces dispositifs sont largement contournés.
Certes, les normes sociales, sanitaires et environnementales constituent l'un des socles du bien-vivre en France et en Europe. Toutefois, comment justifier que nous importions des produits qui ne respectent aucun de ces standards ? Ce déséquilibre crée un biais de compétitivité majeur. La réciprocité devrait s'imposer comme principe. Une norme juste est une norme appliquée à tous. Si l'on estime qu'une exigence environnementale semble indispensable pour notre avenir, pourquoi ne pas l'imposer aux produits importés ? De même, si nous refusons de produire certains biens pour des raisons écologiques, est-il acceptable de continuer à les importer ?
M. Arnaud Montebourg. - Cet enjeu a été au coeur de la révolte des agriculteurs.
Mme Anaïs Voy-Gillis. - Le Fabriqué en France bénéficie d'une image positive, mais notre désindustrialisation a entraîné une perte de savoir-faire. Contrairement à la Chine, nous ne savons plus gérer la production de masse, qui constitue pourtant le standard universel de l'industrie. Le chemin à parcourir s'annonce considérable. Re-fabriquer en France, dans le cadre européen actuel, suppose une mobilisation collective, bien au-delà du seul registre législatif. Il s'agit de susciter une volonté partagée, un engagement réel derrière un projet industriel.
Or, si les Français se montrent sensibles au Fabriqué en France, ils restent guidés par le pouvoir d'achat et la qualité perçue. Je respecte infiniment les entrepreneurs français, mais si nombre de produits atteignent une excellence reconnue, d'autres peinent à rivaliser. Il convient d'élever collectivement le niveau d'exigence dans les entreprises et de garantir au consommateur un produit à la hauteur de son engagement. Certaines marques ont longtemps considéré que les consommateurs se limiteraient à acheter ce qui leur est proposé, sans réelle exigence. Dans un contexte de concurrence mondiale, ce raisonnement ne tient plus.
Reconstituer un tissu industriel implique également de disposer d'un réseau de sous-traitants solides. Aujourd'hui, quiconque tente de relancer une filière se heurte à la rareté des sous-traitants ou à leur fragilité économique. La responsabilité des grands donneurs d'ordre français dans la désindustrialisation, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne saurait être ignorée. Dans les années 2000, la délocalisation était monnaie courante, justifiée par le besoin de survie économique. Nous ne pourrons pas reconstruire un tissu industriel sans l'engagement de ces grands donneurs d'ordre à accorder de la visibilité à leurs sous-traitants. Celle-ci permet l'investissement, la modernisation des outils de production, et, par conséquent, la résilience des filières.
Le Fabriqué en France souffre également d'un manque de clarté. L'abondance des labels renforce la confusion : Origine France Garantie, labels sectoriels, « imaginé en France », usage du drapeau tricolore... Le consommateur ne s'y retrouve plus. De surcroît, les petites marques françaises, bénéficiant d'une visibilité réduite, restent difficilement identifiables dans les circuits de distribution. Il convient par ailleurs de relativiser le différentiel de prix avec les produits importés. Comparer une marque comme Le Slip Français avec une production de masse comme Shein ne fait guère sens. Il ne s'agit pas d'une simple question de pouvoir d'achat, mais d'un modèle de consommation à repenser au prisme des conséquences sociales et environnementales.
Plusieurs leviers peuvent être mobilisés. Premièrement, privilégier quelques labels publics, lisibles, assortis de critères transparents. Ensuite, faire en sorte que la commande publique joue réellement son rôle. Trop souvent, elle échappe à cette exigence, là où nos voisins européens se montrent moins contraints par l'interprétation des traités. La fiscalité, enfin, doit devenir un outil en faveur de la relocalisation. Si nous souhaitons une industrie forte, alors donnons-nous les moyens. Pourquoi ne pas imaginer des zones franches industrielles, ciblées sur des filières stratégiques pour notre souveraineté, notre transition environnementale ou la cohésion de nos territoires ? Pourquoi ne pas lancer des campagnes publiques valorisant les effets sociaux et écologiques du fabriqué en France, à l'image de celles déjà menées sur la sobriété énergétique ?
La grande distribution doit également contribuer à l'effort collectif en massifiant ses commandes auprès des producteurs français, et en offrant une visibilité accrue à leurs produits. Au niveau européen, la question de la traçabilité des produits et de la transparence reste centrale. Informer le consommateur sur les grandes étapes de la chaîne de valeur ne saurait légitimement contrevenir au droit européen. L'Union européenne pourrait s'inspirer d'initiatives étrangères : Buy American Act, labels territoriaux japonais ou coréens, exigences de contenu local au Brésil ou en Afrique du Sud. Le Buy European Act proposé dans le cadre du Clean Industrial Deal, va dans le bon sens. Cependant, sa mise en oeuvre risque d'intervenir trop tard, une fois que les entreprises européennes auront disparu. Je vous renvoie à un rapport réalisé avec Carbone 4 sur l'impact potentiel d'un Buy European Act dans des filières d'industrie lourde telles que l'acier et le ciment.
L'épargne salariale, qui constitue également un levier puissant, demeure largement gérée par des sociétés comme Natixis ou Amundi, qui proposent des supports souvent investis dans des valeurs américaines, au détriment des entreprises françaises ou européennes. Il serait pertinent de créer des dispositifs dédiés à l'industrie française, incluant le luxe, les valeurs cotées et non cotées. À cet égard, si l'on considère le CAC 40 et le SBF 120, les valeurs industrielles - tirées notamment par le luxe - surpassent celles des services. On pourrait envisager un panachage et imposer aux gestionnaires d'actifs de proposer ce type de support, comme pour l'économie sociale et solidaire. Des incitations pourraient également être introduites, qu'elles proviennent de l'État ou des entreprises, par exemple via un abondement renforcé pour les dispositifs d'épargne (plan d'épargne (PE), plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco)) orientés vers le tissu industriel. Le fruit du travail des Français doit bénéficier en priorité à leur économie. Enfin, un effort de transparence, indiquant si l'épargne soutient des emplois, l'environnement ou d'autres priorités, aurait également toute sa place.
Mme Anne-Marie Nédélec, co-rapporteure. -Trois enjeux me paraissent essentiels. Premièrement, il devient nécessaire de s'accorder sur une appellation claire, garantissant lisibilité et fiabilité pour le consommateur. Comment établir une norme unique, contrôlable, qui assure la véracité de l'origine française ? Nos auditions ont révélé de nombreux cas de fraude, de contrefaçon ou de « francolavage ».
Par ailleurs, comment activer pleinement la commande publique sans naïveté excessive, alors que beaucoup s'affranchissent des règles ? Vous avez évoqué la stratégie du « faire d'abord, plaider ensuite » -- une voie possible, mais révélatrice du manque d'outils adaptés.
Enfin, si le consommateur exprime une sensibilité réelle à la souveraineté ou à l'empreinte carbone, il reste fortement attiré par des prix bas et un modèle de consommation rapide. Ce tiraillement, sans être contradictoire, reflète une tension durable qu'il convient de prendre en compte.
M. Franck Menonville, co-rapporteur. - C'est un véritable plaisir de vous auditionner et de contribuer à cette mission d'information sur « Le fabriqué en France ». Chaque intervention révèle de nouveaux enjeux, et la vôtre a permis d'illustrer plusieurs difficultés persistantes.
Monsieur le Ministre, au regard de votre expérience, quels vous semblent être les leviers prioritaires d'une politique publique efficace pour mieux protéger la « marque France » ? Estimez-vous l'arsenal législatif actuel suffisant pour lutter contre les abus ?
Le commerce en ligne est passé en France de 8 à 175 milliards d'euros entre 2005 et 2025, avec 1,5 milliard de colis reçus en 2024, à 91 % venus de Chine -- soit trois fois plus qu'en 2022. Les secteurs du textile, des cosmétiques ou des jouets en sont durement touchés, et les fraudes sur la provenance restent fréquentes. Les douanes semblent débordées et, d'après nos auditions, un seul agent serait en charge du contrôle d'Amazon. Comment améliorer la traçabilité et renforcer les contrôles, notamment sur ces plateformes ?
Enfin, s'agissant de la commande publique, comment encourager efficacement l'achat local, tout en restant dans le cadre européen ? Les exemples italiens et allemands montrent que d'autres États agissent avec moins de retenue. La mission se rendra d'ailleurs en Italie en juin pour étudier ces pratiques. Par ailleurs, la massification des achats publics, en regroupant les commandes, tend à exclure les productions locales sans nécessairement garantir un meilleur rapport qualité-prix. Quelle est votre analyse à ce sujet ?
M. Olivier Rietmann, président. - En outre, comment expliquer à nos concitoyens que les impôts qu'ils versent servent à financer l'achat de produits qui ne contribuent pas à l'économie nationale ?
M. Arnaud Montebourg. - Je me concentrerai sur deux points, avant de laisser la parole à Anaïs Voy-Gillis, dont je partage intégralement les propos.
Concernant le label, il est temps d'agir, car le débat piétine depuis dix ans. Une loi doit résolument imposer l'affichage obligatoire de l'origine des produits, pour garantir une information fiable au consommateur. À défaut de cadre public, le label privé Origine France Garantie -- que je connais bien en tant que membre de son conseil d'administration -- offre une solution efficace en imposant que la majorité de la valeur ajoutée du produit soit issue de France. Il s'agit d'une méthode rigoureuse, basée sur des éléments vérifiables, qui incite les entreprises à relocaliser partiellement leur chaîne de valeur. Toyota, par exemple, a obtenu ce label en augmentant la part de composants français pour sa Yaris produite à Valenciennes. Ce type de démarche soutient l'emploi local et la sous-traitance.
S'agissant de la commande publique, nous nous heurtons à un système d'achat morcelé et fortement décentralisé. La multiplicité des acteurs (collectivités locales, préfectures, établissements publics) compose un véritable puzzle administratif local. La France compte plus de 120 000 acheteurs, contre seulement 30 000 en Allemagne. Cette fragmentation rend toute stratégie industrielle impossible. De plus, les acheteurs publics opèrent sous une forte pression pénale, ce qui les conduit à une lecture excessivement prudente des règles européennes. Pourtant, le droit européen n'a jamais prohibé la commande patriotique, que plusieurs de nos voisins pratiquent avec fermeté.
Il apparaît indispensable de réduire le nombre d'acheteurs et de former efficacement ce groupe restreint à l'utilisation des règles. L'Union des groupements d'achats publics (Ugap) s'est vu confier le rôle de structurer une offre plus favorable à l'industrie française. Toutefois, cet objectif s'avère difficilement conciliable avec sa tutelle actuelle, placée sous l'autorité du ministère du Budget, et non de celui de l'Économie ou de l'Industrie. Cette orientation produit des conséquences concrètes : la priorité donnée à la baisse des coûts conduit mécaniquement à privilégier le moins-disant au détriment du soutien à la production nationale. Lorsque j'étais en responsabilité, j'avais d'ailleurs demandé la tutelle de la commande publique pour pouvoir agir en cohérence avec une stratégie industrielle. Cette demande a été refusée, au nom des équilibres budgétaires traditionnels de Bercy. Tant que la logique d'achat public restera exclusivement budgétaire, elle ne permettra pas d'orienter les commandes vers les producteurs français.
Il serait opportun de créer des agences régionales de la commande publique, avec des acheteurs spécialisés, formés, capables d'appliquer le droit avec rigueur et d'orienter les commandes vers l'économie nationale, tout en respectant le cadre européen. Ces agences permettraient de professionnaliser l'achat public, de libérer du temps pour d'autres missions, et de garantir la cohérence entre l'achat et les objectifs industriels. Cette configuration serait également l'occasion, pour les responsables publics, d'affirmer avec clarté que nos impôts soutiennent l'emploi en France.
Des initiatives existent déjà à l'échelle régionale, comme en Nouvelle-Aquitaine. Il serait pertinent de généraliser ce type de structures, à l'image du CEREMA, qui regroupe État et collectivités sur des enjeux techniques. La trajectoire de CARELID constitue un exemple édifiant. Fournisseur de longue date de l'AP-HP, l'entreprise a perdu son marché au profit d'un concurrent allemand pour un écart de prix marginal. Elle a ensuite connu des difficultés financières majeures, entraînant plusieurs tentatives de reprise et des interventions publiques coûteuses. Or, il aurait suffi d'un pilotage plus stratégique de la commande publique pour éviter cette situation.
La création d'agences techniques permettrait de confier les décisions d'achat à des agents qualifiés, capables de mobiliser les outils existants en cohérence avec une ambition industrielle : la France. Elles constitueraient une alternative plus efficace à l'Ugap, dont l'action reste aujourd'hui limitée. Il semble, en effet, scandaleux que des équipements aussi symboliques que les uniformes de l'armée ou de la sécurité civile soient encore importés de Chine. Cette situation doit cesser.
Face à l'immobilisme de l'exécutif, j'appelle le Parlement à se saisir pleinement de cette question. Des commissions d'enquête ont été menées, des constats solides sont posés. Il est désormais temps d'engager le travail législatif. Les instruments existent ; les majorités sont possibles. Il appartient résolument aux parlementaires de prendre le pouvoir sur ce sujet, car la situation perdure depuis dix ans.
Mme Anaïs Voy-Gillis. - La centralisation de la commande publique sur certaines plateformes, telles que l'Ugap, pose la question du prix réel et de l'efficacité de l'allocation des fonds publics. Il conviendrait d'interroger la manière dont les références sont sélectionnées et de s'assurer qu'elles intègrent mieux les enjeux environnementaux, de durabilité et d'impact territorial. Il pourrait être pertinent, à ce titre, de prévoir une bonification pour les entreprises fabriquant en France. Par ailleurs, on constate parfois un effet pervers : des prestataires tendent à majorer artificiellement leurs offres, estimant que la présence d'une subvention autorise une marge plus élevée. Ce comportement engendre une forme de déperdition de l'argent public qu'il conviendrait de mieux encadrer. Ainsi, je reste perplexe sur le fait que la structure actuelle de la commande publique soit favorable au Fabriqué en France et serve efficacement les finances de l'État.
Ensuite, il reste difficile pour les consommateurs d'établir un lien direct entre leurs achats et le maintien de l'emploi ou du modèle social. L'impact des cartes cadeaux distribuées par les comités sociaux et économiques en constitue une illustration : malgré la bonne volonté de certaines initiatives comme La Carte Française, le critère du pouvoir d'achat l'emporte systématiquement. Même les organisations les plus sensibilisées à l'enjeu - en particulier les syndicats - peinent à franchir le pas d'un engagement systématique en faveur du Fabriqué en France.
Une campagne nationale d'information, simple et pédagogique, pourrait utilement contribuer à faire évoluer les comportements. Il ne s'agit pas d'imposer une consommation 100 % française, mais d'inciter chacun à progresser. Cet effet de levier, à l'échelle individuelle, produirait un impact structurel pour nos filières productives.
Cette logique doit s'étendre à l'ensemble des postes de dépenses. À cet égard, des outils fiscaux pourraient être mobilisés, comme une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) modulée en fonction de la durabilité ou de la provenance. Je doute qu'il existe, dans la classe politique actuelle, des responsables prêts à assumer publiquement une ligne de rupture avec le cadre européen. Même ceux qui tiennent un discours virulent contre l'Europe finissent, bien souvent, par adopter la posture de Viktor Orban : dénoncer Bruxelles tout en allant y recueillir les subsides. Il conviendrait également d'ajuster les crédits d'impôt, qui restent actuellement aveugles à l'origine des produits.
S'agissant des plateformes, il semble impératif de rétablir un principe de fermeté. Lorsqu'un manquement est avéré, l'interdiction ou la taxation renforcée doivent pouvoir être envisagées. Interdire une plateforme comme Shein au motif de conditions de travail inacceptables - comme le recours au travail forcé des Ouïghours - poserait de nombreuses difficultés juridiques et pratiques. Le positionnement réglementaire sur ce sujet reste complexe. Pour autant, le volume de consommation actuel n'est pas compatible avec nos objectifs environnementaux, et contribue à la destruction massive de nos filières industrielles, notamment dans le textile, mais aussi des circuits de recyclage hors d'Europe, désormais saturés par des vêtements de faible qualité.
La robotisation, par exemple via le tricotage 3D, pourrait permettre de réduire certains coûts de production. L'objectif ne vise pas à concurrencer la Chine sur son propre modèle, mais à promouvoir une filière fondée sur la qualité et la durabilité. En ce sens, la seconde main offre également une alternative crédible. En réalité, le pouvoir d'achat est souvent invoqué comme un prétexte. Contrairement aux idées reçues, les personnes les plus modestes ne sont pas celles qui consomment massivement sur des plateformes comme Shein
L'action des douanes doit impérativement se voir renforcée. Il s'agit d'un choix politique : si nous estimons que la lutte contre les importations illégales ou déloyales constitue une priorité cohérente avec nos objectifs industriels et environnementaux, alors il faut en assumer les moyens, en ciblant les contrôles, plutôt que de les diluer.
Des initiatives inspirantes existent dans le secteur privé, comme celle portée par Loïc Hénaff en Bretagne, visant à relocaliser les achats en connectant entreprises et sous-traitants locaux. Cette démarche fait également écho à une difficulté majeure : la méconnaissance du tissu industriel français. À Shenzhen, les entrepreneurs sont accueillis avec tous les égards, et l'offre industrielle parvient de manière fluide et organisée. En revanche, pour identifier un sous-traitant en France, il convient généralement de se débrouiller seul, sans appui, jusqu'à trouver l'usine. Cette différence de traitement et de facilité d'accès pèse dans la décision : face à une offre étrangère structurée, compétitive et attentive, il devient tentant de privilégier le fournisseur qui garantit volume, prix, et service.
Cette situation m'évoque un article récent intitulé : « Quand la France a-t-elle cessé de s'aimer ? » En effet, la question du soutien à la production nationale porte celle de la fierté collective, du sens que l'on donne à l'action, et de la capacité à se projeter dans un projet de société partagé. Il s'agit d'un enjeu éminemment politique : au-delà des ajustements techniques ou des simplifications réglementaires, les citoyens attendent une vision qui rassemble, malgré les désaccords. Or, aujourd'hui, tout nous encourage à l'isolement et à la résignation. Il apparaît urgent de redonner envie aux Français d'agir ensemble.
M. Arnaud Montebourg. - Le monde est en train de rétrécir et le prix mondial, emblème d'une dictature de la mondialisation, aligne tous les acteurs sur le moins-disant social, environnemental et productif. Ce mécanisme a largement contribué à la désindustrialisation de l'Occident et à la montée des colères électorales. La révolte que l'on qualifie souvent de populiste porte un sens : celui du refus d'un système qui a mis en concurrence les classes ouvrières syndiquées depuis un siècle avec les nouveaux esclaves du capitalisme asiatique. Nous devons désormais faire un choix : continuer à plaider pour une ouverture dans un monde qui se ferme ou enfin adapter notre posture. L'enjeu n'est pas tant la riposte vis-à-vis des États-Unis que la relation avec la Chine. Son économie extravertie, en situation de surcapacité de production, cherche désormais à écouler ses produits sur les marchés ouverts dotés d'un pouvoir d'achat. Nous sommes les prochaines victimes de l'industrie chinoise. Les droits de douane récemment adoptés par l'Union européenne dans le secteur des véhicules électriques ne suffiront pas : la Chine, en situation de dumping structurel, peut aisément absorber des hausses tarifaires. L'effondrement du textile constitue un signe avant-coureur du destin qui tend les bras à notre industrie technologique. Nous sommes devenus, par certains aspects, une économie en voie de développement, comme l'a écrit François Bayrou dans son rapport sur le commerce extérieur.
Face à ce constat, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en place, à l'échelle européenne, des barrières protectionnistes. Le Japon, la Chine, les États-Unis ont tous utilisé ces mécanismes pour construire et préserver leur appareil productif. Il convient désormais d'assumer un protectionnisme stratégique, non pas contre les États-Unis - qui agissent avec cohérence pour défendre leurs intérêts -, mais pour faire face à un déséquilibre profond avec la Chine. Comme Donald Trump, qui fait porter le poids de l'effort budgétaire sur les autres pays, l'Europe doit apprendre à protéger ses intérêts et à taxer l'extérieur, plutôt que de s'imposer une austérité intérieure. Les États-Unis ont su relancer leur économie deux années après la récession par une politique budgétaire volontariste, tandis que l'Europe a mis dix ans à retrouver une croissance faible, sans restaurer son potentiel industriel.
Si nous continuons à subir d'un côté la stratégie américaine, et de l'autre, l'offensive industrielle chinoise, alors notre avenir sera celui que redoute Michel Houellebecq dans « La carte et le territoire » : un pays transformé en musée, vivant de services sous-payés, avec quelques stations de ski -si la neige existe encore.
M. Franck Menonville, co-rapporteur. - Vous soulignez l'impasse des mesures de taxation dans le secteur automobile. Seriez-vous plutôt favorable à une stratégie de protection fondée sur les normes ?
M. Arnaud Montebourg. - Tous les leviers doivent être mobilisés pour préserver notre appareil productif. Au-delà des normes, il conviendrait d'imposer des quotas d'importation, à l'instar de ce qui avait été mis en place par le passé avec le Japon et la Corée. Ce mécanisme entraînera, sans doute, des mesures de rétorsion, notamment sur l'industrie automobile allemande. Cependant, l'Allemagne enregistre également un recul notable : Volkswagen et Mercedes ont perdu 40 % de parts de marché en Chine en un an, et envisagent des délocalisations. Mais qui achètera une Mercedes produite en Chine dans une Europe frappée par le chômage ? Volkswagen prévoit déjà 30 000 suppressions de postes. En tout, 15 millions d'emplois sont en jeu dans le secteur automobile européen.
L'ancien directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, l'a d'ailleurs publiquement exprimé. La logique actuelle consiste à durcir nos propres normes sans imposer de contraintes équivalentes à nos concurrents. Il faudrait, à l'inverse, adopter une politique commerciale offensive, à l'image de celle mise en oeuvre par Donald Trump, avec des droits de douane de 100 % voire 120 % - non pas pour fermer nos frontières, mais pour retrouver un équilibre entre notre capacité de production et notre niveau de consommation. Aujourd'hui, seuls deux pays dans le monde partagent une structure économique fortement extravertie : l'Allemagne et la Chine. À l'inverse, les États-Unis et la France cumulent un double déficit - commercial et public. Cette divergence structurelle entre États membres rend tout alignement stratégique au sein de l'Union européenne extrêmement difficile, d'autant plus que Mme von der Leyen conduit une politique alignée sur les intérêts allemands, qui met en péril la survie même du modèle productif européen.
Ce problème touchera directement les Français non pas dans les années, mais dans les mois à venir. La situation devient d'une extrême gravité. Nous devons collectivement nous en saisir, d'autant que le constat semble faire l'unanimité. Ce sujet relève désormais clairement de la responsabilité du gouvernement et du Parlement français.
M. Michel Canévet. - Je tiens à saluer l'enthousiasme et le volontarisme de Monsieur le Ministre, ainsi que la qualité des propositions formulées par Madame Voy-Gillis.
Permettez-moi de rappeler que la dernière des quatre usines de production de masques de protection sanitaire ouvertes en Bretagne depuis 2020 vient de déposer le bilan. Par ailleurs, nous disposons d'une association dynamique, Produire en Bretagne, qui fédère 500 entreprises autour d'un label reconnu et exigeant. Pensez-vous qu'il soit possible de maintenir ces labels régionaux, malgré votre appel à la création d'un label national plus structurant ? Ne pourrait-on pas, à l'image de ce qui existe déjà dans l'agroalimentaire avec les AOC ou les labels territoriaux, consolider ces initiatives locales pour mieux valoriser l'ancrage des entreprises dans nos territoires ?
Je partage également votre constat sur la nécessité d'une mobilisation plus déterminée, d'autant plus que la situation de nos comptes publics ne nous permettra pas de poursuivre indéfiniment des politiques de soutien budgétaire à l'industrialisation. Cette approche suppose de s'attaquer résolument aux normes et contraintes qui freinent encore trop souvent nos entreprises.
M. Pierre Cuypers. - Je salue la pertinence du thème retenu et la qualité des intervenants, tout en regrettant l'absence d'Yves Jégo, dont l'expérience aurait utilement enrichi nos échanges.
Oui, produire en France est possible, mais encore faut-il pouvoir vendre et exporter.
Lors d'une mission en Égypte, j'ai échangé avec le président Al-Sissi, qui m'a confirmé que son pays reste le premier importateur mondial de blé, avec 12 millions de tonnes par an. Pour expliquer pourquoi la France ne lui en fournit que 426 000 tonnes, il m'a confié « Vous avez le meilleur blé du monde, mais il est trop cher. Vos charges et vos normes vous rendent non compétitifs ». De ce fait, nous perdons des marchés face à la Russie, l'Ukraine ou la Roumanie.
Par ailleurs, en contrepartie de livraisons d'armement, un accord a permis l'importation de 200 000 tonnes de sucre ukrainien à droit nul. Aujourd'hui, ce volume approche les 800 000 tonnes, contribuant à la fermeture d'usines françaises, dont celle de Souppes-sur-Loing. Cette décision politique fragilise notre outil industriel.
Enfin, ne pouvant bénéficier d'un accès Internet stable, j'ai eu recours à Starlink. En une semaine, j'ai obtenu une solution fiable, venue des États-Unis. J'ai interrogé le ministre de la Recherche, qui a reconnu que nous avions raté ce virage technologique, sans perspective de rattrapage.
Ces exemples témoignent d'un niveau de dépendance préoccupant. Nous importons ce que nous savons produire, parce que nous nous imposons des normes et des contraintes que nos concurrents ignorent. En tant que rapporteur d'un texte de simplification pour l'agriculture, je mesure combien notre système entrave les initiatives. Oui, nous avons les compétences et les capacités. Néanmoins, nous ne savons plus nous donner les moyens de produire et de rester compétitifs.
Je conclurai avec cette phrase, entendue quelques années plus tôt à Bercy : « Pourquoi produire en France ce que l'on peut acheter moins cher ailleurs ? » Tant que cet état d'esprit dominera, nous resterons empêchés de construire une véritable politique industrielle nationale.
M. Michel Masset. - Merci, Monsieur le Ministre, Madame, pour vos interventions toujours aussi éclairantes, qui m'interrogent : que faire, concrètement ? Au-delà du constat, il s'agit de faire preuve de courage. Nous devons, collectivement, porter des propositions de loi, car la situation actuelle n'est plus tenable.
Le pouvoir d'achat demeure, certes, une priorité pour nos concitoyens. Cependant, le souhait de produire en France et la nécessité de légiférer pour y parvenir s'avèrent tout aussi cruciaux. À cet égard, un levier fondamental n'a pas été abordé : le coût de l'énergie, qui pèse lourdement sur nos filières industrielles.
J'ai retenu plusieurs pistes concrètes, notamment la création d'une agence technique de la commande publique, facilement déployable sur le plan territorial. Vous avez également rappelé le poids du foncier et de l'immobilier, qui devient insoutenable et pénalise profondément la consommation des ménages.
En résumé, vos propos m'interpellent dans mon rôle de parlementaire. Si affronter certains blocages européens s'avère nécessaire, alors faisons-le ensemble.
M. Arnaud Montebourg. - Il convient de se répartir le travail parlementaire, par binôme de sénateurs ou de députés, en engageant des lois d'abrogation secteur par secteur, sans attendre un équilibre entre création et suppression de normes. Lors du « choc de simplification » de 2014, nous avions identifié 500 mesures à partir des remontées de terrain. Cependant, l'arbitrage a été opéré entre technocrates, vidant ainsi le projet de sa substance. Ce dossier doit absolument revenir entre les mains du Parlement.
Le pays est aujourd'hui paralysé par une suraccumulation de normes. Comme l'a souligné M. Cuypers pour l'agriculture, on ne peut plus rien faire sans autorisation préalable. Nous ne sommes plus dans un régime libéral au sens politique, où tout ce qui n'est pas interdit est permis : désormais, sans validation explicite, on s'abstient d'agir. Il appartient aux parlementaires d'alléger ce cadre, au nom de leur pouvoir législatif souverain.
Concernant la commande publique, des initiatives ont vu le jour dans certaines régions, mais elles atteignent leurs limites. Je recommande en effet une agence technique d'achat par région, réunissant État et collectivités, placée sous l'autorité du préfet, et bénéficiant d'un transfert effectif de compétences. Cette structure allégerait la charge des collectivités et garantirait un achat public plus cohérent et plus efficace. Dans cette perspective, une loi s'impose.
S'agissant de la fiscalité, nous portons 70 milliards d'euros de charges de production de plus que l'Allemagne. Le Gouvernement a préféré baisser l'impôt sur les sociétés alors qu'il aurait fallu alléger les impôts sur la production, qui frappent dès le premier euro d'activité, même sans bénéfice. Déplacer la charge fiscale vers les revenus réalisés apparaît bien plus acceptable, à condition, bien entendu, que l'impôt ne soit pas confiscatoire. Plusieurs think tanks, dont La Fabrique de l'industrie, ont déjà produit des analyses solides sur le sujet. Au-delà des positions du Medef, des industriels se sont mobilisés, dans une démarche indépendante. Ainsi, il existe une base de travail claire. Je soutiens ces initiatives, car taxer la production n'est plus tenable.
Enfin, il importe de bâtir une mobilisation nationale autour de la reconstruction de notre appareil productif, agricole et industriel. L'intérêt du producteur doit résider au coeur de nos politiques publiques. Chacun porte sa part de responsabilité. Il est temps de réorganiser la France autour de sa capacité à produire pour elle-même.
Mme Anaïs Voy-Gillis. - Le montant des droits de douane constitue sans doute un axe de travail pertinent. Toutefois, au regard des montants d'aides publiques que nous déployons pour attirer des capitaux étrangers en France et en Allemagne, deux sujets mériteraient d'être étudiés : les transferts de technologie et l'implantation locale. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à rattraper notre retard dans les technologies clés de la transition énergétique, il serait légitime de poser la question des transferts de technologie. Cette démarche a permis à la Chine de développer son industrie. Aujourd'hui, si elle souhaite vendre en France, pourquoi ne pas lui imposer les mêmes conditions qu'elle a exigées des Européens : s'implanter localement, partager des compétences. Cette approche supposerait d'introduire davantage de conditionnalité dans les aides publiques et de renforcer la transparence des mécanismes de soutien. La Chine reste dépendante des exportations vers l'Europe, et ce rapport de force doit être assumé.
Par ailleurs, la désindustrialisation résulte d'un choix politique revendiqué dans les années 1990-2000. Le modèle « entreprise sans usine » a été plébiscité par une large partie des élites économiques et politiques françaises, qui ont tourné le dos à la production. Aujourd'hui, combien se sont réellement intéressés à la complexité des sites industriels ? Il convient de sortir des discours stériles et d'agir concrètement. Les pouvoirs publics disposent de mécanismes normatifs et fiscaux permettant d'orienter efficacement la trajectoire de l'industrie. Sans volonté politique claire et collectivement assumée, le Fabriqué en France sombrera, en une décennie, au rang de chimère.
Entre la dette publique, le pouvoir d'achat, la transition écologique et la réindustrialisation, des choix s'imposent. Dans un pays marqué par une forte tradition corporatiste, ces arbitrages se heurtent à de multiples résistances : une mesure qui pénalise un secteur peut en favoriser un autre, ce qui rend toute simplification ou réforme structurelle difficile à mener. Néanmoins, la confrontation des idées reste indispensable à la construction d'un projet de société. Le consensus, lui, se fait toujours a minima. Il s'agit désormais d'assumer une confrontation avec des exigences élevées, pour parvenir à des compromis robustes. La notion de responsabilité collective et assumée me tient à coeur. À titre personnel, j'ai choisi de lier mes actes à mes convictions. Après une thèse sur l'industrie, j'ai décidé de travailler dans l'un des 50 sites les plus émetteurs de France pour participer concrètement à la décarbonation. En effet, la réalité implique un rapport de force permanent.
Au-delà des discours, quel bouquet d'actions engage-t-on ? Comment dépasse-t-on les lignes partisanes pour trouver des compromis utiles ? Outre les intérêts des industriels, l'enjeu concerne l'avenir des Français qui font tourner ces usines, contribuent au rayonnement de la France et incarnent la souveraineté de notre pays.
M. Olivier Rietmann, président. - La délégation aux Entreprises se distingue par son ancrage sur le terrain. Nous consacrons régulièrement deux jours à chaque département pour aller à la rencontre des chefs d'entreprise, visiter des sites de production, échanger directement avec les acteurs économiques. Après le Pas-de-Calais, nous irons bientôt dans le Puy-de-Dôme. Cette proximité nourrit nos propositions, parfois détonantes, y compris vis-à-vis de l'administration ou de certains collègues.
M. Jean-Luc Brault. - J'ai dirigé une entreprise dans le BTP puis dans l'industrie, revendue à EDF-Dalkia. Avec mon épouse, nous avons tenté de sauver la filière de la confection dans notre région - entre Poitiers et Saint-Aignan - avec 500 emplois en jeu. Malgré plusieurs rachats d'entreprises en difficulté, nous avons échoué. Pourquoi ? Parce que deux paramètres essentiels ont été négligés : la formation et l'apprentissage. Ce sujet me tient à coeur : j'ai moi-même commencé à 13 ans comme apprenti, et sans cette voie, je n'aurais jamais bâti une entreprise florissante. Le constat me semble limpide : sans apprentis, pas de réindustrialisation.
M. Olivier Rietmann, président. - Merci Monsieur le Ministre, Madame Voy-Gillis, pour votre liberté de ton qui résonne parfaitement avec l'esprit de notre délégation. Merci également à mes collègues. Je rencontre tout à l'heure le commissaire européen en charge de la protection des consommateurs. Nous lui transmettrons avec vigueur plusieurs des messages entendus lors de cette table ronde.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
MARDI 4 MARS 2025
Audition
Origine France Garantie
- M. Gilles ATTAF, président.
ADEL
- Mme Fabienne DELAHAYE, fondatrice du salon MIF Expo.
MERCREDI 5 MARS 2025
Audition
La carte française
- M. Charles HUET, président ;
- M. Jean-Baptiste FONTENAUD, associé, co-fondateur et directeur général.
Fédération indépendante du made in France (Fimif)
- Mme Amandine HESSE, porte-parole ;
- M. Samuel COLLIN, secrétaire et responsable communication.
MARDI 11 MARS 2025
Audition
Union des industries textiles (IUT)
- M. Olivier DUCATILLION, président ;
- Mme Bernadette FULTON, Déléguée générale.
Syndicat de l'Industrie Chimique Organique de Synthèse et de la Biochimie (SICOS)
- Mme Céline CRUSSON-RUBIO, déléguée générale ;
- M. Alexis REICHERT, consultant sénior ;
- M. Vincent TOURAILLE, président ;
- M. Gildas BARREYRE, secrétaire général Seqens, administrateur du SICOS ;
- Mme Françoise DURAND-RIVOIRE, responsable mondiale ESG et des affaires publiques.
MARDI 25 MARS 2025
Audition
Direction générale des entreprises (DGE)
- M. Edgar TILLY, directeur de projets transition écologique de l'industrie ;
- Mme Manal EL BEKKARI, coordinatrice de projet Made in France, service de l'industrie ;
- M. Charles DE BISSCHOP, chef de projet Made in France.
MERCREDI 2 AVRIL 2025
Audition
Union des fabricants (UNIFAB)
- Mme Delphine SARFATI-SOBREIRA, directrice générale ;
- Mme Alice ROLAIN, Chargée des affaires publiques et juridique.
UPSA
- Mme Laure LECHERTIER, directrice de l'accès, des affaires publiques et de la RSE ;
- M. Rémi DERA, chargé des affaires publiques.
MERCREDI 7 MAI 2025
Audition
Institut Les savoir-faire
- M. Luc LESÉNÉCAL, président ;
- Mme Anne-Sophie DUROYON-CHAVANNE, directrice générale.
JEUDI 15 MAI 2025
Table ronde
- M. Arnaud MONTEBOURG, ancien ministre, président de « Les équipes du Made in France » ;
- M. Anaïs VOY GILLIS, docteure en géographie et chercheuse associée à l'IAE de Poitiers.
MARDI 20 MAI 2025
Audition
Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales (FFIGIA)
- M. Fabrice DESCOMBES, président ;
- Mme Audrey AUBARD, secrétaire générale.
Union des groupements d'achats publics (UGAP)
- M. Edward JOSSA, président-directeur général ;
- M. Lionel FERRARIS, directeur politiques publiques.
MERCREDI 21 MAI 2025
Audition
Fédération du e-commerce et vente à distance (FEVAD)
- M. Moncef LAMECHE, responsable des affaires publiques ;
- Mme Clara DUVAL, Consultante Sénior.
Direction générale des douanes et droits indirects
- M. Guillaume VANDERHEYDEN, sous-directeur au commerce international ;
- M. Yann AMBACH, chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale.
MARDI 27 MAI 2025
Audition
Assemblée nationale
- Mme Olivia GRÉGOIRE, ancienne ministre, députée.
MARDI 3 JUIN 2025
Audition
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
- Mme Alice CHONIK, adjointe au bureau du droit de la consommation ;
- Mme Laëtitia BASTIAN, rédactrice en charge du MIF ;
- M. Philippe GUILLERMIN, chef du bureau Droit de la consommation.
Programme Territoires d'industrie
- M. Olivier LLUANSI, ancien responsable du programme « Territoires d'industrie ».
COMPTE-RENDU DU DÉPLACEMENT EN ITALIE
Du jeudi 5 au samedi 7 juin à Rome
Personnalités rencontrées
- Mme Anna-Maria FALLUCCHI, Sénatrice, rapporteure de la loi sur le Made in Italy ;
- M. Silvio GIOVINE, député, rapporteur de la loi sur le Made in Italy ;
- M. Frédéric KAPLAN, ministre conseiller pour les affaires économiques, Ambassade de France ;
- M. Fabrice ARS, attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France ;
- Général B. CRESCENZO SCIARAFFA, commandant de l'Unité spéciale pour les biens et services de la Garde des Finances ;
- Colonel Agostino BRIGANTE, commandant du groupe Anti-contrefaçon et Sécurité des produits de la Garde des Finances ;
- M. Amedeo TETI, chef du département marché et protection du ministère des entreprises et du Made in Italy ;
- Mme Laurence MOREL-CHEVILLET, directrice anti-contrefaçon de Bulgarie (LVMH) ;
- M. Antonio FRANCESCHINI, directeur des affaires internationales de la Confédération nationale des artisans (CNA) ;
- M. Claudio ROVERE, président de HModa ;
- M. Julien VEYRIER, secrétaire général de Carrefour Italia ;
- M. Marco FELISATI, directeur des affaires internationales ;
- M. Antonio MATONTI, directeur des affaires législatives ;
- M. Stefania DE FEO, affaires législatives de la Confindustria.
L'Italie a été à la pointe du combat en faveur du marquage obligatoire des produits, initiative qu'elle avait engagée lorsqu'elle présida le Conseil européen en 2003. Cette proposition ne trouva pas de majorité au Conseil, et pas davantage lors d'une seconde tentative en 2014.
L'article 16 de la loi 166 (Décret-loi 135 du 25 septembre 2009) avait établi un cadre strict pour définir les produits pouvant se prévaloir de l'origine « Made in Italy ». Ainsi, seuls les produits entièrement conçus, fabriqués et conditionnés en Italie pouvaient porter les mentions « Made in Italy », « 100% Made in Italy » ou des appellations équivalentes. Ce cadre normatif concernait un petit nombre de produits non alimentaires.
En 2010, l'adoption de loi Reguzzoni (n. 55 du 8 avril 2010) visait à renforcer l'identification nationale pour certains secteurs stratégiques de l'économie italienne : les produits textiles, la maroquinerie et les chaussures. Elle prévoyait l'utilisation de l'indication « Made in Italy » exclusivement pour les produits finis dont les phases de transformation, telles que définies par la loi elle-même, s'étaient déroulées principalement sur le territoire national et, en particulier, si au moins deux des phases de transformation pour chaque secteur avaient été effectuées sur le même territoire et si, pour les phases restantes, la traçabilité pouvait être vérifiée. Chaque produit qui n'avait pas droit à l'indication « Made in Italy » devait néanmoins indiquer l'État d'origine, conformément à la législation communautaire.
Cependant, cette loi a été notifiée à la Commission européenne qui, par note de la direction générale des entreprises et de l'industrie n° 518763 du 28 juillet 2010, a émis un avis défavorable à sa compatibilité avec le droit communautaire, compte tenu des restrictions qu'elle pourrait apporter à la concurrence et à la libre circulation des marchandises sur le territoire européen. En particulier, la Commission a estimé qu'aucun État membre ne pouvait adopter de manière autonome des méthodes techniques de détermination de l'origine différentes des méthodes européennes, car cela reviendrait à entraver la libre circulation des produits. En raison de ce jugement négatif des institutions européennes, les décrets d'application n'ont jamais été adoptés.
Le nouveau gouvernement Meloni a souhaité relancer cette politique de promotion des produits nationaux.
Un Ministère des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT) a été créé en 2021 dans le cadre de la réorganisation gouvernementale italienne afin de fusionner plusieurs ministères, notamment ceux de l'Industrie et du Développement économique. Ce nouveau ministère a pour objectif de soutenir l'innovation, la compétitivité et la promotion des produits « Made in Italy ». Il a été confié à Adolfo Urso, que vos rapporteurs ont rencontré lors de la remise des Farnèse d'Or à l'Ambassade de France, le 5 juin.
Il s'appuie sur l'Istituto Tutela Produttori Italiani (ITPI), fondé en 1999, association dédiée à la protection, la valorisation et la délivrance de la marque « 100% made in Italy - Sistema IT01 ». Cette marque vise à confirmer la valeur du produit de qualité d'origine véritablement italienne. Selon son site : « Ceux qui ne fabriquent pas un produit de valeur entièrement réalisé en Italie ne pourront jamais se prévaloir de la certification 100% Made in Italy ». L'entreprise qui demande la certification doit déclarer répondre aux exigences de production « entièrement italienne, de produits semi-finis italiens, de matériaux de première qualité, d'un style propre, et d'un travail artisanal traditionnel typique ». La certification est délivrée par l'Institut pour la Protection des Producteurs Italiens. L'instruction et la gestion des relations avec l'entreprise pour la certification sont effectuées par Promindustria S.p.A. L'Institut effectue des inspections sur place préventives et périodiques, directement par l'Institut ou par des organismes ou professionnels externes spécialement délégués. Le site internet de l'ITPI affirme que cette certification permet de « plus grands avantages pour les entreprises sur les appels d'offres régionaux, étatiques et communautaires d'aides ».
La loi du 27 décembre 2023 « dispositions organiques pour la valorisation, la promotion et la protection des produits fabriqués en Italie » comporte 59 articles et se veut une loi-cadre de la protection du patrimoine productif italien avec :
· Une journée nationale (le 15 avril) du « Made in Italy », afin de promouvoir « la créativité et l'excellence italiennes ». Il s'agit cependant d'une journée de communication gouvernementale : les opérateurs économiques rencontrés par vos rapporteurs ont indiqué que la grande distribution promouvait toute l'année les produits italiens.
· Une protection des marques historiques de plus de 50 ans en déshérence : le MIMIT pourra reprendre gratuitement la propriété d'une marque historique si le propriétaire a l'intention de cesser définitivement son activité, ne l'a pas vendue à des tiers et l'a notifié au MIMIT en indiquant les raisons économiques, financières ou techniques de l'abandon d'activité. Pour les marques qui n'ont pas été utilisées depuis au moins 5 ans, le MIMIT peut redéposer une demande d'enregistrement de la marque en son nom propre, avec frais d'enregistrement à sa charge, via le fonds stratégique. Le ministère est autorisé à utiliser ces marques « exclusivement en faveur des entreprises, y compris étrangères, qui ont l'intention d'investir en Italie ou de transférer en Italie des activités de production situées à l'étranger ».
· La création d'un fonds souverain, doté de 1 milliard d'euros en 2023 et 2024. Toutefois, son objectif est moins le soutien au « Made in Italy » que « le renforcement et la revitalisation des chaînes d'approvisionnement nationales stratégiques, en faisant également référence aux activités d'approvisionnement et de réutilisation des matières premières critiques pour l'accélération des processus de transition énergétique et le développement de modèles d'économie circulaire »51(*). Il pourra investir dans le capital des entreprises nationales à fort potentiel ou d'importance systémique, pouvant générer des retombées positives pour le pays et réduire les coûts de coordination entre les acteurs des filières impliquées. Ses interventions ne devront pas être contraires aux règles européennes sur les aides d'État et il ne pourra prendre que des participations minoritaires. Cependant, nos interlocuteurs ont indiqué que ce fonds n'avait pas encore été activé.
· La création d'une marque officielle pour certifier l'origine italienne des marchandises, mais sur une base volontaire et « dans le respect de la réglementation douanière européenne relative à l'origine des produits ». L'objectif est de créer une « carte de sécurité » produite par l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Réalisée à l'aide de techniques de sécurité ou de papier filigrané, elle garantit une protection adéquate contre la contrefaçon et la falsification, opposable aux tiers car la marque « 100 % made in Italy - Sistema IT01 » n'a qu'une valeur contractuelle. Les mesures d'application font actuellement l'objet d'une concertation avec les acteurs économiques. Cette disposition suppose au préalable la définition d'un produit « italien ». Selon le MIMIT, la définition s'effectuera en référence à la notion de valeur ajoutée, laquelle devrait être supérieure à 60 % mais variera selon les produits. Cependant, la Confindustria, fédération de 200 associations regroupant 150 000 entreprises de tous les secteurs, excepté la banque, s'est montré sceptique sur la faisabilité de ce processus et opposé au monopole d'un organisme certificateur comme à toute perspective de marquage obligatoire qui imposerait aux entreprises et particulièrement aux PME des coûts administratifs élevés pour garantir la traçabilité des composants des produits fabriqués, lesquels n'ont pas tous besoin d'une indication de leur origine nationale. Celle-ci devrait être réservée aux produits dont la valeur ajoutée « nationale » permet de faire la différence sur le marché mondial. En effet, il n'existe pas toujours de lien entre l'origine et la qualité d'un produit et « la certification de l'origine d'un produit peut constituer un obstacle à la concurrence ». Il faut s'appuyer au contraire sur les indications géographiques protégées, désormais possibles pour les produits manufacturés, car elles émanent des professionnels, sont construites par eux et constituent de vrais facteurs de compétitivité.
· La création d'un réseau de lycées dans les régions, pour former la jeunesse aux métiers d'excellence italiens alliant tradition (sciences humaines) et innovation (matières STEM Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) et favoriser l'accès des jeunes à l'emploi en créant des ponts entre les mondes scolaires et des entreprises via la « Fondation pour l'entreprise et les compétences », également responsable de l'exposition nationale permanente du « Made in Italy ». Initialement prévus pour fonctionner à partir de la rentrée 2025, leur déploiement a pris du retard.
La loi de 2023 a également renforcé la lutte contre la contrefaçon. Elle a étendu le délit de vente de produits industriels avec des signes trompeurs, aux personnes qui détiennent des contrefaçons et a permis la saisie des objets contrefaits. Lorsqu'une saisie de produits de masse est opérée, la loi simplifie le code de procédure pénale afin de prévoir que la « liste » des objets saisis peut être remplacée par « leur catalogage par type et que la quantité peut être indiquée par la masse, le volume ou le poids ». Signe de la prise en compte de la contrefaçon comme nouvelle filière - très lucrative et pénalement peu punie - du crime organisé international, elle permet également les opérations d'infiltration (acquisition de produits contrefaits pour remonter les filières).
L'Italie se caractérise en effet par la puissance de la Guardia di Finanza, forte de 63 000 hommes qui luttent contre le criminalité économique et financière et dispose à cet effet d'une compétence nationale et transversale lui permettant de lutter contre toute une filière économiquement intégrée, allant jusqu'au contrôle fiscal et à la saisie des comptes bancaires, point faible des réseaux criminels. La criminalité de la contrefaçon s'est en effet globalisée et industrialisée. Plus de 800 000 tonnes de produits sont importées chaque année pour le seul aéroport de Milan qui alimente toute l'Europe du Sud. Les saisies ont représenté en Italie, depuis janvier 2024, plus de 800 000 produits contrefaits pour un montant de 1,3 milliard d'euros, selon les informations transmises par les interlocuteurs italiens.
La tendance actuelle est de relocaliser la contrefaçon en Europe avec la création d'usines ou d'entrepôts clandestins notamment à Prato, ville de 200 000 habitants qui compte 4 600 PME gérées par des ressortissants chinois, employant 50 000 travailleurs clandestins dans des conditions sociales indignes. La lutte contre la contrefaçon passe, en Italie, par des campagnes d'information mais aussi la pénalisation des consommateurs (1 942 amendes prononcées en quinze mois), par la saisine du parquet anti-mafia en cas de contrebande en bande organisée, par le déploiement du Système d'information anti-contrefaçon, et, en Europe, par le renforcement de la coopération douanière (laquelle est très insuffisante avec la Belgique ou les Pays-Bas). Une extension de la compétence du Parquet européen serait appropriée.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° |
Recommandations |
Acteurs concernés |
Support |
|
1 |
Définir le « fabriqué en France » comme un produit dont la majorité de la valeur ajoutée a été créée sur le territoire national et non plus comme la dernière transformation substantielle |
Gouvernement |
Loi |
|
2 |
Maintenir le caractère facultatif du marquage de l'origine de fabrication des produits non alimentaires |
Sans objet |
Sans objet |
|
3 |
Regrouper progressivement les labels et certifications publics et privés sous un label unique « fabriqué en France » |
Gouvernement |
Concertation avec les parties prenantes Véhicule réglementaire |
|
4 |
Réserver aux produits dont la majorité de la valeur est ajoutée en France, l'exclusivité de l'apposition du drapeau français, et considérer que le fait d'apposer ou de faire apparaître un drapeau français sur un produit vendu en France qui n'est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse |
Loi |
Insertion au code de la consommation d'un article L. 121-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-2-1.- Le fait d'apposer ou de faire apparaitre un drapeau français sur un produit vendu en France qui n'est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse ». |
|
5 |
Créer une plateforme en ligne unique exclusivement réservée aux produits « fabriqués en France » |
Acteurs économiques |
Association loi 1901 |
|
6 |
Rendre obligatoire au niveau européen le marquage de l'origine de production des produits importés et commercialisés dans l'Union européenne |
Institutions de l'Union européenne Gouvernement |
Règlement européen Loi |
|
7 |
Confier aux comités stratégiques de filières l'élaboration d'une stratégie industrielle de relocalisation, en donnant la priorité aux produits identifiés comme en situation de vulnérabilité d'approvisionnement, avec la création de zones franches ayant une fiscalité allégée |
Gouvernement |
Conseils stratégiques de filières avec l'appui du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan |
|
8 |
Étendre aux produits industriels le principe des clauses miroirs afin d'appliquer aux produits importés les mêmes règles environnementales et sociales |
Union européenne |
Critère à instituer lors des négociations relatives aux accords commerciaux multilatéraux |
|
9 |
Saisir l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 461-2 du code de commerce, du sujet des reventes à perte de la part des plateformes de commerce en ligne, notamment chinoises |
Saisine de la commission des Affaires économiques du Sénat |
Consultation de l'Autorité de la concurrence |
|
10 |
Demander à l'Union européenne de lancer une procédure antidumping contre les plateformes de commerce en ligne chinoises et d'enquêter sur des subventions octroyées par des pays non membres de l'UE à des entreprises actives sur son territoire, afin de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union européenne |
Union européenne |
Mise en oeuvre des règlements (UE) 2016/1036, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et 2016/1037, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne. |
|
11 |
Refonder la politique concurrentielle européenne afin d'intégrer la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne de réduction de la dépendance dans des domaines stratégiques |
Union européenne |
Mise à jour de la politique de la concurrence afin de renforcer la résilience du marché unique |
|
12 |
Mettre en oeuvre rapidement l'amendement du Sénat qui soumet à un minimum de droits de douanes tout colis extra-communautaire de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos |
Union européenne |
Réforme de l'union douanière à réaliser avant le 31 décembre 2025 |
|
13 |
Étendre la taxe carbone (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières) aux produits de consommation courante |
Union européenne |
Révision du mécanisme d'ajustement à la frontière pour le carbone (2025)52(*) |
|
14 |
Réorienter les contrôles de la DGCCRF et des Douanes vers le commerce en ligne extra-communautaire, en priorisant le contrôle de la sécurité des consommateurs |
Gouvernement |
Circulaire |
|
15 |
Sensibiliser les places de marché (marketplaces) à la mise en avant du « fabriqué en France », notamment à l'occasion du « Black Friday », et au déréférencement des entreprises qui fraudent sur l'origine des produits (« francolavage ») |
Acteurs des marchés en ligne |
Charte éthique |
|
16 |
Assimiler la contrefaçon à une non-conformité du produit, dans le cadre de l'application du règlement relatif à un marché unique des services numériques (DSA) et du règlement sur les marchés numériques (DMA) |
Gouvernement |
Intégration, dans le décret d'application de l'article 495-25 du code de procédure pénale, de la fraude sur une allégation de produit « fabriqué en France » |
|
17 |
Créer une amende délictuelle forfaitaire en cas de fraude sur une allégation de produit fabriqué en France, pour les vendeurs comme pour les acheteurs |
Loi |
Ajout au code de la consommation et au code de procédure pénale |
|
18 |
Autoriser le blocage des sites « miroirs » afin de lutter contre la multiplication des pages d'Internet proposant des contrefaçons |
Loi |
Disposition s'inspirant de l'article L.331-27 du code de la propriété intellectuelle |
|
19 |
Augmenter les moyens de la DGCCRF et des Douanes en étendant leur compétence en matière de police judiciaire afin de mieux lutter contre le « francolavage » |
Loi |
Modifications du Code des douanes Code de procédure pénale |
|
20 |
Faire de la contrefaçon une priorité de l'Office européen de lutte anti-fraude, rendre compétent le Parquet européen, renforcer la coopération douanière notamment avec la Belgique et les Pays-Bas |
Commission et Conseil européen |
Communication du Commissaire européen au commerce et à la sécurité économique au Conseil européen53(*). Modification du Règlement (UE) 2017/1939 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Modification de la décision 1999/352/CE de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude. |
|
21 |
Diviser par dix le nombre de pouvoirs adjudicateurs (actuellement 135 000), en les mutualisant |
Collectivités locales |
Accords des pouvoirs adjudicateurs locaux en faveur de leur mutualisation |
|
22 |
Mesurer la part importée de la commande publique |
Observatoire de la commande publique |
Intégration de l'origine des produits dans la liste des données essentielles (arrêtés modifiés du 22 décembre 2022) |
|
23 |
Imposer les appels d'offre hors taxe pour les marchés dans lesquels peuvent se présenter des entreprises extra-communautaires |
Gouvernement |
Précision à l'article 10-3-1 du Cahier des clauses administratives générales54(*) |
|
24 |
Assurer un contrôle des engagements sociaux et environnementaux pris par les entreprises ayant remporté un marché public |
Gouvernement |
Précision à insérer à l'article 10.1.3. du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 |
|
25 |
Faire du critère bas-carbone un levier en faveur des circuits d'approvisionnements territoriaux courts |
Loi |
Préciser, dans les instructions d'application de l'article L. 3-1 du code de la commande publique, que l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, s'apprécie en favorisant les circuits d'approvisionnements territoriaux courts |
|
26 |
Transférer la tutelle de l'UGAP au ministère de l'Industrie |
Gouvernement |
Modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) |
|
27 |
Informer, par des campagnes régulières de sensibilisation, les consommateurs des conséquences sur leur santé et leur sécurité, sur l'impact social et environnemental (conditions sociales de production inacceptables, bilan carbone désastreux) des produits importés |
Gouvernement |
Service d'information du Gouvernement en co-pilotage avec les organisations patronales et consulaires et les fédérations professionnelles |
|
28 |
Stigmatiser et dénoncer les entreprises qui pratiquent le « francolavage » |
Gouvernement |
Sites des ministères économiques |
* 1 Signes visibles sur un produit qui suggèrent que la fabrication est française sans l'affirmer concrètement, tels que des drapeaux tricolores.
* 2 « Le grand basculement : quand l'entreprise devient rempart », The Arcane et Fondation Jean Jaurès, 17 avril 2025.
* 3 « Made in France : un engouement grandissant rattrapé par les réalités économiques », Caisse des dépôts, 13 janvier 2025.
* 4 Ainsi, en 2005, 54 % des plus de 60 ans étaient prêts à payer un surcoût pour consommer des produits français, contre seulement 34 % des moins de 25 ans et 36 % des 25-39 ans. Cet écart entre tranches d'âge s'est estompé et ne s'observe plus en 2020, année où 67 % des moins de 25 ans et 68 % des 25-39 ans sont prêts à payer plus pour consommer français pour 69 % des 70 ans et plus.
* 5 Défini comme l'ingrédient entrant pour 50 % ou plus dans la composition d'une denrée ou le / les ingrédients qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par le consommateur. Si l'étiquetage d'un gâteau revendiquant une origine française alors que la farine mise en oeuvre dans sa fabrication ne serait pas produite en France, l'étiquetage doit renseigner le consommateur sur l'origine de la farine.
* 6 Les noix, noisettes, amandes, pistaches, etc. sans coques, le safran, les fruits séchés : pruneaux, abricots secs, raisins secs, figues sèches, les produits sommairement préparés (exemple : blanc de poireaux, demi-choux), les produits prêts à l'emploi dits « fraîche découpe ».
* 7 https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_fr
* 8 Enquête réalisée par LSA en octobre 2023 et administrée auprès d'un panel de 1 000 répondants représentatif de la population françaises pour Appinio, société d'étude de marchés.
* 9 Un label correspond à une marque protégée qui dispose d'un logo et d'un nom et qui garantit l'origine ou les conditions de fabrication du produit. Il est généralement créé par des organismes publics, des organisations professionnelles, des associations ou par une démarche privée. Pour son obtention, l'entreprise doit répondre aux exigences du cahier des charges de l'organisme qui a créé le label en question. La qualité du label dépend des garanties décrites dans le cahier des charges. Il faut distinguer les labels privés dits « auto-déclaratifs », sous la seule responsabilité de celui qui l'appose sur le produit, des labels « contrôlés ou certifiés » par un organisme tiers indépendant. Ils peuvent être assimilés à de la certification mais ne peuvent pas bénéficier de cette appellation en France, selon le code de la consommation.
La certification, quant à elle, a pour but d'évaluer la conformité d'un produit, d'un service ou d'une organisation aux critères mis en avant dans le cahier des charges, qu'il soit public ou privé. Comme précisé dans le guide pratique des allégations environnementales, « la certification en France est une procédure réglementée, et doit être conforme aux articles L. 433-1 et suivants du code de la consommation ». Par opposition aux labels simples ou auto-déclaratifs, les certifications sont obligatoirement délivrées par un organisme indépendant, comme Ecocert, de manière à garantir l'impartialité la plus totale. Par ailleurs, ce dernier est accrédité par les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'un audit annuel est réalisé par une autorité qui intervient pour s'assurer de la compétence de l'organisme certificateur. À noter que le processus de vérification du bon respect du cahier des charges dit processus de certification s'effectue en plusieurs étapes : un ou plusieurs audits sur le terrain est réalisé par un auditeur qui s'assurera de la conformité des pratiques et du respect du cahier des charges, suivi d'une revue indépendante par un chargé de décision de certification, pour pouvoir décerner la certification.
* 10 Article L. 121-4 du code de la consommation
* 11 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000044563107/2022-05-28/
* 12 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225327
* 13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042615686
* 14 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7702892
* 15 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cecifccpi/l15b4923_rapport-enquete*
* 16 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-11/20241128-10-ans-de-politiques-publiques-en-faveur-industrie.pdf
* 17 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-10/20241029-S2024-1037-Comite-economique-des-produits-de-sante-CEPS.pdf
* 18 Personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, généralement entre 1997 et 2012.
* 19 Mot masculin provenant du terme anglais « duplicate ».
* 20 Union des Fabricants pour la promotion et la défense du droit de la propriété intellectuelle.
* 21 Courrier du 14 février 2023, également signé par l'Alliance du Commerce, la Fédération française de la franchise et la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison.
* 22 https://www.uscc.gov/sites/default/files/2023-04/Issue_Brief-Shein_Temu_and_Chinese_E-Commerce.pdf
* 23 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3650_rapport-information#_Toc256000000
* 24 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20200303-lutte-contre-les-contrefacons_0.pdf
* 25 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cec/l16b1846_rapport-information#_Toc256000049
* 26 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-222.html
* 27 La Commission européenne a ainsi désigné les dix-sept grandes plateformes (AliExpress, Amazon Store, App Store, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube, Zalando) et les deux très grands moteurs de recherche en ligne concernés (Bing et Google Search).
* 28 Alphabet (Google, Chrome, Android, Youtube), Amazon, Apple (iOS, Safari, App Store), ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) et Microsoft (Windows, LinkedIn).
* 29 Les entreprises sont de plus en plus souvent des distributeurs.
* 30 Notamment au regard des lignes directrices de la Commission pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics, du 14 mai 2019.
* 31 Mécanisme de préférence prévu par la directive de 2014 « secteurs spéciaux » (eau, énergie, transports et secteurs postaux), règlement du 23 juin 2022 instaurant l'instrument relatif aux marchés publics internationaux, règlement d'exécution du règlement (UE) 2022/2560 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
* 32 Pour les lots dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens
* 33 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dae/doc/guide_thematique_insertion_VF.pdf?v=1698053361
* 34 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/aspects-sociaux/Guide-aspects%20sociaux_vf.pdf?v=1700649144
* 35 Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour obtenir cette protection : (i) le produit doit être originaire d'un lieu déterminé ; (ii) la qualité du produit, sa réputation ou une autre propriété est attribuée à son origine géographique ; (iii) une étape de production au minimum est réalisée dans l'aire géographique délimitée. Les produits artisanaux protégeables doivent notamment nécessiter une contribution manuelle directe. Plus de 800 produits européens seraient potentiellement protégés.
* 36 Type de code-barres à deux dimensions, constitué de modules-carrés noirs disposés dans un carré à fond blanc, qui définissent l'information que contient le code.
* 37 Technologie de communication sans fil de courte portée permettant à deux appareils équipés de cette fonctionnalité d'échanger des données en les approchant à quelques centimètres l'un de l'autre.
* 38 Utilisation d'ondes électromagnétiques pour lire l'identité d'un marqueur, ainsi que toute autre information pouvant y être stockée.
* 39 Par exemple à partir des 9 304 produits identifiés par le Haut-Commissariat au Plan et des 644 produits identifiés par le Conseil d'analyse économique, voir le rapport : « Reconquête de l'appareil productif : la bataille du commerce extérieur », de décembre 2021.
* 40 https://videos.senat.fr/video.5319109_6810c4165435a
* 41 En application du Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et en complément de la procédure lancée le 27 mai pour pratiques trompeuses ou abusives.
* 42 En application du Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
* 43 Sur 5 200 produits importés dans l'Union, la Commission en a identifié 137 pour lesquels l'UE était très dépendante - la moitié provenant de Chine.
* 44 Selon le rapport de l'Assemblée nationale n° 1846 du 9 novembre 2023 d'évaluation de la lutte contre la contrefaçon.
* 45 Voir le rapport d'information n° 45 du 12 octobre 2022 de la commission des finances sur l'organisation et les moyens de la Douane face au trafic de stupéfiants.
* 46 Il a actuellement le pouvoir d'enquêter et d'engager des poursuites au sujet d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Il peut mener des enquêtes transfrontières sur des fraudes concernant des fonds européens d'un montant supérieur à 10 000 euros ou sur des cas de fraude transfrontière à la TVA entraînant un préjudice supérieur à 10 millions d'euros.
* 47 https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/structures-temporaires/commissions-denquete/commission-denquete-sur-les-couts-et-les-modalites-effectifs-de-la-commande-publique-et-la-mesure-de-leur-effet-dentrainement-sur-leconomie-francaise.html
* 48 « En cas de doute sur le taux de TVA applicable à la lecture des documents du marché, les candidats ont tout intérêt à éclaircir ce sujet, dès la phase de négociations ou, à défaut, au travers de questions formulées dans les conditions et délais prévues par dans la procédure. Devant ce dilemme, et à défaut d'avoir obtenu de réponse satisfaisante du pouvoir adjudicateur lors des négociations, une seconde solution pour le candidat serait de s'aligner sur le taux de TVA suggéré par l'acheteur : il n'altère alors pas ses chances d'attribution du marché mais se met en risque pour l'avenir, cette fois, vis-à-vis de l'administration fiscale. En effet, une fois les mailles de la procédure de passation passées, l'erreur sur le taux de TVA applicable peut toujours être relevée par l'administration fiscale lors d'un contrôle fiscal du candidat attributaire. Dans ce cas, si l'administration considère qu'un taux de TVA supérieur à celui facturé par l'attributaire aurait dû être appliqué, les rappels de TVA notifiés seront calculés en dedans du prix effectivement encaissé auprès de l'acheteur (CE 14 décembre 1979, n° 11798, Comité de propagande de la banane) ». Voir « De l'importance de la détermination du taux de TVA lors de la passation de marchés publics », Margaux Tripier, 10 septembre 2024.
* 49 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/media-document/Clausier%20g%C3%A9n%C3%A9ral_DD.pdf?v=1746809743
* 50 Le fait de déclarer publiquement qu'une entreprise agit de manière fautive.
* 51 Dossier parlementaire AC 1341-A du 1er décembre 2023.
* 52 Cette réforme est évoquée dans le calendrier détaillé des initiatives prévues dans le cadre de la « Boussole pour la compétitivité » : Axe n° 2 : feuille de route commune pour la décarbonation et la compétitivité.
* 53 Afin de donner des instructions à la direction générale « Fiscalité et Union douanière » (DG TAXUD) et au Comité du Code des douanes.
* 54 Pour ce qui concerne les fournitures courantes et de services (arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics les concernant).