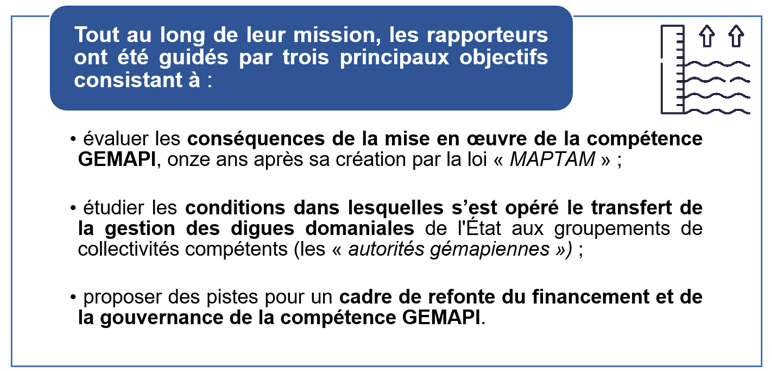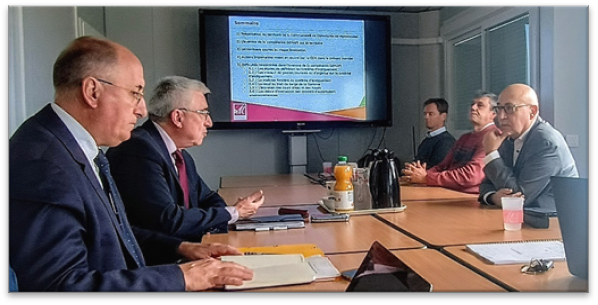N° 793
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juin 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation (1)
relatif à la
compétence
« gestion des
milieux aquatiques
et
prévention des
inondations »
(GEMAPI),
Par MM. Rémy POINTEREAU, Hervé GILLÉ et Jean-Yves ROUX,
Sénateurs
(1) Cette délégation est composée de : M. Bernard Delcros, président ; M. Rémy Pointereau, premier vice-président ; M. Fabien Genet, Mme Pascale Gruny, M. Cédric Vial, Mme Corinne Féret, MM. Éric Kerrouche, Didier Rambaud, Pierre Jean Rochette, Gérard Lahellec, Grégory Blanc, Mme Guylène Pantel, vice-présidents ; MM. Laurent Burgoa, Jean Pierre Vogel, Hervé Gillé, Mme Sonia de La Provôté, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, MM. François Bonhomme, Max Brisson, Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Cédric Chevalier, Thierry Cozic, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Daniel Gueret, Joshua Hochart, Patrice Joly, Mmes Muriel Jourda, Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël, M. Olivier Paccaud, Mme Anne-Sophie Patru, MM. Hervé Reynaud, Jean-Yves Roux, Mmes Patricia Schillinger, Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Jean-Marie Vanlerenberghe.
L'ESSENTIEL
LA COMPÉTENCE « GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS »
(GEMAPI)
|
Pourquoi ce contrôle ?
Onze ans après la création de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) par la loi « MAPTAM » 1(*), les préoccupations restent vives quant aux modalités concrètes de son exercice, confié à des groupements de collectivités trop souvent démunis pour assumer les lourdes responsabilités qui leur incombent.
À l'heure de conclure un travail qui les aura conduits à entendre quelque 120 personnes, à la faveur de 35 auditions et de 3 déplacements dans 4 départements (Alpes de Haute-Provence, Cher, Gironde, Lot-et-Garonne), les rapporteurs proposent 13 pistes concrètes pour adapter l'exercice de la compétence GEMAPI à la réalité des territoires et simplifier l'action des élus locaux.
I. LA COMPÉTENCE GEMAPI : UN CADRE JURIDIQUE INABOUTI ET INSUFFISAMMENT ADAPTÉ AUX RÉALITÉS TERRITORIALES
La compétence GEMAPI - confiée à titre obligatoire, depuis le 1er janvier 2018, au bloc communal2(*) - est née sans étude d'impact3(*). Sa définition, qui repose sur une approche par les missions (items 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement) plutôt que par les finalités, continue de susciter des interrogations4(*).
De nombreux élus alertent sur les charges induites par la gestion des systèmes d'endiguement, fragilisant les finances locales et - in fine - la sécurité des personnes et des biens. En Savoie, les 90 kilomètres de digues confiés au Syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie (SISARC) nécessitent par exemple près de110 millions d'euros de travaux. Le long de la Garonne, la rénovation d'un kilomètre de digues coûte de l'ordre d'un million d'euros.
Visite en Gironde : rencontre avec le Président et les élus de la communauté de communes de Montesquieu
En outre, les « autorités gémapiennes » font face à des procédures fastidieuses et des délais d'instruction parfois excessifs. Les représentants de la communauté de communes de Montesquieu regrettent notamment que les « temps d'instruction fixés par le code de l'environnement [soient] très souvent largement dépassés », et s'inquiètent du « manque de disponibilité des bureaux d'études agréés, rendus obligatoires par la législation ainsi que pour la réalisation des études géotechniques ».
Une piste pourrait consister à créer un système d'agrément - délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) - afin de simplifier certaines procédures (autorisations environnementales, études de danger) des structures gémapiennes dotées d'une expertise en la matière (recommandation n°1). Les autorités gémapiennes dépourvues d'ingénierie pourraient quant à elles compter sur une offre d'ingénierie renforcée de la part, notamment, du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) - cf. recommandation n°9, infra.
Dans ce contexte, l'accélération des procédures relatives aux programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) constitue une priorité,5(*) d'autant que ces programmes permettent d'initier des démarches collectives contribuant à une gestion plus intégrée des enjeux hydrologiques.
Par ailleurs, l'inadéquation entre les exigences réglementaires et les réalités locales est parfois manifeste. À l'occasion de leur déplacement dans les Alpes de Haute-Provence, les rapporteurs ont pu constater les spécificités liées aux crues torrentielles en zone de montagne, les distinguant des inondations de plaine.
Audition à Colmars-les-Alpes
Dès lors, la mission appelle à moduler les exigences réglementaires (études de danger, procédures de déclaration d'intérêt général, autorisations) selon les enjeux locaux et les types de risques.
Visite dans les Alpes de Haute-Provence : les travaux de sécurisation de la digue du Grand Justin (Digne-les-Bains)
Les travaux de réfection de la digue du Grand Justin, fin 2024, ont doté la digue de fondations grâce à l'installation de blocs d'enrochement 2,5 mètres sous le lit de la rivière, pour éviter le creusement de la berge et un effondrement aux conséquences potentiellement dévastatrices. Provence Alpes Agglomération a financé cette opération avec le soutien de l'État au titre du Fonds Vert, pour un montant total d'environ un million d'euros.
Visite dans le Lot-et-Garonne : surmonter les rigidités réglementaires pour protéger plus rapidement les populations et les terrains agricoles
Val de Garonne Agglomération, classée territoire à risque important d'inondation (TRI), a été touchée par un épisode de crue décennale en février 2021. En principe, toute intervention sur les digues classées impose de recourir à un bureau d'études techniques (BET), menant une étude de prospection géotechnique qui aurait toutefois repoussé les travaux au-delà de la période de crue du printemps 2021. Pour réparer rapidement les brèches apparues dans les digues, Val de Garonne Agglomération a décidé de recourir à une procédure de marché public en urgence impérieuse. Les études géotechniques ont été menées a posteriori pour valider la solidité des réparations effectuées. L'intercommunalité a pu compter sur une aide financière de l'État, de la Région et de l'Agence de l'eau Adour Garonne.
* 1 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 2 Ainsi, la compétence revient aux communes avec un exercice d'office confié aux intercommunalités.
* 3 La compétence ne devait concerner, dans le texte du projet de loi initial, que la gestion des milieux aquatiques (« GEMA »), et non la prévention des inondations (« PI »).
* 4 Une foire aux questions de 176 pages, produite par deux ministères, aura ainsi été nécessaire pour répondre aux nombreuses interrogations des élus.
* 5 Les rapporteurs partagent les observations formulées par la mission conjointe de contrôle relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l'année 2024 déposée le 25 septembre 2024 par Jean-François Rapin et Jean-Yves Roux).