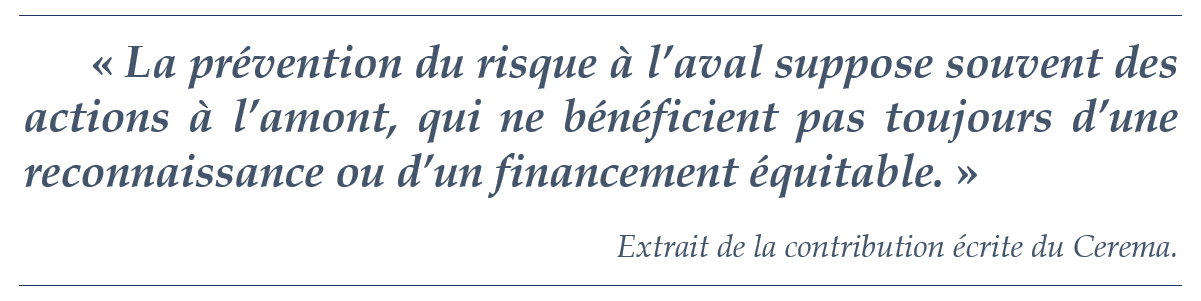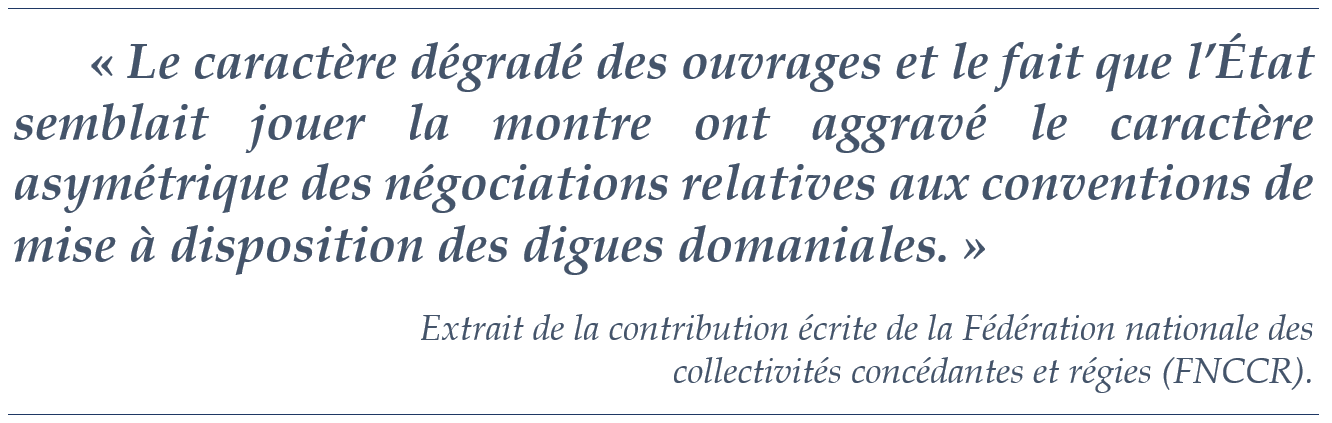II. UN MODE DE FINANCEMENT QUI PERPÉTUE LES INÉGALITÉS TERRITORIALES
La taxe GEMAPI, prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts (CGI), est une ressource affectée, facultative, plafonnée à 40 euros par habitant (au sens de la « population DGF »). En 2024, près de 75 % des EPCI l'avaient instaurée, pour un produit global de 458 millions d'euros.
Outre que ces montants restent largement insuffisants face à l'ampleur des besoins, en particulier pour financer les opérations lourdes - telles que la mise aux normes ou la reconstruction d'ouvrages de protection - le levier fiscal est limité du fait de la réduction de l'assiette fiscale résultant de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Le financement des actions de prévention des inondations tend en outre à préempter les budgets au détriment des actions de gestion des milieux aquatiques pourtant essentielles.
Surtout, la taxe GEMAPI reproduit, voire aggrave, les inégalités entre territoires. Les territoires d'amont - généralement plus ruraux, plus exposés et moins peuplés - peinent à réunir les fonds nécessaires, tandis que les intercommunalités urbaines et densément peuplées mobilisent aisément des ressources avec un taux faible.
Visite dans le Cher : digues et zone d'expansion des crues sur le territoire de la commune de Cuffy
La communauté de communes des Portes du Berry compte 10 000 habitants et 17 kilomètres de digues, ce qui représente une charge très importante (coûts de gestion et d'entretien). Parmi ce linéaire, le système d'endiguement du val du Guétin - Bec d'Allier couvre quelque 6,7 kilomètres et protège les 350 habitants de la commune de Cuffy.
Dans les zones de montagne, de la même manière, le potentiel fiscal des communes tend à diminuer à mesure que l'on progresse en altitude. En revanche, les métropoles situées en aval disposent souvent d'un potentiel fiscal bien supérieur, alors qu'elles bénéficient des travaux réalisés en amont.
III. UN POINT DE CRISPATION MAJEUR : LE TRANSFERT PRÉCIPITÉ ET ASYMÉTRIQUE DES DIGUES DOMANIALES
Le 29 janvier 2024, l'État transférait la gestion de 168 ouvrages domaniaux - représentant quelque 700 kilomètres de digues - aux EPCI « gémapiens ». Cette opération a été réalisée de manière précipitée, sur la base d'un décret d'application publié in extremis en novembre 2023, en dépit de la période transitoire de dix ans prévue par le législateur pour en préparer les modalités. La liste officielle des ouvrages transférés n'a été transmise que le 16 mai 2024.
À bien des égards, la situation s'apparente à un transfert de charges non compensé. Si la DGCL parle plus volontiers d'une « clarification de compétences », les mots utilisés par les élus témoignent d'un malaise profond. Le transfert chaotique de la gestion des digues a été assimilé à un « désengagement de l'État », quand il n'était pas qualifié de « scandaleux » ou d'« inacceptable ».
L'inscription des digues à l'actif des EPCI a également suscité de vives préoccupations. Dans le Cher, par exemple, les élus des communautés de communes de Berry-Loire-Vauvise, du Pays Fort-Sancerrois-Val de Loire et des Portes du Berry ont reçu, en novembre 2024, un courrier de l'État leur enjoignant de procéder à l'inscription de l'ensemble des digues transférées à leur actif, pour des montants s'élevant à plusieurs millions d'euros. Les élus ont expliqué aux rapporteurs être dans l'incapacité d'évaluer les effets financiers d'une telle décision, tant sur la soutenabilité de leurs budgets que sur leur capacité à investir dans d'autres domaines.
L'accès au taux bonifié de 80 % du fonds Barnier pour effectuer des travaux sur les digues domaniales est conditionné à la signature d'une convention avant le 28 janvier 2024 et à un engagement des dépenses avant 20276(*), jugé irréaliste par de nombreuses structures.
* 6 Seul le bassin de la Loire, dans le cadre de son plan d'aménagement d'intérêt commun (PAIC), est actuellement éligible à un taux bonifié jusqu'en 2035.