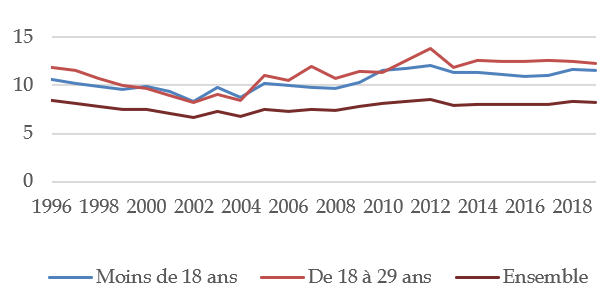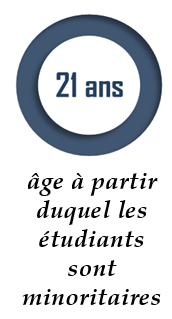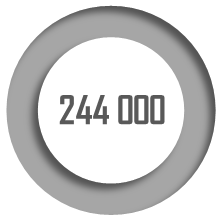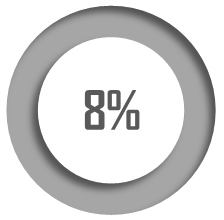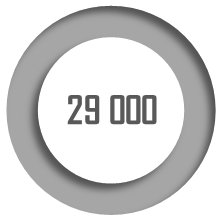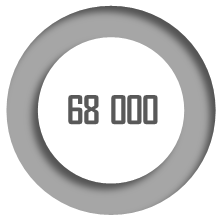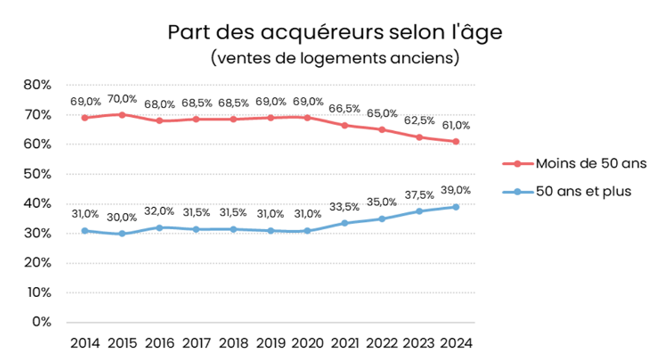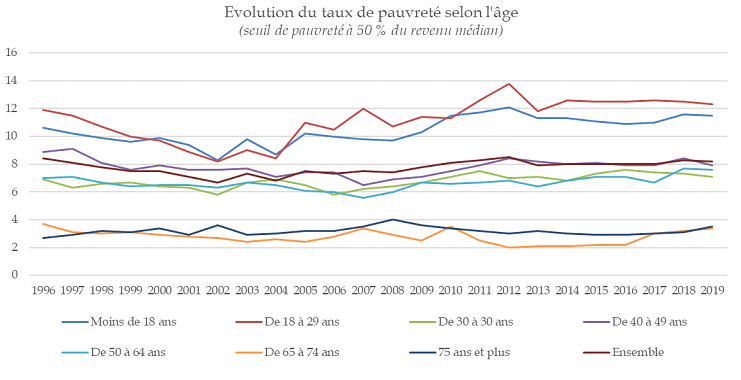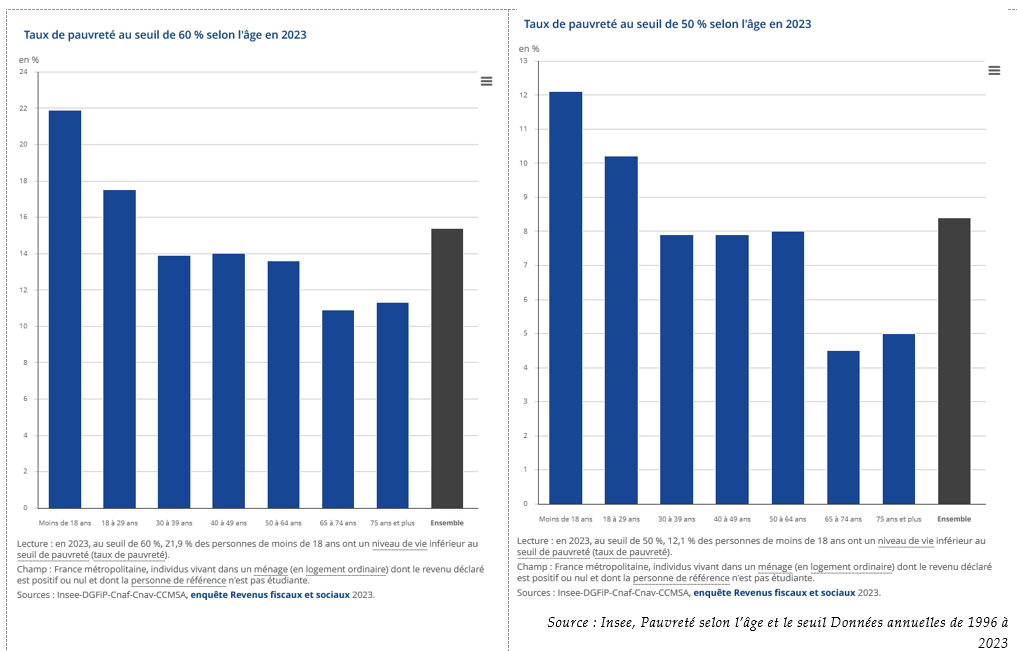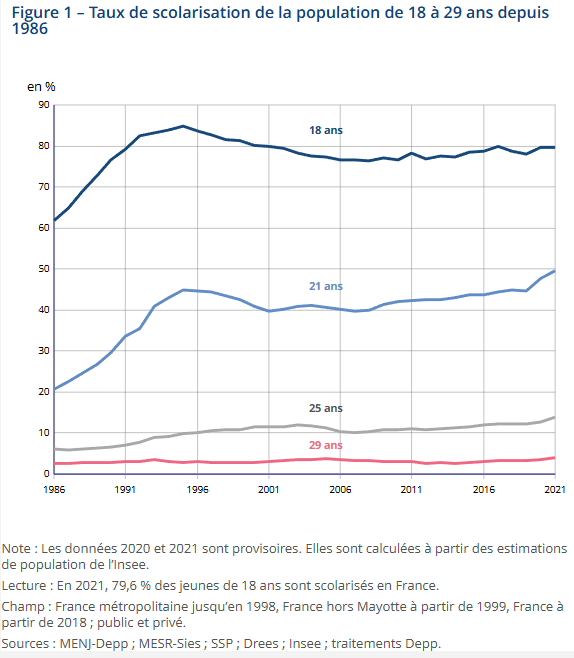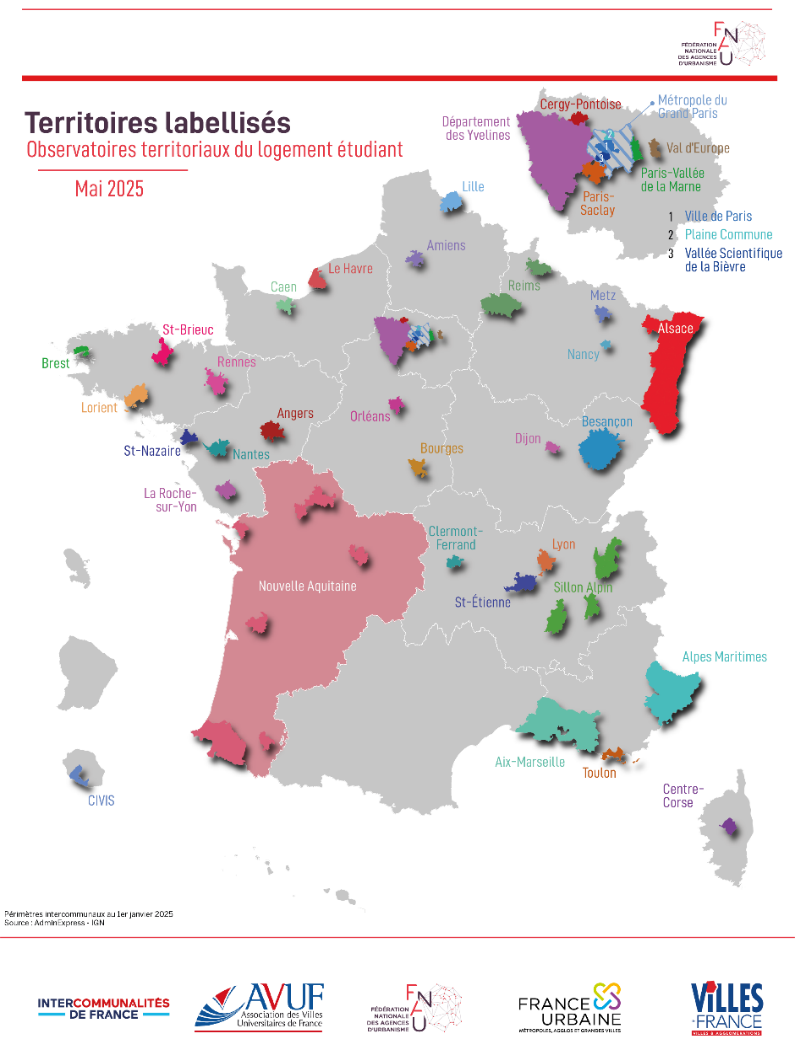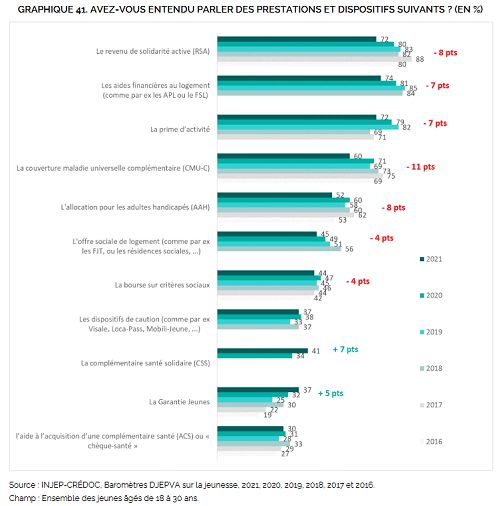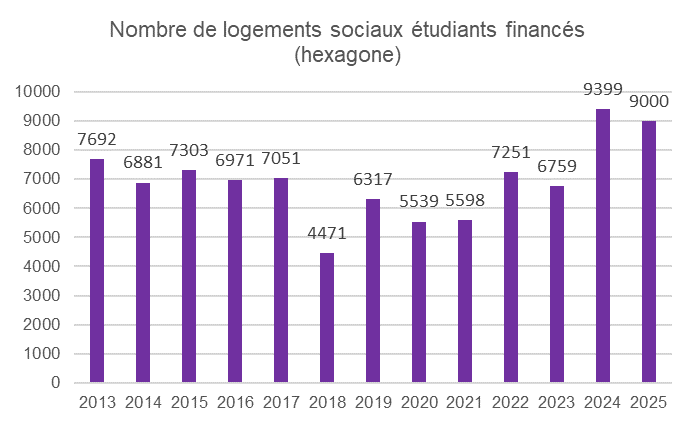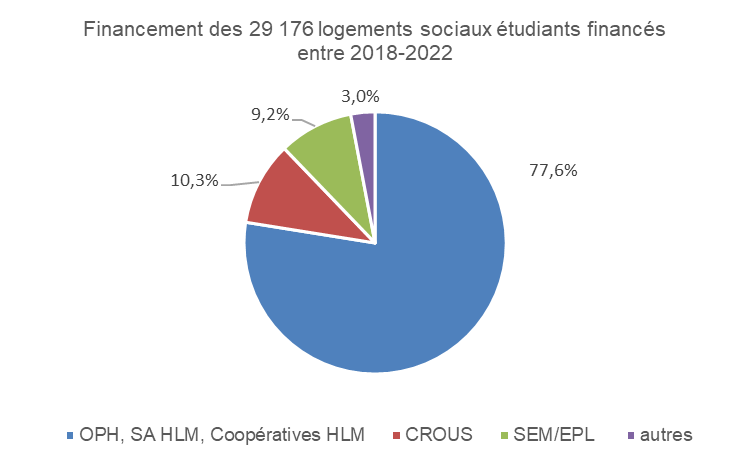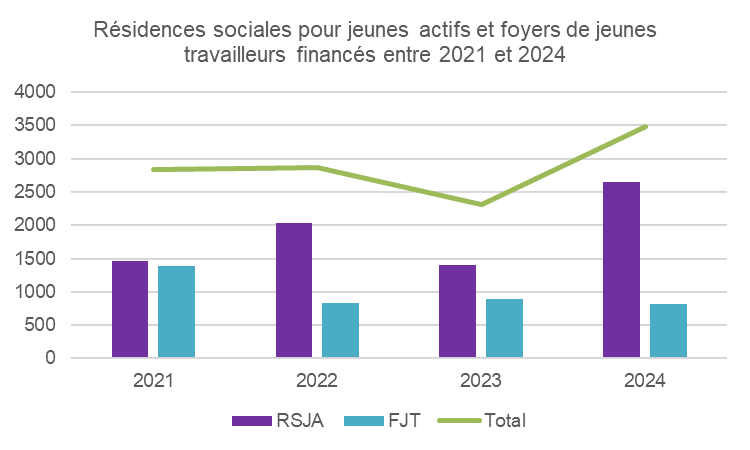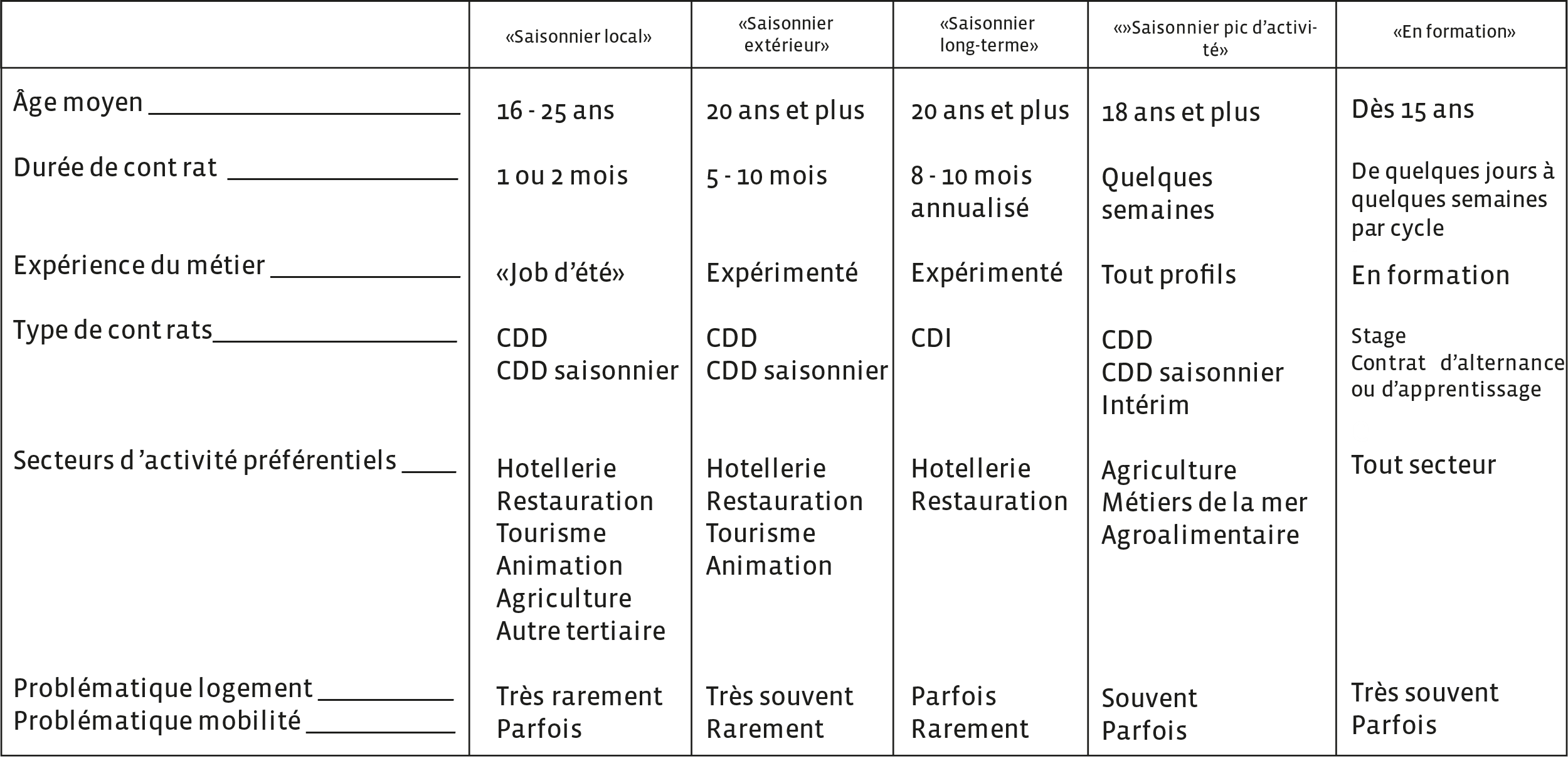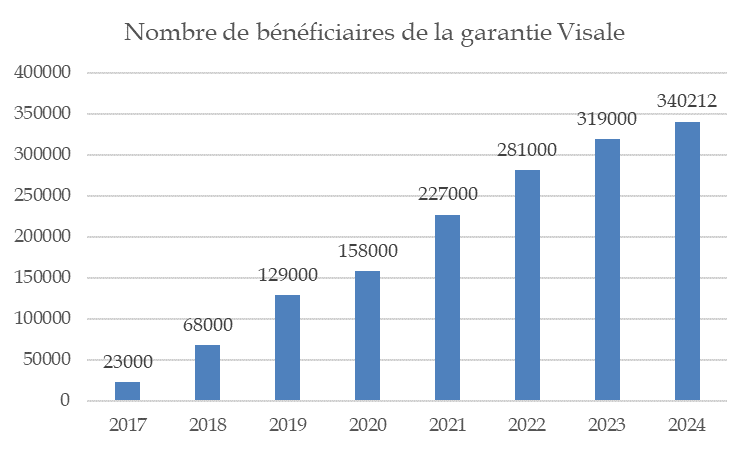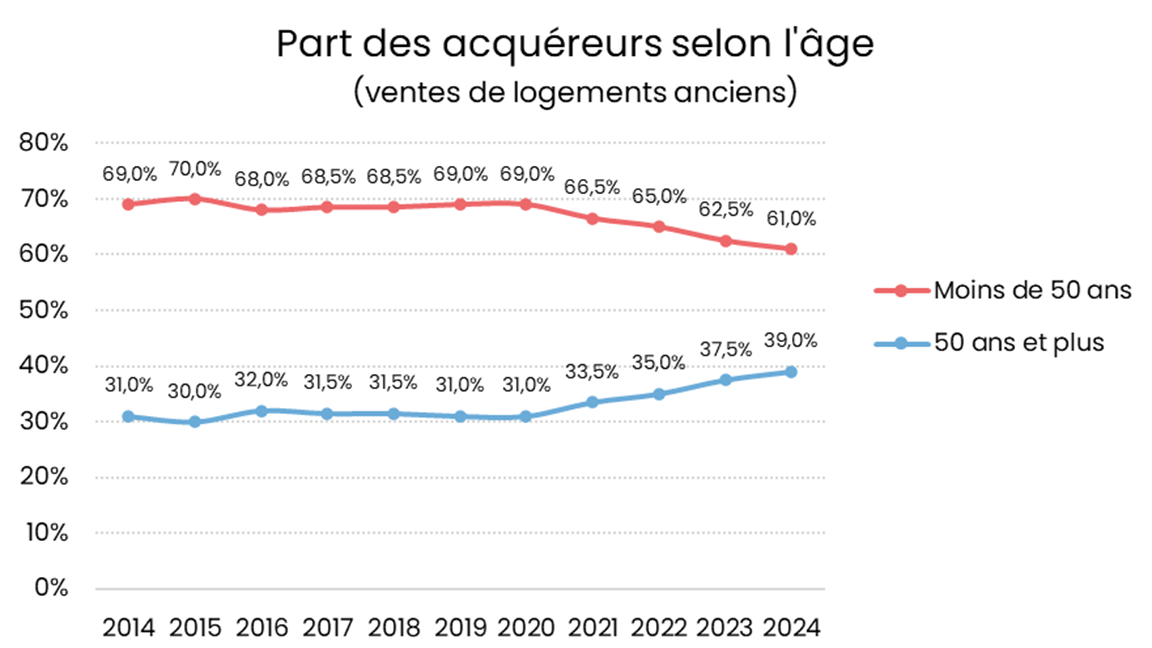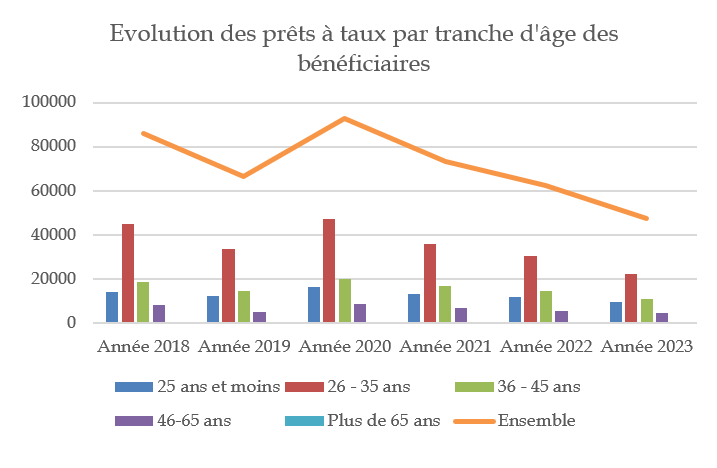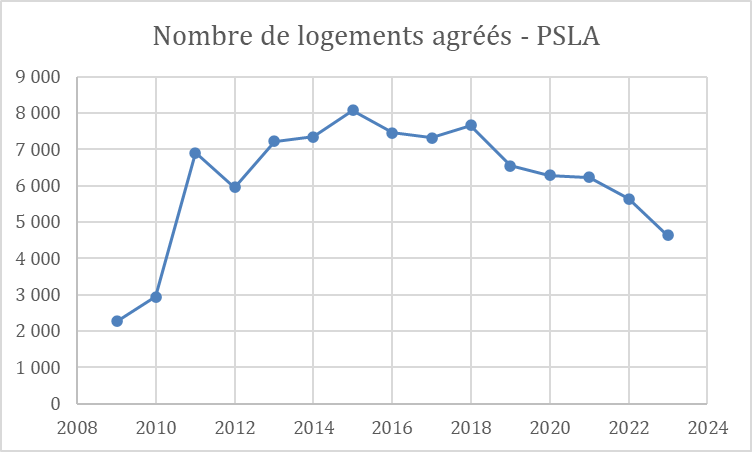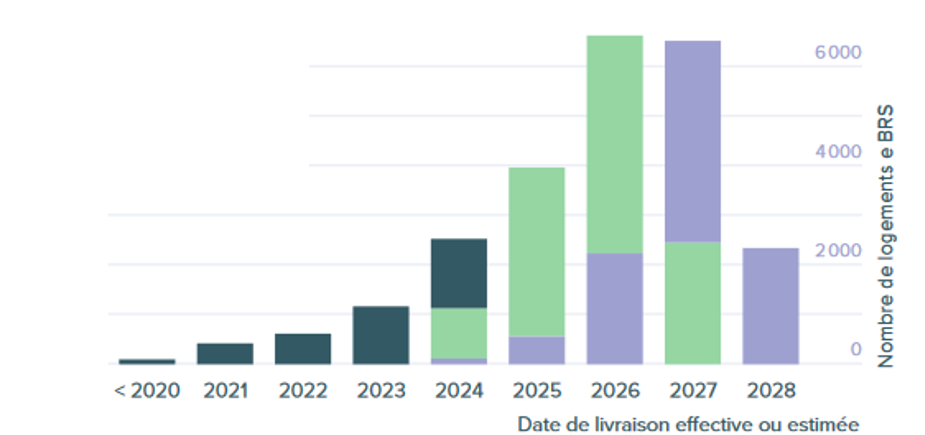- L'ESSENTIEL
- PROGRAMMER, ACCOMPAGNER, INNOVER :
25 CLÉS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
- I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT
L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL
APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES
- A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE
PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES
- 1. Les jeunes, une population plus précaire
que la moyenne, et qui l'est de plus en plus
- 2. Face à la crise du logement, les jeunes
cumulent des facteurs
de précarité qui les rendent particulièrement vulnérables
- 3. Un défi quantitatif mais aussi
politique : faute d'accéder à l'autonomie au moment voulu,
on reste aujourd'hui « jeune » plus longtemps
qu'hier
- 1. Les jeunes, une population plus précaire
que la moyenne, et qui l'est de plus en plus
- B. LE LOGEMENT DES JEUNES PÂTIT DE SON
POSITIONNEMENT
À L'INTERSECTION DE PLUSIEURS POLITIQUES PUBLIQUES
- C. UNE PRIORITÉ : CRÉER LES
CONDITIONS D'UNE PROGRAMMATION TERRITORIALISÉE DU LOGEMENT DES
JEUNES
- A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE
PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES
- II. ACCOMPAGNER LES JEUNES À LEUR
DÉPART DU DOMICILE PARENTAL GRÂCE À UN LOGEMENT
DÉDIÉ
- A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE
DÉDIÉE
- B. PRODUIRE DAVANTAGE DE LOGEMENTS
DÉDIÉS AUX JEUNES,
EN SOUTENANT LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ DONT LE MODÈLE ÉCONOMIQUE EST FRAGILISÉ
- 1. Entre préservation du pouvoir d'achat
des jeunes et équilibre
des opérations, la délicate équation de la production
de logements en résidences pour les jeunes
- 2. Acteurs clés de l'accompagnement, les
gestionnaires de résidence souffrent d'un modèle
économique fragilisé
- 3. Pour qu'il conserve son rôle de tremplin
vers l'autonomisation des jeunes, le modèle du foyer de jeunes
travailleurs
doit être valorisé
- 1. Entre préservation du pouvoir d'achat
des jeunes et équilibre
- C. FACE À LA GRAVITÉ DE LA
SITUATION, JOUER SUR TOUS LES FRONTS ET SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES VISANT
À DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES
- 1. Certaines solutions, déjà
inscrites dans le droit, gagneraient
à être développées dans la pratique
- 2. Il faut encourager les solutions
« de niche » qui répondent
à des besoins locaux et diversifient les parcours résidentiels
sans « cabaniser »
- 3. L'urgence de loger les saisonniers :
prévenir la concurrence
entre publics
- 1. Certaines solutions, déjà
inscrites dans le droit, gagneraient
- A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE
DÉDIÉE
- III. GARANTIR L'ACCÈS À UN LOGEMENT
AUTONOME POUR SE PROJETER DANS LA VIE
- A. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES
À UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN LOCATION ABORDABLE ET DE
QUALITÉ
- B. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES AU
LOGEMENT SOCIAL
- C. FACILITER L'ACCESSION DES JEUNES À LA
PROPRIÉTÉ
- A. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES
À UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN LOCATION ABORDABLE ET DE
QUALITÉ
- I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT
L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL
APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
N° 29
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1)
sur le logement des
jeunes,
Par Mmes Martine BERTHET, Viviane ARTIGALAS et M. Yves BLEUNVEN,
Sénatrices et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
L'ESSENTIEL
Réunie le mercredi 15 octobre 2025, la commission des affaires économiques a adopté le rapport d'information de Viviane Artigalas, Martine Berthet et Yves Bleunven sur le logement des jeunes. De mars à octobre 2025, la mission d'information a mené 18 auditions et entendu 22 administrations, associations, bailleurs sociaux et représentants d'élus locaux.
Les rapporteurs dressent le constat d'une situation économique et sociale alarmante de la jeunesse et identifient deux moments-clés dans le parcours de logement des jeunes sur lesquels agir :
- le départ du domicile parental, avec les études ou l'entrée dans la vie active, qui nécessite un accompagnement au sein d'un logement en résidence dédiée,
- l'accès à un logement autonome, d'abord en tant que locataire puis en tant que propriétaire.
Ils formulent 25 recommandations pour mieux loger les jeunes, qui se résument en trois actions : programmer, accompagner et innover.
I. SE DONNER LES MOYENS D'UNE VÉRITABLE PROGRAMMATION DU LOGEMENT DES JEUNES
A. LOGER LES JEUNES : UNE URGENCE SOCIALE, UN DÉFI POLITIQUE
Les jeunes sont la tranche d'âge la plus affectée par la pauvreté et la situation continue de s'aggraver. Entre 2002 et 2019, le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 29 ans a augmenté de plus de quatre points. Hormis les moins de 18 ans, aucune autre tranche d'âge n'a connu une telle hausse.
Face à la crise du logement, les jeunes cumulent des « facteurs de précarité » : ils sont à la recherche de logements de petite taille, pour des courtes durées, dans des zones où la demande explose. Sans stabilité professionnelle et parfois sans garantie familiale, ils se heurtent à la concurrence de ménages plus solvables, à laquelle s'ajoute la pression de la location saisonnière.
Loger les jeunes est un enjeu social mais aussi politique majeur. À la faveur du phénomène d'allongement de la jeunesse, documenté par les travaux du sociologue Olivier Galland, on reste « jeune » aujourd'hui plus longtemps qu'hier. La poursuite d'études, le report du mariage, du premier enfant et de l'entrée dans la vie active retardent le départ du domicile parental. Ces facteurs s'ajoutent aux difficultés d'insertion sur le marché du travail. Lorsque ces situations sont subies, elles alimentent un sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes qui ont eu plus de facilités à se loger et peuvent entretenir une jeunesse désabusée, déjà parmi les plus pessimistes d'Europe.
B. UNE POLITIQUE PUBLIQUE CENTRÉE SUR LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS
La jeunesse est aussi un ensemble protéiforme : étudiants, apprentis, alternants, jeunes actifs, demandeurs d'emploi, saisonniers... Certains jeunes cumulent même les statuts, voire effectuent des allers-retours entre l'un et l'autre.
Pourtant, la politique du logement des jeunes est aujourd'hui centrée sur les étudiants. Si les besoins de ce public sont indéniables, il n'est pas légitime de négliger les jeunes actifs : à partir de 21 ans, les jeunes non-étudiants sont majoritaires au sein de la classe d'âge des 18-29 ans !
La segmentation entre les logements « étudiants » et non-étudiants est d'ailleurs de moins en moins tenable face à la porosité des statuts des jeunes. Les rapporteurs recommandent d'en sortir en expérimentant des modèles mixtes tenant compte de l'allègement des frontières entre études et emplois.
C. DÉFINIR UNE PROGRAMMATION DU LOGEMENT POUR TOUS LES JEUNES
Les rapporteurs sont en faveur de la définition d'une véritable programmation territorialisée du logement, pour tous les jeunes, qui intègre non seulement le logement des étudiants mais aussi des jeunes actifs et saisonniers et fixe des objectifs à horizon 2030 pour donner de la visibilité aux acteurs, articulés avec une programmation des aides à la pierre qui doit être, elle aussi, pluriannuelle. Pour ce faire, ils soulignent deux outils indispensables :
- Remédier à la « précarité statistique » dont souffre le logement des jeunes. Le parc mobilisable pour les jeunes reste mal identifié. Les observatoires territoriaux du logement étudiant, mis en place par les collectivités, doivent être valorisés et leur regard étendu au-delà du logement étudiant. Ces outils sont précieux pour orienter les politiques locales de l'habitat et la programmation des aides à la pierre.
- Améliorer la lisibilité de l'offre à destination des jeunes. La politique en faveur du logement des jeunes est fragmentée, ce qui produit un millefeuille d'aides disparates. Dans l'espace numérique, les offres des Crous, bailleurs sociaux, associations et autres plateformes se superposent. La mise en place d'une plateforme unifiée rassemblant l'ensemble des offres de logements à vocation sociale, au-delà du public étudiant comme le proposait une expérimentation sur Beta.gouv, doit être accélérée.
II. ACCOMPAGNER LES JEUNES AU DÉPART DU FOYER FAMILIAL
Le parc dédié aux jeunes les soutient à un moment charnière de leur vie, lorsqu'ils construisent leur autonomie et trouvent leur place dans la société. Mais il est en double difficulté.
A. UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS
Malgré les ambitions des plans gouvernementaux successifs, nous accumulons un retard considérable. Le plan « 60 000 » de 2017 pour le logement étudiant n'a abouti qu'au financement d'à peine 30 000 places en 2022.
|
Capacités |
Étudiants ayant pu
accéder |
Nombre |
Places en foyers de jeunes travailleurs |
Quant aux jeunes actifs, le plan lancé en janvier 2025 ne fixe aucun objectif spécifique, hormis la création de 15 000 places en résidences-services à loyers intermédiaires, pouvant accueillir des étudiants ou des actifs mais qui sont inaccessibles aux plus précaires.
B. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DES RÉSIDENCES MIS À RUDE ÉPREUVE
· Une équation délicate entre loyers abordables et viabilité économique des projets
Alors que le niveau des loyers des prêts locatifs sociaux (Pls) qui financent les résidences universitaires est peu adapté à la situation des étudiants les plus modestes, les rapporteurs recommandent d'expérimenter la possibilité de financer ces résidences via le prêt locatif à usage social (Plus), au-delà de l'Île-de-France. Dans les territoires d'outre-mer, le niveau de pauvreté étudiante et les coûts de construction élevés plaident pour des expérimentations similaires.
· Un coût du foncier qui vient parfois grever l'équilibre économique des opérations
Pour minorer le poids du foncier dans le loyer versé par les gestionnaires aux propriétaires, les rapporteurs estiment intéressant d'explorer dans certains cas des dispositifs de dissociation du foncier et du bâti comme le bail réel solidaire en faveur des résidences « jeunes » : un office foncier solidaire conserverait la propriété du terrain, tandis qu'un bailleur social louerait le bâti à une association gestionnaire.
· Un modèle économique des gestionnaires mis à mal
La mission d'accompagnement des gestionnaires de résidences fait face à des besoins grandissants, alors que la précarisation des résidents allonge la durée des séjours. Les FJT et les RSJA accueillent aussi des publics très vulnérables dans le cadre du contingent de l'État ou des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
· Le FJT : un modèle à valoriser, véritable tremplin vers l'autonomie des jeunes
Les FJT se distinguent par un accompagnement renforcé, avec en moyenne 7 encadrants pour 100 jeunes. Malgré cette plus-value, ils sont souvent mis en concurrence avec les résidences sociales, du fait de financements et de publics similaires, ce qui les fragilise. Les rapporteurs recommandent de remplacer l'appel à projets, peu adaptés au montage progressif d'un dossier, par un appel à manifestation d'intérêt qui donnerait davantage de souplesse et pourrait venir en appui d'une programmation triennale.
C. ENCOURAGER L'INNOVATION DU TERRAIN POUR LOGER LES JEUNES
L'innovation pour répondre à la pénurie de logements des jeunes ne peut pas venir que d'en haut mais résulter aussi de l'impulsion de collectivités volontaires. Elles connaissent les besoins du terrain et doivent réagir rapidement, par exemple lors de l'arrivée d'une entreprise sur le territoire, pour offrir du « sur-mesure ».
S'agissant du logement des saisonniers, véritable défi pour les territoires touristiques, les rapporteurs appellent à dépasser les solutions temporaires et à prévenir la concurrence entre les publics en favorisant les solutions ad hoc, à l'instar de la résidence à vocation d'emploi adoptée par la commission dès 2024 ou des résidences mixtes, que commencent à développer certains territoires pour accueillir lycéens et saisonniers.
Les acteurs peuvent néanmoins se heurter à un cadre juridique inadapté, frein à l'innovation. C'est le cas par exemple de la mairie de Grand-Champ (Morbihan) qui a créé un village de 30 tiny houses dont 10 sont proposées à la location par l'office public de l'habitat.
- L'implication de la commune a été décisive : compte tenu du faible loyer des tiny houses, l'équilibre financier du projet n'aurait pas pu être atteint sans la mise à disposition gracieuse du foncier au bailleur social.
- En dépit de son utilité sur le territoire, ce projet a nécessité de longues négociations avec l'État et la mise en oeuvre d'une dérogation préfectorale afin que les tiny houses bénéficient de l'agrément de logements locatifs sociaux.
De tels délais sont décourageants, même pour les plus volontaires. Pour ne pas handicaper de futurs projets, les rapporteurs préconisent de consacrer un droit des collectivités de déroger, par convention avec l'État, à certaines normes en matière de logement lorsqu'elles expérimentent des solutions adaptées à leur territoire.
III. GARANTIR L'ACCÈS DES JEUNES À UN LOGEMENT AUTONOME
A. LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES LOCATAIRES
Malgré sa cherté et sa qualité contrastée, le parc locatif privé accueille la majorité des jeunes qui y occupent de petites surfaces, avec des loyers au mètre carré élevés et souvent revalorisés du fait de leur mobilité. Pour lutter contre leur précarisation, les rapporteurs identifient plusieurs leviers :
· Malgré le potentiel d'économies budgétaires qu'elles représentent, ne modifier que d'une « main tremblante » les règles d'attribution et les montants des APL
Les rapporteurs appellent à la prudence : premier outil de solvabilisation des jeunes sur le marché locatif privé, les APL ont fait l'objet de plusieurs réformes depuis 2017 qui ont été sources d'économies budgétaires mais ont dégradé le pouvoir d'achat des jeunes.
· Accompagner la dynamique de développement de la garantie Visale par une communication accrue auprès des bailleurs
La garantie Visale joue un rôle clé alors que les jeunes ne disposent bien souvent ni de stabilité professionnelle ni de garantie familiale. Malheureusement, encore trop de propriétaires lui préfèrent une caution familiale, pourtant moins sécurisante. Les rapporteurs recommandent de renforcer la communication sur Visale pour accompagner son développement dynamique.
· Évaluer l'expérimentation d'encadrement des loyers d'ici 2026
Avant d'envisager toute modification de ce dispositif facultatif et territorialisé, les rapporteurs rappellent la nécessité d'une évaluation, d'ici mai 2026, qui devra inclure une attention particulière pour l'effet de l'encadrement sur les jeunes et pour le lien entre l'encadrement des loyers et le développement de contournements, comme les baux civils ou encore le coliving.
· Lutter contre le dévoiement des baux mobilité en faveur de la location saisonnière
Le bail mobilité est parfois détourné de son objet pour permettre aux propriétaires de libérer leur logement en vue d'une location estivale. De nombreux jeunes actifs se retrouvent alors sans solution, contraints de dormir dans leur voiture ou au sein de colocations surpeuplées. Les rapporteurs souhaitent donc rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité, car cette pratique est mal documentée.
· Prendre en compte les contraintes des apprentis et des alternants
La double localisation entre centre de formation et entreprise oblige souvent les alternants et les apprentis à louer un second logement. Dans ce cas, ils sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est une règle pénalisante et injuste pour un public déjà fragile que les rapporteurs souhaitent faire cesser.
B. PERMETTRE AUX JEUNES DE MIEUX S'INSÉRER DANS LE PARC SOCIAL
Les jeunes sont de moins en moins représentés dans le parc social : entre 1984 et 2013, la part des moins de 30 ans parmi les locataires est passée de 24 % à 8 % du fait du vieillissement de la population et d'une rotation faible du parc.
De plus, les règles de priorisation, qui valorisent l'ancienneté et les familles, sont inadaptées aux jeunes. Leur mobilité ainsi que leurs besoins à court terme s'accordent mal avec les délais d'attribution. Pour lutter contre une forme de « non-recours » des jeunes au logement social, les rapporteurs estiment important d'inscrire la demande d'un logement social dans un « moment de la vie », d'évaluer les effets de la cotation sur la demande des jeunes et d'améliorer leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution.
L'offre de logements sociaux doit aussi être davantage adaptée aux besoins des jeunes. Le parc social compte peu de petits logements et ils sont extrêmement demandés. Les objectifs du Fnap prévoient l'orientation de la moitié de la production vers ces petits logements, mais il faut agir en amont, en développant un modèle économique pour ces logements dont le loyer au mètre carré ne permet pas d'équilibrer l'opération.
Pour donner des marges de manoeuvre aux bailleurs sociaux, les rapporteurs recommandent d'exonérer les résidences universitaires de la RLS, en contrepartie d'engagements.
Les résidences en gestion déléguée n'y sont pas soumises : cela pénalise les bailleurs qui ont développé une gestion locative destinée aux étudiants !
C. DÉVELOPPER L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DES JEUNES
Longtemps facilitée par des taux favorables, la propriété est de plus en plus l'apanage des plus aisés et des plus âgés. Les plus de 50 ans représentent aujourd'hui près de 40 % des achats dans l'ancien contre 30 % en 2015 ! Pourtant, les jeunes ne sont pas moins attirés que leurs aînés par la propriété : c'est toujours une aspiration forte, synonyme de stabilité, d'ancrage et de réussite sociale.
Les rapporteurs souhaitent que soit menée une réflexion pour soutenir de manière ciblée l'accession à la propriété des jeunes générations, en associant, sur le modèle de pays du nord de l'Europe, un encouragement à l'épargne et des bonifications de taux d'intérêt afin d'assurer une action contracyclique.
Les rapporteurs recommandent de proroger la généralisation du PTZ dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer ses effets sur les jeunes primo-accédants : déjà en 2024, les moins de 35 ans représentaient 68 % des bénéficiaires du PTZ.
Il faut aussi soutenir le développement du bail réel solidaire (BRS). Or la réussite des opérations tient souvent de politiques volontaristes d'élus locaux et d'une culture locale de l'accession sociale à la propriété. Les rapporteurs souhaitent donc encourager l'inscription d'un volet « accession sociale » à la propriété au sein des programmes locaux de l'habitat.
Accompagner le développement du BRS signifie aussi anticiper les parcours résidentiels. Afin d'éviter un goulet d'étranglement à la revente des BRS, les rapporteurs recommandent donc d'ouvrir le PTZ aux reventes de logements acquis via un BRS.
PROGRAMMER, ACCOMPAGNER, INNOVER :
25 CLÉS
POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
Les rapporteurs ont retenu une acception volontairement large de la notion de public « jeune », afin d'inclure dans leurs travaux aussi bien les mineurs apprentis que les jeunes actifs ou les ménages primo-accédants. Le présent rapport considère donc comme « jeunes » les personnes âgées de 16 à 29 ans, tout en accordant, à certains moments, une attention particulière à la tranche d'âge des 18-25 ans.
En revanche, demeurent hors du champ du rapport les besoins en accompagnement social spécifiques de certains publics vulnérables (jeunes en situation de handicap, jeunes de l'aide sociale à l'enfance, jeunes délinquants, mineurs non accompagnés, etc.), qui ne relèvent pas de la compétence de la commission des affaires économiques.
I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES
A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES
1. Les jeunes, une population plus précaire que la moyenne, et qui l'est de plus en plus
La situation économique et sociale des jeunes est alarmante. Toutes les auditions menées par les rapporteurs l'ont rappelé. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle : de nombreux rapports publiés depuis 2021 ont alerté sur la précarisation grandissante des jeunes, tout particulièrement vis-à-vis du logement, à l'instar du rapport du Conseil d'orientation de la jeunesse et du Conseil national de l'habitat, intitulé « Logement des jeunes, une urgence sociale »1(*). Tous font le même constat : les jeunes représentent la tranche d'âge la plus affectée par la pauvreté et cet écart avec la population générale ne fait que se creuser sur une tendance longue, malgré une relative amélioration de la situation après sa forte dégradation lors de la crise Covid-19.
Peut-être plus encore que son niveau, c'est l'augmentation de la précarité des jeunes qui inquiète. Entre 2002 et 2019, leur taux de pauvreté, calculé avec un seuil à 50 % du revenu médian, a augmenté de plus de 4 points2(*) : hormis les moins de 18 ans, aucune autre tranche d'âge n'a connu
d'augmentation équivalente de son taux de pauvreté.
Source : Observatoire des inégalités, d'après l'Insee
Avec un seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, environ 1,3 million de jeunes, soit 16,4 % des 18-29 ans étaient pauvres en 2021 : leur taux de pauvreté était déjà de deux points supérieur à celui de la population générale qui s'élevait à 14,5 %. En 2023, il atteignait 17,5 %, soit plus de deux points au-dessus du taux de l'ensemble de la population (15,4 %).
Quel que soit le seuil de pauvreté monétaire retenu, les moins de 29 ans sont les touchés.
La précarité touche tous les publics jeunes, qu'ils soient étudiants, jeunes actifs ou en formation.
Malgré la diversité de leurs situations, les étudiants représentent une population fortement touchée par la précarité : en moyenne, leurs ressources - issues des salaires, des aides de la famille et des aides publiques - s'élèvent à 1 129 € par mois. Pour les 44 % des étudiants qui déclarent exercer une activité rémunérée pendant l'année universitaire, ce qui inclut les étudiants suivant une formation en apprentissage, le revenu moyen déclaré s'élève à 835 €. Près de 60 % d'entre eux estiment cette activité « indispensable pour vivre » et subvenir à leurs besoins3(*).
La précarisation des jeunes touche aussi les actifs. Selon l'observatoire des inégalités, en trente ans, la part de jeunes diplômés depuis moins de cinq ans occupant un emploi précaire est passée de 13 % à 22 %4(*).
Enfin, quelque 1,6 million de jeunes entre 15 et 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation5(*). Couramment désignés par le terme « Neet »6(*), ces jeunes en décrochage représentent 13,9 % de leur tranche d'âge. Malgré une forte hétérogénéité, ils se caractérisent par de faibles ressources : en moyenne 6 130 € annuels contre 13 630 € pour les actifs et 8 240 € pour les étudiants.
2. Face à la crise du logement, les jeunes cumulent
des facteurs
de précarité qui les rendent
particulièrement vulnérables
La crise du logement, qui s'est aggravée depuis 2022, touche tous les secteurs du logement, qu'il s'agisse du neuf ou de l'ancien, du parc privé ou du parc social. Pour l'ensemble des ménages, le logement est le premier poste de dépenses, loin devant l'alimentation ou les transports : il représente 27,3 % de leurs dépenses de consommation contre 15,9 % pour l'alimentation ou 12,9 % pour les transports en 20237(*).
Pour les jeunes, qui sont structurellement sensibles à l'égard du logement, l'impact de cette crise est décuplé.
Alors qu'ils sont déjà plus précaires que le reste de la population, les jeunes ont des contraintes spécifiques qui restreignent de fait l'offre de logements à leur disposition et augmentent leur exposition à la concurrence de publics plus stables et plus solvables mais aussi, dans les territoires touristiques, de la clientèle de la location meublée. Besoin de proximité géographique avec un lieu d'enseignement ou de formation en apprentissage, souvent en zone tendue, absence de flexibilité sur la date d'emménagement, durée de location souvent courte, demande d'un logement de petite surface, souvent meublé... : ces contraintes sont autant de « facteurs de précarité », qui contribuent à augmenter la dépense dédiée au logement et réduire la qualité de ce dernier.
Dès lors, le poids du logement dans les revenus des jeunes est encore plus marqué que pour le reste de la population. Une fois retranchées les aides au logement, on estime que le « taux d'effort net » des jeunes à l'égard du logement s'élevait à 22 % pour les 18-25 ans et à 18,5 % pour les 25-29 ans, contre 10,3 % pour la population générale en 20068(*).
Depuis 20 ans, le taux d'effort net de l'ensemble de la population a augmenté, passant de 18,3 % en 2013 à 20,5 % en 2022. Il est près de trois fois plus important pour les locataires du secteur libre - à 28,2 % - que pour les propriétaires non-accédant - à 10,1 %. Or les jeunes se logent à 70 % sur le marché locatif privé. Même dans le parc social, ce taux d'effort net atteint 24,6 % en 20229(*).
Les jeunes sont plus affectés que l'ensemble de la population par le mal-logement. Qu'il s'agisse d'un logement trop petit, en situation de surpeuplement, de médiocre qualité ou d'une passoire énergétique, la Fondation pour le logement des défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) démontrait dès 201310(*) que les jeunes étaient les premières victimes du mal-logement : parmi les 18-28 ans ne vivant pas chez leurs parents, ils étaient près de 30 % à vivre dans un logement trop petit contre 16 % dans l'ensemble de la population, et près de 30 % à avoir des difficultés à se chauffer contre 24 % dans l'ensemble de la population. Une étude menée à l'échelle européenne en 202011(*) confirme ce constat : en 2019, près d'un quart des 15-29 ans vivait en surpeuplement, contre 15 % pour le reste de la population.
Les chiffres du mal-logement des jeunes masquent une réalité de plus en plus prégnante : celles de jeunes contraints de demeurer au sein du domicile familial faute de solution alternative mais aussi celle des quelque 600 000 personnes hébergées chez des tiers à d'autres titres, qui sont 80 000 de plus qu'en 2013. Dans ces cas, l'hébergement chez les parents ou les tiers est certes une soupape de sécurité mais il invisibilise les difficultés de logement.
En outre, au départ du domicile familial, nombre de jeunes se tournent vers le parc privé non pas pour accéder, enfin, à un logement autonome, mais par défaut, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir de logement dédié en résidence jeunes. Ils se tournent alors vers les logements les plus abordables possible, parfois en colocation.
La colocation dans le parc privé, une
solution pour de nombreux jeunes
qui demeure onéreuse et n'est pas
toujours voulue
Il n'existe pas de recensement précis de la colocation dans le parc privé. L'Insee recense les « ménages complexes », dont font partie les colocations. Ils sont estimés à 1,2 million en 2019 soit 3,9 % du total des ménages. En 2022, le loyer moyen en colocation était de 439 € charges comprises contre 556 € pour un studio. Cette moyenne cache évidemment de grandes disparités en fonction des secteurs. En province, le loyer moyen en colocation est de 394 € contre 804 € à Paris. Majoritairement étudiante, la colocation attire surtout des jeunes de moins de 30 ans, qui représentent 80 % des demandeurs. L'âge moyen des demandeurs, à 27 ans, est en augmentation constante depuis 10 ans.
Sources : Insee, La carte des colocs, USH
Loin d'être limitées aux zones tendues, les difficultés n'épargnent pas les jeunes ruraux et frappent lourdement les jeunes ultramarins.
Comme relevé par la mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la pauvreté en milieu rural12(*) : « le sujet du logement est apparu comme un sujet de préoccupation important pour les jeunes qui évoquent notamment l'insalubrité, ses effets sur les conditions de vie (froid, santé, etc.) et la facture énergétique qui pèse sur les budgets ». « Face à ces difficultés, les acteurs notent, particulièrement dans les territoires ruraux, la montée de phénomènes de cabanisation, qui vont de la simple voiture, à l'aménagement de caravanes, yourtes, chalets, notamment dans des régions où les jeunes parviennent à obtenir un emploi mais sans pouvoir se loger. ».
Les spécificités des territoires ultramarins contribuent également à décupler les difficultés des jeunes à se loger. Ces territoires, exposés à des conditions météorologiques parfois extrêmes et à des aléas climatiques, souffrent de la pénurie de logements et de logements indignes. Parmi les jeunes ultramarins interrogés lors de la récente consultation du Conseil d'orientation de la jeunesse, 43 % indiquent avoir rencontré des difficultés d'accès au logement sur leur territoire dont 39 % en raison du coût du logement, plus de 31 % en raison de difficultés d'accès à un logement social et 28 % en raison du manque d'offre de logement13(*).
Quant aux quelque 40 000 étudiants ultramarins qui viennent s'installer chaque année dans l'hexagone, ils rencontrent des difficultés d'accès au logement accrues par l'éloignement alors que leur mobilité étudiante est pourtant décisive pour leur formation, leur insertion et le développement des compétences en outre-mer.
Enfin, l'accès des jeunes à la propriété est structurellement délicat : leur taux de pauvreté et la part que représentent le logement, l'alimentation et les transports dans leur revenu ne leur permettent pas d'épargner suffisamment pour se constituer un apport. Cet accès est d'autant plus complexe en période de taux d'intérêt élevés qui renchérissent le coût de l'emprunt.
3. Un défi quantitatif mais aussi politique : faute d'accéder à l'autonomie au moment voulu, on reste aujourd'hui « jeune » plus longtemps qu'hier
L'importance démographique des jeunes ne baisse pas. En 2025, la classe d'âge des 15 à 29 ans compte 12,1 millions de jeunes, soit 165 000 jeunes de plus qu'en 2010. L'accroissement du nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur depuis les années 1960 renforce cette pression démographique. La population étudiante a augmenté de 6 % entre 2020 et 202414(*).
Certes, du fait du vieillissement de la population, le poids des jeunes dans la population française tend à s'amoindrir. La part des jeunes dans la population française a légèrement reculé depuis une vingtaine d'années : de 20,3 % en 1999, elle est passée à 18,5 % en 2010 puis à 17,8 % en 2015 pour atteindre 17,7 % en 2025 selon l'Insee15(*). La part des jeunes dans la population devrait s'infléchir à horizon 2050 pour atteindre 15,7 %.
Mais on reste « jeune » de plus en plus longtemps. Au-delà des projections démographiques, le phénomène d'« allongement de la jeunesse » est documenté par les travaux du sociologue Olivier Galland : entrée plus précoce dans l'adolescence, prolongement des études, report de l'âge du mariage et du premier enfant et décohabitation tardive du domicile parental sont autant de phénomènes qui tendent à retarder le passage à l'âge adulte et ainsi à élargir le spectre de la population des « jeunes » - c'est d'ailleurs pour cette raison que les rapporteurs ont choisi de prendre en compte les jeunes de 18, voire de 16, à 29 ans.
En 2020, on se marie en moyenne pour la première fois à 33,1 ans pour les hommes et 31,5 ans pour les femmes, des âges en augmentations respectives de 3,6 ans et de 4,1 ans depuis 1996. L'âge moyen à la naissance du premier enfant (28,9 ans en 2020) a aussi connu une hausse de 4,7 ans depuis 1967.
Ces facteurs qui s'ajoutent aux difficultés d'insertion sur le marché du travail ont eu pour effet de reporter l'âge de départ du domicile parental : en 1973, les 25-29 ans n'étaient que 13,8 % à habiter chez leurs parents, tandis qu'ils sont 20,5 % en 2013. Les données de l'Insee montrent clairement une corrélation entre l'évolution du taux de cohabitation des jeunes et celle du taux de chômage des jeunes. Plus il est difficile de s'insérer sur le marché du travail, plus il est difficile d'accéder à un logement indépendant. En 2022, les jeunes « décohabitent » en moyenne à 23,4 ans.
Aujourd'hui, près de 5 millions d'adultes vivent chez leurs parents. Ce phénomène des « Tanguy », terme popularisé par la comédie d'Étienne Chatiliez est symptomatique de la crise du logement et de ses effets sur les jeunes adultes. Lorsque cette situation s'éternise, elle est un frein majeur à l'autonomie, notamment pour ceux qui ne sont plus étudiants et de surcroît, en couple. Entre 2013 et 2020, le nombre de jeunes concernés a augmenté de 250 000 pour atteindre 4,9 millions dont 2,4 millions d'étudiants mais aussi 1,3 million de personnes en emploi et 600 000 personnes au chômage16(*).
Lorsque ces situations sont subies, leurs conséquences sociales et politiques ne doivent pas être sous-estimées.
Comment se projeter dans la vie lorsqu'on ne parvient pas à accéder à un logement autonome ? Le logement conditionne l'accès à l'emploi et comme le rappelle l'Institut Montaigne, « les problématiques de mobilité sont parmi les premiers facteurs explicatifs du chômage, notamment chez les jeunes17(*) ».
Les difficultés d'accès au logement des jeunes d'aujourd'hui peuvent en outre alimenter un sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes qui ont pu se loger plus facilement, alors que les jeunes Français sont déjà parmi les plus pessimistes d'Europe18(*).
Au-delà de la comparaison avec les générations précédentes, l'accès au logement autonome est un signe de réussite sociale. Les travaux de la sociologue Pascale Dietrich Ragon, chercheuse à l'Ined, mettent en exergue les motivations à décohabiter des jeunes issus des classes populaires, entre nécessaire réduction des temps de transports d'un côté, et ancrage dans un milieu plus valorisé socialement de l'autre : « ceux qui vivent dans des quartiers disqualifiés aspirent à les mettre à distance afin de favoriser leur réussite sociale19(*) ». Dès lors, selon la sociologue, « quitter le foyer familial au moment de s'engager dans l'enseignement supérieur est vécu comme un facteur de réussite20(*) ».
B. LE LOGEMENT DES JEUNES PÂTIT DE SON
POSITIONNEMENT
À L'INTERSECTION DE PLUSIEURS POLITIQUES PUBLIQUES
1. Le logement des jeunes souffre d'un manque
de vision
stratégique et d'un déficit de pilotage
L'action publique en faveur du logement des jeunes n'est pas pilotée par une seule autorité politique identifiée. Elle s'inscrit dans un cadre nécessairement interministériel associant les ministères du logement, du travail et de l'emploi, de l'économie, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou encore de la santé. Chaque segment de politique publique répond aux besoins d'un champ du logement des jeunes (étudiant, saisonniers, agents publics, jeunes vulnérables), sans vision d'ensemble systématique.
Cette dissémination conduit à un « soutien fragmenté » des pouvoirs publics au logement des jeunes. La Cour des comptes le dénonce dans le volet de son rapport public annuel consacré à l'accès au logement des jeunes : « la question du logement des jeunes est compartimentée en différents silos administratifs ; elle est intégrée à des objectifs plus larges ou, au contraire, ne cible que des publics spécifiques21(*) ».
Le logement des jeunes est souvent inscrit dans le cadre d'autres politiques publiques, comme celle en faveur de l'insertion sociale ou professionnelle, de l'emploi ou de lutte contre la pauvreté, ce qui émiette les démarches en faveur des jeunes précaires, des jeunes actifs, des jeunes étudiants ou encore d'autres statuts.
Plus précisément, la délégation interministérielle à la jeunesse, à l'éducation populaire et à la vie associative (Djepva), que les rapporteurs ont auditionnée, a indiqué qu'elle ne pilotait « pas de dispositif ni de programme concernant le logement des jeunes, ce sujet relevant d'autres départements ministériels [...] et des collectivités territoriales. » Néanmoins, elle « participe depuis 2014 au sein des principales instances interministérielles au suivi de ces politiques en portant les demandes faites par les jeunes en matière de logement et leur souhait d'être associés à la co-construction des politiques publiques qui les concernent22(*). »
En l'absence de politique ès qualités, cette « fragmentation des actions publiques » a des conséquences en matière de suivi budgétaire. Dans le rapport précité, la Cour des comptes déplore la difficulté de recenser et de synthétiser les coûts des politiques publiques en faveur des jeunes : « Les financements dépendent de différents acteurs, dans des configurations variables selon les territoires, et sont souvent intégrés dans des enveloppes plus globales. Lorsqu'elles relèvent de la politique du logement, ces enveloppes ne détaillent pas le budget consacré aux jeunes. A contrario, celles de la politique de la jeunesse ou de la lutte contre la pauvreté ne détaillent pas les financements destinés au logement. Certains financements sont pérennes et d'autre liés à des appels à projets. Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont dans l'incapacité d'estimer les synergies existantes ou l'efficacité des actions menées. »
Il existe un document de politique transversale en faveur de la jeunesse annexé au projet de loi de finances, dit « orange » budgétaire. Néanmoins, les crédits des politiques en faveur du logement bénéficiant spécifiquement à la jeunesse ne peuvent pas toujours être distingués. C'est le cas par exemple des dispositifs suivants, qui déploient une action en faveur des jeunes qui dépasse le seul champ du logement :
- le dispositif « Un chez-soi d'abord jeunes » (220 places en 2023, perspective de 600 places en 2028) ;
- le dispositif Accès au logement et à l'emploi des jeunes (119 jeunes en bidonvilles bénéficiaires depuis 2020) ;
- le volet logement du Contrat engagement « jeunes en rupture » qui s'adresse aux jeunes sans revenu et éloignés du service public de l'emploi, et qui cumulent certaines difficultés.
D'autres dispositifs d'aides indirectes, comme celles liées au logement versées par les Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) ne sont pas non plus détaillées.
En revanche, en matière d'APL, des mesures sont spécifiquement applicables aux jeunes - par exemple pour tenir compte des étudiants boursiers : les crédits bénéficiant spécifiquement aux jeunes s'élevaient à 2,782 milliards d'euros au sein du projet de loi de finances pour 2025.
2. Une politique publique centrée sur les étudiants malgré la porosité grandissante des statuts des jeunes
La focale des politiques publiques en faveur du logement étudiant, qui répond à des besoins évidents, tend à occulter les jeunes non-étudiants.
Les étudiants forment un sous-ensemble de la population doté d'une organisation structurée, notamment grâce à leurs syndicats qui leur confèrent une visibilité politique. Leurs difficultés d'accès au logement, mises en exergue à chaque rentrée universitaire et décuplées par une multiplication par six du nombre d'étudiants depuis les années 1960, ont justifié la construction progressive d'une politique publique identifiée, avec un parc immobilier spécifique, un opérateur principal, le Crous, et des aides spécifiques, formant, pour reprendre l'expression de la Cour des comptes, « une véritable sous-catégorie de la politique du logement23(*) ».
Pourtant, à partir de 21 ans, on compte davantage de jeunes non-étudiants que de jeunes étudiants.
Source : Portrait social de la France, Insee, édition 2023
En outre, les statuts des jeunes sont multiples et de plus en plus mouvants : jeunes en apprentissage, en professionnalisation, en contrat « éducation jeunes » (CEJ), stagiaires en formation professionnelle, demandeurs d'emploi, jeunes en parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea), étudiants, étudiants salariés, jeunes « Neet », jeunes effectuant des allers-retours de l'un vers l'autre statut, jeunes occupant un emploi saisonnier... Les frontières sont de plus en plus floues entre jeunes étudiants et jeunes actifs.
Le lancement du plan national pour le logement étudiant en septembre dernier est révélateur de ce ciblage essentiellement estudiantin. Il vise à atteindre, d'ici 2027, l'objectif de production de 30 000 nouvelles places en logements étudiants à vocation sociale et de 15 000 logements locatifs intermédiaires, sous forme de résidences-services. Bien que ces dernières puissent être mobilisées en faveur des étudiants comme des jeunes actifs, ce plan se concentre tout particulièrement sur les étudiants, à la fois au niveau des outils mobilisés et de ses modalités de pilotage.
Pour les rapporteurs, les jeunes actifs devraient être systématiquement intégrés au sein des objectifs et plans nationaux en faveur du logement des jeunes afin de mieux tenir compte de la porosité des statuts étudiants et de la majorité de non-étudiants au sein des jeunes dès 21 ans.
3. Le logement des jeunes souffre d'une « précarité statistique »
Pour reprendre l'expression de la Fondation sur le logement des défavorisés, le logement des jeunes fait l'objet d'une « précarité statistique » : de nombreux paramètres importants pour certaines études ne font l'objet d'aucun suivi ou alors de retards de l'administration, contribuant à invisibiliser des phénomènes inquiétants - tels que celui des « Tanguy », mentionnés plus haut. Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté le manque de données harmonisées dont disposent les différents acteurs sur le logement des jeunes.
Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) déplore par exemple le manque de données harmonisées entre services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de différents départements, qui ne permet pas d'analyser les besoins à l'échelle régionale24(*).
Au-delà, la connaissance du parc de logements mobilisables au profit des jeunes est lacunaire :
- environ 70 % des jeunes se logent dans le parc « diffus » - c'est-à-dire le parc locatif privé, qui ne leur est pas dédié ;
- les résidences sociales dédiées aux jeunes actifs ne font pas l'objet d'un agrément spécifique permettant de les distinguer, ce qui fragilise les données concernant le nombre de lits disponibles à destination des jeunes ;
- les données concernant les foyers de jeunes travailleurs (FJT), gérés par des tiers associatifs, sont, elles aussi, difficiles à fiabiliser et incomplètes dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
- le ministère du logement ne dispose pas de données affinées sur l'accès des jeunes à différents dispositifs qui les concernent pourtant au premier chef, étant réservés aux primo-accédants, tels que les prêts à taux zéro ou le dispositif du bail réel solidaire ;
- le recensement des logements utiles aux saisonniers est lui aussi quasi inexistant, comme le rappelle la Cour des comptes25(*).
C. UNE PRIORITÉ : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE PROGRAMMATION TERRITORIALISÉE DU LOGEMENT DES JEUNES
La segmentation des politiques publiques en faveur du logement des jeunes se traduit aussi par des données incomplètes et une capacité de projection et d'évaluation des besoins lacunaire.
1. Le logement des jeunes doit faire l'objet d'une programmation pluriannuelle et territorialisée
Il n'existe aucun dispositif national d'identification, d'évaluation et de planification exhaustif des besoins en logements des jeunes. Seuls les programmes locaux de l'habitat (PLH) prennent en compte cette dimension. Or tous les territoires ne sont pas dotés d'un PLH.
Les programmes locaux de l'habitat
Le PLH est un document de planification locale qui a vocation à couvrir l'ensemble des segments du parc de logements ainsi que l'ensemble des publics spécifiques parmi lesquels figurent explicitement les étudiants et les jeunes.
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le PLH indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en hébergement du territoire, en précisant les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. Ce n'est qu'au niveau réglementaire, depuis un décret du 30 décembre 2009, que les jeunes dans leur globalité sont pris en compte dans les PLH : l'article R. 302-1-1 prévoit un diagnostic de la situation locale à l'égard du logement, comprenant une « estimation quantitative et qualitative des besoins liés aux logements des étudiants et des besoins en logements des jeunes ».
L'absence de consensus national sur l'ampleur des besoins en logement des jeunes freine l'élaboration d'une stratégie cohérente et coordonnée en matière de production. Au-delà des seuls logements étudiants ou jeunes actifs en résidences, le déficit de logements mobilisable en faveur des jeunes, y compris des saisonniers, doit être mieux documenté. Si la planification relève de l'échelon local, l'évaluation du déficit et la réalisation de projections à l'échelle pluriannuelle doivent nécessairement être réalisées au niveau national.
Le plan lancé en 2025 en faveur du logement étudiant a impulsé une nouvelle dynamique de programmation, bienvenue mais limitée à un seul segment du public jeune. Lors de sa déclaration de politique générale en janvier 2025, le Premier ministre a annoncé un objectif de 45 000 logements étudiants abordables d'ici 2027 et a déclaré le logement étudiant « Politique prioritaire du Gouvernement » (PIG).
L'atteinte de cet objectif repose sur le financement de 10 000 logements sociaux étudiants et de 5 000 logements intermédiaires par an. En matière de logement social, l'objectif inclut donc 1 000 logements financés supplémentaires par rapport aux objectifs fixés par la programmation annuelle des aides à la pierre arrêtée par le conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre (Fnap) fin 2024. Les rapporteurs invitent l'État ainsi que les bailleurs sociaux à veiller à l'articulation entre les objectifs du plan et la programmation des aides à la pierre, grâce à une visibilité pluriannuelle sur les crédits du Fnap, comme le recommande le rapport de la commission des finances du Sénat de l'été 202526(*).
Ces objectifs sont territorialisés. Par une circulaire du 25 août, le Premier ministre demande aux préfets et aux recteurs de régions d'élaborer des feuilles de route régionales de relance de la production de logements étudiants qui constituent, à compter du 30 septembre 2025, la feuille de route opérationnelle des acteurs locaux pour atteindre les objectifs.
Pour ce faire, la circulaire demande la mise en place de comités de pilotage régionaux réunissant au moins deux fois par an les principaux acteurs concernés : établissements publics d'enseignement supérieur, Crous, établissements publics d'aménagement et établissements publics fonciers, collectivités, bailleurs, promoteurs privés, Banque des territoires...
À ce sujet, les rapporteurs soulignent que des initiatives conduites en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ou en Île-de-France ont permis de créer des instances dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes, au-delà des seuls étudiants, regroupant services de l'État, collectivités, bailleurs sociaux, Action logement, Banque des territoires, Crous, université, observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et associations. Elles doivent être généralisées.
Pour assurer le suivi de ces plans régionaux, opérationnels à compter du 30 septembre 2025, une vision à l'échelle nationale est nécessaire, à l'instar de ce qui a été organisé pour assurer le contrôle et le suivi des objectifs issus de la loi SRU pour le logement social.
Recommandation n° 1 : Approfondir la dynamique actuelle pour définir une véritable programmation territorialisée du logement pour tous les jeunes :
- étendre le plan national « logement étudiants » au logement des jeunes actifs en définissant des objectifs régionaux de production de logements abordables dédiés aux jeunes à horizon 2030 ;
- mettre en place une grille nationale d'analyse et de suivi des carences en logements des jeunes ;
- généraliser la mise en oeuvre d'instances régionales dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes ;
- associer aux objectifs pluriannuels du logement des jeunes une programmation également pluriannuelle des aides à la pierre.
2. Il est urgent de mieux identifier l'offre existante et la
demande
à l'échelle de chaque territoire
Pour mieux documenter cette programmation du logement des jeunes, une meilleure connaissance de l'offre existante est nécessaire.
Partant du constat que le parc de logements mobilisable pour les étudiants était mal connu, la Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) et l'association des villes universitaires de France (Avuf) ont créé le réseau des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) en 2017.
Ces OTLE sont des outils labellisés pour mieux connaître l'offre de logements à destination des étudiants dans les territoires, au-delà du seul logement dédié en résidences, et pour vérifier son adéquation avec les besoins.
Source : Fnau
Ces OTLE réunissent aujourd'hui les collectivités, les acteurs du logement et de l'enseignement supérieur ainsi que les services déconcentrés de l'État pour identifier les spécificités territoriales de l'offre et éclairer les politiques de l'habitat.
À ce jour, 39 OTLE sont actifs. 20 d'entre eux ont renouvelé leur labellisation récemment ; 14 ont été labellisés entre fin 2024 et fin 2025 et 5 devraient être renouvelés prochainement.
Le regard des OTLE sur le logement des jeunes permet l'appropriation des enjeux et l'évaluation des besoins par l'ensemble des acteurs du logement. Il éclaire les exécutifs locaux dans leurs démarches d'élaboration ou de révision des PLH ainsi que dans la programmation des aides à la pierre.
Ce dispositif a montré son utilité et son bon fonctionnement : il doit être favorisé et élargi aux jeunes dans leur ensemble. Auditionné par la mission, le ministère chargé du Logement a indiqué soutenir le développement du réseau des OTLE ainsi que l'extension de leur regard au-delà des seuls étudiants.
De même, la Fnau et l'Avuf ont indiqué aux rapporteurs qu'ils incitent fortement les OTLE à élargir leurs études au logement des jeunes en général. Pour l'heure, cet élargissement se fait principalement sous le prisme du logement des alternants. Les OTLE des secteurs les plus tendus s'emparent d'eux-mêmes de la question du logement des jeunes, conscients des difficultés de plus en plus criantes de ces publics.
Recommandation n° 2 : Améliorer la couverture géographique des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et étendre leur regard au logement des jeunes en général.
3. La lisibilité de la politique du logement des jeunes doit être renforcée
Le niveau d'information des jeunes sur les dispositifs d'aide à l'accès au logement est contrasté.
Hormis les aides personnelles au logement, qui sont bien identifiées, les dispositifs visant à améliorer l'accès au logement ou à réduire la dépense en faveur du logement demeurent mal connus des jeunes.
Les aides personnelles au logement font en effet partie des trois dispositifs d'aides sociales les plus connus avec les allocations familiales et le revenu de solidarité et d'activité (RSA), dont 95 % des personnes interrogées déclarent avoir entendu parler27(*). Ce sont les premières aides au logement auxquelles recourent les jeunes, même si elles ne leur sont pas exclusivement réservées. D'après la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), 29 % des allocataires d'une aide au logement ont moins de 30 ans. En 2021, 22 % des 5,9 millions de bénéficiaires des APL avaient moins de 25 ans et 15 % étaient étudiants.
Les aides personnelles au logement regroupent :
- l'aide personnalisée au logement (APL), créée en 1977 et versée aux locataires d'un logement conventionné ;
- l'allocation de logement familiale (ALF) créée en 1948, versée sous conditions de ressources aux familles ;
- l'allocation de logement sociale (ALS), créée en 1971 pour les locataires d'un logement n'appartenant ni à un ascendant ni à un descendant, sous condition de ressources et de patrimoine. Elles ne sont pas accessibles aux étudiants rattachés au foyer fiscal d'un parent éligible à l'impôt sur la fortune immobilière.
Outre les APL, en matière de logement, moins d'un jeune sur deux est informé de dispositifs tels que la garantie Visale, le prêt Loca-Pass, l'aide Mobili-jeunes ou le contrat d'engagement jeunes, pourtant pensés pour les jeunes. Ces trois dispositifs étaient connus de seulement 37 % des jeunes en 2021.
De même, l'offre sociale de logements comme celle des foyers de jeunes travailleurs ou des résidences sociales en faveur des jeunes actifs n'était connue que de 45 % des jeunes en 2021, contre 49 % en 202028(*).
La profusion des aides contribue à alimenter un sentiment de « non-recours » chez les jeunes, qui concernerait 24 % des 18-30 ans en 202129(*). Le baromètre de la Djepva notait néanmoins un recul de ce sentiment en 2021 en raison des aides exceptionnelles mises en place à la suite de la crise sanitaire, qui ont conduit de nombreux jeunes à s'en saisir. Parmi elles, une aide à l'installation dans le premier logement de 1 000 € s'adressait aux jeunes actifs de moins de 25 ans sous condition de ressources. Au-delà de la crise sanitaire, d'autres aides spécifiques à l'installation sont également proposées par les collectivités : à Paris, une aide à l'installation dans un logement pour les étudiants (Aile), gérée par le Crous permet aux étudiants bénéficiaires des repas à 1 €, boursiers ou non, d'acquérir du matériel, mobilier ou équipement pour l'installation dans un logement du parc privé à Paris.
Face à ce millefeuille d'aides parfois méconnues, ne concernant ni les mêmes publics ni les mêmes acteurs gestionnaires, il n'existe pas de guichet unique du logement des jeunes. Les canaux d'information s'empilent, jusqu'à former un ensemble peu lisible. Dès 1975, la circulaire de Jacques Barrot, alors secrétaire d'État au logement, actait la création des agences d'information sur le logement (Adil), constatant que « le public à la recherche d'un logement est désarmé face à la complexité de la réglementation ». Cinquante ans plus tard, l'accès à l'information lors de la recherche d'un logement reste pénalisant pour certains publics. Malgré la mise en place de nombreuses structures qui distribuent cette information aux jeunes, chaque réseau développe sa propre expertise et s'adresse à un public en particulier, ce qui peut être aussi source de complexité.
Les structures labellisées Information jeunesse (IJ) : généraliste, le service public d'accompagnement « Information jeunesse » vise à fournir aux jeunes des informations fiables et gratuites sur tous les aspects de la vie quotidienne (formation, emploi, logement, santé, loisirs, culture...), à les accompagner dans leurs démarches et leur projet et à les rediriger vers des interlocuteurs spécialisés (associations, missions locales, centres de formation). Les structures labellisées pour une durée de six ans par l'État peuvent être des centres régionaux IJ, des points d'informations voire des médiathèques ou des maisons de quartier.
Les comités centraux pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) sont les seules structures spécialisées dans l'accueil, l'information et l'accompagnement des jeunes en matière de logement. Elles s'adressent aux 16-30 ans et sont portées par des missions locales, des associations, des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou plus rarement par des bailleurs sociaux. Certains CLLAJ peuvent être labellisés IJ. De nombreux CLLAJ sont en outre agréés pour pratiquer l'intermédiation locative ou travaillent en partenariat avec des associations qui le sont.
Les missions locales sont des structures d'accueil et d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Elles jouent principalement un rôle d'information en matière d'emploi et de formation, un rôle d'accès aux droits et d'accompagnement global pour construire un projet d'insertion. En matière de logement, elles jouent principalement un rôle d'orientation vers d'autres acteurs spécialisés même si certaines ont développé des compétences sur le logement des jeunes en interne.
Les agences départementales d'information sur le logement (Adil) jouent un rôle d'accompagnement juridique des locataires et des propriétaires en matière de logement, au-delà des seules jeunes. Elles ont pour mission de distribuer une information neutre, gratuite et experte sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives à l'habitat. Conventionnées par le ministère du logement, elles évoluent dans le cadre d'un réseau national animé par l'Agence nationale d'information sur le logement (Anil), créée en 1975 qui exerce un rôle de centre de ressources des Adil et porte un appui permanent à leur fonctionnement en matière de documentation, d'information, de formation et d'études.
Certaines collectivités tentent d'améliorer la lisibilité de l'information publique à destination des jeunes.
Depuis le 1er septembre 2021, la ville de Paris a regroupé différents dispositifs et acteurs au sein du « Quartier Jeunes », situé dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Cette structure, qui n'est pas spécifiquement dédiée au logement, fournit néanmoins aux jeunes un accueil personnalisé et des solutions dans ce domaine grâce à la présence de conseillers du CLLAJ de Paris, de professionnels du point d'accès au droit (PAD) Jeunes et du centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ).
Autre exemple, le dispositif « Autonomise Toit », mis en place par les conseils départementaux de Touraine mais aussi d'Indre-et-Loire, consiste en un accompagnement complet des jeunes de 16 à 25 ans et a le mérite de mutualiser divers dispositifs d'aide préexistants (recherche de logement, insertion professionnelle, accès aux soins).
Néanmoins, les jeunes s'informent aujourd'hui principalement en ligne, où l'émiettement des dispositifs est sans doute décuplé.
Comme le résume la Cour des comptes dans le rapport public annuel précité, « La profusion d'informations sur les aides, les procédures ou l'offre de logements disponibles, consubstantielle de l'ère numérique et des réseaux, témoigne également de l'éparpillement des acteurs, chacun ayant investi dans la communication. Au niveau national, plusieurs sites traitant du logement des jeunes coexistent (...) sans assurance d'un contenu exhaustif ou à jour. »
Plusieurs plateformes gouvernementales, telles que « 1 jeune, 1 solution » ou la « Boussole des jeunes » (encadré ci-dessous) relaient des informations sur les aides au logement, sur la recherche d'un logement ou encore des annonces de logements dédiés aux jeunes et notamment aux étudiants, en résidences ou en colocation. Les bailleurs sociaux et privés présentent quant à eux leurs propres sites alors que différentes plateformes cherchent à recenser l'offre de particuliers, telle que « Lokaviz' » portée par les Crous. L'Union nationale pour l'habitat des jeunes (Unhaj) a aussi sa plateforme, « Projet'Toit », qui dispense des informations pour préparer sa recherche de logements et propose un accompagnement.
Le service numérique « la Boussole des jeunes »
La « Boussole des jeunes » vise à faciliter l'accès des jeunes aux droits et services locaux, en recensant les offres existantes et en mettant les jeunes en relation avec le bon professionnel. Sur le site boussole.jeunes.gouv.fr, le jeune renseigne sa commune et répond à un bref questionnaire pour découvrir les services disponibles près de chez lui. S'il souhaite être accompagné pour mobiliser un service, un professionnel le contacte rapidement (1 à 7 jours).
La thématique Logement est la plus développée et la plus sollicitée par les utilisateurs : sur 49 000 connexions en 12 mois, 12 000 concernaient le logement.
Cette abondance d'informations demande une grande capacité à s'orienter, à sélectionner et à vérifier l'information, et peut générer des inefficacités ou des redondances. Pour autant, compte tenu des aides spécifiques portées par les collectivités et par des réseaux associatifs, il reste difficile de mettre en place un système d'information national homogène.
En revanche, il est absolument indispensable de mieux recenser les offres pour renforcer leur visibilité et leur lisibilité auprès des jeunes. L'expérimentation menée sur Beta.gouv pour le logement étudiant, lancée en novembre 2024, est bienvenue : elle permet de mettre en visibilité les offres de logements étudiants sur une plateforme unique tout en laissant au gestionnaire la responsabilité de l'attribution ce qui permet de recenser et de diffuser les offres via un canal unique au lieu de nombreux acteurs parfois redondants (Points « Information jeunesse », CLLAJ, réseaux de l'Unhaj, missions locales). Ces initiatives doivent être poursuivies et surtout, étendues au-delà du logement étudiant.
Recommandation n° 3 : Accélérer le regroupement des offres à vocation sociale au sein de plateformes numériques dédiées au logement accompagné et temporaire de tous les jeunes, au-delà des seuls étudiants.
II. ACCOMPAGNER LES JEUNES À LEUR DÉPART DU DOMICILE PARENTAL GRÂCE À UN LOGEMENT DÉDIÉ
A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE DÉDIÉE
1. Le parc dédié aux étudiants est en déficit structurel
Depuis les années 1960, la croissance du nombre de logements pour les jeunes est systématiquement et structurellement déconnectée de celle de la démographie. Entre 1960 et 2022, la part d'étudiants logés dans les Crous est passée de 35 % à 6 %30(*). Selon l'Unef, le nombre de logements étudiants a été multiplié par 2,3 entre 1963 et 2022 mais le nombre d'étudiants par 10,5.
Au total, la capacité de l'offre « sociale » est évaluée à environ 244 000 étudiants :
- les résidences gérées par les Crous ont une capacité totale de 175 39431(*) places. Parmi elles, 47,3 % sont détenues par les Crous et 52,7 % sont gérées par les Crous dans le cadre de conventions conclues avec des bailleurs sociaux ;
- s'y ajoutent environ 70 000 autres logements sociaux en résidences universitaires détenus par des bailleurs sociaux, gérés en direct par ceux-ci ou confiés en gestion à une association.
Ces 244 000 places sont à mettre au regard des quelque 3 millions d'inscrits dans l'enseignement supérieur, dont plus de 700 000 étudiants boursiers.
Outre cette offre sociale, il existe une offre libre. Celle-ci s'élèverait à environ 150 000 places, soit 36 % des résidences en exploitation32(*). Elle a progressé plus rapidement que l'offre sociale en matière de résidences jeunes, à la faveur du dispositif « Censi-Bouvard », aujourd'hui éteint.
La réduction d'impôt dite « Censi-Bouvard »
Créée en 2009, le dispositif dit « Censi-Bouvard », prévu à l'article 199 du code général des impôts, était réservé aux contribuables ayant réalisé des investissements locatifs meublés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2022 portant sur des logements en résidences-services, neufs ou anciens ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation énergétique. Il permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt de 11 % du prix d'achat du bien, plafonnée à 300 000 € pour une durée de neuf ans.
Il ciblait non seulement les résidences-services privées pour étudiants mais aussi pour les personnes âgées ou handicapées ainsi que les résidences autonomie et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
En juin 2022, un rapport de l'inspection générale des finances33(*) recommande de ne pas proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2022 au regard de son périmètre inadapté et de la rentabilité déjà suffisante des projets en résidences seniors. Il déplore aussi le manque de données précises sur la nature des biens financés et sur leur localisation.
Entre 2009 et juin 2022, cette réduction d'impôt a bénéficié à environ 85 000 ménages et a représenté une dépense fiscale cumulée de 1,5 milliard d'euros, soit environ 18 000 € par logement.
Au total, l'offre de logements dédiés, y compris privés à loyers libres, a répondu aux besoins de seulement 12 % des étudiants à la rentrée universitaire 2022. En excluant l'offre libre et en ne retenant que l'offre sociale, cette part est de 8 %.
Les objectifs des plans gouvernementaux successifs n'ont pas été atteints. Le plan « 40 000 », lancé en 2012, a abouti à près de 36 000 logements sociaux étudiants agréés sur le quinquennat34(*). En revanche, entre 2018 et 2022, l'ambition du plan « 60 000 » s'est heurtée au ralentissement du rythme de la production, conduisant à l'agrément de seulement 29 176 logements sociaux étudiants, les trois quarts relevant des bailleurs sociaux. Les données relatives aux places mises en service - donc avec un « delta » de deux voire trois années par rapport aux agréments - font quant à elles état d'environ 37 000 places entre 2018 et 2022 dont environ 10 000 en résidences étudiantes à caractère social, le reste relevant de résidences privées35(*).
|
Moyenne 2013-2017 |
7180 |
|
Moyenne 2018-2024 |
6476 |
Source : DHUP
Ces données ne prennent pas en compte un petit
nombre d'opérations
à maîtrise d'ouvrage directe des
Crous qui ne mobilisent pas de prêts locatifs sociaux
(non-conventionnées aux APL).
L'effort de production de logements étudiants se partage entre Crous et organismes de logement social. Ces derniers ont porté les trois quarts de la production entre 2018 et 2022 puis la moitié en 2024 et en 2025.
Source : commission des affaires économiques du Sénat, données de la DHUP
En décembre 2023, le Gouvernement a lancé un plan en faveur du logement étudiant avec un objectif de 35 000 places de logements abordables pour les étudiants d'ici 2027. Cet objectif a pour nouveauté d'inclure, outre les logements en résidence universitaire, des logements en résidences-services à loyer intermédiaire. Ce nouveau produit a été rendu possible par une disposition de la loi de finances pour 202436(*).
Avec un objectif de 10 000 logements sociaux étudiants financés par an, le plan présenté par le Gouvernement s'inscrit dans la continuité de la dynamique récente tout en la dépassant. En pratique, en 2024, 9 400 logements sociaux étudiants ont été financés tandis que la programmation annuelle des aides à la pierre prévoyait le financement de 9 000 logements sociaux étudiants en 202537(*). Les objectifs incluent en outre 5 000 logements intermédiaires par an.
Parmi les outils mobilisés, le plan met l'accent sur le recensement et la mobilisation du foncier, la diffusion du modèle des résidences-services en LLI ainsi que les autres opérations innovantes (transformation de bureaux et de locaux administratifs, recours à la construction hors site, densification de foncier, surélévation, construction de résidences réversibles...).
La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant
à faciliter la transformation
des bureaux et autres bâtiments
en logements
Alors que la France est frappée par une crise du logement quasiment sans précédent, et que les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi « Climat et résilience » limitent les possibilités de constructions nouvelles, les bureaux vacants constituent un important gisement pour la réalisation de logements : rien qu'en Île-de-France, ils représenteraient environ 4,4 millions de mètres carrés, en hausse d'un million de mètres carrés par rapport à 2019, dont un quart serait en état de vacance structurelle.
Une proposition de loi du député Romain Daubié, définitivement adoptée en juin 2025, prévoyait notamment l'adaptation de règles d'urbanisme et de copropriété pour faciliter la prise de décision lors du changement d'usage du tertiaire vers l'habitation ainsi que la délivrance de permis de construire « à destinations successives » pour prévoir et faciliter la réversibilité des bureaux en logements dès leur construction. Le texte initial prévoyait également de pérenniser la possibilité pour les Crous, auparavant prévue sous forme d'expérimentation, de recourir aux marchés de conception-réalisation.
Au Sénat, le texte, rapporté par Mme Martine Berthet, a été enrichi de plusieurs dispositions, retenues définitivement lors de la commission mixte paritaire :
- l'élargissement du champ d'application du texte à la transformation de tous types de bâtiments ayant une destination autre qu'habitation en habitations. Cet apport permettra notamment de couvrir les transformations de locaux hôteliers ou garages, qui se prêtent particulièrement bien à ce type de transformations, mais aussi de bâtiments agricoles désaffectés ;
- l'encadrement du permis de construire à destinations multiples en bornant sa durée dans le temps et en permettant au maire d'exiger la mention de la première destination.
L'atteinte de ces objectifs mobilisera l'enveloppe de financement du programme AGiLe (Agir pour le logement étudiant) de la Banque des territoires, doté de 5 milliards d'euros pour la construction, la transformation et la réhabilitation lourde des logements étudiants de 75 000 logements étudiants d'ici à 2030, dont deux tiers de logements abordables. Cette enveloppe se répartit entre 3,5 milliards d'euros de prêts sur fond d'épargne et plus de 1,5 milliard d'euros d'investissement en fonds propres de la Banque des territoires et de filiales du groupe CDC.
L'inclusion de la réhabilitation et de la rénovation du parc dans le plan de soutien est bienvenue. En effet, les besoins sont importants dans le parc des Crous. En juillet 2025, la Cour des comptes estimait la diminution de la capacité d'accueil des Crous sur la période 2025-2031 à 838 places, soit 8 % en raison du besoin de réhabilitation. Selon le Gouvernement, 18 300 places ont été réhabilitées dans le parc Crous entre 2018 et 2024. Hormis les Crous, la rénovation des résidences universitaires à vocation sociale doit aussi être soutenue. Tout particulièrement, le parc en gestion « déléguée » fait souvent face à des performances énergétiques plus mauvaises que le parc social classique et les besoins en rénovation se heurtent à une mauvaise connaissance de l'état des résidences.
2. Le parc dédié aux jeunes actifs fait aussi
face à
des besoins grandissants
L'offre de logements dédiés aux jeunes actifs est elle aussi déficitaire. En témoigne le nombre de jeunes travailleurs qui refusent un emploi faute de logements ou le nombre d'apprentis en alternance qui peinent à se loger. À titre d'exemple, l'association pour l'accès au logement des jeunes travailleurs (ALTJ) reçoit ainsi de l'ordre de 65 000 demandes par an pour 4 000 attributions dans ses résidences d'Île-de-France, soit un taux de satisfaction d'un peu plus de 6 %. Selon l'Union régionale habitat jeunes Île-de-France, 88 % des demandes en FJT dans la région ont été refusées en 2022 faute de places. Ce taux était de 75 % en Occitanie38(*).
La capacité d'accueil des foyers de jeunes travailleurs (FJT) et des résidences pour jeunes actifs (RSJA) est estimée à respectivement 54 000 et 14 000 places. La moitié est détenue par des organismes de logement social tandis que la quasi-totalité est gérée par des tiers associatifs. Cette offre est relativement concentrée : un quart de la capacité d'accueil des FJT se trouverait en Île-de-France, de même qu'environ les deux tiers de la capacité d'accueil des RSJA. Les territoires ultramarins restent peu dotés malgré 4 FJT ouverts.
Cette capacité est quatre fois inférieure à celle des résidences universitaires à vocation sociale. Pourtant, les jeunes non-étudiants sont majoritaires dans leur tranche d'âge au-delà de 21 ans, comme le relève la Cour des comptes dans le volet de son rapport public sur l'accès au logement des jeunes, qui ajoute : « Les jeunes en cours d'intégration sur le marché du travail ont bénéficié d'un investissement de moindre ampleur que les étudiants pour la construction d'un parc propre. »
Source : commission des affaires économiques du Sénat, données de la DHUP
Les objectifs du plan « 20 000 » en faveur des jeunes actifs, initié en 2017, n'ont pas non plus été atteints. Néanmoins, la mobilisation d'Action logement via la Peec, les prêts d'Action logement Service, un plan de subventions de 65 millions d'euros d'Action logement et l'intervention d'Action logement Immobilier pour construire 5 000 logements a contribué à retrouver en 2021 et 2022 un niveau de logements sociaux « jeunes » financés - au-delà des seules résidences sociales ou FJT - de plus de 3 800 par an, après un point bas de 1 500 en 201839(*).
Dans le cadre du plan quinquennal Logement d'Abord, l'État a fixé un objectif de 25 000 nouveaux logements agréés en résidences sociales et FJT pour la période 2023-2027. En 2024, plus de 3 400 d'entre eux ont été financés, soit quasiment une hausse de 50 % par rapport à 2023. La hausse se concentre sur les agréments en résidences sociales dédiés aux jeunes, qui ont quasiment doublé entre 2023 et 2024.
Néanmoins, le logement des jeunes actifs est totalement absent du plan lancé par le Gouvernement à la fin du mois d'août 2025.
3. La segmentation de l'offre entre étudiants et
jeunes actifs
se heurte à la porosité des statuts des
jeunes
Les différentes offres de logements en résidence dédiés aux jeunes s'adressent chacune à des publics spécifiques.
Les résidences universitaires, qu'elles soient gérées par des Crous ou par des bailleurs sociaux, accueillent des étudiants mais aussi des personnes de moins de 30 ans en formation ou en stage ainsi que des jeunes en alternance ou en contrat de professionnalisation. À titre exceptionnel, elles peuvent même accueillir des enseignants et des chercheurs40(*).
Les résidences-services à destination des étudiants ne sont quant à elles pas encadrées réglementairement, les résidences-services pouvant s'adresser aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées.
Les FJT accueillent quant à eux principalement des jeunes âgés de 16 à 25 ans et en voie d'insertion. Plus précisément, ils accueillent :
- prioritairement, des jeunes actifs âgés de 16 à 25 ans exerçant une activité salariée, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, en formation professionnelle et en stage ou en recherche d'emploi ;
- dans la limite de 35 %, des jeunes âgés de 26 à 30 ans ;
- dans la limite de 15 %, des jeunes accueillis dans le cadre d'un conventionnement (Aide sociale à l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse).
Les RSJA accueillent des jeunes de 18 à 32 ans, dont 65 % de plus de 25 ans et 35 % de 18-25 ans. Il peut s'agir de public en mobilité professionnelle ou de jeunes actifs, le plus souvent avec des besoins en accompagnement relativement faibles compte tenu de l'encadrement limité des RSJA par rapport aux FJT. Néanmoins, ils peuvent aussi accueillir des jeunes en insertion dans le cadre d'une convention avec un tiers comme une mission locale ou un CLLAJ, jusqu'à 20 % des effectifs.
D'autres types de résidences, à l'instar des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) peuvent être mobilisés en faveur des jeunes actifs bien que cela ne soit pas leur mission première.
Malgré des cibles très distinctes, l'offre à vocation sociale du parc dédié aux étudiants et aux jeunes actifs s'adresse à des publics qui se recoupent de plus en plus et tendent à transcender les catégories. C'est le cas par exemple des apprentis, des alternants, des chercheurs ou encore de jeunes actifs reprenant des études.
Face à la mutation des profils des jeunes, cette segmentation se justifie de moins en moins. De nombreux acteurs auditionnés par les rapporteurs, à l'instar de l'Unhaj, ont souligné que la construction d'un système à deux branches divisé entre résidences étudiantes et résidences « jeunes » n'était plus tenable.
Ainsi, les alternants, dont le nombre a plus que doublé entre 2019 et 2023, peuvent par exemple bénéficier aussi bien d'un logement en résidence universitaire, en RSJA ou en FJT. Pour autant, ces trois offres d'hébergement n'offriront pas les mêmes tarifs compte tenu de leur financement, ni le même accompagnement, ni la même APL. Davantage que le statut du jeune, c'est le besoin en accompagnement qui guide le choix d'une résidence plutôt qu'une autre.
Les rapporteurs souhaitent que soit menée une réflexion sur la création d'une nouvelle offre permettant d'accueillir les jeunes dans la diversité de leurs statuts, en expérimentant un rapprochement des produits entre les jeunes actifs et les étudiants. Cette réflexion devra naturellement prendre en compte l'effet des différentes modalités de détermination de l'APL sur le montant des redevances versées.
Recommandation n° 4 : Sortir de la segmentation stricte entre étudiants et jeunes actifs, de moins en moins adaptée aux profils des jeunes, en expérimentant un rapprochement des produits pour jeunes actifs et étudiants.
B. PRODUIRE DAVANTAGE DE LOGEMENTS DÉDIÉS AUX
JEUNES,
EN SOUTENANT LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ DONT LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE EST FRAGILISÉ
Le modèle économique des résidences dédiées, notamment celles déployant un accompagnement complet et recourant à un tiers gestionnaire, est moins intégré que celui du logement social traditionnel puisqu'il suppose d'équilibrer deux modèles en parallèle. Les hypothèses de fonctionnement du gestionnaire, qui incluent la redevance versée par les résidents, déterminent un loyer potentiel qui « doit être au moins égal au loyer prévu par le propriétaire pour amortir son investissement41(*). »
1. Entre préservation du pouvoir d'achat des jeunes
et équilibre
des opérations, la délicate
équation de la production
de logements en résidences pour les
jeunes
Financées via un prêt locatif social (Pls), les résidences universitaires proposent des loyers qui sont parfois malheureusement peu adaptés aux jeunes les plus modestes.
Depuis 2003, les nouvelles opérations de résidences étudiantes sont exclusivement financées par des « prêts locatifs sociaux » (Pls), avec un conventionnement à l'APL-logement ordinaire et non à l'APL logement-foyer qui solvabilise davantage les étudiants. Ces prêts ne donnent droit qu'à des aides indirectes de l'État - notamment une TVA à taux réduit et des prêts bonifiés. Entre 2013 et 2022, l'extension du parc social étudiant a été financée à 80 % par des prêts bonifiés, à 12 % par des aides publiques et à 8 % par des fonds propres selon la Cour des comptes42(*).
Dans le cas d'un financement via le Pls, les loyers demandés aux étudiants sont donc plus élevés que dans le cas du prêt locatif à usage social (Plus) ou du prêt locatif aidé d'intégration (Plai) qui donnent droit à des subventions de l'État. Ils sont alors peu adaptés aux ressources des étudiants très précaires génèrent en outre des difficultés à équilibrer les opérations pour les bailleurs sociaux.
Seule l'Île-de-France peut recourir au financement des résidences universitaires en Plus, dans le cadre d'une convention de financement qui lie la région à l'État. Ce territoire dispose à ce titre d'une bonification spécifique de 2,040 millions d'euros d'autorisations d'engagement au Fonds national des aides à la pierre (Fnap) au titre du financement d'opérations de logements étudiants en Plus. Les financements en Plus ont représenté environ 30 % de la production francilienne entre 2013 et 2022, conformément à l'objectif de répartition (70 % de résidences financées par un Pls et 30 % financées par un Plus).
La crise sanitaire, qui a aggravé la précarité des étudiants, a justifié des mesures de renforcement de l'offre de logements à bas, voire très bas loyers dans cette région dont les établissements d'enseignement supérieur accueillent plus de 800 000 étudiants par an. Une expérimentation a ainsi été lancée en 2021 pour la production de résidences en faveur des étudiants boursiers via un Plai sur ce territoire, afin d'apporter aux étudiants les plus modestes une offre adaptée en termes de loyers dans ce territoire tendu. En Île-de-France, dans le parc social classique, le loyer moyen des logements financés par un Plai est de 7,3 €/m² tandis qu'il est de 11,2 €/m² pour ceux financés par un Pls.
Pour les opérateurs et les bailleurs, le recours au Plai facilite l'équilibre des opérations malgré les loyers plus faibles et leur donne droit à un taux de TVA réduit de 5,5 % - contre 10 % dans le cadre d'un financement en Plus ou en Pls - ainsi qu'à des niveaux de financements plus élevés.
Quel que soit le type de prêts, les collectivités locales peuvent apporter des subventions additionnelles, pour des aides dont les plafonds vont de 2 000 € par logement à La Rochelle à 40 000 € à Paris.
Dans les outre-mer, où la production de résidences universitaires via un financement en Pls est également la norme, la même difficulté se pose : ce prêt n'est pas éligible aux crédits de la ligne budgétaire unique et ne permet pas d'obtenir d'aides à la pierre pourtant nécessaires pour atteindre un équilibre des opérations compte tenu des spécificités de l'habitat dans les outre-mer et du niveau de pauvreté des étudiants ultramarins.
C'est pourquoi les rapporteurs estiment pertinent d'expérimenter, là où le niveau de précarité des étudiants et les tensions sur le parc de logements le nécessitent, des financements davantage aidés que le Pls pour les résidences universitaires (Plus, voire Plai, ou logements très sociaux dans les outre-mer).
Au regard du coût plus important que représentent les prêts autres que le Pls, ces expérimentations devraient être limitées aux territoires présentant les besoins les plus importants à destination des étudiants les plus modestes.
Recommandation n° 5 : Expérimenter l'ouverture du financement des résidences universitaires par le « Plus » voire le « Plai » ou équivalents dans des territoires présentant des besoins importants pour des étudiants très modestes, au-delà de l'Île-de-France.
Quant aux logements-foyers tels que les FJT ou RSJA, ils sont tous deux financés via des Plai ce qui ouvre droit à des subventions de l'État. Ces aides sont principalement les suivantes :
- les aides à la pierre du Fnap, en Plai ou Plai-adapté ;
- les prêts réglementés de la Caisse des dépôts ;
- les aides d'Action logement, en prêts et en subventions ;
- les aides des collectivités, qu'elles soient délégataires ou non des aides à la pierre ;
- les subventions des caisses d'allocations familiales, qui financent les opérations de FJT sur leurs fonds propres ;
- d'autres aides ponctuelles, telles que celles du plan de relance pour la rénovation et la réhabilitation ;
- d'autres aides provenant de financements européens.
Comparé au logement ordinaire, le financement des FJT se distingue par une part de subventions significativement plus élevée. Celle-ci se justifie par les caractéristiques du public accueilli qui limitent la possibilité d'augmenter les redevances ainsi que par l'accompagnement inhérent aux FJT qui induit des coûts supplémentaires. La part de « fonds gratuits » s'élève à environ 35 % contre 13 % pour les logements ordinaires en Plai. La mobilisation de fonds propres est nettement plus faible : elle est de 3,5 % en moyenne contre 13,8 % pour les logements ordinaires43(*).
Néanmoins, le coût du foncier dans les zones les plus tendues pèse lourdement sur l'équilibre des opérations. C'est le cas dans les zones tendues où la demande est la plus importante mais aussi dans les zones rurales où le taux d'occupation ne permet pas au gestionnaire de proposer les mêmes loyers au propriétaire. Dans ce contexte, un rapport d'information de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale de 202144(*) proposait d'encourager les organismes de foncier solidaires à conclure avec des associations d'exploitation de résidences étudiantes des baux de longue durée, afin de leur permettre de proposer des loyers qui n'intègrent pas pleinement les coûts du foncier.
Ce type de solution est progressivement exploré, à l'initiative d'acteurs locaux : dans le cadre juridique actuel du bail réel solidaire, un office foncier solidaire (OFS) peut effectivement conclure un bail avec un bailleur social en vue de la location du bâti à une association gestionnaire tierce, en faveur de jeunes travailleurs ou d'étudiants. Dans ce schéma, le coût du foncier intégré par l'opérateur dans le calcul du loyer d'équilibre demandé au gestionnaire est donc minoré par rapport à un schéma ne prévoyant pas de dissociation entre le foncier le bâti. Les rapporteurs estiment cette réflexion intéressante.
Recommandation n° 7 : Développer et sécuriser la possibilité d'utiliser des dispositifs de dissociation entre le foncier et le bâti tels que le bail réel solidaire en faveur des résidences « jeunes » pour minorer le poids du foncier dans le loyer demandé par les propriétaires de résidences aux gestionnaires.
2. Acteurs clés de l'accompagnement, les gestionnaires de résidence souffrent d'un modèle économique fragilisé
Les gestionnaires de résidence jouent un rôle essentiel d'accompagnement des jeunes vers l'autonomie résidentielle. Ces structures, notamment en FJT, constituent souvent un véritable tremplin pour des jeunes en transition.
Cet accompagnement est en tension constante face à des besoins grandissants. La précarisation croissante des résidents conduit à un allongement de la durée des séjours, ce qui renforce les besoins d'accompagnement social et individualisé. Un gestionnaire a ainsi indiqué aux rapporteurs que le taux de rotation en résidences pour étudiants et pour jeunes actifs s'est considérablement dégradé ces dix dernières années, passant de plus de 10 % à moins de 5 %, témoignant de manière préoccupante du blocage des parcours résidentiels et du besoin criant des jeunes d'accompagnement vers l'autonomie.
L'éclatement des objectifs assignés à ces structures est aussi source de tensions sur le fonctionnement des FJT. Comme le montre la Cour des comptes, bien que conçus pour accompagner l'autonomisation résidentielle des apprentis et des jeunes en début de parcours professionnel, « les FJT s'inscrivent aussi désormais dans le champ de l'insertion. Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes y orientent des jeunes plus éloignés de l'emploi, quoique solvables. L'État, qui concourt à 30 % environ de leur financement (16,6 M€ en 2023), souhaite y disposer d'un contingent pour des jeunes orientés par les services intégrés d'accueil et d'orientation qui gèrent la plateforme de l'hébergement d'urgence (le 115). Certains départements leur demandent enfin d'accueillir des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. »
Or le modèle économique des logements-foyers est très fragile, le taux d'occupation étant le seul levier d'optimisation des résultats. Selon les gestionnaires auditionnés, un seuil en deçà de 98,5 % est considéré comme emportant un risque de déficit.
Selon les données de la Cnaf, l'accompagnement représente ainsi en moyenne 30 % des charges de fonctionnement des FJT45(*). La réglementation impose en effet au FJT de prévoir un accompagnement individualisé « si besoin, en complément des actions d'animation collective pour aider les jeunes à concevoir un projet, leur proposer un suivi, les guider dans leurs démarches, mobiliser des ressources extérieures, assurer une interface avec d'autres services publics ou associatifs46(*). »
Or cette activité socio-éducative est en déficit et sous-équilibrée, tandis que l'activité de gestion locative se maintient le plus souvent à l'équilibre.
En fonctionnement, les FJT et RSJA sont soutenus notamment par :
- l'aide à la gestion locative sociale (AGLS), destinée aux résidences sociales accueillant des personnes en difficulté d'insertion. Elle prend la forme d'une subvention destinée à contribuer au financement d'un poste d'agent pour assurer une mission d'accompagnement. Selon l'Unhaj, cette AGLS est loin de couvrir les dépenses techniques et de gestion locative. Elle a récemment fait l'objet d'une réforme dont l'objectif premier était de parvenir à une meilleure couverture territoriale de l'aide, certaines résidences sociales ne touchant aucune AGLS avant la réforme. Cette réforme a donc permis de redonner de l'air à quelques résidences qui ne la percevaient pas auparavant mais faute d'améliorer la couverture des besoins de chaque résidence, elle ne règle pas la question de la fragilisation de leur modèle économique ;
- la prestation de service « FJT » de la CAF, qui vise à subventionner les accompagnements et animations réalisés dans le cadre de projets socio-éducatifs au sein des FJT - dont l'encadrement est plus important qu'en RSJA (de l'ordre de 7 ETP pour 100 résidents contre 2 dans les RSJA). Selon l'Unhaj, cette prestation de service de la CAF ne couvre que 30 % de la masse salariale liée à la « fonction socio-éducative ».
Globalement, l'équilibre économique d'un FJT ou d'une RSJA est très dépendant des « autres subventions » et donc du contexte local, avec des variations d'une année sur l'autre. La pérennité du modèle repose également beaucoup sur les marges de manoeuvre dégagées par les subventions d'investissement qui permettent de moduler le montant des redevances. Néanmoins, cette adéquation n'est pas aisée puisque les parties se heurtent à une hausse significative des coûts du foncier, de la construction et de l'énergie depuis plusieurs années.
Recommandation n° 8 : Engager une réflexion sur le modèle économique des gestionnaires de résidences sociales et notamment des foyers de jeunes travailleurs (FJT) qui est aujourd'hui en tension face à des besoins grandissants.
Par ailleurs, les rapporteurs notent que contrairement aux résidences universitaires gérées par des tiers, les résidences universitaires en gestion directe se voient appliquer la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette différence est facteur de distorsion. Une exonération de RLS pour les résidences universitaires en gestion directe serait donc souhaitable pour permettre aux bailleurs sociaux, qui sont non seulement gestionnaires mais surtout producteurs de résidences, de retrouver des capacités d'investissements.
Cela ne peut se faire qu'à condition de veiller au maintien des APL pour les occupants.
La contrepartie de cette exonération pourrait être une augmentation de la contribution des bailleurs sociaux au Fonds national des aides à la pierre, telle que proposée par le rapport de la commission des finances du Sénat sur l'avenir du Fnap de juillet 2025.
Recommandation n° 6 : Exonérer les résidences universitaires en gestion directe et les logements sociaux dédiés aux jeunes dits « article 109 de la loi Élan » de la réduction de loyer de solidarité (RLS), en contrepartie d'engagements de production ou de financement du Fonds national des aides à la pierre de la part des bailleurs sociaux, tout en veillant au maintien des APL pour les occupants.
3. Pour qu'il conserve son rôle de tremplin vers
l'autonomisation des jeunes, le modèle du foyer de jeunes
travailleurs
doit être valorisé
Compte tenu de leurs modalités de financement et des publics qu'ils accueillent, les FJT et les RSJA sont considérés comme en concurrence par de nombreux acteurs.
Les deux formules RSJA et FJT relèvent du statut de logement-foyer, ouvrant droit à des aides comme l'APL, avec des redevances plafonnées et une occupation temporaire, en pratique généralement limitée à deux ans. La différence principale réside dans le taux d'encadrement : environ 7 équivalents temps plein (ETP) pour 100 résidents en FJT, contre environ 2 en RSJA.
Tandis que les RSJA n'ont pas d'existence réglementaire en tant que telle, étant de simples résidences sociales avec un projet socio-éducatif et une cible particuliers, les FJT disposent d'un double statut de résidence sociale et d'établissement médico-social soumis au code de l'action sociale et des familles. À de rares exceptions près, les FJT comme les RSJA sont confiés en gestion par des bailleurs sociaux à des structures spécialisées qui assurent l'encadrement et la conduite du projet socio-éducatif.
Les FJT remplissent une fonction socio-éducative avec trois objectifs : favoriser l'autonomisation des jeunes, stimuler l'engagement, promouvoir le vivre ensemble. La spécificité des FJT est de pouvoir accueillir des mineurs, compte tenu de leur taux d'encadrement élevé.
Les RSJA, quant à eux, ont surtout une fonction de mise en réseau pour faciliter l'accès aux droits, accompagner les parcours résidentiels et faire face aux situations complexes.
Ces deux offres de résidences ont donc des objectifs assez différents tout en présentant des caractéristiques communes au niveau de leur financement en Plai et des publics accueillis.
Cette concurrence pénalise les FJT, qui ont longtemps souffert d'une image vieillissante mais dont le rôle d'accompagnement, de plus en plus crucial au vu de la précarisation des jeunes, est à réhabiliter.
Une circulaire du 5 septembre 2023 du ministère du logement demande ainsi aux services de l'État d'« impérativement éviter toute forme de concurrence entre les FJT et les RSJA. Dans la mesure où ces deux typologies ne proposent pas le même niveau d'accompagnement et ne permettent pas toujours d'accueillir les mêmes publics, un équilibre doit être garanti dans leur développement respectif ». Il leur est enfin demandé de « se mobiliser en priorité pour encourager et faciliter la réalisation des opérations de FJT, en évitant que des projets initialement en FJT soient abandonnés et reconvertis en RSJA ».
La concurrence entre ces produits se concrétise notamment au niveau des opportunités de production : le calendrier de l'appel à projets (AAP) auquel les FJT sont soumis, contrairement aux RSJA, s'accorde difficilement avec les étapes du montage du projet (par exemple, l'obtention d'un agrément et d'un permis de construire) et alourdit l'ingénierie de projet. Le rapport de l'inspection générale du développement durable (IGEDD) sur l'utilité sociale des FJT publié en 2022 concluait déjà que « la procédure des AAP n'est pas adaptée à l'émergence et au montage progressif d'un projet ». En effet, l'imbrication des démarches et des documents à établir est difficilement compatible avec cette procédure : « le processus n'est pas séquentiel, il existe d'indispensables allers-retours sur les différentes composantes du projet avec les auteurs correspondants47(*) ». Dans le cas de l'acquisition d'un bien en Vefa, ce qui est de plus en plus fréquent, la longueur de la procédure d'AAP peut conduire les bailleurs sociaux à se détourner du FJT pour concrétiser une opportunité foncière, alors même que ce dernier produit serait le mieux à même de répondre aux besoins des jeunes vulnérables.
Afin de s'adapter à ces contraintes, les services de l'État lancent parfois des AAP « sur mesure » lorsqu'ils sont sollicités par un porteur sur un projet déjà avancé.
Néanmoins, un dispositif d'AMI « au fil de l'eau » comme proposé par l'IGEDD en 2022 puis par le COJ et par le CNH en 2025, permettrait de donner une meilleure visibilité à l'ensemble de la chaîne opérationnelle. Les candidatures pourraient préciser leur projet tout en ayant la possibilité d'affiner la programmation de l'offre. Ce type de procédure pourrait venir en appui d'une programmation triennale telle qu'initiée en septembre 2025, puisqu'elle laisserait le temps aux porteurs de projets de monter leurs dossiers. Un AMI permettrait aussi aux porteurs d'être plus réactifs : actuellement, le processus même d'élaboration d'un projet de FJT ne les place pas en bonne position pour capter les opportunités foncières.
Il faut également soutenir la rénovation et la réhabilitation des FJT vieillissants pour éviter leur remplacement par des structures au sein desquelles les charges de fonctionnement seraient moindres. Une réhabilitation lourde peut d'ailleurs être plus coûteuse qu'une opération nouvelle.
Selon l'Unhaj, 38 % des FJT ou des RSJA affichent une performance énergétique classée « E », « F » ou « G », soit 174 établissements représentant près de 10 000 logements. L'état de ce parc « géré » demeure encore imparfaitement documenté. De même que pour les logements sociaux étudiants, sa connaissance est sans doute rendue plus difficile par la dispersion patrimoniale : le parc « jeunes » dépend de près de 160 bailleurs différents. À noter enfin que les résidences connaissent une usure plus importante que les logements classiques en raison de leur petite taille et du taux de rotation.
Après un soutien aux FJT dans le cadre du plan de relance en 2021 et 2022, de nouveaux financements ont été mis en place depuis 2023 pour accompagner la rénovation du parc social, que ce soit via le Fnap en 2023 ou via des crédits budgétaires à compter de 2024. Néanmoins, ces enveloppes paraissent limitées par rapport aux besoins des bailleurs. De même, la prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (Palulos) et le prêt à l'amélioration (PAM) distribué par la Banque des territoires restent insuffisants pour réaliser des réhabilitations d'ampleur tandis que le nouveau programme précité AGiLe (Agir pour le logement étudiant) de la Banque des territoires ne concerne que le logement étudiant.
Recommandation n° 9 : Valoriser le modèle du foyer de jeunes travailleurs (FJT) dont l'accompagnement socio-éducatif est un véritable tremplin vers l'autonomie des jeunes, en :
i) soutenant la rénovation et la réhabilitation des FJT ;
ii) prévenant toute compétition sur le financement et les opportunités de réalisation entre FJT et résidences sociales pour jeunes actifs (RSJA) ;
iii) soumettant les FJT non plus à une procédure d'appel à projets, inadaptée au montage progressif d'un dossier, mais à un dispositif d'appel à manifestation d'intérêt.
C. FACE À LA GRAVITÉ DE LA SITUATION, JOUER
SUR TOUS LES FRONTS ET SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES VISANT À
DÉVELOPPER
DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Certaines solutions, déjà inscrites dans le
droit, gagneraient
à être développées dans la
pratique
a) La location « active »
La « location active » ou « voulue », créée par la loi dite « Alur48(*) » et confirmée par la loi Égalité et citoyenneté, permet aux demandeurs d'un logement social de candidater directement à un logement vacant. Elle vise à rendre les demandeurs acteurs de leur projet résidentiel et à fluidifier l'accès au logement. Ce système permet de réduire la vacance ainsi que les refus potentiels des attributaires, mais aussi d'élargir le vivier de candidats.
Mis en oeuvre à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il permet à des bailleurs sociaux partenaires de mettre en ligne une part de leurs logements sociaux disponibles et aux demandeurs de candidater directement. L'attribution demeure de la compétence des commissions d'attribution.
Certains bailleurs répliquent ce dispositif dans le parc dédié aux jeunes, où il est efficace compte tenu de l'aisance des jeunes dans l'espace numérique : la plateforme Yellome permet par exemple aux jeunes demandeurs - étudiants comme jeunes actifs - de candidater eux-mêmes aux logements vacants du parc des filiales d'Action Logement en Nouvelle-Aquitaine.
La marque Yellome d'Action logement, une offre adaptée aux besoins des jeunes
Afin de répondre à la demande de logements abordables pour les jeunes, les filiales du Groupe Action logement, Noalis, Domofrance, La Cité Jardins, Promologis, Enéal, Néolia et SDH ont développé la marque Yellome qui cible les besoins des jeunes actifs, des alternants et des étudiants de 18 à 30 ans. Yellome offre des logements temporaires meublés et/ou équipés d'une durée de 1 à 24 mois.
La création de cette marque dédiée répond au constat du faible recours des jeunes au logement social « ordinaire » et dont la demande présente la caractéristique d'être particulièrement volatile.
La plateforme Yellome.fr a été lancée en août 2021 par les bailleurs filiales d'Action logement pour s'adapter à l'usage des outils numériques par les publics jeunes.
De la même manière, Action logement dispose aussi d'une plateforme AL'In sur laquelle les salariés peuvent candidater à des offres de logement adaptées à leur situation tandis que les moins de 30 ans bénéficient de points supplémentaires, leur assurant une priorité dans la liste des candidats positionnés sur une offre publiée.
Recommandation n° 20 : Développer la « location active », particulièrement adaptée aux jeunes, afin d'améliorer la lisibilité de l'offre dédiée et de réduire le taux de refus des attributaires.
b) La cohabitation intergénérationnelle
La cohabitation intergénérationnelle a été introduite dans la loi par l'article 10749(*) de la loi Élan50(*) de 2018. Elle est notamment mobilisée par les étudiants et les jeunes actifs mais peut résulter davantage d'une contrainte économique que d'un véritable choix.
Dans le parc social, elle permet d'agir face à la sous-occupation des grands logements, de favoriser le maintien à domicile de seniors et de travailler sur l'accès au logement des jeunes autour d'un projet solidaire.
Néanmoins, la pratique est peu développée : elle repose aujourd'hui sur des démarches volontaristes des bailleurs, en partenariat avec une association et le cas échéant sur l'impulsion d'une collectivité. En effet, la sous-location dans le parc social présente des contraintes en termes de durée et de flexibilité. En outre, le caractère modulable du loyer dont s'acquitte le jeune, allant de la gratuité à une redevance en fonction du niveau de service fourni, ainsi que la présence de deux baux séparés compliquent la gestion locative. Pour les bailleurs sociaux, le partenariat avec une association gestionnaire, comme « Ensemble deux générations » ou « Camarage » est donc la norme en cas de cohabitation générationnelle.
Au total, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social, le nombre de cohabitations intergénérationnelles est estimé à quelques milliers par les associations qui mettent en relation les jeunes avec les plus âgés. Toutefois, la pratique, qui ne fait pas l'objet d'une déclaration, est sans doute bien plus étendue.
c) L'intermédiation locative en faveur des jeunes
Dans le parc social, certains bailleurs mettent à disposition des logements relais « jeunes », confiés à des associations comme les CLLAJ. Ces logements sont proposés en sous-location temporaire à des jeunes qui ne disposent pas encore de la stabilité financière ou administrative nécessaire pour accéder à un logement autonome. Les bailleurs peuvent louer directement aux associations, avec ou sans possibilité de glissement de bail vers le jeune occupant. Une partie de ces logements bénéficie du financement de l'allocation logement temporaire (ALT).
Les « baux glissants » dans le cadre de l'intermédiation locative
Il s'agit d'une solution de transition régie par une convention selon laquelle un bailleur social loue un logement à un organisme agréé - comme l'association Inser'Toit - qui le sous-loue ensuite à un ménage bénéficiaire, occupant du logement. À l'issue d'un parcours d'insertion, le ménage occupant devient locataire en titre du logement : c'est le « glissement » du bail. Le bailleur présente alors le dossier lors de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (Caleol). Ce dispositif permet d'aider des personnes et des familles défavorisées à trouver un logement ordinaire et de s'y maintenir grâce à un accompagnement social adapté et individualisé.
La loi dite « Alur » de 2014 a offert la possibilité aux préfets, par décision motivée, de proposer un logement appartenant à un organisme de HLM en bail glissant pour qu'il puisse être sous-loué, durant une période transitoire, à un demandeur prioritaire au titre du Droit au logement opposable (Dalo)51(*).
Cependant, la mobilisation de ce dispositif en faveur des jeunes reste limitée, en raison du manque de petites surfaces à loyers abordables. Pour pallier ces difficultés, certains bailleurs, comme 3F en Île-de-France, expérimentent des sous-locations dans de grands logements, assorties d'un accompagnement social assuré par des associations. Ces pratiques innovantes demeurent toutefois marginales.
2. Il faut encourager les solutions « de
niche » qui répondent
à des besoins locaux et
diversifient les parcours résidentiels
sans
« cabaniser »
Face à la pénurie de l'offre dédiée alors que les jeunes se précarisent, les rapporteurs estiment qu'il faut faire « feu de tout bois ».
Certaines solutions doivent être déployées dans l'urgence, parfois pour répondre à une demande très localisée en raison de l'arrivée d'une entreprise sur un territoire. Le rôle d'impulsion des collectivités est alors décisif, pour concevoir des solutions adaptées aux besoins immédiats du terrain. Certaines de ces solutions sont pérennes, d'autres temporaires : le tout est de ne pas laisser les besoins sans réponse.
Face au blocage des parcours résidentiels, la conception d'offres plus innovantes permet de multiplier le nombre de segments possibles du parcours résidentiel. L'innovation peut aussi être le moyen d'éviter la « cabanisation », compte tenu du développement de certaines solutions peu satisfaisantes, parfois dans l'urgence et faute de mieux : internats, campings, bungalow, mobil home, chalets démontables... Si elles sont préférables au fait de dormir dans sa voiture, ces solutions ne sont acceptables que si elles restent extrêmement ponctuelles. L'accès au logement pérenne doit demeurer la boussole.
Effectivement, le développement de ces solutions innovantes suscite des réactions mitigées tant elles englobent des offres diverses : elles sont tantôt vues comme le fruit d'initiatives locales bienvenues, tantôt comme une « surenchère qui tend à masquer les difficultés actuelles à produire réellement des logements adaptés aux besoins des jeunes ou à s'attaquer à des politiques structurantes sur le sujet52(*) ». Les rapporteurs souhaitent que compte tenu de la situation actuelle, toutes les solutions soient encouragées, sans pour autant négliger les sous-jacents structurels de la crise du logement et l'aspiration des jeunes à un logement autonome classique.
Dans ce contexte, les tiny houses ou micromaisons sont de plus en plus sollicitées : leur faible coût et leur rapidité de construction ainsi que leur caractère souvent démontable sont des attraits indéniables pour des élus souhaitant trouver une solution rapide et peu coûteuse pour loger des jeunes.
En Vendée, Challans Gois Communauté a récemment implanté des micromaisons dans des campings du territoire pour répondre aux besoins en logement des salariés et des saisonniers du territoire. Ces micromaisons sont accessibles via des baux mobilité de six mois, les demandes transitant par le biais des employeurs qui effectuent les démarches pour le compte de leurs salariés.
À Grand-Champ, dans le Morbihan, où la mission d'information devait se rendre53(*), la mairie a créé un village d'une trentaine de tiny houses sur le terrain d'un ancien camping municipal. Ce village compte 10 micromaisons louées comme logements sociaux, par l'office public de l'habitat (OPH) Morbihan Habitat. Les autres micromaisons sont louées en lots libres par le biais de baux emphytéotiques administratifs. Pour celles-ci, la redevance payée par les occupants est de 150 € par mois. L'attribution se fait sur entretien systématique avec les services de la commune.
La réalisation de cette opération innovante a exigé plusieurs adaptations juridiques. Celles-ci ont nécessité de nombreuses concertations entre la commune de Grand-Champ, à l'initiative du projet, l'État et le bailleur social, Morbihan Habitat.
Tout d'abord, le bailleur social a dû solliciter une dérogation préfectorale pour que 10 micromaisons obtiennent l'agrément de logements locatifs sociaux et puissent ainsi bénéficier des modalités de financement du logement social et du conventionnement à l'APL.
Effectivement, les micromaisons n'ont pas de statut réglementaire spécifique. Seul le code de l'urbanisme54(*) définit les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, comme des « installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics ». Il précise qu'elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Bien que cette définition puisse s'appliquer, dans certains cas, aux micromaisons, cette définition englobe aussi les yourtes et les tipis, qui ne sauraient être mis en location dans le parc social.
En outre, la réglementation applicable à la construction neuve de logements prévoit un minimum de surface habitable de 14 mètres carrés par habitant55(*), ce que n'atteignent pas forcément toutes les micromaisons, parfois à quelques centimètres près.
Le droit de dérogation aux normes réglementaires du préfet
Après une expérimentation menée pendant deux ans dans 2 régions, 17 départements et 3 territoires ultramarins, le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 a généralisé un droit de dérogation du préfet aux normes réglementaires. Les normes auxquelles il est possible de déroger sont relatives à 7 domaines, incluant la construction, le logement et l'urbanisme.
Si elles ne sont pas désignées précisément par le décret, les normes auxquelles il est possible de déroger sont limitées :
i) aux règles qui régissent l'octroi des aides publiques afin d'en faciliter l'accès ;
ii) aux seules règles de forme et de procédure applicables dans les matières énumérées afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures56(*).
La dérogation doit être impérativement motivée par l'existence d'un motif d'intérêt général et de circonstances locales.
Dans le cas d'espèce, la dérogation a été obtenue après plus de neuf mois de concertation et de discussion avec les services de l'État. Les 10 micromaisons ont finalement reçu l'agrément de logements locatifs sociaux et le bailleur social a pu bénéficier d'un prêt locatif social (Pls). Classiquement, les logements sont attribués via la Caleol et l'État ainsi que les collectivités (dont la métropole, qui a versé une subvention) disposent de droits de réservation.
Outre les difficultés d'équilibre économique inhérentes aux logements de petite surface du parc social, il n'existait pas de précédents quant au modèle économique de la micromaison : la rotation des locataires, l'usure des micromaisons et le potentiel de vente à moyen ou long terme sont autant de facteurs qui demeuraient inconnus. Dans le cas de Morbihan Habitat, le foncier est mis à disposition à titre gratuit par la commune : pour préserver le modèle économique du projet, cette dernière n'a pas suivi l'avis de France Domaines qui évaluait la redevance annuelle à 3 500 €.
C'est donc un projet à forte dimension d'innovation, qui n'aurait pas pu voir le jour sans le volontarisme de la commune.
Afin de ne pas handicaper de futurs projets répondant aux besoins de leur territoire et portés par les collectivités, le statut de la micromaison doit être clarifié juridiquement. Il s'agit non seulement de les distinguer de formes plus précaires d'habitats comme les yourtes ou les tipis, mais aussi de ne plus nécessairement les lier à une occupation à titre de résidence principale huit mois par an et prévoir qu'elles puissent être utilisées pour le logement temporaire des jeunes en voie d'insertion ou de jeunes salariés en mobilité, comme c'est le cas dans le Morbihan.
Plus largement, afin de fluidifier les procédures liées à ce type de projet innovant et d'accélérer les délais, un droit des collectivités à déroger à des normes en matière d'habitat et de logement, par convention éventuelle avec l'État, devrait être consacré.
Recommandation n° 10 : Faciliter la réalisation de solutions innovantes pour loger les jeunes en consacrant un droit des collectivités à adapter, par convention avec l'État, les règles en matière de logement et d'habitat aux circonstances locales de leur territoire.
3. L'urgence de loger les saisonniers : prévenir
la concurrence
entre publics
Les auditions des rapporteurs, en particulier celles d'associations d'élus locaux, ont mis en évidence le problème prioritaire du logement des travailleurs saisonniers.
Le cadre juridique actuel permet de mobiliser certains segments du logement social en faveur des saisonniers (résidences sociales, FJT, colocations ou sous-locations meublées dans le parc social57(*)) mais ils n'y sont pas prioritaires.
C'est également le cas au sein des résidences universitaires, où leur accueil est néanmoins possible entre le 1er janvier et le 1er octobre de l'année suivante58(*). Une convention entre le Crous Nice-Toulon, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie (Umih) locale a par exemple permis d'accueillir 219 saisonniers en 2024 à Nice et à Valbonne.
Néanmoins, cette solution se heurte à des difficultés de calendrier et reste peu développée en raison d'un taux d'occupation proche de 100 % dans les Crous. De manière légitime, les gestionnaires privilégient donc généralement les publics pour lesquels la résidence a été construite.
De même, l'hébergement des saisonniers en internats est une « fausse bonne idée ». Cette solution, en apparence pratique, se heurte à des coûts importants de mise à disposition, de sécurisation et de remise en état des locaux puisqu'il faut par exemple ajouter des serrures aux logements.
Certains bailleurs développent néanmoins des solutions hybrides répondant aux besoins spécifiques d'un territoire. C'est par exemple le cas de Vilogia qui, au Touquet, a ouvert en juillet 2025, après dix ans de concertation, une résidence de 92 studios meublés qui seront utilisés pour loger des étudiants du lycée hôtelier durant l'année scolaire et mis à disposition de travailleurs saisonniers durant la période estivale. À cela s'ajouteront dix logements dédiés à des effectifs de la gendarmerie.
Pour combler la pénurie de l'offre, certains travailleurs saisonniers sont aussi accueillis en résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). Elles représentent une offre à coût maîtrisé, alternative aux logements meublés parfois chers et de mauvaise qualité. Les RHVS « mobilité » incluent au moins 30 % de publics prioritaires relevant du « contingent préfectoral » tandis que les RHVS « d'intérêt général » en comptent 80 %.
Une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dédiée aux saisonniers
La première RHVS spécifiquement dédiée aux saisonniers a ouvert au premier trimestre 2022 à Libourne en Gironde. Dotée de 87 logements autonomes, équipés et meublés, elle accueillera des travailleurs saisonniers, notamment du secteur viticole, mais pourra accueillir aussi des intérimaires, des travailleurs pauvres, des jeunes en mobilité, des stagiaires en formation et des ménages en situation de fragilité ponctuelle.
Néanmoins, comme mentionné par la commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi pour le développement de logements abordables, le nombre de places en résidences mobilité s'élèverait à seulement 1 300 places sur l'ensemble du territoire, bien loin des besoins. Plutôt que de mobiliser des structures pensées pour un accueil plus large, notamment de personnes vulnérables, les rapporteurs sont en faveur du développement de résidences ad hoc pour loger des salariés en mobilité ou des travailleurs saisonniers. L'allongement progressif de la saison touristique rend d'autant plus nécessaire les solutions dédiées aux saisonniers, le différentiel entre « haute » et « basse saison » tendant à se réduire sensiblement dans plusieurs régions.
Dans cet objectif, les résidences à vocation d'emploi, introduite dans le droit par le Sénat à la fois en 2024 et en 2025, dans le cadre de textes toujours en discussion à la date d'examen du présent rapport59(*).
Le rapport de la Cour des comptes60(*) de juillet 2025 sur le logement des saisonniers souligne aussi « que l'Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) souhait[e] valoriser son offre d'hébergement dans certains territoires, avec une réflexion globale en cours. Des liens pourraient être envisagés avec des acteurs du segment jeunes, notamment avec l'Unhaj et les foyers de jeunes travailleurs comme vecteur de reconversion de certains sites. »
Par ailleurs, la seule mesure fiscale réservée au logement des saisonniers concerne un dégrèvement fiscal pour les propriétaires particuliers. Créé à titre expérimental par la loi de finances pour 202361(*), il reste mal connu et peu utilisé. Le rapport de la Cour des comptes souligne que pour autant, certaines collectivités n'hésitent pas à soutenir les particuliers qui accueillent des saisonniers sur plusieurs saisons, considérant que cet accueil est plus efficace et moins onéreux que la construction des logements spécialement destinés aux saisonniers.
Au-delà du développement d'une offre ad hoc, la connaissance des besoins par les collectivités doit être approfondie, comme le souligne la Cour des comptes en 202562(*). Depuis la loi « Montagne II » de 201663(*), toute commune ayant reçu la dénomination de commune touristique est tenue de conclure avec l'État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers64(*), élaborée avec l'EPCI, le département, Action logement et éventuellement la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ainsi que les bailleurs sociaux. Cette convention inclut un diagnostic des besoins en logement des saisonniers et fixe des objectifs et des moyens à atteindre sous trois ans. Cet exercice semble indispensable alors que les besoins des saisonniers ne sont pas identiques dans tous les territoires, comme le montre une étude en cours de l'Urhaj Bretagne.
Focus sur le profil des travailleurs temporaires, extrait de l'étude co-rédigée par l'Urhaj Bretagne « Logement temporaire pour les travailleurs saisonniers en Bretagne », travaux en cours
Recommandation n° 11 : Pour loger les jeunes travailleurs saisonniers, refuser la mise en concurrence des publics et valoriser les solutions fondées sur des initiatives locales, à l'instar de l'encouragement des particuliers à louer leur bien pour bénéficier d'un dégrèvement fiscal ou des résidences ad hoc comme les résidences à vocation d'emploi.
III. GARANTIR L'ACCÈS À UN LOGEMENT AUTONOME POUR SE PROJETER DANS LA VIE
Le parc dédié demeure une solution temporaire qui ne doit pas amoindrir la nécessité de garantir l'accès des jeunes au logement autonome.
A. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES À UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN LOCATION ABORDABLE ET DE QUALITÉ
1. Lutter contre la précarité des jeunes dans le parc locatif privé
Malgré sa cherté et sa qualité contrastée, le parc locatif privé est celui qui loge le plus les jeunes. Environ 70 % des jeunes habitent le parc locatif privé. Les jeunes y vivent dans des surfaces souvent plus petites que le reste de la population, avec des loyers au mètre carré souvent renchéris. Leurs spécificités les conduisent en outre à quitter leur logement plus souvent que le reste de la population, ce qui entraîne une revalorisation du loyer à chaque renouvellement de bail et augmente d'autant plus leur taux d'effort.
a) Les dispositifs visant à solvabiliser les jeunes
Le rôle de « filet de sécurité » des APL s'est amoindri ces dernières années au gré des réformes. C'est un des constats forts du rapport du COJ et du CNH de janvier 2025.
Un rapport des députés Daniel Labaronne et Charles de Courson en 202365(*) souligne que les différentes réformes des APL mises en oeuvre depuis 2017 représentent, avec la suppression de l'APL-accession et l'introduction de la réduction de loyer de solidarité (Rls) en 2018, un potentiel d'économies budgétaires de 4 milliards d'euros en 2024. Il s'agit des réformes suivantes :
- la réduction forfaitaire de 5 euros des APL, entrée en vigueur au 1er octobre 2017, qui a pénalisé les jeunes locataires du parc privé - dans le parc social, ses effets ont été neutralisés par la mise en oeuvre de la RLS ;
- la contemporanéisation des APL en janvier 2021, qui consiste en la prise en compte des APL « en temps réel », grâce à une actualisation tous les mois sur la base des revenus des 12 mois précédents, au lieu d'une actualisation annuelle sur la base des revenus de l'année « n-2 » ;
- les sous-indexations successives des APL en 2019 et 202066(*) par rapport à l'indice de référence des loyers. En neutralisant les effets de l'inflation, le niveau global des aides versées a baissé en euros constants : c'est ce que note le rapport de l'Insee sur les inégalités et la pauvreté de novembre 2023. En parallèle d'une augmentation des loyers, ces sous-indexations ont fortement dégradé le pouvoir d'achat des jeunes.
Parmi elles, la contemporanéisation du versement des APL a pénalisé les jeunes actifs, oubliés de la réforme. Contrairement aux étudiants et aux apprentis, ils n'ont pas bénéficié de mesures protectrices.
Les étudiants ont en effet bénéficié d'une forfaitisation de leurs ressources tandis que celles des apprentis se sont vues appliquer un abattement forfaitaire67(*). Depuis septembre 2021, un abattement social équivalent a été créé pour les alternants en contrat de professionnalisation afin qu'ils soient traités de la même façon que les apprentis.
Un rapport de la Cour des comptes en 202568(*) confirme que la situation des jeunes actifs n'a que peu, voire pas été prise en compte. Des travaux de la Cnaf corroborent ce constat : 42 % des allocataires de la tranche 25-34 ans connaissent globalement depuis janvier 2021 une variation mensuelle moyenne négative de l'allocation de 37 €69(*).
La réforme a ainsi privé les jeunes actifs d'un filet de sécurité dont ils bénéficiaient auparavant grâce à la prise en compte des deux années précédant leur entrée sur le marché du travail.
Le rapport de septembre 2024 sur l'insertion des jeunes rappelle en outre qu'« alors que l'APL avait jusqu'ici une « fonction assurantielle » permettant aux jeunes de faire face aux coûts de leur installation et de décohabiter plus facilement, il leur est, aujourd'hui, plus difficile d'avoir une visibilité sur les ressources qui vont leur être versées. »
Dans le contexte actuel de fragilisation des jeunes, les rapporteurs appellent à une grande prudence. Manne budgétaire importante pour l'État, les APL n'en restent pas moins un instrument de politique publique dont il est difficile de prévoir les effets des évolutions. Elles représentent en effet une dépense d'environ 17 milliards d'euros. Leur effet inflationniste de long terme dans le parc privé, notamment pour les petites surfaces, a en outre été documenté par certaines études70(*). Toutefois, cet effet est contrasté : tous les segments de marché locatif n'ont pas la même élasticité à une variation du montant des APL. Les zones les plus tendues sont en effet celles où l'offre est la plus rigide. Un billet de la Banque de France de 2023 conclut d'ailleurs qu'il est par conséquent « indispensable d'accroître le nombre de logements offerts [...] pour éviter la captation des aides par les propriétaires71(*). »
Les rapporteurs concluent qu'il ne faut modifier les règles d'attribution et les montants des APL que d'une « main tremblante ». Le cas échéant, ils rappellent la nécessité de mener des études d'impact fouillées, tant les conséquences pour les jeunes sont importantes. Les APL sont certes une manne financière importante en période de difficultés budgétaires mais elles ne doivent pas être détournées de leur objectif de solvabilisation de la demande et de redistribution.
Recommandation n° 12 : Ne plus modifier les règles d'attribution et le montant des APL, qui sont une source d'économies budgétaires potentielles pour l'État, sans en mesurer prudemment les conséquences, pour ne pas réitérer des erreurs antérieures qui ont réduit le pouvoir d'achat des jeunes et notamment des jeunes actifs.
Souvent perçus comme moins stables et ne disposant pas toujours d'un soutien familial, les jeunes peuvent être désavantagés dans leur recherche d'un logement en location. Pour limiter les discriminations auxquelles les jeunes font face sur le marché locatif, les dispositifs comme la Garantie Visale ou Loca-Pass jouent un rôle essentiel.
Créée en 2016, la Garantie Visale est une garantie locative gratuite accordée par Action logement et financée par la participation des employeurs à l'effort de construction (Peec) qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans72(*) sans garantie familiale ni bancaire d'avoir accès au logement. Elle sécurise les propriétaires en cas de défaillance du locataire en couvrant jusqu'à 36 mois d'impayés dans le parc locatif privé et 9 mois dans le parc social ainsi que des dégradations locatives dans la limite de deux mois de loyer.
Le prêt Loca-Pass, également financé par Action logement, permet quant à lui de financer sans intérêt tout ou partie du dépôt de garantie demandé lors de la signature d'un bail pour les moins de 30 ans, remboursable sur une durée maximale de 25 mois.
Initialement réservée aux jeunes en double mobilité, Visale a été progressivement étendue à des publics plus larges :
- depuis septembre 2016, tous les jeunes de moins de 30 ans, salariés ou non, sont éligibles à la garantie Visale ;
- la convention quinquennale 2018-2022 entre l'État et Action logement a élargi le dispositif aux bénéficiaires d'un bail mobilité et à ceux du dispositif « Louer pour l'emploi » ainsi qu'aux salariés de plus de 30 ans en situation de double mobilité ;
- depuis l'avenant « Relance » du 15 février 2021, tous les salariés ayant un revenu inférieur à 1 500 euros nets par mois, sans limite d'âge, y sont éligibles ;
- enfin, la convention quinquennale 2023-2027 du 16 juin 2023 a étendu Visale aux travailleurs saisonniers en juin 2024.
L'impact social de la garantie Visale
Visale aide les publics habituellement exclus du marché locatif à trouver un logement au regard des critères de solvabilité privilégiés par le marché - stabilité professionnelle et taux d'effort inférieur à 33 %. Selon Action logement, plus de 90 % des bénéficiaires de la garantie Visale seraient sinon « hors marché » : 23 %, hors étudiants73(*), ont un taux d'effort supérieur au taux recommandé et 81 % n'ont pas de stabilité professionnelle. Ils sont en proportion plus jeunes que les autres locataires (92 % ont moins de 30 ans contre 28 % dans le parc privé au niveau national), plus isolés (90 % contre 56 %) et plus précaires (leur revenu mensuel est de 17 972 euros en moyenne hors étudiants contre 2 100 € au niveau national) et paient des loyers plus bas.
La garantie Visale a fait l'objet d'une importante dynamique de déploiement depuis sa création et notamment depuis 2018.
Au 31 mars 2025, les étudiants représentaient 54,6 % des bénéficiaires de Visale depuis 2016 et 92 % des contrats émis l'avaient été auprès de locataires de moins de 30 ans74(*).
Source : questionnaire budgétaire et Action logement
L'objectif de la convention quinquennale conclue entre Action logement et l'État en 2023 est de doubler le recours à la garantie Visale, en atteignant 2,1 millions de garanties octroyées sur la période 2023-2028.
Selon le baromètre mis en place d'Action logement, en 2023, plus de 4 Français sur 10 et près de 6 jeunes de moins de 35 ans sur 10 déclarent connaître la garantie Visale, un résultat en hausse et qui atteint son plus haut niveau depuis le début de la mesure.
La garantie Visale est pourtant souvent boudée par les propriétaires. Ils lui préfèrent souvent une caution physique familiale, malgré son caractère plus aléatoire, ou alors des garanties des loyers impayés (GLI) privées pour lesquelles les agences immobilières sont rémunérées, qui sélectionnent les locataires selon des critères stricts et difficiles à tenir pour les jeunes dans des zones tendues.
D'après le ministère chargé du logement, selon la dernière évaluation de Visale réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc) en 2020, « la lisibilité du dispositif n'est pas acquise pour deux tiers des locataires et bailleurs qui pensent que Visale s'adresse aux plus fragiles et qu'il est globalement peu aisé d'identifier clairement sa cible. Un doute subsiste quant à l'efficacité de cette garantie locative au regard de la garantie physique. La moitié des bailleurs comme des locataires pensent que Visale ne vaut pas une garantie physique. La caution solidaire d'un proche est d'ailleurs mobilisée dans les trois-quarts des signatures de bail sans Visale. »
Recommandation n° 13 : Renforcer la communication à l'égard de la garantie Visale pour améliorer son acceptabilité auprès des bailleurs et ainsi accompagner sa dynamique de développement.
b) Les dispositifs visant à modérer le loyer
Certains dispositifs reposent sur des incitations des propriétaires mais restent peu usités.
Le dispositif Loc'Avantages (ancien « Louer abordable ») permet à des propriétaires de bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie de la location de leur bien à un loyer inférieur au prix du marché en faveur de ménages modestes, sur la base d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah).
Son impact est limité. Le nombre de logements conventionnés recule, avec seulement 110 000 logements en 2021, soit 26 % de moins qu'en 2017. Cette baisse s'explique notamment par une attractivité fiscale jugée insuffisante et une mise en oeuvre parfois perçue comme complexe. Néanmoins, ce dispositif a été prorogé pour trois années, jusqu'au 31 décembre 2027, par la loi de finances pour 2025.
Le dispositif « Louer pour l'emploi », mis en place par Action logement, permet de favoriser le logement dans le parc privé des salariés en mobilité professionnelle ou nouvellement embauchés. En contrepartie d'un loyer plafonné, le propriétaire bénéficie par convention d'une sécurisation locative contre les impayés par Action logement, de la prise en charge de ses honoraires de location mais aussi de prêts aidés pour la réalisation de travaux, par exemple en faveur de la rénovation énergétique.
Ce dispositif est lui aussi peu diffusé. En 2024, 596 387 € ont été engagés pour le dispositif dont 7 % pour des logements destinés aux jeunes.
Certaines collectivités ont mis en place un dispositif d'encadrement des loyers.
Cet encadrement a été d'abord introduit par la loi dite « Alur » de 2014 dans les zones tendues. La loi dite « Élan » de 201875(*) l'a ensuite transformé en expérimentation ouverte aux collectivités demandeuses éligibles, situées en zones tendues, pour une durée de cinq ans. Prolongée par la loi « 3DS » de 202276(*), elle arrive à échéance le 21 novembre 2026. Un an avant son échéance, elle reste difficile à évaluer. Un rapport d'évaluation devra être remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme soit le 21 mai 2026. Fin 2024, l'encadrement des loyers s'applique dans 48 communes situées dans 9 collectivités.
Certaines collectivités ont mené des campagnes de communication pour améliorer l'information des locataires sur le dispositif. Depuis 1er janvier 2023, la Ville de Paris a obtenu la délégation du pouvoir de contrôle de l'encadrement des loyers du préfet : il lui revient désormais d'exercer ce contrôle et d'appliquer les sanctions. Grâce à une communication de proximité pour informer les locataires et les propriétaires sur l'existence du dispositif, plus de 3 350 signalements de dépassement de loyer ont été déposés par les locataires au 31 mars 202577(*).
Le dispositif a depuis été consolidé : depuis 2023, les loyers-plafonds sont mentionnés dans les annonces et les contrats de bail.
Partant du constat que certaines communes tendues de territoires d'outre-mer n'avaient pas pu candidater à l'expérimentation compte tenu du calendrier retenu lors de sa création par la loi « Élan », le Sénat a récemment adopté la loi du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer78(*).
Les rapporteurs reconnaissent l'utilité de cette expérimentation dans certaines zones tendues où le déséquilibre entre l'offre et la demande se fait au détriment des locataires. Ce dispositif doit rester facultatif et territorialisé.
Les rapporteurs sont également conscients des nombreux contournements qui existent à l'encadrement des loyers dans les zones les plus tendues - notamment via des baux dits « civils » ou des coliving où le respect de l'encadrement des loyers est contourné grâce à des charges artificiellement élevées.
Les baux dits « civils »
Le bail « Code civil » est un dispositif de droit commun offrant une plus large liberté rédactionnelle du contrat de location (durée, loyer, conditions de résiliation ou de renouvellement) et donnant au propriétaire davantage de flexibilité qu'un bail d'habitation. Néanmoins, le bail « Code civil » s'applique uniquement lorsqu'aucun droit dérogatoire ne régit la situation des parties.
Par exemple, lorsque le bien est la résidence principale du locataire, le contrat doit être un bail d'habitation, régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont certaines dispositions sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux parties quelle que soit leur volonté.
Le bailleur ne peut donc pas utiliser le bail « Code civil » pour se détourner des obligations qu'il aurait en vertu d'un bail régi par un droit spécial, tel qu'un bail d'habitation, mais aussi tel qu'un bail commercial ou un bail professionnel.
Le coliving
Faute de dispositif incitatif pour la location nue de longue durée depuis la fin du Pinel, les investisseurs tendent à se tourner vers des investissements plus immédiatement rentables, à l'instar du coliving.
Sans définition légale, cette pratique protéiforme originaire des États-Unis est à la frontière entre la colocation classique et la résidence-services. Elle allie souvent colocation et prestations para hôtelières, comme des services de ménage ou de buanderie et s'adresse à une clientèle haut de gamme. Elle se développe notamment dans les grandes villes où le marché est tendu et où la location meublée touristique a été restreinte, notamment depuis la loi du 19 novembre 2024. Le flou juridique qui entoure la pratique conduit certains propriétaires à ne pas respecter l'encadrement des loyers ou à le contourner significativement grâce à des compléments de loyers et à la facturation de services inclus dans les charges. Certains propriétaires louent enfin leur bien à une entreprise de coliving assurant elle-même le risque de vacance, ce qui permet par ailleurs de contourner un règlement de copropriété interdisant la location par chambre.
En l'absence de statut juridique, les contentieux se multiplient. Certains logements loués en coliving se sont vus requalifiés en location meublée touristique. Dans d'autres cas, un faisceau d'indices (incluant notamment la présence de serrures aux portes de chaque partie privative) a mené la justice à conclure que chaque chambre louée en coliving constituait un logement, ce qui a des conséquences en termes de droit de l'urbanisme79(*).
Recommandation n° 14 : Dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers d'ici mai 2026, étudier son impact spécifique sur les jeunes et son rôle dans le développement de pratiques telles que le coliving ou les baux civils.
c) Les aides à la mobilité des apprentis et des alternants
Des aides accompagnent le développement de l'alternance et de l'apprentissage, le nombre de jeunes concernés ayant été multiplié par 2,8 entre 2017 et 2022.
Créée en 2018, Mobili-Jeunes est une aide d'Action logement réservée aux alternants de moins de 30 ans touchant moins de 120 % du Smic et qui ont dû changer de résidence principale ou prendre un second logement pour assurer leur formation. Elle propose une subvention complémentaire aux APL jusqu'à 100 € par mois. Entre 2018 et 2022, elle a bénéficié à 518 576 jeunes soit 28,6 % des apprentis préparant un diplôme du supérieur sur cette période. Entre 2023 et 2024, plus de 220 000 aides Mobili-Jeunes ont été distribuées pour un montant total de 252 millions d'euros80(*).
Néanmoins, cette aide ne permet pas de répondre à toute la demande : contrairement aux aides en droits ouverts, Mobili-Jeunes dépend d'une enveloppe fixe.
Au-delà du seul loyer, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires peut renchérir le coût du logement pour les jeunes en alternance. Les rapporteurs ont été alertés sur ces cas, ressentis comme injustes, dans lesquels l'imposition vient dégrader encore davantage le pouvoir d'achat des jeunes. En effet, les jeunes en alternance ou en apprentissage qui se trouvent contraints de prendre un second logement hors d'un Crous ou d'une résidence conventionnée entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, au même titre que les personnes occupant un second logement pour des raisons professionnelles81(*). Cela n'est pas le cas des jeunes cohabitant chez leurs parents et prenant un second logement, qui est alors considéré comme leur résidence principale. Pourtant, les jeunes décohabitant sont sans doute encore plus précaires que ceux qui restent au domicile parental.
Sollicité par les rapporteurs, le ministère du logement a indiqué qu'il est possible de demander un dégrèvement sur réclamation adressée au service gestionnaire des impôts, lorsque la résidence dans un lieu distinct de l'habitation principale s'impose au particulier. Plus largement, le jeune peut également demander une remise gracieuse auprès du même service en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, pour cas de « gêne ».
Les rapporteurs estiment que peu de jeunes feront probablement usage de cette faculté et invitent le Gouvernement à prévoir une exonération pour ce cas précis, qui ne devrait concerner qu'un volume faible de cas.
Recommandation n° 15 : S'assurer que les jeunes alternants ou apprentis en situation de double résidence ne soient pas redevables de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire.
2. Mieux protéger les jeunes de la concurrence de la location meublée touristique
Les jeunes sont particulièrement touchés par les tensions sur le marché locatif résultant de la spéculation et de la transformation des logements en meublés de tourisme. Ce sont les petites surfaces qui sont les plus souvent visées.
De nombreuses collectivités ont renforcé leur régulation des locations saisonnières, d'autant plus à la suite de la loi du 19 novembre 202482(*) qui a accru leurs pouvoirs en la matière. C'est le cas de villes comme Paris, Nice, Bayonne ou Annecy qui ont soumis les changements d'usage des locaux d'habitation à une compensation, à un système de quotas ou encore les ont liés à la location à l'année du bien à des étudiants. La ville de Nice a ainsi conditionné la location meublée touristique en période estivale à la location, durant l'année, à des étudiants, grâce à un bail mobilité. La délibération introduisant cette règle souligne qu'une restriction trop importante de la location meublée touristique, via un dispositif de compensation des changements d'usage, a conduit au retrait du marché locatif de certains biens que les propriétaires ne louent tout simplement plus, faute de pouvoir louer en meublé de tourisme. Dans un territoire avec une population étudiante importante, le recours à un dispositif mixte, avec un bail mobilité étudiant durant l'année, est donc une solution.
Les villes de Nice ou La Rochelle, deux exemples
de réglementation
de la location meublée touristique en lien
avec le logement étudiant
La ville de Nice a été la première à réglementer le changement d'usage en France. Elle a notamment expérimenté un dispositif de conventionnement des locations mixtes pour faire face aux effets pervers du régime d'autorisation avec compensation stricte qui conduisait les propriétaires à se détourner du parc locatif, y compris à destination des étudiants, faute de pouvoir rentabiliser leur bien via une location saisonnière durant l'été. Le dispositif de location mixte permet aux propriétaires de louer à un étudiant allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) pendant l'année universitaire (9 mois), sous condition de plafond de loyer, avant de pouvoir proposer le logement en location touristique durant l'été. Le bon fonctionnement du dispositif repose sur des échanges de données entre la CAF et la ville pour s'assurer de la véracité de l'occupation du logement par un étudiant à titre de résidence principale ainsi que sur une association des partenaires locaux (métropole, ville, Crous, Cafam, Action logement et Adil 06).
Malgré ce type de régulation ambitieuse, des situations préoccupantes persistent. De nombreux jeunes actifs, qui ne quittent pas la région durant l'été, souvent parce qu'ils travaillent plutôt que de partir en vacances, doivent libérer leur logement à l'approche de l'été pour laisser place aux locations touristiques. Certains se retrouvent ainsi contraints de dormir dans leur voiture pendant plusieurs semaines ou d'accepter des colocations en situation de surpeuplement.
L'usage du bail mobilité, instauré par l'article 107 de la loi « Élan » de 2018, est aussi parfois détourné de sa vocation - loger des personnes en études supérieures, en apprentissage, en stade, en service civique ou en mission temporaire - pour optimiser la location saisonnière. En dehors des zones à forte population étudiante, à l'instar de Nice, il peut alors être préjudiciable aux jeunes actifs, en permettant aux bailleurs de renouveler rapidement les occupants et surtout de libérer un logement à l'approche de l'été où la location saisonnière est plébiscitée.
En effet, comme le soulignait le rapport d'Amel Gacquerre et Sophie Primas pour la commission des affaires économiques du Sénat83(*), « le marché locatif français subit l'attraction pour la location touristique de courte durée et le bail mobilité a même pu, dans certaines régions, contribuer à l'optimisation maximale des rendements locatifs, les appartements étant loués en bail mobilité hors saison et en meublé de tourisme pendant la saison touristique ».
Bien que ces pratiques dévoyées soient difficiles à mesurer, le bien-fondé de la mobilisation du bail mobilité pour les jeunes reste lui aussi difficile à démontrer. Un rapport de septembre 2024 sur l'insertion des jeunes notait que « l'impact de ce nouveau bail pour faciliter l'accès au logement locatif privé des jeunes et la réalité de sa mobilisation par les bailleurs au profit des jeunes sont difficiles à mesurer faute de données. De plus, en favorisant le renouvellement rapide des locataires, il tendrait plutôt à confronter les candidats à l'entrée dans le logement à des prix de marché toujours actualisés, et les priverait de l'effet protecteur des mesures de gel des loyers prévues dans les baux ordinaires (hors mise en place et respect de règles d'encadrement des loyers)84(*). »
Malgré les demandes des rapporteurs, aucune administration n'a pu fournir de données chiffrées concernant l'utilisation de ce bail et confirmer ou infirmer son dévoiement dans certaines zones touristiques tendues. Il est donc nécessaire d'augmenter la connaissance des pouvoirs publics à son sujet et de l'encadrer davantage. Le député Inaki Echaniz a déposé une proposition de loi allant dans ce sens qui vise à remplacer la notion de « mutation professionnelle » par celle de « mutation géographique ». Le Gouvernement a indiqué être « ouvert à préciser les dispositions législatives en la matière »85(*).
Recommandation n° 16 : Rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité pour répondre aux préoccupations des zones touristiques tendues et mieux lutter contre les contournements.
3. De manière générale, remédier à l'attrition du marché locatif privé dont sont victimes les jeunes
Comme mis en évidence par le rapport sénatorial sur la crise du logement au printemps 2024, l'attrition du marché locatif est multifactorielle.
Elle découle néanmoins en partie d'un blocage des parcours résidentiels qui font que les ménages ne sortent plus du parc locatif pour accéder à la propriété, et d'une chute de l'investissement locatif. Pour loger les 70 % de jeunes qui vivent dans un logement du parc locatif privé, il n'est pas possible de faire l'impasse sur le développement de l'offre et donc sur la relance de l'investissement locatif.
Depuis la fin du « Pinel » au printemps 2025, le seul dispositif fiscal qui subsiste en faveur de l'investissement locatif est la réduction d'impôt « Denormandie dans l'ancien », applicable jusqu'au 31 décembre 2027. Il vise à encourager l'investissement locatif intermédiaire des particuliers dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat est particulièrement marqué. Toutefois, en raison de conditions particulièrement strictes, ce dispositif est très peu utilisé. D'après les données de la déclaration des revenus, la Fnaim estime qu'il y aurait 650 à 700 Denormandie par an dont seule une partie serait occupée par des jeunes. Le dispositif ne concerne pas spécifiquement les villes étudiantes, ce qui le rend encore plus marginal en matière de logements étudiants.
La mise en place d'un véritable statut du bailleur privé apparaît donc comme une priorité, comme l'avait déjà souligné la commission des affaires économiques du Sénat au printemps 2024 et comme le recommande le récent rapport de MM. Daubresse et Cosson86(*).
Pour les rapporteurs, aucun segment du logement locatif « abordable » ne doit être négligé.
Le Gouvernement s'est récemment engagé dans un plan de développement du logement intermédiaire. S'agissant des jeunes, le logement locatif intermédiaire peut constituer une solution intéressante, à condition de proposer de petites surfaces accessibles financièrement. Le régime fiscal du « LLI institutionnel », soit l'investissement des personnes morales dans des logements destinés au logement de ménages répondant à des plafonds de ressources réglementaires, offre plusieurs avantages :
- l'application d'un taux réduit de TVA de 10 % pour la construction ;
- le bénéfice d'une créance d'impôt sur les sociétés assise sur le montant de taxe foncière, pour une durée de 20 ans.
Depuis 2024, ce régime fiscal s'étend aux logements meublés ainsi qu'aux résidences services.
B. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES AU LOGEMENT SOCIAL
1. Les jeunes sont sous-représentés dans le parc social
Avec plus de 2,8 millions de ménages en attente d'un logement correspondant à leurs besoins87(*), le parc social est en forte tension. Ce chiffre est en augmentation tandis que le taux d'attribution chute depuis 2019.
On constate une très légère sous-représentation des jeunes dans le parc social. Environ 13 à 14 % des moins de 30 ans décohabitant sont locataires du parc social88(*), tandis que le parc HLM loge 16 % de la population. Néanmoins, ces chiffres occultent la part de jeunes cohabitant au domicile parental parfois de manière contrainte ou subie faute d'avoir pu trouver un logement autonome.
Ce qui apparaît toutefois plus significatif est la baisse progressive de la part des jeunes au sein de ce parc. Entre 1984 et 2013, la part des chefs de ménages de moins de 30 ans parmi les locataires du parc social est passée de 24 % à 8 %, tandis que la proportion des plus de 65 ans a progressé de 15 % en 1984 à 22 % en 201389(*). Cela peut s'expliquer par la faiblesse de la rotation dans le parc social, accrue par la précarisation des locataires, ainsi que par le vieillissement de la population.
Pour autant, le taux d'attributions en faveur des jeunes n'est pas inférieur à celui du reste de la population. En 2019, dans une note commune, l'Institut Paris Région et la Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement d'Île-de-France soulignaient : « l'offre reste largement insuffisante au regard de la demande, mais la pression de la demande n'est pas plus forte pour les jeunes que pour leurs aînés : on compte une attribution pour neuf demandes parmi les moins de 35 ans, une pour dix demandes chez les 35 ans et plus. La situation des moins de 25 ans apparaît toutefois nettement plus complexe (15 demandes pour 1 attribution) ».
Les jeunes seraient plus sujets au non-recours90(*). Effectivement, pour les jeunes, l'accès au logement social n'est pas évident. Plusieurs facteurs les éloignent du parcours classique du demandeur : ils recherchent souvent de petits logements, alors que l'offre des bailleurs reste majoritairement tournée vers des surfaces plus grandes91(*). Leur forte mobilité et le temps court dans lequel s'inscrivent leurs demandes, qui contrastent avec les délais longs d'attribution et la faible rotation du parc social, accentuent encore cet écart.
Les règles de priorisation jouent aussi en leur défaveur. Les demandes sont classées en fonction de l'ancienneté, ce qui pénalise les jeunes inscrits depuis peu. En outre, si le jeune est pris en compte dans le système de priorité, c'est uniquement lorsque ses caractéristiques sociales correspondent à une situation de priorité (violence conjugale, sortant de structure d'hébergement, etc.). Par exemple, un étudiant sans logement stable peut être jugé comme non prioritaire, au motif qu'il pourrait simplement abandonner sa formation pour sortir de cette instabilité92(*) !
De même, les critères tenant compte de la taille du ménage privilégient les familles au détriment des célibataires, très nombreux parmi les moins de 30 ans (63 %). Pourtant, les jeunes ne sont pas majoritaires parmi les demandeurs de logements d'une pièce. Hors logements sociaux étudiants, l'UNCLLAJ observe que le taux d'attribution de studios à des jeunes est plus faible qu'en population générale.
Enfin, un des freins à l'accès facile et rapide des jeunes au parc social relève pour certains jeunes (ou pour leurs parents) de la difficulté à se projeter dans un parc social tel qu'ils se le représentent, avec parfois encore des a priori sur l'image d'un logement social.
2. Les jeunes doivent être mieux insérés dans le parcours classique de demande de logement social
Une première solution consiste à mieux insérer les jeunes dans le parcours classique de demandeur d'un logement social. Cela passe par un double objectif : renforcer l'attractivité du parc auprès de cette population et améliorer la prise en compte par le parc social des spécificités des jeunes.
Pour lutter contre le non-recours des jeunes au logement social, il faut mieux articuler l'accès au logement social de jeunes sortant d'un dispositif d'accompagnement ou d'une résidence dédiée.
Sous réserve des conditions d'attribution, un jeune sortant d'un FJT ou d'un autre dispositif d'accompagnement et présentant une stabilité géographique devrait se voir plus systématiquement proposer une demande de logement social. Cela permettrait de l'associer à un « moment de la vie ».
Comme souligné par le rapport du COJ et du CNH, en Île-de-France, la région mobilise son contingent afin de permettre aux jeunes logés en FJT ou accompagnés par un CLLAJ d'accéder prioritairement au logement social, grâce à une mise à disposition du logement à l'Urhaj Île-de-France, qui propose le logement aux jeunes du réseau, positionne les candidatures et s'assure de la complétude des dossiers des jeunes.
Recommandation n° 17 : Faciliter l'accès des jeunes au parc social « classique » en :
- proposant une demande de logement social aux jeunes éligibles sortant d'un logement accompagné ou d'un dispositif d'accompagnement dans le logement, en lien avec les acteurs de l'information sur le logement des jeunes, afin d'associer la demande à un « moment de la vie » ;
- évaluant les effets de la cotation sur la demande des jeunes et en améliorant leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution (CIA).
L'offre doit être davantage adaptée à leurs besoins, notamment en matière de surfaces. Comme l'indique une étude de l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) en 2022, citée par le rapport de Jean-Baptiste Blanc pour la commission des finances du Sénat en juillet 202593(*), 44 % des demandes dans le logement social portent sur des T1 ou des T2, quand seuls 31 % des logements sociaux dans le parc correspondent à ces caractéristiques94(*). En Île-de-France, la demande de petits logements de type « T1 » correspond à 20 fois la capacité d'attribution annuelle95(*).
La circulaire du 12 février 2025 va dans ce sens, en demandant aux préfets de veiller à ce que, sous réserve des particularités locales, 50 % de la production soit orientée vers des logements de type T1 ou T2. Cette orientation doit s'appuyer sur les logements financés en Plai ainsi que sur ceux destinés aux jeunes et aux étudiants, y compris ceux dédiés aux moins de 30 ans au titre de l'article 109 de la loi « Élan ».
Comme le recommande le rapport de la commission des finances du Sénat de juillet 2025, il est par conséquent nécessaire de développer des modèles économiques pour le financement de ces logements de taille plus modeste de même que pour la reconversion des logements sociaux de grande taille en plus petits logements, aujourd'hui très coûteuse.
Les collectivités locales pourraient aussi être encouragées à intégrer cette dimension dans leurs programmes locaux de l'habitat (PLH). Le rapport des députés MM. Corceiro-Logier de 2021 recommande d'ailleurs d'expérimenter des bonifications de subventions afin de favoriser la construction de petites surfaces, mieux adaptées aux jeunes ménages et aux parcours résidentiels de courte durée.
Recommandation n° 18 : Développer un modèle de financement qui encourage la construction de logements sociaux de petite surface et la reconversion de grands logements au vu de la demande actuelle dans le parc social.
3. Les solutions adaptées aux jeunes au sein du parc social doivent être développées
Depuis plusieurs années, le législateur a donné la possibilité aux bailleurs sociaux de développer des offres différenciées répondant aux profils et aux besoins des jeunes. Pour les rapporteurs, ce type de solutions innovantes doit être encouragé.
Face à la crise du logement, il faut diversifier et multiplier autant que possible les segments du parcours résidentiel.
a) La colocation dans le parc social
Issue de la loi dite « Molle » de 200996(*), la colocation dans le parc social a été étendue au-delà des publics jeunes en 2018 par la loi « Élan »97(*) puis assouplie en 2022 par la loi dite « 3DS ». La colocation paraît effectivement intéressante dans le parc social puisque la moitié des ménages demandeurs se compose d'une seule personne souhaitant un T1 et T2 alors que plus d'un tiers du parc social est composé de T4 ou plus.
Un assouplissement progressif du cadre
juridique
de la colocation dans le parc social
- La loi dite « Molle » de 2009 destinait la colocation dans le parc social aux étudiants, aux moins de 30 ans ainsi qu'aux jeunes en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. La colocation était encadrée par un contrat unique pour l'ensemble des colocataires, avec une clause de solidarité. Les locataires n'étaient pas tenus de respecter les plafonds de ressources et ne bénéficiaient pas du droit au maintien dans les lieux ;
- la loi dite « Élan » de 2018 a étendu la colocation dans le parc social à tous les publics (sauf ceux ne pouvant être que cotitulaires du même bail, par exemple les couples mariés, pacsés, les membres d'une même fratrie ou des ascendants ou descendants). Afin de renforcer son attractivité auprès des jeunes, la clause de solidarité a été supprimée : chaque locataire conclut désormais son contrat de location indépendant. Les locataires doivent respecter le plafond de ressources applicable et ont droit au maintien dans les lieux ;
- la loi dite « 3DS » de 2022 a quant à elle permis à des associations de louer des logements du parc social en vue de les sous-louer en colocation.
Plus de quinze ans après sa consécration juridique, la colocation dans le parc social reste peu usitée. En effet, son modèle économique est peu attractif pour les bailleurs sociaux en raison d'une rotation importante avec risque de vacance et d'une absence de solidarité financière qui entraîne un risque d'impayé : on compterait environ 3 300 logements sociaux en colocation pour 6 500 individus concernés au 1er janvier 2022. Cela représente 0,1 % du parc. La colocation reste donc marginale dans le parc social malgré une croissance de 7 % du nombre de logements dédiés entre 2021 et 202298(*).
Il n'existe pas de décompte national des colocations du parc social. Selon une étude de l'Ancols de septembre 2022, moins d'un logement locatif social sur 1 000 était proposé en colocation au 1er janvier 2022, soit moins de 5 000 sur un parc comptant plus de 5 millions de logements. Cela concernait donc environ 10 000 colocataires sur 11 millions de locataires sociaux. L'USH a indiqué qu'une nouvelle enquête pourrait être envisagée en 2025 afin d'observer le développement de cette formule. 51 % des bailleurs intéressés par l'Ancols en 2022 expliquent le non-développement de la colocation par une demande inexistante.
Malgré son caractère marginal, elle reste néanmoins un outil ciblant largement les jeunes : selon l'enquête de l'Ancols, 49 % des individus en colocation dans le parc social ont moins de 30 ans, certains bailleurs privilégiant de fait cette population : 30 % des bailleurs interrogés n'accueillent en colocation que des individus de moins de 30 ans99(*).
Pour les jeunes, elle présente plusieurs avantages : celui d'un loyer à prix réduit au sein d'un logement autonome ainsi que d'une augmentation associée du pouvoir d'achat. Néanmoins, dans le parc social, elle présente le désavantage de ne pas permettre le choix du colocataire et d'être souvent proposée dans le cadre de logements non-meublés.
Pour de nombreux jeunes, la colocation peut aussi être subie. La colocation doit être un choix de vie des demandeurs. C'est sans doute pour cela qu'elle n'a pas vocation à se développer à très grande échelle. Néanmoins, sa très faible diffusion auprès des jeunes laisse penser qu'un potentiel de développement existe.
Aujourd'hui, peu d'organismes de logement social proposent une offre de colocation au sens de la loi « Élan ». Ils sont seulement 32 % et parmi eux, plus d'un tiers offrent moins de 5 logements en colocation. En effet, pour les bailleurs, la courte durée des baux, la gestion de la rotation et des éventuels meubles et équipements peuvent être sources de complexité de gestion. L'Ancols avance que 40 % des baux en colocation dans le parc social ont une durée inférieure à un an, et 31 % une durée de plus de 3 ans.
Depuis 2018, la colocation se fait par baux séparés, sans clause de solidarité : cette suppression a renforcé l'attractivité du dispositif pour les jeunes mais fait peser sur le bailleur une complexité de gestion supplémentaire ainsi qu'un risque de perte financière plus important.
Des projets de colocations solidaires menés par des associations
Certains bailleurs mobilisent des partenariats avec des associations qui repèrent les candidats et gèrent les logements, parfois dans le cadre de projets de colocations solidaires. C'est le cas par exemple des colocations à projets solidaires Kaps de l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) qui permettent à des jeunes de moins de 30 ans de vivre en colocation dans un appartement du parc social, au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en contrepartie d'un engagement en faveur de projets renforçant le lien social comme le mentorat.
Parmi les difficultés juridiques pouvant être levées, le système d'attributions au sein du parc social ne permet pas, dans l'offre en colocation, qu'un colocataire déjà en place choisisse son futur colocataire. Un dispositif de cooptation encadrée, sous réserve du respect des conditions d'attribution pourrait donc être expérimenté dans le parc social.
b) Les logements sociaux dédiés aux moins de 30 ans
L'article 109 de la loi dite « Élan » de 2018 a ouvert la possibilité de réserver tout ou partie de programmes de logements sociaux à des jeunes de moins de 30 ans. Sous réserve d'une autorisation spécifique, ces logements sont loués à des jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de contrats d'un an renouvelable dès lors que les locataires continuent à remplir les conditions d'accès100(*). Ces derniers ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Cette possibilité reste peu mobilisée : en Île-de-France, seuls 130 logements ont été attribués en 2021, 81 en 2022 et 163 en 2023. Selon le ministère du logement, depuis 2021, plus de 1 000 nouveaux logements locatifs sociaux qui seront attribués prioritairement à des jeunes de moins de trente ans sont financés chaque année. Des autorisations spécifiques sont également prises en compte pour plusieurs centaines de logements sociaux du parc existant mais il n'existe pas de décompte systématique au-delà des informations remontées au cas par cas.
Plusieurs freins peuvent l'expliquer. D'abord, les logements sont non meublés, ce qui limite leur attractivité pour des jeunes en mobilité. En outre, l'APL présente des conditions de solvabilisation moins avantageuse que l'APL-foyer, le tout sans accompagnement ni équipements collectifs.
Du côté des bailleurs, cette solution présente un équilibre économique moins avantageux que le logement social classique :
- une rotation plus élevée qui engendre des coûts de gestion d'entrée et sortie plus importants et un risque de vacance ;
- les besoins spécifiques des jeunes privilégient les petits logements, dont la taille ne permet pas toujours d'obtenir un loyer au mètre carré qui absorbe le surcoût de construction et nécessite, pour les résidences étudiantes, une certaine taille de résidences ;
- le mode de récupération des charges, sous la forme d'une régularisation annuelle, est peu adapté aux occupations courtes du logement par les jeunes : à titre de comparaison, autant dans le cas des colocations que des résidences universitaires, il est possible de récupérer les charges sous la forme d'un forfait mensuel n'appelant pas de régularisation ultérieure ;
- la RLS, l'attribution via la Caleol, l'application des réservations-contingent État et le manque de subventions spécifiques limitent encore davantage l'attractivité de cette formule ;
- enfin, les logements dits « article 109 » se gèrent en direct ; or la gestion directe n'est pas toujours maîtrisée ni souhaitée par tous les organismes.
Recommandation n° 19 : Pour faciliter le développement de la colocation dans le parc social ainsi que des logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans :
- expérimenter un dispositif de cooptation encadrée des colocataires, sous réserve du respect des conditions d'attribution ;
- continuer à promouvoir les logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de la programmation des aides à la pierre et ouvrir la possibilité aux bailleurs sociaux de récupérer les charges de ces logements via un forfait, comme dans le cas de la colocation.
c) Le bail mobilité
Autre solution développée dans le parc privé qui pourrait trouver à s'appliquer, quoique de manière sans doute limitée, dans le parc social : le bail mobilité.
Le bail mobilité, prévu par l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989101(*), a été créé par la loi dite « Élan » pour accueillir les jeunes professionnels et les personnes en mobilité géographique pour des durées inférieures à un an. Ce bail n'est pas autorisé dans le parc social où il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement sous quelque forme que ce soit sous peine d'une amende de 9 000 euros102(*). Il existe néanmoins des exceptions pour les logements-foyers, les colocations solidaires via un intermédiaire agréé en vue de l'accueil des personnes âgées, handicapées, de moins de 30 ans, d'étudiants ou de saisonniers, pour les logements dits « Article 109 de la loi Élan » et pour la sous-location pour six mois à des saisonniers de logements meublés103(*).
Dans le parc privé, pour les raisons évoquées plus haut, les baux mobilité n'ont vraisemblablement pas permis de répondre à la demande en logement des apprentis dont le nombre a quasi triplé entre 2017 et 2022.
Dans le cadre du projet de loi pour le développement d'une offre de logements abordables, le Gouvernement a donc souhaité élargir ce bail mobilité au parc social. La commission des affaires économiques du Sénat l'avait alors adopté tout en soulignant son effet probablement très marginal pour le logement des apprentis et des actifs en mobilité.
Néanmoins, les rapporteurs soulignent que le bail mobilité serait, contrairement au parc privé, exempt de risque de dévoiement au profit de la location meublée touristique. Le risque d'éviction au détriment des publics prioritaires est également limité compte tenu de la structure du parc, de la demande et du besoin des bailleurs de limiter au maximum la vacance de leurs logements bien qu'il doive faire l'objet d'attention.
Les rapporteurs se prononcent en faveur de donner aux bailleurs sociaux toutes les souplesses possibles permettant de multiplier les segments de logements en faveur des jeunes.
Recommandation n° 21 : Ouvrir le bail mobilité au parc social car il y serait exempt de risque de dévoiement.
C. FACILITER L'ACCESSION DES JEUNES À LA PROPRIÉTÉ
1. La crise du logement dégrade les conditions d'accès des jeunes à la propriété
Depuis une trentaine d'années, la part de jeunes propriétaires a augmenté du fait de la progression du crédit (taux d'intérêt favorables, allongement des durées d'emprunt, etc.)
En 1998, seuls 11,2 % des ménages dont la personne de référence était âgée de moins de 30 ans étaient propriétaires de leur résidence principale. En 2012, c'était le cas de 12,8 % d'entre eux et en 2018, de 18,5 %104(*).
L'âge moyen des primo-accédants est stable depuis les années 2010 : il est proche de 34 ans105(*).
Néanmoins, plus récemment, les conditions d'emprunt se sont fortement dégradées si bien que l'accès à la propriété est de plus en plus l'affaire des plus aisés et des plus âgés.
La part des moins de 30 ans propriétaires de leur résidence principale a récemment baissé, passant de 18,5 % en 2018 à 16,7 % en 2021106(*).
Parmi les ménages propriétaires d'un seul logement, 4,6 % ont moins de 30 ans107(*), et ils ne sont que 1,8 % parmi les ménages multipropriétaires108(*).
La hausse des prix immobiliers depuis le début des années 2000 a dégradé le pouvoir d'achat des ménages, malgré l'augmentation de l'endettement. Cette dégradation affecte particulièrement les jeunes ménages et les primo-accédants.
Au premier trimestre 2025, « toutes choses égales par ailleurs », le pouvoir d'achat immobilier était inférieur de 26 % à ce qu'il était en 2000 et, pour acheter le même logement, un primo-accédant devait s'endetter sur 23 ans, contre 15 ans en 1965 ou 2000109(*).
Source : Fnaim
Par conséquent, la part des plus âgés dans les ventes de logements anciens a augmenté depuis plusieurs années : alors qu'elle était de 30 % pour les plus de cinquante ans en 2015, elle est de 39 % en 2024.
2. L'accès à la propriété reste un rêve pour les jeunes et revêt un intérêt économique, social et politique
Contrairement aux idées reçues selon lesquelles les jeunes générations privilégieraient aujourd'hui l'économie de l'usage et du partage et délaisseraient la propriété, cette dernière demeure une aspiration.
Même s'ils sont plus ouverts à l'économie de l'usage, les jeunes aspirent, comme leurs parents avant eux, à devenir propriétaires de leur logement. C'est ce que révèle une étude menée par Deloitte et la fédération des promoteurs immobiliers (Fpi) en 2020110(*). L'accès à la propriété reste un signe d'accomplissement personnel, gage de stabilité et de sécurité. L'argument de la sécurité est d'ailleurs le premier déterminant à l'acquisition d'un logement pour 42 % des jeunes interrogés, devant l'investissement (34 %) et la réussite sociale (4 %). En outre, 3 jeunes sur 5 estiment que la réforme des retraites est un argument supplémentaire pour acheter111(*).
Comme dans les années 1950, les jeunes d'aujourd'hui attacheraient en outre une préférence marquée pour les logements neufs : 60 % des répondants à l'étude Deloitte précitée préfèrent acquérir un logement neuf plutôt qu'ancien.
La maison individuelle reste également un idéal pour 73 % des jeunes interrogés.
Face à cela, favoriser l'accès à la propriété des jeunes est d'autant plus nécessaire que cela revêt un intérêt social, économique et politique.
D'un point de vue macro-économique, il est profitable à la croissance de favoriser la circulation du capital dans un contexte où l'épargne des ménages atteint plus de 18 % du PIB112(*), d'autant plus que les plus jeunes ont une plus forte propension à consommer que leurs aînés.
Cela a aussi un intérêt évident dans le contexte de la crise du logement : un propriétaire de plus est un locataire de moins pour un parc locatif en saturation.
Favoriser l'accès à la propriété des jeunes revêt enfin évidemment un intérêt social et politique. Outre le marqueur de réussite sociale que représente l'accès à la propriété, c'est aussi une source de sécurité, de projection dans la vie et d'ancrage dans un territoire. Comme le rappelle l'Institut Montaigne, l'accès à la propriété est « un rempart face au risque de déclassement », dans un contexte où l'angoisse du déclin est ressentie par 87 % des Français113(*).
3. Le soutien à l'accès à la propriété des jeunes doit être renforcé
Contrairement à d'autres pays européens, en France, l'accès à la propriété des jeunes ne fait pas l'objet de mesures de soutien spécifiques ciblées sur cette tranche d'âge.
Le système finnois du « bonus pour les épargnants en logement »
En Finlande, un système d'épargne attractif combiné à un prêt à taux bonifié ainsi qu'à une garantie de l'État permet aux jeunes entre 15 et 44 ans d'être soutenus dans l'acquisition de leur première résidence principale.
* Le dispositif d'épargne : les jeunes ouvrent un compte épargne logement sur lequel ils versent entre 150 € et 4 500 € par trimestre, pendant au moins huit trimestres calendaires. Ce compte rapporte 1 % d'intérêts de base. S'y ajoute un intérêt « bonus » de 4 % si certaines conditions sont remplies (épargne minimale, achat du logement). Ces intérêts ne sont pas imposables.
* Le prêt à taux bonifié : pour être éligible au prêt, le jeune doit avoir épargné un montant au moins égal à 10 % du prix d'achat du logement. L'État prend en charge 70 % de la partie du taux d'intérêt qui dépasse 3,8 % pendant les 10 premières années du prêt. Le montant du prêt, défini par rapport à des plafonds qui varient selon les localités, peut couvrir jusqu'à 90 % du prix d'achat du logement et doit être remboursé dans un délai maximum de 25 ans.
* La garantie : le prêt bénéficie en outre d'une garantie de l'État gratuite pour une partie de l'emprunt et qui peut atteindre 60 000 €.
Recommandation n° 25 : Sur le modèle de pays du nord de l'Europe, développer un dispositif ciblé de soutien à l'accession à la propriété des jeunes générations, associant un encouragement à l'épargne ainsi que des bonifications de taux d'intérêt afin d'assurer une action contracyclique.
Plusieurs mesures exceptionnelles en soutien à la primo-accession à la propriété ont néanmoins été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2025 :
- pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2026, une exonération de droits de succession pour les dons consentis dans le cadre familial (des parents voire des grands-parents ou des arrière-grands-parents jusqu'aux enfants) affectés par le donataire à l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement à usage de résidence principale, dans la limite de 100 000 € par un même donateur et de 300 000 € par donataire. Le bien acquis doit être conservé en résidence principale pendant cinq ans ;
- pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2027, l'extension du prêt à taux zéro à toutes les opérations neuves sur l'ensemble du territoire, y compris pour les maisons individuelles114(*), et aux opérations anciennes sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux, de performance énergétique et de localisation du logement en zone détendue ;
- pour trois ans, jusqu'au 31 décembre 2028, la non-application de la hausse exceptionnelle des droits de mutation à titre onéreux (ou « frais de notaire ») aux primo-acquisitions de logements anciens à usage de résidence principale. En effet, en 2025, 83 conseils départementaux sur 101 ont adopté, conformément à la loi de finances, une augmentation du taux de ces droits pour le porter à 5 %115(*). Outre la non-application de cette hausse, les départements ont également la faculté d'adopter une réduction ou une exonération de ces droits pour les primo-accessions de logements anciens. Néanmoins, seul le département de Savoie a décidé de pratiquer une réduction ciblée, réduisant le taux de 4,5 % à 4 % pour les primo-accédants. Aucun département n'a pratiqué d'exonération.
Il est encore tôt pour mesurer les conséquences de ces mesures sur l'accès à la propriété des plus jeunes, sauf peut-être pour le PTZ dont la généralisation dans le neuf a déjà porté un coup d'accélération aux ventes de maisons individuelles, dont le rebond en 2025 atteint 40 % après une plongée en 2023 et 2024.
En dehors de ces mesures exceptionnelles, l'État soutient plusieurs dispositifs en faveur de l'accession sociale à la propriété, eux aussi sans ciblage spécifique sur les jeunes.
Depuis la suppression de l'APL-accession en 2018, le prêt à taux zéro (PTZ) est le principal levier actuel de soutien de l'État à l'accession à la propriété. Prêt à l'accession sans intérêt destiné aux primo-accédants, il est attribué sous condition de ressources et son montant est égal au produit d'une quotité par le coût total de l'opération, apprécié dans la limite d'un plafond défini en fonction de la localisation du logement et de la composition du ménage. L'âge moyen des bénéficiaires du prêt à taux zéro est de 33 ans. Les ménages bénéficiaires sont souvent de petite taille (une à deux personnes), seulement 30 % des ménages bénéficiaires étant composés de trois personnes ou plus. Le ciblage social du dispositif est plus avéré : 52 % des bénéficiaires sont ouvriers ou employés. Le revenu fiscal de référence dans le neuf s'élève à 27 770 €, la tranche 1 regroupant près de 50 % des bénéficiaires contre 6 % pour la tranche 4 qui inclut les revenus les plus élevés.
Les jeunes de moins de 35 ans ont représenté plus de 68 % des bénéficiaires du PTZ en 2024 selon la DHUP. En 2025, au bénéfice de l'extension du PTZ à tous les logements neufs sur tout le territoire, y compris dans l'individuel, la DHUP estime que le volume de PTZ pourrait atteindre 67 000 dont 46 000 prêts accordés à des moins de 30 ans.
Sources : Réponses au questionnaire budgétaire, Projet de loi de finances pour 2025
En complément du PTZ, les salariés peuvent bénéficier du prêt « Accession » d'Action logement, au taux réduit de 1 % pour un montant de 30 000 €.
Recommandation n° 23 : Proroger la généralisation du PTZ dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer pleinement ses effets sur les jeunes ménages primo-accédants.
Le prêt à l'accession sociale (PAS) est quant à lui un prêt conventionné spécifique, de moins en moins mobilisé depuis la suppression de l'APL-accession en 2018.
Garanti par le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), il est réservé à l'acquisition d'une résidence principale pour les ménages dont les revenus ne dépassent pas des plafonds de ressources en application du décret du 18 mars 1993.
Depuis la mise en extinction progressive de l'APL-accession au 1er janvier 2018, on enregistre une baisse de 34,3 % des PAS entre 2020 et 2023 et une baisse de 37,5 % du montant des opérations entre 2020 et 2023.
|
· PAS 2023 |
|
|
Effectifs |
28 686 |
|
Coût moyen d'opération |
204 465 |
|
Montant moyen prêté |
158 299 |
|
Revenu mensuel moyen |
2 838 |
Source : SGFGAS (déclarations reçues au 15/03/2024)
D'autres leviers d'accession progressive, démembrée ou partagée à la propriété, se développent. Ils permettent de diversifier le parcours résidentiel.
Bien que les jeunes témoignent d'une préférence pour la propriété « classique », l'accession progressive à la propriété, dans le cadre d'un régime inspiré de la location avec option d'achat, est également plébiscitée, comme le montre l'étude précitée. En revanche, la propriété partagée ou coopérative, la propriété à temps limitée ou la propriété démembrée sont moins recherchées, probablement en raison d'une connaissance encore embryonnaire de ces mécanismes116(*).
Créée par la loi du 12 juillet 1984, la location-accession est un statut intermédiaire entre la location et l'accession pour élargir le choix offert aux ménages pour se loger. Une opération de location-accession comporte deux phases :
- une phase locative d'une durée minimale de six mois et habituellement comprise entre un et quatre ans durant laquelle l'accédant verse au vendeur une redevance qui se compose d'une fraction locative (assimilable à un loyer) et une fraction acquisitive (assimilable à une épargne qui représente un paiement anticipé du prix du logement) ;
- une phase acquisitive durant laquelle l'accédant, après avoir levé l'option, verse le prix de vente du logement au vendeur. La fraction acquisitive de la redevance accumulée pendant la phase locative s'impute sur le prix de vente préalablement fixé dans le contrat de location-accession.
Si le ménage ne lève pas l'option à l'issue de la durée maximale de la phase acquisitive, il ne bénéficie pas d'un droit au maintien dans les lieux mais peut disposer d'une garantie de relogement et la fraction acquisitive lui est alors restituée.
La location-accession repose aujourd'hui sur le prêt social location-accession (PSLA), prêt conventionné consenti à un opérateur (HLM, SEM, promoteur...) afin de créer des logements destinés à des ménages modestes et qui feront l'objet d'un contrat de location-accession. Ce PSLA a été créé en 2004 afin de rénover la location-accession qui n'avait pas trouvé son public.
Ce dispositif ouvre droit, après convention avec l'État et décision d'agrément, dans le cas d'un logement neuf, à un taux de TVA réduit à 5,5 % et à une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. Dans le cas d'un logement ancien, il donne droit à une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans sous condition de travaux. Lors de la levée de l'option, l'accédant peut également bénéficier d'un prêt à taux zéro (dans le cas d'un logement neuf). Depuis 2011, les conditions de ressources des locataires-accédants ayant levé l'option sont alignées sur celles du PTZ117(*).
Il ouvre également droit, pour l'accédant, au bénéfice de l'aide personnalisée au logement en phase locative.
Après une forte montée en charge du dispositif entre 2009 et 2015, le nombre de logements agréés dans le cadre du PSLA a stagné entre 2016 et 2018, suivi d'une nette diminution à partir de 2019. En 2023, seulement 4 632 logements ont été agréés, soit le niveau le plus bas depuis 2010.
Source : Infocentre Sisal jusqu'en 2022 puis InfoSIAP en 2023
La part du collectif continue de diminuer pour atteindre 57,4 % des agréments en 2022 (hors opérations mixtes), contre 70 % en 2015.
Ce sont principalement les coopératives HLM, les entreprises sociales pour l'habitat et, plus marginalement, les offices publics de l'habitat qui s'engagent dans des opérations de PSLA (83,1 % en 2022).
Le succès du PSLA est, dans de multiples départements, dû à l'existence d'une culture locale de l'accession à la propriété. Dans certains cas, une politique volontariste des élus locaux (conseils départementaux notamment) favorise également le développement des opérations PSLA.
La société civile immobilière d'accession progressive à la propriété (Sciapp), introduite par la loi dite « ENL » du 13 juillet 2006118(*), est un modèle de financement locatif par le biais d'une société civile immobilière (SCI) partagée entre un organisme HLM et des ménages locataires. Le dispositif permet aux ménages de devenir propriétaire de leur logement au bout d'une durée longue (40 ans) et sans recourir au crédit immobilier : en payant leur loyer qui sert à rembourser des prêts, ils achètent progressivement les parts sociales qui forment le capital de la Sciapp et deviennent in fine propriétaires de l'ensemble de la Sciapp qui peut être dissoute, chaque logement devenant propriété de chaque ménage.
Dans une telle structure, l'organisme HLM est associé-gérant de la SCI : il apporte l'immeuble et assure la gestion de la Sciapp. Le locataire-associé est quant à lui titulaire d'un bail locatif qui lui permet de bénéficier du logement en contrepartie du versement du loyer et des charges. Il apporte un capital de départ (de 2 000 à 5 000 €) qui sert de fonds de roulement pour la Sciapp.
La plupart des logements en Sciapp sont conventionnés en Plus pour que les ménages puissent supporter les charges supplémentaires liées au statut de propriétaires tout en pouvant optimiser leur mensualité avec le recours aux APL le cas échéant. Toutefois le dispositif peut également s'adapter sur des conventionnements Plai ou PLS.
Aujourd'hui, 9 Sciapp sont en gestion en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine par deux organismes : le COL et le groupe des Chalets pour un total de 114 logements.
Les premiers projets sur lesquels a été pensé et développé le modèle de la Sciapp ont été conçus en habitat participatif.
Plus développé, le bail réel solidaire (BRS) semble particulièrement adapté aux jeunes primo-accédants.
Créé par la loi du 6 août 2015 et mis en place dès 2017, le BRS est un mécanisme d'accession basé sur la dissociation entre la propriété foncière et la propriété bâtie qui permet de diminuer significativement le prix d'acquisition d'un logement, en adéquation avec les ressources des ménages modestes. Le preneur occupe le bien à titre de résidence principale et est propriétaire des droits réels immobiliers du logement dont le foncier demeure la propriété permanente de l'office foncier solidaire (OFS), à qui le ménage verse une redevance mensuelle pendant toute la durée du bail, qui varie entre 18 et 99 ans et est rechargeable à l'infini.
Depuis 2017119(*), le PTZ est ouvert aux primo-accédants souhaitant acquérir un logement via un BRS.
Conformément à la loi dite « Élan », depuis le 1er janvier 2019, les BRS sont intégrés dans le décompte des logements sociaux prévu au titre de l'article SRU.
Le BRS est destiné à l'accession de ménages sous plafonds de ressources PSLA à des prix de sortie de l'ordre de 15 à 30 % en-dessous du marché immobilier neuf. En contrepartie, le logement doit être à usage de résidence principale et la plus-value de cession est encadrée.
Le dispositif connaît une dynamique de déploiement récente. Selon le réseau Foncier solidaire France, en novembre 2024, plus de 3 700 logements étaient déjà livrés en BRS tandis que plus de 20 000 étaient en projet. Environ 85 % des BRS livrés sont des programmes neufs, le reste étant des ventes HLM ou d'autres dispositifs dans l'ancien. La majorité des livraisons sont intervenues sur les seules années 2023 et 2024. Les communes SRU représentent 85 % des unités BRS livrées et 76 % de celles en projet.
Source : Foncier solidaire France, bilan d'activité des OFS, données à fin novembre 2024
Les bailleurs sociaux ont réalisé plus de la moitié des BRS commercialisés mais ceux des promoteurs privés sont en hausse : ils représentaient 20 % des BRS en projet en novembre 2024.
Les rapporteurs notent que le développement du BRS semble plus aisé dans le collectif, où la dissociation du foncier et du bâti emporte moins de difficultés et de réticences psychologiques que dans l'individuel.
Comme la location-accession, la progression du BRS est en partie dépendante de l'impulsion de territoires dans lesquels il existe une culture de l'accession sociale à la propriété.
Recommandation n° 22 : Encourager les collectivités à développer l'accession sociale à la propriété, et notamment le BRS dans le logement collectif, via un volet au sein de leurs programmes locaux de l'habitat.
Le développement récent du BRS nécessite d'anticiper la suite du parcours résidentiel des ménages concernés.
En effet, dans le cas de la cession d'un BRS portant sur un logement qualifié d' « ancien » car construit il y a plus de cinq ans, l'acquéreur potentiel ne sera pas éligible au PTZ. Le parcours résidentiel des titulaires d'un BRS pourra donc se heurter à des difficultés dans quelques années, à la revente. Il est donc nécessaire de rendre éligibles au PTZ les reventes de logements dont les droits réels immobiliers ont fait l'objet d'une première acquisition en BRS.
En novembre 2024, seules 39 reventes de BRS ont eu lieu en France. Il s'agit donc d'une mesure d'anticipation alors que ce dispositif connaît un fort déploiement, afin d'éviter un goulot d'étranglement d'ici cinq ou dix ans qui freinerait la mobilité résidentielle de ces ménages.
Une attention doit également être portée au marché de la revente en BRS afin de maintenir un décalage de prix suffisant avec les ventes classiques pour faire perdurer les conditions d'attractivité du BRS au gré des reventes.
Recommandation n° 24 : Ouvrir les logements acquis via un BRS au PTZ lors de leur revente.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
AXE 1 : Se donner les moyens d'une programmation du logement des jeunes
Recommandation n° 1 : Approfondir la dynamique actuelle pour définir une véritable programmation territorialisée du logement pour tous les jeunes :
- étendre le plan national « logement étudiants » au logement des jeunes actifs en définissant des objectifs régionaux de production de logements abordables dédiés aux jeunes à horizon 2030 ;
- mettre en place une grille nationale d'analyse et de suivi des carences en logements des jeunes ;
- généraliser la mise en oeuvre d'instances régionales dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes ;
- associer aux objectifs pluriannuels du logement des jeunes une programmation également pluriannuelle des aides à la pierre.
Recommandation n° 2 : Améliorer la couverture géographique des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et étendre leur regard au logement des jeunes en général.
Recommandation n° 3 : Accélérer le regroupement des offres à vocation sociale au sein de plateformes numériques dédiées au logement accompagné et temporaire de tous les jeunes, au-delà des seuls étudiants.
AXE 2 : Augmenter l'offre de logements dédiés aux jeunes en soutenant le modèle économique du logement accompagné sans créer de concurrence entre les publics
Recommandation n° 4 : Sortir de la segmentation stricte entre étudiants et jeunes actifs, de moins en moins adaptée aux profils des jeunes, en expérimentant un rapprochement des produits pour jeunes actifs et étudiants.
Recommandation n° 5 : Expérimenter l'ouverture du financement des résidences universitaires par le « Plus » voire le « Plai » ou équivalents dans des territoires présentant des besoins importants pour des étudiants très modestes, au-delà de l'Île-de-France.
Recommandation n° 6 : Exonérer les résidences universitaires en gestion directe et les logements sociaux dédiés aux jeunes dits « article 109 de la loi Élan » de la réduction de loyer de solidarité (RLS), en contrepartie d'engagements de production ou de financement du Fonds national des aides à la pierre de la part des bailleurs sociaux, tout en veillant au maintien des APL pour les occupants.
Recommandation n° 7 : Développer et sécuriser la possibilité d'utiliser des dispositifs de dissociation entre le foncier et le bâti tels que le bail réel solidaire en faveur des résidences « jeunes » pour minorer le poids du foncier dans le loyer demandé par les propriétaires de résidences aux gestionnaires.
Recommandation n° 8 : Engager une réflexion sur le modèle économique des gestionnaires de résidences sociales et notamment des foyers de jeunes travailleurs (FJT) qui est aujourd'hui en tension face à des besoins grandissants.
Recommandation n° 9 : Valoriser le modèle du foyer de jeunes travailleurs (FJT) dont l'accompagnement socio-éducatif est un véritable tremplin vers l'autonomie des jeunes, en :
i) soutenant la rénovation et la réhabilitation des FJT ;
ii) prévenant toute compétition sur le financement et les opportunités de réalisation entre FJT et résidences sociales pour jeunes actifs (RSJA) ;
iii) soumettant les FJT non plus à une procédure d'appel à projets, inadaptée au montage progressif d'un dossier, mais à un dispositif d'appel à manifestation d'intérêt.
Recommandation n° 10 : Faciliter la réalisation de solutions innovantes pour loger les jeunes en consacrant un droit des collectivités à adapter, par convention avec l'État, les règles en matière de logement et d'habitat aux circonstances locales de leur territoire.
Recommandation n° 11 : Pour loger les jeunes travailleurs saisonniers, refuser la mise en concurrence des publics et valoriser les solutions fondées sur des initiatives locales, à l'instar de l'encouragement des particuliers à louer leur bien pour bénéficier d'un dégrèvement fiscal ou des résidences ad hoc comme les résidences à vocation d'emploi.
AXE 3 : Lutter contre la précarisation des jeunes sur le parc locatif privé
Recommandation n° 12 : Ne plus modifier les règles d'attribution et le montant des APL, qui sont une source d'économies budgétaires potentielles pour l'État, sans en mesurer prudemment les conséquences, pour ne pas réitérer des erreurs antérieures qui ont réduit le pouvoir d'achat des jeunes et notamment des jeunes actifs.
Recommandation n° 13 : Renforcer la communication à l'égard de la garantie Visale pour améliorer son acceptabilité auprès des bailleurs et ainsi accompagner sa dynamique de développement.
Recommandation n° 14 : Dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers d'ici mai 2026, étudier son impact spécifique sur les jeunes et son rôle dans le développement de pratiques telles que le coliving ou les baux civils.
Recommandation n° 15 : S'assurer que les jeunes alternants ou apprentis en situation de double-résidence ne soient pas redevables de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire.
Recommandation n° 16 : Rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité pour répondre aux préoccupations des zones touristiques tendues et mieux lutter contre les contournements.
AXE 4 : Faciliter la mobilisation du parc social « classique » en faveur des jeunes
Recommandation n° 17 : Faciliter l'accès des jeunes au parc social « classique » en :
- proposant une demande de logement social aux jeunes éligibles sortant d'un logement accompagné ou d'un dispositif d'accompagnement dans le logement, en lien avec les acteurs de l'information sur le logement des jeunes, afin d'associer la demande à un « moment de la vie » ;
- évaluant les effets de la cotation sur la demande des jeunes et en améliorant leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution (CIA).
Recommandation n° 18 : Développer un modèle de financement qui encourage la construction de logements sociaux de petite surface et la reconversion de grands logements au vu de la demande actuelle dans le parc social.
Recommandation n° 19 : Pour faciliter le développement de la colocation dans le parc social ainsi que des logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans :
- expérimenter un dispositif de cooptation encadrée des colocataires, sous réserve du respect des conditions d'attribution ;
- continuer à promouvoir les logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de la programmation des aides à la pierre et ouvrir la possibilité aux bailleurs sociaux de récupérer les charges de ces logements via un forfait, comme dans le cas de la colocation.
Recommandation n° 20 : Développer la « location active », particulièrement adaptée aux jeunes, afin d'améliorer la lisibilité de l'offre dédiée et de réduire le taux de refus des attributaires.
Recommandation n° 21 : Ouvrir le bail mobilité au parc social car il y serait exempt de risque de dévoiement.
AXE 5 : Favoriser l'accès à la propriété des jeunes
Recommandation n° 22 : Encourager les collectivités à développer l'accession sociale à la propriété, et notamment le BRS dans le logement collectif, via un volet au sein de leurs programmes locaux de l'habitat.
Recommandation n° 23 : Proroger la généralisation du prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer pleinement ses effets sur les jeunes ménages primo-accédants.
Recommandation n° 24 : Ouvrir les logements acquis via un BRS au PTZ lors de leur revente.
Recommandation n° 25 : Sur le modèle de pays du nord de l'Europe, développer un dispositif ciblé de soutien à l'accession à la propriété des jeunes générations, associant un encouragement à l'épargne ainsi que des bonifications de taux d'intérêt afin d'assurer une action contracyclique.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 15 octobre 2025, la commission des affaires économiques a examiné le rapport d'information de Mmes Viviane Artigalas, Martine Berthet et M. Yves Bleunven sur le logement des jeunes.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Mes chers collègues, avant de passer à notre ordre du jour, je tiens à saluer en votre nom notre nouvelle collègue Marie-Pierre Bessin-Guérin, sénatrice de la Loire-Atlantique, qui remplace au sein de notre commission Pierre Médevielle. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Nous examinons aujourd'hui le rapport d'information sur le logement des jeunes. Je laisse la parole aux trois rapporteurs.
Mme Martine Berthet, rapporteure. - Madame la présidente, mes chers collègues, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui les conclusions de notre mission d'information sur le logement des jeunes.
Depuis le mois d'avril dernier, nous avons entendu vingt-deux organisations : associations, administrations, bailleurs sociaux, gestionnaires de résidences ou encore représentants d'élus locaux. Notre déplacement prévu dans le Morbihan début septembre pour y observer plusieurs programmes innovants a, quant à lui, été malheureusement annulé, compte tenu de l'actualité politique.
Nous formulons vingt-cinq recommandations que nous considérons comme les clés - si j'ose dire - du logement des jeunes et qui se résument en trois actions : programmer, accompagner, innover.
C'est, je crois, la première fois que notre commission examine la crise du logement à travers le prisme d'une catégorie spécifique, la jeunesse. Pourtant, les raisons de nous y intéresser abondent. Nous avons délibérément opté pour une définition large de la jeunesse, englobant les jeunes de 18 ans, voire de 16 ans, jusqu'à 30 ans, afin de tenir compte autant des mineurs apprentis que des jeunes ménages primo-accédants.
D'abord, un constat s'impose : la situation économique et sociale des jeunes est alarmante. En plus de son niveau, l'aggravation rapide de leur précarité est préoccupante. Entre 2002 et 2019, le taux de pauvreté des 18-29 ans a augmenté de plus de quatre points. Hormis les moins de 18 ans, aucune autre tranche d'âge n'a connu une telle hausse.
La crise du logement frappe les jeunes de plein fouet. En matière de logement, ils cumulent des facteurs de précarité : ils sont à la recherche de logements de petite taille, pour de courtes durées, dans des zones où la demande explose. Sur le marché locatif privé, ils se heurtent à la concurrence de ménages plus solvables, alors qu'ils ne disposent ni de stabilité professionnelle ni de garantie familiale. À cela s'ajoute la pression de la location touristique meublée.
Cela a des effets matériels immédiats pour les jeunes. Leur taux d'effort net, une fois déduites les aides au logement, est deux fois plus élevé que pour le reste de la population. Ils sont aussi plus touchés par le mal-logement : logements trop petits, passoires énergétiques, surpeuplement dû à la colocation ou encore obligation de rester chez leurs parents du fait de l'impossibilité d'accéder à un logement autonome.
Loger les jeunes est un enjeu social et politique majeur que nous ne devons pas sous-estimer. Certains avancent qu'il ne faudrait pas construire davantage de logements dédiés aux jeunes en raison du vieillissement de la population qui réduit le poids démographique de la jeunesse. La réalité est beaucoup plus compliquée que cela : la jeunesse s'allonge ! La poursuite d'études, le report du mariage, du premier enfant et de l'entrée dans la vie active retardent le départ du domicile parental. On est aujourd'hui jeune bien plus longtemps qu'hier ! Si nous n'agissons pas, nous creuserons le fossé intergénérationnel et alimenterons une jeunesse désabusée, déjà l'une des plus pessimistes d'Europe. Comment se projeter dans la vie lorsque l'on ne parvient pas à se loger ?
La jeunesse est aussi un ensemble protéiforme : étudiants, apprentis, alternants, jeunes actifs, saisonniers, demandeurs d'emploi... Leurs statuts sont de plus en plus mouvants, les jeunes en cumulant plusieurs ou effectuant des allers-retours entre l'un et l'autre.
Pourtant, la politique du logement des jeunes est aujourd'hui centrée sur les étudiants. Les besoins pour cette population sont indéniables, mais il n'est pas légitime de négliger les jeunes actifs : à partir de 21 ans, les jeunes non-étudiants sont majoritaires au sein de la classe d'âge des 18-29 ans !
Ce prisme estudiantin se retrouve dans le plan lancé au mois de janvier 2025 par le Gouvernement, qui prévoit la création de 45 000 logements étudiants d'ici à 2027. Nous estimons ce plan nécessaire, mais il doit absolument être élargi aux jeunes actifs et s'inscrire dans une vision de moyen terme, au moins jusqu'en 2030.
C'est l'objet de nos recommandations nos 1 à 3 : définir une véritable programmation du logement pour tous les jeunes.
Pour cela, il faut mieux connaître l'offre existante. Le parc mobilisable pour les jeunes reste mal identifié. Il convient donc de poursuivre et de valoriser les observatoires territoriaux du logement étudiant, mis en place par les collectivités avec l'appui des agences d'urbanisme. Ces outils sont précieux pour orienter les politiques locales de l'habitat et la programmation des aides à la pierre.
Il faut aussi améliorer la lisibilité de l'offre. La politique publique en faveur du logement des jeunes est fragmentée. Elle dépend de plusieurs ministères - logement, enseignement supérieur, économie, santé, travail... Cela forme un millefeuille de dispositifs disparates, gérés par des acteurs différents. Les jeunes sont parfois démunis face à tant de complexité et connaissent malheureusement trop mal les aides auxquels ils peuvent prétendre. Dans l'espace numérique, le foisonnement d'informations est illisible, les offres des Crous, bailleurs, associations et autres plateformes se superposant. Une expérimentation sur la plateforme beta.gouv.fr tente de regrouper les offres étudiantes en une plateforme unique, mais elle est à l'arrêt depuis fin 2024. Nous recommandons donc d'accélérer la création de plateformes unifiées, rassemblant l'ensemble des logements à vocation sociale, au-delà du seul public étudiant.
L'opposition entre jeunes étudiants et non-étudiants n'a d'ailleurs plus beaucoup de sens aujourd'hui. Les gestionnaires de résidences que nous avons auditionnés nous l'ont répété : la fragmentation des offres entre les étudiants et les jeunes actifs n'est plus tenable face à la porosité des statuts des jeunes que j'évoquais à l'instant.
Nous recommandons donc de sortir de la segmentation stricte entre étudiants et jeunes actifs pour expérimenter des modèles mixtes.
Au croisement des jeunes actifs et des étudiants, deux catégories méritent une attention particulière : les alternants et les saisonniers.
Tous les saisonniers ne sont pas jeunes, mais beaucoup le sont - 46 % d'entre eux ont moins de 26 ans. Leur logement doit être intégré à la programmation du logement des jeunes. La Cour des comptes soulignait encore cet été l'absence totale d'outil de suivi du logement saisonnier. Il faut aller au-delà du bricolage autour de solutions pensées pour d'autres publics, comme l'utilisation d'internats, qui ne répondent pas aux besoins. Nous recommandons d'élaborer des solutions ad hoc de logement pour les saisonniers, évitant la concurrence entre publics. Les résidences à vocation d'emploi, comme adopté par la commission dès 2024, sont une bonne solution. Certains territoires commencent en outre à développer des résidences mixtes. Des incitations fiscales existent également et gagneraient à être mieux connues.
S'agissant des alternants et apprentis, leur nombre a été multiplié par 2,8 depuis 2017. C'est une bonne chose, car l'apprentissage favorise l'autonomie, l'expérience et l'insertion professionnelle. Encore faut-il que l'État accompagne les jeunes dans cette évolution. La double localisation entre centre de formation et entreprise oblige souvent à louer un second logement. Dans ce cas, ces jeunes sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est une absurdité qu'il faut faire cesser, car elle est à la fois injuste et pénalisante pour un public déjà fragile.
M. Yves Bleunven, rapporteur. - J'aborde pour ma part le premier moment-clé du parcours des jeunes dans le logement : l'accompagnement, dès leur départ du domicile parental, grâce à un logement dédié.
Le parc dédié aux jeunes les soutient à un moment charnière de leur vie, lorsqu'ils construisent leur autonomie, trouvent leur place dans la société et amorcent leur parcours professionnel.
Aujourd'hui, ce parc est en double difficulté : il manque cruellement de places et son modèle économique est fragilisé.
S'agissant des étudiants, l'offre de logements gérés par les Crous (centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires) ou les bailleurs sociaux représente environ 244 000 places, pour plus de 3 millions d'étudiants. Autrement dit, seuls 8 % des étudiants ont pu accéder à un logement en résidence à la rentrée 2022. Nous accumulons un retard considérable. Entre 2018 et 2022, le plan 60 000 logements n'a permis d'agréer que 29 000 logements sociaux étudiants.
Le tableau n'est pas plus favorable s'agissant des jeunes actifs : les foyers de jeunes travailleurs (FJT) et les résidences sociales pour jeunes actifs (RSJA) comptent à peine 68 000 places, soit quatre fois moins que le parc dédié aux étudiants. Dans les régions les plus tendues, comme l'Île-de-France ou l'Occitanie, moins d'un quart des demandes sont acceptées. Là encore, les objectifs du « programme 20 000 » de 2017 n'ont pas non plus été atteints. Quant au plan de 2025 évoqué par ma collègue, il ne fixe aucun objectif spécifique pour les jeunes actifs, hormis la création de résidences-services à loyers intermédiaires, qui sont inaccessibles aux plus précaires.
S'ajoute une autre difficulté : l'équation délicate du modèle économique des projets de résidences jeunes. Il s'agit de concilier des loyers abordables pour les jeunes et la viabilité économique des projets. Aujourd'hui, seule l'Île-de-France peut financer des résidences universitaires via un prêt locatif à usage social (PLUS). Nous recommandons d'expérimenter ce financement dans d'autres territoires, où les besoins des étudiants modestes sont les plus urgents. Nous pensons par exemple aux outre-mer où les loyers du prêt locatif social (PLS) ne sont pas adaptés au niveau de pauvreté étudiante.
Quant aux résidences sociales et aux FJT, ils sont tous deux financés en PLAI (prêt locatif aidé d'intégration), ce qui ouvre droit à des subventions de l'État. Malgré cela, le coût du foncier pèse sur l'équilibre des opérations. Pour y répondre, le bail réel solidaire (BRS) locatif pourrait être davantage mobilisé : il permet à un office foncier solidaire de conserver la propriété du terrain et de conclure un BRS avec un bailleur, qui loue le bâti à une association gestionnaire. De cette façon, le loyer demandé par le bailleur et versé par le gestionnaire n'a plus à intégrer le coût du foncier.
De manière générale, le modèle économique des gestionnaires de résidences est mis à rude épreuve. La mission d'accompagnement, pourtant cruciale pour les jeunes, est en tension face à des besoins grandissants. Dans le contexte actuel, la précarisation des résidents allonge la durée des séjours, ce qui renforce les besoins d'accompagnement. Le taux de rotation, supérieur à 10 % il y a dix ans, est tombé sous les 5 % aujourd'hui. En outre, même s'ils sont conçus pour soutenir l'autonomie des jeunes actifs, les FJT accueillent aussi des publics vulnérables dans le cadre du contingent de l'État, voire des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans le cadre de conventions avec les départements.
Nous estimons donc indispensable d'engager une réflexion sur le modèle économique des gestionnaires de résidences jeunes.
Plus particulièrement, le modèle du FJT doit être valorisé, car il est un véritable tremplin vers l'autonomie. Les FJT se distinguent par un accompagnement renforcé, avec en moyenne sept encadrants pour cent jeunes, contre deux dans les RSJA. Malgré cette plus-value, ils sont souvent mis en concurrence avec les RSJA, du fait de financements et de publics similaires. Cette rivalité fragilise les FJT, qui ont en outre longtemps souffert d'une image vieillissante. C'est pourquoi nous recommandons de revaloriser le modèle du FJT et de prévenir cette concurrence contre-productive.
Cela passe notamment par une modification de la procédure des appels à projets auxquels ils sont soumis. Leur calendrier s'accorde mal avec le montage progressif d'un dossier. Lorsqu'un projet est proposé en Vefa (vente en l'état futur d'achèvement), la longueur des procédures peut décourager les bailleurs, qui se tournent vers d'autres produits pour concrétiser leurs opportunités foncières. Nous proposons donc, comme d'autres avant nous, de mettre en place un appel à manifestation d'intérêt au fil de l'eau. Ce dispositif donnerait plus de souplesse et de visibilité aux porteurs de projets et pourrait venir en appui d'une programmation triennale.
Plus largement, la pénurie de logements dédiés aux jeunes impose de créer de nouvelles solutions, innovantes et agiles. Il faut faire feu de tout bois ! Certaines réponses doivent être déployées dans l'urgence, notamment pour répondre à une demande localisée liée à l'implantation d'entreprises. Dans ces situations, les collectivités locales jouent un rôle déterminant : elles connaissent le terrain et les besoins. Certains sont extrêmement volontaristes pour innover et développer des solutions sur mesure. Leur capacité d'innovation peut d'ailleurs permettre d'éviter la « cabanisation », avec des campings ou des mobil-homes pour loger des actifs en l'absence d'autre solution.
Malgré leur volontarisme, ces territoires se heurtent souvent à un cadre juridique inadapté qui est un vrai frein à l'innovation. De récents projets de tiny houses en témoignent. Je détaillerai celui que je connais le mieux : celui de la ville de Grand-Champ dont j'ai été maire et où notre mission d'information devait se rendre. La commune a créé un village d'une trentaine de tiny houses. Dix sont louées en tant que logements sociaux par l'office public local, les autres en lots libres via des baux emphytéotiques à faible redevance : 150 euros. Le lieu accueille aujourd'hui jeunes actifs et personnes précaires : c'est un succès indéniable - plus de cent cinquante demandes pour trente emplacements. Reste que sa concrétisation a été rude : il a nécessité près d'un an de négociations avec l'État.
Le principal obstacle résidait dans la qualité de logements sociaux des tiny houses. Le bailleur social a dû solliciter une dérogation préfectorale pour qu'elles obtiennent un agrément de logements locatifs sociaux et puissent ainsi bénéficier des modalités de financement du logement social et du conventionnement à l'APL. Cela a pris neuf mois ! Pourquoi autant de temps ? Parce que les tiny houses n'ont pas de définition règlementaire spécifique. Elles sont assimilées à de l'habitat permanent démontable, ce qui peut aussi englober des yourtes ou des tipis, qui seraient bien sûr inacceptables en tant que logement social. La question de la surface a aussi nécessité une dérogation : à quelques centimètres carrés près, les tiny houses ne respectaient pas le minimum de quatorze mètres carrés du logement neuf.
De tels délais et procédures sont décourageants pour les collectivités volontaristes. Il faut clarifier le statut juridique de ces formes d'habitat innovantes. Surtout, au-delà des tiny houses, pour ne pas handicaper de futurs projets, il faut permettre aux collectivités de déroger, par convention avec l'État, à certaines normes lorsqu'elles expérimentent des solutions adaptées à leur territoire. Cela peut aussi permettre de créer des résidences mixtes, dont les publics accueillis refléteraient les besoins du territoire. L'innovation en matière de logement ne peut pas être imposée que d'en haut : elle doit aussi naître du terrain, au plus près des besoins des jeunes.
Mme Viviane Artigalas, rapporteure. - J'aborde pour ma part le deuxième moment clé du logement des jeunes : l'accès à un logement autonome, qui est essentiel pour se projeter dans la vie.
Malgré sa cherté et sa qualité contrastée, le parc locatif privé loge 70 % des jeunes. Ils y occupent de petites surfaces, avec des loyers au mètre carré élevés et souvent revalorisés du fait de leur mobilité.
Le premier outil de solvabilisation sur le marché locatif privé est évidemment les aides personnelles au logement (APL). Celles-ci ont fait l'objet de réformes importantes depuis 2017 : réduction forfaitaire de 5 euros en 2017, contemporanéisation en janvier 2021, sous-indexations successives en 2019 et 2020... Au total, ces réformes ont représenté 4 milliards d'euros d'économies pour l'État en 2024.
Malgré les mesures protectrices mises en place pour les jeunes étudiants et les apprentis et alternants, les jeunes actifs ont été les grands oubliés de la contemporanéisation des APL. Les travaux de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et de la Cour des comptes le confirment : le montant de leurs APL a été réduit et leur situation peu, voire pas prise en compte. En ces heures de tension budgétaire, alors que les APL représentent 19 milliards d'euros de dépenses, nous appelons le Gouvernement à la prudence. Il ne faut modifier les règles d'attribution et les montants des APL que d'une main tremblante. Ne répétons pas les erreurs antérieures qui ont été dramatiques pour les jeunes, notamment les jeunes actifs.
Toujours sur le marché locatif privé, la garantie Visale, que nous connaissons bien, joue un rôle clé. Depuis 2018, son déploiement s'est fortement accéléré. Action Logement vise à doubler son recours d'ici à 2028, en l'ouvrant à de nouveaux publics. Malheureusement, encore trop de propriétaires lui préfèrent une caution familiale, pourtant moins sécurisante. Pour accompagner la dynamique de développement de Visale, il faut poursuivre nos efforts pour améliorer sa perception par les bailleurs.
J'en viens maintenant à l'encadrement des loyers, dont l'expérimentation arrive à échéance en novembre 2026. Avant d'envisager toute modification du dispositif, il nous faut disposer d'une évaluation : celle-ci devra nous être remise dans six mois. Une chose est sûre : le dispositif doit rester territorial et facultatif. Il faudra évaluer l'effet de l'encadrement des loyers sur les jeunes, mais aussi évaluer son rôle dans le développement de pratiques de contournements, comme les baux civils ou le coliving, encore peu encadré.
Les jeunes font également face à la concurrence de la location touristique. En particulier, le bail mobilité est parfois détourné de son objet pour permettre aux propriétaires de libérer leur logement en vue d'une location estivale. De nombreux jeunes actifs se retrouvent alors sans solution, contraints de dormir dans leur voiture ou au sein de colocations surpeuplées. Malgré nos demandes, aucune administration n'a pu nous fournir de données chiffrées, mais nous nous appuyons sur les remontées de terrain des élus locaux, qui sont unanimes et édifiantes. C'est pourquoi nous proposons de rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité.
Passons maintenant au parc social. Les jeunes y sont de moins en moins représentés : entre 1984 et 2013, la part des moins de 30 ans parmi les locataires est passée de 24 % à 8 %. C'est le résultat combiné du vieillissement de la population et d'une rotation faible du parc.
De plus, les règles de priorisation, qui valorisent l'ancienneté et les familles, sont inadaptées aux jeunes. Par exemple, un étudiant sans logement stable peut être jugé comme non prioritaire, au motif qu'il pourrait abandonner sa formation pour sortir de l'instabilité !
Pour lutter contre une forme de non-recours des jeunes au logement social, il faut inscrire la demande d'un logement social dans un moment de la vie. Il faut aussi évaluer les effets de la cotation sur la demande des jeunes et améliorer leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution.
L'offre de logements sociaux doit également être davantage adaptée aux besoins des jeunes. Le parc social compte peu de petits logements et ils sont extrêmement demandés. En Île-de-France, la demande de studios correspond à vingt fois la capacité d'attribution annuelle. Les objectifs du Fnap (fonds national des aides à la pierre) prévoient l'orientation de la moitié de la production vers ces petits logements, mais il faut agir en amont, en développant un modèle économique pour ces logements dont le loyer au mètre carré ne permet pas d'équilibrer l'opération.
J'évoquais à l'instant les dévoiements du bail mobilité dans le parc privé : à l'inverse, il en serait exempt dans le parc social. Nous avions souligné les effets sans doute limités de l'extension du bail mobilité au parc social lors de l'examen du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables en 2024 ; néanmoins, comme l'a rappelé mon collègue rapporteur, il faut faire feu de tout bois et donner toutes les marges de manoeuvre juridiques possibles aux bailleurs sociaux.
À ce sujet, pour donner des marges de manoeuvre aux bailleurs sociaux, nous recommandons d'exonérer les résidences universitaires de la RLS (réduction de loyer de solidarité), en contrepartie d'engagements. Les résidences en gestion déléguée n'y sont pas soumises : cela pénalise les bailleurs qui ont développé une gestion locative destinée aux étudiants ! Rappelons qu'ils ont financé près de 80 % des logements sociaux étudiants entre 2018 et 2022.
Je terminerai par l'accès des jeunes à la propriété. Longtemps facilitée par des taux favorables, la propriété est de plus en plus l'apanage des plus aisés et des plus âgés. La part des moins de 30 ans propriétaires est passée de 18,5 % en 2018 à 16,7 % en 2021. À l'inverse, les plus de 50 ans représentent aujourd'hui près de 40 % des achats dans l'ancien, contre 30 % en 2015.
Contrairement à ce que l'on entend parfois, les jeunes ne sont pas moins attirés que leurs aînés par la propriété : c'est toujours une aspiration forte, synonyme de stabilité, d'ancrage et de réussite sociale.
Dans certains pays du nord de l'Europe, comme la Finlande, l'accès à la propriété des jeunes générations est soutenu par des dispositifs ciblés, qui allient encouragement à l'épargne, garanties de l'État et bonifications de taux d'intérêt qui permettent d'assurer une action contracyclique. Nous souhaitons encourager la réflexion sur le sujet, car nos dispositifs de soutien à l'accession ne sont pas ciblés pour les jeunes.
La dernière loi de finances a toutefois introduit plusieurs mesures exceptionnelles de soutien aux primo-accédants, comme l'exonération de droits de succession pour les dons familiaux en faveur de l'achat d'un logement neuf ou l'extension du prêt à taux zéro (PTZ). Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de ces mesures sur les jeunes, mais les jeunes de moins de 35 ans représentaient plus de 68 % des bénéficiaires du PTZ en 2024 ; cette part pourrait s'accroître en 2025. Nous recommandons donc de proroger la généralisation du PTZ dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer ses effets sur les jeunes primo-accédants.
Il faut aussi soutenir le développement de formes innovantes d'accession à la propriété, en s'appuyant sur des outils éprouvés comme le BRS. Il connaît une belle dynamique de développement : plus de 1 000 programmes ont été livrés en 2023 et ils devraient être plus de 6 000 en 2026 et en 2027. La réussite des opérations dépend souvent de politiques volontaristes d'élus locaux et d'une culture de l'accession sociale à la propriété sur le territoire. Le BRS se déploie d'ailleurs plus facilement dans le logement collectif, où la dissociation du foncier et du bâti suscite moins de réticences psychologiques. Nous recommandons donc l'inscription d'un volet « accession sociale » à la propriété au sein des programmes locaux de l'habitat.
Accompagner le développement du BRS, c'est aussi anticiper la suite des parcours résidentiels et ce qu'il adviendra des logements en BRS après leur première cession. En effet, aujourd'hui, un bien en BRS construit il y a plus de cinq ans est considéré, s'il est cédé, comme un logement ancien et n'est donc pas éligible au PTZ. Pour l'instant, la question se pose peu : à fin 2024, seules trente-neuf reventes de BRS ont eu lieu. Mais d'ici à 2026 ou 2027, voire à 2030, leur nombre devrait considérablement augmenter ! Il s'agit d'éviter un goulet d'étranglement lorsque les ménages modestes, cibles du BRS, ne seront plus soutenus dans l'acquisition d'un BRS. Nous recommandons donc d'ouvrir les logements acquis via un bail réel solidaire au PTZ lors de leur revente.
Telles sont, chers collègues, les conclusions de notre mission d'information sur le logement des jeunes. Nous avons tenté d'aborder l'ensemble des enjeux, pour rendre compte de la diversité des parcours, des situations et des besoins de toute une génération.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je salue le travail des rapporteurs sur ce sujet ô combien important, qui formule des recommandations non seulement frappées au coin du bon sens, mais aussi innovantes, que nous devrons approfondir.
M. Philippe Grosvalet. - Je salue le travail des rapporteurs qui met l'accent sur un sujet sensible.
La commission des affaires économiques le constate au travers de tous ses travaux : il n'y a pas d'ambition globale sur le logement dans notre pays et l'on note un manque criant de logements. On le sait, ce sont toujours les plus fragiles, en particulier les plus jeunes, qui en souffrent.
Je tiens à mettre l'accent sur l'accompagnement, car il est nécessaire. Vous n'avez pas parlé des missions locales, ces structures mises en place pour accompagner les jeunes de façon globale : emploi, santé, mais aussi logement. Les missions locales sont aujourd'hui mises à mal, ce qui a des répercussions.
Je suis heureux que vous souligniez l'enjeu des FJT, qui ont joué un rôle important dans l'histoire de notre pays et qui ont souffert ces dernières décennies.
Ma question porte sur le BRS, dispositif que j'ai moi-même promu.
Je m'interroge sur la recommandation n° 7 de l'axe 2 - développer et sécuriser la possibilité d'utiliser le bail réel solidaire en faveur des résidences jeunes pour minorer le poids du foncier dans le loyer demandé par les propriétaires de résidences aux gestionnaires. Cela correspond-il vraiment à la fonction du BRS ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - En tant que présidente de la mission locale Côte d'Azur, je partage la préoccupation exprimée. Les missions locales réalisent un accompagnement global pour lever tous les freins qui touchent les jeunes, le logement et l'autonomie en étant les principaux.
M. Yannick Jadot. - Je remercie chaleureusement les rapporteurs : le logement constitue un sujet majeur que nous traitons avec beaucoup de sérieux ici.
Le taux de pauvreté des jeunes explose, tout comme leur malaise psychologique. On connaît les conséquences catastrophiques de l'épidémie de covid.
Le logement est un enjeu de stabilité et de sécurité. Nous lirons le rapport avec beaucoup d'intérêt. Dans les différents débats sur le pouvoir d'achat, nous passons totalement à côté de la question des dépenses ! Quand on pense pouvoir d'achat, on pense revenus, mais la question des dépenses évitées est majeure ; or le logement entre dans cette catégorie de sécurisation des jeunes en difficulté. J'espère que, dans les semaines à venir, nous pourrons parler logement, mais aussi transport.
Mme Amel Gacquerre. - Merci de ce travail très complet qui met en exergue toute la complexité du sujet, avec des demandes très spécifiques - par exemple, de petits logements pour de courtes durées -, auxquelles il faut apporter des réponses également spécifiques.
Bravo d'avoir souligné dans ce rapport la diversité de la jeunesse. On parle en effet beaucoup de logements pour les étudiants - la pénurie de logements pour ces publics est évidemment une problématique très importante, parce que l'on passe à côté de la promesse républicaine d'égalité des chances -, mais pas assez des difficultés de logement auxquelles sont confrontés les autres jeunes.
Je soulignerai trois recommandations, particulièrement intéressantes à mes yeux.
D'abord, sur la question du logement social, vous avez avancé une proposition très concrète, à savoir la transformation de grands logements en petits logements, c'est-à-dire l'adaptation des logements au vieillissement de la population, mais aussi aux publics jeunes. C'est un objectif fort que nous pourrions mettre en avant lors de nos discussions avec les bailleurs.
Ensuite, sur l'innovation, il est question d'habitats alternatifs, comme les tiny houses, mais il y a aussi l'habitat partagé, l'habitat intergénérationnel... J'y crois vraiment. C'est une réponse aux demandes spécifiques que j'ai soulignées. Cela a également un intérêt en termes de coût. On pourrait également prendre exemple sur les habitats légers développés dans les pays du Nord.
Enfin, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit le gel des APL, alors même que l'on sait que le logement représente 40 % à 50 % des dépenses des jeunes. Attention aux conséquences pour eux. Il est même question de la suppression de cette allocation pour certains étudiants rattachés à 20 % des foyers fiscaux les plus importants. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut tout mettre sur la table, mais il faut veiller à toutes les situations particulières pour que cette mesure n'ait pas un impact négatif.
Merci d'avoir évoqué le dispositif Visale et Action Logement. Pour ma part, je tiens beaucoup aux résidences à vocation multiple.
Mme Antoinette Guhl. - Ce rapport aborde un sujet capital. La jeunesse souffre et ce phénomène est trop ignoré. Jamais la jeunesse n'a été autant précarisée qu'aujourd'hui. Quand je faisais mes études, 10 % des étudiants travaillaient, contre près de 60 % aujourd'hui. Ils ne travaillaient d'ailleurs que quelques heures par semaine, souvent pour gagner de l'argent pour leurs sorties, alors qu'aujourd'hui beaucoup travaillent trente heures par semaine, voire à temps plein, ce qui a une incidence sur leurs études.
On ne parle pas assez de ceux qui ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en formation (Neet) et qui n'ont même pas droit aux minima sociaux. Merci d'avoir abordé la question du logement des jeunes de façon globale, mais c'est l'intégralité des politiques universelles qui devraient être appliquées à la jeunesse.
Les logements Crous représentent 7 % du logement étudiant. Vous soulignez à raison que les étudiants ne sont pas les seuls jeunes à connaître des difficultés de logement et semblez vouloir ouvrir les Crous à tous. Pourtant, l'offre des Crous ne couvre même pas les besoins des étudiants boursiers ! Comment l'étendre à d'autres publics dans ces conditions ? Cela supposerait d'élargir considérablement l'offre des Crous, donc leur budget. Je rappelle que les bourses d'études sont les plus faibles d'Europe. Trouver un logement quand on est boursier n'est pas si simple.
Certains jeunes ne sont éligibles à rien ! Nous devons réfléchir à étendre le revenu de solidarité active (RSA) aux 18-25 ans, s'ils y ont droit. La majorité doit également être une majorité sociale. Ces jeunes doivent avoir le droit de bénéficier des minima sociaux, ce qui leur permettra de subvenir à leurs dépenses de logement.
Certaines niches fiscales, par exemple le dispositif Censi-Bouvard, ont enchéri le coût du logement étudiant. En tant que législateurs, nous devons nous pencher sur ces questions.
Le coliving se développe, mais cela fait augmenter le prix des chambres, car les logements sortent de toute réglementation (loi Alur, encadrement des loyers...). Le Conseil de Paris vient d'ailleurs de l'interdire. Je précise qu'il existe des alternatives solidaires, comme le CoopColoc à Paris.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je rappelle que, dans le cadre des missions locales, les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont rien bénéficient aujourd'hui de la garantie Jeunes, devenue contrat d'engagement jeunes (CEJ), qui s'élève à près de 500 euros par mois.
Mme Marianne Margaté. - Merci de ce rapport qui contient des recommandations concrètes. Nous partageons le bilan noir de l'accès au logement pour les jeunes de moins de 25 ans. Ils paient le prix fort du désengagement de l'État dans la politique du logement : dépendance familiale, bas salaires, précarité, etc.
Aux effets de la contemporanéisation des APL, de la baisse de cinq euros, du gel de son montant s'ajoute la non-revalorisation du forfait charges. Ce rapport a le mérite de mettre à jour tous les aspects de la situation des jeunes : toutes ces données mises bout à bout dressent un tableau assez terrible.
Il faut faire tous les efforts nécessaires pour sécuriser le logement des jeunes et faire en sorte qu'ils puissent rester dans leur logement.
Je partage les propositions qui ont été avancées sur les FJT, aujourd'hui fragilisés. La mise en concurrence avec les RJSA pose question. Les FJT sont aujourd'hui la seule possibilité ouverte à tous les jeunes, quelle que soit leur situation.
J'apporterai deux nuances.
D'une part, l'encadrement des loyers a montré son efficacité en zone tendue, notamment pour les petits logements, et ce grâce au volontarisme des communes. Pour autant, la hausse des loyers s'étend partout là où l'encadrement des loyers n'est pas appliqué, ce qui pose question. Il est à parier que le développement du Grand Paris express s'accompagnera d'une flambée des loyers dans le parc privé.
D'autre part, le coliving se développe dans les villes qui cumulent tourisme et pôles étudiants. C'est notamment le cas à Fontainebleau. Il faut mener une réflexion sur l'encadrement de ce type de logement, qui s'exonère de toute règle pour le plus grand profit des propriétaires.
Enfin, une attention particulière est-elle portée aux jeunes sortant de l'ASE ou du sans-abrisme ? Il me semble que ce maillon manque, même si je mesure la complexité de ce problème.
M. Daniel Gremillet. - Si l'on veut favoriser l'apprentissage dans les territoires, encore faut-il que ces apprentis puissent être accueillis. Dans cette optique, il serait peut-être judicieux d'instaurer de la mixité au sein des maisons seniors que l'on inaugure : mixité sociale, sociétale et générationnelle.
Mme Anne-Catherine Loisier. - La question du logement nous préoccupe tous dans nos territoires.
Il semble facile de mettre en oeuvre rapidement la recommandation n° 15, qui a trait au dégrèvement automatique de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les apprentis ou alternants en situation de double résidence. Cela répondrait à une aspiration forte des jeunes. Nous pourrions l'aborder lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026.
Mme Viviane Artigalas, rapporteure. Le BRS présente aujourd'hui plus d'attrait pour le logement individuel, car le foncier est plus cher. Le maire de la station de ski de Saint-Lary a essayé, avec l'office foncier, de construire de petites maisons en BRS pour loger les saisonniers. Cela n'a pas marché.
Par ailleurs, il s'agit non pas de laisser des logements Crous aux non-étudiants, mais plutôt de réfléchir à une non-segmentation des publics jeunes, afin que de nouveaux logements soient ouverts à d'autres publics jeunes. Il ne s'agit pas d'exclure les étudiants du peu de logements qui leur sont réservés.
M. Yves Bleunven, rapporteur. - Ce rapport met en évidence le besoin de créer une nouvelle ère pour les FJT et de leur redonner une nouvelle jeunesse. Il faut revoir leur financement pour qu'ils soient plus compétitifs et moderniser ce concept qui, quoi qu'on en dise, reste très intéressant, ne serait-ce que par l'accompagnement qu'il prévoit.
Il faut de l'innovation dans le parcours résidentiel. Je suis convaincu que le parcours résidentiel sera différent demain : il faut prévoir de nouvelles étapes. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes ont deux logements.
L'appétence des jeunes à la propriété est manifeste. Acheter une tiny house à 25 ans est une première étape : c'est le début de la capitalisation pour ensuite revendre et, ainsi, éviter de verser des loyers à fonds perdu.
Mme Martine Berthet, rapporteure. - Il a fallu déterminer l'amplitude de nos travaux, ce qui explique la faible place accordée aux jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance et aux mineurs non accompagnés qui relèvent d'ailleurs plus des compétences de la commission des affaires sociales. Toutefois, au regard de la porosité des parcours, ces jeunes sont de fait inclus dans les mesures que nous proposons. Nous avons d'ailleurs tenu à créer une tranche d'âge très large, allant de 16 ans à 30 ans.
Nous voulons libérer l'initiative locale, notamment pour favoriser la mixité générationnelle. Il faut donner de la souplesse aux territoires. Nous sommes tous interrogés sur le dégrèvement de la taxe sur les résidences secondaires et, ainsi que cela a été dit, il semble possible d'agir rapidement pour remédier à une situation inacceptable.
Nous recommandons une évaluation du dispositif d'encadrement des loyers, car nous voyons des contournements, notamment le coliving.
Mme Viviane Artigalas, rapporteure. - Sur l'encadrement des loyers comme sur d'autres dispositifs, nous considérons tous les trois que ces outils doivent être à la disposition et à la main des maires. Les élus locaux s'en empareront en fonction des spécificités de leur territoire.
La commission adopte, à l'unanimité, les propositions, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 8 avril 2025
- Audition conjointe :
- Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ) : M. Antoine DULIN, représentant et Mme Naouel AMAR, adjointe au secrétaire général ;
- Conseil national de l'habitat (CNH) : Mme Aude PINAULT et M. Jean-Luc BERHO, membres.
- Fondation pour le logement des défavorisés : M. Manuel DOMERGUE, directeur des études et Mme Éléonore SCHMITT, chargée de plaidoyer.
- Union nationale pour l'habitat des jeunes (Unhaj) : Mme Marianne AUFFRET, directrice générale.
Mardi 29 avril 2025
- Cour des comptes : Mme Clarisse MAZOYER, rapporteure générale à la 5e chambre, conseillère maître et M. Philippe-Pierre CABOURDIN, Conseiller maître, responsable du secteur outre-mer à la 5e chambre.
- Association de résidences pour étudiants et jeunes (Arpej) : Mmes Anne GOBIN, directeur général, Élodie JOSSET, directeur du développement et du patrimoine et Carol ABITBOL, directeur clientèle.
- Ministère de l'éducation nationale - Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) : MM. Christophe CASTELL, sous-directeur des politiques interministérielles de jeunesse et de vie associative et Tristan REILLY, adjoint au chef du bureau des politiques de jeunesse.
Mardi 27 mai 2025
- Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) : MM. Yves RAUCH, chef de projet pour le logement des étudiants et des jeunes actifs et Gaétan POLARD, chef du bureau des aides personnelles au logement.
- Caisse des dépôts et consignations (CDC) Habitat : M. Thierry LAGET, directeur général adjoint en charge du développement du réseau CDC Habitat partenaires et Mme Anne FRÉMONT, directrice des affaires publiques.
- Union professionnelle du logement accompagné (Unafo) : MM. Arnaud DE BROCA, directeur général et Pierre-Marc NAVALES, chargé de mission logement jeunes.
Mardi 3 juin 2025
- Union sociale pour l'habitat (USH) : MM. Thierry ASSELIN, directeur des politiques urbaines et sociales et Antoine GALEWSKI, directeur des relations institutionnelles et parlementaires.
- Action logement Groupe : Mmes Nadia BOUYER, directrice générale, Akila MAT, responsable des relations institutionnelles et Élodie AMBLARD, directrice générale de la filiale immobilière du groupe Action logement Noalis.
- Audition conjointe :
- Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) : Mmes Sonia DE LA PROVÔTÉ, sénatrice du Calvados, présidente et Florence CHARLIER, chargée de mission urbanisme logement foncier ;
- Association des villes universitaires de France (Avuf) : MM. François RIO, délégué général et Maxime BOYER, vice-président délégué au logement.
Mardi 10 juin 2025
- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous) : Mmes Bénédicte DURAND, présidente et Emmanuelle DUBRANA, directrice générale déléguée.
- Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) : Mmes Pascale GALINDO, sous-directrice de l'immobilier, Juliette THOMAS, cheffe du département des expertises immobilières, MM. Charles DUPORTAIL, sous-directeur de la vie étudiante et Amine AMAR, référent ministériel pour le logement des étudiants.
- Union nationale des missions locales (UNML) : MM. Olivier GAILLET, directeur du pôle métier et partenariat et Mario GONZALEZ, administrateur au sein du bureau de l'UNML et président de la mission locale de Paris.
- Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes (UNCLLAJ) : Mme Théodora LIZOP, déléguée nationale.
- Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) : M. Loïc CANTIN, président et Mme Joëlle GOEPFERT, directrice de cabinet.
Mardi 1er juillet 2025
- Table ronde d'Élus :
- Association nationale des élus des territoires touristiques (Anett) : M. Philippe SUEUR, maire d'Enghien-les-Bains, président, Mme Géraldine LEDUC, directrice générale et M. Simon LEBEAU, sous-directeur ;
- Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) : MM. Joël RETAILLEAU, directeur général, Rémi LEDOUX, juriste, Arnaud MATHIEU, maire de Villard-de-Lans et André MIR, maire de Saint-Lary Soulan ;
- France urbaine : Mme Sophie GARCIA, conseillère déléguée au logement abordable et à la mixité sociale à la ville d'Annecy, M. Baptiste BOSSARD, conseiller logement, politique de la ville et urbanisme et Mme Sarah BOU SADER, conseillère parlementaire.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Association nationale des élus de la montagne (Anem)
- Sofiap
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
des principales recommandations de la mission
|
N° |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 1 : Se donner les moyens d'une programmation du logement des jeunes |
||||
|
1 |
Approfondir la dynamique actuelle pour définir une véritable programmation territorialisée du logement pour tous les jeunes : - étendre le plan national « logement étudiants » au logement des jeunes actifs en définissant des objectifs régionaux de production de logements abordables dédiés aux jeunes à horizon 2030 ; - mettre en place une grille nationale d'analyse et de suivi des carences en logements des jeunes ; - généraliser la mise en oeuvre d'instances régionales dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes ; - associer aux objectifs pluriannuels du logement des jeunes une programmation également pluriannuelle des aides à la pierre. |
Gouvernement Collectivités Préfectures |
Au plus tôt |
Programmation à horizon 2030 Grille de suivi Circulaires aux préfets |
|
2 |
Améliorer la couverture géographique des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et étendre leur regard au logement des jeunes en général. |
Gouvernement Collectivités territoriales Fédération nationale des agences d'urbanisme |
Au plus tôt |
Tous moyens |
|
3 |
Accélérer le regroupement des offres à vocation sociale au sein de plateformes numériques dédiées au logement accompagné et temporaire de tous les jeunes, au-delà des seuls étudiants. |
Gouvernement Associations Bailleurs sociaux |
Au plus tôt |
Tous moyens |
|
N° |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 2 : Augmenter l'offre de logements dédiés aux jeunes en soutenant le modèle économique du logement accompagné |
||||
|
4 |
Sortir de la segmentation stricte entre étudiants et jeunes actifs, de moins en moins adaptée aux profils des jeunes, en expérimentant un rapprochement des produits pour jeunes actifs et étudiants. |
Gouvernement Parlement |
2026 |
Expérimentation - Appel à projets Mesures législative et réglementaires |
|
5 |
Expérimenter l'ouverture du financement des résidences universitaires par le « Plus » voire le « Plai » ou équivalents dans des territoires présentant des besoins importants pour des étudiants très modestes, au-delà de l'Île-de-France. |
Gouvernement |
2026 |
Expérimentation - Appel à projets Mesure réglementaire |
|
6 |
Exonérer les résidences universitaires en gestion directe et les logements sociaux dédiés aux jeunes dits « article 109 de la loi Élan » de la réduction de loyer de solidarité (RLS), en contrepartie d'engagements de production ou de financement du Fonds national des aides à la pierre de la part des bailleurs sociaux, tout en veillant au maintien des APL pour les occupants. |
Gouvernement Parlement |
Au plus tôt |
Mesure législative Projet de loi de finances pour 2026 |
|
7 |
Développer et sécuriser la possibilité d'utiliser des dispositifs de dissociation entre le foncier et le bâti tels que le bail réel solidaire en faveur des résidences « jeunes » pour minorer le poids du foncier dans le loyer demandé par les propriétaires de résidences aux gestionnaires. |
Gouvernement |
Dès que possible |
Tous moyens |
|
8 |
Engager une réflexion sur le modèle économique des gestionnaires de résidences sociales et notamment des foyers de jeunes travailleurs (FJT) qui est aujourd'hui en tension face à des besoins grandissants. |
Gouvernement |
Au plus tôt |
Tous moyens |
|
N° |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
9 |
Valoriser le modèle du foyer de jeunes travailleurs (FJT) dont l'accompagnement socio-éducatif est un véritable tremplin vers l'autonomie des jeunes, en : i) soutenant la rénovation et la réhabilitation des FJT ; ii) prévenant toute compétition sur le financement et les opportunités de réalisation entre FJT et résidences sociales pour les jeunes actifs (RSJA) ; iii) soumettant les FJT non plus à une procédure d'appel à projets, inadaptée au montage progressif d'un dossier, mais à un dispositif d'appel à manifestation d'intérêt. |
Gouvernement Préfectures Parlement |
2026 |
Appel à manifestation d'intérêt Mesure réglementaire (circulaires et modification de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles) Mesure législative - projet de loi de finances |
|
10 |
Faciliter la réalisation de solutions innovantes pour loger les jeunes en consacrant un droit des collectivités à adapter, par convention avec l'État, les règles en matière de logement et d'habitat aux circonstances locales de leur territoire. |
Gouvernement Parlement |
Au plus tôt |
Mesure législative Conventions État-collectivités |
|
11 |
Pour loger les jeunes travailleurs saisonniers, refuser la mise en concurrence des publics et valoriser les solutions fondées sur des initiatives locales à l'instar de l'encouragement des particuliers à louer leur bien pour bénéficier d'un dégrèvement fiscal ou des résidences ad hoc comme les résidences à vocation d'emploi. |
Gouvernement Collectivités territoriales |
Dès que possible |
Communication Conventions |
|
N° |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 3 : Lutter contre la précarisation des jeunes sur le marché locatif privé |
||||
|
12 |
Ne plus modifier les règles d'attribution et le montant des APL, qui sont une source d'économies budgétaires potentielles pour l'État, sans en mesurer prudemment les conséquences, pour ne pas réitérer des erreurs antérieures qui ont réduit le pouvoir d'achat des jeunes et notamment des jeunes actifs. |
Gouvernement |
Au plus tôt |
Le cas échéant, étude d'impact |
|
13 |
Renforcer la communication à l'égard de la garantie Visale pour améliorer son acceptabilité auprès des bailleurs et ainsi accompagner sa dynamique de développement. |
Action logement Gouvernement |
Au plus tôt |
Application de la convention quinquennale 2023-2027 entre l'État et Action logement Communication |
|
14 |
Dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers d'ici mai 2026, étudier son impact spécifique sur les jeunes et son rôle dans le développement de pratiques telles que le coliving ou les baux civils. |
Gouvernement |
Mai 2026 |
Évaluation |
|
15 |
S'assurer que les jeunes alternants en situation de double résidence ne soient pas redevables de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. |
Gouvernement |
2026 |
Tous moyens |
|
16 |
Rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité pour répondre aux préoccupations des zones touristiques tendues et mieux lutter contre les contournements. |
Gouvernement Parlement |
2026 |
Mesure législative |
|
N° |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 4 : Faciliter la mobilisation du parc social en faveur des jeunes |
||||
|
17 |
Faciliter l'accès des jeunes au parc social « classique » en : - proposant une demande de logement social aux jeunes éligibles sortant d'un logement accompagné ou d'un dispositif d'accompagnement dans le logement en lien avec les acteurs de l'information sur le logement des jeunes afin d'associer la demande à un « moment de la vie » ; - évaluant les effets de la cotation sur la demande des jeunes et en améliorant leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution (CIA). |
Gouvernement Bailleurs sociaux Associations Collectivités territoriales |
2026 |
Tous moyens |
|
18 |
Développer un modèle de financement qui encourage la construction de logements sociaux de petite surface et la reconversion de grands logements au vu de la demande actuelle dans le parc social. |
Gouvernement Bailleurs sociaux |
Dès que possible |
Tous moyens |
|
19 |
Pour faciliter le développement de la colocation dans le parc social ainsi que des logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans : - expérimenter un dispositif de cooptation encadrée des colocataires, sous réserve du respect des conditions d'attribution ; - continuer à promouvoir les logements réservés aux jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de la programmation des aides à la pierre et ouvrir la possibilité aux bailleurs sociaux de récupérer les charges de ces logements via un forfait, comme dans le cas de la colocation. |
Gouvernement Parlement Bailleurs sociaux |
2026 |
Mesures législative et réglementaires |
|
20 |
Développer la « location active », particulièrement adaptée aux jeunes, afin d'améliorer la lisibilité de l'offre dédiée et de réduire le taux de refus des attributaires. |
Bailleurs sociaux |
Dès que possible |
Tous moyens |
|
21 |
Ouvrir le bail mobilité au parc social car il y serait exempt de risque de dévoiement. |
Gouvernement Parlement |
2026 |
Mesure législative |
|
N° |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier |
Support |
|
AXE 5 : Favoriser l'accès à la propriété des jeunes |
||||
|
22 |
Encourager les collectivités à développer l'accession sociale à la propriété, et notamment le BRS dans le logement collectif, via un volet au sein de leurs programmes locaux de l'habitat. |
Gouvernement Parlement Collectivités territoriales |
Au plus tôt |
Mesure législative éventuelle Programme local de l'habitat |
|
23 |
Proroger la généralisation du prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer pleinement ses effets sur les jeunes ménages primo-accédants. |
Gouvernement Parlement |
2027 |
Mesure législative - projet de loi de finances pour 2026 |
|
24 |
Ouvrir les logements acquis via un BRS au PTZ lors de leur revente. |
Gouvernement Parlement |
2026 |
Mesure législative - projet de loi de finances pour 2026 |
|
25 |
Sur le modèle de pays du nord de l'Europe, développer un dispositif ciblé de soutien à l'accession à la propriété des jeunes générations, associant un encouragement à l'épargne ainsi que des bonifications de taux d'intérêt afin d'assurer une action contracyclique. |
Gouvernement Parlement |
À moyen terme |
Mesure législative - projet de loi de finances |
* 1 Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ) & Conseil national de l'habitat (CNH), Logement des jeunes : une urgence sociale ! janvier 2025.
* 2 Observatoire des inégalités, d'après les données de l'Insee.
* 3 Étude de l'observatoire de la vie étudiante sur les conditions de vie des étudiants, 2023.
* 4 Les jeunes adultes peu diplômés, marqués par le travail précaire, Observatoire des inégalités, publié le 23 juin 2023, consulté le 22 septembre 2025.
* 5 Quentin Francou, Injep, 27 janvier 2020.
* 6 Acronyme anglais de « not in employment, education or training ».
* 7 Insee, Dépenses de logement, paru le 21 novembre 2024.
* 8 Le Logement autonome des jeunes, Conseil économique, social et environnemental, janvier 2013.
* 9 France, portrait social, édition 2024 Insee.
* 10 18e rapport sur l'État du mal-logement en France 2013
* 11 6e Regard sur le mal-logement en Europe 2021, Feantsa et Fondation Abbé Pierre.
* 12 Igas, Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural : Comment adapter les réponses institutionnelles ? janvier 2025.
* 13 Jeunes d'outre-mer : garantir l'égalité des chances pour tous, rapport du COJ adopté le 11 juillet 2025.
* 14 Circulaire n° 6500/SG du Premier ministre aux préfets de région et recteurs de région académique, 25 août 2025.
* 15 Population par sexe et groupe d'âges, données annuelles de l'Insee 2025.
* 16 « Les « Tanguy », le retour », Fondation pour le logement des défavorisés, 2024.
* 17 Rapport « Classes moyennes : les nouvelles clés d'accès à la propriété », Institut Montaigne, 2025 : selon un sondage OpinionWay pour la Fondation Apprentis d'Auteuil publié le 14 novembre 2024 auprès de jeunes de 18 à 25 ans, 76 % des sondés disent avoir déjà renoncé à un emploi ou une formation pour une question de mobilité. 61 % des personnes concernées invoquent des horaires inadaptés ou un manque d'accessibilité des transports publics, 56 % l'absence d'un moyen de transport personnel.
* 18 Étude menée par la fondation britannique Varkey en 2024.
* 19 Les étudiants des catégories populaires face à la décohabitation familiale, Pascale Dietrich-Ragon, Terrains & travaux, revue de sciences sociales, 2021/1.
* 20 Article « Logement : les étudiants parisiens fuient la capitale, devenue inabordable, pour la Seine-Saint-Denis », Le Monde, publié le 25 août 2025.
* 21 Rapport public annuel de la Cour des comptes, volet « 2. Accès des jeunes au logement », 2025.
* 22 Réponses au questionnaire écrit de la Djepva.
* 23 Rapport public annuel de la Cour des comptes, volet « 2. accès des jeunes au logement », 2025.
* 24 Mission d'évaluation relative à la mise en place d'un SIAO unifié en Ile-de-France, Inspection générale des affaires sociales, juin 2021, citée par le rapport de l'institut Paris-Région sur l'insertion professionnelle des jeunes, septembre 2024.
* 25 Rapport sur le logement des travailleurs saisonniers, Cour des comptes, 4 juillet 2025.
* 26 Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur « Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre ? » par Jean-Baptiste-Blanc, 1er juillet 2025.
* 27 Baromètre d'opinion de la Drees, 2021.
* 28 Baromètre Djepva sur la jeunesse en 2021.
* 29 Ibid.
* 30 Rapport d'information par la commission des affaires économiques, sur le logement et la précarité des étudiants et des jeunes actifs (MM. David Corceiro et Richard Lioger), n° 4817.
* 31 Contribution écrite du Cnous.
* 32 Étude CBRE sur les résidences étudiantes, novembre 2024.
* 33 Évaluation de la réduction d'impôt Censi-Bouvard, inspection générale des finances, juin 2022.
* 34 Cour des comptes, rapport sur le soutien public au logement étudiant, juillet 2025.
* 35 Cour des comptes et bilan du comité de pilotage sur le logement étudiant fin 2021.
* 36 Décret du 4 décembre 2024 définissant les modalités d'intégration des espaces communs collectifs dans le calcul du plafond de loyer et le plafond de la part de la quittance relative aux services « non individualisables » visés à l'article D. 631-27 du CCH en application de l'article 279-0 bis A du CGI.
* 37 Circulaire du 12 mars 2024 de programmation des aides à la pierre.
* 38 Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ) & Conseil national de l'habitat (CNH), Logement des jeunes : une urgence sociale ! janvier 2025.
* 39 Cour des comptes, rapport public annuel, volet « 2. l'accès des jeunes au logement », 2025.
* 40 Article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
* 41 Conseil général de l'environnement et du développement durable, rapport « Évaluation et pistes d'évolution pour les foyers de jeunes travailleurs », février 2022.
* 42 Cour des comptes, le soutien public au logement des étudiants, juillet 2025.
* 43 Conseil général de l'environnement et du développement durable, rapport « Évaluation et pistes d'évolution pour les foyers de jeunes travailleurs », février 2022.
* 44 Rapport d'information sur le logement et la précarité des étudiants, des apprentis et des jeunes actifs, MM. David Corceiro et Richard Lioger, 15 décembre 2021.
* 45 Conseil général de l'environnement et du développement durable, rapport « Évaluation et pistes d'évolution pour les foyers de jeunes travailleurs », février 2022.
* 46 Cnaf, juin 2006.
* 47 Conseil général de l'environnement et du développement durable, rapport « Évaluation et pistes d'évolution pour les foyers de jeunes travailleurs », février 2022.
* 48 Article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite Alur.
* 49 Codifié aux articles L.118-1 du code de l'action sociale et des familles et L.631-17 du code de la construction et de l'habitation.
* 50 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
* 51 Article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
* 52 Contribution écrite du COJ et du CNH.
* 53 Le déplacement a dû être annulé compte tenu de l'ordre du jour parlementaire.
* 54 Article R111-51 du code de l'urbanisme.
* 55 Article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.
* 56 Conseil d'État, 17 juin 2019 « Les Amis de la Terre France », n° 421 871.
* 57 Article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
* 58 Article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
* 59 Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables et de l'examen de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
* 60 Cour des comptes, Le logement des travailleurs saisonniers, juillet 2025.
* 61 Article 35 bis CGI : exonération d'impôt sur le revenu pour le produit d'une location au profit de travailleurs saisonniers.
* 62 Cour des comptes, Le logement des travailleurs saisonniers, juillet 2025.
* 63 LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
* 64 Article L. 301-4-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
* 65 Rapport d'information sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l'accession à la propriété, n° 1536, déposé le mercredi 19 juillet 2023.
* 66 Loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
* 67 Article 81 bis du code général des impôts.
* 68 Cour des comptes, La contemporanéisation du versement des aides personnelles au logement, observations définitives, 29 janvier 2025.
* 69 Cnaf, Bilan de l'application de la réforme des APL, février 2022.
* 70 Banque de France, Billet n° 302, Aides au logement, un moindre effet haussier sur les loyers si l'offre s'ajuste, Céline Grislain-Letrémy, Corentin Trevien, mis en ligne le 30 janvier 2023.
* 71 Ibid.
* 72 Elle est également accessible aux jeunes de plus de 30 ans sous conditions de ressources.
* 73 L'APAGL ne dispose pas de données pour eux puisqu'ils disposent d'un loyer d'éligibilité forfaitaire.
* 74 En prenant en compte les publics de moins de 30 ans ayant bénéficié de la garantie via l'intermédiation locative (37 % de ces bénéficiaires).
* 75 Article 40 de la loi Élan.
* 76 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 77 Encadrement des loyers : les résultats sont là !, Ville de Paris, Actualité, Mise à jour le 13/06/2025.
* 78 Loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer.
* 79 CAA de Bordeaux, 1re chambre, 06/07/2023, 22BX01 135, Inédit au recueil Lebon.
* 80 Contributions écrites de la DHUP et d'Action logement.
* 81 https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230 707 716.html
* 82 Loi n° 2024 1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
* 83 Rapport n° 675 sur le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables (2023-2024), déposé le 5 juin 2024.
* 84 Rapport septembre 2024 sur l'insertion des jeunes, Institut Paris Région.
* 85 Question écrite n° 11 103 : Conditions d'accès au bail mobilité, de M. Inaki Echaniz.
* 86 Rapport de Marc-Philippe Daubresse et de Mickaël Cosson « Pour une relance durable de l'investissement locatif », juin 2025.
* 87 Dont quasiment un tiers de demandeurs étant déjà locataires du parc social.
* 88 Données Insee et Filocom.
* 89 Contribution écrite de l'USH.
* 90 Selon une étude de KPMG pour l'USH, en 2022 les jeunes étaient plus sujets au phénomène de non-recours par rapport au reste de la population.
* 91 Près de 70 % des logements sociaux du parc sont des T3 ou plus.
* 92 Contribution écrite d'Action logement.
* 93 Rapport d'information n° 804 (2024-2025), déposé le 1er juillet 2025, Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre ?
* 94 Ancols, Quelle adéquation entre l'offre et la demande de logement social dans les territoires de France métropolitaine, février 2022.
* 95 Cour des comptes, rapport thématique régional : logement social en Île-de-France, 2024.
* 96 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
* 97 Article 128 de la loi, codifié à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
* 98 Ancols, 3 300 logements en colocation dans le parc social au 1er janvier 2022.
* 99 Étude Ancols, ibid.
* 100 Article L. 353-22 du code de la construction.
* 101 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
* 102 Article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation.
* 103 Article L. 444-10 du code de la construction et de l'habitation.
* 104 Les revenus et le patrimoine des ménages Édition 2021, Insee.
* 105 10 ans d'accession à la propriété (2001-2011), USH, Habitat et société, 2012. 34 ans en 2013 ; 34 ans en 2016 selon l'Igedd cité par la Fnaim.
* 106 Les revenus et le patrimoine des ménages Édition 2024, Insee.
* 107 Ibid.
* 108 Ibid.
* 109 Igedd, Le prix de l'immobilier d'habitation sur le long terme, annonces mensuelles, publié le 18 août 2025. L'Igedd présente l'évolution dans le temps d'un indicateur de pouvoir d'achat immobilier, c'est-à-dire la quantité de logements anciens que le ménage peut acheter, pour un taux d'effort (mensualité rapportée au revenu) donné, en base T1 2000=1.
* 110 Martin, S., « La jeune génération et le logement neuf », 2020, Deloitte.
* 111 Sondage Yougov pour Pretto, avril 2023.
* 112 Insee.
* 113 Enquête Fractures françaises par Ipsos Sopra/Steria pour Le Monde, le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, décembre 2024.
* 114 Malgré des quotités légèrement décotées pour les maisons individuelles.
* 115 Rapport d'information par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'application des mesures fiscales (M. Charles de Courson), n° 1888, 30 septembre 2025.
* 116 Martin, S., « La jeune génération et le logement neuf », 2020, Deloitte.
* 117 Arrêté du 31 mai 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés.
* 118 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, articles L. 443-6-2 à 13 et R. 443-9-1 à 4.
* 119 Décret n° 2017-592 du 20 avril 2017 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.