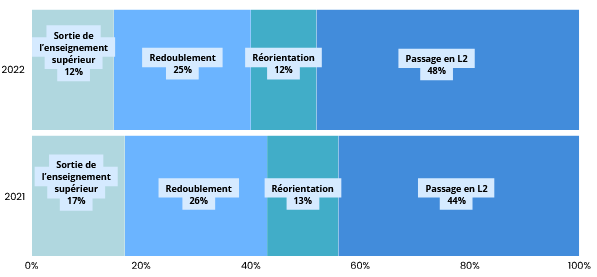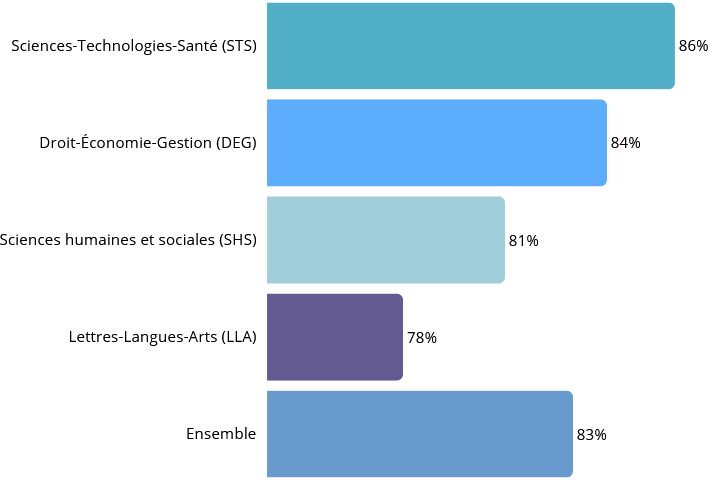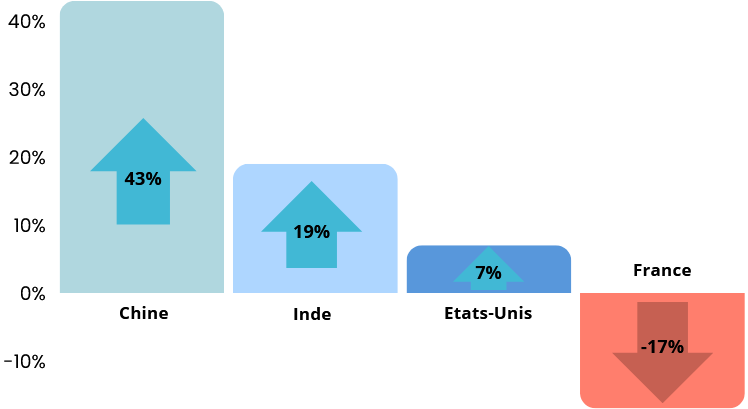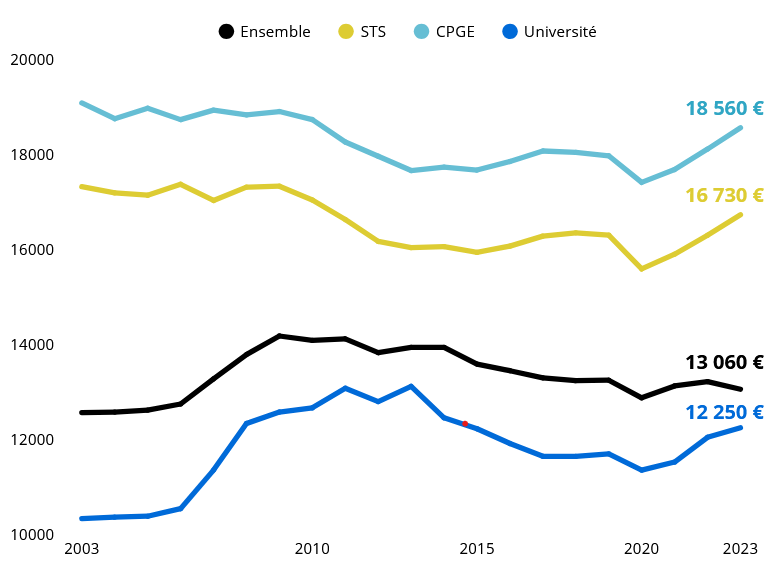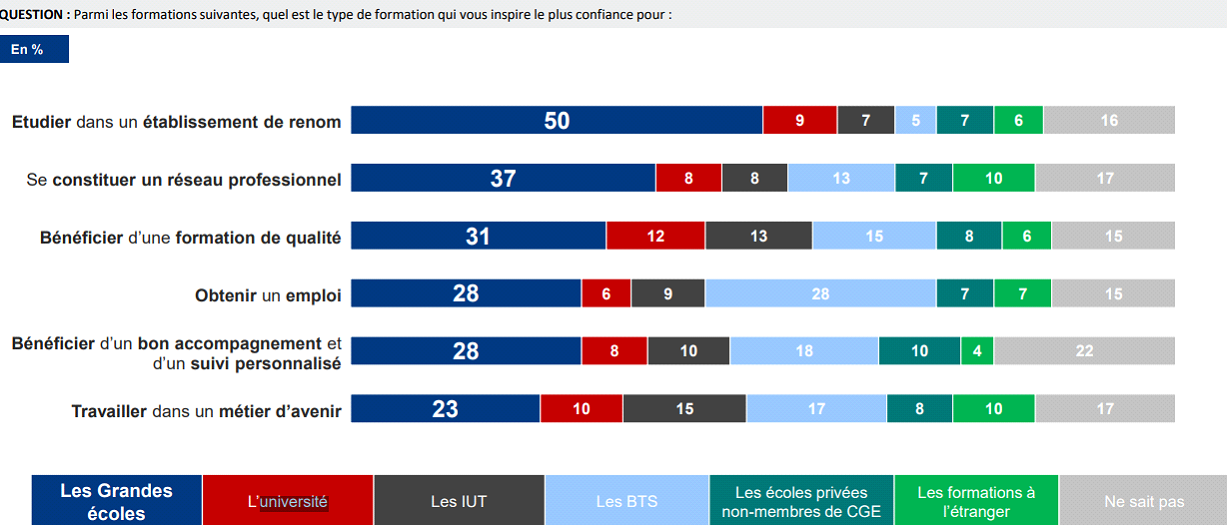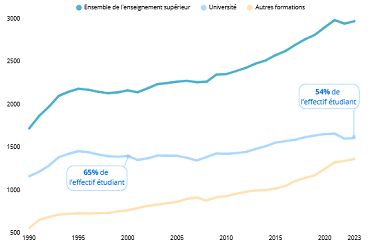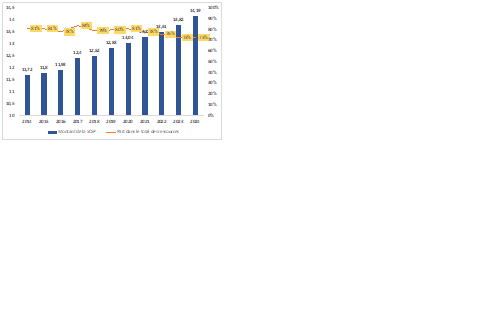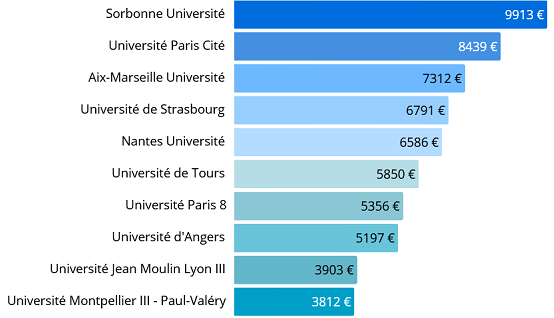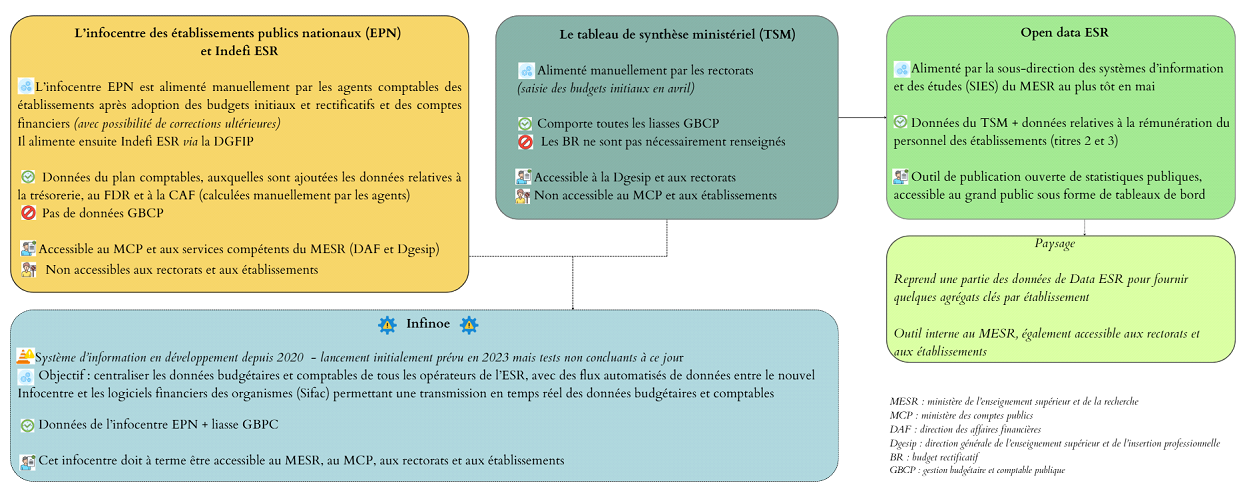- L'ESSENTIEL
- AVANT-PROPOS
- PREMIÈRE PARTIE.
FAUTE DE CAP FIXÉ PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE,
UN PAYSAGE UNIVERSITAIRE ILLISIBLE
- I. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS
BOUSSOLE
- A. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE
STRATÉGIE
- 1. L'ambition de la France pour ses
universités n'est pas définie
- a) Une accumulation de missions législatives
sans cohérence d'ensemble
- b) La carence du ministère dans la
définition d'une stratégie nationale
- (1) Les dispositions législatives relatives
à la Stranes ne sont plus appliquées depuis 2019
- (2) Cette lacune n'est pas compensée par le
report du travail stratégique du ministère sur les Comp
- a) Une accumulation de missions législatives
sans cohérence d'ensemble
- 2. La massification des effectifs étudiants
n'est pas régulée
- a) Une contrainte pesant d'abord sur les
universités
- b) Une formation ouverte à tous les
bacheliers
- (1) En droit, la procédure Parcoursup assure
une conciliation des principes encadrant l'accès à l'enseignement
supérieur
- (2) En pratique, la définition des
capacités d'accueil universitaires crée un droit d'accès
à l'université pour tous les bacheliers
- c) Une forte sélection a posteriori et par
l'échec
- (1) Des mécanismes de sélection
opérant tout au long du parcours universitaire
- (2) Un choix dommageable pour les étudiants,
les établissements et les finances publiques
- a) Une contrainte pesant d'abord sur les
universités
- 1. L'ambition de la France pour ses
universités n'est pas définie
- B. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE PILOTAGE
- C. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE
(RE)CONNAISSANCE
- 1. Un déficit d'influence auprès des
décideurs publics
- 2. Une image dégradée auprès
des étudiants, des familles et des entreprises
- a) Un coût modique assimilé à
une moindre valeur
- (1) Des frais d'inscription sans lien avec le
coût des formations
- (2) Un « signal prix »
négatif pour l'attractivité des filières
universitaires
- (3) Le cas particulier des étudiants
extracommunautaires
- b) Une formation perçue comme peu exigeante
et non professionnalisante
- (1) La faible qualité perçue de la
formation ne permet pas aux filières non sélectives de
l'université d'attirer les meilleurs profils
- (2) Une formation faiblement valorisée par
les entreprises
- c) Des réussites peu mises en avant
- a) Un coût modique assimilé à
une moindre valeur
- 3. La concurrence accrue du secteur
privé
- 1. Un déficit d'influence auprès des
décideurs publics
- A. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE
STRATÉGIE
- II. LES UNIVERSITÉS, DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À LA TRANSFORMATION
INACHEVÉE
- A. UNE POLITIQUE DE DIFFÉRENCIATION AUX
MULTIPLES IMPENSÉS
- 1.
L'hétérogénéité croissante des
établissements universitaires
- a) Les bouleversements induits par le soutien
à la performance de la recherche
- (1) L'ambition de constituer des pôles
d'excellence de rang mondial a entraîné de profondes modifications
du statut, de l'organisation et du financement des établissements
labellisés Idex et Isites
- (2) Le développement des financements
sélectifs a conduit à la mise en concurrence
généralisée des établissements
- b) Une fragmentation croissante du paysage
universitaire
- a) Les bouleversements induits par le soutien
à la performance de la recherche
- 2. Le risque d'un éclatement de la
catégorie des universités
- 1.
L'hétérogénéité croissante des
établissements universitaires
- B. UN OBJECTIF D'AUTONOMISATION SANS MOYENS
OPÉRATIONNELS
- 1. Un sous-calibrage des fonctions support
- a) Une technicité croissante appelant des
compétences spécialisées
- (1) Les lacunes des services dans la gestion
budgétaire et salariale
- (2) De forts besoins pour la mobilisation et la
gestion des financements compétitifs
- b) Un cadre d'exercice mal défini et peu
attractif
- (1) L'absence de corps professionnel
dédié
- (2) Un faible niveau de
rémunération
- a) Une technicité croissante appelant des
compétences spécialisées
- 2. Des impulsions contradictoires dégradant
l'attractivité de la dévolution immobilière
- 1. Un sous-calibrage des fonctions support
- A. UNE POLITIQUE DE DIFFÉRENCIATION AUX
MULTIPLES IMPENSÉS
- I. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS
BOUSSOLE
- DEUXIÈME PARTIE.
FAUTE DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS,
UN PILOTAGE FINANCIER À VUE
- I. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE,
INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET
SOUS-CALIBRÉE
- A. UN MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA
RÉPARTITION DES RESSOURCES
- 1. Une forte dépendance à la
ressource budgétaire
- 2. Un processus d'allocation illisible et
fluctuant
- a) Un introuvable modèle de
répartition
- (1) L'abandon du modèle Sympa a
accentué le poids des facteurs historiques
- (2) La portée limitée de la
négociation individuelle à la performance
- (3) Les comp à 100 % : une
portée financière à clarifier
- b) De forts contrastes nourrissant un sentiment
d'iniquité
- a) Un introuvable modèle de
répartition
- 1. Une forte dépendance à la
ressource budgétaire
- B. UN MANQUE DE CONSTANCE DANS LE SOUTIEN DE
L'ÉTAT
- C. UN MANQUE DE FIABILITÉ DANS LE VERSEMENT
DES DOTATIONS
- A. UN MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA
RÉPARTITION DES RESSOURCES
- II. DES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION SUR LES
MARGES DE MANoeUVRE FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS
- A. LES DÉTERMINANTS D'UN DIAGNOSTIC NON
PARTAGÉ
- B. UNE INDUBITABLE FRAGILISATION FINANCIÈRE
- C. LE DÉBAT MAL POSÉ DE LA
TRÉSORERIE « FLÉCHÉE »
- A. LES DÉTERMINANTS D'UN DIAGNOSTIC NON
PARTAGÉ
- I. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE,
INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET
SOUS-CALIBRÉE
- TROISIÈME PARTIE :
AMÉLIORER LE PILOTAGE STRATÉGIQUE
DES UNIVERSITÉS EN RECRÉANT LES CONDITIONS D'UNE RELATION DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS
- I. DÉFINIR UN CAP STRATÉGIQUE
PARTAGÉ AU NIVEAU NATIONAL
- II. AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE
L'UNIVERSITÉ
- III. GARANTIR LA TRANSPARENCE ET LA
PRÉVISIBILITÉ DE L'ALLOCATION DES MOYENS
- IV. MODERNISER LA FONCTION FINANCIÈRE DES
ÉTABLISSEMENTS
- V. OUVRIR UNE RÉFLEXION NATIONALE SUR
L'ORIENTATION ÉTUDIANTE ET LES TARIFS UNIVERSITAIRES
- I. DÉFINIR UN CAP STRATÉGIQUE
PARTAGÉ AU NIVEAU NATIONAL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
DE LA MISSION D'INFORMATION
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET
ACRONYMES
UTILISÉS DANS LE RAPPORT
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
N° 58
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) par la mission
d'information sur les relations
stratégiques
entre
l'État et les
universités,
Par Mme Laurence GARNIER et M. Pierre-Antoine LEVI,
Sénatrice et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
L'ESSENTIEL
La mission d'information sur les relations stratégiques entre l'État et les universités est née de la volonté de comprendre les raisons du décalage observé, lors des derniers débats budgétaires, entre l'appréciation respectivement portée par les autorités ministérielles et les universités sur la situation financière de ces dernières.
Au terme de travaux qui leur ont permis de recueillir l'éclairage d'une grande diversité d'acteurs, et notamment des représentants de 25 établissements, les rapporteurs constatent que ce diagnostic non partagé constitue un indicateur avancé de la défiance qui s'est installée entre les universités et leur tutelle administrative, sous l'effet de l'insuffisante structuration de la stratégie universitaire de notre pays.
De la carence de l'État dans la définition de sa politique universitaire découle un pilotage erratique, dont les établissements sont contraints d'absorber les conséquences. Cette absence de boussole a de multiples effets sur la cohérence du paysage universitaire, de plus en plus fragmenté, ainsi que sur son financement, dont la soutenabilité apparaît compromise. Face à l'essor du secteur privé, elle tend également à dégrader la qualité perçue de la formation universitaire, parfois regardée comme une orientation par défaut.
La mission d'information a défini cinq axes de recommandations visant à recréer une relation de confiance entre les acteurs et avec les citoyens, l'université étant un bien public dont la préservation constitue un impératif national. Ces 12 recommandations se déploient à la fois sur le long terme, au travers de la clarification du rôle assigné aux universités, et sur le court terme, par l'indispensable stabilisation des conditions de financement des établissements.
I. FAUTE DE CAP FIXÉ PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE, UN PAYSAGE UNIVERSITAIRE ILLISIBLE
A. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS BOUSSOLE
1. Une institution en manque de stratégie
a) L'ambition de notre pays pour son université n'est pas définie
Progressivement sédimentés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, les objectifs et missions confiés par le législateur aux universités constituent un ensemble disparate d'items de portée inégale et dépourvu de priorisation. Cette accumulation d'objectifs multiples, difficilement conciliables et manifestement inapplicables dans leur entièreté, fait courir le risque de la dilution de l'action des établissements et du saupoudrage de moyens déjà fortement contraints.
La faiblesse de ce cadre législatif est aggravée par la carence du ministère dans l'élaboration quinquennale d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (Stranes) concertée avec l'ensemble des acteurs, prévue par l'article L. 123-1. Cette disposition n'étant plus appliquée depuis 2020, date à laquelle la première Stranes adoptée en 2015 aurait dû être révisée, notre pays ne dispose actuellement d'aucun cap actualisé et partagé à l'échelle nationale pour son université.
Cette lacune ne peut être compensée par la montée en puissance de l'outil contractuel, sur lequel le ministère indique reporter l'ensemble de son travail stratégique. Alors que les faibles financements associés aux actuels contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) ne leur confèrent pas la portée adéquate, leur redimensionnement annoncé sous la forme des « Comp à 100 % », dont les contours restent à clarifier, intégrera des priorités définies par le seul ministère, sans nécessaire cohérence d'ensemble entre des instruments par nature multiples.
b) Les parcours de formation sont régulés a posteriori et par l'échec
Cette absence de boussole est notamment visible dans la régulation des activités de formation. Les établissements se trouvent en effet fortement contraints par la massification de leurs effectifs, qui résulte à la fois de l'évolution de la fonction du baccalauréat - qui n'agit plus comme un filtre à l'entrée du supérieur - et de l'absence de conciliation stratégique des principes constitutionnels et législatifs encadrant l'accès aux filières universitaires - le principe d'égal accès à l'instruction étant aujourd'hui mis en oeuvre comme un droit d'accès à l'université.
Le principe d'orientation matérialisé par la plateforme Parcoursup est ainsi associé à la définition par les rectorats de capacités d'accueil universitaires permettant en pratique l'accès de tous les bacheliers au premier cycle. Les étudiants se trouvent cependant confrontés à de forts mécanismes de sélection dans la poursuite de leur cursus. Il en résulte une régulation de fait, a posteriori et par l'échec des parcours universitaires, hautement préjudiciable aux étudiants, aux établissements et aux finances publiques.
2. Une institution en manque de pilotage
Les modalités de la tutelle exercée par le ministère sont perçues comme inadaptées par les universités. Si le récent renouvellement à la tête de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) a marqué une inflexion positive, ses rapports avec les établissements ont globalement été décrits comme pauvres, voire absents. Le faible poids de la Dgesip dans le jeu interministériel crée par ailleurs le doute quant à sa capacité à structurer et à mettre en oeuvre une véritable stratégie universitaire. L'accompagnement assuré par les rectorats, enfin, apparaît excessivement centré sur des aspects administratifs.
3. Une institution en manque de (re)connaissance
Ces difficultés peuvent être mises en lien avec le déficit d'influence de l'université auprès des décideurs publics, qui sont principalement recrutés parmi les diplômés de grandes écoles, tandis que le doctorat reste peu valorisé.
En dépit de ses réussites objectives, l'université pâtit en outre d'une mauvaise image persistante. Alors que l'originalité du modèle universitaire est largement méconnue, son activité de formation est vue comme peu exigeante et professionnalisante.
Cette perception se double d'un « signal prix » négatif : la modicité des tarifs universitaires semble avoir, de manière paradoxale, un effet négatif sur l'attractivité de certaines filières - y compris pour certains étudiants étrangers, la modulation des tarifs pour les étudiants extracommunautaires n'étant que partiellement mise en oeuvre par les établissements.
Face à la concurrence accrue des formations privées, le positionnement de l'université dans l'offre d'enseignement supérieur tend au total à se dégrader.
B. LES UNIVERSITÉS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À LA TRANSFORMATION INACHEVÉE
Les transformations impulsées par la puissance publique au cours des deux dernières décennies, ont été opérées sans vision d'ensemble et avec de nombreux effets de bord. La fragmentation du paysage universitaire qui en découle appelle des ajustements stratégiques.
1. Un processus de différenciation aux multiples impensés
Le processus de différenciation mis en oeuvre depuis 2010, qui a atteint l'objectif de structurer des universités internationalement compétitives, a eu des effets mal régulés au-delà de ces établissements intensifs en recherche. La généralisation des financements sélectifs a favorisé la concentration des moyens sur un seul type d'universités, tout en créant une mise en concurrence généralisée des établissements. Associée à la diversification des cadres de fonctionnement dérogatoires, au travers notamment du statut d'établissement public expérimental, cette évolution conduit à une hétérogénéité croissante du paysage universitaire, qui complexifie son pilotage et fait courir le risque d'un éclatement de la notion même d'université.
Des établissements caractérisés par l'importance de leur activité de formation pluridisciplinaire, avec un fort poids du premier cycle et de filières de sciences humaines moins susceptibles de mobiliser des financements sélectifs, apparaissent comme les « perdants » de cette politique. Le rôle territorial des établissements, notamment au travers de leurs antennes, apparaît par ailleurs comme un impensé stratégique. Dans ce contexte, le pilotage au cas par cas déployé par le ministère ne permet pas la régulation d'ensemble nécessaire au fonctionnement d'un service public de qualité sur l'ensemble du territoire.
2. Un principe d'autonomie sans moyens opérationnels
Alors que leur autonomie réelle apparaît limitée regard des objectifs fixés en 2007, les universités ne disposent pas des moyens opérationnels nécessaires à l'exercice d'une fonction stratégique en partie déplacée à l'échelle des établissements.
Le sous-calibrage de leurs fonctions support constitue un obstacle majeur. La gestion financière des universités ainsi que la mobilisation des financements compétitifs appellent des compétences de plus en plus spécialisées, au regard desquelles les conditions d'emploi des universités présentent une attractivité limitée.
La dévolution du patrimoine immobilier, qui peut constituer un levier d'autonomie important, a fait l'objet d'un pilotage hésitant, qui a obéré son attractivité et n'a pas permis sa généralisation. Le financement de ce dispositif, qui porte sur un parc dégradé et appelant un effort de réhabilitation colossal, a été réévalué en cours d'application, de sorte que seuls les bénéficiaires de la première vague bénéficient des moyens d'assurer la gestion du patrimoine transféré.
II. FAUTE DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS, UN PILOTAGE FINANCIER À VUE
A. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE, INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET SOUS-CALIBRÉE
Si les ressources dites « propres » sont de plus en plus déterminantes dans l'équilibre budgétaire des établissements, leur potentiel de progression est aujourd'hui limité. Les universités demeurent fortement dépendantes de la subvention pour charges de service public (SCSP), dont l'allocation constitue l'outil central de leur relation stratégique avec l'État.
Si la nécessité pour les opérateurs de l'État de contribuer au redressement des finances publiques n'est pas remise en cause, cette allocation est toutefois marquée par des insuffisances cumulées.
1. Un manque de transparence dans la répartition des ressources
En l'absence de modèle de répartition de la ressource entre les établissements, l'allocation de la SCSP se caractérise par son illisibilité et son opacité. La répartition des moyens est effectuée sur la base d'équilibres historiquement construits, corrigés à la marge par le dialogue à la performance, et dont le ministère ne précise pas l'évolution concrètement envisagée dans le cadre des Comp à 100 %. Cette situation aboutit à de fortes disparités dans la SCSP allouée à chaque établissement au regard de sa population étudiante, qui nourrit un sentiment d'iniquité.
2. Un manque de constance dans le soutien de l'État
Le soutien budgétaire aux établissements, en hausse continue depuis dix ans, est toutefois marqué par son imprévisibilité dans la couverture des dépenses nouvelles à la charge des établissements. Matérialisée par la non-compensation répétée par l'État, dans les dernières lois de finances, de dépenses salariales décidées par lui, cette inconstance résulte également du non-respect des « marches » de crédits prévues par la loi pour la programmation de la recherche. Faisant peser la menace annuelle d'une augmentation exogène de leurs dépenses, ces arbitrages budgétaires ont un effet déstabilisateur à court terme sur les budgets des établissements, ainsi que des conséquences délétères sur leur capacité de financement pluriannuelle.
3. Un manque de fiabilité dans le versement des dotations
Au stade de l'allocation des dotations de l'État, les modalités techniques de leur versement sont également à l'origine de difficultés. La SCSP comme la dotation attachée aux Comp sont notifiées puis versées avec retard ; il en découle une incertitude financière infra-annuelle qui contraint les établissements à construire leurs budgets sans connaître ni le montant des dotations dont ils bénéficieront, ni la date à laquelle ils en disposeront.
B. DES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION SUR LES MARGES DE MANoeUVRE FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS
1. Les déterminants d'un diagnostic non partagé
La dégradation de la situation financière des universités ne fait pas l'objet d'un diagnostic entièrement partagé entre les universités et l'État. Cette divergence résulte en partie de la faible lisibilité de l'état des lieux disponible, dont les données sont partiellement hétérogènes, tandis que la comptabilité des établissements demeure insuffisamment fiable et analytique. Les indicateurs comptables retenus par l'État pour apprécier la soutenabilité financière des établissements sont en outre contestés par ces derniers.
Elle est également à mettre en lien avec la défiance marquée et réciproque qui s'est installée entre les acteurs du triptyque constitué par les établissements, la Dgesip et la direction du budget du ministère de l'économie et des finances. Les rapporteurs ont pu le mesurer au cours de leurs auditions, ainsi qu'au travers des réponses écrites de la Dgesip, formulées en termes inhabituellement sévères mettant en cause la « posture » de certains présidents d'université.
2. Une indubitable fragilisation financière
Sous l'effet de la hausse de leurs coûts de fonctionnement, de la progression limitée de leurs recettes et de l'accroissement de leur besoin d'investissement, la situation financière des universités, en dégradation marquée depuis 2021, est indubitablement préoccupante. Si leurs situations individuelles sont très diverses, le résultat consolidé des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) est devenu déficitaire en 2024, tandis que leur capacité d'autofinancement (CAF) s'est réduite des deux tiers depuis 2021. La dynamique d'évolution très négative de ces indicateurs ne peut aboutir qu'à une érosion de l'autonomie des universités.
3. Le débat mal posé de la trésorerie « fléchée »
Le débat budgétaire tend à se focaliser sur le montant très élevé de la trésorerie agrégée des établissements, qui fonde l'appréciation portée sur leur capacité à absorber les mesures d'économies inscrites en lois de finances ainsi que le passage à un régime de gestion dynamique. Les établissements relèvent quant à eux la faiblesse de son montant « libre d'emploi ».
Relevant que la hausse de cet indicateur résulte du cycle d'encaissement des issues des appels à projets et non d'un excès d'épargne, les rapporteurs relèvent que la notion de trésorerie « fléchée », dont aucune évaluation fiable n'est aujourd'hui disponible, ne constitue pas un outil de gestion pertinent. L'affectation juridique de fonds à un usage prédéterminé ne signifie pas, en effet, l'impossibilité pour les établissements de disposer de la trésorerie correspondante, sauf à rigidifier à l'excès la gestion budgétaire.
Pour autant, les conditions du passage à un régime de gestion dynamique n'apparaissent pas réunies. Alors que cette évolution impliquerait une réduction des marges de sécurité financières des établissements, les modalités actuelles de l'allocation budgétaire par l'État, qui présente un caractère erratique et n'assure pas une articulation fine entre les situations agrégée et individuelle, conjuguées aux insuffisances du pilotage assuré par les établissements, feraient courir un risque important de compromettre gravement la soutenabilité financière des universités au profit d'un gain budgétaire de court terme.
III. AMÉLIORER LE PILOTAGE
STRATÉGIQUE DES UNIVERSITÉS
EN RECRÉANT UNE RELATION
DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS
Au terme de leurs travaux, les rapporteurs ont formulé 12 recommandations déclinées en 5 axes, qui visent à donner l'orientation, la visibilité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions fondamentales de recherche et de formation par les universités, dans le cadre d'une autonomie plus effective et sur la base d'une confiance restaurée.
Axe n° 1 : Définir un cap stratégique partagé au niveau national
Les rapporteurs souhaitent créer un cadre stratégique à trois niveaux :
- la loi, qui doit fixer de manière claire et intelligible les missions et les objectifs assignés au service public de l'enseignement supérieur ;
- la concertation entre les acteurs, qui doivent se prononcer tous les cinq ans sur les grandes lignes de la politique universitaire ainsi que sur une programmation budgétaire pluriannuelle ;
- les Comp, qui doivent garantir l'articulation entre ces priorités et les orientations stratégiques de chaque établissement.
Recommandation n° 1 : Clarifier et prioriser les dispositions législatives du code de l'éduction relatives aux missions et aux objectifs des établissements universitaires.
Recommandation n° 2 : Instituer une conférence stratégique quinquennale réunissant l'ensemble des parties prenantes pour déterminer les objectifs et les priorités de la politique universitaire nationale, ainsi qu'un ensemble de variables en découlant pour la négociation des Comp.
Axe n° 2 : Améliorer la
connaissance de l'université
par les décideurs publics et les
citoyens
Les rapporteurs souhaitent accroître la lisibilité du modèle universitaire, en :
- faisant mieux connaître l'originalité d'un modèle de formation fondé sur la centralité de la recherche, ainsi que sa contribution à l'innovation et au progrès scientifique ;
- communiquant sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse au travers du financement des universités. Le coût réel de la formation universitaire ainsi que sa prise en charge quasi-totale par l'État doivent être clairement portés à la connaissance du public.
Recommandation n° 3 : Mieux communiquer sur les réussites de l'université et sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse, en faisant notamment connaître le coût effectif de la formation universitaire (soit en moyenne 12 250 euros par an et par étudiant).
Ils souhaitent également renforcer les liens entre l'administration publique et la communauté de la recherche, afin de garantir que les hauts fonctionnaires chargés du suivi des universités connaissent leur fonctionnement, et d'améliorer l'action publique en plaçant la méthode scientifique au coeur de sa définition.
Recommandation n° 4 : Favoriser les échanges et les parcours croisés entre la haute fonction publique et le monde universitaire, notamment en accroissant le recrutement de diplômés du doctorat parmi les personnels titulaires de catégorie A + et en développant les stages INSP dans les établissements.
Axe n° 3 : Garantir la transparence et la prévisibilité de l'allocation des moyens
Afin de renforcer la visibilité donnée aux établissements sur l'évolution de leurs ressources budgétaires, les rapporteurs appellent à rebâtir les paramètres d'allocation de la SCSP.
Recommandation n° 5 : Redonner de la visibilité aux établissements sur l'évolution de leurs moyens financiers, en :
- précisant de manière transparente les éléments pris en compte dans la détermination du montant de la subvention pour charges de service public (SCSP), de manière à assurer la couverture du socle du fonctionnement des établissements ;
- affirmant le principe de la prise en charge par l'État des mesures salariales nationales ;
- tenant compte, pour la définition de la ressource budgétaire, des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projets.
Ils appellent également à ne plus accroître la part des financements sélectifs dans les budgets des établissements, dans le but d'initier un redéploiement des ressources publiques aboutissant, à moyen terme, à un renforcement des ressources allouées par la SCSP.
Recommandation n° 6 : Rééquilibrer la part respective des financements nationaux alloués via la SCSP et les procédures d'appel à projets compétitif.
Ils appellent enfin à généraliser la dévolution du patrimoine immobilier pour les établissements volontaires, en faisant évoluer la dotation d'accompagnement de manière à garantir son attractivité et sa soutenabilité.
Recommandation n° 7 : Généraliser, pour les établissements volontaires, une dévolution du patrimoine immobilier assortie d'une dotation d'accompagnement pluriannuelle fusionnant l'ensemble des financements immobiliers des établissements.
Axe n° 4 : Moderniser la fonction financière des établissements
L'amélioration du pilotage financier des établissements suppose la généralisation de la comptabilité analytique ainsi que la montée en compétence des services support.
Recommandation n° 8 : Généraliser la comptabilité analytique et développer les outils comptables permettant la connaissance actualisée du montant des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre de leurs appels à projets.
Recommandation n° 9 : Favoriser la montée en compétence des services support en renforçant leur attractivité, en professionnalisant les fonctions relatives à la gestion immobilière et aux appels à projets, et en assurant un accompagnement adapté par les services rectoraux.
L'adaptation de la fonction financière des établissements au nouveau contexte budgétaire et au défi de la rénovation de leur patrimoine immobilier, notamment lorsqu'ils bénéficient de sa dévolution, doit passer par le développement de nouvelles possibilités d'expérimentation ouvertes aux établissements volontaires. Les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des établissements doivent à ce stade passer uniquement par cette voie.
Recommandation n° 10 : Les conditions de sa mise en oeuvre par les établissements n'étant pas réunies, suspendre les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des universités.
Recommandation n° 11 : Développer, pour un échantillon réduit d'établissements volontaires, des possibilités d'expérimentation financière concernant notamment la gestion dynamique de la trésorerie et l'élargissement des possibilités de recours à l'emprunt, dans le but principal de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation énergétique du bâti universitaire.
Axe n° 5 : Ouvrir une réflexion nationale
sur
l'orientation étudiante et les tarifs universitaires
Deux marqueurs fortement identifiants du modèle universitaire français ont fait l'objet de débats nourris : l'absence de sélection à l'entrée du premier cycle et la quasi-gratuité des études. Alors que le paysage de l'enseignement supérieur connaît de profonds bouleversements, le statu quo sur ces deux points est générateur de certains effets négatifs pour les étudiants, les familles, les établissements et, à travers l'enjeu de finances publiques, l'ensemble des citoyens.
La manière de répondre aux questions ainsi soulevées n'a cependant fait l'objet d'un consensus ni entre les acteurs entendus, ni entre les rapporteurs, qui estiment en conséquence nécessaire d'ouvrir la réflexion sur ces sujets, notamment dans le cadre de la concertation stratégique prévue par la première recommandation.
Le débat sur la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire devra inclure une réflexion sur la fonction du baccalauréat, l'organisation du continuum entre le lycée et le premier cycle universitaire ainsi que le fonctionnement de ce cycle de formation. Celui sur les tarifs devra moins porter sur l'augmentation des ressources universitaires, qui ne pourra être que limitée au regard de la modicité des tarifs actuels, que sur la pertinence de la prise en charge par le budget de l'État du coût de la formation des étudiants indépendamment du niveau de ressources des familles.
Recommandation n° 12 : Dans le cadre de la conférence stratégique, ouvrir la réflexion sur :
- la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire ;
- les conditions d'un rehaussement national des droits d'inscription, de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire la part du financement de l'État.
AVANT-PROPOS
Origine de la mission
La mission d'information du Sénat sur les relations stratégiques entre l'État et les universités est née de la volonté de comprendre les raisons du décalage observé, au cours des derniers débats budgétaires, entre l'appréciation respectivement portée par les autorités ministérielles et les établissements universitaires sur la situation financière de ces derniers. Cette divergence a donné lieu, dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2025, à de fortes crispations sur l'évaluation de la trésorerie des établissements.
Les travaux menés par les rapporteurs Laurence Garnier et Pierre-Antoine Levi ont rapidement permis de constater que la source des difficultés dépassait la simple question de l'évaluation comptable. Ce diagnostic non partagé constitue un indicateur avancé du climat de défiance qui s'est installé de longue date entre les universités et les autorités ministérielles chargées de leur pilotage, et plus généralement de l'insuffisante structuration de la stratégie de notre pays pour son université.
Ce sont en conséquence le cadre, les modalités d'organisation concrètes et les nombreux impensés du pilotage des universités qui ont fait l'objet des travaux de la mission. Le rapport qui en est issu est publié dans un contexte de forte actualité sur ce sujet, alors qu'une nouvelle vague de déconcentration ainsi que l'élargissement de la portée des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) viennent d'être annoncés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Ces travaux s'articulent par ailleurs avec ceux de la commission des finances du Sénat sur les conditions et les limites du financement à la performance des universités1(*).
Méthode
Afin d'objectiver leur constat, les rapporteurs ont souhaité partir de la parole des acteurs universitaires. Ils ont ainsi conduit trois tables rondes et quatre déplacements à l'Université Paris 8, à l'Université Angers, à Aix-Marseille Université et à l'Université Paris Cité, qui leur ont permis de recueillir l'appréciation des représentants de 25 universités de toute taille et aux situations financières très différentes, mais également de leurs responsables administratifs et financiers.
Ils ont également recueilli l'éclairage d'une grande diversité d'acteurs contribuant au pilotage des universités et à la réflexion sur celui-ci.
Constats généraux
Alors que les débats budgétaires tendent à mettre l'accent sur les marges d'amélioration des universités en matière de gestion interne, la mission d'information a permis de mettre en évidence la carence générale de l'État dans la définition de la politique universitaire de notre pays. Il en découle un pilotage erratique aux multiples impensés, dont les établissements sont depuis longtemps contraints d'absorber les conséquences.
Cette carence résulte avant tout de l'absence de définition actualisée, au niveau national et de manière concertée, des objectifs et des missions assignés aux universités.
Cette lacune a favorisé le déploiement d'un pilotage fragmenté et sans vision d'ensemble du paysage universitaire. Au cours des dernières décennies, de profondes évolutions ont ainsi été impulsées par la puissance publique sans qu'une régulation de leurs effets sur l'ensemble des établissements y soit associée. La montée en puissance du financement compétitif, en particulier, a permis la structuration d'établissements intensifs en recherche extrêmement performants, mais a durablement déstabilisé le mode d'allocation de leurs ressources aux universités.
Cette absence de boussole a par ailleurs de multiples effets sur la cohérence du paysage universitaire, qui apparaît de plus en plus fragmenté, sur le financement du service public de l'enseignement supérieur, dont la soutenabilité à moyen terme apparaît compromise, ainsi que sur la capacité de la communauté universitaire à se projeter dans l'avenir, qui constitue pourtant une condition fondamentale de toute activité de recherche.
Face à la concurrence accrue du secteur privé, la carence des pouvoirs publics a également des effets sur le positionnement de l'université dans l'offre globale d'enseignement supérieur. Dans le contexte de pénurie de moyens, l'absence de régulation des effectifs étudiants du premier cycle, associée à l'absence de progressivité des droits d'inscription, tend à dégrader la qualité perçue de la formation universitaire et à lui associer l'image d'une solution d'orientation par défaut. Ce manque de reconnaissance résulte également de la méconnaissance globale, par les décideurs publics comme par nos concitoyens, de l'originalité du modèle universitaire.
Contraintes d'évolution
Devant ce tableau, la tâche des pouvoirs publics n'est certes pas aisée.
La régulation de l'université doit en effet prendre en compte, dans une perspective à la fois territoriale et internationale, de multiples principes (les exigences du service public et l'émulation nécessaire à la performance des activités de formation et de recherche), une pluralité d'acteurs (de la communauté universitaire aux collectivités territoriales et aux entreprises privées), des processus d'évolution contradictoires (entre l'approche descendante de l'État et les orientations émanant d'établissements autonomes) et des défis croissants (la contrainte de la démographie étudiante, la réhabilitation d'un parc immobilier vieillissant, l'intégration des nouvelles technologies dans le fonctionnement des établissements ainsi que la préservation de leur fonction de promotion sociale).
Une stratégie et un pilotage efficaces supposent d'assurer la combinaison de ces différents enjeux.
Recommandations
Au terme de ses travaux, la mission d'information a défini cinq axes de recommandations visant à améliorer le pilotage stratégique des universités, en tenant compte de la contrainte du nécessaire redressement des comptes publics.
L'ensemble de ces préconisations sont guidées par la préoccupation de recréer les conditions d'une relation de confiance entre l'ensemble des acteurs du monde universitaire et contribuant à son fonctionnement - et, au-delà, avec tous les citoyens, l'université étant un bien public dont la préservation constitue un impératif pour l'ensemble de la société.
Elles se déploient à la fois sur le long terme, au travers de la clarification du rôle que notre pays assigne à ses universités, et sur le court terme, par l'indispensable stabilisation des conditions de financement des établissements.
Ainsi que l'a récemment rappelé le Conseil d'État dans son étude annuelle pour 2025, la science constitue, aux côtés du droit, l'un des deux piliers de la démocratie. L'enjeu d'une restauration de la confiance dans l'institution universitaire ne se limite donc pas à l'amélioration de l'accompagnement de la jeunesse et de la performance de la recherche et de l'innovation : elle constitue une condition fondamentale de la préservation de notre modèle démocratique.
PREMIÈRE
PARTIE.
FAUTE DE CAP FIXÉ PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE,
UN PAYSAGE
UNIVERSITAIRE ILLISIBLE
I. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS BOUSSOLE
En raison des insuffisances cumulées du cadre législatif en vigueur et de son application par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), notre pays ne dispose aujourd'hui d'aucun cap clairement défini et partagé à l'échelle nationale pour son université. Les modalités de la tutelle exercée par le ministère sur les établissements sont par ailleurs perçues comme inadaptées par les établissements.
Il en découle, en dépit de ses réussites objectives, un manque criant de reconnaissance de l'institution universitaire dans le débat public, qui constitue à la fois la cause et la conséquence de ces difficultés.
A. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE STRATÉGIE
1. L'ambition de la France pour ses universités n'est pas définie
Les dispositions législatives définissant les missions confiées aux universités et les orientations de politique publique en matière d'enseignement supérieur constituent un cas d'école des faiblesses trop souvent reprochées à la loi : bavardes au point d'en devenir inapplicables, elles ne sont pas mises en oeuvre par le ministère chargé d'en assurer l'exécution.
a) Une accumulation de missions législatives sans cohérence d'ensemble
Les objectifs et les missions confiés aux universités par le législateur se sont progressivement accumulés pour constituer aujourd'hui un ensemble disparate d'items de portée inégale, dépourvu de priorisation et manifestement inapplicable dans son entièreté par les établissements.
• Ces missions sont définies dans un chapitre entier du code de l'éducation, comportant douze articles (L. 123-1 à L. 123-9) aux dispositions touffues, peu structurées et largement redondantes. Cette situation résulte de l'adjonction progressive2(*) de dispositions nouvelles, qui s'est faite au gré des urgences politiques, sur le mode de la sédimentation.
L'article L. 123-2, qui détermine les grands objectifs assignés au service public de l'enseignement supérieur, a ainsi connu cinq rédactions successives. Dans sa version initiale, cet article se limitait à trois objectifs socles relatifs au développement de la recherche, à la participation à la croissance économique et aux politiques d'emploi, et enfin à la réduction des inégalités sociales ou culturelles ; il en comporte aujourd'hui onze. Ont ainsi été ajoutés, au gré des urgences politiques du moment, de multiples items relatifs à la réussite étudiante -définie comme l'objectif premier du service public de l'enseignement supérieur-, à la fonction sociale et territoriale des établissements, à l'internationalisation de l'action universitaire ou encore à la prise en compte du développement durable.
|
Les objectifs du service public de l'enseignement
supérieur Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° A À la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 2° À la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; 3° À la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. À cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ; 3° bis À la construction d'une société inclusive. À cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ; 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 4° bis À la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; 5° À l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ; 6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ; 7° À la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ; 8° Au renforcement des interactions entre sciences et société. |
De la même façon, l'article L. 123-3 définissait, dans sa rédaction initiale issue de la même loi Savary, quatre missions du service public de l'enseignement supérieur ; il en compte aujourd'hui six, dont la rédaction particulièrement détaillée va jusqu'à mentionner le « transfert de technologie lorsque celui-ci est possible ».
|
Les missions du service public de l'enseignement supérieur (article L. 123-3 du code de l'éducation) Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ; 3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ; 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale. |
Les articles suivants mentionnent des objectifs et obligations épars, allant de l'accueil des étudiants en situation de handicap au concours apporté à la politique d'aménagement du territoire, en passant par la mise en place d'une action contre les stéréotypes sexués, la promotion des langues régionales, le développement de l'activité physique et sportive ou encore la promotion de valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. Certains de ces items sont mentionnés, de manière redondante, dans plusieurs articles de ce chapitre.
• Il est ainsi attendu des établissements qu'ils assurent leurs missions fondamentales de recherche et de formation tout en déployant des interventions multiples, non priorisées et parfois difficilement conciliables : l'internationalisation de leur activité doit aller de pair avec une contribution au développement de leur territoire d'implantation, et l'établissement de connaissances scientifiques de pointe avec une participation active au renforcement de la cohésion sociale du pays.
La mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble de ces missions est en conséquence largement irréalisable, et leur appropriation complète par les établissements ne peut qu'aboutir à la dilution de leur action et au saupoudrage de moyens déjà fortement contraints.
Cette mise en oeuvre n'est, du reste, pas pertinente pour toutes les universités, ni même pour toutes les composantes d'un même établissement. Certains d'entre eux développent par ailleurs, au-delà des exigences fixées par les textes et au regard des besoins qu'ils constatent sur le terrain, une politique propre sur certains aspects. Aix-Marseille Université a ainsi mis en place des centres de soins adaptés à sa population étudiante, notamment féminine, tandis que l'Université Paris 8 a développé un dispositif d'accompagnement social et de réponse à la précarité étudiante.
• La portée des dispositions législatives relatives aux missions du service public de l'enseignement supérieur, qui devraient constituer le fondement de notre ambition universitaire, se limite au total à celle d'une déclaration d'intention ou d'un catalogue de voeux pieux, sans lien avec les ressources et les défis des établissements.
b) La carence du ministère dans la définition d'une stratégie nationale
(1) Les dispositions législatives relatives à la Stranes ne sont plus appliquées depuis 2019
• Cette absence de définition véritable des missions des universités dans la loi est aggravée par les lacunes des pouvoirs publics dans la détermination de la stratégie universitaire, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
Cet article prévoit en effet, depuis la loi dite « Fioraso » de 20133(*), l'élaboration puis l'adoption, sous l'autorité du ministère chargé de l'enseignement supérieur, d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (Stranes), au terme d'un processus faisant intervenir l'ensemble des acteurs concernés et comportant une transmission obligatoire des dispositions envisagées aux commissions parlementaires compétentes.
La détermination des financements alloués aux établissements fait partie intégrante de cette stratégie, qui doit comporter une programmation pluriannuelle des moyens et définir les principes de leur répartition entre les acteurs de l'enseignement supérieur. Selon les éléments figurant sur le site Internet du MESR, le Stranes doit ainsi « définir les objectifs nationaux engageant l'avenir à l'horizon des dix prochaines années et présenter les moyens de les atteindre ».
Depuis la publication d'une première Stranes en 2015, au terme d'une phase de concertation sous l'égide d'un comité ad hoc4(*), le ministère n'a cependant pas respecté son obligation de révision quinquennale de cette stratégie, pas plus que celle de l'information biennale du Parlement sur les conditions de sa mise en oeuvre. Il en résulte que :
- les dispositions votées par le législateur sur la définition de la stratégie de l'enseignement supérieur ne sont plus appliquées depuis 2019, date à laquelle des travaux préparatoires auraient dû être lancés pour aboutir à une stratégie concertée en 2020 ;
- depuis cinq ans, la France ne dispose d'aucun document stratégique actualisé en concertation avec les acteurs concernés pour définir les orientations pluriannuelles, à l'échelle nationale, de son système d'enseignement supérieur.
• Cette situation est d'autant plus étonnante que des orientations stratégiques ont dans le même temps été définies sur certains aspects de la politique publique de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie numérique du MESR, une feuille de route du comité numérique pour la réussite étudiante et l'agilité des établissements (Coreale), chargé de son application, a ainsi été définie pour la période 2023-2027. La stratégie « Bienvenue en France » d'attractivité pour les étudiants étrangers a également été lancée en 2019, tandis qu'une programmation sur dix ans des moyens alloués à la recherche a été définie par la LPR de 20205(*).
Il semble par ailleurs que le ministère entende se saisir du rôle qui lui revient en matière de définition d'une stratégie pour l'enseignement supérieur. Une circulaire datée du 5 septembre 2025 rappelle ainsi qu'il revient aux services centraux du ministère de « proposer et piloter la politique publique de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
• Les projets annuels de performance (PAP) annexés au programme 150 relatif aux formations supérieures et à la recherche universitaires prévoient par ailleurs des indicateurs chiffrés en matière de formation d'une classe d'âge dans l'enseignement supérieur, d'insertion professionnelle des diplômés en formation initiale, d'admission dans l'enseignement supérieur ou encore de réussite étudiante. Il s'agit cependant d'indicateurs d'efficience des crédits budgétaires, et non d'objectifs stratégiques ayant une incidence sur le montant des crédits alloués à chaque établissement.
(2) Cette lacune n'est pas compensée par le report du travail stratégique du ministère sur les Comp
Le travail stratégique est en conséquence entièrement reporté sur l'outil du contrat.
• Le rôle central du contrat dans le dispositif de pilotage de la politique d'enseignement supérieur a été affirmé par la loi LRU de 2007, dont l'article 17 a rendu obligatoire la passation de contrats pluriannuels. D'abord formalisée par la passation de contrats d'établissements, l'application de cette disposition repose depuis la loi ESR de 2013 sur la mise en place de contrats de site quinquennaux, qui constituaient jusqu'à ce jour l'outil de référence de la politique contractuelle de l'État dans l'enseignement supérieur.
Cette politique contractuelle est actuellement en cours de refondation via le déploiement progressif, depuis 2023, des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp). Initialement mis en place comme des instruments d'allocation de moyens financiers complémentaires à ceux de la subvention pour charges de service public (SCSP), ces contrats sont désormais considérés par le ministère comme ses « vecteurs essentiels pour l'impulsion et la mise en oeuvre des orientations nationales des politiques publiques, notamment dans le domaine du pilotage de l'offre de formation » - orientations définies à ce jour par le seul ministère.
Selon l'ambition affirmée par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau, les Comp doivent permettre l'engagement par les établissements d'actions transformantes dans des champs définis comme prioritaires, le versement des financements associés étant conditionné à la réalisation des objectifs fixés6(*). La mise en oeuvre de ces instruments pluriannuels, d'une durée de trois ans, a été confiée aux rectorats dans le cadre d'un dialogue annuel de performance.
Selon la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du MESR, leur déploiement vise en outre à renouveler l'exercice de la tutelle des opérateurs par le repositionnement des échanges entre les établissements et les rectorats « à un niveau plus stratégique » d'une part, et par l'introduction de la notion de performance dans un dialogue jusqu'ici centré sur le contrôle de la régularité juridique et financière des opérations d'autre part.
• Les premiers bilans dressés de ces instruments par la Cour des comptes7(*) et la commission des finances du Sénat8(*) mettent notamment en avant le caractère très réduit des financements associés, qui représentent globalement 0,8 % des montants attribués via la SCSP. S'il est vrai que leur montant a été calibré pour jouer un rôle d'amorçage, et non couvrir l'intégralité des dépenses correspondant aux axes stratégiques négociés, il n'en reste pas moins que ce dimensionnement des Comp les rend à ce jour impropres à fonder à eux seuls le travail stratégique qui n'est pas déployé dans le cadre de la Stranes.
Les rapporteurs considèrent ainsi qu'il n'est pas possible d'affirmer, comme le fait la Dgesip, que « la stratégie universitaire au niveau national et au niveau de chaque établissement est déployée dans le cadre des Comp ».
• Selon le ministère, cette situation doit évoluer sous l'effet du redimensionnement des Comp.
À compter de 2026, leur portée sera en effet étendue, pour les établissements de deux régions académiques préfiguratrices9(*) et avant leur généralisation ultérieure, à l'ensemble de l'activité des établissements. Ce nouveau format des Comp à 100 %, qui seront fusionnés avec les contrats quinquennaux, signifie selon la Dgesip que « la performance, mais aussi les spécificités de l'ensemble des champs d'activité des établissements, seront pris en considération dans la construction d'un contrat global qui sera négocié, au plus proche, par les recteurs de région académique ».
Les éléments qui devront être pris en compte par les recteurs dans la négociation des Comp correspondent en effet, de manière bienvenue, à des orientations stratégiques qu'il est indispensable de clarifier. Selon une note adressée le 19 juin 2025 par le ministère aux recteurs des deux régions académiques préfiguratrices, le « kit d'outillage » qui leur sera fourni par la Dgesip pour les appuyer dans ce travail comportera une définition des objectifs de négociation et des indicateurs associés, une analyse des « services rendus par l'établissement (indicateurs d'activité et de performance des formations, de la recherche, du pilotage) », ainsi que des éléments permettant de situer chaque établissement au regard des établissements comparables, en termes de financement et de niveau d'activité et de performance.
En dépit de cette extension, les Comp, par nature multiples et adaptés à la configuration particulière de chaque université, ne constitueront pas un document unique de programmation stratégique auquel les décideurs publics et les citoyens pourront se référer. Du fait de leur nature opérationnelle, ils devront par ailleurs s'articuler avec les orientations stratégiques définies dans chacun des domaines d'activité des universités - et notamment, en matière de formation et de recherche, avec les orientations tracées via la procédure d'accréditation des établissements10(*) par le Hcéres11(*). Enfin et surtout, les objectifs qu'ils définissent n'ont pas fait l'objet d'un arbitrage concerté au niveau national et correspondent à des priorités définies par le seul ministère.
Tout en relevant que l'annonce des Comp à 100 % est globalement saluée par les acteurs de l'enseignement supérieur12(*), et en regardant avec intérêt les transformations qu'ils pourraient induire en matière d'allocation des moyens, les rapporteurs estiment en conséquence que le déploiement des Comp à 100 % n'est pas susceptible de remplacer l'établissement d'une stratégie nationale concertée telle que prévue par le code de l'éducation.
2. La massification des effectifs étudiants n'est pas régulée
Cette absence de boussole est notamment visible dans la régulation des activités de formation. Les filières universitaires se trouvent en effet fortement contraintes par la massification des effectifs accueillis, sans que les différents principes encadrant l'accès à ces formations fassent aujourd'hui l'objet d'une véritable conciliation stratégique.
Si l'entrée dans le supérieur se fait selon un principe d'orientation a priori, assimilé dans sa mise en oeuvre à un droit d'accès à l'université, les étudiants massivement accueillis en premier cycle se trouvent confrontés à de forts mécanismes de sélection dans la poursuite de leur parcours.
Il en résulte une régulation de fait, a posteriori et par l'échec des effectifs accueillis dans certaines filières, hautement préjudiciable aux étudiants, aux établissements et aux finances publiques.
a) Une contrainte pesant d'abord sur les universités
• La croissance rapide des effectifs de l'enseignement supérieur, qui compte aujourd'hui neuf fois plus d'étudiants que dans les années 1960, a été principalement absorbée par les universités.
Selon les données de l'EESRI13(*), 54% des effectifs des formations post-baccalauréat sont inscrits à l'université, soit 1,6 millions d'étudiants à la rentrée 2023. La plupart d'entre eux sont des étudiants de premier cycle : 60 % sont inscrits en licence, tandis que 3 % seulement préparent un doctorat. Près d'un tiers des 672 400 néo-bacheliers de 2023, soit 216 500 étudiants14(*), sont entrés en licence au terme d'un processus d'orientation et d'inscription par le biais de la plateforme Parcoursup.
Ces effectifs se répartissent de manière contrastée dans les différentes filières. Avec 31 % des inscrits, ce sont les filières d'arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales qui représentent les premières formations universitaires ; leur évolution est cependant orientée à la baisse (- 3,6 % entre 2018 et 2023). Viennent ensuite les filières scientifiques, qui rassemblent 24 % des inscrits à l'université et dont les effectifs sont orientés à la hausse (+ 4,6 %). Les formations en santé, en économie et en administration (AES), et enfin en droit et sciences politiques comptent respectivement 15 %, 14 % et 13 % des étudiants de l'université, avec toutefois un dynamisme variable (respectivement + 1 %, - 8,6 % et + 3 %). Les sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) représentent enfin 4 % des effectifs universitaires, avec une évolution positive (+ 4,6 %).
• Cette massification des effectifs universitaires résulte de la conjugaison de plusieurs éléments.
L'élargissement des cohortes de bacheliers au cours des dernières décennies en est le premier facteur explicatif, sous l'effet de la croissance démographique, de la diversification des voies d'accès au baccalauréat et de la hausse continue du taux de réussite à cet examen. Après la création du baccalauréat professionnel en 1985, la proportion de bacheliers dans une génération est ainsi passée de 33 % à 63 % entre 1987 et 1995, puis de 65 % en 2010 à 80 % en 2023.
Alors que la loi prévoit l'ouverture du premier cycle universitaire à tous ses titulaires15(*), la progression du taux de réussite au baccalauréat fait par ailleurs profondément évoluer la fonction de ce diplôme, qui agit de moins en moins comme une barrière à l'entrée des études supérieures. Les formations universitaires dites « non sélectives » sont dès lors accessibles à la très grande majorité d'une classe d'âge.
L'accueil des étudiants étrangers dans les filières universitaires contribue également à l'augmentation des effectifs. Selon les données de l'Eesri, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, la croissance annuelle moyenne du nombre d'étudiants internationaux était plus dynamique en 2023 (+ 2,4 % sur cinq ans) que celle de l'ensemble des étudiants (+ 0,7 %). La majorité (65 %) de ces étudiants sont inscrits à l'université : les filières universitaires comptaient ainsi 264 168 étudiants étrangers en 2023, en hausse de 21% en dix ans. Dans l'ensemble du supérieur, les étudiants marocains et algériens sont les plus représentés, suivis par les étudiants chinois ; un peu moins d'un étudiant chinois sur deux (46%) est inscrit à l'université, contre neuf étudiants algériens sur dix, qui sont fortement représentés en master.
À ces facteurs mécaniques s'ajoute l'aspiration croissante des jeunes et de leurs familles à la détention d'un diplôme de l'enseignement supérieur, alors que 48 % des 25-49 ans étaient diplômés de l'enseignement supérieur en 2023, contre 27 % en 2003.
La concentration des effectifs de l'enseignement supérieur dans les universités résulte enfin et surtout de l'absence de régulation à l'entrée des études universitaires.
|
Les trois types de formation universitaire accessibles par Parcoursup Trois types de formation universitaires peuvent être distingués : - les formations non sélectives : il s'agit des licences, des parcours spécifiques accès santé (PASS) et des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) ; - les formations sélectives : en application du VI de l'article L. 612-3, il s'agit notamment des instituts universitaires de technologie (IUT) et des doubles licences ; - les formations sous statut d'apprenti, qui sont rattachées aux parcours sélectifs et non sélectifs. |
b) Une formation ouverte à tous les bacheliers
(1) En droit, la procédure Parcoursup assure une conciliation des principes encadrant l'accès à l'enseignement supérieur
• Le choix fait par notre pays de proposer un accès ouvert à l'université, sans procédure de sélection préalable, constitue l'une des modalités possibles de la conciliation des différents principes et objectifs de politique publique déterminant les conditions d'accès à l'enseignement supérieur.
Il s'agit en premier lieu de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, qui découle du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 194616(*).
Cette exigence n'est pas, en droit, synonyme d'interdiction de toute sélection, dès lors qu'elle est organisée de manière à garantir l'égale admissibilité de tous les candidats. La jurisprudence du Conseil constitutionnel17(*) a ainsi établi que ce principe « ne fait pas obstacle à ce que le législateur [...] puisse [...] établir les conditions dans lesquelles les bacheliers peuvent être inscrits dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ». Les conditions actuelles de son application, développées infra, tendent cependant à l'assimiler à un droit d'accès à l'enseignement supérieur, dont les filières non sélectives de l'université sont les premières à absorber les effets.
Ce principe s'articule avec des objectifs législatifs relatifs, notamment, à l'insertion professionnelle des étudiants et à la capacité de l'offre de formation à répondre aux besoins en compétences de notre pays18(*), d'une part, et à l'orientation et à la réussite étudiante d'autre part - la loi dite « Fioraso » de 2013 ayant fait de « la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants » l'objectif cardinal des établissements publics d'enseignement supérieur.
Ces différents principes sont complétés par les ambitions affichées par les pouvoirs publics quant à l'évolution du nombre de diplômés de l'enseignement supérieur. En septembre 1985, le ministre de l'Éducation Jean-Pierre Chevènement fixait l'objectif d'un doublement de la proportion de bacheliers dans une classe d'âge, afin d'atteindre un taux de 80 % de titulaires du baccalauréat dans une génération. La loi d'orientation sur l'école de 200519(*) a ensuite défini celui de 50 % de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans une classe d'âge, porté à 60 % par la Stranes mentionnée supra. Cette stratégie, qui visait de manière plus précise 50 % de diplômés de niveau Licence et 25 % de niveau Master, inscrivait cette ambition dans l'impératif de « répondre aux besoins de montée en gamme de l'économie et au progrès de la société », après que la stratégie de Lisbonne a défini l'objectif de faire de l'Europe « l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde ».
Le dernier document stratégique concerté publié par le ministère, la Stranes, affirme enfin que « la sélection n'[est] pas une solution ». Ce refus de la sélection est resté prégnant dans les débats qui se sont développés autour de la réforme de l'accès au Master en 2017, qui a consacré un droit à la poursuite d'études pour tous les étudiants, puis de l'adoption de la loi ORE en 201820(*).
• Ces différents objectifs sont conciliés par la procédure d'orientation « Parcoursup »21(*) créée par la loi ORE de 2018 à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui prévoit à la fois le principe de l'ouverture de l'accès aux formations universitaires non sélectives à l'ensemble des titulaires du baccalauréat et la possibilité pour les présidents d'université d'ordonner les candidatures présentées en fonction de critères objectifs.
Leur répartition dans les différents établissements et filières universitaires est ensuite organisée selon plusieurs principes :
- les capacités d'accueil de chacune des formations proposées, précisées sur Parcoursup, sont définies par les rectorats en tenant compte « des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement ». Les établissements ne sont donc pas compétents sur la définition de ce paramètre central de leur organisation ;
- les inscriptions sont ensuite prononcées par les présidents d'établissement dans la limite de ces capacités d'accueil et « au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation » ;
- une commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES), présidée par le recteur et composée de chefs d'établissement du secondaire et du supérieur ainsi que de représentants des collectivités territoriales, se réunit en fin de processus pour aider les candidats n'ayant pas reçu de proposition d'admission à trouver une formation « au plus près de leur projet en fonction des places disponibles »22(*).
|
Parcoursup et l'exigence d'égal accès à l'instruction Les modalités d'accès au premier cycle universitaire définies par l'article L. 612-3 du code de l'éducation ont été jugées conformes à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction par le Conseil d'État. Dans son avis sur la loi ORE de 2018, il a en effet estimé que ce principe « ne fait pas obstacle à ce que le législateur [...] puisse [...] établir les conditions dans lesquelles les bacheliers peuvent être inscrits dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et prévoir, le cas échéant, des modalités d'admission ou de rejet des candidatures à certaines filières universitaires, qui soient fondées sur des critères objectifs en rapport notamment avec le projet, la formation et les compétences des candidats ». S'agissant en particulier de l'accès aux formations « en tension », il relève que la procédure prévue « conduit à porter une appréciation d'ensemble fondée sur des critères suffisamment objectifs et rationnels, en relation avec l'objet du projet pour éviter l'arbitraire. Respectueuse du principe constitutionnel d'égal accès à l'instruction, cette mise en regard laisse en même temps aux établissements d'enseignement supérieur une certaine marge d'appréciation pour ordonner les candidatures à leurs formations non sélectives, dans le respect du principe d'autonomie que le législateur a établi au profit des Universités ». |
• À l'échelle nationale, il ne s'agit donc pas d'un mécanisme de sélection, mais d'une procédure d'orientation, dans la seule limite des places disponibles - dont le volume, comme on le verra, est toutefois déterminé de manière à offrir une solution à l'ensemble des bacheliers.
Il est en ce sens précisé, sur la plateforme Parcoursup, que « l'objectif demeure de remplir les capacités d'accueil des formations universitaires. [...] En revanche, ce qui a changé avec l'apparition de la plateforme, c'est la façon de remplir la capacité d'accueil des formations non sélectives. Auparavant, les inscriptions se faisaient par ordre d'arrivée dans la nuit devant le bureau ou bien par tirage au sort. Désormais, cela se fait à partir de l'examen des dossiers. Il s'agit d'une décision volontaire et assumée, pour plus de méritocratie ».
On peut cependant considérer qu'il existe bien une sélection à l'échelle de chaque formation et de chaque établissement, les formations les plus demandées recrutant les étudiants les mieux classés sur les listes de recrutement établies après analyse des demandes. En 2024, le parcours d'accès spécifique santé (PASS) mention Biologie, physique, chimie de l'université Paris Cité a ainsi satisfait 4,5 % des demandes présentées. D'autres formations moins demandées, tout en présentant un taux d'admission comparable, recrutent des étudiants moins bien classés sur leur liste ou relevant de leur liste complémentaire.
Au cours des tables rondes organisées par la mission d'information, des présidents d'université ont considéré que cette situation aboutissait à la création de fait d'établissements considérés comme « de deuxième zone » par les étudiants et les pouvoirs publics. Ce phénomène serait très marqué dans les établissements situés en petite couronne parisienne, qui se trouvent en périphérie des établissements parisiens plus prestigieux.
(2) En pratique, la définition des capacités d'accueil universitaires crée un droit d'accès à l'université pour tous les bacheliers
• Dans les faits, ces modalités d'accès au premier cycle universitaire23(*) ne permettent de répondre qu'imparfaitement aux différents objectifs mentionnés supra, la régulation exercée par l'État privilégiant l'ouverture des formations à l'insertion professionnelle et à la réussite des étudiants.
Il ressort en effet des auditions que la définition des capacités d'accueil des formations du premier cycle, qui constitue la seule contrainte à l'admission dans les filières universitaires non sélectives, se fait principalement au regard du volume de voeux attendus sur Parcoursup, au détriment de la prise en compte des débouchés professionnels, des projets de formation des établissements et de leurs conditions d'enseignement.
En application du III de l'article L. 612-3 mentionné supra, ces capacités d'accueil sont définies annuellement par les rectorats « après dialogue avec chaque établissement ». Selon le témoignage de plusieurs responsables d'établissement, les demandes d'évolution présentées par les établissements ne sont cependant pas suivies, notamment lorsqu'elles sont orientées à la baisse, en raison d'une profonde divergence d'intérêts entre les établissements et les rectorats :
- les universités formulent leurs propositions d'évolution, sur la base des remontées effectuées par chacune de leurs composantes, en tenant compte de leurs ressources d'encadrement et des caractéristiques de leurs locaux, mais également des poursuites d'études ouvertes en master ainsi que des taux de réussite et des perspectives d'insertion professionnelle de chaque filière ;
- le rectorat, quant à lui, prend principalement en compte le nombre de bacheliers demandant une formation dans l'enseignement supérieur.
• Selon les témoignages recueillis par les rapporteurs, les décisions prises par les rectorats ne répondent que partiellement aux demandes des établissements. Serait caractéristique de cet état de fait la situation dans laquelle une demande de baisse de 300 places dans une formation aboutit à une diminution effective de 100 places seulement. L'université Paris Cité indique par ailleurs demander, depuis plusieurs années et sans succès, une diminution de ses capacités d'accueil en première année de Pass et de Las, en raison à la fois de ses difficultés matérielles à assurer l'accueil et l'encadrement de tous ses étudiants et de l'absence objective de chances de réussite des derniers étudiants recrutés.
Il ne serait en outre pas rare que, après avoir exprimé, dans le temps de l'évaluation et du contrôle, une analyse critique sur le maintien de certaines formations présentant un taux de réussite ou offrant des débouchés professionnels particulièrement faibles, l'État décide finalement le maintien de leurs capacités d'accueil, voire leur dépassement face à la contrainte du flux de candidats. Ce message stratégique brouillé est perçu très négativement par les établissements entendus.
Le rectorat académique de la région Île-de-France confirme qu'il refuse les baisses de capacités d'accueil dans les filières en tension, qui recouvrent notamment les formations en droit. Il souligne à ce titre la forte contrainte démographique qui pèse sur l'Île-de-France, qui accueille 830 000 étudiants et dont les effectifs continuent de progresser, quand le mouvement de baisse de la démographie étudiante est déjà engagé dans d'autres régions24(*). Une forte capacité d'adaptation est ainsi notamment demandée aux universités Paris 8, Sorbonne Paris Nord et Paris-Est Créteil. Cette situation est à mettre en lien avec l'absence de pilotage national de la répartition des effectifs étudiants.
• Il apparaît en revanche que la phase d'inscription des candidats dans les formations, placée à la main des présidents d'établissement par le IV de l'article L. 612-3, ne donne pas lieu à des divergences marquées entre les universités et l'État. Les admissions supplémentaires décidées à ce stade, qui permettent d'offrir une solution aux étudiants n'ayant pas reçu de proposition au terme du processus Parcoursup, mais également de régler des situations particulières comme celles des bacheliers de septembre, sont en effet décrites comme marginales ou anecdotiques.
France Universités indique à ce titre qu'« il ne peut en aucun cas être procédé à des inscriptions d'office passant outre le refus des présidents », et qu'il n'existe sur ce point « aucune opposition doctrinale » entre les « deux acteurs du service public » que sont les responsables universitaires et les recteurs. Cette appréciation est toutefois contestée par plusieurs établissements, qui indiquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'inscrire, en deuxième phase, des étudiants se prévalant d'un accord du rectorat.
Des universités relèvent toutefois que l'admission complémentaire d'étudiants par cette voie, qui conduit à l'inscription de candidats n'ayant trouvé aucune place en phase principale de la procédure, présente deux difficultés. Elle pose tout d'abord un problème d'équité par rapport aux candidats mieux classés, mais non admis en phase principale. Elle revient par ailleurs à « leurrer » des étudiants dont les chances de réussite sont très minces, voire inexistantes au regard des données statistiques et de la connaissance des parcours de formation dont dispose l'établissement.
c) Une forte sélection a posteriori et par l'échec
(1) Des mécanismes de sélection opérant tout au long du parcours universitaire
Si, de l'avis généralement exprimé par les établissements, le recrutement des étudiants via Parcoursup constitue un progrès certain par rapport au système APB, l'absence de sélection des profils a priori obère fortement les chances de réussite, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants inscrits dans les filières non sélectives de l'université.
Ø Un fort taux d'échec en licence
• Dans son rapport public annuel pour 2025, la Cour des comptes a pointé l'échec massivement observé en cursus de licence, pour un « coût humain et financier considérable ». 36 % seulement des étudiants obtiennent leur licence en trois ans et 47 % en trois ou quatre ans ; au terme de leur première année à l'université, moins de la moitié des étudiants passent en deuxième année de licence, et 15 % quittent le cursus universitaire.
Situation des étudiants un an après leur entrée en licence
Source : commission de la culture
à
partir du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2025
Tout en soulignant la mise en place de nombreux dispositifs d'accompagnement par le ministère et les établissements, pour un coût total de 1,38 milliard d'euros depuis 2017, la Cour relève qu'ils ne suffisent pas à enrayer ce phénomène de redoublements et de sorties sans diplôme, pour un coût pour les finances publiques estimé à 534 millions d'euros par cohorte d'étudiants.
• La Cour relève la pluralité des raisons qui concourent à la réussite ou à l'échec, parmi lesquels les facteurs sociodémographiques25(*) propres à chaque étudiant, les conditions de vie étudiantes ou encore les caractéristiques de l'organisation des formations par les établissements. Soulignant que la réussite des bacheliers généraux est beaucoup plus importante (52,2 %) que celle des bacheliers technologiques (17,6 %) ou professionnels (7,7 %), elle pointe tout particulièrement l'absence de sélection à l'entrée du premier cycle universitaire.
Ce choix pèse en effet fortement sur la capacité des établissements à assurer la réussite de leurs étudiants :
- il les conduit tout d'abord à admettre des étudiants dont le dossier a été jugé faible au regard des attendus de la formation, et dont les chances de réussite sont peu élevées. À cet égard, l'enjeu perçu par les établissements sur les capacités d'accueil réside également dans le fait de pouvoir recruter leurs étudiants parmi ceux qui sont les mieux classés sur les listes établies après analyse des candidatures, des capacités d'accueil étendues conduisant à classer également des candidatures peu compatibles avec les attendus de la formation ;
- il contribue ensuite à renforcer la dégradation déjà très marquée du taux d'encadrement dans certaines filières. Bernard Dizambourg a souligné à ce titre le « faible niveau d'encadrement de la licence comparativement aux autres formations » ainsi que, au sein des formations de licence, « des différences significatives entre les champs disciplinaires, les licences SHS et juridico-économique ayant l'encadrement le plus faible » ;
- il ne leur permet pas, enfin, de déployer des dispositifs d'accompagnement suffisants pour soutenir tous les profils qui pourraient en bénéficier. La plupart des universités ont affirmé leur souhait de ne pas fermer leur recrutement aux profils a priori éloignés des attendus de la formation, voire aux profils atypiques, à condition que leur nombre leur permette de déployer les mesures d'accompagnement nécessaires ; il semble cependant que cette condition soit loin d'être satisfaite dans certaines filières très demandées.
|
Les dispositifs d'accompagnement à la réussite déployés par les universités Au cours de leurs déplacements, les rapporteurs ont pris connaissance de plusieurs initiatives déployées par les universités pour assurer l'accompagnement des étudiants en difficulté et augmenter leurs chances de réussite. Outre l'intérêt évident de ces initiatives pour les étudiants, elles contribuent à l'efficience de la dépense publique dans l'enseignement supérieur en réduisant le taux de redoublement. Le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, systématisé par l'arrêté du 30 juillet 2018, est particulièrement mobilisé par Aix-Marseille Université et l'Université Angers. L'Université Paris 8 propose aux étudiants de licence un tutorat d'accueil et d'accompagnement assuré par des étudiants en master ou doctorat. Dans cet établissement où le profil social des étudiants ne leur permet pas toujours de consacrer une année supplémentaire à l'obtention de leur licence, un dispositif de diplomation universitaire a par ailleurs été mis en place, qui permet aux étudiants quittant l'université avant l'obtention de leur licence de se prévaloir d'une validation universitaire. Labellisé en 2020 par le MESR, le diplôme d'Université PaRéO (Passeport pour Réussir et s'Orienter) de l'université Paris Cité vise depuis 2015 à lutter contre le décrochage en première année de licence par une formation d'un an permettant de doter les bacheliers des compétences nécessaires à leur parcours et de les aider à définir un projet académique et professionnel. Le dispositif Rebond'Sup de l'université d'Angers permet enfin d'assurer un suivi individuel des étudiants dans leurs projets de réorientation. |
Si le principe affiché au moment de l'inscription sur Parcoursup est celui d'un droit d'accès aux formations universitaires pour tous les bacheliers, l'absence de sélection à l'entrée dans l'enseignement supérieur masque ainsi une très forte sélectivité des formations universitaires a posteriori et par l'échec.
La sélection évitée à l'entrée à l'université est par ailleurs reportée sur les échéances ultérieures que constituent l'entrée en master puis l'insertion professionnelle.
Ø Des goulots d'étranglement en master
Depuis 2017, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation26(*), une sélection peut être pratiquée à l'entrée du deuxième cycle, la faculté étant donnée aux établissements de fixer des capacités d'accueil pour leurs parcours de master. Pour de nombreuses formations, telles que celle menant à la profession réglementée de psychologue, les capacités d'accueil fixées en deuxième cycle sont ainsi nettement plus restreintes que celles de la licence.
Cette situation conduit, selon France Universités, à la création de « goulots d'étranglement », « le parcours des élèves se trouv[ant] régulé au moment du passage en master ». Le droit à la poursuite d'études reconnu dans la loi ne permet ainsi pas toujours aux étudiants d'être admis dans un master correspondant au parcours d'études souhaité.
Ainsi, selon les données de l'Eesri, 71 % seulement des 235 000 candidats ayant confirmé au moins une candidature sur la plateforme « Mon Master » en 2024 ont reçu au moins une proposition d'admission, et 59,5 % ont effectivement été inscrits dans une formation.
Des situations dans lesquelles le droit à la poursuite d'études a été respecté au prix d'un basculement d'étudiants dans des formations en master ne correspondant pas aux disciplines étudiées en licence ont par ailleurs été portées à la connaissance des rapporteurs27(*). Selon le rectorat académique de la région Île-de-France, de telles situations sont marginales et pourraient être imputées à la configuration technique de la plateforme d'accès en master. Les outils MonMaster, sur lequel les étudiants formulent leurs voeux et déposent leur dossier, et TrouverMonMaster, utilisé par les rectorats pour affecter les candidats n'ayant pas trouvé de place au terme de la procédure et qui précise uniquement les souhaits d'affectation des candidats28(*), sont en effet étanches.
Ø Les diplômés de master face au risque du déclassement professionnel
• Le temps de l'insertion professionnelle peut ensuite faire émerger un décalage entre le niveau du diplôme obtenu et les caractéristiques de l'emploi occupé, qui place de nombreux jeunes en situation dite de déclassement professionnel ou de suréducation29(*).
Selon les données de l'Eesri, le taux d'emploi des diplômés de master (hors enseignement) de 2022 s'élève à 83 % (73 % d'emploi salarié) dix-huit mois après leur diplomation. Ce taux est sensiblement plus élevé pour les diplômés de sciences, technologies et santé (86 %) que pour ceux de lettres, langues et arts (78 %) ou de sciences humaines et sociales (81 %). Les conditions d'emploi varient également selon les disciplines : si 84 % des diplômés de master occupent un emploi stable, ce taux tombe à 62 % pour les diplômés de lettres, langues et arts et à 55 % pour les diplômés de sciences humaines et sociales. Enfin, tandis que 95 % des diplômés de sciences, technologies et santé occupent un emploi de niveau cadre ou profession intermédiaire, ce taux n'est que de 77 % pour les diplômés de lettres, langues et arts.
Taux d'emploi à dix-huit mois des
diplômés de master
(hors enseignement)
Source : commission de la culture à partir des données de l'Eesri 2025
L'étude « Génération » conduite par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq)30(*), qui suit les premières années de vie active des jeunes sortis diplômés de master en 2017, établit un diagnostic plus fin :
- le nombre de jeunes entrant sur le marché du travail avec un diplôme national de master atteint aujourd'hui son plus haut niveau. Malgré une diminution du taux de poursuite d'études en master depuis la réforme de 2017, ce nombre a en effet plus que doublé entre 2000 et 201031(*), pour s'établir à 140 000 en 2020 contre 57 000 en 200532(*). En 2023, plus d'un quart (26 %) des 25-34 ans détenaient un master ou un diplôme équivalent, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne de l'OCDE (16 %) ;
- un effet protecteur de ce diplôme sur l'emploi33(*) est toujours observé : trois ans après leur sortie de l'enseignement supérieur, 85 % des diplômés de master en 2017 sont en emploi, contre 71 % des jeunes entrés sur le marché du travail au même moment ;
- toutefois, l'emploi occupé ne correspond pas toujours au niveau cadre attendu. Philippe Lemistre pointe à ce titre, dans l'étude mentionnée supra, réalisée à partir des données de l'enquête « Génération », une forte hiérarchie entre les filières de l'enseignement supérieur : tandis que le taux de cadres à trois ans est de 89 % pour les diplômés d'école d'ingénieurs, de 73 % pour les diplômés d'école de commerce et de 72 % pour les titulaires d'un master de filière scientifique et technique, il ne s'établit qu'à 61 % pour les titulaires de masters en LSHS.
• Ces différentes tendances peuvent par ailleurs être mises en relation avec la faible maîtrise des compétences fondamentales par les étudiants et les diplômés de l'enseignement supérieur, qui a été soulignée par plusieurs acteurs universitaires et serait en dégradation selon les travaux de l'OCDE.
L'OCDE évalue à ce titre la littératie des diplômés du supérieur, définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité. Dans l'ensemble de l'OCDE, 13 % des diplômés du supérieur obtiennent un score au niveau 134(*) ou en dessous en 2023 ; cette proportion est de 8 % en France, avec une tendance à la diminution du score moyen entre 2015 et 2023.
|
La définition de la réussite étudiante en question Selon la Cour des comptes, la stratégie de lutte contre l'échec en licence « se heurte à une absence de définition claire de l'échec ». Les recueils de données publiques comptabilisent à ce titre les étudiants défaillants sortant sans diplôme de l'enseignement supérieur ainsi que les étudiants « fantômes ou décrocheurs » - qui constitue une catégorie mal appréhendée selon la Cour. Le MESR considère ainsi qu'un étudiant est en situation d'échec lorsqu'il n'a pas « pu valoriser son passage en L1 par une diplomation ultérieure à l'université ou dans un autre établissement de formation ». La Cour souligne que cette définition ne prend pas en compte « certains aspects de l'échec, tels que l'allongement des parcours lié au redoublement ». À l'inverse, France Universités insiste sur la nécessité d'évaluer plus finement les situations d'échec, l'obtention de notes insuffisantes ne pouvant être analysée de la même manière qu'une défaillance ou que la réorientation résultant d'une mauvaise projection initiale dans la formation demandée. Dans ses réponses au rapport public de la Cour pour 2025, le MESR souligne par ailleurs qu'« un redoublement ayant permis à un étudiant d'obtenir son diplôme national de licence peut être perçu, tout autant, comme une situation d'échec ou comme un dispositif ayant contribué à la réussite avec un coût supplémentaire ». Aix-Marseille Université a enfin souligné le caractère nécessairement pluriel de la réussite et de l'échec, dont les données officielles ne rendent qu'imparfaitement compte. Il importe en particulier de mesurer la qualité de l'insertion professionnelle en prenant en compte à la fois le niveau d'emploi, le niveau de salaire et l'adéquation entre la branche d'insertion et la formation suivie (qui peut faire défaut à l'issue de certaines filières très demandées telles que les Staps). |
(2) Un choix dommageable pour les étudiants, les établissements et les finances publiques
Ce mode de régulation a posteriori des effectifs étudiants est au total insatisfaisant à plusieurs titres.
Il pèse en premier lieu sur les étudiants, pour lesquels le report du processus sélectif après l'entrée à l'université est coûteux à la fois en temps et en argent. Cette situation est d'autant plus problématique qu'elle pèse d'abord sur les étudiants les plus défavorisés, qui sont les plus représentés dans les parcours de licence non sélectifs de l'enseignement supérieur (voir encadré). France Universités insiste à ce propos sur la nécessité pour les établissements de ne pas créer d'« illusion » quant aux possibilités de poursuites d'études dans certaines filières très demandées en premier cycle.
Il pèse ensuite sur les établissements. Dans un contexte budgétaire contraint, la massification des effectifs accueillis porte préjudice à la fois à leur mission de transmission des savoirs, rendue difficile par la dégradation du taux d'encadrement qui en découle dans les filières les plus demandées, et à leur mission de recherche, dont les ressources ne peuvent être régulées sur les effectifs étudiants. De nombreux établissements développent d'ailleurs une offre de formation leur permettant de maîtriser leur recrutement dans certaines filières ; il s'agit notamment des doubles licences, des diplômes d'établissement ou encore des cycles pluridisciplinaires d'études supérieures (CPES)35(*).
Il pèse également sur la dépense publique. Dans son rapport annuel pour 2025, la Cour des comptes évalue à 534 millions d'euros le coût des redoublements et des sorties sans diplôme sur les trois années du premier cycle - sans même tenir compte des dépenses publiques non directement liées à la formation (prise en charge de la restauration, de l'hébergement ou de la médecine scolaire), ni des coûts indirects des difficultés rencontrées par les jeunes pour intégrer le marché du travail, ainsi que de l'insertion à un faible niveau de salaire.
Il pèse enfin sur la société tout entière. L'inquiétude des familles sur l'investissement à consentir au titre des études supérieures et le risque de déclassement associé aux mauvais choix d'orientation, ainsi que les frustrations des jeunes entrant sur le marché du travail au terme d'un parcours universitaire heurté ou n'aboutissant pas à un emploi en lien avec leurs compétences, ne sont pas sans conséquences sur la cohésion sociale.
Cette dernière situation fait écho au concept de « surproduction d'élites » développé par l'anthropologue américain Peter Turchin36(*). Selon ses travaux, le décalage entre l'augmentation du nombre d'individus diplômés aspirant à intégrer l'élite financière ou académique et la stagnation du nombre de postes de pouvoir disponibles contribue à l'émergence de fractures dans l'échelle sociale, favorise l'émergence d'une contre-élite antisystème, et participe in fine à la déstabilisation des sociétés.
|
Les étudiants issus des milieux sociaux les
moins favorisés Dans une note publiée en septembre 2021, l'Observatoire des inégalités relève que « socialement parlant, l'entrée à l'université est moins sélective que dans les grandes écoles, mais le tri s'effectue un peu plus tard dans le cursus. 20 % des étudiants de licence sont enfants d'employés, 12 % enfants d'ouvriers [...]. En master, ces données tombent respectivement à 13 % et 9 % et, en doctorat, à 9 % et 6 %. [...] À l'inverse, la proportion de jeunes dont les parents sont cadres supérieurs [...] augmente tout au long du cursus pour se situer à 40 % en master et en doctorat ». Cette situation est décrite par le concept de « démocratisation ségrégative » proposé par le sociologue Pierre Merle en 2012. Selon l'article de Philippe Lemistre précité, cette notion se traduit de deux manières dans l'enseignement supérieur : les enfants des classes sociales supérieures se distinguent par le choix de filières et de spécialités dont sont en partie exclus les enfants des classes populaires, alors qu'auparavant ils se distinguaient par des durées de scolarité plus longues ; les jeunes issus des classes populaires se tournent le plus fréquemment vers des parcours professionnels ou non sélectifs. |
B. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE PILOTAGE
1. Une tutelle perçue comme inadaptée
• L'enseignement supérieur est piloté dans le cadre d'un portefeuille ministériel identifié depuis 197437(*), et d'une direction générale ministérielle dédiée depuis 1993 - aujourd'hui la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip).
En application de l'article 13 du décret n° 2014-133 du 17 février 201438(*), le champ de compétence de la Dgesip comporte cinq ensembles de missions, parmi lesquelles figurent l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique relative aux formations supérieures, assorties de l'accompagnement des établissements dans l'exercice de leur autonomie ; l'exercice de la tutelle des établissements, incluant la répartition des moyens entre eux ; la mise en cohérence de la politique menée en matière d'enseignement supérieur avec celle conduite en matière de recherche et le pilotage du programme des investissements d'avenir (PIA)39(*).
Ces deux dernières compétences sont exercées de manière conjointe avec la direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI). La Dgesip et la DGRI disposent à ce titre d'un service commun, chargé de coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le pilotage est assuré, à l'échelon déconcentré, par les recteurs de région académique40(*), assistés, dans sept régions comportant plusieurs académies41(*), par un recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Ils sont chargés, outre leur mission régalienne de contrôle budgétaire et de légalité pour les établissements du supérieur, du paiement des bourses sur critères sociaux, de la définition des CPER ainsi que du suivi des opérations immobilières des établissements. Il leur revient également de fixer les orientations stratégiques de la politique de la région académique pour l'enseignement supérieur.
• Le jugement porté, au cours des auditions, sur l'organisation et la qualité de la relation entre les établissements et ces différents acteurs a globalement été sévère. Les rapports avec la Dgesip, directement chargée de la tutelle des opérateurs, ont été fréquemment décrits comme pauvres, voire absents, tandis que l'accompagnement assuré par les rectorats a été jugé excessivement centré sur des aspects administratifs. Le pilotage assuré par les services du MESR a au total été considéré comme inadapté aux besoins des établissements, pour trois séries de raisons.
En premier lieu, les échanges entre les établissements et l'administration centrale et déconcentrée sont perçus comme étant de nature essentiellement bureaucratique.
Les établissements universitaires sont soumis à de nombreuses obligations d'évaluation et de production documentaire, qui mobilisent fortement leurs équipes administratives et leurs organes de direction - notamment sur le plan comptable, dans le cadre du suivi des Comp ou à l'occasion des contrôles opérés par la Cour des comptes et le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres). Or, les acteurs entendus par les rapporteurs estiment dans leur ensemble que les résultats produits dans ces différents contextes ne sont pas mis au service d'une réflexion approfondie sur l'amélioration de la politique universitaire. Ils regrettent en particulier que les alertes remontées, dans le cadre de ces évaluations sur la situation budgétaire des établissements, ne paraissent rencontrer aucun écho aux stades de la préparation des lois de finances et de la répartition des crédits.
En second lieu, un sentiment de « solitude » des présidents d'université face aux défis qu'ils rencontrent, notamment dans le calibrage de leurs capacités d'accueil et leur gestion immobilière, a été mentionné à de nombreuses reprises. Ce sentiment semble résulter en partie du retrait relatif des services du MESR après la première phase de mise en oeuvre de l'autonomie des établissements, qui contraste avec l'accompagnement renforcé déployé au cours de cette période initiale.
Cette perception apparaît plus prégnante chez les établissements de petite taille que dans les grandes universités, dont certaines ont estimé que leur absence de relation quasi-complète avec la Dgesip au cours des dernières années n'était pas problématique dans la mesure où elles n'avaient pas besoin d'un accompagnement particulier.
Cette appréciation est en troisième lieu nourrie par les frustrations fréquemment rencontrées dans l'interaction avec les rectorats. Il a en particulier été regretté que ces derniers ne disposent pas d'une véritable capacité d'accompagnement, et que leur intervention auprès des établissements se limite souvent à un ergotage sur des aspects techniques - le rectorat étant dès lors davantage identifié comme un censeur que comme un auxiliaire potentiel.
La commission des finances du Sénat, dans ses récents travaux relatifs à la contractualisation à la performance dans l'enseignement supérieur42(*), relevait sur ce point que l'« articulation [entre les rôles respectifs de l'administration centrale et des rectorats] n'est pas toujours lisible, y compris pour les établissements et pour les rectorats. Les cas de rectorats « court-circuités » par l'administration centrale sont revenus à plusieurs reprises au cours des auditions. La Dgesip traite ainsi en direct avec les établissements sur divers domaines, par exemple sur les enjeux liés à la dévolution, alors même que d'autres établissements relèvent la valeur ajoutée des rectorats sur les sujets immobiliers. Certains rectorats ont indiqué ne pas avoir connaissance de la manière dont l'administration centrale élaborait ses arbitrages budgétaires ».
Les acteurs entendus regrettent enfin que les modalités actuelles de l'organisation du pilotage tendent à opposer les universités et les organismes nationaux de recherche (ONR), qui relèvent respectivement de la Dgesip et de la DGRI. Plusieurs présidents ont au contraire mis en avant les effets vertueux des rapprochements fonctionnels effectués sur le terrain entre les établissements et les ONR voisins, notamment dans la structuration des réponses aux appels à projets.
2. Des inflexions en cours sur le positionnement de l'État
• L'organisation de la relation entre l'administration d'État et les établissements fait actuellement l'objet de multiples initiatives de la part du MESR.
Il semble tout d'abord que le renouvellement récent à la tête de la Dgesip ait marqué une inflexion dans le rapport avec les établissements, le directeur général en poste depuis 2024 étant à l'initiative d'un accroissement et d'un approfondissement des échanges globalement salué.
Le MESR a par ailleurs publié, au cours de l'été 2025, deux circulaires relatives respectivement aux missions de la Dgesip et de la DGRI43(*) et à la déconcentration en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation44(*), témoignant ainsi d'une attention portée à la thématique du pilotage au sommet de l'État. Ces deux textes prévoient un repositionnement marqué des différents services de l'État chargés d'assurer cette mission.
Ce repositionnement est d'abord celui du champ de compétence du ministère dans son ensemble, qui doit se replacer « comme ministère de l'enseignement supérieur, et non plus seulement des universités », dans le contexte de forte progression des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur privé. Cette évolution appelle la mise en place d'une « doctrine en matière de régulation de l'enseignement supérieur privé et de positionnements respectifs du privé et du public ».
Les textes clarifient ensuite la répartition de la mission de tutelle des établissements entre les services de l'État. Ils prévoient à ce titre un accroissement du rôle des rectorats, en affirmant de manière corollaire la subsidiarité du recours à l'échelon central :
- la circulaire du 5 septembre rappelle que l'exercice de la tutelle et du pilotage des opérateurs « ne saurait se réduire à un simple suivi administratif », mais constitue « le coeur de la compétence » des directions centrales du ministère, et doit être assurée de manière à la fois « effective, stratégique, étayée et différenciée » ;
- la circulaire du 11 août affirme l'engagement d'une « nouvelle étape de déconcentration » et appelle les recteurs à « assurer désormais un rôle accru et notamment à conduire un dialogue stratégique exigeant avec les établissements [...], en fédérant le plus grand nombre d'acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales ». Les rectorats auront en particulier un rôle de premier plan dans la préparation, le pilotage et le suivi des nouveaux COMP. Il leur est enfin demandé de préparer pour le 1er octobre 2025 une « feuille de route régionale » précisant leurs priorités d'accompagnement des établissements.
• Tout en saluant la volonté d'apporter ainsi un nouveau souffle à l'exercice de la mission de pilotage du MESR, ainsi que l'affirmation claire de la nécessité de mieux y associer les collectivités territoriales, les rapporteurs demeurent interrogatifs quant à la portée concrète de ces instructions.
La mise en lien d'un objectif de déconcentration renforcée avec celui d'un accroissement de l'autonomie des universités ne semble en effet pas aller de soi. Les auditions ont permis de constater que, quel que soit l'échelon territorial de leur tutelle par l'État, les établissements attendent avant tout de pouvoir disposer des marges de manoeuvre réglementaires et financières leur permettant d'exercer véritablement leur autonomie. Si l'inscription de certaines décisions de gestion au plus proche des réalités du terrain est certainement bienvenue, elle ne saurait cependant être confondue avec une évolution de fond sur ce point. Le texte de la circulaire entretient d'ailleurs un certain flou à ce sujet, en prévoyant par exemple que devront être examinés la possibilité et l'intérêt de « déconcentrer » certains actes de gestion en matière de ressources humaines « vers les rectorats ou les établissements ».
La circulaire ne comporte par ailleurs aucune orientation susceptible de lever certaines limites actuelles de l'accompagnement exercé par les rectorats, qui semblent largement tenir à la faiblesse de leurs effectifs, à l'absence de clarification des objectifs assignés à l'enseignement supérieur, ainsi qu'au manque d'expertise des équipes rectorales sur certains sujets techniques telle que la gestion immobilière.
France Universités indique quant à elle accueillir cette circulaire « avec une certaine circonspection », « dans la mesure où les universités ont une dimension qui dépasse l'empan de leur implantation territoriale », qui se déploie notamment à l'échelle internationale. Elle souligne par ailleurs qu'il importe « que les recteurs, en leur qualité de représentants de l'État, aient une ligne claire en phase avec les objectifs nationaux. L'intervention rectorale doit s'inscrire dans une logique de réglages et non dans une politique académique autonome ».
3. La faiblesse du ministère de l'enseignement supérieur dans le jeu interministériel
Au-delà de ces aspects organisationnels, la capacité de la Dgesip à structurer et à mettre en oeuvre une véritable stratégie universitaire a été mise en doute du fait de son faible poids dans le jeu interministériel, et de son retrait sur la question de l'allocation des moyens des établissements. Cette faiblesse a été mise en lien avec l'absence de relais d'influence du monde universitaire dans l'administration évoqué infra.
Cette faiblesse a notamment été pointée à l'égard de la direction du Budget, qui est perçue comme le véritable décideur de la politique universitaire. Certaines universités ont par ailleurs indiqué avoir développé des relations directes, et parfois plus efficaces, avec des directions ministérielles relevant d'autres ministères, notamment la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'économie et des finances ou les services compétents du ministère des armées.
De l'avis généralement exprimé, la Dgesip dispose pourtant d'une bonne connaissance des situations et des difficultés locales, et partage bien souvent le diagnostic porté par les établissements sur les défis auxquels ils ont face. Elle n'a cependant pas la main sur les leviers, notamment budgétaires, pour agir sur ces situations, de sorte que cette lecture commune n'est pas retrouvée dans le processus d'allocation des moyens.
Ce retrait du MESR dans le jeu interministériel se traduit également par des lourdeurs et des difficultés de coordination sur les sujets transversaux. Il a ainsi été regretté que le MESR ne joue pas le rôle d'interface nécessaire à la mise en cohérence des différentes missions assignées aux établissements d'enseignement supérieur, notamment avec le ministère chargé de l'emploi ; il en résulte une contradiction dommageable dans les objectifs de politique publique affichés par les deux ministères, source d'incompréhensions sur le terrain pour les établissements et les étudiants. Ces pesanteurs sont également sensibles en ce qui concerne l'immobilier universitaire, toute évolution sur ce point, notamment en ce qui concerne la dévolution, devant être prise avec l'accord de la direction de l'immobilier de l'État (DIE).
C. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE (RE)CONNAISSANCE
Le manque de reconnaissance de l'institution universitaire dans la société française, où l'excellence reste associée aux grandes écoles, a été évoqué tout au long des travaux de la mission. Alors qu'elles forment la majorité des étudiants de l'enseignement supérieur45(*) et qu'elles figurent en bonne place dans les classements internationaux, les universités pâtissent d'un déficit d'image persistant.
Cet état de fait résulte plus fondamentalement d'une profonde méconnaissance46(*) par nos concitoyens, et singulièrement par les décideurs publics, du fonctionnement, des mutations, mais aussi des réussites des établissements universitaires français.
1. Un déficit d'influence auprès des décideurs publics
Les auditions ont ainsi mis en évidence le sentiment largement partagé, dans le monde universitaire, d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'institution universitaire par les décideurs publics, mais également d'un désintérêt profond du monde politique pour le modèle de formation offert par les universités - à l'exception de l'attention périodiquement suscitée par les mobilisations étudiantes et les désordres parfois causés.
a) Un recrutement majoritaire de diplômés de grandes écoles
• Cette situation paraît très largement résulter des parcours de formation des décideurs publics, le plus souvent issus des grandes écoles47(*) et ne disposant donc pas d'une connaissance de première main de l'Université. L'institution universitaire demeure ainsi largement inconnue des cadres de la haute fonction publique.
À l'appui de cette hypothèse sociologique, Stéphane Calviac a souligné que les cadres de la direction du budget chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sont principalement diplômés de l'école nationale d'administration (ENA), devenue institut national du service public (INSP), ou encore des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce.
Laurent Batsch, ancien président de l'université Paris-Dauphine, relève en outre que les corps techniques de l'État48(*), de même que les anciens grands corps administratifs49(*), sont très majoritairement constitués de diplômés de l'École Polytechnique, des écoles normales supérieures et de l'INSP.
Il rappelle également l'échec du rapprochement entre l'université Paris-Saclay et l'École Polytechnique en 2017, en raison de l'opposition de cette dernière, signe de la place et de l'influence prépondérantes des grandes écoles dans le processus de décision sur l'enseignement supérieur. L'université souffre au contraire d'un déficit d'influence dans le processus de décision publique, en particulier lors de l'élaboration des projets de loi de finances.
• Cette prépondérance de l'influence des grandes écoles concerne également les cadres dirigeants du secteur privé : seuls trois présidents des sociétés du CAC 40 sont issus de l'université50(*), soit moins de 10 % d'entre eux, tandis que plus d'un quart de ces dirigeants sont diplômés de l'École Polytechnique.
Dans un rapport d'octobre 202351(*), l'association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) soulignait ainsi le « positionnement historique des grandes écoles au sein de tous les secteurs socio-économiques, alors que les universités ont privilégié une posture plus introvertie au service d'une recherche fondamentale pure ».
• Des présidents d'établissement ont souligné que cette absence de culture de l'université, et la méconnaissance des enjeux de la recherche qui en découle, conduisent à des erreurs de positionnement stratégique de la part des pouvoirs publics, notamment du ministère des finances. Une proportion trop importante du soutien financier à l'innovation serait en effet versée aux entreprises plutôt qu'aux laboratoires de recherche, en dépit de leur contribution cruciale au développement des solutions de rupture, et sans considération de leur contribution à la relocalisation des activités industrielles.
b) Une faible valorisation du doctorat
Corollaire de ces observations, les titulaires du doctorat, plus haut grade universitaire, sont peu nombreux parmi les décideurs publics.
(1) Un diplôme moins répandu et moins valorisé qu'à l'étranger
• D'une manière générale, le doctorat est moins répandu en France que dans les pays comparables.
Dans leurs Recommandations pour la reconnaissance du doctorat dans les entreprises et la société d'octobre 202452(*), Sylvie Pommier et Xavier Lazarus relèvent qu'avec 1% de docteurs dans la population âgée de 25 à 34 ans, la France est en retrait par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE (1,3%), la Suisse (3%), les États-Unis (2%), l'Allemagne (1,6%) ou encore le Royaume-Uni (1,5%).
Cet écart tend en outre à se creuser, le nombre de docteurs formés chaque année ayant augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE quand il a stagné en France. De la même façon, l'ANRT indique dans son rapport précité qu' « entre 2011 et 2020, le nombre de docteurs a crû de 43% en Chine, de 19% en Inde et de près 7% aux États-Unis, là où il a diminué de 17% en France ».
Évolution du nombre de docteurs
formés entre 2011 et 2020
en Chine, en Inde, aux États-Unis et
en France
Source : Association nationale de la recherche et de la technologie (2023)
• Cet état de fait est à mettre en lien avec le faible prestige du titre de docteur dans la société française. L'ANRT pointe à ce titre « la faible valeur perçue du doctorat par quasiment toute la société » : « si les familles rêvent encore que leurs enfants deviennent ingénieurs, peu les imaginent docteurs (on exclut évidemment ici le médecin). Immergés dans une technologie omniprésente, la grande majorité de nos concitoyens oublie qu'elle est le fruit d'une recherche patiente, de long terme ».
À ce défaut de reconnaissance répond la faible valorisation du doctorat dans la sphère professionnelle, l'excellence demeurant associée aux parcours en grandes écoles. Un rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de 2021 a pointé la « persistance de représentations stéréotypées et parfois erronées » des entreprises sur le potentiel professionnel des doctorants, qui sont vus comme dépourvus de compétences opérationnelles. Le rapport Pommier-Lazarus a de la même façon souligné que, alors que 11% seulement des chercheurs en entreprise sont docteurs, « le doctorat souffre encore d'une trop faible valorisation sur le marché du travail, en particulier comparativement au diplôme d'ingénieur seul ».
(2) Le recrutement encore timide de docteurs dans la fonction publique
• L'insertion des docteurs dans l'administration publique, et notamment dans la haute fonction publique, est quant à elle « peu visible et peu étudiée », selon les travaux du collectif Idea parus en octobre 202153(*) - qui indique par ailleurs qu'environ 15 % des jeunes docteurs rejoignent chaque année le secteur public hors académique, à la fois au sein de l'État, des collectivités et des hôpitaux, où exerceraient au total environ 18 000 titulaires du doctorat.
• Plusieurs dispositifs ont cependant été mis en place, au cours de la période récente, pour favoriser l'emploi de personnes formées à la recherche dans l'administration, notamment :
- une voie d'accès spécifique à l'INSP pour les titulaires du doctorat. Créé en 201854(*), ce concours spécifique existe pour le moment à titre expérimental55(*) jusqu'en 2026 ;
- les conventions de formation par la recherche en administration (Cofra). Pendant administratif des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre), elles ont été créées sous forme expérimentale par le MESR en 2022, dans le but de transformer l'action publique par la création de ponts entre la fonction publique et la recherche. Après qu'une trentaine de projets doctoraux portant sur des thématiques diverses56(*) ont été lancés, leur pérennisation a été annoncée le 1er juillet 2025 par le ministre Philippe Baptiste ;
- la mise en place d'un parcours doctoral parmi les formations proposées par l'INSP, qui sera accessible aux élèves de la promotion 2025-2027, et vise notamment à accroître la « mobilisation de la science dans la conduite de l'action publique ».
Ces dispositifs présentent cependant de larges marges d'amélioration :
- les rapports du jury de l'INSP font état d'un défaut de calibrage du concours spécifique aux titulaires du doctorat, qui apparaît à la fois trop léger par le nombre de ses épreuves, et inadapté à la vérification de connaissances qui devront rapidement être mises en oeuvre par les lauréats dans le cadre de leurs stages. Plusieurs pistes d'évolution ont à cet égard été proposées par Alain Beretz, professeur de pharmacologie et président du jury des concours d'accès 2022 à l'INSP ;
- le rapport Pommier-Lazarus regrette que le déploiement des Cofra se trouve limité par les plafonds d'emploi des administrations, ou encore qu'il ne soit pas ouvert aux personnels titulaires qui souhaiteraient préparer un doctorat à temps partiel ;
- Le collectif Idea souligne que le recrutement de docteurs sur des postes de titulaires demeure extrêmement minoritaire du fait de la faiblesse du nombre de postes ouverts par les voies d'accès spécifique - les docteurs employés par l'État l'étant principalement sur des postes d'agents contractuels, sans bonification salariale adaptée.
• De la faible présence des docteurs dans l'ensemble des sphères de décision, des conseils d'administration d'entreprise au gouvernement, en passant par la haute fonction publique, s'ensuit nécessairement une faible acculturation aux enjeux de ce qui fait la spécificité des établissements universitaires, c'est-à-dire leur activité de recherche.
2. Une image dégradée auprès des étudiants, des familles et des entreprises
À ce déficit d'influence auprès des décideurs publics répond la perception globalement dégradée de l'institution universitaire par les familles, et plus généralement son image altérée dans l'opinion publique.
Dans un contexte de concurrence accrue entre les formations du supérieur, cette faible reconnaissance résulte de la comparaison avec d'autres établissements, dont les universités se distinguent, de manière réelle ou fantasmée, du point de vue du coût et de l'exigence des formations proposées.
a) Un coût modique assimilé à une moindre valeur
(1) Des frais d'inscription sans lien avec le coût des formations
• L'exigence de gratuité de l'enseignement supérieur public est de valeur constitutionnelle. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 194657(*) dispose en effet que « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».
Cette exigence ne fait pas obstacle à la perception de droits d'inscription par les établissements :
- selon la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 201958(*), « l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » ;
- le Conseil d'État, compétent pour contrôler le montant des frais d'inscription, estime que le caractère modique des frais d'inscription est apprécié au regard du coût des formations, mais également des exonérations et des aides dont peuvent bénéficier les étudiants, « de telle sorte que ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l'égal accès à l'instruction »59(*).
• La mise en oeuvre de cette exigence se traduit aujourd'hui par un financement des établissements provenant essentiellement de fonds publics, tandis que le montant des droits facturés aux étudiants est très faible en valeur absolue. Fixé chaque année par référence au tableau 1 de l'arrêté du 19 avril 201960(*) et déterminé, depuis l'année universitaire 2024-2025, en fonction de l'indice national des prix à la consommation hors tabac61(*), il s'élève, pour l'année universitaire 2025-2026, à 178 euros pour une année en cycle de licence, 254 euros en master et 397 euros en doctorat62(*). Les étudiants boursiers sont exonérés de droits d'inscription.
Les établissements se saisissent peu, par ailleurs, des possibilités de modulation à leur disposition. Ils ont en effet la possibilité63(*) de fixer des frais d'inscription plus élevés pour les diplômes universitaires et les diplômes d'établissement64(*) qui leur sont propres ; selon un rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR de janvier 2025 sur le modèle économique des EPSCP65(*), les établissements ayant mis en place ce type de dispositifs sont en nombre restreint. Il en va de même pour les droits d'inscription différenciés pour les étudiants extracommunautaires (voir infra).
Les frais ainsi mis à la charge des étudiants français sont sans lien avec le coût réel des formations. Selon le 18ème état de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en France (Eesri), publié le 11 juin 2025, la dépense annuelle moyenne de la collectivité nationale pour un étudiant à l'université était de 12 250 euros en 202366(*). Selon le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR précité, les recettes perçues à ce titre par les établissements représentaient au total 500 millions d'euros en 2023, soit 2,7 % de leurs ressources.
Dépense moyenne annuelle par
étudiant
en fonction des modes formation
Source : EESRI 2025
• Cette quasi-gratuité de l'enseignement supérieur public n'est pas une spécificité française, plusieurs de nos voisins européens étant dotés d'un système public d'enseignement supérieur peu coûteux pour les étudiants. Selon le rapport précité, les modèles d'enseignement supérieur finlandais, danois et allemand et espagnol se caractérisent ainsi par des droits d'inscription gratuits ou très peu élevés. Les droits perçus par les établissements sont un peu plus importants en Espagne (1 000 euros) et en Italie (1 600 euros), sans représenter une part déterminante de leurs ressources (18 % en Espagne).
Ce modèle diffère du système anglo-saxon, dans lequel les droits d'inscription représentent une part plus importante des recettes des établissements. En Irlande et au Royaume-Uni (hors Écosse), les frais d'inscription sont en moyenne de 2 000 euros et 9 250 livres, soit respectivement 32 % et 57 % de ces recettes.
(2) Un « signal prix » négatif pour l'attractivité des filières universitaires
• La modicité des tarifs universitaires semble avoir, de manière paradoxale, un effet négatif sur l'attractivité des filières universitaires.
Dans le contexte de l'essor rapide et de la concurrence accrue de l'enseignement supérieur privé, la modicité des tarifs de l'université publique agit en effet comme un « signal prix » négatif67(*). Leur faiblesse est en effet interprétée non comme la marque de l'engagement de la collectivité publique de prendre à sa charge le coût de la formation de sa jeunesse, mais comme un indicateur négatif de qualité de la formation proposée. L'université est dès lors perçue par les étudiants et les familles comme une formation « au rabais ». Ce problème d'image a été largement souligné au cours des auditions ; un intervenant a ainsi déclaré que l'on devenait étudiant en France « pour le prix de deux paires de chaussures ».
• L'écart est en effet significatif avec les autres formations supérieures, y compris par comparaison avec d'autres types d'établissements publics :
- les écoles de management accessibles après une classe préparatoire affichent ainsi des tarifs annuels compris entre 10 000 et près de 25 000 euros ; le coût complet d'une scolarité de trois ans à l'école des hautes études commerciales (HEC) s'échelonne entre 9 350 et 72 350 euros, selon les situations sociales des étudiants ;
- le rapport des députées Béatrice Descamps et Estelle Folest précité estime que les frais de scolarité annuels des établissements du secteur privé lucratif se situent globalement dans une fourchette comprise entre 5 000 et 10 000 euros ;
- les écoles d'ingénieurs ayant le statut d'Eespig68(*) affichaient en 2023 des tarifs s'échelonnant de 5 950 à 9 800 euros, tandis que les écoles d'ingénieur publiques ont fortement augmenté leurs tarifs depuis 2014-2015, pour atteindre 4 150 euros annuels en 2025-2026 à l'école des Mines de Paris et 3 660 euros à Centrale Supélec69(*).
(3) Le cas particulier des étudiants extracommunautaires
Ce « signal prix » joue de manière particulièrement forte pour les étudiants étrangers, notamment lorsqu'ils sont issus de pays dans lesquels les études supérieures sont très coûteuses.
• La France se distingue en effet par la faiblesse des droits d'inscription mis à la charge des étudiants extracommunautaires. Si le programme « Bienvenue en France » prévoit, depuis la rentrée 2019, des droits d'inscription différenciés pour les étudiants extra-communautaires (Dideec), d'un montant de 2 895 euros en licence et 3 941 euros en master, les établissements utilisent largement à leur profit la possibilité qui leur est donnée par l'article R. 719-50 du code de l'éducation de décider une exonération totale ou partielle de frais d'inscription pour 10 % de leurs étudiants non boursiers au maximum70(*).
Selon le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR précité, la majorité des établissements font usage de cette faculté d'exonération. Au total, 8 % seulement des étudiants extra-communautaires se sont acquittés du tarif plein en 2022-2023, soit environ 8 000 étudiants sur les 103 200 éligibles ; 57 % se sont vu appliquer une exonération partielle visant à aligner leurs frais d'inscriptions sur les tarifs des étudiants nationaux.
Tout en affirmant que ce choix de l'exonération fait par un grand nombre d'universités constitue « sans doute une erreur », la Dgesip considère cependant que « la dynamique des Dideec est réelle », relevant que le nombre d'établissements ayant décidé leur mise en place progresse continûment sur les trois dernières années. Pour l'ensemble des EPSCP, cette ressource a ainsi plus que doublé entre l'année 2022-2023, où les 32 établissements les ayant déployés ont ainsi capté 14,5 millions d'euros de recettes, et l'année 2024-2025, où 36,5 millions d'euros de recettes ont été générés dans 62 établissements71(*). Le ministère regrette toutefois que « peu d'universités [aient] mis en place une stratégie de recrutement d'étudiants internationaux avec des objectifs scientifiques clairement établis », ce qui pèse indirectement sur le développement potentiel des ressources associées.
|
Les exceptions prévues au principe de la majoration des droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires Ne sont pas assujettis aux droits d'inscription différenciés les étudiants ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE), de l'espace économique européen (EEE), de Suisse, de Monaco ou d'Andorre. Des exceptions sont en outre prévues pour les étudiants québécois, les membres de la famille d'un citoyen de l'UE, de l'EEE ou de Suisse, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que leurs enfants, les résidents de longue durée sur le territoire français, les personnes ayant leur domiciliation fiscale sur le territoire français depuis plus de deux ans ainsi que les étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Sont par ailleurs exonérés de droits d'inscription différenciés les bénéficiaires d'une bourse du gouvernement français. |
• Au cours des auditions, plusieurs établissements accueillant, pour des raisons historiques ou tenant aux spécificités de leurs enseignements, une forte proportion d'étudiants étrangers, se sont dits attachés à cette exonération. C'est notamment le cas de l'université Paris 8, qui se définit comme une « université monde » et développe des programmes de recherche portant notamment sur le plurilinguisme.
D'autres ont pointé la perception négative de ces tarifs modiques par des étudiants issus de pays dans lesquels la dépense consacrée à la formation supérieure est plus élevée. Cette perception les conduirait à se tourner vers d'autres pays ou d'autres types d'établissements ; elle favoriserait par ailleurs le développement d'intermédiaires facturant des tarifs plus proches des standards de leur pays d'origine, sans bénéfice pour l'université d'accueil.
Le niveau de tarification de l'université française vis-à-vis des étudiants étrangers, associé aux conditions de formation parfois dégradées de certaines filières du premier cycle, la conduit au total à se positionner, au sein de l'offre d'enseignement supérieur des pays comparables, comme une solution d'accueil à bas coût et de qualité moyenne. Selon plusieurs personnes entendues par les rapporteurs, certaines filières non sélectives du premier cycle joueraient ainsi le rôle de point d'entrée dans le système français d'enseignement supérieur.
b) Une formation perçue comme peu exigeante et non professionnalisante
(1) La faible qualité perçue de la formation ne permet pas aux filières non sélectives de l'université d'attirer les meilleurs profils
S'y ajoute une perception globalement négative par les étudiants, les familles et les entreprises de la qualité de la formation dispensée par les universités.
• Selon les éléments recueillis au cours des auditions, cette mauvaise perception serait particulièrement prégnante pour les cursus de SHS et résulterait largement de l'association des universités avec l'enseignement de masse, illustrée médiatiquement, à chaque rentrée universitaire, par des images d'amphithéâtres bondés. Plusieurs présidents d'université ont ainsi estimé que l'absence de sélection en licence contaminait l'image globale de l'université, identifiée comme une institution peu exigeante et aux conditions d'études dégradées, au contraire des grandes écoles recrutant sur concours.
À l'inverse, une image de qualité est attachée aux formations universitaires sélectives, au point que celles-ci ne sont pas toujours associées à l'université ; c'est notamment le cas des instituts universitaires de technologie (IUT), des écoles d'ingénieur universitaires du réseau Polytech, ou encore du modèle de la grande école universitaire représenté par le Celsa72(*).
En témoigne également le succès des cursus de licence sélectifs : il s'agit des doubles licences ainsi que des cycles pluridisciplinaires d'études supérieures (CPES), dont la sélectivité est justifiée par l'exigence et le caractère pluridisciplinaire des enseignements dispensés. En 2024, la double licence Science politique-Économie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ainsi reçu 3 353 voeux pour 30 places, soit un taux de sélection inférieur à 1 % des demandes reçues.
• Les résultats d'une enquête commandée par la conférence des grandes écoles (CGE) à l'institut Ipsos sur le regard porté par le grand public sur les grandes écoles, publiés en novembre 2023, fournissent par ailleurs un éclairage sur la perception des formations universitaires, qui se placent derrière les grandes écoles, les BTS et les IUT sur la plupart des items testés.
12 % seulement des personnes interrogées identifient ainsi l'université comme la formation présentant la meilleure qualité, tandis que cette image est attachée aux IUT, aux BTS et aux grandes écoles par respectivement 13 %, 15 % et 31 % de l'échantillon.
Extrait des résultats de l'enquête
Ipsos-CGE
sur le regard porté par le grand public sur les grandes
écoles (2023)
Dans certaines filières, l'université peine en conséquence à attirer les meilleurs profils, ce qui contribue à figer les écarts entre universités et grandes écoles. Dans son rapport précité, l'ANRT relève ainsi que « de nombreux jeunes hauts potentiels préfèrent ainsi sécuriser leur parcours en choisissant de s'en tenir à une grande école qui leur garantit une bonne reconnaissance salariale et sociale et de plus un solide réseau ».
|
Les « trois visages » de l'enseignement supérieur public selon l'Observatoire des inégalités « L'enseignement supérieur français présente trois visages : - un enseignement court, technique et doté de moyens (les BTS et les IUT), pour partie accessible aux milieux populaires et qui constitue une voie de promotion sociale ; - ensuite, un enseignement universitaire généraliste, faiblement doté, où les enfants de milieux modestes sont présents, mais au premier cycle principalement et dans certaines filières souvent dévalorisées. Les enfants d'ouvriers et d'employés sont beaucoup moins représentés dans les filières sélectives, comme la médecine, ou aux niveaux supérieurs, en master et en doctorat ; - enfin, des classes préparatoires et des grandes écoles hyper sélectives, très richement dotées, mais qui n'intègrent les jeunes de milieux modestes qu'au compte-gouttes. » Source : extrait de la note « Les milieux populaires largement sous-représentés dans l'enseignement supérieur », publiée le 24 septembre 2021 |
(2) Une formation faiblement valorisée par les entreprises
• La formation universitaire pâtit par ailleurs de son identification à la recherche fondamentale, dont résulte une image moins professionnalisante que celle associée, notamment, aux grandes écoles ou aux formations plus techniques des BTS et écoles d'ingénieur.
Dans l'enquête CGE-Ipsos précitée, c'est du point de vue de l'insertion professionnelle que l'image des universités apparaît la plus dégradée : 6 % seulement des personnes interrogées font confiance aux universités dans la perspective de l'obtention d'un emploi, tandis que les IUT, les BTS et les grandes écoles suscitent la confiance de respectivement 9 %, 28 % et 28 % de l'échantillon.
Ces résultats sont confirmés, du point de vue des professionnels, par une enquête réalisée par CCI France auprès de 409 dirigeants d'entreprises privées, à la demande de la Cour des comptes73(*). Selon la Cour, ses résultats font apparaître « un contraste marqué entre les efforts déployés par les universités pour mieux s'ancrer dans le monde économique et la perception encore mitigée qu'en ont les dirigeants d'entreprises », « les critiques [portant], en particulier, sur la capacité des universités à rendre lisible leur offre de formation ».
Au total, plus de la moitié des dirigeants interrogés (51 %) jugent que les parcours universitaires préparent mal les étudiants à intégrer le marché du travail, et 10 % estiment qu'ils ne les y préparent pas du tout. Cette appréciation touche l'ensemble de l'offre universitaire généralistes. Aux niveaux bac +2 et bac +3, les universités sont ainsi moins bien perçues que les BTS, de même que les licences professionnelles sont préférées aux licences générales - qui recueillent moins d'un quart (22 %) d'appréciations positives. Au niveau master, les écoles d'ingénieur sont nettement mieux perçues (avec 47 % d'avis positifs) que les masters universitaires (qui en recueillent 31 %).
Les salaires respectivement perçus par les diplômés de master universitaires et les diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieur, tels que retracés par l'enquête Génération précitée, traduisent en pratique cette perception. Le revenu mensuel médian des diplômés de master est ainsi de 2 080 euros trois ans après la sortie de formation initiale, contre 2 520 euros pour les diplômés d'écoles.
• Un lien a par ailleurs été établi, au cours des auditions de la mission, entre la perception négative de l'université et celle des débouchés offerts par certains parcours universitaires, qui se situent principalement dans l'enseignement et la sphère académique. À l'image dégradée de la profession d'enseignant répondrait ainsi celle des formations qui y mènent.
c) Des réussites peu mises en avant
Tout au long des travaux de la mission, les responsables universitaires ont exprimé un sentiment de décalage entre les discours de dénigrement de l'université qui se diffusent dans l'opinion publique et les réussites objectives de l'institution, qui sont en effet multiples.
L'université constitue d'abord un acteur majeur de l'excellence de la recherche française. Si les performances de l'université française dans le classement de Shanghai, qui compte quatre établissements français parmi les 100 premiers établissements mondiaux (l'université Paris-Saclay à la 13e place mondiale et la 3e place européenne, Paris Sciences Lettres à la 34e place, Sorbonne Université au 43e rang et Paris Cité à la 60e place), font l'objet d'une large publicité, le rôle décisif des laboratoires de recherche universitaire dans le développement d'innovations de rupture est plus méconnu. Lors de son déplacement à l'université Paris Cité, la mission a ainsi pris connaissance des conditions de la valorisation par l'établissement des innovations issues de ses laboratoires, qui ont donné lieu à la création de plusieurs start-ups de biotechnologies. L'influence de premier plan des chercheurs issus des universités françaises a enfin été une nouvelle fois mise en lumière par l'attribution du Prix Nobel de physique 2025 aux recherches conduites notamment par Michel Devoret, docteur de l'Université Paris-Saclay.
L'université forme ensuite la très grande majorité des professionnels de la santé et du droit, en apportant une contribution de premier plan au déploiement des innovations de prise en charge ; en témoigne par exemple la structuration de la formation des professions paramédicales aux pratiques avancées.
Les filières d'arts et de sciences humaines, qui concentrent l'essentiel des préjugés et opinions négatives, affichent également d'éclatantes réussites. La mission a ainsi pris connaissance, lors de son déplacement à l'université, du succès de la filière image de Paris 8, souligné par la Cour des comptes74(*). En particulier, le master Création numérique, qui s'inscrit dans l'école universitaire de recherche « ArTeC » mise en place dans le cadre du troisième programme d'investissements d'avenir, présente une insertion professionnelle proche de 100 % six mois après l'obtention du master ; ses diplômés bénéficient en outre d'une forte reconnaissance de leurs pairs, qui se traduit notamment par des récompenses prestigieuses75(*).
D'une manière plus générale, l'efficience des universités dans l'accomplissement de leurs missions a été relevée par Stéphane Calviac, au regard de la comparaison entre le taux de financement par la France de son enseignement supérieur et la proportion de diplômés du supérieur dans sa population - lesquels restent à ce jour principalement formés par les universités. Alors que la France consacrait 1,6 % de son PIB à l'enseignement supérieur en 2021, contre 1,5 % en moyenne dans les pays de l'OCDE, 50 % des Français âgés de 25 à 34 ans sont diplômés du supérieur, contre 47 % en moyenne dans l'OCDE.
Il a toutefois été souligné, tout au long des travaux de la mission, que l'image de l'institution universitaire est si dégradée que la réussite de certaines de ses filières jouissant d'une bonne réputation ne lui est pas même attribuée. Les écoles d'ingénieurs du réseau Polytech76(*) ainsi que les IUT ne sont ainsi pas spontanément associés à l'université.
3. La concurrence accrue du secteur privé
La désaffection des étudiants et des familles pour les formations universitaires se traduit, au total, par la concurrence accrue d'autres structures d'enseignement supérieur, qui tend à modifier l'équilibre de la massification évoquée supra.
La hausse quasi-continue des effectifs universitaires au cours des dernières décennies masque en effet le recul de la proportion d'étudiants accueillis à l'université sur la même période. Alors que les universités formaient encore près du tiers des étudiants en 2000, cette part connaît une érosion continue depuis plusieurs décennies, qui tend à s'accélérer depuis 2018. Avec un peu plus d'un étudiant sur deux (54 %) accueilli à la rentrée universitaire 2023, l'université connaît ainsi un recul de sa « part de marché » de plus de onze points entre 2000 et 2023.
Ainsi, si la croissance des effectifs du supérieur a été principalement portée par les filières longues de l'université au cours des années 1960, puis par les DUT et les STS durant les années 1970 et 1980, une diversification des filières de l'enseignement supérieur est observée depuis lors. Au cours des deux dernières décennies, la croissance des effectifs étudiants a notamment été portée par les établissements d'enseignement privé, qui formaient plus du quart des étudiants du supérieur en 2023 (27 %, soit 767 000 étudiants). Ce mouvement tend à s'accélérer : depuis 2018, les inscriptions dans les établissements privés ont crû de 34 %, alors que les inscriptions dans le secteur public ont quasiment stagné (+ 0,5 %) sur la même période. À cette concurrence sur le territoire français s'ajoute en outre celle des cursus à l'étranger.
Évolution comparée des effectifs
étudiants
dans l'enseignement supérieur entre 1990 et
2023
en milliers, base 100 en 1990
Source : Données de l'Eesri 2025
Il en résulte que, alors que les EPSCP devraient se situer, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, « au centre du système d'enseignement supérieur », certaines des filières proposées se trouvent de plus en plus souvent à sa périphérie, en constituant la solution d'accueil « par défaut » des étudiants qui n'accèdent pas aux grandes écoles ni ne se tournent vers le secteur privé.
II. LES UNIVERSITÉS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À LA TRANSFORMATION INACHEVÉE
Cette absence de cap stratégique s'inscrit dans le contexte de divergences croissantes dans le positionnement des établissements, après deux décennies de transformations dont une partie seulement a fait l'objet d'un véritable pilotage par la puissance publique. C'est principalement le cas des politiques de différenciation et d'autonomisation des établissements, au regard desquelles les universités présentent une maturité très différente.
Il en résulte, selon le rapport « Universités et territoires » précité de la Cour des comptes, des « fractures évidentes [...] entre des établissements partageant la dénomination d'université, mais qui n'ont plus rien de comparable les uns avec les autres ». À l'illisibilité de la stratégie déployée par les acteurs ministériels répond ainsi celle du paysage universitaire.
A. UNE POLITIQUE DE DIFFÉRENCIATION AUX MULTIPLES IMPENSÉS
Cette évolution résulte en premier lieu du processus de différenciation entre les établissements, mis en oeuvre depuis 2010 dans le but premier de faire émerger de grands établissements de recherche. Ce processus a bouleversé le paysage universitaire de deux façons.
La généralisation des financements sélectifs, tout d'abord, a favorisé la concentration des moyens sur un seul type d'universités, les établissements dits intensifs en recherche, au détriment de la pluralité des missions qu'elles assurent - et notamment de leurs missions de formation.
La différenciation modifie ensuite profondément les enjeux du pilotage d'établissements de plus en plus hétérogènes, qui « n'accueillent plus les mêmes profils d'étudiants, n'assurent plus les mêmes missions et ne bénéficient plus des mêmes financements ». Cet état de fait met en péril l'égalité de traitement entre les étudiants, voire la comparabilité des diplômes nationaux délivrés. Le statu quo stratégique actuel fait dès lors courir le risque d'une accentuation irréversible des fractures entre les établissements, voire d'un éclatement de la notion même d'université.
1. L'hétérogénéité croissante des établissements universitaires
a) Les bouleversements induits par le soutien à la performance de la recherche
(1) L'ambition de constituer des pôles d'excellence de rang mondial a entraîné de profondes modifications du statut, de l'organisation et du financement des établissements labellisés Idex et Isites
Depuis 2010, les politiques publiques mises en oeuvre dans le domaine universitaire, qui découlent du lien établi entre compétitivité de l'économie française et la capacité à innover, ont eu pour objectif principal de faire émerger une dizaine d'établissements intensifs en recherche capables de soutenir la concurrence internationale, matérialisée par le classement de Shanghai. Elles ont ainsi encouragé le développement d'une nouvelle génération d'universités par des évolutions portant à la fois sur la structure, le financement et le statut juridique des établissements.
Il en a résulté, au cours de la décennie écoulée, des évolutions à la fois très profondes et très rapides du paysage universitaire, notamment sur le plan institutionnel. Selon la Cour des comptes, « cette variabilité permanente qui intervient dans de courts intervalles de temps rend la politique universitaire française difficile à suivre ».
|
Quatre générations d'universités Selon le rapport « Universités et territoires » de la Cour des comptes, la structuration actuelle du paysage universitaire français résulte des transformations successives, depuis le début du siècle dernier, de quatre générations d'universités. Après le développement de seize grandes universités métropolitaines au début du XXe siècle, scindées en plusieurs entités juridiques après mai 1968, la puissance publique a été à l'origine d'une deuxième puis d'une troisième génération d'établissements, afin de répondre à des enjeux d'ordre démographique et territorial. Sont ainsi apparues ex nihilo, entre 1960 et 1980, des universités de villes moyennes (Nantes, Nice, Rouen, Angers, Chambéry notamment), avant le déploiement dans les années 1990 et 2000 des « universités nouvelles » (principalement dans les villes nouvelles franciliennes et dans le Nord-Pas-de-Calais, puis plus tardivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie), à la faveur des plans « Université 2000 » puis « Université du troisième millénaire ». Les évolutions en cours depuis les années 2010, initiées par le Plan Campus et les programmes d'investissement d'avenir (PIA), correspondent au déploiement de la quatrième génération d'établissements. |
• Sur le plan de l'organisation des universités, ces politiques ont favorisé le regroupement et la fusion de sites, en procédant à des « opérations de redécoupages institutionnels et de relabellisation à partir d'établissements déjà existants ». L'université Paris Cité, dans laquelle s'est rendue la mission, est ainsi née en 2020 de la fusion entre les établissements Paris 5 et Paris 7 ainsi que l'institut de physique du globe de Paris, auxquels s'associe désormais l'Institut Pasteur ; elle compte aujourd'hui 68 000 étudiants pour un budget de 700 millions d'euros.
La Cour des comptes relève à ce propos que certaines universités, telle que celle de Lille, connaissent ainsi un « retour à la case départ », c'est-à-dire à leur situation de grande université métropolitaine du début du XXe siècle.
• Sur le plan financier, la stratégie de concentration des moyens sur quelques établissements a constitué une profonde évolution du mode de financement des universités, qui rompt avec le modèle traditionnel de la subvention versée par l'État.
Le Plan campus puis le programme d'investissements d'avenir (PIA), qui a donné lieu au déploiement des initiatives d'excellence (Idex)77(*) et des initiatives science-innovation-territoire-économie (I-Site)78(*), sont en effet attribués de manière sélective par le biais d'appels à projets (AAP), et ne bénéficient donc qu'à une minorité d'établissements. 17 établissements sont à ce jour labellisés Idex et Isites et se répartissent une enveloppe annuelle de 300 millions d'euros de financements.
|
Labellisation Idex et Isite : cadre, montants et fonctionnement Les actions Idex et Isites, à l'origine d'une profonde restructuration du paysage de l'enseignement supérieur, s'inscrivent dans le cadre des quatre programmes d'investissements d'avenir (PIA)79(*) qui se sont succédé depuis 2010, repris depuis 2021 par le programme France 2030. L'agence nationale de la recherche (ANR) a été désignée comme opératrice de ces programmes dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle assure ainsi la sélection, le conventionnement, le financement, le suivi, les audits, l'évaluation et l'impact des projets et des actions des programmes financés dans ce cadre. Au total, près de 39 milliards d'euros ont été alloués aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche via ces différents programmes, dont 9 milliards au titre du programme France 2030. Les 17 sites labellisés Idex ou Isites bénéficient de crédits annuels à hauteur de 300 millions d'euros. La majeure partie de ces crédits est allouée aux Idex, qui se répartissent environ 220 millions d'euros, dont l'université Paris-Saclay est la principale bénéficiaire (31,4 millions d'euros annuels). Les 8 Isites bénéficient depuis 2022 d'une dotation annuelle totale d'environ 80 millions d'euros, dont l'université de Montpellier est la première bénéficiaire (17 millions d'euros annuels). Les 117 appels à projets lancés entre 2010 et 2023, qui ont permis le financement de 1 747 projets, couvrent des domaines de recherche très divers aux larges applications potentielles : hydrogène bas carbone, intelligence artificielle, alimentation saine, formation aux métiers d'avenir, exploration des fonds marins et de l'espace, santé, technologies quantiques, stockage sur ADN, etc. |
La rupture observée résulte de l'importance des financements ainsi alloués, dont le montant est susceptible de modifier les conditions de fonctionnement des établissements. Le montant annuel des financements alloués à Aix Marseille Université représente ainsi près de 5 % de celui de sa subvention pour charges de service public (SCSP).
Montant annuel de la dotation
des
établissements labellisés Idex et Isite
|
Idex |
Isite |
||
|
Établissement coordinateur |
Dotation annuelle |
Établissement coordinateur |
Dotation annuelle |
|
Aix Marseille |
25,6 M€ |
Lorraine |
9,3 M€ |
|
Paris Saclay |
31,4 M€ |
Lille |
14 M€ |
|
Bordeaux |
23,9 M€ |
Clermont-Auvergne |
9,3 M€ |
|
PSL |
26,9 M€ |
Gustave Eiffel |
8,2 M€ |
|
Paris Cité |
22,9 M€ |
Pau et Pays de l'Adour |
5,1 M€ |
|
Sorbonne Université |
29,5 M€ |
Montpellier |
17 M€ |
|
Strasbourg |
25,6 M€ |
Nantes |
9,3 M€ |
|
Côté d'Azur |
14 M€ |
Cergy |
7,6 M€ |
|
Grenoble Alpes |
23,7 M€ |
||
• Sur le plan juridique, le statut unique des établissements universitaires, qui relèvent de longue date de la catégorie des EPSCP80(*), a été remis en cause de deux manières :
- les politiques de sites, menées au travers notamment du Plan Campus en 2008-2009 et de la création des communautés d'universités et d'établissements (ComUe) en 201381(*), visaient à développer la coordination entre les établissements de recherche et d'enseignement supérieur d'un même territoire. Selon la Cour des comptes, elles ont abouti à la mise en place, sous la dénomination générique d'université, d'une multiplicité d'organisations juridiques particulières « dont la lisibilité et la stabilité sont loin d'être assurées de façon équivalente d'un territoire à l'autre ». Ces emboîtements d'établissements publics et privés et de personnalités juridiques ont été comparés, au cours des auditions, à des « holdings » opaques pour les observateurs extérieurs ;
- la création par l'ordonnance n° 2018- 1131 du 12 décembre 201882(*) du statut juridique d'établissement public expérimental (EPE) a marqué l'aboutissement de ces politiques de site, en donnant la possibilité aux regroupements ainsi constitués d'opter, jusqu'au 1er janvier 2025, pour un cadre juridique dérogatoire à celui des EPSCP. Les 22 regroupements dotés de ce statut83(*) pourront accéder après évaluation à celui de grand établissement, qui ouvre la possibilité d'adopter des règles autonomes en ce qui concerne notamment la sélection de leurs étudiants et le montant des frais d'inscription.
Ces différentes évolutions se trouvent fréquemment enchâssées : les effets de la labellisation Idex ou Isite constituent bien souvent un levier vers une restructuration des établissements concernés, qui passe le plus souvent par la fusion d'entités et la mise en place d'un EPE.
• En elle-même, cette politique volontariste de développement d'établissements de rang mondial a été jugée de manière globalement positive au cours des auditions de la mission. Outre que l'entrée de plusieurs grands établissements au classement de Shanghai, qui signe le succès de ces initiatives, a permis de renforcer la visibilité internationale du système français d'enseignement supérieur, l'apport de moyens additionnels conséquents a des effets indéniablement positifs sur l'accomplissement des missions de recherche des établissements concernés - qui bénéficie à moyen terme à l'économie et à la société françaises.
En ce qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus général de concentration des ressources allouées aux établissements, les effets produits par cette inflexion sur l'ensemble du paysage du supérieur sont cependant observés de manière plus réservée.
(2) Le développement des financements sélectifs a conduit à la mise en concurrence généralisée des établissements
Un profond mouvement de différenciation des universités se développe en effet sous l'effet de l'extension, au-delà des PIA et du programme France 2030, des financements sélectifs alloués sur le fondement d'appels à projets compétitifs, qui concernent aujourd'hui l'ensemble des universités. Alors que la dépense allouée aux établissements via la SCSP progresse peu, voire diminue si on la rapporte au nombre d'étudiants du supérieur, le dynamisme marqué de ces ressources sélectives en fait un enjeu de financement majeur pour les établissements. Cette situation aboutit à une mise en concurrence généralisée non plus seulement des équipes de recherche, mais des universités elles-mêmes.
• Selon la Dgesip, ces ressources sélectives étaient issues, pour l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) en 202384(*), des appels à projets nationaux portés par l'ANR (à hauteur de 295 millions d'euros), des financements alloués dans le cadre des PIA et du programme France 2030 (pour 520 millions d'euros), ainsi que des programmes européens de financement de la recherche (pour un montant de 223 millions d'euros).
La Dgesip estime qu'ils représentent au total la « majorité » des dotations publiques comptabilisées dans les ressources propres des établissements, qui représentent elles-mêmes la moitié de ces ressources, lesquelles comptaient en 2023 pour un quart des recettes totales EPSCP - soit un poids qui peut être estimé à hauteur de 10 à 12 % du financement des EPSCP en moyenne.
Toutes les catégories d'établissement sont désormais bénéficiaires de financement compétitifs nationaux. Les établissements labellisés Idex ou Isite concentrent en effet les trois quarts des financements PIA, mais la moitié seulement des financements ANR. Dans l'ensemble, ces financements sont cependant captés par une minorité d'établissements : selon la Cour des comptes, deux tiers des financements alloués par ce biais bénéficiaient à six établissements seulement en 2022.
• Pour les universités, l'obtention de ces financements représente un enjeu majeur dans le contexte de maîtrise de la dépense allouée aux établissements via la SCSP.
Leur développement traduit en effet une modification de la structure des ressources allouées par l'État aux établissements, qui se sont déplacées des financements récurrents de la SCSP vers les appels à projets - et, dans une moindre mesure, vers les financements contractualisés des Comp. En témoigne, selon Stéphane Calviac, l'érosion de la dépense publique par étudiant entre 2014 et 202285(*) : les financements issus des appels à projets ne peuvent en conséquence être caractérisés comme des ressources additionnelles au financement du socle de l'activité des établissements, mais doivent être regardés comme une nouvelle façon pour l'État de répartir les moyens entre les établissements.
Les appels à projets étant souvent dotés de montants significatifs, leur obtention emporte par ailleurs des effets importants sur la capacité des établissements à développer leur activité de recherche, qui n'est plus susceptible de résulter d'autres sources de financement publiques.
La forte concurrence qui en découle entre les établissements a été assimilée, au cours des auditions de la mission, à une forme de « darwinisme » organisé par la puissance publique, aboutissant à la concentration des moyens sur quelques établissements au détriment de la majorité des autres.
b) Une fragmentation croissante du paysage universitaire
Ces évolutions ont fait l'objet de fortes inquiétudes de la part des établissements se considérant comme les « perdants » de la différenciation.
Ø Au cours des tables rondes de la mission, les appréciations divergentes des gagnants et des perdants de la politique de différenciation
Les trois tables rondes organisées par la mission d'information ainsi que les quatre déplacements effectués sur le terrain ont permis aux rapporteurs de prendre la mesure concrète des forts contrastes existant entre les établissements. Au terme de ces échanges, trois types d'universités peuvent être distingués.
• Les établissements dits « intensifs en recherche » tout d'abord, qui conduisent des programmes de recherche de premier ordre à l'échelle internationale et orientent leurs formations dans cette perspective, captent une grande partie des financements additionnels déployés via les appels à projets. Ils constituent ainsi les principaux gagnants de la politique de différenciation.
Plusieurs de ces établissements ont insisté sur le fait que leur positionnement d'excellence résultait d'une démarche volontariste de leur gouvernance, à l'instar d'Aix-Marseille Université, qui a opéré une forte structuration de sa fonction de réponse aux appels à projets.
• D'autres établissements n'ayant pas obtenu de labellisation France 2030 affichent cependant des conditions de fonctionnement satisfaisantes, grâce au développement d'une offre de formation et de recherche ciblée leur permettant, indépendamment de leur taille, de maîtriser leur recrutement ou d'afficher un positionnement d'excellence dans certains domaines. Selon les termes employés par l' Association des villes universitaires de France (Avuf), il s'agit d'établissements qui ont « renoncé à tout faire » et font preuve d'« agilité » dans l'évolution de leur positionnement.
Relèvent de cette catégorie des universités de droit et de gestion telles que Paris-Panthéon-Assas, Toulouse Capitole, ou encore Paris Dauphine, ainsi que de petites universités ayant spécialisé leur activité sur certains domaines porteurs. Le cas de l'université de La Rochelle, qui a réduit son offre de formation et de recherche pour la centrer sur la thématique du littoral, a ainsi été cité comme un modèle tout au long des travaux de la mission.
• Une troisième catégorie d'établissements, qui se trouvent plus fréquemment en difficulté financière, accueillent une proportion importante d'étudiants de premier cycle et concentrent leur activité de recherche sur quelques disciplines, faute de disposer des ressources leur permettant de structurer leur fonction de réponse aux appels à projets. Ces établissements présentent par ailleurs souvent une prédominance de filières de lettres et de sciences humaines et sociales, dont les appels à projets sont souvent moins dotés que ceux destinés aux équipes de recherche scientifiques.
Il s'agit notamment des établissements situés en périphérie des grandes universités parisiennes ou des universités pluridisciplinaires des territoires. Ces établissements, qui ont exprimé le sentiment d'être considérés comme des universités « de deuxième zone » et se considèrent comme les « perdants » de la politique de différenciation », redoutent leur cantonnement au rôle de collège universitaire territorial - c'est-à-dire à leur spécialisation dans la formation de premier cycle des publics défavorisés. Paris 8 a ainsi souligné sur le caractère avant tout universitaire de son projet d'établissement, qui vise au développement d'une « excellence inclusive ».
Ce sentiment de déclassement peut être mis en lien avec l'abandon de la notion de « rattrapage » dans les politiques universitaires depuis le tournant des années 2005-2010, qui concernait principalement les universités de troisième génération situées en bordure des grandes métropoles. Christine Musselin date en effet de cette période de changement de paradigme qui a mis fin au discours politique visant à permettre à ces établissements de rattraper leur « retard ».
|
L'éclatement de la représentation des universités S'est récemment structurée, aux côtés de France Universités qui portait depuis 1971 une ambition fédératrice, une représentation des petites et moyennes universités via l'Alliance des universités de recherche et de formation (Auref), ainsi qu'un relais des intérêts de treize établissements intensifs en recherche via l'Udice. L'Initiative représente par ailleurs six établissements labellisés I-Site. Cet éclatement de la représentation des universités en associations distinctes témoigne de la divergence croissante entre ces différentes catégories d'établissements, au point qu'elles se trouvent endossées par les universités elles-mêmes au titre de leur positionnement stratégique. |
Ø La typologie proposée par la Cour des comptes au regard des effets produits par les critères des PIA
• La Cour des comptes considère quant à elle que le déploiement des financements des PIA dans le domaine de l'ESR a « produit de facto des catégories différenciées d'universités en fonction du montant moyen des financements extra-budgétaires dont chacune d'elles a bénéficié de la part de la puissance publique entre 2011 et 2021 », qui recoupent largement les distinctions établies ci-dessus.
Sous l'effet de ce financement différencié, quatre groupes d'établissements se sont ainsi constitués, qui présentent des caractéristiques homogènes au regard de plusieurs critères - taille, poids de la recherche, place des premiers cycles, taux d'encadrement, montant de la SCSP par étudiant, composition sociale de la population étudiante, niveau scolaire et bassin de recrutement des établissements inscrits après le baccalauréat. Certaines de ces caractéristiques reflètent les conséquences évoquées supra de la sélectivité de fait et par établissement de la procédure Parcoursup.
Les établissements ayant le plus bénéficié des financements extrabudgétaires présentent ainsi les caractéristiques les plus favorables. Il s'agit d'établissements de grande taille (45 000 étudiants en moyenne, contre 11 000 pour les établissements du groupe 4 ayant le moins bénéficié de ces financements) présentant la SCSP par étudiant (6 739 euros, contre 5 713 euros pour les établissements du groupe 4) et le taux d'encadrement (8,8 ETP par étudiant, contre 7,1 pour le groupe 4) les plus élevés. Ils recrutent une faible proportion d'étudiants boursiers (22,8 % contre 30,1 %), mais comptent la plus forte proportion d'étudiants ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat (34 % contre 18,5 %).
À l'inverse, les établissements les moins bénéficiaires des financements sélectifs se caractérisent par le poids plus important de leurs formations de premier cycle (77,8 %, contre 52 % dans les universités du groupe 1), un moindre poids de leur activité de recherche (avec 27 unités de recherche en moyenne, contre 130 dans le groupe 1), ainsi qu'un recrutement plus centré sur leur bassin de population.
2. Le risque d'un éclatement de la catégorie des universités
a) La différenciation des opérateurs comme objectif de politique publique
Le ministère appelle, d'une manière générale, à la généralisation du mouvement de différenciation des établissements, désormais définie comme un objectif de politique publique. Plusieurs éléments témoignent de cette évolution.
• À l'occasion d'un colloque de France Universités tenu le 13 janvier 2022, le Président de la République a affirmé son attachement à « la poursuite de la différenciation des établissements », ainsi que son souhait d'accompagner ce mouvement par la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens pluriannuels (Comp).
•Au-delà des enjeux financiers portés par ces contrats, l'ensemble des universités sont incitées, dans le cadre des Comp, à définir leur « signature », qui constitue un prérequis de leur déploiement. Il s'agit ainsi, selon la Dgesip, « de mobiliser les acteurs en fournissant un cadre clair à une démarche stratégique de réflexion, de projection et de différenciation par les établissements » ; Stéphanie Mignot-Girard a dans le même sens indiqué que la signature « oblige les établissements à s'interroger sur leurs points forts et leurs faiblesses, et à tracer une direction vers les axes de développement forts de leur université ».
L'Université Paris 8 s'est ainsi positionnée comme l'« université des créations », tandis que Paris Cité affiche un objectif d'excellence au service de la société, et que Panthéon-Assas Université met en avant la « tradition du savoir [et le] talent de l'innovation ».
• Les deux circulaires publiées à l'été 2025 prennent par ailleurs acte de l'évolution différenciée des établissements universitaires, considérée comme un élément du contexte dans lequel se déploie le pilotage ministériel :
- la circulaire du 11 août précitée indique que « le renforcement de l'autonomie des établissements et le développement des politiques de site, ainsi que le rôle de chef de file confié aux universités sur les territoires, ont conduit à une différenciation accrue qu'illustre en particulier la création récente des établissements publics expérimentaux. Cette autonomie permet à chaque établissement, en fonction de sa signature, de déployer pleinement une stratégie propre [...] » ;
- la circulaire du 28 août précitée souligne que « le fonctionnement des administrations centrales et déconcentrées doit mieux s'adapter à l'autonomie et à la différenciation renforcée des opérateurs de l'État de l'ESRI ».
• Enfin, la création par l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée des établissements publics expérimentaux (EPE) a permis aux établissements d'adopter de nouvelles formes de regroupement leur permettant, tout en conservant leur personnalité morale, d'adopter des modes de gouvernance différenciés et de partager des compétences en coopération.
Le projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, déposé le 30 juillet 2025 sur le bureau de l'Assemblée nationale, comporte des dispositions relatives à la poursuite de cette expérimentation. Son étude d'impact affirme à ce titre que « l'uniformité d'organisation qui est aujourd'hui imposée aux universités, laquelle est régie par les articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation, constitue un frein à leur autonomie, à leur développement et à leur reconnaissance internationale. Afin d'éviter de substituer un autre régime uniforme à celui existant aujourd'hui, il a été fait le choix d'inciter les établissements à se saisir de différents outils expérimentaux pour déterminer l'organisation qui leur semble le mieux correspondre à leurs besoins ».
|
Des établissements publics expérimentaux aux grands établissements, le développement d'un statut institutionnel dérogatoire à la catégorie des EPSCP L'ordonnance du 12 décembre 2018 permet de réunir, au sein d'un établissement public expérimental (EPE), des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés (dits « établissements-composantes »). Ces EPE, d'une durée maximale de dix ans, ont la possibilité de déroger partiellement au régime des EPSCP tracé par le code de l'éducation. Après deux ans, les EPE ont la possibilité de sortir de l'expérimentation et de demander à cette occasion le statut de grand établissement, également dérogatoire au droit commun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), et qui leur est reconnu par décret après évaluation du Hcéres. Ces dérogations permettent notamment de mettre en place une sélection à l'entrée des études et de fixer de manière autonome les droits de scolarité des formations conduisant à des diplômes d'établissement. 23 EPE ont vu le jour sur le fondement de l'ordonnance de 2018. Parmi eux, 7 anciens EPE ont obtenu le statut de grand établissement : l'université Paris sciences et lettres, l'université Grenoble Alpes, CY Cergy Paris université, l'université Polytechnique Hauts-de-France, l'université Paris-Panthéon-Assas, l'université Gustave Eiffel et l'université Côte d'Azur. L'université de Lorraine et l'université Paris Dauphine86(*) ne sont pas passées par le dispositif expérimental pour obtenir le statut de grand établissement. |
b) Le pilotage étatique au défi de la diversité des modèles
• Dans ce contexte mouvant, l'État n'a pas développé les outils de catégorisation qui lui permettraient d'assurer le pilotage de cet ensemble hétérogène d'établissements. Cette lacune est patente sur le plan juridique comme d'un point de vue opérationnel :
- au plan juridique, l'avènement en 2018 du statut de grand établissement a, selon la Cour des comptes, « [achevé] l'éclatement du concept unifié d'université » ;
- d'un point de vue opérationnel, les pouvoirs publics ne disposent pas des critères qui leur permettraient de piloter des établissements aux modèles de fonctionnement de plus en plus hétérogènes. La Cour relève ainsi que « la puissance publique est aujourd'hui confrontée à la gestion d'une diversité qu'elle a de plus en plus de mal à réguler, faute de disposer des outils de catégorisation nécessaires pour le faire, notamment en vue de fixer les critères qui sont ceux de l'allocation des moyens aux établissements ou de suivre la pertinence de leurs différentes implantations territoriales ».
Le seul outil de catégorisation à la main des pouvoirs publics est en effet aujourd'hui celui de la différenciation produite de facto par les critères d'attribution des PIA, centrés sur la taille des établissements et l'importance de leur activité de recherche, sans prise en considération des conditions de l'accomplissement de l'ensemble de leurs missions de service public. Aucun indicateur opérationnel ne permet a contrario de mesurer la capacité des établissements à répondre aux priorités de l'action publique et de permettre à l'État de les accompagner pour ce faire.
Ce vide stratégique explique, selon la Cour, le déploiement d'un pilotage au cas par cas, selon une « logique dérégulée [...] préjudiciable au déploiement équitable d'un service public de qualité sur l'ensemble du territoire national ». Il contribue également certainement à la diversité du jugement porté sur la différenciation des universités, dont témoigne la divergence des expressions recueillies par la mission. Tandis que certains établissements ont dénoncé ses effets avec virulence, d'autres ont considéré que la prise en compte des spécificités de chaque établissement était à ce jour « minimale ».
Le vide stratégique est également patent en ce qui concerne le rôle donné aux antennes universitaires, dont résulte un débat souvent fondé sur leur contribution à l'aménagement du territoire plutôt que sur leur mission de formation et de recherche (voir encadré ci-dessous).
|
Des universités de proximité aux
antennes universitaires, Plusieurs dispositifs permettent de développer une offre d'enseignement supérieur de proximité, sans faire toutefois l'objet à ce jour d'une stratégie lisible pour l'ensemble des acteurs. • Après le développement d'universités de proximité à la fin du XXe siècle, de nombreux établissements ont créé des antennes permettant d'assurer l'accès des néo-bacheliers à une offre universitaire. Selon la Cour des comptes, il existe à ce jour environ 150 antennes accueillant 90 000 étudiants, soit environ 11-12 % des néo-bacheliers. Souvent situées dans des villes moyennes ou des zones rurales, ces antennes présentent un taux de réussite comparable à celui des universités principales, pour un coût par étudiant également comparable, voire moins élevé ; leurs étudiants poursuivent cependant moins fréquemment leurs études en deuxième et troisième cycles. Elles constituent au total une voie d'accès à l'enseignement supérieur privilégiée par les étudiants défavorisés et les étudiants ruraux. Les campus connectés, initiés en 2019, couvrent des sites plus éloignés des grandes métropoles, comme à Redon, à Saint-Affrique ou encore à Saint-Flour. Cette formule est jugée moins efficace par la Cour en raison notamment de son coût par étudiant très élevé et d'une fréquentation décevante. Au cours de ses travaux, la mission a pu prendre connaissance de la diversité des modèles d'antennes développés par les établissements. Tandis que certaines d'entre elles proposent une offre de formation pluridisciplinaire, d'autres ont développé une offre spécialisée en lien avec les caractéristiques de leur bassin d'emploi. Le site délocalisé d'Aix Marseille Université (AMU) à Gap propose ainsi un cursus de Staps spécialisé autour des métiers de la montagne. • La Cour des comptes relève que le suivi des antennes ne fait pas l'objet d'un suivi rigoureux qui permettrait un pilotage efficace. Sur le plan financier en particulier, l'absence de compensation spécifiquement dédiée aux antennes entretient l'idée qu'elles constitueraient un surcoût net pour les établissements. Surtout, la Cour relève que l'efficacité des antennes universitaires est limitée par l'absence d'une doctrine stable de l'État sur sa stratégie territoriale en matière d'enseignement supérieur, et l'instabilité qui en découle dans la conduite des politiques territoriales. N'est pas tranchée, en particulier, la question de la nature de l'offre à développer dans les territoires - pluridisciplinaire dans l'objectif d'assurer l'égal accès à l'enseignement supérieur dans toutes les zones, ou spécialisée en assumant une inégalité partielle entre les néo-bacheliers. En l'absence d'une telle clarification, la question de la place de ces antennes, voire des universités de proximité dans l'offre d'enseignement supérieur a fait l'objet de jugements très contrastés au cours des travaux de la mission. Certains acteurs ont ainsi pu considérer que les antennes comme les établissements de proximité devaient être recentrés sur la mission de formation des universités en premier cycle uniquement87(*), la recherche ayant besoin de concentration de moyens. La question de leur implantation est par ailleurs posée sous l'angle de leur contribution à l'aménagement du territoire plutôt que de leurs missions universitaires. La Cour recommande au total de mieux prendre en compte le territoire dans l'allocation des moyens, en développant des critères permettant de reconnaître leurs spécificités géographiques, sociales et économiques. |
• Plusieurs acteurs ont conséquence appelé à une intervention de la puissance publique pour redonner de la cohérence au paysage universitaire et valoriser la pluralité des missions incombant aux universités. À défaut de pouvoir assurer, dans une période budgétaire contrainte, une forme de péréquation entre les gagnants et les perdants de la différenciation, l'enjeu est ici de garantir une forme d'équivalence entre les missions assurées par les établissements et les diplômes délivrés.
B. UN OBJECTIF D'AUTONOMISATION SANS MOYENS OPÉRATIONNELS
Le paysage universitaire se caractérise en second lieu par des établissements présentant un degré d'autonomie limité au regard des objectifs tracés par les pouvoirs publics. Alors que la logique de contractualisation tend à déplacer la fonction stratégique à l'échelle de chaque établissement, ceux-ci ne disposent pas des moyens opérationnels qui leur permettraient de s'engager dans cette voie.
La mission s'est principalement intéressée à ce titre aux difficultés posées par le sous-calibrage des fonctions supports des établissements, ainsi qu'à celles résultant du cadre actuel de la dévolution immobilière.
|
Près de vingt ans après la loi LRU, une autonomie « en trompe-l'oeil » Le principe et le cadre de l'autonomie des universités ont été tracés en 2007 par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « LRU », ouvrant la voie à un alignement de la France sur le reste du monde en matière d'organisation de l'enseignement supérieur universitaire. Le passage aux « responsabilités et compétences élargies » prévues par ce texte visait à donner aux établissements les marges de manoeuvre leur permettant de définir une stratégie propre. Il s'est notamment traduit par une présidentialisation accrue de leur gouvernance, l'intégration de la masse salariale à leur budget, une maîtrise renforcée de leur carte d'emplois, ou encore la création d'outils destinés à augmenter leurs ressources propres. Les principes définis par ce texte n'ont jamais été remis en cause, ni par les gouvernements qui se sont succédé depuis lors, ni par les établissements eux-mêmes. Pour autant, cette autonomie est loin d'être pleinement aboutie. La Cour des comptes a ainsi évoqué, dans son rapport de 2021 précité, l'autonomie « en trompe-l'oeil » des universités. Laurent Batsch a évoqué devant la mission d'information une « déconcentration de gestion » plutôt qu'une véritable autonomisation des établissements. Ce constat est confirmé au niveau international : une étude réalisée en 2023 par l'association européenne des universités (EUA) a mis en évidence une dégradation de la position relative de la France, par rapport à 2017, en ce qui concerne l'autonomie institutionnelle de ses universités (24ème place sur 35, -4 places), leur autonomie financière (27ème, - 3 places), la gestion autonome de leurs ressources humaines (31ème, -4 places) et leur autonomie académique (32ème, -5 places). Près de vingt ans après l'adoption de la LRU, l'autonomie des universités demeure ainsi un objectif plus qu'une réalité pour la plupart des établissements. Pour l'ensemble de ceux entendus par la mission, cette situation résulte du fait que l'autonomie a été reconnue aux établissements sans transfert des moyens opérationnels correspondants. |
1. Un sous-calibrage des fonctions support
D'un point de vue opérationnel, la possibilité d'une autonomisation et d'une différenciation stratégique des universités découle concrètement de leur capacité à assurer puis à transformer l'exercice de leurs différentes fonctions dites « support » - qui recouvrent notamment la gestion de leurs personnels, l'accompagnement administratif et financier des démarches d'appels à projets, ou encore l'entretien de leur parc immobilier.
Le sous-calibrage patent de ces fonctions constitue dès lors un obstacle majeur au repositionnement stratégique des universités, quand il n'entrave pas la seule marche quotidienne des établissements.
a) Une technicité croissante appelant des compétences spécialisées
(1) Les lacunes des services dans la gestion budgétaire et salariale
• Les universités gèrent dans leur ensemble des budgets très conséquents, qui atteignent 856 millions d'euros dans le cas de l'Université d'Aix-Marseille (AMU), soit un montant comparable au budget primitif d'une ville comme Toulouse ou de celui du CHU de Clermont-Ferrand. Ces budgets couvrent des fonctions très vastes, allant de la rémunération des personnels à la gestion du parc immobilier, en passant le suivi des dispositifs relatifs à la vie étudiante. La tendance au renforcement de la technicité de ces différentes fonctions appelle des compétences de plus en plus spécialisées.
• Dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs, la Dgesip souligne les marges d'évolution des établissements en matière de gestion financière. Si des progrès importants ont été réalisés, au cours des dernières années, dans le suivi des dépenses -en ce qui concerne notamment la démarche de programmation et de vision pluriannuelle et la mise en oeuvre d'un contrôle interne financier-, de nombreux changements doivent être opérés en matière de suivi et de maîtrise de la masse salariale -de la mise en place d'une cartographie des emplois et d'un schéma directeur des ressources humaines à la définition d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
La Dgesip relève par ailleurs que les difficultés financières rencontrées par les établissements « résultent au moins partiellement de problématiques non financières. C'est la raison pour laquelle les établissements concernés font l'objet d'un accompagnement et d'un suivi rapproché, de la part des rectorats au premier chef, du ministère ainsi que, si besoin est, à travers des missions d'accompagnement de l'IGESR. Dans les situations les plus détériorées, il peut être envisageable d'aller jusqu'à la désignation d'administrations provisoires. »
• De l'avis généralement exprimé au cours des auditions, et en dépit de l'engagement des personnels rencontrés par les rapporteurs, les difficultés de gestion observées dans les établissements sont largement imputables au sous-dimensionnement quasiment généralisé des fonctions support des universités, qui ne disposent pas à ce jour des ressources humaines qui leur permettraient d'assurer un véritable pilotage de leurs moyens financiers.
(2) De forts besoins pour la mobilisation et la gestion des financements compétitifs
On l'a vu, la capacité à mobiliser des ressources propres, notamment les financements issus des appels à projets compétitifs, est devenue cruciale pour les universités. Cet exercice suppose cependant la mobilisation de compétences et de moyens dédiés pour identifier les appels à projets susceptibles d'être remportés, confectionner les dossiers de candidature, et enfin assurer le suivi et la gestion des financements remportés.
Ces compétences sont réparties de manière inégale entre les universités. En témoignent les forts écarts relevés quant à la proportion des ressources propres dans le budget des établissements, qui varie, en 2023, de 5 % à 33 % selon les établissements. L'université Paris-Saclay tire ainsi 27 % de ses ressources totales des contrats de recherche, contre 1,2 % pour l'université d'Artois.
Les contrastes observés de ce point de vue recouvrent largement les catégorisations évoquées supra : ce sont généralement les établissements de grande taille et disposant des ressources sélectives les plus importantes qui parviennent à structurer et intégrer leurs services support de manière à renforcer leur développement, tandis que les établissements les moins performants sont confrontés à une forme de « double peine ». Ces contrastes résultent de plusieurs éléments :
- les établissements de petite taille se voient contraints de concentrer leurs ressources humaines sur leurs fonctions indispensables ;
- certains établissements subissent la concurrence d'organismes de recherche (ONR), dont la spécialisation dans la recherche leur permet de disposer d'équipes support mieux outillées. C'est particulièrement le cas des universités implantées sur les territoires éloignés des ONR, qui ne peuvent pas nouer de partenariats leur permettant de tirer profit de l'expérience acquise par ces organismes ;
- de nombreux appels à projets entraînent une augmentation de l'activité des établissements sans accroissement net de leurs ressources, en raison de l'importance des tâches de suivi et de gestion qu'ils induisent, et que le préciput associé ne permet pas de couvrir. Seuls les plus grands établissements ont dès lors la capacité humaine et financière d'absorber ces coûts indirects des appels à projets ;
- l'AMU a souligné le caractère volontariste de la démarche qui lui a permis de transformer et structurer les fonctions support nécessaires à la mobilisation des financements compétitifs, par la mobilisation de ressources humaines et financières et la mise à disposition de locaux.
|
La mission Europe pour la recherche (MER) de l'université d'Aix-Marseille L'AMU s'est dotée en 2024 d'un service d'appui dédié à l'accompagnement des unités de recherche dans leurs activités d'obtention et de mise en oeuvre de projets européens de recherche et d'innovation. Cette mission Europe pour la recherche (MER) comporte une vingtaine d'agents en poste à l'AMU et dans les organismes de recherche partenaires (filiale de l'université Protisvalor, CNRS, Inserm, IRD). Elle offre un guichet unique, transparent pour les chercheurs quel que soit leur organisme de rattachement, et proposant une offre d'accompagnement intégrée allant du sourcing des projets au coaching pour les oraux, en passant par la rédaction des dossiers de réponse. |
b) Un cadre d'exercice mal défini et peu attractif
(1) L'absence de corps professionnel dédié
• Le principe général, en matière d'administration des universités, est celui de leur gestion par des universitaires.
La composition de leur conseil d'administration, fixée par l'article L. 712-3 du code de l'éducation, fait ainsi une large place aux enseignants-chercheurs. Il revient à ce conseil d'administration d'élire un président aux prérogatives particulièrement larges : en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, il est ainsi « ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université » (3°) et exerce « au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement » (8°). Des vice-présidents coordonnent ensuite l'action de l'université sur chacun des domaines de compétence et des priorités qu'elle définit, qui peuvent aller de la politique immobilière des établissements à la gestion de ses ressources humaines, en passant par la lutte contre les discriminations.
Initialement recrutés sur le fondement de leur excellence académique, pédagogique et sur la qualité de leurs travaux de recherche dans leur domaine de spécialisation, ces élus assument ainsi des responsabilités extrêmement larges sur des sujets particulièrement techniques, auxquelles ils ne sont initialement pas préparés. Le cursus honorum traditionnellement observé avant l'accession au poste de président, avec des responsabilités progressivement prises dans les divers conseils, pallie en partie ce manque de formation initiale.
• Ces élus ne peuvent par ailleurs pas s'appuyer sur un corps de personnels dédié et spécifiquement structuré pour leur apporter l'assistance technique nécessaire. Contrairement aux hôpitaux ou aux collectivités territoriales, les universités ne disposent pas d'une fonction publique dédiée. En outre, au contraire du statut donné aux directeurs d'hôpitaux, le rôle du responsable administratif des services n'est pas clairement défini dans les textes.
Le rapport de la Cour des comptes de 2021 précité relevait ainsi que, « alors qu'un régime électif confie à des enseignants-chercheurs des charges de gestion complexes, ceux-ci ne sont en rien préparés aux responsabilités qu'ils exercent. Les conseils d'administration, dans de trop nombreux cas, laissent peu de place à la représentation de membres extérieurs à l'université. [...] Les directeurs généraux des services (DGS), maillons essentiels d'une gouvernance éclairée, sont encore trop souvent relégués à un rôle subalterne et leur statut demeure précaire. Leurs équipes administratives sont rarement l'objet de recrutements prioritaires. »
• L'absence d'un corps de personnels dédiés aux fonctions administratives des établissements ne signifie pas pour autant que les établissements sont libres de leur gestion, qui relève des grandes catégories de la fonction publique.
Cette situation a été déplorée au cours des auditions, plusieurs acteurs ayant souligné qu'une autonomie véritable des universités ne pouvait se concevoir sans que leur soient conférées de véritables marges de manoeuvre dans la gestion de leurs personnels - qui tendraient à les rapprocher de la situation des ONR.
|
Des marges de manoeuvre réduites dans la
gestion Les universités ne disposent d'aucune autonomie véritable dans la gestion de leurs personnels relevant de la fonction publique, dont la masse salariale constitue la principale contrainte de leurs dépenses. Un président d'université a ainsi estimé que les modalités actuelles de la gestion de leurs personnels condamnaient les universités à « courir avec des boulets aux pieds ». La Cour des comptes souligne, dans son rapport de 2021 précité, qu' « on ne peut qualifier d'autonome une université qui ne maîtrise ni ses recrutements ni la gestion des promotions et évolutions de carrière de ses personnels », et que « la gestion des carrières des personnels administratifs par les rectorats et le ministère [prive] les chefs d'établissement de leviers essentiels en matière de management »88(*). En ce qui concerne spécifiquement les enseignants-chercheurs, comme pour l'ensemble des fonctionnaires, plusieurs règles sont fixées au niveau national : - les recrutements des différents corps d'enseignants et de chercheurs sont déterminés au niveau national et répartis entre les différents établissements de manière centralisée. L'arrêté du 24 février 2025 fixe ainsi à 799 le nombre de professeurs d'université à recruter et à 1 546 celui de maîtres de conférences ; - les grilles de salaires des maîtres de conférences et professeurs d'université sont fixées au niveau national par le décret du 10 avril 201389(*). La France, à la différence par exemple des universités américaines qui sont libres de fixer la rémunération de leur personnel, a ainsi privilégié un système unifié qui garantit l'homogénéité du corps, mais prive de facto les établissements de toute marge de manoeuvre une fois le recrutement effectué. Enfin, l'évolution du point d'indice applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique est décidée par l'État. Ces dernières années, les décisions prises au niveau national n'ont été que partiellement prises en compte dans les dotations allouées aux établissements (voir infra). |
(2) Un faible niveau de rémunération
Les établissements rencontrent ainsi de fortes difficultés pour assurer le bon fonctionnement de leurs services support, dont relèvent l'ensemble de leurs personnels non enseignants, désignés sous l'acronyme de Biatss (pour personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, de santé et sociaux). Le sous-dimensionnement de ces services support ainsi que la difficulté à recruter puis fidéliser des profils compétents pour l'exercice de missions de plus en plus techniques a été souligné tout au long des auditions.
Cette situation résulte de la faible attractivité salariale de ces fonctions, qui n'apparaît plus en lien avec leur technicité croissante, notamment en ce qui concerne la gestion immobilière et financière des établissements. Le montant moyen de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) s'élevait ainsi en 2022, pour un agent de catégorie B de la filière recherche et formation, à 5 651 euros par an au sein de l'enseignement supérieur, à 6 965 euros au sein de l'éducation nationale et à 9 211 euros dans les autres ministères90(*).
Les difficultés de recrutement et de fidélisation sont en conséquence plus prégnantes dans les grandes agglomérations, où les universités font face à la concurrence non seulement d'autres établissements d'enseignement supérieur, mais également des recrutements contractuels des collectivités. Cette tension sur les métiers de gestion des universités a en particulier été pointée par les universités parisiennes.
Certaines universités disposant de moyens relativement plus importants, telle que Aix-Marseille Université, ont en conséquence mis en place des politiques autonomes destinées à accroître l'attractivité de leurs fonctions support, notamment par le développement d'une offre de logement de transition.
2. Des impulsions contradictoires dégradant l'attractivité de la dévolution immobilière
Les difficultés opérationnelles de repositionnement des universités sont spécifiquement observées sur la gestion de leur parc immobilier, qui constitue un véritable cas d'école de l'absence de cap donné par l'État.
Les universités ne sont que marginalement propriétaires du patrimoine immobilier qui leur est affecté, qui est essentiellement détenu par l'État (82%) et les collectivités territoriales (12%). Alors que sa gestion représente le deuxième poste budgétaire des établissements91(*), sa transformation et sa valorisation constituent un enjeu stratégique majeur : la rénovation énergétique des bâtiments représente un important gisement d'économies de fonctionnement, tandis que la transformation de l'usage de certains bâtiments pourrait permettre de dégager des ressources additionnelles significatives.
C'est dans cette perspective que la loi LRU a introduit la possibilité pour les universités de bénéficier de la dévolution immobilière, c'est-à-dire du transfert à leur bénéfice de la propriété du patrimoine immobilier de l'État dont ils sont affectataires. Initialement conçu comme un levier majeur de l'autonomie des établissements, ce dispositif a fait l'objet d'un pilotage hésitant qui a obéré son attractivité et n'a pas permis sa généralisation.
Le financement de ce dispositif, qui porte sur un parc immobilier globalement vieillissant et appelant une réhabilitation d'une ampleur colossale, a en effet été réévalué en cours de route, de sorte que seuls les bénéficiaires de la première vague de dévolution bénéficient des moyens d'assurer la gestion et la transformation de leur patrimoine.
a) La dégradation du patrimoine universitaire appelle un investissement massif
(1) Des besoins de réhabilitation colossaux
• Avec 13,7 millions de mètres carrés, auxquels s'ajoutent 6 000 hectares de foncier non bâti, le patrimoine immobilier affecté aux établissements d'enseignement supérieur constitue le deuxième parc de l'État, dont il représente un quart du patrimoine. En dépit de fortes différences entre les établissements, une large partie de ce patrimoine se trouve dans un état dégradé et appelle des opérations de réhabilitation d'ampleur.
Les entretiens menés par les rapporteurs ont largement souligné sa vétusté, qui est à l'origine de dysfonctionnements quotidiens en matière de sécurité, d'accessibilité, de fonctionnalité et de performance énergétique. Selon la Dgesip, un tiers du patrimoine immobilier universitaire se trouve dans un état jugé peu ou pas satisfaisant. Il s'agit principalement des bâtiments construits dans les années 1960 à 1980, qui posent aujourd'hui d'importantes difficultés sur le plan de la régulation thermique.
• Le besoin de financement permettant d'assurer la réhabilitation de ce patrimoine est colossal. La Dgesip évalue les investissements nécessaires à 16 milliards d'euros pour la période 2020-205092(*). France Université considère quant à elle que le « besoin urgent de rénovation dépasserait les 12 milliards d'euros ». Les besoins sont immenses à l'échelle de chaque établissement : l'université Paris-Saclay les évalue à 900 millions d'euros, et l'université de Bretagne Occidentale à 300 millions d'euros.
Sur le plan de la seule transition énergétique des bâtiments, la direction du budget évalue à 7 milliards d'euros au moins l'effort budgétaire permettant d'atteindre l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 203093(*). Un document de travail du secrétariat à la planification écologique (SGPI) évalue à 27 milliards d'euros le montant global des opérations à engager à l'horizon 2050 pour le bâti universitaire94(*).
L'adaptation des locaux aux nouveaux usages en matière de pédagogie et de numérique représente un autre chantier. Si la crise sanitaire de 2019-2020 a mis en évidence la nécessité de développer l'enseignement numérique à distance, l'IGESR relève aussi la nécessité de créer des « espaces modulables et bien équipés, notamment en matière de connexion internet à haut débit », pour répondre aux nouvelles pratiques visant à fluidifier l'utilisation des locaux.
|
Le Plan Campus L'opération Plan Campus, lancée en 2008, concernait initialement douze établissements sélectionnés par deux vagues d'appels à projets. Elle a été dotée de 5 milliards d'euros sur 25 ans, issus de la vente de 3% des actions du groupe EDF. Le financement des opérations est assuré par les intérêts générés par le dépôt du produit de cette cession sur un compté géré par l'agence nationale de la recherche (ANR). Onze sites supplémentaires ont bénéficié d'un financement budgétaire complémentaire de 455 M€ de crédits budgétaires, tandis que Paris-Saclay s'est vu attribuer un milliard d'euros de crédits. En incluant la participation des collectivités territoriales à haute de 1,25 milliard d'euros, le montant décaissé dépasse aujourd'hui 3,6 milliards d'euros. Selon la Cour des comptes, le Plan Campus a permis une montée en compétence de l'administration et des universités sur les questions immobilières. Sa mise en oeuvre a en outre donné lieu à la création du service des grands projets immobiliers (SGPI) au sein du MESR, ainsi qu'à celle de l'établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France (Epauparif). Plusieurs difficultés ont cependant été soulignées par la Cour des comptes. Dix ans après le lancement de l'opération, un quart seulement des opérations prévues avaient été livrées. Le caractère exceptionnel du financement attribué n'a en outre pas été maintenu, l'État ayant concomitamment réduit sa participation au financement des Contrats de plan État-Région (CPER). |
• Les universités présentent à cet égard des situations contrastées qui reflètent largement les catégorisations établies supra. Si la nature du bâti, son âge et sa taille représentent des facteurs de différenciation importante, c'est en effet surtout de la capacité de financement des établissements que dépend leur vulnérabilité immobilière.
Selon la Dgesip, les situations les plus complexes sont ainsi retrouvées dans les universités en sous-financement chronique, dont les questions immobilières n'ont pas été intégrées à la gouvernance et dont la fonction immobilière est insuffisamment professionnalisée. À l'inverse, les universités qui présentent une forte capacité d'autofinancement et ont bénéficié de financements fléchés importants via la première vague de dévolution ou le Plan Campus ont pu mettre en place une fonction immobilière structurée et définir une vision pluriannuelle.
(2) Un sous-financement chronique générateur d'une dette technique
Alors que le rapport d'information sénatorial sur l'optimisation de la gestion de l'immobilier de 202195(*) affirme que « l'immobilier reste un axe porteur de la réussite étudiante », les universités sont ainsi confrontées à des besoins d'investissements massifs mais sans cesse reportés, alourdissant au total la « dette technique » accumulée depuis plusieurs décennies. La Cour des comptes notait ainsi en 2021 que « bien des universités n'ont aucun moyen d'y parvenir, parfois par défaut de compétences en la matière, souvent par manque de financements »96(*).
|
La gestion immobilière des
établissements : Tandis que la maintenance des bâtiments est principalement couverte par la SCSP, les dépenses de gros entretien et de renouvellement (GER) mobilisent une pluralité de financements. Une part du GER est en principe couverte par la SCSP. Au sein de l'enveloppe budgétaire dédiée à la maintenance et à la logistique, d'un montant d'environ 400 millions d'euros annuels depuis 2009, 140 millions d'euros sont identifiés au titre du GER. Ce montant est particulièrement faible : rapporté à la surface de l'immobilier universitaire, il représente 9 euros par mètre carré. Cette enveloppe étant fongible, la Cour des comptes estime en outre que « le montant reçu au titre du GER par les universités n'est pas affecté à ces dépenses par plus du quart d'entre elles »97(*). La majeure partie des crédits alloués à l'investissement immobilier résulte des crédits contractualisés via les contrats de plan État-région (CPER). Dans le cadre du CPER 2015-2021, 925 millions d'euros étaient abondés par l'État en provenance du programme 150, 1 milliard provenait des régions, et 350 millions d'euros des départements et communes. Pour le CPER 2021-2027, l'enveloppe contractualisée par le MESR s'élève à 1,2 milliards d'euros. Les financements sélectifs non récurrents tendent à gagner en importance. Plus de 5 milliards d'euros ont ainsi été apportés via le Plan Campus, tandis que 1,2 milliards d'euros de financements sont issus du plan de relance. Les universités ont enfin la possibilité de mobiliser leurs ressources propres et de recourir à l'emprunt auprès de la banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque des territoires. Ces possibilités sont cependant limitées, les universités s'étant vu interdire par la loi98(*) de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois. L'emprunt auprès de la BEI est autorisé par cette même loi, tandis que la CDC n'est pas considérée comme un « établissement de crédit ». |
L'ampleur du sous-financement de la gestion immobilière a été objectivée par la Cour des comptes dans son rapport précité. Alors que la direction de l'immobilier de l'État (DIE) préconise une dépense annuelle de 30 euros par mètre carré pour un bâtiment en état correct, 75 % des établissements sont en dessous de ce seuil, et 26 % y consacrent un montant égal ou inférieur à 5 euros. C'est notamment le cas de l'université d'Angers, dans laquelle s'est rendue la mission.
Le manque de compétences internes pour élaborer et piloter des stratégies immobilières a par ailleurs été évoqué tout au long des travaux de la mission. Si l'IGESR note un « attachement des établissements à internaliser de nombreuses compétences dans le champ immobilier »99(*), la gestion immobilière fait en effet rarement partie de leurs expertises traditionnelles ; les profils compétents sont par ailleurs souvent captés par un secteur privé plus attractif. Exigeant de nombreuses expertises complémentaires (urbanisme, maîtrise d'ouvrage, conduite de travaux, domaines financiers, juridiques et de la commande publique, etc.), la fonction immobilière n'est au total véritablement professionnalisée que dans les universités ayant bénéficié de la dévolution ou des financements du Plan Campus.
b) L'absence de dotation décourage les candidatures à la dévolution
Dans ce contexte, le dispositif de dévolution mis en place en 2007, pour être attractif, doit être assorti de financements en rapport avec l'état du patrimoine immobilier transféré. L'abandon par l'État, à partir de 2019, des conditions financières initialement très favorables aux établissements a cependant fortement dégradé l'intérêt que lui portent les établissements. À ce jour, onze universités seulement bénéficient ainsi de la dévolution de leur patrimoine.
• L'article L. 719-14 du code de l'éducation, issu de la loi LRU de 2007, prévoit la possibilité pour l'État de transférer aux établissements publics d'enseignement supérieur qui en font la demande, à titre gratuit, la pleine propriété des biens immobiliers appartenant à l'État qu'ils utilisent.
|
Trois vagues de dévolution aux conditions très inégales La première vague de dévolution a concerné en 2011 les universités de Toulouse Capitole, Clermont-Ferrand-I et Poitiers. Le transfert de leur patrimoine a été assorti d'une dotation annuelle sur 25 ans d'un montant annuel de respectivement 5 millions, 6,1 millions et 10,8 millions d'euros, soit 546 millions d'euros au total sur 25 ans. Cette dotation, qui a remplacé le financement État prévu par les CPER de ces établissements, a permis à ces trois universités de déployer une programmation immobilière pluriannuelle sur 25 ans. La deuxième vague de dévolution, qui a concerné de 2019 à 2021 les universités d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de Caen et de Tours, n'a pas été assortie d'une dotation annuelle spécifique. Les établissements concernés financent leurs dépenses immobilières dans le cadre du droit commun. C'est également le cas de la troisième vague de dévolution, qui a permis aux universités de Rennes, Clermont Auvergne, à l'université polytechnique des Hauts de France et à Centrale Supélec d'accéder en 2022 à la propriété de leurs locaux. Certaines universités des deuxième et troisième vagues, comme celles d'Aix-Marseille, ont indiqué pouvoir mitiger l'absence de dotation par d'importantes capacités d'autofinancement, ainsi que par le bénéfice de fonds attribués dans le cadre du Plan Campus ou des PIA. Pour d'autres établissements de la deuxième vague, comme les universités de Caen et Tour, l'IGESR relève que « la gestion de leur patrimoine immobilier s'avère plus complexe en raison de contraintes financières plus importantes ». |
• L'intérêt de ce dispositif, souligné par le rapport d'évaluation de l'IGESR précité, a été souligné tout au long des auditions. Ont en particulier été pointées la flexibilité et la réactivité qu'il confère aux établissements dans la gestion évolutive de leurs missions de recherche et de formation, les potentialités ouvertes du point de vue de leur capacité à dégager des ressources propres, ainsi qu'un renforcement de leur positionnement dans leurs relations avec le rectorat et les collectivités territoriales, face auxquels ils se trouvent élevés au rang de partenaires.
Aucune des universités ayant bénéficié des premières vagues de dévolution ne manifeste d'ailleurs la volonté de revenir en arrière - quoique le rapport de l'IGESR relève que les établissements des deux dernières vagues « regrettent de ne pas bénéficier d'une dotation stable sur 25 ans », et s'inquiètent des perspectives de l' « après-dotation » en raison de l'importance des opérations de réhabilitation énergétique à engager au-delà de cet horizon.
La généralisation du dispositif est dès lors préconisée par l'IGESR à l'horizon 2034, et plusieurs des universités entendues ont manifesté, sur le principe, leur intérêt pour ce dispositif, dans l'objectif de renforcer leur autonomie.
• Si le régime financier de la première vague de dévolution était très favorable, son abandon à compter de la deuxième vague écorne cependant fortement l'attractivité du dispositif et décourage les candidatures.
L'IGESR relève en ce sens que plusieurs universités remplissant les conditions leur permettant de bénéficier de la dévolution renoncent à candidater du fait de l'absence de dotation associée. Cette position est confirmée par France Universités et par l'Auref, qui souligne que des établissements déjà sous-financés ne pourront dans ces conditions gérer les bâtiments dévolus qu'au détriment de leurs autres missions.
Cette absence de dotation financière n'est pas compensée par l'ouverture d'une capacité élargie d'emprunt, ainsi que le demandent plusieurs établissements entendus par la mission. Pour de nombreuses universités, elle n'est pas davantage contrebalancée par la perspective d'une valorisation patrimoniale permettant de dégager des ressources propres, que la Cour des comptes estime limitée et surtout très variable, et qui dans bien des cas ne permet pas de générer des recettes à la hauteur des besoins. Enfin, le bénéfice d'appels à projets ou des CPER, aux financements plus limités dans le temps, n'emporte pas les mêmes effets que la dotation de la première vague100(*), qui a permis la structuration d'une véritable stratégie immobilière sur le temps long.
|
L'université Paris Saclay et la dévolution Le refus de l'université Paris-Saclay, qui compte pourtant parmi les établissements en situation très favorable, de candidater à la dévolution de son patrimoine immobilier est emblématique des réticences des établissements à s'engager dans ce processus aux conditions actuellement proposées par les pouvoirs publics. Dans une réponse adressée au ministère en 2021101(*), l'établissement explique l'arbitrage rendu par son conseil d'administration par les raisons suivantes : - l'importance quantitative de son foncier bâti (près de 500 000m²), dont les trois quarts se trouvent dans un état jugé pas ou peu satisfaisant (donnée SPSI 2020) ; - une connaissance encore perfectible de l'état technique des locaux (bâtiments, mais aussi voirie et réseaux divers) ; - l'absence d'accompagnement financier permettant une rénovation significative ; - l'impossibilité d'accéder à une dévolution partielle102(*) ; - les faibles perspectives de valorisation de ces locaux, en raison notamment de leur localisation. |
• Plusieurs solutions alternatives ou complémentaires de la dévolution ont en conséquence été mentionnées devant la mission d'information.
Un renforcement du recours aux filiales universitaires, et notamment aux sociétés universitaires locales immobilières (SULI)103(*), a ainsi été évoqué dans le but de renforcer la valorisation patrimoniale du bâti universitaire. Cette formule permet notamment aux établissements de bénéficier d'une capacité d'emprunt auprès d'un établissement privé de crédit, dès lors que leur participation au capital de la société n'excède pas 50 %. L'université souligne cependant que le recours à ce type de société est soumis à l'accord de la tutelle, ce qui limite fortement la capacité d'initiative des établissements.
L'IGESR a par ailleurs étudié un scénario, spécifique aux universités pour lesquelles la dévolution n'apparaît pas possible, « où une entité externe, une société foncière publique, prendrait la propriété et la gestion immobilière du patrimoine État jusque-là affecté à l'établissement ».
DEUXIÈME PARTIE.
FAUTE DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS,
UN PILOTAGE FINANCIER À
VUE
L'allocation de leurs moyens financiers constitue l'outil central de la relation stratégique entre l'État et les universités. Bien conduite - dans un contexte de contrainte budgétaire qui n'est pas remis en cause par les rapporteurs -, elle devrait assurer la compensation des missions de service public confiées aux opérateurs, tout en opérant la traduction concrète des orientations arrêtées par la puissance publique, et en prenant en compte les sujétions particulières, les marges de progression et les voies de différenciation propres à chaque établissement.
Les fortes tensions observées au cours des trois dernières années lors de la discussion du programme 150104(*) de la loi de finances, confirmées par les observations souvent virulentes recueillies au cours des travaux de la mission, montrent que la réalité est bien loin de correspondre à cet objectif. Les conditions actuelles de l'allocation des moyens aux universités se caractérisent principalement par leur opacité et leur imprévisibilité, dont résulte un climat de défiance délétère entre les acteurs. Ces conditions pèsent fortement sur la capacité des universités à développer la vision financière pluriannuelle nécessaire au déploiement d'une véritable stratégie.
I. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE, INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET SOUS-CALIBRÉE
La mission d'information s'est tout d'abord intéressée aux conditions de l'allocation et de la répartition aux universités de leurs ressources budgétaires, dont leur modèle économique reste largement dépendant.
Au terme de ses auditions, elle ne peut que souscrire au constat formulé en 2023 par la Cour des comptes, selon lequel « Le dispositif d'allocation des moyens est [...] censé apporter de la visibilité et doit se dérouler de manière transparente afin d'être parfaitement compris. L'objectif est loin d'être atteint actuellement. Très centralisé, ne prenant jamais en compte ni la qualité des formations dispensées, ni la pluralité des territoires occupés par les universités, en évolution permanente et progressivement complexifié, le système a fini par devenir illisible ».
A. UN MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA RÉPARTITION DES RESSOURCES
1. Une forte dépendance à la ressource budgétaire
Le modèle économique des universités connaît de fortes évolutions sous l'effet du développement des financements compétitifs évoqués supra, et plus généralement du caractère de plus en plus déterminant des ressources dites « propres » dans l'équilibre de leur budget. Pour autant, les universités restent fortement dépendantes de la subvention pour charges de service public (SCSP) qui leur est allouée via le budget de l'État, et qui conditionne leur capacité à assurer leurs missions fondamentales.
a) La transformation limitée du modèle économique des universités
(1) Des ressources extra-budgétaires dynamiques mais minoritaires
• Au cours des derniers exercices budgétaires, l'évolution des recettes des établissements a été marquée par le fort dynamisme de leurs ressources dites « propres ».
Selon les éléments figurant dans le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR sur le modèle économique des établissements d'enseignement supérieur, ces ressources sont constituées, pour l'ensemble des EPSCP :
- pour moitié de dotations publiques majoritairement allouées de manière compétitive : financement national de la recherche, via les appels à projets nationaux portés par l'ANR (295 M€) et les programmes d'investissement d'avenir et France 2030 (520 M€), financement européen (223 M€) de la recherche, auxquels s'ajoute l'abondement des collectivités territoriales (224 M€) ;
- pour un quart de recettes issues du secteur économique bénéficiant d'une incitation publique : apprentissage (688 M€), formation continue (425 M€), recherche partenariale, mécénat ;
- pour 16 % de ressources non aidées : il s'agit principalement des droits d'inscription et des recettes issues de l'immobilier.
Si, entre 2019 et 2023, c'est la SCSP qui a connu la croissance en valeur la plus forte, avec 1,7 milliards supplémentaires contre 1,3 milliards pour les ressources propres, ce sont en effet bien ces dernières qui présentent l'évolution la plus dynamique. Leur augmentation de 38 % sur la période, contre 13 % pour la SCSCP, résulte de la hausse combinée des fonds issus de l'apprentissage (à hauteur de 620 millions d'euros), du PIA France 2030 (à hauteur de 264 millions d'euros), et de l'ANR (pour 142 millions d'euros)105(*).
|
Les ressources dites « propres » : une terminologie à préciser Plusieurs établissements entendus par les rapporteurs ont souligné que la terminologie de « ressources propres », aujourd'hui largement répandue, était susceptible de prêter à confusion. La notion renvoie en effet, dans le langage courant, à des financements issus de la gestion d'une collectivité, présentant un caractère pérenne et libres d'emploi. Or il s'agit, dans leur très grande majorité, de ressources d'origine publique, et de ce fait liées aux décisions de politiques publiques de l'État, ou dépendant directement des crédits d'une politique publique incitative - dont les récents revirements sur la politique de soutien à l'apprentissage ont montré la fragilité. L'utilisation des financements compétitifs est par ailleurs fortement encadrée par les cahiers des charges associés. Certains acteurs estiment en conséquence qu'il serait plus exact de parler de « ressources extra-budgétaires », de « ressources non pérennes » ou de « ressources additionnelles ». |
Dans un contexte de resserrement budgétaire pesant sur l'évolution de la SCSP, la captation de ces ressources extra-budgétaires constitue un enjeu crucial pour les établissements. Pour autant, avec un montant de 4,4 milliards d'euros en 2023, elles représentent une part minoritaire du financement des EPSCP - 24 % de leurs ressources totales, soit une proportion jugée marginale » par la direction du budget, et probablement moins encore pour les seules universités106(*).
(2) Un faible potentiel de croissance à court et moyen termes
Plusieurs éléments pèsent par ailleurs sur leur potentiel de développement à court et moyen termes.
• En premier lieu, la progression, voire la récurrence, du montant des ressources extra-budgétaires allouées par les pouvoirs publics semble aujourd'hui de moins en moins garantie.
Cette projection, qui suscite une inquiétude palpable chez plusieurs universités entendues, résulte tout d'abord des arbitrages budgétaires opérés par le gouvernement dans le contexte de maîtrise des finances publiques. En témoigne le resserrement opéré par l'État sur les aides à l'apprentissage dans le cadre de la loi de finances pour 2025107(*), qui ont constitué la ressource propre la plus aisément mobilisable par les universités au cours des dernières années. L'Avuf a fait part à cet égard de la « déception » et de l' « inquiétude » d'établissements fortement incités à développer la formation en apprentissage, et dont l'équilibre économique se trouve aujourd'hui altéré.
D'une manière plus générale, il semble que le consensus général qui avait permis, au tournant des années 2009 et 2010, l'allocation de moyens considérables aux programmes d'investissement d'avenir en vue de favoriser l'innovation et la compétitivité soit aujourd'hui implicitement remis en cause, au profit notamment du renforcement des capacités militaires de notre pays. Laurent Batsch a ainsi estimé que « la probabilité d'un nouveau Plan Campus et d'un nouveau PIA s'éloigne » et que les arbitrages budgétaires pourraient être faits, au cours des prochaines années, « au profit des infrastructures civiles et militaires et de l'armement » et au détriment de la « matière grise ».
• Le potentiel de croissance des ressources issues de la sphère économique, qui représentent 5,6 % des recettes des EPSCP, est ensuite limité.
En particulier, le faible développement des ressources issues de la formation continue, dont la Dgesip relève « l'organisation hétérogène selon les établissements et les disciplines », est à mettre en lien avec des facteurs difficilement maîtrisables par les universités. Il s'agit notamment des déterminants actuels de la rémunération et des évolutions de carrière des enseignants-chercheurs, qui reposent d'abord sur leur activité de recherche, de la forte concurrence exercée par des structures privées spécialisées, ainsi que la meilleure adéquation de cette activité avec certains profils d'établissements (principalement ceux proposant une offre de formation juridico-économique).
• Enfin, la faible structuration des services support des établissements et leur sous-calibrage global pèsent fortement sur la capacité des universités à mobiliser de telles ressources.
La Dgesip estime à ce titre que le développement de ces ressources extra-budgétaires « doit faire l'objet d'une stratégie pilotée par la gouvernance des établissements » et que « la réussite à capter des ressources provient avant tout de la mise en oeuvre de stratégies structurées intégrant une réflexion sur l'offre (adaptation aux besoins, cohérence avec le milieu économique local) et une démarche de développement ». Certains établissements ne disposent cependant ni des moyens humains, ni des compétences nécessaires à la structuration d'une telle stratégie.
• Il apparaît au total, selon le rapport conjoint de l'IGF et de l'IGESR précité, que « l'évolution du modèle économique des EPSCP dépend d'abord des choix retenus en matière d'allocation en fonction de l'activité et de critères de performance, et seulement en second lieu du développement des ressources propres ».
b) La SCSP, recette centrale des établissements
La subvention pour charges de service public (SCSP), destinée à couvrir l'exercice de leurs missions fondamentales, continue au total de constituer la principale source de financement des établissements.
Si sa part dans les ressources totales des établissements connaît une érosion continue depuis 2017, elle représente en effet près des trois quarts de leurs recettes en 2024, avec un montant total de 14,2 milliards d'euros en croissance continue sur les dix dernières années.
Au-delà de son montant financier, c'est également la nature budgétaire de cette ressource qui fonde son caractère central dans les recettes des établissements. Elle se distingue ainsi des ressources allouées par contrat, qui ouvre un soutien financier limité dans le temps, ainsi que par les appels à projets, dont les ressources sont destinées au financement d'actions précises.
Montant de la SCSP et part dans les ressources des établissements
(échelle de gauche : montant de la SCSP en Mds€, échelle de droite : part dans les ressources)
2. Un processus d'allocation illisible et fluctuant
a) Un introuvable modèle de répartition
Sur le fondement de l'article 13 du décret n° 2014-133 du 17 février 2014, qui prévoit que la Dgesip « [répartit] les moyens entre les établissements d'enseignement supérieur à partir d'une analyse de leurs activités et de leurs performances », il revient au ministère de fixer les paramètres et les critères permettant de déterminer le montant de la SCSP des universités.
La détermination des modalités de fixation de ce montant a été caractérisée par une forte instabilité au cours des quinze dernières années. Les errements du pilotage assuré par la Dgesip se sont ici traduits par la succession de trois systèmes de répartition des moyens depuis 2009, sans qu'aucun d'eux n'emporte l'adhésion des acteurs universitaires. La dotation aux universités s'est en conséquence structurée par sédimentations successives résultant de facteurs historiques plus que d'un pilotage stratégique.
(1) L'abandon du modèle Sympa a accentué le poids des facteurs historiques
• Entre 2009 et 2016, la répartition des moyens alloués aux universités résultait de l'application du modèle dit « Sympa »108(*).
Ce modèle paramétrique affectait les crédits et les emplois fixés par la loi de finances109(*) aux établissements à proportion de leur activité (à hauteur de 80 %) et de leur performance (à hauteur de 20 %), de telle manière que l'accroissement de l'activité ou l'amélioration des performances d'une université augmentaient sa dotation au détriment de celles des autres. Dans une période financière favorable, au cours de laquelle le budget de l'enseignement supérieur était plus dynamique que celui de l'État, ce mécanisme ne posait cependant pas de problème majeur dans la mesure où il portait principalement sur l'affectation de moyens nouveaux.
• Lui a succédé, à partir de 2019, un système hybride fondé sur une négociation individualisée à visée stratégique et de performance, conduite à l'échelle de chaque établissement, sur la base des éléments issus de la dernière mouture du modèle Sympa, officiellement abandonné par le ministère, mais continuant d'être utilisé comme référence. Cette négociation individualisée a été conduite dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion (DSG) à partir de 2019, remplacé par les Comp à compter de 2023, et auxquelles devraient désormais succéder les Comp à 100 % (voir infra).
• En l'absence de nouveau système de modélisation, la base de calcul des moyens budgétaires alloués aux universités via la SCSP résulte aujourd'hui de la reconduction des moyens obtenus l'année précédente, eux-mêmes issus des dernières données du modèle Sympa, corrigés des mesures nouvelles inscrites en loi de finances110(*).
Indiquant que les différentes tentatives de modélisation mises en oeuvre au cours des dernières années n'ont pas abouti, la Dgesip explique l'abandon de tout effort de développement d'un nouveau système de modélisation par la difficulté de tenir fidèlement compte dans ce cadre des particularités de chaque établissement en même temps que de ses orientations stratégiques. De manière plus générale, le ministère estime qu' « un pilotage national reposant sur des paramètres peut avoir ses limites et être source de rigidités », ce qui justifie selon lui le passage à une logique entièrement contractuelle.
• L'absence de modèle de répartition actualisé pose cependant trois séries de problèmes.
En premier lieu, l'absence de critères officiels permettant de fonder, de manière transparente, un algorithme de répartition des moyens entre les établissements nourrit la défiance des établissements envers leur tutelle. Se fondant sur les travaux de l'EUA, France Universités relève à ce titre que « la France est le seul pays en Europe où il n'existe pas de formule de financement pour allouer la subvention globale ».
En second lieu, cette situation conduit le ministère à utiliser la dernière répartition issue du modèle Sympa comme base de travail. Outre que cette répartition, issue d'un outil arrêté depuis presque dix ans, ne couvre pas l'ensemble des dépenses actuelles des établissements, son utilisation conduit à fonder la répartition des moyens sur des équilibres historiquement construits, qui ne sont corrigés qu'à la marge par la négociation et le dialogue à la performance.
Cette situation crée des effets de rente injustifiés. Le fonctionnement du modèle Sympa a en effet suscité dès l'origine des sur- ou sous-dotations d'établissements, qui n'ont pas été corrigées avant l'extinction du modèle. Il n'a en outre pas fonctionné de manière uniquement mécanique ; selon l'Avuf, le montant de la SCSP qui en ressortait en 2016 était partiellement le résultat des stratégies d'influence déployées par les présidences d'établissement. La base de répartition actuelle constitue en conséquence un héritage du passé, qui conduit certaines universités à continuer de bénéficier d'une répartition initialement favorable sans lien avec leur évolution actuelle, tandis que d'autres continuent de subir les conséquences d'erreurs d'appréciation vieilles d'une quinzaine d'années.
(2) La portée limitée de la négociation individuelle à la performance
• La négociation individualisée a d'abord été conduite dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion, déployé au deuxième semestre 2018 sous la forme d'abord d'une expérimentation limitée à dix établissements volontaires111(*), avant sa généralisation à la fin de l'année 2019.
Selon la formule employée par Stéphane Calviac, ce dialogue n'était « ni stratégique, ni de gestion ». Il reposait en effet sur la définition de projets ponctuels et d'envergure limitée, dont la validation par l'autorité de tutelle permettait le versement de financements complémentaires d'un montant modeste. Dans leur majorité, les établissements entendus ont pointé le caractère chronophage du DSG, sans rapport avec le volume des financements alloués par ce biais.
Ces observations convergent avec celles formulées par la Cour des comptes dans son rapport de 2023 précité, selon lesquelles « la discussion engendrée via le DSG se cantonne en réalité à négocier de faibles moyens supplémentaires [...], alors qu'il requiert un investissement important des universités. Il s'agit donc plutôt d'un dialogue sur des objets particuliers, contraint par une dimension annuelle, avec pour finalité l'obtention de financements temporaires et ponctuels, complémentaires et non récurrents, mais paradoxalement chronophage ».
• Comme on l'a vu supra, les Comp mis en place en 2023, déployés en trois vagues dotées chacune d'environ 110 millions d'euros sur trois ans, ont partiellement corrigé ces insuffisances. En particulier, la conditionnalité des financements associés aux projets contractualisés a permis d'ancrer la notion de performance dans le dialogue financier entre l'administration centrale et les établissements. Leur pluriannualité est par ailleurs mieux adaptée à la nature des projets qu'ils permettent de développer.
Pour autant, d'un point de vue strictement budgétaire, la portée des Comp a fait l'objet d'appréciations contrastées :
- dans leur majorité, les présidents d'établissements entendus ont regretté que leur ordre de grandeur ne leur permette pas d'avoir un véritable effet de correction sur les moyens alloués via la SCSP ou par le biais des appels à projets. Le ministère reconnaît qu'il n'est en effet « pas en rapport avec une correction des inégalités historiques » ;
- cette appréciation procède cependant, ainsi que l'a souligné la rapporteure de la commission des finances Vanina Paoli-Gagin, d'un « quiproquo » sur l'objet même des financements alloués via les Comp, qui ont vocation à « assurer l'amorçage » des projets qu'ils portent, et non à les financer en totalité. Le caractère déterminant des financements ainsi alloués pour le développement de certaines actions, telle que la réduction de l'empreinte carbone des universités, a ainsi été souligné par les directeurs financiers des établissements ;
- la Dgesip a par ailleurs souligné que le volume des financements alloués par ce biais permettait d'assurer la soutenabilité des annulations de crédits que subiraient les établissements n'ayant pas atteint leurs objectifs, tandis que Stéphanie Mignot-Girard a appelé à ne pas sous-estimer l'importance de l'effort financier ainsi consenti dans le contexte de contrainte budgétaire.
Les réserves formulées par les présidents d'établissement sont dès lors à mettre en lien avec l'absence d'effet correctif des modalités de détermination de la SCSP sur des inégalités historiquement ancrées.
(3) Les comp à 100 % : une portée financière à clarifier
Tel ne devrait pas être le cas des « nouveaux Comp », ou « Comp à 100 % », qui seront déployés au 1er janvier 2026 dans les dix établissements des régions académiques Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avant leur généralisation à l'ensemble du territoire (voir supra).
Ces contrats rénovés portent en effet l'ambition d'une refondation complète du modèle actuel d'allocation de leurs moyens aux établissements. Selon une note adressée le 19 juin 2025 par le ministère aux recteurs des deux régions académiques expérimentatrices, « le Comp rénové portera sur 100 % des missions de l'établissement et sur l'ensemble de son modèle économique : subvention pour charges de service public (enveloppe Comp actuelle comprise), et autres financements publics et ressources propres d'origine privée ».
Les modalités concrètes de la répartition des moyens du programme 150 entre les établissements ne sont cependant pas précisées, la note se bornant à indiquer que « le recteur de région académique pourra répartir, après avis de la Dgesip, les moyens dédiés à la contractualisation. Cette allocation s'appuiera sur l'examen approfondi du modèle économique de l'établissement et de son évolution sur la période à venir, réalisé préalablement à la contractualisation ».
Leur annonce est dès lors accueillie de manière diverse par les acteurs entendus par la mission. Christine Musselin souligne qu'un outil contractuel adapté peut permettre « d'arrêter de ne reconnaître et de ne financer qu'un seul modèle et de mieux valoriser d'autres projets que celui des grandes universités de recherche ». Des présidents d'université émettent cependant la crainte que leur déploiement, contrairement à celui des Comp de 2023, ne conduise qu'à élargir le périmètre de leur évaluation par l'administration, sans attribution de moyens supplémentaires.
b) De forts contrastes nourrissant un sentiment d'iniquité
• Le caractère inéquitable des modalités actuelles de détermination de la SCSP a été souligné tout au long des entretiens de la mission avec les présidents d'établissements, qui, en l'absence d'autre clé publique de répartition, se réfèrent au montant de leur dotation rapportée au nombre de leurs étudiants112(*) pour se positionner par rapport aux autres établissements.
Des disparités massives sont en effet enregistrées dans le montant de la SCSP par étudiant des établissements, qui variait en 2022 de 2 037 euros pour l'université la moins dotée à 13 194 euros pour l'établissement le plus favorisé113(*), pour une moyenne de 6 720 euros. D'une manière générale, les universités proposant une offre de formation majoritaire en lettres, SHS et droit-économie présentent la SCSP la plus basse.
Cette situation a fait l'objet de très vives critiques tout au long des travaux de la mission. Plusieurs présidents se sont ainsi référés à la taille de leur population étudiante pour estimer l'ampleur de ce qu'ils décrivent comme leur sous-financement :
- la présidente de l'université d'Angers a relevé que cet établissement est le moins bien doté des universités pluridisciplinaires comprenant une composante santé, et que sa dotation par étudiant se rapproche davantage de la moyenne des établissements SHS que de celle des établissements proposant une offre de formation comparable ;
- le président de l'université de Bretagne occidentale a considéré que « toutes les universités ne sont pas traitées à la même enseigne » dans la mesure où les « fortes fluctuations de la dotation par étudiant, y compris parmi des universités présentant des caractéristiques proches, ne sont à ce jour pas expliquées ». Il fait en conséquence valoir que, « sur la base du montant de SCSP par étudiant en euros constants, nous estimons que nous accueillons, par rapport à 2021, 3 958 étudiants supplémentaires sans financement associé, soit un manque de financement de l'ordre de 42 millions d'euros de SCSP » ;
- l'université Paris 8 indique dans le même sens que 28 millions d'euros manquent à son établissement pour atteindre la moyenne nationale.
SCSP par étudiant de 10 universités en 2023
Source : Commission de la culture à partir des données du MESR en open data
La prise en compte de ce seul élément en tant que critère d'allocation des moyens ne va pourtant pas de soi. D'autres acteurs ont considéré que, devant le probable recul de la démographie étudiante à l'horizon 2030, il serait dangereux d'établir un lien mécanique entre l'évolution de la SCSP et celle des effectifs étudiants, dès lors qu'ils pourraient s'orienter à la baisse sans que les coûts fixes des établissements ne puissent baisser en proportion. Le rapport précité de l'IGF et l'IGESR sur le modèle économique des établissements relève en outre qu'en l'absence de sélection des étudiants à l'entrée à l'université, et donc de maîtrise du nombre de places offertes, la stabilité du financement par étudiant ne peut être garantie114(*).
Ces échanges traduisent en tout état de cause les tensions résultant de l'absence de recours à des critères opposables et transparents pour déterminer le montant de la SCSP, regardée comme un déterminant aussi majeur qu'injustifié des difficultés budgétaires actuelles des établissements.
Il apparaîtrait dès lors difficile, dans le cadre d'une contractualisation complète des moyens, de se passer entièrement de critères de construction des budgets comparables d'un établissement à l'autre.
• Indiquant que « les écarts entre les trajectoires financières respectives des établissements ne trouvent pas d'explication univoque et résultent de la combinaison de plusieurs facteurs », la Dgesip relativise le poids de ces inégalités historiquement construites dans les difficultés aujourd'hui rencontrées par certains établissements. Elle met en avant les facteurs résultant des décisions prises par les universités elles-mêmes, mentionnant, à côté du « poids de l'histoire de l'établissement », les « difficultés de gouvernance interne », ou encore les « choix ayant entraîné des conséquences financières négatives, par exemple un positionnement sur des activités peu porteuses ».
B. UN MANQUE DE CONSTANCE DANS LE SOUTIEN DE L'ÉTAT
C'est cependant le manque de constance du soutien budgétaire alloué aux établissements qui a fait l'objet des critiques les plus vives, en écho aux débats tenus au cours de la dernière période budgétaire. Matérialisée par la non-compensation répétée par l'État, dans le cadre des dernières lois de finances, de certaines dépenses salariales décidées par lui, cette inconstance résulte également des ajustements à la baisse des « marches » de crédits prévues par la loi pour la programmation de la recherche (LPR) de 2020115(*).
Outre leur effet déstabilisateur à court terme sur les budgets des établissements, ces choix budgétaires ont par ailleurs des conséquences délétères sur la capacité des universités à financer des activités dont la gestion se déploie à l'échelle pluriannuelle, notamment en matière de formation et de vie étudiante, ainsi que sur la qualité de leur relation avec l'État.
1. Des reculs répétés de la compensation des coûts fixes
Da manière unanime, les présidents d'université entendus ont dénoncé l'absence de compensation par l'État, ou la compensation seulement partielle, de certaines de leurs dépenses de fonctionnement dont ils ne peuvent maîtriser la forte augmentation.
• Il s'agit en premier lieu du glissement vieillesse-technicité (GVT)116(*), qui ne fait plus l'objet d'un financement spécifique au sein de la SCSP depuis 2019, et n'est plus compensé aux établissements depuis leur passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE). Le manque à gagner pour les universités est au total estimé à 500 à 600 millions d'euros par France Universités.
La Dgesip a relativisé la portée de cette évolution en soulignant :
- que l'État a apporté son appui au financement du GVT lorsque cela s'est avéré nécessaire. Des enveloppes nouvelles ont ainsi été allouées entre 2020 et 2022, dans le cadre du DSG, pour répondre aux difficultés financières rencontrées par certains établissements « en raison notamment de tensions sur la masse salariale et, en particulier, sur le GVT », pour un total de 45 millions d'euros « soclés » dans les SCSP annuelles. La Dgesip relève par ailleurs que le rééquilibrage de la dotation des établissements les moins bien dotés entre 2020 et 2023, pour un total de 28 millions d'euros également « soclés », a contribué à alléger la charge résultant du GVT, de même que les 11 millions d'euros supplémentaires alloués aux établissements en fin de gestion 2023 au titre de l'accompagnement de leur trajectoire financière et salariale ;
- que les établissements « ont su dégager les marges de manoeuvre nécessaires pour financer leur GVT », comme en témoigne l'augmentation globale des consommations d'emploi ;
- que la perspective de départs à la retraite importants à l'horizon 2030 devrait contribuer à desserrer la contrainte à moyen terme.
• Le surcoût résultant de l'inflation, en second lieu, a affecté les établissements par le biais principal de leurs dépenses énergétiques. Il est évalué par le ministère, par comparaison avec l'année 2021, à 320 millions d'euros pour 2023 et 212 millions pour 2024.
Seuls les surcoûts de l'année 2023 ont fait l'objet d'une compensation partielle par l'État ; 200 millions d'euros ont été prévus à ce titre par loi de finances rectificative pour 2022, puis versés en deux fois, fin 2022 puis fin 2023, afin de tenir compte des surcoûts réellement constatés et de la situation financière des établissements. France Universités estime que le surcoût net en résultant pour les établissements atteint à ce jour 350 millions d'euros.
• Les établissements ont enfin été affectés par les mesures salariales générales prises par le Gouvernement.
Après la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires intervenue, à hauteur de 3,5 % au 1er janvier 2022, une nouvelle revalorisation de 1,5%, entrant en vigueur au 1er juillet 2023, a été décidée lors des rencontres salariales de 2023 (dans le cadre des mesures dites « Guérini »).
La compensation aux établissements du coût de ces mesures décidées par l'État s'est faite de manière partielle et retardée. La revalorisation de 3,5% fait l'objet d'une compensation intégrale et pérenne aux établissements depuis 2023, le surcoût de la demi-année 2022 ayant été laissé à la charge des établissements. La revalorisation décidée en 2023 n'a quant à elle été compensée qu'à partir de 2024, et à hauteur de 50 %. Selon la Dgesip, 220 millions d'euros ont ainsi été laissés à la charge des opérateurs du programme 150 en 2023 et 2024. Le rapporteur de la commission pour l'enseignement supérieur, Stéphane Piednoir, a souligné dans ses deux derniers avis budgétaires le caractère inédit de cette décision, qui a créé un reste à charge pérenne pour les établissements.
Lors de l'examen du projet de loi de finances, de fortes inquiétudes ont également porté l'augmentation de 4 % de la contribution des opérateurs au compte d'affectation spéciale (CAS) Pensions, dont la compensation n'était pas prévue dans la version initiale du texte. Un amendement gouvernemental a finalement prévu la prise en charge intégrale de cette dépense nouvelle par le budget de l'État.
• Dans ses réponses au questionnaire adressé par les rapporteurs, la Dgesip a souligné que « si certains coûts demeurent en effet à la charge des établissements, ce n'est que partiellement ». Elle a par ailleurs relevé que ces arbitrages budgétaires doivent être placés en regard de l'augmentation significative des ressources stables des opérateurs du programme 150 sur la dernière décennie (+ 20 % entre 2016 et 2025).
2. Une dégradation de la visibilité budgétaire des établissements
Cette évolution dégrade la visibilité budgétaire des établissements universitaires de deux manières.
• En premier lieu, le recul de la couverture par le budget de l'État de la dépense salariale des établissements (qui représente 85 % de leur SCSP en 2024)117(*) marque le passage à une situation de sous-financement chronique de leur dépense socle, considéré comme « choquant » par Laurent Batsch et plusieurs universités. France Universités observe ainsi, entre 2020 et 2024, une progression moyenne de la masse salariale des universités de +3,8 %, tandis que la SCSP a progressé au rythme plus modéré de 2 % par an.
Il a par ailleurs été jugé préoccupant que des appels à projets portent désormais sur des activités relevant des missions confiées aux universités par la loi, notamment l'organisation de la lutte contre les discriminations. L'introduction de financements participatifs sur ces activités est lue comme le début d'un désengagement de l'État sur les missions obligatoires des établissements.
• En second lieu, les arbitrages budgétaires des dernières années font peser la menace annuelle d'une augmentation exogène des dépenses à la charge des établissements, venant déstabiliser leurs budgets sans qu'ils ne disposent des marges de manoeuvre pour maîtriser les coûts associés. France Universités indique ainsi qu'il ne lui est « pas possible d'admettre que [le financement de] la masse salariale cesse d'être actualisé lorsque son accroissement est dû à des décisions de l'État ».
L'importance de ces marges de manoeuvre fait débat dans les échanges avec l'administration. La fin de la compensation du GVT, en particulier, a été décidée au regard des conclusions d'une mission commune d'inspection sur le pilotage et la maîtrise de la masse salariale des universités118(*), qui relevait que « compte tenu de ses effets contre-productifs, la mission considère que la compensation du GVT n'a plus lieu d'être s'agissant d'opérateurs autonomes, qui sont libres de leurs choix de structure d'emploi ». L'université Paris Cité relève à ce propos que la part du GVT résultant des évolutions de carrière des hospitalo-universitaires et des professeurs d'université lui échappe en totalité.
Les rapporteurs relèvent par ailleurs que le même rapport considérait « qu'il revient aux pouvoirs publics de limiter la compensation sur l'impact de la déformation de la masse salariale des titulaires à la seule compensation des mesures fonction publique relatives au point d'indice », ce qui signifie que ces mesures au moins devraient bénéficier d'une complète compensation par l'État.
C. UN MANQUE DE FIABILITÉ DANS LE VERSEMENT DES DOTATIONS
• Au stade de l'allocation des dotations de l'État, les modalités techniques de leur versement aux établissements sont également à l'origine de difficultés.
La SCSP comme la dotation attachée aux Comp sont ainsi notifiées puis versées avec retard, ce qui signifie que les établissements doivent construire leurs budgets sans connaître ni le montant des dotations dont ils bénéficieront, ni la date à laquelle ils en disposeront. À la date de l'audition de leur association professionnelle, le 25 mars 2025, les directeurs financiers d'établissements d'enseignement supérieur ont ainsi indiqué qu'ils étaient toujours dans l'attente de la notification des crédits alloués au titre des services votés pour 2025, dont le montant par établissement n'était pas encore connu.
Ce flottement est renforcé par les fluctuations des arbitrages budgétaires de l'État, qui portent sur des montants aussi importants que ceux du relèvement du taux de la contribution au CAS Pensions dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2025 (soit 200 millions d'euros).
Il a par enfin été regretté que les modalités de notification ne permettent pas de distinguer les montants relevant de la SCSP, qui constitue une dotation annuelle, de ceux associés aux Comp, construits dans une logique pluriannuelle.
• Les incertitudes résultant de ces pratiques pèsent bien entendu fortement sur les capacités de pilotage financier des universités, et expliquent en partie les écarts constatés entre les budgets primitif et constaté des établissements (voir infra). Alors qu'il leur est demandé de développer une vision pluriannuelle de leur pilotage financier, les universités sont en effet soumises à de fortes incertitudes budgétaires à l'échelle infra-annuelle.
Ces éléments pèsent fortement sur la capacité des universités à engager des dépenses sur plusieurs années. La plupart des établissements entendus indiquent que leurs ajustements à cette situation passent d'abord par la remise en cause de leurs projets d'investissement, ainsi que par la réduction de la part de leur dépense salariale dont ils ont la maîtrise, au moyen d'une augmentation du recours aux enseignants non titulaires et d'un gel des campagnes d'emplois. Leurs activités de recherche fondamentale, dont le fonctionnement n'est pas adapté à un financement ponctuel par appel à projets, sont également touchées par la réduction du champ couvert par la SCSP.
II. DES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION SUR LES MARGES DE MANoeUVRE FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS
La dégradation de la situation financière des universités résultant de ces évolutions ne fait pas l'objet d'un diagnostic entièrement partagé entre les universités et l'État. Un « décalage » a ainsi été évoqué à de multiples reprises entre le jugement respectivement porté par les universités et les ministères compétents sur les marges de manoeuvre dont disposent les établissements, et sur leur capacité à absorber de nouvelles mesures d'économie. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, de débat s'est principalement porté sur l'évaluation du montant de la trésorerie disponible des établissements.
Les rapporteurs ont dès lors souhaité objectiver les déterminants de ces divergences d'appréciation, afin de disposer d'une vision étayée de la situation financière des universités.
A. LES DÉTERMINANTS D'UN DIAGNOSTIC NON PARTAGÉ
1. Un état des lieux peu lisible
Le manque de lisibilité de la situation financière des universités a été pointé par plusieurs acteurs entendus par les rapporteurs, qui ont déploré l'absence de mise à disposition d'indicateurs synthétiques reflétant la trajectoire et la situation financière des universités.
L'Avuf indique ainsi que les collectivités ont globalement « le sentiment qu'il manque d'indicateurs fiables et publiés régulièrement sur la situation financière des universités, et plus généralement sur toutes leurs activités, leurs résultats, leur impact », et que « ce manque de lisibilité est un handicap pour tous ceux qui souhaitent accompagner et travailler avec les universités ».
a) La production de données nombreuses mais hétérogènes
Cette observation est à première vue paradoxale, dans la mesure où les données disponibles sont nombreuses.
• Outre le système d'information Indefi ESR, alimenté par les données de l'infocentre des établissements publics nationaux (EPN), les données renseignées par les agents comptables de chaque établissement alimentent un tableau de synthèse du MESR.
Ce tableau sert ensuite de base aux tableaux de bord mis à la disposition du grand public en open data par la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du MESR et qui, de l'avis de plusieurs des interlocuteurs entendus par les rapporteurs, sont très complets. Stéphane Calviac a ainsi souligné que ces tableaux de bord permettent, « en quelques clics, de disposer d'un document d'une quinzaine de pages retraçant l'évolution de la situation financière des universités ». France Universités considère toutefois que « ces éléments ont une valeur informative, mais grandement insuffisante pour un véritable pilotage stratégique (indicateurs souvent limités aux crédits alloués ou exécutés, sans éléments d'analyse consolidée) »119(*).
S'y ajoutent les rapports annuels de performance (RAP), qui agrègent des données financières par catégorie d'établissement (universités et assimilées, écoles d'ingénieur, etc.), notamment les éléments principaux du compte de résultat, du tableau de financement et de la trésorerie.
Ces différents ensembles de données ne sont cependant pas homogènes du point de vue des informations qu'ils retracent comme des acteurs auxquels ils sont accessibles, ainsi que l'illustre le tableau ci-après. Le système Indefi ESR, qui est accessible au MESR comme au ministère des comptes publics, comporte ainsi uniquement les données du plan comptable, tandis que les éléments du cadre GBCP ne figurent que dans le tableau de synthèse interne au MESR. Cette hétérogénéité contribue probablement au sentiment de confusion autour de la disponibilité des données, de même que la fréquente méconnaissance de la mise à disposition par l'État de données financières accessibles en open data.
Le chantier du système d'information Infinoe, qui devrait permettre de fluidifier les échanges d'information entre les établissements et les services centraux du MESR et du MCP, est par ailleurs toujours en souffrance. Ce nouveau système, dont le chantier a été lancé en 2020 pour l'ensemble des établissements publics nationaux (EPN) - au-delà donc des universités - doit permettre de collecter, par flux automatisés, toutes les données budgétaires et comptables issues des logiciels des organismes soumis à la comptabilité publique. La production des documents budgétaires s'en trouverait simplifiée et fiabilisée, tandis que le développement de l'open data des données financières des organismes d'État en serait facilité. Surtout, l'État disposerait ainsi d'une vision complète et en temps réel de la situation financière de l'ensemble des établissements.
Initialement prévue pour 2022, la mise en service de ce nouvel infocentre a cependant subi d'importants retards, ainsi que l'ont récemment mis en lumière les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur les agences de l'État120(*).
• La présentation comptable des budgets des établissements est par ailleurs unifiée dans le cadre réglementaire tracé par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit décret GBCP) et le décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des EPSCP.
La liasse des documents budgétaires dits GBCP retrace plusieurs indicateurs : outre le plan de trésorerie de l'établissement, elle comporte également un tableau des recettes fléchées, un tableau des opérations pluriannuelles et un tableau de synthèse budgétaire et comptable dans lequel figurent notamment la CAF, le fonds de roulement et la trésorerie.
Les différents ensembles de données sur la situation financière
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Source : réponses de la Dgesip au questionnaire des rapporteurs
b) Une présentation comptable insuffisamment fiable et analytique
Plusieurs raisons expliquent que, malgré le caractère extensif des données disponibles, un sentiment de flou perdure quant à la compréhension de la situation financière réelle des universités.
• On peut en premier lieu penser, ainsi que l'a souligné Stéphanie Mignot-Girard, que la différenciation croissante des établissements et donc de leur modèle économique limite la possibilité de disposer d'une vision véritablement intégrée au niveau national.
• Il apparaît en second lieu que l'information comptable produite par les établissements souffre parfois d'un manque de fiabilité, ainsi que le constatait, au niveau général des opérateurs de l'État, un rapport de l'IGF de juillet 2023121(*).
La Dgesip relève plus précisément que « la problématique [des indicateurs permettant de comprendre la situation financière des universités] porte moins sur la question du type des indicateurs choisis que sur la fiabilité des éléments renseignés. Les indicateurs existants sont pertinents mais certains ne sont pas renseignés de manière précise. Les recettes fléchées et les opérations pluriannuelles ne sont pas toutes renseignées dans les liasses budgétaires ». Elle indique que des groupes de travail seront prochainement lancés, en lien avec la direction des affaires financières du ministère, pour améliorer la qualité et la fiabilité de ces indicateurs.
• Enfin, l'approche comptable retenue pour les universités, insuffisamment analytique, ne permet pas de faire le lien entre les données budgétaires des établissements et leurs activités. La seule lecture des budgets et des indicateurs techniques associés ne renseigne pas, ainsi, sur la nature et l'étendue de leurs activités de formation et de recherche, sur le coût de leurs fonctions support, sur les choix faits en matière de vie étudiante ou encore sur leurs dépenses bâtimentaires.
Les outils permettant d'établir un lien entre les données budgétaires et les activités des établissements existent pourtant. Bernard Dizambourg a à ce titre rappelé le développement pionnier par l'IGESR (alors IGAENR) d'un outil de macro-analyse de la comptabilité des établissements, dont la diffusion n'a cependant jamais été soutenue par l'administration centrale.
Une approche de comptabilité analytique a plus récemment été portée par le ministère sous le nom de projet de connaissance des coûts des activités des établissements (P2CA). Cet outil polyvalent, auquel plusieurs des établissements entendus ont indiqué recourir, permet de connaître les coûts d'un établissement à un niveau très fin - le diplôme de licence lettres modernes, par exemple - ou agrégé - comme la formation de premier cycle. De l'avis de la plupart des personnes auditionnées, il s'agit d'une réelle avancée.
Sa diffusion apparaît cependant encore limitée. Si la Dgesip indique que les établissements recourent à une comptabilité analytique « la plupart du temps » et que le ministère « [les] pousse et [les] accompagne en ce sens, notamment au moyen du projet PC2A », de nombreux interlocuteurs de la mission d'information ont estimé que cet outil demeurait très largement sous-utilisé, tous les établissements n'y recourant pas, et que le ministère se montrait insuffisamment proactif en la matière. France Universités indique à cet égard que « les universités ont acquis l'autonomie budgétaire sans disposer d'un système partagé de référence analytique. Ainsi, certains établissements comme Sorbonne Université ou Lyon I ont développé une comptabilité analytique avancée tandis que la moitié des établissements ne disposent de tels systèmes ».
2. Une relation entre les opérateurs et la tutelle marquée par la défiance
Les rapporteurs n'ont pu que constater l'existence d'une défiance marquée et réciproque entre les acteurs du triptyque constitué par la Dgesip, la direction du Budget et les établissements. Les réponses apportées par le MESR au questionnaire des rapporteurs, en particulier, sont formulées en des termes fortement et inhabituellement sévères, qui vont jusqu'à mettre en cause la « posture » adoptée par les présidents d'université.
• Les établissements ont indiqué avoir le sentiment de subir, d'une manière générale, le processus de fixation puis d'allocation des moyens qui leur sont alloués au titre de la SCSP. Pour mémoire, il revient à la direction du budget, sur le fondement d'échanges budgétaires interministériels avec la Dgesip, de définir le niveau des ressources associées aux politiques et aux actions portées par les universités, tandis que la répartition des crédits entre les établissements relève de la Dgesip.
Dans leur immense majorité, les établissements entendus ont par ailleurs considéré leur situation financière comme fragile ou préoccupante. Cette analyse est portée tant par les établissements dont les éléments comptables se trouvent effectivement en-deçà des indicateurs fixés par le décret du 2 décembre 2024122(*) que par d'autres qui n'affichent pas de déficit, mais estiment que la trajectoire de leurs indicateurs comptables n'est pas satisfaisante (voir infra). France universités fait ainsi part de son inquiétude face à « l'aggravation de la santé financière des universités ».
• La Dgesip estime quant à elle, dans les réponses écrites adressées aux rapporteurs, que « l'examen du PLF 2025 a été marqué par des projections excessivement négatives » et appelle à « relativiser » l'analyse de la situation financière des universités, en soulignant l'écart entre la prévision et la gestion budgétaire de ces opérateurs.
Elle souligne en effet que les budgets initiaux (BI) sont « systématiquement plus dégradés que ne le laisse apparaître in fine la réalité de gestion », en observant que, de manière agrégée, les BI sont largement votés en déficits tandis que les comptes financiers laissent apparaître une situation plus favorable à la clôture de l'exercice concerné. Elle relève ainsi que pour 2024, dix établissements seulement apparaissent en difficulté par application des critères du décret financier précité aux comptes financiers, contre 56 au regard de leurs budgets initiaux.
Écarts entre les soldes budgétaires
apparaissant au budget initial
et au compte financier des opérateurs
du programme 150
en k€
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Solde budgétaire BI |
-439 |
-526 |
-679 |
- 615 |
-1 005 |
-1 126 |
|
Solde budgétaire CF |
182 |
171 |
171 |
309 |
109 |
119 |
|
Écart |
-622 |
-697 |
-851 |
-925 |
-1 115 |
-1 246 |
Source : Dgesip d'après les apports annuels de performance (RAP) opérateurs
Périmètre : opérateurs « universités et assimilés » du P150
La direction du budget ne dit pas autre chose en estimant qu' « il n'y a pas de divergences de nature quant au diagnostic financier des établissements au sein de l'État », mais que « l'appréhension de la situation financière peut induire des présentations budgétaires différentes de la part des établissements », qui se traduisent par des « écarts significatifs [...] entre les prévisions budgétaires des établissements, retenues selon des hypothèses pessimistes (au budget initial), et une exécution budgétaire dont le résultat est meilleur qu'anticipé (au compte financier) ».
La Dgesip attribue ces écarts à un potentiel « souci de prudence », mais aussi au fait que « certaines gouvernances d'universités peuvent souhaiter afficher dans leurs BI des objectifs ambitieux mais pas toujours complètement réalisables, conduisant à une inflation artificielle des dépenses prévisionnelles. » Elle met également en avant la « posture » adoptée par « certains présidents d'établissement ou certaines communautés universitaires », qui consisterait pour eux à se considérer comme extérieurs à la sphère « État » et à « [estimer] que l'État doit subvenir aux besoins de l'enseignement supérieur », et ainsi à « [refuser] de faire des efforts pour maîtriser sa dépense et gérer avec efficience son budget ».
La question de la posture adoptée par les parties au pilotage financier a également été abordée, en sens inverse, au sujet du point de vue adopté par la direction du budget. Selon une personne auditionnée, le ministère des finances considérerait les universités comme « des centres de coûts particulièrement inefficients » en se fondant sur des indicateurs de performance dégradés, tels que le taux de réussite en premier cycle universitaire.
3. Des indicateurs comptables diversement interprétés
Les indicateurs comptables retenus par l'administration de l'État pour apprécier la situation financière des établissements sont en partie contestés par les universités.
• C'est d'abord le cas du décret du 2 décembre 2024 précité123(*), qui prévoit que la soutenabilité du budget des universités est appréciée au regard de trois critères : le niveau final de trésorerie, qui doit être supérieur à trente jours de crédits de paiement (hors investissement) ; le niveau final de fonds de roulement, qui doit être supérieur à quinze jours de crédits de paiement (hors investissement) ; les charges de personnel, qui doivent demeurer en deçà d'un ratio de 83 % des produits encaissables124(*).
Au regard de ces critères, une dizaine d'établissements sont considérés comme étant en difficulté financière par la Dgesip125(*), soit une petite minorité d'entre eux.
France Universités fait cependant valoir que ces éléments d'appréciation « ne sont pas les plus pertinents » dans la mesure où ils n'intègrent pas la capacité d'autofinancement (CAF) des établissements, qui détermine le niveau de ressources propres pouvant être immédiatement mobilisées, notamment pour des opérations d'investissement126(*). Elle souligne par ailleurs que « le seuil de 83% de dépense de personnel risque d'être atteint et dépassé dans la plupart des universités en raison de la forte augmentation du taux du Cas pensions »127(*). Elle considère enfin que les indicateurs définis par le décret permettent de pointer uniquement les situations les plus dégradées.
• Le désaccord porte ensuite sur le regard porté sur les fonds de roulement.
La direction du budget indique qu'elle s'appuie sur deux indicateurs dans le cadre de la procédure budgétaire : d'une part, le niveau de la trésorerie des universités « pour mieux appréhender les éventuelles orientations budgétaires des établissements en termes, par exemple, d'investissements ou de projets pédagogiques ou de recherches supplémentaires » ; d'autre part, le fonds de roulement « pour apprécier la soutenabilité budgétaire des établissements et leur capacité à faire face à des engagements financiers à court terme ».
France Universités estime quant à elle que le fonds de roulement ne peut être considéré dans cette perspective, en rappelant que « les fonds de roulement constitués par les universités, du fait de leur impossibilité d'accéder à l'emprunt, constituent leur seule source de financement en propre des investissements immobiliers, complété par les CPER ». Elle indique ainsi que les fonds de roulement ne peuvent en aucun cas « servir de variable d'ajustement pour les coûts de fonctionnement et la non-compensation régulière, sauf à obérer sur du long terme les capacités d'investissement ».
La référence à la trésorerie fait par ailleurs d'un vif débat développé infra.
• France Universités indique au total que ces divergences témoignent d'une différence d'approche générale fondamentale des ministères et des établissements sur les sujets budgétaires. Selon l'organisation, le MESR « appréhende les budgets universitaires via une approche orientée politiques publiques », tandis que « Bercy se concentre sur une logique de contrôle budgétaire global », et que les universités « travaillent dans une logique de gestion opérationnelle et multi-budgétaire ».
B. UNE INDUBITABLE FRAGILISATION FINANCIÈRE
Plusieurs éléments tendent cependant à démontrer que la situation financière actuelle des universités comme sa dynamique d'évolution sont très préoccupantes.
1. L'inquiétante dynamique des résultats financiers
• Les facteurs de la dégradation de la situation financière des universités ont fait l'objet d'un consensus au cours des auditions de la mission. L'ensemble des acteurs se sont accordés à reconnaître la conjonction :
- de l'augmentation des coûts de fonctionnement des établissements sous l'effet principalement de l'inflation, qui rehausse notamment leurs dépenses énergétiques, et des mesures salariales partiellement ou non compensées par l'État ;
- de la progression limitée de leurs recettes, le recul de la couverture des coûts fixes par la dotation budgétaire n'étant pas compensé par une augmentation en proportion des ressources extra-budgétaires. Les moyens nouveaux procurés par les financements sélectifs ne contribuent pas, en outre, au financement du fonctionnement courant des établissements, tout en générant par ailleurs des dépenses nouvelles ;
- de l'accroissement de leur besoin d'investissement, en direction notamment de la rénovation énergétique de leur parc immobilier et de la transition numérique de leur offre de formation.
L'ampleur de cette dégradation, très variable selon les établissements, ainsi que les perspectives de son évolution peuvent être approchées au travers de plusieurs éléments.
• La dynamique observée sur plusieurs indicateurs clé traduit une évolution inquiétante.
La direction du budget indique qu'à l'échelle nationale, une dégradation de la situation des établissements est observée depuis 2021 :
- après 2018, on constate une amélioration sensible de l'ensemble des indicateurs, avec un pic en 2021 ;
- après 2021, on observe un « découplage entre certains indicateurs, en particulier une dégradation des comptes d'exploitation, sous l'effet principalement de l'augmentation des charges de personnel et de fluides et de l'infléchissement de la croissance des produits ».
Dans sa note d'analyse de l'exécution budgétaire 2024 de la mission Recherche et enseignement supérieur (Mires), la Cour des comptes relève dans le même sens que le résultat comptable de l'ensemble des opérateurs du programme 150 s'est continûment dégradé entre 2021 et 2024, passant de 339 millions d'euros à - 78 millions d'euros, alors qu'il avait progressé entre 2019 et 2021. France Universités indique que le résultat consolidé des universités est devenu déficitaire pour la première fois en 2024 (- 45 millions d'euros).
La capacité d'autofinancement (CAF) de ces opérateurs, qui détermine le niveau de ressources propres qu'ils peuvent consacrer notamment à leurs programmes d'investissement, s'est par ailleurs repliée de 612 millions d'euros en 2021 à 224,6 millions d'euros en 2024, soit une diminution de près des deux tiers en trois ans (-63 %). Cet indicateur est particulièrement important, puisqu'il traduit la capacité des établissements à mobiliser des ressources internes afin d'assurer par lui-même et la même année ses investissements, sans compter systématiquement sur l'attribution de subventions.
La même dynamique est observée en ce qui concerne les seules universités. Bernard Dizambourg relève ainsi, à partir des données du MESR disponibles en open data pour 62 établissements, une dégradation marquée de leur CAF et de leur résultat entre 2020 et 2023. Cette dégradation est bien plus marquée pour les établissements à dominante SHS et juridico-économique que pour les universités proposant une formation en santé.
• France Universités souligne enfin, sur la base d'une enquête conduite auprès de 49 des 75 universités au premier semestre 2025, la diversité des situations financières des établissements.
Au sein de cet échantillon non exhaustif, la trésorerie la plus basse s'élève à 101 941 euros, et la plus haute à 241 millions d'euros, tandis que les fonds de roulement sont échelonnés de 2,5 à 133,7 millions d'euros.
2. Une remise en cause de l'autonomie des universités
Cette situation traduit au total une érosion des marges d'autonomie des universités, qui a conduit une personne auditionnée à considérer que la fonction financière des universités se rapprochait davantage d'une « déconcentration de gestion » que de l'autonomie qui aurait dû découler de leur accès aux responsabilités et compétences élargies.
Prises en étau entre des ressources dont la grande majorité dépend de décisions de la puissance publique, et des dépenses dont l'évolution leur échappe largement, les universités ne disposent que de très peu de moyens financiers mobilisables au service de projets d'investissement, et plus largement d'évolutions stratégiques de grande ampleur.
Ces projets ne peuvent pas davantage être financés par l'emprunt, les universités disposant, comme l'ensemble des organismes divers d'administration centrale (ODAC), d'une capacité très limitée à cet égard. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de programmation des finances publiques du 28 décembre 2010128(*), les ODAC ne peuvent en effet souscrire un emprunt de terme supérieur à douze mois auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement. Deux exceptions existent pour les prêts souscrits auprès de la caisse des dépôts et consignations (CDC) et de la BEI.
Le pilotage financier de chaque établissement est par ailleurs très encadré par le contrôle budgétaire exercé, en application de l'article R. 719-69 du code de l'éducation, par le recteur d'académie. Lorsque les critères de soutenabilité prévus par l'article R. 719-61 ne sont pas remplis, il peut être décidé par le recteur d'académie ou le ministère de soumettre le budget de l'établissement concerné à l'approbation du recteur.
C. LE DÉBAT MAL POSÉ DE LA TRÉSORERIE « FLÉCHÉE »
Le débat budgétaire tend cependant à se focaliser sur le montant très élevé de la trésorerie agrégée des établissements, qui fonde l'appréciation portée par la direction du budget sur la capacité des établissements à absorber les efforts d'économie inscrits en loi de finances, ainsi que les préconisations récemment formulées sur le passage à une gestion plus dynamique de la trésorerie. Les acteurs de l'enseignement supérieur défendent quant à eux une vision budgétaire fondée sur la notion de trésorerie disponible ou libre d'emploi.
Au terme de leurs travaux, les rapporteurs soulignent que ce débat est avant tout symptomatique de l'absence de confiance des établissements envers le ministère des finances, dans le contexte général de resserrement des contraintes budgétaires.
1. Une hausse de la trésorerie résultant du cycle d'encaissement des recettes
• Contrastant avec les observations précédentes, le niveau de trésorerie des établissements constitue à première lecture un indicateur très positif de la situation financière des établissements.
Dans sa note d'analyse précitée, la Cour des comptes estime son montant à 3,56 milliards d'euros pour 2024. Elle appelle cependant à la prudence dans l'analyse de ces chiffres, dans la mesure où ils ne couvrent que 116 des 160 opérateurs du programme 150, et exclut, faute de données disponibles ou fiables, plusieurs établissements disposant d'une trésorerie importante129(*). Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2025, son montant global avait été réévalué à 5,7 milliards d'euros par le ministère130(*). Ce montant correspond à une moyenne de 204 jours de charges décaissables, avec de fortes variations selon les établissements.
Au cours des dernières années, l'évolution de la trésorerie a globalement été orientée à la hausse. La direction du Budget relève ainsi que la trésorerie des opérateurs du programme 150, « particulièrement abondante », « augmente depuis 2018 et reste stable depuis 2022 ». La Dgesip relève dans le même sens que la situation financière de ces établissements « se caractérise par une augmentation importante chaque année du niveau de la trésorerie (+350 millions d'euros en moyenne sur les trois dernières années), avec toutefois une baisse notable en 2024 ».
• Ces niveaux élevés de trésorerie ne correspondent pas à un excès d'épargne nette des établissements, qui résulterait d'un niveau de ressources durablement plus important que celui des dépenses, mais à un décalage entre les flux d'encaissement et de décaissement de leurs recettes.
Du fait des conditions de versement de la SCSP, et surtout des financements compétitifs, le cycle d'activités des universités a été structurellement producteur de trésorerie au cours de la période récente. Les ressources fléchées des appels à projets, d'un montant souvent très élevé, sont en effet versées à l'avance et en une à trois fois, pour des programmes de recherche exécutés sur plusieurs années. Cette caractéristique s'est très fortement renforcée au cours des dernières années, sous l'effet de la progression de ce mode de financement.
Le montant élevé de la trésorerie des établissements ne reflète donc pas leur capacité à dégager des ressources nettes, mais l'évolution des modalités techniques d'allocation de leurs moyens au cours des dernières années. Alors que la phase de montée en puissance des financements sélectifs des établissements est désormais achevée, il est possible de considérer que la trésorerie constituée par ce biais n'a plus vocation s'accroître et pourrait s'éroder131(*).
2. L'utilisation de la trésorerie « non disponible » en question
a) Une forte progression des recettes affectées
L'analyse de ce mécanisme est partagée par l'ensemble des acteurs entendus par la mission d'information, qui s'accordent en conséquence sur le fait qu'une partie de la trésorerie des établissements, issue notamment des ressources des appels à projets, est constituée de recettes destinées au financement d'opérations précises. Cette part de leur trésorerie est désignée sous les termes de « trésorerie fléchée », « trésorerie non libre d'emploi » ou « trésorerie gagée ».
La Cour des comptes relève ainsi, dans sa note précitée, que « les opérateurs rattachés au programme 150 présentent une trésorerie en forte hausse [...], ce qui s'explique par la hausse de la part potentiellement fléchée de la trésorerie ». La part jugée mobilisable de la trésorerie est corollairement en forte baisse : sur l'échantillon de 116 opérateurs du programme 150 mentionné supra, elle se replierait de 1,1 milliard d'euros en 2019 à 228,8 millions d'euros en 2024132(*), soit une baisse de 80 % en cinq ans133(*). Dans cette approche, la trésorerie libre d'emploi représente 6 % de la trésorerie globale de l'échantillon en 2024.
La direction du budget indique également, dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, que « la hausse de la trésorerie s'explique principalement par l'augmentation de la trésorerie dite « fléchée », qui est celle liée aux opérations financées, au moins partiellement, sur recettes fléchées. Il s'agit de recettes ayant une utilisation prédéterminée, généralement par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées, potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement, telles qu'un projet d'investissement élu à un financement dans le cadre des dépenses d'avenir ou un contrat de recherche ».
b) La trésorerie « fléchée » ne constitue pas un outil de gestion pertinent
Alors que, comme indiqué supra, la direction du budget s'appuie sur le montant de la trésorerie des opérateurs pour construire le programme 150 du budget de l'État, les établissements souhaitent unanimement que soit également prise en compte, voire y soit substituée, l'évaluation de leur trésorerie libre d'emploi. Ils soulignent en effet qu'elle constitue le seul indicateur susceptible de rendre compte de la faiblesse de leurs marges de manoeuvre financières.
Cette prise en compte soulève cependant deux difficultés.
(1) Une évaluation comptable limitée et hétérogène
En premier lieu, aucun agrégat comptable ne permet actuellement de disposer d'une évaluation exhaustive du montant de la trésorerie non disponible.
• Cette situation résulte tout d'abord de l'absence d'indicateur comptable couvrant la totalité du périmètre de la trésorerie fléchée.
La direction du budget indique en effet qu'aucun indicateur de la liasse ne permet à ce jour d'identifier les « opérations pluriannuelles autofinancées n'ayant pas encore fait l'objet d'engagement juridique », en précisant que « cette dimension est actuellement discutée dans le cadre de la refonte de la liasse budgétaire des EPSCP faisant suite à l'entrée en vigueur du décret GBCP ».
Une démarche interne d'identification de la trésorerie fléchée des EPSCP a par ailleurs été développée par la Dgesip, qui diffuse chaque année un guide méthodologique identifiant les composantes134(*) de la trésorerie « gagée, non libre d'emploi ». La direction du Budget, qui souligne que cette approche de la trésorerie est spécifique aux établissements d'enseignement supérieur et ne correspond pas au droit commun de la comptabilité des opérateurs de l'État, relève que l'évaluation ainsi produite constitue un outil méthodologique potentiellement pour identifier, à l'échelle de chaque établissement, ses besoins de trésorerie de l'année. Soulignant que l'application de la méthode proposée par la Dgesip est hétérogène selon les établissements et que son « reporting » se fait en dehors de la liasse budgétaire réglementaire, elle considère en revanche son utilisation comme indicateur comptable d'un niveau agrégé de trésorerie gagée comme « discutable ».
• Cette situation résulte ensuite des lacunes des établissements dans le renseignement de leur liasse budgétaire. La direction du budget indique en effet que le tableau 8 des recettes fléchées, qui permet une première approche de la trésorerie non libre d'emploi, est complété de manière hétérogène et ne permet pas de disposer d'une information fiable au niveau agrégé.
La Dgesip relève dans le même sens que « les établissements suivent, de manière hétérogène, un niveau de trésorerie libre d'emploi, ce qui révèle l'absence d'une approche standardisée ».
• Cette difficulté pourrait cependant être levée par le développement d'indicateurs comptables ad hoc au sein de la liasse budgétaire réglementaire, associée à un meilleur suivi de leur information comptable par les établissements.
La direction du budget indique en ce sens que, à condition qu'ils soient correctement renseignés par les établissements, l'agrégation des montants « [du] tableau 8 des recettes fléchées, [du] tableau 4 de l'équilibre financier, plus particulièrement les opérations non budgétaires, et [d']un nouveau tableau, également intégré à la liasse budgétaire, permettant d'identifier les opérations pluriannuelles autofinancées n'ayant pas encore fait l'objet d'engagement juridique [...], permettra de connaître avec certitude le montant de la trésorerie non disponible ».
(2) Une rigidification de la gestion budgétaire
En second lieu, le rapprochement opéré, dans le débat qui se déroule autour de la notion de trésorerie fléchée, entre l'affectation juridique de fonds à un usage prédéterminé et l'impossibilité pour les établissements de disposer de la trésorerie correspondante pour répondre à leurs besoins de financement généraux procède d'une mauvaise compréhension des principes généraux de la comptabilité et de leur articulation avec la logique de gestion financière.
France Université considère ainsi que la trésorerie fléchée « étant gagée sur des opérations ciblées et contractualisées, elle ne peut être réorientée sur des dépenses courantes telles que les factures d'électricité, les salaires des personnels des universités et encore moins les pensions ». Dans leur ensemble, les établissements entendus partagent cette approche : l'absence de souplesse dans l'utilisation des fonds compétitifs a été soulignée tout au long des auditions, plusieurs acteurs ayant souligné le décalage entre le montant très élevé des fonds sélectifs perçus par les établissements et leurs difficultés à assurer leur fonctionnement courant.
Si les financements affectés doivent effectivement être alloués aux opérations programmées, conformément aux engagements juridiques pris auprès des bailleurs de fonds, cela ne signifie cependant pas que les sommes perçues doivent être bloquées dans l'attente de leur décaissement. Conformément au principe d'unité de caisse, la gestion de la trésorerie des établissements est en effet effectuée de manière globale.
À condition qu'ils disposent, à chaque échéance, de la trésorerie nécessaire pour effectuer leurs dépenses programmées, rien n'interdit donc aux établissements de faire contribuer la part dite « affectée » de leur trésorerie à leur gestion courante.
• C'est en ce sens que la direction du budget estime que le concept même de trésorerie libre d'emploi « contribue à alimenter une conception rigide de la trésorerie par les établissements ».
Bernard Dizambourg a également relevé que l'introduction de la notion de trésorerie fléchée, initialement pensée comme une précaution visant à prévenir la mauvaise utilisation de certaines ressources encaissées, a finalement « pulvérisé le budget » : le recours abusif à cette notion aboutit en effet à une fragmentation du budget remettant en cause son unicité135(*).
• Relevant que la trésorerie importante dont disposaient encore les établissements en 2024 n'a pu être efficacement mobilisée au service de leurs besoins d'investissement, la Dgesip entend en conséquence faciliter la « gestion dynamique des marges de gestion ». Elle annonce à ce titre la mise en place, en lien avec les rectorats, d'un accompagnement visant à « avancer vers une approche dynamique de la gestion de [la] trésorerie des établissements ».
La circulaire du 11 août 2025 précitée affirme ainsi qu'il revient aux rectorats, « dans le cadre du contrôle financier et du dialogue stratégique avec les établissements, de veiller tout particulièrement à les accompagner dans la mobilisation de leur trésorerie afin de réduire l'argent dormant et de financer, dans le respect de leur soutenabilité budgétaire, des opérations qui le nécessitent ».
3. Les conditions d'une gestion dynamique de la trésorerie ne sont pas réunies
L'absence de consensus autour d'une telle mobilisation de la trésorerie des établissements, défendue par les pouvoirs publics mais suscitant un très fort rejet de la part des établissements, constitue la traduction concrète des limites du système actuel d'allocation des moyens, amplifié par le climat de défiance décrit supra.
• Les orientations défendues par le MESR et le ministère de l'économie et des finances visent à améliorer, dans le contexte de maîtrise renforcée des dépenses publiques, l'allocation et la gestion des ressources des établissements.
La démarche de la Dgesip tend à permettre à chaque établissement de retrouver des marges de manoeuvre financières, dans un contexte où le resserrement budgétaire ne permettra pas de dégager de moyens nouveaux à court terme. Le raisonnement tenu par la direction du Budget, qui se développe à l'échelle agrégée des établissements, vise à optimiser la construction du programme 150 en tenant compte de l'objectif de réduction du déficit de l'État.
Ces orientations correspondent à de bonnes pratiques de gestion des finances publiques. Lorsque la trésorerie d'un établissement public excède le montant nécessaire à la couverture des dépenses de l'exercice, il est ainsi courant que l'État effectue un prélèvement sur sa trésorerie ou limite son financement budgétaire, l'obligeant dans ce cas à puiser dans ses disponibilités. En ce qu'elles permettent la diminution des dépenses de l'État, et donc son besoin de recourir à l'emprunt pour l'année concernée, ces opérations participent d'une gestion optimale des deniers publics. Il peut s'entendre, en particulier dans le contexte actuel, qu'on veuille éviter d'accroître l'endettement de l'État alors que des établissements publics disposent d'une trésorerie abondante.
• À l'échelle de chaque établissement, la mise en oeuvre de ces orientations implique de tenir compte de deux éléments :
- en premier lieu, compte tenu du mécanisme de constitution de la trésorerie des établissements évoquée supra, de telles opérations ne pourraient être conduites que ponctuellement. En effet, alors que le volume des financements sélectifs tend à se stabiliser après plusieurs années de montée en puissance, les disponibilités des universités ne se reconstituent pas nécessairement chaque année ;
- en second lieu, leur mise en oeuvre entraînerait une réduction de la marge de sécurité financière des établissements, ayant pour corollaire une augmentation de leur dépendance au financement budgétaire. Les conséquences de la diminution de leurs disponibilités seraient variables selon les établissements, en fonction notamment du montant de leur trésorerie et de l'importance des engagements pris dans le cadre des appels à projets. Dans le cas où le montant résiduel de leur trésorerie ne permettrait pas de couvrir un décaissement correspondant à l'un de ces engagements, ils devraient pouvoir compter sur le soutien de l'État - sauf à réduire fortement le financement d'un fonctionnement déjà très contraint ou à faire défaut aux engagements pris.
Dans les conditions actuelles du pilotage budgétaire des établissements et de l'allocation de leurs moyens, une telle réduction de leur marge de sécurité financière se heurterait à trois difficultés :
- elle rendrait tout d'abord nécessaire la construction, par chacun d'entre eux, d'une programmation budgétaire pluriannuelle permettant de prévenir une éventuelle défaillance. Cette opération suppose un pilotage rigoureux des recettes et dépenses affectées, que toutes les universités n'ont pas encore démontré leur capacité à déployer ;
- elle appellerait ensuite une allocation des ressources budgétaires précisément adaptée à la réalité des besoins de chaque université. Au regard des conditions actuelles de la répartition des moyens entre les établissements, il est permis de douter de la capacité des ministères à assurer une articulation fine entre la mise à contribution de la trésorerie à un niveau agrégé et le suivi des conséquences qui en découlent à l'échelle de chaque établissement ;
- elle supposerait enfin que l'État garantisse le financement des dépenses affectées qui ne seraient plus gagées par une trésorerie fléchée, en fonction de la programmation mentionnée supra ou en cas de dégradation inopinée de la situation budgétaire d'un établissement. Le caractère erratique du soutien financier de l'État au cours des dernières années n'est cependant pas de nature à rassurer sur ce point.
• Les conditions ne semblent donc pas remplies à ce jour pour que l'État oblige les universités, de manière unilatérale, à une gestion dynamique de leur trésorerie. Dans les conditions actuelles du pilotage financier des établissements, une telle évolution des pratiques comporte en effet un risque important d'aboutir à une forme de « cavalerie budgétaire » compromettant gravement la soutenabilité financière des universités au profit d'un gain budgétaire de court terme.
La modification du régime de gestion de la trésorerie des universités suppose au total un important travail préalable permettant, par l'établissement d'un diagnostic partagé et la définition d'engagements réciproques, le retour d'une véritable confiance entre les acteurs.
TROISIÈME
PARTIE :
AMÉLIORER LE PILOTAGE STRATÉGIQUE
DES
UNIVERSITÉS EN RECRÉANT LES CONDITIONS D'UNE RELATION DE
CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS
Au terme de ses travaux, la mission a défini cinq axes de recommandations visant à améliorer le pilotage stratégique des universités.
L'ensemble de ces préconisations sont guidées par la préoccupation de recréer les conditions d'une relation de confiance entre l'ensemble des acteurs du monde universitaire et contribuant à son fonctionnement - et, au-delà, avec tous les citoyens, l'université constituant un bien public dont la préservation constitue un impératif pour l'ensemble de la société. Alors que le fonctionnement et l'image de l'institution universitaire apparaissent aujourd'hui abîmés par deux décennies de bouleversements imparfaitement régulés, cette restauration de la confiance constitue un prérequis de toute nouvelle évolution d'ampleur du service public de l'enseignement supérieur.
Ces recommandations visent en particulier à donner enfin aux établissements, depuis longtemps contraints d'absorber les conséquences d'un pilotage erratique, l'orientation, la visibilité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions fondamentales de recherche et de formation, dans le cadre d'une autonomie effective.
I. DÉFINIR UN CAP STRATÉGIQUE PARTAGÉ AU NIVEAU NATIONAL
L'absence de boussole stratégique de l'État en matière universitaire résulte à la fois de la faiblesse du cadre législatif définissant les missions des universités, construit par accumulation au point d'en devenir illisible, et de la carence du ministère dans la définition d'une stratégie nationale concertée, pourtant prévue par le législateur.
Les rapporteurs estiment en conséquence nécessaire de créer un cadre stratégique à trois niveaux, en tenant compte des instruments opérationnels en cours de déploiement auprès des établissements.
1. Clarifier la définition législative des missions de l'université
Le premier niveau doit être celui de la loi, à laquelle il revient de fixer de manière claire et intelligible les missions et les objectifs assignés au service public de l'enseignement supérieur. Cette ambition suppose un travail de réécriture du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de l'éducation (soit ses articles L. 123-1 à L. 123-9), dont le contenu ne peut être défini que par la voie du débat parlementaire.
Recommandation n° 1 : Clarifier et prioriser les dispositions législatives du code de l'éduction relatives aux missions et aux objectifs des établissements universitaires.
2. Appliquer les dispositions législatives relatives à la Stranes
Le deuxième niveau serait celui de la concertation entre les acteurs, qui doivent être appelés à se prononcer tous les cinq ans sur les grandes lignes de la politique menée par la puissance publique en matière universitaire, ainsi que sur les contours d'une programmation budgétaire pluriannuelle - ainsi que le prévoit déjà l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
Cette concertation doit associer l'ensemble des acteurs intéressés au fonctionnement de l'université, ce qui recouvre, outre les ministères concernés et la représentation des établissements, la communauté universitaire et scientifique, les partenaires culturels, sociaux et économiques ainsi que les collectivités territoriales. L'association du Parlement pourrait être assurée par la présence de députés et sénateurs dans la concertation, ainsi que par la transmission des orientations envisagées à l'Assemblée nationale et au Sénat avant leur adoption définitive.
3. Garantir l'articulation des Comp avec les priorités nationales
Le troisième niveau serait celui des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp), sur lesquels le ministère a récemment reporté l'ensemble de son action stratégique. Il ne paraît pas pertinent de mettre fin à la dynamique enclenchée par le déploiement annoncé des Comp à 100 %, très positive à plusieurs égards ; il est cependant nécessaire de prévoir les conditions de l'articulation entre les orientations définies par ces instruments et les priorités tracées par concertation nationale.
Cette articulation pourrait être assurée par la définition, dans le cadre de la concertation, d'un ensemble de variables obligatoires et facultatives découlant de ces priorités. Pourraient par exemple être fixés, en fonction des résultats de la concertation, des objectifs chiffrés en matière de réussite et d'accompagnement des étudiants, d'insertion professionnelle, de féminisation des filières scientifiques ou encore de mobilisation de financements compétitifs.
Chaque établissement disposerait d'une marge d'appréciation, dans le cadre de son dialogue avec l'administration déconcentrée, pour retenir les variables facultatives les mieux adaptées à son projet d'activité et à son profil d'amélioration. Un tel système permettrait de tenir compte de la différenciation croissante des établissements tout en garantissant que les objectifs qu'ils choisissent de s'approprier s'inscrivent dans un ensemble de priorités partagées au niveau national. Conformément aux recommandations formulées par Vanina Paoli-Gagin dans son rapport précité, la limitation du nombre des variables ainsi définies pourra seule fonder une approche véritablement stratégique, en évitant l'écueil de la dilution.
Recommandation n° 2 : Instituer une conférence stratégique quinquennale réunissant l'ensemble des parties prenantes pour déterminer les objectifs et les priorités de la politique universitaire nationale, ainsi qu'un ensemble de variables en découlant pour la négociation des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp).
II. AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE L'UNIVERSITÉ
La mauvaise image de l'université dans l'opinion publique et son déficit d'influence dans le processus de décision étatique sont d'abord le reflet d'une profonde méconnaissance du modèle universitaire. Les rapporteurs estiment en conséquence indispensable de développer l'information sur les succès, les forces, les contraintes et les défis de l'institution, ainsi que de renforcer les échanges entre la sphère publique et la communauté universitaire.
1. Développer l'information sur le modèle universitaire
L'accroissement de la concurrence exercée par les établissements privés d'enseignement supérieur résulte partiellement de leur capacité à communiquer sur les contours du parcours qu'ils proposent et des débouchés qu'ils annoncent, sans pour autant que la formation dispensée et les diplômes délivrés ne se démarquent toujours positivement de ceux de la sphère universitaire. À l'inverse, certains échecs à l'université peuvent être imputés à une mauvaise appréciation par les bacheliers des spécificités de la formation proposée dans ce cadre.
Les pouvoirs publics doivent en conséquence accroître la lisibilité du modèle universitaire auprès du grand public, en faisant notamment mieux connaître l'originalité d'une institution fondée sur la centralité de la recherche, ainsi que sa contribution à l'innovation et au progrès scientifique. Cet effort d'information peut être déployé de multiples façons, par le biais de campagnes d'affichages dans les lieux publics, de messages informatifs sur les réseaux sociaux, ou encore d'une amélioration de la qualité et de l'attractivité des contenus diffusés en ligne par le ministère et les établissements.
Une telle démarche d'information revient par ailleurs à mieux communiquer sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse au travers du financement des universités. Le coût réel de la formation universitaire, qui est sans rapport avec le montant des frais d'inscription acquittés par les étudiants, ainsi que le principe de sa prise en charge quasi-totale par l'État doivent être clairement portés à la connaissance du public. Cette information pourrait en premier lieu passer par la facturation des établissements, qui pourrait faire apparaître le coût réel de la formation ainsi que le montant pris en charge par l'État, sur le modèle développé dans les hôpitaux publics.
Recommandation n° 3 : Mieux communiquer sur les réussites de l'université et sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse, en faisant notamment connaître le coût effectif de la formation universitaire (en moyenne 12 250 euros par an et par étudiant).
2. Développer les passerelles entre l'administration et l'université
• C'est également à travers la valorisation du plus haut diplôme qu'elles délivrent, le doctorat, que les universités pourront accéder à une meilleure reconnaissance.
Cette valorisation apparaît en outre indispensable pour permettre à notre pays de préparer les transitions majeures des prochaines décennies, qui appellent la mobilisation de compétences de recherche de pointe. La formation de docteurs, dont le diplôme bénéficie d'une reconnaissance internationale, constitue ainsi un enjeu de souveraineté nationale. L'ANRT relève à ce titre que « le relatif désintérêt des entreprises françaises pour ce diplôme peut constituer un risque à court terme » et que « le nécessaire développement de la R&D ne peut s'entendre sans une réelle considération de la place des docteurs dans les entreprises, comme les administrations, si elles ont l'ambition de compter dans les années à venir ».
• Face à ces défis, de nombreuses recommandations ont été formulées par les rapports précités. Le rapport Pommier-Lazarus a en particulier axé ses préconisations sur le changement culturel nécessaire à l'évolution de la perception du doctorat, en recommandant la création d'un indice d'intensité doctorale permettant de mesurer et de valoriser la présence de docteurs dans les entreprises et le secteur public. Les rapporteurs souscrivent globalement aux recommandations formulées et appellent à leur mise en oeuvre rapide.
• Ils insistent plus particulièrement sur la nécessité de renforcer les liens entre l'administration publique et la communauté de la recherche, afin de répondre à deux objectifs : d'une part, garantir que les hauts fonctionnaires chargés du suivi des questions universitaires, notamment à la direction du budget, disposent d'une connaissance satisfaisante du fonctionnement universitaire ; d'autre part, améliorer l'action publique en plaçant la méthode et la recherche scientifiques au fondement de la définition des politiques publiques.
Ce renforcement doit en conséquence passer, en premier lieu, par l'accroissement du nombre de docteurs recrutés sur des postes pérennes de titulaires de catégorie A+ - ce qui suppose de faire évoluer les contours de leur recrutement via le concours de l'INSP, conformément aux recommandations formulées dans les derniers rapports du jury. Elle doit en second lieu se traduire par le développement des terrains de stage universitaires dans le cadre de la formation des futurs cadres de l'administration, afin de développer une acculturation précoce aux enjeux du modèle universitaire.
Recommandation n° 4 : Favoriser les échanges et les parcours croisés entre la haute fonction publique et le monde universitaire, notamment en accroissant le recrutement de diplômés du doctorat parmi les personnels titulaires de catégorie A + et en développant les stages INSP dans les établissements.
III. GARANTIR LA TRANSPARENCE ET LA PRÉVISIBILITÉ DE L'ALLOCATION DES MOYENS
1. Redéfinir les paramètres du financement par les ressources publiques
Sur le plan financier, la restauration de la confiance doit passer par le renforcement de la visibilité donnée aux établissements sur l'évolution de leurs ressources allouées par les pouvoirs publics.
a) Rebâtir le modèle de répartition de la SCSP
• En ce qui concerne, en premier lieu, la subvention pour charges de service public des établissements (SCSP), qui constitue la pierre angulaire de leur budget, les rapporteurs estiment nécessaire d'agir dans trois directions.
Il apparaît tout d'abord nécessaire de déployer un nouveau modèle de répartition de la SCSP entre les établissements. S'il est certain que, en conséquence de la différenciation croissante des modèles de fonctionnement des universités, la mise au point d'un tel modèle supposera le développement d'outils d'analyse très fins appelant des travaux importants, elle est toutefois indispensable au rétablissement de la transparence qui doit caractériser tout processus d'allocation de fonds publics.
Ce modèle devra permettre d'identifier une part socle du fonctionnement des établissements, correspondant au montant de leurs charges fixes permettant d'assurer l'accomplissement normal de leurs missions législatives, et qui a vocation à être entièrement couverte par la SCSP. Dans le contexte budgétaire dégradé, cette couverture ne pourra pas être assurée dans l'immédiat pour les établissements historiquement sous-financés par la ressource budgétaire ; tout apport de moyens nouveaux au programme 150 devra cependant se traduire, dans l'avenir, par le déploiement d'un processus de rattrapage graduel par revalorisation différenciée de la SCSP allouée à chaque établissement.
Cette évolution rendra nécessaire la définition de critères objectifs de détermination du montant de la SCSP. La fixation des critères relatifs à la part de subvention à la performance sera effectuée, pour chaque établissement, dans le cadre des Comp en fonction des variables proposées au niveau national. Celle des critères portant sur la part socle devra faire l'objet d'une réflexion approfondie reposant sur une connaissance fine de la structure d'activité des établissements. Tandis que le poids à accorder aux effectifs étudiants a fait l'objet de débats nourris au cours des auditions, il semble exister un consensus sur la prise en compte, par exemple, de l'encadrement assuré par les établissements dans leurs différentes filières.
Pour ce qui est ensuite de la construction annuelle du montant fixé pour la SCSP dans le cadre du programme 150, les rapporteurs estiment que, y compris dans le contexte de maîtrise renforcée des finances publiques, les mesures salariales décidées par l'État pour l'ensemble de sa fonction publique doivent être entièrement prises en charge par lui. Il apparaît en effet aussi illisible qu'inefficient de faire porter des mesures d'économies, certes nécessaires dans leur principe, sur des dépenses dont les établissements n'ont aucunement la maîtrise.
Afin de dépasser le débat relatif à la trésorerie dite « fléchée » des établissements, cette construction budgétaire doit enfin tenir compte des engagements de dépenses pris par les établissements, notamment dans le cadre de leurs contrats d'appels à projets. La mise en place d'un régime de gestion dynamique de la trésorerie des établissements implique en effet la garantie du financement par l'État des dépenses pré-affectées non gagées par un niveau de disponibilités suffisant.
Recommandation n° 5 : Redonner de la visibilité aux établissements sur l'évolution de leurs moyens financiers, en :
- précisant de manière transparente les éléments pris en compte dans la détermination du montant de la subvention pour charges de service public (SCSP), de manière à assurer la couverture du socle du fonctionnement des établissements ;
- affirmant le principe de la prise en charge par l'État des mesures salariales décidées à l'échelle nationale ;
- tenant compte, pour la définition de la ressource budgétaire, des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projets.
b) Rééquilibrer la part respective des financements récurrents et sélectifs
Si la montée en puissance des financements sélectifs alloués par appels à projets a permis la structuration d'organisations très performantes en matière de recherche, un consensus s'est établi au cours des auditions sur la nécessité, sinon de réduire leur part dans les ressources des établissements, du moins de ne plus accentuer leur progression. Cette évolution doit permettre un redéploiement des fonds correspondants aboutissant, à moyen terme, à un renforcement des ressources allouées par la SCSP .
Cette position résulte de trois séries de considérations :
- le financement récurrent du socle d'activités des établissements est, d'une manière générale, largement sous-calibré ;
- en raison de leur caractère à la fois massif et aléatoire, les financements sélectifs ont un effet déstabilisateur sur le budget des établissements, dont ils font gonfler la trésorerie sans accroître le financement de leur socle de fonctionnement. Cette caractéristique est renforcée par le fait que les coûts de gestion associés au déploiement des projets compétitifs ne sont, le plus souvent, pas entièrement couverts par le préciput associé136(*) ;
- à l'échelle de l'ensemble du système universitaire et sur le long terme, il est plus efficace d'inciter à la performance via la ressource budgétaire qu'au travers d'appels à projets par définition inégalement répartis et pourvoyeurs de ressources non pérennes.
Recommandation n° 6 : Rééquilibrer la part respective des financements nationaux alloués via la SCSP et les procédures d'appel à projets compétitif.
2. Généraliser et financer la dévolution du patrimoine immobilier
La dévolution du patrimoine immobilier de l'État qui leur est affecté constitue une composante majeure de l'autonomie des établissements, et doit en conséquence être généralisée à l'ensemble des établissements volontaires. Si le cadre législatif et réglementaire de la dévolution apparaît globalement satisfaisant, le régime de ses dotations d'accompagnement doit en revanche profondément évoluer pour garantir à la fois son attractivité et sa soutenabilité.
La Dgesip indique à ce titre que l'amélioration de la visibilité financière des établissements pourrait reposer sur « un dispositif de dotations contractualisées de façon pluriannuelle entre le MESR, les régions et les établissements, et dont l'objet serait de soutenir une programmation immobilière à moyen et long termes ». Cette orientation correspond au dispositif de la première vague de dévolution, qui avait été assortie d'une dotation récurrente venue se substituer aux différents financements immobiliers versés par le MESR (crédits CPER, crédits sécurité-sûreté et accessibilité).
Elle nécessiterait bien entendu, hors contexte de maîtrise budgétaire, une revalorisation de crédits immobiliers de l'enseignement supérieur permettant aux établissements de disposer de moyens en adéquation avec les besoins de réhabilitation.
Recommandation n° 7 : Généraliser, pour les établissements volontaires, une dévolution du patrimoine immobilier assortie d'une dotation d'accompagnement pluriannuelle fusionnant l'ensemble des financements immobiliers des établissements.
IV. MODERNISER LA FONCTION FINANCIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS
1. Améliorer la qualité du pilotage financier
a) Généraliser l'approche analytique de la comptabilité
La fiabilisation de l'information comptable produite par les établissements constitue un préalable indispensable à l'établissement d'un diagnostic partagé de leur situation financière et à l'amélioration de leur gestion financière. Les rapporteurs estiment à ce titre indispensable de généraliser l'approche analytique de la comptabilité des universités, afin de pouvoir disposer d'une connaissance fine de la structure de leurs coûts.
Cette évolution est nécessaire au pilotage budgétaire des établissements par l'administration de l'État comme à la définition de leurs orientations financière par les universités elles-mêmes. La construction d'une politique contractuelle sur objectifs suppose ainsi la caractérisation préalable des coûts de chaque établissement. Cette connaissance fine des coûts associés à chaque activité est également nécessaire au développement d'organisations permettant de dégager des ressources extrabudgétaires.
Il est en conséquence préconisé d'accélérer le déploiement du projet « connaissance des coûts des activités des établissements » (P2CA) dans l'ensemble des établissements.
Dans la perspective de la mise en place d'une gestion dynamique de la trésorerie, la généralisation de la comptabilité analytique doit être assortie du développement d'indicateurs comptables permettant de connaître à tout moment et de manière exhaustive le montant des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projets.
Recommandation n° 8 : Généraliser la comptabilité analytique et développer les outils comptables permettant la connaissance actualisée du montant des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre de leurs appels à projets.
b) Favoriser la montée en compétence des services support
Cette évolution comptable ne pourra être menée à bien sans une montée en compétence des services support dédiés aux fonctions financière et immobilière des établissements. Cette montée en compétence ne pourra elle-même advenir qu'à la condition d'un renforcement de l'attractivité, notamment salariale, des emplois correspondants. Elle pourra également être favorisée par un renforcement de l'accompagnement assuré par les services rectoraux, dont il revient à l'État d'assurer le dimensionnement adéquat.
Les expériences conduites avec succès par certains établissements plaident par ailleurs pour une structuration de la fonction de réponse aux appels à projets, notamment par la création de services dédiés, et en encourageant les coopérations avec les organismes de recherche.
Recommandation n° 9 : Favoriser la montée en compétence des services support en renforçant leur attractivité, en professionnalisant les fonctions relatives à la gestion immobilière et aux appels à projets, et en assurant un accompagnement adapté par les services rectoraux.
2. Élargir les possibilités d'expérimentation
L'adaptation de la fonction financière des établissements au nouveau contexte budgétaire et au défi de la rénovation de leur patrimoine immobilier, notamment lorsqu'ils bénéficient de sa dévolution, doit enfin passer par le développement de nouvelles possibilités d'expérimentation ouvertes aux établissements volontaires.
Ces expérimentations doivent notamment porter sur :
- le déploiement d'une gestion dynamique de la trésorerie strictement encadrée. Les conditions n'étant actuellement pas réunies pour assurer le passage indifférencié des établissements à un régime de gestion dynamique de leur trésorerie, toute évolution sur ce point doit d'abord passer par la voie de l'expérimentation ;
- un élargissement de la capacité d'emprunt des universités, mesuré dans son montant et limité à un échantillon restreint d'établissements présentant toutes les garanties de soutenabilité budgétaire et de compétence financière. La levée complète des contraintes encadrant le recours à l'emprunt des établissements n'est en effet pas souhaitable, du fait notamment de la hausse mécanique de la dette des administrations publiques qui en résulterait. Dans le contexte de maîtrise des finances publiques, cette conséquence implique la mise en oeuvre d'un encadrement rigoureux, mettant notamment en rapport le montant des investissements réalisés avec celui des économies de fonctionnement qui pourraient en résulter à l'horizon pluriannuel. Cette condition plaide pour une expérimentation centrée, à titre principal, sur la réhabilitation énergétique du bâti universitaire.
Recommandation n° 10 : Les conditions de sa mise en oeuvre par les établissements n'étant pas réunies, suspendre les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des universités.
Recommandation n° 11 : Développer, pour un échantillon réduit d'établissements volontaires, des possibilités d'expérimentation financière concernant notamment la gestion dynamique de la trésorerie et l'élargissement des possibilités de recours à l'emprunt, dans le but principal de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation énergétique du bâti universitaire.
V. OUVRIR UNE RÉFLEXION NATIONALE SUR L'ORIENTATION ÉTUDIANTE ET LES TARIFS UNIVERSITAIRES
1. Des marqueurs du modèle universitaire aux conséquences non régulées
• Deux caractéristiques centrales du modèle universitaire français ont fait l'objet de débats nourris tout au long des travaux de la mission : l'absence de sélection à l'entrée des filières universitaires et la quasi-gratuité du parcours d'études pour l'ensemble des étudiants. Ces deux éléments correspondent à des marqueurs fortement identifiants du système universitaire français, auxquels les acteurs apparaissent diversement attachés.
Alors que le paysage de l'enseignement supérieur connaît de profonds bouleversements sur le territoire français comme à l'échelle internationale, il n'est pas débattu par les acteurs entendus que le statu quo sur ces deux points est générateur d'effets négatifs, voire contre-productifs pour les étudiants, les familles, les établissements et, à travers l'enjeu de finances publiques, l'ensemble des citoyens :
- l'absence de régulation des effectifs étudiants par la sélection à l'entrée du premier cycle universitaire, dont les effets sont entièrement absorbés par les établissements, fait peser une forte contrainte sur leur fonctionnement. Elle dégrade par ailleurs l'efficience de la dépense publique en direction des universités, dès lors que l'appariement entre les exigences des formations, les capacités des candidats et les perspectives de poursuite d'études et d'insertion professionnelles n'est pas assuré par la procédure d'orientation en vigueur. Surtout, elle agit de manière très négative pour des étudiants entretenus dans une forme d'illusion mais soumis à une sélection massive a posteriori et par l'échec ;
- la modicité des droits d'inscription dans les filières universitaires a été abordée, au cours des auditions, sous l'angle d'une dégradation de la qualité perçue de ces formations au regard d'un « signal prix ». Cette caractéristique emporte également des conséquences en matière financière, notamment en ce qui concerne la structure des ressources des établissements ainsi que l'efficience de la dépense publique - la différence entre le montant des droits d'inscription et le coût réel des formations étant pris en charge par le budget de l'État, y compris pour les étudiants extracommunautaires.
Ces deux éléments ont par ailleurs des effets négatifs sur le positionnement des universités dans l'offre générale d'enseignement supérieur, à l'échelle nationale comme sur le plan international. La massification des effectifs accueillis à l'université, sans que l'adéquation entre les attendus des formations et les profils des candidats toujours soit assurée, dégrade les conditions d'accueil et de formation des étudiants à l'université, perçue en conséquence comme une solution d'orientation par défaut. À l'échelle internationale, le premier cycle universitaire se positionne comme une offre d'enseignement supérieur accessible à bas coût et de qualité moyenne.
2. Une absence de consensus justifiant l'ouverture d'un débat
• Ces constats sont globalement partagés par les acteurs entendus par la mission. La manière de répondre aux questions ainsi soulevées n'a cependant pas fait l'objet d'un consensus entre les acteurs entendus. Les rapporteurs estiment en conséquence nécessaire d'ouvrir la réflexion sur ces sujets, notamment dans le cadre de la concertation stratégique prévue par la première recommandation.
À cet égard, le débat devra prendre en compte plusieurs éléments.
• En premier lieu, l'évolution à la hausse des frais d'inscription n'est pas demandée par tous les établissements et ne fait pas l'objet d'un consensus politique.
L'enjeu soulevé par cette question est par ailleurs moins celui d'une augmentation des ressources des établissements que de l'efficience de la dépense publique.
Du fait de leur grande modicité et de leur très faible poids dans les ressources des établissements, une augmentation même très importante de leur montant n'aurait en effet qu'un effet limité sur le financement des établissements137(*), tout en entraînant un accroissement de la dépense de l'État du fait de leur prise en charge pour les étudiants boursiers.
En revanche, la pertinence de la prise en charge par le budget de l'État de l'essentiel du coût de la formation des étudiants issus de familles aisées ainsi que des étudiants extracommunautaires, indépendamment de leur niveau de ressources, doit faire l'objet d'un débat approfondi. Si le financement par l'État de la formation des étudiants dont la situation économique ou personnelle le justifie, ou dont le projet de formation répond aux priorités de formation138(*) et de recherche de notre pays, ne doit pas être remis en cause, les contours de ces éléments doivent être précisés dans le cadre d'une stratégie concertée.
Les rapporteurs estiment en tout état de cause qu'une augmentation des droits d'inscription ne pourrait être intervenir qu'à la triple condition d'être opérée de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire la part du financement de l'État.
• En second lieu, si l'introduction de mécanismes de régulation des effectifs étudiants à l'entrée dans le premier cycle universitaire constitue une demande plus largement partagée parmi les établissements, il n'existe pas davantage de consensus sur les modalités concrètes d'une telle évolution.
Les rapporteurs relèvent à cet égard que la sélection qui pourrait être mise en oeuvre dans le cadre du service public universitaire ne saurait être confondue avec celle qui prévaut pour l'accès aux grandes écoles, qui relève du régime du concours. Il ne s'agit pas, en effet, de choisir un nombre restreint des meilleurs profils académiques, mais d'éviter l'accueil de candidats dont la probabilité de réussite est très faible et n'est pas susceptible d'être augmentée par un dispositif d'accompagnement bien conduit.
Le débat mériterait d'être inscrit dans un cadre plus large incluant une réflexion sur la fonction du baccalauréat, l'organisation du continuum entre le lycée et le premier cycle universitaire ainsi que le fonctionnement de ce cycle de formation.
Les rapporteurs relèvent enfin qu'il est de l'intérêt de tous que la formation universitaire, qui constitue l'offre d'enseignement supérieur la plus accessible aux bacheliers indépendamment de leur origine sociale et de leur niveau de ressource, demeure une référence de qualité.
Recommandation n° 12 : Dans le cadre de la conférence stratégique quinquennale, ouvrir la réflexion sur :
- la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire;
- les conditions d'un rehaussement national des droits d'inscription, de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire la part du financement de l'État.
LISTE DES
RECOMMANDATIONS
DE LA MISSION D'INFORMATION
La mission a défini cinq axes de recommandations destinées à améliorer le pilotage stratégique des universités en créant les conditions d'une restauration de la confiance entre tous les acteurs de l'écosystème universitaire.
Axe n° 1 : Définir un cap stratégique partagé au niveau national
L'absence de boussole stratégique de l'État en matière universitaire résulte à la fois de la faiblesse du cadre législatif définissant les missions des universités, construit par accumulation au point d'en devenir illisible, et de la carence du ministère de l'enseignement supérieur dans la définition d'une stratégie nationale concertée. Les rapporteurs plaident pour la création d'un cadre stratégique à trois niveaux : les grands principes tracés par la loi, les orientations nationales définies à échéance fixe par la concertation, et les priorités opérationnelles inscrites dans les contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) des établissements.
Recommandation n° 1 : Clarifier et prioriser les dispositions législatives du code de l'éduction relatives aux missions et aux objectifs des établissements universitaires.
Recommandation n° 2 : Instituer une conférence stratégique quinquennale réunissant l'ensemble des parties prenantes pour déterminer les objectifs et les priorités de la politique universitaire nationale, ainsi qu'un ensemble de variables en découlant pour la négociation des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp).
Axe n° 2 : Améliorer la
connaissance de l'université
par les décideurs publics et la
société
La mauvaise image de l'université dans l'opinion publique et son déficit d'influence dans le processus de décision étatique sont d'abord le reflet d'une profonde méconnaissance du modèle universitaire. Les rapporteurs souhaitent développer l'information sur les succès, les forces, les contraintes et les défis de l'institution.
Recommandation n° 3 : Mieux communiquer sur les réussites de l'université et sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse, en faisant notamment connaître le coût effectif de la formation universitaire (soit en moyenne 12 250 euros par an et par étudiant).
Recommandation n° 4 : Favoriser les échanges et les parcours croisés entre la haute fonction publique et le monde universitaire, notamment en accroissant le recrutement de diplômés du doctorat parmi les personnels titulaires de catégorie A + et en développant les stages de l'Institut national du service public (INSP) dans les établissements.
Axe n° 3 : Garantir la transparence et la
prévisibilité
de l'allocation des moyens
Les fortes crispations constatées entre les universités et les ministères compétents au cours des derniers débats budgétaires, centrées sur la non-compensation des mesures salariales décidées par l'État et l'évaluation de la trésorerie dite « libre d'emploi », témoignent avant tout d'un climat de défiance délétère pour le pilotage des établissements. La restauration de la confiance doit notamment passer par le renforcement de la visibilité donnée aux établissements sur l'évolution de leur subvention pour charges de service public (SCSP).
Recommandation n° 5 : Redonner de la visibilité aux établissements sur l'évolution de leurs moyens financiers, en :
- précisant de manière transparente les éléments pris en compte dans la détermination du montant de la SCSP, de manière à assurer la couverture du socle du fonctionnement des établissements ;
- affirmant le principe de la prise en charge par l'État des mesures salariales décidées à l'échelle nationale ;
- tenant compte, pour la définition de la ressource budgétaire, des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projets.
Recommandation n° 6 : Rééquilibrer la part respective des financements nationaux alloués via la SCSP et les procédures d'appel à projets compétitif.
Recommandation n° 7 : Généraliser, pour les établissements volontaires, une dévolution du patrimoine immobilier assortie d'une dotation d'accompagnement pluriannuelle fusionnant l'ensemble des financements immobiliers des établissements.
Axe n° 4 : Moderniser les outils du
pilotage financier
et renforcer l'efficacité et
l'attractivité des services support
L'amélioration du diagnostic porté sur la situation financière des établissements suppose de fiabiliser l'information produite notamment par les services support, qui doivent monter en compétence et en attractivité. Dans l'attente d'une telle évolution et d'une amélioration du processus d'allocation des moyens budgétaires, les projets visant à mobiliser la trésorerie des établissements ou à développer sa gestion dynamique doivent être suspendus. Le renforcement de la confiance entre l'État et les établissements doit par ailleurs se traduire par un élargissement des possibilités d'expérimentation en matière financière.
Recommandation n° 8 : Généraliser la comptabilité analytique et développer les outils comptables permettant la connaissance actualisée du montant des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre de leurs appels à projets.
Recommandation n° 9 : Favoriser la montée en compétence des services support en renforçant leur attractivité, en professionnalisant les fonctions relatives à la gestion immobilière et aux appels à projets, et en assurant un accompagnement adapté par les services rectoraux.
Recommandation n° 10 : Les conditions de sa mise en oeuvre par les établissements n'étant pas réunies, suspendre les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des universités.
Recommandation n° 11 : Développer, pour un échantillon réduit d'établissements volontaires, des possibilités d'expérimentation financière concernant notamment la gestion dynamique de la trésorerie et l'élargissement des possibilités de recours à l'emprunt, dans le but principal de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation énergétique du bâti universitaire.
Axe n° 5 : Ouvrir une réflexion
nationale
sur l'orientation étudiante et les tarifs
universitaires
Alors que le paysage de l'enseignement supérieur se transforme rapidement, le débat sur l'évolution du modèle universitaire achoppe sur deux sujets : la sélectivité des formations, qui existe dans les faits sous la forme d'une sélection massive a posteriori et par l'échec ; la quasi-gratuité des études, à l'heure du resserrement budgétaire et quand d'autres établissements publics augmentent les frais d'inscription des familles les plus aisées. Le statu quo actuel pèse à la fois sur les étudiants, sur les établissements et sur les finances publiques.
Recommandation n° 12 : Dans le cadre de la conférence stratégique quinquennale, ouvrir la réflexion sur :
- la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire ;
- les conditions d'un rehaussement national des droits d'inscription, de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire la part du financement de l'État.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 22 OCTOBRE 2025
___________
M. Pierre-Antoine Levi. - Notre mission d'information est née de la volonté de comprendre les raisons du décalage observé, lors des derniers débats budgétaires, entre l'appréciation portée respectivement par le gouvernement et les universités sur la situation financière de ces dernières, notamment sur l'évaluation de leur trésorerie.
Dès le début de nos travaux, il y a un peu plus de six mois, nous avons compris que la source des difficultés dépassait la simple évaluation comptable. Ce diagnostic non partagé constitue en réalité un indicateur avancé de la défiance qui s'est installée entre les universités et les ministères chargés de leur pilotage, et plus généralement de l'insuffisante structuration de la stratégie de notre pays pour ses universités.
Alors que la commission des finances avait dans le même temps lancé un contrôle budgétaire relatif au financement à la performance des établissements, nous avons donc décidé, en accord avec les présidents Laurent Lafon et Claude Raynal, de travailler sur le cadre plus général des relations stratégiques entre l'État et les universités.
Pour mener à bien cette réflexion, nous avons souhaité partir de la parole des acteurs universitaires. Nous avons ainsi conduit trois tables rondes et quatre déplacements, qui nous ont permis de recueillir l'appréciation des présidents, vice-présidents et responsables administratifs de 25 universités de toute taille et aux situations financières très différentes.
M. David Ros. - Ces échanges nous ont permis de mettre en évidence la carence générale de l'État dans la définition de la politique universitaire de notre pays.
Cette carence est d'abord celle du législateur. Les objectifs et les missions confiés par la loi aux universités ont en effet été progressivement sédimentés dans pas moins de 12 articles du code de l'éducation. Si chacun d'entre eux peut apparaître justifié, leur accumulation aboutit aujourd'hui à un ensemble disparate d'items de portée inégale, non priorisés, parfois inconciliables et manifestement inapplicables dans leur entièreté. Cette loi bavarde alimente la confusion des acteurs universitaires, et fait courir le risque de la dilution de leur action - particulièrement en période de contrainte budgétaire.
Cette carence est également celle du gouvernement, qui ne respecte plus, depuis 2020, son obligation de définir tous les cinq ans une stratégie nationale concertée de l'enseignement supérieur, ou Stranes, telle que voulue par le législateur en 2013.
Cette lacune n'est pas compensée par la montée en puissance des contrats passés avec les établissements, sur lesquels le ministère nous indique reporter son travail stratégique. Les faibles financements associés aux actuels contrats d'objectifs, de moyens et de performance (ou Comp) ne leur confèrent pas la portée adéquate. Leur redimensionnement annoncé sous la forme des « Comp à 100 % », dont les contours restent largement à clarifier, intégrera des priorités définies par le seul ministère, sans cohérence d'ensemble entre des instruments par nature multiples.
Notre constat est donc clair : notre pays ne dispose actuellement d'aucun cap actualisé et concerté à l'échelle nationale pour son université. Il en découle un pilotage erratique, marqué par de nombreux impensés stratégiques, et dont les établissements sont contraints d'absorber les conséquences.
Mme Laurence Garnier. - Cette absence de boussole est notamment visible dans la régulation des activités de formation. Les établissements se trouvent en effet fortement contraints par la massification de leurs effectifs, qui résulte en partie de l'évolution de la fonction du baccalauréat : sous l'effet de l'augmentation du taux de réussite, il n'agit plus comme un filtre à l'entrée du supérieur. En pratique, les universités accueillent aujourd'hui 1,6 millions d'étudiants, soit 54 % des effectifs du supérieur, qui ont été multipliés par 9 depuis 1960.
Nous avons cherché à comprendre comment la procédure d'entrée dans le supérieur issue de la loi « Orientation et réussite des étudiants » de 2018, mise en application via Parcoursup, permettait d'assurer l'appariement entre les profils des bacheliers et les attendus des formations. Notre conclusion est que cet appariement ne se fait pas, ou trop peu, pour un grand nombre de candidats. La fixation des capacités d'accueil universitaires, qui est de la compétence des rectorats, est en effet effectuée de manière à permettre l'accès de tous les bacheliers qui le demandent au premier cycle universitaire. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est ainsi mise en oeuvre sous la forme d'un droit d'accès à l'université.
Cette situation est fortement préjudiciable à tout l'écosystème universitaire. Elle est d'abord source de désillusion pour les étudiants, qui se trouvent confrontés à de forts mécanismes de sélection dans la suite de leur cursus et à l'entrée dans la vie active. 36 % seulement des étudiants obtiennent leur licence en trois ans et 47 % en trois ou quatre ans : il existe donc bien une régulation des parcours universitaires. Elle se fait cependant de la plus insatisfaisante des manières, c'est-à-dire a posteriori et par l'échec.
Cette absence de sélection est regrettée par la plupart des présidents d'université que nous avons rencontrés. L'inscription d'étudiants n'ayant que très peu de chances de réussite fait peser une forte contrainte sur leur capacité à encadrer et à accompagner les étudiants, et dégrade globalement la qualité de leur formation. De nombreux établissements développent d'ailleurs des formations sélectives leur permettant de contourner cette difficulté, avec des doubles licences ou des diplômes d'établissement. Les étudiants et leurs familles se tournent quant à eux plus volontiers vers les parcours universitaires sélectifs, notamment les instituts universitaires de technologie (IUT) et le réseau Polytech.
Le coût de cet échec massif est enfin loin d'être neutre pour les finances publiques, puisqu'il est estimé par la Cour des comptes à 534 millions d'euros par cohorte d'étudiants.
M. Pierre-Antoine Levi. - Nous constatons ensuite que les universités ne sont pas seulement en manque de stratégie, mais également en manque de pilotage. La tutelle exercée par le ministère apparaît en effet lointaine, voire absente, tandis que l'accompagnement exercé par les rectorats s'apparente davantage à un ergotage administratif qu'à un pilotage stratégique.
Ces difficultés cumulées fondent enfin un manque de reconnaissance de l'université, qui constitue à la fois leur cause et leur conséquence.
Il se traduit d'abord par le déficit d'influence de l'université auprès des décideurs publics, qui sont principalement recrutés parmi les diplômés de grandes écoles, tandis que le doctorat reste peu valorisé.
En dépit de ses réussites objectives, l'université pâtit en outre d'une mauvaise image persistante auprès du grand public et des entreprises. Son activité de formation est vue comme peu exigeante et professionnalisante : un sondage Ipsos de 2023 classe à cet égard l'université en dernière position sur la plupart des items testés, derrière les grandes écoles, les BTS et les IUT.
Nous avons constaté avec surprise que cette perception se doublait d'un « signal prix » négatif : la modicité des tarifs universitaires semble avoir, de manière paradoxale, un effet négatif sur l'attractivité de certaines filières, notamment pour certains étudiants étrangers. La faiblesse des droits d'inscription ne reflète évidemment pas le coût de la formation universitaire : si le tarif de l'inscription en licence est actuellement fixé à 178 euros, la dépense annuelle moyenne de l'État pour un étudiant à l'université s'élève à 12 250 euros.
Ce manque de reconnaissance est à mettre en lien avec un manque de connaissance tout court du modèle universitaire. Reste cependant que face à l'essor des formations privées, le positionnement de l'université dans l'offre d'enseignement supérieur tend à se dégrader. Depuis 2018, les inscriptions dans le supérieur privé ont crû de 34 %, alors que les inscriptions à l'université ne progressent plus. Cette évolution doit constituer pour nous un signal d'alerte : la formation universitaire, qui constitue l'offre d'enseignement supérieur la plus accessible, indépendamment de l'origine sociale et du niveau de ressource, doit demeurer une référence de qualité pour nos concitoyens.
M. David Ros. - J'en viens à un deuxième ensemble de constats, qui concerne les effets de la carence stratégique sur le paysage universitaire. Nous relevons que les transformations impulsées par la puissance publique au cours des deux dernières décennies, qui ont visé à la différenciation des établissements ainsi qu'à leur autonomisation, se sont faites de manière fragmentée, sans vision d'ensemble, et avec de nombreux effets de bord.
Le processus de différenciation mis en oeuvre depuis 2010 a atteint l'objectif de structurer des universités « intensives en recherche » internationalement compétitives ; il a eu cependant eu des effets mal régulés au-delà de ces seuls établissements. La généralisation des financements sélectifs a favorisé la concentration des moyens sur ce seul type d'universités, tout en créant une mise en concurrence généralisée des établissements. Si l'on y ajoute la diversification des cadres de fonctionnement dérogatoires, au travers notamment du statut d'établissement public expérimental, on aboutit à une hétérogénéité croissante des établissements, qui fait courir le risque d'un éclatement de la notion même d'université.
Cette politique a en outre fait des « perdants ». Il s'agit principalement des établissements ayant une forte activité de formation pluridisciplinaire, avec un poids important du premier cycle et des filières de sciences humaines, et qui permettent l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur dans les territoires. Pour autant, toutes les petites universités ne sont pas en difficulté : en témoigne l'exemple de l'université de La Rochelle, qui a spécialisé ses activités de formation et de recherche autour des questions de littoral ; elle est ainsi devenue une référence sur ces sujets, ce qui lui permet de mobiliser des financements compétitifs importants.
Dans l'ensemble, nous constatons cependant que le pilotage au cas par cas déployé par le ministère ne permet pas la régulation d'ensemble nécessaire au fonctionnement d'un service public de qualité sur l'ensemble du territoire.
Nous regrettons ensuite que les universités ne disposent pas des moyens opérationnels nécessaires au déploiement d'une vision stratégique - ce qui témoigne par ailleurs d'une autonomisation limitée au regard des objectifs fixés en 2007.
Cette difficulté se traduit d'abord par le sous-calibrage des fonctions support des établissements, alors que leur fonctionnement appelle des compétences de plus en plus spécialisées.
Elle se traduit ensuite par le pilotage hésitant du processus de dévolution du patrimoine immobilier, qui a obéré son attractivité et n'a pas permis sa généralisation. Le financement de ce dispositif a en effet été réévalué en cours d'application, de sorte que seuls ses premiers bénéficiaires ont aujourd'hui la garantie de disposer des moyens permettant d'assurer la gestion du patrimoine transféré. Les montants en jeu sont considérables, puisque ces universités pionnières ont bénéficié d'une dotation totale de 546 millions d'euros sur 25 ans - contrairement à celles qui ont suivi, qui doivent s'appuyer sur les dotations de droit commun des contrats de plan État-région (CPER).
Mme Laurence Garnier. - Nous nous sommes ensuite plus spécifiquement intéressés aux conditions du pilotage financier des établissements, qui fonde à juste titre leur mécontentement.
L'absence de boussole du gouvernement se traduit en effet dans les errements de la subvention de leurs coûts fixes, qui nous est apparue à la fois illisible, inéquitable, imprévisible, court-termiste et sous-calibrée.
Il s'agit d'un enjeu majeur dans la mesure où les établissements restent très dépendants de leur subvention pour charges de service public, ou SCSP, qui représentait les trois quarts de leurs ressources en 2023. La progression des ressources propres a certes été importante au cours des quinze dernières années, notamment sous l'effet de la généralisation du financement par appels à projets. Néanmoins, leur dynamisme tend à s'essouffler, et leur caractère aléatoire ne garantit pas à ce jour la couverture des activités fondamentales de formation et de recherche, qui se déploient dans le temps long.
Or, pour répartir cette SCSP, la direction générale de l'enseignement supérieur, la Dgesip, travaille depuis 2016 sans modèle de répartition. Le processus d'allocation des moyens budgétaires se fait donc principalement sur la base d'équilibres historiques, et aboutit à de fortes disparités dans la subvention allouée à chaque établissement au regard de sa population étudiante. Cette situation nourrit un sentiment d'iniquité et d'opacité chez les établissements, que l'on ne peut que partager.
Le soutien budgétaire de l'État se traduit ensuite par son imprévisibilité dans la couverture des dépenses mises à la charge des établissements. Notre rapporteur budgétaire Stéphane Piednoir a mis en évidence, dans le cadre des trois dernières discussions sur le PLF, la non-compensation répétée par l'État de dépenses salariales décidées par lui, à laquelle s'ajoute le non- respect des « marches » de crédits prévues par la loi pour la programmation de la recherche (LPR). Ces arbitrages font peser la menace annuelle d'une augmentation exogène des dépenses des universités, ce qui déstabilise bien évidemment leurs budgets et les empêche de se projeter à l'échelle pluriannuelle.
L'État manque enfin de fiabilité dans le versement des dotations, créant en outre une incertitude financière à l'échelle infra-annuelle.
M. Pierre-Antoine Levi. Le pilotage financier des établissements se caractérise en deuxième lieu par l'absence de diagnostic partagé, entre les universités et l'État, sur la situation financière de ces dernières.
Cette divergence résulte en partie de la faible lisibilité de l'état des lieux disponible, et des insuffisances de la comptabilité des établissements, qui est ce jour peu fiable et non analytique.
Elle est surtout à mettre en lien avec la défiance marquée et réciproque qui s'est installée entre les acteurs du triptyque constitué par les établissements, la Dgesip et la direction du Budget du ministère de l'économie et des finances. Nous avons pu en prendre toute la mesure au cours de nos auditions, ainsi qu'au travers des réponses écrites de la Dgesip, formulées en des termes inhabituellement sévères. Nous avons ainsi été surpris de voir que le ministère n'hésitait pas à mettre en cause la « posture » de certains présidents d'université, qui selon lui se sentiraient « extérieurs à la sphère État ».
Nous considérons pour notre part, en suivant ici la Cour des comptes, que la situation financière des universités est indubitablement préoccupante. Si les situations individuelles des établissements sont évidemment très diverses, on note cependant une nette dynamique de dégradation depuis quatre ans : le résultat consolidé des établissements est devenu déficitaire en 2024, tandis que leur capacité d'investissement s'est réduite des deux tiers depuis 2021.
M. David Ros. - Dans ce contexte, les débats que nous avons en loi de finances se focalisent sur le montant très élevé de la trésorerie agrégée des établissements, qui constitue le seul indicateur positif de leur situation financière. Tandis que le gouvernement estime que ce montant, qu'il évalue à 5,7 milliards d'euros en 2023, permet aux universités d'absorber des mesures d'économies, celles-ci font valoir que l'essentiel de ce montant est fléché vers des dépenses programmées dans le cadre des contrats d'appel à projets, et doit donc être considéré comme indisponible.
Nous avons procédé en plusieurs étapes pour éclaircir ce débat très technique.
Nous avons tout d'abord constaté que la hausse de la trésorerie des universités résulte du cycle d'encaissement de leurs recettes, les dotations des appels à projets étant souvent versés en une ou deux fois pour des décaissements programmés sur plusieurs années. Ces quelque 6 milliards d'euros ne sont donc pas à mettre en lien avec un excès d'épargne, mais avec les modalités d'encaissement des financements sélectifs.
Nous estimons ensuite que la notion de trésorerie « fléchée » - dont, contrairement à ce qu'avance le gouvernement, aucune évaluation fiable n'est à ce jour disponible - ne constitue pas un outil de gestion pertinent. Nous ne contestons pas que les fonds issus des appels à projets soient affectés, sur le plan juridique, au financement d'activités programmées par contrat. Cela signifie que lorsque ces activités ont lieu, les établissements doivent pouvoir décaisser les montants nécessaires à leur financement. Cela ne signifie cependant pas, sur le plan comptable, qu'il soit impossible pour les établissements de disposer de la trésorerie correspondante en attendant - sauf à remettre en cause le principe d'unité de caisse.
Sur la base de ce raisonnement, le gouvernement souhaite inciter les établissements à basculer vers une « gestion dynamique » de leur trésorerie, c'est-à-dire utiliser ces abondantes disponibilités pour financer certaines dépenses de fonctionnement ou d'investissement, ou absorber des mesures d'économie.
Nous estimons que les conditions de cette évolution ne sont pas réunies à ce jour. Elle impliquerait en effet une réduction des marges de sécurité financière des établissements, et donc une certaine confiance dans la garantie apportée par l'État en cas de besoin de décaissement urgent ; au regard des éléments que nous vous avons exposés, cela nous paraît hasardeux. Le caractère erratique et insuffisamment articulé de l'allocation budgétaire aujourd'hui assurée par l'État, conjugué aux insuffisances du pilotage assuré par les établissements, ferait selon nous courir le risque de compromettre gravement la soutenabilité financière des universités au profit d'un gain budgétaire de court terme.
Mme Laurence Garnier. - Sur la base de ces constats, nous avons formulé 12 recommandations déclinées en 5 axes - dont le dernier est présenté à titre exploratoire, et qui feront l'objet d'un vote distinct. Ces recommandations sont irriguées par l'objectif de recréer les conditions de la confiance entre les acteurs, qui constitue selon nous un préalable et un élément indispensables à l'amélioration du pilotage stratégique des universités.
Le premier axe vise à créer un cadre stratégique à trois niveaux : la loi, qui doit définir de manière claire et intelligible les missions et les objectifs assignés aux universités ; la concertation entre les acteurs, qui doivent se prononcer tous les cinq ans sur les grandes lignes de la politique universitaire ainsi que sur une programmation budgétaire pluriannuelle ; le contrat, en l'occurrence les Comp, qui doivent garantir l'articulation entre ces priorités et les orientations stratégiques de chaque établissement.
C'est l'objet de nos recommandations n° 1 et n° 2.
M. Pierre-Antoine Levi. - Le deuxième axe vise à améliorer la connaissance de l'université par les décideurs publics et les citoyens.
Nous souhaitons à ce titre renforcer l'information sur les caractéristiques du modèle universitaire, ainsi que sur l'investissement que réalise l'État pour sa jeunesse en prenant en charge l'essentiel du coût des formations à l'université ; c'est l'objet de notre recommandation n° 3.
Nous appelons également, par notre recommandation n° 4, à renforcer les passerelles entre l'administration d'État et le monde universitaire, afin de favoriser leur connaissance mutuelle.
M. David Ros. - Le troisième axe vise à garantir la transparence et la prévisibilité de l'allocation de leurs moyens budgétaires aux universités.
Cela suppose selon nous de rebâtir les paramètres d'allocation de la SCSP, en précisant les critères pris en compte, en affirmant le principe de la prise en charge par l'État des mesures salariales nationales, et en tenant compte des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projets avant de décider de toute mesure d'économie : ce sont les orientations de notre recommandation n° 5.
Notre recommandation n° 6 vise à ne plus accroître la part des financements sélectifs dans les budgets des établissements, afin d'aboutir à moyen terme à un renforcement de leurs ressources budgétaires.
Par notre recommandation n° 7, nous souhaitons enfin généraliser la dévolution du patrimoine immobilier pour les établissements volontaires, en faisant évoluer la dotation d'accompagnement pour garantir son attractivité et sa soutenabilité.
Mme Laurence Garnier. - Le quatrième axe vise à moderniser la fonction financière des établissements, ce qui passe selon nous par la généralisation de la comptabilité analytique (c'est notre recommandation n° 8) et la montée en compétence des services support (c'est notre recommandation n° 9).
Nous souhaitons également développer de nouvelles possibilités d'expérimentation financière, dans le but principal de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation énergétique du bâti universitaire. Comme nous le proposons dans notre recommandation n° 11, cela peut passer par un élargissement du recours à l'emprunt, de manière très encadrée dans le contexte budgétaire, ainsi que par une expérimentation de la gestion dynamique de la trésorerie.
Nous souhaitons dans le même temps affirmer clairement, comme vient de vous l'exposer David Ros, que la mise en oeuvre généralisée de ce régime de gestion n'est pas à l'ordre du jour : tel est l'objet de notre recommandation n° 10.
M. Pierre-Antoine Levi. - L'axe n° 5, enfin, vise à ouvrir une réflexion nationale sur l'orientation étudiante et les tarifs universitaires.
Nous avons constaté tout au long de nos travaux que ces deux marqueurs très forts du modèle universitaire suscitaient des débats, en raison de certains effets négatifs pour les étudiants, les familles, les établissements et, à travers l'enjeu de finances publiques, l'ensemble des citoyens.
La manière de répondre aux questions soulevées n'a cependant fait l'objet d'un consensus ni entre les acteurs entendus, ni entre les rapporteurs. La concertation stratégique prévue par la première recommandation constituera dès lors le cadre idéal pour explorer ces sujets : c'est notre recommandation n° 12.
Permettez-moi quelques mots pour cadrer les échanges qui se déploieront à cette occasion - et sans doute dans notre salle de commission dans quelques instants.
Le débat sur la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire doit viser à mettre fin à la régulation par l'échec qui existe aujourd'hui. Il devra inclure une réflexion sur la fonction du baccalauréat et l'organisation du continuum entre le lycée et le premier cycle universitaire. Nous soulignons en outre que la notion de sélection à l'université se distingue nécessairement du régime de la sélection par le concours : il s'agit avant tout d'éviter l'accueil d'étudiants dont la probabilité de réussite est très faible et n'est pas susceptible d'être augmentée par un dispositif d'accompagnement ;
Selon nous, la réflexion sur les tarifs n'est pas liée à un enjeu d'augmentation des ressources universitaires - qui ne pourrait être que limitée au regard de la modicité des tarifs actuels. Elle doit porter sur la pertinence de la prise en charge par le budget de l'État du coût de la formation des étudiants, indépendamment du niveau de ressources des familles.
Tels sont, mes chers collègues, les principaux constats issus de cette mission très riche. Nous en avons tiré d'importantes leçons pour l'examen prochain de la loi de finances. Nos échanges avec les présidents d'université ont en outre permis d'approfondir les liens que nous avions commencé à tisser dans le cadre de nos travaux sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Nous avons enfin ouvert de nombreuses pistes de réflexion, qui pourront sans doute alimenter les travaux futurs de notre commission.
M. Yan Chantrel. - Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par les rapporteurs. Ce rapport traduit clairement une réalité que nous connaissons tous : des universités fragilisées par l'absence de stratégie nationale, le manque de cohérence dans le pilotage et l'insuffisance des moyens. L'université fait face à des défis structurels avec des effectifs en hausse de 15 % en vingt ans, sans recrutements ni capacités d'accueil correspondants, tout en devant absorber des surcoûts et des mesures salariales non compensés par l'État. La notion de confiance figure au coeur des préoccupations.
Nous partageons les constats et recommandations du premier axe, concernant la nécessaire clarification des missions et l'instauration d'une conférence stratégique quinquennale. Nous approuvons également le deuxième axe, qui vise à améliorer l'image et la reconnaissance de l'université française. Cette prise de conscience nous réjouit particulièrement, à l'heure où l'on entend encore trop souvent, y compris au Parlement, des propos caricaturaux à l'encontre de nos universités. Nous soutenons les propositions visant à mieux valoriser l'investissement national consenti dans l'enseignement supérieur et à favoriser les passerelles entre la haute fonction publique et le monde universitaire. Nous apportons également notre soutien aux axes n° 3 et n° 4. En matière de financement, nous approuvons la refondation d'un modèle de répartition plus clair et plus équitable, la prise en charge intégrale des mesures salariales par l'État, ainsi que le nécessaire rééquilibrage entre financement récurrent et appels à projets.
En revanche, nous nous opposerons fermement à l'axe n° 5, relatif à la sélection à l'entrée du premier cycle et au rehaussement des droits d'inscription. Il n'est pas question de transiger sur le principe d'égal accès à l'instruction, à la formation et à la culture, inscrit au coeur de notre bloc constitutionnel. L'université française doit demeurer ouverte à tous, sans barrière sociale déguisée. La quasi-gratuité des études ne constitue pas une anomalie, mais un choix républicain fondamental. Les effets délétères de la marchandisation du savoir, observés dans l'enseignement supérieur privé, doivent nous inciter à éviter cet écueil.
Nous rappelons en outre qu'une hausse des frais d'inscription n'apporterait qu'une recette marginale au regard des besoins réels des universités. C'est pourquoi, si l'axe n° 5 devait être adopté par la commission, nous serions contraints de nous opposer à l'ensemble des conclusions du rapport.
M. Stéphane Piednoir. - Je félicite les trois rapporteurs pour ce travail approfondi. Cette mission répond aux nombreux signaux d'alerte exprimés dans nos territoires. La situation budgétaire des universités se dégrade, avec des budgets désormais déficitaires de manière chronique, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Les trésoreries disponibles sont, pour la plupart, déjà fléchées vers des investissements engagés, limitant les marges de manoeuvre financière des établissements.
Les universités réclament de la clarté dans les règles qui s'appliquent à elles. Contrairement à celles des collectivités locales, leurs dotations budgétaires reposent sur un héritage historique dépourvu de cadre explicite. L'attribution de ces moyens est aléatoire et insuffisamment transparente ; cette situation est devenue intolérable. Les présidents d'université ne revendiquent pas un strict égalitarisme : ils demandent davantage de lisibilité dans la répartition de leurs ressources.
Face aux défis conjoints de la massification du nombre d'étudiants accueillis, de la rénovation énergétique de son patrimoine immobilier et de la modernisation des pratiques pédagogiques, notamment sous l'effet de l'intelligence artificielle, l'université connaît de profondes mutations, sans bénéficier d'une véritable impulsion nationale. Je soutiens pleinement la recommandation relative à la dévolution, pour les établissements qui le souhaitent, ainsi que la possibilité d'un recours encadré à l'emprunt, afin de répondre aux besoins d'investissement croissants.
La plus grande vigilance doit être maintenue sur le déploiement des contrats d'objectifs et de moyens. Il importe, parallèlement, de reconnaître aux universités un véritable droit d'initiative, notamment en matière de différenciation des droits d'inscription - en menant également une réforme globale du système de bourses.
Cette mission invite à une réflexion plus large sur la place et le rôle de l'université publique dans notre société, ainsi que sur le renforcement de son efficience. Nous nous heurtons aux paradoxes de la non-sélection et de l'ouverture à tous les bacheliers, lesquels revendiquent un droit à la poursuite d'études sans considérer l'impérieuse nécessité de leur insertion professionnelle. Faire des études ne saurait constituer une fin en soi : elles doivent permettre d'acquérir un savoir et des compétences ouvrant sur une insertion réussie. Nous avons aujourd'hui des générations de diplômés de master confrontés au chômage ou au sous-emploi. La sélection s'opère finalement par l'échec, soit au cours du parcours universitaire, soit au moment de l'entrée sur le marché du travail.
Je ne peux passer sous silence certaines dérives observées sur quelques campus, notamment récemment à Paris 8, où des actions à caractère antisémite ont été rapportées. Je salue le travail mené par Pierre-Antoine Levi sur cette question.
Nous devons collectivement redonner à l'université publique une image positive et restaurer la confiance. L'enjeu consiste à faire correspondre les profils des étudiants aux formations proposées, plutôt que d'adapter les formations à la demande immédiate, afin de construire une université utile à tous et pleinement au service de la société.
M. Pierre Ouzoulias. - Je me réjouis qu'il soit enfin possible de poser cette question fondamentale : quel rôle l'enseignement supérieur doit-il jouer pour notre société et pour la France ? J'ai toujours regretté que le classement de Shanghai soit érigé en unique référence, occultant la véritable mission de l'université. Celle-ci constitue avant tout un service public, au service de l'aménagement du territoire et de la promotion des générations futures, au bénéfice de l'économie de la connaissance. Dans ce domaine, un constat s'impose : l'Europe souffre d'un sous-investissement chronique, et la France ne fait pas exception. Nous risquons aujourd'hui d'être dépassés, faute de moyens suffisants alloués à la recherche et à la formation.
Le taux d'insertion professionnelle des étudiants demeure élevé - environ 85 % - et progresse avec le niveau de diplôme. Néanmoins, la France manque cruellement de places dans les écoles d'ingénieurs : notre pays devrait en former deux fois plus pour répondre aux besoins économiques et technologiques. Par ailleurs, de nombreux bacheliers professionnels se dirigent vers l'université, faute de places disponibles dans les IUT, qui recrutent majoritairement des bacheliers généraux.
J'attire votre attention sur la complexité inhérente à la détermination des capacités d'accueil. Nous avons adopté lundi une loi prévoyant que, pour les formations en santé, ces capacités doivent être fixées en fonction des besoins médicaux des territoires. Pour d'autres formations universitaires, cela me paraît plus ardu, alors que l'évolution du marché de l'emploi demeure largement imprévisible, en raison notamment des effets mal mesurés de l'intelligence artificielle. Face à la transformation rapide des métiers, je considère pour ma part qu'il convient de privilégier des formations généralistes, seules à même de préparer durablement les étudiants aux mutations à venir.
S'agissant enfin des droits d'inscription, je réaffirme mon attachement au principe d'universalité du service public : chacun doit contribuer à la même hauteur. La régulation tenant compte des ressources doit être opérée par l'impôt, et non par une différenciation des frais d'accès à l'enseignement supérieur.
M. Jean Hingray. - Les travaux de nos collègues rapporteurs mettent en évidence les tensions persistantes entre l'autonomie des universités et les contraintes liées à l'encadrement budgétaire. Le récent débat sur la loi de finances a illustré l'absence de diagnostic partagé sur les marges de manoeuvre réelles des établissements, avec une focalisation des discussions sur leur trésorerie et l'absence de compensation de certaines mesures salariales. Il est essentiel de clarifier les responsabilités de l'État dans le financement des missions fondamentales de l'enseignement supérieur, tout en instaurant un dialogue stratégique fondé sur la transparence et l'équité.
La recherche de ressources propres, si elle constitue une dynamique positive pour certains pôles d'excellence, ne doit pas fragiliser les universités qui assurent un maillage territorial indispensable et garantissent l'accès à une offre de formation de proximité. Le rapport formule des recommandations ambitieuses et ouvre un débat de fond, notamment à travers la recommandation n° 12.
Avec les membres du groupe centriste, nous exprimons notre soutien à l'ensemble des préconisations formulées dans ce rapport.
Mme Laure Darcos. - Je remercie les rapporteurs pour la qualité et la richesse de leur travail. Nombre de collègues de mon groupe se montrent favorables à la recommandation relative à une hausse des frais d'inscription, naturellement corrélée aux ressources des familles, car plusieurs présidents d'université nous confient qu'il sera difficile de trouver une autre voie de financement pérenne. J'y souscris également, à condition qu'elle ne s'accompagne d'aucun désengagement financier de l'État.
S'agissant de la sélection, le terme me semble particulièrement inapproprié. Dans les universités de province, une telle logique risquerait de conduire à la fermeture de certaines filières. Beaucoup de jeunes choisissent leur université avant tout pour sa proximité géographique, et n'envisagent pas d'intégrer un établissement parisien.
Le véritable enjeu, à mon sens, réside dans l'orientation, sans doute insuffisamment abordée dans votre rapport. Une orientation plus effective dès la fin du collège permettrait d'orienter davantage d'élèves vers des IUT professionnalisants et des filières concrètes. D'ailleurs, lorsque les universités remplissent pleinement leur mission, elles assurent elles-mêmes cette fonction d'orientation en première ou deuxième année.
Enfin, la baisse démographique annoncée dans les deux à trois prochaines années ne doit pas servir de prétexte à la fermeture de filières. Au contraire, elle pourrait offrir l'occasion d'améliorer les conditions d'étude et de réduire la surcharge des amphithéâtres. Je préfère ainsi parler de « régulation » plutôt que de « sélection », et j'aurais souhaité que la question de l'orientation soit explicitement intégrée aux recommandations du rapport.
Mme Mathilde Ollivier. - Je vous remercie pour cette mission d'information, qui intervient à un moment charnière pour l'enseignement supérieur. Les universités traversent aujourd'hui une crise de confiance avec l'État, marquée par des tensions budgétaires récurrentes et un manque de visibilité stratégique. Ces constats, nombreux et préoccupants, nourriront utilement nos débats budgétaires dans les semaines à venir.
Malgré les discours réaffirmant la priorité donnée à la jeunesse, les moyens alloués par étudiant diminuent depuis une décennie. Les établissements se trouvent fragilisés par un désengagement structurel de l'État, une succession de réformes et une absence de lisibilité financière. À la fin de l'année 2024, cinquante-huit universités sur soixante-quinze ont adopté un budget déficitaire.
Nous adhérons pleinement aux quatre premiers axes du rapport, qui appellent à une clarification des missions, à l'instauration d'une stratégie quinquennale partagée, ainsi qu'à la revalorisation du rôle et de l'image de l'université dans le débat public. Nous saluons également la volonté de renforcer la transparence dans l'allocation des moyens, notamment concernant la SCSP, et de clarifier la gestion des trésoreries issues des appels à projets.
En revanche, le cinquième axe suscite de profondes réserves. L'augmentation des frais d'inscription et la mise en place d'une sélection à l'entrée du premier cycle constituent, à nos yeux, une ligne rouge. Ces orientations s'éloignent de la vocation républicaine de l'université française, fondée sur l'égalité d'accès au savoir.
Toute hausse des frais, même progressive, romprait avec le principe - déjà relatif - de quasi-gratuité et accentuerait les inégalités sociales. Alors que la précarité étudiante ne cesse de s'aggraver, il serait irresponsable d'alourdir encore la charge financière des familles. Certaines situations extrêmes, comme celle de jeunes femmes confrontées à du marchandage sexuel pour accéder à un logement, rappellent l'urgence de renforcer la protection et le soutien aux étudiants.
La restauration de la confiance entre l'État et les universités passe par un engagement renouvelé de la puissance publique, non par une privatisation rampante du financement. La revalorisation des bourses, longtemps annoncée, demeure une priorité absolue. L'enseignement supérieur public doit être reconnu comme un investissement stratégique pour l'avenir du pays et le rayonnement de ses universités.
Pour ces raisons, nous voterons en faveur des quatre premiers axes du rapport, mais nous nous opposerons fermement au cinquième.
M. Bernard Fialaire. - Je tiens tout d'abord à féliciter les trois rapporteurs pour la qualité et la clarté de ce rapport. Nous avons en effet un besoin urgent d'éclaircissements sur la SCSP. Dans nos échanges avec les universités de nos territoires, nous observons des disparités considérables : par exemple, l'université de Lyon perçoit un tiers de moins par étudiant que celle de Toulouse. Cette situation crée des inégalités majeures entre établissements et souligne l'absence de critères d'attribution transparents, ce qui limite notre capacité à exercer pleinement notre mission de contrôle.
S'agissant de l'axe n° 5, la gratuité de l'enseignement supérieur a été instaurée par Édouard Herriot, qui fut mon prédécesseur en tant que sénateur du Rhône. Il n'est pas envisageable de revenir sur ce principe fondateur, ni d'introduire une sélection par l'argent, inefficace sur le plan budgétaire et profondément discriminante pour de nombreuses familles.
Il convient également de rappeler qu'un examen universitaire ne constitue pas un critère d'embauche. Certaines filières courtes, comme les IUT, se distinguent par leur efficacité et permettent, le cas échéant, des reprises d'études ultérieures. Nous devons préserver ces passerelles, essentielles à la mobilité et à la réussite des étudiants.
L'université n'a pas seulement pour vocation de délivrer des diplômes : elle transmet un savoir qui nourrit la réflexion, l'esprit critique et l'épanouissement de la jeunesse, richesse première de notre pays. C'est pourquoi je voterai en faveur des quatre premiers axes du rapport, mais je ne pourrai approuver le cinquième.
M. Max Brisson. - Je remercie nos collègues pour la qualité et l'exhaustivité de leur travail, qui ouvre une réflexion essentielle sur les relations entre l'État et les universités.
Depuis la loi LRU de 2007, l'autonomie demeure largement théorique, voire illusoire : les universités sont juridiquement autonomes, mais financièrement dépendantes, ce qui les empêche de bâtir une stratégie de long terme. Il est temps d'engager un second acte de la réforme de 2007 afin de leur garantir une autonomie financière réelle.
Le rapport formule des propositions pertinentes : repositionner l'État en stratège plutôt qu'en simple financeur, stabiliser le cadre budgétaire et diversifier les ressources. La recommandation n° 5 me semble décisive pour redonner des marges de manoeuvre aux établissements.
La refonte du système d'admission qui pourrait découler de la recommandation n° 12 apparaît également nécessaire. Parcoursup affecte aujourd'hui des bacheliers vers des formations peu attractives, poussant les universités à multiplier des cursus sans débouchés pour préserver leurs financements. Nous avons créé un droit à la poursuite d'études, sans droit à l'emploi, trompant ainsi une partie de la jeunesse.
Une régulation plus claire de l'accès au premier cycle, accompagnée d'une harmonisation des droits d'inscription et d'une réforme des bourses, s'impose pour redonner sens à notre enseignement supérieur. Les commissaires du groupe Les Républicains voteront en faveur de l'ensemble des recommandations et du rapport.
Mme Karine Daniel. - Je partage les constats présentés dans ce rapport, mais je souhaite insister sur la situation des étudiants en licence sans débouchés ou interrompant leur parcours. Lorsqu'on évoque le coût de ces formations inachevées, il convient également de considérer le coût d'opportunité : où seraient ces étudiants s'ils n'étaient pas à l'université ? Dans des formations plus onéreuses pour la collectivité ? Ou au chômage, avec un coût social bien supérieur ? L'université demeure l'option la moins coûteuse et la plus inclusive pour la société.
Je rejoins l'analyse de Bernard Fialaire : ces étudiants apprennent malgré tout, se réorientent, préparent des concours ou rejoignent d'autres filières. Leur parcours, même interrompu, participe à la construction de leur avenir. Une lecture plus fine de ces trajectoires s'impose, au-delà des 500 millions d'euros évoqués.
S'agissant des frais d'inscription, je reste attachée au principe d'universalité de l'accès à l'enseignement supérieur. Une différenciation selon les revenus familiaux serait particulièrement problématique pour les étudiants en transition entre dépendance et autonomie. L'augmentation des droits d'inscription poserait en outre un risque majeur pour la mixité sociale : elle rapprocherait le coût de l'université publique de celui du privé, créant une rupture d'égalité.
Enfin, concernant la trésorerie des universités, les travaux que je mène pour le Conseil de surveillance des investissements d'avenir (CSIA) montrent que les établissements, contraints de multiplier les appels à projets, voient parallèlement leurs moyens de fonctionnement se réduire. On leur reproche ensuite de disposer d'une trésorerie fléchée pour justifier ce désengagement de l'État. Cette situation paradoxale appelle une analyse approfondie et des réponses structurelles.
M. Jacques Grosperrin. - Je vous remercie pour ce rapport à la fois précis et éclairant. Le dernier débat budgétaire a mis en lumière la fragilité financière croissante des universités. À titre d'exemple, l'Université de Franche-Comté a dû assumer plus de 9 millions d'euros de charges non compensées.
Deux questions se posent dès lors : alors que les collectivités territoriales sont de plus en plus sollicitées pour pallier les insuffisances de la SCSP, ne conviendrait-il pas de repenser en profondeur le mode de financement de l'enseignement supérieur ? Par ailleurs, concernant le rôle des rectorats, la rénovation des contrats d'objectifs, de moyens et de performance permet-elle de mieux articuler priorités nationales et spécificités locales ?
Enfin, s'agissant de l'autonomie universitaire instaurée par la loi de 2007, le mode d'élection des présidents par leurs pairs nous interpelle. Valérie Pécresse avait, à l'époque, proposé un système de nomination par l'État ou d'élection par un comité indépendant. Si cette réforme avait abouti, nous aurions sans doute progressé plus rapidement sur la dévolution patrimoniale et la consolidation du modèle économique des universités. Il est temps, me semble-t-il, de dépasser les positions figées pour offrir à nos établissements les moyens de leur réussite.
Mme Annick Billon. - Je félicite les trois rapporteurs pour ce travail transpartisan, présentant un diagnostic lucide et des recommandations nécessaires. L'état des lieux qu'ils présentent est préoccupant. Leurs préconisations visent à renforcer la visibilité stratégique des universités, à leur assurer des financements pérennes, à consolider leur pilotage financier et à généraliser la comptabilité analytique -- ce qui devrait, à ce stade, constituer un socle de base pour tout établissement public d'enseignement supérieur. Il y a également urgence sur la réussite des étudiants.
Je souhaite insister sur l'axe n° 5, qui a suscité de nombreux échanges. À ceux qui s'opposent à une orientation plus sélective, j'aimerais poser une question simple : que propose-t-on aux 64 % d'étudiants qui n'obtiennent pas leur licence en trois ans ? Cette réalité témoigne d'une sélection déjà à l'oeuvre, mais par l'échec, avec un coût humain et financier considérable, tant pour les étudiants que pour les établissements.
L'approche préconisée par les rapporteurs ne relève pas d'une logique punitive, mais d'une recherche d'efficacité : mieux orienter, mieux accompagner, créer des passerelles entre les filières pour éviter que l'université ne devienne un lieu de désillusion. Une telle orientation sélective, fondée sur l'adéquation entre les profils et les parcours, constitue une condition indispensable à la réussite des étudiants. Déconnecter l'université du monde du travail reviendrait à l'affaiblir durablement.
M. Adel Ziane. - Je remercie les rapporteurs pour la qualité de leur travail et pour l'attention portée au terrain, notamment à travers les échanges menés avec les présidents d'université, qui attendaient depuis longtemps d'être entendus sur leurs préoccupations.
S'agissant de la trésorerie, je me félicite que ce rapport ait mis en lumière que les fonds détenus par les universités ne constituent pas une thésaurisation à long terme, mais bien des ressources affectées que l'on voudrait mobiliser pour compenser des déficits structurels. Les exemples de Lille ou de Paris 8 en témoignent clairement, révélant les difficultés persistantes de l'État à honorer pleinement ses obligations financières envers les établissements.
Sur la question des frais d'inscription, je souhaite rappeler que l'université joue un rôle fondamental dans l'accompagnement des publics les plus fragiles, conformément à l'engagement républicain que nous portons en tant que sénatrices et sénateurs. Nous devons répondre à l'enjeu d'équité territoriale, particulièrement sensible dans certaines régions.
Enfin, de nombreux présidents d'université s'interrogent sur les critères appliqués par la tutelle dans la répartition des dotations. Pourquoi certains établissements bénéficient-ils de moyens plus conséquents sans justification claire ? En outre, le recours croissant aux appels à projets perturbe la trésorerie et la comptabilité analytique, fausse les trajectoires budgétaires pluriannuelles et donne une image déformée de la gestion des établissements. Il devient indispensable de restaurer transparence et cohérence dans la répartition des moyens.
M. Pierre-Antoine Levi. - Je me réjouis de constater, à travers vos nombreuses interventions, l'intérêt marqué des sénateurs pour la question universitaire. Permettez-moi de rappeler quelques éléments de contexte relatifs à notre mission. Initialement centrée sur les relations financières entre l'État et les universités, notre démarche a dû être réorientée après le lancement, par la commission des finances, d'une mission parallèle sur le financement à la performance des établissements. Après concertation entre les présidents et rapporteurs des deux commissions, nous avons élargi notre périmètre aux relations stratégiques entre l'État et les universités, découvrant ainsi d'autres problématiques exprimées par de nombreux présidents d'université. Le rapport que nous présentons en restitue fidèlement la teneur. La marque de fabrique du Sénat repose sur la sincérité de ses travaux.
S'agissant de l'axe n° 5, nous avons volontairement adopté une approche mesurée. Le rapport ne formule pas de position normative, mais propose d'ouvrir une réflexion nationale sur l'orientation étudiante et sur les tarifs universitaires, sans remettre en cause le principe constitutionnel de l'égal accès à l'enseignement supérieur.
Enfin, je tiens à souligner la qualité du travail collectif mené, qui a permis d'aboutir à un rapport dense et exigeant avant l'ouverture des discussions budgétaires. Nos conclusions permettront d'enrichir nos débats sur le projet de loi de finances.
Mme Laurence Garnier. - S'agissant du vocabulaire employé -- sélection, régulation, orientation --, l'enjeu central réside dans l'optimisation de l'adéquation entre les formations et les profils d'étudiants, dans leur intérêt premier, mais aussi dans celui des établissements et de la Nation. L'université a pour mission fondamentale de préparer la jeunesse à une économie de la connaissance tout en favorisant son insertion dans le monde du travail.
C'est pourquoi nous avons délibérément retenu, dans l'intitulé de l'axe n° 5, le terme d'« orientation » plutôt que celui de sélection, qui ne doit en aucun cas être perçu comme un mécanisme d'exclusion. Notre démarche s'inscrit dans une logique d'accompagnement vers la réussite. Il s'agit avant tout d'un enjeu d'orientation éclairée et d'égalité des chances.
Seuls 36 % des étudiants obtiennent leur licence en trois ans, 47 % en quatre ans, et près de la moitié échouent encore après cinq ans. De nombreux établissements, à l'image d'Aix-Marseille Université, ont mis en place des dispositifs adaptés pour accompagner les profils les plus fragiles : ce sont des initiatives qu'il convient de saluer. Néanmoins, ces résultats interrogent quant à la bonne utilisation des fonds publics : cinq années d'études à un coût annuel de 12 250 euros pour un échec final appellent à une réflexion sur l'efficacité du système.
Les présidents d'université accueillent trop souvent des étudiants dont ils savent dès l'origine que le profil ne correspond pas à la formation choisie. Il nous faut les écouter pour éviter de former des générations d'étudiants exposés à l'échec et à la désillusion.
Concernant les droits d'inscription, leur augmentation ne constituerait pas une réponse structurelle au sous-financement des universités, puisqu'ils ne représentent aujourd'hui que 2,7 % de leurs budgets. La réflexion pourrait en revanche porter sur une modulation selon les revenus, accompagnée d'une refonte du système de bourses, sans effet d'aubaine pour l'État. Rappelons que l'étudiant s'acquitte de 178 euros pour une formation dont le coût réel pour la collectivité atteint 12 250 euros par an.
La précarité étudiante et la question du logement demeurent des enjeux majeurs, aggravés par l'élargissement des possibilités offertes par Parcoursup, qui favorise la mobilité géographique, mais accentue les contraintes résidentielles. La dévolution du patrimoine immobilier universitaire pourrait constituer une piste prometteuse, permettant aux établissements propriétaires d'engager directement des programmes de construction de logements étudiants.
Enfin, les présidents d'université ont souligné leurs difficultés à recruter des profils spécialisés, notamment en gestion de projets et en ingénierie immobilière. L'état très dégradé du bâti universitaire, que nous avons pu constater à Paris 8, pèse à la fois sur les conditions d'étude et sur l'attractivité des établissements.
L'objectif fondamental de notre mission reste la restauration de l'excellence universitaire française. Aujourd'hui, l'université n'attire plus que 54 % des effectifs de l'enseignement supérieur, de plus en plus d'étudiants se tournant vers le privé. Les propositions formulées visent toutes à réaffirmer l'excellence académique et le rayonnement de l'université publique.
M. David Ros. - Je remercie mes collègues pour l'intérêt manifesté à travers leurs questions. L'université représente l'avenir de notre jeunesse et de notre pays.
Les axes n° 1 à n° 4, consacrés aux moyens et à la stratégie, constituent le coeur de notre mission. Pour les territoires, le maillage des formations universitaires constitue un enjeu majeur. Les CPER ont été structurants, mais les contraintes budgétaires exigent une vision stratégique claire de l'État, au-delà des Comp et de leurs 850 indicateurs. Une vision quinquennale associant tous les acteurs s'impose.
Concernant l'axe n° 5 et sa proposition n° 12, je constate que le temps consacré à ce point dans notre débat préfigure l'attention médiatique qu'il recevra. Mon groupe a demandé le retrait de cet axe. Je trouve regrettable de compromettre l'unanimité du vote pour une simple proposition d'ouverture de débat qui aurait pu figurer dans le rapport sans constituer une recommandation. Si cet axe n° 5 est maintenu, le groupe socialiste votera contre ce rapport, et je me retirerai par cohérence et solidarité politiques.
M. Pierre Ouzoulias. - L'axe n° 5 justifierait à lui seul une mission d'information spécifique. La question ne se limite pas aux bourses, mais concerne également le logement étudiant. Les universités demandent d'ailleurs à récupérer certaines compétences du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous), ce qui constitue un enjeu majeur méritant un traitement approfondi.
Dans cette perspective, il serait plus cohérent et plus prudent de mettre cet axe en réserve afin d'en faire le cadre d'une future mission d'information dédiée, plus complète et mieux articulée. Au nom de mon groupe, je considère donc préférable que cet axe n° 5 soit retiré du rapport.
M. Laurent Lafon, président. - Les missions d'information sont arrêtées en bureau en début d'année ; il ne m'appartient donc pas d'anticiper les travaux à venir. Il me semble par ailleurs difficile, pour cette mission comme pour d'autres, de différer l'examen des points de divergence. Il convient au contraire de les assumer et de les acter clairement.
M. Max Brisson. - Nos rapporteurs envisagent avant tout d'ouvrir la réflexion sur ces questions, sans prétendre apporter de réponses définitives.
Mme Sylvie Robert. - L'axe n° 5 dépasse le périmètre initial de la mission d'information. Je propose de retenir les quatre premiers, et de mentionner en conclusion qu'une réflexion complémentaire pourra être engagée sur les sujets abordés dans l'axe n° 5.
Mme Mathilde Ollivier. - L'axe n° 5 formule plusieurs constats que nous ne partageons pas, notamment sur la sélectivité des formations et la gratuité des frais de scolarité. Ces sujets méritent une réflexion approfondie et autonome, qui ne saurait être traitée incidemment dans une mission initialement consacrée aux relations entre l'État et les universités. Je rejoins pleinement les positions exprimées par Sylvie Robert et Pierre Ouzoulias.
M. Stéphane Piednoir. - Ouvrir un débat sur une éventuelle régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire relève pleinement des relations stratégiques entre l'État et les universités. Il apparaît légitime que ce sujet figure dans le rapport. L'axe n° 5 ne parle pas de sélection, mais bien d'une réflexion sur l'orientation et la régulation.
De même, la question d'un éventuel ajustement des droits d'inscription s'inscrit dans une réflexion plus large sur la réforme des bourses, explicitement mentionnée dans la recommandation n° 12. Écarter cet axe reviendrait à écarter ce chantier. Ces propositions n'ont pas valeur de décision, mais visent à ouvrir un débat, susceptible d'être approfondi dans un travail ultérieur.
Mme Annick Billon. - Je suis favorable au maintien de l'axe n° 5.
Il est procédé au vote.
Les recommandations n° 1 à n° 11 sont adoptées à l'unanimité.
La recommandation n° 12 est adoptée à la majorité.
M. Laurent Lafon, président. - Deux options sont envisageables : soit les groupes ayant émis une position défavorable sur la recommandation n° 12 s'opposent à l'ensemble du rapport et, si j'ai bien compris ce qui a été exprimé, notre collègue David Ros se retire comme rapporteur, soit ils votent en faveur de son adoption, avec la mention explicite que l'axe n° 5 n'a pas recueilli l'approbation de l'ensemble des groupes, accompagnée le cas échéant d'une contribution du rapporteur qui porte cette position.
Mme Sylvie Robert. - Nous retenons la première option et annonçons notre retrait.
M. Laurent Lafon, président. - Entendu.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 18 mars 2025
- Association des villes universitaires de France (Avuf) : MM. Xavier LATOUR, administrateur national délégué au financement des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et François RIO, délégué général.
Table ronde de chercheurs et d'experts sur l'organisation des universités
- Mme Christine MUSSELIN, directrice de recherche émérite au centre de sociologie des organisations (CSO) ;
- M. Laurent BATSCH, ancien président de l'université Paris-Dauphine et professeur émérite ;
- M. Bernard DIZAMBOURG, ancien inspecteur général honoraire de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et ancien président de l'université Paris-Est Créteil (UPEC).
Mardi 25 mars 2025
- Association des directeurs financiers d'établissements publics d'enseignement supérieur (ADF) : M. Alain SCORDEL, directeur des affaires financières et des achats à l'Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP).
- Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) : MM. Dominique KERVADEC, inspecteur général, Olivier ENGEL, inspecteur général et Mme Mélanie CAILLOT, inspectrice générale.
- Agence nationale de la recherche (ANR) : Mme Claire GIRY, présidente-directrice générale, M. Vincent COTTET, directeur général délégué à l'administration et au budget et Mme Cécile SCHOU, conseillère pour les relations institutionnelles.
Mardi 8 avril 2025
- Alliance des universités de recherche et de formation (Auref) : MM. Xavier LEROUX, président et Éric BLOND, membre.
- Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) : MM. Olivier GINEZ, directeur général, Sébastien MARIA, sous-directeur du financement et Géraud DE MARCILLAC, chef du service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier.
Table ronde des présidents d'université
- Université de Lyon (ComUE Lyon Saint-Etienne) : Mme Nathalie DOMPNIER, présidente ;
- Université Toulouse I Capitole : M. Hugues KENFACK, président ;
- Université Paris Nanterre : Mme Caroline ROLLAND-DIAMOND, présidente ;
- La Rochelle Université : M. Gérard BLANCHARD, président ;
- Université Toulouse Jean Jaurès : Mme Emmanuelle GARNIER, présidente ;
- Université Paris 8 Saint-Denis : Mme Annick ALLAIGRE, présidente.
Mercredi 14 mai 2025
- Départements de France et Régions de France : MM. Bruno FAURE, président du département du Cantal, Olivier DAVID, vice-président vie étudiante, enseignement supérieur et recherche de la région Bretagne et Mme Laura LEHMANN, conseillère santé, social, formations sanitaires et sociales et enseignement supérieur.
- Cour des comptes : M. Michel BOUVARD, conseiller-maître à la troisième chambre (éducation, jeunesse et sports, enseignement supérieur, recherche, culture et communication) et Mme Delphine CERVELLE, conseillère référendaire, responsable du secteur enseignement supérieur.
Mercredi 21 mai 2025
- Udice et l'Initiative : M. Dean LEWIS, vice-président de l'Udice, président de l'université de Bordeaux, Mme Carine BERNAULT, présidente de l'Initiative, présidente de Nantes Université, MM. Serge DEFOIS, délégué général de l'Initiative, vice-président stratégie et développement de Nantes Université et Laurent GATINEAU, membre de l'Initiative, président de CY Cergy Paris Université.
- France Universités : MM. Lamri ADOUI, président et Antoine GUERY, chargé des relations parlementaires et institutionnelles.
Jeudi 22 mai 2025
- M. Stéphane CALVIAC, ancien sous-directeur du financement à la Dgesip, ancien directeur général des services de l'université de La Rochelle.
- M. Bruno BOUCHARD, président de l'Université Paris-Dauphine-PSL.
Mercredi 11 juin 2025
- Mmes Sylvie RETAILLEAU, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ancienne présidente de l'université Paris-Saclay, professeure de l'université Paris-Saclay en physique et Naomi PERES, ancienne directrice de cabinet de Sylvie Retailleau.
- Direction du Budget du ministère de l'économie et des finances : MM. Julien TANNEAU, chef du bureau recherche enseignement supérieur et Kévin MBA-ALLOUMBA, adjoint au chef de bureau de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Mercredi 18 juin 2025
Table ronde des présidents d'université
- Université de Tours : M. Philippe ROINGEARD, président ;
- Université de Bretagne Occidentale : M. Patrick OLIVARD, président ;
- Université d'Orléans : M. Éric BLOND, président ;
- Université Savoie Mont-Blanc : M. Philippe BRIAND, président.
Mercredi 25 juin 2025
Table ronde des présidents d'université
- Université Paris 2 Panthéon-Assas : M. Stéphane BRACONNIER, président ;
- Université de Lille : M. Régis BORDET, président ;
- Université Paris-Saclay : MM. Camille GALAP, président et Julien SEMPÉRÉ, directeur général des services.
Mardi 14 octobre 2025
- Mme Isabelle PRAT, rectrice déléguée pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation de la région académique Île-de-France.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
JEUDI 12 JUIN 2025 : SAINT-DENIS (93)
Université Paris 8 Saint-Denis : M. Arnaud LAIMÉ, président, M. Pierre-Olivier CHAUMET, vice-président du conseil d'administration, M. André-Max BOULANGER, vice-président aux moyens et au budget, Mme Diane BROSSARD, directrice de cabinet, Mme Nathalie VINCENT, directrice générale des services et M. Mohamed HAMDOUN, directeur général des services adjoint chargé du pilotage des moyens, des emplois et de la masse salariale.
JEUDI 17 JUILLET 2025 : ANGERS (49)
Université d'Angers : Mme Françoise GROLLEAU, présidente, M. Philippe LERICHE, premier vice-président, Mme Isabelle MATHIEU, vice-présidente à la formation et à la vie étudiante, M. Éric DELABAERE, vice-président politique ressources humaines et dialogue social et M. Laurent BORDET, vice-président à la vie étudiante et aux campus.
JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 : MARSEILLE (13)
Université Aix Marseille : M. Éric BERTON, président, Mme Maryline CRIVELLE, vice-présidente du conseil d'administration, Mme Aurélie PHILIPPE, directrice générale des services, M. Damien VOGEL, directeur général des services adjoint en charge du pilotage et des moyens, M. Denis BERTIN, vice-président de l'université en charge de la fondation Amidex, M. Patrice VANELLE, vice-président relation avec les collectivités territoriales et le monde politique, M. Stefan ENOCH, vice-chargé de la recherche, M. Damien VERHAEGHE, vice-président chargé de la richesse humaine et du patrimoine, directeur de cabinet, M. Christophe PELLEGRINO, vice-président délégué au pilotage des formations, Mme Florence MESSINA, directrice des affaires financières et M. Raphaël ZGANIC-AUBERT, agent comptable.
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 : PARIS (75)
Université Paris Cité : M. Edouard KAMINSKI, président, Mme Claire BORDES, directrice de cabinet, et M. David CLÉMENT, directeur général des services.
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ACRONYMES
UTILISÉS
DANS LE RAPPORT
ANR : Agence nationale de la recherche
Comp : Contrat d'objectifs, de moyens et de performance
CPER : Contrat de plan État-Région
Dgesip : Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
DGRI : Direction générale de la recherche et de l'innovation
Eesri : État de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
EPE : Établissement public expérimental
EPSCP : Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Esri : Enseignement supérieur, recherche et innovation
IGESR : Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
INSP : Institut national du service public
SCSP : Subvention pour charges de service public
SHS : Sciences humaines et sociales
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES
RECOMMANDATIONS
|
N° |
Recommandations |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
Premier
axe |
||||
|
1 |
Clarifier et prioriser les dispositions législatives du code de l'éduction relatives aux missions et aux objectifs des établissements universitaires |
Parlement |
Après la conférence stratégique |
Loi |
|
2 |
Instituer une conférence stratégique quinquennale réunissant l'ensemble des parties prenantes pour déterminer les objectifs et les priorités de la politique universitaire nationale, ainsi qu'un ensemble de variables en découlant pour la négociation des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) |
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
2026 |
Textes réglementaires |
|
Deuxième axe |
||||
|
3 |
Mieux communiquer sur les réussites de l'université et sur l'investissement de l'État pour Mieux communiquer sur les réussites de l'université et sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse, en faisant notamment connaître le coût effectif de la formation universitaire (soit en moyenne 12 250 euros par an et par étudiant) |
Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche |
Dès maintenant |
Facturation |
|
4 |
Favoriser les échanges et les parcours croisés entre la haute fonction publique et le monde universitaire, notamment en accroissant le recrutement de diplômés du doctorat parmi les personnels titulaires de catégorie A + et en développant les stages INSP dans les établissements |
Ministère de la fonction publique Institut national du service public |
Dès maintenant |
Textes réglementaires |
|
Troisième axe |
||||
|
5 |
Redonner de la visibilité aux établissements sur l'évolution de leurs moyens financiers, en précisant de manière transparente les éléments pris en compte dans la détermination du montant de la SCSP, de manière à assurer la couverture du socle du fonctionnement des établissements ; affirmant le principe de la prise en charge par l'État des mesures salariales décidées à l'échelle nationale ; tenant compte, pour la définition de la ressource budgétaire, des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projet |
Ministère de l'économie et des finances Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Projet de loi de finances pour 2026 |
Loi de finances |
|
6 |
Rééquilibrer la part respective des financements nationaux alloués via la SCSP et les procédures d'appel à projets compétitif |
Ministère de l'économie et des finances Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Dès maintenant |
Loi de finances |
|
7 |
Généraliser, pour les établissements volontaires, une dévolution du patrimoine immobilier assortie d'une dotation d'accompagnement pluriannuelle fusionnant l'ensemble des financements immobiliers des établissements |
Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche Direction de l'immobilier de l'État |
De manière progressive, |
Textes réglementaires |
|
Quatrième axe |
||||
|
8 |
Généraliser la comptabilité analytique et développer les outils comptables permettant la connaissance actualisée du montant des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre de leurs appels à projets |
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Dès maintenant |
Textes réglementaires |
|
9 |
Favoriser la montée en compétence des services support en renforçant leur attractivité, en professionnalisant les fonctions relatives à la gestion immobilière et aux appels à projets, et en assurant un accompagnement adapté par les services rectoraux |
Rectorats académiques Établissements |
Dès maintenant |
Pratique administrative |
|
10 |
Les conditions de sa mise en oeuvre par les établissements n'étant pas réunies, suspendre les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des universités |
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère de l'économie et des finances |
Dès maintenant |
Loi de finances |
|
11 |
Développer, pour un échantillon réduit d'établissements volontaires, des possibilités d'expérimentation financière concernant notamment la gestion dynamique de la trésorerie et l'élargissement des possibilités de recours à l'emprunt, dans le but principal de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation énergétique du bâti universitaire |
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Dès maintenant |
Textes réglementaires |
|
Cinquième axe |
||||
|
12 |
Dans le cadre de la conférence stratégique quinquennale, ouvrir la réflexion sur la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire et les conditions d'un rehaussement national des droits d'inscription, de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire la part du financement de l'État. |
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
2026 |
Conférence stratégique quinquennale |
* 1 Rapport d'information n° 723 (2024-2025) du 11 juin 2025 sur la contractualisation à la performance dans l'enseignement supérieur, fait au nom de la commission des finances du Sénat par Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteure.
* 2 La plupart des dispositions figurant initialement dans le chapitre concerné du code de l'éducation sont issues de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite loi « Savary ». Elles ont principalement été enrichies par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) et la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. D'autres ajouts résultent de textes plus ciblés, comme celui récemment opéré par la loi n° 2025-732 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur.
* 3 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
* 4 Dont le rapport final a proposé 5 axes stratégiques, 3 leviers et 40 propositions visant à favoriser l'émergence d'une « société apprenante ».
* 5 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche, dite « LPR ».
* 6 Parmi ces objectifs figurent notamment le déploiement de formations préparant les étudiants à exercer des métiers d'avenir, en tension ou en évolution ; la conduite d'actions concourant au bien-être et à la réussite des étudiants ; le développement de la recherche et de l'innovation au meilleur niveau européen et international ; la transition écologique et le développement soutenable ; l'optimisation de la gestion et du pilotage de l'établissement.
* 7 Cour des comptes, Les contrats d'objectifs, de moyens et de performance (COMP) conclus entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur, audit flash du 14 mars 2025.
* 8 Dans le même sens que les observations formulées sur la multiplicité des objectifs assignés par la loi aux universités, Vanina Paoli-Gagin souligne par ailleurs le nombre « délirant » et donc « contre-productif » d'indicateurs associés aux Comp.
* 9 Il s'agit des dix établissements des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine.
* 10 Prévue par l'article L. 613-1 du code de l'éducation, issu de l'article 37 de la loi ESR de 2013.
* 11 France Universités insiste ici sur la nécessité de respecter une cohérence entre les objectifs que se donne chaque établissement, sur le fondement de son Comp, en matière de formation et de recherche, et les critères de son évaluation a posteriori par le Hcéres.
* 12 Le rectorat académique de la région Île-de-France, dans laquelle sont passés 39 Comp, insiste cependant sur la nécessité d'une mise en oeuvre échelonnée de la réforme ainsi que du renforcement et de la montée en compétence de ses ressources humaines.
* 13 État de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en France n° 18, publié sur le site Internet du MESR.
* 14 Note Flash du SIES n° 12, juin 2024.
* 15 L'article L. 612-3 prévoit en effet que « le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ».
* 16 Le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui relève du bloc de constitutionnalité, dispose que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ».
* 17 Décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018, par laquelle le Conseil constitutionnel a retenu, au sujet de la mise en place de Parcoursup par la loi ORE de 2018, que le législateur n'a pas méconnu le principe d'égal accès à l'instruction en prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation ainsi que des acquis et compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l'acceptation par eux de dispositifs d'accompagnement et de formation.
* 18 L'article L. 123-2 du code de l'éducation prévoit à ce titre que le service public de l'enseignement supérieur « contribue à la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible », tandis que l'article L. 123-3 prévoit que les établissements assurant le service public de l'enseignement supérieur ont pour missions « l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ».
* 19 Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.
* 20 Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.
* 21 Cette procédure est venue se substituer au dispositif « Admission Post-Bac », qui reposait sur le principe du tirage au sort pour l'admission dans les filières non sélectives les plus demandées.
* 22 Éléments figurant sur la foire aux questions (FAQ) en ligne sur le fonctionnement de Parcoursup.
* 23 Les observations qui suivent portent sur les conséquences de ces modalités d'accès dans le cadre universitaire, et non sur le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, qui a fait l'objet de nombreux travaux récents - notamment le rapport d'information de Jacques Grosperrin, en date du 28 juin 2023, au nom de la commission de la culture du Sénat.
* 24 Selon les précisions apportées par Isabelle Prat, rectrice déléguée pour l'Esri de la région académique Île-de-France, cette situation résulte de la forte attractivité des établissements de la région, associée au fait que de nombreux candidats ont formulé leurs voeux uniquement en direction de cette région (les candidats ayant la possibilité de faire porter l'ensemble de leurs voeux sur les établissements d'une seule région).
* 25 La Cour indique que 53,8 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé » (qui représentent 28,7 % des inscrits) obtiennent leur licence en trois ou quatre ans, contre seulement 38,1 % des étudiants provenant d'un milieu social « défavorisé » (23,1 % des inscrits).
* 26 Dans sa version issue de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat.
* 27 Une université a ainsi mentionné la situation d'un étudiant en licence de langues, parcours vietnamien, qui se voyait proposer une admission en master de sciences physiques.
* 28 Les rectorats n'ont donc accès ni aux informations sur la formation suivie en licence, ni aux résultats académiques des étudiants.
* 29 Selon la terminologie mentionnée par Pierre Lemistre dans « Démocratisations ségrégatives et parcours éducatifs des bac+5 : une étude pour trois générations de diplômés de bac+5 », Lien social et Politiques, (89), 2022.
* 30 Les données de cette étude portent sur les « primo sortants » de formation initiale entre octobre 2016 et octobre 2017, interrogés en 2020. Les données relatives aux titulaires d'un master excluent les jeunes ayant obtenu un autre type de diplôme non universitaire conférant le grade de master (exemples : mastère, diplôme de grandes écoles, etc.).
* 31 Selon Philippe Lemistre, l'évolution constatée sur la décennie 2000-2010 résulte notamment de l'impulsion du ministère, qui a accrédité nombre de masters.
* 32 Données Insee.
* 33 Cet effet protecteur n'est cependant pas observé pour les diplômés de licence. L'Eesri relève à ce propos que « les trajectoires des sortants de licence générale, en particulier à l'issue des filières LSH, se caractérisent par leurs difficultés sur le marché du travail, au point d'être parfois comparables aux parcours des non-diplômés de l'enseignement supérieur ».
* 34 Sur une échelle de 0 à 5, une faible compétence se caractérise par un classement au niveau 1, qui correspond à une compréhension limitée à de très courts textes contenant peu d'informations parasites.
* 35 Il s'agit de cursus généralistes et pluridisciplinaires organisés en partenariat entre des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics et des établissements d'enseignement supérieur. Environ quarante CPES sont accessibles sur Parcoursup.
* 36 Peter Turchin, Le Chaos qui vient. Élites, contre-élites, et la voie de la désintégration politique, octobre 2024.
* 37 Le gouvernement Chirac I du 28 mai 1974 comprenait un secrétaire d'État aux Universités de plein exercice, Jean-Pierre-Soisson. Depuis cette date, ce portefeuille a été confié à des ministres ou des secrétaires d'État tantôt de plein exercice, tantôt rattachés au ministre chargé de l'Éducation nationale, avec un champ de compétence le plus souvent élargi à la recherche.
* 38 Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par l'article 10 du décret n° 2021-790 du 22 juin 2021.
* 39 S'y ajoutent, d'une part, la fixation du cadre national des formations et de la structure des niveaux, la mise en oeuvre d'une politique d'orientation et de préparation à l'insertion professionnelle, le suivi des questions relatives aux établissements privés, la promotion de la réussite et de l'amélioration des conditions de vie étudiantes, l'exercice de la tutelle sur le centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous), d'autre part, la coordination de l'ensemble de ces politiques à l'échelle européenne.
* 40 Dont les compétences sont prévues par l'article R. 222-16 du code de l'éducation.
* 41 Il s'agit, en application de l'article R. 222-16-3, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, du Grand Est, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, de Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
* 42 Rapport d'information n° 723 (2024-2025) du 11 juin 2025 sur la contractualisation à la performance dans l'enseignement supérieur, fait au nom de la commission des finances du Sénat par Mme Vanina Paoli-Gagin.
* 43 Circulaire du 5 septembre 2025, non publiée et communiquée à la mission d'information.
* 44 Renforcer la déconcentration en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, circulaire du 11 août 2025, NOR : MENG2523527C.
* 45 54,4 % des effectifs de l'enseignement supérieur en 2022, selon l'état de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (EESRI) publié par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2025.
* 46 À l'occasion du congrès tenu le 13 janvier 2022 à l'occasion de son cinquantième anniversaire, France Universités se fixait ainsi pour objectif de « donner à voir le modèle universitaire français et d'en accroître la lisibilité », ce qui renvoie en creux à la méconnaissance générale des universités.
* 47 L'enseignement supérieur français est organisé, depuis la Révolution française, selon une logique duale : il comprend d'une part des universités, qui délivrent des diplômes nationaux et in fine, le doctorat, d'autre part des grandes écoles, qui recrutent majoritairement des étudiants issus de classes préparatoires. Cette scission résulte à l'origine de la méfiance de la Convention envers des universités alors perçues comme l'incarnation des privilèges et des corporations. Voir à ce propos l'étude de Guillaume Tronchet « Universités et grandes écoles : perspectives historiques sur une singularité française ».
* 48 Corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées, des Mines, des ingénieurs de l'armement et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
* 49 Notamment le Conseil d'État, la Cour des comptes et l'Inspection générale des Finances (IGF).
* 50 Sébastien Bazin, groupe Accor, université Panthéon-Sorbonne ; Florent Menegaux, Michelin, université Paris-Dauphine ; Daniel Julien, Teleperformance, université Paris-Nanterre.
* 51 ANRT, Pour un grand plan national pour le doctorat, octobre 2023.
* 52 Ces recommandations sont celles de la mission lancée le 1er décembre 2023 par Sylvie Retailleau, alors ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et Roland Lescure, alors ministre de l'Industrie.
* 53 Initiative docteurs et administrations, Recrutement et emploi des docteurs dans les administrations publiques, octobre 2021.
* 54 Décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat.
* 55 Décret n° 2024-680 du 5 juillet 2024 reconduisant pour deux années le concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat.
* 56 Notamment la politique d'innovation agricole, la commande publique durable ou l'utilisation de l'IA pour le traitement de données sensibles.
* 57 Intégré au bloc de constitutionnalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.
* 58 Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019.
* 59 Conseil d'État, 1er juillet 2020, n° 430121. Par cette décision, le Conseil d'État a considéré que le montant maximum des frais applicables aux étudiants extracommunautaires, fixé à 2 770 € en licence et 3 770 € en master, représentant respectivement 30% et 40 % du coût annuel moyen par étudiant, satisfaisait à l'exigence constitutionnelle de gratuité.
* 60 Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prévu par l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951.
* 61 Mesuré par l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) au mois de janvier précédant l'année universitaire en question.
* 62 S'y ajoute le montant acquitté au titre de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), qui s'élève à 105 euros pour l'année 2025-2026.
* 63 Le Conseil d'État ayant précisé dans la décision précitée que « le principe d'égal accès à l'instruction et l'exigence constitutionnelle de gratuité s'appliquent à l'enseignement supérieur public en ce qu'il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation »
* 64 Les diplômes d'établissement se distinguent des diplômes nationaux qui, en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, confèrent les grades et les titres universitaires et donnent les mêmes droits à tous leurs titulaires. Les diplômes d'université (DU), en particulier, ont souvent vocation à apporter une spécialisation dans le parcours des étudiants. Certains diplômes d'établissement reconnus par le MESR confèrent à leurs titulaires le grade de licence ou de master.
* 65 Transmis aux rapporteurs et non publié à ce jour.
* 66 Contre 16 730 euros pour un étudiant en STS et 18 560 euros pour un étudiant en CPGE.
* 67 Le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif a ainsi relevé que « l'idée selon laquelle le prix constitue un indice de la qualité peut être intégrée par un certain nombre de familles », alors que l'enseignement supérieur est considéré comme un « investissement » (rapport d'information n° 2458 du 10 avril 2024, présenté par Béatrice Descamps et Estelle Folest, députées).
* 68 Établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général.
* 69 Ces tarifs sont à mettre en lien avec le coût moyen de la formation d'ingénieur, évalué à 58 909 euros annuels par une note du Conseil d'analyse économique (CAE) de décembre 2021 (« Enseignement supérieur : pour un investissement plus juste et plus efficace »).
* 70 Soit parce qu'ils en font la demande en raison de leur situation personnelle (cette situation concerne notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi), soit parce que leur inscription « répond aux orientations stratégiques de l'établissement ».
* 71 Données provisoires.
* 72 Il s'agit de l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, rattachée à Sorbonne Université et membre de la conférence des grandes écoles (CGE).
* 73 Dans le cadre de son rapport « Universités et territoires » rendu public le 7 février 2023.
* 74 L'enseignement supérieur en arts plastiques, communication à la commission des finances du Sénat, décembre 2020.
* 75 Le rapport de la Cour cite à ce propos quatre oscars pour les meilleurs effets spéciaux (Gravity, Benjamin Button, Matrix 2, Logorama), un prix du jury au festival du film d'animation (Duku space Marine), un grand prix Siggraph Asia (Chase Me), un césar technique (Les Fées spéciales) ainsi que le césar du meilleur film d'animation (Dilili à Paris).
* 76 La première école polytechnique universitaire a été créée le 1er janvier 2000 au sein de l'université de Nantes. Le réseau regroupe aujourd'hui 16 écoles publiques et 5 écoles associées, qui délivrent des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission des titres d'ingénieur. Après un cycle préparatoire de deux ans, les étudiants accèdent à un parcours de spécialité à partir de la troisième année.
* 77 Selon l'appel à projets lancé en 2014, les établissements labellisés Idex sont « des universités de recherche de rayonnement mondial disposant d'une puissance et d'un impact scientifique de tout premier plan dans de larges champs de la connaissance ».
* 78 Selon le même appel à projets, les établissements labellisés Isites sont « des universités qui valorisent des atouts scientifiques thématiques plus concentrés, distinctifs, reconnus sur le plan international, et qui en font un levier d'entraînement et un point d'appui de leur stratégie de développement et de partenariat avec le monde économique ».
* 79 PIA 1 en 2010, PIA 2 en 2013, PIA 3 en 2017, PIA 4 en 2021.
* 80 Ce statut d'établissement public est hérité de la loi Faure du 12 novembre 1968 et de la loi Savary précitée du 26 janvier 1984.
* 81 Créées par la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 précitée. Cette loi a supprimé les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), instruments de coopération issus de la loi de programme pour la recherche de 2006, qui disposaient alors de trois possibilités : la création d'un nouvel établissement résultant de la fusion de ses parties, leur regroupement sous la forme d'une ComUE, ou le rattachement à une université.
* 82 Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
* 83 Il s'agit de l'Université Paris Cité, l'Université Paris-Saclay, l'Université Paris-Panthéon-Assas, CY Cergy Paris Université, l'Université Gustave Eiffel, l'Université de Montpellier, Nantes Université, L'Université de Lille, l'Université Polytechnique Hauts-de-France, l'Université de Côte d'Azur, l'Université Grenoble Alpes, l'Université Clermont Auvergne, l'Université de Rennes, l'Université Toulouse Capitole, l'Institut polytechnique de Paris, l'Université PSL, l'Université Marie et Louise Pasteur, l'Université de Toulouse, l'Université Bourgogne Europe, l'Université Jean Monnet, Nîmes Université, et enfin l'Université de Montpellier Paul Valéry.
* 84 La direction du budget relève à ce propos que la part de ces financements bénéficiant directement aux seules universités est difficile à évaluer, du fait de l'attribution d'une large partie des financements compétitifs à des unités mixtes de recherche (UMR) ou à des projets associant universités et organismes de recherche. Stéphane Calviac a fourni une estimation des ressources propres des universités sur la base du rapport annuel de performance (RAP) du programme 150, selon laquelle les ressources propres des universités se sont élevées à un peu plus de 1,9 Md€ en 2024, soit 11,7 % de la totalité de leurs recettes.
* 85 Stéphane Calviac relève à ce titre qu'entre 2014 (date à laquelle toutes les universités sont entrées dans le régime des responsabilités et compétences élargies) et 2022, les ressources globales des établissements ont progressé de 18 % en euros courants, quand les effectifs étudiants se sont accrus de 8,5 % et l'inflation a atteint 12 %. Au total, la dépense moyenne par étudiant est passée de 13 450 euros en 2009, date à laquelle elle a atteint un point haut, à 12 250 euros en 2022.
* 86 Respectivement en 2004 et 2011, avant que la relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 restreigne, à l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les conditions d'accès au statut de grand établissement.
* 87 La mission d'information du Sénat sur les conditions de la vie étudiante, présidée par Pierre Ouzoulias, a ainsi adopté en juillet 2021 la recommandation de son rapporteur Laurent Lafon tendant à « favoriser une offre diversifiée dans l'enseignement supérieur et encourager le choix de petites structures par certains étudiants ayant besoin d'un accompagnement pédagogique personnalisé, notamment pendant le premier cycle ».
* 88 Au sujet des autres catégories de personnels des universités, la Cour considère que « le maintien de procédures nationales de recrutement pour les enseignants-chercheurs (qualification par le CNU) obère les politiques de formation et de recherche, en limitant le vivier des candidatures potentielles et en restreignant les possibilités d'évolution professionnelle en interne » et que « les personnels des organismes de recherche présents sur les sites universitaires (chercheurs, ingénieurs, techniciens ou autres personnels administratifs) échappent à la gestion ou, à tout le moins, à une cogestion de la part des universités, faute d'une coordination étroite avec les organismes de recherche gestionnaires de ces ressources humaines. »
* 89 Relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur
* 90 La Cour des comptes a relevé, dans un référé du 19 octobre 2023, que le temps de travail effectif des personnels administratifs des universités est inférieur de 140 heures à l'obligation de 1 607 heures fixée dans la loi. La Cour évalue à un peu plus de 300 millions d'euros le manque à gagner pour les universités.
* 91 Après la masse salariale.
* 92 Proportionnellement aux 80 Md€ estimés pour la rénovation de l'ensemble du parc de l'État d'après la trajectoire inscrite dans le décret éco-énergie tertiaire (DEET).
* 93 Objectif prévu par Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN).
* 94 La planification écologique dans les bâtiments. SGPI, réunion de travail sur la rénovation énergétique, 12 juin 2023.
* 95 Rapport d'information n° 842 (2020-2021), déposé le 22 septembre 2021, Optimisation de la gestion de l'immobilier universitaire à l'heure de la nécessaire transition écologique et du déploiement de l'enseignement à distance.
* 96 Cour des comptes, « Les universités à l'horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités », note, octobre 2021.
* 97 Cour des comptes, « L'immobilier universitaire du défi de la croissance à celui du transfert de propriété », rapport public thématique, octobre 2022.
* 98 Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
* 99 Défis et opportunités dans la gestion du patrimoine immobilier des établissements d'ESR, rapport d'évaluation publié en avril 2024 par l'IGESR.
* 100 L'IGESR relève à ce titre que « les enjeux d'adaptation et de transformation du patrimoine immobilier ne sont pas compatibles avec des financements accordés sur de courtes périodes. [...] Le modèle des CPER, et encore plus celui des appels à projets, tel qu'ils existent actuellement, deviennent inadaptés ».
* 101 Ces éléments figurent dans les réponses écrites de France Universités au questionnaire des rapporteurs.
* 102 L'option de la dévolution partielle n'est pas à ce jour retenue par le ministère.
* 103 Prévues par loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration (3DS), les SPL Universitaires ou SULI sont des sociétés de droit privé portées conjointement par les universités et les collectivités locales pour valoriser le patrimoine foncier ou immobilier.
* 104 Les crédits du programme 150 « Enseignement supérieur et recherche universitaire » portent les moyens alloués par l'État aux universités au titre de leurs missions de formation et de recherche.
* 105 Il convient cependant de noter qu'à l'échelle de chaque université, le développement des ressources propres peut se faire en trompe-l'oeil. Dans les établissements où la SCSP est historiquement basse, les ressources propres sont en effet développées de manière mécaniquement plus importante.
* 106 L'université Paris Dauphine, qui relève du statut de grand établissement, fait à ce titre figure d'exception. Ses ressources propres représentent près de la moitié de ses recettes (48 %), dont la majorité provient de l'apprentissage ; 18 % sont issues des droits d'inscription et 23 % de la formation continue.
* 107 Deux décrets d'application entrés en vigueur au 1er juillet 2025 (décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage et décret n° 2025-586 du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance) ont notamment prévu une participation obligatoire de 750 euros des employeurs pour tout contrat d'apprentissage à partir du niveau bac+3. Ces mesures visent à « assurer une meilleure gestion et une soutenabilité des financements de l'apprentissage ».
* 108 Pour « système de répartition des moyens à la performance et à l'activité ». Ce modèle a lui-même succédé au système San Remo.
* 109 Contrairement au modèle développé pour les écoles d'ingénieurs, Modal, le modèle Sympa n'intégrait pas la masse salariale des emplois transférés au titre des RCE, ni ne permettait la mise en place de variations en lien avec des indicateurs de performance.
* 110 Ces mesures nouvelles ne sont cependant pas lisibles pour les établissements, dans la mesure où elles sont désormais presque systématiquement amputées en cours d'années du montant des annulations de crédits. Pour 2025, le montant des annulations de crédits a été fixé à 58 millions d'euros par le décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits.
* 111 Universités d'Aix Marseille, de Bordeaux, de La Rochelle, de Montpellier, de Nice, de Reims, de Strasbourg, Sorbonne Université, l'IEP de Paris et la ComUE Paris Sciences et Lettres.
* 112 France Universités indique que l'évolution de la population étudiante a cessé d'être pris en compte dans le calcul de la SCSP à compter de 2017.
* 113 La SCSP par étudiant de cet établissement au statut d'EPE, l'université Gustave Eiffel, est cependant artificiellement gonflée par le fait qu'il fusionne les dotations de deux universités et d'un institut de recherche, sans que ce dernier ne vienne augmenter les effectifs étudiants de l'EPE.
* 114 Le rapport relève sur ce point que « l'absence de sélectivité des étudiants à l'entrée à l'université conjuguée à un financement public [...] représente un enjeu budgétaire puisque, sans maîtrise du nombre de places offertes, l'État ne peut garantir la stabilité du financement par étudiant ».
* 115 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
* 116 Cette notion recouvre l'évolution à la hausse de la masse salariale des universités sous l'effet de l'avancement de carrière de leurs agents.
* 117 Au total, les dépenses de personnels représentent pour les universités une charge globale comprise entre 70 % et 84 % de leur budget, avec une moyenne de 77 % en 2024. 28 établissements avaient à cette date des charges de personnels supérieures à 83 % de leurs produits.
* 118 Le pilotage et la maîtrise de la masse salariale des universités, rapport conjoint de l'IGF et de l'IGAENR, avril 2019.
* 119 L'université Paris-Saclay indique en outre que « dans un paysage en évolution, où la politique de regroupement est en cours, les établissements et le ministère doivent se concerter pour s'assurer de la cohérence des données mise à disposition en open data. On peut ici citer, à titre d'exemple, que l'addition des inscriptions étudiantes présentes dans les fichiers SISE, qui sera rendue publique en données ouvertes, n'est pas toujours représentative du nombre total d'inscriptions d'un établissement expérimental tel que le nôtre. Des données consolidées au niveau national permettraient une meilleure comparaison sur la base d'éléments tangibles ».
* 120 La page Internet de cette commission d'enquête est accessible en suivant ce lien.
* 121 Analyse du niveau de trésorerie des opérateurs de l'État et du modèle de relations financières entre l'État et ses opérateurs, rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) de juillet 2023.
* 122 Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), dont les dispositions figurent à l'article R. 719-61 du code de l'éducation.
* 123 Les seuils d'alerte sont fixés par un arrêté du 5 décembre 2024 relatif aux seuils de soutenabilité budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
* 124 Ce seuil, dit « ratio Dizambourg », est porté à 85 % pour les établissements à dominante SHS dont la liste est fixée par le MESR.
* 125 Sur le fondement d'une analyse des comptes financiers de 2024.
* 126 France Universités souligne également l'importance de cet indicateur au regard de la possibilité d'aller plus loin dans la dévolution du patrimoine immobilier.
* 127 En 2024, 28 établissements ont des charges de personnels supérieures à 83 % de leurs produits.
* 128 Loi n° 2020-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 1011 à 2014. Le cadre législatif actuellement en vigueur, qui reprend ces dispositions, est celui de la loi n° 2023-1195 du 12 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (en son article 23).
* 129 Notamment les universités Paris Cité, Paris-Saclay, Sorbonne Université et l'université de Strasbourg.
* 130 Selon un communiqué de presse du ministre Patrick Hetzel publié le 3 décembre 2024.
* 131 Il semble en outre que les de versement tendent à évoluer dans le contexte de resserrement budgétaire. Des établissements ont ainsi indiqué que l'ANR privilégiait désormais plus fréquemment les paiements sur facture acquittée aux avances globales de fonds.
* 132 La Cour indique qu'il est probable « que le niveau de trésorerie libre d'emploi soit sous-estimé en raison de la méthode d'estimation retenue ».
* 133 Par une analyse plus fine, la Cour estime que « sur un sous-ensemble de 94 EPSCP, [...] la trésorerie potentiellement libre d'emploi diminuerait de 843,3 millions d'euros en 2019 à - 78,2 millions d'euros en 2024. Plus précisément, pour 64 universités présentes dans le périmètre d'analyse, les montants seraient respectivement de 775,5 millions d'euros en 2019 et 72,3 millions d'euros en 2024 ». Dans les deux cas, la baisse est de l'ordre de 90 % en cinq ans.
* 134 Il s'agit des opérations pluriannuelles, des encaissements et décaissements sur opérations non budgétaires (emprunts), des encaissements exceptionnels en attente d'un dénouement, de la trésorerie nette affectée à des activités particulières (essentiellement les excédents de la taxe d'apprentissage) et des provisions pour risques et charges.
* 135 Au-delà de la question de la trésorerie, d'autres personnes entendues ont plus largement considéré que la logique générale des appels à projets, en ce qu'elle aboutit à une fragmentation des rentrées d'argent déstabilisatrice pour les budgets des établissements, a été poussée trop avant.
* 136 Le préciput correspond à la part du financement alloué à un projet de recherche destinée à couvrir les coûts indirects liés à sa mise en oeuvre.
* 137 La Cour des comptes relève à cet égard que « le montant des droits universitaires étant actuellement très modeste, en valeur absolue et en part dans les ressources des universités, l'objectif de procurer des recettes d'un montant significatif pour les universités nécessiterait une augmentation soutenue. En 2018-2019, une hausse générale des droits de 30 %, qui peut déjà` être considérée comme très substantielle au regard des évolutions historiques, n'aurait procure' aux universités que 102 M€ de recettes supplémentaires ».
* 138 Se poserait notamment la question du maintien du niveau de prise en charge de l'État pour les études en santé.