7. La politique d'investissement de l'État
7.1 Des investissements globalement suffisants
Une description a été faite dans le chapitre I « Diagnostic » du désengagement progressif de l'État en matière d'investissements portuaires, depuis la période de forts équipements caractéristique des années 1970 jusqu'à la période actuelle. Outre la chute des crédits budgétaires, celle-ci est marquée par la participation des crédits d'investissements à des dépenses d'entretien en raison de l'insuffisance des dotations d'entretien Cela freine le financement par l'État des contrats de Plan État-régions 1994-1998, le taux d'exécution de ceux-ci étant divisé par deux par rapport à la norme sur cinq ans.
Rappelons que l'enveloppe financière de l'État prévue par les Contrats de Plan pour les ports de métropole et d'outre-mer est de 756 MF théoriquement sur cinq ans (soit en moyenne 151 MF par an), les collectivités locales participant pour un montant équivalent (700 à 800 MF).
Les tableaux ci-après sont le plus récent relevé des investissements prévus pour les ports par les contrats 1994-1998. Comme indiqué ci-dessus, nous constatons qu'à fin 1996 soit au 3/5 de la période, l'État a financé seulement 29 % de ce programme, et qu'il lui faudrait un effort massif pour combler, même partiellement son retard (les tableaux présentent une simulation très ambitieuse d'achèvement des financements à fin 1999).
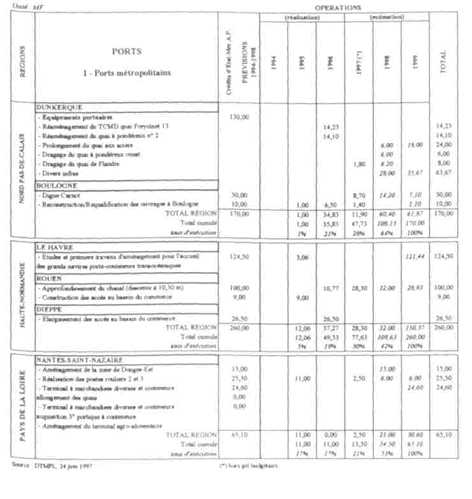
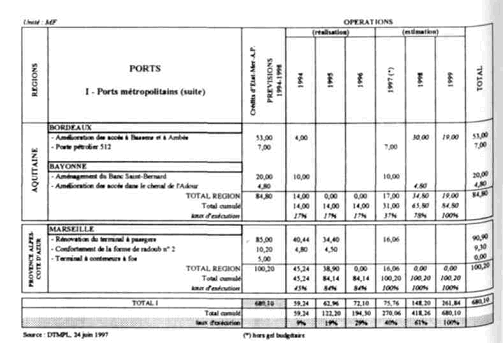
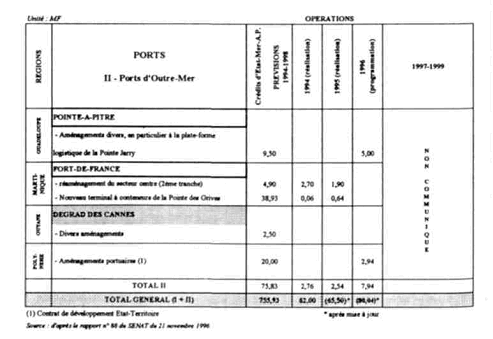
La décroissance de la participation de l'État aux investissements répond à une politique macroéconomique d'effort budgétaire, mais correspond-elle à une stratégie cohérente d'équipement des ports ?
La Cour des comptes considère que l'équipement des ports de la façade Atlantique, qui résulte d'un intense effort d'investissement entre les années 1960 et le début des années 1980, est suffisant sauf exception (Port 2000 au Havre). Par contre, elle relève deux difficultés : l'entretien des infrastructures existantes et, dans certains cas, leur sous-utilisation. Au dire des ports, les crédits réservés à l'entretien sont insuffisants (leur estimation des besoins pour les PIN est de 1,7 milliard de francs sur 10 à 15 ans) : malheureusement, les comptabilités analytiques disponibles sont peu précises, ce qui ne facilite pas l'évaluation objective de ces besoins. En outre, elle relève que les relations entre l'État et les collectivités locales ne sont pas toujours coordonnées, en sorte que les infrastructures de base (à la charge de l'État) peuvent être mal entretenues, alors que les superstructures peuvent dans le même temps être somptuaires. Sur leur sous-utilisation, la Cour relève un manque d'études préalables au moment du choix des investissements et parfois d'études a posteriori, ainsi que des estimations largement contradictoires (exemple : écarts de rentabilité de 1 à 5 pour l'approfondissement du chenal de Rouen). Fondamentalement, on est constamment soumis au cercle vicieux : l'investissement doit-il être calibré sur les trafics existants ou prévisibles ? S'agissant des accès terrestres, se pose pour l'État un certain nombre d'arbitrages nécessaires : ainsi, la SNCF doit-elle préserver son compte d'exploitation « suivant le trafic » vers les ports belges ou doit-elle aider les ports français ? 73 ( * )
De cette analyse découle l'existence d'un problème d'obsolescence de sous-utilisation et ainsi que de maintenance des équipements dont il conviendrait de faire une analyse critique pour déterminer si les efforts ne devraient pas se concentrer sur ceux d'entre eux qui sont le plus utiles à l'activité des ports. Les investissements en équipements nouveaux devraient faire plus souvent l'objet d'études de rentabilité, étant néanmoins admis que les prévisions de trafics sont plus difficiles à établir et plus aléatoires que dans le domaine des transports terrestres. D'ailleurs, la nouvelle Direction du Transport maritime, des Ports et du Littoral (DTMPL, ex-DPNM) s'est dotée récemment à cet effet d'une Mission des études économiques, de la recherche et des statistiques.
Dans cette recherche de sélectivité des investissements, apparaît la question de l'éventuelle concentration des efforts de l'État sur les ports qui sont vraiment d'importance stratégique nationale, à savoir une sélection réaliste des actuels ports autonomes (c'est l'exemple du projet Port 2000 au Havre).
Cela n'enlève rien à l'intérêt des autres ports, notamment dans leur dimension régionale par rapport à leur spécialisation utile sur un certain nombre de niches de trafic (céréales, charbons, fruits, bois, etc.). Mais en ce qui les concerne, l'intervention de l'État, au demeurant de faible niveau relatif par rapport à d'autres équipements de transport, devrait se faire dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire et à ce titre, l'investissement portuaire devrait être comparé dans ses coûts et ses avantages avec d'autres projets d'aménagement du territoire (autoroutes, projets urbains...).
Le tableau suivant (source CIES) reprend les autorisations de programme correspondant à la part de l'État pour les PA et les PIN entre 1987 et 1996.
Part de l'État dans les autorisations de programme
MF courants
|
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
|
PA |
157,6 |
166,8 |
173,6 |
160,0 |
142,0 |
122,3 |
109,6 |
139,4 |
90,0 |
71,8 |
|
PIN |
65,7 |
60,9 |
66,4 |
96,3 |
58,8 |
57,3 |
35,7 |
55,4 |
31,1 |
63,4 |
|
Total |
223,4 |
227,7 |
240,0 |
256,3 |
200,8 |
179,6 |
145,3 |
194,9 |
121,0 |
135,2 |
|
% PA/ total |
71 % |
73 % |
72 % |
62 % |
71 % |
68 % |
75 % |
72 % |
74 % |
53 % |
On observe que, sauf exception, le pourcentage réservé aux PA correspond approximativement à leur part de trafic, ce qui est cohérent avec la classification actuelle 74 ( * ) . Une éventuelle concentration des financements sur les plus grands ports serait d'un impact réel (enjeu maximum 135 MF en 1996), mais relatif comparé à d'autres grands investissements de transport.
Enfin, ces considérations ne remplacent pas une analyse de rentabilité économique qui devrait contribuer à une augmentation significative des financements, lorsque la rentabilité prévisionnelle d'un projet est forte.
* 73 Cf : audition de M. Erik Linquier (groupe Ports).
* 74 De même, les crédits d'entretien et d'exploitation (hors personnel) attribués par l'État aux ports autonomes correspondent approximativement à leur part de trafic.







