B. LE FINANCEMENT DU SYSTÈME FERROVIAIRE
1. Le poids de la dette
La dette de Réseau ferré de France atteint près de 33,7 milliards d'euros à la fin de l'année 2013 . Elle augmente de façon régulière, de 3 milliards d'euros par an , en raison du déficit structurel du réseau existant et de la participation financière de RFF aux investissements de développement du réseau. Elle devrait continuer à augmenter à ce rythme jusqu'en 2016. À partir de 2017, ce rythme devrait décélérer pour atteindre, à partir de 2020, un milliard d'euros par an, à condition qu'aucun projet de développement nouveau ne soit lancé. La tendance à l'augmentation de l'endettement n'est donc pas prête de s'inverser, malgré les conséquences financières qu'elle implique pour le gestionnaire du réseau. Ses frais financiers annuels s'élèvent aujourd'hui à près d'1,4 milliard d'euros, dans un contexte pourtant plutôt favorable sur le marché du crédit.
La réforme ferroviaire adoptée cet été n'a malheureusement pas apporté de réponse tangible à la question de la dette.
Sur le stock de la dette, elle a seulement prévu, ce qui est manifestement insuffisant, à l'article 11, la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, « relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en oeuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire ». L'article indique que « ce rapport examine les conditions de reprise de tout ou partie de cette dette par l'État ainsi que l'opportunité de créer une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire. » Cette disposition n'est pas à la hauteur du problème.
Sur les flux, deux mesures du projet de loi sont en partie destinées à réduire l'endettement du système :
- l'instauration d'une règle de maîtrise de l'endettement, dont l'effet dépendra des ratios déterminés par le Parlement, et de son application effective par les différentes parties concernées ;
- le « retour de l'État stratège » et la conclusion de contrats entre l'État et les différents EPIC du groupe public ferroviaire. Là encore, l'effet escompté dépendra de la capacité effective de l'État à exercer ce rôle de stratège . L'attentisme dont il a récemment fait preuve au sujet des trains d'équilibre du territoire 12 ( * ) n'encourage malheureusement pas à l'optimisme dans ce domaine.
|
LA RÈGLE DE MAÎTRISE DE L'ENDETTEMENT PRÉVUE PAR LA LOI DE RÉFORME FERROVIAIRE Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants : 1° les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat signé entre l'État et SNCF Réseau ; 2° les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement. En cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissement de développement sont financés par l'État, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur. En l'absence de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissement de développement font l'objet, de la part de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés. Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale. Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat qu'il a signé avec l'État. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées. |
En complément de ces mesures législatives, les présidents de la SNCF, Guillaume Pepy, et de RFF, Jacques Rapoport, se sont engagés à réaliser conjointement 1 milliard d'économies en trois à cinq ans, par des gains de productivité internes ou résultant des synergies permises par le regroupement des services chargés de l'infrastructure au sein d'une entité unique. Il appartiendra au Parlement d'en vérifier la réalisation.
Ces mesures ne seront toutefois pas suffisantes pour inverser la tendance, et ne sauraient dissimuler l'ampleur du défi que constitue la réduction des coûts de production de notre système. D'après une étude réalisée par l'union des transports publics et ferroviaires (UTP), l'emploi d'un conducteur de fret par la SNCF coûte jusqu'à 30 % plus cher que chez ses concurrents ! Les comparaisons internationales ne sont pas meilleures.
L'application d'un cadre social homogène à l'ensemble des entreprises du secteur ferroviaire, nouveaux entrants compris, n'est donc pas de nature à rassurer votre rapporteur sur cette question des coûts.
Pour faire baisser les coûts des services de transport ferroviaire, votre rapporteur avait proposé, dans le cadre des débats sur la réforme ferroviaire, leur ouverture à la concurrence, à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne. Il n'a pas été suivi, mais tient à souligner que la mesure sera néanmoins un jour ou l'autre imposée par Bruxelles, et sans doute dans un futur relativement proche. Dès lors, ne pas s'y préparer serait une grave erreur.
2. Des besoins importants en termes d'entretien et de régénération du réseau
L'endettement du gestionnaire d'infrastructures est d'autant plus préoccupant que celui-ci devra assumer, dans les prochaines années, des dépenses importantes d'entretien et de régénération du réseau.
La France a accumulé un retard certain dans ce domaine, mis au jour par l'audit Rivier réalisé par l'école polytechnique de Lausanne en 2005. À la suite de ce constat, deux plans de rénovation ont été lancés, de 2006 à 2010 et de 2008 à 2012, qui ont permis une augmentation des dépenses de renouvellement de 88 % entre 2006 et 2011, particulièrement notable à partir de 2008.
DÉPENSES DE RENOUVELLEMENT PAR TYPE D'ACTIFS SUR
LA PÉRIODE 2006-2011
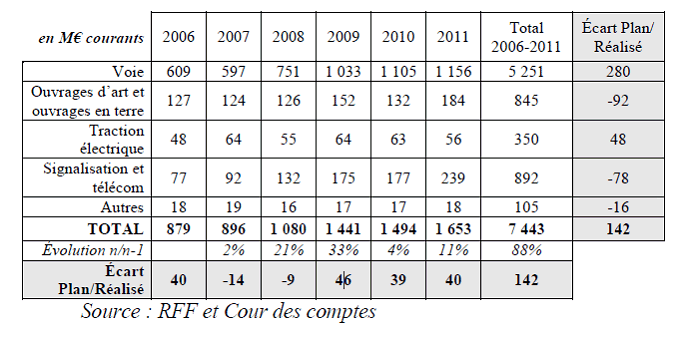
Source : RFF et Cour des comptes
Mais cet effort n'a pas suffi à inverser la tendance au vieillissement du réseau, comme l'a démontré l'actualisation de l'audit Rivier de septembre 2012 :
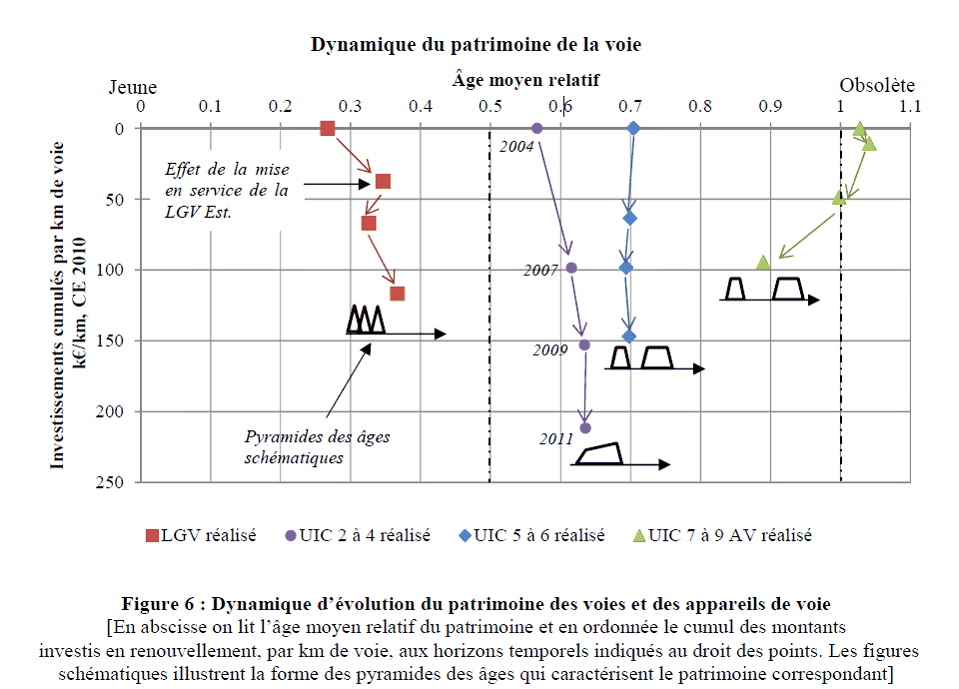
À la suite de ce constat, le Gouvernement a demandé à RFF d'élaborer un grand plan de modernisation du réseau (GPMR) , qui a été adopté par son conseil d'administration le 13 septembre 2013. Avec une enveloppe de 15 milliards d'euros sur six ans, soit 2,5 milliards d'euros par an, ce plan s'attache en particulier à résoudre les difficultés rencontrées en zone dense et dans les noeuds ferroviaires. Il vise à rendre le réseau plus performant, en diminuant les incidents liés à l'infrastructure et leurs conséquences pour l'exploitation, afin d'améliorer la régularité des trains. Il a aussi pour vocation d'augmenter la capacité du réseau en termes de circulation des trains et de maintenir un haut niveau de sécurité.
Ce plan de modernisation est une bonne nouvelle, mais ne suffit pas pour mettre un frein au vieillissement du réseau.
3. Un trafic de fret menacé d'effondrement
La part modale du transport ferroviaire de marchandises a atteint près de 10 % en 2012. Ce chiffre reste toujours en-deçà des proportions atteintes par le passé, comme des objectifs fixés dans la loi « Grenelle I ». Celle-ci prescrit, à son article 11, une augmentation de 14 % à 25 % de la part modale du transport de marchandises non-routier et non-aérien à échéance 2022, et à plus court terme, une augmentation de 25 % de la part modale du fret non-routier et non-aérien d'ici 2012 13 ( * ) .
PART MODALE DU FERROVIAIRE DANS LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE (EN %)
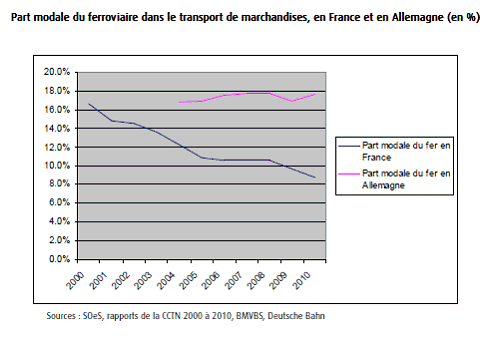
La situation n'est donc pas satisfaisante, d'autant qu'elle pourrait encore se détériorer. D'après le président de RFF, 65 % du trafic de fret ferroviaire pourrait être rapidement transféré sur la route.
Pour mobiliser l'ensemble des acteurs et élaborer un programme d'actions concertées, le précédent ministre des transports, Frédéric Cuvillier, avait mis en place une conférence ministérielle périodique pour le fret ferroviaire, à partir de septembre 2013. Cinq groupes de travail avaient été créés, afin de réfléchir aux sujets suivants :
- domaine de pertinence du fret ferroviaire : le cadre économique et réglementaire, l'articulation avec les autres modes ;
- fret de proximité et action des acteurs locaux ;
- fret ferroviaire et grands ports maritimes ;
- fret ferroviaire et utilisation de l'infrastructure ;
- innovation technologique et évolutions de la réglementation.
Ils ont rendu leurs conclusions en février 2014. Les grands axes retenus sont :
- développer le fret de proximité par l'expérimentation sur des territoires, sur la base d'un diagnostic de la demande de fret ferroviaire et du réseau capillaire qui permet une desserte fine des territoires ;
- assurer une meilleure promotion du fret ferroviaire, qui apparait souvent comme une « boîte noire » pour les chargeurs du fait notamment de sa technicité et de son jeu d'acteurs ;
- améliorer la qualité, la disponibilité et la robustesse des sillons fret, condition essentielle pour rendre le fret ferroviaire plus fiable et plus compétitif pour les industriels ;
- faire des grands ports maritimes des acteurs centraux du fret ferroviaire, en intégrant dans leurs projets stratégiques des objectifs de développement du fret ferroviaire et en optimisant les enjeux de desserte et de capacité du réseau ;
- soutenir l'innovation technologique et simplifier la réglementation, deux conditions essentielles pour améliorer la compétitivité du fret ; sur le second point, le lancement d'un groupe de travail interdisciplinaire a été annoncé ;
- mesurer l'efficience des dispositifs de soutien au secteur et réfléchir à leur optimisation.
Un comité de suivi ad hoc est chargé de définir les modalités de pilotage de chacune des mesures retenues et d'assurer le suivi de leur mise en oeuvre.
Votre rapporteur salue la prise de conscience et la méthode suivie pour répondre aux enjeux soulevés. Il importe désormais de s'assurer de la mise en oeuvre effective de mesures permettant au fret ferroviaire de se remettre à niveau.
Une interrogation persiste également sur la pérennité de la « compensation fret ». Cette compensation a été créée au moment de la réforme de la tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, à la fin 2009, pour en neutraliser l'impact pour les entreprises de fret. Sans cette compensation, leur péage aurait augmenté de plus de 200%.
Or, les contraintes budgétaires actuelles conduisent l'État à ne pas assumer la totalité de cette compensation en 2013, où il a manqué 120 millions d'euros à RFF. Ce sujet devra faire l'objet d'une vigilance particulière.
4. L'enjeu de la lutte contre la fraude
La lutte contre la fraude constitue un levier important en termes de recettes, dans la mesure où la fraude coûte chaque année plus de 300 millions d'euros à la seule SNCF, 100 millions d'euros à la RATP, sans compter les réseaux de transport de province.
La SNCF a certes déjà mis en place un certain nombre d'actions. Elle a par exemple limité, à compter du 2 septembre 2014, la durée de validité des billets sans réservation à sept jours, au lieu de deux mois, pour éviter l'utilisation multiple de billets non compostés. Une mise à jour des forfaits de régularisations, non actualisés depuis 2003, est aussi prévue, pour en garder le caractère dissuasif.
La SNCF développe par ailleurs des opérations d'accueil-filtrage à quai, afin d'inciter à l'achat de titre de transport avant la montée dans le train. En parallèle, la mise en place d'un dispositif sécurisé de contrôle d'accès au train avec auto-validation par le client (comme les portiques d'accès existant en Ile-de-France) est en cours d'analyse pour les axes concentrant les plus forts volumes et taux de fraude.
La SNCF réalise également des efforts de développement du digital (sur Internet fixe et mobile), pour rendre le service de distribution accessible 24 heures/24.
D'autres actions sont envisagées, pour fiabiliser les adresses recueillies et améliorer le processus de recouvrement des pénalités.
Votre rapporteur salue le développement de cette réflexion au sein de la SNCF. Il constate cependant que, pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude, c'est l'ensemble du cadre juridique qui doit être revu.
Aussi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission présentera un amendement en séance, afin de rendre plus dissuasif le délit de fraude d'habitude dans les transports .
En vertu de l'article L. 2242-6 du code des transports, ce délit est passible de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Il est aujourd'hui caractérisé lorsque la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction (c'est-à-dire au paiement d'une indemnité forfaitaire).
L'amendement présenté par votre commission réduit à deux le nombre de contraventions n'ayant pas donné lieu à une transaction nécessaire pour être passible du délit de fraude d'habitude .
* 12 Cf. infra.
* 13 Ces augmentations étant calculées sur la base de l'activité fret enregistrée en 2006.







