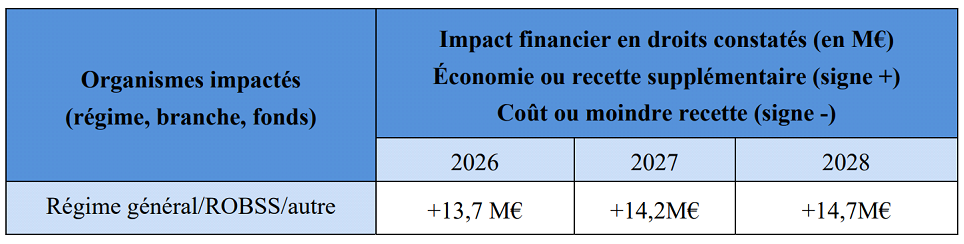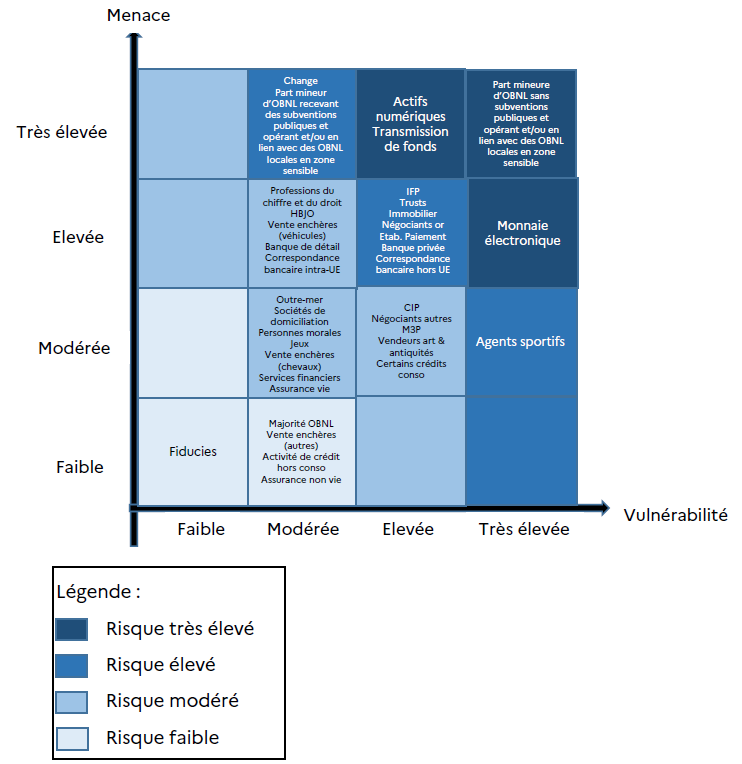EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 1er
Autoriser la transmission d'informations
douanières et fiscales par les officiers de douane judiciaire et les
officiers fiscaux judiciaires
Le présent article vise à permettre aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ou à la direction générale des finances publiques (DGFiP) tous informations et documents susceptibles d'être utiles à l'exercice de leur mission de contrôle.
En tout état de cause, cette transmission serait soumise à l'autorisation du procureur de la République ayant requis ces officiers ou du juge d'instruction leur ayant délivré commission rogatoire, après avis du procureur de la République.
Du reste, seuls les agents de la DGDDI et de la DGFiP chargés d'une mission de contrôle seraient habilités à avoir connaissance de ces informations et documents.
Considérant que l'atteinte ainsi portée au secret de l'enquête et de l'instruction se justifie par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et que le cadre prévu par le dispositif suffit à garantir la proportionnalité de la mesure, la commission est favorable à l'adoption de cet article.
Elle souligne néanmoins que le droit en vigueur permet d'ores et déjà la communication de ce type d'informations aux administrations des douanes et des finances publiques par l'autorité judiciaire et que la plus-value du dispositif proposé paraît relativement limitée.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'IMPOSSIBILITÉ, POUR LES OFFICIERS DE DOUANE JUDICIAIRE ET LES OFFICIERS FISCAUX JUDICIAIRES, DE COMMUNIQUER À LA DGDDI ET À LA DGFIP LES RENSEIGNEMENTS UTILES COLLECTÉS DANS LE CADRE DE LEURS INVESTIGATIONS
A. CERTAINS AGENTS DES DOUANES ET DES SERVICES FISCAUX SONT HABILITÉS À MENER DES ENQUÊTES JUDICIAIRES
Aux termes du code de procédure pénale, des agents des douanes6(*) et des agents des services fiscaux7(*) de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Les agents concernés sont dès lors compétents pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
- s'agissant des officiers de douane judiciaire (ODJ), les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la TVA et de vols de biens culturels, les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, les infractions en matière de trafic d'armes8(*) ou encore le blanchiment de ces infractions9(*) et celui de trafic de stupéfiants10(*) - ils n'ont toutefois pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, sous réserve des dispositions législatives prévoyant la possibilité de constituer des unités temporaires mixtes ;
- s'agissant des officiers fiscaux judiciaires (OFJ), les infractions en matière de fraude fiscale11(*), de blanchiment de fraude fiscale - dans certains cas -, de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale12(*), d'escroquerie13(*) sur la TVA ou d'escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu14(*).
Les unités temporaires
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants15(*), sans préjudice des dispositions législatives excluant du champ de compétence des officiers de douane judiciaire le trafic de stupéfiants, de blanchiment - lorsque les infractions en question sont intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste16(*) - et de financement du terrorisme17(*) et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'officiers de douane judiciaire18(*).
Ces unités temporaires, dont le chef est désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction mandant, agissent sous la direction de l'autorité judiciaire et ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Pour mener des enquêtes judiciaires et commissions rogatoires, ces agents doivent y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs missions, sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction.
Le code de procédure pénale précise que lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, ces agents procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
En tout état de cause, ils ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux que prévoit le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Les OFJ, eux, ne peuvent ni participer à une procédure de contrôle de l'impôt pendant la durée de leur habilitation, ni effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une telle procédure avant d'être habilités à effectuer des enquêtes, ni participer, même après la fin de leur habilitation, à une telle procédure dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par l'autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Concrètement, les ODJ et les OFJ exercent leurs fonctions au sein de l'Office national anti-fraude (Onaf)19(*). Des officiers fiscaux judiciaires sont également mis à disposition de la Brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF) du ministère de l'intérieur.
B. CES AGENTS NE SONT TOUTEFOIS PAS AUTORISÉS À TRANSMETTRE À LEUR ADMINISTRATION LES INFORMATIONS QU'ILS RECUEILLENT À L'OCCASION DE LEURS ENQUÊTES
Des dispositifs d'échanges d'informations existent entre agents des douanes et des services fiscaux et officiers de police judiciaire.
Ainsi, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière20(*).
Dans le sens inverse, et dans le même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière21(*).
En revanche, les ODJ et les OFJ ne sont pas habilités à communiquer eux-mêmes aux administrations dont ils sont issus les renseignements qu'ils obtiennent dans le cadre de leurs enquêtes.
Or, certaines de ces informations, qui ne se rapportent pas directement à l'infraction recherchée et ne sont donc pas exploitées dans le cadre des poursuites pénales concernées (parce qu'elles intéressent des tiers non mis en cause, par exemple) sont susceptibles de comporter une implication de nature douanière, fiscale ou financière et d'être utiles à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ou à la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour déclencher une action de contrôle
En effet, les éléments en question peuvent ainsi révéler des activités occultes, des transferts de fonds suspects, des dissimulations de recettes ou de revenus ou encore des avantages obtenus indûment de certaines administrations ou personnes publiques, voire permettre d'identifier les bénéficiaires de schémas fiscaux frauduleux et de déclencher au plus vite des enquêtes et des contrôles.
Pour autant, comme l'a rappelé l'Onaf au cours de son audition, ces informations peuvent d'ores et déjà être communiquées aux administrations des douanes et des finances publiques par les parquets.
De fait :
- le ministère public peut communiquer, à l'occasion de toute procédure judiciaire, les dossiers à l'administration des finances22(*) ;
- l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt23(*) ;
- l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes24(*).
Ces dispositions ne donnent toutefois lieu qu'à environ 1 300 communications par an en moyenne selon l'étude d'impact du présent article.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : PERMETTRE À CES AGENTS, SUR AUTORISATION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE, DE TRANSMETTRE DIRECTEMENT À LEUR ADMINISTRATION TOUT RENSEIGNEMENT UTILE À L'EXERCICE DE LEUR MISSION DE CONTRÔLE
Le présent article tend à rétablir, au sein du code de procédure pénale, un article 706-1-3 permettant, par dérogation au principe du secret de l'enquête et de l'instruction et sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré commission rogatoire, après avis du procureur de la République, aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet de communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE BON SENS PRÉSENTANT DES GARANTIES SUFFISANTES MAIS LARGEMENT SATISFAITE PAR LE DROIT EN VIGUEUR
Ainsi que l'a relevé le Conseil d'État dans son avis sur le présent projet de loi, la restriction apportée par le présent article au secret de l'enquête et de l'instruction est justifiée par l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude25(*).
La commission constate par ailleurs que le Gouvernement a suivi la préconisation du Conseil d'État tendant à assurer la proportionnalité de la mesure proposée en précisant, d'une part, que seuls peuvent être communiqués les informations et documents susceptibles d'être utiles à l'exercice par la DGDDI et la DGFiP de leur mission de contrôle et, d'autre part, que ces informations et documents ne peuvent être transmis qu'aux agents des douanes et des finances publiques chargés de cette mission de contrôle.
Du reste, le conditionnement de la transmission des éléments en question à l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire est de nature à garantir la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice.
Enfin, comme le rappelle l'étude d'impact du projet, les agents destinataires de ces informations et documents sont soumis au secret professionnel26(*).
Dans ces conditions, la commission approuve le dispositif proposé, qui doit contribuer à faciliter les échanges d'informations entre l'autorité judiciaire et les administrations chargées de missions de lutte contre la fraude.
Elle souligne toutefois que sa plus-value est extrêmement limitée, dans la mesure où les informations en question peuvent déjà, en l'état actuel du droit, être transmises par les parquets à la DGDDI et à la DGFiP.
Le seul intérêt de la modification proposée réside donc dans la capacité d'initiative de la communication de ces informations, attribuée aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité judiciaire, tandis que le droit en vigueur la réserve aux parquets.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3
Transmission par la direction
générale des finances publiques d'informations de nature fiscale
à l'Institut national de la propriété industrielle
Le présent article permet à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de transmettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) les informations que l'administration fiscale recueille dans le cadre de ses contrôles. Les services de la DGFiP pourront transmettre des informations nécessaires :
- à l'immatriculation d'office au registre national des entreprises (RNE) d'une personne dont les agents de la DGFiP auraient constaté, dans le cadre de leur contrôle, qu'elle exerce une activité occulte ;
- à la radiation des personnes non établies dans l'Union européenne qui ne respectent pas l'obligation de désigner un représentant fiscal.
Cet article opère un aménagement équilibré du secret fiscal afin de permettre le partage d'informations nécessaire à la fiabilisation du RNE. La commission a simplement adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de clarification du dispositif.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LA DGFIP PEUVENT ÊTRE UTILES POUR GARANTIR LA FIABILITÉ DES DONNÉES D'IMMATRICULATION DES ENTREPRISES MAIS LES POSSIBILTIÉS DE TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS SONT ENCADRÉES PAR LE SECRET FISCAL
A. LE REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES PERMET DE CENTRALISER ET DIFFUSER LES INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES DES ENTREPRISES
Le registre national des entreprises (RNE), prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, a été créé par l'article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « PACTE ». Il a pour objectif « de centraliser et de diffuser les informations économiques et juridiques des entreprises27(*) ».
L'article L. 123-36 du même code prévoit que « les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante » doivent s'immatriculer au RNE, y compris les entreprises étrangères ne disposant pas d'un établissement stable en France. D'après l'article L. 123-50, le RNE est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce même article prévoit que les immatriculations sont réalisées :
- soit sur demande de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement ;
- soit à l'occasion d'une transmission d'informations ou de pièces par diverses administrations partenaires explicitement mentionnées aux articles L. 123-39 à L. 123-49-228(*) ou d'autres autorités désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.
Les administrations partenaires susmentionnées ont par ailleurs, la possibilité, dans certains cas définis aux articles R. 123-294 à R. 123-317, de modifier les informations du RNE, de procéder à l'immatriculation d'office ou de radier un déclarant, principalement en cas de fraude.
Il est dès lors nécessaire que le RNE « reflète, de manière exacte, les informations relatives aux immatriculations, modifications et cessations d'activité des entreprises29(*) », afin que ces administrations puissent mener à bien leurs missions de contrôle. À cet égard, les informations que sont amenées à recueillir les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), dans le cadre de leur activité de contrôle et de gestion fiscale peuvent constituer un outil d'actualisation pertinent des données du registre.
B. LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) DANS LE CADRE DE LEUR CONTRÔLE SONT COUVERTES PAR LE SECRET FISCAL
Toutefois, les informations recueillies par la DGFiP dans le cadre de ses missions fiscales sont protégées par les règles du secret fiscal.
En effet, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) étend en matière fiscale l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal à toutes les informations recueillies lors d'opérations d'assiette, de contrôle ou de recouvrement, ainsi que d'opérations liées au contentieux, des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI).
Le secret fiscal est par ailleurs garanti par la Constitution, puisqu'il découle du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 178930(*). Le Conseil constitutionnel admet des dérogations au secret fiscal, à condition que celles-ci soient « non seulement justifiées par un motif d'intérêt général, mais également mises en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif31(*) ». Il a par ailleurs reconnu la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales comme un objectif à valeur constitutionnelle32(*) justifiant une telle dérogation.
En tout état de cause, une modification législative est nécessaire pour permettre aux agents de la DGFiP de transmettre des informations de nature fiscale à l'INPI.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE DÉROGATION AU SECRET FISCAL POUR PERMETTRE À LA DGFIP DE TRANSMETTRE À L'INPI DES INFORMATIONS UTILES POUR LA TENUE DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
Le présent article autorise la DGFiP à déroger au secret fiscal en communiquant à l'INPI des informations recueillies par l'administration fiscale à la suite de la détection d'une fraude relative à l'activité d'une entreprise.
Pour ce faire, le II du présent article crée un nouvel article L. 135 JA du livre des procédures fiscales qui prévoit la transmission à l'INPI de certaines informations utiles à « la bonne tenue du registre national des entreprises prévu par l'article L. 123-36 du code de commerce », et plus particulièrement :
- des informations nécessaires à l'immatriculation d'office au RNE d'une personne dont les agents de la DGFiP auraient constaté, dans le cadre de leur contrôle, qu'elle exerce une activité occulte ;
- des « documents justifiant la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue par le I de l'article 289 A du code général des impôts », c'est-à-dire, l'obligation pour une personne non établie dans l'Union européenne de désigner un représentant fiscal33(*).
Le I du présent article procède par ailleurs à une précision au sein de l'article L. 123-50 du code de commerce, en précisant que les informations déclaratives renseignées dans le RNE par l'INPI comprennent notamment « les immatriculations et radiations d'office ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI CONTRIBUERA À LA FIABILISATION DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
La commission des finances est favorable à cet article, qui propose un aménagement équilibré du secret fiscal afin de permettre le partage d'information nécessaire à la fiabilisation du RNE. Ces dispositions sont en phase avec les constats de la commission d'enquête du Sénat chargée d'évaluer les outils de lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales. Celle-ci a en effet souligné, au cours de ses travaux, la nécessité pour les administrations engagées dans la lutte contre la criminalité financière d'exploiter pleinement les données issues des registres centralisés, tout en veillant à ce que ces registres soient aussi complets que possible34(*).
Interrogé par le rapporteur sur la mise en oeuvre concrète du dispositif, le Gouvernement a précisé que les informations relatives au motif de l'immatriculation d'office - en particulier lorsqu'il s'agit d'une activité occulte - ne sont pas diffusables aux partenaires. Toutefois, l'immatriculation des entreprises au RNE, qui est une information publique, facilitera nécessairement la traçabilité des entreprises par les administrations utilisatrices du RNE.
Les administrations partenaires sont en revanche informées de la date, du motif et du partenaire à l'origine de la radiation d'office des radiations d'entreprises. Elles peuvent tirer les conséquences de ces informations dans le cadre de leurs activités, en évitant notamment d'attribuer des prestations aux entreprises concernées par ces radiations.
Elles pourront ainsi être efficacement informées des décisions de la DGFiP concernant la radiation des entreprises défaillantes dans leurs obligations de déclaration d'un représentant fiscal. Cette mesure s'avère d'autant plus pertinente dans un contexte où le nombre d'immatriculations d'entreprises étrangères en France connaît une forte hausse, notamment en raison du développement du commerce en ligne, qui constitue un facteur majeur de fraude à la TVA. Sans une telle mesure, ces entreprises ne pourraient être radiées du RNE ni signalées aux administrations partenaires, ce qui faciliterait la poursuite de leurs activités frauduleuses.
La commission des finances a adopté l'amendement COM-98 de son rapporteur, tendant à apporter une clarification rédactionnelle.
Décision de la commission : La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3
bis
Possibilité pour l'administration fiscale et l'administration
des douanes de demander aux établissements de crédit et
assimilés des informations
sous format
dématérialisé
Le présent article, introduit par l'amendement COM-99 du rapporteur, permet à l'administration fiscale et à l'administration des douanes de solliciter, dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication auprès des établissements de crédit et assimilés, la transmission d'informations sous format dématérialisé.
Cet article leur permettra de disposer d'informations plus facilement exploitables par les outils de traitement de données utilisés pour assurer un meilleur ciblage de leur contrôle.
Le présent article avait été adopté par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, à l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet, avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel, au motif qu'il constituait un cavalier législatif.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : BIEN QUE LES AGENTS DE LA DGFIP ET DES DOUANES PUISSENT OBTENIR COMMUNICATION DE TOUT DOCUMENT UTILE À L'ÉTABLISSEMENT DE L'ASSIETTE ET LE CONTRÔLE DES IMPÔTS, CES INFORMATIONS NE RÉPONDENT AUJOURD'HUI À AUCUN FORMALISME PARTICULIER
A. LES AGENTS DE LA DGFIP ET DES DOUANES PEUVENT OBTENIR COMMUNICATION DE TOUT DOCUMENT PERMETTANT L'ÉTABLISSEMENT DE L'ASSIETTE ET LE CONTRÔLE DES IMPÔTS
Conformément aux dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) bénéficient de la communication d'informations auprès de diverses entités afin de déterminer l'assiette de l'impôt et d'effectuer des contrôles. Ce droit de communication délie les assujettis du secret professionnel et permet la transmission d'informations dans de nombreux cas.
À cet égard, l'administration fiscale précise que le droit de communication peut être exercé vis-à-vis des établissements de crédit en application des articles L. 85 et L. 83 du LPF, dans la mesure où ces établissements ou organismes sont soumis à la fois aux obligations du code de commerce et au contrôle de l'autorité administrative35(*). En application de la combinaison de ces dispositions, le droit de communication peut porter sur l'ensemble des documents comptables détenus par les établissements de crédit, strictement utiles aux services. Le juge administratif a ainsi jugé que les établissements de crédit ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par l'administration sur le fondement de ce droit36(*).
Par ailleurs, le droit de communication de l'administration fiscale à l'égard de ces organismes s'étend aux opérations particulières réalisées en matière de délivrance de chèques non barrés, de transfert de fonds à l'étranger et d'opérations de bourse.
S'agissant des modalités pratiques d'exercice du droit de communication, celui-ci s'exerce à l'initiative du service et permet à l'administration fiscale de prendre connaissance sur place ou par correspondance, y compris électronique, et éventuellement copie, des documents concernés.
Il est précisé que pour les établissements qui utilisent des procédures de gestion informatisée ou de conservation des données sur support informatique, toutes les facilités soient mises en oeuvre afin de permettre aux agents de consulter notamment au moyen d'un appareil de lecture les documents concernés ou de se faire présenter les documents édités par l'ordinateur37(*).
Par ailleurs, l'article 65 bis A du code des douanes prévoit l'extension du droit de communication aux agents douaniers pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude.
B. EN L'ÉTAT DU DROIT, LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES EN RÉPONSE AUX DEMANDES FORMULÉES PAR L'ADMINISTRATION NE RÉPONDENT À AUCUN FORMALISME PARTICULIER
Toutefois, les réponses apportées par les établissements de crédit aux demandes de renseignement de l'administration ne répondent à aucun formalisme particulier en l'état du droit. Ces réponses prennent souvent la forme de courriers postaux pouvant s'avérer être nombreux, d'autant plus que l'une des informations les plus fréquemment demandées concerne les relevés bancaires. Si bien que ces procédures peuvent s'étaler sur des années, le temps que les banques, submergées par les demandes de l'administration, puissent transmettre les documents demandés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : L'INSTAURATION D'UNE OBLIGATION DE RÉPONDRE PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE DANS LE CADRE DU DROIT DE COMMUNICATION EXERCÉ, PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ET DES DOUANES, À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS
A. L'OBLIGATION FAITE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE RÉPONDRE PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE L'ADMINITRATION
Le présent article, introduit par un amendement COM-99 du rapporteur, vise à imposer aux établissements de crédits, saisis d'une demande de renseignement par l'administration fiscale ou douanière dans le cadre du droit de communication, une réponse par voie dématérialisée.
Pour ce faire, il insère, après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, un nouvel article L. 81 B définissant l'obligation à l'égard « d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts » - c'est-à-dire, aux établissements de crédits et assimilés - de répondre aux demandes de renseignement des agents de l'administration fiscale par voie dématérialisée, selon des modalités et formats qui seront fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
En outre, il complète la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes par un article 65 sexies précisant la même obligation en cas d'exercice du droit de communication par les agents douaniers, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Un dispositif identique avait été adopté lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques en avril 2025, à l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet. Ces dispositions, avaient néanmoins été censurées par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 45 de la Constitution38(*).
Par conséquent, le présent article entend reprendre ces dispositions dans un cadre juridique plus sécurisé.
B. UNE OBLIGATION QUI DEVRAIT PERMETTRE D'AMÉLIORER L'EFFICIENCE DU CONTRÔLE ET DU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT
Le présent article permettra de renforcer l'efficacité du droit de communication exercé auprès des établissements de crédits et assimilés, qui constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts.
Lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques en avril 2025, la ministre chargée des Comptes publics avait soutenu ce dispositif. Elle avait alors souligné la pertinence d'une telle mesure au regard du besoin opérationnel des agents de la DGFiP et des services douaniers de disposer d'informations facilement exploitables par les outils de traitement de données utilisés pour assurer un meilleur ciblage de leur contrôle. Elle avait également estimé que cette dématérialisation pourrait permettre de libérer du temps et des effectifs, notamment à la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), afin de les redéployer vers des tâches nécessitant une véritable expertise.
Décision : La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
ARTICLE 9
Améliorer la coopération entre
l'Autorité des marchés financiers
et les parquets
Le présent article prévoit d'étendre à l'ensemble des parquets la faculté, dont dispose actuellement le seul Parquet national financier (PNF), de communiquer à l'Autorité des marchés financiers (AMF) toute pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de sa commission des sanctions, sous réserve, le cas échéant, de l'avis favorable du juge d'instruction.
Compte tenu des garanties offertes par le dispositif et notamment face à la levée du secret de l'enquête et de l'instruction et du droit au respect de la vie privée, et de la nécessité de décloisonner le fonctionnement des autorités de poursuite dans un contexte de montée en puissance des sujets répressifs, la commission est favorable à l'adoption de cet article.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : À L'EXCEPTION DU PNF, LES PARQUETS NE SONT PAS AUTORISÉS À TRANSMETTRE À L'AMF DES ÉLÉMENTS EN LIEN DIRECT AVEC DES FAITS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE SOUMIS À L'APPRÉCIATION DE SA COMMISSION DES SANCTIONS
A. L'AMF PEUT INFLIGER DES SANCTIONS AUX PERSONNES SOUMISES À SON CONTRÔLE QUI MANQUENT À LEURS OBLIGATIONS
Autorité publique indépendante, l'Autorité des marchés financiers (AMF) veille notamment à la protection de l'épargne investie dans les produits financiers ainsi qu'à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés39(*).
Afin d'assurer l'exécution de ses missions, elle réalise des contrôles et des enquêtes40(*). Ses enquêteurs et contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, accéder aux locaux à usage professionnel et recueillir des explications sur place41(*).
Le collège de l'AMF examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par ses services ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, auquel cas il notifie les griefs aux personnes concernées et transmet cette notification à la commission des sanctions42(*).
Après une procédure contradictoire, cette dernière peut prononcer une sanction administrative ou pécuniaire à l'encontre des personnes soumises à son contrôle, notamment lorsque celles-ci se sont rendues coupables d'abus de marché - opérations d'initiés, manipulations de marché, divulgation illicite d'informations privilégiées.
B. SEUL LE PARQUET NATIONAL FINANCIER EST HABILITÉ À COMMUNIQUER À L'AMF DES PIÈCES DE LA PROCÉDURE PÉNALE EN LIEN AVEC DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À SANCTION
Le code de procédure pénale habilite les procureurs de la République ou, sur autorisation de ceux-ci, les officiers ou agents de police judiciaire de requérir, par tout moyen, de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête de lui remettre ces informations, sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel43(*).
Par conséquent, il est permis aux parquets de requérir de l'AMF la communication de tout document susceptible d'intéresser une enquête en cours.
En revanche, l'AMF n'est en mesure de se faire communiquer que par le parquet national financier (PNF), et non par les autres parquets, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de sa commission des sanctions44(*).
Le procureur de la République financier peut ainsi, le cas échéant après avis du juge d'instruction, communiquer ces pièces, d'office ou à leur demande, au secrétaire général de l'AMF, avant l'ouverture d'une procédure de sanction, ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une telle procédure.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'EXTENSION À L'ENSEMBLE DES PARQUETS DE LA FACULTÉ DE COMMUNIQUER À L'AMF DES PIÈCES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Le 1° vise à modifier l'article L. 621-20-4 du code monétaire et financier, qui permet au PNF de transmettre à l'AMF toute pièce de la procédure pénale en lien direct avec des faits susceptibles de donner lieu à sanction, dans le but :
- d'étendre cette faculté à l'ensemble des procureurs de la République, et non plus seulement au procureur de la République financier (a) ;
- de préciser que la communication des pièces ne peut intervenir qu'après avis favorable du juge d'instruction si la procédure fait l'objet d'une information, tandis que le droit actuellement en vigueur prévoit seulement, de façon trop imprécise, que cette transmission n'a lieu que « le cas échéant après avis du juge d'instruction » - ce qui peut être interprété comme ne liant pas le procureur de la République en cas d'avis défavorable (b).
Le 2° modifie les articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 du code monétaire et financier de façon à rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE POURSUITE DOIT ÊTRE RENFORCÉE
Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, le présent article devrait permettre de « renforcer la capacité de l'AMF à conduire son action répressive, dès lors que les informations relatives à un certain nombre de manquements qu'elle a pour mission de réprimer pourront être plus facilement obtenues de la part des autorités de poursuite ». De fait, selon le Gouvernement, une telle mesure serait nécessaire « au regard des enquêtes déjà concernées et de la montée en puissance des sujets répressifs », en lien, notamment, avec l'émergence des crypto-actifs.
La commission, qui souhaite elle aussi permettre à l'AMF d'assumer plus efficacement ses missions, note que, comme l'a constaté le Conseil d'État dans son avis sur le texte, le dispositif proposé se justifie par l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de prévention des atteintes à l'ordre public.
Le présent article lui paraît par ailleurs suffisamment encadré pour garantir la proportionnalité de cette atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction et au droit au respect de la vie privée, dans la mesure où :
- seules des pièces présentant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'AMF pourront être transmises par les parquets ;
- si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, la communication est soumise à l'avis favorable du juge d'instruction ;
- les agents de l'AMF sont tenus au respect du secret professionnel45(*).
Par conséquent, la commission approuve le dispositif proposé et se déclare favorable à l'adoption de cet article.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 14
Majoration de la contribution sociale
généralisée assise sur les revenus issus
d'activités illicites et prise en compte de ces revenus pour le service
des revenus de remplacement
Le présent article prévoit :
- d'une part, la majoration du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus issus d'activités illicites de 9,2 % à 25 % et la suppression de sa déductibilité partielle du revenu imposable ;
- d'autre part, l'interdiction du cumul des revenus de remplacement servis par France Travail (allocation de retour à l'emploi - ARE -, allocation des travailleurs indépendants - ATI - et allocation de solidarité spécifique - ASS) avec les revenus d'activités illicites.
Dans un souci d'équité fiscale et sociale, la commission est favorable à l'adoption de cette mesure, qui permettra de réaliser des économies au bénéfice du budget de l'État, qui finance l'ASS, et celui de l'assurance chômage, dans un contexte de dégradation des finances publiques, à laquelle contribuent les activités illicites.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LA CSG EST PRÉLEVÉE SUR LES REVENUS D'ACTIVITÉS ILLICITES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, TANDIS QUE LA PERCEPTION DE CES REVENUS N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE REVENUS DE REMPLACEMENT
A. LES REVENUS ISSUS D'ACTIVITÉS ILLICITES SONT ASSUJETTIS À LA CSG DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LES REVENUS DU PATRIMOINE
Aux termes du code général des impôts, lorsqu'il résulte des constatations de faits opérées dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire et que l'administration fiscale est informée qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet de certaines infractions46(*) ou d'une somme d'argent, produit direct d'une de ces infractions, cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien ou au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée47(*).
Il en est de même des biens meubles qui ont servi à commettre ces infractions ou étaient destinés à les commettre.
Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme en question, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
Néanmoins, l'étude d'impact du projet de loi précise que « cette assiette est, dans les faits, strictement limitée aux éléments découverts dans le cadre d'une procédure pénale, et sous réserve que l'administration fiscale ait été informée d'une implication présentant un intérêt financier, fiscal ou douanier ».
En tout état de cause, les revenus issus d'activités illicites sont non seulement assujettis à l'impôt sur le revenu, mais aussi à la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les revenus du patrimoine48(*), aux taux, respectivement, de 9,2 %49(*) et de 0,5 %50(*).
Au surplus, le montant des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu et de la CSG sur ces revenus est assorti d'une majoration de 80 %51(*).
En revanche, pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la CSG afférente à ces revenus est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points52(*).
B. EN L'ÉTAT DU DROIT, RIEN NE FAIT OBSTACLE AU CUMUL DE REVENUS DE REMPLACEMENT ET DE REVENUS D'ACTIVITÉS ILLICITES
Aujourd'hui, les revenus d'activités illicites ne sont pas connus de France Travail, qui, en tout état de cause, n'est autorisé par la loi :
- ni à en tenir compte pour faire obstacle à l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)53(*) ;
- ni à les intégrer aux ressources prises en compte pour l'ouverture des droits à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI)54(*) et à l'allocation de solidarité spécifique (ASS)55(*) - bien que le code du travail dispose que doivent être prises en considération pour l'ouverture des droits à cette dernière allocation, en sus de l'allocation elle-même, « les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements »56(*).
Par conséquent, ces revenus de remplacement peuvent être cumulés avec des revenus d'activités illicites, tandis qu'il est impossible à France Travail de récupérer les sommes versées aux bénéficiaires de revenus d'activités illicites une fois ceux-ci découverts.
En revanche, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), elle, tient compte des revenus d'activités illicites pour l'ouverture des droits aux prestations qu'elle sert, dès lors que, comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « ces informations émanent d'un tiers de confiance et que ces revenus soient imposables et quantifiés ».
De fait, les dispositions réglementaires déterminant les conditions d'attribution des prestations sociales prescrivent la prise en compte des revenus imposables du ménage. S'agissant du revenu de solidarité (RSA), par exemple, les caisses d'allocations familiales (CAF) doivent retenir « l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer »57(*).
Dès lors, en pratique, les CAF déclinent localement une convention nationale conclue entre la Cnaf, la direction de la sécurité sociale (DSS), la direction générale de la police nationale (DGPN) et la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : SORTIR DU DROIT COMMUN EN MATIÈRE DE CSG SUR LES REVENUS ILLICITES ET INTERDIRE LEUR CUMUL AVEC DES REVENUS DE REMPLACEMENT
A. LA MAJORATION DU TAUX DE CSG APPLICABLE AUX REVENUS D'ACTIVITÉS ILLICITES ET LA FIN DE SA DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DU REVENU IMPOSABLE
Le I vise à compléter l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui fixe les différents taux de CSG applicables en fonction de la nature des revenus imposés, afin d'appliquer un taux dérogatoire de 25 % - au lieu de 9,2 % actuellement - aux revenus issus d'activités illicites soumis à l'impôt sur le revenu.
Dans le même temps, le II tend à compléter l'article 154 quinquies du code général des impôts de façon à mettre fin à la déductibilité de la CSG afférente à ce type de revenus du revenu imposable.
Aux termes du III, le I serait applicable à compter du 1er janvier 2026, tandis que le II s'appliquerait à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
B. L'INCOMPATIBILITÉ DE LA PERCEPTION DE REVENUS DE REMPLACEMENT ET DE CELLE DE REVENUS D'ACTIVITÉS ILLICITES
Le IV prévoit l'insertion au code du travail d'un article L. 5425-1-1 interdisant le cumul des revenus de remplacement destinés aux travailleurs privés d'emploi avec des revenus d'activités illicites soumis à l'impôt sur le revenu, communiqués à France Travail par l'administration fiscale.
Il est précisé que les modalités d'application de ces dispositions seraient fixées, pour l'ARE et l'ATI, par les accords relatifs à l'assurance chômage conclus par les partenaires sociaux58(*), et, pour l'ASS, par décret en Conseil d'État.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE JUSTICE ET D'ÉQUITÉ, DES ÉCONOMIES POUR L'ÉTAT ET L'ASSURANCE CHÔMAGE
Comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, le trafic de contrefaçons a progressé de 54 % entre 2020 et 2022, tandis que la contrebande de tabac et d'alcool a « plus que doublé » sur la période et que le trafic de stupéfiants et la consommation de drogues illicites à laquelle il donne lieu représentent « un coût pour les finances publiques et en particulier pour les finances sociales estimé à 7,7 milliards d'euros en 2019 ».
Or, les revenus qui en sont tirés ne sont assujettis à la CSG qu'au taux de 9,2 % - quand ils sont révélés -, au même titre que les revenus du patrimoine obtenus de manière parfaitement licite.
Dans un souci d'équité, il paraît donc légitime d'accroître la charge fiscale pesant sur ces revenus, générés au mépris de la législation et au prix d'une dégradation des finances sociales, et ce conformément aux recommandations formulées par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) dans son rapport relatif à la fraude sociale, publié en juillet 2024.
Le Gouvernement estime que la majoration de la CSG applicable aux revenus illicites permettrait de générer un rendement supplémentaire de 13,7 millions d'euros en 2026 et 14,7 millions d'euros en 2028.
Effet estimé de l'application aux revenus
d'activités illicites
d'un taux majoré de CSG
à 25 %
Source : Étude d'impact du projet de loi
Cette mesure paraît non seulement fondée sur le principe, mais aussi conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans la mesure où, d'une part, les revenus concernés revêtent une nature particulière en ce qu'ils ont été dissimulés par leurs bénéficiaires et où, d'autre part, elle porterait le taux marginal maximal d'imposition à 74,5 % pour les contribuables imposés au taux moyen le plus élevé applicable, soit 45 %, et redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au taux maximal de 4 %59(*), ce qui correspond peu ou prou au taux maximal d'imposition de 73,6 % admis par le Conseil constitutionnel pour des revenus de capitaux mobiliers distribués de manière irrégulière ou occulte60(*).
Par ailleurs, l'interdiction du cumul entre allocations et revenus illicites, qui permettra à France Travail de récupérer a posteriori les sommes versées aux bénéficiaires de revenus issus d'activités illicites, constitue une mesure de bon sens, dont l'effet sur l'équilibre financier de l'Assurance chômage et, s'agissant de l'ASS, sur celui de l'État, qui ne peut être que positif, n'a cependant pas pu être estimé par le Gouvernement.
En tout état de cause, même si son rendement devait s'avérer modeste, cette mesure mérite d'être soutenue dans son principe même.
La commission a par conséquent approuvé le dispositif proposé par le présent article.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 15
Extension des obligations en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux
transactions réalisées par tout moyen de paiement auprès
d'un commerçant de biens de haute valeur
Le présent article renforce les obligations imposées aux professionnels de la vente de biens de luxe61(*) en étendant leur assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour toute transaction supérieure à 10 000 euros, et non plus uniquement pour les transactions supérieures à ce même plafond effectuées en espèces ou au moyen de monnaie électronique.
Cette mesure permet ainsi de couvrir désormais l'ensemble des moyens de paiement utilisés par les criminels pour blanchir le produit de leurs infractions.
Par ailleurs, elle permet d'anticiper l'entrée en vigueur en juillet 2027 du règlement 2024/1624 du 19 juin 2024, adopté dans le cadre du sixième paquet « anti-blanchiment » de l'Union européenne, et qui prévoit l'assujettissement aux obligations LBC-FT des négociants en biens de luxe d'une valeur supérieure à 10 000 euros, quel que soit le moyen de paiement utilisé.
Enfin, le présent article permet de préserver la cohérence du cadre anti-blanchiment, à la suite de l'annonce par le Gouvernement d'un abaissement par décret du plafond de paiement en espèces pour les transactions réalisées par des non-résident à 10 000 euros, contre 15 000 euros actuellement. Cet article permet d'éviter que l'abaissement du plafond de paiement en espèces n'entraine la caducité du dispositif d'assujettissement des vendeurs de biens de luxe qui, en l'absence de modification législative, ne s'appliquerait dans plus aucune situation.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'ASSUJETTISSEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA VENTE DE BIENS DE HAUTE VALEUR AUX OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT EST LIMITÉ AUX OPÉRATIONS IMPLIQUANT DES PAIEMENTS EN ESPÈCES OU EN MONNAIE ÉLECTRONIQUE
A. LE DISPOSITIF LCB-FT REPOSE SUR UN LARGE ASSUJETTISSEMENT DE PROFESSIONNELS À DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS AUX AUTORITÉS NATIONALES
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) s'articule autour d'un volet préventif et d'un volet répressif impliquant un certain nombre d'acteurs, dont la cellule de renseignement financier national - Tracfin - qui assure la collecte, l'analyse et l'exploitation de tout renseignement de nature à établir l'origine ou la destination délictueuse d'une opération financière en vertu des dispositions de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier (CMF).
Au titre du volet préventif, le législateur a prévu une collaboration étroite entre les autorités publiques et certains professionnels, prévoyant un large assujettissement des professions les plus exposées au risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Celles-ci sont détaillées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Parmi ces professions, les établissements bancaires et financiers s'avèrent être particulièrement nombreux compte tenu de la nature de leur activité. Les professions juridiques, telles que les avocats, les notaires ou encore les commissaires de justice, sont également mentionnées62(*). Cette liste s'est étoffée au gré des diverses évolutions législatives.
Champ des professions assujetties aux obligations LCB-FT
Sont concernées par les obligations LCB-FT :
- les établissements financiers et de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique ;
- les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les fonds, mutuelles et institutions de retraite ;
- les intermédiaires en opérations de banque, services de paiement et d'assurance ;
- les intermédiaires en financement participatif ;
- la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
- les entreprises d'investissement, les entreprises de marché, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif ainsi que les placements collectifs et les sociétés de gestion de placements collectifs ;
- les changeurs manuels, prestataires de services et les émetteurs de jetons ;
- les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
- les opérateurs de jeux ou de paris, c'est-à-dire les casinos, cercles de jeux et opérateurs de jeux en ligne ;
- les personnes qui négocient des oeuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des oeuvres d'art et d'antiquités ;
- les commerçants de métaux et de pierres précieuses et commerçants de biens pour un montant payé en espèces ou au moyen de monnaie électronique supérieur à 10 000 € ;
- les experts-comptables et commissaires aux comptes ;
- les avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judiciaires ;
- les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
- les personnes exerçant l'activité de domiciliation ;
- les agents sportifs ;
- les personnes intervenant dans la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
- les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ;
- les greffiers des tribunaux de commerce ;
- les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ;
- les loueurs et marchands de véhicules automobiles, de navires de plaisance et d'aéronefs privés63(*) ;
- les clubs affiliés à la Fédération française de football64(*).
Source : « Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société », rapport n° 757 (2024-2025) de la commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, tome I, déposé le 18 juin 2025
Les personnes assujetties doivent se conformer aux obligations suivantes :
- la mise en place d'un système d'identification et d'évaluation des risques LCB-FT et la mise en oeuvre d'une politique adaptée à ces risques65(*) ;
- des mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle66(*), qui se traduisent notamment par une obligation de vérification de l'identité du client avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une transaction, couramment appelées opérations Know your customers (KYC). Cette vigilance doit être constante67(*), ce qui implique pour les professionnels assujettis une obligation d'actualisation de leur connaissance client pendant toute la durée de la relation d'affaires ;
- les déclarations de soupçon, qui désignent l'obligation pour les professions assujetties de déclarer à Tracfin (voir infra), toutes les opérations suspectes qu'elles constatent68(*). Comme le soulignait Maxime Vaudano, journaliste au pôle « Enquêtes » du quotidien Le Monde lors de son audition devant la condition d'enquête du Sénat relative à la lutte contre la délinquance financière, « ces déclarations constituent en effet la première digue contre le blanchiment69(*) ».
B. L'ASSUJETTISSEMENT DU SECTEUR DES BIENS DE HAUTE VALEUR EST JUSTIFIÉ PAR LES VULNÉRABILITÉS QU'IL PRÉSENTE EN MATIÈRE DE LCB-FT
1. Les vendeurs de biens de haute valeur sont soumis aux obligations LCB-FT pour les transactions dépassant un certain montant en espèces ou en monnaie électronique
La cinquième directive anti-blanchiment de l'Union européenne du 30 mai 201870(*) prévoit l'assujettissement des vendeurs de biens de haute valeur aux obligations de prévention, dès lors que le paiement est effectué ou reçu en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. L'assujettissement de ces professions aux obligations LCB-FT figure par ailleurs parmi les recommandations du groupe d'action financière GAFI71(*), pour les opérations en espèces supérieures à 15 000 euros.
Le groupe d'action financière (GAFI) :
un mécanisme de coopération
qui repose sur une
évaluation par les pairs des législations LCB-FT
Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Crée en 1989 sur décision du G7, il fixe des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.
Le GAFI édicte régulièrement un corpus de 40 recommandations qui sont autant de principes à respecter pour lutter contre les délits financiers et connexes. Sur la base de ces recommandations, il procède régulièrement à l'analyse des dispositifs LCB-FT de plus de 200 juridictions, et plus particulièrement :
- des évaluations mutuelles régulières des 40 juridictions membres. La dernière évaluation de la France, en date de 2022, juge le dispositif français comme étant satisfaisant, et fait même partie des pays les mieux notés ;
- des évaluations moins fréquentes des autres juridictions non membres.
Source : « Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société », rapport n° 757 (2024-2025) de la commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, tome I, déposé le 18 juin 2025
Au niveau national, les opérations de vente de biens, sont assujetties aux obligations de prévention de blanchiment de capitaux dès lors que la transaction est réalisée en espèces ou au moyen de monnaie électronique72(*) pour toute transaction dépassant un montant défini par décret, conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 561-2 du CMF. L'article D. 561-10-1 du même code fixe ce montant à 10 000 euros.
Les plafonds de paiement en espèce associés aux obligations de vigilance de certaines professions assujetties s'articulent par ailleurs avec les dispositions du CMF qui visant à limiter la circulation des espèces pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
Les plafonds de paiement en espèce
L'article L. 112-6 prévoit que « ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ».
L'article D. 112-3 du code monétaire et financier fixe ce plafond :
- à hauteur de 1 000 euros pour les professionnels et les particuliers résidents fiscaux ;
- à hauteur de 10 000 euros pour les non-résidents fiscaux ;
- à hauteur de 15 000 euros pour les non-résidents effectuant leur paiement auprès d'un professionnel assujetti à la LCB-FT.
Le règlement 2024/1624 du 19 juin 2024, adopté dans le cadre du 6ème paquet « anti-blanchiment » de l'Union européenne de 2024, prévoit une obligation pour les États membres, d'ici au 1er juillet 2027 de mettre en place un plafond de paiement en espèces ne pouvant être supérieur à 10 000 euros. Cette disposition nécessitera donc une adaptation du plafond de paiement en espèces pour les non-résidents effectuant leur paiement auprès d'un professionnel assujetti à la LCB-FT.
Source : commission des finances
Les vendeurs de biens de haute valeur de type horlogerie, bijouterie, joaillerie ou orfèvrerie, entrent dans le champ d'application du 11° de l'article L. 561-2 du CMF et sont dès lors assujettis aux obligations en matière de LCB-FT pour toute transaction en espèces ou au moyen de monnaie électronique supérieure à 10 000 euros.
En effet, les biens de haute valeur peuvent constituer un vecteur de blanchiment important, comme l'a mis en exergue l'analyse nationale des risques (ANR) adoptée par le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) en 2023. La commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis a également montré que les criminels se tournent fréquemment « vers l'achat de biens moins encombrants, de type joaillerie, pierres précieuses, or, oeuvres d'art73(*) », pour « répondre au défi logistique que représente le volume d'espèces », et ainsi blanchir le produit de leurs infractions.
Aperçu du classement des secteurs en
fonction de l'intensité de la menace
et de la
vulnérabilité
Note : OBNL = organisme à but non lucratif et HBJO = « horlogerie, bijoux, joaillerie et orfèvrerie ».
Source : Analyse nationale des risques LBC-FT (ANR) publiée le 14 février 2023
2. L'assujettissement des professionnels de la vente de biens de haute valeur aux obligations de la LCB-FT concerne uniquement les paiements en espèce ou au moyen de monnaie électroniques mais sera élargi par le législateur européen à tous les types de paiement à l'horizon 2027
L'assujettissement des professionnels de la vente de biens de haute valeur aux obligations de la LCB-FT est aujourd'hui limité aux seuls paiements en espèces ou en monnaie électronique74(*).
Toutefois le règlement 2024/1624 du 19 juin 202475(*) adopté dans le cadre du sixième « paquet anti-blanchiment » de l'Union européenne du 31 mai 2024, prévoit, à compter du 1er juillet 2027, l'assujettissement aux obligations LBC-FT pour les négociants en biens de luxe d'une valeur supérieure à 10 000 euros, et ce, quel que soit le moyen de paiement utilisée dans la transaction concernée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ASSUJETTISSEMENT AUX OBLIGATIONS LCB-FT DE TOUTES LES OPÉRATIONS DE VENTES DE BIENS DE HAUTE VALEUR SUPÉRIEURES À DIX-MILLE EUROS QUEL QUE SOIT LE MOYEN DE PAIEMENT UTILISÉ
Le I du présent article modifie le 11° de l'article L. 561-2 du CMF afin d'étendre le champ d'assujettissement aux obligations LCB-FT des commerçants du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie à toutes les transactions de plus de 10 000 euros, quel que soit le moyen de paiement.
Le II permet l'application de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna.
Le III prévoit que ces dispositions entrent en vigueur « le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi », ce qui serait justifié, d'après Tracfin, par la nécessité pour les acteurs concernés de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS APPLICABLES AUX VENDEURS DE BIENS DE LUXE QUI PERMET DE METTRE LA FRANCE EN CONFORMITÉ AVEC SES FUTURES OBLIGATIONS EUROPÉENNES TOUT EN GARANTISSANT LA COHÉRENCE DE SON ARSENAL ANTI-BLANCHIMENT
A. UNE ADAPTATION DU DISPOSITIF LCB-FT QUI PERMET DE COUVRIR L'ENSEMBLE DES MOYENS DE PAIEMENT ET D'ANTICIPER LA MISE EN CONFORMITÉ DE LA FRANCE AVEC SES OBLIGATIONS EUROPÉENNES
La commission est favorable à cet article qui permet de renforcer le cadre anti-blanchiment en intégrant notamment tous les moyens de paiement dématérialisés qui, bien que moins risqués que les espèces ou la monnaie électronique, peuvent tout de même être utilisés dans les circuits de blanchiment. Cette mesure permet ainsi de couvrir davantage de situations problématiques, qui ne rentrent pas dans le champ déclaratif qui s'applique actuellement aux vendeurs de bien de haute valeur.
Le rapporteur relève par ailleurs que cet article permet d'anticiper la transposition des dispositions du sixième « paquet anti blanchiment » qui prévoient, au 1er juillet 2027, un assujettissement de vendeur de biens de haute valeur pour toutes les transactions supérieures à 10 000 euros, et ce quel que soit le moyen de paiement utilisé.
B. UN DISPOSITIF QUI PERMET DE PRÉSERVER LA COHÉRENCE DU CADRE ANTI-BLANCHIMENT APRÈS L'ANNONCE PAR LE GOUVERNEMENT D'UN ABAISSEMENT PAR DÉCRET DU PLAFOND DE PAIEMENT EN ESPÈCES POUR LES NON-RÉSIDENTS
Le Gouvernement a par ailleurs annoncé, dans le cadre de la présentation du présent projet de loi, un abaissement de 15 000 euros à 10 000 euros du plafond de paiement en espèces pour les non-résidents auprès d'un professionnel assujetti76(*). Cette mesure, qui sera prise par décret, permettra d'anticiper l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2027, des dispositions du règlement 2024/1624 du 19 juin 2024 qui prévoient une obligation pour les États membres de mettre en place un plafond de paiement en espèces ne pouvant être supérieur à 10 000 euros pour tout type de transaction.
La modification législative introduite par le présent article permet d'assurer la cohérence du dispositif LCB-FT, compte tenu de l'abaissement à venir du plafond de paiement en espèce ou en monnaie électronique. En effet, en l'absence de mesure législative complémentaire, l'abaissement du plafond rendrait de facto caduque l'assujettissement des vendeurs de biens de luxe prévu au 11° de l'article L. 561-2 du CMF, qui ne relèverait dans ce scénario d'aucune situation juridiquement admissible77(*).
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18
Criminalisation de l'escroquerie aux
finances publiques réalisée
en bande organisée
Le présent article renforce les sanctions applicables en cas d'escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée au détriment des finances publiques. Il vise plus particulièrement à :
- criminaliser l'escroquerie aux finances publiques en bande organisée, en portant la peine d'emprisonnement encourue pour ce type d'infraction à 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 d'euros d'amende, contre 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende dans le droit actuel ;
- permettre aux officiers de douane judiciaire (ODJ) et aux officiers fiscaux judiciaires (OFJ) des services d'enquête de l'Office national antifraude (ONAF) d'être saisis sur ce nouveau crime, comme c'est déjà le cas en ce qui concerne les délits d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée ;
- appliquer, pour la poursuite de cette infraction, la procédure mentionnée à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, qui correspond à la procédure applicable à la criminalité organisée, à l'exception de la possibilité d'étendre la durée de garde à vue des mis en cause jusqu'à 96 heures. Cette procédure, déjà applicable pour le délit d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée, permettra notamment aux services d'enquête, compte tenu de la sophistication et de la complexification des réseaux de fraude, de mobiliser des techniques spéciales telles que des écoutes, captations de données, surveillances, ou infiltrations.
La commission des finances est favorable à cet article, déjà adopté par le Parlement dans la loi du 30 juin 2025 de lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques, mais censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier législatif.
La criminalisation du délit d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée permettra, d'une part, de renforcer le caractère dissuasif du dispositif répressif contre ce type de fraudes, et d'autre part, de sanctionner leurs auteurs à la hauteur de la gravité des faits qu'ils commettent.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'ESCROQUERIE AU FINANCES PUBLIQUES EN BANDE ORGANISÉE DONNE LIEU À DES SANCTIONS QUE LE PARLEMENT A RÉCEMMENT TENTÉ DE DURCIR
A. LA PROCÉDURE ET LES SANCTIONS PÉNALES APPLICABLES AU DÉLIT D'ESCROQUERIE AUX FINANCES PUBLIQUES COMMISE EN BANDE ORGANISÉE
L'escroquerie est définie à l'article 323-1 du code pénal comme le fait, « soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce même article prévoit également que cette infraction est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le 5° de l'article 312-3 du code pénal porte cette peine à 7 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende lorsque le délit d'escroquerie est commis au préjudice des finances publiques. Il précise par ailleurs que cette même infraction est punie de 10 ans d'emprisonnement et d'1 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Les services de l'office national antifraude (ONAF), composés d'officiers de douane judiciaires (ODJ), prévus à l'article 28-1 du code de procédure pénale (CPP), et d'officiers fiscaux judiciaires (OFJ), prévus à l'article 28-2 du même code, sont compétents pour rechercher et constater ces infractions78(*).
Le délit d'escroquerie aux finances publiques est aujourd'hui dans le champ des infractions de l'article 706-736-1 du CPP, ce qui permet d'appliquer « à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement » de cette infraction, les mêmes garanties de procédures79(*) applicables aux infractions relevant de la criminalité organisée, à l'exception de l'article 708-88 du CPP permettant la garde à vue des mis en cause jusqu'à 96 heures80(*).
B. DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA CRIMINALISATION DE L'ESCROQUERIE AUX FINANCES PUBLIQUES EN BANDE ORGANISÉE ONT ÉTÉ ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT DANS LA LOI DE LUTTE CONTRE TOUTES LES FRAUDES AUX FINANCES PUBLIQUES DU 30 MAI 2025 AVANT D'ÊTRE CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, le Sénat a adopté, à l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet, un amendement81(*) visant à renforcer les sanctions pénales applicables en cas d'escroquerie aux finances publiques réalisée en bande organisée. Ce dispositif a finalement été adopté à l'article 12 du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, et permettait :
- de porter la peine encourue en cas d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée à 15 ans de réclusion criminelle et à 1 000 000 d'euros d'amende ;
- de prévoir la possibilité pour les enquêteurs de l'ONAF mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du CPP d'être saisis des enquêtes portant sur ces infractions ;
- d'appliquer à ce nouveau crime d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée la procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes, à l'exception de la disposition permettant d'étendre la durée de garde à vue des prévenus à 96 heures. À noter que l'amendement prévoyait initialement une disposition permettant de porter la durée de la garde à vue à 96 heures pour ce type d'infraction, avant d'être rectifié par son auteur, compte tenu du risque de censure par le Conseil constitutionnel qu'encourait une telle disposition (voir infra).
Toutefois, le Conseil constitutionnel, saisi sur ce texte en application de l'article 61 de la Constitution, a estimé que cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions initiales de la proposition de loi82(*). Il l'a donc censuré en application de l'article 45 de la Constitution.
Le risque de censure par le Conseil
constitutionnel de l'application de la durée de garde à vue
à 96 heures pour le nouveau crime d'escroquerie
aux finances
publiques en bande organisée
L'inscription d'un crime ou d'un délit à l'article 706-73 du CPP permet, outre le recours aux techniques spéciales d'enquête telles que les écoutes, captations de données, surveillances et infiltrations, la mise en oeuvre de la garde à vue dérogatoire prévue par l'article 706-88 du CPP, pouvant être prolongée jusqu'à 96 heures, contre 48 heures dans le droit commun.
Dans une décision du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a validé la possibilité d'appliquer les techniques spéciales d'enquêtes aux délits de fraude fiscale commis en bande organisée, compte tenu de leur complexité et de leur gravité83(*). Il a rendu la même analyse, dans une décision du 9 octobre 2014, en ce qui concerne l'escroquerie en bande organisée. Il a souligné que ces délits ne portent pas directement atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes84(*). Pour autant, le Conseil constitutionnel a considéré que l'application de la garde à vue de 96 heures à ces délits, même commis en bande organisée, portait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la liberté individuelle85(*).
Toutefois, plusieurs éléments conduisent à nuancer le risque de censure du Conseil constitutionnel d'une disposition qui prévoirait d'inclure l'escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée dans le champ de l'article 706-73 du CPP.
Tout d'abord, le commentaire aux cahiers de la décision du Conseil relative à l'application de la garde à vue de 96 heures aux délits de fraude fiscale commis en bande organisée a précisé que la censure était prononcée car il s'agissait en l'espèce d'infractions « qui ne constituent ni des crimes, ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes », ce qui pourrait laisser supposer que la criminalisation de l'escroquerie en bande organisée pourrait permettre l'application de la garde à vue de 96 heures.
Le Conseil constitutionnel a également admis que certaines infractions, bien que ne portant pas atteinte directement aux personnes, puissent entrer dans le champ de l'article 706-73 du CPP, en raison de leur gravité intrinsèque et des atteintes à l'intérêt général économique ou au patrimoine artistique national qu'elles représentent86(*). Parmi ces infractions figurent :
- le crime de vol lorsqu'il est commis en bande organisée87(*) ;
- le crime de fausse monnaie, dont l'inscription dans le champ de l'article 706-73 du CPP est justifiée par les périls que les faux monnayeurs font courir à l'économie88(*) ;
Dès lors, la question de l'inscription du crime d'escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans la liste des infractions de l'article 706-73 se pose légitimement. Si le risque de censure est bien réel, il est possible que le Conseil constitutionnel valide une telle disposition, en raison du mouvement de sophistication de la fraude aux aides publiques, de la structuration et de la professionnalisation des réseaux qui en bénéficient, ainsi que du coût qu'il implique pour les finances de l'État.
Commission des finances : d'après les réponses aux questionnaires du rapporteur
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN RENFORCEMENT DES SANCTIONS PÉNALES APPLICABLES À L'INFRACTION D''ESCROQUERIE AUX FINANCES PUBLIQUES COMMISE EN BANDE ORGANISÉE
Le présent article reprend à l'identique le dispositif adopté par le Parlement dans la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques89(*), puis censuré par le Conseil constitutionnel.
A. UN DURCISSEMENT DES SANCTIONS EN CAS D'ESCROQUERIE AUX FINANCES PUBLIQUES EN BANDE ORGANISÉE
Le 1° du I du présent article modifie l'article 313-2 du code pénal, de manière à porter à 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 d'euros d'amende les peines prévues lorsque l'escroquerie en bande organisée est réalisée « au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu », autrement dit, au détriment des finances publiques.
Il prévoit en outre que sont appliqués à ce type d'infractions les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, qui fixent la période de sureté pendant laquelle une peine supérieure à dix ans d'emprisonnement ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. Cette période de sureté est ainsi fixée à « la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, (à) dix-huit ans. »
B. L'APPLICATION D'UN RÉGIME DÉROGATOIRE EN CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE APPLICABLE À L'ENQUÊTE
Le 2° du II du présent article garantit l'application de la procédure de l'article 706-73-1 du CPP à ce nouveau crime d'escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée. Il permet ainsi d'appliquer à cette infraction les mêmes garanties de procédures applicables aux infractions relevant de la criminalité organisée, à l'exception de l'article 708-88 du CPP permettant la garde à vue des mis en cause jusqu'à 96 heures.
Le 1° du II modifie les articles 28-1 et 28-2 du CPP afin de permettre aux ODJ90(*) et ODJ91(*) de l'ONAF d'être saisis des enquêtes portant sur le crime d'escroquerie en bande organisée commises au détriment des finances publiques.
Enfin le 2° du I et le 3° du II visent à garantir l'application de l'ensemble des dispositions du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DURCISSEMENT BIENVENU DES SANCTIONS À L'ÉGARD DES FRAUDEURS
La commission des finances souscrit pleinement aux dispositions de cet article, sur lesquelles elle avait rendu un avis favorable lors de l'examen de la proposition de loi de lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques le 2 avril 2025.
La création d'une infraction criminelle d'escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée aura une portée dissuasive en sanctionnant avec plus de sévérité les membres des organisations criminelles qui font profession de détourner l'argent public à leur profit.
Ce durcissement des sanctions permet par ailleurs de procéder à un alignement des peines encourues par les auteurs de cette infraction avec celles prévues pour le crime de vol en bande organisée92(*). Dans son avis rendu sur le projet de loi rendu le 11 septembre 2025, le Conseil d'État, se prononçant sur le caractère proportionné de la sanction fixée par le dispositif, a constaté que « des infractions qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, peuvent être regardées comme comparables à l'escroquerie en bande organisée sont punies par des peines privatives de liberté identiques voire plus lourdes ». Ainsi, comme le souligne l'étude d'impact du présent projet de loi, « le rapprochement entre le vol et l'escroquerie s'impose avec évidence » dans la mesure où « le vol et l'escroquerie participent d'une même logique d'appropriation illégitime du bien d'autrui93(*) ».
Les aides publiques font aujourd'hui l'objet de fraudes conduites par des réseaux criminels structurés, agissant souvent depuis l'étranger, et dès lors, particulièrement difficile à identifier et à démanteler. Ces organisations parviennent à capter frauduleusement une part importante des crédits alloués à chacun des dispositifs d'aides publiques en « usant de moyens importants, profitant de la dématérialisation de l'instruction des demandes et mettant en oeuvre une ingénierie complexe94(*) ». Dès lors, il est parfaitement justifié que les services d'enquête disposent de tous les outils procéduraux mentionnés à l'article 706-73-1 du CPP pour la recherche et la poursuite de ces infractions, dont la complexité implique des moyens d'enquête renforcés. Par ailleurs, le rapporteur a fait le choix de ne pas porter d'amendement visant à intégrer le crime d'escroquerie aux finances publiques en bande organisée dans le champ des infractions pouvant faire l'objet d'une durée de garde à vue dérogatoire de 96 heures, compte tenu du risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 19
Renforcement des sanctions applicables au
délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude
fiscale
Le présent article vise à renforcer le cadre juridique applicable aux sanctions et à l'enquête relatives aux délits concernant les fraudes aux finances publiques présentant un degré de complexité et de gravité particulier. Il prévoit plus particulièrement :
- de durcir les sanctions applicables au délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale, en les portant à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende contre trois ans et 250 000 euros d'amende dans le droit actuel ;
- d'inclure le délit de fraude fiscale, les délits comptables ainsi que le délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale parmi les infractions justifiant le recours à des techniques spéciales d'enquête95(*), dans les cas les plus graves, et notamment, lorsque ces infractions sont commises en bande organisée ;
- d'étendre la compétence du procureur de la République financier à la poursuite du délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale.
Les dispositions de cet article rejoignent les constats de la mission d'information de la commission des finances de 2022 sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales quant à la nécessité d'une plus grande responsabilisation des intermédiaires financiers impliqués dans des schémas frauduleux. Le rehaussement des peines applicables à ce délit permet par ailleurs d'harmoniser les régimes de sanctions et d'enquête visant des délits intrinsèquement liés.
Par ailleurs, la commission estime que le recours à des techniques spéciales d'enquête pour poursuivre ce type de délits est justifié par la sophistication croissante des schémas de fraudes concernés, qui impliquent souvent l'intervention de réseaux criminels structurés et opérant depuis l'étranger.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LA LOI DE FINANCES POUR 2024 A INSTITUÉ UN DÉLIT AUTONOME DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE
A. LA PÉNALISATION RÉCENTE DE LA MISE À DISPOSITION PAR LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS D'INSTRUMENTS FAVORISANT LA FRAUDE FISCALE DE LEURS CLIENTS
1. La création du délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale par l'article 113 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2024
L'article 113 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude, codifié à l'article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. Le législateur a entendu viser plus précisément :
- les intermédiaires qui proposent des schémas de fausse domiciliation fiscale à l'étranger, des montages visant à majorer indûment les charges ou éluder tout ou partie des recettes d'une entreprise, la confection de dossiers de crédits d'impôt fictif, ou encore des schémas de fraude à la défiscalisation outre-mer ;
- les personnes qui créent, à titre individuel, des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier de restitutions d'impôt sur le revenu, en contrepartie d'une rémunération.
Aux termes de l'article 1744 précité, « ce délit consiste en la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au code général des impôts. »
Le délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale peut ainsi être caractérisé au regard de deux éléments cumulatifs.
Un élément matériel, d'une part, est établi par les moyens, services, actes ou instruments mis à disposition de tiers, limitativement énumérés aux 1° à 5° du I de l'article 1744, à savoir :
- l'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
- l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;
- l'usage d'une fausse identité, de faux documents ou de toute autre falsification ;
- la mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
- et la réalisation de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration.
Il est précisé que cette mise à disposition peut s'effectuer aussi bien à titre gratuit, sans contrepartie financière, qu'à titre onéreux, avec une contrepartie financière, qu'elle soit fixe ou à proportion, par exemple, de l'imposition qu'elle permettrait de frauder.
Un élément intentionnel, d'autre part, suppose que les moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers mis à la disposition de tiers le soient dans l'intention de permettre à ces derniers de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt.
2. Le régime des sanctions pénales applicables au délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale
En ce qui concerne le régime de sanctions applicable aux personnes reconnues coupables d'un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude, il convient de distinguer les sanctions portant sur les personnes physiques et les personnes morales.
S'agissant des personnes physiques reconnues coupables de tels agissements, celles-ci encourent, en application du I de l'article 1744 du CGI, une peine d'emprisonnement de trois ans et une amende de 250 000 euros, au titre des peines principales. Ce même article prévoit que les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
En outre, les personnes physiques encourent une série de peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI. Parmi ces peines complémentaires, le juge peut notamment retenir :
- l'affichage et la diffusion du jugement ;
- l'interdiction d'exercer ;
- la privation des droits civiques, civils et de famille du prévenu.
S'agissant des peines encourues par les personnes morales, l'article 131-38 du code pénal prévoit une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, à laquelle peuvent s'ajouter une série de peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. Il s'agit notamment de :
- la dissolution de la personnalité morale ;
- l'interdiction, définitive ou temporaire, d'exercer l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- le placement temporaire sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture, définitive ou temporaire, d'établissements ;
- l'exclusion, définitive ou temporaire, des marchés publics ;
- l'interdiction, définitive ou temporaire, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
- l'interdiction temporaire de percevoir des aides publiques.
B. UN NOUVEAU DÉLIT AUTONOME QUI COMPLÈTE L'ARSENAL PRÉEXISTANT DE SANCTIONS À L'ÉGARD DES INTERMÉDIAIRES COMPLICES DE FRAUDE FISCALE
La création d'un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale a introduit la possibilité de sanctionner de manière « autonome » les intermédiaires financiers sans pour autant que la fraude ne se soit matérialisée, que les clients aient utilisé ces instruments ou que la fraude ait été repérée à l'occasion de contrôles fiscaux96(*).
Il permet ainsi de poursuivre des personnes mettant à disposition ces moyens de facilitation de la fraude et de déclencher des enquêtes judiciaires sans attendre l'issue d'un contrôle fiscal ou l'engagement de poursuites contre le client. Sous l'empire du droit antérieur, les intermédiaires facilitant la fraude fiscale ne pouvaient être poursuivis qu'au cas par cas, lorsqu'ils étaient reconnus complices de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients.
L'arsenal de sanctions pénales contre les complices de fraude fiscale
Le code pénal dispose que tout complice de l'infraction est puni comme son auteur (article 121-6), le complice d'un délit ou d'un crime étant défini comme la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la commission (article 121-7). Est également visée la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Aux termes de l'article 1742 du code général des impôts (CGI), les deux articles précités du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741 du même code, relatif au délit de fraude fiscale et aux sanctions pénales qui lui sont adossées.
L'article 1741 du CGI dispose ainsi que toute personne qui s'est frauduleusement soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de ses impôts est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Elles sont portées à trois millions d'euros pour l'amende, montant qui peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, et à sept ans d'emprisonnement pour la fraude fiscale aggravée97(*). L'article 1741 du CGI prévoit, en plus de l'amende et de la peine d'emprisonnement, le prononcé de peines complémentaires de privation des droits civiques, civils et de famille pour les délits de fraude fiscale aggravée, leur recel et leur blanchiment.
Aux termes de l'article 1743 du CGI, sont également passibles des peines prévues à l'article 1741 les personnes qui ont sciemment violé leurs obligations comptables (omission d'écritures ou écritures inexactes), qui permettent de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'une autre personne (utilisation de dépôts et de titres à l'étranger) ou qui ont sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'agréments ou d'une autorisation dans le cadre de dispositifs d'investissements (Outre-Mer).
Enfin, sont également complices toutes personnes qui apportent leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, telle que par exemple une opération de blanchiment de fraude fiscale. Le blanchiment est puni de cinq ans de prison et de 375 000 euros d'amende (article 324-1 du code pénal), et de dix ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsqu'il est commis en bande organisée (article 324-2 du même code).
Source : rapport général n° 128 (2023-2024), tome II, fascicule 1, déposé au nom de la commission des finances par Jean-François Husson le 21 novembre 2023.
Ainsi le délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale permet désormais, comme l'expliquait le ministre délégué aux comptes publics de l'époque, M. Thomas Cazenave, de « lutter contre la commercialisation, notamment sur internet et les réseaux sociaux, de schémas de fraude fiscale ou d'outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine »98(*). Il s'agit de pouvoir apporter une réponse pénale aux professionnels99(*) qui « communiquent et font la promotion de montages destinés à soustraire des contribuables à l'établissement et au paiement de l'impôt »100(*).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS APPLICABLES AU DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS FACILITANT LA FRAUDE FISCALE ET UNE EXTENSION DE LA POSSIBILITÉ DE MOBILISER DES TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTES DANS LES CAS LES PLUS GRAVES DE FRAUDES FISCALES ET COMPTABLES
A. UN DURCISSEMENT DES SANCTIONS ENCOURUES POUR LES INTERMÉDIAIRES QUI FACILITENT LA FRAUDE FISCALE DE LEURS CLIENTS
Le 1° du I du présent article modifie le 10° du I de l'article 1744 du code général des impôts (CGI) afin de durcir les sanctions pénales applicables au délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale. Les peines encourues par les auteurs de cette infraction seraient ainsi portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, contre trois ans et 250 000 euros d'amende dans le droit actuel.
Le 2° du I du même article porte ces peines à 7 ans d'emprisonnement et 3 000 000 euros d'amende lorsque la mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale est réalisée à l'aide d'un service de communication au public en ligne, contre cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende actuellement. Il crée en outre une nouvelle circonstance aggravante lorsque cette fraude est commise en bande organisée.
Le présent article procède ainsi à un alignement du niveau de peine en cas de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale avec celui prévu pour le délit de fraude fiscale101(*) et les délits comptables102(*).
B. L'OCTROI DE TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE RELEVANT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE POUR LES DÉLITS COMPTABLES, DE FRAUDE FISCALE ET DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS FACILITANT LA FRAUDE FISCALE
Le 3° du II du présent article permet d'étendre les techniques spéciales d'enquête prévues à l'article de 706-73-1 du code de procédure pénale103(*) (CPP) aux délits comptables, au délit fiscal et au délit de mise à dispositions d'instruments facilitant la fraude fiscale lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Concernant les délits fiscaux et comptables, cette procédure est également étendue aux cas où « il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales », c'est-à-dire, pour le délit de fraude fiscale aggravée et les délits comptables les plus graves. Il s'agit concrètement des cas où l'infraction résulte :
- soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
- soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
- soit de la falsification d'identité ou de document ;
- soit de la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
- soit de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration104(*) ;
Par conséquent, le 2° du II abroge le 2° de l'article 706-1-1 du CPP qui inclut les délits de fraude fiscale et les délits comptables dans la procédure spécialement applicable aux infractions en matière économique et financière.
C. L'EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER AU DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS FACILITANT LA FRAUDE FISCALE
Le 1° de ce même II vise à étendre la compétence du procureur de la République financier aux délits de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale, comme c'est déjà le cas en ce qui concerne le délit de fraude fiscale aggravé ou commis en bande organisée, ainsi que les délits comptables commis en bande organisée ou dans les conditions mentionnées au 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN RENFORCEMENT DES PEINES QUI S'INSCRIT DANS UN MOUVEMENT DE RESPONSABILISATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS IMPLIQUÉS DANS DES MONTAGES FRAUDULEUX
A. UN RENFORCEMENT PROPORTIONNÉ DES PEINES APPLICABLES AU DÉLIT DE MISE À DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE FRAUDES FISCALES DANS UNE LOGIQUE DE RESPONSABILISATION DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS
La mission d'information de la commission des finances de 2022 sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales a affirmé la nécessité de « promouvoir une meilleure responsabilisation des intermédiaires impliqués dans des montages financiers abusifs »105(*). Elle s'appuyait sur les travaux de l'OCDE qui, dans un rapport de 2021, appelait à davantage réprimer les intermédiaires fiscaux qui décident de jouer un « rôle décisif pour dissimuler des délits fiscaux et d'autres infractions financières commises par leurs clients »106(*). Le présent article s'inscrit pleinement dans cette logique, en sanctionnant plus sévèrement les intermédiaires favorisant la fraude de leurs clients.
Par ailleurs le renforcement des peines applicables au délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale permet de les aligner sur celles applicables au délit de fraude fiscale et aux délits comptables, et permet ainsi, d'après l'avis du Conseil d'État sur le présent projet de loi, « de mettre en cohérence le régime de plusieurs infractions concourant à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. »
Ce dernier a d'ailleurs rappelé que les peines prévues pour les délits comptables et de fraude fiscale ont été déclarées conformes au principe de proportionnalité des peines par le Conseil constitutionnel107(*). Dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État estime « qu'au regard de la gravité des faits sanctionnés par ce délit et de l'existence d'une délinquance organisée en matière de fraude fiscale, les peines et aggravations prévues par le projet de loi ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni le principe de proportionnalité de ces dernières. »
B. LE RECOURS À DES TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ ET DE DÉLINQUANCE ORGANISÉES SE JUSTIFIE POUR FAIRE ÉCHEC À DES MONTAGES FRAUDULEUX DE PLUS EN PLUS COMPLEXES ET SOPHISTIQUÉS
Par ailleurs, le rapporteur estime que le recours à des techniques spéciales d'enquête pour la poursuite de ces délits est, compte tenu de la sophistication des schémas de fraude aux finances publiques, parfaitement justifié.
À titre d'exemple, une administration fiscale a indiqué au rapporteur que le premier signalement délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale fait par ses services à l'autorité judiciaire concernait un montage impliquant une multitude d'acteurs qui opérait notamment à l'étranger, et consistant en l'absorption par une société bulgare, par voie de transmission universelle de patrimoine, de nombreuses sociétés françaises défaillantes, pour faire obstacle au pouvoir de contrôle de l'administration fiscale et au recouvrement des impôts éludés. La mobilisation des techniques spéciales de l'article 706-73-1 du CPP, telles que les écoutes, captations de données, surveillances et infiltrations, permettra aux services d'enquêtes compétents de poursuivre plus efficacement ce type de fraudes.
Le Conseil d'État a en outre estimé, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, que les dispositions prévoyant le recours aux techniques spéciales d'enquête pour ce type de délit sont suffisamment proportionnées, « compte tenu, d'une part, de la complexité et de la gravité des infractions en cause, susceptibles de nécessiter le recours à des techniques spéciales en vue de les constater, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs et, d'autre part, des garanties encadrant la mise en oeuvre des techniques permises par l'article 706-73-1 » du CPP.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
20
Création d'une obligation déclarative à la
charge des administrateurs de trusts à l'occasion du paiement de droits
de mutation par décès et précision des majorations
encoures en cas de rectification due à une omission
déclarative
Un trust est un montage juridique permettant à un constituant de confier, de son vivant, la gestion de son patrimoine à un administrateur (trustee), qui est chargé de le gérer dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires. Les actifs figurant dans un trust sont soumis à des droits de mutation à titre gratuit au décès du constituant.
Les trustees doivent par ailleurs déclarer auprès de l'administration fiscale la valeur de ces actifs, ainsi que tout évènement susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust. En cas d'omission déclarative de la part du trustee, un mécanisme de majoration de 80 % de l'impôt dû est prévu.
Les obligations de transparence à l'égard des administrateurs de trust et le dispositif de sanctions applicables en cas d'omission de déclaration sont, en l'état actuel du droit, incomplets. En effet, l'obligation contributive des administrateurs de trust en cas de décès du constituant n'est assortie d'aucune obligation déclarative. Cette lacune empêche l'administration fiscale, en cas de défaillance de l'administrateur dans l'accomplissement de son obligation contributive, d'user des outils de contrôle habituellement mis en oeuvre dans cette situation. Par ailleurs, les pénalités prévues en cas d'omission de déclaration par les trustees ne s'appliquent qu'aux seuls actifs immobiliers, alors que l'obligation déclarative s'applique à l'ensemble des actifs mis en trust.
Le présent article vise donc à corriger cette situation :
- d'une part, en instituant une obligation déclarative à la charge du trustee au moment du paiement des droits de mutation par décès ;
- d'autre part, en étendant le champ d'application de la majoration de 80 % en cas d'omission déclarative, jusqu'ici limitée aux seuls biens immobiliers, à l'ensemble des actifs financiers détenus via un trust.
Ce double ajustement permet de rétablir la cohérence du dispositif fiscal applicable aux trusts, d'assurer une égalité de traitement entre les différents types d'actifs et de renforcer les moyens de contrôle de l'administration.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE TRUST, UN MONTAGE JURIDIQUE PAR LEQUEL UNE PERSONNE TRANSFÈRE DES BIENS À UN ADMINISTRATEUR CHARGÉ DE LES GÉRER AU PROFIT D'UN OU PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES
A. LE TRUST, NOTION INCONNUE EN DROIT CIVIL FRANÇAIS, A ÉTÉ DÉFINI PAR LE LÉGISLATEUR FISCAL POUR LUTTER CONTRE L'UTILISATION DU TELS MONTAGES DANS L'OBJECTIF DE SE SOUSTRAIRE À L'IMPÔT
1. Le trust a fait l'objet d'un travail de définition par le législateur pour permettre une meilleure appréhension par les services fiscaux de ce montage visant principalement à éviter ou à se soustraire à l'impôt
Institution répandue dans divers systèmes juridiques étrangers, essentiellement anglo-saxons, le trust est inconnu en droit civil français. D'après l'étude d'impact du présent projet de loi, le trust permet, du vivant du constituant, de confier la gestion du patrimoine à un trustee - c'est-à-dire l'administrateur du trust choisi par le constituant.
Après le décès du constituant, l'administrateur « assure la dévolution de sa succession selon son souhait, tout en permettant également au patrimoine d'être maintenu, en totalité ou partiellement, dans le cercle familial sur plusieurs générations108(*) ». Ainsi, le trust se traduit par un « dédoublement de propriété109(*) », la propriété juridique étant détenue par le trustee, tandis que la propriété économique est détenue par le ou les bénéficiaire(s) du trust. Cet outil patrimonial est susceptible de recevoir toutes sortes d'actifs, tels que des immeubles, des oeuvres d'art, des parts de société, ou des liquidités, eux-mêmes susceptibles de générer des revenus.
Si le trust n'est pas reconnu par le droit français, le législateur110(*) a élaboré une définition fiscale des trusts constitués à l'étranger. Ce travail de qualification juridique du trust au regard du droit fiscal était en effet nécessaire pour permettre une meilleure appréhension par les services fiscaux de ces opérations, situées majoritairement dans des pays à fiscalité privilégiée, et qui poursuivent souvent l'objectif d'éviter ou de se soustraire à l'impôt.
Définition du trust par l'article 792-0 bis du code général des impôts
On entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.
Source : Légifrance
2. Les biens mis en trust sont imposables
Avant 2011, les biens mis en trust n'étaient imposables à aucun titre, ni pour le constituant ni pour les bénéficiaires. Seules les éventuelles distributions de capital ou de revenus devaient être déclarées et taxées.
L'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé une taxe annuelle spéciale sur les trusts prévue à l'article 990 J du CGI.
Les trusts font l'objet également d'une taxation au titre des droits de mutation par décès. Les b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI prévoient en effet la taxation des trusts d'accumulation au décès du constituant puis, le cas échéant, au décès des bénéficiaires réputés constituants.
B. UN DISPOSITIF D'OBLIGATIONS DÉCLARATIVES À L'ÉGARD DES « TRUSTEES » ASSORTIES DE PÉNALITÉS EN CAS D'OMISSION
1. Le législateur a prévu des obligations déclaratives à l'égard des administrateurs de trusts
L'article 1649 AB du code général des impôts définit les obligations déclaratives à la charge de l'administrateur d'un trust. Ce dernier est tenu à deux obligations déclaratives :
- d'une part, une obligation annuelle de déclaration de la valeur vénale au 1er janvier des actifs mis en trust, à déposer avant le 15 juin de chaque année111(*) ;
- d'autre part, une obligation événementielle de déclarer la constitution du trust ainsi que toute modification susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust ou de provoquer l'extinction du trust, dans le mois qui suit cette modification112(*). Cette situation s'applique par exemple à des versements de dividendes, au décès d'un des membres du trust, à la modification de l'acte de trust, à sa dissolution ou à un transfert d'actifs du trust.
Toutefois, l'obligation contributive de l'administrateur du trust au moment du décès du constituant, énoncée aux b et c du 2 du II de l'article 792-0 bis du CGI, n'est assortie d'aucune obligation déclarative. En effet, si l'obligation de déclaration événementielle évoquée supra peut être reliée au décès du constituant, elle ne concerne pas l'obligation contributive spécifique de l'administrateur qui en découle.
Cette absence de déclaration complique le travail de l'administration fiscale dans sa mission de recouvrement des droits de mutation. En effet, en cas de défaillance de l'administrateur dans l'accomplissement de son obligation contributive, l'administration n'est pas en mesure, faute d'obligation déclarative qui lui soit associée, d'user des outils de contrôle habituellement mis en oeuvre dans cette situation, tels que l'envoi de mises en demeure ou l'engagement d'une taxation d'office113(*).
2. Un mécanisme de pénalité prévu en cas de rectification d'une déclaration incomplète de trust en raison d'un oubli de coordination lors de la réforme du remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
a) La rectification d'une déclaration de trust donne en principe lieu à une majoration de 80 % des droits dus
L'article 1729-0 A du CGI prévoit une majoration de 80 % applicable aux droits dus en cas de rectifications effectuées à raison :
- des sommes figurant sur un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, qui n'a pas été déclaré conformément au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI114(*) ;
- des sommes figurant sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placements de même nature qui auraient dû être déclarés conformément à l'article 1649 AA du CGI, c'est-à-dire des contrats souscrits auprès d'organismes établis hors de France115(*) ;
- des actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 bis C116(*) ;
- des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J placés dans un trust qui n'a pas été déclaré en infraction à l'article 1649 AB du CGI, c'est-à-dire, les biens soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)117(*).
b) Un oubli lors de la réforme de l'IFI a fragilisé ce mécanisme de majoration
En cas de rectification du fait de l'omission des actifs figurant dans un trust, la majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A du CGI ne peut être appliquée aux omissions déclaratives des trusts portant sur des biens et droits autres qu'immobiliers. Cette situation résulte d'un oubli, par le législateur, d'une coordination juridique qui aurait dû être introduite au moment de la transformation par l'article 31 de la loi de finances initiale (LFI) de 2018118(*) de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Un oubli du législateur qui a conduit
à ce qu'une partie seulement
des manquements aux obligations
déclaratives des trusts soient sanctionnées
Avant l'instauration de l'IFI en remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l'article 31 de la LFI pour 2018, le périmètre des biens et droits figurant dans la déclaration incombant aux trusts en application des dispositions de l'article 1649 AB du CGI était défini par renvoi aux 1° et 2° du III de l'article 990 J du CGI précisant celui des biens et droits soumis au prélèvement sui generis en matière de trusts, lequel épousait alors les contours de l'assiette de l'ISF.
Toutefois, à la suite de l'instauration de l'IFI, et dès lors que le prélèvement ne frappait plus que les seuls actifs immobiliers, le législateur a modifié la rédaction de l'article 1649 AB du CGI afin d'y supprimer le renvoi à l'article 990 J du CGI et y définir directement les biens et droits devant figurer dans les déclarations des trusts qui ne se limitent pas aux seuls actifs immobiliers, mais s'étend aux actifs qui composaient également l'assiette de l'ISF119(*).
En revanche, le renvoi opéré par l'article 1729-0 A du CGI aux dispositions de l'article 990 J du même code n'a pas été modifié. Cet oubli conduit à ce que la majoration de 80 % prévue en cas d'omissions déclaratives des trusts portant sur des biens et droits autres qu'immobiliers ne peut être appliquée120(*).
Source : commission des finances, d'après l'étude d'impact du projet de loi
Ainsi, en l'état actuel du droit, un contribuable qui dissimule des avoirs financiers dans un trust n'est pas passible de la majoration de 80 % si le trust n'a pas respecté les obligations déclaratives, alors que, en application de l'article 1729-0 A, cette même majoration s'applique s'il n'a pas déclaré un compte bancaire, un contrat d'assurance-vie ou un portefeuille de cryptoactifs détenus à l'étranger.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE CLARIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES TRUSTEES ET UNE EXTENSION DU MÉCANISME DE PÉNALITÉS EN CAS D'OMISSION DE DÉCLARATION
A. UNE CLARIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ADMINISTRATEURS DE TRUST
Le présent article prévoit de renforcer les obligations déclaratives des administrateurs de trusts, en l'étendant à l'obligation contributive des trustees.
Pour ce faire, le 1° du même article complète l'article 792-0 bis du CGI en précisant explicitement que le paiement de l'impôt dû au moment du décès du constituant d'un trust « est accompagné d'une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l'administration, précisant l'identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. »
B. UNE EXTENSION À L'ENSEMBLE DES ACTIFS FINANCIERS DE LA PÉNALITÉ APPLICABLE EN CAS D'OMISSION DE DÉCLARATION
Le 2° du présent article procède à une correction de l'article 1729-0 A du CGI. Il supprime la référence aux 1° et 2° du III de l'article 990 J du CGI, qui conduit, en l'état actuel du droit, à limiter le mécanisme de majoration en cas d'omission de déclaration aux seuls biens immobiliers.
La modification proposée permet ainsi d'aligner le champ d'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A du CGI, et le périmètre des biens et droits devant figurer dans les déclarations incombant aux trusts en application de l'article 1649 AB du CGI.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES AJUSTEMENTS GARANTISSANT LA COHÉRENCE DU CADRE FISCAL APPLICABLE AUX TRUSTS
La commission des finances souscrit aux ajustements proposés par le présent article, qui permettent de rétablir la cohérence du dispositif fiscal applicable aux trusts, d'assurer une égalité de traitement entre les différents types d'actifs et de renforcer les moyens de contrôle de l'administration.
En effet, la nouvelle obligation déclarative pesant sur l'administrateur du trust chargé de verser les droits de mutation par décès facilitera le travail de l'administration fiscale dans l'engagement des procédures adéquates en cas de défaillance de la part du trustee.
Le dispositif proposé permet également d'harmoniser le mécanisme de pénalité applicable en cas de défaillance des administrateurs de trust dans leurs obligations déclarative, en l'appliquant à tous les actifs soumis à cette obligation déclarative, et plus uniquement aux actifs immobiliers. Cette modification est bienvenue et permet de corriger un oubli de coordination législative intervenue au moment de la réforme de l'IFI.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20
bis
Droit de copie de l'administration fiscale dans le cadre du
contrôle des organismes délivrant des reçus fiscaux
Le présent article, introduit par l'amendement COM-103 rectifié de Mme Nathalie Goulet (Union centriste - Orne), permet à l'administration fiscale de prendre copie de documents lors de leurs contrôles de la régularité de la délivrance de reçus fiscaux par les organismes bénéficiaires de dons et versements.
De fait, alors qu'il a étendu, en 2021, le champ du contrôle des reçus fiscaux par l'administration, auparavant cantonné à la vérification de la conformité des montants portés sur ces documents à ceux des dons et versements effectivement perçus, le législateur a omis de procéder à la coordination qui aurait accordé à l'administration le droit de prise de copie des documents contrôlés.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : L'EXTENSION DU CHAMP DU CONTRÔLE DE LA DÉLIVRANCE DES REÇUS FISCAUX NE S'EST PAS ACCOMPAGNÉE DE L'OUVERTURE À L'ADMINISTRATION DE LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE COPIE DES DOCUMENTS EXAMINÉS
A. L'ADMINISTRATION CONTRÔLE DÉSORMAIS LA RÉGULARITÉ DE LA DÉLIVRANCE DES REÇUS FISCAUX PAR LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS ET VERSEMENTS
Jusqu'en 2022, le livre des procédures fiscales habilitait l'administration à contrôler sur place, en suivant les règles qu'il détermine, que les montants portés sur les reçus fiscaux par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers121(*), les entreprises122(*) et les personnes assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)123(*) correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents124(*).
Le législateur a alors étendu le champ de ce contrôle à la vérification de la régularité de la délivrance desdits reçus par les organismes concernés125(*).
Dans ce cadre, les organismes concernés sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature lui permettant de réaliser son contrôle.
Depuis 2024, il est par ailleurs précisé que le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre l'organisme et l'administration126(*). À défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux.
B. DANS LE CADRE DE CES CONTRÔLES, L'ADMINISTRATION N'EST PAS AUTORISÉE À PRENDRE COPIE DES DOCUMENTS EXAMINÉS
Les opérations réalisées lors du contrôle de la régularité de la délivrance de reçus fiscaux par les organismes bénéficiaires de dons et versements ne constituent pas une vérification de comptabilité127(*).
Or, dans le cadre tant de cette dernière procédure128(*) que de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle129(*) ou de la procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement des crédits de TVA130(*), les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance131(*), ce qui n'est pas le cas à l'occasion du contrôle de la régularité de la délivrance de reçus fiscaux.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : PERMETTRE À L'ADMINISTRATION DE PRENDRE COPIE DES DOCUMENTS EXAMINÉS LORS D'UN CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉLIVRANCE DE REÇUS FISCAUX
Le présent article, introduit par un amendement COM-103 rectifié de Mme Nathalie Goulet (Union centre - Orne), modifie l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, qui habilite les agents de l'administration à prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures mentionnées ci-avant, afin de les autoriser à en faire de même lorsqu'ils contrôlent la régularité de la délivrance de reçus fiscaux par des organismes bénéficiaires de dons et versements.
Il s'agit de corriger une lacune législative en complétant le dispositif issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République de façon à renforcer l'efficacité des contrôles des associations habilitées à délivrer des reçus fiscaux.
Il paraît en effet légitime de permettre aux agents de conserver une copie des documents qu'ils examinent dans ce cadre afin de poursuivre sur pièces leurs opérations de contrôle et d'appuyer leurs conclusions.
Décision : La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
ARTICLE 20
ter
Possibilité pour les agents de la direction
générale des finances publiques de contrôler les terminaux
de paiement électronique des professionnels
Le présent article, introduit par l'amendement COM-100 du rapporteur, vise à étendre aux terminaux de paiement électronique le champ des contrôles pouvant aujourd'hui être menés par l'administration fiscale pour vérifier la conformité des logiciels ou systèmes de caisse des personnes assujetties à la TVA aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par la loi.
En effet, le rapide développement du paiement par carte bancaire, conjugué au défaut de connaissance, par l'administration fiscale, des comptes ouverts par les entreprises à l'étranger, aggrave les risques de fraude, qui représente plusieurs milliards d'euros de manque à gagner pour les finances publiques chaque année.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : LES MOYENS DE CONTRÔLE DONT DISPOSE AUJOURD'HUI L'ADMINISTRATION NE SONT PAS ADAPTÉS AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDE À LA TVA
A. L'ADMINISTRATION FISCALE PEUT CONTRÔLER LA CONFORMITÉ DES LOGICIELS OU SYSTÈMES DE CAISSE DES PERSONNES ASSUJETTIES À LA TVA AUX OBLIGATIONS PRÉVUES PAR LA LOI
Aux termes du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la TVA, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne du certificat délivré par un organisme agréé attestant de la conformité des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient aux obligations d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration prévues par la loi132(*).
À cette fin, ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces horaires, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.
Au début de leur intervention, les agents doivent remettre à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention. À l'issue de celle-ci, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements aux obligations prévues par la loi. Ce procès-verbal doit être signé par les agents ainsi que par l'assujetti ou son représentant - en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de ce dernier est remise à l'intéressé.
Lorsque les agents constatent un manquement aux obligations en question et appliquent l'amende prévue par la loi, le procès-verbal informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat délivré par un organisme agréé attestant de la conformité des logiciels ou systèmes de caisse qu'il détient aux obligations légales. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
Les modalités de sanction du non-respect
des obligations d'inaltérabilité,
de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données prévues par la
loi
Le fait, pour une personne assujettie à la TVA, de ne pas justifier, par la production du certificat délivré par un organisme agréé, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par la loi est sanctionné par une amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné133(*).
Lorsqu'il lui est fait application de cette amende, l'assujetti dispose d'un délai de 60 jours pour se mettre en conformité avec ses obligations. Passé ce délai, s'il ne s'est pas mis en conformité, l'assujetti est passible à nouveau d'une amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné.
Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné.
B. L'ADMINISTRATION N'AYANT PAS CONNAISSANCE DES COMPTES DÉTENUS À L'ÉTRANGER PAR LES ENTREPRISES, LE DÉVELOPPEMENT DU PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE FACILITE LA FRAUDE
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les prestataires de services bancaires pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature134(*).
En parallèle, si les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger135(*), l'administration n'est pas informée de la détention par les entreprises de comptes bancaires ouverts à l'étranger.
Or, le développement du paiement sans contact et par carte bancaire, notamment auprès des commerces de proximité, accroît le risque de fraude lié, par exemple, à l'utilisation de terminaux de paiement électronique (TPE) orientant les flux financiers vers des comptes à l'étranger dont l'administration n'a pas connaissance.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION FISCALE AUX TERMINAUX DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE UTILISÉS PAR LES PERSONNES ASSUJETTIES À LA TVA
Le présent article, introduit par un amendement COM-100 du rapporteur, vise à étendre les possibilités de contrôle de l'administration fiscale sur les paiements électroniques.
Le I tend à réécrire l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, qui détermine les modalités de contrôle par les agents de l'administration fiscale de la conformité des logiciels ou systèmes de caisse détenus par les personnes assujetties à la TVA aux conditions prévues par la loi, de façon à :
- permettre à ces agents de se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, d'en relever les références ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés ;
- préciser que l'avis d'intervention peut être remis au représentant de l'assujetti lorsque ce dernier est une personne morale ;
- autoriser le déroulement de l'intervention en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, auquel cas l'avis d'intervention devrait être remis à la personne recevant les agents, qui signerait alors le procès-verbal de fin d'intervention et s'en verrait remettre une copie, une seconde copie devant être transmise à l'assujetti ou son représentant - en cas de refus par cette personne de l'intervention des agents, comme lorsque le refus émane de l'assujetti ou de son représentant, les agents en dresseraient procès-verbal et appliqueraient une amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné ;
- prévoir que le procès-verbal consigne les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés ;
- habiliter les agents, dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse leur intervention ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, à en dresser procès-verbal et à appliquer l'amende prévue par l'article 1770 quaterdecies créée par le II.
Le II vise à insérer dans le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts un article 1770 quaterdecies punissant le fait, pour une personne assujettie à la TVA disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents de l'administration fiscale intervenant dans le cadre d'un contrôle d'une amende de 7 500 euros par appareil non présenté.
En effet, il apparaît nécessaire de donner à l'administration fiscale les moyens d'exercer son contrôle sur ces instruments auxquels recourent de plus en plus les entreprises afin notamment de lutter plus efficacement contre la sous-déclaration de la TVA, qui représenterait 6 à 10 milliards d'euros par an selon la DGFiP.
Décision : La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
ARTICLE 20
quater
Demande d'évaluation du dispositif de collecte de la taxe
sur les transactions financières
Le présent article, introduit par l'amendement COM-101 du rapporteur, prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2026, d'un rapport d'évaluation du circuit de collecte du produit de la taxe sur les transactions financières, dont le recouvrement est confié au dépositaire central, Euroclear France, sous la supervision et le contrôle de l'administration fiscale.
De fait, si la Cour des comptes a invité le Gouvernement à préciser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe, le protocole conclu en 2012 entre Euroclear France et l'administration fiscale n'a jamais été révisé.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF DE RECOUVREMENT DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES REPOSANT SUR LE DÉPOSITAIRE CENTRAL, SOUS LE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION FISCALE
A. OUTIL DE LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION BOURSIÈRE, LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES GÉNÈRE UN PRODUIT LIMITÉ
La taxe sur les transactions financières (TTF) vise à renchérir le coût des transactions financières de manière à infléchir les comportements spéculatifs et redonner de l'autonomie à la politique monétaire136(*).
Elle s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital137(*) ou d'un titre de capital assimilé138(*), à l'exclusion des produits dérivés - sauf ceux qui entraînent le transfert de propriété du titre sous-jacent - et des actifs numériques139(*), dès lors que :
- le titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger140(*) ;
- son acquisition donne lieu à un transfert de propriété141(*), ce qui exclut les opérations intra-journalières ;
- ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition.
Le code général des impôts prévoit l'exonération de certaines opérations, à l'instar des opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital142(*).
Une liste desdits sociétés répondant aux conditions de résidence et de capitalisation boursière est mise à jour chaque année par l'administration fiscale et comptait, en 2024, 122 entreprises143(*).
Le taux de la TFF, quant à lui, a été relevé à deux reprises depuis l'instauration de la taxe en 2012144(*). Initialement fixé à 0,2 % de la valeur d'acquisition du titre, le législateur l'a porté à 0,3 % en 2017145(*), puis à 0,4 % en 2025146(*). Son rendement est resté stable ces dernières années, avec une collecte d'environ 1,8 milliard d'euros par an.
B. LE MODE DE COLLECTE DE LA TTF SUSCITE DES CRITIQUES
Si la direction générale des finances publiques (DGFiP) est chargée du recouvrement du produit de la TTF, en pratique, la collecte est quasi-systématiquement confiée à Euroclear France, un opérateur de droit privé. De fait, la position privilégiée qu'occupe ce dernier du fait de sa qualité de dépositaire central est censée favoriser considérablement les opérations de recouvrement.
Ainsi, en application d'un protocole conclu entre la DGFiP et Euroclear France le 7 septembre 2012, les prestataires de services d'investissement (PSI), qui sont redevables de la TTF, transmettent l'ensemble de leurs données déclaratives à Euroclear France, qui adresse à la DGFiP une situation mensuelle agrégée. Les paiements correspondants doivent être versés avant le 5 du mois suivant les acquisitions de titres par les PSI sur un compte dédié ouvert auprès de l'agence France Trésor. Enfin, avant le 25 du mois suivant l'acquisition des titres, Euroclear France donne l'ordre de reverser l'intégralité des sommes reçues sur ce compte à la direction des grandes entreprises de la DGFiP, chargée du recouvrement de la taxe.
En 2017, dans le cadre d'un référé, la Cour des comptes a formulé plusieurs réserves à l'égard de ce procédé, considérant que la gestion et le contrôle de la collecte de la TTF devaient être améliorés. Dès lors, la Cour recommandait notamment d'actualiser le protocole de 2012 dans le but de préciser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe, sans remettre en cause le circuit de collecte reposant sur Euroclear France.
Ces dernières années, cependant, plusieurs initiatives parlementaires ont plaidé pour le transfert de la mission de recouvrement du produit de la TTF à la DGFiP, dans un souci de renforcement de l'efficacité et de la transparence des procédures de contrôle de la collecte.
En réponse à une question écrite de Mme Nathalie Goulet (Union centriste - Orne)147(*), le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rappelé que la DGFiP n'était pas absente de la gestion du dispositif en ce qu'elle supervise et contrôle la collecte.
Ainsi, pour chacune des échéances déclaratives mensuelles pour lesquelles le dépositaire central intermédie la transmission, une situation nette agrégée par redevable est constituée. Un fichier déclaratif, comprenant une ligne par redevable et précisant le montant total dû et le montant total des opérations pour chaque cas d'exonération, est transmis à la DGFiP.
Du reste, l'ensemble des opérations déclarées par un redevable est stocké par le dépositaire central dans une base de données dédiée et, en tant que de besoin, l'administration lui demande de transmettre la liste des opérations déclarées par un redevable pour une période donnée. Cette base de données est également accessible aux services de contrôle de l'administration fiscale dans les locaux d'Euroclear France.
Au total, le Gouvernement indiquait qu' « aucune difficulté n'a été relevée par l'administration s'agissant de la transparence de la collecte de cette taxe puisque l'intégralité des données détaillées servant à établir les situations agrégées pour chaque PSI sont tenues, par Euroclear France, à la disposition de l'administration »148(*).
L'ancien rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Charles de Courson (Liot - Marne), a interrogé l'administration fiscale au sujet de la perspective d'un transfert à la DGFiP de l'activité de recouvrement actuellement confiée à Euroclear France. Évoquant un « chantier informatique d'ampleur », la DGFiP a répondu que « les coûts de mise en place de la collecte d'informations en provenance des PSI redevables devraient être supportés par l'administration fiscale » et que « des coûts d'ajustements seraient également à prévoir pour les PSI redevables », alors que « la mise en place avait coûté 1,3 million d'euros en 2013 à Euroclear »149(*).
Charles de Courson jugeait néanmoins « a minima souhaitable que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant l'efficience d'Euroclear dans le collecte de la TTF et détaillant le coût potentiel du « chantier » que représenterait le passage à un recouvrement direct par l'administration », lequel « inclurait également un bilan des contrôles réalisés, afin de renforcer la transparence et de permettre un réel suivi de l'activité d'Euroclear »150(*).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : LA REMISE D'UN RAPPORT D'ÉVALUATION DU DISPOSITIF DE RECOUVREMENT DE LA TTF
Le présent article, introduit par un amendement COM-101 du rapporteur, vise à prévoir la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2026, d'une évaluation du dispositif de recouvrement de la TTF, qui :
- dresserait un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par Euroclear France ;
- évaluerait l'opportunité d'une révision du protocole d'accord entre le dépositaire central et l'administration fiscale ;
- et déterminerait les pistes d'amélioration du mode de collecte de la TTF.
Comme le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le rapporteur estime en effet nécessaire de tirer les conclusions des 13 années de recouvrement par Euroclear France et de réfléchir à la meilleure manière d'améliorer la performance et la transparence de la collecte.
Décision : La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article.
ARTICLE 23
Extension du délai de mise en
recouvrement dans le cadre du délai spécial de reprise de
l'administration fiscale
Le présent article prévoit l'allongement d'un an des délais spéciaux de reprise dans lequel, dans certains cas, l'administration fiscale peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition au-delà des délais de reprise de droit commun, sans modifier le délai spécial de prescription du droit de reprise.
En effet, compte tenu de l'ensemble des garanties procédurales qui sont reconnues aux contribuables, la durée de la procédure, de la notification de la proposition de rectification à la mise en recouvrement, peut atteindre 19 mois, alors que, dans le cadre du délai spécial de reprise, l'administration peut ne disposer que de 12 mois à compter de la notification.
Dans un souci d'amélioration de la performance du recouvrement de l'administration fiscale, et de préservation de la sécurité juridique dont jouissent les contribuables, la commission se déclare favorable à l'adoption de cet article.
La commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LE DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION FISCALE S'AVÈRE PARFOIS INSUFFISANT POUR PROCÉDER À LA MISE EN RECOUVREMENT TOUT EN RESPECTANT L'ENSEMBLE DES GARANTIES PROCÉDURALES DONT BÉNÉFICIENT LES CONTRIBUABLES
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les autres personnes compétentes selon le cas151(*).
À titre d'exemple, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, sauf cas particuliers, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due152(*).
Dans les cas où les délais de reprise de droit commun sont écoulés sans que l'administration fiscale ait pu corriger une omission ou une insuffisance d'imposition en raison d'un élément extérieur, des délais spéciaux de reprise sont prévus par le livre des procédures fiscales :
- lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé153(*) ;
- lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas où il existe un risque de dépérissement des preuves, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due154(*) ;
- même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due155(*).
Or, ces délais spéciaux de reprise se révèlent parfois insuffisants pour mener de telles procédures à leur terme, dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration doit respecter plusieurs garanties au profit du contribuable. Ainsi :
- la notification d'une proposition de rectification ouvre le délai de réponse de 30 jours accordé au contribuable156(*), qui peut être prorogé de 30 jours sur la demande de ce dernier157(*) ;
- l'administration doit motiver sa réponse lorsqu'elle rejette les observations du contribuable158(*) ;
- lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, doit soumettre le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la commission départementale de conciliation159(*), soit du comité de l'abus de droit fiscal - ces entités pouvant également être saisies à l'initiative de l'administration160(*).
Selon la direction générale des finances publiques (DGFiP), « jusqu'à ce point, la durée minimale incompressible de la procédure s'établit ainsi autour de 5 mois. Lorsque l'une des commissions administratives est saisie, le délai séparant cette saisine de l'avis de la commission varie entre 7 et 14 mois selon les départements, et peut être plus long pour le comité de l'abus de droit fiscal »161(*).
Au surplus, la proposition de rectification peut également faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique auprès du chef de brigade ou de l'interlocuteur départemental, qui suspend le cours de ce délai162(*).
Enfin, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition et de communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande163(*).
Dans la mesure où toutes ces phases procédurales doivent être achevées pour que l'administration puisse mettre valablement en recouvrement l'imposition, la durée de la procédure peut atteindre 19 mois, alors que, si la proposition de rectification a été adressée au contribuable en fin d'année, l'administration peut ne disposer que de 12 mois dans le cadre du délai spécial de reprise - en tout état de cause, le délai dont dispose, dans ce cadre, la DGFiP, ne peut excéder 24 mois.
Par conséquent, « il peut ainsi arriver que le terme avant lequel l'imposition doit être mise en recouvrement soit atteint et dépassé en dépit des diligences du service »164(*).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'ALLONGEMENT D'UN AN DU DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE
Le I modifie les articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, qui fixent les trois délais spéciaux de reprise de l'administration fiscale, de façon à lui permettre de réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition, dans les cas auxquels ces délais sont applicables, jusqu'à la fin de la deuxième année - et non plus de l'année - suivant celle de l'évènement qui ouvre ces délais, accordant ainsi 12 mois supplémentaires à la DGFiP.
Le II prévoit que cet allongement s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la loi.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : FAVORISER LA SÉRÉNITÉ DU DÉBAT CONTRADICTOIRE ENTRE LES CONTRIBUABLES ET L'ADMINISTRATION FISCALE
La commission constate que la mesure proposée doit permettre d'améliorer le taux de recouvrement des sommes dues par les contribuables, sans limiter pour autant les garanties procédurales dont ceux-ci disposent dans le cadre de leur débat contradictoire avec l'administration fiscale.
En outre, elle ne modifie pas le délai spécial de prescription du droit de reprise, qui reste fixé à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé dans le cas d'une demande de renseignements à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire et à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas de dépôt de plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale ou de révélation d'omissions ou d'insuffisances d'imposition par une procédure judiciaire, une procédure devant les juridictions administratives ou une réclamation contentieuse.
Néanmoins, bien que l'étude d'impact du projet de loi indique que « la mesure n'a pas d'impact budgétaire direct mais peut permettre de mener à bien certains contrôles qui ne peuvent pas l'être aujourd'hui faute de pouvoir respecter toutes les formalités applicables dans le délai actuel d'un an et ainsi permettre de recouvrer des recettes fiscales aujourd'hui perdues », la DGFiP n'a été en mesure de communiquer au rapporteur ni le nombre de cas dans lesquels le délai spécial de reprise s'est avéré insuffisant ni une estimation du préjudice financier en ayant découlé.
De fait, « l'administration ne dispose pas de statistiques sur les droits et pénalités ainsi compromis puisque le quantum de ceux-ci n'a pas pu être définitivement arrêté dans le cadre du débat contradictoire »165(*).
En tout état de cause, il convient de rappeler que le fait de pouvoir régulièrement mettre en recouvrement une imposition supplémentaire avant que la prescription ne soit acquise au contribuable ne garantit pas le recouvrement intégral et effectif des sommes en cause.
Décision de la commission : la commission des finances propose à la commission des affaires sociales d'adopter cet article sans modification.
* 6 Article 28-1 du code de procédure pénale.
* 7 Article 28-2 du code de procédure pénale.
* 8 Articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense.
* 9 Articles 324-1 à 324-9 du code pénal.
* 10 Article 222-38 du code pénal
* 11 Article 1741 du code général des impôts.
* 12 Article 1744 du code général des impôts.
* 13 Articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
* 14 Article L. 313-2 du code pénal.
* 15 Articles 222-34 à 222-40 du code pénal.
* 16 Article 421-1 du code pénal (6°).
* 17 Article 421-2-2 du code pénal.
* 18 Article 28-1 du code de procédure pénale.
* 19 Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude ».
* 20 Article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, article L. 135 L du livre des procédures fiscales et article 59 quater du code des douanes.
* 21 Ibid.
* 22 Article L. 82 C du livre des procédures fiscales.
* 23 Article L. 101 du livre des procédures fiscales.
* 24 Article 343 bis du code des douanes.
* 25 Conseil constitutionnel, décision n° 99-424 DC, 29 décembre 1999, considérant 52.
* 26 Articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
* 27 Étude d'impact annexée au projet de loi.
* 28 Il s'agit concrètement des greffiers de tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, des chambres des métiers et de l'artisanat, des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
* 29 Étude d'impact du projet de loi.
* 30 Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.
* 31 Ibid.
* 32 Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.
* 33 Conformément à l'article 289 A du CGI, lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
* 34 « Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société », rapport n° 757 (2024-2025) de Mme Nathalie Goulet et M. Raphaël Daubet au nom de la commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, tome I, déposé le 18 juin 2025.
* 35 Bulletin officiel des finances publique, BOI-CF-COM-10-70.
* 36 Conseil d'État, décision du 22 décembre 1982, n° 21475.
* 37 Bulletin officiel des finances publique, BOI-CF-COM-10-10-20.
* 38 Décision n° 2025-887 DC du 26 juin 2025.
* 39 Article L. 621-1 du code monétaire et financier.
* 40 Article L. 621-9 du code monétaire et financier.
* 41 Article L. 621-10 du code monétaire et financier.
* 42 Article L. 621-15 du code monétaire et financier.
* 43 Article 77-1-1 du code de procédure pénale.
* 44 Article L. 621-20-4 du code monétaire et financier.
* 45 Articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal et articles L. 621-4 et L. 642-1 du code monétaire et financier.
* 46 Crimes et délits de trafic de stupéfiants, crimes en matière de fausse monnaie, crimes et délits en matière de législation sur les armes et portant sur des armes de la première à la cinquième catégorie, délits de contrebande en matière de tabacs et d'alcools, délit de contrefaçon et délits en matière d'habitat indigne.
* 47 Article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
* 48 Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
* 49 Article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
* 50 Article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
* 51 Article 1758 du code général des impôts.
* 52 Article 154 quinquies du code général des impôts.
* 53 Article L. 5422-3 du code du travail.
* 54 Articles L. 5424-25 et R. 5424-70 à R. 5424-73 du code du travail.
* 55 Articles L. 5423-1 et R. 5423-1 à R. 5423-6 du code du travail.
* 56 Article R. 5423-2 du code du travail.
* 57 Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
* 58 Article L. 5422-20 du code du travail.
* 59 45 % d'impôt sur le revenu, 4 % de CEHR, 25 % de CSG et 0,5 % de CRDS.
* 60 Conseil constitutionnel, n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019
* 61 Biens de type horlogerie, bijoux, joaillerie et orfèvrerie.
* 62 Sur ce point, le lecteur pourra utilement se référer aux développements du rapport n° 757 (2024-2025) de la commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, « Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société », tome I, déposé le 18 juin 2025.
* 63 À l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret.
* 64 Dans des conditions définies par décret.
* 65 Article L. 561-4-1 du CMF.
* 66 Article L. 561-5 du CMF.
* 67 Article L. 561-6 du CMF.
* 68 Article L. 561-15 du CMF.
* 69 Table ronde de la commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, 4 mars 2025.
* 70 Directive 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
* 71 Recommandation n° 22 du GAFI, note explicative.
* 72 D'après les informations transmises aux rapporteurs par Tracfin, la notion de monnaie électronique recouvre principalement deux types de paiements, notamment les cartes prépayées type cartes cadeaux, téléphoniques, pour les jeux en ligne ou encore des cartes de paiement sans ouverture de compte bancaire, ainsi que les porte-monnaie et comptes de paiement électronique qui servent à effectuer des paiements à partir d'une somme préchargée sur un compte. Ils peuvent servir à effectuer des achats en ligne, mais également en physique.
* 73 « Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société », rapport n° 757 (2024-2025) de la commission d'enquête du Sénat aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, tome I, déposé le 18 juin 2025.
* 74 Articles L. 561-2 du CMF.
* 75 Article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du 19 juin 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
* 76 Étude d'impact du présent projet de loi.
* 77 Ibid.
* 78 3° bis de l'article 28-1 du CPP concernant les ODJ et 3° de l'article 28-2 concernant les OFJ.
* 79 Il s'agit notamment de l'intervention de juridictions spécialisées, ou encore, de la possibilité d'utiliser des techniques spéciales d'enquête telles que l'infiltration, la surveillance électronique, la captation de données informatiques, etc.
* 80 1° de l'article 706-73-1 du CPP.
* 81 Amendement n° 3 rect. septies.
* 82 Décision n° 2025-887 DC du 26 juin 2025. Considérant 36.
* 83 Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.
* 84 Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014.
* 85 Il a par ailleurs censuré sur ce fondement la disposition permettant le recours à la garde à vue de 96 heures pour les infractions de corruption et de trafic d'influence dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
* 86 Commentaires aux cahiers du Conseil constitutionnel de la décision n° 2013-679 DC.
* 87 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.
* 88 Commentaires aux cahiers du Conseil constitutionnel de la décision n° 2013-679 DC.
* 89 Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
* 90 Au 3° bis du I de l'article 28-1 du CPP.
* 91 Au 3) du I de l'article 28-2 du même code.
* 92 Article 311-9 du code pénal.
* 93 Page 189 de l'étude d'impact.
* 94 Page 188 de l'étude d'impact.
* 95 Ces techniques d'enquêtes consistent notamment en des écoutes, captations de données, surveillances, infiltrations.
* 96 Sur ce point, le lecteur pourra se référer aux développements du rapport général n° 128 (2023-2024), tome II, fascicule 1, déposé au nom de la commission des finances le 21 novembre 2023 ( article 20).
* 97 C'est à dire lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou en cas de fraude fis « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout autre organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger, de l'usage d'une fausse identité, de faux documents ou de toute autre falsification, d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger, d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
* 98 Réponse de M. Thomas Cazenave, ministre délégué aux comptes publics, à la question écrite n° 7339 de Mme la députée Charlotte Leduc. Réponse apportée le 19 septembre 2023.
* 99 Cabinets de défiscalisation, professionnels du droit et du chiffre, personnes ou structures commercialisant des montages illégaux.
* 100 Réponse à la question écrite précitée.
* 101 Article 1791 du CGI.
* 102 Article 1793 du CGI.
* 103 Il s'agit notamment de techniques telles que l'infiltration, la surveillance électronique, ou la captation de données informatiques.
* 104 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
* 105 Commission des finances du Sénat, mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
* 106 OCDE, « En finir avec les montages financiers abusifs : réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc », 25 février 2021.
* 107 CC, décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018.
* 108 Page 206 de l'étude d'impact du présent projet de loi.
* 109 Ibid.
* 110 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 111 Article 369 A de l'annexe II du CGI.
* 1121° du I de l'article 1649 AB du CGI.
* 113 Page 210 de l'étude d'impact du projet de loi.
* 114 a) du I de l'article 1729-0 A du CGI.
* 115 b) du I de l'article 1729-0 A du CGI.
* 116 d) du I de l'article 1729-0 A du CGI.
* 117 c) du I de l'article 1729-0 A du CGI.
* 118 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
* 119 Article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
* 120 Page 209 de l'étude d'impact du projet de loi.
* 121 Article 200 du code général des impôts.
* 122 Article 238 bis du code général des impôts.
* 123 Article 978 du code général des impôts.
* 124 Article L. 14 A du livre des procédures fiscales.
* 125 Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, article 18.
* 126 Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 117.
* 127 Article L. 14 A du livre des procédures fiscales.
* 128 Article L. 13 du livre des procédures fiscales.
* 129 Article L. 12 du livre des procédures fiscales.
* 130 Article L. 198 A du livre des procédures fiscales.
* 131 Article L. 13 F du livre des procédures fiscales.
* 132 Article L. 80 O du livre des procédures fiscales.
* 133 Article 1770 duodecies du code général des impôts.
* 134 Article 1649 A du code général des impôts.
* 135 Ibid.
* 136 Article 235 ter ZD du code général des impôts.
* 137 Article L. 212-1 A du code monétaire et financier.
* 138 Article L. 211-41 du code monétaire et financier.
* 139 Article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
* 140 Articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du code monétaire et financier.
* 141 Article L. 211-17 du code monétaire et financier.
* 142 Article 235 ter ZD du code général des impôts.
* 143 Bulletin officiel des finances publiques, BOI-ANNX-000467.
* 144 Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, article 5.
* 145 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 25.
* 146 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, article 98.
* 147 Question écrite n° 03767, publiée dans le Journal officiel du Sénat du 20 mars 2025.
* 148 Réponse du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la question écrite n° 03767 de Mme Nathalie Goulet, publiée au Journal officiel du Sénat du 5 juin 2025.
* 149 Rapport d'information n° 1888 déposé au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur l'application des mesures fiscales par M. Charles de Courson, rapporteur général, député, 30 septembre 2025.
* 150 Ibid.
* 151 Article L. 168 du livre des procédures fiscales.
* 152 Article L. 169 du livre des procédures fiscales.
* 153 Article L. 188 A du livre des procédures fiscales.
* 154 Article L. 188 B du livre des procédures fiscales.
* 155 Article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
* 156 Article L. 11 du livre des procédures fiscales.
* 157 Article L. 57 du livre des procédures fiscales.
* 158 Ibid.
* 159 Article L. 59 du livre des procédures fiscales.
* 160 Article L. 64 du livre des procédures fiscales.
* 161 Réponses écrites de la DGFiP au questionnaire de la commission des finances.
* 162 Article L. 54 C du livre des procédures fiscales.
* 163 Article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
* 164 Réponses écrites de la DGFiP au questionnaire de la commission des finances.
* 165 Réponses écrites de la DGFiP au questionnaire de la commission des finances.