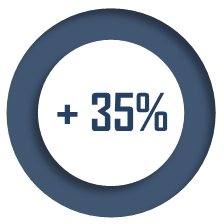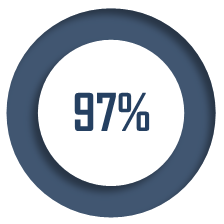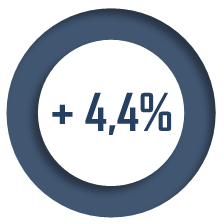N° 63
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1) sur le projet de loi
de lutte contre
la vie chère dans les
outre-mer (procédure
accélérée),
Par Mme Micheline JACQUES et M. Frédéric BUVAL,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
870 (2024-2025) et 64 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
|
Le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer, dont l'examen, initialement prévu au mois de septembre, a été décalé en raison de la démission successive des gouvernements. Le Premier ministre a qualifié à juste titre ce phénomène « d'urgence des urgences » pour les outre-mer, qui subissent des prix à la consommation plus élevés que dans l'Hexagone tout en souffrant d'un niveau de vie plus bas et d'une pauvreté bien plus répandue. Il est source de tensions sociales dans des territoires déjà victimes de leur enclavement et de leur éloignement de l'Hexagone. Pour autant, ce projet de loi n'apporte aucune réponse structurelle à ces difficultés mais propose seulement des mesures à la portée limitée et aux effets difficiles à mesurer. La commission ne souhaite ainsi pas donner de faux espoirs aux populations ultramarines et rappelle qu'une loi ne pourra pas venir transformer un système économique qui est l'héritage de plusieurs siècles de relations entre l'Hexagone et ses outre-mer et la conséquence des caractéristiques propres de ces territoires. Elle regrette également que le texte soit silencieux sur la question des revenus du travail et n'évoque que peu de pistes pour soutenir le tissu économique ultramarin. Elle déplore que la question de l'insertion des territoires ultramarins dans leur environnement régional ne soit même pas abordée. Lors de sa réunion du 22 octobre 2025, elle a néanmoins adopté le projet de loi en y apportant plusieurs modifications, notamment : - la suppression de l'article 1er, qui aurait permis d'abaisser le seuil de revente à perte, au profit de la grande distribution et au détriment des petits commerces ; - la meilleure valorisation des produits locaux dans le bouclier qualité-prix et sa généralisation pour les services (article 2) ; - l'ajout de garanties visant à éviter que l'expérimentation du E-Hub ne se fasse au détriment des entreprises martiniquaises (article 4) ; - la suppression de l'article 5, à charge pour le Gouvernement de proposer un mécanisme fonctionnel de péréquation des frais d'approche et non une habilitation à légiférer par ordonnance sans cadre bien défini. |
I. LA LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE EST UN IMPÉRATIF POUR ASSURER UN MEILLEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
La vie chère est un phénomène multifactoriel qui a été étudié à plusieurs reprises ces dernières années par le Parlement (délégation sénatoriale aux outre-mer, commission d'enquête de l'Assemblée nationale) et diverses autorités publiques (Conseil économique, social et environnemental, Autorité de la concurrence). Ses causes, liées aux caractéristiques des territoires ultramarins, sont bien identifiées, sans pour autant que le poids respectif de chacune puisse être précisément mesuré.
Ainsi, l'insularité et l'éloignement par rapport à l'Hexagone, source de la majeure partie des importations de ces territoires, dont la production locale couvre moins de 10 % de la consommation, entraînent des coûts d'approvisionnement très élevés et une multiplication des acteurs (transporteurs, transitaires, importateurs, distributeurs, etc.) intervenant dans cette chaîne, majorant chacun de leurs marges le prix payé par le consommateur final.
L'étroitesse des marchés domestiques et le tissu économique constitué essentiellement de TPE et PME ne permettent pas de générer des économies d'échelle pour les acteurs locaux, tirant les prix vers le haut. Plus encore, le faible nombre d'acteurs économiques présents dans le secteur de la distribution est la traduction d'un environnement économique peu concurrentiel, où quelques grands groupes, qui exploitent les franchises locales d'entreprises hexagonales, bénéficient de situations oligopolistiques.
De ce fait, ces territoires sont particulièrement exposés aux phénomènes économiques conjoncturels, comme l'augmentation des coûts du transport maritime après la crise sanitaire ou la hausse des prix de l'énergie et la poussée inflationniste consécutives à la guerre en Ukraine, ainsi qu'à des événements spécifiques, notamment climatiques.
Dès lors, les crises sociales liées à la vie chère se succèdent et se ressemblent, tout comme la réponse des pouvoirs publics. 2009 en Guadeloupe et Martinique, 2012 à La Réunion, 2017 en Guyane, 2024 à nouveau en Martinique : les constats restent les mêmes. À chaque fois, le Gouvernement réagit par une nouvelle loi : loi « Lodéom » en 2009, loi « Lurel » sur la régulation économique outre-mer en 2012, loi « Érom » sur l'égalité réelle outre-mer en 2017, et, maintenant, ce projet de loi.
En dépit de cette intense activité législative, la situation n'a pourtant connu aucune amélioration sensible. Selon l'Insee, les écarts de prix avec l'Hexagone ont légèrement progressé depuis 2010 et sont compris entre 9 % (La Réunion) et 31 % (Polynésie française), la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe étant proches de 15 %.
Surtout, ces écarts sont bien plus élevés pour les produits alimentaires : en 2022, ils atteignaient 36,7 % à La Réunion et jusqu'à 40,2 % à la Martinique et 41,8 % en Guadeloupe. Ces chiffres n'ont connu aucune évolution pour La Réunion et la Guadeloupe par rapport à 2015.
|
Évolution des prix alimentaires |
des entreprises martiniquaises |
taux d'inflation des produits alimentaires
à La Réunion |