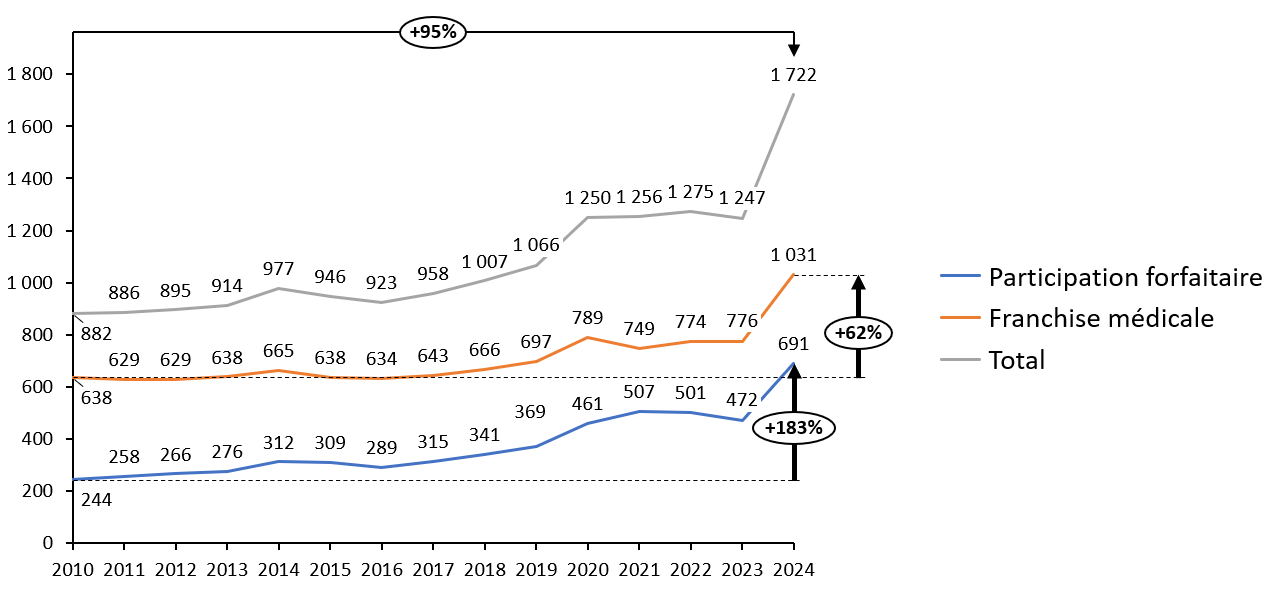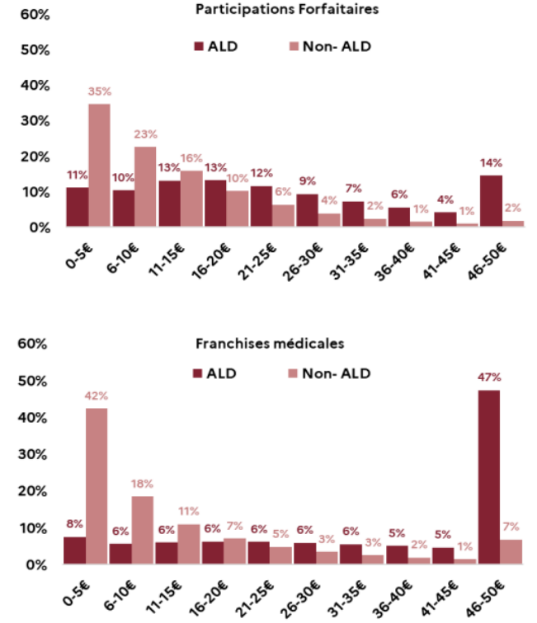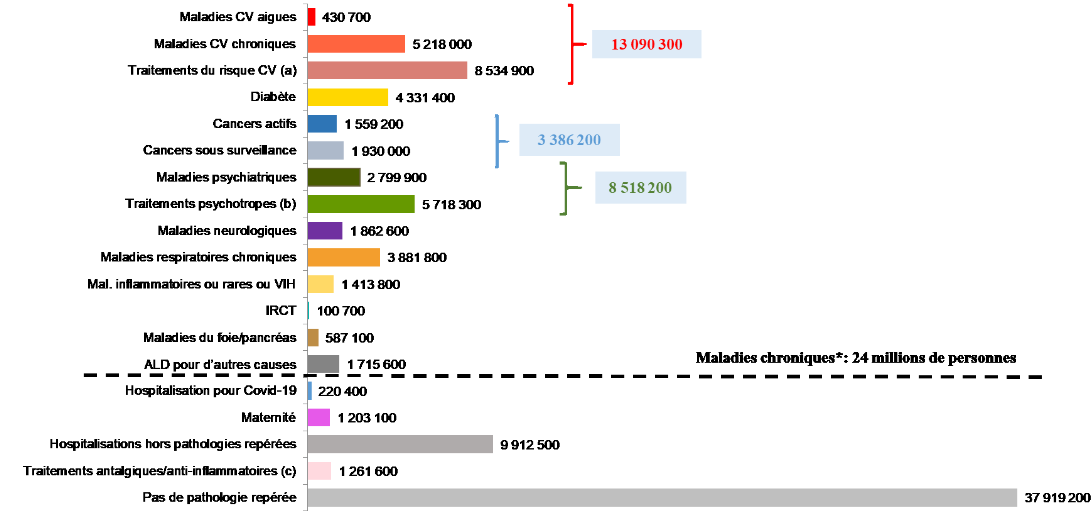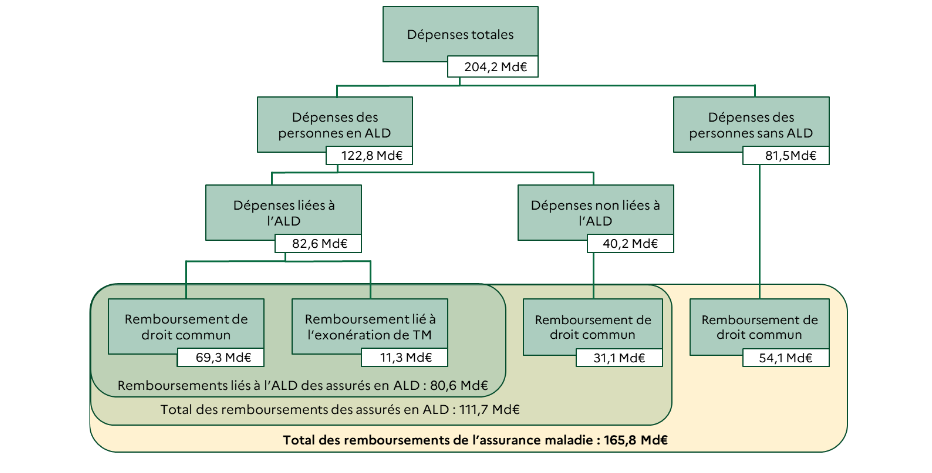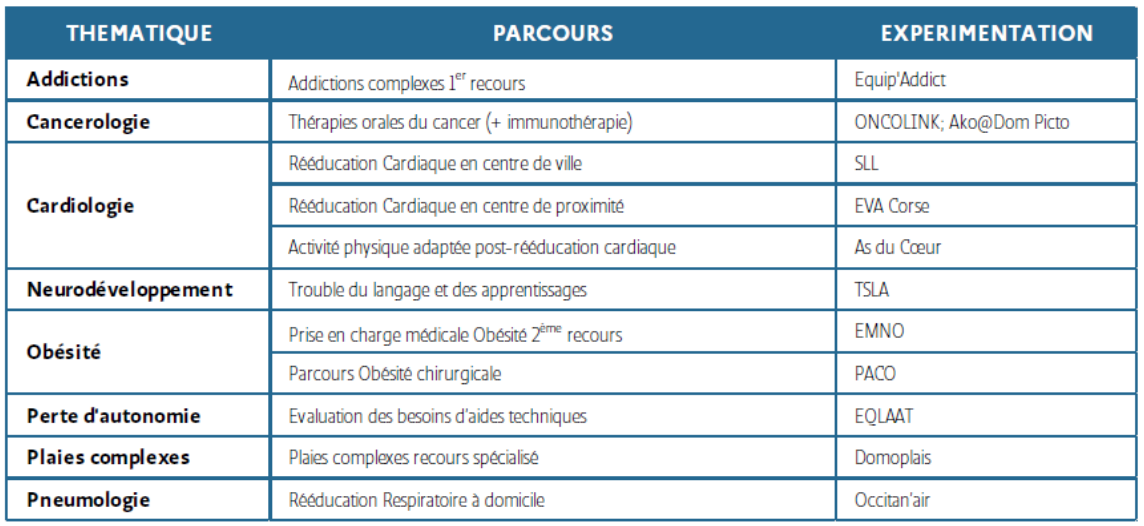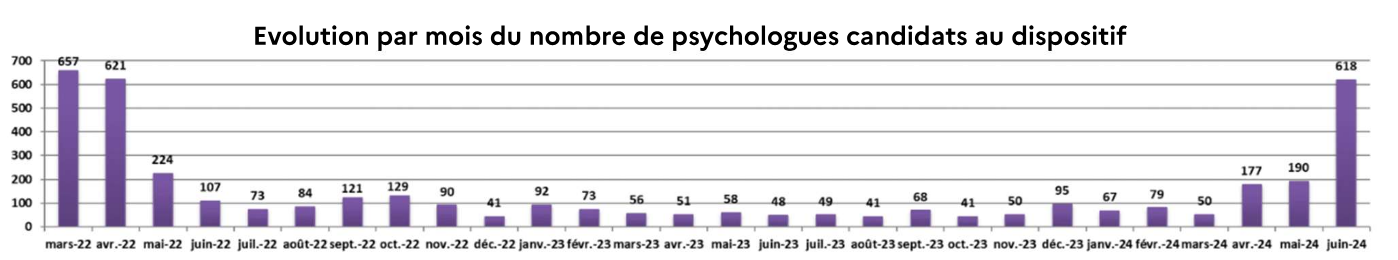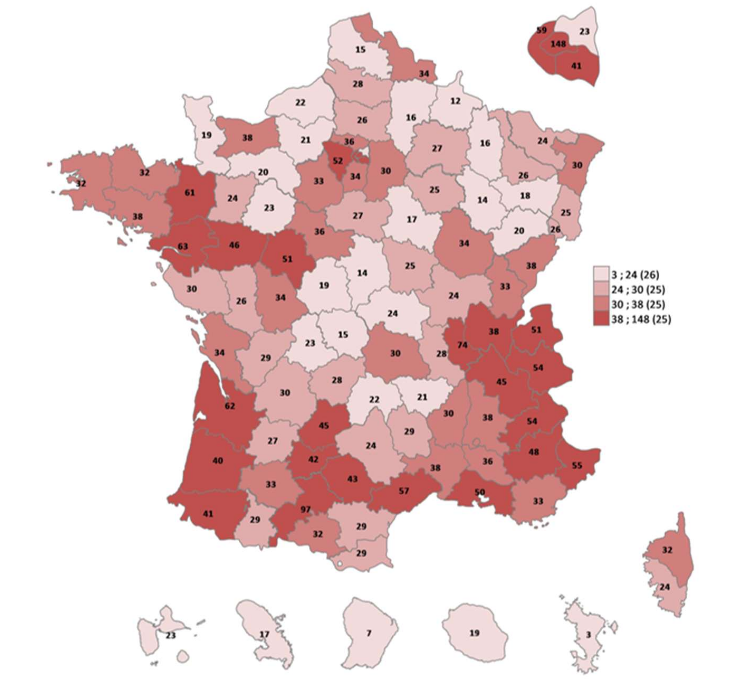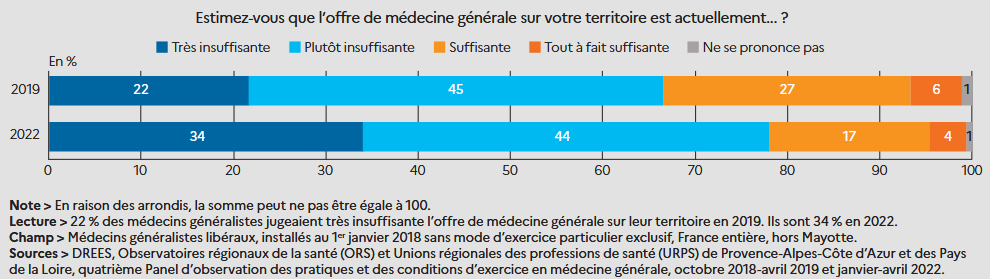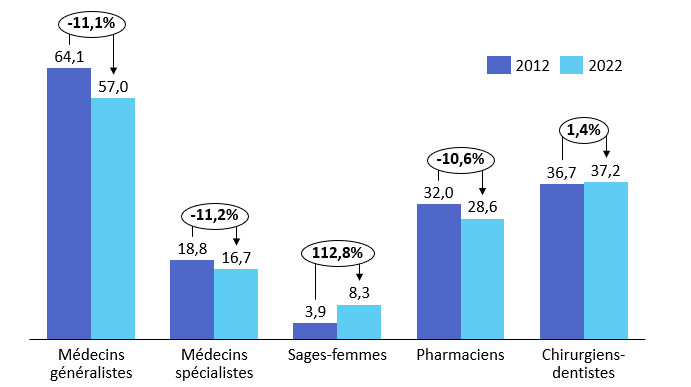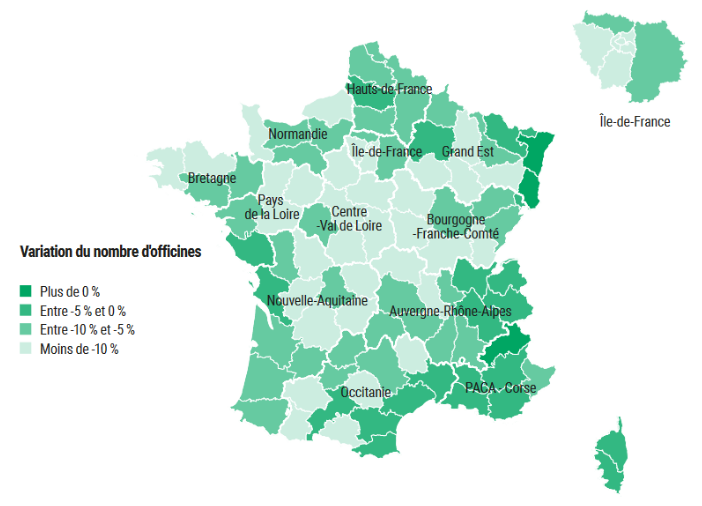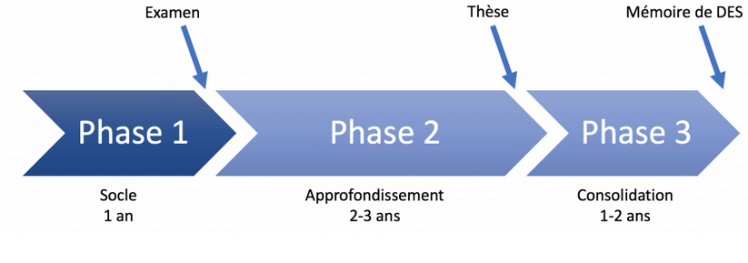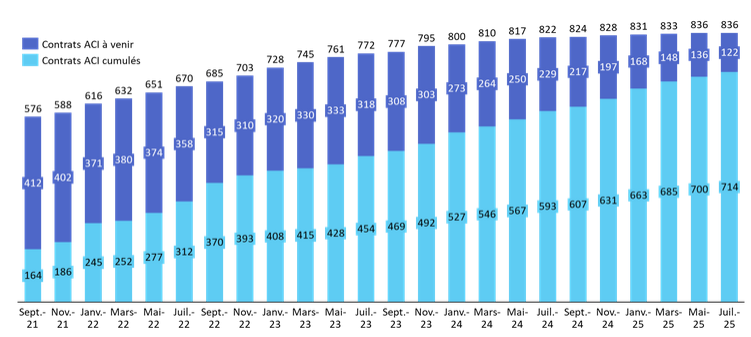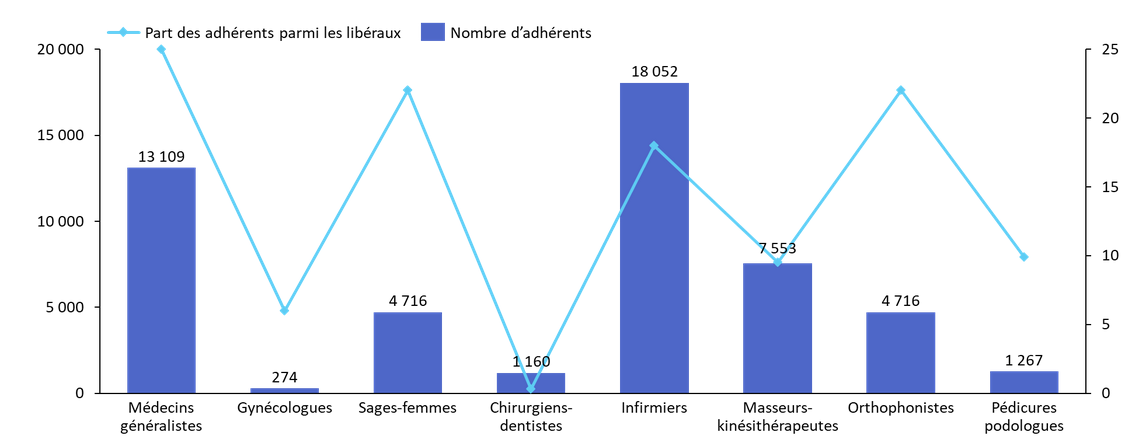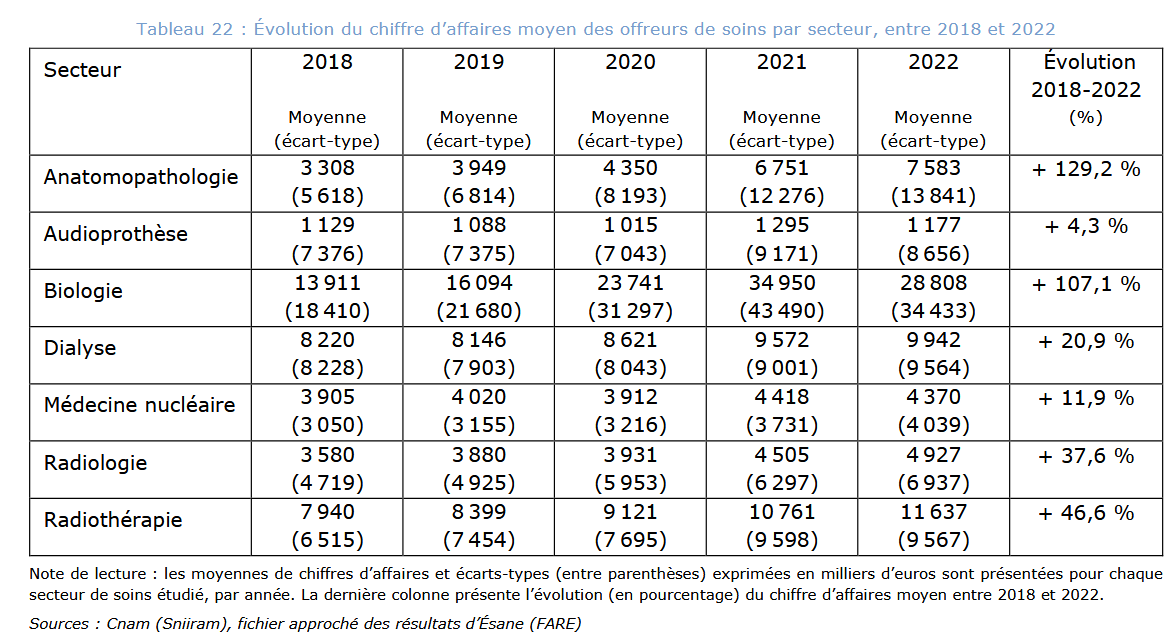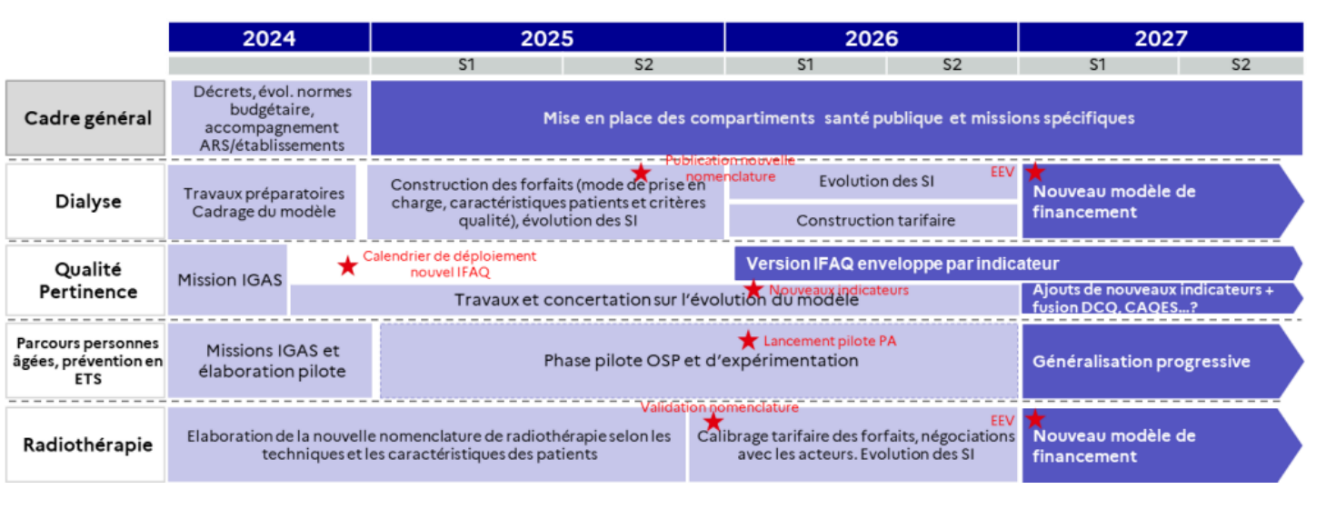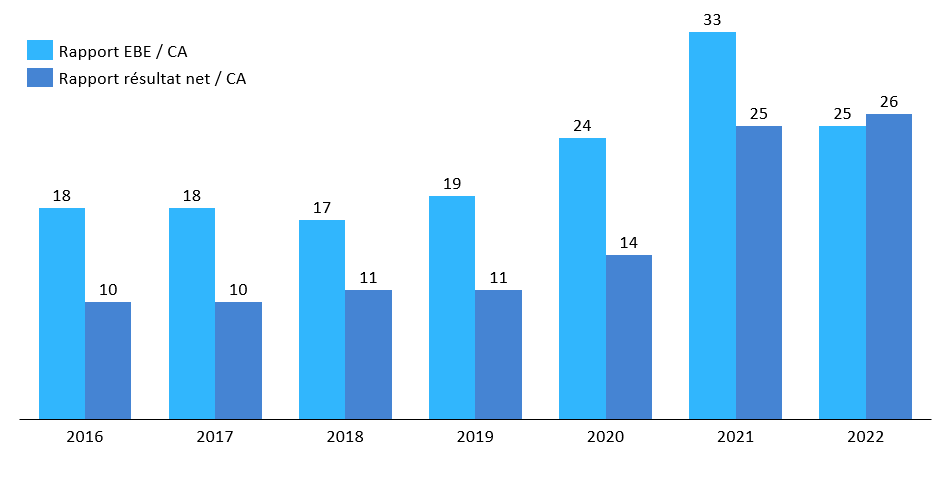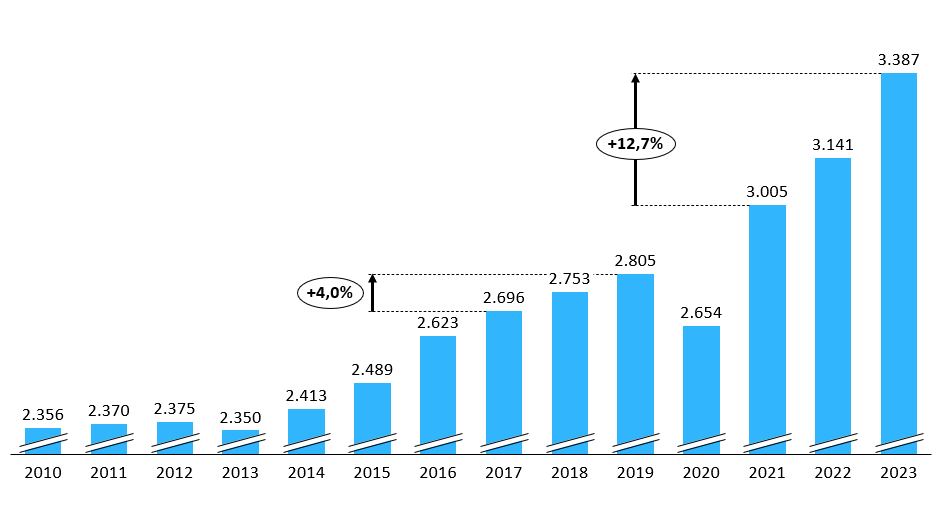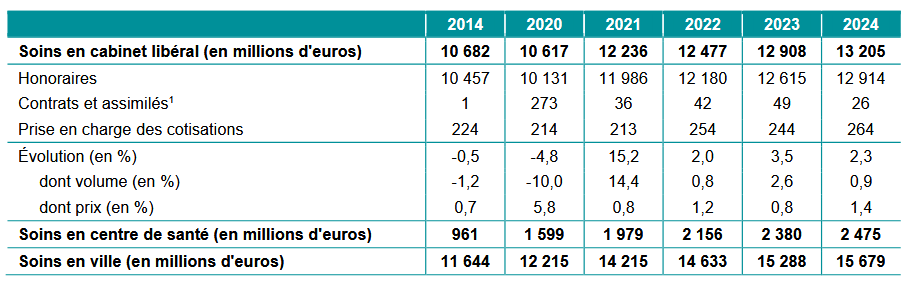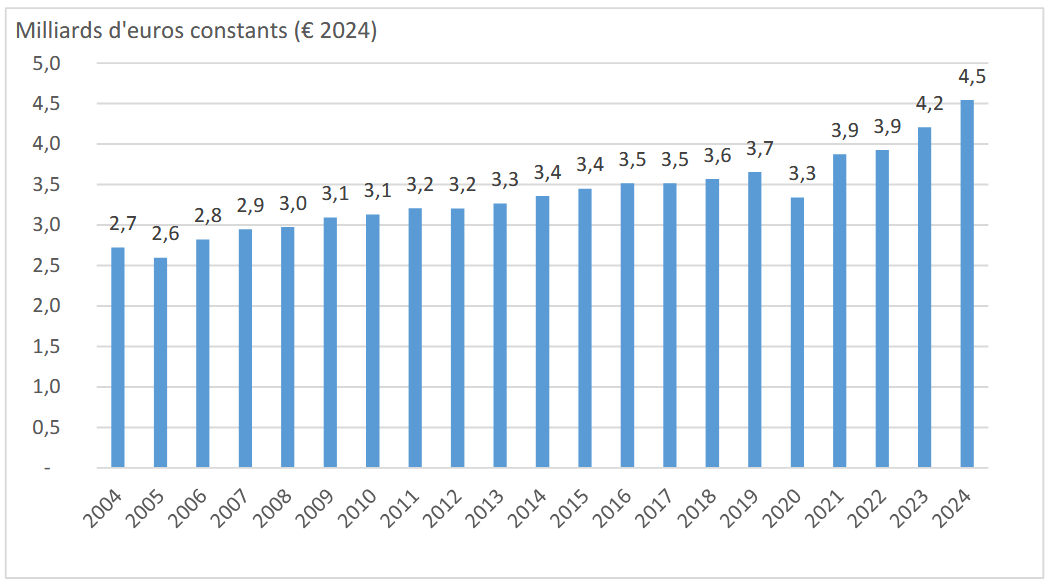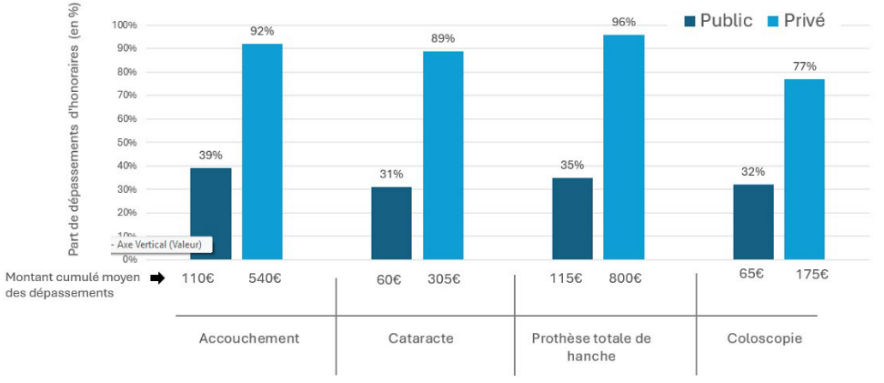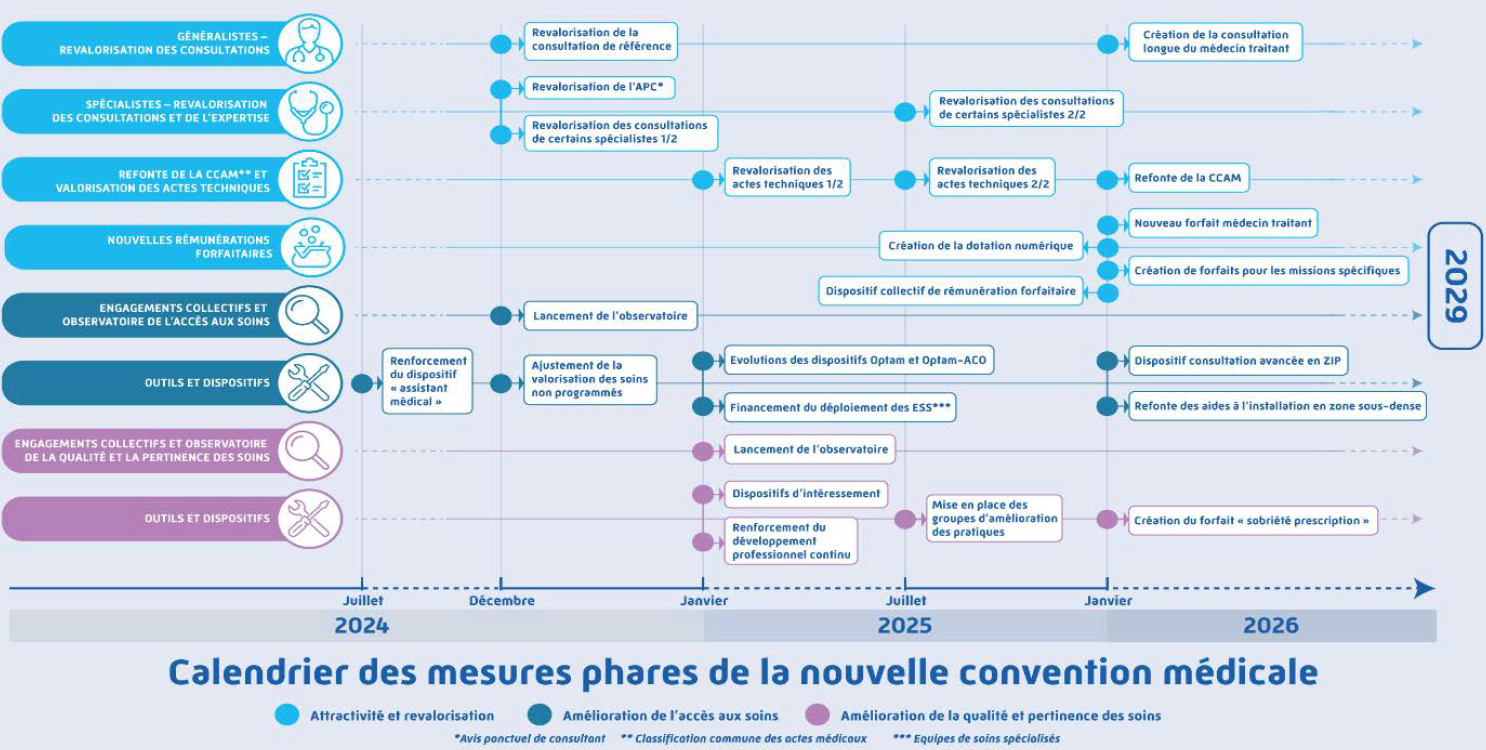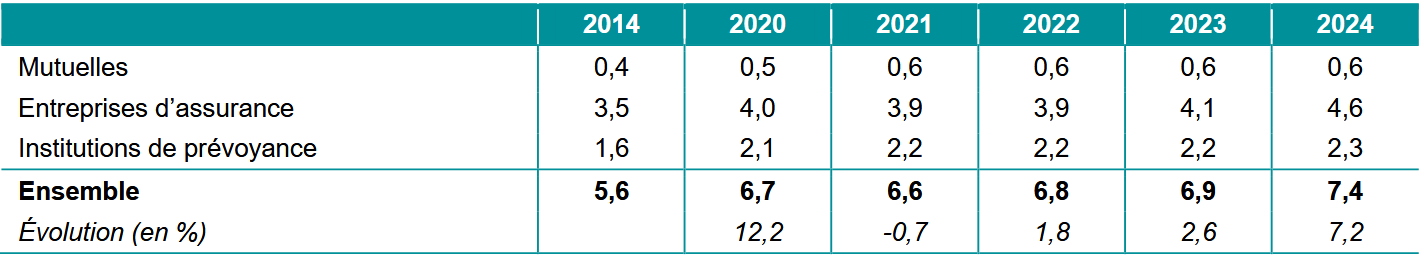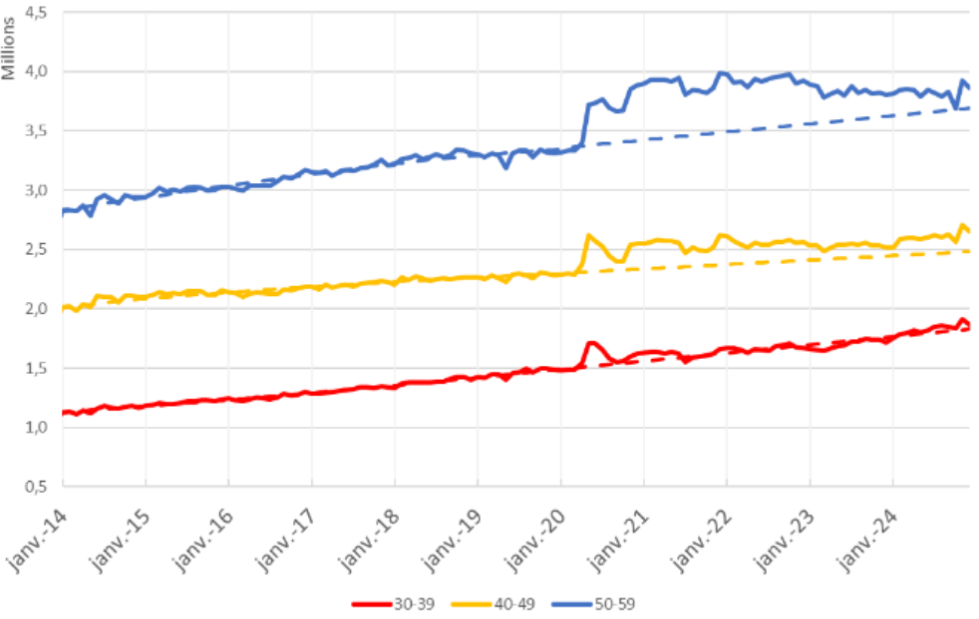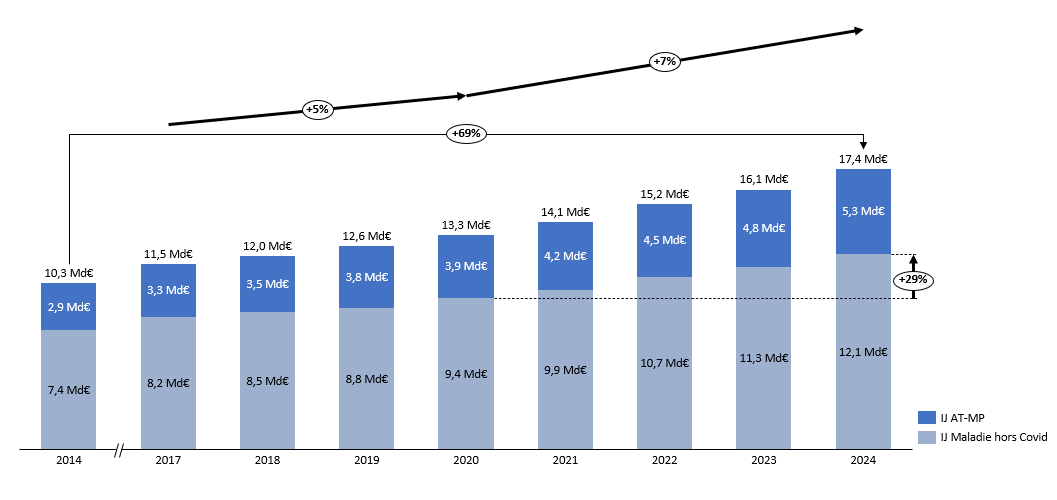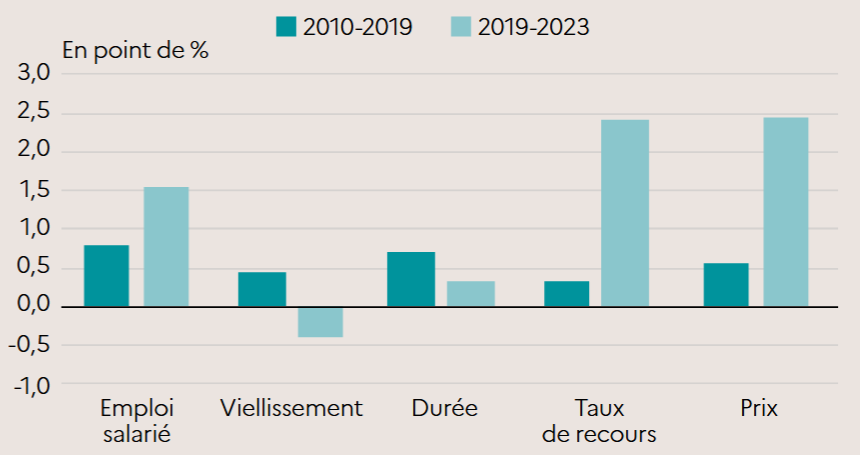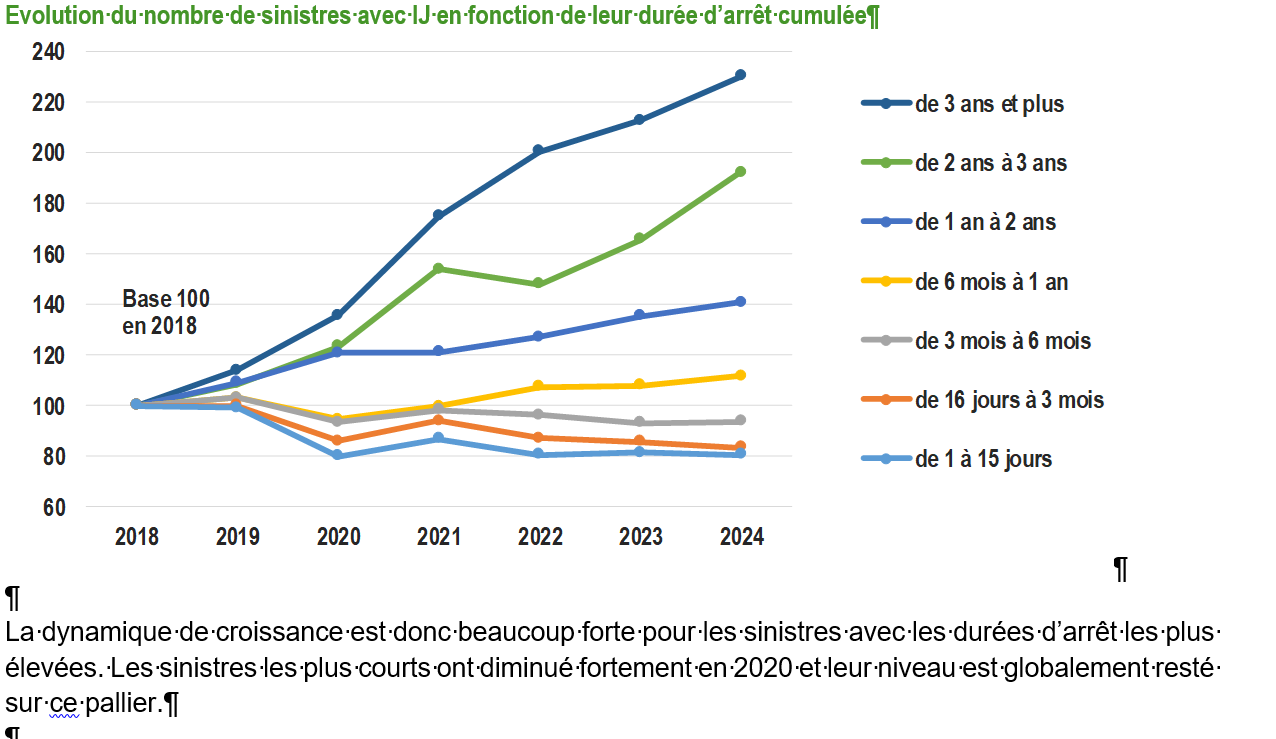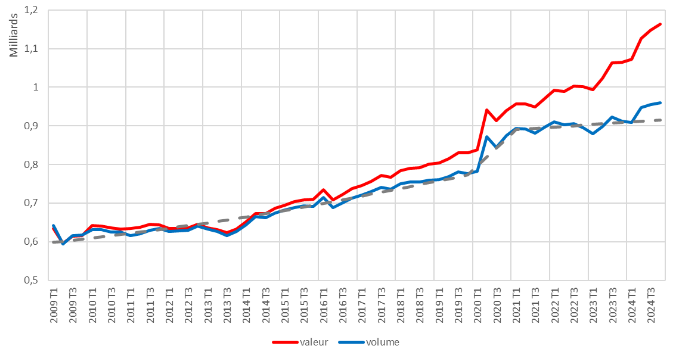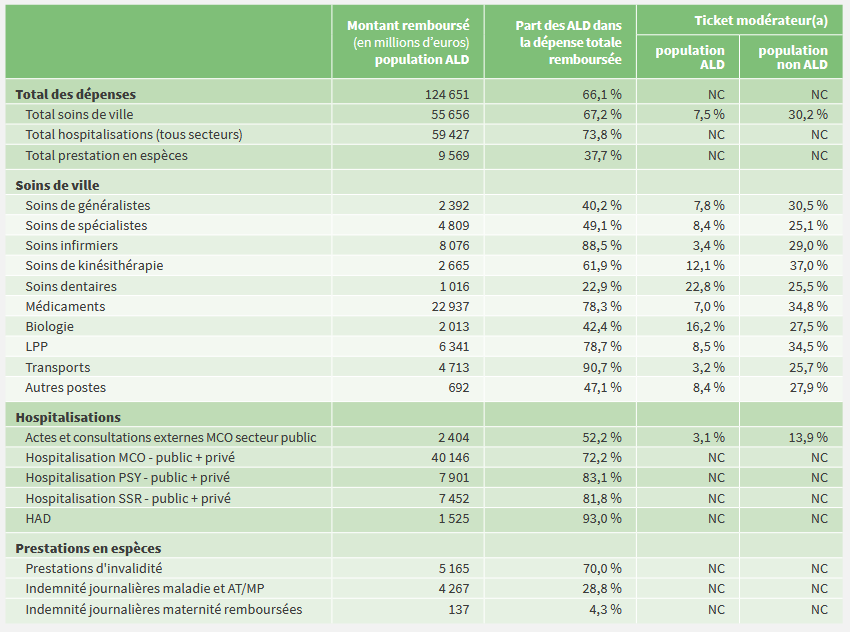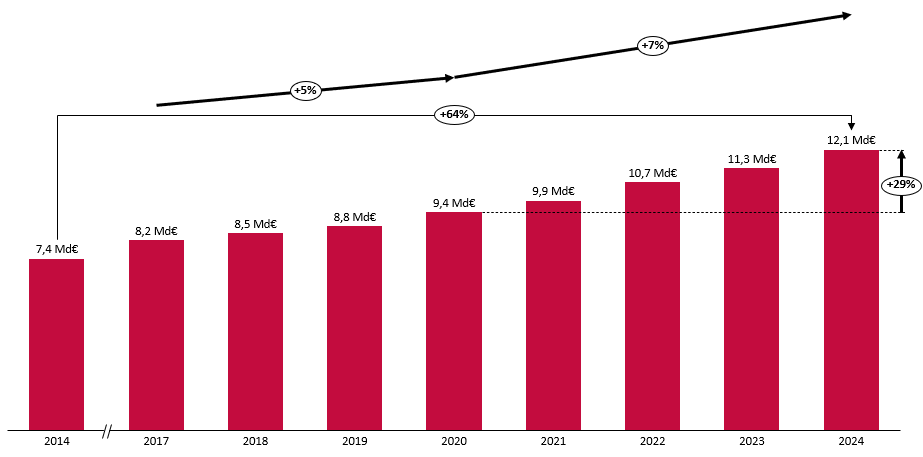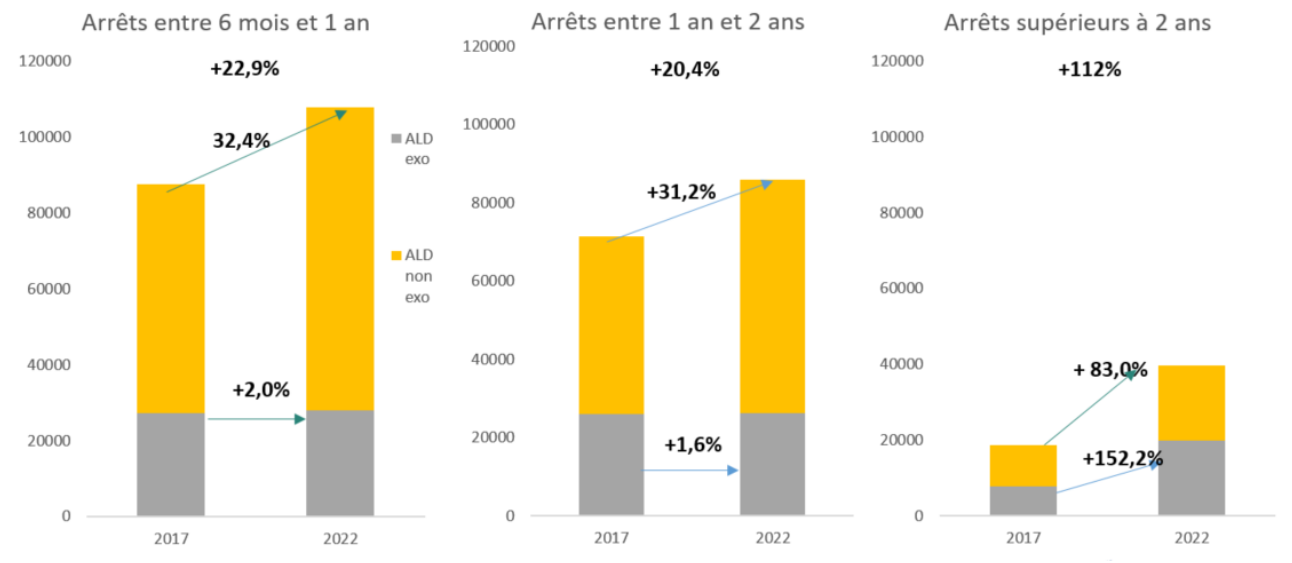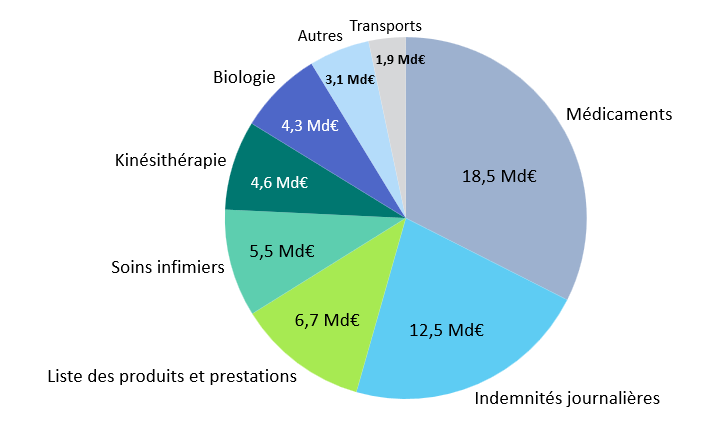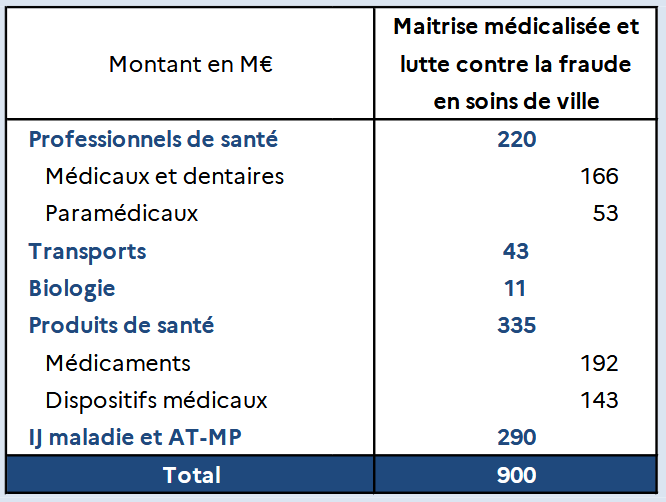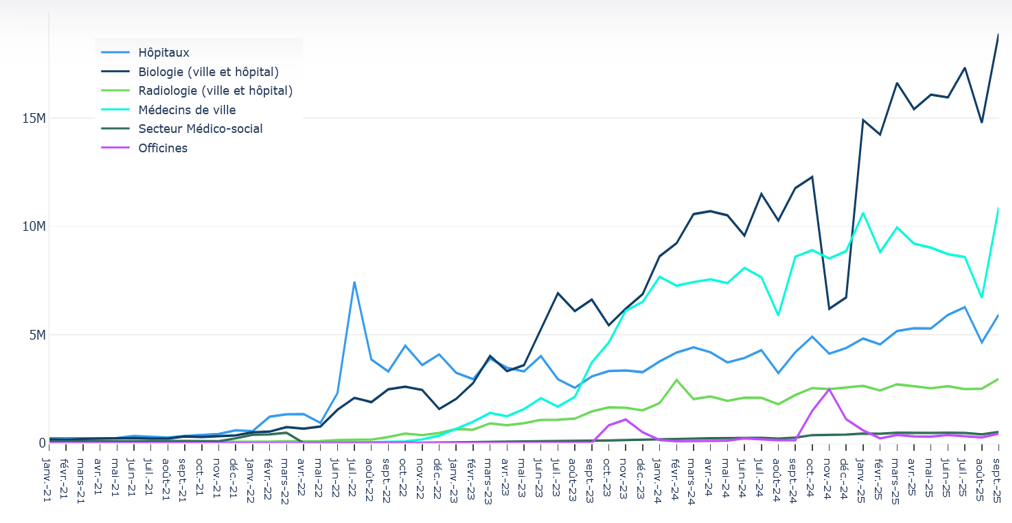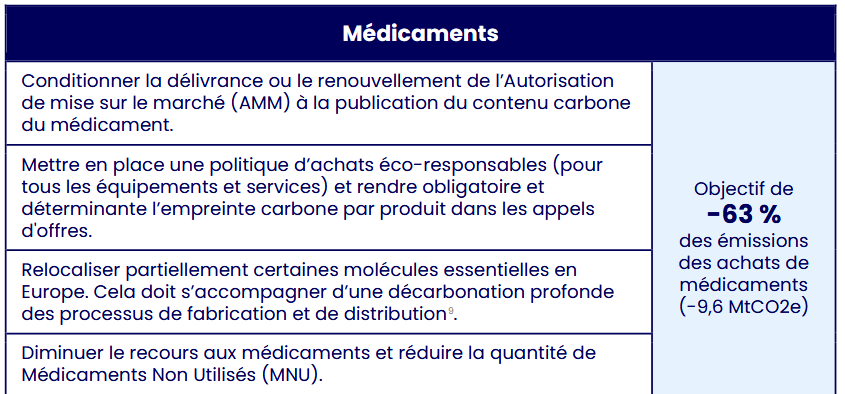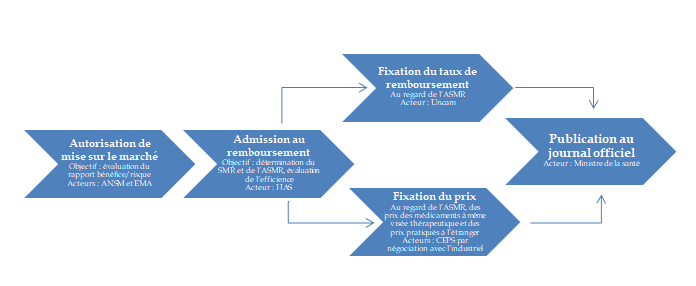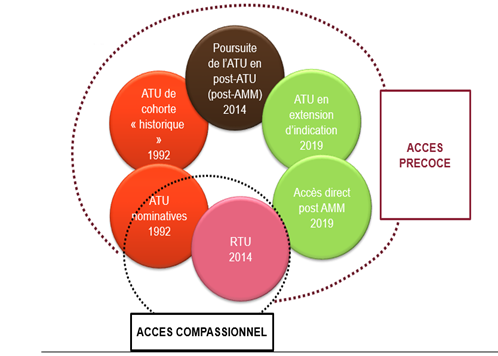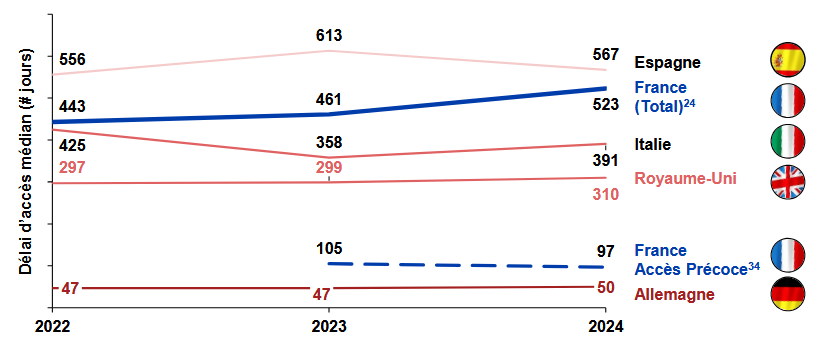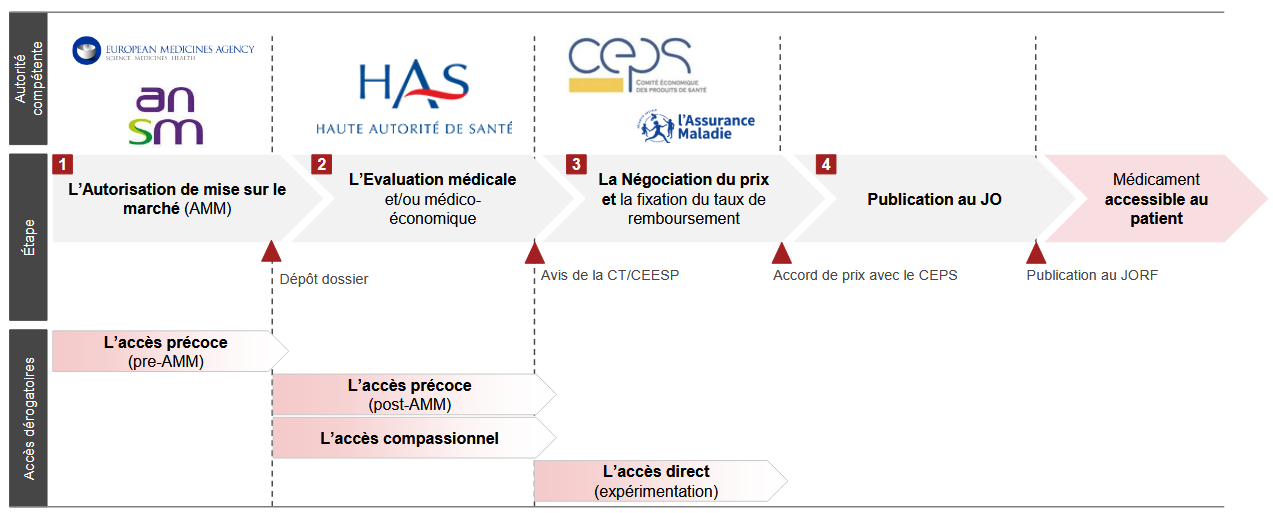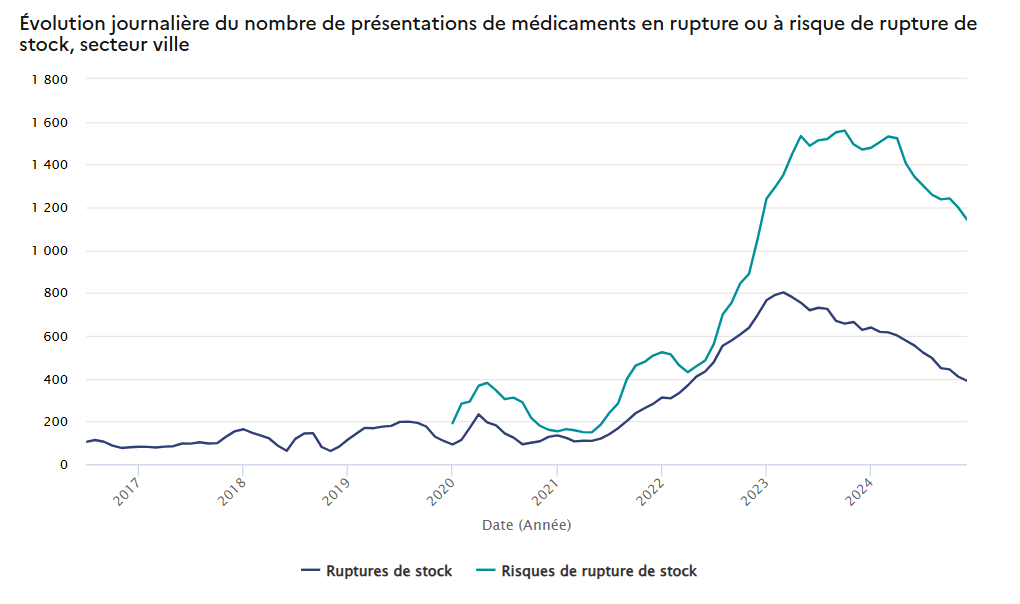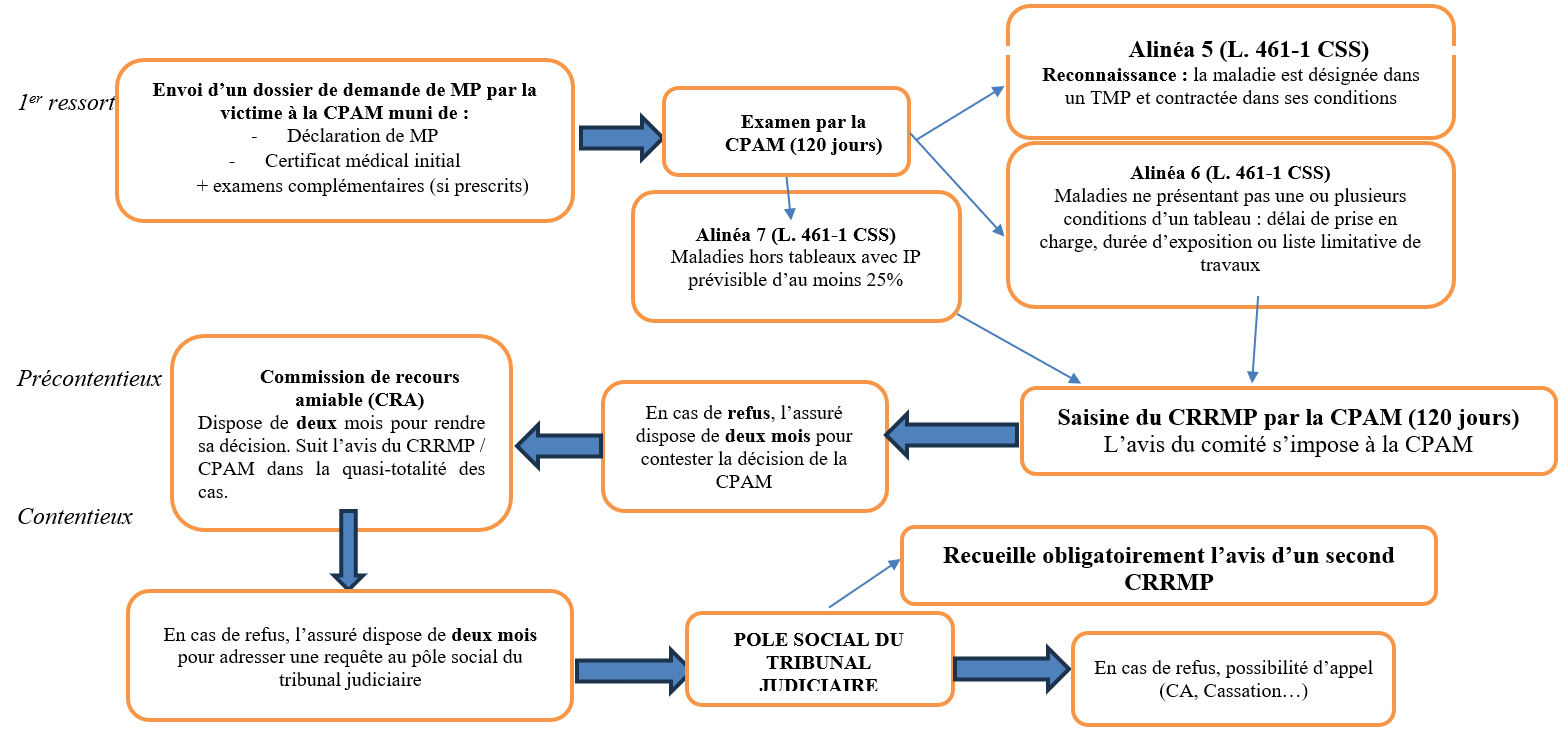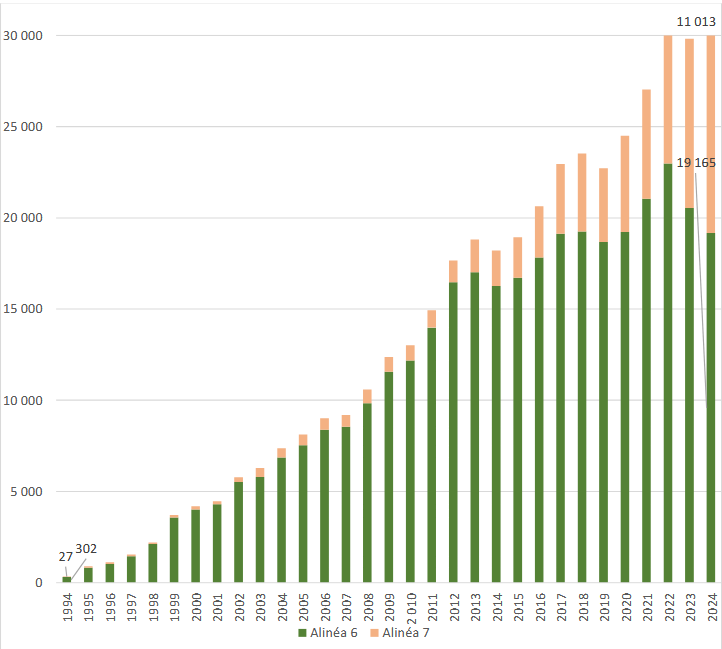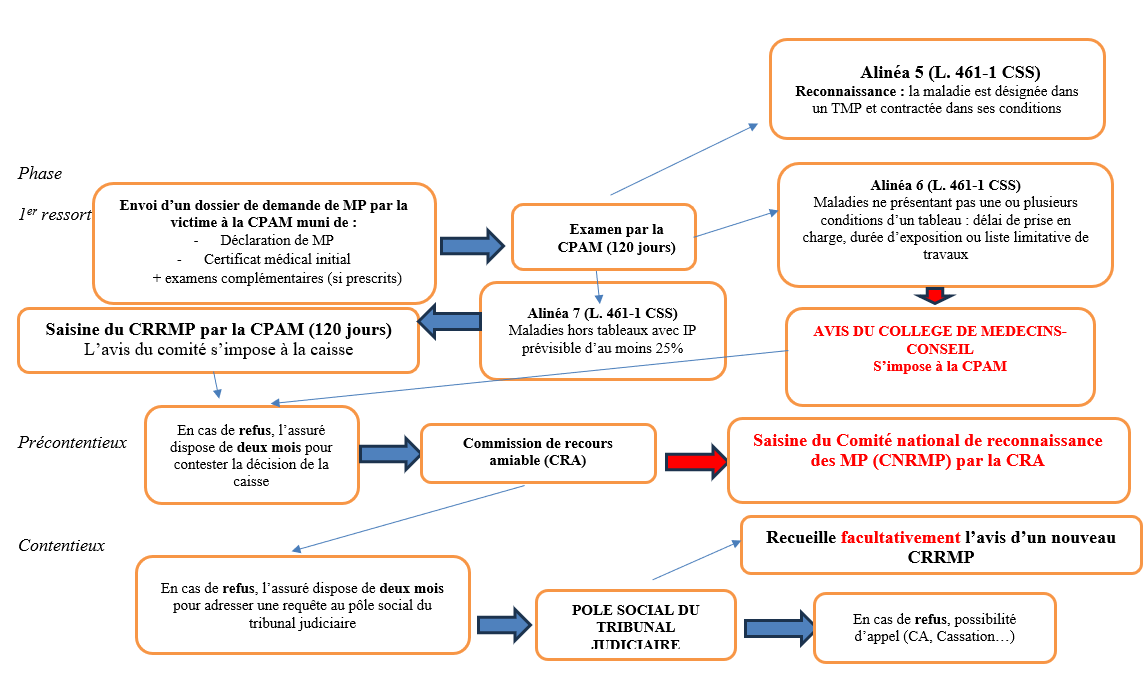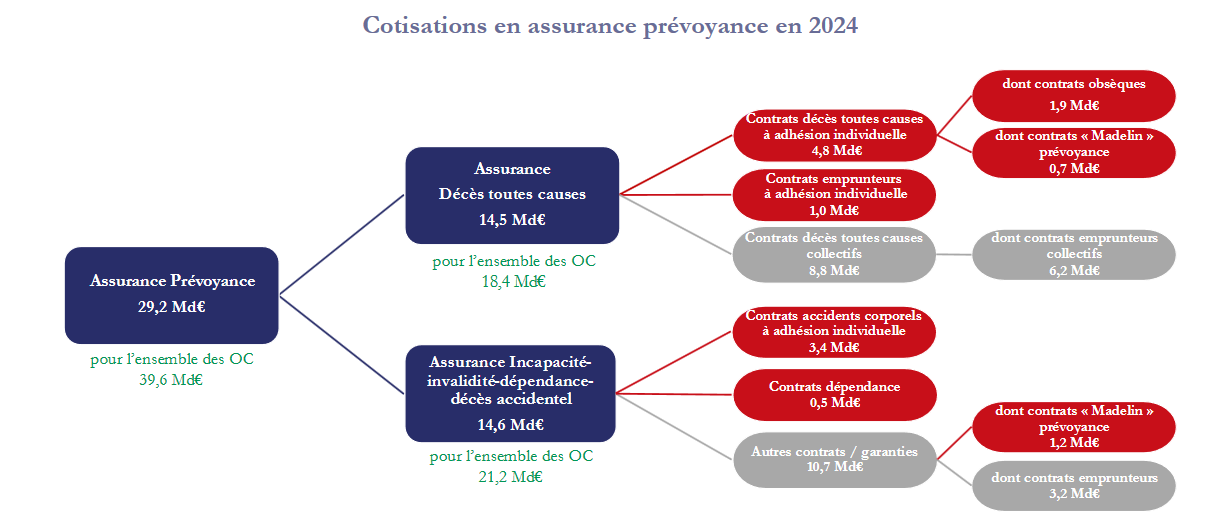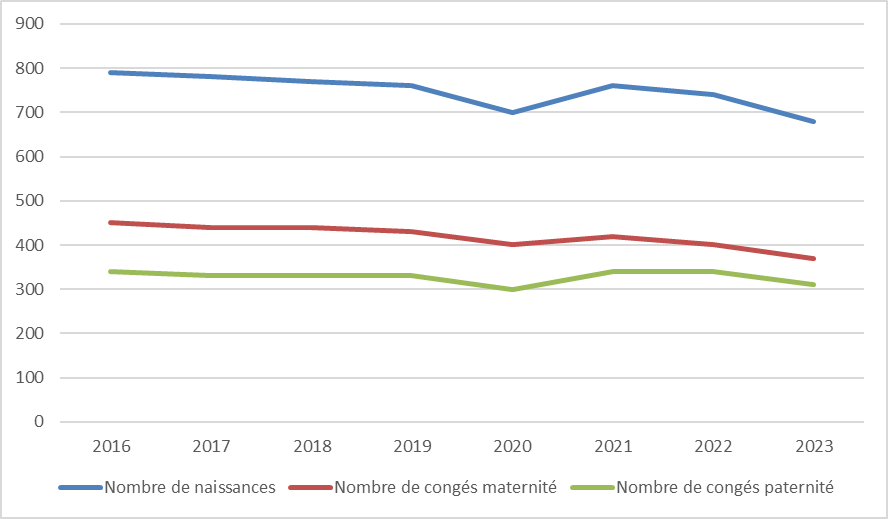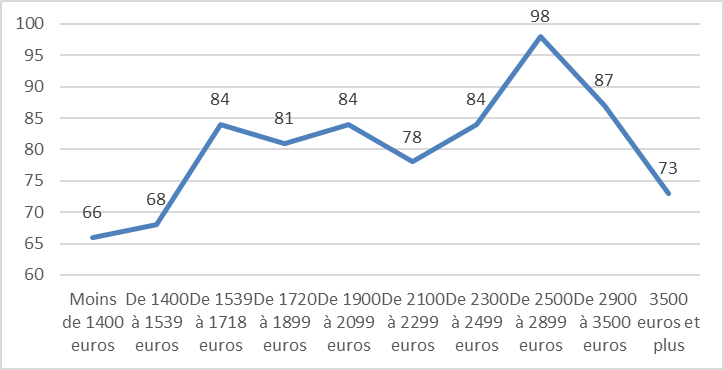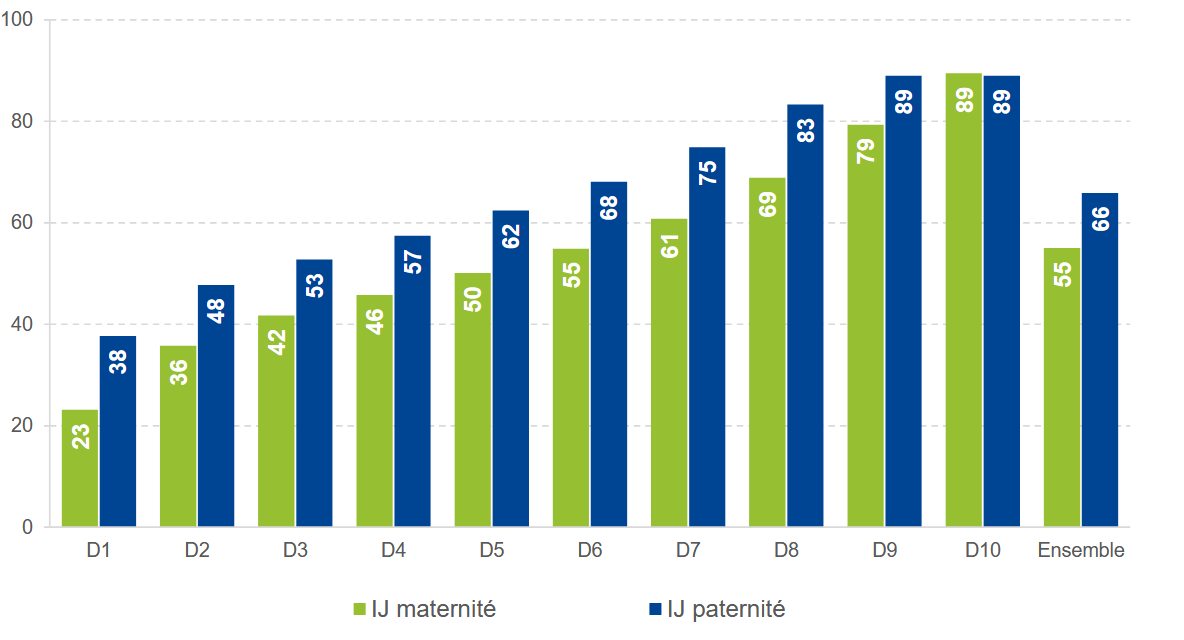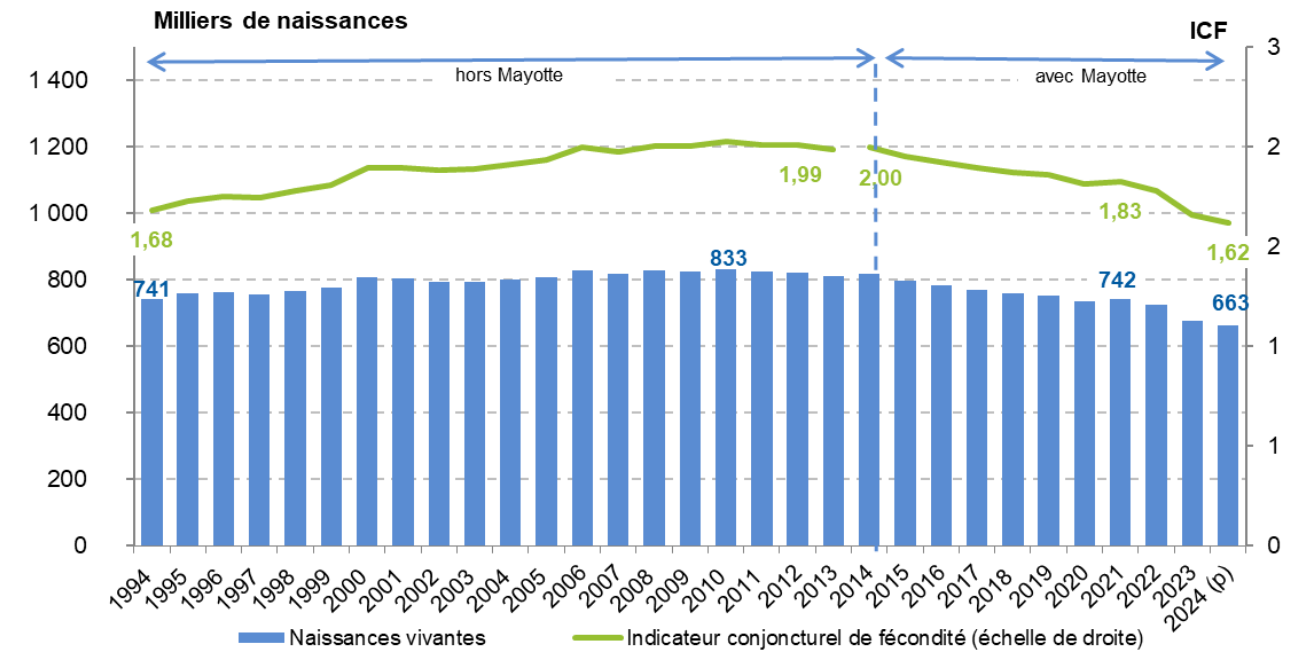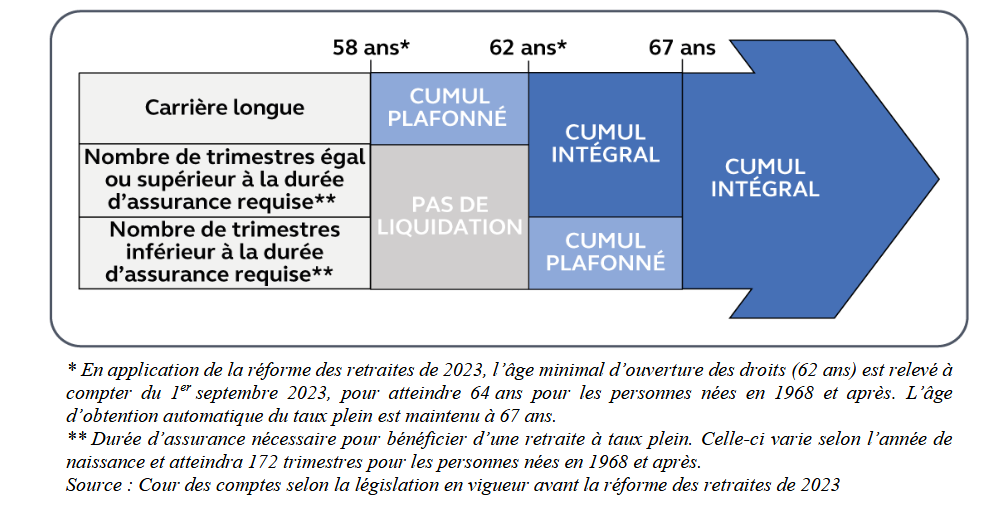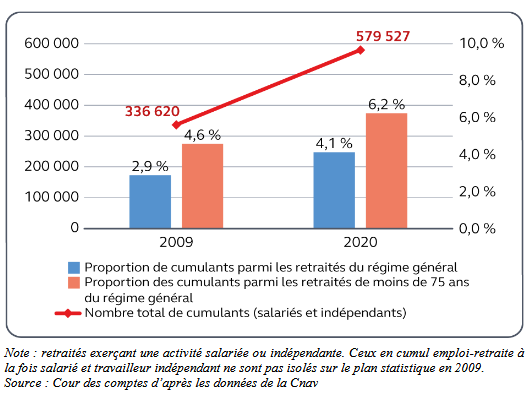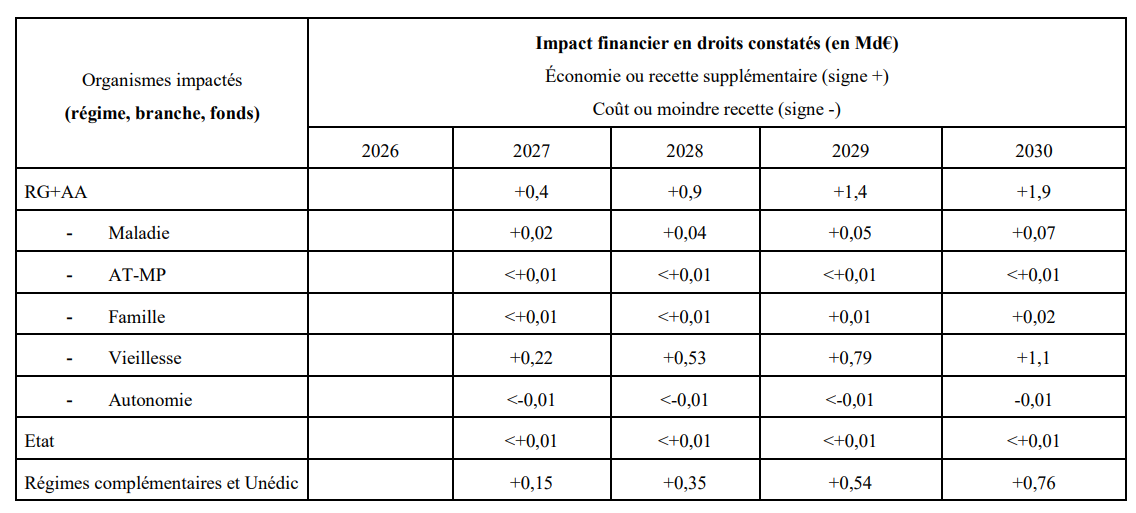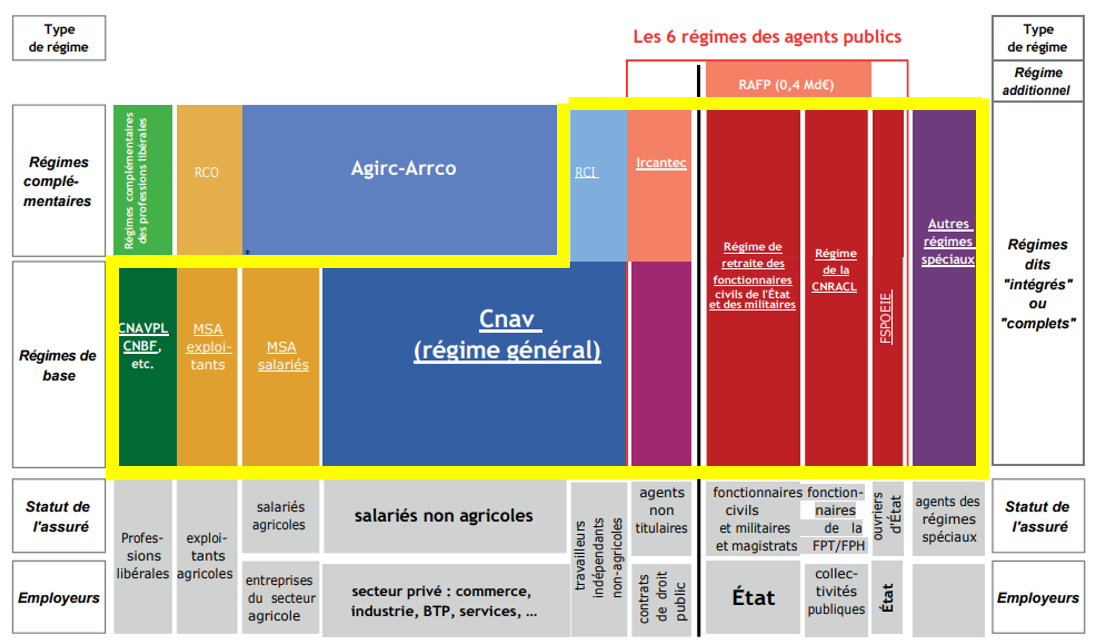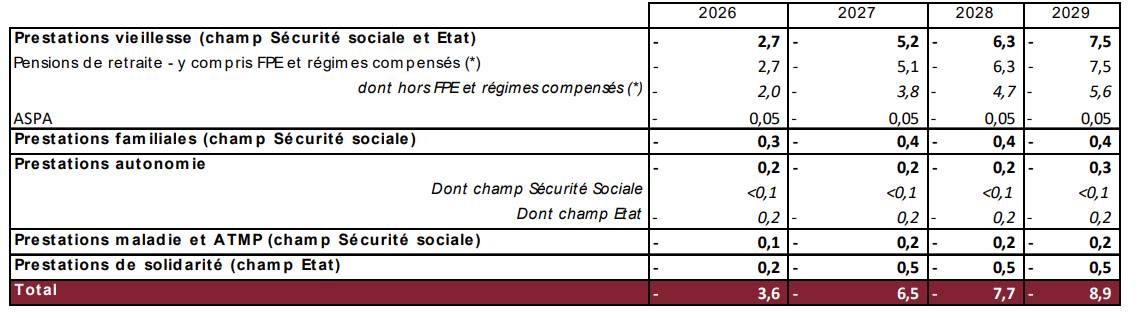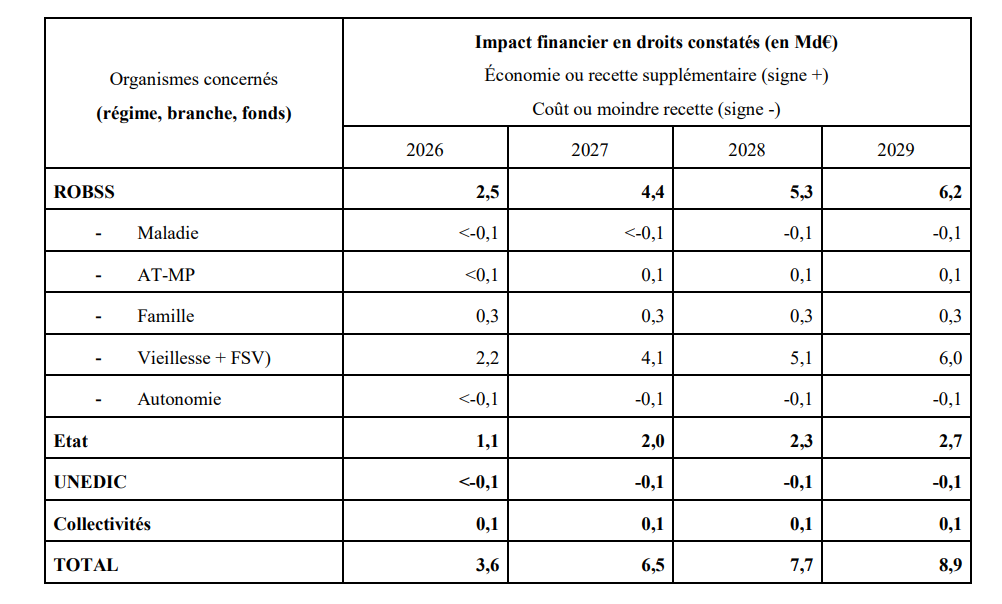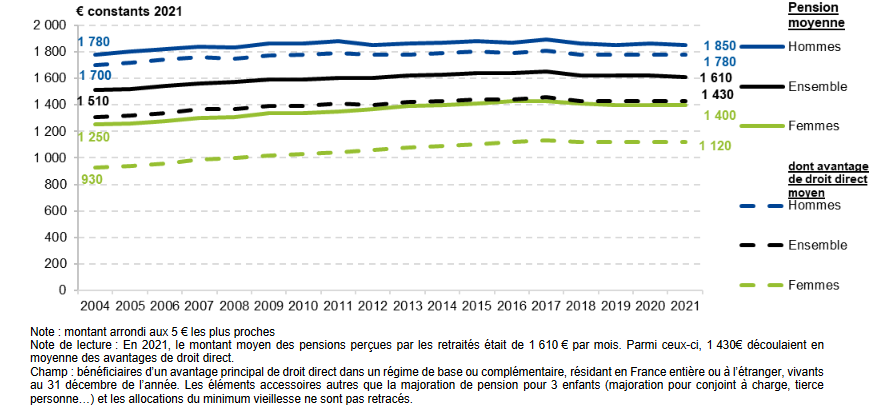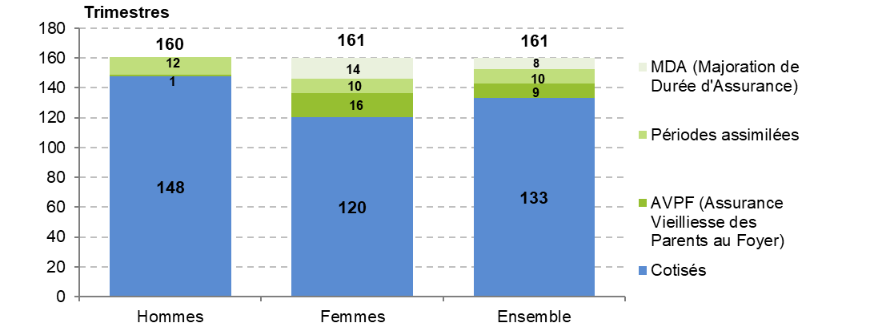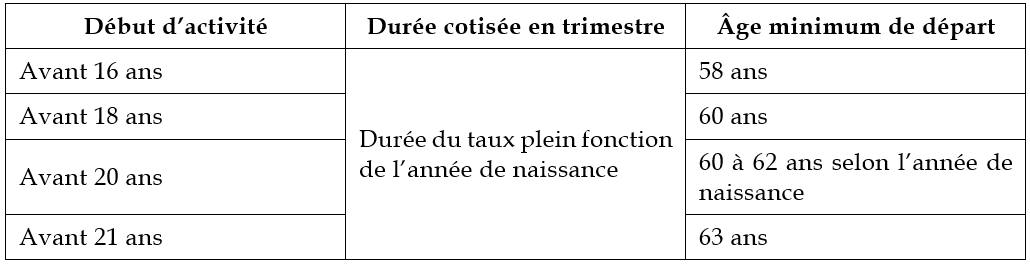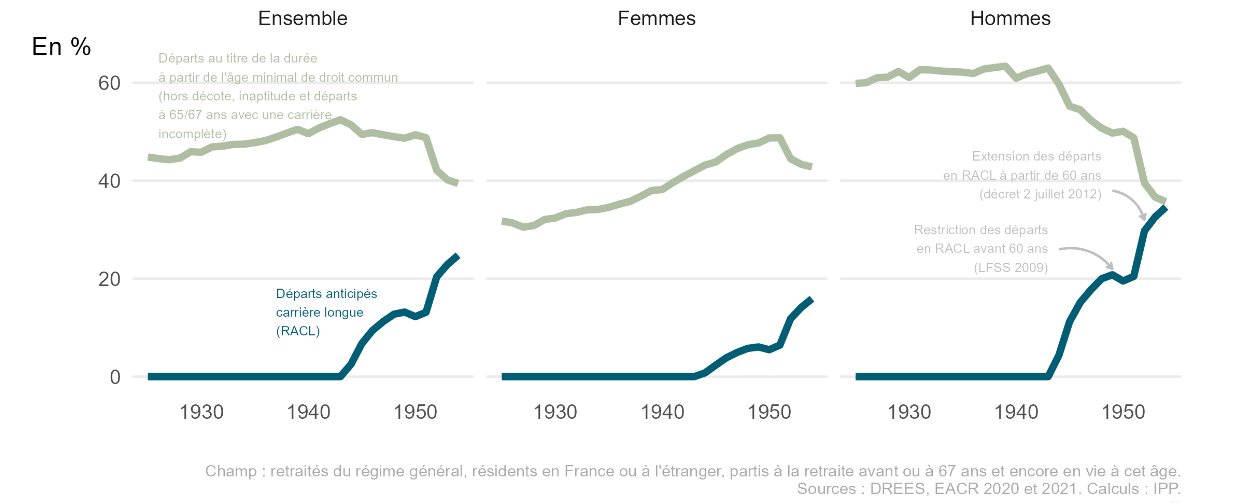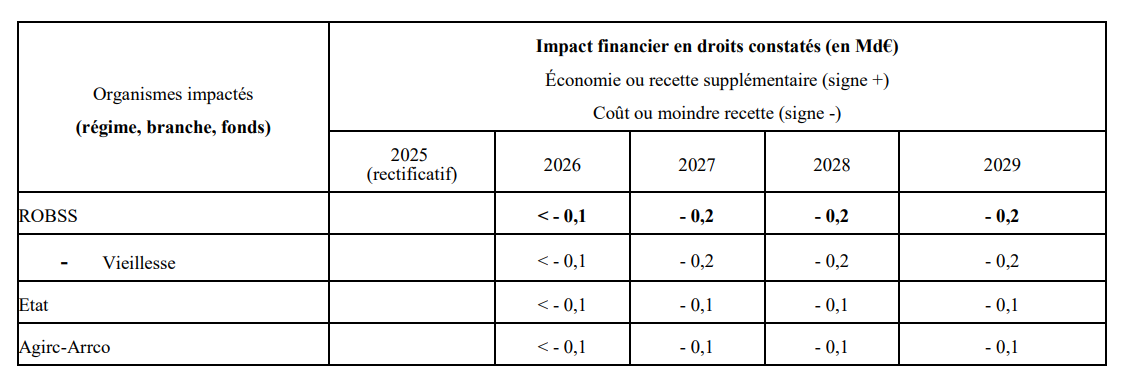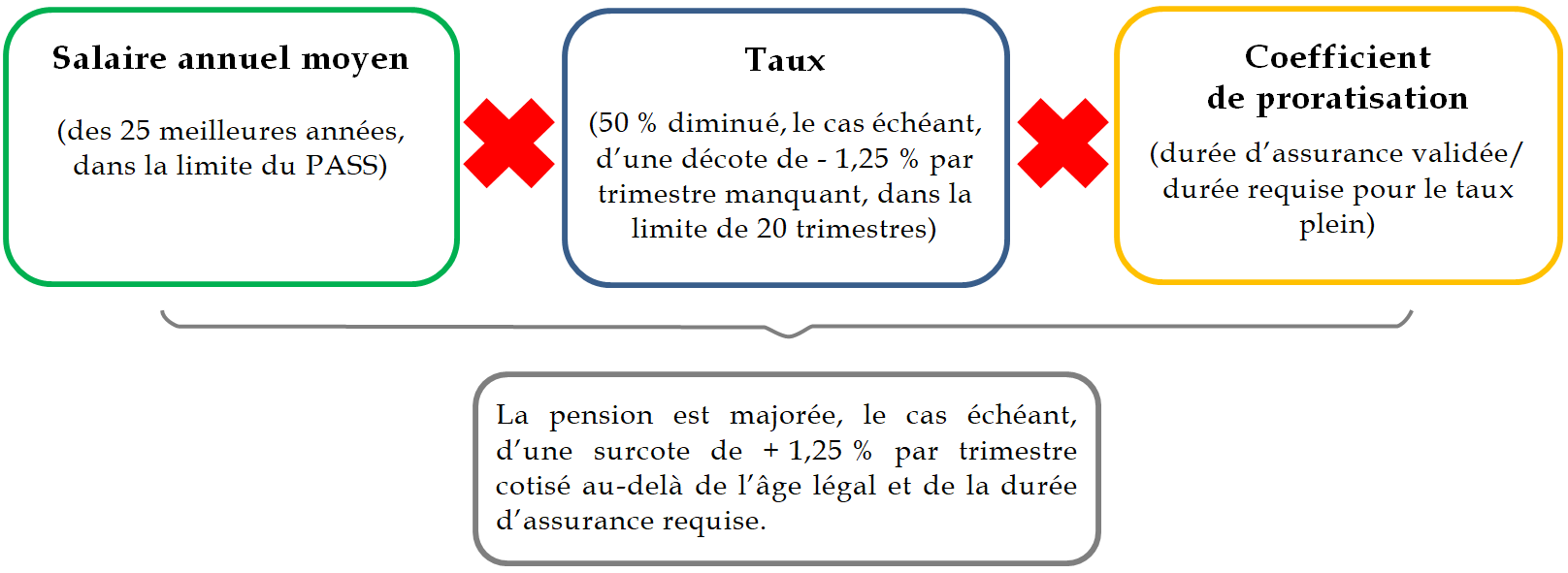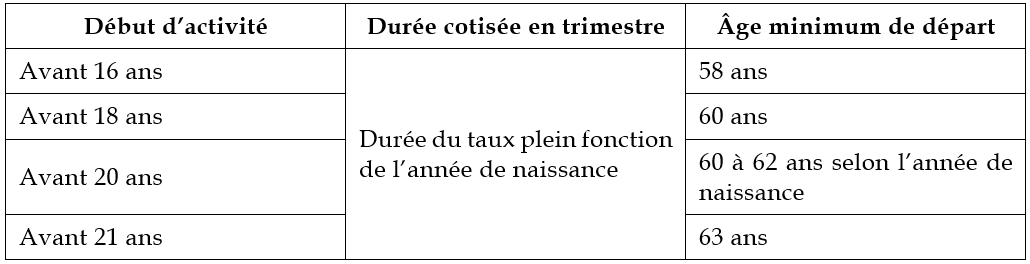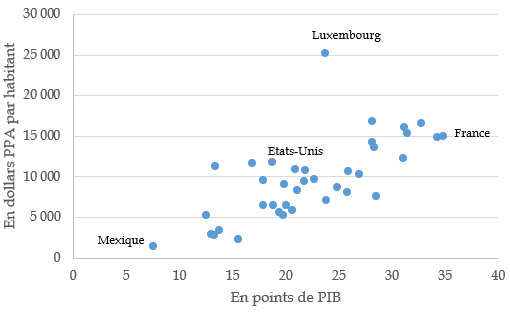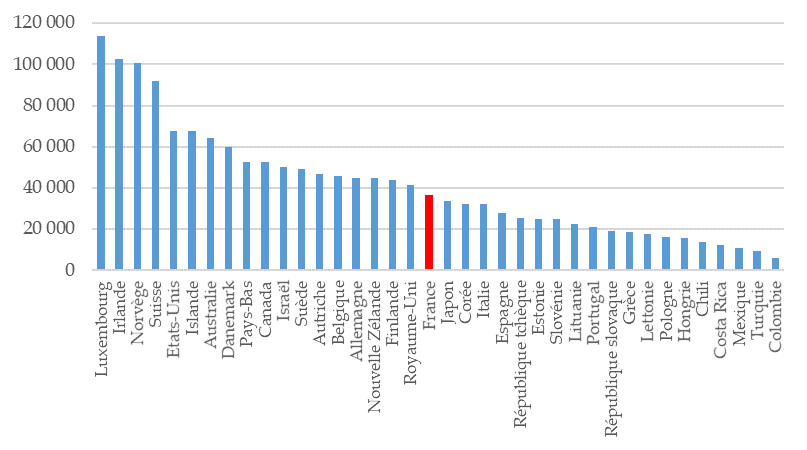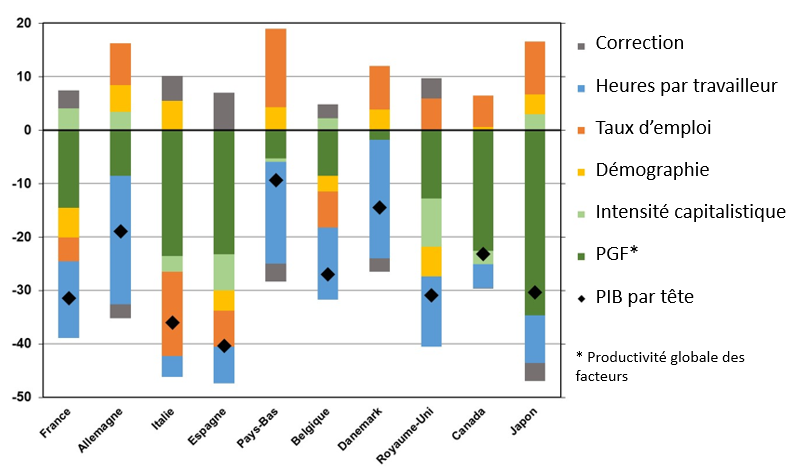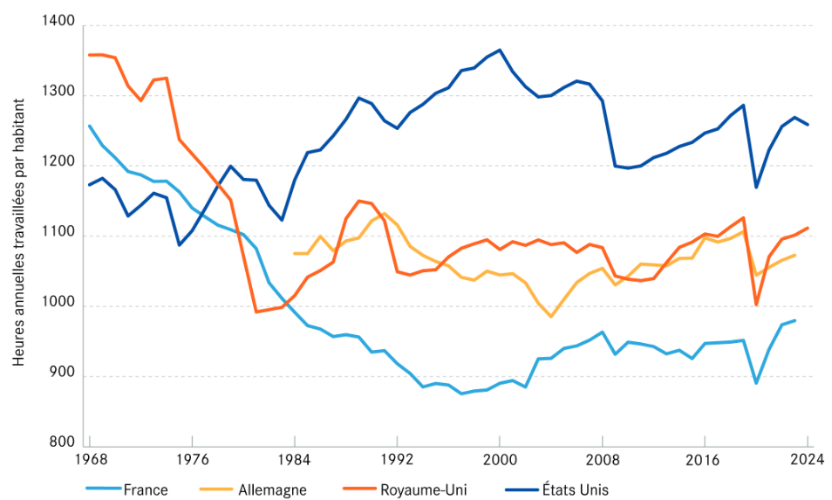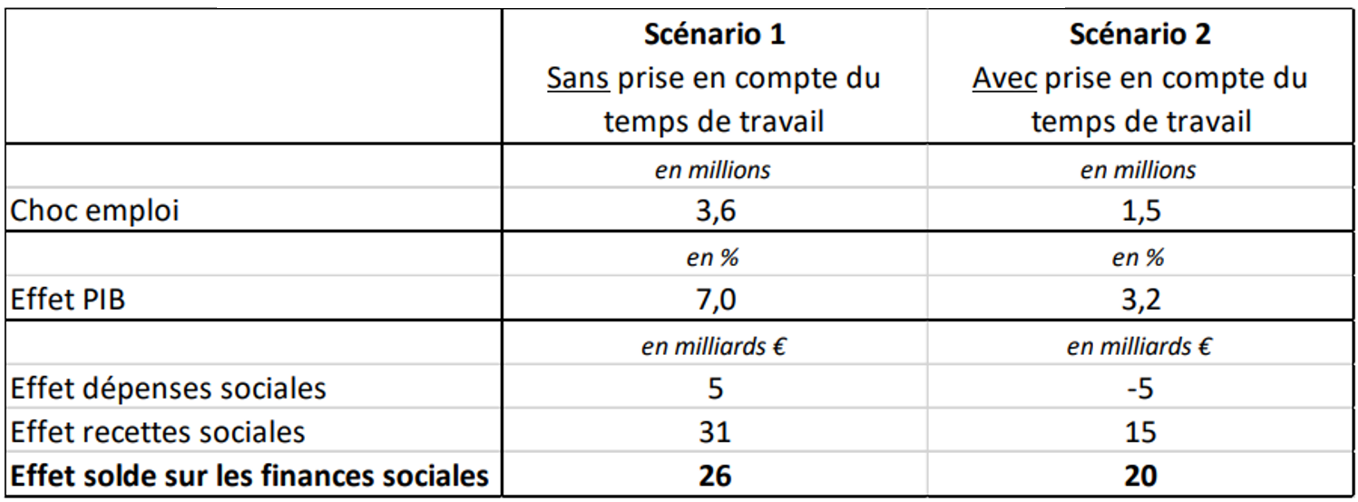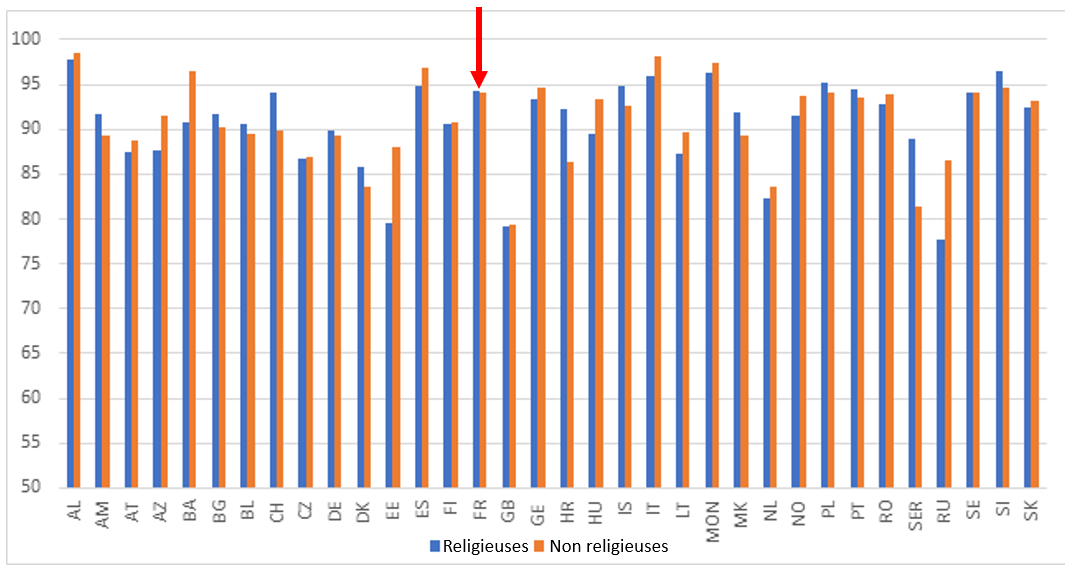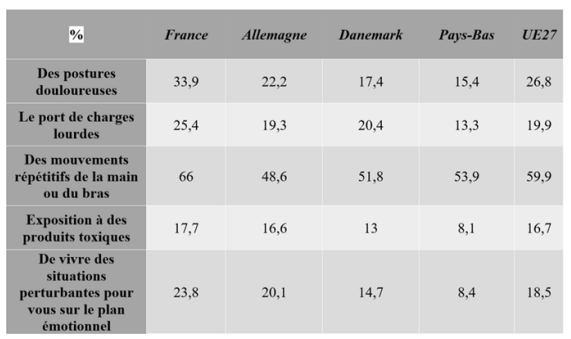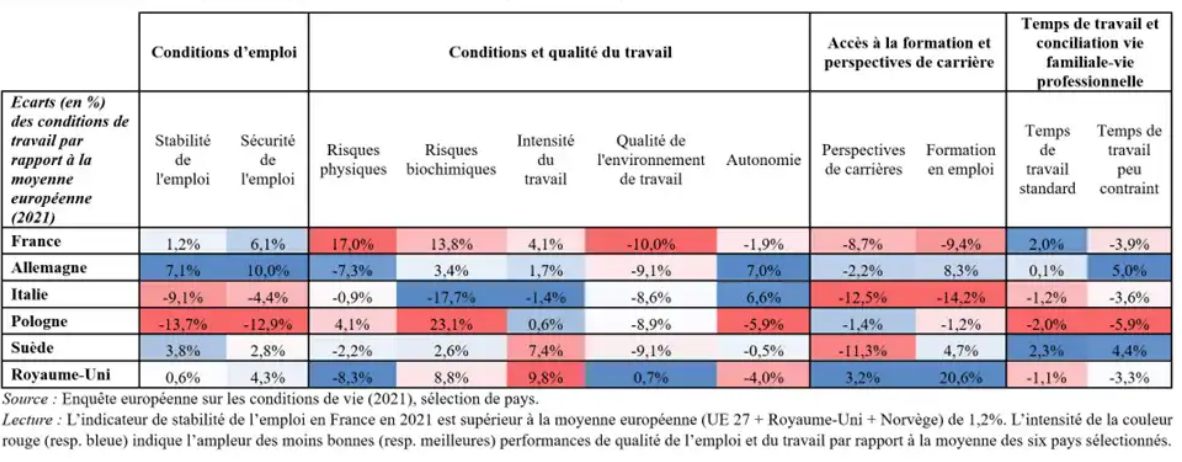N° 131
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
le projet de loi
de financement de la
sécurité sociale, dont le Sénat
est saisi en application
de l'article 47-1, alinéa 2, de la
Constitution, pour 2026,
Par Mme Élisabeth DOINEAU,
Rapporteure générale,
Mmes Corinne IMBERT, Pascale GRUNY, M. Olivier
HENNO,
Mmes Marie-Pierre RICHER et Chantal DESEYNE,
Rapporteures et
Rapporteurs
Sénatrices et Sénateurs
Tome II
Examen des articles
Fascicule 2
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Alain Milon, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, M. Jean Sol, Mmes Nadia Sollogoub, Anne Souyris.
Voir les numéros :
|
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
1907, 2049 et 2057 |
|
Sénat : |
122 et 126 (2025-2026) |
TROISIÈME
PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR
L'EXERCICE 2026
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Article 18
(supprimé)
Extension du champ des franchises et participations
forfaitaires
et évolution de leurs modalités de
recouvrement
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale, propose quatre mesures visant à étendre le champ des franchises et participations forfaitaires et à faire évoluer leurs modalités de recouvrement.
D'abord, il soumet à la participation forfaitaire les actes et consultations réalisés par des chirurgiens-dentistes hors le cadre d'une hospitalisation.
En outre, il étend le champ de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux dispensés hors du cadre d'une hospitalisation, à l'exception d'une liste de produits fixée réglementairement.
L'article 18 prévoit également la création d'un plafond de franchise annuelle spécifique pour le transport sanitaire, qui viendrait s'ajouter au plafond de franchise pour les autres actes, produits et prestations qui y sont soumis.
Enfin, il révise les modalités de recouvrement des participations forfaitaires et franchises en prévoyant que celles-ci puissent être soit acquittées directement par les assurés auprès des professionnels de santé, soit être récupérées par l'assurance maladie sur les prestations à venir ou auprès de l'assuré.
La commission propose de confirmer la suppression de cet article.
I - Le dispositif proposé : une extension du champ des franchises et participations forfaitaires et une évolution de leurs modalités de recouvrement
A. La participation forfaitaire et la franchise annuelle : deux dispositifs poursuivant un objectif de responsabilisation des assurés
Poursuivant un objectif de responsabilisation des assurés, deux dispositifs mettent des montants perçus comme symboliques à la charge de ces derniers sur leur consommation de soins : la participation forfaitaire1(*) et la franchise annuelle2(*), aussi appelée franchise médicale.
Afin de servir cet objectif, ces montants, qui viennent en déduction du montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les complémentaires santé dans le cadre d'un contrat responsable3(*). De tels contrats couvrent 93 % de la population.
Le coût des participations forfaitaires et franchises est donc intégralement supporté par l'assuré.
Ces dispositifs doivent bien être distingués du ticket modérateur, mentionné au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Celui-ci désigne la part des frais de santé qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie obligatoire, peut être prise en charge, tout ou partie, par l'assurance maladie complémentaire4(*), et l'est obligatoirement dans le cadre d'un contrat solidaire et responsable5(*).
Contrairement à la franchise et à la participation forfaitaire, le niveau du ticket modérateur varie donc selon la base de remboursement et le taux de prise en charge applicables à l'acte6(*), au produit ou à la prestation sollicitée. Certains publics ou actes en sont exonérés7(*), tandis qu'il peut être majoré dans certains cas, notamment lorsqu'une consultation s'inscrit en dehors du parcours de soins coordonnés8(*).
Exemple illustratif sur la notion de ticket
modérateur
et de participation forfaitaire
Pour une consultation chez le médecin généraliste, le tarif opposable pour l'assurance maladie obligatoire est de 30 euros, et le taux de remboursement applicable est de 70 % en cas de respect du parcours de soins coordonnés. En multipliant ces deux chiffres, on obtient la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, soit 21 euros.
En retranchant ce montant au prix payé par l'assuré, on obtient le ticket modérateur. Si le médecin est conventionné secteur 1, celui-ci est donc égal à 9 euros. Ce montant peut être pris en charge, tout ou partie, par l'assurance maladie complémentaire.
En déduction des 21 euros ouverts à la prise en charge de l'assurance maladie s'applique la participation forfaitaire de 2 euros : la sécurité sociale ne prend donc, in fine, en charge que la différence, soit 19 euros, à l'assuré.
Le reste à charge du patient est donc égal aux deux euros correspondant à la participation forfaitaire auxquels peut s'ajouter, le cas échéant, tout ou partie du ticket modérateur de 9 euros.
1. La participation forfaitaire frappe les actes et consultations effectués par les médecins et les actes de biologie médicale
Introduite par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie9(*), la participation forfaitaire s'applique à chaque acte ou consultation prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, en ville ou en établissement hors le cadre de l'hospitalisation. Elle frappe également les actes de biologie médicale.
Pour autant, elle ne grève pas les remboursements accordés pour des soins et consultations réalisés par les autres professions médicales que sont les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.
Depuis le 15 mai 202410(*), le montant unitaire d'une participation forfaitaire, déterminé par voie réglementaire, est fixé à deux euros11(*) par acte ou consultation, étant entendu que quatre participations forfaitaires au plus peuvent être facturées par un même professionnel au cours de la même journée12(*).
Au vu de son objectif de responsabilisation, la participation forfaitaire bénéficie d'une assez large assiette, avec un nombre limité d'exemptions. Elle s'applique en effet à tous les assurés, à l'exception :
- des mineurs d'âge13(*) ;
- des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire14(*) ;
- des bénéficiaires de l'aide médicale d'État15(*) ;
- des femmes bénéficiant de l'assurance maternité16(*), applicable à l'ensemble des frais de santé entre le début du sixième mois de grossesse et le douzième jour après l'accouchement ainsi qu'à certains frais encourus au titre de la grossesse à compter de la déclaration de grossesse ;
- des victimes d'actes de terrorisme, pour ce qui concerne les prestations, actes et consultations en résultant17(*) ;
- des invalides de guerre.
La participation forfaitaire s'applique donc, en particulier, aux assurés présentant une affection de longue durée exonérante18(*).
Toutefois, la loi prévoit un plafond au nombre de participations forfaitaires qu'un même assuré est susceptible d'avoir à supporter au cours d'une année donnée19(*). Ainsi, aucun assuré n'a à s'acquitter de plus de 25 participations forfaitaires sur un an20(*), ce qui borne par voie de conséquences le reste à charge encouru au titre de ces participations à 50 euros par an.
2. La franchise annuelle s'applique aux médicaments, aux prestations effectuées par les pharmaciens, aux actes paramédicaux et au transport sanitaire
La franchise annuelle, instituée par la LFSS pour 200821(*), frappe quant à elle un champ plus large, qui recouvre :
- la prise en charge des médicaments, qu'ils soient des spécialités pharmaceutiques industrielles, des préparations magistrales ou des préparations hospitalières, dès lors qu'ils ne sont pas délivrés au cours d'une hospitalisation ;
- la prise en charge des actes paramédicaux, en ville ou en établissement, dès lors que ceux-ci ne sont pas pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
- le transport sanitaire non urgent, qu'il soit réalisé par ambulance, par véhicule sanitaire léger ou par taxi conventionné ;
- depuis la LFSS pour 202022(*), certaines prestations effectuées par des pharmaciens d'officine, précisées par arrêté.
Il est à noter que, contrairement aux médicaments, les dispositifs médicaux ne sont pas concernés par la franchise médicale, « sans que cette exonération ne soit justifiée par des arguments relatifs à l'accès aux soins ni par des spécificités des dispositifs médicaux par rapport aux actes et produits médicaux soumis à franchise » selon une récente revue de dépenses des inspections générales des finances et des affaires sociales23(*).
Les franchises représentent un coût unitaire d'un euro24(*), sauf pour le transport sanitaire où elles atteignent quatre euros par trajet. Lorsque la prise en charge par la sécurité sociale est inférieure à un euro, la franchise due est toutefois réduite à due concurrence25(*). S'applique en outre, dans certains cas, un plafonnement du montant de franchise exigible sur une journée, fixé à quatre euros pour les actes des auxiliaires médicaux et huit euros pour le transport sanitaire.
Poursuivant le même objectif de responsabilisation que les participations forfaitaires, les franchises s'appliquent également à une large proportion d'assurés. Seules les exceptions prévues pour la participation forfaitaire s'appliquent.
Comme pour la participation forfaitaire, la franchise médicale est plafonnée à 50 euros annuels par assuré26(*), ce qui limite le reste à charge des assurés nécessitant le plus de soins, notamment pour traiter des affections de longue durée. Il existe, à ce jour, un unique plafond pour l'ensemble des actes, produits et prestations concernés par la franchise.
B. L'évolution des participations forfaitaires et franchises vers des dispositifs de rendement et de maîtrise de la dépense d'assurance maladie
1. Le récent doublement des montants des participations forfaitaires et franchises a permis d'en accroître le rendement, tout en préservant les patients atteints d'affection de longue durée
Depuis leur institution et jusqu'en 2023, les montants des participations forfaitaires et des franchises étaient restés fixes, à un euro par participation forfaitaire, 0,5 euro par franchise hors transport sanitaire et deux euros par franchise de transport sanitaire.
Dans le cadre du PLFSS pour 2024, le Gouvernement a affirmé son intention de doubler les montants de la participation forfaitaire et de la franchise annuelle. Le Gouvernement chiffrait le rendement potentiel de cette mesure autour de 800 millions d'euros.
Afin de protéger les personnes en affection de longue durée, le Gouvernement avait toutefois souhaité ne pas modifier les plafonds annuels de chacune de ces contributions, qu'il entendait maintenir à 50 euros par an.
Dans un contexte de dégradation durable de la trajectoire de la branche maladie, l'objectif affiché était de responsabiliser davantage les patients, mais nul n'ignore qu'une telle réforme, qui ne nécessite pas de transcription législative, servait également un objectif de rendement.
Malgré de vifs débats parlementaires, au cours desquels le Sénat avait fait adopter le principe d'une consultation systématique des commissions des affaires sociales du Parlement pour tout projet de modification de ces montants - finalement censuré par le Conseil constitutionnel - le Gouvernement avait décidé d'acter cette évolution par un décret en Conseil d'État27(*) et un décret28(*) du 16 février 2024.
Ces évolutions sont entrées en vigueur le 31 mars 2024 pour les franchises, et le 15 mai 2024 pour les participations forfaitaires.
2. Un nouveau doublement réglementaire du montant des franchises et des participations forfaitaires est envisagé, cette fois accompagné d'un doublement des plafonds
Le 15 juillet 2025, l'ancien Premier ministre François Bayrou a présenté, dans le cadre de son plan pluriannuel pour rééquilibrer les finances publiques, son projet de doubler à nouveau le montant des franchises médicales et des participations forfaitaires.
Les contours de la mesure ont progressivement été dessinés au mois d'août par le Gouvernement. Des projets de décrets ont précisé la teneur des réformes envisagées :
- encadrement du montant de la participation forfaitaire entre 4 et 5 euros (entre 2 et 3 euros aujourd'hui). En conséquence, le plafond annuel serait vraisemblablement doublé pour atteindre 100 euros ;
- fixation du montant de la franchise médicale à 2 euros par boîte de médicaments, 2 euros par acte paramédical, et 8 euros par transport sanitaire non urgent ;
- passage de 50 à 100 euros du plafond annuel pour les participations forfaitaires ;
- passage de 4 à 8 euros de plafond journalier de la franchise médicale pour les actes paramédicaux, et de 8 à 6 euros de celui pour les transports sanitaires.
La publication de ces seuls décrets pourrait donc aboutir à doubler le reste à charge supporté au titre de ces contributions pour tous les assurés, y compris ceux en ALD, qui pourraient désormais devoir débourser jusqu'à 200 euros par an de frais de participation et franchise, contre 100 euros aujourd'hui. Pourraient encore s'ajouter 50 à 100 euros supplémentaires, liés à la création d'un plafond spécifique au transport sanitaire, prévu par le présent article du PLFSS29(*).
Les projets de décrets présentés ont été rejetés le 4 septembre par le Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), dont l'avis est consultatif. Le syndicat de généralistes MG France a jugé ce projet « injuste socialement, inefficace économiquement et irréalisable techniquement », décriant au passage « la méthode employée ». Au nom des usagers de santé, France Assos santé a dit « non au passage en force du gouvernement » sur le doublement des franchises, des textes qui « menacent le droit à la santé pour tous ».
Ces mesures ont toutefois été reprises par le Gouvernement dans le cadre du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le dossier de presse associé indique ainsi qu'est intégrée aux projections financières « la mise en oeuvre du doublement des participations forfaitaires et franchises ».
Le Gouvernement espère des économies à hauteur de 2,2 à 2,3 milliards d'euros pour cette mesure, selon l'annexe 5 au PLFSS pour 2026.
La ministre de l'action et des comptes publics a assuré, devant la commission, qu'« en moyenne, pour les personnes en ALD, la hausse du reste à payer représenterait 70 euros par an. Pour un patient moyen, hors enfant, femme bénéficiant de l'assurance maternité et bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, la moyenne s'élèverait à 42 euros par an ».
3. Les participations forfaitaires et franchises ont représenté 1,73 milliard d'euros de moindres dépenses constatées pour l'assurance maladie en 2024 sur le seul régime général
a) Le cas du régime général : des économies dynamiques depuis 2016, considérablement renforcées par le doublement des montants unitaires dus
Si le montant constaté des franchises et participations forfaitaires ne dépassait pas 900 millions d'euros en 2010 au régime général, ces contributions ont vu leur rendement progresser au fil des années, à mesure qu'augmentait le volume de la consommation de soins et de biens médicaux.
La franchise, dont l'assiette est plus large, génère historiquement davantage d'économies pour l'assurance maladie que la participation forfaitaire, bien que le montant unitaire de cette dernière soit supérieur. La participation forfaitaire, portée par la demande de soins de médecine de ville et par la dynamique de la biologie médicale, progresse toutefois plus rapidement que la franchise.
Sur la période 2010-2016, les franchises ont stagné (- 0,1 % de croissance annuelle moyenne) tandis que les participations forfaitaires ont augmenté de manière mesurée (+ 2,9 % de croissance annuelle moyenne). Au total, les participations forfaitaires et franchises ont vu leur montant augmenter de 5 % au total sur la période.
Depuis, la dynamique s'est accélérée : sur la période 2016-2023, les participations forfaitaires ont connu une hausse marquée de 8,5 % par an, et les franchises se sont inscrites dans une trajectoire de croissance, à 3,4 % en moyenne annuelle. En 2023, les franchises représentaient 776 millions d'euros d'économies constatées, et les participations forfaitaires 472 millions d'euros, soit un total de 1,2 milliard d'euros.
Avec le doublement des participations forfaitaires et franchises au cours de l'année 2024, les économies générées par ces dispositifs ont bondi. Le montant constaté au titre des participations forfaitaires s'est accru de 219 millions d'euros en 2024, et celui au titre des franchises de 255 millions d'euros.
De telles données laissent présager un montant d'économies en année pleine autour de 900 millions d'euros pour cette mesure, même si ces données sont encore immatures et extrapolées des données du régime général.
Avec cette augmentation, les franchises ont permis à l'assurance maladie de générer, sur le régime général, 1,0 milliard d'euros d'économies constatées, et les participations forfaitaires 691 millions d'euros, soit un total de 1,7 milliard d'euros.
En extrapolant ces données à l'ensemble des régimes obligatoires de base, le montant d'économies liées à ces deux dispositifs dépasserait 2,1 milliards d'euros en 2024.
Montant d'économies constatées
générées par les franchises
et participations
forfaitaires depuis 2010
Champ : régime général.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après les données du Repss Maladie 2025
Sur le champ du régime général, les participations forfaitaires dues en 2023 sont imputables à 41 % aux actes de biologie médicale, le solde étant équitablement réparti entre médecine générale et autres spécialités.
Quant aux franchises, elles sont essentiellement le fait des médicaments, à plus de 75 %, et, dans une moindre mesure, des actes paramédicaux. Ces derniers constituent 20 % du montant d'économies imputable aux franchises, répartis équitablement entre les actes des infirmiers et ceux des masseurs-kinésithérapeutes, les franchises encourues auprès des autres auxiliaires médicaux étant marginales. Le transport sanitaire représente quant à lui moins de 5 % du montant d'économies produit par les franchises.
b) Sur l'ensemble des régimes obligatoires de base, des données anciennes démontrent une concentration de l'effort sur les patients âgés ou en mauvaise santé
Sur le champ de l'ensemble des régimes obligatoires de base, les dernières estimations concernant les économies générées par les franchises et participations forfaitaires, datées de 2022, étaient respectivement de 900 millions d'euros et 740 millions d'euros, soit un total de 1,64 milliard d'euros.
Avant le doublement des montants unitaires en 2024, la franchise représentait un coût moyen de 18 euros par consommant, dont 14 euros pour les médicaments. Le montant annuel moyen encouru au titre de la participation forfaitaire atteignait quant à lui 15 euros.
Ces moyennes cachent d'importantes disparités en fonction de l'âge et de l'état de santé des patients.
Concernant l'âge, 80 % des assurés entre 18 et 27 ans payent moins de dix euros de franchise annuelle, et 73 % d'entre eux s'acquittent également de moins de dix euros de participation forfaitaire. A contrario, 67 % des assurés âgés de 88 à 97 ans payent plus de 40 euros de franchise.
Concernant l'état de santé, les personnes en ALD sont 18 % à subir plus de 40 euros de participations forfaitaires et 52 % à subir plus de 40 euros de franchises ; alors que les assurés hors ALD sont respectivement 35 % et 42 % à s'acquitter de moins de 5 euros de participations forfaitaires et de franchises.
Répartition du montant de moindre remboursement au titre des participations forfaitaires et des franchises en fonction du statut d'ALD
Source : Bureau 6B de la direction de la sécurité sociale
C. Un mode de recouvrement fondé sur une déduction des prestations versées
1. Un recouvrement par prélèvement sur le flux des prestations versées par l'assurance maladie
Les franchises et participations forfaitaires sont, en règle générale, recouvrées par prélèvement sur le flux des prestations versées30(*) par l'assurance maladie. Leur montant est ainsi déduit de tout remboursement ultérieur de frais de santé en l'absence de tiers-payant, ou de tout versement de prestations en espèces, à l'instar des indemnités journalières ou de la pension d'invalidité.
Toutefois, lorsque le montant ne peut être récupéré sur une autre prestation - par exemple pour un assuré bénéficiant du tiers-payant sur l'ensemble de ses soins et ne percevant pas de prestations en espèces - un avis des sommes à payer est envoyé à l'assuré.
Par dérogation à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement, sauf lorsqu'intervient la prescription31(*), cinq ans après le fait générateur.
2. Un mode de recouvrement qui suscite les réserves du Gouvernement
Ce mode de recouvrement présente, aux dires du Gouvernement, deux désavantages fondamentaux.
• D'une part, dans la majorité des cas, le prélèvement intervient concomitamment au versement d'autres prestations en nature ou en espèces : l'assuré ne s'aperçoit donc pas nécessairement du montant de franchise ou de participation forfaitaire dont il a à s'acquitter. Il en résulte, selon le Gouvernement, une limitation de la responsabilisation des assurés, qui constitue pourtant l'objectif affiché de ces dispositifs.
En ce sens, le Gouvernement estime, dans l'annexe 9 au PLFSS pour 2026, que « rendre visibles ces paiements concourrait à responsabiliser davantage les assurés sur leurs dépenses de santé ».
• D'autre part, ce mode de recouvrement présente une efficacité limitée : le dernier taux de recouvrement stabilisé pour le régime général32(*), celui pour l'année 2019, atteint 89,1 % (88,6 % pour les participations forfaitaires, 89,4 % sur les franchises), un total structurellement baissier en raison du développement du tiers-payant.
Un tel mode de recouvrement suscite également des problématiques de trésorerie en ce que des franchises ou participations dus pour une année donnée peuvent n'être recouvrés que plusieurs années après. Ainsi, en 2024, le taux de recouvrement des participations forfaitaires et franchises n'atteint que 60,7 % pour le régime général - le restant sera partiellement recouvré lors des années 2025 à 2029.
D. Le dispositif proposé : une extension du champ des participations forfaitaires aux soins dentaires et des franchises aux dispositifs médicaux, la création d'un plafond distinct pour le transport sanitaire et une évolution du mode de recouvrement
L'article 18 prévoit quatre mesures nouvelles relatives aux participations forfaitaires et aux franchises. Il modifie, pour cela, les II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, qui les régissent respectivement.
1. L'extension du champ des participations forfaitaires aux actes et consultations des chirurgiens-dentistes
Le 1° du I de l'article 18 soumet les actes et consultations des chirurgiens-dentistes réalisés en ville, en établissement ou en centre de santé à la participation forfaitaire. La participation forfaitaire ne s'appliquerait toutefois pas aux actes ou consultations réalisés par un chirurgien-dentiste dans le cadre d'une hospitalisation, sur le modèle de la dérogation existant pour les médecins.
Il résulte des dispositions des II et III du code de la sécurité sociale tels qu'ils seraient modifiés par l'article 18 que, parmi les professionnels de santé conventionnés, seules les sages-femmes resteraient hors du champ des participations forfaitaires ou des franchises.
300 millions d'euros d'économies supplémentaires sont attendus de cette mesure à compter de son entrée en vigueur.
2. L'extension du champ de la franchise annuelle à certains dispositifs médicaux
Le 1° du II de l'article 18 soumet les dispositifs médicaux à la franchise annuelle, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation et de ceux figurant sur une liste fixée par arrêté. Selon l'étude d'impact, cette liste exclurait notamment les fauteuils roulants du champ de la franchise.
Il est également précisé que les modalités d'application de la franchise aux dispositifs médicaux loués seront fixées par décret.
Le a du 2° du II procède à une coordination rendue nécessaire par l'inclusion des dispositifs médicaux dans le champ de la franchise annuelle.
3. La création d'un nouveau plafond de franchise spécifique au transport sanitaire
Le b du 2° du II prévoit la création d'un plafond annuel de franchise ad hoc pour le transport sanitaire non urgent, distinct de celui qui s'applique au reste des actes, produits et prestations frappés par la franchise. Coexisteraient donc deux plafonds de franchise : l'un applicable aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux actes des auxiliaires médicaux et à certaines prestations réalisées par les pharmaciens, l'autre au seul transport sanitaire.
Cumulées, les deux mesures relatives à la franchise pourraient générer de 300 à 400 millions d'euros d'économies annuelles, selon que le plafond spécifique au transport sanitaire est fixé à cinquante ou cent euros.
4. La révision du mode de recouvrement des participations forfaitaires et franchises
Les 2° du I et 3° du II écrasent les dispositions législatives applicables respectivement au recouvrement des participations forfaitaires et des franchises. Ils leur substituent des dispositions harmonisées entre les deux dispositifs, en renvoyant à un décret en Conseil d'État la définition des modalités de mise en oeuvre des participations forfaitaires et franchises.
Le décret en Conseil d'État édictera notamment les conditions dans lesquelles participation forfaitaire et franchise peuvent être acquittées auprès d'un professionnel de santé, qui serait alors chargé de les reverser à la Cnam, être récupérées sur les prestations de toute nature à venir ou être récupérées directement auprès de l'assuré.
Pour la franchise, il est également précisé qu'il peut être dérogé à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant la possibilité pour les organismes de sécurité sociale de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement sous certaines conditions.
En conséquence du renvoi à un décret en Conseil d'État, le 4° du II supprime le renvoi à un décret simple des modalités de mise en oeuvre de la franchise médicale.
L'amélioration du taux de recouvrement attendu de cette mesure serait source d'économies estimées à 164 millions d'euros par an, à minorer du coût de mise en oeuvre par la Cnam.
5. Date d'entrée en vigueur
Le III de l'article fixe au plus tard au 1er janvier 2027 la date d'entrée en vigueur des mesures portées par cet article. Un tel délai est proposé bien que l'étude d'impact indique, pour l'ensemble des mesures portées par l'article 18, « un délai de mise en oeuvre opérationnelle par la Cnam de l'ordre de 18 mois », soit six mois de plus que la date la plus tardive d'entrée en vigueur potentielle.
II. Le dispositif transmis au Sénat
Par douze amendements issus de députés des groupes La France insoumise - Nouveau Front Populaire, Gauche Démocrate et Républicaine, Écologiste et Social, Socialistes et apparentés, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Les Démocrates, Droite Républicaine, Union des droites pour la République et Rassemblement national, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. L'argument principal sous-tendant cette suppression est celui des risques que cette mesure sous-tendrait pour l'accès aux soins.
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
À titre liminaire, la commission rappelle que, selon le Gouvernement, les évolutions législatives et réglementaires envisagées sur le seul champ des franchises représenteraient un reste à charge supplémentaire de 21 euros par assuré redevable. Celui-ci dépasserait toutefois 52 euros pour les patients en ALD.
Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas estimé le reste à charge supplémentaire encouru au titre des mesures touchant à la participation forfaitaire, qui pourraient augmenter de près de 70 % le coût par assuré de la mesure.
L'ensemble des mesures relatives aux franchises et participations forfaitaires pourrait donc représenter une hausse du reste à charge moyen de près de 40 euros pour les assurés de droit commun, et de près de 80 euros pour les assurés en ALD.
1. Sur l'élargissement du champ des participations forfaitaires et des franchises et la création d'un nouveau plafond
La commission regrette l'évolution indéniable de l'objectif des participations forfaitaires et franchises : si celles-ci devaient, à l'origine, utilement contribuer à la responsabilisation des assurés, elles sont désormais perçues comme un outil de rendement par le Gouvernement, aux dépens des assurés et de l'accessibilité financière aux soins.
À cet égard, le choix du Gouvernement d'instaurer une participation forfaitaire sur les actes et consultations des chirurgiens-dentistes interroge particulièrement, dans la mesure où il ne semble ni nécessaire, ni opportun de « responsabiliser » les patients en la matière. La commission regrette donc le choix de freiner l'accès des assurés aux soins dentaires : il lui semble même au contraire pertinent de l'encourager à des fins de prévention - elle avait d'ailleurs soutenu à cet égard l'extension des examens de prévention bucco-dentaires lors du dernier PLFSS.
En effet, tandis que rien ne tend à documenter l'existence d'un phénomène de surconsommation des soins dentaires qu'il conviendrait de limiter, il est établi qu'un suivi dentaire insuffisamment régulier expose les assurés atteints, sans en avoir conscience, de pathologies dentaires bénignes comme des caries simples à développer des affections plus lourdes, associées à des traitements plus invasifs et, au surplus, à un coût supplémentaire pour la sécurité sociale.
La temporalité de la mesure l'interroge par ailleurs, alors que le Gouvernement prévoit déjà de doubler par voie réglementaire les franchises et participations forfaitaires, ce à quoi le législateur ne pourra s'opposer.
Elle note à cet égard qu'il est particulièrement maladroit, de la part du Gouvernement, d'entendre mettre en place un plafond de franchise spécifique au transport sanitaire qui pèsera, dans les faits, presque exclusivement sur les assurés en affection de longue durée exonérante, déjà fragiles. Rappelons que ces derniers représentent plus de 90 % de la dépense de transport sanitaire remboursable.
La commission propose donc de maintenir, à ce stade, la suppression de l'élargissement du champ des participations forfaitaires et franchises.
2. Sur la réforme des modalités de recouvrement des franchises et participations forfaitaires
Les auditions conduites par la rapporteure a pu démontrer l'opposition unanime que suscitait, chez les professionnels de santé, la perspective de modification des modalités de recouvrement proposée par le Gouvernement.
Il importe, au préalable, de rappeler qu'il ne revient pas aux professionnels de santé de collecter des montants au profit de l'assurance maladie. Cela ne fait partie ni de leurs prérogatives, ni de leurs missions. Ainsi, c'est sans surprise que le Syndicat des médecins libéraux (SML) refuse de « devenir les collecteurs de fonds de l'assurance maladie »33(*).
Outre cette question de principe, le caractère effectif de la mesure est plus qu'incertain. Les franchises et participations forfaitaires sont en effet soumises à un encadrement sophistiqué, prévoyant des plafonds journaliers, annuels, et des exemptions. Il serait particulièrement complexe, si ce n'est impossible, pour le professionnel de santé de vérifier en temps réel l'applicabilité de la contribution au patient qu'il traite. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) affirme d'ailleurs que « les professionnels n'ont pas les outils permettant de vérifier en temps réel si un patient est exonéré ou s'il a atteint son plafond »34(*).
Enfin, la mesure présente trois effets pervers à ne pas négliger.
D'abord, elle conduirait à alourdir la charge administrative subie par les professionnels, alors même que le législateur n'a de cesse de tenter, par ses initiatives, de libérer du temps médical dans un contexte d'accès aux soins dégradé sur le territoire. La CSMF note à juste titre que la réforme proposée de la collecte des franchises, qu'elle juge « inacceptable », est « contraire à la simplification administrative prônée par tous »35(*). Cette réforme induirait une « complexification de [la] comptabilité » des professionnels, crainte par la Fédération des médecins français (FMF)36(*).
Ensuite, dans un contexte marqué par une recrudescence profondément préoccupante des violences à l'encontre des professionnels de santé, la collecte des participations forfaitaires et franchises pourrait s'avérer « source de tensions dans les cabinets », comme le redoute l'union Avenir Spé - Le Bloc37(*).
Enfin, la collecte directe des participations forfaitaires est « d'autant plus inadmissible que les professionnels qui ne pratiquent pas le tiers payant sont dispensés du recouvrement de ces franchises »38(*), selon MG France. L'application d'une telle réforme pourrait donc décourager les professionnels de proposer cette modalité, dont le développement est pourtant soutenu par les gouvernements successifs.
Pour l'ensemble de ces raisons, la FMF estime que cette mesure est « la première à supprimer de ce PLFSS »39(*), qu'elle décrie pourtant dans sa grande majorité.
La commission propose de confirmer la suppression de cet article.
Article 18 bis
(nouveau)
Subordination de la prise en charge des lentilles de contact
à la télétransmission d'un acte de remise
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit de conditionner la prise en charge des lentilles de contact par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire à la télétransmission d'un acte de délivrance, afin de lutter contre la fraude.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée Nationale
A. Les conditions de prise en charge des lentilles dans le droit en vigueur
L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux inscrits sur une liste de prise en charge dénommée liste des produits et prestations remboursable (LPP). Cette inscription peut, entre autres, subordonner la prise en charge à des indications thérapeutiques particulières40(*).
Les lentilles de contact relèvent des dispositifs médicaux, définis comme « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs [...] fins médicales »41(*) incluant notamment le diagnostic, la prévention, la surveillance, la prédiction, le pronostic, le traitement ou l'atténuation d'une maladie.
Inscrites sur la liste des produits et prestations42(*), les lentilles de contact réutilisables ou non peuvent donc faire l'objet d'une prise en charge de l'assurance maladie, quels qu'en soient la durée d'utilisation et le type.
Cette prise en charge est toutefois conditionnée à une prescription médicale et à des indications particulières, qui correspondent à des déficiences visuelles lourdes ou à des pathologies spécifiques :
- astigmatisme irrégulier ;
- myopie égale ou supérieure à 8 dioptries ;
- strabisme accommodatif ;
- aphakie ;
- anisométropie à 3 dioptries non corrigeables par des lunettes ;
- kératocône.
Le remboursement s'effectue alors au regard d'un taux de prise en charge de 60 %43(*) appliqué à un tarif de responsabilité44(*), qui prend en l'espèce la forme d'un forfait annuel par oeil appareillé de 39,48 euros45(*). Le remboursement effectif par l'assurance maladie s'élève donc à 23,69 euros annuels pour un oeil, et 47,38 euros pour les deux yeux. Ce montant est à mettre en regard des prix de vente observés sur ces dispositifs médicaux, qui varient, en fonction des caractéristiques des produits, entre 200 et 500 euros par an. Les produits d'entretien des lentilles ne sont par ailleurs pas remboursables.
Compte tenu, d'une part, de la faiblesse de la prise en charge au regard du prix de vente des lentilles de contact et, d'autre part, de la restriction considérable par la LPP des indications y ouvrant droit, les frais afférents à la fourniture de lentilles de contact sont, dans les faits, presque exclusivement solvabilisés par les complémentaires santé ou assumés par les patients.
Ainsi, le financement total des lentilles correctrices par la sécurité sociale atteint 5 millions d'euros en 2024, soit moins de 1 % du volume total de 861 millions d'euros au titre de la consommation de lentilles de contact. Les complémentaires santé assument 80 % de la charge, soit 685 millions d'euros, et les ménages 20 %, soit 171 millions d'euros.
B. Le dispositif proposé : subordonner la prise en charge des lentilles à la télétransmission d'un acte de remise
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 18 bis, inséré par un amendement d'Anne-Sophie Ronceret (Ensemble pour la République) et plusieurs de ses collègues subordonne le remboursement des lentilles de contact par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire à la télétransmission préalable d'un acte de remise non facturable. Il insère, au 2° du I, à cet effet un article L. 165-1-9 dans le code de la sécurité sociale.
Cet article encadre par ailleurs la télétransmission, assortie d'une authentification du retrait par l'assuré, qui doit permettre l'identification :
- de l'assuré via l'utilisation obligatoire de la carte vitale ;
- du professionnel au moyen de sa carte de professionnel de santé et de son numéro d'inscription au registre partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
- de la date de la prescription ;
- de la référence du produit remis ;
- de ses date et lieu de délivrance.
Il est précisé que le non-respect de cette obligation emporte l'absence de prise en charge des lentilles de contact, et est passible de la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, appliquée notamment en cas de versement indu d'une prestation en nature par l'assurance maladie.
Le 1° du I de l'article 18 bis tire les conséquences de l'obligation créée par le nouvel article L. 165-1-9 sur le recouvrement des indus liés à la prise en charge de lentilles de contact sans télétransmission préalable d'un acte de remise.
Cet article entrerait en vigueur au 1er juillet 2026, avec possibilité d'une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois dans un nombre limité de départements (II de l'article 18 bis).
Les auteurs arguent que cette mesure permettrait de lutter contre certaines pratiques frauduleuses visant à faire prendre en charge des lentilles non effectivement remises au patient.
II - La position de la commission
La commission a accueilli avec réserve l'article 18 bis de ce PLFSS.
La commission estime que le renforcement de la lutte contre la fraude est une priorité, tout particulièrement dans un contexte marqué par la dégradation de la situation financière de la branche maladie, que nul n'ignore.
Ces fraudes sont particulièrement répandues dans le secteur de l'optique médicale : l'ordre de grandeur du préjudice causé serait, selon Santéclair, de l'ordre de 162 millions d'euros par an. Les pratiques de facturation fictive figurent, à cet égard, parmi les schémas les plus fréquemment observés.
Compte tenu de la faible implication de l'assurance maladie dans les dépenses d'optique - rappelons que l'assurance maladie n'a remboursé, en 2024, que 5 millions d'euros au titre des lentilles de contact - les fraudes en la matière touchent au premier chef les complémentaires santé.
La commission partage donc l'objectif défendu par l'article 18 bis. Toutefois, la focalisation du dispositif sur les lentilles de contact peut interroger, alors que les lunettes sont également touchées par les pratiques de facturation fictive, pour des montants de fraudes bien supérieurs. L'opérationnalité du dispositif est ainsi remise en cause par sa faible portée, mais également par l'incertitude entourant les modalités d'« authentification du retrait », une notion aujourd'hui absente des codes.
Le dispositif proposé présente par ailleurs des faiblesses rédactionnelles et empiète largement sur les prérogatives du pouvoir réglementaire.
La rapporteure relève également qu'il est pour le moins incertain que ces dispositions relèvent d'une loi de financement de la sécurité sociale au regard à la fois de son incidence potentielle très limitée sur les finances sociales et de l'accueil réservé aux dispositions relatives à la fraude par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la dernière loi de financement de la sécurité sociale46(*).
La commission note, à cet égard, que ces dispositions, si jamais elles étaient retravaillées, trouveraient mieux à s'insérer dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, inscrit à l'ordre du jour en décembre à l'Assemblée nationale.
Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement n° 635 de sa rapporteure, visant à supprimer l'article 18 bis.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 18 ter
(nouveau)
Expérimentation de la prise en charge des actes de
prélèvements consécutifs aux sévices sexuels subis
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'expérimenter, pour une durée de trois ans et dans au plus trois régions dont une ultramarine, la prise en charge intégrale des actes de prélèvements consécutifs à des sévices sexuels, y compris en l'absence de dépôt de plainte.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. Les victimes de sévices sexuels n'accèdent pas systématiquement sans reste à charge aux prélèvements médico-légaux permettant de constater les infractions
1. Les prélèvements médico-légaux sont déterminants pour le déroulé de la procédure judiciaire lorsque sont en cause des sévices sexuels
En cas de sévices sexuels, la réalisation de prélèvements médico-légaux dans les jours suivant les faits est fondamentale afin de collecter des éléments de preuve clinique et biologique47(*) qui pourront appuyer, le cas échéant, une plainte. À cette occasion, un certificat médical, également utile si une procédure pénale est déclenchée, peut être réalisé, attestant notamment d'un état de choc, de stress post-traumatique ou de déstabilisation psychologique et pouvant donner lieu à un arrêt de travail.
Dans un document conjoint de la ville de Paris et de la préfecture de la région d'Île-de-France à l'attention de victimes d'infractions à caractère sexuel, il est précisé que l'examen « doit se faire le plus tôt possible après l'agression », dans la mesure du possible « avant de [se] laver ». Un autre document de la préfecture d'Île-de-France estime qu'en moyenne, des éléments de preuve biologique ou médicale peuvent être recueillis dans les huit jours suivant les faits.
Les victimes sont toutefois invitées à ne pas renoncer à consulter un médecin même pour des faits anciens, compte tenu de l'intérêt d'un tel examen afin d'insérer la victime dans un parcours de soins adapté et de procéder à une vérification de l'état de santé - notamment en ce qui concerne la contraction d'éventuelles infections sexuellement transmissibles.
2. Les prélèvements médico-légaux peuvent notamment être réalisés dans des structures d'urgence ou dans des centres médico-judiciaires, avec des conditions de prise en charge différenciées selon les situations
Les prélèvements médico-légaux peuvent notamment s'effectuer dans les services d'urgence des établissements publics de santé, dans les unités médico-judiciaires des établissements de santé ou au sein de centres médico-judiciaires (CMJ).
Si et seulement si elle porte plainte et dispose d'une réquisition judiciaire en ce sens, la victime peut voir ses frais médicaux pris en charge par le ministère de la justice lorsque les prélèvements sont réalisés dans des structures médico-judiciaires.
Les missions des unités médico-judiciaires
L'UMJ assure quatre missions au service de la médecine légale du vivant :
- la prise en charge des victimes de violence physique ou de violences sexuelles, majeures ou mineures, et la réalisation de prélèvements médico-légaux ;
- l'examen médical des gardés à vue ou mis en cause ;
- l'examen des mineurs pour des certificats de non-excision dans le cadre du droit d'asile ;
- l'examen psychiatrique des victimes.
Si elle ne porte pas plainte, la prise en charge du ministère de la justice ne lui est pas ouverte en structure médico-judiciaire et la victime « doit faire les examens elle-même par anticipation chez le médecin »48(*) ou aux urgences, la sécurité sociale ne remboursant alors le coût de ces derniers que dans les modalités de droit commun.
En principe, l'action des structures médico-judiciaires est subordonnée à un dépôt de plainte, mais certaines d'entre elles, à l'image des unités médico-légales de Tours ou de Bondy, acceptent de réaliser des prélèvements malgré son absence, la prise en charge par le ministère de la justice n'étant alors pas ouverte.
Un régime de prise en charge des frais de santé dérogatoire pour les assurés victimes de sévices sexuels étant mineurs
La loi dite Guigou49(*) a instauré, en 1998, un régime de prise en charge dérogatoire50(*) pour les frais de santé des assurés qui ont subi un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle alors qu'ils étaient mineurs d'âge.
Celui-ci prévoit la suppression du ticket modérateur, à compter de la date présumée de commission des faits. Le service du contrôle médical se prononce sur le principe et la durée de cette exonération, saisi par la caisse d'assurance maladie à la demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative a été engagée. Si nécessaire, la durée de l'exonération peut être prolongée au-delà de la durée du traitement initialement envisagé51(*).
Ce dispositif est toutefois méconnu et est, dans les faits, rarement convoqué au profit des victimes de sévices sexuels alors qu'elles étaient mineures.
3. La subordination de la prise en charge des prélèvements au dépôt de plainte : un obstacle à lever
Il est fréquent que la survenue d'infractions à caractère sexuel laisse la victime dans un état de sidération ou de stress post-traumatique ou, à tout le moins, la déstabilise profondément sur le plan psychologique.
Dans les heures ou dans les jours suivant la survenue des faits, les conditions ne sont donc pas toujours réunies pour que la victime tranche sur sa volonté de porter plainte. Dans certains cas, la détresse de la victime peut également faire obstacle à un dépôt de plainte rapide. Il n'est pas rare, dans ces conditions, que le dépôt de plainte s'effectue dans un second temps, après une réflexion de la victime et après une prise en charge médicale et psychologique parfois longue de plusieurs mois ou années.
Or la réalisation de prélèvements dans un intervalle de temps restreint avec la commission des faits constitue un appui souvent décisif lors d'une éventuelle procédure pénale.
En ce sens, la subordination de la prise en charge des prélèvements à un dépôt de plainte préalable constitue une barrière à la constitution d'éventuels dossiers judiciaires pour les victimes de violences sexuelles, avec un risque de pertes de preuves et d'affaiblissement des éléments à charge.
Il est estimé que pour la seule ville de Paris, entre 70 et 80 victimes de viols requièrent chaque année un examen médical et des prélèvements dans une structure hospitalière ou médico-légale sans avoir, au préalable, déposé plainte. Il s'agit de victimes qui ne savent pas encore si elles vont porter plainte, mais qui, dans cette éventualité, souhaitent recueillir des preuves matérielles à l'appui de leur dossier.
À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le président de la République avait annoncé, le 25 novembre 2017, qu'il entendait « [mettre] en place dans les UMJ un système de recueil de preuves sans dépôt de plainte, afin de faciliter les démarches des victimes ». Malgré des groupes de travail constitués en ce sens, les conditions de prise en charge n'apparaissent pas avoir évolué depuis.
B. Le dispositif proposé : une expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale des actes et prélèvements consécutifs aux sévices sexuels, même en l'absence de dépôt de plainte
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 18 ter a été inséré à la faveur d'un amendement de Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues des groupes Socialistes et apparentés, Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons et Indépendants, Écologiste et Social et Gauche Démocrate et Républicaine, membres d'une coalition parlementaire transpartisane pour une loi intégrale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Il consiste en une expérimentation, pour trois ans, de la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des prélèvements médico-légaux en lien avec des actes de violence sexiste et sexuelle, pour les victimes de tout âge, y compris en l'absence de dépôt de plainte (I). Les modalités précises de l'expérimentation, qui s'étendrait à trois régions choisies par arrêté dont une dans les outre-mer, seraient définies par décret (II).
L'expérimentation donnerait lieu à un rapport évaluant notamment l'accès effectif des victimes au dispositif, son impact sur la santé des victimes et sur les procédures pénales, et la pertinence d'une généralisation (III).
II - La position de la commission
La commission ne peut qu'apporter son plein soutien à cette mesure, déterminante pour garantir l'accès à la justice des victimes de violences à caractère sexuel et sexiste.
Faire la démarche de déposer plainte et s'exposer ainsi à être interrogées sur des faits présuppose, pour les victimes, d'avoir acquis la certitude qu'elles souhaitent s'engager dans une procédure judiciaire. Il est légitime que les victimes ne sachent pas, immédiatement après les faits, si elles souhaiteront accorder une traduction judiciaire aux actes subis, alors qu'elles peuvent être profondément déstabilisées par ces derniers.
Il est tout aussi légitime qu'elles souhaitent faire médicalement constater leur état physique et procéder à des prélèvements dans l'hypothèse où elles décideraient, ultérieurement, d'un dépôt de plainte. Il convient de rappeler, à cet égard, que les procédures pénales liées aux infractions à caractère sexuel sont marquées par une particulière difficulté d'apporter une preuve de la culpabilité en l'absence de prélèvements consécutifs aux faits reprochés.
La commission appelle le Gouvernement à tirer toutes les conséquences des déclarations précitées du président de la République, et à mettre en oeuvre cette expérimentation dans de brefs délais.
Elle a adopté l'amendement n° 636 de sa rapporteure, qui laisse trois mois supplémentaires au Gouvernement pour rendre le bilan de l'expérimentation et apporte des clarifications rédactionnelles.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 18 quater
(nouveau)
Demande de rapport sur le forfait patients urgences
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, demande au Gouvernement un rapport sur le forfait patients urgences.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Un forfait patient urgences reste à la charge des assurés en cas de passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation
1. D'anciennes modalités de facturation peu lisibles et pouvant aboutir à un fort reste à charge avant prise en charge complémentaire
Jusqu'au 1er janvier 2022, l'assuré s'acquittait de 20 % d'un forfait accueil et traitement des urgences d'un montant de 27,05 euros52(*), ainsi que du ticket modérateur53(*) sur les soins prodigués à l'occasion du passage aux urgences. Il en résultait un reste à charge après assurance maladie obligatoire variable entre 10 et 60 euros en moyenne, supporté en tout ou partie, le cas échéant, par la complémentaire santé.
La facturation des soins réalisés aux urgences, peu lisible pour les assurés, était décriée car, « trop complexe, elle était quasiment impossible à boucler avant la sortie des patients ne nécessitant pas d'être hospitalisés »54(*).
2. L'instauration du forfait patients urgences vise à clarifier les modalités de facturation des passages aux urgences pour les patients et à améliorer le recouvrement pour les établissements
Par conséquent, dans un contexte d'engorgement des services d'urgences, l'article 51 de la LFSS pour 202155(*) a réformé les modalités de participation des assurés lors d'un passage aux urgences en introduisant un forfait appelé « forfait patient urgences »56(*), d'un montant indépendant de la teneur des soins reçus. Le Gouvernement défend que l'instauration de ce forfait n'est pas à mettre en lien avec « des considérations économiques »57(*), mais répond à une volonté de clarification du tarif pour le patient et d'amélioration du recouvrement et de simplification de la gestion pour les établissements.
Ce forfait, qui n'est pas dû lorsqu'une hospitalisation est consécutive au passage aux urgences, est fixé depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 à 19,61 euros58(*) par passage, sauf cas particuliers. Il est intégralement pris en charge par les complémentaires santé dans le cadre d'un contrat responsable et solidaire59(*), dont bénéficient 94 % des assurés.
La loi prévoit que le montant du forfait patient urgences soit réduit pour les assurés en ALD exonérantes ou titulaires d'une rente AT-MP60(*), qui s'acquittent d'un montant de 8,49 euros61(*). Elle rend également ce forfait inapplicable62(*) à certaines catégories d'assurés dont :
- les bénéficiaires de l'assurance maternité, qui s'applique entre le sixième mois de grossesse et le douzième jour après l'accouchement63(*) ;
- les nouveau-nés jusqu'à trente jours après leur naissance64(*) ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente AT-MP avec un taux d'incapacité excédant deux tiers ;
- les assurés malades ou blessés de guerre.
Le forfait patient urgences ne s'applique pas davantage aux passages aux urgences en lien avec un risque sanitaire grave et exceptionnel.
Le rendement du forfait patient urgences, soit 285 millions d'euros en 2023, est affecté au financement des soins de médecine d'urgence65(*). Il constitue 5 % des ressources qui leur sont attribuées.
B. Le dispositif proposé : une demande de rapport sur le forfait patient urgences
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 18 quater, inséré à la faveur d'un amendement de Ségolène Amiot et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, consiste en une demande de rapport sur le forfait patient urgences, notamment relative à « son coût pour la sécurité sociale » et son effet sur l'accès aux soins d'urgence.
II - La position de la commission
Conformément à sa position habituelle vis-à-vis des demandes de rapport, considérant que ces derniers ne sont, dans les faits, que rarement rendus, la commission propose de supprimer cet article, par l'amendement n° 637 de sa rapporteure.
Sur le fond, la commission avait soutenu cette mesure lors de son introduction, au motif de « l'intérêt d'une forfaitisation de la participation des usagers pour améliorer la lisibilité et l'équité et simplifier les modalités de facturation ». Sa position n'a pas varié depuis, la réforme ayant atteint ses objectifs de lisibilité et de simplification de la facturation.
Quant à l'effet de ce forfait sur l'accès aux soins, la commission relève que celui-ci ne peut qu'être limité, dans la mesure où il n'est pas supporté par près de 95 % des assurés, qui bénéficient d'un contrat de complémentaire santé responsable et solidaire.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 19
Prévenir l'augmentation des affections de longue durée par la
mise en place de parcours d'accompagnement préventifs
Cet article propose de créer des parcours d'accompagnement préventifs pour les personnes souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée (ALD). Les pathologies relevant de ce dispositif seraient inscrites sur une liste fixée par décret pris après avis de la HAS.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Une évolution non maîtrisée de la prévalence des pathologies chroniques qui accroît lourdement le coût de prise en charge des affections de longue durée (ALD)
1. Une prévalence des maladies chroniques en progression
a) Une prévalence en hausse sous l'effet du vieillissement de la population et de l'exposition à divers facteurs de risques
L'accélération du vieillissement de la population s'accompagne d'une progression sans précédent des maladies chroniques et des polypathologies, qui constituent désormais le « centre de gravité de notre système de santé »66(*).
En 2023, 23 millions de personnes souffrant d'une pathologie chronique étaient dénombrées, soit 434 000 personnes de plus qu'en 2022. Selon les projections de l'assurance maladie, la part des personnes souffrant d'une maladie chronique devrait atteindre 43 % de la population en 2035, contre 36,9 % en 2023.
Cette progression s'explique pour une large part par la déformation de la structure d'âge de la population, c'est-à-dire par le vieillissement démographique67(*). L'exposition à divers facteurs de risques comportementaux (tabagisme, alcool, sédentarité), métaboliques (surpoids, tension artérielle, hyperglycémie) et environnementaux (pollution de l'air) tend également à accroître la prévalence des pathologies chroniques, avec des inégalités territoriales et socio-économiques marquées. La consommation de tabac et d'alcool, la sédentarité et les déséquilibres nutritionnels sont autant de facteurs favorisant le développement des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et des cancers. L'alcool est par exemple le premier facteur d'apparition du cancer colorectal (47 500 nouveaux cas chaque année), et le tabagisme le principal facteur de risque du cancer du poumon (52 500 nouveaux cas annuels) et de la broncho-pneumopathie obstructive (3,5 millions de personnes concernées). Pourtant, 40 % des cancers sont considérés comme évitables par la réduction des facteurs de risque.
Ces constats plaident en faveur de politiques de prévention plus actives pour diminuer le poids de la mortalité évitable.
Le système de santé français étant principalement organisé autour d'un modèle curatif, la place des actions de prévention y demeure fragile et lacunaire. Les annonces politiques d'un grand virage préventif68(*) tardent à se concrétiser, alors que les actions de prévention doivent s'inscrire dans le temps long pour produire des résultats significatifs.
Ces dernières années, plusieurs mesures importantes ont été adoptées pour renforcer la prévention dans les parcours de soins, par exemple le financement de campagnes nationales de vaccination contre les infections à papillomavirus humains dans les collèges69(*) depuis l'automne 2024, ou la mise en oeuvre des rendez-vous de prévention (« Mon bilan prévention »). Créés par la LFSS pour 202370(*), progressivement généralisés dans toutes les régions à partir de l'été 2024, les rendez-vous de prévention doivent contribuer au repérage des risques individuels et permettre de définir un plan de prévention personnalisé en amont de l'apparition d'une pathologie chronique, à différents âges-clés de la vie71(*). Ces mesures ne suffisent toutefois pas à dessiner les contours d'une politique de prévention globale et structurée.
Le repérage précoce, qui nécessite de pouvoir s'appuyer sur un réseau de professionnels de premier recours accessibles et formés au dépistage, demeure très insuffisant. À titre d'illustration, 28 % des patients diabétiques sont diagnostiqués au stade de complications donnant lieu à hospitalisation72(*). Un accompagnement des usagers à risque doit être initié le plus tôt possible pour prévenir la dégradation des symptômes et les complications, ce qui suppose aussi de déployer des actions d' « aller vers » auprès des publics les plus éloignés du soin. La prévention primaire demeure par ailleurs notoirement sous-investie alors qu'elle permet précisément de faire évoluer les comportements individuels et donc, de limiter la progression des maladies non transmissibles évitables. Enfin, le développement de la prévention tertiaire permettrait de prévenir les rechutes, par exemple dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutiques. Ces programmes, qui visent à autonomiser le patient dans sa prise en charge, restent pourtant peu accessibles en ville, trop hospitalo-centrés73(*) et manquent de soutien financier.
b) Une progression non maîtrisée des maladies chroniques qui pèse lourdement sur les dépenses de santé
L'explosion des maladies chroniques n'a pas été suffisamment anticipée par notre système de soins. Les politiques de prévention n'ont pas été priorisées et les modèles de prise en charge n'ont que peu évolué.
Nombre de personnes prises en charge par catégorie de pathologies en 2022
IRCT : insuffisance rénale chronique terminale. Elle comprend la dialyse chronique, la transplantation rénale et le suivi de transplantation rénale.
Source : Cnam
Quatre pathologies concentrent actuellement les trois quarts des patients en ALD. Ces pathologies sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les affections psychiatriques et traitements chroniques par psychotropes. En 2022, dans le total des ALD reconnues, il était recensé74(*) :
- 27,1 % de maladies cardiovasculaires75(*) ;
- 21,4 % de diabètes de type 1 et de type 2 ;
- 15,5 % de tumeurs malignes ;
- et 9,9 % d'affections psychiatriques de longue durée.
Certaines affections connaissent une croissance particulièrement importante, à l'instar du diabète, dont les effectifs ont cru de 5 % par an en moyenne entre 2010 et 2022.
La progression non maîtrisée des maladies chroniques pèse lourdement sur les dépenses de l'assurance maladie.
Les pathologies chroniques représentent environ 62 % de la dépense remboursée d'assurance maladie, soit 126 milliards d'euros76(*). Les quatre pathologies précitées concentrent un peu plus de la moitié de ces dépenses. Sous l'effet de l'accentuation du vieillissement de la population, leur poids relatif devrait continuer à croître. Aujourd'hui, le coût des dépenses de santé des assurés âgés de 70 à 79 ans est 30 % plus élevé que celui des assurés âgés de 60 à 69 ans, et celui des usagers de 80 à 89 ans est supérieur de 37 % à celui des 70-79 ans77(*). Une meilleure prévention des pathologies chroniques contribuerait à diminuer ces coûts.
Dans un rapport consacré à la prévention, la Cour des comptes s'est intéressée à trois types de pathologies : les cancers, les maladies neuro-cardio-vasculaires et le diabète. Elle constate qu'entre 2015 et 2019, les dépenses de l'assurance maladie obligatoire liées à ces trois pathologies ont augmenté de 16 %, soit une progression supérieure à celle de l'Ondam (+ 10 %) sur la même période78(*). La prise en charge des cancers explique l'essentiel de la progression de ces dépenses, en raison de l'augmentation du nombre de patients ainsi que des innovations thérapeutiques qui ont marqué la cancérologie ces dernières années et qui s'accompagnent de traitements de plus en plus coûteux.
Ces évolutions illustrent le risque financier majeur que fait peser le développement des pathologies chroniques sur la soutenabilité des dépenses d'assurance maladie.
2. Une mise sous tension du modèle de prise en charge des soins : la soutenabilité du régime des ALD en question
a) Le régime des ALD : une socialisation élevée de la dépense d'assurance maladie pour limiter le reste-à-charge et éviter le renoncement aux soins
Le dispositif des ALD permet une socialisation plus importante des coûts de la prise en charge pour les patients souffrant de pathologies longues et coûteuses.
Pour limiter les restes à charge souvent importants supportés par ces patients, et pour éviter le renoncement aux soins, les assurés sociaux souffrant d'une pathologie reconnue en ALD bénéficient, dans la limite des tarifs conventionnels remboursables, d'une exonération de ticket modérateur pour les soins et les transports sanitaires liés à l'ALD. Le tiers-payant leur est par ailleurs systématiquement appliqué et des règles particulières en matière d'arrêt de travail et d'indemnités journalières sont également prévues.
Les affections relevant du régime des ALD
La reconnaissance d'une affection de longue durée fait l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire. Elle repose sur trois dispositifs distincts ouvrant droit à une prise en charge renforcée des dépenses d'assurance maladie :
- Le dispositif ALD 30 : l'affection dont souffre le patient, qui comporte un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, est inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé (HAS)79(*). Cette liste, fixée par l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, comporte désormais vingt-neuf pathologies depuis le retrait en 2011 de l'hypertension artérielle ;
- Le dispositif ALD 31 : l'affection ne figure pas sur la liste des ALD 30 mais constitue une « affection grave caractérisée » c'est-à-dire une « forme grave d'une maladie ou [...] une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave » ou relève de « plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant »80(*) et nécessite un traitement prolongé supérieur à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse81(*) ;
- Le dispositif ALD 32 : l'affection ne figure pas sur la liste des ALD 30 mais est constituée de « plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant » et nécessite un traitement prolongé supérieur à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse82(*).
La HAS contribue à l'élaboration des décisions relatives aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'ALD83(*). Il lui revient en particulier de rendre un avis sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse84(*), soit sur la liste dite des ALD 30.
Toutefois, le régime des ALD n'exclut pas les reste-à-charge ni ne prémunit les assurés concernés contre des reste-à-charge importants.
Les assurés en ALD sont ainsi redevables des franchises médicales et des participations forfaitaires ainsi que du forfait journalier hospitalier. Les éventuels dépassements d'honoraires sur les actes et prestations dont ils bénéficient ne sont pas non plus pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Au final, les assurés en ALD présentent jusqu'à leurs 80 ans un reste-à-charge moyen plus élevé que les assurés sans ALD85(*).
La dépense de santé totale annuelle d'un assuré en ALD, incluant ses soins sans lien avec l'ALD, s'élève à 9 300 euros en moyenne, avec un reste-à-charge de 840 euros86(*). La Cnam évoque une dépense moyenne légèrement plus élevée, de 9 560 euros par an, contre 1 230 euros pour les patients n'étant pas en ALD, la moyenne s'établissant à 2 980 euros par assuré87(*).
Présentation des dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les assurés en ALD et les assurés non en ALD, 2021
Source : IGF et Igas, Revue de dépenses relative aux affections de longue durée
b) Un dispositif qui enregistre un nombre croissant de bénéficiaires, dont la soutenabilité financière n'apparaît pas garantie
Le dispositif des ALD, qui n'a que peu évolué depuis 1986, a enregistré une progression de 37,4 % de ses bénéficiaires entre 2010 et 2022.
Sur cette période, le nombre d'assurés reconnus en ALD a augmenté de 2,7 % en moyenne chaque année et de 4,6 % pour les ALD hors liste88(*). Désormais, 20 % de la population est prise en charge au titre d'une ALD, soit 14,1 millions de personnes. 18 millions de personnes pourraient être concernées d'ici 2035, soit 26 % de la population, contre 12 % en 2004.
En dépit de cette progression spectaculaire, le régime des ALD n'a que peu évolué depuis 1986. À cet égard, plusieurs critiques ont été formulées par l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (Igas) :
- le format du dispositif, qui n'a pas tenu compte de l'évolution des prises en charge et des progrès thérapeutiques, apparaît globalement figé depuis 1986 ; seul le retrait de l'hypertension artérielle sévère de la liste des ALD 30 a constitué une évolution notable en près de quarante ans89(*) ;
- la reconnaissance d'une ALD n'est pas systématiquement corrélée à des critères de sévérité de la pathologie ;
- s'agissant des ALD hors liste (ALD 31 et 32), l'approche extensive qui prévaut dans les critères de reconnaissance favorise l'augmentation du nombre de bénéficiaires sans être fondée sur des critères médicaux précis ;
- le dispositif est peu contrôlé par l'assurance maladie.
Enfin, les inspections évoquent « l'attractivité du dispositif [qui] se mesure également à l'aune des demandes de reconnaissance de nouvelles ALD listes pour des affections actuellement prises en compte via l'ALD 31 (endométriose, COVID long, obésité par exemple). »
Si le régime des ALD joue un rôle protecteur vis-à-vis des patients les plus lourds, sa soutenabilité ne paraît désormais plus assurée.
Sans infléchissement des tendances démographiques et épidémiologiques observées, le déficit de l'assurance maladie pourrait se creuser de 25 milliards d'euros supplémentaires d'ici 203090(*).
La progression non maîtrisée des pathologies chroniques accentue la déformation des dépenses remboursées d'assurance maladie. À cet égard, la Cnam alerte sur « une mise en tension de notre système de prise en charge des soins » et « une polarisation des remboursements de l'assurance maladie vers les personnes dans le dispositif des ALD ».
En 2021, le montant des dépenses remboursées aux assurés en ALD s'élève à 122,8 milliards d'euros. Pour autant, le coût du dispositif lui-même est plutôt estimé à 12,3 milliards d'euros, dont 11,3 milliards d'euros au titre de l'exonération du ticket modérateur91(*).
Ces constats ont conduit la Cnam ainsi que l'IGF et l'Igas à préconiser une adaptation des conditions d'entrée dans le régime des ALD.
La Cnam a ainsi recommandé de développer une gestion plus dynamique des entrées et des sorties du régime des ALD92(*). À l'entrée, tout patient bénéficierait d'un accompagnement prenant la forme d'un parcours de prévention et d'information, incluant un entretien motivationnel et des informations sur les soins nécessaires. Ce parcours, présenté comme un moyen de retarder l'évolution défavorable de la pathologie, pourrait également permettre de mieux personnaliser le programme de soins du patient. La Cnam précise que le médecin traitant devrait être prioritairement chargé de cet accompagnement. Il est également suggéré de mettre en place un parcours de surveillance médicale post-ALD, dans une logique de prévention tertiaire.
En parallèle, l'IGF et l'Igas ont préconisé de mettre en oeuvre un dispositif d'annonce systématique aux patients, lors de leur admission en ALD. Cette démarche viserait à renforcer l'adhésion du patient et son implication dans le parcours de soins. Les inspections ont également proposé d'introduire deux niveaux de reconnaissance en ALD, tenant compte de la sévérité des pathologies, de l'intensité des soins et de leur caractère particulièrement coûteux93(*).
B. La création de parcours d'accompagnement préventifs
Le présent article vise à créer un parcours d'accompagnement préventif pour les patients à risque d'ALD. À cette fin, il propose de compléter le chapitre 294(*) du titre VI95(*) du livre Ier96(*) du code de la sécurité sociale par une section 15 intitulée « Prise en charge des prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée », et constituée d'un article unique L. 162-63.
1. Des parcours réservés à certains patients et soumis à prescription médicale
Aux termes du cinquième alinéa du nouvel article L. 162-63 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une ALD 30, 31 ou 32 pourraient bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif. Ces parcours seraient accessibles et pris en charge sous réserve d'une prescription médicale.
La liste des pathologies concernée devrait être fixée en tenant compte de critères définis par décret. La HAS serait saisie pour déterminer les critères médicaux justifiant l'admissibilité des assurés sociaux au bénéfice d'un parcours d'accompagnement préventif. Cette procédure s'inspire de celle des ALD 30, dont la liste est définie par décret après avis de la HAS.
L'étude d'impact indique que sont visées des « pathologies chroniques à un stade peu avancé et à risque d'évolution vers une affection de longue durée ». Le diabète sans complication, l'hypertension artérielle et l'obésité pourraient figurer dans la liste des pathologies susceptibles d'ouvrir droit aux nouveaux parcours d'accompagnement préventifs. L'objectif du dispositif étant de retarder l'entrée d'un patient dans le régime des ALD, les listes de pathologies entrant dans le champ des parcours préventifs d'une part, et dans celui des ALD d'autre part, ne devraient pas se chevaucher.
2. Un panier de soins et un parcours axés sur la prévention dont le contenu reste à définir
Le contenu des prestations associées à la mise en oeuvre des parcours d'accompagnement préventifs n'est pas défini par le présent article. Celles-ci devraient être fixées par le pouvoir réglementaire.
À cet égard, le Gouvernement indique que pourraient être incluses dans le panier de soins des prestations telles que des séances de suivi psychologique ou des séances d'éducation thérapeutique, prestations actuellement prises en charge par l'assurance maladie, mais également des prestations non remboursées comme des bilans diététiques ou des bilans fonctionnels et motivationnels d'activité physique réalisés par un enseignant en activité physique adaptée.
Le cas échéant, le parcours d'accompagnement préventif pourrait être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé.
Les parcours coordonnés renforcés ont été créés par la LFSS pour 202497(*) et visent à organiser la prise en charge d'un patient nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels98(*). Une structure en charge de la coordination de l'ensemble des professionnels est désignée. Les professionnels intervenant dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou au sein d'un établissement de santé, d'un établissement ou d'un service médico-social, d'un centre de santé, d'une maison de santé ou d'une maison sport-santé. Le parcours coordonné renforcé peut comprendre des prestations non remboursées par l'assurance maladie, réalisées par des professionnels conventionnés ; elles font alors l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie.
Malgré la publication de deux décrets d'application au cours de la dernière année99(*), aucun parcours coordonné renforcé n'est encore entré dans le droit commun. En effet, la liste de ces parcours, qui devait être fixée par un arrêté ministériel, n'a pas été publiée. Les modalités d'organisation des parcours coordonnés et la liste des prestations couvertes par le financement forfaitaire dédié à leur mise en oeuvre n'ont pas non plus été définis par le pouvoir réglementaire. Ces parcours sont actuellement déployés dans le cadre d'expérimentations dites de l'article 51100(*), sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Ils doivent faire l'objet d'un avis du conseil stratégique de l'innovation en santé101(*), chargé du suivi des expérimentations de l'article 51 et de rendre un avis quant à leur généralisation éventuelle.
Exemples de parcours coordonnés renforcés développés au titre d'expérimentations article 51
Source : ARS Ile-de-France, journée de l'innovation en santé, février 2025
3. Une prise en charge subordonnée à l'avis préalable de l'assurance maladie, à laquelle participent les organismes complémentaires d'assurance maladie
Toute prescription médicale d'un parcours d'accompagnement préventif doit être adressée au service du contrôle médical de la caisse dont relève l'assuré. L'avis favorable de ce service conditionne la prise en charge du parcours d'accompagnement préventif par l'assurance maladie. Il est réputé favorable en cas de silence gardé pendant un délai fixé par voie réglementaire. S'agissant du régime d'accord préalable exigé pour certains actes et traitements médicaux102(*), ce délai est en principe fixé à quinze jours à compter de la réception de la demande d'accord préalable103(*). En cas d'avis favorable, la décision d'admission dans le parcours d'accompagnement préventif est notifiée à l'assuré et à son médecin traitant.
Selon l'étude d'impact du Gouvernement, le recours à un régime d'avis préalable de l'assurance maladie se justifierait par la prise en charge de prestations habituellement non remboursées par l'assurance maladie obligatoire ; un diététicien ou un enseignant en activité physique adaptée ne peut ainsi pas facturer les bilans qu'il réalise à l'assurance maladie.
Dans le cadre des parcours d'accompagnement préventifs, l'ensemble des prestations ayant fait l'objet d'un avis favorable pourraient être prises en charge dans les conditions de droit commun104(*).
Le régime de l'accord préalable de l'assurance maladie
En vertu de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, certains actes et traitements médicaux sont soumis à un régime d'accord préalable de l'assurance maladie. Cet accord, qui doit être délivré par le service du contrôle médical, peut être exigé dans l'un des cas suivants :
- « sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ;
- « sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée [...] » ;
- « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie [...] » ;
- « le recours à une autre prestation est moins coûteux ».
Sont notamment soumis au régime de l'accord préalable les traitements d'orthopédie dento-faciale, les actes de masso-kinésithérapie dans le cadre des situations de rééducation soumises à référentiel, certains appareillages médicaux ou les transports de longue distance (plus de 150 kilomètres). D'autres prestations peuvent par ailleurs être soumises à un régime d'accord préalable, à tout moment, par arrêté ministériel.
En pratique, il revient à l'assuré d'adresser la demande d'accord préalable au service du contrôle médical de sa caisse d'assurance maladie, à l'appui du formulaire rempli et remis par le professionnel prescripteur.
En conséquence, afin de garantir la prise en charge de l'ensemble des prestations incluses dans le parcours d'accompagnement préventif, le huitième alinéa de l'article propose de modifier l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale qui liste l'ensemble des actes et prestations ouvrant droit à un remboursement de l'assurance maladie. Précisément, les dispositions du 9° de l'article précité, qui se réfèrent aux frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours coordonnés renforcés105(*), seraient complétées par la mention des parcours d'accompagnement préventifs mentionnés au nouvel article L. 162-63 du code de la sécurité sociale.
La charge du remboursement serait ainsi répartie entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie selon les règles de droit commun.
II - Le dispositif transmis au Sénat
En séance publique, outre un amendement rédactionnel, quatre amendements identiques ont été adoptés, visant à interdire la facturation de dépassements d'honoraires à l'occasion des prestations réalisées dans le cadre des parcours d'accompagnement préventif106(*).
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission réaffirme son attachement aux politiques de prévention pour freiner la progression des maladies chroniques.
Le fardeau que représentent ces pathologies dans les dépenses d'assurance maladie constitue une préoccupation majeure qui doit inciter au développement de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Ainsi, la définition et la mise en oeuvre de politiques de prévention globales, structurées et pilotées au niveau national sont désormais indispensables pour relever les défis urgents que doit affronter notre système de santé, et infléchir la trajectoire des dépenses d'assurance maladie dans une perspective plus soutenable.
À cet égard, la commission regrette que les orientations politiques défendues par les gouvernements successifs ne placent pas suffisamment au coeur de leurs ambitions la prévention en santé, dont les résultats peuvent sembler hypothétiques ou trop lointains pour consentir à y investir à court terme. Ayant réaffirmé sa conviction profonde quant à la nécessité d'un virage préventif plus résolu, la commission engage le Gouvernement à présenter des orientations plus ambitieuses, s'appuyant notamment sur les nombreuses propositions formulées par la Cnam dans son rapport annuel.
Sur le fond de la mesure, la portée des parcours d'accompagnement envisagés apparaît relativement modeste au regard des enjeuxde prise en charge des pathologies chroniques.
Les parcours d'accompagnement préventifs n'ont pas l'ambition de prévenir l'apparition d'une pathologie chronique ni d'en stabiliser l'évolution, mais de retarder l'entrée des patients dans le régime des ALD. Sans remettre en cause l'utilité du dispositif, la présentation faite par le Gouvernement de cette mesure laisse assez clairement apparaître des motivations plus financières que sanitaires. En effet, seuls la maîtrise des facteurs de risques le plus en amont possible de l'apparition des pathologies et le dépistage précoce de symptômes plus ou moins avancés peuvent véritablement contribuer à freiner la progression des pathologies chroniques.
Si les parcours d'accompagnement préventifs peuvent concourir au repérage plus précoce de certaines situations cliniques, leur stade de mise en oeuvre est certainement trop tardif pour maîtriser durablement l'évolution des pathologies détectées. Surtout, au terme de ce parcours, le patient devrait pouvoir se voir orienté vers une prise en charge adaptée. L'article ne fait pourtant pas mention d'un quelconque suivi ni d'une orientation du patient.
Le dispositif lui-même demeure relativement vague, et l'étude d'impact n'apporte que peu d'éléments d'appréciation complémentaires. Rien n'est dit de la durée ni du format de ce parcours, peu d'exemples de prestations ou d'actes susceptibles d'en relever sont cités, et aucune mention n'est faite de la coordination de sa mise en oeuvre. La commission observe par ailleurs qu'aucun dispositif d'accompagnement post-ALD n'est envisagé, alors que des parcours adaptés permettraient de prévenir et d'éviter les rechutes.
La « création d'un statut de risque chronique » telle qu'elle a été évoquée par la ministre de la santé devant la commission107(*), suscite immanquablement des interrogations quant à son impact éventuel sur les conditions d'admission des patients au régime des ALD.
Une telle mesure, qui ouvre droit à de nouvelles prestations, devrait a priori susciter l'adhésion des associations de patients. Elle soulève pourtant des inquiétudes, notamment de France Assos Santé qui l'appréhende comme un « prétexte à une restriction de l'accès à l'ALD ». Les syndicats de médecins libéraux redoutent également une tentative de limiter l'accès au régime des ALD qui pourrait alors engendrer des retards de soins.
La création de ces parcours pose donc clairement la question de leur articulation avec le régime des ALD, que la Cnam, l'IGF et l'Igas ont préconisé de réformer dans un contexte d'augmentation ininterrompue du nombre de patients en ALD. Le Gouvernement a d'ailleurs confirmé son intention de saisir la HAS pour qu'elle rende « un avis sur les critères d'entrée en ALD, afin d'assurer une cohérence avec les prestations d'accompagnement nouvellement proposées ». À ce stade, sur les deux pathologies ciblées par le Gouvernement, l'une n'est plus reconnue comme ALD - l'hypertension artérielle a été retirée de la liste des ALD 30 en 2011 -, l'autre - le diabète -, l'est toujours et concerne 3,3 millions d'assurés en ALD.
Alors que 20 % de la population est pris en charge sous le régime des ALD, la commission considère qu'une réflexion sur la pertinence des critères d'entrée en ALD est devenue inévitable et nécessaire. Face au vieillissement démographique accéléré, à la progression des polypathologies liées au vieillissement et des pathologies chroniques, l'adéquation du régime des ALD, dans son format actuel, et sa soutenabilité financière doivent être questionnés. L'IGF et l'Igas soulignent par ailleurs que « son acceptabilité sociale pourrait aussi diminuer en raison des écarts de couverture par rapport aux assurés hors du dispositif. Il répond enfin insuffisamment aux enjeux de prévention ». La commission souscrit pleinement à ce constat mais souhaite, au stade de l'examen du PLFSS, être informée en toute transparence des intentions du Gouvernement sur tout projet de réforme du régime des ALD.
Elle appelle à ce que les travaux à venir s'accompagnent d'un engagement politique fort du Gouvernement pour faire progresser la prévention, y compris primaire. Dans cette perspective, elle suggère également qu'un dialogue soit noué avec les organismes complémentaires d'assurance maladie, pour favoriser la coordination de leurs interventions en prévention secondaire et tertiaire dans le cadre des orientations qui seraient fixées par le ministère de la santé.
Ni le coût de la mesure ni les économies qu'elle pourrait générer ne sont précisément chiffrés par le Gouvernement, qui indique que ceux-ci dépendront des pathologies entrant dans le champ de ces parcours, lesquelles seront définies après avis de la HAS, et du panier des prestations d'accompagnement prises en charge, qui dépendra lui-même de la liste des pathologies.
Un flou relatif entoure donc encore cette mesure, au stade de l'examen du PLFSS. En imaginant que le diabète et l'hypertension artérielle puissent justifier la prescription d'un parcours d'accompagnement, le Gouvernement estime le coût du dispositif à près de 100 millions d'euros. Des économies plus substantielles pourraient y être associées, de l'ordre de 514 millions d'euros uniquement pour le diabète. L'évaluation de ces montants apparaît néanmoins très incertaine.
• Malgré ces limites et incertitudes, la commission a soutenu l'économie générale de la mesure. À l'initiative de la rapporteure, elle a adopté un amendement rédactionnel (n° 638) et quatre amendements visant :
- à prévoir que la liste des pathologies éligibles aux parcours d'accompagnement préventif soit fixée par décret après avis de la HAS, et non les seuls critères médicaux permettant d'identifier ces pathologies (n° 639) ;
- à préciser le rôle du médecin traitant dans le suivi des parcours d'accompagnement préventifs (n° 640) ;
- à ajouter le médecin prescripteur parmi les destinataires de la décision du directeur de l'organisme local d'assurance maladie statuant sur la demande de prise en charge du parcours (n°641) ;
- à renvoyer à un arrêté la liste des actes et prestations susceptibles d'être pris en charge dans le cadre des parcours d'accompagnement préventif (n° 642).
La commission s'est interrogée sur l'opportunité de recourir à un régime d'accord préalable, perçu négativement par les associations de patients qui y voient un frein à l'accès aux parcours préventifs, et par les syndicats de médecins libéraux qui critiquent les lourdeurs administratives d'un tel processus. Elle a toutefois jugé que les démarches requises n'étaient pas excessivement contraignantes ni les délais trop longs et que le risque de renoncement aux soins lié au régime d'accord préalable n'était pas avéré.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 20
Renforcer la politique vaccinale
Cet article propose, d'une part, de créer une obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et pour les professionnels de santé libéraux et, d'autre part, d'instaurer une obligation d'immunisation contre la rougeole pour les professionnels de santé et les personnels des structures sanitaires et médicosociales prenant en charge des enfants.
Il propose par ailleurs de faire évoluer le modèle de pilotage de l'activité de vaccination dans les territoires en la confiant entièrement aux agences régionales de santé (ARS).
Il précise enfin les conditions de mise en oeuvre de l'obligation vaccinale contre les méningocoques ACWY et B.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. La vaccination, pilier de la politique de prévention
1. Ce que prévoit le cadre législatif et réglementaire
Conformément à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé (HAS).
a) Des obligations vaccinales fixées par la loi
• La loi fixe plusieurs obligations vaccinales.
L'article L. 3111-2 du code de la santé publique prévoit ainsi, depuis le 1er janvier 2018108(*), une liste de onze vaccins obligatoires109(*) à pratiquer dans les dix-huit premiers mois de l'enfant110(*). Les modalités de mise en oeuvre de ces vaccinations, notamment les conditions d'âge, sont fixées par décret en Conseil d'État après avis de la HAS. S'agissant des infections à méningocoques, un décret du 5 juillet 2024 pris en application de l'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a élargi à compter du 1er janvier 2025 le champ de l'obligation vaccinale aux sérogroupes A, B, C, W et Y111(*).
Des immunisations obligatoires sont également prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. D'une part, toute personne exerçant une activité professionnelle dans les structures publiques et privées développant des activités de prévention, de soins ou d'hébergement112(*) doit être immunisée contre cinq affections : l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et les établissements qui accueillent des personnes handicapées tels que les foyers d'accueil médicalisés sont notamment concernés. D'autre part, au sein des laboratoires de biologie médicale, les personnels doivent être immunisés contre la fièvre typhoïde.
Pour l'ensemble de ces vaccinations, les employeurs assurent la prise en charge des dépenses de vaccination.
Sont par ailleurs obligatoires :
- la vaccination contre la fièvre jaune pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane113(*) ;
- la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités114(*).
• Toutefois, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 3111-1, tout ou partie de ces obligations vaccinales peuvent être suspendues par décret115(*), en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.
Trois décrets ont été publiés en application de cette disposition :
- le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006 qui suspend l'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 pour les personnels des établissements de santé et médicosociaux ;
- le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG ;
- le décret n° 2020-28 du 14 janvier 2020 relatif à la suspension de l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde prévue à l'article L. 3111-4 pour les personnels des laboratoires de biologie médicale.
S'agissant de la suspension de l'obligation vaccinale contre la grippe des professionnels des établissements de santé et médicosociaux, le pouvoir réglementaire s'est appuyé sur un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF)116(*) daté du 19 mai 2006. Les considérations formulées dans cet avis méritent d'être exposées.
L'autorité sanitaire y relevait qu'en période de grippe saisonnière inter-pandémique, la vaccination antigrippale vise exclusivement à protéger les professionnels eux-mêmes d'un risque de contamination, et non les patients au contact desquels ils travaillent. Elle indiquait en outre qu'aucune donnée ne permettait, à cette date, d'établir un risque majoré de contamination, de mortalité ou de morbidité grave lié à la grippe pour les professionnels de santé en période de grippe saisonnière inter-pandémique. Elle soulignait enfin qu'une telle obligation vaccinale, annuelle, « risquerait d'altérer l'adhésion des professionnels, [...] n'aurait pas d'impact bénéfique sur la couverture vaccinale par rapport à des campagnes de sensibilisation et pourrait même avoir des effets pervers (risque de multiplication de déclarations d'inaptitude au travail pour des personnes présentant une contre-indication au vaccin ou refusant la vaccination, risque de production de faux certificats de vaccination) »117(*).
En conséquence, le CSHPF recommandait de suspendre l'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et de renforcer les campagnes de sensibilisation des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier avec les personnes à risque, pour augmenter progressivement la couverture vaccinale annuelle grâce au vaccin contre la grippe saisonnière.
b) Des recommandations vaccinales pour certains publics-cibles
Sans être obligatoires, diverses vaccinations font l'objet de recommandations des autorités de santé publique pour certains publics-cibles. Sont notamment recommandées les vaccinations contre la tuberculose, l'hépatite A, les papillomavirus humains, la grippe, la covid-19, le zona, la varicelle, la gastro-entérite du nourrisson à rotavirus et les infections respiratoires dues au virus respiratoire syncitial et à la bronchiolite.
S'agissant de la tuberculose, la vaccination n'est plus obligatoire depuis 2007, mais elle est recommandée, à partir de l'âge de 1 mois, par le vaccin BCG pour les enfants qui présentent un risque élevé de tuberculose. L'obligation vaccinale est seulement maintenue en Guyane et à Mayotte, en période néonatale.
La vaccination contre l'hépatite A est également recommandée, pour certains publics-cibles, notamment les jeunes accueillis dans les établissements et services pour les enfants et jeunes handicapés, les personnes atteintes de mucoviscidose, les enfants âgés d'au moins un an dont un membres de la famille est originaire d'une région où circule l'hépatite A et susceptible d'y séjourner, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Elle est également recommandée pour les personnels des structures d'accueil et de prise en charge de jeunes enfants ou de personnes handicapées, caractérisées par un risque de contamination plus élevé.
S'agissant des infections à papillomavirus humains (HPV), le Gouvernement a fait de cette vaccination une priorité de lutte contre les cancers en inscrivant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024118(*) l'organisation de campagnes nationales de vaccination annuelles, dans les collèges, en visant une couverture vaccinale de 80 % à horizon 2030. Le vaccin contre les HPV est recommandé pour les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans, et jusqu'à l'âge de 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles.
La grippe, maladie très contagieuse, peut s'accompagner de conséquences sanitaires graves pour les personnes les plus vulnérables. Elle est chaque année responsable d'une surmortalité importante. Le vaccin, dont la composition est régulièrement adaptée pour tenir compte des mutations du virus, est particulièrement recommandé à toute personne à partir de 65 ans, aux personnes souffrant de certaines maladies chroniques et d'obésité, aux femmes enceintes, aux résidents des établissements médicosociaux, aux professionnels de santé et à ceux en contact régulier avec des personnes à risque de grippe sévère.
2. Une priorité de santé publique, malgré des résistances vaccinales persistantes et multifactorielles
a) Une mesure de prévention qui présente une balance bénéfice-risque favorable
La vaccination constitue l'une des actions de prévention du risque infectieux les plus efficientes. Elle a permis d'améliorer considérablement l'espérance de vie des populations au cours du XXème siècle et demeure un enjeu majeur de santé publique. La stratégie gouvernementale « vaccination et immunisation 2025-2023 » vise à renforcer la politique vaccinale et à favoriser l'accès à la vaccination pour augmenter l'immunité collective.
Dans son avis du 31 juillet 2023, la HAS a préconisé de rendre obligatoire l'immunisation contre la rougeole et de maintenir sans changement les recommandations de vaccination contre la grippe.
• L'impact de la rougeole demeure important en France. En l'absence d'obligation vaccinale, il existe un risque élevé de transmission aux personnes non immunisées. La rougeole est une maladie hautement contagieuse, qui touche particulièrement les nourrissons de moins de 12 mois, les jeunes adultes, les femmes enceintes et les patients immunodéprimés.
Or la vaccination contre la rougeole présente plusieurs avantages : elle est à la fois très efficace après un schéma de vaccination complet (> 95 %), son efficacité indirecte sur l'entourage des enfants vaccinés est élevée (> 80 %) et la durée de protection vaccinale est longue119(*).
Santé publique France a alerté sur une recrudescence des cas de rougeole en France et en Europe depuis le début de l'année 2025. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, 658 cas de rougeole ont été déclarés, soit un total dépassant déjà de plus de 35 % le nombre de cas déclarés en 2024 (483 cas)120(*). Les contaminations touchent majoritairement les enfants âgés de 1 à 4 ans (21,1 %), les nourrissons de moins d'un an (14,4 %), ainsi que les adultes de 30 à 39 ans (13,9 %) et les plus de 40 ans (10,5 %). Près de la moitié de ces cas a donné lieu à une hospitalisation121(*). Face à cette situation, les autorités sanitaires ont appelé les professionnels du secteur de la santé et de la petite enfance à une vigilance particulière et rappelé les recommandations en vigueur concernant la vaccination.
• Concernant la grippe, les épidémies saisonnières touchent chaque hiver 2 à 6 millions de personnes en France, avec un excès de mortalité évaluée entre 9 000 et 10 000 décès annuels, principalement chez les sujets fragiles. Le risque pandémique associé à la grippe zoonotique constitue également un enjeu majeur de santé publique. En dehors des mesures d'hygiène la vaccination annuelle contre la grippe reste le moyen le plus efficace de se protéger.
L'épidémie de grippe au cours de l'hiver 2024-2025, plus longue et plus précoce que les précédentes, s'est révélée particulièrement sévère comme en témoignent les chiffres communiqués par les autorités sanitaires. Trois millions de consultations en ville causées par l'épidémie ont été dénombrées, 30 000 hospitalisations et une surmortalité de plus de 17 000 décès toutes causes confondues.
Grippe saisonnière et grippe pandémique
La grippe est une infection respiratoire aiguë contagieuse, qui touche principalement les voies respiratoires supérieures (nez, gorge, bronches). Elle est due aux virus influenza qui se caractérisent par une grande variabilité génétique. Les virus de types A et B sont à l'origine des épidémies saisonnières, tandis que les virus de type A ont un potentiel pandémique122(*).
L'épidémie de grippe saisonnière, annuelle, se caractérise par des sous-types de virus surveillés à l'échelle nationale et internationale pour adapter la composition du vaccin annuel contenant les sous-types les plus probables de la saison à venir. Son aire géographique de diffusion est limitée à un pays ou à des régions spécifiques et elle touche particulièrement certaines populations à risque telles que les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimés et les personnes obèses.
En revanche, une pandémie est une épidémie non limitée dans l'espace et qui se répand rapidement. Les pandémies de grippe se caractérisent par de nouveaux sous-types de virus, une aire géographique de diffusion plus vaste et une gravité variable. La grippe espagnole a ainsi fait des millions de morts tandis que la pandémie de 2009 en France a été d'une ampleur comparable à celle d'une épidémie saisonnière.
La direction générale de la santé a de nouveau saisi la HAS pour qu'elle actualise sa recommandation du 31 juillet 2023 sur l'obligation de vaccination contre la grippe saisonnière pour les professionnels de santé, notamment les professionnels libéraux, et qu'elle rende un avis sur une obligation vaccinale des résidents des Ehpad. Ses conclusions devraient être connues avant la fin du premier trimestre 2026.
• On peut enfin rappeler que dans un contexte de recrudescence des infections invasives à méningocoques depuis 2023 (+ 10 % entre 2023 et 2024 selon Santé publique France), la HAS a mis à jour ses recommandations par deux fois en 2024 et en 2025. Ces infections, qui touchent particulièrement les nourrissons et les jeunes enfants, peuvent engendrer des méningites et des septicémies.
Outre la vaccination obligatoire des enfants de 0 à 2 ans, la HAS a formulé un avis en faveur de la vaccination des adolescents de 11 à 14 ans pour les sérogroupes ACWY, ainsi que d'un rattrapage ciblant les enfants jusqu'à 3 ans non vaccinés pour les mêmes sérogroupes, et les adolescents de 15 à 24 ans sur une période de deux ans.
b) Une couverture vaccinale encore insuffisante malgré une adhésion globalement élevée à la vaccination
Les enquêtes de Santé publique France montrent une relative stabilité voire une progression, depuis 2019, de l'adhésion des Français à la vaccination. La crise sanitaire de la covid-19 n'a donc pas altéré la confiance des usagers. En 2023, 83,7 % se déclaraient favorables ou très favorables à la vaccination en général123(*).
En revanche, on observe un décalage entre l'adhésion déclarée et la réalité des couvertures vaccinales, à géométrie variable selon les vaccins considérés et les territoires ou publics-cibles concernés.
• Malgré les campagnes annuelles d'information et de sensibilisation en faveur de la vaccination antigrippale, la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière demeure notoirement insuffisante parmi les personnels des établissements de santé et des établissements médicosociaux.
Lors de l'épidémie 2023-2024, les taux de vaccination des professionnels de santé s'établissaient à 22 % dans les Ehpad et à 19 % dans les établissements de santé124(*). Lors de l'épidémie 2022-2023, ils étaient légèrement supérieurs : 24,7 % dans les Ehpad et 22 % dans les établissements de santé125(*). Pour mémoire, la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance fixe un objectif minimal de 70 % de personnels vaccinés au sein des établissements de santé, et de 80 % pour les professionnels de santé de ville.
Aucune donnée fiable ni consolidée ne permet en revanche d'apprécier la couverture vaccinale des professionnels de santé libéraux. L'envoi d'un bon de prise en charge du vaccin par l'assurance maladie vise néanmoins à les inciter à se faire vacciner. Selon la DGS, environ 370 000 professionnels sont concernés par cette prise en charge126(*).
Dans sa dernière recommandation, la HAS n'a pas préconisé de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe saisonnière. Elle s'est appuyée sur plusieurs arguments pour rendre cet avis, notamment les difficultés d'évaluation de l'efficacité directe du vaccin contre la grippe, qui varie chaque année en fonction de l'adéquation entre les souches virales circulantes et les souches vaccinales, et l'insuffisance des données sur l'impact de la vaccination des soignants sur la grippe nosocomiale.
La HAS a toutefois souligné qu'une étude réalisée aux États-Unis établit un lien entre l'augmentation du taux de vaccination antigrippale des personnels soignants et une réduction significative des infections grippales associées aux soins chez les patients immunodéprimés ayant un cancer.
Par ailleurs, la vaccination contre la grippe stagne à 54 % chez les personnes âgées d'au moins 65 ans et à 25 % chez les personnes de moins de 65 ans à risque de grippe sévère. En revanche, la couverture vaccinale antigrippale des résidents des Ehpad, estimée à 82,7 %127(*), apparaît élevée et satisfaisante.
Diverses raisons contribuent à expliquer la faiblesse de la couverture vaccinale, que l'enquête IRAPrev128(*) permet en partie d'objectiver. Deux raisons principales de refus sont invoquées à propos de la vaccination antigrippale : le rejet d'une vaccination annuelle et une préférence pour une protection basée sur les gestes barrières.
• À l'inverse, la couverture vaccinale contre la rougeole des professionnels de santé travaillant en établissements de santé, estimée à 73 %, est élevée. Elle ne semble pourtant pas suffisante puisque des études de Santé publique France indiqueraient que les professionnels de santé sont impliqués dans 75 à 83 % des cas nosocomiaux de rougeole129(*).
Santé publique France rappelle que l'atteinte d'une immunité collective pour empêcher la circulation du virus de la rougeole , dans une population donnée, nécessite un niveau de couverture vaccinale de 95 % chez le jeune enfant, niveau jamais atteint en France depuis l'intégration de cette vaccination dans le calendrier vaccinal.
Conditions de prise en charge des vaccins par
l'assurance maladie :
un dispositif couvrant pour favoriser
l'accès à la vaccination
Les conditions de prise en charge des vaccins par l'assurance maladie obligatoire visent à inciter la population à se faire vacciner.
Certains vaccins peuvent être pris en charge par l'assurance maladie à 100 %. C'est le cas pour les vaccins suivants :
- le vaccin contre la grippe saisonnière pour les personnes ciblées par les recommandations, en raison de leur vulnérabilité particulière au virus ;
- le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) pour les enfants et les adolescents jusqu'à 17 ans ;
- le vaccin contre la covid-19 à partir de l'âge de 5 ans ;
- le vaccin contre les HPV et contre les méningocoques ACWY pour les publics-cibles dans le cadre des campagnes de vaccination au sein des collèges ;
- le vaccin Abrysvo contre les infections à virus respiratoire syncitial (VRS) pour les femmes enceintes.
Le vaccin contre la grippe est ainsi entièrement remboursé pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques et d'obésité, les femmes enceintes, les résidents des établissements médicosociaux, les professionnels de santé et les professionnels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.
Les autres vaccins sont, le plus souvent, remboursés à hauteur de 65 % de leur coût par l'assurance maladie obligatoire, sur prescription médicale, le reliquat étant fréquemment pris en charge par les organismes complémentaires d'assurance maladie. Les onze vaccins obligatoires chez le nourrisson entrent dans cette catégorie, de même que la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) et contre la coqueluche pour les adolescents et les adultes130(*), ou contre les infections à méningocoques ACWY et B et les infections à papillomavirus humains (HPV) pour les adolescents.
Le coût de l'injection est par ailleurs pris en charge à hauteur de 70 % si l'injection est réalisée par un médecin, une sage-femme ou un pharmacien, de 60 % si elle est réalisée par un infirmier, ou de 100 % pour les personnes souffrant d'une affection de longue durée (ALD), les femmes enceintes à partir du sixième mois de grossesse et pour les vaccinations réalisées dans le cadre de campagnes nationales au sein des collèges (HPV et méningocoques ACWY).
3. Un pilotage de la politique vaccinale confié à l'État
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a confié à l'État la responsabilité de l'activité de vaccination, qui appartenait jusqu'alors aux collectivités territoriales (départements, communes).
• Cette loi a prévu que des conventions puissent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales afin d'encadrer les conditions d'exercice des activités de vaccination par celles-ci131(*). Ces conventions précisent notamment les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et le montant de la subvention accordée par l'État. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
Selon le Gouvernement, trente et un conseils départementaux assuraient encore une activité de vaccination au 1er janvier 2025, les départements d'Ille-et-Vilaine et de Haute-Savoie ayant néanmoins manifesté leur intention de se désengager de cette activité en 2026. Les départements disposent toutefois toujours d'une compétence autonome en matière de vaccination dans le cadre des missions dévolues aux services de protection maternelle et infantile (PMI). Ces activités de vaccination sont mentionnées aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la santé publique.
Les communes peuvent également exercer une activité de vaccination de façon autonome, sur le fondement de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Elles bénéficient, à ce titre, d'une dotation générale de décentralisation (DGD). La DGS indique que deux cent communes environ disposeraient d'une DGD au titre de services communaux d'hygiène et de santé, couvrant potentiellement des activités de vaccination.
• La vaccination des particuliers peut être réalisée en ville, dans un cabinet libéral ou une structure d'exercice coordonné par un médecin, une sage-femme ou un infirmier, par un pharmacien exerçant en officine, en pharmacie à usage intérieur ou dans un laboratoire de biologie médicale. La vaccination peut également être réalisée dans les centres de vaccination départementaux ou communaux, les services de la protection maternelle et infantile, les centres gratuits d'information de dépistage et de diagnostic (Cegidd) ou les services de médecine du travail, par l'un des professionnels de santé habilités.
B. Renforcer la politique vaccinale en créant de nouvelles obligations de vaccination contre la grippe et la rougeole et en adaptant le pilotage territorial de la politique de vaccination
1. La création de nouvelles obligations vaccinales contre la grippe sous réserve d'un avis de la HAS
a) Pour les résidents des Ehpad, sous réserve d'un avis de la HAS
Les alinéas 4 à 6 visent à compléter le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique d'un article L. 3111-2-1, pour fixer une nouvelle obligation de vaccination contre la grippe.
L'obligation concernerait les résidents des Ehpad132(*), sauf contre-indication médicale reconnue et s'appliquerait « pendant la durée de la période épidémique ». Sa mise en oeuvre serait subordonnée à une recommandation préalable de la HAS.
Un décret en Conseil d'État pris après avis de la HAS fixerait les conditions de mise en oeuvre de cette obligation.
b) Pour les professionnels de santé libéraux
L'article L. 3111-4 du code de la santé publique serait modifié pour instaurer une obligation de vaccination contre la grippe à l'égard des professionnels de santé libéraux, dans les limites fixées par un décret en Conseil d'État. La liste des professionnels concernés serait ainsi déterminée par le pouvoir réglementaire, au regard de leurs conditions d'exercice et des risques de contamination qu'elles induisent, pour eux-mêmes ou pour les personnes qu'ils prennent en charge.
Cette obligation complèterait donc, sous la forme d'un II, celle prévue pour les professionnels exerçant dans les établissements de santé et médicosociaux et pour les élèves et étudiants se préparant à l'exercice d'une profession de santé, prévues aux cinq premiers alinéas de l'article L. 3111-4, qui constitueraient désormais un I.
c) Pour les professionnels des établissements de santé et médicosociaux
L'obligation actuellement prévue par le code de la santé publique pour les professionnels exerçant dans les structures de prévention, de soins ou d'hébergement133(*) étant suspendue depuis 2006, il suffirait d'un acte du pouvoir réglementaire pour abroger ledit décret et réactiver l'obligation vaccinale à l'égard de ces professionnels.
Aucune modification législative n'est donc prévue par le présent article.
2. La création d'une obligation d'immunisation contre la rougeole pour les professionnels au contact d'enfants
Tirant les conséquences des dernières recommandations de la HAS, les alinéas 12 à 15 proposent de créer une obligation d'immunisation contre la rougeole pour les professionnels du secteur sanitaire et médico-social et les professionnels de la petite enfance, sans la subordonner à un avis de la HAS. Cette nouvelle obligation ferait l'objet d'un III au sein de l'article L. 3111-4.
Plus précisément, cette obligation s'appliquerait :
- aux professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique134(*) ;
- aux professions mentionnées au livre IV du code de l'action sociale et des familles135(*) ;
- aux personnels des établissements de santé et des établissements ou services sociaux ou médicosociaux assurant l'accueil, la prise en charge ou l'accompagnement d'enfants ;
- aux personnels des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans au sens de l'article L. 2324-1 ;
- à tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice de l'une des professions précitées.
Un décret en Conseil d'État fixerait la liste des professions, des établissements, des services et activités concernés par cette obligation.
Sans préjudice des dispositions prévoyant un avis préalable de la HAS, les nouvelles obligations vaccinales contre la grippe saisonnière et la rougeole entreraient en vigueur le 1er janvier 2027136(*).
3. L'unification des conditions de pilotage et de financement des centres de vaccination dans les territoires
Les alinéas 17 à 26 proposent de procéder à une réécriture complète de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique afin d'unifier le pilotage et le financement des centres de vaccination.
• Conformément au I, le directeur général de l'agence régionale de santé serait compétent pour habiliter l'ensemble des centres de vaccination procédant à des vaccinations gratuites, en fonction des besoins identifiés dans les territoires. Les centres de vaccination déployés par les collectivités territoriales devraient être habilités sur le fondement de ces dispositions.
Cette réécriture est cohérente avec la modification par ailleurs proposée de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique. Cet article serait complété pour mentionner explicitement le pilotage de l'activité de vaccination parmi les missions des ARS, à l'alinéa137(*) qui évoque le rôle de l'ARS en matière de répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale.
Cette nouvelle version de l'article supprime ainsi les dispositions en vigueur concernant la possibilité que soient conclues des conventions entre les collectivités territoriales et l'État pour que celles-ci exercent des activités en matière de vaccination. Le vecteur autorisant les communes et les départements à déployer des centres de vaccination est ainsi modifié : les conventions disparaissent au profit d'une habilitation unilatérale des ARS.
En conséquence, il est proposé de supprimer la référence à l'article L. 3111-11 de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ; ce dernier ne viserait plus, dans son neuvième alinéa, que des conventions conclues entre le département et l'État pour la mise en oeuvre de programmes de santé, notamment des programmes de dépistage des cancers138(*).
• Selon le II, les centres de vaccination contribuent à l'orientation des usagers au sein du système de santé et contribuent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale au travers de trois missions : la vaccination à titre gratuit ; la promotion de la vaccination, notamment par des actions d'information de la population ; enfin, des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels des secteurs sanitaires et médicosociaux.
• Le III uniformise le modèle de financement des centres de vaccination en instaurant un financement intégral par le fonds d'intervention régional (FIR)139(*).
Des transferts de crédits correspondant aux financements des centres de vaccination communaux et départementaux devraient donc être opérés vers l'Ondam depuis la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Le Gouvernement évoque en effet une mesure de périmètre et de transfert financier de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements vers les comptes de la sécurité sociale, « les crédits consacrés par les communes à cette activité à partir de la dotation générale de décentralisation (DGD) étant impossibles à isoler et donc à retracer. Cette mesure de transfert financier (abattement de la DGD et abondement à due concurrence du FIR) interviendra dans le cadre du projet de loi de financement pour 2027 »140(*).
Un régime de transition serait prévu pour l'année 2026, visant à prolonger les éventuelles conventions en cours entre l'État et les collectivités territoriales jusqu'au 31 décembre 2026 lorsque leur terme est antérieur au 1er janvier 2027. L'entrée en vigueur de ces dispositions serait donc prévue au 1er janvier 2027.
La modification de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale, aux alinéas 27 à 29, relève d'une coordination juridique pour prévoir que les dépenses de l'ensemble de ces centres de vaccination sont imputées sur le FIR.
• Enfin, le IV reprend des dispositions existantes141(*) visant à permettre que la caisse nationale d'assurance maladie négocie pour le compte des structures chargées de la gestion de centres de vaccination, notamment des collectivités territoriales, les conditions d'acquisition des vaccins.
4. Une mise en oeuvre de l'obligation de vaccination contre les méningocoques ACWY et B précisée
Enfin, l'article précise les conditions de mise en oeuvre de l'obligation vaccinale contre les méningocoques ACWY et B.
Se fondant sur les recommandations de la HAS, les vaccinations contre les méningocoques ACWY et B sont devenues obligatoires à partir du 1er janvier 2025 pour tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans. Toutefois, l'article 38 de la LFSS pour 2024 ayant permis l'extension des sérogroupes concernés par l'obligation vaccinale n'a pas précisé la cohorte des enfants auxquels elle devrait s'appliquer. Or, la HAS a recommandé en mars 2025 un rattrapage vaccinal provisoire pour les enfants de 2 à 5 ans pour le sérogroupe B.
Pour éviter que ces nouvelles recommandations transitoires ne s'appliquent y compris aux enfants nés avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement propose de compléter l'article 38 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 pour limiter cette obligation vaccinale aux enfants nés à partir du 1er janvier 2023142(*).
II - Le dispositif transmis au Sénat
Les députés n'ont pas adopté cet article. Lors de la séance publique, ils ont pourtant adopté onze amendements dont :
- deux avaient pour objet d'inscrire une exception à l'obligation de vaccination contre la grippe des professionnels de santé libéraux, en cas de contre-indication médicale avérée143(*) ;
- huit étaient des amendements rédactionnels ;
- un corrigeait une erreur de référence légistique.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
• Les conséquences sanitaires de la dernière épidémie de grippe témoignent de la nécessité de renforcer les incitations à la vaccination. La faiblesse de la couverture vaccinale des professionnels de santé en établissement est, de ce point de vue, profondément regrettable. C'est dans ce contexte que le ministre délégué à la santé Yannick Neuder avait, il y a plusieurs mois, reposé la question d'une obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé.
La crise de la covid-19 a mis en lumière la persistance de résistances fortes à la vaccination. La diffusion croissante de fake news et la désinformation médicale qui pullule alimentent les inquiétudes et concourent à discréditer l'intérêt et les bénéfices de la vaccination, solidement établis sur le plan scientifique. La conflictualité potentielle attachée à l'instauration de nouvelles obligations vaccinales ne doit donc pas être sous-estimée, notamment dans les équipes des établissements de santé. Elle pourrait raviver des tensions, voire une défiance, notamment dans certains territoires ultra-marins. Une pédagogie forte devrait donc nécessairement accompagner une telle mesure.
Ce contexte général doit être pris en compte, pour apprécier l'acceptabilité de nouvelles obligations vaccinales et anticiper la faisabilité concrète de leur mise en oeuvre. La question des conséquences dont s'assortiraient les refus de vaccination doit notamment être posée. En tout état de cause, en la matière, l'expertise des autorités sanitaires doit primer. Toute décision portant sur de nouvelles obligations vaccinales doit donc demeurer subordonnée à un avis préalable de la HAS.
• Les professionnels des établissements de santé, sociaux et médicosociaux étant déjà soumis à plusieurs obligations vaccinales, l'hypothèse d'une réactivation de l'obligation de vaccination contre la grippe est anticipée plutôt favorablement par les fédérations représentatives des établissements, qui se déclarent en soutien d'une telle mesure. Les conditions de sa mise en oeuvre et les conséquences à tirer d'une méconnaissance de l'obligation vaccinale sont en revanche moins évidentes.
Actuellement, la vérification des obligations vaccinales des professionnels de santé en établissement est effectuée par les services de médecine du travail au moment de l'embauche et, le cas échéant, des visites médicales périodiques. Toutefois, les problématiques structurelles de recrutement des médecins du travail conduisent en réalité à un défaut de suivi des obligations vaccinales des professionnels de santé. Les conditions de vérification d'une obligation qui devrait se renouveler tous les ans ne sont donc pas assurées. Un contrôle systématique de cette obligation par les services de santé au travail apparaît illusoire.
Quant aux conséquences du non-respect d'une obligation vaccinale, la réglementation prévoit qu'en l'absence de preuve de son immunisation au moment de l'entrée en fonction, le professionnel concerné ne peut exercer une activité l'exposant à un risque de contamination144(*). S'agissant de la vaccination antigrippale, cette règle ne semble pas pouvoir appliquée, du fait de son renouvellement annuel.
Le directeur d'établissement dispose de pouvoirs propres et d'une autorité sur l'ensemble du personnel145(*). Il est donc autorisé à prendre les mesures qui lui sembleraient fondées en cas de méconnaissance des obligations vaccinales (sanction disciplinaire, suspension ou licenciement). De telles mesures sont toutefois exceptionnelles pour deux raisons au moins : un suivi très partiel de l'état des vaccinations par les services de santé au travail ; une tension toujours forte sur le recrutement de nombreux professionnels de santé, a fortiori dans des services de soins critiques comme la réanimation, les urgences ou les maternités. Pour autant, la responsabilité du directeur ou de la structure peut être engagée, sur le plan civil et pénal, en cas de manquement à l'obligation de sécurité et à la prévention des risques professionnels de l'employeur.
À cet égard, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire indiquait explicitement que les professionnels non vaccinés ne pouvaient plus exercer leur activité. Cette interdiction d'exercice, provisoire, s'accompagnait de l'interruption du versement de leur rémunération et prenait fin dès que l'agent public remplissait à nouveau les conditions requises pour l'exercice de son activité146(*). Les fédérations représentatives des établissements de même que plusieurs organisations de la fonction publique hospitalière147(*) ont estimé que des précisions législatives ou réglementaires sur ces conséquences seraient utiles, dans un souci de clarification juridique et de responsabilisation collective des acteurs.
Elles alertent néanmoins sur le fait que l'existence de réticences à la vaccination parmi les soignants, bien que circonscrites, pourrait aggraver les tensions sur les ressources humaines dans certains services et susciter des conflits au sein des équipes. Au-delà d'une contrainte légale, un accompagnement pédagogique dans le temps est donc primordial.
• S'agissant des professionnels de santé libéraux, si la HAS devait recommander une obligation de vaccination contre la grippe, le pragmatisme devrait prévaloir dans les modalités de sa mise en oeuvre.
Il semble en effet illusoire d'envisager que soit contrôlée l'immunisation de tous les professionnels de santé libéraux, par quelque autorité que ce soit. La confiance devrait donc fonder la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation.
La vaccination des professionnels libéraux doit a minima être fortement incitée, avec le soutien des ordres professionnels, tant au regard des devoirs déontologiques des professionnels de santé que des enjeux de protection individuelle et collective de la santé publique.
Au global, pour les professionnels de santé, hospitaliers ou libéraux, la mise en oeuvre de l'une obligation vaccinale contre la grippe devrait s'accompagner d'un calendrier communiqué le plus en amont possible, pour favoriser la planification de la vaccination, l'adhésion des soignants et la réussite du dispositif.
• En revanche, le principe d'une obligation de vaccination pour les résidents des Ehpad apparaît plus contestable et se heurte à davantage de difficultés.
D'une part, près de 83 % des résidents en Ehpad étaient vaccinés contre la grippe en 2024, contre à peine 21 % des professionnels de santé qui y exercent. Les enjeux d'une vaccination obligatoire pour ces deux publics sont donc très différents. D'autre part, une obligation vaccinale soulèverait des difficultés éthiques plus profondes en raison du principe de libre consentement aux soins, surtout s'agissant de personnes qui peuvent être atteintes de troubles cognitifs. Enfin, on peut légitimement s'interroger sur les conséquences à tirer d'un éventuel refus de vaccination d'un résident : aucune exclusion de la structure ni aucune rupture de prise en charge ne saurait être envisagée, sans porter gravement atteinte au respect des libertés individuelles et du droit des personnes vulnérables à être hébergées et prises en charge. Dans la mesure où aucune conséquence juridique concrète ne pourrait éthiquement être tirée d'un refus de vaccination de la part d'un résident, l'obligation serait pour le moins abstraite.
· Selon la commission, l'enjeu prioritaire réside davantage dans l'augmentation de la vaccination des professionnels que dans celle des résidents. Au regard de la couverture vaccinale déjà importante des résidents d'Ehpad et compte tenu de l'opposition que pourrait susciter une obligation imposée, la commission préconise de privilégier une sensibilisation volontariste des résidents aux bénéfices de la vaccination plutôt que d'ériger la vaccination antigrippale en obligation.
En conséquence, à l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté les amendements suivants :
- un amendement n° 643 visant à supprimer l'obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad et proposant de mentionner la promotion de la vaccination auprès des résidents dans le contrat de séjour signé par chaque résident, en tenant compte des recommandations vaccinales en vigueur ;
- un amendement n° 644 visant à inscrire la mention de contre-indication médicale dans le code de la santé publique pour qu'elle s'applique à tous les professionnels de santé concernés par une obligation vaccinale, qu'ils exercent en libéral ou en établissement de santé.
Plus largement, l'adhésion à la vaccination doit prioritairement être soutenue par l'information, la sensibilisation et l'accompagnement. À cet égard, la commission recommande que des mesures de soutien à la vaccination soit engagée, indépendamment de toute nouvelle obligation vaccinale, notamment : ouvrir des discussions avec les représentants des personnels, au sein des instances réglementaires de chaque établissement, pour favoriser l'adhésion à la vaccination ; favoriser l'organisation de séances de vaccination sur le lieu de travail, à des horaires adaptés et variés ; s'appuyer sur des ressources internes ou externes pour assurer la vaccination, avec une rotation des personnels ; déployer des actions de sensibilisation en concertation avec les organismes complémentaires d'assurance maladie.
• Enfin, sur la réorganisation du pilotage des activités de vaccination dans les territoires, la commission entend que la recherche d'efficience et de cohérence dans la conduite de la politique vaccinale puisse justifier les adaptations proposées par le Gouvernement.
Le principe d'une habilitation de tous les centres de vaccination par les ARS a le mérite de la lisibilité. En revanche, la reprise des financements alloués aux départements et aux communes pour abonder le FIR peut susciter des craintes légitimes de la part des élus locaux et des collectivités concernées, d'autant que ces dispositions n'ont semble-t-il pas été concertées. Si la DGS indique que la mesure de périmètre et les transferts de crédits s'opèreront à crédits strictement équivalents, leur sanctuarisation ne peut être garantie ni à moyen ni à long termes. Sur ce sujet, la commission engage le Gouvernement à concerter rapidement les élus locaux.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Articles 20 bis et
20 ter (nouveaux)
Autoriser la détention de vaccins par les
médecins
dans les cabinets de ville
L'article 20 bis vise à autoriser les médecins généralistes à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales des autorités sanitaires.
L'article 20 ter vise quant à lui à autoriser tout médecin à détenir des vaccins pour vacciner toute personne qui le demande.
La commission propose de supprimer ces articles.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat ces articles insérés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La vente et la dispensation de médicaments au public relève d'un monopole des pharmaciens
1. Des dérogations strictement encadrées au monopole des pharmaciens sur la vente et la dispensation de médicaments au public
L'article L. 4211-1 du code de la santé publique prévoit qu'est réservée aux pharmaciens, sauf dérogation, la vente en gros et au détail et toute dispensation au public de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine148(*). Ces activités relèvent donc, par principe, d'un monopole des pharmaciens.
Toutefois, parmi les dérogations, figure celle prévue à l'article L. 4211-3 du code de la santé publique. Cet article dispose que « les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'État dans le département, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige ».
Les médecins autorisés à délivrer des médicaments à leurs patients dans ces conditions sont des médecins propharmaciens. Cette dérogation au monopole des pharmaciens est strictement encadrée, puisqu'elle exige que plusieurs conditions cumulatives soient remplies :
- que le médecin soit installé dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ;
- que l'intérêt de la santé publique l'exige ;
- que le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) délivre une autorisation en ce sens. Une telle autorisation a vocation à être retirée lorsqu'une pharmacie d'officine ouvre dans la commune ou sur le territoire concerné.
Enfin, les médicaments dont la délivrance est autorisée sont inscrits sur une liste après avis du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop).
Les mêmes obligations législatives et réglementaires que celles incombant aux pharmaciens s'imposent aux médecins propharmaciens.
En vertu de l'article R. 162-20-7 du code de la sécurité sociale, les médecins propharmaciens peuvent facturer des dépassements d'honoraires de dispensation dans les conditions prévues par la convention nationale conclue entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine, pour chaque unité de conditionnement de médicament remboursable facturée à l'assurance maladie.
Un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) daté de 2016 relève que « l'effectif des médecins propharmaciens reste marginal et est en diminution constante depuis une vingtaine d'année (152 en 1998, 112 en 2006). Les médecins propharmaciens en activité exercent majoritairement sur certaines iles (Porquerolles) et dans les régions montagneuses (Ardèche, Alpes-Maritimes, Corse...) »149(*).
Aucune donnée publique plus récente sur l'effectif des médecins propharmaciens n'est disponible. En tout état de cause, la qualité et la stabilité du réseau officinal, garant de proximité avec les usagers sur le territoire, tend à réduire la portée de ce dispositif.
2. Une organisation dérogatoire pendant la crise de la covid-19, répondant à l'urgence sanitaire et à l'exigence de protection collective
Lors de la crise de la covid-19, des organisations dérogatoires ont été mises en oeuvre pour accélérer la vaccination dans un contexte d'urgence sanitaire.
Le décret modifié n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a défini un circuit dérogatoire de dispensation et permis aux médecins de s'approvisionner auprès des pharmacies d'officine pour vacciner leurs patients dans leurs cabinets. Ce circuit est rappelé ci-après.
Les grossistes-répartiteurs étaient responsables de déconditionner les boîtes de vaccins afin de permettre la prise en charge au flacon par les pharmaciens. Les pharmaciens d'officine avaient ensuite la charge de délivrer aux médecins effecteurs les doses prévues de vaccin et d'assurer la traçabilité de cette délivrance. Après avoir retiré les vaccins en officine, les médecins pouvaient soit effectuer les vaccinations dans les douze heures suivant le retrait du flacon si ceux-ci avaient été transportés et conservés à température ambiante, soit les réaliser dans les 6 heures à partir du premier prélèvement dans le flacon, sous réserve de disposer au cabinet d'un réfrigérateur adapté. L'acheminement entre la pharmacie d'officine et le cabinet devait garantir l'absence de rupture de la chaîne du froid150(*).
B. Une volonté d'assouplissement de la législation en vigueur pour améliorer la couverture vaccinale en population générale
L'article 20 bis propose de compléter l'article L. 3111-1 du code de la santé publique relatif aux conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique de vaccination de deux alinéas.
Le premier alinéa vise à autoriser les médecins généralistes à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière pour l'administrer aux personnes concernées par les recommandations vaccinales élaborées par les autorités sanitaires.
Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État les précisions relatives aux conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin.
L'article 20 ter propose un dispositif proche mais non équivalent, en créant un nouvel article dans le titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique relatif au monopole des pharmaciens.
Cet article a pour objet de prévoir une nouvelle dérogation au monopole général des pharmaciens, en autorisant tout médecin à détenir sur son lieu d'exercice des vaccins, sans restreindre le type de vaccin au niveau de la loi, pour pouvoir vacciner tous les patients qui en font la demande, et non les seuls patients correspondant aux publics ciblés par les recommandations vaccinales.
II - La position de la commission
Au soutien de l'adoption de ces deux articles, les députés ont invoqué la simplification du parcours vaccinal et l'amélioration de la couverture vaccinale en population générale. La commission ne souscrit pas à ces arguments.
D'une part, elle a tenu à rappeler que le réseau officinal assure une couverture efficiente du territoire, y compris des territoires ruraux et isolés. Ainsi, 18 % des officines sont aujourd'hui situées dans des communes de moins de 2 000 habitants et environ un tiers dans des communes de moins de 5 000 habitants. Dans certains territoires très isolés, des officines ont pu fermer du fait de difficultés économiques ne permettant pas d'équilibrer leur activité. C'est pour y remédier que l'expérimentation des antennes pharmaceutiques est aujourd'hui conduite. La commission appelle d'ailleurs à sa généralisation sur l'ensemble du territoire, pour desserrer un cahier des charges national jugé encore trop contraignant. La commission rejoint sur ce point l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui soutient fortement la démarche. D'autre part, la commission rappelle que les pharmaciens sont autorisés à prescrire et à administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations aux personnes âgées de 11 ans et plus. Cette compétence vaccinale contribue à l'amélioration de la couverture vaccinale de la population.
En outre, la possibilité pour les médecins de conserver des vaccins dans leurs cabinets présente d'importantes complexités logistiques et techniques. Si celles-ci ont pu être levées dans le contexte très particulier de l'urgence sanitaire de la covid-19, la reproductibilité de ces conditions hors contexte de crise n'a rien d'évident et soulève des problématiques de sécurisation de la chaîne du médicament qui ne peuvent être ignorées.
C'est pourquoi la commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, deux amendements n° 645 et n° 646 visant à supprimer respectivement l'article 20 bis et l'article 20 ter.
La commission propose de supprimer ces articles.
Article 20 quater (nouveau)
Application du tiers payant sur la part obligatoire
pour les séances prises en charge dans le cadre de Mon soutien psy
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, entend appliquer le tiers payant sur la part des séances d'accompagnement psychologique prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. Mon soutien psy permet la prise en charge par l'assurance maladie de séances chez le psychologue
1. Mon soutien psy vise à renforcer l'accessibilité financière aux psychologues pour des patients souffrant de troubles psychiques légers à modérés
Les psychologues n'étant pas des professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, le remboursement par l'assurance maladie ne leur est pas ouvert dans les conditions de droit commun lorsqu'ils exercent en ville.
Toutefois, le fait que ces professionnels concourent à la politique de santé mentale151(*) a justifié l'ouverture d'un cadre de prise en charge dérogatoire de séances chez le psychologue par l'assurance maladie, d'abord via une expérimentation conduite entre 2018 et 2022 dans quatre départements152(*), puis via Mon soutien psy.
Annoncé par le Président de la République lors des Assises de la santé mentale en 2021, ce dispositif, mis en oeuvre lors de la LFSS pour 2022153(*), permet aux patients mineurs154(*) ou majeurs souffrant de troubles psychiques légers à modérés155(*) de bénéficier de séances chez un psychologue, partiellement prises en charge156(*) par l'assurance maladie. Il a pour objectif d'améliorer l'accessibilité financière aux séances de soutien psychologique et de permettre un repérage et un traitement anticipé des troubles des patients.
2. Un parcours récemment fluidifié par la suppression de la condition d'adressage, prévoyant jusqu'à douze séances remboursables par an
Mon soutien psy prévoit un parcours constitué d'un entretien d'évaluation permettant au professionnel de présenter le dispositif et de procéder à une première appréciation des besoins du patient157(*), puis de plusieurs séances d'accompagnement psychologique. Un décret158(*) a rehaussé, en mai 2025, de huit à douze159(*) le nombre maximal de séances, entretien d'évaluation compris, pouvant donner lieu à une prise en charge sur une année donnée.
Dans le cadre du dispositif Mon soutien psy, l'assuré a le libre choix du psychologue qu'il souhaite consulter160(*) sous réserve que le professionnel ait été conventionné avec l'assurance maladie161(*). Ce conventionnement, qui s'opère après une sélection par un comité d'experts, est ouvert aux psychologues exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé à condition qu'ils disposent d'une expérience minimale de trois ans et soient inscrits auprès de l'agence régionale de santé de leur lieu d'exercice162(*).
S'il était initialement prévu que la prise en charge des séances d'accompagnement psychologique soit subordonnée à un adressage préalable du patient par un médecin, élargi par la suite à une sage-femme163(*), cette condition, qui restreignait l'accès au dispositif et était jugée comme redondante par près d'un psychologue sur deux164(*), a été supprimée lors de la dernière LFSS165(*).
3. Les conditions de prise en charge des séances, récemment revalorisées
Les tarifs des séances d'accompagnement, qui correspondent à la rémunération perçue par les psychologues, sont fixés par arrêté166(*) à 50 euros et ne peuvent donner lieu à dépassement167(*).
L'assurance maladie opère une prise en charge à hauteur de 60 %168(*) de ces tarifs, et le ticket modérateur fait l'objet d'une couverture obligatoire par les complémentaires santé dans le cadre du contrat responsable et solidaire169(*), couvrant 94 % des assurés. Le recours à Mon soutien psy n'induit donc pas de reste à charge pour l'essentiel des assurés.
Par ailleurs, l'article 5.2 de la convention-cadre conclue avec les psychologues participant au dispositif prévoit que le tiers payant s'applique obligatoirement sur la part prise en charge par l'assurance maladie au bénéfice de patients perçus comme particulièrement vulnérables, à savoir les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'État et les patients pour lesquels la séance est en lien avec une affection de longue durée, une maternité, un sinistre professionnel ou une invalidité.
4. Un bilan plutôt concluant trois ans après l'entrée en vigueur du dispositif, malgré des axes clairs d'amélioration
a) Un dispositif plébiscité par les patients, y compris les moins aisés
Au 30 juin 2024, 336 000 patients avaient bénéficié du dispositif Mon soutien psy, pour 1,8 millions de séances réalisées - soit une moyenne de 5,4 séances par bénéficiaire réalisées, dans 98 % des cas, avec le même psychologue, ce qui indique une adhésion satisfaisante au dispositif.
Près de quatre bénéficiaires sur dix ont entre 25 et 44 ans, tandis que, chez les mineurs, le dispositif touche particulièrement les jeunes garçons (20 % des hommes bénéficiaires ont entre 6 et 14 ans, contre 13 % chez les femmes).
Parmi les patients, 11 % sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, un total proche de la proportion que représentent ces assurés dans la population générale. Cela tend à démontrer que la prise en charge de l'assurance maladie et l'application du tiers payant lèvent au moins une partie des obstacles financiers à l'accès aux psychologues.
Il était toutefois possible de s'attendre à ce que la part de patients précaires inclus dans le dispositif excède celle constatée en population générale dès lors que le dispositif se fixait pour objectif d'offrir la possibilité à des personnes éloignées des soins de bénéficier d'un accompagnement psychologique, notamment ceux pour lesquels l'absence de prise en charge de l'assurance maladie constituait un frein.
Le coût du dispositif atteignait, au total, 35,9 millions d'euros au 30 juin 2024.
b) Une faible participation des professionnels au dispositif entraînant des disparités d'accès territorial, toutefois probablement en résorption
Au 30 juin 2024, 2 905 psychologues étaient conventionnés, sur les plus de 20 000 qui y seraient éligibles.
Le nombre de psychologues participant au dispositif a longtemps été un frein à son déploiement : le conventionnement Mon soutien psy a en effet, dans un premier temps, eu du mal à séduire la profession en raison de tarifs jugés insuffisamment rémunérateurs. Les tarifs à 40 euros pour l'entretien d'évaluation et 30 euros pour les séances suivantes, en vigueur jusqu'en juin 2024170(*), étaient en effet considérablement inférieurs aux honoraires que ces professionnels appliquent habituellement.
L'annonce de la revalorisation des tarifs en avril 2024, à un niveau proche de ceux que la profession pratique usuellement, a ainsi suscité une nouvelle vague de candidatures. Ces dernières ont atteint, en juin 2024, un niveau comparable à celui observé au lancement du dispositif, dix fois supérieur à celui qui avait cours trois mois plus tôt.
Évolution du nombre de psychologues candidats au dispositif
Source : Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositif « Mon soutien psy »
Miroir de la participation limitée des psychologues au dispositif, la répartition géographique des psychologues conventionnés sur le territoire présente d'importantes disparités.
La densité de psychologues conventionnés est particulièrement élevée dans les départements contenant une métropole (Paris, Rhône, Bouches-du-Rhône, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Gironde) et dans ceux qui faisaient l'objet de l'expérimentation de la Cnam préalable à la mise en oeuvre de Mon soutien psy, avec plus de 40 professionnels pour 100 000 habitants.
En revanche, dans certains départements ruraux, l'accessibilité au dispositif n'est pas assurée : des territoires comme la Creuse, l'Indre, le Cher, les Ardennes ou la Haute-Marne disposent de moins de 15 psychologues conventionnés pour 100 000 habitants, soit deux fois et demi moins que la moyenne. Les départements dans lesquels le niveau de vie est moins élevé, en premier lieu dans les outre-mer, sont également concernés par des difficultés d'accès à Mon soutien psy.
Il est toutefois vraisemblable que le nombre de psychologues conventionnés ait continué de progresser fortement depuis le recueil de ces données compte tenu du regain d'attractivité du dispositif, et que les disparités d'accès territoriales s'en trouvent maintenant réduites. Des progrès en la matière ont du reste déjà été constatés entre 2023 et 2024, puisque tous les départements sont désormais couverts.
Répartition de la densité des psychologues conventionnés pour 100 000 habitants
Source : Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositif « Mon soutien psy »
B. Le dispositif proposé : appliquer le tiers payant sur la part obligatoire dans le cadre de Mon soutien psy
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 20 quater, inséré à la faveur d'un amendement de Nathalie Colin-Oesterlé et ses collègues du groupe Horizons et Indépendants, vise à modifier l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, régissant le dispositif Mon soutien psy, afin de renvoyer à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités d'application du tiers payant sur la part obligatoire pour ce dispositif.
Il traduit en cela une des recommandations d'un rapport de l'Assemblée nationale sur la santé mentale des mineurs.
II - La position de la commission
Alors que le Premier ministre a désigné la santé mentale en grande cause nationale pour 2025, la commission juge souhaitable de faciliter l'accès des patients au dispositif Mon soutien psy en développant le recours au tiers payant sur la part obligatoire. Elle confirme en cela la position qu'elle avait émise lors des années précédentes, puisque la commission s'était également prononcée favorablement sur la suppression de la condition d'adressage, un frein au déploiement du dispositif.
S'il est loisible aux professionnels de santé exerçant en ville, depuis le 1er janvier 2017, de proposer le tiers payant à tous les assurés, il ne s'agit d'une obligation que dans un nombre limité de situations, pour lesquelles le tiers payant revêt un intérêt particulier. L'obligation de pratiquer le tiers payant sur la part obligatoire ne concerne ainsi que :
- les patients précaires, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'État ;
- pour ce qui concerne les actes en lien avec leur situation, les assurés dont l'état de santé le justifie, que sont les bénéficiaires de l'assurance maternité et les assurés en affection de longue durée ;
- pour ce qui concerne les actes en lien avec leur affection, les assurés bénéficiant d'un régime plus favorable, à savoir les victimes de sinistres professionnels et les victimes d'actes de terrorisme ;
- les actes considérés comme sensibles tels que l'interruption volontaire de grossesse ;
- les actes de santé publique, dans le cadre de la prévention proposée par l'assurance maladie ou concernant la contraception pour les jeunes de moins de 26 ans.
La commission estime qu'au vu des objectifs fixés à Mon soutien psy, incluant notamment le repérage et le traitement précoce des troubles psychiques afin d'éviter leur aggravation, ce dispositif relève de la prévention secondaire. Il apparaît donc pertinent de lui appliquer, comme à de nombreux autres actes de prévention proposés par l'assurance maladie, le tiers payant sur la part obligatoire, quelle que soit la situation de l'assuré.
La commission note également que la convention-cadre conclue avec les psychologues régissant le dispositif Mon soutien psy prévoit déjà l'application obligatoire du tiers payant sur la part prise en charge par l'assurance maladie dans bon nombre des situations précitées. Tel est le cas pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) ou de l'aide médicale d'État et les patients pour lesquels la séance est en lien avec une affection de longue durée, une maternité, un sinistre professionnel ou une invalidité. Aucune difficulté dans l'application de ce tiers payant n'a été communiquée à la rapporteure, dans un contexte marqué par l'amélioration tendancielle des délais de versement des sommes dues par l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant.
Par ailleurs, la commission tient à exprimer sa satisfaction d'avoir été entendue quant au besoin de revaloriser les tarifs de Mon soutien psy afin de conférer à ce dispositif l'attractivité nécessaire à son bon déploiement. Comme la commission a eu l'occasion de l'indiquer précédemment171(*), le succès de Mon parcours psy ne saurait être garanti sans l'engagement et l'implication des psychologues. Elle appelle le Gouvernement à évaluer rapidement les effets des différents ajustements apportés au dispositif en 2024 et 2025.
La commission a adopté l'amendement rédactionnel n° 647 de sa rapporteure.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Articles 20 quinquies et 20 nonies (nouveaux)
Mise en oeuvre
du dispositif de prise en charge
des protections périodiques
réutilisables
L'article 20 quinquies qui vise à interdire la présence de substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou de perturbateurs endocriniens dans les protections périodiques réutilisables prises en charge par l'assurance maladie.
L'article 20 nonies constitue une demande de rapport d'évaluation du dispositif de prise en charge par l'assurance maladie des protections périodiques réutilisables.
La commission propose de supprimer ces articles.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat ces articles insérés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le dispositif de prise en charge par l'assurance maladie des protections périodiques réutilisables, prévu par la LFSS pour 2024, n'a pas été mis en oeuvre
1. Un dispositif adopté lors de l'examen du PLFSS pour 2024 afin de lutter contre la précarité menstruelle
• La précarité menstruelle désigne la difficulté à se procurer des protections périodiques menstruelles en nombre suffisant. Elle est principalement causée par une insuffisance de moyens financiers, eu égard à la récurrence et au coût de ces achats. L'achat de protections menstruelles à usage unique représente un coût d'environ dix euros par mois. La préoccupation pour la santé menstruelle a gagné en visibilité ces dernières années, notamment sous l'influence des acteurs associatifs. Elle entre en résonance avec la précarité économique des étudiants.
Selon une étude conduite par Opinion Way pour l'association Règles élémentaires, quatre millions de femmes seraient victimes de précarité menstruelle en France. Selon la même enquête, 30 % des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà dû renoncer au moins une fois dans l'année à acheter des protections périodiques, et 14 % des jeunes de la même tranche d'âge sont fréquemment confrontées à cette situation.
En avril 2023, une proposition de loi visant à mieux lutter contre la précarité menstruelle avait été déposée à l'Assemblée nationale172(*), prévoyant notamment la distribution à titre gratuit de protections menstruelles dans les pharmacies, les établissements scolaires et d'enseignement du secondaire.
En parallèle, des collectivités territoriales ont décidé d'agir en mettant des protections gratuites à la disposition de certains publics. Par exemple, la région Île-de-France a financé l'installation de distributeurs de protections périodiques gratuites dans tous les lycées publics de la région. Plusieurs départements ont mis en oeuvre des actions similaires, à l'instar du Val-de-Marne, de l'Oise, de la Loire-Atlantique ou de la Meurthe-et-Moselle.
• L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a autorisé la prise en charge par l'assurance maladie des protections périodiques réutilisables pour les moins de 26 ans et pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S)173(*).
Une prise en charge intégrale est garantie pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires de la C2S174(*).
Les produits concernés par la mesure doivent être inscrits sur une liste fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Leur inscription, qui fait suite à une demande de l'exploitant, est subordonnée à un référencement, selon des critères fixés après un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui fait l'objet d'une publication. La loi prévoit que « ces critères tiennent compte de spécifications techniques et respectent des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement »175(*). Il peut également être tenu compte de l'intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l'objectif d'efficience des dépenses d'assurance maladie.
S'agissant de la composition des protections périodiques, la mention de non-toxicité des produits pour la santé est justifiée par le fait que plusieurs études ont démontré la présence de substances chimiques dans les protections menstruelles. En conséquence, l'Anses a procédé à une évaluation de la sécurité de ces produits en 2018 et en 2020. L'agence n'a toutefois pas mis en évidence de risque pour la santé des femmes exposées, au regard des seuils toxicologiques de référence.
Conformément aux recommandations de l'Anses, un décret a été publié visant à mieux informer les consommateurs sur la composition des produits utilisés, les éventuels risques sanitaires associés à leur composition ou leur utilisation et les précautions d'utilisation de ces produits176(*).
2. Un dispositif qui n'a pas toujours pas été mis en oeuvre
Ainsi que le rappelle le rapport du Sénat portant sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2025, la mesure inscrite à l'article 40 de la LFSS pour 2024 n'a, pour l'heure, bénéficié d'aucun texte réglementaire d'application et n'a pas été mise en oeuvre. Le Gouvernement ne donne pas d'explication sur cette carence. Force est toutefois de constater que la mesure n'a pas été considérée comme prioritaire.
Sont donc toujours en attente de publication :
- le décret en Conseil d'État précisant notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux personnes assurées ayant leurs menstruations ;
- l'arrêté fixant la liste des produits référencés et pris en charge par l'assurance maladie ;
- l'arrêté déterminant le tarif servant de base au calcul des protections périodiques réutilisables prises en charge à 100 % ainsi que le prix maximal de vente au public ;
- les critères de référencement, déterminés après avis de l'Anses, pour guider la décision d'inscription sur la liste précitée.
Pour mémoire, le coût financier de cette mesure était évalué à 94 millions d'euros pour la première année de mise en oeuvre (impact calculé sur quatre mois seulement, la projection ayant été réalisée en tenant compte d'une entrée en vigueur le 1er septembre 2024), puis de 97,2 millions d'euros en N+1 et de 53,5 millions d'euros en N+2.
B. Les articles additionnels adoptés à l'Assemblée nationale sont issus d'amendements d'appel visant à interpeler le Gouvernement quant à son inaction
L'article 20 quinquies propose de compléter l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale, qui fixe les conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables par l'assurance maladie, afin de prohiber l'inscription sur la liste fixée par arrêté ministériel de protections périodiques contenant « des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés ».
L'article 20 nonies propose qu'un rapport d'évaluation du dispositif de prise en charge des protections périodiques réutilisables soit remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la LFSS pour 2026. Ce rapport évaluerait également l'impact financier de la prise en charge des protections périodiques réutilisables pour les assurés âgés de plus de 26 ans.
II - La position de la commission
La commission a pris acte de l'adoption de ces articles par l'Assemblée nationale, sur la base d'amendements d'appel déposés par le groupe La France Insoumise-Nouveau Front Populaire.
Elle regrette que s'agissant d'une mesure inscrite en LFSS à l'initiative du Gouvernement, aucun texte d'application n'ait été pris en deux ans. L'inaction du Gouvernement semble bien relever d'une volonté délibérée d'abandonner la mesure, sans doute jugée non prioritaire dans un contexte budgétaire contraint. Cette carence volontaire, outre qu'elle est significative des errements de l'exécutif, relève d'une abstention coupable vis-à-vis des usagers en attente de ces prestations, et vis-à-vis du Parlement.
Sur le fond, la commission observe que l'article 20 quinquies est déjà satisfait sur le fond, et que l'article 20 nonies ne consiste qu'en un ajustement marginal du rapport d'évaluation de la mesure, qui n'est pas encore mise en oeuvre.
Ces deux articles n'ayant d'autre objet que d'interpeller le Gouvernement sur cette question, et l'article 20 quinquies étant déjà satisfait par la législation en vigueur, la commission a adopté deux amendements de suppression n° 648 et n° 651 de ces deux articles.
La commission propose de supprimer ces articles.
Article 20 sexies (nouveau)
Prolongation de
l'expérimentation des haltes « soins
addictions »
Cet article issu de deux amendements adoptés à l'Assemblée nationale propose de prolonger pour une durée de deux ans l'expérimentation des haltes « soins addictions ».
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Une expérimentation parvenue à son terme dont les évaluations successives ont souligné les impacts positifs
1. Une expérimentation qui s'inscrit dans une politique de réduction des risques
a) Un dispositif de réduction des risques et d'accès aux soins pour les usagers de drogues
La réduction des risques (RdR) correspond à une approche de santé publique qui vise à limiter les risques et les dommages médicaux, psychologiques et sociaux associés à la consommation de substances licites et illicites. La RdR inclut, par exemple, les programmes d'échange de seringues ou les actions de prévention des overdoses. Le concept naît et se développe dans les années 1980, en lien avec l'épidémie de VIH qui a fortement affecté les personnes s'injectant des substances. La RdR est plus particulièrement orientée vers des publics marginalisés. Elle s'incarne le plus souvent dans des dispositifs « d'aller vers », l'objectif étant de toucher des populations éloignées du soin et des accueils institutionnels.
Les salles de consommation à moindre risque, autrement dénommées salles de consommation supervisée ou, en France désormais, haltes soins addictions, s'inscrivent dans le champ de la RdR. L'expérience française en la matière n'est pas isolée. L'inspection générale des affaires sociales (Igas) dénombrait ainsi 151 salles de consommation supervisée dans 16 pays du monde en 2023, dont 39 au Canada, 3 aux États-Unis et 106 dans les différents pays européens, notamment en Suisse (14), en Allemagne (32), aux Pays-Bas (26) et en Espagne (16). La diffusion de ce modèle tient à ses impacts attendus sur la réduction de la mortalité par surdose, des hospitalisations et des complications aiguës associées aux injections (endocardites, risques infectieux, etc...).
b) Un cadre expérimental fixé par la loi dont le terme est prévu le 31 décembre 2025
• La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a fixé le cadre juridique autorisant l'ouverture, à titre expérimental, de salles de consommation à moindre risque. Ces structures, désormais nommées haltes « soins addictions » (HSA), sont des espaces de réduction des risques par usage supervisé dans lesquels les usagers de substances psychoactives ou de stupéfiants sont autorisés à consommer les produits qu'ils détiennent pour leur consommation personnelle. Les équipes présentes au sein des HSA délivrent des conseils en matière de réduction de risques pour sécuriser les pratiques de consommation.
Initialement, l'ouverture des salles de consommation à moindre risque a été prévue pour une durée de six ans à compter de l'ouverture de la première salle.
Le cadre expérimental prévu par la loi déroge à la législation en vigueur sur l'usage et la détention illicite de stupéfiants et garantit une immunité pénale aux consommateurs. Il prévoit en effet que la personne qui consomme des stupéfiants à l'intérieur d'une HSA ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants, et que les professionnels qui y exercent ne peuvent être poursuivis pour complicité d'usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l'usage illicite de stupéfiants.
• Ce cadre expérimental a été ajusté par l'article 83 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le périmètre des structures porteuses de HSA, initialement limité aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue (CAARUD), est étendu aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Les HSA peuvent être situées dans les locaux des CAARUD et des CSAPA ou dans des locaux distincts. Ils doivent respecter le cahier des charges national annexé à l'arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux HSA.
Enfin, le terme de l'expérimentation est décalé au 31 décembre 2025. Dans les six mois précédant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement doit adresser au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur l'impact de l'expérimentation en termes de santé publique et de réduction des nuisances dans l'espace public.
2. Une évaluation positive des deux HSA ouvertes depuis 2016
a) Une expérimentation menée à Paris et à Strasbourg dans des conditions sensiblement différentes
• Deux HSA ont été ouvertes en 2016, à Paris et à Strasbourg. Elles accueillent une file active d'environ 1600 personnes (781 à Paris et 823 à Strasbourg), soit moins de 1 % des 342 000 usagers problématiques de drogues estimés en France en 2023.
La HSA de Paris, réservée aux consommations par injection, accueille un volume de consommations huit fois supérieur à celui de la HSA de Strasbourg, en raison d'une fréquentation plus importante du lieu par ses usagers. La salle, située dans le quartier de la gare du Nord, n'est pas intégrée à une enceinte hospitalière. Sa fréquentation est en hausse ; 194 consommations par jour y sont recensées en moyenne.
La HSA de Strasbourg accueille quant à elle des consommations par injection et par inhalation. Elle est implantée dans l'enceinte des hôpitaux universitaires, en dehors du centre-ville. Au titre d'une expérimentation fondée sur l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, elle propose en outre 20 places d'hébergement, les usagers accueillis étant majoritairement des sans-abris.
Les coûts de fonctionnement des HSA sont imputés sur le sixième sous-objectif de l'Ondam, « autres prises en charge ». Le budget consacré au fonctionnement de la HSA de Paris s'élève à 3,86 millions d'euros et celui dédié à la HSA de Strasbourg à 1,14 million d'euros.
• Ces deux HSA offrent aux usagers de drogues un accueil anonyme, inconditionnel et gratuit pour leur permettre de consommer dans un cadre sécurisé, sous la supervision de professionnels qualifiés, réduisant ainsi les pratiques d'injection dangereuses, les risques infectieux et les overdoses. Elles permettent d'identifier les personnes nécessitant des soins médicaux et de les orienter vers une prise en charge adaptée ; les usagers peuvent notamment se voir proposer une prise en charge addictologique. Elles favorisent en outre la réinsertion sociale de publics en situation de marginalisation et contribuent à sécuriser l'espace public. Le rapport de l'Igas (cf. infra) indique par exemple que le nombre de seringues ramassées autour de la HSA de Paris depuis 2016 a été divisé par quinze.
b) Une évaluation globalement positive de l'expérimentation
Trois rapports ont évalué les résultats de l'expérimentation menée à Paris et à Strasbourg. Le premier, publié par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) en mai 2021, fait le bilan des salles de consommation à moindre risque, soit la première phase de l'expérimentation. Le second est un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), publié en 2023. Enfin, le pôle santé publique des Hospices civils de Lyon a élaboré un rapport d'évaluation des HSA diffusé en mai 2025.
• Dans son rapport de 2021, l'Inserm confirme l'intérêt des HSA comme dispositif de santé publique. Elle conclut ainsi son analyse fondée sur l'expérience française et une revue de littérature internationale : « les salles de consommation apportent des bénéfices individuels importants pour les personnes qui injectent de substances mais aussi à l'échelle collective. Ces lieux dédiés à l'injection et offrant un ensemble de services permettent de réduire les nuisances dans l'espace public préexistantes à l'ouverture de ces dispositifs et de faire des économies »177(*).
• En 2024, l'Igas préconise de prolonger l'expérimentation des HSA, considérant que « la fermeture de ces deux HSA dégraderait la tranquillité publique, mettrait en danger des usagers aux conditions de vie très précaires et mobiliserait inutilement des forces de police pour gérer les consommations rendues à l'espace public »178(*). Dans l'attente du rapport d'évaluation scientifique prévu pour le premier semestre 2025, elle recommandait l'inscription des HSA dans le droit commun, la pérennisation des structures existantes et l'ouverture de nouvelles salles dans les territoires jugés les plus opportuns par les autorités ministérielles. Elle considérait enfin que pour réussir, les HSA, maillon de la politique de RdR, devaient bénéficier d'un soutien politique assumé.
• Le rapport publié par l'équipe des Hospices civils de Lyon (HCL) en mai 2025 prolonge les conclusions des deux précédents rapports. Ses rédacteurs soulignent que « les HSA s'imposent aujourd'hui comme des dispositifs de santé publique à double vocation : d'une part, répondre aux besoins sanitaires et sociaux des usagers de drogues en grande précarité ; d'autre part, agir concrètement sur les nuisances générées dans l'espace public par des pratiques de consommation visibles et souvent mal comprises »179(*).
B. Une volonté de prolonger à nouveau l'expérimentation avant de statuer sur son éventuelle pérennisation
L'article propose de modifier l'article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui fixe le cadre de l'expérimentation des HSA.
Le a prolonge la durée de l'expérimentation de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027.
Le b circonscrit le champ de l'expérimentation à deux régions, soit les régions dans lesquelles sont aujourd'hui implantées les HSA : l'Île-de-France et la région Grand Est.
Le c vise à autoriser l'hébergement des usagers accueillis au sein des HSA lorsque les locaux d'accueil correspondent à des structures mobiles.
Enfin, le 2° précise l'objet du rapport d'évaluation, qui devrait porter sur l'amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique.
II - La position de la commission
La commission prend acte des évaluations successives et positives de l'expérimentation des HSA. Alors que le terme de l'expérimentation est fixé au 31 décembre, le calendrier impose une décision politique rapide. En l'absence de prolongation de l'expérimentation et à défaut de cadre juridique pérenne, les deux HSA de Paris et de Strasbourg seraient dans l'obligation d'interrompre leurs activités. Les usagers ne bénéficieraient plus de l'accompagnement qui leur est actuellement prodigué. Cette situation entraînerait inévitablement des ruptures de suivi des usagers, une aggravation de leur situation et, probablement, une résurgence des problèmes d'intranquillité publique dans les zones proches des HSA. Dans ce contexte, il est apparu indispensable à la commission de prolonger le cadre de l'expérimentation. La commission a par ailleurs jugé opportun de desserrer le champ de l'expérimentation en autorisant l'ouverture de places d'hébergement par les structures porteuses de HSA.
Alors que l'expérimentation a débuté en 2016 avec les salles de consommation à moindre risque, la commission considère qu'une décision politique assumée sur l'inscription des HSA dans le droit commun est désormais inévitable
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 septies (nouveau)
Élargissement de
l'expérimentation de la prise en charge des tests
de détection de la soumission chimique
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, vise à étendre à une région supplémentaire située dans les outre-mer l'expérimentation de la prise en charge par l'assurance maladie des tests et analyses permettant de détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte, adoptée lors de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. La soumission chimique, un phénomène en essor qui constitue un véritable problème de santé publique
1. La soumission chimique consiste en l'administration à des fins criminelles ou délictuelles de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace
Selon la définition donnée par l'édition 2022 de l'enquête de vigilance prospective et annuelle coordonnée par le centre d'addictovigilance de Paris sous la houlette de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), « la soumission chimique est l'administration à des fins criminelles (viols, actes de pédophilie) ou délictuelles (violences volontaires, vols) de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace ».
Soumission chimique, vulnérabilité
chimique
et agressions facilitées par les substances
La soumission chimique ne doit pas être confondue avec la vulnérabilité chimique, qui désigne les actes délictuels ou criminels facilités par l'état de fragilité d'une personne induit par une consommation volontaire de psychoactifs.
Soumission et vulnérabilité chimiques sont regroupés sous le terme d'agressions facilitées par les substances.
Si la soumission chimique n'est pas spécifiquement définie dans la loi française, les actes de soumission chimique relèvent de l'article 222-15 du code pénal au titre de l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. Les peines associées dépendent des conséquences subies par la victime et de la qualité de celle-ci : les peines maximales encourues s'échelonnent de trois ans d'emprisonnement dans le cas où l'administration de substances nuisibles cause moins de huit jours d'incapacité de travail à vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle entraîne la mort sans intention de la donner180(*).
La soumission chimique suppose l'utilisation de substances psychoactives afin d'altérer le niveau de conscience de la victime. Si les données de la base d'appels Drogue Info Service montrent « la persistance de l'idée reçue selon laquelle le GHB serait l'unique drogue du violeur »181(*), l'acide gamma-hydroxybutyrique (GHB) ne représente, en fait, que 5 % des soumissions chimiques vraisemblables en 2022.
Selon l'enquête précitée, les psychoactifs en cause sont majoritairement des médicaments sédatifs (57 % des cas en 2022) : principalement des anxiolytiques comme les benzodiazépines (25,2 %), des antihistaminiques (12,6 %) et des antalgiques opioïdes (11 %) à l'image du tramadol ou de la codéine.
Les substances non médicamenteuses, principalement des psychotropes illégaux, représentent 43,3 % des cas de soumission chimique vraisemblable - la MDMA, la cocaïne, le cannabis et le GHB représentant à eux quatre 75 % de cette catégorie.
2. Une augmentation « exponentielle » des cas suspectés
L'édition 2022 de l'enquête « Soumission chimique » du centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) de Paris, la dernière en date, recense 883 cas de soumissions chimiques possibles ou vraisemblables contre 436 en 2021, soit un doublement en un an.
Le CEIP-A de Paris évoque une augmentation « exponentielle », qu'il corrèle avec la libération de la parole sur les réseaux sociaux. Cette libération de la parole coïncide avec une attention médiatique accrue autour d'affaires judiciaires très commentées, qui ont contribué à donner une place à la question de la soumission chimique dans le débat public.
Il s'agit là d'un recensement des seuls signalements reportés à la justice, un décompte loin de mesurer l'ampleur réelle du phénomène selon l'association spécialisée M'endors pas, selon laquelle le phénomène est encore « largement sous-estimé » dès lors qu' « aucune enquête n'est en mesure de comptabiliser de façon exhaustive le nombre de victimes de soumission chimique par an en France du fait de la complexité de la problématique (faible judiciarisation des affaires, difficultés de la révélation de la preuve qui nécessiterait a minima une systématisation des analyses toxicologiques) ».
Les cas de soumission chimique vraisemblable sont principalement associés à des agressions sexuelles (62,9 %), des violences physiques ou des vols, avec des victimes majoritairement féminines (82,5 %). Aucun âge n'est épargné, mais près du quart des victimes présumées sont des mineurs, et l'âge médian est de 24 ans.
Sur des statistiques globales prenant également en compte les vulnérabilités chimiques, l'Île-de-France concentre plus de la moitié des signalements : c'est la région la plus touchée devant les Hauts-de-France. Les signalements sont concentrés dans les lieux festifs (47 % des cas), mais des suspicions existent également dans des lieux privés, notamment chez les mineurs, et dans des lieux publics non festifs.
3. La soumission chimique pose un important problème de santé publique
La soumission chimique, et plus encore depuis que les cas suspectés augmentent à un rythme très rapide, constitue un véritable problème de santé publique associé à des conséquences cliniques lourdes à court terme et à moyen ou long terme. À court terme, la soumission chimique est associée à des comas, des chutes et des contaminations à des infections sexuellement transmissibles. Selon l'enquête précitée, à long terme, il n'est pas rare que les victimes développent des troubles de l'usage de substances, des angoisses, des réactions phobiques, voire tentent de mettre un terme à leurs jours.
B. La subordination de la prise en charge des tests permettant de détecter une soumission chimique à un dépôt de plainte apparaît inadaptée à la situation des victimes de soumission chimique
Les tests ou analyses permettant de détecter une soumission chimique peuvent être pris en charge lorsque la victime présumée dépose plainte.
Toutefois, l'amnésie totale ou partielle associée à près des deux tiers des cas de soumission chimique en raison des substances psychoactives utilisées peut dissuader le dépôt de plainte chez les victimes. Alors que les souvenirs de l'agression ou de l'intoxication sont imprécis, les victimes redoutent fréquemment de ne pas savoir répondre aux questions posées lors du dépôt de plainte, voire doutent tout simplement de l'existence même de l'agression.
En l'absence de dépôt de plainte, aucune prise en charge n'est possible pour ces tests relevant de la médecine légale et non inscrits comme remboursables à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM). Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom), le coût des analyses et tests nécessaires peut avoisiner 1 000 euros pour les victimes, constituant une barrière financière très dissuasive au recours.
Dans ces conditions, le Cnom a demandé aux pouvoirs publics, dans un communiqué en date du 24 octobre 2024, « de prendre des mesures concrètes pour faciliter l'accès aux tests et analyses, en prenant en charge leur coût dans le cadre de l'Assurance maladie ».
À l'initiative de la députée Sandrine Josso, le législateur en a tiré les conséquences en adoptant, lors de la dernière LFSS182(*), une expérimentation, pour trois ans et dans au plus trois régions, de la prise en charge par l'assurance maladie de recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique, même en l'absence de dépôt de plainte préalable.
Cette expérimentation n'est pas encore entrée en vigueur mais devrait débuter prochainement dans les trois régions sélectionnées : l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire.
C. Le dispositif proposé : un élargissement de l'expérimentation à une quatrième région
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 20 septies, issu d'un amendement de Sandrine Josso et certains de ses collègues des groupes Les Démocrates, Ensemble pour la République, Droite Républicaine et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, relève de trois à quatre le nombre maximal de régions susceptibles de participer à l'expérimentation sur la prise en charge des tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique même en l'absence de dépôt de plainte. Il modifie pour cela l'article 68 de la LFSS pour 2025183(*), qui est le support législatif de cette expérimentation.
Il est indiqué, dans l'exposé des motifs, que cet élargissement vise à inclure une région située dans les outre-mer, qui pourrait être la Guadeloupe.
II - La position de la commission
La commission a, lors de la dernière LFSS, « soutenu sans réserve » l'expérimentation, estimant que « la conditionnalité de la prise en charge de ces tests à un dépôt de plainte n'est pas adaptée à la réalité de la situation des victimes potentielles, souvent en proie à une amnésie totale ou partielle ». Elle avait alors estimé que la mise en oeuvre d'une prise en charge en l'absence de dépôt de plainte serait susceptible de permettre aux victimes de déposer plainte plus facilement si elles le souhaitent, puisque celles-ci auraient connaissance au préalable de la matérialité de l'administration d'une substance psychoactive, malgré l'amnésie qui peut les frapper.
Elle a donc accueilli favorablement l'élargissement de l'expérimentation du remboursement des tests de détection de la soumission chimique à une quatrième région. À l'initiative de la rapporteure, elle a adopté un amendement n° 649 précisant que la région supplémentaire intégrée à l'expérimentation devra se situer dans les outre-mer, afin de sécuriser le dispositif.
La commission rappelle également son souhait que le Gouvernement mène une campagne de sensibilisation en population générale et de formation auprès des professionnels de santé au sujet de la soumission chimique, dont les manifestations sont aujourd'hui encore trop méconnues, donnant lieu à des situations d'errance thérapeutique préjudiciables aux victimes.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 20 octies (nouveau)
Demande de rapport sur le bilan du
dispositif Mon soutien psy
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit une demande de rapport afin de dresser le bilan du dispositif Mon soutien psy.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Mon soutien psy permet la prise en charge par l'assurance maladie de séances chez le psychologue
Le dispositif Mon soutien psy, mis en place par la LFSS pour 2022184(*), permet aux patients mineurs185(*) ou majeurs souffrant de troubles psychiques légers à modérés186(*) de bénéficier de séances chez un psychologue à un tarif opposable de 50 euros187(*), prises en charge188(*) à 60 %189(*) par l'assurance maladie. Il vise à lever les barrières financières s'opposant à l'accompagnement psychologique, particulièrement pour les plus précaires, et à favoriser le repérage et le traitement précoce des troubles psychiques, avant qu'ils ne s'aggravent.
Les patients participant au dispositif disposent de douze séances190(*) prises en charge chaque année avec un professionnel préalablement conventionné avec l'assurance maladie191(*), choisi librement192(*).
Une analyse plus approfondie du cadre juridique du dispositif et de ses résultats à ce jour est présentée dans le commentaire de l'article 20 quater.
B. Le dispositif proposé : une demande de rapport sur le bilan de Mon soutien psy
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 20 octies, inséré à l'initiative de Sébastien Peytavie et ses collègues du groupe Écologiste et Social, consiste en une demande de rapport pour dresser le bilan du dispositif Mon soutien psy et ses conséquences sur la restriction des conditions d'accès aux soins psychiques.
Le rapport devra notamment, pour ce faire, évaluer l'évolution du nombre de professionnels engagés au regard du tarif des séances et l'effet de ce dispositif sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques. Il apprécie également l'impact des restrictions du nombre de séances remboursées sur la qualité de la prise en charge.
Le rapport sera tenu de se prononcer sur l'arrêt du dispositif, au profit d'un renforcement des moyens des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques.
II - La position de la commission
Alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale pour 2025, la commission maintient son attachement au dispositif Mon soutien psy, dont elle a soutenu chacun des élargissements.
Elle se félicite que les revalorisations tarifaires accordées aient considérablement renforcé l'attractivité du dispositif pour les psychologues, qui constituait jusque-là le principal frein observé à Mon soutien psy, et que le Gouvernement ait choisi de rehausser le nombre de séances remboursables.
La commission relève, enfin, que la proportion de patients bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (C2S) parmi ceux ayant recours à Mon soutien psy, 11 %, avoisine la proportion de bénéficiaires de la C2S en population générale. Cela tend à démontrer l'efficacité du dispositif pour favoriser l'accès à l'accompagnement psychologique, y compris chez les patients précaires.
Par conséquent, la commission ne souscrit pas à l'analyse qui sous-tend cet article 20 octies concernant les restrictions d'accès aux soins psychiques qu'engendrerait Mon soutien psy.
S'agissant, en outre, d'une demande de rapport, la commission adopté un amendement n° 650 de sa rapporteure ayant pour objet de supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Articles 20 nonies (nouveau)
Mise en oeuvre du dispositif de prise
en charge
des protections périodiques réutilisables
Cet article est commenté à l'article 20 quinquies.
Article 20 decies (nouveau)
Demande de rapport sur le parcours de
soins
après le traitement d'un cancer
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du parcours de soins après le traitement d'un cancer.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Depuis 2020, les agences régionales de santé mettent en place un parcours de soins global pour les personnes traitées d'un cancer
En application de l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, depuis 2020193(*), les agences régionales de santé (ARS) sont chargées de mettre en place et de financer un « parcours de soins global » soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant194(*) ou ayant reçu un traitement pour un cancer.
Ce parcours comprend un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins identifiés par le médecin prescripteur.
Sa mise en place visait à garantir le suivi des patients, le traitement d'un cancer pouvant avoir un impact durable sur leur qualité de vie dont certaines séquelles, en particulier au travers de douleurs chroniques ou d'une réduction de la mobilité, peuvent devenir handicapantes.
En effet, dans l'enquête VICAN51 réalisée par l'INCa en 2015 et dont les résultats ont été publiés en 2018195(*), si 63,5 % des personnes interrogées déclaraient avoir conservé des séquelles consécutives à la maladie, seulement 26,1 % indiquaient disposer d'un suivi médical ou paramédical pour ces séquelles et 33,1 % des répondants déclaraient ne disposer d'aucun suivi spécifique en médecine générale de leur cancer diagnostiqué il y a cinq ans.
B. Le présent article prévoit la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre de ce parcours de soins
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Issu d'un amendement de Marine Hamelet (Rassemblement national), dont le rapporteur de la commission des affaires sociales et le Gouvernement ont demandé le retrait, il prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du 2° du I de l'article 59 de la LFSS pour 2020, soit la disposition qui a créé le parcours de soins global post-traitement d'un cancer.
II - La position de la commission
L'article 59 de la LFSS pour 2020 dispose déjà que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique.
Pour cette raison, et suivant sa position constante sur les demandes de rapport non justifiées par une circonstance particulière, la commission a adopté l'amendement de suppression n° 652 présenté par la rapporteure.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 20 undecies (nouveau)
Demande de rapport sur les
financements attribués aux centres d'études
et de
conservations des oeufs et du sperme (Cécos)
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à demander un rapport au Gouvernement sur l'Ondam voté lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 afin de connaître le fléchage des financements attribués aux centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme (Cécos).
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : une demande de rapport sur les financements attribués aux centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme (Cécos)
A. Des centres au coeur de l'assistance médicale à la procréation
1. Des centres pluridisciplinaires implantés au sein d'établissements de santé
Les Cécos sont des centres spécialisés dans le don de gamètes et la conservation de la fertilité (ovocytes, spermatozoïdes, tissus gonadiques). Ils participent à l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les personnes souhaitant procéder à l'autoconservation de leurs gamètes et pour les personnes ayant recours à l'AMP avec don.
Ils sont constitués d'une équipe pluridisciplinaire, regroupant médecins, biologistes, psychologues, généticiens, et d'une plateforme de cryobiologie spécialisée.
Chaque centre est en relation avec un centre d'exploration et de traitement de la fertilité et d'AMP mais également avec des services de traitement du cancer, afin de proposer une préservation de la fertilité avant traitement à des hommes, femmes ou enfants.
Créés dans les années 1970, sous forme de « banques de sperme », les Cécos ont été intégrés au système hospitalo-universitaire au début des années 1990. Ils sont aujourd'hui hébergés au sein d'établissements hospitaliers et principalement financés par le budget hospitalier.
La fédération des Cécos, qui représente la quasi-totalité des centres autorisés au don et à la conservation des gamètes, recense 33 Cécos sur le territoire.
L'Agence de la biomédecine recense en 2024 :
- 31 centres de dons de spermatozoïdes ;
- 36 centres d'AMP autorisés et actifs dans l'AMP avec don d'ovocytes (parmi les 104 centres clinico-biologiques de statuts public et privé) ;
- 42 centres clinico-biologiques autorisés et actifs dans l'auto-conservation non médicale des ovocytes.
2. Des demandes en forte augmentation depuis la loi de bioéthique de 2021
La loi de bioéthique de 2021196(*) a étendu l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires sans motif médical et a ouvert la possibilité de procéder à une autoconservation de ses gamètes en dehors de tout motif médical, pour les femmes comme pour les hommes.
Depuis, les Cécos font face à une forte demande.
Ainsi, selon l'Agence de la biomédecine, les demandes de dons de spermatozoïdes sont passées d'environ 2 000 par an avant 2021 à près de 13 000 en 2024, après avoir atteint un pic de 17 000 en 2022. Le délai moyen de prise en charge pour une AMP avec don de spermatozoïdes était de 17,7 mois fin 2024. Celui pour une AMP avec don d'ovocytes était de deux ans avec, fin 2024, 2 770 couples ou femmes non mariées en attente.
Les demandes d'auto-conservation des gamètes augmentent elles aussi. En 2023, 13 000 patients ont bénéficié d'une conservation médicale de gamètes en raison d'une possible altération future de leur fertilité. 15 500 personnes ont émis une demande d'autoconservation non médicale des ovocytes en 2024, avec un délai moyen de 13 mois entre la demande de rendez-vous et la conservation effective.
Pour faire face à cette demande et s'efforcer de réduire les délais d'attente, les Cécos et l'Agence de la biomédecine organisent des campagnes d'information afin d'augmenter le nombre de dons, notamment par le biais d'une campagne #FaitesDesParents. L'Agence de la biomédecine juge que la dynamique de recrutement des donneurs de spermatozoïdes est aujourd'hui positive mais que le nombre de donneuses d'ovocytes est insuffisant.
Lors de son audition devant la commission en janvier dernier197(*), le président du conseil d'administration de l'Agence de biomédecine précisait que certains Cécos étaient davantage receveurs, d'autres davantage donneurs, et que l'Agence de la biomédecine mettait donc en place un registre national pour optimiser la gestion des gamètes entre les différents centres.
B. Une demande de rapport sur le fléchage des financements attribués aux Cécos dans les dotations attribuées aux établissements hôtes
L'article 20 undecies, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Ségolène Amiot, demande au Gouvernement de remettre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'article 97 de la LFSS pour 2025, qui fixe le montant de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) et de ses sous-objectifs pour 2025.
Les auteurs de l'amendement à l'origine de la création de cet article additionnel indiquent souhaiter alerter sur le fléchage des financements des Cécos au sein des établissements de santé qui les hébergent.
Ils déplorent les délais d'attente pour accéder à ces centres et le manque de moyens dont ils bénéficient.
Ils estiment que « le fléchage des dotations directement aux centres leur donnerait les moyens de mettre en place des actions efficaces, comme les campagnes annuelles ou biannuelles d'information adaptées à chaque territoire, et d'agir sur les délais d'attente pour garantir aux patients l'accès à leur droit ».
II - La position de la commission
La commission est naturellement attachée aux Cécos qui jouent un rôle primordial dans la préservation de la fertilité et l'accès à l'assistance médicale à la procréation.
Pour autant, elle ne juge pas nécessaire de prévoir un rapport spécifique sur ce sujet, qui relève davantage des réflexions à mener autour des modalités de financement des établissements de santé, et notamment des dotations attribuées au titre de l'assistance médicale à la procréation. En outre, le dispositif de l'amendement vise en réalité un champ bien plus large, couvrant toutes les dépenses de l'Ondam 2025, sans cibler expressément les Cécos.
Suivant la position constante de la commission sur les demandes de rapport non justifiés par une circonstance ou une nécessité particulière, la rapporteure propose, avec l'amendement n° 653, de supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 20 duodecies (nouveau)
Rapport sur la mise en place des
bilans de santé pour les mineurs
pris en charge par l'aide sociale
à l'enfance
Le présent article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application de l'article 49 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : un rapport sur la mise en oeuvre des bilans de santé pour les mineurs pris en charge par la protection de l'enfance
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 223-1-1 dans sa rédaction issue de la LFSS pour 2020 prévoit « un bilan de santé obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance » en lieu et place de l'évaluation médicale et psychologique du mineur prévue depuis 2016198(*).
Ce bilan, pris en charge par l'assurance maladie, doit permettre « d'engager un suivi médical régulier et coordonné » et d'identifier « les besoins de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant ». Il est pleinement intégré dans le projet pour l'enfant qui « vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social »199(*).
Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements de la protection de l'enfance relevait qu'en 2019 seuls 44 % des conseils départementaux avaient mis en oeuvre l'évaluation médicale prévue par la loi de 2016 et 28 % seulement l'avaient rendu systématique200(*).
La loi de 2022201(*) est venue ajouter la nécessaire formalisation de la coordination du parcours de soins, notamment pour les mineurs en situation de handicap.
Pour soutenir cet enjeu de manière opérationnelle, dans le cadre des dispositions de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, deux expérimentations Santé protégée (enfants et adolescents) et Pegase (ciblant les enfants confiés en pouponnières) ont été autorisées.
Les deux expérimentations se sont terminées en 2024 et sont entrées en phase transitoire pour une période de 16 mois pour permettre aux travaux de pérennisation dans le droit commun de s'engager.
II - La position de la commission
La protection de l'enfance connaît depuis plusieurs années une crise profonde : financement, crise d'attractivité, fragmentation des acteurs, dégradation des conditions de travail, hausse du nombre d'enfants pris en charge, complexification des parcours... Dans ce contexte, l'accès à la santé des mineurs protégés est pourtant essentiel, compte tenu des besoins de ce public particulièrement vulnérable. Selon un rapport de la Cour des comptes paru en 2023, les enfants pris en charge par l'ASE représentent jusqu'à la moitié des adolescents hospitalisés à temps complet notamment pour des troubles du comportement et des syndromes dépressifs202(*). Par ailleurs, les enfants et adolescents en situation de handicap comptent pour 15 % des enfants pris en charge par la protection de l'enfance.
La multiplication des scandales et les récents rapports (Assemblée nationale, CESE, Défenseur des droits, etc.) mettent tous en lumière les difficultés rencontrées par la protection de l'enfance. Le rapport de la commission des affaires sociales sur l'application des lois relatives à la protection de l'enfance en 2023203(*) constatait quant à lui déjà l'inapplication des dispositions législatives en la matière résultant d'une responsabilité partagée : politiques inégales des départements, désengagement de l'État, pratiques antérieures des professionnels solidement ancrées.
Le Sénat a récemment lancé des travaux sur le sujet afin de dépasser le seul constat des difficultés et de pouvoir proposer des recommandations opérationnelles visant à améliorer concrètement le fonctionnement de cette politique publique.
Les rapports sur cette question centrale ne manquent pas et il faut désormais passer aux actes. Dès lors, conformément à la pratique habituelle du Sénat en la matière, la rapporteure a déposé un amendement n° 654 visant à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 21
Améliorer l'accès aux soins
par diverses mesures du pacte
de lutte contre les déserts
médicaux
Cet article propose de mettre en oeuvre quatre mesures visant à renforcer l'accès aux soins dont certaines constituent une traduction des engagements inscrits dans le pacte de lutte contre les déserts médicaux.
En premier lieu, l'article vise à préciser les modalités de facturation des actes réalisés par les docteurs juniors de médecine générale en stage ambulatoire ainsi que leurs conditions de rémunération.
En deuxième lieu, l'article propose de créer un contrat de praticien territorial en médecine ambulatoire pour les jeunes médecins généralistes non installés ou installés depuis moins d'un an.
En troisième lieu, l'article prévoit d'assouplir les conditions d'ouverture des officines pharmaceutiques dans les territoires ruraux.
Enfin, il vise à créer une nouvelle catégorie de structures spécialisées en soins non programmés, auxquelles serait alloué un financement forfaitaire tenant compte de la file active de patients pris en charge.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Face à la dégradation de l'accès aux soins, une multiplication des initiatives parlementaires et gouvernementales
1. Une fragilisation de l'offre de soins de ville et une tendance au creusement des inégalités territoriales d'accès aux soins
L'accès aux soins souffre de fragilités sur la quasi-totalité du territoire national. À l'occasion de la présentation de son pacte de lutte contre les déserts médicaux, le Gouvernement a indiqué que 87 % du territoire national était classé en désert médical204(*).
a) Une médecine générale sous tension
L'accès aux médecins généralistes libéraux, maillon essentiel de l'accès aux soins de premier recours, souffre de carences importantes et persistantes.
En septembre 2022, 6,7 millions de patients ne disposaient pas de médecin traitant, soit environ 12 % de la population205(*). Parmi eux, 714 000 personnes souffrent d'une affection de longue durée (ALD)206(*).
Une étude de la direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques (Drees) a mis en évidence que près de deux tiers des médecins généralistes - 65 % - déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients, une proportion en hausse de 12 points entre 2019 et 2022207(*).
80 % des médecins généralistes libéraux jugent par ailleurs insuffisante l'offre de médecine générale dans leur zone d'exercice208(*).
Perception de l'offre de soins de médecine
générale sur le territoire d'exercice
des médecins
généralistes
Source : Drees, Études et résultats, n°1267, mai 2023
Les difficultés d'accès aux médecins généralistes doivent être corrélées à l'évolution négative des effectifs de médecins libéraux depuis plus de dix ans.
Tous modes d'exercice confondus, les effectifs de médecins généralistes sont en recul de 1,4 % entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2025209(*). S'agissant plus spécifiquement de la médecine libérale, qui représente 56 % des effectifs, la France aurait perdu 7 000 médecins généralistes libéraux entre 2012 et 2022 et 2 000 médecins spécialistes pouvant être consultés en accès direct210(*). De telles évolutions ne sont pas sans conséquence sur l'offre de soins.
Évolution de la démographie des
professionnels
de santé libéraux entre 2012 et
2022
Source : commission des affaires sociales, d'après les données de la Cour des comptes
Ce constat général masque des disparités importantes, reflet des déséquilibres territoriaux de l'organisation de l'offre de soins de ville.
Ainsi, la part de patients dépourvus de médecins traitants varie fortement d'un département à l'autre : elles s'élèvent respectivement à 15 % et 18% dans la Creuse et à Paris, mais à 9,3 % seulement en Charente-Maritime. En parallèle, les départements médicalement les plus denses sont ceux qui continuent à attirer le plus de praticiens. Entre 2012 et 2022, la densité de médecins généralistes a ainsi augmenté de 20 % dans les Hautes-Alpes et de 18 % dans le Morbihan, alors qu'elle diminuait sur le territoire national pris dans son ensemble (- 11,1 %).
Finalement, si l'accessibilité potentielle localisée (APL) des médecins généralistes se dégrade globalement (- 1,4 % entre 2022 et 2023), le rapport d'accessibilité entre les 10 % de la population les mieux dotés en médecins généralistes et les 10 % les moins bien dotés augmente de 5 %.
Non seulement l'accessibilité moyenne des médecins généralistes décroît, mais les inégalités d'accès territoriales continuent de se creuser. À cet égard, le Gouvernement rappelle que la part des zones d'intervention prioritaire (ZIP) est passée de 18 % en 2017 à 37 % en 2025.
Loin de se résorber, les déséquilibres territoriaux tendent donc à s'aiguiser, si ce n'est à s'accélérer.
b) Une couverture officinale en recul depuis dix ans
Les pharmaciens d'officine connaissent des évolutions tout aussi défavorables.
D'une part, leur démographie apparaît également en recul, de 10,6 % entre 2012 et 2022211(*).
D'autre part, la densité des pharmacies d'officine connaît une baisse significative depuis une dizaine d'années.
Avec 20 142 pharmacies d'officine au 1er janvier 2023, la France dispose d'un réseau officinal relativement dense qui contribue à l'accès aux soins dans les territoires. En 2023, un tiers environ des officines étaient installées au sein de communes de moins de 5 000 habitants et un tiers dans des communes de 5 000 à 30 000 habitants212(*).
Variation du nombre d'officines par département entre 2012 et 2022
Source : Conseil national de l'ordre des pharmaciens, 2023
Toutefois, entre 2012 et 2022, 8,2 % des pharmacies d'officine ont fermé, soit plus de 1 800213(*) ; sur la même période, la population de France métropolitaine augmentait de 3,7 %214(*). Le rythme de fermetures des officines, de l'ordre de 200 par an depuis 2015, a ainsi plus que doublé sur la dernière décennie par rapport à la période 2007-2014215(*).
Plusieurs mesures législatives ont eu pour ambition de compenser ces évolutions et de consolider le réseau officinal dans les territoires les plus fragiles.
Ainsi, une ordonnance de janvier 2018216(*) a autorisé, dans un cadre régulé par les ARS, l'ouverture d'une officine dans un ensemble de communes contiguës en étant dépourvues, lorsque l'une recense au moins 2 000 habitants et que toutes totalisent au moins 2 500 habitants. Les territoires concernés sont identifiés par arrêté du directeur de l'ARS, en fonction de divers critères permettant d'apprécier la fragilité d'accès au médicament pour la population217(*).
Par ailleurs, la loi ASAP de décembre 2020218(*) a autorisé, à titre expérimental, la création d'une officine lorsque la dernière officine d'une commune a cessé son activité sans avoir trouvé de repreneur et que l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population y est compromis. Des premières expérimentations ont récemment été mises en oeuvre.
c) Un accès aux soins non programmés insuffisamment régulé
Face à la raréfaction de l'offre de soins dans de nombreux territoires, et compte tenu de la saturation des services d'urgence hospitaliers, de nouvelles structures de soins non programmés se sont développées, en dehors du cadre régulé du service d'accès aux soins (SAS) et de la permanence des soins ambulatoire (PDSA).
Ces structures contribuent à prendre en charge une demande de soins croissante, imputable au vieillissement de la population mais aussi à l'évolution du comportement des usagers, en attente de réponses rapides y compris pour des prises en charges bénignes ou non urgentes.
N'étant régies par aucun cadre juridique spécifique, les ARS ne disposent aujourd'hui d'aucun outil pour réguler la création, l'implantation et le fonctionnement de ces structures dans les territoires. Les difficultés associées à leur développement ont pourtant été soulignées dès 2018, dans un rapport du député Thomas Mesnier sur l'organisation de l'accès aux soins non programmés219(*) : « Si un tel effort de renfort et d'organisation de ce service public confié aux médecins n'était pas entrepris, il ne fait guère de doute que des initiatives privées à but lucratif, qui sélectionnent les patients, et dont on voit déjà l'émergence, se développeront de façon désorganisée avec le risque qu'elles encouragent une approche consumériste, ignorant les parcours de soins et la recherche d'un égal accès aux soins sur le territoire ».
Dans son rapport Charges et produits pour 2025, la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a souligné le risque de désorganisation des parcours de soins ainsi que les dérives attachées à l'optimisation tarifaire que peuvent pratiquer certaines de ces structures.
Le Sénat a également alerté sur les pratiques financières peu éthiques de certains centres de santé non programmés dans son rapport sur la financiarisation de l'offre de soins, appelant à une régulation de leurs activités par les ARS220(*).
2. Une priorité d'action des gouvernements successifs et une préoccupation majeure des parlementaires
Depuis 2018 et l'annonce de la feuille de route « Ma Santé 2022 », les plans d'actions gouvernementaux se sont succédé, plaçant l'accès aux soins au coeur des ambitions affichées. Si le Ségur de la santé s'est conclu par des annonces qui ont principalement concerné les établissements de santé, nombre de textes législatifs et réglementaires ont depuis visé à consolider l'offre de soins de ville et à réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins.
• Plusieurs textes d'initiative parlementaires ont ainsi contribué à cette ambition ces dernières années, qu'il s'agisse de la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification221(*), ou de la loi n° 2021-502 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé222(*).
Plus récemment, le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, adoptée au Sénat le 13 mai 2025, qui comporte plusieurs mesures visant à réduire les inégalités d'accès aux soins en ville. Le texte prévoit notamment de subordonner l'installation des médecins généralistes libéraux en zone sur-dense à un engagement d'exercice à temps partiel en zone sous-dense. Il propose également d'appliquer aux médecins des tarifs spécifiques en zone sous-dense, sans reste à charge pour les 97 % de Français ayant souscrit à une complémentaire santé, afin de rendre ces territoires plus attractifs.
• Chaque année, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) peuvent également constituer un vecteur pour de nouvelles mesures visant à améliorer l'offre de soins. À cet égard, la LFSS pour 2023 comportait plusieurs dispositifs poursuivant cet objectif, en particulier :
- la création du cadre permettant la mise en oeuvre d'une quatrième année de médecine générale réalisée en stage ambulatoire223(*) ;
- l'organisation par les agences régionales de santé en concertation avec le conseil de l'ordre des médecins, de consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les déserts médicaux à titre expérimental224(*) ;
- l'assouplissement des règles du cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant dans un désert médical225(*).
La quatrième année de
médecine générale parachève
la réforme
du troisième cycle des études médicales
La mise en oeuvre de la quatrième année de médecine générale à partir du 1er novembre 2026 parachèvera la réforme du troisième cycle des études médicales.
Cette réforme, engagée en 2017, a conduit à réorganiser en trois phases la dernière séquence de formation des médecins, qui succède au premier et au deuxième cycles. Depuis 2017, le troisième cycle se décompose en une phase socle d'une durée d'un an, une phase d'approfondissement d'une durée de deux à trois ans et une phase de consolidation d'une durée d'un à deux ans. Les durées de ces deux dernières phases varient selon les spécialités.
Organisation du troisième cycle des études médicales
Source : Intersyndicale nationale des internes (Isni)
La médecine générale se distinguait des autres spécialités du fait de l'absence de phase de consolidation dans sa maquette de formation. La création d'une quatrième année corrige donc cette spécificité et aligne le format du DES de médecine générale sur celle des quarante-trois autres DES226(*).
Les premiers docteurs juniors de médecine générale entreront en fonctions le 1er novembre 2026. La loi227(*) prévoit qu'ils réalisent leur stage de dernière année dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
La création d'une quatrième année de médecine générale, qui répond à la nécessité de professionnaliser la formation des futurs médecins généralistes et d'en réviser le contenu pédagogique, devrait également constituer un moyen d'améliorer l'accès aux soins en ville.
Par ailleurs, le projet de LFSS pour 2025 comportait une mesure régulation de l'activité des structures de soins non programmés. Introduites à l'Assemblée nationale, enrichies au Sénat, ces dispositions ont toutefois été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025, en raison d'un effet jugé trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie.
• Enfin, un nouveau pacte visant à lutter contre les déserts médicaux a été présenté par M. François Bayrou, alors Premier ministre le 25 avril 2025. Il comporte notamment les mesures suivantes :
- « Mettre en oeuvre la 4ème année d'internat de médecine générale dès le 2 novembre 2026 avec une valorisation très forte pour la réalisation des stages en zone très sous-dense » ;
- « Un nouveau statut de « praticien territorial de médecine ambulatoire » : pour les jeunes médecins en début de carrière souhaitant s'installer après leurs études dans ces « zones rouges ». Il s'agira d'un engagement d'exercice de deux ans minimum, dans ces territoires, avec une garantie de revenu et une exonération de jours de solidarité territoriale. Ce statut n'a pas vocation à permettre l'accès au secteur 2 » ;
- « Faciliter la création à titre dérogatoire d'une officine dans une petite commune (moins de 2 500 habitants) où la dernière pharmacie a récemment fermé ».
Ce pacte présente un calendrier de l'ensemble des mesures qu'il propose sur 2025 et 2026, en s'appuyant sur des textes d'initiative parlementaire en cours d'examen dans les deux assemblées, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et sur divers textes réglementaires d'application.
B. Des mesures hétérogènes pour renforcer l'offre de soins dans les territoires
1. Rémunérer les docteurs juniors de médecine générale réalisant un stage ambulatoire
Il est proposé de rétablir un article L. 162-5-11 dans le code de la sécurité sociale228(*) pour définir les conditions de facturation des actes par les docteurs juniors (DJ) de médecine générale en stage ambulatoire ainsi que leurs conditions de rémunération.
Aux termes du I de ce nouvel article, dans le cadre du stage qu'il réalise au cours de sa dernière année de DES, le docteur junior de médecine générale est tenu de facturer les soins qu'il délivre aux tarifs conventionnels, sans dépassement d'honoraire et en appliquant le tiers payant.
La somme correspondant à la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire n'est pas perçue par le docteur junior. Cette règle déroge aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les professionnels de santé pratiquant le tiers-payant reçoivent de l'assurance maladie la part des dépenses dont elle assure le remboursement, et que ce versement est garanti au professionnel dans un délai fixé en principe à sept jours ouvrés229(*) s'il utilise la carte vitale de l'assuré pour facturer son activité.
Le II dispose que le paiement de la rémunération du docteur junior est assuré par le centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement. Le montant de la rémunération versée tient compte des sommes perçues par le docteur junior au titre des frais non pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, acquittés par les assurés et directement versés au docteur junior.
Selon le III, ces sommes sont déduites du montant de la rémunération versée par le CHU et assimilées à des émoluments pour l'application des règles de prélèvements sociaux et fiscaux.
En conséquence, à l'instar de tous les étudiants de troisième des études médicales, la rémunération des docteurs de médecine générale en stage ambulatoire serait versée par le CHU. En revanche, dans le modèle proposé, le docteur junior devrait collecter directement le ticket modérateur auprès du patient, dont le total des sommes serait chaque mois retranché du montant des émoluments dus par le CHU230(*).
Ce modèle impliquerait de créer des circuits d'information entre la caisse primaire d'assurance maladie et le CHU de rattachement pour pouvoir écrêter à due concurrence du montant des tickets modérateurs collectés les émoluments du docteur junior.
Modalités de rémunération des docteurs juniors de médecine générale
Conformément à l'article L. 6153-3 du code de la santé publique, le statut des docteurs juniors, qui inclut leurs conditions de rémunération, est en principe fixé par voie réglementaire.
Tout docteur junior perçoit des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant tient compte de l'avancement dans le cursus (28 495,49 euros par an)231(*). Il perçoit également une prime d'autonomie supervisée annuelle dont le montant est fixé à 5 000 euros, ou à 6 000 euros lors de la deuxième année de phase 3 lorsque celle-ci est prévue par la maquette de formation232(*). D'autres primes et indemnités peuvent être versées au docteur junior, notamment des indemnités liées au service de gardes et astreintes.
Toutefois, l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit une brèche dans ce modèle de rémunération afin d'autoriser la création, par décret, d'un modèle de rémunération ad hoc pour les docteurs juniors de médecine générale réalisant un stage ambulatoire.
L'article L. 632-2 du code de l'éducation prévoit désormais que la rémunération des docteurs juniors de médecine générale en stage ambulatoire « peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret ».
Sur le fondement de cette disposition, un décret et un arrêté datés du 27 août 2025 ont été publiés, en application du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Ils prévoient la création de deux primes pour les docteurs juniors de médecine générale en stage ambulatoire233(*) :
- une prime forfaitaire conditionnée à l'activité, d'un montant de 500 euros bruts par semestre, sous réserve que le docteur junior ait réalisé 200 actes ou consultations par mois en moyenne sur le semestre ;
- une indemnité forfaitaire versée à condition que le stage soit réalisé en zone d'intervention prioritaire, d'un montant de 1 000 euros bruts par mois, non cumulable avec les indemnités de transport (130 euros bruts par mois) et d'hébergement (300 euros bruts par mois) par ailleurs prévues par le statut de docteur junior.
2. Inciter les médecins généralistes à s'installer dans les zones sous-denses par un contrat de praticien territorial en médecine ambulatoire
Il est proposé de rétablir un article L. 1435-4-3 dans le code de la santé publique pour créer un contrat de praticien territorial en médecine ambulatoire (PTMA), susceptible d'être conclu avec les agences régionales de santé pour renforcer l'offre de soins dans les territoires fragiles.
Seraient éligibles au contrat de PTMA les médecins généralistes conventionnés, non installés en cabinet libéral ou installés depuis moins d'un an, s'engageant à exercer à titre libéral pour une durée d'au moins deux ans dans une zone identifiée comme prioritaire par les ARS234(*) et à respecter les tarifs opposables. Le PTMA devrait s'engager à participer à des actions en matière d'accès aux soins et de coordination des soins, de permanence et de continuité des soins. Il devrait en outre contribuer à des activités d'enseignement et de formation universitaire en médecine générale.
En contrepartie, le PTMA pourrait percevoir une rémunération complémentaire en cas d'activité inférieure à un certain seuil. Le Gouvernement ne donne toutefois aucune indication sur le seuil d'activité minimale envisagé ni sur le mécanisme de compensation financière qui garantirait l'attractivité du contrat de PTMA vis-à-vis des jeunes médecins, ciblés par ce dispositif.
Il n'est pas prévu que ce statut donne accès au secteur 2.
Cette mesure constitue une traduction du pacte gouvernemental de lutte contre les déserts médicaux, qui indique que le contrat de PTMA serait associé à une garantie de revenu et exonéré de la mission de solidarité territoriale.
Il est à noter que le 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, qui mentionne les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, n'est ici pas visé. Ces zones de sous-densité médicale, déterminées par le directeur général de l'ARS, permettent de définir un cadre d'action territorial pertinent pour mettre en oeuvre des mesures d'incitation à l'installation des professionnels de santé.
3. Assouplir les conditions d'ouverture des officines de pharmacie dans les territoires ruraux
Face à la fragilisation du réseau officinal, le 3° du II propose d'assouplir les conditions d'ouverture des officines pharmaceutiques dans des territoires ruraux en modifiant l'article L. 5125-4 du code de la santé publique.
Selon le code de la santé publique, l'ouverture d'une officine par voie de création peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans une commune sous réserve de deux conditions cumulatives :
- le nombre d'habitants recensés y est au moins égal à 2 500235(*) ;
- elle est située dans une zone franche urbaine-territoires entrepreneurs, (ZFU-TE), dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans une zone France ruralités revitalisation (ZRR).
Le code de la santé publique prévoit également que des transferts et des regroupements d'officines peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population, dans les communes de plus de 2 500 habitants, puis par tranche de 4 500 habitants supplémentaires.
Enfin, lorsque la dernière officine d'une commune a définitivement cessé son activité et qu'elle desservait, jusqu'alors, une population au moins égale à 2 500 habitants, l'ouverture d'une officine peut y être autorisée par voie de transfert ou de regroupement. L'article propose d'autoriser, dans ces mêmes conditions, l'ouverture d'une officine par voie de création.
Le Gouvernement indique que cette mesure permettrait de « relocaliser l'accès aux médicaments en particulier dans les zones rurales, [...] [et] le déploiement des actes médicaux rendus accessibles en officines (vaccination, TROD angine/cystite, accompagnement à la téléconsultation, renouvellement d'ordonnance...) au sein de ces territoires. »236(*) Une trentaine d'officines pourraient, selon une estimation haute, bénéficier de cette mesure237(*).
4. Encadrer les conditions de fonctionnement de structures spécialisées en soins non programmés
Enfin, l'article vise à créer un cadre juridique ad hoc pour organiser l'activité des structures spécialisées en soins non programmées. À cette fin, il est proposé d'insérer un nouveau chapitre III quinquies au sein du titre II « Autres services de santé » du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, qui comprend déjà des chapitres relatifs aux centres de santé, aux maisons de santé, aux maisons de naissance et à la dotation de financement des services de santé238(*). Le nouveau chapitre III quinquies, intitulé « Structures spécialisées en soins non programmées », serait constitué d'un unique article L. 6323-6.
Ces dispositions reprennent presque intégralement la rédaction de l'article 44 du projet de LFSS pour 2025, définitivement adopté par le Sénat le 17 février 2025. Il est donc renvoyé, pour l'analyse de ces dispositions, au rapport de la commission adopté en première lecture du projet de LFSS pour 2025, le 13 novembre 2024239(*).
Quelques différences notables avec la version validée en commission mixte paritaire le 27 novembre 2024 doivent toutefois être relevées, en particulier :
- l'article ne se réfère plus aux centres de santé, aux cabinets médicaux, aux maisons de santé ou aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires pour définir la nature juridique de la structure spécialisée en soins non programmés ; aucune des dispositions applicables aux structures précitées n'aurait donc vocation à régir l'organisation et le fonctionnement d'une structure spécialisée en soins non programmés, nouvelle catégorie juridique autonome ;
- il ne prévoit plus d'obligation de participer au service d'accès aux soins (SAS) ou à la permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les professionnels de santé ; ces-derniers ne doivent que préciser leurs engagements en la matière ;
- en revanche, un projet de prise en charge des soins non programmés doit être élaboré par les professionnels de santé de la structure et validé par l'ARS et la caisse primaire d'assurance maladie ;
- enfin, l'article ne prévoit plus de consultation des représentants du secteur des soins non programmés préalablement à la définition du cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'article 44 du projet de LFSS pour 2025 ayant été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025, le Gouvernement propose de réintroduire ces dispositions dans le projet de LFSS pour 2026, en prenant soin de préciser le modèle de financement associé à ces nouvelles structures de soins non programmés.
Un financement forfaitaire spécifique serait alloué par l'assurance maladie aux structures spécialisées en soins non programmés. Son montant, fixé par arrêté ministériel, tiendrait compte de la file active des patients pris en charge. Il s'agit d'une autre différence notable avec la version soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui vise à mettre en exergue l'impact de la mesure sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie.
L'article propose enfin, aux alinéas 8 et 9, de modifier le code de la sécurité sociale pour pouvoir réserver la facturation de certains actes ou prestations aux structures spécialisées en soins non programmés. Ces modalités auraient vocation à être définies dans le cadre des conventions nationales signées entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les représentants des professions libérales.
Toutefois, à défaut d'avenant à la convention en vigueur signée avec les médecins avant le 1er juin 2026, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pourraient décider, unilatéralement, non seulement des conditions de facturation de ces actes et prestations, mais aussi des modifications à apporter en matière de rémunération des soins non programmés dans leur ensemble, recouvrant le SAS et la PDSA.
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a modifié le présent article en adoptant onze amendements dont quatre rédactionnels.
Dans un souci de simplification, un amendement du Gouvernement240(*) a d'abord modifié le modèle de rémunération des docteurs juniors de médecine générale en stage ambulatoire. Le docteur junior n'encaisserait plus le montant des tickets modérateurs pour son propre compte mais les facturerait pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée. En conséquence, les émoluments versés par le CHU ne seraient plus écrêtés du montant des tickets modérateurs collectés, mais versés en totalité, comme pour les docteurs juniors des autres spécialités en stage hospitalier. Le Gouvernement indique par ailleurs que le montant des tickets modérateurs perçus pour le compte du praticien agréé maître de stage remplacerait l'indemnité de compensation des charges liées à l'encadrement spécifique.
Le contrat de PTMA a également été modifié :
- un amendement des députés socialistes a prévu de plafonner à 10 % le montant de la rémunération complémentaire susceptible d'être versée au médecin sous contrat241(*) ;
- un autre amendement du groupe socialiste a proposé que la définition des zones prioritaires dans les territoires ultra-marins tiennent compte des spécificités de ces territoires et soit faite en concertation avec les collectivités territoriales et les ordres professionnels242(*) ;
- un amendement du rapporteur général a prévu que les conditions dans lesquelles le contrat de PTMA s'articule avec les autres dispositifs d'aide destinés aux médecins s'installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante243(*).
Les dispositions relatives aux structures de soins spécialisées en soins non programmés ont fait l'objet de plusieurs amendements.
Un amendement de M. Cyrille Isaac-Sibille 244(*) requalifie ces structures de points d'accueil pour soin immédiat et précise leur objet. Il prévoit notamment que ces structures prennent en charge des patients dont le pronostic vital et fonctionnel n'est pas engagé et qu'elles s'articulent avec l'offre de soins du territoire. Il prévoit également que les consultations sont assurées par des médecins généralistes exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie et de biologie médicales à proximité, qu'elles pratiquent le mécanisme du tiers payant et ne facturent pas de dépassements des tarifs conventionnels. En cas d'orientation du patient vers une autre structure ou un professionnel de santé tiers, le patient est informé de la pratique d'éventuels dépassements de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.
D'autres amendements ont eu pour objet de préciser que ces structures comprennent un ou plusieurs médecins généralistes245(*), et que leur projet de prise en charge définit les modalités de leur articulation avec les communautés professionnelles territoriales de santé246(*). Des amendements rédactionnels ont par ailleurs été adoptés.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission a pris acte de la volonté du Gouvernement d'utiliser le PLFSS pour pousser diverses des mesures annoncées dans son pacte de lutte contre les déserts médicaux. En toute rigueur, plusieurs d'entre elles lui semblent toutefois relever de l'organisation territoriale de l'offre de soins plutôt que d'un PLFSS. Quatre dispositifs différents sont en réalité inscrits dans le présent article, détachable les uns des autres. La commission les a examinés successivement.
Sur la rémunération des docteurs juniors de médecine générale, la commission s'est inquiétée de l'impréparation manifeste de la réforme, alors que les étudiants débuteront leur stage le 1er novembre 2026.
À un an de leur entrée en fonctions, la plus grande incertitude plane encore sur les modalités de la rémunération de ces docteurs juniors, alors que le ministère s'y prépare depuis trois ans. En 2023, le rapport d'expertise remis par les professeurs Pham, Saint-Lary, Oustric et par Mme Renker soulignait en ces termes l'enjeu de réussite de la réforme : « La filière de médecine générale, qui représente 40 % des étudiants de troisième cycle, doit continuer d'être choisie en toute confiance. » Sur les aspects de rémunération, ils recommandaient de donner à la quatrième année du DES de médecine générale un caractère professionnalisant, préparant à l'installation, s'appuyant sur un statut adapté et associé à une rémunération comportant « une part fixe correspondant aux émoluments forfaitaires mensuels perçus par tous les docteurs juniors » et « une part variable correspondant à une rétrocession sur les honoraires perçus ».
Une autre solution a donc été privilégiée par le Gouvernement. Dans la version du texte déposé par le Gouvernement, celle-ci repose sur un modèle de rémunération qui semble très peu sécurisé et particulièrement complexe, en introduisant une variabilité du montant des émoluments versés par le CHU aux docteurs juniors selon le montant des tickets modérateurs directement perçus. Il repose par ailleurs sur un partage d'informations entre la caisse primaire d'assurance maladie et le CHU de rattachement, qui entraînera « une charge administrative supplémentaire pour les CHU, déjà confrontés à des contraintes organisationnelles très fortes », alors même que ces étudiants ne seront pas présents au sein des établissements.
Les syndicats d'étudiants ont exprimé leurs craintes quant aux risques d'erreurs et de défaut de versement des salaires pour les quelques 3 000 docteurs juniors qui seront concernés. La DGOS ne s'est d'ailleurs pas montrée rassurante sur les conditions de mise en oeuvre d'un tel circuit, indiquant qu'un groupe de travail technique avec la Cnam devait se mettre en place.
Au cours des auditions, la DGOS a finalement indiqué qu'une autre solution semblait se dessiner, plus simple, qui consisterait à ce que la totalité des émoluments soient versés par le CHU, sans écrêtement des sommes, les tickets modérateurs étant collectés par le docteur junior non pour son compte propre mais pour celui du maître de stage. Tel est l'objet de l'amendement n° 2668 déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle solution ne consiste pas davantage en une rémunération à l'acte, qui semble soulever des réserves d'ordre éthique et déontologique dans la mesure où est jugée contraire à l'esprit d'un cursus de formation avant tout pédagogique, et parce qu'elle introduirait une rupture d'équité entre docteurs juniors, selon qu'ils réalisent leur stage en milieu hospitalier ou libéral.
L'Insar-IMG et l'Isni, qui revendiquent un modèle de rémunération mixte, incluant une part d'émoluments de base versés par le CHU et une part de rétrocession à l'acte, ont demandé à plusieurs reprises que ces dispositions soient disjointes du PLFSS, pour prolonger les concertations sur ce modèle.
La commission, déplorant l'impréparation de cette réforme, attend du Gouvernement qu'il détermine un modèle présentant des gages de sécurité pour les étudiants, sans proposer une nouvelle usine à gaz administrative. De ce point de vue, elle a jugé que l'amendement du Gouvernement permettait de dessiner une solution plus réaliste et moins complexe. Prenant acte des réticences persistantes des syndicats d'étudiants, elle a jugé qu'il revenait au Gouvernement de prendre ses responsabilités sur ce sujet, avec un impératif de réussite de la réforme au 1er novembre 2026. Elle n'a pas modifié ces dispositions.
La création de contrats de praticiens territoriaux en médecine ambulatoire (PTMA), traduction du pacte de lutte contre les déserts médicaux, est présenté par la DGOS comme un instrument d'incitation à l'installation territoriale dans les zones sous-denses. Plus particulièrement, seraient concernées les « zones rouges » ciblées comme prioritaires par le Gouvernement.
La commission s'est interrogée sur l'opportunité d'un nouveau dispositif qui viendrait se superposer à la diversité de ceux déjà mobilisables, dont les modalités diffèrent quelque peu mais qui poursuivent globalement un objectif similaire.
À ce titre, elle a rappelé que le dispositif des assistants universitaires de médecine générale (AUMG) permet à un praticien d'exercer dans une structure de soins de ville - centre de santé, maison de santé, cabinet individuel et de groupe, autre - et dans un département universitaire de médecine générale pour une durée de 2 ans. Mobilisé par les ARS, ce dispositif vise à soutenir la médecine de premier recours dans les territoires en tension, à renforcer la filière universitaire de médecine générale et à élaborer des projets de soins territoriaux. Ces contrats, financés par les ARS et/ou par les facultés sont toutefois sous-financés.
Elle relève par ailleurs que l'article n'apporte aucune indication sur le modèle de rémunération susceptible de soutenir l'attractivité du contrat de PTMA, alors qu'elles sont déterminantes pour apprécier l'opportunité du dispositif, dont le coût est évalué par le Gouvernement à 634 000 euros en année pleine.
Pour la commission, l'enjeu réside prioritairement dans la simplification du paysage des aides et des dispositifs d'incitation à l'installation. Plutôt que de créer un nouveau contrat, elle recommande d'harmoniser les outils existants pour les optimiser et améliorer leur efficacité, compte tenu des sommes qu'ils représentent. En outre, le renforcement de l'accès aux soins dans les territoires lui semble passer prioritairement par le développement de l'exercice coordonné, la formation des jeunes médecins dans les territoires les moins dotés, et la régulation de l'installation des médecins dans les zones suffisamment dotées.
À cet égard, elle rappelle que le Sénat a adopté le 13 mai une proposition de loi visant à améliorer l'offre de soins dans les territoires, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. Ce texte propose notamment d'encadrer les conditions d'exercice en zone sur-dense, en la subordonnant à un engagement d'exercice concomitant en zone sous-dense, et d'appliquer des rémunérations forfaitaires modulées en fonction de l'activité réalisée par les médecins en zone sous-dense, afin de rendre ces territoires plus attractifs. La commission a considéré que l'entrée en vigueur rapide de telles dispositions contribuerait de façon plus certaine que les contrats de PTMA à améliorer l'accès aux soins dans les territoires fragiles. En conséquence, elle a adopté un amendement n° 655 visant à substituer ces dispositions à celles relatives au contrat de PTMA.
La commission ne souscrit pas à la nécessité d'assouplir les dérogations aux conditions d'ouverture d'une officine dans les communes de moins de 2 500 habitants dans lesquelles la dernière officine a définitivement cessé son activité.
D'une part, le maillage officinal est aujourd'hui garant d'une bonne proximité avec les usagers. Dans les communes visées par la mesure, l'accès au médicament est couvert à 90 % via des officines plus lointaines. D'autre part, la multiplication des dérogations aux règles organisant l'implantation des officines sur le territoire risquerait de déstabiliser le maillage officinal qui a fait la preuve de sa résilience et de sa stabilité. 18 % des officines sont situées dans des communes de moins de 2 000 habitants et environ un tiers dans des communes de moins de 5 000 habitants. La commission considère que la priorité doit être de soutenir les officines implantées dans ces territoires isolés, sans fragiliser leur équilibre économique.
Enfin, la fermeture de certaines officines dans des territoires peu denses ou isolés s'explique par la difficulté à équilibrer leur activité économique, en raison du manque d'attractivité des territoires concernés. D'après le Cnop, seules 91 communes de moins de 2 000 habitants ont connu une fermeture d'officine en 2024. Il est donc permis de douter de l'ouverture de nouvelles officines, même en assouplissant les conditions de leur création. Le Gouvernement indique qu'une trentaine de communes pourraient être concernées.
Pour favoriser l'accès aux médicaments dans les territoires peu denses, la commission recommande de s'appuyer sur l'ouverture de nouvelles antennes de pharmacie. Si la base légale autorisant leur expérimentation existe depuis 2020 et a été remaniée fin 2023, la première antenne de pharmacie n'a ouvert qu'en juillet 2024 en Corse, après la diffusion du cahier des charges national. Trois autres antennes ont ouvert en Occitanie au cours de l'année 2025, et deux autres ouvertures sont annoncées d'ici la fin de l'année 2025 en Centre-Val-de Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le champ de l'expérimentation, limité à six régions et à douze antennes au total, apparaît trop restrictif pour favoriser le décollage du dispositif. La commission préconise de l'ouvrir beaucoup plus largement, en généralisant le dispositif sur le territoire national.
Par ailleurs, la commission soutient la généralisation de l'expérimentation Osys et son inscription dans le droit commun pour améliorer l'accès aux soins, en autorisant les pharmaciens à prendre en charge certaines situations cliniques simples et à orienter le patient dans le parcours de soins. Le Sénat avait adopté cette mesure, au sein de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires. La commission salue l'initiative du Gouvernement visant à généraliser et à pérenniser l'expérimentation Osys.
Sur la base de ces observations, à l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement n° 656, qui modifie le dispositif envisagé par le Gouvernement pour le limiter à l'ouverture de nouvelles antennes d'officine plutôt que d'autoriser la création d'officines. Ces dispositions auraient vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2027, pour permettre aux antennes ouvertes dans le cadre de l'expérimentation en cours de poursuivre leur déploiement.
Enfin, sur les structures spécialisées en soins non programmés, la commission avait soutenu l'économie générale de cette mesure lors du l'examen du PLFSS pour 2025. Elle juge en effet nécessaire de fixer un cadre général pour réguler l'activité et le fonctionnement de ces structures, dont le développement n'est pas exempt de dérives. La version présentée par le Gouvernement diffère pourtant sur quelques points essentiels de celle qu'avait adoptée la CMP.
En premier lieu, il n'est plus fait référence à la nature juridique des structures qui pourraient entrant dans le champ des structures spécialisées en soins non programmés. Or, la mention des centres de santé, cabinets médicaux, maisons de santé et sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, présentait l'avantage de clarifier le régime juridique applicable à ces structures et de préciser les structures susceptibles d'endosser la qualification de structure spécialisée en soins non programmés.
En deuxième lieu, la commission regrette que le Gouvernement ait renoncé à l'obligation de participation au service d'accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoires qui lui paraissait structurante. Cette obligation lui semble par ailleurs présenter deux avantages : elle serait de nature à conforter l'accès aux soins en dehors des heures ouvrables et donc, à décharger les services d'accueil des urgences hospitaliers en soirée et première partie de nuit ; elle pourrait limiter la captation de médecins urgentistes par ces structures depuis les services d'urgences publics et privés.
En troisième lieu, la consultation préalable des représentants du secteur des soins non programmés pour élaborer le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé lui semblait relever d'une posture de concertation bienvenue, à l'heure où le dialogue conventionnel se crispe, et peu contraignante par ailleurs.
En quatrième lieu, l'étude d'impact présentée par le Gouvernement est pour le moins approximative sur l'évaluation financière de cette mesure. Elle indique que « grâce aux passages aux urgences évités et à la rationalisation de la rémunération des soins non programmés », les économies générées permettront de financer les rémunérations forfaitaires accordées aux structures de soins non programmés. Au global, son impact sur l'Ondam serait donc neutre.
Enfin, la commission a pris acte des amendements adoptés à l'Assemblée nationale qui conduisent à une réécriture importante du dispositif initial. Cette réécriture s'inspire des dispositions de la proposition de loi visant à créer des points d'accueil pour soins immédiats, adoptée à l'Assemblée nationale à l'automne 2019, mais rejetée par le Sénat en juin 2020.
En tout état de cause, sur la base des travaux conduits lors de l'examen du PLFSS pour 2025 ayant permis d'atteindre un consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement n° 657 visant à rétablir la rédaction initiale de l'article, en y ajoutant la mention des structures susceptibles d'être qualifiées de structures spécialisées en soins non programmés, la participation obligatoire au service d'accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoires ainsi que la consultation des représentants du secteur des soins non programmés sur la définition du cahier des charges.
Elle a également considéré qu'un délai maximal de six mois pour renégocier dans le cadre conventionnel les modalités de rémunération des soins non programmés était trop contraint. Elle a donc adopté un amendement n° 658 visant à desserrer ce délai et à repousser l'échéance maximale de négociation au 1er janvier 2027.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 21 bis (nouveau)
Mise en place du Réseau France
Santé et modalités de prise en charge de certaines
situations cliniques par les pharmaciens
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit :
- la mise en place du réseau « France Santé » et les modalités de labellisation des structures y participant ;
- le remplacement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) par les « communautés France Santé » ;
- la pérennisation de l'expérimentation dite « Osys » permettant aux pharmaciens de contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de certaines situations cliniques.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La pérennisation de l'expérimentation « Osys »
1. L'expérimentation « Osys »
Lancée en 2021, en Bretagne247(*), sur le fondement des dispositions dites « de l'article 51 », l'expérimentation « Orientation dans le système de soins » (Osys) avait pour objectif de permettre l'implication du pharmacien d'officine dans la prise en charge des soins non programmés de premier recours, dans des territoires où l'accès à un médecin généraliste est difficile.
Dans le cadre de cette expérimentation, le pharmacien est amené à orienter, à l'aide d'arbres décisionnels validés, le patient qui vient en première intention à l'officine. Il peut, sous certaines conditions, délivrer sans ordonnance des médicaments sous prescription médicale obligatoire dans le cadre de protocoles nationaux de coopération.
L'expérimentation comprenait initialement treize situations cliniques, ou « de triage », pouvant être ainsi prises en charge en première intention par le pharmacien d'officine. L'expérimentation a été étendue, en 2023, aux régions Centre-Val de Loire, Corse et Occitanie pour une durée de 24 mois devant prendre fin le 31 décembre 2025. L'expérimentation a été, à cette occasion, progressivement recentrée sur six puis quatre situations cliniques248(*).
Le comité technique de l'innovation en santé (CTIS) s'est prononcé favorablement sur cette expérimentation et les services du ministère de la santé ont pu relever « les effets positifs de l'expérimentation sur le nombre de recours inappropriés aux urgences, sur la libération de temps médical et sur la capacité des patients à trouver une réponse rapide et efficace à leurs demandes de soins non programmés »249(*).
2. La généralisation proposée de l'expérimentation
L'article 21 bis reprend exactement les termes de l'article 12 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, adoptée le 13 mai 2025 par le Sénat.
Ainsi le 4° du I du présent article insère à l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, relatif aux missions des pharmaciens d'officine, des dispositions prévoyant que ces derniers contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu'à l'orientation du patient dans le parcours de soins. Il renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, le soin de fixer la liste des situations cliniques concernées.
Le 3° du même I du présent article procèdent aux coordinations nécessaires au sein de l'article L. 4161-1 relatif à l'exercice illégale de la médecine afin que ces actes ne puissent plus être considérés comme tel.
Pour permettre la prise en charge de cette nouvelle mission, le 2° du III complète les dispositions de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux conventions nationales régissant les rapports entre l'assurance maladie et les pharmaciens d'officine, pour prévoir que ces conventions devront fixer les tarifs des nouvelles prestations confiées aux pharmaciens.
B. La transformation des CPTS en communautés France Santé
1. Les CPTS, un outil central de l'organisation des soins de ville souffrant toutefois d'une implication inégale de la part des professionnels de santé
Créées par la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, les CPTS ont été, dès l'origine, conçues comme un outil souple de coordination des soins ambulatoires, à l'initiative des professionnels de santé. Un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) conclu par l'assurance maladie et les syndicats de professionnels de santé a fixé les conditions d'accompagnement et de financement des CPTS autour de six missions250(*). La loi prévoit, ainsi, que ces derniers peuvent « décider de se constituer » en CPTS, afin « d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé (...) et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé »251(*).
Poussé par les pouvoirs publics, le nombre de CPTS a très fortement progressé ces dernières années, passant d'une vingtaine en 2018 à plus de 800 en mai 2025. Elles couvrent désormais une grande partie du territoire national et 82 % de la population.
Nombre de CPTS ayant signé ou devant signer l'ACI (2021-2025)
Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Dans le cadre de sa mission flash de contrôle sur le financement des CPTS252(*), la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat a pu constater l'action des CPTS en matière de coordination des professionnels de santé, d'accès aux soins et d'organisation des parcours et de prévention. Ces communautés permettent également aux pouvoirs publics de disposer localement d'interlocuteurs susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des politiques de santé.
Toutefois, malgré ces apports, la contribution des CPTS à la coordination des professionnels, à l'amélioration de l'accès aux soins ou au déploiement des actions de prévention apparaît aujourd'hui inégale.
L'Union nationale des professionnels de santé (UNPS), entendue par les rapporteurs, estime ainsi que « la stratégie de généralisation accélérée des CPTS à l'ensemble du territoire, sans adhésion suffisante des professionnels, s'est révélée, in fine, contre-productive et a pu nuire à l'appropriation du dispositif par les acteurs de terrain »253(*). L'implication inégale des professionnels de santé dans leur CPTS est particulièrement soulignée. L'UNPS indique encore que, bien qu'un « grand nombre de professionnels de santé [ait] adhéré à une CPTS », ces derniers ont, en pratique, « du mal à s'approprier les CPTS, jugées trop administrées et peu lisibles. »
Nombre et proportion des professionnels
libéraux adhérant aux CPTS,
par profession
Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Dans ce contexte, le développement des CPTS continue parfois de susciter la défiance de certains professionnels et la place qui leur est accordée dans l'organisation des soins ou la représentation des professionnels est parfois contestée.
2. Le dispositif proposé : transformer les CPTS en « Communautés France Santé »
Dans ce contexte, le présent article prévoit de renommer les CPTS en « communautés France Santé » (CFS) et de leur attribuer une mission de « soutien » aux structures du réseau France Santé.
Ainsi le I, les 1° et 2° du II, le 1° du III et le IV procèdent aux coordinations nécessaires dans les codes de l'action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité sociale et au sein du code général des impôts afin de remplacer les termes « professionnelles territoriales de santé » par les termes « France Santé ».
Le 1° bis du II, inséré à la suite d'un sous-amendement présenté par le groupe Écologiste et social, vise à systématiser l'adhésion des centres de santé et des maisons de santé aux nouvelles communautés France Santé. Pour rappel, la commission avait supprimé de la proposition de loi dite « Valletoux », en 2023254(*), des dispositions qui visaient à systématiser l'adhésion des professionnels de santé conventionnés et centres de santé aux CPTS, sauf opposition expresse de leur part au motif que ces dispositions contreviennent au principe même des CPTS dont l'adhésion doit être entièrement facultatif.
L'unique référence à la mission d'animation du réseau France Santé attribuée aux nouvelles CFS est insérée au sein de la nouvelle section du code de la santé publique créée par l'article 21 bis et plus précisément au III du nouvel article L. 6330-2 qui précise qu'un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonnée qui encadre l'action des CPTS doit être conclu « dans un délai de deux mois » afin de « prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France Santé ».
Ces modalités de soutien devront donc s'intégrer dans les missions existantes des CPTS fixées à l'article L. 1434-12-2 et qui ne font pas l'objet de modification.
C. La labellisation des structures « France Santé »
1. Les difficultés d'accès aux soins dans les territoires
La France connaît une forte croissance des besoins de santé de sa population, sous l'effet de trois facteurs convergents : la croissance démographique, le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques (le nombre de patients en affection de longue durée (ALD) a augmenté, en moyenne, chaque année de 2,8 % entre 2005 et 2022).
L'offre de soins, notamment en ville, peine à répondre à cette évolution de la demande. La démographie insuffisamment dynamique des professionnels de santé et leur trop inégale répartition sur le territoire entraîne une inadéquation grandissante entre l'offre et la demande de soins.
Ainsi même l'augmentation de leurs effectifs que connaît certaines professions comme les chirurgiens-dentistes (+ 7 000 en treize ans) et les sages-femmes libérales (+ 115 % entre 2012 et 2022) ne permet pas de répondre à l'augmentation des besoins. Le ministère de la santé estime, ainsi, que la France manquera de 80 000 infirmiers en 2050, à tendances inchangées.
D'autres professions apparaissent en très forte tension démographique. Tel est le cas, notamment, des médecins : le nombre de médecins généralistes libéraux a chuté de 5 % entre 2012 et 2022, le nombre de médecins spécialistes accessibles en premier recours de 13 %255(*).
Surtout le pays est marqué par de très fortes inégalités territoriales à la fois entre départements mais aussi et surtout à l'échelle infradépartementale : les professionnels libéraux se concentrent, dans un même département, dans les zones littorales ou urbaines, tandis que des zones rurales ou suburbaines sont fréquemment délaissées. Selon le ministère de la santé, en 2022, les 10 % de la population les mieux dotés avaient accès à 5,6 consultations de médecin généraliste par an, quand les 10 % les moins bien dotés n'avaient accès qu'à 1,4 consultation. L'écart entre ces deux populations s'est creusé de 5 % entre 2022 et 2023256(*).
Pour répondre à ces défis, le 13 septembre 2025, le Premier ministre a annoncé vouloir mettre en place d'ici à 2027 « un réseau de soins de proximité assurant, a minima par bassin de vie, une offre à environ 30 minutes autour de chez soi ». Selon la communication du Gouvernement ce réseau s'inspirerait de ce que propose aujourd'hui les maisons France service. Le Premier ministre avait alors annoncé un objectif de 5 000 structures « France Santé » d'ici à 2027.
2. La création du réseau « France Santé »
Le 5° du II de l'article 25 bis crée un nouveau titre au sein du code de la santé publique intitulé Réseau France Santé. Ce nouveau titre comprend deux articles L. 6330-1 et L. 6330-2.
L'article L. 6330-1 prévoit que « les structures de soins de premiers recours » dès lors qu'elles « fournissent une offre de service socle » peuvent « conclure avec les ARS et les organismes gestionnaires de régime de base d'assurance maladie », une convention fixant leurs engagements et leur permettant de bénéficier de financements spécifiques. Une fois la convention signée, la structure obtient le label « France Santé ».
• Les soins de premier recours sont définis à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique et recouvrent, outre les soins des médecins généralistes et de quelques spécialistes accessibles en accès direct, les conseils des pharmaciens, les soins infirmiers et de kinésithérapie, les soins dentaires ou encore ceux assurés par les orthophonistes ou les psychologues. En revanche, le terme de « structures de soins de premiers recours », bien que semblant vouloir identifier les maisons de santé pluriprofessionnelles ou centres de santé médicaux et polyvalent, ne disposent pas d'une définition au sein du code de la santé publique. Pour rappel, les centres de santé sont définis en application de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, comme des « des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours » et les maisons de santé sont définies, en application de l'article L. 6323-3 en tant que « personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens » qui « assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours [ ...] et, le cas échéant, de second recours ». Ainsi défini, il existe donc une incertitude sur les acteurs de soins et les organisations qui pourront être éligibles au label « France Santé et une question d'articulation avec l'offre de second recours qui peut aussi être assurée par les centres de santé notamment.
• Cet article prévoit également que ces structures de soins devront « fournir une offre de service socle » qui en application de l'article L. 6330-2 sera définie par la convention médicale prévue à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et l'accord national des centres de santé prévu à l'article L. 162-32-1 du même code. La loi ne définirait ainsi aucune mission minimale ou objectifs pour ces structures labellisées « France Santé ».
L'article L. 6330-2 nouvellement créé précise, comme indiqué précédemment, que l'offre de service socle sera définie par voie conventionnelle et que ces services pourront être organisés « de manière itinérante », par exemple sous la forme d'équipe mobile, ou comporter des « modes d'accès dématérialisés » qui pourraient recouvrir des activités de télémédecines dont de la téléconsultation et téléexpertise.
Le deuxième alinéa de l'article L. 6330-2 précise que les structures ne relevant des accords précités seront directement financées par les ARS via le fonds d'intervention régionale. Le texte ne prévoit pas explicitement que les obligations relatives à l'offre de service socle définie par les conventions s'applique également à ces structures ne relevant pourtant pas desdites conventions.
Les II et III prévoient les modalités de la négociation conventionnelle concernant, d'une part, les conditions de participation des structures de soins au réseau France Santé ainsi que les rémunérations liées et, d'autre part, les « modalités de soutien » des communautés professionnelles territoriales de santé, devenues les communautés France Santé, aux structures du réseau France Santé.
À la suite de l'adoption d'un sous-amendement de Jean-Claude Raux et plusieurs de ses collègues à l'Assemblée nationale, le texte prévoit désormais la signature d'une nouvelle convention relative « aux maisons de santé pluriprofessionnelles » en lieu et place d'un avenant à l'accord conventionnel interprofessionnel relatifs aux structures de santé pluriprofessionnelles qui couvre notamment les maisons de santé et les centres de santé. Cet amendement fait notamment suite à la signature le 28 août 2025 d'un accord national spécifique aux centres de santé. Toutefois, il pourrait ainsi exclure du périmètre certaines structures de santé pluriprofessionnelles.
Enfin, le texte prévoit que ces accords doivent être conclus dans un délai de seulement deux mois après l'ouverture de la négociation avec l'Uncam. À défaut d'accord dans ce délai, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définiront unilatéralement les éléments mentionnés précédemment.
Par ailleurs, un dernier sous-amendement adopté par l'Assemblée nationale toujours à l'initiative de Jean-Claude Raux, a inséré un 1° bis au sein du III du présent article prévoit la mise en oeuvre d'un accord conventionnel spécifique aux maisons de santé soumis à la signature des organisations reconnues représentatives des maisons de santé.
II - La position de la commission
• La commission ne peut que se féliciter de la reprise par le Gouvernement des dispositions visant à pérenniser le dispositif « Osys » que le Sénat avait adoptées en mai dernier lors de l'examen de la proposition de loi présentée par Philippe Mouiller visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires.
La commission avait alors jugé qu'une telle extension des compétences des pharmaciens d'officine allait contribuer à améliorer l'accès aux soins des patients, particulièrement dans les zones les plus dépourvues en médecins généralistes. Elle avait également estimé que cette mesure devrait permettrait de libérer du temps médical et de réduire le nombre de recours aux urgences.
Lors de ses auditions, la rapporteure a pu constater que la généralisation de l'expérimentation était largement soutenue, en premier lieu desquels les représentants des pharmaciens d'officine et le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
• En revanche, la commission porte un regard beaucoup plus nuancé sur la mise en place du réseau « France Santé », ainsi que sur les modifications apportées aux communautés professionnelles territoriales de santé.
Bien évidemment la commission soutient l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins. Elle s'est à ce titre pleinement engagée dans l'amélioration de l'accès aux soins dans les territoires notamment au travers de l'adoption de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires au mois de mai 2025. Toutefois, elle refuse que cet enjeu majeur pour la santé de nos concitoyens se résume à une opération d'affichage politique.
La rapporteure regrette le caractère précipité et non concerté de ces mesures qui n'ont vocation qu'à labelliser l'existant à marche forcée sans améliorer concrètement l'accès aux soins pour les Français. En effet, cette mesure n'augmente pas le nombre de structure de soins de premiers recours mais ouvre la voie à un financement spécifique et un label pour celles qui concluent une convention avec les agences régionales de santé et l'assurance maladie.
La mission flash sur le financement des CTPS déjà mentionnée précédemment avait à ce titre souligné le fait que la création à marche forcée des CPTS « pour répondre à l'objectif gouvernemental d'une couverture intégrale du territoire national » avait pu parfois aboutir à la création de « coquilles vides ». Les mêmes causes suscitant les mêmes effets, la rapporteure s'interroge sur la pertinence de réitérer le même schéma concernant le réseau France Santé et la modification du nom des CPTS en communauté France Santé. Changer le nom d'une structure, d'autant plus pour en supprimer l'attache au territoire et la notion d'engagement des professionnels, ne permet pas non plus d'améliorer l'accès aux soins.
Par ailleurs, si le Gouvernement s'engage à consacrer une enveloppe de 130 ou 150 millions d'euros au développement des structures France Santé, soit « un soutien d'environ 50 000 euros par structure » labellisée, cela représente entre 2 600 et 3 000 structures « labellisables » bien loin des 5 000 annoncées par le Premier ministre. La rapporteure s'interroge à ce titre sur le sort qui sera réservé aux structures une fois cette enveloppe consommée. À ce titre, en décembre 2023, 2 501 maisons de santé étaient en fonctionnement. La seule labellisation de toutes ces structures préexistantes épuiserait ainsi l'enveloppe consacrée sans aucune amélioration pour le citoyen et les territoires en matière d'accès aux soins, tout en laissant de côté des structures utiles sur le territoire mais qui ne seraient pas en mesure de pouvoir fournir « l'offre de service socle » du fait de la désertification médicale. Elle regrette cette mise en concurrence des professionnels de santé entre eux alors qu'il est nécessaire de disposer de la participation de tous pour mettre en place une véritable politique de santé utile à nos territoires.
Enfin, l'ajout de ces dispositions relative à l'organisation de notre système de santé et à l'accès aux soins sur nos territoires par voie d'amendement dans un texte financier tel que la loi de financement de la sécurité sociale interroge. Faire le choix d'un autre véhicule législatif permettrait une véritable discussion avec les professionnels de santé et un examen approfondi au Parlement.
Dès lors, la commission a souhaité supprimer les dispositions relatives au réseau France Santé ainsi qu'à la modification des missions et à la nouvelle dénomination des communautés professionnelles territoriales de santé (amendement n° 659). Elle appelle le Gouvernement à enfin engager un dialogue sérieux et constructif avec les professionnels, les territoires et le Parlement en vue de mettre en oeuvre une réforme qui réponde réellement aux attentes des Français et non à un quelconque calendrier politique.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 21 ter (nouveau)
Création de consultations de
prévention pour les femmes
au moment de la ménopause
Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale, propose de créer des consultations longues prises en charge par l'assurance maladie pour les femmes âgées de 45 à 65 ans afin de les informer et de repérer d'éventuels facteurs de risque associés à la ménopause.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. L'accompagnement de la ménopause, un enjeu de santé sexuelle méconnu
1. La ménopause, épisode de fragilisation de la santé des femmes
17,2 millions de femmes âgées d'au moins 45 ans sont concernés par la ménopause en France, et 500 000 environ entrent dans la ménopause chaque année. La ménopause, qui consiste en l'arrêt des cycles menstruels et de l'activité folliculaire ovarienne, survient en moyenne à 51 ans. Elle s'accompagne de symptômes spécifiques pouvant être invalidants - bouffées de chaleur, troubles génito-urinaires, douleurs articulaires, troubles du sommeil, etc. - et majore le risque d'apparition de certaines pathologies, notamment cardiovasculaires et d'ostéoporose.
S'agissant du risque cardio-vasculaire, il est majoré pour les femmes ménopausées précocement (avant 45 ans) ou tardivement (après 55 ans) et peut être prédit par les bouffées de chaleur dont souffrent certaines femmes ménopausées. Une vigilance particulière est alors justifiée, 70 % des facteurs de risque cardiovasculaires à la ménopause étant modifiables ou réversibles. Pour mémoire, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France.
En outre, la ménopause accroît sensiblement le risque d'ostéoporose, du fait de la diminution des oestrogènes. Un tiers des femmes âgées d'au moins 50 ans sont concernées par cette affection.
De même, le risque de troubles cognitifs ou de maladie neurovégétative est plus élevé pour les femmes touchées par une ménopause précoce.
Au global, l'Inserm rappelle que 20 % à 25 % des femmes ménopausées souffrent de symptômes sévères qui affectent leur qualité de vie et que seules 6 % prennent un traitement hormonal de la ménopause.
2. Un enjeu de prévention et de prise en charge
La santé cardiovasculaire et osseuse des femmes peut être améliorée grâce à une meilleure hygiène de vie, incluant une activité physique régulière et une alimentation riche en calcium.
Des traitements hormonaux peuvent par ailleurs permettre de diminuer l'intensité de certains symptômes voire de les faire disparaître, comme les troubles génito-urinaires ou la fragilité osseuse. Toutefois, ces traitements ne sont pas exempts de certains risques ; ils peuvent être contre-indiqués chez les femmes ayant des antécédents personnels d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Des études ont par ailleurs mis en évidence un risque de maladies veineuses thromboemboliques multiplié par deux chez les femmes traitées avec des oestrogènes par voie orale.
À cet égard, à l'occasion d'une réévaluation des spécialités indiquées dans le traitement de la ménopause (octobre 2025), la Haute Autorité de santé (HAS) a confirmé ses précédentes préconisations formulées en mai 2014. De façon générale, toute prescription doit être précédée d'un examen clinique et gynécologique complet et d'une mammographie. Tout traitement hormonal prescrit doit en outre faire l'objet d'une réévaluation périodique, a minima annuelle.
À cet égard, les rendez-vous de prévention, créés par la LFSS pour 2023257(*), ont eu pour objet de permettre à tous les Français d'accéder à certains professionnels de santé à quatre âges-clés de la vie, pour un bilan de prévention et, le cas échéant, pour pouvoir être orientés vers une prise en charge adaptée. Réalisés par des médecins, des sages-femmes, des infirmiers et des pharmaciens, ils sont proposés aux tranches d'âge suivantes : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans258(*). Ces rendez-vous « sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes ». Leur mise en oeuvre est généralisée depuis 2024, au terme d'une phase d'expérimentation préalable accompagnée par la direction générale de la santé dans la région des Hauts-de-France.
Une mission parlementaire sur la ménopause a été confiée à l'automne 2024 à Mme Stéphanie Rist, alors députée, et conduite avec le soutien de l'inspection générale des affaires sociales (Igas). Elle a rendu son rapport accompagné de 25 propositions en avril 2025. Parmi ces propositions, la onzième préconise de mettre à l'ordre du jour des discussions de la négociation du prochain avenant à la convention médicale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie la création d'une consultation longue en début de ménopause. Plusieurs des propositions formulées concernent par ailleurs l'adaptation des conditions de travail.
B. La création d'une consultation longue ménopause prise en charge par l'assurance maladie
Il est proposé de créer un nouvel article L. 1411-6-5 dans le code de la santé publique, inséré après l'article relatif au dispositif « handigynéco »259(*) créé par la LFSS pour 2025.
L'article prévoit que les femmes âgées de 45 à 65 ans bénéficient d'une consultation longue « destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause ».
Cette consultation est réalisée à tarif opposable et prise en charge par l'assurance maladie. Les conditions de cette prise en charge devraient être précisées par les conventions nationales conclues entre l'assurance maladie et les médecins d'une part, l'assurance maladie et les sages-femmes d'autre part.
En l'absence d'étude d'impact, aucun chiffrage de cette mesure n'a été réalisé.
II - La position de la commission
La commission a pris acte de l'adoption de ces dispositions par l'Assemblée nationale qui visent à concrétiser l'une des recommandations du rapport remis par Mme Stéphanie Rist au printemps 2025 sur la ménopause. Elle formule toutefois deux réserves quant à ce dispositif.
D'une part, la commission regrette que le Gouvernement ait fait le choix d'introduire ces dispositions par la voie d'un amendement, ne donnant pas l'opportunité au Parlement de statuer sur la base d'une étude d'impact consolidée comprenant une évaluation financière de la mesure. Le rapport de la mission « ménopause » est sur ce point parfaitement silencieux et ne fournit aucun élément d'appréciation chiffré de l'impact budgétaire attendu.
D'autre part, la commission s'interroge sur la priorisation de cette mesure par le Gouvernement, alors même qu'elle apparaît en partie redondante avec le dispositif des rendez-vous de prévention, que le rapport précité qualifie d'ailleurs de prometteur, en indiquant qu'il « doit pouvoir constituer une porte d'entrée pour les femmes âgées de 45 ans, en termes d'information, de repérage et de prévention. Une fois réalisé, il doit permettre une orientation vers un autre professionnel ». La commission rappelle que les tranches d'âges visées par « Mon bilan prévention » (45-50 ans et 60-65 ans) couvrent en partie la mesure proposée par le présent article (45-65 ans).
Compte tenu des réels enjeux de santé publique attachés à la mesure, la commission l'a néanmoins adoptée.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 quater (nouveau)
Suppression du contrat de début
d'exercice
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose la suppression du contrat de début d'exercice, un dispositif d'incitation à l'installation financé par le fonds d'intervention régional.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. Le contrat de début d'exercice, un dispositif d'incitation à l'installation introduit en 2021 et resserré par la suite
1. Le contrat de début d'exercice, introduit par la LFSS pour 2020, vise à garantir une rémunération minimale aux médecins remplaçants exerçant en zone sous-dense
L'article 51 de la LFSS pour 2020260(*) a supprimé quatre dispositifs d'aide à l'installation261(*) gérés par les agences régionales de santé :
- le contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG), qui prévoyait un complément de rémunération au bénéfice des médecins généralistes installés depuis moins d'un an en zone sous-dense262(*) ;
- le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), garantissant un revenu supplémentaire à l'ensemble des médecins exerçant en secteur 1 et en zone sous-dense ;
- le contrat de praticien de médecine de remplacement (PTMR), articulé autour d'une garantie de revenus pour les praticiens remplaçants exerçant en libéral en zone sous-dotée ;
- le contrat de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS), ouvrant le bénéfice d'une rémunération complémentaire et d'une aide forfaitaire à l'investissement pour les médecins exerçant en secteur 1 en zone isolée.
Ces dispositifs n'avaient pas trouvé leur cible : le PTMG a bénéficié à 8 % des cocontractants potentiels, tandis que les trois autres contrats n'ont pas compté plus de quelques dizaines de signataires.
Le même article a prévu, en remplacement, deux nouveaux dispositifs, dont le contrat de début d'exercice263(*) (CDE).
Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans264(*) avec les agences régionales de santé et financé par le fonds d'intervention régional, a cela d'original qu'il consiste en une garantie de rémunération minimale à l'égard de certains médecins libéraux lors de leur première année d'exercice en contrepartie d'un engagement d'exercice minimal en zone sous-dense ou à moins de dix kilomètres d'une telle zone265(*) pendant la période de validité du contrat. Le CDE agit donc comme une aide différentielle correspondant à la différence entre le revenu garanti et le revenu effectivement perçu266(*).
À la garantie de rémunération s'ajoutent, dans le cadre du CDE, un « accompagnement à l'installation »267(*) et une assurance de prévoyance pour la maternité, la paternité ou l'adoption268(*) d'une part et la maladie269(*) d'autre part.
Le médecin cocontractant est tenu d'exercer en secteur 1 ou en secteur 2 sous option tarifaire maîtrisée (Optam) et il lui est fait obligation de participer à un exercice coordonné dans un délai de deux ans à l'issue de la signature du contrat.
Initialement ouvert aux médecins en activité depuis moins d'un an, aux étudiants remplissant les conditions pour effectuer des remplacements270(*) et aux médecins remplaçants en activité depuis moins d'un an, le CDE a vu son champ restreint aux deux dernières catégories en application de la LFSS pour 2023271(*). Les médecins non remplaçants en activité ne sont donc plus éligibles au CDE depuis le 1er janvier 2023.
Les médecins remplaçants doivent s'engager à exercer au moins 80 % de leur activité en zone éligible, avec une durée minimale d'exercice de 29 journées par trimestre272(*).
Les modalités de garantie de la rémunération s'avèrent complexes. Elles sont déterminées en fonction du nombre de jours d'exercice en zone éligible et sont conditionnées à la perception d'honoraires trimestriels minimaux en zone sous-dense273(*).
Rémunération garantie au titre du
CDE
selon la durée trimestrielle d'exercice en zone
sous-dense
|
Durée trimestrielle d'exercice en zone sous-dense |
Rémunération garantie dans l'Hexagone |
Rémunération garantie dans les Outre-mer |
|
29 à 34 jours |
8 325 euros |
10 300 euros |
|
35 à 40 jours |
10 000 euros |
12 350 euros |
|
41 à 46 jours |
11 675 euros |
14 400 euros |
|
47 à 52 jours |
13 325 euros |
16 450 euros |
|
53 jours et plus |
15 000 euros |
18 500 euros |
Source : Arrêté du 2 février 2021 relatif au contrat type du contrat de début d'exercice
Une prise en charge des cotisations sociales des médecins en activité depuis moins de trois ans : l'autre mesure de l'article 51 de la LFSS pour 2020
L'article 51 de la LFSS pour 2020 a également prévu une aide visant à prendre en charge, pour deux ans, certaines cotisations sociales des médecins274(*) en activité depuis moins de trois ans et s'installant en zone sous-dense entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
Le dispositif, applicable aux médecins en secteur 1 ou en secteur 2 sous option tarifaire maîtrisée (Optam), consiste en une prise en charge intégrale et automatique des cotisations de base d'assurance maladie, maternité et vieillesse et complémentaires d'assurance vieillesse, invalidité, décès et allocations familiales à la charge des bénéficiaires, dans la limite d'un plafond correspondant au montant de cotisations dues pour des honoraires conventionnels de 80 000 euros.
Cette aide, en extinction, n'aura bénéficié qu'à 349 praticiens, loin des 1 500 espérés par le Gouvernement, pour un coût de 0,8 million d'euros en 2023.
2. Un dispositif qui n'a pas rencontré son public
Les contrats de début d'exercice ne fonctionnent guère mieux que les contrats PTMG, PTMA, PTMR et PIAS auxquels il s'est substitué.
Seuls 350 médecins étaient partie à un contrat de début d'exercice en 2023, pour un budget de 2,8 millions d'euros la même année. Un à deux contrats sont donc, en moyenne, signés dans chaque département pour une année donnée.
Le manque d'engouement autour des contrats de début d'exercice peut s'analyser comme le fruit de la complexité d'un dispositif peu lisible, mais doit également se lire au regard du paysage dense et peu lisible des aides à l'installation offertes aux médecins en zone sous-dense.
3. Un dispositif qui s'inscrit dans un paysage dense et peu lisible d'aides à l'installation en zones sous-denses
En effet, face aux difficultés à attirer des médecins dans les zones sous-denses, différents acteurs ont porté des initiatives afin de les inciter à s'installer dans de tels territoires.
On recense à ce jour huit dispositifs nationaux visant à favoriser l'installation ou le maintien de médecins dans des zones d'intervention prioritaires (ZIP) ou d'action complémentaire (ZAC), qui constituent à elles deux les zones sous-denses.
Parmi eux, le contrat d'aide à l'installation des médecins (Caim), versé par la Cnam, représente les montants les plus importants avec 36,1 millions d'euros en 2023. Il consiste en une aide de 50 000 euros versée sur deux ans en contrepartie d'un engagement du praticien à exercer cinq ans sur une zone d'intervention prioritaire.
La refonte des aides de la Cnam
Les quatre dispositifs d'aide de la Cnam seront refondus, au 1er janvier 2026, en deux nouveaux mécanismes de soutien, en vertu de la convention médicale275(*).
Les médecins en secteur 1 ou en secteur 2 sous Optam bénéficieront désormais, pour une primo-installation, d'une aide forfaitaire de 10 000 euros en ZIP et 5 000 euros en ZAC versée dans les trois mois suivant son installation.
À l'ouverture d'un premier cabinet secondaire en ZIP, les médecins en secteur 1 ou secteur 2 sous Optam pourront quant à eux toucher une aide de 3 000 euros.
En outre, les médecins primo-installés en ZIP verront leur forfait médecin traitant majoré de 50 % la première année, 30 % la deuxième, et 10 % la troisième, et les médecins généralistes installés en ZIP disposeront d'une majoration pérenne de 10 % de ce même forfait.
L'État finance également un contrat d'engagement de service public (CESP), consistant en le versement d'une indemnité de 1 200 euros brut par mois le long des études de médecine générale ou d'odontologie du cocontractant, qui s'engage en retour à exercer en zone sous-dense pendant une durée au moins égale à celle durant laquelle il a bénéficié du CESP.
À cela s'ajoutent les aides versées par les collectivités territoriales276(*), qui peuvent prendre différentes formes : primes à l'installation, subventions à l'équipement, mise à disposition de locaux, mise à disposition de logements, soutien à l'installation...
Ce paysage d'aides touffu contribue à minorer globalement les taux de recours, les dispositifs ayant tendance à être en concurrence les uns avec les autres. Il fait obstacle, de plus, à une compréhension claire par les médecins des aides auxquelles ils ont droit, faisant parfois obstacle au recours au dispositif le mieux calibré aux besoins du praticien.
B. Le dispositif proposé : la suppression des contrats de début d'exercice
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 21 quater, inséré par un amendement de Jean-François Rousset et du groupe Ensemble pour la République, vise à mettre en extinction les contrats de début d'exercice.
En son I, il abroge, pour ce faire, l'article L. 1435-4-2, qui encadre le CDE. Les contrats signés continueraient de courir jusqu'à leur terme.
Le II de l'article 21 quater consiste en un gage, qui apparaît dispensable compte tenu que la mesure n'induit pas une diminution de recettes publiques.
Cet article tire les conséquences d'un récent rapport d'information de l'Assemblée nationale277(*), qui s'était montré critique à l'endroit des contrats de début d'exercice. Les députés auteurs avaient noté que l'objectif d'améliorer le taux de recours s'était « soldé par un échec », et estimaient que la réduction du périmètre des CDE aux seuls médecins remplaçants était la « preuve [...] de son inefficacité ».
II - La position de la commission
La commission accueille favorablement l'article 21 quater : elle appelle à une clarification du paysage des aides à l'installation, aujourd'hui trop touffu pour être lisible, et donc efficace. La situation appelle donc à une rationalisation des aides, et surtout des acteurs impliqués.
Elle souhaite à cet égard que les ARS se désengagent du soutien à l'installation au profit de l'assurance maladie, qui gère les volumes plus importants et pourrait alors faire office de guichet unique pour les aides nationales.
La commission tire par-là les conclusions des échecs successifs des contrats PTMG, PTMA, PTMR et PIAS et des CDE.
La commission note toutefois que supprimer le CDE sans contrepartie reviendrait à supprimer tout dispositif d'aide national à l'égard des médecins remplaçants exerçant en zone sous-dense, ce qui n'est pas souhaitable.
Elle a donc décalé, par l'amendement n° 660 de sa rapporteure, d'un an l'entrée en vigueur de la suppression du CDE afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels de s'emparer du sujet et de définir, s'ils le jugent utile, une nouvelle aide en ce sens.
En outre, la rapporteure propose, par ce même amendement d'abroger les dispositions relatives à l'exonération de cotisations sociales créée par le même article que le CDE, aujourd'hui en extinction.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 21 quinquies (nouveau)
Remboursement de séances de
guidance parentale pour les parents d'enfants présentant un trouble du
neuro-développement
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, intègre un programme de guidance parentale dans le parcours de bilan et d'intervention précoce pris en charge par l'assurance maladie pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement (TND).
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La guidance parentale, qui participe à l'amélioration de la prise en charge des enfants qui présentent un trouble du neuro-développement, n'est à ce jour pas prise en charge par la sécurité sociale
1. La guidance parentale : un dispositif pertinent pour accompagner les familles face aux troubles du neuro-développement chez l'enfant
La « guidance parentale » est une pratique structurée d'accompagnement et de soutien proposée aux parents d'enfants présentant un trouble du neuro-développement (TND)278(*).
Concrètement, un programme de guidance parentale est dispensé par des professionnels formés (psychologues, orthophonistes, éducateurs, pédopsychiatres, psychomotriciens, infirmiers...) et qui exercent dans un contexte familier aux problématiques liées aux TND.
Les séances de guidance parentale consistent, pour ces professionnels, à assurer une mission de conseil, d'aide, de soutien et d'accompagnement auprès des parents dans le but de les informer sur la façon de soutenir le développement des compétences de leur enfant sur le plan de l'autonomie, de la communication et des interactions sociales ; de leur permettre de comprendre le fonctionnement de leur enfant au quotidien ; et, à plus long terme, d'améliorer leur qualité de vie en renforçant leur savoir-faire et leur sentiment de compétence.
Bien que cette pratique soit plébiscitée par la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les TND279(*) et recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS)280(*), les séances de guidance parentale ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, sauf contextes spécifiques (organisation de séances gratuites par les structures, séances chez le psychologue prises en charge dans le cadre du dispositif « Mon soutien psy » notamment).
2. Le parcours de bilan et d'intervention précoce : un système de prise en charge des enfants qui présentent un TND récemment mis en place
Les dernières stratégies nationales pour l'autisme et les TND ont permis de faire émerger un modèle de prise en charge précoce des enfants autour de trois actions : le repérage, le diagnostic et l'intervention.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019281(*) a notamment créé des plateformes de coordination et d'orientation (PCO)282(*) chargées d'organiser un parcours de bilan et d'intervention précoce, pris en charge par l'assurance maladie, pour accompagner les enfants de 0 à 6 ans qui présentent des TND283(*). Il existe aujourd'hui plus d'une centaine de plateformes sur l'ensemble du territoire.
Le parcours de bilan et d'intervention précoce intègre notamment l'orientation vers un médecin ORL pour un examen de l'audition, l'orientation vers un ophtalmologue ou un orthoptiste pour un examen de la vision, et la prescription d'un bilan orthophonique ou d'un bilan du développement moteur. Il permet également l'intervention précoce des professionnels auprès de l'enfant, sans attente des résultats des bilans.
En revanche, les séances de guidance parentale ne sont pas intégrées ce parcours. Dans un rapport de 2024284(*), se référant aux recommandations de la HAS et aux études existantes sur la guidance parentale, l'assurance maladie recommande de donner la possibilité à tous les parents ayant un enfant diagnostiqué avec un TND après orientation par les PCO de bénéficier d'un forfait de séances de guidance parentale pris en charge, afin de les aider à comprendre le fonctionnement de leur enfant et de soutenir leur développement.
B. Le présent article prévoit que le parcours de bilan et d'intervention précoce pour les troubles du neuro-développement intègre un programme de guidance parentale
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Issu d'un amendement du Gouvernement, il propose de financer des séances de guidance parentale dans le cadre du parcours de bilan et d'intervention précoce.
Il insère un nouvel alinéa à l'article 2135-1 du code de la santé publique, disposant que ce parcours « intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret ».
Le Gouvernement a précisé que les séances seraient financées de façon forfaitaire, et seraient proposées aux familles après la confirmation d'un diagnostic médical de TND chez l'enfant. L'ouverture au remboursement de ces séances concernerait les prestations réalisées par les professionnels non conventionnés avec l'assurance maladie, ayant contractualisé avec les PCO et intervenant dans le parcours de l'enfant (ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues).
Aucune estimation du coût de cette mesure n'est fournie.
II - La position de la commission
La commission salue cette mesure, qui renforce la stratégie de prise en charge précoce des enfants qui présentent des TND et qui répond à des besoins d'accompagnement et de soutien clairement identifiés chez les parents.
Néanmoins, elle rappelle que le parcours de bilan et d'intervention précoce et les PCO chargés de l'assurer sont récents et que leur notoriété est encore perfectible. Aussi, tous les enfants ne sont pas diagnostiqués dans le cadre de ce parcours, ce qui présente un risque de rupture d'égalité sur le plan du remboursement, par la sécurité sociale, de la prise en charge de l'enfant et des séances d'accompagnement des parents.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 sexies (nouveau)
Extension des compétences des
orthoprothésistes, podo-orthésistes
et
orthopédistes-orthésistes
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, ouvre la possibilité aux orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes de prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux et de procéder à leur réparation et au remplacement d'une partie de ces derniers sans prescription.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes sont des professionnels de santé spécialistes de l'appareillage
Les orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes sont des auxiliaires médicaux relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique : ils revêtent, à ce titre, la qualité de professionnels de santé.
Ces trois professions sont des spécialistes de l'appareillage en faveur des personnes malades ou handicapées et font partie de la famille des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades et handicapées, avec les ocularistes et les épithésistes285(*).
Les orthoprothésistes procèdent à l'appareillage orthopédique externe sur mesure de personnes présentant « soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique »286(*). Ils conçoivent, fabriquent et adaptent287(*) les prothèses de membre inférieur ou supérieur remplaçant un membre amputé ou absent et les orthèses des mêmes membres, du tronc et de la tête, qui compensent une déficience ou une déformation musculaire, osseuse ou neurologique.
Les podo-orthésistes sont quant à eux chargés de l'appareillage orthopédique sur mesure du pied d'une personne malade ou handicapée288(*) présentant une amputation partielle du pied ou une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du même organe289(*). Ces professionnels conçoivent et réalisent290(*) notamment des orthèses plantaires, aussi appelées semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques sur mesure et certains appareils podo-jambiers comme les releveurs ou les coques moulées.
Enfin, les orthopédistes-orthésistes s'appliquent à procéder à l'appareillage orthétique ou orthopédique291(*), sur mesure ou en série, des assurés malades ou présentant un handicap292(*). Ces professionnels sont spécialistes des petits appareillages comme les orthèses de la main, du pied ou les bandages herniaires.
B. Ces professionnels ne disposent à ce jour pas du droit de prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux, ni de les réparer ou remplacer sans prescription
1. Des professions agissant presque exclusivement sur prescription médicale
Les orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes constituent des professions dont l'essentiel du rôle est prescrit, c'est-à-dire qu'ils n'agissent que sur prescription médicale. Ces règles s'appliquent, par la loi, à l'ensemble des prothésistes et orthésistes293(*).
Les cadres d'exercice spécifiques à chacune des trois professions prévoient toutefois une dérogation, de portée limitée. En effet, il est loisible aux orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes d'adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions d'orthèses plantaires datées de moins de trois ans, sauf opposition expresse du prescripteur. Le prescripteur et, le cas échéant, un médecin désigné par le patient sont alors informés par le professionnel de l'adaptation de la prescription initiale.
Ces professionnels ne sont donc pas habilités à réparer ou remplacer une partie des prothèses et orthèses qu'ils conçoivent en l'absence de prescription, ce qui rend la consultation d'un médecin nécessaire.
2. Des professionnels dépourvus de pouvoir de prescription sur les dispositifs médicaux qu'ils dispensent
Pour être pris en charge par la sécurité sociale, les dispositifs médicaux doivent être inscrits sur une liste de remboursement appelée liste des produits et prestations remboursables (LPP)294(*).
Définition d'un dispositif médical
Relèvent de la catégorie des dispositifs médicaux une large variété de produits de santé, incluant notamment les appareillages dont font partie les prothèses et les orthèses.
L'article L. 5211-1 du code de la santé publique définit, dans la loi, un dispositif médical comme « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales mentionnées ci-après et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens :
1° Diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie ;
2° Diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci ;
3° Investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique ;
4° Communication d'informations au moyen d'un examen in vitro d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d'organes, de sang et de tissus. »
La prise en charge d'un dispositif médical est, au surplus, subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en ce sens295(*).
Par dérogation à ce principe, le remboursement par l'assurance maladie est également ouvert lorsque la prescription émane de certains auxiliaires médicaux, dans la limite des compétences qui leur sont spécifiquement attribuées :
- les infirmiers en pratique avancée peuvent prescrire certains dispositifs médicaux à prescription médicale non obligatoire, figurant sur une liste296(*) ;
- les infirmiers ont vu leurs prérogatives s'accroître en matière de pouvoir de prescription des dispositifs médicaux avec la récente loi dédiée à la profession297(*), qui leur ouvre droit à prescrire les produits de santé nécessaires à l'exercice de la profession298(*) ;
- les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession299(*) ;
- les orthophonistes ont la capacité de prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux inscrits sur une liste ad hoc300(*) ;
- les orthoptistes peuvent renouveler et adapter une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact, à condition, pour le renouvellement, qu'un bilan visuel ait été préalablement effectué par un ophtalmologiste301(*) ;
- enfin, les pédicures podologues se voient conférer un pouvoir de prescription des orthèses plantaires302(*), sauf avis médical contraire, et des pansements figurant sur une liste spécifique303(*).
Il ressort de ces dispositions que les orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes ne sont pas habilités à prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux, y compris ceux qu'ils conçoivent, fabriquent et adaptent.
C. Le dispositif proposé : un élargissement des compétences des orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 21 sexies, inséré à l'initiative du Gouvernement et de Corinne Vignon et quatre de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, prévoit d'attribuer de nouvelles compétences aux orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes.
Il porte création d'un article L. 4369-9 du code de la santé publique, renvoyant à un décret les conditions dans lesquelles ces trois professions peuvent :
- d'une part, prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
- d'autre part, remplacer une partie de certains dispositifs médicaux inscrits sur une liste ou les réparer, sans prescription préalable.
Il est prévu que le médecin puisse s'opposer, au cas par cas, à la mobilisation de ces nouvelles compétences.
Le Gouvernement défend que cet élargissement de compétences permettra de lever des obstacles « ralentissant considérablement - [le] parcours de soins et complexifiant [la] prise en charge » et de « désengorger les médecins généralistes » en supprimant des consultations médicales non nécessaires.
II - La position de la commission
La commission a, comme elle en a l'habitude, accueilli favorablement ces dispositions, qui renforceront l'accès aux soins sur nos territoires et fluidifieront le parcours des assurés appareillés en ne rendant la prescription médicale nécessaire que pour les cas où elle apporte la plus forte valeur ajoutée. Ce faisant, cette mesure est de nature à libérer du temps médical, qui pourra être utilement consacré à d'autres assurés.
La commission salue à ce titre l'approche mesurée du présent article, qui n'ouvre pas un droit de prescription absolu mais encadré par une liste. Elle regrette toutefois que cette liste puisse être arrêtée unilatéralement par le ministre, sans regard scientifique ou médical préalable. Pour cette raison, elle a adopté l'amendement n° 661 de sa rapporteure, visant à soumettre les arrêtés définissant le champ des dispositifs médicaux concernés à avis préalable de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.
De la même manière, la commission estime que les représentants des professionnels de l'appareillage aussi bien que des médecins doivent impérativement être consultés sur le décret qui donnera toute sa substance au dispositif. Les bénéfices attendus des évolutions portées par cet article sont en effet largement conditionnés à l'engagement des professionnels et à la manière dont ils s'approprieront la mesure : rappelons que le dispositif prévoit, à juste titre, un pouvoir d'opposition du médecin pour que ce dernier puisse garder la main sur les cas les plus complexes.
L'ensemble des avis insérés par la commission seront réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois, afin d'éviter toute situation de blocage lié au manque de diligence de certaines instances consultées dans la communication de leur avis.
Il s'agit là d'une mesure qui, en outre, reconnaît la contribution décisive des orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes dans le parcours de soins des assurés nécessitant, au titre de leur pathologie, des appareillages. Cet article répond en cela à une demande exprimée de longue date par ces professionnels, et favorise la confiance en les professionnels de santé.
La commission appelle néanmoins le Gouvernement à porter une attention particulière, dans l'application réglementaire de la mesure, au phénomène d'« autoprescription » de dispositifs fournis par le prescripteur et à suivre le risque d'incitation à la consommation ou de fraude qui pourrait en découler.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 21
septies (nouveau)
Soumission de la pratique de la médecine
esthétique à un régime d'autorisation préalable de
l'agence régionale de santé
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, soumet la pratique de la médecine esthétique à une autorisation préalable de l'agence régionale de santé.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. La médecine esthétique : un secteur mal contrôlé et en plein essor
1. La médecine esthétique recouvre des actes médicaux n'ayant pas pour but d'améliorer l'état de santé de la personne, mais de modifier son apparence
La médecine esthétique consiste en un ensemble d'actes médicaux non ou peu invasifs ayant pour but de modifier l'apparence de la personne qui les sollicite.
Si, dans certains cas, ces actes peuvent incidemment avoir pour effet d'améliorer la santé mentale de la personne qui y recourt, il convient d'emblée de préciser que ces soins n'ont pas de visée curative stricto sensu, mais qu'ils ambitionnent plutôt d'améliorer le confort de vie. En ce sens, ces actes ne sont, en principe, pas remboursés par la sécurité sociale.
Le champ de la médecine esthétique recouvre de nombreuses pratiques : injections de toxine botulique (botox) ou d'acide hyaluronique, greffe capillaire, épilation au laser, peeling ou drainage lymphatique contre la cellulite, notamment.
Médecine esthétique, chirurgie esthétique et chirurgie réparatrice
La chirurgie esthétique est définie comme l'ensemble des « actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice »304(*). Elle poursuit le même but que la médecine esthétique, à savoir l'amélioration de l'apparence d'une personne, mais au travers d'interventions chirurgicales invasives, qui peuvent nécessiter une anesthésie locale ou générale. Relèvent par exemple en règle générale de la chirurgie esthétique une liposuccion, un lifting, une augmentation mammaire ou une rhinoplastie. Les opérations de chirurgie esthétique ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, sauf, dans certains cas, lorsque la personne apporte la preuve que l'opération chirurgicale répond à un préjudice important.
La chirurgie réparatrice permet quant à elle de pallier les conséquences esthétiques d'une blessure, d'un accident, d'une malformation ou d'une pathologie et fait l'objet, à ce titre, d'une prise en charge de la sécurité sociale sous conditions. Certains actes de chirurgie réparatrice correspondent à des actes de chirurgie esthétique, mais ne concernent pas le même public, comme les chirurgies mammaires reconstructrices après un cancer du sein.
2. Un secteur en plein développement, attirant toujours plus de praticiens
Le secteur de la médecine esthétique a connu, ces dix dernières années, un essor impressionnant, porté aussi bien par le progrès des techniques médicales en la matière que par la publicité de ces pratiques par des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Selon les données communiquées par le congrès IMCAS, qui réunit chaque année plus de 12 000 acteurs du secteur de l'esthétique médicale et chirurgicale, le marché mondial a plus que triplé en dix ans, passant de 5,7 à 21,7 milliards d'euros entre 2014 et 2024. Les injections représentent à elles seules 46 % du marché, soit plus de 10 milliards d'euros à l'échelle mondiale.
La France n'échapperait pas à la règle selon la société internationale de chirurgie plastique et esthétique (International society of aesthetic plastic surgery) : médecine et chirurgie esthétiques y auraient généré près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) estime à 2 millions le nombre de Français qui auraient déjà recouru à la médecine esthétique, dont 1,2 million pour des injections.
Répondant à la demande dynamique, « de nombreux médecins se sont convertis à l'esthétique »305(*), selon une revue publiée par le Cnom. Un tel afflux n'est pas sans lien avec la faible évolution de la valorisation des actes de médecine curative : « beaucoup de médecins se sont tournés vers la médecine esthétique en raison de la sous-valorisation des actes médicaux qui ne sont pas à la hauteur de nos voisins européens », explique la revue, ajoutant qu'« une injection de botox est beaucoup plus rémunératrice qu'une consultation multipathologie » pour les praticiens.
S'il est difficile d'évaluer avec précision le nombre de praticiens concernés, l'Ordre estime que près de 10 000 médecins s'adonneraient à la médecine esthétique en France, dont 1 000 chirurgiens et 3 700 dermatologues.
3. Un défaut de contrôle de la médecine esthétique, malgré les efforts récents de l'Ordre sur la question
a) Un encadrement des activités de chirurgie esthétique
La pratique de la chirurgie esthétique est subordonnée à la détention, par le médecin, d'un diplôme d'études spécialisées (DES) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique306(*). L'exercice de la chirurgie esthétique fait donc obstacle à l'exercice de toute autre spécialité relevant d'un DES307(*).
Les activités de chirurgie esthétique sont encadrées par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code de la santé publique, qui soumettent à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente308(*) les installations dans lesquelles peuvent être pratiqués des actes de chirurgie esthétique.
L'autorisation est octroyée à l'appui d'un dossier309(*) et à la suite d'une visite de conformité visant à s'assurer que l'installation respecte des conditions techniques de fonctionnement déterminées310(*), pour une durée limitée.
Elle peut être retirée en cours de validité, notamment lorsque l'installation attente à la santé publique par sa politique commerciale, incite les mineurs à recourir à ses prestations ou lorsqu'est identifié un risque pour la sécurité. La pratique de la chirurgie esthétique par une installation non autorisée est punie de 150 000 euros d'amende311(*).
Toute opération de chirurgie esthétique fait, au surplus, l'objet d'une information à la personne qui la subit312(*) quant aux conditions de l'intervention et aux risques et complications qui peuvent y être associés313(*).
b) Un contrôle aujourd'hui minimaliste sur les activités de médecine esthétique, donnant lieu à des dérives
Les activités de médecine esthétique s'inscrivent dans un cadre considérablement moins contraignant. Les activités sans risque pour la santé ne sont pas encadrées par la loi.
Concernant les règles applicables aux activités de médecine esthétique présentant des risques pour la santé :
- les actes esthétiques non chirurgicaux présentant des risques pour la santé peuvent être soumis à des règles sur la formation et la qualification des professionnels effecteurs, et sur les conditions de réalisation de ces actes314(*), définies après avis de la Haute Autorité de santé (HAS) ;
- les actes à visée esthétique dont la mise en oeuvre présente un danger grave réel ou supposé pour la santé humaine peuvent être interdits, après avis de la HAS315(*).
La méconnaissance de ces dispositions expose le praticien à des sanctions financières316(*) et, pour les actes non interdits, à une suspension du droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois317(*).
À cela s'ajoute que la médecine esthétique « n'est pas une spécialité reconnue en tant que telle par l'Ordre », comme l'indique la revue précitée du Cnom. Ainsi, seuls les dermatologues disposent d'une formation diplômante et certifiée par l'Ordre pour pratiquer la médecine esthétique. Le Cnom estime ainsi que « les 5 000 médecins [non dermatologues] environ qui pratiquent ces actes n'ont pas tous l'expertise adéquate ». Ces médecins, en majorité des généralistes, ne sont pour certains pas formés ; d'autres sont titulaires du diplôme inter-universitaire reconnu jusqu'en 2013 ou des diplômes universitaires (DU) courts spécifiques qui existent aujourd'hui318(*), voire ont suivi des stages à l'étranger. En tout état de cause, ils ne disposent pas d'une qualification qui a cours officiel.
L'absence de DES de médecine esthétique renforce paradoxalement l'attractivité de cette pratique dès lors qu'un médecin peut cumuler son activité en médecine esthétique et son activité dans une spécialité dont il est titulaire du DES.
L'attractivité de la médecine esthétique pour les praticiens se traduit en outre par une limitation du temps médical disponible pour le curatif, particulièrement préjudiciable dans un contexte d'accès aux soins dégradé sur le territoire national.
En définitive, « l'essor conséquent des actes médicaux à visée esthétique s'accompagne d'une augmentation significative des dérives liées à cet exercice » selon le Cnom, d'autant plus marquée que les pouvoirs publics ont peu de moyens de contrôler cette activité.
Les « fake injectors » : un phénomène particulièrement préoccupant
Les réseaux sociaux ont offert aux « fake injectors », des personnes non titulaires d'un diplôme de médecine, non qualifiées et non autorisées pratiquant des injections à visée esthétique sans formation, un terrain privilégié pour leur promotion commerciale.
Si cette activité ne relève pas de la médecine esthétique mais plutôt de l'exercice illégal de la médecine, l'ampleur de ce phénomène suscite la préoccupation des autorités en raison des risques de santé publique associés.
c) L'action de l'Ordre en faveur d'un meilleur encadrement de la pratique de la médecine esthétique
Après avoir appelé à « la création d'une pratique réglementée [...] face aux nombreuses complications dues à la médecine esthétique »319(*) en 2023, le Cnom a validé un diplôme inter-universitaire (DIU) de médecine esthétique, associé à une formation de deux ans. Parmi les 350 candidats à la première promotion, 60 médecins ont été retenus.
Ce diplôme, reconnu par l'Ordre pour cinq ans, consiste en près de 90 heures de cours théoriques et 80 heures de stages. Il n'est ouvert qu'aux médecins disposant de trois ans d'ancienneté dans une discipline clinique, afin d'éviter l'afflux de jeunes diplômés vers cette activité réputée lucrative.
La détention de ce titre, par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience, devient obligatoire pour la pratique de la médecine esthétique.
B. Le dispositif proposé : un régime d'autorisation par l'agence régionale de santé de la pratique de la médecine esthétique
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 21 septies, inséré à l'initiative de Philippe Juvin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, vise à renforcer l'encadrement de la pratique de la médecine esthétique.
Au sein d'un article L. 6322-1-1 nouveau inséré dans la section du code de la santé publique relative à la chirurgie esthétique, le présent article instaure un régime d'autorisation par l'agence régionale de santé compétente pour la pratique de la médecine esthétique. L'autorisation est accordée en fonction des besoins médicaux de la population locale, selon des modalités fixées par décret, pour une durée de cinq ans renouvelables.
II - La position de la commission
Il est indispensable que soit renforcé l'encadrement de la médecine esthétique, dont la pratique est l'objet de dérives bien documentées, y compris pour la sécurité des personnes qui y recourent.
La commission accueille en ce sens favorablement l'ensemble des efforts menés par le Cnom pour renforcer l'encadrement de la médecine esthétique, avec la création du récent DIU en la matière. Il s'agit d'une garantie indispensable de santé publique et d'expertise des praticiens, qui répond à ce qui apparaissait jusqu'alors comme un angle mort de l'encadrement des pratiques médicales.
L'attrait particulier que revêt cette discipline pour les médecins, en particulier chez les jeunes générations, s'explique aisément en raison de l'insuffisance des revalorisations accordées aux actes de médecine curative, dont la rétribution est désormais peu incitative.
La commission ne peut toutefois que regretter cette situation, qui s'inscrit dans un contexte où, selon les derniers zonages en vigueur, 75,7 % de la population française habite dans une zone caractérisée par des difficultés dans l'accès aux soins médicaux.
Dans ce contexte, l'accès à la médecine curative, garante du droit constitutionnel à la protection de la santé, doit naturellement demeurer la première préoccupation des pouvoirs publics. La commission souscrit pleinement aux propos de l'un des auteurs de la revue du Cnom précitée, selon lequel les « reconversions vers l'esthétique sont questionnables sur le plan éthique car soigner les malades semble prioritaire par rapport au fait d'embellir l'apparence de nos concitoyens ».
Bien que la commission souscrive sans réserve à l'intention de cet article, la commission émet deux réserves à son encontre, qui la conduisent à le rejeter à l'appui de l'amendement n° 662 de sa rapporteure.
D'une part, la médecine esthétique n'étant pas ou peu remboursée par la sécurité sociale et la pratique de cette discipline étant sans effet sur le conventionnement, la commission s'interroge sur la recevabilité sociale de l'article 21 septies.
D'autre part, la commission note que le Gouvernement et le Cnom ont déjà engagé des travaux dans le sens d'un meilleur encadrement de la médecine esthétique, ce qu'elle salue. Alors que ces dispositions n'ont pas été concertées avec la profession, la commission juge préférable de laisser aux initiatives conjointes du Cnom et du Gouvernement le temps d'aboutir et de produire leurs effets.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 21 octies (nouveau)
Délégation
encadrée de tâches aux auxiliaires médicaux du service
du contrôle médical du régime agricole
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de permettre une délégation encadrée de tâches aux auxiliaires médicaux du service du contrôle médical du régime agricole, sur le modèle des dispositions en vigueur pour le régime général.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. L'ouverture d'une délégation de tâches encadrée au bénéfice des auxiliaires médicaux du service du contrôle médical du régime général
1. Le service du contrôle médical, qui existe aussi bien pour le régime général que pour le régime agricole, vérifie que les conditions médicales d'ouverture des prestations sont bien remplies
Les services du contrôle médical des régimes obligatoires de sécurité sociale sont chargés d'assurer la vérification des conditions médicales auxquelles est subordonné le service des prestations. Ils contrôlent également, à ce titre, que la délivrance des prestations satisfait aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur.
Leur champ, défini par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, s'étend à « tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ». Ils constatent notamment à ce titre les abus en matière de soins ou de prescriptions d'arrêts de travail et se prononcent sur l'attribution du statut d'affection de longue durée, de la pension d'invalidité ou des prestations d'incapacité permanente AT-MP.
Les services du contrôle médical sont notamment composés de médecins conseils (MC), de chirurgiens-dentistes conseils (CDC) et de pharmaciens conseils (PhC), formant les praticiens conseils, d'auxiliaires médicaux et de personnel administratif.
La réforme de l'organisation des services du contrôle médical du régime général
Historiquement, le service du contrôle médical du régime général était structuré selon un échelon local (ELSM), le plus souvent départemental, un échelon régional (ERSM) et un échelon national, en parallèle du réseau des caisses d'assurance maladie. Tous les praticiens-conseils étaient alors des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie320(*).
Toutefois, un décret321(*) est venu réformer, au 1er octobre 2025, l'organisation des services du contrôle médical du régime général, en intégrant les échelons locaux et régionaux de ces derniers aux caisses d'assurance maladie, sans préjudice du maintien de l'indépendance technique dont jouissent les professionnels de santé qui y exercent. Les praticiens-conseils peuvent désormais être des agents des caisses primaires d'assurance maladie.
Le Gouvernement justifie cette évolution par une volonté de réaliser des économies de gestion et par l'opportunité d'offrir à l'assuré un interlocuteur unique pour l'assurance maladie à l'échelon local.
Le régime agricole bénéficie, comme le régime général, d'un service du contrôle médical, encadré réglementairement322(*) et exerçant ses prérogatives en toute indépendance323(*). Le réseau, encore décliné à l'échelle locale et régionale, compte 230 praticiens-conseils dont 200 médecins, ainsi que des auxiliaires médicaux et du personnel administratif.
2. Les services du contrôle médical sont confrontés à des difficultés de recrutement, qui ont justifié l'ouverture de délégations de tâches pour le régime général
Les services du contrôle médical souffrent d'un manque d'attractivité vis-à-vis des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, en raison de leur absence d'activité clinique.
Un récent rapport de l'Igas note à cet égard qu'« entre 2018 et 2022, leur nombre a diminué de 12,15 % contre 4,47 % pour l'ensemble des personnels de l'Assurance maladie, principalement du fait des départs à la retraite. De nombreux départements ne comprennent que peu de MC, et aucun PhC ou CDC, impliquant de recourir à des entraides entre échelons, et avec des impacts sur l'activité. La pyramide des âges des PC tout comme les perspectives démographiques médicales impliquent que ces difficultés s'accentueront à court et moyen terme, sans mesures palliatives »324(*).
Or, les services du contrôle médical reposent en grande partie sur les praticiens-conseils, dès lors qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, « les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseil ». L'accès aux données personnelles, déterminant pour l'activité du service, leur est en outre réservé ainsi qu'aux personnes sous leur autorité325(*).
Par conséquent, le législateur a entendu, lors de la LFSS pour 2024326(*), conférer aux praticiens-conseils la possibilité de déléguer, sous leur responsabilité, certains actes et activités au personnel du service qualifié. Cela concerne notamment des auxiliaires médicaux, dans la limite de leurs compétences. L'attribution et le service de prestations par des auxiliaires médicaux est conditionné à l'établissement d'un protocole écrit avec un praticien conseil.
Ces dispositions n'ont toutefois pas été élargies au service du contrôle médical du régime agricole.
B. Le dispositif proposé : l'extension au régime agricole de la possibilité pour les praticiens conseils de déléguer certains actes
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 21 octies, inséré à l'initiative d'Annie Vidal et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, prévoit d'étendre au régime agricole le bénéfice des dispositions concernant la possibilité pour les praticiens conseils de déléguer certains actes et activités aux membres qualifiés du personnel du service du contrôle médical.
Les auxiliaires médicaux pourront ainsi se voir déléguer certains actes, dans la limite de leurs compétences, et seront habilités à rendre des avis commandant l'attribution et le service de certaines prestations dans le cadre d'un protocole écrit.
Pour procéder à ces modifications, l'article 21 octies modifie l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, relatif au service du contrôle médical du régime général, en faisant également mention des praticiens conseils des organismes de Mutualité sociale agricole.
II - La position de la commission
Il y a deux ans, la commission avait soutenu les dispositions ouvrant la possibilité pour les praticiens conseils du service du contrôle médical du régime général de déléguer des actes.
La délégation s'exerçant sous le contrôle du praticien conseil et, pour le service des prestations, à l'appui d'un protocole écrit, la rapporteure avait en effet estimé que le cadre proposé était suffisamment sécurisé pour garantir la qualité des décisions rendues.
La rapporteure avait alors souligné l'intérêt de cette mesure pour libérer du temps médical dans les services concernés, touchés par des difficultés de recrutement et par une démographie défavorable.
Les services du contrôle médical du régime agricole se trouvant dans la même situation de pénurie de praticiens conseils, la rapporteure estime naturellement pertinent que leur soit appliquées les mêmes dispositions que pour le régime général, d'autant plus que leur démographie devrait malheureusement continuer à se dégrader. Elle soutient donc le dispositif proposé.
La commission a, à des fins de lisibilité et de clarté du droit, préféré inscrire cette possibilité dans un article du code rural et de la pêche maritime. Elle a adopté, en ce sens, l'amendement n° 663 de sa rapporteure.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 21 nonies (nouveau)
Modification de la demande de rapport
de la LFSS 2025 sur le bilan
de l'article 33 de la LFSS 2023
et sur l'indexation automatique du tarif
des actes infirmiers sur le taux
d'inflation
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose de modifier le contenu du rapport demandé dans la LFSS pour 2025 visant à réaliser le bilan de l'article 33 de la LFSS pour 2023 et à étudier l'opportunité de la mise en place d'un mécanisme d'indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l'inflation.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La demande de rapport concerne deux sujets distincts relatifs aux compétences et aux modalités d'exercice du métier d'infirmier
La demande de rapport prévue à l'article 47 de la LFSS pour 2025 concerne d'abord l'extension de la compétence d'administration et de prescription des vaccins aux pharmaciens, aux sages-femmes et aux infirmiers, prévue par l'article 33 de la LFSS pour 2023. Cette extension concerne également les étudiants en troisième cycle des études de médecine et de pharmacie, et plusieurs décrets du 8 août 2023 ont précisé les modalités d'exercice de ces nouvelles compétences327(*)328(*).
En complément, d'une part, ce rapport doit étudier l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmier et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue. D'autre part, il étudie les modalités de mise en place d'un mécanisme d'indexation automatique des tarifs des actes infirmiers sur l'inflation et leurs impacts respectifs pour la sécurité sociale. En effet, les principaux actes réalisés par les infirmiers (les actes médico-infirmiers, de soins infirmiers et la démarche de soins infirmiers) n'ont pas fait l'objet d'une revalorisation significative depuis 2009. Du fait du poids de l'absence de revalorisation sur l'activité des infirmiers, des négociations ont été entamées avec les représentants syndicaux des infirmiers libéraux depuis juillet.
Bien que l'article 47 prévoie que le rapport soit publié dans les trois mois de la promulgation de la LFSS pour 2025, celui-ci n'a pas été communiqué au Parlement à ce jour.
B. L'article 1er de la loi du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier a consolidé l'accès direct aux infirmiers
L'article 1er de la loi dite « Dubré-Chirat »329(*) prévoit l'ouverture de l'accès direct aux infirmiers en soins de premier recours, dans le cadre de leur rôle propre. Il prévoit ainsi qu'un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier, tandis qu'il appartiendra au ministre de la santé de fixer par arrêté la liste des actes et soins réalisés pour chacun des domaines d'activité.
Cette réforme permet également, en son article 6, de manière expérimentale, un accès direct aux soins de premier recours pour certains actes qui dépassent le rôle propre des infirmiers. Cet article prévoit qu'un décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation.
Les actes réglementaires de mise en oeuvre de cette n'ont pas encore été publiés à ce jour, même si un projet de décret sur l'accès direct dans le cadre du rôle propre des infirmiers a été présenté aux représentants de la profession.
C. Le dispositif proposé : une modification de la demande d'un rapport au Gouvernement relatif aux compétences et aux modalités d'exercice du métier d'infirmier
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 21 nonies a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de Karen Erodi et plusieurs de ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire. L'article 21 nonies prévoit de modifier le contenu du rapport demandé au Gouvernement. Il supprime l'analyse des impacts pour la sécurité sociale des mesures renforçant l'attractivité du métier d'infirmier et de la mise en place d'un mécanisme d'indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l'inflation.
Il complète le contenu du rapport demandé en précisant qu'il définit les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue à l'article 6 de la loi « Dubré-Chirat » et le rôle propre de l'infirmier tel qu'encadré par l'article 1er de cette loi.
Il propose de remplacer le délai de trois mois par un délai d'un an pour permettre le respect du délai de publication du rapport prévu par l'article 47 de la LFSS pour 2025.
II - La position de la commission
À titre liminaire, la commission note que cet article ne consiste pas en une demande de rapport, mais en une modification du champ d'une demande de rapport déjà adoptée par le Parlement, non encore remis par le Gouvernement.
La commission estime pertinent de mobiliser ce rapport pour instruire les conditions dans lesquelles les infirmiers pourront bénéficier, sur expérimentation, d'un accès direct hors rôle propre.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 decies (nouveau)
Expérimenter la
désignation d'une équipe de soins traitante
par
l'assuré dans les zones caractérisées par une offre de
soins insuffisante
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit de permettre, à titre expérimental, la désignation par les assurés d'équipes de soins traitantes pluridisciplinaires dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. L'accès au médecin traitant dans un contexte de désertification médicale
1. L'obligation de désigner un médecin traitant en charge de la coordination des soins
• Le principe de l'obligation de la désignation par le patient330(*) de son médecin traitant est prévu et encadré par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article, la qualité de médecin traitant peut être attribuée à un médecin généraliste ou spécialiste, exerçant en tant que médecin libéral, hospitalier ou salarié dans un centre de santé ou un établissement médico-social. Enfin, l'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant. Le médecin remplaçant peut également se substituer au médecin traitant dans l'exercice de ses missions, au titre de la continuité des soins331(*).
La procédure de déclaration du médecin traitant est réalisée par le biais d'une déclaration en ligne remplie par le médecin avec l'accord du patient ou l'établissement d'un document « Déclaration de choix du médecin traitant » envoyé à l'assurance maladie par l'assuré. Cette déclaration doit être réalisée lors d'une consultation physique332(*).
Une majoration du ticket modérateur est prévue lorsqu'un assuré n'a pas désigné de médecin traitant ou a consulté un médecin sans prescription préalable d'un médecin traitant (cf. encadré infra).
L'encadrement de la majoration du ticket modérateur
En application de l'article R. 322-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré n'a pas désigné de médecin traitant, la majoration du ticket modérateur se matérialise par la diminution du taux de prise en charge de la sécurité sociale. Elle peut représenter 37,5 % à 42,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie. Le non-respect du parcours de soins entraîne quant à lui une majoration de 17,5 % des tarifs333(*).
Ces majorations ne peuvent être prises en charge par les complémentaires santé et s'appliquent également aux assurés qui sont exonérés du mécanisme de ticket modérateur.
De nombreuses exceptions sont cependant prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et aux articles D. 162-1-6 et D. 162-1-7 du même code. Elles permettent de prendre en compte les situations d'urgence et de déplacement hors du lieu de résidence stable du patient, de permanence des soins ou de suivi coordonné des soins. Certaines consultations spécialisées sont également exclues (addictologie, médecine préventive ou génétique), tandis que certaines spécialités médicales bénéficient d'un accès direct (gynécologie médicale et obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie).
• Par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie334(*), le législateur a introduit la notion de parcours de soins coordonné, au coeur duquel le médecin traitant joue un rôle majeur. Ses missions sont définies par voie conventionnelle335(*). En application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie336(*), le médecin traitant doit notamment :
- contribuer à l'offre de soins ambulatoires ;
- assurer l'orientation des patients auprès des médecins correspondants dans le cadre du parcours de soins ;
- rédiger le protocole de soins, veiller à son suivi et se prononcer sur son renouvellement ;
- assurer la participation du patient aux actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé ;
- contribuer à assurer la continuité des soins de ses patients en cas de cessation d'activité, notamment ceux atteint d'affection de longue durée.
Le rôle du médecin traitant est également central en ce qu'il participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé du patient337(*).
Le médecin traitant dispose ainsi d'une place capitale dans la coordination du parcours de soins du patient.
2. L'aggravation de la désertification médicale complexifie la désignation d'un médecin traitant par les assurés
Les difficultés d'accès aux soins en France ont été rapportées à de multiples reprises, et se caractérisent par leur gravité et leur persistance338(*). Dans un contexte d'augmentation des besoins de santé lié à la croissance démographique, au vieillissement de la population et à la prévalence accrue des maladies chroniques, l'évolution à la baisse de la démographie médicale fragilise l'accès aux soins dans les territoires339(*). 87 % du territoire est ainsi classé en désert médical, avec près de 3,3 % de la population habitant dans les « zones rouges » en situation de forte vulnérabilité identifiées par le Gouvernement340(*).
Si 241 255 médecins étaient en activité au 1er janvier 2025341(*) (contre 237 300 au 1er janvier 2024), cette hausse est concomitante à l'évolution des modes d'exercice des médecins, avec une part croissante de médecins retraités poursuivant une activité partielle (en hausse de 307 % entre 2010 et 2025) et de praticiens exerçant de façon intermittente (les médecins remplaçants, en hausse de 71,2 %). L'effectif des médecins spécialistes en médecine générale, qui représentent la majorité des médecins traitants, est quant à lui en baisse de 13 % entre 2015 et 2025342(*).
Cette situation altère mécaniquement la disponibilité des médecins et la désignation d'un médecin traitant pour tous les patients. De ce fait, près de 6 millions des Français de 17 ans et plus n'ont pas déclaré de médecin traitant en 2024343(*). Si elle est en diminution depuis la mise en oeuvre du plan « ALD sans médecin traitant » de 2023, la proportion de patients en affection longue durée (ALD) sans médecin traitant est encore de 4,3 % au 30 juin 2025344(*).
De plus, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de 2023, 65 % des généralistes déclarent devoir refuser de nouveaux patients comme médecin traitant, contre 53 % en 2019, tandis que 44 % d'entre eux signalaient leur incapacité à suivre régulièrement tous leurs patients345(*).
3. Les nouvelles formes d'exercice coordonné et les délégations de tâches : des leviers face à l'aggravation de la désertification médicale
• Le législateur favorise depuis les années 2010 la création de structures d'exercice pluriprofessionnelles afin de promouvoir l'exercice coordonné et complémentaire des professionnels de santé et de favoriser l'accès aux soins.
Le développement des organisations territoriales coordonnées
Les centres de santé (CDS)346(*) délivrent des soins de premier ou de second recours, parfois via une prise en charge pluriprofessionnelle, et la moitié d'entre eux est implantée dans une zone en tension347(*).
Quant aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)348(*), constituées entre des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et des pharmaciens, elles assurent une offre de soins primaires et de prévention, et sont majoritairement implantées en zone sous-dotée, c'est-à-dire en zone rurale ou périurbaine pour 61 % d'entre elles349(*). Selon la Cour des comptes, l'exercice en groupe pluriprofessionnel ne concernait toutefois que 40 % des médecins en 2024350(*).
Pour accélérer la coordination des professionnels, des « équipes de soins primaires » ont été introduites par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016351(*), préfigurant la constitution des MSP et des CDS en organisant la coordination entre un médecin généraliste et d'autres professionnels. Ces équipes ont pour objectif de contribuer à la structuration du parcours de santé.
Enfin, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)352(*), également issues de la loi de modernisation de 2016353(*), ont notamment vocation à coordonner les professionnels de santé du premier et du second recours sur un territoire donné354(*).
Si ces organisations coordonnées territoriales facilitent un accès aux soins de premier recours pour les patients dépourvus de médecin traitant, l'Assurance maladie rappelle que l'une de leurs missions consiste également à permettre au patient de retrouver un médecin traitant afin de réintégrer un parcours de soins coordonné355(*).
• En complément au développement de ces structures, les professions paramédicales ont vu leurs compétences étendues par les délégations de tâches, et certains professionnels bénéficient désormais d'un accès direct des patients, afin d'optimiser le temps médical356(*). Ces réformes concernent en particulier les infirmiers, qui peuvent, depuis 2016, exercer en pratique avancée (IPA)357(*).
• Les professionnels de santé se voient également accorder un rôle de « référent », en partenariat avec le médecin traitant. Ainsi, le statut de pharmacien correspondant créé en 2019358(*) et précisé par décret en 2021359(*) permet au patient de désigner un pharmacien correspondant, ayant la capacité de renouveler un traitement et d'en ajuster la posologie sous réserve de l'accord du médecin prescripteur. En sus, un statut d'infirmier référent a été introduit par la loi « Valletoux » du 27 décembre 2023360(*), qui permet à un infirmier d'assurer une mission de prévention, de suivi et de recours, en « lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant », dont les modalités de désignation sont précisées par un décret361(*) qui s'avère encore inappliqué362(*).
B. Le dispositif proposé : expérimenter la désignation par les assurés d'une équipe de soins traitante dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 21 decies a été introduit à l'Assemblée nationale par quatre amendements identiques de Céline Thiébault-Martinez (Socialistes et apparentés), Danielle Brulebois (Ensemble pour la République), Laurent Croizier (Les Démocrates) et Christophe Marion et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République. Il vise à permettre aux assurés, par le biais d'une expérimentation, de désigner une équipe de soins traitante, lorsqu'ils vivent dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante. Ces amendements avaient reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
• En son I, l'article 21 decies prévoit la possibilité pour l'assuré d'autoriser la désignation d'une équipe de soins traitante à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie, à la place d'un médecin traitant. Cette équipe assure une mission de prévention, de suivi du patient et de recours aux soins.
L'expérimentation restreint cette possibilité aux assurés résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Le I précise que la désignation de l'équipe de soins traitante est soumise au même régime juridique que la déclaration d'un médecin traitant, tel qu'elle est précisée à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. De ce fait, les règles suivantes s'appliqueraient :
- seuls seraient concernés les assurés de seize ans ou plus ;
- les membres de l'équipe devraient donner leur accord au patient pour être déclarés comme équipe de soins traitante ;
- l'équipe de soins traitante participerait à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé du patient363(*) ;
- lorsque l'assuré désignerait une équipe de soins traitante à la place de son médecin généraliste référent préalablement désigné, celui-ci perdrait les avantages relatifs à l'adhésion à l'option conventionnelle pour ce qui concerne cet assuré, celui-ci perdant également ces avantages ;
- le ticket modérateur prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pourrait être majoré pour les assurés n'ayant pas désigné une équipe de soins traitante ou ayant consulté un autre médecin. Les exceptions à cette majoration prévues par l'article L. 162-5-3 et aux articles D. 162-1-6 et D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s'appliqueraient également.
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans, et limitée à trois régions.
• Le II établit une liste non-exhaustive des professionnels qui peuvent composer cette équipe pluridisciplinaire, notamment un médecin, un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant un infirmier, un pharmacien et un assistant médical.
L'exposé des motifs des quatre amendements précise que l'initiative de la constitution de l'équipe appartiendrait au patient ou à la CPTS. Il mentionne également la possibilité pour une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute ou un orthophoniste d'en faire partie.
• Le III prévoit qu'un décret vienne préciser les modalités d'application de l'expérimentation, les régions choisies pour la mettre en oeuvre, et les conditions de son évaluation.
II - La position de la commission
La commission appuie l'importance de remédier aux inégalités territoriales d'accès au système de santé en améliorant la coordination des professionnels de santé, dans un contexte de fragilisation de l'offre de soins dans de nombreux territoires.
À cet égard, elle rappelle que le Sénat a adopté en mai dernier une proposition de loi « Mouiller » visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, comprenant de nombreuses dispositions pour remédier à cette problématique. L'article 5 bis prévoit notamment la suppression de la majoration de ticket modérateur pour les patients n'ayant pas pu désigner de médecin traitant.
La commission se questionne cependant sur la pertinence de la mesure proposée par le présent article, qui propose de désigner des équipes de soins traitantes en lieu et place des médecins traitants. Elle s'interroge notamment sur la contribution d'une telle mesure à un meilleur accès aux soins, dès lors que ces équipes devraient notamment comprendre un médecin, et sur le rôle qu'assurerait ce médecin au sein de l'équipe de soins traitante. En tout état de cause, la mesure ne permet pas d'évacuer la difficulté tenant à l'accès à un médecin.
La commission rappelle par ailleurs qu'il existe déjà de nombreuses structures de soins coordonnés qui contribuent à l'accès aux soins des usagers, comme les MSP et les CPTS. Le déploiement des infirmiers référents prévus par la loi « Valletoux » de 2023 y contribue également.
Elle insiste ainsi sur l'importance de la lisibilité de l'organisation de l'offre et de l'articulation des dispositifs existants, et exprime sa crainte d'une complexification accrue par cette expérimentation. La commission rappelle d'ailleurs que l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 pourrait déjà constituer un cadre légal à cette expérimentation en ce qu'il vise à « permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins », puisqu'il s'agit ici d'optimiser la coordination du parcours de santé du patient et de développer les modes d'exercices coordonnés364(*).
Compte tenu de ces observations, à l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement n° 664 tendant à supprimer l'article 21 decies.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 22
Simplifier et sécuriser le financement des
établissements de santé
Cet article propose diverses mesures relatives aux modalités de financement des établissements de santé.
D'une part, il précise ou pérennise certaines règles de détermination des montants de financement et remboursements des établissements par l'assurance maladie : application du coefficient honoraire sur les tarifs hospitaliers des établissements privés du champ des soins médicaux et de réadaptation (SMR) en cas d'honoraires facturés par ces établissements ou des professionnels libéraux y exerçant, fixation de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités SMR, consultations lors de la répartition de certaines dotations entre régions, échelles tarifaires des groupements de coopération sanitaire.
D'autre part, il adapte certaines règles relatives au processus technique de facturation et de recouvrement des recettes. En particulier, il impose la dématérialisation complète des échanges des établissements avec les organismes obligatoires et complémentaires d'assurance maladie. Il procède également au report du passage à la facturation individuelle directe (Fides) restreignant le périmètre de ce dispositif. Enfin, il modifie la date de forclusion de transmission des données d'activités pour les séjours longs en SMR.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : des évolutions et des pérennisations de règles relatives aux modalités de financement des établissements de santé
A. Les règles et processus de financement des établissements de santé demeurent multiples et complexes dans le cadre des réformes en cours
1. Des réformes des modalités de financement sont en cours de mise en oeuvre
Plusieurs réformes ont eu lieu au cours des vingt dernières années, dans le sens d'une convergence des modèles de financement entre les différents établissements de santé, quel que soit leur statut, public ou privé.
Jusqu'en 2004, le financement des établissements de santé par l'assurance maladie était assuré selon deux dispositifs distincts. Les établissements publics et privés non lucratifs étaient financés par une dotation globale (DG). Les établissements privés à but lucratif facturaient quant à eux des forfaits de prestations et des actes sur la base de tarifs régionaux variables (prix de journée ou forfaits de soins), encadrés par des objectifs quantifiés nationaux (OQN).
La mise en place de la tarification à l'activité (T2A), par la loi de 2004 relative à l'assurance maladie365(*), a fait évoluer ce système en rapprochant les règles applicables aux établissements publics et privés. Avec la T2A, le tarif de chaque activité est fixé par le ministre chargé de la santé, via le mécanisme des groupes homogènes de malades et des groupes homogènes de séjour (GHS/GHM). Les recettes des établissements sont déterminées par la comptabilisation et l'évaluation des activités renseignées dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
La T2A est devenue le mode de financement dominant des établissements de santé publics comme privés, en particulier s'agissant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie.
Les réformes récentes du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation à partir de la LFSS pour 2016, de psychiatrie avec la LFSS pour 2020, des urgences avec la LFSS pour 2021, et de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie avec la LFSS pour 2024 ont poursuivi un mouvement d'homogénéisation des financements entre établissements publics et privés mais aussi diversifié les modes de financement, articulant davantage la T2A avec des dotations.
L'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale fixe désormais les modalités de financement des établissements de santé selon quatre grands types d'activité :
- les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie (MCO), y compris sous forme d'hospitalisation à domicile (HAD) et au sein des hôpitaux de proximité ;
- les activités de psychiatrie (PSY) ;
- les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée (USLD) ;
- les activités de soins médicaux et de réadaptation (SMR).
Au total, le financement des établissements combine une part plus ou moins importante de T2A, en fonction des activités, avec des dotations et certains mécanismes complémentaires, tels que :
- des financements forfaitaires pour des activités spécifiques, telles que les urgences ;
- des crédits Migac (missions d'intérêt général et aides à la contractualisation), qui ne concernent désormais plus que les établissements exerçant des activités SMR, et des dotations pour missions spécifiques et objectifs de santé publique ;
- des financements exceptionnels (fonds d'intervention régional, géré par les agences régionales de santé, et fonds spécifiques) ;
- la liste en sus pour certaines spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux innovants ou onéreux, qui sont pris en charge par l'assurance maladie en sus de la tarification d'hospitalisation ;
- des financements propres aux expérimentations dites « article 51 »366(*), qui peuvent se traduire par un financement à la séquence ou à l'épisode de soins.
Enfin, les établissements privés et les professionnels intervenant dans le champ libéral au sein des établissements, privés comme publics, peuvent facturer des honoraires à l'assurance maladie.
S'agissant de la T2A, des arrêtés tarifaires annuels fixent la tarification nationale journalière des prestations (TNJP) et des coefficients géographiques et de transition peuvent s'appliquer aux tarifs nationaux367(*).
Des arrêtés ont ainsi été publiés en mars 2025, fixant la TNJP pour les activités de MCO, HAD, SMR et PSY à compter du 1er mars 2025. Une instruction du ministre chargé de la santé aux ARS, d'avril 2025, encadre l'évolution des TNJP et des coefficients de transition pour les établissements « historiques ».
Au plan national, des objectifs de dépenses d'assurance maladie (ODAM), constitués des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de plusieurs activités, sont définis chaque année. Ainsi l'ODAM SMR finance les dépenses relatives aux soins médicaux et de réadaptation des établissements publics et privés.
À partir des ODAM, les ARS perçoivent des enveloppes régionales. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont notamment pour mission de répartir entre les régions le montant de la dotation nationale de financement des Migac dans le champ SMR et de la dotation populationnelle en ce qui concerne les activités de psychiatrie. Dans ce cadre, les ministres doivent consulter les fédérations représentatives des établissements de santé.
a) Le financement des activités MCO
La LFSS pour 2024 a engagé une réforme du financement des activités MCO en vue de réduire la part assurée par la T2A.
Pour les activités MCO, les établissements de santé sont désormais financés par trois compartiments368(*) :
- un financement à l'activité, via des tarifs nationaux valorisant les différentes prestations d'hospitalisation, mais avec un élargissement au paiement à l'épisode, à la séquence et au parcours ;
- des dotations annuelles forfaitaires relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique (qui intègrent notamment les financements relatifs à la qualité, tels que le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité, dit Ifaq, refondu à l'article 27 du présent projet de loi) ;
- des dotations annuelles forfaitaires relatives à des missions spécifiques (enseignement, recherche, innovation, prise en charge de certains maladies chroniques, soins critiques, soins non programmables, établissements isolés, etc.) et des aides à la contractualisation.
Cependant, il a été prévu une entrée en vigueur progressive de la réforme, seulement à compter de 2025-2026. À ce jour, les travaux de mise en oeuvre de la réforme n'ont pas encore abouti.
b) Le financement des activités de psychiatrie
Le financement des soins psychiatriques a été revu dans le cadre de la LFSS pour 2020 afin d'homogénéiser les règles de financement entre établissements publics et privés et d'assurer une meilleure prise en compte des besoins, à l'échelle de chaque territoire. Un ODAM spécifique aux activités de psychiatrie a été créé, avec trois dotations distinctes369(*) :
- une dotation populationnelle, répartie entre régions sur la base de critères démographiques, sociaux et sanitaires ;
- des dotations complémentaires dont le montant tient compte de l'activité des établissements (dotation à la file active) et de leurs missions spécifiques ;
- une dotation accordée sur des critères de qualité et d'amélioration des soins.
La dotation populationnelle et la dotation à la file active représentent 90 % du financement des activités de psychiatrie des établissements de santé.
Un mécanisme de sécurisation des recettes des établissements, sur le périmètre de ces deux compartiments principaux, a été prévu jusqu'en 2025 afin de permettre une transition vers le nouveau modèle. Le Gouvernement a engagé des échanges avec les acteurs de la psychiatrie afin de prolonger cette sécurisation.
c) Le financement des activités de soins longue durée
Les activités de soins longue durée demeurent financées par l'assurance maladie selon un mode de dotation globale. Chaque année, l'établissement de santé reçoit une dotation annuelle de fonctionnement (DAF) destinée à couvrir l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement liées à cette activité. Cette enveloppe est notifiée par l'ARS dans la limite de l'enveloppe régionale de financement des soins longue durée, elle-même issue de l'ODAM soins longue durée370(*).
Le volet « soins », qui relève du budget hospitalier et représente 60 % des ressources des établissements de soins longue durée, est complété par un tarif journalier d'hébergement et un tarif dépendance.
À la suite de la LFSS pour 2024, une expérimentation a été lancée le 1er juillet 2025 dans 23 départements pour fusionner les sections « soins » et « dépendance » et créer un « forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie ».
d) Le financement des activités SMR
Le secteur des soins médicaux et de réadaptation (SMR), auparavant désigné sous le terme soins de suite et de réadaptation (SSR), a connu une importante réforme de son financement lors de la LFSS pour 2016371(*), afin notamment de corriger les inégalités historiques entre territoires et statuts d'établissements.
Ces soins sont désormais financés par le biais372(*) :
- de financements issus de l'activité : comme pour le champ MCO, l'établissement perçoit pour chaque séjour un montant forfaitaire correspondants aux tarifs en vigueur, avec un mécanisme additionnel de sécurisation pluriannuelle des recettes373(*) ;
- d'une dotation populationnelle, répartie sur la base de critères démographiques et épidémiologiques et attribuée par les agences régionales de santé ;
- de compartiments ciblés (plateaux techniques, activités d'expertise, missions d'intérêt général) ;
- d'un financement à la qualité, à travers le dispositif Ifaq.
Ce nouveau modèle de financement s'accompagne de plusieurs dispositions transitoires introduites par la LFSS pour 2016, puis modifiées et prolongées par les LFSS suivantes.
Ainsi, un coefficient de transition ajuste la dotation populationnelle afin de minimiser et lisser dans le temps l'impact financier de la transition vers ce nouveau modèle de financement.
L'article 78 de la LFSS pour 2016 a mis en place, au départ jusqu'en 2020, un système spécifique transitoire de paiement des établissements de santé pour les activités SMR, qui prévoit que les établissements transmettent leurs données d'activité et de consommation à l'ARS qui procède à la valorisation de l'activité pour chaque établissement, en appliquant, pour les prestations hospitalières, les tarifs nationaux de prestation affectés du coefficient de transition.
e) Le financement des groupements de coopération sanitaire
Des groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens, à but non lucratif, ont été créés pour faciliter les coopérations entre le secteur public et privé, ainsi qu'entre la ville, l'hôpital et les acteurs du secteur médico-social, en mutualisant des moyens de toute nature. Ils peuvent notamment être constitués pour exploiter sur un site unique les autorisations d'activité de soins détenues par un ou plusieurs de ses membres.
Ils peuvent ou non être érigés en établissement de santé. Dans ce cas, ils sont soumis aux mêmes règles que les établissements de santé.
Dans le cas contraire, les modalités de leur financement et de leur comptabilité dépendent de leur statut et des conventions entre les membres.
Le groupement peut être autorisé à facturer les soins délivrés. L'article L. 6133-8 du code de la sécurité sociale précise les règles de financement applicables, avec une flexibilité dans le choix de l'échelle tarifaire lorsque le GCS est constitué à la fois d'établissements privés à but lucratif et d'établissements publics ou privés à but non lucratif.
f) Le financement des honoraires
Les établissements privés à but lucratif et les professionnels exerçant à titre libéral dans les établissements privés comme publics ont la possibilité de facturer des honoraires, pris en charge séparément par l'assurance maladie.
Or, les tarifs hospitaliers (via la valorisation du GHS) sont réputés couvrir l'ensemble des actes de soins, y compris les traitements et les rémunérations des praticiens.
Dans le champ SMR, un « coefficient honoraire » est appliqué depuis 2017 pour minorer les tarifs de certains établissements de santé privés (ex-OQN) et s'assurer que les actes de professionnels de santé libéraux ne sont pas remboursés deux fois par l'assurance maladie.
Ce dispositif, prévu à l'article 78 de la LFSS pour 2016374(*), est dérogatoire et transitoire, prévu pour s'appliquer au plus tard jusqu'au 1er mars 2026.
Selon les données transmises à la rapporteure par la fédération des hôpitaux privés (FHP) portant sur les établissements SMR privés, les professionnels libéraux représentent 21 % des effectifs du personnel médical (majoritairement des cardiologues, mais aussi des neurologues, pneumologues, endocrinologues et psychiatres), et 4 % des effectifs du personnel non médical (majoritairement des masseurs-kinésithérapeutes et, dans une moindre mesure, des orthophonistes), bien que ces comparaisons ne puissent être faites à équivalent temps plein. En nombre, les principaux professionnels libéraux travaillant au sein de ces établissements sont des masseurs-kinésithérapeutes (environ 750 sur un total de 1 600 professionnels libéraux).
• La mise en oeuvre de l'ensemble des réformes des modalités de financement évoquées ci-dessus n'est pas encore pleinement aboutie. Des travaux de catégorisation des actes et de définition des missions spécifiques et des objectifs de santé publique doivent être menés.
En outre, les dispositions transitoires mises en place dessinent un cadre de financement particulièrement complexe.
Or les modalités de financement ont des incidences sur les modalités techniques de prise en charge par l'assurance maladie et de recouvrement des recettes par les établissements de santé.
2. En parallèle des réformes du financement, les modalités de recouvrement des recettes sont en cours d'évolution et de modernisation, faisant coexister valorisation et facturation
Hors l'attribution des dotations, un établissement de santé dispose de deux manières d'obtenir un paiement par l'assurance maladie obligatoire : la valorisation et la facturation. Ces deux circuits coexistent aujourd'hui.
• Avec un paiement par valorisation, les données d'activité déclarées par l'établissement via le PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information) sont valorisées automatiquement, en fonction du codage de l'activité et de tarifs nationaux.
Il n'y a pas de facturation individuelle séjour par séjour, les établissements procèdent à un envoi global mensuel à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH). Les montants sont calculés en fonction du codage de l'activité mais réglés globalement, avec des mécanismes d'acomptes et de régularisations.
Il s'agit du mode de paiement des établissements publics et des établissements privés à but non lucratif depuis la réforme de 2004. Il était cependant alors conçu comme un dispositif transitoire et dérogatoire, le principe étant celui d'une facturation directe à l'assurance maladie. La fin de cette dérogation, initialement prévue jusqu'au 1er mars 2008 a été repoussée à plusieurs reprises.
• Avec un paiement par facturation, l'établissement émet, pour chaque acte ou séjour, une facture, qui est transmise directement à l'assurance maladie obligatoire et éventuellement à l'organisme complémentaire via le dispositif ROC (remboursement des organismes complémentaires), et les organismes payeurs s'acquittent directement du paiement.
Ce mode de paiement est utilisé historiquement par les établissements privés à but lucratif (ex-OQN).
Il est progressivement étendu aux autres établissements via le projet Fides (facturation individuelle électronique), projet national de facturation individuelle standardisée et certifiée.
Si la mise en place de la T2A avait pour objectif un alignement des modalités de financement des établissements publics et privés, le projet Fides, lancé en parallèle, avait pour objectif d'aligner les circuits administratifs et comptables des établissements, en permettant à l'assurance maladie de disposer à la fois des données médicales (PMSI) et des factures individuelles correspondant à chaque prestation.
Le projet Fides a d'abord été pensé et déployé pour les activités MCO. Le passage en facturation individuelle directe des actes et consultations externes est aujourd'hui réalisé. Cependant, tel n'est pas le cas pour les prestations d'hospitalisation.
Il est prévu que le projet Fides s'étende progressivement de manière ciblée. Une extension progressive aux différentes composantes du champ SMR est ainsi en cours, mais des dispositions dérogatoires sont prévues.
La généralisation des financements accordés dans le cadre des expérimentations menées dans le cadre de « l'article 51 » ouvre également un nouveau champ à la facturation individuelle.
En revanche, la psychiatrie est largement financée par des dotations populationnelles, sans facturation individuelle généralisée.
Les activités et missions non tarifées ne sont également pas dans le champ du projet Fides.
L'extension de la facturation individuelle directe se heurte aujourd'hui à des contraintes techniques et organisationnelles pour les établissements de santé. Ceux-ci doivent faire évoluer leurs modalités de recueil et de saisie d'informations et leurs systèmes informatiques, afin de permettre une validation individuelle au fil de l'eau de chaque dossier, et non plus une transmission mensuelle, et l'émission d'une facture unique comprenant l'ensemble des prestations facturables, y compris les dispositifs médicaux implantables et les molécules onéreuses.
En outre, avec les réformes de financement en cours, qui diminuent la part de T2A et augmentent la part des dotations, la part des financements relevant d'une facturation directe est amenée à se contracter.
• Les procédures de recouvrement des recettes sont soumises au respect de certains délais.
La clôture annuelle des transmissions PMSI est stricte, les dates de clôture étant publiées chaque année par l'ATIH. Au-delà de ces dates, l'activité ne peut plus être prise en compte pour valorisation. Ainsi, s'agissant des séjours longue durée, les séjours non transmis ne peuvent plus être valorisés pour l'année considérée sans procédure de régularisation et justification spécifique.
Dans le même temps, l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un établissement de santé peut faire valoriser ou modifier la valorisation des séjours jusqu'à un an après la date de sortie. Cette possibilité lui permet de procéder à des corrections de factures intermédiaires potentiellement plusieurs années après la date initiale de valorisation et de paiement.
Or le système d'information de la Cnam et de l'ATIH, permettant la valorisation et la facturation des prestations des établissements de santé, est dans l'incapacité d'effectuer des modifications sur les données d'activité supérieures à deux ans.
3. Une dématérialisation des échanges entre les établissements de santé et les organismes obligatoires et complémentaires d'assurance maladie est en cours mais n'est pas encore aboutie
Le paiement des prestations hospitalières est un processus complexe, manuel et chronophage, tant pour les établissements de santé que pour les organismes d'assurance maladie. Les délais entre la sortie du patient et le recouvrement des créances peuvent occasionner des difficultés de trésorerie voire un recouvrement incomplet pour les établissements.
Une dématérialisation des échanges des établissements de santé avec les organismes obligatoires et complémentaires d'assurance maladie est donc en cours afin de faciliter la vérification des droits des patients, de transmettre plus rapidement les factures aux organismes payeurs, d'accélérer et sécuriser le recouvrement du montant pris en charge et d'informer le patient de son éventuel reste à charge avant sa sortie et en obtenir le paiement.
• La dématérialisation des échanges avec l'assurance maladie obligatoire est quasiment complète.
En sus de la transmission électronique des données d'activité via le PMSI, les établissements procèdent à la transmission à l'assurance maladie de l'ensemble des éléments nécessaires au recouvrement de leurs recettes de façon quasi-systématiquement dématérialisée.
Selon le ministère de la santé, la dématérialisation des échanges avec l'assurance maladie est presque intégralement systématique pour les établissements avec des activités MCO et est réalisée en tout ou partie pour les établissements avec activité SMR mais sans activité MCO. En revanche, la dématérialisation n'est en place que dans moins d'un tiers des établissements psychiatriques sans activité MCO.
Deux projets visent à renforcer et faciliter la dématérialisation des échanges. D'une part, le projet Consultation des DRoits intégrée (CDRi) permet aux agents administratifs des établissements d'accéder aux données sur les droits ouverts aux patients par l'assurance maladie obligatoire, grâce à une interface spécifique intégrée aux logiciels de gestion administrative des patients (GAP). D'autre part, le projet Fides, présenté supra, permet aux établissements d'adresser une facturation individuelle et directe à l'assurance maladie obligatoire.
• La mise en oeuvre du dispositif ROC d'échange avec les organismes complémentaires est bien plus limitée.
Le dispositif ROC représente le pendant des projets Fides et CDRi pour les organismes complémentaires. Intégré aux logiciels de gestion administrative des patients, il vise à standardiser et dématérialiser les échanges des établissements de santé avec ces organismes, sécuriser le tiers payant pour la part complémentaire, réduire les rejets et accélérer le recouvrement.
Il permet ainsi aux établissements de connaître, en temps réel, les éléments de couverture d'un assuré, de simuler la prise en charge de ses prestations hospitalières et de ses prestations pour exigences particulières (chambre individuelle par exemple) et de calculer avec exactitude le montant à facturer à l'organisme complémentaire et, par conséquent, le reste à charge pour le patient. La télétransmission des factures facilite l'application du tiers payant.
Ce dispositif se déploie progressivement, aux activités MCO d'abord, puis aux champs PSY, SMR et HAD, mais de façon très inégale, en fonction des établissements mais aussi des organismes complémentaires.
Le ministère de la santé ne dispose pas d'une vision nationale des échanges entre établissements de santé et organismes complémentaires mais estime qu'environ le tiers des échanges est aujourd'hui réalisé de façon dématérialisée, avec de fortes variations entre établissements.
Selon la fédération hospitalière de France (FHF), moins d'un quart des flux de recouvrement des hôpitaux publics auprès des organismes complémentaires transite par le dispositif ROC.
La fédération Unicancer indique quant à elle que seuls quatre centres de lutte contre le cancer sont raccordés au dispositif ROC.
B. L'article 22 modifie ou consacre diverses règles et processus de financement, facturation et recouvrement des recettes par les établissements de santé
1. Des dispositions relatives à la détermination des montants de financements et remboursements des établissements de santé
a) Une pérennisation du coefficient honoraire, permettant aux établissements et professionnels libéraux de facturer des honoraires dans le champ SMR sans double paiement par l'assurance maladie
Le 4° du I pérennise le « coefficient honoraire » des établissements privés intervenant dans le champ SMR. Ce dispositif prévoit que les tarifs nationaux de prestations versés à ces établissements sont minorés lorsque des honoraires sont facturés par les professionnels libéraux intervenant en leur sein ou par les établissements eux-mêmes. Le directeur général de l'ARS détermine, pour chaque établissement concerné, le coefficient de minoration permettant de tenir compte de ces honoraires.
Le coefficient honoraire permet ainsi à l'assurance maladie de ne pas payer deux fois la part correspondant aux honoraires, alors que les prestations hospitalières facturées à l'assurance maladie sont réputées intégrer l'ensemble des actes de soins, y compris le paiement des honoraires.
La fiche d'évaluation préalable annexée par le Gouvernement au projet de loi déposé indique qu'il s'agit principalement de permettre aux établissements privés de continuer à recourir à des masseurs-kinésithérapeutes libéraux alors qu'ils font face à des difficultés de recrutement.
b) Une suppression de précisions relatives au financement des activités SMR
Le 3° et le a du 5° du I suppriment des dispositions qui prévoyaient que l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements de santé (ODSMR) distingue :
- la part afférente aux dépenses relatives au financement des spécialités pharmaceutiques figurant sur la liste en sus, c'est-à-dire prises en charge par l'assurance maladie obligatoire en sus des prestations d'hospitalisation ;
- la part afférente à la dotation nationale de financement des Migac.
c) La suppression des consultations des fédérations hospitalières lors de la répartition des dotations entre régions dans les champs des soins médicaux et de réadaptation (SMR) et de la psychiatrie
Les 2° et le b du 5° du I suppriment la consultation des organisations nationales représentatives des établissements de santé - les fédérations hospitalières - pour l'attribution des dotations entre régions des montants de dotation populationnelle de psychiatrie d'une part, et des montants de Migac SMR (missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation dans le champ des soins médicaux et de réadaptation) d'autre part.
La fiche d'évaluation préalable annexée par le Gouvernement au projet de loi déposé indique qu'il s'agit de « fluidifier le processus de notification de ces dotations et de limiter les besoins de trésorerie pouvant découler des retards résultant du processus de notification. »
d) Un encadrement des règles de financement applicables aux groupements de coopération sanitaire de moyens
Le II précise les règles applicables à la facturation des soins délivrés aux patients par des groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens. Deux modalités de détermination des tarifs sont prévues en fonction des autorisations d'activité de soin exploitées par le groupement :
- si elles sont détenues par au moins deux membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables demeurent déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8 du code de la sécurité sociale ;
- si elles sont détenues par un seul membre ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, cette échelle tarifaire s'applique.
La fiche d'évaluation préalable annexée par le Gouvernement au projet de loi déposé précise qu'il s'agit d'éviter des effets d'opportunité financiers pour les établissements de santé, tel que des changements d'échelle tarifaire, par le biais du GCS.
2. Des dispositions relatives au processus technique de facturation et de recouvrement des recettes par les établissements de santé
a) Une dématérialisation complète des échanges entre établissements de santé et organismes d'assurance maladie de base et complémentaires
Le 1° du I inscrit dans la loi l'obligation pour les établissements de santé de procéder à la dématérialisation de leurs échanges avec les organismes d'assurance maladie de base et complémentaires.
Les établissements de santé devront transmettre par voie électronique les documents nécessaires à :
- la prise en charge des soins, produits et prestations par les organismes d'assurance maladie ;
- la mise en oeuvre du tiers payant ;
- la détermination par l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la part des dépenses qu'il prend en charge.
L'organisme complémentaire devra en retour communiquer à l'établissement la part des dépenses qu'il prend en charge et dont il assure le paiement à l'établissement, afin de permettre à celui-ci d'informer le patient et de procéder à la facturation.
L'objectif affiché est l'amélioration du recouvrement de leurs recettes par les établissements de santé, avec une diminution des délais de recouvrement. L'étude d'impact estime à 10 millions d'euros le gain de trésorerie pour une réduction d'un jour de délai de recouvrement, ce qui pourrait permettre un gain d'environ 200 millions d'euros à horizon 2029 sur la base d'une réduction de 20 jours du délai de recouvrement moyen.
b) La révision du calendrier et du périmètre de déploiement de la facturation individuelle directe (Fides)
Le 7° du I déplace l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale au sein d'un titre différent et le renomme article L. 162-27.
Il ajoute au sein de cet article des dispositions prévoyant que le remboursement aux établissements de santé par l'assurance maladie des prestations d'hospitalisation, médicaments, produits, prestations peut s'effectuer soit sur la base d'une facturation, soit sur la base d'une valorisation des données d'activité, selon des modalités définies par arrêté et tenant compte, notamment de la nature de l'activité.
Il pérennise ainsi la possibilité de continuer à recourir à la valorisation, qui était ouverte aux établissements à titre à la fois dérogatoire et transitoire pour les activités MCO et SMR. Ce faisant il décale la mise en oeuvre du passage à la facturation individuelle directe (projet Fides) et permet de revoir le périmètre des activités concernées par ce projet.
La fiche d'évaluation préalable annexée par le Gouvernement au projet de loi déposé indique qu'« il apparaît souhaitable de coupler le chantier de mise en oeuvre de la facturation directe avec les travaux en cours sur les réformes de financement ainsi que le chantier initié visant à simplifier et automatiser le recueil d'informations [qui] comporte en particulier un volet d'automatisation du codage qui pourrait, à terme, limiter les impacts organisationnels et financiers d'un passage à la facturation individuelle ». L'objectif affiché est de cibler le passage à la facturation directe sur « les activités les plus pertinentes au regard de l'évolution des modalités de financement ».
Le 8° du I et le 2° du II procèdent à des coordinations légistiques.
c) Une modification de la date de forclusion de transmission des données d'activités pour les séjours longs en SMR
Le 6° du I modifie l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale qui fixe les délais de transmission des données d'activité par les établissements de santé pour le paiement des prestations de l'assurance maladie.
Comme précédemment, le délai de forclusion est fixé à un an à compter de la date de réalisation de l'acte ou de la consultation pour les actes et consultations externes.
En revanche, pour les prestations hospitalières, le délai de forclusion est fixé à un an, non plus de la date de fin de séjour hospitalier, mais de la date de fin de la prestation d'hospitalisation utilisée pour valoriser l'activité hospitalière auprès de l'assurance maladie, c'est-à-dire de la date de fin de la facture intermédiaire, comme cela se fait déjà pour l'hospitalisation à domicile.
3. Une application des dispositions de l'article au 1er janvier 2026 et une suppression, à cette date ou au 1er janvier 2027, de diverses dispositions transitoires, en quasi-totalité transformées en dispositions pérennes
Le V prévoit que les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Aux termes des 2° et le 3° du III, seront abrogés à cette date deux dispositifs transitoires, prévus au III de l'article 78 de la LFSS pour 2016375(*), dans le cadre de la réforme du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation :
- le D relatif aux coefficients transitoires de majoration des tarifs nationaux de prestations, qui pouvaient s'appliquer jusqu'au 1er mars 2026 ;
- le H relatif aux coefficients de minoration des honoraires libéraux, ceux-ci étant pérennisés par le 4° du présent article.
En revanche, deux dispositifs ne seront abrogés qu'à compter du 1er janvier 2027 :
- le C du III de l'article 78 de la LFSS pour 2016 qui prévoit, par dérogation, la possibilité de procéder à un paiement par valorisation des activités SMR des établissements de santé ;
- l'article 65 de la LFSS pour 2018 qui prévoit, par dérogation, la possibilité de procéder à un paiement par valorisation des activités MCO des établissements de santé et un passage progressif à la facturation directe pour les établissements volontaires ou remplissant des critères fixés par voie réglementaire, certaines dispositions visées par cet article ayant toutefois été abrogées par la LFSS pour 2023.
Ces abrogations différées se veulent en cohérence avec les dispositions du 7° du présent article qui pérennisent l'existence des deux modalités de prise en charge que sont la valorisation et la facturation.
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du député Hendrik Davi et plusieurs de ses collègues visant à maintenir la consultation des fédérations hospitalières dans la répartition entre régions des dotations dans les champs des soins médicaux et de réadaptation (crédits Migac SMR) et de la psychiatrie (dotation populationnelle).
Elle a également adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination juridique du rapporteur général, Thierry Bazin.
En application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
Si les dispositions de cet article constituent essentiellement des mesures techniques, elles soulèvent toutefois plusieurs enjeux cruciaux pour les établissements de santé en matière de financement et appellent trois remarques liminaires d'ordre général.
• Tout d'abord, la pérennisation de règles qui avaient vocation à être transitoires et dérogatoires et le report du passage à la facturation individuelle directe sont révélatrices d'un manque d'anticipation de l'ensemble des conséquences des réformes de financement en cours, sur lequel la commission a déjà alerté à plusieurs reprises.
Dans son rapport sur le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2024, la commission déplorait ainsi un défaut d'anticipation et de programmation dans la mise en oeuvre de la réforme du financement des activités MCO. Elle constate que le report proposé du déploiement du projet Fides est notamment présenté comme une réponse aux conséquences de cette réforme sur la charge de saisie des établissements et vise à adapter l'extension de ce projet avec le calendrier de mise en oeuvre des réformes de financement.
Ce report répond en outre à une demande des acteurs hospitaliers, qui critiquent les charges et complexités administratives générées par ce dispositif, des critiques qui sont récurrentes s'agissant des règles et procédures imposées aux acteurs hospitaliers.
• Ensuite, la modification des règles et procédures d'attributions de certains financements, supprimant en particulier la consultation des fédérations hospitalières pour la détermination de deux enveloppes régionales, renvoie à la problématique plus globale des modalités d'information et d'association des acteurs hospitaliers.
• Enfin, l'imposition de la dématérialisation des échanges des établissements avec les organismes de sécurité sociale suppose des moyens techniques, informatiques, humains et financiers, ainsi que, le cas échéant, un accompagnement dans cette démarche, et doit être reliée à l'impératif d'investissement numérique des établissements, volet essentiel du Ségur de la santé, dont le déploiement doit se poursuivre.
A. Une dématérialisation des échanges souhaitable mais qui soulève encore des difficultés techniques
La dématérialisation des échanges s'inscrit dans une logique de simplification et de sécurisation du financement des établissements de santé, à laquelle la commission ne peut que souscrire.
Cependant, si la dématérialisation est bien avancée avec les organismes de base, elle reste largement incomplète avec les organismes complémentaires.
Les établissements de santé ne sont pas tous en capacité aujourd'hui de procéder à la dématérialisation des échanges avec l'ensemble des régimes complémentaires, via le dispositif ROC, en dépit d'un intérêt certain tant pour les établissements que les organismes complémentaires.
Sur le plan technique, cette dématérialisation est complexifiée par la faible maturité numérique des établissements de santé et des outils utilisés. Elle suppose une adaptation des systèmes d'information et la mise en place de protocoles techniques avec les éditeurs de logiciels. Il est ainsi nécessaire que la solution de gestion administrative des patients utilisée par l'établissement soit référencée « ROC » par le centre national de dépôt et d'agrément de l'assurance maladie. Or, à l'exception des activités MCO des établissements publics et privés à but non lucratifs, le taux de référencement des logiciels est insuffisant pour bon nombre d'établissements.
Les acteurs hospitaliers évoquent des difficultés techniques persistantes et déplorent un manque de compétences techniques chez les éditeurs de logiciel, un manque de coordination entre les éditeurs, les organismes complémentaires et les caisses primaires d'assurance maladie et un déficit d'accompagnement technique et opérationnel.
Sur le plan organisationnel, la dématérialisation emporte des charges administratives et des coûts pour les services de facturation des établissements : frais de mise à jour des logiciels, achat de matériel, formations, paramétrages, etc.
En outre, de nombreux organismes complémentaires ne sont pas intégrés dans le dispositif ROC. Le présent article doit les inciter à le faire.
Afin d'assurer un déploiement complet et homogène du dispositif ROC, soutenu par l'ensemble des acteurs entendus, la commission invite le Gouvernement à trouver des leviers pour que les éditeurs de logiciels mettent en place les protocoles techniques nécessaires et à accompagner les établissements dans la mise en oeuvre de la dématérialisation, notamment en poursuivant l'accompagnement financier à l'amorçage et à l'usage.
B. La nécessité d'associer les acteurs hospitaliers à la détermination des dotations et de leur ventilation régionale
Les fédérations hospitalières et les organisations représentatives du personnel hospitalier s'inquiètent du risque que fait peser la suppression du mécanisme de consultation des fédérations hospitalières, pour l'attribution, entre régions, de financements en SMR et en psychiatrie, sur la lisibilité et la transparence du processus.
En effet, les relais régionaux des fédérations peuvent permettre de faire remonter des sujets locaux spécifiques en vue de la fixation des enveloppes régionales et de s'assurer ainsi qu'elles soient adaptées aux réalités locales.
La commission approuve donc le maintien de la consultation des fédérations, adopté par l'Assemblée nationale.
Elle rappelle par ailleurs son attachement à l'information et la consultation des acteurs hospitaliers sur les sujets de financement. Les échanges entre le ministère de la santé et les fédérations hospitalières sur la définition des dotations populationnelles et la ventilation régionale des dotations, qui se tiennent généralement lors des réunions de campagne, doivent se poursuivre et donner lieu à une transparence sur les critères utilisés.
C. Diverses mesures techniques qui répondent aux demandes des acteurs hospitaliers ou à des objectifs de simplification et d'efficience
• La révision du calendrier et du périmètre de déploiement du projet Fides apparaît indispensable.
Les acteurs hospitaliers ont alerté la commission sur les difficultés opérationnelles, techniques et financières que soulève le passage à la facturation directe pour les établissements. La FHF se mobilisait depuis plusieurs années afin d'exclure les séjours hospitaliers du champ de la facturation individuelle, estimant ce dispositif complexe, coûteux et potentiellement générateur de retards voire de pertes de trésorerie en raison de rejets à traiter.
Les établissements publics de santé estiment que le système actuel, basé sur des exports cumulés et rétroactifs chaque mois, est plus souple et sécurisé pour eux, et qu'il fonctionne aujourd'hui correctement.
Ce système permet également de mieux traiter les situations complexes, notamment pour les patients non assurés sociaux en France ou dont les droits sont encore à construire, par exemple pour une prise en charge à 100 % au titre d'une affection longue durée.
Au regard des difficultés évoquées, également bien identifiées par le ministère de la santé, la commission souscrit à la révision des modalités de passage à la facturation individuelle, s'agissant tant de son calendrier que de son périmètre.
Des discussions techniques devront être engagées entre le ministère de la santé et les acteurs hospitaliers afin de déterminer le périmètre approprié pour le dispositif Fides et d'envisager un phasage du déploiement en fonction des activités des établissements et de la maturité de leurs systèmes d'information.
Selon le ministère de la santé376(*), le déploiement complet de ce dispositif devrait prendre a minima cinq ans, au vu des changements profonds, à la fois organisationnels et d'urbanisation des systèmes d'information hospitaliers, à mettre en oeuvre. Il envisage le phasage suivant : urgences et activité à forfait dès 2026, activités de dialyse et de radiothérapie à partir de 2027, puis séances de chimiothérapie, puis activités d'hospitalisation selon des critères et un calendrier restant à définir.
• La pérennisation du « coefficient honoraires » des établissements privés dans le champ SMR répond à une demande des établissements concernés. Ceux-ci souhaitent en effet continuer à facturer des honoraires en sus, leur permettant d'avoir recours à des professionnels libéraux. Le « coefficient honoraire » permet ce recours, tout en évitant un double paiement du temps médical par l'assurance maladie.
L'ensemble des établissements sont attachés à la possibilité de facturer des honoraires en sus, qui constituent un élément d'attractivité pour les praticiens.
• L'encadrement des règles applicables aux GCS est bienvenu. Il ne paraît pas judicieux de maintenir les possibilités d'optimisation financière qu'offrent les dispositions législatives actuelles, alors que plusieurs situations abusives d'opportunisme financier ont été signalées.
• La révision du délai de forclusion ne soulève pas de difficultés particulières auprès des acteurs hospitaliers. En revanche, la fédération des hôpitaux privés (FHP) alerte sur les difficultés de trésorerie générées par l'absence de facturation intermédiaire dans les établissements SMR privés.
• La suppression de plusieurs précisions relatives au financement des activités SMR n'a également pas fait l'objet d'oppositions de leur part.
D. Des réflexions à poursuivre sur le financement des établissements de santé
Au-delà des ajustements techniques relatifs aux financements des établissements de santé portés par le présent article, la rapporteure déplore le manque d'avancées dans les travaux de mise en oeuvre de la réforme de financement des activités MCO et de réflexion poussée sur les enjeux de financement, dans un contexte financier critique pour les établissements de santé.
Elle appelle, de nouveau, à la mise en oeuvre de réformes fondées sur une méthodologie précise et transparente, donnant de la lisibilité aux acteurs hospitaliers et les accompagnant dans leur appropriation des nouveaux modes de financement.
Elle prend acte de la nécessité de procéder au report au 1er janvier 2027 de l'entrée en vigueur des réformes du financement des activités de radiothérapie et de dialyse, comme détaillé à l'article 24.
Elle renouvelle les inquiétudes qu'elle a déjà exprimées sur l'absence d'avancée concernant le financement des activités de maternité.
Elle note également que la réforme du financement des soins critiques se fait attendre et que les acteurs hospitaliers déplorent un manque de lisibilité et de visibilité sur les perspectives d'évolution dans ce domaine. Cette réforme devra s'articuler avec la réforme en cours des autorisations d'activité, qui posera la question du devenir des unités de soins critiques placées sous prorogation de leur actuelle reconnaissance contractuelle jusqu'en 2027.
Enfin, elle souhaite que des réflexions soient menées autour des financements de parcours et de coordination, partagés au sein des territoires, afin d'inciter aux complémentarités et d'éviter tant les ruptures de parcours que les redondances d'actes.
Sous ces réserves, la commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22 bis et article 22 ter
(nouveaux)
Réforme de la tarification de l'activité
libérale
au sein des établissements publics de
santé
Ces articles, insérés par l'Assemblée nationale, visent à revoir les modalités de tarification de l'activité libérale au sein des établissements publics de santé, avec pour objectif d'éviter un double paiement du temps médical par l'assurance maladie.
L'article 22 bis entend supprimer le remboursement par l'assurance maladie des prestations hospitalières de radiothérapie lorsque la séance est réalisée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale et donne donc lieu au remboursement d'honoraires.
L'article 22 ter propose de tenir compte des honoraires facturés par les praticiens hospitaliers lors du remboursement par l'assurance maladie des actes effectués par ceux-ci dans le cadre de leur activité libérale.
Compte tenu de la situation financière dégradée et des problématiques d'attractivité des hôpitaux publics, la commission propose de supprimer ces articles.
I - Le dispositif proposé : une réforme de la tarification de l'activité libérale au sein des établissements de santé
Le Gouvernement a transmis au Sénat ces articles insérés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Les praticiens hospitaliers peuvent exercer, au sein des établissements publics de santé, une activité libérale donnant lieu à la facturation d'honoraires à l'assurance maladie
Les praticiens hospitaliers peuvent exercer une activité libérale au sein des établissements publics de santé, de façon encadrée et dans la limite de 20 % de la durée de leur service hospitalier hebdomadaire377(*).
Cette possibilité vise à apporter un complément de rémunération aux praticiens hospitaliers et à réduire les écarts de rémunération avec le secteur privé et l'exercice libéral, dans une optique d'attractivité et de fidélisation du personnel au sein des établissements publics.
Selon les données de la fédération hospitalière de France (FHF), 10 % des praticiens éligibles pratiquent une activité libérale, soit 5 % du total des praticiens publics.
Dans le cadre de leur activité libérale, les praticiens facturent aux patients des honoraires378(*), qu'ils perçoivent en sus du salaire versé par l'établissement.
En contrepartie de cette possibilité et de la mise à disposition des locaux et de l'équipement, ils versent à l'établissement une redevance allant de 15 à 60 % des honoraires perçus379(*). Cette redevance est de 15 ou 25 % pour les consultations, respectivement au sein des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires, de 60 % pour les actes de radiothérapie, d'imagerie, de médecine nucléaire et de biologie, et de 20 ou 40 % pour les autres actes.
Les honoraires facturés par le praticien hospitalier sont remboursés par l'assurance maladie, en sus du tarif hospitalier.
Or, le tarif hospitalier des établissements publics (fondé sur un groupe homogène de soins ou GHS) intègre l'ensemble des frais liés à la prise en charge du patient, y compris la rémunération des médecins salariés.
Cette situation a été critiquée par la Cour des comptes dans son rapport de 2023 consacré aux établissements de santé publics et privés380(*) qui estimait qu'elle conduisait à un double paiement des actes et prestations concernées par l'assurance maladie dans la mesure où les honoraires couvrent le temps de travail du praticien et les moyens mobilisés par l'établissement à l'appui de son activité, justifiant le versement d'une redevance, tandis que le tarif de GHS inclut déjà l'ensemble des frais liés à la prise en charge du patient.
Elle recommandait donc de « réformer la tarification de l'activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l'assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens ».
Cette préconisation a été reprise par la Cnam dans son rapport Charges et produits pour 2026381(*), qui évalue à 166 millions d'euros le montant des honoraires facturés en sus des groupes homogènes de séjour en excluant le premier et dernier jour d'hospitalisation afin de cibler uniquement les actes liés au séjour d'hospitalisation (367 millions en d'euros en incluant le premier et dernier jour d'hospitalisation). Elle relève que près de la moitié des dépenses concernent des actes de chirurgie (entre 89 et 168 millions d'euros selon le premier ou le second scénario) et qu'en considérant que les actes de chirurgie sont nécessairement liés à une hospitalisation, le montant s'élèverait à 245 millions d'euros.
La Cnam recommande donc de « revoir le financement de l'activité libérale des praticiens hospitaliers durant un séjour d'hospitalisation en établissement public de santé », estimant que « le financement de ces établissements devrait prendre en considération ce double financement imputable aux dépenses de sécurité sociale ». Elle ne précise cependant pas les modalités que pourrait prendre cette révision du financement.
B. Les articles 22 bis et 22 ter entendent revoir les modalités de facturation de l'activité libérale au sein des établissements publics de santé
1. L'article 22 bis vise les activités de radiothérapie
L'article 22 bis, introduit par un amendement du député Jean-François Rousset, avec un avis défavorable du rapporteur général382(*) et un avis favorable du Gouvernement, propose de compléter l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale relatif à la valorisation des prestations dans le champ des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie (MCO) par le biais de tarifs hospitaliers.
Il entend préciser que les établissements publics de santé ne peuvent facturer le tarif afférent à la prestation de l'activité de traitement du cancer par radiothérapie lorsque celle-ci est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale.
Il prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 afin de s'articuler avec la réforme en cours du financement de la radiothérapie.
Les auteurs de cet amendement indiquent avoir pour objectif de rendre impossible un cumul de facturations par les établissements et par les praticiens s'agissant de l'activité de radiothérapie, estimant que le tarif de la séance dans le champ libéral couvre les charges de fonctionnement, y compris le coût de l'équipement.
2. L'article 22 ter vise l'ensemble des prestations d'hospitalisation
L'article 22 ter, introduit par un amendement de la députée Annie Vidal, avec un avis défavorable du rapporteur général383(*) et un avis défavorable du Gouvernement, propose également de compléter l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale relatif aux tarifs afférents aux prestations dans le champ des activités MCO.
Il vise à tenir compte des honoraires facturés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de la tarification des actes effectués par ceux-ci au titre de leur activité libérale, qui font l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, ainsi que dans la facturation des prestations ; non remboursées, pour exigences particulières des patients sans justification médicale.
Les auteurs de cet amendement indiquent souhaiter clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens exerçant en secteur libéral en tenant compte du fait que les tarifs hospitaliers ainsi que, le cas échant, certaines prestations non remboursées intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines.
II - La position de la commission
La commission reconnaît les difficultés soulevées par les modalités actuelles de tarification de l'activité libérale au sein des établissements publics de santé, dont on peut considérer qu'elles se traduisent par une double prise en compte du temps médical dans le cadre de remboursements des tarifs hospitaliers et des honoraires par l'assurance maladie.
Cependant, les établissements publics de santé sont aujourd'hui dans une situation financière particulièrement dégradée et font face à un sous-financement chronique, comme cela se manifeste, cette année encore, dans l'Ondam envisagé par le Gouvernement.
Réduire les remboursements de tarifs hospitaliers, voire les supprimer, en cas de facturation d'honoraires ne pourra que menacer encore davantage le financement des établissements publics. En effet, l'établissement continue à assurer la rémunération totale du praticien hospitalier, même lorsqu'il exerce une part d'activité libérale, les honoraires constituant un complément de rémunération pour le praticien. En cas de diminution des tarifs versés à l'établissement, celui-ci devra malgré tout continuer à assumer la charge de la rémunération du praticien, sans le financement adéquat.
L'augmentation des tarifs hospitaliers publics doit donc constituer un préalable à toute révision de leur valorisation en cas d'activité libérale des praticiens hospitaliers.
En outre, revoir la tarification de l'activité libérale fragilisera l'attractivité et la capacité de fidélisation du personnel médical des hôpitaux publics, qui font d'ores et déjà face à des difficultés de recrutement, en raison de rémunérations plus attractives dans le secteur privé. Elle devra donc s'accompagner de mesures d'accompagnement.
Par ailleurs, la rapporteure rappelle que des travaux sont en cours afin de réformer le financement de la radiothérapie, dont les modalités font encore l'objet de discussion comme en témoigne l'article 24 du PLFSS. Il semblerait plus opportun d'intégrer toute révision des modalités de tarification de cette activité, y compris lorsqu'elle est exercée par un praticien hospitalier à titre libéral, au sein de la réforme en cours.
La rapporteure a donc souhaité déposer un amendement n° 665 de suppression de l'article 22 bis et un amendement n° 666 de suppression de l'article 22 ter, adoptés par la commission.
La commission propose de supprimer ces articles.
Article 23
(supprimé)
Report du financement de la protection sociale
complémentaire
pour les agents de la fonction publique
hospitalière
Cet article propose de décaler au 1er janvier 2028 l'entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire pour les agents fonctionnaires et contractuels de la fonction publique hospitalière, initialement prévue le 1er janvier 2026.
La commission propose de rétablir cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé : un report de l'entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique hospitalière
A. La réforme récente du régime de protection sociale complémentaire pour la fonction publique est venue combler un vide juridique qui prévalait pour les agents de la fonction publique hospitalière
1. Les agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficient pas historiquement d'une protection sociale complémentaire, faisant figure d'exception au sein de la fonction publique
La participation de l'employeur public à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique était initialement encadrée par le code de la mutualité384(*) et l'arrêté dit « Chazelle » du 19 septembre 1962385(*). L'État pouvait ainsi accorder des subventions386(*) à des mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'État afin de participer à la couverture complémentaire qu'elles assuraient pour le risque maladie. Toutefois, le Conseil d'État387(*) ainsi que la Commission européenne388(*) ont concomitamment remis en cause ces dispositions en 2005, notamment au titre de la réglementation européenne des aides d'État, entraînant leur abrogation respective389(*).
Pour combler ce vide juridique, le législateur a introduit la faculté pour les employeurs publics de participer financièrement à la protection sociale complémentaire des fonctionnaires et des contractuels de la fonction publique390(*) par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique391(*). La loi de 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique392(*) a ensuite précisé ses modalités d'application pour la fonction publique territoriale. Les employeurs publics n'étaient pas, par ce texte, tenus de participer au financement et les agents n'étaient pas davantage tenus d'y adhérer.
Bien que la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale aient fait l'objet de décrets d'application393(*) entre 2007 et 2011, les modalités d'application à la fonction publique hospitalière de la loi de 2007 n'ont pas été fixées par décret, empêchant ainsi de rendre effective la participation financière de l'employeur public à la protection sociale complémentaire.
En application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique394(*), l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique395(*) a fixé des obligations nouvelles aux employeurs publics en matière de protection sociale complémentaire396(*).
Les employeurs privés sont tenus de proposer une complémentaire santé collective à leurs salariés depuis 2016
Il faut par ailleurs noter que les salariés du secteur privé, quelle que soit leur ancienneté, sont tenus d'adhérer au contrat collectif de complémentaire santé souscrit par leur employeur, depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi397(*) ayant transposé un accord national interprofessionnel en ce sens398(*). Il est fait obligation aux employeurs de prendre à leur charge a minima 50 %399(*) des primes prévues par le contrat collectif.
Ce contrat collectif prévoit un panier de soins minimal reprenant largement celui du contrat solidaire et responsable.
Par dérogation, certains salariés sont toutefois dispensés de l'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur, notamment400(*) :
- les salariés qui bénéficient d'une autre couverture complémentaire obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit ;
- les salariés qui bénéficient, au titre de leurs faibles revenus, de la complémentaire santé solidaire401(*) ;
- les salariés à temps partiel de moins de 15 heures hebdomadaires, qui bénéficient alors d'un dispositif de participation ad hoc appelé versement santé ;
- les salariés en contrat à durée déterminée, sous conditions.
Cette obligation est entrée en vigueur au 1er janvier 2016 pour tous les employeurs du secteur privé.
2. Une compensation par des dispositifs spécifiques aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux demeurant partielle et inadaptée
a) Un dispositif de soins gratuits à la portée limitée et d'application hétérogène
Depuis la loi du 9 janvier 1986402(*), les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière bénéficient de la gratuité des soins médicaux qui leur sont prodigués et des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés par l'établissement où ils exercent403(*). Pendant une durée de six mois, les frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale sont également pris en charge lorsque l'hospitalisation a lieu dans l'établissement d'exercice ou dans un autre établissement, en cas d'urgence ou de nécessité404(*). Les praticiens hospitaliers bénéficient également d'un dispositif similaire405(*).
Alors que les agents de la fonction publique hospitalière bénéficient d'un dispositif de gratuité des soins, leur taux de renoncement aux soins est peu ou prou équivalent au taux observé dans le reste de la fonction publique, ce qui alerte sur la pertinence et la connaissance du dispositif. Ce phénomène concernait ainsi 22 % d'entre eux contre 26 % de l'ensemble des agents de la fonction publique, d'après une enquête déclarative de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) de 2014406(*).
Cette situation s'explique par les nombreuses limites que présente ce dispositif.
• Dans sa rédaction actuelle, il apparaît d'abord inadapté aux besoins des agents. En effet, le dispositif n'accorde pas la gratuité des soins à tous les agents de la fonction publique hospitalière. Seuls les fonctionnaires y sont éligibles, ce qui exclut les agents contractuels, alors qu'ils constituent environ 22 % de l'effectif des agents de la fonction publique hospitalière407(*). De la même manière, il ne couvre ni les ayants droit des agents, ni les agents retraités.
De plus, elle n'offre qu'une couverture partielle aux agents dès lors que la gratuité ne s'applique pas aux soins effectués dans un établissement tiers. Si les agents exerçant à l'hôpital ont accès à un plus grand panel de prestations, à l'exception cependant des soins prothétiques dentaires ou d'optique, l'offre de soins est plus réduite pour les agents des hospices publics, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ou encore les centres d'hébergement et de réadaptation sociale.
Enfin, les soins gratuits ont été assimilés par la Cour de cassation408(*) à des avantages en nature accordés aux agents, soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), constituant un frein à son application. Cependant, une lettre des ministres de la santé et des affaires sociales de 2004 précise que le montant intégré dans l'assiette sociale de ces contributions constitue le montant des soins non pris en charge par la sécurité sociale ou une complémentaire (le reste à charge « réel » de l'agent) lorsqu'il excède 30 % de la valeur de la prestation409(*).
• Les travaux publiés en 2019 des inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas) ont mis en exergue l'application très hétérogène du dispositif par les établissements, en fonction des catégories de frais et en fonction de la taille des établissements. 33 % des centres hospitaliers le mettent en oeuvre pour les consultations médicales, 13 % pour les produits pharmaceutiques et 25 %410(*) pour les frais d'hospitalisation411(*).
Du reste, il est rare que les directions des établissements soient promptes à communiquer son existence aux agents412(*). Peu nombreux sont ainsi les agents ayant recours aux soins gratuits, voire connaissant l'existence de ce droit. D'après la mission Igas-IGF, seuls 25 % d'entre eux usent du dispositif pour les consultations médicales, 3 % pour l'hospitalisation, et une proportion encore moindre pour les produits pharmaceutiques413(*).
b) Le CGOS, acteur central mais contraint de la prévoyance hospitalière
En matière de prévoyance, les personnels non médicaux (80 % de l'effectif)414(*) peuvent bénéficier d'une prestation servie par des comités d'actions sociales dont le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS), regroupant la majorité des établissements. Le CGOS, agréé par le ministère415(*), verse notamment une aide sociale aux agents en situation de maladie (ASASM)416(*) compensant partiellement la perte de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail prolongée (hors contrats de courte durée). Ce dispositif présente de ce fait des limites :
- la durée d'indemnisation par l'ASASM est limitée à 150 jours pour un congé maladie ordinaire, et à 150 jours par an pendant deux ans pour un congé de longue maladie ou de longue durée. Cette durée d'indemnisation est plus réduite pour les agents contractuels ;
- les agents ne sont pas couverts en cas d'invalidité, et le risque de décès n'est couvert que de manière forfaitaire ;
- les dépenses afférentes à l'ASASM sont en forte croissance puisqu'elles s'élèvent à 148,9 millions d'euros en 2024. Aussi, elles pèsent fortement dans le budget du CGOS, à hauteur de 38 % de ses dépenses d'action sociale417(*).
Le dispositif de la gratuité des soins et les prestations du CGOS sont ainsi insuffisamment adaptés aux besoins des agents et ne sauraient, à elles seules, répondre aux problématiques auxquelles font face les établissements publics de santé en matière d'attractivité. Les établissements de santé, et en particulier l'hôpital public, souffrent en effet de difficultés dans le recrutement et la fidélisation des agents, qui s'illustrent par exemple par de forts taux de vacance statutaire418(*).
Cette problématique trouve notamment racine dans l'exposition plus forte des agents aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Les travaux de compilation d'études menées entre 2013 et 2019, réalisés par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, soulignent en effet l'exposition plus importante des agents de la fonction publique hospitalière aux contraintes physiques intenses, par comparaison aux autres pans de la fonction publique et au secteur privé. 54 % des agents subissent ainsi au moins trois contraintes intenses. Ils travaillent plus souvent debout, dans des postures pénibles et en portant des charges lourdes ou en effectuant des gestes fatigants. Enfin, ils sont particulièrement exposés à des produits dangereux, à savoir des produits chimiques (57 %) ou des agents biologiques (73 %)419(*).
Dans ce contexte, l'amélioration des avantages sociaux proposés par les établissements, notamment par une participation financière à la protection sociale complémentaire des agents, constitue un levier d'attractivité non-négligeable. Une réforme est donc apparue nécessaire pour pallier la couverture partielle des agents de la fonction publique hospitalière, et soutenir l'amélioration de la protection des agents, à la fois actifs et retraités, et de leurs ayants-droits.
3. Une réforme à entrée en vigueur différée : la montée en charge inachevée de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière
En application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique420(*), l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique421(*) a créé un cadre commun, entre les trois versants de la fonction publique, quant à la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels. Elle a également précisé les conditions d'adhésion et de souscription de ceux-ci. L'ordonnance a à ce titre remplacé l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires422(*) par des dispositions désormais introduites dans le code général de la fonction publique423(*).
Cette participation est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel qui garantissent la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles. Ces contrats sont sélectionnés par les employeurs publics par le biais d'une procédure de mise en concurrence424(*).
a) Les règles applicables à la fonction publique hospitalière
L'article 1er de l'ordonnance425(*) crée une obligation commune de participation des employeurs publics au financement de la complémentaire couvrant les « frais de santé » restant à la charge des agents après le remboursement de la part versée par leur régime obligatoire de base de sécurité sociale.
Il fixe, comme dans le secteur privé, une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales alignées sur celles du secteur privé426(*).
En vertu d'un accord collectif, les employeurs de la fonction publique hospitalière pourront proposer des contrats collectifs427(*) à leurs agents, auxquels l'adhésion pourra être obligatoire ou facultative428(*).
Les garanties minimales couvertes, à titre individuel ou collectif, consistent en un panier de soins composé des éléments suivants :
- l'intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables429(*) ;
- le forfait journalier hospitalier acquitté par le patient en cas d'hospitalisation au titre des frais d'hébergement et d'entretien430(*) ;
- une partie des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement (frais d'optiques remboursés de manière forfaitaire par période de deux ans).
Contrairement à la fonction publique de l'État431(*) et à la fonction publique territoriale432(*), les agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficieront pas d'une prise en charge partielle obligatoire des employeurs s'agissant des garanties de prévoyance. L'ordonnance prévoit cependant que les employeurs hospitaliers ont la faculté d'abonder son financement433(*).
Enfin, lorsqu'un accord mène à la souscription d'un contrat collectif de complémentaire santé, celui-ci peut prévoir une participation obligatoire de l'employeur à un contrat collectif de prévoyance complémentaire des agents, le cas échéant avec adhésion obligatoire434(*).
b) La fonction publique hospitalière, maillon manquant dans la montée en charge de la réforme
Si l'entrée en vigueur différée de cette réforme devait permettre une montée en charge progressive et effective pour chaque versant de la fonction publique, les négociations nécessaires à son application à la fonction publique hospitalière sont au point mort, plus de quatre ans après la publication de l'ordonnance.
• Dans le cadre de la fonction publique hospitalière, la prévision d'un délai de près de cinq ans avait pour objectif de permettre la tenue des négociations, la transposition de l'accord au Journal Officiel, le lancement des appels d'offres ainsi que la sélection subséquente des organismes complémentaires. Il convient de noter qu'il appartient également aux partenaires sociaux, dans le cadre des négociations initiales, de choisir entre un contrat collectif national ou des contrats collectifs à l'échelle des établissements, une décision qui pourrait avoir pour conséquence la mise en oeuvre de nouvelles négociations à l'échelle des établissements de santé.
Pour prendre en compte de manière réaliste ce processus de long terme, l'ordonnance du 17 février 2021 précitée a ainsi prévu plusieurs dates d'entrée en vigueur pour chaque versant de la fonction publique :
- l'obligation de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire santé s'imposait depuis le 1er janvier 2024 aux employeurs publics de la fonction publique de l'État qui ne disposaient pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022435(*). Depuis le 1er janvier 2025, ces administrations proposent progressivement des contrats collectifs de complémentaire santé et de prévoyance ;
- concernant la fonction publique territoriale, l'obligation de participation financière à la protection sociale complémentaire santé s'imposera aux employeurs à compter du 1er janvier 2026. L'obligation de participation financière à la couverture prévoyance s'applique depuis le 1er janvier 2025436(*) ;
- concernant les employeurs de la fonction publique hospitalière, l'obligation de participation au financement de la complémentaire santé ainsi que la faculté de participation au financement de la couverture prévoyance entrent en vigueur au 1er janvier 2026437(*).
• Les fonctions publiques territoriale et de l'État ont fait l'objet des négociations nécessaires entre 2021 et 2023, qui ont permis la conclusion des accords pour leur mise en oeuvre.
Il s'agit, pour la fonction publique de l'État, de l'accord interministériel du 26 janvier 2022438(*), transposé par un décret du 24 avril 2022439(*), et de l'accord du 20 octobre 2023440(*). Il s'avère néanmoins que la longueur du processus de conduction des négociations et des procédures d'appel d'offres par secteur a nécessité de repousser l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2021 à plusieurs reprises :
Entrée en vigueur des obligations relatives à la fonction publique de l'État
|
Version du 2° du I de l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 |
Existence d'une convention de participation au 1er janvier 2022 |
Absence de convention de participation au 1er janvier 2022 |
|
Version initiale |
Applicable au terme |
1er janvier 2024 |
|
Version modifiée par la loi de finances pour 2024441(*) |
Au terme de la convention, prolongeable d'un an ou jusqu'au 31 2025 |
1er janvier 2025 |
|
Version actuelle modifiée par la loi de finances pour 2025442(*) |
Au terme de la convention, prolongeable d'un an ou jusqu'au 31 décembre 2026 |
1er janvier 2026 |
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, un décret en date du 20 avril 2022443(*) est venu encadrer les dispositions de l'ordonnance, suivi par la signature de l'accord national du 11 juillet 2023444(*).
Dans la fonction publique hospitalière, la mise en oeuvre de la protection sociale complémentaire demeure embryonnaire et les discussions n'ont pas véritablement débuté. Selon la Confédération française démocratique du travail (CFDT), si un groupe technique s'est réuni pour la première fois le 25 mars 2022, la prochaine date d'échange n'a été fixée qu'au 3 décembre 2025445(*). En effet, l'annonce, en mai, de leur prochaine ouverture par le ministre de la santé d'alors, Yannick Neuder n'a pas été suivie d'effet, la première réunion prévue en septembre ayant été reportée au mois de décembre en raison de la démission du Gouvernement.
Lors de l'examen de l'article 23 en séance publique à l'Assemblée nationale du 9 novembre 2025, la ministre de la santé Stéphanie Rist a annoncé avoir reçu les organisations syndicales446(*) et planifié le démarrage des discussions.
La Fédération hospitalière de France (FHF) souligne que la mise en oeuvre de la réforme suppose encore la finalisation du cadrage national et des protocoles d'application, l'élaboration et la passation des marchés afférents, la définition des modalités de financement et la validation des arbitrages budgétaires. Ces étapes s'accompagnent de délais de concertation incompressibles qui justifient selon elle un report pour garantir la faisabilité opérationnelle du dispositif447(*). En effet, selon la CFDT, ces négociations risquent notamment de durer pour déterminer le niveau de garantie de protection des agents, en particulier en matière de couverture prévoyance448(*).
La FHF souligne également le manque de visibilité des établissements de santé quant au financement de sa mise en oeuvre.
Les agents de la fonction publique hospitalière, soit 1,21 million d'agents449(*) sont donc, de ce fait, les seuls travailleurs dont les employeurs , ne sont pas tenus de participer au financement de la protection sociale complémentaire.
B. Le dispositif proposé : un report de deux ans de l'entrée en vigueur du cadre de financement de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique hospitalière par les employeurs publics
L'article 23 prévoit le report au 1er janvier 2028 de l'entrée en vigueur des règles de participation financière de l'employeur hospitalier à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique hospitalière, initialement prévue le 1er janvier 2026. Il modifie ainsi le 4° du I de l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021, qui est l'article non codifié de l'ordonnance venant établir une liste des dérogations et des modalités d'application de l'article 1er de l'ordonnance à chaque pan de la fonction publique.
Si cette mesure va nécessairement engendrer des économies pour les établissements de santé, celles-ci ne sont pas mentionnées par l'étude d'impact. La Fédération hospitalière de France (FHF) a évalué que le déploiement de cette réforme, si elle suivait un format similaire à celui déployé pour la fonction publique de l'État, nécessiterait 500 à 600 millions d'euros450(*).
II - Le dispositif transmis au Sénat
Par trois amendements issus de députés des groupes La France insoumise - Nouveau Front Populaire, Écologiste et Social et Rassemblement national, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. L'argument principal sous-tendant cette suppression est celui de la rupture d'égalité causée par ce report.
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La rapporteure considère qu'il n'apparaît plus réaliste de maintenir la date d'entrée en vigueur de la réforme PSC au 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière au vu des impératifs de négociation et de mise en oeuvre des procédures d'appel d'offres préalables par les employeurs publics. L'exemple de la fonction publique de l'État montre en effet que près de trois ans se sont écoulés entre l'ouverture des négociations et l'application du dispositif, malgré sa gestion centralisée.
La rapporteure souligne qu'il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas favorisé plus tôt l'engagement des négociations avec les partenaires sociaux afin de respecter les échéances prescrites par l'ordonnance du 17 février 2021.
Pour autant, un report de deux ans, jusqu'au 1er janvier 2028, constituerait une aggravation de la rupture d'égalité entre les agents de la fonction publique hospitalière et ceux des autres versants de la fonction publique, au surplus dans un contexte de crise de l'attractivité de l'hôpital public.
Si le dispositif des soins gratuits n'a pas vocation à disparaître, a minima pour des raisons symboliques de reconnaissance des métiers de la fonction publique hospitalière, il ne peut couvrir, à lui seul, de manière suffisante et efficace les besoins des agents, en particulier des contractuels, puisqu'ils en sont exclus.
Ainsi, s'il est indubitable que la carence à agir du Gouvernement rend désormais inévitable le décalage de l'entrée en vigueur de cette réforme, la commission ne saurait accepter un report qui excéderait un an.
Elle propose donc, par l'adoption de l'amendement n° 667 de sa rapporteure, un décalage au 1er janvier 2027 du report de l'entrée en vigueur de la participation financière des employeurs à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique hospitalière. La Fédération hospitalière de France (FHF) et la CFDT estiment qu'il est possible que les négociations aboutissent sous un an, à condition d'avoir « la faculté politique et collective à lever les obstacles identifiés »451(*). La ministre de la santé Stéphanie Rist a également abondé dans ce sens lors de l'examen de l'article 23 en séance publique à l'Assemblée nationale, en soulignant la faisabilité technique de ce rapprochement de la date d'entrée en vigueur.
Afin de limiter les conséquences de ce report sur l'accès à la complémentaire santé des agents de la FPH, la commission appelle par ailleurs le Gouvernement à mettre en place, au titre de l'année 2026, un versement mensuel forfaitaire de quinze euros à l'attention des agents justifiant souscrire à un contrat de complémentaire santé responsable et solidaire, sur le modèle du dispositif transitoire qui s'était appliqué pour la fonction publique de l'État à compter du 1er janvier 2022.
La commission s'inquiète néanmoins de l'opacité qui entoure le financement de la réforme PSC pour les employeurs de la fonction publique hospitalière, dont nul n'ignore la situation financière dégradée.
La commission propose de rétablir cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 24
Lutte contre la rentabilité excessive
Le présent article prévoit divers dispositifs visant à réduire les dépenses d'assurance maladie dans des secteurs dont la rentabilité économique apparaîtrait excessive :
En premier lieu, il offre au Gouvernement la faculté de permettre à l'Uncam de procéder, en l'absence d'avenant conventionnel, à des baisses unilatérales de tarifs lorsqu'il est documenté, dans des conditions définies par décret, une rentabilité excessive d'un secteur, d'un acte, d'une prestation ou d'un produit de l'offre de soin.
En deuxième lieu, il propose une évolution des modalités de rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie médicale (forfaits techniques) en les écartant du champ conventionnel.
Enfin, il harmonise les modalités de fixation des tarifs des actes de dialyse et de radiothérapie en ville et à l'hôpital d'ici 2027 avec un processus de convergence dès 2026.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. L'augmentation des niveaux de rentabilité dans le système de santé et plus particulièrement au sein de certains secteurs
Le rapport « Charges et produits » pour 2026 de l'Assurance maladie452(*) consacre un chapitre spécifique aux enjeux des rentes économiques et de l'optimisation financière de certains secteurs. Elle définit les « rentes économiques » dans le champ de la santé comme « les situations dans lesquelles on observe un écart anormalement élevé entre la tarification d'une activité de soin et le coût moyen de réalisation de cette activité ». La Cnam précise que cette rente « peut ainsi s'observer à l'échelle d'un seul acte de soins, d'une série d'actes, voire à l'échelle d'un secteur entier de l'offre de soins ».
Si la rentabilité n'est pas, par défaut, illégitime dans un secteur où la coexistence d'une offre variée - publique, privée à but lucratif et privée à but non lucratif - vise « un optimum de fonctionnement du point de vue de la dépense et de la qualité du service de santé »453(*), l'origine très majoritairement publique du financement des activités de soins et la situation budgétaire dégradée de la branche maladie posent la question de la « juste rémunération » de ces activités de soins. Par ailleurs, comme le soulève également l'Assurance maladie, « la recherche de profits peut conduire à des pratiques d'optimisation financière qui peuvent se faire au détriment de l'accès, de la pertinence et de la qualité des soins ». Ainsi, la focalisation excessive sur certains actes plus rentables, la concentration de l'offre de soins dans les zones attractives au détriment des territoire peu dotés, des processus de sélection des patients ou encore des politiques de réduction de la qualité du matériel utilisé constituent des risques importants pour les usagers et fragilisent notre système de santé.
Enfin, comme le souligne un récent rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur la financiarisation de l'offre de soins, l'existence de dividendes réalisés en France sur des activités financées par les cotisations sociales et réinvestis pour certains à l'étranger constitue « une privatisation de ressources publiques transformées en profits »454(*).
À cet égard, lors de son audition par la commission des affaires sociales le 23 octobre 2025, le directeur général de la Cnam a indiqué qu'il était « légitime que l'assurance maladie adapte ses tarifs pour ne pas laisser se développer ce que j'appelle des rentes, c'est-à-dire une rentabilité excessive au regard d'une situation économique normale » 455(*).
Au sein de notre système de santé, les tarifs sont, dans la grande majorité des secteurs, fixés par convention entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs des différentes professions concernées. Dès lors, l'ajustement des tarifs ne se faisant pas librement par le jeu du marché et les prix intégrant d'autres critères que la seule loi de l'offre et de la demande (attractivité du secteur, recherche d'une offre de soins homogène sur le territoire...), des situations de « rentes » peuvent apparaitre. La maîtrise de ces situations constitue dès lors « un levier essentiel pour préserver la soutenabilité financière du système de santé et pour renforcer l'équité dans la répartition de l'offre de soins »456(*).
Dans son rapport précité, la Cnam identifie certains secteurs au sein desquels se seraient constituées des situations de rentes. Ces situations sont définies à partir de trois critères :
- le ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaires (EBE/CA). II mesure la part du chiffre d'affaires restant après prise en compte des coûts directs et avant amortissements, provisions et impôts sur les sociétés. Il permet d'évaluer la performance de l'entreprise indépendamment de sa politique d'investissement et de sa structure financière ;
- le ratio flux de trésorerie disponible/chiffre d'affaires (FTD/CA). Ce ratio mesure la proportion de trésorerie nette, y compris après investissements, par rapport au chiffre d'affaires. Il permet de mesurer la capacité d'une entreprise à générer de la liquidité ;
- le ratio résultat net/chiffre d'affaires, qui mesure la rentabilité financière soit le bénéfice final après prise en compte de l'ensemble des charges et produits de l'entreprise (liés à l'exploitation, financiers, impositions, etc). Ce dernier ratio en ce qu'il permet d'évaluer le bénéfice net de l'entreprise est largement utilisé.
L'assurance maladie a appliqué, pour leur seule activité libérale, cette analyse aux secteurs suivants : l'anatomopathologie, de l'audioprothèse, de la dialyse, de la radiologie, de la biologie, de la médecine nucléaire et de la radiothérapie.
Deux rapports de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'inspection générale des finances (IGF), l'un sur la radiologie457(*), l'autre sur la financiarisation458(*), ont également montré que le niveau de valorisation de ces activités et la rentabilité dans ces secteurs et notamment la radiologie étaient élevés. Ainsi, le ratio d'excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires des sociétés de radiologie est passée de 10 % à 13 % entre 2019 et 2023.
Le tableau ci-dessous présente dans sa dernière colonne l'évolution du chiffre d'affaires moyen entre 2018 et 2022 pour chacun des secteurs étudiés par l'Assurance maladie. Les secteurs de l'anatomopathologie (études des tissus biologiques et des cellules pathologiques prélevés sur des individus vivant ou mort) et de la biologie connaissent les croissances les plus fortes avec respectivement + 129,2 % et + 107,1 %.
Évolution du chiffre d'affaires moyen par secteur entre 2018 et 2022
Source : Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025
Le secteur de la radiologie non hospitalière est caractérisé par une rentabilité médiane stable mais une forte dispersion de celle-ci. En effet alors que la rentabilité des entreprises détenant les équipements lourds (scanner, IRM) est plus élevée (environ 34 % en 2022), « 25 % des cabinets de radiologie présentaient un taux de marge inférieur à 2 % »459(*). La Drees estime par ailleurs que le revenu d'activité moyen des 4 918 radiologues percevant des honoraires est de 212 700 € en 2021, soit 72 % de plus que la moyenne de l'ensemble des médecins460(*).
Les dépenses relatives aux actes d'imagerie médicale, en ville, proviennent tant de la rémunération des actes techniques d'imagerie, relevant de la classification commune des actes médicaux (CCAM), que de la prise en charge, sous forme de forfaits techniques, des frais d'amortissement et de maintenance des appareils d'imagerie lourde (cf. infra). Les actes d'imagerie lourde représentaient, en 2019, 48 % des montants remboursés par l'assurance maladie pour seulement 19 % des actes réalisés461(*).
En termes de montants remboursés par l'assurance maladie, en 2024, les radiologues représentent 3,74 milliards d'euros, soit une hausse de 22,5 % par rapport à 2019 (4,1 % de croissance annuelle moyenne sur la période)462(*). Si le nombre total d'acte semble relativement stable sur les dernières années, la croissance constatée des dépenses semble avoir été portée par l'augmentation du nombre de scannographies, plus coûteuses pour l'Assurance maladie463(*).
Par ailleurs, alors que le secteur se caractérisait par sa fragmentation, la progression de groupes d'imagerie privés financiarisés, portés par des besoins d'investissement importants et des départs en retraite de nombreux praticiens détenteurs de cabinets indépendants entraine un profond bouleversement de la structure de l'offre de soins464(*).
Concernant la radiothérapie, l'assurance maladie note qu'il s'agit du secteur présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés avec une rentabilité opérationnelle de 27 % et une rentabilité moyenne (investissements déduits) de 21 % en 2022. Surtout, les modalités de tarification actuelles, différentes entre le secteur public et privé non lucratif465(*) et le secteur libéral466(*) peuvent être facteurs d'une inflation du nombre de séances facturées. Ainsi, comme le note l'Assurance maladie, « Entre 2013 et 2023, les dépenses de radiothérapie pour le seul secteur libéral ont progressé de 159 % (pour atteindre 1,1 milliard d'euros en 2023). » Ce mode de financement actuel apparaît inadapté en ce qu'il désincite à l'innovation : les nouvelles techniques permettent un nombre réduit de séances, au bénéfice du patient.
Évolution de la rentabilité
financière (résultats net / capitaux propres)
en
radiothérapie et radiologie entre 2018 et 2022
|
Secteur |
Rentabilité Financière Moyenne 2018 (%) |
Rentabilité Financière Moyenne 2022 (%) |
|
Radiothérapie |
39,10% |
60,6 % (+ 55 % par rapport à 2018) |
|
Radiologie |
20,30% |
27,9 % (+ 37,4 % par rapport à 2018) |
|
Biologie |
15,40 % |
27,2 % (+ 76,6 % par rapport à 2018) |
Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de la Cnam
La réforme issue de la LFSS pour 2024 prévoit alors que l'activité de traitement du cancer par radiothérapie soit financée par des forfaits ainsi qu'un rapprochement des modes de financement selon les secteurs avec une échéance au 1er janvier 2026 ramenée au 1er octobre 2025 en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La réforme ne concerne dans un premier temps que les établissements hospitaliers.
Au regard des premiers travaux réalisés le Haut conseil des nomenclatures puis par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) qui ne permettent pas d'appréhender la globalité de l'activité de radiothérapie, le report de l'entrée en vigueur de cette réforme et son application simultanée au secteur libéral et aux établissements de santé semblent être souhaités par les différents acteurs.
À ce titre, dans sa réponse au questionnaire transmis par la rapporteure, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) appelle également à « une application au 1er janvier 2027 de la réforme tant pour les établissements de santé que pour les cabinets libéraux ».
Calendrier prévisionnel de la réforme des financements de la tarification en établissements de santé actualisé transmis par la DGOS à la rapporteure
Source : DGOS, réponse au questionnaire transmis par la rapporteure
Pour ce qui est de la néphrologie, la hausse du diabète et de l'hypertension entraine une prévalence croissante des maladies rénales au sein de la population. L'association de patients Renaloo estime à environ 80 000 € par an et par patient, le coût d'un tel traitement, pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie dans le cadre des ALD. La Société Francophone de Néphrologie Dialyse et Transplantation (SFNDT), dans un livre blanc de mars 2024467(*), mentionne une dépense annuelle moyenne de 62 950 € pour un patient dialysé (contre 13 450 € pour un patient en suivi de greffe rénale), pour un coût total pour l'Assurance Maladie de 4,3 milliards d'euros par an. La SFNDT précise également qu'on observe sur les dernières années une diminution significative du nombre de patients sous dyalise (- 500 entre 2022 et 2023) générant ainsi une économie de 40 millions de non dépense468(*).
Le cas de la dialyse médicale : une rente de situation non régulée
L'activité de dialyse médicale constitue un exemple des rentes de situation que peut occasionner l'absence de révision du tarif de certains actes dans le système de la tarification à l'activité (T2A). Dans son rapport public annuel de 2020, la Cour des comptes relevait la rentabilité « anormalement élevée » de l'activité de dialyse aux dépens de l'assurance maladie.
L'excessive valorisation de l'activité de dialyse par la T2A s'est accompagnée de dérives que l'association Renaloo s'emploie à recenser, dans une course au profit négligeant les intérêts du patient. Ces situations mettent en exergue les conséquences pouvant résulter d'un déficit de régulation économique des activités de soins par les pouvoirs publics.
Parmi les pratiques abusives observées figurent l'anticipation de l'entrée des patients dans les protocoles de dialyse, la facturation de consultations à l'occasion de chaque séance ou encore, un défaut d'orientation vers la greffe, qui demeure, malgré la persistance de nombreuses difficultés d'accès, le traitement de suppléance le plus adapté et le moins coûteux pour l'insuffisance rénale chronique. Des économies réalisées sur la qualité des prises en charge ont également été recensées, telles que le défaut d'entretien des locaux et de nettoyage des machines, des consommables inadaptés et en nombre insuffisant, l'absence de collations pour les patients...
La Cour des comptes notait un étonnant différentiel de rentabilité au profit du secteur privé lucratif par rapport à la moyenne d'ensemble : selon elle, les structures privées à but lucratif réalisant une activité de dialyse présentaient un résultat d'exploitation oscillant entre 15 % et 18 % de leur chiffre d'affaires sur la période 2010-2016, contre un taux proche de 5 % pour l'ensemble des structures. Or le secteur privé lucratif concentre 35 % de l'activité de dialyse. Les groupes Ramsay et Elsan figurent parmi les principaux acteurs concernés.
Pour limiter ces biais et favoriser la qualité des soins, un encadrement de la profitabilité des activités de dialyse par une révision des modalités de financement et de cotation des actes apparaît nécessaire.
Source : Commission des affaires sociales, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024) déposé le 25 septembre 2024
Comme pour la radiothérapie, une réforme des modalités de financement vers un financement au forfait du traitement par dialyse, dont l'entrée en vigueur est prévue pour janvier 2026, est en cours. Elle ne concerne également à ce stade que les tarifs hospitaliers. À ce titre, les représentants des radiothérapeutes entendus par la rapporteure ont pu exprimer leur soutien à la réforme du financement vers une rémunération au forfait et espèrent que le « délai de mise en oeuvre au 1er janvier 2027 permettra d'avoir un dialogue transparent et constructif avec l'administration afin de fixer des forfaits et des valorisations correspondant aux besoins des patients et à la pérennité de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire »469(*).
Enfin, dans le champ de la biologie médicale, l'épisode de la crise covid a nettement accéléré la profitabilité du marché.
L'emballement du marché a conduit la Cnam à évoquer dans son rapport « Charges et produits » pour 2024 le risque de formation d'une « bulle spéculative » dans le secteur. D'après la Cnam, en 2022, l'excédent brut d'exploitation (EBE) atteignait 25 % du chiffre d'affaires et le résultat net, 26 % du chiffre d'affaires470(*). Après cette phase de croissance exceptionnelle, plusieurs indicateurs et notamment le taux de marge brut se sont corrigés partiellement. Ainsi, hors nouvelles baisses tarifaires, les représentants de la profession estiment que le résultat d'exploitation des laboratoires devrait avoisiner les 5 % en 2026.
La rentabilité de ce secteur s'explique avant tout par des coûts fixes qui n'évoluent pas totalement en fonction de l'activité réelle. Dès lors « toute augmentation de l'activité au-delà du point mort d'un laboratoire suscite des gains en termes de marge »471(*).
Ce secteur est également marqué par une importante concentration des structures. Selon la Cnam, alors la France comptait 2 625 structures à la fin de l'année 2009, elles n'étaient plus que 377 à la fin de l'année 2021472(*).
Excédent brut d'exploitation et
résultat net des laboratoires,
rapportés au chiffre
d'affaires du secteur (2016-2022)
En %
Source : commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données Cnam (2024)
B. L'objet du présent article : lutter contre la rentabilité excessive
1. Réformer les modalités de financement de l'imagerie médicale et de la radiothérapie
a) Les forfaits de radiothérapie libérale
Le 1° du I rétablit un article L. 162-1-7-1 au sein du code de la sécurité sociale.
Cet article L. 162-1-7-1 dispose que les tarifs des activités de radiothérapie sont fixés de manière dérogatoire à la procédure prévue à l'article L. 162-1-7473(*) et pris en charge par l'assurance maladie sur la base de forfaits « déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients ». Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 précité. Il précise aussi que cette modalité de détermination des prix est dérogatoire à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale qui indique que les tarifs et rémunération sont fixés par voie conventionnelle.
Cet article procède donc à l'extension au secteur libéral de la réforme engagée par la loi de financement de la sécurité sociale en 2024 et qui s'appliquait jusque-là uniquement aux activités en établissements de santé (cf. supra). Cette convergence des modes de financement de ces actes est, dans son principe, souhaitée par l'ensemble des acteurs du secteur.
Le Gouvernement souligne dans l'annexe 9 que cette disposition vise à assurer la convergence des tarifs entre le secteur hospitalier et le secteur libéral en mettant en place des modalités de détermination des prix similaires.
Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2027. Toutefois, alors que les acteurs entendus par la rapporteure appellent de leur voeux une réforme simultanée entre les différents secteurs, le texte déposé ne prévoit pas de report de la mise en oeuvre de la réforme concernant les activités en établissements de santé fixée par la LFSS 2025 au 1er octobre 2025. Unicancer s'est ainsi positionné en faveur du report identique du calendrier de démarrage de la réforme des acteurs libéraux et hospitaliers au 1er janvier 2027.
Lors de l'examen de la LFSS pour 2025, la commission s'était interrogée sur la pertinence d'avancer de trois mois l'entrée en vigueur d'une réforme systémique des financements de la radiothérapie à l'hôpital. Elle regrette que les éléments ne sont toujours pas réunis à ce jour pour mettre en oeuvre cette réforme dès 2026474(*).
b) Sortir les forfaits techniques d'imagerie médicale du champ conventionnel
Contrairement à l'ensemble des autres actes médicaux, les actes de radiologie donnent lieu, d'une part, à une rémunération de l'acte et, d'autre part, à un forfait technique qui vise à couvrir le coût d'acquisition et l'ensemble des coûts de fonctionnement induits par l'utilisation de l'appareil. Le forfait technique est défini en fonction de la catégorie d'équipement et évolue selon le niveau d'amortissement de l'équipement et le nombre d'utilisations par an. Il convient de souligner que la fixation du montant des forfaits techniques est particulièrement complexe. Il existe en effet une réelle asymétrie d'information entre les professionnels et l'assurance maladie quant aux coûts réels d'acquisition et d'exploitation des matériels d'imagerie.
L'étude d'impact du PLFSS précise qu'en 2024, 61 % du revenu des radiologues provient des actes d'imagerie, 34 % des forfaits techniques et 5 % des consultations, visites et autres actes. Dans le rapport Igas/IGF précité les inspecteurs évoquent un financement des machines par le forfait technique qui serait « surdimensionné ». Selon la mission, sur une période de sept ans, « le forfait technique couvre en moyenne 166,2 % des coûts liés aux machines et à leur utilisation »475(*). Elle appelle dans son rapport à refonte de ce mode de financement et propose d'exclure ces tarifs de la négociation conventionnelle.
Dans sa réponse au questionnaire transmis par la rapporteure, la Fédération nationale des médecins radiologue (FNMR) estime quant à elle que les charges couvertes par les forfaits techniques comprennent l'acquisition ou la location des machines « mais aussi la maintenance, le foncier, les salaires des personnels, les fluides » et que ces derniers éléments ont connu des hausses importantes ces dernières années.
Montants remboursés pour les actes d'imagerie et forfaits techniques (2010-2023)
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données Cnam (2024)
Ces forfaits sont arrêtés dans le cadre de la négociation conventionnelle, après avis d'une commission des équipements lourds d'imagerie médicale composée de représentants des spécialités concernées, des fédérations hospitalières et de l'assurance maladie, éventuellement après une étude nationale de coûts auprès des exploitants d'imagerie médicale.
Le présent article propose par son 2° du I de modifier l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure d'établissement des forfaits techniques dans le domaine de l'imagerie médicale. Il conserve l'avis de la commission, mais il exclut les partenaires conventionnels de la décision finale. Il reviendra désormais au directeur général de l'Uncam de se prononcer seul sur la rémunération de ces forfaits techniques.
En conséquence, le 3° du I abroge le 26° de l'article L. 162-5 relatif à la fixation des tarifs des forfaits techniques dans les négociations conventionnelles.
Il convient de noter que la LFSS pour 2017 avait déjà permis au directeur général de l'Uncam, à défaut d'accord conventionnel sur l'évolution des forfaits techniques après avis de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale, de fixer unilatéralement ces forfaits. Cette faculté avait été supprimée par l'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 en contrepartie d'une amélioration du recueil des données relatives aux charges associées aux équipements de matériels lourds en imagerie.
2. Instaurer un dispositif de régulation des tarifs en fonction de la rentabilité du secteur
Le 4° du I constitue la mesure phare du présent article. Est ainsi créé un nouvel article L. 162-14-5 qui prévoit la possibilité pour le Gouvernement de permettre à l'Uncam de procéder, en l'absence d'avenant conventionnel, à des baisses unilatérales de tarifs lorsqu'il est documenté, dans des conditions définies par décret, une rentabilité excessive d'un secteur, d'un acte, d'une prestation ou d'un produit de l'offre de soin.
Concrètement, si une telle rentabilité venait à être constatée, les ministres compétents chargeraient le directeur de l'Uncam d'engager dans un délai d'un mois des négociations en vue d'une baisse de tarif pour un montant qu'ils déterminent. Ces baisses de tarifs doivent « permettre une convergence du niveau de rentabilité » du secteur ou du soin considéré avec la moyenne. À défaut d'accord, il serait procédé à des baisses unilatérales de tarifs pour atteindre le montant voulu.
Le II du nouvel article L. 162-14-5 se limite à indiquer que le « niveau de rentabilité est évalué [...] au regard des données comptables et statistiques pertinentes » et renvoi au pouvoir réglementaire pour déterminer les critères et modalités de l'évaluation sans plus de précision quant aux éléments pris en compte pour déterminer ce niveau. L'annexe 9 évoque quant à elle la création d'un observatoire dédié.
Le deuxième alinéa du même II précise que tout professionnel de santé ou toute autre personne, physique ou morale, habilitée à délivrer des soins, dispenser une prestation, délivrer des produits ou dispositifs médicaux seront tenus de communiquer ces données. Si cette obligation n'est pas respectée, une pénalité financière pourra être infligée. Celle-ci devra être « au plus égal à 1 % du montant des honoraires » versés par l'assurance maladie pendant les douze mois précédents.
3. Mettre en place la convergence des tarifs de dialyse et de radiothérapie entre la ville et l'hôpital
Les II et III étendent à la radiothérapie et de la néphrologie, une partie des dispositifs mis en place par l'article 41 de la LFSS pour 2025. Cet article prévoyait notamment qu'en l'absence d'accord de maîtrise des dépenses d'imagerie médicale permettant de réaliser un montant d'économies de 300 millions d'euros sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l'Uncam peut procéder à des baisses de tarifs d'imagerie permettant d'atteindre le montant d'économies. En l'espèce le présent article prévoit :
- Concernant la radiothérapie, le II permet de procéder à des ajustements tarifaires pour les actes de traitement du cancer par radiothérapie dans les trois semaines suivant la promulgation de la LFSS, « afin de réaliser une économie de 100 millions d'euros au cours de l'année 2026 ». Aucune négociation conventionnelle préalable n'est prévue ;
- concernant la néphrologie, le III autorise le directeur de l'Uncam à procéder aux baisses de tarif nécessaires afin de réaliser une économie de 20 millions d'euros sur l'année 2026 en cas d'échec, après deux mois, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux « permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale » c'est-à-dire du nouveau financement au forfait mis en place dans les établissements pour les traitements par dialyse.
II - Le dispositif transmis au Sénat
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le dispositif transmis au Sénat intègre 9 amendements et un sous-amendement.
Un amendement présenté par le rapporteur général476(*) et sous-amendé par le Gouvernement précise que l'étude de rentabilité prévu par le présent article doit se faire entre secteurs « dont les besoins d'investissement sont comparables » afin de mieux tenir compte des réalités économiques de chaque secteur de l'offre de soins. Un second amendement présenté par le rapporteur général477(*) prévoit que le décret déterminant les critères et les modalités de l'évaluation de la rentabilité fixe également la périodicité de cette évaluation afin de pouvoir adapter ces études à l'évolution de la situation économique des secteurs concernés.
Un amendement de Laurent Crozier478(*) (Les Démocrates) introduit l'exigence de motivation des décisions tarifaires prises par le directeur de l'Uncam en cas d'échec de la négociation conventionnelle engagée en cas de rentabilité manifestement disproportionnée. L'Assemblée nationale a également adopté un amendement479(*) présenté par Hendrik Davi (Écologiste et Social) et plusieurs de ses collègues, prévoyant que le résultat des évaluations de rentabilité est rendu publique.
Le dispositif transmis au Sénat intègre également un amendement480(*) inséré à l'initiative du groupe Socialistes et apparentés qui ajoute, dans le cadre de l'évaluation du niveau de rentabilité, un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d'installation, d'exploitation et de fonctionnement propres aux collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution.
Enfin, le texte transmis au Sénat prévoit que le directeur de l'Uncam engage en 2026 des négociations conventionnelles afin de réaliser un montant d'économie de cent millions d'euros dans les secteurs de la biologie, de la radiologie, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et de l'anatomopathologie481(*).
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission soutient l'objectif de maitrise des dépenses de santé. Elle avait, à ce titre, accueilli favorablement les dispositions relatives aux nouveaux accords de maîtrise des dépenses au sein du PLFSS 2025, susceptibles de favoriser la recherche, par l'assurance maladie et les représentants des professionnels de santé, de mesures négociées de régulation des prix et des volumes.
Comme l'a souligné Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, lors de son audition devant la commission des affaires sociales : « La médiatisation d'affaires dans lesquelles il a été porté gravement atteinte à la sécurité des soins pour des motifs de rentabilité financière a rendu suspectes les intentions de certains opérateurs, dès lors qu'elles impliquaient des structures appartenant à des groupes privés, financiarisés ou non »482(*). En effet, comme le souligne l'IGF dans son rapport précité : « soigner n'est pas une activité comme une autre »483(*). Sans stigmatiser l'ensemble d'un secteur ou même certaines activités, l'investissement privé dans le secteur de la santé doit contribuer à l'amélioration de la qualité des soins.
Toutefois, la commission insiste sur la difficulté pour les pouvoirs publics pour appréhender la réalité des coûts, charges et des activités des acteurs du secteur de l'offre de soins. Par ailleurs, si les entreprises cotées en bourse sont soumises à des obligations déclaratives, les informations financières ne font en effet pas l'objet d'une publicité de la part des autres groupes. Les déterminants de la rentabilité, pour utiles qu'ils soient pour identifier des situations potentiellement déviantes voire frauduleuses, ne peuvent qu'être imparfaits et parfois même approximatifs. Dès lors, fonder la mise en oeuvre d'une politique unilatérale de baisse des prix sur les seuls déterminants de la rentabilité peut s'avérer contre-productif.
S'il apparaît légitime que le régulateur tienne compte, dans la négociation des tarifs, des gains de productivité et des taux de marge, la rapporteure estime nécessaire de mieux prendre en compte la situation des structures indépendantes, dans un contexte de concentration excessive de nombreux secteurs faisant peser un risque sur la répartition de l'offre de soins sur notre territoire ainsi que sur la qualité des soins.
En effet, la politique des « coûts de rabot » ainsi pratiquée peut amener les acteurs du secteur à une réduction des coûts rendant intenable la poursuite d'activité pour certains indépendants de taille modérée et favorisant le rachat de ces structures par des grands groupes seuls à même de supporter la modération tarifaire via des gains d'efficiences qui peuvent s'avérer préjudiciables pour le patient.
Dès lors la commission souhaite réitérer son attachement à la négociation conventionnelle et au caractère négocié des tarifs applicables aux professionnels libéraux. À titre d'exemple, dans le secteur de la biologie, les protocoles signés entre les partenaires conventionnels ces dix dernières années se sont révélés efficaces pour maîtriser les dépenses de biologie médicale484(*).
Elle estime que les mesures de baisse unilatérale des tarifs doivent rester exceptionnelles et décidées, le cas échéant et au cas par cas, par le Parlement. Plusieurs représentants des professionnels de santé entendus lors des travaux préparatoires ont pu exprimer leur crainte de voir remis en cause l'exercice même de la convention médicale du fait de ces décisions unilatérales.
Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement n° 670 de sa rapporteure, supprimant du texte transmis les dispositions qui autorisent le directeur général de l'Uncam à procéder à des baisses de tarifs unilatérales tout en conservant le mécanisme d'identification des situations de rentabilité excessive.
Elle souhaite également, par ce même amendement, que les représentants des professionnels de santé des secteurs concernés participent à l'évaluation du niveau de rentabilité. Il apparaît essentiel de permettre ainsi dans un esprit de responsabilité partagée la mise en place d'études réalisées conjointement entre le régulateur et les professionnels de santé.
Concernant la réforme du financement de la radiothérapie, la commission regrette une nouvelle fois que les conditions de mise en oeuvre de la réforme à horizon 2026 ne semblent toujours pas réunies. Elle souligne l'importance de la mise en oeuvre concomitante de la réforme dans les établissements de santé et en secteur libéral afin d'éviter les distorsions de tarifs. Dès lors, par cohérence, la rapporteure a proposé un amendement n°668 visant à décaler la mise en oeuvre de la réforme du financement de la radiothérapie dans les établissements de santé au 1er janvier 2027.
Elle souhaite également supprimer la dérogation au principe conventionnel pour déterminer le prix des forfaits techniques (amendement n°669). Elle considère effectivement que les baisses de tarifs décidées par le directeur de l'Uncam en octobre 2025 à la suite de l'échec de la négociation conventionnelle ouverte en application de l'article 41 de la LFSS pour 2025 constituent déjà une première étape nécessaire dans l'objectif de maitrise des dépenses qui doit désormais être intégrée par le secteur.
Enfin, la rapporteure a souhaité supprimer les baisses de tarifs prévues au II et III du présent article considérant qu'il était nécessaire de permettre aux secteurs de la radiothérapie et de la dialyse de préparer et mettre en oeuvre la réforme de leur tarification en cours sans leur imposer en parallèle des régulations tarifaires au cours de l'année 2026 (amendement n° 668). De plus la réforme des financements de ces deux secteurs aura effectivement nécessairement un impact sur la tarification et la rémunération des acteurs.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 24 bis (nouveau)
Réduction unilatérale des
tarifs par le ministre en charge de la santé
en cas de
rentabilité excessive constatée dans un secteur
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, donne pouvoir aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de réduire d'autorité et sans négociations conventionnelles préalables, les tarifs de certains actes et prestations pris en charge par l'Assurance maladie.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : attribuer aux ministres de la santé et de la sécurité sociale le pouvoir de réduire unilatéralement les tarifs pour des actes ou prestation lorsqu'une rentabilité excessive est constatée.
A. L'augmentation des niveaux de rentabilité dans le système de santé et plus particulièrement au sein de certains secteurs
Les études relatives à l'évolution de la rentabilité dans certains secteurs, les risques associés ainsi que les limites inhérentes aux outils de de mesure de la rentabilité des activités de soins sont largement présentés au commentaire de l'article 24 auquel le lecteur est invité à se reporter.
Le présent commentaire ne reprend donc pas ici ces développements
B. La mise en place d'un régime de baisse unilatérale des tarifs des actes et prestation
Le présent article, introduit par amendement à l'Assemblée nationale485(*), modifie l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de détermination de la liste des actes et prestations pouvant faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement par l'Assurance maladie.
Il ajoute un I bis qui précise que « lorsque le rapport moyen entre l'excédent brut d'exploitation et le chiffre d'affaires »486(*) et le « rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d'affaires »487(*) dégagés par les actes ou prestation inscrits sur la liste des actes et prestations soumis à remboursement et prise en charge dépassent « des seuils déterminés par décret » alors les tarifs peuvent être réduits « d'autorité », et sans négociation conventionnelle préalable, par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.
Il instaure ainsi un régime dérogatoire au régime conventionnel défini aux article L. 162-14-1 et suivants qui précisent que les tarifs des honoraires et rémunérations dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux sont définis par les conventions professionnelles conclues entre l'Uncam et les organisations syndicales représentatives.
II - La position de la commission
Cet article a pour objectif de supprimer toute négociation conventionnelle pour attribuer un pouvoir de baisse des tarifs au Gouvernement sur la base de deux seuls ratios dont les limites ont déjà été rappelées (difficultés à estimer les coûts réels afférents à chaque activité, rentabilité moyenne ne permettant pas de saisir la diversité des situations et notamment dans les territoires rencontrant déjà des difficultés d'accès aux soins, etc.). À titre d'exemple, si la radiologie connait une rentabilité moyenne de 16 %, celle-ci n'est que de 2 % pour les plus petits cabinets indépendants.
La commission estime que le mécanisme prévu à l'article 24 permet, dans un esprit de responsabilisation de l'ensemble des acteurs, de pouvoir identifier et, le cas échéant, engager des négociations conventionnelles pour maitriser les risques associés à une rentabilité excessive qui aurait été constatée dans un secteur ou sur un acte ou une prestation. Il permettra ainsi de cibler précisément les excès sans jeter l'opprobre sur tout un secteur ou une profession.
La commission rappelle son attachement à la négociation conventionnelle et refuse qu'une politique de santé puisse être menée sur la seule base de chiffres inscrits dans un tableur informatique. Elle souligne enfin à nouveau le risque de concentration des activités au sein des grands groupes, pour certains financiarisés, que peut constituer une politique de baisse des tarifs généralisée.
Pour ces raisons, la commission a adopté l'amendement n° 671 de la rapporteure qui tend à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 25
Mieux réguler les dépenses dans le secteur des
soins dentaires
Le présent article étend les protocoles sectoriels de maîtrise des dépenses d'assurance maladie prévus par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 au champ des soins dentaires.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Le secteur des soins dentaires
En 2024, la consommation de soins dentaires dans le secteur libéral s'est élevée à 13,2 milliards d'euros488(*). Cette consommation est principalement portée par les prothèses dentaires, dans le contexte de la réforme du 100 % Santé, et l'orthodontie et croît de 2,3 % entre 2023 et 2024. Au total sur la période 2019-2024, les dépenses remboursées ont augmenté de 5,6 % par an.
Ces dépenses de santé sont supportées à 48,5 % par les organismes complémentaires, 36,1 % par l'assurance maladie et 15,5 % sous la forme de reste à charge pour les ménages.
Les différentes modalités de tarification des soins dentaires
Trois modes de tarification des soins dentaires coexistent :
- les consultations et les soins préventifs et conservateurs sont facturés au tarif opposable et pris en charge à 70 % par l'assurance maladie obligatoire (AMO) jusqu'au 15 octobre 2023. À partir de cette date, ce taux de remboursement passe à 60 %, avec un transfert vers les organismes complémentaires.
Les dépassements ne sont pas autorisés sur ces types de soins ;
- les soins d'orthodontie commencés avant le 16ème anniversaire du patient et les soins prothétiques sont facturés le plus souvent avec dépassements. Le taux de remboursement AMO est le même que pour les consultations et les soins préventifs et conservateurs ;
- les soins de parodontologie, d'implantologie et ceux d'orthodontie débutés après 16 ans font l'objet d'honoraires totalement libres. Ces actes ne sont ni inscrits dans la classification commune des actes médicaux (CCAM), ni remboursés par l'AMO. Ils sont cependant partiellement pris en charge par certains organismes complémentaires.
Cette dernière catégorie de soins non remboursables se développe. Ils sont très mal mesurés par la statistique publique, en raison de leur non-inscription dans la CCAM. En conséquence, leur estimation dans les comptes de la santé est fragile.
Source : Extrait de Les dépenses de santé en 2024, édition 2025 - Fiche 9 : les soins dentaires
Le secteur connaît une restructuration profonde avec une baisse depuis plusieurs années de la part des soins dentaires en cabinet libéral (91,7 % en 2014, 84,2 % en 2024) au bénéfice de ceux réalisés dans les centres de santé. En effet, comme le souligne le rapport de la commission sur la proposition de loi visant à libérer l'accès aux soins dentaires, les 10 % de la population les mieux dotés ont une accessibilité aux soins dentaires 7,8 fois supérieure à celle des 10 % les moins bien dotés plaçant ainsi la profession de chirurgien-dentiste comme celle présentant les inégalités d'accès territoriales les plus fortes en France, devant les kinésithérapeutes (rapport de 6,7) et les médecins généralistes (rapport de 4,1)489(*).
Par ailleurs, le rapport Charges et produits pour 2026490(*) de la Cnam indique que le secteur est particulièrement concerné par l'ouverture à des acteurs européens et ceux dans l'ensemble des États membres. Ainsi, « 90 % des 30 plus grands groupes de soins dentaires en Europe sont détenus par des fonds d'investissement ». L'Assurance maladie précise que ces fonds étaient « impliqués dans 96 des 116 plus importantes opérations financières menées par des groupes dentaires en Europe entre 2017 et 2019 ». Dans ce contexte, les risques liés à une financiarisation non maîtrisée et notamment que des dividendes générés en France à partir de ressources publiques ne soient réinvestis en dehors du système de santé - voire à l'étranger ne sont pas à négliger.
Toutefois, la Drees dans la note consacrée aux soins dentaires figurant dans sa revue des dépenses de santé pour 2024491(*) note que la progression des dépenses de soins dentaires en cabinet libéral ralentit en 2024 (+ 2,3 % après + 3,5 %), comme les volumes de soins (+ 0,9 % après + 2,6 %). La montée en charge progressive du 100 % Santé depuis 2021 avait en effet porté la hausse des dépenses dans le secteur. Dans sa réponse au questionnaire transmis par la rapporteure, les Chirurgiens-dentistes de France (CDF) indique que la « hausse du ticket modérateur sur les seuls actes réalisés par les chirurgiens-dentistes en 2024 a entraîné une baisse des dépenses dentaires prises en charge par l'assurance maladie obligatoire (4,74 milliards d'euros en 2024 contre 6,1 milliards d'euros en 2023) ».
Consommation de soins courants dentaires en ville
Source : Drees, comptes de la santé ; Statistique mensuelle de la Cnam pour les indices des prix
B. La mise en place des accords de maîtrises de dépenses afin de réguler les dépenses dans certains secteurs des soins de ville
Mis en place par l'article 41 de la LFSS pour 2025 pour les secteurs dans le champ de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, ces accords fixent un objectif de maîtrise de la dynamique des dépenses remboursées par l'Assurance maladie et des mesures correctrices en cas de non-respect de celles-ci.
L'article L. 162-12-18 rétabli par la LFSS pour 2025 porte les dispositions relatives à ces accords de maîtrise des dépenses. Ces accords définissent pour une période pluriannuelle :
- des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;
- des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé ;
- les engagements des partenaires conventionnels mis en oeuvre pour respecter ces objectifs ;
- les modalités de suivi du respect de ces objectifs ;
- les mesures correctrices, enfin, pouvant être adoptées en cas de non-respect, annuel ou infra-annuel, des objectifs ou de la trajectoire définis.
L'Uncam informe de son intention d'ouvrir une négociation en vue de la conclusion d'un accord de maîtrise des dépenses les organisations syndicales représentatives de la profession concernée, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (Unocam) et les conseils nationaux des ordres professionnels.
Pour être validés, ces accords doivent être signés par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national et ayant réuni, aux élections à l'Union régionale des professionnels de santé (URPS), au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national492(*).
Les accords sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de 21 jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à son approbation « du fait de sa non-conformité aux lois et règlements en vigueur, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou, enfin, parce qu'il est porté atteinte au principe d'égal accès aux soins »493(*).
L'article L. 162-12-19 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de saisir, afin de concourir au respect de l'Ondam, les partenaires conventionnels pour qu'un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine.
Enfin, le II de l'article 41 qui n'est pas codifié dans le code de la sécurité sociale fixe à 300 millions d'euros, pour les trois prochaines années, le niveau minimal d'économies devant être réalisées dans le champ de l'imagerie et des transports sanitaires. Pour ce faire, il prévoit qu'en l'absence, au 30 septembre 2025, d'accord de maîtrise des dépenses permettant de réaliser un tel montant d'économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l'Uncam peut procéder, jusqu'au 31 octobre 2025, à des baisses de tarifs d'imagerie permettant d'atteindre le montant d'économies prescrit.
Si un accord a finalement pu être adopté avec les transporteurs sanitaires494(*), les négociations avec les radiologues n'ont pas abouti. Conformément au II de l'article 41 de la LFSS pour 2025, le directeur général de l'Uncam était alors habilité à décider unilatéralement de ces baisses de tarifs. Lors de son audition par la commission des affaires sociales, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie a ainsi précisé privilégier « toujours la négociation » mais que « lorsque le Parlement considère que, faute d'accord, la décision doit être unilatérale » il devait « malheureusement procéder à des baisses de tarifs »495(*).
C. L'objet du présent article : étendre ces accords de dépenses au champ du soins dentaires
Cet article étend le champ d'application de l'article 41 de la LFSS pour 2025, relatif aux accords de maîtrise de dépenses dans les secteurs des transports sanitaires, de la biologie et de l'imagerie au secteur des soins dentaires.
Son unique alinéa ajoute pour cela le champ des « soins dentaires » aux différents champ couverts par les accords de maîtrises de dépenses au titre de l'article L.162-12-18 précité. Il précise également que ces accords dans le champ des soins dentaires sont conclus par les parties à la convention des chirurgiens-dentistes mentionnée à l'article L. 162-9.
Toutefois, cet article ne comporte pas de disposition équivalente au II de l'article 41 de la LFSS pour 2025 imposant la conclusion d'un accord de maîtrise des dépenses dès 2026 pour un montant donné. Mais la possibilité pour les ministres d'imposer, en application de l'article L. 162-12-19, le déclenchement de négociations dans le but de parvenir à des baisses de tarifs reste quant à elle applicable.
Par ailleurs, la convention nationale des chirurgiens-dentistes de 2023 couvrant la période 2023-2028 permet d'envisager un investissement financier de plus de 600 millions d'euros sur la durée de la convention et d'engager un virage préventif ainsi qu'un renforcement de l'accès aux soins dentaires496(*). Le directeur général de la Cnam a indiqué devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée se satisfaire à ce stade de cet accord497(*).
II - Le dispositif transmis au Sénat
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement sur cet article afin de le compléter par une demande de rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l'article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025498(*).
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
Lors de l'examen du PLFSS 2025, la commission avait accueilli favorablement la mise en place d'accords de maîtrise des dépenses dans certains secteurs.
Toutefois, le secteur des soins dentaires ne semble pas aujourd'hui comporter des risques d'augmentation non maîtrisées des dépenses. Dès lors cet article semble excessif par rapport à la réalité du secteur et donne un mauvais signal à la profession qui s'est engagée dans un processus de maitrise des dépenses.
Le mécanisme de supervision de la rentabilité excessive mis en place par l'article 24 du présent projet de loi pourra permettre de mieux identifier les conséquences et les risques associés à la multiplication des centres dentaires et le processus de centralisation que connait ce secteur.
Par ailleurs, comme la rapporteure l'a indiqué dans son commentaire de l'article 24, les baisses de tarifs peuvent également être source d'une concentration excessive et d'une financiarisation non maîtrisée d'un secteur. Lors de l'examen du PLFSS 2025, la commission avait déjà identifié un risque de vulnérabilité financière des plus petites structures dans les territoires liés à la baisse des tarifs. Elle avait alors ajouté, parmi les éléments définis par les accords de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé ceci est particulièrement vrai pour les soins dentaires.
Dès lors, considérant qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de déroger au principe conventionnel dans le secteur des soins dentaires, la commission a adopté un amendement n° 672 de suppression de cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 25 bis (nouveau)
Insertion de l'ophtalmologie et des soins
dentaires dans les accords de maîtrise des dépenses
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, ajoute les soins dentaires et l'ophtalmologie dans la liste des secteurs pouvant conclure des accords de maîtrise des dépenses.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : intégrer le champ de l'ophtalmologie dans les secteurs pouvant conclure des accords de maitrise des dépenses
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Le secteur de l'ophtalmologie connait une profonde mutation de son offre de soins qui peut traduire un risque de concentration excessive et de pratique d'optimisation financière
Le secteur de l'ophtalmologie connaît, comme le secteur du soin dentaire, depuis plusieurs années un phénomène de concentration des activités dans les centres ophtalmologiques. Ces éléments ont notamment été relevés dans le rapport Charges et produits 2026 de la Cnam499(*).
En 2023, 21,4 millions de patients ont été pris en charge, contre 18 millions en 2013 avec une prise en charge des patients qui se déplace significativement au profit des centres ophtalmologiques. Ainsi, cette même année, 15 % des patients (3,2 millions) ont été traités dans ces centres, contre seulement 2 % (0,4 million) en 2013. Le nombre de patients pris en charge en centre progresse beaucoup plus vite (+ 25,32 % par an en moyenne entre 2014 et 2023) que dans les cabinets libéraux (+ 0,45 % sur la même période), les centres absorbant près de 85 % de l'augmentation globale des besoins en soins ophtalmologiques. Cette déformation de la demande au profit des centres entraine également une augmentation des coûts.
Ainsi, le taux de croissance annuel moyen d'une séance a augmenté de 3,07 % entre 2014 et 2023, principalement sous l'impulsion des centres.
En effet, le coût moyen par patient semble sensiblement supérieur dans les centres par rapport aux cabinets libéraux. Toujours selon les chiffres de la Cnam, le coût moyen par patient en 2023 était de 91 euros dans les centres, contre 72 euros dans les cabinets libéraux. Il en est de même pour le coût moyen par séance qui était cette même année toujours de 67 euros en centre contre 51 euros en libéral.
Selon la Cnam, « ces chiffres suggèrent une forme d'optimisation financière dans les centres, se manifestant par des volumes d'actes réalisés et des cotations pratiquées supérieurs pour des prises en charge similaires ».
Il faut toutefois noter que, dans sa revue des dépenses de santé pour 2024500(*), la Drees indique que les soins d'ophtalmologie en ville ont augmenté de 4,5 % en 2024 soit moins que la moyenne des soins courants des médecins spécialistes (5,2 %). Les ophtalmologistes représentent cependant la première spécialité en termes de montant des dépenses en ville avec une dépense s'élevant à 2,25 milliards d'euros en 2024 (soit 19 % des montants des soins courants des médecins spécialistes en ville (hors médecins généralistes).
B. L'extension des accords de maitrise des dépenses au secteur de l'ophtalmologie
Le présent article a été inséré par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption de l'amendement présenté par Élise Leboucher et plusieurs de ses collègues après un double avis défavorable du rapporteur général et du Gouvernement. Son unique alinéa ajoute pour cela les champs de l'ophtalmologie et également des soins dentaires, pourtant déjà couverts par l'article 25 du présent PLFSS, aux différents champs concernés par les accords de maîtrise des dépenses au titre de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.
Le contenu de ces accords de maîtrise des dépenses est présenté dans le commentaire de l'article 25.
Comme c'est le cas pour les soins dentaires à l'article 25, cet ajout n'est pas accompagné de dispositions visant à engager des négociations sur l'année 2026 afin d'engager des réductions de dépenses pour un montant donné.
II - La position de la commission
Pour les mêmes raisons que celles exprimées dans le commentaire de l'article 25, la rapporteure a déposé un amendement n° 673 visant à supprimer cet article. Il n'apparait pas nécessaire à ce stade de déroger au principe conventionnel dans le secteur de l'ophtalmologie.
En effet, les secteurs de l'ophtalmologie et des soins dentaires connaissent des similitudes importantes liées notamment aux risques de concentration des activités de soins.
Le mécanisme prévu à l'article 24 d'amélioration de l'identification des situations de rentabilité excessive permettra de mieux appréhender les risques liés à ce phénomène et auquel la réponse ne peut se limiter à une politique de baisse des tarifs qui, en elle-même, peut renforcer la mainmise des grands groupes sur l'offre de soins.
Pour ces raisons, la commission propose de supprimer cet article.
Article 26
(supprimé)
Renforcer la taxation des dépassements
d'honoraires
Cet article propose de renforcer la taxation des dépassements d'honoraires et des prestations non conventionnées. Pour cela, il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux de cotisation appliqué, dans un objectif de réévaluation du taux en vigueur, et élargit le champ des praticiens redevables de la cotisation.
La commission propose de maintenir la suppression de cet article.
I - Le dispositif proposé
A. La pratique des dépassements d'honoraires : un enjeu de régulation pour les pouvoirs publics, un principe de liberté pour les praticiens
1. Des dépassements d'honoraires en hausse qui posent la question de l'égal accès aux soins des Français
a) Une augmentation particulièrement soutenue depuis 2019
• Les dépassements d'honoraires connaissent une augmentation très dynamique depuis 2019, de l'ordre de + 5,5 % par an. À titre de comparaison, ils ont progressé de 1,7 % par an en moyenne sur la période 2010-2019.
Évolution du montant des dépassements d'honoraires, 2004-2024
Source : Cnam, rapport Charges et produits pour 2026
En 2024, le montant total des dépassements d'honoraires s'est élevé à 4,5 milliards d'euros501(*). Les deux tiers de ce montant proviennent des dépassements pratiqués sur les actes techniques502(*), qui incluent notamment les actes d'imagerie, les explorations fonctionnelles, les actes chirurgicaux et d'anesthésie, les accouchements ou les frottis. Ces actes sont principalement réalisés par les médecins spécialistes.
En parallèle, la proportion des médecins installés en secteur 2 tend à s'accroître, passant de 37 % en 2000 à 56 % en 2024, reflétant une moindre attractivité du secteur 1. Le choix du secteur 2 concerne majoritairement les médecins spécialistes : 76 % d'entre eux optent pour ce secteur à l'installation.
Il est à noter que l'assouplissement des conditions d'exercice d'une activité libérale à l'hôpital depuis 2021503(*) n'explique pas ces évolutions. En 2022, le montant des dépassements d'honoraires réalisés sur des activités pratiquées à l'hôpital s'élevait à 73 millions d'euros, soit 2 % du total.
• La pratique des dépassements d'honoraires est hétérogène, concentrée sur un nombre restreint de spécialités.
Quatre spécialités représentent les deux tiers du montant total des dépassements d'honoraires en 2024504(*) :
- la chirurgie (plus d'un milliard d'euros, en croissance de 44 % entre 2029 et 2024) ;
- l'ophtalmologie (749 millions d'euros) ;
- l'anesthésie (546 millions d'euros) ;
- le radiodiagnostic et l'imagerie médicale (97 millions d'euros).
La part que représentent les dépassements d'honoraires dans la rémunération des médecins en France s'établit en moyenne à 21,1 % toutes spécialités confondues, malgré des contrastes marqués entre spécialités. Elle s'établit à 1,1 % pour l'ensemble des médecins généralistes.
Ces données financières traduisent les choix du secteur d'exercice à l'installation. Le choix du secteur 2 est ainsi particulièrement marqué dans un nombre restreint de spécialités : à l'installation, il concerne 87 % des chirurgiens, 85 % des anesthésistes, 89 % des gynécologues-obstétriciens et des ophtalmologues.
b) Un enjeu d'accessibilité financière des soins
• Le recul global du secteur 1 et la progression des dépassements d'honoraires engendrent une réduction de l'offre de soins à tarif opposable qui peut être synonyme de renoncement aux soins.
Le défaut d'accessibilité aux soins fait l'objet d'enquêtes régulières. En 2019, un sondage établissait à 17 % la part des personnes interrogées affirmant avoir renoncé à des soins médicaux au cours des douze derniers mois pour des raisons financières, avec une surreprésentation des jeunes actifs de 25 à 34 ans505(*).
Le renoncement aux soins pour raisons financières fait aussi l'objet d'un indicateur suivi annuellement au titre de l'évaluation des politiques de sécurité sociale. Il montre que la part de la population ayant renoncé à des soins pour ce motif au cours des douze derniers mois, relativement stable sur la période 2020-2023 - entre 1,8 % et 2 % pour l'ensemble de la population et entre 3,2 % et 4,3 % pour les 20 % des ménages les plus modestes - est en augmentation par rapport à la période 2015-2019. Le taux de renoncement aux soins dentaires pour raisons financières est substantiellement plus élevé : il s'élève à 5,1 % pour l'ensemble de la population et à 9,1 % parmi les 20 % des ménages les plus modestes506(*).
• La pratique des dépassements d'honoraires tend ainsi à creuser les inégalités sociales de santé, de même que les inégalités territoriales.
En effet, la prépondérance du secteur 2 dans certaines spécialités limite davantage l'accessibilité aux soins dans les territoires où l'offre est la plus carencée. Dans les territoires caractérisés par une offre de soins peu dense, la barrière financière aux soins que peuvent représenter les dépassements d'honoraires renchérit les inégalités territoriales d'accès aux soins, par défaut d'accès à une offre à tarifs opposables.
Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) relève à cet égard que « l'ampleur des difficultés d'accessibilité à une offre à tarif opposable est très variable selon les spécialités en raison de la plus ou moins grande importance de médecins en secteur 2 ». Alors que les patients sont relativement captifs du secteur 2 en ophtalmologie, l'accès à un cardiologue présente moins de disparités territoriales si on analyse successivement l'accessibilité potentielle localisée (APL) d'un cardiologue en secteur 1 puis en secteur 2.
• L'inégale répartition de l'offre de soins entre le secteur public et le secteur privé accentue le risque de renoncement aux soins dans certaines spécialités.
Une prise en charge à l'hôpital public ou en clinique privée expose très différemment le patient aux dépassements d'honoraires. Or, certaines activités sont largement exercées dans le secteur privé au détriment du secteur public. Cette déformation de l'offre de soins peut, selon les territoires, rendre des patients captifs du secteur 2 pour accéder à certains soins, par exemple une chirurgie de la cataracte ou une prothèse totale de hanche.
Proportion de patients concernés par des
dépassements d'honoraires,
selon le secteur, et montant
cumulé moyen des dépassements pratiqués
NB : patients non protégés par la C2S.
Source : HCAAM
• Les reste-à-charge constitués par les dépassements d'honoraires sont par ailleurs d'autant plus élevés que l'on prend en compte un épisode de soins complet plutôt qu'un acte isolé. Une pathologie ou une affection ne nécessite que rarement un acte unique, par exemple lorsqu'une chirurgie est nécessaire. Le cumul des reste-à-charge devient alors un véritable obstacle financier.
Si les organismes complémentaires d'assurance maladie concourent à la prise en charge des dépassements d'honoraires, la Drees a estimé que 60 % à 63 % de ces dépassements demeurent à la charge du patient507(*).
• Pour les députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, cette situation traduit « un essoufflement des dispositifs de modération » du secteur 2.
Ce constat n'est pourtant pas nouveau. Déjà, le préambule de l'avenant à la convention nationale signé le 26 juillet 2011508(*) entre l'assurance maladie et les médecins libéraux le résumait en ces termes :
« si l'accès aux soins est aujourd'hui facilité du point de vue financier par l'existence de tarifs opposables, la progression constatée, depuis de nombreuses années, des dépassements d'honoraires de certains praticiens exerçant en secteur 2 conduit à une augmentation du reste à charge et, en conséquence, pose le problème de l'accès aux soins »
[...]
« les dépassements excessifs sont régulièrement dénoncés par les représentants des assurés sociaux ou des patients. Si elles sont le fait d'une minorité de médecins libéraux, ces pratiques tarifaires atypiques nuisent à l'exercice libéral et doivent donc faire l'objet d'un dispositif conventionnel de régulation efficace comportant des sanctions suffisamment dissuasives ».
Le choix du secteur d'exercice : un marqueur
de la médecine libérale
et du système
conventionnel
C'est en 1980 qu'est reconnue l'existence d'un secteur 2, consacrant le principe de liberté tarifaire. Aujourd'hui, les médecins libéraux peuvent, au choix, pratiquer leur activité en secteur 1, en secteur 2 ou en secteur 3. Les secteurs 1 et 2 relèvent du cadre conventionnel.
En secteur 1, le praticien ne facture pas de dépassement d'honoraires et exerce son activité aux tarifs conventionnels opposables, qui constituent la base de remboursement de l'assurance maladie obligatoire. La part non remboursée est prise en charge par les organismes complémentaires d'assurance maladie. En contrepartie, il bénéfice d'une prise en charge d'une partie de ses cotisations sociales par l'assurance maladie. Environ 50 000 médecins généralistes et 25 000 médecins spécialistes relèvent aujourd'hui de ce secteur509(*).
En secteur 2, le praticien peut facturer des dépassements d'honoraires. Il peut également adhérer à des options de pratique tarifaire maîtrisée, dénommées Optam et Optam-ACO pour l'anesthésie, la chirurgie et l'obstétrique. Comme en secteur 1, les patients sont remboursés sur la base des tarifs fixés par la convention médicale, le reste-à-charge et les dépassements d'honoraires pouvant être pris en charge, en tout ou partie, par des organismes complémentaires d'assurance maladie. Environ 30 000 médecins spécialistes et 1 600 médecins généralistes exerceraient en secteur 2.
Quant au secteur 3, il correspond au secteur non conventionnel, où la pratique des honoraires est libre. Les consultations et les actes sont remboursés sur la base d'un tarif d'autorité très faible510(*). Seuls 800 médecins relèveraient de ce secteur.
Le praticien choisit son secteur d'exercice au moment de son installation. Le choix du secteur 1 est ensuite irrévocable, de même que la décision d'adhérer au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
2. Des mesures de régulation en demi-teinte
a) Des mesures législatives et réglementaires peu nombreuses
Conformément à l'obligation déontologique des médecins, les honoraires médicaux doivent être déterminés « avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières »511(*).
• En conséquence, les dépassements excessifs ou abusifs constituent des manquements. Ils peuvent être sanctionnés par l'instance ordinale compétente ou par l'assurance maladie.
L'instance ordinale est compétente pour veiller au respect des principes éthiques et déontologiques des professions médicales512(*) ; elle exerce un rôle disciplinaire. Outre qu'elles sont contraires aux devoirs déontologiques de la profession, « les pratiques tarifaires excessives contreviennent au pacte conventionnel et sont, à ce titre, susceptibles d'être sanctionnées »513(*).
En cas de dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure, la loi autorise le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à infliger une pénalité financière forfaitaire, ou proportionnelle aux dépassements facturés514(*). Dans ce cadre, la notion de tact et mesure s'apprécie notamment « au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, du pourcentage d'actes avec dépassement ou du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département ou dans la même région administrative »515(*).
Toutefois, la mise en pratique de ces dispositions est rare, pour ne pas dire inexistante.
• Par ailleurs, la loi a interdit la pratique des dépassements d'honoraires pour les catégories de patients les moins solvables.
Ainsi, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ne peuvent se voir facturer des dépassements d'honoraires, hors exigence particulière du patient516(*).
• Enfin, afin de lutter contre les honoraires non conventionnels, l'article 84 de la LFSS pour 2016 a introduit une taxation des dépassements d'honoraires et des revenus tirés des prestations non conventionnées.
L'instauration d'une nouvelle contribution vise alors à pénaliser les dépassements d'honoraires pour en désinciter la pratique. En sont redevables les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, à hauteur de 3,25 % du montant de ces revenus d'activités. Le taux de 3,25 % n'a pas été modifié depuis. Les praticiens non conventionnés n'en sont pas redevables.
Le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC)
Les médecins généralistes et spécialistes en secteurs 1 et 2, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux relèvent du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), de même que les étudiants en médecine qui assurent le remplacement d'un médecin libéral517(*).
Toutefois, les médecins exerçant en secteur 2 et les pédicures-podologues peuvent choisir de ne pas adhérer à ce régime et être affilié au régime des travailleurs indépendants. Ce droit d'option s'exerce au moment de l'installation en libéral. Après exercice du droit d'option, le choix du secteur 1 est irrévocable ; le praticien ne peut plus évoluer vers le secteur 2.
Le régime PAMC assure plusieurs avantages, en particulier :
- une prise en charge partielle des cotisations sociales par l'assurance maladie sur la base de l'activité conventionnée, pour les médecins du secteur 1 et ceux du secteur 2 adhérant à l'Optam ;
- le remboursement des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, dans les mêmes conditions que les assurés sociaux du régime général ;
- le versement d'indemnités ou d'allocations spécifiques en cas de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
- le versement d'un capital décès ;
- une indemnisation des arrêts de travail.
En contrepartie, les praticiens affiliés à ce régime sont redevables d'une contribution de 3,25% sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés des dépassements d'honoraires et des prestations non conventionnées, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins518(*).
b) Des mesures essentiellement conventionnelles
À partir des années 1990, plusieurs dispositifs de régulation ont tenté d'encadrer les installations en secteur 2 et la pratique des dépassements d'honoraires.
• L'accès au secteur 2 a d'abord été canalisé, dès 1990, en fixant une liste de statuts ouvrant droit à la pratique d'honoraires différenciés.
La convention médicale fixe ainsi des règles statutaires précises519(*) : seuls les statuts d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCU-AH), d'ancien chef de clinique des universités de médecine générale (CCU-MG), de médecin des armées, d'ancien assistant des hôpitaux et de praticien hospitalier permettent aujourd'hui d'accéder au secteur 2520(*).
Cet encadrement a globalement pour effet de réserver le secteur 2 aux médecins spécialistes et d'en exclure les généralistes, compte tenu du modèle de formation et d'exercice de ces-derniers. Il contribue à expliquer l'attractivité des statuts précités.
• Puis, la convention nationale signée le 26 juillet 2011 s'empare du sujet des dépassements d'honoraires excessifs.
D'une part, elle propose de cibler les pratiques tarifaires excessives en proposant comme repère un taux de dépassement de 150 % du tarif opposable. D'autre part, elle crée le contrat d'accès aux soins, prédécesseur de l'Optam (cf. infra), par lequel le médecin s'engage à respecter un taux de dépassement moyen - plafonné à 100 % - et à réaliser un pourcentage minimal d'activité aux tarifs opposables.
À partir de 2016, les options pratiques tarifaires maîtrisées (Optam et Optam-CO pour la chirurgie et l'obstétrique) remplacent le contrat d'accès aux soins.
Tous les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents (secteur 2) peuvent adhérer à l'Optam ou à l'Optam-CO. Ils s'engagent pour cela à respecter un taux d'activité réalisée à tarif opposable et un taux de dépassement d'honoraires. En contrepartie de ces engagements, le médecin bénéficie des tarifs de remboursement du secteur à honoraires opposables, ainsi que d'une rémunération complémentaire sous forme de prime annuelle pour les adhérents à l'Optam521(*), ou de l'application de certaines majorations tarifaires dans le cadre de l'Optam-CO.
• La convention médicale 2024-2029 a élargi l'Optam-CO aux médecins anesthésistes-réanimateurs : l'Optam-CO est devenu l'Optam-ACO. La convention a également adapté la règle du partage de gains522(*), en différenciant plusieurs seuils d'atteinte des objectifs, pour mieux valoriser les médecins en fonction du niveau de respect de leurs engagements.
B. Freiner la progression des dépassements d'honoraires en renforçant leur imposition
1. Une cotisation sur les revenus tirés des dépassements d'honoraires dont le taux serait fixé par le pouvoir réglementaire
La contribution sur les revenus tirés des dépassements d'honoraires et des prestations non conventionnées serait transformée en cotisation et son taux, aujourd'hui fixé à 3,25 % du montant des revenus précités, serait désormais fixé par voie réglementaire. Le Gouvernement a confirmé son intention d'augmenter le taux en vigueur pour désinciter à la pratique des actes non-conventionnés et des dépassements d'honoraires, sans préciser toutefois le nouveau taux envisagé.
Le périmètre des revenus concernés par la cotisation serait en outre ajusté :
- en y incluant les revenus tirés des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale523(*) ;
- en ajoutant aux deux exclusions déjà mentionnées au 2° de l'article L. 646-3524(*) les forfaits et suppléments versés au titre de soins réalisés dans une structure d'urgences, non suivis d'une hospitalisation, qui rémunèrent les consultations et les actes des médecins libéraux conventionnés et les actes des laboratoires de biologie médicale525(*).
Enfin, les modalités de recouvrement de cette cotisation seraient modifiées (suppression de la référence aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale).
2. Une cotisation à l'assiette élargie du fait de la suppression du droit d'option
L'article L. 646-2 du code de la sécurité sociale autorise actuellement les médecins généralistes et spécialistes libéraux conventionnés ayant opté pour l'exercice en secteur 2 à ne pas adhérer au régime des PAMC. Ils relèvent alors des dispositions applicables aux travailleurs indépendants. Ce droit d'option concerne également les pédicures-podologues.
Il est proposé d'abroger cet article L. 646-2, c'est-à-dire de supprimer la possibilité d'exercer ce droit d'option. Cette suppression aurait pour effet d'affilier automatiquement tous les praticiens conventionnés au régime des PAMC, quel que soit leur secteur d'exercice, leur ouvrant droit aux prestations associées.
Il en résulterait un élargissement de l'assiette de la nouvelle cotisation sur les dépassements d'honoraires, désormais due par tous les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sans exception.
• Les dispositions du présent article, y compris la fixation du taux de cotisation par voie réglementaire, s'appliqueraient aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2026.
3. Une réorganisation des dispositions relatives aux praticiens et auxiliaires médicaux
Le présent article procède à une réorganisation d'une partie des dispositions du titre IV qui comprend les dispositions applicables aux professions libérales, en regroupant au sein du chapitre VI l'ensemble des articles relatifs aux prestations associées au régime des praticiens et auxiliaires médicaux en matière de maternité et vieillesse.
Le chapitre VI, intitulé « Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès) » serait renommé « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux ». Ce nouvel intitulé, dans lequel ne figurerait plus le terme « conventionnés », reflèterait la suppression du droit d'option permettant de ne pas s'affilier au régime des PAMC.
Des modifications de cohérence rédactionnelle seraient apportées à l'article L. 646-1, pour préciser que les dispositions du chapitre 6 concernent :
- les médecins généralistes et spécialistes libéraux exerçant dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- les biologistes libéraux exerçant dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du même code ;
- les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans le cadre des conventions qui leur sont applicables respectivement mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;
- les étudiants autorisés à effectuer des remplacements en libéral.
Une section 1 serait créée, intitulée « Régime maternité - décès » et comprenant les articles L. 646-3 et L. 646-4.
Les dispositions correspondant au chapitre V du même titre seraient insérées dans le chapitre VI sous la forme d'une nouvelle section 3 intitulée « Prestations complémentaires de vieillesse ».
Il est enfin proposé de procéder à diverses coordinations juridiques rendues nécessaires par l'insertion des articles du chapitre V au sein du chapitre VI.
II - Le dispositif transmis au Sénat
Les députés ont adopté quatre amendements de suppression de cet article526(*).
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article supprimé par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 117-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
Sans surprise, cette mesure a suscité la colère des syndicats de médecins libéraux. Non concertée, non anticipée, non calibrée, elle est reçue, à juste titre, comme une brutalité supplémentaire par les professionnels de santé du monde libéral. Pénalisant de façon indiscriminée l'ensemble des praticiens du secteur 2, la commission a regretté son format profondément inadapté.
La proposition de surtaxer les dépassements d'honoraires et les prestations non conventionnées intervient alors que deux rapports viennent d'être publiés en octobre 2025 : celui du HCAAM dresse un état des lieux objectif de l'évolution des dépassements d'honoraires ; celui des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, en réponse à une commande du Premier ministre, formule dix propositions « pour sortir des dépassements d'honoraires ».
Le sujet des dépassements d'honoraires nécessite de replacer les termes du débat dans une perspective plus globale, pour comprendre les déterminants des évolutions constatées dont la réalité n'est pas niée. Le secteur 2, qui autorise une liberté tarifaire encadrée, offre aux praticiens qui ne disposent pas de la maîtrise des tarifs des actes qu'ils pratiquent la possibilité d'adapter le niveau de leur rémunération. La reconnaissance de ce secteur 2 en 1980 visait ainsi à permettre de revaloriser la rémunération des médecins, sans coût pour les dépenses publiques.
• Sur cette question délicate qui met en jeu l'accessibilité des soins, la commission invite en priorité à s'abstenir de toute analyse simpliste ou schématique. Elle rappelle que deux raisons principales contribuent à expliquer l'augmentation conséquente des dépassements d'honoraires ces dernières années : l'absence de revalorisation de la cotation des actes médicaux depuis 2005, et la hausse des charges supportée par les praticiens, incluant les loyers, les salaires du personnel, le coût du matériel informatique et biomédical, mais aussi les frais de formation continue. Sur ce dernier point, il convient sans doute de rappeler que les charges supportées par les praticiens sont plus élevées en secteur 2 qu'en secteur 1.
Ces arguments ne peuvent être balayés d'un revers de manche ; ils pèsent sur la rémunération des médecins et doivent être pris en compte pour apporter des réponses adaptées. Sans dépassement d'honoraires « réalisés avec tact et mesure », en l'absence de réévaluation des tarifs des actes techniques, certains spécialistes ne pourraient certainement pas poursuivre leur pratique, faute de rentabilité. Comme le souligne le Cnom, « la question des dépassements ne peut être isolée de celle de la juste rémunération des médecins et de la valeur accordée à l'acte médical ». Le développement du secteur 2 résulte donc, pour une part certaine, d'une revalorisation insuffisante de la qualité du travail médical. Le rapport du HCAAM met d'ailleurs en lumière cet aspect préoccupant, trop souvent occulté, en rappelant que « dans certaines spécialités, la progression des dépassements d'honoraires a servi à compenser la progression des charges (et l'érosion, en valeur réelle, du tarif opposable qui en résulte), sans suffire parfois à stabiliser le revenu. Les dépassements d'honoraires sont en partie révélateurs, en creux, des limites du pilotage des tarifs opposables et des inadéquations tarifaires, qui [...] laissent s'installer des situations de sous-financement [de certaines] spécialités [...] et contribuent à nourrir la dynamique des dépassements ».
• Ce premier constat étant posé, il faut ensuite admettre que tous les dépassements ne sont pas équivalents. Si certains sont nécessaires pour compenser des actes longs, complexes ou peu remboursés, d'autres correspondent à des dépassements abusifs qui peuvent excéder 200 % de la valeur d'un acte. Ces deux pratiques ne peuvent être traitées indistinctement. Or, la mesure que présente le Gouvernement propose de soumettre au même régime tous les dépassements d'honoraires, plutôt que de cibler les pratiques répréhensibles.
Il est d'ailleurs à redouter, dans un contexte où 75 % des médecins spécialistes environ font le choix du secteur 2, qu'une telle mesure produise des effets inverses à ceux recherchés, en incitant les praticiens à compenser la hausse de leurs cotisations par un renchérissement des dépassements pratiqués. Ce risque a d'ailleurs été confirmé par le président de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP). Si l'objectif principal du Gouvernement est de trouver de nouvelles sources de recettes527(*), il pourrait sans doute atteindre sa cible, au prix toutefois d'une dégradation de l'accessibilité financière aux soins. L'effet pervers et contre-productif du dispositif lui fait perdre encore davantage de sa pertinence.
Sans doute aurait-il été plus judicieux de réfléchir à une mesure proportionnée, visant à surtaxer les seuls dépassements jugés manifestement excessifs. Tel était l'esprit de la convention médicale de 2011, qui proposait de s'attaquer à ces pratiques non éthiques et fixait des repères pour apprécier le caractère excessif du dépassement. À cet égard, la commission relève que l'assurance maladie dispose déjà d'outils pour sanctionner ces comportements, puisque la loi l'autorise à appliquer des pénalités financières en cas de dépassement excédant le tact et la mesure. Il est regrettable qu'elle ne s'en saisisse pas davantage.
Sur la base de ces précédentes observations, la commission exprime son profond désaccord avec les conclusions du rapport remis par MM. Yannick Monnet et Jean-François Rousset, qui proposent de plafonner les dépassements d'honoraires et de rendre l'Optam obligatoire pour les nouveaux médecins s'installant en secteur 2. De telles mesures font fi des sous-jacents des dépassements d'honoraires et se désintéressent des contraintes de l'exercice libéral. Selon la commission, l'amélioration de l'attractivité du secteur 1 et des Optam en secteur 2 passe par la revalorisation des actes plutôt que par l'alourdissement des charges de l'ensemble des professionnels du secteur 2.
• En conséquence, la commission a maintenu la suppression de cet article.
En parallèle, elle engage le Gouvernement à ouvrir dès à présent une réflexion de fond avec les syndicats de médecins libéraux sur l'encadrement et la pénalisation des dépassements d'honoraires abusifs.
La commission propose de maintenir la suppression de cet article.
Article 26 bis (nouveau)
Dérembourser les actes et
prestations des médecins exerçant en secteur 3
Cet article inséré à l'Assemblée nationale propose de dérembourser les actes et prestations réalisés ou prescrits par des médecins exerçant en secteur 3.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. L'exercice des médecins en secteur 3, très minoritaire, donne lieu à un remboursement marginal de leurs consultations par l'assurance maladie et à un remboursement dans les conditions de droit commun de leurs prescriptions
1. Un exercice très minoritaire
En vertu du principe de liberté conventionnelle, les médecins choisissent, au moment de leur installation d'être ou non conventionné avec l'assurance maladie et décident de leur secteur d'exercice. Ils peuvent donc opter pour le secteur 1, le secteur 2 ou le secteur 3, seuls les deux premiers relevant du cadre conventionnel.
Environ 800 médecins exercent aujourd'hui en secteur 3 selon le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie528(*), 1 347 selon le syndicat des médecins secteur 3, contre 108 000 médecins en secteur 1 et 2. Ils représentent donc environ 0,01 % du total des effectifs des médecins libéraux. Leur effectif est globalement stable depuis quinze ans. Les spécialités les plus représentées dans ce secteur sont les suivantes : médecine générale à exercice particulier, dermatologie, médecine générale, psychiatrie, chirurgie esthétique et ophtalmologie529(*). Ces praticiens accordent souvent des consultations longues.
Non conventionnés, les médecins du secteur 3 fixent librement le montant de leurs honoraires. Toutefois, comme les praticiens du secteur 2, ils sont soumis au principe du tact et de la mesure, qui relève d'une obligation déontologique. L'article R. 4127-53 prévoit ainsi que « les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ».
2. Un remboursement inégal par l'assurance maladie : marginal pour les consultations du secteur 3, dans les conditions de droit commun pour les prescriptions de ces praticiens
L'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins non conventionnés sont remboursés par l'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité. Le montant de ce tarif, fixé par arrêté interministériel530(*), ne permet qu'un remboursement marginal des patients des frais de consultation d'un praticien de secteur 3.
En effet, le montant de ce tarif est fixé :
- entre 0,43 euro et 0,61 euro pour une consultation de médecine générale ;
- entre 0,85 euro et 1,22 euro pour une consultation chez un spécialiste.
En revanche, leurs prescriptions des médecins de secteur 3 sont remboursées dans les mêmes conditions que celles des médecins des autres secteurs.
3. Une proposition de déremboursement du secteur 3 issue du rapport remis par deux députés au Premier ministre en octobre 2025
Les députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset ont remis au Premier ministre en octobre 2025 les conclusions de leur mission sur les dépassements d'honoraires, que leur avait confiée François Bayrou, alors Premier ministre. Les députés formulent dix propositions pour « sortir des dépassements d'honoraires », notamment le plafonnement des dépassements d'honoraires, ou l'obligation de l'option pratique tarifaire maîtrisée (Optam) pour les médecins choisissant d'exercer en secteur 2.
La septième proposition du rapport consiste à dérembourser les prescriptions du secteur 3. Les auteurs du rapport relèvent : « Si l'activité du secteur 3 a peu d'effets sur le volume des dépassements d'honoraires, le non-remboursement de la consultation et le remboursement des prescriptions est une cohérence symboliquement contestable ».
B. L'objectif affiché : dérembourser les prescriptions du secteur 3 pour inciter les praticiens à se conventionner
Le présent article propose de compléter l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale relatif à la prise en charge des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins non conventionnés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches. »
Ainsi, les patients ne bénéficieraient plus d'une prise en charge par l'assurance maladie des prescriptions réalisées par les médecins du secteur 3, qu'il s'agisse de médicaments, d'un acte d'imagerie ou de biologie par exemple. En revanche, seraient exclus de ce déremboursement les produits, actes et prestations prescrits par ces médecins pour eux-mêmes ou leurs proches sans facturation à l'assurance maladie. Cette précision visait à ne pas soumettre au déremboursement les prescriptions effectuées par les médecins retraités pour eux-mêmes ou leurs familles, ceux-ci n'étant plus conventionnés.
Il est proposé que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
II - La position de la commission
La commission considère que la mesure prévue au présent article manque sa cible : en voulant viser les praticiens du secteur 3, elle pénalise en réalité les patients qui s'orientent le plus souvent vers des praticiens du secteur 3 pour des raisons tenant à des compétences rares ou à la notoriété d'un praticien plutôt que par indifférence de choix.
De même que la surtaxation des dépassements d'honoraires des praticiens du secteur 2 n'est pas de nature à renforcer l'attractivité du secteur 1, le déremboursement des prescriptions du secteur 3 n'incitera pas les professionnels concernés à migrer vers le secteur 2. S'il existe une volonté politique d'affaiblir le secteur 3, qui représente une part très minoritaire des médecins en exercice, la commission est d'avis d'assumer totalement ce choix, en supprimant le secteur 3. Telle n'est toutefois pas l'option qu'elle prône.
À cet égard, la commission rappelle que les praticiens du secteur 3 sont, au même titre que ceux du secteur 2, soumis à l'obligation de fixer leurs honoraires avec tact et mesure, en tenant compte notamment de la durée des consultations et de la complexité des actes réalisés, ou de leur notoriété individuelle.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, la commission a soutenu une mesure visant à dérembourser les prescriptions des médecins déconventionnés pour avoir fraudé et manqué à leurs obligations conventionnelles. Cette mesure, adoptée au stade de l'examen par la commission531(*), est apparue proportionnée à l'objectif recherché, contrairement à celle inscrite au présent article qui risque de ne pas produire les effets escomptés et qui pénalisera, à coup sûr, les patients.
À l'initiative de la rapporteure, la commission a donc adopté l'amendement n° 674 de suppression du présent article.
Article
26 ter et article 26 quater (nouveaux)
Mise en oeuvre d'une
nouvelle nomenclature et d'une revalorisation des soins
remboursés
Ces articles, insérés par l'Assemblée nationale, visent à accélérer la mise en oeuvre d'une nouvelle nomenclature des soins remboursés et la revalorisation des tarifs afférents.
L'article 26 ter prévoit de définir les conditions de prise en charge ou de remboursement des actes et prestations par voie réglementaire si leur inscription dans la nomenclature n'est pas traduite dans la convention médicale dans un délai de six mois après la fin de l'évaluation technique.
L'article 26 quater propose de permettre de procéder à tout moment à une modification de la nomenclature des actes et prestations et de négocier un avenant à la convention médicale chaque année, afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l'objet d'une nouvelle hiérarchisation au cours de l'année.
Attachée à la négociation conventionnelle, qui doit permettre de fixer les nouveaux tarifs, la commission propose de supprimer ces articles.
I - Le dispositif proposé : une accélération de la mise en oeuvre d'une nouvelle nomenclature et d'une revalorisation des soins remboursés
Le Gouvernement a transmis au Sénat ces articles insérés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. La nomenclature des actes médicaux est en cours de rénovation
Aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste des actes et prestations, qui est composée de trois nomenclatures :
- la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;
- la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ;
- la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM).
La procédure d'inscription au sein d'une de ces nomenclatures est composée de plusieurs étapes :
- un avis de la Haute Autorité de santé, qui réalise une évaluation médicale du service attendu d'un acte ou d'une prestation dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population ;
- pour la CCAM, il est ensuite procédé à une évaluation scientifique et technique par des commissions de hiérarchisation des actes et prestations, dont le rôle est d'établir des règles de hiérarchisation des actes et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Dans le cas de l'inscription d'un acte nouveau, la proposition en commission de hiérarchisation est précédée de l'attribution d'un score de travail médical (durée, stress, effort mental et compétence technique) par un panel d'experts proposés par les sociétés savantes et de la validation de ce score par une instance de cohérence qui a pour rôle d'en assurer la cohérence par rapport à l'échelle des actes de la CCAM en vigueur ;
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Ucam) rend sa décision après avoir procédé à une évaluation médico-économique de l'opportunité de l'inscription ou de la modification de l'acte, défini le tarif de l'acte ou de la prestation, dans le respect des règles de hiérarchisation et consulté l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam) ;
- les ministres compétents approuvent la décision, qui est ensuite publiée au Journal officiel.
La CCAM, qui répertorie environ 13 000 actes, n'a pas été rénovée depuis 2005. Faute d'une actualisation au fil de l'évolution des pratiques médicales et des progrès techniques, certains actes sont aujourd'hui obsolètes, tandis que de nouveaux actes techniques ne sont pas reconnus.
Cette obsolescence, associée à des tarifs figés depuis vingt ans, est l'un des facteurs explicatifs de l'augmentation des dépassements d'honoraires, présentés par les médecins comme un complément de rémunération compensant la valorisation insuffisante de certains actes et présentations.
Une rénovation en profondeur de la CCAM et une revalorisation des actes et prestations inscrits dans la CCAM ont été engagés.
Les travaux de refonte de la CCMC menés sous l'égide du Haut Conseil aux nomenclatures devraient aboutir au cours de l'année 2026.
La nouvelle nomenclature des actes techniques issue des travaux du Haut Conseil aux nomenclatures sera reprise dans un avenant à la convention médicale, signée entre l'Ucam et les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes d'une part et des médecins spécialistes d'autre part, dédié aux seules mesures relatives à la CCAM.
Les nouveaux tarifs des actes de la CCAM seront le résultat de l'application de la nouvelle hiérarchisation des actes et de la réévaluation des coefficients de charges par spécialité médicale ou famille d'actes.
Une actualisation régulière de la hiérarchisation est par ailleurs prévue : tout acte ou prestation inscrit fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation par cycle de cinq ans532(*).
Au-delà de la révision actuelle de la CCAM, il a été demandé au Haut Conseil aux nomenclatures de proposer une méthodologie permettant une réévaluation régulière des actes techniques au regard de l'évaluation des pratiques médicales et de la diffusion des pratiques innovantes.
Calendrier de mise en oeuvre de la convention médicale 2024-2029
Source : Cnam
B. Les articles 26 ter et 26 quater entendent accélérer la révision de la nomenclature des actes médicaux et leur revalorisation tarifaire
1. L'article 26 ter
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par deux amendements identiques de M. Yannick Monnet et de M. Jean-François Rousset, propose de compléter l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relatif à l'inscription des actes et prestations dans une des nomenclatures de soins remboursés.
Il vise à définir les conditions de prise en charge ou de remboursement des actes et prestations par voie réglementaire si leur inscription dans la nomenclature n'est pas traduite dans la convention médicale dans un délai de six mois après la fin de l'évaluation technique.
Les auteurs des amendements, à l'origine d'un rapport consacré aux dépassements d'honoraires533(*), estiment que l'absence de mise à jour de la nomenclature est l'un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d'honoraires et entendent accélérer la mise en oeuvre des nouveaux tarifs si les négociations conventionnelles n'aboutissent pas suffisamment rapidement.
2. L'article 26 quater
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par deux amendements identiques de M. Jean-François Rousset et du rapporteur général Thierry Bazin, propose également de compléter l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relatif à l'inscription des actes et prestations dans une des nomenclatures de soins remboursés.
Il vise à permettre de procéder à tout moment à une modification de la nomenclature des actes et prestations.
Il prévoit également la négociation annuelle d'un avenant à la convention médicale pour déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l'objet d'une nouvelle hiérarchisation au cours de l'année.
II - La position de la commission
La commission estime que les articles proposés ne sont pas opportuns, alors qu'une révision d'ampleur de la nomenclature des actes médicaux est en cours, avec un achèvement prévu au cours de l'année 2026 et que cette révision sera suivie d'une négociation conventionnelle afin de tirer toutes les conséquences tarifaires de cette refonte.
La commission considère que les tarifs des actes médicaux relèvent par nature de la négociation conventionnelle, qui constitue le cadre légitime d'un dialogue équilibré entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Elle réaffirme sa confiance dans ce processus, fondé sur la responsabilité partagée et la recherche d'un consensus.
L'article 26 ter, en prévoyant une fixation des tarifs par voie réglementaire à l'issue d'un délai de seulement six mois de négociation, introduit une contrainte excessive et fait peser une pression inutile sur le déroulement de ces discussions. Une telle disposition risquerait de déséquilibrer le rapport entre partenaires conventionnels et de réduire la portée même du dialogue social dans le champ médical. La commission considère qu'il convient au contraire de préserver la souplesse et la durée nécessaires à la conduite de négociations de qualité.
De même, si la commission souscrit pleinement à l'objectif de révisions plus régulières de la nomenclature et des tarifs, porté par l'article 26 quater, elle rappelle qu'une révision de tout acte inscrit, par cycle de cinq ans, est d'ores et déjà prévue dans la loi et que le Haut Conseil des nomenclatures, installé en 2021, a, parmi ses missions, l'introduction au fil de l'eau des nouveaux actes évalués par la HAS et la maintenance régulière de la CCAM. La commission entend laisser toute sa place à la négociation conventionnelle et lui offrir des délais suffisants, estimant que prévoir un avenant à la convention médicale avant le 31 décembre de chaque année rigidifierait excessivement le calendrier des négociations.
Dans un esprit de respect du dialogue conventionnel, la rapporteure a donc souhaité déposer un amendement n° 675 de suppression de l'article 26 ter et un amendement n° 676 de suppression de l'article 26 quater, adoptés par la commission.
La commission propose de supprimer ces articles.
Article
27
Favoriser l'efficience, la pertinence et la qualité des
activités des établissements de santé
Cet article crée ou modifie des dispositifs visant à favoriser, au sein des établissements de santé et des hôpitaux d'instruction des armées, à la fois l'efficience et la pertinence des actes, prestations et prescriptions, et la qualité et la sécurité des soins, par le biais notamment d'une incitation financière.
Il crée un mécanisme global d'incitation financière à l'efficience et à la pertinence (Ifep).
Il simplifie le dispositif de mise sous surveillance des établissements dont les pratiques s'éloignent le plus de la moyenne.
Enfin, il rénove le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins (Ifaq).
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé : des mécanismes d'incitation à l'efficience, la pertinence et la qualité des activités des établissements de santé et des hôpitaux d'instruction des armées
A. Une démarche d'amélioration de l'efficience, la pertinence et la qualité des activités des établissements de santé est en cours, face à des pratiques hospitalières hétérogènes, à l'impératif du juste soin pour les patients et à un contexte budgétaire contraint
1. Des marges de progrès dans l'efficience et la pertinence des activités des établissements de santé
• L'augmentation de certaines dépenses et leur niveau particulièrement élevé dans certains territoires ou établissements interrogent sur leur efficience et leur pertinence.
Ainsi, la croissance des dépenses liées aux prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) - prescriptions effectuées par un professionnel exerçant en établissement de santé ou hôpital d'instruction des armées (HIA) et dont la réalisation ou la délivrance a lieu en ville (transports sanitaires et produits de santé en particulier) - est nettement plus élevée que le reste des prestations soumis à prescriptions : 8,3 % par an en moyenne entre 2019 et 2024, contre 5,5 % pour l'ensemble des prestations soumises à prescriptions.
Cette différence de dynamique est particulièrement notable sur certaines classes thérapeutiques. Ainsi, les dépenses générées par des PHEV d'inhibiteurs de pompe à protons - utilisés pour réduire la sécrétion d'acide gastrique - ont augmenté de 4 % par an entre 2021 et 2024 quand celles générées par des prescriptions en ville sur ces médicaments ont diminué de 6 % par an sur cette période. Or, la Haute Autorité de santé estime que 40 à 80 % des usages d'inhibiteurs de la pompe à protons ne seraient pas justifiés et elle recommande, depuis 2020, de moins et mieux prescrire ces médicaments534(*).
Selon le ministère de la santé, les PHEV ont engendré une dépense de 21,5 milliards d'euros en 2023, soit 21 % des remboursements de soins de ville.
• Des pratiques chirurgicales hétérogènes entre établissements de santé et territoires sont également objectivées par l'atlas des variations de pratiques médicales, produit par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes) et la Haute Autorité de santé (HAS) en 2016 et en 2024535(*).
Ce rapport étudie les écarts de pratiques chirurgicales - taux de recours aux interventions chirurgicales courantes, taux de chirurgie ambulatoire, utilisation des protocoles de Récupération améliorée après chirurgie (Raac) et taux de réadmission à 30 jours - existant entre les départements et leur évolution sur une période de cinq ans, afin d'interroger leurs causes et leur pertinence.
Il met en lumière de fortes variations régionales et départementales dans le taux de recours à onze interventions chirurgicales courantes, notamment les chirurgies de la cataracte, de la tumeur bénigne de la prostate, et du canal carpien, les poses de stents coronaires sans infarctus et l'hystérectomie. La chirurgie de la cataracte enregistre de loin le plus fort taux national avec 1 374 interventions pour 100 000 habitants - l'un des taux les plus élevés en Europe - avec un écart du simple au double selon les départements (de 838 à 1 702 interventions pour 100 000 habitants). Autre exemple, le taux de recours standardisé à la chirurgie du canal carpien varie de 51 à 333 interventions pour 100 000 habitants selon les départements, soit un rapport de 1 à 6,5.
Les auteurs de l'atlas estiment que ces variations peuvent refléter à la fois une sous-utilisation des interventions efficaces dans les départements à très faible taux de recours, mais aussi des taux de recours très élevés à des interventions pour lesquelles le ratio bénéfice-risque est très faible. Elles soulèvent donc la question de la qualité des soins consommés, de l'équité d'accès aux soins et de l'efficience dans l'allocation de ressources limitées.
Si le taux de recours à la chirurgie ambulatoire présente peu de variations départementales pour la plupart des opérations, les écarts sont en revanche élevés pour la chirurgie de la cholécystectomie et de l'amygdalectomie. Or, le recours à la chirurgie ambulatoire est désormais encouragé dans la mesure où il limite l'exposition aux infections nosocomiales, est souvent moins stressant pour les patients, optimise les ressources des établissements et réduits les coûts.
Le recours aux protocoles de Récupération améliorée après chirurgie (Raac) est encore peu diffusé en France, avec une appropriation inégale entre établissements et territoires. Ces protocoles englobent des mesures pré-, per- et postopératoires destinées à réduire les conséquences du stress chirurgical et à permettre au patient de récupérer plus vite ses capacités fonctionnelles et ses activités quotidiennes.
Ils sont surtout utilisés lors de la pose de prothèse du genou (taux de recours de 31 %) et la chirurgie bariatrique (taux de recours de 24 %) mais avec des écarts significatifs entre départements.
Depuis 2016, la HAS promeut les protocoles Raac afin de susciter le développement de bonnes pratiques, mais, en 2019, moins d'un tiers des établissements MCO avait codé au moins un séjour Raac. Il convient de noter que la tarification à l'activité est désincitative à l'utilisation de ces protocoles qui ont vocation à réduire la durée de séjour et donc les tarifs associés aux groupements homogènes de soins et groupements homogènes de malades (GHS/GHM) associés.
Enfin, les variations départementales constatées dans les taux de réadmission à 30 jours peuvent être révélatrices à la fois de la performance des établissements de santé pour l'intervention en question et de la coordination des soins au niveau local, lorsque le patient sort de l'hôpital et que les professionnels de santé en ville prennent le relai.
Au total, l'atlas indique que « dans la plupart des cas, ces variations ne sont pas liées aux besoins ou aux préférences des patients mais reflètent davantage la nature de l'organisation et de l'offre de soins, les différences de perception des médecins quant à l'efficacité de certaines interventions chirurgicales, ainsi que la qualité des preuves et des recommandations cliniques ».
Or des prises en charge non pertinentes ou non optimales peuvent présenter des risques pour les patients et représentent une utilisation inefficiente des ressources de l'assurance maladie.
La Cour des comptes estime qu'en 2018 environ 2,8 milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie ne s'expliquant ni par des besoins de santé ni par les caractéristiques sociales des territoires auraient pu être évitées536(*).
2. Des dispositifs incitatifs, à l'efficacité encore limitée
Plusieurs dispositifs visant à améliorer les pratiques hospitalières existent mais sont critiqués pour leur lourdeur administrative, leur manque de lisibilité et de prévisibilité, leurs effets limités, ainsi que le manque d'articulation entre eux.
La démarche de qualité et de sécurité des soins, qui vise à améliorer les pratiques et les organisations, à anticiper les risques éventuels et à en limiter les conséquences, est globalement bien identifiée, en dépit de critiques sur les indicateurs retenus.
En revanche, les objectifs de pertinence et d'efficience sont moins bien appréhendés. La pertinence des soins s'entend comme le juste soin au bon patient, par le bon professionnel, au bon moment, en fonction de ses besoins et compte tenu des connaissances scientifiques actuelles. L'efficience constitue quant à elle l'allocation des ressources qui permet d'atteindre les meilleurs résultats de santé au moindre coût.
Des contrats de performance d'objectifs et de moyens (CPOM) sont signés entre l'agence régionale de santé (ARS) et les établissements de santé. Ils listent les autorisations dont dispose l'établissement, les activités spécifiques et missions de service public qui lui sont reconnues et les financements octroyés. Ils comportent des dispositions relatives à l'amélioration de la performance et de la gestion interne des établissements. Ils comprennent également l'ensemble des autres contrats et accords en cours avec l'ARS (contrats de performance, contrats de retour à l'équilibre, contrat de bon usage du médicament, etc.).
• Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (Caqes), rénovés par la LFSS pour 2016 et la LFSS pour 2020, visent à améliorer la pertinence et l'efficience des soins et des prescriptions et à engager une diminution des dépenses de l'assurance maladie537(*).
Des contrats peuvent être conclus entre l'agence régionale de santé (ARS) et un établissement de santé, fixant des objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. Ces objectifs sont évalués annuellement et l'ARS peut attribuer à l'établissement une dotation en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat.
Ce dispositif s'applique désormais uniquement à certains établissements de santé. Y sont soumis les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par arrêté ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels nationaux ou régionaux de pertinence et d'efficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, prévus par un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins établi par l'ARS.
1 104 établissements entraient dans le dispositif Caqes en 2023. Ce dispositif génère des économies relativement faibles, estimées à 45,2 millions d'euros en 2023.
Le dispositif Caqes comporte, depuis 2020, un levier de mise sous surveillance, qui permet aux ARS de cibler les établissements aux pratiques s'écartant de la moyenne.
Au sein du plan d'actions pluriannuel régional précité, l'ARS :
- définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région ;
- précise les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le Caqes ;
- identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.
En pratique, ce plan cible notamment les actes chirurgicaux identifiés dans l'atlas national des variations des pratiques médicales évoqué supra.
Les ARS peuvent coopérer avec l'Assurance maladie, qui a développé, depuis 2015, un dispositif d'identification des établissements de santé atypiques, ayant des taux d'intervention très élevés, à partir des indicateurs d'alerte issus des référentiels de la Haute Autorité de santé et des données hospitalières, notamment du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), et d'analyse des variations de pratiques interdépartementales non expliquées par des indicateurs démographiques ou épidémiologiques, ou par d'autres facteurs liés à l'organisation de l'offre de soins (présence de plateaux techniques, de filières territoriales...).
Lorsque l'ARS constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par la Haute Autorité de santé ou en application du plan d'actions régional, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins. Est alors fixé au sein du Caqes un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement, pour ceux présentant des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales.
L'établissement est mis sous surveillance pendant deux ans, avec un dialogue rapproché avec l'ARS.
Si, à l'issue de cette période, il présente toujours un nombre d'actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu, le directeur général de l'agence régionale de santé peut lui fixer une pénalité financière, sous la forme d'un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d'actes et prestations excédant le nombre cible fixé, ou d'une minoration forfaitaire de la part des produits de santé de la liste en sus prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Cette décision est prise après recueil des observations de l'établissement, de l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, et elle tient compte des caractéristiques du territoire de santé et de l'établissement.
Cependant, ce levier de mise sous surveillance n'a jamais été mis en oeuvre.
• Le dispositif d'incitation à la qualité et à la sécurité des soins (Ifaq)538(*) est quant à lui bien identifié et opérationnel, en dépit de critiques portant sur la pertinence de ses indicateurs. Il repose sur une incitation financière à deux volets.
D'une part, une dotation complémentaire est versée aux établissements de santé et aux hôpitaux d'instruction des armées en fonction des résultats obtenus aux indicateurs de mesure de la qualité et de la sécurité des soins.
D'autre part, une pénalité financière peut être appliquée à un établissement de santé lorsqu'il n'atteint pas le seuil minimal d'un indicateur pour lequel un tel seuil est requis.
L'établissement est alerté par l'ARS et se voit proposer des mesures d'accompagnement dès lors qu'il n'atteint pas le seuil minimal d'un indicateur, pour une mesure de résultat donnée.
S'il n'atteint pas le seuil minimal sur trois mesures successives, dont la période de recueil ne peut être inférieure à un an, l'ARS le met en demeure de présenter des observations, puis lui applique une pénalité financière, sauf décision spécialement motivée.
Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d'indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. Elle ne peut excéder 0,5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
Le dispositif d'Ifaq s'applique aux activités MCO depuis 2016, SMR depuis 2017 et psychiatrie depuis 2020.
L'enveloppe Ifaq s'élève à 700 millions d'euros en 2025, un montant stable depuis 2023 mais en-deçà de l'objectif initialement affiché d'un milliard d'euros.
Selon un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas)539(*), le dispositif Ifaq actuel est peu lisible, sans lien direct entre les efforts réalisés et la dotation obtenue par l'établissement. En outre, il apparaît peu connu des équipes soignantes, donc avec un impact limité sur les modifications de pratiques. Ainsi, seul un tiers des établissements lui trouve un effet positif sur la qualité des soins.
Les acteurs hospitaliers ont confirmé ces observations auprès de la rapporteure, déplorant le manque de pertinence des indicateurs actuels de l'Ifaq, qui sont mal appréhendés par les soignants, qui les perçoivent comme trop économiques voire technocratiques plutôt que qualitatifs. Ils relèvent ainsi que ce dispositif est davantage porté par les directions qualité que par les professionnels eux-mêmes et ne permet donc pas de développer une stratégie d'amélioration réelle de la qualité clinique, mobilisant les soignants.
En outre, la FHF alerte sur les dérives du modèle actuel qui tend à favoriser en pratique les établissements exerçant les activités les moins contraignantes et pénalise ceux qui assument les missions les plus lourdes, génératrices de désorganisation et qui affectent directement les résultats des indicateurs.
• Des dispositifs sont également mis en oeuvre par la Haute Autorité de santé. Celle-ci met au point et diffuse des outils d'amélioration des pratiques professionnelles, des recommandations de bonne pratique et indicateurs de qualité des soins, afin d'aider à la prise de décision dans le choix des soins, d'harmoniser les pratiques, de réduire les traitements et actes inutiles ou à risque, et de promouvoir les actes pertinents.
Elle procède à la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, selon une procédure rénovée en 2020. Cette évaluation externe est effectuée tous les quatre ans.
Les résultats obtenus pour chaque critère évalué permettent de calculer un score global, décliné en quatre niveaux : certifié avec mention (vert foncé), certifié (vert), certifié sous condition (orange) ou non certifié (rouge).
B. L'article 27 crée ou modifie des dispositifs d'incitation à l'efficience, la pertinence et la qualité des actes, prestations et prescriptions par les établissements de santé et les hôpitaux d'instruction des armées
L'article 27 comporte trois grandes mesures visant l'ensemble des établissements de santé et des hôpitaux d'instruction des armées :
- les deux premières concernent le volet « efficience et pertinence » des soins, avec d'une part la création d'un mécanisme global d'incitation financière et d'autre part la rénovation d'un dispositif ciblant les établissements dont les pratiques s'éloignent le plus de la moyenne ;
- la troisième concerne le volet « qualité et sécurité », avec un recentrage du dispositif Ifaq sur la valorisation, supprimant la possibilité de pénalité financière sur ce volet.
1. La création d'un dispositif transversal d'incitation financière à l'efficience et à la pertinence pour tous les établissements de santé et hôpitaux d'instruction des armées
Il est proposé de créer, au travers d'un nouvel article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale, un mécanisme global d'incitation financière à l'efficience et à la pertinence des soins et prescriptions (Ifep).
Ce nouveau mécanisme reposera sur des critères s'appliquant de manière transversale à tous les établissements et hôpitaux d'instruction des armées (HIA), là où le dispositif Caqes ne cible que certains établissements dans le cadre d'une contractualisation individuelle. Sont ainsi concernés tous les établissements exerçant des activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie (MCO), de psychiatrie ou de soins médicaux et de réadaptation (SMR).
Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État et un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale devra fixer des listes d'objectifs nationaux et régionaux, qui pourront être exprimés en volume ou en évolution, et d'indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements.
Parmi les objectifs possibles, l'étude d'impact mentionne la réduction, en volume et en durée, des prescriptions hospitalières réalisées en ville, qui « font régulièrement l'objet d'adaptation peu de temps après leur réalisation, [...] génèrent donc une dépense inutile et du gaspillage et conduisent parfois les patients à stocker des médicaments antidouleurs devant normalement être soumis à un usage contrôlé ».
L'article précise que le dispositif d'incitation financière pourra prendre la forme :
- d'un intéressement, avec une dotation complémentaire aux établissements calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie ;
- d'une pénalité financière, via la minoration des financements de l'assurance maladie auxquels l'établissement est éligible, dans la limite de 2 % du total de ces financements.
La décision reviendra au directeur général de l'ARS.
L'étude d'impact prend l'hypothèse d'une réduction de 0,5 % des prescriptions hospitalières réalisées en ville grâce à ce mécanisme ; ce qui représenterait a minima une économie annuelle de l'ordre de 100 millions d'euros par an.
2. Une rénovation du dispositif visant les établissements dont les pratiques s'écartent le plus de la moyenne
Il est proposé de rénover, au sein d'un nouvel article L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale, le mécanisme de mise sous surveillance du dispositif Caqes et d'en faire un dispositif autonome, plus simple et plus modulable.
Ce dispositif ciblera, tout comme l'actuel, les établissements dont les pratiques présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en évolution, d'actes, prestations ou prescriptions, par rapport aux moyennes régionales ou nationales.
Le directeur général de l'ARS pourra alors fixer à cet établissement, après avis de la caisse primaire d'assurance maladie, un objectif annuel cible, exprimé en volume ou en évolution.
À l'issue d'une période donnée, non précisée par les dispositions de l'article, le directeur général de l'ARS pourra infliger une pénalité financière à l'établissement s'il n'atteint pas l'objectif fixé. Cette pénalité sera celle prévue par le mécanisme global d'incitation financière créé par le présent article, à savoir une minoration des financements de l'assurance maladie auxquels l'établissement est éligible, dans la limite de 2 % du total de ces financements.
Il est précisé, comme dans le dispositif actuel, que le directeur général de l'ARS devra tenir compte des caractéristiques du territoire de santé et de l'établissement et recueillir les observations de l'établissement, ainsi que l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Les modalités d'application de ce dispositif sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
L'étude d'impact précise, sans que cela figure expressément dans les dispositions de l'article, que :
- les actes concernés seront déterminés en s'appuyant notamment sur les actes analysés dans l'atlas de variations des pratiques médicales précité, après discussion avec les fédérations hospitalières ;
- les modalités de ciblage des établissements et HIA seront précisés en mobilisant les ARS ;
- seront, enfin, précisés par voie réglementaire la durée de la mise sous surveillance, qui pourrait être de deux ans comme dans le dispositif actuel, le degré d'exigence dans la normalisation des pratiques, le dimensionnement des efforts à fournir par les établissements et les modalités de la pénalité financière.
L'étude d'impact estime qu'au-delà de l'amélioration des soins délivrés aux patients, ce dispositif représente un potentiel d'économies annuelles d'au moins 10 millions d'euros en retenant les départements en sur-recours de 10 % par rapport à la moyenne nationale sur cinq actes chirurgicaux.
En parallèle, il est proposé d'abroger les dispositions relatives au dispositif Caqes à compter du 1er janvier 2027, à l'issue des contrats existants, et d'abroger dès le 1er janvier 2026 les dispositions relatives au dispositif actuel de mise sous surveillance et d'incitation financière associées au dispositif Caqes.
3. Une évolution du dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins (Ifaq)
L'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale relatif au dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins (Ifaq) est modifié pour ne garder que le volet « dotation complémentaire » et supprimer le volet « pénalité financière ».
Demeurent concernés par ce dispositif tous les établissements exerçant des activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie, de psychiatrie ou de soins médicaux et de réadaptation.
Comme dans le dispositif actuel, les modalités de détermination et de mise en oeuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories d'indicateurs sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, tandis qu'un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dressera la liste des indicateurs et leurs modalités d'évaluation.
En revanche, des précisions relatives au type d'indicateurs pris en compte (résultats et expériences rapportées par les patients, développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile et lutte contre les erreurs médicamenteuses évitable) sont supprimées.
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la députée Annie Vidal et plusieurs de ses collègues visant à décaler au 1er janvier 2028 l'entrée en vigueur des pénalités financières prévues dans le cadre des deux dispositifs d'incitation à l'efficience et à la pertinence des soins.
Elle a également adopté neuf amendements rédactionnels ou de coordination juridique du rapporteur général, M. Thierry Bazin.
Le Gouvernement a transmis cet article ainsi modifié au Sénat, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission soutient naturellement le renforcement de la pertinence, l'efficience, la qualité et la sécurité des soins au sein des établissements de santé. Une telle démarche, qui doit être transverse, a pour objectif à la fois d'améliorer la prise en charge des patients et de mieux orienter les ressources vers les besoins de santé, une condition primordiale pour la soutenabilité du système de santé.
• Le succès des dispositifs proposés reposera sur la mobilisation de tous les acteurs hospitaliers, qui doivent être impliqués dans l'évolution de leurs pratiques en faveur de la qualité des soins, être associés à la définition des indicateurs et se les approprier, et juger l'intéressement financier suffisamment significatif.
Les acteurs hospitaliers expriment leur soutien à la démarche proposée, sous réserve que les dispositifs soient simples, lisibles et prévisibles et n'emportent pas de charges administratives trop lourdes pour leurs équipes.
Alors qu'ils déploraient la complexité et le caractère chronophage de la mise en oeuvre et du suivi des Caqes ainsi que leur manque d'effet mobilisateur en raison de la faiblesse de l'intéressement financier, ils appellent à ce que les nouveaux dispositifs mis en place ne reproduisent pas les mêmes erreurs.
Parvenir à mobiliser les établissements et disposer d'une incitation financière suffisante est d'autant plus important que les exigences d'efficience et de pertinence des soins peuvent entrer en contradiction avec les préoccupations financières des établissements. Ainsi, la part plus importante de l'activité ambulatoire, dont les bénéfices sont connus, peut conduire à une baisse des recettes des établissements en dépit d'une hausse de l'activité en volume en raison d'un tarif moindre.
• La définition, pour les différents dispositifs, d'indicateurs lisibles, pertinents, facilement évaluables et prévisibles sera un sujet primordial, qui devra associer les acteurs hospitaliers, les sociétés savantes et les associations de patients.
S'agissant des dispositifs visant à améliorer la pertinence des soins, l'identification d'un nombre limité d'actes prioritaires, choisis pour leur volume, leur coût ou leur impact en santé publique, permettrait de concentrer les efforts sur les domaines où les marges d'amélioration sont les plus fortes et les plus pertinentes.
La rénovation de l'Ifaq doit également se traduire par la définition d'indicateurs de résultat lisibles et acceptés par les acteurs hospitaliers, ce qui est la condition indispensable à leur appropriation par les équipes soignantes. Plusieurs réunions de travail ont réuni le ministère de la santé et les fédérations hospitalières ces derniers mois afin d'établir les modalités d'un Ifaq rénové, en vue de sa mise en oeuvre dès 2026.
Le modèle actuellement envisagé prévoit la création d'une enveloppe financière par indicateur, attribuée en fonction de la performance de l'établissement en niveau et en progression.
Les fédérations hospitalières estiment que la réforme en cours de l'Ifaq est bien engagée et approuvent ses grands principes, tout en se montrant préoccupés sur certaines modalités, liées notamment à la définition et aux poids respectifs des indicateurs.
Tous les indicateurs ne font pas consensus et devront relever d'une concertation approfondie.
La rapporteure estime que des indicateurs relatifs à la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables et aux résultats et expériences rapportées par les patients seraient pertinents, d'autant qu'ils sont prévus dans les dispositions législatives actuelles. Le taux de recours aux protocoles de Récupération améliorée après chirurgie (Raac) apparaît également comme un indicateur intéressant, qui permettrait de contrebalancer l'effet dissuasif de la T2A sur le recours à ces protocoles.
• L'intéressement financier devra récompenser non seulement les établissements faisant preuve d'une amélioration de leurs pratiques mais aussi les établissements ayant déjà atteint un haut niveau de qualité et de pertinence des soins. Cet intéressement devra être suffisamment élevé pour être incitatif et ne saurait être réservé aux seuls établissements en situation dégradée.
Ainsi, la fédération Unicancer s'inquiète du caractère peu discriminant du modèle de rémunération proposé par le dispositif d'Ifaq rénové, qui conduira à des baisses de revenus pour les établissements les plus engagés dans une démarche qualité de haut niveau. En effet, le poids de 40 % qui serait donné à l'indicateur « certification » est très élevé alors même que 65 % des établissements obtiennent la même note « qualité des soins confirmée » et que la note est conservée quatre ans. En revanche, le bonus donné à l'atteinte du niveau de certification « haute qualité des soins », qui demande un engagement très significatif, ne serait plus que de 10 %.
De même, Unicancer estime que les établissements atteignant le niveau le plus élevé ne devraient pas subir de minoration quelle que soit leur évolution, tandis que les établissements avec un niveau faible et une évolution négative ne devraient pas percevoir de rémunération.
La commission a donc adopté un amendement n° 678 de la rapporteure visant à préciser certains indicateurs de l'Ifaq et à prévoir que l'intéressement repose au moins pour moitié sur le niveau de qualité atteint.
• Par ailleurs, il sera indispensable de tenir compte des caractéristiques du territoire de santé et de l'établissement pour le mécanisme global d'incitation à la pertinence et l'efficience, et non uniquement pour le dispositif de mise sous surveillance.
La commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement n° 677 visant à inscrire cette précision au sein des dispositions relatives à l'Ifep.
• Il devra en particulier être tenu compte des spécificités des hôpitaux d'instruction des armées (HIA).
Les hôpitaux des armées
Il existe trois types d'hôpitaux des armées : quatre hôpitaux nationaux d'instruction des armées, deux hôpitaux régionaux d'instruction des armées et deux hôpitaux spécialisés des armées.
Ces hôpitaux, qui sont assimilés par le ministère de la santé à des centres hospitaliers et universitaires, relèvent de la direction centrale du service de santé des armées.
Les ressources financières allouées au service de santé des armées pour l'accomplissement de ses missions sont constituées de crédits budgétaires attribués par la loi de finances pour les deux tiers, et de crédits extrabudgétaires pour le tiers restant. Ces derniers proviennent principalement de remboursements de l'assurance maladie, des organismes de protection complémentaire ou de particuliers ; de remboursements de molécules onéreuses et de dispositifs médicaux implantables ; de remboursements au titre des missions de santé publique relevant de politiques nationales (dotations et forfaits) ou régionales (fonds d'intervention régionaux) ; de recettes hors soins et recettes liées à la production de produits de santé issus de la recherche du service de santé des armées. Les dotations et forfaits sont attribuées par la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé et leur suivi est assurée par l'ARS Île-de-France.
Les hôpitaux des armées participent à l'offre publique de soins. Ils accueillent des patients militaires (21 % en 2024), des familles de militaires et des réservistes (7 %) et une majorité de patients civils hors communauté de défense (72 %).
Dans une contribution adressée à la rapporteure, la direction centrale du service de santé des armées se montre favorable à l'application aux HIA des impératifs d'efficience et de pertinence des soins dans la mesure où ces hôpitaux accueillent majoritairement une patientèle civile et bénéficient d'un financement par l'assurance maladie (notamment via la tarification à l'activité) et où ces impératifs permettent d'optimiser la prise en charge des patients.
Elle précise que le dispositif d'incitation financière à la qualité des soins s'applique aux HIA, qui ont bénéficié de financements à hauteur de 3,1 millions d'euros au titre de l'Ifaq en 2024540(*).
Pour autant, elle alerte sur la nécessité de tenir compte des spécificités des HIA dans l'application du nouveau dispositif d'Ifep, si celui-ci devait bien lui être appliqué - une position sur laquelle elle émet des réserves.
En effet, les HIA sont soumis à l'autorité du ministère des armées. Ils relèvent d'un pilotage national centralisé et non des différentes ARS. Ainsi, les ressources liées aux dotations et forfaits font l'objet d'arrêtés nationaux de la direction générale de l'offre de soins et d'un suivi par l'ARS Île-de-France. La direction générale de l'offre de soins indique que, dans ce cadre, l'ARS Île-de-France serait chargée du suivi de l'Ifep.
En outre, les HIA étant avant tout au service des forces armées, il devra être tenu compte de leurs impératifs opérationnels.
La direction centrale du service de santé des armées souligne le fait que les ressources financières et humaines des HIA sont principalement financées par le budget de l'État, avec des crédits limitatifs justifiés au premier euro, au sein d'une seule unité opérationnelle pour l'ensemble des hôpitaux. Elle estime ainsi que « le contrôle de la bonne gestion des HIA relève d'un processus continu de sincérisation en lien avec la direction des affaires financières du ministère des armées, plutôt que de sanctions décidées par le régulateur ».
• En outre, les établissements devront être accompagnés et non uniquement sanctionnés. Dans cette optique, la commission est favorable au report, introduit par l'Assemblée nationale, de l'entrée en vigueur des pénalités financières uniquement à partir du 1er janvier 2028.
• Enfin, la commission appelle à poursuivre la démarche d'efficience au-delà des dispositifs proposés par le présent article, en s'appuyant sur les recommandations recensées au sein de son rapport « boîte à outils » publié en septembre dernier541(*). Cela doit notamment se traduire par la poursuite du virage ambulatoire dans les établissements de santé ou encore un développement des analyses des événements indésirables graves afin de faire évoluer les pratiques le cas échéant.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 27 bis et article 27
ter (nouveaux)
Plafonnement des dépenses liées à la
rémunération de professionnels
intérimaires ou contractuels au sein des établissements publics
de santé ou médico-sociaux
Ces articles, insérés par l'Assemblée nationale, visent à réduire les dépenses liées à la rémunération de professionnels médicaux et paramédicaux non permanents au sein des établissements publics de santé et médico-sociaux.
L'article 27 bis propose d'étendre le plafonnement des dépenses d'intérim au sein de ces établissements en supprimant la condition d'un écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent.
L'article 27 ter vise à plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice au même niveau que la rémunération des praticiens contractuels recrutés pour des besoins ponctuels.
La commission propose de supprimer ces articles.
I - Les dispositifs proposés : des plafonnements des dépenses liées à la rémunération de professionnels médicaux et paramédicaux intérimaires ou contractuels au sein des établissements publics de santé et médico-sociaux
Le Gouvernement a transmis au Sénat ces articles insérés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
A. Les établissements publics de santé et médico-sociaux ont recours à des personnels contractuels et intérimaires
Pour faire face à des besoins ponctuels mais aussi à des difficultés de recrutement, les établissements publics de santé et médico-sociaux ont recours à des personnels contractuels et intérimaires.
Le recours à l'intérim et à des contractuels ponctuels génère des coûts pour les établissements, en raison de rémunérations qui peuvent se révéler plus élevées que pour des professionnels permanents. Il peut également déstabiliser les équipes et générer des tensions. Avec la multiplication des types de contrat et le recours à l'intérim, un même service peut accueillir des professionnels médicaux et paramédicaux rémunérés de façon différente, avec parfois de forts écarts de rémunération entre eux pour une même activité.
1. Un recours à l'intérim coûteux et désormais plafonné
Le recours aux prestations d'intérim n'a cessé de croître dans les établissements publics de santé et médico-sociaux. Il demeure cependant limité en proportion au niveau global, atteignant 0,4 % dans les établissements de santé publics et privés en 2023542(*), avec des taux variables entre les établissements.
Le coût pour les établissements publics du recours à des prestations d'intérim est fréquemment dénoncé en raison des rémunérations supérieures au personnel titulaire et des frais de gestion pratiqués par les agences d'intérim. Les dépenses d'intérim médical et paramédical ont été multipliées par quatre entre 2014 et 2023 dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux543(*). Les dépenses d'intérim paramédical au sein des établissements publics de santé atteignaient ainsi 462 millions d'euros en 2023.
L'article 70 de la LFSS pour 2025 a introduit un plafonnement des dépenses d'intérim médical et paramédical, lorsqu'il existe un écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, et en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Ce plafonnement s'applique à la fois dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics médico-sociaux.
Un arrêté du 5 septembre 2025 a fixé les plafonds de rémunération des principales professions concernées544(*). Des plafonds sont ainsi fixés pour les médecins, odontologistes, pharmaciens, infirmiers diplômés d'État, infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État, infirmiers anesthésistes diplômés d'État, manipulateur en électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière, masseurs kinésithérapeutes et sage-femmes.
Le recours à l'emploi temporaire est toutefois plus large que les prestations d'intérim, avec un recours à des professionnels sur différents types de contrats, parfois de courte voire très courte durée.
2. Un recours à des praticiens contractuels qui peut être coûteux en cas de tensions de recrutement
L'article 33 de la loi dite « Rist » du 26 avril 2021545(*) a créé un nouveau statut de praticien contractuel avec quatre motifs de recrutement, dont l'un a été supprimé en 2023546(*). Aujourd'hui, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, un praticien contractuel peut être recruté pour :
- motif 1 : répondre à des besoins ponctuels, assurer le remplacement d'un médecin absent ou faire face à un accroissement temporaire d'activité ;
- motif 2 : répondre à des difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, avec dans ce cas des rémunérations dérogatoires, particulièrement attractives ;
- motif 4 : compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés.
Le recours aux contrats dits de motif 2 s'est accru ces dernières années, avec des effets d'aubaine. La Cour des comptes547(*) dénonce un dévoiement du recours au contrat de motif 2, dont « la rémunération très attractive attire les nouvelles candidatures dans un rapport de force désavantageux pour les hôpitaux ». Elle estime que « pour les établissements vulnérables, les contrats de motif 2 sont devenus le moyen privilégié pour recruter, aux conditions financières exigées par les médecins ».
En outre, la Cour des comptes relève que des praticiens hospitaliers titulaires peuvent faire le choix de démissionner pour être recrutés sur des contrats dits de motif 2, mieux rémunérés. Ces contrats peuvent également détourner les médecins des contrats de motif 1, moins bien rémunérés. Elle estime que le recours au travail intérimaire se trouve indirectement encouragé, en raison du défaut d'attractivité du contrat de motif 1 pour des remplacements de courte durée.
B. Les articles 27 bis et 27 ter entendent limiter les dépenses liées au recours à des personnels médicaux et paramédicaux intérimaires ou contractuels
1. L'article 27 bis propose d'étendre le plafonnement des dépenses d'intérim médical et paramédical
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Sandrine Runel, modifie l'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles et l'article L. 6143-3 du code de la santé publique afin que le plafonnement de dépenses de recours à l'intérim, prévu par ces deux articles, ne soit plus conditionné à l'existence d'un écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent.
Les auteurs de l'amendement introduisant cet article estiment que cette condition de « surcoût » restreint la portée du plafonnement.
2. L'article 27 ter vise à plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Ségolène Amiot, introduit un nouvel article au sein d'un chapitre du code de la santé publique consacré aux praticiens hospitaliers.
Il propose de plafonner la rémunération des médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat au sein des établissements publics de santé en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire (motif 2). Leur rémunération ne pourrait excéder le plafond de la rémunération des médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité (motif 1).
Les auteurs de l'amendement introduisant cet article indiquent souhaiter limiter les surcoûts liés à l'intérim médical et à certains contrats à durée déterminée en encadrant les écarts de rémunérations entre les différents contrats de praticiens.
II - La position de la commission
La commission rappelle qu'elle a soutenu le plafonnement des dépenses d'intérim médical et paramédical introduit par la LFSS pour 2025 tout en soulignant qu'il ne constituait qu'un remède partiel à un problème structurel. Elle se félicite de la mise en oeuvre de cette réforme, avec l'adoption des plafonds de rémunération qui en découlent, et souhaite désormais que soient évalués les effets produits par ces plafonds sur la maîtrise des dépenses et l'organisation des soins.
Dans ce contexte, la commission estime que l'article 27 bis, qui prévoit un plafonnement des dépenses de recours à l'intérim même en l'absence d'écart significatif de rémunération, introduirait une contrainte supplémentaire non justifiée. Les plafonds de rémunération fixés par l'arrêté du 5 septembre 2025, déjà étendus et précis, couvrent l'ensemble des professions les plus problématiques.
S'agissant de l'article 27 ter, la commission considère que le plafonnement uniforme des rémunérations applicables aux contrats conclus pour tensions de recrutement, au même niveau que celles prévues pour les contrats pour besoins ponctuels, risquerait d'accroître les difficultés de recrutement des établissements publics de santé. En ne tenant pas compte des spécificités locales et de la nature durable des besoins concernés, cette disposition pourrait fragiliser encore davantage l'attractivité du service public hospitalier.
La commission souligne la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des tensions de recrutement des établissements publics et de leur perte d'attractivité : conditions de travail, organisation du temps médical, reconnaissance des carrières et perspectives d'évolution.
Elle espère également voir engagés, avec les fédérations hospitalières et les organisations syndicales représentatives, des travaux en vue renforcer la convergence des modalités de rémunération des professionnels.
La rapporteure a souhaité déposer un amendement n° 679 de suppression de l'article 27 bis et un amendement n° 680 de suppression de l'article 27 ter, adoptés tous deux par la commission.
La commission propose de supprimer ces articles.
Article 28
Limitation de la durée de prescription des
arrêts de travail
et de versement des indemnités
journalières AT-MP
Cet article propose quatre mesures visant à renforcer l'encadrement des arrêts de travail.
Il limite la durée maximale de prescription des arrêts de travail en ville et en établissement, et borne également la durée des prolongations d'arrêt de travail.
L'article 28 fait également obligation aux prescripteurs de renseigner le motif pour lequel un arrêt de travail a été prescrit.
En outre, l'article 28 met un terme au caractère obligatoire de la visite à la médecine du travail préalable à toute reprise d'activité consécutive à un congé maternité.
Enfin, il introduit un plafonnement de la durée de versement des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Au nom de la liberté de prescription, le droit en vigueur n'impose pas de limite générale à la durée d'un arrêt de travail initial ou prolongé et prévoit même, dans certains cas, des visites obligatoires à la médecine du travail avant toute reprise d'activité
1. L'arrêt de travail peut être prescrit par un professionnel médical, sans limitation de durée
Un arrêt de travail consiste en une prescription, établie par un professionnel médical du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, attestant que l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas d'exécuter son contrat de travail de manière temporaire. Le contrat de travail est alors suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail548(*).
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'un arrêt de travail « l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin [...] de continuer ou de reprendre le travail ». Tout médecin, généraliste ou exerçant une autre spécialité, est donc susceptible d'en prescrire ou d'en renouveler549(*). Le même article L. 321-1 précise en outre qu'il est loisible aux sages-femmes d'effectuer une telle prescription, « dans la limite de sa compétence professionnelle ». Il est précisé, par décret, que cela concerne les femmes enceintes en cas de grossesse non pathologique550(*) ou les femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse551(*). Si le droit en vigueur est à ce jour silencieux sur la question, il est admis que les chirurgiens-dentistes peuvent également prescrire des arrêts de travail, dans la limite de leur compétence professionnelle.
Au sein des médecins, les généralistes libéraux prescrivent 74 % des arrêts de travail indemnisés en 2024. Les médecins libéraux relevant d'autres spécialités sont à l'origine de 10 % des arrêts de travail, et les médecins exerçant en établissement de 13 % d'entre eux.
À peine de ne pas recevoir d'indemnisation à ce titre, une prolongation d'arrêt de travail552(*) doit en principe émaner du médecin prescripteur de l'arrêt initial, du médecin traitant ou d'une sage-femme, sauf dans les situations suivantes553(*) :
- impossibilité dûment justifiée par l'assuré ;
- prolongation de l'arrêt de travail prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
- prolongation de l'arrêt de travail prescrite par le remplaçant du primo-prescripteur de l'arrêt ou du médecin traitant ;
- prolongation de l'arrêt de travail prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.
Le prescripteur est responsable de l'arrêt de travail, qui « doit comporter [sa] signature ».
L'avis d'arrêt de travail fait figurer « la durée probable de l'incapacité de travail »554(*), sans que le professionnel soit, à ce jour, soumis à une durée maximale de primo-prescription ou de prolongation, sauf exceptions555(*).
La prescription d'un arrêt de travail ou de sa prolongation peut prendre une forme matérielle ou dématérialisée556(*). Il comprend trois volets : le volet 1, le seul à comprendre des données médicales, est à adresser au service médical de la caisse locale d'assurance maladie compétente, le volet 2 doit être transmis aux services administratifs de ladite caisse, et le volet 3 doit être communiqué à l'employeur.
Lorsque l'arrêt de travail est établi sous forme dématérialisée, soit dans 72 % des cas en 2024, il est envoyé au service du contrôle médical de l'assurance maladie par le prescripteur, depuis son ordinateur via un téléservice dédié. Le service du contrôle médical transmet alors le volet 2 aux services administratifs. Il revient toutefois à l'assuré de transmettre à son employeur557(*), sous 48 heures, le volet 3 de l'arrêt de travail confié par le prescripteur afin de justifier sa non-venue558(*), à risque de se voir notifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lorsque l'arrêt de travail est établi sous forme papier, des conditions supplémentaires s'appliquent pour sa validité.
D'une part, le professionnel est tenu, depuis le 1er septembre 2025, de renseigner son avis d'arrêt de travail depuis un formulaire spécifique et sécurisé559(*), le Cerfa n° 10 170*07.
Le nouveau formulaire sécurisé pour l'édition d'un avis d'arrêt de travail papier
Constatant l'évolution préoccupante du préjudice financier détecté par l'assurance maladie au titre des faux arrêts de travail (42 millions d'euros en 2024 contre 17 millions d'euros en 2023), attribuable à la vente de faux arrêts de travail par des sites internet dédiés, l'assurance maladie a mis à disposition un nouveau formulaire Cerfa plus sécurisé.
Rendu obligatoire le 1er septembre 2025, celui-ci comprend sept points d'authentification dont un papier spécial, une étiquette holographique, une encre magnétique et des traits d'indentification du prescripteur, le rendant difficilement falsifiable.
D'autre part, l'assuré est tenu d'envoyer sous 48 heures les volets 1 et 2 de son arrêt de travail à sa caisse d'assurance maladie, et d'envoyer sous les mêmes délais le volet 3 de son arrêt de travail à l'employeur560(*).
2. Un encadrement des arrêts de travail sous certaines conditions, et la publication de durées recommandées par pathologie à l'initiative de la Cnam
a) La Cnam publie des fiches repères sur les durées appropriées d'arrêt de travail en fonction des pathologies, après avis de la Haute Autorité de santé
Bien que le droit ne fasse aucune obligation au praticien sur la durée de l'arrêt de travail qu'il prescrit, la Cnam publie, pour certaines pathologies, des fiches repères concernant la durée de référence d'un arrêt de travail afin d'accompagner les professionnels dans leur pratique. Dans le cadre des missions législatives qui lui incombent561(*), la Haute Autorité de santé (HAS) rend un avis sur ces durées de référence, fixées en collaboration avec les sociétés savantes concernées, au regard des pratiques nationales et des travaux de recherche nationaux et internationaux.
Ces recommandations sont assorties de modulations souhaitables en fonction des caractéristiques du patient et de son emploi. Elles se fondent en effet sur une approche moyenne, populationnelle, chaque patient pouvant par ailleurs présenter des complications qui lui sont propres.
Il existe aujourd'hui, selon la Cnam, 68 fiches, dont la majorité concerne des interventions chirurgicales, mais certaines concernent également des infections courantes.
Par exemple, la durée de référence d'un arrêt de travail pour une angine est fixée à trois jours, mais la durée de l'arrêt est à adapter selon la sévérité des symptômes, l'âge et la condition physique du patient et, le cas échéant, selon qu'il travaille au contact de personnes fragiles.
Pour une bronchite, la durée de référence est de quatre jours en cas de travail sédentaire, mais de cinq jours lorsque le travail comporte une dimension physique légère, et de sept s'il s'agit d'un travail physique modéré ou lourd. L'arrêt peut être modulé en fonction de la sévérité des symptômes et de l'environnement de travail (présence de poussières ou de fumées, par exemple).
b) Par dérogation, la durée d'un arrêt de travail prescrit ou renouvelé lors d'une téléconsultation est limitée à trois jours, sauf exceptions
Par dérogation au droit commun des arrêts de travail, le législateur a entendu, lors de l'examen de la LFSS pour 2024562(*), limiter à trois jours la durée d'un arrêt de travail établi ou prolongé lors d'une téléconsultation.
Ce, afin de lutter contre les dérives observées quant à la prescription massive d'arrêts de travail en téléconsultation, sans possibilité d'effectuer un examen clinique rigoureux du patient, et préjudiciable au suivi médical de celui-ci.
L'insertion de ces dispositions s'inscrit dans un contexte d'émergence de plateformes frauduleuses en ligne exclusivement dédiées à la prescription d'arrêt de travail, tantôt faisant intervenir des médecins fraudeurs, tantôt usurpant l'identité de prescripteurs.
La fermeture, par la justice, des sites frauduleux arretmaladie.fr et docteursecu.fr avait attiré l'attention sur l'émergence de ce phénomène. Malgré l'interdiction par la loi de toute « plateforme visant à fournir, à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail »563(*), de nouveaux sites continuent à se constituer à mesure que d'autres sont clôturés par décision de justice.
Afin de ne pas porter une atteinte excessive au droit à la protection de la santé, constitutionnellement garanti564(*), le législateur a toutefois prévu de déroger aux durées maximales de téléprescription d'un arrêt de travail dans certaines situations. Tel est le cas lorsque l'arrêt de travail est téléprescrit par le médecin traitant, la sage-femme référente ou lorsque l'assuré justifie de l'impossibilité pour lui d'avoir bénéficié d'une consultation en personne565(*).
Les données dont dispose la Cnam sur les arrêts prescrits en téléconsultation permettent d'observer une baisse du nombre de bénéficiaires d'un arrêt de travail prescrit à la suite d'une téléconsultation : ils étaient 376 500 en 2022, 271 788 en 2023 et 234 824 en 2024.
c) Un encadrement de la durée des arrêts de travail prescrits par des sages-femmes, partiellement abrogé
En outre, par le passé, le législateur avait prévu que les arrêts de travail prescrits par des sages-femmes ne puissent excéder une durée maximale566(*), alors fixée à quinze jours567(*) par décret dans le cadre d'une grossesse non pathologique, et à quatre jours renouvelables une fois dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse568(*).
La loi dite « Rist 1 »569(*) a abrogé la base législative sur laquelle ces limitations à la durée de prescription étaient fondées, sans toutefois que soient abrogés les articles réglementaires associés. Ces limitations seraient aujourd'hui inappliquées pour ce qui concerne le suivi général de la grossesse, selon l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes.
3. Dans certains cas, il ne peut être mis fin à l'arrêt de travail qu'après une visite à la médecine du travail
En outre, le droit du travail prévoit que, dans certaines circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour des raisons de santé, la reprise d'activité soit conditionnée à la réalisation d'un examen de reprise par un médecin du travail570(*).
Cet examen vise à vérifier si le poste de travail est compatible avec l'état de santé de la personne. Il permet de proposer des aménagements ou adaptations du poste, voire le reclassement du travailleur ou, le cas échéant, à examiner les propositions faites en ce sens par l'employeur et à émettre, lorsque la situation l'appelle, un avis d'inaptitude571(*).
S'agissant d'une visite auprès de la médecine du travail, elle est financée par l'employeur et est donc neutre sur les finances sociales.
Cette visite est obligatoire572(*) :
- après un congé de maternité ;
- après un arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
- après un arrêt de travail d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;
- après un arrêt de travail d'au moins 60 jours pour tout autre motif médical.
À l'approche du terme de l'arrêt de travail, l'employeur sollicite le service de prévention en santé au travail573(*) afin d'organiser l'examen de pré-reprise, qui se tient, en principe, le jour de la reprise effective du travail ou, au plus tard, dans les huit jours suivant la reprise574(*). Pour autant, les services de prévention et santé au travail, confrontés à une pénurie médicale de grande ampleur, sont confrontés à des difficultés pour tenir les délais réglementaires. Dans les faits, selon l'enquête annuelle de PRESANSE, 30 % des examens de pré-reprise consécutifs à un congé de maternité ont été réalisés hors délai.
Toute reprise durable étant impossible tant que l'examen de pré-reprise n'est pas réalisé, l'engorgement des services de prévention et santé au travail peut entraîner, le cas échéant, une prolongation ou une nouvelle prescription d'arrêt de travail jusqu'à ce que cette visite puisse être réalisée.
Dans les faits, il semble toutefois que ces dispositions soient inégalement appliquées.
B. Un encadrement de la durée de l'indemnisation des arrêts de travail, que celle-ci soit le fait de la sécurité sociale ou de l'employeur
1. L'encadrement de la durée de versement des indemnités journalières proscrit toute prise en charge par la sécurité sociale des premiers jours d'arrêt, ainsi que des jours d'arrêt une fois excédé un seuil
Lorsque le salarié est en arrêt de travail, son contrat de travail est suspendu, et l'employeur n'est donc pas tenu de lui verser son salaire. Afin d'offrir un revenu de remplacement aux assurés en incapacité de continuer ou de reprendre le travail, la sécurité sociale verse, sous conditions575(*), des indemnités journalières (IJ)576(*) pour chaque jour calendaire d'arrêt de travail577(*).
Les conditions tiennent notamment, pour le régime général, à la durée d'affiliation578(*), au temps de travail effectué préalablement à l'arrêt, ou aux cotisations acquittées au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès579(*). Des conditions alternatives existent dans certains régimes580(*).
Il existe également des conditions administratives581(*) et de contrôle médical582(*) de la caisse d'assurance maladie, incluant notamment l'abstention de réaliser toute activité non autorisée, le respect des heures de sorties autorisées583(*), ou la soumission aux contrôles organisés par le service du contrôle médical584(*).
Les indemnités journalières ainsi versées correspondent à une proportion d'un revenu de référence, fixée à 50 %585(*) par voie réglementaire586(*) pour le régime général, dans la limite d'un plafond587(*) et ramenés à une valeur journalière588(*).
Ce revenu de référence est calculé en fonction d'une attestation589(*) fournie par l'employeur590(*) pour les assurés du régime général et des salariés agricoles591(*), des revenus soumis à cotisation pour les indépendants592(*) et d'un montant forfaitaire pour les non-salariés agricoles593(*).
Pour les assurés ne bénéficiant pas d'indemnités journalières calculées forfaitairement, un plafond s'applique au montant des IJ. Le salaire des assurés du régime général et des salariés agricoles est ainsi plafonné à 1,4 fois le Smic594(*), depuis un récent décret595(*) qui a abaissé le seuil auparavant fixé à 1,8 fois ce montant. L'indemnité journalière est ainsi plafonnée à 41,47 euros bruts. Pour les indépendants, le plafond est fixé à 1/730e du plafond annuel de la sécurité sociale596(*), soit 64,52 euros, sauf pour les professions libérales qui peuvent bénéficier d'indemnités journalières allant jusqu'au triple de ce montant, soit 193,56 euros.
Chez les non-salariés agricoles, le montant de l'IJ est fixé forfaitairement à 25,36 euros par jour pour les vingt-huit premiers jours d'indemnisation, puis à 33,81 euros par jour597(*).
L'indemnisation de l'incapacité temporaire
pour les assurés
du régime général de la branche
AT-MP
En règle générale, les prestations en nature et en espèces versées par la branche AT-MP bénéficient de règles plus favorables à l'assuré que leurs contreparties pour la branche maladie : il s'agit d'un principe déterminant du fonctionnement de cette branche visant à inciter les assurés concernés à solliciter une prise en charge au titre des risques professionnels, dont ils relèvent, plutôt que de la maladie.
En particulier, en cas d'accident du travail, d'accident du trajet ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité temporaire, les assurés du régime général et des régimes alignés sur celui-ci perçoivent une indemnité journalière d'un montant supérieur à celui dû en cas de maladie598(*).
Celle-ci équivaut à 60 % du salaire journalier de référence pour les vingt-huit premiers jours d'arrêt, et à 80 % de ce salaire pour les jours suivants599(*). Le salaire journalier de référence est calculé comme 1/30,42 fois600(*) les revenus d'activité perçus lors du mois précédent, diminués d'un taux forfaitaire de cotisations de 21 %601(*).
Son maximum, déterminé comme 0,834 % du Pass journalier, est fixé à 235,69 euros en 2025 pour les vingt-huit premiers jours d'arrêt et 314,25 euros par jour à compter du vingt-neuvième jour, en application de l'article R. 433-2 du code de la sécurité sociale602(*).
b) Un encadrement de la durée de versement des IJ
i. Un délai avant le versement : le délai de carence
L'indemnité journalière n'est servie qu'à l'expiration d'un certain délai à compter de l'arrêt de travail603(*). Ce délai, appelé délai de carence, est fixé à trois jours604(*), correspondant à une période non indemnisée par la sécurité sociale. Il peut toutefois l'être dans le cadre d'une couverture prévoyance.
Le délai de carence ne s'applique toutefois pas dans certaines situations :
- lorsque l'arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle605(*), sauf pour les non-salariés agricoles606(*) qui doivent s'acquitter d'un délai de carence de trois jours ;
- lorsque l'arrêt de travail est consécutif au décès, dans les treize semaines précédant l'arrêt, d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans607(*) ;
- lorsque l'arrêt de travail est consécutif à une interruption spontanée de grossesse intervenant avant la 22e semaine d'aménorrhée ou à une interruption médicale de grossesse608(*).
En outre, un deuxième délai de carence ne s'applique pas lorsque moins de 48 heures d'activité s'écoulent entre deux arrêts de travail.
De la même manière, les assurés bénéficiant du statut d'affection de longue durée (ALD), que celle-ci soit exonérante609(*) ou non610(*), ne s'acquittent du délai de carence que pour le premier des arrêts de travail rendus nécessaires par la pathologie qui justifie leur statut611(*).
L'indemnisation de l'incapacité temporaire pour les fonctionnaires
Les fonctionnaires ne perçoivent pas d'indemnités journalières, mais un maintien partiel de rémunération de l'administration employeuse, qui est son propre assureur. L'administration employeuse maintient 90 % du traitement indiciaire brut, des primes et indemnités et de la nouvelle bonification indiciaire lors des trois premiers mois d'arrêt, puis 50 % lors des neuf mois suivants612(*). Les indemnités de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus à 100 % sur la période.
Ces conditions d'indemnisation ont été revues par la dernière loi de finances613(*), la rémunération étant jusqu'alors intégralement maintenue lors des trois premiers mois.
Un délai de carence s'applique, sauf exceptions incluant celles du régime général, mais celui-ci n'est que d'un jour614(*).
ii. Une durée maximale de versement des indemnités journalières maladie, variant en fonction du statut de l'assuré
La loi prévoit également des durées maximales de versement des indemnités journalières pour maladie.
Pour les non-salariés agricoles615(*) comme pour les assurés du régime général616(*), 360 indemnités journalières peuvent être versées, au plus, sur une période de trois ans décomptée de date à date. Un assuré qui aurait déjà atteint ce seuil ne peut donc plus bénéficier d'indemnités journalières, jusqu'au troisième anniversaire de la première indemnité journalière versée sur la période.
Les règles encadrant les IJ pour les professions libérales sont plus strictes, puisque ce régime encadre également le nombre d'indemnités journalières qu'il est possible de percevoir consécutivement. Le code de la sécurité sociale fixe, pour ces assurés, un maximum de 87 indemnités journalières consécutives pour une même incapacité de travail617(*).
Le législateur a toutefois entendu préserver certains assurés souffrant de pathologies pouvant provoquer de longues interruptions de travail en créant un régime propre aux affections de longue durée. Par dérogation, les assurés en ALD exonérante ou non peuvent bénéficier d'indemnités journalières tout le long d'une période de trois ans. Une fois épuisée cette période, les assurés en ALD doivent reprendre leur activité pendant un an avant de pouvoir à nouveau bénéficier d'indemnités journalières durant une période de trois ans618(*). S'il y a lieu, ces assurés peuvent également, à l'expiration du délai de trois ans, bénéficier d'indemnités journalières dans les conditions de droit commun.
Enfin, le législateur n'a pas entendu, à ce stade, encadrer la durée des indemnités journalières liées à des sinistres professionnels pour les assurés des régimes général et alignés : leur versement est dû « pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation »619(*).
2. Les modalités d'indemnisation complémentaires, qu'elles soient du fait de l'employeur ou d'un contrat de prévoyance, peuvent également être bornées dans le temps
a) L'indemnité complémentaire de l'employeur, une garantie légale de maintien de salaire partiel pour une durée au plus égale à 180 jours
En sus de l'indemnisation proposée par la sécurité sociale, l'assuré peut bénéficier d'un revenu de remplacement complémentaire, émanant soit directement de son employeur, soit d'un contrat de prévoyance souscrit individuellement par l'assuré ou collectivement par son employeur.
Ce mécanisme, instauré en 1978 par la loi dite « de mensualisation »620(*), a été renforcé par la loi dite « ANI » de 2008621(*).
L'article L. 1226-1 du code du travail fixe le principe d'un maintien de salaire partiel de l'assuré par son employeur, dès lors qu'il dispose d'une ancienneté supérieure à un an622(*). En contrepartie, l'employeur a le droit de demander une contre-visite afin de vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail.
Ce mécanisme prend la forme d'une « indemnité complémentaire »623(*) aux IJ, permettant au salarié de toucher 90 % de sa rémunération brute lors d'une première période, puis, le cas échéant, les deux tiers pendant une période suivante624(*). Elle est donc calculée en déduction des indemnités journalières625(*) et, le cas échéant, des prestations de prévoyance résultant d'un versement de l'employeur626(*).
S'agissant d'une indemnité « complémentaire »627(*), elle n'est versée que dans la mesure où la sécurité sociale verse également des indemnités journalières.
La période d'indemnisation légale est, comme pour les indemnités journalières, bornée dans le temps. Les durées de maintien de salaire à 90 % et aux deux tiers sont de trente jours chacune, soit soixante jours au total, pour un salarié disposant d'une ancienneté comprise entre un et cinq ans. Chacune augmente de dix jours par tranche de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise supplémentaires, dans la limite de 90 jours à 90 % et 90 jours aux deux tiers628(*).
Durée d'ancienneté et durée
de versement
de l'indemnité complémentaire
|
Ancienneté dans l'entreprise |
Durée maximale de versement des indemnités |
|
De 1 à 5 ans |
60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
|
De 6 à 10 ans |
80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
|
De 11 à 15 ans |
100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
|
De 16 à 20 ans |
120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
|
De 21 à 25 ans |
140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
|
De 26 à 30 ans |
160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
|
31 ans et plus |
180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Source : Commission des affaires sociales d'après code du travail
La période légale maximale de versement de l'indemnité complémentaire est donc de 180 jours.
Comme pour les indemnités journalières, un délai de carence s'applique. Celui-ci est fixé à sept jours629(*), sauf lorsque l'arrêt procède d'un sinistre professionnel, auquel cas il ne s'applique pas.
Toute entreprise peut, par accord de branche, convention collective ou accord d'entreprise déroger favorablement à ces dispositions, tant quant au niveau de l'indemnisation qu'à sa durée ou à l'existence d'un délai de carence.
b) L'indemnité complémentaire peut être versée ou complétée par un organisme complémentaire de prévoyance
L'indemnité complémentaire de l'employeur peut être prise en charge par un organisme complémentaire de prévoyance630(*), c'est-à-dire une mutuelle, une entreprise d'assurance ou une institution de prévoyance, lorsque le salarié est couvert par une assurance complémentaire prévoyance pour l'incapacité à laquelle contribue l'entreprise.
Si la couverture prévoyance des salariés pour l'incapacité est facultative, elle peut être rendue obligatoire par un accord de branche ou une convention collective. Toutefois, chez les cadres, un accord national interprofessionnel signé en 2017631(*) a institué un régime complémentaire obligatoire de prévoyance632(*), affecté en priorité à l'assurance décès, mais pouvant également concerner l'incapacité temporaire.
Des prestations de prévoyance complémentaire, souscrites à titre individuel par l'assuré ou à titre collectif par l'employeur, peuvent également compléter l'indemnisation offerte à l'assuré et, le cas échéant, prévoir des durées d'indemnisation accrues, un maintien intégral de salaire en cas d'arrêt de travail, ou la couverture partielle ou totale du délai de carence pour les indemnités journalières.
Selon une étude ancienne633(*), 80 % des salariés bénéficieraient d'un maintien de salaire intégral entre les quatrième et septième jours d'arrêt de travail. L'actualisation de cette étude en 2017 fait valoir que les deux tiers des salariés bénéficieraient d'une prise en charge au titre des jours de carence de la sécurité sociale, avec une forte hétérogénéité en fonction de la taille des entreprises634(*).
Au total, la prévoyance complémentaire pour incapacité représente 7,4 milliards d'euros de dépenses pour les organismes concernés en 2024, principalement les entreprises d'assurance (4,6 milliards d'euros) et les institutions de prévoyance (2,3 milliards d'euros). On constate une accélération de la dynamique de ces prestations, avec + 7,2 % en 2024, contre + 2,6 % en 2023.
Compléments d'indemnités
journalières
versés par les organismes
complémentaires
(en milliards d'euros)
Source : Drees, Les dépenses de santé en 2024, édition 2025
C. Des arrêts de travail prolongés sont à la fois responsables d'un manque de suivi des assurés, favorisant la désinsertion professionnelle, et d'une hausse soutenue des dépenses d'indemnités journalières
1. Une proportion considérable d'arrêts de travail de longue durée, excédant parfois les durées de référence recommandées par la Cnam
a) Un phénomène d'allongement des arrêts de travail prescrits, constaté tant par la branche maladie que par la branche AT-MP
Les arrêts de travail longs, excédant quinze jours en ville ou trente jours en établissements, représentent une part non négligeable des arrêts prescrits.
En 2024, près de 900 000 arrêts de travail prescrits en ville excédaient une durée de quinze jours, soit 8,6 % du total, et 300 000 arrêts de travail prescrits en établissement l'étaient pour une durée d'au moins un mois, soit 7 % d'entre eux.
Le phénomène concerne à la fois les primo-prescriptions et les prolongations d'arrêt de travail. Selon les données du rapport Charges et produits pour 2026 de la Cnam, 491 000 arrêts prescrits en primo-prescription excédaient une durée de 33 jours, soit 3,3 % du total.
En ce qui concerne les prolongations, 22 % de celles effectuées sous forme dématérialisée ont excédé 32 jours en 2024, soit 1,2 million d'arrêts.
La hausse de la prescription d'arrêts de travail longs concerne tout particulièrement les assurés de plus de 40 ans, les plus touchés par les risques professionnels et sanitaires associés au manque de suivi qui peut leur être corrélatif635(*). La crise sanitaire a causé une augmentation significative du nombre de jours indemnisés au titre d'arrêts supérieurs à trois mois pour toutes les classes d'âge, mais chez les assurés de plus de 40 ans, il n'y a pas eu, depuis, de retour à la tendance antérieure.
Nombre de jours d'arrêts indemnisés de plus de trois mois par classe d'âge
Source : Rapport Charges et produits pour 2026
La durée des arrêts de travail AT-MP tend également à s'allonger : selon la DSS, ces derniers sont passés de 40 à 50 jours en moyenne depuis le début de la crise sanitaire pour les accidents du travail, et de 200 à 260 jours pour les maladies professionnelles. La hausse de la durée moyenne d'arrêt est plus sensible encore pour les régimes agricoles636(*).
Des durées de versement d'indemnités journalières AT-MP parfois très longues
Les arrêts de travail AT-MP ouvrent droit à des indemnités journalières jusqu'à la guérison de l'assuré ou jusqu'à la consolidation de son état, sans limite de durée fixée.
En 2024, 2,8 % des sinistres indemnisés en incapacité temporaire AT-MP dataient de trois ans ou plus au régime général, représentant près de 10 % du montant total d'IJ versées. La même année, la direction des risques professionnels de la Cnam dénombrait 5 050 arrêts de plus de quatre ans. 618 arrêts de plus de quatre ans étaient, en outre, recensés chez les salariés agricoles, et 89 chez les non-salariés agricoles.
De telles durées d'arrêt rendent difficile le retour à l'emploi pour les assurés concernés. Se pose également, pour ces assurés en arrêt de travail depuis plusieurs années, la question de la compatibilité de leur état de santé avec les conditions de versement des indemnités journalières, qui ne visent qu'à pallier une incapacité de travail temporaire. En effet, lorsque l'incapacité devient permanente, la branche l'indemnise via d'autres canaux, à savoir les rentes viagères et les indemnités en capital, en fonction du taux d'incapacité permanente.
Cette interrogation se pose avec davantage d'acuité encore face au constat de la diminution rapide de l'établissement des certificats médicaux finaux par les médecins de ville. Ces certificats, qui mettent fin à l'incapacité temporaire et ouvrent droit, le cas échéant, aux prestations d'incapacité permanente, ont ainsi vu leur nombre diminuer de 528 000 en 2017 à 143 000 en 2024, soit une baisse de près de 75 % en sept ans, sans que le Gouvernement ou la direction des risques professionnels de la Cnam soit en mesure de l'expliquer. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) émet l'hypothèse d'un lien avec des modifications opérées sur les formulaires d'arrêt de travail, tandis que le Medef suppute une moindre implication de la branche dans l'information auprès des médecins. La DSS note, en tout état de cause, que « ce changement de pratique de la part des médecins est un des facteurs explicatifs de l'allongement de la durée des arrêts de travail pour AT-MP »637(*).
Selon des campagnes de contrôle menées par les directions régionales du service médical de l'assurance maladie, le bénéfice des prestations d'incapacité temporaire pour ces assurés serait, dans les faits, rarement justifié. Selon la DSS, les contrôles sur les arrêts de plus de quatre ans donnent ainsi lieu, dans 72 % des cas, à une décision de consolidation, sortant l'assuré du régime de l'incapacité temporaire pour le faire entrer dans celui de l'incapacité permanente.
b) Une déconnexion entre les prescriptions et les durées d'arrêt de référence préconisées par la Cnam
L'analyse de la durée des arrêts de travail prescrits fait, en outre, apparaître une déconnexion fréquente entre les prescriptions constatées et les durées d'arrêt de référence préconisées par la Cnam.
S'il convient de noter que ces durées de référence, fondées sur une approche populationnelle et non individuelle, peuvent être dépassés notamment lorsque des complications particulières interviennent, la fréquence de ces dépassements autant que l'hétérogénéité des pratiques entre prescripteurs ont de quoi interpeler.
Dans son rapport Charges et produits pour 2026, la Cnam estime ainsi que, pour les quatre principaux motifs d'arrêt de travail en 2023, « la majorité des arrêts dépassent les durées recommandées avec des écarts entre les patients et les prescripteurs très importants ».
Il ressort en effet de l'analyse des données de prescription que :
- la durée de près de 30 000 prescriptions d'arrêt de travail pour des troubles anxio-dépressifs mineurs dépasse la durée de référence de 14 jours, soit « une large part » des arrêts concernés. Parmi eux, plus de 30 % excèdent 28 jours, soit le double de la durée de référence ;
- plus de 35 000 prescriptions d'arrêt de travail pour des lombalgies communes ont une durée supérieure aux cinq jours recommandés, dont plus de 15 000 excèdent quinze jours ;
- 13 % des arrêts consécutifs à une sciatique dépassent la durée de référence fixée à 35 jours avec, en leur sein, 50 % de prescriptions supérieures à 59 jours et 10 % excédant même 124 jours ;
- pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, 10 % des prescriptions dépassent la durée maximale recommandée, de 21 jours sans chirurgie et 90 jours avec, excèdent 130 jours.
2. Des arrêts de travail longs sont associés à un suivi médical insuffisant et à un risque de désinsertion professionnelle
Les arrêts de travail de longue durée entraînent, pour certains assurés, une perte de contact avec le monde médical, préjudiciable à leur santé, et une progressive désinsertion professionnelle, d'autant plus marquée que l'accompagnement proposé est insuffisant et le patient isolé.
L'absence ou l'insuffisance de contacts médicaux périodiques peuvent participer à la dégradation de la santé de l'assuré, qui peut prendre, au cours de longues périodes d'arrêt de travail sans suivi, de mauvais réflexes ou connaître une détérioration évitable de ses symptômes. C'est tout particulièrement le cas pour les maladies psychiques, dont les durées d'arrêt de travail associées sont pourtant particulièrement longues. Dans son rapport Charges et produits pour 2026, la Cnam touche ainsi un paradoxe : « les motifs majoritairement renseignés pour des durées supérieures à un mois correspondent à des syndromes dépressifs et à des troubles anxio-dépressifs mineurs, alors que la HAS recommande un suivi médical régulier dans ces situations ».
Plus généralement, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) note également, dans un rapport de 2017 sur la désinsertion professionnelle638(*), que « lorsque l'arrêt de travail se prolonge et indépendamment de son motif médical, il peut participer au risque de désinsertion professionnelle ». En effet, le défaut de suivi des assurés en arrêt de travail de longue durée fragilise les compétences et réduit les opportunités de réadaptation progressive. Sur le plan individuel, l'isolement social, la perte d'habitudes professionnelles et l'anxiété liée à la situation financière favorisent la perte de l'emploi ; au plan organisationnel, l'insuffisance d'anticipation des adaptations de poste et l'absence de parcours de retour structurés privent l'employeur et le salarié de solutions aménagées. Dans son rapport Charges et produits pour 2026, la Cnam estime ainsi que le « manque de suivi et la prescription d'arrêts de travail de longue durée participent [...] à l'éloignement des assurés du marché du travail et rendent plus difficile la reprise ensuite ».
L'expérimentation SOS IJ : une solution à généraliser ?
Confrontés à des situations complexes d'arrêt de travail pour leurs patients, qui peuvent être liées à des problématiques de santé, à des difficultés sociales ou à des conflits professionnels, les médecins libéraux expriment souvent des difficultés à trouver les bons interlocuteurs au sein de l'assurance maladie [...].
L'expérimentation du dispositif SOS IJ (pour « indemnités journalières »), dont l'objectif est d'offrir aux médecins un point d'entrée unique vers l'assurance maladie afin de les aider face aux situations complexes d'arrêt de travail, a été conduite entre fin janvier et fin mai 2025 dans les départements du Rhône et d'Eure-et-Loir auprès de plus de 2 500 médecins.
Cette expérimentation poursuivait plus particulièrement les objectifs suivants :
- valider le périmètre et les modalités d'activation de l'offre de service attentionnée SOS IJ ;
- mesurer la qualité et les délais de réponse aux sollicitations des médecins ;
- évaluer l'impact sur la charge de travail pour les équipes de l'Assurance Maladie ;
- tester la soutenabilité du dispositif pour une potentielle généralisation en 2025.
Le bilan de l'expérimentation permettra d'envisager les conditions de la généralisation de l'offre SOS IJ en 2025.
Source : Rapport Charges et produits pour 2026
3. Les indemnités journalières versées, qui atteignent 17,4 milliards d'euros en 2025, suivent une hausse non maîtrisée portée par les arrêts longs et les IJ AT-MP
a) Une trajectoire de hausse non contrôlée, qui continue de s'accélérer en 2024
Les dépenses d'indemnités journalières, particulièrement dynamiques depuis 2020, pèsent sur l'équilibre des branches maladie état-MP.
Sur le champ des régimes obligatoires de base, leur montant atteint, pour ces deux branches, 17,4 milliards d'euros en 2024, répartis entre 12,1 milliards pour la branche maladie, soit 70 % de la dépense, et 5,3 milliards d'euros pour la branche AT-MP. Les indemnités journalières versées par le régime général représentent ainsi 15,5 % des dépenses de ville de ce régime.
Afin de ne pas fausser les analyses, les données présentées ci-après excluent systématiquement les dépenses supplémentaires liées au régime spécifique d'indemnités journalières créé pour les arrêts en lien avec la covid-19 durant la crise sanitaire.
Le montant d'indemnités journalières versé s'est montré particulièrement dynamique ces dernières années : il a augmenté de 69 % entre 2014 et 2024, et de 38 % depuis 2019. Cette trajectoire s'accélère : le taux de croissance annuel moyen des IJ, de 5 % entre 2017 et 2020, atteint 7 % entre 2020 et 2024. Les années 2022 (+ 7,8 %) et 2024 (+ 8,1 %) ont été particulièrement exposées à la hausse des indemnités journalières.
Depuis la crise sanitaire, la trajectoire est encore plus rapide pour les IJ de la branche AT-MP, qui voient leur poids dans le total des IJ progresser et connaissent un taux de croissance à deux chiffres en 2024. La DSS fait remarquer que les IJ sont devenues, cette année-là, le principal poste de dépenses de la branche.
Selon le rapport d'octobre 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale, « les IJ représentent le poste de dépense le plus dynamique en 2024 et contribuent pour 1,1 points de pourcentage à la croissance globale des dépenses des soins de ville ».
Évolution du montant d'IJ hors covid versé depuis 2014
Source : Commission des affaires sociales d'après les données des éditions 2023 à 2025 des rapports « Les dépenses de santé » de la Drees
b) Une dynamique des indemnités journalières maladie entre 2019 et 2023 imputable à plus de 40 % à la hausse de la sinistralité et de la durée des arrêts à âge fixé
Une conjonction de phénomènes peut expliquer la dynamique de la trajectoire des indemnités journalières. Ces dernières dépendent de cinq facteurs :
- le nombre de personnes en emploi, en hausse de 1,5 % par an entre 2019 et 2023 ;
- l'âge des personnes en emploi, qui influe sur la sinistralité : les arrêts maladie des personnes de 50 ans ou plus représentent 29 % des arrêts et 42 % des dépenses. Le vieillissement de la population active serait responsable de 16 % de l'augmentation des IJ maladie versées par le régime général entre 2010 et 2019, mais l'augmentation de l'emploi des jeunes entre 2019 et 2023, porté notamment par l'apprentissage, a inversé la tendance : ce facteur joue désormais à la baisse sur les IJ (- 6 % entre 2019 et 2023) ;
- la sinistralité à un âge donné a augmenté légèrement entre 2010 et 2019, avant de connaître une accélération nette entre 2019 et 2023, sans que les causes précises de cette tendance puissent être évaluées. Le rapport Charges et produits pour 2026 évoque notamment une potentielle dégradation des conditions de travail, faisant valoir que « ces dernières années, l'exposition à des pénibilités physiques (Mauroux et al., 2021 ; Algava et Nass, 2023 ; Havet et Penot, 2021) et à des contraintes psychosociales (Havet et Penot, 2023) - toutes deux fortement associées aux arrêts de travail (Inan, 2013 ; Pollak, 2015 ; Havet et Plantier, 2023) - a augmenté ». Une recrudescence des arrêts frauduleux, des évolutions dans les comportements de prescription et, au-delà de cela, des facteurs sociologiques comme la dégradation de l'état de santé de la population en lien avec les difficultés d'accès aux soins sur les territoires sont également évoqués. Près de 40 % de la dynamique des indemnités journalières maladie du régime général entre 2019 et 2023 serait imputable à ce facteur ;
- le revenu des assurés ayant recours à un arrêt, qui a augmenté avec l'inflation : près de 40 % de la hausse des IJ maladie du régime général entre 2019 et 2023 seraient attribuables au montant moyen des IJ versées, en lien avec la hausse des salaires ;
- la durée des arrêts, avec une prégnance renforcée des arrêts les plus longs, qui sont également les plus coûteux. Selon la Drees639(*), les arrêts de plus de six mois représentent 7 % des arrêts, mais 45 % de la dépense d'IJ maladie du régime général.
57 % de la hausse des indemnités journalières maladie du régime général entre 2019 et 2023 est imputable à des facteurs économiques et démographiques - on parle d'effet prix et d'effet structure. Le solde s'explique par la hausse de la sinistralité et de la durée des arrêts à âge donné, c'est-à-dire l'effet volume.
Facteurs explicatifs de l'évolution du montant des IJ maladie
Source : Drees
c) Les IJ AT-MP, portées par les effets prix et durée, tirent à la hausse la croissance des indemnités journalières
Les IJ AT-MP, particulièrement dynamiques, sont portées par les effets prix et durée.
L'effet prix découle de la hausse des salaires consécutive à la période d'inflation traversée par la France. Le taux de remplacement et le plafond des IJ AT-MP étant supérieur à ceux des IJ maladie, l'effet prix y est d'autant plus important.
L'effet durée est responsable à lui seul d'une hausse de 7,1 % du montant des IJ AT-MP en 2024. Les arrêts les plus longs pèsent en effet de plus en plus lourd sur la trajectoire des dépenses d'indemnités journalières de la branche : selon la DSS, « les IJ de 2 à 3 ans ont presque doublé en 2024, tandis que les IJ de 3 ans et plus ont connu une évolution de près de 130 % ».
Évolution du nombre de sinistres avec
indemnités journalières
en fonction de la durée
d'arrêt cumulée
Source : DSS
d) Des perspectives de hausse toujours dynamique en 2025, mais un ralentissement anticipé pour 2026 sous l'effet du ralentissement économique et des mesures de régulation des indemnités journalières déjà engagées
Pour l'année 2025, sur le régime général, la commission des comptes de la sécurité sociale table sur une hausse de 4,9 % des indemnités journalières maladie état-MP, portées par un fort effet volume.
La tendance à l'allongement des arrêts de travail devrait en effet se confirmer en 2024 et en 2025 : selon le rapport d'octobre 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale, les IJ de plus de trois mois devraient augmenter de 10,0 % en 2025, principalement lié à l'accroissement du nombre de jours indemnisés (+ 6,2 %).
Les IJ AT-MP, qui ressortiraient à nouveau en hausse de plus de 10 % en 2025 (+ 10,3 % pour le régime général), tireraient également la dynamique globale.
En 2026, le ralentissement économique devrait limiter la contribution à la dynamique des IJ de la hausse de l'emploi salarié et de l'augmentation des IJ moyennes, par ailleurs affectées par l'effet année pleine du plafonnement des revenus à 1,4 Smic. Pour autant, la hausse de la sinistralité et de la durée des arrêts à âge fixé pourrait continuer de peser durablement sur la trajectoire des indemnités journalières, si aucune mesure n'était entreprise pour la circonscrire.
Dépenses trimestrielles d'IJ maladie de
plus de trois mois à la charge
du régime
général, corrigées des jours ouvrés et des
variations saisonnières
Source : Rapport Charges et produits pour 2026
La montée en charge de diverses mesures réglementaires et législatives visant à maîtriser les indemnités journalières devrait également permettre de ralentir la trajectoire des IJ, du moins pour le régime général à en croire les prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale. Une hausse de 0,5 % est attendue, pour ce régime, sur les IJ maladie, tandis que les IJ AT-MP devraient rester dynamiques, mais moins qu'en 2025 (+ 7,6 %, contre + 10,3 %).
D. Le dispositif proposé : limiter la durée des prescriptions d'arrêts de travail, plafonner la durée de versement des indemnités journalières AT-MP, rendre obligatoire la mention des motifs de l'arrêt de travail sur les avis d'arrêt de travail et rendre facultatif l'examen de reprise à l'issue d'un congé de maternité
L'article 28 prévoit trois mesures visant à limiter la hausse des dépenses des indemnités journalières pour les branches maladie état-MP, et à renforcer le suivi des assurés.
1. La limitation de la durée des primo-prescriptions et des renouvellements d'arrêts de travail, sauf exception
Sauf exceptions, la loi n'encadre à ce jour pas la durée de prescription des arrêts de travail, le législateur ayant préféré encadrer plutôt l'indemnisation associée, au nom de la liberté de prescription.
L'article 28 prévoit de revenir sur ce principe, à la fois pour une primo-prescription et pour une prolongation. Il modifie à cet effet respectivement les articles L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale (1° du II), relatif notamment aux règles d'établissement des prescriptions d'arrêt de travail, et L. 162-4-4 du même code (2° du II), relatif aux conditions de maintien de l'indemnisation par la sécurité sociale lors d'une prolongation d'arrêt de travail.
Le b du 1° du II et le b du 2° du II prévoient respectivement de soumettre la durée de primo-prescription et de prolongation des arrêts de travail à un plafond, fixé dans les deux cas par décret en Conseil d'État.
Il est précisé, pour la primo-prescription comme pour la prolongation d'un arrêt de travail, qu'il restera loisible au prescripteur de déroger au plafond dans le cas où il justifierait, sur la prescription, de la nécessité d'une durée d'arrêt plus longue eu égard à la situation du patient et en considération des recommandations émises par la HAS, lorsqu'elles existent (c du 1° du II et b du 1° du II).
L'étude d'impact indique que le Gouvernement envisage de fixer ces durées à quinze jours en ville et trente jours à l'hôpital pour une primo-prescription, et à deux mois pour une prolongation.
Ces évolutions s'appliqueront également au régime des non-salariés agricoles, dans l'Hexagone comme dans les outre-mer (a du 1° du II).
L'étude d'impact évalue à 40 millions d'euros le montant d'économies brut potentiel de la limitation de la durée de prescription des arrêts de travail, en estimant à 1,2 million le nombre de journées d'arrêt de travail évitées.
Le rendement net de la mesure serait toutefois considérablement diminué du fait du remboursement par l'assurance maladie des consultations rendues nécessaires pour faire prolonger des arrêts de travail, qui pourrait représenter un coût de 30 millions d'euros.
En définitive, seuls 10 millions d'euros d'économies annuelles sont donc attendus de la mesure, une fois pris en compte les effets de bord qu'elle suppose sur les prestations en nature de la branche maladie.
2. La mention obligatoire des motifs de l'arrêt de travail sur l'avis d'arrêt de travail
Le b du 1° du II de l'article 28 prévoit de faire obligation aux prescripteurs de mentionner sur l'avis d'arrêt de travail non seulement les « éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail », comme le prévoit aujourd'hui l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, mais également ses motifs.
3. Le plafonnement de la durée de versement des indemnités journalières AT-MP
Le 1° et 2° du I et le 3° du II de l'article 28 prévoient d'instaurer un plafonnement de la durée de versement des indemnités journalières versées par la branche AT-MP, respectivement pour le régime des non-salariés agricoles et pour le régime général.
Ils modifient pour ce faire respectivement les articles L. 752-3 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à la définition du champ des indemnités journalières AT-MP pour les non-salariés agricoles, et l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, qui régit les IJ AT-MP pour le régime général. Le régime des salariés agricoles sont également concernés par la réforme, par renvoi aux dispositions relatives au régime général640(*).
La fixation de la durée maximale de versement, calculée de date à date, est renvoyée au décret (1° et a du 2° du I, a du 3° du II). Il est également précisé que la durée de versement des indemnités journalières court à nouveau dès lors que la reprise du travail entre deux arrêts pour un sinistre professionnel excède une durée minimale fixée par décret (b du 2° du I et a du 3° du II).
Lorsque la durée maximale de versement des IJ est atteinte, leur perception par l'assuré s'interrompt et l'incapacité est alors réputée permanente (b du 2° du I et b du 3° du II), ouvrant ainsi droit aux assurés de bénéficier, si leur situation le justifie, d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, selon leur régime et leur taux d'incapacité permanente. Comme le prévoit le droit en vigueur, le versement des IJ AT-MP prend également fin en cas de guérison, de consolidation ou de décès de l'assuré.
Enfin, pour le seul régime général, il est prévu une dérogation à la durée maximale de versement des IJ AT-MP lorsque ces dernières sont versées au titre d'un travail aménagé ou à temps partiel reconnu par le médecin-conseil comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure (c du 3° du II). La loi ne prévoit pas un tel dispositif pour les non-salariés agricoles.
Selon l'étude d'impact, cette mesure devrait permettre de dégager un montant de 30,8 millions d'euros d'économies annuelles pour la branche AT-MP, dont 28 millions d'euros pour le régime général et 2,8 millions d'euros pour le régime agricole.
4. La transformation de l'examen de reprise après un congé de maternité en une simple faculté à la main de l'employeur ou du travailleur
Le III de l'article 28 prévoit de rendre facultatif l'examen de pré-reprise auprès de la médecine du travail après un congé de maternité, aujourd'hui obligatoire.
Il réécrit, en ce sens, l'article L. 4624-2-3 du code du travail, qui régit l'examen de reprise après certains arrêts de travail.
Dans sa nouvelle rédaction proposée, le 2° de cet article prévoit désormais que l'examen de reprise par un médecin du travail à la suite d'un congé pour maternité soit réalisé à la demande de l'assurée ou de l'employeur, et non plus obligatoirement.
La réécriture de l'article L. 4624-2-3 du code du travail se fait à droit constant pour ce qui concerne l'examen de reprise consécutif à une maladie ou à un accident.
Cette mesure pourrait générer 17,6 millions d'euros d'économies : elle évitera en effet à certaines assurées revenant de congé de maternité et n'ayant pas pu accéder dans les délais à l'examen de reprise d'avoir à solliciter un arrêt de travail indemnisé dans l'attente de la réalisation dudit examen. L'étude d'impact concède toutefois qu'il est « impossible de chiffrer précisément le coût que représentent, pour les comptes de la sécurité sociale, ces arrêts ».
5. Diverses dispositions
Le a du 2° du II et le 2°641(*) du II visent à faire figurer explicitement le chirurgien-dentiste parmi les professionnels susceptibles respectivement de prolonger et de prescrire un arrêt de travail.
Le IV de l'article prévoit des modalités d'application de cet article à Mayotte. Il y rend inapplicables la limitation de la durée de primo-prescription et de prolongation des arrêts de travail, ainsi que l'obligation pour le prescripteur d'en mentionner les motifs sur l'avis d'arrêt de travail.
Le V de cet article procède à une coordination rendue nécessaire par les modifications prévues au présent article.
Le VI de l'article fixe au 1er septembre 2026 l'entrée en vigueur de la limitation de la durée des primo-prescriptions et des prolongations d'arrêts de travail pour maladie.
Le même VI rend applicable le plafonnement de la durée de versement des IJ AT-MP aux victimes dont le sinistre professionnel intervient à compter du 1er janvier 2027.
Le reste des dispositions de l'article entrera en vigueur au lendemain de la publication au Journal Officiel de la présente loi.
II - Le dispositif transmis au Sénat
S'agissant de la limitation de la durée de prescription des arrêts de travail, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Sandrine Runel et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés visant à préciser, dans la loi, que la durée maximale des arrêts de travail fixée par décret ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription, et à deux mois pour une prolongation.
L'Assemblée nationale a également supprimé de l'article 28 les dispositions revenant sur le caractère obligatoire de l'examen de reprise à l'issue d'un congé de maternité, par cinq amendements identiques du rapporteur général, de Sandrine Runel et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, de Yannick Monnet et ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, de Paul-André Colombani et ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires et de Ségolène Amiot et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire.
Les auteurs, à l'exception du rapporteur général, arguent des dangers que ferait courir une telle évolution sur le suivi de l'état de santé des femmes après leur congé de maternité, dans une période où l'assurée est particulièrement sujette à des risques tels que la dépression du post-partum.
Le rapporteur général, quant à lui, a entendu supprimer ces dispositions au motif qu'elles ne relevaient pas d'une loi de financement de la sécurité sociale dès lors qu'elles concernent, au premier chef, la médecine du travail.
Sept amendements du rapporteur général, apportant des coordinations ou des précisions rédactionnelles, ont également été adoptés.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
1. Sur l'encadrement de la durée des arrêts de travail
Il est indubitable que les longs arrêts de travail, en progression, sont source de risques pour les assurés concernés, ces derniers pouvant alors être exposés à une désinsertion professionnelle progressive ou à un manque de suivi médical préjudiciable à l'amélioration de leur état de santé.
Il n'est pas moins certain que la dynamique des indemnités journalières, aujourd'hui incontrôlée, doit être freinée pour être soutenable dans un contexte marqué par une situation financière toujours plus dégradée de la branche maladie.
La rapporteure partage, en outre, les constats du Gouvernement quant à l'inadéquation entre les durées d'arrêt de travail observées et les durées de référence établies, quoiqu'il faille rappeler que ces dernières sont fournies à titre indicatif et peuvent être adaptées à la hausse en fonction de la situation du patient et des manifestations de sa pathologie.
Pour autant, si la rapporteure rejoint le Gouvernement sur les éléments de bilan, elle ne peut souscrire à la solution retenue. Celle-ci porte en effet une atteinte manifestement disproportionnée à l'accès aux soins et à la liberté de prescription au regard de l'objectif affiché.
• La rapporteure dénonce, d'abord, une atteinte manifeste à la liberté de prescription dont jouissent les praticiens habilités à fournir des arrêts de travail. Elle rappelle que les prescripteurs sont seuls habilités à apprécier la nécessité et la durée d'un arrêt de travail au regard de l'état de santé de leurs patients, sur le fondement de leur évaluation clinique indépendante. L'union Avenir Spé - Le Bloc fait donc bien de rappeler que « la limitation légale des durées de prescription d'arrêts de travail constitue une ingérence directe dans la liberté de prescription médicale, pourtant garantie par le code de la santé publique »642(*).
Instaurer un plafonnement uniforme à quinze jours de la durée des primo-prescriptions d'arrêts de travail en ville irait, par ailleurs, à l'encontre des efforts mis en place pour oeuvrer à la pertinence des soins. Il ne fait en effet, dans certains cas, aucun doute que l'arrêt de travail doit être prescrit pour une durée supérieure à ce seuil. L'adoption de cette mesure résulterait en des situations défiant le bon sens : un ouvrier du secteur des bâtiments et travaux publics ne pourrait, par exemple, se faire prescrire plus d'un mois d'arrêt de travail pour une double fracture tibia-péroné, sauf à ce que le prescripteur le justifie expressément.
La commission appelle donc le Gouvernement à la confiance envers les professionnels de santé, qui adaptent déjà aujourd'hui la durée de prescription des arrêts de travail aux besoins du patients, à ses caractéristiques et à celles de sa pathologie.
La rapporteure rappelle, à cet égard, que les partenaires conventionnels se sont déjà pleinement saisis des enjeux de pertinence de prescription des arrêts de travail, ces derniers figurant parmi les engagements communs et réciproques pris dans le cadre de l'article 60 de la convention médicale entrée en vigueur l'an dernier. Un des quinze programmes de pertinence de l'article 61 de ladite convention fixe un objectif de 2 % de réduction du nombre de jours d'arrêt de travail par an, à l'appui d'un renforcement de l'information des professionnels, de l'accompagnement des prescripteurs et d'un respect du « principe de sobriété des prescriptions ».
La rapporteure estime qu'il convient de laisser à la convention le temps de produire ses effets pour raccourcir la durée moyenne des arrêts de travail, non en imposant un rabot uniforme et inadapté, mais en collant au plus près des besoins de chaque assuré à l'aide des outils développés en ce sens. La rapporteure appelle à ce titre à la généralisation de l'expérimentation SOS IJ, souhaitée par la Cnam.
• Plafonner la durée des arrêts de travail s'accompagnerait, en outre, d'un besoin massif de nouvelles consultations, en ville comme à l'hôpital, ayant pour objet de renouveler des arrêts de travail. Sur la base du coût indiqué de la mesure initiale, la rapporteure estime à un million le nombre de nouvelles consultations rendues nécessaires en ville, et à plus de 300 000 en établissement. Cela représenterait 325 000 heures de temps médical supplémentaires consacrées à la prolongation et au renouvellement d'arrêts de travail. C'est donc à juste titre que la Confédération des syndicats de médecins libéraux affirme que la limitation normative de la durée des arrêts de travail « imposera des consultations inutiles pour faire une prolongation alors que l'on manque de temps médical »643(*).
Alors que, selon les derniers zonages644(*), 75,7 % de la population française vit dans une zone sous-dense en médecins, la commission exprime ses plus vives réserves à l'idée de stimuler ainsi artificiellement la demande de soins. Elle ne saurait accepter que les cabinets médicaux soient engorgés par des consultations ayant pour seul objet de prolonger des arrêts de travail dont il était, pour bon nombre d'entre eux, prévisible voire certain qu'ils dussent l'être.
La commission regrette donc la profonde déconnexion, dont témoigne cette proposition, entre les positions du Gouvernement et les réalités vécues par les assurés, confrontés à des difficultés d'accès aux soins toujours plus marquées.
Au surplus, les économies engendrées par la mesure, nettes des surcoûts liés à la prise en charge des consultations supplémentaires, atteindrait 10 millions d'euros par an, un total dérisoire par rapport aux risques que le plafonnement de la durée des arrêts de travail ferait peser sur l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
La commission a donc supprimé le plafonnement de la durée des arrêts de travail en adoptant un amendement n° 682 de sa rapporteure.
Elle a également adopté son amendement n° 683, précisant dans certains articles du code de la sécurité sociale n'en faisant pas mention que les sages-femmes et chirurgiens-dentistes sont habilités à prescrire des amendements, dans la limite de leur compétence respective.
2. Le plafonnement de la durée de versement des indemnités journalières AT-MP
La commission a accueilli favorablement les dispositions de l'article 28 concernant le plafonnement de la durée de versement des indemnités journalières AT-MP, dans la seule mesure où l'article prévoit la systématicité du basculement de l'assuré vers les prestations d'incapacité permanente de la branche s'il en relève.
• Ces évolutions permettront en effet d'assurer un meilleur calibrage entre la situation de l'assuré et les prestations qui lui sont versées.
En s'en tenant aux principes, l'indemnité journalière AT-MP a vocation à couvrir les assurés dont l'incapacité de travail est temporaire.
Or, dans les faits, l'incapacité de la grande majorité des assurés ayant touché des IJ AT-MP durant plus de quatre ans ne présente plus de caractère temporaire, mais bien un caractère permanent. Les contrôles réalisés par le service du contrôle médical sur les assurés bénéficiant d'IJ AT-MP depuis plus de 3 ans résultent ainsi, dans plus de trois quarts des cas, en une décision de consolidation.
Acter la fin de la période d'incapacité temporaire à l'issue de la durée maximale de versement des indemnités journalières n'a rien d'une sanction pour l'assuré. En effet, le texte prévoit bien qu'en pareilles circonstances, « l'incapacité est réputée permanente », ce qui ouvre droit aux assurés de bénéficier des prestations d'incapacité permanente de la branche, spécialement prévues à cet effet et mieux calibrées à leur situation.
Les assurés qui auront atteint la durée limite de versement des IJ AT-MP et dont la diminution des capacités professionnelles perdurerait pourront ainsi bénéficier, selon leur taux d'incapacité permanente, de l'indemnité en capital ou de la rente viagère, considérablement revalorisées par l'article 90 de la dernière LFSS, qui leur confère un caractère dual.
Les assurés présentant un taux d'incapacité élevé pourront également bénéficier de la prise en charge intégrale de leurs soins et de ceux de leurs ayant droits : une modalité utile lorsque les besoins médicaux sont forts.
La rapporteure souhaite toutefois qu'une attention particulière soit apportée, lors du déploiement de la mesure, au cas des non-salariés agricoles, dont le régime ne prévoit aucune prestation d'incapacité permanente en dessous de 30 % de taux d'IPP. La faible volumétrie d'assurés concernés, une dizaine par an, permettra à la Mutualité sociale agricole d'organiser, à leur attention, un suivi spécifique.
La Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole indique, à ce titre, qu'elle compte user de cette mesure pour « prévenir et sécuriser le risque de rupture avec le travail ainsi que la désinsertion professionnelle ».
• D'autre part, bien que les indemnités journalières AT-MP présentent une trajectoire aussi préoccupante que celles versées par la branche maladie, avec une hausse de 10,3 % en 2025 et une hausse prévisionnelle de 7,8 % en 2026, celles-ci n'ont, à ce jour, fait l'objet d'aucune mesure de maîtrise des dépenses.
Dans un contexte désormais marqué par un déficit important et durable de la branche, il est indispensable que des efforts soient mis en oeuvre pour contenir la progression des dépenses. La question de l'équité entre les assurés peut également être posée, alors même que, chaque année, des mesures sont mises en oeuvre pour freiner la trajectoire des indemnités journalières maladie, à commencer par la réduction réglementaire du plafond du montant des indemnités journalières.
La rapporteure rappelle que les arrêts les plus longs, qui ne relèvent pourtant plus pour la majorité de l'incapacité temporaire, sont également ceux qui pèsent le plus lourd financièrement pour la branche. 2,8 % des arrêts indemnisés en AT-MP datent de trois ans ou plus ; ils représentent 10 % du montant d'indemnités journalières versé.
• Toutefois, la commission a souhaité encadrer le dispositif afin de garantir le principe de favorabilité des prestations AT-MP sur les prestations maladie. En effet, afin de limiter la sous-déclaration et de traduire le préjudice spécial que constitue un sinistre professionnel, la branche AT-MP prévoit systématiquement des prestations au moins aussi avantageuses que leurs contreparties de la branche maladie.
La commission a donc adopté un amendement n° 681 de ses rapporteures pour les branches maladie et AT-MP, visant à garantir que le pouvoir réglementaire ne puisse pas prévoir une durée maximale de versement des IJ AT-MP inférieure à celle des IJ maladie.
3. Le caractère facultatif de l'examen de reprise après un congé de maternité
La commission note que les dispositions supprimées par l'Assemblée nationale ne relevaient pas d'une loi de financement de la sécurité sociale mais du droit du travail. Aussi, elle n'entend pas les réintroduire dans le texte.
Au demeurant, sur le fond, la commission estime qu'il eût été pertinent de prévoir le maintien du caractère obligatoire de l'examen de reprise après un congé de maternité a minima pour les assurées exposées à des risques professionnels particuliers, bénéficiant d'un suivi individuel renforcé ou d'un compte professionnel de prévention.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 28 bis (nouveau)
Application à
Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives au service du
contrôle médical
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, vise à rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon quatre articles du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical des prestations.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité de l'article 74 de la Constitution à laquelle s'applique le principe d'identité législative, sauf dans des domaines particuliers
L'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit le statut applicable aux cinq collectivités d'outre-mer que sont la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Chacune de ces collectivités dispose d'un statut spécifique, défini par une loi organique qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les lois et règlements nationaux y sont applicables645(*).
Ces collectivités peuvent donc valablement opter pour un régime dit de spécialité législative, prévoyant que seuls sont pourvus d'effet juridique sur les territoires concernés les textes nationaux qui y ont expressément été rendus applicables.
Wallis-et-Futuna et la Polynésie française ont opté pour un tel régime, tandis que les trois autres collectivités se sont plutôt tournées vers un modèle d'identité législative restreint.
En particulier, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été un département646(*) avant de relever des collectivités d'outre-mer, s'applique un principe d'identité législative647(*), sauf dans certaines matières définies.
Les dispositions organiques régissant, en application de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, le statut de l'archipel prévoient en effet que « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité »648(*). Ces dernières incluent notamment « l'organisation des services et des établissements publics de la collectivité »649(*). En outre, le statut de l'archipel ne fait pas obstacle à l'adaptation des lois et règlements nationaux à l'organisation particulière de la collectivité.
En conséquence, certaines dispositions relatives aux affaires sociales sont adaptées ou rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le code de la sécurité sociale ou par une ordonnance650(*).
Tel est le cas, notamment, des dispositions encadrant l'assurance maladie, et notamment les articles L. 315-1 et L. 315-4 du code de la sécurité sociale, relatifs au service du contrôle médical651(*) et applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les autres articles relatifs au service du contrôle médical ne sont en l'état pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui entrave l'action de la Caisse de prévoyance sociale, qui gère localement les prestations de sécurité sociale en matière de contrôle du versement des prestations et de lutte contre la fraude.
B. Le dispositif proposé : rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon quatre articles du code de la sécurité sociale relatifs au service du contrôle médical
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 28 bis, inséré par un amendement de Stéphane Lenormand et ses collègues du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, modifie quatre articles du code de la sécurité sociale pour les rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s'agit :
- de l'article L. 315-2, relatif notamment aux conditions de suspension des prestations non médicalement justifiées et à la procédure d'accord préalable à laquelle peut être subordonné le bénéfice de certaines prestations caractérisées par :
• un risque prévisible ou avéré de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ;
• la nécessité de vérifier la justification de la prestation au regard de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, en prenant notamment en compte l'état du bénéficiaire et les alternatives thérapeutiques envisageables ;
• le caractère particulièrement coûteux de la prestation, unitairement ou en volume ;
• la possibilité de recourir à une alternative moins dispendieuse ;
- de l'article L. 315-2-1, qui permet de convoquer un assuré lorsque le service du contrôle médical le juge nécessaire au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail, et d'établir à son attention des recommandations sur les soins et traitement appropriés, conjointement ou non avec un médecin ;
- de l'article L. 315-3, qui prévoit, dans le cadre d'une procédure d'accord préalable, l'information du patient par le pharmacien, l'obligation pour ce professionnel de s'assurer de l'accord du service du contrôle médical avant la dispensation et la possibilité d'une action en recouvrement de l'indu en cas de méconnaissance de ces obligations ;
- de l'article L. 323-6, qui subordonne le service des indemnités journalières à diverses conditions652(*), à peine de restitution des indemnités versées et, en cas d'activité ayant donné lieu à revenu lors de l'arrêt de travail, de sanction financière.
II - La position de la commission
La commission ne peut que soutenir cet article, qui permettra d'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de droit national en matière de contrôle médical des prestations par la sécurité sociale, afin d'améliorer l'efficience de la dépense et de renforcer la lutte contre la fraude.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28 ter (nouveau)
Adaptations au droit des arrêts de
travail
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit deux adaptations au droit des arrêts de travail.
La première conditionne le versement de l'indemnité journalière à l'incapacité pour l'assuré de continuer ou de reprendre toute activité professionnelle salariée ou non.
La seconde restreint à un mois la durée d'arrêt de travail à compter de laquelle le médecin du travail peut être sollicité par le médecin conseil ou le médecin traitant pour préparer et étudier avec l'assuré les conditions et modalités de la reprise du travail ou envisager des démarches de formation.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
Lorsqu'un salarié se trouve en arrêt de travail, la sécurité sociale lui sert, sous conditions653(*), des indemnités journalières654(*), un revenu de remplacement en l'absence de versement de salaire655(*).
A. Les conditions médicales ouvrant droit au versement de l'indemnité journalière
1. Une définition de l'incapacité à continuer ou reprendre le travail qui laisse ouverte deux interprétations
Le service de l'indemnité journalière n'est dû qu'à condition de la prescription d'un arrêt de travail par un médecin. Une sage-femme ou un chirurgien-dentiste peuvent également prescrire un arrêt de travail, dans la limite de leur compétence professionnelle respective.
Une telle prescription est établie au regard de l'état de santé de l'assuré, qui doit être incompatible avec le travail. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin [...] de continuer ou de reprendre le travail ».
La formulation retenue par le législateur ne spécifie pas plus précisément la notion d'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Celle-ci laisse toutefois ouvertes deux interprétations concurrentes, selon que l'incapacité de continuer ou reprendre le travail concerne le poste de travail spécifique de l'assuré avant son arrêt, ou plus largement toute activité professionnelle.
Dans le silence de la loi, la Cour de cassation a statué, par deux arrêts de 2015656(*) et 2018657(*) concernant respectivement les arrêts pour maladie et les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle658(*), en faveur de la seconde interprétation. Celle-ci a en effet estimé, dans le premier de ces arrêts, qu'en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ».
2. Le droit proposé : inscrire dans la loi une définition de l'incapacité de travail proche de celle retenue par la Cour de cassation
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
L'article 28 ter, inséré à l'initiative du rapporteur général et d'un sous-amendement du Gouvernement, substitue en son 1° la notion d'incapacité à continuer ou reprendre une activité professionnelle659(*) salariée ou non à celle d'incapacité à continuer ou reprendre le travail, au sein de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale précité.
Il inscrit donc dans la loi une rédaction proche de l'interprétation des dispositions du même article L. 321-1 par la Cour de cassation, en y adjoignant toutefois l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle non salariée.
B. Le suivi par le médecin du travail lors d'un arrêt de travail long
1. La possibilité pour le médecin du travail, sur sollicitation, de contacter l'assuré en arrêt de travail long pour préparer et étudier les conditions de reprise du travail
Lorsque l'arrêt d'un assuré dépasse trois mois, le médecin conseil ou le médecin traitant peuvent solliciter le médecin du travail afin que celui-ci émette un avis sur la capacité de l'assuré à reprendre le travail660(*).
Le médecin du travail est par la suite chargé d'étudier conjointement avec l'assuré les conditions et modalités de reprise du travail ou, le cas échéant, d'engager des démarches de formation.
Avec l'accord de ce dernier, le médecin du travail organise une visite de préreprise661(*), visant à vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur est compatible avec son état de santé et à envisager le cas échéant les aménagements ou adaptations de poste nécessaires, voire son reclassement.
Sous vingt jours, le médecin du travail transmet les éléments pertinents au médecin conseil afin de lui permettre de décider, en fonction des cas, d'attribuer une pension d'invalidité ou un mi-temps thérapeutique, de maintenir le versement des indemnités journalières ou d'acter son interruption si l'arrêt de travail n'est pas justifié.
L'assuré et, lorsqu'il n'est pas à l'initiative de la procédure, le médecin traitant sont informés de la saisine du médecin du travail662(*). Il est également précisé qu'en pareille hypothèse, l'assuré peut être assisté par la personne de son choix.
2. Le droit proposé : la possibilité d'engager la saisine du médecin du travail pour envisager la reprise du travail pour des arrêts d'au moins un mois
L'article 28 ter prévoit également, en son 2°, une réduction de trois à un mois de la durée d'arrêt de travail à compter de laquelle le médecin conseil ou le médecin traitant est fondé à saisir le médecin du travail afin que celui-ci détermine, en lien avec l'assuré, les conditions et modalités de la reprise du travail. Il modifie à cet effet l'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale.
Cette rédaction procède d'un sous-amendement du Gouvernement, le rapporteur général ayant souhaité, dans son amendement, ouvrir une telle possibilité pour tout cas d'arrêt de travail, quelle qu'en soit la durée.
II - La position de la commission
La commission a accueilli favorablement les évolutions apportées par l'article 28 ter.
Elle estime en effet que la définition donnée à l'incapacité de travail, compatible avec l'interprétation qu'en propose, dans les faits, la Cour de cassation, contribue à clarifier le droit pour tous les assurés et permettra de lutter contre le phénomène de dévoiement des arrêts de travail comme moyen d'opposition à l'employeur.
Pour contribuer à cet objectif, les rapporteures pour les branches maladie et AT-MP ont déposé un amendement n° 684, adopté par la commission, visant à rendre cette nouvelle définition applicable aux arrêts liés à un sinistre professionnel, en conformité avec la jurisprudence établie de la Cour de cassation663(*).
Quant à l'évolution apportée sur la durée d'arrêt de travail à compter de laquelle le médecin du travail peut, sur sollicitation, contacter l'assuré en arrêt pour évoquer avec lui les conditions et modalités de la reprise du travail, la rapporteure estime qu'elle permettra d'améliorer utilement le suivi des assurés en arrêt de travail afin de prévenir la désinsertion professionnelle.
La rapporteure émet toutefois des réserves quant à la pleine portée effective de cet article dans un contexte démographique particulièrement défavorable chez les médecins du travail.
Elle note également que la visite de préreprise n'est automatique qu'à compter d'un arrêt de travail de deux mois, soit davantage que la durée d'un mois à compter de laquelle le médecin du travail pourrait être saisi pour réaliser, avec l'accord de l'assuré, un tel examen en application du présent article 28 ter. Rien n'empêche toutefois en droit le salarié d'effectuer une visite de préreprise que dans d'autres cas que ceux rendus obligatoires par la loi.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article 29
(supprimé)
Suppression du régime des ALD non
exonérantes
Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement, propose de supprimer le régime des ALD non exonérantes, qui permettent de bénéficier de conditions de versement dérogatoires des indemnités journalières sans ouvrir droit à une exonération du ticket modérateur.
La commission propose de confirmer la suppression de cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Deux régimes d'affections de longue durée cohabitent, associés à des conditions de prise en charge dérogatoires
1. Le régime des affections de longue durée exonérantes, instauré presque concomitamment à la sécurité sociale, offre une couverture renforcée à près de 14 millions d'assurés atteints d'une pathologie longue et coûteuse
a) Le régime des affections de longue durée exonérante : un pilier de l'action de la sécurité sociale en faveur du « gros risque »
Le régime des affections de longue durée (ALD) exonérantes trouve ses sources dans la volonté d'accorder une protection particulière aux assurés souffrant de maladies longues et coûteuses, émise dès la création de la sécurité sociale664(*). Il ouvre droit à un régime dérogatoire de prise en charge concernant les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie.
Mis en oeuvre dès 1947, ce régime concernait alors toute « affection de longue durée nécessitant un traitement régulier, et notamment l'hospitalisation, ou lorsque son état nécessite le recours à des traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux ».
Les conditions d'admission dans le régime des ALD exonérantes n'ont, depuis, que peu varié : les critères de durée et de coût des thérapeutiques sont toujours en vigueur au sein du 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le régime s'applique aux pathologies « comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».
Toutefois, les situations ouvrant droit à ce régime se sont considérablement élargies depuis 1947. En relèvent en 2022 13,8 millions d'assurés, soit 20,1 % de la population, répartis en trois catégories, en fonction des caractéristiques de leur pathologie.
• Les ALD 30 regroupent en 2022 97 % des assurés en ALD exonérantes, soit 13,4 millions d'assurés, atteints d'une pathologie figurant sur une liste.
Leur nom provient d'une liste qui comprenait à l'origine 30 pathologies ouvrant droit au régime d'exonération. Cette liste, établie par décret665(*), n'inclut désormais plus que 29 pathologies666(*), depuis le retrait667(*) de l'ALD 12 « hypertension artérielle sévère »668(*). Elle s'est toutefois considérablement étoffée depuis la création du régime des ALD en 1947, date à laquelle seules quatre pathologies étaient énumérées.
Liste des pathologies ouvrant droit à une ALD exonérante
|
Code |
Libellé de l'ALD |
|
1 |
Accident vasculaire cérébral invalidant |
|
2 |
Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques |
|
3 |
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques |
|
4 |
Bilharziose compliquée |
|
5 |
Insuffisance cardiaque, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires ou congénitales graves |
|
6 |
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses |
|
7 |
Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH |
|
8 |
Diabète de type 1 et diabète de type 2 |
|
9 |
Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave |
|
10 |
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères |
|
11 |
Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves |
|
12 |
Hypertension artérielle sévère (en extinction) |
|
13 |
Maladie coronaire |
|
14 |
Insuffisance respiratoire chronique grave |
|
15 |
Maladie d'Alzheimer et autres démences |
|
16 |
Maladie de Parkinson |
|
17 |
Maladies métaboliques héréditaires |
|
18 |
Mucoviscidose |
|
19 |
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique |
|
20 |
Paraplégie |
|
21 |
PAN, LEAD, sclérodermie généralisée |
|
22 |
Polyarthrite rhumatoïde |
|
23 |
Affections psychiatriques de longue durée |
|
24 |
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives |
|
25 |
Sclérose en plaques |
|
26 |
Scoliose structurale évolutive |
|
27 |
Spondylarthrite ankylosante grave |
|
28 |
Suites de transplantation d'organe |
|
29 |
Tuberculose active, lèpre |
|
30 |
Tumeur maligne |
Source : Article D. 160-4 du code de la sécurité sociale
Si les maladies cardio-neurovasculaires, réparties entre les ALD 1, 3, 5, 12 et 14, sont les plus fréquentes puisqu'en relèvent 4,3 millions d'assurés (32,2 % des ALD 30), les ALD comprenant les effectifs les plus importants sont le diabète (3,6 millions d'assurés, 27,2 % des ALD 30), les tumeurs malignes (2,6 millions, 19,8 %) et les affections psychiatriques de longue durée (1,7 million, 12,4 %).
Les inspections générales des finances et des affaires sociales ont, dans leur revue de dépenses sur le sujet669(*), décrié une liste qui « a peu tenu compte des évolutions thérapeutiques et du caractère aujourd'hui curable de certaines maladies, qui ne peuvent de ce fait plus être considérées comme « de longue durée » », convoquant l'exemple de pathologies comme la tuberculose, aujourd'hui curable en une année.
• Les ALD 31, dites « hors liste », instituées en 1987, regroupent des affections graves, nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse670(*), mais ne figurant pour autant pas sur la liste des ALD. Elles concernent 7 % des assurés pris en charge au titre d'une ALD exonérante671(*).
Un décret en Conseil d'État précise que peuvent relever du régime des ALD 31 les patients atteints « d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie »672(*), nécessitant « un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements ».
Tel peut être le cas des ulcères chroniques, de la maladie de Paget ou de l'endométriose, par exemple.
• Les ALD 32 couvrent les polypathologies entraînant un état invalidant et nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux. Il s'agit là de pathologies qui, individuellement, n'ouvriraient pas droit à une ALD 30 ou 31, mais qui, cumulées, risquent de susciter un reste à charge important et durable pour l'assuré.
b) Les assurés en ALD exonérante bénéficient d'une prise en charge intégrale du ticket modérateur sur les soins liés à leur pathologie
i. Des modalités de prise en charge plus favorables que le droit commun, qui majorent considérablement l'effort de l'assurance maladie sans pour autant supprimer tout reste à charge
Les assurés en ALD exonérante bénéficient d'un régime de prise en charge dérogatoire des prestations en nature de l'assurance maladie, qui vise à limiter leur reste à charge potentiel et à préserver leur assurabilité auprès des assurances maladies complémentaires.
Ainsi, les articles L. 160-14 et R. 160-11 du code de la sécurité sociale prévoient, sous conditions, la suppression du ticket modérateur pour les assurés en ALD. Les soins pris en charge dans ce cadre sont donc remboursés à hauteur des tarifs conventionnels.
Les assurés en ALD ne bénéficient pour autant pas, à proprement parler, de la gratuité des soins. Un reste à charge peut en effet survenir dans plusieurs situations, dont voici quelques exemples.
• Si l'inapplicabilité du ticket modérateur recouvrait, à l'origine, l'ensemble des soins dont bénéficiait un assuré en ALD exonérante, un décret673(*) a restreint, en 1986, ce champ aux seuls actes, prestations et traitements en lien avec une ALD exonérante674(*). Ces derniers sont prévus dans un protocole de soins, institué par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie675(*).
Les assurés en ALD exonérante s'acquittent donc du ticket modérateur sur l'ensemble des actes, produits et prestations sans lien avec la ou les pathologies leur ouvrant droit à ce régime.
Les prescripteurs sont, à ce titre, chargés de remplir une ordonnance bizone, distinguant les soins pris en charge à 100 % au titre de l'ALD et les soins sans lien avec cette dernière, pris en charge selon le droit commun.
Vers l'instauration d'un ticket modérateur pour les assurés en ALD ?
Le rapport Charges et Produits pour 2026 de l'assurance maladie a préconisé de « ne plus permettre la prise en charge à 100 % des prestations ou des produits de santé dont l'efficacité ne justifie pas ce remboursement intégral (par exemple, cures thermales »676(*), estimant que l'exonération de ticket modérateur sur ces soins « engendre non seulement un coût pour l'Assurance Maladie, mais peut également nuire à la qualité du parcours de soins en entretenant des usages de produits inadaptés ». Le rapport préconise donc de rembourser ces prestations « selon le droit commun pour tous les assurés y compris ceux qui bénéficient d'une exonération au titre d'une affection de longue durée ».
Le Gouvernement entend reprendre et adapter cette recommandation dans le cadre du présent PLFSS. Les mesures réglementaires de régulation visant à limiter l'évolution de l'Ondam, présentées dans l'annexe 5 au PLFSS pour 2026, comprennent en effet « l'alignement du taux de prise en charge de certains actes pour les personnes en ALD sur le taux des assurés hors-ALD (cure thermale et médicaments à faible service médical rendu) ».
300 millions d'euros d'économies annuelles sont attendus de cette mesure, qui constituerait une rupture en ce qu'elle rendrait, pour la première fois, un ticket modérateur applicable aux assurés en ALD, y compris sur les actes, produits et prestations en lien avec cette dernière.
• Les assurés en ALD peuvent également subir un reste à charge lorsque les tarifs des soins liés à leur ALD excèdent les limites conventionnelles, notamment en cas de dépassement d'honoraires.
• Les dispositifs de participation forfaitaire677(*) et de franchise médicale678(*) sont applicables aux assurés en ALD, dans la limite d'un plafond de 50 euros chacun679(*), qui pourrait bientôt évoluer680(*). Pour ce qui concerne les soins hospitaliers, les assurés en ALD exonérante doivent, comme les assurés de droit commun, s'acquitter du forfait hospitalier et du forfait patients urgences681(*), pour un montant minoré dans ce second cas.
ii. Un dispositif efficace pour limiter le reste à charge potentiel des assurés
Le dispositif des ALD exonérantes est considéré, selon la revue de dépenses précitée, comme « un des piliers de la solidarité de la sécurité sociale, tant par les assurés et leurs représentants que par les professionnels de santé », en raison de « l'utilité » et du « caractère protecteur du dispositif en matière d'accès aux soins ».
En 2022, le ticket modérateur acquitté par les assurés en ALD atteint ainsi en moyenne 7,5 % de leurs dépenses de santé en ville, et 3,1 % de leurs dépenses au titre d'actes ou de consultations en médecine, chirurgie ou obstétrique dans le secteur hospitalier public, à comparer avec des taux de 30,2 % et 13,9 % respectivement pour les assurés relevant du droit commun.
Ainsi, seul 18 % du reste à charge après AMO subi par les assurés en ALD l'est au titre de cette ALD, bien que les soins afférents soient souvent les plus fréquents et les plus coûteux.
Il en résulte, pour les assurés en ALD exonérante, un moindre renoncement aux soins pour des motifs financiers. La revue de dépenses réalisée par l'Igas et l'IGF affirme à cet égard qu'« à caractéristiques identiques, les personnes en ALD renoncent 2,5 fois moins aux soins que les autres ».
iii. Les assurés en ALD exonérantes représentent 70 % des prestations en nature versées par l'assurance maladie
Le dispositif des ALD exonérantes, particulièrement protecteur, justifie un effort massif de l'assurance maladie, dont les prestations en nature sont concentrées sur les assurés concernés.
L'assurance maladie a ainsi pris en charge 115 milliards d'euros d'actes, produits et prestations en faveur d'assurés en ALD exonérante en 2022, soit 70,4 % de ses dépenses totales au titre des prestations en nature.
Montant remboursé à des assurés en ALD et part dans la dépense totale en 2022
Source : Cnam
Cet effort s'explique à la fois par un effet d'assiette de prise en charge, dès lors que les ALD consomment en moyenne plus de soins et des soins plus coûteux, et par un effet de taux de prise en charge, lié à l'exonération du ticket modérateur sur leurs soins en lien avec leur pathologie.
Le coût spécifique des exonérations de ticket modérateur pour les assurés en ALD atteint 16,1 milliards d'euros en 2024, selon les données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).
c) Des conditions de prise en charge en espèces dérogatoires
Les assurés atteints d'une ALD exonérante bénéficient également de conditions de versement des indemnités journalières plus favorables que le droit commun.
Les indemnités journalières682(*), versées sous conditions683(*), assurent un revenu de remplacement aux assurés en incapacité de continuer ou de reprendre le travail du fait d'un accident ou d'une maladie et placés, à ce titre, en arrêt de travail par un professionnel médical684(*).
Si les conditions d'ouverture des droits et le montant des indemnités journalières est identique que l'assuré relève ou non d'une ALD, la loi prévoit un régime plus favorable pour les assurés en ALD en ce qui concerne la période d'arrêt indemnisable.
Les indemnités journalières versées aux assurés en ALD exonérante représentent environ 1 milliard d'euros en 2023, selon les données du rapport Charges et produits pour 2026.
i. Une dérogation au principe du délai de carence
En droit commun, les indemnités journalières ne sont servies qu'à compter d'un certain délai après l'arrêt de travail, appelé délai de carence685(*).
Ce délai, fixé en règle générale686(*) à trois687(*) jours688(*), correspond à une période d'arrêt de travail non indemnisée par la sécurité sociale. Le cas échéant, une couverture complémentaire prévoyance peut toutefois permettre un maintien de salaire partiel ou total durant cette période689(*).
Toutefois, l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés faisant l'objet d'un protocole de soins, notamment les assurés en ALD exonérante, ne se voient appliquer le délai de carence que pour le premier des arrêts de travail rendus nécessaires par la pathologie qui justifie leur statut, sur une période de trois ans.
Par conséquent, après avoir subi une fois le délai de carence pour un arrêt au titre de leur pathologie, les assurés en ALD exonérantes sont indemnisés par la sécurité sociale dès le premier jour pour chaque arrêt suivant et ce, pendant une durée de trois ans.
ii. Une durée de versement des indemnités journalières plus favorable que le droit commun
Outre l'encadrement du début de la période de versement des indemnités journalières, la loi régule la durée maximale de versement des IJ maladie sur une période donnée. À ce stade690(*), seules les IJ maladie sont concernées par des durées maximales de versement, les IJ AT-MP étant servies « pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation »691(*).
Pour les non-salariés agricoles692(*) comme pour les assurés du régime général693(*), 360 indemnités journalières peuvent être versées par l'assurance maladie, au plus, sur une période de trois ans décomptée de date à date694(*). Un assuré qui aurait déjà atteint ce seuil ne peut donc plus bénéficier d'indemnités journalières, jusqu'au troisième anniversaire de la première indemnité journalière versée sur la période.
Les assurés faisant l'objet d'un protocole de soins pour ALD se voient toutefois appliquer des règles plus souples, adaptées à leur situation médicale qui tend à justifier des arrêts plus longs ou plus fréquents.
Par dérogation, les assurés en ALD exonérante peuvent en effet bénéficier d'un déplafonnement des indemnités journalières, ce qui signifie que celles-ci peuvent être versées tout le long d'une période de trois ans.
Une fois épuisée cette période, les assurés en ALD doivent reprendre leur activité pendant un an avant de pouvoir à nouveau bénéficier d'indemnités journalières durant une période de trois ans695(*). S'il y a lieu, ces assurés peuvent également, à l'expiration du délai de trois ans, bénéficier d'indemnités journalières dans les conditions de droit commun.
2. Les ALD non exonérantes, des pathologies longues, mais dont la thérapeutique n'est pas nécessairement coûteuse, ouvrent droit à des prestations en espèces renforcées sans dérogation aux conditions de prise en charge en nature
a) Les ALD non exonérantes concernent des pathologies longues, mais non nécessairement coûteuses, principalement la dépression et les troubles musculosquelettiques
À côté du régime des ALD exonérantes, l'assurance maladie a développé la notion d'ALD non exonérante696(*) pour qualifier des pathologies qui, sans présenter une thérapeutique coûteuse leur permettant de relever des ALD 30, 31 ou 32, nécessitent une interruption de travail ou des soins d'une durée prévisible supérieure à six mois697(*). Il n'existe pas de liste de pathologies ouvrant droit à ce régime, qui concerne principalement des assurés atteints de dépression légère (33 % des situations) ou de troubles musculosquelettiques (32 %).
Selon les données de l'assurance maladie citées par la revue de dépenses précitée, 4,1 millions d'assurés relèveraient, en 2023, du régime d'ALD non exonérante au titre de l'une au moins de leurs pathologies698(*). Parmi eux, les trois quarts ne présentent par ailleurs aucune ALD exonérante.
b) Les ALD non exonérantes bénéficient des mêmes dérogations au droit des indemnités journalières que les ALD exonérantes, sans pour autant ouvrir droit à une exonération de ticket modérateur
• Les ALD non exonérantes tirent leur nom du fait que, contrairement aux ALD 30, 31 et 32, leur reconnaissance n'ouvre pas droit à une exonération de ticket modérateur sur les frais de santé afférents à la pathologie.
En matière de prestations en nature, le régime d'ALD non exonérante ouvre cependant droit à la prise en charge de frais de transport699(*) prévus par le protocole de soins, au taux de droit commun. Ce droit est ouvert sans base légale ou réglementaire claire700(*), dans la mesure où l'article qui porte ces dispositions ne se réfère pas explicitement aux ALD non exonérantes.
• Les assurés présentant une ALD non exonérante bénéficient des mêmes dérogations au droit des indemnités journalières que ceux atteints d'une ALD exonérante : application d'un seul délai de carence pour les arrêts en lien avec la pathologie sur une période de trois ans, et déplafonnement de la durée de versement des indemnités journalières701(*).
c) Une origine incertaine
Ce régime a été développé sans base juridique nette, par interprétation des textes de loi. En effet, les dispositions spécifiques aux affections de longue durée en matière de prestations en espèces se réfèrent aux « affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 »702(*) du code de la sécurité sociale, lequel prévoit l'élaboration d'un protocole de soins pour les patients « en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption du travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée », sans se référer explicitement aux ALD exonérantes.
L'assurance maladie a interprété cet article, dont l'objet était initialement tout autre, comme ouvrant droit aux assurés dont la pathologie justifie des arrêts de travail ou des soins continus d'une durée supérieure à six mois sans relever d'une ALD exonérante de bénéficier des dérogations prévues aux conditions de versement des prestations en espèces.
Les inspections générales
réclament une clarification
du régime des ALD non
exonérantes
Selon la revue de dépenses précitée des inspections générales des finances et des affaires sociales, « l'appellation « ALD non exonérante » introduit une confusion, avec une référence au dispositif ALD, alors qu'il s'agit de régimes bien distincts ». Par conséquent, la mission appelle à « distinguer plus clairement les situations relevant des ALD et des « ALD non exonérantes » en supprimant l'appellation « ALD non exonérantes ».
Elles appellent par ailleurs à clarifier son régime juridique aujourd'hui incertain, estimant que « la création d'un article législatif à ce sujet semble [...] pertinente ».
3. La procédure d'admission en affection de longue durée, commune aux deux régimes
La reconnaissance d'une pathologie comme affection de longue durée se fait à l'initiative d'un médecin703(*) ou de l'assuré lui-même704(*). La caisse locale d'assurance maladie d'un assuré peut également, lorsqu'elle constate que l'assuré est atteint d'une pathologie nécessitant une thérapeutique prolongée, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant pour envisager une reconnaissance comme ALD, exonérante ou non.
La demande de reconnaissance d'une pathologie comme ALD se fait à l'appui d'un protocole de soins705(*) révisable, rédigé par le médecin traitant706(*), qui indique notamment le projet thérapeutique à mettre en oeuvre707(*) et, lorsqu'une demande d'ALD exonérante est émise, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection ouvrant droit à exonération de ticket modérateur.
La décision est prise, sous un mois à compter de la réception du protocole de soins, par le directeur de la caisse locale d'assurance maladie après avis du service du contrôle médical. Elle est adressée à l'assuré et à son médecin traitant708(*).
La durée du statut dépend de la pathologie : elle est fixée à l'annexe à l'article D. 160-4 pour les ALD 30709(*). À défaut, elle est décidée en cohérence avec les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS).
Dans les faits, deux types d'admission sont mises en place : les admissions déclaratives, qui bénéficient d'un accord de principe, et les admissions argumentées. Ces dernières, qui représentent le quart des dossiers, sont soumises à un contrôle a priori du service du contrôle médical, et concernent trois ALD 30710(*), les ALD 31, les ALD 32 et les ALD non exonérantes.
Afin de bénéficier des prestations plus favorables auxquelles il a droit, l'assuré est ensuite tenu de se soumettre aux traitements prescrits par le médecin traitant et aux visites et contrôles organisés par la caisse, de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'accomplir les exercices prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
B. La dynamique des indemnités journalières est portée par les arrêts de travail longs dont bénéficient les assurés en ALD exonérante, sans pour autant que ce régime leur apporte le suivi nécessaire à leur état de santé
1. Les assurés en ALD, et notamment en ALD non exonérante, représentent une part importante des dépenses d'indemnités journalières
En 2023, plus de 4 milliards d'euros d'indemnités journalières maladie ont été versées aux assurés en ALD exonérante ou non, ce qui représente environ le tiers du budget total dédié à ce poste de dépenses.
Parmi elles, les dépenses liées à des ALD non exonérantes représentent le triple de celles liées à des ALD exonérantes, soit 3,17 milliards d'euros, répartis sur 401 000 arrêts.
Les arrêts de travail en ALD non exonérante sont particulièrement dispendieux pour l'assurance maladie : chacun représente en moyenne 7 900 euros d'indemnités journalières.
Cela s'explique par un facteur prix et un facteur volume. D'une part, les cadres sont surreprésentés au sein des assurés en ALD non exonérante, par rapport au profil moyen de l'assuré qui reçoit un arrêt de travail : cela implique des IJ renforcées pour chaque jour de versement.
D'autre part, les dérogations offertes à ces assurés en matière de durée de versement des IJ contribuent à un effet volume : on compte, parmi les assurés en ALD non exonérante, 160 000 arrêts longs supérieurs à six mois, soit plus du tiers du total pour les assurés concernés.
2. Les arrêts de travail des assurés en ALD non exonérante contribuent singulièrement à la dynamique non maîtrisée des indemnités journalières
Les indemnités journalières maladie présentent une dynamique peu maîtrisée, qui contribue à la dégradation de la situation financière de la branche711(*).
Leur taux de croissance annuel moyen, déjà peu soutenable sur la période entre 2017 et 2020 lors de laquelle il atteignait 4,7 %, n'a cessé de progresser depuis et atteint 6,5 % sur la période post-covid (+ 29 % en cumulé entre 2020 et 2024).
Leur montant augmente en moyenne de près de 750 millions d'euros chaque année de telle sorte que, selon le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, les IJ contribuent à elles seules pour 1,1 point de pourcentage à la croissance globale des dépenses de soins de ville.
Évolution du montant des IJ maladie hors covid depuis 2014
Source : Commission des affaires sociales d'après données 2023 à 2025 des rapports « Les dépenses de santé » de la Drees
Cette hausse est notamment causée par un allongement de la durée de versement des indemnités journalières, non sans lien avec l'allongement de la durée des arrêts de travail712(*). Selon la Drees713(*), les arrêts de plus de six mois, notamment liés aux ALD non exonérantes, représentent 7 % des arrêts, mais 45 % de la dépense d'IJ maladie du régime général.
Les ALD non exonérantes alimentent singulièrement ce phénomène : entre 2017 et 2022, les arrêts de travail longs prescrits à ces assurés ont prospéré, avec des hausses de 32,4 % pour les arrêts entre six mois et un an, 31,2 % pour les arrêts d'un à deux ans, et même 83 % pour les arrêts supérieurs à deux ans. Un tel phénomène ne se retrouve pas chez les arrêts des assurés en ALD exonérante, avec moins de 2 % de hausse des arrêts de travail entre six mois et deux ans prescrits entre 2017 et 2022.
Évolution du nombre d'arrêts de travail longs chez les assurés en ALD exonérante et non exonérante
Source : Rapport Charges et Produits pour 2026
3. Des inquiétudes quant au suivi des patients en ALD non exonérante à qui sont prescrits des arrêts de longue durée, parfois a contrario des recommandations scientifiques
Les arrêts de travail de longue durée entraînent, pour certains assurés, une perte de contact avec le monde médical, préjudiciable à leur santé, et une progressive désinsertion professionnelle, d'autant plus marquée que l'accompagnement proposé est insuffisant et le patient isolé.
C'est pourquoi les arrêts de plus de six mois, caractéristiques des ALD non exonérantes, doivent être surveillés de près.
Le manque de suivi médical est particulièrement préjudiciable pour les patients atteints de syndromes dépressifs, qui représentent plus du tiers des assurés en ALD non exonérante : c'est pourquoi « la HAS recommande un suivi médical régulier dans ces situations », comme le rappelle le rapport Charges et produits pour 2026.
Pour autant, le même rapport déplore que « le cadre actuel de prescription des indemnités journalières n'impose pas un suivi médical régulier de ces bénéficiaires [...] pourtant particulièrement concernés par les syndromes dépressifs (motif le plus fréquent) ».
S'ajoute à cela le risque qu'un arrêt prolongé, non suivi de mesures d'accompagnement, participe à l'éloignement des assurés du marché du travail en fragilisant les compétences professionnelles et en réduisant les opportunités de réadaptation. C'est pourquoi le rapport Charges et produits pour 2026 insiste sur l'opportunité de « favoriser le développement de la prescription de temps partiel thérapeutique lorsque cela est possible », afin d'offrir aux salariés concernés les conditions d'une reprise d'activité sereine et adaptée à leur pathologie.
C. Le dispositif proposé : la suppression du régime des ALD non exonérantes
L'article 29 du PLFSS prévoit de supprimer le régime des ALD non exonérantes, ouvrant droit à des dérogations en matière de durée de versement des indemnités journalières sans faire bénéficier aux assurés qui en relèvent d'exonérations de ticket modérateur.
Pour cela, l'article 29 modifie l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit lesdites dérogations au délai de carence et au délai maximal de versement des IJ pour les assurés présentant une ALD exonérante ou non.
Il substitue, en son I, aux renvois à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne les ALD exonérantes ou non, des renvois aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 du même code, qui ne concerne que les ALD ouvrant droit à une exonération de ticket modérateur.
Le II prévoit que les dispositions du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026, étant entendu que les assurés bénéficiant d'une reconnaissance en ALD non exonérante au 31 décembre 2025 continueraient de disposer des dérogations qui y sont associés jusqu'à épuisement des droits ouverts.
L'étude d'impact fixe les économies attendues de cette évolution à 100 millions d'euros en 2026, un total qui devrait progresser à mesure que s'éteignent les droits ouverts pour atteindre 400 millions d'euros en 2027 puis 600 millions d'euros en 2028.
La suppression des ALD non
exonérantes : une mesure préconisée
par le
rapport Charges et produits pour 2026
Dans son rapport Charges et produits pour 2026, la Cnam recommande notamment de « supprimer le régime dit d'« ALD non exonérante » au profit des deux régimes de droit commun (ALD ou non-ALD) avec, en parallèle, un renforcement des actions pour éviter la désinsertion professionnelle ».
La mesure portée à l'article 29 semble inspirée de cette préconisation, mais elle ne s'accompagne, ni dans le corps du dispositif législatif, ni dans les mesures réglementaires afférentes envisagées, nullement d'une évolution de l'engagement des pouvoirs publics pour prévenir la désinsertion professionnelle.
II. Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a adopté les amendements de suppression de Sandrine Runel et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, Sandrine Rousseau et ses collègues du groupe Écologiste et Social, Paul-André Colombani et ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Karine Lebon et ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine et Hadrien Clouet et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire.
Selon les auteurs de ces amendements, le dispositif d'ALD non exonérante recouvrirait une situation médicale définie appelant au maintien des dérogations applicables en matière de droit des indemnités journalières en raison de la plus forte exposition aux arrêts de travail des assurés concernés.
Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
L'évolution insuffisamment maîtrisée des indemnités journalières, dont le coût s'accroît de près d'un milliard d'euros par an, impose au législateur de prendre des mesures difficiles, dans une situation financière plus que jamais dégradée pour la branche maladie.
À cet égard, la commission observe que la progression de la dépense d'indemnités journalières est notamment tirée à la hausse par le régime des ALD non exonérantes, dont la création procède d'une interprétation des textes de loi en vigueur davantage que d'une volonté positive du législateur. Rappelons que les arrêts en lien avec une ALD non exonérante représentent aujourd'hui le tiers de la dépense totale d'indemnités journalières pour maladie.
Or le dispositif d'ALD non exonérantes est insuffisamment abouti en ce qu'il n'ouvre droit qu'à une révision des conditions d'indemnisation des arrêts de travail, sans prévoir de suivi spécifique ou d'accompagnement du retour à l'emploi. Comme le rappelle la Cnam, qui propose sa suppression dans son dernier rapport Charges et produits, le régime des ALD non exonérantes « n'offre aucun service d'appui à ces assurés » et fragilise les assurés qui en relèvent en les « maintenant éloigné[s] de l'emploi ».
S'ajoute la problématique du suivi médical des assurés : alors que plus du tiers des assurés placés en ALD non exonérante le sont pour des dépressions légères qui nécessitent, selon la HAS, un suivi médical régulier, le cadre actuel de ce régime n'impose pas un tel suivi, et peut renforcer l'isolement médical et social des assurés concernés.
Le régime des ALD non exonérantes apparaît donc contreproductif en plus d'être coûteux, en ce qu'il est susceptible d'enfermer les assurés qui en relèvent dans un cercle vicieux de désinsertion professionnelle, sans leur offrir les conditions propices à améliorer leur état de santé. En ce sens, il ne conduit qu'à différer dans le temps la survenue de la perte de revenus professionnels de l'assuré, le laissant sans solution lorsque le plafond d'indemnités journalières versé est atteint.
En outre, le maintien de ce régime entretient une confusion pour les assurés comme pour les professionnels de santé, tout en complexifiant inutilement la gestion des droits par l'assurance maladie.
Sa suppression permettrait au contraire de clarifier les parcours, de réorienter les patients vers un suivi adapté, et d'inscrire pleinement la prise en charge dans une logique de prévention et de réinsertion.
Toutefois, la commission estime inenvisageable d'adopter cet article si celui-ci n'est pas assorti de mécanismes de développement du temps partiel thérapeutique, d'un accroissement des garanties de prévoyance, ou de toute autre mesure d'accompagnement pour les assurés concernés.
La commission souscrit ainsi pleinement à l'analyse de la Cnam dans son rapport Charges et produits pour 2026, lorsqu'elle affirme que « favoriser le développement de la prescription de temps partiel thérapeutique lorsque cela est possible permettrait probablement à certains salariés ou indépendants une reprise d'activité dans de meilleures conditions ».
Alors que la santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025, il importe également, pour le Gouvernement et les partenaires sociaux, de lutter pour le bien-être au travail et la prévention des risques psycho-sociaux afin de limiter la survenue de dépressions liées à des conditions d'exercice professionnel défavorables, particulièrement fréquentes chez les assurés placés en ALD non exonérante.
L'article 29 n'offre aucune garantie quant au renforcement des modalités d'accompagnement accordées aux assurés. En l'état, la commission ne favorisera donc pas son rétablissement.
Limitée dans son initiative par les règles de recevabilité financière ou sociale qui seraient opposées à des amendements en ce sens, la rapporteure appelle le Gouvernement à travailler, en lien avec les partenaires sociaux, aux mesures d'accompagnement nécessaires afin de favoriser le suivi médical et le retour à l'emploi des assurés qui auraient été susceptibles de bénéficier du dispositif d'ALD non exonérante, le cas échéant par la voie de la formation professionnelle afin de réorienter les assurés vers des emplois plus adaptées à leur état de santé.
De telles mesures devront être mises en oeuvre d'ici fin 2027714(*), afin de ne laisser sans solution aucun assuré souffrant de pathologies psychiques ou de troubles musculosquelettiques faisant obstacle à la reprise du travail.
À condition d'avoir les garanties suffisantes sur la mise en oeuvre de dispositifs d'accompagnement assortis à la fin du régime des ALD non exonérantes, la commission soutiendra la réintroduction de l'article 29.
Dans l'attente, la commission propose de confirmer la suppression de cet article.
Article
30
Contribuer au financement de systèmes d'aide à la
décision médicale
Cet article propose soutenir le déploiement de systèmes d'aide à la décision médicale en allouant aux exploitants un financement tenant compte du montant des économies générées par l'utilisation de ces logiciels.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. OEuvrer à la pertinence des soins : une priorité de la convention médicale 2024-2029
1. La pertinence des soins : un gisement d'économies potentiellement élevées
a) La forte dynamique des dépenses de prescriptions médicales remboursables
La maîtrise médicalisée des dépenses de santé recouvre les diverses actions mises en oeuvre pour réduire les dépenses de santé inutiles, redondantes ou inefficaces, sans porter atteinte à la qualité des soins.
Elle contribue au respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) dont le montant est fixé en LFSS. Aujourd'hui intégrée à une approche plus globale de gestion du risque portée par la Cnam, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé constitue un modèle de régulation des dépenses de santé qui s'appuie sur deux leviers principaux : les tarifs et le nombre d'actes de soins.
Chaque année, des objectifs d'économies sont définis, pour les soins de ville et des établissements de santé, tenant compte du montant et de la dynamique des dépenses prescrites remboursables.
Or ces dépenses connaissent une évolution particulièrement dynamique ces dernières années. Entre 2019 et 2024, le montant des prestations soumises à prescription a progressé en moyenne de 5,5 % par an, avec une contribution relativement plus forte des prescriptions réalisées en établissement de santé (+ 8,3% par an en moyenne)715(*). En 2022, le montant des dépenses remboursables prescrites par les médecins s'élevait à 57 milliards d'euros, en hausse de 9 % depuis 2019 (+ 4,8 milliards d'euros).
Les médicaments constituent le principal poste de dépenses remboursables prescrites, à hauteur d'un tiers environ716(*), suivis des indemnités journalières et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (liste des produits et prestations ou LPP717(*)).
Répartition du montant des prescriptions
médicales remboursables
par poste de dépense, en
2022
Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de la Cnam
b) Des objectifs ambitieux de maîtrise médicalisée des dépenses inscrits dans les PLFSS successifs
Pour 2026, les prévisions de progression des dépenses de santé intègrent des actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude pour un rendement escompté de 900 millions euros sur les soins de ville718(*), soit un montant identique à celui présenté dans le PLFSS initial pour 2025.
À cet égard, il peut être relevé que le comité d'alerte de l'Ondam a plusieurs fois réitéré « son appréciation du caractère très incertain et circulaire de l'estimation du montant des économies de maîtrise médicalisée des dépenses de soins de ville »719(*), au regard notamment de la faible documentation de ces mesures par le Gouvernement et du dépassement systématiquement constaté du sous-objectif de l'Ondam portant sur les soins de ville.
Le PLFSS pour 2026 prévoit notamment 335 millions d'euros d'économies sur les produits de santé et 290 millions d'euros sur les indemnités journalières (cf. infra), contre 185 et 440 millions d'euros dans le PLFSS pour 2025.
Répartition des mesures de maîtrise
médicalisée et de lutte contre la fraude
en ville dans le
PLFSS pour 2026
Source : Annexe 5 du PLFSS pour 2026
2. Le plan d'action ambitieux de la nouvelle convention médicale en matière de pertinence et de qualité des soins
a) Quinze programmes d'actions partagés définis dans la convention médicale
Dans le cadre de la convention médicale signée le 4 juin 2024, les syndicats de médecins libéraux et l'assurance maladie se sont engagés à mener conjointement des actions relevant de quinze programmes de pertinence nommés programmes d'actions partagés720(*). À chacun de ces programmes est associé un objectif chiffré, dont certains sont présentés ci-dessous.
Pour leur bonne mise en oeuvre, les parties signataires de la convention ont réciproquement convenu de développer des actions pour faciliter l'atteinte des objectifs fixés. L'assurance maladie s'est notamment engagée à améliorer les retours d'information auprès des médecins et à mieux outiller les médecins pour encourager la juste prescription et soutenir la pertinence des soins. Par exemple, le relevé individuel d'activité et de prescriptions (RIAP) est aujourd'hui jugé peu ergonomique, ce qui a pour effet d'en limiter l'utilisation par les professionnels de santé ; ce RIAP serait remplacé par un relevé digitalisé, intégrant les données de suivi des indicateurs de pertinence de la prescription pour chaque médecin.
Exemples de programmes d'actions partagés inscrits dans la convention nationale signée entre l'assurance maladie et les médecins libéraux
|
Programmes |
Objectifs |
|
Actes d'imagerie |
Diminuer de 8 % les actes d'imagerie identifiés |
|
Actes infirmiers |
Réduire de 25 % les rejets et indus |
|
Transports sanitaires |
Atteindre jusqu'à 30 % de transports partagés |
|
Examens biologiques |
Réduire drastiquement les remboursements d'examens biologiques inutiles en diminuant d'au moins 80 % le nombre de ces actes |
|
Antibiorésistance |
Diminuer de 25 % en 2027 et de 10 % dès 2025 le volume d'antibiotiques prescrits et délivrés |
|
Analgésiques |
Diminuer de 10 % les volumes d'analgésiques de palier 2 prescrits et délivrés |
|
Biosimilaires |
Atteindre un taux de pénétration de 80 % de biosimilaires |
Les médecins libéraux s'engagent quant à eux à prescrire aux meilleurs standards de pertinence (respect des référentiels de la HAS, participation aux groupes d'analyse de pratiques, ...), à respecter le principe de sobriété des prescriptions et les qualités techniques des prescriptions (recours à l'ordonnance numérique, usage des téléservices de l'assurance maladie pour lutter contre les faux...).
L'utilisation de logiciels d'aide à la prescription et à la décision est mentionnée parmi les engagements de chacune des deux parties. En matière de lutte contre l'antibiorésistance, la convention fait par exemple référence à la mise à disposition des prescripteurs d'un outil d'aide à la décision thérapeutique par l'assurance maladie. En parallèle, le recours à des logiciels d'aide à la prescription référencés par l'assurance maladie constitue l'un des engagements des médecins libéraux pour diminuer la polymédication des patients.
• Les 15 programmes d'actions partagés pour la qualité et la pertinence des soins pourraient générer 1,14 milliard d'euros d'économies d'ici 2029721(*). Le détail de ces économies par programme n'est pas précisé.
Les économies qui pourront être dégagées dans ce cadre seront également réparties entre l'assurance maladie et les médecins. En effet, la convention prévoit : « Pour les programmes qui auront dépassé leur cible en 2027 et ce, jusqu'en 2029, les partenaires conventionnels conviennent que les économies supplémentaires résultant de cette performance seront partagées à part égale entre l'Assurance Maladie et les médecins. Cette incitation collective pourra prendre la forme d'une revalorisation transversale de la lettre clé de l'ensemble des médecins libéraux, selon des modalités qui seront définies le cas échéant par un avenant. »
b) Le rôle des logiciels d'aide à la prescription et à la décision médicale en matière de pertinence des soins : opportunités et limites
Les logiciels d'aide à la prescription et à la décision médicale peuvent constituer « un vecteur essentiel de transformation des pratiques »722(*) des professionnels de santé.
• Les logiciels d'aide à la prescription (LAP) ont pour finalité d'appuyer les praticiens dans leurs décisions de prescriptions.
Ces logiciels, certifiés selon les critères de la HAS et dotés d'un marquage CE/DM723(*), permettent d'élaborer et de sécuriser les prescriptions médicales en détectant les interactions médicamenteuses et les posologies inadaptées ou contre-indiquées. Quarante-sept LAP sont aujourd'hui certifiés par la HAS en médecine ambulatoire et un seul LAP en milieu hospitalier, sur le fondement du référentiel de mai 2021.
Les LAP historiques, ayant pour seule finalité l'édition et la sécurisation de prescription médicale, sont déployés depuis plusieurs années chez la majeure partie des médecins de ville. Leur interopérabilité avec les logiciels de gestion des cabinets facilite leur utilisation et la certification HAS en garantit les standards de qualité.
Toutefois, les LAP ne semblent pas avoir démontré de gain d'efficience dans la pratique clinique ou de pertinence dans les prescriptions. L'Agence du numérique en santé (ANS) indique que « leur utilisation, souvent perçue comme contraignante, souffre d'une ergonomie perfectible et d'un taux de désactivation élevé par des médecins qui y voient davantage une contrainte administrative qu'un véritable soutien. Si ces outils sécurisent, ils ne transforment pas la pratique médicale »724(*).
• De nouveaux outils logiciels ont émergé ces dernières années sur le marché du numérique en santé, dont la portée et l'ambition dépassent le secteur du médicament et la sécurisation des prescriptions : les systèmes d'aide à la décision médicale (SADM).
Les SADM intègrent les données cliniques du patient, les examens d'imagerie, de biologie, les dispositifs médicaux, les actes du parcours de soins et constituent une aide décisionnelle grâce à l'appui de l'intelligence artificielle qui accompagne leur développement. Ces logiciels, dotés d'une ergonomie supérieure à celle des LAP, sont ainsi « capables d'accompagner le clinicien du diagnostic à la prise en charge, en passant par l'optimisation des examens et la coordination des parcours »725(*). Toutefois, ces SADM demeurent le plus souvent des solutions logicielles indépendantes des LAP et des logiciels de gestion des cabinets.
Si les SADM sont soumis à la réglementation européenne en matière de sécurité et d'éthique - règlement général sur la protection des données personnels (RGPD) notamment -, aucun dispositif de certification spécifique n'a été prévu par le droit français, le marché de ces logiciels étant encore assez peu structuré.
B. Soutenir financièrement le déploiement de logiciels d'aide à la prescription et à la décision médicale
Il est proposé de créer un nouvel article L. 162-1-25 au sein du code de la sécurité sociale pour fixer un cadre autorisant le financement de logiciels d'aide à la prescription médicale (LAP), dans le cadre d'une convention conclue entre le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) et l'exploitant du logiciel.
• Le logiciel devrait présenter certaines garanties minimales, énumérées aux 1° à 3° du nouvel article :
- disposer d'un marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ;
- être certifié par l'Agence du numérique en santé726(*), ce qui suppose d'avoir été déclaré conforme aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique que l'agence élabore et met à jour, conformément aux articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique ;
- contribuer à l'amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins et favoriser l'atteinte d'objectifs fixés par les ministres de la santé. À cet égard, la nature des évaluations et comparateurs mentionnés par l'article comme étant susceptibles d'attester de la plus-value de l'outil apparaît relativement imprécise.
Il est supposé que ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de la stratégie ministérielle visée à la première phrase du nouvel article, sans qu'il ne soit établi si cette stratégie vise la feuille de route ministérielle du numérique en santé, celle que se fixent les partenaires conventionnels dans le cadre de la convention nationale 2024-2029, ou les deux.
En revanche, les logiciels susceptibles de bénéficier d'un financement seraient exonérés du respect des critères de certification fixés par la HAS, qui s'appliquent aux autres logiciels d'aide à la prescription. La HAS est en effet chargée d'établir la procédure de certification des LAP, sur le fondement de l'article L. 161-38 du code de la santé publique, laquelle participe à l'amélioration des pratiques de prescription des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. Toutefois, cette certification est facultative depuis que le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales et la société Philips France ont porté devant le Conseil d'État un contentieux tendant à l'annulation de l'obligation de certification des LAP et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale727(*). Seul s'impose donc le marquage CE.
Compétences de la HAS en matière de
certification des logiciels d'aide
à la décision
médicale
Extrait de l'article L. 161-38 du code de la santé publique :
« [...]
« II. [La HAS] établit également la procédure de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels intègrent les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits de santé et des prestations éventuellement associées au moment de la prescription et le montant total de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des génériques, au registre des médicaments hybrides ou à la liste de référence des groupes biologiques similaires et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.
« Cette procédure de certification participe à l'amélioration des pratiques de prescription des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. Elle garantit la conformité des logiciels à des exigences minimales en termes de sécurité, de conformité et d'efficience de la prescription.
« Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste pour les produits de la liste mentionnée à l' article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. [...] »
Selon l'étude d'impact jointe par le Gouvernement au projet de LFSS pour 2026 :
- les logiciels financés s'appuieraient obligatoirement sur les LAP qui garantissent la sécurisation de la prescription, sans nécessité de faire évoluer la certification ;
- seraient exclus de ce financement les dispositifs médicaux numériques déjà pris en charge au titre de la liste des actes et prestations sur le fondement de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, de la liste des activités de télésurveillance médicale sur le fondement de l'article L. 162-48 du même code, et de la prise en charge anticipée numérique prévue à l'article L. 162-1-23.
• Le montant du financement alloué à l'exploitant du logiciel serait lié aux économies générées grâce au recours à ce logiciel en matière de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire qu'il prendrait la forme d'un mécanisme d'intéressement de l'exploitant, ajusté selon le montant des économies constatées sur la consommation de soins. Un forfait de démarrage serait versé la première année, avant la mise en oeuvre d'une tarification à l'impact l'année suivante, sur la base des résultats constatés. Le montant du forfait de démarrage, estimé à 500 000 euros, aurait vocation à être récupéré dès l'application de la tarification à l'impact728(*).
Un décret en Conseil d'État déterminerait les conditions d'application de cet article, notamment la procédure de sélection des exploitants et les modalités du financement alloué.
II - Le dispositif transmis au Sénat
Outre trois amendements réactionnels du rapporteur général, deux amendements ont été adoptés :
- l'un729(*) rectifie l'intention du dispositif conformément à l'étude d'impact, en substituant la notion de système d'aide à la décision médicale à celle de logiciel d'aide à la prescription ;
- l'autre730(*) prévoit que ces outils ne peuvent servir à contrôler ni à évaluer les actions de ses utilisateurs.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article modifié par ces amendements adoptés par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La palette des LAP disponibles sur le marché s'est progressivement étoffée, intégrant de nouvelles fonctionnalités d'aide à la décision médicale. La mise au point de logiciels autonomes plus performants, recourant à l'intelligence numérique, peut constituer un outil utile et confortable pour les professionnels de santé. Elle peut également constituer une opportunité pour favoriser l'atteinte des objectifs fixés en matière de pertinence des soins, et un vecteur potentiel d'économies pour l'assurance maladie, quoiqu'aucune étude systémique n'ait été conduite et ne puisse donc l'attester. En tout état de cause, la mesure inscrite au présent article ne permet en elle-même aucune moindre dépense. Elle n'est qu'un outil visant à faciliter l'atteinte des objectifs inscrits dans la convention médicale de 2024.
• La commission a fait état de ses interrogations quant à l'impact concret de ces outils sur les pratiques médicales, en l'absence d'évaluation disponible et au regard des limites qui caractérisent les LAP traditionnels. L'appréciation de leurs potentialités nécessite donc une approche prudente et une remise en perspective dans un cadre global : on ne saurait par exemple attendre de ces outils qu'ils épuisent les enjeux de coordination des parcours ou de formation et de sensibilisation des professionnels de santé à la juste prescription.
Par ailleurs, la question de l'adhésion des praticiens à ces outils doit être posée. Moins de 20 % des médecins généralistes utiliseraient aujourd'hui les SADM731(*), qui demeurent relativement méconnus et très peu utilisés. Cette faible diffusion peut s'expliquer par le caractère encore émergent du marché des SADM, et par le fait que le coût de l'équipement numérique en ville repose directement sur les professionnels de santé. Quoi qu'il en soit, aucune donnée ne permet d'estimer de façon fiable sur un échantillon élargi l'adhésion des principaux acteurs concernés à ces logiciels.
Dans ce contexte, la proposition d'allouer une dotation de démarrage de l'ordre de 500 000 euros à des exploitants sélectionnés sur un nombre de critères limité pour des économies incertaines interroge immanquablement. Selon l'ANS, quatre entreprises ont développé des SADM répondant aux prérequis de l'article : Vidal, Synapse, Cegedim, Doctolib.
• Si la commission admet la nécessité de soutenir l'innovation pour favoriser la réalisation de gains d'efficience, elle a tenu à réaffirmer l'exigence prioritaire de sécurisation des pratiques. Celle-ci passe par des prérequis qualitatifs élevés. Or, l'article fixe des critères relativement peu contraignants, pouvant être jugés insuffisants pour justifier l'allocation d'un financement visant à généraliser l'utilisation de certains logiciels.
La commission constate que l'article n'impose pas de certification selon les critères de la HAS, ce qui aurait pourtant permis de garantir la qualité des SADM sélectionnés au regard des recommandations de la HAS et des avis médico-économiques. Elle a pris acte de l'initialisation par l'ANS de travaux d'élaboration d'un référentiel spécifique visant à garantir des critères de sécurité, d'éthique en matière de partage des données et d'interopérabilité. Si une certification par l'ANS lui semble être une condition indispensable à la sélection de logiciels candidats à cette procédure, le respect de référentiels validés par la HAS ne saurait être considéré comme secondaire.
En conséquence, la commission a jugé nécessaire de renforcer les garanties que devraient présenter ces logiciels et donc, les exigences de l'assurance maladie, en tant que financeur, vis-à-vis des exploitants qui recevront les financements. À cette fin, elle a entendu confier à la HAS le soin d'élaborer les référentiels ou des méthodologies d'évaluation de la pertinence pour fonder les décisions d'allocation des financements (n° 686).
• De façon générale, l'étude d'impact et la rédaction de l'article, imprécises, si ce n'est négligées, laissent le sentiment d'une mesure peu travaillée.
D'une part, l'étude d'impact du Gouvernement présente un chiffrage hasardeux et non documenté. D'autre part, l'article ne précise pas le périmètre sur lequel seraient déployés ces logiciels (ville ou établissements, échelle départementale, régionale ou nationale), ni les modalités de pilotage et de suivi du déploiement. Il ne dit rien des modalités d'évaluation des économies que pourraient générer ces logiciels, ni des conditions d'octroi du financement, de sa durée ou de son montant.
La commission a donc souhaité apporter une amélioration rédactionnelle à l'article (n° 685), préciser le modèle de financement (n° 688) ainsi que la nature des évaluations attendues au soutien de la demande de financement (n° 687), et prévoir que la durée maximale de financement du SADM était prévue par un décret en Conseil d'État (n° 689).
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 31
Sanctionner les manquements à l'obligation de
remplissage
et de consultation du DMP
Cet article propose de sanctionner les professionnels de santé en cas de manquement à leurs obligations de renseignement et de consultation du dossier médical partagé (DMP). Des sanctions sont également prévues pour les établissements ou services n'ayant pas mis en oeuvre les mesures permettant aux professionnels d'accomplir leurs obligations.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Le DMP, un outil globalement plébiscité pour favoriser la coordination des soins, mais encore sous-utilisé
1. Une lente consolidation de l'outil depuis 2016
• Le dossier médical partagé (DMP), véritable carnet de santé numérique, naît avec la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016732(*).
Cette loi confie à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) la conception, la mise en oeuvre et l'administration du DMP ainsi que celles d'un système de messagerie sécurisée.
Le DMP remplace alors le dossier médical personnel, créé par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie733(*), dont la mise en oeuvre a été un relatif échec, pour des raisons tenant tant à la complexité du dispositif qu'à l'inadéquation de sa gouvernance734(*).
La loi de 2004 prévoit déjà que les professionnels de santé exerçant en ville et en établissement de santé reportent dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. La loi du 26 janvier 2016 réaffirme cette règle et ajoute une obligation d'alimentation du DMP par le médecin traitant au moins une fois par an. La loi exige alors un consentement exprès de la personne pour créer un DMP.
• Avec la loi du 24 juillet 2019 dite OTSS, l'ouverture du DMP devient automatique pour chaque patient735(*), et le DMP est adossé à l'espace numérique de santé (« Mon espace santé »)736(*) à partir du 1er janvier 2022737(*).
Désormais, l'accès au DMP constitue un droit pour les patients tandis que son alimentation ainsi que sa consultation relèvent d'une obligation pour les professionnels de santé. Aux termes de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, « chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. [...] Le médecin traitant mentionné à l'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale doit verser périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. »
La liste des documents soumis à l'obligation d'alimentation du DMP et d'envoi par messagerie sécurisée a été fixée par arrêté ministériel738(*). Elle comprend notamment :
- la lettre de liaison en vue d'une hospitalisation, lorsqu'elle est dématérialisée ;
- la lettre de liaison de sortie d'hospitalisation ;
- le compte rendu des examens de biologie médicale mentionnées à l'article R. 6211-4 du code de la santé publique ;
- le compte rendu des examens radio-diagnostiques ;
- le compte rendu opératoire ;
- la prescription de produits de santé et d'examens de biologie médicale hors séjour hospitalier ;
- le volet de synthèse médicale réalisé par le médecin traitant au moins une fois par an ;
- les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé.
2. Une accélération du déploiement du DMP ces dernières années
En avril 2019, la barre des 5 millions de DMP ouverts est franchie, puis celle des 10 millions à la mi-2021. La dynamique d'activation des comptes reste alors toujours inférieure à l'objectif fixé par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la Cnam pour la période 2018 à 2022, qui prévoyait une cible de 40 millions de DMP ouverts.
• À partir de 2022, le changement d'approche des pouvoirs publics a permis une forte accélération du déploiement. 65,1 millions de comptes ont ainsi été ouverts dans le courant de l'année 2022 grâce à l'activation automatique des comptes des usagers.
Désormais, 97 % des assurés sociaux disposent d'un carnet de santé numérique ouvert et 50 % des documents de santé sont intégrés à Mon espace santé739(*).
Nombre de documents mis à disposition, par secteur, dans Mon espace santé (janvier 2021-septembre 2025)
Source : Agence du numérique en santé
L'Agence du numérique en santé indique en outre que près de 95 000 professionnels de santé libéraux, dont 67 000 médecins (hors radiologues), 17 000 pharmacies de ville et plus de la moitié des radiologues libéraux ont déjà déposé des documents dans Mon espace santé740(*).
• D'importants moyens financiers sont consacrés au soutien du déploiement du DMP.
D'une part, le Ségur du numérique en santé contribue au financement des mises à jour de logiciels pour l'alimentation et la consultation du DMP. Selon le Gouvernement, plus de 70 % des logiciels métiers des acteurs de santé auraient été mis à jour dans le cadre du Ségur du numérique, permettant aux professionnels de santé de communiquer aux patients des données de santé741(*). À l'hôpital, le Ségur du numérique permet de financer l'installation de nouvelles versions logicielles référencées Ségur par l'ANS, tandis qu'en ville, l'objectif est ainsi d'intégrer dans les logiciels de cabinet des fonctionnalités de partage des données de santé.
D'autre part, la Cour des comptes relève que « la Cnam devrait engager d'ici à 2027 un budget de l'ordre de 0,7 milliard d'euros au titre du développement des applicatifs du dossier médical partagé, de la messagerie sécurisée, de l'agenda partagé et de prestations d'hébergement confiées, après appel d'offres, à des prestataires. Ce chantier informatique est, à lui seul, le troisième chantier informatique le plus coûteux parmi ceux recensés par la direction interministérielle du numérique »742(*).
3. Des efforts à poursuivre
a) Une utilisation toujours en deçà des cibles
Malgré les investissements importants consacrés depuis plusieurs années au déploiement du DMP, celui-ci demeure notoirement sous-utilisé au regard des ambitions affichées.
• Plusieurs indicateurs témoignent de cette sous-utilisation persistante.
Si le nombre de comptes créés a explosé à partir de 2022, seuls 15 % des usagers ont activé le service, enregistré des documents ou complété leur profil médical en janvier 2024743(*).
Le nombre de documents versés au DMP demeure insuffisant au regard des cibles inscrites dans la feuille de route du numérique en santé, soit 250 millions de documents par an fin 2023 et 400 millions de documents fin 2026. Alors que toutes les données de santé devraient être versées au DMP pour que cet outil puisse véritablement jouer son rôle, seule la moitié des documents de santé est effectivement adressée aux patients dans Mon espace santé.
Enfin, la commission a déjà eu l'occasion de constater, lors de l'examen du PLFSS pour 2025, le niveau d'appropriation très variable du DMP, d'un secteur à l'autre et d'une profession à l'autre. Il reste ainsi relativement décevant dans le champ de la radiologie et des hôpitaux, a fortiori si l'on tient compte de l'accompagnement financier de ces derniers par les crédits du Ségur numérique. L'adhésion de la médecine de ville a toutefois connu une évolution positive à compter de l'été 2023, sur la base du nombre de documents versés à « Mon espace santé » (cf. graphique supra).
• Des difficultés techniques et logistiques majeures restent à lever.
La principale réside probablement dans la nécessité de développer l'interopérabilité des logiciels et des interfaces numériques. À cet égard, si la délégation du numérique en santé indique que plus de 280 types de logiciels ont été déployés, plus de 50 000 médecins équipés et que deux hôpitaux sur trois disposent d'un logiciel compatible744(*), le Conseil national de l'ordre des médecins fait état de réserves sur les conditions actuelles du déploiement du DMP, qui ne permettent toujours pas aux professionnels de s'en saisir745(*).
L'ergonomie des logiciels pour favoriser leur appropriation par les professionnels de santé constitue un autre enjeu essentiel pour garantir l'adhésion des principaux acteurs et favoriser l'utilisation du DMP. Il apparaît notamment indispensable d'oeuvrer à la hiérarchisation des documents et des informations versées au DMP. Aujourd'hui, les contraintes techniques et opérationnelles à l'utilisation du DMP continuent de peser sur les professionnels de santé.
Les fédérations des établissements de santé font aussi état de retards de déploiement préoccupants. La Fédération hospitalière de France (FHF) évoque « des dispositifs nationaux, portés par le volet numérique du Ségur de la Santé, [qui] n'ont [...] pas encore pleinement produit leurs effets, du fait notamment de retard de certains éditeurs »746(*), quand la fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (Fnehad) constate : « Les conditions actuelles pour le renseignement et la consultation du DMP ne sont pas pleinement effectives dans les établissements. [...] À l'heure de l'intelligence artificielle, il reste paradoxal que les systèmes hospitaliers et libéraux peinent à communiquer entre eux. Le succès du DMP repose donc sur une interopérabilité réelle et sur des outils ergonomiques facilitant la saisie et l'exploitation des données au bénéfice du patient »747(*).
Lever ces difficultés exige une implication forte des exploitants de logiciels, seuls à même de pouvoir faire évoluer les solutions informatiques disponibles sur le marché, avec l'appui de la délégation du numérique en santé (DNS) et de l'Agence du numérique en santé (ANS).
• Les obstacles organisationnels et culturels doivent également être pris en compte. En effet, le développement de nouveaux outils numériques ne suffit pas à transformer les organisations humaines et les pratiques soignantes. Ce changement doit être accompagné, à l'échelle individuelle et des territoires. Des programmes pilotés par la DNS et l'ANS doivent soutenir ces changements pour renforcer l'adhésion à l'utilisation du DMP.
b) La mobilisation récente d'incitations financières visant à renforcer l'utilisation du DMP
Des dispositifs incitatifs visant à renforcer l'utilisation du DMP récemment ont été promus.
• Ainsi, lors de l'examen du projet de LFSS pour 2025, la commission a entendu oeuvrer au renforcement de l'obligation d'utilisation du DMP par les professionnels de santé.
Par son article 48, la LFSS a subordonné la prise en charge par l'assurance maladie de certains produits de santé, prestations, actes ou transports particulièrement coûteux ou susceptibles de donner lieu à un mésusage à une preuve de consultation préalable du DMP par le professionnel de santé748(*). La commission a soutenu l'économie de cette mesure portée par la rapporteure de la branche maladie. Son application effective suppose désormais la définition par le Gouvernement des produits, actes et prestations entrant dans le champ du dispositif.
La commission avait par ailleurs proposé d'inscrire dans la LFSS d'autres mesures incitatives à l'utilisation du DMP par les professionnels de santé, en ville comme en établissement, en intégrant la consultation et le renseignement du DMP parmi les critères conventionnels de rémunération des professionnels libéraux et parmi les critères de l'incitation financière à la qualité (Ifaq) des établissements de santé. Le Conseil constitutionnel les a finalement censurées, jugeant leur impact sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie trop indirectes pour justifier leur place en LFSS749(*).
• Par ailleurs, la convention médicale signée entre l'assurance maladie et les médecins libéraux a prévu une dotation numérique (Donum) pour soutenir l'utilisation des solutions numériques sécurisées par les médecins libéraux et l'équipement des cabinets.
Cette dotation, qui se substitue au forfait structure prévu par l'avenant n° 9 à la convention médicale de 2016, constitue une aide financière calculée à partir d'indicateurs valorisant la pratique numérique des médecins libéraux. La cible concernant le taux de recours à l'espace numérique en santé, incluant l'alimentation du DMP et le recours à l'ordonnance numérique, est fixée par la convention à 30 % en 2026 et à 60 % en 2028.
|
Indicateur |
Cible 2026 |
Cible 2028 |
|
Moyenne des taux de recours à l'espace numérique en santé : alimentation du DMP, recours à l'ordonnance numérique |
30 % |
60 % |
Cet indicateur est toutefois optionnel et sa rémunération peu incitative. Une valeur maximale de 420 euros par an lui est associée750(*). L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue le 1er janvier 2026.
• Le Ségur du numérique dédie également des financements visant à soutenir le partage des données de santé. Le programme SUN-ES (Ségur usage numérique en établissement de santé) prévoit ainsi, au titre du Volet 1, de dédier 158 millions d'euros à l'alimentation de « Mon espace santé » et du DMP à l'hôpital en fonction de l'atteinte de cibles d'usage.
B. Renforcer l'obligation d'alimentation et de consultation du DMP par la pénalisation financière des professionnels
1. Renforcer les obligations pesant sur les établissements et structures de soins pour favoriser l'utilisation du DMP
a) De nouvelles obligations à la charge des structures de santé pour créer des conditions propices à l'utilisation du DMP par les professionnels de santé
• L'article propose, au 1° du I, de créer de nouvelles obligations à la charge des établissements, services et structures exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, consistant à mettre en oeuvre des « mesures matérielles, organisationnelles et d'information » permettant aux professionnels exerçant en leur sein de respecter leur obligation d'alimentation du DMP, conformément au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret en Conseil d'État aurait vocation à préciser les mesures concernées.
Ces dispositions feraient l'objet d'un deuxième alinéa à l'article L. 1111-15 précité.
b) La création de pénalités financières associées au non-respect des nouvelles obligations à la charge des structures de santé
• Un nouvel article L. 1111-15-2 serait créé pour sanctionner le non-respect des obligations qui incomberaient désormais aux établissements et structures exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.
Au terme d'une procédure contradictoire comprenant une mise en demeure de la structure concernée de présenter ses observations, en cas de manquement supposé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie pourrait prononcer une pénalité financière d'un montant maximal de 25 000 euros. Le montant total des pénalités appliquées au cours d'une année ne pourrait excéder 100 000 euros en cas de manquements successifs. Le montant de la pénalité tiendrait compte du volume d'activité de la structure, de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés.
L'article ne précise au regard de quels éléments le directeur de l'organisme local d'assurance maladie pourrait apprécier et constater un manquement.
• Conformément à un nouvel article L. 1111-15-3, les pénalités seraient recouvrées par l'organisme local d'assurance maladie et leur montant serait affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie. La décision du directeur de l'organisme local de l'assurance maladie pourrait être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement constitué pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
S'agissant des conditions de leur recouvrement, la référence aux huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale permet de prévoir :
- qu'en l'absence de paiement dans le délai fixé, la structure peut être mise en demeure de procéder au règlement de la pénalité et, en cas de non-paiement persistant, se voir opposer une contrainte comportant tous les effets d'un jugement et appliquer une majoration de 10 % du montant des pénalités dues ;
- la possibilité de procéder à des retenues sur les prestations à venir.
• Les dispositions relatives à l'obligation faite aux structures de santé de prendre toute mesure permettant l'utilisation du DMP et les sanctions financières associées à ces obligations entreraient en vigueur au plus tard le 1er mars 2027, conformément au IV.
2. Pénaliser financièrement les professionnels de santé en cas de manquement à leur obligation d'alimentation du DMP ou de non-respect des indications ouvrant droit au remboursement
a) La création de pénalités financières en cas de manquement à l'obligation d'alimentation du DMP
• Pour tirer les conséquences de l'obligation d'alimentation du DMP prévue au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, un nouvel article L. 1111-15-1 serait créé pour permettre de sanctionner financièrement les professionnels de santé ne respectant pas ladite obligation.
Comme pour les établissements et structures de soins, la pénalité financière pourrait être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie au terme d'une procédure contradictoire comprenant une mise en demeure du professionnel de présenter ses observations. Le manquement justifiant la pénalité serait apprécié et constaté au regard de seuils de report définis, par activité, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant maximal de la pénalité serait fixé à 2 500 euros par manquement et le montant total des pénalités appliquées au cours d'une année ne pourrait excéder 10 000 euros en cas de manquements successifs. Le montant de la pénalité tiendrait compte de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés.
Les dispositions du nouvel article L. 1111-15-3 relatives à l'affectation du produit des pénalités, aux modalités du recouvrement des pénalités et aux conditions d'exercice d'un recours juridictionnel contre la décision prononçant la pénalité seraient également applicables aux pénalités prononcées à l'encontre des professionnels de santé sur le fondement de l'article L. 1111-15-1.
Ces dispositions entreraient également en vigueur le 1er mars 2027 au plus tard.
b) La création de pénalités financières en cas de manquement à l'obligation de consultation du DMP préalablement à la prescription d'actes, de prestations ou de transports particulièrement coûteux
L'article propose enfin de sanctionner les professionnels de santé n'ayant pas respecté l'obligation de consultation du DMP préalablement à la prescription d'un produit de santé ou des prestations associées, d'un acte ou d'un transport de patient, particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou à risque de mésusage. À cette fin, il modifie l'article L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale et il crée un nouvel article L. 162-1-7-6 au sein du même code.
• En premier lieu, l'article L. 162-1-7-1 serait modifié pour supprimer les apports de la LFSS pour 2025, qui ont consisté à compléter l'article précité pour subordonner la prise en charge par l'assurance maladie de produits de santé, de prestations, d'actes ou de transports particulièrement coûteux à une preuve de consultation préalable du DMP établie par le prescripteur.
Il est ainsi proposé de supprimer, aux trois premiers alinéas de l'article, la condition de consultation préalable du DMP par le professionnel de santé pour garantir la prise en charge par l'assurance maladie de produits, prestations, actes ou transports particulièrement coûteux pour l'assurance maladie.
• En second lieu, un nouvel article L. 162-1-7-6 serait créé pour fixer une obligation de consultation du DMP préalablement à la prescription des produits, prestations, actes ou transports particulièrement coûteux, sans que cette consultation ne conditionne la prise en charge par l'assurance maladie ni qu'un document de preuve établi par le prescripteur soit exigible. La liste des actes et produits coûteux serait définie par un arrêté ministériel.
En cas de non-respect de cette obligation de consultation préalable du DMP, une pénalité financière pourrait être prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, au terme d'une procédure contradictoire comprenant une mise en demeure du professionnel de présenter ses observations.
Comme en cas de manquement à l'obligation d'alimentation du DMP, le montant maximal de la pénalité serait fixé à 2 500 euros par manquement et le montant total des pénalités appliquées au cours d'une année ne pourrait excéder 10 000 euros en cas de manquements successifs.
Des dispositions identiques à celles du nouvel article L. 1111-15-3 concernant l'affectation du produit des pénalités, les modalités du recouvrement des pénalités et les conditions d'exercice d'un recours juridictionnel contre la décision prononçant la pénalité sont prévues.
Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er juillet 2027 au plus tard, conformément au IV.
Elles sont rendues applicables à Mayotte par la coordination juridique effectuée au III.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
• Alors que le DMP devait être un outil essentiel à l'amélioration de la coordination des parcours, des prises en charge et à l'accès des usagers à leurs données de santé, les retards successifs de déploiement du DMP ne peuvent qu'être regrettés par la commission. Certes, le rythme de déploiement du DMP s'est nettement accéléré ces dernières années, mais il pâtit encore d'obstacles essentiellement techniques et organisationnels que les autorités en charge de son pilotage peinent manifestement à lever. Ainsi, face aux données encourageantes communiquées par l'assurance maladie et l'ANS, les professionnels de santé et les fédérations d'établissements font toujours état de difficultés qui s'éternisent et qui se soldent aujourd'hui par un bilan relativement décevant au regard des moyens engagés pour le déploiement du DMP, et de l'énergie consacrée à ce projet.
Dans ce contexte, la commission avait porté lors du dernier PLFSS des mesures incitatives visant à soutenir, autant que possible, l'utilisation du DMP par les professionnels équipés de logiciels interfacés et répondant aux prérequis techniques du DMP. De telles mesures devaient, a minima, lever les freins culturels et contribuer à évacuer les barrières tenant au manque persistant d'ergonomie de l'outil. Censurées par le Conseil constitutionnel en raison de leur effet jugé trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie, ces dispositions pourraient opportunément être insérées dans un autre véhicule législatif. En tout état de cause, elles se fondaient sur une logique bien différente de celle promue par le Gouvernement, en s'inscrivant dans une dynamique incitative plutôt que punitive.
• La commission prend acte de la volonté du Gouvernement de pénaliser les manquements aux obligations de renseignement et de consultation du DMP, dont le principe figure dans la loi depuis 2004. Cet article s'inscrit dans une logique punitive non dissimulée, et sanctionne indistinctement tous les acteurs de santé rendus responsables des défauts du DMP, qui pénalisent avant tout les patients et l'assurance maladie.
Elle prend acte également de la suppression proposée par le Gouvernement de dispositions introduites dans la loi lors de la dernière LFSS, à l'initiative de la commission, visant à subordonner la prise en charge par l'assurance maladie de certains produits de santé, prestations, actes ou transports particulièrement coûteux à une preuve de consultation préalable du DMP. Le Gouvernement fait part de complexités techniques à la mise en oeuvre de cette mesure, sans apporter davantage de précisions. Aucune chance n'aura donc été laissée à cette mesure adoptée il y a quelques mois par la représentation nationale. Elle aurait pourtant pu contribuer utilement à renforcer la consultation du DMP, sans pénaliser pour autant les professionnels de santé.
Au terme de ces considérations liminaires, la commission a fait état de plusieurs observations.
• En premier lieu, la place de cet article en LFSS lui apparaît discutable, dès lors que les mécanismes de pénalité financière sont considérés par le Conseil constitutionnel comme n'ayant pas d'impact direct ou seulement un impact trop indirect sur les recettes de la sécurité sociale. Au titre des pénalités financières, le Gouvernement escompte des recettes à hauteur de 15 millions d'euros environ. Par ailleurs, l'impact de la mesure en dépenses lié à une moindre redondance supposée des actes coûteux apparaît difficile à évaluer. Le Gouvernement envisage une très forte progression de ces moindres dépenses sur la période 2026-2028, passant de 5,2 millions d'euros en 2026 à 99,6 millions d'euros en 2027, puis à 298 millions d'euros en 2028. De l'aveu même du Gouvernement, ces estimations doivent être appréhendées avec précaution.
• En deuxième lieu, la commission s'est fait l'écho des représentants des médecins libéraux et des fédérations d'établissements de santé, qui déclarent unanimement souscrire à l'utilisation d'un DMP fiable et ergonomique, mais se sentent injustement ciblés par des pénalités infondées. Pour la Fédération des médecins de France (FMF), il s'agit d'« une mesure punitive, inutile, déconnectée des réalités, source de démotivation et d'hostilité supplémentaire contre un outil jugé trop défaillant »751(*). Elle évoque une « culpabilisation numérique » délétère alors même que l'outil souffre encore de nombreuses limites techniques.
À cet égard, la commission a relevé que le texte ne prévoyait aucune sanction spécifique à l'encontre des éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations. Nombre de logiciels de santé ne sont en effet toujours pas conformes aux prérequis légaux.
Ayant pris connaissance du calendrier de déploiement prévisionnel de logiciels référencés dans le cadre de la deuxième phase du Ségur numérique, elle a jugé profondément inadapté de fixer un cadre juridique visant à sanctionner les professionnels de santé pour défaut d'utilisation du DMP tant que les conditions techniques et organisationnelles relatives à son usage optimal ne seraient pas pleinement réunies.
Sur ce point, la FHF rappelle que « la généralisation effective des moyens techniques d'accès et d'identification, notamment via les outils d'authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu'à partir de 2027 ». Dans les établissements médico-sociaux, le calendrier est même encore plus tardif puisque le déploiement des dossiers patients informatisés référencés Ségur vague 2 ne devraient pas avoir pas lieu avant 2027 ou 2028. En conséquence, les conditions ne sont aujourd'hui pas remplies pour contraindre les professionnels de santé et les établissements à l'utilisation du DMP.
En conséquence, à l'initiative de sa rapporteure, la commission a adopté un amendement de suppression n° 690.
La commission propose de supprimer cet article.
Article
32
Lutter contre le gaspillage des produits de santé
Cet article propose deux mesures visant à lutter contre le gaspillage des produits de santé. L'une consiste en une expérimentation de re-dispensation de médicaments non utilisés au sein de certains établissements de santé. L'autre concerne la cession à titre gratuit de masques du stock stratégique de l'État, avant leur date de péremption, pour répondre aux besoins des établissements de santé et médicosociaux publics.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. La consommation des produits de santé, un enjeu de sobriété et d'efficience pour limiter les gaspillages de ressources
1. Un gaspillage qui présente un coût environnemental et financier conséquent
a) Un coût environnemental élevé
• En France, la consommation de produits de santé engendre chaque année 25 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit 48 % de l'ensemble des émissions du système de soin français752(*).
Les médicaments représentent 60 % de ce total annuel, soit 15 millions de tonnes, et les dispositifs médicaux 40 %753(*). Chaque année, environ 8 000 tonnes de médicaments non utilisés sont collectées en ville, auxquelles s'ajoutent 4 500 tonnes de déchets issus de médicaments, en particulier les emballages.
Le secteur pharmaceutique constitue donc un champ d'action prioritaire pour décarboner le système de santé, c'est-à-dire réduire son impact environnemental. À cet égard, la feuille de route ministérielle pour la planification écologique du système de santé a fait de la transition écologique des industries et des produits de santé l'un de ses huit objectifs-cibles pour contribuer à la neutralité carbone du secteur de la santé.
• L'exigence de réapprovisionnement régulier du stock stratégique de l'État est également une source de gaspillage important, dans les conditions actuelles de gestion de ce stock.
Alors que le volume cible des masques à conserver dans le stock sanitaire est désormais fixé à 2 milliards d'unités, la totalité des masques acquis pendant la crise sanitaire de la covid-19 sera périmée en 2026. La péremption de 1,2 milliard de masques est en effet programmée en 2025 et 2026, tandis que 715 millions de masques acquis pendant la crise de la covid-19 étaient déjà périmés fin 2024. Ces masques devront être prochainement détruits pour libérer les espaces de stockage saturés à 97 %754(*).
b) Un coût financier non négligeable mais difficile à objectiver
• Le coût financier que représentent les médicaments non utilisés n'est pas précisément évalué en France.
Alors que les dépenses de produits de santé remboursés par l'assurance maladie connaissent une dynamique importante, particulièrement marquée pour les médicaments, l'absence de données sur les médicaments non utilisés et sur les motifs de cette non-utilisation est préjudiciable à la définition d'actions stratégiques pour favoriser le bon usage des produits de santé et pour limiter la production de déchets évitables.
D'autres pays européens se sont d'ailleurs penchés sur ces enjeux et ont cherché à mesurer le coût des médicaments non utilisés. Ainsi, la valeur des déchets de médicaments collectés a été évaluée en Italie à environ 200 millions d'euros, soit 2,6% de la dépense nationale de médicaments, et à 300 millions de livres sterling en Grande-Bretagne755(*).
En France, la Cour des comptes estime que la valeur des médicaments non utilisés rapportés en officine pourrait s'élever à 674,5 millions d'euros, si l'on fait l'hypothèse que les médicaments les plus chers ne sont pas jetés, et à près d'un milliard et demi d'euros si l'on considère que tous que les médicaments sont représentés parmi les médicaments jetés, y compris les plus onéreux756(*). En tout état de cause, la Cour des comptes a recommandé d'améliorer la connaissance des produits de santé jetés en réalisant des études dédiées, en ville et dans les établissements de santé757(*).
Un projet de redistribution des médicaments
anticancéreux non utilisés
déposé par la
fédération Unicancer
Dans le cadre du dispositif France Expérimentation piloté par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la direction générale des entreprises (DGE), la fédération des centres de lutte contre le cancer (Unicancer) a proposé une expérimentation portant sur la redistribution des médicaments anticancéreux oraux non utilisés.
Ce projet répond à plusieurs objectifs : améliorer la continuité des soins face aux ruptures d'approvisionnement, réduire les pertes financières et diminuer l'impact écologique des activités de soins. Unicancer indique que « ce projet s'inscrit dans une démarche sociétale et environnementale à un moment où la pénurie des médicaments anticancéreux ne cesse de croître, menaçant la continuité des traitements des patients atteints de cancer »758(*).
La mise en oeuvre de ce projet nécessite toutefois un cadre législatif ad hoc, dérogeant aux dispositions législatives en vigueur. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a inscrit un projet d'expérimentation de nouvelle dispensation des médicaments non utilisés par les établissements de santé.
Ce projet fait écho à une étude menée aux Pays-Bas sur la réutilisation des médicaments anticancéreux par voie orale, dont les conclusions ont été publiées dans le JAMA Oncology en 2024759(*). Il en ressort une réduction de deux tiers des déchets de médicaments inutilisés grâce à la re-dispensation, associée à une économie annuelle nette moyenne de 576 euros par patient.
• S'agissant de la gestion des masques du stock sanitaire de l'État, au coût lié à la non utilisation des produits achetés s'ajoute celui de leur destruction, évalué à 5 millions d'euros pour 1,4 milliard de masques chirurgicaux et à 4 millions d'euros pour 700 millions de masques FFP2760(*).
2. Un cadre juridique et des pratiques à faire évoluer
a) Promouvoir la pertinence des soins et la sobriété des pratiques
La lutte contre le gaspillage des produits de santé passe inévitablement par un travail sur la pertinence des prescriptions et par une réflexion sur les conditions de délivrance des produits de santé. De nombreuses actions sont entreprises à ce titre, par la caisse nationale d'assurance maladie et par le ministère de la santé.
• La convention nationale signée le 4 juin 2024 entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux a notamment identifié parmi ses priorités d'actions le bon usage des produits de santé, incluant la pertinence des prescriptions et la réduction des actes et soins inutiles ou redondants, ainsi que la promotion de la sobriété des pratiques, qui vise à intégrer dans la pratique médicale quotidienne les enjeux environnementaux du système de santé.
Outre des engagements relatifs à la mise en oeuvre de quinze programmes d'action partagés en faveur de la pertinence761(*), la convention nationale a institué un bonus sobriété762(*), pouvant être versé aux médecins généralistes libéraux en fonction de leurs pratiques de prescription évaluées par un « ratio de sobriété »763(*). D'un montant de 1 000 euros, le bonus sobriété pourra être versé à compter de 2026 aux 30 % des médecins généralistes dont le ratio de sobriété aura été le plus faible en 2025, et à ceux dont le ratio aura diminué de plus de 10 % entre 2026 et 2025.
Extrait de la convention nationale organisant les
rapports
entre les médecins libéraux et l'assurance maladie
signée le 4 juin 2024
Article 66. Principe du dispositif sobriété
Afin d'accompagner la baisse de l'empreinte carbone des médecins conventionnés un « dispositif sobriété » est créé. Celui-ci vise à informer et sensibiliser les médecins généralistes sur leurs prescriptions de médicaments, et à récompenser les médecins les plus vertueux via la mise en place d'un « bonus sobriété ». Celui-ci, repose sur le calcul annuel d'un indicateur individuel pour chaque médecin, appelé ci-après ratio de sobriété.
[...]
Article 68. Méthodologie de calcul du ratio de sobriété annuel
[...] Le montant des prescriptions de chaque médecin généraliste est corrigé pour tenir compte des caractéristiques de sa patientèle médecin traitant selon la méthodologie décrite ci-après. Dans un premier temps, pour une année N, est calculé, pour chaque médecin généraliste, le montant remboursable total observé issu des prescriptions des médicaments entrant dans le champ de l'indicateur. Dans un second temps, pour cette même année, est calculé le montant remboursable total corrigé pour chaque médecin généraliste. Ce calcul est effectué en stratifiant sa patientèle médecin traitant selon quatre variables :
- patients avec une exonération au titre d'une affection de longue durée (oui/non) ;
- âge (< 45 ans ; 45-54 ans ; 55-64 ans ; 65-74 ans ; >= 75 ans) ;
- homme/femme ;
- bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (oui/non).
[...]
Article 69. Rémunération des médecins généralistes et modalités de mise en oeuvre du ratio de sobriété
En année N, pour souligner l'investissement en faveur de la sobriété des prescriptions, un bonus sobriété sera versé chaque année aux médecins généralistes :
- avec un ratio de sobriété inférieur ou égal au 3e décile, c'est-à-dire les 30 % des médecins avec le ratio de sobriété le plus faible en année N ;
- avec un ratio de sobriété compris entre le 3e et le 6e décile en année N et dont le ratio de sobriété a diminué d'au moins 10 % entre l'année N-1 et l'année N.
• Le think tank The Shift Project, dans un rapport récent sur la décarbonation du système de santé764(*), a formulé plusieurs pistes d'actions pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5 % par an jusqu'en 2050. Les conclusions de ce rapport, qui passe au crible les principaux secteurs émetteurs de carbone dont celui des médicaments, ont inspiré la feuille de route ministérielle relative à la planification écologique du système de santé.
La réduction des quantités de médicaments non utilisés est identifiée comme une piste d'action pour contribuer à l'objectif de réduction de 63 % des émissions de gaz à effet de serre générées par les achats de médicaments. Le rapport précise que cet objectif est associé à une baisse de 10 % du volume de médicaments vendus qui pourrait être obtenue « strictement par une réduction du gaspillage des produits de santé ».
Source : The Shift Project
b) Adapter le cadre législatif
Le cadre législatif en vigueur ne permet pas toujours de développer des actions innovantes pour contribuer à réduire le gaspillage des produits de santé. Des adaptations peuvent s'avérer nécessaires pour assouplir certaines dispositions ou prévoir un cadre expérimental spécifique, à l'instar de l'article 66 de la LFSS pour 2024 (cf. encadré infra).
• En premier lieu, la législation impose aux pharmacies à usage intérieur et aux pharmacies d'officine de collecter gratuitement et de détruire les médicaments à usage humain non utilisés qui leur sont rapportés.
Elle fixe en outre une interdiction de redistribuer ces médicaments ou de les mettre à la disposition des patients765(*). Une infraction à cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende766(*).
À législation constante, aucune re-dispensation de médicaments non utilisés ne pourrait donc être envisagée. Nombre de travaux ont pourtant été conduits sur le manque d'observance et les interruptions de traitements en cancérologie, que ce soit en raison de la toxicité des thérapeutiques, d'une évolution de la maladie justifiant une adaptation du traitement, ou d'un simple défaut d'observance par le patient.
• En deuxième lieu, la loi interdit à l'État, de même qu'à ses établissements publics, aux départements et aux communes, de procéder à toute aliénation de son domaine mobilier à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale767(*). Par exception, le code général de la propriété des personnes publiques dresse, à l'article L. 3212-2, la liste des cessions de biens mobiliers pouvant être réalisées gratuitement. En l'état actuel du droit, seuls sont autorisés les dons :
- à des États étrangers dans le cadre d'actions de coopération ;
- à des fondations ou à des associations faisant oeuvre d'assistance aux personnes les plus défavorisées ;
- à des établissements publics de l'État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics de biens meubles dont l'État n'a plus l'usage et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret.
La législation en vigueur n'autorise donc pas la cession à titre gratuit de produits de santé issus du stock stratégique de l'État à des établissements de santé ou à des établissements sociaux et médicosociaux. Le Haut Conseil de la santé publique et la Cour des comptes ont pourtant recommandé que soit mise en oeuvre une gestion dynamique plutôt que dormante du stock stratégique de l'État, appuyée sur des possibilités de cessions des produits à d'autres entités publiques.
L'expérimentation du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique : une mesure prévue en LFSS pour 2024 pour réduire l'impact environnemental des activités de santé
Afin de contribuer à l'objectif de décarbonation du système de santé, l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu une mesure d'expérimentation du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) pour une durée de deux ans.
Pour l'autoriser, l'article introduit dans le code de la santé publique une dérogation au principe d'interdiction du retraitement de DMUU, fixé à l'article L. 5211-3-2. En janvier 2024, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'inspection de l'environnement et du développement durable (Igedd) ont rendu leurs conclusions pour définir les conditions de mise en oeuvre d'une filière de DMUU retraités en France768(*). Les deux inspections ont, à cette occasion, souligné l'importance de mobiliser d'autres leviers de décarbonation du système de santé et d'agir le plus en amont possible de la filière des dispositifs médicaux, en travaillant avec les fabricants à l'éco-conception des dispositifs médicaux et en développant des dispositifs médicaux à usage multiple.
Un décret du 4 septembre 2025769(*) est finalement venu préciser les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation. Il fixe la liste des dispositifs pouvant être retraités et définit notamment les modalités applicables en matière d'information et d'opposition des patients. Les établissements de santé autorisés à participer à cette expérimentation pourront soit acheter des DMUU retraités auprès de fabricants de dispositifs médicaux en vue de leur réutilisation, soit faire retraiter les DMUU utilisés en leur sein par une entreprise de retraitement externe.
L'expérimentation doit débuter le 1er janvier 2026.
B. Favoriser le réemploi de certains produits de santé pour lutter contre le gaspillage
Le présent article propose deux mesures visant à lutter contre le gaspillage de certains produits de santé en favorisant leur réemploi.
1. Expérimenter la re-dispensation de médicaments non utilisés
• Le I du présent article fixe le cadre d'une expérimentation visant à autoriser une nouvelle dispensation de médicaments non utilisés au sein d'établissements de santé publics ou privés à but non lucratif ou à but lucratif.
Dans la mesure où les médicaments concernés par l'expérimentation devraient figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, cette dispensation serait restreinte au cadre de la rétrocession.
L'expérimentation durerait trois ans, à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État.
Une liste limitative d'établissements autorisés à y participer serait fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, les pharmacies à usage intérieur (PUI) de ces établissements étant chargées du conditionnement ainsi que du contrôle des médicaments collectés en vue de leur re-dispensation.
Les patients seraient obligatoirement informés de toute re-dispensation et bénéficieraient d'un droit d'opposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
Seraient également définies par décret en Conseil d'État la liste des médicaments entrant dans le champ de l'expérimentation, les conditions de leur conditionnement, de leur collecte et de leur nouvelle dispensation par les PUI, les obligations spécifiques de sécurité et de contrôle incombant aux PUI ainsi que le cadre méthodologique général de l'expérimentation.
• Tout en indiquant que « le rapport coût-bénéfice entre destruction et re-dispensation [...] n'est probablement favorable que sous certaines conditions précises », le Gouvernement considère que ce cadre expérimental permettra de « tester le dispositif, qui pourrait être source d'économies substantielles pour l'assurance maladie, tout en prévenant tout risque de falsification, de trafic ou d'abus »770(*).
À cet égard, les conditions de mise en oeuvre qui seront définies par voie réglementaire apparaissent déterminantes pour évaluer l'opportunité de la mesure (liste des médicaments concernés, procédures garantissant l'intégrité et la qualité des médicaments, traçabilité, critères d'évaluation).
Les économies potentielles associées à cette mesure sont estimées à 150 000 euros annuels.
2. Autoriser la cession à titre gratuit de produits issus du stock stratégique de l'État avant leur péremption
Les II et III du présent article visent à autoriser la cession à titre gratuit de produits issus du stock stratégique de l'État, achetés pour faire face aux menaces sanitaires graves.
• Le II propose d'inscrire une nouvelle dérogation à l'interdiction faite à l'État de céder ses biens meubles à titre gratuit, en complétant l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques d'un 12°.
Serait ainsi autorisée la cession à titre gratuit de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, acquis par Santé publique France au titre de la constitution et de l'entretien du stock sanitaire de l'État.
Cette nouvelle dérogation permettrait de céder des masques avant leur date de péremption, pour éviter leur destruction et répondre notamment aux besoins des hôpitaux publics et des établissements médico-sociaux publics. Outre ces établissements, pourraient bénéficier d'une cession à titre gratuit les établissements publics de l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public.
• Le III modifie par ailleurs l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, qui précise les missions qu'exerce Santé publique France au titre de la préparation et de la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires771(*).
Aux termes de l'article précité, à la demande du ministre chargé de la santé, Santé publique France est chargé de procéder « à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction. » Il est donc proposé d'ajouter à ces missions la cession à titre gratuit de ces mêmes produits, dans les conditions prévues au nouveau 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
• La commission souscrit à l'ambition générale de décarbonation du système de santé. Pourtant, au-delà des mesures d'affichage, elle partage la circonspection de l'Igas et l'Igedd pour lesquelles « les moyens et la gouvernance retenus pour mettre en oeuvre la planification écologique du système de santé méritent d'être questionnés. Avec 0,5 ETP en charge de la transition écologique au sein du ministère de la santé, [...] la feuille de route reste essentiellement portée au niveau des cabinets. [...] Le défaut d'expertise et d'accompagnement ne favorisent pas un passage à l'échelle des actions les plus pertinentes »772(*). Déplorant la présentation de mesures isolées, de faible envergure et peu préparées au surplus - elle rappelle qu'il aura fallu deux ans entre le vote de l'expérimentation du retraitement des DMUU et le démarrage de sa mise en oeuvre -, la commission appelle plutôt à l'engagement d'un plan d'action systémique et structuré, appuyé par des compétences dédiées, sur la base d'orientations politiques claires.
• S'agissant de l'expérimentation de nouvelle dispensation des médicaments non utilisés, la rapporteure a exprimé d'importantes réserves et une inquiétude quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait se dérouler.
Outre que les modalités de sécurisation du circuit du médicament pour la conduite de l'expérimentation n'ont pas été définies, les prérequis de base ne semblent aujourd'hui pas réunis dans les établissements de santé, en particulier concernant la traçabilité de médicaments hors champ hospitalier. En effet, les syndicats de pharmaciens hospitaliers ont alerté la rapporteure sur l'absence de sécurisation du circuit du médicament pour des médicaments d'origine non hospitalière, et fait état de leurs inquiétudes dans la perspective d'un déploiement de l'expérimentation.
Or, la mise en oeuvre d'une telle expérimentation nécessite que l'intégrité des produits pharmaceutiques soit pleinement garantie. Le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) souligne à cet égard l'exigence d'« une traçabilité renforcée via des systèmes numériques adaptés, des systèmes supplémentaires de traçabilité de la température sur chaque conditionnement et un système d'inviolabilité pour assurer l'intégrité des médicaments apposés lors de la dispensation initiale ». Le syndicat national des pharmaciens des établissements de santé (Synprefh) relaie les mêmes alertes : « une fois qu'un médicament a quitté la pharmacie ou l'hôpital, il devient impossible de garantir ses conditions optimales de conservation (température, humidité, exposition à la lumière...). Même lorsque l'emballage paraît intact, des altérations invisibles peuvent affecter la stabilité ou l'efficacité du produit ». La mise en oeuvre de l'expérimentation envisagée supposerait de pouvoir évacuer ces difficultés, au risque sinon de compromettre la qualité des médicaments et donc, la sécurité des patients. Aucune garantie n'est pourtant apportée quant aux modalités de son déploiement et d'accompagnement des établissements qui seront sélectionnés. La rapporteure a donc émis de vives réserves sur ces dispositions.
En parallèle, la rapporteure a rappelé que d'autres solutions permettraient d'atteindre des objectifs de moindre gaspillage des produits de santé et d'efficience de la dépense. Elle a notamment insisté sur l'enjeu de rationalisation des prescriptions de médicaments, qui pourrait être soutenu par l'emploi de logiciels d'aide à la décision médicale, ainsi que sur la nécessité d'un travail sur le conditionnement des médicaments, en lien avec les laboratoires pharmaceutiques et en cohérence avec les posologies recommandées. De tels travaux ont pu aboutir pour certains opioïdes, conformément aux recommandations de l'ANSM. Ils mériteraient d'être poursuivis pour d'autres médicaments très utilisés ou très coûteux, pour lesquels des interruptions de traitement sont régulièrement observées, en raison d'un défaut d'observance ou en cas d'adaptation des traitements, comme cela peut survenir en cancérologie.
Diverses raisons peuvent en effet expliquer la non-utilisation de médicaments prescrits. Celle-ci peut résulter d'un conditionnement inadapté à la durée de prescription, d'un défaut d'observance, d'une modification ou d'un arrêt de traitement, mais aucune étude ne permet de les objectiver en France. La rapporteure a préconisé de dresser un état des lieux en la matière, pour déterminer les solutions les plus adaptées à la lutte contre le gaspillage des produits de santé.
En tout état de cause, elle a regretté la présentation d'une mesure trop peu expertisée techniquement, pour un rendement pour le moins modeste, évalué à 150 000 euros. Elle a également alerté sur les risques que comporterait une transposition de cette expérimentation à la ville, comme l'ont proposé plusieurs députés par amendement. En conséquence, la rapporteure a demandé au Gouvernement de prendre ses responsabilités, en donnant aux acteurs hospitaliers les moyens de réussir cette expérimentation, sans mettre en danger les patients. Elle l'engage à ne pas se précipiter, et à travailler en étroite concertation avec les syndicats de pharmaciens hospitaliers.
• Par ailleurs, la commission a soutenu la mesure visant à autoriser la cession à titre gratuit de masques du stock stratégique de l'État à des établissements de santé et médicosociaux publics.
Elle a toutefois rappelé qu'un dispositif similaire avait été inséré dans la LFSS pour 2022 et que le Conseil constitutionnel l'avait censuré773(*).
Selon le Gouvernement, l'économie maximale annuelle induite par la mesure serait stable et pérenne à partir de 2029, à hauteur d'environ 40 millions d'euros. En raison des faibles sorties du stock entre 2026 et 2028, l'économie est estimée respectivement à 1 millions d'euros, 4 millions d'euros et 17 millions d'euros pour ces trois années.
Cette mesure de bonne gestion a fait l'objet d'une recommandation de la Cour des comptes, qui préconise également de prévoir l'organisation du circuit de distribution avant la péremption des masques, selon les besoins des hôpitaux publics. Toutefois, la commission a tenu à souligner que cette mesure devait s'inscrire dans un cadre de réapprovisionnement sécurisé des stocks de l'État, pour prévenir toute indisponibilité temporaire de stock, en cas de survenue d'une crise sanitaire non anticipée. Or, le réapprovisionnement peut subir des aléas de délais et être retardé pour divers motifs. Santé publique France fait d'ailleurs état d'un retard sur la réception des commandes passées en septembre 2024 pour un total de 917 millions de masques, lié à des contraintes de production relatifs aux volumes commandés et à des non conformités observées à la réception. Ainsi, pour garantir le maintien d'un niveau de stock correspondant aux cibles validées par le ministère, il conviendrait de s'assurer que toute sortie de stock soit précédée d'une entrée de stock équivalente et d'organiser les flux d'entrée et de sortie dans les délais les plus courts possible pour optimiser la gestion des espaces de stockage.
Pour sécuriser la gestion des stocks stratégiques, la commission a adopté un amendement n° 691 à l'initiative de sa rapporteure prévoyant que les conditions de cession à titre gratuit de produits de santé issus du stock de l'État ne doivent pas conduire à diminuer, même provisoirement, l'intégrité de ce stock.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article
33
Améliorer la pénétration des biosimilaires et des
génériques en ville
Le présent article vise à appliquer aux médicaments biosimilaires plusieurs dispositifs utilisés pour encourager le recours aux génériques afin d'en favoriser le taux de pénétration. Il prévoit notamment :
- un mécanisme de tiers payant contre biosimilaires et hybrides et d'avance de frais par le patient s'il refuse cette délivrance ainsi ;
- la mise sous tarif ajusté deux ans après l'inscription d'un biosimilaire au sein d'un groupe donné. Ainsi, le remboursement du médicament bioréférent sera fondé sur la base du biosimilaire le plus cher, laissant à la charge de l'assurée, en cas de refus de substitution et sauf justification médicale, la différence entre ces deux prix.
La commission propose d'adopter cet article avec modifications.
I - Le dispositif proposé
A. Le marché des biosimilaires : un secteur en fort développement et source d'économie pour l'assurance maladie
1. Les médicaments biologiques et biosimilaires
On distingue deux grandes familles de médicaments : les médicaments chimiques - les plus anciens - et les médicaments biologiques.
Les médicaments chimiques sont fabriqués à partir de la synthèse de composés chimiques. Les médicaments génériques sont des médicaments identiques à un médicament de référence, appelé princeps, ayant perdu son brevet. Ils constituent une source d'économie, car leur prix est plus faible que celui du médicament de référence (ou « princeps »). Les médicaments « hybrides » quant à eux correspondent aux médicaments qui ne répondent ni à la définition de médicaments de référence ni à celle de générique en raison d'une différence par rapport à la spécialité de référence. Ils permettent également de diminuer les coûts pour l'Assurance maladie et d'augmenter le nombre de médicaments disponibles sur le marché limitant ainsi le risque de rupture.
Selon le rapport « Charges et produits » de la Cnam paru en juillet 2025, les médicaments génériques représentaient en 2024 44 % des boîtes vendues en officine et 54 % des médicaments délivrés en établissement de santé pour des dépenses de remboursement de 4,3 milliards d'euros774(*).
Selon la définition de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), « un médicament biologique est une substance produite à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant ou dérivée de ceux-ci »775(*). Le biomédicament de référence ou « bioréférent » est le premier biomédicament autorisé pour une substance donnée et protégé par brevet. Les laboratoires pharmaceutiques développent par la suite des médicaments dits « biosimilaires », sur le même schéma que les génériques pour les médicaments chimiques, comparables au « bioréférent ». Ces biosimilaires peuvent être commercialisables une fois le brevet du bioréférent expiré.
Toutefois, comme le précise l'ASNM « du fait de leur procédé de production, les médicaments biosimilaires ne peuvent être strictement identiques aux produits de référence ; le principe de substitution, valable pour les médicaments chimiques et les génériques qui sont leurs copies, ne peut pas s'appliquer automatiquement »776(*). Dès lors, un médicament biosimilaire n'est pas une copie parfaite de son médicament de référence. Cette différence explique que pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, le médicament biosimilaire doit fournir des études et données supplémentaires à celles nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un générique d'un médicament chimique. L'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments biosimilaires est délivrée par la Commission européenne, selon une procédure centralisée au sein de l'Union européenne, après évaluation par l'Agence européenne des médicaments (EMA).
L'ensemble formé par un bioréférent et ses biosimilaires constitue un « groupe biologique similaire », tel que défini dans la « liste de référence des groupes biologiques similaires » fixée par l'ASNM. Au 1er novembre 2025, cette liste comporte 24 groupes biologiques similaires777(*). Les médicaments inclus dans chacun de ces groupes sont précisés avec pour chacun d'entre eux le nom, son dosage, sa forme pharmaceutique, le nom du titulaire de l'AMM, sa ou ses indications thérapeutiques, sa posologie et, le cas échéant, les excipients à effets notoires qu'il contient.
Parmi ces 24 groupes biologiques similaires, 9 sont substituables par le pharmacien d'officine778(*). L'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, prévoit que l'ANSM rend un avis au ministre sur les modalités de cette substitution. C'est dans ce cadre que l'ANSM s'est prononcée favorablement sur la substitution au sein de six groupes de biosimilaires779(*). En revanche, elle a émis des avis défavorables sur la substitution au sein de trois autres groupes780(*).
L'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique encadre les conditions dans lesquelles le pharmacien peut substituer un médicament biosimilaire à un médicament biologique de référence :
- celui-ci appartient au même groupe biologique similaire que le médicament prescrit ;
- le prescripteur n'a pas exclu cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance ;
- ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient, fixée par arrêté après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Les conditions générales de substitutions sont rappelées par les arrêtés fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables.
Extrait de l'arrêté du 20 février 2025 fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient telles que prévues au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique
« 1° Les conditions générales de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de la substitution des spécialités applicables à l'ensemble des groupes listés en annexe sont les suivantes :
- le prescripteur informe le patient de la possibilité de substitution par le pharmacien du médicament biologique prescrit ;
- le pharmacien informe le patient lors de la dispensation de la substitution effective et des informations utiles associées, dont le rappel des règles de conservation de la spécialité dispensée ;
- le pharmacien mentionne sur l'ordonnance le nom du médicament effectivement dispensé ;
- le pharmacien informe le prescripteur quant au médicament dispensé ;
- le pharmacien procède à l'enregistrement du nom du médicament délivré par substitution et son numéro de lot par tous moyens adaptés afin de mettre en oeuvre la traçabilité requise pour tous les médicaments biologiques ;
- le pharmacien assure la continuité de la dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes. »
2. Un secteur en forte croissance
Les dépenses liées aux médicaments biologiques ont très fortement progressé, passant de 6 milliards d'euros en 2017 à 14 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 127 % en sept ans. Cette évolution se constate au niveau mondial. Comme l'indique l'Assurance maladie dans son rapport Charges et produits pour 2026 : « le panorama des médicaments les plus vendus au monde en 2024 met en lumière une tendance structurelle : la domination progressive des médicaments biologiques, aussi bien en matière de chiffre d'affaires que de réponses thérapeutiques innovantes dans de multiples aires thérapeutiques ».
En 2024, les dépenses remboursées liées aux médicaments appartenant aux groupes de médicaments pour lesquels au moins un biosimilaire est commercialisé représentent 2,9 milliards d'euros, dont 1,48 milliard d'euros pour les médicaments biosimilaires.
3. Un taux de pénétration encore limité malgré un engagement des pouvoirs publics en ce sens
Malgré ces avantages économiques, les biosimilaires peinent encore à s'imposer sur le marché français. Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de 2017, la Cour des comptes estimait ainsi qu'en prenant pour hypothèse une substitution à 80 % des huit principaux biomédicaments dont le brevet arrivait à expiration avant 2020, l'assurance maladie pourrait économiser plus de 680 millions d'euros. Plus récemment, l'assurance maladie a indiqué que « dans le contexte actuel de contraintes budgétaires pesant sur notre système de santé, les médicaments biosimilaires représentent un levier d'efficience considérable pour l'Assurance maladie. Leur développement constitue un enjeu stratégique tant sur le plan économique que sur celui de l'accès aux soins »781(*). Au-delà des seuls bénéfices financiers, les biosimilaires permettent également de sécuriser l'approvisionnement en diversifiant les sources de production.
C'est pourquoi depuis plusieurs années, de nombreuses dispositions ont été mises en place pour soutenir et favoriser la diffusion des biosimilaires.
On peut notamment citer :
- le dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription des médicaments biosimilaires, issu de la négociation conventionnelle et entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il concerne l'ensemble des médecins libéraux conventionnés. Il prévoit un intéressement annuel valorisant l'augmentation du nombre de patients auxquels sont prescrits des médicaments biosimilaires.
- les dispositifs d'encouragement à la substitution par le pharmacien :
• la LFSS pour 2022 a réintroduit la possibilité, pour les pharmaciens d'officine, de substituer un médicament biosimilaire au médicament biologique prescrit, sous certaines conditions (cf. supra) ;
• En application de l'article 54 de la LFSS pour 2024, la liste des groupes biologiques substituables doit être arrêtée, sauf avis contraire de l'ASNM, au plus tard deux ans après la perte de brevet des médicaments bioréférents et l'inscription au remboursement du premier médicament biologique similaire. L'article 77 de la LFSS pour 2025 a réduit ce délai à un an. Ce dispositif accélèrera l'extension du champ des médicaments biosimilaires substituables. L'extension de 2 à 9 groupes substituables en 2025 pourrait générer en 2026 près de 130 millions d'euros d'économie pour l'assurance maladie782(*);
• L'élargissement du dispositif incitatif de rémunération sur objectif de santé existant pour les médicaments génériques aux médicaments biosimilaire et hybrides.
Pourtant, l'évolution du taux de pénétration reste en deçà des objectifs, particulièrement en ville où ce taux n'était que de 34 % en 2024 contre 90 % à l'hôpital, soit un taux de pénétration global de 47 %.
Toutefois, l'annexe 9 du PLFSS 2026 précise que le taux de pénétration sur les douze mois glissants entre août 2024 et juillet 2025 est égal à 52 %, soit une augmentation conséquente mais toujours en deçà de l'objectif plancher de 80 %.
B. Faciliter la pénétration des biosimilaires en ville
Dans ce contexte, le présent article vise à appliquer aux médicaments biosimilaires plusieurs dispositifs utilisés pour encourager le recours aux génériques afin d'en favoriser le taux de pénétration.
Il prévoit :
• un mécanisme de tiers-payant contre biosimilaires et hybrides et d'avance de frais par le patient s'il refuse cette délivrance.
Ce dispositif existe pour les médicaments génériques depuis 2007 et généralisé en 2012. En application de l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, le tiers payant est réservé aux patients qui acceptent la dispensation de médicaments génériques, lorsqu'il en existe, pour la spécialité de référence qui leur est prescrit. Le tiers-payant reste applicable, même en cas de refus de substitution :
- si le prix du générique commercialisé dans le groupe est supérieur ou égal à celui du princeps ;
- si la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient. En application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la non-substituabilité doit être indiquée « par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance » couramment dénommée mention « non substituable »;
- si le médicament d'origine appartient à un groupe générique soumis au tarif forfaitaire de responsabilité783(*) prévue au II de l'article L. 162-16.
Le II du présent article étend ces dispositions aux médicaments biosimilaires inscrits sur la liste des groupes biosimilaires substituables mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ainsi qu'aux médicaments hybrides substituables. Sont ainsi exclus du dispositif les biosimilaires pour lesquels la substitution a été autorisée à titre dérogatoire en application du deuxième alinéa du même 2° de l'article L. 5125-23-2.
Par ailleurs, le dispositif proposé n'étend pas la mise sous tarif forfaitaire de responsabilité aux biosimilaires.
Le IV de l'article 33 étend le dispositif de tiers payant contre générique et de tiers payant contre biosimilaires prévu à l'article L. 162-16-7 à Mayotte.
• la mise en place d'un tarif ajusté de remboursement deux ans après l'inscription du premier biosimilaire dans un groupe donné.
Le B du I du présent article réécrit intégralement les dispositions du V de l'article L. 162-16 afin de mettre en place une procédure de mise sous tarif ajusté pour les biosimilaires. Cette disposition existe déjà pour les génériques.
Ainsi, le dispositif du tarif remboursement ajusté (ou de limitation de la base de remboursement) permet pour un groupe de génériques d'encadrer la base de remboursement de l'assurée en instaurant un plafond correspondant à « la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides ». Le refus d'un générique par l'assuré aboutit à laisser à sa charge la différence entre le prix du médicament princeps et le prix du générique le plus cher.
Sont concernées par l'extension du tarif sous remboursement ajusté les spécialités biosimilaires appartenant à un groupe biologique similaire « mentionné à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique » et figurant sur la liste des biosimilaires substituables mentionnée au premier alinéa 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code. Sont ainsi exclus les biosimilaires pour lesquels la substitution a été autorisée à titre dérogatoire.
Le dernier alinéa du V de l'article L. 162-16 précise que cette mise sous tarif ajusté s'applique deux ans après la commercialisation du premier médicament biosimilaire du groupe. Ainsi deux ans après l'inscription d'un biosimilaire au sein d'un groupe donné, le remboursement du médicament bioréférent sera fondé sur la base du biosimilaire le plus cher, laissant à la charge de l'assuré la différence entre les deux prix.
Le dernier alinéa du B du I de l'article 33 précise que le mécanisme de mise sous tarif ajusté n'est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution. En application de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique cette mention doit être « expresse et justifiée ».
Enfin, le B du V de l'article 33 prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la mise sous tarif ajusté des biosimilaires. Ainsi ce dispositif s'appliquera aux groupes biologiques similaire dont la première commercialisation a lieu dans les deux ans à compter du 1er septembre 2026. Pour les biosimilaires commercialisés avant le 1er septembre 2024, cette mise sous tarif ajusté s'appliquera à compter du 1er septembre 2026. Enfin pour les groupes pour lesquels un biosimilaire verrait son prix publié (et donc sa commercialisation autorisée) entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, la mise sous tarif ajusté s'appliquerait deux ans après la date de publication du prix.
• La suppression de l'obligation de prescrire les médicaments biosimilaires en nom de marque en plus de la dénomination de la molécule.
En effet, la prescription d'un médicament biologique ne peut s'effectuer en dénomination commune seule. Elle doit être suivie du nom de marque (article L. 5121-1-2 du code de santé publique). Cet élément supplémentaire par rapport au dispositif existant pour les génériques désincite à la substitution et favorise la préférence pour la spécialité biologique de référence au détriment de la pénétration des biosimilaires.
Le III de l'article 33 supprime ainsi les médicaments biologiques et les médicaments biosimilaires mentionnés aux 14° et 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, des spécialités pour lesquelles, en application de l'article L. 5121-1-2, la prescription doit obligatoirement faire figurer « aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie »784(*). Lors de son audition par la rapporteure, l'ANSM a souligné que la France serait le seul pays de l'Union européenne à autoriser la prescription en seule nom de molécule.
Concernant les génériques et les médicaments hybrides, les 1°, 2° et 3° du I du présent article :
- diminuent de deux à un an le délai de mise sous tarif de remboursement ajusté prévu au III de l'article L. 162-16 précité ;
- corrigent une erreur matérielle afin de bien préciser que les médicaments hybrides sont bien intégrés au périmètre de mise sous tarif ajusté. Jusqu'ici alors que les médicaments génériques et hybrides faisaient l'objet en application du premier alinéa du même III d'une mise sous tarif ajusté, les délais de mise sous tarif ajusté prévu au dernier alinéa dudit III ne faisaient référence qu'aux médicaments génériques.
Le A du V prévoit que ce raccourcissement du délai de mise sous tarif ajusté s'applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité génériques ou hybride est publié à compter du 1er septembre 2026.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
Consciente des enjeux financiers associés à une plus grande pénétration des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires dans le secteur officinal, la commission soutient la diffusion des génériques et le développement des biosimilaires, qui constituent un gisement d'économies pour l'assurance maladie. Elle a donc accueilli favorablement les dispositions du présent article.
L'élargissement de la liste des biosimilaires substituables au cours de l'année 2025 permet de renforcer les économies liées aux biosimilaires en augmentant les possibilités de substitutions. Par ailleurs, cela rend disponible une offre de spécialités plus large permettant d'assurer la mise en place des mécanismes de tiers-payant contre biosimilaires et de mise sous tarif ajusté de ces médicaments prévus par cet article sans pénaliser les usagers du fait du manque d'alternative disponible. Une substitution ou une interchangeabilité entre deux médicaments biologiques en primo-prescription ou en cours de traitement peuvent davantage être encouragées mais toujours sous conditions strictes et dans le cadre des indications, des schémas posologiques, et des voies d'administration communes au médicament de référence. Ces mesures sont par ailleurs soutenues par les représentants des pharmaciens d'officine entendus en audition par la rapporteure.
Toutefois, la rapporteure rejoint une observation formulée par l'ANSM lors de son audition. L'agence a précisé « que les biosimilaires peuvent présenter des différences, notamment en ce qui concerne le dispositif d'injection (flacons, stylos ou seringues préremplies) ce qui peut avoir un impact important pour le patient en auto-administration ». Cet élément spécifique renforce la nécessité d'accompagner les patients lors de la substitution d'un biosimilaire qui doit être privilégiée en initiation de traitement. Il s'agit de pouvoir pleinement intégrer les réticences que peuvent parfois formuler certains patients et prescripteurs à la substitution par biosimilaire.
La commission a adopté un amendement rédactionnel n° 692 de la rapporteure ainsi qu'un amendement visant à réduire d'un an à six mois le délai d'inscription des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables (amendement n° 693) afin d'augmenter plus rapidement le nombre de spécialités substituables.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article
34
Réforme des accès
dérogatoires au médicament et intégration des tarifs de
nouveaux pays dans la fixation des prix des produits de santé
Cet article propose diverses mesures visant à réformer l'accès précoce et l'accès compassionnel, à pérenniser l'accès direct et à supprimer l'accès temporaire.
Concernant l'accès précoce, l'article 34 restreint son champ aux produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu'ils en bénéficient, présentant des données cliniques trop immatures. Il en clarifie également les critères d'octroi, et redéfinit les conditions financières de sa mise en oeuvre : la prise en charge au titre de l'accès précoce serait limitée à trois ans, à l'issue desquels la fourniture s'effectuerait à titre gracieux. Enfin, l'article 34 prévoit de faire figurer dans la loi l'encadrement des continuités de traitement.
Concernant l'accès compassionnel, il est proposé d'en clarifier les critères d'octroi, les conditions d'éligibilité et de préciser les modalités de continuités de traitement.
Concernant l'accès direct, celui-ci serait pérennisé et élargi aux molécules bénéficiant d'une inscription sur les listes de remboursement pour d'autres indications que celle au titre de laquelle est demandé l'accès direct. Il est prévu que l'accès direct soit accordé pour trois ans au plus, mais que la prise en charge de l'assurance maladie et, le cas échéant, la libre fixation de l'indemnité par l'industriel, ne dure pas plus que douze mois, à l'issue desquels la fourniture s'effectue à titre gratuit.
En outre, l'article 34 prévoit d'élargir à certains pays comparables non-européens la liste des États dont les tarifs en matière de produits de santé peuvent servir de base à une modulation à la baisse des prix pratiqués en France.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Le circuit de commercialisation et de prise en charge de droit commun du médicament
1. L'autorisation de mise sur le marché, un préalable obligatoire à la commercialisation d'un médicament
Afin d'accéder au marché français et, au surplus, d'être pris en charge par l'assurance maladie, l'industriel exploitant un médicament doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Celle-ci est accordée à l'issue d'une évaluation concluante de son rapport bénéfices/risques, au regard notamment de l'efficacité du produit, de ses effets indésirables prévisibles, de sa qualité chimique et de celle de ses procédés de fabrication785(*).
Pour accéder au marché français, l'AMM peut être attribuée au niveau européen selon trois procédures, par l'agence européenne du médicament (EMA), en application d'un règlement européen786(*), ou, à défaut, par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), en application de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique.
Si l'AMM fait en principe l'objet d'une demande de l'exploitant, l'ANSM peut également accorder une AMM à un médicament autorisé dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en l'absence d'une telle procédure, lorsque des motifs de santé publique le justifient787(*).
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de cinq ans. À l'issue de cette période, elle peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans ou, lorsque les conditions le justifient, sans limitation de durée788(*). Toutefois, cette autorisation devient caduque en l'absence de commercialisation effective dans les trois ans suivant sa délivrance. Elle peut également être retirée à tout moment lorsque le produit se révèle nocif, lorsqu'il n'atteint pas les résultats thérapeutiques attendus, lorsque le titulaire manque à ses obligations, lorsque la spécialité ne correspond pas à la composition déclarée ou encore lorsque le rapport entre ses bénéfices et ses risques devient défavorable789(*).
2. Une procédure complémentaire pour figurer sur les listes de remboursement
Afin de rendre sa spécialité admissible au remboursement, l'industriel doit suivre une procédure spécifique.
En premier lieu, il lui revient de saisir la Haute Autorité de santé (HAS), dont la commission de la transparence (CT)790(*) procède à une évaluation scientifique791(*) de l'efficacité et du caractère innovant du médicament, en vue d'attribuer à la spécialité un niveau de service médical rendu (SMR) et d'amélioration du service médical rendu (ASMR).
Service médical rendu et amélioration du service médical rendu
Le service médical rendu792(*) est un indicateur composite prenant notamment en compte l'efficacité d'un produit, ses effets indésirables et la gravité de la pathologie pour laquelle il est indiqué afin de déterminer si une prise en charge par la solidarité nationale est justifiée. Le niveau de SMR détermine l'admissibilité au remboursement et, le cas échéant, le taux de remboursement par la sécurité sociale pour un médicament remboursable. La HAS, par le biais de sa commission de la transparence, fixe le niveau de SMR d'un produit de santé, qui peut être majeur ou important, modéré ou faible mais justifiant cependant le remboursement, ou insuffisant pour justifier une prise en charge par la collectivité793(*).
L'amélioration du service médical rendu794(*) vise à évaluer le progrès thérapeutique apporté par un médicament, en comparaison avec les traitements déjà disponibles. Il existe cinq niveaux d'ASMR, allant d'ASMR I (majeure) à ASMR V (inexistante). Le niveau d'ASMR, fixé par la commission de la transparence de la HAS, influe sur la détermination du prix du médicament.
Source : Rapport n° 84 (2023-2024), tome II, déposé le 8 novembre 2023, des rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat
Lorsque le niveau d'ASMR est majeur, important ou modéré (ASMR I à III) et lorsque le produit est susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie, l'entreprise est ensuite tenue de saisir la commission d'évaluation économique et de la santé publique (CEESP) de la HAS, qui procède à une étude médico-économique en vue d'émettre un avis sur l'efficience de la prise en charge795(*).
Par la suite, deux procédures distinctes existent : l'une pour la prise en charge en ville, l'autre à l'hôpital.
a) La détermination du prix et des modalités de prise en charge en ville
• Du niveau de SMR évalué par la commission de la transparence dépend le taux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire : 65 % en cas de SMR important, 30 % en cas de SMR modéré et 15 % en cas de SMR faible.
• Le niveau d'ASMR influe, quant à lui, sur le prix du médicament. Conjointement à d'autres facteurs, notamment les prix pratiqués dans les pays européens comparables, des négociations se tiennent entre l'industriel et le Comité économique en vue de fixer un prix pour la spécialité. À défaut d'accord, le CEPS est fondé à fixer le prix de manière unilatérale.
Le ministre de la santé arrête l'inscription du médicament au remboursement, qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel (JORF). Le code de la sécurité sociale fixe un délai réglementaire de 180 jours796(*) entre la date de réception de la demande d'inscription par le ministre compétent et la publication du prix au JORF.
Par convention ou, à défaut, décision du CEPS, les tarifs peuvent par la suite être révisés à la baisse au regard de l'ancienneté de leur inscription au remboursement, lorsque des médicaments à même visée thérapeutique présentent un prix moins élevé, lorsque le médicament représente une charge particulièrement lourde pour l'assurance maladie ou lorsque les tarifs applicables dans d'autres pays européens comparables sont plus avantageux797(*).
Circuit simplifié de commercialisation d'un médicament remboursable
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
b) En établissement, l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités doit se doubler d'une inscription sur la liste en sus pour que l'hôpital bénéficie d'une prise en charge spécifique
Une spécialité doit, pour être dispensée en établissement, faire l'objet d'une inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités798(*), proposée par la commission de la transparence799(*). Son prix, fixé librement dans la limite d'un tarif maximal800(*), est supporté par l'établissement, sans prise en charge supplémentaire de l'assurance maladie : il est en effet réputé inclus dans les tarifs hospitaliers.
Cependant, si la spécialité concernée bénéficie en outre d'une inscription sur la liste en sus801(*), l'assurance maladie en assume intégralement le coût en lieu et place de l'établissement, sur le fondement d'un tarif encadré. Il s'agit là de produits efficaces802(*), innovants803(*) et onéreux804(*), notamment de traitements contre le cancer, représentant une charge financière qui ferait obstacle à leur dispensation en établissement en l'absence d'intervention de l'assurance maladie en sus de la tarification à l'activité.
B. Accès précoce, accès direct, accès compassionnel : trois modalités d'accès dérogatoire au marché
Face aux délais importants induits par la procédure de droit commun -- en moyenne 523 jours805(*) entre l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) et la disponibilité effective du médicament --, le législateur a, de longue date, instauré des mécanismes dérogatoires destinés à accélérer l'accès des patients à certaines innovations thérapeutiques.
Cependant, les dispositifs historiques, à savoir l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) mise en place en 1992 et la recommandation temporaire d'utilisation (RTU) introduite en 2014, avaient progressivement montré leurs limites. Les multiples ajustements réglementaires dont ils avaient fait l'objet les avaient rendus complexes, peu lisibles et parfois redondants, ne répondant plus pleinement aux attentes des professionnels de santé ni aux besoins des patients.
Pour remédier à ces difficultés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021806(*) a simplifié le cadre d'accès dérogatoire en remplaçant six dispositifs préexistants par deux régimes :
- l'accès précoce, destiné aux médicaments innovants appelés à être commercialisés, ayant reçu une AMM ou non ;
- l'accès compassionnel, réservé à l'usage dérogatoire de produits sans vocation commerciale.
Ces deux dispositifs, visant à la fois une meilleure lisibilité pour les acteurs de santé et une réduction des délais d'accès pour les patients, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2021.
Articulation entre les dispositifs
dérogatoires historiques
et les nouveaux dispositifs d'accès
précoce et compassionnel
Source : Ministère de la santé et de l'accès aux soins
En outre, le législateur a souhaité expérimenter, dans la LFSS pour 2022807(*), l'accès direct, un dispositif visant à rendre accessibles des médicaments innovants dès leur AMM, sans attendre leur inscription sur les listes de remboursement.
1. L'accès précoce : un dispositif d'accès anticipé à l'innovation pour les patients en impasse thérapeutique
a) Un mécanisme destiné aux patients atteints de maladies graves et en situation d'impasse thérapeutique
L'accès précoce, défini à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, est venu en remplacement de l'ATU pour offrir aux patients atteints d'une maladie grave et en impasse thérapeutique un accès anticipé à des médicaments innovants, susceptibles d'être indiqués pour leur pathologie mais non encore inscrits à la prise en charge. La HAS en assure la gestion808(*).
Cet accès dérogatoire est accordé à une indication donnée d'un médicament, qui peut présenter deux stades de maturité distincts. Peuvent ainsi en relever :
- les produits ne disposant pas encore d'une AMM pour l'indication considérée, mais pour lesquels l'exploitant a déposé ou s'engage à déposer une demande dans un délai fixé par la HAS et ne pouvant excéder deux ans809(*) : on parle alors d'accès précoce pré-AMM. Les accès précoces pré-AMM représentent 44 % des premières demandes ;
- les produit attributaires d'une AMM dans l'indication considérée, mais non encore inscrits sur les listes de remboursement, une demande d'inscription sur lesdites listes devant alors être déposée dans le mois suivant l'obtention de l'AMM. L'accès précoce, alors dit « post-AMM », peut le cas échéant être attribué après un accès précoce pré-AMM.
Pour se voir accorder une autorisation d'accès précoce au titre d'une indication donnée, un médicament doit répondre à un cahier des charges précis :
- indication dans une maladie grave, rare ou invalidante ;
- absence de traitement approprié810(*) ;
- impossibilité de différer la mise en oeuvre du traitement ;
- présomption forte d'efficacité et de sécurité au vu des résultats d'essais thérapeutiques et, pour les vaccins, au vu des recommandations de la HAS ;
- présomption de caractère innovant du médicament.
Certains de ces critères apparaissent interdépendants : l'impossibilité de différer la mise en oeuvre du traitement découle, par exemple, assez naturellement du fait que le patient souffre d'une maladie grave, rare et invalidante au titre de laquelle il se trouve en impasse thérapeutique.
L'exploitant doit par ailleurs s'engager à assurer un approvisionnement approprié et continu du territoire national, et à assumer la continuité des traitements initiés pendant la durée de l'autorisation et l'année qui suit. Lors des trois premiers mois, les continuités de traitement sont à la charge de la sécurité sociale811(*). Le manquement à ces obligations donne lieu à une pénalité pouvant atteindre 30 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'industriel au titre de la spécialité concernée au cours des deux dernières années.
Pour bénéficier d'un accès précoce, l'exploitant doit en faire la demande à la HAS812(*), qui statue dans un délai de trois813(*) mois814(*) et octroie l'autorisation pour une durée d'un an renouvelable815(*). Le délai médian d'instruction est de 78,5 jours. Lorsque le médicament ne bénéficie pas encore d'une AMM dans l'indication considérée816(*), l'autorisation est délivrée après avis conforme de l'ANSM concernant la forte présomption de sécurité et d'efficacité sur l'indication considérée817(*).
L'accès précoce prend fin :
- automatiquement, dès l'inscription du médicament sur les listes de prise en charge de droit commun ;
- ou par arrêté ministériel lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies, en cas de retrait de l'autorisation par la HAS, de non-octroi d'AMM ou de non-respect des engagements pris par le laboratoire.
À l'issue de la période d'accès précoce, les médicaments ayant confirmé leur intérêt clinique sont inscrits sur les listes de remboursement, la majorité relevant de la liste en sus. Dans les faits, quatre médicaments sur cinq ayant fait l'objet d'un accès précoce se sont vu reconnaître une amélioration du service médical rendu.
b) Une prise en charge intégrale et dérogatoire par l'assurance maladie
Pendant toute la durée de l'accès précoce, les médicaments concernés sont intégralement et automatiquement pris en charge par la sécurité sociale, selon un régime dérogatoire818(*), en sus des tarifs hospitaliers819(*).
L'exploitant fixe librement l'indemnité qu'il réclame820(*) lorsque le médicament ne connaît d'inscription sur les listes de prise en charge pour aucune de ses indications, ou perçoit le prix prédéterminé par négociation avec le CEPS ou les prix maximal de vente aux établissements de santé en cas d'extension d'indication. Ces modalités tarifaires, favorables aux industriels, participent à l'attractivité du dispositif.
Toutefois, un double système de remises821(*) s'applique afin de minorer le coût de l'accès précoce pour la sécurité sociale :
- une remise annuelle frappe le chiffre d'affaires réalisé sur chaque indication en accès précoce, selon un taux progressif. Cette remise peut être majorée, par exemple en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations, lorsqu'est inscrite au remboursement une spécialité couvrant les mêmes besoins thérapeutiques ou lorsque la procédure d'accès précoce est allongée par une durée excessive de fixation du tarif de droit commun ;
- une remise dite « de débouclage », versée à la fin de la période d'accès précoce, vise à assurer la neutralité financière rétrospective de la libre fixation de l'indemnité par l'industriel, hors effets de trésorerie. Son montant est fixé pour faire correspondre rétroactivement le chiffre d'affaires réalisé par l'industriel sur l'indication considérée avec l'indemnité d'accès précoce, minoré par les remises annuelles, avec celui qui aurait prévalu si la sécurité sociale avait payé, lors de la période d'accès précoce, le prix net de référence applicable822(*). La remise de débouclage peut être à la charge de l'industriel ou de la sécurité sociale.
c) Des résultats satisfaisants sur l'accélération de la mise à disposition des médicaments innovants, mais des lacunes identifiées par la HAS
Depuis son instauration, l'accès précoce a permis à plus de 120 000 patients d'accéder à un traitement plus rapidement afin d'éviter toute perte de chances. En juin 2024, la HAS avait émis 122 décisions favorables à l'attribution d'une autorisation d'accès précoce, pour moitié en oncologie, mais également en endocrinologie, en maladies infectieuses et dans treize autres domaines.
Le dispositif a fait la preuve de son utilité pour accélérer l'accès au médicament : il faut en effet compter 97 jours en moyenne entre l'attribution de l'AMM et l'accès aux patients au titre de l'accès précoce, un total de 423 jours moins long que pour le reste des médicaments.
L'accès précoce, très efficace pour réduire les délais d'accès aux patients, suscite également l'enthousiasme des industriels, qui y voient « un dispositif essentiel », en ce qu'il passe pour le « dernier levier effectif d'accès rapide aux innovations thérapeutiques » en France823(*).
Délais d'accès au marché
médians en Europe pour
une primo-inscription sur les
listes
Source : Leem
Le coût annuel de l'accès précoce atteint 400 millions d'euros après versement des remises, selon le Leem.
Toutefois, la HAS émet certaines réserves et pistes d'évolution sur les accès précoces. Elle constate que plus de 40 % des demandes d'accès précoces reçues concernent des renouvellements d'autorisations, parfois même pour des « deuxième, troisième, voire maintenant quatrième renouvellements pour des médicaments qui disposent d'une AMM et d'une évaluation de droit commun depuis plusieurs années »824(*).
Cela démontre une longueur excessive des négociations sur la fixation des prix des médicaments en accès précoce lorsque se pose la question de leur prise en charge sur une liste de droit commun. Si celle-ci peut être subie, certains industriels sont suspectés de ralentir volontairement les négociations sur les prix officiels afin de bénéficier plus longtemps de l'avance de trésorerie que leur procure le régime d'accès précoce grâce à la libre fixation de l'indemnité sous cet empire.
En moyenne, les médicaments qui bénéficient d'un accès précoce y restent treize mois avant leur inscription pour une prise en charge de droit commun.
En tout état de cause, comme la note la HAS, « cela ne correspond pas à l'esprit du dispositif tel qu'il avait été présenté, et alourdit inutilement la charge de travail de la HAS ».
2. L'accès compassionnel : un recours exceptionnel à des médicaments sans vocation commerciale dans l'indication considérée
a) Les conditions d'éligibilité
L'accès compassionnel, défini à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, autorise l'usage exceptionnel sur des patients en impasse thérapeutique de médicaments non titulaires d'une AMM pour une indication considérée et sans perspective de commercialisation dans ce cadre. Il cible donc des besoins médicaux auxquels peuvent répondre des médicaments pour lesquels un laboratoire n'a pas de stratégie commerciale. Ce dispositif relève principalement de la compétence de l'ANSM825(*).
Pour être éligible, le médicament doit :
- concerner une pathologie dépourvue de traitement approprié ;
- ne pas être utilisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine à visée commerciale ;
- présenter une présomption d'efficacité et de sécurité sur le fondement des données disponibles.
L'accès compassionnel peut prendre la forme d'une autorisation d'accès compassionnel (AAC), succédant aux anciennes ATU nominatives, ou d'un cadre de prescription compassionnelle (CPC) qui a remplacé les RTU.
b) L'autorisation d'accès compassionnel (AAC) : une autorisation nominative d'utiliser un médicament sans AMM sur un patient en impasse thérapeutique
L'AAC permet, à la demande d'un prescripteur826(*), qu'un patient en impasse thérapeutique, nominativement désigné, puisse recevoir en établissement de santé un médicament qui n'a reçu d'AMM pour aucune de ses indications ou qui n'est plus commercialisé et n'a pas reçu d'AMM pour l'indication sollicitée. Il s'agit bien d'une autorisation accordée à un patient donné, et non pas d'une autorisation générale accordée pour une indication. L'AAC est délivrée par l'ANSM, pour une durée d'un an renouvelable827(*).
Il convient de noter que, l'autorisation d'accès compassionnel concerne également l'accès dit « pré-précoce » au médicament. Une telle autorisation peut en effet être accordée, par dérogation aux conditions générales de l'accès compassionnel, lorsque le médicament est en phase de recherche clinique à un stade très précoce et que l'exploitant s'engage à demander, sous douze mois828(*), une autorisation d'accès précoce. L'autorisation d'accès compassionnel dite « pré-précoce » vise alors à couvrir la période précédant l'octroi de l'accès précoce. Des conditions d'éligibilité supplémentaires, inspirées de celles auxquelles est subordonné l'accès précoce, s'appliquent alors : une AAC très précoce ne peut concerner que des maladies graves, rares ou invalidantes dont le traitement ne peut être différé.
En principe, un refus d'accès précoce pour une indication donnée empêche l'octroi d'une autorisation d'accès compassionnel pour cette même indication, sauf, depuis la LFSS pour 2024829(*), lorsque le refus fait suite à un défaut de présomption de caractère innovant du médicament - cette condition n'étant pas requise pour l'accès compassionnel.
c) Le cadre de prescription compassionnelle (CPC) permet de sécuriser la prescription non conforme d'un médicament, qui dispose par ailleurs d'une AMM dans d'autres indications
Le cadre de prescription compassionnelle830(*) ne répond ni aux mêmes objectifs, ni aux mêmes conditions que l'autorisation d'accès compassionnel.
Il vise à encadrer et sécuriser la prescription, en ville ou en établissement, d'un médicament qui ne dispose pas d'une AMM dans l'indication d'intérêt, mais qui est déjà autorisé pour d'autres indications. Le CPC concerne donc une indication donnée, et non un patient nominativement désigné. Il est accordé pour trois ans renouvelables à l'initiative de l'ANSM, du Gouvernement ou à la suite d'un signalement.
Par dérogation aux conditions générales de l'accès compassionnel, un CPC peut être accordé à un médicament malgré l'existence d'alternatives thérapeutiques, si ces dernières ne revêtent pas le même principe actif, le même dosage ou la même forme pharmaceutique.
d) La prise en charge des médicaments en accès compassionnel
Les médicaments bénéficiant d'une AAC ou d'un CPC font l'objet d'une prise en charge dérogatoire et immédiate par la sécurité sociale831(*). Elle peut intervenir, le cas échéant, en sus des tarifs hospitaliers832(*).
La prise en charge peut, par ailleurs, être conditionnée par arrêté au dépôt d'une demande d'AMM ou d'inscription sur les listes de prise en charge de droit commun, ou au respect de conditions particulières de dispensation.
Elle s'interrompt en cas d'octroi d'un accès précoce, d'attribution d'une AMM dans l'indication considérée, d'inscription sur les listes de remboursement de droit commun ou, par arrêté des ministres compétents, si l'accès compassionnel s'interrompt ou si une alternative thérapeutique est inscrite au remboursement.
Si la spécialité bénéficiant d'un accès compassionnel fait déjà l'objet d'une prise en charge en ville sur une autre indication, les conditions de prise en charge en accès compassionnel sont identiques à celles qui prévalent pour l'indication concernée. Il en va de même si la spécialité est inscrite sur les listes en sus et de rétrocession.
Lorsque la spécialité fait l'objet, dans d'autres indications, d'un prix maximal de vente au titre de son inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, la sécurité sociale prend intégralement en charge le médicament, au prix maximal de vente existant.
À défaut, le remboursement s'effectue sur la base du prix librement fixé par le laboratoire ou d'un forfait annuel par patient.
Comme pour l'accès précoce, des remises annuelles croissant avec le chiffre d'affaires réalisé pour chaque AAC ou CPC833(*) peuvent être exigées, sauf lorsque la prise en charge repose sur un forfait. Dans certaines conditions, ces remises peuvent être majorées.
3. L'accès direct, dont l'expérimentation a pris fin courant 2025, vise à accélérer la prise en charge de médicaments innovants et efficaces à compter de l'avis de la commission de la transparence sur une indication donnée
a) L'accès direct concerne des médicaments innovants et présentant un service médical rendu majeur ou important
L'article 62 de la LFSS pour 2022834(*) a mis en oeuvre, pour deux ans, une expérimentation de l'accès direct aux médicaments, une modalité de prise en charge dérogatoire des médicaments innovants après leur évaluation par la commission de la transparence de la HAS, dans l'attente de l'aboutissement des négociations tenues avec le CEPS pour fixer son prix. L'objectif est donc d'anticiper l'accès pour le patient aux médicaments innovants, par rapport aux 180 jours réglementaires de droit commun.
Mise en oeuvre le 9 juillet 2023, l'expérimentation a donc pris fin le 9 juillet 2025 pour l'inclusion de nouvelles spécialités - les spécialités bénéficiant à cette date d'un accès direct bénéficiant d'une prise en charge jusqu'à la date arrêtée.
L'accès direct concerne des médicaments innovants, présentant une ASMR I à IV dans l'indication considérée, et au service médical rendu majeur ou important dans ladite indication835(*).
Il est réservé aux médicaments en attente d'inscription sur les listes de remboursement à la suite de l'avis de la CT, et qui ne bénéficient pas, dans d'autres indications, d'une prise en charge en ville ou d'un accès compassionnel avec dispensation en officine. L'accès direct est, en outre, incompatible avec l'octroi d'un accès précoce dans la même indication.
Lorsque la spécialité est classée dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, l'accès direct est en outre subordonné au remplissage, par cette dernière, des conditions d'inscription sur la liste en sus.
La demande d'accès direct, qui peut concerner une ou plusieurs indications, est adressée par l'industriel aux ministres compétents dans le mois suivant l'avis de la commission de la transparence de la HAS.
Lors d'un accès direct, les conditions de prescription et de dispensation peuvent être particulièrement encadrées, notamment au vu des exigence de qualité et de sécurité des soins.
b) Une prise en charge dérogatoire des spécialités en accès direct pour une durée maximale d'un an
Lorsqu'il est fait droit à la demande d'accès direct par arrêté des ministres compétents, s'instaure une prise en charge dérogatoire et intégrale par la sécurité sociale dans certains établissements de santé et hôpitaux des armées.
De manière analogue à l'accès précoce, cette prise en charge s'effectue au regard d'une indemnité librement fixée par l'industriel, ou, lorsqu'il existe, au regard du prix maximal de vente aux établissements de santé ou du prix associé à sa prise en charge en ville ou sur la liste en sus.
Ce régime s'applique pendant une durée au plus égale à un an, qui peut être réduite à la demande de l'exploitant ou en cas d'inscription sur les listes de prise en charge, de refus d'inscription sur ces dernières, ou de retrait de la demande d'inscription.
À l'issue de la période de prise en charge, s'appliquent des continuités de traitements qui suivent les conditions de prise en charge et de dispensation au titre de l'inscription de la spécialité sur une liste de remboursement dans l'indication considérée. À défaut d'inscription sur ces listes, les dernières conditions de dispensation en vigueur lors de l'accès direct continuent de s'appliquer, associées à un prix de référence déterminé par le CEPS. L'industriel qui manquerait à ses obligations en matière de continuités de traitements est passible d'une pénalité pouvant atteindre 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la spécialité concernée lors des deux dernières années.
En contrepartie de la prise en charge dérogatoire, l'accès direct prévoit qu'en l'absence d'accord avec le CEPS sur le prix à accorder à la spécialité en droit commun dans un délai de dix mois à compter de la prise en charge, ce comité puisse fixer unilatéralement le prix de vente au public, le prix de cession, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements.
Le modèle financier de l'accès direct est également structuré autour d'un mécanisme de remises. Comme pour l'accès précoce, il existe :
- des remises annuelles qui suivent un taux croissant avec le chiffre d'affaires réalisé par l'industriel au titre de la spécialité en accès direct836(*) ;
- une remise de débouclage, calculée à la fin de l'accès direct comme la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de la spécialité à son prix définitif net de remises837(*) et le chiffre d'affaires effectif réalisé avec l'indemnité d'accès direct, net de remises également. Celle-ci peut, si le prix définitif est supérieur à l'indemnité d'accès direct, consister en un reversement à l'industriel.
c) Un bilan globalement favorable, mais une articulation à revoir
L'expérimentation a concerné six médicaments, pour une dépense nette de remises de 14,6 millions d'euros.
Au vu des résultats satisfaisants de l'accès direct sur la réduction du délai d'accès au marché pour le patient, le Leem estime qu'il est « cohérent que ce dispositif d'accès direct soit pérennisé et optimisé »838(*).
Toutefois, sur la période, 37 spécialités remplissant les critères pour bénéficier de l'accès direct ont été autorisées en accès précoce post-AMM, laissant craindre un manque d'articulation entre les dispositifs.
42 autres spécialités ont reçu un avis de la CT de la HAS rendant possible l'accès direct, mais n'ont pas fait l'objet d'une demande en ce sens, par choix de l'industriel ou parce que la spécialité était déjà prise en charge en ville au titre d'une autre indication. L'impossibilité de bénéficier d'un accès direct pour une extension d'indication thérapeutique en ville apparaît donc comme un frein au dispositif.
Enfin, alors que, comme le rappelle le Leem, « la négociation de prix ne peut débuter qu'à l'obtention de [l'] avis [de la CEESP] »839(*), la durée d'accès direct est fixée à douze mois, sans prendre en compte l'éventuel délai nécessaire à l'émission de l'avis de la CEESP.
Parcours d'accès schématisé
du médicament en France
et temporalité des accès
dérogatoires
Source : Leem
4. L'accès temporaire : un dispositif jamais mis en oeuvre
L'article 76 de la LFSS pour 2024840(*) a introduit l'accès temporaire, un régime temporaire de prise en charge dérogatoire pour les médicaments dont l'accès précoce a pris fin après l'inscription sur une liste de prise en charge, mais non-inscrits sur la liste en sus du fait de l'attribution par la HAS d'un ASMR V ou d'un SMR modéré ou faible en l'attente de données supplémentaires.
La prise en charge841(*) s'effectue au plus pour trois ans, sur la base de l'indemnité d'accès précoce, à laquelle s'appliquent des remises annuelles dont le taux est notamment majoré pour chaque nouvelle année dans le dispositif. Une remise de débouclage, sur le modèle de celle applicable à l'accès précoce, neutralise rétrospectivement l'effet de la libre fixation de l'indemnité retenue pour l'accès précoce, sur laquelle est déterminée la prise en charge au titre de l'accès temporaire.
Faute de publication des textes d'application réglementaire, l'accès temporaire, pourtant adopté il y a deux ans par le législateur, n'a jamais pu être mis en oeuvre.
C. Le dispositif proposé : réformer l'accès précoce et l'accès compassionnel, pérenniser l'accès direct, supprimer l'accès temporaire et faire évoluer les critères de fixation des prix des produits de santé
L'article 34 porte une réforme de l'accès précoce et, plus à la marge, de l'accès compassionnel, une pérennisation de l'accès direct en en faisant évoluer les conditions et la suppression de l'accès temporaire.
Il prévoit, en outre, de modifier les critères de fixation ou de révision des prix des produits de santé.
1. Un recentrage de l'accès précoce et un encadrement renforcé des conditions de prise en charge dérogatoire qu'il permet
Le 1° du I, en modifiant l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, fait évoluer les conditions d'éligibilité à l'accès précoce et les obligations à remplir pour les industriels afin d'en bénéficier.
Le 5° du II fait évoluer l'article L. 162-16-5-1, relatif aux conditions de prise en charge de l'accès précoce par l'assurance maladie.
a) Le recentrage de l'accès précoce sur les médicaments immatures et une obligation de déposer, sous trois ans, une demande d'inscription sur les listes de prise en charge
• Le b du 1° du I recentre l'accès précoce sur les médicaments immatures, en restreignant le champ de l'accès précoce post-AMM. Cette modification est opérée dans une optique de clarification des champs respectifs de l'accès précoce et de l'accès direct.
L'accès précoce post-AMM est aujourd'hui possible lorsque le médicament n'est pas inscrit sur les listes de remboursement dans l'indication considérée et lorsque l'exploitant a déposé une demande d'inscription sur ces listes ou s'engage à le faire dans le mois suivant l'attribution de son AMM.
Le iii du b du 1° du I prévoit de restreindre l'accès précoce post-AMM aux seuls cas où le médicament a vu rejetée sa demande d'inscription sur les listes de prise en charge en raison de l'immaturité des données disponibles. L'éligibilité à l'accès précoce est alors subordonnée à un avis de la commission de la transparence qui lui accorde un niveau de service médical rendu excédant un seuil, et estime soit que les données disponibles laissent présumer d'une amélioration du service médical rendu, soit qu'il est envisageable que, sous trois ans, les données issues du plan de développement puissent justifier une inscription sur les listes de prise en charge842(*). Dans ce dernier cas, il est fait obligation à l'exploitant de déposer une demande de réévaluation de l'inscription sous trois ans.
En coordination, le b du 5° du II modifie l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions de prise en charge au titre de l'accès précoce. Il prévoit que le retrait d'une demande de réévaluation d'inscription et que la carence à transmettre les données du plan de développement mettent fin à la prise en charge au titre de l'accès précoce. Le c du même 5° tire les conséquences des modifications du champ de l'accès précoce post-AMM sur les conditions entourant la demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables en ville.
Les conditions d'éligibilité révisées de l'accès précoce post-AMM reprennent largement celles qui s'appliquaient, en droit, à l'accès temporaire.
En cohérence avec la rédaction en vigueur, le ii du b du 1° du I prévoit qu'une spécialité doit, pour bénéficier d'un accès précoce pré-AMM, non seulement s'engager à déposer une demande d'AMM843(*) dans un délai déterminé, mais également, dans le mois qui suit l'obtention de cette dernière, une demande d'inscription sur les listes de prise en charge.
Le même ii précise que l'accès précoce pré-AMM n'est possible qu'à condition que l'indication considérée n'ait pas fait l'objet d'un avis favorable du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments, celle-ci annonçant la reconnaissance prochaine d'une AMM.
• Par ailleurs, le i du d du même 1° conditionne toute autorisation d'accès précoce à l'engagement de l'exploitant de déposer, sous trois ans, une demande d'inscription sur les listes de prise en charge. Le e dudit 1° assure une coordination rendue nécessaire par les évolutions apportées aux b, c et d du même 1°.
b) Une évolution des critères de l'accès précoce avec la suppression de la condition d'impossibilité de différer le traitement dans le temps
Le a du 1° du I prévoit une révision des critères d'éligibilité à l'accès précoce.
Son i restreint le champ de l'accès précoce aux indications « cliniquement pertinentes », et non seulement « précises » comme le prévoit le droit en vigueur.
Son ii supprime également la nécessité que la mise en oeuvre du traitement ne puisse être différée : cette condition serait, selon le Gouvernement, redondante avec les critères d'absence de traitement approprié et de présomption d'innovation.
Ses i, iii et iv apportent par ailleurs des précisions rédactionnelles et des coordinations rendues nécessaires par le ii précité.
c) Une sécurisation de la procédure applicable en matière de continuités des traitements
Le c du 1° du I et le 10° du II sécurisent la procédure de continuité des traitements pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce, qui laisse aujourd'hui un vide juridique quant à qui a la charge des continuités de traitements après la période de trois mois où l'assurance maladie les finance.
Pour bénéficier de l'accès précoce, l'exploitant serait désormais tenu d'assurer à titre gracieux la continuité des traitements pendant une période de douze mois à l'issue de la fin de la période d'octroi si la spécialité n'est pas inscrite sur les listes de remboursement844(*), sauf raisons sérieuses tenant à la sécurité des patients. Les conditions de prescription et de dispensation sont maintenues pendant les continuités de traitements.
d) Une prise en charge en accès précoce et une liberté tarifaire limitées dans le temps
Afin d'accélérer les négociations en vue de l'inscription des médicaments en accès précoce pour une prise en charge de droit commun, l'article 34 prévoit de limiter la durée de prise en charge de l'accès précoce. Durant une période de trois ans, le laboratoire conserve le droit de fixer son indemnité librement845(*), sauf si un prix est déjà fixé pour une autre indication, mais la fourniture s'effectue à titre gracieux au-delà de cette période.
• Le i du a du 7° du II prévoit la limitation à trois ans de la période au cours de laquelle l'exploitant bénéficie d'une libre fixation de l'indemnité due au titre de l'accès précoce, sauf à ce qu'un prix de vente ait déjà été défini pour la même spécialité dans une autre indication. Au-delà, le médicament est fourni à titre gracieux si l'accès précoce se prolonge.
Des dispositions spécifiques s'appliquent aux spécialités en accès précoce post-AMM. La durée d'accès précoce rémunéré est alors limitée à un an à compter de la réévaluation de la commission de la transparence846(*). Elle peut, en outre, aux termes du ii du a du 7°, être prolongée de trois ans lorsqu'un médicament ayant bénéficié d'un accès précoce pré-AMM reçoit un accès précoce post-AMM.
• Le ii du a du 5° du II limite en outre la prise en charge des spécialités en accès précoce à une durée de douze mois à compter de l'évaluation de la commission de la transparence pour les accès précoces pré-AMM, et à compter de la réévaluation de ladite commission pour les accès précoces post-AMM.
Il est précisé que lorsque la commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS émet un avis sur la spécialité, la prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter de cet avis.
• Le c du 1° du I en tire les conséquences dans l'article régissant l'accès précoce dans le code de la santé publique, en prévoyant que l'industriel s'engage, lors de sa demande d'accès précoce, à fournir à titre gracieux la spécialité concernée à l'issue de la période de prise en charge ou de libre fixation de l'indemnité.
e) La suppression des majorations de remises
Les remises annuelles dues au titre des spécialités en accès précoce peuvent aujourd'hui être majorées, par exemple lorsqu'est inscrite au remboursement une spécialité couvrant les mêmes besoins thérapeutiques ou lorsque la procédure d'accès précoce est allongée par une durée excessive de fixation du tarif de droit commun.
Ces majorations de remises sont supprimées par le b du 7° du II.
f) Autres dispositions
Le i du b et le ii du d du 1° du I apportent des modifications rédactionnelles.
Le i du a du 5° du II corrige une référence.
Il est à noter que l'étude d'impact ne fournit aucune estimation des effets budgétaires attendus des modifications apportées au régime de l'accès précoce.
2. Une évolution des critères de l'accès compassionnel et l'apport de garanties supplémentaires en matière de continuité des traitements
a) La précision des critères de l'accès compassionnel
Le 2° du I, qui modifie l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique relatif à l'accès compassionnel, précise les critères que doit remplir un médicament pour relever de l'accès compassionnel, que ce soit dans le cadre d'une AAC ou d'un CPC.
Le critère d'absence de recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales serait clarifié par le a du 2° du I : il s'entendrait désormais au niveau national ou international.
Il serait précisé, au b, que l'absence de traitement approprié doit être comprise comme s'appliquant, quant à elle, au seul territoire national. Le f en tire les conséquences sur les dérogations à cette condition pour les cadres de prescription compassionnelle. Cet ajout permettra notamment d'ouvrir le cadre de prescription compassionnelle aux spécialités non commercialisées en France et bénéficiant d'une AMM.
Le h prévoit quant à lui qu'en cas de retrait, de refus ou de non-renouvellement d'une AMM pour une indication donnée, seule la poursuite du traitement pour un patient donné peut donner lieu à une AAC.
b) La clarification des modalités de continuités de traitements pour un accès compassionnel
Le 8° du II modifie l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de prise en charge des accès compassionnels, afin de faire évoluer les modalités de continuités de traitements pour un accès compassionnel.
Il convient de distinguer deux situations :
Une prise en charge des continuités de traitements par l'assurance maladie est prévue lorsque la spécialité se voit accorder une AMM sur l'indication considérée sans être inscrite sur les listes de remboursement. Cette prise en charge peut aujourd'hui durer jusqu'à sept mois après la fin de l'AAC ou du CPC, une durée réduite à un mois en l'absence de demande d'inscription sur lesdites listes. Le b du 8° du II fixe la durée de prise en charge à douze mois dans l'ensemble de ces situations.
Dans le seul cas de l'autorisation d'accès compassionnel, une prise en charge des continuités de traitements par l'assurance maladie est prévue tout le long de la durée du traitement, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'AMM. Le c du 8° du II fixe, dans ce cas, à deux ans la durée de la prise en charge.
c) Autres dispositions
Le c du 2° du I opère une coordination rendue nécessaire par les évolutions apportées sur l'accès précoce.
Le d et le e du même 2° replacent des dispositions supprimées par le h dudit 2°, afin que les dérogations prévues figurent dans les structures encadrant spécifiquement l'autorisation d'accès compassionnel et le cadre de prescription compassionnelle.
Le g du même 2° est également de nature rédactionnelle.
Il devrait résulter des évolutions sur l'accès compassionnel une économie de 0,5 million d'euros par an, aux termes de l'étude d'impact.
3. Une pérennisation de l'accès direct associée à une révision de son champ et de ses conditions financières
Le 6° du II prévoit la pérennisation de l'accès direct, dont l'expérimentation a pris fin en mai 2025. Il insère les dispositions qui y sont relatives à l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale, qui encadre aujourd'hui l'accès temporaire que l'article 34 se propose de supprimer.
a) Les conditions d'éligibilité à l'accès direct
Le A du I de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 définit les conditions d'octroi d'un accès direct.
Un médicament peut relever de l'accès direct, après l'octroi d'une AMM pour l'indication considérée et avant l'inscription sur les listes de remboursement, lorsqu'il justifie d'un niveau de SMR et d'ASMR au moins égaux à des seuils définis par décret - pour mémoire, l'expérimentation exigeait un SMR majeur ou important et une ASMR I à IV. L'accès précoce et l'accès direct sont mutuellement exclusifs.
Ces conditions sont similaires à celles qui s'appliquaient au cours de l'expérimentation, si ce n'est que la pérennisation élargit le champ de l'accès direct aux extensions d'indication.
L'accès direct est accordé, sur arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, pour une indication donnée et pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.
b) Les conditions financières de l'accès direct
i. Fixation du prix et durée de prise en charge
Pour une période d'un an à compter de l'attribution de l'accès direct, le III de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 prévoit la libre fixation de l'indemnité par l'exploitant, sauf lorsqu'un prix est déjà fixé pour une autre indication. Ce montant est déclaré au CEPS, qui en assure la publicité.
Sur cette période, le II de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 prévoit une prise en charge intégrale, en sus des tarifs hospitaliers, de la spécialité par la sécurité sociale.
Les II et III du même article prévoient la fourniture de la spécialité à titre gracieux à compter du treizième mois d'accès direct, sauf lorsque la commission d'évaluation économique et de santé publique de la HAS émet un avis sur la spécialité, auquel cas la prise en charge est prolongée jusqu'au premier anniversaire de cet avis. Cette exception, prévue par le IV dudit article, vise à répondre à des difficultés observées lors de l'expérimentation puisque la négociation du prix ne peut être enclenchée qu'à compter de la réception de l'avis de la CEESP, si ce dernier est requis.
ii. Versement de remises
Comme l'accès précoce, le modèle financier de l'accès direct repose sur deux types de remises : les remises annuelles et les remises de débouclage.
Le V de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 prévoit le reversement d'une remise annuelle pour chaque spécialité bénéficiant d'un accès direct. Ces remises sont calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxe facturé au titre de l'accès direct sur chaque spécialité, selon un taux progressif par tranche de chiffre d'affaires défini par arrêté.
Les VII et VIII du même article encadrent les remises de débouclage, versées en une fois (B du VII) au terme de la période d'accès direct. Celles-ci visent à assurer ex post la neutralité financière847(*) du dispositif de libre fixation de l'indemnité. Elles sont donc calculées par le CEPS comme la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation du médicament au prix net de remises déterminé à l'issue des négociations entre l'exploitant et le CEPS, et celui effectivement constaté avec l'indemnité librement fixée. Lorsque le résultat est positif, le solde est versé à l'assurance maladie ; lorsqu'il est négatif, il est reversé à l'exploitant.
En l'absence de fixation d'un prix de référence à défaut d'inscription sur les listes de remboursement à l'issue de l'accès direct, le CEPS fixe un prix en fonction des critères applicables (VIII).
b) La procédure menant à l'octroi d'un accès direct
Le B du même I définit la procédure conduisant à l'attribution d'un accès direct.
L'accès direct est demandé par l'exploitant dans le mois suivant l'avis de la commission de la transparence sur la demande d'inscription aux listes de remboursement.
L'exploitant s'engage à assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national, à assurer gracieusement la continuité des traitements pour une période de douze mois au terme de la période d'accès direct sauf en cas d'arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité du patient, et à fournir gracieusement la spécialité à compter de la fin de la période de prise en charge de l'assurance maladie, fixée à douze mois.
Il s'agit d'engagements similaires à ceux qui figurent ou figureront dans les demandes d'accès précoce.
Outre que le manquement à ces engagements peut justifier l'arrêt de la période d'accès direct848(*), il peut exposer l'industriel à une pénalité financière dont le montant peut atteindre 30 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre de la spécialité les deux années précédant la constatation du manquement, toutes indications confondues, comme le prévoit le IX de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34. Cette pénalité, recouvrée par les Urssaf, est affectée à la Cnam. Le droit au contradictoire s'applique, ainsi que le droit au recours, de plein contentieux.
c) Les conditions de dispensation des médicaments en accès direct
Les médicaments en accès direct sont dispensés, aux termes du II de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34, dans certains établissements de santé et dans certains hôpitaux des armées. Il s'agit du même champ que l'accès précoce.
Le même II prévoit la possibilité d'assortir, sur avis de la commission de la transparence, l'accès direct de conditions quant à la compétence des prescripteurs, l'environnement technique, l'organisation des soins et la mise en place d'un dispositif de suivi des patients. Les médicaments bénéficiant d'un accès direct peuvent faire l'objet de conditions particulières de prescription et de dispensation ; en tout état de cause, le prescripteur fait figurer la mention « Prescription au titre de l'accès direct » sur l'ordonnance.
d) La fin de la période d'accès direct et les continuités de traitements
Le VI de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 prévoit qu'il est mis fin à la période d'accès direct lorsque :
- la durée d'attribution arrêtée est échue ;
- le médicament est inscrit sur une liste de remboursement au titre de l'indication considérée ;
- l'exploitant refuse l'inscription sur une liste de remboursement pour l'indication considérée ou retire sa demande en ce sens ;
- l'exploitant en fait la demande ;
- l'exploitant manque aux engagements qu'il a pris lors de la demande d'accès direct.
Dans les trois derniers cas, la fin de l'accès direct est arrêtée par les ministres de la santé et de la sécurité sociale.
À l'issue de la période d'accès direct, l'industriel est tenu d'assurer la continuité des traitements pour une durée d'un an.
En cas d'inscription sur les listes de remboursement, le IX du même article prévoit que s'appliquent les conditions de prise en charge et de dispensation associées. Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation de l'accès direct sont maintenues et l'exploitant fournit la spécialité à titre gracieux. Il s'agit là d'une différence avec l'expérimentation qui prévoyait, dans cette dernière situation, une indemnisation sur le fondement d'un prix de référence déterminé par le CEPS.
e) Autres dispositions
Le X de l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 34 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de l'accès direct.
Le III de l'article 34 du PLFSS modifie l'article 281 octies du code général des impôts pour appliquer le taux réduit de 2,10 % de TVA aux médicaments bénéficiant d'un accès direct. Ce taux s'applique aujourd'hui notamment aux médicaments bénéficiant d'un accès précoce ou d'un accès compassionnel.
Les 3° et 4° du I et les 1°, 2°, 3°, c du 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°849(*), 16°, 17°, 19°, 20° et 21° du II de l'article 34 opèrent des coordinations rendues nécessaires par la pérennisation de l'accès direct respectivement dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale.
L'étude d'impact fixe à 22 millions d'euros par an le coût prévisionnel de la pérennisation de l'accès direct ainsi encadrée.
4. Une suppression de l'accès temporaire, introduit par la LFSS pour 2024
Le 6° du II écrase l'article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale, qui portait les dispositions relatives à l'accès temporaire, sans replacer ces dernières. L'accès temporaire, introduit par la LFSS pour 2024, serait donc supprimé.
Le c du 7° du même II prévoit une coordination rendue nécessaire par la suppression de l'accès temporaire.
5. La révision des critères de fixation des prix des produits de santé
Les 4° et 18° du II prévoient respectivement de modifier les critères de fixation du prix des médicaments et des dispositifs médicaux.
Le 4° modifie pour cela l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, qui régit la fixation des tarifs des médicaments et les motifs pour lesquels ces derniers peuvent être abaissés.
Le 18° en fait de même vis-à-vis de l'article L. 165-2 du même code, qui contiennent des dispositions similaires pour le prix des dispositifs médicaux.
Les tarifs des produits de santé pourraient désormais être minorés au motif que des prix ou tarifs inférieurs850(*) existent dans d'autres pays présentant des caractéristiques de marché comparables et figurant sur une liste fixée par décret. Cette possibilité n'est aujourd'hui ouverte qu'au regard des tarifs ayant cours dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable.
L'étude d'impact mentionne notamment le cas du Japon et de la Corée du Sud, qui pourraient être les premiers à intégrer la liste, et qui bénéficient de produits de santé à des tarifs globalement plus avantageux que les pays européens.
Cette mesure pourrait, à horizon 2029, générer 530 millions d'euros d'économie en appliquant les prix japonais ou sud-coréens, lorsqu'ils sont plus bas, aux prix des médicaments ayant actuellement cours en France.
6. Entrée en vigueur
Le A du IV fixe l'entrée en vigueur du présent article à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2026.
Le B du IV prévoit que les médicaments bénéficiant d'un accès précoce accordé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les conditions d'éligibilité et de prise en charge actuellement en vigueur. Ces spécialités peuvent toutefois bénéficier d'un accès direct si elles en remplissent les conditions.
Le C du IV prévoit que les médicaments bénéficiant d'un accès compassionnel accordé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article se voient appliquer le cadre de prise en charge de l'accès compassionnel actuellement en vigueur.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission a accueilli avec une certaine réserve les dispositions de l'article 34.
1. Sur les accès dérogatoires
• La commission s'émeut des évolutions apportées au régime de l'accès précoce, qui pourraient fragiliser ce dispositif pourtant plébiscité par les industriels et reconnu pour son rôle déterminant dans l'accès aux médicaments innovants pour les patients, en premier lieu ceux qui souffrent du cancer.
La commission estime, d'une part, qu'il est souhaitable d'opérer une répartition claire des champs des dispositifs d'accès dérogatoires, à des fins de lisibilité. Elle note donc que la pérennisation de l'accès direct doit nécessairement s'accompagner d'un recentrage de l'accès précoce autour de son coeur de cible : les médicaments immatures n'ayant pas encore reçu d'AMM. Elle juge pour autant que la restriction de l'accès précoce post-AMM proposée par le Gouvernement est excessive au regard des besoins de clarification, et laisse des périodes de vie du médicament où n'est ouvert aucun dispositif d'accès dérogatoire. Elle propose donc, en ce sens, de maintenir un accès précoce post-AMM pour les médicaments qui n'ont pas encore reçu d'évaluation de la commission de la transparence et qui sont, à ce titre, hors du champ de l'accès direct, par son amendement n° 694.
D'autre part, il convient de noter que l'accès précoce sous sa forme actuelle satisfait un grand nombre d'acteurs : les patients et les établissements y voient une garantie essentielle pour l'accès aux médicaments innovants, et les industriels un dispositif attractif, qui justifie de privilégier le marché français sur d'autres. La prudence appelle donc, autant que faire se peut, à maintenir ce dispositif.
La rapporteure ne peut nier que des dérives sont observées : les médicaments bénéficiant d'un troisième ou quatrième renouvellement d'accès précoce seraient certainement, sauf situation particulière, déjà inscrits à la prise en charge de droit commun si les industriels ne bénéficiaient pas, au titre de l'accès précoce, de la possibilité de bénéficier, pour aussi longtemps que dure la négociation, de ventes à un tarif librement déterminé par lui. L'accès précoce est donc paradoxalement, dans sa version actuelle, désincitatif à la célérité des négociations dans la mesure où un industriel est susceptible de tirer un avantage à rester sous le régime de l'accès précoce.
Cette situation appelle, à n'en pas douter, des corrections - et la rapporteure ne s'oppose pas, à cet égard, à une modulation de la prise en charge à compter d'une certaine durée après l'attribution de l'avis de la commission de la transparence pour dynamiser les négociations tarifaires. Elle regrette néanmoins une forme de jusqu'au-boutisme du Gouvernement, qui, en retenant une fourniture gracieuse après trois ans d'accès précoce, menace de manière trop directe l'attractivité du dispositif. La commission a donc adopté en ce sens l'amendement n° 699 de sa rapporteure, qui prévoit plutôt une prise en charge minorée de moitié à compter de la quatrième année d'accès précoce.
Par l'amendement n° 700 de sa rapporteure, la commission corrige ce qui semble être une erreur matérielle pouvant conduire à des ruptures de prise en charge : dans le cadre d'un accès précoce pré-AMM, le texte prévoit en effet la possibilité pour l'industriel de maintenir l'indemnité d'accès précoce qu'il réclame au-delà d'un an après l'avis de la commission de la transparence, sans toutefois prévoir de prise en charge associée de la sécurité sociale. La commission précise donc que, dans ce cadre, la fourniture s'effectue à titre gracieux.
Il en va de même pour les continuités de traitement, fournies aux termes du texte à titre gracieux alors qu'elles font aujourd'hui l'objet d'une prise en charge partielle de la sécurité sociale sur la période. En adoptant l'amendement n° 695 de sa rapporteure, la commission maintient une prise en charge de la sécurité sociale sur une partie de la durée des continuités de traitements, mais précise que la fourniture s'effectue, par la suite, à titre gracieux.
• La commission soutient la pérennisation de l'accès direct, qui a démontré son utilité lors de son expérimentation. Si la commission se félicite que le Gouvernement ait corrigé certains aspects qui agissaient comme des freins au dispositif, par exemple l'exclusion des spécialités bénéficiant d'une inscription au remboursement en ville dans une autre indication, elle regrette que les modalités de continuités de traitements proposées reposent uniquement sur un caractère gracieux. Elle estime qu'un partage de la charge entre l'industriel et l'assurance maladie serait plus équitable.
• La commission soutient les évolutions apportées au régime de l'accès compassionnel, qui constituent des précisions utiles. Elle a toutefois souhaité prévoir que des motifs de sécurité pouvaient faire obstacle à l'obligation de continuités des traitements en cas de retrait ou non-renouvellement d'AMM, par l'adoption de l'amendement n° 697 de sa rapporteure.
• Si la commission ne peut que regretter que le Gouvernement n'ait jamais véritablement mis en oeuvre l'accès temporaire qu'il avait pourtant lui-même porté devant le Parlement il y a deux ans, elle ne s'oppose pas à sa suppression à des fins de clarification, ces dispositions étant inappliquées.
2. Sur les modalités de fixation des prix des produits de santé
La commission s'oppose vivement à la réforme des modalités de fixation des prix des produits de santé par l'ouverture de la possibilité de décider de baisses tarifaires sur la base des prix qui ont cours au Japon ou en Corée du Sud.
La question du rattachement de ces dispositions sensibles à un article particulièrement technique, long de plus de 140 alinéas et ne présentant pas de lien avec les conditions générales de fixation des prix des produits de santé, avait, d'emblée, de quoi interroger.
Relevant que les prix des produits de santé en France ne sont déjà pas particulièrement élevés, la rapporteure exprime des craintes sur les effets que pourrait avoir la mesure proposée sur l'attractivité du marché français pour les industriels, et donc, en conséquence, sur l'approvisionnement du marché national en produits de santé, au préjudice des assurés.
La rapporteure note par ailleurs que la construction de l'Ondam pour 2026 repose notamment sur 2,3 milliards d'euros de mesures de maîtrise tarifaire regardant les produits de santé, dont 1,6 milliard de baisses de prix sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Elle ne peut donc que constater que le Gouvernement dispose déjà, avec les outils en vigueur, de leviers suffisants pour mettre à contribution le secteur des produits de santé lorsqu'il en est besoin, sans nécessiter de mesures nouvelles.
La commission a adopté l'amendement n° 698 de sa rapporteure, supprimant ces dispositions du texte.
Enfin, la commission a adopté un amendement n° 696, d'ordre rédactionnel.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article
35
Expérimenter le référencement de certains
médicaments thérapeutiquement équivalents
Cet article propose de mettre en place, à titre expérimental, une procédure de référencement sélectif par le Comité économique des produits de santé (CEPS) de certains groupes de médicaments substituables (génériques, hybrides et biosimilaires) ou jugés thérapeutiquement équivalents, en dérogation des modalités de fixation des prix de droit commun.
Pour certains groupes de médicaments, ne seraient remboursés par l'assurance maladie que certains médicaments sélectionnés sur appel d'offres, en fonction de critères de prix, de sécurité d'approvisionnement ou d'impact environnemental.
Le dispositif proposé prévoit l'attribution des offres à plusieurs laboratoires, auxquels seraient assignées des obligations en matière d'approvisionnement, avec des sanctions en cas de manquement.
Inquiète des conséquences d'un tel dispositif sur le tissu de l'industrie pharmaceutique français et l'approvisionnement en médicaments matures, la commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : une procédure expérimentale de référencement sélectif de certains médicaments thérapeutiquement équivalents
A. La politique française de régulation économique et financière du médicament est confrontée à enjeux d'approvisionnement, d'attractivité du marché français et d'impact environnemental
1. Le cadre légal de fixation du prix des médicaments matures ne garantit pas leur présence pérenne sur le marché français
La fixation des prix du médicament est encadrée de manière stricte en droit interne, et en application de la directive « transparence » de 1988851(*).
Le prix public des médicaments est fixé par voie réglementaire, par le biais d'une politique conventionnelle de négociation entre le CEPS et les entreprises exploitant le médicament ou assurant son importation ou sa distribution parallèle852(*), en application des orientations ministérielles qui lui sont données853(*). Ces négociations s'appuient également sur un accord-cadre signé entre le CEPS et le syndicat représentant les entreprises du médicament (Leem), qui étoffe largement les règles de discussion des prix. Le dernier accord, datant du 5 mars 2021, a été prorogé en 2024 puis en 2025854(*).
Les critères de fixation du prix de vente au public par le CEPS dans la version actuellement en vigueur de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale
« Le prix de vente au public de chacun des médicaments [...] est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament [...] et le Comité économique des produits de santé [...] ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix [...]. »
« La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, fixé dans le cadre d'un achat national [...] ou d'un achat conjoint [...], des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Elle tient également compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. »
La fixation du prix des médicaments génériques855(*), biosimilaires856(*) et hybrides857(*) donne lieu à des mécanismes de décote spécifiques par rapport au prix facial de la spécialité de référence, précisés dans l'accord-cadre858(*). Ainsi, un médicament générique entrant dans le champ de la ville est affecté d'une décote de prix de 60 % par rapport au prix net du médicament générique de référence, tandis que ce dernier subit une baisse de prix de 20 %.
En sus, dans les deux ans qui suivent la commercialisation des médicaments génériques, des baisses supplémentaires de prix sont appliquées.
L'inscription des médicaments sur la liste de remboursement en officine se fonde, quant à elle, sur l'évaluation du service médical rendu (ASMR) par la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS), le ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale fixant ensuite par arrêté, son taux de remboursement, compris entre 15 % et 100 %859(*).
Les mécanismes de fixation des prix des médicaments conduisent automatiquement à un nivèlement vers le bas des prix des médicaments matures.
L'assurance maladie fait état d'une baisse des prix des médicaments génériques. Alors qu'ils représentent en volume une part croissante des médicaments vendus en officine, passant de 28,8 % à 44,0 % entre 2013 et 2024, leur part dans les montants remboursés est passé, sur la même période, de 18,9 % à 16,2 %860(*).
L'association GEnérique Même MEdicament (GEMME) souligne la faiblesse du prix des médicaments génériques en France, qui serait, selon elle, en 2023, de 41 % inférieur au niveau des prix dans quatre pays européens (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni), soit 16 centimes par comprimé contre 27 centimes dans les autres pays étudiés861(*). Cette analyse est identique concernant les médicaments biosimilaires, dont le prix par unité de dispensation est de 44 % inférieur en France, soit 212 euros contre 377 euros pour les pays de référence862(*).
Or, une trop faible rentabilité peut détourner les entreprises vers la production de médicaments innovants et coûteux non substituables ou vers d'autres marchés.
2. La régulation économique et financière du médicament cherche à se renouveler
a) Vers une intégration graduelle du critère de sécurité d'approvisionnement dans la fixation des prix
• Si la lettre d'orientation ministérielle au CEPS de février 2021 évoquait les enjeux de souveraineté sanitaire et d'approvisionnement en médicaments et « le rôle du CEPS en matière de politique industrielle, d'efficience du système de soins et de résilience de l'approvisionnement en médicaments », elle n'en précisait pas les modalités de prise en compte863(*).
L'accord-cadre de mars 2021 entre le CEPS et le Leem864(*) prévoit néanmoins une procédure conventionnelle de sécurisation de l'approvisionnement par le prix. L'article 28 stipule ainsi que des hausses de prix peuvent être envisagées, à l'initiative de l'entreprise, lorsqu'une augmentation des coûts d'un médicament met en danger sa production ou sa commercialisation, et que sa disparition du marché français créerait un risque de rupture d'un besoin thérapeutique mal couvert, ou en cas d'urgence à l'initiative du CEPS. Le CEPS conditionne l'attribution de hausses tarifaires à un engagement de l'entreprise à approvisionner le marché français
Ainsi, selon le rapport d'activité 2024 provisoire du CEPS, que la rapporteure a pu consulter, une revalorisation tarifaire a été accordée par le CEPS pour un produit en 2024, sur un total de sept demandes reçues. Une autre demande, portant sur un produit éligible, n'a pas pu être instruite initialement en raison de l'absence de documentation justificative. L'entreprise a déposé une nouvelle demande, accompagnée de pièces actualisées, permettant au CEPS d'en poursuivre l'examen.
En parallèle, de nombreuses mesures ont été intégrées dans les lois de financement de la sécurité sociale successives pour anticiper les pénuries et permettre un rétablissement rapide de l'approvisionnement en cas de rupture865(*).
Un panel varié de mesures de lutte contre les pénuries de médicaments866(*)
Le cadre juridique actuel repose majoritairement sur les orientations suivantes :
- des obligations d'approvisionnement867(*)
et de constitution de stocks de sécurité868(*) avec la mise en place d'un stock de sécurité minimal par les exploitants et titulaires d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)869(*) couvrant les besoins d'approvisionnement pour deux mois (extensible à quatre mois pour les MITM ayant connu des ruptures régulières sous deux ans)870(*) ou temporairement, d'un niveau inférieur871(*) ;
- des obligations déclaratives et de planification passant, d'abord, par la notification des ruptures par les titulaires d'AMM deux mois en amont de la suspension ou cessation de commercialisation872(*) (portée à un an pour les MITM sans alternative873(*)), ensuite, par l'obligation d'élaborer des plans de gestion des pénuries (notamment pour les MITM)874(*) et de renseigner un système d'information sur la disponibilité des MITM (mis en oeuvre par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, appelé « DP-ruptures »)875(*), ainsi que par l'existence de centres d'appel d'urgence876(*) ;
- pour les grossistes-répartiteurs, une interdiction d'exporter ou de vendre à des distributeurs en gros exportateurs des MITM en rupture ou risque de rupture 877(*);
- des mesures de soutien à la relocalisation, en prévoyant notamment une concession temporaire de l'AMM à un établissement pharmaceutique public en l'absence de repreneur privé878(*), et par la planification d'investissements pour des projets de relocalisation (France 2030) ;
- des mesures de régulation de la demande, par le biais d'ordonnances de dispensation conditionnelle879(*) et par l'autorisation de la délivrance à l'unité880(*), des mécanismes pouvant être imposés en cas de rupture881(*);
- la possibilité d'une intervention étatique dans la régulation de l'offre, par l'action de Santé Publique France882(*) soutenue par les mécanismes de coordination européenne (notamment la plateforme européenne de surveillance des pénuries, l'ESMP)883(*) ;
- des sanctions financières en cas de manquement aux obligations précitées884(*).
• La LFSS pour 2022 a introduit la possibilité de tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantir l'implantation des sites de production dans la fixation du prix des médicaments par le CEPS. En effet, l'existence de sites de production sur le territoire français ou européen est un enjeu stratégique de la prévention des pénuries.
Le CEPS a précisé en 2023 sa doctrine d'emploi de ce critère légal supplémentaire.
Il apprécie d'abord la propension des médicaments à être concernés par un enjeu de sécurité d'approvisionnement, puis évalue si les étapes de fabrication et leur localisation permettent de garantir la sécurité de l'approvisionnement885(*).
Cette analyse conduit à classer les conditions de production des produits éligibles selon trois niveaux de sécurité d'approvisionnement : faible, moyen ou élevé. Dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments et aux choix de l'industrie pharmaceutique française de 2023, le CEPS avait ainsi indiqué que « les hausses qui peuvent être octroyées peuvent aller jusqu'à 15 % : si le principe actif est fabriqué en Chine, que le médicament est produit au Maroc et que le conditionnement a lieu en France, la hausse de prix ne sera pas de 15 %. Nous avons une grille de calcul »886(*).
Seuls les médicaments d'Amélioration du service médical rendu (ASMR)887(*) I à III conçus sur le territoire sont éligibles à cette disposition, ainsi que des ASMR de niveau IV et V s'il appartiennent à un domaine thérapeutique vulnérables, c'est-à-dire lorsque des mesures de gestion ont été prises par l'ANSM pour des produits thérapeutiquement équivalents dans les deux années qui précèdent.
Malgré le silence de la loi, ces tarifs préférentiels sont uniquement mis en oeuvre pour les nouvelles autorisations de mise sur le marché (AMM), et non pour les spécialités déjà inscrites au remboursement, réduisant ainsi grandement la portée du mécanisme888(*). La rapporteure de la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments et aux choix de l'industrie pharmaceutique française de 2023 appelait de ce fait à la modification de la doctrine du CEPS pour inclure les médicaments matures à ce dispositif889(*).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025890(*) est venue renforcer la prise en compte par le CEPS du critère industriel du lieu de production des médicaments dans la procédure de détermination de leur prix. Ce critère tarifaire est donc devenu obligatoire, non plus seulement facultatif.
Par le biais d'une nouvelle lettre d'orientation ministérielle891(*), le Gouvernement a incité le CEPS à modifier sa doctrine pour soutenir et développer une industrie pharmaceutique « forte et souveraine » et l'a invité à rendre pleinement opérationnelles les dispositions législatives inscrites en LFSS 2022 et renforcées en LFSS 2025 lors de la signature du nouvel accord-cadre avec les entreprises du médicament.
• On constate actuellement une baisse des tensions d'approvisionnement892(*).
L'ANSM fait état de 3 825 signalements de ruptures et de risques de ruptures en 2024, contre 4 925 signalements en 2023893(*).
Évolution du nombre de présentations
de médicaments
en rupture ou à risque de rupture de
stock894(*)
Source : Drees, ANSM
Les tensions d'approvisionnement en MITM avaient atteint un niveau inédit entre 2021 et 2023, culminant à l'hiver 2022-2023 avec près de 800 présentations simultanément en rupture de stock, avant un repli progressif en 2024895(*).
La même tendance est constatée à l'échelle de l'Union européenne : le nombre de pénuries s'est stabilisé entre 2023 et 2024, alors que l'année 2023 était la pire jamais enregistrée, d'après une enquête du Groupement pharmaceutique de l'Union européenne896(*).
Toutefois, cette évolution quantitative ne traduit pas nécessairement une amélioration qualitative de la situation, puisque l'ANSM précise que cette tendance « ne reflète pas la sévérité ni la complexité de ces tensions d'approvisionnement ». En effet, « 63 % des déclarations de risque de rupture ou de rupture sont liées à des capacités de production industrielle insuffisantes et/ou une augmentation du volume des ventes, 10 % sont liées à des défauts d'approvisionnement en matière première, ou de conditionnement »897(*).
L'ANSM rappelle également qu'il s'agit toujours des médicaments « matures » qui sont les plus touchés par les ruptures d'approvisionnement, comme cela avait déjà été mis en exergue par la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments et aux choix de l'industrie pharmaceutique française de 2023898(*).
b) Des réflexions en cours sur l'intégration de l'impact environnemental de l'industrie pharmaceutique dans la fixation des prix des médicaments
L'impact environnemental de l'industrie pharmaceutique est encore peu pris en compte. La loi du 10 février 2020 dite « AGEC »899(*) a prévu la délivrance de médicaments à l'unité, afin de limiter leur gaspillage, mais ces dispositions n'ont été que faiblement appliquées900(*), et restreintes aux seuls antibiotiques901(*). Les politiques de régulation par le prix ne tiennent quant à elles pas compte de l'impact environnemental des entreprises.
D'après les travaux du Shift Project, un think tank menant des réflexions sur la transition vers une économie post-décarbonée, l'industrie des médicaments représente 1,4 % de l'empreinte carbone de la France, étant à l'origine de l'émission de 9,1 millions de tonnes de CO2 annuellement. 55 % de ces émissions sont directement liées à la production des principes actifs, à la recherche et développement et aux activités corporatives. 8 % des émissions proviennent de la production des emballages902(*).
Ces travaux soulignent également l'effet significatif de la relocalisation dans l'Union européenne ou en France sur la baisse de ces émissions. Ils estiment à ce titre que les médicaments actuellement produits entièrement en Chine présenteraient, s'ils étaient fabriqués en Europe, des émissions de production inférieures d'environ 40 %, et de 50 % s'ils étaient produits en France.
B. L'article 35 propose d'expérimenter une procédure de référencement certains médicaments thérapeutiquement équivalents sur des critères de prix, de sécurité d'approvisionnement, voire d'impact environnemental
L'article 35 prévoit la mise en place d'une expérimentation pour une période maximale de cinq ans d'une « procédure de référencement » consistant à sélectionner un nombre restreint de médicaments remboursés dans une même catégorie. Les médicaments génériques, similaires et hybrides sont les principaux médicaments visés.
L'objectif affiché de cette procédure est d'obtenir des prix inférieurs, avec en contrepartie une perspective de volume pour les laboratoires référencés, mais également de bénéficier d'engagements en matière d'approvisionnement.
Ainsi, par dérogation aux règles de fixation et de révision du prix des médicaments remboursables et de remises903(*), cet article prévoit de subordonner l'inscription sur les listes de médicaments remboursés à une sélection de plusieurs candidats au sein de certains groupes de génériques, de médicaments hybrides, similaires, ou jugés thérapeutiquement équivalents.
Le CEPS serait doté d'une nouvelle mission904(*) de mise en oeuvre de la procédure de référencement sur saisine des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui déterminent les catégories de médicaments.
Il sélectionnerait les groupes en fonction « des volumes, de la dépense remboursée, de l'évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d'acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d'approvisionnement ».
Pour chaque groupe, il attribuerait l'offre à plusieurs entreprises en fonction de différents critères : les conditions tarifaires proposées, les garanties d'approvisionnement, au regard notamment de la diversité et la sécurité des sources d'approvisionnement, et, de façon facultative, l'impact environnemental des médicaments et des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale.
Il est prévu que l'analyse des conditions tarifaires tienne compte des remises commerciales accordées aux pharmacies d'officine905(*).
L'exposé des motifs précise que l'impact environnemental des médicaments pourrait être déterminé à partir du calcul de leur impact carbone. Cependant, ce critère ne serait que facultatif.
Les médicaments retenus au sein d'un groupe seraient seuls admis au remboursement, pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.
Dans le cadre du référencement, les laboratoires attributaires concluraient avec le CEPS des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, s'agissant notamment de la couverture du marché français.
Il est prévu que l'octroi du référencement par convention puisse être assorti d'une obligation, pour les entreprises exploitant le médicament ou les entreprises d'importation ou de distribution parallèle, de garantir l'approvisionnement du médicament sur le territoire national, en assurant :
- la fourniture de quantités minimales sur le marché ;
- une couverture suffisante du territoire.
Le non-respect de ces engagements pourrait entraîner :
- la possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de déroger à la convention afin d'assurer l'approvisionnement du médicament ;
- le retrait du référencement et, le cas échéant, la sélection de nouveaux médicaments ;
- l'application de pénalités financières à l'encontre de l'entreprise, à hauteur de 10 % maximum du chiffre d'affaires réalisé en France, selon la gravité, la durée, et la répétition des manquements ;
- la mise à la charge de l'entreprise des surcoûts supportés par l'assurance maladie, le cas échéant.
Les conditions d'application de cette procédure de référencement seront fixées par un décret en Conseil d'État.
Il est prévu que cette expérimentation fasse l'objet d'un rapport d'évaluation quant à l'opportunité de sa pérennisation.
L'étude d'impact estime que les économies s'élèveraient 13 millions d'euros par an, à partir de 2028. Ce résultat est estimé en considérant que 2 à 3 % des groupes génériques et biosimilaires seraient concernés par l'expérimentation, et que la sélection entraînerait une baisse de 10 % des prix des médicaments.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
A. Les expériences et tentatives de référencement sélectif montrent que cet outil de maîtrise des dépenses a des effets de bord sur le marché du médicament
1. La procédure de référencement des médicaments aux Pays-Bas a des effets ambivalents
Depuis 2006, six assureurs privés se substituent à l'action du gouvernement néerlandais par une politique groupée de « marques préférentielles ». Les assureurs privés lancent des appels d'offres aux laboratoires pharmaceutiques, pour sélectionner la marque de médicament générique la moins chère pour sa catégorie de substance active, qui est ainsi éligible au remboursement.
Comme le souligne la mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) de 2012, l'objectif de cette mesure était d'accroître les conditions concurrentielles entre producteurs afin de faire pression sur la baisse de prix906(*). La raison d'être du dispositif se rattachait ainsi plus à la maîtrise des prix des entreprises qu'à des enjeux de sécurité d'approvisionnement.
L'Igas avait mis en lumière l'impact des politiques de médicaments génériques, notamment entre la France et les Pays-Bas, en jugeant la politique de référencement favorable à la baisse des niveaux de prix et défavorable au maintien du tissu pharmaceutique industriel et la sécurisation de l'approvisionnement.
Analyse de l'impact de différentes
politiques
des médicaments génériques mises en oeuvre
en Europe
|
Prix administré (France) |
Appels d'offre par les assureurs (Pays-Bas) |
|
|
Niveau de prix |
Défavorable |
Favorable |
|
Intérêt pour l'assureur |
Défavorable |
Favorable |
|
Tissu pharmaceutique industriel |
Favorable |
Défavorable |
|
Marge officinale |
Favorable |
Neutre |
|
Sécurité d'approvisionnement |
Favorable |
Défavorable |
|
Accès aux soins/reste à charge |
Favorable |
Défavorable |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat à partir de la mission Igas
Le rapport de l'association néerlandaise des assureurs santé Zorgverzeketaars Nederland (ZN) de 2024 déclare que 86 % des groupes de prescription sont inclus dans le « domaine préférentiel » et se voient appliqués la politique de préférence. Le rapport confirme par ailleurs les conclusions de l'Igas et affirme l'existence d'une corrélation entre la politique de préférence et :
- la faiblesse des prix des médicaments du domaine préférentiel ;
- l'accroissement de la fréquence des pénuries (14 à 19 % des volumes en dose disponible journalière sont concernés par les pénuries contre 7 à 9 % hors politique de préférence) ;
- la diminution du nombre de fabricants actifs par groupe ;
- l'augmentation de la durée moyenne des ruptures (13 semaines contre 10 semaines hors politique de préférence) ;
- la propension plus importante d'occurrence des pénuries durant les périodes de renouvellement de la préférence907(*).
2. L'Autorité de la concurrence a souligné les risques concurrentiels d'un référencement sélectif des dispositifs médicaux
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 contenait une disposition permettant de conditionner le remboursement de certains dispositifs médicaux, tels que les fauteuils roulants, à une procédure de référencement908(*). Le projet de décret afférent a fait l'objet d'un avis « réservé » de l'Autorité de la concurrence, qui a considéré que la procédure de référencement sélectif, en excluant certains dispositifs médicaux du remboursement, « [conduirait] vraisemblablement à la disparition définitive de certaines entreprises et à une concentration des marchés concernés », faciliterait la constitution d'un oligopole pouvant limitant l'innovation et ainsi entraîner une hausse des prix à terme. Elle recommandait par ailleurs d'assouplir les contraintes pour les entreprises, s'agissant de leurs engagements d'approvisionnement et de couverture territoriale, du fait du risque d'éviction pour les petites entreprises pouvant difficilement s'engager sur des grands volumes ou des prix fixes909(*).
Dans le prolongement de l'avis de l'Autorité de la concurrence, le CEPS souligne dans sa contribution écrite que si un dispositif de référencement devait être mis en place sur les médicaments thérapeutiquement équivalents, il conviendrait de restreindre la durée des marchés, malgré le surcoût administratif engendré, et d'assurer le caractère multi-attributaire de l'appel d'offres pour limiter la concentration des acteurs910(*).
B. La procédure proposée est rejetée par tous les acteurs pharmaceutiques
La commission ne peut que regretter que le Gouvernement n'ait pas entendu les inquiétudes des acteurs quant aux effets délétères d'une telle expérimentation sur la stabilité du marché des médicaments matures.
Elle émet des doutes sur la capacité du dispositif à soutenir la production de ces médicaments sur le territoire national, et craint au contraire qu'il contribue à fragiliser le tissu de l'industrie pharmaceutique français.
Elle rappelle qu'il existe déjà des obligations légales pour les industriels et les pharmaciens d'officine qui visent à prévenir les ruptures d'approvisionnement, dont certaines sont encore en cours de mise en oeuvre.
En refusant le remboursement aux entreprises non retenues, il existe un risque de perte de flexibilité de l'offre, certains acteurs pouvant rediriger leur production vers d'autres médicaments. Ils pourraient alors être dans l'incapacité de pallier à court terme les défaillances des acteurs retenus, le cas échéant, voir cesser la commercialisation sur le long-terme, sachant que l'AMM d'un produit non commercialisé pendant une durée de trois ans est considérée comme caduque911(*). En outre, même les laboratoires retenus risquent de quitter le marché français s'ils ne sont pas reconduits à l'issue de l'appel d'offres.
La commission fait également part de ses craintes quant à l'impact que cette expérimentation pourrait avoir sur la continuité de la prise en charge des patients souffrant de pathologies chroniques.
Dans sa contribution écrite, le Leem met en avant les impacts négatifs qu'un référencement sélectif aurait sur la commercialisation des médicaments, sur l'observance de leur traitement par les patients et sur l'attractivité du marché français. Il estime qu'une telle procédure aurait « un effet délétère » sans traiter les causes des problématiques d'approvisionnement.
Le syndicat national des pharmaciens des hôpitaux publics et des collectivités territoriales unis (SNPHPU) met également en exergue l'impact potentiel de cette expérimentation sur les marchés publics hospitaliers, pour lesquels les prix d'appel d'offres sont bas, du fait de la captation du marché de ville par la prescription hospitalière, les prescriptions hospitalières influençant les traitements poursuivis en ville. Cela concerne notamment les inhibiteurs de la pompe à protons visés par cette expérimentation. Le nouveau dispositif aurait pour conséquence une augmentation des prix pour l'hôpital, en l'absence d'intérêt pour les laboratoires de conserver cette stratégie de prix912(*).
La commission rappelle qu'une telle mesure de référencement sélectif avait déjà été envisagée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et avait fait l'objet de nombreuses critiques en l'absence de concertation préalable avec les acteurs. Il apparaît que son inclusion dans ce projet de loi n'a, de nouveau, pas donné lieu à suffisamment de concertations avec ceux-ci et fait l'objet d'un rejet quasi unanime.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté l'amendement n° 701 de la rapporteure qui vise à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 36
Réformer la tarification des
établissements pour enfants et jeunes adultes en situation de handicap
dans le cadre de la réforme « SERAFIN-PH »
Cet article prévoit la mise en oeuvre de la réforme de la tarification dite « SERAFIN-PH » dans les établissements pour enfants et jeunes adultes handicapés à partir de 2027, avec pour objectif d'améliorer l'adéquation entre les dotations versées et les besoins de financement des structures d'une part, et d'encourager la transformation de l'offre d'autre part.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé
A. Le financement des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées : un système devenu obsolète
1. L'accompagnement médico-social des personnes handicapées est assuré par une diversité d'établissements et de services
De l'enfance à l'âge adulte, l'accompagnement des personnes en situation de handicap est assuré par une diversité de structures.
En 2024, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) comptent 542 000 places, dont 181 000 places pour les enfants et 361 000 places pour les adultes913(*).
Ils se répartissent en différentes catégories listées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF)914(*), selon la nature des prestations proposées (accueil, hébergement ou logement ; accompagnement médico-social, éducatif et psychologique ; insertion sociale et professionnelle...) et le profil des personnes accompagnées (enfants, jeunes adultes et/ou adultes).
L'orientation des personnes en situation de handicap vers ces structures relève principalement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). En leur sein, une équipe pluridisciplinaire est chargée d'évaluer les besoins des personnes handicapées et de prendre les décisions relatives à leurs droits, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation vers des structures médico-sociales915(*).
2. Le financement des ESMS pour personnes handicapées repose sur un système peu lisible
Les ESMS pour personnes handicapées relèvent de la responsabilité des agences régionales de santé (ARS), en tant que relais locaux de la branche autonomie de la sécurité sociale, et des conseils départementaux, en vertu de leur chef de filât dans le domaine de l'action sociale916(*).
En application de l'article L. 314-7 du CASF, le montant global des dépenses autorisées des structures est fixé par l'autorité compétente en matière de tarification917(*) (qui est également compétente pour attribuer les autorisations)918(*), à savoir :
- le directeur général de l'ARS pour les ESMS pour enfants et jeunes adultes, les ESAT et les établissements ou services de réinsertion sociale et professionnelle ;
- le président du conseil départemental et le directeur général de l'ARS conjointement pour les établissements et services, co-financés par la sécurité sociale et les départements, qui accueillent et apportent une assistance, des prestations de soins, un accompagnement médico-social ou une aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ;
- et le président du conseil départemental pour les établissements et services non médicalisés tels que les foyers d'hébergement, les foyers de vie, les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) et les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS).
Dans la majorité des cas - sauf pour les ESMS pour enfants et jeunes adultes qui sont intégralement financés par la sécurité sociale -, les ARS financent les prestations médicales et paramédicales (soit environ 80 % du financement des ESMS pour adultes)919(*), tandis que les départements interviennent par le biais de financements directs (dotations) et indirects (versement de prestations) pour financer l'accompagnement et l'hébergement.
La part du financement des ESMS pour personnes handicapées relevant de la sécurité sociale dépend, chaque année, de l'objectif global de dépenses (OGD-PH)920(*) fixé en LFSS. En 2025, ces financements représentent 15,2 milliards d'euros pour la branche autonomie921(*).
C'est sur la base de l'OGD-PH qu'est fixé le montant annuel total des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, tarifs et prix de journée. Ce montant est réparti par la CNSA en dotations régionales limitatives (DRL) aux ARS. Celles-ci disposent alors de deux mois pour adresser à chaque établissement ou service médico-social une décision tarifaire précisant le montant qui sera versé à la structure et pour quels types de charges.
Le fonds de financement des établissements et services médico-sociaux
Le fonds de financement des ESMS englobe les frais de fonctionnement des ESMS pour personnes âgées et handicapées, conformément à l'objectif global de dépenses médico-sociales (OGD), ainsi que le concours aux dépenses des départements destiné à compenser les coûts de mise en oeuvre de certaines revalorisations salariales des structures que ces derniers financent intégralement. Plus précisément, ce fonds finance :
- les charges d'exploitation des structures relevant du périmètre de la branche autonomie, comme les salaires des professionnels, l'augmentation des dotations au regard de l'évolution générale des prix, des actions spécifiques (coordination des activités d'aide et de soins pour les services intervenant à domicile, renforcement des accompagnements pour les résidents en établissement pour personnes âgées dépendantes atteints de maladies neurodégénératives...) et certaines revalorisations salariales des professionnels, notamment celles déployées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues au secteur médico-social ;
- et la diversification de l'offre médico-sociale, notamment pour le repérage et l'accompagnement précoces pour les enfants de 0 à 6 ans, la création de pôles d'appui à la scolarité (PAS) pour mettre en place des solutions pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ; le déploiement de solutions médico-sociales supplémentaires, ou encore la création de nouvelles places en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Source : CNSA
Les financements alloués par les conseils départementaux représentent quant à eux 8,4 milliards d'euros en 2024, net des concours versés par la CNSA aux départements922(*).
Ces financements s'opèrent, de façon indirecte, par le biais du versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui solvabilise l'aide humaine et technique apportée aux bénéficiaires et de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) qui prend en charge tout ou partie des frais d'hébergement en établissement médico-social.
Ils prennent également la forme de dotations globales et de prix de journée, dans les structures pour lesquelles les départements disposent d'une compétence tarifaire (voir tableau ci-après)923(*).
Enfin, s'il n'existe pas de reste à charge dans les structures pour enfants, les établissements non médicalisés proposant un hébergement sont intégralement à la charge des résidents si ceux-ci ne sont pas éligibles à l'ASH. Dans le cadre de la PCH, certaines actions ou services peuvent excéder le plan d'aide et ainsi constituer un reste à charge.
Principaux financeurs par type d'ESMS pour personnes en situation de handicap
|
Type de missions |
Structure(s) |
Financement |
|
ESMS pour enfants et jeunes adultes (moins de 20 ans) |
||
|
Établissements pour enfants atteints de déficience à prédominance intellectuelle proposant une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique |
Instituts médicoéducatifs (IME) |
ARS (dotation globale) |
|
Services intervenant au sein des différents lieux de vie de l'enfant (domicile, lieu d'accueil de la petite enfance, centre de loisirs) pour lui apporter un soutien éducatif et thérapeutique individualisé |
Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) |
ARS (dotation globale) |
|
Accueil d'enfants ou adolescents présentant un trouble du comportement important, sans déficience intellectuelle |
Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) |
ARS (dotation globale) |
|
Instituts pour déficients visuels, les instituts pour déficients auditifs et instituts d'éducation sensorielle pour sourds et aveugles |
Établissements d'éducation spéciale pour déficients sensoriels |
ARS (dotation globale) |
|
Accueil des enfants présentant une déficience motrice importante, et dont certains sont spécialisés dans l'accueil des enfants polyhandicapés |
Instituts d'éducation et de rééducation motrice (IEM) |
ARS (dotation globale) |
|
Prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique adaptée à l'ensemble des besoins de chaque jeune lorsque l'intégration en milieu scolaire ordinaire n'est pas envisagée |
Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés (EEAP) |
ARS (dotation globale) |
|
Autres |
Autres, dont centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) |
ARS (dotation globale) Conseil départemental (dotation globale) |
|
ESMS pour adultes |
||
|
Accompagnement dans l'exercice d'une activité professionnelle en milieu protégé |
Établissements et services d'aide par le travail (ESAT) |
ARS (dotation globale) État (garantie de ressources) |
|
Hébergement pour les travailleurs en situation de handicap |
Foyers d'hébergement (FH) Foyers de vie (FV)924(*) |
Conseil départemental (prix de journée) |
|
Aide à la vie sociale au domicile |
Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) |
Conseil départemental (prix de journée) |
|
Soins infirmiers et aide à la vie quotidienne au domicile |
Services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) |
ARS (forfait global de soins) Conseil départemental (prix de journée) |
|
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) |
ARS (forfait global de soins, dotation de coordination, financements complémentaires) |
|
|
Services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) |
ARS (forfait global de soins, dotation de coordination, financements complémentaires) Conseil départemental (tarifs horaires) |
|
|
Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) |
Conseil départemental (tarifs horaires) |
|
|
Prise en charge médicale ou paramédicale pour les personnes lourdement handicapées qui nécessitent une surveillance médicale et des soins constants |
Foyers d'accueil médicalisé (FAM) |
ARS (forfait global) Conseil départemental (prix de journée) |
|
Maisons d'accueil spécialisé (MAS) |
ARS (prix de journée) |
|
|
Aide à la réinsertion sociale et professionnelle |
Établissements et services de préorientation ou de réadaptation professionnelle (ESPO ou ESRP) |
ARS (dotation globale) |
Source : Commission des affaires sociales
3. Le mode de financement des structures médico-sociales pour personnes handicapées est obsolète
Le rapport rendu en 2012 par la mission conjointe de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) (rapport Jeannet-Vachey)925(*) a mis en avant que le financement du secteur des ESMS pour personnes handicapées est à la fois complexe (multiplicité de financeurs et des règles de tarification), chronophage (pour les financeurs comme les gestionnaires) et marqué par de fortes iniquités, liées au caractère principalement historique des dotations de fonctionnement et au manque d'outils d'aide à la décision (évaluation des besoins d'accompagnement, indicateurs médico-sociaux, études de coûts, référentiels de prestations...).
a) Une logique de reconduction des dotations historiques déconnectée des besoins de financement réels et peu incitative
La majorité du financement des structures médico-sociales pour personnes handicapées repose sur la reconduction de dotations financières historiques.
L'annexe 1 de la circulaire budgétaire pour 2025926(*), qui détaille le calcul de l'assiette de la reconduction des dotations, en démontre le caractère essentiellement linéaire : il s'agit du montant des dépenses engagées pour l'exercice précédent diminué du montant des financements de régularisation non reconductibles et, le cas échéant, ajusté du montant des « opérations de fongibilité » intervenues (en cas de conversion de structures sanitaires en structures médico-sociales et inversement).
À cette assiette particulièrement stable est ensuite appliqué un taux de reconduction (0,92 % en 2025) prenant en compte l'évolution de la masse salariale et des dépenses matérielles. Des financements complémentaires peuvent intervenir, en lien avec la mise en oeuvre de mesures nouvelles.
Outre la reconduction quasi-mécanique des dotations historiques, le système repose sur le financement de places, plutôt que sur le financement des parcours des personnes accompagnées. Il tient peu compte des caractéristiques des personnes accueillies et de la complexité de certaines prises en charge (personnes polyhandicapées ou présentant un trouble psychique notamment) ce qui tend à pénaliser les structures qui accompagnement les publics les plus lourdement handicapés. En somme, ce mode de financement est source d'iniquités entre les établissements, ce qui affecte directement la qualité de prise en charge.
En outre, ce système de financement est peu incitatif en ce qu'il ne permet pas de valoriser la transformation de l'offre médico-sociale conduite par certaines structures, notamment sur le plan du virage domiciliaire, de l'adaptation au vieillissement des personnes handicapées, de l'amélioration de la prise en charge de certains handicaps et de la personnalisation des parcours.
b) De premiers pas vers une plus grande souplesse budgétaire sans remise en cause globale du système de financement
L'adéquation entre les financements, les besoins des structures et l'atteinte d'objectifs de transformation de l'offre suppose de combiner la logique quantitative en vigueur (une ouverture de place = une ligne de crédits) avec une logique qualitative, basée sur des indicateurs de gestion plus fins.
Dans cet esprit, une certaine souplesse gestionnaire a été introduite à partir de 2016 via la diffusion d'outils budgétaires tels que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).
L'EPRD et le CPOM
• L'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) est un document budgétaire dont le modèle est fixé par arrêté ministériel927(*). Il a progressivement remplacé les anciens budgets prévisionnels des structures médico-sociales.
L'EPRD décrit, pour l'année à venir, l'ensemble des recettes et des dépenses prévues. Son caractère prévisionnel permet de donner de la visibilité aux gestionnaires sur l'équilibre économique de leurs structures, et d'en suivre la trajectoire financière pluriannuelle (le document doit comprendre un plan global de financement pluriannuel simulant la trajectoire financière des établissements et services sur une période glissante de six ans)928(*).
Il est élaboré chaque année et transmis à l'autorité de tarification (ARS et/ou conseil départemental). La dotation annuelle de financement de la structure est fixée sur la base de son ERPD, lequel est censé traduire les choix de gestion et les priorités inscrites dans le projet d'établissement et dans le CPOM, ce qui permet un dialogue entre le gestionnaire et l'autorité de financement.
• La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est obligatoire, depuis 2016929(*), pour toutes les structures médico-sociales accompagnant des personnes handicapées930(*). Elle est en revanche facultative pour les structures non médicalisées relevant de la compétence unique du conseil départemental, en lien avec la libre administration des collectivités territoriales, bien qu'elle soit explicitement encouragée931(*). La généralisation des CPOM est allée de pair avec la généralisation, pour les structures concernées, de l'EPRD.
Conclus entre les gestionnaires de structure et la ou les autorités chargées de leur tarification, les CPOM fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de qualité de prise en charge définis, sur une durée maximale de cinq ans.
L'article L. 313-12-2 du CASF précise que la conclusion d'un CPOM entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret. Il peut prévoir - il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation - une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, l'activité de l'établissement ou du service ne pouvant « en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation ».
En parallèle, le Gouvernement et la CNSA ont tenté de laisser aux autorités tarifaires la possibilité (et non l'obligation) d'opérer une reconduction tarifaire moins mécanique.
Par exemple, l'annexe 9 de la circulaire budgétaire pour 2018932(*) donne la possibilité aux ARS qui le souhaitent de définir les dotations versées aux établissements selon l'application d'une formule d'actualisation ou de revalorisation ou d'une équation tarifaire.
En outre, de premiers indicateurs qualitatifs ont été publiés à l'annexe 16 de cette même circulaire. Au nombre de vingt-trois, ils se déclinent en quatre objectifs de transformation de l'offre : prévenir les ruptures de parcours, l'absence ou l'inadéquation de solutions ; développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations servies pour mieux répondre aux besoins ; consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des parcours ; et améliorer en continu la qualité des accompagnements en favorisant l'adaptation des pratiques.
Néanmoins, comme le soulignait déjà un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat en 2018933(*), les ARS se sont très diversement emparées de ces outils. Le maintien d'une certaine « rigidité tarifaire » s'expliquerait en grande partie par une remontée des besoins lacunaire au niveau des ARS, doublée de l'absence d'outil de suivi susceptible de leur permettre d'actualiser le montant des dotations en fonction de données quantitatives et qualitatives.
B. La réforme « SERAFIN-PH » entend répondre aux limites du système de financement tout en promouvant la transformation de l'offre
1. La réforme « SERAFIN-PH » s'inscrit dans un contexte de transformation de l'offre médico-sociale
Prenant acte des conclusions du rapport Jeannet-Vachey sur la tarification des structures médico-sociales, en 2014, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la CNSA ont lancé des travaux pour dessiner une réforme du système de financement.
Ce projet, baptisé « SERAFIN-PH » (services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées »), poursuit selon le Gouvernement trois objectifs :
- renforcer l'équité dans l'allocation des ressources aux établissements et services, en prenant en compte des critères objectifs permettant de mieux appréhender la complexité de certains accompagnements ;
- inciter à la transformation de l'offre médico-sociale via la tarification, avec pour objectifs la continuité et la personnalisation des parcours, notamment en facilitant l'accompagnement sur le lieu de vie et en tenant compte des aspirations des personnes ;
- et garantir la stabilité et la lisibilité du modèle de financement des structures médico-sociales, par la combinaison de dotations forfaitaires et de dotations variables en fonction de la réalité de l'activité.
Les objectifs de continuité et de personnalisation des parcours poursuivis par cette réforme s'inscrivent plus généralement dans un contexte de transformation de l'offre médico-sociale encouragée par les pouvoirs publics. Celle-ci vise à passer d'un développement de l'offre centré sur le nombre de places à la valorisation d'objectifs qualitatifs.
La qualité de l'accompagnement sur tout le territoire et pour toutes les personnes handicapées est en effet l'un des quatre grands objectifs de la conférence nationale du handicap (CNH) d'avril 2023934(*).
À ce titre, le Gouvernement a annoncé le déploiement de 50 000 solutions médico-sociales à horizon 2030 pour un budget d'1,5 milliard d'euros. Les moyens sont fléchés vers des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs entre création de places dans les territoires en tension ; amélioration de l'accompagnement des publics les plus vulnérables (personnes polyhandicapées, enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, personnes handicapées vieillissantes) ; création d'un service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce pour les enfants de moins de 6 ans ; et soutien à la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire.
La CNH 2023 a également fixé comme objectif le passage d'une logique de place à une logique d'offre de services coordonnés. En ce sens, le Gouvernement a annoncé que tous les établissements et services pour enfants handicapés devraient passer d'une logique de places à une logique plus ouverte de services en proposant hébergement, appui à la vie sociale et soins. À terme, l'objectif est que ces structures se constituent en « plateformes de services » capables d'assurer une prise en charge globale de chaque enfant, dépassant le strict accompagnement médico-social.
Selon un récent rapport de l'Igas, aujourd'hui, une telle modularité de l'accompagnement n'est proposée que par 25 % des établissements pour enfants et 3 % des établissements pour adultes935(*).
2. La réforme SERAFIN-PH prévoit que le nouveau système de financement repose sur une part dite « socle » et une part dite « variable »
La construction du nouveau modèle de financement a reposé sur une feuille de route en plusieurs phases, associant les différentes parties prenantes au sein d'un comité stratégique.
Les premières étapes (2015-2018) ont permis d'améliorer la connaissance des coûts de prise en charge et de construire des outils permettant une meilleure allocation des ressources, afin de pouvoir adapter les financements aux besoins réels. Une nomenclature a ainsi été mise en place, permettant d'appliquer à toutes les structures un référentiel commun pour identifier les besoins des personnes accompagnées.
À partir de 2018, une nouvelle étape a été lancée pour définir le nouveau modèle de tarification, en intégrant une phase de simulation des impacts financiers.
Un pré-arbitrage a d'abord été rendu, proposant de travailler à un modèle de financement reposant sur, d'une part, une dotation dite « socle » emportant une stabilité sur la durée du CPOM et, d'autre part, une dotation dite « variable » réévaluable plus fréquemment, qui serait constituée d'une majoration valorisant la complexité des situations accompagnées et de financements complémentaires, par exemple liés à la qualité.
L'objectif de cette formule est à la fois de garantir une certaine sécurité et stabilité pour les gestionnaires, grâce à la dotation socle, et d'inciter à la transformation de l'offre et à l'innovation, par le biais de la dotation complémentaire. La CNSA a également indiqué qu'une attention particulière était portée aux transports, leur accessibilité et leur développement allant de pair avec la désinstitutionalisation.
Le Gouvernement a annoncé le fléchage de 360 millions d'euros sur la période 2027-2030 (soit 90 millions d'euros par an) pour permettre d'accompagner les structures vers la transformation de l'offre et, ainsi, éviter que certaines ne ressortent perdantes de la nouvelle équation tarifaire.
Afin de préciser les contours du modèle proposé, des travaux complémentaires sont actuellement conduits pour recueillir des données à la personne plus détaillées, nécessaires pour approfondir le travail sur le budget variable. De nouvelles données médico-économiques sont également recueillies pour affiner le nouveau modèle et simuler ses effets.
C. Le présent article prévoit l'application de la réforme SERAFIN-PH aux ESMS pour enfants et jeunes adultes handicapés
1. Champ des établissements et services médico-sociaux concernés par le présent article
Le I insère un article L. 314-2-4 au sein du CASF, dans la partie relative aux règles de compétence en matière de tarification des structures médico-sociales.
Ce nouvel article applique un régime de financement dérogatoire aux établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, soit les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation936(*).
Il est précisé que les structures concernées sont celles qui accompagnent des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap, après orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH. Sont ainsi exclus du périmètre les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les bureaux d'aide psychologique universitaires (BAPU), et les services d'aide (SAAD) et de soins (SSIAD) à domicile, afin, par souci de simplification, de ne conserver que les structures relevant de la compétence tarifaire exclusive des agences régionales de santé (ARS).
En application de l'article D. 312-0-1 du même code, qui précise les catégories d'établissement visées par le 2° du I de l'article L. 312-1, sont ainsi concernés les instituts médicoéducatifs (IME), les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), les instituts d'éducation motrice (IEM), les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés, les instituts pour déficients auditifs, les instituts pour déficients visuels et les services assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire aux enfants.
2. Régime de financement dérogatoire applicable à ces établissements et services
Le I prévoit que les établissements et services mentionnés ci-avant bénéficient d'une dotation globale de financement composée :
- d'une part principale prenant en compte, notamment, leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées et les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées ; cette part principale pouvant être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ;
- et, le cas échéant, de financements complémentaires définis dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM).
Ces dispositions doivent être précisées par décret en Conseil d'État. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement précise que le modèle devrait prévoir diverses incitations pour développer l'accueil en milieu ordinaire (école, centre de loisir, milieu professionnel pour les adolescents et jeunes adultes, etc.) en valorisant l'innovation et en soutenant spécifiquement les dépenses liées aux transports, qui augmenteront en lien avec le mouvement de désinstitutionalisation.
Par ailleurs, afin de permettre la détermination du montant de la dotation globale de financement, le I prévoit que les structures doivent transmettre à la CNSA et à l'ARS compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions fixées par décret.
3. Dispositions relatives à la transition vers le nouveau régime de financement
Le II prévoit un régime de financement transitoire avant que le régime dérogatoire prévu au I ne s'applique pleinement, afin de permettre une mise en oeuvre progressive de la réforme et de laisser aux structures le temps de s'adapter au nouveau mode de financement.
Ainsi, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement est déterminée chaque année en fonction :
- d'une part, du montant versé au titre de l'année précédente ;
- et, d'autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l'application du nouveau régime de financement.
Les modalités d'application de ce régime de financement transitoire, notamment la durée de sa mise en oeuvre et la formule de modulation appliquée, sont précisées par décret en Conseil d'État.
Le III prévoit que l'ensemble des établissements et services concernés par le présent article adoptent le cadre budgétaire de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
4. Entrée en vigueur
Le IV prévoit une entrée en vigueur du présent article à compter du 1er janvier 2027. Le Gouvernement a précisé que l'année 2026 serait consacrée aux travaux réglementaires et aux derniers réglages du modèle.
Pour préparer cette entrée en vigueur, le V dispose que dans des conditions fixées par décret, les établissements et services concernés transmettent à la CNSA et à l'ARS compétente, en 2026, les informations nécessaires pour simuler les montants selon les nouvelles règles de financement.
Ces informations seront également utilisées pour calculer, pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l'année précédente dans le cadre du régime de financement transitoire prévu au II.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission se félicite du lancement opérationnel de la réforme SERAFIN, engagée il y a déjà plus de dix ans.
Au cours des auditions conduites par le rapporteur, l'ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels les fédérations du secteur médico-social et les associations représentatives des personnes handicapées, ont indiqué l'importance de cette réforme et leur satisfaction vis-à-vis des objectifs poursuivis.
L'annonce d'une enveloppe de 360 millions d'euros marque l'engagement du Gouvernement pour préserver les structures qui n'auraient pas encore pris le virage de la transformation de l'offre et de les accompagner dans cette démarche. Au-delà des financements, il conviendra d'assurer un appui aux ESMS dans leurs projets de transformation, via l'intervention de la CNSA et de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap).
Non seulement cette réforme doit permettre d'améliorer l'adéquation entre le montant des dotations attribuées aux structures et leurs besoins réels de financement, mais elle doit également encourager la transformation de l'offre médico-sociale qu'il est indispensable de mener. La commission juge en effet nécessaire d'encourager concrètement, par le biais de financements, les pratiques vertueuses qui permettent de renforcer les liens entre le secteur médico-social et le milieu ordinaire et de personnaliser l'accompagnement.
La commission restera toutefois vigilante quant aux travaux qui seront conduits en 2026 et qui permettront d'affiner le modèle de financement. En effet, l'équation tarifaire n'est pas encore déterminée et l'orientation prise par la réforme SERAFIN en dépend largement. Une attention particulière sera portée à la question des transports, dont les coûts vont mécaniquement augmenter avec la hausse des interactions entre le secteur médico-social et le milieu ordinaire. Les territoires ruraux sont particulièrement exposés à cette hausse des coûts, et doivent être dûment accompagnés afin que la réforme ne soit pas source d'inégalités territoriales.
Enfin, elle rappelle qu'au-delà de la question du financement des ESMS pour personnes handicapées, la question de la lisibilité de la répartition des compétences entre les ARS et les départements dans le champ médico-social mériterait de faire l'objet d'une réforme structurelle, dans l'optique d'améliorer l'efficacité et l'agilité de la politique de l'autonomie.
La commission a adopté un amendement rédactionnel n° 702 proposé par le rapporteur.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article
37
Contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
à la prise en charge du coût de l'accord
du 4 juin 2024 pour les départements
Cet article prévoit la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), à hauteur de 85 millions d'euros, à la prise en charge du coût de l'accord du 4 juin 2024 pour les départements.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Les revalorisations salariales dans le secteur médico-social privé à but non lucratif : une mise en oeuvre entravée par les difficultés financières des départements
1. La CNSA a compensé une partie du coût des récentes revalorisations salariales du secteur médico-social pour les départements
a) Des revalorisations salariales tardivement appliquées au personnel soignant du secteur médico-social privé à but non lucratif
En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 et du déficit d'attractivité croissant des métiers liés à la santé, le « Ségur de la santé » a abouti à la signature des accords de Ségur le 13 juillet 2020 entre le Gouvernement et les organisations syndicales.
Afin de revaloriser les rémunérations des professionnels, un complément de traitement indiciaire (CTI) dit « prime Ségur » été accordé, dans un premier temps, aux professionnels non médicaux des établissements de santé publics et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) publics et privés non lucratifs (183 euros nets mensuels) et privés (160 euros nets mensuels).
Au niveau législatif, cette mesure a été mise en oeuvre par l'article 48 de la LFSS pour 2021937(*). Appliquée à l'ensemble des professionnels non médicaux (personnel soignant, éducatif, administratif ou encore médico-technique) - soit environ 975 000 agents -, elle visait à reconnaître les efforts consentis durant la crise sanitaire et à renforcer l'attractivité des métiers.
En réponse aux revendications du secteur médico-social, également confronté à de forts enjeux de recrutement et de fidélisation et pourtant exclu de ces revalorisations (en dehors des Ehpad), des négociations ont été conduites dans le cadre de la mission confiée à Michel Laforcade sur l'attractivité des métiers de l'autonomie.
À l'issue de ces négociations et dans une logique de filière professionnelle, les « accords Laforcade » signés en 2021938(*) entre l'État et les partenaires sociaux ont étendu le CTI de 183 euros nets mensuels au personnel soignant (aide-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux...) des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) rattachés à un établissement de santé ou à un Ehpad, puis à l'ensemble des ESMS financés ou co-financés par la branche autonomie de la sécurité sociale qu'ils soient publics ou privés non lucratifs. Il s'agit principalement des structures accueillant des enfants ou adultes en situation de handicap et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Ces extensions de la prime Ségur ont été traduites à l'article 42 de la LFSS pour 2022 pour le secteur public939(*), et dans des recommandations patronales et des accords collectifs pour le secteur privé non lucratif. La LFSS pour 2022 a également étendu ces revalorisations aux soignants des ESMS financés exclusivement par les conseils départementaux.
En parallèle, un avenant à la convention collective de la branche de l'aide à domicile (BAD), agréé par arrêté ministériel, a permis d'appliquer une revalorisation salariale aux salariés des services d'aide (SAD) ou de soins (SSIAD) à domicile privés à but non lucratif940(*).
Enfin, en février 2022, dans le cadre de la conférence des métiers, le Premier ministre et l'Assemblée des départements de France ont conjointement annoncé l'extension de la prime Ségur aux travailleurs de la filière socioéducative (travailleurs sociaux) des secteurs public et privé à but non lucratif941(*).
Périmètre des revalorisations « Ségur » (jusqu'en 2022)
|
Revalorisation |
Établissements couverts |
Métiers |
Statut |
Nombre de personnels |
|
Ségur de la santé (juillet 2020) |
Établissements de santé (ES) et Ehpad |
Tous (sauf personnel médical en Ehpad) |
Public et privé |
1 500 000 |
|
Accords Laforcade (février et mai 2021) |
ESMS publics rattachés à un ES ou à un Ehpad ESMS (co)financés par la branche autonomie |
Soignants |
Public et privé |
86 000 |
|
Avenant 43 de la BAD (octobre 2021) |
Services et établissements rattachés à la BAD |
Tous |
Privé à but non lucratif |
150 000 |
|
LFSS 2022 |
ESMS financés exclusivement par les conseils départementaux |
Soignants |
Public et privé |
23 000 |
|
Conférence des métiers du 18 février
2022 |
ESMS, établissements sociaux relevant de l'État, collectivités territoriales |
Personnel médical, personnel socioéducatif, aides à domicile des centres communaux d'action sociale (CCAS) |
Public et privé |
237 000 |
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (2022)
b) Des coûts jusqu'ici partiellement compensés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Les revalorisations salariales intervenant dans le secteur social et médico-social représentent un coût pour les départements :
- ils financent intégralement certains établissements et services sociaux, en vertu de leur compétence dans le champ de l'action sociale ;
- et ils co-financent le fonctionnement de certaines structures médico-sociales pour ce qui a trait à l'hébergement et à l'accompagnement, directement via des dotations et indirectement via le versement de l'aide sociale à l'hébergement (ASH), de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
S'il n'existe pas d'obligation de compensation par l'État des nouvelles dépenses départementales liées au Ségur, les premières vagues de revalorisations salariales ont été accompagnées d'un mécanisme de compensation par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Celui-ci prend la forme de concours financiers aux départements :
- le concours « article 47 » (231 millions d'euros en 2025)942(*) compense en partie943(*), en application de l'article 47 de la LFSS pour 2021944(*), les revalorisations salariales dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) suite à la signature de l'avenant 43 de la convention collective de la BAD et à l'extension du CTI aux agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées ;
- et le concours « article 43 » (125 millions d'euros en 2025) compense intégralement, en application de l'article 43 de la LFSS pour 2022945(*), les surcoûts liés à l'extension du CTI au personnel soignant des ESMS intégralement financés par les conseils départementaux.
Le financement des « revalorisations Ségur »
En 2023, le coût des revalorisations liées au Ségur est pris en charge à 90 % par la Sécurité sociale, pour un coût de 11,3 milliards d'euros.
Cela s'explique, en premier lieu, par son poids en tant que financeur des établissements sanitaires, médico-sociaux et des services sociaux. Cela s'explique également par la volonté des pouvoirs publics de ne pas accroître les restes à charge des assurés (notamment en Ehpad, où les résidents financent plus du tiers des coûts de revient des structures). Le choix a également été fait de limiter le surcoût supporté par les autres financeurs, principalement les départements.
Ainsi, les revalorisations dites « Laforcade » (établissements et services sociaux et médico-sociaux (co)financés par la Sécurité sociale et financés intégralement par les départements) ont été prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale, essentiellement au titre de l'objectif global de dépenses de la branche autonomie. Les départements absorbent en conséquence 5 % du coût des revalorisations salariales (avant accord du 4 juin 2024).
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, juillet 2022
2. Un accord sur la revalorisation des professionnels d'ESMS privés à but non lucratif difficile à appliquer pour les départements
b) L'accord du 4 juin 2024 a étendu la prime Ségur au personnel non soignant des ESMS privés non lucratifs
Malgré l'extension progressive du champ d'application de la prime Ségur, la majorité des professionnels non soignants exerçant en structure sanitaire, sociale ou médico-sociale à but privé non lucratif en demeuraient exclus.
L'accord du 4 juin 2024 a répondu à cette situation en généralisant la prime Ségur à l'ensemble des professionnels, spécialement administratifs et techniques, relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (BASS) - soit environ 112 000 salariés supplémentaires. Il s'agit principalement des professionnels exerçant en structure sociale et médico-sociale, dans certaines associations intervenant dans les politiques d'action sociale et de santé (aide alimentaire, point conseil budget, planning familial...), dans des établissements d'accueil du jeune enfant, ou encore dans les centres de soins infirmiers.
Cet accord ayant été agréé par l'arrêté ministériel du 25 juin 2024946(*) dans les conditions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), il est opposable aux financeurs des établissements et services concernés qui sont financés par des fonds publics.
Rétroactif au 1er janvier 2024, cet accord s'appliquait initialement à l'ensemble des employeurs appliquant les conventions collectives de 1951 (Fehap) et de 1966 (Nexem), ainsi que l'accord d'entreprise de la Croix-Rouge. Il a été étendu, par un arrêté du 5 août 2024947(*), à l'ensemble des employeurs qui, sans adhérer à une fédération nationale et sans relever du champ d'application des conventions collectives précitées, relèvent du champ d'application de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées à but non lucratif en raison de leur activité principale.
b) Face aux difficultés financières des départements, un accord a été trouvé sur la compensation par la CNSA du surcoût généré
L'accord du 4 juin 2024 se traduit par un surcoût significatif pour les départements au titre de leur participation au financement des ESMS, estimé à 170 millions d'euros annuels, sans qu'aucun mécanisme de compensation financière ne soit initialement prévu.
Dans son dernier rapport sur les finances publiques locales948(*), la Cour des comptes souligne ainsi qu'en 2024, les dépenses des départements au titre des frais d'hébergement en établissements médico-sociaux et en famille d'accueil ont été particulièrement dynamiques (+ 6,6 %) en lien avec l'arrêté ministériel du 25 juin 2024 portant agrément de l'accord du 4 juin 2024.
Dans un contexte où les départements subissent une situation financière dégradée, et dont la dynamique des dépenses sociales est en partie la cause, il est apparu particulièrement difficile pour la majeure partie d'entre eux d'attribuer les financements supplémentaires nécessaires à l'application de l'accord du 4 juin 2024.
Contestant l'absence de compensation financière et dénonçant une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, le 13 septembre 2024, Départements de France a appelé les conseils départementaux à ne pas mettre en oeuvre l'accord du 4 juin949(*). De fait, une partie des conseils départementaux a décidé de ne pas répercuter cet accord sur la tarification des structures qu'elles financent, empêchant à ces dernières d'appliquer les revalorisations salariales.
Un accord a finalement été trouvé entre le Gouvernement et Départements de France, lors du comité des financeurs des politiques sociales du 29 avril 2025. Il prévoit que dès l'année 2025, la CNSA apporte un soutien financier pérenne aux départements à hauteur de 85 millions d'euros, ce qui correspond à la moitié du surcoût annuel estimé de l'accord du 4 juin 2024 pour les départements.
B. Le présent article prévoit la compensation par la CNSA de la moitié du coût de l'accord du 4 juin 2024 pour les départements
Le 2° du présent article insère un alinéa à l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui porte sur l'application de la prime Ségur aux agents publics qui exercent au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et pour personne handicapées.
Ce nouvel alinéa dispose qu'afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales dans les ESMS à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap résultant de l'accord de branche du 4 juin 2024, la CNSA verse aux départements « une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d'euros ».
Les modalités de répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de places dans ces établissements et services, sont précisées par décret.
En vertu du b du 3°, ces dispositions seraient applicables à compter du 1er janvier 2025. La compensation prévue par le présent article est donc rétroactive sur l'année 2025 mais ne l'est pas sur l'année 2024, malgré la rétroactivité de l'accord au 1er janvier 2024.
Le 1° et le a du 3° sont des dispositions de coordination.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission ne peut qu'être favorable à cet article, qui acte la participation de la CNSA à la prise en charge du coût de l'accord du 4 juin 2024 pour les départements.
Elle souligne néanmoins que malgré ce dispositif de compensation, il restera très difficile pour certains départements d'appliquer pleinement l'accord du 4 juin au regard de la contrainte budgétaire qui pèse sur eux. Comme l'a rappelé l'association Départements de France au rapporteur, « l'effet ciseaux » qui résulte de la diminution des recettes et du fort dynamisme des dépenses sociales met en grande difficulté la majorité des départements, qui peu à peu, rognent sur certains postes de dépenses pourtant jugés essentiels dans le champ de l'action sociale.
De manière plus générale, la commission juge nécessaire de mener une réflexion sur la répartition des compétences entre les départements et la CNSA dans le champ du médico-social, en veillant à apporter des garanties aux départements sur leur capacité d'action et sur leurs marges de manoeuvre financières. Ces derniers ont en effet regretté que les dernières revalorisations salariales aient été actées par l'État sans concertation au niveau local, alors même que la charge financière finale repose en partie, voire intégralement sur les départements.
La commission a adopté l'amendement n° 704 du rapporteur, indiquant que les modalités de répartition de l'aide de la CNSA aux départements tiennent compte du nombre de personnels concernés par les revalorisations salariales plutôt que du nombre de places, jugeant cette modalité de répartition plus pertinente.
Elle a également adopté un amendement rédactionnel n° 703 du rapporteur.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 38
Déduction des indemnisations
versées par les assurances et fonds d'indemnisation de l'allocation
personnalisée d'autonomie (Apa)
et de la prestation de compensation
du handicap (PCH)
Cet article permet aux départements de déduire les indemnisations versées par les assurances et les fonds d'indemnisation de l'Apa et de la PCH, afin que les dommages causés par le tiers responsable ne soient pas doublement pris en charge.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit en vigueur, qui permet aux caisses de sécurité sociale d'obtenir un remboursement de prestations versées auprès des tiers responsables, ne s'applique pas dans le cadre de l'Apa et de la PCH
1. Le recours subrogatoire : un mécanisme qui permet aux caisses de sécurité sociale de récupérer, auprès des tiers responsables, les sommes versées au titre des prestations
a) Les recours subrogatoires exercés par les caisses de sécurité sociale
En vertu du principe de responsabilité civile, la personne responsable d'un dommage est tenue de le réparer dans son intégralité via le versement de dommages et intérêts, de sorte qu'il n'en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime (principe de réparation intégrale)950(*).
Dans le cas du dommage corporel, l'indemnisation peut être versée à la victime par une personne autre que le responsable du dommage (par exemple, un assureur), auquel cas la personne qui a pris en charge l'indemnisation peut agir contre le tiers responsable afin de récupérer la somme afférente, au moyen d'un « recours subrogatoire »951(*).
En droit des assurances, par exemple, il est prévu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur952(*).
En droit de la sécurité sociale, un recours subrogatoire est ouvert aux caisses de sécurité sociale afin que celles-ci puissent récupérer auprès du tiers responsable ou de son assureur les dépenses qu'elles ont supportées en lien direct avec le dommage causé953(*). De la sorte, le poids financier des dommages causés par les tiers responsables ne pèse pas sur la collectivité, et les victimes ne perçoivent pas de double financement (via l'indemnisation et via la prestation) pour un même préjudice.
Ce mécanisme est principalement utilisé par l'assurance maladie en cas d'accident de la route, de coups et blessures volontaires ou encore d'accidents médicaux fautifs954(*). La branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) y a également recours, principalement en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de faute d'un tiers responsable de l'accident du travail955(*).
La possibilité d'exercer un tel recours n'affecte pas le droit de l'assuré social aux prestations, les caisses de sécurité sociale restant tenues de les lui servir. Inversement, la circonstance que des prestations lui soient servies ne prive pas la victime de son droit d'agir contre le tiers responsable si le préjudice n'est pas réparé intégralement par les prestations.
Afin de permettre aux caisses de sécurité sociale de réaliser les recours contre tiers, la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers956(*).
La demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
b) Un recours qui s'exerce poste par poste
Deux parts sont donc distingués dans l'indemnité que le tiers responsable doit à la victime : l'une est vouée, en cas de RCT, à rembourser les frais de la sécurité sociale ; l'autre, qui représente le « reste à charge » de la victime, constitue la fraction des préjudices que les prestations ne sauraient réparer.
En vertu de l'article L. 317-1 du code de la sécurité sociale, un RCT porte sur les indemnités qui réparent des préjudices que les caisses de sécurité sociale ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel957(*). Ce recours s'exerce poste par poste, c'est-à-dire à l'échelle de petites unités regroupant des chefs de préjudice homogène.
Postes de préjudice sur lesquels s'imputent
la créance des caisses
d'assurance maladie
|
Postes de préjudices temporaires |
Dépenses de sécurité sociale afférentes |
|
Dépenses de santé actuelles |
Frais médicaux, frais pharmaceutiques, appareillages, frais de transport, hospitalisations |
|
Pertes de gains professionnels actuelles |
Indemnités journalières |
|
Postes de préjudices permanents |
Dépenses de sécurité sociale afférentes |
|
Dépenses de santé futures |
Frais médicaux, frais pharmaceutiques, appareillages, frais de transport, hospitalisations |
|
Pertes de gains professionnels futures |
Indemnités journalières, rente, |
|
Incidence professionnelle, |
Pension d'invalidité |
Source : Assurance maladie
Les sommes récupérées dans le cadre de ces recours ne sont pas négligeables : en 2024, elles représentent 821,9 millions d'euros pour la branche maladie et 436 millions d'euros pour la branche AT-MP958(*). Elles le sont principalement sur les dépenses de frais médicaux et pharmaceutiques, de frais d'hospitalisation, d'indemnités journalières, de frais d'appareillage, de transport, de rente « accident du travail » et de pension d'invalidité.
2. Le recours subrogatoire n'est pas ouvert aux départements au titre du versement de l'Apa et de la PCH
a) L'Apa et la PCH sont des prestations susceptibles de se superposer aux indemnités versées par les tiers responsables
La prestation de compensation du handicap (PCH) et l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) sont des prestations versées par les départements au titre de leur compétence dans le champ de l'action sociale.
La PCH est ouverte à toute personne dont le handicap survient avant l'âge de 60 ans959(*). Il s'agit d'une prestation individualisée, dont le montant est déterminé à l'issue d'une évaluation des besoins de compensation des conséquences du handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)960(*).
Cette prestation, qui bénéficie en 2025 à près de 407 000 personnes961(*), est constituée de cinq éléments permettant de couvrir les charges afférentes à l'aide humaine, aux aides techniques (fauteuil roulant, aide auditive, adaptations informatiques...) - souvent en complément d'une prise en charge par la sécurité sociale -, à l'aménagement du logement et du véhicule (mise en accessibilité, surcoûts liés au transport), à certaines aides spécifiques ou exceptionnelles (acquisition ou entretien de produits liés au handicap) et, enfin, à l'attribution et à l'entretien d'une aide animalière962(*).
L'Apa, qui compte 1,36 million de bénéficiaires en 2023963(*), est attribuée aux personnes âgées en perte d'autonomie de 60 ans et plus. Son montant varie en fonction du degré de perte d'autonomie et des ressources du bénéficiaire.
Elle permet de financer les dépenses liées au maintien au domicile et inscrites dans un « plan d'aide » telles que les prestations d'aide à domicile, du matériel, le portage des repas, des travaux d'aménagement du logement, des dépenses de transport (Apa à domicile) ou leur hébergement en établissement (Apa en établissement).
Cette allocation est principalement destinée aux personnes âgées dont la perte d'autonomie est liée à l'âge, mais du fait de la barrière d'âge de la PCH, elle peut également être attribuée aux personnes dont la perte d'autonomie est liée à un handicap survenu après 60 ans.
Qu'il s'agisse de l'Apa ou de la PCH, la situation de handicap qui ouvre le droit aux prestations peut résulter d'un dommage imputable à un tiers ; et dans un tel cas, lesdites prestations couvrent en partie des dépenses indemnisables par le tiers responsable ou son assureur (frais de transport, aide humaine, aménagement du logement ou du véhicule notamment).
b) Ces prestations ne peuvent pas faire l'objet d'un recours contre tiers
La loi « Badinter » du 5 juillet 1985964(*), qui liste de manière limitative les prestations ouvrant droit à subrogation et les organismes pouvant exercer ce type de recours, ne permet pas aux départements d'exercer de tels recours au titre du versement de l'Apa et de la PCH.
Néanmoins, la jurisprudence a progressivement reconnu un caractère indemnitaire à ces prestations, en autorisant leur déduction de l'indemnisation allouée à la victime lorsqu'une disposition légale le prévoit et uniquement lorsque la victime a fait valoir ses droits à la prestation avant d'être indemnisée.
Cette possibilité concerne aujourd'hui exclusivement les fonds d'indemnisation - le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)965(*), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam)966(*) et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva)967(*) -, qui sont autorisés à tenir compte, dans le montant de l'indemnisation allouée, des indemnités de toute nature étant reçues ou à recevoir au titre du même préjudice.
Des inégalités de traitement peuvent résulter de cette situation, les personnes n'étant pas encore bénéficiaires de l'Apa et de la PCH au moment où le montant de l'indemnité est fixé pouvant cumuler réparation et compensation.
Dans les autres cas d'indemnisation, l'Apa et la PCH ne peuvent être déduites de l'indemnisation et inversement, l'indemnisation ne peut être déduite du montant de la prestation versée. La Cour de cassation l'a précisé dans plusieurs décisions968(*), en refusant la déduction de la PCH et de l'Apa d'indemnisations dues par des assureurs, jugeant que le responsable d'un accident ou son assureur ne peuvent déduire de l'indemnisation des prestations qui ne peuvent donner lieu à recours subrogatoire.
Ainsi, les départements ne disposent, en l'état actuel du droit, d'aucun mécanisme leur permettant de récupérer les sommes versées au titre de l'Apa et de la PCH lorsque celles-ci sont directement imputables à un tiers responsable, ce qui conduit à des situations de « double-compensation » entre l'indemnisation versée par le responsable d'une part, et la prestation versée par le département d'autre part.
c) La proposition de l'Igas et de l'IGF
Ce constat a amené l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale des finances (IGF) à recommander, dans un rapport sur l'attribution des aides sociales, d'ouvrir la possibilité de déduire les éventuels droits à indemnisation versés par les assurances et autres tiers de la PCH et de l'Apa, en cas de cause accidentelle ; et d'instaurer une obligation de notification par les assureurs des montants d'indemnisations alloués969(*). Les postes indemnisés concernés seraient essentiellement l'aide humaine et l'adaptation du logement et du véhicule.
Il ne s'agit pas d'un recours subrogatoire, ce mécanisme étant considéré comme trop complexe sur le plan juridique et plus lourd en gestion pour les départements.
L'économie potentielle pour les départements (financeurs de ces prestations) et la branche autonomie (qui participent à leur financement via le versement de concours aux départements) est difficile à évaluer en l'absence de données retracées par les systèmes d'information sur la proportion de bénéficiaires de l'Apa et de la PCH dont l'origine du handicap est accidentelle, avec tiers responsable identifié et donnant lieu à indemnisation.
Le Gouvernement a néanmoins réalisé des calculs en estimant cette proportion à 1,5 % de bénéficiaires pour la PCH et à 0,5 pour l'Apa. Il en résulte que cette mesure rapporterait, à horizon de trois ans, environ 17,7 millions d'euros aux départements et 10,1 millions d'euros à la branche autonomie970(*).
B. Le présent article instaure un principe de subsidiarité de l'Apa et de la PCH vis-à-vis des indemnisations, permettant aux départements d'en obtenir le remboursement auprès des tiers responsables
1. La subsidiarité de l'Apa vis-à-vis des indemnités
Le I complète l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles relatif à la détermination du montant de l'Apa par un alinéa.
Il dispose que le département déduit du montant de l'Apa à domicile les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d'un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan d'aide. Les modalités de déduction seront précisées par voie réglementaire.
L'Apa en établissement n'est pas concernée par la mesure : versée sous forme de dotation globale, elle se prête mal à une décomposition entre ce qui relève d'un dommage lié à un accident et ce qui relève de la perte d'autonomie liée à l'âge. De plus, les dépenses d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) peuvent déjà être couvertes par la réparation intégrale, auquel cas elles sont prises en compte par le département dans la détermination de l'éligibilité à l'aide sociale.
Le II insère un nouvel article L. 232-4-1 au sein du même code, disposant qu'il appartient au bénéficiaire d'informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d'un dommage corporel et de toute modification de son montant.
Ce nouvel article prévoit également qu'à la demande du département, l'assureur ou le fonds d'indemnisation met à sa disposition les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la subsidiarité de l'Apa vis-à-vis des indemnités, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
2. La subsidiarité de la PCH vis-à-vis des indemnités
Le III prévoit les mêmes dispositions pour la PCH : l'article L. 245-6 du code de l'action sociale, qui porte sur ses modalités d'attribution, est complété par un alinéa disposant que le département pourra déduire du montant de la prestation les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d'un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan personnalisé de compensation, et que les modalités et déduction seront précisées par voie réglementaire.
De même que pour l'Apa, en vertu d'un nouvel article L. 245-6-1, il reviendra au bénéficiaire d'informer le département de toute indemnisation reçue en réparation d'un dommage corporel et de toute modification de son montant ; et à la demande du département, l'assureur ou le fonds d'indemnisation devra mettre à sa disposition les informations nécessaires selon les modalités précisées par voie réglementaire (IV).
3. Les dispositions de coordination
Les fonds d'indemnisation sont actuellement autorisés, suite aux décisions jurisprudentielles évoquées ci-avant, à déduire l'Apa et la PCH des sommes qu'ils versent aux victimes.
Dans la mesure où le département sera désormais compétent pour déduire les montants indemnisés des prestations qu'il verse, il convient par cohérence de retirer cette compétence aux fonds d'indemnisation. À cet effet, des dispositions sont introduites pour prévoir que l'Apa et la PCH ne peuvent être déduites des sommes versées par :
- le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), à l'article 706-9 du code de procédure pénale (V) ;
- l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), à l'article L. 1142-14 du code de santé publique (VI) ;
- et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), à l'article 53 de la LFSS pour 2021 (VII).
4. Entrée en vigueur
Le VIII prévoit une application des dispositions du présent article aux demandes d'Apa et de PCH déposées à compter d'une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027.
Dans un souci de sécurité juridique, elles ne s'appliqueront donc pas aux droits déjà ouverts aux bénéficiaires de l'Apa et de la PCH.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission comprend l'intention du Gouvernement d'améliorer l'efficience de la dépense publique et l'équité entre les assurés sociaux, traduite dans le présent article. Néanmoins, elle s'interroge sur la pertinence et la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif instauré.
Premièrement, elle émet des doutes quant à la sécurisation du dispositif. Il lui semble que peu de garanties sont apportées pour que la distinction entre les dépenses relevant de la solidarité nationale d'une part, et celles qui relèvent de l'indemnisation d'un préjudice d'autre part, soit réalisée de manière juste. De manière plus générale, le fait de mettre sur le même plan des prestations sociales mises en place pour limiter les effets du handicap sur le quotidien des personnes, dans une approche globalisée, et des indemnités versées pour compenser des préjudices précis liés à un accident peut être questionné.
Deuxièmement, la commission s'interroge sur le risque de surcharge administrative des départements et des assurés sociaux, déjà acculés par les démarches chronophages. Dans le champ du handicap, la procédure d'attribution des droits est déjà souvent longue et fastidieuse, et le fait d'obliger les bénéficiaires à informer le département de chaque changement de situation sur le plan des indemnisations qu'il perçoit - et d'obliger le département à solliciter les informations requises auprès des assurances - risque d'accentuer ce phénomène. Il ne serait d'ailleurs pas à exclure, à cet égard, que la mesure soit inégalement appliquée sur le territoire.
Troisièmement, elle remarque que le dispositif proposé se heurte à d'importantes complexités sur le plan opérationnel, pouvant se répercuter sur les bénéficiaires. Elle souligne notamment que des différences de temporalité existent entre, d'une part, la notification des droits par les MDPH et, d'autre part, la détermination des montants dus par les tiers responsables. Cela pourrait susciter l'incompréhension des bénéficiaires des prestations face à d'éventuelles révisions à la baisse de leurs plans de compensation. En outre, la commission s'interroge sur l'articulation du caractère évolutif des prestations (plus particulièrement de la PCH) avec l'indemnisation, qui peut être versée sous forme de capital ou de rente.
Enfin, les associations représentatives des personnes handicapées auditionnées par le rapporteur ont regretté l'absence de concertation sur cette mesure.
Au regard de ces observations, la commission a adopté l'amendement de suppression n° 705 présenté par le rapporteur.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 39
Réforme des
conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
Cet article propose de revoir les modalités de reconnaissance des maladies professionnelles, tant en ce qui concerne le système principal que le système complémentaire.
En ce qui concerne le système principal, il propose de fixer par décret en Conseil d'État, et non plus dans les tableaux de maladies professionnelles, les conditions tenant aux modalités de diagnostic des pathologies.
En ce qui concerne le système complémentaire, il prévoit de ne plus recourir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) mais à des médecins-conseils de la caisse pour la procédure dite de l'alinéa 6, applicable lorsqu'un assuré est atteint d'une pathologie figurant sur un tableau, mais ne remplit pas toutes les conditions pour en relever. L'avis du CRRMP serait maintenu pour les pathologies hors tableaux.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Deux systèmes coexistent pour la reconnaissance des maladies professionnelles
Depuis la loi du 25 octobre 1919, les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation lorsqu'ils souffrent d'une maladie contractée du fait de leur activité professionnelle971(*).
Sous réserve d'une reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie972(*), les assurés concernés peuvent alors bénéficier des prestations en nature et en espèces de la branche, plus avantageuses que celles de l'assurance maladie973(*) : prise en charge intégrale des frais de santé liés à leur pathologie974(*), indemnités journalières renforcées en cas d'incapacité temporaire975(*), indemnité en capital976(*) ou rente viagère en cas d'incapacité permanente977(*).
Le régime général représente 79 % des 87 000 maladies professionnelles reconnues en 2023, et le régime agricole 7 %978(*). Dans 88 % des cas, la maladie professionnelle reconnue est un trouble musculosquelettique.
Pour voir sa pathologie reconnue comme d'origine professionnelle, l'assuré doit suivre une procédure, qui diffère en fonction de sa maladie979(*).
1. La déclaration de maladie professionnelle : un préalable à la procédure
La reconnaissance d'une maladie professionnelle s'effectue à la demande de l'assuré980(*).
Celui-ci est chargé de transmettre à sa caisse primaire, une déclaration de maladie professionnelle981(*), y compris si la maladie fait, à ce stade, l'objet d'une indemnisation au titre du risque maladie. Il dispose, pour ce faire, d'un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ou de la date à laquelle il est informé d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle982(*), et, le cas échéant, de quinze jours983(*) à compter de la date de son arrêt de travail984(*).
Ce formulaire comprend notamment des informations sur la nature de la maladie et la durée de l'exposition au risque professionnel suspecté de l'avoir engendrée. Il ne peut être transmis que sous format papier : la Cour des comptes recommande, à cet égard, d'opérer la dématérialisation des formulaires de déclaration d'ici 2027985(*).
L'assuré transmet également en double exemplaire à la caisse, sauf si le médecin le lui a déjà communiqué, un certificat médical initial. Le certificat médical, dont l'assuré conserve un exemplaire, comprend des informations sur la nature de la maladie, ses manifestations et les suites probables986(*).
Il joint enfin à sa demande, le cas échéant, les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin et une attestation de salaire de l'employeur, sauf si ce dernier l'adresse directement à la caisse987(*).
Après réception de sa demande, l'assuré reçoit la feuille de maladie professionnelle, qui lui ouvre droit à la prise en charge intégrale des soins en lien avec sa pathologie, dans la limite des tarifs conventionnels988(*).
Il revient à la caisse d'avertir sans délai l'employeur et le médecin du travail compétent de la demande, en lui adressant une copie du dossier de déclaration de maladie professionnelle989(*).
La suite de la procédure dépend de la catégorisation de la pathologie : elle diffère selon que la pathologie relève ou non d'un tableau de maladies professionnelles990(*).
2. Deux voies distinctes d'accès à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, associées à des procédures différenciées
On distingue deux voies d'accès à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Lorsque l'assuré souffre d'une pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues audit tableau, s'applique la procédure dite principale. Dans le cas contraire, l'assuré relève de la procédure complémentaire, plus longue.
a) La voie principale, appliquée lorsque la pathologie relève d'un tableau de maladies professionnelles
i. Les tableaux de maladies professionnelles et la présomption d'imputation de la maladie à l'activité professionnelle
Les assurés relevant des tableaux de maladies professionnelles, dont l'origine remonte à la loi du 25 octobre 1919991(*) précitée, bénéficient d'une présomption d'origine professionnelle et suivent, à cet égard, une procédure simplifiée et accélérée.
Il s'applique alors la logique du compromis fondateur de l'indemnisation des accidents du travail issu de la loi du 9 avril 1898 : en contrepartie d'une présomption d'imputation de la maladie à l'activité professionnelle, l'assuré perçoit une réparation forfaitaire, et non intégrale.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, à cet effet qu'« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Le régime des non-salariés agricoles suit également ce principe992(*).
On compte aujourd'hui, annexés respectivement à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale993(*) et du code rural et de la pêche maritime, 121 tableaux de maladies professionnelles pour le régime général, et 62 pour le régime agricole, un total qui s'est étoffé au fil du temps994(*).
Les tableaux sont institués ou modifiés par décret simple995(*), après avis de la CAT-MP et d'une commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail (CS4)996(*) associant des représentants de l'État, de la sécurité sociale, des salariés et des employeurs, ainsi que des personnalités qualifiées.
Dans la pratique, le Gouvernement est le plus souvent saisi sur l'opportunité d'une révision en amont du projet de décret, sur proposition de la CS4, bénéficiant elle-même de l'éclairage scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). La CAT-MP est aussi amenée à se prononcer sur l'opportunité d'une révision avant l'établissement du projet de décret.
Les tableaux peuvent concerner une pathologie997(*) ou un groupe de pathologies relevant de l'exposition à un même risque998(*). Chaque tableau suit la même structure, comprenant trois colonnes :
- la première concerne la désignation de la maladie, et peut faire figurer des modalités de diagnostic de cette dernière999(*) ;
- la deuxième est relative au délai de prise en charge1000(*), qui fixe la durée maximale entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux facteurs de risque incriminés et la constatation de la maladie1001(*). Cette colonne peut également fixer une durée minimale d'exposition au risque1002(*) ;
- la troisième vise la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, qui peut être indicative1003(*), notamment pour ce qui concerne les « manifestation aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action d[`]agents nocifs » ou limitative1004(*), notamment pour les infections microbiennes1005(*).
Tableau n° 32 : affections
professionnelles provoquées par le fluor,
l'acide fluorhydrique et
ses sels minéraux
|
DÉSIGNATION DES MALADIES |
DÉLAI de prise en charge |
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
|
A. - Manifestations locales aiguës : Dermites. Brûlures chimiques. Conjonctivites. Manifestations irritatives des voies aériennes supérieures. Bronchopneumopathies aiguës, oedème aigu du poumon. |
5 jours |
Tous travaux mettant en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment : Fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ; Electrométallurgie de l'aluminium ; Fabrication des fluorocarbones ; Fabrication des superphosphates. |
|
B. - Manifestations chroniques : Syndrome ostéo-ligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéo-condensation diffuse et associé à des calcifications des ligaments sacrosciatiques ou des membranes interosseuses, radiocubitale ou obturatrice. |
10 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 8 ans |
Source : Code de la sécurité sociale
ii. La procédure applicable lorsque la pathologie de l'assuré relève pleinement d'un tableau de maladies professionnelles prévoit un délai maximal de quatre mois pour statuer
Lorsque la pathologie relève pleinement d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse dispose de 120 jours1006(*) pour statuer1007(*) à compter de la date de réception de la demande de reconnaissance complétée. En pratique, ce délai est presque intégralement consommé par les caisses, qui instruisent en moyenne les dossiers en 115,2 jours en 2023, pour ce qui concerne le régime général.
Au cours de la période d'examen, la caisse dispose de cent jours pour diligenter une enquête, se fondant sur un questionnaire adressé à l'assuré et à l'employeur et, le cas échéant, sur des investigations complémentaires ou des entretiens avec tout employeur ou tout médecin du travail de l'assuré1008(*).
À l'issue de son enquête, le dossier établi par la caisse est mis à la disposition de l'assuré et de l'employeur concerné, qui peuvent formuler des observations dans un délai de dix jours, en application du principe du contradictoire.
Tenant compte du dossier et de ces observations, la caisse rend alors sa décision sur la conformité de la situation de l'assuré aux conditions du tableau. Lorsque la caisse estime que l'assuré remplit l'ensemble des conditions de diagnostic, de délai de constatation de la maladie à compter de la fin de l'exposition, de durée et de type d'exposition associées au tableau concerné, elle lui accorde la reconnaissance de maladie professionnelle.
b) Une voie complémentaire, instituée en 1993, permet la reconnaissance de maladies dont il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime
Le système de reconnaissance par tableaux ne pouvant couvrir l'ensemble des situations de survenue d'une maladie professionnelle, le législateur a instauré, par la loi dite Neiertz de 19931009(*), un système de reconnaissance complémentaire. Il a répondu, en cela, à plusieurs recommandations émises par la Commission européenne en 1962, 1966 et 1990.
i. La voie complémentaire permet la reconnaissance comme maladies professionnelles lorsque toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies ou de pathologies hors tableaux
Le système complémentaire vise à répondre à deux catégories de situations distinctes :
- les situations dites de l'alinéa 61010(*), dans lesquelles l'assuré présente une pathologie figurant dans un tableau, mais ne répond pas à tous les critères que prévoit ledit tableau. Tout assuré ne remplissant pas une ou plusieurs conditions du tableau associé à sa maladie, relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux exposant à la pathologie, relève de ce régime1011(*). N'en relèvent pas, en revanche, les assurés ne répondant pas aux conditions de diagnostic fixées par les tableaux ;
- les situations dites de l'alinéa 71012(*), dans lesquelles la pathologie de l'assuré n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais entraîne un taux d'incapacité permanente supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État à 25 %1013(*). Depuis 20151014(*), les pathologies psychiques - notamment le syndrome d'épuisement professionnel ou burn out - peuvent être reconnues comme maladies professionnelles dans ce cadre.
La question du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de l'alinéa 7
Lorsque le système complémentaire a été institué, en 1995, le taux plancher d'incapacité permanente ouvrant droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableaux avait été fixé à deux tiers.
Ce seuil, particulièrement restrictif, a été réduit à 25 % en 2002 en vertu du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002 relatif à certaines procédures de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cette condition est toutefois encore jugée trop étroite, c'est pourquoi les partenaires sociaux représentatifs à l'échelle nationale ont réclamé, à l'unanimité, son abaissement à 20 % dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
La commission des affaires sociales du Sénat a, dans son rapport de 20241015(*), recommandé de suivre l'avis des partenaires sociaux et de « renforcer les capacités de traitement de dossiers [...] pour envisager, dans le futur, de nouvelles baisses »1016(*).
Cette baisse n'a, à ce jour, pas été mise en oeuvre par le Gouvernement.
Contrairement au système de reconnaissance principal, la procédure complémentaire ne repose pas sur l'application d'une présomption d'origine professionnelle ; pour autant, l'indemnisation accordée est identique. Pour bénéficier d'une reconnaissance, il doit donc être établi un lien suffisamment étroit entre l'activité professionnelle et la survenue de la pathologie. Il importe ainsi d'apporter la preuve qu'une pathologie relevant de l'alinéa 6 « est directement causée par le travail habituel de la victime ». Une pathologie relevant de l'alinéa 7 est soumise à un régime plus strict encore puisqu'elle doit être « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime »1017(*) pour être reconnue.
Il s'ensuit un taux de reconnaissance limité, autour de 42 % pour les procédures de l'alinéa 6 et de 35 % pour celles de l'alinéa 7.
ii. Une procédure plus longue et plus complexe que pour la voie principale
Les procédures de l'alinéa 6 et de l'alinéa 7 sont en grande partie communes, même si leurs conditions d'application diffèrent à la marge.
La procédure de l'alinéa 6 est déclenchée lorsque, saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la voie principale, la caisse constate l'inapplicabilité du tableau, faute de vérification de l'ensemble de ses conditions. Elle transmet alors le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du lieu où réside l'assuré1018(*), composé d'experts médicaux.
Pour les maladies hors tableaux, après réception de la demande de reconnaissance, la procédure se poursuit par l'évaluation, par un médecin-conseil, du taux d'incapacité permanente (IPP) prévisionnel de l'assuré. Lorsque celui-ci est inférieur à 25 %, il rejette la demande. Lorsque le taux d'IPP est supérieur à ce seuil, le CRRMP est saisi.
La composition du CRRMP
Le CRRMP se compose1019(*), en principe, de trois médecins1020(*) :
- le médecin-conseil régional ou un médecin-conseil désigné pour le remplacer ;
- un médecin inspecteur du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin diplômé en médecine du travail particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles et figurant sur une liste1021(*) ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ou un praticien hospitalier (PH), particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, inscrit sur une liste. Pour les pathologies psychiques, il peut s'agir d'un PU-PH ou d'un PH spécialisé en psychiatrie.
Toutefois, depuis 20161022(*), pour les procédures de l'alinéa 6, le CRRMP peut valablement ne compter que deux de ses membres. Une telle dérogation, « largement utilisée »1023(*) selon la Cour des comptes, se justifie par le moindre niveau d'expertise médicale nécessaire à la décision dans les procédures de l'alinéa 6, les procédures de l'alinéa 7 étant les « plus complexes » aux dires de l'étude d'impact. Dans les faits, selon l'étude d'impact, le comité se réunit alors sans médecin du travail. Lorsqu'apparaît un désaccord entre les deux membres, la composition plénière du CRRMP est toutefois exigée.
Hormis les différences de composition éventuelles du CRRMP, la procédure d'instruction de la demande est ensuite la même pour les pathologies de l'alinéa 6 et celles de l'alinéa 7.
À compter de la saisine du CRRMP, la caisse dispose d'un nouveau délai de 120 jours1024(*) pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie1025(*). La durée totale de l'instruction peut donc atteindre huit mois, contre quatre pour la voie principale. En moyenne, la durée constatée au régime général est de 207,5 jours pour les procédures de l'alinéa 6, et 200,6 jours pour celles relevant de l'alinéa 7.
La caisse, l'employeur ou l'assuré peuvent compléter le dossier et formuler des observations pendant les trente premiers jours suivant la saisine du CRRMP, puis le consulter durant les dix jours suivants.
Le CRRMP est, quant à lui, tenu de rendre un avis collégial dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine1026(*), sur la base du dossier le cas échéant enrichi par les observations de la caisse, de l'assuré ou de l'employeur1027(*). Cet avis lie la caisse, qui informe sans délai l'assuré et l'employeur de la décision de reconnaissance - ou non - du caractère professionnel de la maladie.
Procédure actuelle de reconnaissance des maladies professionnelles
Source : DSS
B. Des obstacles compliquent le parcours de reconnaissance de maladie professionnelle pour les assurés, sur la voie principale comme sur la voie complémentaire
Dans son rapport précité, la Cour des comptes décrie « une procédure longue et complexe qui décourage les victimes » et obstrue son appropriation par les médecins, résultant en une sous-reconnaissance conséquente. Selon une consultation qu'elle a réalisée, 78 % du panel, certes non représentatif, confiait avoir rencontré des difficultés pour la mener à bien, à commencer par le manque de connaissance du dispositif (50 %) et la peur de la longueur et de la complexité des démarches (43 %).
1. La vétusté des tableaux de maladies professionnelles, souvent critiquée
De nombreux observateurs regrettent le caractère archaïque voire obsolète des tableaux de maladies professionnelles, soit parce qu'ils n'ont pas été modifiés durant de trop longues périodes malgré l'avancée de la science, soit parce que ceux-ci n'intègrent pas certaines pathologies.
• Certains tableaux ont été institués il y a plus d'un siècle, et ont parfois été peu modifiés depuis. Tel est, par exemple, le cas du tableau n° 3, relatif aux intoxications par tétrachloréthane, modifié pour la dernière fois en 1951. Si l'évolution des tableaux de maladies professionnelles n'est pas toujours rendue nécessaire par le progrès des connaissances scientifiques, il reste, dans certains cas, indispensable d'actualiser à cette aune les modalités de diagnostic préconisées, les pathologies concernées par l'exposition à un risque, ou la durée d'exposition susceptible d'engendrer la survenance d'une pathologie professionnelle. Les demandes de modification des tableaux font toutefois fréquemment l'objet de blocages, en raison de dissensions entre les membres de la CS4.
• D'autre part, les tableaux de maladies professionnelles ne comprennent pas l'ensemble des pathologies dont un lien avec certaines activités professionnelles est présumé.
Si, après 19 mois de négociations, les cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante ont été intégrés aux tableaux sous le numéro 30 ter1028(*), tel n'a pas été le cas des leucémies dues au formol, une substance contenue dans de nombreux produits d'entretien, en raison d'un désaccord entre les partenaires sociaux.
A contrario, certains tableaux sont aujourd'hui peu utilisés compte tenu de l'évolution des activités professionnelles sur le territoire : ainsi du tableau n° 18 relatif au charbon.
La Cour des comptes1029(*) déplore ainsi « une évolution des tableaux soumise à de fortes contraintes, qui conduisent à des délais parfois longs », entre un et deux ans, pour créer ou modifier un tableau.
Le cas du chlordécone : une
reconnaissance intervenue tardivement
et sous la pression de
l'actualité
L'exemple du chlordécone illustre les délais parfois très longs pris pour la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies provoquées par certaines substances toxiques. Le chlordécone est un insecticide qui a été utilisé dans les bananeraies des Antilles à partir de 1972. En 1979, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS l'a classé parmi les cancérogènes possibles.
Il a fait l'objet d'une interdiction d'utilisation dès 1976 aux États-Unis mais a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993. Très persistant, il a contaminé durablement les sols et l'eau. La présomption forte d'un lien entre l'exposition au chlordécone et le risque de survenue de cancers de la prostate a été confirmée.
En septembre 2017, dans le contexte d'un mouvement social aux Antilles, le président de la République a annoncé que le cancer de la prostate pourrait entrer dans la liste des maladies professionnelles reconnues. L'Anses a été saisie fin 2018 dans le cadre du 4e plan « chlordécone » pour la réalisation d'une expertise sur les pesticides, et notamment le chlordécone, en vue de la création d'un tableau de maladie professionnelle et a présenté son rapport à la CS4 et à la Cosmap au printemps 2021. Le tableau du régime agricole sur les pesticides (tableau n° 61) a été publié en décembre 2021 et celui du régime général en avril 2022 (tableau n° 102), malgré l'avis défavorable des représentants des employeurs de la CS4, qui souhaitaient le limiter à un seul produit, le chlordécone.
Source : Cour des comptes
2. Des modalités de diagnostic parfois inadaptées, y compris sur des tableaux représentant d'importants volumes d'assurés
Il est fréquent que les tableaux de maladies professionnelles fassent figurer, dans leur première colonne, les modalités de diagnostic requises pour bénéficier d'une reconnaissance. Selon la Cour des comptes1030(*), tel serait le cas dans 61 tableaux du régime général.
Or, du fait des difficultés rencontrées à modifier les tableaux pour les maintenir à l'état le plus avancé de la science, certaines modalités de diagnostic archaïques voire dangereuses pour les assurés continuent de figurer parmi les conditions nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en va ainsi de l'artériographie, une modalité de diagnostic qui, bien qu'elle puisse provoquer une nécrose des doigts, reste prévue obligatoirement1031(*) pour la reconnaissance d'une atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale1032(*).
Certaines autres modalités de diagnostic sont difficilement accessibles sur certains territoires souffrant de pénuries de professionnels compétents pour les réaliser, à l'image des IRM nécessaires pour objectiver les troubles musculosquelettiques de l'épaule relevant du tableau n° 57, parmi les plus fréquents. Pourtant, comme le note la direction des risques professionnels de la Cnam dans une note émise à l'attention de la rapporteure, la pratique médicale admet désormais un scanner, la HAS retenant même l'échographie tendineuse. La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) cite d'autres exemples : « électromyogrammes anciens, radiographies spécifiques, voire tests de laboratoire disparus ».
La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath) confirme les difficultés qui peuvent émerger de l'inscription, dans les tableaux, de modalités de diagnostic excessivement restrictives. Elle estime que « l'insertion de modalités cumulatives obligatoires (par exemple un examen biologique spécifique ou une imagerie de haute technicité) pourra rendre la reconnaissance très complexe pour certaines victimes. Ces modalités peuvent être difficiles à mobiliser dans la pratique (coût, disponibilité du matériel, inégalités territoriales d'accès aux examens spécialisés) ».
Dans ces conditions, l'Anses a recommandé, en 2024, de remplacer les modalités de diagnostic propres à chaque pathologie par une formulation s'adaptant par elle-même, sans nécessiter de modification des tableaux, aux progrès médicaux. La commission chargée d'évaluer le coût de la sous-déclaration a partagé, dans son dernier rapport daté de 2024, cette préconisation, en proposant que la maladie puisse désormais être « confirmée par les examens recommandés par les sociétés savantes ou la HAS au moment du diagnostic ».
Il importe, en outre, de noter que la non-vérification des conditions de diagnostic n'emporte pas le basculement de l'assuré sur la procédure de l'alinéa 6, mais le rejet de la demande. Seule reste donc ouverte, pour les assurés concernés, la voie du recours contre la décision de la caisse. Selon la DSS, « en 2024, 313 contentieux ont été réalisés relativement à des rejets de dossiers au titre du TMP 57 », pour partie liés à la non-réalisation des conditions de diagnostic.
3. L'engorgement des CRRMP, malgré les mesures palliatives mises en oeuvre
Les CRRMP, sur lesquels repose la procédure complémentaire, font face à un engorgement lié tant à l'augmentation très dynamique des demandes qui leur parviennent qu'à la pénurie de professionnels susceptibles d'y participer.
Si les saisines du CRRMP ont initialement été portées par les dossiers en alinéa 6, réputés moins complexes, ces derniers semblent désormais plafonner autour de 20 000 dossiers par an depuis 2017 (19 165 en 2024).
Ce sont désormais les procédures pour des reconnaissances hors tableaux qui alimentent la croissance de la charge des CRRMP : ces procédures ont vu leur nombre multiplié par 16 depuis 2010 et dépassent désormais 11 000 dossiers par an. Une analyse plus fine, portant sur les pathologies dont la reconnaissance est demandée, fait apparaître la place prépondérante des troubles psychosociaux dans la dynamique observée, avec une multiplication par 42 des dossiers concernés depuis 2010. Ces derniers représentent désormais plus de la moitié des dossiers d'alinéa 7 traités.
Nombre d'avis rendus par les CRRMP
Source : Cour des comptes
Le contentieux, qui fait obligatoirement intervenir l'avis d'un CRRMP, participe également à accroître le volume de dossiers à traiter pour ces comités.
Les carences des tableaux évoquées supra sont un déterminant majeur de l'engorgement des CRRMP : les difficultés à faire évoluer les tableaux de maladies professionnelles et à en créer alimentent la dynamique des procédures de l'alinéa 6 et de l'alinéa 7, respectivement. De la même manière, l'inadéquation des modalités de diagnostic avec l'offre de soins disponible et l'état de la science est source d'une inflation contentieuse, non sans conséquence sur la charge des CRRMP.
S'ajoute à cela des pénuries de professionnels susceptibles d'intervenir dans les CRRMP : si la France manque de médecins sur une grande majorité de son territoire, cette tendance est particulièrement marquée pour les médecins-conseils et, encore davantage, pour les médecins du travail. Cela complexifie encore l'absorption de la charge de travail par les CRRMP, qui rencontrent des difficultés accrues à tenir les délais. Ainsi, 1,2 % des dossiers traités en 2022 ont abouti en une reconnaissance implicite, faute de respect des délais.
En conséquence, les pouvoirs publics ont entendu mettre en oeuvre diverses mesures, depuis les années 2010, afin d'octroyer des marges de manoeuvre supplémentaires aux CRRMP et de limiter la sollicitation de la ressource médicale.
En plus de la possibilité de ne réunir que deux médecins dans les CRRMP instruisant les dossiers de l'alinéa 6, la composition des comités a été élargie en 20221033(*), sous conditions, aux médecins retraités, et les médecins du travail peuvent désormais se substituer aux médecins inspecteurs du travail, initialement requis1034(*).
En outre, le même décret a offert au directeur général de la Cnam a la possibilité de donner compétence de traiter les dossiers à un autre CRRMP que celui qui serait spontanément saisi, « afin d'améliorer le délai »1035(*) sous lequel il peut être procédé à la reconnaissance. De telles délégations sont valables pour six mois renouvelables.
Ces mesures ne suffiront toutefois pas à absorber, sur le long terme, la hausse de la charge de travail des CRRMP si celle-ci venait à poursuivre la même dynamique.
C. Le dispositif proposé : une révision des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
L'article 39 réforme les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles, tant pour la voie principale que pour la voie complémentaire. Il modifie pour ce faire l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui décrit les différentes voies d'accès à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
1. Sur la voie principale, un renvoi à un décret en Conseil d'État de la détermination des modalités d'établissement du diagnostic des maladies figurant sur un tableau
En ce qui concerne la voie principale, le 1° du I prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine désormais les modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies figurant sur un tableau de maladies professionnelles. Les dispositions ainsi décrétées, qui pourraient se référer à la réalisation d'« examens conformes aux données acquises de la science, au regard des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé (HAS) ou, à défaut, des sociétés savantes » selon l'étude d'impact, s'imposeraient aux dispositions des tableaux, d'un niveau de norme inférieur.
Aux termes du II, ces dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 30 septembre 2026.
L'étude d'impact estime que cette mesure, en facilitant la reconnaissance des maladies professionnelles relevant des tableaux, pourrait présenter un coût annuel de 18,7 millions d'euros pour la branche AT-MP à compter de 2027.
2. Sur la voie complémentaire, le recours à des médecins-conseils plutôt qu'au CRRMP pour traiter les dossiers relevant de l'alinéa 6
Le 2° du I prévoit de ne plus recourir aux CRRMP pour la reconnaissance des maladies professionnelles lorsque celles-ci sont inscrites sur un tableau, mais que l'assuré ne remplit pas l'ensemble des critères requis pour en relever. Ces procédures, dites de l'alinéa 6, seraient désormais instruites par un binôme1036(*) de médecins-conseils, dont l'avis s'imposerait à la caisse.
Le 4° du I restreint donc, en conséquence, le champ de compétences des CRRMP aux seules pathologies hors tableaux.
Ces dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2027, en application du II de l'article 39.
Des adaptations réglementaires seraient apportées concernant les recours contre les décisions prises par le binôme de médecins-conseils.
L'étude d'impact estime que la mesure serait neutre sur les décisions de reconnaissance, mais pourrait susciter des économies de frais de gestion à hauteur de 1,7 million d'euros, correspondant à la rémunération non-perçue des membres des CRRMP.
Procédure de reconnaissance proposée des maladies professionnelles
Source : DSS
3. Dispositions diverses
Le 3° du I procède à des coordinations rendues nécessaires par l'entrée en vigueur prochaine de la réforme des rentes résultant de l'article 90 de la LFSS pour 20251037(*). Le II aligne l'entrée en vigueur de ces dispositions sur celles dudit article 90.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
En préambule, la commission rappelle son attachement fort à ce que les partenaires sociaux soient consultés et associés à la définition de toute évolution législative ou réglementaire susceptible d'être mise en oeuvre en matière d'AT-MP. La commission regrette donc vivement que le Gouvernement n'ait pas pris soin de travailler cet article, qui réforme en profondeur les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles, en amont avec les partenaires sociaux.
Ce faisant, le Gouvernement se rend coupable d'une faute dans la méthode, qui fragilise doublement des mesures qui apparaissent pourtant par certains aspects nécessaires à ce que soit garanti l'accès à la reconnaissance des maladies professionnelles pour les assurés. Elle les fragilise, d'une part, en faisant obstacle à l'adhésion des partenaires sociaux à ces mesures, indispensable à leur application sereine. Elle les fragilise, d'autre part, en se privant des améliorations que seraient susceptibles de proposer par les partenaires sociaux.
Si nul n'ignore les circonstances dans lesquelles le présent texte a été rédigé, l'instabilité politique ne saurait tenir lieu d'excuse pour se dispenser de concertation avec les partenaires sociaux sur ce sujet, qui les concerne au premier chef.
1. Sur la voie principale
La commission a donc reçu avec une certaine réserve les modifications apportées à la voie principale, qui font l'objet d'un accueil mitigé de la part des partenaires sociaux.
La commission note en effet que l'élévation à un décret en Conseil d'État des modalités d'établissement des maladies professionnels en dépossède les partenaires sociaux. Une telle évolution n'est, en général, pas souhaitable : la branche AT-MP devant, par sa construction comme par son objet, accorder une place prépondérante à ces derniers dans la définition du champ des politiques qu'elle met en oeuvre.
Pour autant, la rapporteure note qu'en l'espèce, les modalités d'établissement du diagnostic d'une pathologie relèvent de prérogatives strictement médicales, sur lesquelles les partenaires sociaux ne disposent pas d'une compétence particulière. Il ne s'agit pas là de caractériser le lien entre une pathologie et l'exposition à des risques professionnels donnés, mais bien d'encadrer les examens médicaux nécessaires pour constater ladite pathologie.
Il importe toutefois que le dialogue social puisse continuer de présider aux décisions relatives aux modifications et aux élargissements des tableaux de maladie professionnelle sur leur champ de compétences restant. La rapporteure souscrit, en ce sens, pleinement aux propos de la CFTC, qui déplore le « manque chronique de moyens »1038(*) dont souffre la CS4, auquel il revient au Gouvernement d'apporter enfin des réponses.
Les auditions conduites, notamment auprès des associations de victimes, ont pu démontrer l'étendue des difficultés générées par l'inscription des modalités de diagnostic dans les tableaux de maladies professionnelles : la Fnath estime par exemple qu'« en imposant des critères trop stricts ou rigides, on fragmente le droit à reconnaissance » avec une « barrière procédurale » qui, rappelons-le, rend les assurés inéligibles à toute reconnaissance, y compris en alinéa 6.
Pour ces raisons, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva) juge « très intéressante » la proposition du Gouvernement de ne plus fixer au sein des tableaux les modalités de diagnostic des pathologies professionnelles, qui leur « convient parfaitement ». Cet avis est partagé par certaines organisations syndicales, notamment la CFTC, qui indique que « le renvoi à un décret en Conseil d'État, fondé sur les recommandations de la HAS ou des sociétés savantes, peut moderniser une réglementation parfois obsolète »1039(*).
La rapporteure juge, elle aussi, regrettable que les tableaux, qui n'évoluent pas de manière aussi rapide que l'état des connaissances scientifiques, puissent contenir des modalités de diagnostic obsolètes, non nécessaires, peu accessibles voire dangereuses. Elle considère donc que prévoir une fixation dynamique des modalités de diagnostic, par référence aux recommandations de la HAS et des sociétés savantes, serait plus opportun que de les figer, comme c'est le cas actuellement, au sein des tableaux.
Toutefois, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, souhaité apporter des garanties supplémentaires à la rédaction proposée.
D'abord, elle a entendu encadrer, par un amendement n° 707, le champ du décret en Conseil d'État, pour préciser que celui-ci tient compte des données acquises de la science. Il s'agit là de ne pas laisser carte blanche au Gouvernement dans la définition des modalités de diagnostic, la proposition de ce dernier n'étant pertinente que dans la stricte mesure où celles-ci sont fixées au regard des connaissances scientifiques établies.
En adoptant l'amendement n° 706 de sa rapporteure, la commission a également souhaité que le décret en Conseil d'État précisant les modalités de diagnostic des maladies inscrites sur le tableau soit soumis à l'avis préalable des partenaires sociaux représentatifs à l'échelle nationale, afin de s'assurer de la prise en considération de leur position dans la rédaction retenue. La commission réitère, par-là, son attachement au caractère paritaire de la gouvernance de la branche.
Les modalités d'application réglementaire devront notamment traiter de la question de l'information des employeurs et des assurés, qui suscite notamment l'inquiétude du Mouvement des entreprises de France (Medef) ou de Force ouvrière. Aujourd'hui assurée par la publication des examens nécessaires au sein des tableaux, elles devront, en cas d'adoption de cet article, être diffusées via un autre canal assurant leur bonne prise en compte et leur lisibilité par les assurés, les employeurs et les professionnels de santé.
2. Sur la voie complémentaire
a) Des évolutions qui laissent craindre une diminution de la qualité de l'instruction des dossiers relevant de l'alinéa 6
Les modifications apportées à la voie complémentaire, prévoyant une instruction par un binôme de médecins-conseils des dossiers de l'alinéa 6 en lieu et place des CRRMP, ont suscité l'inquiétude des partenaires sociaux autant que celle des associations de victimes, qui craignent pour la qualité des décisions ainsi rendues.
Les associations d'employeurs, Medef et Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) en tête, craignent un affaiblissement du principe du contradictoire. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires afin de garantir ce principe dans le cadre de la procédure révisée. La commission y sera très attentive.
En outre, le traitement par un binôme de médecins-conseils des dossiers de l'alinéa 6 irait, selon Force Ouvrière, « à l'encontre de l'esprit même de cette procédure, qui repose sur une appréciation collégiale et indépendante du lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle »1040(*). La réforme de l'organisation du service médical de la Cnam, à laquelle s'opposent la plupart des organisations syndicales, « rend le contexte d'autant plus défavorable »1041(*) selon la CFTC, avec des craintes sur le niveau d'indépendance des médecins-conseils. Ces arguments appellent trois nuances de la rapporteure.
D'abord, il convient de noter que la proposition du Gouvernement n'induit pas de perte de la collégialité, puisqu'un médecin-conseil seul ne serait pas habilité à trancher. Seul un binôme de médecins-conseils aurait cette possibilité.
Elle induit bien, en revanche, une perte de pluridisciplinarité. Il importe cependant de rappeler que les dossiers de l'alinéa 6 sont déjà aujourd'hui, dans les faits, le plus souvent traités par un CRRMP en format réduit, composé d'un binôme médecin-conseil-praticien hospitalier, sans médecin du travail. C'est pourtant l'absence de médecin du travail qui cristallise les craintes sur la perte d'expertise engendrée par la modification des modalités de reconnaissance, alors même que la rédaction retenue est conciliable avec une demande d'avis à un médecin du travail en amont de la décision, pour les cas les plus sensibles.
Enfin, si la réforme de l'organisation du service médical est source d'inquiétudes, pour certaines légitimes, elle n'abroge pour autant pas les garanties d'indépendance statutaires dont jouissent les médecins-conseils, qui bénéficieront d'ailleurs désormais de comité d'éthique en ce sens. La directrice des risques professionnels de la Cnam, Anne Thiebeauld, a rappelé, devant la commission, qu'il relevait « pleinement du rôle légitime des médecins-conseils du service médical de l'Assurance maladie de statuer sur ces dossiers médicaux et sur l'accès aux prestations, comme ils le font déjà pour l'invalidité et pour d'autres prestations », sur lesquels ils peuvent d'ailleurs être amenés à statuer seuls, et non en binôme.
Malgré ces nuances, il ne fait toutefois pas de doute, selon la rapporteure, que la modification de la procédure est susceptible d'atténuer la qualité de l'instruction des dossiers, aujourd'hui enrichie par le regard au moins bi-disciplinaire que permet d'apporter le CRRMP.
b) L'impossibilité pour les CRRMP de faire faire à la poursuite de la progression du nombre de dossiers à traiter laisse présager des risques plus préjudiciables encore aux assurés
Pour autant, la situation appelle le législateur à un principe de réalité. Un effet ciseaux est à l'oeuvre entre la hausse continue et très dynamique du nombre de dossiers transmis aux CRRMP1042(*) et les difficultés considérables à constituer ces derniers, faute de professionnels disponibles. La pénurie de médecins, constatée sur tout le territoire, touche en effet singulièrement les praticiens susceptibles de siéger dans les CRRMP.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement et les caisses ont actionné un certain nombre de leviers pour élargir le champ des médecins susceptibles de participer aux CRRMP et alléger leur fonctionnement pour débloquer des marges de manoeuvre et absorber la charge de travail supplémentaire, mais ces mesures, utiles, n'ont pas permis de redimensionner les capacités de traitement des CRRMP à la hauteur des besoins.
Dans ce contexte défavorable, les CRRMP ne disposent plus des capacités pour faire face à la charge de dossiers qui leur incombe. Anne Thiebeauld rappelait même, devant la commission, que la justice avait récemment rappelé à l'ordre la Cnam alors que, « saisie d'un contentieux, elle ne parvenait pas à trouver de C2RMP disponible pour réunir ces trois compétences médicales, dont certaines sont rares sur le territoire ».
Par conséquent, en l'absence de modification du droit, seuls deux scénarios sont envisageables : soit les CRRMP consacreront moins de temps à l'ensemble des dossiers ; soit les CRRMP ne seront plus en mesure de tenir les délais qui leur sont réglementairement associés. Dans la première hypothèse, il sera porté atteinte à la qualité de la décision, y compris pour les dossiers plus complexes relevant de l'alinéa 7 ; dans la seconde, les délais seront inévitablement rehaussés par voie réglementaire, alors même que la procédure dure déjà huit mois et constitue un obstacle favorisant la sous-déclaration.
La rapporteure porte un regard pragmatique sur la mesure proposée, qu'elle ne juge pas à l'aune de sa qualité intrinsèque, mais bien au regard de son rapport bénéfices/risques par rapport au maintien du droit en vigueur.
c) La solution proposée par la rapporteure : une restriction du champ de la mesure aux seuls dossiers relatifs au dépassement du délai de prise en charge, les moins techniques
Dans ces conditions, la rapporteure estime préférable d'alléger la procédure de l'alinéa 6, sur laquelle les CRRMP apportent une moindre valeur ajoutée médicale puisqu'ils « se transforment en instances de traitement presque industrielles »1043(*) sur ces dossiers, plus simples.
Compte tenu des risques mentionnés supra et des craintes exprimées par les partenaires sociaux, la rapporteure ne saurait toutefois souscrire à l'ensemble de la solution proposée par le Gouvernement.
• Les dossiers de l'alinéa 6 relatifs au délai de prise en charge seraient désormais traités par un binôme de médecins-conseils.
Afin de décharger les CRRMP sans porter excessivement atteinte à la qualité de l'instruction, la commission a adopté l'amendement n° 708 de sa rapporteure, visant à restreindre le champ de la mesure aux seuls dossiers de l'alinéa 6 relatifs à la non-vérification du délai de prise en charge prévu par les tableaux. Ces dossiers, qui représentent 45 % des procédures au titre de l'alinéa 6, sont en effet ceux pour lesquels une expertise médicale est la moins nécessaire afin de maintenir la qualité de la prise de décision. Ils sont déjà, dans les faits, fréquemment traités à la chaîne par les CRRMP.
Une telle évolution est notamment soutenue par l'Andeva, qui estime que « lorsque la victime ne satisfait pas aux conditions des délais de prise en charge fixés par le tableau de maladie professionnelle, [...] le passage devant deux médecins-conseils de la sécurité sociale à la place des C2RMP [...] permettrait effectivement de raccourcir les délais de traitement des dossiers et simplifierait la procédure sans compromettre les droits des victimes ».
• Les autres dossiers relevant de l'alinéa 6 continueraient d'être traités par les CRRMP, sauf dans certaines caisses où serait menée une expérimentation
Pour les autres dossiers relevant de l'alinéa 6, plus complexes, la rapporteure estime qu'il est prématuré d'acter, dès aujourd'hui, le dessaisissement des CRRMP au profit d'un binôme de médecins-conseils.
Le fait de confier à un binôme de médecins-conseils les dossiers de l'alinéa 6 relatifs au délai de prise en charge permettra à la majorité des CRRMP d'absorber, pendant encore quelques années, le volume de dossiers à traiter au titre de ses autres attributions.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article 40
Institution d'un capital
décès pour les ayants droit des non-salariés agricoles
décédés consécutivement à un sinistre
professionnel
Cet article propose de verser un capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles décédés à la suite d'un sinistre professionnel, sur le modèle de celui qui existe déjà lorsque le décès résulte d'un accident ou d'une maladie de la vie privée.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La sécurité sociale couvre le risque de décès dans certaines situations, et peut voir son indemnisation complétée par des prestations de prévoyance complémentaire
1. Les assurés du régime général, les indépendants, les fonctionnaires et les non-salariés agricoles bénéficient d'une assurance décès de base obligatoire
Différents régimes prévoient, de manière obligatoire, une assurance contre le décès. L'assurance décès procède, en fonction des cas, de la loi ou des règlements propres à chaque régime.
L'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale définit ainsi les cinq branches qui constituent le régime général, parmi lesquelles la branche « maladie, maternité, invalidité et décès ». L'assurance décès contient des prestations en espèces, aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux prestations d'assurance décès pour le régime général s'appliquent également au régime des salariés agricoles1044(*).
Les fonctionnaires sont, comme les assurés du régime général, couverts contre le risque de décès, qui ouvre droit à des prestations pour les ayants droit1045(*).
Pour les non-salariés agricoles, la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, intitulée « Assurance maladie, invalidité, décès et maternité », prévoit également des prestations d'assurance décès1046(*).
Les artisans et commerçants, cotisants ou retraités, bénéficient eux aussi d'une assurance décès1047(*), rattachée dans le code de la sécurité sociale à l'assurance vieillesse. Pour les professions libérales, l'assurance invalidité-décès, instituée en vertu d'une demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, est rattachée à cette dernière caisse1048(*). Les assurés de la caisse nationale des barreaux s'acquittent également d'une cotisation spécifique au financement de leur assurance décès1049(*).
2. L'assurance décès ouvre droit au versement d'un capital aux ayants droit d'un assuré en cas de décès de celui-ci, sous des conditions et dans des modalités qui diffèrent en fonction des régimes
L'assurance décès proposée par les régimes de sécurité sociale prend principalement la forme d'un capital décès, versé aux ayants droit du défunt assuré. Ce capital décès vise à la fois à soutenir le niveau de vie des ayants droit, qui peut être affecté négativement par le décès de l'assuré, et à couvrir tout ou partie des frais liés aux obsèques.
a) Les ayants droit d'un assuré du régime général peuvent percevoir, sous conditions, un capital de 3 977 euros en cas de décès de celui-ci
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale garantit aux ayants droit d'un assuré du régime général1050(*) ou du régime des salariés agricoles1051(*) le versement d'un capital en cas de décès de celui-ci, à condition qu'il vérifie certaines conditions de cotisations ou de durée de travail1052(*) et que celui-ci ait, dans les trois mois qui ont précédé son décès, rempli l'une des trois conditions suivantes :
- avoir exercé une activité salariée ;
- avoir perçu une indemnisation versée par France Travail, notamment au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi ;
- avoir été titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente AT-MP avec un taux d'incapacité permanente de plus de deux tiers.
Le capital décès est également versé aux assurés bénéficiant du maintien de leurs droits au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : cela concerne essentiellement les assurés qui se seraient trouvés dans une situation ouvrant droit au capital décès dans les douze mois précédant leur mort. La perception d'une pension de retraite ne fait pas, en elle-même, obstacle à l'ouverture du droit au capital décès, sous réserve que l'assuré remplisse bien les conditions de cotisation ou de durée de travail requises1053(*).
Il est précisé, par voie réglementaire1054(*), que le bénéfice du capital décès est dû non seulement pour les décès résultant d'un accident ou d'une maladie de la vie privée, mais aussi en cas de décès consécutif à un sinistre professionnel, ou intervenu lors de la journée de défense et de citoyenneté, au cours d'une période d'appel, de mobilisation ou de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
Le capital décès, d'un montant revalorisé chaque année à l'inflation hors tabac et atteignant 3 977 euros en 20251055(*), est attribué, à leur demande1056(*), aux ayants droit du patient.
Peuvent en bénéficier les conjoints ou partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) non séparés de droit ou de fait ou, à défaut, les descendants ou, à défaut, les ascendants. Lorsque plusieurs bénéficiaires relèvent du même rang, c'est-à-dire lorsque plusieurs enfants ou plusieurs parents sont éligibles au capital décès, celui-ci est partagé à parts égales entre les bénéficiaires.
Lorsqu'un ayant droit à la charge effective, totale et permanente du défunt en fait la demande sous un mois1057(*), un droit de priorité1058(*) s'applique, suivant le même ordre de préférence1059(*).
Le versement du capital décès n'est pas automatique : le capital décès n'est plus perceptible, faute de prescription1060(*), lorsque la demande intervient plus de deux ans à compter de la date du décès.
Le capital décès n'est soumis ni à la CSG1061(*), ni à la CRDS, ni aux cotisations de sécurité sociale, ni à l'impôt sur les successions. Il est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement d'un capital indûment versé à la suite d'une fraude ou d'une fausse déclaration1062(*).
Il est à noter que d'autres branches peuvent être mobilisés pour soutenir des veufs ou des veuves. La caisse d'allocations familiales peut par exemple accorder, en cas de décès, une allocation de soutien familial, tandis qu'une allocation de veuvage ou une pension de réversion peuvent être servies, sous conditions, par la caisse d'assurance vieillesse.
b) Les ayants droit d'un fonctionnaire bénéficient, en cas de décès de ce dernier, d'un capital décès plus avantageux que celui versé par le régime général, ainsi que de prestations complémentaires
i. Un capital décès plus avantageux que celui versé par le régime général
L'article L. 828-1 du code général de la fonction publique prévoit que « le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d'un capital décès », versé quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès1063(*). Les contractuels peuvent aussi en bénéficier, sous conditions.
Si celui-ci partage certaines caractéristiques communes avec le capital décès du régime général, notamment son absence de soumission à tout prélèvement obligatoire, il ne présente pas de caractère forfaitaire mais dépend de la rémunération de l'agent public décédé.
Il correspond, en règle générale1064(*) et dans les trois versants de la fonction publique, à la dernière rémunération brute1065(*) annuelle1066(*) du contractuel ou du fonctionnaire1067(*). En tout état de cause, pour les fonctionnaires de l'État, le capital décès ne peut être inférieur à quatre fois le montant du capital décès prévu par le régime général1068(*).
Dans certains cas, l'écart d'indemnisation avec le régime général est encore accru. Le capital décès est en effet triplé, et versé sur trois ans, si le décès fait suite à un accident de service, à une maladie professionnelle, à un attentat, à une attaque en lien avec le service ou la fonction ou à un acte de dévouement1069(*).
Le capital décès est affecté pour le tiers de son montant au conjoint ou partenaire de Pacs non séparé de l'agent public, et pour les deux tiers à ses enfants infirmes et non soumis à l'impôt sur le revenu ou âgés de moins de 21 ans1070(*), qui se répartissent le cas échéant cette proportion à parts égales. Chaque enfant reçoit, en outre, une majoration de 884,33 euros.
En l'absence de conjoint ou d'enfant à charge, le capital décès est versé directement aux attributaires restants ou, lorsqu'ils n'existent pas, aux éventuels ascendants du fonctionnaire à sa charge1071(*).
ii. D'autres prestations d'assurance décès complètent le capital décès, au bénéfice des enfants du fonctionnaire de l'État décédé
Outre le capital décès, le code général de la fonction publique prévoit une rente temporaire d'éducation et une rente viagère de handicap au bénéfice des enfants de fonctionnaires de l'État décédés1072(*).
• La rente temporaire d'éducation est versée au profit de l'enfant d'un fonctionnaire de l'État décédé :
- sans condition jusqu'à ses 18 ans1073(*), pour un montant de 2 355 euros annuels1074(*) ;
- à condition qu'il poursuive des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel, jusqu'à ses 27 ans1075(*), pour un montant de 7 065 euros annuels1076(*).
• Quant à la rente viagère pour handicap, elle consiste en le versement d'un montant de 7 065 euros annuels1077(*) au profit de l'enfant d'un fonctionnaire de l'État décédé lorsque celui-ci est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou rend son tuteur légal éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé1078(*).
c) Les différents régimes applicables aux indépendants prévoient le versement de capitaux décès dont les montants sont hétérogènes
• En cas de décès d'un artisan ou d'un commerçant, un capital décès est versé à ses ayants droit, selon des modalités similaires à celles qui s'appliquent aux assurés du régime général. Il est destiné aux mêmes ayants droit, selon les mêmes règles qu'au régime général, et n'est soumis à aucun impôt ou cotisation.
Ses conditions de versement diffèrent toutefois de celles du capital décès du régime général, puisque le capital décès des indépendants est ouvert aux assurés retraités inactifs.
Le montant du capital décès diffère également entre le régime général et le régime des indépendants. Il correspond en effet, pour les artisans et commerçants, à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 9 420 euros, lorsque le défunt était en activité1079(*), et à 8 % de ce plafond, soit 3 768 euros lorsqu'il était en retraite1080(*).
S'y ajoute un capital pour orphelins, d'un montant de 5 % du Pass, soit 2 355 euros en 2025, dans l'hypothèse où l'indépendant décédé était, à la date de sa mort, parent d'enfants de moins de 16 ans, en études entre 16 et 20 ans, ou bénéficiaire d'une allocation au titre du handicap.
• Les assurés cotisants relevant de professions libérales bénéficient d'un capital décès versé composé d'une partie forfaitaire de 15 % du Pass (7 065 euros en 2025) et d'une partie proportionnelle aux cotisations prévoyance du professionnel sur l'année précédant le décès. Le capital décès est versé :
- au conjoint non-séparé de droit ou de fait ou au partenaire de Pacs ;
- ou, à défaut, aux enfants de moins de 21 ans ou atteints d'une infirmité permanente faisant obstacle à la réalisation de tout travail rémunéré ;
- ou, à défaut, aux personnes physiques nommément désignées par l'assuré ;
- ou, à défaut, aux personnes à la charge effective, totale et permanente de l'assuré à la date du décès.
• Les assurés cotisants relevant de la caisse nationale des barreaux ouvrent également à leurs ayants droit, lorsqu'ils décèdent, le bénéfice d'un capital décès dont le montant est de 50 000 euros1081(*). Ce montant est versé quelle que soit la cause du décès.
Pour ce régime, le capital décès est reversé1082(*) :
- au conjoint survivant ;
- ou, à défaut, aux enfants de moins de 21 ans, aux enfants de 21 à 25 ans en études, ou aux enfants présentant un handicap physique ou mental ;
- ou, à défaut, aux parents, frères et soeurs à la charge totale et effective du défunt ;
- ou, à défaut, dans la limite de 12 500 euros, à toute personne assumant la charge des obsèques1083(*).
d) Le régime des non-salariés agricoles se démarque en ne proposant qu'un capital décès pour les accidents et maladies de la vie privée
Le régime des non-salariés agricoles prévoit le versement d'un capital décès pour les ayants droit de certains non-salariés agricoles1084(*) actifs, affiliés au régime depuis plus d'un an1085(*) et décédés dans le cadre d'un suicide, d'un accident ou d'une maladie de la vie privée1086(*).
Le versement ne concerne toutefois pas les non-salariés agricoles décédés consécutivement à un sinistre professionnel, contrairement à ce qui prévaut pour le régime général, celui des salariés agricoles ou pour les fonctionnaires. La direction de la sécurité sociale note que ces derniers bénéficient cependant, au titre de l'assurance accident du travail des exploitants agricoles (Atexa) d'une prise en charge des frais funéraires.
Il ne concerne pas, non plus, les non-salariés agricoles décédés alors qu'ils n'étaient pas en position d'activité - invalides, titulaires d'une rente Atexa : il s'agit là d'une autre différence avec le régime général.
La création de ce capital, intégrée à la LFSS pour 20221087(*), s'inscrivait alors dans le cadre du plan gouvernemental d'accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide. L'objectif affiché était de permettre à la Mutualité sociale agricole de mettre en oeuvre un véritable soutien financier en cas de suicide du chef d'exploitation ou d'un membre de la famille travaillant sur l'exploitation.
Les montants, modalités de revalorisation, modalités de versement et bénéficiaires potentiels du capital décès sont largement alignés sur ceux du régime général.
Le capital décès, d'un montant de 3 977 euros en 20251088(*), est donc versé, sur demande, au conjoint ou partenaire de Pacs non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants ou, à défaut, aux ascendants1089(*). Lorsque plusieurs ayants droit de même rang sont éligibles, le capital est réparti entre eux à parts égales1090(*).
Un régime de priorité similaire à celui du régime général s'applique lorsqu'un ayant droit est à la charge effective, totale et permanente du non-salarié agricole défunt. L'ayant droit prioritaire bénéficie d'un délai de deux mois1091(*) pour faire valoir son droit, soit un de plus qu'au régime général.
Il est à noter que l'article D. 732-12-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour lutter contre le non-recours, des actions d'aller-vers des caisses de Mutualité sociale agricole. Celles-ci sont chargées d'adresser aux ayants droit connus, dans les deux mois suivant le décès d'un assuré, les informations relatives aux conditions d'attribution du capital décès.
Comme le capital décès du régime général, celle du régime des non-salariés agricoles n'est soumise à aucun prélèvement obligatoire et est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement d'un capital indûment versé1092(*).
B. La possibilité de bénéficier d'une indemnisation complémentaire en cas de souscription d'un contrat de prévoyance
Proposée par une mutuelle, une entreprise d'assurance ou une institution de prévoyance, l'assurance complémentaire décès s'ajoute aux prestations d'assurance décès obligatoires afin de compléter les garanties accordées aux proches d'un assuré si celui-ci venait à disparaître.
Le souscripteur d'une assurance complémentaire décès choisit avec l'organisme assureur une prime d'assurance et ce dernier s'engage, en contrepartie, à verser aux bénéficiaires du contrat un capital fixe ou une rente en cas de décès de l'assuré.
L'assurance décès peut résulter d'un contrat temporaire, comme pour les prêts immobiliers, ou d'un contrat vie entière. Dans certains cas, elle se borne à un contrat obsèques, qui ne couvre que les démarches et frais afférents aux funérailles.
Les contrats d'assurance décès peuvent être à adhésion individuelle ou collective, ce dernier cas correspondant le plus souvent à une couverture prévoyance prévue par un employeur pour tout ou partie des personnels. Les cadres en bénéficient par exemple obligatoirement1093(*).
Le souscripteur d'un contrat d'assurance décès peut être l'assuré ou un tiers1094(*), dans le cadre d'un contrat collectif ou, lorsque l'assuré a donné son consentement par écrit, d'un contrat individuel1095(*).
Le capital ou la rente d'un contrat d'assurance décès ne rentre pas dans la succession du défunt1096(*) et est donc exonéré de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), sauf lorsque le contrat ne stipule aucun bénéficiaire1097(*).
Selon les données de France Assureurs, le marché de l'assurance prévoyance représente, en 2024, 39,6 milliards d'euros pour l'ensemble des acteurs, répartis entre l'assurance décès toutes causes seule (18,4 milliards d'euros) et l'assurance incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel (21,2 milliards d'euros), dont le spectre est plus large.
La dynamique du secteur est portée par le développement des contrats de prévoyance collectifs à l'initiative des employeurs privés comme publics, dans le cadre de la réforme de la protection sociale complémentaire1098(*).
Les non-salariés agricoles n'apparaissent pas participer à la dynamique du marché de l'assurance décès en France.
Marché de l'assurance prévoyance en France
Source : France Assureurs
C. Le dispositif proposé : l'ouverture du versement d'un capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles décédés consécutivement à un sinistre professionnel
L'article 40 vise à permettre le versement d'un capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles décédés à la suite d'un sinistre professionnel.
En son I, l'article 40 du PLFSS modifie l'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime, régissant le capital décès pour les non-salariés agricoles. Il y précise que le capital décès est dû à l'ayant droit, y compris lorsque le décès résulte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En son II, l'article 40 prévoit que cette prestation soit ouverte aux ayants droit concernés pour l'ensemble des décès survenant à compter du 1er janvier 2026.
L'étude d'impact anticipe, à ce titre, une hausse des dépenses à la charge de la branche AT-MP du régime des non-salariés agricoles de l'ordre de 400 000 euros par an à compter de l'entrée en vigueur.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission a accueilli favorablement les dispositions de l'article 40 du PLFSS, qui permettront aux ayants droit d'un cotisant non-salarié agricole décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de percevoir un capital-décès, comme ils y sont aujourd'hui éligibles lorsque le décès provient d'un accident ou d'une maladie de la vie privée.
La commission rappelle son attachement au principe de favorabilité de la législation AT-MP, qui prévoit que les prestations à la charge de cette branche soient au moins aussi avantageuses pour les assurés que leur contrepartie pour la branche maladie. En l'espèce, le capital-décès des non-salariés agricoles, ouvert aux seuls ayants droit des assurés décédés à la suite d'un sinistre de la vie privée, à l'exclusion de ceux dont la mort est consécutive à un sinistre professionnel, ne respecte pas cette règle, dans la mesure où les prestations d'assurance décès prévues par ailleurs par la branche AT-MP du régime des non-salariés agricoles ne sont pas aussi favorables que le capital-décès.
Il semble, dans ces conditions, que l'absence d'inclusion des victimes de sinistres professionnels dans le champ du capital-décès procède plutôt d'un oubli du législateur, voire d'une interprétation stricte de la lettre de la loi par les caisses relevant de la Mutualité sociale agricole1099(*), plutôt que d'une volonté positive de celui-ci. Il faut dire que l'attention s'était concentrée, lors des débats parlementaires, sur le soutien aux familles en cas de suicide, les non-salariés agricoles étant malheureusement tout particulièrement touchés. La DSS note, à cet égard, que l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit ces dispositions « circonscrit ce bénéfice aux décès faisant suite à une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide »1100(*).
Cet article répond, en outre, « à une demande de longue date de la MSA, qui se félicite d'avoir été entendue et souscrit au dispositif tel que présenté dans le projet »1101(*).
La commission se réjouit de l'harmonisation que porte cette mesure, à la fois entre les non-salariés agricoles, mais également entre les assurés victimes d'AT-MP fatals relevant de différents régimes.
La commission relève, à cet égard, que le décès d'un assuré du régime général ou de celui des salariés agricoles consécutivement à un sinistre professionnel permet à ses ayants droit de bénéficier d'un capital-décès, dont le montant, 3 977 euros en 2025, servirait de référence à celui du capital décès ouvert pour les ayants droit de non-salariés agricoles dans la même situation.
Toutefois, la commission regrette que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin dans l'effort d'harmonisation entre le régime général, donc le régime des salariés agricoles qui lui est aligné, et celui des non-salariés agricoles.
Ainsi, tandis que le premier prévoit le versement d'un capital pour le décès de tout assuré, actif ou non, bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente lorsque le taux d'incapacité permanente associé dépasse deux tiers, le présent PLFSS ne prévoit pas de telle disposition en cas de décès d'un non-salarié agricole placé dans la même situation.
Contrainte dans son initiative par l'article 40 de la Constitution, la rapporteure espère pouvoir aboutir à un amendement commun avec le Gouvernement en ce sens.
Dans l'attente, la commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 41
Optimiser le recouvrement des pensions
alimentaires
Cet article propose :
- d'étendre la durée de la procédure de paiement direct pour faciliter le recouvrement des pensions alimentaires ;
- de permettre à l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) de recouvrer par la procédure de paiement direct les termes échus d'une créance alimentaire et plus seulement ceux qui sont à échoir.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. L'Aripa permet des progrès significatifs dans le recouvrement et l'intermédiation des pensions alimentaires mais certaines de ses procédures peuvent être améliorées
1. Le cadre juridique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires
L'article 372-2-2 du code civil dispose que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en cas de séparation des parents, prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires afin d'en faciliter le versement ainsi que le recouvrement1102(*).
La progressive consolidation des missions de l'Aripa
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a généralisé la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Elle a permis d'étendre les possibilités de recouvrement par paiement direct et d'aider la créancière à bénéficier le plus tôt possible des sommes dues par le débiteur.
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a facilité la saisine de l'Aripa par la créancière en supprimant l'obligation de présenter la preuve qu'elle a engagé une procédure de recouvrement auprès du débiteur.
Récemment, l'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a rendu automatique l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
En 2024, l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires a recouvré près de 295 millions d'euros par les procédures de recouvrement amiable ou forcé. Elle verse annuellement près de 397 millions d'euros d'allocations de soutien familial pour 97 000 enfants, pour près de 104 000 procédures de recouvrement forcé1103(*).
Le mécanisme d'intermédiation financière, prévu à l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, consiste en ce que lorsque le recouvrement de la pension alimentaire s'avère en tout ou partie impossible, l'agence verse au parent créancier, à titre d'avance, tout ou partie de cette pension. Il institue l'allocation de soutien familial comme filet de sécurité pour les créancières confrontées au manque de coopération du débiteur. En outre, l'article L. 581-9 du même code dispose que les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux créances d'aliments, des avances spécifiques sur pensions.
a) La procédure de paiement direct
L'article L. 213-1 du code des procédures civiles dispose que tout créancier d'une pension alimentaire « peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension ». L'article L. 213-2 du même code précise que ce paiement est prioritaire par rapport à tous les autres créanciers du débiteur. L'article L. 213-4 du même code précise que l'Aripa peut user de la procédure de paiement direct dans la limite des 24 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le même article dispose en outre que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
En cas de non-paiement ayant donné lieu au versement d'une allocation de soutien familial, l'article L. 581-3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le surplus de la créance, la demande de cette même allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme, c'est-à-dire que l'Aripa dispose du droit de recouvrer la somme directement auprès du débiteur en usant de toutes les voies d'exécution de droit privé et notamment la saisie sur rémunérations1104(*). L'agence a également droit au montant des sommes qui sont versées à titre d'avance auprès du créditeur.
Ainsi, lorsque l'allocation de soutien familial est versée, l'Aripa est subrogée dans les droits du parent créancier, c'est-à-dire qu'elle recouvre les montants à son propre compte1105(*).
Enfin, l'article L. 581-6 du même code prévoit que le titulaire d'une créance alimentaire peut bénéficier durant une durée de deux années de l'aide de l'Aripa pour le recouvrement des termes échus et des termes à échoir de la pension alimentaire.
En 2024, près de 102 000 procédures de paiement direct sont mises à en oeuvre par l'Aripa, à l'encontre de 77 000 débiteurs1106(*).
La distinction entre la procédure de
paiement direct
et la procédure de saisie sur
rémunération
La procédure de saisie sur rémunération est plus lourde que la procédure de paiement direct. En effet, elle nécessite l'intervention d'un commissaire de justice ou de l'office des dettes publiques et familiales, qui doit d'abord délivrer un commandement de payer, puis organiser une tentative de conciliation. En cas d'échec, un procès-verbal de saisie est établi et notifié à l'employeur. Ce dernier verse ensuite chaque mois une partie de la rémunération au commissaire de justice, qui se charge de la redistribuer entre les créanciers.
À l'inverse, le paiement direct se limite à une notification adressée à l'employeur, sans formalités préalables. Cette différence rend le paiement direct bien plus rapide et moins coûteux en termes de procédures.
Le paiement direct produit un effet attributif immédiat pour la créancière et est assorti d'un privilège pour les créanciers d'aliments. Ainsi, les pensions alimentaires sont payées en priorité, même devant des créances publiques comme celles du Trésor. Par exemple, si un débiteur fait l'objet à la fois d'une saisie sur rémunération pour des dettes fiscales et d'un paiement direct pour des arriérés de pension alimentaire, la pension sera prélevée en premier sur les sommes saisissables. Ce privilège garantit une sécurité accrue pour les créancières de créances alimentaires, souvent vulnérables.
Enfin, le paiement direct évite de nombreuses lourdeurs administratives liées à la redistribution des fonds. Dans le cadre d'une saisie sur rémunération, l'article L. 212-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'employeur verse les sommes au commissaire de justice, qui doit les redistribuer aux créanciers au moins toutes les six semaines. Ce délai peut retarder significativement le paiement effectif. Avec le paiement direct, l'employeur verse directement les sommes au créancier, selon les échéances prévues dans le titre exécutoire1107(*). Le flux est donc immédiat, transparent et sans intermédiaire, ce qui réduit les risques de retard ou d'erreur.
Depuis le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur rémunération a néanmoins été simplifiée par la suppression de l'obligation de saisir un juge, en application de l'article 47 de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice de 20231108(*). Désormais, cette procédure est confiée aux commissaires de justice, sous le contrôle d'un juge de l'exécution. Malgré cette évolution, le paiement direct conserve des atouts majeurs, notamment pour les créances alimentaires, en raison de sa simplicité, de son efficacité et de ses garanties juridiques.
b) La mise en recouvrement public
En 1975, l'article 1er de la loi relative au recouvrement public des pensions alimentaires1109(*) a institué une procédure permettant aux comptables publics compétents de recouvrer pour le compte de la créancière toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé. Elle revêt un caractère subsidiaire car elle ne peut être mise en oeuvre qu'après échec des autres voies d'exécution.
Le parent créancier doit adresser sa demande de recouvrement public au procureur de la République près le tribunal judiciaire. Cette demande est admise si l'intéressé justifie qu'il a effectivement eu recours à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux. Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au service compétent de l'État pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande. L'état exécutoire est ensuite transmis à la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour la mise en recouvrement1110(*).
Le recouvrement public est effectué par les comptables publics, majoré de 10 % au profit du Trésor public.
En 2024, près de 4 500 procédures de recouvrement public ont été mises en oeuvre, pour un montant exigible de 20 470 000 euros1111(*).
2. Les difficultés posées par la procédure de paiement direct et la mise en recouvrement public
Le délai maximal durant lequel une créance peut être recouvrée via la procédure de paiement direct est susceptible de conduire à ce que des créances initialement couvertes par cette procédure ne le soient plus par la suite, entraînant des pertes de mensualité de pension alimentaire pour la créancière. Environ 30 000 créances par an ont par exemple fait l'objet d'un recouvrement partiel en lien avec le délai de prise en compte de la procédure de paiement direct. En tout, le préjudice se chiffrerait, au minimum, à 17 millions d'euros par an1112(*).
Par exemple, l'insolvabilité du débiteur en cours de procédure fait que le paiement direct ne peut plus s'exercer. En effet, lorsque le débiteur a retrouvé sa solvabilité, une nouvelle procédure de paiement direct est engagée. Néanmoins, les sommes n'ayant pas pu être recouvrées à la suite de la première notification de paiement direct ne peuvent pas être recouvrées malgré l'ouverture de la seconde procédure de paiement direct.
À cela s'ajoute un décalage temporel de deux à trois mois entre la notification à l'assuré de l'état de sa dette -- qui déclenche le délai initial de 24 mois -- et la notification de paiement direct au tiers détenteur, qui relance un nouveau délai de 24 mois. Ce délai s'explique par la nécessité pour l'Aripa de tenter un recouvrement amiable avant, en cas d'échec, d'identifier un tiers détenteur. Ce décalage réduit mécaniquement le nombre de mensualités recouvrables dans le cadre de la procédure en cours, aggravant ainsi les difficultés existantes.
La procédure de paiement direct ne permettant de recouvrer que deux années d'arriérés, l'Aripa fait souvent face à la contrainte de devoir transférer le recouvrement des créances alimentaires au Trésor public. Il est alors engagé une procédure de recouvrement public, pouvant s'étaler sur cinq ans1113(*). La procédure est qualifiée de « lourde et source de complexité tant pour les comptables publics que pour l'Aripa, qui est contrainte de recourir à deux ou plusieurs procédures de recouvrement forcé distinctes au lieu d'une seule et avec des partenaires tiers »1114(*).
Par exemple, si un débiteur a accumulé 30 mois d'impayés de pension alimentaire, lorsque l'Aripa notifie l'état de la dette au débiteur, il s'enclenche un délai de 24 mois avant que la procédure ne bascule en recouvrement public. Après trois mois de tentatives de recouvrement amiable infructueuses, l'Aripa identifie l'employeur du débiteur et notifie un paiement direct. À cette date, seuls 21 mois d'arriérés précédant la notification au tiers peuvent être récupérés par paiement direct, tandis que trois premiers mois d'impayés survenus après la notification sortent du champ de recouvrement direct. Ils devront faire l'objet d'une procédure de recouvrement public. De plus, si le débiteur perd son emploi en cours de procédure et retrouve une activité professionnelle six mois plus tard, l'Aripa devra engager une nouvelle procédure de paiement direct qui ne pourra recouvrer que les 24 mois précédant cette nouvelle notification.
La procédure de recouvrement public constitue une source de lourdeur en gestion pour l'Aripa et la DGFiP. Si la procédure de recouvrement public permet effectivement d'engager davantage de moyens et recouvrer une créance sur une antériorité de cinq ans, elle apparaît comme inappropriée pour le recouvrement des pensions alimentaires. En effet, les moyens mobilisés sont disproportionnés par rapport au montant des créances et des sommes effectivement recouvrées. La procédure demande de multiples échanges entre l'Aripa, la DGFiP et les débiteurs, générant un grand nombre de procédures sans garantie de résultats. Ainsi, en 2025, la DGFiP fait état d'un constat de 75 % d'irrécouvrabilité et de seulement 10 % de recouvrement effectué avec succès sur les procédures de recouvrement public engagées1115(*).
B. Le dispositif permettrait d'optimiser le recouvrement des pensions alimentaires par l'Aripa
Le I de l'article 41 propose de modifier le dernier alinéa de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles afin de permettre à l'Aripa de disposer non plus de vingt-quatre mois dans la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct mais de cinq années, en cohérence avec le délai de prescription applicable aux créances alimentaires. L'objectif est d'éviter que les procédures de recouvrement basculent dans une procédure de recouvrement public, lourde de complexité et durant laquelle le paiement direct ne peut plus être appliqué.
Le 1° du II de l'article 41 tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin que l'organisme de recouvrement puisse également recouvrer par la procédure de paiement direct les termes échus et non plus seulement ceux qui sont à échoir. Ainsi l'Aripa pourrait plus facilement procéder au recouvrement des avances de créance auprès du débiteur. Le nouveau dispositif permettrait donc de déconnecter la période des termes échus recouvrables de la période maximale pendant laquelle l'allocation de soutien familial est versée, pour préciser que le recouvrement se fait désormais sur cinq années en cohérence avec la modification proposée au I du même article.
Le 2° du II de l'article 41 vise à supprimer dans le premier alinéa de l'article L. 581-6 du code de la sécurité sociale la limite de deux ans durant laquelle le titulaire d'une créance alimentaire peut bénéficiaire de l'aide de l'Aripa pour les termes échus. L'objectif est de permettre à l'Aripa de recouvrer des sommes pour lesquelles la procédure de paiement direct est aujourd'hui abandonnée du fait du délai maximal de deux ans, dans la logique de la modification opérée au I de l'article 41.
Le Gouvernement a précisé qu'un décret en Conseil d'État serait nécessaire afin de tirer les conséquences sur le plan pratique de l'extension du paiement direct à cinq ans. Le décret devrait notamment :
- modifier les dispositions réglementaires1116(*) qui limitent à deux ans le recouvrement des impayés de pension alimentaire, pour passer à cinq ans ;
- modifier l'échéancier de paiement des sommes dues au titre des termes échus de pension alimentaire afin d'aligner de les aligner sur le nouveau délai de cinq ans1117(*) ;
- et adapter, suite à la modification opérée au I de l'article du présent projet de loi, des dispositions réglementaires1118(*) afin que l'échéancier de paiement volontaire de la dette d'une pension alimentaire dans le cadre d'un recouvrement amiable puisse également s'effectuer sur cinq années.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission salue la volonté du Gouvernement de vouloir améliorer le recouvrement des pensions afin de :
- permettre à l'Aripa de recouvrer des sommes pour lesquelles la procédure de paiement direct est aujourd'hui abandonnée du fait du délai maximal de 2 ans grâce à la possibilité de recouvrer par ce canal les termes échus et non plus seulement ceux qui sont à échoir ;
- d'étendre la durée de la procédure de paiement direct à cinq années afin d'éviter de basculer dans une mise en recouvrement public et ainsi de la faire coïncider avec le délai de prescription applicable aux créances alimentaires.
En revanche, la commission souhaite que le recours à un décret pris en Conseil d'État soit directement précisé dans la loi, afin de s'assurer de la bonne application des dispositions votées. Elle a adopté, à cette fin
La commission a adopté un amendement rédactionnel.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements n° 709 et 710 du rapporteur.
Article 42
Créer un congé
supplémentaire de naissance
Cet article propose de créer un congé supplémentaire de naissance pour chacun des deux parents, pouvant aller jusqu'à deux mois, et s'ajoutant à leurs droits existants à congé parentaux.
Le congé de naissance pourrait être pris à la suite de congé de maternité, de paternité et d'adoption dans la limite de neuf mois après l'extinction des droits. Cette possibilité permettrait de laisser aux parents le choix entre bénéficier simultanément entre eux du congé de naissance, ou d'en bénéficier successivement.
L'indemnisation serait dégressive, à hauteur de 70 % du salaire net antérieur pour le premier mois et à hauteur de 60 % du salaire net antérieur pour le second mois.
L'objectif est de soutenir davantage les parents dans la première année de leur parentalité, en leur permettant de passer davantage de temps auprès de leur enfant tout en bénéficiant d'un revenu. En particulier, le dispositif pourrait favoriser l'implication du père auprès de l'enfant, mettant ainsi en place une dynamique favorable au retour dans l'emploi des mères.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
I - Le dispositif proposé
A. Les congés parentaux existants visent à faciliter l'accueil de l'enfant mais ils présentent des résultats encore insuffisants
1. Les congés parentaux s'articulent autour de quatre dispositifs distincts : le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation.
a) Le congé de maternité
L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale dispose que le congé de maternité est d'une durée de 16 semaines, soit 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après, pour les mères ayant accouché d'un premier enfant, et ouvre droit aux indemnités journalières du risque maternité sous condition d'activité professionnelle antérieure.
Rappel historique sur le congé de maternité
Le principe d'un congé de maternité émerge dans le droit français au début du XXe siècle avec la loi Engerand du 27 novembre 1909, qui reconnaît pour la première fois aux femmes un congé de maternité non rémunéré de huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, sans rupture de contrat de travail. La loi Strauss du 12 juin 1913 le rend obligatoire en partie pour les femmes salariées et lui associe une indemnisation compensatrice partielle. La durée du congé de maternité est progressivement allongée en 1928 par la loi sur les assurances sociales et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour l'ensemble des femmes actives, qu'elles soient salariées, indépendantes ou fonctionnaires1119(*).
La durée légale de 16 semaines n'a pas été modifiée depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses1120(*).
Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du salaire journalier de référence, correspondant à la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale1121(*), ce dernier ne pouvant être inférieure à 11,02 euros ni supérieur à 101,94 euros par jour1122(*).
La durée du congé de maternité varie en fonction du nombre d'enfants à charge. À partir de la naissance du troisième enfant, elle est portée à 26 semaines, dont huit semaines avant la naissance et 18 semaines après. Dans le cas de naissances multiples, la durée totale s'établit à 34 semaines pour des jumeaux et 46 semaines pour des triplés et plus1123(*).
Le dispositif prévoit plusieurs mécanismes d'ajustement de la durée du congé. En cas de risques ou de complications liées à la grossesse attestées par un certificat médical, la durée peut être augmentée dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après celle-ci. Le congé prénatal peut être abrégé, sur avis médical favorable, au plus d'une durée de trois semaines qui se reportent sur la période postnatale. De même, en cas de naissance prématurée, les jours non-pris sur la période prénatale sont reportés sur la période postnatale. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre1124(*).
Durées du congé de maternité
(en nombre de semaines)
|
Composition de la famille |
Congé prénatal |
Congé postnatal |
Total |
|
Inférieure à 1 |
6 |
10 |
16 semaines |
|
Supérieure à 3 enfants |
8 |
18 |
26 semaines |
|
Jumeaux |
12 |
22 |
34 semaines |
|
Triplés et plus |
24 |
22 |
46 semaines |
|
Enfant malade |
+ 2 |
+ 4 |
+ 6 |
Source : Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, rapport d'information n° 1971 sur les congés parentaux, 16 octobre 2025
En 2023, les mères se sont arrêtées en moyenne 128 jours, soit 18 semaines et 2 jours, dont 48 jours au titre du congé prénatal et 80 jours au titre du congé postnatal. Cette durée moyenne masque de nombreuses hétérogénéités : un tiers des mères sont indemnisées 112 jours, soit 16 semaines, correspondant à la durée de congé obligatoire pour la naissance des 2 premiers enfants ; 17 % le sont 126 jours, soit 18 semaines, correspondant aux 16 semaines de congé obligatoire allongées de 2 semaines de congé pathologique ; 7 % le sont 182 jours, soit 26 semaines, correspondant à la limite du congé indemnisé pour un troisième enfant1125(*).
Au cours des dernières années, le nombre de congés maternité a diminué de près de 20 %, passant de 450 000 en 2016 à 370 000 en 2023. Cette baisse s'explique en partie par une diminution des naissances, celles-ci ayant reculé de 13 % entre 2016 et 2023. Si le nombre de congés maternité a globalement diminué, leur durée est restée stable dans le temps. Depuis 2016, le congé maternité moyen s'établit à environ 128 jours1126(*).
Dans le secteur public, les fonctionnaires bénéficient du maintien de l'intégralité de leur traitement auquel peuvent s'ajouter le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence, des primes et autres indemnités. Les agents contractuels de la fonction publique conservent également l'intégralité de leur rémunération sans condition d'ancienneté1127(*).
Les travailleuses indépendantes disposent d'une allocation forfaitaire de repos maternel versée pour moitié au début du congé et pour moitié à la fin de la période obligatoire de cessation d'activité, pour un montant de 3 925 euros si le revenu d'activité annuel est supérieur ou égal à 4 208 euros, et d'une indemnité journalière forfaitaire, pour un montant maximum de 64,52 euros.
En 2023, le montant brut moyen d'indemnités journalières versées aux mères relevant du régime général s'élève à 59 euros, soit 1 790 euros par mois. Les salariées du secteur privé perçoivent des indemnités proportionnelles à leur salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale et pouvant être complétées dans le cadre de conventions collectives ou d'accords d'entreprise plus favorables. Les travailleuses indépendantes, de même que les professionnelles libérales, disposent d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire1128(*).
En 2023, la branche maladie a versé un total de 3,9 milliards d'euros au titre des congés maternité, représentant 83 % des dépenses totales consacrées aux congés maternité et paternité. L'indemnité journalière est versée aux bénéficiaires directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, alors que le financement du congé prénatal est intégralement pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, représentant 1,2 milliard d'euros, depuis 2023, celui du congé postnatal fait l'objet d'un transfert de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) vers la caisse nationale de l'assurance maladie, à hauteur de 2,1 milliards d'euros. Depuis 2015, l'ensemble des dépenses d'indemnités journalières ont augmenté de 0,7 milliard d'euros, passant de 3,2 milliards d'euros à 3,9 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 19 %1129(*).
b) Le congé de paternité
L'article L. 1125-35 du code du travail et l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale disposent que le congé de paternité, destiné au père biologique ou au conjoint de la mère ayant accouché, est d'une durée de 25 jours et peut être pris dans une limite de 6 mois après la naissance de l'enfant. Il ouvre droit aux indemnités journalières, selon le même calcul que le congé de maternité, sous condition d'activité professionnelle antérieure1130(*). Les travailleurs indépendants bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire fixée à 64,52 euros maximum par jour au 1er janvier 2025.
L'article 73 de loi de financement de la sécurité sociale pour 20211131(*) , entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a substantiellement modifié le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. La durée du congé a été portée de 11 à 25 jours pour les naissances, et de 18 à 32 jours pour les naissances multiples. Cette extension s'accompagne de l'instauration de quatre jours obligatoires devant être pris immédiatement après le congé de naissance, ainsi que de la possibilité de fractionner la partie optionnelle du congé en plusieurs périodes jusqu'à six mois après la naissance. L'objectif consistait à renforcer le lien père-enfant dans les premiers mois suivant la naissance et à favoriser un partage plus équitable des tâches domestiques entre les parents.
Fin 2021, près de 65 % des pères avaient déjà pris la totalité des 25 jours et 20 % des pères ont fractionné leur congé1132(*). En 2023, 300 000 pères affiliés au régime général ont débuté un congé de paternité, représentant 46 % des pères ayant eu un enfant au cours de l'année, avec une durée moyenne de congé de 23 jours1133(*).
Évolutions du nombre de congés
maternité et de congés paternité
indemnisés au
régime général
(en centaine de milliers)
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, mai 2025
La réforme de 2021 a été peu appropriée par les pères en raison de la persistance de freins significatifs. Les contraintes professionnelles, qu'elles soient réelles ou intériorisées, en constituent le principal obstacle. Les pères cadres expriment des craintes à s'absenter durablement de leur lieu de travail, tandis que les salariés en contrat précaire subissent une pression hiérarchique et disposent d'un faible pouvoir de négociation. Pour les travailleurs indépendants, l'arrêt temporaire du travail est perçu comme un risque d'autant plus important pour la suite de leur activité que le congé est long1134(*). Les disparités sont donc particulièrement importantes dans les taux de recours : en 2021, avant la réforme, seulement 46 % des travailleurs indépendants et 51 % des salariés en contrat court prenaient un congé, contre 82 % des salariés en contrat à durée indéterminée du secteur privé1135(*).
La méconnaissance des droits constitue également un obstacle majeur. Les pères indépendants, en contrat à durée limitée ou demandeurs d'emploi indemnisés se croient fréquemment inéligibles au dispositif, le percevant comme un droit réservé aux salariés en contrat à durée indéterminée1136(*).
Le congé de paternité présente des bénéfices réels pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. En effet, il constitue une parenthèse temporaire dans le partage des tâches domestiques. Si une répartition plus équilibrée s'observe pendant la période du congé, cette dynamique se referme au moment du retour à l'emploi du père, réinstaurant une répartition inégalitaire des responsabilités parentales. Le désalignement des durées des congés de paternité et de maternité favorise ce déséquilibre structurel1137(*).
Taux de recours des mères et des
pères éligibles aux congés de maternité
et de
paternité selon le statut dans l'emploi en 2021
(en pourcentage)
|
Statut dans l'emploi |
Congé de maternité |
Congé de paternité |
|
Salarié en CDI |
96 % |
82 % |
|
Fonctionnaire ou agent en CDI dans le secteur public |
96 % |
91 % |
|
Salarié en CDD, autres contrats dans le secteur privé ou public |
84 % |
51 % |
|
Indépendant |
88 % |
46 % |
|
Ensemble |
93 % |
74 % |
Source : Drees, « Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants », juillet 2021.
c) Le congé d'adoption
L'article L. 1225-37 du code du travail et l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale disposent que le congé d'adoption est d'une durée de 10 semaines et est destiné à tout salarié ayant adopté un enfant. Il peut être porté à 18 semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le foyer assure la charge et à 22 semaines en cas de multiples adoptions. Il ouvre droit aux indemnités journalières, selon le même calcul que le congé de paternité et de maternité, sous condition d'activité professionnelle antérieure, selon les conditions définies à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
d) Le congé parental d'éducation
L'article L. 1225-47 du code du travail dispose que le congé parental d'éducation permet au salarié de suspendre ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant jusqu'à ses trois ans, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté de moins de seize ans1138(*). Ce congé peut être pris par l'un ou l'autre des parents, sans condition d'ancienneté pour les naissances ou adoptions1139(*). Durant cette période, le contrat de travail est suspendu mais non rompu, ce qui garantit au salarié le droit de retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente1140(*). Le congé parental d'éducation n'ouvre pas droit au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, mais peut donner lieu, sous conditions de ressources et d'activité antérieure, au versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)1141(*).
Sur le plan financier, le montant de l'allocation s'avère substantiellement inférieur au salaire antérieur, créant une perte de revenus significative pour le foyer. Par exemple, un parent percevant 2 000 euros mensuels nets qui opte pour une cessation totale d'activité ne recevra qu'environ 428 euros par mois1142(*), soit une diminution de près de 80 % de ses ressources. Cette limitation des ressources incite de nombreuses familles à renoncer au dispositif ou à limiter leur engagement à une durée réduite. L'article L. 1225-53 du code du travail dispose que le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle que celle d'assistant maternel.
Montant de la prestation partagée
d'éducation de l'enfant
selon la quotité de travail au
1er avril 2025
(en euros)
|
Activité |
Montants mensuels |
|
Cessation totale d'activité |
456,05 euros |
|
Majoration à partir du troisième enfant |
745,43 euros |
|
Temps de travail inférieur ou égal |
294,81 euros |
|
Temps de travail entre 50 % et 80 % |
170,07 euros |
Source : Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, rapport d'information n° 1971 sur les congés parentaux, 16 octobre 2025
Les conditions d'éligibilité requièrent la justification de huit trimestres de cotisations vieillesse dans les quatre années précédant la naissance pour le premier enfant, et dans les cinq années pour les suivants. Cette exigence exclut de l'accès au congé parental d'éducation les parents, souvent dans une situation accrue de précarité financière et sociale, subissant des parcours professionnels discontinus.
Une interruption du travail supérieure à douze mois, voire plus longtemps en cas de prolongation, engendre un phénomène d'hystérèse des compétences professionnelles du parent et est susceptible de l'éloigner durablement du marché du travail. Les employeurs manifestent des réticences à maintenir les responsabilités antérieures ou à garantir les perspectives d'évolution professionnelle au retour du salarié, créant ainsi un frein supplémentaire à l'utilisation du dispositif.
Les conséquences du dispositif affectent disproportionnément les mères, qui demeurent les principales bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Ainsi, seulement 5 % des pères font le choix de bénéficier du dispositif, environ 25 % des mères, et près de 94 % des bénéficiaires de ce même congé parental d'éducation sont des mères1143(*). Cette surreprésentation féminine engendre des répercussions durables sur les trajectoires professionnelles : stagnation salariale, réduction des opportunités de promotion, accumulation moindre de droits à la retraite. Le retour à l'emploi, lorsqu'il se produit, s'accompagne fréquemment d'une relégation vers des postes moins qualifiés ou des contrats précaires.
Le maintien du congé parental d'éducation a été présenté comme nécessaire par le Gouvernement au regard de la pénurie des modes de garde des enfants. En effet, la suppression de ce dispositif risquerait d'aggraver les tensions existantes et d'empêcher des parents, qui en plus de perdre l'accès à ce dispositif, ne pourraient pas faire garder leur enfant.
e) La problématique de la fusion des congés existants
Le champ des congés parentaux et familiaux est large, incluant sept congés pour événements familiaux, listés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du code du travail, à savoir les congés pour mariage ou mariage d'un enfant, naissance, décès, adoption, annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant, les quatre congés parentaux développés ci-dessus, et enfin le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.
La fusion d'une partie des dispositifs existants en un congé parental unique, d'une durée comprise entre neuf mois et un an, serait de nature à rendre plus lisible l'offre de congés pour les parents et de clarifier leurs règles en aboutissant in fine à une augmentation de leur taux de recours, notamment chez les pères. En l'état actuel du droit, les familles sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour appréhender la chronologie, la cumulativité et les conditions de rémunération des congés, rendant le continuum de congés parentaux peu lisible et difficile à organiser dans l'arbitrage entre vie personnelle et vie professionnelle.
Toutefois, de nombreux congés existants répondent à un objectif de protection de la santé, comme le congé de maternité, pour permettre aux parents d'être présent à côté de leur enfant quel que soit son âge, avec le congé de présence parentale ou pour répondre aux besoins des personnes apportant leur aide à des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, avec le congé du proche aidant et le congé de solidarité familiale. De plus, la coexistence de congés avec des règles différentes permet de couvrir des populations diverses et ainsi de bénéficier au plus grand nombre d'allocataires dans l'intérêt de l'enfant.
La fusion de congés familiaux risquerait de poser des difficultés quant à l'articulation du nouveau congé avec les stipulations conventionnelles conclues par les partenaires sociaux. En effet, la durée existante des congés légaux peut être allongée par des accords collectifs de branche et d'entreprise. La suppression de congés pourrait ainsi enlever des droits sociaux acquis par les salariés.
Les accords de branche et d'entreprise favorisant
la vie familiale
et l'accueil du jeune enfant
La convention collective nationale de la banque prévoit un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours avec un salaire plein et de 90 jours pour un demi-salaire. La branche de la distribution directe accorde un congé de maternité de 18 semaines aux salariées. La branche de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions accorde aux mères deux semaines supplémentaires de congé maternité.
L'entreprise Schneider Electric a allongé la durée du congé de maternité de quatre semaines, indemnisé à 100 %. L'entreprise Renault a prolongé la durée du congé de maternité de deux semaines, rémunéré à 100 %. L'entreprise Alstom a allongé la durée du congé de maternité d'une semaine, rémunéré à 100 % et donné la possibilité, durant les deux premières semaines de reprise du travail d'un mi-temps sans perte de salaire1144(*).
2. Les congés parentaux présentent des effets concrets sur la réduction des inégalités entre les parents et le retour à l'emploi, mais ils demeurent insuffisants au regard des attentes fortes des parents.
a) Les limites des dispositifs
Trois problématiques principales émergent pour les parents de manière récurrente à la fin du congé maternité ou du congé paternité. Premièrement, l'utilisation des modes de garde, parfois multiples, s'avère insuffisante, saturée ou inadaptée aux besoins du nourrisson. Deuxièmement, la durée des congés apparaît trop court pour sécuriser l'organisation familiale, occasionnant du stress et de la culpabilité par rapport à des choix contraints, tels que l'interruption de carrière ou le recours à des solutions précaires. Troisièmement, la reprise professionnelle intervient trop rapidement, certaines mères témoignant d'une fatigue persistante, d'un manque de préparation psychologique et d'une pression professionnelle qui ne tient pas compte des réalités familiales1145(*).
Les chiffres relatifs à la répartition des tâches domestiques et parentales demeurent particulièrement inégalitaires. Les femmes assument encore 72 % des tâches domestiques et de soin, qu'elles soient en activité ou non. Ce travail invisible, non rémunéré et sous-estimé, pèse lourdement sur leur quotidien avec des conséquences préoccupantes : 46 % des mères françaises déclarent souffrir de problèmes de santé mentale, dont 22 % de surcharge professionnelle en raison de leur responsabilité parentale, et 71 % se sentent surchargées. Cette situation est renforcée par le fait que le père ne prend généralement pas sa part de responsabilité parentale, laissant les mères seules face à cette transition. Les normes de genre encore tenaces et la culture d'entreprise, notamment la crainte de stigmatisation ou de ralentissement de carrière, constituent des freins majeurs à l'implication paternelle1146(*).
L'articulation entre vie professionnelle et vie familiale contraint de nombreuses mères à modifier leur situation professionnelle. Près de 53 % des mères ont modifié leur quotité de travail afin de passer plus de temps avec leur enfant. Cette modification intervient principalement parce que la séparation précoce est vécue comme une source de stress et d'anxiété, tant pour les mères que pour l'enfant. Plus largement, quatre parents sur dix ont déjà interrompu ou réduit leur activité professionnelle plus d'un mois, en dehors des congés parentaux, pour s'occuper de leur enfant : c'est le cas pour 49 % des mères et 33 % des pères. La proportion explose à 68 % chez les parents de 18 à 29 ans. Logiquement, cette réduction d'activité a des conséquences financières négatives pour 82 % des parents qui y ont eu recours1147(*).
Dès lors, 51 % des femmes en temps partiel déclarent l'être pour s'occuper de leurs enfants, contre seulement 14 % des hommes. Cinq après une naissance, toutes choses égales par ailleurs, l'écart salarial entre un homme et une femme causé par l'arrivée d'un nourrisson est de 25 %. Ainsi, le coût de la maternité sur la carrière des femmes est réel, alors que seulement 27 % des mères de jeunes enfants travaillent à temps plein1148(*).
Près de 49 % des parents ayant renoncé à avoir un enfant alors qu'ils le souhaitaient, affirment pouvoir l'envisager si les congés parentaux étaient davantage accessibles et mieux rémunérés1149(*). Environ 85 % des parents se disent intéressés par un congé parental indemnisé à 70 % du salaire et 60 % des parents aimeraient qu'un tel congé mieux indemnisé puisse durer un an et soit librement partageable entre les deux parents. Les parents veulent avoir du temps sur la durée avec leur nourrisson. Même au niveau des pères, 32 % d'entre eux seraient intéressés par un congé parental de six mois rémunérés à 70 % de leur salaire. Leur intérêt pour les dispositifs permettant de prolonger le temps passé avec leur tout-petit, bien que moins fort que celui des mères, existe1150(*).
Les attentes des parents en matière d'organisation professionnelle sont claires. Concernant le retour au travail, 44 % des mères souhaitent un retour graduel, 50 % réclament des horaires flexibles pour concilier vie professionnelle et parentale, et 37 % demandent un accès accru au télétravail. Entre zéro et deux ans, 50 % des femmes préfèrent travailler à temps partiel pour mieux s'occuper de leur enfant. Par ailleurs, 58 % des mères estiment qu'un congé paternité plus long limiterait les risques de dépression post-partum, et 53 % affirment qu'un congé maternité plus long permettrait de reprendre plus sereinement le travail1151(*).
b) La persistance des inégalités socio-économiques et de genre
Les pères continuent de moins recourir aux congés parentaux que les mères. Ainsi, 71 %des pères utilisent au moins un dispositif de congé parental pour 91 % des mères1152(*). Plus précisément, seuls 40 % des pères utilisent intégralement leur congé paternité en 2024, et 14 % des pères ne prennent aucun jour de congé de paternité, contre 25 % en Europe1153(*).
Entre 2013 et 2021, le recours au congé de paternité a pourtant progressé. La proportion de pères d'enfants de moins de trois ans ayant bénéficié d'un congé de paternité est passée de 62 % à 67 %1154(*).
Le temps de congé est souvent perçu comme insuffisant pour installer durablement le partage des tâches domestiques au sein du couple et l'attachement père-enfant, particulièrement lorsque l'autre parent reprend son activité professionnelle. Le père présente donc plus de difficultés pour installer ce rapport privilégié dès la naissance par rapport aux mères. D'autres obstacles subsistent, notamment la vision du monde de l'entreprise sur la place de l'homme dans la famille, ainsi que le caractère jugé peu attractif du congé en raison de sa durée ou de sa rémunération1155(*).
Le recours au congé paternité se révèle plus faible aux deux extrémités salariales. Ainsi, 73 % des pères en emploi à la naissance de leur enfant et dont les revenus mensuels nets étaient supérieurs à 3 500 euros ont recouru à tout ou partie du congé de paternité, contre 98 % des pères dont les revenus mensuels étaient compris entre 2 500 euros et 2 899 euros. Pour les salaires plus modestes, les jeunes pères indiquent une crainte des conséquences de la prise du congé paternité sur leurs carrières professionnelles. Le taux de recours du congé paternité chute alors à 66 % pour les pères dont le revenu est inférieur à 1 400 euros. Pour les plus hauts salaires, la raison évoquée est celle du surinvestissement professionnel lié à des postes de direction, avec potentiellement l'impact du plafonnement de l'indemnité. Dans les structures de plus de 200 salariés, le congé paternité est davantage utilisé car sa mise en oeuvre dans l'organisation du travail est moins évidente dans les très petites entreprises1156(*).
Taux de recours au congé de paternité par décile de revenus
(en points de pourcentage)
Source : Centre d'études et de recherches sur les qualifications, mars 20221157(*)
Enfin, le montant des indemnités journalières relatif aux congés de maternité, de paternité et d'adoption reproduit le niveau des inégalités salariales observées sur le marché du travail, entre les ménages et entre les femmes et les hommes. En 2021, les 10 % des mères avec l'indemnité journalière la plus faible avaient une indemnité journalière moyenne de 23 euros, en comparaison aux 89 euros pour les 10 % des mères avec l'indemnité journalière la plus élevée, soit un rapport de 1 à 4.
Ces inégalités illustrent les difficultés que les ménages les moins favorisés peuvent rencontrer dans l'entretien du nouvel enfant dont les indemnités ne permettent pas toujours de protéger de la pauvreté. Ainsi, en 2021, le taux de pauvreté des enfants de moins de trois ans est estimé à 19,7 %, pour 366 000 enfants pauvres, contre 14,5 % pour l'ensemble de la population1158(*).
Distribution des montants moyens d'indemnité journalière maternité et paternité en 2021 au régime général
(en euros)
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2025
L'écart entre le montant moyen d'indemnité journalière de paternité et celui de maternité, respectivement 70 euros et 59 euros, reflète également la persistance des inégalités salariales observées entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, bien que celles-ci soient en partie estompées par le plafonnement de l'indemnité journalière au plafond annuel de la sécurité sociale.
Le congé parental d'éducation, le plus faiblement rémunéré, est pris à 98 % par les mères, favorisant leur appauvrissement et aggravant l'inégal partage des tâches domestiques1159(*). Significativement, 84 % des mères souhaitent la coexistence d'un congé parental court bien rémunéré avec un congé long plus faiblement rémunéré afin qu'elles puissent disposer d'un choix1160(*).
c) L'état des lieux de la démographie
En 2024, la France enregistre 663 000 naissances, soit une diminution de 15 000 naissances par rapport à l'année précédente, représentant un recul de 2,2 %. Ce chiffre constitue un niveau historiquement bas, jamais atteint depuis 1994. Cette tendance baissière s'inscrit dans une dynamique de long terme, puisque le nombre de naissances diminue chaque année depuis 2010, à l'exception notable de l'année 2021 qui a connu un rebond temporaire. La pandémie de covid-19 a eu un effet sur cette dynamique démographique, en décourageant les couples à procréer et en les incitant à reporter leurs projets de parentalité. Au total, entre 2010 et 2024, le nombre de naissances a diminué de 20,4 %1161(*). Les prévisions font état d'un rebond de la démographie en 2026, avec une hausse prévue de la natalité de 0,6 %1162(*).
Le repli des naissances observé entre 2015 et 2020 s'explique par deux facteurs : la diminution de la population féminine en âge de procréer et la baisse de la fécondité. Le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans, qui concentrent aujourd'hui plus de 95 % des naissances, est en recul depuis la fin du XXe siècle. Elles étaient 8,9 millions en 2005, 8,5 millions en 2019 et sont 8,6 millions au 1er janvier 20251163(*).
L'indicateur conjoncturel de fécondité, qui mesure le nombre moyen d'enfants par femme, s'établissait à 1,62 enfant par femme en 2024, contre 1,83 en 2021. Il faut remonter à la période 1993-1994 pour retrouver un niveau aussi bas. Cette baisse fait suite à une période de forte progression de la fécondité entre 2002 et 2008, puis à son maintien autour du seuil de renouvellement des générations, soit deux enfants par femme, jusqu'en 2014. Entre 2014 et 2019, la baisse était déjà significative avec une moyenne annuelle de 1,6 %. Depuis lors, le rythme s'est fortement accéléré avec une chute de 6,6 % en 2023, suivie d'une diminution de 2,2 % en 20241164(*).
Nombre de naissances et indicateur conjoncturel de fécondité en France
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2025
En 2023, la France a perdu sa position de pays le plus fécond de l'Union européenne, avec un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,66 enfant par femme, en baisse par rapport aux 1,83 enfants par femme enregistrés en 2020. Néanmoins, la France conserve un niveau de fécondité nettement supérieur à la moyenne de l'Union européenne qui s'établit à 1,38 enfant par femme. Cette situation témoigne d'une baisse tendancielle généralisée de la fécondité à l'échelle européenne, mais avec des disparités importantes selon les régions1165(*).
Les pays du sud, du centre et de l'est de l'Europe présentent les niveaux de fécondité les plus faibles. Ainsi, l'Espagne, l'Italie et la Pologne affichent des taux compris entre 1,16 et 1,2 enfant par femme. Les pays nordiques et l'Irlande se situent au niveau de la moyenne européenne, avec environ 1,38 enfant par femme. Quelques pays se distinguent par des niveaux de fécondité plus élevés : la Roumanie et la Hongrie enregistrent un taux avoisinant 1,6 enfant par femme, tandis que la Bulgarie occupe la première place en 2023 avec un taux de fécondité de 1,8 enfant par femme, devançant ainsi la France1166(*).
La composition des familles françaises
Le nombre de familles comptant un ou deux enfants a progressé de 29 % entre 1975 et 2021. Elles représentent maintenant 39 % des familles, contre 32 % en 1975, soit une augmentation de sept points de pourcentage en un demi-siècle1167(*).
À l'inverse, les familles nombreuses connaissent un déclin marqué. Le nombre de familles avec au moins quatre enfants a fortement régressé, leur part dans l'ensemble des familles ayant été divisée par 2,6 entre 1975 et 2021. Les familles de trois enfants affichent quant à elles une relative stabilité, leur effectif ne diminuant que de 3 % sur l'ensemble de la période considérée1168(*).
Près de 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes, avec un risque de pauvreté deux fois plus élevé que la moyenne. Plus de 40 % d'enfants de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté1169(*).
Le nombre de familles monoparentales a atteint 2,5 millions en 2021, soit 27 % des familles avec enfants. Cette proportion témoigne d'une croissance continue et significative depuis quarante ans, puisqu'elle n'était que de 13 % en 1990 et de 9 % en 1975. Cette progression représente un quasi-triplement de la part des familles monoparentales en moins d'un demi-siècle. Plus de quatre familles monoparentales sur cinq, soit plus de 80 %, sont composées d'une femme avec enfant1170(*).
Les causes de la monoparentalité ont profondément évolué au fil des décennies, traduisant notamment l'émancipation des valeurs amoureuses du modèle familial traditionnel1171(*). Les ruptures d'unions constituent désormais l'origine principale de la croissance de la monoparentalité, alors qu'auparavant les familles monoparentales résultaient principalement du décès précoce d'un des parents, le plus souvent du père1172(*). Cette transformation est particulièrement visible : en 1962, 55 % des parents à la tête d'une famille monoparentale étaient veufs, alors qu'en 2011, ils ne représentaient plus que 6 % de cette catégorie, soit une division par plus de neuf en un demi-siècle1173(*).
B. Le dispositif viserait à mettre en place un congé supplémentaire de naissance d'une durée pouvant aller jusqu'à deux mois bénéficiant aux assurés actifs, indépendants et aux non-salariés agricoles
1. Les modifications du code de la sécurité sociale et du code du travail poseraient les fondements du congé supplémentaire de naissance
a) Les modifications proposées au code de la sécurité sociale
Le 5° du V de l'article 42 prévoit d'insérer au chapitre I du titre III du code du livre III précité une section 4 bis intitulée « congé supplémentaire de naissance ».
L'article L. 331-8-1 nouvellement créé au sein de ce même chapitre disposerait que l'assuré bénéficiant d'un congé supplémentaire de naissance, à condition de cesser toute activité salariée, recevrait une indemnité journalière correspondant à une fraction de ses revenus antérieurs dans la limite d'un plafond déterminé en décret pris en Conseil d'État. L'indemnité serait calculée en fonction des salaires bruts des trois mois précédant l'interruption de travail dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
L'article L. 331-8-2 nouvellement créé au sein dudit chapitre disposerait que l'indemnité journalière versée au titre du congé supplémentaire de naissance ne serait pas cumulable avec l'indemnité journalière versée par l'assurance maladie1174(*) ainsi qu'avec les indemnités journalières relatives à la maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en cas de décès d'un enfant1175(*). Elle ne serait également pas cumulable avec les indemnités relatives à l'assurance-chômage.
Le c du 5° susmentionné fait référence à un article L. 331-11 du code de la sécurité sociale, qui n'existe pas. Le gouvernement a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de mise en cohérence et donc d'une erreur du texte.
Le 6° de ce même V préciserait à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale que la période durant laquelle l'assuré bénéficie d'un congé supplémentaire de naissance, au même titre que les prestations maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, ouvre droit à pension.
Le 7° dudit V complèterait l'article L. 531-9 du code précité en disposant que le complément de libre choix du mode de garde ne serait pas cumulable avec l'indemnité versée au titre du congé supplémentaire de naissance lorsque ces prestations sont effectivement versées au titre du même enfant.
Dans la même logique, le 8° dudit V modifierait l'article L. 532-2 du code précité afin d'insérer le congé supplémentaire de naissance dans la liste des dispositifs incompatibles avec le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, au même titre que les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.
Également, le 9° dudit V modifierait l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale afin de faire en sorte que le congé supplémentaire de naissance ne soit pas cumulable avec le versement de l'allocation journalière de présence parentale.
Un décret en Conseil d'État est nécessaire afin de fixer le montant de l'indemnité journalière mentionnée au nouvel article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale. En effet, le congé supplémentaire de naissance est rémunéré par une indemnité journalière de naissance construite sur le fondement réglementaire de l'indemnité journalière de maternité1176(*). L'indemnité subirait un régime fiscal et social identique à celui des indemnités journalières maladie, à savoir 6,7 % au titre de la contribution sociale générale et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Le 10° dudit V procèderait à une modification rédactionnelle dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI en intégrant le congé supplémentaire de naissance dans les dispositions applicables aux travailleurs indépendants.
À ce même chapitre, il serait rétabli un article L. 623-2 au sein du même code, placé après les dispositions relatives aux prestations de maternité des travailleurs indépendants, disposant que les travailleurs indépendants pourraient bénéficier d'indemnités journalières de naissance à l'issue des congés de maternité, de paternité et d'adoption. L'article fait référence au nouvel article L. 331-8-1 du code précité en précisant que ses dispositions s'appliqueraient aux travailleurs indépendants.
Un décret doit déterminer les conditions d'applications du nouvel article L. 623-2. Le Gouvernement a précisé que l'indemnité journalière des indépendants serait soumise, dans les mêmes proportions que celui des salariés du régime général, à un abattement à hauteur de 70 % le premier mois et de 60 % le second mois.
Le 1° du V insèrerait à l'article L. 136-8 du code précité les indemnités journalières et allocations versées au titre du congé supplémentaire de naissance comme assujetties au taux dérogatoire de 6,2 % des contributions sociales, au même titre que les autres allocations versées au titre de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant.
Le 2° du V insèrerait à l'article L. 168-7 dudit code le congé supplémentaire de naissance dans la liste des allocations qui ne sont pas cumulables avec le versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Dans la même logique, le 3° du V précité insèrerait à l'article L. 168-10 dudit code le congé supplémentaire de naissance dans la liste des allocations qui ne sont pas cumulables avec le versement de l'allocation journalière du proche aidant dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles1177(*).
Le 4° du V complèterait le 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant que la Cnaf assurerait le remboursement de la totalité du montant des indemnités en lien avec le congé supplémentaire de naissance. Il insèrerait également le congé supplémentaire de naissance au même titre que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant comme une prestation qui fait l'objet du remboursement de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales pour les agents de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique1178(*).
Le 5° du V assurerait des coordinations rédactionnelles, à l'intitulé du titre III du livre III du code de la sécurité sociale et dans l'intitulé du chapitre Ier dudit code. Il préciserait également que le congé supplémentaire de naissance n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue en cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans1179(*).
b) Les modifications proposées au code du travail
Le 1° du VI de l'article 42 insèrerait un article L. 1225-4-5 au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail. Cet article disposerait qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant son congé supplémentaire de naissance. Seul un motif en lien avec une faute grave du salarié ou extérieure à la naissance de son enfant serait justifié pour rompre le contrat de travail. Le même 1° procèderait à une insertion à l'article L. 2225-6 dudit code de la référence au nouvel article L. 1225-4-5 qui ne ferait ainsi pas obstacle à l'échéance de renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée.
Le même 1° intègrerait au même code une nouvelle section 3 bis dédiée au congé supplémentaire de naissance.
L'article L. 1225-46-2 nouvellement créé disposerait qu'un salarié ayant bénéficié « d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d'un congé supplémentaire de naissance. La condition d'avoir épuisé son droit à congé ne s'applique pas au salarié qui n'a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées » au titre des prestations relevant de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Le même article prévoirait que le bénéfice du congé supplémentaire de naissance entraînerait la suspension du contrat de travail. Il préciserait que sa durée serait d'un mois ou de deux mois au choix du salarié, mais que cette période ne pourrait être fractionnée.
Le délai de prévenance de l'employeur devrait être fixée par décret bien que ce même nouvel article précise qu'il doit être compris entre quinze jours et un mois. Le délai d'un mois semblerait le plus cohérent car il serait identique à celui déjà prévu pour le congé de paternité et d'accueil du nouvel enfant1180(*). Le délai de quinze jours permettrait néanmoins de répondre à certaines situations, comme par exemple pour un salarié qui prendrait 28 jours du congé de paternité et d'accueil sans fractionnement et qui ne pourrait ainsi pas respecter le délai de prévenance d'un mois. Dans le cadre d'une adoption, le délai de prévenance d'un mois est inadapté car la date exacte d'arrivée de l'enfant adopté n'est parfois connue qu'une semaine ou deux avant son arrivé.
Ce même délai pourrait être augmenté en application des conventions collectives conclues.
L'article L. 1225-46-3 nouvellement créé assimilerait la durée du congé supplémentaire de naissance comme « une période de travail effective dans la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté » En conséquence, le salarié conserverait « le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé ».
L'article L. 1225-46-4 nouvellement créé rappellerait que « le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé ». L'interdiction est identique à celle prévue pour le congé parental d'éducation, sauf qu'il n'est pas prévu que le salarié puisse exercer le métier d'assistant maternel, ce qui aurait peu de sens en raison de la faible durée du congé de naissance.
L'article L. 1225-46-5 nouvellement créé disposerait « qu'en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance ». La loi prévoit déjà qu'en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le parent salarié bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant peut anticiper son retour dans l'entreprise1181(*). La demande du salarié doit être motivée et la baisse de ressources doit est effective au jour de sa demande et pas par l'anticipation d'un risque ultérieur1182(*).
L'article L. 1225-46-7 nouvellement créé indiquerait que tout « salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, si cet entretien n'a pas déjà été réalisé à l'issue des congés de maternité ou d'adoption ».
En symétrie, le 2° du VI de l'article 42 modifierait l'article L. 6315-1 du code du travail en intégrant le congé supplémentaire de naissance dans la liste des dispositifs qui entraînent systématiquement à leur issue la réalisation d'un entretien professionnel.
Le 3° du même VI intègrerait le congé supplémentaire de naissance dans la liste des dispositifs, au même titre que le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, qui feraient que sa durée « est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée »1183(*). La même logique serait appliquée pour les travailleurs indépendants, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur dans la prise en compte de la durée du congé supplémentaire de naissance dans le calcul des droits au titre du compte personnel de formation1184(*). La situation spécifique des travailleurs en situation de handicap mentionnée à l'article L. 6323-35 serait également adaptée au congé supplémentaire de naissance.
Le IX du présent article disposerait que les articles du code général de la fonction publique relatifs aux congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption1185(*) seraient directement applicables aux agents des administrations parisiennes. En l'état actuel du droit, l'article L. 417-1 du code général de la fonction publique précise que les agents des administrations publiques parisiennes sont soumis à un statut fixé directement par décret en Conseil d'État. Le décret n° 94-415 du 4 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes précise que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale leur est applicable dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2018. Il est donc nécessaire de préciser que toute modification relative à un article applicable aux agents des administrations parisiennes faute de quoi seule la version de la loi précitée en vigueur au 31 mars 2018 leur serait applicable.
2) Les modifications présentées seraient ensuite déclinées à divers codes
a) Les modifications proposées au code général de la fonction publique
Le 1° du II procéderait, au sein de l'article L. 326-14 du code général de la fonction publique, à l'insertion du congé supplémentaire de naissance dans le dispositif visant à faire en sorte que la prolongation de la durée d'un contrat de droit public puisse être effectuée en cas de congé pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption.
Le 2° du même II s'attacherait dans la même logique, à l'article L. 515-2 du code général de la fonction publique, à l'insertion du congé supplémentaire de naissance dans le dispositif permettant d'accorder de droit tout congé parental à un fonctionnaire.
Le 3° dudit II complèterait l'article L. 631-1 du code général de la fonction publique afin de fixer le principe du maintien du traitement des fonctionnaires pendant la durée du congé supplémentaire de naissance en dérogation avec la règle du service fait. Les modalités de maintien du traitement des fonctionnaires seraient alignées sur celles des salariés du régime général et justifieraient ainsi, par parallélisme avec la fixation de l'indemnité journalière du régime général, que ses quotités soient fixées par la voie réglementaire.
Le 4° du même II harmoniserait les dispositions des articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique avec la création du congé supplémentaire de naissance, en intégrant le congé de naissance comme motif de préservation des droits acquis avant le début du congé, ou en prévoyant que le fonctionnaire a droit au congé de naissance au même titre qu'au congé d'adoption ainsi que de paternité et d'accueil de l'enfant.
b) Les modifications proposées au code de la défense et au code des pensions civiles et militaires de l'État
Le 1° du I de l'article 42 modifierait l'article L. 4138-2 du code de la défense en précisant qu'un militaire continuerait de bénéficier de cette qualité s'il bénéficie d'un congé supplémentaire de naissance, au même titre que pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Il intègrerait également le congé supplémentaire de naissance dans l'énumération des situations dans laquelle un militaire ne peut pas conserver l'intégralité de sa rémunération.
Le 2° du I précité modifierait l'article L. 4138-4 du code de la défense afin de préciser que le parallélisme des modalités de durée entre les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption entre les dispositions du code général de la fonction publique et celles du code de la défense vaut également pour le congé supplémentaire de naissance. En raison de la transposition de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État à la rédaction actuelle de l'article L. 4138-4 du code de la défense, il n'existe actuellement pas de référence au congé de paternité et d'adoption dans le code précité. Ainsi, il est nécessaire d'intégrer cette référence à l'article susvisé afin de le mettre en cohérence avec l'article L. 515-2 du code général de la fonction publique. La suppression de la mention des personnels militaires correspond à un ajustement rédactionnel indépendant de la création du congé supplémentaire de naissance.
Le 3° du I de l'article 42 modifierait l'article L. 4138-14 du code de la défense afin d'y intégrer une référence au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, manquante alors qu'elle devrait y figurer pour que l'article précité soit cohérent avec l'article L. 515-2 du code général de la fonction publique.
Le III actualiserait l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de l'État pour confirmer la prise en compte du congé supplémentaire de naissance dans le calcul des droits à la retraite des militaires. En particulier, « les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » ne seraient plus celles qui permettraient d'être comptabilisées comme des périodes de service effectif mais il s'agirait désormais de celles énumérées à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de l'État, c'est-à-dire celles incluant le congé supplémentaire de naissance. Un décret pris en Conseil d'État devrait préciser les modalités issues des modifications du même article.
Le 4° et le 5 du même III, créés par l'article 42, vise à clarifier la liste des congés relevant de la position d'activité du fonctionnaire qui ne comportent pas, par nature, l'accomplissement de services effectifs pour détailler les références mentionnées à l'article L. 9 du code précité.
c) Les modifications proposées au code rural et de la pêche maritime
Le 2° du IV de l'article 9 insèrerait un nouvel article L. 732-12-1-1 au sein du code rural et de la pêche maritime qui assurerait l'application du congé supplémentaire de naissance pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation, aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole1186(*).
Ce même 2° préciserait que l'allocation de remplacement du congé supplémentaire de naissance ne pourrait être versée que si la personne ne reprend pas son activité, et le cas échéant si elle ne peut pas être remplacée, prévoirait le versement d'une indemnité journalière forfaitaire supplémentaire, sur le modèle de celle versée aux travailleurs indépendants.
Les durées maximales d'attribution de cette allocation et de cette indemnité seraient similaires à celles prévues par l'article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale. La prise en charge financière de ces prestations doit tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité de l'exploitation agricole durant cette période. En l'état actuel du droit, les bénéficiaires des congés parentaux du régime agricole peuvent bénéficier de l'appui d'un salarié pour effectuer les tâches agricoles à leur place. Le congé de naissance reprendrait ces modalités, à l'image des différents congés du régime agricole. L'allocation en question serait versée aux services départementaux de la mutualité sociale agricole et permettrait de couvrir intégralement le coût de remplacement du parent bénéficiant du congé.
Le 2° précité disposerait enfin qu'un décret pris en Conseil d'État doit apporter des précisions sur les montants et la période pendant laquelle les allocations peuvent être versées.
Le 1° du IV assurerait une coordination légistique en intégrant le nouvel article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 732-11 du même code. Ce dernier disposerait que les allocations de remplacement des congés parentaux bénéficient également aux non-salariés agricoles.
d) Les modifications proposées aux ordonnances relatives au Département de Mayotte
Le VII de l'article 42 modifierait l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de la sécurité sociale de Mayotte afin d'y intégrer le dispositif du congé supplémentaire de naissance.
Le 1° du VII précité modifierait l'article 20-1 de la même ordonnance en y intégrant dans le périmètre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte le versement de l'indemnité journalière relative au congé supplémentaire de naissance, au même titre que le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption.
Ce même 1° complèterait la mention de la maternité qui permet aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale de bénéficier d'une allocation journalière et d'une indemnité forfaitaire en y ajoutant donc celle du congé supplémentaire de naissance. Dans la même logique, ce même 1° développerait la mention du parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale en y ajoutant le congé supplémentaire de naissance qui leur permettrait de bénéficier d'une allocation journalière et d'une indemnité forfaitaire. Également, le 1° précité accorderait un droit identique pour les conjoints collaborateurs du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle1187(*).
Le 2° du VII précité intègrerait à l'article 20-6 de cette même ordonnance le congé supplémentaire de naissance dans la liste des dispositifs qui nécessiteraient, pour l'assuré, d'avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti1188(*) afin de pouvoir en bénéficier.
Le 3° de ce même VII modifierait l'article 20-8 de ladite ordonnance afin de préciser que l'indemnité afférente au congé supplémentaire de naissance serait versée à condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Il préciserait en outre que cette même indemnité n'est pas cumulable avec celles des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage. Il prévoirait la fixation par un décret « les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en oeuvre » du congé supplémentaire de naissance.
Le VII précité insèrerait un nouvel article L. 20-10-3 à cette même ordonnance qui préciserait que l'article L. 623-2 du code de la sécurité sociale rétabli par l'article 42 du projet de loi de financement pour la sécurité sociale de 2026 et l'article 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime nouvellement créé au 2° du IV de l'article 42 seraient pleinement applicables à Mayotte, avec des conditions fixées par décret.
Pour rappel, l'article L. 623-2 du code de la sécurité sociale rétabli au 10° du V porte sur l'intégration du congé supplémentaire de naissance aux prestations disponibles aux indépendants et l'article L. 732-12-1-1 assurerait l'application du congé supplémentaire de naissance pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation, aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Au VIII, il serait inséré après l'article 10-7 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 un nouvel article 10-8 disposant que le complément du libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec les indemnités et allocations du congé supplémentaire de naissance lorsque ces dernières sont versées pour le même enfant.
Le X de l'article 9 conclurait en affirmant que les dispositions du présent article seraient applicables « pour les enfants nés ou adoptés à compter de 1er juillet 2027 ».
3. L'adoption du congé de naissance aurait de nombreuses implications socio-économiques et financières
a) L'amélioration de l'accueil du jeune enfant et la réduction des inégalités hommes - femmes
Le congé supplémentaire de naissance est construit dans la perspective de permettre une meilleure répartition des tâches entre les mères et les pères ainsi que de meilleure inclusion des mères dans la population active. La création d'un congé de courte durée et bien rémunéré répondrait aux attentes des parents qui sont près de 87 % à considérer que la garde par les parents est le meilleur mode de garde dans les six premiers mois de l'enfant1189(*).
Taux de recours estimés du congé supplémentaire de naissance
(en pourcentage)
|
Année d'entrée en vigueur |
N+ 3 |
|||
|
Taux de remplacement du salaire net |
Pour les pères |
Pour les mères |
Pour les pères |
Pour les mères |
|
70 % le premier mois |
10 % |
35 % |
20 % |
55 % |
|
60 % le second mois |
3 % |
30 % |
10 % |
40 % |
Source : Étude d'impact en vue du présent projet de loi
Les estimations du taux de recours sont conventionnelles car il n'existe aucun modèle statistique permettant d'évaluer l'adaptation des comportements à la création d'un nouveau dispositif de congé parental. En revanche, il est à prévoir que le succès du dispositif dépendra principalement à la montée en charge du dispositif à travers une communication effectuée par les entreprises à leurs salariés et par les organismes de sécurité sociale à leurs affiliés.
b) Les conséquences financières de la création d'un congé supplémentaire de naissance
Pour une mise en oeuvre à compter du 1er juillet 2027, le coût de la mesure est estimé à 300 millions d'euros en 2027, 400 millions d'euros en 2028, 500 millions d'euros en 2029 et 600 millions d'euros en 2030.
Le congé supplémentaire de naissance permettrait d'éviter un certain volume de dépenses relatives au complément du libre choix du mode de garde pour les assistantes maternelles (CMG). Le montant exact n'est pas possible à déterminer d'avance. Le dispositif permettrait aussi de réduire les dépenses afférentes au versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à hauteur de deux mois, correspondant à la durée du nouveau congé de naissance.
c) Les implication techniques pour la Caisse nationale d'assurance maladie
L'indemnité du congé supplémentaire de naissance serait versée par les caisses primaires d'assurance maladie car elle est construite selon des fondements identiques aux indemnités journalières pour maladie ou maternité. De surcroît, afin de pouvoir être mis en place le plus rapidement possible, seules les caisses primaires d'assurance maladie disposent des systèmes d'information permettant le versement de l'indemnité du congé supplémentaire de naissance. En effet, les infrastructures informatiques des caisses d'allocations familiales, fonctionnant sur le référentiel du foyer familial, ne peuvent pas individualiser le versement d'une prestation au sein d'une même famille alors que les caisses primaires d'assurance maladie le peuvent en raison de leur expertise sur le versement des indemnités journalières.
Il n'est pas possible d'envisager une mise en oeuvre antérieure au premier trimestre 2027 car les caisses primaires d'assurance maladie doivent vérifier les conditions d'ouverture de droit des assurés concernés et adapter leurs systèmes d'information. En particulier, le logiciel Arpège doit être adapté à trois paramètres inédits :
- la dégressivité du montant d'indemnisation ;
- la possibilité de prendre un congé consécutivement au congé maternité, paternité ou d'adoption ou plus tardivement ce qui suppose de paramétrer un module de recalcul des droits à congés ;
- et enfin la vérification de l'épuisement des droits à congés précédents.
Le logiciel Arpège est déjà en cours de construction, succédant à l'applicatif Progrès utilisé pour les indemnités journalières. La mise en oeuvre de la mesure dépend donc du bon déploiement du logiciel Arpège. La mesure de limitation de la durée de prescription des indemnités journalières, prévue au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, renchérit la durée d'implantation du congé supplémentaire de naissance au sein de ce même logiciel.
De plus, la création du congé supplémentaire de naissance suppose d'assurer son adaptation à la déclaration sociale nominative (DSN). Les employeurs devront effectuer un signalement en DSN pour indiquer que le salarié bénéficie du nouveau dispositif sur une période donnée en indiquant ses revenus précédents par la création d'une nouvelle rubrique.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'amendement n° 1442, déposé par la députée Delphine Lingemann, modifie le 1° du VI en prévoyant au nouvel article L. 1225-46-2 du code du travail que le congé supplémentaire de naissance pourrait être fractionné, c'est-à-dire qu'un parent, ou les deux, disposeraient de la possibilité de ne pas profiter successivement des deux mois du congé supplémentaire de naissance. De plus, l'amendement prévoit qu'un mois minimum doit être pris de manière non simultanée avec l'autre parent. L'objectif est de faire en sorte que les pères se retrouvent seuls pendant un mois minimum avec leur enfant, afin de les responsabiliser dans leur fonction parentale.
L'amendement n° 1611, déposé par la députée Sarah Legrain, prévoit que la date d'entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance est avancée au 1er janvier 2026, en lieu et place du 1er juillet 2027.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels : amendement n° 2387, n° 2388, n° 2389, n° 2390, n° 2391, n° 2392, n° 2404, n° 2392, n° 2393, n° 2405, n° 2401, n° 2394, n° 2395, n° 2397, n° 2396, n° 2402, n° 2398 et n° 2399.
L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission regrette que le dispositif proposé par le Gouvernement n'entraîne qu'une refonte partielle des congés parentaux.
En effet, le congé supplémentaire de naissance se contente d'être une addition aux congés de maternité, de paternité et d'adoption alors qu'il serait nécessaire de travailler sur un nouveau congé parental unifiant le congé de maternité, de paternité et d'adoption pour un congé bien rémunéré et d'une durée comprise entre 9 mois et 12 mois afin de faire en sorte qu'il convienne pleinement aux attentes des parents. Il risque également d'ajouter de la confusion pour les parents dans leur choix de congé : la commission s'interroge sur l'éventuelle faiblesse de son taux de recours.
La commission renouvelle son souhait de rénover l'architecture globale des congés parentaux afin de créer des conditions de développement optimales pour les 1 000 premiers jours de l'enfant tout en favorisant le retour à l'emploi des parents.
Malgré ces éléments, la commission considère que la création du congé supplémentaire de naissance est une avancée pour les droits des parents ainsi que des enfants et soutient pleinement sa mise en oeuvre.
La commission rétablit le 1° du VI dans sa version antérieure à l'examen à l'Assemblée nationale. En effet, le rapporteur a pris note lors de l'audition du mercredi 4 novembre 2025 de l'impossibilité pour les caisses primaires d'assurance maladie de mettre en oeuvre le congé supplémentaire de naissance avant le 1er juillet 2027. De plus, la proposition d'obliger les parents à prendre au minimum un mois de façon non-simultanée leur congé supplémentaire de naissance se heurte à une impossibilité technique pour les caisses primaires d'assurance maladie car elles ne disposent pas des systèmes d'information afférents à la composition exacte du foyer.
La commission considère que le congé supplémentaire de naissance doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027, revenant ainsi sur la modification opérée par l'Assemblée nationale qui visait à le rendre effectif dès le 1er janvier 2026. Or, les services des caisses primaires d'assurance maladie ne sont absolument pas prêtes pour tenir un délai aussi réduit. Le rapporteur estime que la date du 1er janvier 2027 est un compromis acceptable.
Elle a adopté les amendements n° 711, 712, 713 et 714 à l'initiative de son rapporteur.
La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.
Article
43
Rationaliser et simplifier le cumul emploi-retraite
Cet article propose de réformer le dispositif de cumul emploi-retraite afin de le rendre moins attractif aux assurés n'ayant pas atteint l'âge de 67 ans.
Le cumul emploi-retraite serait désormais décomposé en trois étages, soit :
- un premier niveau pour les assurés n'ayant pas atteint l'âge légal d'ouverture des droits, dont la pension de retraite sera écrêtée à due concurrence des revenus ;
- un second niveau pour les assurés entre l'âge légal d'ouverture des droits et 67 ans, dont le cumul emploi-retraite sera plafonné et la pension sera écrêtée à hauteur de 50 % des revenus en cas de dépassement du plafond ;
- un troisième niveau de cumul emploi-retraite intégral créateur de nouveaux droits à pensions pour les assurés d'au moins 67 ans.
Le cumul emploi-retraite plafonné sera étendu aux non-salariés agricoles et il sera mis fin au système déclaratif, les contrôles étant opérés automatiquement par les caisses de retraite.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : la réforme du cumul emploi-retraite pour maintenir les assurés en activité jusqu'à l'âge légal d'ouverture des droits a minima
A. Le cumul emploi-retraite a fait l'objet de nombreuses modifications qui en avaient complexifié le dispositif et suscité des effets d'aubaine
1. Le dispositif de cumul emploi-retraite, initialement restreint, a été progressivement élargi au fil des réformes
a) Le cumul emploi- retraite a fait l'objet d'un premier encadrement dans les années 1980
Le dispositif de cumul emploi-retraite a été introduit par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pension de retraite et revenus d'activité, concomitamment à l'abaissement de l'âge légal de départ en retraite à 60 ans1190(*).
La réglementation du cumul emploi-retraite a toujours été construite comme un cadre dérogeant au principe cardinal conditionnant la liquidation d'une pension de retraite à la cessation définitive de l'activité de l'assuré1191(*).
La liste des activités cumulables avec une pension de retraite était strictement encadrée à l'article 3 bis de l'ordonnance du 30 mars 1982 précitée, et comprenait notamment les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, des consultations données occasionnellement, ainsi que la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives.
La limitation de l'activité exercée
au titre du cumul emploi-retraite
est conforme à la
Constitution
Le Conseil constitutionnel, saisi a priori de la loi ratifiant les deux ordonnances du 26 et du 30 mars 1982, a estimé que la limitation des activités autorisées au titre du cumul emploi-retraite était conforme à la Constitution, dans son principe, et dans son contenu1192(*). D'une part, il a estimé que le fait de poser des règles interdisant le cumul de pensions de retraite et de certaines activités était conforme à l'article 34 de la Constitution qui confère au domaine de la loi le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail. D'autre part, il a jugé que les dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance du 30 mars 1982, restreignant la nature des activités cumulables avec une pension de retraite, ne portaient pas atteinte au principe d'égalité dans la mesure où ces activités impliquaient « de la part de ceux qui les exercent des aptitudes créatrices particulières » ou n'avaient « qu'un caractère accessoire ou temporaires », ce qui justifiaient qu'elles bénéficient d'un traitement dérogatoire.
b) Le cumul emploi-retraite a fait l'objet de modifications successives entre les années 2000 et 2023, qui en ont complexifié la lisibilité
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a apporté des modifications substantielles au dispositif du cumul emploi-retraite, inspirées pour certaines d'un rapport du Conseil d'orientation des retraites de 20011193(*) et d'un rapport de l'Igas sur le cumul emploi-retraite de 20031194(*). Elle a ainsi introduit le principe de plafonnement des revenus perçus en situation de cumul emploi-retraite. Le dépassement du plafond entraîne la suspension du versement de la pension. Elle a également introduit un « délai de carence » de six mois suivant la liquidation de la pension de retraite, pendant lequel les salariés ne peuvent pas reprendre d'activité chez leur employeur. À défaut de respecter ce délai, le versement de la pension est également suspendu.
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a circonscrit les limitations précitées (plafonnement et délai de carence) aux seuls retraités qui ne sont pas accessibles au taux plein, soit parce qu'ils n'avaient pas validé la durée minimale d'assurance requise, soit parce qu'ils n'avaient pas atteint l'âge d'obtention automatique du taux plein1195(*). En revanche, pour les retraités ayant liquidé l'intégralité de leurs pensions de vieillesse au taux plein, le législateur a supprimé le mécanisme de plafonnement en leur offrant droit au cumul emploi-retraite intégral, sans limitation de revenus d'activité.
Depuis la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, le dépassement du plafond ne donne plus lieu à suspension du versement de la pension mais à un écrêtement de celle-ci : elle est réduite en tout ou partie du montant correspondant au dépassement du plafond.
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale autorise, depuis le 1er janvier 2023, les seuls assurés en situation de cumul emploi-retraite intégral1196(*) à bénéficier de nouveaux droits à pension au titre des cotisations versées depuis leur reprise d'activité. Le droit à bénéficier d'une nouvelle pension leur est ouvert à l'issue du « délai de carence » de six mois en cas de reprise d'une activité chez le même employeur.
En revanche, les assurés qui sont en situation de cumul emploi-retraite plafonné ne bénéficient pas de nouveaux droits à pension au titre des périodes cotisées pendant leur reprise d'activité après liquidation de leur pension.
Actuellement, sont soumis au cumul emploi-retraite plafonné :
- les assurés qui ont liquidé leur pension de retraite avant l'âge légal d'ouverture des droits sur le fondement de dispositifs de départ en retraite anticipée pour carrières longues. Ils peuvent bénéficier d'un cumul emploi-retraite plafonné jusqu'à l'âge légal d'ouverture des droits ;
- les assurés ne bénéficiant pas de la durée d'assurance requise pour avoir une retraite à taux plein. Ils peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite plafonné jusqu'à l'âge d'obtention automatique du taux plein.
Structure du cumul emploi-retraite
Source : Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2025
Les revenus des pensions de retraite de base et complémentaire, et de la nouvelle activité, ne peuvent être cumulés au-delà d'un plafond de :
- 160 % du Smic, soit 2 882,88 euros bruts mensuels en 2025 ;
- de la moyenne des derniers revenus d'activité, calculée sur les trois derniers mois précédant la cessation de l'activité1197(*).
Le cas échéant, le versement de la pension est suspendu.
2. Les dysfonctionnements du cumul emploi-retraite mis en lumière par la Cour des comptes
Dans son rapport annuel sur les lois de financement de la sécurité sociale pour 2025, la Cour des comptes s'est livrée à une analyse du profil des personnes en situation de cumul emploi-retraite, dont le nombre a augmenté de 75 % entre 2009 et 2020, alors que le nombre de retraités du régime général de moins de 75 ans a crû de seulement 23 % sur la même période.
Évolution du nombre et de la part des
retraités du régime général
en cumul
emploi-retraite entre 2009 et 2020
Source : Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2025
Ce rapport met en lumière certaines caractéristiques de la population des assurés recourant au cumul emploi-retraite qui contredisent dans les faits l'ambition affichée du législateur depuis plusieurs années, qui est de repousser l'âge moyen de départ en retraite pour contribuer à assurer le financement d'un système de retraite par répartition au ratio démographique défavorable.
Or il apparaît des travaux de la Cour des comptes que les retraités qui reprennent à ce titre une activité salarié liquident en moyenne leur pension à l'âge minimal de 62 ans, seulement 8,8 % des retraités en situation de cumul emploi-retraite ayant liquidé leur pension à l'âge de 67 ans, les médecins libéraux faisant toutefois figure d'exception1198(*).
Ces travaux renseignent en outre une forte disparité entre les niveaux de revenus en situation de cumul emploi-retraite selon le sexe, disparité qui reconduit les différences de carrières entre les hommes et les femmes.
Les deux catégories de retraités cumulant un salaire les plus aisées sont majoritairement des hommes : 27 % de ces retraités sont des cadres, et parmi eux, 73 % des hommes, qui cumulent le niveau de pension et de salaire les plus élevés. La seconde catégorie à bénéficier d'un salaire de cumul élevé concerne les personnes ayant liquidé leur pension avant l'âge de 62 ans, au titre de l'inaptitude (7,3 %) ou du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue (21,4 %)1199(*). Il s'agit à 79 % d'hommes.
Par ailleurs, le recours au dispositif de cumul emploi-retraite avait surtout pour objectif de permettre à des retraités bénéficiant de petites pensions de pouvoir compléter leurs revenus. Or, ceux-ci ne constituent qu'une minorité des personnes bénéficiant réellement de ce dispositif. Ils sont répartis entre deux catégories que sont les assurés issus de professions intermédiaires ayant liquidé leur pension, certes au taux plein, mais à un montant modeste, et bénéficiant d'un salaire de cumul limité, ainsi que de personnes ayant accompli des carrières fractionnées, qui bénéficient du taux plein à l'âge d'annulation de la décote (67 ans) et touchent également une pension et un salaire de cumul faibles. Ces publics sont en outre majoritairement féminins (respectivement 68 % de femmes issues de professions intermédiaires et 87 % de femmes ayant effectué des carrières fractionnées).
Il existe d'autres dispositifs que le cumul emploi-retraite pour maintenir les assurés en emploi, que sont la surcote et la retraite progressive.
• Les mécanismes de surcote et de décote
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit des mécanismes de décote et de surcote.
Tout trimestre cotisé au-delà de l'âge minimal d'ouverture des droits à la retraite et de la durée d'assurance requise pour avoir une pension à taux plein, ouvre droit à une surcote qui majore le montant de la pension de retraite de base de 1,25 % par trimestre, soit 5 % par année travaillée supplémentaire.
À l'inverse, tout trimestre d'assurance manquant pour atteindre la durée d'assurance requise minore la pension de retraite de base de 1,25 %, selon un mécanisme de décote.
Si la décote est limitée à 20 trimestres, la surcote n'est pas plafonnée.
• La retraite progressive
La retraite progressive est ouverte deux ans avant l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite aux assurés justifiant d'une durée d'assurance minimum de 150 trimestres. Ils peuvent réduire leur activité entre 40 et 80% d'un temps complet, tout en percevant une fraction de leur pension de retraite de base et complémentaire.
B. Le présent article opère une refonte structurelle du dispositif de cumul emploi-retraite afin de limiter son attractivité, tout en conservant une certaine souplesse en maintenant de nombreuses dispositions dérogatoires
1. Une refonte intégrale de l'architecture du dispositif de cumul emploi-retraite
Le présent article réforme le dispositif de cumul emploi-retraite selon les préconisations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 20251200(*).
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui structure les conditions du cumul emploi-retraite au sein des dispositions communes à tout ou partie des régimes de base, est entièrement réécrit par le 2° du III du présent article.
D'une part, il étend aux non-salariés agricoles ainsi qu'aux fonctionnaires civils et militaires le principe cardinal selon lequel la liquidation d'une pension de retraite est subordonnée, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette rupture se matérialise, pour les non-salariés agricoles, à la cessation d'activité dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, et pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres.
Des dispositions de coordination avec le code des pensions civiles et militaires et le code rural et de la pêche maritime complètent cet alignement, via des mécanismes de renvoi à l'article L. 161-22 précité.
D'autre part, l'article L. 161-22 précité précise désormais les conditions dans lesquelles le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance de base est suspendue, soit :
- lorsque l'assuré reprend une activité non salariée agricole hors cas dérogatoires exposés ci-après ;
- conformément au principe de subsidiarité, lorsque l'assuré poursuit ou reprend une activité sans avoir liquidé l'intégralité des pensions de vieillesse auxquelles il est éligible auprès des régimes de base, complémentaires, français et étrangers.
Le principe de subsidiarité est désormais étendu au cumul emploi-retraite plafonné, alors qu'il s'applique actuellement aux seuls assurés en situation de cumul emploi-retraite intégral.
Enfin, en son III, il détaille les nouvelles conditions du cumul emploi-retraite, qui déroge au principe cardinal précité conditionnant la liquidation d'une pension de retraite à la cessation d'activité.
La nouvelle architecture du dispositif de cumul emploi-retraite est définie en trois branches qui correspondent aux âges auxquels les assurés partent à la retraite.
• La première branche a pour objectif de désinciter les assurés à liquider leur pension avant l'âge légal d'ouverture des droits, et notamment les bénéficiaires du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue ou pour invalidité.
La pension des personnes qui partiraient en retraite avant l'âge légal d'ouverture des droits serait écrêtée à due concurrence des revenus. Si les revenus d'activité dépassent le montant de la pension, celle-ci sera écrêtée en intégralité et ne sera plus versée. En revanche, si les revenus perçus sont inférieurs au montant de la pension, le retraité percevra toujours un revenu total équivalent au montant de celle-ci.
• La seconde branche a pour objet de restreindre le recours au cumul emploi-retraite avant 67 ans, pour privilégier le recours au dispositif de retraite anticipée et la poursuite d'une surcote.
Les revenus des personnes qui partiraient en retraite entre l'âge d'ouverture des droits et 67 ans, âge d'obtention automatique du taux plein, seraient soumis à un plafond fixé par décret1201(*). Ce plafond serait étendu aux non-salariés agricoles. Le calcul du plafond intègrerait les revenus de remplacement qui sont définis au sixième alinéa du A du III de l'article L. 161-22 précité, à savoir les indemnités journalières1202(*), les indemnités complémentaires versées par l'employeur et les allocations d'assurance chômage. En cas de dépassement du plafond, les pensions seraient écrêtées à hauteur de 50 % des revenus. Pour les assurés percevant plusieurs pensions de retraite, les règles d'écrêtement seront déterminées par décret, et seront uniformisées entre les régimes de base et complémentaires, les retraites de base étant écrêtées en priorité. Comme l'a relevé la Cour des comptes lors de son audition par le rapporteur de la branche vieillesse, eu égard au montant du plafond annoncé de 7 000 euros, cet écrêtement risque peu de toucher les pensions de retraite complémentaires1203(*).
Le délai de carence de 6 mois entre la liquidation de la pension et la cessation d'activité, qui était selon la Cour des comptes incompris par la plupart des personnes recourant au CER, est supprimé.
• La troisième branche offre une possibilité de cumul intégral, créateur de nouveaux droits à pensions, aux seuls assurés accédant au cumul emploi-retraite après 67 ans, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens. Le plafond de pension de 5 % du plafond de la sécurité sociale est supprimé.
2. Le maintien de règles dérogatoires au cadre général du cumul emploi-retraite
a) Le détail des activités autorisées après la liquidation de sa pension sans avoir à recourir au cumul emploi-retraite figurera désormais dans le règlement et non plus dans la loi
Tout d'abord, la liste des activités pouvant être poursuivies après liquidation de sa pension sans recourir au dispositif de cumul emploi-retraite est profondément remaniée par rapport à celle figurant dans la version actuelle de l'article L. 161-22 précité, et sa définition détaillée est désormais renvoyée au pouvoir réglementaire, afin de pouvoir être régulièrement adaptée aux métiers en tension sans avoir à recourir à un vecteur législatif.
Elles sont définies en quatre larges catégories1204(*), qui recoupent partiellement la liste figurant actuellement dans la loi.
b) Les dérogations liées à l'activité exercée avant la liquidation de pension sont maintenues
Il en est ainsi des dérogations offertes aux titulaires d'une pension militaire et des marins qui reprendraient une activité auprès des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics ne présentant pas de caractère industriel ou commercial.
Les militaires non officiers ayant moins de 25 ans de service et les militaires ayant atteint la limite d'âge de service auraient ainsi toujours accès au cumul emploi-retraite intégral.
En revanche, les autres resteraient soumis à un cumul emploi-retraite plafonné, le plafond étant égal à la somme du tiers du montant brut de la pension et d'un montant correspondant à l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004. La pension sera réduite à due concurrence du dépassement de ce plafond.
Ces dérogations sont maintenues à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les dispositions sont réécrites aux termes du I du présent article. L'extension aux marins est opérée par un jeu de renvoi à l'article L. 86 précité, par l'article L. 5552-38 du code des transports (IV du présent article).
Enfin, des dérogations au bénéfice des policiers retraités reprenant une activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et aux activités de certains professionnels de santé exerçant des zones de désert médical sont également maintenues.
c) La reprise d'une activité non salariée agricole est autorisée sous certaines conditions
Des spécificités relatives aux salariés non agricoles sont également reprises au II du présent article. La reprise d'une activité agricole dans le cas du cumul emploi-retraite est restreinte :
- aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant une activité au moins égale à 1200 heures de travail par an ;
- aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole dont l'exploitation correspond à la surface minimale d'assujettissement via l'application des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol ;
- aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exploitant ou mettant en valeur une « parcelle de subsistance » qui ne doit pas dépasser deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;
- aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux.
Les différents statuts des non-salariés agricoles
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole1205(*), qui dirige et met en valeur une exploitation ou une entreprise dont l'importance atteint l'un des critères de l'activité minimale d'assujettissement, à savoir :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement, fixée par arrêté préfectoral pour chaque département et chaque type de culture ;
2° Dans le cas où la condition fixée au 1° ne peut être appréciée, le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité doit être au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Les cotisants exploitant un quart de la surface minimale d'assujettissement ou travaillant entre 150 et 1 200 heures par an ont le revenu professionnel est au moins égal à l'assiette forfaitaire applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, soit 800 Smic horaire.
L'aide familial est une personne âgée d'au moins 16 ans, ascendant, descendant, frère, soeur ou allié du même degré du chef d'exploitation agricole, ou de son conjoint, qui vit sur l'exploitation et participe à sa mise en valeur sans être salarié.
Le conjoint collaborateur : ce statut a été créé en 1999 afin de permettre aux personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant une activité non rémunérée sur l'exploitation et l'entreprise, de bénéficier d'une protection sociale au même titre que les aides familiaux, en contrepartie de cotisations sociales relativement faibles. Depuis le 1er janvier 2022, ce statut est limité à 5 ans, durée au terme de laquelle le conjoint devrait opter entre le statut de co-exploitant ou de salarié.
L'associé d'exploitation s'entend d'une personne non salariée, âgée de 18 ans révolus et de moins de 35 ans, descendant, frère, soeur ou allié du même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, qui a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation1206(*). Les personnes bénéficiant de ce statut depuis le 18 mai 2005 sont également soumises à une durée maximale de 5 ans, au terme de laquelle ils doivent opter pour le statut de co-exploitant ou de salarié.
d) Des dérogations au principe de subsidiarité demeurent
Le II de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale tel que réécrit par le présent article précise deux dérogations au principe de subsidiarité :
- l'assuré d'un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits est supérieur à l'âge légal d'ouverture des droits1207(*) peut liquider ses pensions de retraite en deux temps distincts. Il est toutefois tenu de liquider sa dernière pension lorsqu'il atteint l'âge d'ouverture des droits spécifique à ce régime ;
- les assurés relevant du régime des marins, les artistes du ballet relevant de la caisse des retraites de l'Opéra de Paris, et les anciens agents relevant du régime des mines bénéficient d'une dérogation au principe de subsidiarité. Les militaires et les fonctionnaires bénéficiaires d'une pension d'invalidité ont accès au cumul emploi-retraite intégral dès la liquidation de la pension de leur régime spécial.
e) La possibilité pour le Gouvernement de déroger aux conditions du cumul emploi-retraite plafonné de manière exceptionnelle est conservée
Lors de la crise sanitaire de la covid-19, les lois n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique avaient permis au personnel soignant retraité de reprendre une activité dans un cadre dérogatoire à celui du cumul emploi-retraite.
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 réformant les retraites a pérennisé ces dispositions à l'article L. 161-22-1-4 du code de la santé publique, en inscrivant la possibilité pour le Gouvernement de suspendre par décret, pour une durée d'un an renouvelable pendant six mois, les plafonds et seuils du cumul emploi-retraite plafonné. Ces dispositions restent inchangées dans leur principe, les modifications apportées par le présent article se limitant à de la coordination avec le nouveau dispositif figurant au III de l'article L. 161-22-1 auquel elles dérogent.
La réforme du dispositif de cumul emploi-retraite bénéficie d'une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027.
Les V et VII du présent article prévoient les modifications nécessaires à son adaptation aux territoires de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
3. Il est mis fin au système déclaratif des revenus et de la reprise d'activité, au profit de contrôles automatiques réalisés par les caisses
La réécriture de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale opérée par le présent article a supprimé l'obligation pour les assurés de déclarer leurs revenus d'activité et leur reprise à la caisse qui leur verse leur pension de retraite. Cette obligation demeure toutefois pour certains profils d'assurés soumis à des règles dérogatoires tels que les militaires non officiers1208(*).
Actuellement, les retraités qui recourent au cumul emploi-retraite sont tenus de le déclarer par écrit dans le mois suivant leur reprise d'activité, et la caisse les renseigne sur leur assujettissement éventuel au cumul emploi-retraite plafonné, ou leur accès au cumul emploi-retraite intégral.
Le passage d'un système déclaratif à un système automatique était demandé par la Cour des comptes, qui relevait que la Cnav n'avait pas intégré le respect des conditions du cumul plafonné dans ses contrôles périodiques.
Comme l'a rappelé Renaud Villard, directeur de la Cnav, lors de son audition par la commission des affaires sociales le 30 octobre dernier, le système déclaratif est source de non-conformités qui relèvent de l'erreur de bonne foi de la part d'assurés qui méconnaissent leurs droits. Ces erreurs appellent des rattrapages de pension plusieurs années plus tard.
Désormais, les caisses effectueront des contrôles automatiques via le dispositif de ressources mensuelles (DRM) qui agrège la base des déclarations sociales nominatives (DSN), alimentée par les déclarations mensuelles de salaires effectuées par les employeurs de salariés du secteur privé, et la base des autres revenus (Pasrau), alimentée par les données de prestations sociales monétaires (retraites, allocations chômage, indemnités journalières, pensions d'invalidité). Comme l'a déclaré Renaud Villard, « avec le dispositif de ressources mensuelles, nous recevons deux mois après l'ensemble des salaires et prestations sociales ».
4. L'impact budgétaire de cette mesure demeure difficile à évaluer
La mesure portée au présent article génèrerait de moindres dépenses de pensions, compte-tenu du fait que les assurés seraient dissuadés de liquider leur retraite avant l'âge de 67 ans d'une part, et du fait que ceux qui les liquideraient avant cette borne d'âge tout en recourant au cumul emploi-retraite verraient leur pension écrêtée selon les modalités précisées ci-avant.
Selon l'étude d'impact figurant en annexe 9 du PLFSS pour 2026, elle permettrait d'économiser 0,4 milliard d'euros en 2027 et 1,9 milliard d'euros en 2030 pour les régimes de retraite de base et complémentaire.
Le maintien en emploi des personnes qui seraient désincitées à recourir au cumul emploi-retraite rapporterait des recettes aux branches famille, maladie et accident du travail - maladie professionnelles via les cotisations acquittées, comme détaillé ci-après.
Impact financier de la mesure portée à l'article 43
Source : Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
S'agissant des économies induites par la restriction de l'ouverture des droits à seconde pension aux seuls assurés de plus de 67 ans, elles sont particulièrement difficiles à évaluer dans la mesure où ces nouveaux droits à pensions ont été créés depuis le 1er janvier 2023 par la loi du 14 avril 2023 réformant les retraites et n'a pas encore donné lieu à de nouvelles liquidations.
Selon les réponses écrites apportées au rapporteur de la branche vieillesse, dans le cas où le cumul serait moins encouragé entre 64 et 67 ans, la Cour des comptes a estimé à 208 millions d'euros l'économie annuelle de seconde pension liée à la réduction du nombre de cumulants pour le régime général et au moins autant pour les régimes complémentaires.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission rappelle son attachement au système de retraite par répartition, et se félicite à ce titre de la mise en oeuvre de la réforme du cumul emploi-retraite selon les préconisations formulées par la Cour des comptes.
Le dispositif de cumul emploi-retraite français faisait figure d'exception en Europe dans la mesure où il était le seul qui permettait un cumul intégral créateur de droits à pension dès l'âge légal d'ouverture des droits. Comme l'a démontré la Cour des comptes, il était financièrement plus avantageux pour des cadres à haut revenus de liquider leur retraite et de recourir au cumul emploi-retraite que de rester en activité pour atteindre la surcote.
Par ailleurs, le fait que 21 % des personnes recourant au cumul emploi-retraite le fassent après avoir pris leur retraite via le dispositif de carrières longues interroge le rapporteur de la branche vieillesse dans la mesure où ce dispositif est fait pour permettre aux assurés victimes d'usure professionnelle de s'arrêter avant l'âge légal d'ouverture des droits, afin de ménager leur espérance de vie. Ce nouveau dispositif a pour objectif, que la commission partage, d'inciter les personnes désireuses de travailler à rester en activité jusqu'à l'obtention de la surcote.
En conséquence, la commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 44
(supprimé)
Stabiliser le montant des prestations sociales, dont les
pensions
Cet article propose en premier lieu de « geler » les prestations sociales et pensions de retraite au titre de l'année 2026 (qui ne seraient donc pas revalorisées sur l'inflation), pour un rendement attendu de 3,6 milliards d'euros (dont 2,5 milliards d'euros pour la sécurité sociale).
Il propose en second lieu de minorer le coefficient de revalorisation sur l'inflation des seules pensions de retraite des régimes obligatoires de base de 0,9 point pour les années 2027 à 2030, pour une économie estimée à 6,5 milliards d'euros en 2027, 7,7 milliards d'euros en 2028 et 8,9 milliards d'euros en 2029.
La minoration applicable en 2027, de 0,4 point dans le texte déposé le 14 octobre 2025, a en effet été portée à 0,9 point par la lettre rectificative du 23 octobre 2025. Cette hausse de 0,5 point doit susciter une économie de 1,5 milliard d'euros, destinée à financer le décalage de la montée en puissance de la réforme des retraites de 2023 par l'article 45 bis du PLFSS.
La commission propose de rétablir cet article modifié par son amendement n° 715.
I - Le dispositif proposé
A. Depuis 2016, les conditions de revalorisation des prestations sociales versées par l'État et de certaines prestations versées par les organismes de sécurité sociale, dont les pensions de retraite, sont unifiées
Le montant et le plafond de ressource ouvrant droit aux minima sociaux sont revalorisés annuellement sur l'inflation afin de maintenir le pouvoir d'achat relatif des prestations sociales.
Les lois financières pour 20161209(*) ont aligné la revalorisation des prestations financées par l'État et les collectivités territoriales, d'une part, et les prestations relevant du champ de la loi de financement de la sécurité sociale, d'autre part, afin de simplifier et améliorer la lisibilité des règles de revalorisation.
Les prestations et minima dont la revalorisation a
été unifiée
par la loi de finances pour
2016
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social catégoriel attribué aux personnes reconnues handicapées selon des critères d'incapacité, d'âge et de ressources. L'AAH est subsidiaire par rapport à d'autres prestations, telles que les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail ou les avantages vieillesse. Elle est soumise à une condition de ressources. Depuis le 1er avril 2025, son montant maximum est de 1 033, 32 euros par mois.
Le revenu de solidarité active (RSA) est un minimum social destiné aux personnes disposant de faibles ressources âgées de plus de vingt-cinq ans, et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans qui sont parents isolés ou justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle. Il constitue une allocation différentielle, qui vise à garantir un niveau minimum de ressources, variable en fonction de la composition et des revenus du foyer ; depuis le 1er avril 2025, son montant est de 646,52 euros pour une personne seule, 969,78 euros pour un couple et 1 163,74 euros pour un couple avec deux enfants. Le financement du RSA est assuré par les départements.
La prime d'activité est une prestation ouverte, sous conditions de ressources, aux actifs salariés de plus de 18 ans, afin de soutenir leur pouvoir d'achat et favoriser leur retour en emploi. Elle est composée d'une part de montant forfaitaire et d'une part de bonus destinée à favoriser l'activité professionnelle.
L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est versée aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits au régime d'assurance chômage et dont les ressources mensuelles sont inférieures à 1353,10 euros pour une personne seule et à 2126,30 euros pour un couple.
L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vise à compléter les ressources d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'un avantage vieillesse (pensions de réversion, de veuvage, de retraite anticipée pour carrière longue...), qui prend fin dès que la personne atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite, auquel cas elle peut bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Son montant est égal à la différence entre le revenu perçu et un plafond de 1530,60 euros pour un couple.
L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants (ARFS), devenue aide à la vie familiale et sociale, est une allocation mensuelle accordée aux retraités de nationalité étrangère qui souhaitent vivre temporairement dans leur pays d'origine et ont de faibles ressources.
L'allocation temporaire d'attente (ATA) est une allocation chômage temporaire de solidarité versée aux demandeurs d'asile et à certains détenus et ressortissants étrangers.
Les prestations de sécurité sociale
dont la revalorisation a été unifiée
par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2016
Les prestations familiales et assimilées
Les rentes d'accident du travail et de maladies professionnelles qui sont versées pour indemniser les victimes d'AT-MP dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %.
La pension d'invalidité qui compense la perte de revenus résultant de la réduction de la capacité de travail. Son montant est fonction du revenu annuel moyen calculé selon les dix meilleures années, ainsi que de la catégorie d'invalidité attribuée par le médecin conseil.
Les pensions de retraite
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation de solidarité vieillesse, qui composent le minimum vieillesse. L'Aspa est accordée mensuellement aux retraités vivant en France et disposant de faibles revenus. Son montant résulte de la différence entre les revenus perçus et le plafond de 1034,28 euros pour une personne seule et 1 605,73 euros pour un couple.
Les plafonds de ressources pour la couverture maladie universelle (CMU-C), l'aide médicale d'État (AME) et l'assurance complémentaire santé (ACS). Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C et l'ACS ont été remplacées par la complémentaire santé solidaire (CSS).
Source : Commission des affaires sociales, d'après les rapports des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la loi de finances pour 2016
La revalorisation de ces prestations est effectuée sur la seule inflation constatée par l'Insee. Désormais, les prestations sont revalorisées sur la base de l'inflation moyenne des douze derniers mois, constatée l'avant-dernier mois précédant le mois de la revalorisation.
Depuis 2016, le législateur a également mis en place un « bouclier » afin de prévenir l'évolution à la baisse des prestations en cas d'inflation négative. Dans l'hypothèse d'une baisse des prix, le coefficient de revalorisation égal à l'inflation est porté à un. Les montants sont maintenus à leur niveau antérieur, ce qui signifie qu'ils augmentent en termes réels.
B. Depuis 2018, les pensions de retraites sont revalorisées sur l'inflation au 1er janvier de chaque année
1. Le principe d'indexation des pensions sur l'inflation est inscrit dans la loi depuis 2003
Afin de maintenir le niveau de vie des retraités, les pensions de retraite sont revalorisées annuellement sur l'inflation hors tabac.
Pratiquée depuis 1987, l'indexation sur l'inflation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés a été consacrée en son principe à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Cette même loi a également étendu le principe de l'indexation sur l'inflation aux pensions de retraite des fonctionnaires1210(*). Avant cette date, l'indexation des pensions des fonctionnaires retraités était fonction des revalorisations de traitement des fonctionnaires en activité.
Jusqu'en 2015, le coefficient de revalorisation prenait en compte l'inflation prévisionnelle de l'année en cours, établie par la Commission économique des comptes de la Nation. En cas d'écart avec l'inflation finalement constatée, il était rectifié par arrêté.
Les pensions de retraite sont désormais revalorisées chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation, selon un coefficient défini à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Concrètement, pour une revalorisation qui interviendrait au 1er janvier 2026, le coefficient de revalorisation correspondrait au taux de variation entre la valeur moyenne des indices des prix à la consommation hors tabac de novembre 2024 à octobre 2025 et de novembre 2023 à octobre 2024.
Ce coefficient s'applique aux différents régimes de retraite, ainsi qu'aux salaires portés au compte et à certaines prestations de sécurité sociale telles que les pensions d'invalidité, les rentes AT-MP et l'allocation de solidarité aux personnes âgées1211(*).
2. La date de revalorisation annuelle des pensions de retraite a fait l'objet de plusieurs modifications successives
Depuis 20191212(*), la revalorisation du montant des retraites et des prestations non contributives intervient au 1er janvier de chaque année, tandis que d'autres prestations sont, elles, revalorisées le 1er avril selon le même principe.
Les prestations revalorisées le 1er janvier
Les prestations de la branche vieillesse : les pensions de base, la retraite complémentaire du BTP, la retraite complémentaire des contractuels de la fonction publique, l'allocation de solidarité, la pension majorée de référence des exploitants agricoles et le seuil d'écrêtement, la retraite complémentaire des travailleurs indépendants, les pensions de retraite additionnelle des enseignants du privé, les prestations de vieillesse et de réversion, l'allocation de veuvage, le minimum contributif non majoré et majoré ; le minimum des pensions de réversion, la majoration forfaitaire pour enfant à charge, la rente forfaitaire des retraites ouvrières et paysannes , les prestations non contributives que sont l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), ainsi que les anciennes prestations constituant le minimum vieillesse.
Les prestations revalorisées le 1er avril
• Les prestations familiales : revalorisation des bases mensuelles sur lesquelles sont calculées les prestations de la branche famille ;
• Les prestations d'invalidité et les rentes AT-MP des régimes de sécurité sociale : les pensions d'invalidité, l'indemnité en capital AT-MP, les rentes AT-MP et le salaire minimum de rentes AT-MP, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, la majoration pour tierce personne AT-MP, l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
• Les plafonds de ressources pour la complémentaire santé : couverture maladie complémentaire (CMU-c) et aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) ;
• Les prestations hors champs de la sécurité sociale mais relevant du champ de l'article L. 161-25 : le revenu de solidarité active, l'allocation pour demandeur d'asile, l'allocation temporaire d'attente, l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants, la prestation transitoire de solidarité, l'allocation aux adultes handicapés ;
• Les prestations hors champ de la sécurité sociale et de l'article L. 161-25 : la prime d'activité, les allocations pour le logement et l'aide médicale d'État.
La date de revalorisation des pensions de retraite a changé plusieurs fois au cours des dernières décennies, et n'a pas toujours été alignée sur celle des prestations non contributives.
Entre 2009 et 2013, les pensions ont été revalorisées au 1er avril de chaque année. Cette date a ensuite été décalée au 1er octobre en 2014, et figure désormais au 1er janvier depuis 2018.
Les dates de revalorisation des pensions de retraite et des prestations de solidarité vieillesse n'ont pas toujours concordé. Les secondes étaient revalorisées au 1er avril de chaque année jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fixé leur revalorisation au 1er janvier. Cette harmonisation a également permis une anticipation de la revalorisation exceptionnelle du montant maximum de l'Aspa.
Portée par le décret n° 2018-227 du 30 mars 2018, cette revalorisation a consisté en une hausse mensuelle cumulée de 100 euros accordée entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020 pour une personne seule, et de 155,25 euros pour un couple. Au 1er janvier 2025, l'Aspa s'élève à 1 034,28 euros par mois pour une personne seule et à 1 605,73 euros par mois pour un couple.
3. Plusieurs dérogations à la règle de revalorisation des pensions sur l'inflation sont intervenues ces dernières années
En 2018, les pensions n'ont pas été revalorisées sur l'inflation.
Entre 2019 et 2020, les lois de financement de la sécurité sociale ont dérogé à la règle de revalorisation des pensions de base décrite précédemment.
Ainsi, en 2019, toutes les pensions de retraite, à l'exception de certains minima sociaux, dont le minimum vieillesse, ont été revalorisées à un niveau inférieur à l'inflation pour toutes les pensions, soit 0,3 %. Et, en 2020, seules les pensions de retraite inférieures à 2 000 euros bruts par mois ont été revalorisées sur l'inflation des douze derniers mois, qui était de 1,0 %. De façon dérogatoire à la règle, les pensions supérieures à ce seuil ont été revalorisées à un niveau de 0,3 %, inférieur à l'inflation.
La mesure portée à l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 tel que déposé à l'Assemblée nationale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoyait, dans sa version déposée devant l'Assemblée nationale, de décaler de manière pérenne la date de revalorisation annuelle des pensions sur l'inflation au 1er juillet, à l'exception des prestations de solidarité relevant du minimum vieillesse (Aspa et allocation de solidarité vieillesse), pour un rendement global estimé à 3,9 milliards d'euros.
La commission des affaires sociales du Sénat avait modifié cet article en première lecture afin de maintenir le principe de la revalorisation au 1er janvier à un montant équivalent à la moitié de l'inflation et de revaloriser les pensions inférieures au Smic sur l'intégralité de l'inflation au 1er juillet, le manque à gagner étant compensé par un versement unique.
Le rejet du texte par le vote par l'Assemblée nationale le 4 décembre 2024 d'une motion de censure après utilisation de l'article 49-3 a entraîné la revalorisation automatique des pensions sur l'inflation à droit constant au 1er janvier 2025, soit 2,2 %.
C. Le présent article prévoit de geler la revalorisation des prestations sociales et pensions de retraite des régime obligatoires de base au titre de l'année 2026, et de minorer le coefficient de revalorisation des secondes au titre des années 2027 à 2030
1. Au-delà des deux mesures phares précitées, l'article 44 contient des dispositions parcellaires qui décalent dans le temps la revalorisation de certains plafonds et prestations
Le présent article prévoit de ne pas revaloriser les prestations sociales concernée par l'application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026, et de ne pas revaloriser au 1er janvier 2026 sur l'inflation les plafonds de ressource des prestations familiales sous conditions de ressources.
Les V et VI du présent article disposent ainsi que les montants des prestations et indemnisations, rémunérations hors salaires et plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ne sont pas revalorisés au titre de l'année 2026.
Sont exclus du V :
- le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé dite complémentaire santé solidaire dite C2S ;
- les rentes versées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) pour indemniser un dommage causé par un professionnel de santé ou un établissement de santé1213(*) ;
- les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base.
La rente versée par l'Oniam pour indemniser un dommage exclusif de la responsabilité d'un professionnel de santé est bien revalorisée au titre de l'année 2026, mais cette revalorisation est décalée de façon pérenne au 1er avril comme il sera développé ci-après.
Le IV prévoit toutefois que les pensions de retraites servies par les régimes obligatoires de base ne seront pas revalorisées au titre de l'année 2026 (1° du IV), et seront revalorisées sur le coefficient prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale minoré de 0,9 point pour l'année 2027 et de 0,4 point pour les années 2028 à 2030.
Le texte déposé le 14 octobre 2025 prévoyait une seule sous-indexation de 0,4 point par an des pensions de retraite sur l'inflation au titre des années 2027 à 2030. La version issue de la lettre rectificative du 23 octobre 2025 inclut une sous-indexation supplémentaire des pensions de retraite de base de 0,5 point en 2027 afin de financer le décalage de la réforme des retraites portée à l'article 45 bis.
Pour plus de détails sur le financement de l'article 45 bis, il sera renvoyé au II du tome I du présent rapport.
Détail des régimes concernés
par le gel de la revalorisation des pensions et prestations d'assurance
vieillesse et la sous-indexation
au titre des années 2027 à
2030
La mesure s'applique aux régimes délimités par le cadre jaune.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après la Cour des comptes
Le VI étend le gel de la revalorisation annuelle à l'allocation journalière du proche aidant1214(*) et à l'allocation journalière de présence parentale1215(*), qui sont revalorisées sur le salaire minimum de croissance (Smic).
Les VII et VI excluent de la revalorisation au titre de l'année 2026 les plafonds de ressources déterminant le droit au versement des allocations familiales1216(*), au complément familial1217(*) et à sa majoration1218(*), de la prime à la naissance et à l'adoption1219(*), de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant1220(*), de l'allocation de rentrée scolaire1221(*), de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant1222(*), du complément familial1223(*) ainsi qu'à sa majoration1224(*) et au complément de libre choix du mode de garde1225(*).
Les prestations gelées au titre de l'année 2026
• Les pensions de retraite de droit propre et dérivé ;
• Les pensions d'invalidité et capital-décès ;
• Les prestations familiales ;
• Les prestations d'autonomie ;
• Les prestations de solidarité ;
• L'aide universelle d'urgence pour les victimes de violence conjugale ;
• Les rentes et indemnités en capital servies aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que le montant du salaire minimal servant au calcul de ces rentes et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ;
• L'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Acaata) ;
• L'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie (Ajap) ;
• La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
• La rémunération des personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel ;
• L'allocation forfaitaire versée aux jeunes en contrat d'engagement jeune ;
• L'allocation versée aux jeunes volontaires de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi.
Les plafonds de ressources des prestations
familiales gelés
au titre de l'année 2026
• Les allocations familiales ;
• Le complément familial et le complément familial majoré ;
• L'allocation de base de la PAJE, la prime à la naissance ou à l'adoption, le complément mode de garde « structure » ;
• L'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
• L'allocation forfaitaire en cas de décès.
Source : Étude d'impact du présent article (annexe 9 du PLFSS pour 2026)
Par ailleurs, le présent article modifie de manière pérenne la date de revalorisation annuelle de certaines rentes et prestations :
- les rentes versées par l'Oniam au titre de l'indemnisation de préjudices causés par un dommage survenu dans un établissement de santé, qu'il soit de nature à engager la responsabilité d'une personne physique ou morale, ou qu'il s'agisse d'une responsabilité délictuelle sans faute. Les articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique sont modifiés1226(*) afin de prévoir que ces rentes soient revalorisées au 1er avril, et non plus au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (I) ;
- l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. L'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, qui en prévoit les conditions de versement, est modifié afin que son montant soit revalorisé au 1er avril de chaque année sur le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 (II 1°) ;
- le montant du plafond de ressources ouvrant droit au versement de la prime à la naissance et de la prime à l'adoption, de l'allocation de base visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant, l'allocation de rentrée scolaire, ainsi qu'à leur majoration, est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac (II 2°, 3° et 4°).
Le III du présent article modifie l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 afin de prévoir que l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et travailleurs de l'amiante (Acaata) soit revalorisée au 1er janvier de chaque année et en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et non plus sur l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sur laquelle elle était indexée et qui a disparu depuis 2012.
Les dispositions du I, II et III précitées bénéficient d'une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026.
Enfin, le IX du présent article coordonne l'application de ses dispositions à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte1227(*) ainsi que les plafonds de ressources mentionnés aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales n'étant toutefois pas revalorisé au titre de l'année 2026.
2. Un rendement pour l'ensemble des administrations publiques de 3,6 milliards d'euros en 2026 et 8,9 milliards d'euros en 2029
Selon l'étude d'impact du présent article, le gel de la revalorisation des pensions de retraite des régimes de base et des prestations sur l'inflation annuelle améliorerait le solde 2026 de la sécurité sociale (régimes obligatoires de base) de 2,5 milliards d'euros et celui de l'État de 1,1 milliard d'euros.
Avec un rendement global de 3,6 milliards d'euros, cette mesure est la plus importante du présent PLFSS en termes financiers.
Ventilation selon les prestations des économies générées par le présent article
(en milliards d'euros)
Source : Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Ce rendement serait ventilé comme suit : 2,5 milliards d'euros seraient économisés sur les prestations des régimes obligatoires de base, nets de l'« effet retour » du gel des prestations sur la CSG sur les revenus de remplacement (pour un montant de 2,7 milliards d'euros hors cet « effet retour »). Selon l'annexe 9 du présent PLFSS, pour l'année 2026, la non-revalorisation des pensions de vieillesse et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rapporterait 2,2 milliards d'euros, des prestations familiales 0,3 milliard d'euros1228(*), des prestations autonomie dans le champ de la sécurité sociale moins de 0,1 milliard d'euros1229(*), des prestations maladie 0,1 milliard d'euros, des rentes AT-MP 0,1 milliard d'euros.
Le gain pour l'État, de 1,1 milliard d'euros, proviendrait principalement du fait que la réduction du montant des pensions aurait pour effet de réduire les subventions d'équilibre versées par l'État aux régimes spéciaux fermés et aux régimes dits « équilibrés », ainsi que les dépenses de pension des fonctionnaires d'État. L'étude d'impact chiffre également une moindre dépense de 0,2 milliard d'euros au titre des prestations de solidarité qui relèvent du champ de l'État, dont 150 millions d'euros au titre de la non-revalorisation de l'AAH.
S'agissant de l'impact financier de la mesure toutes administrations publiques confondues pour les années 2027 à 2030, l'annexe 9 correspondant au texte déposé le 14 octobre 2025, qui prenait en compte la seule hypothèse d'une sous-indexation de 0,4 point des pensions de retraite sur l'inflation, estimait que la mesure rapporterait 5,1 milliards d'euros en 2027, 6,3 milliards d'euros en 2028 et 7,5 milliards d'euros en 2029.
La version issue de la lettre rectificative du 23 octobre 2025, qui comme indiqué supra inclut une sous-indexation supplémentaire des pensions de retraite de base de 0,5 point en 2027 afin de financer le décalage de la réforme des retraites porté à l'article 45 bis, porte ce rendement à 6,5 milliards d'euros en 2027, 7,7 milliards d'euros en 2028 et 8,9 milliards d'euros en 2029.
Estimation de l'impact financier global du présent article
(en milliards d'euros)
Source : Annexe 9 du PLFSS pour 2026
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a supprimé cet article.
III - La position de la commission
La commission a constamment défendu le pouvoir d'achat des retraités et s'est d'ailleurs opposée aux différentes mesures de non-indexation ou de sous-indexation des revalorisations de pensions intervenues depuis la fin des années 2010 et rappelées dans le présent commentaire. Elle a, à l'inverse, pleinement soutenu la revalorisation anticipée des pensions au moment du pic d'inflation de 2022, lors de l'examen de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
C'est ce même souci de préserver à long terme le niveau des pensions tout en assurant la soutenabilité financière du système de retraites qui l'avait conduite, de longue date, à soutenir une augmentation progressive de l'âge de départ à la retraite avant que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 porte une telle mesure.
Toutefois, la commission considère que la dégradation brutale et imprévue des finances publiques, notamment de la sécurité sociale et de sa branche vieillesse, impose incontestablement un effort ponctuel de la part de tous - actifs, employeurs et retraités.
Soucieuse de rétablir l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale, la commission ne se satisfait pas de la suppression de l'article 44 par l'Assemblée nationale. Cet article représentait la première mesure d'économie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, avec un rendement estimé à 3,6 milliards d'euros en 2026 pour l'ensemble des administrations publiques.
La dérogation à la règle d'indexation des pensions de retraite de base sur l'inflation s'impose comme une mesure d'équité sociale depuis que dernières ont été revalorisées à hauteur de 5,3 % au 1er janvier 2024, pour un coût de 15 milliards d'euros.
C'est pourquoi la commission a adopté un amendement n° 715 réintroduisant l'article 44 et dérogeant au principe de revalorisation annuelle des pensions de retraite et des prestations sociales au titre de l'année 2026.
Toutefois, la commission a toujours eu à coeur de préserver le pouvoir d'achat des citoyens les plus fragiles.
Cela justifie que les pensions de retraite inférieures à 1400 euros d'une part1230(*), et l'allocation adulte handicapé, d'autre part, soient revalorisés au 1er janvier 2026 sur l'inflation de l'année passée.
L'article 44 ainsi réintroduit aurait un rendement de 1,9 milliard d'euros en 2026.
La commission n'a toutefois pas repris la mesure de sous-indexation des pensions de retraite sur l'inflation au titre des années 2027 à 2030, qui figurait à l'article 44 avant sa suppression par l'Assemblée nationale, de crainte qu'elle ne déroge au principe constitutionnel d'annualité des lois financières.
La commission propose de rétablir cet article dans sa rédaction ainsi modifiée par l'amendement qu'elle a adopté.
Article
45
Réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes à la retraite
Cet article propose de comptabiliser les trimestres de bonification et de majoration de durée d'assurance attribués au titre de la maternité et de l'éducation des enfants comme des trimestres réputés cotisés au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
Il annonce également une mesure réglementaire visant à réduire le nombre de meilleures années de carrières des mères pris en compte pour calculer la pension de retraite de base des assurés du régime général, des régimes alignés, et du régime agricole.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Les pensions de retraite perçues par les femmes restent inférieures à celles perçues par les hommes
En 2021, le montant de la pension de droit direct1231(*) perçu par les femmes restait inférieur de 37 % à celui perçu par les hommes, et ce malgré la prise en compte de la majoration pour trois enfants ou plus1232(*).
Selon les chiffres transmis par M. Jean-Jacques Marette1233(*) à la rapporteure générale et au rapporteur de la branche vieillesse, en 2025 les pensions de droit direct des femmes représentent 62 % de celles des hommes et l'écart est de 74 % après prise en compte des pensions de réversion.
Si cet écart a tendance à se réduire progressivement (il était de 40 % en 2020 et de 54 % pour la génération née en 19301234(*)) en raison de l'insertion croissante des femmes sur le marché du travail, de leur augmentation de niveau de diplôme et de rémunération, les carrières des femmes pâtissent plus que celles des hommes des conséquences de l'éducation des enfants, creusant de fait les inégalités entre les sexes.
1. Cet écart résulte des différences de carrière entre les femmes et les hommes
Le niveau moyen des pensions de retraite de droit direct connaît une tendance à l'augmentation depuis le début des années 2000, ce qui s'explique par l'effet dit « de noria ». En effet, les retraités disposent, pour le calcul de leur pension, d'évolutions de carrière plus favorables et d'un niveau de rémunération croissant par rapport aux générations précédentes.
Évolution de la pension moyenne versée par les régimes de base
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale « Retraites » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024
Cette dynamique est plus favorable aux femmes qu'aux hommes : entre 2004 et 2021, la pension de droit direct des femmes a augmenté de 20 %, contre 4,7 % pour celle des hommes. Cette différence d'augmentation s'explique avant tout par le fait que les pensions de retraite des femmes sont plus faibles que celles des hommes ; aussi, la plus forte hausse qu'elles connaissent ne doit toutefois pas occulter une persistance des écarts de pensions entre les sexes.
Le système de retraite par répartition est un système de nature contributive. Le niveau des pensions de retraite du régime général et des régimes de base dépend du revenu d'activité d'une part, et de la durée d'assurance validée d'autre part.
Outre les différences de rémunérations1235(*), la persistance d'un écart de pension entre les femmes et les hommes s'explique également par l'impact de l'éducation des enfants sur la carrière, qui pèse principalement sur les femmes.
L'étude du taux d'activité de la tranche d'âge entre 25 et 49 ans, qui correspond à la période d'éducation des enfants, révèle ainsi de grandes disparités. En 2021, il était supérieur à 90 % pour les pères en activité, et ce indépendamment du nombre d'enfant au foyer. À l'inverse, on constate une corrélation certaine entre le nombre d'enfants et l'activité des mères : 88,2 % des femmes sans enfants appartenant à cette tranche d'âge étaient en activité en 2021, contre 83,7 % des mères avec un enfant, et seulement 50,5 % des mères avec trois enfants ou plus. Les femmes sont également plus sujettes au temps partiel que les hommes : en 2021, parmi les femmes en emploi salarié, 39,7 % des mères recouraient au temps partiel1236(*).
2. Les femmes retraitées sont les principales bénéficiaires des dispositifs visant à assurer un revenu minimum, ce qui atteste de leur paupérisation
Au-delà du constat des écarts de pension de droit direct, les femmes sont sur-représentées parmi les retraités bénéficiaires des mécanismes visant à assurer un revenu minimum que sont le minimum de pension et le minimum vieillesse.
Le minimum de pension, mis en place au sein des régimes de base, est ouvert aux assurés ayant liquidé l'ensemble de leurs pensions et accessibles au taux plein dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée d'assurance requise et d'âge légal d'ouverture des droits. Il permet d'élever le niveau de la pension de retraite jusqu'à un seuil d'écrêtement. Les femmes représentent 73 % de ses bénéficiaires au sein du régime général.
Le minimum vieillesse, dont le versement est indépendant de la durée d'assurance, et qui permet d'assurer une pension minimale de 1 034,28 euros par mois à une personne seule ainsi qu'à une personne en couple, et de 1 605,73 euros pour les deux membres d'un couple1237(*), compte 56 % de femmes parmi ses bénéficiaires. Parmi les 76 % d'allocataires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui sont des personnes isolées, deux tiers sont des femmes1238(*). Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), en 2022, 30 % des femmes seules non veuves étaient bénéficiaires de l'Aspa1239(*).
B. Ces inégalités peuvent être compensées par des mécanismes correcteurs
1. Les dispositifs de solidarité permettent d'atténuer les écarts de pension entre les femmes et les hommes
Outre le minimum de pension et le minimum vieillesse, certains mécanismes de solidarité, qui sont spécifiquement destinés à compenser les inégalités de carrière résultant de l'éducation des enfants, bénéficient dans les faits principalement aux mères et contribuent à réduire l'écart de niveau de pension de retraite avec les hommes. Les juridictions européennes et nationales ont toutefois jugé discriminatoire le fait de réserver juridiquement ces dispositifs aux seules mères1240(*).
Les dispositifs de solidarité remplissent différents objectifs
Les minima de pension et les majorations de pension pour trois enfants et plus majorent le montant de la pension de droit direct.
Les dispositifs compensatoires que sont l'assurance vieillesse des parents au foyer, les majorations de durée d'assurance pour enfant augmentent la durée d'assurance validée.
Les départs anticipés pour motif familial et pour carrières longues permettent de partir à la retraite avant l'âge légal.
La reconnaissance d'un statut d'inaptitude ou d'invalidité permet de partir à la retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite, et ce même lorsque la durée d'assurance validée est inférieure à celle requise pour l'obtention du taux plein.
La pension de réversion ou pension de droit dérivé permet, sous certaines conditions, de verser au conjoint survivant tout ou partie de la retraite dont bénéficiait son conjoint décédé.
Les droits familiaux de retraite que sont les majorations de durée d'assurance pour enfant, les majorations de pension pour les parents de trois enfants ou plus, ainsi que l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)1241(*), bénéficient principalement aux mères. Quelque 90 % des femmes retraitées bénéficient d'au moins un droit familial1242(*). Au titre de l'année 2022, le nombre de trimestres validés au titre de l'AVPF, des trimestres dits de période assimilée et des trimestres de majoration de durée d'assurance est en moyenne de 40 pour les femmes et de 13 pour les hommes.
Décomposition de la durée validée par les nouveaux retraités de l'année 2022 selon la nature des trimestres
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale « Retraites » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024
Selon la Cour des comptes, la part des droits familiaux que sont les trimestres de majoration de durée d'assurance (MDA), d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et les majorations de pensions représenterait 10 % de la masse des pensions de droit direct en 2040 contre 6,7 % en 20161243(*). Il convient néanmoins de souligner que les majorations de pension augmentent les écarts de pension entre les sexes lorsqu'elles s'appliquent aux pensions des pères, qui sont en moyenne plus élevées. La part de ces majorations dans la masse des pensions de droit direct n'est pas renseignée, de sorte qu'il ne peut être déduit que cette masse financière bénéficie principalement aux mères.
Le dernier mécanisme qui contribue au rattrapage du niveau de pension des hommes par les femmes est enfin la pension de réversion1244(*), dont 88 % des bénéficiaires étaient en 2021 des femmes1245(*). Cela s'explique par leur plus grande longévité, le fait qu'elles sont en moyenne plus jeunes de deux ans que leur conjoint, mais également par le fait que les hommes veufs perçoivent des pensions de droit direct plus élevées qui leur ouvrent moins de droit à la pension de réversion. En 2020, les pensions de réversion ont réduit de 12 points (28 % contre 40 %) les écarts de pension entre hommes et femmes1246(*).
Selon les estimations effectuées par le Conseil d'orientation des retraites dans son rapport annuel de 2022 et reprises par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2023, cet écart de pension se réduirait jusqu'à atteindre 17 % en 2040 mais persisterait en raison de l'écart des salaires.
2. Certains mécanismes continuent toutefois de pénaliser les femmes
Si les dispositifs de solidarité participent au rattrapage du niveau des pensions entre les femmes et les hommes, certaines règles restent dans les faits défavorables aux femmes, qui subissent plus d'interruption de carrière que les hommes.
Tel est le cas de la prise en compte du salaire de référence sur les 25 meilleures années dans le calcul de la pension de retraite du régime général. Ce mécanisme, qui permet d'exclure les plus bas salaires, est accessible aux assurés ayant une carrière d'une durée supérieure à 25 ans. Par ailleurs, l'effet du temps partiel sur le salaire de référence est beaucoup plus fort en fin de carrière qu'en début de carrière. Or, les femmes sont plus souvent amenées que les hommes à recourir au temps partiel en fin de carrière pour endosser leur rôle d'aidant familial de leurs enfants ou de leurs parents âgés.
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (RACL) bénéficie également dans les faits aux hommes plus qu'aux femmes, dans la mesure où ils sont plus nombreux à remplir la condition de durée légale de cotisation.
Le dispositif de départ en retraite anticipé pour carrière longue (RACL)
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue (RACL) permet aux personnes ayant travaillé avant un certain âge et ayant validé la durée d'assurance minimale requise pour obtention du taux plein, de partir à la retraite à taux plein avant l'âge légal d'ouverture des droits. Ce dispositif a été créé en 2003 comme une alternative à la prise en compte de la pénibilité pour permettre un départ anticipé. Il est modifié à chaque réforme des retraites et bénéficient aujourd'hui aux assurés ayant eu des carrières précoces, de sorte que l'objectif de la prise en compte de l'usure professionnelle n'est pas toujours atteint.
La réforme de 2023 a redéfini les bornes d'âge de début d'activité entre 16 et 21 ans, relevant l'âge d'ouverture des droits à 63 ans pour les personnes ayant débuté à travailler à 21 ans, comme suit :
Les conditions de départ en retraite des femmes et des hommes
Source : Patrick Aubert, Les départs anticipés pour carrière longue devraient-ils permettre de partir à la retraite dès qu'on a cotisé la durée requise ?, Institut des politiques publiques, février 2024
Si les trimestres de maternité ainsi que ceux validés au titre de l'AVPF comptent, depuis la réforme des retraites de 2023, parmi les trimestres cotisés pour le départ en retraite anticipée, ce n'est pas le cas des majorations de durée d'assurance pour enfants.
Enfin, le dispositif de cumul emploi-retraite permet à une personne ayant atteint la durée d'assurance requise et liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite de continuer à exercer une activité rémunérée, dans les limites d'un plafond lorsqu'elle n'a pas atteint l'âge légal d'ouverture des droits. La réforme des retraites du 14 avril 2023 a ouvert la possibilité, pour les retraités bénéficiant du cumul emploi-retraite intégral (non plafonné), d'acquérir par leur activité rémunérée de nouveaux droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023.
Parmi les retraités du régime général exerçant une activité salariée dans le cadre de ce dispositif en 2020, les femmes sont majoritaires dans les groupes ayant les plus faibles pensions de retraite et les plus faibles salaires. Elles représentent ainsi 68 % des professions intermédiaires ayant eu des carrières complètes avec des salaires compris entre la moitié et les deux tiers du plafond de la sécurité sociale, qui leur offrent des pensions modestes, et 87 % des retraités ayant liquidé leur pension sans avoir rempli la durée d'assurance requise, soit à l'âge d'obtention automatique du taux plein, à la suite d'une carrière incomplète, et qui touchent de ce fait les pensions les plus faibles1247(*).
B. Le présent article reprend deux mesures débattues par la délégation paritaire permanente, l'une de niveau législatif, et l'autre, annoncée, de niveau réglementaire
La délégation partiaire permanente
Le 14 janvier 2025, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre François Bayrou a annoncé la création d'une délégation paritaire permanente des partenaires sociaux, qu'il a installée le 17 janvier sous la coordination de M. Jean-Jacques Marette. Cette délégation avait pour feuille de route de proposer une nouvelle réforme des retraites avant l'été 2025, tout en respectant la consigne de rétablir l'équilibre financier du système de retraite à l'horizon 2030.
Les travaux de cette délégation n'ont pas pu faire l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux. Toutefois, l'annexe 9 du présent projet de loi renseigne que les deux mesures visant à réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, qui consistent à réduire les inégalités d'accès à la retraite anticipée pour carrières longues que subissent les femmes, et à réduire le nombre des meilleures années de salaire ou de revenu prises en compte pour le calcul du salaire des mères, ont été discutées par la délégation paritaire permanente.
1. Une mesure législative visant à intégrer les trimestres de bonification et de majoration de durée d'assurance pour enfant parmi les trimestres réputés cotisés dans le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues
L'article 45 inclut dans le dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue les trimestres de bonification et de majoration de durée d'assurance attribués au titre de la maternité et de l'éducation des enfants, afin de les comptabiliser comme des trimestres réputés cotisés dans la durée d'assurance requise pour ouvrir droit à la retraite anticipée.
L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, qui régit le dispositif de départ en retraite anticipée pour les assurés du régime général, est modifié par le 1° du III du présent article afin d'intégrer les trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance pour maternité, adoption et éducation des enfants, ainsi que de majoration en cas de prise d'un congé parental parmi les périodes réputées cotisées.
Cette extension est réalisée au I du présent article pour les fonctionnaires d'État, de la fonction publique hospitalière et des collectivités locales au 4° de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires.
Dans les articles L. 351-1-1 et L. 25 bis précités, les périodes étant réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont entièrement réécrites. Ces dispositions sont toutefois reprises à droit constant. Seule l'adjonction des trimestres de majorations de durée d'assurance pour enfant est véritablement novatrice.
L'article L. 351-1-1 précité devient un article pivot auquel il est renvoyé pour le calcul des droits à pension de retraite anticipée pour carrière longue des professions libérales (article L. 643-3 du code de la sécurité sociale), des avocats (article L. 653-2 du code de la sécurité sociale), ainsi que des assurés non salariés et salariés agricoles relevant des dispositions d'assurance vieillesse et veuvage de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (article L. 781-29-1 nouvellement inséré au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre VII du code rural et de la pêche maritime)1248(*).
En conséquence, le XI de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, qui excluait la prise en compte dans le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues des trimestres de majoration de durée d'assurance et les bonifications attribuées au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, est supprimé par le 2° du III du présent article.
Enfin, le V du présent article diffère l'entrée en vigueur de ses dispositions au 1er septembre 2026.
2. Une mesure réglementaire visant à tenir compte du nombre d'enfants dans le calcul du salaire annuel moyen des mères
L'étude d'impact du présent article annonce une seconde mesure, qui sera mise en oeuvre par décret, visant à modifier le mode de calcul du salaire et du revenu annuel moyen des mères dans les régimes alignés et le régime des non-salariés agricoles. Actuellement, la pension de retraite de base des assurés des régimes alignés est calculée sur les vingt-cinq meilleures années de carrière.
La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a réformé en son article 87 le mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles pour prendre en compte les vingt-cinq meilleures années de points acquis par les non-salariés agricoles avant 2016, et les vingt-cinq meilleures années de revenus postérieurs à 20151249(*).
La mesure réglementaire annoncé propose, pour les mères d'un enfant ou plus, de prendre en compte les vingt-quatre meilleures années de carrière, et pour les mères de deux enfants ou plus, les vingt-trois meilleures années de carrière.
Il conviendra toutefois de s'assurer qu'une telle mesure ne porte pas atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination.
3. Un faible impact budgétaire difficile à quantifier
Selon l'annexe 9 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, le nombre de trimestres pris en compte au titre de la majoration de la durée d'assurance dans le dispositif de carrière longue seraient plafonnés à deux. L'effet de la mesure sur les effectifs du dispositif de carrière longue serait maximal en 2028 et se traduirait par une augmentation de 12 000 retraités pour cette année.
Elle représenterait un coût de 0,1 milliard d'euros en 2026, compte tenu de son entrée en vigueur au 1er septembre de cette année, et de 0,2 milliard d'euros pour les régimes obligatoires de base et la branche vieillesse pour les années ultérieures.
Impact financier de la mesure portée à l'article 45
Source : Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2029
Les mutations générationnelles, marquées par une entrée de plus en plus tardive sur le marché du travail et des carrières fractionnées, atténueraient les dépenses à compter de 2030.
S'agissant de la mesure réglementaire, le Gouvernement anticipe que la prise en compte du nombre d'enfants dans le nombre d'années de revenus fondant le calcul de la pension de retraite devrait en augmenter le montant moyen de 1 % à la liquidation, pour un coût estimé à 0,2 milliard d'euros en 2030 et 2,2 milliards d'euros en 2050.
Lors de son audition par la commission des affaires sociales le 30 octobre 2025, M. Renaud Villard, directeur de la Cnav, a estimé qu'elle bénéficiera à environ la moitié des femmes, avec un impact de 2 % sur le montant de leur pension. Cette mesure ciblerait les mères de famille qui ont eu une carrière complète et un salaire moyen.
Selon les éléments d'impact que M. Villard a communiqués par écrit au rapporteur de la branche vieillesse, l'entrée en vigueur annoncée de la mesure à compter de septembre 2026 permettrait à 3 % des femmes nées en 1970 de bénéficier d'une anticipation de leur départ en retraite.
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à l'article 45, dont deux visant respectivement à corriger une erreur matérielle1250(*) et à apporter une précision1251(*).
Sur le fond, l'Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement1252(*) visant à accorder aux femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement une bonification d'un trimestre, qui pourra prendre en compte l'un des deux trimestres de majoration de durée d'assurance dont elles bénéficient déjà, en vertu de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004.
Cet amendement permet de compenser le fait que la mesure réglementaire annoncée au présent article, qui prend en compte les 23 ou 24 meilleures années pour le calcul du salaire annuel moyen sur lequel est calculée la pension du régime général, ne serait pas applicable dans la fonction publique. La bonification d'un trimestre augmenterait ainsi le niveau de la pension des femmes fonctionnaires.
L'impact de cette mesure est évalué à 30 millions d'euros en 2035 et 490 millions d'euros en 2050 pour la fonction publique d'État et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière (CNRACL). Le Gouvernement projette un gain moyen de 2% du niveau de la pension dont bénéficieraient 70 % à 80 % des femmes fonctionnaires nées à la fin des années 1970 dont la durée de services et bonifications n'est pas suffisante à éviter une proratisation dans l'un des régimes de la fonction publique.
L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
La commission se félicite de ces mesures qui tendent vers l'objectif de solidarité assigné par le législateur au système de retraite par répartition, qui se traduit notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes.
L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que la Nation se fixe pour objectif, à l'horizon 2050, la suppression de l'écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et les hommes, et, à l'horizon 2037, sa résorption de moitié par rapport à 2023.
Si la mesure législative visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes était appelée de ses voeux par le rapporteur de la branche vieillesse1253(*), la commission restera toutefois vigilante à ce que la mesure réglementaire de modification du calcul des années de carrière selon le nombre d'enfants puisse être effective.
En effet, comme précédemment exposé, les jurisprudences européenne et nationale estiment discriminatoire le fait de réserver des dispositifs juridiques relatifs à l'éducation des enfants aux seules mères. 1254(*)
Si un tel obstacle juridique s'avérait incontournable, la commission invite le Gouvernement à étendre l'application de cette mesure à l'un des parents et non à la seule mère, sur le modèle de la majoration de durée d'assurance pour enfant, des majorations de pension pour les parents de trois enfants ou plus, ainsi que de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)1255(*).
Dans la mesure où 90 % des femmes retraitées bénéficient actuellement d'au moins un droit familial, il apparaît qu'un tel droit d'option serait favorable aux mères.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 45
bis
Décalage d'une génération du calendrier
d'augmentation de l'âge d'ouverture des droits et de la durée
d'assurance requise
prévu par la réforme des retraites de
2023
Cet article, inséré dans le texte initial par la lettre rectificative du 23 octobre 2025, propose de réduire d'un trimestre par rapport à la chronique de hausse prévue par la réforme du 14 avril 2023, l'âge d'ouverture des droits (AOD) à la retraite, qui serait maintenu à 64 ans pour les générations nées en 1969, et de réduire, également d'un trimestre, la chronique de hausse de la durée d'assurance requise (DAR) pour obtenir le taux plein pour les générations nées en 1964 et 1965.
Ainsi, l'AOD atteindrait 64 ans pour la génération 1969 (au lieu de la génération 1968) ; et la DAR 43 ans pour la génération 1966 (au lieu de la génération 1965).
Les dispositifs de départ en retraite anticipée et les territoires de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont exclus de la suspension opérée par le présent article.
La commission propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : la suspension annoncée de la réforme des retraites du 14 avril 2023
A. Le droit existant : la réforme du 14 avril 2023 constitue le dernier aboutissement d'un processus de recul de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, désormais fixé à 64 ans
1. L'âge d'ouverture des droits à la retraite et la durée d'assurance requise conditionnent l'obtention d'une pension de retraite à taux plein
a) Ces paramètres ont été régulièrement modifiés depuis les années 1980 pour maintenir les actifs en emploi et repousser l'âge du départ en retraite face à la dégradation du ratio démographique
La date de liquidation d'une pension de retraite dépend de deux paramètres que sont l'âge d'ouverture des droits (AOD) et la durée d'assurance requise (DAR). Le premier détermine l'âge à partir duquel un assuré peut faire légalement valoir ses droits à la retraite, et le second la durée minimale permettant l'accès à une pension de retraite à taux plein.
Les paramètres de la durée d'assurance requise et de l'âge d'ouverture des droits ont été modifiés à de multiples reprises depuis 19821256(*), date à laquelle l'âge d'ouverture des droits a été abaissé à son niveau le plus bas, soit 60 ans. En effet, la prise de conscience progressive, depuis les années 1980, de la dégradation projetée du ratio démographique du nombre de cotisants par retraités a amené le législateur à tenter de retarder le départ de la population active en retraite afin de préserver un système par répartition.
Plusieurs grandes réformes successives sont intervenues.
Les décrets n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions et 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite ont fixé la durée minimale d'assurance requise pour bénéficier du taux plein à 160 trimestres, soit quarante annuités. La durée du salaire de référence prise en compte pour calculer le montant de la pension des assurés au régime général a été augmentée aux 25 meilleures années, contre dix meilleures années auparavant.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a aligné la durée d'assurance minimale requise pour bénéficier du taux plein des fonctionnaires sur celle des salariés du privé, et a allongé cette durée à quarante et une annuités soit 164 trimestres.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a augmenté l'âge d'ouverture des droits de 4 mois par an à compter de la génération née en 1951, pour le porter à l'âge de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 19551257(*).
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a ensuite porté la durée requise à 172 trimestres, soit quarante-deux annuités, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973.
Durée d'assurance requise pour l'obtention
d'une pension à taux plein
en fonction de la génération
de l'assuré avant la réforme de 2023
|
Génération |
Durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein |
|
1955 à 1957 |
166 trimestres |
|
1958 à 1960 |
167 trimestres |
|
1961 à 1963 |
168 trimestres |
|
1964 à 1966 |
169 trimestres |
|
1967 à 1969 |
170 trimestres |
|
1970 à 1972 |
171 trimestres |
|
À partir de 1973 |
172 trimestres |
Source : Article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale
b) La réforme des retraites de 2003 a introduit des mécanismes de décote et de surcote modulant le montant de la pension de retraite selon la durée d'assurance effectuée
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit des mécanismes de décote et de surcote.
Tout trimestre cotisé au-delà de l'âge minimal d'ouverture des droits à la retraite et de la durée d'assurance requise pour avoir une pension à taux plein, ouvre droit à une surcote qui majore le montant de la pension de retraite de base de 1,25 % par trimestre, soit 5 % par année travaillée supplémentaire.
À l'inverse, tout trimestre d'assurance manquant pour atteindre la durée d'assurance requise minore la pension de retraite de base de 1,25 %, selon un mécanisme de décote. Le coefficient de minoration est calculé sur la base du plus petit de ces deux nombres :
- le nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension prend effet du soixante-septième anniversaire de l'assuré ;
- le nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire à l'assuré, à la date d'effet de sa pension, pour atteindre la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le taux plein est diminué de 1,25 % (soit 0,625 point)1258(*). Par construction, la décote ne peut être supérieure à 25 % du montant de la pension (soit 12,5 points), car le nombre de trimestres séparant la date d'effet de la pension du soixante-septième anniversaire de l'assuré ne peut être supérieur à 20 - hors départs en retraite anticipée assortis automatiquement du bénéfice du taux plein et départs en retraite anticipée au titre de la pénibilité, qui s'accompagnent d'une limitation de la décote à 25 %1259(*).
Si la décote est limitée à 20 trimestres, la surcote n'est pas plafonnée.
Mode de calcul de la pension de retraite dans les régimes alignés
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
Enfin, le législateur a défini un âge ouvrant droit à l'obtention automatique du bénéfice du taux plein, et ce même si les assurés ne justifient pas de la durée d'assurance requise. Cet âge a été porté de 65 à 67 ans1260(*) depuis la réforme des retraites de 20101261(*).
Les situations ouvrant droit au bénéfice du taux plein
Au-delà des seuls assurés atteignant, dans le secteur privé, l'âge d'annulation de la décote ou, dans la fonction publique, la limite d'âge applicable à leur corps ou cadre d'emplois, plusieurs catégories d'assurés bénéficient automatiquement du calcul de leur pension à taux plein1262(*) :
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial, qui atteignent l'âge de 65 ans ;
- les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %1263(*), qui atteignent l'âge de 62 ans ;
- les assurés reconnus inaptes au travail ;
- les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- les mères de famille salariées justifiant d'au moins 120 trimestres au régime général ou à ce régime et au régime des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension1264(*) ;
- les travailleurs handicapés bénéficiant d'un départ en retraite anticipée ;
- les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité ou de service actif passé sous les drapeaux.
La pension des intéressés est toutefois toujours calculée au prorata de la durée d'assurance validée par rapport à la durée requise pour l'obtention du taux plein.
c) La réforme des retraites de 2023 marque une nouvelle étape du recul de l'âge d'ouverture des droits et d'augmentation de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein
La réforme introduite par le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a reporté l'âge d'ouverture des droits pour le porter à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, comme exposé ci-après.
Calendrier de montée en charge du
relèvement de l'âge d'ouverture
des droits de droit commun
prévu par la réforme de 2023
|
Âge d'ouverture des droits |
||
|
Génération |
Avant réforme de 2023 |
Après réforme de 2023 |
|
1960 |
62 ans |
62 ans |
|
01/01/1961 au 31/08/1961 |
62 ans |
62 ans |
|
01/09/1961 au 31/12/1961 |
62 ans |
62 ans et 3 mois |
|
1962 |
62 ans |
62 ans et 6 mois |
|
1963 |
62 ans |
62 ans et 9 mois |
|
1964 |
62 ans |
63 ans |
|
1965 |
62 ans |
63 ans et 3 mois |
|
1966 |
62 ans |
63 ans et 6 mois |
|
1967 |
62 ans |
63 ans et 9 mois |
|
1968 |
62 ans |
64 ans |
Source : Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
En parallèle de l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits, la réforme de 2023 a prévu d'accélérer l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein jusqu'à 172 trimestres, de façon à fixer cette durée à :
- 168 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 30 août 1961 ;
- 169 trimestres pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ;
- 170 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
- 171 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
- 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1965.
Calendrier de montée en charge de
l'allongement de la durée d'assurance
requise pour l'obtention du
taux plein prévu par la réforme de 2023
|
Durée d'assurance requise |
||
|
Génération |
Avant réforme |
Après réforme |
|
1960 |
167 trimestres |
167 trimestres |
|
01/01/1961 au 31/08/1961 |
168 trimestres |
168 trimestres |
|
01/09/1961 au 31/12/1961 |
168 trimestres |
169 trimestres |
|
1962 |
168 trimestres |
169 trimestres |
|
1963 |
168 trimestres |
170 trimestres |
|
1964 |
169 trimestres |
171 trimestres |
|
1965 |
169 trimestres |
172 trimestres |
|
1966 |
169 trimestres |
172 trimestres |
|
1967 |
170 trimestres |
172 trimestres |
|
1968 |
170 trimestres |
172 trimestres |
|
1969 |
170 trimestres |
172 trimestres |
|
1970 |
171 trimestres |
172 trimestres |
|
1971 |
171 trimestres |
172 trimestres |
|
1972 |
171 trimestres |
172 trimestres |
|
1973 |
172 trimestres |
172 trimestres |
Source : Article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale
2. Une montée en charge différenciée de la réforme de 2023 à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
La montée en charge de la réforme des retraites de 2010 différait déjà entre l'Hexagone et Mayotte d'une part, et l'Hexagone et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part. Ainsi, l'âge d'ouverture des droits de 62 ans s'appliquait aux assurés du régime général nés à compter de 1955 1265(*), aux assurés mahorais nés à compter de 19611266(*) et aux assurés habitant Saint-Pierre et Miquelon nés à compter de 1962 1267(*). Ces échéances étaient acquises à Mayotte en 2023 et à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2024.
Le cumul des relèvements opérés respectivement par la réforme de 2010 et par celle de 2023 aurait entraîné, pour les assurés nés à la fin de l'année 1961, à Mayotte, un report de l'âge d'ouverture des droits de sept mois (contre quatre prévus initialement) par rapport à la génération 1960. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les assurés nés à la fin de l'année 1961 auraient subi un report de l'âge d'ouverture des droits de treize mois par rapport à la génération 1960, contre cinq mois prévus initialement.
En conséquence, la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a adapté le calendrier de report de l'âge d'ouverture des droits applicable à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en décalant d'une année le début de la montée en charge de la réforme des retraites à Mayotte, et de deux années à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Calendrier de montée en charge du report de l'âge d'ouverture des droits à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon résultant de la LFSS pour 2024
|
Âge d'ouverture des droits |
||||
|
Génération |
Réforme sans adaptation à Mayotte |
Réforme adaptée à Mayotte |
Réforme sans adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon |
Réforme adaptée à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
1960 |
61 ans et 8 mois |
61 ans et 8 mois |
61 ans et 2 mois |
61 ans et 2 mois |
|
01/01/1961 au 31/08/1961 |
62 ans |
62 ans |
61 ans et 7 mois |
61 ans et 7 mois |
|
01/09/1961 au 31/12/1961 |
62 ans et 3 mois |
62 ans |
62 ans et 3 mois |
61 ans et 7 mois |
|
1962 |
62 ans et 6 mois |
62 ans et 3 mois |
62 ans et 6 mois |
62 ans |
|
1963 |
62 ans et 9 mois |
62 ans et 6 mois |
62 ans et 9 mois |
61 ans et 3 mois |
|
1964 |
63 ans |
62 ans et 9 mois |
63 ans |
61 ans et 6 mois |
|
1965 |
63 ans et 3 mois |
63 ans |
63 ans et 3 mois |
61 ans et 9 mois |
|
1966 |
63 ans 6 mois |
63 ans et 3 mois |
63 ans et 6 mois |
63 ans |
|
1967 |
63 ans et 9 mois |
63 ans et 6 mois |
63 ans et 9 mois |
63 ans et 3 mois |
|
1968 |
64 ans |
63 ans et 9 mois |
64 ans |
63 ans et 6 mois |
|
1969 |
64 ans |
64 ans |
64 ans |
63 ans et 9 mois |
|
1970 |
64 ans |
64 ans |
64 ans |
64 ans |
Source : Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
B. Le présent article propose de décaler d'une génération l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits et de la durée d'assurance requise
1. Le présent article suspend l'application de la réforme des retraites de 2023 pour les seuls assurés nés en 1964 et décale le calendrier initialement prévu pour les générations suivantes
Le présent article, introduit par la lettre rectificative en date du 23 octobre 2025, propose de suspendre le calendrier d'augmentation de l'âge d'ouverture des droits et de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein tel qu'il résulte de la loi du 14 avril 2023.
a) L'âge d'ouverture des droits est gelé pour les assurés nés en 1964
Le premier effet de la mesure proposée est le gel de l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits (AOD), c'est-à-dire l'âge légal ouvrant droit au départ en retraite, pour la seule génération née en 1964. Ce gel a pour effet de retarder d'un trimestre la montée en charge initialement prévue au terme de la réforme, comme exposé dans le tableau ci-après. L'âge d'ouverture des droits de 64 ans s'appliquerait désormais aux personnes nées en 1969, contre 1968 aux termes de la loi du 14 avril 2023.
Calendrier de montée en charge du relèvement de l'âge d'ouverture des droits de droit commun résultant des modifications proposées par le présent article
|
Âge d'ouverture des droits |
||
|
Génération |
Réforme du 14 avril 2023 |
Propositions du présent article |
|
1960 |
62 ans |
62 ans |
|
01/01/1961 au 31/08/1961 |
62 ans |
62 ans |
|
01/09/1961 au 31/12/1961 |
62 ans et 3 mois |
62 ans et 3 mois |
|
1962 |
62 ans et 6 mois |
62 ans et 6 mois |
|
1963 |
62 ans et 9 mois |
62 ans et 9 mois |
|
1964 |
63 ans |
62 ans et 9 mois |
|
1965 |
63 ans et 3 mois |
63 ans |
|
1966 |
63 ans et 6 mois |
63 ans et 3 mois |
|
1967 |
63 ans et 9 mois |
63 ans et 6 mois |
|
1968 |
64 ans |
63 ans et 9 mois |
|
1969 |
64 ans |
|
Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le I du présent article modifie l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe l'âge d'ouverture des droits aux pensions de retraite des régimes de base de la sécurité sociale et des fonctionnaires civils et militaires à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
La référence à un décret déterminant l'âge d'ouverture des droits pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968, et pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, est remplacée par neuf alinéas inscrivant cette montée en charge dans le texte de l'article L. 161-17-2 dans sa version rectifiée.
b) La montée en charge de la durée d'assurance requise pour obtention du taux plein est gelée pour les assurés nés en 1964
Le second effet de la mesure proposée est de geler la montée en charge de la durée d'assurance requise pour obtenir le taux plein pour la génération née en 1964. Cela a également pour effet de retarder d'un trimestre l'augmentation de la durée d'assurance minimale votée aux termes de la loi du 14 avril 2023. Ce retard impactera la seule génération née en 1965.
Contrairement aux dispositions décalant d'une génération la montée en charge de l'âge d'ouverture des droits, que le présent article propose de codifier1268(*), le IV du présent article créé une disposition « volante »1269(*) qui déroge à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale en prévoyant que la durée d'assurance requise prévue à cet article est réduite d'un trimestre pour les assurés nés en 1964 ou 1965 dont la pension servie par un régime de base prend effet à compter de l'âge d'ouverture des droits tel que prévu à l'article L. 161-17-2 du même code.
Calendrier de montée en charge de
l'allongement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux
plein résultant des modifications
proposées par le
présent article
|
Durée d'assurance requise |
||
|
Génération |
Réforme du 14 avril 2023 |
Propositions du présent article |
|
1960 |
167 trimestres |
167 trimestres |
|
01/01/1961 au 31/08/1961 |
168 trimestres |
168 trimestres |
|
01/09/1961 au 31/12/1961 |
169 trimestres |
169 trimestres |
|
1962 |
169 trimestres |
169 trimestres |
|
1963 |
170 trimestres |
170 trimestres |
|
1964 |
171 trimestres |
170 trimestres |
|
1965 |
172 trimestres |
171 trimestres |
|
1966 |
172 trimestres |
172 trimestres |
Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Cette rédaction a pour effet de corréler le gel de la durée d'assurance requise au gel de l'âge d'ouverture des droits et de limiter ainsi les effets de la suspension opérée aux seules générations nées en 1964 et 1965 qui partiraient à la retraite à taux plein en conjuguant ces deux paramètres. Autrement dit, le fait de ne pas avoir modifié les dispositions de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale fixant la durée minimale d'assurance requise pour obtention du taux plein, permet de ne pas appliquer la suspension aux assurés qui bénéficieraient d'un taux plein sur le seul fondement de ce paramètre via un mécanisme de départ en retraite anticipée.
Comme il a déjà été exposé précédemment dans le II du tome I du présent rapport, lors des auditions qui ont été menées par la rapporteure générale et rapporteur de la branche vieillesse de la commission des affaires sociales les 28 et 29 octobre 2025, la direction de la sécurité sociale et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) ont justifié cette exemption par l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre la suspension de la réforme des retraites au 1er janvier 2026. Le directeur de la Cnav, Renaud Villard, a indiqué que ses services seraient en capacité de procéder à la liquidation des pensions après adaptation des paramètres informatiques de calcul du montant des retraites en mai 20261270(*).
La prise en compte de la pénibilité au travail ouvre droit à des dispositifs de départ en retraite anticipée avant l'âge d'ouverture des droits de droit commun
Les catégories actives de la fonction publique
L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre un droit au départ en retraite anticipé aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi en catégories dites « actives » et « super-actives », par opposition aux autres catégories d'emplois de fonctionnaires, dites « sédentaires ».
La catégorie « active » désigne des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, définis par décret1271(*) et par arrêté1272(*). Elle est notamment composée des métiers d'instituteurs et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de douaniers, de policiers municipaux ou encore d'infirmiers.
La catégorie super-active comprend des emplois présentant un risque particulier (danger, insalubrité, fatigues exceptionnelles) comme les personnels actifs de la police et de la gendarmerie nationale, les personnels de l'administration pénitentiaire ou encore les contrôleurs aériens.
L'âge d'ouverture des droits est diminué de 5 ans par rapport à l'âge d'ouverture des droits de droit commun pour les agents de la catégorie active et de dix ans pour les agents de la catégorie super-active.
La réforme des retraites de 2023 a relevé de deux ans les bornes d'âge ouvrant droit à un départ à la retraite anticipée, soit 59 en 2030 pour la catégorie active et 54 ans en 2030 pour la catégorie super-active, ainsi que l'âge d'obtention du taux plein qui est de 62 ans pour les catégories actives et 57 ans pour les catégories super-actives.
Le dispositif de départ en retraite anticipé pour carrière longue (RACL)
Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue a été créé en 2003 et modifié à chaque nouvelle réforme des retraites intervenue depuis cette date. Il permet aux personnes ayant commencé à travailler avant un certain âge de partir à la retraite avant l'âge d'ouverture des droits de droit commun dès lors qu'elles disposent de la durée minimale d'assurance requise. La réforme de 2023 a redéfini les bornes d'âge de début d'activité entre 16 et 21 ans, relevant l'âge d'ouverture des droits à 63 ans pour les personnes ayant débuté à travailler à 21 ans.
Le dispositif de départ en retraite anticipé pour carrière longue (RACL)
Il existe enfin d'autres dispositif de départ anticipé que sont :
- la retraite anticipée pour handicap (RATH) à partir de l'âge de 55 ans, créée en 2003 et dont l'accès est subordonné à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente pendant des durées d'assurance et des durées cotisées ;
- la retraite anticipée pour incapacité permanente, qui permet de partir à la retraite dès 60 ans ou deux ans avant l'âge d'ouverture des droits de droit commun aux assurés percevant une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 10 %, à la condition d'avoir été exposé au moins 17 ans à des facteurs de risques, ou sans cette condition pour les assurés dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 20 % ;
- la retraite anticipée pour inaptitude au travail et invalidité à partir de 62 ans.
L'ensemble de ces dispositifs n'est pas concerné par la suspension de la montée en charge de la durée d'assurance.
Le II opère des modifications de coordination aux articles L. 13 et L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires, qui prévoient respectivement le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir la durée minimale d'assurance requise et l'âge d'annulation de la décote. Il est désormais fait référence à l'article L. 13 précité du nombre de trimestres mentionné « à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » et non plus au nombre de trimestres prévu au « 6° de l'article L. 161-17-3 » précité, soit 172 trimestres, et ce afin d'aligner le calendrier de la durée d'assurance requise entre le régime général et la fonction publique.
Cet alignement supprime les dispositions transitoires dérogatoires à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, relatives aux fonctionnaires sédentaires, qui figuraient au XXIV A de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 (III du présent article). Les fonctionnaires sédentaires désignent les fonctionnaires dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ou super-active.
2. La suspension de la réforme ne concerne pas Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Le Gouvernement n'a pas souhaité étendre la suspension de la réforme de 2023 opérée au présent article aux collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le V du présent article opère des coordinations à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qu'il fixe le calendrier de report de la réforme de 2023 en référence à celui de droit commun prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune modification n'est apportée au calendrier de montée en charge propre à Saint-Pierre-et-Miquelon qui figure à cet article, ni à celui propre à Mayotte, qui est précisé dans le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
La suspension opérée au présent article aligne de fait la montée en charge de la réforme des retraites en Hexagone au calendrier mahorais, l'âge d'ouverture des droits de 64 ans étant atteint pour la génération née en 1969. Le calendrier de la montée en charge à Saint-Pierre-et-Miquelon impose cette borne d'âge à la génération née en 1970.
3. L'impact budgétaire de cette suspension et son financement
L'estimation des effets financiers de la mesure portée par le présent article a été effectuée par le modèle de micro-simulation Prisme1273(*) de la Cnav et repose sur des hypothèses de modélisation des comportements des assurés.
Selon les explications apportées par la direction de la sécurité sociale à la rapporteure générale et au rapporteur de la branche vieillesse, la mesure d'anticipation de l'âge d'ouverture des droits à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans s'appliquera à un quart de la génération née en 1964 qui aura 62 ans et 9 mois en octobre 2026, soit ceux qui sont nés entre janvier et mars 1964, et pour un quart de l'année 2026 (octobre-décembre). Cela justifie que le coût estimé au titre de l'année 2026 soit d'environ 100 millions d'euros.
En revanche, la mesure de suspension s'appliquerait sur une année pleine à compter du 1er janvier 2027, ce qui justifie un coût estimé en 2027 à 1,4 milliard d'euros pour le système de retraite. Pour l'ensemble des administrations publiques, en tenant compte de l'effet négatif sur le PIB, l'impact de la mesure portée par le présent article est estimé à 3 milliards d'euros en 2027.
Le présent article ayant pour seul effet de décaler d'une génération la réforme de 2023, il n'aurait pas d'effet durable sur les finances publiques. Selon l'évaluation préalable du présent article, il aurait même pour effet d'améliorer le solde du système de retraite de 0,1 milliard d'euros en 2033, du fait d'une réduction du montant des pensions.
S'agissant des hypothèses comportementales retenues, la direction de la sécurité sociale estime qu'environ 5 millions de personnes pourraient bénéficier de la suspension de cette mesure, mais que seulement la moitié d'entre elles pourraient effectivement anticiper leur départ en retraite.
Selon ses calculs, sur une génération, environ 40 % des assurés partent en retraite anticipée, et 20 % partent avant l'âge d'annulation de la décote, de sorte que la suspension serait susceptible d'impacter 40 % d'une génération.
Le coût de la mesure portée au présent article serait compensé :
- pour 2026, à hauteur de 0,1 milliard d'euros par une majoration de la contribution ponctuelle des organismes complémentaires proposée par l'article 7 du PLFSS ;
- à partir de 2027, à hauteur de 1,5 milliard d'euros par une majoration de 0,5 point de la sous-indexation de la revalorisation des pensions de retraite de base proposée par l'article 44 du PLFSS.
Pour plus de développements, il est renvoyé à l'analyse budgétaire figurant dans le II du tome I du présent rapport.
II - Le dispositif transmis au Sénat
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement1274(*) :
- étendant la mesure de la suspension de la réforme de 2023 portée au présent articles aux assurés nés au premier trimestre 1965 afin qu'ils bénéficient d'un AOD et d'une DAR respectivement figés à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres ;
- étendant la mesure de suspension de la réforme de 2023 à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
- étendant la suspension de la durée d'assurance aux assurés relevant des catégories actives et super-actives de la fonction publique, aux militaires de plus de 15 ans de service, ainsi qu'aux infirmiers ayant exercé leur droit d'option pour la catégorie A
- avançant l'entrée en vigueur du présent article au 1er septembre 2026 afin de l'étendre aux assurés bénéficiant d'un départ anticipé au titre du dispositif pour carrière longue, inaptitude et invalidité.
Le coût de l'ensemble des modifications est estimé à 200 millions d'euros en 2026 et 500 millions d'euros en 2027.
Cet amendement a été sous-amendé par trois sous-amendements, dont un rédactionnel et de procédant à des coordinations. Un sous-amendement porté par la députée Estelle Youssouffa, imposant au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et portant sur la situation des pensions de retraite à Mayotte et l'accélération de la convergence vers le droit commun 1275(*), a également été adopté.
L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié, dont le coût est désormais estimé à 300 millions d'euros en 2029 et 1,9 milliard d'euros en 2027.1276(*)
III - La position de la commission
A. Il ne serait pas responsable de chercher à faire croire à l'opinion que la France pourrait se dispenser de poursuivre le recul de l'âge de départ à la retraite
Comme indiqué supra, le décalage par le présent article d'une génération de la mise en oeuvre de la réforme des retraites de 2023 n'aurait pas, en lui-même, d'effet durable sur les finances publiques.
Toutefois le présent article a pour objet de permettre, si cela était décidé à l'issue de la prochaine élection présidentielle, de réellement suspendre la réforme des retraites, c'est-à-dire de figer sine die l'AOD à 62 ans et 9 mois et à 170 trimestres.
La commission est bien consciente du fait que la réforme des retraites de 2023, qui prévoit le passage de l'âge d'ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, est contestée par la majorité de l'opinion1277(*).
Il n'en demeure pas moins que si la France veut préserver son modèle de sécurité sociale, parmi les plus généreux au monde, elle devra travailler plus.
Il ne serait pas responsable de chercher à faire croire à l'opinion que la France pourrait se dispenser de poursuivre le recul de l'âge de départ à la retraite.
Les développements ci-après, qui s'inspirent largement d'un récent rapport1278(*) de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, rappellent quelques faits incontestables à cet égard.
a) Une suspension pérenne de la réforme de 2023 aggraverait l'exception française en Europe pour l'âge légal de départ à la retraite
Tout d'abord, une suspension pérenne de la réforme des retraites de 2023 accentuerait l'exception française actuelle. En effet, la France fait déjà partie des États européens où l'âge légal de départ est le plus faible, alors qu'une augmentation de cet âge légal est prévue dans la quasi-totalité de ces États, comme le montre le tableau ci-après.
Âges légaux de départ à la retraite dans les pays européens
|
Pays |
Âge légal de départ |
Évolution |
|
Allemagne |
66 ans et 2 mois (assurés nés en 1959) |
+2 mois/an, jusqu'à atteindre 67 ans pour les assurés nés en 1964 ou après. |
|
Autriche |
• Hommes : 65 ans |
• Augmentation progressive de l'âge de la retraite des femmes (+ 6 mois par an). • Même âge légal que les hommes pour les femmes nées après juin 1968. |
|
• Femmes : 61 ans |
||
|
Belgique |
Personnes nées avant 1960 : 65 ans |
• Personnes nées de 1960 à 1963 : 66 ans • Personnes nées en 1964 ou après : 67 ans |
|
Bulgarie |
• Hommes : 64 ans et 8 mois • Femmes : 62 ans et 4 mois |
• Jusqu'à 65 ans, au rythme de : +1 mois/an pour les hommes +2 mois/an pour les femmes jusqu'en 2029, puis +3 mois/an à partir de 2030. • À partir de 2038, l'âge de la retraite devrait être lié à l'espérance de vie. |
|
Chypre |
65 ans |
L'âge de la retraite devrait être ajusté tous les 5 ans, en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. |
|
Croatie |
• Hommes : 65 ans • Femmes : 63 ans et 9 mois |
L'âge de la retraite des femmes est relevé de 3 mois par an pour atteindre 65 ans en 2030. |
|
Danemark |
67 ans |
• 68 ans pour les personnes nées entre 1963 et 1966 inclus • 69 ans pour les personnes nées en 1967 ou après. |
|
Espagne |
65 ans (avec au moins 38 années et 3 mois de cotisations) ou 66 ans et 8 mois |
• Augmentation de la durée d'assurance nécessaire pour un départ à 65 ans, jusqu'à atteindre 38 années et 6 mois de cotisations en 2027 (38 années et 3 mois pour 2026). • En cas de cotisations insuffisantes : augmentation de l'âge légal de 2 mois par année (66 ans et 10 mois en 2026 ; 67 ans à partir de 2027). |
|
Estonie |
64 ans et 9 mois (personnes nées en 1960) |
• 65 ans en 2026. • Sera ensuite modifié en fonction de l'évolution de l'espérance de vie, sans pouvoir être augmenté de plus de 3 mois par an (2027 : 65 ans et 1 mois). |
|
Finlande |
• 64 ans et 6 mois (personnes nées en 1960) • 64 ans et 9 mois (personnes nées en 1961) |
• Jusqu'à 65 ans en 2027, au rythme de +3 mois/an. • Pour les personnes nées en 1965 ou après, l'âge de la retraite sera lié à l'espérance de vie à 62 ans. |
|
France |
• 62 ans et 6 mois (personnes nées en 1962) • 62 ans et 9 mois (personnes nées en 1963) |
Report de 3 mois/an, jusqu'à atteindre 64 ans pour les personnes nées en 1968 ou après. |
|
Grèce |
• 67 ans (pour 15 ans d'assurance) • 62 ans (pour 40 ans d'assurance) |
Susceptible d'être modifié au 1er janvier 2027 en fonction de l'évolution de l'espérance de vie (réexamen prévu tous les 3 ans). |
|
Hongrie |
65 ans |
|
|
Irlande |
66 ans |
|
|
Islande |
67 ans |
|
|
Italie |
67 ans |
|
|
Lettonie |
65 ans |
|
|
Liechtenstein |
65 ans |
|
|
Lituanie |
• Hommes : 64 ans et 10 mois • Femmes : 64 ans et 8 mois |
65 ans pour tous en 2026 |
|
Luxembourg |
65 ans |
|
|
Malte |
64 ans (assurés nés de 1959 à 1961) |
65 ans pour les assurés nés à partir de 1962 |
|
Norvège |
62 ans* |
|
|
Pays-Bas |
67 ans (2024-2027) |
• 2028-2030 : 67 ans et 3 mois • Au Pays-Bas, le futur âge légal de la retraite est calculé 5 ans avant son application. Il augmente de 8 mois par année d'espérance de vie en plus. |
|
Pologne |
• Femmes : 60 ans • Hommes : 65 ans |
|
|
Portugal |
66 ans et 7 mois |
Régulièrement ajusté en fonction de l'espérance de vie à 65 ans (annoncé à 66 ans et 9 mois pour 2026). |
|
République tchèque |
• 64 ans et 4 mois (assurés nés en 1961) • Âge moins élevé pour les femmes ayant eu des enfants |
Augmente chaque année de 2, 4 ou 6 mois (en fonction du genre, et du nombre d'enfants pour les femmes). |
|
Roumanie |
• Hommes : 65 ans • Femmes : 62 ans et 4 mois (62 ans et 5 mois à compter de juillet 2025) |
• Augmentation progressive de l'âge légal des femmes jusqu'à atteindre 65 ans en 2035. • Ensuite, augmentation en fonction de l'évolution de l'espérance de vie (hommes et femmes). |
|
Royaume-Uni |
66 ans |
2026-2028 : passage de 66 à 67 ans |
|
Slovaquie |
Assurés sans enfants : 63 ans et 4 mois (nés en 1962) |
Jusqu'à 64 ans pour les assurés nés en 1966 ; lié à l'espérance de vie pour les générations suivantes (64 ans et 1 mois pour les personnes nées en 1967). |
|
Slovénie |
65 ans |
|
|
Suède |
63 ans* |
À partir de 2026 : ajusté en fonction de l'espérance de vie. |
|
Suisse |
• Hommes : 65 ans • Femmes : 64 ans et 3 mois |
Relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 3 mois/an, jusqu'à atteindre 65 ans (en 2028). |
* À proprement parler, il n'y a pas d'âge « fixe » de la retraite en Norvège et en Suède (on parle de « retraite flexible »). Sachant qu'en Norvège, pour liquider sa pension de vieillesse avant 67 ans, il faut pouvoir prétendre à une retraite au moins égale à un certain montant.
Données consolidées en juillet 2025 à partir des tableaux comparatifs du réseau européen Mutual Information System on Social Protection (Missoc), auquel le Cleiss participe pour la France, et des sites officiels des différents États membres.
Source : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)
À titre d'illustration, l'âge légal de départ à la retraite est de 67 ans au Danemark et aux Pays-Bas, et doit encore augmenter.
b) Si le taux d'emploi de la France était le même qu'en Allemagne, le PIB par habitant ne serait pas 20 % plus faible et le solde public serait excédentaire
• La France, « pauvre parmi les riches » à cause d'un taux d'emploi plus faible qu'ailleurs en Europe
Si les dépenses de protection sociale de la France sont les plus élevées de l'OCDE en points de PIB, elles sont plus banales si l'on raisonne en montant par habitant (sixième position), en particulier dans le cas de la santé (dixième position).
Dépenses publiques de protection sociale des pays membres de l'OCDE (2019)
(en dollars PPA par habitant et en points de PIB)
PPA : parités de pouvoir d'achat. La conversion des différentes monnaies en dollars est ici effectuée non sur la base du taux de change, mais de manière à ce qu'un dollar corresponde au même pouvoir d'achat dans chaque pays.
D'après données OCDE (https://data explorer.oecd.org/). L'année 2019 est la dernière permettant la comparaison de tous les pays.
Source : Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025
En effet, le PIB par habitant de la France est proche de la médiane des pays de l'OCDE. Parmi les pays d'Europe occidentale, seuls les pays d'Europe du Sud (mais presque plus l'Italie, qui a quasiment rattrapé la France) ont un PIB par habitant lus faible. Ainsi, le PIB par habitant de la France est inférieur d'environ 20 % à celui de l'Allemagne.
C'est ce qui a fait dire au président du Conseil d'orientation des retraites (COR), lors de son audition par les rapporteures du rapport précité de la Mecss du Sénat, que « la France est pauvre parmi les riches ».
PIB par habitant des pays membres de l'OCDE (2022)
(en dollars PPA)
PPA : parités de pouvoir d'achat. La conversion des différentes monnaies en dollars est ici effectuée non sur la base du taux de change, mais de manière à ce qu'un dollar corresponde au même pouvoir d'achat dans chaque pays.
D'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/).
Source : Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025
Ce PIB par habitant plus faible que, par exemple, en Allemagne ou aux Pays-Bas, s'explique par le fait qu'en France, la proportion de personnes en âge de travailler qui travaillent effectivement (c'est-à-dire son « taux d'emploi ») est plus faible que dans ces pays.
Écart de PIB par habitant relativement au
niveau des États-Unis
et contributions (2022)
(en % et en points)
Source : Graphique transmis à la Mecss du Sénat par Gilbert Cette (d'après Cette et Lecat, 2016)
Comme le montre le graphique ci-après, issu d'une récente note du Conseil d'analyse économique1279(*), depuis le début des années 1990 la France a un nombre d'heures travaillées par habitant inférieur à celui de nos principaux partenaires.
Nombre d'heures annuelles travaillées par habitant (1968-2024)
Note : Nombre moyen d'heures annuelles travaillées estimé sur l'ensemble des 16-74 ans.
Lecture : En France, en 2023, un habitant de 16 à 74 ans travaille en moyenne 980 heures par an. C'est environ 100 heures de moins qu'en Allemagne où la moyenne est à 1 070 heures par habitant et qu'au Royaume-Uni où la moyenne est à 1 100 heures. Les États-Unis se trouvent bien au-dessus, avec une moyenne de 1 270 heures travaillées par habitant.
Source : Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025
Selon le Conseil d'analyse économique, « cet écart avec l'Allemagne et le Royaume-Uni s'explique entièrement par un taux d'emploi plus faible en France et pas du tout par un nombre plus faible d'heures en emploi ».
Par ailleurs, « le taux d'emploi plus bas de la France se concentre entièrement sur les jeunes et les seniors : l'insertion sur le marché du travail des jeunes est beaucoup plus lente en France, et les sorties du marché du travail sont plus précoces ».
• Un alignement du taux d'emploi de la France sur celui de l'Allemagne permettrait quasiment de résorber le déficit de la sécurité sociale
Selon une note de 2024 de la direction générale du Trésor1280(*), aligner le taux d'emploi (c'est-à-dire la proportion de personnes de 15-64 ans ayant un emploi) sur celui de l'Allemagne améliorerait le solde des administrations de sécurité sociale de 20 milliards d'euros (dont 15 milliards d'euros d'augmentation de recettes et 5 milliards d'euros de réduction de dépenses).
Impact pour les administrations de
sécurité sociale d'un alignement
du taux d'emploi de la France
sur celui de l'Allemagne,
selon la direction générale du
Trésor
Source : Juliette Ducoulombier, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la direction générale du Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024
b) Le véritable enjeu : améliorer la qualité de l'emploi et les conditions de travail
L'opposition d'une majorité de Français à la réforme des retraites de 2023 provient certes pour partie des mauvaises conditions dans lesquelles le débat a eu lieu. Elle semble toutefois également provenir de réels problèmes de qualité de l'emploi et des conditions de travail.
Comme cela a été rappelé par le rapport précité de la Mecss du Sénat, les Français font partie des Européens les plus nombreux à déclarer que le travail est très ou plutôt important, comme le montre le graphique ci-après.
Proportion de personnes indiquant que le travail est très ou plutôt important dans leur vie, dans l'enquête sur les valeurs européennes de 2017
Source : European Values Study, Atlas of European Values
La véritable spécificité française semble plutôt consister en des conditions de travail plutôt moins bonnes en France qu'ailleurs en Europe, comme le montre le tableau ci-après. Ainsi, selon Maëlezig Bigi et Dominique Méda, « la principale explication du paradoxe français concerne les conditions de travail. La France est un des pays où le fossé entre les très fortes attentes placées sur le travail et la réalité des conditions d'exercice du travail est le plus grand. Des attentes peut-être trop élevées viennent en quelque sorte se fracasser sur la réalité du travail »1281(*).
« À quelle fréquence votre emploi rémunéré implique-t-il toujours ou souvent : » (enquête Eurofound, vague 2021)
Source : Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Prendre la mesure de la crise du travail en France, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp), Sciences Po, 11 septembre 2024
De fait, la France paraît singulièrement peu performante en matière de qualité du travail, en particulier pour ce qui concerne les risques physiques (ergonomie et risques biochimiques) et la qualité de l'environnement de travail, comme le montre le tableau ci-après.
Écart à la moyenne européenne
des indicateurs de qualité de l'emploi
et du travail
Source : Christine Erhel, Mathilde Guergoat Larivière, Malo Mofakhami, La qualité de l'emploi et du travail en comparaison européenne : une contre-performance française ?, 11 septembre 2024
Les causes de ces moins bonnes conditions de travail ne sont pas absolument évidentes, et sortent du champ du présent commentaire. Une moindre autonomie des salariés et une moindre présence des syndicats ont pu être évoquées1282(*). Comme les rapporteures du rapporteur précité de la Mecss du Sénat le soulignaient, « il y a probablement un chantier à ouvrir si l'on souhaite favoriser l'augmentation de la quantité de travail en France ».
Aussi, la commission se félicite de ce que la conférence sur le travail et les retraites lancée le 4 novembre 2025 ait prévu d'aborder la question du « travailler mieux »1283(*). La question de l'amélioration de la qualité de l'emploi et des conditions de travail ne peut en effet être dissociée de celle de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite.
B. La proposition de la commission : supprimer cet article
En conséquence de ce qui précède, il ne serait pas responsable de contribuer à faire croire aux Français que la France pourrait préserver son modèle social, la soutenabilité de ses finances publiques, son rang dans le monde et son indépendance, tout en aggravant l'une de ses principales pathologies : un PIB par habitant nettement plus faible que dans la plupart des pays d'Europe occidentale, résultant d'un plus faible taux d'emploi, découlant lui-même largement d'un plus faible âge légal de départ à la retraite.
La suppression de cette mesure se justifie d'autant plus que son coût est désormais de 300 millions d'euros en 2026 et 1,9 milliard d'euros en 2027, après que la suspension ait été étendue aux dispositifs de départ en retraite anticipé pour carrière longue, invalidité et incapacité, ainsi qu'aux territoires de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.
Or, la suppression par l'Assemblée nationale de l'article 44 tarit le financement initialement prévu de 1,5 milliard d'euros au titre de l'année 2027. Le présent article alourdit les dépenses de la branche vieillesse en surajoutant une dépense inique qui n'est désormais plus compensée.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté un amendement n° 716 visant à supprimer cet article. Cela permettra de poursuivre au rythme prévu la montée en charge de la réforme de 2003.
* 1 II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 2 III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 3 Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
* 4 Le ticket modérateur est, par ailleurs, entièrement pris en charge pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire définie à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
* 5 Article R. 871-2, sauf pour les frais liés aux cures thermales, à l'homéopathie, aux médicaments à faible service médical rendu ou traitant des pathologies sans caractère habituel de gravité.
* 6 Article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
* 7 C'est par exemple le cas des actes liés à une affection de longue durée exonérante, à une interruption volontaire de grossesse, des soins liés à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des frais de santé de la femme enceinte après le sixième mois de grossesse, des soins et frais hospitaliers à destination de nouveau-nés de moins d'un mois, des contraceptifs pour les femmes de moins de 26 ans, etc.
* 8 Article R. 160-6 du code de la sécurité sociale.
* 9 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 10 Décret n° 2024-113 du 16 février 2024, pour la participation forfaitaire, encadrant son montant entre deux et trois euros, complété par la décision du 21 mars 2024 fixant le taux de la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale fixant le montant de la participation forfaitaire à deux euros.
* 11 Article R. 160-19 du code de la sécurité sociale.
* 12 Article D. 160-7 du code de la sécurité sociale.
* 13 Article L. 160-15 du code de la sécurité sociale.
* 14 Article L. 160-15 du code de la sécurité sociale.
* 15 Article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 16 Article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
* 17 Article L. 169-2 du code de la sécurité sociale.
* 18 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 19 II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 20 Article D. 160-6 du code de la sécurité sociale.
* 21 Article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
* 22 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 23 Inspection générale des finances et inspection générale des affaires sociales, mars 2024, « Revue de dépenses : les dispositifs médicaux ».
* 24 Article D. 160-9 du code de la sécurité sociale.
* 25 Article D. 160-9 du code de la sécurité sociale.
* 26 Article D. 160-10 du code de la sécurité sociale. Des plafonds journaliers trouvent également à s'appliquer : ceux-ci sont de quatre euros pour les actes des auxiliaires médicaux et de huit euros pour les transports sanitaires.
* 27 Décret n° 2024-113 du 16 février 2024, pour la participation forfaitaire, encadrant son montant entre deux et trois euros, complété par la Décision du 21 mars 2024 fixant le taux de la participation forfaitaire des assurés sociaux aux frais de santé en application du II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale fixant le montant de la participation forfaitaire à deux euros.
* 28 Décret n° 2024-114 du 16 février 2024, pour la franchise médicale.
* 29 Voir infra.
* 30 Article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 31 Article D. 160-7 du code de la sécurité sociale.
* 32 Pour les années postérieures à 2019, des recouvrements sont toujours possibles, le délai de prescription n'étant pas échu.
* 33 Réponses écrites du SML au questionnaire de la rapporteure.
* 34 Réponses écrites de la CSMF au questionnaire de la rapporteure.
* 35 Réponses écrites de la CSMF au questionnaire de la rapporteure.
* 36 Réponses écrites de la FMF au questionnaire de la rapporteure.
* 37 Réponses écrites d'Avenir Spé - Le Bloc au questionnaire de la rapporteure.
* 38 Réponses écrites de MG France au questionnaire de la rapporteure.
* 39 Réponses écrites de la FMF au questionnaire de la rapporteure.
* 40 Article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
* 41 Article L. 5211-1 du code de la santé publique.
* 42 Section 2 du chapitre 2 du titre II de la LPP.
* 43 20° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
* 44 Article L. 165-2 du code de la sécurité sociale.
* 45 Section 2 du chapitre 2 du titre II de la LPP.
* 46 Décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025.
* 47 Il est également conseillé de conserver tout linge souillé dans un sac en papier et de le confier à un centre médico-judiciaire afin de collecter des preuves permettant l'identification du responsable de l'infraction et d'établir la matérialité des faits.
* 48 Fondation des femmes, Le coût de la justice pour les victimes de violences sexuelles, 2022.
* 49 Article 30 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
* 50 15° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 51 II de l'article R. 160-17 du code de la sécurité sociale.
* 52 Soit 5,41 euros à la charge de l'assuré ou de sa complémentaire santé.
* 53 I de l'article L. 160-13 et article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
* 54 Site internet du ministère de la santé.
* 55 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
* 56 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 57 Site internet du ministère de la santé.
* 58 Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 59 Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
* 60 Avec un taux d'incapacité inférieur à deux tiers.
* 61 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 62 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 63 Articles L. 160-9 et D. 160-3 du code de la sécurité sociale.
* 64 Article R. 160-17 du code de la sécurité sociale.
* 65 Article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale.
* 66 HAS, Avis sur la liste et les critères d'admission en ALD, décembre 2007.
* 67 Selon la Cnam, la progression des pathologies chroniques serait pour 55 % imputable au vieillissement de la population et pour 45 % à la hausse de leur prévalence par âge. Rapport Charges et produits pour 2026, p. 83.
* 68 Stratégie nationale de santé 2018-2022.
* 69 Article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 70 Article 29 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 71 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans (article 2 de l'arrêté du 28 mai 2024 relatif aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention).
* 72 Cnam, rapport Charges et produits pour 2025, juillet 2024, p. 99.
* 73 Cour des comptes, La santé respiratoire, un enjeu de santé environnement insuffisamment pris en compte, mai 2024, p. 59.
* 74 Inspection générale des finances (IGF) et inspection générale des affaires sociales (Igas), Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - Pour un dispositif plus efficient et équitable, juin 2024, p. 8.
* 75 Catégorie incluant : les maladies coronaires ; l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme cardiaque, les cardiopathies valvulaires et congénitales graves ; les artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; les accidents vasculaires cérébraux invalidants ; l'hypertension artérielle sévère.
* 76 Cnam, Rapport Charges et produits pour 2026, p. 103.
* 77 Ibid., p. 83.
* 78 Cour des comptes, La politique de prévention en santé, Les enseignements tirés de l'analyse de trois grandes pathologies, novembre 2021, p. 35.
* 79 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 80 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 81 4° de l'article L. 160-14 et article R. 160-12 du code de la sécurité sociale.
* 82 Ibid.
* 83 1° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
* 84 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 85 Inspection générale des finances (IGF) et inspection générale des affaires sociales (Igas), Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - Pour un dispositif plus efficient et équitable, juin 2024, p. 14.
* 86 Ibid., p. 1.
* 87 Réponses de la Cnam au questionnaire transmis par la rapporteure de la branche maladie.
* 88 Inspection générale des finances (IGF) et inspection générale des affaires sociales (Igas), Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - Pour un dispositif plus efficient et équitable, juin 2024, p. 1.
* 89 Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère de la liste es affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
* 90 Réponses de la Cnam au questionnaire transmis par la rapporteure de la branche maladie.
* 91 Le reste du coût correspond à l'exonération d'impôt sur le revenu sur les indemnités journalières et au surcoût du forfait « patientèle » des médecins traitants des patients en ALD.
* 92 Proposition n° 21 du rapport Charges et produits pour 2026, juillet 2025.
* 93 Recommandations n° 7 et n° 9 de la revue de dépenses relative aux affections de longue durée de l'IGF et de l'Igas, juin 2024.
* 94 Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention.
* 95 Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales.
* 96 Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base.
* 97 Article 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 98 Article L. 4012-1 du code de la santé publique.
* 99 Décret n° 2024-1035 du 15 novembre 2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés, et décret n° 2025-394 du 30 avril 2025 relatif à la liste des catégories de structures à coordonner des parcours coordonnés renforcés.
* 100 Article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 101 III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
* 102 Article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
* 103 Article D. 315-5 du code de la sécurité sociale.
* 104 Tel est l'objet du dernier alinéa qui modifie le 9° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
* 105 Article L. 4012-1 du code de la santé publique.
* 106 Amendements 23, 588, 593 et 1 829.
* 107 Audition par la commission des affaires sociales du Sénat de Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, et de Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, 29 octobre 2025.
* 108 Article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 109 Cette liste comprend les vaccinations suivantes : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, contre la coqueluche, contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, contre le virus de l'hépatite B, contre les infections invasives à pneumocoque, contre les méningocoques des sérogroupes AWCY et B conformément à l'article R. 3111-2-1, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
* 110 Article R. 3111-2 du code de la santé publique.
* 111 Décret n° 2024-694 du 5 juillet 2024 relatif à l'obligation vaccinale contre les méningocoques de type B et ACWY.
* 112 Article L. 3111-4 du code de la santé publique.
* 113 Article L. 3111-6 du code de la santé publique.
* 114 Article L. 3112-1 du code de la santé publique.
* 115 Peuvent être suspendues par décret les obligations vaccinales précitées, mentionnées aux articles L. 3111-2, L. 3111-4 et L. 3111-6 du code de la santé publique, ainsi que l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG prévue à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique.
* 116 L'article 4 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a remplacé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France par le Haut Conseil de la santé publique.
* 117 Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 19 mai 2006 relatif à la mise en oeuvre de la protection individuelle contre la grippe des professionnels visés à l'article L 3111-4 du code de la santé publique par une obligation vaccinale.
* 118 Article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 119 HAS, Actualisation des recommandations et obligations vaccinales des professionnels, juillet 2023, p. 20.
* 120 Étude d'impact du Gouvernement accompagnant le PLFSS pour 2026.
* 121 Données communiquées par Santé publique France, Rougeole : appel à la vigilance renforcée face à la recrudescence des cas en France et en Europe, mars 2025.
* 122 En 2009 et 2010, la pandémie de grippe A (H1N1) fut ainsi responsable de 280 000 morts.
* 123 Santé publique France, Données pour les 18-75 ans résidant en France hexagonale, bulletin vaccination, édition nationale, 28 avril 2025.
* 124 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 125 HAS, Actualisation des recommandations et obligations vaccinales des professionnels, juillet 2023, p. 11.
* 126 Réponse de la DGS au questionnaire transmis par la rapporteure : médecins généralistes, gynécologues, pédiatres, cardiologues, endocrinologues, gériatres, néphrologues, pneumologues, rhumatologues, infirmier(e)s, sage-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens titulaires d'officine et chirurgiens-dentistes, pédicures-podologues et orthophonistes.
* 127 Santé publique France, Études de couverture vaccinale contre la grippe et la Covid-19 des résidents, saison 2024-2025, 18 juillet 2025.
* 128 Santé publique France, enquête IRAPrev : adhésion vaccinale des séniors aux vaccins contre les infections respiratoires aigües, 7 octobre 2025.
* 129 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 130 Le vaccin DTP est également remboursé à 65 % par l'assurance maladie pour les personnes âgées de plus de 65 ans.
* 131 Article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
* 132 I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
* 133 Premier alinéa de l'article L. 31 111-4 du code de la santé publique.
* 134 Les professions mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique sont les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, préparateurs en pharmacie et physiciens médicaux, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaires et les assistants de régulation médicale.
* 135 Les professions mentionnées au livre IV du code de l'action sociale et des familles sont les assistants de service social, les assistants maternels et assistants familiaux, les éducateurs et aides familiaux, les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs et permanents des lieux de vie.
* 136 Un doute peut toutefois subsister sur l'intention du Gouvernement quant à cette échéance, en raison d'une erreur rédactionnelle de l'article ayant conduit à regrouper les alinéas 17 à 26 sous un 4° et non sous un 5°.
* 137 c du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique.
* 138 Article L. 1423-2 du code de la santé publique.
* 139 Article L. 1435-8 du code de la santé publique.
* 140 Le montant des crédits à prévoir en PLFSS pour l'année 2027 s'élèverait à 18,3 millions d'euros.
* 141 Dernier alinéa de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique.
* 142 Cette modification s'explique par l'évolution des recommandations de la HAS, qui a préconisé en mars 2025 un rattrapage transitoire de la vaccination des enfants entre 2 et 5 ans.
* 143 Amendements 1231 et 2504.
* 144 Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
* 145 Article L. 6147-3 d code de la santé publique.
* 146 Article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
* 147 CFDT Santé sociaux, CGT, Unsa.
* 148 4° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique.
* 149 IGF, La régulation du réseau des pharmacies d'officine, octobre 2016.
* 150 DGS-Urgent n° 2021-45, 24 avril 2021.
* 151 Article L. 3221-1 du code de la santé publique.
* 152 Morbihan, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Landes.
* 153 Article 78 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 154 À partir de trois ans en application de l'article R. 162-64 du code de la sécurité sociale.
* 155 Il est à noter que l'arrêté du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue ouvre le dispositif aux patients sous antidépresseurs depuis moins de six mois.
* 156 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
* 157 Article R. 162-66 du code de la sécurité sociale.
* 158 Décret n° 2025-424 du 13 mai 2025 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.
* 159 Article R. 162-65 du code de la sécurité sociale.
* 160 Articles L. 162-58 et R. 162-65 du code de la sécurité sociale.
* 161 Article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
* 162 Article R. 162-60 du code de la sécurité sociale.
* 163 Article 4 de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche.
* 164 Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositif « Mon soutien psy », 27 mars 2025.
* 165 Article 66 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 166 Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturations et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique.
* 167 Article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
* 168 Article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
* 169 Articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
* 170 Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique.
* 171 Notamment lors de la dernière LFSS.
* 172 Proposition de loi n° 1158 déposée par les députés Laurent Panifous, Jean-Louis Bricout, Benjamin Saint-Huile, David Taupiac, Bertrand Pancher, Jean-Félix Acquaviva, Nathalie Bassire, Michel Castellani, Paul-André Colombani, Béatrice Descamps, Stéphane Lenormand, Max Mathiasin, Paul Molac, Christophe Naegelen, Estelle Youssouffa.
* 173 Article 40 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 174 11° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
* 175 Article L. 162-59 du code de la sécurité sociale.
* 176 Décret n° 2023-1427 du 30 décembre 2023 relatif à l'information sur certains produits de protection intime.
* 177 Inserm, Salles de consommation à moindre risque en France : rapport scientifique, mai 2021.
* 178 Inspection générale des affaires sociales, Les haltes soins addictions : un dispositif expérimenté depuis 2016 pour réduire les risques et nuisances associés à la consommation de stupéfiants dans l'espace public, octobre 2024.
* 179 Pôle de santé publique des Hospices civils de Lyon, Évaluation des haltes soins addictions, mai 2025.
* 180 Articles 222-7 à 222-14-1 du code pénal pour le détail des peines encourues.
* 181 Résultats de l'enquête 2022 sur la soumission chimique du centre d'addictovigilance de Paris.
* 182 Article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 183 Article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 184 Article 78 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 185 À partir de trois ans en application de l'article R. 162-64 du code de la sécurité sociale.
* 186 Il est à noter que l'arrêté du 24 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue ouvre le dispositif aux patients sous antidépresseurs depuis moins de six mois.
* 187 Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturations et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique.
* 188 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
* 189 Article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
* 190 Article R. 162-65 du code de la sécurité sociale.
* 191 Article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
* 192 Articles L. 162-58 et R. 162-65 du code de la sécurité sociale.
* 193 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 59).
* 194 Le dispositif a été étendu aux personnes en cours de traitement par la loi n° 2025-106 du 5 février 2025 visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie (article 1er).
* 195 INCa, La vie cinq ans après le diagnostic de cancer, juin 2018.
* 196 Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
* 197 Audition du 22 janvier 2025.
* 198 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
* 199 Article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 200 Rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, déposé le 1er avril 2025.
* 201 Article 11 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
* 202 Cour des comptes, La pédopsychiatrie - Un accès et une offre de soins à réorganiser, Communication à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, mars 2023.
* 203 Rapport de Bernard Bonne, Protection de l'enfance : mieux appliquer les lois pour mieux protéger, rapport n° 837 (2022-2023) commission des affaires sociales du Sénat.
* 204 Gouvernement, Pacte de lutte contre les déserts médicaux, 25 avril 2025.
* 205 Cour des comptes, L'organisation territoriale des soins de premier recours, mai 2024, p. 36.
* 206 La réduction de la proportion de personnes en ALD sans médecin traitant est devenue une priorité d'action de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec des premiers résultats dont elle fait état dans son rapport de propositions « Charges et produits » pour 2026.
* 207 Drees, Études et résultats, « Les deux tiers des généralistes déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant », n° 1267, mai 2023.
* 208 Drees, ibid.
* 209 Drees, Démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2025, communiqué de presse.
* 210 Cour des comptes, Organisation territoriale des soins de premier recours, mai 2024, p. 24.
* 211 Cour des comptes, Organisation territoriale des soins de premier recours, mai 2024, p. 24.
* 212 Sénat, rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi tendant à préserver l'accès aux pharmacies dans les communes rurales, G. Pantel, 3 avril 2024.
* 213 Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Démographie des pharmaciens : panorama 2022, juillet 2023, p. 47.
* 214 Institut national de la statistique et des études économiques, Bilan démographique 2023.
* 215 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 216 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie.
* 217 Décret n° 2024-756 du 7 juillet 2024 relatif aux conditions de détermination des territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante.
* 218 Article 95 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'amélioration et de simplification de l'action publique.
* 219 T. Mesnier, Assurer le premier accès aux soins, Organiser les soins non programmés dans les territoires, rapport remis à Madame la ministre des solidarités et de la santé, mai 2018.
* 220 C. Imbert, B. Jomier, O. Henno, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales, septembre 2024.
* 221 La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 a notamment élargi le périmètre des protocoles de coopération entre professionnels de santé et étendu les compétences de prescription des sages-femmes et des masseurs-kinésithérapeutes. Elle a aussi consacré la mise en oeuvre du service d'accès aux soins (SAS), qui vise à organiser l'accès aux soins non programmés en améliorant l'orientation des patients.
* 222 La loi n° 2021-502 du 19 mai 2023 a autorisé l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux masseurs-kinésithérapeutes ainsi qu'aux orthophonistes, sous certaines conditions. Elle a élargi les compétences des infirmiers en matière de prévention et de traitement des plaies, et leur a permis de prescrire certains examens complémentaires et produits de santé. Elle a également autorisé les pharmaciens à renouveler des ordonnances expirées concernant le traitement d'une pathologie chronique.
* 223 Article 37 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023.
* 224 Article 41 de la LFSS pour 2023.
* 225 Article 111 de la LFSS pour 2023.
* 226 La médecine générale se distinguait comme l'unique spécialité dont la durée du troisième cycle demeurait inférieure à quatre ans. La création d'une phase de consolidation d'une durée d'un an fait passer la durée du troisième cycle de médecine générale de trois à quatre ans.
* 227 Article 37 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 228 Cet article serait rétabli au sein d'une sous-section comportant diverses dispositions relatives notamment aux modalités de remboursement par l'assurance maladie des honoraires et rémunérations des praticiens non conventionnés et à l'interdiction de dépassements d'honoraires pour certaines catégories de patients.
* 229 Article D. 161-13-3 du code de la sécurité sociale.
* 230 La part correspondant au montant pris en charge par l'assurance maladie obligatoire serait versée par la caisse primaire d'assurance maladie au CHU.
* 231 1° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique, et arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé.
* 232 3° de l'article D. 6153-1-8 du code de la santé publique, et arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors.
* 233 Décret n° 2025-850 du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale, et arrêté du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale.
* 234 Ces zones correspondent aux zones rouges du Pacte de lutte contre les déserts médicaux présenté par le gouvernement le 25 avril 2025.
* 235 Articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique.
* 236 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 237 Réponse de la DGOS au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 238 Respectivement, chapitres III, III bis, III ter et III quater.
* 239 Sénat, rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont le Sénat est saisi en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, tome II, 13 novembre 2024 (article 15 bis).
* 240 Amendement 2668.
* 241 Amendement 622.
* 242 Amendement 623.
* 243 Amendement 2516 rect.
* 244 Amendement 1856.
* 245 Amendement 1407.
* 246 Amendement 1410.
* 247 Arrêté n° 2021/001 portant autorisation de l'expérimentation « Orientation dans le Système de Soins (Osys) » du directeur général de l'ARS Bretagne du 18 février 2021.
* 248 Conjonctivite, petites plaies, brûlures superficielles, piqûres de tique, cystites et maux de gorge.
* 249 Guylène Pantel, rapport n° 502 (2023-2024) sur la proposition de loi tendant à préserver l'accès aux pharmacies dans les communes rurales, commission des affaires sociales, 3 avril 2024.
* 250 L'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation des parcours de soins, le développement d'actions territoriales de prévention, la participation à la réponse aux crises sanitaires graves, le développement de la qualité et de la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. Les quatre premières sont obligatoires.
* 251 Article L. 1434-12 du code de la santé publique.
* 252 Corinne Imbert et Bernard Jomier, Financement des CPTS : pour un contrôle au service de l'action des professionnels de santé, rapport d'information n° 32 (2025-2026), commission des affaires sociales, 15 octobre 2025.
* 253 Corinne Imbert et Bernard Jomier, Financement des CPTS : pour un contrôle au service de l'action des professionnels de santé, rapport d'information n° 32 (2025-2026), commission des affaires sociales, 15 octobre 2025.
* 254 Article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 2023 et transmise au Sénat.
* 255 Corinne Imbert, rapport sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, n° 576 (2024-2025, commission des affaires sociales du Sénat, 6 mai 2025.
* 256 Ibid.
* 257 Article L. 1411-6-2 du code de la santé publique.
* 258 Arrêté du 28 mai 2024 aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention.
* 259 Ce dispositif consiste en l'organisation de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle destinées aux femmes en situation de handicap résidant dans certains établissements médicosociaux. Il est codifié à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique.
* 260 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 261 Articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la LFSS pour 2020.
* 262 Au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
* 263 Article L. 1435-4-2 du code de la santé publique.
* 264 Article R. 1435-9-1 du code de la santé publique.
* 265 Article R. 1435-9-1 du code de la santé publique.
* 266 Article R. 4135-9-6 du code de la santé publique.
* 267 Article L. 1435-4-2 du code de la santé publique.
* 268 Article R. 1435-9-9 du code de la santé publique.
* 269 Article R. 1435-9-10 du code de la santé publique.
* 270 Article L. 4132-2 du code de la santé publique.
* 271 Article 38 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 272 Article 1er de l'arrêté du 2 février 2021 relatif au contrat type du contrat de début d'exercice
* 273 Les honoraires trimestriels minimaux pour ouvrir droit à la garantie de revenus correspondent à 50 % de la rémunération garantie ci-dessous.
* 274 Article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale.
* 275 Articles 26-1 à 26-3 de la convention médicale approuvée par l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 276 Article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.
* 277 Rapport d'information n° 1649 déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de l'évaluation présenté par Mme Farida Amrani, M. Hadrien Clouet, M. Thierry Frappé, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Yannick Monnet, M. Jean-François Rousset et Mme. Annie Vidal, Députés, p.55, 30 juin 2025.
* 278 Les troubles du neuro-développement regroupent les troubles du spectre de l'autisme (TSA), les troubles du développement intellectuel (TDI), le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et les troubles Dys (troubles de la communication, des apprentissages, et troubles moteurs).
* 279 Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neuro-développement, Guidance parentale dans les troubles du neurodéveloppement, septembre 2025.
* 280 Haute Autorité de santé, Recommandation de bonne pratique « Troubles du neurodéveloppement : repérage et orientation des enfants à risque », février 2020.
* 281 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 62).
* 282 Les PCO sont portées par des structures désignées par les directeurs généraux des ARS parmi les établissements et services médico-sociaux spécialisés.
* 283 Article L. 2135-1 du code de la santé publique.
* 284 Assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l'assurance maladie pour 2025, juillet 2024.
* 285 Article L. 4364-1 du code de la santé publique.
* 286 Article D. 4364-2 du code de la santé publique.
* 287 Aux termes de l'article D. 4364-2, « l'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations ».
* 288 Article D. 4364-3 du code de la santé publique.
* 289 Ou de l'extrémité distale de la jambe, voire du pied et de l'extrémité distale associée.
* 290 Aux termes de l'article D. 4363-3 du code de la santé publique, « l'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations ».
* 291 Pour ces professionnels, en application de l'article D. 4363-6 du code de la santé publique, « l'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations ».
* 292 Article D. 4363-6 du code de la santé publique.
* 293 Article L. 4364-1 du code de la santé publique.
* 294 Article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
* 295 Article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.
* 296 Article L. 4301-1 et R. 4301-3 du code de la sécurité sociale.
* 297 Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier.
* 298 Article L. 4311-1 du code de la santé publique.
* 299 Article L. 4321-1 du code de la santé publique.
* 300 Article L. 4341-1 du code de la santé publique.
* 301 Article L. 4342-1 du code de la santé publique.
* 302 Article L. 4322-1 du code de la santé publique.
* 303 Article R. 4322-1 du code de la santé publique.
* 304 Article R. 6322-1 du code de la santé publique.
* 305 Médecins, n° 94, nov.-déc. 2024.
* 306 Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.
* 307 Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins.
* 308 Article R. 6322-2 du code de la santé publique.
* 309 Article R. 6322-4 du code de la santé publique.
* 310 Articles L. 6322-1 et R. 6322-15 à R. 6322-29 du code de la santé publique.
* 311 Article L. 6324-2 du code de la santé publique.
* 312 Et à son représentant légal si la personne est mineure.
* 313 Article L. 6322-2 du code de la santé publique.
* 314 Article L. 1151-2 du code de la santé publique.
* 315 Article L. 1151-3 du code de la santé publique.
* 316 Article L. 1152-2 du code de la santé publique.
* 317 Article L. 1152-1 du code de la santé publique. La suspension peut être portée à cinq ans en cas d'absence de mise en conformité au cours de la première suspension.
* 318 DU de techniques d'injection et de comblement en chirurgie plastique et maxillo-faciale, DU d'implantation capillaire, etc.
* 319 Site internet du Cnom.
* 320 Article L. 224-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er octobre 2025.
* 321 Décret n° 2025-599 du 30 juin 2025 relatif à l'organisation du service du contrôle médical.
* 322 Articles R. 723-126 à D. 723-153 du code rural et de la pêche maritime.
* 323 Article D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime.
* 324 Inspection générale des affaires sociales, n° 2023-023R1, « L'organisation du service du contrôle médical de l'Assurance maladie », janvier 2024.
* 325 Article R. 315-9 du code de la sécurité sociale.
* 326 Article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 327 Décret n° 2023-737 du 8 août 2023, concernant les sages-femmes.
* 328 Décret n° 2023-736 du 8 août 2023, concernant les autres professionnels.
* 329 I de l'article 1er de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, codifié au 3° du II de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
* 330 Pour les assurés et ayant droits de 16 ans et plus.
* 331 Article 18-3 de la convention nationale organisant les relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 332 Article 18-2 de la convention susmentionnée.
* 333 Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2005 fixant le montant de la majoration prévue à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
* 334 Article 6 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 335 En application des articles L.162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15 du code de la sécurité sociale.
* 336 Article 18 de la convention nationale organisant les relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée l'arrêté du 20 juin 2024 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 337 Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
* 338 Voir, à ce titre, le rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires, rapporteure Corinne Imbert, 6 mai 2025.
* 339 Voir, à ce titre, le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation du système de santé et les difficultés d'accès aux soins, rapporteur Christophe Naegelen, 3 juillet 2025.
* 340 Pacte de lutte contre les déserts médicaux, présentation par le Premier ministre du plan d'action pour renforcer l'accès aux soins des Français, dossier de presse, avril 2025, p. 11.
* 341 Conseil national de l'ordre des médecins, Atlas démographique, 2025, p. 15 et 17.
* 342 Ibid, p. 81.
* 343 Dossier de presse du pacte de lutte contre les déserts médicaux, p. 12.
* 344 Données issues de l'Observatoire de l'accès aux soins de l'assurance maladie « Data ameli ».
* 345 Drees, « Les deux tiers des généralistes déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecin traitant », Études & Résultats, n° 1267, mai 2023.
* 346 Article L. 6323-1 du code de la santé publique.
* 347 Sénat, rapport d'information n° 137 fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, relatif aux inégalités territoriales d'accès aux soins, rapporteur Bruno Rojouan, 13 novembre 2024, p. 68.
* 348 Article L. 6323-3 du code de la santé publique.
* 349 Irdes, « Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes dans les zones sous-dotées en offre de soins ? », Questions d'économie de la Santé, n° 247, mars 2020, p. 3.
* 350 Cour des comptes, Organisation territoriale des soins de premier recours, mai 2024, p. 55.
* 351 Article 64 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 352 Article L. 1434-2 du code de la santé publique.
* 353 Article 65 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 354 Cour des comptes, op. cit., p. 56.
* 355 Assurance maladie, page web « Difficile de trouver un médecin traitant ? Les organisations coordonnées territoriales peuvent aider », 26 février 2025, url : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/organisations-coordonnees-territoriales.
* 356 Voir, à ce titre, le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation du système de santé et les difficultés d'accès aux soins, rapporteur Christophe Naegelen, 3 juillet 2025.
* 357 Pour des développements sur les IPA, voir, notamment, l'audit flash de la Cour des comptes, Les infirmiers en pratique avancée, une évolution nécessaire, des freins puissants à lever, juillet 2023.
* 358 Article 28 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
* 359 Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant.
* 360 Article 15 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
* 361 Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent.
* 362 Avec une abrogation partielle par le Conseil d'État par la décision n° 497270 du 22 juillet 2025 du Conseil d'État statuant au contentieux.
* 363 Article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale.
* 364 Ces objectifs correspondent aux catégories citées au a) et d) du 1° du I de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
* 365 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 366 Expérimentations introduites par l'article 51 de la LFSS pour 2018.
* 367 Article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale.
* 368 Article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
* 369 Articles L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale.
* 370 Article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
* 371 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
* 372 Article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale.
* 373 Article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale.
* 374 Tel que modifié par l'article 34 de la LFSS pour 2020.
* 375 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
* 376 Réponses de la direction générale de l'offre de soins au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 377 Articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.
* 378 Article R. 6145-25 du code de la santé publique.
* 379 Article D. 6154-10-3 du code de la santé publique.
* 380 Cour des comptes, Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité, octobre 2023.
* 381 Cnam, Rapport charges et produits pour 2026, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025.
* 382 La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas examiné cet amendement.
* 383 La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas examiné cet amendement.
* 384 Article R. 523-2 du code de la mutualité (abrogé).
* 385 Arrêté du 19 septembre 1962 fixant les conditions de la participation de l'État a la couverture des risques sociaux assures par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'État et des établissements publics nationaux.
* 386 Le cadre juridique permettait également la mise à disposition de locaux ou de personnels à ces mutuelles.
* 387 Conseil d'État, 1re-6e sous-sect. réunies, 26 sept. 2005, n° 270 234.
* 388 Demande de la Commission européenne, C(2005) 2712, 20 juillet 2005, Aides à la Mutualité Fonction Publique et ses mutuelles membres, cas E 21/2004.
* 389 Concernant l'article R- 523-2 du code de la mutualité, par l'article 1 du décret n° 2006-689 du 13 juin 2006 portant modification du code de la mutualité. Concernant l'arrêté « Chazelle », par l'article 1 de l'arrêté du 13 juin 2006 portant abrogation de l'arrêté du 19 septembre 1962 relatif aux conditions de la participation de l'État à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'État et des établissements publics nationaux.
* 390 Article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le Pors ».
* 391 Article 39 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
* 392 Article 38 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
* 393 Décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
* 394 I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
* 395 Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
* 396 Voir infra.
* 397 Article premier de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
* 398 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salarié.
* 399 Article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
* 400 Articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et D. 911-7 du code de la sécurité sociale.
* 401 Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
* 402 Article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
* 403 Article L. 722-1 du code général de la fonction publique.
* 404 Article L. 722-2 du code général de la fonction publique.
* 405 Article 12 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, codifié à l'article L. 6152-2 du code de la santé publique.
* 406 Inspections générales des finances et des affaires sociales, La protection sociale complémentaire des agents publics - Rapport spécifique à la fonction publique hospitalière, 2019, p. 49.
* 407 Direction générale de l'administration et de la fonction publique, rapport Fonction publique - Chiffres clés 2024, 2024.
* 408 Chambre sociale, 13 décembre 2001, n° 00-13 509 et 00-13 673, publié au bulletin et Chambre civile 2, 17 juin 2003, n° 01-20 777, inédit.
* 409 Inspections générales des finances et des affaires sociales, La protection sociale complémentaire des agents publics - Rapport spécifique à la fonction publique hospitalière, 2019, p. 29.
* 410 Respectivement 39 %, 22 % et 33 % pour les centres hospitaliers universitaires ou régionaux.
* 411 Ibid, p. 27.
* 412 Ibid, p. 32.
* 413 Ibid, p. 28.
* 414 Ibid, p. 3.
* 415 Article L. 733-2 du code général de la fonction publique.
* 416 Anciennement prestation « maladie ».
* 417 CGOS, chiffres clés de 2024.
* 418 Voir le rapport n° 587 de la commission d'enquête sénatoriale sur la situation de l'hôpital et le système de santé en France, rapporteure Catherine Deroche, 29 mars 2022.
* 419 Direction générale de l'administration et de la fonction publique, L'exposition aux risques professionnels - Édition 2025.
* 420 I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
* 421 Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
* 422 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, abrogée par le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
* 423 Articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. L'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 prévoyant les dates d'entrée en vigueur des dispositions n'ont cependant pas été introduites dans le code général de la fonction publique.
* 424 Article L. 827-3 du code général de la fonction publique.
* 425 Article L. 827-1 du code général de la fonction publique.
* 426 II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
* 427 Article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
* 428 Les contrats collectifs sont obligatoirement proposés par les employeurs de l'État, avec souscription obligatoire des agents, sauf situations particulières.
* 429 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires.
* 430 Article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
* 431 Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'État, appliqué par l'article 11 du décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'État.
* 432 Article L. 827-11 du code général de la fonction publique.
* 433 Alinéa 3 de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique.
* 434 Article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
* 435 2° du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
* 436 3° du I du même article.
* 437 4° du même article.
* 438 Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État du 26 janvier 2022.
* 439 Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État.
* 440 Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'État.
* 441 Article 196 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 442 Article 160 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 443 Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement.
* 444 Accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux du 11 juillet 2023.
* 445 Réponse écrite de la CFDT au questionnaire de la rapporteure.
* 446 La ministre a précisé que le ministre de la fonction publique David Amiel les avait également reçues.
* 447 Réponse écrite de la FHF au questionnaire de la rapporteure.
* 448 Réponse écrite de la CFDT au questionnaire de la rapporteure.
* 449 Direction générale de l'administration et de la fonction publique, rapport Fonction publique - Chiffres clés 2024, 2024.
* 450 Contribution écrite de la FHF.
* 451 Réponses écrites de la FHF au questionnaire de la rapporteure.
* 452 Assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025.
* 453 Commission des affaires sociales, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024) déposé le 25 septembre 2024.
* 454 Commission des affaires sociales, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024) déposé le 25 septembre 2024.
* 455 Audition de Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, 22 octobre 2025.
* 456 Assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025.
* 457 Igas-IGF, Pertinence et efficience des dépenses de radiologie, mai 2025.
* 458 Igas IGF, Causes et effets de la financiarisation du système de santé, mai 2025.
* 459 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, juillet 2025.
* 460 Drees, Les revenus libéraux et salariés des médecins ayant une activité libérale en France en 2021, décembre 2024.
* 461 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, juin 2021.
* 462 Igas-IGF, Pertinence et efficience des dépenses de radiologie, mai 2025.
* 463 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2022.
* 464 Commission des affaires sociales, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024) déposé le 25 septembre 2024.
* 465 Le secteur public ou privé non lucratif facture à l'assurance maladie son activité de radiothérapie - les séances de préparation ou d'irradiation - selon des tarifs associés à des groupements homogènes de séjours (GHS).
* 466 Le secteur libéral, les structures facturent à l'acte selon la classification commune des actes médicaux (CCAM), sur le fondement, pour les séances d'irradiation, d'une codification inchangée depuis 2004.
* 467 Maladie rénale chronique, Prévenir - Mieux prendre en charge - Générer des économies, SFNDT et autres, mars 2024.
* 468 Réponse de la SFNDT au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 469 Réponse de la Société française de radiothérapie oncologique au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 470 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l'assurance maladie pour 2025, juillet 2024.
* 471 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l'assurance maladie pour 2026, juillet 2025.
* 472 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l'assurance maladie pour 2023, juillet 2022.
* 473 Relatif à la liste des actes ouvrant droit à une prise en charge par l'assurance maladie.
* 474 Par exemple, aucun cahier des charges permettant les développements logiciels nécessaires à la prise en compte des nouvelles spécification techniques n'a été publié.
* 475 Igas-IGF, Pertinence et efficience des dépenses de radiologie, mai 2025.
* 476 Amendement n° 2526 présenté par le rapporteur général et sous-amendement n° 2670 du Gouvernement.
* 477 Amendement n° 2529.
* 478 Amendement n° 1273.
* 479 Amendement n° 984.
* 480 Amendement n° 652.
* 481 Amendement n° 741 présenté par Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues.
* 482 Audition de Thomas Fatôme, Directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, 22 octobre 2025.
* 483 Igas-IGF, Causes et effets de la financiarisation du système de santé, mai 2025.
* 484 D'après la Cnam, les dispositifs de régulation négociés ont ainsi permis de réaliser, entre 2014 et 2021, 545 millions d'euros d'économies.
* 485 Amendement n° 651 présenté par Sandrine Runel et les membres du groupes socialistes et apparentés.
* 486 Mesure la part du chiffre d'affaires restant après prise en compte des coûts directs et avant amortissements et provisions.
* 487 Mesure le bénéfice final après prise en compte de l'ensemble des charges et produits de l'entreprise.
* 488 Drees, Les dépenses de santé en 2024, édition 2025.
* 489 Commission des affaires sociales du Sénat, rapport de Mme Guylène Pantel sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dentaires (n° 84 (2025-2026)), déposé le 28 octobre 2025.
* 490 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l'assurance maladie pour 2026, juillet 2025.
* 491 Drees, Les dépenses de santé pour 2024, édition 2025.
* 492 Article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale.
* 493 Article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
* 494 Arrêté du 29 septembre 2025 portant approbation du protocole d'accord sur la maîtrise des dépenses de transports sur le champ du transport sanitaire.
* 495 Audition de Thomas Fatôme par la commission des affaires sociales, 22 octobre 2025.
* 496 Convention nationale des chirurgiens-dentistes libéraux pour la période 2023-2028 du 21 juillet 2023.
* 497 Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, rapport de M. Thomas Bazin sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 498 Amendement n° 1086 présenté par Ségolène Amiot et plusieurs de ses collègues.
* 499 Assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance maladie pour 2026, juillet 2025.
* 500 Drees, Les dépenses de santé en 2024, édition 2025.
* 501 Cnam, rapport Charges et produits pour 2026, p. 51.
* 502 Les dépassements d'honoraires, 10 propositions pour en sortir, rapport au Premier ministre des députés Y. Monnet et J-F. Rousset, octobre 2025, p. 22.
* 503 Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières.
* 504 Ibid., p. 26.
* 505 Sondage réalisé par Opinonway pour le journal Les Échos et Harmonie Mutuelle.
* 506 Sécurité sociale, rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale, données 2025.
* 507 HCAAM, Les dépassements d'honoraires des médecins : état des lieux, octobre 2025, p. 79.
* 508 Arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011.
* 509 Les dépassements d'honoraires, 10 propositions pour en sortir, rapport au Premier ministre des députés Y. Monnet et J-F. Rousset, octobre 2025.
* 510 Tarif compris entre 0,43 euro et 0,61 euro pour une consultation chez un généraliste, et entre 0,85 euro et 1,22 euro pour une consultation chez un médecin spécialiste.
* 511 Article R. 4127-53 du code de la santé publique.
* 512 Articles L. 4121-1 et L. 4122-2 du code de la santé publique.
* 513 Article 3 de la convention nationale signée le 26 juillet 2011 signée entre les syndicats de médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 514 Article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
* 515 Article R. 147-13 du code de la sécurité sociale.
* 516 Précédemment, l'interdiction s'appliquaient pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé.
* 517 Article L. 646-1 du code de la sécurité sociale.
* 518 Article L. 646-3 du code de la sécurité sociale.
* 519 Article 38-1-1. « Titres donnant accès au secteur à honoraires différents », arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecin libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016.
* 520 Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel a été supprimé lors de la réforme du statut de praticien hospitalier, avec le décret n° 2022-134 du 5 février 2022.
* 521 Le montant de la prime tient compte du montant des honoraires réalisés à tarifs opposables, du taux de charges de la spécialité et du niveau de respect des engagements.
* 522 Le partage des gains consiste à faire bénéficier les praticiens adhérents d'une partie des revalorisations tarifaires des actes lorsque leur base de remboursement évolue.
* 523 3° de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale.
* 524 Ces exclusions sont les suivantes : revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des praticiens et de la participation à la permanence des soins.
* 525 2° de l'article L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale.
* 526 Amendements 483, 783, 948 et 2533.
* 527 L'étude d'impact du Gouvernement fait état de recettes nettes évaluées à 200 millions d'euros, sans que l'hypothèse de taux employé ne soit précisée.
* 528 HCAAM, Les dépassements d'honoraires des médecins : état des lieux, octobre 2025, p. 13.
* 529 Ibid., p. 79.
* 530 Arrêté du 1er décembre 2006 modifiant l'arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d'autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l'absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux.
* 531 Amendement n° COM-139 à l'article 17 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
* 532 VIII de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
* 533 Rapport remis au Premier ministre par MM. Yannick Monnet et Jean-François Rousset, Dépassements d'honoraires : 10 propositions pour en sortir, octobre 2025.
* 534 Haute autorité de santé, Avis sur le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu par les inhibiteurs de la pompe à protons, novembre 2020.
* 535 Zeinep Or (Irdes), Julie Cartailler (Irdes), Morgane Le Bail (HAS, Irdes), Atlas des variations de pratiques médicales. Recours à onze interventions chirurgicales. Édition 2023, février 2024.
* 536 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), avril 2025.
* 537 Article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.
* 538 Article L162-23-15 du code de la sécurité sociale.
* 539 Igas, Financer la qualité des soins dans les établissements de santé : un levier pour redonner du sens aux soignants, juillet 2024.
* 540 2 785 519 euros au titre des activités MCO, 80 393 euros au titre des activités SMR et 252 252 euros au titre des activités de psychiatrie.
* 541 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 542 A-L. Biotteau (Dares) et C. Dixte (Drees), À l'hôpital, un taux de recours faible à l'intérim mais en nette hausse depuis six ans, n° 50, septembre 2023.
* 543 Annexe 9 au PLFSS pour 2025.
* 544 Arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d'une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées.
* 545 Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
* 546 Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
* 547 Cour des comptes, Intérim médical et permanence des soins dans les hôpitaux publics, janvier 2024.
* 548 Ce qu'il est possible de déduire de l'article L. 1226-1-2 du code du travail.
* 549 Un cadre plus strict enserre néanmoins l'indemnisation des arrêts de travail prolongé, cf. infra.
* 550 Article D. 331-1 du code de la sécurité sociale.
* 551 Article D. 323-5 du code de la sécurité sociale.
* 552 Article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale.
* 553 Article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.
* 554 Article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
* 555 Cf. infra.
* 556 Article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
* 557 Ces conditions ne s'appliquent naturellement pas aux non-salariés agricoles ni aux travailleurs indépendants.
* 558 Article L. 1226-1 du code du travail.
* 559 Article R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
* 560 Articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
* 561 Article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.
* 562 Article 65 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 563 Article 54 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 564 Alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.
* 565 Article L. 6316-1 du code de la santé publique.
* 566 Ancienne rédaction de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
* 567 Article D. 331-2 du code de la sécurité sociale.
* 568 Article D. 323-5 du code de la sécurité sociale.
* 569 Article 6 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
* 570 Article L. 4624-2-3 du code du travail et R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 571 Article R. 4624-32 du code du travail.
* 572 Article R. 4624-31 du code du travail.
* 573 Les services de santé au travail en agriculture pour les salariés agricoles.
* 574 Article R. 4624-31 du code du travail
* 575 Lors d'un arrêt de travail prescrit à l'occasion d'une cure thermale, les indemnités journalières ne sont pas dues en vertu de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent toutefois être versées après accord préalable de l'assurance maladie si les ressources de l'assuré sont inférieures à un plafond, aux termes de l'article D. 323-1 du même code.
* 576 Article L. 311-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
* 577 L. 323-1 du code de la sécurité sociale, pour les assurés du régime général et des régimes alignés.
* 578 Douze mois pour les régimes général, des salariés agricoles et des indépendants.
* 579 Articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour les assurés du régime général. Pour les assurés du régime général, il convient, lorsque l'arrêt est inférieur à six mois, d'avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ou d'avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période. Lorsque l'arrêt est supérieur à six mois, il faut justifier, à la date d'interruption de travail, d'une affiliation à un régime de sécurité sociale (CPAM, MSA) depuis 12 mois au moins et avoir travaillé au moins 600 heures les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l'arrêt ou avoir cotisé, pendant les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période. Ces dernières conditions s'appliquent également aux travailleurs discontinus ou saisonniers, en vertu de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale.
* 580 L'indemnité journalière n'est par exemple pas versée aux indépendants dont le revenu annuel d'activité moyen sur les trois dernières années est inférieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
* 581 Articles L. 323-6 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et assimilé, article D. 732-2-9 du code rural et de la pêche maritime pour les adaptations pour les non-salariés agricoles.
* 582 Article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
* 583 En vertu de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, les sorties peuvent ne pas être autorisées, ou l'être hors des plages entre 9 heures et 11 heures et 14 heures et 16 heures, sauf pour des examens médicaux. Le prescripteur peut, s'il le justifie, prévoir un régime de sorties libres.
* 584 Figurent également les conditions d'observer les prescriptions du praticien et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité préalable au terme de l'arrêt de travail.
* 585 Sauf pour les non-salariés agricoles, pour lesquels il est fixé à 63 % du gain forfaitaire annuel dans les 28 premiers jours d'arrêt de travail, et 84 % après, en vertu de l'article D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime.
* 586 Article R. 323-5 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et assimilés.
* 587 Sauf pour les non-salariés agricoles, dès lors que l'indemnité journalière est forfaitaire.
* 588 Article L. 323-4 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et assimilés,
* 589 Article R. 323-10 du code de la sécurité sociale.
* 590 Il s'agit de 1/91,25 du montant des salaires bruts des trois derniers mois avant l'arrêt lorsque le revenu est versé mensuellement, de 1/84 du montant des six paies antérieures au mois de l'arrêt lorsque le revenu d'activité est réglé toutes les deux semaines, ou des douze dernières lorsqu'il est versé toutes les semaines, et de 1/365 du montant du revenu des douze mois civils d'activité antérieurs à l'arrêt en cas de travail discontinu ou saisonnier, en vertu de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
* 591 Articles L. 742-3, R. 742-2 et D. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 592 Article D. 622-7 du code de la sécurité sociale.
* 593 Articles L. 732-4-1 et D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime.
* 594 Article R. 323-9 du code de la sécurité sociale.
* 595 Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 - art. 1.
* 596 Article D. 622-7 du code de la sécurité sociale.
* 597 Article D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime.
* 598 Tel n'est pas le cas pour les non-salariés agricoles, dont les conditions de calcul des IJ AT-MP (Atexa) sont alignées sur celles des IJ maladie (Amexa) en vertu de l'article D. 752-23 du code rural et maritime.
* 599 Articles L. 433-2, R. 433-1 et R. 433-3 du code de la sécurité sociale.
* 600 Si le salaire est réglé mensuellement, 1/28e du montant des deux ou quatre dernières paies du mois civil antérieur à l'arrêt de travail si le salaire est réglé respectivement toutes les deux semaines ou toutes les semaines, 1/365e du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
* 601 Article R. 433-4 du code de la sécurité sociale et Arrêté du 30 décembre 1995 portant sur les modalités de calcul du gain journalier net mentionné à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
* 602 Soit 83,4 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
* 603 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et des régimes alignés, article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
* 604 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et des régimes alignés, article D. 622-12 pour les professions libérales, article D. 732-2-2 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
* 605 Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
* 606 Articles L. 752-5 et D. 752-22 du code rural et de la pêche maritime.
* 607 Article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés des régimes général et alignés, article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
* 608 Article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale pour les assurés des régimes général et alignés, article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
* 609 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 610 Article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
* 611 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 612 Articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique.
* 613 Article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 614 Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
* 615 Article D. 732-2-4 du code rural et de la pêche maritime.
* 616 Articles L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 617 Articles L. 622-2 et D. 622-12 du code de la sécurité sociale.
* 618 3° de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 619 Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
* 620 Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative a la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
* 621 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
* 622 D'autres conditions s'appliquent : notamment le fait pour l'assuré d'avoir transmis son avis d'arrêt de travail sous 48 heures ou le fait d'être soigné au sein de l'espace économique européen.
* 623 Article L. 1226-1 du code du travail.
* 624 Article D. 1226-1 du code du travail.
* 625 Article D. 1226-5 du code du travail.
* 626 Cf. infra.
* 627 Article L. 1226-1 du code du travail.
* 628 Article D. 1226-2 du code du travail.
* 629 Article D. 1226-3 du code du travail.
* 630 Article D. 1226-4 du code du travail.
* 631 Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
* 632 Sur la base d'une cotisation de 1,5 % des salaires dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
* 633 Enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise, 2009.
* 634 84 % des salariés d'une entreprise de 500 salariés en bénéficient, mais moins de 40 % des salariés d'une entreprise de moins de 10 salariés.
* 635 Cf infra.
* 636 De 155 jours en 2014 à 196 en 2024 pour les salariés, et de 96 à 122 jours pour les non-salariés.
* 637 Réponses écrites de la DSS au questionnaire de la rapporteure pour la branche AT-MP.
* 638 Igas, 2017, La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés.
* 639 « Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019 », Drees, Études et Résultats, décembre 2024, n° 1321.
* 640 L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.
* 641 Il s'agit d'une coquille dans le texte déposé, qui comporte deux 2° du II. Il s'agit là du second 2° du II de l'article 28.
* 642 Réponses écrites d'Avenir Spé - Le Bloc au questionnaire de la rapporteure.
* 643 Réponses écrites de la CSMF au questionnaire de la rapporteure.
* 644 Arrêté du 9 mai 2025 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
* 645 Article 74 de la Constitution.
* 646 Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 647 Le régime de la spécialité législative s'y est toutefois appliqué jusqu'à la loi du 19 juillet 1976 précitée.
* 648 Article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales.
* 649 Article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales.
* 650 Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
* 651 Article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée.
* 652 Observance des prescriptions du praticien, soumission aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respect des heures de sortie autorisées, abstention de toute activité non autorisée et information sans délai de la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
* 653 Articles L. 313-1, L. 323-1, L. 323-6 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
* 654 Article L. 311-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
* 655 Se référer au commentaire de l'article 28 pour une analyse plus détaillée des conditions de versement des indemnités journalières.
* 656 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18.830.
* 657 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-18.587.
* 658 Quant à eux régis par l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
* 659 L'amendement du rapporteur général a été sous-amendé par le Gouvernement afin de restreindre la définition aux seules activités professionnelles.
* 660 Article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 661 Article R. 4624-31 du code du travail.
* 662 Article D. 323-3 du code de la sécurité sociale.
* 663 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-18.587.
* 664 Article 24 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
* 665 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 666 Article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.
* 667 Les assurés déjà reconnus en ALD 12 à la suppression de cette pathologie du régime des ALD exonérantes continuent toutefois de bénéficier de ce régime.
* 668 Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
* 669 IGF et Igas, Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - pour un dispositif plus efficient et équitable, juin 2024.
* 670 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
* 671 Un même assuré peut relever à la fois du régime des ALD 30 et des ALD 31 s'il présente deux pathologies distinctes, l'une sur la liste et l'une hors liste.
* 672 Article R. 160-12 du code de la sécurité sociale.
* 673 Décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986 relatif à la participation des assurés atteints d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
* 674 Article R. 160-11 du code de la sécurité sociale.
* 675 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 676 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, rapport au ministère chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 677 II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 678 III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 679 Articles R. 160-19 et D. 160-6 du code de la sécurité sociale pour la participation forfaitaire, article D. 160-10 du code de la sécurité sociale pour la franchise.
* 680 Se référer au commentaire de l'article 18.
* 681 I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
* 682 Article L. 311-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
* 683 Se référer au commentaire de l'article 28 pour une présentation détaillée des conditions et modalités de versement des indemnités journalières.
* 684 Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
* 685 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et des régimes alignés, article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
* 686 Des situations d'inapplicabilité du délai de carence existent, notamment en cas de sinistre professionnel, de décès d'un enfant ou d'interruption spontanée de grossesse. Se référer au commentaire de l'article 28.
* 687 Le délai de carence applicable aux fonctionnaires n'est que d'un jour, conformément à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
* 688 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et des régimes alignés, article D. 622-12 pour les professions libérales, article D. 732-2-2 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles.
* 689 Une étude réalisée en 2017 fait valoir que les deux tiers des salariés bénéficieraient d'une prise en charge au titre des jours de carence de la sécurité sociale, avec une forte hétérogénéité en fonction de la taille des entreprises.
* 690 L'article 28 du PLFSS pour 2026 prévoit toutefois le plafonnement de la durée de versement des IJ AT-MP.
* 691 Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.
* 692 Article D. 732-2-4 du code rural et de la pêche maritime.
* 693 Articles L. 321-1, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 694 Les règles encadrant les IJ maladie pour les professions libérales sont plus strictes, puisque ce régime encadre également le nombre d'indemnités journalières qu'il est possible de percevoir consécutivement. Le code de la sécurité sociale fixe, pour ces assurés, un maximum 87 indemnités journalières consécutives pour une même incapacité de travail aux termes des articles L. 622-2 et D. 622-12 du code de la sécurité sociale.
* 695 3° de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 696 Article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
* 697 Article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
* 698 La fiabilité de ces données peut toutefois être remise en cause alors que le Gouvernement annonce, dans son étude d'impact, 400 000 assurés bénéficiant au titre d'une année donnée d'un arrêt de travail sous le régime des ALD non exonérantes.
* 699 Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
* 700 Le rapport des inspections précité s'interroge également sur « le support juridique permettant l'ouverture du remboursement des frais de transport dans la mesure où les « ALD non exonérantes » ne rentrent pas dans le champ couvert par le b du 1° de l'article R. 322-10 du CSS ».
* 701 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 702 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.
* 703 Article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
* 704 En pareille hypothèse, le service du contrôle médical de la caisse se rapproche du médecin traitant.
* 705 Article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
* 706 En application de l'article 198 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, la procédure de reconnaissance d'une pathologie comme ALD a été simplifiée et ne fait plus intervenir un examen conjoint du médecin traitant et du médecin conseil.
* 707 Celui-ci doit être conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé.
* 708 Article R. 324-2 du code de la sécurité sociale.
* 709 Par exemple, cinq ans renouvelables pour une tumeur maligne, dix ans renouvelables pour le diabète ou cinq ans renouvelables pour la maladie de Crohn.
* 710 Insuffisance respiratoire chronique grave, maladies métaboliques héréditaires et certaines affections psychiatriques de longue durée.
* 711 Les données fournies dans ce commentaire d'article s'entendent en dehors du cadre des IJ covid, afin de ne pas biaiser l'analyse.
* 712 Le commentaire de l'article 28 propose une analyse plus détaillée du phénomène d'allongement de la durée de prescription des arrêts de travail et des causes de la dynamique des indemnités journalières.
* 713 Drees, Études et Résultats, décembre 2024, n° 1321, Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019.
* 714 La suppression des entrées dans le régime des ALD non exonérantes sera effective au 1er janvier 2026. À compter de cette date, les assurés qui seraient entrés dans le régime bénéficieront, pour leur arrêt de travail, des dispositions de droit commun ouvrant droit à 360 indemnités journalières. À compter de fin 2027, les premiers assurés qui n'auront pas pu relever du régime des ALD non exonérantes du fait de sa suppression arriveront donc au bout de leur période d'arrêt de travail indemnisée.
* 715 Cnam, Rapport Charges et produits pour 2026, juillet 2025, p. 172.
* 716 Plus de 40 % hors indemnités journalières.
* 717 La LPP inclut les dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, les aliments diététiques, les articles pour pansements, les orthèses et prothèses externes, les dispositifs médicaux implantables et les véhicules pour handicapés physiques.
* 718 Annexe 5 du PLFSS pour 2026.
* 719 Avis du comité d'alerte n° 2025-2 du 18 juin 2025.
* 720 Articles 60-1 à 61-15 de la convention nationale signée le 4 juin 2024 par les syndicats de médecins libéraux et l'assurance maladie.
* 721 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 722 Cnam, rapport Charges et produits pour 2026, p. 184.
* 723 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.
* 724 Réponse de l'Agence du numérique en santé (ANS) au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 725 Ibid.
* 726 Article L. 1111-24 du code de la santé publique.
* 727 Conseil d'État, 1ère chambre, 12/07/2018, N° 387 156.
* 728 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 729 Amendement n° 2553.
* 730 Amendement n° 1451.
* 731 Étude conduite par l'institut BVA pour l'assurance maladie auprès de 150 médecins.
* 732 Article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
* 733 Article 3 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 734 Cour des comptes, Chapitre X « Mon espace santé » : des conditions de réussite encore à réunir, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, in La Sécurité sociale, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 735 Article 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS).
* 736 Article 45 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.
* 737 Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé.
* 738 Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique.
* 739 Audition de Mme Hela Ghariani, déléguée ministérielle au numérique en santé, le 28 févier 2025 par la commission des affaires sociales du Sénat sur le bilan de « Mon espace santé ».
* 740 Site internet de l'agence du numérique en santé.
* 741 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS 2026.
* 742 Cour des comptes, Chapitre X « Mon espace santé » : des conditions de réussite encore à réunir, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, in La Sécurité sociale, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 743 Ibid.
* 744 Audition de Mme Hela Ghariani, déléguée ministérielle au numérique en santé, le 28 févier 2025 par la commission des affaires sociales du Sénat sur le bilan de « Mon espace santé ».
* 745 Audition de M. Stéphane Oustric, vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, le 28 févier 2025 par la commission des affaires sociales du Sénat sur le bilan de « Mon espace santé ».
* 746 Réponses de la FHF au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 747 Réponse de la Fnehad au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 748 Article 48 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 749 Décision n° 2025-875 DC du 28 février 2025.
* 750 60 points sont attribués à l'indicateur, pour une valeur du point fixée à 7 euros. Pour l'ensemble des indicateurs socles et optionnels, la rémunération peut atteindre un maximum de 2940 euros par an.
* 751 Résultats d'une enquête menée par la FMF auprès de ses adhérents, avec environ 3000 répondants, sur l'utilisation du DMP et la perception des mesures de sanction inscrites à l'article 31 du PLFSS.
* 752 Le système de santé émettrait 49 millions de tonnes en équivalent CO2, soit plus de 8 % de l'empreinte carbone de la France.
* 753 Gouvernement, Feuille de route planification écologique du système de santé, décembre 2023, d'après les données du rapport Décarboner la santé, The Shift Project, avril 2023.
* 754 Cour des comptes, « La gestion du stock stratégique de masques : des progrès encore insuffisants depuis la crise sanitaire », chapitre VI du rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 755 Cour des comptes, Le bon usage des produits de santé, septembre 2025, p. 51-52.
* 756 Ibid., p. 53.
* 757 Recommandation n° 3 du rapport thématique sur le bon usage des produits de santé.
* 758 Réponses de la fédération Unicancer au questionnaire transmis par la rapporteure.
* 759 Smale EM, van den Bemt BJF, Heerdink ER, Desar IME, Egberts TCG, Bekker CL ; ROAD Study Group. Cost Savings and Waste Reduction Through Redispensing Unused Oral Anticancer Drugs : The ROAD Study. JAMA Oncol. 2024 Jan.
* 760 Cour des comptes, « La gestion du stock stratégique de masques : des progrès encore insuffisants depuis la crise sanitaire », chapitre VI du rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 761 Articles 60 à 61-15 de la convention médicale signée le 4 juin 2024 entre l'assurance maladie et les représentants des médecins libéraux.
* 762 Articles 66 à 68 de la convention médicale signée le 4 juin 2024 entre l'assurance maladie et les représentants des médecins libéraux.
* 763 Celui-ci mesure le rapport entre le montant des prescriptions remboursées de chaque médecin et le montant moyen remboursable observé au niveau national.
* 764 The Shift Project, Décarboner la santé pour soigner durablement, rapport final V2, avril 2023.
* 765 Article L. 4211-2 du code de la santé publique.
* 766 Article L. 4212-7 du code de la santé publique.
* 767 Articles L. 3211-18 et L. 5342-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
* 768 Igas et Igedd, Retraitement des dispositifs médicaux à usage unique dans le cadre de la transition écologique du système de santé, janvier 2024.
* 769 Décret n° 2025-895 du 4 septembre 2025 relatif à l'expérimentation du retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique.
* 770 Étude d'impact du Gouvernement jointe au PLFSS pour 2026.
* 771 5° de l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
* 772 Igas et Igedd, Retraitement des dispositifs médicaux à usage unique dans le cadre de la transition écologique du système de santé, janvier 2024.
* 773 Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.
* 774 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, juillet 2025.
* 775 ANSM, État des lieux sur les médicaments biosimilaires, février 2022.
* 776 Ibid.
* 777 https://ansm.sante.fr/documents/reference/medicaments-biosimilaires.
* 778 Arrêté du 20 février 2025 fixant la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient.
* 779 Adalimumab, Enoxaparine, Epoetine, Etanercept, Follitropine alfa, Teriparatide.
* 780 Insuline asparte, Insuline Glargine, Insuline Lispro.
* 781 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l'assurance maladie pour 2026, juillet 2025.
* 782 Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l'assurance maladie pour 2026, juillet 2025.
* 783 Le tarif forfaitaire de responsabilité est calculé par le CEPS à partir du prix des médicaments génériques les moins chers. Ainsi lorsque le taux de substitution est jugé trop faible, il peut être décidé que le médicament d'origine est remboursé sur la base du prix de ses génériques les moins chers.
* 784 L. 5121-1-2 du code de la santé publique.
* 785 En droit national, l'article L. 5121-9 du code de la santé publique dispose que l'AMM est refusée « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur. Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ».
* 786 Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
* 787 Article L. 5121-9-1 du code de la santé publique.
* 788 Article L. 5121-8 du code de la santé publique.
* 789 Article L. 5121-9 du même code.
* 790 Article L. 5123-3 du code de la santé publique.
* 791 1° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
* 792 1° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale.
* 793 Article R. 163-3 du code de la sécurité sociale.
* 794 2° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale.
* 795 Article R. 161-71-3 du code de la sécurité sociale.
* 796 Article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.
* 797 Article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale.
* 798 Article L. 5123-2 du code de la santé publique.
* 799 Article L. 5123-3 du code de la santé publique.
* 800 Article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale.
* 801 Article L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale.
* 802 SMR majeur ou important.
* 803 ASMR I à IV.
* 804 Leur prix doit excéder 30 % du forfait attribué pour le groupement homogène de séjour considéré.
* 805 Données collectées entre 2020 et 2023.
* 806 Article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
* 807 Article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 808 III de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
* 809 Article D. 5121-69-3 du code de la santé publique.
* 810 Un traitement approprié est, selon la HAS, une alternative thérapeutique un traitement approprié est une alternative thérapeutique recommandée au même niveau de la stratégie thérapeutique à la date de l'évaluation, accessible en pratique courante en France à la date de l'évaluation, prise en charge par la solidarité nationale à la date de l'évaluation et disposant de données d'efficacité et de tolérance satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour le patient au regard de l'apport prévisible du médicament faisant l'objet de la demande d'accès précoce.
* 811 Article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
* 812 En application de l'article R. 5121-68 du code de la santé publique, une copie de la demande est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'ANSM en cas d'accès précoce pré-AMM.
* 813 Article R. 5121-69 du code de la santé publique.
* 814 En application de l'article R. 5121-69 du code de la santé publique, ce délai peut être fixé à quatre mois en cas de forte demande. Passé ce délai, le silence de la HAS vaut autorisation d'accès précoce pour les accès post-AMM et pré-AMM, dès lors, pour ces derniers, que l'ANSM a rendu un avis favorable sur la forte présomption d'efficacité et de sécurité.
* 815 Article D. 5121-69-3 du code de la santé publique.
* 816 III de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
* 817 Article R. 5121-69 du code de la santé publique.
* 818 Article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.
* 819 Article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.
* 820 Article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 821 Article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale.
* 822 Ou, en cas d'inscription sur la seule liste à l'usage des collectivités ou en l'absence d'inscription sur une liste, d'un prix de référence déterminé par le CEPS selon les modalités de droit commun.
* 823 Réponses écrites du Leem au questionnaire de la rapporteure.
* 824 Réponses écrites de la HAS au questionnaire de la rapporteure.
* 825 Article L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
* 826 Et non d'un exploitant.
* 827 II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
* 828 Article D. 5121-74-1-1 du code de la santé publique. Ce délai est porté à 18 mois lorsque la demande porte sur une maladie rare. Il peut par ailleurs être prorogé par le directeur général de l'ANSM en fonction de l'état de la recherche sur la personne humaine en cours.
* 829 Article 76 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 830 III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique.
* 831 Article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale.
* 832 Article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.
* 833 Défini comme le produit du chiffre d'affaires réalisé pour la spécialité par la part que revêt l'indication considérée dans l'utilisation de la spécialité.
* 834 Article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 835 Décret n° 2023-367 du 13 mai 2023.
* 836 Défini comme le produit du chiffre d'affaires total facturé pour la spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.
* 837 Ou, en l'absence d'inscription sur les listes de remboursement, à son prix de référence déterminé par le CEPS en application de la tarification de droit commun des médicaments.
* 838 Réponses écrites du Leem au questionnaire de la rapporteure.
* 839 Réponses écrites du Leem au questionnaire de la rapporteure.
* 840 Article 76 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 841 Article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale.
* 842 Il s'agit de la liste officinale et de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
* 843 Il s'agit là du droit en vigueur.
* 844 Dans le cas contraire, la prise en charge de droit commun s'applique, ainsi que les conditions de dispensation.
* 845 Il est tenu d'en informer le CEPS, qui publie le montant de l'indemnité.
* 846 Ces dispositions figurent à la fois au i et au ii du a du 7° de l'article 34 sous une forme très similaire, indiquant un éventuel doublon.
* 847 Hors effets de trésorerie.
* 848 Voir infra.
* 849 Les i et ii du 15° du II procèdent à des modifications rédactionnelles en lien avec la coordination réalisée au iii du même 15° consécutivement à la pérennisation de l'accès direct.
* 850 Après déduction des remises et taxes applicables.
* 851 Directive 89/105/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie.
* 852 I de l'article L. 161-16-4 du code de la sécurité sociale.
* 853 I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.
* 854 Accord cadre du 5 mars 2021 entre le CEPS et les entreprises du médicament modifié par les avenants des 6 avril et 21 juillet 2022, 20 juin et 27 juillet 2024. Prorogé par l'avenant du 24 février 2024 et le 4 mars 2025.
* 855 Défini au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
* 856 c du 5° du même article.
* 857 a du 15° du même article.
* 858 Articles 24 à 26 de l'accord-cadre du 5 mai 2021 précité.
* 859 Article L. 162-17 et R. 163-19 du code de la sécurité sociale.
* 860 Cnam, Rapport « Charges et produits 2026 », p. 141.
* 861 GEMME, communiqué de presse « Le prix du générique en France : 41 % inférieurs à la moyenne des prix européens », janvier 2025.
* 862 GEMME, communiqué de presse « Le prix du biosimilaire en France : 44 % inférieur à la moyenne des prix européens », juin 2025.
* 863 Lettre d'orientation du 19 février 2021 du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, du ministre délégué chargé des Comptes publics, de la ministre déléguée chargée de l'Industrie et du ministre des Solidarités et de la Santé.
* 864 Accord cadre du 5 mars 2021 entre le CEPS et les entreprises du médicament modifié par les avenants des 6 avril et 21 juillet 2022, 20 juin et 27 juillet 2024. Prorogé par l'avenant du 24 février 2024 et le 4 mars 2025.
* 865 Les ruptures d'approvisionnement sont définies à l'article L. 5121-29 du code de la santé publique depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 866 Cette liste n'est pas exhaustive.
* 867 Réglementées à l'échelle européenne par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
* 868 I de l'article L. 5121-29 du code de la santé publique.
* 869 Les MITM sont définis à l'article L. 5111-4 du code de la santé publique. Il s'agit des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ».
* 870 Article R. 5124-49-4 du code de la santé publique.
* 871 I de l'article L. 5121-29 du code de la santé publique.
* 872 Article 23 bis de la directive européenne susmentionnée.
* 873 Article L. 5124-6 du code de la santé publique.
* 874 Article R. 5124-49-5 du code de la santé publique.
* 875 Article L. 5121-29-1 du code de la santé publique.
* 876 Article R. 5124-49-1 du code de la santé publique.
* 877 Article L. 5124-17-3 du code de la santé publique.
* 878 II de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique.
* 879 Article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.
* 880 Article L. 5123-8 du code de la santé publique.
* 881 Article L. 5121-33-1 du code de la santé publique.
* 882 Article L. 1413-4 du code de la santé publique.
* 883 Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l'Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux.
* 884 Article L. 5423-9 du code de la santé publique.
* 885 Réponse du Ministère de la Santé et de la Prévention en date du 16 avril 2024 à la question écrite n° 3816 : Mise en oeuvre de l'article 65 de la LFSS 2022 de M. le député T. Bazin.
* 886 Rapport fait au nom de la commission d'enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, rapporteur Laurence Cohen, 4 juillet 2023, p. 321.
* 887 Article L. 5123-3 du code de la santé publique.
* 888 Réponse du Ministère de la santé et de la prévention en date du 16 avril 2024 à la question écrite n° 3816, « Mise en oeuvre de l'article 65 de la LFSS 2022 » du député Thibault Bazin.
* 889 Laurence Cohen, Rapport fait au nom de la commission d'enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, 4 juillet 2023, p. 322.
* 890 II de l'article 75 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale.
* 891 Lettre d'orientation du 5 mai 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, de la ministre chargée des comptes publics et du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie.
* 892 Le caractère multifactoriel des pénuries a été étudié à de multiples reprises, notamment par la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments et aux choix de l'industrie pharmaceutique française de 2023.
* 893 ANSM, Rapport d'activité 2024, p. 8.
* 894 La rupture d'approvisionnement concerne l'incapacité d'une pharmacie à obtenir un médicament dans un délai de 72 heures, tandis que la rupture de stock désigne l'impossibilité, pour le fabricant ou l'exploitant, de produire ou de mettre ce médicament sur le marché.
* 895 Drees, « Tensions et ruptures de stock de médicaments déclarées par les industriels : quelle ampleur, quelles conséquences sur les ventes aux officines ? », Études et résultats, mars 2025.
* 896 GPUE, Medicine Shortages Report 2024, février 2025.
* 897 ANSM,Rapport d'activité 2024, p. 10.
* 898 Rapport n° 828 (2022-2023) Pénurie de médicaments : Trouver d'urgence le bon remède, tome I, déposé le 4 juillet 2023, p. 105.
* 899 Article 40 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, codifié à l'article L. 5123-8 du code de la santé publique.
* 900 Comme le présente le rapport d'information n°2696 sur l'évaluation de l'impact de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, rapporteurs Mme V. Riotton et M. S. Delautrette, 29 mai 2024.
* 901 Arrêté du 1er mars 2022 portant création de la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du code de la santé publique.
* 902 Think tank Shift Project, synthèse du rapport « Décarbonons les industries du médicament », juin 2025.
* 903 Articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-18 du code de la sécurité sociale.
* 904 Les missions du CEPS sont inscrites à l'article L. 162-17-3 du code de la santé publique.
* 905 Contribution écrite du CEPS.
* 906 Igas, Évaluation de la politique française des médicaments génériques », Septembre 2012, p 67 et 68.
* 907 Gupta Strategists pour Zorgverzekeraars Nederland, « Grip op toenemende geneesmiddeltekorten : Onderzoek naar aard, omvang en oplossingsrichtingen [Maîtriser les pénuries croissantes de médicaments : Recherche sur la nature, l'ampleur et les solutions possibles ]», octobre 2024.
* 908 B du I de l'article 39 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, codifié à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
* 909 Autorité de la Concurrence, Avis n° 21-A-15 du 29 octobre 2021 concernant un projet de décret relatif au référencement de certains produits de santé et prestations en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
* 910 Contribution écrite du CEPS.
* 911 Article R. 5121-36-2 du code de la santé publique.
* 912 Contribution écrite du syndicat national des pharmaciens des hôpitaux publics et des collectivités territoriales unis.
* 913 CNSA, Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2025, Juin 2025.
* 914 Ces catégories sont listées aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF et les établissements et services concernés sont précisés aux articles D. 312-0-1 à D. 312-0-3 du CASF.
* 915 Article L. 146-9 du CASF.
* 916 Article L. 121-1 du CASF.
* 917 Article L. 314-1 du CASF.
* 918 Article L. 313-3 du CASF.
* 919 Annexe 7 du PLFSS 2026.
* 920 Article L. 314-3 du CASF.
* 921 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 2).
* 922 La CNSA compense une partie des dépenses des départements au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), au moyen de concours financiers.
* 923 Article R. 314-105 du CASF.
* 924 Ces structures, qui ne proposent pas d'accueil médicalisé, n'entrent pas dans le champ de la branche autonomie de la Sécurité sociale.
* 925 Laurent Vachey et Agnès Jeannet, Établissements et services pour personnes handicapées : offre et besoins, modalités de financement, octobre 2012.
* 926 Instruction n° DGCS/SD5B/SD1B/DSS/SD1A/DGS/SP2/SP3/2025/71 du 7 août 2025.
* 927 Article L. 314-7-1 du CASF.
* 928 Article R. 314-216 du CASF.
* 929 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 75).
* 930 Article L. 313-12-2 du CASF.
* 931 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 72).
* 932 Instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018.
* 933 Philippe Mouiller, Le financement de l'accompagnement médico-social des personnes handicapées, rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat n° 35 (2018-2019).
* 934 Dossier de presse de la conférence nationale du handicap, 26 avril 2023.
* 935 Igas, Handicap : comment transformer l'offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes, janvier 2025.
* 936 Les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) n'entrent pas dans ce champ.
* 937 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 48).
* 938 Accords du 28 mai 2021.
* 939 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (articles 42 et 43).
* 940 Avenant 43 agréé par l'arrêté du 21 juin 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la BAD par l'arrêté d'extension du 28 juillet 2021.
* 941 Décrets n° 2022-728, n° 2022-738 et n° 2022-741 du 28 avril 2022 et arrêté du 17 juin 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
* 942 CNSA, Chiffres clés de l'aide à l'autonomie, 2025.
* 943 Cette aide financière de la CNSA ne peut excéder 50 % des coûts supportés par les départements, dans la limite d'un montant global porté à 261 millions d'euros par an en application de l'article 80 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 944 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 47).
* 945 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 43).
* 946 Arrêté du 25 juin 2024 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
* 947 Arrêté du 5 août 2024 portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
* 948 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, juin 2025.
* 949 Communiqué de presse de Départements de France du 13 septembre 2024.
* 950 Article 1240 du code civil.
* 951 Article 2309 du code civil.
* 952 Article L. 121-12 du code des assurances.
* 953 Articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
* 954 Procédure prévue aux articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
* 955 Procédure prévue aux articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
* 956 Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
* 957 Les préjudices à caractère personnel n'ont pas de dimension économique. Ils incluent le préjudice moral (souffrances psychologiques), le préjudice physique (blessures, douleur physique...), le préjudice d'agrément (perte de qualité de vie) et le préjudice esthétique.
* 958 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, édition 2025.
* 959 Sauf pour les personnes atteintes d'une pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles, en application de l'article 2 de la loi n° 2025-138 du 17 février 2025.
* 960 Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 961 CNSA, Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2025.
* 962 Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 963 CNSA, Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2025.
* 964 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (article 29).
* 965 Article 706-9 du code de procédure pénale.
* 966 Article L. 1142-14 du code de la santé publique.
* 967 Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (article 53).
* 968 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14.12-792 ; 10 septembre 2025, 14-23.623 ; 17 mars 2016, 15-13.865 ; Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16.17.864 ; 20 octobre 2016, 15-17.507.
* 969 Igas et IGF, Divergences territoriales dans les modalités d'attribution des aides sociales légales (AAH, AEEH, PCH, APA, PSH) et panorama des aides extralégales, Mai 2025.
* 970 Annexe 9 du PLFSS 2026.
* 971 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 972 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 973 En ce qui concerne le régime général et celui des salariés agricoles, qui suit les mêmes dispositions conformément aux articles L. 751-7 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime.
* 974 Articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 752-3 et L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime.
* 975 Articles L. 433-1, R. 433-1 et R. 433-3 du code de la sécurité sociale et article L. 752-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 976 Article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Cette prestation ne s'applique pas au régime des non-salariés agricoles.
* 977 Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime.
* 978 Les fonctionnaires, dont le régime n'est pas analysé en détail dans ce commentaire, peuvent également bénéficier de prestations lorsqu'ils souffrent d'une maladie reconnue en lien avec le service, depuis l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Ils représentent l'essentiel des autres reconnaissances de maladies professionnelles.
* 979 Le présent commentaire se concentre sur la procédure applicable au régime général. Des différences peuvent exister pour le régime agricole.
* 980 Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
* 981 Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
* 982 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 983 Les délais mentionnés dans ce commentaire sont ceux applicables au régime général. Pour le régime agricole, la procédure est similaire mais les délais peuvent varier.
* 984 Article R. 461-5 du code de la sécurité sociale.
* 985 Cour des comptes, juillet 2025, « La reconnaissance des maladies professionnelles ».
* 986 Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
* 987 Article R. 461-6 du code de la sécurité sociale.
* 988 Article R. 461-6 du code de la sécurité sociale.
* 989 Article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
* 990 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 991 Article 2 de la loi du 25 octobre 1919.
* 992 Article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime.
* 993 Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
* 994 La loi du 25 octobre 1919 n'avait créé que deux tableaux, relatifs aux maladies causées par le plomb et le mercure.
* 995 Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
* 996 Pour le régime agricole, la commission compétente est la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (Cosmap), qui associe également, sans droit de vote, des associations de victimes.
* 997 Tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
* 998 Tableau n° 1 : Affections dues au plomb et à ses composés, comprenant notamment l'anémie, la néphropathie, l'encéphalopathie...
* 999 Le tableau n° 79 : lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif fait par exemple obligation à ces lésions d'être confirmées par IRM, le cas échéant par arthroscanner, ou au cours d'une intervention chirurgicale.
* 1000 Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
* 1001 Cela s'entend, en application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été médicalement constatées, et non comme la date du diagnostic.
* 1002 Le tableau n° 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit par exemple une durée d'exposition minimale de cinq ans pour la présomption d'imputation professionnelle des sciatiques par hernie discale reconnues.
* 1003 55 occurrences dans les tableaux du régime général, notamment pour le tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
* 1004 74 occurrences dans les tableaux du régime général, notamment pour le tableau n° 47 : affections professionnelles provoquées par les poussières de bois.
* 1005 Article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
* 1006 Au-delà de ce délai, la reconnaissance est implicite.
* 1007 Article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
* 1008 Article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
* 1009 Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
* 1010 Par référence à l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui l'encadre.
* 1011 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 1012 Par référence à l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui l'encadre.
* 1013 Article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
* 1014 Article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
* 1015 Marie-Pierre Richer et Annie Le Houérou, 9 octobre 2024, « Branche AT-MP : vers un juste équilibre entre réparation et prévention des risques professionnels », rapport d'information n° 18 (2024-2025).
* 1016 Proposition n° 4.
* 1017 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 1018 Article D. 461-28.
* 1019 Article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
* 1020 Lorsque le comité a à traiter d'une pathologie psychique, il peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
* 1021 Pour le régime agricole, il peut s'agir d'un médecin qualifié en médecine du travail et titulaire du diplôme de l'Institut national de médecine agricole.
* 1022 Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
* 1023 Cour des comptes, juillet 2025, « La reconnaissance des maladies professionnelles ».
* 1024 Au-delà de ce délai, la reconnaissance est implicite.
* 1025 Article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
* 1026 Article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
* 1027 Le contenu exhaustif du dossier est défini à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
* 1028 Décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023.
* 1029 Cour des comptes, juillet 2025, « La reconnaissance des maladies professionnelles ».
* 1030 Cour des comptes, juillet 2025, « La reconnaissance des maladies professionnelles ».
* 1031 En droit, car en fait les médecins-conseils ont reçu l'instruction d'accepter d'autres modalités de diagnostic.
* 1032 Tableau n° 69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes.
* 1033 Décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
* 1034 Article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
* 1035 Article D. 461-28 du code de la sécurité sociale.
* 1036 L'article 39 ne prévoit pas un nombre précis, mais évoque bien des « médecins-conseils ».
* 1037 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 1038 Réponses écrites de la CFTC au questionnaire de la rapporteure.
* 1039 Réponses écrites de la CFTC au questionnaire de la rapporteure.
* 1040 Réponses écrites de Force Ouvrière au questionnaire de la rapporteure.
* 1041 Réponses écrites de la CFTC au questionnaire de la rapporteure.
* 1042 Rappelons que la charge de travail des CRRMP a doublé en quinze ans, portée désormais par la progression irrésistible des maladies hors tableaux, les plus complexes à traiter.
* 1043 Audition d'Anne Thiebeauld, directrice des risques professionnels de la Cnam, par la commission des affaires sociales.
* 1044 Article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 1045 Articles L. 828-1 et L. 821-1-1 du code général de la fonction publique.
* 1046 Article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 1047 Article L. 632-1 du code de la sécurité sociale.
* 1048 Articles L. 644-2 et D. 644-3 du code de la sécurité sociale.
* 1049 Article L. 652-9 du code de la sécurité sociale.
* 1050 Y compris si celui-ci est détenu ou écroué, aux termes des articles L. 382-47 et L. 382-35 du code de la sécurité sociale.
* 1051 En application de l'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 1052 Articles L. 313-1, R. 313-6 et R. 361-3 du code de la sécurité sociale.
* 1053 Article R. 361-3 du code de la sécurité sociale.
* 1054 Article R. 361-2 du code de la sécurité sociale.
* 1055 Article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
* 1056 Article R. 361-4 du code de la sécurité sociale.
* 1057 Article R. 361-5 du code de la sécurité sociale.
* 1058 Article L. 361-4 du code de la sécurité sociale.
* 1059 Article R. 361-3 du code de la sécurité sociale.
* 1060 Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.
* 1061 Article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
* 1062 Article L. 361-5 du code de la sécurité sociale.
* 1063 Article 11 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, pour ce qui concerne la fonction publique d'État.
* 1064 Des règles dérogatoires s'appliquent, dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale, pour les fonctionnaires stagiaires, les contractuels et les fonctionnaires dont la durée de travail est inférieure à 28 heures par semaine. Le capital décès, versé sous conditions, correspond alors a minima à 75 % des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, ou, pour les fonctionnaires stagiaires, à 75 % des rémunérations qu'il aurait perçues sur un an de services.
* 1065 Perçue ou qui aurait été perçue si le fonctionnaire était en disponibilité pour raisons de santé ou en congé parental au moment de son décès.
* 1066 Lorsque le fonctionnaire territorial ou hospitalier a atteint l'âge légal de départ à la retraite, une décote de 75 % s'applique.
* 1067 Article 12 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, pour ce qui concerne la fonction publique d'État. Cette rémunération inclut, pour les fonctionnaires de l'État, le traitement indiciaire au jour du décès, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les primes et les indemnités.
* 1068 Article 12 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État.
* 1069 Article 13 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, pour ce qui concerne la fonction publique d'État.
* 1070 Ou, le cas échéant, aux enfants répondant aux mêmes conditions recueillis au foyer de l'agent public et à sa charge.
* 1071 Article 15 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, pour ce qui concerne la fonction publique d'État.
* 1072 Article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique.
* 1073 Article 2 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État.
* 1074 Article 3 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, soit 5 % du Pass.
* 1075 Article 2 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État.
* 1076 Article 3 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, soit 15 % du Pass.
* 1077 Article 6 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État, soit 15 % du Pass.
* 1078 Article 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État.
* 1079 À condition qu'il ait cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des indépendants, lors des trois exercices précédant le décès, sur un revenu équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du Pass sur la période et soit à jour de ses cotisations à la date du décès. Le capital décès est tout de même dû, comme au régime général, lorsque le défunt était bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou d'indemnités journalières du régime des indépendants.
* 1080 Il doit alors avoir validé au moins 80 trimestres sous le régime des indépendants et avoir été affilié, en dernier lieu avant sa retraite, à ce régime.
* 1081 En application de l'article R. 653-14 du code de la sécurité sociale, le montant a été déterminé par l'assemblée générale de la caisse, sur proposition de son conseil d'administration.
* 1082 Article R. 653-16 du code de la sécurité sociale.
* 1083 Article R. 653-17 du code de la sécurité sociale.
* 1084 Le capital est versé :
- aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sur le territoire métropolitain présentant une certaine importance ;
- aux assurés assimilés à ceux-ci ;
- aux aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation des chefs d'exploitation ou d'entreprise éligibles ;
- aux membres non-salariés de toute société consacrée à l'exploitation agricole métropolitaine.
* 1085 Article D. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 1086 Article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 1087 Article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
* 1088 Article D. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime.
* 1089 Article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 1090 Article D. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime
* 1091 Article D. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime.
* 1092 Article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
* 1093 Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
* 1094 Articles L. 132-1 du code des assurances et L. 223-3 du code de la mutualité.
* 1095 Articles L. 132-2 du code des assurances et L. 225-4 du code de la mutualité.
* 1096 Articles L. 132-12 du code des assurances et L. 223-13 du code de la mutualité.
* 1097 Article L. 132-11 du code des assurances et L. 223-12 du code de la mutualité.
* 1098 Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'État et accord collectif national du 11 juillet 2023.
* 1099 La loi n'excluant pas explicitement les ayants droit de victimes de sinistres professionnels, ni ne restreignant positivement le champ aux seuls assurés décédés à la suite d'un sinistre professionnel.
* 1100 Réponses écrites de la DSS au questionnaire de la rapporteure.
* 1101 Réponses écrites de la MSA au questionnaire de la rapporteure.
* 1102 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 1103 Réponse de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires au questionnaire du rapporteur en vue du présent projet de loi.
* 1104 Cour de cassation, 2 novembre 2004, pourvoi n° 03-12-218.
* 1105 Cour de cassation, 11 mars 2003, pourvoi n° 01-12.093.
* 1106 Réponse de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires au questionnaire du rapporteur en vue du présent projet de loi.
* 1107 Article L. 213-2 du code des procédures civiles d'exécution.
* 1108 Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice pour les années 2023 à 2027.
* 1109 Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
* 1110 Ibid.
* 1111 Réponse de l'agence de recouvrement et d'intermédiation alimentaire au questionnaire du rapporteur en vue du présent projet de loi.
* 1112 Réponse de l'agence de recouvrement et d'intermédiation alimentaire au questionnaire du rapporteur.
* 1113 Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
* 1114 Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907, annexe 9, déposé le 14 octobre 2025 sur le bureau de l'Assemblée nationale.
* 1115 Réponse de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires au questionnaire du rapporteur spécial.
* 1116 En particulier, les dispositions du II de l'article R. 58-8 du code de la sécurité sociale.
* 1117 En particulier, les dispositions de l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.
* 1118 En particulier, les dispositions de l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution et ce avant le 1er avril 2026, date d'entrée en vigueur prévu du dispositif du présent projet de loi.
* 1119 Michelle Perrot, Mon histoire des femmes, 2008.
* 1120 Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses.
* 1121 Article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
* 1122 Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d'activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie.
* 1123 Articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
* 1124 Ibid.
* 1125 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2024.
* 1126 Ibid.
* 1127 Article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pour la fonction publique d'État, article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour la fonction publique territoriale et article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pour la fonction publique hospitalière.
* 1128 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2024.
* 1129 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2025.
* 1130 Article L. 331-3 du code de la sécurité sociale.
* 1131 Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
* 1132 Drees, « Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants », juillet 2021.
* 1133 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2024.
* 1134 Drees, « Paternage », juillet 2021.
* 1135 Drees, « Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants », juillet 2021.
* 1136 Alix Sponton, « Des pères absents ? Saisir le non-recours au congé de paternité dans sa diversité à partir de méthodes mixtes », Population, 2023.
* 1137 Ibid.
* 1138 Article L. 1225-48 du code du travail.
* 1139 Article L. 1225-47 du code du travail, modifié par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
* 1140 Article L. 1225-55 du code du travail.
* 1141 Article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
* 1142 Selon le montent de base à taux plein en 2024.
* 1143 Réponse de la direction de la sécurité sociale au questionnaire du rapporteur.
* 1144 Réponse de la direction de la sécurité sociale au questionnaire du rapporteur en vue du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
* 1145 Réponse des associations familiales au questionnaire du rapporteur en vue du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
* 1146 Make Mothers Matter, L'état de la maternité en Europe, septembre 2025.
* 1147 Observatoire des familles, Comment les familles réussissent-elles à concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle ? mars 2023.
* 1148 Institut national des statistiques économiques, direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, Emploi, chômage, revenus du travail, juin 2022.
* 1149 Institut français d'opinion publique, Enquête sur le congé parental auprès des personnes ayant renoncé à avoir un ou d'autres enfant, octobre 2023.
* 1150 Ibid.
* 1151 Make Mothers Matter, L'état de la maternité en Europe, septembre 2025.
* 1152 Drees, « Premiers jours de l'enfant : un temps de plus en plus sanctuarisé par les pères via le congé de paternité », juillet 2023.
* 1153 Make Mothers Matter, L'état de la maternité en Europe, septembre 2025.
* 1154 Make Mothers Matter, L'état de la maternité en Europe, septembre 2025.
* 1155 Réponse des associations familiales au questionnaire du rapporteur en vue du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
* 1156 Centre d'études et de recherche sur les qualifications, « Quels freins limitent encore le recours au congé de paternité chez les jeunes pères ? », mars 2022.
* 1157 Centre d'études et de recherche sur les qualifications, « Quels freins limitent encore le recours au congé de paternité chez les jeunes pères ? », mars 2022.
* 1158 Insee, Les revenus et le patrimoine des ménages, octobre 2024.
* 1159 Make Mothers Matter, L'état de la maternité en Europe, septembre 2025.
* 1160 Ibid.
* 1161 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2025.
* 1162 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1163 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2025.
* 1164 Ibid.
* 1165 Ibid.
* 1166 Ibid.
* 1167 Ibid.
* 1168 Ibid.
* 1169 Ibid.
* 1170 Ibid.
* 1171 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Histoire des émotions, 2016.
* 1172 Peggy Bette, « Veuves et veuvages de la première guerre mondiale à Lyon », Vingtième siècle, 2008.
* 1173 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, annexe 1, mai 2025.
* 1174 Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
* 1175 Articles L. 331-3 à L. 331-9 du code de la sécurité sociale.
* 1176 Articles R. 331-5 à R. 313-17 du code de la sécurité sociale.
* 1177 Articles L. 232-7 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
* 1178 Article L. 2101-2 du code des transports.
* 1179 Article L. 3142-1-1 du code du travail.
* 1180 Article D. 1225-8 du code du travail.
* 1181 Article L. 1225-52 du code du travail.
* 1182 Cour de cassation, n° 06-44.751, 29 janvier 2008.
* 1183 Article L. 6323-12 du code du travail.
* 1184 Article L. 6323-28 du code du travail.
* 1185 Articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique.
* 1186 Article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime.
* 1187 Article L. 121-4 du code de commerce.
* 1188 Article L. 3231-2 du code du travail.
* 1189 Réponse de la direction de la sécurité sociale au questionnaire du rapporteur.
* 1190 L'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles a autorisé les assurés du régime général à bénéficier du taux plein dès soixante ans, à la condition d'avoir validé 150 trimestres d'assurance.
* 1191 La cessation d'activité s'entend de l'activité salariée ou non salariée exercée au cours de l'année précédant la liquidation de la pension par le régime général. Une fois la cessation d'activité constatée et la pension de retraite liquidée, il était loisible aux assurés de reprendre une activité chez un autre employeur ou une nouvelle activité non salariée.
* 1192 Décision n° 83-156 DC du 28 mai 1983 sur la loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse. Les auteurs de la saisine a priori soutenaient que la limitation de l'activité exercée en situation de cumul avec une pension de vieillesse violaient le principe de la liberté professionnelle en limitant les possibilités d'exercer un emploi et portait atteinte au principe d'égalité en ce qu'elle pénalisait, sans justification, certaines catégories professionnelles.
* 1193 Rapport du Conseil d'orientation des retraites du 6 septembre 2001 « Retraites : renouveler le contrat social entre générations ».
* 1194 Rapport « cumul emploi-retraite » de Jean-Marc Boulanger, inspecteur de l'Igas, publié à la Documentation française le 6 mars 2003.
* 1195 L'âge d'obtention automatique du taux plein était de 65 ans en 2009 et est désormais de 67 ans depuis la loi du 9 novembre 2010.
* 1196 Le cumul emploi-retraite intégral est ouvert aux assurés ayant liquidé l'intégralité de leurs pensions de retraite auprès des régimes obligatoires de base et complémentaires au taux plein, ce qui signifie qu'ils ont atteint l'âge légal d'ouverture des droits (AOD) et justifient de la durée d'assurance requise (DAR), ou qu'ils ont atteint l'âge d'obtention du taux plein (67 ans).
* 1197 Selon la Cour des comptes, le plafond global minimum de 1,6 Smic s'élève à 34 595 euros par an à partir de novembre 2024. La pension moyenne tous régimes est de 18 000 euros, de sorte que le plafond minimum de revenu d'activité est environ de 16 000 euros, soit le double de la moyenne du revenu d'activité des retraités en cumul emploi-retraite en 2020. (Rapport pour l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2025, p. 237).
* 1198 Selon la Cour des comptes, les médecins sont en proportion trois fois plus nombreux à recourir au cumul emploi-retraite que le reste de la population. La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a fait part à la rapporteure générale de la commission des affaires sociales et au rapporteur de la branche vieillesse des effets d'aubaine nés des dispositifs d'exonérations de cotisations vieillesse des médecins recourant au cumul emploi-retraite dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Une telle mesure a été votée à l'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ainsi qu'à l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 1199 Presque un quart des retraités en situation de cumul emploi-retraite bénéficient d'un départ anticipé à taux plein, et ce alors même que leur départ en retraite est justifié par l'usure professionnelle ou l'incapacité à travailler.
* 1200 Le chapitre VII du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025 de la Cour des comptes formule en sa page 254 les deux recommandations suivantes :
- simplifier la réglementation du cumul emploi-retraite de droit commun en prévoyant l'écrêtement des pensions servies par les régimes de base à hauteur de tout ou partie des revenus d'activité tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge d'obtention automatique du taux plein ;
- organiser l'automatisation du contrôle des revenus d'activité et de l'écrêtement des pensions servies.
* 1201 Selon l'étude d'impact figurant en annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce plafond serait fixé à 7 000 euros annuels, ce qui correspond à la fourchette basse proposée par la Cour des comptes dans son rapport - la fourchette haute étant de 10 000 euros. Entendus par le rapporteur de la branche vieillesse, les auteurs de ce rapport ont justifié cette fourchette par la comparaison avec les autres pays européens autorisant le cumul emploi-retraite.
* 1202 Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025, la Cour des comptes rappelle qu'avant 2021, un retraité pouvait être indemnisé jusqu'à 36 mois par l'assurance maladie tout en continuant de percevoir sa pension, ce qui a généré 35 milliards d'euros de dépenses d'indemnités journalières en 2019. Depuis le 1er janvier, les retraités ne peuvent percevoir d'indemnités journalières que dans la limite de soixante jours, ce qui a réduit les dépenses de 12,6 milliards d'euros en 2023. La prise en compte des indemnités journalières dans le plafond de revenus permettra de générer de nouvelles économies au titre des pensions qui seront écrêtées.
* 1203 Le calcul du plafond intégrerait les « revenus professionnels et de remplacement », qui sont précisés dans le dernier alinéa du A du III. Y figurent notamment les indemnités journalières de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires versées par l'employeur et les allocations d'assurance chômage.
* 1204 Les quatre catégories sont les suivantes : 1° activités dont la nature, ou le caractère accessoire, ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ; 2° activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ; 3° activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; 4° activités d'intérêt général ou concourant à un service public.
* 1205 Articles L. 722-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
* 1206 Article L. 321-6 du code de la sécurité sociale.
* 1207 Il s'agit souvent de régimes étrangers.
* 1208 Article L. 86 du code des pensions civiles et militaires tel que réécrit par le présent article.
* 1209 L'article 67 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et l'article 89 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ont aligné la revalorisation sur l'inflation des prestations relevant de leur champ d'application respectif.
* 1210 Article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 1211 Article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
* 1212 Article 41 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
* 1213 Article L. 1142-14 du code de la sécurité sociale.
* 1214 Article L. 168-9 du code de la sécurité sociale.
* 1215 Article L. 544-6 du code de la sécurité sociale.
* 1216 Article L. 521-1 du code de la sécurité sociale.
* 1217 Article L. 522-2 du code de la sécurité sociale.
* 1218 Article L. 522-3 du code de la sécurité sociale.
* 1219 Article L. 531-2 du code de la sécurité sociale.
* 1220 Article L. 531-3 du code de la sécurité sociale.
* 1221 Article L. 543-1 du code de la sécurité sociale.
* 1222 Article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.
* 1223 Article L. 755-16 du code de la sécurité sociale.
* 1224 Article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale.
* 1225 Article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.
* 1226 Le visa de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est remplacé par celui de l'article L. 341-6 du même code, qui prévoit la revalorisation des salaires servant de base au calcul des pensions d'invalidité au 1er avril de chaque année sur le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code.
* 1227 Article L. 5524-4 du code du travail.
* 1228 Ce rendement serait principalement porté par les allocations familiales, dont la non-revalorisation entraînerait une moindre dépense de 0,1 milliard d'euros.
* 1229 L'étude d'impact détaille un gain de 10 millions d'euros en 2026 au titre de la non-revalorisation de l'AEEH.
* 1230 Ce montant correspond à celui du Smic net qui était de 1426 euros au 1er janvier 2025.
* 1231 Les pensions de droit direct correspondent à un droit propre à une prestation vieillesse versée sous forme de rente, et se différencient des pensions de droit dérivé que sont réversion et de vieillesse de veuf ou veuve, ainsi que des prestations de droit direct non contributives tel que le minimum vieillesse.
* 1232 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale « Retraites » annexé au présent projet de loi, p. 43.
* 1233 M. Jean-Jacques Marette a été entendu par la rapporteure générale et le rapporteur de la branche vieillesse le 10 novembre 2025, en sa qualité d'ancien animateur de la délégation paritaire permanente.
* 1234 Cour des comptes, « La retraite des femmes et des hommes : une réduction des écarts à poursuivre », La Sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023.
* 1235 Selon l'Insee, en 2023, l'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes était de 22,2 % pour les salariés du secteur privé. Les différences de rémunération s'expliquent par les différences de qualification et de temps de travail.
* 1236 Cour des comptes, « La retraite des femmes et des hommes : une réduction des écarts à poursuivre », in La Sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023.
* 1237 L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) consiste en l'attribution d'un montant égal à la différence entre le montant maximum de pension cité ci-dessus, et le montant des revenus des allocataires. Plus de la moitié des personnes qui y sont éligibles ne le sollicitent toutefois pas.
* 1238 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale « Retraites » annexé au présent projet de loi.
* 1239 Drees, Les retraités et les retraites, édition 2024.
* 1240 CJUE, 13 décembre 2021, Mouflin c/ France ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2009.
* 1241 Les trimestres de majoration de durée d'assurance (MDA) sont attribués au titre de la maternité et de l'éduction des enfants. Les trimestres d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permettent aux parents qui bénéficient de prestations familiales pour avoir réduit ou cessé leur activité, de valider des trimestres au régime général, le report au compte étant équivalent au Smic. Enfin, l'un des deux parents d'une fratrie d'au moins trois enfants peut prétendre à une majoration de sa pension.
* 1242 Cour des comptes, « La retraite des femmes et des hommes : une réduction des écarts à poursuivre », in La Sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023.
* 1243 Cour des comptes, « Les droits familiaux de retraite : des dispositifs à simplifier et à harmoniser », in La Sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2022.
* 1244 La pension de réversion est une pension de droit dérivé qui permet, sous certaines conditions, de verser à un conjoint ou ex-conjoint survivant d'un assuré décédée une partie de la retraite dont ce dernier bénéficiait, afin de préserver le niveau de vie de la personne ayant été mariée. Les conditions d'attribution ainsi que le taux de réversion varient selon les régimes, ce qui est source de disparités entre les assurés.
* 1245 Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale « Retraites » annexé au présent projet de loi.
* 1246 Cour des comptes, « La retraite des femmes et des hommes : une réduction des écarts à poursuivre », in La Sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023.
* 1247 Cour des comptes, « Le cumul emploi-retraite : un coût élevé, une cohérence à établir », Ralfss 2025, chapitre VII.
* 1248 La réforme du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles opérée à l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 inclura les non-salariés agricoles dans le périmètre de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie l'absence de dispositions afférentes dans le présent article.
* 1249 Ce découpage se justifie par le fait que la pension de retraite proportionnelle des non-salariés agricoles repose sur un système de points, et que la MSA ne garde pas trace des déclarations de revenus de ses assurés au-delà d'une durée de dix ans. Le passage d'un système à points à un système de revenus ne pouvait se faire qu'à partir des années postérieures à 2015, la MSA ne conservant pas trace des revenus antérieurs. Compte tenu des difficultés de paramétrage du système informatique auquel se heurte la MSA pour transformer la prise en compte de points en revenus, l'entrée en vigueur de la réforme ne sera possible qu'au 1er janvier 2028 pour la partie de revenus antérieure à 2015.
* 1250 Amendement n° 2375.
* 1251 Amendement n° 2376.
* 1252 Amendement n° 2693.
* 1253 Proposition n° 13 formulée par Mme Pascale Gruny, rapporteur de la branche vieillesse, en page 93 du rapport n° 756 sur le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024 de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales.
* 1254 CJUE, 13 décembre 2021, Mouflin c/ France ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 février 2009.
* 1255 Les trimestres de majoration de durée d'assurance (MDA) sont attribués au titre de la maternité et de l'éduction des enfants. Les trimestres d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permettent aux parents qui bénéficient de prestations familiales pour avoir réduit ou cessé leur activité, de valider des trimestres au régime général, le report au compte étant équivalent au Smic. Enfin, l'un des deux parents d'une fratrie d'au moins trois enfants peut prétendre à une majoration de sa pension.
* 1256 Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
* 1257 Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
* 1258 Article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
* 1259 Article R. 351-27-1 du code de la sécurité sociale.
* 1260 Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
* 1261 Article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
* 1262 Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
* 1263 Article R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale.
* 1264 Article R. 351-23 du code de la sécurité sociale.
* 1265 Article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
* 1266 Article 6 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation et article 19 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
* 1267 Article 1er de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 1268 Dans le code de la sécurité sociale.
* 1269 C'est-à-dire qui ne figurerait que dans le présent article de la LFSS pour 2026, et pas dans le code de la sécurité sociale.
* 1270 « Si la mesure devait entrer en vigueur au 1er janvier, cela serait impossible. Nous serions en conformité en mai, si bien que les dossiers de janvier à mai seraient bloqués : des assurés ne toucheraient pas leur retraite pendant plusieurs mois. À cette date, le texte n'a pas d'impact de recalcul. L'entrée en vigueur est prévue au 1er septembre 2026 : nous calculerons d'emblée les bons montants. » (Renaud Villard, directeur général de la Cnav, audition par la commission des affaires sociales du Sénat, 29 octobre 2025).
* 1271 Décret n° 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaire de retraite.
* 1272 Arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B.
* 1273 Projection des Retraites, Simulations, Modélisation et Évaluations. L'estimation des effets financiers via Prisme ne porte que sur le système de retraite et ne tient pas compte des économies en prestations ni des pertes de recettes sur les autres branches, induites par l'anticipation de la liquidation des pensions. En effet, les dépenses de pension induisent des effets sur les recettes, compte tenu du rôle d'équilibrage que joue la Cnav auprès du régime agricole mais également des régimes dits « fermés ».
* 1274 Amendement n° 2686.
* 1275 Sous-amendement n° 2708.
* 1276 Ce coût a été estimé par M. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des solidarités, lors de son interview au Télématin 4 Vérités de France 2 du mercredi 12 novembre. Il a par ailleurs indiqué que l'inclusion des dispositifs de retraite anticipée au présent article permettrait d'inclure « à peu près 20 % de personnes supplémentaires. » Cette suspension « pourrait être financée par l'augmentation de 1,4 point de CSG et par la CSG sur le patrimoine », après que l'Assemblée ait rejeté l'article 44 du présent texte en première lecture qui prévoyait de sous-indexer les pensions de retraite de 0,5 point supplémentaires sur l'inflation au titre de l'année 2027, pour un rendement de 1,5 milliard d'euros destiné à financer l'article 45 bis.
* 1277 Selon un sondage Elabe pour BFMTV de janvier 2025, 62 % des Français souhaitent revenir à un âge légal de départ à la retraite de 62 ans, tandis que 31 % veulent le maintenir à 64 ans.
* 1278 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 1279 Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025.
* 1280 Juliette Ducoulombier, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la DG Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024.
* 1281 Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Prendre la mesure de la crise du travail en France, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp), Sciences Po, 11 septembre 2024.
* 1282 « La France se singularise par une proportion beaucoup plus importante qu'ailleurs d'un type d'organisation du travail caractérisé par une autonomie et une participation plus faible. Les travailleurs n'ont que très peu d'influence sur leur propre travail et les décisions de leur entreprise. Exploitant la vague 2015 de l'enquête européenne sur les conditions de travail, Agnès Parent-Thirion et ses collègues avaient mis en évidence la plus forte présence dans les pays nordiques d'organisations du travail dites apprenantes, associées à plus de bien-être au travail. À la recherche des variables clés expliquant cette situation ils en avaient trouvé une seule : la forte présence syndicale » (Dominique Méda, « De la crise du travail en France », Le Monde, 29 et 30 janvier 2023).
* 1283 Selon les termes du communiqué du ministère du travail du 4 novembre 2025.