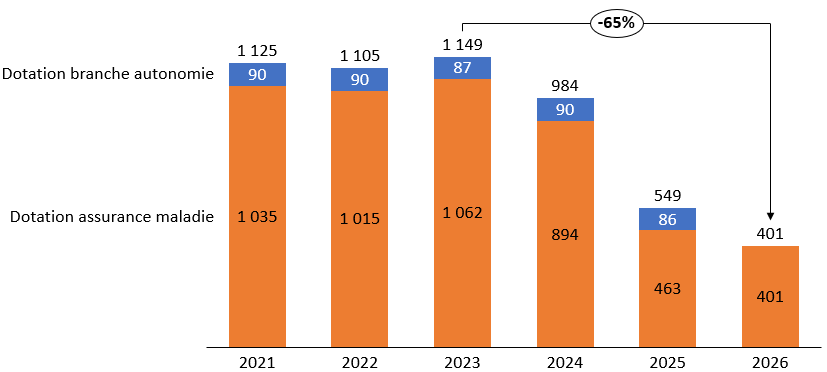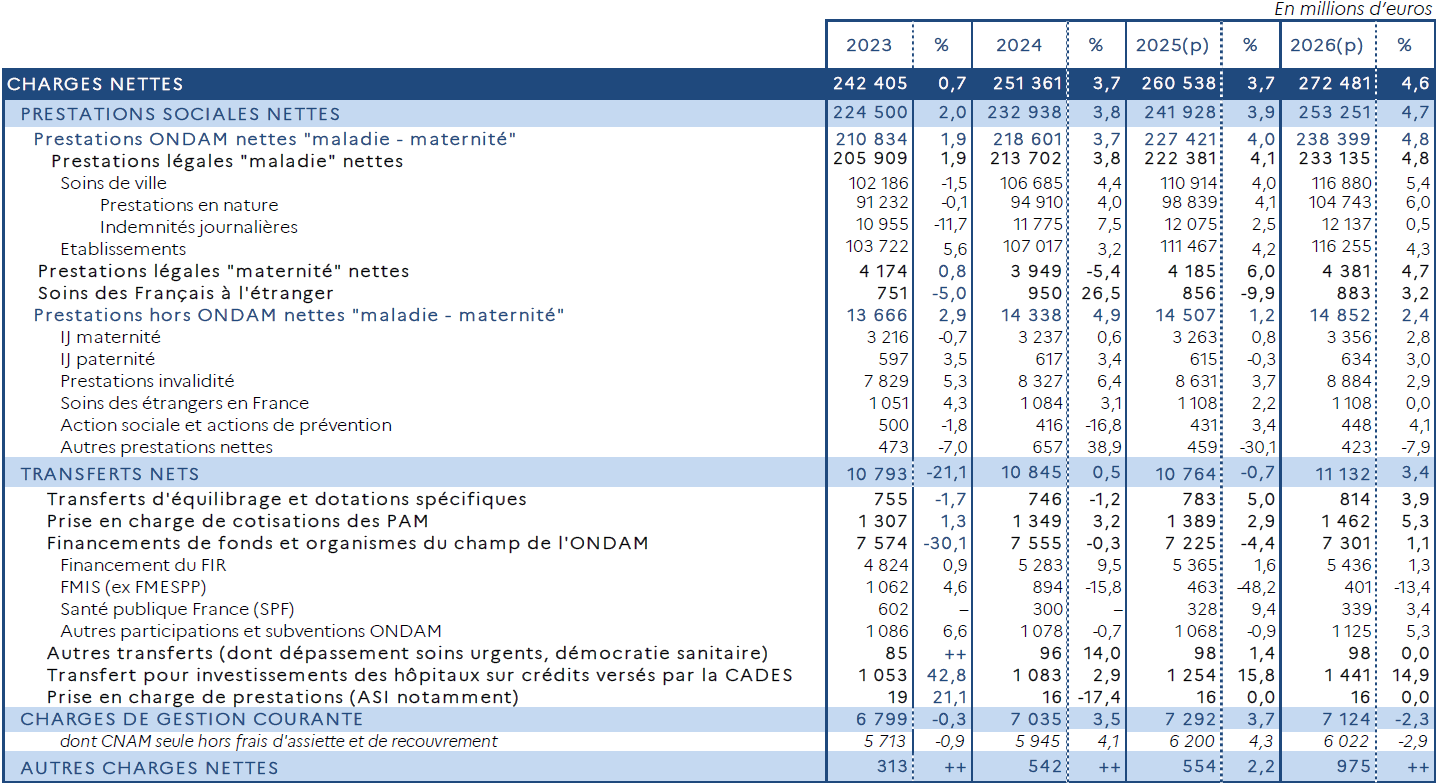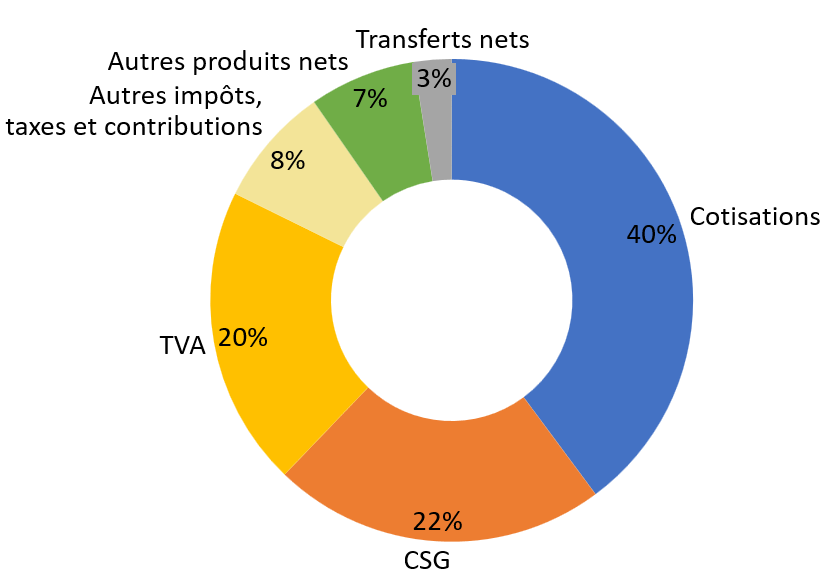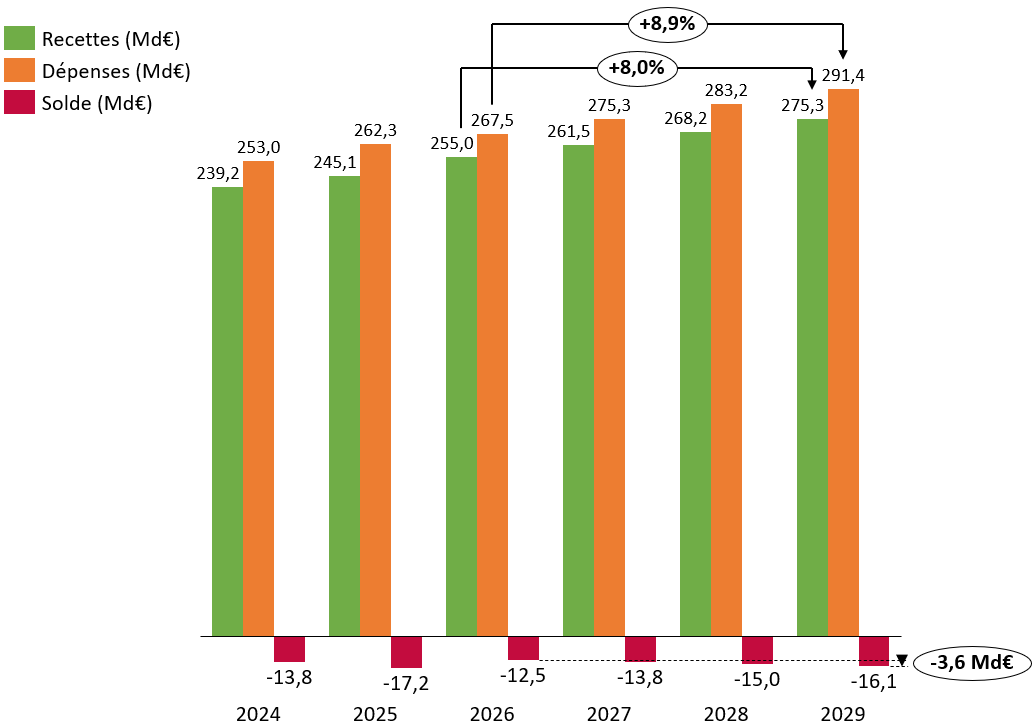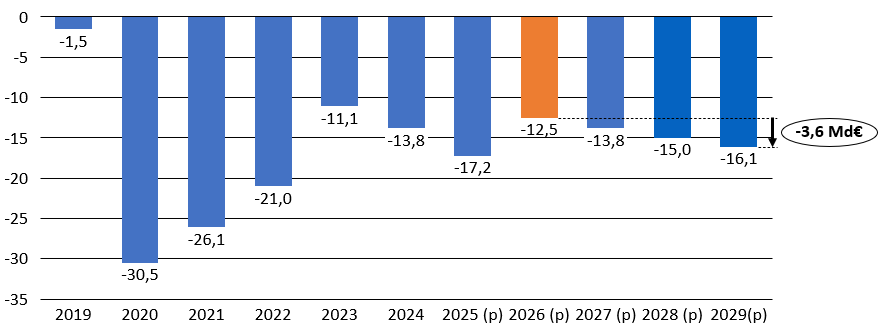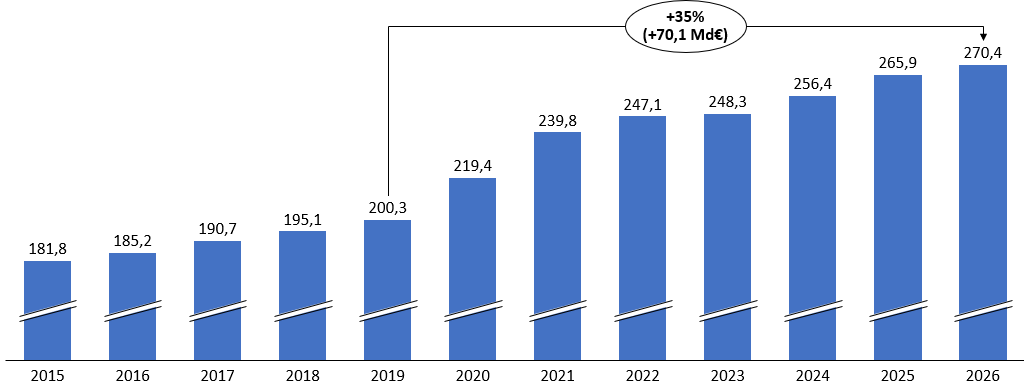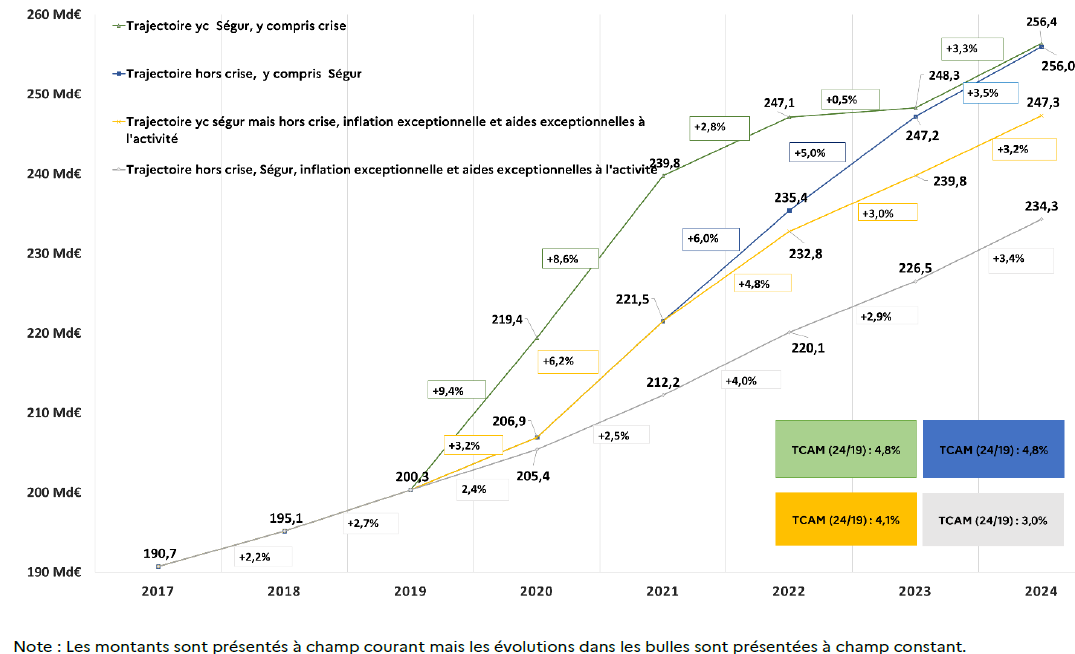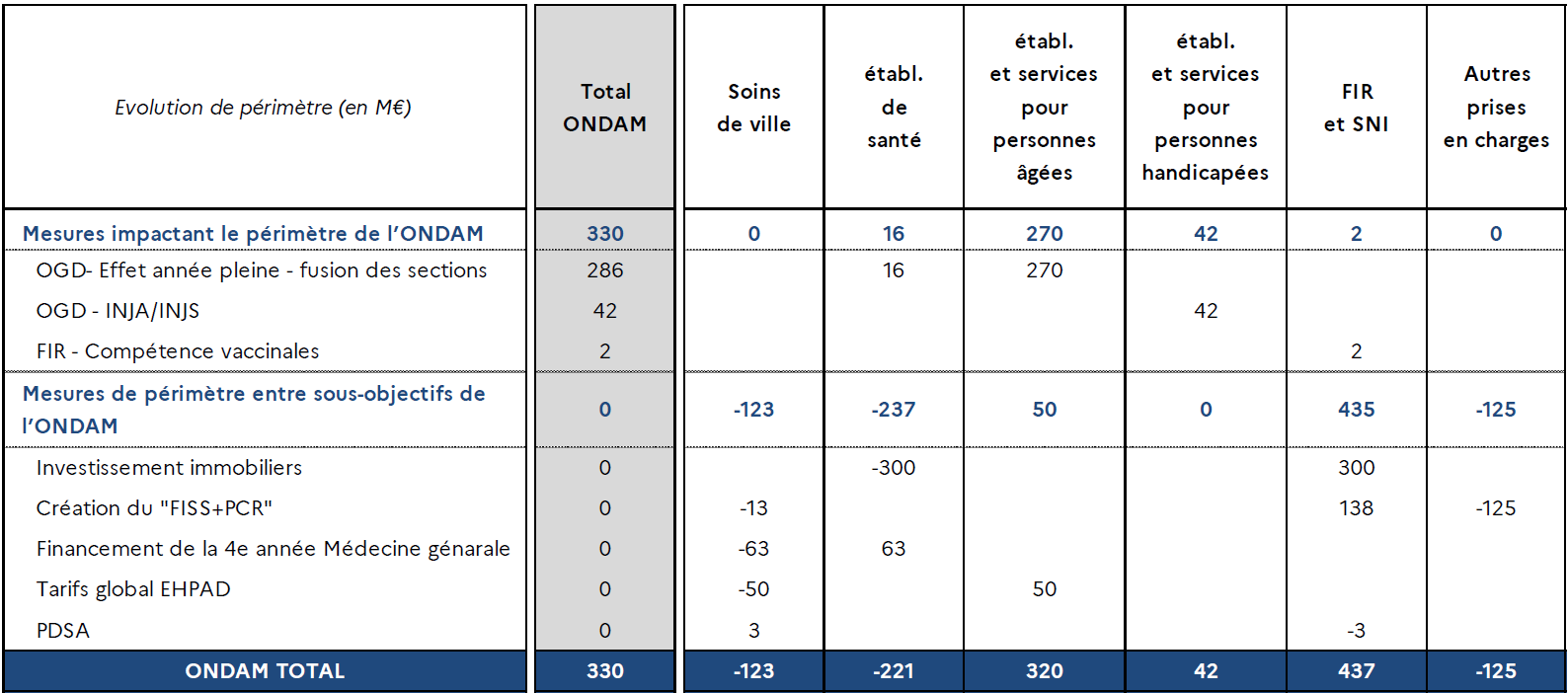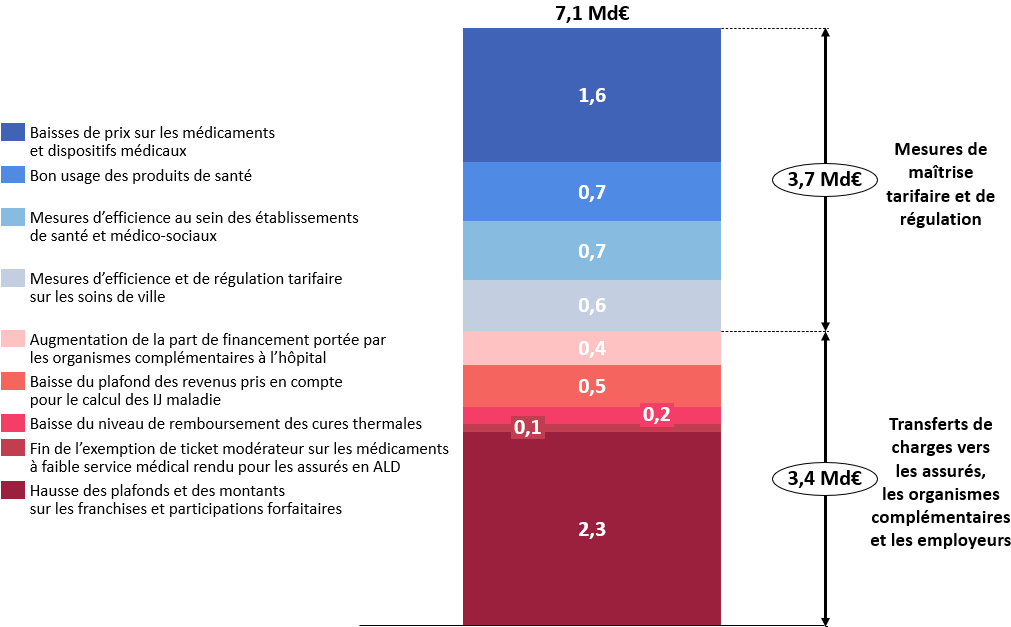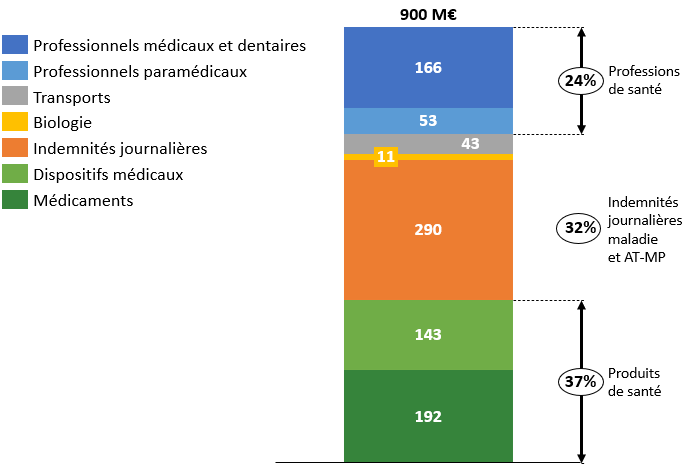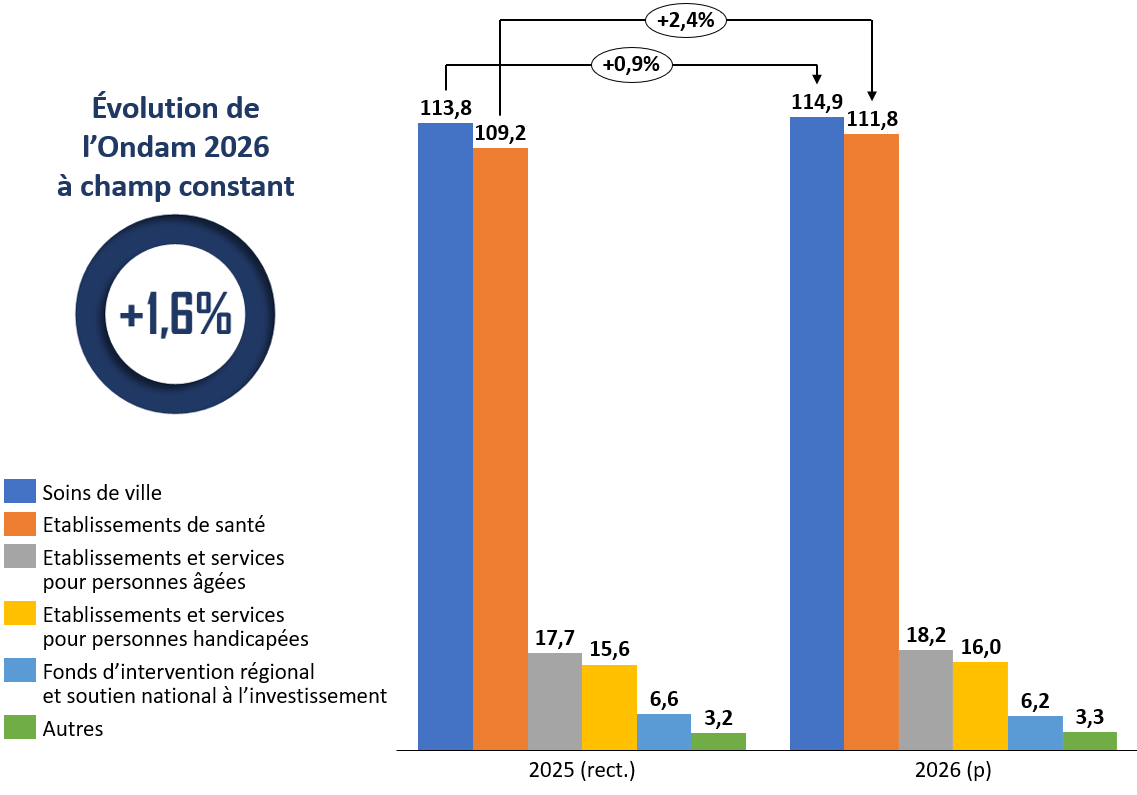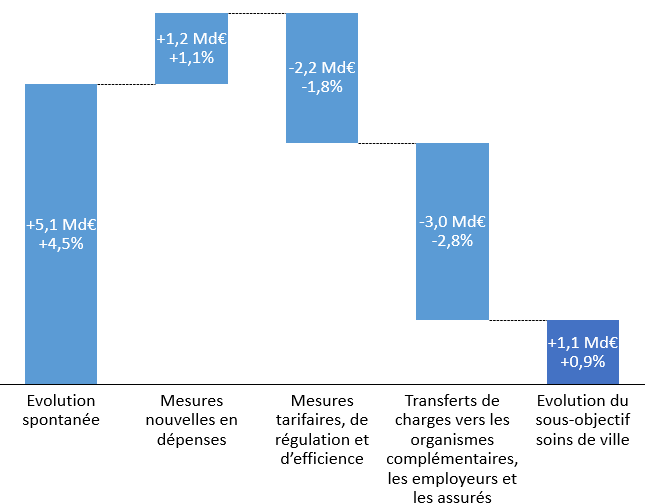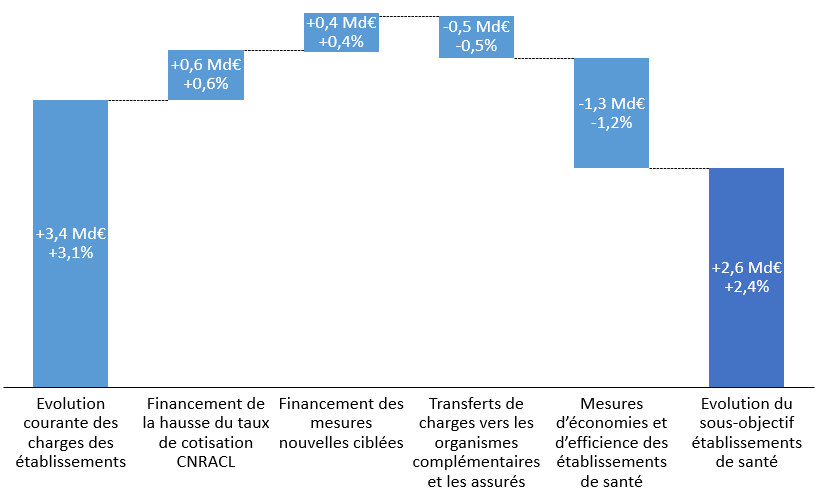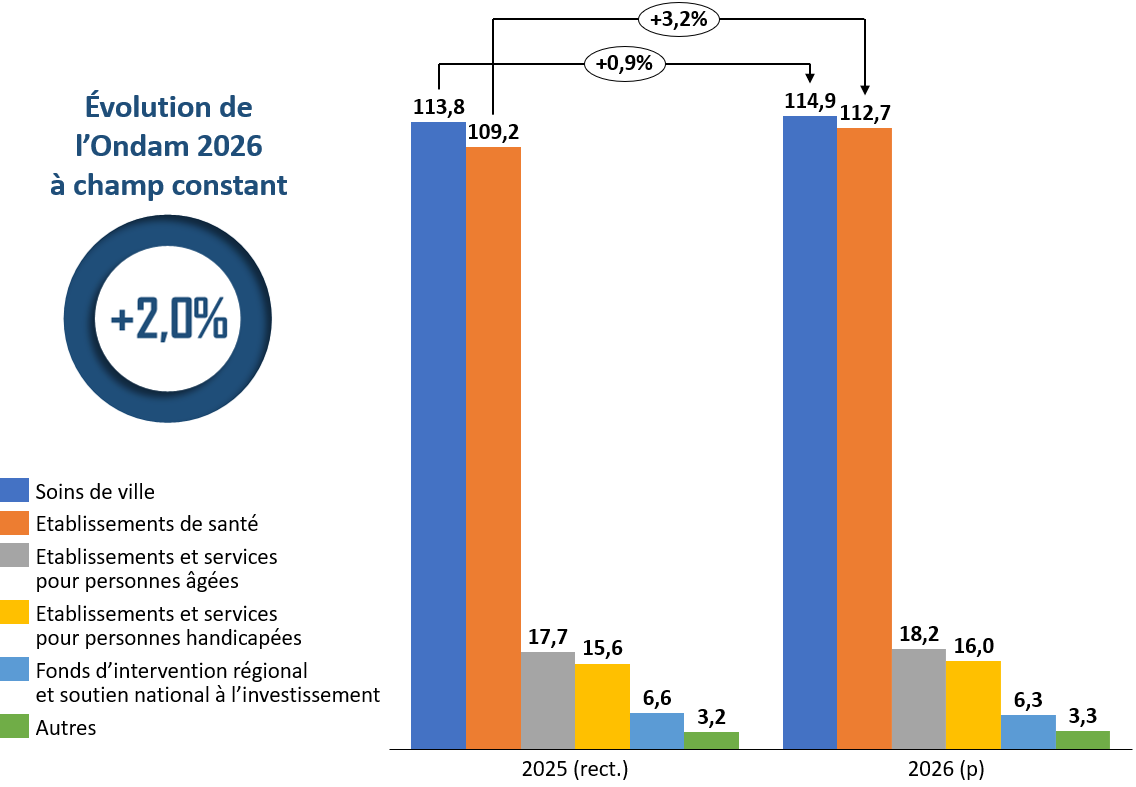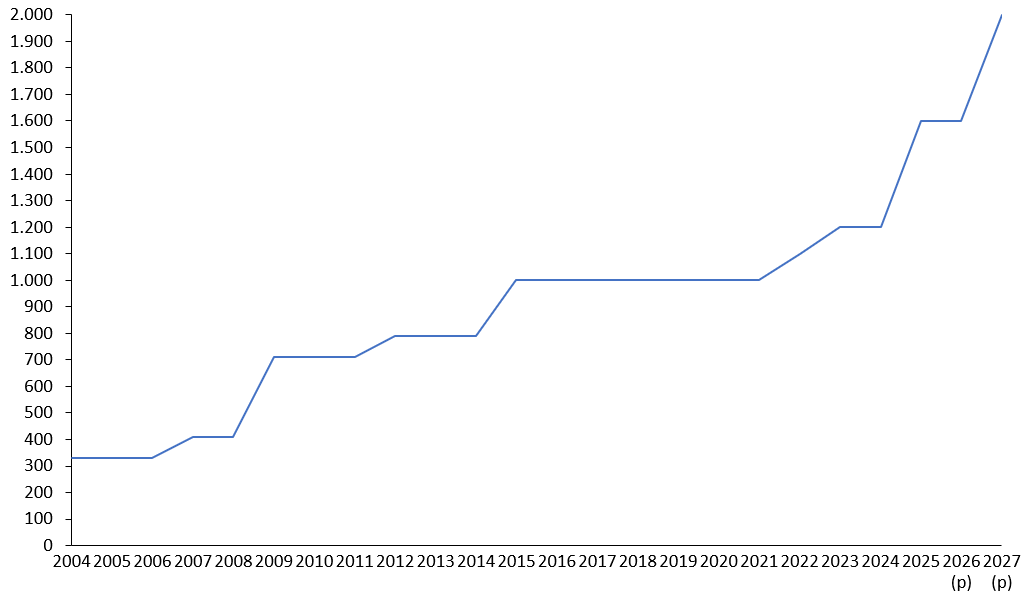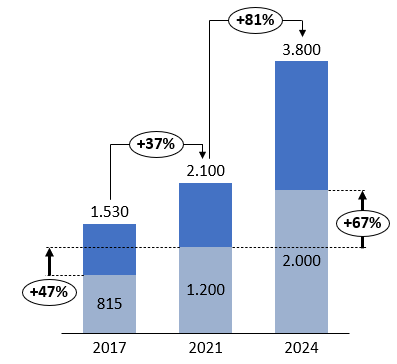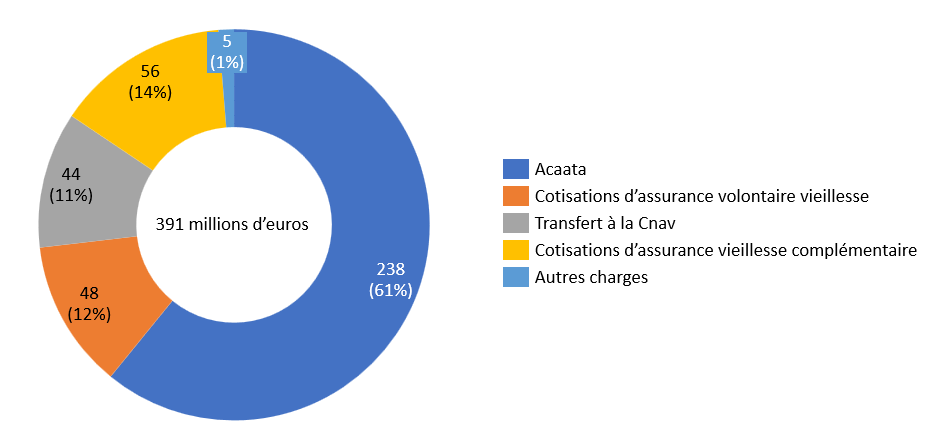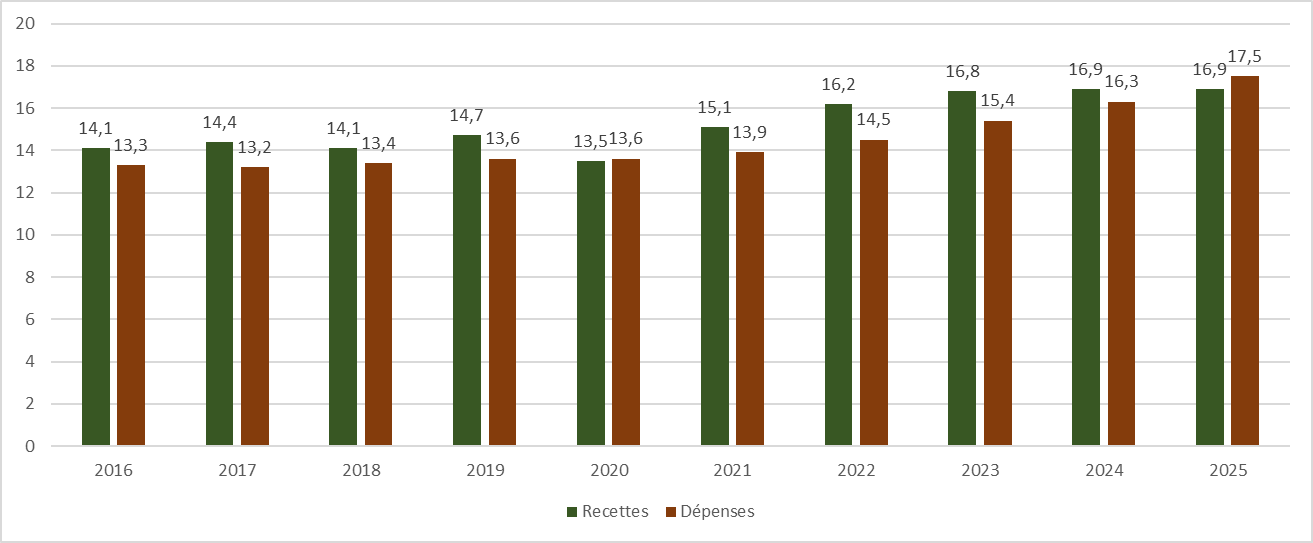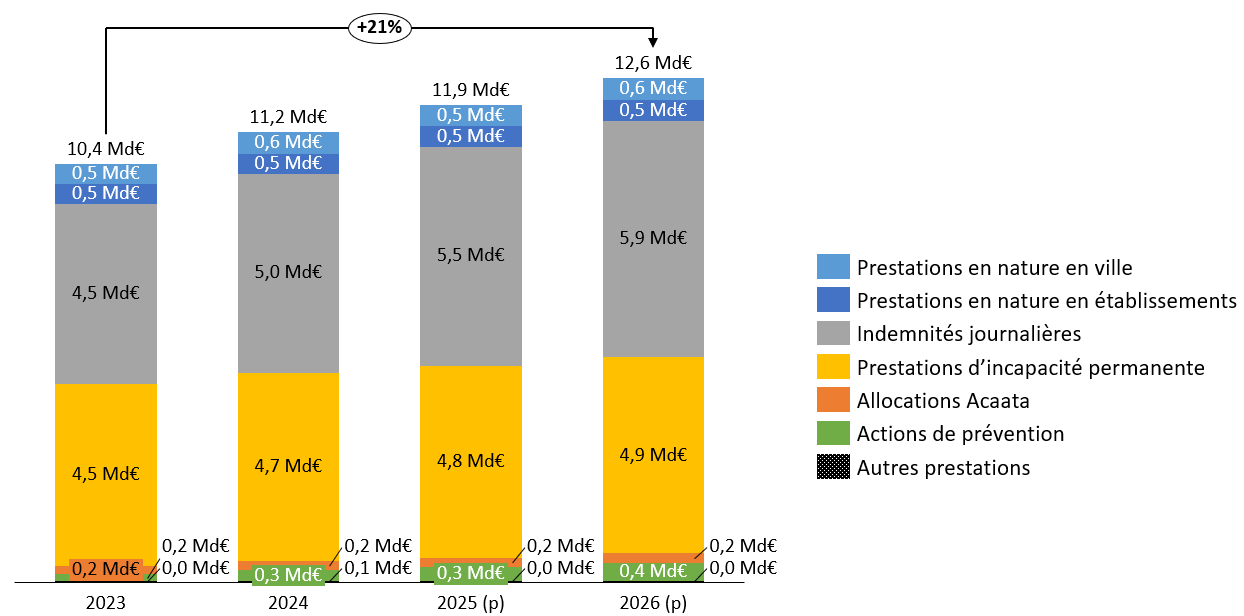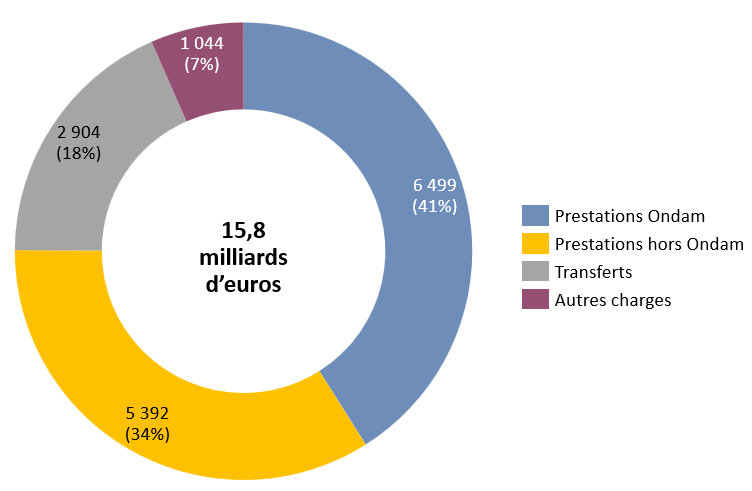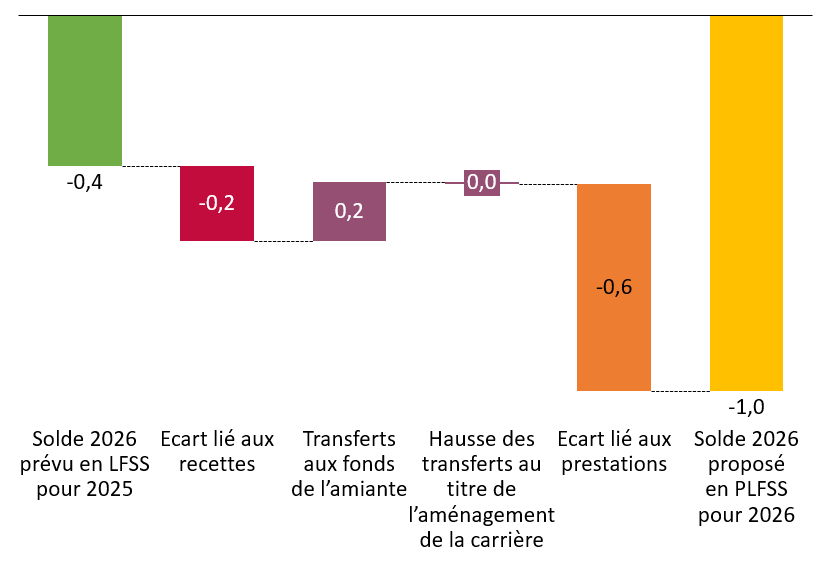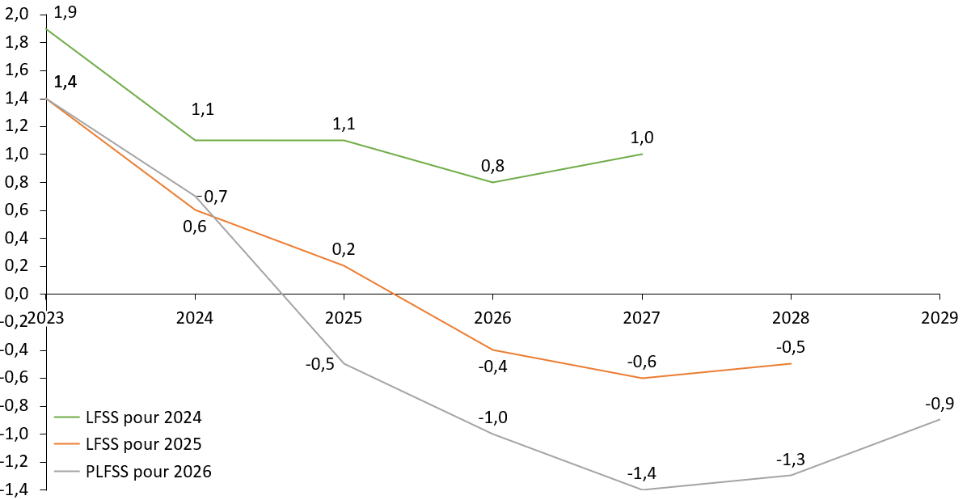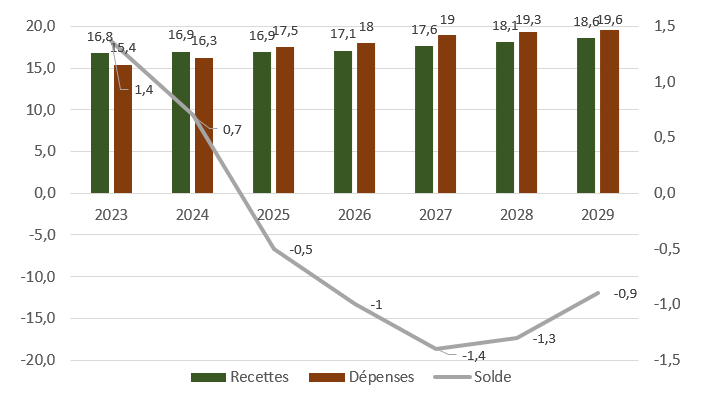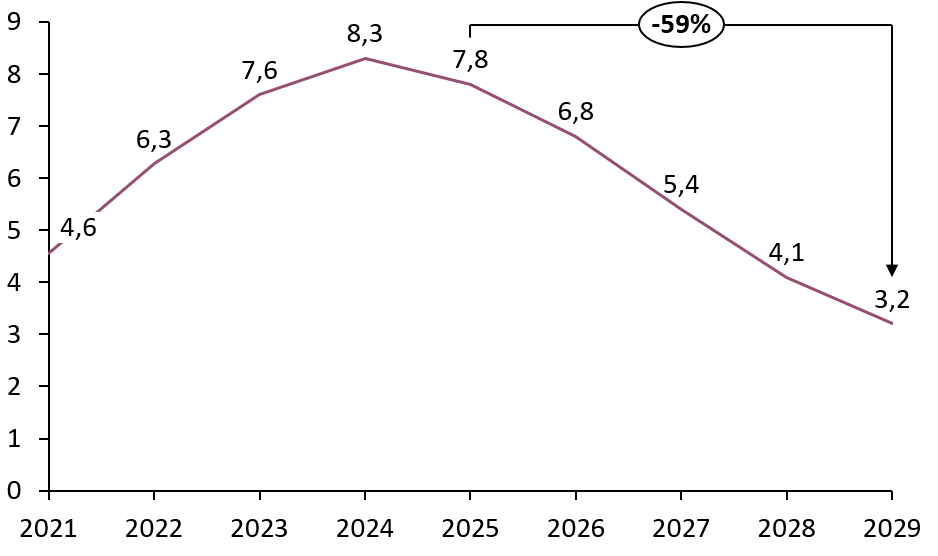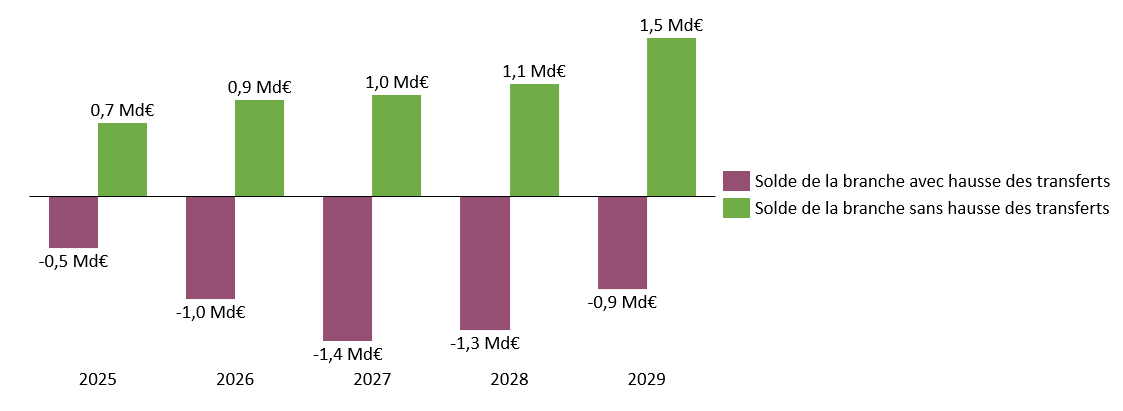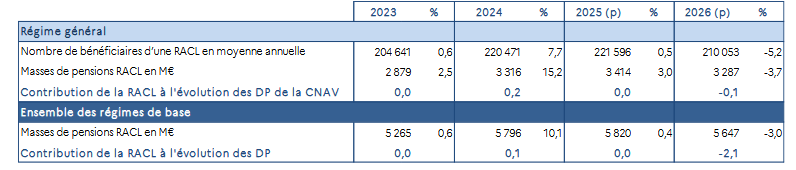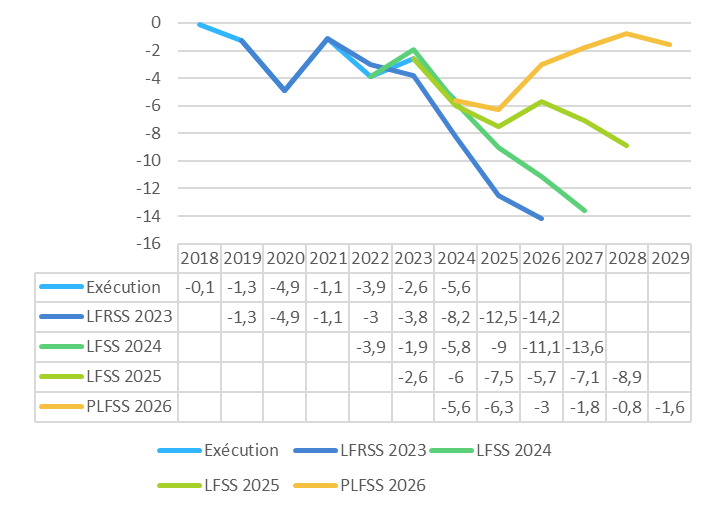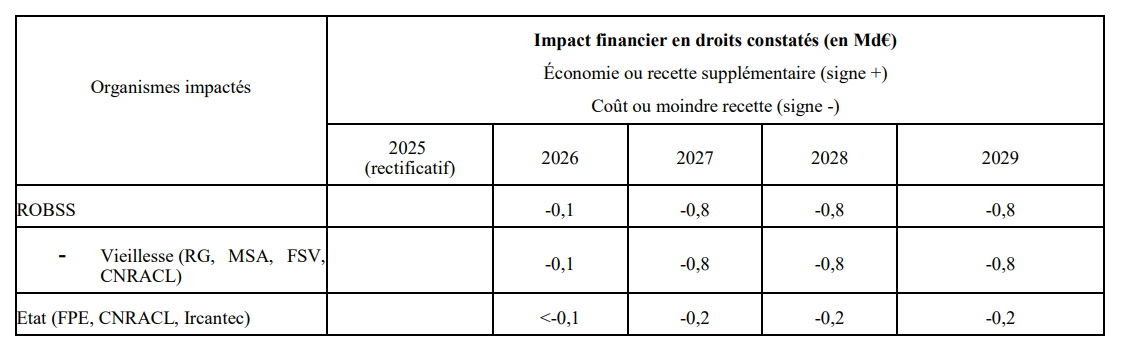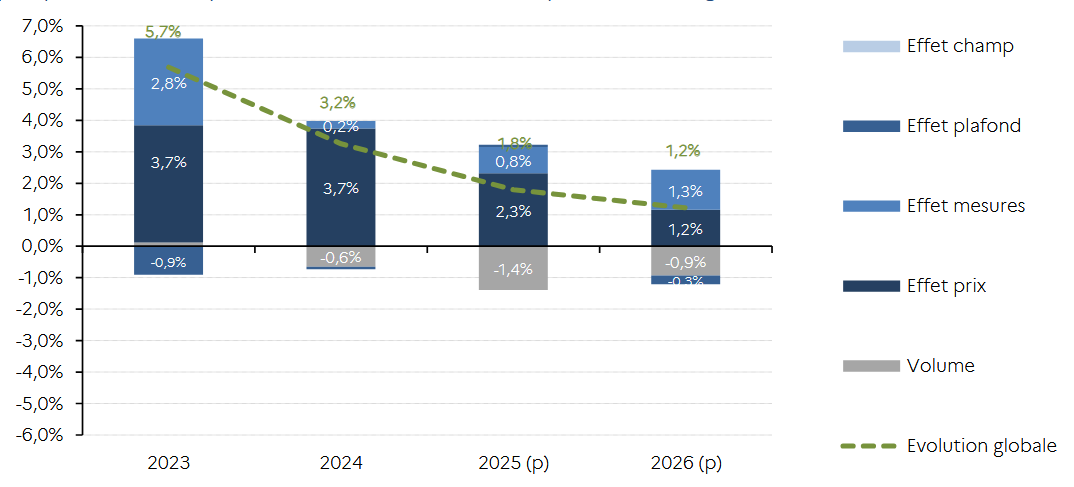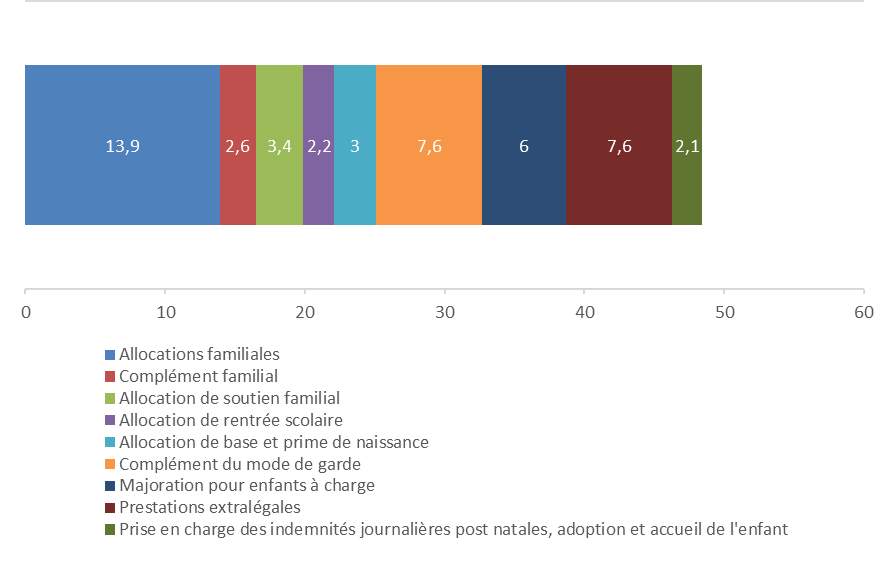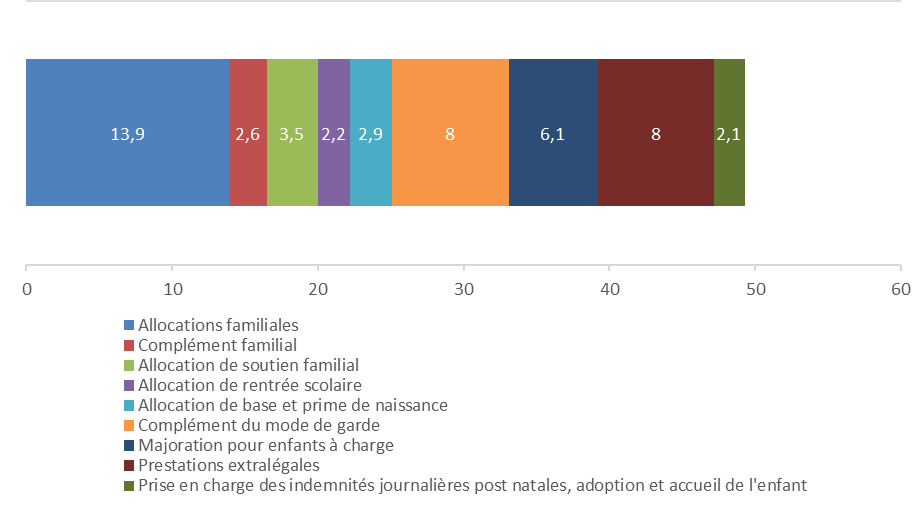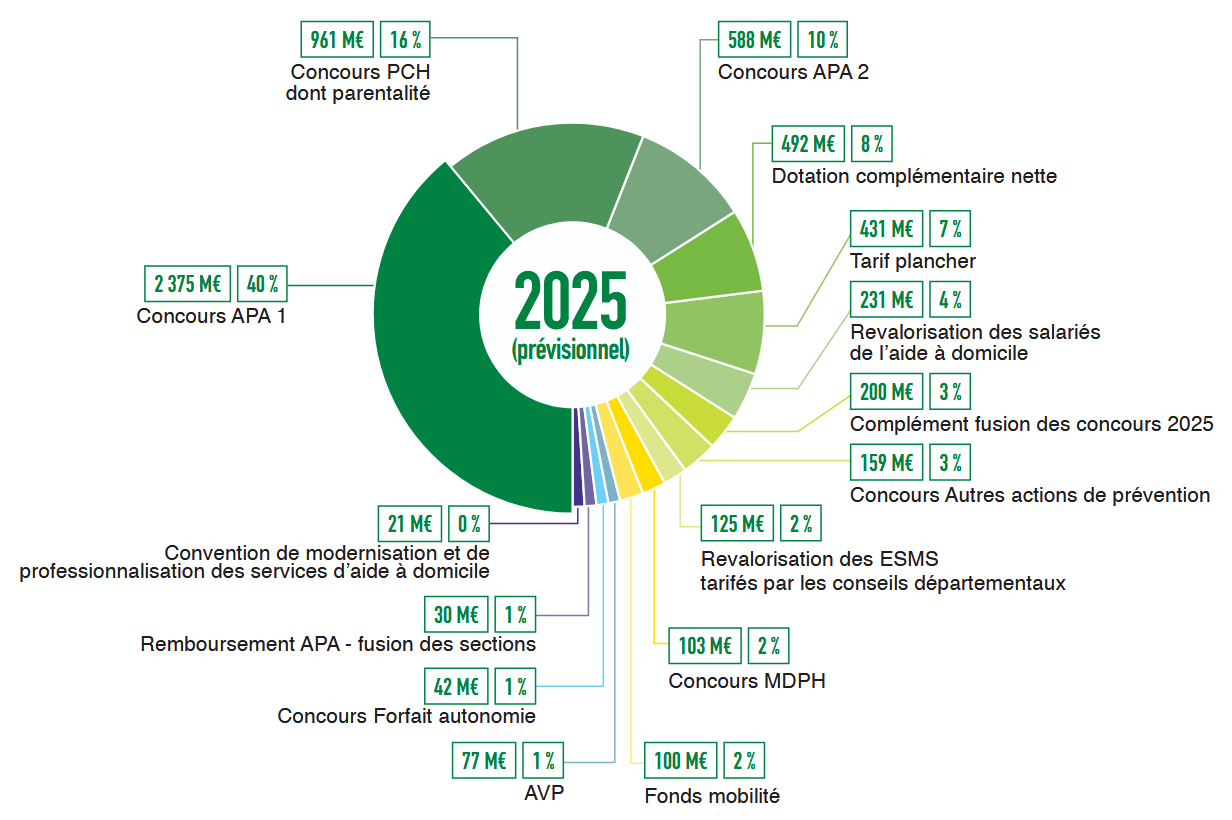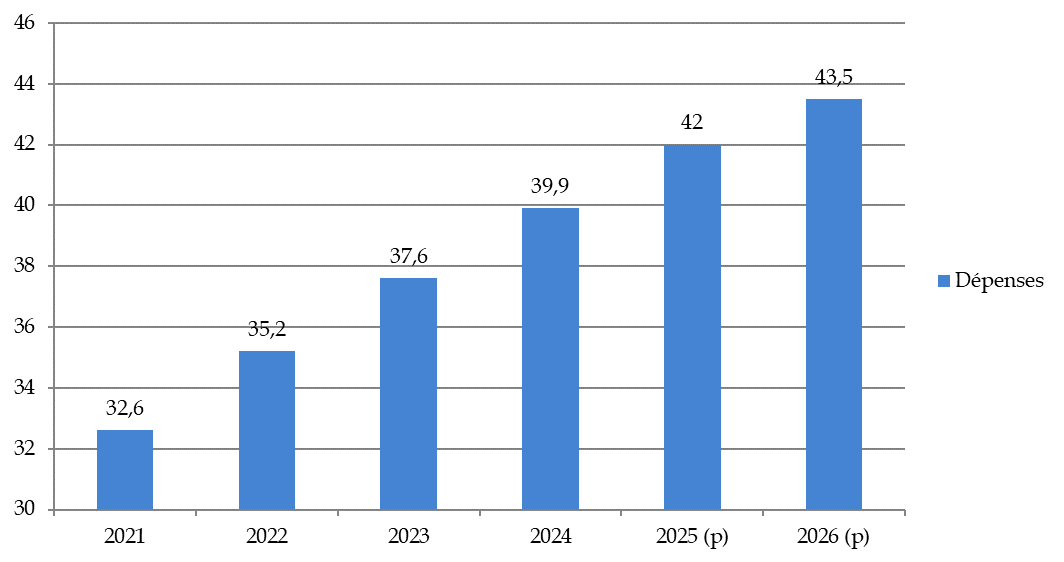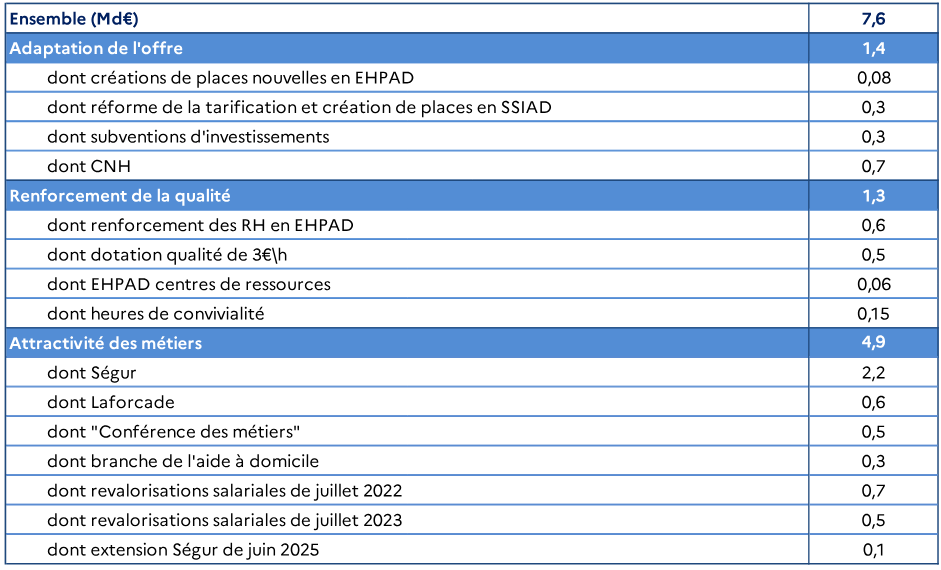TITRE II
DOTATIONS ET
OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU
FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 46
Dotation de l'assurance maladie au Fonds pour la modernisation et l'investissement
en santé et de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie aux agences régionales de santé
Cet article fixe le montant de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) à 401 millions d'euros pour 2026.
Il fixe également le montant de la dotation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux agences régionales de santé, à 190 millions d'euros.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. La baisse continue de la dotation au Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé se poursuit en 2026
Le Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) constitue le principal vecteur de financement du volet « investissement » du Ségur de la santé, tout en assurant d'autres actions d'accompagnement de l'investissement hors Ségur. S'il finance principalement l'investissement immobilier et numérique des établissements de santé, il contribue également au programme « ESMS numérique » d'investissement numérique des établissements médico-sociaux.
Jusqu'en 2025, ce fonds percevait des dotations de l'assurance maladie d'une part, et de la branche autonomie d'autre part. Pour la première année, il ne percevra plus en 2026 qu'une dotation de l'assurance maladie, actant l'extinction du projet « ESMS numérique » dont la programmation couvrait uniquement la période 2021-2025.
En outre, le mouvement à la baisse de la dotation se poursuit. Alors que le fond avait bénéficié de dotations annuelles supérieures à un milliard d'euros les trois premières années de sa création, de 2021 à 2023, le montant de la dotation diminue de façon continue depuis, à mesure que l'échéance finale des opérations d'investissement au titre du Ségur de la santé approche.
La dotation au FMIS s'établirait à 401 millions d'euros en 2026, soit une diminution de 60 % par rapport à la période 2021-2023.
Évolution des dotations au FMIS
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, données du ministère de la santé
Les projets financés par le FMIS en 2025 sont détaillés supra dans le commentaire de l'article 3.
En revanche, le ministère de la santé n'a fourni à la commission aucun détail précis sur les prévisions de dépenses pour 2026 par type de projets.
B. La dotation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux agences régionales de santé reste au même niveau
Chaque année, la branche autonomie verse une contribution financière aux ARS au titre des actions du fonds d'intervention régional (FIR) en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette contribution est encadrée par la convention d'objectifs et de gestion (COG) État-CNSA 2022-2026.
Cette contribution permet, historiquement, à la branche autonomie de soutenir les dispositifs d'autodétermination et d'entraide, notamment via le financement de la création de Groupes d'entraide mutuelle (GEM) et de Collectifs d'entraide pour l'insertion sociale et professionnelle (CEISP).
Elle permet également à la CNSA d'appuyer le développement et de contribuer au financement du fonctionnement des dispositifs d'appui à la coordination des parcours complexes (Dac), créés en 2019, qui visent à simplifier et mieux structurer le parcours des personnes prises en charge.
D'autres actions sont financées, notamment le développement de l'habitat inclusif, le financement de projets de centres régionaux d'études, d'actions et d'informations (Creai) ou encore le déploiement du système d'information de suivi des orientations dans le champ du handicap.
La mise en oeuvre des revalorisations salariales issues des déclinaisons du Ségur de la santé pour les GEM, les CEISP et les Dac, jusqu'à présents exclus du bénéfice de ces revalorisations, sera plus spécifiquement financée en 2026, à hauteur de 11 millions d'euros1284(*).
Après plusieurs années d'augmentation, en 2026, le montant de la contribution de la branche autonomie au FIR se stabilise à 190 millions d'euros.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission prend acte des dotations proposées, tout en déplorant le manque d'informations quant aux projets qui seront financés par le FMIS au titre de l'année 2026.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
47
Dotation aux opérateurs financés par le 6ème
sous-objectif
Cet article fixe les dotations à douze opérateurs financés par le 6ème sous-objectif de l'Ondam, pour un montant total d'environ 1,4 milliard d'euros.
La commission propose d'adopter cet article, modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
I - Le dispositif proposé : la fixation des dotations de l'assurance maladie à douze opérateurs
A. Les dotations aux opérateurs sont désormais inscrites au sein du PLFSS
La majorité des dotations attribuées à des opérateurs financés par l'assurance maladie n'étaient pas inscrites dans la loi jusqu'à l'année dernière.
La commission l'avait déploré à de nombreuses reprises. Dans le cadre d'une mission d'information sur les organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (Offrob), elle soulignait ainsi que « le degré d'autorisation parlementaire sur les subventions de la sécurité sociale aux Offrob était insatisfaisant et empêchait les parlementaires de défendre les moyens accordés à ces agences, dont le rôle sanitaire est pourtant essentiel. »1285(*)
Lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, elle rappelait régulièrement la nécessité de renforcer le contrôle du Parlement en fixant par la loi la dotation des principaux opérateurs publics de santé, eu égard à leurs missions et au montant des dotations qui leur sont allouées. Elle estimait également nécessaire un retour devant le Parlement en cas de dotations exceptionnelles en cours d'exercice budgétaire.
Lors de l'examen du PLFSS pour 2025, la commission avait fait adopter un amendement prévoyant l'inscription dans la loi des dotations fixées aux opérateurs et en avait fixé les montants pour l'année 2025.
L'article 47 est la traduction de cette demande de la commission.
B. Des dotations de l'assurance maladie sont attribuées à douze opérateurs pour un total d'environ 1,4 milliard d'euros
L'exposé des motifs indique que l'enveloppe globale allouée aux opérateurs financés par le 6ème sous-objectif prévoit une hausse des dotations, de l'ordre de 55 millions d'euros, par rapport à 2025, en intégrant des économies à hauteur de 18 millions d'euros et des mesures nouvelles estimées à 74 millions d'euros. L'analyse des montants indiqués dans l'annexe 2 du PLFSS affiche une augmentation de 98,3 millions d'euros.
Dotations de l'assurance maladie aux opérateurs du 6ème sous-objectif, hors dotations exceptionnelles
(en millions d'euros)
|
Dotation 2024 |
Dotation 2025 |
Dotation 2026 |
Variation 2025-2026 |
|
|
Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (Oniam) |
160,2 |
181,23 |
202,20 |
+ 11,6 % |
|
Agence nationale de santé publique (Santé publique France SPF) |
200,1* |
328,2* |
395,54 |
+ 20,5 % |
|
Agence de la biomédecine (ABM) |
53,4 |
54,95 |
56,27 |
+ 2,4 % |
|
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) |
142,6 |
142,62 |
143,69 |
+ 0,8 % |
|
Haute Autorité de santé (HAS) |
72 |
72,42 |
69,97 |
- 3,4 % |
|
Agence du numérique en santé (ANS) |
114,2 |
112,80 |
115,80 |
+ 2,7 % |
|
Établissement français du sang (EFS) |
100 |
110 |
108,40 |
- 1,5 % |
|
École des hautes études en santé publique (EHESP) |
45,2 |
45,2 |
44,76 |
- 1,0 % |
|
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) |
20,3 |
19,8 |
19,45 |
- 1,8 % |
|
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) |
11,5 |
11,49 |
11,74 |
+ 2,2 % |
|
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) |
43,6 |
43,62 |
43,55 |
- 0,2 % |
|
Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) |
226,46 |
215,88 |
225,14 |
+ 4,3 % |
|
Total |
1 189,56 |
1 338,21 |
1 436,51 |
+ 7,35 % |
* Changement de périmètre (dotation socle uniquement en 2024, à l'exclusion de la dotation de crise)
Source : Annexe 2 aux PLFSS pour 2025 et 2026
Les montants des dotations octroyées aux opérateurs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'Agence nationale du développement professionnel continu, peuvent être complétés par des versements, pour des montants fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect du plafond fixé par le 6ème sous-objectif de l'Ondam.
Les missions des différents opérateurs, les faits marquants de l'activité de l'année 2025 et les prévisions de comptes de résultat et de tableaux de financement pour 2025 sont détaillés dans l'annexe 2 du PLFSS.
L'évolution de quatre dotations semble devoir être signalée.
• La dotation de Santé publique France augmente de 20,5 % par rapport à la dotation initiale pour 2025. L'agence indique1286(*) que cette évolution s'explique principalement par la nécessité d'anticiper les menaces face à une augmentation des risques sanitaires. Elle doit ainsi financer la constitution du stock stratégique de masques, ainsi que des contre-mesures dans le cadre de plans de lutte contre des pandémies grippales et aviaires et contre le risque variolique et NRBC. Par ailleurs, Santé publique France devra encore faire face à d'importants paiements dans le cadre de la fin des livraisons de vaccins contre la Covid-19, 2026 étant la dernière année pour laquelle l'agence est l'acheteur exclusif pour l'ensemble des besoins de la France.
• La dotation à l'Oniam, chargé d'organiser des dispositifs de règlement amiable, mais aussi de gérer les différents contentieux en matière d'indemnisation des victimes de dommages imputables à différents accidents (accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales, accidents survenus dans le cadre de la recherche biomédicale, dommages résultant de mesures sanitaires d'urgence, accidents dus à la prise du Mediator ou de la Dépakine, contaminations d'origine sanguine par le VIH, le virus de l'hépatite C, celui de l'hépatite B, le virus T-lymphotropique humain ou encore des contaminations par la maladie de Creutzfeldt-Jakob par la voie de traitement par l'hormone de croissance extractive), augmente de 11,6 %. Le ministère de la santé indique en effet prévoir une augmentation des dépenses d'indemnisation, en raison d'une hausse du coût moyen des dossiers.
• La dotation à l'Agence nationale du développement professionnel continu augmente de 4,3 % entre 2025 et 2026 bien que restant à un niveau inférieur à celui de 2024, l'année 2025 ayant été marquée par une diminution de la dotation. Cette agence est chargée de piloter le maintien des connaissances et l'amélioration des compétences pour l'ensemble des professionnels de santé, à travers le développement professionnel continu (DPC), qui est obligatoire pour 1,9 millions de professionnels depuis 2009.
• La dotation à la Haute Autorité de santé, agence en charge d'apporter son expertise technique aux pouvoirs publics, aux professionnels, aux patients et aux usagers, dans un but d'amélioration du système de santé, diminue de 3,4 % alors que dans le même temps son plafond d'emplois est réhaussé de 452 à 458,5 ETPT.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission se félicite de l'amélioration des informations désormais communiquées au Parlement quant aux comptes de résultats et aux dotations des opérateurs financés par le 6ème sous-objectif de l'Ondam, qui répond à l'une de ses préconisations répétées.
Cette meilleure information l'amène à s'interroger sur le montant particulièrement élevé de la dotation attribuée à l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), qui pourrait atteindre plus de 225 millions d'euros en 2026. Un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas)1287(*) pointe les manquements de cette agence qui n'a pas su accompagner la généralisation du développement professionnel continu (DPC). Ainsi, au cours de la période 2020-2022, seuls 5 % des professionnels soumis à l'obligation de DPC l'ont respectée. Le rapport précité préconise de supprimer cette agence et de transférer ses moyens à la Haute Autorité de santé.
En outre, la commission relève qu'il est prévu une augmentation du montant global des dotations aux douze opérateurs de 247 millions d'euros entre 2024 et 2026, soit une hausse de 21 %.
À l'heure où des efforts sont demandés à tous les acteurs, professionnels de santé comme assurés, la commission souhaite faire participer les opérateurs à cette dynamique collective. Elle propose donc un gel des dotations, en rectifiant l'ensemble des dotations en hausse, pour les ramener à leur niveau de 2025.
La commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement n° 717 procédant à cette rectification.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'au titre de l'article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement doit également présenter, dans les annexes au PLFSS, les comptes prévisionnels de ces opérateurs pour l'année en cours et les trois années suivantes. Or les annexes ne présentent que les comptes prévisionnels de l'année en cours. La commission regrette que ces dispositions organiques ne soient pas respectées, au détriment de l'information du Parlement et de la visibilité des opérateurs sur leur trajectoire de recettes.
La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.
Article
48
Objectif de dépenses de la branche
maladie, maternité, invalidité et décès
Cet article fixe le montant de l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour l'ensemble des régimes obligatoires de base.
En dépit de réserves relatives à la soutenabilité des dépenses d'assurance maladie sur le moyen terme, la commission propose d'adopter cet article sans modification et de fixer l'objectif de dépenses de la branche à 267,5 milliards d'euros pour 2026.
I - Le dispositif proposé : une augmentation limitée des dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
Conformément à l'article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale, cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2026, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.
La branche maladie, maternité, invalidité et décès
Cette branche assure la couverture de quatre risques distincts :
- le risque « maladie » correspond aux coûts que peut engendrer le traitement des maladies de toute nature. Depuis 2016, l'ensemble de la population exerçant son activité en France ou y ayant une activité stable et régulière est couverte au titre des prestations en nature couvrant les coûts des soins, dans le cadre de la protection universelle maladie (Puma). Depuis cette date, les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) sont présentés sur le champ élargi des régimes maladie servant des prestations de droit commun ;
- le risque « maternité » correspond aux dépenses de soins induites par une grossesse, un accouchement et leurs suites, ainsi qu'à l'indemnisation des pertes de revenus liées aux congés maternité (partagée avec la branche famille à l'arrivée de l'enfant) ;
- le risque « invalidité » assure le maintien du niveau de vie des personnes subissant une perte importante de la capacité à travailler et de leurs revenus ;
- le risque « décès » couvre les conséquences immédiates pour sa famille du décès d'un travailleur.
Prévisions de recettes, dépenses et solde de la branche maladie, maternité, invalidité et décès en 2025 et 2026
(en milliards d'euros)
|
Prévisions 2025 initiale (LFSS pour 2025) |
Prévisions 2025 rectifiées (PLFSS 2026) |
Prévisions 2026 (PLFSS 2026) |
Écart prévisionnel 2025-2026 (PLFSS 2026) |
|
|
Recettes |
246,4 |
245,1 |
255,0 |
+ 4,0 % |
|
Dépenses |
261,8 |
262,3 |
267,5 |
+ 2,0 % |
|
Solde |
- 15,4 |
- 17,2 |
- 12,5 |
+ 27,3 % |
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après les sources indiquées
A. Un objectif de dépenses fixé à 267,5 milliards d'euros en 2026, en hausse de 2 % par rapport à 2025
L'article 48 fixe l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès à 267,5 milliards d'euros pour 2026.
Les dépenses de la branche augmenteraient ainsi de 5,7 milliards d'euros par rapport à la prévision initialement fixée pour 2025, et de 5,2 milliards d'euros par rapport à la prévision actualisée. Cet objectif de dépenses représente une hausse de 2 % entre 2025 et 2026.
Cette progression est principalement en lien avec celle de l'Ondam, décrite à l'article suivant.
Avant prise en compte des mesures du PLFSS, la direction de la sécurité sociale du ministère de la santé estime que les prestations légales nettes de la branche hors Ondam représenteront 16,4 milliards d'euros en 2026 (14,9 milliards d'euros s'agissant des prestations sociales « maladie-maternité » nettes de la Cnam hors Ondam), en progression de 3 %, en raison d'une revalorisation des prestations.
Charges nettes de la Cnam
(au regard
de l'Ondam tendanciel pour 2026)
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
Le Gouvernement envisage, au sein du PLFSS, des mesures venant réduire les dépenses dans le champ de l'Ondam de 6,0 milliards d'euros par rapport à l'Ondam tendanciel, déduction faite des mesures nouvelles en dépenses et des effets des mesures décidées en amont du PLFSS qui montent en charge progressivement1288(*). Hors du champ de l'Ondam, le Gouvernement prévoit de ne pas revaloriser les montants de l'ensemble des prestations sociales, ce qui inclut les pensions d'invalidité et de capital décès.
B. La hausse des recettes pourrait atteindre 4 % en 2026
L'article 14 du projet de loi initial déposé par le Gouvernement prévoit une augmentation des recettes de 4 % en 2026. À l'évolution tendancielle, s'ajoutent les nouvelles recettes et le rendement supplémentaire de certaines recettes existantes dont le PLFSS pour 2026 prévoit de faire bénéficier la branche maladie :
- les recettes de la taxe sur les organismes complémentaires proposée par l'article 7 du PLFSS atteindraient 1,1 milliard d'euros1289(*) ;
- la rétrocession par l'article 40 du projet de loi de finances, via l'affectation d'une fraction supplémentaire de TVA, du rendement de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités journalières des personnes en affection longue durée, représenterait 0,7 milliard d'euros ;
- la hausse des recettes du forfait social et de la contribution spécifique affectée à la Cnav, résultant de la réduction des niches sociales sur les compléments de salaire par l'article 8 du PLFSS, serait reversée à la branche, via une quote-part de la taxe sur les salaires1290(*), à hauteur de 1,2 milliard d'euros ;
- la mise en oeuvre d'un nouveau mécanisme d'acomptes pour le paiement des remises conventionnelles sur les produits de santé (article 11 du PLFSS) rapporterait 0,1 milliard d'euros grâce à la réduction des charges financières liées à la gestion de trésorerie.
Structure des recettes de la branche maladie
Un mouvement ancien d'évolution du panier de recettes de la branche maladie a conduit à une réduction structurelle de la part des cotisations. Si leur part n'est plus que de 40 % aujourd'hui, elles demeurent néanmoins la ressource prépondérante de la branche.
La contribution sociale généralisée (CSG), qui avait atteint près de 46 % des ressources de la branche maladie en 2018, n'en représente aujourd'hui que moins du quart.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représente désormais également une ressource importante, à hauteur de 20 % environ.
Source : Commission des affaires sociales, données de la commission des comptes de la sécurité sociale
C. Un déficit de la branche qui devrait se réduire en 2026, avant de se creuser de nouveau progressivement
En 2025, selon les projections actualisées du PLFSS pour 2026, le déficit de la branche maladie devrait s'accroître de 3,4 milliards d'euros par rapport à 2024, pour atteindre 17,2 milliards d'euros.
Selon la Cnam1291(*), ce déficit s'explique notamment par les dépenses liées au Ségur de la santé, qui représentent environ 13 milliards d'euros de charges annuelles pérennes, mais aussi, plus structurellement, par une trajectoire d'augmentation des dépenses portée par le vieillissement de la population et la croissance continue des maladies chroniques.
En 2026, le Gouvernement prévoit un redressement de la situation de la branche, qui serait déficitaire à hauteur de 12,5 milliards d'euros. Cette amélioration du solde, de 4,7 milliards d'euros, serait principalement le résultat des mesures d'économies portant sur l'Ondam et de la réaffectation de la CSG assise sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille.
En revanche, au sein du projet d'annexe à la LFSS décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche pour les années 2026 à 2029, le Gouvernement prévoit une nouvelle dégradation du déficit de la branche dès 2027, en raison d'une augmentation des dépenses supérieure à celle des recettes. Le déficit atteindrait 16,1 milliards d'euros en 2029. Les charges financières liées à l'accumulation des déficits passeraient ainsi de 0,5 milliard d'euros en 2025 à 2,3 milliards d'euros en 2029.
Trajectoire prévisionnelle des recettes, dépenses et soldes de la branche maladie
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, données du PLFSS 2026
Évolution passée et
prévisionnelle du déficit de la branche maladie
entre 2019 et
2029
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, données du PLFSS 2026
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
A. Une situation financière lourdement et durable déficitaire
• La commission met en doute l'amélioration du solde de la branche maladie sur laquelle le Gouvernement table pour 2026.
Le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025 estime qu'avant mesures nouvelles du PLFSS pour 2026, le déficit de la branche maladie continuerait à se dégrader en 2026, pour atteindre 22,3 milliards d'euros, en raison d'une dynamique des dépenses plus soutenue que celle des recettes. La prévision gouvernementale, qui attend ramener ce déficit à 12,5 milliards d'euros, repose ainsi sur un écart de près de 10 milliards d'euros avec la prévision tendancielle.
La rapporteure considère que ce redressement annoncé repose sur des hypothèses macroéconomiques et des ambitions de maîtrise des dépenses particulièrement optimistes. Elle émet en particulier des réserves quant à l'hypothèse d'une relance de la croissance des ménages fondée sur une diminution de 1,5 point du taux d'épargne, dans un contexte économique marqué par l'incertitude et la prudence des comportements.
Dans son avis sur le PLF et le PLFSS pour 2026, le Haut Conseil des finances publiques juge que le scénario macroéconomique sur lequel ont été construits ces textes « repose sur des hypothèses optimistes », « suppose une reprise de la demande intérieure privée dont l'ampleur paraît volontariste au regard du climat générale d'incertitude » et minimise les effets sur l'activité de l'orientation restrictive des finances publiques.
La commission estime également peu crédibles les prévisions d'économies sur le champ de l'Ondam au regard du dynamisme des dépenses hospitalières et de soins de ville1292(*).
Le redressement des comptes ne se décrète pas, il se construit. Or, les fondations de ce PLFSS paraissent bien fragiles.
• La commission alerte en outre sur la poursuite envisagée de la dégradation du solde de la branche maladie au-delà de 2026. Aucune trajectoire de retour à l'équilibre ni même de réduction du déficit n'est présentée par le Gouvernement. L'horizon d'un hypothétique retour à l'équilibre semble s'éloigner durablement.
Dans ce contexte, la commission appelle à redéfinir une stratégie de financement de la branche maladie crédible et soutenable, qui ne repose ni sur des paris macroéconomiques incertains ni sur des économies de court terme, mais sur une trajectoire de moyen terme réaliste et assumée.
B. Une nécessaire réflexion de fond sur le financement de la branche maladie
Dans son rapport Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat1293(*), la commission relevait que l'assurance maladie constitue le principal défi des prochaines décennies pour la soutenabilité de notre système de sécurité sociale.
Alors que le Gouvernement indique que le retour à l'équilibre des comptes sociaux d'ici 2029 exigera des efforts supplémentaires de 18,3 milliards d'euros sur quatre ans, par rapport à la trajectoire prévue au sein du PLFSS pour 20261294(*), la branche maladie devra, de toute évidence, en porter une part significative, au vu du poids de son déficit.
Le temps des ajustements ponctuels est révolu : la santé de nos comptes sociaux exige, elle aussi, un traitement de fond.
Alors que la situation de la branche maladie apparaît durablement fragilisée, la commission renouvelle ses alertes sur la nécessité de mener une réflexion sur des réformes structurelles de plus grande ampleur et de long terme, qui permettent d'organiser un meilleur accès aux soins dans les territoires, tout en tenant compte de la rareté des ressources et de la contrainte budgétaire.
Il ne s'agit plus de colmater les brèches, mais bien de repenser l'architecture même du financement et de l'organisation de notre système de santé.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
49
Ondam et sous-objectifs de l'Ondam
Cet article fixe, pour 2026, le montant de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) et le montant des sous-objectifs qui le composent.
L'article transmis au Sénat propose de fixer l'Ondam à 271,4 milliards d'euros, soit une hausse de 2 % par rapport à 2025.
La commission estime que l'Ondam n'est pas à la hauteur des besoins de santé et notamment des charges qui pèsent sur les établissements de santé. Afin de marquer sa préoccupation, elle propose de supprimer cet article.
I - Le dispositif proposé : une hausse de l'Ondam limitée à 1,6 %
Conformément à l'article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale, cet article fixe l'objectif de national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour l'année à venir.
L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie
L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) est un objectif de dépenses à ne pas dépasser, un indicateur de maîtrise des dépenses de santé. Il a été créé par les ordonnances de 1996 et est fixé chaque année par le Parlement dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale.
L'Ondam est à distinguer de l'objectif de dépenses de la branche maladie, fixé à l'article 48 du PLFSS.
D'une part, ces deux objectifs reposent sur des concepts de nature distincte : l'Ondam retient une approche économique, interrégimes et interbranches, alors que les dépenses de la branche maladie relèvent d'une approche comptable.
D'autre part, leurs champs ne se recoupent pas intégralement :
- si l'Ondam recouvre plus de 80 % des charges de la branche maladie, il ne prend en revanche pas en compte certaines prestations, telles que les prestations en espèces de maternité et paternité (indemnités journalières) ou les prestations invalidité-décès, ainsi que certaines dépenses de prévention ;
- l'Ondam intègre des produits atténuatifs de dépenses, c'est-à-dire des recettes de l'assurance maladie qui viennent en réduction de l'objectif (remises et clause de sauvegarde sur les produits de santé et contribution des organismes complémentaires) ;
- l'Ondam intègre également les prestations de soins de la branche AT-MP (prestations en nature et indemnités journalières compensant l'incapacité temporaire mais pas les rentes versées en cas d'incapacité permanente, ni les dispositifs destinés aux travailleurs ou aux victimes de l'amiante) et les dépenses de la branche autonomie relatives aux établissements médicosociaux (correspondant à l'objectif global de dépenses).
A. Une hausse limitée de l'Ondam, en rupture avec la dynamique de dépenses connue depuis 2019
1. Un Ondam 2026 fixé à 270,4 milliards d'euros, en hausse de seulement 1,6 % par rapport à 2025
L'article 49 fixe l'Ondam à 270,4 milliards d'euros pour 2026. Cela représente une hausse de 4,2 milliards d'euros à périmètre constant1295(*) par rapport à 2025, soit 1,6 %. L'augmentation de l'Ondam serait même de seulement 0,3 point en volume, compte tenu d'une prévision d'inflation à 1,1 point.
Cet objectif marque un net ralentissement de la dynamique de dépenses connue depuis 2020, tout en correspondant à un montant en volume supérieur de plus d'un tiers à celui de la période antérieure à la crise sanitaire.
En effet, le rythme de progression de l'Ondam est passé de 2,5 % par an en moyenne entre 2015 et 2019 à 7,3 % par an entre 2019 et 2022, et 4,8 % entre 2019 et 2025. Entre 2019 et 2026, le montant de l'Ondam a évolué de 200,3 milliards d'euros à 270,4 milliards d'euros, soit un bond de 35 %.
Évolution du montant de l'Ondam au
cours
des dix dernières années, à champ
courant
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales d'après les données de l'annexe 5 du PLFSS pour 2026
Une hausse de l'Ondam à 1,6 % serait largement inférieure à la tendance des six dernières années, y compris en excluant les dépenses liées à la crise sanitaire, au Ségur de la santé, à l'inflation exceptionnelle et aux aides exceptionnelles à l'activité. Le taux de croissance annuel moyen de 2019 à 2024, de 4,8 % toutes dépenses comprises, a en effet été de 3 % en excluant les dépenses exceptionnelles.
Trajectoire de l'Ondam entre 2017 et 2024, avec
les taux de croissance
annuelle à champ constant
(en milliards d'euros)
Source : Annexe 5 au PLFSS
2. Une construction qui repose sur des économies significatives
La construction de l'Ondam a fait l'objet de quelques changements de périmètres, qui sont pris en compte dans la présentation des évolutions de l'Ondam, qui se fait toujours à périmètre constant dans un souci de lisibilité. Le calcul du taux d'évolution de l'Ondam à périmètre constant suit les principes énoncés dans l'annexe 5 de loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027.
Synthèse des évolutions de périmètre de l'Ondam entre 2025 et 2026
Source : Annexe 5 du PLFSS pour 2026
Hors mesures de périmètres, l'analyse de la construction de l'Ondam repose sur quatre grands indicateurs, dont les champs peuvent se recouper : l'estimation du taux d'évolution spontanée de l'Ondam ; les effets, à la hausse comme à la baisse de mesures déjà actées ; l'estimation des mesures nouvelles ; et les mesures d'économies envisagées.
• Le Gouvernement indique que le taux de progression spontanée de l'Ondam en 2026 atteindrait 3,4 % avant mesures nouvelles et économies, soit environ 9 milliards d'euros. Cette estimation repose sur deux principales hypothèses : un retour à une dynamique d'activité en ville comparable aux années précédant la crise sanitaire et la poursuite du rattrapage de l'activité hospitalière.
Elle intègre les effets attendus des mesures de maîtrise médicalisée des dépenses et de lutte contre la fraude (voir infra).
• À cette progression spontanée, doivent être ajoutés les effets sur les dépenses de 2026 de mesures déjà actées, qui amènent à une croissance de l'Ondam à champ constant de 3,9 % avant les mesures de la LFSS. Ces mesures ont des effets :
- à la hausse, à hauteur de 2,2 milliards d'euros : les revalorisations conventionnelles (0,9 milliard d'euros, dont 0,4 milliard d'euros pour la convention médicale), la compensation du nouveau relèvement des taux de cotisation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et le financement d'évolutions apportées aux offres sanitaire et médico-sociale ;
- à la baisse, à hauteur de 0,8 milliard d'euros : l'arrivée à terme des financements du Ségur de la santé au titre de projets d'investissement immobilier et numérique et des crédits assimilés (0,5 milliard d'euros), les effets en année pleine de la baisse du plafond des salaires pris en compte pour calculer les indemnités journalières au 1er avril 2025 et des protocoles de régulation des dépenses conclus avec les radiologues et les transporteurs sanitaires.
• Le Gouvernement indique porter 3 milliards d'euros de mesures nouvelles au sein de l'Ondam, dont 2,5 milliards d'euros de mesures nouvelles en dépenses (qui sont, à hauteur de 2,2 milliards d'euros, la conséquence de mesures décidées antérieurement) :
- 0,7 milliard d'euros pour neutraliser le coût de la hausse de trois points du taux de cotisation vieillesse de la CNRACL pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, acté lors de la LFSS pour 2025 ;
- 1,2 milliard d'euros sur les soins de ville, correspondant en majorité à des mesures déjà décidées (revalorisations conventionnelles, prise en charge des fauteuils roulants, amélioration de la couverture vaccinale contre le méningocoque) ;
- 0,4 milliard d'euros pour les établissements de santé ;
- 0,5 milliard d'euros pour les établissements médico-sociaux ;
- 0,2 milliard d'euros pour le financement du Fonds d'intervention régionale (FIR) et le soutien national à l'investissement ;
- il intègre les moindres crédits Ségur et assimilés pour 0,5 milliard d'euros comme de moindres mesures nouvelles.
• Enfin, la construction de l'Ondam 2026 repose sur des mesures d'économies chiffrées à 7,1 milliards d'euros, en montant brut, soit près du double des économies des deux dernières années (3,5 milliards d'euros en 2024 et 4,3 milliards d'euros en 2025).
Ces économies (qui sont à hauteur de 6,3 milliards d'euros de nouvelles économies et à hauteur de 0,8 milliard d'euros les conséquences d'économies décidées antérieurement) correspondent :
- pour 3,7 milliards d'euros, à des mesures de maîtrise tarifaire et de régulation. Ces mesures portent en majorité sur les produits de santé (2,3 milliards d'euros). Elles sont également liées à des protocoles de maîtrise de dépenses en soins de ville et à des mesures visant la rentabilité estimée excessive de certains secteurs en partie déjà décidés (0,6 milliard d'euros). Elles concernent enfin l'efficience en établissements de santé et médico-sociaux (0,7 milliard d'euros) ;
- pour 3,4 milliards d'euros à des transferts de charge vers les organismes complémentaires, les employeurs et les assurés.
Au sein de ces transferts, 2,3 milliards d'euros correspondent à la hausse des montants et plafonds sur les franchises et participations forfaitaires qui sont à la charge exclusive des assurés. Cette hausse est annoncée par le Gouvernement et serait portée par voie réglementaire : les montants passeraient respectivement d'un à deux euros et de deux à quatre euros, tandis que chacun des deux plafonds serait relevé de 50 à 100 euros.
Les transferts de charge incluent également la montée en charge, déjà décidée, de la baisse du plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières (0,5 milliard d'euros), la hausse de la part des complémentaires à l'hôpital, la baisse du remboursement des cures thermales et la hausse du ticket modérateur sur les médicaments à faible service médical rendu pour les assurés en affection longue durée (ALD).
Répartition des mesures d'économies
au sein de l'Ondam présentées
par le Gouvernement au sein du
PLFSS pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales d'après les données de l'annexe 5 du PLFSS pour 2026
En outre, comme évoqué ci-avant, des actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude d'un montant de 900 millions d'euros, intégrées par le Gouvernement dans la progression tendancielle de 3,4 %, s'ajoutent à ces montant d'économies.
Répartition des mesures de maîtrise
médicalisée des dépenses
et de lutte contre la fraude
pour 2026
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales d'après les données de l'annexe 5 du PLFSS pour 2026
Les économies nettes nouvelles sur le champ de l'Ondam représentent 6,0 milliards d'euros, soit presque les deux tiers des 9,1 milliards d'euros d'effort d'économies nettes porté par le PLFSS. Ces économies nettes s'élèvent à 4,6 milliards d'euros en tenant compte des mesures déjà décidées1296(*).
B. Des évolutions différenciées entre les six sous-objectifs de l'Ondam
Les six sous-objectifs de l'Ondam
L'Ondam est ventilé en six sous-objectifs :
- le sous-objectif soins de ville correspond aux honoraires des professionnels libéraux, aux remboursements de produits de santé et aux indemnités journalières ;
- le sous-objectif établissements de santé regroupe les financements des établissements à l'activité, les dotations allouées sur la base de modèles de répartition nationaux, ainsi que le financement des médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus des séjours hospitaliers (« liste en sus ») ;
- les deux sous-objectifs médico-sociaux correspondent au financement, par la branche autonomie créée en 2021, des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées d'une part et pour personnes en situation de handicap d'autre part, dans le cadre de l'objectif global de dépenses (OGD) ;
- le sous-objectif Fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement ;
- le 6e sous-objectif « autres prises en charge » recouvre les soins des Français de l'étranger, le fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) et les dotations de l'assurance maladie à ses opérateurs (ANSM, SPF, etc.), ainsi que les dépenses médico-sociales spécifiques hors du champ de l'OGD (dotations aux établissements accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, comme l'addictologie).
La ventilation de l'Ondam 2026 et l'évolution des sous-objectifs entre 2025 et 2026 est précisée dans le tableau et le graphique suivants.
Évolution de l'Ondam et des sous-objectifs entre 2025 et 2026
(en milliards d'euros)
|
Ondam 2025 en PLFSS pour 2026 (champ 2025) |
Ondam 2025 en PLFSS pour 2026 (champ 2026) |
Ondam 2026 en PLFSS pour 2026 |
Taux d'évolution 2025-2026 à champ constant (2026) |
|
|
Ondam total |
265,9 |
266,2 |
270,4 |
1,6% |
|
Soins de ville |
113,9 |
113,8 |
114,9 |
0,9% |
|
Établissements de santé |
109,5 |
109,2 |
111,8 |
2,4% |
|
Établissements et services médico-sociaux |
33,0 |
33,4 |
34,2 |
2,4% |
|
Pour personnes âgées |
17,4 |
17,7 |
18,2 |
2,4% |
|
Pour personnes handicapées |
15,6 |
15,6 |
16,0 |
2,5% |
|
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement |
6,1 |
6,6 |
6,2 |
-5,1% |
|
Autres prises en charge |
3,3 |
3,2 |
3,3 |
4,2 % |
Source : Commission des affaires sociales d'après l'annexe 5 au PLFSS pour 2026
Évolution des sous-objectifs de l'Ondam à champ constant
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales d'après l'annexe 5 au PLFSS pour 2026
• Le sous-objectif relatif aux soins de ville progresse de 1,1 milliard d'euros, soit +0,9 %, à champ constant. Outre la tendance d'évolution spontanée de ces dépenses, tirée - par ordre décroissant de contribution - par la hausse des dépenses de produits de santé, d'indemnités journalières, d'honoraires médicaux, dentaires et paramédicaux, de prise en charge des cotisations, de biologie médicale et d'autres prestations de santé, ce montant inclut :
- d'une part, des mesures nouvelles en dépenses, avec en particulier les revalorisations des professionnels de santé, l'effet année pleine de la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap, et la prise en charge l'obligation vaccinale des nourrissons contre les méningocoques ;
- d'autre part, des mesures de régulation et de maîtrise tarifaire sur les produits de santé, la biologie, le transport sanitaire, les soins dentaires1297(*) et les secteurs dont la rentabilité est estimée excessive1298(*), ainsi que des transferts de charges vers les organismes complémentaires, les employeurs et les assurés1299(*).
Construction du sous-objectif soins de ville
Source : Commission des affaires sociales d'après l'annexe 5 au PLFSS pour 2026
• Le sous-objectif relatif aux établissements de santé progresse de 2,6 milliards d'euros, soit +2,4 %, à champ constant.
Ce taux intègre des mesures de transferts entre sous-objectifs. Ainsi, 300 millions d'euros sont transférés du sous-objectif établissements de santé vers le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS), intégré au 5ème sous-objectif, afin que ce fonds porte toutes les dépenses de l'Ondam dédiées aux investissements sanitaires. L'Ondam hospitalier 2025 qui représentait 109,5 milliards d'euros est revu à 109,2 milliards d'euros avec les mesures de périmètre et de transferts du PLFSS pour 2026. Cette actualisation - qui est la norme afin de rendre plus lisibles et sincères les comparaisons - fait passer le taux d'évolution de 2,1 à 2,4 %.
Cette évolution intègre également le financement de l'augmentation du taux de cotisation employeurs pour la CNRACL à hauteur de 0,6 milliard d'euros, ce qui représente 0,55 point de pourcentage.
Les dépenses consacrées à des mesures nouvelles ciblées en établissements de santé s'élèvent à 0,4 milliard d'euros. Cela recouvre principalement des mesures de revalorisations salariales, de financement de l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine, de mesures en faveur de la psychiatrie, de la santé de l'enfant, des soins critiques ou encore de la recherche et de l'innovation.
Le reste des dépenses correspond à l'évolution tendancielle des charges des établissements, estimée à 3,4 milliards d'euros sur la base de la croissance de l'activité hospitalière et des dépenses de médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la liste en sus, du coût du glissement vieillesse technicité et de la hausse de l'inflation.
La prévision repose donc sur des mesures de transferts de charges, estimées à 0,5 milliard d'euros, et surtout sur des mesures d'économies et d'efficience estimées à 1,3 milliard d'euros.
Construction du sous-objectif établissements de santé
Source : Commission des affaires sociales d'après l'annexe 5 au PLFSS pour 2026
• Les dépenses des établissements et services médico-sociaux, portées par l'objectif global de dépenses (OGD), augmentent de 0,8 milliard d'euros, soit + 2,4 %. Ce montant - détaillé à l'article 54 - intègre :
- une progression spontanée des dépenses, sous l'effet du glissement vieillesse technicité et de la compensation des effets de l'inflation sur les charges non salariales ;
- la compensation de 3 points de cotisations CNRACL et la poursuite du financement du surcoût de l'expérimentation relative à la fusion des sections soin et dépendance ;
- 800 millions d'euros de mesures nouvelles, notamment en faveur de l'amélioration du taux d'encadrement en Ehpad et de l'augmentation de l'offre médico-sociale ;
- des mesures d'efficience.
• Les financements dédiés au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement diminuent de 5,1 % pour atteindre 6,2 milliards d'euros, en raison de la diminution des crédits du FMIS1300(*).
•Les autres prises en charge sont en hausse de 4,2 %, atteignant 3,3 milliards d'euros. La progression de l'enveloppe allouée aux douze opérateurs et quatre fonds financés par ce 6ème sous objectif serait de 4,4 %1301(*).
II - Le dispositif transmis au Sénat : un Ondam réhaussé d'un milliard d'euros
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la députée Sandrine Runel, sous-amendé par le Gouvernement réhaussant l'Ondam d'un milliard d'euros. L'article ainsi modifié augmente les financements attribués aux établissements de santé, à hauteur de 850 millions d'euros. Il doit également permettre de financer le développement des maisons France Santé souhaitées par le Gouvernement, via 75 millions d'euros supplémentaires au titre du fonds d'investissement régional et 75 millions d'euros supplémentaires sur les dépenses de soins de ville, au titre des négociations conventionnelles avec les professionnels de santé.
L'Ondam augmenterait donc de 2,0 % contre 1,6 % dans le texte initial et l'Ondam hospitalier de 3,2 % contre 2,4 % initialement.
Évolution des sous-objectifs de l'Ondam à champ constant,
dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales, données du PLFSS pour 2026 transmis au Sénat par le Gouvernement
En application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement a transmis au Sénat cet article ainsi modifié.
III - La position de la commission
A. Un Ondam insincère, incohérent et intenable
La commission dénonce le manque de sincérité, de crédibilité et de pertinence d'un Ondam aussi resserré, en hausse de seulement 1,6 % dans le texte initial et 2,0 % dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. L'Ondam ne saurait être à l'affichage d'un simple voeu pieux : il doit traduire une trajectoire réaliste. Une vertu budgétaire affichée ne suffit pas à faire une politique de santé.
1. Une nette rupture de trajectoire par rapport aux années précédentes, qui repose sur des hypothèses et ambitions excessivement optimistes
Les principaux organismes publics qui ont émis un avis sur le PLFSS - Haut Conseil des finances publiques (HCFP), comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie et Cour des comptes - alertent sur le caractère ambitieux de l'Ondam. S'ils constatent tous une part d'économies bien documentées, portant notamment sur les franchises et participations forfaitaires et sur la régulation des produits de santé, ils relèvent en revanche la fragilité des économies avancées en matière de maîtrise tarifaire, de régulation des dépenses et d'efficience.
• Dans son avis du 9 octobre sur le PLFSS, le Haut Conseil des finances publiques souligne que l'évolution de l'Ondam envisagée par le Gouvernement suppose un effort de maîtrise nettement plus important que les années précédentes. Il juge la cible de dépenses sociales « très ambitieuse », précisant qu'elle repose certes sur des mesures substantielles annoncées, notamment la hausse des franchises, mais qu'elle est « fragilisée, par certaines économies peu documentées sur le champ de l'Ondam », s'agissant notamment des mesures d'efficience. Il indique que « l'atteinte de cette cible exige au minimum une mise en oeuvre rapide de l'ensemble des mesures, ce qui est loin d'être acquis ».
En outre, le HCFP considère que le scénario économique, qui fonde les prévisions de dépenses et de recettes, repose sur des hypothèses optimistes.
• Dans son avis du 4 novembre 2025, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses maladies a émis des « réserves »1302(*) sur la prévision d'Ondam pour 2026 en ce qui concerne les soins de ville et les établissements de santé, dont il estime que les sous-objectifs présentent « des risques significatifs de dépassement ».
S'agissant des soins de ville, le comité d'alerte estime que la prévision pourrait être dépassée au vu des incertitudes qui entourent la progression spontanée des dépenses et la réalisation d'une partie des mesures d'économies projetées, hors transferts de charges aux complémentaires santé, aux assurés et aux employeurs.
S'agissant des établissements de santé, il relève que la faiblesse du montant des mesures nouvelles - qui n'atteint que 0,4 milliard d'euros hors CNRACL - limite les possibilités de mise en réserve de financements afin de couvrir de possibles dépassements de la part tarifaire du financements des établissements ou du sous-objectif des soins de ville. Il estime également qu'une partie des mesures d'économies imposées aux établissements présente des incertitudes.
• Dans son rapport de novembre 2025 sur la situation financière de la sécurité sociale1303(*), la Cour des comptes relève que l'évolution envisagée de l'Ondam « repose à la fois sur des mesures importantes d'économies précises et documentées, comme la mesure de doublement des franchises et participations, et sur des mesures moins précises, comme les mesures de maîtrise tarifaire et de régulation, en volume comparable à d'autres années mais dont les objectifs n'ont pas été systématiquement atteints par le passé ». Elle précise que « les mesures de maîtrise tarifaire et de régulation sont insuffisamment documentées, au risque de ne pas atteindre les objectifs assignés ».
Elle ajoute également que la concentration de l'effort des dépenses sur un petit nombre de mesures, essentiellement le doublement des franchises et participations forfaitaires et les mesures de maîtrise tarifaire et de régulation des produits de santé, « fragilise l'objectif de réduction du déficit au cas où ces mesures ou d'autres équivalentes ne seraient pas adoptées in fine ou représenteraient en exécution moins d'économies qu'annoncé ».
• S'appuyant sur ces avis, la commission ne peut qu'exprimer elle aussi ses préoccupations. L'affichage d'une hausse de l'Ondam aussi limitée et surtout s'appuyant sur des économies qui ne sont qu'en partie étayées laisse présager un dépassement très probable.
Or, lorsque la procédure d'alerte est déclenchée par le comité d'alerte de l'Ondam, comme ce fut le cas en juin 2025, le Gouvernement décide seul des mesures de régulation, sans aucune association du Parlement, et remet en cause la ventilation des crédits entre les sous-objectifs et donc les engagements pris vis-à-vis de la représentation nationale et des acteurs concernés.
La commission s'interroge donc à la fois sur la crédibilité de l'Ondam annoncé et sur les dangers qu'il soulève en matière de respect de l'autorisation parlementaire et de transparence et de prévisibilité pour l'ensemble des acteurs du système de santé qui seront affectés par les très probables mesures de régulation infra-annuelles qui devront être décidées en 2026.
En outre, les mesures que le Gouvernement prendra en cas de dépassement de l'Ondam seront nécessairement techniques et conjoncturelles, évitant l'obstacle des mesures structurelles pourtant nécessaires, en particulier pour les établissements de santé.
2. Un Ondam qui n'est pas à la hauteur des besoins des établissements de santé
La commission est particulièrement préoccupée par la situation financière des établissements de santé, dont les financements n'augmenteraient que de 2,6 % déduction faite de la compensation de la hausse des taux de cotisations CNRACL. Imposer aux établissements de santé un effort d'économies de 700 millions d'euros, au titre des mesures de régulation et d'efficience, apparaît peu réaliste.
• L'évolution de l'Ondam hospitalier n'apparaît pas en cohérence avec la hausse tendancielle des charges des établissements de santé ni avec celle des besoins de santé, en lien avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques.
L'ensemble des fédérations hospitalières a alerté sur l'insuffisante progression de l'Ondam hospitalier au regard de la progression naturelle des dépenses, de l'inflation et de la nécessité de préserver les capacités de soins et d'investissements. La fédération hospitalière de France (FHF) estime que la progression naturelle des charges pour l'année 2026 s'établit à 1,8 % pour les personnels, 4,2 % pour les dépenses médicales et 2,4 % pour les dépenses hôtelières et générales.
Les fédérations hospitalières estimaient, avant le rehaussement de l'Ondam, qu'il manquait a minima 1,1 milliard d'euros pour les établissements de santé. Une fois intégrée la hausse de 850 millions d'euros, octroyée par l'amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale, il manquerait donc toujours a minima 250 millions d'euros.
La FHF évalue même le sous-financement des établissements publics de santé à 2,3 à 4,1 milliards d'euros, en raison d'un décrochage des recettes par rapport aux dépenses, de l'absence de compensation des coûts associés à l'inflation et du manque de couverture des charges des établissements.
Elle alerte également sur le sous-financement croissant des activités à forte sujétion comme la permanence des soins, alors que les établissements publics de santé assument 85 % de l'activité aux horaires de permanence des soins et qu'une revalorisation des astreintes publiques à hauteur du forfait des astreintes privées avait été annoncée.
Enfin, elle déplore la réduction annoncée du soutien spécifique aux activités de recherche et d'innovation, en raison de fortes économies sur la liste en sus, d'une décote sur les actes de biologie hors nomenclature et de la diminution de la dotation socle recherche.
À l'examen de l'Ondam hospitalier initialement annoncé, les fédérations hospitalières anticipaient une diminution des tarifs hospitaliers, qui pourrait constituer la plus forte baisse tarifaire depuis la mise en place de la tarification à l'activité (T2A).
Si une telle diminution des tarifs se matérialise, les établissements de santé devront alors faire face à des tensions accrues sur les personnels, avec des postes non pourvus en dépit des besoins, à des reports d'investissement, et à un affaiblissement de l'accès aux soins.
• Un Ondam hospitalier aussi contraint ne peut qu'aggraver la situation financière déjà préoccupante des établissements de santé.
Depuis 2021, le déficit des établissements publics de santé n'a cessé d'augmenter et de concerner un nombre croissant d'établissements. En 2024, il atteindrait 2,7 milliards d'euros sur le champ du budget principal, lié à l'activité hospitalière, et 2,9 milliards d'euros en résultat consolidé avec les budgets annexes, en raison de la situation des Ehpad et des unités de soins de longue durée. De ce fait, 61 % des établissements sont en déficit, contre 56 % en 2023.
Le déficit continue ainsi à se creuser en dépit d'une reprise de l'activité, signe d'un essoufflement du modèle de financement, avec un manque désormais habituel de couverture des charges des établissements et des annulations de mises en réserve en cours d'exercice qui pèsent directement sur les établissements.
La FHF estime ainsi que le déficit des établissements publics de santé s'explique intégralement par le sous-financement des effets prix, sur lesquels les établissements ne disposent quasiment d'aucun levier d'action.
La fédération de l'hospitalisation privée (FHP) indique, pour sa part, que 45 % des établissements de santé privés sont en déficit en 2024, contre 26 % en 2021.
Selon Unicancer, dix des dix-huit centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont en situation de déficit, dont cinq présentent un déficit supérieur à 5 millions d'euros. La fédération identifie en outre des facteurs de dégradation supplémentaires : une incertitude financière, une perte d'attractivité et de fidélisation des personnels des CLCC accentuée par un écart de tarif persistant et une absence de vision pluriannuelle de la régulation budgétaire, qui entraîne des difficultés pour les établissements.
Dans son avis sur le PLFSS, le HCFP relevait que la prévision d'une réduction du déficit des hôpitaux à 2,0 milliards d'euros paraissait « très fragile à ce stade ».
Dans son avis du 4 novembre 2025, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie estimait qu'une partie des mesures d'économies imposées aux établissements de santé « présente des incertitudes, s'agissant tout au moins de la capacité des établissements publics de santé à les réaliser effectivement sans dégradation supplémentaire de leur situation financière ». Comme il le fait régulièrement dans ses avis, il a alerté sur le point de fuite majeur de l'Ondam lié au déficit des établissements publics de santé, qui devrait perdurer en 2026, en dépit de l'augmentation du volume de leur activité.
Au-delà de la situation préoccupante des établissements de santé, la commission a bien conscience des préoccupations exprimées par les professionnels de santé libéraux, qui attendent des revalorisations conventionnelles, et par les assurés, sur lesquels reposera entre un tiers et la moitié des économies annoncées.
B. Une réflexion plus large à mener sur la construction de l'Ondam et sur l'évolution des dépenses de santé à moyen et long terme
1. Un outil de pilotage à rénover
• La commission plaide pour une révision architecturale de l'Ondam, avec une présentation plus fine des dépenses qui donnerait une meilleure visibilité et davantage de sens à l'autorisation parlementaire.
En effet, les enveloppes financières consacrées aux soins de ville et aux établissements de santé représentent chacune plus de 110 milliards d'euros, ce qui ne permet pas une appréciation précise de la finalité des dépenses ni une analyse détaillée de la dynamique propre à certains postes de dépenses, tels que les indemnités journalières ou les produits de santé.
Aux termes de l'article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale, la définition des composantes des sous-objectifs de l'Ondam est à la main du Gouvernement, après consultation des commissions des affaires sociales des deux chambres.
La commission appelle donc le Gouvernement à lui présenter une décomposition plus fine des sous-objectifs de l'Ondam. Parmi les propositions envisagées par différents interlocuteurs figurent : un recentrage du sous-objectif soins de ville sur les consultations, et, en parallèle, la création de plusieurs sous-objectifs spécifiques, dédiés par exemple aux produits de santé et dispositifs médicaux (regroupant les dépenses en ville, à l'hôpital et liées aux prescriptions hospitalières réalisées en ville), au transport sanitaire (dont les dépenses sont aujourd'hui inscrites dans les soins de ville alors qu'elles résultent principalement de prescriptions hospitalières) ou encore aux indemnités journalières. Pourraient également être distingués dans une même enveloppe les financements dédiés aux missions d'intérêt général et à l'investissement des établissements de santé.
Lors de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale en 2022, la commission avait notamment proposé de distinguer les dépenses relevant d'assurances sociales et de remboursements de soins de celles relevant de dotations et crédits arbitrables.
La commission se félicite toutefois que l'annexe 5 du PLFSS constitue une certaine préfiguration d'un sous-objectif dédié aux produits de santé en présentant, de façon centralisée bien que non exhaustive, les dépenses d'assurance maladie relatives aux produits de santé nettes, intégrant les remises conventionnelles, ainsi que le rendement de la clause de sauvegarde et de la contribution sur le chiffre d'affaires.
• La commission souhaite également disposer d'une vision pluriannuelle plus précise des financements des dépenses de santé.
L'annexe au PLFSS est censée décrire les prévisions de recettes et de dépenses, avec une trajectoire pluriannuelle de l'Ondam. Formellement, des tableaux figurent bien au sein de cette annexe.
Trajectoire de l'Ondam au regard des hypothèses du PLFSS pour 2026
|
2024 |
2025 (p) |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
|
3,3 % |
3,6 % |
1,6 % |
2,9 % |
2,9 % |
2,9 % |
Source : Annexe au PLFSS pour 2026
Cependant, la commission déplore que les sous-jacents de la trajectoire pluriannuelle de l'Ondam ne soient pas davantage explicités, ni détaillés par sous-objectifs. Le Gouvernement indique uniquement reprendre la même hypothèse sous-jacente à la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques qui fixait l'évolution de l'Ondam à 2,9 % en 2027.
La commission appelle donc le Gouvernement à mener de véritables travaux de réflexion et d'analyse pour définir la trajectoire pluriannuelle de l'Ondam, alors qu'une stratégie durable et crédible d'économies est indispensable et que les professionnels de santé, en particulier les établissements de santé, ont besoin d'une vision à moyen terme de leurs financements.
L'adoption attendue du protocole pluriannuel de financement, qui était annoncé mais n'a toujours pas été signé, serait de nature à apporter de la visibilité aux établissements et à sécuriser leurs financements.
Les fédérations hospitalières appelaient à la signature de ce protocole mais semblent aujourd'hui plus réticentes au vu de la trajectoire annoncée pour l'Ondam en 2026, qui signifiera des baisses tarifaires et un sous-financement de certaines activités.
En revanche, la signature d'un protocole pluriannuel centré sur l'investissement, la recherche et l'innovation a été annoncée par la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, lors de son audition par la commission1304(*). La commission l'appelle de ses voeux, dans le cadre d'une concertation avec les fédérations, qui devra leur apporter davantage de transparence et de visibilité sur les évolutions budgétaires à venir.
2. Des réformes structurelles à engager
La commission appelle également à une véritable réflexion sur les choix de société et de vision à long terme qu'implique le financement de notre système de santé, alors que les dépenses dans le champ de l'Ondam représentent désormais 8,8 % du PIB contre 7 % lors de sa création en 1997.
Des propositions d'économies et d'augmentation des recettes ont été formulées, notamment par la Cour des comptes1305(*) et par la Cnam1306(*), et sont recensées et chiffrées dans le récent rapport de la commission, intitulé Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat1307(*).
L'impératif de maîtrise et d'efficience des dépenses de santé implique des choix conscients et raisonnés, mobilisant des réformes structurelles et ne sacrifiant pas l'investissement de long terme.
La commission appelle le Gouvernement à impulser ces réformes, notamment à travers la construction de filières et de parcours de soins cohérents à l'échelle des territoires et la sécurisation de l'accomplissement des missions de service public.
Enfin, elle rappelle la nécessité de développer un modèle de financement adapté à la prévention, qui doit être mise au coeur des politiques de santé.
Au vu de ces réserves significatives, la commission a adopté l'amendement n° 718 de la rapporteure qui vise à supprimer cet article.
La commission propose de supprimer cet article.
Article 50
Transferts à la charge de la branche AT-MP
Cet article fixe pour 2026 le montant du transfert de la branche AT-MP au profit des fonds de l'amiante, de la branche maladie au titre de la sous-déclaration et de la branche vieillesse au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité et du financement du compte professionnel de prévention (C2P).
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : des dotations à la charge de la branche en léger recul, responsables pour partie de la situation financière dégradée de la branche
A. Le reversement de la branche AT-MP au titre de la sous-déclaration restera constant à 1,6 milliard d'euros en 2026, avant d'augmenter à nouveau en 2027 pour atteindre 2,0 milliards d'euros
Le défaut de détection des pathologies d'origine professionnelle du fait d'une insuffisante sensibilisation des professionnels de santé aux enjeux AT-MP, la méconnaissance par les assurés de leurs droits, la lourdeur des procédures déclaratives ou encore la crainte de répercussions à la suite de la déclaration d'une affection comme sinistre professionnel peuvent conduire les assurés à ne pas solliciter une prise en charge au titre de la législation spécifique aux AT-MP. Ce phénomène, appelé « sous-déclaration » des AT-MP, est indubitable puisqu'il est largement documenté par divers rapports.
Qu'elle découle d'une sous-déclaration à proprement parler ou d'une sous-reconnaissance, la sous-déclaration aboutit à une prise en charge indue par la branche maladie de prestations en nature et en espèces qui devraient en principe relever de la branche AT-MP.
En compensation de ces sommes, l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale prévoit depuis 19971308(*) que la branche AT-MP du régime général est redevable d'un « versement annuel » à la branche maladie du même régime. Initialement restreint aux maladies professionnelles, ce versement a été étendu, en 2002, aux accidents du travail. En application de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, le montant du versement est défini par la loi de financement de la sécurité sociale.
Le III de l'article 50 fixe, pour 2026, le montant de ce versement à 1,6 milliard d'euros, un montant constant par rapport à 2025. Cette dernière année avait été marquée par un accroissement historique du montant du transfert, à hauteur de 400 millions d'euros. Dès 2027, le montant du transfert augmentera à nouveau de 400 millions d'euros malgré la santé financière chancelante de la branche, pour atteindre 2,0 milliards d'euros.
En dépit des efforts mis en oeuvre par les entreprises et les caisses, le montant du versement annuel au titre de la sous-déclaration n'a toujours fait que croître : depuis le retour à l'équilibre de la branche AT-MP en 2013, son montant a doublé, au bénéfice d'une branche maladie toujours déficitaire. En 2026, le transfert à la branche maladie représentera 8,9 % des charges de la branche. En 2027, il consommera 10,5 % de ses dépenses, un record depuis son instauration.
Évolution du versement de la branche AT-MP
à la branche maladie au titre de la
sous-déclaration
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat.
Le transfert est fixé au niveau de la fourchette basse de l'estimation réalisée par le dernier rapport de la commission chargée d'évaluer le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, le cas échéant en lissant la montée en charge.
Cette commission, présidée par un magistrat à la Cour des comptes et composée de représentants de sociétés savantes et de représentants de diverses administrations, remet en effet tous les trois ans, au Gouvernement et au Parlement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles1309(*). La commission « met en regard une prévalence estimée en population générale, à partir de données épidémiologiques, et les cas reconnus par la branche AT-MP »1310(*), puis chiffre sur cette base le coût de la sous-déclaration en fonction des coûts moyens encourus par la branche maladie pour chaque pathologie.
Le dernier rapport en date, rendu en juin 2024, estime le coût de la sous-déclaration entre 2,0 et 3,8 milliards d'euros. Ce total est significativement supérieur à la précédente évaluation qui faisait état d'un montant compris 1,2 et 2,1 milliards d'euros - déjà en nette hausse par rapport à l'évaluation de 2017, qui misait sur un indu compris entre 815 et 1 530 millions d'euros. La sous-déclaration des AT-MP aurait donc été multipliée par deux et demi entre 2017 et 2024. La commission explique cette évolution par quatre piliers principaux :
- l'évolution du coût de la prise en charge avec la hausse des prix en santé (négociations conventionnelles, Ségur de la santé), qui représente le tiers de l'accroissement estimé ;
- l'évolution stagnante ou baissière des cas reconnus par la branche AT-MP qui induit une hausse de la sous-déclaration dès lors que la prévalence ne suit pas la même tendance en population générale ;
- l'actualisation des estimations sur la base de nouveaux travaux scientifiques ;
- l'extension progressive du champ des sinistres couverts : le rapport 2024 marque notamment l'introduction de la sous-déclaration au titre de la souffrance psychique en lien avec le travail.
Fourchettes hautes et basses des trois dernières estimations de la commission chargée d'évaluer le coût réel de la sous-déclaration
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
La hausse du montant attendu du transfert - de 1,2 milliard à 2,0 milliards - est telle que le Gouvernement a fait le choix de lisser la montée en charge sur plusieurs années. En 2025, le régime général de la branche AT-MP a déjà dû consentir à 50 % de l'effort supplémentaire puisque la dotation a été portée à 1,6 milliard d'euros. Bien que le Gouvernement ait indiqué, dans l'exposé des motifs du PLFSS pour 2025, que « le montant du transfert vers la branche maladie augmentera[it] par la suite progressivement pour atteindre la fourchette basse de l'estimation de la commission, soit 2 Md€ », celui-ci a finalement renoncé à rehausser la dotation à la branche maladie en 2026 compte tenu de la situation économique dégradée de la branche.
La hausse du transfert en faveur de la branche maladie explique en effet largement1311(*) la dégradation du solde de la branche AT-MP, qui devrait plonger, dès cette année, dans une situation déficitaire durable.
2. Les dotations de la branche AT-MP du régime général aux fonds de l'amiante diminueront de 157 millions d'euros en 2026, sans retrouver le niveau d'effort de l'année 2024
a) La dotation de la branche AT-MP au Fiva est fixée à 387 millions d'euros pour 2026, contre moins de 7 millions d'euros pour l'État
Le I de l'article 50 fixe à 387 millions d'euros la contribution de la branche AT-MP au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), l'établissement public administratif créé par l'article 53 de la LFSS pour 20011312(*) chargé d'assurer la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par les victimes de l'amiante - professionnelles ou environnementales - sur le territoire français et par leurs ayants droit.
Les 387 millions d'euros de dotation pour 2025 marquent certes une forte diminution par rapport aux 465 millions d'euros versés en 2025, mais sont à mettre en regard des 335 millions d'euros accordés au fonds en 2024 et avec les 220 millions d'euros consentis les années précédentes.
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution.
D'une part, alors que les dépenses du Fiva ont été particulièrement dynamiques entre 2023 et 2025, celles-ci devraient freiner en 2026 du fait de la diminution du nombre de demandes d'indemnisation (- 4 %), malgré des efforts de lutte contre le non-recours qu'il appartiendra au Fiva de mettre en oeuvre en application de l'article 89 de la LFSS pour 20241313(*). Le fonds reste, pour cela, toujours en attente des publications des décrets d'application de cet article, près de deux ans après son adoption par le Parlement.
Un effet prix, lié au ralentissement de l'inflation, entre également en compte : les rentes n'ont, à cet égard, été revalorisées que de 1,7 % en 2025, elles ne devraient pas l'être davantage en 2026.
En outre, la réaffirmation du caractère dual de la rente lors de la dernière LFSS devrait permettre de diminuer, sur le moyen terme, les dépenses d'indemnisation du Fiva. En effet, la Cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 20231314(*), avait mis fin à la dualité de la rente, ce qui avait indirectement affecté le Fiva, celui-ci indemnisant intégralement le déficit fonctionnel permanent des victimes de l'amiante par le versement d'une rente. Afin d'éviter toute double indemnisation, le Fiva pouvait, jusqu'à récemment, déduire du montant de rente qu'il devait verser celui attribué par la branche AT-MP au titre du déficit fonctionnel permanent. Or, en vertu des arrêts de la Cour de cassation, la rente AT-MP est réputée n'avoir qu'une vocation professionnelle, et donc ne plus indemniser le déficit fonctionnel permanent. Le Fiva ne peut donc plus déduire la rente AT-MP du montant de ses rentes de déficit fonctionnel, ce qui a des conséquences financières certaines sur le fonds : le coût moyen d'un dossier est passé de 37 500 euros à 56 100 euros pour les victimes et de 9 300 euros à 10 500 euros pour les ayants droit. La réaffirmation de la dualité de la rente, qui entre en vigueur au 1er juin 2026, devrait progressivement mettre fin à cette situation.
Le Fiva indique que ses dépenses d'indemnisation devraient donc tout de même progresser de 8 % en 2026, un total qui restera à confirmer eu égard à la fréquence des sous-exécutions budgétaires constatées pour ce fonds.
Dans ce contexte, il est possible d'abaisser le montant de la dotation au Fiva, d'autant plus que la sous-exécution du budget 2025 a permis au fonds de consolider son fonds de roulement, attendu à 73 millions d'euros fin 2025.
Toutefois, la dotation au Fiva ne saurait retrouver le niveau qu'elle avait avant 2022, alors qu'était menée une politique dite de « prélèvement sur fonds de roulement », consistant à mobiliser les excédents passés du fonds en lui attribuant une dotation volontairement insuffisante à la couverture de ses frais.
Alors que la branche AT-MP est fortement mobilisée pour le financement du Fiva, l'État entend maintenir constante sa dotation à 8 millions d'euros, comme chaque année. Ce montant ne permet pas de couvrir les frais d'indemnisation des victimes environnementales ou non assurées du Fiva, alors même que celles-ci ne pourraient pas prétendre à une indemnité AT-MP de droit commun.
b) La dotation de la branche AT-MP au Fcaata, en baisse de 75 millions d'euros dans un contexte de diminution structurelle du nombre de bénéficiaires
Le II de l'article 50 fixe la dotation de la branche AT-MP du régime général au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata) à 378 millions d'euros en 2026 contre 453 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 75 millions d'euros. La contribution du régime AT-MP des salariés agricoles devrait se limiter à un niveau inférieur à 0,1 million d'euros.
Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 19991315(*), le Fcaata est un fonds sans personnalité juridique, qui finance des dispositifs de préretraite au bénéfice des anciens travailleurs de l'amiante.
Le fonds verse l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), qui constitue un revenu de remplacement équivalent à 65 % du salaire1316(*) pour les travailleurs de l'amiante éligibles à un mécanisme de préretraite et qui ont, à ce titre, interrompu leur activité professionnelle avant l'âge légal de départ à la retraite. L'âge à partir duquel l'Acaata peut être versée dépend de la durée d'exposition1317(*). Les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et ceux dont la durée d'exposition professionnelle à l'amiante a excédé 30 ans peuvent cesser leur activité dès 50 ans.
Le Fcaata finance, en sus, la prise en charge de cotisations d'assurance vieillesse volontaire et complémentaire, et verse une compensation à la Cnav au titre du maintien à 60 ans de l'âge légal du départ en retraite pour les travailleurs de l'amiante.
À la fin de l'année, 114 650 assurés auront bénéficié des prestations du Fcaata depuis sa création.
Charges prévisionnelles du Fcaata pour 2026
(en millions d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après l'annexe 2 au PLFSS pour 2026
L'activité du fonds tend à se réduire du fait du tarissement du flux de nouveaux bénéficiaires. Alors qu'entre 2006 et 2010, le stock d'allocataires était supérieur à 30 000, il tombera sous la barre des 7 000 fin décembre 2025. Cela a résulté en un redimensionnement à la baisse du budget du fonds, moins sollicité : la dotation de la branche AT-MP, seul financeur, tutoyait le milliard d'euros annuel à la fin de la décennie 2000, et a été réduite jusque 327 millions d'euros en 2022.
Toutefois, le fonds a connu, en 2023 et 2024, une hausse des dépenses liée à un rebond du nombre d'allocataires, combinée à une hausse de l'Acaata moyenne de 7,8 % en 2024 selon la direction de la sécurité sociale. Alors que les dépenses d'Acaata pour 2024 et 2025 étaient estimées à 198,9 et 184,2 millions d'euros lors du PLFSS pour 2024, celles-ci ont été nettement revues à la hausse avec des prévisions d'Acaata brute à 223 millions d'euros pour 2024 et 233 millions d'euros pour 2025.
Cette trajectoire s'expliquerait principalement par un effet incitatif au recours lié au décalage de l'âge légal de départ en retraite porté par la LFRSS pour 2023, qui n'a nullement affecté le dispositif, le rendant plus attractif. S'y adjoindrait un effet périmètre, du fait de l'ouverture de l'éligibilité à l'Acaata de salariés de nouveaux ports1318(*).
La croissance inattendue du nombre de bénéficiaires s'est traduite, en 2024, par un déficit prévisionnel conséquent, atteignant 30 millions d'euros. Le recalibrage de la dotation de la branche AT-MP en 2025 a toutefois permis de redresser la situation financière du fonds, qui s'apprête à réaliser un exercice bénéficiaire de 60 millions d'euros en 2025, permettant au fonds de disposer d'un résultat cumulé excédentaire de 14 millions d'euros.
Pour 2026, les dépenses du fonds devraient très légèrement diminuer, de 393 à 391 millions d'euros, du fait d'une diminution des transferts à la Cnav au titre de la compensation des départs dérogatoires à la retraite.
La dotation de la branche AT-MP au Fcaata est fixée afin de couvrir les dépenses prévisionnelles du fonds et d'équilibrer son résultat cumulé, ce qui justifie une dotation inférieure de 14 millions d'euros au besoin, soit un transfert de 378 millions d'euros.
3. Les dispositifs de prévention de la pénibilité continuent leur montée en charge
La majoration « M4 »1319(*) s'appliquant aux cotisations AT-MP des employeurs, fixée à 0,03 % des salaires en 20251320(*), permet à la branche de financer deux dispositifs de prévention de la pénibilité : le départ en retraite anticipé pour certains assurés présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 10 % à la suite d'un sinistre professionnel, et le compte professionnel de prévention (C2P).
Le régime des salariés agricoles finance également ces deux dispositifs pour ses assurés en reflétant leurs coûts dans le calcul du taux de cotisation applicable, aux termes de l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime.
• Le dispositif de retraite anticipée pour incapacité
Aux termes de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, certains assurés présentant un taux d'incapacité permanente (IPP) supérieur à 10 % consécutivement à un sinistre professionnel ne sont pas soumis à l'âge légal de 64 ans1321(*), mais à un âge dérogatoire. Celui-ci est fixé à 60 ans lorsque le taux d'IPP excède 20 %1322(*), et à deux ans sous l'âge légal, soit 62 ans, lorsque l'assuré a été exposé au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels en lien direct avec son1323(*) affection1324(*) et que celle-ci a provoqué un taux d'IPP compris entre 10 %1325(*) et 20 %.
L'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses supplémentaires occasionnées à la branche vieillesse du fait des dispositifs de départ en retraite anticipée pour incapacité soient couvertes par une contribution de la branche AT-MP.
Pour 2026, l'exposé des motifs de l'article 50 indique que le montant du transfert de la branche AT-MP à la branche vieillesse au titre des dispositifs de départ à la retraite anticipée pour incapacité représentera 157 millions d'euros en pour le régime général, et 13,29 millions d'euros pour le régime agricole ; soit un total de 160,3 millions d'euros.
Le transfert connaît une hausse de 28 % par rapport à 2025, liée à la montée en charge du dispositif consécutivement à la réforme des retraites.
• Les dépenses imputables au compte professionnel de prévention
Le compte professionnel de prévention (C2P), issu de la transformation du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P)1326(*) par l'ordonnance du 22 septembre 20171327(*), ouvre des droits aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels. Les salariés exposés cumulent des points sur leur compte en fonction du nombre de trimestres d'exposition au risque et, depuis la LFRSS pour 2023, du nombre de facteurs de risques1328(*). Depuis la LFRSS pour 2023, le C2P est déplafonné1329(*).
Ils peuvent ensuite convertir ces points pour financer une formation ou un projet de reconversion professionnelle, bénéficier d'un passage à mi-temps avec maintien de salaire ou valider des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse et ainsi partir plus tôt à la retraite1330(*). La LFRSS pour 2023 et ses décrets d'application1331(*) ont conduit à revaloriser la valeur du point pour la formation et le mi-temps avec maintien de salaire.
Aux termes de l'article L. 4163-21 du code du travail, il revient aux organismes nationaux de la branche AT-MP du régime général et du régime agricoles de financer, « chacune pour ce qui la concerne », les dépenses engendrées par le C2P. L'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale précise, en outre, que la branche AT-MP couvre les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite anticipés liés au C2P par une contribution à la branche vieillesse.
L'exposé des motifs de l'article 50 estime à 66 millions d'euros les dépenses au titre du C2P pour le régime général en 2026 et à 0,5 million d'euros pour le régime des salariés agricoles. Ce total ressort en nette baisse par rapport à l'année 2025, lors de laquelle les dépenses prévisionnelles afférentes atteignaient 105,5 millions d'euros. La direction de la sécurité sociale explique ces évolutions par la baisse des utilisations du C2P pour des bonifications liées à la retraite au profit des bonifications en matière de formation et de reconversion professionnelle, « qui ont un impact plus faible sur les dépenses »1332(*).
Le IV de l'article 50 fixe, pour 2025, les montants des dépenses engagées au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité et du C2P à 223 millions d'euros pour la branche AT-MP du régime général, et à 13,79 millions d'euros pour celle du régime des salariés agricoles. Ces montants correspondent à la somme des dépenses évoquées par l'exposé des motifs au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité et au titre du C2P. Ils sont en hausse de 2,7 % par rapport à 2025, année pour laquelle ces transferts représentaient 230,4 millions d'euros.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
1. Le transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration : un effort important pour la branche AT-MP
La commission des affaires sociales dénonce, de manière constante, le choix d'affecter les excédents de la branche AT-MP à d'autres entités, estimant que les cotisations perçues au titre des risques professionnels doivent servir aux investissements nécessaires en matière de réparation et de prévention.
Elle regrette en particulier le poids du transfert à la branche maladie, fondé sur des estimations qui, si elles ne sont pas insincères, souffrent d'un grave défaut de fiabilité.
La rapporteure a pu entendre, à l'occasion de l'instruction du dernier PLFSS, le président de la commission chargée d'estimer le coût réel de la sous-déclaration des AT-MP. Celui-ci a confirmé que la méthodologie de calcul de la sous-déclaration la valorisait aux tarifs de la branche maladie et prenait bien en compte, lorsqu'elle existait, la sur-déclaration des AT-MP. Sous ces réserves, la rapporteure estime que le montant de sous-déclaration estimé n'est pas insincère.
Pour autant, comme elle l'avait indiqué l'an dernier, la rapporteure juge préoccupante la volatilité des estimations, témoin de leur manque de fiabilité, dans l'optique de leur utilisation pour aiguiller des choix de politique publique.
Ce défaut de fiabilité ne remet pas en cause l'expertise des membres de la commission chargée d'évaluer le coût réel de la sous-déclaration : il est inhérent à l'exercice qui leur est confié, à savoir l'estimation d'un contrefactuel inobservable. Ladite commission concédait elle-même l'an dernier que « par définition, les personnes qui ne recourent pas à une prise en charge AT-MP alors qu'elles y seraient éligibles sont absentes des fichiers administratifs, et la complexité des diagnostics médicaux et de l'imputabilité professionnelle requerrait des bases de données très riches pour pouvoir repérer précisément les personnes concernées, ce qui n'existe pas ».
L'an dernier, la commission des affaires sociales avait noté que le transfert n'empêchait pas la réalisation d'un excédent pour la branche AT-MP et ne portait, en cela, pas d'atteinte excessive à la santé financière de la branche. Elle avait également salué des réformes ambitieuses portées par la dernière LFSS en matière de réparation, ainsi que la montée en charge de l'effort de la branche en faveur de la prévention. C'est pourquoi, contrairement aux exercices précédents, la commission avait fait le choix, l'an dernier, de ne pas modifier le montant du transfert.
La commission indiquait l'an dernier que « si le montant préconisé par la commission chargée d'évaluer le coût réel de la sous-déclaration devient insoutenable pour la branche AT-MP », elle s'opposerait à son utilisation comme standard de fixation du transfert à la branche maladie, et plaiderait pour geler la part du transfert dans les dépenses de la branche à un niveau donné.
Dès lors que le montant du transfert reste constant en 2026 malgré la hausse des dépenses de la branche, son poids relatif recule en dessous du taux d'effort cautionné l'an dernier par la commission. En conséquence, la commission propose d'adopter le montant du transfert sans modification.
2. Vers un rééquilibrage de l'effort financier en faveur du Fiva ?
Si l'effort demandé à la branche AT-MP pour le financement du Fiva décroît en 2026, il reste que la dotation de la branche AT-MP au Fiva a augmenté de 75 % entre 2023 et 2026.
La commission réitère sa position habituelle sur la question : s'il est naturel que la branche AT-MP prenne sa juste part dans l'effort nécessaire de financement du Fiva, l'État doit en faire de même. Or la dotation de ce dernier reste invariablement fixée à moins de 8 millions d'euros, soit 2 % des ressources publiques du fonds.
Ce total ne permet pas, loin s'en faut, de couvrir les frais d'indemnisation des victimes environnementales ou des victimes indemnisées par le Fiva sans relever de la législation des AT-MP, qui doivent pourtant, en principe, être assumés par l'État. En 2024, ces victimes, qui relèvent de la solidarité nationale, représentaient 18 % des assurés indemnisés par le Fiva.
La commission appelle donc l'État, reconnu responsable du scandale de l'amiante, à intensifier son effort financier en faveur du Fiva afin de couvrir intégralement les frais d'indemnisation des victimes dont il est censé avoir la charge.
3. Sur l'information du Parlement
La commission rappelle enfin qu'au titre de l'article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale, il est fait obligation au Gouvernement de présenter, dans les annexes au PLFSS, « pour l'année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels [...] des organismes financés par les régimes obligatoires de base », étant entendu que cette annexe fait figurer « le montant de la dotation [...] pour l'année en cours et de la dotation prévisionnelle [...] pour l'année à venir ».
La commission ne peut que regretter que, cette année encore, les dispositions organiques relatives à l'information du Parlement n'aient pas été respectées. Alors même que le PLFSS pour 2024 respectait les dispositions organiques précitées concernant la visibilité pluriannuelle sur les comptes du Fiva et du Fcaata, tel n'est plus le cas depuis le PLFSS pour 2025.
La commission note donc que l'information communiquée au Parlement dans le PLFSS pour 2026 ne satisfait les dispositions de l'article L.O. 111-4-1 pour aucun des quinze organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base, qu'ils relèvent de la branche maladie ou de la branche AT-MP.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
51
Objectif de dépenses de la branche AT-MP
Cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche AT-MP à 18,0 milliards d'euros pour 2026 sur le champ des régimes obligatoires de base.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : un objectif de dépenses de 18,0 milliards d'euros pour 2026, en hausse de 3,3 % par rapport à 2025
A. L'année 2024 marque la dernière année d'excédents de la branche AT-MP, avant la montée en charge du transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration
En 2024, la branche AT-MP a, pour la onzième fois en douze exercices, dégagé un solde excédentaire, à hauteur de 0,7 milliard d'euros - un résultat conforme aux prévisions de la dernière LFSS.
1. En 2024, les recettes de la branche AT-MP ont atteint 16,9 milliards d'euros sur le champ des Robss
Les recettes de la branche AT-MP ont stagné en 2024, avec une hausse de 0,9 % sur le champ des Robss, très inférieure à la dynamique observée les années précédentes (+ 3,8 % en 2023).
À une évolution plus contenue de la masse salariale du secteur privé (+ 3,3 % en 2024, contre + 5,7 % en 2023), en raison du ralentissement de l'inflation, s'ajoutent en effet les conséquences de l'attribution de 0,12 point de cotisations AT-MP à la branche vieillesse, en vertu de la loi de financement rectificative de financement de la sécurité sociale pour 20231333(*) portant réforme des retraites1334(*). Ce « swap » de taux entraîne, pour la branche, une perte de 0,8 milliard d'euros de recettes, dynamique dans le temps. Un second transfert est attendu pour 2026.
Dans le détail, sur le régime général, les cotisations brutes ont chuté de 2,1 %, la dynamique des salaires ne suffisant pas à compenser les effets du « swap » de taux. Les recettes de ce régime ont toutefois progressé de 0,7 % en raison d'une forte progression des autres produits nets de la branche, portés par son résultat financier de 756 millions d'euros, soit 211 millions de plus qu'en 2023.
Grâce à une progression de la masse salariale légèrement plus prononcée qu'anticipé, les recettes ont, malgré tout, été plus dynamiques que ne l'annonçait la LFSS pour 2025, qui prévoyait des rentrées à hauteur de 16,7 milliards d'euros.
2. En 2024, les dépenses de la branche AT-MP ont atteint 16,3 milliards d'euros sur le champ des Robss
Les dépenses de la branche AT-MP poursuivent leur dynamique avec une hausse de 5,8 % en 2024 (+ 0,9 milliard d'euros), une progression légèrement moins marquée qu'en 2023 (+ 6,6 %). Cette hausse s'avère nettement plus rapide que celle des recettes, contribuant à une réduction de moitié l'excédent de la branche par rapport à 2023.
Cette évolution a été portée par la forte dynamique des prestations en espèces, insuffisamment anticipée lors de la dernière LFSS, laquelle avait sous-estimé de près de 300 millions d'euros leur niveau. Les dépenses sont alimentées par une nouvelle hausse de 10,1 % des indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire pour le régime général. Les prestations d'incapacité permanente AT-MP, portées par la revalorisation de 4,6 % des rentes liées à l'inflation, ont également progressé de 3,6 % entre 2023 et 2024 au régime général.
Hors du champ des prestations stricto sensu, un accroissement des transferts aux fonds de l'amiante a également pesé sur la trajectoire des dépenses.
B. La branche AT-MP devrait connaître, pour la deuxième fois en treize ans, un exercice déficitaire en 2025
La branche AT-MP devrait connaître, en 2025, une dégradation brutale de son solde. Combinée à des recettes atones, la hausse de 400 millions d'euros du transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration devrait en effet plonger la branche dans une situation déficitaire en 2025, à hauteur de 0,5 milliard d'euros.
Il s'agit là de prévisions considérablement dégradées par rapport à celles qui figuraient dans la LFSS pour 2025 - un excédent de 0,1 milliard d'euros était alors attendu. En effet, les prévisions en recettes ne se sont pas réalisées du fait d'une masse salariale du secteur privé en berne (1,8 % dans les dernières prévisions, contre une estimation de 2,8 % dans la LFSS pour 2025), tandis que les dépenses de la branche ont dérapé de quelque 500 millions d'euros sous l'effet de la dynamique des prestations en espèces, et tout particulièrement des indemnités journalières (+ 13 % pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale).
Prévisions des recettes, dépenses et solde de la branche AT-MP pour 2025
(en milliards d'euros)
|
LFSS pour 2025 |
PLFSS pour 2026 |
|
|
Recettes |
17,1 |
16,9 |
|
Dépenses |
17,0 |
17,5 |
|
Solde |
0,1 |
- 0,5 |
Source : Commission des affaires sociales d'après LFSS pour 2025, PLFSS pour 2026
1. En 2025, les recettes de la branche AT-MP atteindraient 16,9 milliards d'euros sur le champ des Robss, un total stable par rapport à 2024
Les recettes de la branche AT-MP devraient stagner en 2025, et atteindre, comme en 2024, 16,9 milliards d'euros.
Les cotisations prévisionnelles, au régime général, évoluent pourtant plus vite que la masse salariale privée (2,2 % contre 1,8 %) grâce à une intensification des efforts de contrôle.
La dynamique des recettes est toutefois grevée par les charges liées au non-recouvrement, qui progresseraient de 186 millions d'euros, sans qu'une explication soit apportée par le Gouvernement. En outre, les autres produits de la branche, qui comprennent notamment le résultat financier, seraient en baisse prévisionnelle de 129 millions d'euros en raison de l'incidence de la dégradation du solde sur les produits financiers à venir pour la branche.
Trajectoire de recettes et dépenses de la branche AT-MP depuis 2016
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données PLFSS pour 2017 à 2026
2. En 2025, les dépenses de la branche AT-MP devraient avoisiner 17,5 milliards d'euros sur le champ des Robss, soit 7,6 % de plus qu'en 2024
Parallèlement à la stagnation des recettes, les dépenses de la branche devraient augmenter de 1,2 milliard d'euros en 2025, pour atteindre 17,5 milliards d'euros.
Plus encore que les prestations, ce sont les transferts à la charge de la branche qui ont pesé particulièrement lourd sur son équilibre en 2025. Le rebond des prestations aurait pu être absorbé pour laisser un léger excédent à la branche si celle-ci n'avait pas vu être mis à sa charge plus de 600 millions d'euros de transferts supplémentaires.
D'une part, le transfert à la branche maladie1335(*) a été porté à 1,6 milliard d'euros, soit 400 millions d'euros d'augmentation par rapport à 2024. Cette hausse intervient alors que, dans son dernier rapport publié en juin 20241336(*), la commission chargée d'évaluer le coût réel de la sous-déclaration1337(*) a revu à la hausse son estimation du montant indûment pris en charge par la branche maladie en lieu et place de la branche AT-MP, désormais comprise entre 2 et 3,8 milliards d'euros. Conformément à sa doctrine en la matière, le Gouvernement a donc souhaité s'inscrire dans une trajectoire d'augmentation du transfert afin d'atteindre 2 milliards d'euros en 2027, soit la borne basse de l'estimation de la commission.
D'autre part, les transferts aux fonds de l'amiante ont également progressé de 210 millions d'euros en 2025. En effet, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) a bénéficié de 465 millions d'euros de subventions en 2025, contre 335 millions d'euros en 2024 et 220 millions d'euros les années précédentes. Une telle hausse vise à couvrir la dynamique des dépenses liées tant à un effet volume (+ 16 % de demandes en 2024) qu'à un effet prix, et à tirer les conséquences de l'épuisement de fonds de roulement du Fiva. Le fonds de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (Fcaata) a quant à lui perçu 453 millions d'euros en 2025, après 355 millions d'euros en 2024, afin de ramener à l'équilibre le résultat cumulé du fonds, chiffré à - 47 millions d'euros fin 2024.
L'évolution des prestations légales nettes (+ 660 millions d'euros pour le régime général, + 5,9 %) contribue également à la hausse des dépenses.
La dynamique des dépenses serait principalement portée par les indemnités journalières, qui poursuivent une trajectoire peu contrôlée (+ 13 % en 2025). En cause, un effet volume (+ 10,2 %) explicable en partie par une progression de l'emploi, l'allongement des arrêts et la prolongation de la durée d'activité des séniors.
Il est notable que les actions de prévention financées par le régime général ont également suivi une hausse rapide, + 29,4 % en 2025, sous l'effet de la montée en charge du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (Fipu).
Les prestations d'incapacité permanente, représentant 6,0 milliards d'euros sur l'ensemble des régimes obligatoires de base, ressortent en hausse nettement plus modérée (+ 0,6 %) en raison de l'atonie des rentes.
Cette dernière évolution s'explique par une compensation partielle entre :
- les effets de la revalorisation des montants induits, de 2,4 % ;
- et ceux de la tendance structurellement baissière du nombre de bénéficiaires, avec un effet volume jouant négativement de 0,7 % dans l'évolution des dépenses.
Le régime général représente l'essentiel des dépenses de la branche AT-MP, avec 15,8 milliards d'euros de dépenses (+ 8,5 %). Les régimes agricoles, que ce soit celui des salariés (719 millions d'euros, + 2,4 %) ou des exploitants (359 millions d'euros, - 15,5 %) affichent, parmi les autres régimes obligatoires de base, les dépenses les plus importantes, suivis de celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (244 millions d'euros, + 4,5 %) et du régime minier (142 millions d'euros, - 7,6 %).
Les dépenses du régime général en 2025
Les dépenses du régime général se décomposent entre des prestations, certaines étant dans le champ de l'Ondam, et d'autres en dehors, des transferts, et d'autres charges.
les prestations sociales, marquées par une croissance dynamique de 5,9 %, représentent plus des trois quarts des dépenses du régime général et atteignent 11,9 milliards d'euros en 2025. Ces dépenses sont réparties entre prestations relevant du champ de l'Ondam et n'en relevant pas :
- les prestations du champ de l'Ondam atteignent 6,5 milliards d'euros et sont constituées de prestations en nature en ville (532 millions d'euros) ou en établissement (503 millions d'euros) et de prestations en espèces via le versement d'indemnités journalières visant à compenser l'incapacité temporaire (5,5 milliards d'euros). Leur croissance de 8,2 % en 2025 est intégralement portée par des indemnités journalières (+ 10,3 %) ;
- les prestations hors du champ de l'Ondam compteraient pour 5,4 milliards d'euros en 2025 et connaîtraient une évolution moins dynamique, attendue à 3,2 %. Les prestations d'incapacité permanente, qu'elles soient sous forme de rentes viagères ou d'indemnités en capital, sont notifiées à 4,8 milliards d'euros, soit 88 % du sous-total. Leur évolution positive de 1,7 %, portée par la revalorisation des rentes de 2,4 % en moyenne annuelle, explique pour moitié la trajectoire des prestations hors Ondam.
L'autre moitié de la hausse provient des actions de prévention, qui atteindraient 339 millions d'euros, un total en hausse de 29 % sur un an. Cette évolution s'explique par la montée en charge du compte professionnel de prévention (C2P) et du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (Fipu), respectivement élargi et créé par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les allocations de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) demeurent quant à elles à 233 millions d'euros malgré le tarissement de flux de nouveaux bénéficiaires ;
Évolution des prestations versées
par le régime général
de la branche AT-MP depuis
2023
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données du rapport d'octobre 2025 de la CCSS
les transferts représentent, en 2025, 2,9 milliards d'euros pour le régime général de la branche AT-MP, soit 18 % des charges du régime. Le transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration représente plus de la moitié de ce total. Le régime général de la branche AT-MP finance également d'autres transferts, que ce soit avec d'autres régimes obligatoires de base (362 millions d'euros) à l'image du régime minier, à d'autres branches (243 millions d'euros pour la branche vieillesse) ou à divers fonds (493 millions d'euros, dont 465 millions d'euros pour le Fiva, + 211 % en deux exercices) ;
les autres charges du régime général de la branche AT-MP atteignent 1,0 milliard d'euros en 2024 et sont quasi-intégralement composées des charges de gestion courante (+ 8,8 %).
Répartition des dépenses du régime général de la branche AT-MP en 2025
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données du rapport d'octobre 2025 de la CCSS
C. La branche AT-MP devrait connaître une nouvelle dégradation de son solde en 2026 pour accuser un déficit de 1,0 milliard d'euros
Le PLFSS pour 2026 prévoit une nouvelle dégradation de la situation financière de la branche AT-MP, dont le déficit annoncé semble présenter un caractère structurel, et non transitoire. Pour 2026, le solde atteindrait - 1,0 milliard d'euros, soit un déficit de 5,8 %. Il faut remonter à l'année 2010, en pleine crise économique, pour retrouver trace d'un déficit d'une telle ampleur par rapport aux recettes.
La branche serait en effet touchée par un effet ciseaux : les recettes, en berne, ne suffiraient pas à couvrir des dépenses dynamiques.
1. Les recettes de la branche AT-MP progresseraient légèrement, malgré le transfert de cotisations à la branche vieillesse, pour atteindre 17,1 milliards d'euros en 2026
Les recettes de la branche AT-MP seront affectées par la seconde partie du transfert de cotisations à la branche vieillesse, qui amputera de 0,09 point les cotisations affectées aux risques professionnels. Cela représente, pour le régime général, une perte de 700 millions d'euros de cotisations.
Pour alimenter la dynamique des cotisations qu'elle perçoit, la branche ne pourra, de plus, pas compter sur un rebond de la masse salariale privée : celle-ci ne devrait augmenter que de 2,3 %, soit 0,8 point de moins que les projections de la dernière LFSS.
Le Gouvernement prévoit toutefois, sans en donner le détail, des mesures réglementaires d'amélioration des recettes de la branche, pour 0,4 milliard d'euros en 2026. La DSS affirme qu'une « hausse limitée du taux de cotisation AT/MP » pourrait avoir lieu, précisant que « la fixation des taux 2026 sera soumise à l'examen de la CAT-MP avant la prise d'arrêté d'ici la fin d'année ».
Il résulte de l'ensemble de ces effets que l'évolution des recettes de la branche devrait rester atone en 2026 : celles-ci ne progresseraient que de 0,2 milliard d'euros pour atteindre 17,1 milliards d'euros (+ 0,9 %).
2. Un objectif de dépenses de 18,0 milliards d'euros pour 2026, témoin de dépenses contenues
La diminution des transferts, le gel des prestations d'incapacité permanente et des mesures réglementaires de maîtrise des dépenses non détaillées (pour 0,2 milliard d'euros) limiteraient la progression des dépenses de la branche (+ 3,3 % en 2026, contre + 7,6 % en 2025).
Ces mesures ne suffiraient pas à toutefois pas à compenser leur hausse tendancielle, en raison d'une nouvelle augmentation prévisionnelle marquée des indemnités journalières (+ 7,6 % en 2026 pour le régime général), de la poursuite de la montée en charge du Fipu et de l'entrée en vigueur de la réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche1338(*), qui leur confère un caractère dual. Cette dernière réforme contribuerait, sur l'ensemble des régimes obligatoires de base, à une hausse de 1,2 % des dépenses au titre de l'incapacité permanente.
L'article 51 fixe un objectif de dépenses de 18,0 milliards d'euros en 2026 pour la branche, sur le champ des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Il est à noter que les perspectives financières de la branche se sont considérablement dégradées par rapport aux prévisions de la dernière LFSS, qui faisait état d'un déficit prévisionnel de 0,4 milliard d'euros. Cette évolution découle principalement de la sous-estimation de 0,6 milliard d'euros de la dynamique des prestations en 2026, elle-même conditionnée par un saut de base non anticipé en 2025.
Décomposition de l'évolution du solde 2026 de la branche AT-MP entre les estimations de la LFSS pour 2025 et du PLFSS pour 2026
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données de la LFSS pour 2025 et du PLFSS pour 2026
D. Les perspectives pluriannuelles des comptes de la branche
La branche AT-MP s'enfoncerait, à compter de 2027, dans une situation de déficit structurel particulièrement préoccupante, marquée par des niveaux de pertes inédits.
Le solde se détériorerait à nouveau considérablement en 2027 pour atteindre - 1,4 milliard d'euros, soit un déficit de 8 %. Sur les vingt dernières années, jamais la branche n'avait connu un résultat aussi défavorable, tant en valeur absolue qu'en proportion des recettes.
Malgré des recettes prévisionnelles de 17,6 milliards d'euros, en hausse de 2,9 % du fait de la progression attendue de 3,0 % de la masse salariale privée, le déficit de la branche continuerait à se creuser en raison de la dynamique des dépenses.
Ces dernières atteindraient 19,0 milliards d'euros, soit 5,6 % de plus qu'en 2026, en raison de la trajectoire spontanée des prestations, de la montée en charge de la réforme des prestations d'incapacité permanente mais, surtout, d'une nouvelle hausse de 400 millions d'euros du transfert au titre de la sous-déclaration des AT-MP. Le Gouvernement souhaite en effet fixer à 2 milliards d'euros le montant de ce transfert pour 2027 - soit la borne basse de la dernière estimation de la commission chargée d'évaluer le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des AT-MP1339(*).
Le solde serait ensuite stabilisé à - 1,3 milliard d'euros en 2028, avant de s'améliorer légèrement en 2029, année au cours de laquelle il atteindrait - 0,9 milliard d'euros.
Solde prévisionnel de la branche AT-MP entre 2023 et 2029
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données des LFSS pour 2024, LFSS pour 2025 et PLFSS pour 2026
Ces résultats constituent une dégradation considérable par rapport aux prévisionnels de la LFSS pour 2025, qui anticipait un déficit de 0,6 milliard d'euros en 2027, et plus encore de la LFSS pour 2024, qui indiquait 1,0 milliard d'euros d'excédent pour cette même année.
L'écart à la trajectoire fixée lors de la dernière LFSS s'explique uniquement par un saut de base dans les dépenses. Leur taux d'évolution en 2027 et 2028 reste similaire au prévisionnel issu de la LFSS pour 2025, mais cette évolution s'impute sur une base nettement supérieure à celle qui était envisagée du fait de la mauvaise anticipation du niveau de dépenses en 2025 puis en 2026.
Recettes, dépenses et soldes observés et prévisionnels de la branche AT-MP
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données LFSS pour 2025 et 2026
Les excédents de la branche AT-MP depuis 2013 ont toutefois permis non seulement d'apurer la dette constituée par la branche lors de la crise économique de 2008, mais également de constituer un excédent cumulé de 8,3 milliards d'euros en 2024. Malgré la dégradation du solde de la branche, celle-ci devrait conserver un excédent cumulé pendant encore sept ans au moins. Fatalement, les déficits prévisionnels de la branche entameront progressivement ces excédents cumulés, qui devraient n'atteindre plus que 4,1 milliards d'euros en 2028 et 3,2 milliards d'euros à horizon 2029.
Le total pour 2028 est près de 3 milliards d'euros plus bas que le prévisionnel de la LFSS pour 2025, ce qui indique une consommation de l'excédent cumulé nettement plus rapide qu'imaginée.
Excédents cumulés de la branche AT-MP depuis 2021
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après données PLACSS pour 2023 et 2024 et PLFSS pour 2026
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission ne peut que déplorer la dégradation subite et non anticipée de la situation financière de la branche AT-MP qui, plus encore qu'aucune autre en raison de sa nature largement assurantielle, doit poursuivre un objectif d'équilibre.
• Longtemps un exemple de gestion financière, la branche AT-MP devrait, à l'instar des branches maladie et vieillesse, plonger dans un déficit qui n'apparaît pas conjoncturel, mais bien structurel.
La rapporteure regrette, peut-être encore davantage, le fait que la détérioration de la santé financière de la branche résulte d'un choix politique en ce sens, plus que de la dynamique des prestations.
En prenant pour référence la fin 2023, il convient en effet de noter que le surcoût, pour la branche AT-MP, des transferts de cotisations à la branche vieillesse et de l'évolution du transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration atteint 2,4 milliards d'euros en 2027, 2028 et 2029 ; des montants bien supérieurs aux déficits rencontrés par la branche.
Les gouvernements successifs ont donc choisi de plonger la branche AT-MP dans le déficit en réattribuant l'excédent de la branche à d'autres entités dont la situation financière était plus dégradée, à commencer par la branche maladie et la branche vieillesse.
Solde prévisionnel de la branche AT-MP avec
et sans hausse du transfert
à la branche maladie au titre de la
sous-déclaration et transfert
de cotisations à la branche
vieillesse
Source : Commission des affaires sociales du Sénat
S'ajoutent à ces choix politiques les conséquences de l'imprécision des prévisions fournies sur la situation financière de la branche. À titre d'exemple, le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale publié en juin 2025 anticipait une hausse de 3,8 % des indemnités journalières AT-MP versées par le régime général en 2025, soit une hausse trois fois plus modérée que celle désormais envisagée. Le rapport à cette même commission quatre mois plus tard annonce désormais une hausse prévisionnelle de 10,3 % sur le même champ, entrainant une dégradation du solde de 300 millions d'euros.
Grâce aux excédents engrangés sur les derniers exercices, la branche conserverait toutefois un excédent cumulé sur l'ensemble de la période de prévision.
• Prenant acte de la nature particulière de la branche AT-MP, le Gouvernement indique que « cette tendance dégradée pourrait cependant être corrigée en partie par un effort de retour à l'équilibre, avec des leviers à identifier ». Aucun levier législatif, ni en recettes, ni en dépenses, n'est en tout état de cause mobilisé sur ce PLFSS, si ce n'est la limitation de la durée de versement des indemnités journalières AT-MP.
La commission déplore le flou qui entoure les leviers que le Gouvernement entend actionner pour ramener la branche AT-MP à l'équilibre budgétaire, privant les parlementaires de se prononcer en connaissance de cause sur l'objectif de dépenses de la branche. Elle appelle donc le Gouvernement à énoncer clairement et sans délai ses intentions quant aux mesures de redressement financier de la branche AT-MP.
S'il est certain que la mise en oeuvre de telles mesures est nécessaire afin de ramener la branche à l'équilibre, la commission ne saurait pour autant donner carte blanche au Gouvernement pour en définir les modalités. Attachée au paritarisme, la commission estime notamment indispensable que les partenaires sociaux soient amenés à négocier pour décider par eux-mêmes des évolutions à mettre en oeuvre pour retrouver l'équilibre budgétaire.
En dépenses, la commission appelle le Gouvernement à accélérer les efforts réalisés par la branche en matière de prévention des risques professionnels : il s'agit là du principal levier pour faire reculer la sinistralité et générer, à terme, des économies.
En recettes, la précision, au sein de l'annexe 3 au PLFSS pour 2026, que la branche AT-MP pourrait bénéficier d'une « mesure d'amélioration de ses recettes de 0,4 Md€ » a de quoi inquiéter sur le risque d'une augmentation des cotisations applicables aux employeurs.
En tout état de cause, la commission s'opposerait frontalement à toute mesure d'augmentation uniforme des cotisations, par voie réglementaire. Outre que la France dispose déjà d'un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés au monde, il apparaît en effet tout à fait injustifié de faire peser sur les employeurs le retour à l'équilibre de la branche AT-MP, alors même que la situation déficitaire est au premier chef causée par des transferts et non par la sinistralité.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 52
Objectif de dépenses de la branche vieillesse
Cet article tend à fixer l'objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 à 307,5 milliards d'euros.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Un objectif de dépenses de 307,5 milliards d'euros en 2025
Le présent article, disposition obligatoire des LFSS de l'année, fixe l'objectif de dépenses de la branche vieillesse à 307,5 milliards d'euros en 20251340(*), ce qui représenterait une augmentation de 1,1 % par rapport à l'objectif de dépenses de la LFSS pour 2025, qui était de 304,1 milliards d'euros après prise en compte de la revalorisation des pensions sur l'inflation de 2,2 % au 1er janvier 20251341(*).
Le déficit de la branche vieillesse s'est aggravé entre l'année 2024, où il a été de 5,6 milliards d'euros, et l'année 2025, où il serait de 6,3 milliards d'euros. Il convient de rappeler qu'il était en 2023 de 2,6 milliards d'euros.
Cette augmentation progressive s'explique par plusieurs facteurs qui sont :
- l'évolution tendancielle de hausse des dépenses liées aux pensions de retraites s'explique par la hausse des effectifs de retraités, en raison du départ à la retraite des générations du baby-boom et de l'allongement de la durée d'espérance de vie, ainsi que par l'augmentation de la pension moyenne des retraités liée à l'amélioration des carrières et de leur durée, et au fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses à liquider des pensions de retraite de droit direct ;
- l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation moyenne des douze derniers mois1342(*), qui est fixée depuis 2019 au 1er janvier de chaque année. Les dépenses de pensions de retraite ralentissent néanmoins spontanément en 2025, en raison d'une moindre revalorisation sur l'inflation (+ 2,2 % au 1er janvier 2025 contre + 5,3 % au 1er janvier 2024).
Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025, en 2025, les prestations de retraite servies par les régimes de base ralentiraient (+ 3,4 % contre + 6,8 % en 2024) en raison de la baisse de l'inflation, et ce alors même que les effectifs de pensionnés progresseraient de 1 % entre 2024 et 2025. Si la montée en charge de la réforme des retraites ralentit temporairement le flux des nouvelles liquidations, les départs en retraite anticipée au titre des carrières longues ont temporairement bénéficié des assouplissements issus de la réforme de 20231343(*) et ont connu une nette augmentation en 2024.
Cette augmentation a toutefois vocation à ralentir selon les prévisions, sous le double effet de l'augmentation de la durée d'assurance requise telle qu'issue de la réforme de 2023, et d'une entrée plus tardive des nouvelles générations sur le marché du travail.
Évolution des départs en retraite anticipée pour carrière longue
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025
Par ailleurs, le transfert des missions et du financement du Fonds de solidarité vieillesse à compter du 1er janvier 20261344(*) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) augmentera en 2026 ses charges de 1,5 milliard d'euros et ses recettes1345(*) de 22,8 milliards d'euros. À périmètre constant, les transferts à la charge de la Cnav progresseraient de 2,8 %.
Par rapport à l'année 2024, la hausse des recettes de la branche vieillesse (+ 3,05 %) ne permet toutefois pas de compenser la hausse des dépenses (+ 3,3 %). Cette dernière s'explique notamment par la prise en charge par la Cnav à compter de 20251346(*) des nouveaux transferts d'équilibrage de régimes spéciaux qui ont été fermés par la réforme des retraites de 2023, ce qui représente 5,4 milliards d'euros de charges au titre de l'année 2025. La Cnav devrait recevoir une dotation budgétaire de l'État de 5,2 milliards d'euros pour couvrir ces nouvelles dépenses1347(*).
B. Les projections du solde de la branche vieillesse du PLFSS sont en amélioration par rapport aux projections passées, mais reposent sur des hypothèses incertaines
1. Les projections du déficit de la branche vieillesse sont moins défavorables que par le passé, malgré une dégradation continue du ratio démographique
Le graphique ci-après compare l'évolution du solde de la branche vieillesse depuis 2018 et les prévisions à moyen terme issues des LFSS de 2023 à 2025 et du présent PLFSS pour 2026.
Les projections de la LFSS pour 2024 correspondaient à une dégradation rapide du déficit, qui devait atteindre 13,6 milliards d'euros en 2027. La LFSS pour 2025 a redressé la trajectoire prévisionnelle en intégrant le relèvement en 2025, 2026 et 2027 du taux de cotisation des employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents de la fonction publique hospitalière (CNRACL) à hauteur de 4 points par an, soit 12 points au total1348(*).
En l'absence de mesure, le déficit cumulé de la CNRACL était projeté à 38 milliards d'euros en 2028, et aurait représenté les trois quarts du déficit de la branche vieillesse en 20271349(*).
La situation de la CNRACL reste toutefois préoccupante en raison de la dégradation de son ratio démographique, qui était de 1,4 en 2023, et devrait être de 1,2 en 2028 puis se stabiliser à 0,8 en 2040, ainsi que du poids financier de sa dette.
Comme le relève la Cour des comptes dans son rapport sur le financement du système de retraite de février 2025, la dégradation projetée du déficit de retraite autour de 6 à 7 milliards d'euros en 2030 est principalement imputable au régime général, qui représente 42 % des pensions versées, ainsi qu'à la CNRACL, qui représente 8 % des cotisants en 2022.
Prévision de solde de branche vieillesse
par la LFRSS 2023,
la LFSS 2024, la LFSS 2025 et le
présent PLFSS
(en milliards d'euros)
Ces chiffres intègrent le FSV jusqu'à son intégration à la Cnav au 1er janvier 2026.
Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après les LFSS 2023 à 2025 et le présent PLFSS
2. La réduction projetée du déficit repose sur des mesures attendues en 2025 ainsi que sur la compensation du décalage de la réforme des retraites de 2023
L'amélioration à moyen terme du solde de la branche vieillesse résulterait de quatre mesures portées par le présent PLFSS.
• La première, portée à l'article 44, consiste en le gel des prestations sociales et pensions de retraite de base sur l'inflation au titre de l'année 2026. Cet article prévoit également de minorer le coefficient de revalorisation sur l'inflation des seules pensions de retraite des régimes obligatoires de base de 0,9 point en 2027 et de 0,4 point pour chacune des années 2028 à 2030.
Selon l'évaluation préalable de l'article 44, cette mesure rapporterait 3,6 milliards d'euros en 2026, 6,5 milliards d'euros en 2027, 7,7 milliards d'euros en 2028 et 8,9 milliards d'euros en 2029.
La minoration applicable en 2027 était de seulement 0,4 point dans le texte déposé le 14 octobre 2025. Elle a en effet été augmentée de 0,5 point par la lettre rectificative du 23 octobre 2025. Cette hausse doit susciter une économie de 1,5 milliard d'euros, destinée à financer le décalage de la montée en puissance de la réforme des retraites de 2023 par l'article 45 bis du PLFSS.
• La deuxième mesure, portée à l'article 45 bis, prévoit de décaler d'une génération la réforme des retraites de 2023.
Le coût en 2026, de 0,1 milliard d'euros, serait financé par une majoration à due concurrence de la contribution ponctuelle des organismes complémentaires prévue à l'article 7 du présent projet de loi. En effet, celle-ci a vu son montant porté de 1 milliard d'euros dans le texte déposé le 14 octobre 2025 à 1,1 milliard d'euros dans le texte résultant de la lettre rectificative du 23 octobre 2025.
Le coût à partir de 2027 serait financé par la majoration de 0,5 point (1,5 milliard d'euros) de la sous-indexation des prestations en 2027 par l'article 44 (cf. supra).
Sur le seul périmètre de la sécurité sociale, le décalage de la réforme des retraites engendrerait en 2026 une perte de recettes de 0,1 milliard d'euros. Le décalage de l'âge légal d'ouverture des droits entraînerait à partir de 2027 un surcroît de dépenses de 0,8 milliard d'euros.
Détail du coût du décalage de la réforme de 2023 portée à l'article 45 bis
(en milliards d'euros)
Source : Annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
La suspension de la réforme des retraites (par l'article 45 bis) et sa compensation par la majoration de la sous-indexation de la revalorisation des prestations en 2027 (par l'article 44) amélioreraient le solde de la branche vieillesse et de l'ensemble des régimes obligatoires de base de 0,3 milliard d'euros en 2027.
Détail de la compensation en 2027 du
décalage de la réforme de 2023
portée par
l'article 45 bis
(en milliards d'euros)
|
Décalage réforme des retraites 2023 |
Sous-indexation additionnelle |
Écart total |
|
|
Solde Robss |
- 0,8 |
1,1 |
0,3 |
|
Dépenses |
- 0,7 |
1,4 |
0,7 |
|
Recettes |
- 0,1 |
- 0,3 |
- 0,4 |
Lecture : un montant positif correspond à une amélioration du solde, un montant négatif à une dégradation du solde.
Source : Direction de la sécurité sociale
• La troisième mesure inclue dans les prévisions du PLFSS pour 2026 consiste en la réforme du dispositif du cumul emploi-retraite portée à l'article 43, dont le rendement est estimé à 0,2 milliard d'euros en 2027. La refonte de ce dispositif a pour objectif d'inciter les assurés à reporter leur départ en retraite, et à diminuer la masse de secondes pensions à verser dès lors en restreignant l'accès au cumul emploi-retraite intégrale créateur de droit à compter de 67 ans.
• La quatrième mesure est portée à l'article 45, qui prévoit de réduire les inégalités entre sexes en prenant en compte jusqu'à deux trimestres de majorations de durée d'assurance pour maternité et pour éducation de l'enfant comme des trimestres réputés cotisés au sein du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue, a un coût estimé à 0,2 milliard d'euros au titre de l'année 2027. Les prévisions incluent également la mesure d'ordre réglementaire annoncée aux termes de l'article 45, qui consiste à réduire le nombre d'années retenues dans le calcul du salaire annuel moyen qui sert de base aux calculs des pensions pour les parents bénéficiant de majorations de durée d'assurance pour enfant, et qui entraînera un surcroît de dépenses de 0,1 milliard d'euros par an à compter de 2028.
Enfin, les prévisions prennent en considération le relèvement progressif jusqu'en 2027 du taux de contribution des employeurs à la CNRACL, comme il a été exposé ci-avant.
L'augmentation des dépenses de retraite est appelée à se poursuivre en raison du vieillissement de la population. Selon les estimations du Conseil d'orientation des retraites (COR) dans son rapport de juin 2025, elles continueraient de progresser, passant - régimes complémentaires compris - de 13,9 % du PIB en 2024 à 14,1 % en 2045 et 14,2 % en 2070. Parallèlement, les ressources du système de retraite, qui étaient de 13, 9 % du PIB en 2024, continueraient de baisser pour s'établir à 13,3 % en 2045 et 12,8 % en 2070.
Comme l'a indiqué Renaud Villard, directeur de la Cnav, lors de son audition par la commission des affaires sociales le 29 octobre 2025, la dégradation du ratio démographique se matérialise très clairement par le fait que le nombre de cotisants continue de croître mais à un rythme moindre que l'augmentation du nombre de retraités. Le plafond de 24 millions de cotisants sera atteint avant 2030, et ce alors que le nombre de retraités, qui était en 2023 de 14,6 millions1350(*), continuera à augmenter.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission prend acte des prévisions de dépenses de la branche vieillesse pour l'exercice 2026. Elle accueille favorablement les projections moins défavorables que les années passées de son déficit à moyen terme.
Le présent article devra également être ajusté, afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 44 qui a été supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture et rétabli par un amendement n° 715 de la commission, pour un rendement désormais estimé à 1,9 milliard d'euros au titre de l'année 2026.
La commission a également adopté un amendement n° 716 supprimant l'article 45 bis portant la mesure de suspension de la réforme des retraites.
Ces différents ajustements pourront être réalisés dans la suite de la navette.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article
53
Objectif de dépenses de la branche famille
Cet article propose de fixer l'objectif de dépenses de la branche famille à 59,4 milliards d'euros pour l'année 2026.
La commission propose d'adopter cet article sans modification, malgré notamment la faible ambition du congé de naissance et le transfert de 1,4 milliard d'euros à la branche maladie.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. En 2025, l'excédent de la branche famille s'établirait à 0,8 milliard d'euros, soit en diminution de 0,3 milliard d'euros par rapport au solde de l'année 2024
1. Le solde, les charges et les produits
En 2025, le solde de la branche famille s'établirait à 0,8 milliard d'euros, soit en diminution de 0,3 milliard d'euros par rapport au solde de l'année 2024, établie à 1,1 milliard d'euros. Ce solde est en revanche supérieur de 0,4 milliard d'euros par rapport aux prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Évolution des dépenses et des recettes de la branche famille pour 2025
(en milliards d'euros)
|
Dépenses |
Recettes |
Solde |
|
|
LFSS pour 2024 |
60,0 |
60,4 |
0,4 |
|
LFSS pour 2025 |
59,5 |
59,9 |
0,4 |
|
PLFSS pour 2026 |
59,3 |
60,2 |
0,8 |
Source : Commission des affaires sociales, d'après les textes indiqués
En 2025, les charges nettes seraient de 59,3 milliards d'euros, en augmentation de 2,6 % par rapport à 2024, contre une augmentation de 3,8 % entre 2023 et 20241351(*). Les prestations sociales nettes1352(*) s'établiraient à 41,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2024, alors que l'augmentation entre 2023 et 2024 était de 4,5 %. Parmi ces dernières, les prestations légales se chiffreraient à 34,3 milliards d'euros, en augmentation de 1,4 %.
Cette progression s'explique principalement par la revalorisation des prestations en 2025 de 2,4 % en moyenne annuelle, inférieure à celle intervenue en 2024, à hauteur de 3,9 %. Cet effet est partiellement compensé par le nouveau recul de la natalité, estimé à environ 2,8 % en 2025. Les prestations extralégales, quant à elles, sont estimées à 7,6 milliards d'euros, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2024, sous l'effet de la montée en charge des investissements en faveur du service public de la petite enfance1353(*).
Les produits nets de la branche seraient de 60,2 milliards d'euros, en croissance de 2,1 % par rapport à 2024, soit à un rythme moins élevé qu'entre 2023 et 2024. Entre 2024 et 2025, l'augmentation des recettes issues des cotisations demeurerait soutenue, à hauteur de 4,1 %, contre 4,4 % entre 2024 et 2023, grâce à la dynamique des cotisations du secteur privé, tirée par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 20241354(*) et par celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 20251355(*).
L'augmentation des recettes issues des cotisations du secteur privé est légèrement moins importante que celle survenue entre 2023 et 2024, à hauteur de 4,1 % en 2025 contre 4,4 % en 2024. Les recettes issues de la contribution sociale généralisée affectées à la branche famille sont estimées à 14,7 milliards d'euros en 2025, contre 14,3 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 2,2 %, mais qui demeure moins importante que celle observée entre 2023 et 2024, à hauteur de 3,5 %1356(*). Cette baisse s'explique principalement par la réduction de la quote-part de taxe sur les salaires affectée à la branche afin de la rétrocéder à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
2. La décomposition par prestation
Les prestations d'entretien progresseraient de 1,9 % en 2025, après une hausse de 3,8 % en 2024. L'allocation de soutien familial connaîtrait une forte croissance de 5,3 % en 2025, soutenue par la généralisation de l'intermédiation des pensions alimentaires qui en accroît durablement le recours. À l'inverse, les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire suivraient une évolution plus modérée en 2025, demeurant proche de la progression globale des prestations d'entretien1357(*).
Les dépenses consacrées à la petite enfance ralentiraient en 2025 avec une progression de 1,6 %, après 1,7 % en 2024. Le recul accentué des allocations versées au titre du congé parental depuis 2024, ainsi que la diminution des dépenses liées à la naissance et à l'adoption, reflet de la baisse de la natalité, sont deux éléments explicatifs de cette trajectoire. En contrepartie, la hausse des dépenses associées au complément de libre choix, estimé à 4,1 %, viendrait compenser cet effet. Cette progression est amplifiée par la disposition introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et mise en oeuvre à compter de septembre 2025, qui modifie le mode de calcul du complément de mode de garde et l'étend aux enfants de 6 à 12 ans dans les familles monoparentales1358(*).
Décomposition de la croissance des prestations légales
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
Après deux années de forte croissance de 19,8 % en 2023 et 16,9 % en 2024, l'augmentation des dépenses associées aux autres prestations légales de la branche famille se limiterait à 3,5 % en 2025. Cette évolution serait principalement tirée par l'allocation journalière de présence parentale qui progresserait de 12,4 %, tandis que l'érosion des autres postes de dépenses exercerait un effet modérateur sur la croissance globale de ces prestations1359(*).
Hors prestations légales, les prestations extralégales connaîtraient une croissance toujours soutenue de 5,6 % en 2025. Les majorations de pensions de retraite pour enfants à charge, deuxième poste de dépenses, connaîtraient une croissance modérée de 2,0 %, reflétant la revalorisation légale des pensions. Les indemnités journalières de maternité et de paternité accéléreraient sous l'effet d'une croissance plus dynamique du salaire moyen1360(*).
Projection des principales prestations familiales en 2025
(en milliards d'euros)
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
B. L'exercice 2026 présenterait des comptes en excédent de 0,7 milliard d'euros, sous l'effet de la natalité et malgré les nouvelles mesures en dépenses ainsi que les transferts financiers internes à la sécurité sociale
Pour 2026, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit un solde excédentaire de 0,7 milliard d'euros pour la branche famille, en baisse de 0,1 milliard par rapport à 2025 et de 0,7 milliard par rapport au solde tendanciel1361(*).
1. Les charges
Les charges nettes sont estimées à 59,4 milliards d'euros, soit en hausse de 0,1 % par rapport à 2025. Cette croissance serait principalement portée par les prestations extralégales, qui augmenteraient de 5,6 %, reflétant la poursuite de l'investissement public dans le service public de la petite enfance. Les prestations légales connaîtraient une augmentation modérée de 1,2 %. Cette évolution s'expliquerait d'abord par un tassement des revalorisations légales, qui s'établissent à 1,1 % en moyenne annuelle contre 2,4 % en 2025. Les autres composantes du dynamisme des prestations légales, à savoir les mesures nouvelles, l'effet plafond et l'effet démographique, se compenseraient globalement et auraient une contribution nette quasi nulle, estimée à 0,1 point1362(*).
Les mesures en dépenses du présent projet de loi permettraient une réduction des dépenses de 0,9 milliard d'euros. Parmi ces mesures, le gel de la revalorisation des prestations contribuerait à une économie de 0,3 milliard d'euros. Le ralentissement de la croissance du fonds national d'action sociale génèrerait une économie de 0,4 milliard d'euros. Le décalage de quatre ans de la majoration pour âge des allocations familiales, prévu par décret, permettrait une économie supplémentaire de 0,2 milliard d'euros1363(*).
La faible natalité observée depuis 2022 constituerait un facteur modérateur important des dépenses. Malgré une légère reprise de la natalité prévue en 2026, avec une hausse de 0,4 %, consécutive à la baisse de 2,8 % en 2025, le nombre de naissances demeurerait à un niveau particulièrement bas. Il s'établirait à 647 000 en 2026 contre 644 400 en 2025 et 742 100 en 2021. Cette situation se traduirait par un effet baissier de 0,9 point sur les dépenses1364(*).
2. Les produits
Les produits nets s'établiraient à 60,1 milliards d'euros. Ce niveau s'expliquerait principalement dans l'augmentation des recettes issues des cotisations sociales, en croissance de 3,1 % par rapport à 2025. Les cotisations du secteur privé augmenteraient de 3,3 %, un niveau sensiblement supérieur à celui de la masse salariale déplafonnée qui ne croîtrait que de 2,3 %. Cet écart s'expliquerait par une stabilisation des allégements généraux, avec une baisse attendue de 0,2 % au titre de la réduction générale dégressive unique1365(*).
Les impôts, taxes et autres contributions seraient particulièrement dynamiques, avec une progression de 6,2 % avant nouvelles réaffectations de recettes. Cette hausse proviendrait principalement du dynamisme de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, qui augmenterait de 13,5 %, sous l'effet de la forte progression de la base taxable liée à l'augmentation des primes d'assurance automobile et habitation. Les taxes sur les émissions de CO2 et autres polluants progresseraient également fortement, à hauteur de 11 %, en lien avec le relèvement des barèmes de taxation et la suppression progressive des exonérations accordées aux véhicules hybrides1366(*).
Le gel des seuils de revenu pour la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) par l'article 6 du présent PLFSS, dans sa version initiale, engendrerait une augmentation des recettes de 0,1 milliard d'euros1367(*).
Les cotisations des travailleurs indépendants enregistreraient une croissance très dynamique de 8,4 %. Cette évolution doit toutefois être mise en regard de la forte baisse des recettes de la contribution sociale généralisée assises sur leurs revenus, qui chuteraient de 34,3 %, expliquant à elle seule le repli de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité. Ces mouvements contraires résulteraient de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026, avec une régularisation au titre de l'exercice 2025, de la réforme de l'assiette des travailleurs non-salariés1368(*).
Cette réforme se traduirait par une baisse des taux de CSG compensée, intégralement si l'on considère le champ incluant les régimes complémentaires, partiellement si l'on considère uniquement les régimes de base, par une hausse des taux de cotisations. Pour la Caisse nationale des allocations familiales, cette réforme engendrerait sur une année complète une hausse de cotisations de 100 millions d'euros et une baisse de la contribution sociale généralisée de 300 millions d'euros1369(*).
Enfin, les transferts internes à la sécurité sociale affecteraient significativement le solde de la branche famille, avec une rétrocession s'élevant à près de 4,3 milliards d'euros au titre de la réforme des allégements généraux, dont environ 0,3 milliard d'euros correspondant à une réduction nette, ainsi que par la réaffectation de 1,4 milliard d'euros de CSG à la Caisse nationale de l'assurance maladie1370(*) (Cnam).
Les conséquences de la réforme des
allégements généraux
pour la branche
famille
Comme indiqué supra (cf. commentaire de l'article 12), en l'absence de compensation, la suppression des bandeaux famille et maladie résultant à compter du 1er janvier 2026 de la réforme des allégements généraux par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 entraînerait d'importantes redistributions entre administrations de sécurité sociale1371(*) et entre branches. Le projet de loi de finances pour 2026 et le présent PLFSS proposent de neutraliser ces redistributions, par une réduction de la TVA affectée à la sécurité sociale (article 40 du projet de loi de finances) et par divers transferts entre branches (article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale). Dans le cas de la branche famille, l'augmentation des cotisations sociales résultant de la suppression du bandeau famille, de 3,9 milliards d'euros, serait neutralisée par la réduction de la part de diverses taxes affectées1372(*) dont bénéficie la branche.
L'article 40 du projet de loi de finances réalise également un transfert plus « politique » de 3 milliards d'euros de recettes de la sécurité sociale vers l'État, correspondant au gain estimé en 2026 pour la sécurité sociale de la réforme des allégements généraux de 2025 et de celle prévue pour 2026 (devant être réalisée par décret d'ici la fin 2026). La commission s'oppose à ce transfert (cf. supra commentaire de l'article 12). Dans le cas de la branche famille, cette moindre portion de la taxe sur la valeur ajoutée pour la sécurité sociale, concrètement, pour la branche maladie1373(*), se traduirait par une perte de recettes d'environ 0,3 milliard d'euros, correspondant à la réduction de la part de diverses taxes affectées1374(*) dont elle bénéficie.
Projection des principales prestations familiales
en 2026
hors mesures du présent projet de loi de financement de la
sécurité sociale
(en milliards d'euros)
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
Contribution des facteurs à l'évolution des charges et des produits nets de la branche famille de la sécurité sociale hors mesures du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale
(en points)
|
2024 |
2025 (p) |
2026 (p) |
|
|
Prestations légales nettes |
2,1 |
0,8 |
0,7 |
|
Prestations extralégales nettes |
1,0 |
0,9 |
0,7 |
|
Transferts versés nets |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
|
Cotisations sociales nettes |
2,5 |
2,2 |
2,1 |
|
Cotisations prises en charge par l'État |
- 0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Contribution sociale généralisée |
0,8 |
0,5 |
- 0,3 |
|
Autres impôts, taxes et contributions sociales |
0,4 |
- 0,2 |
0,6 |
|
Autres produits nets |
0,4 |
- 0,3 |
0,0 |
Source : Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, octobre 2025
Le présent texte prévoit pour la branche famille un solde positif de 1,9 milliard d'euros pour l'exercice 2027 puis un une augmentation graduelle de ce dernier, à respectivement 2,2 milliards d'euros en 2028 et 2,4 milliards d'euros en 20291375(*).
Projection de l'équilibre financier de la branche famille de la sécurité sociale
(en milliards d'euros)
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Recettes |
60,1 |
61,8 |
62,9 |
64,1 |
|
Dépenses |
59,4 |
59,9 |
60,7 |
61,6 |
|
Solde |
0,7 |
1,9 |
2,2 |
2,4 |
Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission considère que l'objectif de dépenses fixé pour l'année 2026 ne répond que partiellement aux besoins relatifs à l'investissement dans le service public de la petite enfance. En particulier, elle s'étonne de la mention, dans le tableau figurant page 12 de l'annexe 3 au projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'une ligne « Ralentissement du dynamisme du Fnas1376(*) » correspondant à une économie chiffrée à 0,4 milliard d'euros en 20261377(*).
Elle regrette également la faible ambition du congé supplémentaire de naissance, à l'article 42 du présent projet de loi, qui ne prévoit qu'une courte et partielle indemnisation des parents, au lieu d'engager la refonte tant attendue du congé parental.
La commission regrette vivement que la réforme des allégements généraux ne bénéficie pas aux comptes de la branche famille en raison de l'article 40 du projet de loi de finances pour 2026. Comme indiqué supra, dans le cas de la branche famille, cela correspond à une réduction de recettes d'environ 0,3 milliard d'euros.
De surcroît, la commission constate que les transferts vers la Cnam se poursuivent avec la réaffectation, pour 1,4 milliard d'euros, d'une part de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus de remplacement, à l'article 12 du présent projet de loi, puis vers la branche autonomie à compter de 2027. Si ces réaffectations sont compréhensibles au regard de la solidarité entre les branches, la commission réaffirme la nécessité pour la branche famille de conserver des marges de manoeuvre financière afin de réformer le congé parental ou pour lutter contre la pauvreté des familles à travers son fonds national d'action sociale.
La commission prend acte des prévisions actant l'excédent croissant du solde de la branche famille à compter de 2026 et souhaite que cette situation se traduise par la mise en place de politiques publiques familiales ambitieuses. En effet, le recul de la natalité et la crise de pouvoir d'achat rencontrées par les familles les plus fragiles appellent à de vigoureuses décisions pour garantir aux familles un avenir qui puisse leur être source d'épanouissement.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 54
Objectif de dépenses de la branche
autonomie
Cet article fixe à 43,5 milliards d'euros l'objectif de la branche autonomie de la sécurité sociale pour 2026.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Le périmètre de la branche autonomie intègre des dépenses en croissance continue depuis 2021
1. La structure financière de la branche autonomie
a) Le périmètre d'intervention de la branche autonomie
En 2024, les financements publics dédiés à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap atteignent respectivement 31,1 et 64,5 milliards d'euros, soit, au total, 95,6 milliards d'euros.
La branche autonomie de la sécurité sociale, dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) assure la gestion financière1378(*), contribue à hauteur de 41 % à ces financements.
Le reste est pris en charge par l'État (24 %), d'autres branches de la sécurité sociale - principalement la branche maladie (21 %), les départements (13 %) ainsi que l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (1 %)1379(*).
Le périmètre de la branche autonomie comprend tout d'abord le financement des établissements et services médico-sociaux (ESMS), au travers de l'objectif global de dépenses (OGD) fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale1380(*) et de la contribution aux revalorisations salariales.
Il intègre également le financement de prestations individuelles, de manière directe pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation journalière du proche aidant (AJPA), l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et l'assurance vieillesse des aidants (AVA) ; de manière indirecte, via le versement de concours aux départements, pour l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ; et, enfin, via le financement de mesures destinées à renforcer les services d'aide à domicile (mise en oeuvre d'un tarif plancher, d'une dotation « qualité » et d'un fonds mobilité).
Divers financements sont par ailleurs regroupés dans le « budget d'intervention » de la CNSA tels que le concours aux dépenses des départements en matière de prévention de la perte d'autonomie, le soutien à la coordination des dispositifs ou encore la promotion de la qualité de l'offre. Des dépenses d'investissement sont, enfin, déployées en faveur des ESMS.
b) Les relations financières entre la CNSA et les départements
La politique de l'autonomie est en partie décentralisée, les départements disposant d'une large compétence au titre de leur chef-de-filât dans le champ de l'action sociale.
Afin de couvrir une partie des dépenses qu'ils allouent à l'autonomie, la CNSA verse des concours financiers aux départements. Ils se sont multipliés et diversifiés au gré des réformes, et leur montant total est passé de 3,4 milliards d'euros en 2021 à près de 5,9 milliards d'euros en 20251381(*). Les principaux concours visent à couvrir une partie des dépenses supportées par les départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), deux prestations particulièrement dynamiques.
Répartition des financements alloués
par la CNSA aux départements
pour l'année
2025 (prévisionnel)
Source : CNSA (2025)
La multiplication des concours nuisant à la clarté des relations financières entre la CNSA et les départements, et ces derniers revendiquant davantage de sécurité, sur le long terme, quant au soutien financier de la CNSA face au dynamisme des dépenses d'Apa et de PCH, une réforme des concours a été amorcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 20251382(*). Elle a permis de réduire le nombre de concours, par la fusion d'un certain nombre d'entre eux, et de garantir un taux de couverture minimal des dépenses d'Apa et de PCH des départements.
La réforme des concours de la CNSA aux départements
L'article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a opéré une simplification des concours de la CNSA aux départements :
- d'une part, il fusionne cinq concours (Apa 1, Apa 2, PCH, compensation du tarif plancher et compensation « avenant 43 BAB ») en deux concours globaux consacrés pour l'un aux personnes âgées et pour l'autre aux personnes handicapées, permettant de regrouper les flux dans une logique de pilotage par public cible et de réduire la complexité comptable interne pour la CNSA et les départements ;
- d'autre part, pour un coût estimé à 200 millions d'euros en 2025, il modifie les modalités de calcul de ces nouveaux concours afin de garantir, pour l'Apa et la PCH, un taux de couverture des dépenses au moins égal à celui enregistré au titre de l'année 2024.
2. La progression des dépenses de la branche autonomie
Depuis sa création, les dépenses de la branche autonomie ont connu une forte augmentation, passant de 32,6 milliards d'euros en 2021 à 42,4 milliards d'euros en 2025 soit une hausse de 30,1 %.
Progression des dépenses de la branche autonomie
(en milliards d'euros)
Source : Commission des affaires sociales
Si cette progression s'explique en partie par le dynamisme des prestations financées (notamment l'AAH) et co-financées (l'Apa et la PCH) par la CNSA, elle résulte principalement des mesures nouvelles qui ont été adoptées, depuis 2020, en faveur de l'attractivité des métiers et de l'adaptation de l'offre médico-sociale aux besoins. En effet, entre 2020 et 2025, les dépenses de la branche autonomie ont augmenté de 9,8 milliards d'euros dont 7,6 milliards d'euros sous l'effet des mesures nouvelles.
Effet en 2025 des mesures nouvelles
financées
par la branche autonomie depuis 2020
(en milliards d'euros)
Source : Annexe 7 du PLFSS pour 2026, d'après les données de la DSS
B. Le solde de la branche autonomie s'éloigne de plus en plus de l'équilibre budgétaire
1. En 2024, la branche autonomie était légèrement excédentaire
En 2024, la branche autonomie a enregistré un excédent de 1,3 milliard d'euros.
a) Évolution des dépenses en 2024
Les dépenses de la CNSA ont atteint 39,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à 2023.
Elles ont principalement été tirées à la hausse par la progression des prestations sociales (+ 4,5 %), à l'image des prestations financées par l'objectif global de dépenses (OGD) (+ 4,3 %), notamment sous l'effet des mesures de la LFSS pour 2024 estimées à 0,9 milliard d'euros1383(*).
Les transferts opérés par la CNSA ont également été très dynamiques (+ 15 %), portés par les concours versés aux départements (+ 11 %). Cette hausse s'explique principalement par les mesures nouvelles en faveur des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) (montée en charge des concours au titre du tarif plancher, de la dotation qualité et des « heures de convivialité ») ainsi que par le concours exceptionnel aux départements de 150 millions d'euros décidé en LFSS pour 2024.
Par ailleurs, les dépenses relatives à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et l'assurance vieillesse des aidants (AVA) ont triplé du fait de l'entrée en vigueur, en 2024, des mesures votées en loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 20231384(*) ; et les dépenses d'AEEH ont connu une croissance soutenue.
b) Évolution des recettes en 2024
Les recettes de la CNSA se sont quant à elles établies à 41,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 11,4 % par rapport à 2023.
Cette hausse conséquente provient de l'affectation, à partir de 2024, de l'affectation de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) supplémentaire à la CNSA1385(*). Elle s'est traduite par un apport de recettes de 2,6 milliards d'euros, expliquant le retour de la CNSA à un solde excédentaire.
En dehors de cette ressource nouvelle, les recettes affectées à la CNSA ont augmenté de 4,3 %, notamment grâce au dynamisme de la contribution de solidarité autonomie (CSA) (+ 4,2 %), la masse salariale qui en constitue l'assiette ayant été dynamique, et à la croissance de la taxe sur les salaires (+ 15 %), en lien avec la hausse de la quote-part de la branche qui permet de compenser la charge nouvelle d'AVPF et la création de l'AVA.
La contribution annuelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) a aussi été dynamique (+ 4,5 %), sous l'effet de la revalorisation en 2024 des prestations de retraite, qui en constituent la principale assiette.
2. En 2025, la branche autonomie retrouve une situation déficitaire
Selon les prévisions du dernier rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale1386(*), la CNSA devrait à nouveau être déficitaire en 2025, avec un solde négatif de 0,3 milliard d'euros.
a) Évolution des dépenses en 2025
Les dépenses de la CNSA devraient rester dynamiques et s'élever à 42 milliards d'euros, soit une progression de 6,1 % par rapport à 2024.
Comme les années précédentes, ce dynamisme résulte de la progression des dépenses relevant de l'OGD (+ 5,6 %), cette fois-ci sous l'effet des mesures de la LFSS pour 2025 (expérimentation de la fusion des sections de financement « soins » et « dépendance » des Ehpad dans vingt-trois départements1387(*), dont le coût est estimé à 0,3 milliard d'euros en 2025 ; et soutien exceptionnel de 0,3 milliard d'euros aux Ehpad en difficulté1388(*)).
En outre, les dépenses de prestation d'AEEH restent dynamiques (+ 3,8 %), de même que les dépenses d'AVPF et d'AVA (+ 3,4 %).
Les transferts aux départements continuent de progresser (+ 10,3 %), principalement via la hausse des financements aux SAAD (+ 34 %) en lien avec la montée en charge de mesures votées dans les précédentes LFSS (dotation qualité, indemnités kilométriques) ; et sous l'effet de la réforme des concours de la CNSA aux départements, votée en LFSS pour 2025 et dont le coût est estimé à 0,2 milliard d'euros1389(*).
Enfin, les subventions d'investissement (0,3 milliard d'euros) connaissent un repli important (-26 %) en raison notamment de la diminution progressive des dotations liées au Ségur de la santé.
b) Évolution des recettes en 2025
Toujours selon les prévisions du rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, les recettes de la CNSA atteindraient 41,7 milliards d'euros, soit une hausse de 1,3 % par rapport à 2024.
Ce faible dynamisme s'explique principalement par une progression mesurée de la masse salariale du secteur public, qui constitue une partie de l'assiette de la CSG et de la CSA.
Les recettes seraient toutefois portées par l'affectation d'une partie de la taxe sur les contrats d'assurance automobile (TSCA), pour un montant estimé à 0,1 milliard d'euros au détriment des départements, afin de lui compenser partiellement la charge supplémentaire liée à la fusion des sections de financement « soins » et « dépendance » des Ehpad dans les départements expérimentateurs.
Enfin, les dotations affectées à la CNSA au titre du financement du soutien à l'investissement en ESMS se tarit : celui-ci ne couvre plus que les montants restants liés au Ségur de la santé, soit 54 millions d'euros en 2025, ce qui représente un recul de 0,3 milliard d'euros par rapport à 2024.
Résultats de la branche autonomie en 2025 (p)
(en milliards d'euros)
|
Dépenses |
42 |
|
OGD personnes âgées et OGD personnes handicapées |
33 |
|
AEEH |
1,7 |
|
Concours versés aux départements |
6 |
|
Subventions d'investissement |
0,3 |
|
Autres subventions |
0,2 |
|
Participation aux dépenses du FIR |
0,2 |
|
AVPF/AVA |
0,4 |
|
Charges de gestion courante |
0,2 |
|
Recettes |
41,7 |
|
CSG |
37,3 |
|
CSA |
2,5 |
|
CASA |
0,9 |
|
Taxe sur les salaires |
0,9 |
|
Taxe sur les conventions d'assurance automobile (TSCA) |
0,1 |
|
Solde |
- 0,3 |
Source : Rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale (octobre 2025)
3. À partir de 2026, la branche autonomie deviendrait durablement déficitaire
Les prévisions fournies par le présent PLFSS font état d'une dégradation durable du solde. Le déficit serait de 1,7 milliard d'euros dès 2026, et se stabiliserait à ce niveau jusqu'en 2029.
Comme exposé dans le tableau ci-après, les prévisions contrastent nettement avec celles fournies en LFSS pour 2025, qui étaient bien plus pessimistes avec un déficit estimé à 2,8 milliards d'euros à horizon 2028.
L'amélioration des prévisions provient principalement des dépenses, qui seraient moins élevées qu'escompté. D'après les informations fournies au rapporteur par la CNSA, la principale source d'amélioration est le niveau des dépenses soumises à l'OGD : celui-ci a été réduit de 0,3 milliard d'euros en ajustement de la prévision de dépenses 2025, et une révision supplémentaire de - 0,5 milliard d'euros est appliquée sur l'année 2026 (soit au total une diminution de 0,8 milliard d'euros des prévisions de dépenses par rapport à celles inscrites en LFSS pour 2025), en lien avec le ralentissement de l'Ondam1390(*). Cette amélioration du solde de 0,8 milliard d'euros se décline ensuite sur les années suivantes.
Prévisions pluriannuelles des comptes de la branche autonomie
(en milliards d'euros)
|
2025 (p) |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
|||||
|
LFSS 2025 |
PLFSS 2026 |
LFSS 2025 |
PLFSS 2026 |
LFSS 2025 |
PLFSS 2026 |
LFSS 2025 |
PLFSS 2026 |
PLFSS 2026 |
|
|
Recettes |
41,9 |
41,7 |
42,1 |
41,8 |
43,9 |
43,5 |
45,2 |
45,3 |
47,2 |
|
Dépenses |
42,6 |
42 |
44,3 |
43,5 |
46 |
45,2 |
47,9 |
47 |
48,8 |
|
Solde |
- 0,7 |
- 0,3 |
- 2,2 |
- 1,7 |
- 2,1 |
- 1,7 |
- 2,8 |
- 1,7 |
- 1,7 |
|
Amélioration des prévisions |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,9 |
|||||
Source : LFSS 2025 et PLFSS 2026
Malgré des prévisions moins pessimistes, le constat dressé depuis plusieurs années demeure : la branche autonomie devra impérativement voir ses ressources augmenter pour disposer de moyens à la hauteur des besoins liés au vieillissement de la population et des ambitions en matière de transformation de l'offre médico-sociale.
Dans le champ du grand âge, la hausse des besoins est principalement liée à des déterminants démographiques. Le vieillissement de la population, qui résulte à la fois de l'arrivée des générations du « baby-boom » à des âges élevés et de l'amélioration de l'espérance de vie, se traduit par une hausse importante du nombre de personnes en risque de perte d'autonomie. Pour les seules dépenses relatives à l'Apa, qui s'élèvent à 6,8 milliards d'euros en 2023, une progression de 80 % à 100 % devrait intervenir à horizon 2040 en lien avec le nombre de bénéficiaires (+ 460 000)1391(*).
Dans le champ du handicap, également, les besoins de financement iront croissant. La reconnaissance des handicaps et les réponses médicosociales apportées s'améliorent, notamment chez les enfants ; le nombre de bénéficiaires des prestations augmente grâce à l'amélioration du taux de recours ; et le vieillissement des personnes handicapées induit automatiquement une augmentation des dépenses de prise en charge. Surtout, la transformation de l'offre médico-sociale amorcée, qui vise à « désinstitionnaliser » la prise en charge au profit d'un accompagnement modulaire et « sur-mesure » facilitant le maintien au domicile et en milieu ordinaire, devrait se traduire par des coûts supplémentaires.
Enfin, dans l'ensemble du secteur médico-social, l'enjeu de l'attractivité des métiers et des niveaux de rémunération reste d'actualité, malgré les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé.
Dans son dernier rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale1392(*), la Cour des comptes déplore que la branche ne dispose pas d'outils de projection et d'analyse approfondies des besoins de financement à long terme, et souligne que les trajectoires définies par le Gouvernement dans les derniers textes financiers reposent sur une hypothèse forte de virage domiciliaire. Elle remarque également que les besoins de financement à la croisée des champs du grand âge et du handicap, en lien avec le vieillissement des personnes handicapées, sont certainement sous-évalués.
C. Les enjeux de la branche autonomie en 2026
1. En 2026, la branche autonomie serait déficitaire
Le présent PLFSS anticipe un déficit de 1,7 milliard d'euros pour la branche autonomie en 2026. L'objectif de dépenses est fixé à 43,5 milliards d'euros (+ 3,5 % par rapport aux dépenses prévisionnelles de l'année 2025), ce qui constitue un ralentissement de la progression des dépenses, tandis que les recettes sont estimées à 41,8 milliards d'euros. Ces prévisions ne tiennent toutefois pas compte des éventuelles mesures nouvelles votées en LFSS pour 2026.
Selon les prévisions du rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, en 2026, l'évolution des dépenses serait de nouveau dynamique (+ 3,2 %) en lien avec la mise en oeuvre des mesures nouvelles votées dans les LFSS antérieures, alors que celle des recettes serait nulle.
Les recettes sont en revanche révisées à la baisse par rapport aux prévisions de la LFSS pour 2025, et plus particulièrement ceux de la CSG assise sur la masse salariale du secteur privé, qui pâtit d'un moindre dynamisme. Les recettes sont également réduites en conséquence de la réforme de l'assiette des travailleurs indépendants sur les prélèvements non contributifs qu'ils acquittent, dont la CSG affectée à la CNSA fait partie. À partir de 2027, la montée en charge de la rétrocession d'une fraction supplémentaire de CSG prélevée sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille devrait progressivement neutraliser les perspectives moins bonnes attendues sur les recettes.
2. L'objectif de dépenses reste en progression afin de financer la montée en charge des mesures récentes
L'objectif de dépenses de la branche autonomie, fixé à 43,5 milliards d'euros pour l'année 2026, progresse de 1,5 milliard d'euros : 1,2 milliard d'euros relèvent de l'objectif global de dépenses (OGD) et 0,3 milliard d'euros sont fléchés vers des dépenses hors OGD.
a) Les financements qui relèvent de l'objectif global de dépenses
L'objectif global de dépenses (OGD), qui correspond au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), s'élève à 34,2 milliards d'euros pour l'année 2026 (+ 2,4 % à champ constant par rapport à 2025) dont 18,2 milliards d'euros pour le sous-objectif personnes âgées (+ 2,4 %) et 16 milliards d'euros pour le sous-objectif personnes handicapées (+ 2,5 %).
Les dépenses soumises à l'OGD progressent donc de 1,2 milliard d'euros, principalement en lien avec les mesures détaillées dans le tableau ci-dessous.
Mesures financées par la hausse de l'OGD en 2026
(en milliards d'euros)
|
Mesure |
Montant |
|
Augmentation du financement des ESMS (prise en compte de l'inflation et de l'évolution de la masse salariale) |
0,30 |
|
Mesures nouvelles (secteur grand âge) |
0,55 |
|
Neutralisation, pour les établissements, du coût de la hausse de cotisations CNRACL |
0,10 |
|
Expérimentation de la fusion des sections de financement « soins » et « dépendance » |
0,11 |
|
Création de places en Ehpad |
0,07 |
|
Amélioration du taux d'encadrement en Ehpad (+ 4 500 ETP), évolution du calcul des besoins en soins (réforme de la coupe PATHOS) et création de places en SSIAD |
0,26 |
|
Stratégie nationale pour les maladies neurodégénératives (MND) |
0,09 |
|
Mesures nouvelles (secteur handicap) |
0,27 |
|
Neutralisation, pour les établissements, du coût de la hausse de cotisations CNRACL |
0,014 |
|
Création de nouvelles solutions médico-sociales |
0,25 |
Source : CNSA
Ces moyens supplémentaires doivent notamment permettre de financer l'accroissement de l'offre médico-sociale face aux besoins démographiques : création de places en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), création de nouvelles solutions médico-sociales à destination des personnes handicapées, et recrutements en Ehpad.
En dépit du ralentissement du déploiement des nouvelles solutions médico-sociales et des recrutements en Ehpad, au regard du contexte budgétaire très contraint et de l'évolution globale de l'Ondam fixé à 2 %, la hausse des moyens alloués à la branche autonomie représente un effort et permet de poursuivre le déploiement des mesures récentes.
b) Les financements hors du champ de l'OGD
Les dépenses hors du champ de l'OGD devraient atteindre 9,3 milliards d'euros, augmentant de 0,3 milliard d'euros (+ 3 % par rapport à 2025).
Les deux tiers de cette augmentation proviennent de la réforme des concours versés par la CNSA aux départements. Celle-ci garantit un certain taux de couverture des dépenses des départements au titre de l'Apa et de la PCH ce qui induit mécaniquement, du fait du dynamisme de ces prestations, une hausse des concours.
Le tiers restant de l'augmentation correspond au dynamisme des prestations qui évoluent avec l'inflation et le nombre de bénéficiaires, et de compléments de crédits en soutien à l'habitat inclusif (+ 100 millions d'euros, répartis entre 50 millions d'euros d'investissement dans l'habitat intermédiaire et 50 millions d'euros pour améliorer la prévention et la coordination des soins en résidence autonomie).
c) Les mesures d'efficience de la dépense
Outre l'article 38 du présent projet de loi relatif à la subsidiarité de l'Apa et de la PCH vis-à-vis des indemnités d'assurance, qui pourrait d'ici trois ans rapporter près de 10 millions d'euros annuels à la branche autonomie1393(*), le Gouvernement a annoncé que des mesures de maîtrise de la dépense d'Apa et de PCH seraient portées par voie réglementaire.
Au cours de son audition par la commission1394(*), la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées a précisé qu'une réflexion avait été lancée, en lien avec l'association Départements de France, afin d'identifier des « mesures de bonne gestion permettant de contenir des dépenses d'Apa et de PCH en croissance rapide », et que parmi les pistes évoquées, figuraient « l'harmonisation des taux de conjugalisation, ainsi qu'une meilleure prise en compte des ressources du foyer fiscal ». Aucun calendrier ni chiffrage précis de ces mesures n'a toutefois été annoncé.
D. Le dispositif proposé : la fixation de l'objectif de dépenses de la branche à 43,5 milliards d'euros pour 2026
Le présent article fixe, pour l'année 2026, à 43,5 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale.
II - Le dispositif transmis au Sénat : une transmission sans modification
L'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet article, le Gouvernement l'a transmis au Sénat dans sa version initiale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.
III - La position de la commission
La commission est consciente que la branche autonomie est relativement préservée malgré le contexte budgétaire très contraint de la sécurité sociale, et la progression de l'objectif de dépenses de la branche autonomie (+ 3,5 %) illustre que les efforts se poursuivent en faveur de la politique de l'autonomie.
Malgré ces efforts, la commission renouvelle le constat déjà dressé les années précédentes d'une couverture très insatisfaisante des besoins. Dans le champ du grand âge comme dans le champ du handicap, la trajectoire pluriannuelle de la branche autonomie proposée en annexe du présent projet de loi ne permettra pas de garantir un accompagnement adapté à chaque personne, de réussir le virage domiciliaire et d'améliorer durablement l'attractivité des métiers du secteur médico-social. La commission demande toujours, à cet égard, l'examen d'une grande loi cadre relative à l'autonomie permettant, d'une part, d'aborder la question du financement et d'autre part, de mieux structurer l'action de la branche autonomie sur le moyen et le long terme autour des principaux enjeux.
Il est par exemple impératif de développer de façon massive l'habitat intermédiaire au moyen d'une planification nationale, comme la CNSA l'a défendu devant la commission1395(*). Celle-ci a évalué un besoin de création de 500 000 places d'ici 2050, et juge que les 100 millions d'euros mobilisés pour l'année 2026 ne sont pas suffisants.
La commission est particulièrement inquiète concernant la situation financière des Ehpad, qui reste très dégradée à défaut d'une réforme structurelle du secteur, et souligne que ce PLFSS ne prévoit pas, contrairement aux trois années précédentes, de fonds d'urgence destiné à soutenir les établissements les plus en difficulté. Or, tant qu'il ne sera pas remédié aux causes profondes des problèmes financiers des Ehpad, les conditions de vie des résidents risquent de se détériorer et certaines structures pourraient s'effondrer.
Comme l'ont souligné les fédérations auditionnées par le rapporteur, la contrainte financière ne pèse pas seulement sur les Ehpad, mais également et de plus en plus sur les ESMS pour personnes handicapées, dans un contexte où les récentes revalorisations salariales et la hausse des cotisations à la CNRACL ne sont que partiellement compensées. La commission place à ce titre de l'espoir dans la mise en oeuvre progressive de la réforme dite « SERAFIN », prévue à l'article 36 du présent projet de loi1396(*), dont l'un des objectifs est de garantir une meilleure adéquation entre les financements alloués aux établissements et les besoins des personnes handicapées accompagnées.
La commission propose d'adopter cet article sans modification.
* 1284 Source : CNSA.
* 1285 Sénat, rapport d'information sur les organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale, Mmes Doineau et Le Houérou, juillet 2023.
* 1286 Éléments complémentaires adressés à la rapporteure.
* 1287 Igas, L'avenir de l'Agence nationale du développement professionnel continu, mars 2025.
* 1288 Ce qui explique la différence avec le montant de 7,1 milliards d'euros d'économies sur le champ de l'Ondam présenté à l'article 49.
* 1289 1 milliard d'euros pour le texte déposé le 14 octobre 2025, majoré de 0,1 milliard d'euros par la lettre rectificative du 23 octobre 2025 afin de financer en 2026 le décalage de la réforme des retraites de 2023.
* 1290 Article 12 du PLFSS.
* 1291 Cnam, Rapport Charges et produits pour 2026, juin 2025.
* 1292 Voir article 49.
* 1293 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 1294 Selon le III du projet d'annexe à la LFSS (qui n'a pas été actualisé par rapport à la prévision de déficit pour 2029 du texte déposé le 14 octobre, de 18,3 milliards d'euros).
* 1295 La base des dépenses pour l'Ondam 2025 s'obtient en intégrant aux réalisations estimées pour l'année en cours, soit 265,9 milliards d'euros, les effets de champ affectant le périmètre de l'Ondam ou celui de ses sous-objectifs en 2026. Au global, le niveau de l'Ondam est affecté de 330 millions d'euros par les mouvements de transfert et de périmètre.
* 1296 En effet, les mesures décidées antérieurement au PLFSS ont un effet majorant sur les dépenses nettes de 2026, à hauteur de 1,4 milliard d'euros : elles ont pour conséquence, d'une part, une augmentation des dépenses de 2,2 milliards d'euros en montant brut et, d'autre part, 0,8 milliard d'euros d'économies.
* 1297 Article 25.
* 1298 Article 24.
* 1299 Mesures réglementaires annoncées.
* 1300 Voir article 47 du PLFSS pour 2026.
* 1301 Voir article 48 du PLFSS pour 2026.
* 1302 Au sens de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 1303 Cour des comptes, La situation financière de la sécurité sociale. Une perspective de redressement fragile en 2026, une impasse de financement préoccupante, communication à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, novembre 2025.
* 1304 Audition du 29 octobre 2025.
* 1305 Cour des comptes, Note de synthèse sur l'Ondam. Maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, avril 2025.
* 1306 Cnam, Rapport annuel « Charges et produits pour 2025 », juin 2025.
* 1307 Élisabeth Doineau, Raymonde Poncet Monge, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, rapport d'information n° 901 (2024-2025), Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, commission des affaires sociales, 23 septembre 2025.
* 1308 Ce transfert a été instauré par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997.
* 1309 Article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.
* 1310 Réponses écrites de la commission au questionnaire de la rapporteure lors de l'examen du PLFSS pour 2025.
* 1311 D'autres éléments s'y ajoutent, comme le « swap » de taux avec la branche vieillesse ou l'effort accru de la branche en faveur de la réparation et de la prévention, mais la hausse du transfert explique, à 100 millions d'euros près, à elle seule le déficit prévisionnel de la branche AT-MP pour 2025.
* 1312 Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
* 1313 Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 1314 Cass., Ass. Plen., 20 janvier 2023, n° 20-23673 et 21-23947.
* 1315 Article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* 1316 Le montant de l'Acaata est compris entre 1 260 et 4 443 euros brut par mois. Pour les assurés ayant touché entre 1 938 et 3 864 euros brut sur les douze derniers mois, l'Acaata est égale à 65 % du salaire de référence. Le taux de remplacement est accru pour les bas salaires, et diminué pour les hauts salaires.
* 1317 L'âge d'ouverture du droit à l'Acaata est fixé à 60 ans moins le tiers de la durée d'exposition.
* 1318 L'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant et complétant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention a inscrit de nouveaux ports sur la liste ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité : Ajaccio, Bayonne, Boulogne-sur-Mer, Brest, Lorient, Nice, Port La Nouvelle, Port-Vendres, Roscoff.
* 1319 Article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale.
* 1320 Arrêté du 29 avril 2025 fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale et de la contribution prévue à l'article D. 242-6-9-1 du même code pour l'année 2025.
* 1321 Article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
* 1322 Article D. 351-1-9 du code de la sécurité sociale.
* 1323 Contrairement au dispositif prévu pour les assurés présentant un taux d'IPP supérieur à 20 %, aucun cumul n'est possible entre affections.
* 1324 Articles L. 351-1-4 et D. 351-1-10 du code de la sécurité sociale.
* 1325 Article D. 351-1-10 du code de la sécurité sociale.
* 1326 Lequel avait été créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
* 1327 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
* 1328 Article L. 4163-5 du code du travail.
* 1329 Il était auparavant plafonné à 100 points.
* 1330 Article L. 4163-7 du code du travail.
* 1331 Article R. 4163-11 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention.
* 1332 Réponses écrites de la direction de la sécurité sociale au questionnaire de la rapporteure.
* 1333 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 1334 Pour rappel, une baisse du taux de cotisations en AT-MP avait été actée lors de la réforme des retraites afin de neutraliser le coût pour les employeurs d'une hausse symétrique au profit de la branche vieillesse, initialement fixée à 0,1 point mais finalement rehaussée à 0,12 point afin de pallier le coût des amendements dépensiers adoptés sur ce texte et de poursuivre l'objectif de l'équilibre de la branche vieillesse à horizon 2030.
* 1335 Article L. 176-1 du code de la sécurité sociale.
* 1336 Commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 30 juin 2024.
* 1337 Article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.
* 1338 Celle-ci entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2026.
* 1339 Commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 30 juin 2024.
* 1340 La version initialement déposée à l'Assemblée nationale fixait l'objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 à 307,4 milliards d'euros, et la lettre rectificative l'a réhaussé à 307,5 milliards d'euros après intégration de la mesure de décalage de la réforme des retraites figurant à l'article 45 bis.
* 1341 Article 99 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 1342 Selon le coefficient défini à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
* 1343 La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a adopté le dispositif de départ en retraite anticipée pour carrières longues à compter du 1er septembre 2023 en refondant 4 nouvelles bornes d'âge de départ anticipé entre 58 et 62 ans pour lesquelles il n'existe plus de durée cotisée supplémentaire exigée au-delà de la durée d'assurance de droit commun.
* 1344 Article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 1345 Les recettes du FSV sont issues de la contribution sociale généralisée.
* 1346 L'article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu l'intégration progressive des régimes spéciaux mis en extinction au régime général, en premier lieu desquels figure le régime de la SCNF et de la RATP.
* 1347 Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2025, p. 163.
* 1348 Celle-ci a été mise en oeuvre par le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les taux de cotisations seront de 34,65 % en 2025, de 37,65 % en 2026, de 40,65 % en 2027 et de 43,65 % en 2028.
* 1349 Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2024.
* 1350 Estimation issue du Panorama de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) « Les retraités et les retraites - édition 2025 ».
* 1351 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1352 Les prestations sociales nettes incluent les prestations légales nettes (allocations en faveur de la famille, prestations d'accueil du jeune enfant) et les prestations relatives à l'action sociale.
* 1353 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1354 Gel du montant maximal de salaire en deçà duquel s'applique le taux réduit de cotisations d'allocations familiales à l'article 16 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
* 1355 Réduction de 3,5 Smic à 3,3 Smic le montant maximal de salaire en deçà duquel s'applique le taux réduit de cotisations d'allocations familiales à l'article 5 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 1356 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1357 Ibid.
* 1358 Ibid.
* 1359 Ibid.
* 1360 Ibid.
* 1361 Évaluation préalable du présent projet de loi à son annexe 3.
* 1362 Ibid.
* 1363 Ibid.
* 1364 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1365 Évaluation préalable du présent projet de loi à son annexe 3.
* 1366 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1367 Évaluation préalable du présent projet de loi à son annexe 3.
* 1368 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025, octobre 2025.
* 1369 Évaluation préalable du présent projet de loi à son annexe 3.
* 1370 Ibid.
* 1371 Gain de 6,8 milliards d'euros pour la sécurité sociale et perte de 6,8 milliards d'euros pour l'Agirc-Arrco et l'Unédic.
* 1372 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), ex-taxe sur les véhicules de société (TVS), prélèvements sur les stock-options et attributions gratuites d'action.
* 1373 La seule à percevoir la taxe sur la valeur ajoutée.
* 1374 Prélèvements sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions et prélèvements sur les jeux et paris en ligne.
* 1375 Évaluation préalable du présent projet de loi à son annexe 3.
* 1376 Le fonds national de l'action sociale est le fonds national d'action sociale de la caisse nationale des allocations familiales.
* 1377 L'annexe 3 au PLFSS évoque « l'anticipation d'économies sur les dépenses du fonds national de l'action sociale pour 0,4 milliard d'euros liée à la faible dynamique des créations de place de garde d'enfants, en partie atténuée par le soutien aux offres de garde péri-scolaire ».
* 1378 La branche autonomie de la sécurité sociale a été créée par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (article 5).
* 1379 Annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
* 1380 Cet objectif est décliné en deux sous-objectifs, l'un relatif aux établissements et services pour personnes âgées (OGD PA) et l'autre relatif aux établissements et services pour personnes handicapées (OGD PH), qui sont fixés chaque année dans l'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatif à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam).
* 1381 CNSA, 17e édition des Chiffres clés de l'aide à l'autonomie, 2025.
* 1382 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 81).
* 1383 Ces mesures visent à soutenir le secteur du domicile (réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile), à financer la hausse du taux d'encadrement dans les Ehpad, à créer des solutions médico-sociales nouvelles pour les personnes handicapées et à appliquer des revalorisations salariales.
* 1384 La LFRSS pour 2023 a réformé l'AVPF et créé l'AVA pour simplifier les conditions d'accès des aidants à cette assurance, et en a confié la charge, auparavant assumée par la branche famille, à la branche autonomie.
* 1385 En application de la n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (article 3).
* 1386 Rapport à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, octobre 2025.
* 1387 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 82).
* 1388 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 85).
* 1389 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (article 81).
* 1390 Alors que la LFSS pour 2025 fixait une trajectoire de progression de l'Ondam à 2,9 % pour 2026 et 2027, cette trajectoire est ramenée à 2 % dans le présent PLFSS, le ralentissement de la progression des dépenses s'appliquant aussi bien (mais dans des proportions différentes) au secteur sanitaire qu'au secteur médico-social.
* 1391 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 1392 Ibid.
* 1393 Voir le commentaire de l'article 38.
* 1394 Audition du mercredi 29 octobre 2025.
* 1395 Audition du mercredi 22 octobre 2025.
* 1396 Voir le commentaire de l'article 36.