III. L'EFFICACITÉ DU BUDGET
A. LE FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. La dépense d'éducation supérieure en 1996
En 1996, la dépense d'éducation
supérieure -mesure de l'effort consenti par la collectivité
nationale pour le fonctionnement et le développement du système
d'enseignement supérieur en France métropolitaine- est de
100,2 milliards de francs. Cet effort peut être
précisé à partir des trois éléments suivants
: la dépense d'éducation supérieure est de
1.700 francs par habitant, de 47.200 francs par étudiant et
représente 1,3 % du produit intérieur brut en 1996.
De 1989 à 1996, la dépense d'éducation supérieure
connaît une forte croissance : elle augmente plus vite que le PIB. De
1 % du PIB en 1989, la dépense d'éducation passe à
1,1 % en 1991, à 1,2 % en 1992, puis à 1,3 % en
1995- niveau auquel elle se maintient en 1996.
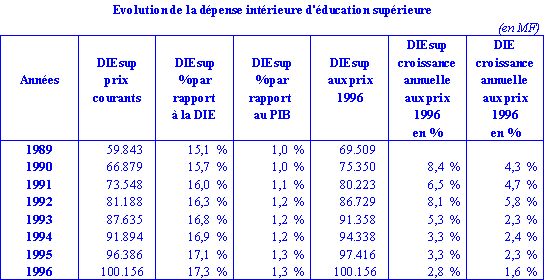
La dépense intérieure d'éducation supérieure
augmente également plus vite que la dépense intérieure
d'éducation. A prix constants, elle croît de 44,1 % entre 1989 et
1996 alors que la dépense intérieure d'éducation
croît, sur cette même période, de 25,8 %. La dépense
intérieure d'éducation supérieure représente ainsi
chaque année une part croissante de la dépense intérieure
d'éducation : de 15,1 % en 1989 à 17,3 % en 1996.
Cependant, de 1989 à 1994, ce rythme soutenu de la croissance de la
dépense d'éducation supérieure s'est accompagné
d'un fort accroissement des effectifs étudiants. Sur cette
période, les effectifs d'étudiants ayant crû, en moyenne,
annuellement, de 6,2 %, la dépense moyenne par étudiant (aux prix
de 1996) est passée de 44.700 francs à 45.400 francs,
enregistrant sur cinq ans une hausse limitée à 1,6 %. De 1994
à 1996, on observe un ralentissement de la croissance des effectifs
étudiants, avec une moyenne annuelle de 1,1 %. En deux ans, la
dépense moyenne par étudiant passe de 45.400 francs à
47.200 francs, enregistrant une hausse de 4 %.
Sur les 100,2 milliards de francs dépensés en 1996, 83,9
milliards de francs (soit 84 %) l'ont été pour des
activités d'enseignement. Les 16 % restants sont utilisés
à hauteur de 8,3 milliards pour les activités annexes
(administration générale, restauration et hébergement,
médecine scolaire et universitaire) et de 8 milliards de francs pour
l'achat de livres ou matériels nécessités par la
fréquentation des établissements d'enseignement supérieur
et la rémunération des personnels en formation.
Les dépenses d'enseignement se répartissent ainsi :
19 % pour les activités d'enseignement post-baccalauréat
effectuées dans les établissements du second degré, soit
les sections de techniciens supérieurs (STS) et les classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;
74 % pour les activités d'enseignement effectuées dans les
autres établissements d'enseignement supérieur
(universités, écoles, centres de formation interne des
administrations, etc.) ;
les 7 % restants sont consacrés aux autres formes d'enseignement
(enseignement à distance, formation professionnelle continue et autre
extra-scolaire).
2. La structure de financement
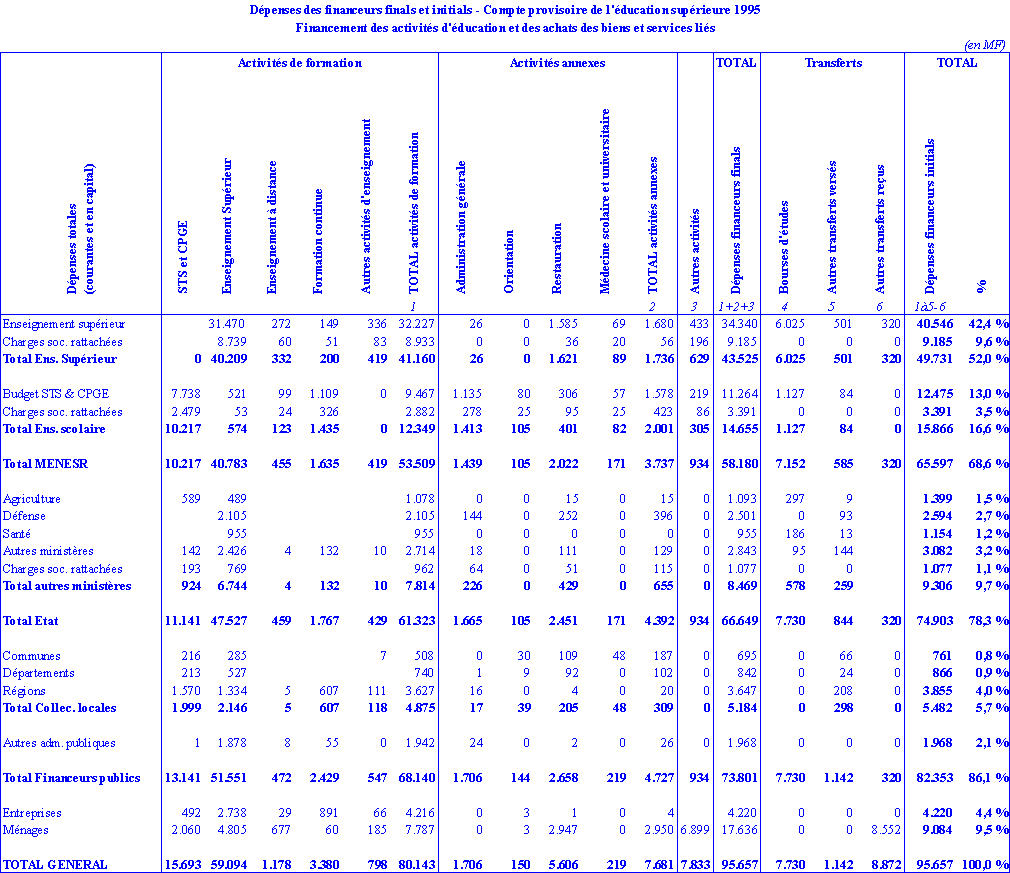
Le financement initial - avant prise en compte des
transferts
- est assuré essentiellement par l'Etat (77,8 %). Les ménages
viennent en deuxième position pour le financement de la dépense
intérieure d'éducation supérieure et participent à
hauteur de 9,5 % de cette dépense en 1995.
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, principal financeur de l'ensemble du
système éducatif avec 52 % du financement initial total
(incluant les charges sociales rattachées, payées sur le budget
des charges communes et correspondant aux charges sociales employeur de
l'Etat), voit son rôle de principal financeur encore accru pour le
système d'éducation supérieure puisqu'il assure 68,6 % du
financement initial total (incluant les charges sociales rattachées).
En revanche, alors que les collectivités territoriales participent
à hauteur de 20,3 % au financement de la dépense
intérieure pour l'ensemble du système éducatif, cette part
n'est que de 5,7 % pour le système d'éducation supérieure.
Parmi les collectivités territoriales, les régions sont les plus
importants financeurs (4,0 %) du système d'éducation
supérieure.
3. La dépense moyenne par étudiant
La dépense moyenne par étudiant est
passée de 40.500 francs en 1975 à 45.200 francs en 1995, en
francs constants (+ 11,5 %) alors que, sur la même période, la
dépense moyenne par élève a progressé de 61 %.
En 1996, la dépense moyenne par étudiant s'établit
à 47.200 francs.
L'indicateur de dépense moyenne par étudiant ainsi que son
évolution recouvrent une grande variété de situations
compte tenu de la forte diversité caractérisant les
différentes formations de l'enseignement supérieur. Ainsi, en
1996, un élève-ingénieur d'université
entraîne une dépense moyenne de 89.200 F, un élève
d'IUT de 53.500 F par an, un étudiant dans une autre formation
d'université (hors IUT) de 35.500 F. Ces différences sont
liées à des différences d'encadrement (personnel
enseignant et non enseignant relativement plus nombreux en IUT qu'en
université).
La dépense moyenne par étudiant dans le supérieur (en francs)
|
1996 |
STS |
CPGE |
Universités* |
Ingénieur universitaire |
IUT |
|
Dépense moyenne |
64.400 |
75.500 |
35.500 |
89.200 |
53.500 |
* Universités hors IUT et hors écoles
d'ingénieurs dépendantes des universités. Ces deux
dernières catégories apparaissent dans les deux colonnes
suivantes. Les trois catégories "Universités", "Ingénieurs
universitaires" et "IUT" concernent uniquement les universités
publiques
; les effectifs d'étudiants sont ceux des inscrits administratifs en
début d'année, ramenés à l'année civile.
Mis à part les Etats-Unis, les dépenses des différents
pays sont comprises entre 2.500 et 8.670 équivalents-dollars par
étudiant, et leur moyenne s'établit à 6.510
équivalents-dollars. Tout en ayant une dépense par
étudiant (6.030 équivalents-dollars) proche de cette moyenne, la
France se situe parmi les pays où cette dépense est la plus
faible.
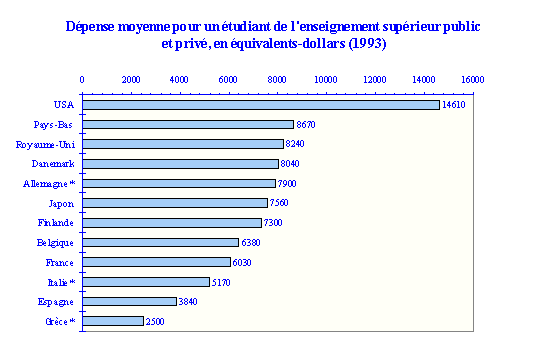 * Secteur public
* Secteur public
B. L'EFFICACITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Outre des éléments de comparaison internationale
(source OCDE), quatre indicateurs sont proposés pour apprécier
l'efficacité de l'enseignement supérieur en France :
- niveau de formation et diplôme obtenu par les sortants de
l'enseignement supérieur ;
- taux de redoublement et taux d'abandon à l'issue de la première
année universitaire
- taux d'accès en second cycle universitaire
- taux de réussite en DEA et doctorats
1. Niveau de formation et diplôme obtenu par les sortants de l'enseignement supérieur
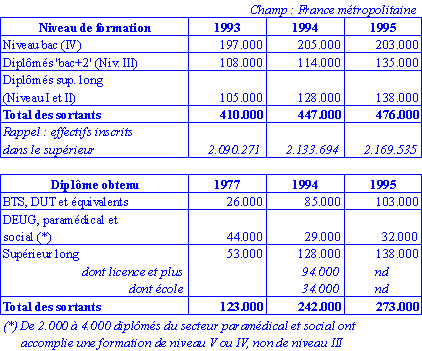
Note importante : les sortants présentés dans les tableaux précédents sont des sortants définitifs de l'enseignement supérieur. Un certain nombre d'étudiants "sortent" en effet plusieurs fois de l'enseignement supérieur, ou, dit autrement, interrompent provisoirement une ou plusieurs fois leurs études ; comme il n'est pas possible d'évaluer chaque année le nombre de sortants "définitifs", les tableaux précédents présentent en fait le nombre de sorties nettes une année donnée, c'est-à-dire le solde entre toutes les sorties recensées et les reprises d'études observées.
2. Taux de redoublement et taux d'abandon à l'issue de la première année dans les principales filières universitaires
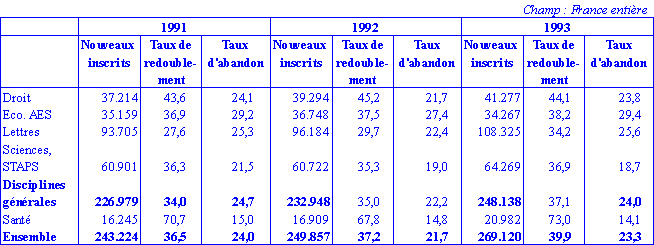
Dans l'ensemble, un peu moins d'un quart des nouveaux
inscrits
en première année ne renouvellent pas leur inscription
l'année suivante ; parmi eux, certains avaient en fait engagé un
cursus parallèle (classes préparatoires par exemple) et n'avaient
pris leur inscription universitaire que par précaution. Le taux
d'abandon en première année reste stable au cours des
dernières années.
C'est en économie-AES que ce taux d'abandon est le plus fort où
il avoisine les 30 % ; le taux de redoublement de la première
année y est également particulièrement
élevé, le cas de la filière santé devant être
mis à part en raison de l'existence d'un numerus clausus : faible taux
d'abandon qui conduit à un taux élevé de redoublement, la
règle étant de tenter 2 fois sa chance pour franchir la
barrière que constitue le passage en deuxième année.
Seule la filière sciences voit son taux d'abandon diminuer
régulièrement au cours des trois dernières années,
pour s'établir à un niveau sensiblement inférieur à
celui des autres disciplines générales.
3. Taux d'accès en second cycle universitaire
Toutes filières générales confondues
(c'est-à-dire hors médecine, odontologie et pharmacie), 59 % des
étudiants entrés en premier cycle universitaire ont pris une
inscription en second cycle universitaire à la rentrée 1996 ; ce
même taux était de 51,5 % en 1988. Depuis 1992, il ne progresse
plus que faiblement, voire diminue ces deux dernières années.
C'est en sciences que cette proportion est la plus élevée
puisqu'elle atteint 62,7 % ; à l'inverse, avec 50,2 %, c'est la
filière droit qui enregistre la moins bonne performance.
L'importance de la qualité du parcours effectué dans le second
degré apparaît primordiale ; en effet, alors que le taux global
d'accès en deuxième cycle est de 59 %, il est de 74,3 % pour les
étudiants qui ont obtenu leur baccalauréat à l'heure ou en
avance, de 54,3 % pour ceux qui avaient un an de retard et de seulement 34 %
pour ceux qui avaient plus de un an de retard lors de leur réussite au
baccalauréat.
Enfin, il est important de souligner que les étudiants qui
n'accèdent pas en second cycle universitaire ne peuvent pas pour autant
être considérés comme ayant échoué dans le
supérieur. Ceci tient notamment au fait que certaines inscriptions en
DEUG ne sont que des inscriptions de précaution par rapport à une
inscription principale prise dans un autre cursus (cas fréquent des
étudiants en classes préparatoires), mais aussi au fait que
certains étudiants ayant réussi au DEUG continuent leurs
études supérieures à l'extérieur de
l'université, donc ne sont pas comptabilisés comme
accédant en second cycle universitaire.
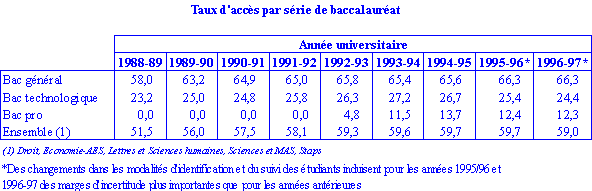
4. Taux de réussite dans les DEA et doctorats
Après la réforme des doctorats de 1984 qui avait
diminué la capacité des établissements universitaires
à former des chercheurs, il fallut attendre 1989 pour que le nombre de
DEA délivrés retrouve son niveau de 1985. L'augmentation
régulière constatée depuis lors se ralentit depuis ces
deux dernières années : après une hausse moyenne annuelle
de 10 % entre 1988 et 1992 et une augmentation de seulement 4 % en 1993, 1994
s'est soldée par une progression de 3,5 % et 1995 par une hausse de
seulement 1,1 %. Le nombre de DEA délivrés approche en 1995 la
barre des 27.000.
Les doctorats, après avoir retrouvé une certaine vigueur entre
1992 et 1994, en rupture avec la stagnation qui avait marqué la
période 1983-1991, enregistrent un recul en 1995 : 9.522 thèses
ont été soutenues avec succès contre 9.901 en 1994. Plus
de 63 % l'ont été en sciences.
Ces différentes évolutions se retrouvent dans l'analyse des "taux
de rendement".
La progression des maîtrises obtenues par des étudiants
français étant plus forte que celle des DEA, le rendement de
celles-ci, en termes de prolongement par un DEA, diminue à nouveau cette
année ; elle s'établit à 37,5 %, soit près de 2
points de moins que l'an dernier. Cette baisse se retrouve dans toutes les
disciplines, tout en étant moins marquée en droit. Les sciences,
avec un rendement de 61,2 %, se distinguent toujours des autres disciplines
générales où le ratio DEA/maîtrises est plus de deux
fois moindre. Toutefois, depuis 1983, les maîtrises de sciences
enregistrent un recul de plus de 20 points quant à leur prolongement par
un DEA.
Le rendement des DEA, mesuré par le ratio doctorats/DEA, diminue
lui-aussi nettement cette année, pour s'établir à 35,1 %,
soit un recul de plus de quatre points par rapport à 1994.
Rendement 3ème cycle pour les étudiants
français
|
DEA |
1983 |
1994 |
1995 |
|
Disciplines générales |
42,7 |
39,1 |
37,5 |
|
dont |
|||
|
Droit |
22,5 |
30,5 |
29,9 |
|
Sciences économiques |
29,5 |
26,5 |
23,7 |
|
Lettres & sciences humaines |
33,5 |
29,6 |
28,6 |
|
Sciences |
81,6 |
64,9 |
61,2 |
|
Doctorats |
1994 |
1995 |
|
|
Disciplines générales |
ns |
39,4 |
35,1 |
|
dont |
|||
|
Lettres & sciences humaines |
ns |
36,4 |
27,4 |
|
Sciences |
ns |
52,1 |
49,5 |
Indications méthodologiques
Taux de rendement en DEA : les DEA délivrés l'année n sont
rapportés aux maîtrises (stricto sensu) délivrées
l'année n-1. L'indicateur est calculé pour les principales
disciplines générales. Les diplômes délivrés
en MASS et AES ne sont pas pris en compte.
Cet indicateur est imparfait, puisque l'accès en DEA ne se fait pas
exclusivement à partir de la maîtrise, mais aussi après un
diplôme d'ingénieur. La maîtrise représente environ
65 % de l'ensemble des recrutements, mais beaucoup plus, ce qui est le cas ici,
si on s'intéresse aux seuls étudiants français inscrits
dans une discipline générale, soit une proportion
supérieure à 80 %.
Taux de rendement en doctorat : les doctorats de tous régimes (y compris
diplômes d'ingénieur) délivrés l'année n sont
rapportés aux DEA délivrés l'année n-3 pour les
doctorats scientifiques, l'année n-4 pour les autres disciplines.
C. L'INSERTION DES DIPLOMÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
La période actuelle est marquée par un
accroissement important du nombre des sortants de l'enseignement
supérieur. Ce nombre était en effet de 367.000 en 1995
représentant un peu plus de 50 % des sortants du système
éducatif, traduisant ainsi les effets de la massification des effectifs
d'étudiants enregistrée des dernières années. Ce
mouvement devrait encore se poursuivre pendant quelques années,
notamment pour les formations supérieures à Bac + 2 en
raison de l'augmentation continue du taux de poursuite d'études. Selon
la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP), il y avait
138.000 sortants en 1995, alors qu'ils n'étaient que 128.000 en 1994.
En outre, et sous l'effet du retournement de la conjoncture économique,
les conditions d'insertion des diplômés de l'enseignement
supérieur qui étaient auparavant très favorables (taux de
chômage de 4,5 % en 1991 pour les diplômés de 1988), se sont
largement dégradées. On assiste aujourd'hui à une
insertion professionnelle de plus en plus différée, à un
certain déclassement des emplois trouvés et à un
recrutement plus important sur les contrats à durée
déterminée. Toutefois, les projections effectuées par le
BIPE (Bureau d'Informations et de Prévisions Economiques) et par la DEP
montrent que si 510.000 emplois en moyenne se sont libérés chaque
année entre 1985 et 1995, il devrait y en avoir 710.000 entre 1995 et
2005.
Enfin, se pose le problème spécifique des sortants
non-diplômés de l'enseignement supérieur.
Une enquête du CEREQ en cours de publication sur les
diplômés de 1994, montre que l'insertion professionnelle a
été caractérisée :
-
par un accès à l'emploi un peu moins difficile que pour
leurs prédécesseurs
: trois ans après leur sortie du
système éducatif les diplômés de 1994
s'insèrent mieux que ceux de 1992. Leur taux de chômage est de 9,3
% contre 11,5 % pour les diplômés de 1992. Ils sont plus nombreux
à accéder à un contrat de durée
indéterminée. Les diplômés de 1994 semblent avoir
profité au moment de leur sortie de l'enseignement supérieur
d'une "mini-reprise" du marché du travail, la proportion de
diplômés de l'enseignement supérieur occupant un emploi
temporaire a fortement diminué entre 1994 et 1997 ;
-
par des emplois "cadres" aussi nombreux et mieux
rémunérés
: la part des emplois de cadre obtenus au
bout de 3 ans est identique à celle des diplômés de 1992
(41 %), les rémunérations proposées à l'embauche
sont plus élevées et retrouvent en francs courants leur niveau de
1991 (au lieu de celui de 87 pour leurs prédécesseurs).
Selon le CEREQ, 50 % des titulaires de licences ou de maîtrises et
70 % des diplômés de troisième cycle s'orientent vers
le secteur privé. Il s'agit là d'une traduction des effets du
rapprochement des universités avec les entreprises et de la construction
de nouveaux cursus de formations professionnalisées (IUT, IUP, DESS).
Cependant, les métiers de l'enseignement, qui étaient auparavant
les débouchés principaux de l'enseignement supérieur,
connaissent encore un engouement lié en partie à la crise du
recrutement des cadres.
De même, les compétences nouvelles qui sont désormais
demandées aux jeunes diplômés, en raison des mutations
technologiques et organisationnelles des entreprises (développement des
aptitudes à l'autonomie - élévation du niveau de culture
générale - maîtrise de l'informatique ou des langues
étrangères...) doivent être prises en compte dans les
enseignements, afin de favoriser une meilleure articulation qualitative entre
formation et emploi.
Par ailleurs, les enquêtes réalisées par les
universités font apparaître un fort taux de diplômés
allant rechercher leur premier emploi dans une autre région. Selon
l'association pour l'emploi des cadres (APEC), 60 % de recrutements de jeunes
diplômés en qualité de cadres en 1993 l'ont
été par la région parisienne.
En 1994, 81.000 jeunes sont sortis de l'enseignement supérieur sans
obtenir de diplôme autre que le baccalauréat.
L'attention est aujourd'hui attirée sur cette catégorie
particulière d'étudiants, qu'il s'agisse de la mise en place des
procédures de réorientation prévues par
l'arrêté du 9 avril 1997, ou par les dispositions de l'article 54
de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 qui offrent à ceux qui
le souhaitent une deuxième chance sous forme d'une formation
professionnelle organisée en liaison avec les milieux professionnels.







