B. LA POURSUITE DE LA RÉFORME DU SERVICE DE L'EXPANSION ÉCONOMIQUE
Les moyens du secrétariat d'Etat au commerce extérieur comprennent d'une part, les services de l'expansion économique dirigés par la direction des relations économiques extérieures (DREE) ; d'autre part, les organismes parapublics d'appui au commerce extérieur le (Centre français du commerce extérieur -CFCE- et l'Agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises françaises -CFME -ACTIM-).
1. La confirmation de la rationalisation des moyens de la direction des relations économiques extérieures
a) L'exécution des budgets 2000 et 2001
La
consommation des crédits du réseau public a été
particulièrement élevée en 2000, compte tenu notamment de
la dépréciation de l'euro
, qui a pesé sur les
dépenses de fonctionnement des postes. Les économies
réalisées sur les dépenses de personnel, qui ont
permis de transférer 4,01 millions d'euros vers le chapitre des
dépenses de fonctionnement, et les reports disponibles, ont permis de
faire face à cet accroissement de la dépense.
L'exécution du budget pour 2001 apparaît proche des
prévisions, et n'appelle pas de commentaires particuliers.
b) Les dotations pour l'année 2002 sont stables
De
2000 à 2002, le principal facteur d'augmentation des crédits est
constitué par la dérive des indemnités de résidence
due à l'évolution défavorable de la parité entre le
franc (puis l'euro) et le dollar
. En application du contrat d'objectifs et
de moyens signé avec la direction du budget pour les exercices
2000-2002, l'unique raison de l'augmentation des crédits est cette
dérive des indemnités de résidence,
considérée dans le contrat comme un facteur exogène
susceptible de déclencher un abondement ou une réduction des
crédits.
Les crédits du réseau des postes d'expansion économique et
des directions régionales du commerce extérieur (DRCE)
augmentent de 3,5 %
, soit 168,87 millions d'euros contre 163,13 millions
d'euros en 2001. En application du contrat d'objectif et de moyens, les
dépenses de personnel sont stabilisées. Une
provision de
5,73 millions d'euros
a cependant été inscrite
afin
de faire face à l'effet change-prix sur les indemnités de
résidence des agents à l'étranger
, compte tenu de la
dépréciation de l'euro. De même, en application du contrat,
aucune suppression d'emploi n'est prévue.
Les mesures nouvelles relatives aux dépenses de personnel sont
compensées par des mesures de transfert négatives, la
dérive des dépenses devant être compensée par les
gains de productivité. Elles se décomposent comme suit :
- incidence des revalorisations du point fonction publique intervenues en 2000
et 2001 : 1,70 million d'euros ;
- incidence de l'attribution de points différenciés en
2001 : 0,04 million d'euros ;
- Modification de la base de calcul des prestations familiales :
0,003 million d'euros ;
- Adaptation de la structure fonctionnelle des emplois: - 0,02 million
d'euros ;
- Congé de fin d'activité : 0,004 million d'euros ;
Les crédits de fonctionnement sont stables
, et
s'élèvent à 59,39 millions d'euros. Ils incluent une
dotation de 3,87 millions d'euros destinée à faire face au
renouvellement des équipements et au développement intranet de la
DREE.
Enfin, les crédits pour dépenses d'investissement sont maintenus
à 2,29 millions d'euros en autorisations de programmes et en
crédits de paiement, conformément aux dispositions du contrat
d'objectifs et de moyens. Ils permettront essentiellement de faire face aux
dépenses de rénovation du parc immobilier existant.
La réduction des dotations de certaines procédures de soutien
à l'exportation, en crédits de paiement et surtout en
autorisations de programme, s'explique essentiellement par l'importance des
reports de crédits estimés sur l'exercice 2002.
c) Le réseau à l'étranger est stabilisé
Depuis
l'important redéploiement d'effectifs opéré au cours des
années 1996-1999
3(
*
)
, seuls
quelques ajustements ont été mis en oeuvre.
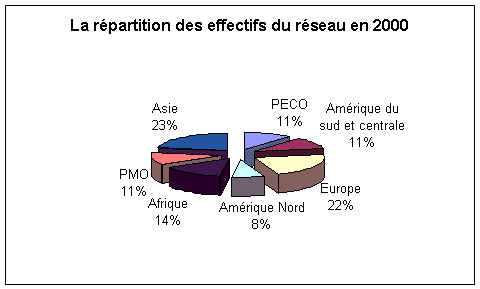
Le secrétariat d'Etat indique à votre rapporteur spécial
que : «
La prise en compte des technologies de l'information
et de la communication constitue un aspect essentiel dans la réflexion
sur l'évolution du réseau. Si le travail de proximité
continue de fournir la légitimité première des postes
d'expansion économique, le renforcement des expertises et de la valeur
ajoutée apportée par l'échange d'informations et
d'analyses nécessitent une réflexion permanente sur
l'implantation des postes, non plus individuellement, mais en termes de
maillage et de réseaux.
Afin d'améliorer sa capacité d'analyse sur les questions
économiques ou multilatérales et de suivi des grands secteurs
stratégiques, la DREE a mis en place une nouvelle organisation en
réseau, associant un certain nombre de PEE bénéficiant de
moyens renforcés.
Ainsi, plusieurs d'entre eux, situés dans des zones émergentes
(Budapest, Istanbul, Caracas...), ont accueillis, en sus de leurs effectifs,
des experts dont l'objectif est d'approfondir les analyses de la Direction sur
le risque-pays, l'insertion de ces économies dans le système
commercial mondial...
».
Il convient par ailleurs de souligner avec intérêt la
décision de
fusionner des missions financières et les postes
d'expansion économique à l'étranger
. Il était
en effet peu opérant, du point de vue de la lisibilité de notre
dispositif à l'étranger comme de celui de la bonne gestion des
deniers publics, de conserver deux réseaux appartenant à deux
directions d'un même ministère.
d) La mise en oeuvre de la démarche qualité de la DREE
La
démarche qualité de la DREE, conçue sur la base du
référentiel ISO 9001 (qui inclut les activités de
production et de conception) a été mise en oeuvre à partir
du 1er septembre 1999 dans trois postes pilotes, puis dans six autres postes.
Le succès de cette première phase a conduit la DREE à
étendre la démarche qualité au reste du réseau
(soit, au total, 156 PEE et 23 DRCE), ce qui implique la formation de 170
responsables qualité chargés ensuite de la formation à la
qualité de l'ensemble de ses agents (1.926 personnes dans son
réseau à l'étranger). Par ailleurs,
le Comité
Qualité de la DREE a estimé nécessaire qu'un audit
qualité interne soit effectué dans chaque poste avant les audits
de certification
. 60 auditeurs qualité interne seront donc
formés parmi les responsables qualité locaux les plus performants
afin de mener à bien cette tâche.
Les premiers audits de certification devraient avoir lieu à compter du
mois d'octobre 2001 et se terminer en mars 2002. La certification sera
effectuée selon la procédure de l'échantillonnage
4(
*
)
.
2. La restructuration des organismes d'appui au commerce extérieur
Le montant global des dotations aux organismes d'appui au commerce extérieur pour 2002 s'élève à 44,61 millions d'euros, contre 39,94 millions en 2001, soit une progression de 11,7 %. Cependant, cette dotation inclut 4,65 millions d'euros destinés à l'Agence française pour l'investissement international (AFII), créée en 2001. A périmètre constant, la dotation des organismes d'appui au commerce extérieur est stable .
a) Le CFCE
Les moyens destinés au Centre français du commerce extérieur (CFCE) pour l'année 2002 augmentent de 3,9 % pour s'élever à 20,28 millions d'euros.
Les ressources et les effectifs du CFCE sont stables depuis 1998 :
|
(en millions d'euros) |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Ressources de fonctionnement |
38,1 |
39,4 |
40,3 |
40,2 |
? |
|
Dotation prévue en loi de finances |
18,3 |
19,5 |
19,1 |
18,3 |
20,3 |
|
Ressources globales hors loi de finances (facturations, subventions des ministères techniques, produits financiers...) |
19,8 |
19,9 |
21,2 |
21,9 |
? |
|
Effectif réel au 31 décembre de l'exercice |
352 |
362 |
355 |
355 |
? |
(source : DREE)
(1) Un renouvellement de la démarche commerciale du CFCE
Depuis
quelques années, le CFCE a diversifié sa gamme de produits et a
développé les démarches commerciales auprès de ses
clients. Une structure a été mise en place afin de produire des
études approfondies sur les stratégies des grands groupes
étrangers. De plus, l'année 2000 a vu un
développement
significatif des travaux par souscription
, effectués à la
demande d'entreprises, de groupements professionnels ou d'administrations, dont
le montant unitaire atteint parfois plusieurs centaines de milliers de francs.
Enfin,
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication s'est largement développée
afin de de
collecter, traiter, archiver et rendre accessible l'information : le CFCE
s'est doté d'une chaîne entièrement numérisée
de l'information
5(
*
)
et d'un site
internet marchand, «
Planet Export
».
Entre 7 et
10 % de l'activité commerciale du CFCE s'effectue aujourd'hui par
l'intermédiaire des nouvelles technologies
de l'information et de la
communication.
Le nombre de prestations payantes a été réduit
(gratuité de certaines prestations de base des PEE et croissance des
produits gratuits du réseau sur Internet), mais l'amélioration de
la démarche commerciale du CFCE s'est traduite par une
fidélisation accrue de la clientèle
et un
développement significatif du chiffre d'affaire moyen par client
(celui-ci est passé de 488 euros en 1998 à 671 euros en
2001).
Pour l'exercice 2002, l'action du CFCE a été
réorientée vers une logique de demande plutôt que d'offre,
afin de mieux prendre en compte les attentes des entreprises et des
organisations professionnelles. Ainsi, les produits les plus
opérationnels et les plus demandés par la clientèle du
réseau, tels que les guides-répertoires d'opérateurs
étrangers, ont été développés à
compter de l'année 2001 et l'offre devrait croître en 2002 et les
années suivantes.
(2) L'action régionale du CFCE
Le CFCE
s'est largement impliqué dans la mise en place des programmes d'actions
régionales pour le développement international (PARDI) en
régions. Il a participé aux différents
Ateliers
Techniques Régionaux
(ATR) qui ont permis de sélectionner les
secteurs prioritaires dans une douzaine de régions. Puis, les experts
sectoriels du CFCE ont effectué une
sélection de
marchés prioritaires
pour ces secteurs et ont remis, lors des
réunions régionales de préparation des PARDI, des dossiers
d'information sur ces marchés ciblés reprenant les informations
disponibles au sein du réseau public, accompagnés de propositions
d'actions qui ont servi de base à l'élaboration des programmes
sectoriels régionaux. Au total, le CFCE a réalisé
33
dossiers sectoriels d'information et proposition d'actions
dans
13 régions.
Le CFCE poursuit parallèlement un étroit partenariat dans les
6 premières Régions retenues pour la signature de
PARDI : Centre (automobile, textile-habillement),
Midi-Pyrénées (agro-alimentaire, médical, textile),
Limousin (eau - environnement, sous-traitance, transformation agro-alimentaire,
art de vivre), Ile-de-France (multimédia, instruments de mesure, art de
vivre), Nord-Pas-de-Calais (ferroviaire, textiles techniques, produits de la
mer), Poitou-Charentes (nouvelles technologies de l'information et de la
communication, filière caprine, métiers d'art).
Le travail réalisé par le CFCE sur ce programme doit permettre
un fort développement de l'activité du CFCE en région,
un rapprochement avec les DRCE et de déboucher sur des
opérations, interventions et prestations du CFCE et des PEE
partiellement financées dans le cadre des Contrats de plan
Etat-régions.
b) Le CFME ACTIM
A partir
du 1er octobre 2001 le CFME ACTIM change d'appellation et devient :
« UBIFRANCE - l'Agence Française pour le Développement
International des Entreprises ». Le nom précédent
était en effet sans signification (il résultait de la fusion du
CFME et de l'ACTIM en 1997), et était difficilement prononçable
en français, sans parler des langues étrangères.
La dotation publique de cet organisme est fixée à
19,57 millions d'euros, et représente environ 45 % de l'ensemble de
ces recettes
. Les ressources propres d'UBIFRANCE sont assurées, pour
l'essentiel, par la participation des entreprises à la procédure
des CSNE. Les ressources propres du CFME ACTIM issues de cette procédure
étaient importantes et permettaient de financer de nombreuses actions
collectives au profit des entreprises exportatrices.
Le nouveau dispositif
du volontariat international en entreprise (VIE) doit donc rencontrer un
réel succès pour asseoir solidement les finances de l'Agence au
delà de la dotation budgétaire annuelle.
Les ressources et l'activité du CFME ACTIM depuis 1997
|
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Dotation budgétaire
|
15,40 |
17,99 |
19,21 |
17,68 |
19,36 |
|
Nombre d'entreprises utilisatrices, dont : |
2.752 |
2.825 |
2.672 |
2.538 6( * ) |
? |
|
CSNE |
932 |
970 |
799 |
850 |
? |
|
Colloques |
264 |
290 |
357 |
309 |
? |
|
Invitations en France |
630 |
591 |
614 |
509 |
? |
|
Sidex |
167 |
231 |
167 |
174 |
? |
|
Actions de presse |
330 |
462 |
481 |
380 |
? |
|
Expositions et salons |
1.334 |
1.207 |
1.301 |
1.065 |
? |
(en
millions d'euros - source : DREE)
Le budget du CFME ACTIM (devenu UBIFRANCE) en matière de soutien des
entreprises pour la participation à des salons et le nombre de salons
soutenus supporte difficilement la comparaison avec les dispositifs des autres
pays de l'Union européenne
(les chiffres indiqués
correspondent aux prévisions pour l'année 2001) :
Soutien public aux entreprises participant à des salons 7( * )
|
Pays |
Nombre de salons |
Budgets d'Etat affectés au soutien des salons (en millions de dollars) |
|
Allemagne |
220 |
29,7 |
|
Espagne |
245 |
26,3 |
|
Grande-Bretagne |
484 |
24 |
|
Italie |
105 |
14,4 |
|
Finlande |
100 |
8,3 |
|
Portugal |
85 |
6,3 |
|
France |
90 |
4 |
Du
côté des dépenses, une stabilisation des dépenses de
fonctionnement a été obtenue grâce à l'accord de
modération salariale conclu pour la mise en oeuvre des 35 heures, ainsi
que grâce à la rationalisation des moyens issue de la fusion du
CFME et de l'ACTIM.
Les résultats de l'exercice 2000 sont
néanmoins négatifs compte tenu d'une très forte
activité notamment aux Etats-Unis, où le cours du dollar a
pesé fortement sur le coût des manifestations organisées
par le CFME ACTIM.
Depuis trois ans, la demande la plus forte adressée au CFME ACTIM vient
de la nouvelle économie (nouvelles technologies de l'information et de
la communication, biotechnologies) constituée souvent d'entreprises qui
démarrent et qui ont tout de suite besoin de se développer
à l'international, notamment d'être présent dans la presse
spécialisée nord américaine, européenne ou
japonaise et de participer aux salons spécialisés aux Etats-Unis
ou en Allemagne.
Le programme mis en oeuvre par le CFME ACTIM en 2001 a maintenu un niveau
d'activité équivalent à celui de 2000. Outre les
opérations collectives de promotion sectorielle (pavillons
français sur des salons spécialisés, colloques à
l'étranger, invitation de délégations
étrangères en France) le CFME ACTIM réalise 5
manifestations multisectorielles : 2 Expositions françaises
à Mexico et Pékin et 3 Semaines françaises à
Prague, Riga et Casablanca. Pour l'année 2002, 175
opérations collectives sont proposées, outre une vingtaine de
rencontres industrielles et une vingtaine de séminaires techniques.
c) Le Centre d'Information du Volontariat International (CIVI)
Le
centre d'information sur le volontariat international (CIVI) a
été ouvert en octobre 2000 pour informer, motiver et enregistrer
les jeunes désirant travailler en entreprise à l'étranger.
Une centaine de nouveaux volontaires s'inscrivent en moyenne chaque jour au
centre et environ 20.000 jeunes se sont portés volontaires sur le
site du CIVI, dont plus de 60 % de jeunes femmes. On notera que 65 %
des candidats ont un niveau supérieur à Bac+3 et que 235 d'entre
eux ont la nationalité d'un autre pays de l'Union européenne.
Environ 800 jeunes devraient partir comme volontaires sur l'ensemble de
l'année 2001, en sus des 1.200 CSNE ayant été
incorporés avant le mois de juillet
8(
*
)
.
Pour l'année 2002, contrairement à l'année 2001 où
le CIVI bénéficiait d'une dotation spécifique, le
CFME-ACTIM affectera des crédits au CIVI, en tant que de besoin, en
prélevant sur sa trésorerie, notamment sur la marge
réalisée dans la gestion de la procédure des volontaires
internationaux en entreprise (VIE).
d) Le rapprochement du CFCE et d'Ubifrance
Le
rapprochement du CFCE et du CFME Actim, devenu Ubifrance, décidé
en 1996, a largement été mise en oeuvre, permettant une
clarification de la répartition des rôles entre les deux
organismes et une plus étroite collaboration.
Plusieurs hypothèses envisagées dans un premier temps afin de
rapprocher les deux organismes ont du être abandonnées :
- la fusion juridique des deux organismes a été
abandonnée, compte tenu des contraintes existantes, notamment en
matière de statut des personnels ;
- la création d'un groupement d'intérêt public
« commerce extérieur » a également
abandonnée car elle risquait de compliquer la gestion des deux
organismes.
Par conséquent, une convention de rapprochement a été mise
en oeuvre le 2 juillet 1998, prévoyant notamment que les deux
organismes :
- s'engagent à coordonner systématiquement les accords à
passer avec leurs fournisseurs et partenaires ainsi que la programmation de
leurs actions. La réalisation en commun d'appels d'offres doit
également permettre de dégager des économies
d'échelle sur les prestations de services externes ;
- mettent en consultation commune leurs bases clientèles afin de
permettre un meilleur suivi individuel et global des adhérents, clients
ou usagers et d'améliorer leur fidélité à
l'égard du service public ;
- rapprochent leur gestion des ressources humaines (mise en commun des
formations, possibilités de mobilité entre les deux organismes,
représentation croisée des instances dirigeantes dans les
conseils d'administration de chaque organisme).
Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place un
comité d'orientation stratégique présidé par le
directeur des relations économiques extérieures, et
composé des présidents et directeurs généraux des
deux organismes ainsi que de certains sous-directeurs de la DREE. Son
rôle est de déterminer les priorités d'action et les
grandes orientations des deux organismes.
Si le rapprochement de deux organismes a constitué un progrès
important, leur regroupement géographique ne devrait être
effectué qu'à la fin de l'année 2004, dans un immeuble
à construire à proximité de la Bibliothèque
nationale.
Ce regroupement est indispensable pour la lisibilité du
dispositif public de soutien à l'exportation et pour que les entreprises
puissent s'adresser à un pôle unique d'information et de promotion
sur le commerce extérieur.
e) La création de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII)
L'Agence
française pour les investissements internationaux a été
inaugurée le 22 octobre 2001 par Yves Cochet, ministre de
l'aménagement du territoire, et Christian Pierret, secrétaire
d'Etat à l'industrie. Cette agence avait été
créée par l'article 144 de la loi sur les nouvelles
régulations économiques, promulguée le 15 mai 2001. Il
s'agit d'un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), placé sous la double tutelle du ministère de
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre chargé de l'aménagement du territoire et de
l'environnement.
Avant la création de cette agence, les candidats à
l'investissement en France pouvaient solliciter soit le réseau des 18
bureaux de la Délégation à l'aménagement du
territoire (DATAR) à l'étranger, dénommés
«
Invest in France Agencies
», soit la
Délégation aux investissement internationaux (DII) ou la DREE, au
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en sus
des organismes travaillant pour les collectivités territoriales
(régions notamment).
La nouvelle agence
, financée par la
DATAR à hauteur des 6,43 millions d'euros destinés au
fonctionnement de son réseau international et par le ministère de
l'économie et des finances à hauteur de 4,65 millions d'euros,
réunit les différents intervenants cités plus haut et
devient l'acteur unique, au niveau national, pour faciliter les
démarches des entreprises internationales et accompagner leur
installation.







